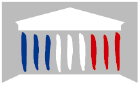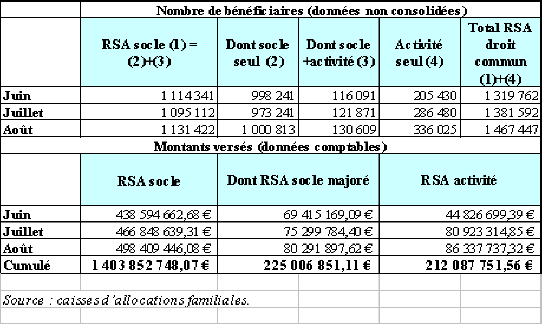N° 1971
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2009.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2010 (n° 1946)
TOME III
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES
SOLIDARITÉ
Par M. Christophe SIRUGUE,
Député.
___
Voir le numéro : 1967 (annexe n° 43).
A. LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE : UNE LENTE MONTÉE EN CHARGE QUI MASQUE L’INSUFFISANCE DES FINANCEMENTS 10
1. Le financement du RSA : des prévisions budgétaires pour le moins incertaines 10
a) Le complexe dispositif de financement du RSA 10
b) La taxe sur les revenus du patrimoine : une révision seulement partielle du rendement 12
c) Les dépenses : des interrogations sur la montée en charge du RSA et sur le financement de son extension partielle aux jeunes 14
2. La lenteur de la montée en charge : quelles difficultés sur le terrain ? 16
3. Une compensation insuffisante aux départements 17
B. LES EXPÉRIMENTATIONS : UN FINANCEMENT ESSENTIELLEMENT EXTRABUDGÉTAIRE 20
C. LES FAMILLES VULNÉRABLES : DES ENGAGEMENTS NON TENUS 21
1. L’action « Accompagnement des familles dans leur rôle de parents » : des moyens insuffisants pour financer les engagements et les annonces 21
a) Le soutien à la parentalité : un État qui se désengage 23
b) Le conseil conjugal et familial : un financement incertain malgré les engagements pris 23
2. L’allocation de parent isolé : l’absorption par le RSA, fin d’un processus d’alignement des droits à la baisse 23
3. La réforme des mesures de protection des majeurs : un transfert budgétaire déguisé aux départements 24
D. L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES : DES MOYENS LIMITÉS 25
E. LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT : LA PERSPECTIVE DE LA SUPPRESSION DU DÉFENSEUR DES ENFANTS ? 26
II.- LES JEUNES EN SITUATION D’EXCLUSION : PASSER DES DISCOURS AUX RÉALISATIONS 27
A. DES CONSTATS SÉVÈRES SUR LA SITUATION DES JEUNES 27
1. Des jeunes qui accèdent difficilement à l’emploi 27
a) Les jeunes, variable d’ajustement des effectifs dans la crise 27
b) Des difficultés structurelles d’accès à l’emploi durable 28
c) La France, mauvaise élève pour l’emploi des jeunes en Europe 31
2. Des jeunes durement frappés par la pauvreté 31
B. LES PLANS ANNONCÉS PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 33
1. Des mesures annoncées pour les jeunes 33
a) Le plan pour l’emploi des jeunes du 24 avril 2009 : des mesures conjoncturelles fondées sur des leviers classiques 33
b) La commission de concertation sur la politique de la jeunesse : une méthode qu’il convient de saluer 34
c) Le plan « Agir pour la jeunesse » du 29 septembre 2009 : des mesures à vocation structurelle 34
2. Mais une action des pouvoirs publics qui ne transparaît guère sur le terrain 35
a) Des expériences passées qui mettent en lumière l’écart qu’il peut y avoir entre annonces et réalisations 35
b) Le recul actuel des entrées dans les mesures pour l’emploi des jeunes 36
3. Et des annonces qui restent à concrétiser 38
a) Une ouverture contrainte et restreinte du RSA aux jeunes 38
b) Un cadre très général pour réformer l’orientation et lutter contre le décrochage scolaire 40
C. AGIR POUR LES JEUNES EN SITUATION D’EXCLUSION : DES LIGNES DE CONDUITE À SUIVRE ET DES ÉCUEILS À ÉVITER 40
1. Mieux définir et mieux identifier les jeunes en situation d’exclusion 41
2. Se donner les moyens d’« aller vers » ces jeunes 43
3. Donner la priorité au renforcement du lien social 44
4. Agir dans la durée 45
5. Ne pas faire de l’emploi – et de n’importe quel emploi – l’objet unique des politiques d’insertion 45
6. User avec prudence de la dialectique du contrat, des droits et des devoirs s’agissant de jeunes très désocialisés 47
7. Éviter de recourir systématiquement, pour des raisons idéologiques, aux partenaires privés pour la mise en œuvre des actions d’accompagnement 47
8. S’appuyer sur les acteurs existants 49
La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » du projet de loi de finances 2010 rassemble cinq programmes couvrant les politiques publiques d’insertion. Le présent rapport se propose de rendre globalement compte de quatre d’entre eux : le revenu de solidarité active, les actions en faveur des familles vulnérables, l’égalité entre les hommes et les femmes et la conduite et le soutien des politiques sanitaires et sociales. À travers ces différents programmes, il fera plus précisément état de la question de l'autonomie des jeunes en situation d'exclusion.
La mise en place très récente du revenu de solidarité active, généralisé le 1er juin 2009, ne permet pas à ce jour d’établir un bilan définitif de la pertinence et de la pérennité de son financement comme de son efficacité. Cependant, des effets conjoncturels liés à la crise économique ont entraîné une modification importante des recettes destinées au financement du RSA, en particulier la contribution sur les revenus patrimoniaux, bien que la lente montée en charge du dispositif, qui peine à trouver sa cible, occulte l’insuffisance de ces financements. À la fin du mois de juillet 2009, seules 286 000 personnes aux revenus d’activité modestes, soit seulement 15 % des bénéficiaires potentiels, auraient touché la nouvelle prestation (RSA « chapeau »). Mais une fois réglés les problèmes d’information sur le droit au RSA et dépassées les réticences des travailleurs pauvres à user d’un dispositif relevant de l’aide sociale, il est à craindre que la complexité du montage financier et la sous-évaluation budgétaire ne permettent pas de couvrir les besoins de l’ensemble des allocataires potentiels, soit près de 2 millions de personnes.
À cela s’ajoute la question du financement du RSA « jeunes » annoncé par le Président de la République le 29 septembre 2009. Son extension aux moins de 25 ans se fera à des conditions telles – avoir travaillé 3 600 heures sur les 3 années précédentes – que seuls 160 000 jeunes devraient en bénéficier. Son financement, même minime de ce fait, n’apparaît nulle part. Il ne faudrait pas que les marges dégagées par l'insuccès temporaire du RSA « chapeau » soient affectées au financement du RSA jeune. L’effet de vase communiquant, lié à une situation conjoncturelle, pourrait conduire à « souhaiter » que tous les allocataires potentiels ne fassent pas valoir leurs droits et que la montée en charge du dispositif de départ ne s’arrête à mi-chemin.
À la problématique d’un financement complexe, incertain et insuffisant se surajoute la question épineuse de la compensation aux départements. Le basculement du RMI sur le RSA « socle » perpétue l’écart entre les dépenses d’allocation et la compensation réelle aux départements. Le basculement de l’API sur le RSA « socle » s’accompagne de même d’une compensation partielle des dépenses d’allocation. Enfin, les dépenses de gestion et d’accompagnement des familles monoparentales basculées sur le RSA et des bénéficiaires du RSA « chapeau » ne sont pas compensées. Outre les méfaits de transferts de compétences gestionnaires avec des prestations dont les collectivités locales ont l’attribution mais pas le contrôle, le risque d’émergence d’inégalités territoriales est réel.
Les effets dramatiques de la crise économique sur la situation des jeunes ont amené votre rapporteur a examiné plus précisément les mesures budgétaires qui leur sont consacrées. Leur précarité n’est pas strictement conjoncturelle puisque depuis 1970, le taux de pauvreté des personnes de plus de 60 ans a été divisé par deux pendant que celui des jeunes de 20 à 30 ans doublait. Malgré tout, avec 24 % des jeunes actifs au chômage et 20 % de jeunes sous le seuil de pauvreté, la récession actuelle a clairement fait de cette génération une variable d’ajustement.
Si la commission de concertation sur la politique de la jeunesse a entraîné une certaine conscientisation des problèmes, elle n’a jamais pris en compte la part de jeunes en profonde rupture qui ne sollicite jamais d’aide et n’accède pas même à une existence statistique. Cette frange « invisible » – selon le terme employé par les représentants de plusieurs mouvements associatifs rencontrés par votre rapporteur –, dans l’impossibilité de se fédérer, ne participe à aucune des concertations consacrées à la jeunesse, contrairement aux étudiants représentés par de puissants syndicats. Et s’il faut aujourd’hui entre 7 et 10 ans de stabilisation pour qu’un jeune diplômé s’insère durablement dans le monde professionnel, que dire de ceux qui ne sont ni en situation de formation, ni en situation d’emploi ? Les réponses apportées par le plan Agir pour la jeunesse ne leur sont pas inadaptées, elles ne les concernent tout simplement pas.
La précarité de ces jeunes sous-représentés est à la fois matérielle et relationnelle. À leur pauvreté s’ajoute l’isolement dû à des ruptures répétitives dans un cercle familial dégradé. Or l’autonomie des jeunes ne se décrète pas, elle se construit sur la durée et sous l’influence déterminante d’un environnement.
Une politique de jeunesse ne peut réussir qu’en adéquation avec une politique familiale. Le projet de loi de finances 2010 ne prend pas acte de cette synergie nécessaire. Le programme 137 « Egalité entre les hommes et les femmes » évolue à la marge avec une dotation de 29 115 344 euros en 2009 et de 29 497 358 euros en 2010. Le programme 106 « Actions en faveur des familles vulnérables » voit son enveloppe se réduire principalement en raison de la disparition de l’API en métropole au bénéfice du RSA. Néanmoins, il est à noter une baisse de 6,5 % des crédits destinés à l’accompagnement des familles dans leur rôle de parents. Pourtant toutes les actions de médiation familiale, de soutien à la parentalité ou encore de conseil conjugal contribuent à une politique de prévention contre les ruptures de liens familiaux et sociaux. On sait aujourd’hui, d’une part que les séparations conflictuelles ont un coût social exorbitant, d’autre part que la France est particulièrement atteinte, comparée à d’autres pays européens, par le délitement du lien social.
Outre l’absence de réflexion sur la décohabitation et l’autonomie des jeunes, les mesures annoncées récemment par le Président de la République lors du discours d’Avignon reprennent des logiques inappropriées aux plus exclus d’entre eux.
Le RSA jeunes, comme le RSA classique, sera un instrument de lutte contre la pauvreté, pas contre la misère. Selon les chiffres du Conseil national des missions locales, depuis 2005, 808 939 jeunes sont entrés dans le dispositif du CIVIS, mais seuls 202 634 en sont sortis pour un emploi durable. Croire que le CIVIS permettra l’insertion de tous les jeunes exclus revient à méconnaître la situation globale des plus éloignés de l’emploi. Avant d’envisager une insertion professionnelle, il leur faudra se réinsérer socialement, se sentir légitime à partager la vie collective, parfois même retrouver la notion du temps. Ce parcours préalable peut prendre des années. Or toute la logique du plan Agir pour la jeunesse repose sur l’équilibre des droits et des devoirs. Pourtant, la difficile question de l’assistanat ne peut se poser qu’en période de plein emploi. Les politiques publiques doivent se délester d’une vision morale de l’aide sociale, selon laquelle une prestation se mérite, et aller au devant de ces jeunes qui n’ont recours à rien. Les dispositifs doivent s’inscrire dans la durée, leurs atermoiements brouillent le message envoyé à la jeunesse et découragent les travailleurs sociaux.
Le déficit de cohérence des politiques touchant à la jeunesse pose froidement la question de l’ambition que le Gouvernement nourrit pour les enfants et les très jeunes gens relégués aux marges de la société française et renforce le devoir ardent du Parlement à lutter contre le retour en force du déterminisme social.
L’article 49 de la loi organique du 1er août 2001 fixe au 10 octobre la date butoir pour le retour des réponses aux questionnaires budgétaires.
Le rapporteur pour avis a demandé que les réponses lui parviennent le 25 septembre 2009. À cette date, une seule réponse (soit 1 % de celles attendues) lui était parvenue. À la date butoir du 10 octobre 2009, le taux de réponses n’atteignait que 36 %.
I.- LES PRINCIPALES INFLEXIONS DES CRÉDITS DE LA SOLIDARITÉ
Parmi les trente-trois missions du budget général de l’État, la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » est l’une des dix à présenter un caractère interministériel. Plusieurs membres du Gouvernement sont en effet responsables de sa gestion : d’une part, M. Xavier Darcos, ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et Mme Nadine Morano, secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité ; d’autre part, M. Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et à la jeunesse. Cette mission regroupe, pour un montant total de crédits de plus de 12 milliards d’euros, cinq programmes de poids très inégal. Le mieux doté, le programme « Handicap et dépendance », qui représente les trois quarts de l’ensemble des crédits, n’est pas commenté dans le présent avis car, conformément aux usages, la commission des affaires sociales a désigné un rapporteur spécialement chargé de ce programme (M. Paul Jeanneteau).
Les crédits globaux de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » ressortent dans le projet de loi de finances pour 2010 en forte hausse, ce qui rend principalement compte du déploiement du revenu de solidarité active (RSA). L’effort consenti pour financer le RSA, dont le chiffrage est au demeurant incertain, ne doit pas dissimuler l’absence de tout effort budgétaire sur d’autres politiques de la mission qui sont pourtant présentées comme « prioritaires ».
Le tableau ci-après permet d’identifier, à l’intérieur des programmes de la mission, les principales interventions auxquelles ils correspondent.
Les principales lignes de crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »
Crédits de paiement en millions d’euros |
2009 |
2010 |
Évolution 2010/2009 (%) |
MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES, DONT : |
11 163,1 |
12 371,2 |
10,8 |
Programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales », dont : |
582,5 |
1 684,5 |
189,2 |
Expérimentations |
10,1 |
10 |
-0,8 |
Revenu de solidarité active |
572,5 |
1 674,5 |
192,5 |
Programme 106 « Actions en faveur des familles vulnérables », dont : |
836,5 |
407,6 |
- 51,3 |
« Accompagnement des familles dans leur rôle de parents » |
15,6 |
14,6 |
- 6,5 |
Allocation de parent isolé (API) |
601,5 |
164,2 |
- 72,7 |
Protection des enfants et des familles (tutelles/curatelles notamment) |
219,4 |
228,8 |
4,3 |
Programme 157 « Handicap et dépendance » |
8 629,3 |
9 103,8 |
5,5 |
Programme 137 « Égalité entre les hommes et les femmes » |
29,1 |
29,5 |
1,3 |
Programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » |
1 085,7 |
1 145,9 |
5,5 |
A. LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE : UNE LENTE MONTÉE EN CHARGE QUI MASQUE L’INSUFFISANCE DES FINANCEMENTS
Le RSA, tel que l’a établi la loi fondatrice n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, repose sur un dispositif financier complexe. À ce titre, un bref rappel de ce dispositif est utile avant d’en analyser le financement budgétaire inscrit dans la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », au programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentation sociales ».
S’agissant du financement, la première distinction à effectuer porte sur le RSA « socle » et le RSA « chapeau » :
● Le RSA « socle » correspond à la part de l’allocation de RSA qui vise à porter le revenu des bénéficiaires à un montant forfaitaire tenant compte de la composition de leur foyer. À ce titre, il s’inscrit dans la continuité du revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’allocation de parent isolé (API), qui ont été supprimés au bénéfice du RSA.
Le RSA « socle », dont le coût est évalué à un peu plus de 6 milliards d’euros pour 2009, est pris en charge par les départements :
– ceux-ci finançaient déjà le RMI (soit une dépense nette de plus de 5 milliards d’euros en allocations en 2008) ;
– quant à l’API, dont les départements prennent la suite, du fait de son intégration au RSA « socle », alors qu’elle était financée par l’État par le biais des caisses d’allocations familiales, elle fait l’objet d’une compensation aux départements par l’attribution d’une recette fiscale, une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (voir infra sur les conditions de cette compensation).
● Le RSA « chapeau » correspond à la part de l’allocation qui porte le revenu global des bénéficiaires qui travaillent à un niveau supérieur aux anciens montants du RMI et de l’API, du fait que les revenus d’activité ne sont désormais pris en compte dans le calcul de l’allocation qu’à hauteur de 38 % de leur montant, ce qui signifie que les intéressés conservent en fin de compte 62 % de tout revenu d’activité supplémentaire. Le RSA « chapeau » est donc réservé aux bénéficiaires ayant des revenus d’activité.
Le financement de ce RSA « chapeau », dont le coût en année pleine a été estimé à environ 2,9 milliards d’euros (hors DOM où il n’est pas encore en vigueur), transite par le Fonds national des solidarités actives (FNSA), géré par la Caisse des dépôts et consignations et non doté de la personnalité morale (on doit le considérer comme un élément de l’État). Le FNSA est alimenté par une subvention budgétaire, inscrite au programme 304 de la mission, et par le produit d’une contribution sociale de 1,1 % sur les revenus du capital instituée à cet effet.
Dans le « montage » financier initial du RSA, cette contribution, dont le rendement était espéré à environ 1,5 milliard d’euros par an, devait financer l’intégralité du surcoût (par rapport aux dispositifs préexistants) du RSA pour l’État, de sorte que la réforme devait être une « opération blanche » pour le budget de l’État : ainsi qu’on le voit sur le tableau ci-après, la contribution budgétaire au FNSA équivalait au « recyclage » d’économies réalisées sur d’autres postes grâce à l’instauration du RSA. En effet, outre la suppression des dispositifs absorbés (API, mesures dites d’intéressement), la création du RSA s’accompagne de la remise en cause partielle de certains « droits connexes » qui étaient liés au RMI en matière d’aides au logement, de taxe d’habitation et de redevance audiovisuelle, ainsi que d’une non-revalorisation en 2009 de la prime pour l’emploi (PPE) ; de plus, cette dernière ne sera pas cumulable avec le RSA, alors que les publics des deux mesures se recoupent, ce qui conduira à réduire la dépense de PPE.
L’impact du RSA sur le budget de l’État tel qu’évalué initialement (fin 2008)
En millions d’euros, les mesures d’« économie » sont en négatif |
2009 |
2010 |
2011 |
Suppression de la prime de retour à l’emploi (mesure d’« intéressement » au retour à l’emploi à la charge de l’État) |
- 38 |
- 153 |
- 170 |
Suppression de l’API |
- 439 |
- 928 |
- 1 065 |
Baisse de dépenses sur les aides au logement |
- |
- 23 |
- 23 |
Diminution de la prime pour l’emploi (non-indexation et subsidiarité par rapport au RSA) |
- 400 |
- 750 |
- 1 100 |
Réforme du dégrèvement de taxe d’habitation |
- |
- 30 |
- 30 |
Compensation de l’extension de compétence des départements aux parents isolés (suppression de l’API) |
322 |
644 |
688 |
Contribution budgétaire au Fonds national des solidarités actives (FNSA) |
555 |
1 240 |
1 700 |
Solde (coût net du RSA pour l’État) |
- |
- |
- |
Source : travaux préparatoires de la loi généralisant le RSA.
Cependant, cette construction équilibrée apparaît a posteriori toute théorique, notamment du fait de la crise économique, ainsi que l’on y reviendra.
Par ailleurs, elle ne prend pas en compte la nécessité d’un déploiement du RSA dans les départements d’outre-mer. À la Réunion, le taux de chômage atteint 27,2 % et a augmenté de 21,3 % en un an. Le chômage des jeunes est particulièrement élevé : il atteint près de 50 % des hommes de moins de 25 ans et 53 % des femmes du même âge. Les mouvements sociaux de très grande ampleur qui se sont déroulés durant l'hiver 2008-2009, notamment à la Réunion et en Guadeloupe, avaient donné lieu à un protocole de sortie de crise entre les populations et les pouvoirs publics. L’accord du 4 mars 2009 a permis la mise en place d’un revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) d’un montant de 200 euros pour la Guadeloupe (dont 50 à la charge des collectivités locales) et de 100 euros pour le reste des départements ultramarins. Or, lors de la négociation de cet accord, il n’a jamais été question de substituer le RSTA au RSA, l’un et l’autre n’ayant d’ailleurs pas la même finalité. Il ne faudrait pas que ce simulacre d’anticipation du RSA repousse son véritable déploiement au-delà de 2011, date à laquelle il a déjà été reporté par le Gouvernement pour des motifs techniques et budgétaires. Le rapport rendu en avril 2009 par M. René-Paul Victoria à la demande du Gouvernement conclut d’ailleurs à la nécessité d’appliquer le RSA outre-mer de la même manière qu’en métropole, ce qui permettrait de couvrir 42 % de la population ultramarine pour un coût annuel estimé à 250 millions d’euros.
Du côté des ressources du Fonds national des solidarités actives, il convient d’abord de relever le rendement très décevant de la contribution sur les revenus patrimoniaux (revenus fonciers et financiers, plus-values…) des particuliers. Évalué l’an passé à plus de 1,4 milliard d’euros pour 2009 et 1,5 milliard pour 2010, ce rendement est révisé dans l’annexe « bleue » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » à respectivement 1,235 milliard et 1,287 milliard pour ces deux exercices.
En conséquence, afin d’assurer l’équilibre du FNSA à prévisions de dépenses inchangées, la subvention budgétaire qui lui est allouée sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » est portée par le présent projet de loi de finances à 1,675 milliard d’euros pour 2010, contre 1,24 milliard d’euros anticipés l’an dernier pour ce même exercice dans le cadre de la programmation triennale des finances publiques.
Cependant, cet ajustement va vraisemblablement se révéler insuffisant : selon le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2009, le produit de la contribution sur les revenus patrimoniaux serait encore inférieur d’une centaine de millions d’euros, en 2009 puis en 2010, aux prévisions révisées du présent projet de loi de finances. Il en résulterait alors, toujours toutes choses égales par ailleurs, un déficit cumulé du FNSA d’environ 200 millions d’euros fin 2010, comme on peut l’observer sur le tableau ci-après. En bonne logique, la subvention budgétaire pour 2010 devrait être encore relevée de ce montant pour atteindre près de 1,9 milliard d’euros.
Équilibre prévisionnel du Fonds national des solidarités actives
(en millions d’euros)
2009 (1) (prévision initiale) |
2009 (prévision révisée en PLF 2010) |
2009 (CCSS prise en compte) |
2010 (prévision en LF 2009) |
2010 (prévision en PLF 2010) |
2010 (CCSS prise en compte) | ||
Dépenses |
Allocations de RSA « chapeau » |
1 450 |
inchangé |
inchangé |
2 900 |
inchangé |
inchangé |
Aide personnalisée de retour à l’emploi |
75 |
inchangé |
inchangé |
150 |
inchangé |
inchangé | |
Frais de gestion CNAF |
100 |
inchangé |
inchangé |
77 |
inchangé |
inchangé | |
Total |
1 625 |
inchangé |
inchangé |
3 127 |
inchangé |
inchangé | |
Recettes |
Prélèvement de 1,1 % sur les revenus du capital |
1 432 |
1 235 |
1 136 |
1 502 |
1 287 |
1 181 |
Subvention budgétaire (programme 304) |
555 |
inchangé |
inchangé |
1 240 |
1 675 |
inchangé | |
Total |
1 987 |
1 790 |
1 691 |
2 742 |
2 962 |
2 856 | |
Solde |
362 |
165 |
66 |
- 385 |
- 165 |
- 271 | |
Résultat (solde cumulé) |
362 |
165 |
66 |
- 23 |
- |
- 205 | |
Source : documents budgétaires et Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS).
La commission des comptes impute l’effondrement du rendement des prélèvements sociaux sur les revenus patrimoniaux (dont la contribution au titre du RSA) principalement « à la forte contraction des principales composantes de l’assiette [due à la crise financière]. Ainsi, en matière de revenus du patrimoine, les plus-values sont en repli de près de 40 %. S’agissant des revenus de placement, les plus-values immobilières et les dividendes s’inscrivent en recul de près de 30 % (…) » ; sont également en cause des mesures passées qui ont généralisé les prélèvements à la source sur ces revenus, ce qui accroît leur rendement la première année, mais au détriment des suivantes.
Le choix de financer le RSA par un prélèvement sur les revenus patrimoniaux avait été discuté sur le terrain de l’équité lors de l’examen de la loi généralisant le RSA. Ainsi d’autres modes de financement pouvaient être retenus, comme la remise en cause du bouclier fiscal et des « niches fiscales ». Aujourd’hui, l’effet particulièrement marqué de la crise économique sur l’assiette « revenus patrimoniaux » démontre en outre l’imprudence qu’il y a à asseoir une politique publique fondamentale sur une ressource tellement sensible à la conjoncture que son rendement peut varier de 20 %.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’à l’initiative de parlementaires de la majorité, il a été prévu, dans la loi généralisant le RSA, à son article 3, que le taux de la contribution sur les revenus patrimoniaux serait diminué, au vu de l’effet du plafonnement des niches fiscales institué par la loi de finances pour 2009, du rendement (en impôt sur le revenu supplémentaire) de ce plafonnement. Il y est également disposé que « le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l’exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit [de la contribution sur les revenus patrimoniaux], du produit du plafonnement [des niches fiscales] et de l’équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux [de la contribution sur les revenus patrimoniaux] en fonction de ces prévisions d’équilibre ». Il est à noter que ce rapport ne semble pas avoir été déposé à ce jour.
Certes ce dispositif, qui envisage une diminution du taux de contribution de 1,1 % en fonction tout à la fois du rendement – bien incertain – du plafonnement des niches fiscales et de l’équilibre du FNSA, apparaît très compliqué à mettre en œuvre. Son application augmenterait la marge d’incertitude du financement du RSA.
c) Les dépenses : des interrogations sur la montée en charge du RSA et sur le financement de son extension partielle aux jeunes
Lorsqu’il avait présenté la généralisation du RSA lors d’un discours prononcé en Mayenne le 28 août 2008, le Président de la République avait indiqué que la nouvelle prestation devrait bénéficier à 3,7 millions de ménages. Cette prévision a déjà été revue à la baisse : les données transmises à votre rapporteur pour avis dans le cadre du questionnaire budgétaire font état, sous l’hypothèse théorique d’une montée en charge complète du RSA dès le 1er juin 2009, de 3 millions de foyers bénéficiaires fin 2009 et 3,1 millions fin 2010.
Estimation du nombre de bénéficiaires du RSA
(métropole, tous régimes)
(en milliers)
2e semestre 2009 |
2010 | |
RSA « socle » seul |
876 |
986 |
RSA « socle » + « activité » (« chapeau ») |
478 |
476 |
RSA « activité » seul |
1 640 |
1 625 |
Total |
2 995 |
3 087 |
Source : réponses au questionnaire budgétaire.
Encore cette estimation intègre-t-elle, on l’a dit, une hypothèse de montée en charge immédiate du RSA, qui n’est pas réalisée à ce jour. Selon des données provisoires extraites de la comptabilité des caisses d’allocations familiales, le RSA avait fin août 2009 environ 1,47 million de bénéficiaires (payés), en grande majorité au titre du seul RSA « socle » (dans la continuité du RMI et de l’API), comme il ressort du tableau ci-après. Avec un nombre de bénéficiaires du RSA « chapeau » (ou « activité »), combiné ou non au RSA « socle », en augmentation de l’ordre de 70 000 unités par mois et atteignant 467 000 fin août, on voit qu’il pourrait falloir deux ans pour atteindre la « cible » de 2 millions de bénéficiaires du RSA « chapeau ».
De même, s’agissant des dépenses générées par le RSA « chapeau », avec 212 millions d’euros durant les trois premiers mois, il est clair que l’on sera très loin en fin d’année des 1,45 milliard d’euros de dépenses attendues à ce titre pour 2009 selon les documents budgétaires, qui provisionnent une montée en charge totale immédiate de la prestation.
Quelles que soient les raisons de cette montée en charge ralentie, sur lesquelles on reviendra, force est de constater qu’elle met en cause la crédibilité des prévisions de dépenses au titre du RSA « chapeau », qui paraissent dans les documents budgétaires très fortement surestimées, pour 2009 mais aussi 2010.
Se pose bien sûr la question de l’extension annoncée du RSA à certains des jeunes de moins de 25 ans et de son financement. Le Gouvernement entend-il financer cette extension sur les marges supposées disponibles sur l’enveloppe du RSA chapeau ? En ce cas, n’y a-t-il pas là l’expression inavouable d’un pari sur l’incapacité du RSA à toucher toutes les personnes auquel il est destiné (puisqu'il faudrait qu’il reste une marge de manœuvre pérenne à affecter au RSA « jeune »). L’objectif prioritaire doit rester une accessibilité exhaustive du RSA à tous ses bénéficiaires potentiels.
Pour conclure sur la question de l’équilibre financier du RSA à la charge de l’État, on peut certes se rassurer en observant que différents mouvements se neutralisent : la contribution sur les revenus patrimoniaux rapporte 20 % de moins que prévu et le RSA « jeunes » doit être financé, mais dans l’autre sens la montée en charge du RSA « chapeau » est beaucoup plus lente que prévu.
Mais que penser de la fiabilité d’un financement qui repose sur des données conjoncturelles !
Même si une prestation nouvelle met toujours longtemps à trouver son « public », le rythme de montée en puissance du RSA pose question. Diverses explications ont été avancées par les interlocuteurs de votre rapporteur, dont certaines très classiques : la complexité des démarches, la diffusion insuffisante de l’information… Cela dit, le très grand nombre de connexions effectuées sur le site Internet qui permet de réaliser un test d’éligibilité tend à montrer que la création du RSA a bien été intégrée par l’opinion. La Caisse nationale des allocations familiales a transmis à votre rapporteur le chiffre global de 15 millions de connexion depuis le 1er juin 2009.
Il a également été observé que peu de dossiers conduisant à des prestations de RSA « chapeau » faibles (quelques dizaines d’euros) arrivent à terme. Les demandeurs potentiels s’abstiennent en amont ou abandonnent en cours de démarche. Le montant moyen de RSA « chapeau » versé en août 2009 (dernier mois connu) représente 185 euros par foyer bénéficiaire, alors que l’on tablait plutôt, lors des débats sur l’instauration du RSA, sur un gain mensuel moyen par ménage de l’ordre de 107 euros. Les « petits » RSA « chapeau » sont donc sous-représentés. Outre la lourdeur des démarches, cette situation est imputée par certains à la crainte des contrôles et des mesures imposées au nom de l’obligation d’insertion. Indépendamment de ces contrôles, au demeurant nécessaires, la pesanteur des discours sur la « lutte contre la fraude », sur « les droits et les devoirs » et sur la primauté à l’emploi qui doit imposer à tous de passer par Pôle emploi a pu décourager certains demandeurs. Plus fondamentalement, l’opposition entretenue par certains responsables politiques entre ceux qui vivent de leur travail et ceux qui vivent de l’assistance peut amener des travailleurs pauvres à ne pas solliciter une prestation qui les ferait, dans leur esprit, basculer du « mauvais » côté. Un responsable associatif entendu par votre rapporteur a ainsi estimé que « ce n’est pas seulement une question d’accès à l’information, mais de dignité des personnes ».
La référence à la mise en œuvre des obligations alimentaires – puisque l'attribution du RSA, comme celle du RMI avant lui, peut en effet être subordonnée à la mise en œuvre par les demandeurs de toutes les créances alimentaires à l’encontre d’ex-conjoints, mais aussi de leurs parents – figurant clairement dans le formulaire du RSA (à l’inverse du RMI) a été selon les associations un élément d’inquiétude pour les demandeurs, qui ne s’imaginent pas engager une procédure contre leurs parents. Le Haut commissaire aux solidarités actives, saisi par le rapporteur en juillet 2009 sur ce sujet, a reconnu que « pour éviter toute confusion et se prémunir contre les risques de dérive (...), le formulaire de demande a été modifié pour souligner le caractère exceptionnel des instances dans lesquelles ces règles trouvent à s’appliquer et prévoit que celles-ci ne peuvent s'appliquer qu’à titre strictement exceptionnel et à la demande du président du conseil général » (2). Malgré cette modification, le pouvoir dissuasif de cette mesure subsiste.
Enfin, concernant les problèmes sur le terrain, il convient de signaler une certaine difficulté à mobiliser l’enveloppe nationale de 150 millions d’euros (en année pleine) inscrite au titre de l’« aide personnalisée au retour à l’emploi » sur les crédits du Fonds national des solidarités actives. Il s’agit d’un dispositif novateur, cette aide devant être attribuée de manière très souple en fonction des besoins des personnes. Or, cette souplesse et l’absence de critères d’attribution nationaux semblent perturber les organisations administratives (préfectures et Pôle emploi principalement) chargées de gérer cette mesure.
La mise en œuvre opérationnelle du RSA implique également, pour les acteurs administratifs de terrain, le déploiement de nouveaux moyens et de nouvelles compétences ainsi que l’organisation de relations conventionnelles, en particulier entre départements, caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole et Pôle emploi. Pour l’heure, et même si Pôle emploi ne participe toujours pas à l’instruction des dossiers, le rythme de la montée en charge du RSA limite les tensions sur ce point. Notons néanmoins qu’il pourrait en aller différemment à l’avenir, du fait des conditions défavorables dans lesquelles les nouvelles compétences attribuées sont financièrement compensées par l’État.
S’agissant des caisses d’allocations familiales, chargées non seulement du service de la prestation, mais également dotées pour le RSA d’un rôle de référence dans l’instruction des dossiers qu’elles n’avaient pas pour ce qui est du RMI, le réseau bénéficie d’une subvention du Fonds national des solidarités actives au titre de la gestion du RSA « chapeau » : 100 millions d’euros en 2009 et 77 millions en 2010. Le recrutement de 1 257 agents supplémentaires a été autorisé. Il convient toutefois d’être conscient que l’application de la règle de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux imposée aux caisses par la convention d’objectifs et de gestion entre la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et l’État pour 2009-2012 devrait quasiment neutraliser ces recrutements, dans l’effectif global des caisses, d’ici 2012.
Pour ce qui est des départements, la compensation (ou la non-compensation) de l’instauration du RSA doit être envisagée sur plusieurs plans :
● La compensation du RSA « socle » dans la continuité de celle du RMI
Pour ce qui est des bénéficiaires du RMI « basculés » sur le RSA « socle », leurs allocations étaient déjà à la charge des départements, depuis 2004, en contrepartie de quoi une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) avait été attribuée aux départements. Le décalage qui s’est creusé entre les dépenses effectives de RMI et cette ressource peu dynamique est bien connu et n’a pas été comblé par la création d’un Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) à hauteur de 500 millions d’euros par an. L’écart entre dépenses d’allocations et compensation s’est ainsi établi, selon l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) (3), à 340 millions d’euros en 2007 (5,15 milliards d’euros de dépenses d’allocations nettes d’indus pour 4,81 milliards de ressources de compensation) et 240 millions d’euros en 2008 (5,04 milliards d’euros de dépenses d’allocations nettes d’indus pour 4,8 milliards de ressources de compensation).
Quant aux dépenses d’insertion des bénéficiaires du RMI, elles ont toujours été à la charge des départements.
Le RSA « socle » des ex-bénéficiaires du RMI devrait rester compensé dans les mêmes conditions. En effet, le FMDI sera reconduit en 2010 et le droit à compensation assis sur la TIPP serait le même en 2010 qu’en 2009 en euros courants : 4,942 milliards.
● La compensation de l’intégration de l’allocation de parent isolé (API) au RSA « socle », pour ce qui est des dépenses d’allocations
L’intégration de l’API au RSA « socle » est compensée par l’attribution aux départements d’une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).
Cependant, cette compensation ne couvre pas la totalité de la dépense d’API. En effet, le milliard d’euros de dépense globale d’API est réduit du montant des mesures d’intéressement, que le Gouvernement estime ne pas avoir à verser puisque dans le régime RSA, l’intéressement rendu permanent est assuré par le RSA « chapeau », lequel n’est pas à la charge des départements. La compensation à verser aux départements au titre de l’API a donc été estimée à 644 millions d’euros en année pleine.
L’article 7 de la loi généralisant le RSA du 1er décembre 2008 dispose que le montant de cette compensation, fixé pour la première fois, pour 2009, par la loi de finances pour cet exercice, est calculé sur la base des comptes administratifs des départements pour l’exercice précédent et sera ajusté sur la base de ces comptes afférents aux exercices 2009 et 2010 ; la fixation définitive du droit à compensation devrait donc s’effectuer sur la base des comptes 2010 (donc au cours de l’année 2011, vraisemblablement en loi de finances pour 2012).
L’article 19 du projet de loi de finances pour 2010 propose un premier ajustement : le montant global du droit à compensation en base annuelle serait réduit de 644 à 599 millions d’euros, les dépenses à prendre en compte ayant été révisées à la baisse ; toutefois, pour l’exercice 2009, c’est bien 644 millions d’euros qui seraient versés aux départements (le droit à compensation est en revanche réduit pour l’avenir).
Au total, les départements disposeraient donc en 2010 pour le RSA « socle » d’une compensation à hauteur de 5,586 milliards d’euros (4,942 milliards au titre de l’ex-RMI + 644 millions au titre de l’API). Ce montant peut être comparé avec des prévisions de dépenses, selon les réponses au questionnaire budgétaire de votre rapporteur, qui s’élèvent pour le RSA « socle » à près de 6,9 milliards d’euros en 2010 (après 6,2 milliards en 2009) : dès 2010, on aurait ainsi aux dépens des départements un écart de 1,3 milliard d’euros que le maintien du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion à hauteur de 500 millions d’euros sera loin de combler.
● La non-compensation des dépenses de gestion et d’accompagnement des familles monoparentales basculées sur le RSA et des bénéficiaires du RSA « chapeau »
Par ailleurs, alors même que la loi confie au président du conseil général la responsabilité globale de l’attribution du RSA (sans distinguer le cas du RSA « socle » de celui du RSA « chapeau », ni le cas des familles monoparentales), aucune ressource de compensation n’est attribuée aux départements pour la gestion et l’accompagnement, d’une part des bénéficiaires ex-allocataires de l’API, d’autre part des nouveaux entrants que sont les bénéficiaires du seul RSA « chapeau ».
Certes, pour ce qui est des familles monoparentales, l’accompagnement semble rester pour le moment assuré par les caisses d’allocations familiales, qui avaient développé ces dernières années une action en direction des bénéficiaires de l’API. Cela dit, la loi ne leur demande pas de réaliser cet accompagnement. Quant à la convention d’objectifs et de gestion CNAF/État pour 2009-2012, elle comporte un engagement limité en ces termes : « dans la continuité de la COG 2005-2008, poursuivre la mise en œuvre du socle minimum d’accompagnement : information et conseil sur la prestation RSA et sur les offres de service et actions collectives des CAF ». Pour le reste, cette convention renvoie aux « partenariats locaux » et aux ressources de chaque caisse pour apporter éventuellement un appui au service public de l’emploi (pour les bénéficiaires du RSA qui lui seront adressés) ou se voir déléguer par le conseil général l’accompagnement des familles monoparentales. Ce cadre facultatif paraît laisser aux caisses la liberté de se retirer largement de l’accompagnement des familles monoparentales… ou bien de prétendre le facturer aux départements.
Quant au RSA « chapeau », on peut supposer que la majorité de ses bénéficiaires, qui par définition ont déjà un emploi et donc un certain niveau d’insertion, seront suivis par Pôle emploi. Mais les prestations de Pôle emploi, dès lors qu’elles excéderont les « interventions de droit commun » au bénéfice des demandeurs d’emploi, feront, selon la loi du 1er décembre 2008, l’objet d’un financement contractuel par le département. Un accord-cadre a d’ailleurs été finalisé sur cette question entre Pôle emploi et l’Assemblée des départements de France (ADF) et les conventions locales sont en cours de négociation dans la plupart des départements.
Les mesures d’insertion financées par les départements pour environ un million de bénéficiaires du RMI représentaient ces dernières années selon l’ODAS, en 2007 et 2008, 500 à 600 millions d’euros par an (4). Même si la dépense par bénéficiaire du RSA « chapeau » sera logiquement moindre (puisque les intéressés sont déjà en emploi), on voit que le passage à 3 millions de bénéficiaires du RSA ne pourra se faire sans d’importantes dépenses supplémentaires d’insertion. L’enveloppe annuelle d’aide personnalisée au retour à l’emploi, prévue à hauteur de 150 millions d’euros, ne saurait les couvrir et les départements seront nécessairement mis à contribution en l’absence de nouvelle ressource de compensation.
10 millions d’euros sont inscrits dans le projet de loi de finances pour 2010 au titre des « expérimentations sociales et autres expériences en matière sociale et d’économie sociale » gérées jusqu’à présent par la Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale (DIIESES), dont 8 millions affectés au Fonds d’innovation et d’expérimentation sociale (FIES).
Cet instrument budgétaire est cependant faible par rapport au principal outil d’expérimentation mis en place par le Haut commissariat à la jeunesse, le Fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA. Géré hors budget par la Caisse des dépôts et consignations, ce fonds, doté par l’État de 150 millions d’euros pour la période 2009-2011, bénéficie également de contributions d’opérateurs privés (fondations d’entreprises comme Total, fédérations patronales…) pour un montant de 39 millions d’euros à ce jour selon les réponses au questionnaire budgétaire. En 2009, la délégation interministérielle contribue au financement du nouveau fonds à hauteur de 5,1 millions d’euros.
Le fonds d’expérimentation a lancé en avril 2009 une première vague d’appels à projets, qui a débouché sur 165 projets retenus pour une enveloppe globale de 65 millions d’euros. Un deuxième appel à projets intitulé « 10 000 permis pour réussir » (centré sur l’accès au permis de conduire pour les jeunes issus de familles modestes) a été lancé en juin 2009 avec une enveloppe de 10 millions d’euros et un troisième appel à projets concerne l’outre-mer pour 1 million d’euros. Le fonds d’expérimentation est toutefois critiqué par des responsables associatifs qui observent que les projets financés émanent très largement des services de l’État (Éducation nationale et direction de la jeunesse et des sports…) ; ainsi l’État se subventionnerait lui-même… On peut s'étonner dès lors de la place faible réservée au mouvement associatif.
1. L’action « Accompagnement des familles dans leur rôle de parents » : des moyens insuffisants pour financer les engagements et les annonces
L’État se propose de consacrer en 2010 un montant de 14,577 millions d’euros à ses interventions destinées à « accompagner les familles dans leur rôle de parents », contre 15,587 millions d’euros en 2009, soit une diminution de 6,5 %. Ces crédits sont pour l’essentiel versés à des associations intervenant dans le champ visé. Ils comportent une petite part de crédits nationaux destinés aux « têtes de réseau » de ces associations et sont pour le reste gérés de manière déconcentrée. Le tableau ci-après permet de mesurer l’ampleur du désengagement de l’État en trois ans (de 2007 à 2010), les crédits déconcentrés globaux étant divisés par deux (de 25 à 12,6 millions d’euros).
Évolution des crédits déconcentrés d’accompagnement des familles
(en millions d’euros)
LFI 2007 |
LFI 2008 |
LFI 2009 |
PLF 2010 | |
Conseil conjugal et familial |
2,5 |
2,5 |
1,5 |
2,1 |
Médiation familiale |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
Soutien à la parentalité |
17,6 |
13,6 |
7,1 |
6,1 |
Autres actions, dont « maisons des adolescents » |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2 |
Total |
25 |
21 |
13,5 |
12,6 |
Source : questionnaire budgétaire. NB : les montants indiqués sur les différentes lignes sont essentiellement indicatifs, car fongibles en gestion.
Ce désengagement de fait entre en contradiction avec les préconisations, venant de tous les bords, qui insistent sur l’importance des actions d’accompagnement social des couples et des familles. Alors que le délitement des liens sociaux et familiaux et la progression de la « précarité relationnelle » sont peut-être dans notre pays plus inquiétants que la pauvreté matérielle, renforcer ces actions d’accompagnement préviendrait certainement des coûts sociaux ultérieurs bien plus lourds. Des responsables associatifs rencontrés par votre rapporteur ont notamment mis en lumière l’opportunité qu’offre la période où elles ont de jeunes enfants pour proposer un accompagnement aux familles les plus précarisées, notamment monoparentales. C’est dans cette période que ces familles ont de fait le plus de contacts avec les services sociaux et administratifs au sens large (avec l’école notamment) et que ces services peuvent donc le mieux les identifier et leur proposer de l’aide. Au demeurant, dans les annonces gouvernementales comme dans les travaux parlementaires, tout le monde semble admettre l’importance de l’accompagnement des couples et des parents. Malheureusement, les annonces et les engagements, voire les textes de loi, ne sont guère suivis d’effet. Quelques exemples sont à cet égard flagrants :
– On peut ainsi observer que les crédits consacrés à la médiation familiale stagnent à 2,4 millions d’euros, quand bien même le rapport remis par M. Jean Leonetti au Premier ministre le 7 octobre sur la modernisation de la législation sur l’autorité parentale et le droit des tiers appelle au renforcement de la médiation.
– De même, les moyens consacrés à la mise en place des « maisons des adolescents » reculeront-ils en 2010, alors que l’annexe budgétaire « bleue » indique que le Gouvernement souhaite en doter durant cet exercice tous les départements qui n’en ont pas encore, soit le quart d’entre eux (donc 25 environ). Comment financera-t-on 25 maisons nouvelles avec 2 millions d’euros, quand en 2009, selon la même source, on en aura financé 19 avec 2,5 millions d’euros ? Les maisons des adolescents sont pourtant reconnues comme une initiative pertinente pour prendre contact avec des jeunes en difficulté, qui ne fréquenteront pas spontanément des services plus spécialisés, et pour apporter une réponse globale, en réseau, à leurs problèmes.
– L’article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a prévu la création d’un « fonds national de financement de la protection de l’enfance ». Il doit être cofinancé par l’État et la Caisse nationale des allocations familiales, en vue « de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre [de la réforme] et de favoriser des actions entrant dans le cadre [de cette réforme] ». Or, ce fonds, inscrit dans un texte législatif, n’est toujours pas mis en œuvre, le Gouvernement n’ayant pas pris le décret d’application, bien qu’un projet de décret ait été préparé et soumis à l’avis du comité des finances locales le 5 février 2008.
Deux lignes budgétaires de l’action « Accompagnement des familles dans leur rôle de parents » méritent un développement particulier : le soutien à la parentalité et le conseil conjugal et familial.
L’implication budgétaire de l’État dans les actions de soutien à la parentalité, notamment les « réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents » (REAAP), ressort en forte baisse : 13,6 millions d’euros en 2008 ; 7,1 millions en 2009 ; 6,1 millions en 2010. Cette évolution est certes compensée par une intervention de la branche famille ; en effet, selon l’annexe IV de la convention d’objectifs et de gestion CNAF/État 2009-2012, les caisses d’allocations familiales doivent consacrer à ces réseaux 8,5 millions d’euros en 2009, 9 millions en 2010 et 9,5 millions en 2011. Cependant, il semble que, sur le terrain, la mise à disposition de ces fonds au bénéfice des associations soit difficile. En outre, dans la mesure où les crédits de l’État diminueront en 2010 de 1 million d’euros (7,1 – 6,1) quand ceux des caisses n’augmenteraient, selon leurs engagements, que de 0,5 million d’euros (9 – 8,5), l’exercice 2010 devrait voir une diminution globale de 0,5 million d’euros des moyens consacrés à l’aide à la parentalité.
On se souvient que suite à une tentative de réduction des moyens de l’État affectés à la prise en charge des actions de conseil conjugal et familial, le Mouvement français pour le planning familial, principal réseau associatif intervenant dans ce domaine, et l’État ont signé le 11 mars 2009 un protocole visant à garantir un financement stable à hauteur de 2,6 millions d’euros.
Pour l’année 2009, l’État devrait effectivement consacrer à ces actions 2,6 millions d’euros, alors que 1,5 million seulement ont été inscrits en loi de finances initiale, grâce à des redéploiements budgétaires internes et à un apport de 0,5 million en provenance de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé). En 2010, il est proposé de reconduire cette formule : aux 2,1 millions de crédits d’État s’ajouterait une contribution de 0,5 million de l’agence afin de rester au niveau global de 2,6 millions d’euros. Mais ce « bricolage » budgétaire ne va pas sans difficultés, notamment dans les relations des associations pratiquant le conseil conjugal avec l’Acsé. Le fonctionnement normal de l’agence, ciblé sur des territoires et reposant sur le financement a priori de projets, n’est pas compatible avec l’attribution de subventions a posteriori, justifiées par des heures de conseil conjugal effectuées par des associations qui n’interviennent pas spécifiquement sur les quartiers de la politique de la ville.
2. L’allocation de parent isolé : l’absorption par le RSA, fin d’un processus d’alignement des droits à la baisse
Les crédits de « soutien en faveur des familles monoparentales » correspondent au financement par l’État de l’allocation de parent isolé. Consécutivement à son absorption par le RSA, le montant de 164 millions d’euros inscrit dans le projet de loi de finances pour 2010 représente un crédit résiduel, destiné principalement à financer l’allocation outre-mer dans l’attente que le RSA y soit déployé.
L’intégration de l’API au RSA en a changé le fondement, passant d’une prestation familiale à une logique d’engagements contractuels d’insertion. Cette intégration a été précédée de toute une série de mesures restrictives, permettant à l’État de réduire la dépense d’API, qui ont été justifiées au nom de l’alignement – mais toujours à la baisse des droits – des réglementations de l’API et du RMI avant leur absorption par le RSA. Ainsi ont été décidés la mise en œuvre d’une stricte subsidiarité par rapport aux autres prestations telles que l’allocation de soutien familial, l’alignement du barème de récupération des indus d’API sur celui du RMI et la suppression du maintien de six mois de l’API en cas de demande tardive. Lorsque la demande d’API avait été présentée tardivement, la réglementation autorisait en effet la poursuite du versement de l’allocation pendant six mois au-delà de l’échéance de droit commun, soit le troisième anniversaire du plus jeune enfant ou le premier anniversaire à compter de la séparation ou du décès du conjoint ou concubin.
3. La réforme des mesures de protection des majeurs : un transfert budgétaire déguisé aux départements
229 millions d’euros sont inscrits dans le projet de loi de finances au titre de la « protection des enfants et des familles », l’essentiel de ces crédits étant destiné au financement des mesures de protection des majeurs, telles que tutelles et curatelles.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a profondément modifié les règles en la matière, avec pour effet de substantielles économies budgétaires pour l’État. Selon les éléments transmis à votre rapporteur, en l’absence de réforme, l’État aurait été amené à financer 278 000 mesures de cette nature en 2010 et 299 000 en 2011, pour un coût évalué respectivement à 288 et 315 millions d’euros. Il ne devrait, après réforme, financer que 186 000 mesures en 2010 et 191 000 en 2011, pour un coût évalué respectivement à 222,2 et 231,2 millions d’euros. C’est donc une économie annuelle de 70, voire 80 millions d’euros qui est ainsi réalisée.
Or, dans le même temps, il apparaît que cette réforme va entraîner un accroissement de dépenses pour les départements. Selon une note de la Direction générale de l’action sociale, les départements pourraient en effet avoir de moindres dépenses en matière de financement des mesures d’accompagnement judiciaire des personnes bénéficiant de prestations d’aide sociale qu’ils versent, du fait d’une diminution du nombre de ces mesures et d’une harmonisation à la baisse de leur coût unitaire. Mais dans l’autre sens, la mise en place de « mesures d’accompagnement social personnalisé » (MASP) pourrait mobiliser de l’ordre de 800 postes équivalents temps plein de travailleurs sociaux. Le solde entre économies et nouvelles dépenses, neutre en 2009 selon ce document, conduirait à une dépense nette supplémentaire départementale de 18 millions d’euros en 2010 et de 32 millions en 2011.
Sans doute ces estimations reposent-elles sur des hypothèses incertaines et demandent-elles à être confirmées. Il n’empêche que c’est bien à un transfert déguisé de charges de l’État aux départements que l’on assiste.
Le programme « Égalité entre les hommes et les femmes » devrait voir en 2010 ses faibles moyens – 29,5 millions d’euros – reconduits en très légère augmentation (+ 1,3 %). Cette stagnation ne permettra manifestement pas de faire face aux enjeux du nécessaire renforcement de plusieurs politiques imputées sur ce programme :
– Une réelle mise en œuvre du plan interministériel 2008-2012 de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes demanderait des moyens plus importants. À l’Assemblée nationale, une mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a été mise en place, présidée par Mme Danielle Bousquet et rapportée par M. Guy Geoffroy. Elle a notamment mis l’accent sur la nécessité d’inscrire dans les projets des établissements scolaires les actions à mener pour promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons et l’éducation au respect. Elle a par ailleurs incité à la systématisation de ces actions (5), qui relèvent de la responsabilité de l’Éducation nationale dans le cadre de l’article L. 312-16 du code de l’éducation et de sa circulaire d’application du 17 février 2003. Or, de fait l’Éducation nationale ne remplit pas sa mission dans ce domaine et, par ailleurs, les moyens destinés à prendre en charge les interventions extérieures (associatives) qui y suppléent sont très insuffisants.
– L’action « Articulation des temps de vie » bénéficiera, en 2010 comme en 2009, de moyens budgétaires d’un niveau symbolique – 168 113 euros –, l’État s’étant manifestement désengagé de toute politique en la matière. Cela a pour conséquence de priver de visibilité les actions menées localement par des collectivités dans ce domaine. C’est regrettable, car l’action sur les « temps », même si elle est rattachée budgétairement à la problématique de l’égalité des sexes, est aussi et surtout une politique d’insertion des plus précaires. Quand une entreprise, motivée par l’intervention d’une collectivité locale, accepte d’envisager que le ménage soit fait dans ses locaux pendant que ses propres salariés s’y trouvent, c’est l’opportunité d’horaires de travail « normaux », aux heures de fonctionnement des transports en commun, qui est offerte à des salariés le plus souvent à temps partiel. De manière générale, l’action sur les temps de vie permet de prendre en compte les problèmes de mobilité, qui sont un facteur d’exclusion important.
Le programme 124, qui regroupe les moyens de fonctionnement des administrations sanitaires et sociales, appelle en général peu de commentaires, bien qu’il représente un montant supérieur au milliard d’euros.
On doit cependant signaler que le projet de loi de finances pour 2010 identifie pour la première fois, sur ce montant, les crédits afférents aux agences régionales de santé (ARS) en cours de création : 271 millions d’euros. Les autres mesures de réorganisations en cours, notamment dans les services déconcentrés autour des directions de la cohésion sociale, n’ont en revanche pas de traduction budgétaire évidente.
Le programme 124 intègre également les modestes crédits de fonctionnement – 3,18 millions d’euros inscrits pour 2010 – du service de la Défenseure des enfants. La perspective d’une éventuelle suppression de l’autorité administrative indépendante « Défenseur des enfants » mérite un développement particulier. Cette réforme est présentée comme une mesure d’application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a établi un « Défenseur des droits ». Deux projets de loi présentés lors du Conseil des ministres du 9 septembre 2009 précisent ainsi le statut, les missions et les pouvoirs envisagés pour le Défenseur des droits. Ses attributions incluraient celles aujourd’hui exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Il serait assisté de deux collèges de trois personnalités qualifiées pour l’examen des réclamations en matière de déontologie de la sécurité et de protection de l’enfance. Le Gouvernement insiste sur les prérogatives importantes dont disposera le Défenseur des droits : faire des injonctions aux administrations, proposer des transactions, intervenir dans tout procès… Cependant, la suppression du Défenseur des enfants en tant que tel aurait deux conséquences très dommageables :
– Cela entraînerait une évidente perte de visibilité de la mission de défense des droits des enfants. Alors que l’accès direct des enfants aux institutions chargées de les défendre est un enjeu évident que l’on retrouve notamment dans les préconisations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, il est essentiel que soit bien en vue une institution spécifiquement en charge des droits des enfants, que ces derniers connaissent et peuvent saisir directement. Les Maisons des adolescents rencontrent ainsi un vif succès auprès des jeunes parce que l’appellation même de l’organisme supprime l’appréhension qu’ils ont à franchir le seuil des institutions. Il est primordial que les enfants bénéficient de ce pouvoir d’identification immédiat par le maintien d’une institution clairement appelée « Défenseur des enfants ».
– Les modes d’intervention assez spécifiques du Défenseur des enfants risquent d’être dilués : le Défenseur des enfants a plus vocation à être une instance de médiation (dans des conflits familiaux notamment) et une force de proposition qu’un organe d’injonction comme le sera le Défenseur des droits.
II.- LES JEUNES EN SITUATION D’EXCLUSION : PASSER DES DISCOURS AUX RÉALISATIONS
Le 29 septembre dernier, à Avignon, le Président de la République a indiqué que la politique de la jeunesse devait être centrée sur « un projet, l’autonomie ». Chacun peut se reconnaître dans ce projet. Mais il reste à le mettre en œuvre car, si le constat de la situation très difficile de nombreux jeunes est unanime et si la plupart des mesures annoncées pour y remédier peuvent faire consensus dans leur principe, les vraies difficultés – et l’échec – des plans gouvernementaux qui se sont succédé pour les jeunes depuis trente ans résident évidemment dans la mise en œuvre sur le terrain.
C’est un euphémisme de dire que les résultats de ces plans n’ont pas toujours été au rendez-vous, en particulier pour les jeunes en situation d’exclusion. Il n’existe sans doute pas de recette-miracle pour ces jeunes, mais votre rapporteur, après avoir auditionné des acteurs de différents bords (associations, administrations et collectivités publiques…), relève quelques lignes de conduite que ne devrait pas perdre de vue l’action publique.
Le constat de la situation très difficile par rapport à l’emploi et, corrélativement, de la surexposition des jeunes à la pauvreté n’est pas discutable, ni discuté. Quelques chiffres particulièrement marquants méritent toutefois d’être rappelés.
La première donnée frappante, s’agissant de l’emploi des jeunes, est son évolution conjoncturelle dans la crise actuelle. Le taux de chômage (au sens du Bureau international du travail) est, pour les moins de 25 ans, passé en un an, du second trimestre 2008 au second trimestre 2009, de 18,7 % à 23,9 %, quand il passait de 7,3 % à 9,1 % pour l’ensemble de la population active française : non seulement les jeunes sont beaucoup plus souvent au chômage que les moins jeunes, mais leur situation relative s’est dégradée avec la crise, le rapport du taux de chômage des jeunes au taux de chômage global passant de 2,56 à 2,63.
Les chiffres bruts étant parfois plus parlants que les pourcentages, on peut aussi se référer aux inscrits à Pôle emploi : en un an, d’août 2008 à août 2009, on décompte près de 150 000 jeunes supplémentaires au chômage, comme on le voit sur le tableau ci-après, soit une augmentation d’un tiers. Cette augmentation est encore plus marquée si l’on prend les seuls jeunes hommes, du fait sans doute de leur plus grande présence dans l’emploi industriel : l’augmentation approche alors les 50 %. Il est clair que les jeunes, du fait des emplois précaires – contrats à durée déterminée, intérim – qu’ils occupent très souvent, constituent la première variable d’ajustement de l’emploi à la conjoncture, phénomène renforcé par l’absurde défiscalisation des heures supplémentaires, qui a amené nombre d’entreprises à préférer conserver celles-ci plutôt que leurs intérimaires.
Évolution du chômage des jeunes : jeunes inscrits à Pôle emploi
Moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi : |
Février 2008 (en milliers) |
Août 2008 (en milliers) |
Août 2009 (en milliers) |
Evolution août 2009/ août 2008 (en %) |
Evolution août 2009/ février 2008 (en %) |
- En catégories A, B et C (disponibles et donc tenus de chercher un emploi) |
476,4 |
488,9 |
633,7 |
29,6 |
33 |
- En catégorie A |
328,9 |
342,7 |
457,7 |
33,6 |
39,2 |
- Hommes en catégories A, B et C |
223,9 |
234,7 |
328,9 |
40,1 |
46,9 |
- Hommes en catégorie A |
160,1 |
171,7 |
246,1 |
43,3 |
53,7 |
- Femmes en catégorie A, B et C |
252,5 |
254,2 |
304,8 |
19,9 |
20,7 |
- Femmes en catégorie A |
168,8 |
171 |
211,6 |
23,7 |
25,4 |
Source : Pôle emploi, DARES.
Au-delà du seul aspect conjoncturel, les difficultés structurelles croissantes d’insertion des jeunes dans l’emploi, et plus encore dans l’emploi stable, sont flagrantes. Comme on le voit sur le tableau ci-dessous, il y a aujourd’hui environ 7,5 millions de jeunes de 16-25 ans en France, dont 4 millions ne sont plus en scolarité. Sur ces 4 millions, une grosse minorité seulement, soit 1,7 million, occupait en 2008 un emploi dit « durable » (contrat à durée indéterminée ou emploi temporaire de plus de six mois), plus de 1,2 million un emploi précaire et plus de 1 million étaient chômeurs ou inactifs.
Situation des 16-25 ans sur le marché du travail
(en moyenne annuelle 2008)
Effectifs (en milliers) |
En % du total | |
En emploi |
2 959 |
39,2 |
Dont CDI ou CDD de plus de 6 mois |
1 710 |
22,6 |
Au chômage |
609 |
8,1 |
Inactifs |
3 987 |
52,8 |
Dont en scolarité |
3 513 |
46,5 |
Total |
7 555 |
100 |
Source : ministère du travail, « Tableau de bord trimestriel – Activité des jeunes et politique de l’emploi – septembre 2009 ».
Une étude du CRÉDOC (6) fondée sur des données plus anciennes (datant de 2003) et au champ un peu différent, car elle portait sur les jeunes de 18 à 29 ans sortis du système scolaire et universitaire, dénombrait parmi eux en France :
– 2,4 millions de jeunes bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
– 2,5 millions de jeunes plus ou moins éloignés d’un emploi « de qualité » : en temps partiel, contrats à durée déterminée (CDD), intérim, contrat aidé ou au chômage (cette dernière catégorie regroupant 860 000 personnes) ;
– 430 000 jeunes complètement hors du marché du travail.
Ces données, peu différentes de celles issues de la statistique du ministère du travail présentée supra, confirment cette réalité : jusqu’à 30 ans, une grosse minorité (de l’ordre de 40 %) seulement des jeunes ayant achevé leurs études occupent des emplois à vocation durable ; un quart sont, en revanche, en recherche d’emploi ou inactifs ; les autres occupent des emplois plus ou moins précaires.
La précarité des statuts d’emploi des jeunes apparaît également dans la statistique reproduite ci-dessous : sans même compter les apprentis, 25 % des moins de 30 ans en emploi sont intérimaires ou en contrat à durée déterminée, contre moins de 8 % des 30-49 ans et moins de 5 % des plus de 50 ans.
Statut d’emploi des actifs occupés selon l’âge
(France métropolitaine, moyenne annuelle 2007)
(en %)
De 15 à 29 ans |
De 30 à 49 ans |
50 ans et plus |
Total | |
Intérimaires |
5,1 |
1,7 |
0,8 |
2,1 |
Apprentis |
6,9 |
- |
- |
1,4 |
Contrats à durée déterminée |
20 |
6,2 |
4 |
8,4 |
Contrats à durée indéterminée |
64,4 |
81,4 |
78,4 |
77,2 |
Source : INSEE.
Les enquêtes que mène le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) permettent, au-delà des simples « photographies » de l’insertion dans l’emploi des jeunes que l’on a présentées supra, une analyse de l’insertion progressive d’échantillons de jeunes représentant une « génération ». La dernière enquête, portant sur la génération de jeunes ayant quitté le système de formation initiale en 2004, montre que sur 737 000 jeunes ayant fait leurs premiers pas dans la vie active en 2004, 123 000, soit 17 %, ont quitté le système éducatif sans aucun diplôme, à 18 ans en moyenne.
Interrogés trois ans plus tard (en 2007), 58 % des jeunes sortis de l’école en 2004 font partie d’une « trajectoire » dite d’accès rapide et durable à l’emploi (cette « trajectoire » regroupe un ensemble de jeunes ayant passé en moyenne 34 mois en emploi et seulement un mois au chômage sur les trois années 2004-2007), mais 16 % ont débuté leur vie active par une période de chômage ou d’inactivité avant de se stabiliser en emploi et 11 % ont eu un parcours dominé par le chômage ou l’inactivité.
Le niveau de qualification en fin de parcours scolaire apparaît déterminant pour les chances d’insertion durable dans l’emploi et l’origine ethnique est également importante, alors que l’origine sociale l’est moins : si elle concerne 58 % de l’ensemble des jeunes, la trajectoire dite d’accès durable et rapide à l’emploi ne concerne que 34 % de ceux sortis du système sans diplôme (cf. tableau ci-dessous) et que 49 % de ceux issus de l’immigration ; en revanche, les chances d’insertion durable des jeunes issus d’une famille de cadres sont à peine plus élevées que celles de ceux issus d’une famille d’ouvriers (62 % contre 58 %), bien que l’accès des premiers aux études reste beaucoup plus élevé (on compte neuf enfants de cadres pour un enfant d’ouvriers parmi les titulaires d’un doctorat ; à l’inverse, parmi les jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme, on compte sept enfants d’ouvriers pour un enfant de cadres).
Le niveau de qualification en fin de parcours scolaire est aussi très important pour les chances d’être en emploi stable trois ans après la sortie de l’école : 77 % de la génération a alors un emploi, contre 58 % de ceux qui n’ont pas de diplôme ; pour 63 % de l’ensemble, c’est un emploi à durée indéterminée, mais ce n’est le cas que pour 44 % des sans diplôme ; le taux de chômage de l’ensemble de ces jeunes est alors de 14 %, mais il est de 32 % pour les sans diplôme.
Insertion dans l’emploi des jeunes sortis de l’école en 2004 trois après la fin de leur scolarité
Qualification en fin de scolarité |
Trajectoire d’accès à l’emploi |
Situation trois ans après la fin de la scolarité | ||||
Effectifs |
En % |
Accès rapide et durable (en %) |
En emploi (en %) |
En emploi à durée indéterminée (en %) |
Taux de chômage (chômeurs/ « actifs », en %) | |
Non diplômés |
123 000 |
17 |
34 |
58 |
44 |
32 |
CAP/BEP |
127 000 |
17 |
55 |
76 |
58 |
17 |
Bac |
177 000 |
24 |
57 |
74 |
59 |
13 |
Bac + 2 |
137 000 |
19 |
73 |
88 |
70 |
7 |
Licence |
51 000 |
7 |
68 |
84 |
71 |
7 |
Bac + 4 |
38 000 |
5 |
59 |
83 |
68 |
10 |
Master |
70 000 |
9 |
68 |
91 |
80 |
5 |
Doctorat |
14 000 |
2 |
77 |
91 |
59 |
7 |
Ensemble |
737 000 |
100 |
58 |
77 |
63 |
14 |
Source : Céreq, « Quand l’école est finie… », enquête génération 2004, interrogation à trois ans (2007).
Le Céreq a également analysé la situation des jeunes sortis de scolarité en 1998 sept ans après (en 2005) (7) : 95 % sont alors actifs et 86 % ont un emploi, le taux de chômage étant de 10 %. Cependant, environ 10 % de cette « génération 1998 », soit 70 000 jeunes, n’ont que peu, voire pas, travaillé durant la sixième et la septième années qui ont suivi leur sortie du système éducatif et n’ont toujours pas d’emploi stable au terme de cette période ; 9 000 n’ont même jamais occupé d’emploi depuis qu’ils ont terminé leurs études.
Si le taux de chômage des jeunes reste de 14 % trois ans après la fin de leur scolarité et de 10 % sept ans après, cela signifie que même à cette échéance leur insertion dans l’emploi n’a toujours pas rejoint la moyenne, puisque le taux de chômage pour l’ensemble de la population était avant la crise inférieur à 8 %. Les jeunes mettent maintenant pratiquement dix ans pour avoir une insertion professionnelle « normale » !
Par ailleurs, les statistiques comparatives, dont nous disposons quant à l’emploi des jeunes chez nos partenaires européens, sont peu flatteuses : selon les derniers chiffres disponibles, on a ainsi un taux d’emploi de 35,3 % pour les 15-24 ans dans l’ensemble de l’Union européenne contre 30,8 % en France au premier trimestre 2009, un taux de chômage de 15,6 % pour les mêmes contre 19 % en France en 2008, une part de l’ensemble de ces jeunes qui est au chômage de 6,8 % contre 7,1 % en France. Seuls cinq de nos vingt-six partenaires ont des performances plus mauvaises que les nôtres pour ce qui est du taux de chômage des jeunes et quatre des performances plus mauvaises pour ce qui est de la part de l’ensemble de ces jeunes qui est au chômage.
Ces constats comparatifs sont importants, car les résultats atteints par nos voisins démontrent l’existence de marges d’amélioration pour notre pays.
Les jeunes sont également lourdement frappés par la pauvreté. Un million de 18-24 ans, soit plus de 20 % d’entre eux, sont considérés comme pauvres (c’est-à-dire ont un revenu inférieur, par unité de consommation, à 60 % du revenu médian). Ainsi qu’on peut l’observer sur le tableau et le graphique ci-après, c’est chez ces jeunes majeurs et ensuite chez les mineurs que le taux de pauvreté est, de loin, le plus élevé. Cette situation de « pic de pauvreté » chez les jeunes est relativement neuve ; comme l’a relevé un interlocuteur de votre rapporteur, il est frappant de constater que depuis quarante ans, le taux de pauvreté des personnes âgées a été divisé par deux, mais que celui des jeunes a doublé.
Taux de pauvreté monétaire des personnes selon leur âge en 2006
(revenu inférieur à un pourcentage du revenu médian, par unité de consommation)
(en %)
Femmes |
Hommes | |||
Sous 60 % du revenu médian |
Sous 50 % du revenu médian |
Sous 60 % du revenu médian |
Sous 60 % du revenu médian | |
Moins de 18 ans |
17,6 |
9,8 |
17,8 |
9,7 |
18 à 24 ans |
23,2 |
13,4 |
18,9 |
12 |
25 à 34 ans |
12 |
6,5 |
9,5 |
5,3 |
35 à 44 ans |
13,2 |
7,1 |
11,2 |
6 |
45 à 54 ans |
12,1 |
7,1 |
10,6 |
6,2 |
55 à 64 ans |
9,9 |
5,4 |
10 |
5,7 |
65 à 74 ans |
8,5 |
2,7 |
7,7 |
2,7 |
75 ans et plus |
13,6 |
5,5 |
9,3 |
2,5 |
Ensemble |
13,9 |
7,4 |
12,5 |
6,8 |
|
Présentation graphique (pour le seuil de 60 %) | ||||
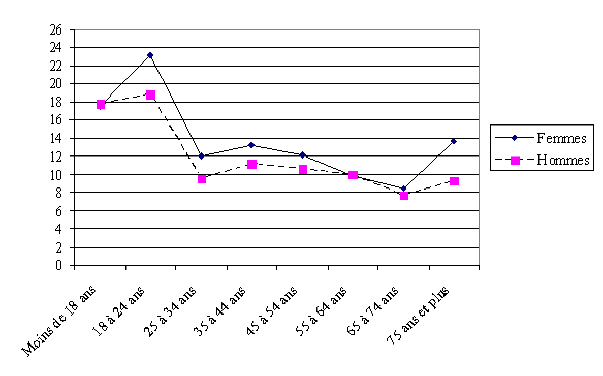
Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.
Source : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête « revenus fiscaux et sociaux » 2006.
Dans le contexte dramatique qui a été décrit supra, le Gouvernement multiplie les annonces. Mais les jeunes les plus précarisés et les travailleurs sociaux qui les accompagnent ont besoin de stabilité. La révolution d’une politique de la jeunesse consisterait aussi à mettre fin au va-et-vient des dispositifs et à construire une politique publique pérenne, imperméable aux changements ministériels, plutôt que de désactiver puis réactiver des dispositifs parcellaires comme le CIVIS.
a) Le plan pour l’emploi des jeunes du 24 avril 2009 : des mesures conjoncturelles fondées sur des leviers classiques
Le plan pour la formation, l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes de moins de 26 ans développé le 24 avril dernier à Jouy-le-Moutier par le Président de la République a été présenté comme une réponse conjoncturelle à la crise. Le tableau ci-dessous récapitule les mesures de ce plan, avec le nombre de bénéficiaires attendu et les coûts annoncés au printemps par le Gouvernement, ainsi que les coûts légèrement révisés inscrits dans le présent projet de loi de finances.
Le plan d’avril 2009 pour l’emploi des jeunes
(coûts en millions d’euros)
Mesures |
Nombre de bénéficiaires (2009 et 2010) |
Coût en 2009 : annonce initiale |
Coût en 2010 : annonce initiale |
Coût pour 2010 selon le PLF |
Prime exceptionnelle de 1 000 ou 2 000 euros (selon niveau de qualification) aux recrutements en contrat de professionnalisation |
170 000 |
113,3 |
113,3 |
144,5 |
Exonération intégrale de charges sur les contrats d’apprentissage |
120 000 |
50,4 |
50,4 |
55,3 |
Prime de 1 800 euros au recrutement d’apprentis supplémentaires dans les entreprises de moins de 50 salariés |
40 000 |
36 |
36 |
36 |
Contrats accompagnement formation (mesures de formation orientées vers des métiers porteurs) |
50 000 |
80 |
250 |
181,5 |
Ouverture de 7 200 places supplémentaires dans les Écoles de la deuxième chance |
7 200 |
9 |
17 |
17 |
Contrats initiative-emploi (secteur marchand) supplémentaires, orientés vers les métiers du développement durable et de l’économie sociale |
50 000 |
75 |
75 |
102,1 |
Contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE, secteur non marchand) supplémentaires dits « contrats passerelle » |
30 000 |
70 |
160 |
167,4 |
Prime de 3 000 euros à l’embauche de stagiaires en CDI |
50 000 |
150 |
- |
30 |
Total |
517 200 |
583,7 |
701,7 |
733,8 |
Source : site internet du Gouvernement et documents budgétaires.
Ce plan d’urgence repose sur des leviers classiques (contrats en alternance, contrats aidés) qui étaient pourtant largement décriés par le Gouvernement il y a quelques mois encore. Il s’agit d’aider, pour un coût évalué à 1,3 milliard d’euros (imputé sur la mission budgétaire « Plan de relance de l’économie »), 500 000 jeunes à s’insérer dans la vie active d’ici à juin 2010. En matière d’alternance, le Gouvernement s’est donné pour objectif la conclusion, de mi-2009 à mi-2010, de 320 000 contrats d’apprentissage (soit 35 000 de plus qu’en 2008) et de 170 000 contrats de professionnalisation (soit 30 000 de plus qu’en 2008).
b) La commission de concertation sur la politique de la jeunesse : une méthode qu’il convient de saluer
Les personnes rencontrées par votre rapporteur lors de ses auditions ont salué la méthode de travail de la commission de concertation sur la politique de la jeunesse, qui a permis de confronter des expériences très diverses (partenaires sociaux, organisations étudiantes, réseaux associatifs, monde économique, parlementaires, collectivités territoriales, universitaires, etc.) au cours de travaux intenses (170 heures de réunion) qui ont débouché sur la publication d’un « Livre vert » début juillet 2009. Cette démarche a permis une véritable reconnaissance des problèmes des jeunes et a aussi mis en lumière la diversité de ces problèmes, la diversité des jeunesses. Le plan qui en est issu semble cependant bien en retrait face aux attentes formulées, au risque de décevoir les espoirs suscités par la commission de concertation.
Le plan « Agir pour la jeunesse » présenté à Avignon le 29 septembre a pour objet, selon les termes du Président de la République, d’établir une « politique structurelle de la jeunesse » dans la suite des travaux de la commission de concertation. Le plan traite de l’orientation, de la lutte contre le « décochage » scolaire, de la formation en alternance, de l’autonomie financière des jeunes et de leur engagement citoyen :
– En matière d’orientation, il s’agit d’aller vers un dispositif plus progressif, comportant un droit à la réorientation en cours d’année, et qui prenne en compte l’ensemble des compétences, y compris non scolaires, avec l’expérimentation d’un « livret de compétences », le tout s’inscrivant dans la volonté de créer un véritable « service public de l’orientation ». Des plateformes régionales d’orientation doivent être généralisées.
– Le Président de la République a insisté sur la situation de ceux que l’on nomme désormais les « décrocheurs », qu’il assimile aux jeunes quittant le système scolaire à 16 ans. Tous les jeunes de 16 ans qui quitteront l’école devront être « suivis, répertoriés » systématiquement et se voir proposer « une formation ou un emploi », aucun ne devant rester abandonné à lui-même. Etre en formation ou en emploi doit même devenir une « obligation ». Ces mesures passeront notamment par un renforcement des moyens des missions locales et du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS).
– Pour ce qui concerne les formations en alternance, le statut des apprentis doit être rapproché de celui des étudiants, les pré-recrutements (où une entreprise finance la formation d’un futur salarié en échange d’un engagement contractuel) inscrits dans un cadre de droit et les stages hors-cursus interdits.
– Le RSA va être étendu à certains jeunes qui travaillent ou ont travaillé, tandis qu’un dixième mois de bourse pourra être accordé aux étudiants et que des expérimentations portant sur d’autres formes d’autonomie financière – par le transfert aux jeunes d’aides financières attribuées à leurs parents notamment – auront lieu.
– Enfin, le volet du plan consacré à l’engagement des jeunes affiche en particulier l’ambition d’un service civique qui concernerait 10 000 jeunes dès 2010 et 70 000 par an (10 % d’une classe d’âge) à terme.
Les intentions de ce plan sont louables. Reste maintenant à voir la réalité des moyens qui leur seront donnés et sa déclinaison concrète.
Le souvenir de quelques plans récents visant eux aussi à améliorer la situation des jeunes, en particulier en matière d’emploi, incite à la prudence.
a) Des expériences passées qui mettent en lumière l’écart qu’il peut y avoir entre annonces et réalisations
Il y a parfois loin, en effet, des ambitions affichées aux résultats effectifs, ainsi qu’il apparaît si l’on regarde quelques grands « plans » récents, mais sur lesquels on a maintenant quelques années de recul.
Le plan de cohésion sociale, lancé en 2004 par M. Jean-Louis Borloo, alors ministre chargé des affaires sociales, couvrait la période 2005-2009. Il est légitime, alors que l’on arrive au terme de cette période, de s’interroger sur les résultats obtenus. Pour ce qui concerne l’insertion des jeunes, l’ambition était d’« accompagner 800 000 jeunes en difficulté vers l’emploi durable » par trois voies d’accès : l’alternance dans le cadre d’un programme « 500 000 apprentis, étudiants des métiers » visant cet objectif chiffré ; l’emploi marchand avec les contrats aidés et l’alternance dans le secteur public ; laquelle devait permettre de recruter 100 000 jeunes sur la durée du plan.
Quel bilan cinq ans plus tard ? Pour l’apprentissage en général, l’objectif était d’atteindre 500 000 apprentis, en partant d’un niveau de 362 000 jeunes en apprentissage au 31 décembre 2004. Or, sans même évoquer le dernier chiffre connu, celui d’août 2009, où l’on décomptait 378 000 apprentis, on peut se référer (pour se placer au même moment du cycle annuel) à décembre 2008, où l’on avait 419 000 apprentis : là où, depuis 2004, il aurait fallu augmenter les effectifs de près de 140 000, on a réalisé moins de la moitié de ce chemin avec une augmentation de 57 000.
La même déception est présente pour les contrats de professionnalisation : le remplacement, en 2004, des contrats de qualification, d’orientation et d’adaptation par cette nouvelle formule reposait sur l’idée de faire des contrats plus courts (un an dans le droit commun contre deux antérieurement) avec un moindre contenu en formation afin de pouvoir, avec les mêmes moyens, intégrer beaucoup plus de jeunes. Or, là aussi, le résultat n’est pas au rendez-vous : seulement 195 000 contrats de professionnalisation en cours fin 2008 quand on avait 224 000 contrats de qualification, d’orientation et d’adaptation fin 2001.
Quant à l’alternance dans la fonction publique, le résultat est encore plus décevant. On est bien loin des 100 000 recrutements que l’on attendait notamment de la mise en œuvre d’un dispositif ad hoc, dit « PACTE » : de 2005 à 2008, selon les chiffres collectés par M. Laurent Hénart dans son récent rapport sur l’alternance dans le secteur public (8), on n’a compté qu’un peu plus de 22 000 entrées en apprentissage dans la fonction publique, le dispositif PACTE lui-même n’ayant représenté que 1 700 entrées de 2006 à 2008.
Il en est de même du plan de M. Dominique de Villepin en 2005, dont deux des mesures-phares (le « contrat nouvelles embauches » et la non-prise en compte des jeunes dans les seuils d’effectif applicables aux entreprises) ont dû être abandonnées en cours de route car contraires aux engagements internationaux de la France. Par ailleurs, le dispositif « Défense deuxième chance » mis en œuvre par l’Établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) devait selon la déclaration de politique générale de M. de Villepin former 20 000 jeunes dès 2007. Or, un an pourtant après cette échéance, en 2008, à peine plus de 3 000 jeunes ont été accueillis par les établissements de l’EPIDE…
Nous disposons de quelques mois de recul pour apprécier le premier impact des mesures mises en œuvre au printemps 2009, censées avoir un effet rapide, car délibérément fondées sur l’activation de dispositifs classiques. Cet impact n’est pas concluant. Dans les derniers chiffres consolidés mis en ligne par le ministère des affaires sociales s’agissant de l’accessibilité des mesures destinées aux jeunes, arrêtés à août 2009, on relève une dramatique dégradation depuis un an. Globalement, on a, en août 2009, 15,5 % de jeunes en moins qui bénéficient d’une de ces mesures qu’un an plus tôt, le frémissement constaté sur les contrats dans le secteur non-marchand étant loin de compenser l’effondrement des contrats dans le secteur marchand ; de même, si l’on raisonne en flux, les entrées dans ces mesures ont baissé de presque 13 % des huit premiers mois de 2008 à la même période de 2009. Pour l’heure, les mesures de la politique de l’emploi ne semblent donc pas en mesure de contrebalancer la montée du chômage des jeunes, puisque ces mesures sont elles-mêmes en recul.
Les jeunes de moins de 26 ans dans les dispositifs de la politique de l'emploi en 2008-2009
(France métropolitaine)
Effectif (stock) décembre 2007 |
Effectif (stock) août 2008 |
Effectif (stock) août 2009 |
Évolution des effectifs (stock) août 2009/2008 (en %) |
Entrées cumulées janvier-août 2008 |
Entrées cumulées janvier-août 2009 |
Évolution des flux d'entrées janvier-août 2009/2008 | |
Emploi marchand : |
746 047 |
679 943 |
565 349 |
- 16,9 |
182 032 |
146 181 |
- 19,7 |
Apprentissage |
417 611 |
387 961 |
377 868 |
- 2,6 |
107 162 |
87 822 |
-18 |
Contrats de professionnalisation |
191 542 |
177 630 |
152 186 |
- 14,3 |
67 616 |
44 704 |
- 33,9 |
Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise |
134 981 |
109 018 |
21 835 |
- 80 |
- |
- |
- |
Contrats initiative-emploi |
1 644 |
5 065 |
13 260 |
161,8 |
6 994 |
13 522 |
93,3 |
Contrats insertion – revenu minimum d’activité |
269 |
269 |
200 |
- 25,7 |
260 |
133 |
- 48,8 |
Emploi non marchand : |
51 479 |
32 889 |
37 198 |
13,1 |
21 089 |
30 783 |
46 |
Contrats emploi-consolidé |
74 |
21 |
- |
n.s. |
- |
- |
- |
Contrats d'accompagnement dans l’emploi (CAE) |
46 374 |
29 087 |
34 038 |
17 |
17 530 |
27 999 |
59,7 |
Contrats d'avenir |
3 716 |
3 097 |
2 920 |
- 5,7 |
2 631 |
2 357 |
- 10,4 |
Emplois-jeunes |
1 315 |
684 |
240 |
- 64,9 |
675 |
309 |
- 54,2 |
PACTE |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
253 |
118 |
- 53,4 |
TOTAL |
797 526 |
712 832 |
602 547 |
- 15,5 |
203 121 |
176 964 |
- 12,9 |
Source : DARES, tableau de bord trimestriel « Activité des jeunes et politiques d’emploi », livraison de septembre 2009.
Si l’on regarde l’évolution des mesures « jeunes » de la politique de l’emploi à plus long terme, on constate que de 2000 à 2008, l’effectif de jeunes bénéficiant de ces mesures est tombé de 820 000 à 712 000 ; cela représentait 30 % des jeunes en emploi en 2000, 27 % en 2007 et moins de 25 % en 2008. La baisse de ce taux entre fin 2007 et fin 2008 montre qu’en 2008 le recul des mesures de la politique de l’emploi des jeunes a même été plus rapide que celui de l’emploi des jeunes dans sa globalité : loin de combattre la crise, il a contribué à l’aggraver.
Les jeunes de moins de 26 ans dans les dispositifs de la politique de l'emploi à moyen terme
(France métropolitaine, effectifs en fin d’année)
(en milliers)
1982 |
1990 |
2000 |
2007 |
2008 | |
Alternance : |
230 |
442 |
579 |
592 |
615 |
Apprentissage |
230 |
225 |
359 |
419 |
419 |
Contrats de qualification, d’orientation et d’adaptation |
- |
216 |
220 |
- |
- |
Contrats de professionnalisation |
- |
- |
- |
173 |
195 |
Emploi marchand hors alternance : |
72 |
74 |
77 |
142 |
67 |
Contrats initiative-emploi (CIE) |
- |
- |
36 |
6 |
8 |
Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) |
- |
- |
- |
135 |
59 |
Autres mesures |
72 |
74 |
41 |
- |
- |
Emploi non marchand : |
7 |
120 |
163 |
51 |
30 |
Contrats emploi-solidarité (CES) |
7 |
120 |
36 |
- |
- |
Emplois jeunes |
- |
- |
118 |
1 |
- |
Contrats emploi-consolidé |
- |
- |
10 |
- |
- |
Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) |
- |
- |
- |
46 |
27 |
Contrat d’avenir |
- |
- |
- |
4 |
3 |
Total |
310 |
636 |
820 |
785 |
712 |
Part des emplois aidés parmi les emplois occupés par des jeunes (en %) |
7,8 |
20,3 |
30 |
27 |
24,7 |
Sources : DARES, Insee.
Le plan « Agir pour la jeunesse » propose de nombreuses mesures qui recueillent une large approbation des parties prenantes : la réforme de l’orientation, la volonté de mieux prendre en compte toutes les compétences avec le livret de compétences, le renforcement de l’alternance, le développement du service civique et le principe de l’élargissement du RSA aux jeunes constituent des mesures consensuelles. Encore faut-il s’interroger sur la mise en œuvre et les conditions d’application de ces réformes. En pratique, on peut craindre que ce plan, du fait d’une application restrictive d’une partie de ses mesures, du fait aussi de la faiblesse ou de l’absence de volets « emploi » et « logement », n’ait lui encore, comme la plupart de ceux qui l’ont précédé, qu’un impact limité.
L’ouverture du RSA à certains jeunes, annonce-phare du discours d’Avignon, apparaît comme une mesure contrainte et restreinte, voire difficile à appliquer.
Cette ouverture est largement une mesure contrainte car dès lors que le RSA, comme la prime pour l’emploi, est pour partie un dispositif de complément des revenus du travail, il ne pouvait être justifié d’en écarter des travailleurs sur un critère d’âge. Le même raisonnement vaut d’ailleurs, plus généralement, pour tout dispositif social. Au demeurant, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a établi, dans sa délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008, le caractère discriminatoire de l’exclusion des jeunes du RSA, qui est contraire aux engagements internationaux de la France tels que la Charte sociale européenne les a fixés. Par ailleurs, pratiquement tous nos voisins européens attribuent leurs minima sociaux dès l’âge de 18 ans, voire 16 ans parfois (9).
Le « RSA jeunes » tel qu’il a été présenté est également un dispositif restreint et qui sera difficile à appliquer. Selon le Gouvernement, il ne concernerait que 160 000 jeunes, soit moins de 3 % des 6 millions de 18-25 ans, du fait de l’exigence d’avoir à justifier, si l’on en croit les annonces, 3 600 heures de travail durant les trois dernières années, ce qui représente près de deux ans et trois mois (10) de travail à temps plein sur cette période (ou un trois quarts temps durant les trois ans).
Outre que cette règle écartera – mais c’est son but – la majorité des bénéficiaires potentiels, elle sera extrêmement lourde à gérer pour les jeunes, qui devront prouver les heures déclarées, correspondant parfois à une multitude de petits contrats allant d’emplois agricoles saisonniers aux animations de colonies de vacances. Pour leur part, les organismes payeurs chargés de contrôler ces déclarations risquent de ne pas pouvoir instruire les dossiers dans des délais raisonnables.
Par ailleurs, cette règle restrictive, même si elle est manifestement conçue pour écarter massivement du RSA les étudiants qui travaillent (on rappelle que les trois quarts des jeunes travaillent durant leurs études selon le Céreq), ne réglera pas totalement la question de la compatibilité – ou non – du RSA avec le statut d’étudiant, sachant que certains étudiants, par exemple en médecine, pourront sans doute justifier des 3 600 heures : dans la législation actuelle, indépendamment de la règle d’âge des 25 ans, il existe une exclusion des étudiants du RSA (sauf charge d’enfant ou dérogations individuelles) ; on ne sait pas si cette règle spécifique sera remise en cause. De même, se posera la question de la prise en compte ou non, dans les heures travaillées, de celles effectuées dans le cadre d’une formation en alternance.
Enfin, le « RSA jeunes » est un dispositif qui n’est pas, pour le moment, financé (voir supra les développements du présent avis sur le financement du RSA).
Il est à noter que les autres mesures d’autonomie financière annoncées présentent également des limitations qui en restreindront la portée : l’attribution d’un dixième mois de bourse sera conditionnée à l’allongement effectif de l’année universitaire ; l’expérimentation d’une sorte d’allocation d’autonomie serait apparemment fondée sur le recyclage de prestations familiales qui ne seraient plus versées aux parents.
La plupart des autres dispositions du plan « Agir pour la jeunesse » correspondent à des mesures-cadres dont l’application pratique dépendra des moyens qui seront mis en œuvre. C’est le cas notamment de celles concernant l’orientation et le décrochage scolaire : des cadres légaux sont posés dans le projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie pour la création d’un service public de l’orientation et la systématisation du repérage des décrocheurs, mais dans la mesure où il existe déjà aussi bien des organismes d’orientation que des systèmes de prise en charge des « décrocheurs », ce sont les conditions de mise en œuvre de ces mesures législatives générales qui détermineront si elles auront un réel impact concret ou ne donneront qu’un nouvel « habillage » à l’existant. Pour ce qui est de l’orientation, il est clair que l’échec sera au rendez-vous si les régions, responsables de la formation professionnelle, sont systématiquement écartées du pilotage du système au bénéfice de l’État.
Certaines mesures du plan ont une portée encore plus incertaine car elles exigent une traduction juridique, vraisemblablement législative, qui n’apparaît pas évidente. Il en est ainsi de l’idée d’une obligation de formation (sauf accès à l’emploi) jusqu’à 18 ans : est-ce une obligation pour les jeunes, mais alors avec quelle sanction ? Et/ou pour les collectivités publiques, mais lesquelles – l’État dans la continuité de la scolarité obligatoire, les régions en tant que responsables de la formation professionnelle ? Il en est de même pour l’idée d’autoriser les pré-recrutements, qui touche en fait au droit du contrat de travail.
C. AGIR POUR LES JEUNES EN SITUATION D’EXCLUSION : DES LIGNES DE CONDUITE À SUIVRE ET DES ÉCUEILS À ÉVITER
Parler des « jeunes » n’est pas signifiant en soi, les jeunes ne constituant pas un groupe homogène dont chaque élément répondrait à des critères communs dépassant celui de l’âge. Or dans cette pluralité, il ressort que les étudiants, les apprentis, les jeunes travailleurs, les jeunes chômeurs et les décrocheurs ne bénéficient pas de la même visibilité. C’est justement la frange « invisible » de cette jeunesse, celle qui ne revendique rien, celle qui est surreprésentée dans les chiffres de la pauvreté et sous-représenté dans les enquêtes qui lui sont consacrées, qui doit être prioritairement aidée. Ces jeunes en très grande exclusion ne sont non seulement pas en situation de pouvoir se fédérer et se faire entendre, mais ils ne s’en sentent même pas la légitimité. La commission de concertation sur la politique de la jeunesse n’a pas su prendre en compte ceux qui ne réclament rien. C’est pourtant sur eux qu’il faut concentrer les moyens.
La première difficulté à laquelle sont confrontées les politiques publiques tient à l’identification collective – la définition – puis individuelle – le repérage – des jeunes en situation d’exclusion.
Tout le monde s’accorde à dire que l’exclusion est multifactorielle et que l’on ne peut donc la qualifier à partir d’un seul indicateur. La plupart des acteurs de terrain insistent toutefois sur la rencontre, à l’origine des situations d’exclusion, de situations de précarité matérielle et de précarité « relationnelle » liée à la fragilité de plus en plus grande des liens familiaux. Cette fragilité signifie, pour les enfants et les jeunes, des ruptures affectives de plus en plus fréquentes, pour eux comme pour leurs parents un isolement croissant, notamment dans le cas de familles monoparentales. Désormais, pauvreté signifie très souvent isolement et c’est la conjonction de ces deux facteurs qui crée l’exclusion.
● Comme on l’a vu supra, la pauvreté matérielle frappe désormais tout particulièrement les enfants et les jeunes. Près de 2,4 millions de mineurs, soit près de 18 % d’entre eux, vivent dans des foyers où le revenu par unité de consommation est inférieur à 60 % du revenu médian (soit en 2007, à titre d’exemple, un revenu mensuel inférieur à 1 181 euros pour une famille monoparentale avec un jeune enfant et à 1 907 euros pour un couple avec deux jeunes enfants) ; 1 million de 18-24 ans, soit plus de 20 % de cette classe d’âge, sont dans la même situation.
Corrélativement, les jeunes semblent surreprésentés parmi ces plus marginalisés que sont les sans-domicile : une étude de l’INSEE relevait ainsi, en 2002, plus d’un tiers de 18-29 ans parmi les usagers des services d’hébergement et de distribution de repas (11).
● Pour ce qui est de la précarité relationnelle, on observe qu’un enfant ou jeune sur quatre, soit 4 millions au total, ne vit pas avec ses deux parents.
Le fait d’être l’objet de mesures judiciaires ou administratives de protection qualifie plus précisément les mineurs dont la situation familiale est très défectueuse. Les témoignages convergent pour indiquer que les jeunes les plus marginalisés que l’on rencontre notamment dans la rue ont très souvent été l’objet de ces mesures. On sait que, dans ce domaine, coexistent deux dispositifs qui se recoupent : dans les mains de l’État, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), dans celles des départements, l’aide sociale à l’enfance (ASE).
D’après les statistiques du ministère de la justice, en 2008 :
– 218 000 mineurs ont été mis en cause par les services de police et de gendarmerie pour des infractions, dont 161 000 ont fait l’objet de poursuites pénales ou de mesures alternatives et 92 000 ont été pris en charge par la PJJ et les associations qu’elle finance ;
– 291 000 mineurs ou jeunes majeurs sont pris en charge en application de décisions de protection prises par la PJJ, 212 500 étant alors confiés à l’ASE et 170 500 restant dans le dispositif de la PJJ (dont les 92 000 délinquants mentionnés supra).
Par ailleurs, au 31 décembre 2008, on dénombrait en France métropolitaine 284 000 mesures d’ASE (moitié de placements et moitié de « mesures éducatives »), dont on l’a vu plus de 200 000 suite à une décision judiciaire. Le nombre total d’enfants et de jeunes qui sont l’objet d’une mesure de PJJ ou d’ASE pourrait donc être de l’ordre de 450 000 (284 000 mesures ASE + 170 000 mesures PJJ gérées hors ASE), soit environ 3 % des enfants et jeunes (12).
Ces jeunes sont pour le moment identifiés et pris en charge par un système administratif complexe dans des conditions qui ne sont pas pleinement satisfaisantes. Les situations qui justifient les mesures sont insuffisamment qualifiées. Le rapport thématique que la Cour des comptes vient de rendre public sur la protection de l’enfance insiste ainsi sur la nécessité de préciser et de normaliser la notion d’« information préoccupante », qui est la porte d’entrée dans ces mesures, de mieux organiser le jeu des acteurs et d’affirmer le rôle pivot de l’un, le département.
● L’échec scolaire, qui est lourdement corrélé à la pauvreté et aux difficultés familiales, constitue un autre facteur d’exclusion ultérieure, même s’il convient de rappeler que ce n’est pas un facteur rédhibitoire de non-insertion ultérieure dans l’emploi (et donc de pauvreté durable) : comme il a été dit supra, selon les études du Céreq sur l’insertion de « générations », un tiers des jeunes sortis de formation initiale sans diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (sans CAP, BEP, bac ou plus) parvient quand même à s’insérer rapidement et durablement dans l’emploi, ce qui n’est pas négligeable, même si c’est nettement moins que la moyenne des jeunes (où ce taux est de l’ordre de 60 %).
La sortie du système scolaire sans diplôme concerne environ 120 000 jeunes par an, soit 17 % d’une génération. Avant que soit retenu ce critère du diplôme, l’Éducation nationale se référait à une autre définition du « non-qualifié » : le jeune qui n’est pas entré au lycée général et technologique ou qui n’a pas eu accès à une classe terminale de préparation à un BEP ou à un CAP ; en 2005, 6 % des sortants de la scolarité étaient dans cette situation (13), ainsi que le rappelle un rapport de mai 2008 du CERC (14).
L’illettrisme constitue enfin un indicateur d’échec radical du système scolaire. Selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, 9 % des adultes vivant en France et qui y ont été scolarisés sont illettrés ; ce taux augmente avec l’âge, mais atteint déjà 4,5 % pour les 18-25 ans.
● Les jeunes en exclusion combinent généralement pauvreté, situation familiale difficile et échec scolaire, mais restent mal connus.
Pour mieux procéder à l’identification individuelle ou au repérage de ces jeunes exclus ou en passe de l’être, il serait nécessaire d’en approfondir la perception générale et de les qualifier plus précisément.
La question du « repérage » est mise sur le devant de la scène, depuis quelques mois, au nom de la lutte contre le « décrochage » scolaire, autre thème à la mode. Comme on l’a dit, un dispositif légal de repérage systématique des « décrocheurs » a été inscrit dans le projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Le fait est pourtant qu’il existe déjà dans l’Éducation nationale un dispositif de suivi et de relance des élèves dont on ne connaît pas la nouvelle affectation à la rentrée scolaire ; ce dispositif ne fonctionne sans doute pas parfaitement, mais il est peu probable qu’une disposition législative vienne améliorer la situation à cet égard. Sur le principe, le repérage est évidemment souhaitable – sous réserve de ne pas tourner à la « surveillance policière » –, mais n’est pas aisé à mettre en œuvre : le décrochage scolaire est un phénomène progressif, qui ne se manifeste même pas forcément, dans un premier temps, par de l’absentéisme ; il faut agir tôt, au collège, avoir les moyens pour cela, être en mesure d’établir une connexion avec les parents…
L’identification des jeunes exclus est également rendue plus difficile par la nécessité d’aller vers eux, de chercher à les contacter sans attendre qu’ils se présentent spontanément aux services sociaux qui peuvent les aider.
En effet, ces jeunes sont souvent très isolés et dépourvus de « réseau ». Un responsable associatif rencontré a observé que nombre d’entre eux ne peuvent citer plus de cinq personnes qu’ils fréquentent régulièrement. Peu à l’aise dans les contacts avec les institutions, anxieux, humiliés, ils n’osent pas, le plus souvent, engager les démarches qui leur ouvriraient des droits ou l’accès aux dispositifs existants, pour autant qu’ils en connaissent. A fortiori, aller au bout de démarches administratives qui impliquent de se rendre à des rendez-vous, de remplir des dossiers, de fournir des pièces peut être très difficile. Des interlocuteurs de votre rapporteur ont signalé que les jeunes les plus marginalisés pouvaient être issus de familles où, n’ayant pas d’emploi depuis au moins deux générations, aucun des membres ne leur avait jamais donné l’exemple d’une vie rythmée par le travail. Ayant perdu jusqu’à la notion du temps, ces jeunes se retrouvent dans l’incapacité de respecter des horaires ou d’honorer un rendez-vous. Même s’il s’agit là de situations extrêmes, il est incontestable que pour toucher les plus désocialisés, il faut aller vers eux (comme le font d’ailleurs depuis longtemps, de manière de plus en plus professionnelle, les structures d’aide aux sans-domicile).
Le monde associatif, mais aussi privé au sens large, a largement investi ce champ de l’« aller vers », non seulement vis-à-vis des plus marginalisés, mais aussi plus généralement des jeunes des quartiers défavorisés : on pense là aux initiatives de « coaching », de tutorat lancées notamment par de grandes écoles ou leurs associations d’élèves, voire des grandes entreprises.
Les acteurs institutionnels classiques, comme les missions locales, ne devraient pas rester à l’écart de ce type de démarches. Du moins, à défaut de s’y engager directement, les acteurs publics ont tout intérêt à soutenir fortement ceux qui pratiquent l’« aller vers », notamment en finançant la formation des animateurs associatifs de terrain et en organisant des formations communes entre les agents des services administratifs et sociaux et ces militants associatifs, pour leur permettre de mieux travailler ensemble et de dépasser les peurs et les réticences mutuelles.
L’insistance, dans tous les témoignages entendus par votre rapporteur, sur la solitude des jeunes exclus et des familles les plus précaires, généralement monoparentales, conduit aussi à mettre l’accent sur les conséquences du délitement du lien social. La précarité relationnelle est aussi grave que la précarité économique. Une personne auditionnée a observé que les trois quarts des enfants pris en charge car « en danger » ne souffrent pas de précarité matérielle ; les familles pauvres, le plus souvent, s’efforcent de faire en sorte que leurs enfants accèdent à un certain nombre de biens, y compris informatiques ; le problème est ailleurs. D’autres pays européens où il y a aussi des personnes pauvres et où la crise économique peut être plus sévère qu’en France – l’Irlande ou l’Espagne ont été cités – semblent moins exposés au développement de l’exclusion, du fait du maintien de liens sociaux plus forts.
S’il n’est pas possible de recréer à court terme des solidarités traditionnelles qui n’existent plus, les initiatives visant à préserver celles qui existent ou à en créer de nouvelles, comme les colocations intergénérationnelles, méritent bien au contraire d’être soutenues.
Les jeunes les plus marginalisés ont une autre caractéristique souvent évoquée : préoccupés par leur survie quotidienne, ils vivent dans l’instant et n’ont pas de projet de vie. Les multiples ruptures et la précarité permanente qu’ils subissent entretiennent cet état de fait. Ces jeunes attendent d’abord un peu de sécurité, notamment matérielle, à moyen terme. Par ailleurs, un projet d’insertion réussie les concernant doit le plus souvent s’étaler sur une période de plusieurs années.
Dès lors, il est important que l’accompagnement qui leur est proposé s’inscrive dans la durée, en comportant des garanties de prise en charge à moyen terme pour les sécuriser. Une telle préoccupation était prise en compte dans le dispositif des emplois-jeunes mis en œuvre avant 2002, qui offrait un horizon de cinq ans et permettait une stabilité professionnelle aboutissant très souvent à une pérennisation des emplois. Mais depuis lors, une sorte d’obsession de ne pas créer de mesures qui s’assimileraient à de l’assistanat a conduit à limiter systématiquement la durée des mesures offertes, quitte à en autoriser le renouvellement. Il en est ainsi du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) géré par les missions locales, qui est conclu pour un an mais peut être renouvelé. Dans son rapport précité sur l’insertion des jeunes sans diplôme, le CERC invite à « s’interroger sur la durée du [CIVIS]. Un dispositif d’un an renouvelable n’a en effet pas le même sens qu’un dispositif qui, dès le départ, propose un horizon de plusieurs années ». On retrouve le même travers dans le dispositif des « contrats passerelle » institué au printemps 2009.
5. Ne pas faire de l’emploi – et de n’importe quel emploi – l’objet unique des politiques d’insertion
Une autre constante du discours politique dominant est la priorité absolue donnée à l’insertion dans l’emploi. Dans ce discours, trouver un emploi, quel qu’il soit, est apparemment la condition nécessaire et suffisante d’un processus d’insertion. L’accès à l’emploi peut sans doute être précédé d’une formation, mais alors elle doit être courte et ciblée sur une spécialité en manque de main-d’œuvre, pour accroître les chances d’accès à l’emploi du bénéficiaire tout en répondant aux demandes des entreprises. Ce principe d’« adéquationisme » anglo-saxon revient à programmer un futur employé en fonction de l’offre de marché disponible, en occultant toutes ses capacités de développement personnel.
Pourtant, le processus d’insertion, pour ceux qui sont le plus enfoncés dans l’exclusion, est souvent long avant qu’ils n’aient une réelle capacité à occuper un emploi. Envoyer, à tout prix, un jeune qui n’y est pas préparé répondre à une offre d’emploi, c’est prendre le risque d’un triple échec : du dispositif d’accompagnement, qui aura déçu l’employeur potentiel comme le jeune ; de l’employeur, qui n’aura pas réalisé son recrutement et se défiera désormais des jeunes adressés par les dispositifs publics ; du jeune, qui aura été humilié et se dira que l’emploi, ce n’est décidément pas pour lui !
La valorisation excessive de l’accès à l’emploi est critiquée par le CERC dans son rapport précité, en ce qui concerne les critères d’évaluation des missions locales : « L’accent est mis, dans les conventions entre l’État et les missions locales, sur l’objectif d’insertion dans l’emploi (…). En ce qui concerne les jeunes sans diplôme, cet objectif (dont la traduction dans les indicateurs de résultats est le fait que le jeune trouve un emploi non aidé d’une durée de plus de six mois ou un contrat de formation en alternance) devrait être complété par un accent mis sur la progression de ses qualifications et la certification de celles-ci. Actuellement, la définition de l’objectif prioritaire d’accès à l’emploi ne tient pas suffisamment compte de la durée nécessaire, dans bien des cas, pour l’atteindre. C’est en terme de construction de parcours d’insertion que devrait davantage s’exprimer l’objectif, ce qui permettrait de mieux prendre en compte, aussi, les autres dimensions de l’intervention des missions locales ». Dans le même esprit, partant du constat que la grande majorité des contrats aidés par l’État (contrats initiative-emploi, d’accompagnement dans l’emploi, d’avenir…) n’ont pas de contenu en formation autre qu’une éventuelle action d’adaptation au poste de travail, ce rapport invite à renforcer considérablement le contenu en formation de ces dispositifs. Dans ses récentes « propositions en faveur de l’emploi » actualisées au 21 octobre 2009, le Conseil d’orientation pour l’emploi exprime une position voisine en appelant à faire évoluer les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) de sorte qu’ils permettent l’acquisition d’une véritable qualification professionnelle.
Par ailleurs, alors que les jeunes, comme on l’a vu, sont trop souvent dans des statuts d’emploi précaire et que le sentiment de « déclassement » grandit, la priorité à l’emploi ne doit pas faire oublier la question de la qualité de cet emploi. Imposer à un jeune diplômé dans une spécialité peu porteuse une réorientation qu’il vivra comme une contrainte et un déclassement, ce n’est évidemment pas un bon choix de son point de vue, mais il n’est pas certain non plus que cela en soit un pour la collectivité. Ce constat est encore plus criant pour les jeunes victimes de leur orientation et sortis sans qualification aucune du système scolaire.
La préoccupation de la formation et celle de la qualité de l’emploi se rejoignent dans une préconisation exprimée par un mouvement d’éducation populaire, dont un responsable rencontré par votre rapporteur a souligné qu’il serait utile de donner aux jeunes, en amont, une formation de base en droit du travail afin qu’ils soient prémunis contre les abus les plus criants dans leurs premiers emplois. Cette proposition est fondée sur les résultats d’une enquête conduite par ce mouvement auprès de jeunes prenant des emplois saisonniers qui montre, sans surprise, que les règles du droit de travail ne leur sont guère appliquées : 14 % des jeunes concernés étaient employés sans contrat de travail, 25 % n’étaient pas rémunérés pour leurs heures supplémentaires… Or, par ailleurs, un tiers seulement des jeunes interrogés estimaient très bien connaître leurs droits en tant que travailleurs.
6. User avec prudence de la dialectique du contrat, des droits et des devoirs s’agissant de jeunes très désocialisés
L’équilibre des droits et des devoirs, qu’il faut inscrire dans un « contrat », est devenu un autre leitmotiv du discours de certains responsables politiques. Le discours du Président de la République à Avignon y fait ainsi une référence devenue habituelle : « … on va contractualiser devoirs et droits. Et les aides que les référents pourront donner à ces décrocheurs seront exclusivement réservées aux jeunes décrocheurs qui suivent assidûment une formation. Ceux qui ne suivront pas une formation n’auront rien ».
Votre rapporteur ne conteste pas que les droits sont équilibrés par des devoirs, mais les « contrats » que les citoyens sont désormais obligés de passer avec la puissance publique quand ils sollicitent son aide sont totalement inadaptés à un public en situation de grande exclusion. Cette logique des droits et devoirs se heurte à deux limites : l’une de principe, car il y a des droits inconditionnels que l’on ne peut subordonner à des devoirs ; l’autre pratique, car il faut que le contrat ait un sens pour celui auquel on l’impose et aussi que l’on dispose d’une possibilité réelle de sanction de son non-respect.
Dans la pratique, les expériences de contractualisation intégrées dans des politiques d’insertion sont souvent peu convaincantes, comme le montre celle du « contrat d’insertion » dans le cadre du RMI. Plus récemment, le « contrat de responsabilité parentale », instauré par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances pour faire face à l’absentéisme scolaire et aux autres carences de l’autorité parentale et sanctionné le cas échéant par une suspension des allocations familiales, n’a guère reçu d’application : les présidents de conseil général ne se sont pratiquement pas saisis de cet instrument laissé à leur appréciation. Sa mise en œuvre aurait conduit à suspendre les prestations familiales de familles pour qui elles représentent une ressource vitale.
Aucune politique en direction des personnes en situation d’exclusion ne peut être efficace si elle repose exclusivement sur la logique du contrat et sur la répression.
7. Éviter de recourir systématiquement, pour des raisons idéologiques, aux partenaires privés pour la mise en œuvre des actions d’accompagnement
Depuis quelques années, les pouvoirs publics confient par principe l’accompagnement de certains publics en difficulté à des « opérateurs » choisis suite à un appel d’offres en dehors du champ traditionnel des administrations et des organismes créés dans leur orbite.
L’assurance chômage le fait depuis fin 2006 pour certains demandeurs d’emploi et Pôle emploi poursuit et amplifie cette politique d’externalisation. Cette option vient d’être l’objet d’un rapport d’évaluation (15), lequel a comparé les résultats de l’accompagnement renforcé de demandeurs d’emploi présentant des risques de chômage de longue durée soit par des opérateurs externes, soit en interne par l’ancienne Agence nationale pour l’emploi (ANPE) dans le cadre d’un programme spécifique. Or, il apparaît que l’accompagnement assuré en interne a permis des reprises d’emploi plus précoces et plus nombreuses que celui qui était externalisé… et ce pour un coût très vraisemblablement bien moindre vus les tarifs pratiqués par les opérateurs externes.
Mais une récente politique destinée aux jeunes conduit sur cette question à un constat encore plus saisissant : il s’agit du « contrat d’autonomie », élément du « Plan espoir banlieue » lancé le 8 février 2008 par le Président de la République. Ce contrat vise à accompagner des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville vers l’emploi, la création d’entreprise ou l’accès à une formation qualifiante. Il est d’une durée d’un an et l’objectif affiché est d’en conclure en trois ans (d’ici fin 2011) 45 000, dont 22 500 d’ici fin 2009. Avec 12 425 contrats signés au 31 août 2009, cet objectif sera difficile à atteindre, mais là n’est pas le problème principal.
La mise en œuvre de ce dispositif, confiée à des opérateurs, privés ou publics, dans le cadre d’un appel d’offres, donne lieu à des coûts déraisonnables, du fait principalement des rémunérations versées à ces opérateurs. Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit, selon l’annexe « bleue » « Travail et emploi », 65 millions d’euros au titre du contrat d’autonomie pour 11 500 entrées dans le dispositif ; le coût par bénéficiaire est donc évalué à 5 650 euros. Des articles de presse ont évoqué des coûts unitaires plus élevés : 7 500, voire 9 600 euros.
Dans le même temps, les crédits afférents aux contrats CIVIS, dispositif d’accompagnement de droit commun géré par les missions locales, sont calculés pour 2010, selon le même document, sur la base de 366 euros en allocation par bénéficiaire. En 2008, cette dépense a été de 308 euros. Il faut certes y ajouter le coût de gestion et d’accompagnement par les missions locales mais, dans la mesure où, en 2008, les missions locales ont accueilli 467 000 nouveaux inscrits et ont reçu en entretien individuel 1 021 000 jeunes, le tout avec une subvention budgétaire de 163 millions d’euros (qui ne représente certes pas leur seul financement), on peut en conclure que le coût budgétaire unitaire d’une jeune en CIVIS doit être seulement de l’ordre de 500 à 1 000 euros.
Or, les résultats du CIVIS en termes de « sorties positives », indicateur habituel des politiques d’insertion, semblent pour le moment meilleurs que ceux des contrats d’autonomie : d’après les dernières statistiques disponibles, portant sur l’ensemble des contrats CIVIS conclus jusque fin 2007, le taux de sortie en emploi « durable » (contrat à durée indéterminée ou contrat temporaire de six mois et plus) dans l’année suivant la passation du contrat serait de 19 %, tandis que les premiers chiffres parus sur les contrats d’autonomie fin août 2009, certes avec beaucoup moins de recul, feraient apparaître selon des articles de presse 7 % seulement de sorties positives…
Vaut-il vraiment la peine de dépenser cinq ou dix fois plus par jeune pour des chances d’insertion qui sont peut-être deux ou trois fois plus faibles en fin de parcours ?
Il apparaît donc bien préférable de s’appuyer sur les acteurs existants, qui ont fait leurs preuves : les mouvements associatifs présents sur le terrain, notamment les mouvements d’éducation populaire, mais aussi les grands dispositifs publics, notamment l’Éducation nationale et les missions locales.
● Depuis 1996, il existe au sein de l’Éducation nationale une « mission générale d’insertion » (MGI), dont l’objectif est de prévenir les sorties du système scolaire sans diplôme. Son public prioritaire est constitué par les jeunes de plus de 16 ans en cours de « décrochage » ou sortis du système depuis moins d’un an. Elle mène une action de prévention à travers des cellules de veille constituées dans les établissements scolaires, qui repèrent les « décrocheurs » et organisent des « entretiens de situation » avec eux. 50 000 de ces entretiens ont eu lieu en 2007-2008, qui ont permis de trouver une « solution » dans 84 % des cas (76 % de retours en formation, 4 % d’orientations vers l’emploi et 4 % d’orientations vers d’autres structures). La mission conduit aussi des actions d’aide à l’insertion professionnelle, principalement des pré-formations en vue de l’accès à une formation qualifiante, qui ont concerné 34 000 élèves en 2007-2008.
● Les missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) constituent un dispositif généraliste, présent sur tout le territoire et qui prend en charge globalement les problèmes d’insertion des jeunes. Au 31 décembre 2008, on en décomptait 485 qui employaient 11 000 agents et disposaient de près de 5 000 antennes et relais. Cette même année, 467 000 jeunes ont été accueillis pour la première fois dans ce réseau et 1 021 000 ont été reçus en entretien individuel.
Les missions locales et permanences d’accueil gèrent le dispositif CIVIS, qui a été institué en 2005 au bénéfice des jeunes de 16 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, avec une priorité aux jeunes sortis sans qualification du système scolaire, lesquels bénéficient d’un CIVIS « renforcé ». Les jeunes sont accompagnés par un référent et peuvent obtenir une allocation, s’ils sont majeurs et n’ont pas d’autres ressources. Cette allocation est toutefois modeste : 300 euros maximum par mois et 900 euros par an. Elle joue un rôle important pour assurer la continuité des parcours et il apparaît nécessaire d’en relever les plafonds et d’en accroître les moyens de financement.
Environ 180 000 jeunes entrent chaque année en CIVIS depuis 2006 et l’effectif de jeunes en cours de contrat s’élevait fin 2008 à 270 000. 763 500 jeunes au total sont entrés dans le dispositif de mai 2005 à juin 2009, dont 91 % n’ayant pas le bac. Parmi les 468 000 sorties du dispositif dénombrées jusqu’au 31 mai 2009, 176 000 ont eu lieu vers un emploi « durable », 32 000 vers un emploi non durable et 31 000 vers une formation.
Le renforcement des moyens budgétaires afférents aux missions locales et au CIVIS qui est prévu dans le cadre du plan « Agir pour la jeunesse » à hauteur de 120 millions d’euros en 2010 constitue une bonne mesure. Mais il est regrettable qu’elle soit inscrite sur la mission « Plan de relance de l’économie » et non sur la mission « Travail et emploi », ce qui donne à cette mesure un caractère non-pérenne.
● Les écoles de la deuxième chance ont pour objet de proposer, pour neuf mois à un an, une formation à des jeunes sans qualification professionnelle. La pédagogie est personnalisée et donne une place importante à la construction d’un projet et à l’alternance. 43 sites ont accueilli 4 100 jeunes en 2008 (contre 1 000 en 2003 et 2 700 en 2006). Sur les stagiaires accueillis en 2007, 93 % n’avaient pas validé le niveau V de formation (CAP) ; durant cet exercice, on a relevé 19 % d’abandons en cours de formation ; parmi les jeunes ayant achevé leur cycle, 61 % ont connu une « sortie positive » : accès à l’emploi « durable », à la formation ou à l’alternance. Les moyens des écoles de la deuxième chance vont être renforcés afin d’atteindre un effectif de 12 000 jeunes accueillis. Il a également été décidé d’abaisser de 18 à 16 ans l’âge minimal d’entrée de droit commun dans ce dispositif, ce qui suscite des interrogations.
Quoi qu’il en soit, il semble acquis que les dispositifs susceptibles d’être mobilisés pour venir en aide aux jeunes en situation de grande exclusion peuvent reposer sur des outils existants ou d’autres à créer, mais doivent avoir une pérennité d’action permettant tout à la fois une identification et une plus grande efficacité.
La Commission des affaires sociales examine pour avis les crédits pour 2010 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », sur le rapport de M. Christophe Sirugue pour les crédits de la partie Solidarité, au cours de sa séance du mercredi 4 novembre 2009.
Un débat suit l’exposé de M. le rapporteur pour avis.
M. Bernard Perrut. Les jeunes que vous dites invisibles pour nos structures d’accueil, monsieur le rapporteur, sont bien visibles pour nous les élus de terrain. Et s’agissant du problème de l’emploi, il n’est pas totalement nouveau dans notre pays, puisque cela fait vingt ou trente ans que les jeunes rencontrent des difficultés pour entrer sur le marché de l’emploi, contrairement à d’autres pays.
Quant à opposer la multiplication des annonces au besoin de stabilité, si le Gouvernement propose des outils nouveaux c’est parce qu’il n’y a non pas une, mais des jeunesses. Il est normal par conséquent, qu’il souhaite y répondre par des solutions diverses qui, elles-mêmes, doivent évoluer. Bien évidemment, une approche de fond est également nécessaire – vous avez d’ailleurs rendu hommage à la commission mise en place par M. Martin Hirsch –, car on ne peut dissocier le problème de l’emploi de ceux de la formation, de l’orientation, des ressources, de la citoyenneté, du logement ou encore de la santé.
À cet égard, votre analyse pourrait faire penser que le Gouvernement et les parlementaires qui le soutiennent ne sont pas assez attentifs aux jeunes. Pourtant, les crédits en direction de ces derniers sont passés de 3,2 milliards l’année passée à 3,7 milliards aujourd’hui, soit plus 19 % d’augmentation, qu’il s’agisse du CIVIS – dont les moyens sont passés de 55 millions d’euros en 2009 à 135 millions en 2010 –, des missions locales – dont les crédits atteignent 220 millions contre 156 l’an passé –, de la prime à l’embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée, des dispositifs en faveur des apprentis, des contrats d’accompagnement passerelle, des contrats initiative emploi, ou encore des contrats d’accompagnement formation. Et il en va de même pour les mesures non plus conjoncturelles, mais structurelles, qu’il s’agisse du plan Agir pour la jeunesse ou encore de l’orientation.
En tout état de cause, un effort doit, j’en suis d’accord, être mis en œuvre pour aller vers les jeunes. À côté des outils mis en place, ces derniers ont droit à une deuxième chance lorsqu’il s’agit de publics précarisés, qui n’ont peut-être pas la volonté d’entrer dans un système contraignant. À cet égard, le RSA ne peut être une mesure d’accompagnement pérenne, c’est-à-dire d’assistanat. Je suis, pour ma part, favorable à des mesures d’accompagnement qui débouchent sur un emploi plutôt qu’à des mesures dans lesquelles les jeunes pourraient se complaire et les considérer comme une fin en soi.
Votre rapport laisserait croire que le maximum n’est pas fait en faveur des jeunes qui sont les plus éloignés de nos structures de la formation et de l’emploi. Ce n’est pas le cas.
Mme Marisol Touraine. Il me semble que, dans notre pays, une préférence implicite existe pour les personnes qui sont déjà en situation d’intégration, fussent-elles en difficulté. En effet, au même titre qu’hier l’on préférait revaloriser la situation de ceux qui avaient un emploi au détriment de celles des chômeurs, aujourd’hui nos politiques tendent plus ou moins à soutenir ceux qui sont déjà dans des circuits d’intégration plutôt que ceux qui sont dans une situation de grande exclusion. De ce point de vue, ni la commission Hirsch ni le Gouvernement ne me semblent avoir proposé des leviers permettant de rompre ce cercle non vertueux, puisque les mesures se concentrent plutôt sur les personnes qui vont vers l’emploi.
La solution tient à la mise en place, d’une part, de dispositifs simplifiés – ne rajoutons pas des dispositifs à l’existant, favorisant l’accès des jeunes au droit commun et, d’autre part, de parcours inscrits dans la durée.
S’agissant du RSA, je tiens à insister sur les difficultés que pose l’insuffisante compensation par l’État. Dans la mesure où celle-ci s’opère sur la base du nombre de Rmistes en 2004, non seulement un décalage existe nécessairement, surtout en période de crise, mais les ressources ainsi sollicitées de la part des conseils généraux ne peuvent plus l’être pour la mise en œuvre des politiques actives d’insertion et d’accompagnement. C’est là un effet de ciseau, que l’on voit se produire dans de nombreux départements.
Par ailleurs, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, M. Xavier Darcos, a annoncé au cours des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sa volonté de faire de l’égalité entre les hommes et les femmes l’un des axes forts de son ministère. Le programme correspondant ne me semble pourtant pas en mesure de donner une traduction concrète à cette priorité.
Le Planning familial, enfin, joue un rôle important en direction des femmes, mais aussi des familles et des jeunes. On retrouve là la nécessité d’avoir une politique globale et une action de soutien à la parentalité, si l’on veut être plus efficace à l’égard des jeunes en difficulté. Quelles garanties a-t-on d’un maintien des fonds dont peut disposer le Planning familial ?
Mme Martine Billard. Les mesures de la mission sont toutes tournées vers l’emploi. Malheureusement, 28 % des allocataires du RSA socle en restent très éloignés, soit pour des raisons de santé, soit du fait même de vivre dans la rue. Ceux qui ne sont pas en état de repartir vers l’emploi sont ainsi devenus totalement invisibles dans les politiques de lutte contre l’exclusion, d’autant qu’après l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA socle, qui tend à étrangler les départements, le basculement de l’allocation de parent isolé vers le RSA ne s’est accompagné que d’une compensation partielle.
Sachant par ailleurs que, du fait du préalable idéologique de la majorité selon lequel il ne faut pas maintenir les jeunes dans l’assistanat, le RSA jeunes – dont le financement ne semble d’ailleurs pas prévu – ne sera versé aux moins de vingt-cinq ans qu’à condition d’avoir travaillé 3 600 heures sur les trois années précédentes, son extension ne concernera pas grand monde ! En outre, aucune réponse n’est apportée dans le budget au fait que les jeunes ne peuvent pas toujours accéder à des dispositifs d’hébergement saturés et qu’ils restent donc à la rue, comme c’est le cas en région parisienne.
Par ailleurs, peut-on être assuré que la question des droits connexes est maintenant réglée ? Sur le terrain, des problèmes subsistent.
Il est prévu également, par une mesure fiscale, de donner des avantages, en conséquence du nombre d’enfants, aux familles qui sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette mesure n’a coûté que 25 millions d’euros en 2008 et 20 millions en 2009 – il en ira de même pour 2010 –, mais cette somme ne serait-elle pas mieux utilisée en faveur des familles vulnérables ?
S’agissant enfin de l’égalité entre les hommes et les femmes, les crédits du programme correspondant stagnent. On peut craindre encore un long chemin pour les femmes avant toute amélioration en ce domaine !
M. Francis Vercamer. Si je me félicite du dispositif du RSA qui devient enfin une réalité, même si la montée en charge est longue, je regrette que l’on n’ait pas travaillé sur tous les minima sociaux, en particulier l’allocation de solidarité spécifique (ASS), afin de ne pas diviser les Français entre ceux qui bénéficient du RSA et les autres.
Quant à la compensation des départements, il me paraît normal, à partir du moment où l’on a décentralisé une politique, que les départements s’en saisissent pleinement. S’ils veulent avoir moins de bénéficiaires de RSA à aider, libres à eux de développer une politique d’insertion ! Mais s’ils restreignent les budgets d’insertion active, qu’ils ne s’étonnent pas alors que le stock des bénéficiaires du RSA augmente !
Pour avoir été nommé parlementaire en mission sur le sujet du développement de l’économie sociale et de l’entreprenariat social, je ne peux que regretter le faible montant, seulement 10 millions d’euros, affecté en la matière. J’espère qu’à la fin de la mission, les crédits augmenteront, car il existe selon moi des gisements d’emplois très forts dans l’économie sociale et l’entreprenariat social.
Concernant, selon le rapporteur, l’effort insuffisant des interventions de l’État destinées à accompagner les familles dans leur rôle de parents, qu’il me soit permis de regretter le temps passé en réunion par les partenaires en la matière, ce qui conduit ces derniers à se plaindre de ne pas avoir le temps de travailler et à réclamer en conséquence des moyens supplémentaires ! Mais, la manipulation n’est pas non plus absente en matière de parentalité et, plus généralement, de jeunes…
Je ne suis pas opposé, par ailleurs, à la départementalisation des caisses d’allocations familiales, à condition que l’on conserve l’autonomie des antennes dans les bassins d’emploi, car les situations sont loin d’êtres équivalentes au sein d’un même département.
Il est selon moi incompréhensible que l’Éducation nationale ne soit pas capable de signaler aux organismes chargés de suivre les jeunes en difficulté, ceux qui sont en décrochage scolaire. Certains s’appuient pour justifier cela sur le secret professionnel, mais les dispositifs de réussite éducative, par exemple, comprennent des assistantes sociales à qui l’on peut faire confiance.
S’agissant enfin des parcours, il faut avoir l’emploi comme finalité même si c’est difficile et que cela demande des étapes intermédiaires. Car, si l’on fait croire au jeune qu’au bout du parcours ce ne sera pas l’emploi mais l’assistanat tout au long de sa vie, il ne faudra pas s’étonner si le nombre des gens exclus augmente.
M. le président Pierre Méhaignerie. On peut se plaindre, c’est vrai, du morcellement des outils. Il n’en reste pas moins qu’avec les nombreux moyens qui nous ont été donnés et une mobilisation des acteurs locaux, beaucoup peut être fait par des solutions simples.
Par ailleurs, le procès fait à l’État en matière de transfert des dépenses est profondément injuste : si le retard de l’État vis-à-vis des dépenses des départements se chiffre à 1,2 milliard d’euros à peu près, ses dotations en faveur des collectivités locales ont, ces sept dernières années, progressé, elles, de 10 milliards d’euros, dont 6,5 milliards de dégrèvements et d’exonérations, qui rendent l’impôt local plus indolore et permettent de l’augmenter !
Mme Catherine Génisson. Après m’être étonnée des propos de Francis Vercamer qui a parlé de manipulation s’agissant des difficultés des familles, je précise, monsieur le président, que ce n’est pas un manque de compensation qui a été dénoncé. Simplement, on ne peut tenir deux raisonnements différents, l’un exonérant l’État du fait d’une situation conjoncturelle, l’autre accablant les collectivités territoriales en raison de leur revendication d’autonomie. Les conséquences de la crise valent pour tout le monde.
S’agissant du décrochage scolaire, je souhaite appeler l’attention sur le problème de la proximité des places dans les filières techniques et professionnelles. Si le nombre de places, selon les schémas régionaux de formation, répond globalement aux besoins, tout tient à la proximité pour les populations en difficulté. Or, il manque des places dans certains établissements scolaires qui leur sont proches.
Quant aux dispositifs de retour à l’emploi, si vous avez souligné la diversité de l’offre en matière de stages dans les entreprises, vous avez omis de parler de la difficulté à accéder à de tels stages, en dépit d’exonérations de cotisations sociales ou d’autres avantages multiples et variés. Peut-on disposer de données à cet égard ?
M. Jean-Patrick Gille. Alors qu’en un an, d’août 2008 à août 2009, on décompte une augmentation d’un tiers des jeunes au chômage – et de 50 % si l’on prend les seuls jeunes hommes –, la stabilité des dispositifs se révèle nécessaire. De la même manière, ne peut-on craindre, avec la substitution annoncée aux missions générales d’insertion des plates-formes de lutte contre le décrochage, la reprise à zéro d’un travail déjà effectué ?
S’agissant des jeunes « invisibles », ne faut-il pas réfléchir à des relais qui leur permettent de se faire entendre ? Il existe, en effet, des mesures qui sont sous-utilisées tant de la part des employeurs que des jeunes. Ne faut-il pas s’interroger, par exemple, sur la pertinence du contrat d’autonomie ?
De même, après la chute des contrats aidés passerelle dans le secteur non marchand, il conviendrait de réfléchir à un contrat plus long, comprenant un encouragement à la formation, comme l’a demandé le Conseil d’orientation pour l’emploi, même s’il ne s’agit pas de relancer les emplois jeunes. Pour ma part, je regrette le manque de réponses apportées aux jeunes des quartiers, notamment des zones urbaines sensibles.
Plus généralement on ne fera pas l’économie du débat, qui n’a pas été tranché dans le cadre de la commission Hirsch, sur le choix entre une allocation à tout jeune à dix-huit ans, une généralisation du RSA ou un statut générique du jeune en formation. Je suis, pour ma part, de plus en plus sceptique quant à la multiplication des mesures pour l’emploi en faveur des jeunes, car elles créent des effets pervers dans le mode de raisonnement des employeurs voire des jeunes eux-mêmes. Je demeure, en revanche, persuadé de la nécessité du développement de l’effort de formation, associée si possible à un contrat, aussi bien dans le secteur marchand que dans le secteur non marchand. Les jeunes demandent un accompagnement particulier, notamment ceux qui connaissent la précarité relationnelle.
Mme Monique Iborra. L’un des mérites du rapport est de montrer le décalage qui existe entre ce qui est affiché et ce qui est effectivement réalisé. Si les outils mis en place n’ont pas eu les résultats escomptés – je pense par exemple aux contrats d’autonomie –, peut-être conviendrait-il de réexaminer, en particulier, le mode d’intervention des missions locales ?
Quant aux missions générales d’insertion de l’Éducation nationale, il faudrait non pas les remplacer par d’autres structures, mais plutôt les ouvrir aux autres acteurs, car elles sont par trop cloisonnées.
On nous parle des jeunes en grande difficulté, en particulier dans les banlieues, alors que dans le même temps on diminue les crédits en faveur des familles vulnérables, des maisons de l’adolescence, du soutien à la parentalité : c’est la raison essentielle pour laquelle nous ne voterons pas ces crédits.
Mme Catherine Coutelle. Les faibles moyens du programme « Égalité entre les hommes et les femmes » sont en stagnation, ce qui est loin de montrer une volonté politique d’améliorer la situation dans une matière où la France vient même d’être rétrogradée dans un classement international : non seulement la différence de salaires entre les hommes et les femmes ne diminue pas – alors que M. Xavier Bertrand, alors ministre du travail, avait annoncé en novembre 2007 que cette égalité se ferait en 2010 –, mais la précarité des emplois reste forte pour les femmes, tous éléments qui expliquent que les retraites soient 40 % plus faibles chez ces dernières que chez les hommes.
On ne retrouve pas non plus ce qui pourrait améliorer les carrières des femmes, c’est-à-dire l’accompagnement dans leur vie professionnelle. En France, après la naissance des enfants, les femmes ne retrouvent ni leur emploi ni leur salaire. Une politique d’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle est nécessaire, ce que ne permet pas le budget de 168 113 euros de l’action « Articulation des temps de vie ».
Je ne peux que regretter qu’un ministère aux droits des femmes attitré ne puisse porter cette politique indispensable d’égalité entre les hommes et les femmes et que le nombre de postes du service des droits des femmes et de l’égalité diminue de quatre équivalent temps plein. C’est bien la marque de l’absence d’une volonté politique de lutter pour l’égalité.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’aurais souhaité que le rapporteur soit un peu plus modéré, voire moins partisan, dans l’élaboration de son rapport.
S’agissant du décrochage scolaire, il existe, au même titre que pour la problématique du retour à l’emploi, des structures qui sont sous-utilisées, à savoir les classes relais au sein des collèges. Les trois que j’ai mises en place en trois ans dans le département du Jura m’ont ainsi permis de m’assurer qu’elles constituaient une réponse individuelle dans le cadre de l’Éducation nationale, et j’aurais aimé retrouver cette référence dans le rapport. En matière d’illettrisme, ce n’est pas après la seconde que l’on récupérera des jeunes, mais entre la sixième et la troisième.
Pour ce qui est de la longueur des dispositifs, il faut être très vigilant, car, à l’exemple des emplois tremplin, le problème se pose du financement dans la durée.
Quant aux écoles de la deuxième chance, quarante-trois sites en France ont accueilli 4 100 jeunes en 2008. Sachant qu’il y a eu 19 % d’abandons en cours de formation, cela fait, pour 2 025 sorties positives, moins de 50 % de réussite. Sans rejeter ce dispositif, qu’est-il prévu pour les jeunes qui n’ont pas connu de sortie positive ?
M. le président Pierre Méhaignerie. Un autre dispositif à l’appellation voisine existe, appelé Défense deuxième chance, mais je ne suis pas sûr que le ministère de la défense s’enthousiasme à l’idée de continuer un effort pourtant justifié et adapté à certains jeunes.
(M. Pierre Morange succède à M. Pierre Méhaignerie à la présidence de la Commission).
M. Maxime Gremetz. Pour revenir sur la notion de jeunes « invisibles », je souhaite que l’on fasse attention aux termes employés car, pour ne prendre que l’exemple de ma circonscription, les 62 % de jeunes au chômage sont loin d’être invisibles !
Je regrette, par ailleurs, que le rapport ne fasse pas état du problème du logement des jeunes. Or, sans un toit, un jeune ne peut avoir de travail. On ne peut parler de la jeunesse sans parler de la crise du logement ! Nous avons pour notre part toujours réclamé une allocation autonomie pour la jeunesse.
Quant au RSA et aux droits connexes, la maire UMP de Beauvais elle-même m’a demandé, avec raison, de déposer un amendement, afin que les bénéficiaires du RSA soient, comme les bénéficiaires du RMI avant la réforme, exonérés de taxe d’habitation et de redevance audiovisuelle.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Alors que nous butons tous depuis des années sur la situation des jeunes en grande difficulté, le rapport fait honneur au travail des parlementaires.
À cet égard, je ne peux laisser dire, comme l’un de nos collègues, que certains dispositifs conforteraient les jeunes en grande difficulté dans un avenir d’assistés. Au contraire, il nous faut faire en sorte que tous les dispositifs existants permettent d’apporter les réponses attendues.
Quant à aller vers les jeunes – car les difficultés sont telles que ces derniers ne sont pas toujours en capacité d’entreprendre eux-mêmes des démarches –, il convient de renforcer les dispositifs tels que les missions locales et, en tout cas, de soutenir toutes les associations qui peuvent accompagner les jeunes sur leur lieu d’exclusion.
M. Jacques Domergue. Le manque de lisibilité des contrats étant réel, ne serait-il pas temps d’arrêter d’inventer des contrats qui ne répondent en fait qu’à une vision théorique des choses, et de toiletter tout l’arsenal d’aide aux jeunes et à l’emploi, afin de repartir sur de nouvelles bases, en mettant surtout en place un véritable système d’évaluation ?
M. Pierre Morange, président. Le déficit d’information que le rapporteur pour avis soulignait dans la première partie de son rapport pourrait justement trouver une réponse dans l’interconnexion des fichiers des 1 700 organismes sociaux qui devrait être opérationnelle pour la fin de l’année, ce qui permettait également une évaluation des différents dispositifs mis en place.
M. Christophe Sirugue, rapporteur pour avis. Si le problème de l’emploi n’est pas nouveau, comme l’a souligné Bernard Perrut, la durée pour stabiliser le parcours jusqu’à un emploi à durée indéterminée est aujourd’hui entre sept et dix ans, élément qui contribue également à fragiliser les parcours notamment des plus jeunes.
Personne n’a dit que la finalité n’était pas l’emploi, et je ne comprends pas à cet égard la remarque de Francis Vercamer. La place dans la société est aussi déterminée par l’emploi que l’on occupe. Pour autant, il convient de faire attention à ne pas mettre dans un parcours emploi des jeunes qui ne sont pas en situation d’y faire face, car on enregistrerait alors un triple échec : pour le dispositif, pour le jeune et pour l’employeur. Il faut accepter que, dans le cadre d’un parcours, il y ait un temps d’insertion sociale pour certains.
Pour ce qui est du RSA et des droits connexes, madame Billard, monsieur Gremetz, les choses sont claires : faute de droit automatique à dégrèvement de taxe d’habitation et de redevance audiovisuelle, certains bénéficiaires du RSA ou ex-rmistes ont des frais qu’ils n’avaient pas à supporter auparavant. Certains sont donc perdants.
S’agissant de la diminution de l’attractivité de certains dispositifs, madame Génisson, non seulement les dispositifs ne sont pas attractifs en eux-mêmes car on n’en voit pas véritablement la finalité, mais la problématique des stages se pose à chaque fois cruellement. Alors que l’on a fait un effort d’insertion, on se trouve là encore en situation d’échec.
Quant au financement du RSA jeunes, aucune ligne budgétaire ne lui est affectée. Mais comme les inscriptions budgétaires sont particulièrement élevées dans le cadre du RSA, le Haut commissaire considère qu’il peut financer cette mesure sur les crédits RSA sans prévoir de ligne nouvelle. Faut-il croiser les doigts afin que, pour financer le RSA jeunes, le RSA ne touche pas tous ses bénéficiaires potentiels ? Sans en arriver là, il nous faut en tout état de cause être vigilants.
Concernant les contrats d’autonomie évoqués par Monique Iborra, les chiffres sont clairs : alors qu’un CIVIS coûte 1 000 euros contre 6 000 euros pour un contrat d’autonomie, on compte 19 % de sorties positives à un an pour les CIVIS contre 7 % pour les contrats d’autonomie qui coûtent plus cher ! À l’évidence, c’est un dispositif qui ne fonctionne pas.
Il est vrai, madame Dalloz, que le rapporteur a eu du mal à cacher sa sensibilité, mais c’est là une attitude assez logique – Bernard Perrut la semaine dernière ne nous expliquait-il pas pour sa part que la situation de l’emploi s’améliorait ?
S’agissant de l’illettrisme, des expérimentations intéressantes sont menées, mais il ne s’agit que d’expérimentations. Nous ne disposons pas encore d’éléments suffisamment significatifs pour en apprécier les résultats. J’ajoute que ce phénomène est de plus en plus difficile à identifier depuis la disparition du service militaire pour les garçons.
Pour ce qui est de la question de la durée, peut-être faut-il se demander si les dispositifs ont tous vocation à être pérennisés et si l’on est prêt à accepter que certains le soient, tandis que d’autres serviraient de support à la logique d’insertion ?
Quant aux écoles de la deuxième chance, je vous trouve très sévère : 93 % des entrants n’ont pas le CAP et, alors qu’ils font partie de ceux qui sont dans les situations de plus grande exclusion, 50 % connaissent une sortie positive. Ces écoles de la deuxième chance ont donc une pertinence.
La formulation « jeunes invisibles », monsieur Gremetz, est due aux associations elles-mêmes. Elle ne signifie pas dans leur esprit que ces jeunes n’existent pas, mais qu’aucun outil ne permet d’aller vers eux.
En conclusion, je me réjouis que l’on puisse axer nos travaux sur les jeunes en situation de très grande exclusion. À cet égard, ne faisons pas de confusion entre les jeunes qui sont dans des parcours d’insertion – que Bernard Perrut nous a parfaitement décrits dans son rapport – et ceux qui, pour l’instant, relèvent de rien ou de pas grand-chose. Le problème en l’occurrence ne tient pas seulement aux moyens, mais également aux structures. Comme l’a souligné Jacques Domergue, il est à cet égard nécessaire d’identifier ce qui fonctionne bien avant d’inventer d’autres dispositifs qui viendront encore complexifier la mission qui nous est donnée, cela dans une perspective de retour à l’emploi.
M. Pierre Morange, président. Je rappelle que Christophe Sirugue a exprimé un avis défavorable à l’adoption des crédits de la partie « Solidarité », alors que Paul Jeanneteau a donné un avis favorable à l’adoption des crédits du programme « Handicap et dépendance ».
*
La Commission émet un avis favorable à l’adoption des crédits pour 2010 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
(par ordre chronologique)
Ø Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) – Mme Nicole Maestracci, présidente, et Mme Elsa Hajman, chargée de mission « jeunes »
Ø Mouvement français pour le planning familial – Mme Carine Favier, présidente, Mme Françoise Laurant, ancienne présidente, et Mme Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale
Ø Jeunesse ouvrière chrétienne – M. Stéphane Haar, président
Ø Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) – Mme Audrey Massié, présidente
Ø Association Tempo territorial – M. Dominique Royoux, président, directeur du service « prospective et coopérations territoriales » et de l’agence des temps de la communauté d’agglomération de Poitiers, et Mme Mireille Terny, animatrice de cette agence des temps
Ø Secours populaire français – Mme Seynabou Dia, secrétaire national chargée du développement
Ø Union nationale des associations familiales (UNAF) – M. François Fondard, président, M. Rémi Guilleux, administrateur, président du département « éducation-jeunesse », et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
Ø Pôle Emploi – M. Christian Charpy, directeur général, et Mme Odile Marchal, directrice du programme « diversité »
Ø Secours catholique – M. Bernard Schricke, directeur de l’action « France »
Ø Éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) – Mme Marie-Véronique Patte, chef du bureau de la formation professionnelle initiale, de l’apprentissage et de l’insertion
Ø Union nationale des missions locales (UNML) – M. Claude Fournet, premier vice-président, et M. Michel Guernion, secrétaire du bureau
Ø Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ) – Mme Nadine Dussert, directrice générale
Ø Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) – M. Jean-Louis Sanchez, délégué général
Ø Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – M. Jean-Louis Deroussen, président, et Mme Patricia Chantin, chargée des relations avec les parlementaires
Ø Aide à toute détresse (ATD) quart-monde – M. Pierre Saglio, président, et M. Yann Bertin, volontaire permanent
Ø Assemblée des départements de France (ADF) – M. René-Paul Savary, président de la commission « insertion et cohésion sociale », et Mme Marylène Jouvien, chargée des relations institutionnelles
Ø Fédération Léo Lagrange – M. Yann Lasnier, secrétaire général adjoint, et M. Samir Bensaadi, délégué national à la jeunesse
Ø Défenseur des enfants – Mme Dominique Versini, défenseure, et M. Hugues Feltesse, délégué général