![]()
N° 2235
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION
SUR LA RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE (1)
Président
M. Alain CLAEYS,
Rapporteur
M. Jean LEONETTI,
Députés.
——
La mission d’information est composée de :
M. Élie Aboud, Mme Patricia Adam, Mme Martine Aurillac, M. Jean Bardet, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Xavier Breton, M. Jean-François Chossy, M. Alain Claeys, Mme Pascale Crozon, M. Bernard Debré, M. Jacques Domergue, M. Henri Emmanuelli, Mme Catherine Génisson, M. Philippe Gosselin, Mme Claude Greff, Mme Françoise Hostalier, M. Olivier Jardé, M. Paul Jeanneteau, M. Armand Jung, M. Jean Leonetti, M. Noël Mamère, M. Jean-Marc Nesme, Mme Dominique Orliac, Mme Françoise de Panafieu, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Jean-Luc Préel, M. Jean-Louis Touraine, Mme Isabelle Vasseur, M. Michel Vaxès, M. Jean-Sébastien Vialatte
INTRODUCTION 17
PARTIE I : DÉSIR D’ENFANT ET DROIT À L’ENFANT 23
CHAPITRE 1 – L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION 25
A. FAUT-IL ÉLARGIR LES CONDITIONS D’ACCÈS À L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION ? 25
1. L’encadrement actuel : l’assistance à la procréation comme réponse médicale à un problème médical 25
a) Les conditions médicales et sociales d’accès aux techniques d’aide à la procréation 26
b) La finalité médicale de l’AMP 27
2. Faut-il assouplir la condition relative à l’existence d’un couple marié ou en mesure de prouver une vie commune d’au moins deux ans ? 28
a) Le critère de durée de vie commune pour les couples non mariés 28
b) Les critères de la stabilité et de l’infertilité du couple 30
3. Les limites biologiques et temporelles de la procréation doivent-elles être repoussées? 34
a) L’« âge de procréer » : critère biologique ou exigence sociale ? 34
b) Procréer par delà la mort ? 37
4. Faut-il mieux prendre en compte l’intérêt de l’enfant à naître ? 43
5. Convient-il de répondre à l’« infertilité sociale » ? 46
a) Les femmes seules 46
b) Les couples de même sexe 50
B. COMMENT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE L’INFERTILITÉ ? 54
1. Agir en amont 55
a) Améliorer l’information des femmes sur l’évolution de leur fertilité avec l’âge et sur les résultats de l’AMP 55
b) Renforcer la recherche sur les causes de la stérilité 57
2. Simplifier et adapter l’organisation de l’offre de soins 58
a) Réformer le dispositif d’autorisation et d’agrément pour les activités d’assistance à la procréation et de diagnostic prénatal 58
b) Reconnaître les missions actuellement exercées par les sages-femmes dans les centres d’AMP 62
c) Veiller à un financement adapté des activités d’assistance à la procréation 64
3. Améliorer la prise en charge des couples dans les centres d’AMP 66
a) Renforcer leur accompagnement psychologique 66
b) Faciliter la conciliation de la vie professionnelle des femmes avec les contraintes des traitements d’AMP 67
4. Renforcer l’évaluation, la transparence et l’encadrement des techniques d’AMP 69
a) Développer le recueil des données individuelles par patiente et rendre publics les résultats des centres d’AMP 69
b) Améliorer le suivi des personnes ayant eu recours à l’AMP, des enfants qui en sont issus ainsi que des donneuses d’ovocytes 74
c) Renforcer l’encadrement des techniques actuelles d’assistance médicale à la procréation 76
d) Les interrogations éthiques soulevées par les recherches visant à améliorer les techniques d’AMP 79
C. QUELLES SONT LES QUESTIONS ÉTHIQUES SOULEVÉES PAR LA CRYOCONSERVATION DES EMBRYONS ? 79
1. La conception d’embryons « surnuméraires » : convient-il de modifier l’encadrement actuel ? 80
2. Le sort des embryons congelés : à quelles conditions leur conservation peut-elle être arrêtée ? 84
D. L’AMP AVEC TIERS DONNEUR : LES PRINCIPES D’ANONYMAT ET DE GRATUITÉ DU DON DE GAMÈTES DEVRAIENT-ILS ÊTRE RECONSIDÉRÉS ? 87
1. Promouvoir le don de gamètes sans remettre en cause le principe de non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments 87
a) La pénurie d’ovocytes ne doit pas justifier la rémunération du don 87
b) Le don de gamètes doit être promu 92
c) La pénurie d’ovocytes peut favoriser le risque d’une rémunération occulte du don 97
2. Faut-il lever l’anonymat du donneur de gamètes ? 100
a) Les arguments avancés pour assouplir ce principe 101
b) Les solutions proposées et leurs limites 106
3. Adapter les dispositions de la loi relatives à l’accueil d’embryon 110
a) Le don d’embryon doit-il être maintenu ? 111
b) La procédure d’accueil d’embryon ne pourrait-elle pas être allégée ? 115
CHAPITRE 2 – LA GESTATION POUR AUTRUI 119
A. UNE INTERDICTION CONTESTÉE 120
1. Une interdiction par la jurisprudence et par la loi 120
a) Une pratique ancienne renouvelée par la dissociation possible de la maternité biologique 120
b) Une condamnation par la jurisprudence du fait de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes 122
c) Une interdiction consacrée depuis 1994 par le législateur et assortie de sanctions civiles et pénales 124
2. Les arguments avancés en faveur de la légalisation 126
a) Des arguments médicaux 126
– L’absence de réponse médicale aux infertilités d’origine utérine 126
– Une situation ressentie comme une injustice 127
– L’expression du primat du biologique sur l’éducatif 129
b) Des arguments juridiques 129
– L’argument du fait accompli 129
– La réponse aux difficultés relatives à l’état civil des enfants 131
c) Des arguments psycho sociaux 132
– Prévenir certaines dérives et permettre l’expression d’un acte de générosité 132
– Des études et des enquêtes globalement rassurantes 133
– Un moyen de mettre fin à des discriminations sociales 135
B. UNE INTERDICTION POURTANT NÉCESSAIRE CAR PROTECTRICE 135
1. Les risques de la gestation pour autrui 136
a) Des risques physiques et psychiques pour la gestatrice 136
b) La négation des relations entre la mère gestatrice et l’enfant 139
c) Des répercussions sur l’entourage de la mère porteuse 141
d) Des risques pour le couple d’intention 141
e) De multiples interrogations concernant l’enfant 142
f) Le danger d’une parenté fragmentée 143
2. Une forme d’aliénation et de marchandisation du corps humain 144
a) Une remise en cause de l’indisponibilité du corps humain 145
b) Le risque d’exploitation des femmes les plus vulnérables 148
c) L’enfant objet d’un contrat et source de contentieux 153
d) Un consentement de la gestatrice qui n’affranchit pas de toute réflexion éthique 155
3. L’impossibilité de définir un encadrement susceptible de garantir l’absence de toutes dérives 159
a) Interdire ou encadrer la rémunération des mères porteuses : une illusion 159
b) La grossesse pour autrui dans un cadre intrafamilial : une impasse 161
c) La limitation du recours à la GPA à certaines indications médicales : une pente glissante 164
d) Une légalisation pour lutter contre le tourisme procréatif : un faux espoir 165
4. D’importantes répercussions sociales, juridiques et anthropologiques 167
a) Une remise en question de principes fondamentaux des lois de bioéthique 167
b) Une pratique qui survaloriserait la transmission génétique 167
c) Une remise en cause des fondements du droit de la filiation 168
d) Et demain, l’utérus artificiel ? 170
C. LA QUESTION DE LA RECONNAISSANCE EN DROIT FRANÇAIS DES ENFANTS CONÇUS PAR MATERNITÉ POUR AUTRUI 171
1. Les tentatives d’établissement de la filiation d’un enfant né d’une mère porteuse 172
a) L’adoption de l’enfant par la mère d’intention 172
b) La possession d’état 174
c) La reconnaissance volontaire de l’enfant 175
2. Dans quelles conditions les actes établis à l’étranger peuvent être ou non transcrits sur les registres d’état civil français? 177
a) La transcription aux seules fins de permettre l’action du ministère public 177
b) L’impossibilité de transcrire partiellement l’acte étranger 179
c) Les cas où des actes étrangers ont pu être transcrits sur les registres de l’état civil français 180
3. Quelles sont les conséquences de l’absence de transcription en droit interne des actes d’état civil étrangers ? 182
a) La force probante présumée des actes étrangers d’état civil 182
b) L’absence de transcription ne pose pas de difficultés majeures dans les actes de la vie courante 183
c) Les enfants ne sont pas privés de filiation 185
4. Quel est l’état de la jurisprudence concernant la transcription sur les registres de l’état civil français des actes étrangers établis suite à une maternité pour autrui ? 185
a) La décision de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2007 n’a qu’une portée procédurale 186
b) La transcription de la filiation paternelle a été admise par la Cour d’appel de Paris en février 2009 190
c) L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être instrumentalisé 191
5. Faut-il modifier la législation actuelle pour répondre aux difficultés nées des violations de la loi française ? 192
a) Aménager un statut aux enfants nés de GPA remettrait en cause les fondements de l’établissement de la filiation 192
b) Appliquer des solutions offertes par le droit en vigueur 196
– Recourir à la délégation partage si la filiation paternelle est reconnue 196
– Désigner la mère d’intention comme tutrice en cas de décès du père d’intention si la filiation paternelle est reconnue 197
PARTIE II : QUELLES LIMITES OPPOSER À L’UTILISATION DES DONNÉES GÉNÉTIQUES ? 201
CHAPITRE 3 – LE DIAGNOSTIC ANTÉNATAL 203
A. LE DIAGNOSTIC PRÉNATAL 203
1. Les questions éthiques soulevées par le diagnostic prénatal 204
a) L’encadrement actuel 204
b) Le développement de techniques de diagnostics conduit-il à un eugénisme déguisé ? 206
2. Renforcer l’information et l’accompagnement des femmes 211
a) Préciser les mesures d’accompagnement et de soins 211
b) Mieux accompagner les femmes prenant connaissance de tests effectués au cours du premier trimestre de grossesse 212
c) Mieux encadrer les activités d’échographie fœtale et améliorer l’information des femmes sur ces examens 214
3. Renforcer la recherche sur les maladies détectées à l’occasion d’un DPN et améliorer la prise en charge du handicap 216
B. LE DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE (DPI) 217
1. Peut-on envisager une extension des indications du DPI ? 218
a) Maintenir l’encadrement actuel qui parait suffisant face à des risques de dérives 218
b) Apprécier les capacités de diagnostic des formes héréditaires de maladies 221
c) Écarter l’idée de l’établissement d’une liste de maladies susceptibles de faire l’objet d’un diagnostic préimplantatoire 223
d) Envisager la possibilité de rechercher une trisomie 21 à l’occasion d’un diagnostic préimplantatoire 224
2. Comment renforcer le rôle des centres pluridisciplinaires ? 226
a) Conserver la composition des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et de DPI 226
b) Instituer une commission auprès de l’ABM pour aider les praticiens 227
c) Renforcer les moyens des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et de DPI 229
3. Faut-il maintenir les dispositions de la loi relatives au « bébé du double espoir » ? 231
a) Une possibilité très strictement encadrée qui n’a pas encore permis une naissance 231
b) Maintenir la possibilité de recourir au double DPI en évaluant parallèlement le développement des banques de sang de cordon 234
C. RENFORCER L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE DÉPISTAGE NÉONATAL 237
CHAPITRE 4 – DE L’USAGE DES DONNÉES GÉNÉTIQUES 241
A. L’EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS MÉDICALES 242
1. Préciser ce qu’est un examen génétique 243
2. Évaluer l’utilité des tests génétiques 245
a) Les tests de susceptibilité 246
b) Les tests pan génomiques 247
c) Renforcer les conditions de mise sur le marché des tests génétiques 248
d) Les dérives marchandes de la vente des tests génétiques sur Internet 250
3. Concilier le secret médical avec l’information de la parentèle 254
a) La finalité du dispositif adopté en 2004 254
b) Une procédure restée lettre morte 257
c) D’autres procédures possibles d’information 258
d) Redéfinir une procédure simple et équilibrée 260
e) Faut-il étendre le champ des maladies pouvant faire l’objet d’une information de la parentèle ? 264
4. La pharmacogénétique : un usage méconnu de la génétique et des questions éthiques nouvelles 266
B. L’EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 269
1. Les biobanques : un encadrement législatif récent 269
a) Une activité en plein essor 269
b) Les choix du législateur en 2004 271
2. Procéder à des ajustements ou modifier le fond de la réglementation relative aux biobanques ? 273
a) Améliorer l’information du donneur 273
b) Renforcer les garanties d’information du donneur en cas de découverte incidente 275
c) Développer l’information des comités de protection des personnes 276
d) Assouplir les conditions imposées à l’utilisation secondaire des collections à des fins de recherches génétiques 277
e) Évaluer la nécessité de créer des centres de ressources biologiques 278
C. L’EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS D’IDENTIFICATION 280
1. L’utilisation des tests génétiques en matière civile 280
2. L’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques 281
3. Le fichier national des empreintes génétiques 282
D. L’INTERDICTION DE RECOURIR A DES DONNÉES GÉNÉTIQUES DANS LES DOMAINES DE L’ASSURANCE ET DU TRAVAIL 283
1. La portée de l’interdiction des tests génétiques dans les contrats d’assurance 284
2. Les données génétiques peuvent-elles être utilisées pour évaluer l’aptitude au travail ? 285
PARTIE III : SE SERVIR DU CORPS HUMAIN POUR SOIGNER ET CHERCHER : TOUT EST-IL PERMIS ? 287
CHAPITRE 5 – LA RECHERCHE SUR L’EMBRYON HUMAIN ET SUR LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES 289
A. LA PROTECTION LÉGALE DE L’EMBRYON IN VITRO 289
1. L’embryon in utero 289
2. L’embryon in vitro 290
3. L’embryon in vitro sans projet parental 292
B. BILAN ET PERSPECTIVES DES RECHERCHES MENÉES SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES 297
1. La nature des recherches et leur finalité 299
2. Les perspectives thérapeutiques 300
a) La thérapie cellulaire 300
b) La pharmacologie 302
c) Les recherches sur les techniques de culture des cellules embryonnaires 302
3. Les recherches sur les autres types de cellules souches 303
4. La découverte de la reprogrammation cellulaire change-t-elle les termes du débat ? 305
C. QUEL SERA LE FUTUR STATUT DE LA RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES ? 307
1. Sur quels principes fonder le futur régime de contrôle ? 307
a) Faut-il mettre fin au régime dérogatoire et revenir à une interdiction absolue de toute recherche sur l’embryon ? 308
b) Faut-il maintenir un régime dérogatoire provisoire ? 309
c) Faut-il instaurer un régime dérogatoire pérenne ? 310
d) Faut-il lever le principe de l’interdiction et adopter un régime d’autorisation ? 311
2. Redéfinir les critères de délivrance des autorisations de recherche 314
a) Des recherches susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs 315
b) L’absence d’une méthode alternative d’efficacité comparable en l’état des connaissances scientifiques. 317
c) Les trois critères complémentaires 318
– La pertinence scientifique du projet 318
– Le respect des principes éthiques 318
– L’intérêt pour la santé publique 320
d) Assurer une meilleure information des autorités de tutelle. 320
D. DE L’EMBRYON À LA CELLULE : PRÉCISER LES RÉGIMES DE CONTRÔLE 320
1. Maintenir l’unité du régime de contrôle sur les recherches portant sur l’embryon et sur les lignées de cellules souches 321
2. Les cellules souches différenciées sont-elles encore des cellules embryonnaires ? 323
3. De quel régime d’autorisation relèvent les essais cliniques de thérapies cellulaires réalisés à partir de cellules embryonnaires différenciées ? 325
4. Le consentement à un don d’embryons au bénéfice de la recherche est-il suffisamment éclairé ? 327
5. Limiter la portée de la révocabilité du consentement 329
6. Les problèmes éthiques posés par les cellules iPS 331
E. QUELS INTERDITS MAINTENIR ? 333
1. Faut-il autoriser les transferts nucléaires ? 333
a) Le clonage d’embryons humains 334
b) Les cybrides 336
2. Faut-il autoriser la création d’embryons pour la recherche ? 337
3. Faut-il autoriser les recherches sur les embryons destinés à naître ? 339
a) Les principes qui s’y opposent 339
b) Une évaluation des nouvelles techniques d’AMP pourrait-elle être prévue dans un nouveau cadre légal ? 341
CHAPITRE 6 – LA BREVETABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN 351
A. LA FRANCE DÉPOSE PEU DE BREVETS PORTANT SUR LES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN 351
1. Des raisons d’ordre économique 352
2. Des raisons d’ordre culturel 352
a) Une réticence d’origine culturelle au dépôt de brevets 352
b) Les actions entreprises pour inciter au dépôt de brevet 353
3. Des raisons d’ordre juridique ? 355
B. LES CONDITIONS DE BREVETABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN SONT-ELLES LA CAUSE DE CE RETARD ? 355
1. Les incertitudes concernant les critères de brevetabilité des séquences génétiques et des cellules souches humaines 356
a) La brevetabilité des séquences génétiques humaines 357
b) La brevetabilité des cellules souches humaines 360
2. Des dispositifs visant à garantir l’intérêt général 362
a) L’exception pour la recherche, un mécanisme satisfaisant 362
b) La licence d’office, un dispositif inusité 362
CHAPITRE 7 – LES GREFFES D’ORGANES ET DE CELLULES 367
A. LES PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES SUR PERSONNES DÉCÉDÉES EN ÉTAT DE MORT ENCÉPHALIQUE ET APRÈS ARRÊT CARDIAQUE 369
1. Les données statistiques sur les prélèvements d’organes 370
a) Un déficit important de dons d’organes 370
b) De longs délais d’attente 371
c) Une comparaison entre la France et l’Espagne défavorable à la France mais qui mérite d’être relativisée 371
2. Les données institutionnelles : l’organisation du système français de prélèvement d’organe sur personne décédée 373
a) Un système basé sur le consentement présumé des dons d’organes 373
b) Une organisation des réseaux de prélèvements d’organes insuffisamment efficace 379
c) Une tarification de l’activité des prélèvements d’organes sous évaluée 389
d) Une absence de suivi psychologique des familles 393
3. Les interrogations éthiques soulevées par les prélèvements sur les personnes décédées 393
a) Les prélèvements sur donneurs en état de mort encéphalique 393
b) Les prélèvements sur donneurs décédés après arrêt cardiaque 394
B. LES PRÉLÈVEMENTS SUR DONNEURS VIVANTS 402
1. Faut-il élargir le cercle des donneurs vivants ? 404
2. La procédure actuelle faisant appel à des experts et à un magistrat est-elle adaptée ? 406
3. La prise en charge financière des donneurs vivants est-elle satisfaisante ? 407
4. Comment assurer un suivi des receveurs et des donneurs et exprimer la reconnaissance de la collectivité ? 411
1. Le statut des greffes de cellules souches hématopoïétiques 413
2. Faut-il autoriser ou interdire les banques autologues ? 414
3. Faut-il développer les banques allogéniques de sang placentaire? 417
4. Faut-il modifier le régime juridique du consentement des prélèvements des cellules souches hématopoïétiques ? 419
5. Faut-il mieux encadrer l’importation et l’exportation des cellules à usage thérapeutique ? 421
CHAPITRE 8 – LE RESPECT DE L’IDENTITÉ ET DU CORPS DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 423
A. RENFORCER L’ENCADREMENT JURIDIQUE DES AUTOPSIES JUDICIAIRES ET DES DONS DU CORPS À LA SCIENCE 425
1. Les autopsies judiciaires 425
a) L’existence d’un vide juridique 425
b) Les difficultés qui en résultent 426
2. Le don du corps à la science 427
B. LES TESTS GÉNÉTIQUES POST MORTEM ET LE RESPECT DÛ AUX MORTS 429
C. LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES FœTUS DÉCÉDÉS, NÉS VIVANTS ET VIABLES 432
1. Les actes établis pour les enfants décédés avant leur déclaration à l’état civil 432
2. Les critères de l’OMS ne sont pas des conditions légales 434
3. Les difficultés d’interprétation que pose le dispositif mis en place 435
4. Instaurer des critères légaux 436
PARTIE IV : COMMENT SE PRÉPARER AUX QUESTIONS ÉTHIQUES POSÉES PAR LES SCIENCES ÉMERGENTES ? 439
CHAPITRE 9 – NEUROSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES ET CONVERGENCE DES TECHNOLOGIES 439
A. LES NEUROSCIENCES SOULÈVENT DES PROBLÈMES ÉTHIQUES NOUVEAUX 439
1. Des espoirs médicaux importants 440
a) Les progrès de l’imagerie cérébrale et de la connaissance du cerveau 441
b) Les réalisations des neurosciences 441
c) Les défis des neurosciences impliquent d’accroître l’effort de recherche 442
2. Des interrogations éthiques nouvelles 444
a) Leurs applications au cerveau 444
b) Leurs applications en imagerie cérébrale 445
c) La production en nombre d’images cérébrales 446
3. Des régulations nécessaires 447
a) Veiller aux enjeux éthiques des neurosciences et de leurs applications 447
b) Limiter l’usage de certaines techniques portant sur le cerveau humain 448
B. LES NANOTECHNOLOGIES METTENT EN LUMIÈRE DES PROBLÉMATIQUES ÉTHIQUES EXISTANTES 451
1. De nombreuses applications dans le domaine médical 451
a) Les nanosciences, un domaine en progrès rapide 451
b) Des applications prometteuses dans le domaine médical 452
2. Des enjeux qui ne relèvent pas tous des lois de bioéthique 454
a) La toxicité des nanoparticules 454
b) Les menaces pesant sur la vie privée 454
c) Les enjeux militaires 455
3. Des enjeux qui amplifient des problèmes éthiques existants 455
a) Les possibilités de personnaliser la connaissance du corps humain 455
b) Les principes éthiques sont-ils remis en cause par cette nouvelle technique ? 456
C. LA PERSPECTIVE DE LA CONVERGENCE DES TECHNOLOGIES, UN DÉFI POUR LA BIOÉTHIQUE DE DEMAIN 458
1. La réflexion éthique appelée par cette convergence 459
a) La convergence des sciences émergentes ouvre de très nombreuses possibilités d’action sur l’humain 459
b) Une réflexion éthique indispensable 461
2. L’évaluation de ces technologies au regard des principes fondamentaux 464
a) Les grandes problématiques éthiques liées à l’amélioration des performances humaines 465
b) La médecine face à l’amélioration des performances humaines 469
c) Les principes éthiques de la loi de bioéthique de 1994 peuvent encadrer les sciences émergentes 471
PARTIE V : COMMENT RENFORCER LA VIGILANCE DES INSTITUTIONS ET FAVORISER LE DÉBAT ÉTHIQUE ? 473
CHAPITRE 10 – LA LOI BIOÉTHIQUE DE DEMAIN 473
A. CONFORTER LA LÉGISLATION BIOÉTHIQUE 473
1. Opter pour une loi soumise à évaluation 474
a) Écarter l’idée d’une loi-cadre 474
b) Écarter le principe d’une clause de révision périodique 476
2. Ratifier la convention d’Oviedo 479
a) La ratification par la France de la convention d’Oviedo aurait une signification importante 479
b) Les principaux obstacles à la ratification ont été levés 481
c) Les conditions de la ratification de la convention par la France 483
3. La portée de la dignité de la personne humaine et du consentement 486
a) La valeur constitutionnelle de la notion de dignité 486
b) Veiller au respect du consentement de la personne 488
B. RENFORCER L’IMPLICATION DU PARLEMENT DANS LE CHAMP DE LA BIOÉTHIQUE 491
1. Assurer une information permanente du Parlement 492
a) Développer le pouvoir d’alerte de l’ABM 492
b) Accroître les obligations d’information de l’ABM 493
c) Charger le CCNE de procéder à un examen régulier des enjeux éthiques de la loi 495
2. Affirmer la compétence du législateur 497
a) Ratifier les ordonnances modifiant la loi de bioéthique 497
b) Consulter le Parlement sur la nomination du directeur général de l’ABM 498
c) Contrôler l’application de la loi 499
C. FAVORISER LE DÉBAT ÉTHIQUE 502
1. Organiser le débat éthique 502
a) Le succès des États généraux de la bioéthique 503
b) Institutionnaliser la participation du public 504
c) Promouvoir la réflexion éthique au niveau régional 507
2. Diffuser les principes de la bioéthique auprès des professionnels et du grand public 508
a) La nécessité d’une meilleure formation des citoyens aux questions de bioéthique 508
b) Sensibiliser les professionnels aux enjeux éthiques de leurs disciplines 510
3. Promouvoir une réflexion éthique sur les recherches conduites ou financées par des Français dans des pays étrangers 511
a) Les carences de la législation actuelle en matière d’évaluation éthique 512
b) Instituer des dispositifs d’examen éthique des recherches menées dans des pays extracommunautaires 513
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 515
CONTRIBUTIONS DE MEMBRES DE LA MISSION D’INFORMATION 529
CONTRIBUTION DE M. ALAIN CLAEYS, PRÉSIDENT DE LA MISSION D'INFORMATION ET DES DÉPUTÉS DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE 529
CONTRIBUTION DE MM. SERGE BLISKO, VICE-PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION ET PATRICK BLOCHE, DÉPUTÉS DE PARIS 534
CONTRIBUTION DE M. XAVIER BRETON, DÉPUTÉ DE L’AIN 537
CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN, DÉPUTÉ DE LA MANCHE, SECRÉTAIRE DE LA MISSION D'INFORMATION …538
CONTRIBUTION DE M. JEAN-MARC NESME, DÉPUTÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE 540
CONTRIBUTION DE M. JEAN-FRÉDÉRIC POISSON, DÉPUTÉ DES YVELINES 542
CONTRIBUTION DE M. JEAN-SÉBASTIEN VIALATTE, DÉPUTÉ DU VAR, VICE-PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION 544
EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT 549
GLOSSAIRE 551
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 553
La bioéthique s’entend comme le champ des questions éthiques et sociétales liées aux innovations médicales impliquant une manipulation du vivant. Dans des matières aussi sensibles, peut-on définir des règles sans s’interroger au préalable sur la finalité des pratiques qui y ont cours ? Face à l’accélération des mutations de la science et des techniques dans des champs tels que la recherche sur l’embryon, la procréation médicale assistée ou la génétique, il revient au Parlement de définir les droits et obligations des personnes concernées par ces enjeux. Ces droits doivent s’exercer au regard des principes fondamentaux que sont la dignité de l’être humain, le respect dû au corps, la protection de l’embryon humain et l’intérêt de l’enfant. Dans un domaine où ne prévaut pas de consensus international, la loi française n’est pas contrainte de s’aligner sur des options retenues par certains pays, inspirées par une approche de l’éthique moins exigeante et moins régulatrice. Le législateur peut dès lors revendiquer dans ses décisions une spécificité influencée par nos valeurs ainsi que par notre culture juridique et médicale.
Parce que les enjeux sanitaires, juridiques, sociaux et économiques des innovations scientifiques et médicales sont multiples et parce que leurs retombées sur la santé et le corps social sont difficiles à apprécier par avance, le Parlement a pris le parti de la prudence. Dans ce contexte marqué par l’incertitude, il a fait le choix de procéder à une révision périodique de la loi. Une clause de rendez-vous de cinq ans a été ainsi introduite par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994. Ce n’est cependant qu’en 2004 que le législateur a pu édicter de nouvelles règles. La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 inscrivant pour la seconde fois une clause de révision à cinq ans, l’Assemblée nationale était tenue d’évaluer cette loi avant ce terme. Elle y était d’autant plus contrainte que le délai autorisant la recherche sur les embryons conçus in vitro et les cellules souches embryonnaires vient à échéance en 2011.
Pour préparer les modifications législatives susceptibles de voir le jour à l’issue de ce terme, une mission d’information de 32 députés a été constituée à l’initiative de la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale. Créée le 17 juin 2008, elle a procédé à de larges consultations. Elle s’est entourée des avis de chercheurs, de professionnels de santé, de juristes, de philosophes, de sociologues, de psychiatres, de psychanalystes, des représentants des religions, des courants de pensée et des associations de malades. Ces 108 auditions qui se sont déroulées entre le 15 octobre 2008 et le 15 décembre 2009 ont été retransmises pour la plupart d’entre elles sur la chaîne parlementaire et sur Internet. (2)
Ce travail succédait à la réflexion menée par le Comité consultatif national d’éthique (3), par l’Agence de la biomédecine (4) et par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (5). La démarche de cette mission d’information parlementaire s’inscrivait aussi parallèlement aux travaux conduits par le Conseil d’État (6) et aux conclusions des forums des États généraux de la bioéthique, qui se sont tenus au cours du premier semestre 2009 et ont alimenté une réflexion collective (7). Trois forums régionaux, à Marseille, Rennes et Strasbourg, réunissant des citoyens représentatifs ont porté respectivement sur la recherche sur les cellules souches et l’embryon, l’assistance médicale à la procréation, les greffes et la médecine prédictive. Le site Internet de ces États généraux a été visité par plus de 70 000 personnes et les espaces éthiques régionaux se sont particulièrement investis dans ce débat.
La multiplicité de ces contributions, auxquelles s’ajoutent les travaux des sociétés savantes et des associations de malades donne la mesure du travail de préparation de ce réexamen de la législation de bioéthique appelée à être adoptée en 2010. Il a intéressé, au-delà des chercheurs, du monde médical, universitaire et des juristes, tous nos concitoyens. Afin d’informer au mieux la représentation nationale et d’éclairer les décideurs, le présent rapport s’attache à dresser la synthèse de tous ces apports.
Pour les autorités politiques, procéder à l’évaluation des acquis et des perspectives de la biomédecine, c’est essayer de concilier plusieurs impératifs : s’attacher à ne pas surévaluer par avance les bienfaits des découvertes tout en favorisant la recherche, protéger les personnes les plus vulnérables et ne pas sous-estimer dans ces choix l’implication d’intérêts économiques dans un monde de plus en plus globalisé. C’est tenter de concilier plus globalement la recherche avec les finalités médicales et les principes éthiques. Sur un plan juridique, c’est tenir compte dans cette dialectique entre la recherche et l’éthique du principe de dignité et des règles qui en découlent. Sont rattachés à la dignité dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil constitutionnel en 1994, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de la personne humaine.
Dans cette démarche conformément à la nature même de l’éthique, les membres de la mission d’information sont restés toujours convaincus de la nécessité d’allier la réflexion au doute.
Parce qu’il avait considéré que ni la morale commune ni le droit positif n’offraient des garanties suffisantes pour assurer le bon usage des nouvelles techniques, le législateur en 1994 avait défini plusieurs principes qui constituent aujourd’hui le socle de notre législation : l’anonymat et la gratuité du don, le caractère libre et éclairé du consentement au don, l’interdiction des manipulations génétiques, la prohibition de la recherche sur l’embryon, l’encadrement de l’assistance médicale à la procréation et l’interdiction de la gestation pour autrui. L’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la convention internationale des droits de l’enfant ne saurait être occulté non plus dans un débat touchant à la procréation.
La loi de 2004 s’inscrit dans la continuité de celle de 1994. Tout en interdisant la recherche sur l’embryon, elle autorise pendant cinq ans une recherche encadrée sur des embryons surnuméraires. Elle prohibe le clonage thérapeutique. Elle élargit le champ du diagnostic préimplantatoire, celui-ci pouvant être réalisé dans l’hypothèse où l’un des parents aurait des ascendants immédiats victimes d’une maladie gravement invalidante à révélation tardive et mettant en jeu prématurément le pronostic vital. Elle organise une procédure d’information génétique familiale lorsqu’un membre de la famille est affecté d’une anomalie génétique grave. Elle met surtout en place un organe destiné à encadrer notamment les activités de recherche autorisées par la loi, l’Agence de la biomédecine. Si celle-ci reçoit les compétences autrefois dévolues à l’Établissement des greffes, son champ d’attribution s’étend à la reproduction, à l’embryologie et à la génétique. C’est à elle que revient, après avoir examiné les dimensions scientifiques et éthiques des projets qui lui sont soumis, le soin de délivrer des autorisations de recherche sur l’embryon.
En dehors même de l’obligation légale de révision, l’intervention du législateur en 2010 se justifie au regard de plusieurs autres considérations.
Si les équilibres prévalant depuis 2004 ne sont pas bouleversés, plusieurs tendances se sont dégagées au cours de ces dernières années au sein de la recherche justifiant que le Parlement se saisisse à nouveau de ces questions. Sur un plan scientifique on a assisté en effet depuis cette date à un double mouvement : la portée limitée des résultats de plusieurs recherches a modifié les données du débat qui dominaient l’élaboration de la loi de 2004 et en même temps les perspectives ouvertes par plusieurs évolutions scientifiques donnent raison à ceux qui ont attiré l’attention du législateur sur les risques que pourraient présenter certaines pratiques.
Ainsi à la différence de 2004, le débat autour du clonage thérapeutique a perdu de son acuité. À la suite notamment du discrédit jeté sur les recherches conduites par le professeur Hwang, ce thème n’a pratiquement pas été évoqué lors des travaux de la mission. De leur côté les retombées pour la thérapie cellulaire des recherches sur les cellules souches embryonnaires n’ont pas été à la hauteur des espoirs formés en 2004. À l’inverse, la communauté scientifique s’accorde à reconnaître beaucoup de potentialités aux cellules souches pluripotentes induites, découvertes en 2007, sans pour autant considérer qu’il faille arrêter toute recherche sur les cellules souches embryonnaires.
La recherche sur les sciences émergentes s’est accélérée et mérite que l’on s’interroge sur leur utilisation. Parce qu’elles ne répondent pas à la démarche réparatrice traditionnelle de la médecine mais ont pour ambition affichée, dans la perspective d’une société « posthumaniste », d’améliorer l’être humain, elles pourraient avoir de très nombreuses implications sur lesquelles la représentation nationale et à travers elle l’ensemble des citoyens se doit d’être éclairée.
La multiplication des tests génétiques et leur diffusion sur Internet sans aucun contrôle préalable sur la validité de leur contenu, constituent aussi une nouveauté par rapport à 2004. Le développement des biobanques justifie d’être analysé au regard du respect des droits de la personne. Les incertitudes entourant le statut juridique des recherches sur les embryons transférés in vitro auraient également tout intérêt à être levées.
Parmi les évolutions juridiques marquantes depuis 2004, on citera un arrêt de la Grande chambre des recours de l’Office européen des brevets du 25 novembre 2008 qui a jugé non brevetables les inventions biotechnologiques concernant des cellules souches conduisant à la destruction de l’embryon.
Parallèlement à ces évolutions scientifiques, médicales et juridiques, certaines demandes témoignent de nouvelles représentations de la part de la société et ont reçu un écho médiatique important. C’est vrai de la revendication de la gestation pour autrui de la part de femmes qui sont dans l’incapacité de procréer. Le législateur est également sollicité pour élargir l’accès de l’assistance médicale à la procréation aux femmes célibataires et aux couples homosexuels. Enfin si des dizaines de milliers d’enfants sont nés aujourd’hui d’une assistance médicale à la procréation avec don anonyme de gamètes, des voix se font entendre pour permettre à ceux qui le réclament d’accéder à leur origine. Ces demandes ont pour point commun de privilégier le sociétal sur le médical et de s’inscrire dans une démarche qui fait prévaloir la relation personnelle et le contrat privé sur la règle générale.
Certaines de ces questions dépassent les seuls enjeux de la stérilité du couple auxquels obéissaient jusqu’ici une grande part des débats de bioéthique. C’est particulièrement vrai de la gestation pour autrui et de l’élargissement de l’assistance médicale à la procréation, qui sont invoqués pour satisfaire une demande de parentalité. Il appartiendra au législateur en 2010 de considérer ou non que ces questions peuvent être traitées dans le cadre de la bioéthique et de dire si la médecine a pour vocation de répondre à des problèmes d’infertilité par des techniques médicales appropriées ou si elle doit aller au-delà, en proposant des réponses sociales en matière de procréation.
C’est l’un des enjeux de cette révision législative et l’originalité de celle-ci par rapport aux lois qui l’ont précédée. Elle fait apparaître plusieurs oppositions. Entre les tenants du lien génétique et les personnes attachées au primat de l’éducation. Entre la revendication de désirs individuels et l’expression d’une demande de soins pour venir à bout de pathologies. Entre la fiction de la création d’êtres aux facultés augmentées et la protection des plus vulnérables. Entre un discours qui prône l’autonomie de la personne et une vision de la société fondée sur un projet collectif.
Dans la mesure où la mission d’information parlementaire a pour ambition d’analyser les applications de la loi du 6 août 2004 et leurs perspectives, elle a procédé à cette évaluation à travers cinq thèmes de réflexion :
– le désir d’enfant et le droit à l’enfant, dans le cadre des pratiques d’aide médicale à la procréation (chapitre 1) et de la gestation pour le compte d’autrui (chapitre 2) ;
– l’exploitation des données génétiques pour les diagnostics prénatals (chapitre 3) et, plus généralement l’examen des caractéristiques génétiques (chapitre 4) ;
– l’utilisation du corps humain dans un but médical et de recherche. Sont évoquées à ce titre la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires (chapitre 5) ; la brevetabilité des éléments et des produits du corps humain (chapitre 6) ; les greffes d’organes et de tissus (chapitre 7) ainsi que diverses pratiques mettant en cause le respect et l’identité du corps de la personne décédée (chapitre 8) ;
– les questions éthiques soulevées par les sciences émergentes
– neurosciences et nanotechnologies – et les conséquences de la convergence des technologies (chapitre 9) ;
– les procédures susceptibles de renforcer la vigilance des institutions et de favoriser le débat éthique (chapitre 10).
*
* *
PARTIE I : DÉSIR D’ENFANT ET DROIT À L’ENFANT
« Ce serait théoriquement l’un des plus grands triomphes de l’humanité, l’une des libérations les plus tangibles à l’égard de la contrainte naturelle à laquelle est soumise notre espèce, si l’on pouvait élever l’acte de la procréation au rang d’une action volontaire et intentionnelle. »
Sigmund Freud (8)
Existerait-il un droit à l’enfant différent du désir d’enfant ? Que faire des quelque 155 000 embryons actuellement congelés en France ? De quelle façon pourrait-on mieux remédier à l’infertilité, mais aussi tenter de la prévenir ? Faut-il opposer les droits de l’enfant au « droit à l’enfant » ? Comment freiner le développement inquiétant d’un véritable « Baby business », qui génère plus de trois milliards de dollars de chiffre d’affaires aux États-Unis (9) ? Une femme peut-elle porter l’enfant de sa fille ? Doit-on autoriser l’insémination et le transfert post mortem d’embryon ?
Les progrès de la médecine et de la biologie de la reproduction soulèvent des questions majeures, qui sont au cœur du débat bioéthique.
Historiquement, c’est d’ailleurs le développement de l’assistance médicale à la procréation qui a conduit à rassembler les questions soulevées par les avancées de la connaissance dans le domaine des sciences du vivant, en favorisant une réflexion bioéthique. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a été ainsi créé en 1983, moins d’un an après la naissance en France du premier enfant conçu par fécondation in vitro, prélude à l’élaboration progressive d’un encadrement normatif.
Si ces avancées favorisent l’émerveillement, la fascination, elles suscitent aussi l’angoisse et la prise de conscience plus ou moins aiguë d’une responsabilité nouvelle, inédite sans doute dans l’histoire de l’humanité. Comme l’a souligné Mme Sophie Marinopoulos (10), psychanalyste, « notre maîtrise scientifique est telle que l’on sait maintenant « faire » des enfants hors corps, hors sexe, hors vie ».
Avec la contraception et l’interruption volontaire de grossesse, le développement des techniques d’aide à la procréation traduit en effet une rupture dans l’histoire des sociétés humaines, en permettant de dissocier la sexualité et la procréation et, dans une certaine mesure, de choisir ou non d’avoir un enfant. La procréation s’identifie de plus en plus à une « action volontaire et intentionnelle », comme l’avait imaginé Sigmund Freud.
Faut-il franchir une nouvelle étape et permettre la dissociation de la gestation et de la procréation en légalisant les mères porteuses ?
Le développement des diagnostics prénataux a encore élargi le champ des possibles, les techniques permettant désormais de prévenir la naissance d’un enfant atteint d’une maladie particulièrement grave, mais aussi de choisir l’enfant à naître en fonction par exemple de son absence de prédisposition à certaines maladies et même de son sexe. (11)
Or comme l’a fait valoir Mme Monique Canto-Sperber, philosophe et directrice de l’École normale supérieure (12), ces avancées ne sont pas neutres car « chaque fois qu’une possibilité d’agir se substitue à une impuissance, se pose la question fondamentale des limites dans lesquelles doit être contenue cette nouvelle capacité d’action (…) En matière d’assistance médicale à la procréation, ces limites constituent aujourd’hui la principale question éthique. (…) Celles-ci doivent reposer sur des principes moraux clairs car nos contemporains n’acceptent que leurs préférences individuelles puissent être frustrées, et donc leurs libertés limitées, qu’à condition que soit parfaitement établi le bien-fondé des limites posées. »
Sur quels principes peut-on dès lors fonder un encadrement des pratiques en matière de procréation ? La non instrumentalisation du corps d’autrui, la prise en compte de l’intérêt de l’enfant à naître ainsi que la non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments peuvent-elles, par exemple, contribuer à dessiner les contours de ces frontières éthiques ? Par ailleurs, dans le respect des principes qui seraient ainsi collectivement définis, comment apporter des réponses à la détresse des couples infertiles, en veillant notamment à garantir l’égalité d’accès aux soins sans céder à l’illusion d’une forme de scientisme tout-puissant ?
En d’autres termes, comment concilier des contraintes éthiques avec des revendications individuelles et s’assurer que les progrès des sciences et des techniques en matière de procréation soient aussi un progrès pour tous ?
*
* *
CHAPITRE 1 – L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
L’encadrement actuel de l’assistance médicale à la procréation (AMP) résulte essentiellement des premières lois de bioéthique du 29 juillet 1994, qui n’ont été que légèrement modifiées dans ce domaine par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la création de l’Agence de la biomédecine ayant incontestablement permis de mieux contrôler et suivre ces activités.
Les évolutions sociales et scientifiques intervenues depuis 1994, le développement du recours aux techniques d’aide à la procréation, grâce auxquelles plus de vingt mille enfants sont nés en 2007, soit 2,5 % de l’ensemble des naissances ainsi que l’examen de la mise en application des lois de bioéthique peuvent conduire à s’interroger sur l’opportunité de réviser ou d’apporter certains aménagements à la législation actuelle.
Quatre thèmes retiennent principalement l’attention : serait-il tout d’abord envisageable d’élargir les conditions d’accès à l’AMP ? Comment améliorer la prise en charge de l’infertilité ? Quels sont les enjeux éthiques soulevés par la congélation des embryons surnuméraires ? Faut-il reconsidérer les principes d’anonymat et de gratuité du don de gamètes ?
A. FAUT-IL ÉLARGIR LES CONDITIONS D’ACCÈS À L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION ?
Si l’AMP est aujourd’hui considérée comme un acte médical ayant principalement pour objectif de suppléer l’altération de processus naturels de la reproduction humaine, plusieurs personnes auditionnées par la mission ont suggéré d’assouplir les conditions d’accès à ces techniques, jugées trop strictes, voire toutes « obsolètes (13) ».
Ces demandes portent sur les dispositions de la loi relatives à la stabilité du couple et l’âge de procréer ainsi que sur la possibilité d’autoriser la procréation post mortem ou l’accès à l’AMP pour les femmes seules et les couples de même sexe. Elles conduisent aussi à se poser la question suivante : en matière de procréation, « dans quelle mesure peut-on ne pas prendre en compte la différence des sexes, des générations, mais aussi des vivants et des morts (14) ? »
1. L’encadrement actuel : l’assistance à la procréation comme réponse médicale à un problème médical
Quelles sont les conditions actuelles d’accès aux techniques d’aide à la procréation et conviendrait-il de modifier la loi afin de préciser leurs finalités ?
a) Les conditions médicales et sociales d’accès aux techniques d’aide à la procréation
L’AMP recouvre les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. L’insémination artificielle et la fécondation in vitro (FIV) constituent les principales techniques d’aide à la procréation.
LES PRINCIPALES TECHNIQUES D’ASSISTANCE À LA PROCRÉATION | |
Pratiquée dans les CECOS depuis les années 1970, cette technique consiste à déposer des spermatozoïdes dans la cavité utérine (insémination intra-utérine) ou au niveau du col (insémination intra-cervicale) au moment de l’ovulation. La fécondation a donc lieu in utero. L’insémination artificielle peut avoir lieu avec le sperme du conjoint (IAC) ou celui d’un donneur (IAD), en particulier si le sperme du conjoint est dépourvu de spermatozoïdes (azoospermie) ou s’il est porteur d’une maladie génétique dominante sévère et que le couple souhaite éviter tout risque de transmission à l’enfant. L’insémination peut être pratiquée par les gynécologues, sans hospitalisation. Afin de l’optimiser, elle est le plus souvent précédée d’une stimulation ovarienne. Dans le cas général, le sperme est recueilli et préparé dans un laboratoire le jour de l’insémination. | |
Ÿ Fécondation in vitro (FIV) |
La FIV consiste à prélever un ovule en voie de maturation pour le placer dans une éprouvette au contact des spermatozoïdes. Elle comprend plusieurs étapes pratiquées dans un centre clinique et un laboratoire de biologie (appartenant à un même établissement ou associé par convention) : stimulation ovarienne, ponction des follicules (qui contiennent les ovocytes), préparation des gamètes en laboratoire, mise en fécondation, développement embryonnaire, transfert d’un embryon deux à trois jours après la ponction. En l’espace de trente ans, les techniques de FIV se sont diversifiées, avec en particulier l’apparition en 1992 de l’injection intra-cytosplasmique de spermatozoïdes (ICSI), qui consiste à sélectionner un seul spermatozoïde et à l’introduire directement dans l’ovule en « forçant » le processus de fécondation, ou encore l’IMSI, qui consiste à observer à un très fort grossissement et à choisir le spermatozoïde qui sera injecté dans l’ovocyte par ICSI. |
● Les conditions médicales
Conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, l’AMP est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple, deux cas de figure étant susceptibles de justifier le recours à ces techniques :
– une infertilité pathologique a été médicalement diagnostiquée ;
– il existe un risque de transmettre une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à l’un des membres du couple, ces dernières dispositions ayant été introduites par la loi de 2004 afin de permettre à des personnes atteintes de maladies virales, telles que le VIH ou les hépatites, de bénéficier d’une aide à la procréation.
Ainsi, « l’AMP n’est pas un soin de confort, c’est la réparation de la défaillance d’une des fonctions essentielles de l’espèce humaine, la reproduction, dont des personnes se sont trouvées privées par la maladie », comme l’a souligné Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l’Agence de la biomédecine (15).
Corollaire de cette conception de l’AMP comme thérapie, ces techniques sont aujourd’hui prises en charge par l’assurance maladie (16). La générosité de notre système de soins a été particulièrement mise en exergue par M. François Olivennes (17) : « la France dispose d’un système de remboursement extraordinaire que tout le monde nous envie : une tentative de FIV à New York coûte 15 000 à 20 000 dollars, alors qu’elle est gratuite en France. »
● Les conditions sociales
Conformément au dernier alinéa de l’article L. 2141-2 précité, l’accès à ces techniques est réservé aux couples composés d’un homme et d’une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
Il en résulte que le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’AMP, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons.
Ainsi, l’encadrement issu des lois de 1994 traduit l’idée que la procréation naturelle doit constituer le cadre de référence de l’AMP, les limites apportées à l’une pouvant se justifier par comparaison avec l’autre.
b) La finalité médicale de l’AMP
Au cours des travaux de la mission, les dispositions de la loi définissant les finalités de l’AMP ont suscité deux séries de questions.
La finalité première de l’AMP est-elle de répondre à une infertilité pathologique ou à une demande parentale ?
Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, les membres du panel citoyen du forum de Rennes sur l’AMP ont jugé « essentiel que l’assistance médicale à la procréation reste réservée aux cas d’infertilité médicale », en soulignant qu’elle « ne doit pas être considérée comme une solution à tous les désirs d’enfants ».
Si, comme le relève le rapport final des États généraux de la bioéthique (18), les citoyens ont reconnu que le désir d’enfant était naturellement une raison essentielle de recourir à l’AMP, ils ont considéré que la satisfaction de ce désir était une conséquence possible de l’AMP et non pas sa finalité première. L’expression d’une demande ne suffit pas, selon eux, à justifier l’usage de ces techniques.
Or il apparaît que la loi ne traduit qu’imparfaitement cette conception de l’AMP. En effet, cet article prévoit, dans son premier alinéa, que « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple », avant de préciser, à l’alinéa suivant, les raisons médicales justifiant le recours à ces techniques (remédier à une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée ou éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité).
La rédaction de l’article L. 2141-2 pourrait être aménagée afin de poser plus clairement la finalité de l’AMP, considérée comme un traitement médical palliatif de l’infertilité naturelle.
Proposition n° 1.
Poser dans la loi que la finalité du recours à l’AMP est d’ordre médical et que la demande parentale d’un couple n’est recevable que dans ce cadre. (Cela exigerait une modification des deux premiers alinéas de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique consistant à faire apparaître en premier la raison médicale du recours à l’AMP).
2. Faut-il assouplir la condition relative à l’existence d’un couple marié ou en mesure de prouver une vie commune d’au moins deux ans ?
Pour pouvoir recourir à la procréation assistée, l’homme et la femme formant le couple doivent être « mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans ». Au regard notamment des évolutions sociales et juridiques intervenues depuis 1994 mais aussi de certaines difficultés rencontrées dans la mise en application de ces dispositions, ces conditions devraient-elles être modifiées?
a) Le critère de durée de vie commune pour les couples non mariés
Au-delà des interrogations portant sur leur bien-fondé (cf. infra), les dispositions de la loi subordonnant l’accès à l’AMP des couples non mariés à l’existence d’une durée minimale de vie commune, soulèvent certaines difficultés aux praticiens qui sont tenus de la vérifier.
Tout d’abord, les équipes médicales se fondent aujourd’hui sur des documents de nature diverse – une facture, un contrat de bail ou un certificat de concubinage – en se montrant plus ou moins exigeantes ; en l’absence de document officiel permettant de prouver l’existence de la condition requise, le principe qui prévaut est celui de la liberté de la preuve. En effet, l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP prévoit, dans son annexe, que les pièces exigées avant le recours à l’AMP comportent notamment un justificatif du mariage ou « tout document » apportant les éléments en faveur d’une durée de vie commune d’au moins deux ans, sans autre forme de précision.
Ainsi, M. Jean-François Guérin (19), chef du service de biologie de la reproduction de l’hôpital de Bron, a indiqué que, dans la plupart des centres, « l’attitude des équipes médicales est fondée sur la confiance. On demande au couple une preuve de vie commune, sous la forme de quittances, par exemple, mais aussi, souvent, d’une attestation sur l’honneur. Il ne nous revient pas de diligenter une enquête pour vérifier qu’un couple qui se prétend stable vit bien ensemble depuis au moins deux ans. » Par ailleurs, comme l’a souligné Mme Dominique Mehl (20), sociologue, « un certificat de concubinage est très facile à établir et n’a donc pas beaucoup de valeur juridique ». Mme Dominique Lenfant (21), présidente de l’association Pauline et Adrien, a également estimé qu’il y a « de faux certificats de concubinage et les témoins peuvent être des passants ou des employés de mairie. »
De plus, la rupture de la vie de couple fait en principe obstacle à la mise en œuvre d’une technique d’AMP mais dans les faits les équipes médicales n’ont aucun moyen officiel d’être informées de l’existence d’une requête en divorce ou en séparation de biens ou de la cessation de la communauté de vie. C’est donc en pratique le recueil du consentement du couple qui tient lieu de vérification du maintien d’une vie commune.
Mme Dominique Mehl a considéré que « la condition du concubinage stable et avéré depuis deux ans n’a jamais été appliquée : les médecins ne se sont jamais résignés à demander aux gens d’apporter la preuve de leur concubinage, considérant qu’ils n’avaient pas à entrer dans l’intimité des couples. » En effet, les difficultés rencontrées dans la mise en application de ces dispositions de la loi s’expliqueraient aussi en partie par les réserves de praticiens, qui contestent dans certains cas leur bien-fondé et considèrent qu’en tout état de cause, la vérification de la vie commune ne doit pas incomber au corps médical.
Ainsi, Mme Joëlle Belaisch-Allart (22), chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Sèvres, s’est élevée contre ces dispositions, en déclarant : « nous, médecins, ne souhaitons pas être transformés en policiers, exigeant des pièces justificatives dont nous ne savons pas exactement lesquelles sont valables. ». Dans le même sens, Mme Jacqueline Mandelbaum (23), chef du service d’histologie et de biologie de la reproduction de l’hôpital Tenon et membre du CCNE, a fait part de son expérience dans ces termes : « nous leur faisons bien évidemment signer des déclarations, mais nous ne sommes pas officiers d’état civil ! Le respect d’une obligation aussi précise est difficile à vérifier, même si l’exigence d’une réflexion minimale ou d’une vie commune d’une certaine durée comme préalable à ce projet procréatif est tout à fait légitime ».
Il semblerait ainsi que si les praticiens s’accordent à 80 % sur la nécessité d’une certaine durée de vie commune, selon Mme Joëlle Belaisch-Allart, « quasiment tous jugent deux ans excessifs et estiment qu’il n’appartient pas au corps médical de s’en assurer ».
Dès lors, s’il était décidé de maintenir les dispositions de la loi relatives à cette durée minimale de vie commune, ne pourrait-on à tout le moins préciser dans une circulaire les critères ou documents à présenter pour aider les équipes médicales dans leur décision, comme le suggère le Conseil d’État dans son rapport de mai 2009 ?
b) Les critères de la stabilité et de l’infertilité du couple
• Le critère de la stabilité du couple
La durée minimale de vie commune pour les concubins peut être rapprochée des deux ans médicalement reconnus comme nécessaires pour évoquer chez un couple une difficulté à procréer et envisager des explorations en vue du diagnostic d’une éventuelle infertilité, comme l’a rappelé l’Agence de la biomédecine, dans son rapport d’octobre 2008 sur l’application de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Dans ce sens, Mme Chantal Lebatard (24), a estimé qu’« une stérilité doit se prouver par un temps suffisamment rigoureux de vie commune. »
Ces dispositions de la loi peuvent également être interprétées comme visant à protéger l’enfant, en veillant à ce qu’il soit accueilli par un couple aussi stable que possible. Certes, la durée de deux ans de vie commune n’est pas requise dans le cas de couples mariés mais le législateur a sans doute considéré que la stabilité est mieux garantie en cas de mariage que dans les autres formes de vie de couple. À cet égard, M. Xavier Lacroix (25), théologien, professeur d’éthique à l’université catholique de Lyon, a observé que « l’exigence de deux ans de vie commune, bien que légère et fragile, avait au moins le mérite de rappeler que l’enfant, né d’une union, a intérêt à être élevé par un couple, en principe le couple parental ». Il a rappelé que la convention internationale des droits de l’enfant prévoit que l’enfant a, dans la mesure du possible, « le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
Pour des raisons différentes, Mme Geneviève Delaisi de Parseval (26) a également estimé que « la demande parentale devrait émaner d’un couple stable –le délai requis de deux ans (…) semble d’ailleurs un peu insuffisant –, de préférence marié : en un sens je préférerais que la loi, comme elle le fait pour l’adoption, exige le mariage pour l’accès à l’AMP, car la filiation d’un enfant est plus solide quand ses parents sont mariés – le PACS n’ayant pas d’effet sur la filiation. (…) Il me semble important qu’un enfant ait deux parents, que ce couple soit stable, et que le législateur se donne les moyens d’aider ce couple et de vérifier sa stabilité – à l’instar des entretiens psychologiques qui précèdent l’adoption. »
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont néanmoins contesté la pertinence des ces dispositions, en suggérant leur assouplissement.
Tout d’abord, la différence introduite entre les couples mariés dont la stabilité est présumée et qui peuvent accéder à l’AMP dès le lendemain de leur mariage, et les couples non mariés, qui doivent apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans, n’est pas toujours comprise dans la pratique. Cette exigence peut apparaître pénalisante pour les concubins qui doivent attendre deux ans avant de pouvoir commencer un traitement, alors que l’âge de la femme est un facteur important du succès de l’AMP et que cette démarche intervient souvent tardivement dans la vie d’une personne.
M. François Olivennes (27), par exemple, a regretté que prévale cette distinction, « comme si le mariage était un gage de longévité du couple ! Soit on demande deux ans de vie commune à tous, soit on ne les demande pas du tout. » En rappelant qu’il existe « des couples mariés qui vivent quinze jours par mois ensemble parce que leur mutation professionnelle les a envoyés chacun à un bout de la France », Mme Dominique Lenfant (28) s’est également interrogée sur le point de savoir si « l’AMP est là pour sacraliser le mariage ».
En effet, le mariage est aujourd’hui concurrencé par d’autres façons de former un couple : en particulier, la loi, en matière d’AMP, ne prend pas en compte le pacte civil de solidarité (PACS), lequel a connu un développement continu depuis sa création en 1999. À cet égard, Mme Joëlle Belaisch-Allart a jugé nécessaire de « tenir compte des évolutions sociales. La moitié des couples aujourd’hui, du moins en Île-de-France, ne sont pas mariés et ont le sentiment d’être discriminés en matière d’AMP », en soulignant en particulier que « la loi de 2004 ne reconnaît pas le pacte civil de solidarité (PACS) – il faudra y réfléchir ». À cet égard, M. Jean Hauser (29) a fait remarquer qu’« à part le droit de succession, il n’y a plus rien qui distingue le PACS du mariage, si bien qu’on se demandera bientôt pourquoi on choisit l’un plutôt que l’autre. »
• Le critère de l’infertilité du couple
Par ailleurs, les dispositions de la loi prévoyant que « l’infertilité pathologique du couple » doit avoir été « médicalement constatée » (article L. 2141-2) ainsi que les délais exigés avant la mise en œuvre de l’AMP, du fait des différents examens et démarches requis, pourraient suffire pour établir l’existence d’indications médicales et la réalité du projet parental. Mme Dominique Lenfant a rappelé que « c’est à la suite de très longs examens, pouvant s’étaler sur une période de quatre mois à un an, qu’un couple infertile se rend chez son médecin qui, au vu des examens, lui indique la meilleure façon pour les aider. C’est à ce moment-là qu’est remis au couple le consentement qu’il doit signer et rapporter un mois plus tard. Ce délai de réflexion me semble suffisant pour être convaincu que ce couple veut vraiment avoir un enfant. »
Enfin, plusieurs praticiens entendus par la mission ont indiqué que l’exigence d’une vie commune d’au moins deux ans est de fait contournée dans certains cas. Ainsi, M. François Olivennes (30) a expliqué que cette « cette disposition n’est pas respectée – par exemple, pour une femme de 38 ans qui vient de rencontrer l’homme de sa vie et qui devrait attendre encore deux ans pour être traitée. » Selon Mme Joëlle Belaisch-Allart (31), « comme chaque fois qu’on est obligé de contourner une loi, il faut se demander si celle-ci était vraiment nécessaire ou s’il n’y a pas une meilleure solution. La loi ne pourrait-elle pas là aussi prévoir que ces dispositions s’appliquent « sauf exception dûment justifiée » ou « sauf dérogation », notamment pour les femmes de plus de 38 ans ? ».
De même, ces dispositions de la loi poseraient des difficultés lorsqu’un traitement susceptible d’altérer la fertilité de la femme est envisagé. Ainsi, selon Mme Joëlle Belaisch-Allart, les praticiens seraient nombreux à souhaiter une dérogation à ces conditions strictes, dans le cas notamment de survenue d’un cancer. Elle a illustré ainsi cette situation : « lorsqu’une femme de 36 ans apprenant qu’elle a un cancer du sein qui exige une chimiothérapie, nous demande une FIV d’urgence, nous n’exigeons bien sûr pas le délai de réflexion d’un mois non plus que, si elle n’est pas mariée, les preuves d’une vie commune depuis au moins deux ans. (…) Nous agissons alors dans l’illégalité. Peut-être suffirait-il que la loi précise que ces dispositions valent " sauf exception justifiée. " »
• Au regard de ces interrogations, dans quel sens les dispositions de la loi pourraient-elles être modifiées ?
Dans son étude de mai 2009 sur la révision des lois de bioéthique, le Conseil d’État a jugé préférable de conserver dans la loi le principe d’une période minimale de deux ans de vie commune. Il a proposé néanmoins de compléter le dispositif en prévoyant que les couples ayant conclu un PACS puissent accéder à l’AMP, comme les couples mariés, sans condition relative à la durée de vie commune. Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports, a rejoint le Conseil d’État sur ce terrain lors de son audition. (32)
Il aurait également pu être envisagé de remplacer la référence actuelle de la loi à un délai fixe de vie commune par les critères exigés par l’article 515-8 du code civil, qui définit le concubinage comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ». Cependant comment cette condition serait-elle appréciée par les équipes médicales et ne présente-t-elle pas l’inconvénient majeur de conduire à des pratiques hétérogènes sur l’ensemble du territoire ?
Une autre modification consisterait à compléter les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique réservant l’accès à l’AMP aux couples mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans. Il pourrait être reconnu un pouvoir d’appréciation à l’équipe médicale sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, par exemple en raison de l’âge avancé de la femme.
Enfin, on pourrait imaginer supprimer les dispositions de la loi concernant la nécessité pour les concubins d’être en mesure de prouver une vie commune d’au moins deux ans, en considérant que l’infertilité pathologique devrait en tout état de cause être médicalement constatée par les professionnels. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique, l’Assemblée nationale avait supprimé cette exigence en première lecture, en 2002, le Sénat l’ayant finalement rétablie.
Votre rapporteur estime qu’il convient de maintenir la condition de stabilité du couple, le critère des deux ans étant médicalement justifié. Néanmoins, il est souhaitable que le dispositif d’accès à l’AMP ne différencie plus les couples pacsés des couples mariés. Par ailleurs, il suggère d’ouvrir des exceptions pour raisons médicales ou d’âge.
Proposition n° 2. Assouplir les conditions que les couples doivent remplir pour accéder à l’AMP : ne plus exiger deux ans de vie commune pour les couples pacsés et, dans les autres cas, admettre des exceptions pour raisons médicales ou d’âge.
La majorité des membres de la mission estime nécessaire de maintenir la condition selon laquelle le couple doit être formé d’un homme et d’une femme.
Une partie des membres de la mission s’est déclarée favorable à l’accès des femmes célibataires infertiles à l’AMP (33).
3. Les limites biologiques et temporelles de la procréation doivent-elles être repoussées?
a) L’« âge de procréer » : critère biologique ou exigence sociale ?
Les dispositions de la loi réservant l’accès à l’AMP aux personnes en âge de procréer (article L. 2141-2 du code de la santé publique) soulèvent plusieurs questions.
Tout d’abord, Mme Marie-Pierre Micoud (34), co-présidente de l’Association des parents gays et lesbiens (APGL), a suggéré de remplacer ces dispositions par une référence aux personnes « en âge d’être parent », en faisant notamment valoir que « les conditions de recours à l’AMP et au don de gamètes doivent prendre en considération les progrès de la science qui permettent d’accroître l’espérance et la qualité de vie ainsi que l’âge de procréation pour les hommes comme pour les femmes. Le critère qui doit prédominer est que l’enfant soit accueilli par des adultes en mesure de l’accompagner jusqu’à l’âge où il sera autonome. »
Toutefois, comme l’a souligné l’Agence de la biomédecine, dans son bilan d’application de la loi du 6 août 2004, des préoccupations sociales et éthiques ont conduit à retenir la notion de couples « en âge de procréer ». Elle répond au souci d’éviter que les femmes ménopausées aient recours à l’AMP. Cette crainte n’a du reste rien d’hypothétique, puisqu’en effet grâce à des dons d’ovocytes, des femmes d’un âge avancé peuvent désormais être enceintes. Ainsi, en Inde, une femme de 70 ans a donné naissance à son premier enfant en 2008, et la même année, une femme de 59 ans a accouché en France de triplés après avoir bénéficié d’un don d’ovocytes au Vietnam. Par ailleurs, par qui et sur quels critères la notion d’« âge d’être parent » serait-elle appréciée ? Celle-ci serait susceptible d’interprétations variables et serait surtout extensive, allant à l’encontre de l’idée selon laquelle l’AMP doit être réservée aux infertilités pathologiques, ce qui ne serait pas le cas des femmes dont l’âge seul est à l’origine de l’infertilité.
Il convient en conséquence de maintenir les dispositions de la loi relatives à l’âge de procréer. Leur application semble toutefois soulever des difficultés pour les praticiens, auxquels il incombe d’apprécier si les membres du couple sont ou non en âge de procréer. Selon Mme Chantal Lebatard (35), cette question « ne doit pas être abordée sous l’angle social, mais bien sous l’angle médical – la décision médicale devant déterminer l’âge de procréer pour une femme et pour un homme au cas par cas. »
En particulier, les différences éventuelles d’appréciation entre les centres d’AMP pourraient entraîner des inégalités de traitement entre les couples. M. Pierre Jouannet (36) a par exemple indiqué que « certains centres sont plus stricts que d’autres s’agissant de l’âge des femmes, si bien que leurs résultats sont meilleurs ». Cela pourrait conduire à s’interroger sur l’opportunité de fixer une limite normative d’âge pour bénéficier des traitements d’aide à la procréation.
On rappellera que, conformément à une décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), les fécondations in vitro (FIV) ne peuvent être prises en charge après le quarante-troisième anniversaire de la femme ou après la quatrième tentative de FIV. Pour les hommes, les équipes médicales ne prennent pas en charge, dans la pratique, de couples dont l’homme a dépassé soixante ans, selon l’Agence de la biomédecine ; les CECOS ont également limité depuis longtemps l’âge des donneurs de sperme à 45 ans, plusieurs études montrant l’impact de l’âge paternel sur la descendance.
En outre, la détermination, au niveau national, d’un âge limite ne permettrait pas de prendre en compte les différences clinico-biologiques pouvant exister entre les patients. Par ailleurs, le Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine (37) est défavorable à l’introduction d’une limite normative d’âge. La discussion des indications autant que la décision de mise en œuvre de l’AMP renvoient, selon lui, au seul discernement que permet le colloque singulier, le clinicien et l’équipe médicale étant tenus de respecter des règles de bonne pratique (38).
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont suggéré un assouplissement de la limitation à 43 ans de la prise en charge des actes de FIV par la sécurité sociale. Mme Dominique Mehl, sociologue, a par exemple souligné « le fait que la sécurité sociale retienne l’âge limite de 43 ans pour la prise en charge, ce qui conduit en fait les centres d’AMP à refuser les femmes à partir de 40 ans, est un énorme problème », qui serait « à l’origine de ce qu’on nomme terriblement le « tourisme procréatif », les femmes se rendant à l’étranger, notamment en Espagne, lorsqu’elles veulent bénéficier d’un don d’ovocyte ». Mme Laure Camborieux, présidente de l’association Maia, a souhaité que « la limitation en raison de l’âge et du nombre de traitements à partir de FIV soit revue et que les arrêts de traitement soient décidés en accord entre le médecin et le couple sur des critères biologiques – chances de réussite trop faibles, par exemple ».
À propos de la limite de 43 ans, Mme Dominique Lenfant (39), présidente de l’association Pauline et Adrien, a également jugé que « c’est une moyenne mais il est très difficile de faire entendre ce discours à un couple qui est dans la détresse. Une femme de trente ans peut avoir une ménopause précoce et être infertile alors qu’une femme de 45 ans peut être féconde. Si on augmentait un peu cet âge, cela permettrait aux couples d’être moins frustrés. »
Toutefois, au-delà du fait que les conditions de prise en charge des actes cliniques ou biologiques d’AMP par la sécurité sociale ne relèvent pas du champ des lois de bioéthique, il convient de rappeler qu’après 42 ans, les taux de grossesse s’effondrent, sans être nuls et que les taux de complications obstétricales et générales augmentent également.
À cet égard, Mme Joëlle Belaisch-Allart (40) a indiqué que « toutes les études internationales montrent qu’après 43 ans, il n’y a, avec ses propres ovocytes, quasiment pas de chance de parvenir à un accouchement. Les professionnels sont unanimes sur ce point » et que « les professionnels ne remettent pas en question cette limite d’âge, car les chances de succès sont trop faibles au-delà ».
ÉVOLUTION AVEC L’ÂGE DES TAUX DE SUCCÈS DE LA FIV EN INTRACONJUGAL
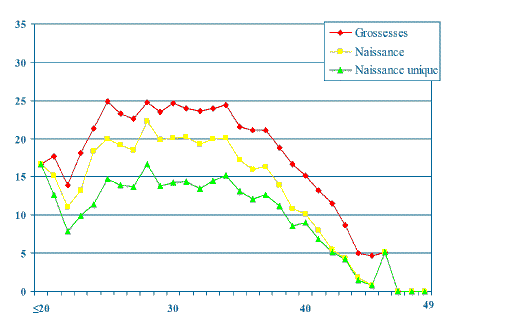
Source : audition de Mme Joëlle Belaisch-Allart du 31 mars 2009
M. François Olivennes (41) a rappelé de son côté que la fertilité de la femme baisse avec l’âge, « essentiellement parce que ses ovocytes se réduisent en quantité et en qualité » mais aussi du fait d’« un très fort taux de fausses couches et de complications obstétricales à un âge plus avancé ».
Repousser l’âge à partir duquel il est possible de recourir à l’AMP, en assouplissant les dispositions de la loi relatives à l’âge de procréer ou en reculant de plusieurs années l’âge limite de prise en charge par la sécurité sociale, pourrait également induire une pression accrue sur les dons d’ovocytes. Cela favoriserait une évolution vers une extension de l’accès à l’AMP pour des indications sociales, alors qu’elle est aujourd’hui considérée comme un traitement palliatif d’une infertilité pathologique.
Votre rapporteur estime par conséquent que repousser la limite d’âge à partir de laquelle les actes de FIV sont pris en charge ne renvoie à aucune nécessité, serait source d’illusions pour les femmes et constituerait une prise de risque inutile pour leur santé.
b) Procréer par delà la mort ?
Avant 1994, dans le silence des textes, les tribunaux avaient eu à connaître de demandes de femmes qui souhaitaient être inséminées avec les gamètes de leur mari ou concubin défunt. Ainsi, dans l’affaire Parpalaix (42), le Tribunal de grande instance de Créteil avait autorisé en 1984 la remise à une femme des paillettes de sperme de son défunt mari en vue d’une insémination, laquelle n’a d’ailleurs pas abouti, tandis qu’une demande analogue fut refusée à Toulouse (43).
En interdisant clairement la procréation post mortem – qu’il s’agisse de la fécondation ou du transfert d’un embryon congelé après la mort du géniteur – la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 a mis fin au risque de décisions de justice divergentes, même si la jurisprudence la plus récente se montrait plutôt défavorable à une telle pratique. L’article L. 2141-2 du code de la santé publique prévoit ainsi que l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, le décès d’un des membres du couple faisant obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons.
Y a-t-il lieu de reconsidérer ces dispositions ? En tout état de cause, il convient de distinguer deux situations qui soulèvent des interrogations éthiques de portée très différente : l’insémination et le transfert d’embryon post mortem.
● L’interdiction de l’insémination post mortem doit être maintenue
Très récemment, la justice a été saisie d’une demande présentée par une femme qui souhaitait récupérer les gamètes congelés de son mari décédé, afin de pouvoir se faire inséminer à l’étranger. Cette demande a été rejetée en raison de l’interdiction très clairement posée par la loi sur ce point (44). En effet, si l’on ne peut rester sourd à la douleur de ces femmes, l’insémination post mortem soulève de très lourdes objections éthiques.
En premier lieu, alors que le consentement libre et éclairé constitue l’un des principes cardinaux des lois de bioéthique, qu’en est-il en l’occurrence du consentement du défunt ? En particulier, le fait qu’une personne puisse recourir à une autoconservation de gamètes, lorsqu’une prise en charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité, ne peut être considéré comme équivalent à un consentement à l’utilisation de ses gamètes dans le cadre d’une AMP, quelques mois ou quelques années plus tard, alors que l’intéressé décédé ne pourrait donner son accord. Peut-on disposer ainsi des éléments du corps des morts? Et si l’on admet cette possibilité, en l’absence du consentement de la personne, devrait-on également autoriser l’insémination avec les gamètes de personnes plongées dans le coma ou encore permettre l’extraction de gamètes sur des corps morts ?
En deuxième lieu, la femme ne risque-t-elle pas de subir des pressions, notamment familiales, pour demander une telle insémination ? Dans ce sens, M. Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine (45), a indiqué que l’académie, par ailleurs favorable au transfert post mortem d’embryon, était en revanche opposée à l’insémination après la mort du conjoint car « des pressions extérieures fortes peuvent s’exercer sur la jeune femme ». Outre ce risque, sont également mises en avant des objections d’ordre psychologique, dès lors que la décision prise par la femme de concevoir pourrait n’être que le reflet d’une souffrance qui la conduirait à repousser le travail de deuil et pourrait l’empêcher d’envisager toutes les conséquences de sa décision.
En troisième lieu, la conception délibérée d’un enfant avec les gamètes d’un mort est-elle conforme à l’intérêt de l’enfant ? À cet égard, M. Philippe Bas (46) a expliqué la position du Conseil d’État contre toute forme de procréation post mortem (insémination ou transfert) par la volonté « de ne pas mobiliser le concours de la médecine et de la sécurité sociale pour concevoir des enfants sans père ». Autrement dit, s’il est vrai qu’il existe de fait des orphelins de père et que personne ne songe à retirer à une femme seule la garde de son enfant ou de faire avorter une femme enceinte si son conjoint décède pendant sa grossesse, on peut considérer que dans la procréation post mortem, il ne s’agit pas d’un accident de la vie ou d’un choix de la femme mais d’une situation créée et organisée par la société. Dans ces conditions, comment la société pourrait-elle endosser la responsabilité de permettre la conception délibérée d’un enfant orphelin conçu en outre dans un contexte très particulier de deuil ?
L’autorisation de l’insémination post mortem constituerait par ailleurs une exception à l’encadrement actuel de l’AMP, considérée comme un traitement médical pour des couples infertiles. Une fois l’insémination post mortem autorisée, faudrait-il ensuite envisager de permettre l’accès à l’AMP des femmes seules ?
Enfin, la possibilité de procréer par-delà la mort marquerait une importante rupture symbolique. Ainsi, M. Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre (47) a souligné qu’au regard des limites à poser, « la question est de trouver le cadre qui permettra des repères suffisamment clairs. Il ne faut pas céder sur les enjeux symboliques importants – la différence des sexes, ou la différence entre le vivant et le mort. Ainsi, les inséminations post mortem nous font franchir une limite. Or toutes ces limites sont liées les unes aux autres ». Ne faut-il pas en effet « respecter les limites qui sont celles même de la vie et que nous n’avons encore jamais transgressées », comme l’a fait valoir M. Jean-Luc Bresson (48) ?
Pour ces différentes raisons votre rapporteur estime qu’il convient de maintenir l’interdiction de l’insémination post mortem. Il n’en reste pas moins qu’il subsiste un problème d’information du couple.
Dans un cas dont la justice a été saisie très récemment, la femme qui souhaitait récupérer les gamètes de son mari décédé en vue d’une insémination post mortem a notamment fait valoir l’absence d’information claire, lors de l’autoconservation de gamètes, sur l’impossibilité d’utiliser les gamètes en cas de décès de la personne ayant fait procéder à celle-ci.
S’il semble que les centres informent en général la personne bénéficiant de la conservation de ses gamètes des conditions légales d’accès à l’AMP, aucune disposition du code de la santé publique n’impose actuellement la délivrance d’une telle information. En revanche, concernant l’impossibilité de procéder au transfert post mortem d’embryon, l’article L. 2141-10 du même code prévoit que lors des entretiens préalables à la mise en œuvre d’une AMP, le couple demandeur doit être informé de « l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d’un de ses membres ».
En conséquence, l’article L. 2141-11 pourrait être complété par un nouvel alinéa prévoyant l’information de la personne souhaitant faire procéder à une autoconservation de gamètes sur les conditions légales d’accès à l’AMP, voire sur la destruction de ses gamètes en cas de décès.
● En revanche, le transfert post mortem d’embryon pourrait être autorisé sous certaines conditions précises.
Dans le cas d’un transfert post mortem d’embryon, qui ne fait l’objet que de très rares demandes, il s’agit de permettre l’implantation, après le décès du conjoint, d’un embryon congelé, ayant été déjà conçu dans le cadre d’une AMP avant ce décès.
Cette possibilité suscite des réserves dont certaines sont communes à celles précédemment évoquées concernant l’insémination post mortem. Il en est ainsi du fait de permettre la venue au monde d’un enfant privé de père, des risques de pression sur la femme ou d’une décision prise sous l’émotion du deuil, encore qu’un délai de réflexion puisse être institué pour lui permettre de prendre plus sereinement sa décision. Ainsi, Mme Jacqueline Mandelbaum a jugé nécessaire, si un assouplissement devait être envisagé, de respecter au minimum un « temps de deuil, période lors de laquelle, comme [elle a] pu le constater dans [sa] pratique, les positions évoluent souvent ». Par ailleurs, de quelle façon les transferts post mortem pourraient-ils être encadrés ? Mme Carine Camby (49) a estimé que « ce débat est né de cas particuliers douloureux, peu nombreux mais très emblématiques, posant des problèmes de principe. On pourrait imaginer d’ouvrir cette possibilité à certaines personnes, dans un cadre très strict. Dans ce cas, une instance de régulation devrait apprécier les situations et tenter, en équité, d’y apporter une réponse, comme c’est le cas pour les donneurs vivants d’organes. Comment la loi peut-elle cependant encadrer des cas particuliers, dans le but de résoudre des situations de détresse individuelle, sans autoriser de dérives ? C’est la question qui se pose aussi sur la fin de vie. »
À ces réserves, s’ajoutent des interrogations spécifiques au transfert post mortem d’embryon. La première tient aux taux de succès limités des transferts d’embryons congelés (50). Si le transfert d’embryon échoue, ne risque-t-il pas d’être vécu comme un second deuil ? Il conviendrait, à tout le moins, de veiller à ce que la femme soit pleinement informée du fait que le transfert d’embryon peut ne pas conduire à la naissance d’un enfant.
En outre, en autorisant le transfert post mortem, risquerait-on d’entraîner du même coup l’augmentation des demandes de FIV ante mortem ? Ainsi, M. Jean-Luc Bresson (51), président de la Fédération nationale des CECOS, a jugé que « la position de repli de l’OPECST, qui envisage d’autoriser le transfert d’embryons post mortem dans le cas où le conjoint y aurait consenti avant son décès, (…) semble la pire des solutions, en dépit de sa prudence apparente. En effet, il y a un risque lié au fait que l’insémination serait interdite après le décès du conjoint, tandis que le transfert post mortem de l’embryon in utero serait autorisé. Depuis trente ans, nous voyons régulièrement des couples qui, face à une maladie grave, ont recours à l’autoconservation de spermatozoïdes ; nous savons comment les tentations de se précipiter dans une AMP surgissent lorsque le pronostic s’assombrit. On peut craindre que l’autorisation du transfert de l’embryon post mortem ne suscite des demandes de FIV ante mortem, ce qui à notre sens ne serait pas un service rendu à cette population de patients. »
Mme Dominique Regnault (52), présidente de la commission des psychologues de la Fédération des CECOS, s’est également interrogée sur la motivation de telles demandes : « S’agit-il bien de faire aboutir un projet d’enfant préexistant à la maladie ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une dénégation de la maladie et du deuil, ou d’une culpabilité de l’homme vis-à-vis de la femme, ou de la femme vis-à-vis de l’homme, ou d’un désir de lui venir en aide ? Dès lors, faute de pouvoir bien démêler ces motivations, on encourt la responsabilité de réunir tous les éléments d’un deuil impossible en cas de décès du conjoint et d’acculer la femme dans une situation sans issue ».
Il existe néanmoins des différences fondamentales sur le plan éthique entre l’insémination et le transfert post mortem, plusieurs arguments plaidant en faveur de l’autorisation de ce dernier.
En premier lieu, dans le cas du transfert, l’enfant aurait été conçu par AMP dans le cadre d’un projet parental, qui a été rompu par un décès brutal mais qui existait bien et résultait de la volonté exprimée par chacun des membres du couple.
En deuxième lieu, la disparition de l’homme ne fait pas disparaître les droits que la femme peut considérer avoir sur ses embryons, comme l’avait notamment fait valoir le CCNE (53). Certes, le projet parental est interrompu, mais l’homme disparu, on ne voit pas quelle autorité pourrait in fine faire prévaloir sur les embryons des droits égaux ou supérieurs à ceux de la femme à l’origine de leur conception.
Ainsi, la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme Valérie Pécresse (54), favorable au transfert, a jugé « extrêmement difficile sur le plan éthique que le législateur interfère dans la décision de la mère et puisse faire obstacle à son souhait d’avoir un enfant du père décédé ». Dans le même sens, M. Axel Kahn (55) a considéré que, « vu de l’extérieur, le mieux serait sans doute que la femme fasse le deuil du disparu et puisse aimer un autre homme avec lequel elle ait envie d’avoir un enfant. Mais si après lui avoir laissé le temps nécessaire, elle veut toujours un enfant de l’homme qu’elle a aimé – ce qui ne signifie pas qu’elle n’en aimera pas un autre – et qu’elle souhaite achever la mission qu’ils s’étaient tous deux assignée, en dépit des épreuves que représente la fécondation in vitro, je ne vois pas qui mieux qu’elle, aurait légitimité pour dire ce qu’il convient de faire de ces embryons congelés, en tout cas pas la République ! »
En troisième lieu, les répercussions psychologiques pour l’enfant né dans ce contexte ne semblent pas, selon Mme Geneviève Delaisi de Parseval (56), psychanalyste, se distinguer de celles qui affectent tout enfant orphelin : « il est clair qu’il vaut mieux avoir un père et une mère vivants ! Mais le transfert post mortem répond à un cas tout à fait particulier, à une « pathologie » de la médecine qui a créé des embryons congelés (...). Dans des cas si particuliers, et heureusement rares, je ne vois pas au nom de quoi on refuserait à une veuve le transfert de cet embryon conçu normalement. Qu’en est-il du point de vue psychologique ? J’ai travaillé sur la paternité avec l’historien Jean Delumeau, et dans ce séminaire (…), quelqu’un a étudié les enfants conçus pendant la Grande Guerre, et nés alors que leur père avait péri. Ils ont grandi avec une image héroïque de leur père défunt, avec sa photo posée sur le poste de radio. Or, l’étude montre que cette génération avait présenté une bonne santé sur le plan psychique. Or, les enfants issus d’un transfert post mortem savent qu’ils ont eu un père, ils savent qu’ils ont été fortement désirés, ils savent pourquoi il n’est pas là : il n’y a pas lieu de s’attendre à de gros problèmes – même si bien sûr il leur reste à faire un travail de deuil. »
En quatrième lieu, la possibilité de procéder ou non au transfert in utero d’un embryon ne doit pas s’évaluer dans l’absolu mais au regard d’autres voies possibles du devenir de l’embryon, personne humaine potentielle, à savoir la destruction, le don à la recherche ou l’accueil par un autre couple. En effet, à la différence de la situation créée par une demande d’insémination avec le sperme du conjoint décédé, les embryons ont été fécondés et existent déjà. La question est celle du devenir d’un embryon déjà conçu, et non de savoir s’il faut conserver ou non des gamètes. Dès lors, la destruction de l’embryon ou son accueil par un autre couple, alors que la femme qui est à l’origine de sa conception aurait souhaité le porter, n’auraient-ils pas pour effet d’ajouter au deuil un sentiment de profonde incompréhension ?
En cinquième lieu, des interrogations sur l’intérêt de l’enfant né dans un tel contexte exceptionnel sont légitimes mais, du point de vue de celui-ci, la mort accidentelle de son père pendant la grossesse ne le prive-t-elle pas de la même manière de sa présence, qu’elle soit survenue quelques jours avant ou après le transfert de l’embryon in utero ?
Enfin, plusieurs personnes auditionnées ont évoqué les difficultés juridiques qui seraient susceptibles de se poser en cas d’autorisation du transfert post mortem, du fait de la nécessité d’adapter le droit de la filiation et des successions (57). Ces difficultés n’apparaissent cependant pas dirimantes. Un dispositif complet régissant les successions dans cette situation avait été élaboré en collaboration avec la Chancellerie en 2002 et adopté à l’occasion de la première lecture du projet de loi de bioéthique. Il était prévu de geler la succession jusqu’à la naissance de l’enfant dans le cas où le père aurait consenti de son vivant à ce transfert et où la mère souhaitait qu’il soit réalisé. Les biens du défunt auraient été confiés à un administrateur désigné par le président du tribunal de grande instance.
En tout état de cause, elles n’ont pas empêché plusieurs pays européens d’autoriser le transfert post mortem d’embryon, sans que ceci ait, semble-t-il, entraîné de bouleversement du droit de la filiation.
LA PROCRÉATION POST MORTEM À L’ÉTRANGER
L’Allemagne, le Danemark, l’Italie et la Suisse prohibent explicitement l’insémination et le transfert d’embryons post mortem, tandis que la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni admettent ces pratiques. Dans chacun de ces quatre pays, la procréation post mortem est subordonnée à un accord exprès du mari ou du compagnon de la future mère, c’est-à-dire de l’homme qui devait devenir père. Par ailleurs, la période pendant laquelle l’insémination ou le transfert d’embryons post mortem est possible est limitée par la durée maximale de cryoconservation, en général fixée à cinq ans. La loi belge prévoit en outre un délai spécifique pour ces opérations, qui ne peuvent avoir lieu ni moins de six mois, ni plus de deux ans après le décès.
À l’exception de la loi espagnole, qui établit le lien de filiation entre l’homme décédé et le l’enfant si l’insémination ou le transfert d’embryons post mortem ont lieu moins de douze mois après le décès, les textes ne règlent pas cette question. La filiation des enfants ainsi nés doit donc être établie par voie judiciaire. C’est notamment le cas au Royaume-Uni qui a pourtant adopté une loi spécifique sur ce sujet en 2003 : désormais, en cas de procréation post mortem, certaines données d’état civil relatives au mari (ou au compagnon) de la mère peuvent être enregistrées, mais cette disposition, purement symbolique n’a aucune conséquence juridique.
Source : étude de législation comparée du Sénat n° 19, « L’accès à l’AMP » (janvier 2009)
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est donc envisageable d’autoriser le transfert post mortem d’embryons sous certaines conditions précises. La femme doit être en mesure de prendre une décision éclairée et autonome et il convient d’éviter de favoriser la naissance programmée d’enfants orphelins. Lorsque le décès du conjoint vient interrompre un projet parental déjà engagé et devant aboutir dans un bref délai à la naissance d’un enfant, il apparaît que le transfert d’embryon post mortem est éthiquement concevable. Ce droit pourrait s’exercer jusqu’à deux ans après le décès du conjoint, terme qui semble raisonnable pour assurer à la femme une liberté de choix compatible avec sa situation.
Un droit équivalent ne saurait être ouvert aux hommes ayant perdu leur épouse ou leur concubine. L’instauration d’une stricte égalité de droit supposerait en effet que soit reconnue à l’homme la possibilité de recourir à une gestation pour autrui.
Proposition n° 3.
Autoriser le transfert post mortem d’embryon à titre exceptionnel lorsque le projet parental a été engagé mais a été interrompu par le décès du conjoint. Encadrer cette procédure par des délais stricts : le transfert pourrait être autorisé par l’Agence de la Biomédecine après trois ou six mois de veuvage et être permis jusqu’à dix-huit mois ou deux ans après le décès du conjoint, afin notamment de permettre éventuellement une deuxième tentative. (L’autorisation du transfert post mortem nécessiterait une modification du dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique et une adaptation en conséquence du code civil en matière de successions et de filiation).
Maintenir l’interdiction de l’insémination post mortem.
Compléter la loi pour préciser qu’avant toute autoconservation des gamètes, le couple est informé des conditions légales d’accès à l’AMP et notamment que les gamètes conservés seront détruits en cas de décès. (Il conviendrait à cet effet de compléter par un nouvel alinéa l’article L. 2141-11 du code de la santé publique).
4. Faut-il mieux prendre en compte l’intérêt de l’enfant à naître ?
L’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée et ratifiée par la France en 1990, stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme l’a fait valoir Mme Monique Canto-Sperber (58), la meilleure manière de justifier la limitation apportée à l’exercice de la liberté individuelle est de se référer à quelques principes faisant très largement consensus. On peut, en ce sens, être tenté d’aller plus loin en déduisant de cet intérêt supérieur de l’enfant un intérêt de l’enfant à naître. Cet intérêt a également été évoqué par Mme Chantal Lebatard, administratrice de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)(59).
Si ce principe ne figure pas explicitement dans la loi, il en est fait mention à l’article L. 2141-10 du code de la santé publique. En vertu de cette disposition l’AMP ne peut être mise en œuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions exigées pour celle-ci ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs « dans l’intérêt de l’enfant à naître ».
On peut penser aussi que ce principe est implicitement contenu dans l’interdiction de l’insémination post mortem et du transfert in utero d’embryons ayant fait l’objet de recherches.
Plus généralement, M. Claude Huriet (60) a regretté que « l’enfant [ait] paradoxalement été le grand absent des lois de 1994 et 2004 et des débats sur ces lois. Il y est question du droit à l’enfant, jamais du droit de l’enfant. Or, ce qui importe le plus est-il le couple, capable de s’exprimer, ou l’enfant à naître qui, lui, ne le peut pas ? Toutes les nouvelles méthodes de procréation présentées comme un progrès pour les couples infertiles en sont-elles un pour les enfants à naître ? (…) le droit à l’enfant et le droit de l’enfant peuvent sans doute se rejoindre, mais ils peuvent aussi s’opposer. Or, jamais il n’a été question dans les débats parlementaires précédents du devenir des enfants conçus par AMP. Il n’est pas acceptable sur le plan humain de ne traiter dans la loi que du droit à l’enfant. »
De même, M. Pierre Lévy-Soussan (61) a jugé que pour « réviser les lois bioéthiques, il faut savoir si l’on doit prendre en compte toutes les demandes de tous les adultes et donc privilégier le désir d’enfant (…) ou au contraire si l’on doit privilégier l’enfant à venir et ses intérêts. On sait qu’il existe des enfants adoptables, du sperme congelé, des embryons implantables, des ovocytes qu’on peut donner, des mères porteuses, des législations différentes de la nôtre : c’est ce qui transforme souvent de nos jours le désir d’enfant en un certain droit à la technique. Mais il est important de ne pas perdre de vue que dans toutes ces nouvelles questions, l’enfant n’est pas là pour faire valoir ses droits et ses intérêts ».
La définition des intérêts d’un être qui n’existe pas encore est certes matière à débat. Son existence même dépend d’actions auxquelles se livreront ou non les individus en situation de désirer telle ou telle chose par rapport à lui. Leurs préférences présentes peuvent être opposées aux intérêts d’un être qui n’existe pas encore. Dans certains cas, il apparaît clairement que la satisfaction du désir des parents s’oppose aux intérêts de l’enfant à naître, par exemple lorsqu’un couple de malentendants sollicite un diagnostic préimplantatoire (DPI), afin d’avoir un enfant également malentendant. En d’autres termes, s’il est parfois difficile de s’accorder sur ce que sont les intérêts d’un être encore en puissance, un consensus peut cependant être trouvé pour ne pas mettre délibérément au monde, avec l’aide de la médecine et donc de la société, un individu dans des conditions reconnues comme dommageables. Il ne s’agirait cependant, en aucun cas, de remettre en cause, par ce biais, la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse.
Les britanniques ont intégré cette préoccupation dans leur législation relative à l’AMP. L’évaluation du bien être de l’enfant à naître est reconnue par la HFEA (Human fertilisation and embryology authority) comme un critère déterminant pour l’accès à l’AMP(62).
En rappelant que le principe de l’intérêt de l’enfant « n’a pas été inscrit dans le code civil », Mme Michèle Alliot-Marie (63), Ministre d’État, garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, a considéré que « c’est un principe abstrait et difficile à appréhender, mais nous y sommes très attachés » ; il permet « d’apprécier la frontière entre les procréations médicalement assistées susceptibles d’être autorisées et les interventions biomédicales qui reviendraient à consacrer une sorte de « droit à l’enfant », lequel a été écarté. »
Proposition n° 4. Prendre en compte dans la loi « l’intérêt de l’enfant à naître » dans les décisions relatives à l’assistance médicale à la procréation. (La référence à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant à naître dans les décisions relatives à l’assistance médicale à la procréation pourrait constituer un nouvel article L. 2141-1-1)
Une partie des membres de la mission s’est déclarée réservée sur l’opportunité de cette proposition.
5. Convient-il de répondre à l’« infertilité sociale » ?
Pourrait-on permettre aux femmes seules et aux couples de même sexe de bénéficier des techniques d’aide à la procréation ? Les interrogations suscitées par ces deux types de demandes apparaissent en définitive assez proches.
En Belgique, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les femmes seules ainsi que les couples homosexuels féminins peuvent bénéficier d’une aide à la procréation. Cette faculté existe depuis de nombreuses années dans tous ces pays, sauf au Danemark, où elle a été introduite en 2006.
Au regard de ces législations étrangères ou en faisant valoir les évolutions sociales intervenues depuis les premières lois de bioéthique de 1994, plusieurs personnes entendues par la mission ont souhaité que l’accès à ces techniques soit ouvert à toute femme en âge de procréer, quelle que soit sa situation conjugale.
Ainsi, Mme Dominique Mehl (64) a souligné que « l’interdiction de l’accès à l’AMP pour les célibataires (…) devient aujourd’hui de plus en plus difficile à justifier. La demande a en effet évolué. Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, il s’agissait d’une demande de type féministe, visant à faire un enfant sans homme – sans père et sans présence masculine. Maintenant, la demande émane plutôt de femmes sans conjoint, qui regrettent de ne pas avoir trouvé celui avec qui elles pourraient faire un enfant et qui sont confrontées à leur horloge biologique. (…) Ces femmes qui se dirigent vers la quarantaine se disent que le conjoint et père souhaité risque d’arriver dans leur vie quand elles ne seront plus en âge de procréer ; d’où l’idée d’inverser l’ordre d’entrée en conjugalité et en parenté, qui progresse dans la société, d’autant plus que l’entrée en maternité est de plus en plus tardive ».
Il convient également de rappeler que les femmes célibataires ont la possibilité d’adopter et que les familles monoparentales, constituées d’un parent élevant ses enfants sans conjoint, représentent une part croissante de l’ensemble des foyers français, soit désormais près d’une famille sur cinq ; dans la majorité des cas, c’est la mère qui vit seule avec les enfants (65).
Mme Marie-Pierre Micoud (66), coprésidente de l’Association des parents gays et lesbiens (APGL), a souhaité que « la loi évolue de façon à permettre l’accès à l’AMP et au don de gamètes et d’embryons à tout couple ou toute personne seule porteurs d’un projet parental, s’engageant à être parents des enfants qui en naîtront et en âge d’être parents ».
Mme Françoise Dekeuwer-Defossez (67) a par ailleurs jugé qu’« interdire l’accès à l’AMP pour les femmes célibataires et l’admettre pour les couples de concubins est, du point de vue du droit des femmes, très contestable. On peut concevoir le refus de procéder à une insémination artificielle chez une femme au motif qu’elle n’a pas de mari, mais pas au motif qu’elle n’a pas de concubin, car le concubinage n’a aucune portée juridique. D’ailleurs, n’importe quel partenaire pourrait jouer ce rôle. ».
Certains des arguments avancés en faveur de l’extension de l’accès de l’AMP aux femmes seules apparaissent toutefois contestables.
D’une part, le fait que d’autres pays autorisent l’accès à l’AMP pour les femmes seules ou les couples de même sexe et que la loi française puisse être contournée à l’étranger n’est pas, en soi, un argument recevable sur le plan des principes et n’implique pas en tout cas que la France doive nécessairement en faire de même. D’autre part, on peut estimer qu’il n’y a pas d’incohérence entre la possibilité d’adopter pour les femmes célibataires et le fait qu’elles ne puissent bénéficier des techniques d’aide à la procréation, tant il y a une différence fondamentale entre ces deux modes d’accès à la parentalité. Ainsi, l’adoption s’inscrit dans une logique de réparation d’un accident de la vie, la société étant collectivement responsable de l’avenir d’enfants déjà nés, en leur donnant une famille. Dans le cadre de l’AMP, il s’agit de prendre la décision de concevoir un enfant et à ce titre, la responsabilité de la société est de veiller à lui offrir ce qu’elle considère être les meilleures conditions possibles pour sa venue au monde.
Mme Corine Pelluchon (68), docteur en philosophie, a clairement exposé cette différence, en considérant que « c’est faire une confusion majeure que de mettre sur un même plan adoption et procréation médicalement assistée (PMA). L’adoption, c’est le fait de donner des parents à un enfant qui est déjà là et qui a été abandonné. Il est de notre responsabilité d’aider cet enfant qui a besoin d’un autre et de l’aide de la société. Avec les PMA, il s’agit d’aider un couple infertile à avoir un enfant. Dans l’adoption, c’est l’enfant qui prime et notre responsabilité envers lui est première par rapport au désir des adultes (…) Il y a une dissymétrie totale entre ces deux cas de figure et l’ouverture de l’adoption aux femmes célibataires n’implique pas l’accès des PMA aux célibataires et aux couples homosexuels. Si l’on est pour cette ouverture des PMA, il faut trouver un autre argument que celui-ci. »
Il importe, d’autre part, de mesurer pleinement la portée de cet élargissement de l’accès à l’AMP, qui peut sembler lourd de conséquences.
Tout d’abord, la possibilité pour toutes les femmes seules de bénéficier des techniques d’AMP conduirait à organiser la conception délibérée d’enfants privés de père, alors même que, depuis les premières lois de bioéthique, prévaut le principe « un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins », et qu’à ce titre, par exemple, toutes les garanties ont été apportées par la loi pour que l’enfant issu d’un don de gamètes ait deux parents et que sa filiation ne puisse être remise en cause.
La possibilité pour les célibataires de bénéficier des techniques de procréation assistée entraînerait aussi le recours accru aux AMP avec don de gamètes, ce qui, comme pour les couples de même sexe, suscite certains questions liées à la manière dont l’anonymat du donneur sera vécu par les enfants ainsi conçus, en l’absence de référent paternel.
Lors des États généraux de la bioéthique, les citoyens du forum de Rennes ont souligné l’importance de la notion de couple dans le développement de l’enfant. Ils se sont prononcés contre l’ouverture de l’AMP aux personnes célibataires, fertiles ou infertiles. Dans le même sens, Mme Geneviève Delaisi de Parseval (69) a considéré que « la notion de couple est très importante pour le devenir psychologique d’un enfant ».
En outre, permettre l’accès à ces techniques pour toutes les célibataires ne risquerait-il pas faire de l’AMP un mode de procréation en dehors de toute justification médicale, dès lors que la raison de la stérilité serait sociale et personnelle (le célibat) et non une infertilité pathologique ? Ne risquerait-on pas ainsi d’ouvrir la voie à des AMP « de convenance » visant à répondre à toute forme de désir d’enfant ? La médecine, la loi ont-elles pour vocation de répondre à des désirs individuels ?
On pourrait en effet considérer, ainsi que l’a fait valoir Mme Françoise Dekeuwer-Defossez (70), que « l’AMP pour un célibataire n’a aucun sens, sauf à adopter une logique de prestation de services. Dans ce cas, on peut considérer que l’équipe médicale fournit des gamètes à une personne qui, pour des raisons qui sont les siennes, n’a pas de partenaire. »
Il convient enfin de s’interroger sur les possibles répercussions de cet élargissement de l’accès à l’AMP à toute femme seule. En effet, l’exigence d’un couple vivant, qui fait obstacle à l’insémination post mortem, apparaît plus difficile à maintenir si les célibataires ont accès à l’AMP. En outre, un élargissement de l’accès de l’AMP aux femmes seules impliquerait la possibilité pour les femmes homosexuelles de bénéficier des techniques d’aide à la procréation. Une fois l’accès des couples de femmes autorisé de fait, sinon en droit, faudra-t-il autoriser ensuite le recours à la gestation pour autrui pour les couples d’hommes ?
Mme Françoise Dekeuwer-Defossez (71) s’est notamment interrogée sur ce point, en estimant que « si nous sortons du droit des couples, nous entrons dans un autre monde et nous perdons les repères qui nous permettent de fixer des normes. En quoi la demande d’une femme célibataire serait-elle plus juste que celle d’une veuve, ou que celle d’une femme homosexuelle vivant en couple ? Quant aux critères qu’il conviendra d’adopter pour classer les demandes, je n’en vois personnellement aucun, ce qui signifie que tous les cas seront acceptés. Mais, dans ces conditions, serons-nous contraints, par respect du principe de non-discrimination à l’égard des femmes célibataires, d’accepter le recours à la maternité pour autrui pour les couples homosexuels masculins ? »
Ne pourrait-on néanmoins permettre l’accès à l’AMP pour les femmes célibataires médicalement infertiles ?
Dans son rapport de novembre 2008 (72), l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a proposé d’ouvrir l’accès à l’AMP aux femmes célibataires médicalement infertiles avec un suivi psychologique. M. Claude Sureau (73) a soutenu cette proposition, en indiquant « avoir pu observer que les enfants élevés par des mères célibataires recevaient une éducation de grande qualité. Vous allez me dire qu’une femme célibataire qui veut un enfant peut très bien le faire sans utiliser la médecine. C’est une évidence, mais il faut considérer le cas des femmes célibataires et stériles, et c’est pour celles-ci que je partage totalement [cette] proposition d’autoriser ces femmes célibataires à recourir à l’AMP. »
Cet élargissement présenterait l’avantage de conserver le cadre médical d’accès aux techniques d’AMP. Toutefois, dans quelles conditions pourra-t-on constater l’infertilité pathologique de la femme ? L’introduction de telles dispositions pourrait-elle entraîner des inégalités entre les femmes selon la possibilité d’identifier ou non l’origine de la stérilité ? Il convient en effet de rappeler qu’il existe des infertilités inexpliquées au sein des couples qui recourent à l’AMP, lorsque l’on constate une impossibilité à procréer après plusieurs mois, en général deux ans, de rapports sexuels réguliers et que les explorations complémentaires réalisées dans la recherche diagnostique n’ont pas identifié de problème particulier. Dès lors, est-ce qu’une femme seule invoquant des difficultés à procréer lors de relations antérieures, ce que personne ne pourra vérifier, pourra prétendre bénéficier des techniques d’aide à la procréation ou bien, en l’absence de la possibilité d’établir un diagnostic précis de la cause médicale de l’infertilité, en sera-t-elle privée, contrairement à d’autres femmes vivant en couple ? Enfin, quand bien même, la femme éprouverait une difficulté médicale à procréer, est-ce que la première raison de l’infertilité et donc du recours à l’AMP, ne serait pas à rechercher dans l’absence de partenaire avec qui procréer, ce qui correspondrait donc à une indication sociale ?
Attaché à la cohérence du critère de l’infertilité médicale votre rapporteur ne souhaite pas élargir l’accès de l’AMP aux femmes célibataires. Cette question a été l’objet d’un débat au sein de la mission, certains de ses membres se prononçant pour cet élargissement.
Plusieurs éléments sont invoqués à l’appui des demandes visant à permettre l’accès à l’AMP des couples de même sexe.
• Les arguments en faveur de la reconnaissance de ce droit aux couples homosexuels
Tout d’abord, si l’Allemagne, l’Italie et la Suisse, par exemple, réservent l’AMP aux couples hétérosexuels, en Belgique, au Danemark, en Espagne, au Canada, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les couples homosexuels féminins peuvent recourir aux techniques d’aide à la procréation. Au Québec, lorsqu’un enfant naît dans un couple de femmes suite à une AMP avec tiers donneur, les deux femmes peuvent figurer sur son acte de naissance en tant que mères.
Au Royaume-Uni, M. David Gomez (74), conseiller auprès de la directrice de l’Autorité pour la fécondation et l’embryologie humaines (HFEA), a indiqué que « la nouvelle loi [dite HFEA Act, adoptée en 2008] a voulu tenir compte des changements de mentalité (…). La loi de 1991 considérait que l’enfant devait avoir un père. Ce n’est plus le cas aujourd’hui ; avec l’introduction de la notion de soutien parental (supportive parenting), l’enfant doit bénéficier de la nourriture affective nécessaire, dans la durée, en prenant en compte l’existence d’un réseau familial et social. Bref, le concept juridique de parent est de plus en plus large. »
En outre, selon une étude réalisée par l’Institut national des études démographiques (INED), entre 24 000 et 40 000 enfants vivraient actuellement dans un foyer composé de deux adultes de même sexe (75). En particulier, selon l’APGL (76), la grande majorité des familles en coparentalité (soit un homosexuel et une homosexuelle, qui s’entendent pour concevoir et élever ensemble un enfant) ainsi que des femmes ou couples de femmes font appel à un donneur de leur entourage et procréent déjà par insémination « artisanale », c’est-à-dire hors contexte médical.
De plus, après une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en janvier 2008 (77) pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et atteinte au respect de la vie privée, le tribunal administratif de Besançon, a donné raison à une femme homosexuelle vivant en couple qui avait contesté un refus d’agrément en vue d’une adoption, le 10 novembre 2009.
Au regard de l’intérêt de l’enfant, Mme Delaisi de Parseval (78) a notamment fait valoir que l’existence d’un couple stable, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, est essentielle pour le développement de l’enfant. Par ailleurs, dans le cas d’un projet de « coparentalité », les problèmes soulevés par le recours à une AMP avec tiers donneur et par l’absence de père ne se poseraient pas, dès lors que les deux parents biologiques restent présents dans la vie de leur enfant.
De même, Mme Joëlle Belaisch-Allart (79) a jugé qu’« il faut se garder des clichés. Ainsi sur l’homoparentalité, les psychologues français ont longtemps fait valoir que les conséquences en seraient désastreuses pour les enfants – on se demande d’ailleurs sur la base de quelles études puisque dans notre pays, elle n’est pas reconnue. Or, la littérature internationale fait apparaître qu’il n’en est rien. Les enfants de couples homosexuels ne sont pas plus enclins à l’homosexualité que les autres et vivent parfaitement bien. À l’exception de moqueries dont ils ont pu être victimes dans leur enfance, ils ne semblent pas avoir souffert de leur situation. Leurs capacités intellectuelles et affectives sont identiques à celles des autres enfants. » M. Israël Nisand (80) a également évoqué l’exemple de deux femmes, en couple depuis quatorze ans qui « ne voient pas en quoi elles seraient moins capables qu’un couple hétérosexuel d’élever un enfant dans l’amour et l’équilibre. Nous n’avons aucun élément qui nous permette de leur soutenir le contraire – il n’y a rien, dans le millier de publications sur le psychisme des enfants issus de couples homosexuels californiens, qui aille à l’encontre de ce postulat. »
Certains estiment par ailleurs que la situation actuelle s’apparente à une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Ainsi, Mme Marie-Pierre Micoud (81), co-présidente de l’APGL, a dénoncé l’existence d’« une discrimination profonde (…) En refusant l’accès à l’AMP à une femme en couple avec une autre femme, la loi dit à cette femme : « Madame, vous vivez avec une femme. Nous sommes désolés. Vous avez le choix entre être homosexuelle et ne pas avoir d’enfant ou celui de trouver un partenaire masculin pour résoudre votre désir d’enfant. » En clair et autrement dit, soyez hétérosexuelle et tout ira bien. »
Mme Marie-Pierre Micoud (82) a souhaité dès lors que l’accès à l’AMP soit ouvert « à tout couple ou toute personne seule porteurs d’un projet parental, s’engageant à être parents des enfants ». On peut toutefois se demander si l’existence de ce projet parental sera vérifiée et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités. Faut-il dès lors rompre avec l’« idéologie de la parenté sexuée » et le paradigme « un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins » ? Plusieurs éléments invitent à ne pas envisager un tel élargissement de l’accès à l’AMP.
• Les arguments contre la reconnaissance de ce droit aux couples homosexuels
Les avis précédents n’ont pas été partagés par toutes les personnes auditionnées par la mission. Ainsi M. Christian Flavigny (83), psychanalyste, a considéré que « l’enfant naît de l’union d’un homme et d’une femme, sur le plan biologique mais aussi psychique. C’est tout l’enjeu de la différence des sexes. (…) L’enfant aspire à se sentir advenu d’une union crédible qu’il symbolise. »
Le parallèle avec l’adoption
Comme pour les femmes seules et pour les raisons évoquées plus haut, la question de l’adoption par des personnes homosexuelles, en couple ou non, est fondamentalement différente de celle de l’accès à l’AMP. Dans ce sens, le panel citoyens du forum de Rennes a proposé que les couples de même sexe puissent adopter mais s’est clairement prononcé contre la possibilité pour ces couples ainsi que pour les célibataires de recourir à l’AMP. Ce faisant, ils ont distingué très clairement la question de la parentalité de celle de la filiation biologique.
Le reproche de discrimination
Il semble excessif de qualifier de discriminatoire la législation actuelle en matière d’AMP. Il convient à cet égard de rappeler que la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (84) définit la discrimination directe comme la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, « son orientation sexuelle » ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été « dans une situation comparable ». Comment dès lors évoquer une discrimination, tant il peut sembler évident qu’en termes de procréation, un homme et une femme, d’une part, et un couple de même sexe, d’autre part, ne sont pas dans une situation comparable ? À cet égard, Mme Sophie Marinopoulos (85), psychanalyste, a regretté que « les homosexuels [aient] ouvert un débat, mais ils l’ont malheureusement fermé en utilisant cet argument écran qu’est la discrimination. »
Il ne semble pas y avoir un traitement particulier et discriminant envers les personnes homosexuelles, pas plus qu’il n’y a de discrimination à l’égard des femmes seules, des femmes qui ne sont plus en âge de procréer ou encore des veuves. Dans aucune de ces situations, il n’y a de motif à recourir à l’AMP si celle-ci ne constitue pas une réponse à un problème médical d’un couple.
Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, les membres du panel citoyens du forum de Rennes ont d’ailleurs exprimé le souhait que l’AMP demeure un traitement médical palliatif de l’infertilité et ne soit pas une réponse à toute forme de désir d’enfant. Cette conception de l’aide à la procréation ne vise pas à écarter certaines catégories de personnes, du seul fait de leur orientation sexuelle ou de leur mode de vie mais concerne l’ensemble des situations qui nécessiteraient de solliciter ces techniques pour des fins autres que la prise en charge d’une infertilité pathologique ou la prévention de la transmission d’une grave maladie. À cet égard, si l’on abandonne le critère médical pour le recours à l’AMP, on pourrait s’interroger sur le rôle attribué au corps médical et sur la prise en charge ou non des actes cliniques et biologiques, en l’absence d’indications médicales.
En d’autres termes, on peut condamner fermement toute forme d’homophobie ou de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle sans pour autant souhaiter que l’accès à l’AMP soit ouvert aux couples de même sexe.
« L’effet domino »
Directement (pour les couples d’hommes) ou indirectement, l’accès à l’AMP aux couples de même sexe serait susceptible d’entraîner la légalisation de la GPA, récusée par la majorité des membres de la mission. Les membres du panel citoyens du forum de Rennes se sont aussi inquiétés d’un tel « effet domino ».
Mme Joëlle Belaisch-Allart (86) a fait valoir que « ce qui parasite le débat sur la question est que l’homoparentalité masculine exige la gestation pour autrui, alors que l’homoparentalité féminine n’exige que l’insémination », en se déclarant « convaincue que si l’homme et la femme sont égaux, ils sont différents et que, pour cette raison même, ils ne peuvent être placés sur le même plan en matière d’infertilité ».
Cet élargissement entraînerait également une augmentation du nombre de procréations assistées avec tiers donneur et poserait la question soulevée précédemment de l’absence de tout référent paternel. Les difficultés qu’expriment aujourd’hui certains enfants, du fait de l’anonymat du donneur, ne risqueraient-elles pas d’en être aggravées?
Par ailleurs, l’ouverture de l’accès à l’AMP pourrait impliquer d’établir un lien de filiation entre l’enfant et les deux membres du couple à l’origine de sa conception. Cela conduirait à envisager qu’un enfant puisse avoir légalement deux parents du même sexe et de faire reposer une partie de la filiation sur le critère, par nature plus fragile, de la volonté, ce qui constituerait une mutation profonde du droit de la famille. Plusieurs personnes entendues par la mission ont fait part de leurs interrogations sur ce point, au regard notamment de l’intérêt de l’enfant.
S’agissant des revendications des couples de même sexe, Mme Sophie Marinopoulos (87) a estimé « qu’on ne peut pas changer l’inscription filiative sans toucher à la construction des origines psychiques de l’enfant ». M. Pierre Lévy-Soussan (88) a ainsi considéré que « l’homoparentalité (…) – un terme en lui-même contradictoire – n’est qu’une situation homoéducative, pas une situation filiative ».
Une question qui ne peut pas être traitée dans le seul cadre de la loi de bioéthique.
Enfin, la question de l’homoparentalité ne dépasse-t-elle pas le champ des lois de bioéthique ? Dans son étude de mai 2009 sur la révision des lois de bioéthique, le Conseil d’État estime que si la demande d’une meilleure reconnaissance de l’homoparentalité s’accroît et si la question de l’accès des couples de femmes à l’AMP est posée, son émergence à l’occasion du réexamen des lois de bioéthique ne doit pas faire oublier que cette question relève fondamentalement du droit de la famille. Dès lors, « il ne serait pas de bonne législation de la traiter sans prendre en compte toutes ses implications, ni de légiférer sur l’homoparentalité dans le seul cas particulier des demandes d’AMP. Il est vrai qu’une meilleure reconnaissance de l’homoparentalité peut, à certaines conditions, répondre à l’intérêt des enfants élevés par deux adultes de même sexe formant un couple stable et constituant avec ces enfants une famille. Mais il serait peu compréhensible qu’une évolution sociale de cette importance soit initiée dans le domaine de l’AMP, qui relève d’une logique spécifique. »
La Secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, Mme Nadine Morano (89), a également jugé qu’« il s’agit d’une question de société, qui dépasse le cadre de la révision des lois de bioéthique ». Lors de son audition, Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports a considéré que « le recours à l’AMP ne peut répondre qu’à une infertilité biologique, médicalement constatée, donc celle d’un couple formé d’un homme et d’une femme. » (90)
La majorité des membres de la mission estime nécessaire de maintenir les dispositions de la loi réservant aux couples composés d’un homme et d’une femme la possibilité de recourir à l’AMP.
B. COMMENT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE L’INFERTILITÉ ?
Il y aurait aujourd’hui 6 % de couples infertiles, 15 à 20 % de couples ayant consulté un médecin pour des difficultés à avoir un enfant (91).
C’est dire combien il est essentiel de chercher à mieux prendre en charge l’infertilité, ce qui suppose tout d’abord d’agir en amont en vue de prévenir des difficultés à procréer, en renforçant notamment l’information des femmes sur l’évolution de leur fertilité avec l’âge. Il apparaît, par ailleurs, nécessaire d’améliorer l’organisation du dispositif actuel, de renforcer l’accompagnement des personnes concernées mais aussi de mieux évaluer les techniques ainsi que les résultats des centres d’AMP.
a) Améliorer l’information des femmes sur l’évolution de leur fertilité avec l’âge et sur les résultats de l’AMP
« Le recul de l’âge de la grossesse est une cause majeure d’infertilité », comme l’a souligné Mme Jacqueline Mandelbaum (92). Depuis une trentaine d’années, l’âge moyen à la première maternité progresse régulièrement : il atteint quasiment 30 ans (93), contre 24 ans en moyenne dans les années 1970.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES POUR 100 FEMMES DE CHAQUE ÂGE ENTRE 1983 ET 2008
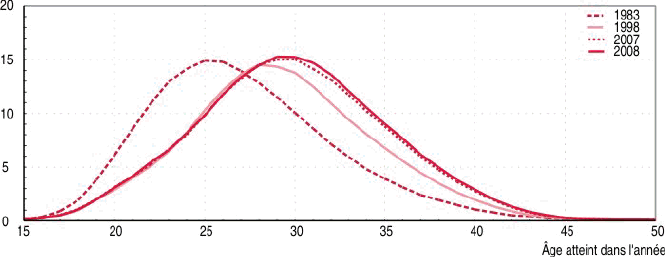
Lecture : pour 100 femmes de 25 ans, il y a eu 9,7 naissances en 2008 ; en 1983, 100 femmes de 25 ans donnaient naissance à 14,9 enfants
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Le désir d’enfant est « de plus en plus tardif dans notre société », ce que Mme Joëlle Belaisch-Allart (94) a expliqué de la façon suivante : « C’est là un phénomène social qui résulte d’une meilleure maîtrise de la contraception. Toute une génération de femmes, leurrée par le slogan « Un enfant quand je veux » - certes porteur mais mensonger car la pilule, c’est seulement de ne pas avoir d’enfant tant que l’on n’en veut pas –, ont voulu prendre le temps de terminer leurs études, de progresser dans leur carrière professionnelle, de rencontrer l’homme de leur vie, d’acheter avec lui la maison de leurs rêves… avant de songer à faire un enfant vers la quarantaine, âge auquel cela est, hélas, beaucoup plus difficile. Il faut en outre compter avec les secondes unions, de plus en plus nombreuses, où des couples dont chacun des membres a déjà des enfants, souhaitent concrétiser leur amour par un autre enfant. »
Or, si la ménopause constitue une limite absolue au démarrage d’une grossesse, les capacités fertiles de la femme diminuent plusieurs années avant, et ce dès la trentaine. Selon M. François Olivennes (95), gynécologue-obstétricien au centre d’AMP Eylau-La Muette, « le taux de fécondité baisse à partir de trente-cinq ans » ; selon une étude récente de l’INED (96), la probabilité d’obtenir une grossesse reculerait même dès l’âge de 30 ans « et devient quasiment infime à partir de quarante ans, alors que la femme continue d’avoir des règles jusqu’à la ménopause, vers cinquante ans. »
Par ailleurs, si les progrès de l’AMP donnent parfois le sentiment que la médecine peut répondre à toutes les demandes, il apparaît que l’AMP n’est qu’un remède incertain à l’infertilité après 35 ans (cf. supra, le graphique sur l’évolution avec l’âge des résultats des FIV). Ainsi, d’après Mme Jacqueline Mandelbaum, contrairement à l’image véhiculée par certaines grossesses tardives médiatisées, « le taux de succès de l’AMP connaissant la même évolution, celle-ci ne saurait être une solution pour ce type d’infertilité. »
Pourtant, cette réalité est encore méconnue des femmes, comme l’ont déploré plusieurs personnes entendues par la mission.
Mme Joëlle Belaisch-Allart a regretté « l’ignorance, voire le déni, du déclin de la fertilité avec l’âge des femmes [qui] se nourrissent de ces reportages diffusés à l’envi dans les médias sur des femmes enceintes de 50 ou 60 ans, où l’on oublie seulement de préciser que celles-ci ont bénéficié d’un don d’ovocytes et non pas d’une FIV classique. »
De même, M. François Olivennes a jugé « urgent d’informer les femmes sur les limites de leur reproduction » en soulignant qu’elles « pensent qu’elles peuvent avoir un enfant jusqu’à l’âge de la ménopause, ce qui est faux. (…) Je vois des couples qui vivent ensemble depuis quinze ans et qui décident d’avoir un enfant à la quarantaine. Quand on leur explique ce qu’il en est, ils regrettent les choix qu’ils ont faits, par manque d’information. J’ai été attaqué par certaines féministes, mais je me contente de donner de l’information. Chacun peut mener sa vie comme il le veut, mais qu’il le fasse en toute connaissance de cause ». Il est en effet essentiel d’améliorer l’information sur ce point, et de « ne plus laisser penser qu’on peut être enceinte quand on le veut », selon les termes de Mme Jacqueline Mandelbaum (97).
Trop souvent négligée, cette question soulève pourtant de réels enjeux éthiques, dans la mesure où il s’agit de donner aux femmes les moyens d’exercer pleinement leur liberté de procréer ou non. Il conviendra notamment de veiller à ce que cette information soit délivrée de manière positive et factuelle et ne puisse évidemment pas être perçue comme une injonction à procréer. Le CCNE pourrait dès lors être saisi de cette question et des modalités selon lesquelles cette information pourrait être organisée, à travers des campagnes d’information ou encore dans le cadre du colloque singulier avec le médecin.
De manière plus générale, une réflexion collective doit aussi être engagée sur les moyens de favoriser des grossesses plus précoces, comme l’a notamment suggéré Mme Joëlle Belaisch-Allart, s’agissant par exemple des modes d’accueil des jeunes enfants, de la conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle, ou des modalités de remplacement et d’organisation de l’activité pendant les congés maternité. Dans ce sens, M. Pierre Le Coz (98) a indiqué que le CCNE, loin de vouloir remettre en cause le travail des femmes, souhaitait « aider [les femmes] à prendre leurs décisions en toute connaissance de cause et œuvrer afin que les pouvoirs publics favorisent une meilleure conciliation entre éducation des enfants et vie professionnelle ».
À défaut d’une telle réflexion, on peut craindre que l’âge moyen des candidates à l’AMP ne cesse de s’accroître, avec des chances de succès sensiblement plus limitées, voire qu’un jour les femmes mettent leurs ovocytes en réserve par vitrification pour pouvoir poursuivre leurs études ou mener à bien leurs projets professionnels.
Mme Chantal Lebatard (99) a également appelé de ses vœux le renforcement de « la prévention de certaines infertilités dues, par exemple, à des maladies sexuellement transmissibles ou à l’âge tardif de la procréation. Ce volet oublié de prévention peut être d’ordre social, avec l’information sur les risques des pratiques sexuelles non protégées et des maternités retardées, tout en favorisant la place des jeunes familles pour que les projets d’enfants ne soient pas retardés indéfiniment, ceux-ci pouvant conduire à des maternités à risque et des fécondités retardées ».
b) Renforcer la recherche sur les causes de la stérilité
En amont des interrogations, notamment éthiques, suscitées par l’AMP, les citoyens du forum de Rennes ont jugé nécessaire de travailler à mieux comprendre les causes de la stérilité et de développer les moyens pour pallier l’infertilité et l’hypofertilité. Ils ont invité les pouvoirs publics à « tout mettre en œuvre pour réduire les causes environnementales et sanitaires de l’infertilité. »
Mme Chantal Lebatard (100) a également jugé « important de développer la recherche pour lutter contre les infertilités et les stérilités non maîtrisées. Il faut consentir autant d’efforts en faveur de cette démarche que dans celle visant à contourner les stérilités et à y apporter des réponses ». M. André Syrota, directeur général de l’INSERM (101), a aussi attiré l’attention sur la nécessité de « trouver les moyens d’améliorer les taux de succès, qui ne dépassent pas aujourd’hui 50 % ». Il a estimé que « cette relative inefficacité tient à un manque de connaissances biologiques sur les mécanismes et les multiples origines des infertilités
– génétiques, environnementales, psychologiques… On se contente aujourd’hui d’un classement assez sommaire, distinguant seulement entre les infertilités d’origine dite maternelle, paternelle, mixte ou inconnue. »
Il apparaît dès lors indispensable de renforcer la recherche dans ce domaine afin de mieux connaître les causes de la stérilité et, le cas échéant, d’identifier les moyens de la prévenir. Il pourrait être suggéré de compléter l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, aux termes duquel l’Agence de la biomédecine est chargée de « promouvoir la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence » – par exemple en matière d’AMP. Cette adjonction recouvrirait les recherches sur les causes de l’infertilité et lui permettrait de lancer des appels à projets et de contribuer au financement de recherches dans ces domaines.
Proposition n° 5. Améliorer l’information du public sur l’évolution de la fertilité des femmes avec l’âge et sur les résultats de l’AMP, en suggérant une saisine du CCNE par le ministre chargé de la santé sur les modalités de mise en œuvre de cette information.
Développer la recherche sur les causes de l’infertilité, notamment environnementales et sanitaires et étendre les missions de l’Agence de la biomédecine afin qu’elle puisse lancer des appels à projets dans ce domaine.
2. Simplifier et adapter l’organisation de l’offre de soins
Concernant l’organisation de l’offre de soins dans le domaine de la procréation assistée et du diagnostic prénatal, le bilan de la mise en application de la loi du 6 août 2004 fait apparaître des difficultés liées à la complexité du dispositif d’agrément des praticiens ainsi qu’à l’absence de prise en compte par la loi des missions actuellement exercées par les sages-femmes dans les centres d’AMP. Il convient également de s’interroger sur les modalités de financement de ces activités dans le cadre de la tarification à l’activité.
a) Réformer le dispositif d’autorisation et d’agrément pour les activités d’assistance à la procréation et de diagnostic prénatal
Selon M. Jean-Luc Bresson (102), président de la Fédération nationale des Centres d’études et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), la délivrance des agréments des praticiens et des autorisations des structures habilitées à pratiquer les activités d’AMP suit aujourd’hui « un cheminement d’une complexité qui n’est peut-être pas techniquement indispensable ». Pourrait-on dès lors simplifier ce dispositif sans que cela n’ait d’effet sur la qualité des soins ?
● Le régime d’autorisation des établissements et laboratoires exerçant des activités d’AMP et de DPN
L’Agence de la biomédecine est chargée notamment de délivrer les autorisations pour la création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) et des centres de diagnostic préimplantatoire (DPI), d’agréer les praticiens habilités à pratiquer les activités cliniques et biologiques d’AMP, de diagnostic prénatal (DPN) et de DPI (cf. infra) et d’exercer les contrôles afférents à ces autorisations, dans le cadre de ses missions d’inspection.
En revanche, les autorisations des établissements et laboratoires d’analyses de biologie médicale dans lesquels peuvent être pratiquées des activités cliniques et biologiques d’AMP ou de DPN, sont délivrées par les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), après avis de l’Agence de la biomédecine(103).
Résultant de la loi du 6 août 2004, ce dispositif traduit sans doute la volonté de prendre en compte les enjeux éthiques particuliers liés à l’activité des centres de diagnostic prénatal, pour lesquels un encadrement national est de nature à garantir un traitement homogène sur l’ensemble du territoire.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MISSIONS DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
EN MATIÈRE D’AUTORISATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PROCRÉATION
Activité autorisée |
Structure ou acteur autorisé(e) |
Compétences de l’ABM* |
Compétences de l’ARH** |
Activités cliniques et biologiques d’AMP |
Établissements et laboratoires |
Avis |
Autorisation |
Praticiens |
Agrément et contrôle |
||
Activités de DPN |
Établissements et laboratoires |
Avis |
Autorisation |
CPDPN |
Autorisation et contrôle |
||
Praticiens |
Agrément et contrôle |
||
Activités de DPI |
Centres de DPI |
Autorisation et contrôle |
|
Praticiens |
Agrément et contrôle |
* Agence de la biomédecine
** Au plus tard le 1er juillet 2010, les ARH doivent être remplacées par les agences régionales de santé (ARS), instituées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
En s’interrogeant sur la pertinence de confier à deux autorités distinctes (l’Agence de la biomédecine ou les ARH) l’agrément des centres d’AMP et celui des praticiens qui y exercent, plusieurs personnes auditionnées par la mission ont suggéré de simplifier le dispositif actuel.
Mme Joëlle Belaisch-Allart (104) s’est, par exemple, demandée « pourquoi l’Agence ne pourrait-elle pas à la fois autoriser les centres et agréer les praticiens ? » M. Jacques Montagut (105), médecin biologiste de la reproduction et directeur de l’IFREARES à Toulouse, a également regretté que les « autorisations des structures de soins, qui devraient relever en principe de la compétence de l’Agence, (…) [soient] confiées à l’ARH au détriment d’une véritable politique nationale ».
Toutefois, l’Agence de la biomédecine n’apparaît aujourd’hui pas organisée pour délivrer ces autorisations aux établissements ; par ailleurs, un tel choix pourrait sembler contradictoire avec la création des agences régionales de santé (ARS), qui visent à unifier le pilotage régional de la politique de santé.
● L’agrément individuel des praticiens pour l’AMP, le diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI)
En vertu des articles L. 2142-1-1 et L. 2131-4-2 du code de la santé publique, les professionnels habilités à pratiquer les activités cliniques et biologiques d’AMP ainsi que ceux autorisés à procéder aux DPN et DPI doivent être agréés individuellement par l’Agence de la biomédecine. L’agrément est valable cinq ans et le praticien peut exercer son activité dans n’importe quelle structure dès lors que celle-ci est autorisée. Entre le 22 décembre 2006, date de parution des décrets d’application (106), et le 30 juin 2008, 755 praticiens ont ainsi été agréés pour les activités d’AMP.
Le Conseil d’orientation de l’agence définit les critères d’appréciation de la formation et de l’expérience nécessaires à l’agrément des praticiens pour les activités précitées. Ces critères portent actuellement sur la formation initiale, la formation spécialisée, afin de garantir la capacité à répondre au haut degré de technicité requis dans ces domaines ainsi que sur l’expérience dont les praticiens doivent justifier pour prendre en charge les personnes dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité.
Plusieurs éléments peuvent cependant conduire à réexaminer l’intérêt de cette procédure pour « revenir sur une particularité française, l’agrément des praticiens en AMP, biologique et clinique, et en génétique », ainsi que l’a suggéré M. Bernard Loty (107), adjoint à la directrice générale de l’Agence.
Tout d’abord, le nombre de refus est extrêmement faible. Selon l’Agence de la biomédecine, la structuration de la formation des personnels, le développement d’enseignements de bon niveau spécifiques aux activités encadrées et la transparence des résultats, assurée notamment par le suivi annuel de l’activité, expliquent sans doute la qualité des dossiers.
En outre, il existe désormais d’autres dispositifs visant à inciter les professionnels à améliorer la qualité et la sécurité des pratiques, en particulier la directive n° 2004/23 du 31 mars 2004 relative aux tissus et cellules humains (108) qui comporte plusieurs dispositions applicables aux gamètes. On peut ajouter les démarches de certification de type ISO ainsi que l’obligation de formation continue et d’évaluation des pratiques professionnelles qui s’imposent aux professionnels. Ce dispositif a d’ailleurs été réformé récemment par l’article 59 de la loi du 27 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, le développement professionnel continu constituant une obligation pour les médecins. (109)
Enfin, le régime d’autorisation des établissements dans lesquels les activités biologiques et cliniques d’AMP ou de DPN peuvent être effectuées vise également à garantir la qualité de la prise en charge médicale. Dès lors, il pourrait être envisagé de compléter le dispositif actuel en introduisant de nouvelles dispositions habilitant ces établissements s’ils font appel à des praticiens « en mesure de prouver leur compétence ». Cette condition serait vérifiée lors de la visite de conformité réalisée par les services déconcentrés dans les établissements autorisés, ainsi que l’a suggéré l’Agence de la biomédecine (110).
À cet égard, Mme Carine Camby (111) a estimé que « l’agrément individuel des praticiens dans le domaine de l’AMP, cause d’une grande complexité administrative, est devenu inutile. Les procédures de qualité, l’édiction de règles de bonnes pratiques, l’évaluation par l’Agence de la biomédecine de chaque centre d’AMP et la publication de leurs résultats sont beaucoup plus efficaces et protecteurs des patients. (…) Cette tâche considérable, qui incombe à l’agence, n’a plus de raison d’être puisqu’il s’agit désormais de spécialités reconnues. Il n’en va pas de même pour l’agrément des personnes pratiquant le DPI, en nombre beaucoup moins important. »
Il serait en effet nécessaire de maintenir l’agrément individuel des praticiens habilités à pratiquer le DPI, au regard notamment des enjeux éthiques spécifiques qu’il soulève et du faible nombre de professionnels concernés.
Proposition n° 6. Simplifier les contraintes qui pèsent sur les praticiens procédant à des activités d’AMP et de DPN en supprimant l’agrément individuel (Ceci entraînerait l’abrogation de l’article L. 2142-1-1, la modification du premier alinéa de l’article L. 2131-4-2 et l’abrogation par coordination du quatrième alinéa de l’article L. 2142-4 du code de la santé publique).
Prévoir en conséquence que l’autorisation pour les activités cliniques et biologiques d’AMP et de DPN ne peut être délivrée aux établissements et organismes concernés que s’ils font appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, le respect de cette condition devant être contrôlé lors de la visite de conformité (Ceci supposerait une modification des articles L. 2131-2 et L. 2142-1 du même code).
Maintenir l’agrément individuel pour les professionnels pratiquant le DPI.
b) Reconnaître les missions actuellement exercées par les sages-femmes dans les centres d’AMP
Aux termes de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, l’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession. L’examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l’accouchement a été eutocique, l’exercice de la profession de sage-femme pouvant par ailleurs comporter également la participation aux consultations de planification familiale. À ce titre, les sages-femmes sont notamment autorisées à pratiquer des échographies, conformément à l’article R. 4127-318 du même code, mais uniquement « dans le cadre de la surveillance de la grossesse ».
Elles ne sont donc pas en droit habilitées à travailler dans les centres d’AMP, ainsi que l’a rappelé Mme Marianne Benoît, membre du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (112).
Pourtant, sur les 20 000 sages-femmes en exercice en France, une centaine (dont 80 dans des CHU) travaillerait actuellement dans les 110 centres cliniques d’AMP. « Même si elles sont peu nombreuses, elles y occupent une place très importante », selon Marianne Benoît, qui a précisé la nature des activités exercées par les sages-femmes dans les centres d’AMP :
« Elles procèdent à des échographies de monitorage de l’ovulation ou à des échographies folliculaires ; elles font des consultations au moment du démarrage du traitement de stimulation, de l’information sur les dons d’ovocyte et des échographies de début de grossesse ; elles suivent l’évolution des courbes des hormones de grossesse ; elles assurent le suivi des « issues de grossesse » – terme qui signifie que l’AMP a réussi ; elles s’occupent aussi de l’informatisation, notamment pour les bilans statistiques et ministériels ; enfin, elles gèrent des réunions d’information des couples en vue d’une fécondation in vitro (FIV), et des receveuses en vue d’un protocole de don ». De plus, « les chiffres pour 2009 sont à la hausse puisqu’ils prévoient pour les sages-femmes 4 000 échographies, 1 350 consultations pré-FIV, 200 consultations d’information sur le don, notamment pour les dons d’ovocytes, et 1 500 accompagnements aux transferts, avec la prise en charge psycho-prophylactique. »
Cette situation semble par ailleurs à l’origine de difficultés en matière de codification des actes et de tarification à l’activité (T2A). En effet, selon Mme Marianne Benoît, « les sages-femmes ne pouvant pas coter en acte externe les échographies et les consultations pré-FIV qu’elles réalisent, soit leurs actes ne sont pas cotés et ne rapportent pas d’argent à l’hôpital, ce qui pose problème, soit leurs actes sont cotés en actes de médecins, mais il s’agit alors en quelque sorte d’une fraude à l’assurance maladie, puisque les sages-femmes n’ont pas le droit de pratiquer ces actes. Ce sont pourtant les gynécologues-obstétriciens qui sont venus chercher les sages-femmes quand les centres d’AMP ont été mis en place. Et cette pratique, courante depuis de nombreuses années puisque la majorité des centres d’AMP comptent au moins une sage-femme, est efficace, utile et reconnue par tous, que ce soit le corps médical ou les patients. »
Dès lors, afin de mettre en concordance le droit et des pratiques, il pourrait être suggéré de modifier la rédaction de l’article L. 4151-1 précité, en précisant que les sages-femmes peuvent exercer leurs activités dans des centres d’AMP, sous certaines conditions définies par voie réglementaire.
Selon Mme Marie-Josée Keller(113), présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, il s’agirait ainsi « simplement de légaliser une pratique ». Allant dans le sens d’une délégation de tâches accrue entre professionnels de santé, cette modification de la loi s’inscrirait par ailleurs dans la continuité des dispositions prévues par l’article 86 de la loi n° 2009-879 du 27 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, qui a prévu que l’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme enceinte à un médecin en cas de situation pathologique.
Proposition n° 7. Autoriser les sages-femmes à exercer dans les centres d’AMP, dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État. (Cela supposerait de compléter par un nouvel alinéa l’article L. 4151-1 du code de la santé publique).
c) Veiller à un financement adapté des activités d’assistance à la procréation
Comme les autres activités de soins, les activités d’AMP des établissements de santé autorisés à les pratiquer relèvent de la tarification à l’activité (T2A). Elles bénéficient de plusieurs catégories de financement.
Pour l’essentiel, l’AMP est une activité ambulatoire qui repose sur des consultations spécialisées avec des examens biologiques et échographiques planifiés. Les recettes sont donc en majorité issues d’une activité externe de consultations, d’actes de laboratoires tarifés par la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) ainsi que d’actes cliniques relevant de la classification commune des actes médicaux (CCAM). Les tarifs de prestations – groupes homogènes de séjour (GHS) – ne permettent de financer que l’hospitalisation liée à la ponction d’ovocytes. Certaines activités peuvent également relever des MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation).
LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ
La tarification à l’activité est un mode de financement des établissements de santé qui a été lancé en 2004 dans le cadre du plan « Hôpital 2007 ». Désormais, les ressources sont calculées à partir d’une mesure de l’activité produite conduisant à une estimation de recettes. Les dispositifs de financement se répartissent en plusieurs catégories :
– les groupes homogènes de séjour (GHS) constituent le tarif de prestation des séjours en hospitalisation complète ou partielle : le PMSI permet de classer le séjour de chaque patient au sein d’un groupe homogène de malades (GHM) auquel est associé un ou parfois plusieurs tarifs. Des suppléments journaliers sont également facturés pour les séjours des patients passés dans des services de réanimation, de surveillance continue et de soins intensifs ;
– les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) : par la création de cette dotation, le législateur a entendu maintenir, pour tous les établissements, publics ou privés, des sources de financement en dehors du principe général de la T2A, en reconnaissant que les ressources d’un certain nombre de missions ne devaient pas être soumises aux variations de l’activité réalisée ; ces financements concernent les activités qui sont difficilement identifiables par patient (par exemple, les actions de prévention et de dépistage) ou qui nécessitent une permanence, qu’elle que soit le niveau effectif d’activité (par exemple, les SAMU, les centres anti-poison ou équipes mobiles de liaisons) ; ces missions sont clairement identifiées et rémunérées par établissement sur la base d’une liste fixée par décret ;
– les autres modalités de financement : certaines activités spécifiques telles que les urgences, la coordination des prélèvements d’organes et les greffes font l’objet d’un financement forfaitisé. De même, les médicaments onéreux et certains dispositifs médicaux sont pris e n charge en sus des tarifs de prestations.
Il semblerait toutefois que les modalités actuelles de financement ne permettent pas de prendre pleinement en compte les spécificités des activités d’AMP.
En effet, s’agissant de l’organisation de la prise en charge et de l’expertise assurée par les équipes pluridisciplinaires, qui sont nécessaires au suivi des couples et à la mise en place des protocoles, il n’existerait pas véritablement de financement idoine dans le cadre de la T2A. En particulier, il n’y a pas aujourd’hui de crédits fléchés pour les activités connexes à la prise en charge clinique et médico-technique en AMP. Il en est ainsi du volet organisationnel des tentatives d’AMP, des réunions d’information des couples qui sont prévues en début de processus, des entretiens individuels avec les professionnels et les équipes pluridisciplinaires intervenant au cours des cycles. Ces missions sont indispensables au déroulement d’un cycle d’AMP et exigent beaucoup de temps de la part des équipes.
Par exemple, les réunions pluridisciplinaires et d’information des couples, mobilisent en moyenne 1,2 équivalent temps plein (ETP) pour un centre réalisant 500 tentatives, alors qu’il n’existe pas, semble-t-il, de forfait annuel fléché pour financer ces réunions. En outre, depuis 2008, les règles de gestion, de management et de sécurité sanitaire ont été renforcées par un arrêté relatif aux bonnes pratiques en AMP. Elles supposent la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et les centres sont également de plus en plus sollicités pour alimenter le registre national des FIV(114). Ces évolutions récentes auraient accru les contraintes des professionnels et accentué leurs préoccupations à l’égard des limites de la T2A.
Concernant les MIGAC (115), il semblerait, selon les informations recueillies par les membres du groupe de travail mis en place par l’Agence de la biomédecine sur cette question, qu’il y ait une sous-utilisation des crédits et un manque de transparence concernant la réallocation en interne des crédits des activités spécifiques pouvant être prises en charge.
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont aussi souligné les difficultés liées au niveau de tarification de certains actes. Plus généralement, elles ont attiré l’attention sur l’importance de veiller aux moyens et à l’équipement des centres pour améliorer les conditions d’accès, de prise en charge et les résultats de l’AMP.
Ainsi, Mme Joëlle Belaisch-Allart (116) a fait part de ses inquiétudes concernant le fait que « la tarification à l’activité (T2A) désormais en vigueur dans tous les établissements, publics ou privés, impose que toute activité soit rentable. Or, l’AMP non seulement n’est pas rentable, mais elle a même les plus grandes difficultés à être équilibrée. Déjà le parent pauvre des établissements de santé, elle est menacée de disparition si ses moyens continuent de diminuer. »
Si cette question ne relève pas du domaine de la loi, elle soulève cependant des enjeux non négligeables au regard de la qualité des soins, de l’amélioration des résultats des techniques de procréation assistée ainsi que des délais d’attente pour les couples infertiles.
Soulignant « l’existence de carences de moyens, matériels et humains, dans les laboratoires français », M. François Olivennes (117) a ainsi estimé que « la tarification actuelle des actes semble assez basse, d’après les comparaisons faites par les biologistes. Le laboratoire est le facteur de résultat principal. Or les nôtres sont sous-équipés par rapport aux laboratoires européens ».
Dans le même sens, Mme Joëlle Belaisch-Allart (118) a fait valoir qu’« en matière d’AMP, les moyens sont fondamentaux. Nous avons ainsi besoin dans nos laboratoires d’incubateurs permettant de maintenir à 37° C les gamètes et les embryons. L’efficacité exigerait un incubateur pour 100 ponctions, de façon à n’avoir pas à ouvrir trop souvent les portes, ce qui risque toujours de déséquilibrer la température et le pH. Or, aucun centre en France ne dispose d’un tel ratio d’appareils. À Sèvres, nous en avons trois, dont deux payés par l’hôpital et l’autre acquis grâce aux dons des patientes. Nous allons bientôt en avoir un quatrième mais avec 600 tentatives par an, nous demeurerons, comme tous les centres français, bien en dessous du ratio souhaitable. » Cette situation pourrait également générer des difficultés d’accès aux soins dans les centres publics. Il semblerait en effet que l’activité de FIV des centres hospitaliers universitaires (CHU) stagne, tandis qu’en Île-de-France, par exemple, elle se développe surtout dans le secteur privé.
Proposition n° 8.
Afin d’assurer un meilleur financement des activités d’AMP, inviter le ministre chargé de la santé à saisir l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’un rapport sur les modalités de tarification de ces activités, en étudiant notamment les possibilités de mieux prendre en compte certaines activités connexes aux actes cliniques et biologiques.
3. Améliorer la prise en charge des couples dans les centres d’AMP
a) Renforcer leur accompagnement psychologique
La loi prévoit aujourd’hui que la mise en œuvre de l’AMP doit être précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel en tant que de besoin au service social (article L. 2141-10 du code de la santé publique).
En vertu de l’article R. 2142-8 du code de la santé publique, les centres d’AMP doivent comporter une équipe médicale pluridisciplinaire et bénéficient « du concours d’un psychologue ou d’un médecin qualifié en psychiatrie ». L’arrêté du 11 avril 2008 de la Ministre chargée de la santé relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP précise à cet égard que l’équipe pluridisciplinaire fait appel, en tant que de besoin, à d’autres spécialistes, notamment un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue. En outre, l’article R. 1244-3 du même code prévoit que toute mise à disposition de gamètes est précédée d’un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire à laquelle doit s’adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue ; l’article R. 1244-2 relatif aux entretiens préalables des donneurs ne comporte cependant pas de disposition analogue.
Selon le ministère de la santé, les centres d’AMP recourent en pratique systématiquement à ces professionnels. Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont souligné l’importance de renforcer l’accompagnement des couples engagés dans un parcours d’AMP mais aussi des donneurs de gamètes, notamment sur le plan psychologique.
Par exemple, Mme Laure Camborieux (119) a exprimé au nom de l’association Maia « le souhait de la prise en compte des aspects psychologiques de l’infertilité dans les traitements ». M. Pierre Lévy-Soussan (120), pédopsychiatre, a suggéré d’améliorer « l’accompagnement des personnes qui s’engagent dans les inséminations artificielles avec donneur, qui exigent un travail psychique important. Il faut parfois plus d’un entretien pour que l’enfant puisse se sentir bien dans sa famille en arrivant. »
Cette demande a été formulée également lors des États généraux de la bioéthique. Les citoyens du forum de Rennes ont en effet préconisé un accompagnement bien plus important qu’il ne l’est aujourd’hui, en mettant en avant la nécessité de l’accompagnement psychologique de couples tout au long de leur démarche d’AMP, en amont et en aval du don de gamètes ou de l’aide à la conception.
Renforcer l’accompagnement psychologique des couples procédant à une AMP en augmentant le nombre de psychologues et de psychiatres exerçant dans les centres d’AMP.
b) Faciliter la conciliation de la vie professionnelle des femmes avec les contraintes des traitements d’AMP
Les femmes suivant un traitement d’AMP peuvent poursuivre leur activité professionnelle. Un arrêt de travail n’est pas systématiquement proposé. La stimulation ovarienne est particulièrement contraignante, du fait notamment des injections quotidiennes, des prises de sang et des échographies. Les rendez-vous sont nombreux et ne sont pas fixés longtemps à l’avance. Certains peuvent être modifiés au dernier moment. Pour les femmes actives, ces contraintes peuvent parfois être difficiles à concilier avec leurs obligations professionnelles.
Évoquant le « parcours du combattant » de l’AMP, Mme Joëlle Belaisch-Allart (121) a indiqué qu’« une étude menée en son temps par le secrétariat d’État aux droits de la femme avait démontré que 10 % des femmes faisant une FIV perdaient leur emploi, du fait des retards récurrents résultant de tous leurs rendez-vous médicaux. Nous veillons désormais dans nos centres à ce que les dosages hormonaux et les échographies puissent être réalisés tôt le matin, à ce que les femmes ne soient pas obligées de revenir l’après-midi et à ce que les résultats puissent être communiqués par téléphone. En un mot, nous nous efforçons de leur faciliter la tâche au maximum. »
Une nouvelle enquête pourrait être réalisée afin de mieux identifier les difficultés rencontrées par les femmes suivant des traitements d’AMP dans leur vie professionnelle, et d’envisager, le cas échéant, des mesures visant à y remédier. On pourrait, par exemple, réfléchir à l’opportunité de prévoir des autorisations d’absence, sans diminution de rémunération, pour certains examens, comme cela est actuellement prévu pour les femmes enceintes par l’article L. 1225-16 du code du travail.
Par ailleurs, même s’il semble que les centres aient mieux intégré cette préoccupation dans leur organisation, il pourrait être envisagé de prévoir l’élaboration par l’Agence de la biomédecine de recommandations de bonnes pratiques et leur diffusion aux centres d’AMP, s’agissant par exemple des horaires des examens ou de la communication de certains résultats par téléphone ou par courrier électronique.
Proposition n° 10.
Prévoir la réalisation d’une enquête sur les difficultés rencontrées par les femmes actives suivant des traitements d’AMP. Cette étude pourrait être confiée au ministère de la santé ou à l’Agence de la biomédecine. Au vu des résultats de cette enquête, demander à l’Agence de la biomédecine l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques sur ce sujet à l’attention des centres d’AMP.
L’amélioration de la prise en charge des couples infertiles implique par ailleurs de renforcer le suivi et l’évaluation des techniques d’assistance à la procréation, en vue notamment d’améliorer leurs résultats.
4. Renforcer l’évaluation, la transparence et l’encadrement des techniques d’AMP
Lors de son audition par la mission, M. François Olivennes (122) a souligné que « bien sûr, la loi existe et on discute dessus », mais « on s’intéresse assez peu aux résultats de l’AMP, à ses moyens et à la cotation appliquée aux actes ».
Si cette question est, en effet, parfois occultée dans les débats sur l’AMP, l’évaluation de ces techniques et de leurs résultats est pourtant nécessaire pour améliorer la prise en charge de l’infertilité et garantir la sécurité et la qualité des pratiques. Plusieurs pistes pourraient être envisagées en ce sens : une transparence accrue des résultats des centres d’AMP, un meilleur suivi des personnes concernées et des enfants ainsi conçus ainsi qu’un encadrement renforcé des techniques actuelles d’AMP. En revanche, la possibilité d’autoriser certaines recherches visant à améliorer les techniques d’AMP, qui impliqueraient de réimplanter in utero des embryons, suscite d’importantes questions éthiques.
a) Développer le recueil des données individuelles par patiente et rendre publics les résultats des centres d’AMP
Selon les dernières données disponibles, 122 056 tentatives d’AMP ont été effectuées en 2007 et 20 657 enfants sont nés au titre de l’AMP la même année. Selon Mme Joëlle Belaisch-Allart (123), le taux d’accouchement en France après une FIV classique était de 19 % en 2006 et 9,6 % seulement après une insémination intra-utérine : ces résultats, qui ne sont pas tout à fait ceux rapportés dans la presse grand public, « sont donc à la fois magnifiques, puisque rien de tout cela n’était possible il y a trente ans, et limités. »
Plusieurs personnes entendues par la mission se sont interrogées sur les taux de succès des techniques d’AMP en France et l’existence de disparités entre les centres.
M. François Olivennes (124) a jugé qu’« aujourd’hui, la situation de l’AMP en France est une honte », en rappelant que « la France fut un pays pionnier de l’assistance médicale à la procréation, avec, en particulier, Jacques Testart et René Frydman. (…) Tous les médecins qui s’occupent d’AMP citent nos travaux pionniers du début des années quatre-vingt. Aujourd’hui, pour la troisième année consécutive, les résultats de la France sont classés parmi les plus mauvais d’Europe, avec ceux de la Slovénie et du Monténégro. »
Ce constat sévère a toutefois été nuancé par Mme Joëlle Belaisch-Allart (125) qui a considéré que, certes, selon une étude de la revue Human Reproduction, le taux de grossesse n’était en France que de 20,6 % et le nombre d’accouchements de 15,6 % en 2004, contre 20 % au Danemark, mais qu’il serait fallacieux de « prétendre sans autre forme de procès que nous serions moins bons en France ».
TAUX DE GROSSESSES ÉCHOGRAPHIQUES APRÈS TENTATIVE D’AMP* SELON LA TECHNIQUE ET L’ORIGINE DES GAMÈTES EN 2007
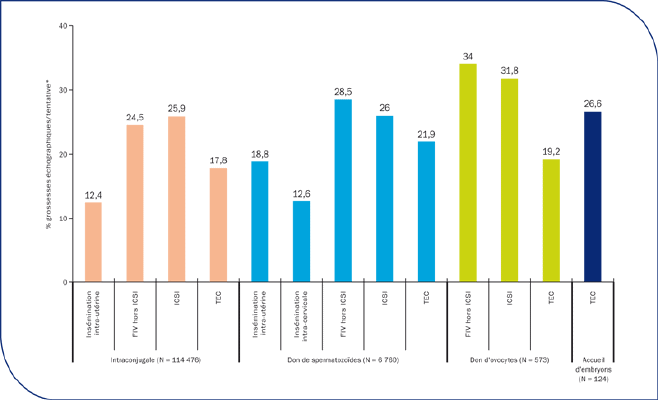
Tentatives d’AMP* : cycles d’insémination artificielle (inséminations intra-utérine et intra-cervicale), ponctions d’ovocytes dans le cadre des fécondations in vitro (FIV classique ou ICSI) et transferts d’embryons congelés (TEC)
Source : rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine (juillet 2009)
Avant de procéder à des comparaisons internationales, il conviendrait en effet de prendre en compte plusieurs éléments, en relevant notamment que tous les États européens n’ont pas la même définition de la grossesse, ni d’ailleurs de la tentative (126).
Par ailleurs, le profil des patientes n’est pas partout le même, la prise en charge de l’infertilité différant fortement d’un pays à l’autre : ainsi, selon Mme Joëlle Belaisch-Allart, parmi les bénéficiaires de FIV, les femmes de moins de 29 ans ne représentent que 14,3 % en France contre 20 % dans les pays nordiques. Or leurs bons résultats sont souvent cités en exemple, alors que les femmes de plus de 40 ans représentent plus de 15 % des femmes en France et seulement 8 % dans certains pays.
Les stratégies de recours à l’AMP semblent également différer entre les pays, selon que l’on décide de recourir directement à une FIV ou, comme c’est plutôt le cas en France, de tenter dans un premier temps des stimulations ovariennes et des inséminations artificielles. Or il a été démontré que plus longue a été l’infertilité, plus les couples sont vraiment infertiles et donc difficiles à traiter.
Enfin, il faut aussi rapporter le nombre d’AMP à la population. Alors qu’au Danemark, on dénombre 1 830 cycles de FIV ou d’ICSI pour un million d’habitants, ce nombre est de moitié inférieur en France. Cela suggère qu’au Danemark, on prend en charge des femmes beaucoup plus jeunes, beaucoup moins infertiles, avec lesquelles il est plus facile d’obtenir de bons résultats.
Il n’en demeure pas moins nécessaire de s’interroger sur les moyens d’améliorer les résultats de l’AMP, d’autant que plusieurs personnes entendues par la mission ont mentionné l’existence de disparités entre les centres.
Ainsi, Mme Dominique Lenfant (127), présidente de l’association Pauline et Adrien a indiqué avoir voulu savoir « si l’application de la loi avait amélioré les résultats des centres de fécondation in vitro mais [n’avoir] pas trouvé de réponse évidente. Il existe des différences de 10 à 30 % dans les résultats des centres d’AMP. (…) Les femmes ont besoin d’avoir ces informations pour pouvoir prendre des décisions. » M. François Olivennes (128) a également regretté cette inégalité, en déclarant que « l’association FIVNAT, à [son] initiative, a accepté de présenter, sur une année, de manière anonyme, les résultats des centres français de FIV – et les a mis sur Internet. On constate que ces résultats vont de 8 % à 40 % : cette disparité n’est pas acceptable. Soit il y a un problème de qualité, soit certaines patientes sont traitées alors qu’elles ne devraient pas l’être. Ce problème doit être pris à bras le corps. ». Comment pourrait-on améliorer cette situation ?
En premier lieu, il est essentiel de disposer de données plus complètes sur les parcours individuels et les facteurs associés au succès des techniques, ce qui devrait être possible avec le déploiement du registre national des FIV.
Les données dont l’Agence de la biomédecine dispose actuellement sont transmises sous un mode agrégé par les centres. Elles ne donnent pas d’indications sur les données individuelles par patiente ni sur les facteurs associés au succès des tentatives. Elles ne permettent donc pas de prendre en compte l’hétérogénéité de recrutement des centres. C’est vrai notamment du critère de l’âge des patientes, alors qu’il s’agit d’un élément indispensable à l’évaluation de la qualité des centres. Cette analyse devrait toutefois être rendue possible prochainement avec la mise en place plus complète du registre national des FIV. Selon Mme Joëlle Belaisch-Allart (129), « le recueil des données, tentatives par tentatives, est prévu dès janvier 2010 par l’Agence de la biomédecine ».
LE REGISTRE NATIONAL DES FÉCONDATIONS IN VITRO
Après avoir obtenu un avis favorable de ses instances et l’accord de la Commission nationale informatique et des libertés (CNIL), l’Agence a créé en 2007 le registre national des FIV, qui constitue un nouveau dispositif de recueil continu et exhaustif de données individuelles concernant le couple, le déroulement de chaque tentative de FIV jusqu’à la naissance du ou des enfants.
Développé par l’Agence sur la base du registre de l’association FIVNAT existant depuis 1986, le registre national des FIV est alimenté par les informations transmises par les centres d’AMP sur chacune des tentatives réalisées ainsi que sur les éventuels transferts d’embryons congelés et grossesses qui en sont dérivés. Le taux de participation des centres au registre était d’environ 50 % en 2005 et en 2006.
Ses objectifs à long terme sont de permettre une analyse plus fine des facteurs associés au succès des tentatives de FIV en tenant notamment compte des indications et des pratiques, d’identifier les pratiques le mieux adaptées selon ces facteurs et de proposer des recommandations sur la base d’indicateurs chiffrés, en vue de l’amélioration globale de la prise en charge et de caractériser les parcours des couples après une première tentative de FIV.
Source : Agence de la biomédecine
En second lieu, les résultats des centres d’AMP pourraient être rendus publics, en présentant notamment les caractéristiques de leur patientèle.
M. Jacques Testart (130), directeur de recherche honoraire à l’INSERM, a déclaré « [se battre] depuis des années pour que les pratiques et les résultats des centres d’AMP soient publiés de manière transparente. Les praticiens en avaient accepté le principe, à condition de mettre en évidence un certain nombre de critères propres à chaque équipe, comme l’âge moyen des patients ou le nombre moyen d’embryons transférés. Mais alors que l’Agence de la biomédecine a donné son accord et dispose de toutes les informations, il n’existe toujours pas de bilans individualisés. Si bien que, par exemple, des centres continuent d’exercer certaines pratiques, comme la congélation d’embryons, sans obtenir de résultats, mais les patients n’en sont pas informés ». Mme Laure Camborieux (131) a également exprimé, au nom de l’association Maia qu’elle préside, le souhait de « plus de transparence quant aux résultats des centres d’AMP. »
Regrettant que les résultats des centres ne soient pas diffusés, M. Pierre Jouannet (132), professeur des universités, praticien hospitalier consultant en biologie de la reproduction à l’hôpital Cochin, a rappelé qu’aux États-Unis, le CDC (Center for disease control and prevention) d’Atlanta publie les résultats centre par centre avec des statistiques établies par catégorie comparable de personnes, les taux de succès dépendant largement de l’âge de la femme et de l’origine de l’infertilité. Il a également jugé « souhaitable que de telles statistiques existent en France. Certaines différences de résultats peuvent s’expliquer par des différences de recrutement. Certains centres sont plus stricts que d’autres s’agissant de l’âge des femmes, si bien que leurs résultats sont meilleurs. Mais on peut tenir compte de ces biais et établir des statistiques permettant d’utiles comparaisons à population comparable. ».
Plus réservée sur la possibilité d’imposer à chaque centre de rendre publics ses résultats, Mme Joëlle Belaisch-Allart (133) a estimé que « si la transparence brute est à proscrire, un indice de performance est nécessaire » et qu’il « faudrait en tout cas faire preuve de la plus extrême prudence, car l’arme est à double tranchant. La transparence risque en effet de conduire à une sélection des patientes… »
Il convient en conséquence de prévoir la publication des résultats des centres d’AMP mais aussi leur présentation de manière équitable, en s’intéressant à tous les facteurs, notamment l’âge des femmes traitées ou encore le nombre moyen d’embryons transférés. Cela pourrait être « le moyen de tirer les équipes vers le haut », selon les termes de M. François Olivennes (134), qui a également suggéré que l’Agence de la biomédecine fixe un seuil en deçà duquel un centre serait amené à se remettre en cause. Il a fait remarquer qu’« une patiente française a à peu près deux fois moins de chances en moyenne d’être enceinte qu’une suédoise. Ces résultats doivent faire l’objet d’une enquête, si l’on veut répondre à cette question : pourquoi de tels résultats ? » L’Agence de la biomédecine pourrait également organiser des missions d’appui et de conseil dans certains centres, voire proposer des recommandations sur la base d’indicateurs chiffrés. Pour améliorer la prise en charge de l’infertilité, il est en tout état de cause nécessaire de chercher à mieux identifier les facteurs de succès et les bonnes pratiques en AMP et de renforcer l’évaluation de ces techniques, en s’appuyant notamment sur les données par patiente du registre FIVNAT et les résultats de chaque centre. Ce faisant, il conviendra également de s’interroger sur les éléments qui seraient susceptibles d’améliorer les taux de succès. Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont rangé parmi ces facteurs l’équipement et les moyens humains des laboratoires, la formation continue ; la spécialisation des médecins ou encore les stratégies adoptées par les centres, la France ayant plutôt opté pour « la politique du cheminement », selon les termes de Mme Jacqueline Mandelbaum (135), avec stimulations, inséminations et seulement ensuite FIV.
Proposition n° 11.
Afin de mieux évaluer les résultats des centres d’AMP :
– assurer un recensement plus complet de données individuelles, par patiente et par tentative d’AMP, dans le cadre du déploiement du registre FIV-NAT;
– compléter les missions de l’Agence de la biomédecine, afin de prévoir la publication régulière des résultats de chaque centre d’AMP, selon une méthodologie prenant notamment en compte les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l’âge des femmes ;
– inviter l’Agence de la biomédecine, au vu de ces données, à diligenter des missions d’appui et de conseil dans certains centres, voire à proposer des recommandations d’indicateurs chiffrés à certains centres.
b) Améliorer le suivi des personnes ayant eu recours à l’AMP, des enfants qui en sont issus ainsi que des donneuses d’ovocytes
Aux termes de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, l’Agence de la biomédecine est chargée d’évaluer les conséquences éventuelles de l’AMP sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus et de mettre en œuvre un suivi de l’état de santé des donneuses d’ovocytes, afin d’évaluer les conséquences des prélèvements sur leur santé.
Ce suivi est d’autant plus important que plus de 200 000 enfants auront été conçus par FIV en France depuis le début des années 1980(136). En outre, selon les informations recueillies auprès de l’Agence de la biomédecine, il semblerait que les conséquences de l’AMP sur la santé des enfants restent encore méconnues à ce jour ; en particulier, les nombreuses études disponibles seraient contradictoires et aucune donnée scientifique ne permettrait d’identifier une pathologie particulière plutôt qu’une autre.
L’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux bonnes pratiques en AMP prévoit que, dans le cadre des entretiens avec l’équipe médicale pluridisciplinaire, l’information du couple porte également sur l’obligation légale de l’Agence de la biomédecine d’évaluer les conséquences éventuelles de l’AMP sur la santé des personnes qui y ont recours et des enfant qui en sont issus ; le praticien doit aussi encourager le couple à participer aux études épidémiologiques qui pourront lui être proposées.
Le dispositif dit d’« AMP vigilance (137) » n’a pas pour objectif d’évaluer les conséquences à long terme sur la santé des personnes mais les praticiens concernés par le don de gamètes et l’AMP sont tenus de déclarer à l’agence tout événement indésirable survenu dans l’accomplissement de ces activités, susceptible d’avoir des conséquences graves pour les membres du couple ou l’enfant à naître.
Ce suivi soulève toutefois plusieurs difficultés dans la pratique.
Dans son rapport précité d’octobre 2008, l’agence souligne en effet que « l’application de la loi de bioéthique sur le suivi des personnes ayant été l’objet d’une AMP est une action au long cours et que le temps est nécessaire pour approfondir la réflexion, finaliser les différents dispositifs et les exploiter. »
Tout d’abord, le suivi individuel et exhaustif des 22 000 enfants conçus chaque année par AMP en France et ce, jusqu’à l’âge adulte, ne semble pas envisageable, d’autant que l’état actuel des connaissances scientifiques et médicales ne permet pas d’orienter ce suivi (par exemple, sur certaines techniques d’AMP ou des maladies qui seraient susceptibles de se développer).
Par ailleurs, l’évaluation des conséquences éventuelles des traitements d’aide à la procréation peut se heurter à la volonté de ne pas stigmatiser les enfants et de respecter le souhait des parents de « tourner la page ». Mme Carine Camby (138) a ainsi expliqué que « l’Agence n’est pas parvenue à mettre en place une méthode simple de suivi des enfants issus d’une AMP et des femmes ayant subi des simulations ovariennes car cela obligeait à revenir vers les familles et à révéler, le cas échéant, la vérité sur la conception de l’enfant et l’existence d’un don de gamètes. Le dispositif était par essence intrusif et risquait de stigmatiser ces enfants. La seule solution consiste à croiser des registres existants, comme ceux des handicaps à la naissance, mais elle demande du temps et ne répond pas entièrement aux questions posées. »
L’Agence de la biomédecine mène actuellement une réflexion sur le sujet. Elle s’oriente, au niveau épidémiologique, vers la possibilité de croiser différents registres, notamment le registre national de FIV, ceux de l’assurance maladie et du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) ou les registres de pathologies, afin de pouvoir étudier en tant que de besoin l’impact des FIV sur la santé des personnes et de mettre en évidence des pathologies qui affecteraient ces enfants et auraient nécessité des soins. Cette approche pourrait être complétée par la réalisation d’enquêtes ciblées.
En outre, le registre national des FIV, créé par l’Agence de la biomédecine et qui est actuellement en cours de développement, pourrait permettre de renforcer le suivi des personnes qui ont recours à l’AMP et des donneuses d’ovocytes. Le recueil de données individuelles relatives aux tentatives de FIV, dans le cadre de ce registre, s’inscrit dans le suivi de l’état de santé des personnes recourant à l’AMP. Il permettra en particulier la réalisation d’études statistiques et servira de base au suivi des patients.
Ces études impliquent la mobilisation de certains fichiers existant dans le domaine de la santé. Il est donc nécessaire que soient respectées les conditions d’utilisation de ces fichiers fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces fichiers sont régis par le chapitre X de cette loi, relatif aux « traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention ». Conformément à l’article 63 de la dite loi, les fichiers médicaux, tant publics que privés, ainsi que les fichiers de la sécurité sociale, peuvent être utilisés à des fins d’évaluation de l’AMP si les données sont anonymisées. En revanche, en vertu des articles 64 et 65, si les données sont susceptibles d’identifier les personnes en question, la recherche doit être soumise à autorisation préalable de la CNIL. Le cadre législatif actuel ne fait donc pas obstacle à ce que de telles études soient conduites.
Proposition n° 12. Renforcer le suivi de l’état de santé des personnes ayant eu recours à l’AMP, des enfants ainsi conçus et des donneuses d’ovocytes, en améliorant notamment le recueil des données individuelles relatives aux tentatives de fécondation in vitro (FIV) en France et en envisageant le croisement de différents registres existants.
c) Renforcer l’encadrement des techniques actuelles d’assistance médicale à la procréation
Au-delà de la nécessité d’améliorer leurs résultats, la mise en œuvre des techniques d’AMP doit également être suivie et encadrée pour des raisons de sécurité sanitaire. Plusieurs mesures pourraient être envisagées dans ce sens.
● L’arrêté relatif aux techniques d’effet équivalent
Aux termes de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique, l’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que « toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine ».
Ces dispositions ont été introduites à l’initiative du gouvernement, lors de l’examen par l’Assemblée nationale en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique adopté en 2004. M. Jean-François Mattei, alors Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ayant souligné que « la définition actuelle de l’assistance médicale à la procréation est suffisamment souple pour englober les évolutions médicales et techniques qui pourraient apparaître », mais qu’il était « nécessaire de veiller à la mise en œuvre des seules techniques dont les risques sont considérés comme acceptables (139). » Cet amendement avait également pour objet d’encadrer ces techniques, en réponse à l’opposition exprimée par le Gouvernement d’adopter un dispositif d’évaluation des nouvelles techniques d’AMP qui aurait pu aboutir à la création d’embryons à des fins de recherche.
Cet arrêté prévu par la loi de 2004 n’a cependant pas été publié.
Selon les informations recueillies auprès du ministère de la santé, la préparation de ce texte a été entreprise dès la publication de la loi, mais le groupe de travail, constitué de représentants de la Direction générale de la santé (DGS) et de l’Agence de la biomédecine, a constaté des difficultés qui n’ont pas permis d’aboutir à la rédaction d’un texte.
Selon l’Agence de la biomédecine (140), la formulation retenue par la loi conduit à des interprétations divergentes du contenu de cette liste, ce qui a empêché, jusqu’à ce jour, d’aboutir à un consensus pour l’établir. La difficulté résiderait dans la définition du degré d’innovation qui permet de différencier une nouvelle technique de l’évolution d’une technique existante. Par exemple, la congélation des embryons ou des ovocytes par la méthode de vitrification, qui permet d’accélérer fortement la descente en température peut être analysée, soit comme une nouvelle technique de congélation, soit comme une évolution de la technique de congélation.
Dès lors et compte tenu de la position des membres de la mission en matière de recherches sur les embryons (cf. infra, dans le chapitre 5 du présent rapport), il apparaît nécessaire de publier l’arrêté prévu par la loi de 2004 et d’admettre le principe que cette liste sera complétée en fonction des progrès techniques et au vu de critères particulièrement stricts d’innocuité.
Proposition n° 13. Publier l’arrêté prévu à l’article L. 2141-1 du code la santé publique, issu de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, validant les techniques d’AMP d’effet équivalent.
Cet arrêté devra être complété au fur et à mesure de la conception de techniques nouvelles d’AMP faisant l’objet d’un consensus des professionnels sur la base de critères de qualité, d’innocuité, d’efficacité et de reproductibilité.
● Transferts in utero de plusieurs embryons et grossesses multiples
M. Pierre Jouannet (141) a attiré l’attention des membres de la mission sur les transferts in utero de plusieurs embryons conduisant à des grossesses multiples. Il a estimé que « l’une des principales difficultés de l’AMP réside aujourd’hui dans le risque pour la santé des enfants, résultant essentiellement du taux très élevé de grossesses multiples. Chacun sait qu’en cas de grossesse gémellaire, a fortiori triple ou quadruple, les risques de prématurité, d’hypotrophie fœtale, ou encore de nécessité d’une réanimation néonatale sont beaucoup plus importants. » En conséquence, M. Pierre Jouannet a considéré que « si on souhaite améliorer nos résultats en matière d’AMP, il faut lutter résolument contre les grossesses multiples, ce qui signifie réduire le nombre d’embryons transférés. Un progrès a été enregistré sur ce point, hélas encore trop faible. Il a été beaucoup plus rapide dans d’autres pays, nordiques notamment, où le nombre de grossesses multiples a été quasiment réduit à zéro, sans que le taux de grossesses ne diminue. Je regrette donc qu’en France, on ne soit pas plus volontariste sur ce point, tant au niveau institutionnel que professionnel. »
Il convient cependant de rappeler que l’arrêté du 11 avril 2008 (142) prévoit que le nombre d’embryons à transférer est discuté conjointement entre le couple, le clinicien et le biologiste. Ce nombre dépend notamment de la morphologie des embryons, des résultats des tentatives antérieures éventuelles, de l’âge de la patiente et des ses antécédents. Il est autant que possible limité à deux embryons transférés, voire un seul. Au–delà de deux embryons, les raisons doivent être justifiées dans le dossier médical du couple.
Il appartiendra à l’Agence de la biomédecine de dresser le bilan de l’application de l’arrêté sur cette question dans son rapport annuel.
● Les recommandations de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne
L’article L. 2141-1 du code de la santé publique prévoit que la stimulation ovarienne est soumise à des recommandations de bonnes pratiques, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre indépendamment d’une technique d’AMP. En principe, ces recommandations devraient être édictées par l’Agence de la biomédecine, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ainsi que le prévoit l’article R. 2141-1 du même code.
Toutefois, dans son rapport d’octobre 2008 précité, l’Agence de la biomédecine indique qu’il ne lui est jusqu’à présent pas apparu nécessaire de définir de bonnes pratiques, dans la mesure où l’AFSSAPS a rédigé, avec les professionnels et en lien avec l’agence, des recommandations de bon usage des médicaments inducteurs de l’ovulation.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’aux termes de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique est chargée d’élaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, de procéder à leur diffusion et de contribuer à l’information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l’AFSSAPS dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire.
Dès lors, il pourrait être envisagé de préciser par voie réglementaire l’autorité responsable de la définition des règles de bonnes pratiques sur la stimulation ovarienne.
Proposition n° 14. Préciser quel est l’organisme chargé de l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne.
d) Les interrogations éthiques soulevées par les recherches visant à améliorer les techniques d’AMP
Dans son rapport d’octobre 2008, l’Agence de la biomédecine observe que les professionnels sont aujourd’hui confrontés à l’absence de cadre légal pour effectuer des recherches biomédicales sur les gamètes et sur le développement embryonnaire in vitro. Ces recherches visent notamment à améliorer le processus de fécondation in vitro et de développement de l’embryon en culture avant son transfert in utero. Les innovations portent en particulier sur les techniques de fécondation, les milieux de culture ou de fécondation ainsi que les techniques de congélation embryonnaire ou ovocytaire.
L’autorisation de ce type de recherches se heurterait toutefois aux dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique dont le dernier alinéa dispose que les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
Cette question sera donc évoquée dans le chapitre 5 du présent rapport relatif aux recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires.
C. QUELLES SONT LES QUESTIONS ÉTHIQUES SOULEVÉES PAR LA CRYOCONSERVATION DES EMBRYONS ?
Si la possibilité de procéder à des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires suscite de vives interrogations éthiques, ce débat ne doit cependant pas conduire à occulter celui qui se situe en amont. Se pose en effet le problème de la conception in vitro de plusieurs embryons et de la cryoconservation de ceux d’entre eux qui ne seraient pas transférés in utero, en vue d’améliorer les chances de succès de l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour le couple.
En d’autres termes, avant de s’arrêter sur la transgression que constituerait l’instrumentalisation de l’embryon à des fins de recherche, ne faut-il pas d’abord s’interroger sur ce qui peut apparaître comme la transgression première, c’est-à-dire la faculté de concevoir puis, le cas échéant, de détruire des embryons « en surnombre » ? Et que faire des quelque 155 000 embryons qui sont aujourd’hui plongés dans l’azote liquide ? Se trouvent-ils dans « une sorte de no man’s land », selon les termes du Grand rabbin Haïm Korsia (143) ?
1. La conception d’embryons « surnuméraires » : convient-il de modifier l’encadrement actuel ?
Dans le cadre de l’AMP, la loi permet au couple de consentir à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental (article L. 2141-3 du code de la santé publique), c’est-à-dire en vue d’une nouvelle tentative de transfert en cas d’échec ou d’une autre maternité ultérieure. Ainsi, quand le nombre d’embryons obtenus lors d’une FIV est supérieur au nombre d’embryons transférés in utero, les embryons restant dont le développement est satisfaisant, dits « surnuméraires », sont congelés. La loi n’impose aucune limite quant au nombre des ovocytes à féconder.
Au 31 décembre 2007, environ 155 000 embryons étaient conservés par congélation dans les centres d’AMP, pour environ 43 000 couples (144).
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMBRYONS CRYO-CONSERVÉS DEPUIS 2004
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
Nombre d’embryons congelés |
134 358 |
141 460 |
176 523 |
154 822 |
Source : Agence de la biomédecine
La conception et la congélation d’embryons surnuméraires suscite plusieurs interrogations, voire une contestation de son principe même.
Comme l’a rappelé M. Jean-René Binet (145), maître de conférences à la faculté de droit de Besançon, le choix de permettre la conception d’un nombre plus important d’embryons qu’il ne pourrait en naître d’enfants tenait initialement à des « raisons techniques liées au faible taux de réussite des grossesses après FIV et à l’impossibilité de congeler les ovocytes », l’existence de « ce stock d’embryons ayant rapidement suscité une interrogation profonde sur leur statut ontologique et juridique ». Est-il cependant éthique de permettre la conception en surnombre d’embryons humains pour des raisons techniques de rendement de la FIV ? À cet égard, M. Géraud Lasfargues (146), président de l’Académie nationale de médecine, a souligné combien « les chiffres à l’heure actuelle sont impressionnants : il faut 240 000 embryons pour avoir 12 000 naissances par an. »
En outre, la congélation des embryons peut poser des problèmes aux couples, dans la mesure où elle a d’une certaine manière pour effet de suspendre le temps, entre la conception et la venue au monde éventuelle mais aussi de les placer devant des choix parfois difficiles.
Ainsi, Mme Geneviève Delaisi de Parseval (147) a estimé que c’est « dans tout le domaine de l’AMP, le point qui [lui] inspire, comme psychanalyste, le plus de réserves. Ce procédé arrête le temps, peut inverser l’ordre des générations, oblige les gens à une gymnastique mentale bizarre, comprendre que deux « jumeaux » par exemple naissent avec cinq ans d’écart… » C’est pourquoi il faudrait, selon elle, « limiter le plus possible la congélation d’embryons surnuméraires, qui sont trop nombreux, de l’avis même des professionnels de la FIV. [Les membres du couple] voulaient un ou deux enfants, mais pas quinze embryons surnuméraires, qui leur posent un problème dont ils se seraient volontiers passés… » M. Pierre Boyer (148), biologiste au service de médecine et de biologie de la reproduction de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, a également évoqué une étude réalisée par le Dr. Adjiman, dont il ressort que la moitié des femmes objets de l’étude éprouve un sentiment d’abandon d’enfant lorsque les embryons congelés ne sont pas implantés.
La cryoconservation des embryons surnuméraires constitue-t-elle dès lors « une impasse éthique » au regard de « l’imbroglio » qu’elle représenterait « pour la société, pour les médecins et pour les familles confrontées à la nécessité de prendre une décision », ainsi que l’a estimé M. Xavier Mirabel (149), président de l’Alliance pour les droits de la vie ? Faudrait-il l’interdire, comme c’est le cas en Italie ? M. Jean-Marie Le Méné (150), président de la fondation Jérôme Lejeune, a suggéré de « s’inspirer du modèle allemand, puisque le nombre d’embryons conçus dans le cadre d’une AMP est volontairement réduit outre-Rhin ». Il a constaté que « la France mène une politique "généreuse", grande consommatrice d’embryons, ce qui justifie a posteriori l’utilisation des embryons par la recherche. (…) Que faire du stock d’embryons surnuméraires ? Il faut déjà arrêter de l’alimenter ; nous aurions dû le faire dès 2004. »
La conception d’embryons en surnombre peut notamment conduire à leur destruction ou à leur utilisation pour la recherche. M. Xavier Lacroix (151) a rappelé à cet égard qu’en amont de la question de la recherche, « l’Église [catholique] déplore le fait que la FIV, dans notre pays comme dans quelques autres – ce n’est pas le cas en Allemagne – s’accompagne presque toujours de la production d’embryons surnuméraires, qui seront voués à la destruction. Là est le problème le plus grave, qui est à l’origine de la plupart des autres. »
La conception d’embryons et leur éventuelle congélation est toutefois subordonnée à plusieurs conditions visant à garantir le respect de certains principes éthiques.
Tout d’abord, un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de FIV avant le transfert in utero de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons (article L. 2141-3 précité), du fait notamment des dommages consécutifs à la congélation des embryons. Cette limitation des nouvelles tentatives de fécondation lorsque des embryons ont déjà été conçus marque ainsi la volonté du législateur de ne pas multiplier excessivement le nombre d’embryons conçus in vitro.
En outre, le couple doit donner son consentement écrit avant toute tentative de fécondation multiple. M. Pierre Boyer (152) a ainsi indiqué avoir rencontré un certain nombre de couples ne souhaitant pas la congélation d’embryons. Lorsque c’est le cas, l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux bonnes pratiques en AMP prévoit que le nombre d’ovocytes traités est limité à deux ou trois, en fonction du nombre d’embryons que l’on souhaite transférer, le couple en ayant été averti au moment du consentement.
Par ailleurs, une information détaillée doit être remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir des embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental, selon les termes de l’article L. 2141-3 précité.
La Secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, Mme Nadine Morano (153) a souligné la nécessité de « mieux informer à ce sujet les couples qui s’engagent dans une FIV », en jugeant souhaitable de freiner l’hyperstimulation ovarienne suivie de l’insémination d’un trop grand nombre d’embryons. Dans le même sens, l’avis citoyen du panel de Marseille a recommandé « vivement qu’une information approfondie soit dispensée au couple entamant une démarche parentale ». S’il convient effectivement de veiller à ce que chacun des membres du couple reçoive une information détaillée, afin de garantir son consentement libre et éclairé, il n’apparaît pas nécessaire a priori de modifier la loi en ce sens, au regard des dispositions déjà prévues par le code de la santé publique.
La loi pourrait cependant être clarifiée, afin de préciser que l’information détaillée sur les possibilités de devenir de leurs embryons est remise aux membres du couple préalablement au recueil de leur consentement, la loi ne précisant pas clairement le moment de cette information.
La loi précise enfin que la conservation des embryons est autorisée « compte tenu de l’état des techniques médicales ». Il n’est donc pas exclu que des progrès scientifiques conduisent dans quelques années à reconsidérer l’opportunité de recourir à la cryoconservation, en particulier si les capacités de développement et d’implantation de l’embryon étaient mieux connues ou du fait des progrès de techniques de congélation ovocytaire, telles que la vitrification. Selon certains praticiens, ce mode de congélation rapide pourrait en effet permettre de ne plus concevoir d’embryons qu’en vue d’un transfert immédiat ; seuls les ovocytes seraient alors congelés. Selon M. Géraud Lasfargues (154), les gynécologues pensent pouvoir diminuer de moitié le nombre d’embryons conçus dans le cadre d’une FIV.
À cet égard, M. Jean-René Binet (155) a considéré que « la loi est claire : si le couple peut consentir à l’existence d’embryons cryo-conservés, c’est à condition que cette technique corresponde bien à l’état de la science. Or, s’il n’était pas possible de conserver les ovocytes au début des années 80, la vitrification le permet aujourd’hui avec des résultats qui semblent tout à fait satisfaisants. (…) J’observe que dans d’autres pays où, comme en Allemagne, on n’autorise pas la production d’embryons surnuméraires et où l’on utilise cette technique, les choses ne se passent pas si mal ». L’autorisation des recherches sur cette technique susciterait néanmoins de nombreuses interrogations éthiques et juridiques (156).
Par ailleurs, les alternatives à la congélation des embryons surnuméraires – l’interdiction ou la limitation normative du nombre d’ovocytes à féconder in vitro – poseraient d’autres difficultés.
La congélation embryonnaire offre en effet aux couples une chance de réussite supplémentaire des traitements d’AMP. Elle est également envisagée lorsqu’il est nécessaire de différer le transfert in utero avant un traitement potentiellement stérilisant, dans le cadre de la préservation de la fertilité. Mme Jacqueline Mandelbaum (157) a déclaré ne pas partager « la hantise de l’embryon surnuméraire », en rappelant que la FIV permet le recueil de huit à dix ovocytes en moyenne, que 25 % des couples suivant un protocole de FIV bénéficieront d’une congélation d’embryons et que « cette technique améliore de 7 % leur chance d’obtenir une naissance, puisqu’elle permet d’atteindre un taux moyen de presque 30 % de naissances par cycle. »
De plus, la limitation du nombre d’ovocytes susceptibles d’être fécondés risquerait de conduire à des grossesses multiples. Comme l’a fait valoir M. Jean-François Guérin (158), « tous les biologistes sont d’accord pour dire qu’il faut maintenir la congélation. Car dans le cas contraire, que faire des embryons surnuméraires ? Il serait scandaleux, ou pour le moins contestable d’un point de vue éthique, de les détruire. Ou alors on en arrive à la législation italienne, qui ne permet de mettre en fécondation que trois ovocytes. Et quand on a obtenu trois embryons, on transfère les trois, si bien que dans ce pays, le taux de grossesses triples – et donc hautement à risque – a augmenté de manière spectaculaire en trois ans. Tels sont les effets pervers d’une loi qui se voulait plus moralisante. »
En tout état de cause, s’il est vrai que la formule idéale serait « un ovocyte, un embryon, un enfant », selon Mme Jacqueline Mandelbaum (159), « c’est probablement davantage par une amélioration de nos pratiques – par une meilleure définition de ce que sont un gamète ou un embryon de qualité, par exemple, ou une plus grande précision dans la gestion des cycles – que nous y parviendrons, et non par une limitation arbitraire du nombre d’embryons surnuméraires. » Par ailleurs, le nombre des couples en grande souffrance en raison d’une incapacité à décider du sort de ces embryons serait en définitive très limité et ne justifierait pas une disposition légale ; selon Mme Jacqueline Mandelbaum : « il vaut mieux laisser aux praticiens le soin de s’entendre à l’avance avec ces couples pour limiter dans leur cas le nombre d’embryons surnuméraires ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la législation actuelle paraît donc globalement satisfaisante, étant précisé que, dans le cadre fixé par la loi, la congélation embryonnaire doit relever des bonnes pratiques en AMP, sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine et du ministère de la santé.
2. Le sort des embryons congelés : à quelles conditions leur conservation peut-elle être arrêtée ?
En application de l’article L. 2141-4 du code de la santé publique, les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. Les équipes médicales rencontrent certaines difficultés pratiques pour appliquer ces dispositions, évoquant par exemple les changements d’adresse. Les professionnels ne remettent cependant pas en cause le principe de cette consultation annuelle, selon l’Agence de la biomédecine (160).
Dans la grande majorité des cas (62 %), les embryons sont conservés en vue de réaliser le projet parental des couples à l’origine de leur conception.
S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple ou le membre survivant peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple, à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche ou encore à ce qu’il soit « mis fin à leur conservation », à savoir qu’ils soient détruits. Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit et doit être confirmé après un délai de réflexion de trois mois.
Les enjeux éthiques liés à l’accueil d’embryon et à la recherche sur l’embryon étant abordés ultérieurement, on évoquera plus spécifiquement la question des conditions d’arrêt de leur conservation.
Les embryons sont détruits à la condition qu’ils aient été conservés pendant une durée minimale de cinq ans lorsque le couple, consulté à plusieurs reprises, ne répond pas ou en cas de désaccord au sein du couple sur le maintien du projet parental ou le devenir des embryons. L’absence de réponse du couple peut notamment s’expliquer par le fait que des « couples confrontés à ce problème vivent très difficilement cette relation aux embryons surnuméraires » et que « l’occultation, l’oubli peut être la façon pour eux de résoudre cette difficulté », selon Mme Chantal Lebatard (161). Par ailleurs lorsque le couple a consenti à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans, il est également mis fin à la conservation des embryons.
SITUATION DES EMBRYONS CONSERVÉS AU REGARD DU MAINTIEN OU NON
DU PROJET PARENTAL AU 31 DÉCEMBRE 2007
Projet parental en cours |
Abandon du projet parental |
Défaut de réponse ou désaccord |
Total | |
Embryons conservés |
96 109 |
23 282 |
35 431 |
154 822 |
Pourcentage |
62,1 % |
15,0 % |
22,9 % | |
Couples dont les embryons étaient conservés au 31/12 |
27 172 |
6 484 |
9 626 |
43 282 |
Pourcentage de couples |
62,8 % |
15,0 % |
22,2 % |
Source : Agence de la biomédecine (juillet 2009)
Mme Carine Camby (162) a constaté que « la disposition de la loi de 2004 permettant la destruction des embryons cinq ans après la disparition du projet parental n’est que très peu mise en œuvre par les centres hospitaliers, tant les médecins ont besoin d’être confortés dans ce geste définitif ». Toutefois la diminution du nombre d’embryons cryo-conservés et l’augmentation concomitante du nombre d’embryons faisant l’objet d’un projet parental peuvent suggérer que l’interruption de la conservation, rendue possible par la loi du 6 août 2004, a été effective en 2007.
M. Carlos de Sola a rappelé que dans le cadre des travaux du Conseil de l’Europe, « beaucoup de délégations ont estimé que, même si en principe la destruction des embryons surnuméraires n’est pas nécessairement souhaitable, il n’est pas opportun de l’interdire ». Selon M. Xavier Mirabel, si l’embryon peut être transféré in utero, on peut aussi envisager d’arrêter cette congélation, « que l’on pourrait regarder comme une forme d’acharnement thérapeutique, comme une pratique tout à fait indue sur un être humain très fragile ».
Conviendrait-il de déterminer une durée maximale de conservation des embryons faisant encore l’objet d’un projet parental ou de prévoir un délai plus court de conservation de ceux pour lesquels ce projet n’existe plus ?
Tout d’abord, la possibilité offerte au couple de conserver ses embryons, du fait de la poursuite de son projet parental, doit-elle avoir une limite dans le temps ? Les premières lois de 1994 avaient en effet fixé à cinq ans la durée maximale de conservation des embryons, cette disposition ayant été supprimée par la loi du 6 août 2004 et remplacée par un délai (également de cinq ans) qui court en fonction de l’absence de manifestation d’un projet parental. Il n’apparaît pas opportun de revenir sur ce point, dans la mesure où la fixation d’un tel délai de conservation pourrait sembler arbitraire, dès lors que le couple a encore un projet parental et continue d’être en âge de procréer. La cohérence de la loi, qui met l’accent sur la volonté et la responsabilité des couples, ne justifie-t-elle pas que ce soit eux qui décident du devenir des embryons dont ils ont permis la conception ?
Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, les citoyens du panel de Marseille ont par ailleurs jugé trop long le délai de conservation de cinq ans des embryons surnuméraires ne s’inscrivant plus dans un projet parental. Ils ont préconisé que « ce délai soit ramené de cinq à un an renouvelable une fois, l’absence de réponse des parents, une fois ce délai écoulé, signifiant la fin du projet parental ». Ils ont également proposé qu’une information approfondie sur ce point soit dispensée au couple entamant une démarche parentale et qu’il leur soit demandé « dès cet instant de décider du devenir des embryons surnuméraires, en cas d’absence de réponse de leur part par la suite (destruction, don à un autre couple ou à la recherche) » ; l’objectif serait de préciser le fait que « l’éventuelle destruction de l’embryon sera de la responsabilité des concepteurs et non des médecins. Cela permettrait également une meilleure compréhension de l’intérêt du don d’embryons à la recherche ».
La diminution de la durée de la conservation des embryons à un an renouvelable une fois pourrait cependant être source de difficultés et ressentie douloureusement par les couples. On ne peut exclure qu’ils ne répondent pas dans les délais impartis pour différentes raisons notamment psychologiques, qui ne peuvent pas toujours être interprétées comme une indifférence de leur part. On ne peut écarter non plus l’hypothèse qu’ils soient, momentanément, en désaccord sur l’avenir des embryons. Là encore, ne doit-on pas autant que possible tenter de s’appuyer sur la liberté de choix des couples ?
Par ailleurs, demander aux couples dès qu’ils s’engagent dans une démarche parentale de se prononcer sur le don à la recherche des embryons conçus en surnombre ne serait-il pas contradictoire avec les dispositions de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique qui s’opposent à la conception d’embryons in vitro à des fins de recherche ?
Proposition n° 15. Maintenir l’encadrement actuel concernant la conception, la congélation et le devenir des embryons surnuméraires.
Préciser dans la loi que l’information délivrée aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons doit leur être remise préalablement au recueil de leur consentement à la fécondation multiple d’embryons (en complétant en ce sens le deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique).
D. L’AMP AVEC TIERS DONNEUR : LES PRINCIPES D’ANONYMAT ET DE GRATUITÉ DU DON DE GAMÈTES DEVRAIENT-ILS ÊTRE RECONSIDÉRÉS ?
L’AMP avec tiers donneur prend deux formes : le don de gamètes ou l’accueil d’embryon. Elle peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques de procréation assistée au sein du couple ne peuvent aboutir ou, depuis 2004, lorsque le couple, dûment informé, y renonce (163).
Les enfants nés d’un don de gamètes représentent aujourd’hui environ 6 % de l’ensemble de ceux conçus par AMP. Les deux principes fondamentaux sur lesquels repose ce don, l’anonymat et la gratuité, sont aujourd’hui contestés : pour quelles raisons et dans quel sens conviendrait-il, le cas échéant, de les remettre en cause ? Par ailleurs, les dispositions de la loi relatives à l’accueil d’embryon doivent-elles être maintenues ?
1. Promouvoir le don de gamètes sans remettre en cause le principe de non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments
Le don de gamètes consiste en l’apport par un tiers de spermatozoïdes ou d’ovocytes en vue d’une AMP. De quelle façon doit-il être promu et pourrait-on envisager qu’il puisse faire l’objet d’une compensation financière ?
a) La pénurie d’ovocytes ne doit pas justifier la rémunération du don
La loi définit précisément les conditions dans lesquelles un don de gamètes peut être effectué, afin notamment de protéger le donneur. Ainsi, « aucun paiement, quelle qu’en soit la forme », ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits (article L. 1211-4 du code de la santé publique). Ces dispositions découlent du principe général posé par l’article 16-1 du code civil, aux termes duquel le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. En outre, le donneur doit déjà avoir procréé (L. 1211-2 du même code). Son consentement et s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, doit être recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes (article L. 1244-2 du même code).
La situation actuelle se caractérise par une insuffisance de dons, en particulier d’ovocytes.
Près de 1 300 couples étaient en effet en attente d’un don d’ovocytes à la fin de l’année 2007. En dépit d’une légère augmentation du nombre de ponctions (247 en 2007, contre 228 en 2006 et 168 en 2005), ce nombre reste insuffisant dans la mesure où, à raison de 1,8 couple en moyenne pouvant bénéficier d’ovocytes issus une même donneuse, il aurait fallu 700 donneuses supplémentaires en 2007 pour résorber totalement la liste d’attente. Il en résulte que les couples peuvent attendre de deux à cinq ans un don d’ovocytes.
Concernant le don de spermatozoïdes, la pénurie est moins grande, comme l’indique le tableau suivant.
DONS DE GAMÈTES EN 2007
Dons de spermatozoïdes | |
Donneurs |
|
Donneurs acceptés dont le sperme a été congelé dans l’année |
232 |
Paillettes congelées dans l’année issues des donneurs acceptés dans l’année |
13 345 |
Nombre de paillettes congelées/donneur |
57,5 |
Paillettes utilisées dans l’année |
10 230 |
Paillettes en stock au 31 décembre de l’année |
49 480 |
Couples receveurs |
|
Demandes d’AMP avec spermatozoïdes de donneur dans l’année |
2 113 |
Nombre de demandes d’AMP dans l’année/donneur accepté dans l’année |
9 |
Couples ayant effectué au moins une tentative d’AMP avec les spermatozoïdes d’un donneur dans l’année |
2 913 |
Dons d’ovocytes | |
Donneuses |
|
Ponctions réalisées dans l’année : |
247 |
- Dons exclusifs |
236 |
- Dons au cours d’une FIV/ICSI |
10 |
- Non renseigné |
1 |
Receveuses |
|
Nouvelles demandes acceptées |
556 |
Receveuses ayant bénéficié d’un don d’ovocytes |
453 |
Receveuses en attente de don d’ovocytes au 31 décembre de l’année |
1 296 |
Source : Agence de la biomédecine, rapport d’activité 2008 (juillet 2009)
Encore faut-il préciser que ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre de couples qui se rendent à l’étranger, en particulier en Espagne, pour bénéficier d’un don de gamètes. Ainsi, Mme Hélène Letur-Konirsch (164), co-présidente du Groupe d’études des dons d’ovocytes (GEDO), a souligné que « le niveau annuel de la demande n’est pas connu avec certitude. En 2006, l’Agence de la biomédecine notait l’inscription de 647 nouveaux couples demandeurs. Or, ce chiffre ne prend absolument pas en compte les couples qui choisissent de se rendre à l’étranger, soit après une première consultation dans les centres autorisés, soit après avoir été directement orientés vers un autre pays par leur praticien libéral ou leur association. Si l’on prend en compte les couples qui se sont inscrits en 2006 en Espagne, en Grèce et en République tchèque, la demande annuelle peut être estimée à 2 000 nouveaux couples. Or, durant la même période, seules 228 donneuses ont fait l’objet d’un prélèvement ovocytaire, ce qui représente 0,35 donneuse par couple receveur inscrit – et non pas par couple demandeur ! »
Faut-il autoriser les femmes n’ayant jamais procréé à consentir à un don d’ovocytes ?
Les dispositions de la loi prévoyant que le donneur doit avoir déjà procréé, visent à protéger le donneur, en particulier s’il devenait stérile ultérieurement. Elles évitent le recrutement de donneurs trop jeunes. Ces règles ont cependant deux conséquences : elles restreignent le champ des donneuses potentielles et ont pour effet que les dons proviennent de femmes plus âgées dont les ovocytes sont de moins bonne qualité. L’Agence de la biomédecine a de ce fait proposé la levée de la condition de procréation antérieure, en soulignant que ces dispositions ont pour effet de diminuer l’efficacité du don.
En rappelant que certains proposent de remettre en cause le principe de gratuité du don, Mme Dominique Mehl (165) a jugé, dans ce sens, qu’il existe « un problème beaucoup plus important encore : il faut avoir déjà été parent pour être donneur ou donneuse. On considère en effet que si la personne, après son don, devenait elle-même incapable de concevoir, elle risquerait d’infiniment regretter ce don. Le résultat, c’est que les donneuses sont rares et trop âgées : la pénurie de dons d’ovocytes en France tient pour partie au manque d’informations, mais plus encore au fait que ce don ne peut pas être proposé à des jeunes filles – à l’occasion, par exemple, d’une intervention chirurgicale – dès lors qu’elles n’ont pas eu d’enfant. Il serait important de réfléchir à ce problème car à ma connaissance, la France est le seul pays à avoir institué cette clause. »
Modifier la loi sur ce point serait toutefois lourd de conséquences. Ainsi, Mme Jacqueline Mandelbaum (166)pense qu’« il ne serait pas du tout raisonnable, par ailleurs, d’autoriser le don par des femmes qui n’ont pas eu d’enfants, en dépit de tous les avantages qu’offrirait la disposition d’ovocytes de femmes de vingt ans : les taux de succès exploseraient ! Mais on ne peut pas négliger les risques, même faibles, que la ponction d’ovocytes et les traitements afférents font peser sur la fécondité de la donneuse. Il y a aussi le risque psychologique encouru par ces femmes si d’aventure elles n’avaient pas d’enfants par la suite. » Il apparaît dès lors préférable de maintenir les dispositions protectrices de la loi excluant les femmes n’ayant jamais procréé.
Faut-il plaider pour une extension de ces activités au secteur privé lucratif ?
Les activités cliniques et biologiques d’AMP relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, aucune rémunération à l’acte ne pouvant être perçue par les praticiens au titre de ces activités (article L. 2142-1 du même code tel que modifié par l’ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008).
Dans son rapport précité d’octobre 2008, l’Agence de la biomédecine évoque la possibilité d’étendre au secteur privé lucratif les activités de don de gamètes, sous réserve d’une stricte réglementation. Mme Joëlle Belaisch-Allart (167)partage ce point de vue en estimant que « le don d’ovocytes et l’accueil d’embryons restent limités aussi parce qu’ils sont uniquement réalisés dans le secteur public ». Mme Dominique Lenfant (168) a également considéré que « la solution la plus évidente pour aider les donneuses, c’est d’autoriser à pratiquer les activités de don de gamètes et d’accueil d’embryons les établissements de santé privés à but lucratif soumis aux mêmes règles que les centres agréés qui en font la demande. S’il existe un réseau national du don, on facilitera la vie des donneuses. »
Toutefois, comme l’a fait observer M. Pierre Jouannet (169), opposé à cette proposition de l’Agence de la biomédecine, « cela constituerait une rupture majeure dans la pratique du don des éléments du corps humain qui a toujours prévalu dans notre pays. Cela risquerait en outre de soumettre cette activité aux lois du marché. Il ne faut pas (…) rompre avec les choix éthiques faits depuis longtemps en France, qui ont évité les dérives constatées dans d’autres pays. » Ces propos sont à rapprocher de l’inquiétude exprimée par M. Claude Huriet (170), qui rappelait l’existence d’un « commerce des ovocytes et l’accroissement de l’offre, notamment aux États-Unis où le développement d’un véritable marché fait que l’on peut désormais choisir son ovocyte, à condition de pouvoir y mettre le prix. Plus on paie cher, plus on a de chances d’espérer obtenir " un bon produit".»
Les activités de don de gamètes, qui diffèrent des autres activités médicales du fait du questionnement éthique spécifique qu’elles soulèvent, devraient dès lors demeurer dans le secteur public ou privé à but non lucratif.
Faut-il instituer une indemnisation forfaitaire, voire une rémunération du don de gamètes ?
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont proposé de permettre l’indemnisation ou la rémunération des dons d’ovocytes, en faisant notamment valoir que l’obtention et le prélèvement d’ovocytes sont beaucoup plus compliqués et contraignants qu’un don de sperme (171). Dès lors, selon M. Alain Grimfeld (172), « comment, à terme, ne pas indemniser, sinon rémunérer, les donneuses d’ovocytes, ne serait-ce que pour le pretium doloris ? »
Certains praticiens soulignent notamment qu’un certain nombre de couples, et notamment ceux qui en ont les moyens, se rendent aujourd’hui dans des pays étrangers qui ont des politiques différentes de « recrutement » des donneuses. Mme Laure Camborieux (173) a ainsi considéré que « la très grande difficulté du don d’ovocytes pousse les couples à se rendre à l’étranger et les place parfois à la merci d’intermédiaires peu fiables. »
En effet, plusieurs États européens ont permis l’indemnisation forfaitaire voire la rémunération des dons de gamètes. Selon M. Carlos de Sola (174), « les pays européens sont d’accord sur le principe de non rémunération, contrairement aux États-Unis, où certains États autorisent la rémunération. Mais la question est celle de la mise en œuvre du principe ». Ainsi, au Royaume-Uni, le don d’ovocytes ne pourrait être rémunéré plus de 250 livres sterling et les femmes qui acceptent de donner leurs ovocytes ne paient pas leur FIV. L’Espagne a également mis en place un barème d’indemnisation de 900 euros par ponction.
Faut-il dès lors maintenir le principe de gratuité, « au risque que la pratique demeure confidentielle », comme s’en est inquiétée Mme Joëlle Belaisch-Allart (175), avec des « des femmes qui courent le monde, parfois seules, et se rendent dans des officines douteuses, ce qui peut provoquer des catastrophes », selon M. François Olivennes (176) ? Faut-il au contraire assouplir le principe de gratuité du don de gamètes et instituer, même temporairement, « un dédommagement, au moins symbolique » ?
Pour éviter des dérives et notamment des transactions directes, M. René Frdyman (177) s’est déclaré favorable à une « indemnisation solidaire, c’est-à-dire prise en charge par la société. Cela porterait certes atteinte au principe éthique de la gratuité. Mais parce qu’on aura légèrement déplacé le curseur, ira-t-il inéluctablement plus loin ? Je n’en suis pas sûr. (…) Mieux vaudrait une solution du type de celle que je préconise plutôt que de distribuer, comme aujourd’hui, larga manu, des listes d’adresses de centres à l’étranger et d’encourager ainsi le tourisme procréatif. »
Votre rapporteur estime cependant que le don de gamètes ne doit faire l’objet ni de rémunération ni d’indemnisation.
En effet, la rémunération du don conduirait à une remise en cause du principe de non commercialisation du corps humain et de ses éléments, qui constitue l’un des piliers des lois de bioéthique et vise à protéger la dignité de la personne.
Comme l’a lui-même reconnu M. René Frydman (178), « la frontière est bien sûr ténue entre indemnisation et rémunération, et on peut craindre qu’on passe facilement de l’une à l’autre ». De même, M. Carlos de Sola (179) a indiqué qu’en Espagne une réforme de 2005 introduit la possibilité d’indemniser non seulement la perte de revenus, mais aussi les « gênes » ou les « incommodités ». Or, « contrairement au défraiement, ce dernier concept n’est pas objectif. Comment évalue-t-on la gêne, la molestia ? Où s’achève le défraiement de la gêne et où commence une rémunération dont le montant risque d’évoluer au gré du marché ? On peut se poser la question. »
À cet égard, Mme Carine Camby (180) n’a pas manqué d’observer combien « la perspective de l’indemnisation de certains donneurs ne laisse pas d’inquiéter », tant la frontière est étroite avec la rémunération, et de rappeler que « l’indemnisation des donneuses d’ovocytes en Espagne, même si elle n’est que de quelques centaines d’euros, incite ainsi nombre de jeunes femmes à financer leurs études en se prêtant à des stimulations ovariennes ». La rémunération pourrait être de nature à altérer le consentement libre et éclairé de la donneuse, alors même que le don d’ovocytes n’est pas sans risques.
Par ailleurs, une telle entorse au principe de non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments risquerait d’avoir des répercussions dans d’autres domaines. Ainsi, M. François Olivennes (181) a admis qu’« ouvrir la porte à la rémunération du don d’ovocyte poserait des problèmes pour les dons de sang, de moelle, etc. ». Dès lors que le don d’ovocyte serait rémunéré, alors même que ses contraintes et risques à long terme sont moindres que des dons d’organes, comment pourrait-on justifier ensuite que le don d’organe ne puisse être soumis aux mêmes règles ?
De plus, la rémunération pourrait avoir pour effet de changer le profil et les motivations des donneurs, ainsi que s’en est inquiété M. Jean-Marie Kunstmann (182), vice-président de la Fédération des CECOS. Si le don, aujourd’hui fondé sur l’altruisme, est rémunéré, il y a un risque que les informations médicales communiquées par le donneur soient moins fiables, ce qui porterait préjudice à l’enfant issu de ce don.
Enfin, comme l’ont notamment souligné Mmes Carine Camby et Emmanuelle Prada-Bordenave (183), l’insuffisance des dons d’ovocytes ne tient pas d’abord à la non-rémunération des donneuses mais plutôt à l’incapacité de notre système de soins de les accueillir convenablement et, dans une moindre mesure, à un défaut d’information sur ce point.
b) Le don de gamètes doit être promu
Sans remettre en cause le principe de non-patrimonialité du corps humain, plusieurs voies pourraient être envisagées afin de promouvoir le don de gamètes.
Il est, d’une part, nécessaire de poursuivre et de renforcer les campagnes d’information sur le don de gamètes.
Le nombre insuffisant de donneurs s’explique en effet, pour partie, par le manque d’information du public mais aussi des professionnels de santé. Aucune campagne n’a été engagée sur ce sujet jusqu’à très récemment et la promotion en faveur du don ne peut par ailleurs légalement être faite par les centres eux-mêmes. Il en résulte que très peu de candidates au don d’ovocytes se présentent spontanément dans les centres (moins de 8 % des donneuses). Jugeant qu’« une information est indispensable », Mme Dominique Lenfant a indiqué à cet égard qu’« il existe encore des gynécologues qui refusent de prendre en charge des femmes qui veulent faire un don d’ovocyte. Ils font valoir que, juridiquement, ils ne sont pas protégés et qu’ils ne peuvent pas gérer ce problème. »
L’Agence de la biomédecine a cependant lancé en mai 2008 sa première campagne visant à délivrer une information sur l’encadrement médical et juridique du don d’ovocytes (184) et, en novembre 2008, sur le don de spermatozoïdes, conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2004 prévoyant que l’agence est chargée de promouvoir le don de gamètes. Si certaines personnes auditionnées se sont interrogées sur l’impact de ces actions (185), Mme Hélène Letur-Konirsch (186) a néanmoins préconisé de renforcer « la politique d’information, dont nous avons pu constater qu’elle commençait à porter ses fruits ».
Les actions engagées par l’agence doivent être considérées comme une première étape d’une information à long terme et sont d’autant plus importantes qu’elles visent à sensibiliser le grand public, et notamment les femmes qui pourraient ainsi se présenter spontanément dans les centres pour donner leurs ovocytes dans le cadre d’un don purement altruiste. Par là même ces donneuses ne subiraient de pression d’aucune sorte. En particulier, serait écarté le risque de rémunération occulte des donneuses « relationnelles », qui accompagnent des couples en attente d’un don d’ovocyte afin que leur délai d’attente soit plus court (cf. infra).
Il convient, d’autre part, d’accroître le nombre d’établissements pratiquant des prélèvements ovocytaires et, éventuellement, d’envisager une adaptation des modalités de financement de ces activités.
Il semble que la faiblesse du don de gamètes en France est imputable pour l’essentiel aux difficultés, financières ou d’organisation, rencontrées par les centres d’AMP, selon la directrice générale de l’Agence de la biomédecine (187). Elle a estimé devant la mission qu’« avant de s’interroger sur des remèdes extrêmes qui risqueraient de saper les piliers mêmes de nos lois de bioéthique, au premier rang desquels la gratuité du don, (…) il faut se demander si la France s’est vraiment donnée les moyens d’assurer cette activité et si, de manière insidieuse, on ne s’est pas tout simplement reposé de manière confortable sur les pays voisins. Il faut donc soutenir cette activité dans les centres français. »
En effet, seuls deux tiers des 24 centres autorisés pour le don d’ovocytes sont effectivement en capacité budgétaire d’accueillir et de prendre en charge les donneuses d’ovocytes. Un tiers des centres ayant été autorisés par l’Agence de la biomédecine pour le don d’ovocyte n’assurent plus aujourd’hui cette activité. Par exemple, il n’existe pas de centre de don en Corse, ni dans les territoires d’outre-mer. Mme Hélène Letur-Konirsch (188) a précisé que, parmi les centres autorisés, six n’ont pas d’activité et sept réalisent moins de dix attributions ovocytaires par an et « s’ils ne fonctionnent pas, c’est qu’ils n’ont pas débuté l’activité ou qu’ils ont été contraints de l’arrêter par manque de moyens. En réalité, seuls douze centres – moins de la moitié – effectuent plus de dix attributions ovocytaires par an ». Par ailleurs, une grande partie de l’activité est concentrée sur la région Île-de-France (47 % des dons en cycle synchronisé donneuse-receveuse en 2005).
En tout état de cause, le nombre limité de centres n’est pas de nature à encourager le don. Cette situation pourrait s’expliquer en partie par le fait que les moyens techniques, financiers et humains des centres ne semblent pas pleinement adaptés au développement des dons d’ovocytes. Invoquant ce manque de moyens, M. Patrick Fenichel(189), co-président du GEDO, a ainsi estimé que « le don d’ovocytes, en termes de T2A – le nouveau credo des hôpitaux – rapporte peu. (…) Ne relèvent de la T2A que la ponction effectuée sur la donneuse, qui entre alors dans le cadre d’une fécondation in vitro, et le transfert à un seul des couples receveurs, alors que les ovocytes sont souvent répartis sur plusieurs couples (…) le reste entre théoriquement dans le champ des MIGAC » mais « les MIGAC ne sont pas définies et fléchées… Le don d’ovocytes exige beaucoup de temps de la part des personnels médicaux, mais il ne rapporte rien ! Dans la logique actuelle, il faut faire des choix, et de nombreuses équipes choisissent d’abandonner ces pratiques. »
Dès lors, la reconnaissance tarifaire du don d’ovocytes pourrait être l’un des leviers de son développement. L’adaptation de ses modalités de financement dans le cadre de la tarification à l’activité pourrait aussi être étudiée (cf. supra).
Par ailleurs, les frais engagés par les donneuses doivent être mieux pris en charge, conformément aux dispositions prévues par la loi.
L’article L. 1244-7 du code de la santé publique dispose en effet que « la donneuse d’ovocytes bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don », une disposition analogue n’étant pas prévue pour les dons de sperme. L’application de ce principe de neutralité financière pourrait cependant être significativement améliorée en vue de promouvoir le don. Ainsi, Mme Emmanuelle Prada-Bordenave (190) a relevé que l’Agence de la biomédecine a reçu « de nombreux témoignages de donneuses potentielles qui ont été dissuadées d’effectuer la démarche, soit qu’elles ne pouvaient être accueillies dans un établissement près de chez elles, ce qui les aurait obligé à se déplacer parfois très loin et à passer plusieurs nuits à l’hôtel, soit parce que les hôpitaux ayant des difficultés financières, elles en auraient été de leur poche, des frais exposés à l’occasion du don n’étant pas pris en charge. ».
Mme Dominique Lenfant (191) a estimé que s’il y a peu de donneuses en France, c’est parce que « le don est en fait payant pour celles-ci », comme l’a confirmé le témoignage de Mme Hortense de Beauchaine. M. Pierre Jouannet (192) a également souligné les difficultés rencontrées par les donneuses pour « se faire rembourser les actes infirmiers nécessaires lors des stimulations ovariennes, leurs frais de transport jusqu’aux centres autorisés ou de garde d’enfants durant les absences qu’imposent les ponctions ». Faut-il par ailleurs prendre en compte la perte de salaire du donneur et de quelle façon ?
Les difficultés rencontrées par les donneuses d’ovocytes : le témoignage de Mme Hortense de Beauchaine, membre de l’association Pauline et Adrien
« Faire un don d’ovocyte coûte aujourd’hui de l’argent quand on n’habite pas à côté d’un CECOS. Vivant à 400 kilomètres de Paris, je suis obligée de faire tous mes dosages ovariens et mes échographies près de chez moi. Ayant des enfants, comme toute donneuse, je ne peux pas me permettre de m’installer quinze jours à Paris, temps requis pour ces examens. Pour donner un ordre de grandeur, je précise que rien que mon dosage ovarien et mon échographie pour savoir si je pouvais ouvrir un dossier en tant que donneuse m’ont coûté 145 euros. Pour avoir fait de nombreuses FIV, je sais que, pour pouvoir procéder à une ponction ovarienne, je vais être obligée de faire cinq stimulations. Je ne suis pas sûre que toutes les femmes puissent avancer une telle somme. J’ai la chance d’avoir une mutuelle privée qui va prendre ces frais en charge mais ce n’est pas le cas général.
Mes déplacements à Paris ont également un coût. Depuis le mois d’octobre, je suis déjà venue quatre fois et je vais revenir une cinquième fois pour ma ponction à la fin du mois. Le CECOS m’a annoncé qu’il fallait compter à peu près un an pour obtenir le remboursement de ces frais, qui s’élèvent à 120 euros pour chaque voyage aller et retour. Lors de chaque déplacement à Paris, je dois faire garder mes enfants et, pour mes derniers dosages et ma ponction, je devrai rester quatre ou cinq jours. Tous ces coûts additionnés font une somme très importante. J’ai fait la promesse en 2003 de faire un don d’ovocyte car, ayant connu des problèmes de fertilité, j’aurais aimé que quelqu’un en fasse de même pour moi. Je tiendrai ma promesse mais à quel prix ? »
Source : compte-rendu de la table ronde du 10 mars 2009
Il apparaît ainsi très clairement que « la loi n’a pas été appliquée comme elle aurait dû l’être », comme l’a relevé M. Pierre Jouannet (193). Il semble que dans la pratique, les établissements de santé appliquent très diversement le principe de neutralité financière posé par la loi. Le décret du 11 mai 2000 garantit une prise en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement de tous les frais occasionnés par le don. Toutefois, les difficultés sur le terrain sont réelles ; les établissements refusent de rembourser les frais de déplacement par exemple, ou préfèrent parfois renoncer à cette activité, plutôt que de devoir assurer le coût d’une activité jusque là non financée.
Le décret du 24 février 2009 (194) a permis d’améliorer ce dispositif en prévoyant l’exonération du ticket modérateur pour les frais afférents aux examens, traitements, hospitalisations, soins et suivi des soins liés au prélèvement. Il autorise également les établissements de santé à adresser aux caisses d’assurance maladie les demandes de prise en charge. L’activité de don d’ovocytes enfin reconnue par l’assurance maladie devrait être financée pour ce qui concerne la prise en charge de la donneuse. Toutefois, l’Agence de la biomédecine a été alertée à plusieurs reprises par les professionnels sur les difficultés locales d’application du nouveau décret. Des établissements rechigneraient ainsi à avancer une prise en charge de frais qui ne seraient finalement pas remboursés par l’assurance maladie.
Afin de remédier à ces difficultés, une circulaire d’application du décret du 24 février 2009 pourrait être élaborée et diffusée rapidement aux services de l’assurance maladie, aux établissements de santé et aux professionnels concernés, de façon à lever les doutes sur les modalités de prise en charge de ces frais.
Mme Hélène Letur-Konirsch (195) a par ailleurs suggéré d’encourager les dons « en reconnaissant le temps [que les donneuses] y ont consacré par un temps officiellement alloué, dans le même esprit que le congé maternité. Voilà ce que demandent beaucoup de donneuses d’ovocytes. (…) Beaucoup de donneuses se sentent « humiliées » par l’anonymat qui les entoure durant le parcours médical et par la nécessité de quêter le remboursement de leurs frais auprès des services hospitaliers. (…) D’autant qu’il leur faut ensuite solliciter la compréhension de leur employeur, qui doit accepter tacitement les retards engendrés par la réalisation d’examens complémentaires et les congés nécessaires pour assurer leur récupération. Pour les femmes disposées à faire un don, ces éléments pèsent d’un poids aussi lourd que la pénibilité d’une stimulation ovarienne et d’un prélèvement ovocytaire. »
Ne pourrait-on en effet mieux prendre en compte les éventuelles contraintes professionnelles des donneuses d’ovocytes ? La mise en place d’un dispositif spécifique pourrait être imaginé dans ce sens, par exemple en étendant aux donneuses d’ovocytes les autorisations d’absence prévues pour les femmes enceintes par l’article L. 1225-16 du code du travail (196), ces absences n’entraînant aucune diminution de la rémunération et étant assimilées à une période de travail effectif. Une autre option tendrait à instituer un congé spécifique. Une concertation pourrait être engagée à ce sujet avec les partenaires sociaux.
Proposition n° 16. Afin de promouvoir le don d’ovocytes et d’améliorer les conditions dans lesquelles les dons sont réalisés :
– poursuivre des actions régulières d’information et de promotion du don de gamètes ;
– améliorer le remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneuses d’ovocytes (y compris les frais de transports et de garde d’enfants) (En complétant le dernier alinéa de l’article L. 1244-7 du code de la santé publique);
– ouvrir aux donneuses d’ovocytes salariées le droit à une autorisation d’absence ou à un congé spécifique pour se rendre aux examens et consultations nécessaires pour le don ;
– accroître le nombre de centres pratiquant le don d’ovocytes et revoir le financement des actes qui y sont réalisés ;
– préciser les modalités de la prise en charge financière des frais médicaux afférents au don d’ovocytes (Préciser par circulaire les modalités d’application du décret n° 2009-917 du 24 février 2009).
c) La pénurie d’ovocytes peut favoriser le risque d’une rémunération occulte du don
L’insuffisance de dons d’ovocytes conduit certains centres à inciter des couples demandeurs à venir accompagnés d’une donneuse d’ovocytes, au profit d’un autre couple demandeur et à le faire bénéficier en contrepartie d’un temps d’attente plus court (pratique de la « double liste », qui constitue une forme de don croisé). Le don dirigé – c’est-à-dire le don de gamètes entre deux personnes qui se connaissent – étant interdit, les donneuses ainsi sensibilisées font un don au profit de couples inconnus mais, par leurs dons au centre, aident indirectement les personnes qu’elles connaissent.
Ainsi, « les délais sont supérieurs à un an, si la femme peut aider le centre à trouver une donneuse, et de trois à cinq ans, si elle n’a pas de donneuse », selon M. François Olivennes (197). De fait, il n’y a que très peu de femmes qui se présentent spontanément pour donner leurs ovocytes, près de 92 % des donneuses d’ovocytes ayant été sensibilisées par un couple infertile de leur entourage (donneuses « relationnelles »), selon l’Agence de la biomédecine.
Ces pratiques sont-elles conformes à la loi ?
L’article L. 1244-7 du code de la santé publique dispose que « le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme ». La méconnaissance de ces dispositions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, en application de l’article 511-13 du code pénal.
À cet égard, M. Patrick Fenichel (198) a expliqué qu’« en principe, la loi nous interdit de subordonner notre réponse à la présentation d’une donneuse, mais aucun des douze centres qui fonctionnent actuellement n’applique ce principe, car dans l’état actuel des choses, il est inapplicable ! Concrètement, nous informons les couples que ceux qui présentent une donneuse verront leur attente réduite. C’est ainsi que fonctionnent la plupart des centres… » Mme Hélène Letur-Konirsch (199) a précisé toutefois que les centres « ne [refusaient] pas d’inscrire les couples qui ne présentent pas de donneuse ».
De fait, selon l’Agence de la biomédecine, l’OPECST (200) et d’après plusieurs personnes auditionnées par la mission, les dispositions prévues par la loi ne s’opposeraient pas à la pratique de la double liste, dès lors qu’un couple infertile, qui ne pourrait ou ne voudrait désigner une donneuse de son entourage, peut néanmoins bénéficier d’une AMP avec don d’ovocytes. En revanche, ces dispositions interdisent que la présentation d’une donneuse soit requise comme une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d’un don. En d’autres termes, selon Mme Joëlle Belaisch-Allart (201), les centres demandent aux patients « d’en amener une avec elles, sans que cela soit obligatoire, la loi interdisant d’en faire une condition sine qua non. »
On peut cependant s’interroger sur cette interprétation de la loi dans certains cas, par exemple, lorsqu’une femme de 39 ans s’adresse à un centre qui incite les couples à présenter une donneuse. Compte tenu des délais d’attente, qui peuvent aller jusqu’à cinq ans, ainsi que de la limite d’âge de 43 ans pour la prise en charge des traitements est-ce que la présentation d’une donneuse d’ovocytes de son entourage ne sera pas, de fait, une condition sine qua non pour pouvoir bénéficier d’une AMP avec don d’ovocytes ?
Par ailleurs, les chances de succès se réduisent à mesure que le délai d’attente et donc l’âge de la demandeuse, augmentent. Ainsi, selon Mme Hortense de Beauchaine (202), « il ne faut pas oublier qu’un couple qui a recours à un don a souvent un parcours long derrière lui. L’homme et la femme ne sont souvent plus très jeunes. Un couple receveur pour un don d’ovocyte a cinq ans d’attente. Si une femme en fait la demande à 35 ans, elle aura 40 ans lorsqu’elle y aura droit. Leurs chances sont donc vraiment diminuées. »
Il convient par ailleurs de rappeler que lors de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique, cette question avait été évoquée devant le Sénat. Un amendement visait à compléter les dispositions précitées de l’article L. 1244-7 par un nouvel alinéa prévoyant qu’aucune priorité de prise en charge ne serait accordée à un couple qui désigne un donneur. Cet amendement avait été rejeté, après que M. Jean-François Mattei, alors Ministre de la santé, eut indiqué que cette disposition était « redondante ». À ce titre le Ministre avait rappelé les règles de l’article L. 1244-7 (le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d’un donneur) et déclaré s’« engager à demander à l’Agence de la biomédecine d’exercer une vigilance particulière sur ce point (203)».
Outre une inégalité d’accès aux soins, ces pratiques n’entraînent-elles pas le risque d’une rémunération occulte de la donneuse ?
Il y a en effet un réel risque que les donneuses « relationnelles » soient rémunérées par les couples infertiles qu’elles accompagnent, ce qui constituerait une entorse au principe de non-patrimonialité du corps humain. Dès lors qu’il n’y a plus d’anonymat de la donneuse, il est incontestablement plus difficile de garantir effectivement le principe de la gratuité du don.
Lors d’une audition publique organisée par l’OPECST le 10 juin 2008 (204), Mme Ginette Guibert, gynécologue dans un centre d’AMP, avait ainsi affirmé que « le trafic existe en France » et qu’« il existe des pressions entre donneuses et receveuses. Nous recevons des femmes qui sont les employées de celle qui a besoin d’ovocytes ou qui sont en tractation financière avec elle. Il existe réellement un phénomène de marchandisation et l’anonymat ne préserve absolument pas de cela. »
Pour éviter de telles pratiques, il convient de renforcer les actions visant à sensibiliser le grand public sur le don, afin que des femmes se présentent spontanément dans les centres sans risque de pressions ou de sollicitations.
Il serait nécessaire par ailleurs de rappeler que la loi prévoit actuellement que la donneuse d’ovocytes doit être informée des conditions légales du don, concernant notamment les principes d’anonymat et de gratuité (article L. 1244-7 précité). L’article R. 1244-2 du même code dispose, en outre, que le consentement du donneur ainsi que le prélèvement des gamètes sont précédés d’entretiens avec les membres de l’équipe médicale pluridisciplinaire. Ces entretiens ont notamment pour but de vérifier que le donneur remplit les conditions posées par l’article L. 1244-2 (le donneur doit avoir déjà procréé et donné son consentement par écrit, de même, le cas échéant, que l’autre membre du couple) et de l’informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes.
Selon l’Agence de la biomédecine, cette discussion avec l’équipe médicale et notamment avec un psychologue ou un psychiatre vise non seulement à renforcer l’information sur le principe légal de gratuité du don mais aussi à évaluer les motivations des donneuses. Toujours selon l’agence, elle permettrait de mettre en évidence d’éventuelles pressions qui pèseraient sur la donneuse de la part de l’entourage ou même sa rémunération, les équipes médicales récusant le don en cas de doute.
Il pourrait dès lors être proposé de compléter la loi pour affirmer clairement le principe et les objectifs de ces entretiens préalables avec l’équipe pluridisciplinaire, en précisant éventuellement qu’à celle-ci doit s’adjoindre un psychologue ou un docteur en psychiatrie, comme cela est d’ailleurs expressément prévu par l’article R. 1244-3 pour les entretiens concernant les couples receveurs d’un don de gamètes.
La loi pourrait également prévoir la délivrance d’une information écrite à la donneuse ainsi qu’un délai de réflexion avant cet entretien avec l’équipe pluridisciplinaire, ainsi que l’a notamment suggéré Mme Bénédicte Rivière (205), maître de conférences à la faculté de droit de Besançon. Cette information inviterait les donneurs à réfléchir sur le don et ses conséquences ; inciterait l’équipe à se poser davantage de questions ; rappellerait sans équivoque les principes de gratuité et d’anonymat du don et aurait sans doute pour effet, dans une certaine mesure, de limiter les pressions, même involontaires de l’entourage sur le couple receveur.
Afin de s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la donneuse d’ovocytes et afin d’écarter tout don qui ne respecterait pas le principe de gratuité, prévoir dans la loi l’organisation d’un entretien préalable de la donneuse avec l’équipe pluridisciplinaire, comprenant notamment un psychologue. Prévoir également la délivrance d’une information écrite sur l’encadrement légal et les risques que peut présenter le don pour la santé. (Il conviendrait de compléter à cet effet l’article L. 1244-2 ou L. 1244-7 du code de la santé publique).
2. Faut-il lever l’anonymat du donneur de gamètes ?
En 2007, 1 163 enfants sont nés après une AMP avec tiers donneur et, depuis la création des CECOS en 1973, ils seraient aujourd’hui environ 50 000.
Comme le souligne M. Jean-Loup Clément (206), psychologue au CECOS de Lyon, « ces enfants sont peu nombreux, mais leur mode de conception interroge chacun d’entre nous sur le rapport à ses propres origines, réelles ou fantasmatiques ». Les demandes formulées par certains enfants nés après un don de gamètes qui souhaitent avoir accès à des informations relatives à leurs origines doivent-elles conduire à reconsidérer le principe de l’anonymat du don ?
a) Les arguments avancés pour assouplir ce principe
« Répondre à la question qui, c’est raconter une histoire », pour reprendre une formule de la philosophe Hannah Arendt. C’est sans doute à la lumière de cette conception de l’identité comme identité narrative, que l’on peut débattre des demandes formulées aujourd’hui en faveur d’un assouplissement de l’anonymat du don de gamètes. Plusieurs raisons sont invoquées à l’appui de cette quête d’origine.
Tout d’abord, comme l’a rappelé M. Didier Houssin (207), directeur général de la santé, « le principe de l’anonymat n’est pas reconnu comme une valeur fondamentale dans certains pays ». Depuis quelques années, il existe en effet dans les législations européennes une tendance à la levée de l’anonymat sous une forme partielle ou totale.
LA LEVÉE DE L’ANONYMAT DE DONS EN AMP : UNE TENDANCE FORTE
DANS LES SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES DÉVELOPPÉES
La Suède fut le premier pays au monde à changer sa loi, en 1984, et à accorder aux enfants nés d’un don de sperme le droit de connaître l’identité de leur donneur. La loi est entrée en vigueur le 1er mars 1985 et le même droit a été ensuite étendu aux enfants nés grâce à un don d’ovocytes, après que celui-ci eût été légalisé le 1er janvier 2003. En Suisse, le principe selon lequel « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance » a été inscrit dès 1992 dans la constitution fédérale, puis développé par la loi fédérale de 1998 sur la procréation médicalement assistée. Cette loi est applicable depuis le 1er janvier 2001. La même année 1992, l’Autriche, qui n’autorise ni le don d’ovocyte, ni le don d’embryon, permet aux enfants d’obtenir des données identifiantes sur le donneur de sperme ayant rendu possible leur naissance.
En 1996, l’Islande adopte un « système à double guichet » autorisant, à côté des dons anonymes de gamètes, des dons issus de personnes ayant donné leur accord pour que leur identité soit communiquée à l’enfant. La Norvège, où seul le don de sperme est autorisé, vote en décembre 2003 la levée de l’anonymat. Cette loi a fait l’objet d’une mise en œuvre progressive de 2003 à 2005. Aux Pays-Bas, après quinze ans de débats, les dons ne sont plus anonymes depuis 2004 : en adoptant en 2002 une loi sur les informations relatives aux donneurs de gamètes, ce pays a finalement abandonné le système du double guichet, qui proposait auparavant aux donneurs de dévoiler ou non leur identité. En Nouvelle-Zélande, depuis 2004, il n’y a plus d’anonymat des donneurs de gamètes (…). Au Royaume-Uni, après deux ans de consultations, la levée de l’anonymat a été décidée et est entrée en vigueur le 1er avril 2005. Non rétroactive, elle permet cependant à ceux qui ont fait un don avant 2005 de lever le secret de leur identité en s’inscrivant sur le fichier de donneurs volontaires qui a été créé à l’exemple de la Nouvelle-Zélande.
La Finlande, qui avait auparavant le principe du double guichet, a levé l’anonymat des donneurs par une loi du 15 octobre 2006 : elle permet désormais à l’enfant de connaître l’identité du donneur à sa majorité. En Belgique, la loi du 15 mars 2007 a instauré le principe du double guichet permettant d’opter pour le don anonyme ou le don nominatif. Le couple peut en outre choisir la donneuse dans le cas du don d’ovocyte : c’est ce qu’on appelle le don « direct » que l’on distingue du don « indirect » ou par échange. »
Source : « L’anonymat des dons d’engendrement est-il vraiment éthique ? », Irène Théry, Esprit, « La filiation saisie par la biomédecine » (mai 2009)
Mme Pauline Tiberghien (208), présidente de l’association Procréation médicalement anonyme, a ainsi souligné que « l’accès aux origines que nous demandons n’est pas une idée franco-française. Il est émouvant de voir que toutes les personnes privées d’origine issues d’un don de sperme, qu’elles soient néozélandaises, canadiennes, françaises ou anglaises, emploient les mêmes mots pour décrire le trouble qu’elles ressentent et l’instabilité avec laquelle elles doivent avancer dans la vie. »
En effet, sur les 50 000 enfants nés par insémination avec donneur, plusieurs sont aujourd’hui adultes et certains d’entre eux expriment leurs souffrances, d’être privés d’« un petit bout du puzzle que constitue l’identité », selon Mme Pauline Tiberghien. Ainsi, M. Arthur Kermalvezen, auteur du livre « Né de spermatozoïde inconnu » et porte-parole de l’association PMA, s’est déclaré en faveur de la levée d’un anonymat « total et à perpétuité »:
« Notre projet est la possibilité d’accéder aux données identifiantes du donneur à la majorité de l’enfant. (…) L’essentiel est que les enfants puissent avoir le choix, le choix de savoir ou de ne pas savoir : du côté des enfants, certains aimeraient simplement avoir une photographie, d’autres une lettre expliquant les motivations du don, d’autres encore qu’une rencontre soit organisée avec le donneur, à travers, par exemple, un Centre national d’accès aux origines personnelles comme il en existe un pour les enfants nés sous X. Cela pourrait aussi être encadré, du moins pour la première rencontre, par un médiateur juridique. C’est ce que j’avais proposé il y a deux ans. Il est très bien et très sain que ce soit encadré. Chez les enfants, il y a une grande souffrance. Il est faux de dire qu’ils vont bien. »
L’application du principe de l’anonymat serait susceptible d’avoir à long terme des effets préjudiciables sur l’enfant, essentiellement parce que ce dernier est privé d’une dimension de son histoire selon certains travaux menés par la sociologue, Mme Dominique Mehl (209). Dans son rapport précité, le Conseil d’État, observe que la plupart des études réalisées montrent que les motivations des enfants conçus par AMP avec tiers donneurs sont diverses et qu’il s’agit essentiellement d’une démarche visant à mieux se construire personnellement, non dans le but d’avoir un autre père ou une autre mère, mais pour ne pas vivre dans l’ignorance ou le mensonge.
Mme Delaisi de Parseval (210), psychanalyste, s’est ainsi prononcée en faveur de la levée de l’anonymat des donneurs, en faisant valoir que « nous pouvons maintenant entendre des enfants nés de la sorte et devenus adultes (et parfois eux-mêmes parents). Or, ce ne sont pas des fanatiques de la vérité biologique. Ils ne supportent pas que quelqu’un d’autre (en l’occurrence l’État) en sache plus qu’eux sur eux-mêmes. Ils ont le sentiment d’être des citoyens de deuxième ordre, d’être discriminés notamment par rapport aux enfants adoptés. Il est clair pour eux que leurs parents sont ceux qui les ont élevés. Leurs demandes sont variables : parfois ils veulent des informations sur le donneur, sa photographie, savoir l’âge et le nombre de ses enfants, ses motivations. Ils sont parfois hantés par la possibilité de rencontrer sans le savoir leurs demi-« frères » et « sœurs » biologiques. »
Dans le même sens, Mme Dominique Mehl a considéré que ces enfants souhaitent « disposer de la totalité de leur histoire personnelle. En effet, les conditions de leur venue au monde leur sont non seulement cachées, mais interdites d’accès : le problème de l’anonymat n’est pas qu’il y ait un secret – il y en a dans beaucoup de familles –, mais que pour l’enfant ce secret-là ne puisse jamais être levé, n’étant pas à la disposition de ses parents ou de son entourage mais verrouillé par un système légal. (…) Pour ces enfants, leur père est celui qui les a élevés et qui a la responsabilité légale ; ils ne souhaitent pas aller frapper à la porte du donneur pour qu’il les adopte ou les prenne en charge – ce qui était la crainte du législateur en 1994, comme des CECOS. (…) Ils n’affichent pas de dévotion envers le lien génétique, mais ils ne souhaitent pas non plus que celui-ci soit éradiqué.» (211)
Le fait que la levée de l’anonymat entraîne une baisse des dons de gamètes ou encore une déstabilisation de la filiation paternelle a par ailleurs été contesté par une psychanalyste et une représentante d’association auditionnées par la mission.
Mme Delaisi de Parseval a remarqué que « l’expérience d’autres pays montre d’ailleurs que c’est le cas dans un premier temps, après quoi la courbe des dons remonte ». De même, Mme Pauline Tiberghien. a indiqué que « le docteur Whirthner, responsable de la plus grande banque de sperme de Suisse, m’a chargée de vous remettre un document dans lequel il montre qu’il n’y a aucun problème à trouver des donneurs de sperme quand l’accès aux origines est autorisé. Par ailleurs, on a observé, en Angleterre, une augmentation de 27 % du nombre des donneurs. Si on lève l’anonymat, les donneurs ne seront pas les mêmes. Il suffit de leur expliquer qu’un don peut aussi être responsable. »
En outre, un assouplissement du principe de l’anonymat du don pourrait être proposé, sous réserve que le donneur y consente, auquel cas les donneurs conserveraient la possibilité de rester anonymes, limitant ainsi les répercussions probables sur le don de gamètes.
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont également contesté le fait que l’assouplissement du principe de l’anonymat, par exemple à la majorité de l’enfant et à la condition que le donneur y consente, ainsi que l’a proposé le Conseil d’État, conduirait nécessairement à déstabiliser les fondements de la filiation paternelle. D’un point de vue juridique, les associations revendiquant cet assouplissement ne remettent pas en cause les dispositions actuelles excluant tout lien, notamment de filiation, entre l’enfant et le tiers donneur (212).
Lors du forum de Rennes (213), M. Philippe Bas, avait plaidé pour une levée de l’anonymat susceptible d’aider l’enfant à se construire : « on voit souvent les pères de jeunes adultes aider leurs enfants à chercher l’auteur du don et les soutenir, dans tous les cas, dans la demande qu’ils font que la loi change. Et pourquoi le font-ils ? Parce qu’ils ne se sentent nullement mis en cause dans leur paternité qui s’est établie depuis vingt ans par la relation d’amour entre le père et l’enfant. Pour eux, c’est la tranquillité absolue. Mais ils sentent bien, quand même, qu’ils doivent à leur enfant de les aider, pour se construire, à accéder à certaines informations qui concernent leur propre histoire. »
Il existe par ailleurs des interrogations sur la conformité de la réglementation actuelle, fondée sur l’anonymat absolu du don de gamètes, à la convention européenne des droits de l’homme.
Dans un arrêt du 13 février 2003 (Odièvre contre France) concernant l’accouchement sous X, la cour a considéré que l’article 8 de la convention, relatif au droit à la protection de la vie privée, consacre notamment un droit à l’épanouissement personnel, au titre duquel figurent l’établissement des détails de son identité d’être humain et l’intérêt vital à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, soit par exemple l’identité de ses géniteurs. Reconnaissant ainsi l’existence d’un « droit à la connaissance de ses origines » et « l’intérêt vital de l’enfant dans son épanouissement », la cour a cependant estimé que les États disposent d’une marge d’appréciation importante pour concilier ce droit avec les intérêts légitimes qui pouvaient justifier l’anonymat. Sont visés en particulier : l’intérêt de la mère, des motifs d’intérêt général liés notamment à la volonté d’éviter des avortements clandestins, des abandons ou de préserver la santé de la mère, le respect de la vie privée et familiale de tiers, en l’occurrence la famille adoptive.
La cour a par ailleurs relevé que la requérante avait eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique dans le respect de la préservation des intérêts des tiers ; elle a fait état également de la loi du 22 janvier 2002, qui a renforcé la possibilité de lever le secret de l’identité en prévoyant la mise en place d’un Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP). Au surplus la requérante avait la possibilité de demander la réversibilité du secret de l’identité de sa mère, sous réserve de l’accord de celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a considéré que le dispositif français d’accouchement sous X était conforme à la convention européenne des droits de l’homme. S’agissant en revanche de l’AMP avec tiers donneur, les intérêts susceptibles de contrebalancer le droit à la connaissance de ses origines semblent de portée plus limitée et la loi ne prévoit aucune possibilité d’accès à des informations, même non identifiantes, sur le donneur.
Enfin, est-il pertinent d’opposer les dimensions sociale et biologique de la filiation ?
Mme Dominique Mehl a indiqué avoir retiré de l’enquête qu’elle a effectuée auprès de parents et d’enfants « la certitude que ni les CECOS ni la loi ne peuvent décider ou décréter ce que représente le lien génétique sur le plan psychique dans les constructions identitaires. Pour certaines d’entre elles, le gamète donné est une cellule comparable à d’autres, et les identités ne proviennent que de l’éducation. Pour d’autres, c’est une composante du socle identitaire, notamment dans sa dimension corporelle. (…) Ce qui est demandé aujourd’hui, c’est qu’on prenne en compte toutes les composantes de la procréation, et non pas du tout qu’on affirme le primat du génétique (214). »
En particulier si, bien évidemment, « les gamètes ne sont pas des parents », selon la formule du CCNE, doivent-ils être considérés pour autant comme des cellules comme les autres, le don du sang par exemple ? Du reste, un appariement des donneurs n’est-il pas effectué par les CECOS, afin que le phénotype d’un enfant ne diffère pas trop de celui de ses parents ?
Selon ces approches, la levée de l’anonymat n’impliquerait en rien une fascination pour le biologique mais traduirait plutôt la volonté de ne pas être privé d’une partie de son identité et de pouvoir se situer, comme les autres, dans une histoire humaine. Dans ce sens, Mme Irène Théry(215), sociologue, a observé que « revendiquer d’être situé comme les autres au sein de la temporalité complexe caractéristique de la vie humaine n’a donc rien à voir avec la quête naïve d’un quelconque « début » ou « fondement » pas plus que cela n’a à voir avec la fascination pour le « biologique ». La vérité est bien différente : c’est qu’il faut sans doute un peu de sensibilité pour comprendre que revendiquer l’accès à ses origines est en réalité une protestation de l’être tout entier contre le fait d’avoir été transformé autoritairement et symboliquement en origine de soi-même. »
b) Les solutions proposées et leurs limites
Pour assouplir le cadre actuel, plusieurs voies pourraient être envisagées. À l’analyse, elles posent cependant trop de difficultés pour pouvoir être retenues.
• L’accès à des informations non identifiantes sur le donneur
Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports, a préconisé un modèle inspiré de celui applicable à l’accouchement sous X (216) qui permettrait l’accès à des informations non identifiantes sur le donneur et le cas échéant médical. L’avis citoyen de Rennes s’est prononcé en faveur d’une solution similaire.
Considérant qu’il faudrait « sans aucun doute améliorer grandement la communication de données génétiques et médicales non identifiantes, afin de permettre à l’enfant de bénéficier de prévention et de prévoyance » , M. Jean-François Mattei (217) a souscrit aussi à cette position. Cependant cela s’impose moins que pour l’accouchement sous X, les donneurs étant sélectionnés pour leurs qualités génétiques.
Mme Françoise Dekeuwer-Defossez (218) a fait valoir que « les médecins interrogent systématiquement les patients sur les pathologies de leurs parents – à quel âge la mère a-t-elle été ménopausée, le père a-t-il des problèmes de foie, etc. ? La personne qui ne peut répondre se sent alors discriminée. Les enfants adoptés s’en plaignent, comme s’en plaindront les enfants nés d’une IAD. La pire situation provient du mensonge. Si le médecin demande à une personne à qui l’on a menti sur ses origines si son père était diabétique, celle-ci répond naturellement par la négative. Si par manque de chance son père biologique était diabétique, cette personne perd une chance d’être soignée ! ».
Il convient cependant de rappeler que l’article L. 1244-6 du code de la santé publique précise déjà que les organismes et établissements autorisés pour cette activité fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs et qu’un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes « en cas de nécessité thérapeutique » concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don. En outre, le dossier médical du donneur ne contient que des informations sur l’état de santé de celui-ci au moment où il a procédé au don. Les maladies dont il a pu souffrir par la suite n’y figurent pas. Par ailleurs plusieurs examens médicaux sont effectués dans le but d’écarter les donneurs à risques pour les enfants(219).
Si l’information devait être directement accessible aux parents ayant recouru à une AMP avec tiers donneur ou à l’enfant, un tel dispositif soulèverait des interrogations au regard du principe du secret médical. Si cette possibilité devait être réservée au corps médical, par exemple au médecin traitant, alors la disposition prévue à l’article L. 1244-6 précitée suffit pour répondre à cette demande.
Il n’a pas été porté à la connaissance de la mission parlementaire de cas où une demande d’accès au dossier médical du donneur, faite conformément à la procédure en vigueur, aurait été refusée.
• Le « double guichet », consistant à admettre le don anonyme et le don identifiant, en fonction des souhaits du donneur.
Un tel dispositif serait toutefois susceptible d’entraîner une discrimination, comme l’a souligné M. Jean-François Mattei ainsi que plusieurs personnes entendues par la mission, dès lors que « certains enfants auront été conçus grâce à l’insémination du sperme d’hommes qui ne veulent pas donner leur identité, tandis que d’autres auront accès à leurs origines ».
• La possibilité pour tout enfant né d’un don de gamètes devenu majeur qui le souhaiterait d’accéder à des informations identifiantes ou à l’identité du donneur et la possibilité pour le donneur si l’enfant le demande, à sa majorité, de lever l’anonymat.
Reprenant le principe de l’anonymat du don posé par l’article 16-8 du code civil (220), l’article L. 1211-5 du code de la santé publique dispose que « le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique. »
En 1994, le législateur a en effet opté pour un principe absolu d’anonymat du donneur à l’égard du couple infertile et de l’enfant, en reprenant les principes adoptés par les CECOS depuis le début des années 1970. Comme le rappelle le Conseil d’État dans son rapport de mai 2009, « la vision française de l’anonymat est radicale : c’est une interdiction absolue », qui concerne non seulement l’identité mais aussi les données non identifiantes sur le donneur (concernant par exemple ses motivations ou encore les informations médicales portant sur sa famille et ses antécédents). Absolue, cette interdiction est aussi perpétuelle, puisque même devenu adulte, l’enfant ne peut connaître l’identité du donneur, ni avoir accès d’autres informations le concernant.
Ce principe de l’anonymat a été adopté pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il vise à garantir le caractère altruiste et désintéressé du don, en évitant notamment tout paiement du donneur par le couple bénéficiaire, ainsi qu’à protéger le couple d’une immixtion d’un tiers dans leur vie familiale. L’anonymat a également permis aux centres de disposer de gamètes en nombre suffisant pour les AMP.
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont fait part de leurs réserves quant à la possibilité de revenir sur ce principe. Ils ont invoqué la baisse du nombre de donneurs mais aussi de couples souhaitant recourir à une AMP avec tiers donneur que la levée de l’anonymat serait susceptible d’entraîner. S’agissant de l’impact sur les dons de gamètes, Mme Emmanuelle Prada-Bordenave (221) a indiqué que « des sondages effectués auprès de donneurs de sperme ont révélé que près de la moitié d’entre eux ne viendrait pas si l’anonymat n’était pas garanti ».
LES LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE SUÉDOISE
La Suède, comme on l’a vu, a décidé en 1984 de lever l’anonymat des donneurs de gamètes. Cette loi est appliquée depuis 1985, l’accès à l’identité des donneurs étant permis à partir de 16 ans pour les enfants issus de ces dons.
Sur une cohorte de 300 enfants nés de cette technique en 1985 et 1993, aucun n’a demandé à connaître l’identité des donneurs. La raison avancée par les praticiens est que les parents n’ont pas informé leurs enfants du mode de leur conception. Loin de contribuer à la transparence, la levée de l’anonymat a eu pour effet de favoriser le secret et les appréhensions des parents.
Parallèlement, on observe une diminution des demandes d’AMP en Suède. Entre 1989 et 2005, 1147 enfants sont nés d’une insémination avec tiers donneur. Dans le même temps ce chiffre était de 25000 en France, soit une proportion quatre fois inférieure en Suède qu’en France. Corrélativement à ce faible taux d’AMP en Suède, on constate qu’entre 1994 et 2005, 600 grossesses ont été dénombrées sur des femmes suédoises ayant eu recours à une insémination par tiers donneur dans un centre privé au Danemark (Cryos) où l’anonymat est garanti. Sur la même période, on n’enregistrait que 800 grossesses dans les 7 centres suédois d’AMP.
Étude réalisée par le professeur Pierre Jouannet pour l’ABM
Selon M. Jean-Marie Kunstmann (222), l’anonymat correspondrait également au projet du donneur. Celui-ci considèrerait qu’il fait don d’un support biologique dénué de tout projet d’enfant autre que celui du couple receveur, en ne souhaitant pas que sa responsabilité soit engagée dans le devenir de ces enfants. L’anonymat garantirait ainsi aux yeux du donneur « la dépersonnalisation du produit biologique, destiné à être humanisé par le couple receveur ». Comment, par exemple, le donneur assumera-t-il la souffrance d’un enfant en mal de représentation paternelle ? Comment gérera-t-il cette intrusion dans sa famille ?
De ce fait, la levée de l’anonymat ne risquerait-elle pas de changer le profil des donneurs ? M. Jean-François Mattei a ainsi estimé que « les donneurs ont l’intention de donner, mais aucunement celle d’assumer la paternité, quand bien même celle-ci serait-elle réduite à la connaissance de leur identité. On n’entend qu’un cas sur mille, celui de l’enfant qui écrit un livre, alors que les 999 autres ne disent rien. Lever l’anonymat serait ouvrir la boîte de Pandore. Nous risquerions de voir le nombre de dons baisser ou, à tout le moins, voir le profil psychologique des donneurs changer. »
Par ailleurs, selon une enquête réalisée par la Fédération nationale des CECOS en 2006 auprès de 1 068 personnes, un quart des couples renoncerait à une procréation par don de sperme en cas de levée de l’anonymat. À cet égard, Mme Dominique Regnault (223), présidente de la commission des psychologues de la Fédération des CECOS, a souligné que « la préservation de l’anonymat du donneur et même de la confidentialité du don permet à l’homme de faire au don de spermatozoïdes une place symbolique dans son projet de paternité. »
Des interrogations ont également été émises sur le faible nombre d’enfants souhaitant accéder à leurs origines en émettant parfois des doutes sur le fait que la levée de l’anonymat puisse réellement répondre à leurs difficultés.
Dans ce sens, M. Géraud Lasfargues (224) s’est par exemple demandé : « Quant aux douze enfants qui naissent par an et qui sont malheureux de ne pas connaître leur père biologique, iront-ils mieux en le connaissant ? Cela reste à prouver. » M. Jean-Marie Kunstmann a rappelé les travaux de M. Jean-Loup Clément, psychologue au CECOS de Lyon, qui a recueilli les témoignages de plusieurs enfants conçus par AMP avec tiers donneur, en notant que « même si tous ont déploré d’avoir été tardivement informés des conditions de leur conception, ils n’étaient pas en quête de l’identité du donneur, bien au contraire. »
On peut également s’interroger sur les conséquences pour l’enfant de la levée de l’anonymat pour l’enfant ainsi conçu. La levée de l’anonymat ne risquerait-elle pas d’inciter des couples, afin d’éviter l’immixtion d’un tiers, à garder le secret sur le mode de conception de l’enfant, dont les psychologues ont souligné le caractère délétère ? L’assouplissement de l’anonymat, voire la rencontre avec le donneur, ne peuvent-elle également avoir des répercussions négatives pour l’enfant ?
Plusieurs personnes auditionnées par la mission se sont inquiétées de l’interprétation de la filiation et des origines qu’une éventuelle levée de l’anonymat serait susceptible de favoriser.
Dans ce sens, M. Pierre Lévy-Soussan (225) a ainsi évoqué le « kidnapping des origines », c’est-à-dire « le fait qu’on considère que c’est la biologie qui fait les origines de l’enfant, pas les familles adoptantes ou qui ont eu recours aux inséminations artificielles avec donneur (…) Ce n’est pas d’informatif qu’a besoin l’enfant, c’est de narratif. Il doit savoir sa place dans une histoire parlée par le couple, lequel doit se présenter comme originaire pour lui. La valorisation par la société du biologique participe des problèmes de filiation. » M. Jean-François Mattei (226) a aussi estimé qu’« avec ces demandes d’enfants nés de l’IAD, c’est le triomphe de la biologie sur l’amour qui est dans la balance », en déclarant « ne pas se satisfaire de cette inversion de la logique. »
De manière analogue, Mme Corine Pelluchon (227) a jugé que « La levée de l’anonymat obéit à un idéal de transparence problématique. Outre le fait qu’elle ne protège pas ceux qui donnent, elle cautionne une idée de l’identité qui devient contre-productive lorsqu’elle est érigée en credo et qui a quelque chose de délétère. »
Au-delà une levée de l’anonymat fragiliserait encore un peu plus l’édifice de l’accouchement sous X, au risque même de le faire disparaître peu à peu. En s’inscrivant dans une vision biologique de la famille, cette levée de l’anonymat ne serait pas sans conséquence sur la pérennité des règles de l’adoption.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, votre rapporteur et la majorité des membres de la mission préconisent le maintien du dispositif actuel.
Cette position n’est cependant pas partagée par le président de la mission, M. Alain Claeys, qui a estimé que la levée de l’anonymat constituait une revendication légitime qu’il convenait d’entendre. Reprenant les propositions formulées dans le rapport de l’OPECST (228), le président a considéré qu’il convenait de s’inspirer d’un des deux dispositifs suivants : soit la réglementation espagnole qui permet un accès aux motivations et données non identifiantes du donneur, à la majorité de l’enfant, si l’enfant le demande ; soit la législation britannique qui autorise la levée totale de l’anonymat à la majorité de l’enfant si celui-ci le demande.
Proposition n° 18.
Maintenir l’anonymat du don de gamètes.
Certains membres de la mission ont estimé que le débat sur cette question devait rester ouvert.
3. Adapter les dispositions de la loi relatives à l’accueil d’embryon
Depuis 1994 le couple dont les embryons surnuméraires ont été conservés et qui n’a plus de projet parental ou le conjoint survivant, en cas de décès de l’un des membres du couple, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple, c’est-à-dire transférés in utero et portés par la femme de celui-ci. En matière de filiation, la décision de l’autorité judiciaire autorisant l’accueil équivaut à un acte de reconnaissance : les deux membres du couple accueillant les embryons seront considérés comme les parents légaux des enfants nés.
Procédant d’une dissociation entre les dimensions biologique et sociale de la filiation, cette possibilité n’est toutefois devenue effective qu’après plusieurs années, du fait notamment de la publication tardive du décret d’application en 1999 (229). La naissance du premier enfant après accueil d’embryon a ainsi eu lieu en 2004, soit dix ans après la promulgation de la loi l’ayant autorisé.
a) Le don d’embryon doit-il être maintenu ?
Quels sont les enjeux éthiques de l’accueil d’embryon et devrait-il être considéré comme une adoption prénatale ?
L’accueil d’embryon ou le don d’un embryon d’un couple à un autre, suscite des interrogations concernant tant son principe que ses indications définies par la loi.
En premier lieu, de quelle façon sera vécu le principe d’anonymat du don dès lors que, dans ce cas, l’enfant n’est rattaché génétiquement à aucun de ses parents ? N’est-il pas imposé à l’enfant une trop grande dissociation de parenté ? M. Pierre Le Coz (230) a estimé qu’alors que « les enfants conçus avec les gamètes d’un donneur anonyme peuvent être tourmentés par la quête de leurs origines et connaissent parfois des problèmes identitaires, qu’en sera-t-il de ceux qui ignoreront tout de leurs deux parents biologiques ? Le don d’embryon ne manquera pas de décupler ces difficultés. (…) À cela s’ajoute qu’ils ont des frères et des sœurs biologiques dans la nature ». »
De même, Mme Pauline Tiberghien (231), jugeant que « la loi refuse une partie d’identité » aux enfants issus d’une AMP avec tiers donneur ainsi qu’à ceux nés sous X, a considéré que « le don d’embryon anonyme prévu par la loi de 1994 dépasse, selon nous, les bornes dans l’irrespect de l’enfant. »
Par ailleurs, l’accueil d’embryon est-il tout à fait assimilable au don de gamètes et aux autres techniques d’AMP ? Ne faudrait-il pas l’envisager comme une adoption prénatale, ainsi que le suggérait Mme Geneviève Delaisi de Parseval (232) : « Les enfants accueillis de la sorte sont encore très jeunes et je n’ai pu en rencontrer. En revanche, je connais des parents : c’est très difficile pour eux, et ils se posent tous la question – de même que les donneurs d’embryons, que je connais également – de ces enfants qui auront de vrais frères et sœurs, non légaux certes, mais biologiques. Cette procédure est très hasardeuse, et serait considérablement assainie si l’on envisageait une adoption prénatale. »
En outre donner la possibilité à une femme de porter un enfant conçu par un autre couple ne risque-t-il pas de conduire plus souvent les couples à ne pas révéler à l’enfant la vérité sur son mode de conception, alors même que plusieurs psychologues ont insisté sur l’importance de ce facteur pour le développement de l’enfant ?
Plus généralement, ne risque-t-on pas ainsi de faire porter à l’enfant des contraintes psychologiques dont l’impact sera difficile à évaluer, ainsi que s’en inquiétait le CCNE, dans un avis rendu en novembre 2005 (233) ? Comment lui expliquer qu’après avoir été congelé, le plus souvent pendant plusieurs années, ses parents biologiques en ont fait don à un autre couple, le principe même de sa venue au monde ayant été validé par un tiers, en l’occurrence le juge ?
À cet égard, M. Pierre Le Coz a jugé que si « le législateur a jusqu’ici cherché une voie médiane », il n’est « pas néanmoins certain qu’il soit toujours resté fidèle à cette heureuse ligne de conduite car un couple peut donner un ou des embryons surnuméraires à un autre couple doublement stérile ou risquant de transmettre à un enfant une maladie d’une particulière gravité, ce qui, à vouloir coûte que coûte « sauver la peau » de cet embryon, peut amener à concevoir des enfants génétiquement orphelins qui apprendront peut-être un jour qu’ils sont restés un certain temps au fond d’un congélateur ou qu’ils ont été transférés dans le ventre de leur « mère porteuse ».
« Tout en reconnaissant la légitimité de cette disposition législative », M. Claude Sureau (234) s’est également interrogé sur « ses conséquences, éventuellement perverses ». Il a déclaré partager « assez largement les réserves émises par M. Pierre Le Coz : il évoque « la « psychologie de fond de tube » des enfants qui (…) ne seront pas transplantés dans l’utérus de leur mère biologique mais dans celui d’une autre femme », « alors que les autres enfants, eux, ont eu la chance d’être accueillis par leurs vrais parents. Cela pose un vrai problème pour la fratrie. Or, la loi française – elle a peut-être eu tort – a autorisé l’accueil de l’embryon. »
Il apparaît cependant nécessaire de conserver cette possibilité, au regard notamment de ses enjeux et de son importance symboliques.
L’accueil d’embryon permet d’abord de répondre à des indications médicales spécifiques de double infertilité du couple, le double don de gamètes étant actuellement interdit. En d’autres termes, « si un homme et une femme, tous deux stériles, veulent vivre une grossesse et avoir un enfant, il n’y a pas d’autre solution que l’accueil d’embryon », comme l’a souligné M. Jacques Montagut(235).
En outre, si elle ne concerne qu’un nombre très limité de couples (28 enfants sont nés en 2007, pour 124 transferts d’embryons congelés réalisés), cette possibilité assure une fonction symbolique importante, en permettant que les embryons surnuméraires ne faisant plus l’objet d’un projet parental n’aient pas pour seule vocation d’être détruits(236).
Enfin, constituant dans une certaine mesure l’« image en miroir inversée de la gestation pour autrui », selon les termes de M. Jacques Montagut, la possibilité de porter et d’accueillir un embryon conçu par un autre couple, génétiquement étranger au couple, souligne l’importance de la grossesse et de la relation fœto-maternelle, et en particulier le fait qu’« il se passe des choses sur un plan physiologique, et même sur l’expression phénotypique d’un support génétique ou épigénétique ». Cette démarche relativise du même coup la place du génétique dans la construction de la parentalité, en consacrant d’une certaine manière « la primauté de la filiation sociale sur la filiation biologique ».
Cette possibilité ne doit-elle être autorisée qu’à titre exceptionnel et subsidiaire ?
Les termes de la loi définissant les conditions de l’accueil d’embryon reflètent ces interrogations éthiques et traduisent la prudence qui inspire cette procédure. En effet, aux termes des articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique, c’est « à titre exceptionnel » que les deux membres du couple peuvent consentir à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple, et c’est encore « à titre exceptionnel » qu’un couple répondant aux conditions d’accès à l’AMP et pour lequel « une assistance médicale sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir » peut accueillir un embryon.
Ces dispositions soulèvent toutefois plusieurs interrogations.
En premier lieu, la recherche sur l’embryon n’étant actuellement admise que par dérogation, il résulte de ce qui précède que la rédaction de la loi peut apparaître établir une hiérarchie entre les trois options possibles lorsque des embryons surnuméraires ne font plus l’objet d’un projet parental (don à un autre couple, à la recherche ou arrêt de leur conservation). Elle semble suggérer que leur destruction serait d’une certaine manière la voie de droit commun. La suppression des dispositions de la loi relatives au caractère exceptionnel de l’accueil d’embryon n’emporterait certes aucun effet en droit mais elle conduirait à une écriture plus équilibrée du dispositif législatif.
En second lieu, la rédaction ambiguë de l’article définissant les conditions de recours à l’accueil pour le couple receveur conduit à des difficultés d’interprétation, ainsi que l’a souligné l’Agence de la biomédecine. La loi du 6 août 2004 avait en effet assoupli les conditions de recours à une AMP avec tiers donneur. Celle-ci peut être mise en œuvre si l’AMP en intraconjugale ne peut aboutir ou si le couple, dûment informé, y renonce (article L. 2141-7 du même code). De ce fait, il est difficile de déterminer si l’accueil d’embryon est subordonné à l’échec de l’AMP intraconjugale ou si le couple peut également demander un accueil d’embryon après avoir simplement renoncé à une AMP sans tiers donneur.
La loi pourrait dès lors être modifiée afin de supprimer les dispositions relatives au caractère exceptionnel de l’accueil d’embryon et prévoir qu’il peut être mis en œuvre si l’AMP intraconjugale ne peut aboutir « ou si le couple, dûment informé, y renonce ».
L’interdiction du double don de gamètes doit-elle être reconsidérée ?
La loi prévoit qu’un embryon ne peut être conçu qu’avec des gamètes provenant d’un au moins des membres du couple (article L. 2141-3 du même code). Selon l’Agence de la biomédecine, cette interdiction du double don de gamètes « n’est plus comprise, pas plus par les professionnels qui sont amenés à traiter des cas de double infertilité que par les patients », dans la mesure où la loi permet par ailleurs l’accueil d’un embryon, dont la conception n’a donc fait intervenir les gamètes d’aucun des deux membres du couple l’accueillant.
Alors que l’accueil d’embryon est autorisé en France, mais difficile à mettre en œuvre, quelles seraient les raisons susceptibles de justifier l’interdiction ?
M. Jean-François Guérin (237) a fait observer que la loi interdit le double don, « destiné aux couples souffrant d’une double stérilité, alors que les indications sont les mêmes que pour l’accueil d’embryon. Je suppose que le législateur, en 1994, a autorisé cette dernière technique parce qu’il jugeait important que les embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental soient donnés. Mais en fait, on s’aperçoit que les couples qui acceptent de faire ce don ne sont pas si nombreux. Or le double don de gamètes serait très simple à mettre en œuvre, et je ne vois pas en quoi il pourrait poser des problèmes – que ce soit d’un point de vue médical ou psychologique. Peut-être serait-il même préférable à la procédure actuelle, qui oblige les couples donneurs à prendre des décisions difficiles. »
Mme Geneviève Delaisi de Parseval a par ailleurs suggéré de « favoriser le double don de gamètes (non anonyme), beaucoup plus sécurisant pour l’enfant qui n’aurait pas de « frères » et de « sœurs » ailleurs. C’est au demeurant une procédure très limitative, qui concernera peu de cas par an, mais qui peut se dérouler dans de bonnes conditions. »
Si certains perçoivent une contradiction entre l’autorisation de l’accueil d’embryon et l’interdiction du double don de gamètes, il y a cependant une différence fondamentale entre les deux procédures. Dans un cas, un embryon est déjà conçu et il s’agit de déterminer quel sera son sort et s’il a ou non un avenir autre que la destruction. Dans l’autre cas il s’agit uniquement de gamètes. En outre cela pourrait détourner, en situation de pénurie d’ovocytes, une partie des dons destinés aux couples dont la femme est infertile, alors que les embryons surnuméraires donnés en vue d’accueil sont disponibles en quantité suffisante pour répondre numériquement à la demande liée à la double infertilité (238). Il semble en conséquence préférable de maintenir l’interdiction du double don de gamètes.
b) La procédure d’accueil d’embryon ne pourrait-elle pas être allégée ?
Il est encore rarement recouru à cette procédure, alors qu’elle ne présente pas de problème technique particulier, même si l’on constate une augmentation sensible en 2007, avec 28 enfants nés après un accueil d’embryon, contre 10 enfants en 2006.
Cette situation s’explique en partie par les souhaits des couples n’ayant plus de projet parental, qui sont de fait peu nombreux à consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple.
M. Jacques Montagut (239) a indiqué qu’« environ 80 % des couples demandent la destruction des embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental, 10 % à 11 % l’accueil et 8 % à 9 % la recherche. Ce sont nos chiffres depuis que nous congelons des embryons dans notre équipe, c’est-à-dire depuis 1986, et les chiffres nationaux sont semblables ». De fait, comme l’a souligné M. Jean-François Guérin(240), « ce don est rare : on s’aperçoit qu’il est difficile pour un couple de céder un embryon qui porte son patrimoine génétique et qu’il considère, d’une certaine façon, comme son enfant. En outre, la procédure administrative et juridique est assez lourde, puisque les donneurs doivent exprimer leur accord formel à trois reprises. »
En effet, cette situation semble également résulter du faible nombre d’équipes mobilisées du fait de problèmes d’organisation et de moyens, auxquels s’ajoutent la lourdeur et la complexité de la procédure actuelle.
Le régime juridique de l’accueil d’embryon s’apparente à celui de l’AMP avec tiers donneur mais nécessite également une décision judiciaire qui le rapproche de l’adoption. Selon M. Jean-François Guérin, « il s’agit d’une technique intéressante qui mériterait d’être soumise à une procédure administrative allégée – même si (…) elle a beaucoup inquiété le législateur en raison du risque de remise en cause des lois sur la filiation. »
S’il importe de veiller à ce que le couple soit en mesure de donner un consentement libre et éclairé et de s’assurer du respect des règles de sécurité sanitaire, on peut s’interroger sur certains éléments de cette procédure, comme, par exemple, l’intervention de l’autorité judiciaire ou la durée du délai de réflexion.
S’agissant tout d’abord du couple donneur, qui est sollicité annuellement sur le maintien de son projet parental par le centre qui conserve ses embryons, il doit indiquer par courrier qu’il n’a plus de projet parental et qu’il souhaite le cas échéant que ses embryons soient accueillis par un autre couple. Dans ce cas, il est reçu par l’équipe pluridisciplinaire du centre à des fins d’information, de recueil du consentement et de constitution de son dossier médical. Il doit ensuite se déplacer, après un délai de réflexion de trois mois, dans un autre centre, celui autorisé pour l’accueil, afin de confirmer son consentement, qui est alors envoyé au tribunal de grande instance (TGI). En définitive, lorsque cette technique est mise en œuvre, la congélation des embryons date en général de plusieurs années.
L’accueil de l’embryon est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire, le juge devant s’assurer que le couple demandeur remplit les conditions légales d’accès à l’AMP et fait procéder à « toutes investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que ce couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique ». (241)
Toutefois, selon l’Agence de la biomédecine, l’investissement de la justice et la prise en charge matérielle de l’enquête sont très inégaux d’un point à l’autre du territoire. M. Jacques Montagut a souscrit à cette opinion pour estimer que les juges sont « parfois peu au fait de la spécificité de leur décision, notamment par rapport au don de gamètes ». L’enquête sociale diligentée par le juge arrive par ailleurs tardivement et n’est pas toujours bien comprise, a fortiori lorsqu’elle concerne des couples qui ont déjà effectué plusieurs tentatives d’AMP sans qu’une telle enquête soit réalisée. En définitive, « peu d’équipes se sont mobilisées pour mettre en place l’activité d’accueil d’embryon, compte tenu des lourdes tâches à accomplir », selon M. Jacques Montagut.
Quelles réformes pourrait-on dès lors proposer ?
Une option pourrait être de supprimer le principe d’une intervention judiciaire concernant le couple receveur et de ne prévoir, le cas échéant, que le recueil par un juge du consentement du couple donneur. Ainsi, Mme Geneviève Delaisi de Parseval a indiqué se rallier « à la position (…) qui propose que leur consentement soit recueilli par un juge. Quant à ceux qui veulent accueillir ces embryons, le cas est différent : c’est une tentative de la dernière chance, après un long parcours, et ils s’interrogent moins sur ce qu’ils diront plus tard à cet enfant. Ils ne peuvent pas avoir d’enfant, on leur en donne un : le cas est assez simple. Il l’est moins pour ceux qui donnent : ils voulaient un ou deux enfants, mais pas quinze embryons surnuméraires… »
Une autre option pourrait être de promouvoir la participation des juges aux réunions des équipes pluridisciplinaires des centres d’AMP. M. Jacques Montagut a expliqué que son équipe à Toulouse a pu mettre en place une collaboration avec un juge : « sa participation à des réunions pluridisciplinaires dans notre service, en l’éclairant sur les couples candidats à l’accueil d’embryon dans le respect du secret médical, a permis d’éviter d’onéreuses enquêtes sociales – entre 900 et 1 300 euros à Toulouse – et des délais d’accueil bien trop longs pour ces couples qui déjà ont un long parcours. Ce mode de collaboration a fait des émules et s’inscrit dans un enseignement que nous codirigeons à l’École nationale de la magistrature sur le juge face aux enjeux de la bioéthique. »
Il pourrait également être envisagé de simplifier la procédure sur certains points, par exemple le délai de trois mois pour la confirmation écrite par le couple « donneur » ou encore le déplacement de celui-ci dans un autre centre.
Enfin, le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives. M. Jacques Montagut a cependant estimé que « s’il est une situation dérogatoire susceptible d’être examinée, c’est bien celle de l’accueil d’embryon qui, comme l’adoption et la naissance sous X, provient d’une rupture forcée de projet parental. Y a-t-il lieu de s’interroger sur le regard social porté sur ces trois situations, considérées par certains comme inégalitaires vis-à-vis des enfants qui en sont issus ? La levée possible de l’anonymat à la demande de l’enfant, à sa majorité, lorsqu’il est issu d’un accueil d’embryon, pourrait-elle, dans notre droit, traduire une différence d’importance éthique accordée à l’embryon par rapport aux gamètes, à l’accueil d’embryon plus qu’au don de gamètes, comme le suggérait le CCNE dès 1988 dans son avis sur la révision de la loi ? ». Le CCNE, dans un avis rendu en 2005 (242), a ainsi suggéré que l’accueil d’embryon puisse faire l’objet d’un traitement différencié en matière d’anonymat du don, en évoquant la possibilité de la création d’une extension du CNAOP chargée de la recherche des origines des enfants issus de cet accueil, sous la condition de l’accord des géniteurs.
À partir de l’ensemble de ces éléments, votre rapporteur estime que certaines contraintes pesant sur le couple donneur sont excessives et gagneraient à être simplifiées. Cependant les conditions à remplir par le couple d’accueil et la procédure prévue sont justifiées au regard notamment de l’intérêt de l’enfant à naître.
Votre rapporteur est d’autant plus opposé à toute disposition qui fragiliserait l’anonymat du don d’embryon qu’il ne juge pas souhaitable la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes. Le pire serait en effet d’opter pour un dispositif qui ferait resurgir dans l’histoire de l’enfant et de celle de sa famille, les figures simultanées de son père et de sa mère génétiques.
Enfin, si la demande en faveur du double don de gamètes est sur le fond justifiée, sa mise en œuvre exigerait le recours à des ovocytes qui sont par ailleurs en nombre très insuffisant.
Proposition n° 19. Maintenir la possibilité pour un couple infertile d’accueillir les embryons surnuméraires d’un autre couple. Supprimer la disposition de la loi selon laquelle cette alternative au don à la recherche et à la destruction de l’embryon est ouverte « à titre exceptionnel »
Simplifier les démarches que le couple donneur doit effectuer. Maintenir l’intervention du juge dans la procédure d’accueil de l’embryon.
Maintenir l’obligation selon laquelle l’embryon doit être conçu avec des gamètes provenant d’au moins un des membres du couple, l’interdiction du double don de gamètes se justifiant par la pénurie d’ovocytes et par un nombre suffisant d’embryons surnuméraires pouvant être accueillis par des couples dont les deux membres sont infertiles.
CHAPITRE 2 – LA GESTATION POUR AUTRUI
Le développement des techniques d’aide médicale à la procréation a banalisé l’idée que la conception d’un enfant pouvait, sans risque, emprunter des chemins détournés. Le recours à un tiers anonyme, donneur de spermatozoïdes ou d’ovocytes, n’a pas fragilisé les liens de filiation. La conception d’embryons sous microscope n’a en rien affecté le respect qu’on attribue à la vie. Alors pourquoi ne pas pousser l’artifice plus loin et, face à l’absence de réponse médicale à certaines formes de stérilité utérine ne pas dissocier la gestation de la maternité, en faisant de la mère qui porte l’enfant un moyen de procréation pour la mère qui se destine à le recueillir ? Puisqu’il importe peu de savoir d’où viennent les gamètes et comment ils se rencontrent, pourquoi ne pas considérer que le choix des méthodes de gestation est indifférent si la finalité est de réaliser un projet parental pour des couples en souffrance ?
On ne saurait cependant ramener les termes de ce débat à leur seule dimension compassionnelle. En effet, il serait trop simpliste d’opposer ceux qui savent entendre la détresse des couples infertiles à ceux qui s’interrogeraient sur l’opportunité de permettre la gestation pour autrui, parce qu’ils y resteraient obstinément sourds. La revendication de devenir mère est légitime. Elle doit être entendue tout comme le sentiment d’injustice que peut représenter pour une femme le fait de ne pouvoir donner la vie.
Pour le législateur, analyser la possibilité d’autoriser la gestation pour autrui et son encadrement éventuel impose d’examiner précisément les moyens qui seraient nécessaires à sa mise en œuvre, dès lors qu’il est recouru à un tiers dont on utilise au surplus les fonctions corporelles. Cette pratique ne saurait être assimilée aux autres techniques d’assistance médicale à la procréation.
La portée et les conséquences d’une éventuelle légalisation de la maternité pour autrui doivent également être évaluées avec précaution au regard des principes qu’elle serait ou non susceptible de remettre en cause et des risques qu’elle pourrait présenter.
En d’autres termes, la gestation pour autrui pourrait-elle être considérée comme une pratique permettant de répondre aux souffrances de couples infertiles, qui pourrait être très strictement encadrée en France pour prévenir des dérives et correspondre ainsi à un acte de générosité, comme le souhaitent certains ? Ou bien, comme s’en inquiètent d’autres, constitue-t-elle une nouvelle forme d’aliénation et de marchandisation du corps humain?
1. Une interdiction par la jurisprudence et par la loi
La pratique des mères porteuses ou maternité de substitution (« surrogate motherhood ») est prohibée par la jurisprudence et par la loi.
a) Une pratique ancienne renouvelée par la dissociation possible de la maternité biologique
Le fait de concevoir naturellement un enfant et de le porter en vue de le remettre à un autre couple est une pratique ancienne.
Des histoires de maternité pour autrui sont en effet rapportées dans l’Ancien Testament et dans la Rome antique (ventrem locare). Encore faut-il souligner que, dans la Genèse, il ne s’agissait pas précisément d’exemples plaidant pour cette pratique, puisque les premières mères porteuses étaient des esclaves (par exemple Agar, la servante de Sara, qui donna naissance à Ismaël) portant l’enfant pour le compte de leur maîtresse. Ces récits connaissent d’ailleurs rarement une fin heureuse. Ainsi Agar, la servante de Sara, fut-elle finalement châtiée et prit la fuite.
Ces pratiques, plus ou moins ignorées ou tolérées se sont ensuite poursuivies dans un cadre privé. Si « la maternité et la paternité pour autrui se pratiquent depuis des lustres, plus ou moins facilement et plus ou moins humainement », comme l’a rappelé M. Israel Nisand (243), gynécologue-obstétricien, « aujourd’hui, la médecine permet d’adoucir ces situations », en notant toutefois que « si nous autorisons la GPA, nous devons faire en sorte de ne pas créer de nouvelles figures d’Agar et d’Ismaël ».
La maternité pour autrui s’est en effet développée avec les progrès des techniques d’assistance médicale à la procréation, qui l’ont rendue possible en dehors de tout rapport charnel mais aussi dans le cadre d’une dissociation de la maternité biologique. En effet, si « la GPA « première génération », sans dissociation de la maternité, existait depuis la Bible et s’est pratiquée dans toutes les sociétés, au sein des familles », comme l’a rappelé Mme Dominique Mehl (244), sociologue, « la technique de l’AMP a apporté une révolution en permettant de scinder en deux la maternité biologique : on peut être mère biologique, simplement par les gamètes, ou mère biologique simplement par la gestation. »
La maternité pour autrui peut ainsi avoir lieu après une fécondation in vitro (FIV) permettant à des couples de faire porter un enfant conçu avec leurs propres gamètes par une autre femme. Elle peut également être envisagée après insémination artificielle, la fécondation ayant lieu dans ce cas in utero, avec les ovocytes de la donneuse, étant précisé que l’insémination peut également être effectuée en dehors de tout contexte médical.
Il convient donc de distinguer la procréation pour le compte d’autrui, lorsque la femme qui porte l’enfant est aussi la génitrice (elle fournit l’ovocyte qui permet sa conception), de la gestation pour autrui par une « femme porteuse », selon les termes de Mme Nadine Morano (245), Secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité . Dans ce cas, l’enfant a été conçu in vitro à partir de l’ovocyte de la femme du couple demandeur, voire d’une donneuse, la gestatrice n’étant donc pas la génitrice. À cet égard, M. Dominique Mennesson, père de deux jumelles nées en octobre 2000 à l’issue d’une gestation pour autrui (246) et cofondateur de l’association Clara (247), a jugé que « l’expression de « mère porteuse » doit (…) être bannie car trop réductrice : on ne peut ramener tout ce cheminement, qui engage plusieurs personnes, à l’une seule d’entre elles. »
S’il est vrai que le code civil fait référence, depuis 1994, à la gestation ou à la procréation pour le compte d’autrui, le terme de gestation pour autrui (GPA) qui tend à se généraliser pour désigner les mères porteuses ou maternités de substitution, apparaît doublement contestable.
En premier lieu, au-delà de sa connotation animale – les termes de grossesse ou de maternité semblent a priori plus appropriés à l’espèce humaine –, la « gestation » désigne étymologiquement l’action de porter et de ce fait, comme le fait justement observer Mme Sylviane Agacinski dans un ouvrage récent (248), elle semble passer sous silence le fait qu’elle conduit in fine à la naissance d’un enfant. De surcroît, le terme dérivé de « gestatrice » peut donner à penser qu’il s’agit là d’une activité, d’une fonction séparable de la personne et non pas d’un état.
Mme Sylviane Agacinski (249) a ainsi fait valoir que « le vocabulaire isole la fonction gestatrice comme si celle-ci pouvait avoir lieu seule. L’expression « gestation pour autrui » occulte le problème majeur de l’accouchement, comme si l’on pouvait assurer une gestation sans accoucher et donner une gestation sans donner un enfant. Or, ce que l’on donne à la fin, c’est bien un enfant. Ce tour de passe-passe linguistique n’est pas innocent. »
En second lieu, la grossesse « pour autrui » est associée d’emblée à l’idée de générosité et peut sembler tout entier être tournée vers le couple d’intention.
Dans ce sens, M. Henri Atlan (250) a rappelé qu’« on parlait autrefois de mère porteuse ou de mère de substitution, termes à connotation assez péjorative alors que gestation pour autrui renvoie à l’expression d’une solidarité. Là encore, au-delà des mots, il faut analyser les pratiques. Si la gestation pour autrui peut en effet marquer une authentique solidarité, comme dans le cas où une femme porte un enfant pour une sœur qui ne peut en avoir, elle peut aussi conduire à un trafic de location d’utérus ou à des ventes d’enfants. Si l’on souhaite légiférer en ce domaine, ce qui sera probablement nécessaire, il faudra éviter les pièges de la sémantique, se libérer du poids du vocabulaire et ne pas tenter des généralisations hasardeuses. »
b) Une condamnation par la jurisprudence du fait de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes
Par un arrêt d’Assemblée plénière de mai 1991 (251), la Cour de cassation a condamné la convention par laquelle une femme s’engage, « fût-ce à titre gratuit », à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance, en ce qu’elle constitue un détournement de l’institution de l’adoption et qu’« elle contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ».
● L’indisponibilité du corps humain
Le corps n’est pas seulement le support matériel de la personne ; il ne peut dès lors être qualifié de chose car il ne peut pas être envisagé en soi, isolément de l’être humain qui l’habite. Le corps n’est pas de l’ordre de l’avoir mais de l’être.
Le droit au respect du corps, qui vise à protéger la personne, a pour conséquences directes les principes d’inviolabilité et d’indisponibilité du corps humain.
L’indisponibilité du corps humain, qui a été reconnue par la jurisprudence mais n’est pas expressément formulée en tant que telle par la loi, signifie que le corps ne peut être mis à disposition, qu’une convention ne peut établir des droits sur celui-ci, qu’il ne peut être vendu, donné, sauf, dans certaines conditions, pour certains de ses éléments. Au surplus, l’article 1128 du code civil consacre le principe selon lequel « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions. » C’est notamment sur le fondement de cet article que la Cour de cassation a conclu au caractère illicite de la convention de mère porteuse dans l’arrêt précité de mai 1991.
Parce qu’il indisponible, le corps humain ne peut faire l’objet d’un acte de mise à disposition : dès lors, on peut considérer que le contrat passé entre la mère de substitution et le couple demandeur porte atteinte au principe d’indisponibilité du corps, en ce qu’il porte « tout à la fois sur la mise à la disposition des demandeurs des fonctions reproductrices de la mère et sur l’enfant à naître (252) ».
● L’indisponibilité de l’état des personnes
L’état des personnes désigne l’ensemble des éléments par lesquels les personnes physiques sont individualisées, à travers par exemple le nom, l’âge, le sexe, la filiation ou la situation matrimoniale. Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes signifie que les intéressés ne peuvent modifier leur état comme ils l’entendent, de façon unilatérale ou par contrat. Ainsi, une personne ne peut changer sa filiation ou sa date de naissance, ni échanger celles-ci avec une autre.
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation, en vertu de l’article 323 du code civil. La filiation est un élément de l’état des personnes qui peut, dans une certaine mesure, être modifié mais l’établissement comme la contestation de la filiation relèvent d’exigences légales. Ainsi, l’établissement de la filiation d’un enfant ne résulte pas d’un acte de volonté mais doit respecter des règles d’ordre public.
En ce qui concerne l’établissement de la filiation maternelle, les dispositions du code civil (253) reposent sur le principe que la mère est celle qui accouche de l’enfant (« mater semper certa est ») et visent à garantir à l’enfant la solidité et l’évidence de sa filiation. Ce principe a été récemment généralisé et étendu à la filiation hors mariage par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la filiation.
Le seul moyen d’attribuer la maternité d’un enfant à une femme qui n’en ait pas accouché est l’adoption mais, s’agissant des conventions de maternité pour autrui, « en raison de l’indisponibilité de l’état des personnes le rapport de filiation adoptive ne [peut] faire l’objet d’une telle convention privée », comme l’a jugé la Cour de cassation (254). Le juge ne peut en effet valider un tel accord en prononçant l’adoption, dans la mesure où celui-ci en constituerait un détournement. L’adoption a pour raison d’être de donner une famille à un enfant et non de faire venir au monde un enfant pour le « donner » à une famille qui n’en a pas. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Les conventions de mères porteuses sont donc contraires au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes « en ce qu’elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen d’une renonciation et d’une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la future mère (255) ».
En cela, il est clair que si la maternité pour le compte d’autrui a été clairement condamnée par le législateur en 1994, son caractère illicite se déduisait, et continue de se déduire, des principes généraux du code civil (256).
c) Une interdiction consacrée depuis 1994 par le législateur et assortie de sanctions civiles et pénales
● Les sanctions civiles
La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 a défini plusieurs principes fondateurs garantissant le respect dû au corps humain. Inviolable, ce dernier ne peut faire l’objet, pas plus que ses éléments et produits, d’un droit patrimonial, conformément à l’article 16-1 du code civil. Il en résulte que les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain ou à ses éléments sont nulles.
Par ailleurs, le principe de la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui a été expressément consacré par le législateur en 1994 et figure à l’article 16-7 du code civil. Ces dispositions et notamment l’article 16-7 sont d’ordre public car elles visent à protéger tant les intéressés que l’ensemble de la société (article 16-9 du même code).
À cet égard, le Conseil constitutionnel (257) a considéré que les principes du code civil, « au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine (…) tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».
La convention de maternité de substitution étant nulle en raison de sa contrariété à l’ordre public, ne produit aucun effet juridique. Elle n’entraîne aucune obligation pour des parties et n’est susceptible d’aucune exécution forcée. La situation des enfants nés d’une GPA, s’agissant de leur filiation comme de l’exercice de l’autorité parentale, est donc régie par la loi comme s’il n’y avait pas eu de convention de maternité de substitution.
Par ailleurs, l’ordre public français ne peut être contourné par le recours à une mère porteuse étrangère, quand bien même cette pratique serait autorisée dans le pays concerné, comme l’a rappelé récemment la Cour de cassation (258). Il en résulte que ces dispositions font obstacle, quelque soit le moyen juridique utilisé, à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, qui ne pourra donc être considérée comme la mère légale en droit interne.
● Les sanctions pénales
Dans les cas de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui, des sanctions pénales sont encourues par la gestatrice, le couple commanditaire et les intermédiaires.
L’article 227-13 du code pénal, issu de la loi précitée du 29 juillet 1994, incrimine tout d’abord la supposition d’enfant, en tant qu’elle constitue une atteinte à l’état civil de celui-ci, c’est-à-dire la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant ; elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, la tentative étant punie des mêmes peines. Seront considérés comme co-auteurs la gestatrice, qui dissimulera son lien avec l’enfant, la mère intentionnelle qui le simulera et le mari de cette dernière, qui aura déclaré à l’état civil une fausse filiation.
L’article 227-12 du même code réprime par ailleurs la provocation à l’abandon d’enfant ou l’entremise en vue d’une maternité de substitution.
Ainsi, la provocation à l’abandon d’un enfant né ou à naître par ses parents ou l’un d’entre eux, dans un but lucratif ou par don, promesse, menace ou abus d’autorité, constitue un délit passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
En outre, le même article incrimine le fait de s’entremettre, dans un but lucratif, entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter cet enfant en vue de le leur remettre est puni des mêmes peines. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. Pour ces infractions la tentative est sanctionnée par les mêmes peines. Les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables de ces infractions, sur le fondement de l’article 227-14 du même code.
Au surplus, selon les circonstances, il pourrait être envisagé d’engager des poursuites au titre de faux en écritures publiques (article 411-4 du même code), voire de l’obtention d’embryons humains contre paiement (article 511-15 du même code), ou de la mise en œuvre d’une AMP à des fins autres que celles prévues par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique (article 511-24 du code pénal).
Toutefois, outre la rareté des actions pénales engagées, se pose dans de telles circonstances le problème de l’effectivité de ces sanctions. En effet, lorsque le délit est commis à l’étranger, les faits ne sont incriminés par la loi française que si la loi du pays les incrimine elle aussi, conformément aux règles d’application des lois pénales françaises dans l’espace prévues par les articles 113-2 et 113-6 du code pénal (259).
Il en résulte que les couples ayant recouru à la gestation pour autrui dans un pays où cette pratique est légale ne peuvent être poursuivis en France que si l’un des faits constitutifs de l’infraction a eu lieu en France (260).
2. Les arguments avancés en faveur de la légalisation
Plusieurs personnes auditionnées par la mission se sont prononcées en faveur d’une légalisation encadrée de la GPA, en faisant notamment valoir l’absence, pour certaines formes de stérilité, de solution alternative permettant de répondre à un désir d’enfant. Elles ont également mis en avant les difficultés affectant l’état civil des enfants ainsi conçus, estimant qu’un encadrement strict en France pourrait permettre de lutter contre certaines dérives.
– L’absence de réponse médicale aux infertilités d’origine utérine
L’absence d’utérus, d’origine congénitale ou accidentelle, pourrait être l’une des « indications » médicales de la GPA – ce terme apparaissant toutefois pour le moins contestable, dans la mesure où il s’applique non pas à un produit de santé ou à une thérapeutique, mais à une personne.
Ainsi, le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), qui se caractérise par l’absence congénitale d’utérus et des deux tiers supérieurs du vagin, atteint une femme pour 4 500, soit environ 200 par an, selon un rapport récent de l’Académie nationale de médecine (261). La stérilité peut également résulter d’une ablation de l’utérus, du fait notamment d’une hystérectomie pratiquée suite à une hémorragie de la délivrance lors d’un accouchement, éventualité qui se produirait dans une grossesse sur mille environ (700 à 800 cas par an). L’existence d’une rupture utérine ou encore d’un placenta accreta peut aussi entraîner l’ablation de l’utérus ; autrefois exceptionnelles, ces deux éventualités seraient devenues plus fréquentes avec l’augmentation du nombre de césariennes. Enfin, un cancer peut être à l’origine de l’ablation de l’utérus.
Le recours à la GPA pourrait, par ailleurs, être motivé par l’existence de malformations et d’anomalies fonctionnelles de l’utérus, résultant notamment de la prise de distilbène par la mère, de curetages après avortements spontanés dans les suites de couches ou, plus rarement d’aspirations pour interruptions volontaires de grossesse.
Enfin, parmi les situations médicales qui seraient susceptibles de justifier le recours à la grossesse pour autrui, l’Académie nationale de médecine évoque les risques de rupture utérine, les antécédents d’avortements spontanés ou de grossesses extra-utérines à répétition, d’échecs successifs de fécondation in vitro ou encore les maladies mettant en jeu la vie de la mère au cours de la grossesse, par exemple une hypertension artérielle grave ou une insuffisance rénale sévère.
Pour ces femmes qui souhaitent procréer alors qu’elles n’ont pas d’utérus fonctionnel, il n’y a pas actuellement de réponse médicale.
Certes, on pourrait imaginer qu’il soit un jour possible de procéder à des greffes d’utérus. Ainsi, Mme Jacqueline Mandelbaum (262) a estimé que « le salut viendra peut-être de la greffe d’utérus. La faisabilité d’une greffe autologue a été attestée par des recherches menées chez la souris et la brebis. Des équipes travaillent actuellement sur une greffe allogénique chez la brebis, la souris et le singe. Une greffe allogénique nécessiterait un traitement anti-rejet, dont la nocivité n’a pas été démontrée sur la grossesse de femmes atteintes d’une insuffisance rénale. Les Suédois envisagent de mener d’ici deux à trois ans des essais cliniques chez l’humain ».
Le rapport bénéfice-risque n’apparaît cependant pas jouer en faveur de telles transplantations. La lourdeur des traitements immunosuppresseurs et leur toxicité éventuelle pour l’enfant, les risques obstétricaux accrus après une greffe, les problèmes médicaux liés à la préservation de l’organe ne permettent pas, à l’heure actuelle, d’envisager de telles greffes. En tout état de cause, les contraintes et les risques de ces traitements conduiraient nécessairement à s’interroger sur la légitimité de telles greffes, alors qu’aucun pronostic vital n’est en jeu. De fait, la seule transplantation d’utérus dans l’espèce humaine rapportée par la littérature, après un premier épisode de rejet a été accompagnée de signes de nécrose avec thrombose vasculaire.
Dans l’avenir, la reconstruction d’un utérus à partir de cellules souches ou de fragments de tissus autologues sera peut-être réalisable. Cette perspective semble cependant a priori particulièrement complexe et aléatoire, du fait notamment des modifications de l’utérus pendant la grossesse.
Il en résulte qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de réponse thérapeutique à certaines formes de stérilité et donc d’alternative possible à la GPA, ce qui est ressenti comme une injustice.
– Une situation ressentie comme une injustice
« L’infertilité, quelle qu’en soit la cause, a des répercussions majeures sur les individus et les couples à tous les niveaux de leur vie », comme l’a souligné Mme Laure Camborieux (263), présidente de l’association Maia. En effet, l’infertilité est source de souffrances et conduit souvent à un isolement, une perte d’estime de soi, un sentiment de culpabilité et parfois à la séparation du couple, selon l’Académie nationale de médecine.
À cette souffrance s’ajoute par ailleurs un sentiment d’injustice. Celui-ci peut avoir deux origines. Il tient au fait que les fonctions ovariennes de ces femmes sont le plus souvent normales, ce qui leur permettrait donc de procréer en recourant à la GPA. Il s’explique également par le caractère irrémédiable de la stérilité utérine au regard des autres formes de stérilité qui peuvent bénéficier, elles, de traitement d’AMP.
À cet égard, Mme Nadine Morano (264) a déploré qu’en dépit de cette « souffrance légitime », la réglementation actuelle conduise à « n’apporter ainsi de réponse qu’à certaines catégories de femmes qui ne peuvent pas avoir un enfant », en jugeant nécessaire de se demander « comment répondre, avec justice, à un désir d’enfant lorsqu’il est contrarié par des problèmes médicaux ». M. Israël Nisand (265) a également regretté « devoir faire une différence entre la femme de vingt-cinq ans ménopausée, que je peux aider, et celle qui est née sans utérus, pour qui je ne peux rien ».
Il convient toutefois dans ce débat de garder plusieurs éléments présents à l’esprit.
Tout d’abord, de nombreux couples s’engagent aujourd’hui dans un parcours d’AMP sans finalement parvenir à avoir un enfant et sans d’ailleurs qu’on identifie toujours précisément les causes de la stérilité ou des échecs de l’AMP. M. René Frydman (266), chef du service de gynécologie-obstétrique à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart, a en effet rappelé que « près de la moitié des couples qui recourent à une AMP n’auront jamais d’enfant », jugeant « dangereux de laisser croire que tous les problèmes peuvent être résolus. Il y en a qui ne le peuvent pas, ou en tout cas ne le pourraient qu’à un prix éthique beaucoup trop élevé ». De ce point de vue, il apparaît donc excessif d’évoquer une stigmatisation de la stérilité utérine, en laissant entendre que toutes les autres formes de stérilité pourraient trouver une réponse médicale.
En outre, il serait juridiquement peu pertinent de mettre en avant le principe d’égalité pour justifier le recours à la GPA. Ainsi, M. Bertrand Mathieu (267), professeur de droit à Paris I, a estimé qu’« on ne saurait invoquer un principe d’égalité entre les femmes – car nous sommes tous inégaux devant la vie. »
Enfin, on peut se demander, comme y a invité Mme Gisèle Halimi (268) , avocate et présidente de l’association Choisir – La Cause des femmes, dans quelle mesure un sentiment d’injustice peut fonder un droit : « On peut éprouver en effet un sentiment d’injustice, face à une telle situation. Mais on peut l’éprouver lorsque l’on constate que certains sont beaux et d’autres non, que certains sont handicapés et d’autres pas... La question est : jusqu’où peut-on aller pour remédier à l’injustice ? Je trouve frappant qu’un tel débat se développe pour une cinquantaine de femmes. Bien sûr, nous sommes confrontés à cinquante malheurs. J’ai discuté avec ces femmes, dont le désir d’enfant devient obsédant (…) ; elles se sentent handicapées et pensent qu’elles ne sont pas les égales des autres. Pour autant, ce sentiment d’injustice ne saurait déboucher sur un droit. La raison majeure est que l’enfant n’est pas quelque chose sur laquelle nous aurions un droit ».
– L’expression du primat du biologique sur l’éducatif
Selon M. Christian Flavigny (269), psychanalyste et pédopsychiatre, la pratique des mères porteuses « donne le primat à la biologie et va à l’encontre de la pratique de l’adoption – que certains couples refusent en avançant des arguments, souvent discutables, comme celui de la longueur des délais. ». Il reste que les procédures d’adoption demeurent longues et difficiles et sont parfois source de déceptions pour les couples candidats. En effet, il y a environ 28 000 demandes annuelles d’adoption et 4 000 enfants sont adoptés chaque année, l’adoption internationale ayant notamment diminué de plus de 20 % entre 2005 et 2007.
Quoi qu’il en soit, les couples stériles ne souhaitent pas nécessairement recourir à l’adoption et le désir d’un enfant biologique, c’est-à-dire issu de ses propres gamètes ou d’au moins l’un des membres du couple, est tout aussi compréhensible que pour les autres couples s’engageant dans une AMP.
Ainsi, Mme Laure Camborieux (270) a considéré à propos de l’adoption, que « le propre de l’assistance médicale à la procréation est justement de permettre à des couples infertiles d’avoir un lien génétique avec leur enfant. C’est un souhait légitime que l’on ne peut pas, pas plus qu’aux autres, nous reprocher. » Mme Nadine Morano (271) a partagé ce point de vue : « "Qu’ils adoptent ! ", diront certains. Mais, face à cette souffrance légitime, de quel droit priver ces couples du recours à une femme porteuse ?»
M. Israël Nisand (272) a déclaré avoir « longtemps (…) demandé à [ses] patientes pourquoi elles ne souhaitaient pas adopter, avant de réaliser que c’était pour elles une question obscène, tant qu’existait une possibilité de ne pas rompre la chaîne fantasmatique de la transmission biologique. ».
Il apparaît cependant que le débat se concentre, là encore, sur les finalités de la GPA. Si le désir d’un enfant biologique est compréhensible et peut sembler légitime, en tant que tel, il doit être apprécié aussi par rapport aux moyens qui devront être mis en œuvre pour le satisfaire.
Pour contourner l’interdiction de la maternité pour autrui en France, certains couples se rendent dans les pays étrangers où celle-ci est autorisée et ouverte aux ressortissants étrangers, le plus souvent aux États-Unis ou au Canada. Selon certaines associations favorables à cette pratique, il y aurait actuellement plus d’une centaine de couples (273), voire 300 selon certains, qui se rendraient chaque année à l’étranger en vue de recourir à la GPA, sans qu’il soit cependant possible de vérifier cette évaluation.
« Se pose ainsi le problème d’une prohibition qui est contournée de façon importante », selon les termes de Mme Michèle André (274), notre collègue sénatrice. Encore faut-il préciser que la maternité pour autrui est légalement interdite dans de nombreux pays : de ce point de vue, la position de la France n’apparaît pas marginale en Europe, loin s’en faut.
LA MATERNITÉ POUR AUTRUI À L’ÉTRANGER :
SYNTHÈSE DE L’ANALYSE INTERNATIONALE
La gestation pour autrui est légalement interdite en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Suède et en Norvège notamment, ainsi que dans certains pays d’Asie (Vietnam, Japon, Philippines). Aux États-Unis, certains États criminalisent le recours à une mère porteuse (Washington, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, l’Utah, le Michigan et l’État de New York).
L’essentiel des pays qui acceptent cette pratique la tolèrent en réalité, voire adaptent leur droit de la filiation, notamment la Grande-Bretagne, la Finlande, le Danemark, la Grèce, certains États des États-Unis, le Canada. La Belgique n’interdit pas la pratique, mais elle n’y est pas encore encadrée. Les Pays-Bas l’ont admise, mais semblent ne plus la pratiquer. Israël est le seul pays à avoir adopté une loi spécifique autorisant et encadrant la GPA.
Source : Agence de la biomédecine
Cette pratique peut toutefois être également réalisée clandestinement en France. En effet, la procréation pour autrui ne nécessite qu’une insémination, qui peut être effectuée en dehors de tout contexte médical. Dans d’autres cas, la femme accepte de porter un enfant conçu par FIV à l’étranger. Il peut ensuite y avoir échanges de papiers à la maternité ou dissimulation dans le cadre d’un accouchement à domicile. Dans le cas d’un accouchement sous X, la reconnaissance de l’enfant par le conjoint du couple d’intention peut être suivie d’une requête en adoption de l’enfant par son épouse. À cet égard, pour les GPA réalisées à l’étranger comme en France, Internet peut être utilisé pour rapprocher l’offre et la demande.
Mme Laure Camborieux (275) a ainsi fait valoir que « l’interdiction actuelle est délétère. Les dérives existent déjà en France : en tapant « mère porteuse en France » sur Google, vous voyez apparaître les agences des pays de l’Est et les endroits où trouver des annonces. Croire que l’interdiction actuelle empêche les dérives, ne pas vouloir regarder la vérité en face, c’est être totalement naïf, voire irresponsable. (…) Pour qu’une interdiction soit respectée, il faut qu’elle soit juste, justifiée et efficace. Aujourd’hui, l’interdiction de la GPA ne remplit pas ces critères. »
Au regard de la pratique d’un véritable tourisme procréatif, emblématique d’une forme de « forum shopping (276) » au niveau mondial, on peut s’interroger sur l’efficacité d’un encadrement national. Selon les termes de M. Alain Grimfeld (277), président du CCNE, s’« il est certes important de légiférer en matière de bioéthique (…) quelle en sera la portée si ce qui est interdit chez nous est autorisé ailleurs ? »
Toutefois, si les exemples étrangers doivent nourrir la réflexion du législateur, ce ne peut être que dans le but d’inciter à promouvoir l’adoption de règles internationales dans certains domaines relevant des lois de bioéthique et non pas pour s’aligner sur le « moins-disant éthique » et abdiquer toute réflexion souveraine en la matière.
Par ailleurs, en défendant certains principes, la loi assure une fonction symbolique et protectrice, qui ne saurait être remise en cause sous prétexte qu’elle n’est pas respectée dans certains cas. En outre, le fait qu’une loi soit contournée ne constitue pas en soi une raison de modifier la norme. Faudrait-il pour les mêmes raisons autoriser en France la consommation de stupéfiants ou l’euthanasie, au motif que ces pratiques sont légalisées dans quelques pays ?
Mme Gisèle Halimi (278) s’est vivement opposée à l’invocation de ce type d’argument pour légaliser la GPA, en soulignant qu’« en Europe, il n’y a qu’un seul pays qui ait mis au point une législation complète, à savoir la Grande-Bretagne (…) ; dans ces conditions, nous n’avons pas à aller dans ce sens par désir d’être européens à tout prix ! Nous avons plutôt à montrer la voie à l’Europe et à dire qu’il faut arrêter cette pratique. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Ce n’est pas parce que cela se fait dans un certain pays que cela doit se faire chez nous. Nous avons un droit d’inventaire, un droit d’examen et un libre choix. Enfin, le fait que cela se fasse ailleurs dans des conditions déplorables, voire clandestines, n’est pas un argument qu’un législateur puisse retenir. Car si on le retenait, ne faudrait-il pas cesser de légiférer contre la drogue ? »
– La réponse aux difficultés relatives à l’état civil des enfants
Le code civil frappant de nullité toute convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui, une convention conclue à l’étranger ne peut, par définition, produire d’effets en droit interne. Autrement dit, la loi ne peut pas se contredire, ce d’autant moins qu’elle sanctionne par ailleurs pénalement la supposition et la provocation à l’abandon d’enfant. Il en résulte que la filiation maternelle ne peut être établie à l’égard de la mère commanditaire. La transcription d’actes d’état civil étrangers établis suite à la conclusion d’une convention de GPA serait dès lors contraire à l’ordre public.
La question de la reconnaissance de la paternité est plus complexe, la jurisprudence n’étant pas clairement tranchée sur ce point. Au demeurant, les conséquences réelles de l’absence de transcription sur les registres d’état civil des actes étrangers, qui n’est d’ailleurs pas obligatoire, ne sont pas aussi dramatiques qu’on semble parfois le suggérer (cf. infra).
Il reste que la mère d’intention, qui élève l’enfant conçu le plus souvent avec ses propres gamètes, ne peut en effet être reconnue comme la mère légale. Dans ce sens, Mme Laure Camborieux (279) a par exemple déclaré que « c’est aussi au nom de cette interdiction injustifiée qu’on prive des enfants d’un lien de filiation avec leurs parents (…). La levée de l’interdiction de la GPA coupera également court aux tentatives de l’appareil judiciaire d’empêcher l’établissement de filiations stables pour les enfants déjà nés. »
c) Des arguments psycho sociaux
– Prévenir certaines dérives et permettre l’expression d’un acte de générosité
Les personnes auditionnées par la mission qui se sont prononcées en faveur de la légalisation de la GPA ont défendu l’idée de son encadrement, afin de prévenir certaines pratiques.
Ainsi, Mme Marie-Pierre Micoud (280), coprésidente de l’Association des parents gays et lesbiens (APGL), a souhaité que « la GPA soit autorisée pour toute personne seule ou tout couple porteur d’un projet parental, qu’elle soit organisée et strictement encadrée pour éviter toute dérive marchande, garantir la dignité de tous les protagonistes et permettre un consentement libre et éclairé de la femme qui accepte de porter un enfant pour autrui, et que les personnes qui mettent en œuvre une maternité pour autrui puissent bénéficier de conseils juridiques et d’un suivi médical et psychologique approprié. »
A propos de la procréation pour autrui, qui peut être effectuée clandestinement en France, M. Dominique Mennesson (281) a rappelé que celle-ci « ne requiert qu’une insémination, qui peut être faite très simplement, sans intervention même du corps médical, ni donc vérification, conseil psychologique et cheminement éthique. Or, celui-ci nous semble indispensable. Le long parcours médical qu’exige la gestation pour autrui le rend précisément possible ».
Cet encadrement aurait un double objectif : garantir que la GPA serait réalisée en France dans le respect de principes éthiques – tels que le consentement libre et éclairé, voire l’interdiction de la rémunération de la gestatrice – avec un accompagnement et un cadre protecteur de l’ensemble des parties sous le contrôle des pouvoirs publics et mettre fin à certaines dérives.
Ainsi, Mme Nadine Morano (282) a jugé que l’interdiction actuelle « est dangereuse, car elle pousse des Français à s’entendre avec des femmes porteuses à l’étranger pour mener à bien un processus qui n’est pas toujours encadré sur le plan juridique. » De la même manière, Mme Laure Camborieux (283) a souligné qu’« on nous dit que la légalisation de la GPA conduira à des dérives, mais les dérives existent justement parce que cette pratique n’est pas contrôlée (…) On parle souvent de l’Inde ou des pays de l’Est pour dresser une image apocalyptique de la GPA. Nous condamnons aussi les pratiques hors du temps et hors de l’acceptable qui y sont menées. Mais nous considérons que l’interdiction française, qui prive nos concitoyens d’une solution acceptable, les pousse à un « exil procréatif » et encourage ces filières plus ou moins douteuses. (…) Nous demandons un véritable encadrement de la GPA qui mette fin aux dérives actuelles ».
Pour assurer cet encadrement, M. Israël Nisand (284) a suggéré « la constitution de comités régionaux, qui recevraient les médecins comme grands témoins et les solliciteraient pour évaluer le risque obstétrical – il ne revient pas aux médecins de répondre au problème sociétal que constitue la GPA. Les décisions seraient prises sur le plan national, pour éviter les pressions locales ou les éventuels dérapages d’un comité régional. ». Mais on ne saurait encadrer une telle procédure sans s’assurer au préalable de la légitimité des membres de cette instance régionale et sans définir l’étendue de ses fonctions et le contrôle juridictionnel auquel elle pourrait être soumise. La difficulté de l’exercice n’a pas échappé au Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, qui s’interroge sur la composition d’une telle commission et sur les critères pertinents pour l’appréciation des motivations de la gestatrice et de sa capacité à confier l’enfant aux parents d’intention. (285)
– Des études et des enquêtes globalement rassurantes
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont souligné l’existence de données rassurantes sur la pratique de la GPA et son encadrement, concernant notamment la gestatrice et l’enfant conçu ainsi.
Ainsi, Mme Laure Camborieux (286) a considéré qu’« à ce jour, les données de la recherche scientifique ne montrent pas d’exploitation des femmes dans les pays où la GPA est correctement encadrée. On n’observe pas de dérives financières incontrôlables en Grande-Bretagne et au Canada. Les données médicales obstétricales et néonatales sont rassurantes. On n’observe pas non plus de refus de remettre l’enfant aux parents qui l’attendent. Les personnes qui ont porté l’enfant ne présentent pas de difficultés majeures pendant ou après sa remise – sous réserve, là encore, que la pratique soit correctement encadrée – et les relations entre les parents et les gestatrices sont harmonieuses pendant la grossesse et souvent après. Il en est de même des relations dans les familles ainsi constituées. »
Selon l’association Clara (287), présidée par M. et Mme Mennesson, dans la quasi-totalité des pays qui ont légiféré pour autoriser la GPA dans un cadre réglementé, une agence accrédite les organismes de santé reproductive et assure un suivi des enfants nés suite à un protocole d’AMP. Des études, principalement réalisées en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Israël et au Royaume-Uni, décrivent les conditions dans lesquelles la GPA est pratiquée dans ces pays.
De ces études, il ressortirait notamment, selon la contribution précitée, que « les motivations des gestatrices ne reposent pas sur l’argent, mais sur le désir d’aider son prochain, suite à une sensibilisation à l’infertilité par des proches, ou sur la volonté de se dépasser soi-même par un acte altruiste ». Les dépressions post partum seraient exceptionnelles et, dans 90 % des cas, les relations continueraient dans les deux familles après la naissance de l’enfant. Par ailleurs, dans la plupart des États qui ont encadré légalement la GPA (plusieurs États d’Australie et des États-Unis mais aussi le Canada), les gestatrices ne seraient ni rémunérées ni dédommagées mais seulement remboursées de frais sur présentation des factures. Enfin, en termes d’épanouissement psychosocial des enfants nés par GPA, les études réalisées ne décèleraient pas d’écart significatif avec les enfants conçus sans aide médicale et l’on n’assisterait que très marginalement à des revendications de la gestatrice envers l’enfant qu’elle a porté, les conflits pour plus de 25 000 naissances en vingt-cinq ans étant présentés comme rares.
Selon ces associations, on disposerait donc d’un recul suffisant depuis plus de deux décennies pour envisager la mise en place de règles répondant aux aspirations des couples infertiles dans des conditions protectrices pour toutes les parties concernées.
Cet avis n’est cependant pas partagé par l’Académie nationale de médecine, qui a procédé à une analyse particulièrement approfondie de la littérature internationale dans son rapport de mars 2009 précité. Tout en faisant état de certaines études dont les conclusions pourraient sembler rassurantes, du moins à court terme, ce rapport souligne l’existence d’« une carence majeure en données factuelles sur les risques éventuels » de la GPA. Concernant en particulier les États-Unis, l’académie estime que « le manque de données exploitables est non seulement déplorable, mais inquiétant », qu’il s’agisse des risques médicaux ou des conséquences sur la deuxième génération, aussi bien sur les enfants ainsi conçus que sur ceux de la gestatrice.
Ce manque de données est en effet préoccupant en ce qu’il s’accompagne d’une communication médiatique qui donne à penser que la GPA serait une procédure bien maîtrisée, ce qui est pourtant loin d’être le cas.
– Un moyen de mettre fin à des discriminations sociales
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont fait valoir que le recours à une maternité pour autrui à l’étranger s’avère onéreux et conduit de fait à une discrimination par l’argent. À cet égard, Mme Sandra Saint-Laurent (288), membre de l’association Maia, a livré le témoignage suivant :
« La compensation de la « nounou » a été de l’ordre de 18 000 dollars, c’est-à-dire d’environ 15 000 euros. Il faut ajouter à cela tout ce qu’on doit payer à côté. De ce point de vue, il est vraiment dommage qu’on ne puisse pas le faire en France. La grande chance que nous avons eue dans notre malheur, c’est d’être très à l’aise financièrement. (…) Nous avons pu payer les avocats, les cliniques, les billets d’avion. Je me suis déplacée à chaque fois avec mon mari, notre fille et ma mère pour garder cette dernière pendant les traitements puisque nous avions rendez-vous un jour sur deux à l’hôpital. C’est très lourd financièrement. Depuis que je suis dans l’association Maia, je vois arriver quasiment tous les jours de couples qui rêvent de faire comme moi mais qui n’en ont pas les moyens. »
Mme Nadine Morano (289) a également souligné que la situation actuelle crée une « injustice entre les couples selon leurs revenus », en évoquant le cas d’une famille française ayant « des revenus suffisants pour dépenser les 80 000 euros qui lui ont été nécessaires pour se rendre plusieurs fois aux États-Unis, y louer une maison, régler les frais de prélèvement d’ovocytes et d’implantation de l’embryon, accompagner la femme porteuse lors de l’accouchement. L’ampleur des frais encourus est discriminatoire. J’ai ainsi rencontré un jeune couple dont l’épouse a subi une ablation de l’utérus à la suite d’un accouchement à problème. Ces jeunes gens de moins de trente ans, désargentés, ont décidé de tout sacrifier dans leur vie quotidienne – vacances, voitures, meubles – pour atteindre leur unique objectif : avoir un enfant, grâce à une GPA. »
B. UNE INTERDICTION POURTANT NÉCESSAIRE CAR PROTECTRICE
Si l’on peut entendre la détresse de certaines femmes, « la question est de savoir si l’on est prêt à prendre les risques importants de dérives inhérents à la GPA pour satisfaire la demande d’avoir un enfant génétiquement issu de soi », selon M. René Frydman(290).
La gestation pour autrui soulève en effet de lourdes interrogations éthiques à plusieurs titres : au regard des risques, physiques ou psychologiques, qu’elle implique de faire prendre à des tiers et au regard de l’aliénation et de la marchandisation du corps humain, à travers l’exploitation des femmes les plus vulnérables, auxquelles elle serait susceptible de conduire. Il apparaît pratiquement impossible de définir un encadrement apte à garantir l’absence de toute dérive. Enfin, la légalisation de la gestation pour autrui aurait d’importantes répercussions sociales, juridiques mais aussi anthropologiques.
Au surplus tant le garde des sceaux que les ministres chargés de la santé et de la recherche, le Conseil d’État, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le Conseil d’orientation de l’ABM et les États généraux de la bioéthique se sont prononcés nettement contre la GPA.
1. Les risques de la gestation pour autrui
Comme l’a souligné l’Académie nationale de médecine, qui a estimé qu’au titre de sa mission médicale, elle ne pouvait être favorable à la GPA, celle-ci met en jeu non seulement les intéressés directs mais aussi d’autres personnes, notamment le conjoint et les propres enfants de la mère porteuse. En outre, elle a la particularité de concerner une personne en bonne santé, la gestatrice, qui est engagée dans un parcours qui n’est pas sans risque.
a) Des risques physiques et psychiques pour la gestatrice
Les risques physiques
Concernant les risques auxquels serait exposée la gestatrice, on pourrait envisager que ceux-ci soient limités par une sélection attentive des candidates, en fonction notamment de l’âge et d’un antécédent de grossesse normale.
La femme resterait cependant exposée aux risques et contraintes inhérents à toute grossesse, par exemple une grossesse extra-utérine, une poussée hypertensive, une hémorragie, une césarienne et accessoirement les douleurs de l’accouchement ou de ses suites. Mme Jacqueline Mandelbaum (291) a fait part de l’existence de tels risques :
« Les risques, quoiqu’on veuille en dire, sont loin d’être négligeables pour ces femmes, même si leurs grossesses précédentes se sont bien passées. Ils ne peuvent être comparés à ceux encourus par les donneuses d’ovocytes, circonscrits et limités dans le temps, mais déjà suffisamment importants pour constituer la limite de ce qu’il est possible de demander à autrui lorsque la vie du receveur n’est pas en jeu.
« Il s’agit d’abord de risques physiques, inhérents à la grossesse : 15 % de fausses-couches, 1 à 3 % de grossesses extra-utérines, amniocentèse si l’âge de la donneuse-receveuse est élevé, interruption médicale de grossesse en cas d’anomalie, grossesse gémellaire… Le diabète gestationnel, l’hypertension, une menace d’accouchement prématuré peuvent compliquer la fin de la grossesse. L’accouchement peut être réalisé par césarienne, avec les risques que cela comporte. Enfin, il ne faut pas exclure une possibilité d’hémorragie de la délivrance conduisant à une hystérectomie d’hémostase. Ces accidents sont rares, mais ils sont déjà survenus dans le cadre d’une GPA. Leur multiplicité fait qu’il est difficile de présumer une grossesse sans problèmes, ce qui renforce encore la dose d’altruisme nécessaire pour porter l’enfant d’une autre. »
L’hémorragie de la délivrance est en effet une complication particulièrement grave qui peut notamment conduire à une hystérectomie en urgence. Cette complication reste la cause la plus fréquente des morts maternelles en France. Le président de l’Académie nationale de médecine, M. Géraud Lasfargues (292), en a donné un exemple particulièrement marquant, en évoquant le cas d’« une jeune femme, ayant fait une hémorragie de la délivrance, [qui] a subi une hystérectomie quinze jours après, l’empêchant d’avoir d’autres enfants. Comme elle n’avait pas eu d’enfant avant, elle a refusé de donner celui qu’elle avait porté ».
S’il est vrai que certains de ces risques, et notamment les plus graves, sont statistiquement limités, est-il cependant éthiquement acceptable, alors qu’aucun intérêt vital ou thérapeutique n’est en jeu contrairement par exemple aux dons d’organes, de faire prendre à une personne en bonne santé de multiples risques, y compris celui de mourir pour autrui ?
Les risques psychiques
Les avis sur ces éventuelles répercussions psychologiques divergent. Mme Geneviève Delaisi de Parseval (293), psychanalyste, a estimé que « psychanalytiquement, la GPA tient la route, parce que la grossesse ne constitue pas l’alpha et l’omega de la maternité », en soulignant que « des travaux britanniques ont montré que les gestatrices bien suivies font beaucoup moins de dépressions post-natales que la moyenne des mères – sans doute en raison de la qualité de l’encadrement et de la clarté de leur projet. »
Mme Sophie Marinopoulos (294), également psychanalyste, a déclaré ne pas « [redouter] particulièrement une éventuelle revendication de la part de la femme qui aura porté l’enfant », en indiquant avoir « rencontré beaucoup de mères qui accompagnent leur enfant en se représentant la séparation qu’elles ont projetée. ». Mme Jacqueline Mandebaum (295), chef du service de biologie de la reproduction de l’hôpital Tenon et membre du CCNE, a ajouté qu’« une étude anglaise a montré que les risques psychologiques d’une GPA n’augmentaient pas, au moins dans les six premiers mois de la grossesse – et dans le cadre de la loi anglaise, très restrictive et protectrice des gestatrices. »
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont cependant fait part de leurs interrogations et de leurs inquiétudes sur les répercussions possibles de la GPA pour la mère porteuse (296).
Tout d’abord, les sentiments de la mère porteuse peuvent évoluer au cours de la grossesse, et la séparation peut devenir beaucoup plus difficile que prévu, comme en a témoigné la célèbre affaire « Baby M », du nom d’un procès ayant eu lieu en 1986 et qui avait opposé un couple commanditaire à une mère porteuse qui, à la naissance de l’enfant, avait finalement souhaité le garder.
La gestatrice peut également être victime d’une décompensation psychologique sévère après la naissance, la fréquence des dépressions du post partum étant de l’ordre de 15 %.
Enfin, si plusieurs personnes auditionnées par la mission ont souligné la proximité et les liens souvent conservés après la naissance entre la mère porteuse et les parents d’intention, l’Académie nationale de médecine, dans son rapport précité, fait état du cas où ces relations sont très mauvaises, la gestatrice pouvant se sentir ignorée, écartée ou méprisée. Avec le temps, la femme peut aussi estimer ne pas avoir eu la reconnaissance qu’elle était en droit d’attendre et avoir de ce fait la sensation d’avoir été utilisée comme « un sac » (297), selon les termes mêmes d’une mère porteuse.
Ainsi, Mme Marianne Benoît (298), sage-femme, a livré le témoignage suivant d’un accouchement ayant vraisemblablement eu lieu dans le cadre d’une maternité pour autrui en France : « Alors qu’une femme allait accoucher, deux hommes et une femme ont commencé à faire des allers et retours à tour de rôle dans la salle d’accouchement dans un silence extrêmement pesant, palpable. J’en ai déduit
– sans aucune preuve – que la seconde femme, qui gardait les yeux rivés sur le monitoring et posait de nombreuses questions sur le bébé, allait recevoir l’enfant et qu’il y avait eu un échange de papier d’identité pour que je puisse faire la déclaration de naissance au nom de la femme qui n’était pas enceinte. J’étais dans l’impossibilité de faire correctement mon métier, d’entrer en contact vrai avec la femme qui allait accoucher du fait de ce secret extrêmement fort entre nous. Il est évident que cet accouchement ne s’est pas fait dans la joie et le bonheur. »
Certes, on pourrait imaginer une sélection très attentive des candidates, sur les plans physique et psychologique, de manière à prévenir de telles situations, mais qui serait habilité à opérer cette sélection et sur le fondement de quels critères ? Faudrait-il s’assurer que la gestatrice est « indemne de toute pathologie psychiatrique » ? « Sa capacité de donner l’enfant » devra-t-elle être « soigneusement appréciée », ainsi que l’ont par exemple suggéré MM. Roger Henrion et Pierre Jouannet de l’Académie nationale de médecine dans le cas où la gestation pour autrui serait légalisée (299) ?
Quand bien même la candidate semblerait psychologiquement équilibrée
– si tant est qu’un tel critère ait un sens quand il s’agit pour une mère d’abandonner, en dehors de toute situation de détresse, l’enfant qu’elle a porté – qui peut prévoir la façon dont elle vivra finalement sa grossesse ? Et si l’État légalisait la gestation pour autrui, à condition notamment que la gestatrice soit choisie en fonction d’un certain nombre de critères, sa responsabilité ne s’en trouverait-elle pas engagée si des complications devaient survenir ?
b) La négation des relations entre la mère gestatrice et l’enfant
Pour certains, il serait paradoxal de permettre la gestation pour autrui, alors que l’on découvre progressivement la complexité et la richesse des liens et des échanges biologiques entre la mère, l’enfant in utero et son environnement.
La sensorialité fœtale est en effet de mieux en mieux connue : par exemple, les structures anatomiques permettant l’audition du fœtus se mettent en place entre le quatrième et le cinquième mois de la grossesse et son audition se développe à partir du sixième ou septième mois de grossesse. Le fœtus peut ainsi mémoriser les sons avec une sensibilité différentielle dépendant de l’âge gestationnel et réagit à la voix de sa mère et à d’autres stimulations sonores.
Plusieurs psychanalystes et pédopsychiatres ont insisté sur l’importance de la vie intra-utérine pour le développement de l’enfant. On sait aussi que la naissance est le moment où l’enfant peut habituellement rétablir une continuité sensorielle avec la peau, les odeurs, la voix ou le rythme cardiaque de la mère. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les obstétriciens mettent le nouveau-né sur le ventre de sa mère ou sur sa poitrine pour favoriser la continuité de leur relation.
D’autres travaux relativisent toutefois l’importance des acquis prénataux dans le développement de l’enfant, d’autant que ces enfants sont particulièrement attendus et désirés. Partageant cette perception des choses, M. Israël Nisand (300) a notamment fait valoir que « les liens qui se noueront avec le fœtus ne sont pas négligeables, mais ces échanges n’ont rien à voir avec ceux qui uniront parents et enfant après la naissance, bien plus complexes et affectifs. »
À l’inverse, M. Pierre Lévy-Soussan (301) a souligné le risque pour l’enfant de « la rupture imposée. Il ne s’agit pas d’un abandon, qui est la moins mauvaise solution décidée par une mère dans une histoire psychique compliquée, mais d’une rupture programmée, délibérée de ce que l’enfant a vécu pendant la grossesse (repères olfactifs, auditifs, traces mnésiques des rythmes de la mère…). Une telle rupture a toujours des conséquences psychiques. La psychanalyse de l’enfant sait désormais que la préhistoire psychique commence dès l’embryogenèse et perdure jusqu’à l’accouchement, et que la sensation de perte de la contenance utérine entraîne chez le bébé la recherche d’une autre contenance capable d’apaiser ses angoisses. Cette fonction apaisante est optimale lorsque le bébé peut établir une continuité sensorielle avec la peau, les odeurs, la nourriture, la voix, la rythmicité de la mère, repères déjà présents lors de la grossesse. Faute de la trouver, le bébé s’agrippera à d’autres objets, mais il s’agira d’une organisation défensive secondaire, après la faillite de l’environnement primaire à valeur organisatrice. »
De ce point de vue, le parallèle établi parfois entre la GPA et l’adoption peut sembler erroné dans la mesure où l’adoption est instituée dans l’intérêt de l’enfant pour pallier un accident de la vie, tandis que la GPA impose, d’une certaine manière, cet accident de la vie à un enfant. M. Jean-François Mattei (302) a montré combien « la situation de ces enfants est très différente de celle des enfants abandonnés, dont le sort n’était pas programmé. En l’espèce, la grossesse et l’abandon sont programmés. »
Certaines études insistent également sur les liens biologiques in utero entre la mère et son enfant, en s’interrogeant aussi sur le rôle de l’épigénétique, c’est-à-dire l’influence du milieu sur les gènes. Par exemple, le développement du cerveau du bébé dépendrait de la sécrétion de la sérotonine maternelle et les cellules fœtales resteraient présentes dans le sang maternel très longtemps après la naissance (303).
M. Jacques Montagut ( 304) a par ailleurs soulevé le contraste existant de ce point de vue entre la GPA et l’accueil d’embryon. Il a invoqué à cet effet « la primauté de la filiation sociale sur la filiation biologique, qui a toujours prévalu en matière de don de gamètes et d’embryon, avec ce que nous expliquons tous les jours aux couples sur l’importance à donner à la grossesse quant à son rôle signifiant, voire identifiant pour l’enfant à naître. Ce poids, ce sens donné à la grossesse s’inverserait au titre de la GPA, dans une paradoxale primauté donnée au biologique, négligeant la relation fœto-maternelle et les repères sensoriels dont la rupture et la blessure pourraient retentir dans la construction de l’identité de l’enfant, comme nous le disent certains pédopsychiatres. Comment, en conscience, le praticien pourrait-il tenir des discours aussi différents sur la grossesse ? » M. Jean-François Mattei (305) s’est aussi interrogé sur le rôle du médecin dans ce contexte : « Doit-il être l’instrument d’une évolution sociétale ? Doit-il être le prestataire de services ? Ne doit-il pas donner son sentiment sur l’avenir de l’enfant ? »
De plus, une grossesse vécue sans attachement affectif est-elle concevable d’un point de vue psychologique et anthropologique ?
Le rapport du groupe de travail sénatorial sur la GPA prévoyait par exemple que la gestatrice devra déjà avoir eu un enfant, non seulement pour des raisons médicales, afin de prévenir les risques d’accident durant la grossesse ou l’accouchement, mais aussi pour « faciliter son désinvestissement affectif ». Alors que selon certains psychiatres, notamment Mme Myriam Szejer, l’indifférence de la mère à l’égard de son fœtus pendant sa grossesse pourrait affecter ultérieurement le psychisme de l’enfant, on peut en effet s’interroger sur l’opportunité d’encourager ce type d’attitude, qui peut du reste s’apparenter à un mécanisme de défense. Revient-il aux pouvoirs publics de légiférer sur le « désinvestissement affectif » de la mère porteuse vis-à-vis de l’enfant qu’elle porte ?
Par ailleurs, comme s’en est notamment inquiété M. René Frydman, la gestation pour autrui ne revient-elle pas, « sous couvert d’intentions louables, [à] faire courir des risques, physiques et psychologiques, non négligeables à certaines femmes mais aussi à leur famille, car elles ont souvent un conjoint et des enfants » ?
c) Des répercussions sur l’entourage de la mère porteuse
De quelle manière l’état de grossesse et ses contraintes directes ou indirectes, seront-ils ressentis par l’entourage de la gestatrice, en particulier sa famille ?
Comme l’a souligné M. Jean-François Mattei (306), « dans les deux ou trois pays ayant légalisé cette pratique, la femme porteuse doit avoir déjà enfanté, et donc avoir un conjoint. Quel comportement aura ce dernier ? Personne ne le sait ». Mme Jacqueline Mandelbaum (307) a également regretté qu’« il n’existe aucune étude sur les conséquences d’une GPA sur l’entourage de la mère porteuse, son mari, ses enfants ».
En particulier, quel regard les enfants porteront-ils sur la grossesse de leur mère ? Considèreront-ils l’enfant qu’elle porte comme un membre de la fratrie ou comme un intrus ? Ne risquent-ils pas de se demander si leur mère ne pourrait également les donner, voire les vendre, eux aussi ? À cet égard, M. Pierre Lévy-Soussan (308), pédopsychiatre, a fait part de ses inquiétudes concernant les « problèmes psychiques de la mère porteuse, de son mari et de leurs enfants, qui devront intégrer le fait de voir leur mère enceinte et qu’elle donne cet enfant à un autre, avec toutes les angoisses que cela suppose ».
d) Des risques pour le couple d’intention
La gestation pour autrui n’est pas non plus exempte de tout risque pour le couple qui souhaite y recourir. Le couple peut en effet être confronté, notamment, au fait que la gestatrice change d’avis et souhaite garder l’enfant, ou qu’à l’inverse, elle décide d’avorter. Le couple devra également être préparé à accueillir un enfant atteint d’une maladie ou d’une malformation grave, si la gestatrice ne souhaite pas une interruption de grossesse. Enfin, sans même évoquer l’hypothèse d’un véritable chantage financier (309) , il n’est pas à exclure que la mère porteuse s’ingère ensuite dans la vie privée du couple ou l’éducation de l’enfant, a fortiori si la gestatrice fait partie de sa famille.
Mme Sophie Marinopoulos (310) a par ailleurs exprimé ses « doutes concernant la fabrication d’un matériel psychique à partir d’un élément biologique provenant d’une tierce personne. Certaines femmes préféreraient avoir recours à une GPA, me disent-elles, au motif que l’enfant serait biologiquement le leur. Mais l’enfant naîtra tout de même d’une autre femme. C’est une donnée qu’il leur faudra transcender. »
e) De multiples interrogations concernant l’enfant
Comme l’a notamment fait valoir notre collègue sénatrice, Mme Michèle André(311), un enfant conçu par GPA sera sans doute particulièrement « désiré et attendu par ses parents intentionnels ». Mme Jacqueline Mandelbaum (312) a également estimé que ces enfants « sont aimés comme des enfants issus d’une gestation naturelle et s’adaptent à cette situation particulière, comme le montre une étude menée par Suzanne Golombok sur 34 familles. » Certaines études (313) ainsi que le témoignage des associations suggèrent qu’il n’y aurait aucun trouble particulier chez l’enfant. La plupart des études en la matière sont cependant encore limitées en nombre et dans le temps et se concentrent sur la petite enfance.
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont fait part des répercussions préjudiciables de la GPA pour l’enfant.
Quels problèmes sont susceptibles de se poser en cas de grossesses multiples, d’anomalies ou de malformations, voire de décès du couple d’intention pendant la grossesse ?
Pour les GPA, comme l’a fait remarquer Mme Barbara Vilain (314), « il est très souvent nécessaire de transférer plusieurs embryons. Cela aboutit à des grossesses multiples, et il faut fréquemment recourir à une réduction embryonnaire, et cela accroît par ailleurs le risque de césarienne, pour la gestatrice, et le risque de prématurité, pour l’enfant. » Le désir d’augmenter les chances de succès et de diminuer les frais afférents à cette procédure, peut en effet conduire à transférer deux ou trois embryons.
Les risques physiques pour l’enfant sont analogues à ceux de toute grossesse. Mais se posent des problèmes particuliers dans le cas d’une GPA. Par exemple, qui prendra la décision de la réduction embryonnaire en cas de grossesse multiple ou de la poursuite ou de l’arrêt éventuel de la réanimation pour des grands prématurés, voire de l’interruption de grossesse en cas de grave malformation ou de trisomie 21 ?
Que se passera-t-il en particulier si, après la découverte d’une malformation à la naissance, les parents d’intention ne veulent plus de l’enfant et que la gestatrice ne souhaite pas non plus le garder ? En sens inverse, si l’on prévoit qu’il reviendra à la gestatrice et à elle seule de prendre toutes les décisions relatives à la grossesse, on peut se demander si, en imposant ainsi à des parents l’accueil d’un enfant gravement malformé ou trisomique, contre leur volonté initiale, cet enfant sera accueilli dans les meilleures conditions. Enfin, qu’adviendra-t-il de l’enfant si les membres du couple d’intention venaient à décéder pendant la grossesse ?
Certains proposent de préciser dans un contrat, voire dans la loi, les conditions dans lesquelles les décisions seraient prises dans certaines situations. Toutes les éventualités peuvent-elles cependant être envisagées ex ante ? M. Pierre Lévy-Soussan (315) a considéré que, dans la GPA, « il y a tellement de risques qui se cumulent, pour l’enfant comme pour autrui, qu’on peut se demander si ce n’est pas disproportionné par rapport au seul désir d’avoir un enfant. Toute grossesse pour autrui doit s’envisager comme une illustration de la loi de Murphy : tout ce qui peut aller de travers ira réellement de travers. Et tous les cas ont déjà été expérimentés, des changements d’avis au décès d’une des parties prenantes. Il faut donc conclure un contrat extrêmement précis qui recense tous les risques, des problèmes médicaux du bébé au changement d’avis de la donneuse. Ce contrat implique l’irruption d’une réalité dérangeante que parfois, et c’est aussi le cas dans des histoires d’adoption, les couples ne peuvent pas métaboliser et qui va faire obstacle au lien avec l’enfant (…). Le réalisme du contrat est donc un facteur de risque. »
f) Le danger d’une parenté fragmentée
Au minimum, la GPA pourra faire intervenir le père d’intention et deux mères « biologiques » (mère génétique/mère utérine). La situation peut toutefois se compliquer encore dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur, l’enfant pouvant ainsi avoir jusqu’à cinq parents ou géniteurs : le donneur de sperme, la donneuse d’ovocytes, la gestatrice, le père et la mère d’intention. Dans son rapport de mars 2009, l’Académie nationale de médecine évoque l’exemple d’un homme célibataire ayant fait porter un embryon par une gestatrice, après une FIV réalisée avec ses spermatozoïdes et un ovocyte obtenu d’une donneuse recrutée sur Internet. Ce père a renouvelé l’opération à plusieurs reprises. Les enfants ont donc des gestatrices inconnues et un père, qui ne voulant aucune femme dans son entourage, les fait élever par sa gouvernante.
Dès lors, on pourrait se demander « comment un enfant pourra-t-il, psychologiquement, se débrouiller avec cinq ou six co-parents ? » Mme Geneviève Delaisi de Parseval (316) a expliqué à cet égard s’en tenir à « l’expression de « reproduction avec un tiers » (third party reproduction). Il doit y avoir deux parents, pas plus. Il y a, en plus, des tiers, que j’appelle « donneurs de corps » ; ce ne sont pas des parents, mais des sujets humains qui donnent quelque chose du corps (gamètes, gestation…). L’idée de parentalité partagée n’a d’intérêt que relativement aux beaux-parents des familles recomposées, mais je la trouve inadaptée pour l’AMP. »
Cette fragmentation de la parenté a été dénoncée par M. Jean-Pierre Foucault (317), président de la Commission de santé publique et de bioéthique du Grand Orient de France. Il a fait valoir qu’ : « Il y a en effet trop d’acteurs qui interviennent dans l’acte de procréer : père biologique, mère biologique, mère porteuse, donneuse d’ovocyte… La mère porteuse pourra revendiquer un lien de filiation avec l’enfant. Qui peut alors prétendre être le père et la mère de l’enfant ? »
Les relations entre la gestatrice et l’enfant soulèvent également des interrogations sur le long terme. Ainsi, M. Jean-François Mattei a estimé que « d’autres questions restent sans réponse : Quel rapport l’enfant établira-t-il avec la gestatrice non anonyme ? Voudra-t-il la rencontrer, par curiosité ou désir de savoir ? Comment la considérera-t-il ? Ne demandera-t-elle pas un droit de visite ? Nous ne sommes pas du tout à l’abri d’une novation juridique. ». Une étude canadienne récente fait par exemple état de déclarations spontanées sur le blog de jeunes ayant été conçus par le recours à la gestation pour autrui. Elle révèle une grande souffrance, ce qui est présenté comme un don étant perçu comme un abandon.
Enfin, il restera à l’enfant de s’accommoder d’avoir été l’objet d’un contrat, puisqu’en effet la GPA s’inscrit le plus souvent dans le cadre d’un marché, ce qui soulève la question de l’instrumentalisation du corps humain.
2. Une forme d’aliénation et de marchandisation du corps humain
Lors des États généraux de la bioéthique, les participants au forum de Rennes se sont unanimement prononcés contre la légalisation en France de la GPA, en raison essentiellement des risques d’instrumentalisation et de marchandisation du corps de la femme.
a) Une remise en cause de l’indisponibilité du corps humain
À l’inverse le groupe de travail sénatorial sur la maternité pour autrui (318) a considéré que celle-ci pourrait être légalisée en tant qu’« instrument » au service de la lutte contre l’infertilité « au même titre que les autres techniques » d’AMP, dès lors notamment qu’elle serait vécue comme « un don réfléchi et limité dans le temps d’une partie de soi », afin d’éviter, selon les auteurs du rapport, la réification, l’instrumentalisation et la marchandisation du corps de la femme. De manière analogue, Mme Sylvie Mennesson (319) a considéré que « la GPA est une technique d’AMP comme une autre et doit être jugée comme telle ». Ne serait-il pas cependant plus approprié de parler du corps, donc de la personne de la femme, que d’une technique ?
À l’opposé de cette argumentation, Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports, a mis en garde les membres de la mission devant les risques d’une légalisation de la GPA pour les femmes : « Faire courir aux plus fragiles le risque d’une instrumentalisation aliénante de leur corps et de leur psyché, reconnaître le primat du génétique tout en admettant que la mère puisse être celle qui élève et non celle qui porte et accouche , voilà une bien étrange conception du progrès et de l’éthique , une bien étrange façon de défendre la cause des femmes. » (320)
Contrairement à une vision réductrice et fonctionnelle de la grossesse, celle-ci engage l’ensemble du corps et le psychisme d’une femme.
Se pose dès lors la question du sens que peut revêtir ou non la grossesse pour autrui pour la femme destinée à porter l’enfant. Elle a pour effet de dissocier sa propre existence corporelle et psychique de son histoire personnelle et est susceptible de favoriser l’expression d’un sentiment d’aliénation et de dépossession de soi.
Mme Sylviane Agacinski (321) a ainsi fait valoir que « la grossesse constitue une série de transformations très profondes et très longues. Elle bouleverse l’ensemble de l’existence d’une femme sur le plan physiologique, mais aussi psychologique et moral. Considérer qu’une femme pourrait faire abstraction du processus d’enfantement qu’elle vit, c’est lui demander un clivage entre ce qui se passe dans son corps et le sens qu’elle donne à sa vie, comme si les aspects biologiques et biographiques d’une vie humaine pouvaient être scindés. Bref, c’est réduire son corps à une machine ou à un animal. (…) Chaque femme prend [des] risques pour elle-même, avec tout le sens qu’une grossesse a pour elle, mais la loi doit-elle autoriser une femme à courir ces risques pour porter l’enfant d’une autre, sans que cela ait de sens dans sa propre vie ? Instrumentaliser ainsi les organes d’une femme, ce qui revient à la traiter comme une chose et à faire d’elle un outil vivant, est contraire au principe de l’inviolabilité du corps. »
En effet, la grossesse engage bien davantage que le seul utérus d’une femme, ce que démontrent, s’il était besoin, les clauses prévues dans des contrats américains de mères porteuses.
Ainsi, on peut lire dans des modèles de contrats américains (322) de nombreuses clauses contraignantes. La gestatrice est soumise à de multiples sujétions : ne pas fumer ni boire des boissons alcoolisées ou trop de boissons comportant de la caféine ; ne pas consommer de drogues illicites ou prendre des médicaments délivrés ordonnance sans le consentement écrit de son médecin ; ne pas pratiquer des activités ou sports dangereux ; se conformer aux prescriptions de son médecin, y compris de prendre les médicaments et vitamines nécessaires ; se soumettre à une amniocentèse à la demande du père génétique et de la mère d’intention ; ne pas voyager à l’extérieur des États-Unis après le deuxième trimestre de grossesse, à l’exception d’un cas de maladie extrêmement grave ou décès dans la famille de la gestatrice et uniquement avec l’accord écrit de son médecin ou obstétricien ; ne pas avoir de relations sexuelles avec quiconque depuis le premier jour de son cycle menstruel avant le transfert embryonnaire jusqu’à la date de confirmation de la grossesse, et ne pas avoir de relations sexuelles non protégées avec quelqu’un autre que son mari pendant la grossesse, voire rester monogame. Les parties (la gestatrice, son mari et le couple d’intention) acceptent de passer des examens psychologiques avant le transfert embryonnaire.
M. Jean Hauser (323), professeur de droit privé, a dès lors considéré que « certains pays ont autorisé la GPA sans se soucier des conséquences. Les contrats de mère porteuse dans le droit californien sont effrayants : il est imposé à la mère porteuse un régime alimentaire pendant neuf mois, il lui est interdit bien sûr de fumer, il est fixé un délai pour remettre l’enfant. Ce n’est plus la peine, ensuite, de signer des conventions pour l’interdiction de l’esclavage parce que c’en est une forme. » Mme Catherine Labrusse-Riou (324), professeur de droit à Paris I, a également jugé sévèrement ces pratiques, en considérant que « les contrats américains d’inspiration libérale sont fascinants par la servitude totale qu’ils organisent. La servitude volontaire est la pire qui soit ».
Comme le fait remarquer le Conseil d’orientation de l’ABM, « le contrôle des comportements quotidiens tendrait à rappeler l’aliénation dont certains travaux d’histoire sur les nourrices, ou " l’allaitement mercenaire " ont pu se faire l’écho. » (325)
Il en résulte une différence de nature et non de degré entre les dons d’éléments du corps humain et la GPA, dès lors que celle-ci suppose la mise à disposition de l’ensemble du corps de la femme et donc de sa personne.
Certes, le principe de l’indisponibilité du corps humain n’est pas absolu, puisqu’il permet à une personne de céder certains de ses éléments, par exemple du sang, des gamètes, du lait maternel ou encore des organes. Il apparaît cependant que cette disponibilité est restreinte et encadrée par la loi : on ne peut donner que certains éléments de son corps, la plupart du temps régénérables ou produits périodiquement (sang, gamètes) et dans certaines conditions précisément définies.
En revanche, le principe d’indisponibilité s’oppose à ce que la femme puisse mettre son corps à disposition d’autrui pendant près d’un an dans le cadre d’une grossesse, a fortiori si elle est rémunérée pour cela. Les juges ont d’ailleurs refusé d’assimiler la maternité de substitution au don d’organe, de cellules ou de gamètes, en estimant que « l’analogie avec le don d’ovule ne peut être retenue s’agissant en l’espèce d’une substance produite périodiquement par le corps humain alors que le « don de gestation » ou « prêt d’utérus » constitue réellement la mise à disposition d’un organe du corps de la mère porteuse (326)».
La GPA ne peut non plus être comparée à une activité professionnelle, notamment parce qu’il n’y a plus dans ce cas de distinction entre le temps du travail et celui de la vie personnelle.
Quels sont précisément les fondements du principe d’indisponibilité du corps humain et en quoi la maternité pour autrui diffère-t-elle de la mise à disposition par un salarié de ses forces physiques ou intellectuelles dans le cadre d’un contrat de travail ? M. Israel Nisand (327) a fait valoir dans ce sens que « s’agissant de la mère porteuse, le principe de l’indisponibilité du corps humain (…) ne [lui] parle pas sur un plan philosophique. Faut-il remettre en question les contrats de travail ? Le mineur de fond ne met-il pas sa force de travail au service de la houillère ? Le soldat ne risque-t-il pas sa vie en Afghanistan, et n’est-il pas rémunéré en conséquence ? Kant explique qu’il ne faut pas se servir de l’autre uniquement comme d’un moyen, mais nous nous servons de la force et du corps des autres à longueur de temps. Si l’utilisation du corps humain est un délit, l’État doit cesser de profiter du « travail » des péripatéticiennes et ne plus percevoir leurs impôts. »
Il y a cependant des différences fondamentales entre la GPA et un contrat de travail. Ce dernier peut être librement interrompu et il est limité dans son objet et dans le temps, tandis qu’une gestatrice ne cesse pas d’être enceinte à la fin de la journée. Mme Sylviane Agacinski (328) a ainsi souligné que « faire entrer les organes humains dans l’ordre d’une production artisanale et d’un commerce contribue à défaire le lien établi par le droit entre la personne et son corps, qui assure que la même dignité est reconnue aux deux. C’est toute la différence entre l’usage des organes et l’usage du corps. Certains prétendent qu’après tout, chacun en travaillant vend en quelque sorte son corps, ses bras pour les travaux manuels, son cerveau pour les travaux intellectuels… Mais, d’une part, on distingue soigneusement dans nos sociétés entre le temps de travail et la vie intime. D’autre part, le travail et la gestation pour autrui n’ont rien à voir dans la mesure où la gestation et l’accouchement, fonctions organiques, ne constituent pas une activité. Une femme qui attend un enfant ne fait rien et n’a rien à faire. C’est la substance corporelle qui est en cause, ce n’est en aucun cas une tâche ou un labeur. »
b) Le risque d’exploitation des femmes les plus vulnérables
Aux termes de l’article 16-1 du code civil, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. A la lumière des pratiques observées dans des pays étrangers mais aussi des interrogations suscitées par les motivations des donneuses, en l’absence de toute rémunération, ce principe semble difficilement compatible avec la GPA.
L’absence de toute forme de compensation financière semble a priori difficile à envisager.
Au regard de l’ensemble des contraintes, des modifications physiologiques, de la durée, des risques mais aussi des frais afférents à une grossesse, on peut s’interroger sur la possibilité d’exclure toute forme de rémunération ou de dédommagement pour la gestatrice.
Dans l’hypothèse d’une légalisation de la GPA, les frais médicaux directs concernant la grossesse, l’accouchement et les suites de couches devraient relever de l’assurance maladie de la gestatrice, éventuellement complétée par une assurance complémentaire. Toutefois, la GPA entraîne des frais supplémentaires, directs ou indirects, qui ne pourraient pas être pris en charge par les organismes de sécurité sociale. Ils sont par nature plus difficiles à évaluer mais surtout ils posent le problème d’une compensation financière, contraire au principe de gratuité du don. Doit-on par exemple indemniser le pretium doloris, pour compenser la douleur d’un accouchement par voie basse, d’une césarienne ou d’une épisiotomie, ou encore une dépression post partum ?
Par ailleurs, quand bien même la loi interdirait toute forme de rémunération pour prévoir uniquement un « dédommagement raisonnable » dont le montant serait fixé par le juge, rien ne garantirait dans la pratique l’absence de toute rémunération occulte ou encore de « cadeaux » (cf. infra).
Le terme de « dédommagement » semble d’ailleurs trahir le fait que la gestation pour autrui peut en effet entraîner un dommage, un dol, qu’il conviendrait donc de réparer.
De fait, dans la très grande majorité des pays étrangers, acceptant de répondre aux demandes de GPA de non-ressortissants, il est prévu une rétribution de la gestatrice par les couples d’intention. Ainsi, comme l’a rappelé le président du CCNE, M. Alain Grimfeld(329), « chacun sait que des femmes françaises font aujourd’hui porter leur enfant par des mères porteuses aux États-Unis, moyennant une rémunération de 10 000 à 15 000 dollars. »
Mme Sandra Saint-Laurent, membre de l’association Maia(330), ayant elle-même recouru à une mère porteuse, a expliqué que « la compensation de la « nounou » a été de l’ordre de 18 000 dollars, c’est-à-dire d’environ 15 000 euros. Il faut ajouter à cela tout ce qu’on doit payer à côté. » Elle a fait valoir que « la gestatrice n’était pas mue par l’argent », tout en indiquant que cela leur avait « sans doute amélioré leur quotidien et peut-être contribué pour une part aux études de leur deuxième fille qui rentrait à l’université. » M. Dominique Mennesson, co-président de l’association Clara (331), a également convenu que « la gestatrice n’a pas été rémunérée, mais a reçu une compensation, une indemnité destinée à couvrir notamment les frais des examens médicaux ou la participation obligatoire à des groupes de parole… Cela a représenté environ 12 000 dollars, auquel s’ajoutait un engagement à rembourser les pertes de revenus de la gestatrice en cas d’arrêt de travail. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on peut donc raisonnablement s’interroger sur la réalité de l’absence de toute forme de compensation financière, conformément au principe de non-patrimonialité du corps humain posé par le code civil.
Mme Catherine Labrusse-Riou (332) a considéré qu’« il serait impossible de ne pas admettre de rémunération. Et en un sens ce serait inique. D’autant que la gratuité maintiendrait inévitablement des liens entre la femme qui a commandé l’enfant et celle qui l’a porté. C’est ce qui s’appelle un don pervers. L’argent impliquerait donc une coupure plus nette. On invoque la solidarité, mais elle ne joue pas en matière de filiation. »
M. Philippe Bas (333)a également mis en garde les députés contre ce risque de rémunération : « tant la dignité de la femme porteuse que l’intérêt de l’enfant à naître doivent nous conduire à ne pas l’autoriser, car les procédures les plus rigoureuses ne permettront jamais d’évacuer toute dimension financière des relations entre les parents d’intention et la mère porteuse. »
Quelles seraient par ailleurs les motivations des donneuses, autres que la rémunération ?
Certains avancent l’argument que certaines femmes aimeraient l’état de grossesse pour lui-même, celui-ci leur donnant un sentiment de plénitude et d’épanouissement. M. Jean Hauser (334), s’est toutefois montré circonspect sur ce point, en déclarant : « Dans le rapport du Sénat, on fait valoir qu’il y a des femmes qui sont très heureuses d’accoucher. Elles le sont certainement d’un enfant qu’elles gardent mais je ne suis pas sûr qu’elles se précipiteront pour accoucher d’un enfant qu’elles devront donner à d’autres ».
Mme Laure Camborieux (335) a par ailleurs expliqué lors de son audition que « les femmes qui ont porté leurs enfants sont blanches dans la quasi-totalité des cas. Elles sont infirmières, militaires, sages-femmes, employées municipales, employées de banques ou d’assurance, comptables. Leur mari est cadre, propriétaire de restaurant, fonctionnaire, employé. Permettez-moi de raconter une anecdote à ce sujet : lorsqu’une amie a rencontré pour la première fois sa « nounou » – c’est l’appellation qui a ma préférence –, cette dernière avait un sac et des chaussures Chanel ainsi que des lunettes Gucci. Habillée en Zara, mon amie s’est sentie « plouc »… Les femmes qui ont accepté d’être nounous ne l’ont pas fait par nécessité vitale. Souvent profondément croyantes, elles souhaitaient aider un couple infertile. Elles sont généralement très investies auprès de leur église et au sein d’associations d’aide à la personne. »
Cette présentation semble toutefois contredite par plusieurs études qui font état d’un décalage entre les niveaux socio-économiques des mères porteuses et des couples qui font appel à celles-ci (336) mais aussi par la simple navigation sur des sites Internet y compris français. La lecture de certains sites sur Internet montre que des candidates à la GPA ne dissimulent pas leurs prétentions financières en contrepartie de la prestation consentie.
On peut également s’interroger sur les motivations d’ordre psychologique de ces femmes, à la lumière du témoignage apporté par M. Israël Nisand (337) : « Lorsque j’ai commencé à réaliser des FIV, en 1983, je me suis rapproché d’une association, le Nid, qui, comme Alma Mater à Marseille, réunissait des femmes souhaitant être mères porteuses. Souhaitant faire une publication sur leurs motivations, j’ai interrogé la dizaine de ses membres. Je dois dire que, lorsque l’interdiction de la GPA a été adoptée, je me suis senti rassuré. La moitié d’entre elles reconnaissaient que leur motivation était l’argent. L’autre moitié était des donneuses de sang et de moelle. Certaines, catholiques, affirmaient que Dieu leur avait donné un corps intègre et s’inscrivaient dans le partage. Pour toutes, la gestation pour autrui était une forme de narcissisation. Elles étaient hypomanes, aucune ne portant grande attention aux liens qui peuvent exister entre la mère et le fœtus… » Quant aux femmes, qui ne seraient ni hypomanes ni mercantiles, M. Israël Nisand a indiqué en « [rencontrer] régulièrement, qui se sont rendues en Angleterre pour suivre toute la procédure. Ces femmes reçoivent une compensation narcissique; elles sont totalement comblées par le service qu’elles rendent en portant l’enfant d’une autre. »
Plusieurs personnes auditionnées ont contesté la possibilité d’un acte de pur altruisme « excepté dans quelques cas idylliques dont on peut certes toujours exciper ». Ainsi, selon M. René Frydman (338), il serait « naïf de croire qu’il n’y a pas de transaction en cas de GPA. Nous ne vivons pas dans l’univers d’Alice au pays des merveilles. Malgré toutes les barrières érigées dans les pays qui ont autorisé la GPA, il y a bel et bien exploitation du corps de la femme moyennant finances. Le groupe de travail sénatorial qui s’est prononcé en faveur de la GPA a sans doute pris en compte des cas irréprochables sur le plan éthique, sans bien mesurer cependant qu’une telle autorisation ouvrirait la voie à toutes sortes de dérives éthiques que l’on voit aujourd’hui survenir, en Inde notamment. Arguer de bonnes intentions pour refuser de poser cette barrière éthique, c’est se voiler la face et au final, accepter la marchandisation des corps et le développement d’un vaste marché autour. » De manière analogue, Mme Françoise Héritier (339) a souligné qu’« il convient de bien considérer que la location d’utérus doit davantage à la nécessité qu’à l’altruisme et qu’elle aboutit au don (vente ?) d’une personne humaine. »
Le développement de l’industrie de la procréation et du « Body shopping (340) » ne peut que favoriser l’exploitation des femmes les plus vulnérables.
Comme l’a relevé Mme Valérie Pécresse (341), Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la maternité pour autrui présente « un risque réel d’exploitation de certaines femmes en situation précaire par d’autres femmes ».
Ce risque est à replacer dans le contexte du développement d’un véritable « Baby business » dans un certain nombre de pays étrangers, lié notamment au développement des agences intermédiaires qui ont pour fonction de sélectionner les candidates et de veiller au bon déroulement de la maternité et, en termes commerciaux, de mettre en rapport l’offre et la demande.
Aux États-Unis, il semble ainsi que la maîtrise du secteur ait totalement échappé au corps médical au profit d’une nouvelle catégorie d’intervenants, les surrogacy agencies. Ces agences intermédiaires établissent des contrats de droit privé fixant les droits et les devoirs des parties, le montant de la rémunération étant déterminé par les lois du marché. Cette activité s’est en effet fortement développée du fait de son attrait financier : le coût est dans l’ensemble élevé pour les couples d’intention et irait de 60 à 150 000 euros, en comprenant le voyage, les frais médicaux, le séjour, la traduction éventuelle, l’assurance et l’assistance juridique. Le dédommagement de la gestatrice serait de l’ordre de 15 à 30 000 euros.
Le développement d’une véritable industrie de la procréation ne laisse pas d’inquiéter sur les risques d’exploitation des femmes, d’autant que l’on observe aujourd’hui une délocalisation de ces activités, par exemple en Inde.
Mme Sylviane Agacinski (342) a ainsi souligné que « l’industrie procréative et le marché qu’elle ouvre concernent au premier chef les femmes, et nécessairement les plus pauvres d’entre elles, notamment les chômeuses. Lorsque la gestation est séparée de la fécondation in vitro, l’origine et les traits ethniques des gestatrices ne comptent pas. D’où un large recours au sous-prolétariat des femmes noires aux États-Unis et la délocalisation des gestations en Inde. À l’inverse, le marché des ovocytes, qui requiert des femmes blanches pour les couples occidentaux, fait massivement appel aux Caucasiennes qui sont à la fois blanches et bon marché. Celles-ci fournissent en ovocytes non seulement les établissements d’Ukraine et de Chypre, mais aussi des cliniques espagnoles spécialisées en procréation médicalement assistée. C’est en cela que cette pratique me paraît poser un problème social et ce contexte invite à ne pas tomber dans le piège d’une rhétorique exclusivement sentimentale et compassionnelle, qui ne parle que d’aider des couples en détresse. »
LA MONDIALISATION DU MARCHÉ DE LA PROCRÉATION : L’EXEMPLE INDIEN
« Après l’informatique, les grossesses se délocalisent en Inde. L’opération, qui peut coûter en Inde jusqu’à 20 000 dollars (13 000 euros environ), est cinq fois moins chère qu’aux États-Unis. Des agences se sont même créées dans le but de recruter des mères porteuses. À Anand, une petite ville de l’ouest de l’Inde, une clinique a construit une résidence pour loger, durant leur grossesse, les mères, qui ont la possibilité de suivre des cours d’anglais et d’informatique. Pour porter le bébé d’un couple étranger, rien n’est plus simple. La "clinique de la fertilité", à Bombay, propose sur son site Internet un formulaire de candidature. La postulante doit avoir eu au moins un enfant et répondre à une série de questions, dont celle-ci : "Dans le cas d’une malformation, accepteriez-vous un avortement ?"
Les demandes de couples étrangers auraient quadruplé l’année dernière. En l’absence de régulation, ce nouveau "marché", évalué à 450 millions de dollars (près de 290 millions d’euros), est en pleine croissance. La seule protection juridique à laquelle peut prétendre Puja tient dans les quelques pages de son contrat signé avec le couple américain. L’essentiel concerne le mode de rémunération. En cas d’accident ou de malformation du bébé, les clauses restent allusives. En Inde, les seules directives, données par le Conseil de recherche médicale indien, un organisme public de recherche, sont jugées insuffisantes par les défenseurs des droits des femmes. La section 3.10 recommande, par exemple, que l’âge maximum légal soit fixé à 45 ans. L’âge minimum légal n’est même pas mentionné.
"Et si la mère meurt à la naissance ?", s’interroge Bhavana Kumar, coordinatrice au Conseil national des femmes. "En l’absence de loi, les mères porteuses s’exposent à tous les dangers", conclut-elle. En Inde, la pratique de la maternité par substitution n’est pas nouvelle. "Il arrivait qu’une femme porte l’enfant de sa sœur, stérile. Mais on restait dans le cadre familial. Désormais, le corps peut être exploité commercialement. C’est la porte ouverte à tous les abus", avertit le docteur Girija Viyas, la présidente de la Commission nationale des femmes. Récemment, la commission nationale a recueilli le témoignage d’une femme qui, après avoir accouché sept ou huit fois, aurait rencontré de sérieux problèmes de santé. »
Source : « Les mères porteuses, un créneau indien », Le Monde (5 août 2008)
Mme Geneviève Delaisi de Parseval (343) a évoqué « ces horribles trafics qu’on a pu voir en Ukraine ou en Inde, avec des femmes anesthésiées au moment de l’accouchement et qui ne savent même pas pour qui elles portent l’enfant… », en soulignant combien « ici le rôle de la loi est décisif ».
c) L’enfant objet d’un contrat et source de contentieux
Aux termes de l’article 1128 du code civil, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de convention. On peut néanmoins se demander dans quelle mesure l’enfant n’est pas finalement l’objet des conventions de gestation ou de procréation pour le compte d’autrui.
Sur ce point, M. Jean-François Mattei (344) a souligné que « s’agissant d’une convention ou d’un accord, il faudrait signer un document ressemblant à un contrat, qui aurait l’enfant pour objet. En échange d’un dédommagement, la gestatrice s’engagerait à porter l’enfant, puis à accoucher, mais aussi à ne pas fumer, à ne pas consommer d’alcool, à respecter une hygiène de vie, ce qui serait fort difficile à vérifier au quotidien. Je vous laisse imaginer les contentieux susceptibles d’apparaître si l’enfant n’était pas tout à fait normal à la naissance : le couple intentionnel pourrait refuser l’enfant. Que l’enfant devienne objet de contentieux me fait évidemment frémir. (…) On peut déplorer que des personnes libres et responsables fassent ce choix, (…) mais c’est leur droit. Autre chose est de légitimer une pratique par la loi car la société engage sa responsabilité. J’attends les premiers procès d’enfants mettant en cause la responsabilité de l’État arguant du fait que le procédé par lequel ils ont été conçus ne leur convient pas. »
En effet, quel sera précisément l’objet du contrat et comment sera-t-il résilié ? Qu’adviendra-t-il de l’enfant s’il ne répond pas aux attentes du couple d’intention ? Que fera-t-on par exemple si le couple se sépare pendant la grossesse et ne souhaite finalement plus l’enfant ? Doit-on craindre que « l’acte de renoncer à un enfant et de le céder contre rétribution le [fasse] basculer dans le monde des choses, appropriables et disponibles, à l’inverse de la personne radicalement indisponible », selon les termes de notre collègue sénatrice Mme Marie-Thérèse Hermange (345) ? Ne peut-on redouter que l’enfant soit commandé, fabriqué, livré et finalement vendu, comme peuvent le donner à penser certains exemples particulièrement inquiétants ?
L’ENFANT COMME OBJET DE CONTRAT ET DE CONTENTIEUX
– Lors de son intervention devant la Cour de cassation, sur l’affaire Alma mater, le professeur Jean Bernard a donné l’exemple, survenu aux États-Unis, d’un couple de milliardaires ayant conclu un contrat avec une mère de substitution. Pour 15 000 dollars, la femme accepte de recevoir le sperme du milliardaire. Neuf mois plus tard naît un enfant mal formé. Les milliardaires déclarent qu’ils n’en veulent pas. La mère de substitution allègue son bon droit et réclame ses 15 000 dollars. Un procès a lieu. L’étude des groupes sanguins révèle que l’enfant mal formé n’est pas le fils du milliardaire mais le fils du mari de la mère de substitution qui n’avait pas observé une chasteté suffisante pendant les jours entourant l’insémination….
– Donna est née le 26 février 2005. La mère porteuse, une habitante de la province du Limbourg en Belgique l’a mis au monde pour un couple de Flamands, en échange d’un dédommagement de 10 000 euros, mais elle est ensuite revenue sur sa décision. Elle avait essayé de vendre l’enfant à des candidats plus offrants, un couple d’homosexuels belges, puis un couple de Néerlandais de la région d’Utrecht, qui avait finalement remporté le « marché » pour 15 000 euros et entamé la procédure d’adoption. Après une décision du tribunal d’Utrecht, l’enfant né de la mère porteuse est finalement resté auprès du couple néerlandais, soit les parents les plus offrants.
– Un couple de Japonais divorce avant la naissance d’un enfant porté par une gestatrice en Inde. L’enfant est abandonné par la gestatrice. Le père désire récupérer l’enfant mais la législation indienne interdit l’adoption par un homme célibataire. L’enfant ne peut rejoindre le Japon qu’après que la Cour suprême indienne lui a délivré un certificat de naissance établissant sa filiation japonaise.
– Aux États-Unis, Mme H. Beasley, gestatrice, tombe enceinte de jumeaux. Le couple d’intention n’accepte d’accueillir qu’un seul enfant et, à défaut d’une réduction embryonnaire, demande d’être remboursé des frais engagés.
Mme Valérie Pécresse (346) a souligné à cet égard que « les contrats de gestation pour autrui signés à l’étranger interdisent à la mère porteuse de refuser de donner le bébé à la mère d’intention. Mais quid si finalement elle ne veut pas se séparer de l’enfant ? Quid, à l’inverse, si l’enfant naît handicapé et que la mère d’intention n’en veut plus ? Le droit des contrats peut certes prévoir très précisément toutes ces situations en théorie, mais la dimension psychologique dépasse les obligations contractuelles ou légales. »
La définition d’un régime légal, plutôt que contractuel, permettrait d’éviter certaines dérives mais ne saurait prétendre résoudre toutes les difficultés juridiques susceptibles de se poser.
Le rapport du groupe de travail sénatorial a proposé de définir dans la loi et de préciser par voie réglementaire l’ensemble des règles applicables, comme en matière d’adoption. La GPA serait ainsi subordonnée à une décision du juge judiciaire et il appartiendrait à la gestatrice et à elle seule de prendre les décisions concernant le déroulement de la grossesse et son éventuelle interruption.
Cet encadrement à minima permettrait-il pour autant d’écarter tout risque de contentieux, par exemple si l’enfant est atteint d’un syndrome d’alcoolisation fœtale à la naissance ou si la mère porteuse doit subir une ablation de l’utérus lors de l’accouchement ? Par ailleurs, que ce soit dans un contrat ou dans une loi, ne faudrait-il pas poser des conditions, en exigeant certains critères pour être gestatrice ? Dès lors, la gestatrice ou les parents d’intentions pourraient-ils se retourner contre l’État en cas d’événement imprévu ?
L’institution d’un régime légal soulèverait nécessairement la question emblématique d’un droit au remords, c’est-à-dire un « délai de rétractation » pour la mère porteuse.
M. Jean Hauser (347) a évoqué cette hypothèse : « Dans le projet du Sénat, il est prévu un droit de rétractation. Comment pourra-t-il s’appliquer ?... Elle l’est même moins, biologiquement. Il faut être conscient que toute référence à une convention précipite dans les difficultés que connaît le code de la consommation en matière économique : délai de réflexion, droit de rétractation. Or, concernant un enfant, la rétractation est beaucoup plus grave que s’agissant d’un prêt pour acheter un réfrigérateur. (…) On est en droit de se demander comment [ce délai de rétraction pour la mère porteuse] pourra s’appliquer, sans compter les drames que cela va occasionner. On regrettera peut-être alors d’avoir autorisé la GPA. »
« L’idée que la femme porteuse pourrait disposer d’un délai de rétractation de trois jours après l’accouchement pour devenir la mère légale et garder un enfant qui ne serait pas le sien » a été jugée « aberrante » par Mme Nadine Morano (348). Il est vrai que ce droit peut apparaître curieux en ce qu’il contient une analogie avec le droit de la consommation et le délai de rétractation inhérent aux régimes des contrats, alors même qu’il est proposé d’instituer un régime légal et non contractuel.
Toutefois, quelle est véritablement l’alternative ? Ne prévoir aucune possibilité pour la femme de devenir la mère légale et la priver de tout droit à l’égard de l’enfant auquel elle a donné la vie ? Mais lui dénier ce droit ne reviendrait-il pas à « admettre une forme d’asservissement d’un être humain par un autre », comme l’a considéré le groupe de travail sénatorial (349) ? N’y aurait-il pas là une forme de violence ? Et si elle refuse, ira-t-on requérir le concours de la force publique pour chercher l’enfant afin de garantir l’application de la loi ?
Cette question apparaît dès lors comme une aporie : en réalité, que l’on prévoie ou non un droit au remords, la mère porteuse sera contrainte de prendre une décision morale – donner ou non son enfant – dont la portée psychologique est incommensurable.
d) Un consentement de la gestatrice qui n’affranchit pas de toute réflexion éthique
L’ensemble des arguments précédemment développés ne doivent-ils pas être écartés au nom de la liberté et du droit de chacun à disposer de son corps ? Dès lors que la femme est parfaitement informée, son consentement et à travers lui son autonomie, ne doivent-il pas prévaloir ? Ne faut-il pas sortir d’une forme de « paternalisme moralisateur » et de « l’idée sous-jacente qu’il faut protéger les femmes d’elles-mêmes, comme si elles étaient incapables de savoir où était leur propre intérêt », comme l’a estimé le philosophe Ruwen Ogien (350) ?
En d’autres termes, doit-on « œuvrer pour légaliser la GPA en France au titre de l’émancipation des femmes », ainsi que l’a fait valoir par exemple l’association Clara (351) ? Mettre son corps à disposition d’autrui, et de surcroît contre de l’argent, peut-il cependant constituer une émancipation et non une régression pour les droits des femmes ?
La réalité du consentement libre et éclairé de la femme fait problème.
En effet, les lois de bioéthique ont posé les principes d’anonymat et de gratuité du don, en vue notamment de garantir le consentement libre et éclairé de la personne. Ces deux conditions, l’anonymat et la gratuité, semblent toutefois difficiles à réunir comme on l’a vu, ce qui peut conduire à s’interroger sur le contenu, voire la liberté, du consentement donné par la gestatrice.
Mme Catherine Labrusse-Riou (352) a ainsi considéré que « dans de tels domaines, le consentement ne saurait être une condition suffisante de validité. Il y a des consentements pervers, extorqués, qui ne sont pas libres ». Mme Gisèle Halimi (353) a également souligné que « les juristes savent à quoi s’en tenir, s’agissant du libre consentement. En l’occurrence, c’est d’appât du gain, voire de nécessité, qu’il faut parler. Les femmes se disent que cela leur assurera une grosse somme
– et pas une indemnité. Or nous ne pouvons pas accepter un contrat, une commercialisation de l’utérus d’une femme, qui ne serait qu’une variante de la prostitution. »
Autrement dit, un consentement exprès mais économiquement contraint, est-il encore une liberté ? Et de quelle façon peut-on garantir le consentement libre mais aussi éclairé de la personne ? « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur », n’est-ce pas, selon la formule d’Henri Lacordaire, « la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » ?
Par ailleurs, la possibilité de recourir à la maternité pour autrui s’apparente davantage à un « droit-créance » qu’à un « droit-liberté ».
En effet, la possibilité de recourir à la gestation pour autrui correspondrait en réalité, non pas à l’exercice de « droits-libertés », c’est-à-dire de droits individuels impliquant une abstention de l’État, sans exiger de sa part une action positive – comme pourrait le suggérer l’argumentaire développé sur la liberté de chacun de disposer de son corps – mais plutôt à l’exercice de « droits-créances », c’est-à-dire de droits impliquant une action effective de l’État, puisqu’il lui incomberait la responsabilité de définir les conditions de recours et de mise en œuvre de la GPA.
La mise à disposition, de surcroît tarifée, des capacités reproductrices et, plus généralement, du corps des femmes est-elle compatible avec le principe de dignité de la personne ?
C’est à l’occasion de l’examen de deux des trois premières lois de bioéthique que le Conseil constitutionnel a déduit du Préambule de la Constitution de 1946 que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle », estimant en l’espèce que les principes affirmés par ces lois tendaient à assurer le respect de ce principe (354). Le principe de dignité interdit dès lors de traiter la personne humaine comme une simple chose, qu’elle puisse être achetée ou devenir la propriété d’une autre personne ou encore de lui faire subir des traitements dégradants ou avilissants.
Le Conseil d’État, dans une décision du 27 octobre 1995 (355) a également consacré le principe de respect de la dignité de la personne humaine, comme étant l’une des composantes de l’ordre public, en considérant que l’attraction consistant à ce qu’une personne de petite taille, harnachée à cet effet, soit lancée par des spectateurs, « par son objet même, port[ait] atteinte à la dignité de la personne », quand bien même cette personne « se prêtait librement à cette exhibition contre rémunération ».
Si elle occupe ainsi une place éminente dans la hiérarchie des normes, c’est parce qu’elle se situe au sommet de nos valeurs humanistes depuis Emmanuel Kant (356): « ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre à titre d’équivalent. Ce qui est supérieur à tout prix, ce qui n’admet aucun équivalent, c’est ce qui a une dignité. »
Le recours à la maternité pour autrui, également qualifiée de « location d’utérus » par ses opposants – cette expression signalant de manière très claire tant la transaction dont fait l’objet le corps humain, que son caractère interchangeable – est-il compatible avec ce principe de dignité de la personne ? La question qui se pose dès lors est de savoir jusqu’où le législateur a le devoir de protéger la personne contre elle-même.
Le principe constitutionnel de liberté personnelle protégé par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 n’est pas absolu, notamment parce qu’il peut entrer en contradiction avec d’autres principes fondamentaux, tels que les droits d’autrui et la dignité de la personne.
Selon l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Un équilibre doit en conséquence être recherché entre le respect du principe constitutionnel de liberté personnelle et celui d’autres principes, notamment la dignité, auxquels elle serait susceptible de s’opposer.
En ce sens, le Conseil constitutionnel a notamment considéré, à l’occasion d’un recours contre la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (357), que le respect de la Constitution impose « l’équilibre (…) entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
De ce point de vue, la possibilité de recourir à la GPA, du fait des risques qu’elle comporte en termes de marchandisation et d’instrumentalisation du corps humain, permet-elle d’atteindre un équilibre satisfaisant entre la liberté personnelle et le principe de dignité ou encore la volonté de ne pas nuire à autrui ?
Le précédent du don d’organe ne saurait être transposé. L’interdiction de la vente d’organes, qui vise à protéger la personne, y compris contre elle-même, constitue en effet une restriction à la liberté de disposer de son corps, ce que personne ne songe sérieusement à remettre en cause. Autrement dit, le consentement, a fortiori lorsqu’il repose sur le besoin plutôt que sur le libre-arbitre, ne permet pas de tout justifier.
Par ailleurs on ne saurait occulter dans ce débat la fonction protectrice de la loi. Protéger la personne est d’ailleurs l’une des fonctions premières de la loi : l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit ainsi que « La loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Mme Sylviane Agacinski (358) a considéré à cet égard que « la responsabilité du législateur est de définir ce qui est conforme ou non à la dignité des personnes. Les lois de bioéthique depuis 1994 et la Constitution garantissent le respect de cette dignité. Le droit protège ainsi a priori les personnes les plus pauvres et les plus fragiles contre des marchés dégradants, la France et d’autres pays de l’Union européenne plaçant la dignité au-dessus du consentement éventuel des personnes. C’est la loi, et non la philosophie ou l’opinion personnelle de tel ou tel, qui doit, en l’occurrence, fixer la limite entre le digne et l’indigne. C’est lorsque cette limite est fixée que la liberté individuelle peut s’exercer et que le consentement des individus prend sens, sans qu’il puisse l’emporter sur la dignité. « Si cela plaît à une femme d’être mère porteuse, pourquoi l’en empêcher ? », entend-on parfois. (…). Mais un intérêt financier ou une pression morale peuvent inciter une personne à sacrifier sa dignité et sa santé. Beaucoup consentiraient aujourd’hui à travailler douze heures par jour dans des conditions dangereuses pour leur santé si la loi l’autorisait ! C’est donc bien à la loi de fixer les limites, la liberté individuelle s’exerçant ensuite et dans le cadre fixé. »
3. L’impossibilité de définir un encadrement susceptible de garantir l’absence de toutes dérives
Serait-il possible d’introduire un encadrement de la GPA qui pourrait garantir l’absence de toutes formes de dérives – au regard notamment du principe de non-patrimonialité du corps humain mais aussi du souci de prévenir un glissement vers des pratiques de convenance, en dehors de toutes indications médicales ? Ou bien faut-il se ranger à l’avis de M. Christian Flavigny, psychanalyste et pédopsychiatre (359), pour qui « quels qu’ils soient les verrous envisagés seront fragiles »?
a) Interdire ou encadrer la rémunération des mères porteuses : une illusion
Le groupe de travail sénatorial a proposé de définir « des conditions d’éligibilité rigoureuses », tant pour les bénéficiaires de la maternité pour autrui que pour les gestatrices, en préconisant un régime légal plutôt que contractuel.
Mme Michèle André (360), présidente de ce groupe de travail, a ainsi indiqué que « conformément au principe de gratuité du don, qui constitue l’un des fondements des lois de bioéthique, la gestation pour autrui ne saurait donner lieu à rémunération. Toutefois, une somme correspondant à un « dédommagement raisonnable » pourrait être versée par le couple à la gestatrice, à l’exemple de ce qui se pratique au Royaume-Uni, afin de couvrir les frais qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Le juge fixera le montant de ce dédommagement. »
Il convient toutefois de rappeler qu’au Royaume-Uni, le montant du dédommagement « raisonnable » n’est pas fixe et qu’en règle générale les sommes sont comprises entre 7 000 et 15 000 livres, le tribunal l’appréciant en fonction notamment de la situation sociale de la mère de substitution. En principe, le dédommagement doit couvrir uniquement les frais liés à la grossesse, tels que les frais médicaux, l’alimentation, le soutien psychologique et la perte de salaire. Par ailleurs, les couples qui n’ont pas obtenu le « parental order », qui permet d’établir la filiation à leur égard, doivent passer par la voie plus longue de l’adoption mais la transaction n’est pas annulée.
Ce montant n’est donc pas négligeable, surtout quand on sait qu’en Espagne, l’indemnisation forfaitaire du don d’ovocytes, qui s’élève à environ 900 euros, est suffisamment attractive pour inciter des étudiantes espagnoles mais aussi des étrangères à consentir ce type de don.
Par ailleurs, à quoi correspondrait en France un tel dédommagement, alors que les soins de la femme enceinte sont pris en charge à 100 % par la sécurité sociale (hors dépassements d’honoraires certes) à partir du sixième mois de grossesse et que la femme enceinte est dans la très grande majorité des cas affiliée au régime de sécurité sociale et titulaire d’une couverture complémentaire ? Outre les frais de garde-robe, voire de garde d’enfants, qui ont été évoqués dans le rapport précité – qui prévoit toutefois également que son montant pourra être révisé en cas d’« événement imprévu » au cours de la grossesse – ce dédommagement devrait-il aussi indemniser les contraintes et le pretium doloris et selon quelles modalités?
Surtout, quand bien même la loi interdirait la rémunération, en envisageant tout au plus un dédommagement raisonnable dont le montant serait fixé par le juge, à partir du moment où il n’y aurait plus d’anonymat du don, comment pourra-t-on être tout à fait certain que, dans les faits, avant la naissance ou plusieurs années ensuite, il n’y aura pas de rémunération occulte de la gestatrice par le couple ? M. Jean Hauser (361) s’est notamment montré dubitatif sur ce point, en déclarant être « persuadé que la gratuité ne sera pas respectée ».
Il convient de rappeler la cohérence d’ensemble des lois de bioéthique : les trois principes fondateurs sur lesquels elles reposent – l’anonymat, la gratuité et le consentement libre et éclairé de la personne – sont non pas distincts mais interdépendants. Ainsi la gratuité et l’anonymat du don ont deux fonctions : ils visent à assurer son caractère altruiste et désintéressé et ils ont pour objet de garantir le consentement réellement libre et éclairé de la personne. L’anonymat de la personne qui consent au don d’un élément ou d’un produit de son corps est en effet la plus sûre garantie de la gratuité du don. En fait comme en droit, il assure de manière certaine qu’il ne pourra jamais y avoir d’échanges marchands avec le receveur.
En revanche, dans le cas de la GPA, il n’y aurait vraisemblablement pas d’anonymat de la mère porteuse. Dès lors, si l’on ne peut écarter d’emblée la possibilité que dans certains cas, sans doute très rares, une femme puisse accepter de porter l’enfant d’une autre de manière totalement bénévole, altruiste et désintéressée, il reste qu’en autorisant la maternité pour autrui, le législateur ne pourrait être sûr et certain que, dans les faits, l’interdiction ou l’encadrement de la rémunération seraient effectivement respectés. Par là même on ne saurait garantir qu’en fait, comme en droit, aucune atteinte ne serait portée au principe de non-patrimonialité du corps humain.
Au vu de ces éléments, il apparaît à tout le moins difficile d’encadrer strictement la GPA. M. Jean Hauser (362) a dès lors considéré que « les conditions drastiques qui sont proposées [dans le rapport du Sénat] ne sont que des chiffons de papier. Dès le lendemain de la promulgation de la loi autorisant la GPA, aucune ne sera respectée (…). Il en est de la GPA comme du divorce ; (…) soit on l’interdit, soit on l’autorise mais, si on l’autorise, ce n’est pas la peine d’espérer y mettre des conditions. »
b) La grossesse pour autrui dans un cadre intrafamilial : une impasse
La possibilité d’autoriser la GPA dans un cercle restreint familial, voire amical proche – en permettant par exemple qu’une femme porte un enfant pour sa sœur, sa cousine ou sa fille – pourrait de prime abord apparaître de nature à répondre aux inquiétudes liées au risque de marchandisation du corps humain et s’apparenterait à un acte de pur altruisme.
La Secrétaire d’État chargée de la famille, Mme Nadine Morano (363) s’est ainsi déclarée « prête à porter un enfant pour [sa] fille », en soulignant que « dans ce cadre, l’enfant aurait le bonheur de grandir, aimé, dans une famille qui l’a attendu avec espoir, mais il est vrai que cela peut ne pas être exempt d’inconvénients. »
Quelques pays autorisent d’ailleurs cette pratique, en particulier la Hongrie où le recours à une mère porteuse n’est accepté que si les parties sont de la même famille, ou encore en Belgique où elle est, semble-t-il, tolérée. Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont également rapproché la GPA dans un cadre intrafamilial de la possibilité de procéder à des prélèvements sur donneurs vivants, appartenant à la famille ou au conjoint du receveur.
Mme Nadine Morano a ainsi fait valoir qu’« autoriser la GPA, c’est permettre de donner beaucoup de bonheur à des couples en très grande souffrance par un acte profondément généreux. Y aurait-il une hiérarchie des organes ? Pourquoi aurait-on le droit de donner un rein et de ne pas prêter son ventre si, dans les deux cas, il s’agit d’un acte de générosité avec un consentement éclairé ? » M. Didier Sicard, ancien président du CCNE (364), a également envisagé « la possibilité exceptionnelle offerte à une femme de prêter son utérus à sa propre sœur, sous le contrôle de l’Agence de biomédecine et dans des conditions seulement intrafamiliales », en jugeant qu’« à la rigueur, la gestation pour autrui pourrait s’inscrire dans le champ des greffes d’organes ».
La GPA ne saurait être assimilée cependant au don d’organes. Tout d’abord, alors que l’article 16-3 du code civil consacre le principe selon lequel « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui », ces dispositions permettant notamment le don d’organes entre vifs, dans des situations où la santé, voire le pronostic vital, du receveur est en jeu. La GPA cependant n’est pas engagée dans l’intérêt thérapeutique d’autrui mais vise à répondre à un désir d’enfant. À l’évidence, ces deux finalités ne peuvent être mises sur le même plan. En outre, comme on l’a déjà vu, la mise à disposition du corps d’une femme pendant près d’un an ne saurait être identifiée à un don d’organe ; la GPA implique, pour la gestatrice, l’ensemble de son être, ainsi que celui d’un tiers, l’enfant à naître.
Mme Gisèle Halimi (365) s’est élevée vivement contre ce type de comparaison : « Vous parliez d’un don de rein. Nous parlons de donner la vie, ce qui est tout de même assez différent… Vous parlez d’un don de rein gratuit. Or, encore une fois, je ne pense pas une seconde qu’une mère porteuse accepterait de porter un enfant gratuitement, voire pour une indemnité, pour quelqu’un d’autre. Ensuite, vous parlez d’un don de rein dans la famille. Or, si la législation devait permettre la pratique des mères porteuses, il faudrait prendre un certain nombre de précautions pour ne pas créer des situations quasi incestueuses. (…) Cela dit, je suis évidemment favorable au don d’organes gratuit et au don d’organes dans la famille ; c’est même ce qui est recommandé pour avoir les meilleures chances. Mais c’est sans rapport avec notre débat. »
Cette possibilité suscite par ailleurs de multiples interrogations.
Elle pourrait apparaître de nature à induire un brouillage des générations et de la généalogie de l’enfant. Mme Catherine Labrusse-Riou (366) a ainsi souligné que « notre tradition romaine fixe l’ordre généalogique et il est très important de placer chaque individu dans une position singulière et non interchangeable. Être à la fois le petit-fils et le fils d’une même personne, et devenir ainsi le frère d’un de ses parents, fût-ce par adoption légale, n’est pas souhaitable. L’expérience a montré que chambouler l’univers généalogique rend les individus fous. Il ne faut pas semer le doute sur la maternité. »
La GPA dans un cadre intrafamilial multiplierait également les risques de conflits et de pressions psychologiques comme l’a souligné l’Académie nationale de médecine dans son rapport précité.
Initialement favorable à la possibilité d’autoriser la GPA dans ce cadre, M. Israël Nisand (367) a ainsi déclaré avoir été « convaincu des ravages qu’entraînerait l’existence d’une « dette impayable », entre mère et fille par exemple, ou des pressions insoutenables que pouvait exercer la famille, entre sœurs notamment », en en concluant que « la GPA intrafamiliale doit être interdite ».
Mme Sophie Marinopoulos (368) a insisté sur la confusion symbolique que pouvait provoquer une gestation pour autrui intrafamiliale : « si une mère acceptait de porter l’enfant de sa fille, elle renverrait cette dernière à son incapacité de la dépasser en devenant, elle aussi, une mère, parce qu’incapable de porter ses propres enfants. (…) Tout n’est donc pas possible à l’intérieur de la famille, cela non pour des raisons morales, mais tenant à la vie psychique ».
Plusieurs personnes auditionnées se sont même demandées dans quelle mesure la GPA ainsi circonscrite ne revêtirait pas une dimension incestueuse.
Mme Sophie Marinopoulos a par exemple déclaré : « À un collègue me demandant si je prêterais mon utérus à ma fille, j’ai eu l’impression de devoir cocher la case : « oui », sous peine de passer pour une mère dénaturée. Puisque ce collègue envisageait que les mères et les filles puissent se « prêter » un bout de leur corps, je lui ai demandé si un père pouvait prêter son sperme à sa fille en cas de stérilité du mari. J’ai alors fait face à une levée de boucliers ! C’est que chaque partie du corps est investie d’une part psychique : en ce sens, un gamète n’est pas seulement biologique. »
Adhérant à ce point de vue, Mme Sylviane Agacinski (369) a souligné que « L’anthropologue Françoise Héritier a montré dans divers travaux que porter un enfant pour un membre de sa famille ne peut être dénué de connotations incestueuses. Ainsi porter un enfant pour sa fille, c’est porter un embryon conçu avec le sperme de son gendre ; porter un enfant pour sa sœur, un embryon conçu avec le sperme de son beau-frère ; porter un enfant pour sa mère – pourquoi certaines filles ne le feraient-elles pas ? –, un embryon conçu avec le sperme de son père. Même le don d’ovocytes entre sœurs, souligne Françoise Héritier, constitue un inceste d’un autre type : c’est, d’une certaine manière, faire un enfant avec son beau-frère. Peut-on tenir pour négligeable ce brouillage des générations, une mère portant l’enfant de sa fille étant appelée à en être à la fois la mère et la grand-mère, et ignorer totalement ces aspects incestueux ? Si le don et la générosité sont assurément respectables, l’institution de la filiation, l’ordre des générations et la prohibition de l’inceste ne doivent pas être négligés. Tout se passe, hélas, à notre époque comme si le sentiment pouvait tout remplacer ! Il faut pourtant bien, avant de laisser s’exercer le sentiment, demander d’abord quel ordre humain, quel ordre symbolique entre les personnes est décent ou ne l’est pas. »
Par ailleurs, si l’absence de rémunération est certes plus vraisemblable dans le cas où la gestatrice fait partie de la famille, ce type de maternité pour autrui n’exclut pas pour autant toute forme de pressions, voire d’échanges marchands, comme cela a d’ailleurs pu être observé pour des donneurs vivants d’organes. Mme Gisèle Halimi (370) a ainsi estimé que « même dans le cadre familial, le chantage financier reste possible ».
Enfin, qu’elle soit ou non admise au sein d’un cercle familial et au-delà de la question de la rémunération, toutes les autres objections éthiques soulevées par la GPA, qui ont été évoquées plus haut, n’en demeureraient pas moins valables, notamment l’instrumentalisation de la femme, les interrogations concernant l’enfant et l’existence de risques pour la gestatrice et son entourage.
c) La limitation du recours à la GPA à certaines indications médicales : une pente glissante
L’autorisation de la GPA pour des raisons médicales ouvrirait la voie à une évolution, qui pourrait s’avérer difficile à contenir.
En effet, quelles seraient précisément ses indications ? Le rapport du groupe de travail sénatorial proposait par exemple de permettre cette pratique dans l’hypothèse où « la femme ne pourrait mener une grossesse à terme ou ne pourrait la mener sans danger pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître. » Cette définition n’est-elle cependant pas susceptible d’interprétations extensives ? En particulier, peut-on déterminer avec certitude, ex ante, qu’une femme peut mener une grossesse sans aucun danger pour sa santé ou celle de l’enfant à naître ?
À cet égard, l’Académie nationale de médecine (371) a conclu que si certaines indications de la GPA seraient incontestables, par exemple le syndrome de MRKH, « d’autres ne seraient que relatives et devraient être appréciées par des gynécologues-obstétriciens expérimentés». Dans le même sens, M. Jean-Luc Pouly, responsable du centre d’AMP du CHU de Clermont-Ferrand, a estimé lors de son audition par le groupe de travail sénatorial, que les indications médicales pour lesquelles une femme ne peut porter un enfant ne sauraient être définies avec précision. Le rapport du groupe de travail sénatorial a dès lors considéré que « la diversité des cas dans lesquels une gestation pour autrui peut se justifier et la difficulté de les apprécier militent en faveur de la mise en place d’une commission pluridisciplinaire chargée de l’agrément des couples demandeurs ». N’est-ce pas cependant reconnaître du même coup les difficultés qu’il y a à définir avec précision les conditions de recours à la GPA ? Ne risque-t-on pas avec le temps une appréciation variable de ces conditions, voire leur extension progressive ?
Au-delà d’une malformation utérine susceptible de justifier le recours à la GPA, ne courrait-on pas ainsi le « risque d’un glissement vers une pratique de convenance », comme s’en est inquiété le Conseil d’État dans son rapport de mai 2009, dès lors qu’il serait difficile d’affirmer a priori qu’une grossesse sera sans danger ? Par exemple, une femme dans la quarantaine, n’ayant pas de problème de stérilité utérine, pourrait-elle en bénéficier, en faisant valoir les risques de complications accrues de la grossesse avec l’âge ?
Ce risque de glissement progressif des conditions de recours à la GPA est du reste admis par certains partisans de sa légalisation. Il en va ainsi de Mme Élizabeth Badinter (372) qui a estimé qu’ «avec le temps, on ira vers un élargissement. Mais je pense de façon très pragmatique qu’il faut peut-être d’abord la réserver aux femmes qui n’ont pas d’utérus ».
M. Jean Hauser (373) a également évoqué des demandes de GPA qui ne s’inscriraient clairement pas dans le cadre d’indications médicales, en soulevant la question suivante : « Limitera-t-on la GPA aux cas de stérilité thérapeutique ou bien l’étendra-t-on à des motifs de convenance personnelle ? Telle dame, à l’agenda trop rempli, considérant qu’elle n’a pas de temps pour porter un enfant le fera porter par autrui. Il peut y avoir aussi des dérapages de ce genre ».
d) Une légalisation pour lutter contre le tourisme procréatif : un faux espoir
Peut-on raisonnablement attendre de la légalisation en France de la maternité pour autrui une diminution notable du nombre de couples qui se rendent aujourd’hui à l’étranger pour y recourir, en dehors de tout contrôle, dans l’espoir de lutter ainsi contre le tourisme procréatif ? Plusieurs éléments incitent à en douter.
Tout d’abord, de l’avis de plusieurs personnes auditionnées par la mission, si la GPA devait être autorisée, elle devrait faire l’objet d’un encadrement strict, concernant notamment les personnes susceptibles d’y recourir (par exemple, un couple hétérosexuel en âge de procréer) ainsi que l’existence d’indications médicales, telles qu’une absence ou malformation de l’utérus. Cet encadrement aurait pour effet d’écarter un certain nombre de couples demandeurs.
Mme Michèle Alliot-Marie (374), garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, a écarté cette option : « Certains estiment que la légalisation de la GPA réduirait le nombre de couples qui vont dans les pays où elle est assurée, pour conclure des conventions interdites par notre législation. Je ne suis pas de cet avis. Les personnes qui ne rempliraient pas les conditions fixées – âge, absence de contre indication médicale, etc. – seraient toujours tentées de se rendre à l’étranger. »
Se poserait par ailleurs sans doute le problème du nombre de femmes volontaires pour porter un enfant par rapport à la demande, a fortiori si la rémunération du don est interdite et si seulement un dédommagement limité est autorisé.
Alors que certains estiment à 300 le nombre de couples infertiles qui se rendent chaque année à l’étranger pour une GPA, l’« offre », soit le nombre de gestatrices, ne sera-t-elle pas insuffisante au regard de la demande entraînant ainsi une pression accrue sur la rémunération de la gestatrice – comme on l’observe aujourd’hui en matière de dons d’ovocytes – mais aussi la poursuite du tourisme procréatif ?
Il n’est, pour s’en convaincre, que de rappeler le nombre actuel de femmes acceptant de faire un don d’ovocytes, qui serait de l’ordre de 200 par an, alors même que ce don est certes contraignant mais limité dans le temps et autrement moins que ne peut l’être une grossesse qui s’accompagne par ailleurs de risques accrus, y compris vitaux. Il y a donc des raisons de penser que le nombre de femmes qui souhaiteraient porter un enfant serait sensiblement inférieur à celui des donneuses d’ovocytes, sauf bien sûr à ce que la rémunération des mères porteuses soit significative.
Les termes de ce débat ont été très clairement résumés par Mme Jacqueline Mandelbaum (375) : « L’un des arguments avancés en faveur de la GPA est qu’il faut limiter le tourisme procréatif. Mais une loi est-elle à même de résoudre ce problème ? Si cette loi est restrictive, et si la GPA n’est autorisée que pour les femmes privées d’utérus en raison d’une malformation ou d’une hystérectomie d’hémostase – une cinquantaine de cas par an –, cela ne répondra pas à toute la demande : le tourisme procréatif demeurera une solution pour les femmes sujettes à de multiples fausses couches, souffrant de pathologies utérines ou de pathologies interdisant la grossesse – une équipe recommande ainsi la GPA pour des femmes qui ont eu un cancer du sein – ou pour celles chez qui un problème de réceptivité utérine fait échouer les tentatives d’AMP. Si l’on accepte d’étendre la GPA à ces indications, il sera difficile de trouver suffisamment de mères porteuses, volontaires et bénévoles, et un glissement vers la rémunération ou le dédommagement substantiel se produira inéluctablement. »
Enfin, même dans des États comme le Royaume-Uni qui ont interdit la rémunération des gestatrices, tout en admettant qu’un dédommagement raisonnable leur soit versé, des couples continuent de se rendre à l’étranger, en raison notamment, de l’insuffisance du nombre de gestatrices mais aussi, semble-t-il, pour des raisons de coût moindre. Ainsi, M. David Gomez (376), conseiller juridique de l’Autorité britannique de la fécondation et de l’embryologie humaines (HFEA), a évoqué le cas « de couples anglais qui vont à l’étranger conclure des contrats de GPA, peut-être pour des raisons de prix », en expliquant qu’« au Royaume-Uni, la publicité pour ce type de service est interdite. Il n’y a pas de liste de mères porteuses mais comme pour les donneurs de gamètes, il y a un nombre insuffisant de mères porteuses. Le paiement est illégal en théorie. Mais peu de femmes sont prêtes à porter le bébé de quelqu’un d’autre sans incitation financière. Dans certains pays, la gestation pour autrui peut être rémunérée. Et il y est moins cher d’obtenir une mère porteuse. Je crois que c’est la réalité de la nature humaine. »
Enfin, la légalisation de la GPA ne permettrait pas non plus de répondre aux difficultés soulevées par la reconnaissance en droit interne des enfants nés d’une convention de mère porteuse à l’étranger. Ainsi, M. Bertrand Mathieu (377) a estimé que « si la France admettait la GPA, la parenté pourrait être reconnue dans le cas d’enfants conçus et portés selon ses règles, et non reconnue dans le cas de mères porteuses vivant dans un pays aux règles différentes ; nous serions ainsi confrontés au même problème qu’aujourd’hui. » Le groupe de travail sénatorial sur la maternité pour autrui avait d’ailleurs également reconnu que la question de la filiation maternelle des enfants nés en violation de la loi française continuerait à se poser après la légalisation de la maternité pour autrui.
De ce double point de vue, la légalisation de la GPA apparaît donc comme un faux espoir, qui emporterait également d’importantes conséquences au niveau juridique, social et anthropologique.
4. D’importantes répercussions sociales, juridiques et anthropologiques
a) Une remise en question de principes fondamentaux des lois de bioéthique
La légalisation de la GPA impliquerait une remise en cause du triptyque des lois de bioéthique : l’anonymat, la gratuité et le principe du consentement libre et éclairé.
Cette autorisation conduirait également à remettre en cause certains grands principes tels que l’indisponibilité du corps humain ou encore la possibilité de ne porter atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui (article 16-3 du code civil).
Une fois ce pas franchi, peut-on espérer en contenir les effets ? Si l’anonymat du don n’est plus garanti dans le cas de la gestation pour autrui, pourquoi le serait-il davantage en matière de dons de gamètes ? Si l’indemnisation ou le dédommagement raisonnable de la mise à disposition d’un utérus est autorisé, pourquoi n’en irait-il pas de même pour le don d’ovocyte et a fortiori pour le don d’un rein qui, lui, est effectué dans un intérêt thérapeutique ?
En d’autres termes l’introduction d’une exception à des principes comme ceux de l’indisponibilité et de la non-patrimonialité du corps humain ne risque-t-elle pas nécessairement de porter atteinte à la légitimité et à la crédibilité même de ces mêmes principes ?
b) Une pratique qui survaloriserait la transmission génétique
Ainsi qu’il a déjà été dit, le désir d’un enfant issu de ses propres gamètes qui est exprimé par des couples dont l’infertilité est d’origine utérine n’est pas en soi illégitime et apparaît en tout cas aussi compréhensible que pour les autres couples s’engageant dans une AMP. Ce désir doit néanmoins être appréhendé au regard des moyens qu’il requiert pour être satisfait et au regard de sa signification sociale.
En effet, contrairement aux AMP avec don de gamètes et plus encore à l’accueil d’embryon ou à l’adoption, qui valorisent une forme de parentalité d’intention, la GPA peut sembler reposer sur une approche privilégiant la génétique, ainsi que s’en est inquiété M. René Frydman (378). Celui-ci a jugé qu’« elle donne le primat à la génétique par rapport à l’éducation et à l’intention. Pour ma part, j’ai du mal à être schizophrène en expliquant à une femme qui va bénéficier d’un don d’ovocyte que son projet de maternité et l’expérience de la grossesse, vont faire d’elle la mère de cet enfant, même s’il n’est pas génétiquement issu d’elle – et à une autre que porter un enfant pour le compte d’autrui ne pose pas de problème et que la grossesse ne s’accompagne pas en elle-même d’attachement… ». M. René Frydman a également considéré que « donner une telle importance à la génétique est extrêmement dangereux sur le plan idéologique – cela va à l’encontre de tous nos principes de tolérance et d’ouverture à l’autre ».
N’y a-t-il pas là selon le Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine (379) le risque de réifier la gestatrice « au profit d’une sacralisation des gènes du couple demandeur » ?
En d’autres termes, en autorisant en France les mères porteuses, le législateur ne donnerait-il pas à penser que la possibilité d’avoir un enfant génétiquement de soi est d’une valeur telle que la société est prête à faire courir de nombreux risques physiques et psychiques à une femme et à déroger à des principes aussi fondamentaux que l’indisponibilité et la non-patrimonialité du corps humain ? Cette démarche ne serait-elle pas alors interprétée comme un pas supplémentaire vers la reconnaissance d’une forme de « droit à l’enfant » au nom d’une survalorisation du facteur biologique?
c) Une remise en cause des fondements du droit de la filiation
● La précarisation et la contractualisation de la filiation
La gestation pour autrui remet en cause une règle fondamentale du droit de la filiation, selon laquelle la mère est celle qui accouche – mater semper certa est – , alors même que ce principe (cf. articles 325 et 32 du code civil) vise à garantir à l’enfant la stabilité de sa filiation. Elle inaugure de ce fait une rupture entre la grossesse et l’accouchement et la filiation, « rupture qui remet fondamentalement en cause le statut légal, anthropologique et social de la maternité », comme l’a souligné notamment l’Académie nationale de médecine.
En effet, la gestation pour autrui conduirait à faire reposer la filiation, au moins en partie, sur la volonté des personnes concernées et par conséquent à la contractualiser. À cet égard, Mme Catherine Labrusse-Riou (380) a relevé que pour autoriser la GPA, « il faudrait bouleverser entièrement le système juridique actuel des règles de filiation pour pouvoir l’établir sur la base d’un contrat portant substitution de mère. Il y en aura forcément, en fait, sous une forme ou sous une autre. Et si c’est la société qui s’en occupe, je serais encore plus choquée ! »
Certes, il a été proposé de définir dans la loi les conditions d’établissement de la filiation dans de tels cas. Toutefois, si la loi reconnaît à la mère porteuse un droit au remords, c’est-à-dire qu’elle puisse devenir la mère légale de l’enfant si elle le souhaite, l’établissement de la filiation de l’enfant ne dépendra-t-il pas de sa seule volonté et non de l’application d’une norme générale et objective ?
Mme Michèle Alliot-Marie (381), garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, a décrit ainsi les effets de la GPA sur la filiation : « La légalisation de la GPA conduit obligatoirement à remettre en cause un certain nombre des principes fondamentaux (…)
D’abord, elle remettrait en cause le statut donné à l’enfant à naître. Dans l’état actuel du droit, une convention portant sur la filiation d’un enfant ou sur son accueil dans une autre famille est nulle, parce qu’elle porte atteinte au principe de la primauté de la personne et de respect de l’être humain. C’est ce qui interdit les conventions portant sur l’être humain. Légaliser ces conventions portant sur la filiation serait affaiblir la portée juridique des deux principes et de l’interdiction de convention.
Ensuite, parce qu’elle serait porteuse d’incertitudes, la consécration juridique de la GPA remettrait en cause le principe de la sécurité de la filiation, qui est au cœur du droit de la famille depuis le code Napoléon. Enfin, elle remettrait en cause le statut conféré à la mère gestante, la génitrice. Selon un vieux principe latin, protecteur pour la femme qui accouche, mater semper certa est (…) . »
En particulier, doit-on, pour remédier aux quelques difficultés nées de violations délibérées de la loi française, remettre en question ces principes fondamentaux de la filiation, et introduire une forme de précarité dans la filiation maternelle ? On peut considérer en tout état de cause qu’« il est quand même curieux qu’à peine la loi française vient-elle d’entériner l’arrêt Marks, à savoir que le nom de la femme qui a accouché sur l’acte de naissance suffit à établir la maternité (382), ce principe apparaisse tout à coup si peu évident… L’accouchement deviendrait-il une présomption de maternité aussi précaire et discutable que la présomption de paternité légitime (383) ? »
● L’affaiblissement des dispositions pénales réprimant l’abandon d’enfant et des conséquences probables également sur le régime de l’adoption
La légalisation de la maternité pour autrui n’aurait-elle pas tout d’abord pour effet d’affaiblir la portée de l’interdiction, réprimée par l’article 227-12 du code pénal, de la provocation à l’abandon d’enfant, et de légaliser celui-ci ?
Celle-ci n’aura-t-elle pas également des répercussions sur le droit de l’adoption ? Il existe actuellement une frontière hermétique entre la femme ou la famille qui abandonne l’enfant et celle qui l’adopte. En particulier, l’article 348-5 du code civil prévoit que, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption.
Mme Françoise Dekeuwer-Defossez (384)s’est fait l’écho de cette préoccupation au regard du délit d’abandon d’enfant : « la gestation pour autrui légalise l’abandon d’enfant. Je ne connais pas la législation grecque sur l’adoption, mais il est clair que les pays qui autorisent la gestation pour autrui sont ceux qui pratiquent l’open adoption, qui permet aux familles adoptives d’entrer en relation directe avec une jeune maman désireuse d’abandonner son enfant. Cette manière de voir les choses n’est pas la nôtre. » De fait la GPA est autorisée dans les États américains pratiquant l’open adoption.
M. Jean-Claude Ameisen (385), président du Comité d’éthique de l’INSERM, membre du CCNE et du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, a attiré l’attention de la mission sur ce danger : « Que les avancées de la biologie et de la médecine rendent possibles certaines pratiques n’amène-t-il pas certains à les considérer de ce simple fait comme légitimes alors qu’a priori, ils ne les accepteraient pas si elles n’étaient pas le fruit de ces innovations ? À ma connaissance, aucun pays ne reconnaît un contrat d’adoption sur un enfant à naître comme une forme normale de filiation. Faut-il accepter, à partir d’un certain niveau de sophistication des techniques médicales, des formes de filiation qu’on aurait sans cela jugées non souhaitables ? »
d) Et demain, l’utérus artificiel ?
En poursuivant la réflexion ouverte en 1932 par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, Henri Atlan s’est interrogé, dans un ouvrage récent, sur les conséquences possibles de la technique qui permettrait la gestation des embryons humains hors du corps de la femme, c’est-à-dire l’ectogenèse ou L’Utérus artificiel (386).
Selon son auteur, l’objectif de cet ouvrage n’est pas tant de prédire l’avenir que de pousser dans ses limites le processus déjà en cours de dissociation progressive de la procréation et de la sexualité, afin de projeter une lumière plus brutale sur des problèmes actuels, que l’habitude ou la négligence contribuent à masquer ou à sous estimer. Il s’agit ainsi d’une « expérience de pensée », voire d’une « semi-fiction » – même si de rares travaux, très préliminaires, auraient déjà été entrepris dans quelques laboratoires (387).
Dans le cas où l’on déciderait aujourd’hui d’autoriser les mères porteuses et en envisageant l’éventualité qu’un jour l’ectogenèse devienne techniquement possible, quelles objections pourra-t-on opposer alors au recours à l’utérus artificiel comme alternative à la mère porteuse ?
Des voix ne s’élèveraient-elles pas pour justifier le recours à l’ectogénèse pour des raisons « éthiques », en faisant valoir que dans le cas d’un utérus artificiel, il n’y aurait ni risques physiques et psychiques courus par des tiers ni aliénation ou marchandisation du corps humain ? Le risque d’exploitation des femmes les plus vulnérables serait de fait écarté. M. Jean-François Mattei (388) s’est notamment ému de cette perspective : « Comment l’utérus pourrait-il être considéré comme un simple incubateur, première étape vers l’utérus artificiel d’Henri Atlan ? Si tel était le cas, on aboutirait à une déshumanisation de la maternité. »
Les membres de la mission, dans leur très large majorité, préconisent en conséquence de maintenir les dispositions protectrices de la loi et de ne pas légaliser la gestation pour autrui.
Proposition n° 20. Maintenir l’interdiction de la gestation pour autrui.
C. LA QUESTION DE LA RECONNAISSANCE EN DROIT FRANÇAIS DES ENFANTS CONÇUS PAR MATERNITÉ POUR AUTRUI
Les enfants nés suite à la conclusion d’une convention de gestation ou de procréation pour le compte d’autrui sont-ils des « enfants fantômes de la République (389) », des « sans-papiers » et doit-on juger « indigne d’un pays civilisé » la situation d’un enfant qui serait « sans mère, quelque fois orphelin, et sans patrie », voire « un intouchable, un paria (390) » ?
De lege lata, il apparaît que la filiation de la mère d’intention à l’égard d’un enfant né d’une mère porteuse ne peut en effet être établie, que ce soit par la possession d’état, par l’adoption ou encore par la transcription d’un acte d’état civil étranger, la question de la reconnaissance de la filiation paternelle étant plus complexe. Toutefois, quelles sont réellement les conséquences de l’échec des tentatives d’établissement de la filiation par l’invocation des règles du droit interne, voire du droit international privé, à travers la transcription sur les registres d’état civil français d’un acte établi à l’étranger, dans la mesure notamment où ces actes ont une force probante présumée ? En particulier, cette situation pose-t-elle réellement des difficultés aux familles dans les actes de la vie courante ? De lege ferenda, un statut devrait-il être défini pour remédier aux difficultés nées des violations délibérées de la loi française ?
1. Les tentatives d’établissement de la filiation d’un enfant né d’une mère porteuse
Il existe plusieurs modes d’établissement non contentieux de la filiation. Aux termes de l’article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie par l’effet de la loi (qui prévoit notamment que la mère est celle qui accouche (391), ce qui ne peut donc s’appliquer aux femmes ayant recouru à une GPA à l’étranger, sauf en cas de fraude, par exemple par un échange de papiers à la maternité ou dans le cadre d’un accouchement à domicile) ; par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. Elle peut également l’être par un jugement, dans le cadre d’actions aux fins d’établissement de la filiation ou en contestation de la filiation. L’action en recherche en paternité ou maternité est en revanche réservée à l’enfant et ne peut donc être engagée par le couple d’intention. Enfin, l’adoption opère un transfert de filiation.
Des couples ayant recouru à une maternité pour compte d’autrui, à l’étranger voire en France, ont tenté de faire reconnaître leur filiation à l’égard d’un enfant né de mère porteuse, par l’adoption ou la possession d’état, ces deux voies ayant cependant été fermées par la jurisprudence. Ils ont également essayé de recourir à la voie d’une reconnaissance volontaire de maternité ou de paternité.
a) L’adoption de l’enfant par la mère d’intention
En dépit de la fermeté de la prohibition de la maternité pour autrui en France, des couples ont voulu la contourner, en se rendant à l’étranger mais aussi parfois en y recourant en France. Dans les années 1980, les associations proposant le recours à la maternité pour autrui, par exemple Alma mater, faisaient appel à une femme qui accouchait sans reconnaître l’enfant, le père intentionnel reconnaissant, lui, l’enfant et son épouse demandant ensuite l’adoption plénière. Comme l’a souligné Mme Frédérique Bozzi (392), conseiller à la Cour d’appel de Paris, cette hypothèse « est tombée en désuétude. L’ordonnance de 2005 relative à la filiation disposant désormais que la mention du nom de la mère dans l’acte suffit à établir la filiation maternelle, elle n’a plus de sens. » On pourrait néanmoins imaginer que suite à un accouchement sous X et la reconnaissance de l’enfant par le père, la mère d’intention demande ensuite à adopter l’enfant.
L’adoption de l’enfant né suite à la conclusion d’une convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui par la mère d’intention ne peut cependant être envisagée au regard du droit interne et du droit international.
Au regard du droit interne
La jurisprudence est constante sur ce point depuis l’arrêt de principe rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en mai 1991 (393). Pour la Cour, l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, qui ne constituait que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre à un couple l’accueil d’un enfant conçu par exécution d’un contrat tendant à l’abandon à la naissance par sa mère, porte atteinte aux principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes et constitue un détournement de l’institution de l’adoption dont l’objet est de donner une famille à un enfant et non l’inverse.
Depuis l’entrée en vigueur des articles 16-7 et 16-9 du code civil, en juillet 1994, cette jurisprudence n’a pas été remise en cause. La Cour de cassation a par exemple jugé en décembre 2003 (394) que la maternité pour autrui réalise un détournement de l’adoption que les juges du fond ont, à bon droit, refusé de prononcer et qu’en raison de l’indisponibilité de l’état des personnes le rapport de filiation adoptive ne pouvait faire l’objet d’une telle convention privée.
Dans son rapport sur la révision des lois de bioéthique, le Conseil d’État suggère de permettre la transcription de la filiation paternelle et d’admettre l’établissement, en droit interne, d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, par exemple en lui permettant d’engager une procédure d’adoption, afin de permettre au juge de contrôler l’adoption et de ne l’admettre que si celle-ci est dans l’intérêt de l’enfant.
Cette solution poserait d’abord problème pour les couples non mariés (395). L’adoption n’étant pas possible pour de tels couples il en résulterait une inégalité de traitement selon le statut matrimonial du couple.
En application de l’article 353 du code civil, le tribunal doit vérifier si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant mais rien ne permet de s’assurer a priori de cette conformité.
Au regard du droit international
M. Pierre Lecat, vice-procureur chargé du service de l’état civil du parquet du tribunal de grande instance de Nantes, a rappelé que « l’adoption est encadrée, notamment sur le plan international ». Le refus de procéder à la transcription de l’acte étranger prend en compte les dispositions de l’article 370-3 du code civil et surtout de la convention de La Haye sur l’adoption qui comporte des dispositions relatives aux finalités de l’adoption et en particulier à la manière dont le consentement peut être donné. Le parquet de Nantes considère de ce fait que la gestation pour autrui est une « adoption déguisée » et interdit la transcription de l’acte étranger qui en est l’expression. Dès lors, « il serait très intéressant de savoir ce que pensent les auteurs ou plutôt nos partenaires de la convention sur l’adoption. En effet, il faudrait la modifier si l’on voulait y intégrer une éventuelle modification législative, s’agissant notamment de cette notion de consentement sans contrepartie. (…) Toutes les prohibitions qui concernent l’adoption ont pour but de protéger les enfants, notamment ceux du tiers monde, des risques de trafic. Si on ouvre cette porte, on protégera quelques dizaines d’enfants. Il ne faudrait pas que tous les autres en pâtissent. »
Outre l’acte de naissance ou de reconnaissance de l’enfant, la filiation peut se prouver par l’acte de notoriété constatant la possession d’état.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil, la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont les suivants : il faut que la personne ait été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les ait traités comme son ou ses parents ; que ceux-ci aient, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; que cette personne soit reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; qu’elle soit considérée comme telle par l’autorité publique et qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
La question pourrait dès lors se poser de permettre aux parents d’un enfant né d’une gestation pour autrui de voir leur filiation établie par la voie de la possession d’état. Dans ce sens, M. Xavier Labbée (396), professeur de droit à l’université de Lille et avocat, a indiqué avoir « proposé à la cour d’appel de Douai la voie de la possession d’état, selon laquelle le fait de se comporter en parents suffit pour établir la filiation », en estimant que « ce procédé permettrait de régler la question de l’enfant de la gestation pour autrui. »
Toutefois, l’article 311-2 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, dispose que la possession d’état doit être « continue, paisible, publique et non équivoque ». La formulation retenue par l’ordonnance de 2005, ratifiée par le Parlement en janvier 2009 (397), n’apporte pas d’innovation mais constitue une codification des principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence.
La circulaire du 30 juin 2006 relative à la réforme de la filiation (398) précise à cet égard que « le caractère équivoque peut notamment résulter d’une fraude ou d’une violation de la loi. Il peut en être ainsi lorsque la possession d’état est invoquée pour contourner les règles régissant l’adoption, l’interdiction d’établir la filiation incestueuse ou la gestation pour le compte d’autrui ».
La voie de la possession d’état, concernant les enfants nés après le recours à une mère porteuse, a été clairement fermée par la jurisprudence. Par un jugement du 27 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Lille a ainsi contesté la possession d’état constatée par un acte de notoriété, que les époux avaient obtenu pour contourner le refus de transcription de l’acte de naissance dressé aux États-Unis, au motif que la fraude à la loi (399) rendait celle-ci équivoque. La Cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement en estimant, dans un arrêt du 14 septembre 2009, que cette possession d’état reposait sur un contrat portant sur la gestation pour autrui, contrat frappé, en application des articles 16-7 et 16-9 du code civil, d’une nullité absolue qui s’impose aux parties comme aux tiers. Par conséquent, une telle possession d’état est viciée et ne peut avoir d’effet en ce qui concerne la filiation quel que soit le demandeur.
Supprimer la notion de possession d’état « non équivoque », posée par le nouvel article 311-2 du code civil issu de l’ordonnance du 4 juillet 2005, aurait par ailleurs des répercussions dans d’autres domaines et conduirait notamment, selon les services de la Chancellerie, à ce que les qualités exigées pour établir la filiation soient moindres qu’en matière de meubles, ce qui serait paradoxal.
c) La reconnaissance volontaire de l’enfant
En cas de gestation pour autrui réalisée à l’étranger et d’établissement de la filiation paternelle, il convient de distinguer deux situations possibles : soit la transcription de l’acte de naissance étranger est admise (cf. infra), auquel cas le père n’a pas de démarche particulière à accomplir, puisque les énonciations de cet acte figureront dans l’acte établi par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, soit la transcription de l’acte étranger est refusée ou annulée.
Dans ce dernier cas, le père pourrait reconnaître l’enfant devant un officier de l’état civil, dans les conditions prévues à l’article 316 du code civil, même s’il est marié. Certains représentants de la doctrine estiment que pour les enfants nés de mères de substitution, « la filiation paternelle peut être établie à l’égard de l’homme commanditaire. (…) L’homme du couple commanditaire peut établir sa paternité en reconnaissant l’enfant. Si la femme qui a porté l’enfant est mariée, il faudra commencer par contester la paternité de son mari, ce qui suppose d’agir dans les délais pour le faire. Même si l’enfant est né à l’étranger d’une mère porteuse étrangère, l’homme peut toujours reconnaître l’enfant, à moins que ce dernier n’ait déjà une filiation paternelle qu’il faudrait là encore commencer par contester. (400) » Dans le même sens, selon le Dictionnaire permanent de bioéthique (401), la paternité de l’homme demandeur s’établit comme n’importe quelle filiation paternelle hors mariage, « la maternité pour autrui ne concernant par définition que la maternité » et, lorsque l’enfant est né à l’étranger d’une mère porteuse étrangère, l’homme demandeur peut également reconnaître l’enfant.
Toutefois, cette reconnaissance aurait peu d’effectivité, selon les services de la Chancellerie, puisqu’en l’absence d’acte de naissance français, elle ne pourrait être portée en marge d’un tel acte.
● Une reconnaissance paternelle subordonnée à une absence d’action du parquet.
Cette reconnaissance pourrait tomber sous le coup des dispositions de l’article 336 du code civil. En vigueur depuis le 1er juillet 2006, cet article a étendu les cas dans lesquels le ministère public peut contester une filiation établie frauduleusement. Alors qu’auparavant, le parquet ne pouvait agir qu’en cas de fraude à l’adoption, il peut désormais remettre en cause une reconnaissance établie en fraude à la loi. Ces dispositions pourraient trouver à s’appliquer en cas de gestation pour autrui et conduire à l’annulation de la reconnaissance paternelle.
Mme Frédérique Bozzi (402) a indiqué que « quand le parquet attaque et fait tomber la filiation maternelle (…) la filiation paternelle peut de toute façon subsister, dès lors que le mari de la mère d’intention reconnaît l’enfant » ; « on n’a pas besoin d’un texte particulier pour intervenir et sauver la filiation paternelle » et il n’y « pas actuellement d’obstacle fondamental à l’établissement de la filiation paternelle dans le cadre de la gestation pour autrui ».
● Une reconnaissance paternelle subordonnée à une transcription de l’acte de naissance
Le problème de l’absence de transcription de l’acte de naissance en droit interne peut cependant compliquer cette situation apparemment simple. Mme Frédérique Bozzi a considéré qu’« on peut souscrire une reconnaissance devant n’importe quel officier d’état civil, même avant la naissance de l’enfant. Dans le cadre d’un procès, c’est à l’avocat de conseiller à son client de reconnaître l’enfant. C’est très facile : il se présente dans n’importe quelle mairie et déclare qu’il est le père de l’enfant issu de telle dame. Mais pour que cette reconnaissance produise effet, elle doit figurer en marge d’un acte. La transcription est donc nécessaire. (…) On ne peut pas enrichir directement un acte étranger d’une mention de reconnaissance française. Les actes sont dissociés : l’acte français peut être enrichi par une reconnaissance française ou par un acte de reconnaissance souscrit à l’étranger, dans la mesure où les pays étrangers la connaissent. Mais la transcription demeure indispensable : c’est en marge de la transcription que la reconnaissance sera apposée, et c’est cette transcription qui donnera son effet matériel à la reconnaissance. Dans la relation familiale, la reconnaissance existe dès qu’elle est souscrite. Mais vis-à-vis des administrations et des tiers, il faudra qu’elle soit apposée en marge de la transcription et donc qu’elle devienne publique, pour produire son effet. »
Par ailleurs, l’article 311-17 du code civil a pour objet de régler le conflit de loi éventuel en matière de reconnaissance et est applicable uniquement dans le cas où les parents ne sont pas mariés. Le principe est celui de l’application de la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance. En conséquence, si le père est français, la loi française doit s’appliquer.
2. Dans quelles conditions les actes établis à l’étranger peuvent être ou non transcrits sur les registres d’état civil français?
La transcription d’un acte étranger concernant un Français sur les registres de l’état civil consulaires n’est pas obligatoire. Toutefois, comme l’indique le rapport du groupe de travail sénatorial précité, elle présente notamment l’intérêt d’éviter à l’intéressé de devoir s’adresser aux autorités ayant établi l’acte pour en obtenir un extrait ou une copie, de supporter des démarches plus ou moins longues et difficiles et de s’exposer éventuellement à des frais de traduction. L’acte étranger se « transforme » en acte français et il permet ainsi d’en obtenir une copie ou un extrait, ainsi que la délivrance ou la mise à jour d’un livret de famille, auprès du consulat français ou du service de l’état civil à Nantes.
À quelles conditions et pour quelles raisons des actes établis à l’étranger concernant un enfant né suite à la conclusion d’une convention de gestation ou de procréation pour le compte d’autrui, peuvent-ils être ou non transcrits sur les registres de l’état civil français ?
a) La transcription aux seules fins de permettre l’action du ministère public
La transcription des actes étrangers sur les registres de l’état civil peut être effectuée à la demande de la personne concernée ou d’office, sur les instructions du procureur de la République.
En sa qualité d’« autorité supérieure », selon les termes de l’instruction générale relative à l’état civil, le parquet de Nantes exerce la tutelle sur les officiers d’état civil consulaires français, à l’étranger et sur le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères , installé à Nantes. À ce titre, il est amené à donner à ceux-ci des instructions lorsqu’il est saisi d’une difficulté relative à la transcription sur les registres consulaires de l’acte de naissance d’un enfant à l’étranger.
Lors de son audition, M. Pierre Lecat (403) a indiqué que ce parquet est ainsi, en matière de GPA, « la porte d’entrée de toutes ces affaires qui nous viennent de l’étranger » mais ces affaires « demeurent très rares ». En effet, il n’y a pas eu plus d’une vingtaine de cas recensés, c’est-à-dire d’affaires identifiées liées à des demandes de transcription d’acte de naissance d’un enfant issu d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger, exclusivement aux États-Unis et très majoritairement en Californie.
Le recours à une mère porteuse peut être soupçonné facilement, par exemple, lorsque le passeport d’une mère d’intention, qui ne peut produire de certificat de son accouchement, indique qu’elle est venue sur le lieu de la naissance neuf mois avant l’accouchement, qu’elle y retourne précisément à une date extrêmement proche de celui-ci, alors que sa prétendue grossesse proche du terme aurait été incompatible avec un déplacement en avion. Dès que l’officier de l’état civil consulaire soupçonne que cet enfant est issu d’une gestation pour autrui prohibée, il demande des justifications de la grossesse de la femme française, de son suivi médical, de sa déclaration à la caisse d’allocations familiales et de son séjour aux États-Unis.
Ainsi que l’a précisé M. Pierre Lecat, « dès lors qu’il est vérifié que les soupçons de l’officier d’état civil consulaire sont suffisamment fondés, le parquet de Nantes refuse par principe la transcription » de l’acte étranger, en considérant que des données extérieures à celui-ci établissent que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, de sorte que l’acte à transcrire ne fait pas foi de son contenu. Ce refus de procéder à la transcription a plusieurs fondements : la nullité de la convention de gestation pour autrui (article 16-7 du code civil), l’existence de sanctions pénales ainsi que le principe selon lequel la mère est celle qui accouche. Selon M. Pierre Lecat, ce refus prend également en compte « les engagements internationaux de la France : l’article 370-3 du code civil et surtout la convention de la Haye sur l’adoption qui comporte des dispositions relatives au but de l’adoption, et à la manière dont le consentement peut être donné et dont il ne doit pas être obtenu (rémunération). Le parquet de Nantes considère que la gestation pour autrui est une adoption déguisée et interdit la transcription de l’acte étranger qui en est l’expression. »
Dans la mesure où la transcription d’un acte de naissance étranger désignant la mère d’intention en qualité de mère serait contraire à l’ordre public, le parquet ordonne dans ce cas la transcription aux seules fins de permettre l’action du parquet compétent territorialement.
b) L’impossibilité de transcrire partiellement l’acte étranger
« On pourrait concevoir de transcrire au moins la paternité », toutefois, comme l’a souligné M. Pierre Lecat(404), « en fait, la transcription se fait ou ne se fait pas : ni l’officier consulaire, ni le parquet de Nantes ne sont autorisés à faire le tri dans l’acte étranger, qui est un acte authentique, dont toutes les données doivent être reprises. »
En effet, le principe de la transcription d’un acte de l’état civil est la reprise du contenu de l’acte dans son intégralité, en application de l’article 7 du décret de 1962 (405). Certains tempéraments lui sont toutefois apportés :
– tout d’abord, le contenu des actes de l’état civil étant déterminé par la loi (article 57 du code civil concernant l’acte de naissance), l’officier d’état civil français ne peut assortir les actes concernant des étrangers, d’énonciations prévues par la loi personnelle étrangère mais non admises par notre droit, comme la race, la nationalité ou la religion ; ainsi, des indications prohibées, inconnues du code civil ou contraires à l’ordre public international français mais qui ne sont pas essentielles à l’acte ou sont détachables de l’acte peuvent être expurgées par l’officier de l’état civil, qui se tient à une application stricte des énonciations devant être contenues dans les actes de l’état civil français ;
– de plus, le contenu de l’acte étranger ne doit pas être contraire à l’ordre public français : l’indication d’une information essentielle de l’acte qui serait considérée comme une violation de l’ordre public international autorise en effet l’officier d’état civil, après avis du procureur de la République à en refuser la transcription (par exemple, en cas d’adoption frauduleuse) ou à ne transcrire que le contenu de l’acte conforme au droit français (par exemple en cas d’homoparentalité, si la femme française du couple est celle qui a accouché).
Tel n’est pas le cas en revanche pour les actes dressés à l’étranger concernant des enfants conçus après le recours à une mère porteuse. M. Pierre Lecat a indiqué à cet égard que « s’agissant de la paternité, le parquet se fonde sur le principe selon lequel on ne fait pas le tri dans l’acte d’état civil étranger dont on opère la transcription. De toute façon, au moment où on lui demande s’il faut ou non transcrire l’acte étranger, il a rarement en main la décision juridictionnelle étrangère qui désigne le père et la mère. En général, la filiation s’établit par rapport à la loi de la mère, mais de la mère connue comme ayant accouché. Il faudrait donc que le parquet sache si la loi américaine désigne comme étant le père celui qui se présente comme tel. Cela suppose une analyse juridique que le parquet estime ne pas pouvoir, ni devoir faire au moment où il est saisi. Il considère qu’il appartient aux juridictions qui seront éventuellement saisies, soit par lui-même, soit par un autre parquet, soit par les parents français, de se prononcer sur cette question. »
c) Les cas où des actes étrangers ont pu être transcrits sur les registres de l’état civil français
Quand bien même les actes étrangers d’état civil auraient été dressés suite au recours à une mère porteuse par un couple de Français, il apparaît qu’ils pourraient être transcrits sur les registres de l’état civil français dans les trois cas de figure suivants.
Tout d’abord, l’acte étranger peut être transcrit si l’officier d’état civil consulaire ne dispose pas d’élément lui permettant de soupçonner l’existence d’une gestation pour autrui.
Comme l’a souligné M. Pierre Lecat (406), « le faible nombre d’affaires rapporté aux centaines de naissances par gestation pour autrui évoquées par les associations, montre bien que le parquet de Nantes n’a pas connaissance de l’ensemble de ces cas ». Cette situation s’explique tout d’abord par le caractère non obligatoire de la transcription (cf. supra), mais aussi par le fait que les officiers d’état civil consulaires et le parquet du tribunal de grande instance de Nantes ne disposent pas toujours d’éléments de nature à éveiller leurs soupçons et à leur permettre de vérifier l’existence d’une maternité pour le compte d’autrui. C’est par exemple le cas pour les Français installés aux États-Unis depuis plusieurs années.
Précisant que le parquet de Nantes est « loin de connaître tous les cas existants », M. Pierre Lecat a évoqué un autre cas de figure, dans lequel le parquet de Nantes, en tant qu’autorité supérieure des officiers d’état civil consulaires, a été contourné ; on a ainsi « découvert, il y a quelques années, à l’occasion d’une perquisition par la police judiciaire faite à Lille au domicile d’un homme soupçonné d’abus de confiance, deux enfants dont l’état civil figurait au service central de l’état civil et qui venaient des États-Unis. Ils avaient été ramenés en France par cet homme, qui y vivait avec un autre homme, et qui avait obtenu pour eux un certificat de nationalité française. (…) : il avait demandé au greffier en chef, compétent territorialement, la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il avait démontré, avec son acte américain, que son enfant était français dans la mesure où il avait au moins un parent français. Le greffier en chef lui a délivré ce certificat de nationalité, qui fut transmis directement au service central d’état civil en vue de la transcription. La transcription eut lieu.»
La transcription peut également être effectuée dès lors que l’acte étranger ne mentionne pas la mère d’intention en qualité de mère légale.
M. Pierre Lecat a en effet expliqué que « la nullité du processus vient de la désignation de la mère par le jugement de la cour californienne. [Le parquet du TGI de Nantes a] examiné des dossiers dans lesquels la mère n’apparaissait pas. Dès lors que la décision californienne et l’acte américain ne désignent qu’un père, si par ailleurs, à l’analyse de cet acte et compte tenu des déclarations qui s’y trouvent, on peut considérer qu’il y a déjà une reconnaissance valide, même si elle mérite d’être réitérée « à la française », la transcription est possible. »
Dans la pratique, il semblerait que pour la moitié environ des cas recensés, la gestation pour autrui concerne un homme célibataire français, qui a recouru à une femme ayant été inséminée avec ses gamètes et qui porte l’enfant. Dans ces cas, une convention préalable serait conclue afin que la garde de l’enfant soit attribuée à l’homme, qui rentrera sur le sol français avec celui-ci. Dans la mesure où des actes de naissance des enfants désignaient la femme ayant porté l’enfant en qualité de mère, le parquet ne s’est pas opposé à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil français.
Concernant les couples (composés d’un homme et d’une femme), le rapport du groupe de travail sénatorial note par ailleurs que la mention de la mère d’intention sur les registres de l’état civil français étant impossible, il leur a été proposé, dans certains cas, de faire désigner la mère porteuse en qualité de mère (407) et qu’en cas d’acceptation, la transcription a été réalisée, aucune action judiciaire n’ayant été engagée. En cas de refus ou d’absence de possibilité de procéder ainsi, la transcription est réalisée aux seules fins de permettre la saisine de la justice.
Par conséquent, un acte étranger mentionnant la femme qui a accouché et le père commanditaire pourrait actuellement être transcrit. D’une certaine manière, le raisonnement suivi par le parquet du TGI semble être le suivant : le contrat illicite de mère porteuse vicie la maternité d’intention parce qu’il en est l’unique fait générateur, en l’absence d’accouchement, qui demeure en France la condition de la maternité légale. Mais il n’en est pas de même pour la paternité qui, en cas de reconnaissance repose sur cette démarche légale et non pas sur le contrat illicite.
Ce raisonnement pourrait cependant occulter le fait que le père dont la filiation (ou plutôt l’acte instrumentaire) peut à ces conditions être transcrite en droit interne, a commis une fraude à la loi en se rendant à l’étranger pour recourir à la GPA.
Il en résulte que si le nom de la mère qui a accouché n’est pas mentionné sur l’acte de naissance étranger ou si la fraude est soupçonnée, la transcription de la filiation paternelle peut être refusée comme l’a fait récemment le parquet de Nantes à propos d’une gestation pour autrui en Inde.
Enfin, la transcription ordonnée par le parquet de Nantes à seule fin de saisine du juge peut ne pas être suivie d’une action judiciaire, le parquet territorialement compétent n’agissant pas en ce sens.
Le parquet de Nantes ne dispose que d’une compétence liée par rapport aux actes d’état civil sur le plan de leur transcription, de leur rectification ou de leur annulation. Les actions d’état qui visent à établir ou contester une filiation ne relèvent pas de sa compétence pas plus que l’exercice de l’action pénale.
M. Pierre Lecat a indiqué que le parquet de Nantes est en conséquence tributaire des « autres parquets de France, qui ont rarement l’expérience de ces affaires. Sur [ses] signalements et [ses] transmissions, ils agissent ou n’agissent pas, opportunément ou non ». Il a notamment évoqué des « parquets qui, malgré notre signalement, n’avaient pas du tout réagi : nous avions ordonné la transcription avec interdiction d’exploiter l’acte, à seule fin de saisine du juge, mais ce juge n’a jamais été saisi. Au bout de deux ans, et en l’absence d’instruction de la Chancellerie, nous avons autorisé l’exploitation de l’acte. »
Ainsi, selon M. Pierre Lecat, « de nombreux actes ne sont donc pas soumis à l’autorisation judiciaire et sont transcrits parce qu’ils nous ont échappé et se trouvent librement exploités, cependant que d’autres nous sont passés entre les mains et nous en avons nous-mêmes autorisé l’exploitation. »
3. Quelles sont les conséquences de l’absence de transcription en droit interne des actes d’état civil étrangers ?
La transcription de l’acte d’état civil étranger n’est pas obligatoire pour les couples concernés, l’absence de transcription sur les registres d’état civil français de ces actes, qui bénéficient d’une force probante présumée, ne faisant pas obstacle à ce que cet état civil soit reconnu et utilisé par les parents dans les actes de la vie courante. Par ailleurs, les enfants dont les parents n’ont pas demandé la transcription de l’acte ne sont pas a priori privés de toute filiation ou d’état civil.
a) La force probante présumée des actes étrangers d’état civil
L’article 47 du code civil reconnaît sous certaines conditions la force probante des actes d’état civil dressés à l’étranger. Celui-ci prévoit que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait dans un État étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Ces dispositions s’imposent aux administrations françaises qui doivent apprécier l’authenticité et la régularité de tout acte de l’état civil étranger qui leur est produit. En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte, les administrations chargées d’établir ou de délivrer un titre ou un acte sont compétentes pour procéder ou faire procéder aux vérifications utiles visées à l’article 47 du code civil auprès de l’autorité étrangère.
La Cour de cassation (408) a défini l’acte comme étant un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personnes. La force probante attribuée en France à un acte de l’état civil étranger est celle reconnue par la loi française.
Cette force probante ne s’attache qu’aux constations faites personnellement par l’officier de l’état civil, c’est-à-dire la date de l’acte, l’identité de l’officier, la conformité de l’acte aux déclarations qui lui sont faites. Les énonciations relatant le contenu des déclarations (identité des déclarants et des parties, réalité de la naissance ou du décès déclaré, date, heure et lieu de survenance de l’événement, état civil ou situation matrimoniale des parents ou déclarants) ne font foi que jusqu’à preuve du contraire.
b) L’absence de transcription ne pose pas de difficultés majeures dans les actes de la vie courante
Selon les propos mêmes de Mme Laure Camborieux, présidente de l’association Maia, dont fait état le rapport du groupe de travail sénatorial précité, les couples ayant eu recours à la maternité pour autrui ne rencontrent pas de difficulté particulière dans leur vie quotidienne.
En effet, dans un certain nombre d’actes de la vie courante, il n’est pas nécessaire de produire un acte de l’état civil.
Ainsi, selon les informations communiquées par les services de la Chancellerie, pour l’inscription à l’école, qui relève de la compétence des mairies, les pratiques peuvent être variables quant aux justificatifs exigés. Certaines communes demandent la production du livret de famille mais, dans la mesure où de nombreux enfants étrangers sont scolarisés en France, l’acte de naissance étranger traduit en français peut s’y substituer, sans autre vérification. Pour l’affiliation à la sécurité sociale ou pour le bénéfice des prestations sociales, aucune pièce d’état civil n’est exigée, le critère retenu étant celui de la charge de l’enfant, attestée par une déclaration de situation.
Par ailleurs, l’absence de transcription de l’acte d’état civil étranger ne fait pas obstacle à ce que cet état civil étranger soit utilisé par les parents dans les actes de la vie courante.
En effet, lorsqu’un acte d’état civil doit être produit, aucun texte n’impose que l’acte étranger soit préalablement transcrit sur les registres du service central de l’état civil. La production de l’acte étranger, dont la force probante est présumée en application de l’article 47 précité, est en principe suffisante.
Ainsi l’absence de transcription n’empêche pas que l’acte étranger soit utilisé par les parents dans les actes de la vie courante, par exemple dans les rapports avec les administrations, les écoles ou les établissements de santé. Il doit dans tous les cas être traduit et, sous réserve de conventions contraires, être légalisé ou apostillé par les autorités compétentes. La légalisation ou l’apostille sont des mécanismes visant uniquement à authentifier une signature et la qualité du signataire de l’acte par l’apposition d’un contreseing officiel. Selon le pays où a été établi l’acte de naissance et l’existence ou non d’une convention, l’un de ces mécanismes peut s’avérer nécessaire.
Dans son rapport de mai 2009, le Conseil d’État estime cependant que « la vie des familles est plus compliquée en l’absence de transcription, en raison des formalités à accomplir à l’occasion de certains évènements de la vie », en omettant cependant de préciser lesquels. Il note simplement qu’en l’absence de reconnaissance de la filiation établie à l’égard de la mère d’intention, lorsque celle-ci décède, l’enfant ne peut hériter d’elle, sauf à ce qu’elle l’ait institué légataire, les droits de succession étant alors calculés comme si l’enfant était un tiers.
Il semblerait même que dans certains cas un certificat de nationalité, voire une carte d’identité ait pu être délivré.
M. Dominique Mennesson (409), co-président de l’association Clara, a souligné lors de son audition que « c’est un droit élémentaire de ces enfants que d’avoir une filiation stable », en notant cependant qu’« ils peuvent obtenir des papiers, notamment une carte d’identité, mais cela n’établit pas une filiation. »
En effet, l’acte étranger faisant foi a priori de son contenu, un certificat de nationalité aurait pu, semble-t-il, être délivré dans certains cas. Ceci s’expliquerait par le fait que dans le cadre de la délivrance d’une carte nationale d’identité, conformément à l’article 47 du code civil, les actes de l’état civil dressés à l’étranger, rédigés dans les formes usitées dans le pays concerné, sont acceptés, s’ils sont traduits et s’ils satisfont à l’obligation de légalisation sous réserve de l’existence d’une convention internationale qui dispense de cette dernière exigence. Ces actes font foi en France sans que, lorsqu’ils concernent des Français, leur transcription sur les registres consulaires puisse être exigée. Il en résulte que des préfectures aient pu ne pas exiger la transcription de l’acte pour établir un titre d’identité. Comme il en a déjà été fait mention, M. Lecat a évoqué lors de son audition le cas d’un homme qui avait demandé et obtenu du greffier en chef, compétent territorialement, la délivrance d’un certificat de nationalité française.
En tout état de cause, si Mme la garde des sceaux (410) a jugé nécessaire de « réfléchir au statut des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger », en estimant que si « leur actuelle absence de statut, au regard de l’état civil français, place le mineur et ses parents dans des situations incertaines », c’est toutefois « moins un problème de quotidien que de confort moral et juridique des personnes. »
c) Les enfants ne sont pas privés de filiation
La filiation de l’enfant né à l’étranger dans le cadre d’une gestation ou de procréation pour le compte d’autrui est établie à l’étranger à l’égard des parents intentionnels français. La mère intentionnelle ne peut être désignée comme mère dans les registres de l’état civil français, la situation étant moins clairement tranchée concernant la transcription de la filiation paternelle.
Les juridictions françaises sont incompétentes pour se prononcer sur la validité des actes d’état civil étrangers et annuler de tels actes. Seule leur transcription sur les registres du service central de l’état civil peut être contestée par le ministère public en démontrant leur non conformité à l’ordre public international. Les actions relatives à l’état, au demeurant très rares, n’ont pas pour objet de se prononcer sur le lien de filiation constaté par l’acte mais seulement sur la validité de cet acte en droit français.
Ainsi, le fait de ne pas avoir d’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil français ne signifie pas qu’il n’y a pas de filiation. Il convient toutefois de distinguer deux situations : l’absence de transcription (le couple ne l’ayant pas demandée) et le cas où un tribunal français se serait prononcé sur cette transcription ou sur la filiation. Le jugement qui a force de chose jugée s’opposerait dès lors à ce qu’on se prévale en France d’un acte étranger qui le contredirait. Sous cette réserve importante, on peut donc posséder un acte étranger qui fait foi a priori de son contenu.
S’agissant des naissances en France d’enfants conçus dans le cadre d’une gestation ou d’une procréation pour autrui réalisées en France, toute GPA réalisée sur le territoire français et connue des autorités judiciaires donnerait lieu à une action tant civile que pénale. Ainsi, sur le plan civil l’enfant pourrait être privé de filiation dans la mesure où le ministère public pourrait contester cette filiation établie en fraude à la loi, sur le fondement de l’article 336 du code civil.
4. Quel est l’état de la jurisprudence concernant la transcription sur les registres de l’état civil français des actes étrangers établis suite à une maternité pour autrui ?
Outre les tentatives d’établissement de la filiation par l’invocation des règles de droit interne, des couples ayant conclu une convention de maternité pour autrui dans un pays où elle est autorisée ont également tenté de se prévaloir des règles de droit international privé pour permettre à cette convention de produire des effets en droit interne, en s’appuyant sur la force probante présumée des actes étrangers ou en demandant leur transcription sur les registres de l’état civil français.
Quelle réponse a apportée la jurisprudence à ces tentatives ?
a) La décision de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2007 n’a qu’une portée procédurale
Dans un arrêt du 25 octobre 2007 (411), qui a eu un important retentissement médiatique, la Cour d’appel de Paris a confirmé un jugement rendu le 13 décembre 2005 par le TGI de Créteil et estimé que le ministère public était irrecevable à agir en annulation de la transcription sur les registres de l’état civil des actes de naissance étrangers de jumelles établis aux États-Unis après une gestation pour autrui, pratiquée en Californie pour le compte du couple Mennesson. La Cour a également considéré que « la non transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique ».
Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui a débouté le ministère public de sa demande d’annulation de la transcription, doit cependant être replacé dans son contexte, sa portée semblant en réalité limitée.
En effet, si par le jugement du 13 décembre 2005, confirmé par la Cour d’appel de Paris, le tribunal a déclaré l’action du parquet irrecevable, Mme Frédérique Bozzi (412) a fait observer qu’« il ne valide pas le processus de mère porteuse. Il dit simplement que le parquet est irrecevable à agir pour demander la nullité des transcriptions. »
En effet, le TGI de Créteil puis la Cour d’appel de Paris ont déclaré irrecevable l’action du ministère public en considérant que, selon les dispositions de l’Instruction générale relative à l’état civil, lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public lorsque l’ordre public est en jeu. En l’espèce, le ministère public n’a pas agi en contestation de l’état des jumelles mais s’est borné à solliciter l’annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l’ordre public, le ministère public ayant également demandé à la cour d’ordonner la transcription du jugement en marge des actes annulés.
En outre, la cour n’a pu que constater que le ministère public n’avait contesté ni l’opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet État. La conformité des actes de naissance étrangers à la réalité aurait cependant pu être contestée par le ministère public, l’inopposabilité et la contrariété à l’ordre public international français de la décision étrangère constituant le support du processus de maternité pour autrui.
Mme Frédérique Bozzi a expliqué les raisons pour lesquelles la Cour d’appel de Paris a jugé que le ministère public était irrecevable de la manière suivante : « D’abord, parce qu’elle a été saisie d’une action en annulation d’actes, et non d’une action en matière d’état des personnes. Il n’y a pas de contestation de filiation, maternelle ou paternelle. L’action ne vise qu’à une nullité intrinsèque de l’acte, qui ne s’adosse à aucune action d’état. Ensuite, parce que l’annulation s’attaque à la régularité formelle de l’acte : c’est ce qui a lieu lorsque les énonciations sont fausses, sans objet ou font double emploi. Dans ce cas, la nullité est consubstantielle à celle de l’acte juridique, et cela suppose que les énonciations mêmes de l’acte soient attaquées quant au fond. Or, en l’occurrence, le parquet de Créteil s’était borné à dire que les actes avaient été transcrits irrégulièrement, sans s’expliquer sur les irrégularités en question, pour demander l’annulation. Enfin, le parquet n’attaquait pas la régularité internationale de la décision californienne. Pourtant, c’était là que résidait la véritable faiblesse du processus en cause : le jugement californien par lequel les actes américains ont été établis puis transcrits aurait mérité d’être passé au crible. Il aurait fallu vérifier si l’opération validée par le jugement était ou non conforme aux exigences de l’ordre public international français. Mais cela n’a pas été fait. » Mme Frédérique Bozzi en a dès lors conclu que « la cour d’appel de Paris n’a pu que prononcer l’irrecevabilité de l’action du parquet, dans la mesure où celle-ci n’était pas juridiquement efficace au regard du but poursuivi. »
Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi à l’initiative du ministère public. La décision de la Cour de cassation était d’autant plus attendue que les moyens invoqués par le ministère public avaient paru inadaptés, selon certains. Surtout, comme l’avait indiqué le rapport du groupe sénatorial précité, si la Cour de cassation avait suivi la cour d’appel, « la prohibition des conventions de gestation ou de procréation pour autrui pourrait être contournée en se rendant à l’étranger et ne concernerait donc plus que les couples respectueux de la loi française ou peu fortunés. »
Cet arrêt a été cassé en décembre 2008 par la Cour de cassation qui a reconnu l’intérêt à agir du ministère public.
Dans son arrêt du 17 décembre 2008 (413), la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel de Paris, en considérant que le ministère public avait un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 16-7 du code civil. L’article 423 du code de procédure civile prévoit en effet que le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. Il reviendra dès lors à la cour d’appel de Paris, autrement composée, devant laquelle l’affaire a été renvoyée, de se prononcer à nouveau sur la validité des actes d’état civil des enfants.
La Cour de cassation n’a ainsi été amenée à envisager cette question que sous un angle procédural. M. Jean Hauser (414) a déclaré en ce sens qu’« en matière de gestation pour autrui, la Cour de cassation n’a pas répondu et ne répondra pas. La Cour de cassation de Paris a cassé l’arrêt de la Cour d’appel parce qu’il avait été dit que le ministère public ne pouvait pas contester l’acte d’état civil. C’est donc une cassation sans intérêt de fond. »
Mme Frédérique Bozzi (415) a néanmoins indiqué que « certains commentateurs ont relevé que la Cour de cassation, en visant l’article 16-7 du code civil, ainsi que l’article 423 du code de procédure civile qui autorise le parquet à agir lorsque l’ordre public est en jeu, avait entendu marquer son hostilité à la gestation pour autrui. C’est possible. Mais son arrêt se concentre essentiellement sur la recevabilité de l’action. La solution en est classique et se rattache parfaitement à la décision fondatrice de 1991. Il y a là une continuité jurisprudentielle. »
Enfin, la même Cour d’appel de Paris, saisie de faits similaires, s’est prononcée différemment en février 2009.
En l’espèce, le ministère public a contesté, d’une part, l’opposabilité en France, au regard de la conception française de l’ordre public international de deux jugements américains (416) ayant eu pour effet de valider le recours par des Français à la gestation pour autrui et, d’autre part, la foi qui peut être accordée, au sens de l’article 47 du code civil, à l’acte de naissance de l’enfant dressé par les services de l’état civil de l’État du Minnesota, suite au prononcé de ces jugements.
Par un arrêt en date du 26 février 2009, la Cour d’appel de Paris (417) a considéré que les jugements américains ayant eu pour effet de valider une convention de gestation pour le compte d’autrui, sont contraires à la conception française de l’ordre public international et qu’en conséquence la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil devait être rectifiée, conformément à la demande du ministère public, en supprimant les mentions relatives à la mère d’intention.
Mme Frédérique Bozzi (418) a relevé que la cour d’appel a ainsi été saisie d’une « affaire qui se [présentait] exactement comme l’affaire Mennesson quant aux circonstances de fait, mais qui a été « bien ficelée », pour reprendre notre jargon : le parquet de Paris demandera à son tribunal, puis, sur appel des parents, à la cour, de vérifier la régularité internationale de la décision californienne. Après avoir constaté que la décision heurtait frontalement l’article 16-7, elle dira que l’on ne peut pas maintenir sur les registres français des actes tels que transcrits en exécution d’une décision contraire à l’ordre public français. Elle confirmera la mise à néant, non pas de la filiation paternelle, qui va demeurer, mais de la filiation maternelle ainsi que la rectification de l’acte de naissance de l’enfant par ablation de l’indication de la filiation maternelle. »
Mme Frédérique Bozzi a souligné que « la même formation, dès lors qu’elle a été saisie convenablement, est revenue dans le classicisme jurisprudentiel », en considérant dès lors que « l’arrêt Mennesson est un non événement, un imbroglio judiciaire, mais pas un fait fondateur de jurisprudence. » M. Pierre Lecat (419) a également estimé que « l’action récemment menée devant le tribunal de Créteil n’était probablement pas la bonne, alors que celle menée devant le tribunal de Paris était plus correcte. »
L’arrêt de la cour d’appel a néanmoins fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
b) La transcription de la filiation paternelle a été admise par la Cour d’appel de Paris en février 2009
Dans son rapport de mai 2009, le Conseil d’État a estimé que « la reconnaissance de la paternité du père, s’il a été donneur ne soulève pas toujours de difficultés, quoique la jurisprudence, assez rare sur ces questions, ne soit pas clairement tranchée ». Il a indiqué notamment que « certains tribunaux » – sans toutefois préciser quels tribunaux se seraient effectivement prononcés en ce sens – « considèrent que, en se rendant à l’étranger pour y conclure une convention illégale en France, le couple contourne sciemment la loi française et que par suite, en vertu du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », la filiation paternelle doit être refusée. » Qu’en est-il exactement ?
Selon la Direction des affaires civiles et du sceau, la réponse à la question de la recevabilité, ou non, de la transcription de la paternité dépendrait en conséquence du fondement retenu pour interdire la transcription de la filiation maternelle. En effet, si celle-ci repose sur l’existence d’une fraude à la loi, alors il pourrait apparaître difficile d’admettre la transcription de la filiation paternelle ; en effet, la violation de la loi est l’œuvre du couple et, en application des principes généraux, la fraude corrompt tout, ce qui pourrait entraîner le refus de transcription de l’ensemble des énonciations de l’acte de naissance étranger.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’y a que peu d’affaires de gestation pour autrui portées devant la justice et que la plupart des procédures semblent concerner l’adoption de l’enfant par l’épouse du père ou encore la possession d’état, plutôt que la transcription de l’acte de naissance. De fait, il n’y aurait que deux procédures actuellement engagées concernant la transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant sur les registres de l’état civil français :
– dans le premier cas, qui a fait l’objet de l’arrêt précité du 25 octobre 2007 de la Cour d’appel de Paris, l’ensemble de la transcription (filiation paternelle et maternelle) a été contesté par le ministère public ;
– dans le second (arrêt précité du 26 février 2009), le ministère public avait limité la portée de l’assignation à l’annulation des énonciations de l’acte relatives à la mère (rectification de l’acte par ablation des indications relatives à la mère d’intention) « pour des raisons biologiques et humaines », selon les services de la chancellerie ; la Cour d’appel ne s’est pas opposée à la transcription de la paternité au motif de sa conformité supposée à la réalité biologique de la filiation et de l’intérêt de l’enfant d’avoir une filiation établie et reconnue en France à l’égard d’au moins l’un des parents intentionnels. Cet arrêt a néanmoins fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
En tout état de cause, si la transcription de la filiation paternelle était admise, la filiation ainsi établie pourrait rester fragile, car il ne pourrait pas être exclu que le ministère public engage une action judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 336 du code civil, qui lui permettent de contester toute filiation établie en fraude à la loi, selon la Direction des affaires civiles et du sceau. Toutefois, si le ministère public a limité la portée de l’assignation à l’annulation des énonciations de l’acte relatives à la mère d’intention, il serait peu vraisemblable que la filiation paternelle soit ensuite contestée par le ministère public sur le fondement de l’article 336.
c) L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être instrumentalisé
L’intérêt de l’enfant invoqué par la Cour d’appel de Paris constitue, il est vrai, une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Ce principe a été déclaré d’application directe par la Cour de cassation (420).
Si cette notion gagnerait à être mieux mise en valeur dans la législation française, il convient toutefois de l’appréhender avec prudence, d’autant plus que sa définition même demeure incertaine. Certains considèrent en effet qu’il s’agit d’une notion « à géométrie variable qui ne peut avoir le même contenu partout dans le monde. On ne saurait le définir de façon objective (421) ». C’est pourquoi la convention du 20 novembre 1989, en déclarant que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale à prendre en compte, fait de ce principe une condition nécessaire de la décision concernant l’enfant, sans toutefois l’ériger en critère suffisant.
Fonder exclusivement la décision sur l’intérêt supérieur de l’enfant reviendrait à faire primer cet intérêt sur toute autre considération, par exemple sur le respect de l’ordre public international et la sanction de la fraude à la loi. Cependant en adoptant un tel raisonnement, ce serait tout l’ordre public familial qui pourrait être remis en question. Ainsi, toutes les interdictions d’établissement du lien de filiation pourraient être écartées au nom du seul intérêt de l’enfant : filiations incestueuses, adoptions d’enfants dont le consentement des parents biologiques n’a pas été donné, etc. Par exemple, l’interdiction d’établir la filiation incestueuse à l’égard des deux parents ne devrait-elle pas être écartée au nom de l’intérêt de l’enfant né d’un inceste et qui ne peut hériter de son père ? La filiation d’un enfant acheté à des parents en détresse dans un pays pauvre ne devrait-elle pas finalement être établie à l’égard du couple français qui l’élève depuis dix ans ?
Une telle interprétation de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant pourrait s’avérer in fine fragiliser la protection de l’enfant. Dès lors, on peut considérer, comme l’a souligné Mme Aude Mirkovic (422), maître de conférences de droit privé à l’université d’Évry, que « la régularisation de la situation des enfants nés de mères de substitution ne sert pas, contrairement aux apparences, l’intérêt de l’enfant». C’est en effet l’intérêt in concreto d’un enfant particulier, né d’une mère porteuse, qui est invoqué pour justifier le contournement de la loi et pour permettre notamment la transcription de son acte sur les registres de l’état civil français. Au delà des incohérences que pourrait induire un tel raisonnement dans le système juridique, cela ne reviendrait-il pas à faire primer un intérêt particulier sur l’intérêt général défini par le législateur ? L’intérêt d’un enfant, en particulier, peut-il s’opposer à l’intérêt de l’enfant en général ?
Par ailleurs, si l’on permettait à des Français de se rendre à l’étranger pour y obtenir des droits contraires à la conception française de l’ordre public international, et de les reconnaître ensuite au seul nom de l’intérêt de l’enfant, le recours aux mères porteuses, et plus largement au tourisme procréatif, ne serait-il pas entériné et même encouragé ?
En tout état de cause, l’intérêt supérieur de l’enfant implique avant tout qu’il puisse bénéficier de fait d’une protection en France, qui lui permette d’être pris en charge par ceux qu’il considère comme ses parents. Ne pas reconnaître sa filiation maternelle et/ou paternelle en France ne fait, en effet, nullement obstacle à ce que les parents d’intention s’occupent de l’enfant au quotidien.
5. Faut-il modifier la législation actuelle pour répondre aux difficultés nées des violations de la loi française ?
Plusieurs personnes auditionnées par la mission ont souhaité que les enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger puissent bénéficier d’une certaine sécurité de la filiation en droit français et que cette question soit dissociée de celle de la légalisation ou non de la gestation pour autrui dans notre pays. Quelles en seraient cependant les conditions et surtout les conséquences ? Modifier les règles de filiation pour la gestation pour autrui ne serait-ce pas valider indirectement la GPA ?
Les dispositions législatives relatives aux règles de la filiation ne doivent pas être modifiées et il serait également inopportun de prévoir l’inscription en marge de l’acte de l’acte de naissance de l’enfant d’une mention relative au jugement étranger ayant reconnu la mère d’intention comme mère. En revanche, dès lors que la paternité serait reconnue, la mère d’intention pourrait bénéficier d’une délégation avec partage de l’autorité parentale ou d’une tutelle en cas de décès du père.
a) Aménager un statut aux enfants nés de GPA remettrait en cause les fondements de l’établissement de la filiation
Il apparaît impossible de maintenir l’interdiction de la gestation pour autrui, comme l’a souhaité la majorité des membres de la mission tout en définissant un statut plus protecteur pour les enfants qui en sont nés.
L’impossibilité de reconnaître la maternité de la mère d’intention par la transcription de l’acte d’état civil étranger
La reconnaissance en droit interne de la maternité de la mère d’intention par la voie de la transcription de l’acte étranger, se heurterait aux principes fondamentaux du droit de la filiation selon laquelle la mère est celle qui accouche, selon l’adage mater semper certa est, ainsi qu’à la possibilité pour le ministère public de contester toute filiation établie en cas de fraude à la loi, selon l’article 336 du code civil. Autoriser la transcription de l’acte de naissance rédigé à l’étranger suite à la naissance d’un enfant après une gestation pour autrui réalisée à l’étranger et permettre l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de la mère remettrait en cause la conception de l’ordre public français en la matière.
La difficulté de créer un régime dérogatoire
Prévoir dans la loi que seules les énonciations de l’acte étranger relatives à la paternité seraient transcrites, méconnaîtrait les principes régissant tant l’état civil que la filiation. Pour les couples mariés, la paternité résulte de ce que le père est le mari de la mère désignée dans l’acte de naissance. Pour les couples non mariés ou si l’épouse n’est pas considérée comme mère de l’enfant, la reconnaissance de paternité est susceptible de relever des dispositions précitées de l’article 336 du code civil. En effet comment rendre compatible avec un régime dérogatoire pour la GPA les dispositions selon lesquelles la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public en cas de fraude à la loi ou lorsque des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable? Le ministère public reviendrait à admettre que la fraude n’est pas établie, « pour le père d’un enfant conçu suite à la conclusion à l’étranger, en France, d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ».
Mais de tels mécanismes ne conduiraient-ils pas à ne sanctionner que la mère d’intention, au motif qu’elle n’a pas accouché de l’enfant, alors même que le détournement de dispositions d’ordre public serait l’œuvre du couple ? Ne serait-ce pas porter atteinte au principe d’égalité et traduire une conception contestable de la filiation faisant primer le lien biologique à l’égard du père ?
L’impossibilité d’adresser des instructions au parquet
S’agissant des actions judiciaires engagées suite à la transcription d’office d’actes d’état civil étrangers en matière de gestation pour autrui, il ne serait pas non plus possible d’adresser des instructions générales aux parquets, afin qu’ils ne contestent pas la transcription de l’ensemble de l’acte mais demandent uniquement la rectification de l’acte par la suppression des mentions relatives à la mère d’intention. De telles instructions pourraient s’avérer contra legem, en faisant produire des effets partiels à la convention de mère porteuse, que les articles 16-7 et 16-9 frappent de nullité.
La reconnaissance de la seule filiation paternelle résultant de la fraude constituerait une discrimination par rapport à la filiation maternelle
Le Conseil d’État a estimé dans son rapport de mai 2009, que « des solutions ponctuelles » pourraient « être imaginées dans le but de pallier les difficultés pratiques des familles, sans modifier les règles relatives à la filiation ». Dans cet objectif, « on pourrait ainsi permettre la transcription de la seule filiation paternelle » – cette proposition pouvant néanmoins sembler contradictoire avec la volonté exprimée antérieurement de ne pas modifier les règles relatives à la filiation – « en considérant qu’il en va de l’intérêt de l’enfant que sa filiation soit légalement reconnue à l’égard de son père biologique ».
D’abord, la mise en œuvre de cette proposition nécessiterait l’adoption de dispositions législatives risquant d’entraîner une remise en cause de la cohérence du droit de la filiation : il ne s’agirait donc pas de « solution ponctuelle ».
En effet, en l’état actuel du droit, il ne serait pas possible, par exemple, d’adresser des instructions générales aux officiers d’état civil consulaires en vue de permettre la transcription de la seule filiation paternelle, le cas échéant sous certaines conditions. Un fondement législatif serait nécessaire dès lors que cette mesure concerne l’état des personnes.
Par ailleurs, cette proposition est apparue juridiquement fragile à Mme la garde des sceaux lors de son audition par la mission (423) : « même s’il ne s’agit que de reconnaître la paternité du père d’intention, l’infléchissement de notre législation dans le sens d’une reconnaissance pose des difficultés : le fait, pour ce père d’intention, de conclure à l’étranger une convention qui est illégale en France, constitue un contournement de la loi française. Et il n’y a pas plus de motifs de retenir la filiation paternelle résultant de la fraude que la filiation maternelle : dans tous les cas, il y a un projet commun et ni l’un ni l’autre n’ont été pris au dépourvu. »
L’inscription en marge de l’acte de l’enfant d’une mention relative à la mère d’intention serait juridiquement contestable
Parmi les pistes qu’il avance, le Conseil d’État propose également, « sans modifier les règles relatives à la filiation », d’autoriser l’inscription en marge de l’acte de naissance de l’enfant d’une mention relative au jugement étranger ayant reconnu la mère d’intention comme mère, en prévoyant que celle-ci aurait pour seul effet d’éviter qu’en cas de décès de la mère, une procédure d’adoption plénière par un tiers puisse priver les parents de la mère d’intention de tout lien avec l’enfant.
Lors de son audition, M. Luc Derepas (424), rapporteur général du groupe de travail du Conseil d’État, a expliqué que le Conseil d’État « suggère des solutions pragmatiques permettant d’atténuer les inconvénients que cette absence de reconnaissance peut entraîner pour l’enfant. Ainsi, si la mère décède – ou le père, si sa filiation n’a pas été reconnue –, les grands-parents ne seraient pas juridiquement fondés à maintenir un contact. »
Une telle inscription serait cependant juridiquement source d’incohérence. Elle risquerait de stigmatiser les enfants nés de mère porteuse et ses effets seraient au surplus limités ou sans portée.
Mme Michèle Alliot-Marie (425), garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, a fait valoir qu’elle n’était « pas favorable à l’inscription en marge de l’acte d’état civil de l’enfant de la référence à la mère d’intention, pour deux raisons majeures. D’une part, étant donné que cet acte constitue un contournement de la loi française, une telle inscription n’entraînerait aucune conséquence juridique. D’autre part, elle risquerait d’aboutir à une forme de stigmatisation de l’enfant, alors même que nous sommes aussi chargés de nous pencher sur son intérêt. »
Une indication de ce type ne répondrait pas aux exigences posées par les dispositions de l’article 57 du code civil et de l’article 7-1 du décret du 3 août 1962. Dès lors, elle n’aurait aucun effet juridique et elle rendrait donc l’exploitation de l’acte plus complexe, puisqu’il serait fait référence à la mère d’intention, sans pour autant répondre au but poursuivi de protection des intérêts de celle-ci et de sa famille. En effet, la mère d’intention ne serait pas pour autant reconnue comme la mère légale de l’enfant ; aucun droit ne pourrait découler de cette indication, notamment en matière successorale.
En sens inverse, la mention proposée ne pourrait être de nature à empêcher l’éviction de la mère d’intention et de sa famille, dès lors qu’aucun lien de droit ne leur est reconnu avec l’enfant. Elle n’interdirait notamment pas à la nouvelle épouse du père d’intention de déposer une requête en adoption, seul le consentement de ce dernier étant requis. Il appartiendrait dès lors au tribunal de se prononcer sur l’adoption envisagée en considération de l’intérêt de l’enfant, au vu de l’ensemble des circonstances.
La création d’incohérences juridiques
Plus généralement, toutes ces solutions auraient pour effet de créer une profonde incohérence juridique par rapport à l’interdiction de la gestation pour autrui, puisqu’elles reviendraient à reconnaître des effets juridiques à une convention frappée de nullité. Or peut-on accepter de faire produire un effet juridique même limité à une décision étrangère contraire au principe de l’ordre public consacré par notre droit interne ? Sauf à introduire une incohérence dans notre droit, ne faudrait-il pas dès lors modifier les articles 16-7 et 16-9 du code civil, posant le principe de la nullité d’ordre public de la gestation pour autrui mais aussi son article 6, aux termes duquel on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ?
Les assouplissements qui pourraient être proposés, en ce qu’ils reviendraient à reconnaître des situations contraires à l’ordre public et obtenues en fraude à la loi, présenteraient un risque important d’effets de contagion dans d’autres domaines, notamment l’adoption. En outre, la reconnaissance de la filiation, uniquement au profit des enfants des couples ayant eu recours à la gestation pour autrui à l’étranger, sans autoriser en parallèle la même pratique en France créerait une injustice entre les couples ayant les moyens de se rendre à l’étranger et ceux qui ne peuvent le faire.
La fonction protectrice assurée par la loi ne serait-elle pas réduite à néant s’il suffisait de se rendre à l’étranger pour la contourner en étant assuré, à son retour en France, de voir sa situation « régularisée » ? Ce faisant, n’encouragerait-on pas le tourisme procréatif ? Et l’interdiction légale de la gestation pour autrui ne concernerait-elle plus, de fait, que les couples les moins fortunés qui n’auraient pas moyens de se rendre à l’étranger ?
Si ces obstacles juridiques sont incontournables, deux pistes méritent en revanche d’être explorées sur la base du droit en vigueur.
b) Appliquer des solutions offertes par le droit en vigueur
– Recourir à la délégation partage si la filiation paternelle est reconnue
Prévue par l’article 377-1 du code civil, la délégation avec partage de l’autorité parentale permet, avec l’accord du ou des parents, selon les cas, un partage de tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale entre parent(s) et délégataire par décision du juge aux affaires familiales lorsque les circonstances et les besoins éducatifs de l’enfant justifient une telle mesure.
Cette procédure n’a jamais été utilisée dans des situations de gestation pour autrui à la connaissance des services de la Chancellerie. Pourtant, dès lors que la filiation serait légalement établie à l’égard du père, il semble que rien n’interdirait ensuite à celui-ci de saisir le juge d’une demande en délégation avec partage de l’autorité parentale en faveur de la mère intentionnelle, dès lors que les conditions de fond sont réunies.
Cette procédure serait subordonnée à l’accord de la mère porteuse si la maternité est établie à son égard, ce qui est en pratique très rare. M. Pierre Lecat (426) a ainsi indiqué qu’aux États-Unis, il semblerait que « la décision californienne rompt définitivement le lien de filiation avec la mère porteuse, qui n’a plus le droit de récupérer l’enfant. » Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir de dispositions législatives spécifiques, s’agissant de situations exceptionnelles que le droit en vigueur permet de résoudre : dans l’éventualité où la maternité de la mère porteuse serait établie, le père pourrait demander au juge des affaires familiales de lui conférer l’exercice unilatéral de l’autorité parentale, puis le saisir d’une demande de délégation avec partage de cette autorité.
Ainsi, si la filiation paternelle était reconnue en France, le père d’intention exercerait l’autorité parentale sur l’enfant et le mécanisme de la délégation avec partage de l’autorité parentale pourrait permettre à la mère d’intention d’exercer les mêmes attributs à l’égard de l’enfant, qu’elle soit ou non mariée avec le père.
Le rapport de la mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant de l’Assemblée (427) faisait état de craintes exprimées par des représentants associatifs que la délégation-partage de l’autorité parentale « ne soit refusée par le juge au nom d’un détournement d’institution ». Ces craintes n’apparaissent cependant pas fondées. En effet, dès lors que la filiation serait légalement établie et reconnue à l’égard du père, celui-ci pourrait demander au juge aux affaires familiales que l’exercice de l’autorité parentale soit délégué et partagé avec la mère d’intention. Dans la mesure où la délégation ne crée aucun lien de filiation entre le délégataire et l’enfant, le risque de détournement d’institution n’apparaît pas réel. En application des dispositions prévues par les articles 377 et 377-1 du code civil, le juge, pour faire droit à la demande, ne doit prendre en considération que l’intérêt de l’enfant et vérifier que les circonstances et les besoins éducatifs de l’enfant justifient une telle mesure.
– Désigner la mère d’intention comme tutrice en cas de décès du père d’intention si la filiation paternelle est reconnue
Si la filiation maternelle de la mère d’intention n’est pas reconnue alors que celle à l’égard du père d’intention est légalement établie, aucun obstacle de droit ne s’oppose à ce que le père désigne la mère intentionnelle comme tutrice de l’enfant par testament ou par une déclaration spéciale devant notaire, conformément à l’article 403 du code civil (428). Le tuteur choisi par le père s’impose au conseil de famille sauf si l’intérêt du mineur commande de l’écarter. À défaut de désignation d’un tuteur testamentaire, les dispositions de l’article 404 du code civil (429) issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs s’appliquent. Le tuteur est alors choisi par le conseil de famille selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
*
Enfin, si la question de l’adoption ne relève pas du champ des lois de bioéthique, plusieurs personnes auditionnées par la mission ont souligné, dans le cadre du débat sur la gestation pour autrui, la nécessité de faire « de l’amélioration de l’adoption nationale et internationale une priorité (430) », voire même d’envisager « un recours aménagé à l’adoption » pour les femme privées d’utérus (431).
Mme Gisèle Halimi a vivement plaidé dans ce sens : « L’adoption permet un autre avenir pour les enfants abandonnés, pour les femmes en mal d’enfant, et pour nous qui voulons rester rivés à des valeurs avec lesquelles on ne peut pas transiger. » (432)
Si les couples infertiles ne souhaitent pas nécessairement recourir à l’adoption – au-delà du débat relatif à l’assistance médicale à la procréation et à la gestation pour autrui – on peut néanmoins se réjouir que, suite notamment à la remise au Président de la République du rapport sur l’adoption de M. Jean-Marie Colombani en mars 2008, qui suggérait des améliorations du dispositif français de l’adoption, le Gouvernement ait décidé de mettre en œuvre un plan d’action ambitieux dans ce domaine. Ainsi, la Secrétaire d’État chargée de la famille et la Secrétaire d’État chargée des affaires étrangères ont présenté, le 27 août 2008, au conseil des ministres un plan de réforme de l’adoption, fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant et comportant un volet national et international. S’inscrivant dans ce cadre et suite notamment à la création d’un Comité interministériel pour l’adoption en janvier 2009, le projet de loi relatif à l’adoption vise notamment à accélérer la résolution des situations de délaissement parental, par l’intervention du parquet et l’examen annuel de la situation de l’enfant placé. Il a également pour objet de renforcer le suivi des agréments pour l’adoption et d’améliorer les conditions d’intervention de l’Agence française de l’adoption.
Votre rapporteur constate que dans la pratique les difficultés évoquées du fait de l’absence de filiation maternelle ne doivent pas être exagérées et que le plus souvent la filiation paternelle peut être établie. Sauf à modifier l’ensemble du droit de la filiation, les solutions offertes par la délégation partage et la tutelle permettent de répondre à ces situations exceptionnelles.
PARTIE II : QUELLES LIMITES OPPOSER À L’UTILISATION DES DONNÉES GÉNÉTIQUES ?
L’activité médicale suscite de nombreuses questions éthiques quand elle ne consiste pas à rechercher les voies du meilleur soin mais à apprécier s’il est nécessaire ou non de transférer un embryon in utero, de le laisser ou non se développer, d’informer ou non une personne de la dégradation inéluctable de son état de santé. La capacité prédictive de certains examens médicaux, notamment des analyses génétiques, en donnant la possibilité d’anticiper des états de santé impose des choix d’action dont la justification est toujours contestée. Faut-il laisser la grossesse se poursuivre quand on sait que le fœtus est atteint d’une anomalie génétique grave ? Faut-il respecter la volonté du patient chez lequel est détectée une maladie héréditaire pouvant faire l’objet de prévention mais qui refuse que sa parentèle soit informée du risque qui pèse sur elle ? S’il ne revient pas au législateur d’entrer dans les consciences, il est de sa responsabilité de garantir le caractère libre et éclairé des décisions prises dans ces situations.
Or les informations d’ordre génétique sont complexes à comprendre et peuvent facilement être l’objet de méprises, voire d’abus. Le déterminisme en cette matière n’a pas le caractère absolu qu’on lui prête. Sauf à exposer les pouvoirs publics à certains contentieux, le législateur ne saurait négliger ces données.
*
* *
CHAPITRE 3 – LE DIAGNOSTIC ANTÉNATAL
Le terme de « diagnostic anténatal » recouvre, d’une part, le diagnostic prénatal (DPN), qui a pour objet de rechercher, pendant la grossesse, des anomalies embryonnaires ou fœtales et, d’autre part, le diagnostic préimplantatoire (DPI), qui consiste, en vue d’une grossesse, à sélectionner parmi des embryons conçus par fécondation in vitro (FIV) ceux indemnes de l’affection génétique recherchée, susceptibles d’être transférés in utero.
Comme l’a souligné le CCNE dans un avis récent (433), « la problématique éthique liée à ces techniques diagnostiques est grave et complexe lorsqu’il s’agit de décider de la naissance ou non d’un être humain ». Le développement des connaissances, avec l’identification de nouveaux gènes, et les progrès des techniques, permettant des diagnostics plus larges et plus précoces, soulèvent par ailleurs de nouvelles questions éthiques.
L’encadrement actuel des diagnostics anténatals est-il satisfaisant ? En particulier, les dispositions de la loi encadrant les activités de DPN et DPI garantissent-elles une application effective du principe prohibant toute pratique eugénique tendant à l’organisation et à la sélection des personnes ? De quelle façon pourrait-on, le cas échéant, améliorer le dispositif actuel, en renforçant en particulier l’information et l’accompagnement des femmes enceintes ?
Le diagnostic prénatal (DPN) recouvre les pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité, selon les termes de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique, à travers plusieurs explorations effectuées pendant la grossesse (imagerie, analyses biologiques, tests cytogénétiques et biochimiques). À la différence du diagnostic préimplantatoire (DPI), le DPN n’est pas réservé aux maladies génétiques transmissibles.
La synthèse des données statistiques de 2005 a conduit Mme Stoppa-Lyonnet, chef du service de génétique oncologique de l’Institut Curie, qui a animé en 2007 un groupe de travail sur le dépistage des formes héréditaires de cancer à la demande de l’Institut national du cancer et l’Agence de la biomédecine, à dresser le bilan suivant : « Les maladies les plus fréquentes sont des maladies neuromusculaires avec des manifestations apparaissant dans l’enfance (amyotrophie spinale, myopathie de Duchenne, certaines maladies de Steinert : ~ 25 %), la mucoviscidose (~ 20 %), des maladies neuromusculaires et/ou mentales dont les manifestations sont retardées (myopathie de Becker, maladie de Charcot-Marie-Tooth, X fragile, maladie de Huntington : ~ 17 %), des maladies hématologiques (drépanocytose, thalassémie, hémophilie : ~ 14 %). Enfin, un ensemble non détaillé de différentes maladies (~ 24%) comprenant en particulier les maladies du métabolisme et certaines formes héréditaires de cancers de l’enfant. » (434)
Les questions éthiques soulevées par le développement de ces tests, qui peuvent conduire à une interruption de grossesse, nécessitent d’apporter certains aménagements à une réglementation globalement satisfaisante, en vue notamment de prévenir des risques de dérives eugénistes.
1. Les questions éthiques soulevées par le diagnostic prénatal
L’exploration prénatale la plus pratiquée est l’imagerie par échographie. Sur le plan biologique, le diagnostic prénatal se rapporte à des prélèvements soit sur le fœtus ou ses annexes (liquide amniotique, villosité choriale, sang fœtal), soit sur le sang de la mère. Les techniques d’analyse employées sont la cytogénétique (pour l’étude du nombre et de la forme des chromosomes), la génétique moléculaire (pour les études de l’ADN fœtal) et toutes les autres disciplines biologiques (hématologie, immunologie, maladies infectieuses, biochimie fœtale) qui mettent en évidence une pathologie fœtale.
La loi définit précisément les conditions de mise en œuvre du DPN.
Pour les examens autres que l’échographie, le DPN doit être précédé d’une consultation médicale adaptée à l’affection recherchée, sans toutefois que l’article L. 2131-1 précité définissant le DPN n’indique les objectifs de cette consultation. Au niveau réglementaire, l’article R. 2131-2 du même code précise néanmoins que la consultation a plusieurs objets : elle doit permettre d’évaluer le risque pour l’enfant à naître d’être atteint d’une maladie d’une particulière gravité compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse; elle doit servir à informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, sur les moyens de la détecter, sur les possibilités thérapeutiques, sur les résultats susceptibles d’être obtenus au cours de l’analyse ainsi que sur leurs éventuelles conséquences. Elle a vocation à l’informer également sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences.
En outre, les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d’établir un DPN ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés par l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH), après avis de l’ABM et du Comité régional de l’organisation sanitaire, dans les conditions définies par le code de la santé publique. Pour ces analyses, les praticiens sont agréés individuellement par l’ABM (article L. 2131-4-2 du même code), la question de l’opportunité de cet agrément individuel pouvant être soulevée (cf. supra).
NOMBRE DE STRUCTURES AUTORISÉES POUR LE DPN AU 31 DÉCEMBRE 2008
Laboratoires autorisés pour une ou plusieurs activités biologiques de diagnostic prénatal |
123 |
Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) |
48 |
Centres de diagnostic préimplantatoire (CDPI) |
3 |
Source : Agence de la biomédecine (juillet 2009)
Par ailleurs, l’article R. 2131-1-1 du même code prévoit que les pratiques médicales concourant au DPN, y compris l’utilisation des techniques d’imagerie, sont soumises à des règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), tenant compte des recommandations de la Haute Autorité de santé. Lancée en 2007, la rédaction de recommandations professionnelles pour le fonctionnement des CPDPN a été finalisée en 2008.
RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL EN 2007 | |||
Techniques d’analyse |
Nombre de laboratoires autorisés |
Nombre de fœtus étudiés |
Nombre de diagnostics positifs |
Cytogénétique |
74 |
94 375 |
4 100 |
Génétique moléculaire |
45 |
2 881 |
510 |
Biologie infectieuse · Parasitologie seule · Virologie seule · Parasitologie et virologie |
47 18 23 6 |
1 414 5 029
|
175 158
|
Hématologie |
2 |
1 |
0 |
Immunologie |
2 |
2 |
0 |
Biochimie fœtale · Maladies héréditaires · Hormonologie · Défaut de fermeture du tube neural |
32 9 5 24 |
169 59 8 856 |
48 39 217 |
Marqueurs sériques |
77 |
665 054a |
514b |
(a) Nombre de femmes testées (b) Nombre de trisomies 21 diagnostiquées | |||
Source : Agence de la biomédecine
La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est soumise à autorisation de l’Agence de la biomédecine. Les établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités de DPN et les CPDPN sont tenus de présenter à l’ARH et à l’Agence de la biomédecine un rapport annuel d’activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les CPDPN réunissent des équipes pluridisciplinaires constituées de gynécologues obstétriciens, échographistes, pédiatres, généticiens, psychiatres ou psychologues, foetopathologistes et conseillers en génétique. Plusieurs missions leurs sont conférées. Ils sont chargés de confirmer ou non les indications d’interruption de grossesse pour motif médical et de diagnostic préimplantatoire (DPI) ; de favoriser l’accès aux activités de DPN ; d’assurer leur mise en œuvre par la constitution d’un pôle de compétences cliniques et biologiques (pour les patients et les praticiens) ; de délivrer des avis et conseils (en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic) aux cliniciens et biologistes en cas de suspicion d’affection d’un embryon ou d’un fœtus ; d’assurer la formation théorique et pratique des praticiens.
Les CPDPN ont également pour fonction de confirmer ou non les indications de grossesse. En effet, l’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment de la gestation, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (article L. 2213-1 du code de la santé publique). Dans ce dernier cas, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un CPDPN.
b) Le développement de techniques de diagnostics conduit-il à un eugénisme déguisé ?
Le DPN permet une meilleure connaissance de l’état de santé de l’enfant à naître. Il apporte l’information nécessaire à la mise en œuvre de thérapies, en particulier dans le domaine de la médecine et de la chirurgie fœtales ou postnatales.
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DES CPDPN DE 2005 À 2007 | |||
|
2005 |
2006 |
2007 |
Nombre de dossiers examinés |
25 022 |
24 389 |
28 292 |
Nombre d’attestations délivrées en vue d’une IMG |
6 093 |
6 790 |
6 645 |
Nombre de refus d’autorisation d’IMG |
106 |
122 |
112 |
Nombre de grossesses poursuivies avec une pathologie qui aurait pu faire autoriser une IMG |
406 |
402 |
475 |
Source : Agence de la biomédecine
Toutefois, les progrès que connaissent les techniques de DPN sont plus rapides que ceux des thérapies. Il en résulte que parmi les anomalies ou malformations décelables in utero, peu fréquentes sont celles qui peuvent bénéficier d’un traitement en l’état actuel des connaissances. Un diagnostic sur un enfant « à naître » amène ainsi le plus souvent à une décision de poursuite ou non de la grossesse. Le CCNE a reconnu très tôt, dans un avis rendu en 1985 (435), que ce lien est à l’origine des problèmes éthiques majeurs qui se posent en matière de DPN, en soulignant que « l’application du diagnostic prénatal des anomalies génétiques du fœtus est (…) étroitement liée aux problèmes moraux posés par l’interruption de grossesse » et que « la décision à prendre, c’est-à-dire le choix entre l’interruption volontaire de grossesse et la naissance d’un enfant plus ou moins profondément handicapé, met en cause la conception que chacun se fait de la vie et de la personne humaine. »
● Peut-on parler de pratiques eugénistes ?
L’article 16-4 du code civil dispose que « toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. ». Les sanctions pénales sont particulièrement lourdes : trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende (article 214-1 du code pénal).
Selon le Conseil d’État, l’eugénisme défini comme « l’ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l’espèce humaine » peut être l’effet de deux types d’action. Il peut, d’une part, « être le fruit d’une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. » Il peut être, d’autre part, « le résultat collectif d’une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents, dans une société où primerait la recherche de l’enfant parfait, ou du moins indemne ».
Si le premier risque est à écarter, le second a été évoqué par plusieurs intervenants, en particulier au regard des moyens employés pour procéder au dépistage de la trisomie 21. En France, 92 % des cas de trisomie sont détectés, contre 70 % en moyenne européenne, et 96 % des cas ainsi identifiés donnent lieu à une interruption de grossesse.
M. Jean-Marie Le Méné (436) a dénoncé un « système français de dépistage, unique au monde, qui aboutit à une forme d’eugénisme. Il s’agit d’un choix collectif qui entraîne des décisions individuelles, et non l’inverse. C’est l’offre d’État qui, de fait, crée la demande. »
Mme Chantal Lebatard, administratrice de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), a indiqué (437) redouter, en matière de DPN, « le glissement insidieux, sinon vers le refus de l’accueil de l’enfant différent ou malade, du moins vers l’idée d’une impossibilité induite d’accueillir l’annonce d’un enfant différent ou malade, en tout cas non conforme à l’enfant idéal attendu. Cette difficulté conduit à une société du refus du risque de l’engendrement, comme si l’on pouvait imaginer « l’enfant qualité zéro défaut ». Cette espèce d’induction sociale est gênante, mais toutes les pratiques – comme le dépistage échographique systématique, celui de la trisomie 21 par les marqueurs sériques, etc. – y conduisent et peuvent induire une banalisation et un oubli des enjeux. »
Le recul du délai légal d’IVG à 14 semaines d’aménorrhée alors que des échographies très performantes peuvent être réalisées dès la 12ème semaine semblerait avoir suscité des cas contestables d’interruption de grossesse. Mme Sylvie Manouvrier-Hanu (438) a ainsi relaté l’exemple suivant : « après la découverte à l’échographie pratiquée à 12 semaines qu’il manquait une main à un fœtus, pathologie isolée qui se prend très bien en charge par une prothèse – nous avons même une consultation multidisciplinaire associant généticiens et praticiens de rééducation fonctionnelle où nous expliquons aux couples toutes les possibilités d’appareillage pour les malformations des membres –, nous avons rappelé 48 heures plus tard le couple pour lui fixer un rendez-vous de consultation multidisciplinaire : la mère nous a dit que « son problème était résolu ». Il est clair que, se trouvant encore dans le délai légal, elle avait décidé de recourir à une IVG. »
Le récent arrêté (439) pris par le ministère de la santé qui ouvre la possibilité de procéder au dépistage de la trisomie 21 dès le premier trimestre de grossesse n’aurait fait qu’aggraver cette tendance et les considérations de santé publique liées aux risques de fausse couche que présente l’amniocentèse, invoquées à cette occasion ne seraient pas convaincantes selon M. Jean-Marie Le Méné : « Pratiquer des examens de dépistage plus tôt ne fera qu’anticiper le problème. Le dépistage n’est qu’un calcul de risques. Si le risque est faible, il n’écartera pas totalement la possibilité pour l’enfant d’être atteint. Si le risque est élevé, il faudra quand même procéder à la confirmation diagnostique par un prélèvement. Il sera alors proposé, l’amniocentèse étant impossible à ce stade précoce, de recourir à la choriocentèse – biopsie du trophoblaste –, qui induit un taux de pertes fœtales 1,5 à 2 fois plus élevé. La baisse escomptée du nombre des amniocentèses sera compensée par l’augmentation de celui des choriocentèses et le nombre de grossesses perdues sera le même. Le gain en fiabilité n’est donc pas avéré. »
Pratiquées dans les délais qui permettent une interruption volontaire de grossesse, ces analyses sont portées à la connaissance des personnes concernées en dehors du cadre des CPDPN. La promotion d’un système performant de dépistage aurait ainsi un effet incitatif sur la volonté des mères en induisant des décisions allant presque toutes dans le sens d’une interruption de grossesse en cas de risque avéré. Le développement rapide des tests génétiques et leur capacité croissante de criblage pourraient renforcer cette tendance en rendant possible le diagnostic d’un nombre plus grand de pathologies.
Par ailleurs, la multiplication des tests génétiques de susceptibilité portant sur des maladies multifactorielles et la mise à disposition sur Internet de tests tels que ceux destinés à identifier le sexe de l’enfant ajouteront encore à la confusion des valeurs en parachevant le projet d’obtenir l’enfant correspondant aux désirs du couple.
● Le désir naturel d’avoir un enfant qui ne soit pas en mauvaise santé
Le risque d’une pente glissante doit toujours être envisagé. C’est pourquoi la mission propose diverses mesures pour mieux réguler l’usage des tests génétiques (cf. infra).
Cependant, l’ensemble des arguments tendant à soupçonner dans les pratiques actuelles d’AMP un eugénisme dissimulé paraît fondé sur une mauvaise appréciation de la nature du projet parental qui conduit à surestimer les ambitions du couple. Le désir d’enfant s’autorégule lui-même : entre désirer l’enfant idéal et désirer un enfant à tout prix, les couples engagés dans le lourd processus d’AMP cherchent naturellement la voie moyenne. Une décision d’avorter suite à un test révélant un risque grave de maladie n’est pas prise en considération d’un idéal d’enfant mais dans le souci de réduire, dans la mesure des connaissances, l’éventualité de créer une situation de détresse – processus de décision consistant non pas à rechercher le meilleur mais à éviter le pire.
En ce sens, la réalisation de plus en plus précoce d’analyses de DPN a moins pour but de maîtriser le processus de gestation que de donner à la femme enceinte la possibilité de faire des choix moins tardifs et donc moins traumatisants. On rappellera que, dans le cas du dépistage de la trisomie 21, le taux actuel d’amniocentèse est de 11 %. Selon une évaluation du ministère de la santé (440), ce taux devrait passer à moins de 5 % grâce à un dépistage plus précoce.
Dans la pratique, le recours aux IMG demeure d’ailleurs limité. 6 441 attestations de gravité autorisant une interruption de grossesse pour motif médical ont été délivrées par les CPDPN en 2005(441). La même année, plus de 400 couples ont décidé de poursuivre la grossesse malgré l’attestation établie par le CDPPN indiquant que le fœtus était porteur d’une affection d’une particulière gravité.
On citera également le cas des DPN réalisés pour déterminer des risques cancéreux. Leur légitimité a pu être contestée, en particulier dans le cadre de DPI (cf infra). Mais les chiffres indiquent qu’en moyenne seulement 22 DPN pour ce type de risque sont réalisés annuellement (442). Selon le rapport précité de Mme Stoppa-Lyonnet, « Ce sont des situations où le risque de cancer ou de tumeur bénigne [mais de localisation cérébrale (NF2)] est élevé chez les enfants et les jeunes adultes. Dans ces situations, les interventions thérapeutiques ou préventives sont limitées et très invalidantes (…). Si on retient que, du fait du mode de transmission dominant, un DPN conduit dans 50 % des cas au diagnostic d’un fœtus atteint (ce qui est une estimation maximale car dans certains cas le risque d’atteinte du fœtus est moindre) et que ces diagnostics positifs ont conduit à une IMG, on peut retenir qu’une dizaine d’IMG sont réalisées annuellement dans un contexte isolé de formes héréditaires de cancers. »
Enfin les praticiens savent que le recours aux techniques de DPN laisse toujours une part d’incertitude. Ainsi, en matière de tests génétiques, comme l’a expliqué la Fédération française de génétique humaine, un test présentant une fiabilité de 99,9 % « engendrerait un faux positif tous les 1 000 tests. Si ce test était utilisé en France pour le dépistage et proposé à toutes les femmes enceintes (800 000) par an, il conduirait annuellement à 800 faux positifs pour lesquelles les grossesses risqueraient d’être interrompues. Ce chiffre de 800 interruptions non justifiées de grossesse est à multiplier par autant de maladies pour lesquelles on testerait la prédisposition ». Un raisonnement analogue peut être développé pour les faux négatifs.
Dans le cas des échographies, 40 % des malformations ne sont pas dépistées et l’expérience montre, selon l’expression utilisée par les professionnels, que « ce qui est vu à l’échographie est le minimum de ce qui existe. »
L’état des connaissances et la complexité du phénomène vivant renvoient ainsi au rang du mythe ou du fantasme l’idée d’une maîtrise démiurgique de la vie. Considérer que relèvent de l’eugénisme les choix que sont amenées à faire les mères recourant à des pratiques d’AMP constitue en outre une méprise sur le sens des actions médicales auxquelles il est procédé dans ce cadre. Mme Corinne Pelluchon a ainsi estimé que le concept d’eugénisme « devrait être réservé à l’eugénisme étatique, lequel désigne la volonté de purifier la race humaine et renvoie à des mesures violentes. Parler d’eugénisme libéral, comme l’ont fait Jürgen Habermas ou Jacques Testard, ne m’apparaît pas tout à fait juste, car les individus n’ont pas pour volonté d’améliorer l’espèce humaine. Ils redoutent simplement que leur enfant handicapé soit malheureux et craignent d’être incapables de l’élever. Ils ne sont donc pas eugénistes, mais ils adhèrent parfois à une vision normalisatrice de la vie humaine et en ont peut-être des représentations aliénées, déterminées par des valeurs de compétitivité et de performance. »
Dans cette perspective, il convient que les dispositions législatives encadrant les pratiques d’AMP garantissent que la mère bénéficie de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions qui ne soient pas la conséquence d’une incitation ou l’effet d’une représentation sociale mais un choix libre et raisonné.
2. Renforcer l’information et l’accompagnement des femmes
Comme l’a souligné M. Axel Kahn, lors du forum organisé à Strasbourg le 16 juin 2009 dans le cadre des États généraux de la bioéthique (443), lorsqu’une femme est enceinte d’un enfant atteint d’une maladie d’une particulière gravité, « personne n’est plus justifié que la femme à déterminer ce qu’il convient de faire. Pour qu’elle puisse décider ce qu’il convient de faire, pour qu’elle puisse déterminer ce qu’elle croit être la voie bonne, elle doit être informée. (…) La société a un devoir, si elle reconnaît cette liberté de la femme : celui de l’accompagner quelle que soit sa décision. »
Les citoyens du forum de Marseille ont déploré que les informations données à la femme enceinte soient insuffisantes et ont souhaité que son accompagnement soit amélioré. Plusieurs modifications au dispositif actuel pourraient contribuer à cet objectif.
a) Préciser les mesures d’accompagnement et de soins
L’article L. 2131-1 du code de la santé publique prévoit que le DPN doit être précédé d’une consultation médicale adaptée à l’affection recherchée. L’article R. 2131-2 du même code précise que l’information délivrée à cette occasion à la femme enceinte porte en particulier sur les caractéristiques de la maladie qui fait l’objet du diagnostic, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d’être obtenus au cours de l’analyse ainsi que sur leurs éventuelles conséquences.
Si la communication des résultats du diagnostic établi en vue d’une éventuelle IMG fait l’objet de règles de bonne pratique que l’ABM a définies en 2009 sous forme de recommandations professionnelles à l’attention des CPDPN, il n’y a pas de dispositions législatives encadrant les conditions dans lesquelles doit se faire la bonne information de la femme enceinte qui prend connaissance des résultats du diagnostic (444). Afin que celle-ci prenne une décision éclairée, il pourrait être proposé, comme le suggère le Conseil d’État, de préciser la loi sur ce point. Serait ainsi imposé au médecin prescripteur, un devoir d’information, d’une part, et d’orientation vers une prise en charge adaptée, d’autre part, au cas où un traitement serait envisageable pour le fœtus ou l’enfant né. Le fait que tous les éléments d’information doivent été proposés à la femme enceinte garantit l’autonomie de sa décision et assure que ni une décision d’arrêt de grossesse ni une décision de poursuite de traitement ne doivent a priori être favorisées.
Proposition n° 21. Prévoir que le médecin qui porte à la connaissance de la femme enceinte le résultat d’analyses effectuées dans le but de poser un diagnostic prénatal donne à celle-ci toute information nécessaire à leur compréhension et l’oriente, le cas échéant, vers une prise en charge adaptée, notamment en vue d’apporter un traitement au fœtus ou à l’enfant né. (Cela impliquerait de compléter le premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique)
Mme Chantal Lebatard (445) a insisté par ailleurs sur l’importance de l’accompagnement de la femme enceinte qui doit affronter cette situation : « l’information doit être renforcée vis-à-vis des couples et des femmes – y compris par des rencontres avec des associations de parents d’enfants malades – afin de permettre aux familles un véritable libre choix, et non une induction dans un climat d’angoisse, de stress terrible et de souffrance. Nous demandons également le renforcement de l’accompagnement avant, pendant et après la décision prise suite à un diagnostic prénatal, car les parents – quelle que soit la décision – se retrouvent souvent seuls et livrés à une souffrance qu’ils n’arrivent pas facilement à gérer. »
Les participants au forum de Marseille se sont déclarés attachés à ce que chaque couple confronté à un diagnostic de maladie puisse bénéficier de l’accompagnement, du soutien et du suivi d’un psychologue, dès l’annonce du diagnostic par le médecin, ce qui semble ne pas être toujours le cas, bien que la présence de ce professionnel au sein des CPDPN soit requise par l’article R. 2131-12 du code de la santé publique.
Pour évaluer la réalité de ce suivi dans les 48 CPDPN, il pourrait être demandé à l’ABM de procéder à une enquête sur ce point.
Proposition n° 22. Faire évaluer par l’ABM les dispositions mises en œuvre pour assurer le suivi psychologique des femmes prises en charge par les CPDPN.
b) Mieux accompagner les femmes prenant connaissance de tests effectués au cours du premier trimestre de grossesse
Alors que les analyses des caractéristiques du fœtus tendent à devenir de plus en plus précoces, sans que ni le diagnostic ni le pronostic des anomalies détectées ne soient toujours confirmés, la question de l’information de la femme enceinte, dès le début de sa grossesse, apparaît essentielle.
En particulier, comme le souligne le CCNE dans son avis n° 107 (446), de nouveaux problèmes éthiques pourraient naître de la conjugaison de plusieurs facteurs : l’accessibilité de l’ADN fœtal circulant dans le sang de la femme enceinte, la conception de marqueurs génétiques de maladies dont la validité clinique n’est pas toujours établie et l’offre de ces tests sur Internet par des sociétés commerciales.
Les perspectives d’un diagnostic prénatal très précoce présentent certes l’avantage d’éviter des gestes invasifs mais aussi le risque de conduire à une interruption volontaire de grossesse en cas de moindre doute par des couples non accompagnés. En particulier, la nature « probabiliste » des informations données par les tests génétiques, par exemple pour des prédispositions à des maladies tardives, risque de susciter une inquiétude liée à la délivrance de multiples pronostics à la probabilité difficile à appréhender.
Dans son étude précitée sur la révision des lois de bioéthique, le Conseil d’État propose « de renforcer l’information et l’accompagnement de la femme lorsque les analyses fœtales à partir de prélèvements sur le sang maternel, effectuées au cours du premier trimestre sont susceptibles, après confirmation diagnostique, de conduire à des interruptions de grossesse motivées par des raisons médicales, intervenant dans le délai légal de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). » À cet effet, il pourrait être précisé dans la loi que la femme enceinte peut s’adresser à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN), lorsque sa demande est motivée par des raisons tenant à la santé de l’enfant à naître (447).
La femme enceinte bénéficierait ainsi des compétences propres aux CPDPN. Elle recevrait des conseils médicaux prodigués par une équipe pluridisciplinaire et bénéficierait d’un accompagnement psychologique, afin de pouvoir prendre sa décision en toute connaissance de cause. Il convient à cet égard de rappeler que les missions des CPDPN, définies par l’article R. 2131-10-1 du code de la santé publique, comportent déjà un rôle de conseil mais uniquement à l’égard des cliniciens et biologistes.
L’accès à ces centres devrait être possible sans délai dans le cas où la femme enceinte peut demander le bénéfice d’une IVG.
Proposition n° 23. Prévoir que lorsqu’il existe un risque que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, la femme enceinte est reçue, à sa demande, par un ou plusieurs membres d’un CPDPN pour être informée sur les caractéristiques de cette affection, des moyens de la détecter et des possibilités de prévention ou de soin. Lorsque la demande intervient dans un délai compatible avec l’interruption volontaire de grossesse, la femme enceinte est reçue avant le terme de ce délai par le CPDPN (Cela impliquerait de compléter par un nouvel alinéa l’article L. 2131-1 du code de la santé publique).
c) Mieux encadrer les activités d’échographie fœtale et améliorer l’information des femmes sur ces examens
Depuis 1975, l’échographie obstétricale permet de donner des images du fœtus suffisamment fines pour autoriser le dépistage de certaines malformations ou troubles du développement. Les moyens technologiques d’imagerie n’ont depuis lors pas cessé de s’affiner et offrent la possibilité d’exercer une surveillance étroite de l’embryon dès les premières semaines et le suivi de son développement jusqu’à la naissance de l’enfant.
Si l’imagerie par échographie est devenue l’exploration prénatale la plus pratiquée, cette technique n’est cependant pas réglementée comme les autres explorations prénatales, biologiques et génétiques. Se pose également la question de la formation des professionnels pratiquant ces échographies.
• La question de la formation des professionnels
Les participants au forum des états généraux de Marseille ont jugé « souhaitable que la formation d’échographe soit validée par l’obtention d’un diplôme d’État afin d’assurer une meilleure qualité des diagnostics. »
Selon les informations communiquées par le ministère de la santé, la profession d’échographe n’existe pas en tant que telle, même si pour certains praticiens elle apparaît comme l’essentiel de leur activité. Les échographies peuvent être réalisées par des médecins relevant de plusieurs spécialités médicales. La spécialité de référence est celle de « radiodiagnostique et d’imagerie médicale » (anciennement appelée radiologie) réservée aux titulaires du diplôme d’études spécialisées (DES), diplôme universitaire acquis durant le troisième cycle des études médicales et d’une durée de cinq ans. Les titulaires de cette spécialité peuvent pratiquer les échographies dans toutes les disciplines médicales. Les échographies peuvent également être réalisées par des médecins appartenant à d’autres spécialités mais uniquement dans le champ de leur spécialité : gynécologie-obstétrique, cardiologie, médecine nucléaire, urologie par exemple. Les sages-femmes peuvent également pratiquer l’échographie obstétricale.
Outre la formation de base en échographie pouvant être acquise au cours du DES de la spécialité ou des études de sages-femmes, il existe des diplômes universitaires de formation dans ce domaine. Pour l’échographie générale, il s’agit du diplôme d’études interuniversitaire (DIU) d’échographie dont l’enseignement théorique et pratique est dispensé dans de nombreuses universités en France. Il comprend un tronc commun général ainsi des modules spécialisés (il existe ainsi un module d’échographie obstétricale). Par ailleurs, il existe un DIU d’échographie gynécologique et obstétricale accessible aux médecins et aux sages-femmes. Il ne s’agit pas de diplômes nationaux mais de diplômes universitaires dont les programmes sont certes harmonisés dans les différentes universités mais dont le contenu peut légèrement varier d’une université à une autre. Selon le ministère de la santé, la formation en échographie pourrait être envisagée dans l’avenir sous la forme d’un diplôme national encadré par le ministère de l’enseignement supérieur, avec le risque qu’il soit peu adapté à la demande de spécialistes souhaitant une formation uniquement dans leur champ de compétences.
Il convient par ailleurs de rappeler que les diplômes précités ne sont pas obligatoires en général pour exercer l’échographie, sauf pour certaines activités prénatales comme la mesure de la clarté nucale pour le calcul du risque de trisomie 21, conformément à l’arrêté du 23 juin 2009 (448). En outre, si la formation initiale en échographie est évidemment importante pour assurer la qualité des échographies, le nombre d’actes pratiqués, l’évaluation et la formation continue ainsi que la qualité des matériels utilisés sont également essentiels. Le Comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal placé auprès de la ministre de la santé contribue à faire avancer la réflexion sur les règles de bonnes pratiques et l’information du public.
Sans encadrer excessivement cette technique très répandue dans tous les champs de la médecine, il serait opportun, selon le ministère de la santé, de soumettre à des critères relatifs à la formation ou à la pratique de professionnels certaines échographies considérées comme sensibles, comme cela vient d’être fait pour la mesure de la clarté nucale pendant la grossesse (449).
• L’encadrement de l’échographie fœtale
Si l’échographie fœtale est devenue le premier moyen utilisé pour le diagnostic prénatal, la loi ne réglemente pas l’échographie fœtale comme les autres explorations prénatales. Elle n’est ainsi pas visée à l’article R. 2131-1 du code de la santé publique qui dresse la liste des analyses rentrant dans le champ du DPN. De ce fait, comme le souligne l’Agence de la biomédecine dans son rapport précité d’octobre 2008, « cette technique n’entre pas dans les domaines de compétences de l’Agence de la biomédecine, notamment en termes d’encadrement et d’évaluation », même si aux termes de l’article R. 2131-1-1 les techniques d’imagerie sont soumises à des règles de bonne pratique. L’agence a dès lors évoqué la possibilité que l’imagerie fœtale par échographie puisse être encadrée comme le sont les autres types d’explorations prénatales.
En effet, quelle que soit la nature du diagnostic effectué (biologique ou par échographie), les enjeux et les conséquences de la découverte d’une pathologie sont analogues pour la femme. Ainsi, selon l’Agence de la biomédecine, les explorations sonographiques étaient impliquées en 2007 dans près des deux tiers des décisions d’interruption de grossesse pour motif médical (61 %). Pourrait-on dès lors envisager que l’encadrement de l’échographie, lorsqu’elle entre dans une démarche de diagnostic prénatal, soit rapproché de celui prévu pour les explorations à caractère biologique (informations préalables, consentements explicites, discussions multidisciplinaires) ?
De manière plus générale, les citoyens du forum de Marseille ont par ailleurs regretté « le déficit d’informations données à la future mère sur le caractère obligatoire ou non des différents examens prénataux ».
Une étude réalisée par l’INSERM (450) révèle que la plupart des femmes ne sont pas conscientes des implications possibles du dépistage de la trisomie 21 ou ne les comprennent pas. Environ 40 % des femmes interrogées au cours de cette enquête qui ont eu une échographie et un dosage sanguin ignoraient que les résultats d’une échographie ou d’un dosage sanguin pouvaient les confronter à un moment donné à la décision de ne pas poursuivre leur grossesse. Plus de la moitié d’entre elles n’avaient pas pensé au fait que le dépistage pouvait aboutir à une amniocentèse et environ un tiers ne comprenait pas les résultats du dosage sanguin.
La distinction entre les analyses destinées à procéder à un dépistage et conduisant à une évaluation du risque et celles dont la finalité est d’établir un diagnostic devrait également faire l’objet d’explications accessibles à tous.
Proposition n° 24. Renforcer l’information de la femme enceinte sur les échographies prénatales par des personnels formés à cet effet.
Préciser les critères relatifs à la formation et aux pratiques des professionnels procédant à ces échographies.
3. Renforcer la recherche sur les maladies détectées à l’occasion d’un DPN et améliorer la prise en charge du handicap
Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, les citoyens du panel de Marseille ont indiqué appréhender le DPN ainsi d’ailleurs que le DPI comme un correctif individuel et non comme un outil de sélection collective, au service d’une idéologie eugéniste, en estimant que « la société est garante de la protection, du bien être et de l’intégration des personnes handicapées, et ce durant toute leur vie. Pour cela, l’État doit assumer cette mission, en mettant en place les structures et les financements nécessaires. » Les participants ont également considéré que « la solution au handicap passe exclusivement par la recherche sur les maladies et non par l’élimination. Le rappel de ces gardes fous nous semble utile pour préserver le principe de respect de la diversité humaine. »
Dans le même sens, Mme Chantal Lebatard (451), administratrice de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), a souligné la nécessité de « soutenir la recherche pour des progrès thérapeutiques car, on l’oublie, la recherche d’un certain nombre d’outils de diagnostic progresse très vite par rapport à celle concernant les progrès thérapeutiques ; il serait bon de veiller à un rééquilibrage des moyens. »
À cet égard, M. Jean-Marie Le Méné (452), président de la fondation Jérôme Lejeune, a relevé qu’« en 1997, M. Jean-François Mattei avait, dans son rapport sur la généralisation du dépistage de la trisomie 21, prévu deux garde-fous à l’eugénisme ». Ceux-ci tenaient au fait que les femmes puissent donner un consentement éclairé et à ce qu’« un effort de recherche à visée thérapeutique équivalent à l’effort de dépistage devait être consenti « sauf à croire que le choix est fait de l’élimination plutôt que de la compréhension des causes de l’affection dans le but de mieux prévenir ». La France n’a développé aucune politique publique de recherche à visée thérapeutique et seule la Fondation Jérôme Lejeune organise et finance ces programmes, à partir de dons privés. »
Il convient également de rappeler que dès 1999 (453), le Conseil d’État avait insisté sur la nécessité de mettre l’accent sur « l’objectif avant tout curatif » des diagnostics anténatals, en suggérant à cette fin aux pouvoirs publics d’inciter les grands instituts de recherche et les structures hospitalières à faire de la médecine fœtale et embryonnaire une des priorités de leurs activités .
Proposition n° 25. Renforcer les recherches sur les maladies particulièrement graves détectées sur l’embryon ou le fœtus in utero et poursuivre les actions visant à améliorer la prise en charge des personnes handicapées.
B. LE DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE (DPI)
Quelques années avant que ne soit autorisé en France le diagnostic préimplantatoire (DPI) en 1986, dans L’œuf transparent, le professeur Jacques Testart alertait l’opinion publique sur les risques de dérives liées à « la rencontre de la médecine prédictive avec la médecine procréative ». En effet, le DPI recèle par nature des risques de dérives eugénistes, puisqu’il consiste à déterminer les caractéristiques d’embryons conçus in vitro en vue d’éclairer une décision de transfert in utero, ce qui revient à sélectionner les embryons susceptibles d’être implantés en vue d’une grossesse.
Le législateur est en droit de se demander si l’encadrement actuel présente des garanties éthiques suffisamment solides pour prévenir des risques de dérives eugénistes et si, le cas échéant, la réglementation en vigueur et ses modalités d’application pourraient être améliorées.
1. Peut-on envisager une extension des indications du DPI ?
Autorisé en France depuis les lois de 1994 (454), le diagnostic préimplantatoire (DPI) requiert une FIV. Il est réservé aux couples qui risquent de transmettre à l’enfant une maladie génétique particulièrement grave et incurable.
a) Maintenir l’encadrement actuel qui parait suffisant face à des risques de dérives
Le DPI, dont l’encadrement est plus strict que pour le DPN, est resté une pratique exceptionnelle, conformément aux intentions du législateur.
Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro n’est possible qu’à titre exceptionnel et sous des conditions très précises posées par l’article L. 2131-4 du code de la santé publique :
– le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;
– l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie doivent avoir été préalablement et précisément identifiées chez l’un des parents ou, depuis la loi de 2004, chez l’un de ses ascendants immédiats dans le cas d’une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital telle que la maladie de Huntington ;
– le DPI a pour seul objet de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, hormis le cas du DPI-HLA ou « bébé du double espoir » (cf. infra) ;
– un médecin du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) doit attester que les conditions exigées par la réglementation pour la réalisation du DPI sont réunies. Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. Le DPI ne peut être réalisé, sous certaines conditions, que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine, trois centres étant actuellement habilités (Paris, Montpellier et Strasbourg).
La particulière gravité de l’affection constitue donc la condition commune d’accès aux diagnostics prénatal et préimplantatoire. L’encadrement du DPI est cependant beaucoup plus rigoureux. En effet la maladie doit être incurable et avoir déjà atteint un membre de la famille. Il est ainsi exclu de procéder à un « tri » ou à une « sélection » d’embryons sur d’autres critères. Le profil des couples ayant accès au DPI est le suivant : des couples ayant eu recours à une IMG , des couples qui se savent à risque mais qui refusent une IMG ou des couples ayant un historique lié à des problèmes d’infertilité. Le processus de prise en charge de la demande de DPI peut être ancien s’il s’agit d’une maladie dominante dans la famille ou fortuit s’il s’agit d’une maladie récessive (455).
SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DE L’INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE DPI
La pratique en matière de DPI est plutôt libérale, les pays autorisant majoritairement le DPI et le DPI-HLA. En Belgique, le DPI-HLA est pratiqué sans critère de gravité ou d’incurabilité de la maladie. Le choix du sexe est interdit par la plupart des pays sauf aux États-Unis, où les centres le proposent, et en Israël où il est possible quand un couple a donné naissance à 4 enfants du même sexe. Le criblage génétique est pratiqué en Belgique et en Grande-Bretagne. En revanche, l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et la Suisse sont défavorables au DPI.
Source : Agence de la biomédecine
Si le DPI est présenté comme une forme très précoce du DPN, M. Stéphane Viville a rappelé la teneur de l’encadrement du DPI par rapport à celui du DPN. Il existe « une différence fondamentale entre le DPN et le DPI : le DPN est un test pratiqué in utero, à un moment où la grossesse a débuté, et de façon systématique puisque toutes les femmes enceintes, en France, ont droit à une échographie, première forme de DPN ; le DPI est un test ex utero, réservé en France à des couples avec des antécédents, et pratiqué avant que ne débute la grossesse. » Ce même praticien, responsable du centre de DPI du CHU de Strasbourg a expliqué que « la FIV a un double intérêt : obtenir des embryons en dehors de l’utérus, et les obtenir en grand nombre : quatre, cinq, six, sachant que le risque de transmission de ces maladies génétiques varie de un sur deux à un sur quatre – sur cinq ou six embryons, la probabilité est donc forte d’en avoir qui soient sains. Nous laissons ces embryons se développer jusqu’au stade de huit cellules, stade auquel on peut prélever une ou deux cellules sur un embryon sans risquer de l’endommager, pour réaliser une analyse génétique. Cette analyse nous permet de trier les embryons atteints de la pathologie et les embryons sains. Un ou deux embryons sains seront alors transférés chez la patiente. »
Selon les données recueillies par l’Agence de la biomédecine, 50 enfants sont nés suite au recours à un DPI en 2007, comme l’illustre le graphique présenté ci-après. Outre le caractère très strict et protecteur de l’encadrement actuel, ce chiffre s’explique par le fait que ce diagnostic reste une prouesse technique et que cette procédure est contraignante puisqu’elle exige une FIV et est très longue (456).
Mme Julie Steffann, praticien hospitalier dans le laboratoire de génétique médicale de l’hôpital Necker, responsable des activités de DPN et de DPI a fait valoir que « le DPI est en quelque sorte aux examens biologiques conventionnels ce que la haute couture est au prêt-à-porter. D’une très haute technicité, le diagnostic exige un très long travail, il est lourd à mettre en œuvre et coûte très cher, pour un résultat qui n’est pas toujours à la hauteur des espérances puisque les chances de ramener un bébé à la maison pour un couple s’engageant dans la démarche ne sont que de 17 %. »
TRANSFERTS D’EMBRYONS SUITE À UN DPI EN 2006 ET 2007
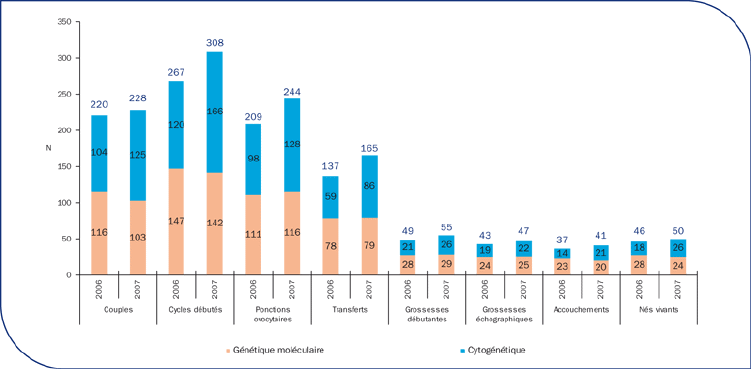
Source : Agence de la biomédecine
Le DPI peut présenter des risques de dérives qui soulèvent des interrogations éthiques, compte tenu notamment du progrès des connaissances et du champ des tests.
Il est un fait incontestable que la connaissance de l’état du fœtus est de plus en plus précoce puisqu’elle intervient, comme on l’a vu, entre 11 semaines et 13 semaines et 6 jours d’aménorrhée, l’interruption volontaire de grossesse étant permise à 14 semaines d’aménorrhée. Mais en même temps le dépistage de prédispositions génétiques ne saurait conduire à des interruptions volontaires de grossesse sans rapport avec l’état de santé de l’enfant à naître, pas plus qu’il ne saurait favoriser une forme d’eugénisme condamné par l’article 214-1 du code pénal.
Lorsque l’on constate que le choix du sexe de l’enfant est autorisé aux États-Unis et que le DPI est systématiquement proposé à toutes les femmes de plus de 35 ans recourant à une AMP au Royaume – Uni, ce risque de dérive n’est pas imaginaire. Le DPI a, par exemple, été sollicité pour prévenir la naissance d’un enfant atteint d’un strabisme ou encore par un couple de malentendants qui souhaitait avoir un enfant également malentendant. Non seulement ces usages du DPI constitueraient un dévoiement de la médecine mais pour reprendre l’expression du CCNE dans son avis n 107, ils seraient assimilables « à une ingénierie biologique ».
Lors de son audition, M. Jacques Testart a mis en garde les membres de la mission contre les effets à terme de la conjugaison du contrôle de la viabilité de l’œuf et de la recherche de tous ses caractères indésirables, dans la perspective de donner naissance à un œuf, qui serait à la fois « viable et normal » (457). Les nouvelles technologies d’étude du génome (puces à ADN) qui permettent d’étudier simultanément des milliers de paramètres génétiques ou celles visant à séquencer rapidement l’ensemble du génome (séquençage à haut débit) nourrissent également des interrogations éthiques en matière de diagnostic prénatal. Comme le relève le Conseil d’État : « la part d’incertitude qui s’attache au résultat d’un test génétique exprimé sous forme probabiliste place les intéressés devant le choix difficile de procéder à une interruption volontaire de grossesse si elle est encore possible alors même que la probabilité de réalisation du risque chez l’enfant resterait limitée. » (458) Dans une société qui éprouve toujours de la difficulté à accepter le handicap, les termes de ce débat ne sont pas neutres, l’appréciation de la gravité du handicap ne pouvant être ramenée à la capacité de la société à intégrer celui-ci.
Sans doute est-ce en raison des craintes suscitées par de tels risques de dérives que l’avis citoyen du panel de Marseille a proposé que la loi précise clairement que lors d’un DPI ne puisse être recherchée qu’une et une seule maladie.
Le débat sur le DPI se concentre aujourd’hui sur des questions d’ordre technique et éthique. Il s’agit d’apprécier les capacités de diagnostic des maladies héréditaires, d’évaluer l’opportunité de l’établissement d’une liste de maladies pouvant faire l’objet d’un DPI et de la détection de la trisomie 21 à l’occasion du DPI.
b) Apprécier les capacités de diagnostic des formes héréditaires de maladies
– Comment évaluer l’incurabilité de l’affection, s’agissant notamment de maladies à révélation tardive et de formes héréditaires de cancer ?
L’étude des formes familiales de cancer a conduit au cours de ces vingt dernières années, à l’identification de gènes dont les altérations constitutionnelles sont associées à un risque élevé de cette maladie. Un des cas classique auquel sont confrontées les équipes médicales est la demande de recherches BRCA 1 et BRCA 2 dont la mutation est à l’origine de certains cancers du sein. Toutefois l’échéance à laquelle la maladie peut se manifester est très incertaine et l’on ne saurait affirmer que l’embryon identifié comme responsable de la maladie est appelé à développer celle-ci. Comme le fait remarquer le CCNE dans son avis n° 107, il existe aujourd’hui un risque de majorer l’estimation de la gravité. Or cette appréhension de la gravité est loin d’être systématiquement fondée.
Mme Dominique Stoppa Lyonnet a rassuré la mission sur ces risques de dérive: « Il est apparu qu’une soixantaine de DPN sont en moyenne réalisés chaque année pour des maladies monogéniques à transmission dominante, c’est-à-dire pour lesquelles si l’un des deux membres du couple est porteur d’une mutation, le risque qu’il la transmette à un enfant est de 50 %. Statistiquement, une trentaine de fœtus sont donc atteints chaque année, pouvant conduire à une trentaine d’IMG. Sur ce nombre, environ vingt sont faites dans le cas de maladies conjuguant une pathologie donnée comme la sclérose tubéreuse de Bourneville et un risque accru de cancer, du rein en l’espèce, et environ dix dans des cas de prédispositions à un cancer. Il s’agit essentiellement de cancers se révélant dès l’enfance ou chez l’adulte jeune comme la polypose adénomateuse, les syndromes de von Hippel-Lindau ou Li-Fraumeni. Il n’y a donc aujourd’hui aucune dérive par rapport aux dispositions de la loi qui autorisent DPN, DPI et IMG pour des maladies d’une particulière gravité ».
– Faut-il pondérer la notion de gravité des affections justifiant un DPN ou un DPI par d’autres facteurs ?
Les différentes formes héréditaires de cancer sont analysées sur la base d’une combinaison de plusieurs paramètres de gravité et d’incurabilité afin de définir une typologie générique indicative des situations. La classification des formes héréditaires de cancer ne suffit pas cependant pour évaluer chaque situation particulière. C’est la raison pour laquelle M. Stephane Viville a plaidé au cours de son audition pour qu’il soit tenu compte de la perception qu’a le couple de la gravité de la pathologie dans la famille comme le font les Britanniques et de l’histoire médicale de celle-ci.
– À quel degré de diagnostic la recherche médicale est-elle arrivée aujourd’hui ?
M. Stéphane Viville n’a pas dissimulé le degré de développement des diagnostics auquel la médecine était désormais parvenue : « Nous avons atteint aujourd’hui une telle technicité dans le diagnostic sur cellule unique que, si nous en avons les moyens, le fait de devoir développer un nouveau diagnostic n’est pas une limitation dans la prise en charge du couple. Cela signifie que nous pouvons assurer une quasi égalité de traitement des patients, quelle que soit la pathologie, qu’il s’agisse de la mucoviscidose, la pathologie la plus fréquente dans la population caucasienne, ou de ce genre de pathologie, extrêmement rare, où l’on observe une mutation du gène de la protéine prion » (459). Ce praticien a précisé que pour une quarantaine de pathologies son équipe avait développé plus de 150 diagnostics. En revanche, les données de la génétique dont on dispose à l’heure actuelle ne sembleraient pas conférer un pouvoir important de diagnostic à des technologies comme celle du criblage (screening), sachant que celui-ci est au demeurant interdit .
Le risque de dérives ne pouvant pas être écarté, il est apparu que le cadre législatif actuel du DPI devait être maintenu. Il permet un examen au cas par cas des maladies et le paramètre de la « particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic » est suffisamment large pour être adapté aux situations en cause. Au surplus on comprendrait mal que pour des maladies génétiques une demande de DPI soit acceptée, alors qu’elle serait refusée pour une IMG. Lors de son audition, la Ministre de la santé et des sports, Mme Roselyne Bachelot a insisté sur le caractère exceptionnel de la procédure du DPI. : « Le DPI ne doit pas non plus, alors qu’il est l’exception, devenir la règle par un élargissement abusif de ses indications. (460) » S’agissant du problème de la détection de la trisomie 21, celui-ci mérite d’être traité à part (cf. infra.).
Votre rapporteur souhaite conserver le dispositif actuel d’encadrement du DPI, qui constitue un système de régulation rigoureux et adapté aux besoins.
c) Écarter l’idée de l’établissement d’une liste de maladies susceptibles de faire l’objet d’un diagnostic préimplantatoire
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques s’est prononcé dans son rapport pour l’établissement, à titre indicatif, d’une liste de maladies d’une particulière gravité (461). Le site Internet de la Haute autorité chargée de la régulation des activités d’assistance médicale à la procréation et à la recherche des embryologies (HFEA) enregistre 65 pathologies. Cette solution aurait pour elle l’avantage de permettre à un couple de choisir de ne pas avoir recours à l’AMP et de tenir compte de l’histoire familiale.
À l’inverse, une liste aurait pour effet de stigmatiser les malades porteurs des maladies figurant sur celle-ci et serait une source de discriminations comme le relève le CCNE dans son avis n° 107. On peut supposer au demeurant que patients et associations de malades vivraient très mal une telle identification des maladies, qui serait perçue comme une « norme », selon l’expression retenue par la Ministre chargée de la santé lors de son audition devant la mission. (462)
Par ailleurs, le contenu d’une liste apparaît toujours trop restrictif pour certains ou trop exhaustif pour d’autres et amène celle-ci à être révisée périodiquement, le risque étant in fine que cette liste soit extensible.
Enfin se pose la question de la légitimité de l’autorité à qui l’établissement de la liste serait confié. Est-ce aux médecins de le faire ? M. Jacques Testart a suggéré que si le législateur se ralliait à cette solution, « il reviendrait aux citoyens de contribuer effectivement à son élaboration. » (463)
Votre rapporteur s’est montré extrêmement réservé à l’idée de l’établissement de toute liste de maladies.
d) Envisager la possibilité de rechercher une trisomie 21 à l’occasion d’un diagnostic préimplantatoire
Aujourd’hui comme le rappelle le CCNE dans son avis n° 107, lorsque les femmes ont une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une affection grave et incurable, les médecins sont tenus dans le cadre du diagnostic prénatal à une obligation d’information de la mère, de l’existence du dépistage de la trisomie 21. Rien n’est imposé aux couples. 96 % des cas détectés font l’objet d’une interruption médicale de grossesse.
Plusieurs médecins ont soulevé la question de l’extension de ce dépistage dans le cadre du DPI.
M. Claude Sureau, membre du CCNE et professeur de gynécologie obstétrique s’est prononcé en faveur de cette extension (464) : « Ne serait-il pas légitime de dépister en même temps la trisomie 21 ? Dans la mesure où l’on accepte le DPI, sachant que celui-ci sera éventuellement suivi d’une ponction amniotique
– deux étapes qui ne sont pas sans danger – il me paraîtrait normal de procéder au dépistage de la trisomie 21 en même temps que celui de l’anomalie congénitale. »
De même, M. Stéphane Viville (465) a estimé que l’« on pourrait envisager la possibilité de rechercher aussi la trisomie 21. Nous recevons des couples qui ont dépassé les trente-cinq ans. Alors que nous pourrions techniquement le faire, dans certaines situations, nous n’avons pas le droit de rechercher cette trisomie 21. Or ces patients bénéficieront automatiquement par ailleurs d’un dépistage de la trisomie 21 qui sera remboursé par la sécurité sociale. »
Dans son avis n°107 précité, le CCNE s’est déclaré très réservé à l’idée de rechercher une anomalie chromosomique avant un transfert in utero dans le cadre d’une FIV classique motivée par une infertilité. Cela reviendrait en effet à franchir une frontière éthique. Cette limite tient au fait que le DPI est exclusivement réservé aux couples pour lesquels existe un risque élevé de donner naissance à un enfant porteur d’une maladie génétique grave et incurable, au regard d’antécédents médicaux.
Le comité a estimé cependant que l’interdiction de rechercher une trisomie 21 à l’occasion d’un DPI pour maladie génétique présente chez l’un des parents devrait être levée. Le dépistage de la trisomie 21 étant de toute façon proposé à la femme enceinte, le CCNE considère qu’il peut se faire plus en amont, à l’occasion d’un DPI. Cette autorité a fait valoir à cet effet que la finalité du DPI était de conduire à une grossesse qui, comme les autres, ferait l’objet d’un suivi et pourrait éventuellement donner lieu à une amniocentèse, voire à une interruption médicale de grossesse. Le DPI peut également éviter une fausse couche, risque que présente toute amniocentèse (466). Il peut empêcher enfin, et c’est même la vocation du DPI en cas d’affection héréditaire grave, l’épreuve toujours traumatisante de l’IMG. En cela il peut être envisagé comme une alternative à l’IMG. Il convient par ailleurs de rappeler que le DPI, à l’occasion duquel une trisomie peut être recherchée, demeure une pratique exceptionnelle : en 2007, 308 cycles d’AMP débutés pour 228 couples ont permis la naissance de 50 enfants suite à un DPI. Comme la probabilité d’avoir une trisomie 21 est d’1 cas pour 600 naissances, le dépistage de la trisomie 21 concernerait en réalité un enfant tous les 12 ans.
Craignant cependant que cet assouplissement ne conduise à modifier le sens de la pratique du DPI, plusieurs membres du CCNE n’ont pas souscrit à cette proposition. Pour ces membres la trisomie pourrait ne pas être la seule malformation recherchée, voire pourrait conduire, à terme, à son extension à toutes les procréations assistées, alors que l’interdit actuel constituerait une voie moyenne à laquelle ils ont estimé utile de se tenir.
Au regard de ces éléments, votre rapporteur estime que les dépistages effectués dans le cadre du DPN doivent pouvoir être réalisés également à l’occasion d’un DPI et dans les mêmes conditions que le DPN. Cependant pour maintenir au DPI sa spécificité tenant au caractère de la maladie détectée (mise en jeu du pronostic vital), il convient de prévoir que le dépistage de la trisomie 21 soit réalisé en complément de la recherche motivant le DPI. La prise en compte de l’âge de la femme pourrait être un critère déterminant.
La crainte que cette proposition ne se traduise par une stigmatisation de la trisomie 21 et qu’elle obéisse dans les faits à la logique de l’établissement d’une liste de maladies a conduit certains membres de la mission à exprimer leur réserve sur l’opportunité de cette recommandation.
Votre rapporteur fait cependant remarquer que les femmes demeurent libres de leur décision, que la fréquence de ce type d’anomalie dans le cadre d’un DPI est très faible, qu’en tout état de cause le dépistage sera proposé à la mère après le transfert de l’embryon et enfin que nul ne saurait contester qu’une telle procédure demeure moins traumatisante qu’une IMG.
Proposition n° 26. Maintenir l’encadrement actuel du DPI, et notamment l’absence de liste a priori des maladies susceptibles de faire l’objet de ce diagnostic.
Permettre qu’à la recherche d’une maladie génétique gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, identifiée dans la famille des parents de l’embryon, soit adjoint le dépistage de la trisomie 21. Cette recherche complémentaire pourrait être entreprise sous réserve de l’existence de facteurs prédisposant à cette anomalie génétique, comme l’âge de la femme, et dans les mêmes conditions que les dépistages effectués dans le cadre du DPN.
Certains membres de la mission ont exprimé leurs réserves sur l’opportunité de ce dépistage.
2. Comment renforcer le rôle des centres pluridisciplinaires ?
a) Conserver la composition des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et de DPI
Comme on l’a vu, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal sont des instances hospitalières d’expertise créées dans des établissements de santé à but non lucratif et autorisées par l’Agence de la biomédecine. Ils réunissent divers professionnels (obstétriciens, généticiens, échographistes, conseillers en génétique et psychologues) qui sont chargés de délivrer des avis et des conseils en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic. La pluridisciplinarité des CPDPN ne se limite pas aux seules professions médicales, puisqu’ils doivent comporter des conseillers en génétique ainsi que des psychologues.
Cette procédure de discussion répond à une exigence de collégialité dans la prise de décision qui constitue le plus sûr moyen de limiter les risques d’erreur diagnostique et de vérifier le bien-fondé de la demande des couples souhaitant une interruption médicale de grossesse ou le recours à un DPI. Elle permet de s’assurer notamment du caractère grave et incurable de l’affection dont est atteint l’enfant à naître ou qui serait recherchée parmi les embryons conçus in vitro.
Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, les citoyens du panel de Marseille ont fait état d’un manque de diversité dans la composition des CPDPN et ont envisagé la possibilité que des représentants des familles (familles ou parents ayant été concernés) y siègent.
Extrait de l’avis citoyen du panel de Marseille
« Il est crucial à nos yeux de mieux informer, accompagner et soutenir psychologiquement les couples entrant dans un processus de DPI. À cet effet, il pourrait être judicieux de mettre en relation, au sein des CPDPN, ces couples avec des personnes ayant déjà été confrontées à cette expérience ou à des associations spécialisées sur le sujet. (…)
Nous jugeons satisfaisant le fonctionnement des CPDPN. Toutefois, pour ce qui relève de la composition des comités décidant des suites à donner à un DPN, nous pointons un manque de diversité et regrettons l’absence de psychologues et de représentants des familles (associations, parents ayant connu cette situation). Nous, citoyens, considérons que le recours au DPN ne doit en aucune façon avoir pour finalité la naissance d’un « bébé parfait ». Dans le cas d’un handicap détecté par le DPN, les parents devront être informés des suites par une équipe pluridisciplinaire intégrant notamment les associations de parents d’enfants handicapés. Dans ce cadre, nous estimons que le choix des parents est souverain et incontestable. »
Il n’apparaît cependant pas opportun de prévoir des représentants d’associations parmi les CPDPN, la gravité et le caractère incurable de l’affection devant d’abord relever d’une appréciation médicale.
En effet, le CCNE, dans son avis n°107 précité, a considéré qu’il ne convenait pas de multiplier les acteurs de ces instances, en y incluant par exemple des représentants de la société civile ou de réseaux associatifs. Il a rappelé que l’attestation de gravité et d’incurabilité faisait suite à une délibération collégiale étayée par des sources médicales et a précisé que la perception personnelle de la gravité par les couples et la souffrance qu’elle entraînait chez eux pouvait être prise en compte à titre complémentaire.
En revanche, il pourrait être envisagé de prévoir que les CPDPN transmettent au couple, lorsque cela est possible, les coordonnées des associations susceptibles de compléter leur information sur la maladie détectée chez le fœtus. Il convient, à cet égard, de rappeler que l’article L. 2141-10 du code de la santé publique confie à l’équipe pluridisciplinaire des centres d’AMP le soin de transmettre les coordonnées des associations susceptibles de renseigner les demandeurs en matière d’adoption.
b) Instituer une commission auprès de l’ABM pour aider les praticiens
Dans son rapport précité, Mme Dominique Stoppa-Lyonnet a proposé plusieurs mesures afin d’aider les CPDPN dans leurs décisions.
En particulier, un médecin oncogénéticien compétent pour l’affection en cause (467) pourrait être associé à l’équipe du CPDPN. En outre, une commission consultative pourrait être installée à l’Agence de la biomédecine et placée conjointement sous l’égide de l’Institut national du cancer, la possibilité étant donnée aux centres de référence pour les maladies rares ou des groupes spécialisés d’y être représentés.
Il apparaît, par ailleurs, nécessaire d’assurer une veille régulière sur les progrès de la prise en charge des formes héréditaires de cancers, afin de réévaluer la gravité et l’incurabilité de ces derniers et d’examiner si des demandes de DPN, d’IMG et de DPI qui seraient aujourd’hui recevables ne le seraient plus demain. Il pourrait être envisagé de confier cette mission à la commission consultative de l’Agence de la biomédecine dont la création a été proposée par le rapport précité.
De manière plus générale, cette commission pourrait également être chargée de réaliser des études ponctuelles. Celles-ci pourraient s’attacher à mieux connaître le point de vue des couples, qu’ils appartiennent ou non à des populations à risque. Elles pourraient recueillir l’avis des associations de patients, suivre les demandes exprimées en consultation de génétique et dans les CPDPN et examiner l’équité de l’accès aux examens au niveau national.
Enfin il serait utile d’accompagner les couples dans leur demande et dans leur décision. L’implication des CPDPN suppose des informations claires et compréhensibles, la reformulation de ces demandes par le couple, une prise en charge psychologique et une disponibilité des équipes, ainsi que le souligne le rapport précité de Mme Stoppa-Lyonnet. Cette suggestion a été satisfaite par les recommandations professionnelles de l’ABM sur le fonctionnement des CPDPN dans leur version de février 2009, qui toutefois n’ont pas été validées par arrêté ministériel.
Proposition n° 27. Afin de guider les CPDPN dans leurs décisions, notamment dans le domaine de l’oncogénétique :
– Prévoir la possibilité pour les CPDPN d’avoir recours à un médecin généticien ou à un oncologue prenant en charge les personnes atteintes de formes héréditaires de cancer (En modifiant l’article R. 2131-12 du code de la santé publique) ;
– Créer une commission consultative de l’ABM, qui pourrait être aussi placée sous l’égide de l’INCa et qui serait saisie par les CPDPN.
Cette commission serait notamment chargée : de réaliser des études qualitatives et quantitatives auprès des couples et des associations ; d’assurer une veille sur les progrès de la prise en charge des formes héréditaires de cancer, afin de réévaluer leur gravité et leur curabilité et de concourir à l’harmonisation des pratiques en oncogénétique (en complétant l’article L. 1418-1 du code de la santé publique).
c) Renforcer les moyens des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et de DPI
Dans son rapport d’octobre 2008 sur l’évaluation de la loi du 6 août 2004, l’Agence de la biomédecine souligne qu’en dépit du rôle fondamental des CPDPN pour l’organisation du diagnostic prénatal, pour l’évaluation des indications des interruptions médicales de grossesse (IMG) et de DPI ainsi que pour leur activité de conseil, il apparaît que « la réalité des CPDPN est très diversement reconnue par les établissements de santé ». Il en résulterait une grande disparité de moyens humains et financiers selon les établissements, « incompatible avec les préoccupations d’égalité d’accès aux soins ». Une autre conséquence concrète de cette situation est qu’actuellement, la totalité des centres n’est pas en mesure de respecter l’obligation d’intégrer des conseillers en génétique, contrairement à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et au décret d’application n° 2007-1429 du 3 octobre 2007.
Des travaux d’investigation conduits par l’agence, il ressort que si des moyens financiers substantiels sont mis à disposition des établissements par le biais des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), qui représenteraient environ 8 millions d’euros, une certaine opacité préside à l’attribution de ces crédits, des établissements au surplus ne les utilisant pas. Enfin, certains d’entre eux n’ont présenté aucune demande de contractualisation. Il en résulte une hétérogénéité des moyens disponibles pour les praticiens de terrain. Or l’agence apporte son appui technique aux établissements, en les informant de ces modes de financement, au demeurant assez complexes, afin que les sommes qui leurs sont attribuées (environ 10 euros par grossesse) reviennent au fonctionnement propre des CPDPN. Pour préciser et mieux faire connaître ces modalités de financement, il serait opportun d’adresser une circulaire ministérielle aux établissements de santé.
À propos des difficultés et des incertitudes rencontrées dans le financement des activités de DPI, M. Stéphane Viville (468) a livré le témoignage suivant : « Si je m’adresse à ma direction hospitalière, on me dit qu’il s’agit d’une activité nationale, qui doit donc être financée par le ministère de la santé, et le ministère de la santé me renvoie vers l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH). Mais actuellement, le DPI est pris en charge par le budget général de l’hôpital. » Mme Julie Steffann (469) a également indiqué que « la FIV est intégralement prise en charge par l’assurance maladie pour un coût d’environ 10 000 euros. Le coût du DPI, lui, est pour l’instant assumé en totalité par les hôpitaux qui le pratiquent mais, là encore, la situation ne pourra pas durer éternellement. En Belgique, ce diagnostic est facturé environ 6 000 euros. »
Ces difficultés se traduisent notamment par des délais d’attente importants pour les couples. Ainsi, selon Mme Julie Steffann (470), « les contraintes budgétaires font que le délai moyen d’attente entre l’inscription à une demande de DPI et le début de la FIV est aujourd’hui de deux ans (…) Auparavant, il n’y avait à l’hôpital Necker qu’une seule personne pour pratiquer les DPI. L’équipe s’est quelque peu étoffée, sur les effectifs du laboratoire de génétique. Nous sommes maintenant trois à y travailler, mais il faut savoir qu’un DPI exige la présence quotidienne d’un médecin, week-ends et jours fériés compris, durant six semaines d’affilée. La situation actuelle n’est donc pas tenable à long terme. C’est d’ailleurs pourquoi le DPI ne peut s’envisager que dans de grosses structures disposant d’un personnel suffisant. » M. Stéphane Viville (471) a également souligné « le manque de moyens, matériels et humains des centres de DPI, qui entraîne des délais dramatiques. » Il semble en effet qu’aujourd’hui, les centres français de DPI ne peuvent répondre dans des délais satisfaisants aux demandes, d’autant que compte tenu des taux de réussite limités, beaucoup de couples doivent refaire une tentative.
Si ces questions de financement et de prise en charge ne relèvent pas directement du champ des lois de bioéthique, elles n’en soulèvent pas moins des difficultés en termes d’accès aux soins et de mise en œuvre de la loi, qui intéressent le législateur. M. René Frydman s’en est inquiété dans une tribune parue en juillet 2009 (472): « Est-ce éthique de ne pouvoir traiter que dix-huit mois plus tard – avec un risque d’échec plus élevé que le taux de réussite ? La réponse est non, ce n’est pas éthique, ce n’est même pas de la bonne médecine. »
Cette position faisait écho à l’avis citoyen du panel de Marseille qui a formulé le vœu que « de plus nombreux CPDPN soient habilités à réaliser des DPI. Cela permettrait de prendre en charge les demandes dans des délais plus raisonnables : le délai actuel de deux ans d’attente nous semble inacceptable pour les parents confrontés à cette situation. Cette demande d’augmentation du nombre de centres habilités n’enlève rien aux conditions très strictes que nous estimons nécessaires à la pratique du DPI. » Un tel constat rejoint également une préoccupation exprimée par le Conseil d’État dans son étude précitée de mai 2009 : « au plan strictement matériel, le délai d’attente pour obtenir un DPI n’est pas satisfaisant et nécessite d’augmenter les moyens humains et financiers pour cette pratique afin de réduire sensiblement ce délai. À Barcelone, le délai d’attente serait par exemple de trois mois et sur les sept naissances ayant eu lieu dans des familles touchées par l’amyotrophie spinale, les sept DPI auraient été réalisés à l’étranger. »
Le CCNE déplore de son côté l’insuffisance des moyens en matière de DPI et considère que la création en France d’autres centres autorisés à effectuer des DPI mériterait d’être étudiée (473).
Proposition n° 28. Accroître les moyens des centres de DPI en vue de raccourcir les délais d’attente, en envisageant par exemple la création d’un quatrième centre, ainsi que l’a proposé le CCNE.
Prévoir le dépôt, par le ministère chargé de la santé, d’un rapport au Parlement sur les modalités actuelles de financement des CPDPN, en faisant mieux connaître le recours possible aux MIGAC.
3. Faut-il maintenir les dispositions de la loi relatives au « bébé du double espoir » ?
Le double DPI – encore appelé « bébé du double espoir », « DPI-HLA », « bébé-docteur » ou encore, de manière plus contestable, « bébé-médicament » consiste à effectuer un diagnostic en vue de transférer in utero un embryon, à la fois indemne d’une maladie génétique particulièrement grave et dont les caractéristiques immunologiques, en termes de compatibilité du système HLA (474), permettent d’envisager le prélèvement à sa naissance de cellules souches hématopoïétiques issues du sang de cordon ombilical pour traiter un aîné gravement malade.
La question est de savoir si cette extension du champ des indications du DPI, rendue possible par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique sous certaines conditions très précises, doit être maintenue et selon quelles modalités.
a) Une possibilité très strictement encadrée qui n’a pas encore permis une naissance
Issu d’un amendement parlementaire (475), l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique prévoit qu’un double DPI peut être autorisé, « à titre expérimental », dès lors que l’ensemble des conditions suivantes est réuni:
– un couple a donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;
– le pronostic vital de cet enfant doit pouvoir être amélioré, de façon décisive, par l’application sur celui-ci d’une thérapeutique ne portant pas atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant né du transfert de l’embryon in utero ;
– le diagnostic effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro a deux objets : rechercher la maladie génétique et les moyens de la prévenir et de la traiter, d’une part ; permettre l’application de la thérapeutique précitée, d’autre part ;
– ce type de DPI ne peut être réalisé qu’après autorisation de l’Agence de la biomédecine, le conseil d’orientation de l’agence devant être consulté par le directeur général, en application de l’article L. 1418-4 et les deux membres du couple étant tenus d’exprimer leur consentement préalable par écrit ;
– cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2141-3 (476) : ainsi, il ne peut y avoir de nouvelle fécondation in vitro (FIV) sans épuisement du « stock » d’embryons surnuméraires, sauf si un problème de qualité affecte ceux-ci. En d’autres termes, les embryons conçus in vitro qui ne seraient pas « HLA-compatibles » doivent en principe être transférés in utero, avant d’envisager la conception de nouveaux embryons surnuméraires ;
– enfin, le rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine doit comporter une analyse des autorisations délivrées pour le double DPI ainsi que l’examen de l’opportunité de maintenir les dispositions de la loi relatives à celui-ci, en application du dernier alinéa de l’article L. 1418-1.
Cette extension du champ des indications du DPI a suscité des interrogations éthiques à propos de la réalité du projet parental et du risque d’instrumentalisation de l’enfant à naître. En effet, engager une grossesse dans le seul but de donner naissance à un enfant « HLA-compatible » pour le traitement du membre de la fratrie malade pourrait apparaître en contradiction avec le principe selon lequel l’enfant ne devrait jamais être un moyen aux fins d’autrui.
Toutefois, dans le cas très particulier prévu par le législateur, il s’agit en réalité d’adjoindre un second motif de dépistage concernant la compatibilité immunologique, afin de faire naître un enfant indemne d’une maladie particulièrement grave dans le cadre d’un projet parental. Pour cette raison, le CCNE avait admis que permettre qu’un enfant désiré représente de plus un espoir de guérison pour son aîné, est un objectif acceptable s’il est second (477). Confortant ce point de vue, M. Axel Kahn (478) s’est appuyé sur la diversité des projets parentaux : « la notion de « projet parental » peut recouvrir des situations fort différentes : on peut faire un bébé pour remplacer un enfant disparu, assurer la continuité d’une lignée, éviter une séparation, avoir un descendant auquel léguer sa fortune, et même faire un bébé-médicament, mais dans tous ces cas, le but est quand même bien de faire un bébé ».
En outre, cette extension du champ des indications du DPI a été très strictement encadrée par le législateur, l’objectif du dispositif applicable étant de permettre de soigner un enfant très gravement malade, atteint d’une maladie qui entraînerait la mort dès les premières années de la vie et qui serait donc condamné en l’absence de traitement. On peut ainsi le concevoir comme « un geste d’amour à expliquer comme tel aux enfants », selon les termes de la Secrétaire d’État chargée de la famille, Mme Nadine Morano(479).
Pour l’auteur de l’amendement à l’origine de ces dispositions, M. Pierre-Louis Fagniez (480), il s’agissait, de permettre « le prélèvement, à la naissance de cet enfant, dans le cordon ombilical, de cellules-souches qui permettront peut-être de guérir l’aîné, autrement condamné », en évoquant en particulier « le prélèvements de cellules-souches du cordon ombilical pour le traitement de la maladie de Fanconi (481) ».
En effet, le sang de cordon a des indications médicales qui ont été validées pour diverses maladies hématologiques, notamment les leucémies et les aplasies médullaires. Comme l’a rappelé M. Marc Benbunan (482), la première greffe de sang de cordon a eu lieu en 1988 à l’hôpital Saint-Louis, des cellules du sang du cordon d’une petite fille à naître ayant été greffées à un aîné atteint de la maladie de Fanconi ; il s’agissait d’un usage allogénique de sang de cordon (le donneur n’étant pas le receveur), dans un cadre intrafamilial et dans des conditions d’histocompatibilité maximale.
À cet égard, si le législateur décidait de maintenir le DPI-HLA, la rédaction de l’article L. 2131-4-1 gagnerait à être clarifiée.
Tout d’abord, on peut s’interroger sur l’opportunité de maintenir les dispositions de la loi prévoyant que celui-ci est autorisé « à titre expérimental ».
La loi de 2004 n’a pas prévu que cette clause expérimentale ne s’applique que pour une durée limitée, alors que l’article 37-1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 2003-273 du 28 mars 2003 autorise la loi et le règlement à contenir des dispositions à caractère expérimental ayant un objet et une durée limités. Faute de précision du terme de l’expérimentation, la rédaction actuelle de l’article L. 2131-4-1 ne peut être maintenue en l’état au regard des exigences constitutionnelles. Soit le législateur fixe une échéance à cette expérimentation, soit il supprime cette clause. Cependant si le législateur convient de ne pas réexaminer périodiquement la loi, il apparaît cohérent de lever cette réserve afin de conférer à ce dispositif un caractère permanent.
Le troisième alinéa de l’article L. 2131-4-1dispose que la thérapie mise en œuvre sur l’aîné gravement malade ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant né du transfert de l’embryon in utero « conformément à l’article 16-3 du code civil ». Mais cet article du code civil précise qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». Ces dispositions permettent par exemple, sous certaines conditions bien définies, des prélèvements d’organes sur donneur vivant. Dès lors, il pourrait être envisagé de supprimer les dispositions de l’article L. 2131-4-1 renvoyant à l’article 16-3 du code civil, afin qu’il soit parfaitement clair que la thérapeutique envisagée ne doit en aucun cas porter atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant, comme c’est le cas des greffes de sang placentaire (le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques issues du sang de cordon ne portant pas atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant).
Il apparaît enfin que le nombre des autorisations délivrées au titre du double DPI est resté très limité.
Entre juillet 2007 – le décret d’application des dispositions relatives au bébé du double espoir n’ayant été publié qu’en décembre 2006 (483) – et juin 2008, seules sept demandes avaient été présentées, l’Agence de la biomédecine en ayant autorisé cinq. En avril 2009, neuf demandes avaient été déposées et six autorisations délivrées selon Mme Julie Steffann (484), praticien dans le service de génétique médicale de l’hôpital Necker, qui est actuellement le seul centre autorisé à pratiquer ce type de diagnostic. En octobre 2008, selon le bilan de la mise en application de la loi de 2004 dressé par l’Agence de la biomédecine, seules deux tentatives de FIV avaient été menées chez l’un des cinq couples et aucun enfant n’était né à l’issue d’un double DPI.
Ce constat peut conduire à s’interroger sur l’opportunité de maintenir les dispositions de la loi relatives au double DPI, compte tenu notamment du développement des banques de sang de cordon.
b) Maintenir la possibilité de recourir au double DPI en évaluant parallèlement le développement des banques de sang de cordon
Au-delà de ses enjeux éthiques, qui ont fait l’objet d’un débat nourri lors de l’examen par le Parlement du projet de loi relatif à la bioéthique, le double DPI soulève des interrogations concernant ses difficultés de mise en œuvre et le risque en résultant de donner de faux espoirs aux parents.
En effet, comme l’a expliqué M. Stéphane Viville (485), « statistiquement, le nombre d’embryons qui vont répondre aux deux critères (pas de maladie génétique et histocompatibilité) est de 3 sur 16. En moyenne, dans notre activité, nous analysons 5,6 embryons ; ainsi, les chances d’avoir des embryons qui répondent aux deux critères sont extrêmement limitées. Il s’agit en outre de patientes plus âgées que la moyenne de celles que nous recevons ; les chances de grossesses sont donc elles aussi très limitées. »
Dans le même sens, Mme Julie Steffann (486) a souligné que « le DPI, déjà extrêmement lourd, l’est encore davantage lorsqu’il doit être couplé à un typage tissulaire HLA. Les résultats des autres équipes qui le pratiquent de par le monde depuis plus longtemps que nous, et qui ont donc plus de recul, révèlent que les chances de succès sont divisées par deux par rapport à un DPI standard, c’est-à-dire qu’elles deviennent extrêmement faibles. ». Ainsi, « pour les DPI avec typage HLA, les chances de ramener un bébé à la maison ne sont que d’environ 10 % à chaque tentative.»
Se déclarant très réservé sur cette pratique « pour des raisons déontologiques » en estimant qu’elle revient à « donner de faux espoirs aux couples », M. Stéphane Viville a par ailleurs fait valoir que les médecins du centre de Bruxelles, « qui est l’un des tout premiers centres mondiaux de DPI (…) se trouvent confrontés à des situations qui ne [lui] conviennent pas : refus du couple de transférer des embryons qui ne seraient pas affectés par la maladie génétique mais non compatibles ; grossesse trop tardive, l’enfant étant décédé ou décédant juste avant la naissance du « bébé-médicament ». Pourtant, quand on parle avec des hématologues, le traitement est idéal : avec un petit frère ou une petite sœur répondant au critère d’histocompatibilité, les chances sont excellentes. »
À cet égard, Mme Julie Steffann a évoqué les difficultés liées « au fait de savoir ce que l’on fait des embryons sains mais non HLA compatibles. Certains couples souhaitent d’abord l’implantation d’un embryon sain, quel que soit son typage HLA. D’autres veulent avant tout un embryon HLA compatible pour soigner leur aîné. La situation est compliquée et il est difficile de demander aux couples de prendre préalablement une décision ferme et définitive car, après la « galère » que représente un DPI, le jour du transfert, ils peuvent reconsidérer leur position. Des couples qui a priori ne souhaitaient pas l’implantation d’un embryon non HLA compatible peuvent encore changer d’avis. » Il convient cependant de rappeler qu’en application de l’article L. 2141-3, la mise en œuvre d’une nouvelle FIV est subordonnée au transfert in utero de ceux déjà conçus, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.
Enfin, une autre difficulté a été mise en avant à propos des couples dont un enfant souffre d’une maladie génétique résultant d’une mutation de novo chez l’enfant atteint et qui, de fait, n’ont pas de risque de transmettre la maladie à un autre enfant, auquel cas ils n’ont pas droit au DPI, « ce qu’ils ressentent comme une injustice », selon Mme Julie Steffan (487).
Le développement des banques de sang placentaire allogéniques pourrait conduire à reconsidérer l’intérêt du DPI-HLA d’un point de vue médical.
En effet, dans son rapport de novembre 2008 (488), notre collègue sénatrice Mme Marie-Thérèse Hermange, a estimé que « tous les patients devant subir une greffe de sang de cordon trouvent un greffon compatible ». Elle considère que « les chances de trouver un échantillon de sang de cordon compatible avec un malade sans lien de parenté avec le donneur sont très nettement supérieures à celles de trouver un donneur de moelle osseuse pour une greffe dite allogénique. Les chiffres donnés par le professeur Gregory Katz-Benichoupour les États-Unis en témoignent : (…) dans le monde entier, toutes les recherches faites sur les bases recensant les greffons de sang de cordon disponibles sont fructueuses. »
Mme Isabelle Desbois, responsable des tissus et cellules de l’Établissement français du sang (489), a indiqué qu’« à l’heure actuelle, nous pouvons satisfaire la quasi-totalité des besoins en unités de sang placentaire, avec des produits français ou provenant d’un pays étranger ».
Il n’en reste pas moins nécessaire de maintenir les dispositions de la loi relatives au double DPI.
En effet, si la diversité HLA des banques de sang placentaire est grande, il semble que certaines catégories de la population, notamment des minorités ethniques, sont encore peu représentées et dès lors sont susceptibles de ne pas trouver de donneur.
M. Marc Benbunan (490)a également souligné que si « les banques de sang de cordon permettent (…) de trouver des solutions là où il n’y en aurait pas avec des donneurs vivants de moelle », « il existe toutefois une injustice ethnique : les patients d’origine européenne ou nord-américaine ont plus de chance de trouver un donneur compatible que les autres. D’où l’intérêt de prélever du sang de cordon sur des patients de toutes origines afin d’enrichir les banques d’une plus grande diversité d’échantillons de population. » Dans ces conditions, la suppression de la possibilité de pratiquer un double DPI pourrait entraîner l’impossibilité d’identifier un donneur pour les patients appartenant à ces minorités.
En outre, quand bien même ses taux de succès seraient limités, le double DPI permet d’offrir un espoir à des familles déjà durement éprouvées et confrontées à une maladie génétique susceptible d’entraîner la mort de leur enfant dès ses premières années et reconnue comme incurable. Observant que cette problématique « s’est posée dans de très rares cas, pour un service rendu [qu’elle] considère immense », Mme Ségolène Aymé (491) a estimé que « c’est une pratique qu’il faut permettre, tout en l’encadrant strictement. »
C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles, lors des États généraux de la bioéthique, les citoyens du panel de Marseille ont fait part de leur perplexité concernant la pratique du double DPI mais ne s’y sont pas clairement opposés (« notre panel reconnaît la difficulté à trouver un consensus d’autant plus que cette pratique est déjà autorisée en France »). De plus, il pourrait sembler prématuré de supprimer ces dispositions, alors même qu’à ce jour, aucune greffe de sang placentaire n’a été rendue possible grâce au prélèvement de sang de cordon à la naissance d’un enfant suite à la réalisation d’un double DPI et qu’en conséquence, l’application de la loi de 2004 n’a pas pu encore être complètement appréciée.
Enfin, si ce dispositif doit être évalué régulièrement au regard notamment de l’évolution des connaissances scientifiques et des alternatives thérapeutiques qui pourraient être proposées aux familles concernées – en procédant en particulier à une analyse plus précise de la diversité HLA des banques de sang par rapport aux besoins des patients –, il apparaît en revanche inopportun, de ne le proroger que pour une durée limitée à cinq ans, comme le préconise le Conseil d’État, dans son rapport de mai 2009.
En effet, un tel choix entrerait en contradiction avec la préconisation de la mission parlementaire de ne plus prévoir de réexamen d’ensemble de la loi à une échéance déterminée et de ne pas introduire de dispositions transitoires (cf. dernière partie du présent rapport). Au surplus la loi prévoit déjà une évaluation annuelle de ce dispositif par l’Agence de la biomédecine dans le cadre de son rapport d’activité. Le cas échéant, il serait donc loisible au législateur de modifier ce dispositif, notamment si de nouveaux éléments scientifiques et médicaux conduisaient à reconsidérer l’opportunité de maintenir ce type de DPI. Il ne serait pas nécessaire pour autant de fixer un terme après lequel ces dispositions seraient abrogées, ce choix risquant d’être arbitraire.
Proposition n° 29. Maintenir les dispositions de la loi relatives au « bébé du double espoir ».
Supprimer le caractère expérimental de ce dispositif.
(Modification de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique).
C. RENFORCER L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE DÉPISTAGE NÉONATAL
En France, tous les nouveau-nés bénéficient, pendant leur séjour à la maternité, d’un dépistage de cinq maladies : la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie, l’hyperplasie des surrénales, la mucoviscidose et la drépanocytose. Ce dépistage précoce, effectué par un simple prélèvement de quelques gouttes de sang, permet de mettre en œuvre très rapidement une prise en charge médicale adaptée.
Le nombre de maladies dépistées à la naissance est supérieur dans certains pays comme l’Allemagne, le Canada et surtout les États-Unis où, dans plusieurs États, il est aujourd’hui possible de dépister jusqu’à cinquante maladies héréditaires. Dans un rapport récent (492), le Conseil d’éthique placé auprès du Président des États-Unis met en garde contre les effets d’un accroissement massif des informations génétiques et considère qu’il ne faut retenir comme pertinentes que les informations susceptibles d’apporter un bénéfice direct à l’enfant.
Au-delà de ses enjeux en termes de santé publique, le dépistage néonatal soulève en effet d’importantes questions éthiques et sociétales.
En particulier, « la multiplicité des tests génétiques disponibles permet de diagnostiquer de plus en plus de maladies rares », selon les termes employés devant la mission par Mme Françoise Antonini, Déléguée générale de l’Alliance maladies rares (493) « mais est-il éthique de dépister des maladies contre lesquelles on ne peut rien faire ? »
Dans les années à venir, un grand nombre de pathologies génétiques pourront en effet être diagnostiquées. Il sera également possible de déterminer les marqueurs génétiques associés à une prédisposition pour des pathologies communes multifactorielles dont la prévalence est de très loin supérieure à celle des pathologies génétiques (par exemple, l’hypertension artérielle, l’obésité ou le diabète), ces tests pouvant être effectués sur des populations ciblées ou plus larges.
Qu’il s’agisse de leur utilité en termes de santé publique, de leur validité clinique, de l’interprétation, de l’utilisation, de la confidentialité des résultats ainsi que de la question du consentement ou du risque de discrimination, la généralisation éventuelle de ces tests pourrait cependant poser de nouveaux problèmes.
Concernant le dépistage néonatal, Mme Laurence Lwoff (494), chef de la division bioéthique du Conseil de l’Europe, a estimé qu’en la matière, « l’utilité clinique (…) paraît rester un « critère essentiel », comme le dit le protocole [additionnel à la convention d’Oviedo portant sur les tests génétiques à des fins médicales (495)], pour décider si l’on doit ou non proposer un test génétique. On peut vraiment se poser la question de la légitimité de ce type de test, notamment dans le cas de tests concernant des maladies à développement tardif, surtout si l’on ne peut pas agir préventivement. »
Il apparaît dès lors nécessaire d’engager une réflexion continue sur l’utilisation des tests génétiques qui pourraient être utilisés pour un dépistage en population, ainsi que le souligne la Fédération française de génétique humaine (496), en suggérant la création d’une commission au sein de l’Agence de la biomédecine pour suivre ces questions.
Estimant que les dépistages organisés dans une population générale posent des problèmes sociétaux et éthiques, Mme Françoise Antonini (497) a préconisé de mettre en place une instance indépendante, en rappelant que « le premier Plan national maladies rares prévoyait la mise en place d’un comité consultatif indépendant chargé de rendre un avis sur la politique de dépistage. Ce comité n’a pas été mis en place (…). La création d’une autorité indépendante sur ce thème nous paraît indispensable. »
Mme Françoise Antonini a également fait valoir que « le dépistage néonatal des cinq maladies (…) est important car, même s’il n’existe pas de traitement permettant de les guérir, la prise en charge de l’enfant atteint peut améliorer son état. Dans le cas de la phénylcétonurie, un régime permet à l’enfant dépisté puis à l’adulte de vivre tout à fait normalement. Dans le cas de la mucoviscidose, une prise en charge bien menée permet d’améliorer l’espérance de vie des personnes atteintes. On observe d’ailleurs que, dans les pays nordiques, l’espérance de vie de ces dernières est largement supérieure à celle des personnes vivant en France alors qu’il n’y a pas de dépistage néonatal. C’est pourquoi nous souhaiterions qu’une autorité indépendante se penche sur toutes ces questions. »
Dès lors, il pourrait être proposé d’élargir les missions du CCNE, en prévoyant que dans l’éventualité d’une généralisation d’un dépistage néonatal pour une maladie particulière, cette instance serait chargée de rendre un avis préalable. En outre, le comité pourrait être saisi dès maintenant de la question de l’évaluation de la politique de dépistage néonatal et des tests organisés en population générale.
Le CCNE a d’ailleurs déjà émis en 2007 (498) un avis concernant l’opportunité d’organiser un dépistage néonatal de la surdité en population générale, en avançant plusieurs préconisations qui mettent en exergue les enjeux éthiques de ce type de dépistage.
Proposition n° 30. Suggérer au CCNE d’évaluer la politique de dépistage néonatal et envisager de compléter la loi, afin de prévoir sa saisine obligatoire avant toute extension éventuelle d’un dépistage néonatal à d’autres pathologies. (En complétant L. 1412-3 du code de la santé publique).
CHAPITRE 4 – DE L’USAGE DES DONNÉES GÉNÉTIQUES
Le législateur a posé des conditions restrictives à l’examen des caractéristiques génétiques en en limitant le recours à des fins médicales ou de recherche. De même a-t-il restreint à certaines procédures de justice l’identification d’une personne par ses empreintes ADN. Il a en outre encadré avec précision la prescription des tests génétiques, fixé des modalités particulières pour la communication de leurs résultats et en a réservé la réalisation à des spécialistes agréés.
Ces précautions trouvent leur justification dans les risques de discrimination et d’atteinte à la vie privée qui pèsent sur la personne dont des données génétiques sont établies. Elles sont également motivées par la complexité que présente l’interprétation de ces données, source d’incompréhension et de surinterprétation comme nulle autre information d’ordre médical.
C’est pourquoi les droits de la personne en ce domaine doivent faire l’objet d’une protection particulière. Celle-ci passe par les garanties suivantes : l’exigence d’un consentement exprès, libre et éclairé, donné préalablement à la réalisation de l’analyse génétique ; le droit d’être informé des résultats obtenus comme celui de ne pas l’être ; la nécessaire garantie du secret des données relevant de la vie privée et enfin l’assurance qu’aucune utilisation discriminante et stigmatisante n’en sera faite.
Des modalités particulières de prise en charge médicale sont en outre nécessaires. Le caractère prédictif de l’analyse génétique, le fait que la personne peut être asymptomatique ou porteur sain d’une maladie, le sort qu’elle découvre partager avec l’ensemble de sa parentèle, sont autant de spécificités qui doivent être reconnues et faire l’objet d’un encadrement particulier.
Ces principes font l’objet d’un consensus très large. Ils ont pour la plupart été consacrés par la déclaration universelle de l’UNESCO sur le génome humain et les droits de l’homme du 11 novembre 1997, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, ainsi que par la convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine du 4 avril 1997.
Ils ont été complétés par la déclaration internationale sur les données génétiques humaines adoptée le 16 octobre 2003 par l’UNESCO et par le protocole additionnel à la convention d’Oviedo relatif aux tests génétiques à des fins médicales du 27 novembre 2008.
L’OCDE a pour sa part adopté, le 20 avril 2007, une recommandation portant sur la qualité des tests de génétique moléculaire.
En droit interne, ces principes ont été inscrits aux articles 16-10 à 16-13 du code civil introduits par les lois bioéthiques de 1994 et 2004 et par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Les auditions de la mission d’information ont permis d’évaluer la portée et les limites des dispositifs juridiques en vigueur face à des progrès scientifiques qui, dans le domaine de la génétique, ont été importants depuis la dernière révision des lois bioéthiques.
Mme Ségolène Aymé, médecin généticien et épidémiologiste, directrice de recherche à l’INSERM a ainsi expliqué que « le contexte [avait] changé : le nombre et la diversité des tests disponibles ont crû de façon vertigineuse. Le décryptage du génome, rendu plus accessible technologiquement et financièrement, a permis une accumulation des connaissances, si massive d’ailleurs qu’il est difficile de les utiliser à bon escient. » (499)
Ces avancées techniques, et les intérêts financiers de ceux qui s’en emparent dans un but commercial, multiplient les risques de dérive. Elles confortent aussi la croyance à l’égard du mythe du « tout génétique », alors que parallèlement le bilan des évolutions récentes des connaissances en épigénétique montre, comme l’écrit M. Henri Atlan, que « L’organisme contrôle les gènes au moins autant que les gènes contrôlent l’organisme. » (500)
Il revenait à la mission d’information d’évaluer la portée des problèmes que peuvent poser les différents usages faits de ces nouvelles technologies dans les domaines où la loi les autorise.
A. L’EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS MÉDICALES
Sur les 12 000 maladies héréditaires recensées, 1 000 d’entre elles peuvent en France faire l’objet d’un test génétique. Parmi les nombreuses maladies rares, 80 % sont d’origine génétique (501).
Les conditions de prescription des examens génétiques, d’agrément des praticiens, d’autorisation des laboratoires, de communication des résultats et de conservation des documents n’ont été précisées par décret qu’en 2008 (502).
Les règles des bonnes pratiques relatives à ces examens doivent être définies par arrêté du ministre de la santé pris sur proposition de l’ABM (503). Elles n’ont cependant pas encore été rédigées et ne seront pas disponibles avant 2011.
Un tel retard est regrettable et rend difficile l’établissement d’un bilan d’application. Les auditions menées par la mission ont fait écho aux inquiétudes et aux interrogations relatives à la définition du test génétique, à son objet et à son utilisation.
1. Préciser ce qu’est un examen génétique
L’article R. 1131-2 du code de la santé publique définit la nature des examens qui relèvent du régime des analyses génétiques. Il s’agit des analyses de cytogénétique visant à détecter des anomalies chromosomiques, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, ainsi que des analyses de génétique moléculaire qui portent sur l’ADN. À ces deux types d’examens s’ajoutent les analyses de biologie médicale prescrites dans l’intention d’obtenir des informations équivalentes à celles obtenues par les analyses cytogénétiques ou de génétique moléculaire.
En raison de la nature des données obtenues, ces analyses relèvent d’un cadre juridique spécifique. Elles font l’objet de conditions de prescription particulières notamment au regard de la nature du consentement de la personne concernée ainsi que des conditions exigées pour leur réalisation et leur habilitation.
Il convient en conséquence de distinguer les analyses médicales relevant du droit commun de celles ressortissant au régime des analyses génétiques telles que les définit l’article R. 1131-2 précité. Si les analyses de cytogénétique et de génétique moléculaire sont parfaitement identifiées, les analyses de biologie médicale conduisant à l’établissement de données génétiques sont de nature très diverse. Cette disposition réglementaire prévoit qu’une liste de ces dernières analyses est établie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
Mais il s’avère qu’un tel recensement est difficile à réaliser du fait du nombre d’examens concernés. Selon les explications fournies par l’Agence de la biomédecine « certaines analyses de pratique courante comme l’électrophorèse de l’hémoglobine, non « génétiques » au sens technique du terme, sont utilisées pour le diagnostic d’anomalies génétiques. Elles permettent de détecter des personnes asymptomatiques hétérozygotes pour la thalassémie ou la drépanocytose. » (504) On pourrait même considérer, selon l’agence, que toute analyse de biochimie ou d’hématologie est susceptible de conduire à l’établissement d’informations relatives à des caractéristiques génétiques.
M. Jean-François Mattei avait déjà soulevé la difficulté, en 2002, devant l’Assemblée nationale au cours des discussions du projet de loi de bioéthique : « Un simple examen clinique ou biologique permet de distinguer des caractères génétiques. Lors d’une numération sanguine, vous savez, par la forme des globules rouges, s’il y a ou non une anomalie de l’hémoglobine. Je pourrais multiplier les exemples. Un groupage sanguin, un groupage HLA ne sont pas des études génétiques mais peuvent aboutir à observer et apprécier des données génétiques » (505)
Il semblerait qu’une définition des analyses génétiques qui porterait non sur la nature des méthodes utilisées mais sur la finalité de la prescription permettrait de contourner cette difficulté : constituerait une analyse génétique toute analyse réalisée dans le but de connaître un caractère héréditaire. Le groupe de travail « stratégie Diagnostic » réuni par l’Agence de la biomédecine réfléchit sur les principes directeurs qui encadreraient une telle définition.
Mettre en exergue la finalité de l’examen posera cependant des problèmes d’habilitation, la même analyse risquant de relever de régimes différents suivant l’usage qui en sera fait.
En l’absence des dispositions nécessaires, on ne peut que constater que le cadre réglementaire demeure déséquilibré, puisque, en l’état, des informations génétiques peuvent être obtenues par une multiplicité d’analyses biomédicales dont les conditions de réalisation échappent à l’encadrement voulu par le législateur.
La question se complique en outre du fait que certaines analyses non biomédicales sont, elles aussi, susceptibles de contenir des informations d’ordre génétique. Il en va ainsi des techniques d’imagerie médicale pour certaines pathologies telles que les pathologies vasculaires cérébrales (506). Un document d’information rédigé par l’Inserm précise que « le test génétique n’est souvent pas la seule façon de faire le diagnostic d’une maladie génétique : une échographie rénale pour la polykystose rénale ou une coloscopie pour la polypose colique peut poser le diagnostic avec autant de certitude. » (507)
En plus des tests génétiques et des marqueurs biologiques, une troisième catégorie d’analyses est à prendre en compte – analyses qui ont en outre la particularité d’être toujours prescrites en dehors du cadre d’un conseil génétique. L’encadrement de ces examens, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées de leur état, la possibilité ou non de mettre en œuvre la procédure d’information de la parentèle sont alors autant de questions en suspens.
Le rapport explicatif au protocole additionnel à la convention d’Oviedo relatif aux tests génétiques à des fins médicales, constatait qu’il y avait une distinction à opérer entre des analyses fournissant des informations ayant un lien direct avec des caractéristiques génétiques et celles qui ne fournissent qu’une indication sur elles (508).
Sous réserve d’une évaluation plus générale de ce type de situation, il semble qu’il conviendrait, à tout le moins, que les bonnes pratiques auxquelles le ministère de la santé peut soumettre la prescription et la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne (509), prennent en compte cette multiplicité des sources d’information et la possible implication de plusieurs spécialités médicales dans l’établissement de certains diagnostics de maladies génétiques. Une coordination entre ces spécialités semble nécessaire pour que le patient soit dirigé vers des médecins généticiens et bénéficie de la procédure du conseil génétique, en particulier si l’information de la parentèle se révèle nécessaire.
Proposition n° 31. Dresser par décret la liste des analyses réalisées aux fins de détermination des caractéristiques génétiques.
Proposition n° 32. Définir des règles de bonnes pratiques dans le cas où des informations d’ordre génétique seraient établies de manière incidente à l’occasion d’examens médicaux.
2. Évaluer l’utilité des tests génétiques
L’article R. 1131-1 du code de la santé publique donne pour définition de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne, l’analyse de ses caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.
Selon ce même article, cette analyse a pour objet :
« 1° Soit de poser, de confirmer ou d’infirmer le diagnostic d’une maladie à caractère génétique chez une personne ;
2° Soit de rechercher les caractéristiques d’un ou plusieurs gènes susceptibles d’être à l’origine du développement d’une maladie chez une personne ou les membres de sa famille potentiellement concernés ;
3° Soit d’adapter la prise en charge médicale d’une personne selon ses caractéristiques génétiques. »
Les tests réalisés à l’occasion d’un DPI ou d’un DPN font l’objet de dispositions spécifiques.
Dans la pratique médicale, les tests génétiques peuvent être répartis en deux groupes. Le premier porte sur des maladies monogéniques à forte pénétrance. La personne concernée est alors susceptible de se trouver dans trois situations : elle peut présenter les manifestations cliniques de la maladie associée à l’anomalie (le test est dit diagnostique) ; elle peut ne pas en avoir encore développé les signes cliniques (le test est présymptomatique) ou elle peut encore être assurée de ne jamais en manifester les signes mais de la transmettre à ses descendants (la personne a le statut de porteur sain).
Dans un second groupe figurent les tests de prédisposition, de nature probabiliste. On y distingue les tests de prédisposition qui portent sur des gènes dont les anomalies accroissent fortement le risque de développer une maladie (510) et les tests de susceptibilité qui renvoient à des anomalies sur plusieurs gènes dont l’expression dépend fortement de facteurs épigénétiques et environnementaux. Dans ce dernier cas, la présence des marqueurs génétiques augmente peu la probabilité de développer la maladie.
Si l’on met à part les questions propres à l’utilisation des tests génétiques dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (511), les problèmes apparus récemment en ces domaines portent principalement sur les tests de susceptibilité. Font également l’objet d’interrogations les tests pangénomiques.
a) Les tests de susceptibilité
Mme Anne Cambon-Thomsen, directrice de recherche au CNRS dont les travaux concernent en particulier les maladies multifactorielles, a exposé les raisons pour lesquelles les tests de susceptibilité présentent très peu d’intérêt médical : « On a longtemps pensé – le discours des scientifiques a été amplifié par les médias – que, dès lors que le risque pouvait être calculé, un paramètre était créé qui pouvait être utilisé. Or, dans les maladies multifactorielles, dans bon nombre de cas, les risques sont relatifs, souvent faibles et associés à des facteurs génétiques différents : autrement dit, même si leur identification est extrêmement importante sur le plan de la recherche, pour la compréhension des mécanismes, elle n’a aucune utilité clinique à titre individuel. Le nombre de cas où il y aura utilisation du risque, lorsque celui-ci peut vraiment être évalué, est vraiment faible. » (512).
Sont visées par ce type d’analyse des maladies communes telles que le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité ou l’arthrite rhumatoïde. Il convient de rappeler que l’évaluation du risque est faite à partir d’un lien de corrélation, et non de causalité, entre la présence d’une ou de plusieurs anomalies génétiques et le développement d’une maladie. Cette corrélation est calculée sur la base d’études statistiques, dénommées « études d’association », qui consistent à comparer avec une population générale témoin, la prévalence des variants génétiques dans une population de personnes atteintes par la maladie étudiée. La valeur de prédictivité du test doit être confirmée par des études conduites par des laboratoires différents sur des populations distinctes. L’interprétation de ces tests varie beaucoup en fonction du progrès des techniques. En tout état de cause, il s’agit de déterminer une augmentation minime du risque, le faisant passer, selon les explications données par Mme Ségolène Aymé, directrice de recherche à l’Inserm, « de 1 à 1,1 à 1,5, au maximum de 1 à 10. » (513).
Par ailleurs des problèmes de méthodologie interprétative sont posés par le développement de tests qui procèdent à des séquençages larges du génome. L’évolution des techniques de robotisation laisse à penser que ces tests auront une capacité croissante de traitement. (514) « Tester une mutation donnée, a expliqué Mme Anne Cambon-Thomsen, procure une information très précise, mais unique et isolée de son contexte. Au contraire, séquencer pour obtenir plus d’information sur cette mutation crée de l’information qui n’est pas forcément nécessaire ni interprétable au moment où elle est produite. Lorsque le séquençage effectué est complet, on est loin de pouvoir donner une signification à l’ensemble de la séquence d’un génome. Cependant, l’information s’engrange. » (515).
Ces techniques engendrent un changement en profondeur des méthodes suivies par le chercheur ou le clinicien. « La méthode traditionnelle – beaucoup de recherches continuent à être conduites ainsi – consistait à formuler une hypothèse, après quoi une expérimentation était conduite pour produire les données permettant de la confirmer ou de l’infirmer. Avec la génomique est apparue une nouvelle façon de travailler, qui consiste, grâce à la puissance de la technologie, à générer une masse d’informations, à en faire une analyse, et, sur ces bases, à formuler des hypothèses de recherches. Le système de santé va connaître la même évolution : des informations vont être générées dont une petite partie seulement sera immédiatement utile, le reste pouvant peut-être – on le ne sait pas toujours – l’être demain » (516).
La nouveauté de ces approches, la complexité et la pertinence très variable des informations produites devraient conduire à une extrême prudence dans l’utilisation des données ainsi obtenues.
Pour les praticiens, les règles de bonnes pratiques prévues à l’article L. 1131-2 du code de la santé publique devront définir, notamment dans le cas des tests pan génomiques, les conditions dans lesquelles les informations génétiques sont utilisées et portées à la connaissance de la personne concernée à mesure que leur interprétation se précise dans le temps.
Ces règles devront aider le praticien à répondre aux interrogations que Mme Perrine Malzac, praticien hospitalier dans le département de génétique médicale de l’hôpital de la Timone à Marseille et coordinatrice de l’Espace éthique méditerranéen, a recensées au cours de son audition : « que faire lorsque l’on découvre une variation de séquence dont l’effet pathogène n’est pas scientifiquement démontré ? Faut-il informer le patient de la découverte fortuite d’une anomalie génétique, comportant un effet pathogène potentiel pour lui ou pour sa descendance ? Les connaissances demeurant incomplètes, faut-il remettre à jour les données transmises au patient, et à quel rythme ? Et comment valider ou invalider les informations initialement données ? » (517).
Mais certains de ces tests sont à la disposition immédiate du public, en particulier par le biais d’Internet. La mise en œuvre de contrôles paraît alors plus difficile.
c) Renforcer les conditions de mise sur le marché des tests génétiques
Les tests génétiques relèvent du régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette catégorie a été introduite en droit interne (518) par l’ordonnance n°2001-198 du 1er mars 2001 transposant la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998. Elle comprend les réactifs de laboratoires, ceux destinés à être utilisés par le public – dénommés autotests – et l’ensemble des instruments destinés spécifiquement aux diagnostics in vitro dont la finalité consiste entre autres à « fournir une information concernant un état physiologique ou pathologique, avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale. » (519)
La procédure de marquage CE subordonne la mise sur le marché de ces produits à des exigences concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. Ces exigences garantissent la qualité technique du produit mais non son utilité clinique, laquelle constitue pourtant « un critère essentiel dans la décision de proposer un tel test à une personne ou à un groupe de personnes », selon l’article 5 du protocole additionnel à la convention d’Oviedo relatif aux tests génétiques à des fins médicales.
Faisant la synthèse de la pratique des généticiens dans le domaine du conseil génétique, le rapport explicatif au protocole précédemment cité pose deux catégories de critères définissant l’utilité clinique d’un test.
En premier lieu, il s’agit de vérifier le « service rendu » par ce dernier, « notamment la valeur des résultats du test pour la détermination des moyens d’agir sur le plan médical en termes de prévention ou de traitement. ». Le cadre dans lequel le test est proposé doit aussi être pris en considération, à savoir la qualité des services offerts en matière de génétique et l’accès à ces derniers, y compris le conseil génétique (520).
En second lieu, il doit être tenu compte de la situation de la personne à laquelle le test est proposé. « La mesure de l’utilité clinique d’un test peut être en effet différente d’un individu à un autre. » (521). Ces différences tiennent aux rapports qu’a la personne concernée avec sa famille, potentiellement intéressée par l’information, ainsi qu’à des aspects sociaux et culturels.
Ces deux critères devraient servir de principes directeurs à un renforcement du contrôle de la mise sur le marché des tests génétiques.
Des consultations visant à renforcer la régulation européenne telle que l’a définie la directive 98/79/CE ont été lancées en 2008. Plusieurs contributeurs ont souligné la nécessité d’une meilleure évaluation de l’utilité clinique des tests bénéficiant du marquage CE (522).
Le suivi de cette procédure devrait faire l’objet d’une attention particulière des autorités françaises pour qu’une version de la directive plus protectrice des utilisateurs soit rédigée dans un bref délai.
En droit interne, si l’AFSSAPS depuis la transposition de la directive précitée n’intervient plus dans la procédure d’autorisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, il lui appartient au titre de sa mission de surveillance du marché d’évaluer les bénéfices et les risques de leur utilisation (523).
Pour renforcer le contrôle en amont, il pourrait être envisagé de créer un régime d’autorisation de mise sur le marché, assorti de sanctions, similaire à celui qui existe pour les médicaments. Un tel dispositif, suggéré par le Conseil d’État (524), anticiperait le resserrement de la régulation auquel pourrait conduire un réexamen de la directive 98/79.
Il répondrait pour partie aux interrogations formulées par le CCNE (525) : « Les agences de santé ne devraient-elles pas être chargées d’évaluer, non seulement la sécurité des médicaments mis sur le marché, mais aussi la fiabilité des tests diagnostiques qui contribueront à déterminer l’opportunité de leur prescription ? […] Une telle validation est absolument indispensable afin d’éviter des résultats à l’interprétation douteuse et donc de conduire à des diagnostics erronés par excès ou par défaut, et à la prescription d’un traitement inapproprié ou à l’inverse à un geste d’abstention alors qu’un traitement aurait été nécessaire. »
L’adoption de mesures plus restrictives que celles imposées par les autorités européennes pourrait trouver sa justification sur le fondement de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des exceptions au principe de libre circulation des produits pour des motifs relevant en particulier de la santé publique, sous réserve de non discrimination commerciale.
À défaut d’une telle procédure, le CCNE estime nécessaire que « l’absence d’évaluation de ou des applications médicales de l’invention devrait faire l’objet d’une mention obligatoire portée à la connaissance du public. » (526)
Limité au territoire national, ce nouveau cadre resterait cependant d’une portée restreinte car, en France, seuls les professionnels agréés rattachés à des centres autorisés utilisent ces dispositifs de diagnostics in vitro. Le problème ne se pose véritablement que lorsqu’il est procédé à des tests génétiques, portant notamment sur des maladies multifactorielles, dans des laboratoires situés à l’étranger et dont les services sont vendus sur Internet.
d) Les dérives marchandes de la vente des tests génétiques sur Internet
Des sociétés de biotechnologie situées à l’étranger proposent sur Internet des tests génétiques de toute nature. Les examens offerts à la vente portent essentiellement sur des maladies multifactorielles, des vérifications de paternité (527) ainsi que sur la détermination du sexe des enfants à naître (528).
M. Josué Feingold, directeur de recherche émérite à l’Inserm, a dressé un constat alarmant de l’utilisation des tests génétiques sur Internet : « Aux États-Unis, et chez certains de nos voisins européens, nous assistons à un déluge de tests génétiques commercialisés sur l’Internet. Pour 260 dollars, une personne peut savoir si elle est porteuse du gène de la mucoviscidose – les résultats ne sont accompagnés d’aucun conseil génétique, ce qui est pour le moins problématique – pour 370 dollars, les marqueurs du diabète de type II sont étudiés.
Les tests de facteurs génétiques de maladies multifactorielles sont très coûteux : la société 23andMe propose de tester pour 999 dollars 600 000 marqueurs génétiques ; une entreprise concurrente teste un million de marqueurs pour 2 500 dollars et peut même effectuer, moyennant un abonnement annuel de 250 dollars, une mise à jour des données. Ces tests sont à la limite de l’escroquerie. Les risques sont relatifs et les marqueurs ne les augmentent ou ne les diminuent que très peu. De plus, un examen clinique permet de prévenir efficacement ces pathologies. » (529)
Un simple prélèvement de salive suffit pour réaliser l’examen. À cet effet, les laboratoires vendent des kits de prélèvement.
Le succès de ces tests ne trouve pas sa seule cause dans l’idéologie du « tout génétique ». Ces activités sont aussi liées à des préoccupations de rentabilisation financière. Comme l’a expliqué Mme Ségolène Aymé, directrice de recherches à l’Inserm, « Mus par l’illusion que le secteur des biotechnologies constituerait le marché du futur, les investisseurs ont engagé d’importants moyens financiers. Aujourd’hui, la pression pour de nouveaux produits est forte et certains tests n’ont d’autre utilité que de rentabiliser les investissements initiaux. » (530)
Il est difficile d’évaluer l’ampleur de ce phénomène. Seule une estimation du nombre de tests de paternité a été faite ; ceux-ci se seraient élevés à 10 000 en 2007, envoyés depuis la France à des laboratoires étrangers, selon le Conseil d’État rapportant un chiffre avancé par un expert judiciaire près la Cour de cassation.
Les tests à finalité médicale réalisés par le biais d’Internet ne semblent cependant pas avoir pris une importance telle que les consultations génétiques classiques s’en verraient dénaturées, même si pour tous les spécialistes auditionnés le risque est réel.
Des tests inutiles et incertains
S’agissant de la qualité des tests proposés, une étude publiée le 8 octobre 2009 dans la revue Nature fait part de différences notables dans les résultats de tests réalisés par des laboratoires démarchant sur Internet. Des taux de concordance inférieurs à 50 % ont été relevés pour des examens effectués sur des échantillons de provenance identique. Les calculs des risques de développer des maladies multifactorielles sont, en particulier, très disparates. (531)
La réalisation de ces tests ne garantit aucun des principes qui fondent l’encadrement du conseil génétique. Le secret des données recueillies échappe à tout contrôle. Le consentement de la personne dont les données génétiques sont analysées n’est pas vérifié puisque le prélèvement peut aisément avoir été effectué à son insu. La prise en charge médicale de l’individu testé est inexistante : ni la prescription du test ni la communication du résultat ne sont effectuées dans le cadre d’une consultation médicale individuelle. (532)
Certes, l’autotest « s’inscrit dans un souci légitime d’accroître l’autonomie de l’usager » constate le CCNE (533). Celui-ci de fait s’interroge sur la légitimité qu’il y a à restreindre l’accès à des données ayant aussi la caractéristique d’être non pas l’expression d’un état physique temporaire, comme une maladie, mais qui semblent renseigner sur ce qu’est la personne de façon pérenne.
Mais cette liberté, poursuit le CCNE dans le même avis, se fait « au détriment de l’éclairage dans sa forme médicale habituelle et pose de façon générale la question de l’accès, hors système de santé, à des informations ponctuelles, impliquant souvent de graves conséquences pour l’utilisateur et parfois son entourage […] La revendication contemporaine d’un libre accès à la connaissance provoque un marketing irresponsable qui entraîne une utopie perverse. Si cette revendication peut apparaître de l’ordre de l’évidence, elle méconnaît l’extrême complexité de ce que peut constituer cette connaissance. »
Privilégier l’information plutôt que la régulation
Une régulation en la matière paraît pour autant délicate à concevoir. La décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes, le 11 décembre 2003 dans l’affaire DocMorris (534), illustre les difficultés auxquelles se heurterait toute réglementation restrictive. L’arrêt reconnaît en effet la licéité de la vente par correspondance sur Internet des médicaments autorisés et ne faisant pas l’objet d’une prescription médicale. La Cour avait notamment rejeté l’argument du Deutscher Apothekerverband selon lequel l’objectif poursuivi par l’interdiction de la vente par correspondance de tels médicaments était de garantir au patient une information et un conseil personnalisés.
La publication d’une liste des tests utilisés par le public à délivrer sur prescription médicale contribuerait à asseoir la légalité d’un contrôle renforcé en ce domaine. Comme le souligne le rapport du Conseil d’État précité (535), il conviendrait que le ministre chargé de la santé prenne l’arrêté prévu à cet effet par l’article L. 5221-6 du code de la santé publique.
Même si les tests génétiques étaient soumis à une procédure de contrôle plus contraignante, le fait que les laboratoires engagés dans ce domaine sont implantés pour l’essentiel en Amérique du Nord(536), que les prélèvements peuvent facilement être envoyés par courrier postal et les résultats être transmis par téléphone ou courrier électronique limite cependant la portée de tout encadrement de ce commerce.
Une meilleure sensibilisation des éventuels utilisateurs de ces tests semblerait encore être le mode d’intervention des pouvoirs publics le plus réaliste.
Il convient de rappeler qu’il revient à l’AFSSAPS, aux termes de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique de contrôler « la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire ».
Prenant en considération la compétence de l’Agence de la biomédecine dans le domaine de la génétique, la Fédération française de génétique humaine (FFGH) propose de confier à l’agence « le soin d’exercer une veille permanente sur les produits disponibles sur le marché en recensant les examens en libre accès, en les évaluant et en diffusant l’information auprès du grand public. » (537) Cette mission de recensement et d’évaluation pourrait se traduire par l’élaboration d’un référentiel, comme le propose le Conseil d’État, « donnant une grille de lecture de la qualité des tests » (538) au regard de leur pertinence scientifique, de leur utilité clinique, de la fiabilité de leurs résultats, de leur valeur prédictive ainsi que de l’accompagnement de la personne et de la confidentialité des données fournies.
On notera qu’au Royaume Uni, la Commission de génétique humaine a lancé en septembre 2009 une consultation visant à évaluer une série de principes - plus de soixante sont formulés – pouvant servir de base à un code de bonne conduite aux entreprises commerciales proposant des tests sur Internet. Les propositions recueillies insistent en particulier sur la nécessité pour le promoteur de tests génétiques d’en décrire précisément les caractéristiques et les limites et d’indiquer que certains examens de génétique ne peuvent avoir de sens que s’ils sont précédés et suivis de consultations médicales individuelles. Elles soulignent l’obligation de fournir des explications claires sur le rôle de l’information génétique par rapport aux facteurs épigénétiques et environnementaux, et d’évaluer chaque test en conséquence. La confidentialité des données personnelles, l’utilisation secondaire des échantillons envoyés et le caractère libre et éclairé du consentement doivent faire l’objet de garanties explicites (539).
On rappellera que dans certaines circonstances des actions judiciaires peuvent contraindre les annonceurs à plus de prudence. Ainsi en 2008 en Inde, suite à une plainte d’associations luttant contre les avortements de fœtus féminins, Google, Microsoft et Yahoo ont retiré des sites Internet indiens les publicités qui portaient sur des tests génétiques visant à déterminer le sexe de l’enfant à naître.
Proposition n° 33. Inclure dans les bonnes pratiques à suivre pour prescrire des tests génétiques des dispositions relatives à l’utilisation et l’interprétation des tests pan génomiques.
Proposition n° 34. Soumettre à des conditions plus strictes les autorisations de mise sur le marché des tests génétiques en mettant en avant le critère de leur utilité clinique et renégocier la directive 98/79/CE sur les dispositifs de diagnostics in vitro.
Proposition n° 35. Confier à l’Agence de la biomédecine le soin d’exercer une veille permanente sur les tests génétiques proposés en particulier sur Internet, en recensant les examens en libre accès, en les évaluant et en diffusant l’information auprès du grand public. Cette veille devrait conduire à l’élaboration d’un référentiel qui servirait de grille de lecture de la qualité des tests.
3. Concilier le secret médical avec l’information de la parentèle
a) La finalité du dispositif adopté en 2004
Le contenu d’une information génétique présente le caractère très singulier de ne pas renseigner seulement sur l’état de santé de la personne qui s’est soumise au test mais aussi sur celui de ses parents, ascendants, collatéraux ou descendants. Quand des mesures de prévention ou de soin peuvent être proposées ou que la naissance d’enfants atteints d’une anomalie génétique pourrait être évitée, la connaissance de l’information génétique obtenue par le test d’un seul individu engage le destin de tout un groupe.
Les dispositions relatives à l’information de la parentèle se sont trouvées renforcées par la création de la profession de conseiller en génétique. 56 spécialistes sont ainsi venus renforcer depuis 2005 les équipes de médecins généticiens pour aider à la délivrance d’informations et conseils aux personnes et à leurs familles (540).
Mais les dispositions législatives portant spécifiquement sur l’information de la parentèle n’ont pas été appliquées. Le cadre traditionnel du colloque singulier entre le patient et le médecin, fondé sur la confiance que garantit le secret médical, s’adapte en effet mal à cette situation.
Proposer une voie indirecte d’information
En 2004, le législateur a conçu un dispositif qui tendait à assurer, dans la mesure du possible, la bonne information de la parentèle concernée par le résultat d’un test génétique dans le cas où la personne ayant bénéficié du test refuse d’en avertir de lui-même ses apparentés.
Les motivations d’un tel refus peuvent être diverses. Ce peut être, selon les praticiens auditionnés par la mission parlementaire, le souhait de ne pas inquiéter ses parents, la crainte d’être celui qui apporte la mauvaise nouvelle, la honte d’être celui par qui la maladie a été transmise, une mauvaise appréciation de l’importance de l’information ou encore un état de sidération après l’annonce du résultat du test qui rend toute personne peu apte à jouer le rôle d’informateur. Le CCNE a avancé d’autres cas de refus d’information : « il peut se rencontrer des situations de négligence, de doute d’un homme (ou de sa femme) sur la réalité biologique de la paternité, et même de conflit familial majeur, de situation psychiatrique, voire de sentiment bien ambivalent de " ne pas sombrer seul " »(541).
Les anomalies génétiques entraînant des maladies pouvant faire l’objet de mesures de prévention ou de soins si les individus touchés en sont informés suffisamment tôt sont nombreuses et bien identifiées. Les spécialistes mentionnent en particulier le déficit en ornithine carbamoyltransférase, maladie qui a donné lieu à deux décès d’enfants pour non transmission de l’information génétique, les hémochromatoses héréditaires pour lesquelles des mesures simples de prévention existent, les maladies récessives liées à l’X où, comme l’explique Mme Dominique Stoppa Lyonnet, chef du service oncologique de l’Institut Curie, « les apparentés ne disposent d’aucun indice pouvant les alerter et les amener à agir d’eux-mêmes. » (542). Le CCNE dans l’avis précité a fait mention de la phénylcétonurie, du myxoedème congénital, de la polypose colique familiale, du glaucome familial et de divers cancers familiaux.
Définie à l’article L.1131-1 du code de la santé publique, la procédure retenue par le législateur en 2004 vise le cas où l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne pose le diagnostic d’une « anomalie génétique grave ». Pèse alors sur le médecin le devoir d’informer la personne ou son représentant légal « des risques que son silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. » Cette obligation d’information se matérialise par la remise à la personne concernée d’un document résumant les renseignements communiqués. La personne diagnostiquée bénéficie d’une clause d’irresponsabilité dans le cas où elle ne porterait pas d’elle-même à la connaissance de ses apparentés l’information qu’elle a reçue.
Ce même article du code de la santé publique offre à la personne testée la possibilité de suivre une autre voie d’information que le législateur a appelée « information médicale à caractère familial » et dans laquelle l’Agence de la biomédecine intervient comme intermédiaire. La personne concernée communique au médecin les noms, adresses et liens de parenté des membres de sa famille, lequel transmet ces informations à l’ABM. L’Agence charge ensuite un autre médecin d’informer « lesdits membres de l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d’y accéder. »
L’engagement de la responsabilité
C’est la question de l’engagement de la responsabilité pouvant peser sur la personne refusant d’informer sa parentèle qui a motivé le dispositif retenu par le législateur en 2004.
La responsabilité engagée doit être analysée comme une responsabilité délictuelle de nature civile sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil. Le dommage résiderait, en l’espèce, dans l’absence de mesures de prévention ou de soins, pour laquelle la personne laissée dans l’ignorance de son état serait en droit de demander réparation au titre d’une perte de chance.
Les dispositions d’ordre pénal relatives à la mise en danger de la personne, en particulier le délit d’omission de porter secours (543), ne semblent pas applicables à des situations relevant de l’information génétique. Comme l’expliquait M. Francis Giraud, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, « Le droit pénal étant d’interprétation stricte, il conviendrait que la victime soit réellement en danger, c’est-à-dire, au sens du droit pénal, dans un état de péril imminent exigeant une action immédiate. » (544)
En 2004, ce dispositif avait été introduit à la fin de la navette parlementaire, en deuxième lecture au Sénat, après l’adoption par les députés d’une rédaction de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique qui faisait porter une responsabilité sur la personne en cas de non information de sa part de la parentèle potentiellement concernée.
Jugeant qu’il n’était pas admissible, au regard de la protection due à l’intimité de la vie privée, d’invoquer une telle responsabilité du patient, le Sénat, à l’initiative de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, avait suggéré une voie d’information subsidiaire passant par l’ABM.
Après que Mme Valérie Pécresse, alors rapporteure pour avis au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, eut fait part (545) des risques de contradiction qu’un tel dispositif risquait de présenter avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel(546), laquelle interdit qu’une loi puisse priver les victimes de leur droit à obtenir réparation des dommages résultant d’actes fautifs, le texte finalement adopté en commission mixte paritaire proposait une rédaction équilibrée. Son président, M. Francis Giraud, la résumait ainsi : « La commission mixte paritaire a prévu que le fait pour le patient de ne pas transmettre l’information directement ne pourrait servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre. En revanche, elle a refusé que ne puisse pas être recherchée la responsabilité de patients qui refuseraient de prévenir leurs proches par la procédure [de l’information familiale à caractère familial], qui est anonyme. Cette solution est logique en droit, la CMP ayant concilié le secret de l’intimité médicale, dont le patient peut se prévaloir, et les règles générales régissant la responsabilité à l’égard des tiers. Cette solution est aussi humaine : elle respecte le patient et permet qu’il soit accompagné dans cette démarche difficile, tout en laissant au juge la faculté de sanctionner d’éventuelles malveillances dont les conséquences peuvent être gravissimes. Je dois souligner que c’est à l’unanimité que la CMP a adopté cet article ainsi rédigé. » (547)
Le décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui devait préciser les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d’accès de ces informations n’ayant pas été publié, la procédure d’information médicale à caractère familial n’a pas, à ce jour, été mise en œuvre.
On comprend que le Conseil d’État ait constaté le profond déséquilibre, au regard de la question de la responsabilité, de la situation ainsi créée : « il en résulte de fait, un régime d’irresponsabilité totale de la personne concernée qui ne transmet pas l’information à ses apparentés. » (548)
b) Une procédure restée lettre morte
Plusieurs difficultés paraissent avoir fait obstacle à la rédaction du décret en Conseil d’État nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de l’information familiale :
– les problèmes inhérents à la composition de toute liste de noms et d’adresses, à savoir l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies ;
– les problèmes de sécurité que pose la constitution d’un fichier de données personnelles, même si le décret d’application prévoyait l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
– les problèmes liés à la communication des données médicales personnelles nécessaires au médecin qui prendra contact avec les personnes ;
– l’intervention possible de plusieurs médecins généticiens du fait de la dispersion éventuelle de la famille sur le territoire ;
– la nature de la lettre à envoyer aux apparentés et la nécessité de s’assurer de sa bonne réception ;
– le respect du droit de ne pas savoir qui fait partie des principes généraux des droits de la personne malade et qui vaut aussi bien pour la personne refusant de prendre connaissance du test que pour les apparentés éventuellement contactés (549);
– la nature de la responsabilité de l’organisme servant d’intermédiaire.
Face à toutes ces interrogations, le Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine a jugé que la procédure retenue par le législateur est « particulièrement compliquée voire inadaptée », « complexe à gérer en surajoutant les interventions » et « n’aide guère au discernement éthique. » (550)
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l’ABM, a moins mis l’accent sur des problèmes techniques ou éthiques que sur le caractère singulier de la démarche au regard des traditions médicales : « Si le décret n’a pas été pris, c’est sans doute que les esprits n’étaient pas mûrs […] La solution qui aurait consisté à faire de l’Agence de la biomédecine l’interface entre les patients et leurs familles, ce qui évitait aux médecins une violation directe du secret médical, n’a pas marché, car le corps médical était encore trop hésitant. Les médecins généticiens, eux, sont parfaitement au fait de ces questions et seraient prêts à assumer cette information. Mais ils manquent de relais parmi leurs confrères [...] Si on demande [à l’Agence] expressément de jouer ce rôle, elle le jouera, même si elle n’est pas convaincue que ce soit la meilleure solution. » (551)
c) D’autres procédures possibles d’information
Toute communication de données médicales personnelles à des tiers constitue une levée du secret médical dont il convient de rappeler qu’il est une disposition d’ordre public dont la transgression est un délit. Le patient ne peut en conséquence pas délier de lui-même le médecin du secret médical. Seule une disposition législative permet d’aménager l’exception nécessaire pour asseoir la légalité de la transmission de données individuelles de santé ne se faisant pas au profit direct du patient.
La question qui se pose au législateur est de savoir s’il convient de garantir ou seulement de favoriser l’information de la parentèle. Dans le premier cas, la levée du secret médical pourrait se faire sans le consentement de la personne ; dans le second, l’accord du patient serait une condition substantielle à la mise en œuvre de la procédure.
Seule, en Europe, la législation helvétique a prévu de passer outre au consentement du patient dans l’hypothèse où certaines données génétiques pourraient concerner la parentèle. La procédure retenue est la suivante : « Si la personne concernée refuse son consentement, le médecin peut demander à l’autorité cantonale compétente d’être délié du secret professionnel, […] lorsque la protection d’intérêts prépondérants des membres de la famille, du conjoint ou du partenaire nécessite que ceux-ci soient informés. L’autorité peut solliciter l’avis de la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine, la seule à prévoir une levée du secret médical. » (552) Il ne serait en effet pas envisageable d’habiliter le seul médecin à lever le secret médical dans ce cas. C’est pourquoi, si le choix est fait de garantir à la parentèle une information dans le cas extrême d’un refus de consentement, il est nécessaire de prévoir l’appel à une autorité habilitée et le recours à l’avis collégial d’un comité d’experts. Selon Mme Laurence Lwoff, chef de la division bioéthique du Conseil de l’Europe, aucune demande n’a été formulée auprès de la commission d’experts depuis que la loi suisse est entrée en vigueur en 2007. (553)
Au regard de la convention d’Oviedo, l’article 18 du protocole additionnel relatif aux tests génétiques à des fins médicales stipule que « lorsque les résultats d’un test génétique sur une personne peuvent être pertinents pour la santé d’autres membres de sa famille, la personne ayant fait l’objet du test doit en être informée. » Le rapport explicatif au protocole indique que le choix de la procédure suivie pour sensibiliser la personne de l’importance que revêt l’accès des intéressés à l’information génétique qu’il détient est laissé à l’appréciation des États membres ; par exemple il s’agit de « la possibilité de prévoir qu’une instance compétente, après évaluation comparative des intérêts respectifs des personnes concernées puisse décider de la communication ou non des informations concernées aux membres de la famille. » (554) Mme Laurence Lwoff a estimé que la procédure instaurée en Suisse, assortie de ses garanties procédurales, s’inscrit dans les exceptions prévues à l’article 26 de la convention, selon lequel « l’exercice des droits et les dispositions de protection ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». (555)
Le Conseil d’État propose une procédure différente qui respecterait le principe du consentement du malade et encadrerait strictement la levée du secret médical. La personne serait tenue d’informer ses apparentés, un défaut d’information engageant sa responsabilité. En cas d’impossibilité ou de difficulté, le médecin prescripteur serait habilité à informer les membres de la parentèle dont les adresses lui auraient été communiquées, après avoir recueilli le consentement de la personne concernée. Le contenu de la lettre qui serait envoyée ne serait pas attentatoire à la vie privée du patient puisque son nom ne serait pas mentionné. Le droit de ne pas savoir serait également respecté, ni l’anomalie génétique ni le risque qui lui est associé n’étant mentionnés.
La Fédération française de génétique humaine suggère une autre procédure, inspirée de l’avis n°76 du CCNE en ce qu’elle maintient de façon absolue le secret médical : « Une alternative à la procédure d’information familiale pourrait être d’envoyer une lettre au médecin traitant avec un double au patient expliquant les risques pour ses apparentés. A la lettre destinée au patient, pourrait être associé un document explicatif que le patient pourrait utiliser pour diffuser l’information à sa parentèle. Des modèles de documents de ce type pourraient être élaborés sous l’égide de l’Agence de Biomédecine dans le cadre [de] règles de bonnes pratiques […]. » (556)
d) Redéfinir une procédure simple et équilibrée
Une première proposition consisterait à ne pas légiférer. Telle est la position de Mme Roselyne Bachelot, Ministre la santé et du sport : « Tout cela se résout en général de manière humaine, par le dialogue entre cette personne et son médecin. Il n’y aurait aucun sens que la loi interdise cette information, car elle serait très souvent transgressée. En revanche, imposer au médecin de rompre le secret médical dans ce cas serait extrêmement difficile sur le plan éthique. Je pense qu’il faut faire confiance et laisser une large latitude au colloque singulier entre le médecin et son patient porteur d’une anomalie génétique. » (557)
Trouver des solutions de droit à des situations de blocage implique de mettre en balance le principe du respect de la vie privée du patient – reconnu au nombre des droits de la personne malade (558) et déduit du principe fondamental de l’autonomie de la personne –avec l’intérêt de la parentèle dont la vie de certains membres peut être en cause.
Il convient de souligner que peu d’éléments sont disponibles pour apprécier la fréquence de ce type de refus. Se référant à leur pratique, les médecins auditionnés par la mission ont estimé que les cas de refus de communiquer l’information sont très rares, un travail d’explication de la part du médecin, du conseiller en génétique ou du psychologue suffisant le plus souvent à lever les éventuelles réticences. Des situations extrêmes néanmoins ont fait l’objet d’une saisine du Médiateur de la République. Mme Ségolène Aymé, directrice de recherche à l’Inserm, estime, quant à elle, que ces difficultés ne sont pas négligeables : « Dans 10 % des familles, l’information est bien diffusée et dans 10 % des cas, elle ne passe pas du tout. Pour le reste, elle est donnée ou non selon que l’on entretient ou pas de bonnes relations avec son parent. » (559)
L’information familiale dans le domaine du dépistage du cancer est cependant mieux évaluée. Mme Marcela Gargiulo, psychologue clinicienne, après avoir rappelé que l’information revêt dans ce cas « un caractère vital puisque les personnes porteuses de la mutation peuvent bénéficier de mesures préventives, de surveillance renforcée et d’un dépistage précoce de la maladie rapporté les conclusions de deux études. » (560) a communiqué les résultats de deux études sur la prédisposition héréditaire aux cancers familiaux du colon et au cancer du sein et de l’ovaire. Celles-ci montrent « que la personne qui consulte informe souvent ses frères et sœurs du risque encouru – 78 % et 90 % – ainsi que ses enfants – 52 % et 72 % –, beaucoup moins ses propres parents – 30 et 58 %. La diffusion de l’information est plus problématique pour les parents éloignés comme les oncles et tantes – 13 % –, soit par manque de contact, soit parce que la personne estime que d’autres se chargeront de les informer à sa place. » (561)
Les personnalités médicales auditionnées se sont toutes prononcées pour le maintien du principe du consentement. L’avis citoyen du panel de Strasbourg exprimé dans le cadre des États généraux de la bioéthique a défendu une position similaire dans les termes suivants : « dans l’hypothèse d’une potentielle mise en danger de la vie d’apparentés du patient […] seul le dialogue entre le médecin et le patient peut aider à régler cette situation. » (562)
Plus généralement, une procédure médicale dans laquelle le respect de la vie privée du malade ne serait plus garanti semble présenter plus de défauts que d’avantages. Elle répondrait certes aux quelques cas où la vie d’autrui est menacée du fait de la volonté d’une seule personne mais elle risquerait de conduire à de nombreux refus de consultation aux conséquences encore plus graves.
Pour ces raisons, toute procédure, aussi exceptionnelle soit-elle, qui ouvrirait la voie à une levée du secret médical sans l’accord du patient paraît devoir être écartée.
Il semble cependant difficile de ne pas reconnaître une spécificité à la consultation génétique et d’ignorer les dilemmes éthiques qui peuvent naître à cette occasion. Pour y répondre, il convient de conserver une procédure souple qui propose à la personne testée différentes voies possibles d’information de sa parentèle, tout en mettant en avant la responsabilité qui, de fait, pèse sur elle.
La solution proposée en particulier par la Fédération française de génétique humaine consistant à faire du médecin traitant le destinataire de la lettre contenant l’information établie par le généticien semble d’une portée pratique très réduite. Elle s’inscrit dans le cadre traditionnel du médecin de famille familier de parentés entières et renvoie à la seule conscience du médecin la question de la levée du secret médical.
La solution avancée par le Conseil d’État et par plusieurs généticiens qui, le cas échéant, charge le médecin généticien, avec l’accord du patient, de procéder, dans la mesure du possible, à l’information de la parentèle paraît la plus équilibrée. En l’absence de toute clause d’irresponsabilité, elle répond à l’exigence posée en 2004 de responsabiliser la personne détentrice d’une information qui, de fait, concerne une collectivité d’individus. Elle propose un dispositif plus efficace que celui adopté en 2004, en ce qu’elle substitue à une procédure administrative complexe et opaque, décalée de la consultation génétique de la personne testée, une voie d’information directe, initiée par le médecin ayant prescrit le test. Elle autorise une levée partielle du secret médical tout en demeurant conforme au principe d’autonomie de l’individu, puisque l’information sera transmise sous réserve de son consentement. Elle s’appuie sur le lien de confiance entre le patient et le médecin, seul à même d’amener la personne à communiquer les coordonnées des membres de sa parentèle.
Le dispositif ne pourrait être mis en œuvre que dans le cas où une anomalie génétique grave est détectée et que celle-ci est susceptible de prévention ou de soins.
Pour aider la personne testée à évaluer les risques que son silence peut faire courir à l’égard des apparentés potentiellement concernés, il devrait être précisé que le document que le médecin lui remet et qui résume les informations communiquées indique explicitement la nature de la responsabilité qui pèse sur elle. Comme l’a fait remarquer Mme Nicole Philipp, médecin coordonnateur au département de génétique médicale de l’hôpital de la Timone-Enfants à Marseille, « les exigences actuelles en matière d’information sont insuffisantes […]. Le patient est généralement averti sur l’importance de cette information lors de la prescription de l’examen, avant même que le diagnostic soit établi. Il conviendrait plutôt que le médecin rappelle au patient cette nécessité lors de la remise de résultats ayant une possible implication familiale, et les accompagne d’un document écrit, si possible personnalisé, résumant les conséquences pour la descendance et les apparentés. » (563)
Mme Dominique Stoppa-Lyonnet, chef du service de génétique oncologique de l’Institut Curie, a attiré l’attention des membres de la mission sur le fait que la responsabilité sera appréciée par le juge en fonction des situations propre à chaque malade : « Les juridictions éventuellement appelées à se prononcer le feront bien entendu au cas par cas. Dans le cas d’une maladie dominante grave, où il y a déjà eu de nombreux décès dans la famille, on peut imaginer que le juge, saisi en responsabilité par un apparenté qui n’a pas été informé, puisse faire valoir que cet apparenté, vu l’histoire familiale, aurait pu par lui-même chercher à en savoir davantage, et que ne soit pas retenue la responsabilité de son parent qui ne l’a pas informé. En revanche, dans le cas d’une maladie récessive liée à l’X, où les apparentés ne disposent d’aucun indice pouvant les alerter et les amener à agir d’eux-mêmes, la responsabilité de la personne porteuse de l’anomalie génétique pourrait être recherchée. » (564)
Des interrogations ont été formulées sur la procédure consistant à informer par courrier les membres de la parentèle. Selon Mme Marie-Christine Ouillade, administratrice de l’Association française contre les myopathies (AFM), « La proposition du Conseil d’État me paraît peu réaliste. D’abord, la personne qui est en déni de la maladie ne voudra pas fournir les adresses de sa parentèle. On ne va pas faire appel à un généalogiste pour les trouver. Ensuite, la réception d’une lettre informant que l’on doit consulter parce qu’il y a une maladie génétique dans sa famille provoque un choc énorme. La nouvelle est déjà difficile à entendre quand elle est annoncée de manière encadrée mais, par ce biais, elle est très violente. » (565). Il convient cependant de rappeler que le médecin généticien ne sera tenu d’informer que les apparentés dont les adresses lui auront été fournies par la personne concernée. En outre, le contenu de la lettre restera le plus neutre possible, précisant l’existence d’un risque familial et recommandant de prendre contact avec un service de consultation génétique. Enfin, un choix doit être opéré entre les conséquences psychologiques que peut avoir un tel mode d’information et la mise en péril de la vie d’autrui que risque d’entraîner une absence d’information.
En complément de cette procédure, il pourrait être proposé de renforcer le rôle des associations de malades dont les membres sont familiers de ces situations. Mme Viviane Viollet, responsable de la commission éthique de l’Alliance maladies rares a suggéré que la consultation génétique au cours de laquelle les conséquences de la maladie sont envisagées « soit ouverte à un « grand témoin », à savoir une personne malade acceptant de parler de son vécu avec sa maladie, des retombées sur toute la famille et de l’urgence de faire de la prévention. » (566) Si la présence d’une personne n’appartenant pas à une profession médicale pourrait faire problème au regard du secret médical, il pourrait cependant être proposé, au titre des bonnes pratiques portant sur la délivrance de l’information génétique, qu’en cas de refus de la part du patient d’informer ses apparentés, sous quelque forme que ce soit, le médecin recommande au patient de prendre contact avec une association de malades. L’éclairage de personnes connaissant des situations similaires est susceptible de fournir une aide précieuse à la personne en détresse. Les associations qui pourraient être sollicitées devraient au préalable être agréées, au niveau régional ou national, conformément à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Le dispositif législatif proposé devra cependant composer avec deux difficultés. La première tient au fait que la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne n’est pas réservée aux seuls médecins généticiens, les habilitations prévues en ce domaine ne portant que sur la réalisation des examens génétiques. La spécificité de la procédure de l’information de la parentèle rend cependant difficilement envisageable que celle-ci puisse être mise en œuvre dans un cadre plus large que celui de la consultation de génétique. Aussi conviendra-t-il de prévoir ou bien des conditions restrictives à l’habilitation de lever partiellement le secret médical, ou bien que les règles de bonnes pratiques relatives à la prescription des tests génétiques disposent que, dans cette situation, le médecin non spécialiste doit adresser le patient au service de génétique compétent.
La seconde difficulté tient au risque d’une interprétation différente suivant les cas de la notion d’anomalie génétique grave susceptible de prévention ou de soins. Convient-il d’établir une liste des maladies visées, ce que le ministère de la santé estime impossible à réaliser, ou faut-il laisser les sociétés savantes en décider et renvoyer l’appréciation de la gravité des cas à des codes de bonnes pratiques ?
e) Faut-il étendre le champ des maladies pouvant faire l’objet d’une information de la parentèle ?
Les conditions au regard desquelles la procédure d’information familiale peut être engagée sont restreintes : il s’agit de maladies génétiques graves pour lesquelles des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées. On peut s’interroger, comme l’a fait la Fédération française de génétique humaine, sur la portée de ces critères : « Que recouvre la notion de maladie génétique grave ? S’agit-il d’une maladie potentiellement fatale si aucune mesure de prévention n’est prise comme le déficit en OTC? S’agit-il d’une maladie très invalidante mais se révélant tardivement comme la maladie de Huntington ? S’agit-il d’une maladie grave mais pouvant faire l’objet d’une surveillance efficace comme un cancer du sein chez les porteurs de mutation BRCA1 ou BRCA2 ? » (567)
On remarquera que le terme de maladie peut aussi faire l’objet d’interprétations. Si les particularités génétiques d’une personne peuvent induire des réponses très différenciées à des médicaments, comme le montrent certaines données de pharmacogénétique, ne conviendra-t-il pas d’en prévenir aussi les membres de sa famille, sans qu’il s’agisse en l’occurrence de maladie ? Il semble que dans ce cas aussi la responsabilité de la personne pourrait être engagée sur des fondements identiques à ceux précédemment décrits.
Inclure ces données dans la procédure d’information familiale étendrait à l’excès le champ de la responsabilité qui en est le corollaire. Il reviendrait cependant au généticien d’informer avec précision la personne concernée de l’importance que ces informations peuvent avoir pour d’éventuels apparentés.
La Fédération française de génétique humaine s’interroge aussi sur le cas où la maladie ne peut pas faire l’objet de mesure de prévention et ne relève donc pas de la procédure d’information de la parentèle. Mme Catherine Avanzini, membre de la commission de la fédération Alliance maladies rares a estimé que « la majorité des personnes préfère en avoir connaissance pour consulter et prendre des dispositions. » (568) On remarquera aussi que le rapport explicatif du protocole additionnel à la convention d’Oviedo relatif aux tests génétiques prend en compte dans la définition de l’utilité clinique d’un test génétique la délivrance d’une information sur un risque de développement d’une maladie « même en l’absence de stratégie ou de traitement de la maladie en question. » (569)
Cependant un certain consensus se dégage pour considérer que la procédure d’information familiale n’a pas à s’appliquer dans le cas de maladies incurables. Des études portant sur la maladie de Huntigton ont révélé que moins du quart des personnes atteintes avaient été informées par leurs propres parents, ce que Mme Marcela Gargiulo, psychologue clinicienne a commenté dans les termes suivants : « Ces résultats montrent combien il est difficile de parler de la maladie de Huntington à ses propres enfants, et que l’information se fait assez tard – certainement en raison de l’apparition tardive de la pathologie et de l’absence de prévention possible. » (570) Les médecins paraissent particulièrement réticents à faciliter la communication d’informations qui dépassent le conseil médical et qui mettent en jeu le rapport intime que des individus encore en bonne santé entretiennent avec leur propre destin.
La question se pose différemment dans l’éventualité de projets parentaux, comme l’explique la Fédération française de génétique humaine : « Certaines maladies "graves" n’ont actuellement pas de prévention possible ni de traitement curatif (ex : la maladie de Huntington). Doit-on inclure l’accès au conseil génétique et au diagnostic prénatal (DPN) ou au diagnostic pré-implantatoire (DPI) comme des moyens de prévention de ces maladies? Dans ce cas faut-il considérer que l’absence d’information constitue une perte de chance pour la parentèle du sujet atteint ? » Cette situation est particulièrement complexe : la prévention ne se ferait pas au bénéfice direct du patient mais porterait sur le fait de donner naissance à un enfant atteint ou non par la maladie.
Selon le CCNE, prévenir une naissance ne saurait constituer une mesure de prévention. Ce serait là une expression « excessivement paradoxale »(571), inappropriée en l’espèce.
Mais s’il est manifeste qu’il ne saurait être reproché à une personne de ne pas être informée des projets parentaux que sont susceptibles d’avoir certains de ses apparentés, il n’en reste pas moins que l’information qu’elle détient peut être déterminante.
Dans une telle situation aucune solution d’ordre général ne paraît satisfaisante.
On rappellera par ailleurs le problème, précédemment abordé, des diagnostics génétiques posés indirectement par le biais d’analyses dont la finalité première n’est pas d’établir les caractéristiques génétiques d’une personne. Dans ce cas, il semble nécessaire que le patient soit dirigé vers une consultation de génétique, seule à même d’engager, le cas échéant, la procédure d’information de la parentèle.
Proposition n° 36. Autoriser la personne concernée à lever partiellement le secret médical pour habiliter le médecin prescripteur d’un examen génétique à informer les membres de la parentèle de cette personne dans le cas où une anomalie génétique grave, susceptible de mesures de prévention ou de soins, serait détectée. Une lettre serait envoyée aux apparentés pour lesquels la personne testée aura fourni les adresses, les invitant à procéder à une consultation génétique, sans que le nom de la personne testée ni la nature de l’anomalie ne soient mentionnés.
Rappeler dans le document remis à la personne testée que sa responsabilité est engagée en cas de refus d’informer ses apparentés soit directement soit par la voie du médecin prescripteur.
Réserver cette procédure aux médecins spécialisés dans le domaine de l’examen des caractéristiques génétiques.
Proposition n° 37. Proposer au patient qui refuserait d’informer sa parentèle de prendre contact avec une association de malades agréée susceptible d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique dépistée.
4. La pharmacogénétique : un usage méconnu de la génétique et des questions éthiques nouvelles
La pharmacogénétique est « l’étude de l’influence de la variabilité du génome dans la réponse aux médicaments. »(572). Elle pourrait contribuer à lutter contre une iatrogénie médicamenteuse importante – 128 000 hospitalisations en France chaque année– et contre certaines inefficacités médicamenteuses. (573)
Certes, comme l’a expliqué M. Philippe Beaune, chef du service de biochimie de l’hôpital européen Georges Pompidou, « Le plus souvent, la cause de la variabilité observée demeure inconnue. La génétique n’en explique qu’une petite part […] » (574) mais d’ores et déjà, la prescription d’une dizaine de médicaments, pour lesquels des risques toxiques élevés ou des effets indésirables sont prouvés, est liée à la réalisation de tests génétiques. (575)
La pharmacogénétique a, par exemple, montré son efficacité dans le cas de certains traitements anticancéreux particulièrement onéreux et caractérisés par une importante variabilité de leurs effets. Il a été ainsi mis en évidence que des anticorps monoclonaux, susceptibles d’exposer les patients à des effets toxiques importants, étaient d’une inefficacité totale en présence d’une mutation génétique bien identifiée. Ces résultats ont conduit l’AFSSAPS à exiger la réalisation d’un test génétique préalablement à la prescription de ce type de traitement. (576)
Comme l’observe le professeur Beaune « La pharmacogénétique peut aussi permettre de « sauver » certains médicaments. Certains, pourtant très efficaces et bon marché, ne sont plus vendus aux États-Unis ou en France, alors qu’ils le sont encore en Australie. Simplement, un test génétique y est requis avant qu’ils puissent être prescrits : 5 % de la population ne doivent pas y avoir recours, mais 95 % en retirent un grand bénéfice. » (577)
En ce sens, le partage des informations génétiques pertinentes devient un enjeu croissant pour les chercheurs. Les auteurs du rapport de l’Inserm insistent sur l’importance de la mise en commun des résultats des essais cliniques de pharmacogénétique réalisés sur différentes populations, seul moyen de corréler des données génétiques à l’effet d’une thérapie.
Cependant, en dépit de certains succès et d’une recherche fondamentale importante en la matière, les essais cliniques de pharmacogénétique peuvent, en un premier bilan, apparaître assez décevants(578). Aussi, un encadrement légal particulier ne paraît pas nécessaire – même s’il conviendrait selon les professionnels de mieux reconnaître et d’organiser cette activité hospitalière qui représente 15 laboratoires agréés ou en cours d’agrément en France.
Néanmoins, dans l’hypothèse où ces techniques gagneraient en importance en s’étendant à une gamme très large de thérapies (579), les principes protecteurs de la personne, précédemment décrits, seraient mis à l’épreuve et de nouvelles problématiques éthiques apparaîtraient.
La première question est celle du coût pour la santé publique que représenteraient des médicaments de plus en plus individualisés. « Du médicament utilisé par tous, passera-t-on à un médicament sur mesure pour chacun ? Derrière cette question, se posent, on le voit, de véritables problèmes éthiques, notamment celui de l’accessibilité des soins […] La pharmacogénétique a bien entendu nourri l’espoir de pouvoir mettre au point des thérapeutiques personnalisées. Utopie ou réalité ? Certains font valoir que cela coûte tellement cher que cela demeurera un rêve inaccessible, d’autres que c’est si important qu’il faut tout faire pour que ce rêve se réalise. Disons raisonnablement qu’il faut apprécier le rapport coût/efficacité, ce qui est d’ailleurs très difficile » (580) a expliqué le professeur Beaune.
La multiplication des tests génétiques soulèvera, en outre, de manière plus aiguë, le problème de la protection des données personnelles en multipliant les possibilités d’atteinte à la vie privée et les risques de discrimination.
La question de l’utilisation à des fins commerciales des données généti-ques ne manquera pas non plus de surgir.
On remarquera enfin, comme il en a déjà été fait mention, que la question de l’information de la parentèle se pose lorsqu’une mutation génétique héréditaire ne s’exprime pas par des signes cliniques mais détermine une sensibilité particulière à un médicament.
B. L’EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
La recherche scientifique dans le domaine de la génétique humaine nécessite l’utilisation d’éléments biologiques à partir desquels les chercheurs effectuent leurs travaux. La mission d’information a été ainsi amenée à s’intéresser à la question des collections d’échantillons, sujet qui concerne de manière générale l’ensemble des recherches biomédicales.
1. Les biobanques : un encadrement législatif récent
a) Une activité en plein essor
Les collections de matériel biologique constituent des instruments de recherche scientifique dont l’importance ne cesse de croître. Systématisant la diversité du vivant autour d’une unité thématique, les collections d’échantillons sont indispensables dans le domaine médical où, selon une typologie dressée par l’Agence nationale de la recherche, elles ont trois finalités principales : « l’identification et la validation de cibles thérapeutiques, d’outils diagnostiques et de biomarqueurs nouveaux ; les études de variations phénotypiques, génétiques et épidémiologiques ; la caractérisation de nouvelles entités pathologiques, fondées sur des critères moléculaires. » (581)
Constituées entre autres de tissus, de cellules, de sérums et d’ADN, leur création relève d’initiatives très diverses. On citera comme exemple et modèle le Plan cancer qui a favorisé la mise en place de plus de 60 tumorothèques (582). Les données des diverses tumorothèques feront l’objet d’un accès simplifié grâce à la mise en œuvre d’une tumorothèque virtuelle nationale (583).
Une association de malades telle que l’Association française contre les myopathies a financé la banque d’ADN et de cellules de Généthon, l’une des plus importantes en Europe pour les maladies génétiques, créé une banque de tissus pour la recherche (Myobank-AFM/Institut de Myologie) et a initié le réseau EuroBioBank en collaboration avec plusieurs pays européens. Elle a en outre contribué à la création de 14 biothèques internationales.
La biobanque de Picardie regroupe une grande diversité de collections pour plus d’une dizaine de groupes de pathologies et comptait plus de 80 000 échantillons au 1er octobre 2008.
De nombreux établissements de santé disposent de collections qui font l’objet de regroupements. Ainsi, le CHU de Lyon coordonne au sein du même centre de ressources biologiques cinq collections : une neurobiotec, une cardiobiotec, une tumorothèque, une virobiotec et un centre de biotechnologies cellulaires consacré aux maladies génétiques. (584) Le 24 juin 2009, a été inaugurée la plate-forme de ressources biologiques de la Pitié-Salpêtrière qui rassemble dans un même lieu plusieurs biobanques : Myobank, la banque de tissus musculaires de l’Institut de Myologie-AFM, le GIE NeuroCEB, banque de tissus pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, la Tumorothèque et la Cérébrothèque de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Les centres de ressources biologiques peuvent fonctionner en réseau, comme c’est le cas dans l’agglomération marseillaise.
Au niveau européen, le projet BBMRI (585), soutenu par la Commission européenne, se fixe pour but, par exemple, de soutenir la recherche effectuée à partir des biobanques en harmonisant les pratiques de qualité, en assurant le transfert efficace des connaissances et des technologies et en définissant un cadre légal, éthique et financier de référence. De tels réseaux contribuent à leur tour à la réalisation de projets d’études à large échelle, à l’image du projet P3G (586) qui, dans le domaine de la génétique populationnelle, favorise les études d’association.
Les missions des biobanques, dénommées encore centres de ressources biologiques à l’instar de la biobanque de Picardie, sont les suivantes :
– La collecte des prélèvements biologiques et leur conservation par aliquots ;
– Le stockage et la gestion d’échantillons biologiques selon la demande des partenaires (protocoles) ;
– L’expertise et l’évaluation de façon rétrospective sur le plan médico-scientifique de tout ou partie des échantillons biologiques conservés ;
– L’assurance de la préservation de l’information clinique et biologique associée à chaque échantillon et cohorte ;
– La cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie des échantillons conservés auprès des demandeurs membres ou non de l’association ;
– La vente de prestations en rapport avec les missions de Centre de Ressources Biologiques (587).
L’activité des biobanques est fondée sur le principe de non-patrimonialité du corps humain. Le don de l’échantillon est gratuit et ce dernier ne peut pas faire l’objet d’un droit patrimonial. Ce principe n’interdit cependant pas toute transaction financière. Comme l’a expliqué Mme Anne-Laure Morin « Le service que rend la biobanque à une industrie pharmaceutique ou à tout chercheur peut être monnayé dès l’instant où aucun prix n’est fixé pour la cession de l’échantillon. C’est ce que mettent en œuvre les praticiens du droit à l’heure actuelle. La biobanque mobilise des personnels, entretient des congélateurs, stocke, elle détient un savoir-faire très technique : c’est ce coût qui est récupéré. Ainsi, il n’est pas dérogé au principe de non-patrimonialité. » (588)
b) Les choix du législateur en 2004
La loi de bioéthique de 2004 a introduit une définition juridique des collections d’échantillons biologiques humains et encadré les activités des organismes qui en assurent la conservation.
Aux termes de l’article L.1243-3 du code de la santé publique « Les termes "collections d’échantillons biologiques humains" désignent la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d’un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements. »
Le législateur a distingué les organismes qui constituent et utilisent ces collections pour les besoins de leurs programmes de recherche (589) de ceux qui assurent la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique, dans le cadre d’une activité commerciale ou à titre gratuit(590). Les premiers relèvent d’un régime de déclaration, les seconds d’un régime d’autorisation, l’autorité compétente étant le ministre chargé de la recherche.
Le dispositif adopté obéit au souci d’éviter une utilisation des échantillons humains qui les ferait considérer comme des choses. En tant qu’éléments et produits du corps humain, les échantillons sont considérés comme substantiellement rattachés à la personne du donneur, même si le don est ancien.
Le respect des droits des donneurs est contrôlé par le comité de protection des personnes territorialement compétent, lequel intervient dans la procédure de déclaration des collections en émettant un avis portant sur la qualité de l’information des participants, les modalités de recueil du consentement et la pertinence éthique et scientifique du projet.
L’autorisation nécessaire pour exercer une activité de biobanque est liée à un avis du comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS), organisme institué auprès du ministre de la recherche dont le rôle est d’éclairer la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur la justification du traitement de données à caractère personnel dans un but de recherche(591). Les collections constituées à des fins de recherche génétique ne font pas exception à ce cadre commun. Cependant, si le traitement des données personnelles ne permet pas une identification directe des personnes concernées, les organismes peuvent bénéficier d’une procédure de déclaration simplifiée (592).
Le décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 et l’arrêté du 16 août 2007 ont précisé ces dispositions.
Cette approche protectrice des droits de la personne se traduit aussi par le respect de la volonté du donneur dans toutes les étapes du développement de la collection, illustrant ce que Mme Anne-Laure Morin a appelé « le régime personnaliste » de l’échantillon (593). Ainsi, le consentement à la recherche ne saurait être considéré comme valant aussi pour la conservation des échantillons à l’issue de la recherche. Cette possibilité doit avoir été explicitement incluse dans le champ du consentement du donneur (594). De façon similaire, l’article L. 1211-2 du code de la santé publique définit les conditions légales dans lesquelles des changements de finalité dans l’utilisation des échantillons sont possibles : le donneur doit en être dûment informé et être en mesure, le cas échéant, d’exprimer son opposition. Aucune dérogation à cette obligation d’information pour les échantillons constitués de tissus ou cellules germinaux n’est admise. Pour les autres produits du corps humain, des dérogations sont autorisées dans deux cas : s’il n’est pas possible de retrouver le donneur ou si le comité de protection des personnes n’estime pas cette information nécessaire.
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment prendre des mesures de contrôle sur ces organismes et, en cas de non respect des exigences réglementaires, édicter des mesures de suspension, d’interdiction ou de retrait d’autorisation.
Pour les activités soumises à déclaration, l’article R. 1243-5 du code de la santé publique impose la remise au ministre de la recherche d’un rapport d’activité tous les cinq ans qui comporte, en particulier pour les collections, des éléments d’information sur les programmes de recherche engagés par l’organisme.
Pour les activités soumises à autorisation, l’autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans. La demande de renouvellement est accompagnée d’un rapport d’activité (595).
2. Procéder à des ajustements ou modifier le fond de la réglementation relative aux biobanques ?
a) Améliorer l’information du donneur
Un changement de finalité dans l’utilisation d’échantillons pour la recherche exige de s’interroger sur le champ du consentement du donneur. Cela suppose que le contenu du consentement initial ait été suffisamment précis pour qu’une nouvelle recherche puisse être caractérisée comme relevant ou non de ce consentement. Or, au vu des formulaires de consentement rédigés par divers organismes intéressés, on ne peut que constater une très grande variété de formulations ; certaines ont la précision requise, d’autres se contentent de dispositions très générales qui équivalent à une demande de consentement pour toute recherche à finalité médicale.
Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, par une recommandation en date du 15 mars 2006, rappelle que « la recherche utilisant du matériel biologique ne devrait être entreprise que si elle relève du champ du consentement donné par la personne concernée. La personne concernée peut faire des restrictions quant aux conditions de l’utilisation de son matériel biologique. » (596)
Le principe du consentement pour toute atteinte à l’intégrité du corps humain est fixé à l’article 16-3 du code civil. Il est formulé, en tant que principe général, à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui dispose qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Ce même principe est rappelé à l’article L.1211-2 à propos des produits du corps humain dans les termes suivants: « le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. » Au regard de la jurisprudence, le consentement devant être libre et éclairé, il conviendrait de le considérer comme vicié s’il portait sur un ensemble d’actes non explicités en tant que tels.
Pour exprimer un consentement éclairé, le donneur d’échantillons biologiques doit bénéficier d’informations qui lui permettront de se déterminer en toute connaissance de cause. Le consentement est bien lié à la description d’un projet de recherche précis, que le consentement soit exprès ou prenne la forme d’une non opposition.
Le respect de la volonté du donneur entraîne aussi la possibilité, pour celui-ci, de retirer son accord pour la recherche. En ce sens, si le projet prévoit une anonymisation irréversible des données, le donneur doit en être informé au préalable.
Certes il pourrait être avancé que, d’une part, de telles exigences valent plus dans le cas de recherches sur la personne que sur des éléments séparés du corps humain et, d’autre part, qu’un consentement qui porterait sur la recherche en général n’est pas à écarter par principe si la volonté du donneur venait à s’exprimer clairement en ce sens.
Par ailleurs, sur un plan pratique, la nécessité de recueillir un consentement au contenu précis, à savoir être lié à un projet de recherche bien identifié est considéré comme une gêne par certains chercheurs. Ainsi, selon l’Institut Pasteur, « le fait que le consentement des patients ne soit pas recueilli largement (pour des analyses génétiques notamment) offre à la recherche des marges d’actions limitées dans l’utilisation des échantillons biologiques humains et des données leur étant associées. » (597).
En outre, les chercheurs font valoir que la notion de changement de finalité dans l’utilisation d’une collection est toujours difficile à évaluer. Quels critères utiliser pour estimer que le changement est substantiel et exige de s’assurer derechef du consentement des donneurs ?
Il convient cependant de souligner que si la législation encadrant la création des collections d’échantillons biologiques est en effet fondée sur le respect des droits de la personne, le législateur a introduit des dispositifs souples qui adaptent les exigences du droit à cette utilisation particulière des éléments du corps humain que constitue l’activité des biobanques. Ainsi, n’est exigé un consentement exprès que dans les cas où les droits de la personne risqueraient d’être particulièrement menacés, ce qui est le cas lorsque des données génétiques sont l’objet de recherches. Par ailleurs, la dispense de recueillir le consentement lorsqu’il s’avère impossible de retrouver le donneur et l’habilitation donnée au comité de protection des personnes d’apprécier la nécessité de revenir ou non vers celui-ci sont des règles qui simplifient les démarches à effectuer en cas de modification du contenu du projet de recherche.
Ces assouplissements de la procédure ne sauraient néanmoins restreindre les droits de la personne sur laquelle le prélèvement a été réalisé et au premier chef la portée du principe du consentement libre et éclairé. C’est pourquoi il conviendrait que les formulaires de consentement fassent l’objet d’exigences réglementaires précises garantissant la bonne information de la personne.
Le CCNE a ainsi défini cinq groupes de conditions à remplir pour garantir l’information indispensable au consentement :
« – la description du but de la recherche, rappelant l’état des connaissances ;
– la présentation du cadre dans lequel cette recherche doit se dérouler : équipes médicales et non médicales, éventuelle intervention d’acteurs du monde industriel ;
– la description des conséquences envisageables de la recherche sur le plan du diagnostic, de la prévention, de la thérapie, en précisant ce que pourraient être les conséquences pour les personnes participant à l’étude ;
– l’utilisation des données acquises, publications, brevets, accords de recherche et développements envisagés ;
– le devenir des échantillons à la cessation de la recherche menée par les initiateurs du programme. Dans le cas où une recherche à finalité scientifique différente serait envisagée à partir des mêmes éléments, un nouveau consentement devrait être obtenu dans les mêmes conditions que précédemment. » (598)
Cette information a d’autant plus d’importance dans les cas où le donneur est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement étant alors donné par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Cette exigence est également à apprécier au regard du fait qu’aucune procédure de confirmation du consentement n’est prévue lorsque le mineur accède à l’âge de la majorité.
b) Renforcer les garanties d’information du donneur en cas de découverte incidente
Les recherches effectuées sur les échantillons peuvent conduire à établir des informations présentant un intérêt pour le donneur, en particulier lorsqu’elles portent sur des données génétiques dont l’interprétation est très évolutive.
En cas de défaut d’information, on pourrait s’interroger sur la responsabilité du professionnel de santé ayant connaissance du résultat de la recherche et de celle de l’organisme gérant la biobanque dont relève la collection d’échantillons du donneur concerné.
Pour garantir au donneur qu’il sera bénéficiaire des études effectuées sur les produits de son corps, il convient de s’assurer que l’accès à leurs résultats lui sera garanti, même après un certain temps.
La procédure d’information devra, en outre, respecter le droit de savoir comme celui de ne pas savoir.
Dans une perspective plus générale, les donneurs devraient être informés des résultats des recherches conduites sur les produits de leurs dons, même si ces résultats ne présentent pas de bénéfice direct pour leur santé.
L’organisme sollicitant le don pourrait prendre l’engagement explicite, par exemple dans le formulaire de consentement, qu’une information d’ordre général sera délivrée au donneur à l’issue des recherches et, le cas échéant, que toute information intéressant directement la santé de ce dernier pourra être portée à sa connaissance. Dans le cas où une anonymisation irréversible des données personnelles est envisagée, le donneur doit en être averti.
c) Développer l’information des comités de protection des personnes
Le comité de protection des personnes (CPP) a pour mission d’apprécier « la qualité de l’information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil du consentement ou les modalités de vérification de l’absence d’opposition ainsi que la pertinence éthique et scientifique du projet. » (599)
Selon plusieurs personnes auditionnées, les CPP ne disposent pas des informations suffisantes pour mener à bien cette mission. Mme Emmanuelle Rial-Sebbag a estimé par exemple que la composition actuelle de ces comités « ne leur permet pas de faire ce contrôle éthique […] Soit il faut renforcer les missions des CPP et leur donner les moyens d’évaluer vraiment les collections d’un point de vue éthique, soit il faut réfléchir à une autre autorité. » (600)
L’objet principal des travaux conduits par les CPP étant de rendre des avis sur des projets de recherches biomédicales sur les personnes, leur saisine dans le cadre du contrôle exercé sur les biobanques peut paraître une activité dont l’importance est moins évidente pour ces structures. Mme Anne-Laure Morin, avocate, a ainsi jugé que « La majorité [des CPP] ne s’est pas emparée de cette nouvelle compétence dans la mesure où ils considèrent très souvent qu’examiner un dossier de biobanque, ce n’est pas protéger la personne. » (601)
Par ailleurs, notre collègue Olivier Jardé, dans le rapport (602) consacré à la proposition de loi relative aux recherches sur la personne, souligne les imperfections de la procédure de saisine des CPP : « Il est […] difficile pour les comités de protection des personnes de se prononcer sur la pertinence d’une déclaration d’activité, qui est un document essentiellement technique de recensement des collections et de description des conditions de conservation. Aussi, beaucoup refusent d’émettre un avis, ce qui conduit à l’interruption des projets de recherche faisant appel à des collections d’échantillons. »
Les mesures proposées par la proposition de loi de M. Olivier Jardé devraient améliorer le fonctionnement des CPP. En évitant le découplage de l’instruction des avis portant sur les collections avec celle portant sur les projets de recherches qui y sont liés, les CPP disposeront de l’ensemble des données techniques nécessaires pour éclairer leurs travaux d’évaluation.
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article R. 1123-13 du code de la santé publique, les CPP peuvent associer à leurs travaux un ou plusieurs experts. On peut cependant se demander dans quelle mesure cette disposition est appliquée et si les quarante CPP existants ont les moyens de contrôler la réalité des consentements donnés dans les cas de collections importantes.
Dans le prolongement du rapport de l’IGAS (603) rendu en 2005 sur l’activité des CPP, notre collègue sénatrice Mme Marie-Thérèse Hermange propose une réorganisation de ces comités en réseau. Il conviendrait aussi de mieux apprécier leurs activités, mais, comme le constate Mme Hermange « l’évaluation des pratiques des comités à partir d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé n’a pu encore être mise en œuvre, faute de publication du document de référence. » (604)
On ne peut qu’appeler à ce que des éléments d’évaluation soient rapidement disponibles.
d) Assouplir les conditions imposées à l’utilisation secondaire des collections à des fins de recherches génétiques
Les recherches génétiques sont soumises au principe du consentement exprès de la personne concernée consacré par l’article 16-10 du code civil : « L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment ».
L’importance croissante des recherches d’ordre génétique et le fait que toutes les collections de produits du corps humain soient susceptibles d’être utilisées dans ce cadre confèrent à ce principe une portée particulièrement contraignante. Ainsi, à l’issue d’un programme de recherche, si une utilisation secondaire d’une collection est envisagée aux fins de recherches génétiques, que l’utilisation initiale ait ou non relevé de ce domaine, il est obligatoire pour les promoteurs de la nouvelle recherche d’obtenir à nouveau le consentement exprès des donneurs.
Mme Françoise Antonini, déléguée générale de l’Alliance maladies rares, a évoqué les difficultés engendrées par une telle exigence : « […] nous souhaiterions que la loi permette l’utilisation secondaire des échantillons biologiques dans le cadre d’un examen des caractéristiques génétiques. Quand il est procédé à une collecte d’ADN dans des familles pour déterminer le gène atteint, aucun échantillon ne peut être réutilisé : le retour vers la personne pour un nouveau consentement est indispensable, ce qui pose des difficultés, notamment en cas de maladies rarissimes, ne touchant que quelques naissances par an, quand les collections se sont constituées au fil du temps. » (605)
Le Conseil d’État propose dans son rapport sur la révision des lois de bioéthique d’introduire de nouvelles dispositions législatives consistant à prévoir une dérogation au principe posé à l’article 16-10 du code civil : serait autorisé l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche, dans le cadre d’une utilisation secondaire des prélèvements effectués sur elle, sur la base de l’expression d’une simple non opposition. Si l’information nécessaire à l’expression de la non-opposition du donneur n’a pu être délivrée du fait de l’impossibilité de retrouver la personne concernée, un comité de protection des personnes serait saisi pour s’assurer de la réalité de cette non opposition et de la pertinence scientifique du projet.
Les recherches dont les résultats sont susceptibles de conduire à l’identification de la personne seraient exclues de cette dérogation. De même, conformément à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, l’utilisation des tissus et cellules germinaux nécessite l’information directe du donneur.
e) Évaluer la nécessité de créer des centres de ressources biologiques
L’OCDE a défendu dès 2001 l’idée de développer des conservatoires et des fournisseurs de matériels biologiques appelés centres de ressources biologiques. En 2007, l’OCDE a édicté des lignes directrices relatives aux pratiques exemplaires concernant les centres de ressources biologiques.
En droit français, les notions de centre de ressources biologiques (CRB) ou de biobanque n’existent pas. L’Académie nationale de médecine, dans un rapport adopté le 17 mars 2009, recommande de définir un statut des CRB. Ceux-ci pourraient être issus de la coopération de divers organismes. Ils disposeraient d’une autonomie de moyens et seraient dotés d’un conseil scientifique. Des métiers propres aux CRB devraient être reconnus et ils devraient avoir un interlocuteur administratif unique.
Selon le ministère de l’enseignement et de la recherche, « En ce qui concerne le statut juridique des CRB, il s’agit non pas d’imposer un modèle unique, mais de tenir compte de la diversité des organismes qui les accueillent. » (606)
Les entités juridiques concernées peuvent en effet être très diverses : établissement public de santé, établissement privé participant au service public hospitalier, établissement privé, hôpital des armées, établissement public à caractère scientifique et technologique, établissement public d’enseignement supérieur, autre établissement public, fondation reconnue d’utilité publique, groupement d’intérêt public, société commerciale, association.
Cette diversité n’est pas contradictoire avec des actions de développement initiées au plan national. Ainsi, un Comité consultatif sur les ressources biologiques (CCRB) existe depuis 2001 à la suite des travaux de l’OCDE et réunit, sous la coordination du ministère de la recherche, toutes les parties prenantes impliquées. En collaboration avec le Gis IBiSA (607), le CCRB lance des procédures d’agrément des banques et collections biologiques d’intérêt national. Les CRB qui obtiennent l’agrément du CCRB peuvent postuler aux appels d’offre IBiSA pour le financement de leur structure. Des normes de qualité sont ainsi encouragées.
Au vu de ces différentes initiatives et du caractère récent des dispositions réglementaires en ce domaine, il n’est pas apparu nécessaire de proposer la création de centres de ressources biologiques dans la future loi de bioéthique. Ces derniers existent de fait et connaissent un développement tel qu’un nouvel encadrement législatif pourrait plus constituer un frein qu’un encouragement.
Proposition n° 38. Améliorer l’information des personnes qui consentent à des prélèvements d’échantillons biologiques au bénéfice de biobanques afin que ces personnes donnent un consentement éclairé sur l’utilisation qui sera faite de leur don.
Proposition n° 39. Garantir au donneur d’échantillons qu’il sera informé dans le cas où, au cours de la recherche dont font l’objet des produits de son corps, des données intéressant directement sa santé seraient établies. L’informer en outre des résultats généraux de la recherche que son don a permis.
Proposition n° 40. Assouplir les conditions dans lesquelles une utilisation secondaire des collections peut être autorisée quand le nouveau projet consiste en des recherches génétiques.
Proposition n° 41. Améliorer l’information des comités de protection des personnes saisis pour rendre un avis sur la création de collections d’échantillons.
C. L’EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS D’IDENTIFICATION
L’utilisation des données génétiques dans une finalité autre que médicale ou de recherche scientifique est autorisée par la loi comme moyen de preuve dans le cadre de certaines actions judiciaires. Lorsque des traces génétiques peuvent être relevées, l’analyse des empreintes génétiques – technique tendant à identifier les séquences d’ADN spécifiques à un individu – sont en effet d’une très haute fiabilité pour attribuer avec certitude un acte à une personne.
L’article 16-11 du code civil limite strictement le recours à cette technique aux mesures d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure pénale et, en matière civile, aux mesures d’instruction ordonnées par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.
L’article 16-12 du même code réserve la réalisation des tests génétiques dans ce cadre aux personnes ayant obtenu un agrément et inscrites sur une liste d’experts judiciaires.
1. L’utilisation des tests génétiques en matière civile
Le Conseil d’État évalue, dans son rapport sur la révision des lois de bioéthique, la portée des modifications législatives qui tendraient à légaliser un usage plus étendu des tests de paternité que ce que permet l’article 16-11 du code civil.
La Haute juridiction exclut une première piste de réforme qui consisterait à ouvrir à d’autres actions la possibilité de procéder à une identification génétique. Si dans une première approche, il semblerait que les actions successorales, les litiges d’assurance vie et les divorces « sont aussi légitimes que ceux actuellement prévus par la loi et justifient donc aussi de recourir à cet instrument de preuve » (608), le fait que ces actions pourraient être entreprises à tout moment, en particulier alors que la filiation ne pourrait plus faire l’objet d’une action en contestation (609) conduirait à des situations « inextricables ».
Le Conseil d’État écarte ensuite la possibilité d’autoriser la réalisation de tests de paternité dans le seul but de connaître ses origines car une information de cet ordre serait susceptible d’être reconnue comme un moyen de preuve lors d’un éventuel litige successoral.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme oblige à évaluer une troisième voie de réforme, plus restreinte que les précédentes, qui ouvrirait la possibilité de recourir à des tests génétiques post mortem dans le cadre des actions prévues à l’article 16-11 précité.
Les membres de la mission d’information estiment qu’au regard du respect dû aux morts cette voie ne doit pas être retenue(610).
2. L’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques
La loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a introduit, dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le dispositif suivant :
« Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée.
Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
Si le tribunal estime la mesure d’identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d’identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l’État. »
Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. (611)
Le Comité consultatif national d’éthique, saisi de la question, a attiré l’attention « sur la dimension profondément symbolique dans la société de toute mesure qui demande à la vérité biologique d’être l’ultime arbitre dans des questions qui touchent à l’identité sociale et culturelle. Elle conduirait furtivement à généraliser de telles identifications génétiques, qui pourraient se révéler à terme attentatoires aux libertés individuelles. Elle risquerait d’inscrire dans l’univers culturel et social la banalisation de l’identification génétique avec ses risques afférents de discrimination. » (612)
Cette mesure législative demeure sans effet en raison du fait que le décret nécessaire à son application n’a pas été publié et qu’aux termes de l’article précité le dispositif consistait en une expérimentation achevée le 31 décembre 2009.
3. Le fichier national des empreintes génétiques
Placé sous le contrôle d’un magistrat et mis en œuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur, le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) sert à faciliter l’identification des auteurs d’infractions à l’aide de leur profil génétique et la recherche de personnes disparues à l’aide du profil génétique de leurs apparentés (613). 400 000 analyses génétiques sont effectuées annuellement dans ce cadre et le FNAEG comprenait plus de 800 000 profils génétiques d’individus au 1er octobre 2008.
On soulignera le fait qu’en matière pénale, le principe de l’inviolabilité du corps est compatible avec l’imposition d’une sanction en cas de refus de se soumettre au prélèvement nécessaire à la réalisation de l’analyse génétique. L’infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (614).
Des considérations de sécurité publique font que dans le cas d’une personne condamnée pour crime ou délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du Procureur de la République.
La durée de conservation des informations varie selon les situations. Elle est de 40 ans pour les personnes définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues et les traces recueillies au cours des enquêtes. Elle est de 25 ans pour les personnes mises en cause, qui disposent toutefois du droit de saisir le procureur de la République d’une demande d’effacement de leurs empreintes.
Les empreintes prélevées, dans un but de rapprochement, sur des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis un crime ou un délit ne peuvent pas être conservées.
Les services de police et de gendarmerie pouvant accéder aux informations enregistrées doivent être habilités.
Ce fichier a fait l’objet en 2009 d’une évaluation par une mission parlementaire rapportée, au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, par nos collègues Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti(615). Ceux-ci estiment qu’il conviendrait, en particulier, de définir avec plus de précision les cas où des prélèvements destinés à des rapprochements d’empreintes peuvent être effectués lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner que la personne concernée a commis un crime ou un délit. En effet, en l’état du texte (616), le champ des infractions n’est pas circonscrit, ce qui conduit, comme l’indiquent les rapporteurs, citant un responsable du ministère de la justice, à une prise d’ADN « un peu trop systématique. »
Un renvoi explicite aux infractions prévues dans les autres cas de prélèvement paraît indispensable (617). Cette suggestion a été reprise dans la proposition de loi de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti (618), proposition déposée à l’issue de leur rapport mais qui n’a pas été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2009.
Par ailleurs la mission s’est interrogée sur l’effectivité de la disposition du 3ème alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale, selon laquelle ces empreintes prélevées pour rapprochement ne sont pas conservées.
Proposition n° 42. Préciser la nature des délits ou des crimes au vu desquels il est procédé à un prélèvement des empreintes génétiques dans le cas où seules des raisons plausibles d’infraction à la loi pèsent sur la personne.
D. L’INTERDICTION DE RECOURIR A DES DONNÉES GÉNÉTIQUES DANS LES DOMAINES DE L’ASSURANCE ET DU TRAVAIL
Les risques de discriminations sociales que pourrait entraîner un mauvais usage des données génétiques se concentrent dans le domaine des assurances et dans celui du travail. Des informations anticipant un état de santé futur sont en effet susceptibles de présenter un caractère déterminant, tant pour écarter un contractant que pour le choisir.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé les règles en ce domaine. Elle a introduit dans le code civil le principe général de non-discrimination dans l’usage des données génétiques, l’a décliné dans le code du travail et dans le code de la santé publique, et a défini l’interdiction pénale correspondante. (619)
Le caractère protecteur de ces dispositions n’a pas été remis en cause pendant les travaux de la mission d’information.
1. La portée de l’interdiction des tests génétiques dans les contrats d’assurance
La loi 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit dans le code de la santé publique la disposition suivante : « Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. » (620)
Cette disposition avait été précédée en 1994 d’un moratoire de la Fédération française des sociétés d’assurance s’engageant pour 5 ans à ne pas recourir à l’examen des caractéristiques génétiques des personnes. Ce moratoire a été reconduit en 1999. La même année, la loi portant création d’une couverture maladie universelle a interdit aux organismes de protection sociale complémentaire de « tenir compte des résultats de l’étude génétique des caractéristiques d’une personne demandant à bénéficier d’une protection complémentaire en matière de santé, même si ceux-ci leur sont apportés par la personne elle-même. »(621).
Le fondement de l’interdiction d’utiliser les résultats d’examens génétiques dans le domaine de l’assurance renvoie aux dispositions pénales qui sanctionnent la discrimination.
L’article 225-1 du code pénal inclut parmi les actes discriminatoires relevant d’une sanction pénale, la discrimination opérée entre les personnes physiques en raison de leur état de santé, de leur handicap et de leurs caractéristiques génétiques. La discrimination consistant à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou à en subordonner la fourniture à une condition discriminatoire est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, selon l’article 225-2 du même code.
L’article 225-3 du code précité délimite le champ des discriminations qui font exception à l’application des deux articles précédemment cités. Il en va ainsi des discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Ce même article aménage toutefois une exception à ces exceptions dans le cas des discriminations qui se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie. Les peines encourues sont celles prévues à l’article 225-2.
La combinaison de ces trois articles traduit la nature juridique des données génétiques. Elles ne sont pas des données de santé dans la mesure où elles ne font que renvoyer à un état de santé futur. Un examen génétique ne saurait être traité au même titre que les examens médicaux demandés pour faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge(622).
Le législateur n’a pas considéré que la non communication d’un examen génétique établissant un diagnostic présymptomatique d’une maladie grave et incurable était susceptible de vicier le caractère aléatoire du contrat d’assurance (623).
La législation française apparaît ainsi assurer un degré de protection supérieure à certaines législations européennes. Ainsi, la récente loi allemande relative aux recherches génétiques sur l’homme aménage des exceptions à l’interdiction de se référer à des informations d’ordre génétique dans le domaine des assurances dans les cas où les montants assurés atteignent 300 000 euros (624). La législation suisse fixe un seuil à 400 000 francs(625).
2. Les données génétiques peuvent-elles être utilisées pour évaluer l’aptitude au travail ?
Si le code du travail, en son article L.1132-1 (626), interdit qu’une personne puisse être écartée d’une procédure de recrutement en raison de ses caractéristiques génétiques, la question a été posée de savoir si, dans la situation où un travailleur peut être affecté à des travaux l’exposant à des agents dangereux pour la santé, le médecin du travail chargé d’établir la fiche d’aptitude obligatoire était en droit d’utiliser des informations médicales tirées des caractéristiques génétiques de la personne.
Une réponse positive semblerait devoir être apportée au regard d’une décision du Conseil d’État (627) qui mentionne les éléments d’ordre génétique parmi les moyens dont disposent les médecins pour déceler les risques particuliers que peuvent présenter certains salariés.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article L. 1133-1 du code du travail, le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de différences de traitement, « lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. ».
Cependant, un raisonnement similaire à celui développé en matière assurantielle peut être avancé pour exclure l’utilisation des données génétiques dans cette situation. Comme le rappelle le CCNE, citant l’avis n°18 du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, « le dépistage génétique a trait à l’état futur et potentiel du sujet qui le subit et […] en règle générale, seul l’état de santé actuel du travailleur doit être pris en considération dans le contexte de l’emploi. » (628)
En outre, les conditions légales dans lesquelles un examen des caractéristiques génétiques peut être effectué sur une personne asymptomatique en réservent la réalisation à un médecin œuvrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques, conditions qui ne répondent pas à celles dans lesquelles exerce le médecin du travail.
Les dispositions analogues figurant dans les législations étrangères paraissent moins protectrices. Selon le rapport explicatif de la convention d’Oviedo, « dans des conditions particulières, lorsque les conditions de travail pourraient avoir des conséquences préjudiciables pour la santé d’une personne, en raison de sa prédisposition génétique, des tests génétiques prédictifs pourraient être proposés, sans préjudice d’améliorer le cadre du travail. » (629).
Sur l’ensemble de ces questions, des principes directeurs qui seraient formulés au niveau européen sont nécessaires. Or la convention d’Oviedo n’a pas abordé directement ces thèmes et le protocole additionnel de novembre 2008 ne porte que sur les tests génétiques à des fins médicales. C’est pourquoi, le Comité directeur pour la bioéthique du Conseil de l’Europe a confié à un groupe de travail la mission d’élaborer, avant le 31 décembre 2011, des projets d’instruments juridiques relatifs aux tests génétiques dans les domaines de l’assurance et du travail.
Il conviendra que les autorités françaises veillent à ce que le contenu de ces propositions n’affaiblisse pas les choix faits par le législateur en ces matières.
PARTIE III : SE SERVIR DU CORPS HUMAIN POUR SOIGNER ET CHERCHER : TOUT EST-IL PERMIS ?
La nécessité de disposer, dans un but thérapeutique ou de recherche, d’éléments du corps humain en grand nombre et de nature très diverse est devenue de plus en plus pressante sous l’effet du progrès des connaissances. Pour le législateur, trouver la voie moyenne facilitant l’usage altruiste du corps humain tout en garantissant le respect de frontières éthiques protectrices exige de dresser un bilan précis de la réglementation à l’aune des perspectives offertes par la médecine et la recherche.
La question se pose en premier lieu lorsque les voies de la recherche passent par l’utilisation d’embryons. Au regard de quelle finalité peut-on considérer comme acceptable la destruction d’un être humain potentiel ?
Dans le cas où les résultats des recherches ainsi autorisées acquièrent une valeur commerciale protégée par le dépôt d’un brevet d’invention, dans quelle mesure les principes éthiques invoqués ont-ils vocation à s’appliquer à ce brevet?
Lorsque le don passe par un prélèvement sur une personne et est réalisé au bénéfice d’un patient, comment peut-on encourager le développement de ces actes d’altruisme tout en veillant à ce que les droits de la personne ne soient pas fragilisés ?
Enfin, lorsque la personne est décédée, peut-on considérer que sa dépouille est réduite au rang de simple chose ?
*
* *
CHAPITRE 5 – LA RECHERCHE SUR L’EMBRYON HUMAIN
ET SUR LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES
Le législateur a décidé en 1994 de prononcer une interdiction absolue de toute recherche sur l’embryon au vu du constat que les valeurs traditionnellement reconnues à la vie humaine en toutes ses phases de développement risquaient d’être mises en péril par les progrès de la biomédecine. Les perspectives thérapeutiques qui se sont progressivement dessinées dans ce domaine l’ont cependant convaincu de la nécessité d’autoriser des travaux scientifiques consacrés à ce stade initial de la vie. Partant du fait que de nombreux embryons issus des techniques de fécondation in vitro étaient voués à la destruction quand ils ne faisaient plus l’objet d’un projet parental, le Parlement a rendu légal en 2004 le don, au profit de la recherche, des embryons dits « surnuméraires ».
La loi du 6 août 2004 a ainsi aménagé, pour une période provisoire de cinq ans, des dérogations à l’interdiction posée par la loi du 29 juillet 1994. Sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, des protocoles de recherche ont été autorisés permettant ainsi aux scientifiques français de lancer d’importants programmes d’études.
Il revenait à la mission d’information de tirer le bilan des dispositions provisoires mises en place en 2004 : convient-il de mettre fin à ce régime en le considérant comme une parenthèse à refermer et doit-on à l’inverse réaffirmer le principe d’une interdiction absolue de toute recherche dans ce domaine ? Faut-il maintenir le cadre dérogatoire posé en 2004 soit en en repoussant le terme, soit en le pérennisant ? Courrait-on des risques excessifs en introduisant une autorisation de principe pour ce type de recherche ? Quelle est l’effectivité des critères de contrôle de l’Agence de la biomédecine ? Quels interdits convient-il de maintenir ?
A. LA PROTECTION LÉGALE DE L’EMBRYON IN VITRO
La portée des réponses à ces interrogations est à évaluer au regard des règles de droit qui assurent une protection juridique de l’embryon.
Parmi les principes généraux relatifs au respect du corps humain posés par le code civil, la protection de la vie de l’embryon renvoie à l’article 16 qui dispose que la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Si l’embryon n’a pas de personnalité juridique (630), il est néanmoins un être humain auquel le respect est dû. Le législateur a ainsi posé divers interdits destinés à protéger l’embryon : il ne peut être conçu ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles ; toute pratique de clonage, quelle que soit sa finalité, est interdite.
« Un principe général de protection de la vie humaine prénatale, composante de la protection de la vie humaine », semble se dégager de ces règles, selon M. Jean-René Binet, maître de conférences à la faculté de droit de Besançon. (631)
Certes, parce qu’il n’est pas un sujet de droit, la protection assurée à l’embryon demeure relative. Le degré de protection accordé au fœtus diffère ainsi à mesure de son développement. Les conditions qui doivent être réunies pour procéder à une interruption de grossesse sont moins restreintes avant douze semaines de gestation qu’après. Mais, en tout état de cause, la destruction intentionnelle de l’embryon au cours d’une interruption volontaire de grossesse ou d’une interruption médicale de grossesse n’est autorisée qu’en cas de nécessité – la détresse de la femme dans le premier cas, la mise en danger de sa santé dans le second.
L’embryon mort-né fait par ailleurs l’objet d’une reconnaissance symbolique dès le stade où il a un corps formé (632).
La jurisprudence portant sur des cas d’atteinte involontaire à l’embryon par un tiers met cependant en évidence la portée de l’absence de personnalité juridique de l’embryon. Ainsi, la Cour de cassation, suivant une jurisprudence constante(633), a considéré que l’interprétation stricte de la loi pénale qu’impliquait le principe de légalité des peines et des délits empêchait que les faits reprochés en cas d’atteinte mortelle au fœtus puissent relever des dispositions de l’article 221-6 du code pénal réprimant les atteintes involontaires à la vie « d’autrui ». L’enfant qui n’est pas né n’est pas un alter ego. L’instant de la naissance demeure la ligne de partage entre le moment où l’être humain qu’est l’embryon est protégé par des droits objectifs fixés en fonction des choix de la société et celui où il est porteur de droits subjectifs opposables aux autres. A contrario, la Cour de cassation a jugé que le chef d’homicide involontaire pouvait être retenu dans le cas d’un enfant décédé une heure après sa naissance des suites des graves blessures reçues le jour même par sa mère lors d’un accident de la circulation (634).
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 souligne que « le législateur a assorti la conception, l’implantation et la conservation des embryons fécondés in vitro de nombreuses garanties ».
Les garanties visées sont celles qui définissent les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation. L’embryon ne peut être conçu que dans le cadre d’une demande parentale d’un couple et pour des raisons médicales. La conception d’embryons surnuméraires exige le consentement écrit du couple. Chaque année les deux membres du couple sont consultés sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. En cas d’abandon du projet ou de décès de l’un des membres du couple, possibilité est donnée, après un délai de réflexion de trois mois, de consentir ou de demander à ce que les embryons surnuméraires fassent l’objet de l’une des trois procédures suivantes : être accueillis par un autre couple, être donnés à la recherche ou être détruits. L’accueil de l’embryon est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire. En cas d’absence de réponse de l’un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises, de désaccord entre eux sur le maintien du projet parental ou sur le devenir de l’embryon ou encore s’il n’y a pas de couple d’accueil, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à 5 ans.
Néanmoins, l’ensemble de ces garanties porte sur le projet dont l’embryon est l’objet et non sur l’embryon, lequel n’est pas, comme il a été dit, sujet de droit. La jurisprudence dégagée à l’occasion d’une affaire relative à une perte accidentelle de neuf ovocytes fécondés cryoconservés est particulièrement éclairante.
En première instance, le Tribunal administratif d’Amiens a jugé (635) que le principe de non-patrimonialité du corps posé à l’article 16-1 du code civil empêchait que les parents puissent se prévaloir d’un préjudice matériel ; les ovocytes fécondés n’étant pas des personnes, le couple n’était pas non plus fondé, selon les juges, à se prévaloir d’un préjudice moral résultant de la perte d’êtres chers ; en outre, le couple étant à même, du fait de l’âge de chacun de ses membres, de réaliser une nouvelle procréation médicale assistée, il ne pouvait se prévaloir d’une perte de chance de devenir parents. Cependant les juges ont admis que les requérants avaient droit d’obtenir réparation des troubles divers dans les conditions d’existence qu’ils avaient subis à l’occasion de cet événement(636).
En appel, la Cour administrative de Douai a annulé, le 6 décembre 2005, le jugement du Tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il condamnait le Centre hospitalier régional universitaire d’Amiens à verser à ce couple une réparation : « considérant que la création médicalement assistée d’embryons in vitro ne peut être réalisée, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, que dans le cadre du projet parental du couple bénéficiaire ; que, dès lors, la perte d’embryons dont les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que ceux-ci constituent des êtres humains ou des produits humains ayant le caractère de chose sacrée auxquels est attachée une valeur patrimoniale, n’est source de préjudice indemnisable que pour autant que ce couple poursuit un projet de procréation auquel cette perte porte une atteinte. » (637) Il était apparu en l’espèce que le couple n’avait produit aucun élément de nature à démontrer qu’il entendait poursuivre un projet parental.
On remarquera que pour les juges du Tribunal administratif d’Amiens, l’évidence que l’embryon in vitro n’est pas un être humain est telle qu’on ne saurait « sérieusement » affirmer le contraire. Une condamnation à un versement de 207 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des neuf embryons et de 76 225 euros au titre de la perte de chance d’être parents était demandée par le couple requérant.
3. L’embryon in vitro sans projet parental
Comme l’a fait remarquer Mme Françoise Dekeuwer-Defossez, professeur émérite de droit à l’université Lille 2, la notion de projet parental n’est pas bien cernée dans le droit français : « on a le sentiment que la nature juridique de l’embryon dépend du regard qui sera porté sur lui. En effet, celui qui est conçu pour donner naissance à un enfant n’est pas le même objet de droit que celui qui, demain, sera fabriqué par des scientifiques pour réaliser des expériences. » Un tel relativisme, a considéré Mme Françoise Dekeuwer-Defossez « est extrêmement dangereux, car ce projet est susceptible de changer, si les parents divorcent, par exemple, ou s’ils ne sont pas d’accord sur la naissance d’un autre enfant. Il est grand temps que les juristes se préoccupent de la notion de projet parental. » (638)
Ces paradoxes du relativisme, sources de conflits d’interprétation sur le statut de l’enfant à naître, sont cependant conjurés par les règles de droit précédemment citées, qui définissent strictement la nature de ce qu’il faut entendre par couple et précisent ce que devient le projet parental en cas désaccord entre les membres du couple.
L’avis citoyen du panel de Marseille, recueilli dans le cadre des États généraux de la bioéthique, a insisté sur l’importance qu’il convient de reconnaître au projet parental, considérant même que l’embryon tirait son statut de l’existence ou non d’un tel projet.
Il est un fait qu’au regard de la législation, ne pas être implanté in utero et ne pas faire l’objet d’un projet parental sont des conditions qui réduisent de beaucoup la protection de l’embryon. La destruction de celui-ci devient admissible dans des conditions plus larges dont le statut juridique est cependant disputé.
Deux approches juridiques aux conséquences sensiblement différentes sont en effet possibles pour asseoir la légalité de l’atteinte portée, dans le cadre d’une recherche scientifique, à l’intégrité de l’embryon in vitro ne faisant plus l’objet d’un projet parental.
En cohérence avec les principes du code civil susmentionnés, les juristes auditionnés par la mission ont estimé que la légalité des recherches menées sur ces embryons dits surnuméraires continue de s’analyser comme une exception au principe du respect de la vie dès son commencement, exception qui, comme toute autre atteinte à l’intégrité de l’embryon, n’est recevable que dans la mesure où des intérêts supérieurs peuvent s’opposer à ce principe, en l’espèce l’intérêt que présentent ces recherches pour la santé publique.
Cette analyse concorde cependant mal avec la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994, laquelle développe un raisonnement différent. Bien que le législateur ait entouré l’embryon in vitro des garanties précitées, il « n’a pas considéré, a-t-il été jugé, que devait être assurée la conservation, en toutes circonstances, et pour une durée indéterminée, de tous les embryons déjà formés ; […] il a estimé que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne leur était pas applicable ; […] il a par suite nécessairement considéré que le principe d’égalité n’était pas non plus applicable à ces embryons. » Une telle position du législateur n’est contraire à aucun principe à valeur constitutionnelle : « considérant qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne détient pas un pouvoir d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur. »
La Cour d’appel de Paris avait ainsi pu rappeler, par un jugement en date du 9 mai 2005, que l’interdiction de procéder à des expérimentations sur l’embryon, posée sous le régime de la loi antérieure à 2004, ne procédait « d’aucun principe de valeur constitutionnelle qui appliquerait aux embryons humains le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, » et n’avait pas eu « pour objet ni pour effet de protéger de façon absolue l’embryon humain ». (639)
La portée de cet argument par rapport à la question de la légalisation des recherches sur l’embryon fait l’objet d’analyses divergentes. Un premier raisonnement consisterait à s’appuyer sur la décision précitée du Conseil constitutionnel pour considérer que l’atteinte portée à l’embryon à l’occasion d’une recherche relève de la même analyse que celle qui légitime sa destruction à l’issue de cinq ans de conservation. Dans cette perspective, il n’y a pas à invoquer de justifications à la destruction de l’embryon, quelle que soit sa cause, dès l’instant où ce dernier ne fait plus l’objet d’un projet parental. En ce sens, même si la décision du Conseil constitutionnel en 1994 ne portait que sur la non-conservation de l’embryon et non sur sa destruction à des fins de recherche – celle-ci étant à l’époque interdite –, on serait amené à reconnaître que le principe de protection de la vie dès son commencement ne s’applique pas à l’embryon objet d’une recherche, si telle est la décision du législateur.
Une autre lecture tendrait à faire valoir que la destruction de l’embryon est, dans le cadre de la recherche, opérée avec une finalité pratique, détachable en tant que telle et obéissant à un régime juridique spécifique : l’absence de projet parental ne justifie pas à elle seule l’utilisation de l’embryon dans un projet scientifique qui non seulement détruira l’embryon mais procédera à une multiplicité d’interventions sur l’embryon lui-même et sur ses cellules, ces dernières pouvant par exemple être reproduites en un nombre illimité d’exemplaires. Dans cette perspective la décision du Conseil constitutionnel n’entrerait pas en contradiction avec la nécessité d’avancer une justification juridique propre à la situation de l’embryon objet de recherche. Cette justification s’inscrirait alors dans la logique mise en œuvre pour justifier des atteintes légitimes au principe du respect de l’embryon in utero, si une telle légitimité pouvait être établie.
Que la recherche sur l’embryon surnuméraire soit justifiée du fait que le législateur estime que le principe posé à l’article 16 du code civil n’est pas plus applicable dans cette situation que dans celle relative à une conservation illimitée des embryons surnuméraires, ou qu’elle soit rendue admissible dans le cadre d’une exception légitime au principe de l’article 16 n’emporte pas les mêmes conséquences.
La première voie repose sur un état du savoir qui éclaire une décision : reconnaître ou non une dignité à l’embryon surnuméraire. L’article 16 du code civil qui affirme le principe du respect de l’être humain « dès le commencement de sa vie », retrouve dans cette perspective les réserves d’interprétation formulées par le législateur en 1994 lors de la discussion de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain relative et rappelées par M. Claude Huriet au cours de son audition : « Nous avons longuement débattu à l’époque pour savoir s’il fallait écrire « de sa vie » ou « de la vie » pour les raisons qu’on imagine et avons retenu la formulation « dès le commencement de sa vie » qui présentait l’avantage de ne pas poser, au moins temporairement, la question du statut de l’embryon. » (640) Ce raisonnement est cohérent avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé que « le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des États » (641). Il n’est pas non plus contradictoire avec la démarche suivie dans la rédaction de la convention d’Oviedo qui convient « de laisser au droit interne le soin de donner les précisions pertinentes quant à la portée de l’expression " êtres humains ". »(642). Une conception stadiste de l’embryon qui amène à fixer à un moment particulier du son développement l’acquisition de sa qualité d’être vivant (par exemple le moment où se forme la gouttière primitive, préformation du système nerveux(643)) sera davantage liée à cette approche juridique.
La seconde voie consiste à mettre en balance les intérêts en conflit : la recherche sur l’embryon surnuméraire pourrait devenir illégitime si elle ne présentait plus d’intérêt pour la santé. Cette démarche est, en particulier, en cohérence avec l’article 18 de la convention d’Oviedo qui stipule que « Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon ». Une conception essentialiste de l’embryon qui attribue une valeur à l’embryon en tant que tel dès le moment de sa formation se reconnaîtra plus facilement dans cette interprétation.
Cependant ces deux voies prises au sens strict devraient aboutir à des conséquences opposées : si l’embryon est digne de respect, il paraît difficile d’accepter qu’il puisse être détruit au nom d’intérêts qui ne sont que généraux. Cet argument tendrait donc, poussé au bout de ses conséquences, à interdire toute recherche sur l’embryon in vitro. Si à l’inverse l’embryon in vitro est en deçà du stade où une dignité doive lui être reconnue, les règles éthiques encadrant cette recherche, que chacun considère pourtant comme nécessaires, trouvent difficilement à se justifier.
Sur quel fondement asseoir des principes éthiques justifiant l’institution d’un régime de contrôle des recherches sur l’embryon in vitro sans pour autant inscrire ce dernier dans la perspective d’une sacralisation de la vie ? Avancer la notion de potentialité de personne – au sens biologique – et de personne potentielle – au sens éthique – offre dans ce débat une base axiologique qui sans personnifier l’embryon ne le réduit pas au rang d’une quasi chose. Ces concepts sont à comprendre, selon les commentaires de M. Lucien Sève, philosophe membre du CCNE de 1983 à 2000, de la façon suivante : « En assignant [à l’embryon] le titre éthique de personne potentielle, nous disons deux choses importantes. D’abord, qu’il n’est pas une personne actuelle, ce qui tout à la fois autorise à limiter ce que son respect nous interdit – par exemple dans l’interruption volontaire de grossesse, où est jugé à bon droit prioritaire le respect de la femme actuelle qu’est la femme enceinte – et, en sens inverse, fait ressortir le champ d’obligations que son incapacité présente nous impose d’assumer consciemment à sa place. En second lieu, parler de personne potentielle revient à dire que les intérêts de l’embryon sont à déterminer bien moins en fonction de son présent que de son avenir d’être humain, ce qui peut conduire, lorsque le pronostic médical est des plus sombres, à décider de lui épargner une existence future véritablement inhumaine. » (644) Certes cette notion pourrait sembler avoir une portée juridique réduite car elle ne trace pas une limite déterminée entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Mais elle permet cependant de déterminer une telle limite, en obligeant à poser la question de l’utilisation de l’embryon en termes éthiques, en donnant les moyens de penser la nécessaire protection de l’embryon tout en rendant admissible son éventuelle destruction dans des situations particulières – respect du corps de la femme ou absence de projet parental. Elle porte l’exigence éthique au-delà même de la question de la recherche sur l’embryon et justifie aussi la vigilance qu’il sera nécessaire d’exercer devant des techniques nouvelles comme la reprogrammation de cellules souches adultes, technique qui pourrait faire de chaque cellule somatique humaine une personne en puissance.
On remarquera que la protection de l’embryon relève d’un raisonnement très différent dans le domaine des brevets. La convention sur le brevet européen exclut de la brevetabilité les utilisations d’embryons à des fins industrielles ou commerciales (645). Les fondements de cette disposition sont les principes du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs (646). Sur cette base, la Grande Chambre de recours de l’Office Européen des Brevets, a rejeté (647) le 25 novembre 2008 une demande de brevet qui portait sur une méthode pour obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires, en tant que celle-ci supposait la destruction d’embryons (648).
B. BILAN ET PERSPECTIVES DES RECHERCHES MENÉES SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
Au 31 décembre 2007, on dénombrait 154 822 embryons cryo conservés, dont 62 % étaient en cours de projet parental.
Au 23 novembre 2009, 871 embryons étaient enregistrés par l’ABM en tant qu’objets d’un protocole de recherche autorisé.
A la même date, on comptait 20 lignées de cellules souches embryonnaires dérivées à partir d’embryons et déclarées auprès des services de l’ABM.
Enfin, depuis 2005, 97 lignées de cellules souches embryonnaires ont été importées par des équipes de recherches présentes sur le territoire.
NOMBRE D’EMBRYONS FAISANT L’OBJET D’UNE RECHERCHE
2006* |
2007 |
2008 |
2009** |
37 embryons |
251 embryons |
156 embryons |
427 embryons |
Total : 871 embryons | |||
* Les autorisations de recherche sur l’embryon par l’Agence de médecine ont été rendues possibles avec la parution au Journal Officiel du décret du 6 février 2006. Avant cette date, les recherches n’étaient permises, dans le cadre du dispositif transitoire (autorisations des ministres de la santé et de la recherche), que sur les cellules embryonnaires.
** Au 23 novembre 2009.
NOMBRE DE LIGNÉES DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES FAISANT L’OBJET D’UNE RECHERCHE
2005 |
2006* |
2007 |
2008 |
2009*** | |
Autorisations d’importation |
14 décisions |
6 décisions |
6 décisions |
13 décisions** |
0 décision |
Nombre de lignées faisant l’objet d’une autorisation d’importation |
45 lignées autorisées |
24 lignées autorisées |
33 lignées autorisées |
28 lignées |
- |
Nombre de lignées effectivement importées par les équipes de recherche (présentes sur le territoire) |
33 importées |
19 importées |
21 importées |
24 importées |
- |
* À partir de la parution du décret du 6 février 2006 donnant compétence à l’agence pour délivrer les autorisations de protocoles de recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires, d’importation et de conservation à des fins scientifiques. Avant cette période, la compétence appartenait conjointement aux ministres de la santé et de la recherche (période septembre 2004-janvier 2006).
** Dont une autorisation d’importation de tissus fœtaux issus d’interruption de grossesse, dans le cadre d’un protocole de prélèvement à fins scientifiques (article L. 1241-5 du code de la santé publique)
*** Au 23 novembre 2009.
Les embryons donnés à la recherche sont répertoriés sur un registre national tenu par l’ABM de même que les lignées de cellules souches dérivées ; les données identifiantes de l’embryon (en particulier les informations permettant l’identification des géniteurs) sont anonymisées. (649)
Déposées auprès de l’ABM à l’occasion de trois fenêtres d’enregistrement par an, les demandes d’autorisations de recherches sont instruites dans un délai maximal de 4 mois. Chaque projet est expertisé par des experts scientifiques et fait l’objet d’un avis éthique du conseil d’orientation de l’agence. La décision est rendue par le directeur général de l’agence.
Du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2008 (650), 47 protocoles de recherche ont été autorisés, 9 modifications substantielles de projet ont en outre été autorisées, 2 protocoles ont fait l’objet de refus. 20 autorisations ont été délivrées pour la conservation de cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques et 1 demande a été rejetée. 39 autorisations ont été données pour l’importation de lignées de cellules souches, 4 demandes ont été refusées. (651)
36 équipes de chercheurs sont, en France, engagées dans ces travaux.
Chaque décision d’autorisation rendue par l’ABM est communiquée, accompagnée de l’avis du conseil d’orientation, aux ministres chargés de la santé et de la recherche. Ils peuvent interdire ou suspendre un protocole en particulier « lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré. » (652) Sur les 30 protocoles autorisés par l’ABM à compter du 6 février 2006, aucun n’a été interdit ou suspendu dans le cadre d’un recours hiérarchique.
Toute recherche autorisée est placée sous la direction d’une personne responsable. Celle-ci adresse au directeur général de l’ABM un rapport annuel et un rapport à l’issue de la recherche. Aux termes de l’article R. 2151-8 du code de la santé publique, « ces rapports contiennent en particulier les informations relatives à la destination des embryons et des cellules embryonnaires ayant fait l’objet du protocole, notamment à leur destruction. »
Conformément au même article, le directeur général de l’ABM peut à tout moment demander à la personne responsable de la recherche de rendre compte de l’état d’avancement des travaux. Ainsi, l’agence a-t-elle décidé de procéder systématiquement à l’inspection des équipes de recherche autorisées dans les six mois suivants la réception de leur premier rapport annuel. Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l’ABM, a souligné que « c’est un contrôle extrêmement important car certains laboratoires ne sont pas toujours conscients de l’extrême rigueur que requiert toute recherche sur l’embryon » (653). Les contrôles sur site, onze pour l’année 2008, ont, selon les experts de l’ABM, « montré une totale conformité à la réglementation et aux éléments techniques du dossier déposé en vue de l’autorisation, notamment en matière de traçabilité, point important de la réglementation. » (654)
1. La nature des recherches et leur finalité
11 protocoles de recherches sur 47, soit un peu moins du quart, ont porté sur l’embryon lui-même. Ces études pourraient contribuer à mieux comprendre les raisons du faible taux de réussite des AMP. Parmi les protocoles autorisés on citera par exemple une recherche menée au CHU de Montpellier sur la régulation de la ségrégation chromosomique dans les ovocytes et les embryons préimplantatoires et l’effet de l’âge maternel.
Du 1er septembre 2004 à la fin 2008, 36 protocoles de recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines ont été autorisés.
On rappellera que les cellules embryonnaires humaines ont la propriété d’être des cellules souches totipotentes jusqu’au stade de 8 cellules puis pluripotentes du stade de la morula à celui de blastocyste (du 5,5ème au 7,5ème jour de développement). Ces cellules se spécialisent ensuite en cellules souches multipotentes puis unipotentes. (655)
Les lignées de cellules souches embryonnaires humaines sont établies à partir de cellules extraites de la masse interne du blastocyste. Le prélèvement implique la destruction de l’embryon. Les cellules prélevées ne peuvent pas se développer en un embryon viable car elles ne sont plus totipotentes.
Les embryons utilisés peuvent être des blastocystes surnuméraires dans le cadre d’une AMP ou des blastocystes pour lesquels un diagnostic préimplantatoire a révélé la présence d’une anomalie génétique gravement invalidante, à révélation tardive et mettant en jeu le pronostic vital ; dans ce dernier cas, les lignées cellulaires dérivées fournissent aux chercheurs des outils de modélisation des pathologies liées à des anomalies génétiques.
La culture des cellules souches rend possible leur multiplication illimitée et met à la disposition des chercheurs une biomasse non transformée, renouvelable constamment. Ces cellules conservent de génération en génération leurs propriétés de pluripotence. Une lignée peut être différenciée en de multiples précurseurs de cellules différenciées. Est aujourd’hui maîtrisée la différenciation de plus d’une vingtaine de phénotypes cellulaires, en particulier la spécification en neurones, cellules gliales, cellules bêta du pancréas sécrétrices d’insuline, cellules rétiniennes, cellules endothéliales, hépatocytes, cardiomyocites.
Les recherches effectuées ont contribué à l’élaboration d’éléments de réponse à quatre questions relevant de la connaissance fondamentale :
– qu’est-ce qui explique la pluripotence d’une cellule ?
– comment maîtriser les mécanismes de différenciation cellulaire ?
– comment réduire le risque tumoral ?
– comment assurer une compatibilité immunologique ?
2. Les perspectives thérapeutiques
La fonction des cellules souches est d’assurer le renouvellement des tissus. In vivo, ces cellules sont difficiles à identifier. En disposer en nombre illimité pour les utiliser dans le cadre de thérapies cellulaires visant à recomposer des tissus présentant des dysfonctionnements du fait d’une maladie ou de la vieillesse a constitué l’argument essentiel avancé par les chercheurs auprès du législateur pour obtenir des dérogations à l’interdiction de recherches sur l’embryon humain.
Selon l’ABM, depuis 2004, « La perspective d’essais cliniques utilisant des cellules souches embryonnaires humaines s’est précisée. » (656)
Le nombre de maladies visées demeure cependant encore très restreint. Comme l’explique Mme Laure Coulombel, directrice de recherche à l’Inserm : « deux obstacles importants persistent : 1. – Le risque lié à la persistance de cellules souches embryonnaires humaines pluripotentes résiduelles dans le greffon ou à l’émergence d’un comportement aberrant des précurseurs greffés. Ce dernier écueil est commun aux cellules iPS et aux cellules pluripotentes adultes ; 2. – Le risque immunologique de rejet de la part du receveur, puisqu’on est dans une situation classique de greffe allogénique. » (657)
Des essais pré cliniques sont en préparation aux États Unis à propos desquels le Professeur Philippe Ménasché a apporté les précisions suivantes : « l’essai prévu par Geron Corporation, concernant la paraplégie, a été autorisé par la FDA, mais n’a pas encore commencé. Geron attend l’autorisation des comités d’éthique des hôpitaux dans lesquels l’essai doit avoir lieu. […] Un essai clinique va également sans doute être lancé par une autre société américaine Advanced Cell Technology visant à traiter par des progéniteurs rétiniens la dégénérescence maculaire liée à l’âge. » (658) Les autorisations délivrées à Geron Corporation ont cependant été suspendues au cours de l’été 2009 dans l’attente d’une meilleure évaluation des risques de développement de tumeurs ou de dérèglements du système immunitaire (659).
En France, une thérapie cellulaire portant sur le tissu cardiaque devrait passer à court terme en phase d’essai. Le Professeur Philippe Ménasché a résumé devant la mission parlementaire l’état des recherches qu’il mène en ce domaine : « On sait aujourd’hui différencier des cellules souches embryonnaires pluripotentes en progéniteurs cardiaques : la technique est parfaitement maîtrisée et reproductible. On a montré sur des modèles animaux, y compris chez les primates, que ces progéniteurs, injectés dans une zone nécrosée du cœur, achèvent de s’y différencier en cellules cardiaques fonctionnelles. Notre objectif est maintenant de pouvoir passer à des essais cliniques chez l’homme. » (660) Ces recherches ont été réalisées en collaboration avec M. Michel Pucéat dont les travaux portent sur la différenciation des cellules souches cardiaques à partir des cellules embryonnaires. (661)
L’obtention par l’équipe dirigée par M. Marc Peschanski et Mme Christine Baldeschi d’un épiderme stratifié chez la souris à partir de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en kératinocytes représente une avancée scientifique importante. Si ces recherches devaient conduire à des résultats cliniques, une voie de thérapie cellulaire complémentaire à celles déjà à l’étude à partir de cellules mésenchymateuses (662) pourrait être développée pour obtenir des greffons de peau au bénéfice des personnes gravement brûlées.(663)
L’Inserm a par ailleurs lancé, le 10 février 2009, un projet de recherche européen (Liv-ES) visant à développer des thérapies cellulaires à partir de cellules souches embryonnaires humaines pour les maladies associées au foie. Regroupant neuf équipes de recherches (Espagne, Finlande, France, Israël, Royaume-Uni), le consortium est financé par la Commission européenne dans le cadre du 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement et est coordonné par le Docteur Anne Weber-Benarous de l’Inserm. Ce projet consiste à créer les conditions pour que des thérapies cellulaires puissent faire l’objet d’essais et proposer des alternatives aux transplantations du foie. A cette fin, le consortium mettra en place, d’ici fin 2011, une banque d’hépatocytes humains matures utilisables dans des conditions cliniques acceptables.
A plus long terme, le recours à des cellules neurales issues de cellules souches embryonnaires devrait faciliter la mise en œuvre de thérapies cellulaires visant à améliorer l’état clinique de patients atteints de la maladie de Huntington (664).
L’effet biologique et la toxicité des produits de pharmacologie sont aujourd’hui étudiés sur des produits cellulaires issus soit de lignées de cellules transformées (cellules tumorales ou cellules génétiquement modifiées) soit de prélèvements sur des patients. Certains chercheurs (665) estiment que les lignées de cellules souches embryonnaires offriront des modèles in vitro d’une efficacité très supérieure pour identifier des cibles thérapeutiques ou pour disposer d’outils de toxicologie prédictive. Il s’en suivra en outre un recours moindre à l’expérimentation animale.
Les cellules du foie et les cellules cardiaques devraient être les premiers domaines d’application de ces nouvelles techniques comme le souligne un rapport du ministère de la santé britannique rédigé en juillet 2006 (666). En particulier, la difficulté à disposer d’hépatocytes humains et à les faire proliférer in vitro conduit à privilégier l’utilisation des cellules dérivées de cellules embryonnaires dont la culture garantit une disponibilité illimitée. Les recherches sont nombreuses en ce domaine. Le projet Liv-ES précédemment mentionné fait de l’utilisation des cellules hépatocytes en pharmacotoxicologie l’une des finalités de la future biobanque.
L’intérêt que présentent ces recherches pour l’industrie pharmaceutique devrait conduire, selon M. Marc Peschanski, directeur de recherche à l’Inserm, à « un changement d’échelle » (667) dans les capacités de culture des cellules souches. Le projet britannique Stem Cells for Safer Medicines (SC4SM), cofinancé par des compagnies pharmaceutiques internationales (GlaxoSmithKline, AstraZeneca et Roche) et lancé en octobre 2007 à l’issue du rapport précité offre un exemple de l’intérêt que suscitent ces perspectives de recherche.
c) Les recherches sur les techniques de culture des cellules embryonnaires
Plusieurs projets de recherche autorisés par l’ABM ont porté sur les techniques de prolifération des cellules embryonnaires en vue d’une application clinique. Les difficultés pour maîtriser la différenciation cellulaire in vitro, la nécessité d’obtenir des milieux de culture de qualité, la demande de quantités importantes de cellules ont suscité divers projets de recherche à orientation technique. En raison des investissements qu’ils impliquent, ces projets incluent des participations privées.
M. Marc Peschanski a dessiné des perspectives plus larges de développement : « le plein bénéfice des capacités d’expansion des cellules souches embryonnaires ou iPS ne pourra être atteint qu’à condition que l’on quitte les limites étroites des flasques des laboratoires académiques pour passer aux outils industriels de la bioproduction. » (668) La finalité de cette production massive consistera moins en l’utilisation thérapeutique de ces cellules, laquelle dépend plus d’un gain de qualité des cultures que d’un accroissement quantitatif, qu’en la mise à disposition pour les chercheurs d’une multiplicité de modèles biologiques.
3. Les recherches sur les autres types de cellules souches
Comme l’ont à plusieurs occasions souligné les députés membres de l’OPECST (669), les recherches menées sur les cellules souches adultes n’ont pas à être opposées à celles effectuées sur les cellules embryonnaires. Les scientifiques auditionnés par la mission parlementaire ont, pour la plupart, défendu la même position.
Certaines cellules souches adultes ont prouvé depuis plus de trente ans leur potentiel thérapeutique. Ainsi, les thérapies recourant aux cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique bénéficient à plus de 3000 malades par an traités pour des hémopathies malignes, pour des tumeurs solides ou pour contrer les effets sur la moelle osseuse de chimiothérapies (670).
Depuis les essais cliniques de Mme Éliane Gluckman, en 1989, on sait utiliser les cellules du sang placentaire dont notre collègue sénatrice Mme Marie-Thérèse Hermange, a souligné le potentiel thérapeutique (671). Le prélèvement de ces cellules ne présente pas de difficultés techniques. Elles offrent l’avantage de ne pas poser les problèmes de compatibilité qu’ont les greffes de cellules de la moelle osseuse. Mme Éliane Gluckmann a rappelé les traitements réalisables au moyen de cette technique : « Aujourd’hui, le recours à une greffe de sang de cordon allogénique a été validé dans le cas des leucémies aiguës de l’adulte et de l’enfant – pas toutes, certaines relevant d’un traitement chimiothérapeutique –, et ce sans limite d’âge, des lymphomes, des myélomes, des myélodysplasies, en bref de la plupart des hémopathies malignes. Elles sont également indiquées dans le cas d’hémopathies génétiques non malignes, comme la thalassémie, la drépanocytose ou le déficit immunitaire congénital, ou bien encore d’arrêt de fonctionnement de la moelle osseuse. Il a été démontré que la greffe de sang de cordon donnait les mêmes résultats que celle de la moelle osseuse. » (672)
D’autres indications de thérapies à partir de cellules souches issues du sang placentaire sont envisageables selon Mme Éliane Gluckman : « Dans le sang et surtout dans le placenta, on trouve des cellules souches qui, conservées, pourraient ultérieurement être différenciées en hépatocytes, neurones, cellules pancréatiques… Il s’agit là seulement d’une indication thérapeutique en puissance, et on en est encore au stade des recherches. » (673)
Les thérapies cellulaires employant des cellules souches autres que celles provenant de la moelle osseuse ou du sang placentaire en sont encore au stade d’essais.
Des préparations de myoblastes ont été testées dans plusieurs pathologies : insuffisance cardiaque (la faisabilité de la technique a été prouvée mais pas le bénéfice thérapeutique), dystrophies musculaires localisées et incontinence urinaire.
Les cellules souches multipotentes à l’origine de l’épiderme sont identifiées mais ne font pas l’objet d’essai clinique. Aussi, même si la reconstruction de surfaces de peau par culture des cellules de l’épiderme est une technique aujourd’hui maîtrisée, les greffons obtenus par culture demeurent très fragiles, ne contenant ni annexe ni terminaison nerveuse. Le laboratoire de recherche du centre de transfusion sanguine des armées de Percy travaille sur les cellules souches mésenchymateuses afin d’améliorer la production en culture d’épiderme pour les grands brûlés (674).
Ces différents exemples montrent combien les recherches sur les cellules souches adultes demeurent d’actualité et offrent des perspectives thérapeutiques. Mais la revue de ces travaux conduit à constater que, comme il en va des thérapies cellulaires à partir des cellules embryonnaires, aucune technique de thérapie cellulaire à partir de cellules souches adultes n’est pour le moment utilisée en routine, à l’exception notoire des techniques de greffe des cellules hématopoïétiques. Il paraît par conséquent difficile de mettre en avant l’efficacité d’une technique au détriment d’une autre quand l’ensemble des équipes de recherche en est encore au stade des études fondamentales.
En outre, traiter ces différentes voies en termes de concurrence ou d’alternatives ne correspond pas à la pratique des chercheurs qui dirigent leurs travaux là où l’espoir d’obtenir des résultats est le plus grand. Chaque voie de recherche est plus ou moins prometteuse en fonction des tissus cellulaires concernés. La stratégie de recherche suivie par M. Michel Pucéat et M. Philippe Ménasché est un exemple de cette démarche : « Les thérapies cellulaires, explique M. Michel Pucéat dans un entretien, ont eu le mérite de démontrer la faisabilité d’une injection dans un tissu, mais il faut reconnaître que leur efficacité s’est révélée faible, voire nulle. Les cellules souches adultes sont d’abord peu accessibles. Elles ne se remettent pas en fonction lorsque l’organe est altéré, sauf pour certains tissus gardant une bonne capacité de prolifération, comme les muscles ou le foie. Et surtout, elles ne sont pas aussi multipotentes qu’on l’espérait initialement. Pour toutes ces raisons, on revient aujourd’hui aux cellules souches embryonnaires. » (675)
Les recherches mentionnées précédemment sur la reconstitution de l’épiderme, les unes à partir de cellules mésenchymateuses, les autres à partir de cellules souches embryonnaires humaines, sont aussi une illustration du fait qu’en l’état des connaissances on ne saurait préjuger de la technique qui se révèlera finalement la plus efficace.
4. La découverte de la reprogrammation cellulaire change-t-elle les termes du débat ?
Toutes les cellules ont le même matériel génétique. La spécialisation des différentes populations de cellules tient au fait que les gènes contenus dans leurs noyaux sont rendus actifs ou maintenus inactifs.
On sait que l’ovocyte a la capacité de reprogrammer les cellules comme le prouve le processus naturel de fécondation ou l’obtention de cellules souches embryonnaires par transfert nucléaire.
En août 2006, le professeur Shinya Yamanaka de l’université de Kyoto a fait la découverte étonnante qu’il était possible, « hors de tout contexte d’une cellule germinale » (676) de forcer une cellule différenciée adulte à adopter de nouveau, comme si on lui faisait remonter le temps, la conformation d’un noyau de cellule souche embryonnaire pluripotente. Ainsi à partir de toute cellule adulte il est possible d’obtenir une cellule quasi identique à une cellule embryonnaire pluripotente naturelle ; comme celle-ci, cette cellule, appelée iPS (induced pluripotent stem cell) peut être mise en culture et subir un processus de différenciation. La reprogrammation d’une cellule de l’épiderme peut conduire, par exemple, à l’obtention d’une cellule neuronale. A cette fin, la technique utilisée consiste à recourir à des rétrovirus pour insérer dans la cellule des gènes dont l’expression rend à la cellule son état de pluripotence.
Depuis cette découverte, les avancées se sont succédées avec rapidité, notamment dans la compréhension de ce mécanisme. En novembre 2007, l’équipe du professeur Yamanaka démontrait que cette technique était applicable aux cellules d’origine humaine.
Dès 2008, plusieurs équipes ont réussi à dériver selon cette méthode des cellules spécifiées à partir de prélèvements effectués sur des personnes atteintes de maladies génétiques, ouvrant ainsi la perspective de produire des matériels d’étude aisément disponibles, similaires aux cellules in vivo, qui aideront à la compréhension des mécanismes pathologiques (677).
En mai 2009, une expérience combinant la reprogrammation cellulaire et la thérapie génique pour obtenir des cellules indemnes d’une anomalie génétique a donné des résultats encourageants(678).
En août 2009, le professeur Yamanaka démontrait qu’en inactivant directement le gène p53, gène dit suppresseur de tumeurs, il était possible d’augmenter considérablement (dans un facteur de 10) le nombre de cellules déprogrammées.
Pour les uns, la maîtrise de la production des cellules iPS rend caduque l’utilisation des cellules embryonnaires dans la conception de nouvelles thérapies cellulaires. En effet la technique de déprogrammation nucléaire présente non seulement l’avantage de rendre disponible plus facilement que les cellules embryonnaires, un nombre illimité de cellules souches (puisqu’il suffit de procéder à partir de cellules somatiques) mais, en outre, elle ne soulève pas de problème de compatibilité (puisqu’elle permet d’envisager une utilisation autologue). Le chercheur n’aura plus à recourir à des pratiques éthiquement contestables consistant à détruire des embryons pour se procurer des cellules souches.
Pour les autres, la découverte de cette nouvelle technique prouve à l’inverse l’utilité de poursuivre les recherches sur les cellules embryonnaires puisque seule la compréhension des processus de spécialisation cellulaire permise par ces dernières a rendu possible la conception des procédés de reprogrammation. De plus, l’étude de la différenciation de ces « quasi » cellules embryonnaires devra toujours être comparée (notamment dans la perspective de leur utilisation clinique) avec celle de cellules dont la multipotence n’a pas été artificiellement induite. On peut en effet se demander si ces cellules artificiellement « rajeunies » ne continuent pas de conserver des caractères de la cellule somatique. Enfin, au vu des techniques utilisées pour procéder aux reprogrammations, le risque de développement cancérigène de ces cellules reste à évaluer.
La découverte des iPS a ainsi ajouté une troisième voie de recherche à celles ouvertes depuis plusieurs années sur les cellules souches adultes et les cellules souches embryonnaires, sans pour autant se révéler être la seule option pouvant conduire au développement des thérapies cellulaires. On a moins affaire, du moins en l’état des connaissances, à une substitution d’un champ de recherche par un autre qu’à une imbrication croissante des techniques et des savoirs. Comme a pu le souligner Mme Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le constat de cette complémentarité entre les différentes voies de recherche doit conduire sur ces questions « à un apaisement des débats. » (679)
Un tel constat devrait se traduire aussi par des financements équilibrés entre les différentes voies de recherche. Mme Marie-Christine Ouillade, administratrice de l’Association française contre les myopathies (AFM) après avoir indiqué que son association finançait à hauteur de 5 millions d’euros par an le laboratoire I-Stem a précisé que l’AFM avait « veillé à répartir de manière équitable ces trois types de recherches dans les budgets 2008 et 2009 afin de ne fermer aucune porte. »
Il existe certes encore d’autres sources de production de cellules souches : le prélèvement de cellules avant le stade de blastocyste et sans destruction de l’embryon ; la parthénogénèse ovocytaire ; le transfert nucléaire dans un ovocyte humain ou dans celui d’un autre mammifère. L’interdiction de créer des embryons pour la recherche, la difficulté à disposer d’ovocytes humains et les difficultés techniques propres à chacune de ces méthodes rendent ces voies de recherche marginales.
Un état des lieux complet de ces questions sera dressé par l’OPECST et l’ABM avant la discussion de la prochaine loi de bioéthique, conformément à l’article 26 de la loi du 6 août 2004 (680).
C. QUEL SERA LE FUTUR STATUT DE LA RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES ?
1. Sur quels principes fonder le futur régime de contrôle ?
Il reviendra à la prochaine loi de bioéthique de déterminer les conditions légales dans lesquelles se poursuivront, le cas échéant, les recherches sur l’embryon.
En l’état du droit, la période dérogatoire fixée par la loi du 6 août 2004 s’achèvera le 6 février 2011. L’article L. 2151-5 du code de la santé publique dispose en effet que la dérogation à l’interdiction de toute recherche est limitée à une période de 5 ans. Ce délai court à compter de la publication, intervenue le 7 février 2006, du décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 2151-8 du même code fixant notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre de ces recherches.
Comme le précise le Conseil d’État, la combinaison de ces dispositions avec l’article R. 2151-2 du code de la santé publique qui habilite le directeur général de l’Agence de la biomédecine à autoriser un protocole de recherche sur l’embryon ou sur les cellules embryonnaires pour une durée maximale de cinq ans fait que « les projets autorisés avant le 6 février 2011 pourront se poursuivre au-delà de cette date, dans la limite de la durée indiquée dans l’autorisation. » (681)
a) Faut-il mettre fin au régime dérogatoire et revenir à une interdiction absolue de toute recherche sur l’embryon ?
Le retour à l’interdiction de toute recherche sur l’embryon telle que l’ont posée les lois bioéthiques de 1994, conduirait à adopter une législation semblable à celle de la Lituanie, de la Norvège, de la Pologne et de la Slovaquie. L’argument avancé en faveur de cette thèse est que les perspectives thérapeutiques présentées par les recherches sur les cellules souches adultes et, plus encore sur les cellules iPS, font perdre leur raison d’être à celles conduites sur les cellules souches embryonnaires. L’intérêt que pouvaient présenter de telles recherches en 2004 – lequel avait pu rendre moralement admissible la transgression de l’interdiction formulée dans la loi de 1994 – ayant considérablement diminué au regard des autres voies de recherche, il conviendrait de mettre fin à la parenthèse ouverte par la dernière loi de bioéthique et de revenir à une position éthique plus rigoureuse. Telle a été la position défendue en particulier par M. Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune pour qui : « Les dérogations sont inutiles puisque la modélisation et le criblage moléculaires sont possibles sur les iPS. Les arguments en faveur du maintien du moratoire sont idéologiques ou économiques ; ils ne peuvent prévaloir sur un plan éthique. » (682)
Certes il convient de reconnaître qu’à l’occasion de la préparation de la loi de 2004, il avait été fait un usage pour le moins hyperbolique, par de nombreux chercheurs, de l’argument selon lequel les recherches sur l’embryon conduiraient au développement de thérapies innovantes. Mais il était entendu que la voie ouverte exigerait du temps avant que des bénéfices pour la santé puissent en être tirés. Le rapporteur de la mission parlementaire préparatoire à la loi de 2004, M. Alain Claeys, président de la présente mission, après avoir exposé la nature des perspectives scientifiques telles qu’elles se présentaient en 2001 avait ainsi conclu : « De l’ensemble de ces éléments, il faut donc retenir les perspectives immenses et prometteuses de la thérapie cellulaire ou génétique basée sur les cellules souches, qui pourraient faire franchir à la médecine un saut qualitatif majeur. Toutefois, ces perspectives thérapeutiques sont susceptibles de ne déboucher que dans le moyen ou long terme. Il s’agit donc aujourd’hui de franchir la première étape en autorisant et en encadrant la recherche sur les cellules souches puisque l’on se trouve pour l’heure au stade de la recherche fondamentale. » (683)
Le bilan tiré des recherches effectuées depuis 5 ans montre que les équipes de chercheurs qui sont passées à la recherche appliquée sont en nombre réduit. Mais les conditions à réunir pour passer à une application thérapeutique sont aujourd’hui mieux comprises des scientifiques.
La recherche a besoin de temps, ce qu’a rappelé Mme Nicole Le Douarin, professeur honoraire au Collège de France : « Il faut […] travailler, mais longtemps, humblement, modestement, en se disant qu’il faudra des années pour arriver à obtenir des cultures pures d’un type similaire sans risquer d’introduire des cellules susceptibles de devenir tumorales. La recherche biologique est longue et difficile. Elle progresse formidablement par rapport à tout ce qu’on a connu, mais pour arriver à faire quelque chose de fiable quand il s’agit d’introduire des cellules vivantes dans un être humain, il faut vraiment prendre des précautions. » (684)
b) Faut-il maintenir un régime dérogatoire provisoire ?
Le choix de poursuivre les recherches étant retenu, il pourrait être en premier lieu envisagé de maintenir le dispositif actuel en repoussant, par exemple de cinq nouvelles années, le terme de la dérogation.
Cependant, le caractère provisoire de la dérogation était lié, dans la loi de 2004, à l’idée qu’il convenait de procéder à une expérimentation, nécessairement limitée dans le temps, dont le bilan devait permettre de prendre une position plus tranchée. Il y aurait peu de sens à repousser de 5 ans ce délai et à faire ainsi subsister un régime expérimental sur une période de 10 ans, alors que le bilan des recherches effectuées depuis 5 ans peut être considéré comme positif. L’ABM s’est en outre acquittée de manière satisfaisante des fonctions de contrôle que lui a confiées le législateur : « Le système fonctionne bien et évite le risque réel d’une prise en main par les professionnels » (685) a estimé Mme Nicole Questiaux, ancienne membre du CCNE et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
En outre un régime provisoire entraînerait un manque de visibilité juridique défavorable à la constitution d’équipes de chercheurs et serait peu propice à des investissements financiers qui par nature sont conséquents. Selon l’ABM, le faible nombre de projets de recherche émanant du secteur pharmaceutique et biotechnologique s’expliquerait ainsi par le fait que l’importance des investissements n’est pas compatible avec des délais de recherche restreints : « le développement d’un secteur de haute technologie français dans le domaine des cellules souches embryonnaires était par conséquent incompatible avec la période de 5 ans fixée en 2004. De l’avis des spécialistes, il le restera si ce type de disposition est renouvelé dans la future loi. » (686)
c) Faut-il instaurer un régime dérogatoire pérenne ?
Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports s’est déclarée favorable à un régime pérenne d’interdiction avec dérogation, notamment au regard de la portée symbolique de l’interdiction(687).
Ce choix consisterait à ne modifier les dispositions actuelles qu’en en supprimant les conditions portant sur leurs délais de validité. M. Jean-François Mattei a souscrit devant les membres de la mission à une telle formule : « il faut maintenir l’interdit, poser un principe dérogatoire et y revenir lorsque ce sera opportun, sans fixer de délai a priori. » (688)
L’interdiction de principe de toute recherche sur l’embryon, pivot des lois de 1994 et de 2004, serait maintenue. La protection de la vie de l’embryon demeurerait un impératif légal, en cohérence avec l’article 16 précité du code civil. La dérogation à cette interdiction ne serait justifiée que par l’existence d’intérêts majeurs liés aux bénéfices pour la santé attendus de ces recherches ; si cet élément déterminant venait à manquer au vu du constat du caractère infructueux des recherches entreprises, la dérogation devrait être réévaluée.
En ce sens, le régime dérogatoire implique une interprétation stricte de la possibilité de déroger à l’interdiction maintenue : en cas de situation incertaine dont le juge serait saisi, le principe de l’interdiction prévaudra. Comme l’explique M. Jean-René Binet : « Le principe présente l’intérêt d’affirmer la valeur à laquelle on reconnaît un caractère prépondérant tandis que les exceptions en permettent un assouplissement encadré. Le principe a vocation à interprétation analogique tandis que les exceptions sont d’interprétation stricte. » (689)
Il peut, en outre, être estimé important de conserver la portée symbolique de l’interdiction. L’obtention d’une autorisation de recherche entendue comme une dérogation à une interdiction de principe souligne en effet le caractère exceptionnel, du point de vue moral, de la procédure. Le fait que la quasi totalité des projets de recherche présentés à l’ABM ait été autorisée en raison de la qualité de leurs protocoles paraît indiquer que le régime dérogatoire actuel conduit leurs promoteurs à assumer leurs responsabilités en se soumettant rigoureusement aux exigences requises.
M. Xavier Lacroix, présentant la position de l’Eglise catholique, a ainsi estimé que « maintenir l’interdit de principe rappelle l’essentiel, à savoir que l’embryon n’est pas une chose. Le minimum éthique nous semble être de faire en sorte que la transgression apparaisse comme telle. » (690)
d) Faut-il lever le principe de l’interdiction et adopter un régime d’autorisation ?
On peut s’interroger sur la valeur d’un interdit de principe pour lequel serait aménagé de façon permanente un régime de dérogation.
Relevant le caractère apparemment ambigu d’une telle position et constatant la qualité des contrôles auxquels procède l’ABM, Mme Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est déclarée favorable à l’adoption d’un régime d’autorisation : « Tout risque de dérive et d’abus semble aujourd’hui écarté. C’est […] pourquoi je pense que l’Assemblée pourrait dans ce contexte examiner la possibilité que ces recherches ne soient plus permises seulement par dérogation mais soient autorisées, avec bien entendu le maintien d’un encadrement très strict par l’Agence de la biomédecine. Cela permettrait d’en finir avec une certaine hypocrisie. » (691)
Cette solution est défendue par de nombreux intervenants. L’OPECST (692) a pris position en ce sens ainsi que le Conseil d’État.
Le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas d’argument juridique à opposer à l’introduction d’un régime d’autorisation. Rappelant la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 déjà citée, le Conseil d’État estime que « sous réserve que les atteintes portées à l’embryon soient justifiées par des motifs majeurs tenant à la protection de la santé, des recherches sur les cellules embryonnaires peuvent donner lieu à autorisation sans que le principe constitutionnel de protection de la dignité humaine puisse leur être opposé. » (693)
Ce raisonnement reprend les argumentations précédemment exposées.
Si le principe constitutionnel cité par le Conseil d’État porte plus précisément sur la sauvegarde de « la dignité de la personne humaine » et pourrait difficilement être invoqué dans les cas des embryons non pourvus de personnalité juridique, il apparaît clairement que l’introduction d’un régime d’autorisation n’entrerait en contradiction avec aucune norme supérieure dès le moment où le législateur peut légitimement considérer, selon le juge constitutionnel, que les embryons surnuméraires sans projet parental sortent du champ couvert par l’article 16 du code civil qui énonce le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie.
Comme il en a déjà été fait mention, la nécessité de justifier les atteintes portées à l’embryon par des motifs tenant à la protection de la santé relève d’un raisonnement sensiblement différent. Il consiste à mettre en balance différents intérêts (l’intérêt de l’embryon, d’une part, et l’intérêt général de santé publique, d’autre part) qui n’a de sens que si on estime que l’article 16 du code civil inclut même indirectement dans son champ les embryons in vitro. C’est en comparant la portée du principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie et le bénéfice que toute personne peut recueillir de telles recherches que les autorisations sont délivrées(694).
Lever l’interdiction de recherche sur l’embryon ne paraît pas incompatible avec l’article 18 de la convention d’Oviedo déjà cité, sous réserve que des conditions adéquates à la protection de l’embryon soient maintenues, comme l’a rappelé Mme Laurence Lwoff, chef de la division bioéthique du Conseil de l’Europe(695). Les conditions restrictives à la destruction des embryons surnuméraires seraient en effet maintenues : abandon du projet parental, consentement du couple et motifs tenant à l’intérêt médical de la recherche.
Certains juristes auditionnés ont cependant exprimé des réserves sur la cohérence d’un tel dispositif au regard d’un ensemble de règles affirmant par ailleurs la nécessaire protection du fœtus et de l’embryon. Selon M. Jean-René Binet, « Abandonner le principe d’interdiction des recherches sur l’embryon marquerait une rupture avec cet ensemble cohérent. Autoriser ces recherches, même sous conditions strictes, reviendrait à poser la première règle affirmant à titre de principe la possibilité d’attenter à la vie humaine, si cette atteinte peut servir les intérêts d’autrui. Une telle évolution remettrait en question la cohérence du droit actuel et affaiblirait le principe de respect de l’être humain dès le commencement de la vie. Elle aboutirait également à diminuer la possibilité de contrôle des conditions que vous pourriez poser. Des deux points de vue, ce serait une mauvaise solution. » (696)
Pour le professeur Bertrand Mathieu, le passage à un régime d’autorisation nécessiterait à tout le moins un renforcement des principes protecteurs de l’embryon in vitro : « Le législateur devrait alors rappeler que l’embryon humain est protégé, dans le même temps que cette protection est limitée dans certaines circonstances et sous certaines conditions. Il faudrait qu’il rappelle au niveau des principes – et non s’agissant des conditions dans lesquelles les recherches doivent être conduites – que les recherches ne conduisant pas à la destruction d’embryons doivent être privilégiées. Une telle rédaction permettrait la poursuite des recherches que le législateur souhaiterait autoriser, tout en ne rompant pas complètement avec le principe selon lequel l’embryon humain, quelle que soit sa situation, ne peut être assimilé à un matériau de laboratoire. Au surplus, elle s’inscrirait dans la logique de la jurisprudence constitutionnelle. » (697)
La différence entre les deux options porte aussi sur l’interprétation qui pourra être faite par le juge éventuellement saisi d’un litige sur l’autorisation de recherche : « Les conséquences juridiques directes ne seraient pas tout à fait les mêmes car lorsqu’un texte d’application ne répond pas à une situation donnée, on remonte au principe ; or ici les principes – interdiction, autorisation – sont opposés », a expliqué le professeur Bertrand Mathieu (698). Dans un cas la possibilité de déroger est d’interprétation stricte, dans l’autre c’est la condition qui restreint la liberté qui l’est.
On remarquera cependant, comme il l’a déjà été exposé, que le Conseil constitutionnel a explicitement reconnu une marge d’interprétation au législateur sur l’application de principe du respect de la vie dès son commencement. Cette liberté signifie que la question de la nature de l’embryon demeure ouverte et que le législateur peut fixer des degrés de protection différents.
Sur la procédure, le Conseil d’État reconnaît que la méthode d’interprétation des textes pourrait différer dans le cas où une situation donnée serait incertaine mais souligne que l’instauration d’un dispositif d’autorisation sous conditions strictes ou d’un régime d’interdiction avec dérogation n’emportent pas de différences importantes dans les modalités pratiques des contrôles administratifs qui pèseront sur ces recherches : « Juridiquement, la différence entre ces deux formules n’est pas fondamentale : l’un ou l’autre de ces schémas peut être indifféremment employé pour encadrer la recherche par des conditions en réalité identiques. Dans les deux cas, ce seraient les mêmes recherches qui seraient interdites, et tout recherche non expressément autorisée serait interdite, sous peine de sanctions pénales. » (699)
Pour les raisons exposées précédemment, une partie des membres de la mission parlementaire dont son président, M. Alain Claeys, s’est prononcée en faveur du passage à un régime de recherche d’autorisation sous conditions.
Les autres membres de la mission, ainsi que votre rapporteur, estiment que la destruction d’embryons humains à des fins de recherche pose des questions éthiques trop complexes pour ne pas maintenir un régime d’interdiction avec dérogation, lequel est le seul à même de rappeler le caractère exceptionnel d’une telle recherche.
Proposition n° 43. Maintenir le principe de l’interdiction de la recherche sur l’embryon. Autoriser les recherches à titre dérogatoire, sans encadrer cette dérogation par des délais.
Une partie des membres de la mission s’est déclarée favorable à la levée de l’interdiction pesant sur la recherche sur l’embryon et a plaidé pour l’adoption d’un régime d’autorisation sous conditions.
Il a été reconnu que ces deux options devaient conduire dans les faits à un encadrement réglementaire équivalent.
2. Redéfinir les critères de délivrance des autorisations de recherche
La portée pratique des options précédemment décrites repose sur le choix des critères que l’ABM aura la mission d’appliquer. Le dispositif actuel a certes permis un contrôle rigoureux des protocoles de recherche. Néanmoins, de nombreuses personnes auditionnées par la mission parlementaire, y compris les représentants de l’Agence de la biomédecine, estiment que certains des critères définis à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique posent des problèmes d’interprétation. La future loi de bioéthique sera conduite, à tout le moins, à les reformuler.
Les conditions portant sur la situation des embryons pouvant faire l’objet de recherche n’ont pas été remises en cause : il s’agit d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et qui ne font plus l’objet d’un projet parental ; ces embryons sont donnés à la recherche avec le consentement écrit du couple dont ils sont issus ou du membre survivant de ce couple, consentement confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois, révocable à tout moment et sans motif. Le couple est dûment informé des possibilités d’accueil de leurs embryons par un autre couple ou de l’arrêt de leur conservation.
La condition imposant que les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation a fait l’objet de discussions rapportées à la fin du présent chapitre.
Les conditions de délivrance des autorisations qui demanderaient à être réévaluées sont celles fixées aux alinéas 3 et 5 de l’article L. 2151-5 précité : « Les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques ; […] la décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. »
a) Des recherches susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs
Le décret n° 2006-121 du 6 février 2006 a précisé que « Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, au sens de l’article L. 2151-5, les recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l’embryon ou du fœtus. » (700)
Ce critère réserve les autorisations de recherche aux seules activités scientifiques orientées vers une finalité thérapeutique. Mais sa formulation en restreint la portée en n’exigeant qu’un lien potentiel entre le contenu de la recherche et son application clinique.
Le Conseil d’État ne propose pas d’apporter de modification à cette formulation qui paraît garantir que l’atteinte à l’embryon impliquée par la recherche est justifiée par une finalité médicale d’importance.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l’ABM, a insisté sur la portée de ce critère qui fournit la justification éthique aux autorisations délivrées : « On ne peut accepter le sacrifice d’un embryon que pour une recherche visant à soigner l’être humain ; il serait insupportable, en tout cas en a-t-il toujours été ainsi jusqu’à présent en France, de sacrifier un embryon ou une cellule souche embryonnaire pour un objectif militaire, agro-alimentaire, cosmétique… C’est ce qu’a voulu dire le législateur lorsqu’il a posé la condition de « progrès thérapeutiques majeurs. » (701)
Demeure cependant un décalage entre le plan cognitif où se situent encore les recherches et la nécessité de démontrer que des avancées thérapeutiques majeures en découleront, comme cela ressort de la description faite par Mme Emmanuelle Prada-Bordenave de la nature des arguments avancés par les chercheurs : « Les chercheurs s’inscrivent spontanément dans une démarche de soin, expliquant tout naturellement lorsqu’ils présentent un projet à l’Agence, même si celui-ci relève encore de la recherche fondamentale, qu’il pourra servir à comprendre telle ou telle maladie, et constitue donc le premier pas pour en soigner les malades, ou bien encore les mécanismes d’expression des gènes, ce qui est essentiel pour comprendre l’apparition et le développement des cancers. » (702)
Trop précis, il est à craindre que selon le rapport de l’ABM sur l’application de la loi bioéthique(703)le critère de progrès thérapeutiques « ne bloque la soumission de projets très fondamentaux », dont on ne peut anticiper leur application dans la mise au point de thérapies. Trop vague, ce critère ne prémunirait pas « contre un usage futile des cellules souches issues d’embryons surnuméraires », selon le conseil d’orientation de l’ABM. (704)
L’ABM propose dans le rapport précité qu’il soit fait mention d’une « amélioration des connaissances au bénéfice de la santé de l’humanité ». (705)
Dans sa version de 2001, le projet de loi relatif à la bioéthique avait retenu la notion de « fin médicale », que M. Alain Claeys, rapporteur pour la première lecture du texte avait justifiée ainsi: cette notion « englobe et dépasse celle de « finalité thérapeutique » puisqu’elle englobe non seulement le but de soigner ou de traiter la maladie mais aussi celui de la prévenir ou de la diagnostiquer. » (706)
Convient-il de conserver un terme caractérisant l’importance du progrès attendu ? On soulignera que moins on caractérise la nature des progrès espérés, plus on rend difficile, en particulier dans une logique d’interprétation stricte, le maintien d’un régime d’interdiction avec dérogations. Il faut en effet que l’exception soit justifiée par des arguments suffisamment convaincants et précis pour rendre admissible la dérogation à l’interdit. L’exigence n’est d’ailleurs pas moindre dans un régime d’autorisation sous conditions qui devra, en particulier, rester compatible avec l’article 18 de la convention d’Oviedo ; celui-ci posant le principe d’une protection adéquate de l’embryon, les atteintes à ce dernier ne sauraient en effet être admises qu’au regard d’intérêts d’une portée suffisante. Dans cette logique, le Conseil d’État propose de conserver la formulation actuelle.
On doit cependant constater que le caractère majeur ou non du progrès attendu ne constitue pas un critère effectif dans le cadre d’un contrôle exercé sur des activités de recherches qui en sont encore au stade fondamental. Il est encore plus difficile au chercheur d’anticiper la portée des applications thérapeutiques des résultats de sa recherche que la nature même de ces résultats. Les grands témoins du forum de Marseille des États généraux de la bioéthique ont insisté sur ces difficultés en citant François Jacob : « La qualité d’une découverte se mesure au degré de surprise qu’elle provoque ».
Le choix devra être fait entre la formulation d’un nouveau critère plus conforme à la réalité de l’effectivité du contrôle de l’ABM ou le maintien du critère actuel qui s’intègre dans une cohérence juridique d’ensemble.
On peut cependant estimer que cette cohérence juridique ne sera pas mise en péril si le critère retenu n’est accolé d’aucun qualificatif. La préservation de la santé constitue un objectif en soi, sans qu’il y ait à y distinguer d’intérêts majeurs ou mineurs.
Viser une finalité médicale et non seulement thérapeutique serait en outre plus en cohérence avec les dispositions relatives à l’expérimentation sur la personne humaine et celles portant sur l’utilisation des éléments et produits du corps humain, sous réserve que la finalité exclusivement scientifique soit écartée. Une des conditions posées à la réalisation de recherches biomédicales sur l’être humain est en effet qu’« aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l’être humain si […] elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’en améliorer la condition. » (707) et l’une des dispositions légales portant sur le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain est que « les activités afférentes à ces éléments et produits […] doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique […] » (708)
b) L’absence d’une méthode alternative d’efficacité comparable en l’état des connaissances scientifiques.
Le décret du 6 février 2006 n’a pas précisé les modalités d’application de cette condition posée par le législateur en 2004.
Elle a pour finalité de maintenir le caractère exceptionnel de l’utilisation de l’embryon à des fins de recherche et suppose l’exercice d’une veille portant sur l’état des connaissances. Cette veille a une finalité éthique – elle rend, le cas échéant, admissible la dérogation à l’interdit – et juridique : l’existence avérée d’une méthode de recherche ne recourant pas à l’embryon et pouvant conduire à des résultats identiques ferme la voie de la recherche utilisant l’embryon. On retrouve une démarche analogue dans la législation allemande, qui limite les autorisations à des projets de recherche prioritaires visant à apporter des connaissances ne pouvant vraisemblablement être acquises qu’à l’aide de cellules-souches embryonnaires. (709)
Selon l’ABM, « cette condition, bien que n’ayant pas posé de problèmes lors de l’examen des demandes, semble, au regard des réalités scientifiques, superflue. » (710) Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, a expliqué au cours de son audition que l’expression « « méthode alternative d’efficacité comparable » n’a pas grand sens sur le plan scientifique. On a très rarement le choix entre plusieurs méthodes d’égale rigueur. Il est très rare, sinon impossible, que deux méthodes aient exactement la même efficacité. On perçoit bien ce qu’a voulu dire le législateur mais en pratique, cela n’est pas très pertinent. » (711)
Reconnaissant que ce critère « n’est pas en adéquation avec les réalités de la recherche », le Conseil d’État estime néanmoins important de « maintenir dans la loi l’idée que la recherche sur les cellules embryonnaires n’est autorisée que lorsqu’elle permet d’aller dans des directions impossibles à emprunter selon d’autres méthodes » (712). La Haute juridiction propose de préciser le champ sur lequel doit s’exercer la comparaison entre les méthodes en le limitant aux autres types de cellules : seules recevraient une autorisation les recherches qui ne pourraient pas être conduites avec la même efficacité sur les cellules souches adultes et les cellules reprogrammées (iPS).
Les difficultés que soulève une telle démarche qui met en concurrence les voies de recherches ont déjà été décrites. Un exercice comparatif dont la pertinence épistémologique n’est pas assurée, serait rendu nécessaire. Sera-t-on, par exemple, jamais certain de l’équivalence entre les cellules embryonnaires et les cellules iPS, et plus généralement entre un état naturel et un état induit par le recours à un artefact ? En outre, un tel dispositif concentrerait les questions éthiques sur l’utilisation des seules cellules embryonnaires, alors que les autres cellules pourront en poser aussi(713). Enfin la finalité protectrice de ce dispositif aurait une portée restreinte ; en effet, limitant la procédure comparative aux types de cellules utilisables, l’existence d’une thérapie obtenue par un biais autre que la thérapie cellulaire ne pourrait pas être invoquée comme motif de refus d’autorisation de recherche sur les cellules souches embryonnaires.
La suppression de tout critère comparatif entre techniques n’affaiblira en rien les contrôles sur les autorisations de recherche, puisque de fait, ce critère n’a jamais présenté d’effectivité.
c) Les trois critères complémentaires
En sus de ces critères généraux, la rédaction actuelle de l’article L. 2151-5 subordonne la délivrance par l’ABM des autorisations à trois conditions: la pertinence scientifique du projet, le respect des principes éthiques et l’intérêt du projet pour la santé publique.
– La pertinence scientifique du projet
Cette exigence ne prête pas à discussion. Tout dossier de recherche présenté à l’ABM est soumis à un collège d’experts. « Ce collège d’experts réunit des spécialistes du plus haut niveau de toutes les disciplines pouvant être concernées par les cellules souches embryonnaires, a expliqué Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. Un projet médiocre n’a aucune chance de passer ce filtre. » (714)
– Le respect des principes éthiques
Ce critère porte sur les conditions de mise en œuvre des protocoles de recherche.
Le fait de mentionner des principes éthiques sans en préciser le contenu a suscité des interrogations de la part du conseil d’orientation de l’ABM pour lequel une telle rédaction manque singulièrement de clarté. « Que veut dire « au regard des principes éthiques »? De quels principes éthiques s’agit-il ? Qu’est-ce qu’un principe éthique ? Seulement ce qui est autorisé par la loi ? » (715)
En 2002, le rapporteur du projet de loi, M. Alain Claeys expliquait qu’il s’agissait « de principes éthiques reconnus et précisés par la loi. » (716)
Comme l’indique le rapport de l’ABM (717), il s’agit des principes généraux portant sur le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain tels que formulés par les articles L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique : le consentement, la gratuité et l’anonymat du don.
Ces principes renvoient eux-mêmes aux principes fondamentaux (718) relatifs au respect du corps humain posés au chapitre II du titre I du livre I du code civil, à savoir, en l’espèce : le respect de l’être humain et du corps humain, la non patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits, le consentement pour toute atteinte à son intégrité, l’interdiction de toute pratique eugénique et de clonage, de toute pratique pouvant porter atteinte à l’intégrité de l’espèce ou visant à modifier la descendance de la personne, la gratuité et l’anonymat des dons d’un élément ou d’un produit du corps.
Le sens à donner à ce critère s’éclaire en outre si on le compare avec la référence au respect « des principes éthiques » faite à l’article L. 1241-5 du code de la santé publique portant sur les conditions de recherche relatives aux embryons et aux cellules embryonnaires issus d’une interruption de grossesse. Introduite à l’initiative du Sénat, cette référence renvoie (719) aux principes posés dans l’avis n°1 du 22 mai 1984 du CCNE relatif aux prélèvements de tissus d’embryons et de fœtus humains morts, à des fins thérapeutiques, diagnostiques et scientifiques parmi lesquels l’exigence qu’une « totale indépendance » soit établie entre, d’une part, les conditions de réalisation de l’acte médical d’assistance à la procréation ainsi que l’équipe qui en est chargée et, d’autre part, les conditions de réalisation de la recherche ainsi que les chercheurs qui les effectuent.
Sur un plan plus général, les principes éthiques qu’il convient de respecter lors de la mise en œuvre des protocoles de recherche renvoient au principe de bienfaisance qui rend moralement admissible un moindre mal si la finalité de l’action est d’obtenir un bien. Il s’agit alors de justifier la destruction de l’embryon en s’assurant que l’utilisation qui est faite des produits de cette destruction n’est pas futile mais conforme à la finalité éthique visée.
– L’intérêt pour la santé publique
Ce critère fait double emploi avec celui de finalité médicale. Selon le Conseil d’État, le législateur pourrait ne pas le retenir.
Proposition n°44. Poser les critères suivants pour la recherche sur l’embryon :
– les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles poursuivent une finalité médicale ;
– la pertinence scientifique du projet doit être établie ;
– les conditions de mise en œuvre du projet doivent être conformes aux principes éthiques.
Ne pas retenir la condition limitant les recherches à celles qui ne peuvent pas « être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. »
d) Assurer une meilleure information des autorités de tutelle.
Le ministre de la santé et le ministre de la recherche devraient être mieux informés des délibérations conduisant l’ABM à donner une autorisation de recherche. Les décisions rendues par l’ABM sont transmises accompagnées de l’avis du Conseil d’orientation ; cet avis est actuellement non motivé. Il conviendrait, comme le préconise le Conseil d’État, d’obliger le conseil d’orientation à motiver chacune de ses décisions afin d’assurer la pleine information des autorités publiques.
Proposition n° 45. Prévoir que le Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine rende un avis motivé sur les décisions d’autorisations de recherche afin d’assurer une meilleure information des ministres de la santé et de la recherche.
D. DE L’EMBRYON À LA CELLULE : PRÉCISER LES RÉGIMES DE CONTRÔLE
Plusieurs difficultés sont apparues au cours de la mise en application des dispositions votées en 2004. Celles-ci proviennent en premier lieu du fait que l’objet sur lequel porte le contrôle confié à l’ABM voit sa nature se modifier à mesure que se rapproche la finalité thérapeutique pour laquelle la recherche a été autorisée. L’embryon surnuméraire est détruit pour en extraire des cellules souches. Celles-ci sont mise en culture et multipliées sous forme de lignées. Ces dernières sont à leur tour dérivées en une grande diversité de cellules souches de tissus. Dans ce continuum, jusqu’où le régime de contrôle de l’ABM doit-il s’exercer ? Jusqu’à quelle phase de spécificité cellulaire convient-il de maintenir le postulat éthique consistant à considérer qu’on a affaire non pas à un produit du corps humain mais à la continuation d’un être potentiel qui a été, à titre exceptionnel, détruit dans une finalité médicale ? Faut-il introduire des distinctions, qui renverraient à des règles de contrôle différentes, entre les embryons, les lignées de cellules souches embryonnaires et les cellules différenciées qui en sont dérivées ?
Par ailleurs, la diversité des recherches faites sur les embryons pose la question du consentement éclairé des couples donneurs. Un déchet opératoire, ou encore ce qui est appelé un fond de tube, ne peut faire l’objet d’une recherche qu’à condition que soit délivrée au donneur une information suffisante sur la nature des recherches entreprises ; ne devrait-il pas en aller de même des couples donnant un embryon ? Mais, sur un autre plan, quelle portée donner à la révocabilité du consentement, – corollaire du consentement libre et éclairé – lorsque le produit du don a été mis en culture et différencié en une multiplicité de cellules différenciées ?
1. Maintenir l’unité du régime de contrôle sur les recherches portant sur l’embryon et sur les lignées de cellules souches
La législation britannique n’impose aucune autorisation pour les recherches sur les lignées de cellules souches.
La législation allemande interdit les recherches sur l’embryon et les recherches sur les cellules souches embryonnaires dérivées mais autorise les recherches sur les lignées de cellules souches importées.
La législation française soumet l’ensemble de ces recherches au même cadre d’autorisation. Le contrôle est ainsi plus étendu que dans la législation britannique et ne souffre pas des ambiguïtés de la législation allemande.
Ces recherches sont à distinguer de celles conduites sur les cellules embryonnaires prélevées à l’issue d’une interruption volontaire de grossesse ; celles-ci font l’objet d’un régime de contrôle différent – contrôle a posteriori de l’ABM (720) –, la destruction de l’embryon étant alors la conséquence d’une situation de fait (situation de détresse ou situation médicale de la mère) et non pas un moyen pour une finalité.
Selon l’ABM, on pourrait néanmoins considérer que « l’interrogation éthique semble d’une autre nature » (721) dans le cas des recherches conduites sur des lignées de cellules souches déjà établies que dans celui des recherches procédant à la destruction d’embryons. Les lignées de cellules souches « ne disposent pas des propriétés organisatrices qui leur permettraient de reproduire un nouvel organisme » (722). Certaines lignées importées sont en outre utilisées en routine depuis plusieurs années par des laboratoires renommés (les plus anciennes lignées datent de 1998). Les équipes de chercheurs comprennent mal la lourdeur des procédures de demande d’autorisation qui leur sont imposées, d’autant que les différences qualitatives entre les lignées les obligent à tester les résultats de leur recherche sur plusieurs d’entre elles.
L’ABM a allégé la procédure d’autorisation d’importation des lignées de cellules souches dans le cas de demandes additionnelles portant sur des protocoles de recherche déjà autorisés. La demande n’est plus instruite par un collège de scientifiques, ce qui réduit le délai du rendu de la décision. Elle fait néanmoins l’objet d’un avis du Conseil d’orientation qui vérifie les conditions dans lesquelles la lignée a été obtenue et le respect des principes éthiques. Ne sont pas soumises à examen les demandes d’importation portant sur des lignées ayant reçu précédemment des autorisations dans le cadre desquelles leurs conditions de production ont déjà été vérifiées.
L’ABM suggère en conséquence que les conditions d’autorisation des protocoles de recherches recourant à des lignées de cellules souches bien identifiées soient assouplies. Par exemple, de tels protocoles pourraient être dispensés de l’avis rendu par le conseil d’orientation et faire l’objet d’une expertise scientifique dans le cadre d’une procédure accélérée. Une simplification d’une portée pratique plus grande pour les chercheurs consisterait à n’imposer, dans ce cas précis, qu’un régime déclaratif.
De tels aménagements supposent qu’une différence soit établie entre des recherches au cours desquelles des embryons sont détruits – soit pour mener des investigations sur l’embryon lui-même soit pour y prélever des cellules afin de créer une lignée – et des recherches qui utilisent a posteriori les produits de la destruction d’un embryon, destruction qui peut être intervenue plusieurs années auparavant – le matériel cellulaire ayant proliféré entre temps.
Le Conseil d’État ne reconnaît cependant pas de pertinence à une telle distinction, du fait que la mise à disposition d’une cellule embryonnaire suppose toujours la destruction intentionnelle d’un embryon. Toutes les activités de recherche impliquant une atteinte à l’embryon sont à considérer de manière identique et doivent relever du même régime, même si, comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris (723), une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne constitue pas une recherche sur l’embryon.
Si l’on peut comprendre la demande des chercheurs, il n’en reste pas moins qu’exclure les recherches faites sur les lignées de cellules souches embryonnaires du régime de contrôle auxquelles sont soumises les recherches sur les embryons reviendrait à introduire des degrés variables d’exigence éthique peu compatibles avec la nature même de l’éthique. A partir de quand, par exemple, estimera-t-on qu’une lignée de cellules souches est « bien établie » ? La démarche de contrôle fixée dans la loi de 2004 doit conserver sa cohérence. Il ne paraît par conséquent pas opportun de procéder aux distinctions suggérées sur ce point par l’ABM.
2. Les cellules souches différenciées sont-elles encore des cellules embryonnaires ?
Les dispositions législatives relatives aux recherches sur les cellules embryonnaires ne sont pas exemptes d’imprécisions dans la définition de l’objet sur lequel doivent porter les contrôles. En témoigne le recours à une terminologie relativement flottante dans la loi, où il est question de cellules embryonnaires, de cellules souches embryonnaires ou de tissus. Que convient-il d’entendre par cellule embryonnaire ? S’agit-il de toute cellule issue de l’embryon même après différenciation ou de toute cellule dans l’état de pluripotence qui est le sien au moment où elle est prélevée sur le blastocyste ? Jusqu’à quel degré de différenciation des cellules les exigences posées par la loi sont-elles requises ?
La recherche sur les cellules embryonnaires passe par différentes étapes. Ce ne sont naturellement pas les mêmes équipes qui sont engagées au départ dans la recherche fondamentale puis dans la recherche clinique sur des thérapies cellulaires. L’objet de l’étude se modifie aussi d’une étape à une autre : d’abord en quantité, les quelques cellules initiales étant multipliées en un très grand nombre, puis en qualité, les cellules étant orientées vers l’état de précurseur de cellules spécifiques à tel ou tel tissu.
Préciser le niveau de développement de spécification cellulaire à partir duquel le régime d’autorisation de recherche propre au domaine des cellules embryonnaires ne trouve plus à s’appliquer soulève un problème technique.
Le processus de différenciation cellulaire est en effet induit sur des milieux de culture comprenant un très grand nombre de cellules parmi lesquelles certaines peuvent ne pas s’être engagées dans le processus de différenciation et demeurer dans leur état de pluripotence. Se pose alors la question de la traçabilité de ces cellules, lorsqu’une lignée de cellules dérivées par une équipe de chercheurs dans le cadre d’un protocole autorisé par l’ABM est transmise à une équipe spécialisée sur tel ou tel type de cellules dont les travaux se font dans le cadre ordinaire de la recherche biomédicale.
En l’absence de dispositions législatives particulières, le Conseil d’orientation de l’ABM a proposé dans une délibération en date du 9 novembre 2007 que soit respectée par les équipes de chercheurs concernées une série de conditions :
Est proposé « en premier lieu que les responsables des protocoles de recherche sur les cellules souches issues d’embryons surnuméraires et autorisés par l’Agence de la biomédecine, puissent transmettre des composants cellulaires produits de ces CSEh (ADN, ARN, protéines, etc.) à d’autres équipes, à la condition que l’Agence de la biomédecine soit informée de façon anticipée de ce transfert.
Le conseil d’orientation propose en second lieu que ces mêmes responsables puissent transmettre des cellules différenciées dérivées de CSEh à d’autres équipes, si les conditions suivantes sont respectées :
1) que le responsable du projet autorisé :
– déclare de façon anticipée à l’Agence de la biomédecine le transfert des cellules différenciées et assure la traçabilité du produit,
– montre l’absence de cellules souches indifférenciées résiduelles,
– conserve un échantillon des cellules transférées,
– rédige un contrat de collaboration ponctuelle avec l’équipe collaboratrice, décrivant ce qu’il attend de la collaboration recherchée et comprenant la description des techniques de culture qui seront utilisées comme la garantie de l’absence de culture permettant l’amplification de CSEh indifférenciées.
2) que l’équipe collaboratrice s’engage à :
– respecter les termes de ce contrat de collaboration passé avec le responsable du projet,
– transmettre au responsable l’ensemble des expériences réalisées (procédures et résultats), afin qu’elles soient présentes dans le cahier de suivi,
– restituer aux chercheurs autorisés, les cellules restantes une fois la collaboration terminée.
Par cette procédure, comme l’explique Mme Carine Camby, ancienne directrice générale de l’ABM, « l’Agence a opté pour une solution consistant à placer les équipes hors du régime d’autorisation si elles apportaient la preuve que les cellules étaient totalement différenciées et qu’il n’y avait plus de cellules souches embryonnaires dans les milieux de culture. » (724)
Qu’une cellule pluripotente issue d’un milieu de culture n’ait pas d’équivalent in vivo autre que des cellules contenues dans un embryon justifie le fait qu’on ne saurait créer un régime de contrôle différent pour les recherches utilisant des lignées de cellules souches embryonnaires de celles portant sur l’embryon. Substantiellement, il s’agit de la même entité qui fait l’objet de recherches différentes. Mais la cellule une fois différenciée n’a plus les propriétés d’une cellule embryonnaire ; elle est identique à toute cellule souche présente in vivo dans un tissu. Le même régime de contrôle n’a pas lieu alors d’être mis en œuvre et des dispositions permettant de faire passer le matériel biologique d’un régime à un autre sont nécessaires.
Si le détail de la procédure proposée par l’ABM relève du niveau réglementaire, une base légale est nécessaire. Il pourrait donc être suggéré que dans la prochaine loi de bioéthique une disposition précise que les conditions de cession des cellules embryonnaires après différenciation soient définies par décret en Conseil d’État.
Proposition n° 46. Préciser les conditions de transfert entre équipes de chercheurs des cellules dérivées des cellules embryonnaires, une fois celles-ci différenciées.
3. De quel régime d’autorisation relèvent les essais cliniques de thérapies cellulaires réalisés à partir de cellules embryonnaires différenciées ?
Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de constater que la loi de 2004 s’est attachée à poser comme critère pivot l’existence d’une finalité thérapeutique pour toutes les recherches autorisées sur l’embryon mais que le dispositif adopté n’a pas clairement réglé le cadre légal et réglementaire des essais cliniques auxquels ces recherches ont vocation à conduire. Là aussi, la question est rendue confuse du fait des difficultés à caractériser les limites du cadre de contrôle de l’ABM.
La première demande d’autorisation d’essai clinique pour une thérapie cellulaire portant sur le tissu cardiaque a été de fait confrontée à un vide juridique. M. Michel Pucéat (725) a ainsi décrit, dans un entretien dans une revue médicale, les difficultés rencontrées :
« Quelles sont les démarches pour démarrer un essai clinique avec des cellules souches ?
Michel Pucéat. Il faut déposer un dossier à l’AFSSAPS, avec plusieurs étapes pour la thérapie cellulaire. Il y a une étape de contrôles de la sécurité, du point de vue des micro-organismes, de la population cellulaire que l’on va transplanter. Nous devons également faire la preuve que la population est extrêmement sécurisée, sans aucune chance de se mettre à proliférer de façon anarchique au sein du tissu, ici le myocarde, dans lequel les cellules vont être injectées.
Quels seront les obstacles à cet essai ?
M. P. Les obstacles sont assez confus, par le fait de notre loi de bioéthique, qui nous autorise sous dérogation à faire des recherches sur des cellules souches embryonnaires humaines, à condition que cette recherche ait une vocation pré-clinique, ciblée vers des pathologies. Néanmoins, suivant les juristes auxquels on s’adresse, elle reste relativement floue sur l’autorisation de faire un essai clinique avec ces cellules. Ce qui est complexe, c’est qu’il y a trois parties dans le circuit : l’Agence de biomédecine, qui régule l’utilisation des cellules souches embryonnaires, l’AFSSAPS qui donne les autorisations d’essais cliniques et le ministère de la Santé. L’Agence de biomédecine dit oui, la loi est d’accord. L’AFFSAPS dit qu’elle validera le dossier mais ne donnera pas l’autorisation car ce n’est pas leur fonction puisque le sujet a une autre composante que la simple sécurité sanitaire. C’est probablement une décision qui ne pourra pas être prise par une des trois institutions et qui viendra sans doute de plus haut que le ministère de la Santé. » (726)
Le Professeur Philippe Menasché a expliqué devant la mission parlementaire qu’il lui avait fallu « six mois pour obtenir un courrier conjoint de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine et du directeur général de l’AFSSAPS indiquant que la loi n’interdisait pas les essais cliniques, et donc le dépôt d’une demande… » (727)
Certes, l’article L. 1243-5 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées les recherches portant sur les thérapies cellulaires. « Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l’objet d’une autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques et après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Mais, en l’état des textes, ce dispositif ne s’applique pas aux préparations de thérapie cellulaire issues de l’utilisation de cellules embryonnaires, le statut encadrant l’usage de celles-ci relevant des seules dispositions des articles L. 2151-1 à L. 2151-8 du même code relatives aux recherches sur l’embryon. Mme Carine Camby a souligné que la solution consistant à faire sortir les cellules différenciées du régime des cellules souches embryonnaires « emporte une autre [difficulté], non sécurisée sur le plan juridique, qui consiste à considérer que l’AFSSAPS est autorisée à délivrer des autorisations de recherche biomédicale sur ces cellules. » (728)
Il pourrait être proposé, comme le suggère l’ABM, de définir un régime d’autorisation pour ce type d’essai identique à celui régissant les autres protocoles de recherche biomédicale avec produits de thérapie cellulaire. L’AFSSAPS délivrerait en conséquence les autorisations de recherche.
Les protocoles feraient néanmoins l’objet d’un avis de l’ABM. Celle-ci suggère que cet avis porte en particulier :
– sur les aspects éthiques de l’origine de ces cellules : législation du pays de dérivation (si hors de France), forme du consentement recueilli auprès du couple donneur, type de mise à disposition de ces cellules…
– sur les aspects techniques de l’utilisation des lignées initiales et de la méthode de différenciation : qualité initiale de la lignée, protocoles de différenciation, purification des cellules obtenues (notion d’absence de cellules indifférenciées dans le produit final). (729)
La collaboration des deux agences devra être particulièrement étroite au vu des risques de développement tumoral que présentent ces essais. En ce sens, la suspension des autorisations délivrées aux États Unis à Geron Corporation au cours de l’été 2009 rappelle à la prudence.
Proposition n° 47. Préciser le régime d’autorisation dont relèvent les essais cliniques de thérapies cellulaires réalisés à partir de cellules embryonnaires différenciées.
4. Le consentement à un don d’embryons au bénéfice de la recherche est-il suffisamment éclairé ?
La recherche sur les cellules embryonnaires présente la particularité de ne pas conduire seulement à un progrès des connaissances ou à la mise au point de procédés thérapeutiques nouveaux. Elle amène le chercheur à cultiver ces cellules, à les différencier et à les utiliser dans la perspective de régénérer des tissus. Les cellules embryonnaires sont utilisées comme source de production d’une biomasse à usage multiple.
Il est moins que certain que les couples consentant au don aient une connaissance claire de l’usage des cellules extraites de l’embryon. Les exemplaires de formulaire de consentement portés à la connaissance de votre rapporteur ne fournissent aucune information sur la nature des recherches dont font l’objet les embryons (730). Si la différenciation de ces cellules en cellules du cœur ou en neurones au bénéfice de malades ne devrait pas susciter de réticences, encore faudrait-il que le couple donneur en soit informé. Surtout, la maîtrise technique d’une différenciation des cellules en cellules germinales sera peut-être acquise à moyen terme (731). Le contenu du consentement du couple inclut-il aussi cette possibilité-là qui rendrait envisageable une utilisation de ces cellules dans un but procréatif ?
L’avis citoyen du panel de Marseille a insisté sur la nécessité qu’une « information approfondie soit dispensée au couple. » (732)
Le formulaire de consentement des couples donneurs d’embryons devrait par conséquent présenter un degré de précision analogue à tout formulaire de dons au bénéfice d’une biobanque (733). Certes, les dons de produits du corps humain sont encadrés de conditions relevant spécifiquement du respect des droits de la personne. Dans le cas de l’embryon donné pour la recherche, le cadre légal est différent puisque l’embryon ne saurait être rattaché à la personnalité juridique de ses géniteurs. Cette différence justifie qu’on puisse concevoir certaines modalités du consentement, comme sa révocabilité abordée ci-après, de façon spécifique. Mais le don d’embryon n’en reste pas moins le don d’une entité corporelle issue du couple. Il paraît légitime que le couple soit mieux informé de l’usage qui en sera fait.
Les dispositions prévues au Royaume-Uni dans le code de bonnes pratiques pour l’utilisation des cellules souches embryonnaires encadrent précisément la nature des renseignements devant figurer dans le formulaire de consentement. Il y est notamment précisé que le couple consent à ce que les lignées de cellules dérivées des embryons qu’il donne peuvent être utilisées dans d’éventuels traitements tels que des thérapies cellulaires. Le couple est également informé que ces lignées ainsi que les procédés techniques que celles-ci auront permis de mettre au point peuvent faire l’objet de brevets et être utilisées à des fins commerciales (734).
On peut enfin s’interroger sur l’opportunité de la disposition du décret du 6 février 2006 qui prévoit que « lorsque le couple consent à la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation auprès du praticien agréé en application de l’article L. 2142-1-1 pour la pratique de la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation, il peut lui être proposé, en application de l’article L. 2141-3, de consentir dans le même temps par écrit à ce que les embryons, qui ne seraient pas susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche. » (735) Il est ainsi procédé, en un même moment, au recueil du consentement pour l’AMP et au consentement du don d’embryons pour la recherche, dans le cas où ceux-ci ne seraient pas de qualité suffisante pour être transférables. Cette disposition a été justifiée par le ministère de la santé dans les termes suivants : « revenir auprès du couple pour ce consentement, si aucun embryon n’est de qualité suffisante pour un transfert ou une conservation, paraît délicat, risque d’être mal accepté psychologiquement et d’aboutir à un refus. » (736)Mais créer des conditions de procédure telles que l’obtention d’un accord devient plus probable que celle d’un refus est peu conforme avec l’obligation d’obtenir un consentement libre et éclairé. En outre, le principal critère posé par la loi pour permettre la recherche sur l’embryon est l’absence d’un projet parental ; c’est à partir du constat de cette absence de projet, et par conséquent à l’issue de l’AMP et non au préalable, que le consentement au don peut être sollicité ; le fait que l’embryon ne soit pas en état d’être transféré, n’a pas, en tout état de cause, de portée sur cette obligation légale.
5. Limiter la portée de la révocabilité du consentement
Trop imprécis, le consentement du couple donneur est, d’un autre côté, d’une portée trop large.
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 2151-5 du code de santé publique « Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif. » Cette disposition laisse penser qu’à toutes les étapes des recherches qui peuvent être menées sur l’embryon, et en particulier à tous les stades de différenciation des cellules embryonnaires, le couple qui a consenti à donner son embryon peut retirer son consentement.
La révocabilité du consentement a été introduite par analogie avec les dispositions portant sur la recherche biomédicale. Aux termes de l’article L. 1122-1 du code de la santé publique, l’investigateur de la recherche doit informer la personne dont le consentement est sollicité pour participer à une recherche, de son droit « de refuser à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. ».
Une telle règle, selon le Conseil d’État, « peut créer des situation inextricables lorsque l’embryon a donné lieu à une dérivation de lignées de cellules souches, dont ont été prélevées des cellules qu’il n’est plus possible de distinguer au sein d’un matériau de recherche. » (737) On peut s’interroger aussi, comme le fait l’ABM (738), sur les conséquences qu’aurait un retrait de consentement lorsque des essais thérapeutiques sur des patients ont débuté.
Ces difficultés ont trouvé des solutions différentes dans les législations étrangères. Au Royaume-Uni le consentement est révocable jusqu’au début de la recherche (739). Au Canada, la limite est définie au début du processus de décongélation de l’embryon ou avant la création d’une lignée de cellules souches à partir de l’embryon (740).
Le Conseil d’État suggère de choisir comme terminus ad quem du consentement la dérivation de lignées de cellules embryonnaires.
S’il est certain qu’au stade clinique, un retrait du consentement du couple qui a donné l’embryon serait difficilement acceptable, les cellules prélevées étant alors différenciées et utilisées in vivo, il pourrait cependant être envisagé de maintenir un champ de révocabilité plus large que celui proposé par le Conseil d’État. Il s’agirait de fixer la limite de la révocabilité non pas au moment de la mise en culture des cellules embryonnaires mais à compter de la spécification des cellules cultivées, à savoir de leur orientation vers un usage clinique allant de pair avec la perte de leur pluripotence. Même multipliées en grand nombre dans un milieu de culture, les cellules pluripotentes demeurent en effet, comme il l’a été dit, substantiellement liées à l’embryon dont elles sont issues. A la différence du Conseil d’État, l’ABM ne propose d’ailleurs pas dans son rapport de fixer la limite temporelle du retrait du consentement au moment de la création des lignées et ne fait mention que du problème qui se poserait au stade des essais cliniques.
Restreindre le champ de la révocabilité du consentement tout en le laissant plus ouvert que dans les législations étrangères mentionnées se heurterait cependant à des difficultés pratiques considérables. Une même lignée pouvant faire l’objet d’amplification dans plusieurs laboratoires, un retrait de consentement risquerait d’avoir des conséquences sur une multiplicité de projets de recherche. On peut aussi se demander comment serait rendu effectif un retrait de consentement sur une lignée exportée à l’étranger.
Convient-il de fixer aussi une limite à la révocabilité du consentement dans le cas des recherches portant sur l’embryon ? Le Conseil d’État ne le propose pas. Mais se créerait alors un déséquilibre entre les équipes de recherche s’occupant de cellules embryonnaires dont les travaux ne risqueraient pas d’être arrêtés par un retrait du consentement des donateurs et les équipes se consacrant à l’étude de l’embryon dont les travaux ne bénéficieraient pas de la même garantie. En outre, un tel dispositif supposerait que le couple soit tenu informé du type précis de recherche dont les embryons qu’il a donnés font l’objet ainsi que de l’avancée de ces recherches.
Il paraîtrait plus simple de fixer un délai, par exemple de trois mois, à l’issue duquel, le couple ne pourra plus retirer son consentement, quelle que soit la nature de la recherche entreprise. Ce délai devrait être porté à la connaissance du couple dans le formulaire de consentement(741).
Ce dispositif devrait préciser le moment à partir duquel il conviendra de faire courir la révocabilité du consentement. Trois solutions sont envisageables.
La première consiste à fondre cette procédure avec celle déjà prévue selon laquelle le couple confirme son consentement trois mois après l’avoir donné. Le retrait du consentement présuppose cependant que ce dernier soit effectif, à savoir qu’il puisse intervenir à l’issue de ce premier délai. Avant ce délai, il ne s’agirait pas d’un retrait de consentement mais d’une non confirmation.
Si le point de départ est le moment où il est procédé au don, le consentement sera retiré au vu des informations d’ordre général qui auront été fournies au couple.
Si le délai court à partir du moment où l’embryon est inclus dans un projet de recherche précis, le couple se déterminera en fonction de la nature de celui-ci.
Proposition n° 48. Dans le cas où le couple accepte de donner à la recherche des embryons surnuméraires, s’assurer du caractère éclairé du consentement en l’informant de la nature des recherches projetées.
Proposition n° 49. Préciser les conditions dans lesquelles le consentement du couple ayant donné des embryons surnuméraires à la recherche peut être retiré.
6. Les problèmes éthiques posés par les cellules iPS
La vigilance éthique dont font l’objet les recherches sur les cellules embryonnaires est motivée par une double considération : la mise à disposition des cellules passe par la destruction d’embryons et les cellules extraites sont pluripotentes. Ces deux caractères sont corrélés : la pluripotence des cellules est liée à leur origine embryonnaire.
Dans le cas des cellules iPS, les cellules ne sont pas issues de la destruction d’un embryon mais sont néanmoins pluripotentes. Elles constituent une potentialité de vie provenant d’un processus de réexpression et non de la destruction d’un être potentiel. Des problèmes éthiques complexes, liés à l’utilisation des cellules iPS, se poseront si cette technique venait à faire ses preuves.
En premier lieu, comme il en va pour les cellules embryonnaires, une différenciation en divers types de cellules semble possible, en particulier, en cellules germinales. S’il s’avérait qu’une technique de lutte contre l’infertilité était ainsi disponible, quel contrôle serait exercé sur l’usage des gamètes obtenus et sur la nature des manipulations génétiques opérées ?
De plus, la multiplication des cellules iPS constitue une perpétuation biologique de fragments d’une personne existante. Les cellules pluripotentes obtenues à partir de cellules adultes de la personne sont analogues aux cellules qui étaient contenues dans l’embryon de cette même personne. Ces cellules pouvant être multipliées par prolifération en milieu de culture, des interrogations éthiques pourraient émerger sur l’identité de ces éléments, ce qui n’est pas le cas des cellules embryonnaires où l’entité qu’est l’embryon a disparu sans avoir jamais eu de personnalité. Pourrait-on par exemple imaginer que de telles lignées soient brevetées ? Qu’en est-il quand le donneur est décédé et que continuent à être cultivées des cellules quasi identiques à celles de l’embryon dont le corps du défunt est issu ?
Enfin, les déprogrammations pouvant être réalisées sur de simples cellules de peau, le prélèvement du matériel biologique est des plus simples. Il pourrait même se faire à l’insu de la personne.
Le docteur Jérôme Larghero du service des Biothérapies cellulaires et tissulaires à l’hôpital Saint-Louis a attiré l’attention sur ces questions éthiques : « Après avoir un temps pensé que la reprogrammation de cellules adultes résoudrait bien des questions éthiques, permettant notamment de se passer des cellules souches embryonnaires, d’autres problèmes sont apparus. Ainsi si n’importe quelle cellule adulte humaine peut être déprogrammée puis reprogrammée pour redevenir totipotente, alors il pourrait être envisageable de fabriquer un embryon à partir de n’importe quelle cellule prélevée sur un individu et qui lui serait identique. Sans aller jusque-là, a-t-on le droit de prélever une cellule chez une personne et de la reprogrammer, sans le consentement de cette personne ? » (742)
M. Pierre Savatier, qui dirige une équipe de chercheurs à l’institut Cellule souche et cerveau de Lyon, a pour sa part exprimé les craintes suivantes : « Premièrement, on peut craindre que des données génomiques des cellules iPS soient employées à l’insu de patients pour identifier des gènes ou des marqueurs de susceptibilité à telle ou telle pathologie. Deuxièmement, des cellules germinales obtenues à partir de cellules iPS pourraient être utilisées pour traiter des stérilités masculines ou féminines ; cette technologie constituerait un progrès notable mais risquerait de conduire à des usages socialement contestables comme la correction de gènes mutants ou l’introduction dans la lignée germinale de l’homme de gènes de résistance à des maladies. Des protections doivent être prévues pour empêcher de telles dérives. » (743)
Rappelant qu’il ne peut être atteint à la liberté de la recherche que pour des raisons exceptionnelles, comme cela a été le cas pour les recherches sur l’embryon, Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l’ABM, s’est interrogée sur la nécessité de procéder à une régulation de ce type de technique : « Doit-on intervenir chaque fois qu’une recherche est potentiellement porteuse de dérives ? Il faudrait y réfléchir à deux fois avant de faire peser de trop lourdes contraintes sur la recherche. Interdire une recherche ou la subordonner a priori à une autorisation doit demeurer exceptionnel. Il est normal en revanche de l’encadrer. » (744)
L’engagement de la recherche française en ce domaine demeurant relativement réduit par rapport aux travaux menés en particulier aux États Unis et en Asie, il ne paraît pas opportun de retarder les initiatives des chercheurs en leur imposant des procédures administratives complexes destinées à anticiper des problèmes éthiques qui, au vu des l’état des techniques, ne se posent pas encore.
Cependant, l’avancée des connaissances se fait à un rythme accéléré – 83 publications étaient consacrées à ce sujet en 2007, 230 pour le premier semestre 2009. C’est pourquoi, il conviendrait que l’ABM veille particulièrement à suivre les progrès réalisés en ce domaine et anticipe les problèmes éthiques qui risquent d’apparaître.
Cette veille ne devrait pas exclure les autres types de cellules souches susceptibles elles aussi de voir leur usage se multiplier avec les progrès techniques et d’engendrer leurs propres problématiques éthiques. On pensera, par exemple, aux conséquences d’un éventuel usage autologue des cellules souches issues du sang placentaire.
Proposition n° 50. Charger l’Agence de la biomédecine d’exercer une veille éthique portant sur les conséquences que peut avoir l’utilisation de tout type de cellules souches.
E. QUELS INTERDITS MAINTENIR ?
1. Faut-il autoriser les transferts nucléaires ?
Un noyau de cellule somatique inséré dans un ovocyte énucléé déclenche, sous certaines conditions, la formation artificielle d’un embryon. Ce processus est lié au fait que les ovocytes ont la capacité de reprogrammer le noyau d’une cellule adulte. Si le transfert nucléaire est fait entre espèces, en insérant par exemple un noyau de cellule humaine dans un ovocyte de vache, le produit est un embryon hybride cytoplasmique appelé cybride. Si le transfert est réalisé à l’intérieur de l’espèce humaine, l’embryon obtenu est un clone de l’individu qui a donné le matériel génétique.
Ces techniques de clonage sont interdites en France, que leur finalité soit thérapeutique, commerciale ou de recherche (745). Les sanctions pénales encourues sont lourdes : elles s’élèvent à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (746) pour la constitution d’embryons par clonage et entrent dans la catégorie des crimes contre l’espèce humaine punis de trente ans de réclusion criminelle et à 7 500 000 euros d’amende dans le cas d’une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée (747).
On rappellera que la Déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le clonage des êtres humains adoptée le 8 mars 2005 n’a pas été votée par la France, le texte impliquant de fait l’interdiction de toute recherche sur l’embryon. La France n’a pas non plus ratifié le protocole du 12 janvier 1998 à la convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains, mais elle l’a signé.
a) Le clonage d’embryons humains
L’intérêt que présente cette technique est qu’elle constitue un moyen d’engendrer des cellules embryonnaires sans détruire d’embryons issus d’une fécondation naturelle. Si des lignées de cellules pouvaient être dérivées selon cette méthode celles-ci seraient en outre immuno-compatibles avec le patient.
Très tôt après le vote de la loi de bioéthique de 2004, des demandes ont vu le jour pour lever certaines des interdictions posées par la législation. Une proposition de loi visant à autoriser les recherches sur le clonage thérapeutique a ainsi été déposée le 25 mai 2005 (748). L’Assemblée nationale a également reçu une pétition en faveur de l’autorisation des recherches sur le transfert nucléaire (749).
Fin 2005, la révélation de la fraude du Pr. Woo Suk Hwang, de l’université de Séoul, qui avait affirmé avoir cultivé onze lignées de cellules souches obtenues à partir d’embryons clonés et la mise à jour des conditions dans lesquelles les ovocytes nécessaires à ces expériences avaient été prélevés sur les collaboratrices du Professeur Hwang en échange de rémunération ont cependant jeté la suspicion sur ce type de recherche.
Sur le fond, deux arguments sont avancés pour maintenir l’interdiction de du clonage à fins de recherche. En premier lieu, la pénurie d’ovocytes pour réaliser des procréations médicales ne permet pas la mise à disposition en quantité suffisante de ce type de gamète au bénéfice des chercheurs. Si le clonage venait à représenter un enjeu financier important, un commerce d’ovocytes serait à redouter. Par ailleurs, les progrès dans la maîtrise des techniques de reprogrammation cellulaire font perdre beaucoup des avantages dont cette voie se réclame. Mme Jacqueline Mandelbaum, chef du service d’histologie et de biologie de la reproduction et responsable du CECOS de l’hôpital Tenon, membre du CCNE, a ainsi pu constater que « le clonage thérapeutique – dont il fut un temps considéré comme assez réactionnaire de dire qu’il était si consommateur d’ovocytes humains qu’il ne pourrait être un outil thérapeutique qu’au prix d’une instrumentalisation des femmes – est aujourd’hui mis à l’écart par les chercheurs qui se tournent vers les cellules iPS.» (750)
Cette analyse est en particulier partagée par M. Axel Kahn qui a estimé que « le transfert de noyau nucléaire est certes intéressant sur un plan scientifique mais cette méthode n’est toutefois pas la mieux à même de créer des cellules souches à usage médical. Le clonage thérapeutique […] n’a plus grand sens – si jamais il en a eu un. » (751)
Toutefois, l’hypothèse d’une levée de l’interdiction du clonage à fins de recherche serait en cohérence avec une démarche prônant le maintien de toutes les voies envisageables de production de cellules embryonnaires. Ainsi, selon M. Marc Peschanski « L’important […] c’est que le catalogue des méthodes possibles reste ouvert, et c’est en ce sens que la loi ne devrait pas interdire le clonage thérapeutique. » (752)
L’ABM souligne que le développement des techniques de reprogrammation cellulaire a considérablement fragilisé les arguments en faveur de cette technique de transfert. Elle évoque aussi « le côté irréaliste en pratique d’une thérapeutique « patient-spécifique » dans le cadre d’une réflexion de santé publique pour l’application à des pathologies mettant en jeu un grand nombre de patients. » (753) Cette approche pourrait néanmoins conserver un intérêt « pour la compréhension du processus de reprogrammation nucléaire par les protéines ovocytaires. »
L’OPECST propose « d’autoriser sous réserve de la disponibilité des ovocytes humains, la transposition nucléaire avec un dispositif rigoureux de contrôle par l’Agence de la biomédecine et une interdiction d’implantation. » (754)
Le président de la mission, M. Alain Claeys, a estimé que cette question devait rester en débat.
Il ne paraît pas à votre rapporteur, ni à la majorité des membres de la mission, souhaitable de légaliser cette technique qui suppose l’utilisation en quantité importante d’ovocytes humains. Dans quelles conditions seraient-ils prélevés ? Quelle femme accepterait de subir une stimulation ovarienne pour une recherche dont elle ne serait pas l’immédiat bénéficiaire ? Quel impact cette utilisation d’ovocytes aurait-elle sur les dons, trop rares, effectués dans le cadre d’une AMP ? Les différentes voies de recherches existantes paraissent suffisamment prometteuses pour ne pas avoir à autoriser une technique soulevant autant de problèmes.
On peut s’interroger sur la nature juridique des hybrides cytoplasmiques humain-animal dont l’existence n’est envisagée par aucune disposition légale. Il semblerait qu’il conviendrait de les analyser comme des embryons quasi humains, même s’ils contiennent de l’ADN mitochondrial provenant d’un ovocyte d’animal et qu’à la différence des embryons issus du clonage humain, les produits de ces expériences ne peuvent pas se développer.
L’interdiction de confectionner des cybrides pourrait se déduire alors de l’interdiction de créer in vitro des embryons humains pour la recherche.
Pour les chercheurs, cette technique a l’avantage d’être une source de cellules embryonnaires n’ayant pour condition de production ni la destruction d’un embryon qui serait une personne potentielle ni l’utilisation d’ovocytes humains. Le comportement des cellules souches et le développement de certaines maladies pourraient ainsi être étudiés sans que les chercheurs soient confrontés à des dilemmes éthiques, sous réserve que le principe d’un mélange de l’humain et de l’animalité soit considéré comme acceptable.
En 2008, la constitution de cybrides a été autorisée par la HFEA au Royaume-Uni, sous condition que les entités produites soient détruites après 14 jours de développement.
En 2008, l’université de Newcastle a affirmé avoir obtenu un embryon cybride homme-animal à partir d’un ovocyte de vache. Cette entité a cependant été créée à partir d’une cellule souche embryonnaire et non d’une cellule adulte ; les avantages attendus de cette technique n’ont donc pas reçu de preuve à cette occasion.
M. Axel Kahn s’est déclaré favorable à la légalisation de cette voie de recherche en France : « Pour ma part, je ne suis pas opposé à cette technique. […]. L’embryon a une singularité qui mérite d’être respectée, mais sa sacralité n’est pas telle qu’il ne puisse faire l’objet de recherches. Les recherches sur les modalités de la reprogrammation des gènes d’une cellule somatique quelconque placée dans un environnement ovocytaire sont extrêmement importantes. Je ne suis pas choqué que l’on puisse, à cette fin, transférer une cellule humaine de peau ou de sang dans un ovocyte de vache ou de lapine. En effet, de ce protocole expérimental, ne naîtra pas un minotaure ! Ces embryons dégénèrent rapidement. À l’inverse d’un embryon cloné, ces artefacts n’ont aucune chance de donner un bébé. Pour moi, c’est un matériau expérimental, de première importance, et rien ne me semble pouvoir justifier d’interdire ces recherches. » (755)
Sans prendre position sur le fond, l’OPECST propose que cette demande soit, à tout le moins, débattue.
Mme Jacqueline Mandelbaum fait remarquer que la rapidité des progrès réalisés sur les cellules iPS conduit à une réévaluation de cette question : « Devant la difficulté de se procurer des ovocytes humains, les chercheurs anglais autorisés à se lancer dans cette aventure ont très vite demandé à créer des cybrides à partir d’ovocytes animaux. Mais à leur tour, ces cybrides ont vu leur intérêt s’effacer devant celui des cellules iPS. » (756)
Au vu de l’absence de résultats significatifs dans ce domaine en comparaison des progrès réalisés à partir des cellules iPS, considérant aussi la portée symbolique que peut avoir pour beaucoup des manipulations conduisant à confondre, même au niveau d’entités primaires, des éléments organiques humains et animaux, il n’apparaît pas souhaitable d’autoriser de telles pratiques.
2. Faut-il autoriser la création d’embryons pour la recherche ?
La création d’embryons à des fins de recherche est interdite(757). Les sanctions encourues sont celles définies à l’article 511-18 du code pénal (758).
En 2004, le législateur a tenu à circonscrire aux seuls embryons surnuméraires les possibilités de recherche afin de ne pas instrumentaliser, pour quelle que fin que ce soit, la conception d’embryon.
Cette interdiction demeure justifiée selon M. Axel Kahn : « Pour ma part, je ne suis pas favorable à la création d’embryons hors d’un projet parental, à de seules fins expérimentales, fussent-elles les plus nobles. Si on reconnaît une spécificité irréductible et une singularité indicible à l’embryon, il me semble raisonnable d’en interdire la création à d’autres fins que procréatives et de se contenter des embryons surnuméraires, déjà fort nombreux. » (759)
Une telle interdiction rend cependant impossible l’évaluation expérimentale de nouvelles techniques d’assistance médicale à la procréation.
Aussi, selon M. Axel Kahn, conviendrait-il d’assouplir le dispositif légal en aménageant des exceptions au principe de l’interdiction : « Je n’ignore toutefois pas que pour effectuer des recherches sur l’infécondité, notamment sur les moyens d’améliorer le pouvoir fécondant d’un spermatozoïde ou la fécondabilité d’un ovule, la seule manière de tester l’efficacité des techniques est de pratiquer des fécondations in vitro, en fabriquant donc des embryons n’étant pas destinés à être implantés. C’est là accepter de créer des embryons hors d’un projet parental. Le législateur devra, dans son infinie sagesse, envisager cette exception à la règle et l’Agence de la biomédecine et la jurisprudence permettre que s’applique l’esprit, et non la lettre, de la loi. » (760)
Développant l’apparent paradoxe selon lequel une exception à un principe éthique peut elle-même être éthique, Mme Jacqueline Mandelbaum s’est exprimée en faveur d’une modification législative : « Pourrais-je vous entraîner jusqu’à concevoir que créer des embryons pour la recherche peut être éthique ? Ce serait le garant que de nouvelles avancées de l’AMP – comme ce fut le cas pour l’ICSI ou pour la maturation in vitro – soient précédées, après une nécessaire expérimentation animale, par une phase d’essais cliniques chez l’humain. Cela éviterait ce que l’on peut qualifier d’expérimentation in vivo. » (761)
La technique de fécondation in vitro par micro injection d’un gamète mâle dans un ovocyte, introduite en France en 1994, a en effet été précédée d’une phase expérimentale très réduite. L’expérimentation s’est faite de facto sur les enfants nés de cette technique.
« J’aurais préféré, a précisé Mme Jacqueline Mandelbaum au sujet de cette technique, qu’on puisse analyser ses effets sur l’embryon avant de transférer celui-ci dans l’utérus, d’autant que nous disposons de plus en plus d’outils permettant d’analyser le fonctionnement embryonnaire. Dans un tel cas, c’est l’éthique elle-même, et le devoir qu’elle nous impose vis-à-vis des individus que nous allons faire naître, qui impose la création d’embryons, conformément au principe médical d’expérimentation préalable à l’utilisation d’une nouvelle technique. » (762)
La question de la création d’embryons pour l’expérimentation et celle de l’expérimentation sur des embryons destinés à être implantés (abordée ci-après dans le présent rapport) sont à mettre en regard. Le champ d’autorisation des recherches étant celui des embryons surnuméraires déjà conçus et ne pouvant pas être réimplantés, aucune recherche ne peut en effet être entreprise sur les phases de développement qui précèdent cet état (la conception) ou sur celles qui le suivent (le développement in utero). Or les techniques d’AMP ne pourront être améliorées tant que l’ensemble du continuum de la formation embryonnaire ne fera pas l’objet d’expérimentations.
L’expérimentation sur des embryons destinés à être implantés pose des interrogations éthiques majeures, l’état de santé futur d’un individu à naître étant engagé (cf. ci-après). Il n’en va cependant pas de même avec des recherches qui s’exerceraient sur la phase de la procréation dès l’instant où les embryons qui en sont issus ne seraient pas transférés in utero mais détruits en laboratoire.
Cette dernière considération constitue-t-elle une condition suffisante pour rendre acceptable la création d’embryons pour la recherche ?
La convention d’Oviedo interdit cependant cette pratique en son article 18 alinéa 2. L’admettre serait, pour votre rapporteur, franchir un seuil dans la réification utilitariste du vivant, même s’il convient de reconnaître que la demande des chercheurs est fondée au regard de leur préoccupation d’améliorer les techniques d’AMP.
3. Faut-il autoriser les recherches sur les embryons destinés à naître ?
a) Les principes qui s’y opposent
L’article L. 2151-5 du code de la santé publique pose en son dernier alinéa que « les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. » L’embryon in vitro qui fait l’objet d’un projet parental bénéficie ainsi d’une protection qui garantit son avenir en le préservant de toute intervention qui serait faite dans un but de recherche.
Des recherches biomédicales pouvant avoir des conséquences sur l’embryon ne sont autorisées que dans le cadre des dispositions relatives aux recherches sur la femme enceinte (763).
La portée de cette protection conduit-elle à interdire également les recherches portant sur les techniques d’AMP, que l’article L. 2141-1 du code de la santé publique définit comme les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ?
Selon l’argumentation retenue par le législateur en 2004, l’évaluation complète d’une nouvelle technique d’AMP ne pouvant se concevoir sans une expérimentation sur l’embryon in vitro puis sur l’embryon réimplanté in utero, l’interdiction de la création d’embryons à des fins de recherche et l’interdiction d’implanter des embryons ayant fait l’objet de recherche seraient enfreintes.
Au cours de la discussion parlementaire en 2003 au Sénat, M. Jean-François Mattei, Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s’était ainsi opposé à la proposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture d’autoriser une évaluation sur des embryons qui ne feraient pas l’objet de transfert soulignant que « l’on ne peut pas s’arrêter à l’évaluation in vitro : c’est une fausse sécurité ! » (764) M. Jean-François Mattei décrivait, quelques mois plus tard à l’Assemblée nationale, la dérive qui menaçait : « Nous irions alors vers l’essai d’implantation, puis vers l’essai de développement et, en poussant jusqu’au bout la logique, jusqu’à la naissance pour voir si les conditions de fécondation in vitro conduisent à la naissance d’un enfant normal. Essai de fécondation, essai d’implantation, de développement : de fil en aiguille, on n’en est plus à des essais sur l’homme mais à des essais d’homme ! » (765)
S’opposant à l’idée selon laquelle des incertitudes juridiques entoureraient les demandes de recherche en ce domaine, le Conseil d’État conclut que « les recherches visant à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation et impliquant la fécondation et / ou la réimplantation d’embryons doivent être considérées comme interdites depuis la loi de 2004. » (766)
En l’état actuel du droit aucune expérimentation visant à améliorer une de ces techniques n’est donc possible si sa mise en œuvre peut s’analyser comme une recherche sur l’embryon faisant l’objet d’un projet parental (767).
Serait ainsi illégale aujourd’hui l’introduction, selon un protocole d’expérimentation validé, d’une méthode de fécondation artificielle innovante telle que l’ICSI. Selon l’ABM, ces dispositions aboutissent « in fine à une qualité de soins diminuée, puisque des innovations pratiquées efficacement à l’étranger ne peuvent être testées et mises en pratiques en France. » (768) L’agence constate ainsi que le dispositif législatif actuel a pour conséquence que « l’embryon apparaît comme exclu de la recherche pour lui-même et de la recherche clinique en particulier. […] Abolir l’interdiction systématique d’implanter des embryons soumis aux « recherches » permettrait par exemple de prendre en compte les difficultés d’évaluer, en particulier en termes de sécurité, de fiabilité, voire d’efficacité, d’éventuelles nouvelles techniques en AMP. » (769)
M. Jean-Luc Bresson, chef du service de biologie du développement et de la reproduction au CHU de Besançon a exprimé des critiques analogues : « l’évaluation des nouvelles pratiques d’AMP, que la réglementation impose légitimement, suppose des essais de fécondation, et donc nécessairement des transferts in utero d’embryons issus de ces fécondations. » (770)
Cette situation a conduit à des divergences d’interprétation entre la Direction générale de la santé et l’ABM qui n’ont pas permis la publication de l’arrêté prévoyant de fixer la liste des techniques d’AMP d’effet équivalent (771). Pour l’ABM, les techniques innovantes et émergentes doivent être retenues dans cette liste « dans la mesure où elles peuvent être considérées comme de simples évolutions des techniques existantes. » (772) Pour la Direction générale de la santé, « seules les techniques ayant fait preuve de leur qualité, de leur innocuité, de leur efficacité et de leur reproductibilité peuvent figurer sur cette liste réglementaire. » (773)
b) Une évaluation des nouvelles techniques d’AMP pourrait-elle être prévue dans un nouveau cadre légal ?
La distinction études / recherches
Il pourrait être proposé d’assimiler ces techniques nouvelles d’AMP à des études ne portant pas atteinte à l’intégrité de l’embryon.
Cette distinction entre études et recherches, présente dans la loi de 1994 a été maintenue dans la loi de 2004. La rédaction de l’article L. 2151-5 lui a fait perdre cependant toute portée, les dispositions concernant les études étant toutes renvoyées à celles qui traitent des recherches (774).
Les mêmes critiques que celles formulées en 2001 envers le dispositif adopté en 1994 peuvent être reprises. Si une étude se distingue d’une recherche en ce qu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’embryon (775), la preuve de l’innocuité de l’étude ne pourra être apportée qu’après la naissance de l’enfant. « On appréciera, disait M. Axel Kahn devant la mission d’information sur la révision de lois bioéthique en 2001, le succès ou l’insuccès de l’étude à l’état du bébé qui naîtra. » (776)
Ainsi, les études sur les milieux de culture ne comportent pas de geste invasif sur l’embryon. Elles n’en sont pas pour autant anodines, comme l’expliquait en cette même occasion M. Jean-Paul Renard, directeur de recherches à l’Institut national de recherches agronomiques (INRA) : « Si des « études » par exemple l’exposition à un nouveau milieu de culture, peuvent être réalisées sur l’embryon humain, on sait aujourd’hui, avec les données chez la souris, qu’elles peuvent avoir des conséquences très importantes à long terme, non seulement sur les organismes issus des ces embryons, mais aussi peut-être sur leurs descendants ! » (777)
La distinction soins / recherches
L’OPECST suggère que « toute technique ayant pour objectif d’améliorer les possibilités de développement in utero d’un embryon devrait être considérée comme un soin et non comme une recherche. » (778)
Cette solution présenterait l’avantage de ne pas entraîner de modifications dans les principes régissant la recherche sur l’embryon.
Le Conseil d’État estime que, s’agissant de techniques déjà utilisées, leur perfectionnement « relève de ce fait tout autant de l’amélioration du soin que d’une recherche expérimentale. » (779)
Mais rattacher à un régime de soins courants les techniques d’évaluation d’AMP resserre considérablement le champ des recherches possibles. Il convient en effet de rappeler que sont entendues par soins courants, aux termes de l’article R. 1121-3 du code de la santé publique « les recherches dont l’objectif est d’évaluer des actes, combinaisons d’actes ou stratégies médicales de prévention, de diagnostic ou de traitement qui sont de pratique courante, c’est-à-dire faisant l’objet d’un consensus professionnel, dans le respect de leurs indications.
Ne relèvent pas de cette catégorie […] :
1° Les recherches qui portent sur des techniques ou des stratégies innovantes ou considérées comme obsolètes ;
2° Les recherches qui portent sur l’évaluation d’une combinaison innovante d’actes ou de produits, même si chacun de ceux-ci pris isolément est d’utilisation courante ;
3° Les recherches portant sur une comparaison de stratégies médicales, lorsque l’une de ces stratégies peut, en l’état des connaissances être considérée comme supérieure à l’autre en termes de sécurité et d’efficacité. » (780),
Considérer par principe que toute recherche sur l’amélioration des techniques de l’AMP est un soin exigerait d’admettre soit que ces techniques n’ont aucun caractère innovant, soit que le critère d’innovation technique n’a pas de sens. Dans le premier cas, on peut s’interroger sur l’utilité de mener des recherches sur des techniques non innovantes ; dans le second, il faudrait admettre que même les techniques les plus novatrices sont assimilables à des améliorations de soins.
La distinction recherche clinique / recherche fondamentale
M. Bernard Loty, adjoint à la directrice générale de l’agence de la biomédecine, a estimé que l’ensemble de ces interrogations a pour origine une confusion sur l’intention du législateur lorsque celui-ci a posé le principe de l’interdiction de recherche sur les embryons destinés à être transférés : « Concernant le fondement de l’interdiction des recherches, le problème est que le Conseil d’État ne fait pas la différence entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Il est évident qu’il faut s’abstenir de réimplanter un embryon sur lequel a porté une recherche fondamentale, et c’est ce qu’a prévu le législateur. En revanche, l’article sur lequel s’appuie le Conseil d’État ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir de recherche clinique dans le domaine de l’AMP. Il serait insensé que celle-ci soit la seule discipline à ne pas pouvoir être évaluée ! » (781)
Les débats précités sur les ambiguïtés que présente la distinction entre études et recherches rendent cependant manifeste que l’interdiction posée par le législateur est liée au souci de la protection de l’enfant à naître. Cette dernière peut être mise en danger par tout type de recherche, indépendamment de sa finalité.
Un régime de recherche biomédicale
En dépit des compétences reconnues par la loi à l’ABM dans le domaine de la reproduction, l’agence a exprimé sa préférence pour faire intervenir l’AFSSAPS dans le processus d’autorisation de recherches sur l’AMP.
Selon l’ABM, « Une solution pourrait être de considérer le transfert embryonnaire comme un domaine de la recherche clinique. Il serait ainsi soumis au régime des recherches biomédicales. Ceci serait sans doute une avancée simplificatrice car utilisant un dispositif existant sans exposer à des risques majeurs de dérive. Il serait même plus protecteur, car il prémunirait, en les maîtrisant, contre les tests sauvages (à l’étranger ou dissimulés) lors de mise au point de techniques innovantes en AMP. » (782)
Ainsi, pour répondre aux demandes des chercheurs, dont certaines portent sur les gamètes et d’autres sur les embryons, l’ABM a réfléchi à un dispositif provisoire entre elle et l’AFSSAPS : toutes les recherches biomédicales, y compris celles portant sur les tissus germinaux et les cellules reproductrices d’origine humaine, qu’ils soient ou non destinés à des fins d’assistance médicale à la procréation, relèveraient de la compétence de l’AFSSAPS; un régime particulier, incluant l’AFSSAPS et l’ABM, encadrerait les recherches sur l’embryon.
Sur ce dernier point, on remarquera que des recherches sur des gamètes réalisées afin d’améliorer des techniques d’AMP peuvent difficilement être distinguées des recherches effectuées sur l’embryon. Une technique innovante portant sur les gamètes ne s’évalue qu’au regard du développement des embryons issus de ceux-ci. Ainsi l’efficacité des procédures de congélation d’ovocytes est mesurée en fonction du nombre d’embryons obtenus et de grossesses.
De façon générale, soumettre à un régime de recherches biomédicales de droit commun les protocoles de recherche portant sur des techniques d’AMP suppose que l’interdiction de procéder à un transfert d’embryon sur lequel une recherche a été effectuée soit levée par la loi. Ce type de recherche ne saurait par conséquent être autorisé par un décret.
Ce dispositif conduirait ensuite à l’élaboration d’une fiction juridique selon laquelle un régime d’expérimentation sur la personne, en l’occurrence sur la mère destinée à recevoir l’embryon, serait étendu à un élément du corps humain détaché – puisque l’expérimentation débuterait sur l’embryon in vitro – et pouvant n’être lié à lui par aucun lien génétique (tel est le cas lorsque l’embryon in vitro est issu d’une fécondation d’un ovocyte provenant d’une donneuse).
Il impliquerait aussi des modalités de consentement très particulières. Le consentement du couple serait requis pour une expérimentation qui se prolongerait in utero.
Enfin, comment interviendra le comité de protection des personnes alors que l’expérience porte, en son début, sur le seul embryon, lequel n’est pas une personne ?
Selon le Conseil d’État, un tel dispositif ne serait pas recevable au regard de deux principes posés dans la législation adoptée en 2004 : l’interdiction de concevoir in vitro des embryons humains à fins de recherche (783) et l’interdiction de transférer à des fins de gestation des embryons sur lesquels une recherche a été conduite (784).
Un régime spécifique d’autorisation
Le Conseil d’État propose de réserver à l’Agence de la biomédecine l’instruction des demandes d’autorisation de recherches visant à améliorer les techniques d’AMP. Cette compétence s’inscrirait dans le champs d’intervention de l’ABM chargée, selon le 4° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, d’évaluer les conséquences éventuelles de l’AMP sur la santé des personnes qui y ont recours et des enfants qui en sont issus.
Le Conseil d’État suggère de créer un régime spécifique d’autorisation qui viendrait s’insérer dans la partie du code de la santé publique consacrée à l’assistance médicale à la procréation et serait rédigé comme suit :
Art. L. 2141-1-1 : Les protocoles de recherche conduits dans le cadre d’activités d’assistance médicale à la procréation et visant à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation existantes sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine. La recherche peut être autorisée si elle ne porte pas atteinte à l’embryon et après vérification de son innocuité à l’égard de la mère et du respect des principes éthiques. Préalablement à l’expression du consentement prévu par l’article L. 2141-2, les couples intéressés sont informés du caractère expérimental de la technique mise en œuvre et des risques qu’elle peut impliquer pour l’enfant à naître. (785)
Ce dispositif circonscrit son champ aux recherches portant sur les techniques existantes, s’inspirant de la distinction entre recherches portant sur des soins courants et recherches portant sur des techniques innovantes. Une partie du problème se concentre ici sur l’appréciation du caractère novateur ou non d’une technique. La différence entre une innovation apportée à une technique existante et une technique pouvant être dite nouvelle est particulièrement discutable. Jusqu’à quel degré d’innovation une technique demeure-t-elle une technique de routine ? A partir de quand entre-t-elle dans la catégorie des techniques nouvelles ?
Surtout, à suivre cette rédaction, on peut se demander sur qui porte les recherches mentionnées. Afin de contourner l’interdiction de procéder au transfert in utero d’embryons sur lesquels une recherche a été réalisée, le Conseil d’État conçoit un régime d’expérimentation sans sujet d’expérience. Il est pourtant mentionné que la recherche pourrait comporter des risques pour l’enfant à naître, sans qu’il en soit précisé le degré, à la différence des dispositions relatives aux recherches sur les femmes enceintes dans lesquelles le risque doit présenter « un caractère minimal » (786) L’innocuité de la recherche n’est exigée qu’envers la mère. Envers l’embryon la seule condition posée est qu’il ne soit pas porté atteinte à son intégrité. Un tel critère semble difficile à évaluer comme le montrent les interrogations mentionnées précédemment sur les conséquences que peuvent avoir des études sur les milieux de culture.
Ce dispositif poserait, en outre, des problèmes de cohérence. L’expérience débutée in vitro ne pourra connaître son achèvement qu’in utero, à savoir sous le régime d’une expérimentation sur femme enceinte. Que se passera-t-il, par exemple, si le comité de protection de personnes est défavorable à la poursuite de la recherche autorisée par l’ABM ?
La validation des techniques d’AMP pratiquées à l’étranger
Les techniques nouvelles d’AMP cliniquement validées à l’étranger devraient à tout le moins pouvoir être utilisées par les médecins français. Selon le Conseil d’État(787), les autorisations nécessaires pourraient être données par les autorités compétentes, notamment l’Agence de la biomédecine et l’AFSSAPS.
Il convient de remarquer que s’il s’agit d’utiliser des produits bénéficiant du marquage CE (788), cette utilisation n’a pas à être soumise à des dispositions nationales spécifiques, sauf à invoquer l’article 36 (ex-article 30) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorisant des restrictions d’importation en particulier pour des raisons de moralité publique ou d’ordre public.
On soulignera l’ambiguïté d’une situation qui autorise de tirer bénéfice de recherches faites sur l’embryon hors du territoire français mais interdit ces mêmes recherches en France.
La nature des techniques concernées
Plusieurs demandes d’autorisation d’essais cliniques portant sur les milieux de culture, les techniques de fécondation et de congélation sont en attente d’instruction par l’AFSSAPS. Par exemple :
– des projets de vitrification ovocytaire ;
– un nouveau peptide, qui serait ajouté dans un milieu de fécondation existant et qui permettrait l’augmentation des taux de fécondation ;
– des essais de comparaison des techniques de vitrification embryonnaire et des techniques de congélation lente d’embryons ;
– un projet de recherche incluant un embryon mis au contact d’un nouveau PTA « ENDOCELL » constitué à partir de cellules de l’endomètre de la femme ;
– un projet impliquant l’IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection) qui a pour but de comparer l’efficacité de la technique IMSI à la technique ICSI. L’IMSI consiste à sélectionner les spermatozoïdes utilisés en ICSI, en utilisant des microscopes plus puissants qu’en ICSI conventionnelle permettant de détecter les spermatozoïdes présentant des anomalies morphologiques, et donc à ne pas les sélectionner pour la fécondation.
L’embarras de certains spécialistes de l’AMP face aux difficultés juridiques qui leur sont opposées pour mettre en œuvre des expérimentations portant sur la vitrification des ovocytes est réel.
Au cours des auditions menées par la mission d’information, M. Pierre Boyer, biologiste au service de médecine et de biologie de la reproduction de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, a ainsi fait part de son incompréhension face aux difficultés qu’il rencontre pour recevoir une autorisation d’essai clinique. Après avoir expliqué que l’ABM avait refusé de considérer cette technique comme un simple transfert de technologie et lui avait demandé de se placer dans le cadre d’une recherche biomédicale, M. Pierre Boyer a regretté d’avoir à attendre depuis plus d’un an une réponse de l’AFSSAPS, bien que son dossier ait reçu un avis favorable du comité de protection des personnes de Marseille.
En tout état de cause, chaque recherche en attente d’autorisation paraît receler des degrés de risques très divers pour l’enfant à naître. Sous réserve d’une évaluation scientifique, il ne paraît pas que les recherches portant sur la vitrification ovocytaire ou sur les milieux de culture puissent être considérées comme étant sans effet potentiel sur l’intégrité de l’embryon.
La vitrification ovocytaire
La technique a été décrite dans les termes suivants par l’un de ses promoteurs en France, M. Pierre Boyer docteur en médecine et biologiste au service de médecine et de biologie de la reproduction de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille : « La congélation dite « lente », qui progresse d’environ 0,3 degré par minute, permet à la cellule, initialement liquide, de devenir solide après avoir atteint le point de cristallisation, marqué par la solidification de l’eau intracellulaire ; on descend ensuite jusqu’à une température de conservation égale à celle de l’azote liquide, à savoir moins 196°. La congélation « ultra-rapide » – terme sans doute plus heureux que « vitrification » – comporte une descente thermique beaucoup plus rapide ; elle aussi repose pour l’essentiel sur un phénomène essentiellement physique, même si on recourt à des cryo-protecteurs dans des concentrations plus élevées qu’en cas de congélation « lente ».
En cas de congélation « lente », la survie de l’ovocyte est compromise par la cristallisation de l’eau intracellulaire, les cristaux d’eau faisant augmenter le volume des cellules, qui cassent pour une grande partie d’entre elles. Cela explique que cette technique n’ait pas été suivie d’applications cliniques. Un ovocyte vitrifié pourra en revanche être fécondé par ICSI ; il donnera ensuite un œuf composé de quelques cellules. Celui-ci n’ayant jamais connu la cristallisation, il bénéficie d’un bien meilleur pronostic de développement qu’un embryon congelé, dont plusieurs cellules n’ont pas survécu et qui a perdu la moitié de ses chances de développement quand bien même il serait morphologiquement intact. […]Sur six ovocytes fécondés, on peut ainsi produire trois embryons dont le pronostic d’implantation est proche de 50%. » (789)
Les conséquences qu’aurait cette technique sur les pratiques d’AMP sont importantes. La fécondation in vitro n’ayant plus à être réalisée sur des ovocytes frais, seraient évitées les stimulations ovariennes à répétition ; surtout, un nombre réduit d’ovocytes serait fécondé (puisqu’en cas d’échec de l’implantation, la procédure d’AMP serait plus aisément recnouvelable) ce qui éviterait, comme l’a souligné le professeur René Frydman, « la constitution de stocks d’embryons surnuméraires. » (790)
Plusieurs études menées à l’étranger, notamment au Canada, en Espagne et en Italie, ont été mentionnées par les spécialistes auditionnés. Elles tendent à démontrer la faisabilité et l’innocuité de cette technique. Plus d’un millier d’enfants sont nés de cette technique.
La communauté scientifique n’est cependant pas unanime. Ainsi, selon Mme Hélène Letur-Konirsch, présidente du Groupe d’étude des dons d’ovocytes (GEDO, la technique « ne donne pas encore des résultats aussi concluants que ceux que nous obtenons avec des ovocytes qui ne sont pas passés par la congélation et la décongélation. » (791)
Tout en partageant ces réserves M. Jean-François Guérin, et membre du conseil d’administration et du groupe d’experts sur la recherche sur l’embryon de l’Agence de la biomédecine, se déclare cependant « favorable à ce que l’on autorise la vitrification des ovocytes et des embryons, quitte à faire le point plus tard sur cette technique. Si elle fait ses preuves, on pourrait envisager de congeler bien moins d’embryons. » (792)
Le Dr. Pierre Boyer, bien que spécialiste et promoteur de cette technique, fait remarquer qu’« Il faut toutefois être conscient que certaines dérives sont à craindre : le développement de la vitrification pourrait ainsi relancer des programmes de transfert nucléaire ou bien stimuler la demande de conservation des ovocytes dans la perspective d’une utilisation ultérieure, sans indication médicale. Il reste que nous n’en sommes pas encore là ; il s’agit, pour le moment, de réaliser une simple évaluation de cette technique. » (793)
L’AFSSAPS, en l’état du droit, n’est pas en mesure de traiter cette demande.
Un nouveau milieu de culture : Endocell
Une seconde illustration de la difficulté à appréhender la portée du caractère novateur de certaines techniques d’AMP est la mise en place d’expérimentations portant sur un nouveau milieu de culture, l’Endocell, développé par les laboratoires Genèvrier.
Après décongélation, l’embryon est transféré in utero au troisième jour de sa maturité. Au milieu de culture utilisé à cet effet, Endocell substitue un milieu de culture qui utilise des cellules de l’endomètre de la mère. L’embryon se développe in vitro 48 heures supplémentaires. Il en est alors à un développement de 5 jours au moment où il est transféré, ce qui semblerait diminuer les risques d’échec de l’implantation.
Afin de valider cette technique, des essais cliniques ont débuté en février 2008 sur une cohorte de patientes.
La procédure complexe qui a abouti à la délivrance de l’autorisation nécessaire à la réalisation de ces essais ne paraît pas avoir tenu compte de l’interdiction de procéder à des expériences sur l’embryon objet d’un projet parental. Selon les explications apportés par L’AFSSAPS à votre rapporteur, celle-ci « ne pouvait remettre en cause les droits acquis du promoteur au titre de l’autorisation individuelle dont il était devenu titulaire […]. Mais elle a adressé un courrier le 10 octobre 2008 demandant aux laboratoires Genévrier de fournir les éléments manquants dans le dossier […] ainsi qu’un descriptif détaillé de la recherche en cours (nombre de patientes incluses, nombre de femmes pour lesquelles l’embryon a été réimplanté, liste des effets indésirables et incidents, le cas échéant). Elle a également mené une inspection concernant le respect des bonnes pratiques cliniques de la recherche biomédicale en décembre 2008 et début janvier 2009 et elle reçoit les modifications substantielles du protocole d’essai clinique. »
Les recherches sur les techniques d’AMP paraissent peu conciliables avec la protection de l’embryon
Deux arguments plaident pour introduire un dispositif favorable aux techniques d’AMP innovantes. Le progrès de l’état des techniques est inévitable en soi et nécessaire au regard du taux important d’échec des grossesses par AMP. Le statu quo pénaliserait en outre la recherche française en subordonnant de facto les progrès des techniques d’AMP aux résultats de la recherche étrangère.
Cependant, la mise en place d’un dispositif qui rendrait possibles des expériences visant à améliorer les techniques d’AMP risque d’entamer la protection dont bénéficie l’embryon faisant l’objet d’un projet parental et de restreindre la portée d’un principe qui garantit que des essais sur l’homme ne puissent se transformer en « essai d’homme », selon la mise en garde de M. Jean-François Mattei. Juridiquement, il s’avère très difficile d’introduire un régime dérogatoire au dernier alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique sans remettre en cause l’interdit posé par ce dernier alinéa. De plus, les risques que se révèlent à terme des préjudices sur la santé de la mère ou de l’enfant ne sauraient être exclus et pourraient soulever immanquablement des questions de mise en jeu de la responsabilité particulièrement difficiles. Aussi est-il apparu plus sage au rapporteur de ne pas modifier le droit positif.
Néanmoins, il est clair que la situation de blocage actuelle est regrettable et qu’on ne saurait se satisfaire d’un dispositif qui figerait définitivement l’état des techniques d’AMP. Les quatre critères, de qualité, d’innocuité, d’efficacité et de reproductibilité que la DGS a rappelés dans ses discussions avec l’ABM relativement à l’établissement de la liste des techniques d’AMP d’effet équivalent, doivent constituer les conditions à remplir pour toute autorisation. Mais si ces critères excluent de valider toute technique dont le caractère innovant apparenterait son application à une expérimentation, ils ne doivent pas écarter des techniques validées scientifiquement, auxquelles des professionnels à l’étranger recourent en tant que pratiques de routine et qui ont fait l’objet d’évaluations conduisant à considérer comme acceptable, parce que minimal, le risque encouru.
L’arrêté, non encore publié, fixant les techniques d’effet équivalent devrait par conséquent être pris sur les bases posées par la DGS. Cet arrêté serait cependant amené à être complété au fur et à mesure de la conception de techniques nouvelles faisant l’objet d’un consensus des professionnels (794).
Proposition n° 51. Maintenir les interdits suivants :
– Interdire les transferts nucléaires : clonages d’embryons humains et cybrides.
Des membres de la mission estiment cependant que la question des transferts nucléaires dans un but de recherche médicale, avec interdiction d’implantation et sous réserve de la disponibilité d’ovocytes humains, doit demeurer en débat.
– Interdire la création d’embryons pour la recherche.
– Interdire la recherche sur les embryons destinés à naître mais autoriser l’introduction de nouvelles techniques d’AMP sous réserve de critères de qualité, d’innocuité, d’efficacité et de reproductibilité.
CHAPITRE 6 – LA BREVETABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
« Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. », énonce l’article 16-5 du code civil, posant ainsi le principe de non-commercialisation des éléments et produits du corps humain. Or, les brevets, qui sont des titres de propriété industrielle, « sont indispensables pour oser investir dans des projets novateurs » (795) et pour faire progresser la recherche. Il existe donc un risque de contradiction entre le principe de non-commercialisation, qui interdit l’exercice d’un droit de propriété sur le corps humain et la nécessité, pour les progrès de la recherche, d’avoir recours à ces titres de propriété intellectuelle, afin d’attirer des investisseurs.
Les règles actuelles en matière de brevetabilité des produits et éléments du corps humain tentent de répondre à ces deux exigences contradictoires. Elles ont été fixées par deux lois, la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, relative à la bioéthique et la loi n° 2004-1338 relative à la protection des inventions biotechnologiques. La plupart des règles qui ont été inscrites dans le code de la propriété intellectuelle par ces deux lois trouvent leur origine dans une directive communautaire, la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Se pose la question de savoir si ces textes parviennent à instaurer un équilibre satisfaisant entre ces deux exigences. Cette question se pose d’autant plus que les résultats de la France en matière de dépôt de brevets dans le domaine des biotechnologies sont décevants.
A. LA FRANCE DÉPOSE PEU DE BREVETS PORTANT SUR LES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Selon M. Philippe Pouletty, président de France Biotech, association française des entreprises de biotechnologies, « la France n’est pas perçue comme le pays idoine pour conduire des recherches dans le domaine des biotechnologies. Elle ne se classe que troisième en Europe, assez loin derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne. » (796) Le tableau suivant illustre le fait que la part des biotechnologies, de manière générale, ne représente que 2 % du nombre total des brevets déposés en France, alors qu’au niveau européen, ce chiffre est de plus de 6 %. Ainsi, en 2008, seuls deux brevets déposés en France portaient sur des procédés utilisant des séquences génétiques et sept sur des techniques comportant l’utilisation de cellules souches humaines. Des raisons d’ordre culturel, économique et juridique peuvent être avancées pour expliquer ce retard.
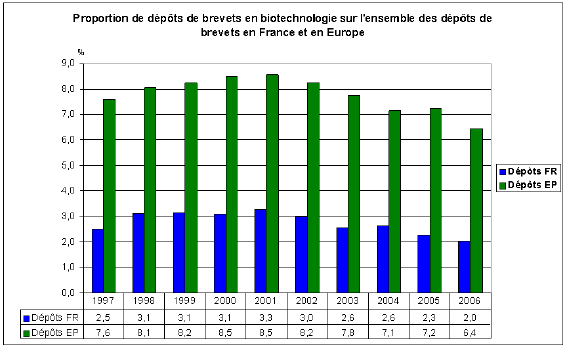
Source : Institut national de la propriété industrielle.
1. Des raisons d’ordre économique
Le tissu industriel en biotechnologies est moins dense en France que chez nos voisins européens, en terme de nombre et de taille des entreprises. Mécaniquement, il en découle un moins grand nombre de brevets déposés. Ainsi que l’a indiqué Mme Cyra Nargolwalla, trésorière de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), « sur la question du retard de la France concernant le nombre de brevets déposés, celui-ci n’est pas spécifique au domaine des biotechnologies. Il a des causes générales qui résident dans la nature du tissu industriel français et dans l’effort de recherche dans le domaine des biotechnologies. » (797)
2. Des raisons d’ordre culturel
a) Une réticence d’origine culturelle au dépôt de brevets
Tout secteur technologique confondu, la France dépose moins de demandes de brevet que ses voisins anglais ou allemand. En ce qui concerne les organismes publics de recherche, deux causes peuvent être identifiées.
D’une part, les chercheurs académiques manquent d’informations sur le sujet et certains d’entre eux pensent que le brevet pourrait constituer un frein dans la diffusion de leurs inventions, qui devraient être librement accessibles à l’ensemble de la communauté scientifique. De surcroît, le fait de déposer un brevet n’est pas perçu comme étant particulièrement valorisant au sein de la communauté scientifique. « Certains de nos chercheurs refusent parfois, dans un premier temps, de déposer un brevet sur l’une de leurs inventions afin qu’elles soient à la libre disposition de tous. Mais ils se rendent généralement compte par la suite que cette absence de brevet empêche les industriels de travailler sur leur découverte. » a expliqué Mme Christine Vanhee-Brossollet, responsable de la propriété intellectuelle à l’Institut Curie.
D’autre part, le manque d’intérêts des chercheurs académiques pour les mécanismes de propriété intellectuelle se traduit par une faible connaissance des procédures à utiliser afin de protéger leurs inventions.
Ces réticences ont pu être accentuées par la faible réactivité des organismes français de recherche. M. Philippe Pouletty a comparé leur politique en matière de dépôt de brevet à celle des universités américaines : « Les organismes de recherche français n’ont pas la culture du dépôt rapide de brevets. J’ai, pour ma part, déposé 29 brevets, dont celui qui est aujourd’hui le plus rémunérateur pour l’université de Stanford. Deux jours après que j’ai imaginé dans cette université un procédé d’amplification génique, le responsable des brevets me recevait et le brevet était déposé moins de deux semaines après ma découverte. Cette rapidité est déterminante car dès qu’un chercheur a une idée intéressante, nécessairement un de ses collègues, ailleurs de par le monde, n’est pas loin d’avoir la même. Or, en France, les organismes de recherche ont une politique plutôt restrictive. Dans la mesure où leur budget ne leur permet pas de financer toutes les demandes de brevets, ils diffèrent les dépôts, posant sous de fallacieux prétextes de nouvelles exigences, ce qui, entre-temps, fait que des brevets nous échappent. » (798)
b) Les actions entreprises pour inciter au dépôt de brevet
Pour remédier à ces difficultés, plusieurs acteurs ont engagé des actions afin de promouvoir le dépôt de brevets auprès des chercheurs. Il s’agit, d’une part, de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et, d’autre part, des organismes de recherche.
Les actions engagées par l’INPI
La formation et la sensibilisation à la propriété industrielle figurent parmi les missions de l’INPI. Celui-ci est notamment chargé de diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations selon l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le premier axe de son contrat d’objectif 2009-2012 vise ainsi, pour les utilisateurs potentiels, notamment les PME et les chercheurs, à encourager le recours à la propriété industrielle afin de favoriser la croissance par l’innovation. L’institut mène des actions de formation à la propriété industrielle, notamment au sein des écoles d’ingénieur et de l’enseignement supérieur. Il développe des partenariats avec les pôles de compétitivité et l’ensemble des réseaux qui accompagnent le développement des entreprises. Il effectue des pré-diagnostics au sein des PME innovantes, destinés à les sensibiliser à la propriété industrielle et à les orienter vers les autres acteurs de l’innovation tels qu’OSEO et les pôles de compétitivité.
L’INPI mène une action générale en faveur de l’innovation, pour inciter les inventeurs à déposer des brevets. Dans le cadre de ces missions, il peut être amené à expliquer la législation existante en matière de brevetabilité des produits et éléments du corps humain, notamment dans le cadre de la formation « protéger l’innovation biotechnologique » qu’il organise ou de cours consacrés à la valorisation des innovations biotechnologiques donnés dans des universités.
La mise en œuvre de structures de valorisation dans les organismes de recherche
Tous les grands organismes de recherche, qu’ils soient publics ou privés (tels que l’Institut Pasteur ou l’Institut Curie) ont créé des structures de valorisation de la propriété industrielle.
M. Frédéric Foubert, directeur du service Transfert de technologies de la direction de la politique industrielle au CNRS a ainsi décrit le cheminement d’un brevet, depuis le laboratoire où l’invention a été faite jusqu’à l’industriel qui exploitera l’invention : « Pour ce qui est des brevets et du licencing, nos services de partenariat et de valorisation mènent des actions de formation aux enjeux de la propriété intellectuelle dans les laboratoires. Ils sont en contact avec nos équipes de recherche pour formaliser les déclarations d’invention, première étape dans le chemin conduisant au dépôt d’un brevet. Ces déclarations sont ensuite transmises à la direction de la politique industrielle où une première évaluation est réalisée portant sur l’opportunité de breveter l’invention, qui va donner lieu au mandatement d’un cabinet de propriété intellectuelle dans un délai bref. Pour promouvoir l’accès à la propriété intellectuelle, nous sommes engagés à répondre dans des délais rapides : à réception d’une déclaration d’invention par une équipe de recherche, nous sommes engagés à prendre une décision dans les quatorze jours, afin de stimuler les équipes et de réduire les lenteurs administratives. Ensuite, nous contactons un cabinet en vue de la rédaction du brevet, l’engagement général étant d’avoir un dépôt de brevet dans les trois mois à compter de la déclaration d’invention. […]
Dès que le brevet est confirmé, voire même avant, nous mandatons notre filiale Fist pour faire un portage technologique et rechercher des entreprises qui seraient susceptibles d’être intéressées par cette technologie et entrer dans la négociation de la licence. » (799)
3. Des raisons d’ordre juridique ?
Enfin, certaines des personnes entendues par la mission ont mis en cause les dispositions législatives en vigueur, susceptibles selon elles de freiner les dépôts de brevets. Il est vrai qu’il existe des discordances non négligeables entre la directive de 1998 et la transposition qui en a été faite dans les lois de 2004. Cette différence engendrerait une insécurité juridique dommageable au dépôt de brevets. C’est ce qu’a souligné Mme Christine Vanhee-Brossollet : « Le principal problème tient à la différence entre les dispositions du code de la propriété intellectuelle et les directives appliquées par l’OEB. Ceci amène une incertitude juridique tant du point de vue de la procédure d’examen, puisque ce ne sont pas les mêmes règles de brevetabilité qui s’appliquent, que de la portée de la protection qui est délivrée. » (800)
M. Jean-Christophe Galloux, professeur du droit de la propriété intellectuelle à Paris II a, pour sa part, évoqué les risques financiers qui pouvaient découler de cette transposition de la directive : « Les transpositions non conformes génèrent des contentieux auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, engendrant d’inutiles pertes de temps et de moyens. Engager un contentieux devant la CJCE pour sauver une conception nationale peut coûter jusqu’à 200 000 euros au contribuable, et l’issue en est connue d’avance. » (801)
Il est cependant nécessaire d’étudier quelles sont les conditions de brevetabilité des éléments et produits du corps humain afin de déterminer si elles constituent actuellement un réel obstacle au dépôt de brevets en France.
B. LES CONDITIONS DE BREVETABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN SONT-ELLES LA CAUSE DE CE RETARD ?
Trois critères conditionnent la brevetabilité d’une invention ; selon l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle : « Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. »
— La nouveauté. Dans le domaine des biotechnologies, ce critère est rendu plus complexe par le fait que les inventions sont fondées pour partie sur des données naturelles (la matière biologique). Or, l’article L. 611-10, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle exclut les simples découvertes de la brevetabilité. Il est donc nécessaire de préciser le degré d’intervention humaine qui fonde la ligne de partage entre invention et découverte. La directive du 6 juillet 1998 fournit à cet égard un critère de distinction. Son article 3-2 dispose : « une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel ». Cette règle est précisée par le considérant 21 de cette même directive : « un élément isolé du corps humain ou autrement produit n’est pas exclu de la brevetabilité puisqu’il est, par exemple, le résultat de procédés techniques l’ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, techniques que seul l’être humain est capable de mettre en œuvre et que la nature est incapable d’accomplir par elle-même ».
— L’inventivité. « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. », selon l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Dans le domaine des biotechnologies, ce critère évolue rapidement. Par exemple, le séquençage d’un gène est devenu une opération routinière, qui ne présente plus de caractère inventif. L’homme du métier est entendu par l’Office européen des brevets comme une équipe composée de trois membres dont un docteur dans le domaine concerné et deux techniciens de laboratoire(802).
— La possibilité d’applications industrielles. Conformément à l’article L. 611-15 du CPI, « Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture. » Ce critère est le moins discriminant des trois.
Ces trois conditions peuvent être remplies pour des inventions impliquant des éléments ou des produits du corps humain, qui peuvent donc donner lieu à brevet dans les conditions de droit commun. Le fait qu’une invention soit issue des biotechnologies et soit fondée sur la mise en valeur d’éléments issus d’êtres vivants ne fait pas obstacle au dépôt d’un brevet, depuis que la directive du 6 juillet 1998 transposée à l’article L. 611-10, alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « sont brevetables […] les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique ». La matière biologique est elle-même définie au cinquième alinéa de ce même article : « Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. » Si les conditions de nouveauté, d’inventivité et de possibilité d’application industrielle sont réunies, une matière biologique est donc brevetable.
Néanmoins, la brevetabilité des séquences génétiques humaines et des cellules souches humaines soulève plusieurs difficultés spécifiques.
1. Les incertitudes concernant les critères de brevetabilité des séquences génétiques et des cellules souches humaines
Les règles formulées ci-dessus s’appliquent à tous les secteurs couverts par le droit de la propriété industrielle. Néanmoins le droit des brevets concernant les séquences génétiques et les cellules souches présente des spécificités.
a) La brevetabilité des séquences génétiques humaines
Il convient de distinguer la nature des inventions qui peuvent être brevetées de la portée du brevet qui est attribué à l’inventeur.
Une séquence génétique peut être brevetée si elle a une application en droit communautaire comme en droit interne
La question s’est posée, à propos des gènes, de savoir si leur découverte pouvait être brevetée en tant que telle et pour toutes leurs utilisations ultérieures. Au début des années 1990, des réactions importantes se sont fait entendre à l’encontre des tentatives de brevetage de gènes. Ainsi, le CCNE, dans son avis n° 27 (803) a mis en garde les scientifiques contre la tentation de déposer des brevets portant sur des gènes. De même, l’Office américain des brevets a rejeté en 1991 une demande de brevets portant sur 2500 gènes.
La directive du 6 juillet 1998 a traduit en droit cette interdiction de breveter des gènes en tant que tels. Dans son article 5 § 3, elle dispose que « l’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet ». La condition relative à l’application industrielle possible d’un gène n’est donc pas remplie quand une demande de brevet visant la simple découverte d’un gène est déposée. De surcroît, dans sa décision Ico du 20 juin 2001, l’OEB a indiqué que la condition d’inventivité n’était pas non plus satisfaite dans ce cas. En effet, la découverte d’un gène relève de la pratique routinière des hommes du métier. L’article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle en a tiré toutes les conséquences, en indiquant que la simple découverte d’un élément du corps humain, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peut constituer une invention brevetable.
A l’inverse, une séquence génétique est brevetable si l’invention remplit les conditions exposées ci-dessus (nouveauté, inventivité, possibilité d’applications industrielles). La condition relative à l’application industrielle est renforcée, afin d’exclure de la brevetabilité les simples découvertes de gènes. Ainsi, l’application industrielle doit-elle être clairement définie lors de la demande de brevet. La directive du 6 juillet 1998 précise cette condition dans son considérant 24 : « pour que le critère d’application industrielle soit respecté, il est nécessaire, dans le cas où une séquence ou une séquence partielle d’un gène est utilisée pour la production d’une protéine ou d’une protéine partielle, de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite ou quelle fonction elle assure ».
Le code de la propriété intellectuelle insiste également sur la nécessité de décrire l’application de l’invention sur laquelle un brevet est revendiqué, à l’article L. 611-18 : « Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par un brevet. […] [L’application] doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet. »
Aux États-Unis, la situation a longtemps été différente, puisque des brevets pouvaient être délivrés par l’office américain des brevets (USPTO) sur des séquences génétiques prises isolément, sans que l’une de leurs applications ne soit décrite. Néanmoins, ainsi que l’a expliqué Mme Christine Vanhee-Brossolet, cette époque semble révolue : « Pendant longtemps, des brevets très larges sur des gènes y ont été accordés. Mais cette époque est révolue parce que les brevets ne sont plus accordés pour ces revendications et que beaucoup de séquences ont déjà été brevetées. De manière générale, les demandes de brevet portant sur des séquences géniques ont chuté de moitié depuis le début des années 2000. Désormais, le niveau d’exigence de l’office américain rejoint celui des offices européen et japonais. » (804)
La portée des brevets portant sur une séquence génétique diffère en droit communautaire et en droit interne
Dans les deux cas (directive communautaire comme loi), les séquences génétiques, sous réserve qu’une application soit décrite, peuvent faire l’objet d’un brevet de produit. Le brevet de produit couvre la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou l’importation du produit. Il couvre donc le produit et sa commercialisation. Cette protection est détaillée par l’article 9 de la directive du 6 juillet 1998, qui dispose que « La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière […] dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. »
Selon l’article 5 de la directive, une séquence génétique peut faire l’objet d’un brevet si une application industrielle est décrite dans la demande de brevet. Néanmoins, la portée de ce brevet n’est pas précisée dans la directive. C’est donc le droit commun des brevets qui s’applique : le brevet de produit portant sur une séquence génétique couvre l’ensemble des applications qui pourront trouver leur origine dans cette séquence génétique. Si une autre application de la même séquence génétique est découverte, le nouveau brevet sera dépendant, c’est-à-dire que l’autorisation du détenteur du premier brevet devra être obtenue et qu’une redevance devra lui être versée, ainsi que l’a indiqué Mme Cyra Nargolwalla : « La revendication du premier brevet couvre bien la séquence de gènes puisque son application est contenue dans la description. La séquence est donc bien brevetable au sens de la directive. Si une autre application est découverte à partir de la même séquence, le nouveau brevet est dépendant du premier brevet. Tel est également le cas dans d’autres domaines de la propriété industrielle : si l’on découvre une nouvelle propriété pour l’aspirine, un nouveau brevet pourra être déposé pour cette nouvelle application mais il sera dans la dépendance du premier. » (805)
Comme souligné précédemment, la transposition des dispositions de la directive par la loi du 6 août 2008, à l’article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle s’est sensiblement écartée des intentions du législateur européen. Le deuxième alinéa de cet article prévoit en effet que « Cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. » Ainsi, un gène n’est pas breveté pour toutes ses applications effectives ou possibles. C’est ce que pose également l’article L. 613-2-1 du code de la propriété intellectuelle: « La portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l’article L. 611-18 et qu’elle expose une autre application particulière de cette séquence. » Les mêmes séquences peuvent donc faire l’objet de brevets différents et indépendants les uns des autres. En choisissant cette rédaction le législateur a exprimé sa volonté de faire obstacle à la création de rentes de situation.
Dans les deux cas, le dépôt d’un brevet de produit sur une séquence génétique est possible. Cependant, leur portée varie.
DIFFÉRENCES ENTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT INTERNE CONCERNANT LA BREVETABILITÉ DES SÉQUENCES GÉNÉTIQUES
Droit communautaire |
Droit national |
Un brevet de produit ne peut être déposé que si une application est décrite. |
Un brevet de produit ne peut être déposé que si une application est décrite. |
Le brevet de produit couvre la séquence génétique et toutes ses applications ultérieures. |
La portée du brevet est réduite à l’application décrite. |
Pour breveter une application découverte ultérieurement, il faut avoir recours à un brevet d’application dépendant du brevet de produit initial. |
Pour breveter une application découverte ultérieurement, il sera possible de déposer un brevet indépendant du premier. |
Ainsi, en droit communautaire, le premier brevet déposé sur une séquence génétique couvre toutes ses applications ultérieures, alors qu’en droit interne, il couvre la séquence génétique et l’application décrite. Mme Cyra Nargolwalla a estimé que les règles appliquées par l’USPTO étaient désormais similaires à celles pratiquées par l’OEB : « Aux États-Unis, la jurisprudence tend également à se rapprocher de celle de l’OEB : une séquence sans application ne pourra pas être brevetée ; une séquence avec une application déterminée pourra donner lieu à un brevet de produit, qui ne protège pas uniquement l’application exposée. Pour les autres brevets portant sur cette même séquence génétique, parce qu’une nouvelle application a été découverte, la protection ne porte que sur cette nouvelle application. » (806)
b) La brevetabilité des cellules souches humaines
Conformément au droit commun des brevets tel qu’établi par l’article 3-2 de la directive, il n’existe pas d’impossibilité de principe tenant à la nature même des cellules souches qui interdirait leur brevetabilité.
La limite entre cellules souches et corps humain
L’article 5, alinéa 1 (transposé littéralement à l’article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle), qui interdit le dépôt de brevets sur « le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments » limite la brevetabilité des cellules souches. Ainsi, des cellules souches ou des lignées de cellules souches qui n’ont pas été modifiées ne sont pas brevetables. De surcroît, elles ne sauraient l’être que si la demande de brevet est accompagnée de la description de l’une de leurs applications.
L’interdiction d’utiliser un embryon humain à des fins industrielles ou commerciales
Le troisième alinéa de l’article L. 611-18 prohibe la brevetabilité des « utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ». Il reprend sur ce point l’article 6 de la directive, qui l’interdit également, sur le fondement général qu’elle constituerait une invention « dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ».
Se pose donc la question de la brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines. Celle-ci vient d’être pour partie tranchée par la grande chambre des recours de l’Office européen des brevets, dans sa décision WARF (807), qui indique, en son paragraphe 25 que « la destruction [d’embryons humains] est une étape nécessaire et essentielle de l’exploitation commerciale et industrielle de l’invention et viole ainsi l’interdiction fixée par l’article 28 de la convention sur les brevets (808). »
Selon Mme Cyra Nargolwalla, cette décision « apporte une partie de la réponse à la question de la brevetabilité des cellules souches embryonnaires en indiquant que les méthodes qui nécessitent la destruction d’un embryon humain pour obtenir des cellules souches ne sont pas brevetables. Cette décision pose donc une interdiction claire : s’il y a destruction du vivant, la brevetabilité est exclue ; sinon, les options restent ouvertes. » (809) Il est donc interdit de breveter des cellules souches humaines qui seraient obtenues par destruction d’un embryon. En revanche, si elles pouvaient être obtenues d’une autre manière, leur brevetabilité n’est pas exclue par la décision. Cependant, les chercheurs semblent connaître des difficultés pour déposer des brevets sur des procédés impliquant des cellules souches embryonnaires humaines, ainsi que l’a indiqué M. Marc Pechanski : « On ne peut déposer à l’Office européen des brevets aucun brevet portant, de quelque manière, sur les cellules souches embryonnaires, leur utilisation, leur développement ou leur production. Ainsi, nous avons été « retoqués » lorsque nous avons déposé un brevet portant sur un bioréacteur permettant de produire ces cellules de manière industrielle – mais le même brevet a été validé aux États-Unis… Cette question est très grave. Au cours des dix-huit derniers mois, nous avons déposé auprès de l’Office européen sept brevets, qui portent sur des applications technologiques, des protocoles de différenciation et l’utilité fonctionnelle des cellules souches embryonnaires ; nous savions qu’ils ne seraient pas validés, mais nous l’avons fait pour garantir notre antériorité… et, dans le même temps, nous déposons les mêmes brevets aux États-Unis. » (810)
Les autres types de cellules souches, qu’elles soient humaines ou non humaines, ne semblent pas poser de difficultés particulières au regard de leur brevetabilité, ainsi que l’a indiqué Mme Christine Vanhee-Brossolet, selon laquelle « le site Internet de l’OEB semble indiquer que des cellules souches non humaines sont brevetables, de même que des cellules foetales, issues par exemple de sang de cordon. » (811)
En droit interne, un jugement du tribunal administratif de Paris de 2003, confirmé en appel le 9 mai 2005 (812), a établi que « les cellules souches d’origine embryonnaire ne sont pas des embryons ». La cour d’appel a également soutenu que « les cellules souches pluripotentes prélevées sur des embryons humains au stade du blastocyste ne constituent pas l’embryon et sont insusceptibles de permettre le développement d’un embryon ». Cependant, la directive européenne n’était pas encore applicable à l’espèce. La solution retenue serait donc très certainement différente aujourd’hui.
Aux États-Unis, en revanche, la brevetabilité des cellules souches embryonnaires est largement admise : « La situation est effectivement assez différente aux État Unis, où l’on a tendance à penser que l’on peut breveter tout ce qui existe : anything under the sun made by man est brevetable. Ce principe très libéral reste effectif aux États-Unis » (813) a expliqué Mme Cyra Nargolwalla.
Selon le site Internet de l’office britannique (UK Patent office), cet office délivre des brevets portant sur des cellules souches humaines. En ce qui concerne les cellules souches embryonnaires humaines, il refuse de délivrer des brevets sur des procédés d’obtention de telles cellules souches, considérés comme des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles et commerciales, ainsi que sur des cellules souches totipotentes, en ce qu’elles peuvent conduire au développement d’un être humain complet. En revanche, l’office accepte de délivrer des brevets sur des cellules souches pluripotentes (cellules souches embryonnaires qui ne peuvent produire un organisme entier).
2. Des dispositifs visant à garantir l’intérêt général
L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle établit qu’un brevet « confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » valable 20 ans. Deux dispositifs limitent cependant les droits que confère normalement un brevet sur une invention : l’exception pour la recherche et le mécanisme de la licence d’office. A ce titre, ils sont potentiellement susceptibles de décourager le dépôt de brevet, dans la mesure où ils constituent des limitations possibles des droits de propriété qui en découlent.
a) L’exception pour la recherche, un mécanisme satisfaisant
Selon l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas « aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention. » La recherche académique demeure donc possible y compris si elle implique l’utilisation de produits, de procédés ou d’applications tombant sous le coup d’un brevet.
Cette disposition ne semble pas poser de difficulté particulière. Comme l’a indiqué Mme Frédérique Faivre Petit, membre de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, a indiqué : « Dans l’exercice de notre activité, nous ne voyons pas de contentieux reposant sur ce fondement. Cette disposition semble donc être satisfaisante. » (814)
Les représentants des organismes de recherche n’ont pas non plus formulé de critique à l’égard de ce dispositif. Mme Christine Vanhee-Brossolet a fait valoir qu’en ce qui concerne l’Institut Curie : « Toutes les recherches qui sont réalisées dans nos laboratoires entrent dans le cadre de l’exception de recherche telle qu’elle existe aujourd’hui. » (815) M. Frédéric Foubert a développé le même point de vue pour le CNRS : « Pour nous, l’exception de recherche telle qu’elle existe en France nous convient. Elle couvre l’essentiel des activités de nos laboratoires. » (816)
b) La licence d’office, un dispositif inusité
Un brevet constituant un titre de propriété sur une invention, son titulaire peut également s’en servir en empêchant ses concurrents d’accéder à l’invention brevetée. Ce danger a été souligné par Mme Christine Vanhee-Brossolet : « Certains industriels cherchent à créer le portefeuille de brevets le plus large possible non pour l’exploiter mais pour gêner leurs concurrents et les empêcher de mettre un produit concurrent sur le marché. C’est une dérive du système. » (817)
Pour tenter de remédier à cette difficulté, en cas de non exploitation du brevet trois ans après sa délivrance, une licence obligatoire peut être délivrée en vertu de l’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle. De même, si une invention nécessite pour être exploitée industriellement de posséder une licence sur un brevet, le tribunal de grande instance peut accorder une licence d’exploitation obligatoire du brevet antérieur (art. L. 613-15, alinéa 4).
Il existe également des licences d’office, visant à satisfaire l’intérêt général lié notamment à la santé publique (art. L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle). Si dans la majorité des cas, les détenteurs de brevet, face à la menace que constitue cette disposition, se conforment à l’intérêt général, le droit des brevets peut parfois entrer en conflit avec ce dernier. C’est ce qu’illustre l’affaire « Myriad genetics ».
Cette société a reçu de l’OEB un brevet portant sur des tests génétiques permettant de détecter les prédispositions au cancer du sein. Ils portaient sur le gène BRCA1. La société vendait ces tests à un prix élevé et refusait de délivrer des licences d’exploitation. L’Institut Curie et l’AP-HP ont contesté ce monopole devant la division d’opposition de l’OEB, qui a donné raison aux opposants en 2004. Néanmoins en novembre 2008, deux autres brevets ont été confirmés au profit de Myriad genetics. Ils couvrent l’utilisation de la séquence du gène à des fins de diagnostic, quelle que soit la technique utilisée. Ils portent sur la moitié des mutations génétiques prédisposant au cancer du sein ou des ovaires.
Pour mieux prendre en compte l’intérêt général, la possibilité de délivrer des licences d’office a été élargie en 2004. Elle figure à l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit cette possibilité quand la mise à la disposition du public est faite « en quantité et qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés ».
Néanmoins, le dispositif de la licence d’office n’a jamais été mis en œuvre. Le ministère de la santé a menacé d’y avoir recours à deux reprises : lorsque la société qui fabriquait la RU 486 ou "pilule abortive", a annoncé son retrait du marché à la fin des années 80 et en 2004 quand une épidémie de grippe aviaire était redoutée et que les quantités d’antibiotiques disponibles n’étaient pas suffisantes. Ce dispositif n’est donc pas de nature à décourager les investisseurs.
Il apparaît donc que le seul élément juridique susceptible de dissuader les investisseurs de déposer des brevets réside dans la distorsion existante entre les règles communautaires, qui offrent un niveau de protection plus important, et les règles nationales. Cependant, cette différence ne semble pas avoir de conséquence majeure sur l’attractivité de la recherche biotechnologique en France pour plusieurs raisons.
On peut supposer que s’il y avait incompatibilité entre les règles nationales et les règles communautaires, un contentieux serait apparu à ce sujet. Or, tel n’est pas le cas. Toutes les personnes auditionnées travaillant dans le domaine de la propriété industrielle ont d’ailleurs souligné le fait qu’aucune décision de justice n’avait été rendue à ce sujet au niveau national. En cas de contentieux, le juge national serait tenu d’appliquer la directive communautaire(818). Dans sa décision n° 2004-498 du 29 juillet 2004, le Conseil Constitutionnel a indiqué que les dispositions de l’article 5 de la directive du 6 juillet 1998 étaient claires et inconditionnelles. Elles sont donc directement invocables par les particuliers devant le juge national. Cette interprétation a été confirmée par M. Jean-Christophe Galloux : « Notre transposition n’est pas conforme à la directive, mais cela n’a pas de conséquence puisque le droit communautaire prime sur le droit français. » (819)
De surcroît, la position de la France n’est pas isolée en Europe. « Si l’on n’acceptait pas du tout la brevetabilité des séquences génétiques en Europe, la réglementation serait pénalisante pour les chercheurs français. Mais les règles européennes et américaines se rapprochent. J’ajoute que l’Allemagne a transposé la directive de manière similaire à la France en tentant de limiter la portée d’une revendication de produit sur un gène à une utilisation spécifique de ce gène, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis. » (820) a estimé Mme Cyra Nargolwalla au cours de son audition.
Enfin, la manière dont la France a transposé la directive semble acceptable pour les autorités communautaires. Deux indices plaident en ce sens : d’une part, le fait que la Commission n’ait pas engagé d’action contre la France devant la CJCE et, d’autre part, le rapport de la Commission du 14 juillet 2005 sur l’évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique, qui ne se prononce pas sur la validité des transpositions nationales qui ont choisi, comme la France, une protection limitée. Dans ce document, la Commission admet que certaines dispositions de la directive pouvaient être lues en ce sens. Selon l’INPI, « la France a réalisé une transposition de la directive en utilisant la marge de souplesse que la Commission européenne a bien voulu admettre de considérer »(821).
La mission préconise donc de ne pas modifier les conditions actuelles de brevetabilité des éléments et produits du corps humain, rejoignant en cela tant l’analyse du Conseil d’État, qui a estimé « qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir le débat » (822) que celle de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme Valérie Pécresse, qui indiquait à la mission : « S’agissant de la brevetabilité du corps humain, aucun des acteurs de la recherche, ni du milieu académique ni du milieu industriel, ne remet en cause la transposition en droit interne de la directive européenne de 1998. Jamais, par exemple, il n’a été argué du flou de cette directive pour expliquer la faiblesse de nos investissements dans le domaine des biotechnologies. » (823)
Proposition n° 52.
Conserver en l’état la transposition en droit interne, dans les termes adoptés par le législateur en 2004, de la directive communautaire relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
CHAPITRE 7 – LES GREFFES D’ORGANES
ET DE CELLULES
L’organe se définit comme « toute partie du corps qui remplit une fonction ». Les greffes sont regroupées en trois catégories : les greffes d’organes qui visent le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, le rein et l’intestin; les greffes qui affectent les tissus comme la cornée, les os, les vaisseaux, la peau, les valves cardiaques et les greffes des cellules souches hématopoïétiques comme la moelle osseuse et le sang.
Le don d’organes recouvre les dons d’organes sur personnes décédées et les dons d’organes entre vivants, le donneur pouvant être décédé suite à un état de mort encéphalique (DDME) ou après un arrêt cardiaque (DDAC), pour reprendre la terminologie médicale la plus récente.
Si au cours du temps le champ des dons d’organes s’est étendu, la première transplantation rénale remontant à 1952 et la première greffe partielle de visage à 2005, les termes anthropologiques et sociaux de la problématique n’ont pas sensiblement varié. On constate que les évolutions de la société sur ces questions touchant à l’intimité de chaque individu supposent un effort d’information préalable très important et sont très lentes. Par ailleurs comme le rappelle le Conseil d’État, (824) tout dysfonctionnement médiatisé en la matière entraîne une chute de l’acceptation sociale du don d’organes. L’extrême sensibilité du sujet doit donc inciter le législateur à la prudence.
Parce qu’il fait appel aux notions de don et de solidarité, parce qu’il est associé à l’image d’un don de soi-même tout en intéressant la société dans son ensemble, parce qu’il renvoie à la représentation du corps après la mort, le don d’organes sur donneur décédé ne saurait se résumer à un simple dialogue entre sa famille et le personnel soignant et être ramené à une banale opération chirurgicale. Ainsi lorsqu’un donneur en état de mort encéphalique ne s’est pas opposé expressément de son vivant au don, la légitimité du don d’organe peut se poser pour l’entourage. Celui-ci considère souvent en effet que le corps du défunt a été réincorporé dans le cercle familial et n’a plus sa place dans l’espace commun qu’est l’hôpital. Cette dimension collective est encore plus évidente, lorsque la mort vécue comme l’expression de la finitude de chaque être humain est confrontée à la sphère médicale publique, c’est-à-dire en fin de compte à des choix de politique de santé.
S’agissant des donneurs vivants, les motivations individuelles du don d’organe ont été analysées depuis longtemps. Elles font appel aux valeurs d’altruisme, au sentiment d’avoir accompli un acte généreux. Naturellement ce souci de l’autre ne va pas jusqu’à effacer toute préoccupation envers soi-même. S’il se déclare prêt à donner un organe pour sauver un proche parent, le donneur hésite à mettre sa vie en danger et appréhende de mourir pendant une intervention qui n’est pas anodine. En quête d’une certaine reconnaissance, il peut par son geste, aspirer aussi à une valorisation de lui-même. Si après la transplantation, le donneur attend inconsciemment son dû, à l’inverse le don peut être vécu par le receveur comme un acte normal. (825) La dimension éventuelle d’une réparation, d’une dette, en particulier dans les rapports entre parents et enfants ne saurait être cependant occultée dans cette relation complexe entre donneur et receveur.
Avec le temps la législation relative au don d’organe s’est précisée. Elle s’efforce de concilier le principe intangible de l’inviolabilité du corps humain avec les besoins thérapeutiques. Au départ la législation a subordonné l’utilisation médicale du corps humain après la mort à une déclaration expresse dans un testament. (826) La loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 consacre la règle du consentement présumé de la personne au prélèvement d’organe, celle-ci devant faire connaître de son vivant le refus d’un tel prélèvement. Ce principe n’a jamais été remis en cause. Aux termes de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, le prélèvement d’organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur. S’agissant du prélèvement d’organes sur une personne décédée, celui-ci ne peut être réalisé qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques après que le constat de la mort ait été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette même loi de 1994 crée un registre national des refus de dons d’organes.
Le principe selon lequel le prélèvement ne peut donner lieu à une contrepartie financière a été posé par la loi du 22 décembre 1976 et rappelé par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 précitée, sous réserve d’un remboursement de frais engagés défini par voie réglementaire. (827) Cette interdiction applique au prélèvement d’organes le principe de la non patrimonialisation du corps humain affirmé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et inscrit à l’article 16-1du code civil. La neutralité financière revêt une double signification: d’une part, elle exclut la commercialisation des dons d’organes ; d’autre part, elle assure une équité dans l’accès aux soins, en ne réservant pas le don à la personne qui pourrait le rémunérer. Cette gratuité du don d’organes a reçu également un ancrage en droit international puisque la convention d’Oviedo prohibe les profits financiers pour les donneurs.
La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 consacre par ailleurs l’anonymat du donneur et du receveur. Un Établissement français des greffes voit le jour.
Les prélèvements d’organes sur une personne vivante et sur une personne décédée sont encadrés. S’agissant des prélèvements sur une personne vivante, ils ne peuvent être effectués, comme il a été rappelé précédemment, que dans l’intérêt thérapeutique du receveur, qui doit être le père, la mère, le fils ou la fille, le frère ou la sœur du donneur. Les prélèvements ne peuvent être effectués ni sur une personne mineure sauf prélèvement de moelle osseuse au bénéfice du frère ou de la sœur ni sur une personne majeure faisant l’objet d’une protection légale. S’agissant des prélèvements d’organes sur une personne décédée, ces derniers ne peuvent être entrepris qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort ait été établi, le prélèvement étant possible lorsque la personne concernée ne s’est pas opposée de son vivant à un tel prélèvement. Lorsque la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement ne peut avoir lieu que si chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal y consent expressément. Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt, exprimé soit directement de son vivant, soit par le témoignage de la famille.
Ces principes du consentement, de la neutralité financière et de l’anonymat ont été confortés par la loi du 6 août 2004. Celle-ci a par ailleurs affirmé que le prélèvement et la greffe constituaient une priorité nationale.
Le prélèvement d’organes est une activité médicale. Tous les établissements de santé, qu’ils soient ou non habilités à prélever, participent à l’activité de prélèvement d’organes et de tissus en s’intégrant aux réseaux de prélèvement. L’information des jeunes de 16 à 25 ans sur les modalités du consentement fait l’objet de dispositions particulières. Le cercle des donneurs vivants limité au père, à la mère, au fils, à la fille, au frère ou à la sœur du donneur est élargi par la loi du 6 août 2004 aux grands-parents, oncles ou tantes, cousins et cousines germaines, aux conjoints, au conjoint du père ou de la mère et à toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur. La gestion du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques est confiée à l’ABM, qui succède à l’Établissement français des greffes pour traiter des questions touchant aux greffes d’organes.
Afin de couvrir tout le champ des greffes d’organes, on traitera successivement des prélèvements d’organes sur personnes décédées en état de mort encéphalique et après arrêt cardiaque, des greffes sur donneurs vivants, des greffes de tissus composites et des greffes de cellules souches.
A. LES PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES SUR PERSONNES DÉCÉDÉES EN ÉTAT DE MORT ENCÉPHALIQUE ET APRÈS ARRÊT CARDIAQUE
Pour tenter d’appréhender de manière exhaustive la situation des prélèvements d’organes sur personnes décédées, il apparaît nécessaire de l’analyser sous trois angles: statistique, institutionnel et éthique.
1. Les données statistiques sur les prélèvements d’organes
a) Un déficit important de dons d’organes
Le rappel de données chiffrées permet de prendre la mesure de l’enjeu du don d’organes. L’Agence de la biomédecine évalue à 41 500 le nombre de patients vivant en France avec un greffon fonctionnel. Si le terme de pénurie habituellement usité pour désigner la situation française emprunte à un vocabulaire consumériste et renvoie à une période historique qui évoque les files d’attente et les cartes de rationnement, force est de constater que la France souffre d’un déficit de dons d’organes.
Plusieurs chiffres reflètent la réalité de ce déficit de prélèvements et de dons. En 2008, 4 620 greffes dont 5 % grâce à des donneurs vivants (232) et 95 % sur des personnes décédées ont été réalisées, soit un chiffre comparable à ceux des années précédentes : 4 238 en 2005, 4 428 en 2006 et 4 666 en 2007.
Sur la même période, on constate une augmentation progressive des demandes de greffes, puisque celles-ci étaient au nombre de 13 687 en 2008 contre 13 081 en 2007 et 12 492 en 2006. L’adéquation entre la demande et l’offre demeure donc faible. Elle était de 28 % en 2008.
La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 impartit au médecin qui n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, de s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille. Or on observe une légère hausse des cas où la famille est en mesure de témoigner de l’opposition du patient et une baisse parallèle des cas où la famille s’oppose sans que l’avis potentiel du défunt ne soit évoqué. Le taux d’opposition des familles était de 31 % en 2008 (30,7 %) contre 28 % en 2007, soit 977 donneurs non prélevés pour ce motif, à comparer à 889 en 2007. Ce taux d’opposition est stable depuis 10 ans, le chiffre de 2007 étant exceptionnel. Ces oppositions de type non médical signifient que chaque année environ 2 000 reins potentiellement greffables sont finalement perdus.
En 2008, 1 563 personnes ont été prélevées et 4 620 greffées. Malgré cela 218 personnes sont décédées faute de greffe, sachant qu’un donneur permet de greffer quatre personnes en moyenne.
La répartition des greffes en 2008 s’établit ainsi :
– rein : 2 937, soit 64 %
– foie : 1 011, soit 22 %
– cœur : 360, soit 8 %
– poumon : 196, soit 4 %
– cœur-poumon : 19, moins de 1 %
– pancréas : 84, soit 2 %
– intestin : 13, moins de 1 %.
Un autre paramètre est à prendre en compte, celui des délais sur les listes d’attente. Il était de 18,4 mois en 2008 pour les greffes rénales. Pour la seule greffe rénale 201 malades inscrits sur la liste d’attente sont décédés sans avoir été greffés.
c) Une comparaison entre la France et l’Espagne défavorable à la France mais qui mérite d’être relativisée
L’Espagne est le pays qui est le mieux placé pour les prélèvements avec un taux de 34,2 donneurs par million d’habitants, suivi par la Belgique – 28,1 –, les États-Unis – 26,6 – et la France – 24,6. Il est d’ailleurs de tradition d’évoquer le « modèle espagnol » lorsque l’on entreprend des comparaisons internationales. Tout comme la littérature spécialisée, l’Agence de la biomédecine reprend cette expression dans son rapport d’évaluation de la loi de 2004. En Espagne le taux d’opposition des familles représente la moitié de celui constaté en France, soit 15 % contre 30 %. L’avance prêtée à l’Espagne gagnerait toutefois à être relativisée si l’on analyse plus en détail les chiffres et si l’on intègre des facteurs financiers incitatifs.
COMPARAISON RECENSEMENT – PRÉLÈVEMENT FRANCE / ESPAGNE
2008 |
France |
Espagne |
Différence |
Recensement, nombre de donneurs pmh |
50,0 |
54.2 |
8,4% |
Prélèvement, nombre de donneurs pmh |
24.6 |
34.2 |
39,0% |
Prélèvement, nombre de donneurs dont au moins un organe prélevé sera effectivement greffé pmh |
23.4 |
29.6 |
26,5% |
Taux de greffe rénale pmh |
42.3 |
45.9 |
8,5% |
pmh : par million d’habitants
On constate au départ un recensement des donneurs en état de mort encéphalique plus exhaustif en Espagne qu’en France (+ 8,4 %). Mais il y a un écart important en Espagne entre les prélèvements et les greffes. La relativité du succès espagnol se confirme lorsque l’on rapporte le nombre de transplantations rénales au nombre d’habitants. Ce chiffre est de 45,9 en Espagne, de 42,3 en France et de 42,2 en Belgique. Le même constat peut être dressé en Espagne à propos des greffons cardiaques. Seuls 15 % des prélèvements peuvent faire l’objet d’une transplantation contre 24 % en Belgique et en France. (828) L’âge des personnes prélevées en Espagne est avancé pour expliquer ce différentiel plus important, dans la mesure où cet âge s’élève régulièrement avec le temps. Il était en effet de 54,2 ans en 2008 contre 37, 8 en 1996, alors que l’âge moyen constaté en France est de 51,9 ans. Ceci correspond à une augmentation de l’âge moyen des donneurs de 1,36 /an en Espagne et de 1,2 /an en France.
PRÉLÈVEMENTS ET GREFFES – COMPARAISON BELGIQUE, ESPAGNE, FRANCE
Belgique |
Espagne |
France | |
Population en millions d’habitants |
10,7 |
46,2 |
63,6 |
Donneurs prélevés (DDAC inclus) |
|||
nombre |
274 |
1 577 |
1 610 |
pmh |
25,7 |
34,2 |
25,3 |
Donneurs prélevés d’au moins un organe greffé (DDAC inclus) |
|||
nombre |
274 |
1 368 |
1 504 |
pmh |
25,7 |
29,6 |
23,7 |
Greffes rénales |
|||
nombre |
487 |
2 229 |
2 937 |
pmh |
45,7 |
48,3 |
46,2 |
Greffes rénales à partir de donneurs décédés (EME et DDAC) |
|||
Nombre |
442 |
2 073 |
2 715 |
pmh |
41,4 |
44,9 |
42,7 |
– EME : état de mort encéphalique
– DDAC : donneur décédé après arrêt cardiaque
– Donneurs décédés : EME + DDAC
On s’accorde à reconnaître que la création d’un réseau de coordination de prélèvement avec des professionnels formés et dédiés à l’activité de recensement et de prélèvement (« Organization national de transplantes ») est à mettre à l’actif de l’Espagne. La transplantation y a été favorisée par plusieurs facteurs. L’Espagne en a fait une priorité nationale. Elle y a affecté des moyens et a adopté des mesures qui se sont révélées adaptées. Ainsi, alors que la coordination en matière de transplantations était en général confiée à une infirmière dans les hôpitaux français, cette responsabilité a été dévolue à un médecin, parfois de rang élevé, dans les hôpitaux espagnols. Le caractère décentralisé de l’organisation espagnole, qui s’appuie sur 17 coordinations régionales et 155 équipes de coordination a permis également de disposer d’une grande visibilité locale et d’instaurer un climat de confiance dans l’opinion publique. Les personnes peuvent appeler de jour comme de nuit l’organisme national des transplantations. (829)
Les relais médiatiques ont également joué un rôle non négligeable. Des réalisateurs comme Pedro Almodovar ne sont pas pour rien dans la réussite du modèle espagnol. Ses films et de nombreuses campagnes d’information du public ont permis de lever le tabou du don dans la société espagnole.
Mais des facteurs d’ordre financier ont aussi leur part dans ce succès. En effet l’activité de transplantation peut constituer jusqu’à 70 % du total des ressources d’un coordonnateur. Il semblerait que les rémunérations spécifiques perçues par les personnels médicaux et paramédicaux participant au prélèvement soient versées collectivement au service et réparties ensuite entre ces personnels, cette forme de mutualisation étant censée éviter toute dérive. Ces pratiques pourraient expliquer les différences existantes avec la France, tout risque de conflit d’intérêts ne pouvant par ailleurs être totalement exclu. (830) Le versement d’une compensation financière pour la prise en charge des frais d’obsèques et de rapatriement du corps s’il s’agit d’un donneur étranger paraît aussi avoir été un facteur incitatif loin d’être négligeable. (831)
Si les résultats espagnols doivent être affinés et replacés dans leur contexte, on ne saurait se contenter pour autant de la situation française actuelle car les marges de progression pour la France ne sont pas négligeables.
2. Les données institutionnelles : l’organisation du système français de prélèvement d’organe sur personne décédée
Le système français présente quatre caractéristiques :
– il est fondé sur le consentement présumé des dons d’organes ;
– il repose sur une organisation du prélèvement dont on peut penser qu’elle n’est pas assez efficace ;
– la rémunération du prélèvement et de la greffe s’avère insuffisamment attractive ;
– le suivi psychologique de la famille du donneur n’est pas pris en compte.
a) Un système basé sur le consentement présumé des dons d’organes
Les pays qui ont une organisation de prélèvement d’organes se partagent en deux groupes : ceux qui ont fait le choix du consentement présumé et ceux qui ont opté pour le consentement explicite. Le consentement présumé implique qu’après sa mort, chaque personne est supposée accepter donner des éléments de son corps en vue d’une greffe si elle ne s’est pas opposée à ce don. En France, une opposition éventuelle doit se traduire par l’inscription de la personne de son vivant sur un registre national automatisé des refus de prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée. Ce registre doit être consulté avant tout prélèvement. Il comprenait 74 698 noms validés au 31 décembre 2008.
Le consentement explicite suppose que le donneur ait demandé à être donneur.
Cependant ces deux statuts reconnaissent des différences de degré dans l’expression de la volonté de la personne. Ainsi dans le consentement explicite fort (hard opt in), la famille ne peut pas révoquer la volonté de la personne. Avec le consentement explicite faible (soft opt in), la famille peut s’opposer au don si le donneur s’est inscrit comme donneur et l’accepter si celui-ci ne s’est pas inscrit comme donneur. Dans un système de consentement présumé fort (hard opt out), la famille ne peut pas refuser le don si l’individu n’a pas exprimé de refus et ne peut aller contre sa volonté s’il s’est prononcé contre le don. Enfin le consentement présumé faible (soft opt out) signifie qu’aucun prélèvement n’est réalisé si la famille le refuse(832). De fait les procédures de consentement explicite faible (soft opt-in) où l’individu s’est inscrit comme donneur mais où la famille peut refuser le don sont identiques en pratique aux procédures de consentement présumé faible comme en France (soft opt out), où aucun prélèvement n’est réalisé si la famille le refuse.
Comme l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Italie, le Portugal et la Suède, la France a fait le choix de la formule du consentement présumé. À l’inverse, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont opté pour le consentement explicite. En termes d’efficacité il n’est pas sûr toutefois que ces derniers pays enregistrent de meilleurs résultats que le premier groupe de pays, alors même que pour certains cette formule serait l’assurance d’un taux plus élevé de dons. L’Allemagne affiche en effet en 2008 4 675 transplantations tandis que 12 000 malades sont en attente de prélèvements d’organes. Au Royaume-Uni seulement 3 513 transplantations d’organes ont été effectuées entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009 et 64 % de la population serait favorable au consentement présumé. (833)
Le taux moyen de prélèvement par pmh est de 23 dans les pays ayant un consentement présumé et de 15 dans les pays ayant un consentement explicite.
COMPARAISON GREFFES RÉNALES ALLEMAGNE, FRANCE, ROYAUME-UNI
Population en millions d’habitants |
Nombre de malades greffés |
Malades en attente |
Greffes rénales pmh | |
Allemagne |
82,1 |
4 675 |
12 000 |
34,0 |
France |
63,6 |
4 620 |
13 678 |
46,1 |
Royaume-Uni |
60,1 |
3 513 |
7 877 |
33,5 |
pmh: par million d’habitants
Sources: ABM, Deutsche Stiftung Organstransplantation, National Health Service Blood and Transplant
Dans sa contribution aux États généraux de la bioéthique, l’association « Demain la greffe » relève qu’à l’inverse, en Belgique trois ans après avoir substitué au prélèvement explicite le prélèvement présumé, le taux de dons par million d’habitants a presque doublé (834) et que les pays européens s’étant prononcés pour un consentement présumé ont vu le nombre de donneurs augmenter de 16,2 %(835). Ce constat est corroboré par une étude britannique récente qui relève une très forte augmentation dans le même sens, à partir des exemples de l’Autriche et de Singapour(836). En Autriche, le taux des donneurs par pmh est passé de 4,6 à 27,2 sur une période de 5 ans, tandis qu’à Singapour le taux de donneurs de foie par pmh augmentait de 4,7 à 31, 3 sur 3 ans. Cette étude conclut que le don présumé est associé à une hausse des dons d’organes. Pour les auteurs de cette analyse, les résultats obtenus en matière de dons d’organes résultent d’une combinaison de différents facteurs, à savoir le cadre juridique applicable, la disponibilité des donneurs, l’organisation des prélèvements, l’investissement dans la politique de santé publique et l’attitude de l’opinion publique à l’égard des dons d’organes.
Il ne faut pas se dissimuler toutefois que l’option française présente deux difficultés : il convient, d’une part, de s’assurer que chaque citoyen est suffisamment informé pour s’inscrire sur le registre des refus et il est difficile, d’autre part, d’inciter chaque personne à s’exprimer sur ce sujet devant sa famille. Comme le relève un médecin réanimateur : « quand bien même il sait que la règle du consentement présumé existe, la difficulté de notre contemporain réside dans notre choix d’adhérer ou non à cette demande, choix qui oppose l’homme rationnel, correctement informé à l’homme affectif qui répugne à envisager sa mort à venir » (837)Tant qu’elle est en bonne santé la personne se préoccupe peu de l’utilisation qui pourrait être faite de son cadavre et ne porte pas sur elle un document manifestant ses volontés en ce domaine. (838) Cette remarque rejoint l’opinion de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, qui devant la mission d’information, a plaidé pour le maintien du régime actuel du consentement présumé. (839)De fait, que le consentement soit présumé ou explicite, les familles sont toujours consultées.
Par conséquent non seulement le passage d’un consentement présumé à un régime de consentement explicite serait vraisemblablement contreproductif sur le volume des prélèvements d’organes mais il ne dispenserait pas de consulter les familles car comme l’a relevé le Conseil d’État dans son rapport, il est difficile de passer outre le refus de ces dernières. (840) L’OMS remarque de son côté que les services demandent généralement l’autorisation de la famille même si la personne a donné son consentement de son vivant (841) ; en effet le consentement explicite n’est pas voué à être intangible et rien ne permet d’assurer qu’une personne porte le même regard sur le don d’organe à 20 ans et à 50 ans. Une étude espagnole montre aussi que 96 % des personnes interrogées défendent le principe de l’autorisation préalable par la famille. (842) Le médecin coordonnateur des prélèvements d’organes du groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière a fait valoir devant la mission que, dans la pratique, il ne se voyait pas ignorer l’avis de la famille. (843)
Il a été rappelé que le taux d’opposition des familles est de 30,7 % en 2008 en France, soit le double de celui constaté en Espagne. Rapporté aux résultats des enquêtes d’opinion qui font état de 82 % d’opinions favorables au don d’organes, ce taux est élevé. On observe au surplus une légère augmentation des cas où la famille est en mesure de témoigner de l’opposition du patient et une baisse parallèle des cas où la famille s’oppose sans que l’avis potentiel du défunt soit évoqué.
Cette réalité de l’opposition des familles dissimule toutefois une grande disparité régionale. En 2007, on dénombrait 37,8 oppositions pour 100 donneurs potentiels en Picardie et 11,7 oppositions pour 100 donneurs potentiels en Bourgogne. Mais cette dernière région a vu ce taux fortement augmenter en 2008 et dépasser les 37 %, tout comme la Franche-Comté – 23,8 % en 2007 puis 41,1 % en 2008. Pour le professeur Louis Puybasset, praticien au service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, on peut imaginer, qu’à la source de telles variations prévalent des facteurs, traduisant éventuellement un ressentiment ou une gratitude envers le système de soins. (844)Une autre explication peut provenir du désinvestissement d’un professionnel jusque là très impliqué dans cette activité.
Ce faible taux de consentement n’est pas en totale symbiose avec les pistes de réflexion dégagées par le jury citoyen de Strasbourg dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Les membres de ce panel ont estimé que le système en vigueur privilégiait trop le consentement présumé au détriment de l’expression d’un témoignage de solidarité et ont préconisé l’établissement d’un registre du choix où les personnes pourraient faire valoir leur décision. En voulant conjuguer ainsi l’esprit de solidarité et l’exercice des responsabilités, ils aspiraient à l’émergence d’une conscience collective en faveur du don d’organes. Il appartiendra au législateur d’évaluer cette louable ambition au regard des réalités, du risque de diminution des dons qu’une telle règle pourrait être susceptible de générer. S’agirait-il au demeurant d’un choix obligatoire peu compatible avec la liberté personnelle ou d’un choix facultatif avec un taux de réponse vraisemblablement faible ?
Il reste que le taux d’opposition des familles est élevé. C’est cette variable qui illustre d’ailleurs la différence du nombre de donneurs prélevés entre l’Espagne et la France. Une simulation d’une diminution de ce taux jusqu’à 15 % montre les gains attendus d’une diminution du taux d’opposition des familles :
IMPACT SUR LE NOMBRE DE REINS GREFFÉS ET LA PÉNURIE ISSUS DES DONNÉES 2007, DES NIVEAUX DE DIMINUTION DU TAUX D’OPPOSITION OU D’AUGMENTATION
DU NOMBRE DE DONNEURS (845)
Reins greffés |
Pénurie | |
Opposition |
||
30% |
0 |
3,7 |
25% |
264 |
3,3 |
20% |
529 |
3,1 |
15% |
793 |
2,8 |
Ainsi une diminution de 30 % à 20 % du taux d’opposition aurait permis théoriquement en 2007 de greffer 529 patients supplémentaires.
Les axes d’action
Pour infléchir cette situation deux axes d’action sont envisageables : une action orientée en particulier vers les jeunes et une action plus générale tournée vers le grand public.
Afin de sensibiliser les jeunes à cette cause, la journée d’appel de préparation à la défense qui touche 700 000 d’entre eux devrait déjà être mieux mise à profit qu’elle ne l’est actuellement. Cette journée constitue un moment exceptionnel pour toucher une population nombreuse et jeune. Le deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, introduit dans la loi de 2004 par votre rapporteur, prévoit en effet de délivrer une information sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Mais l’occasion de ce moment privilégié se limite à la diffusion d’une brochure élaborée par l’ABM. Ce document n’est malheureusement plus disponible à ce jour.
L’article R. 1211-50 du code de la santé publique impose aussi à tout médecin traitant qui suit un patient âgé de seize à vingt-cinq ans de s’assurer, à un moment qu’il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d’organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce don. Le médecin est tenu de préciser au jeune patient les sources d’information disponibles émanant de l’Agence de la biomédecine, notamment l’existence de son site Internet. Il l’invite à accéder lui-même à ce site, et, s’il l’estime souhaitable, lui remet personnellement une version imprimée des pages spécialement éditées par l’agence à destination des jeunes. Il répond, le cas échéant, aux demandes d’information complémentaire. Une même obligation pèse sur les médecins de l’éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d’enseignement supérieur (Art. R. 1211-51). Cette procédure dont il est difficile d’apprécier exactement l’application effective gagnerait à être évaluée par l’ABM.
En réalité on ne sait pas quel est l’impact de ces actions d’information. Une enquête menée par l’ABM en 2006 auprès de 1092 jeunes âgés de 16 à 25 ans a montré que si 84 % d’entre eux étaient favorables au don et 70 % prêts à donner leurs organes au moment de leur décès, ils manquaient de connaissances précises sur les modalités pratiques du don et les dispositifs en vigueur. Une campagne nationale d’information a été lancée par l’ABM en 2007 à la suite de cette enquête. Des spots radio dans le cadre d’une campagne de promotion, un site Internet et un guide pratique offrent aux jeunes les moyens de trouver des réponses aux questions qu’ils peuvent se poser en la matière. Les analyses d’opinion révèlent en réalité un déficit majeur d’informations sur les conditions du prélèvement, le respect de l’intégrité du corps ainsi que sur l’application des rites funéraires. Plus généralement cette enquête traduit l’appréhension de notre société à évoquer la mort.
En dehors de ces actions d’information ciblées à développer, on peut se demander si l’option du consentement présumé pourrait être aménagée pour favoriser les prélèvements.
Lors du débat du projet de loi relatif à la bioéthique en première lecture devant l’Assemblée nationale en 2002, l’idée avait été émise de recueillir l’avis des jeunes de dix-huit à vingt cinq ans : s’ils se déclaraient opposés au don d’organe, le refus était enregistré sur la carte vitale. Au motif qu’il aurait pour effet de remplacer le régime du consentement présumé par un régime du refus exprès et qu’il risquait par son caractère très rigoureux, de provoquer un réflexe de repli, l’amendement ne fut pas retenu. Les leçons de l’expérience brésilienne vont dans le même sens. En 1997 le recueil de l’expression du refus sur une carte d’identité fut autorisé dans ce pays mais celui-ci fut très mal perçu par l’opinion publique (846).
Il existe bien des cartes de donneurs éditées par l’ABM mais la carte de donneur n’a pas de valeur légale et ne remplace pas le dialogue avec l’entourage comme le souligne l’agence sur son site. Au mieux, la carte peut faciliter le dialogue avec les proches, mais il un parent, un enfant, un conjoint qui n’a pas été psychologiquement préparé à comprendre et accepter ce don d’organes peut mal le vivre.
Les actions d’information en la matière sont donc délicates à engager. Il apparaît clairement en revanche que le plus grand nombre de personnes possibles doivent être incitées à prendre position sur la question de leur vivant, afin de ne pas mettre leurs proches dans l’embarras le moment venu. Au surplus afin de relayer l’information de l’ABM sur les dons d’organes, celle-ci pourrait s’appuyer sur le réseau des pharmacies pour diffuser ses messages. Cette formule aurait pour avantage de rendre cette information accessible, dans un lieu tourné vers le soin.
b) Une organisation des réseaux de prélèvements d’organes insuffisamment efficace
Un recensement des donneurs potentiels encore incomplet
Le recensement des donneurs intéresse les sujets en état de mort encéphalique. Le nombre de sujets en état de mort encéphalique déclarés ou donneurs recensés à l’ABM était de 3 181 en 2008, soit un taux national de 50 donneurs recensés par million d’habitants (pmh). En intégrant la prise en compte des contre indications médicales et la probabilité ou la certitude du diagnostic médical, le taux de donneurs potentiels est estimé entre 40 et 62 pmh. L’application de cette fourchette haute permettrait d’obtenir un potentiel de 3 900 donneurs contre les 3 181 évoqués précédemment(847). Ces chiffres prennent en compte les donneurs exclus présentant des contre-indications médicales (cancers, infections par le VIH, tuberculose…). Il y a donc là une marge d’amélioration à exploiter.
Aujourd’hui cette activité de recensement des donneurs potentiels qui engage des frais n’est pas rémunérée. Cette absence d’intéressement n’est certainement pas étrangère au caractère incomplet du recensement et aux disparités régionales constatées. Il conviendrait donc d’intéresser les hôpitaux à cette activité ainsi que le Samu pour les donneurs à cœur arrêté.
Le recensement pourrait être facturé à 35 % du forfait prélèvement multiorganes (PMO) ; ce pourcentage correspond au temps requis pour les médecins et les équipes de coordination pour recenser le patient et voir la famille pendant le temps total dévolu à un prélèvement multi-organes. Ce chiffre serait cohérent avec l’objectif d’une augmentation du taux de recensement en France (cf.infra).
Proposition n° 53. Valoriser l’activité hospitalière de recensement des donneurs potentiels en état de mort encéphalique. Le recensement pourrait être facturé à 35 % du forfait prélèvement multi-organes.
Une organisation du prélèvement qui ne couvre pas encore tout le territoire
L’article R. 1233-7 du code de la santé publique définit les règles auxquelles les établissements de santé sont astreints pour être autorisés à effectuer des prélèvements d’organes :
– disposer du personnel et de l’équipement nécessaires à l’établissement du constat de la mort ;
– justifier d’une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l’exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
– désigner un médecin coordonnateur de l’activité de prélèvement après avis de l’instance médicale consultative de l’établissement et un ou le cas échéant des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ;
– disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l’exercice de l’activité de prélèvement, et au moins en service continu, d’un médecin spécialiste en anesthésiologie réanimation chirurgicale, ou d’un médecin compétent qualifié en anesthésie – réanimation ou en réanimation ou d’un médecin titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
– disposer des locaux nécessaires à l’exercice de cette activité et au moins d’un local adapté à l’accueil de familles, d’une zone permettant l’isolement des donneurs et facilement accessible aux familles ainsi que d’une salle d’opération pour la réalisation de l’explantation d’organes.
L’organisation et la gestion des greffes ainsi que le manque d’organes ont imposé d’établir une liste nationale d’attente qui permet d’enregistrer les candidats à la greffe et d’élaborer des règles de répartition et d’attribution des greffons prélevés sur personnes décédées. Un arrêté du 6 novembre 1996 modifié le 31 mars 2009 a défini ces règles de répartition avec une hiérarchie d’attributions. Une proposition prioritaire de greffon peut être faite successivement au profit des receveurs suivants: ceux dont la vie est menacée à très court terme; ceux pour lesquels la probabilité d’obtenir un greffon est très faible et enfin les enfants. Une base de données informatisée permet à l’ABM de gérer 24 heures sur 24 la liste d’attente et d’attribuer les greffons.
L’attribution prioritaire des greffons répond à des conditions d’urgence vitale ou à des difficultés particulières d’accès à la greffe si l’on songe par exemple à des groupes sanguins rares ou aux enfants. On observe pour la greffe cardiaque une augmentation constante des greffes appliquées à des malades en situation d’urgence vitale avant le stade de l’assistance circulatoire mécanique. L’ABM explique cette augmentation par l’inscription sur la liste d’attente des candidats à la greffe de candidats ayant un état de santé de plus en plus sévère.
En l’absence de receveurs prioritaires, l’attribution se fait par échelons géographiques successifs : local, interrégional, national et international selon les règles spécifiques applicables à chaque organe. Le territoire est divisé en sept zones interrégionales de prélèvement et de répartition des greffons. L’équipe médicochirurgicale est toujours en droit de refuser une proposition de greffon si l’appariement entre le donneur et le receveur est insuffisant, si la qualité du greffon n’est pas bonne ou pour des raisons logistiques.
On constate cependant de fortes inégalités territoriales dans le recensement des donneurs et le prélèvement.
DE FORTES INÉGALITÉS TERRITORIALES DANS LE RECENSEMENT DES DONNEURS
ET LE PRÉLÈVEMENT
Zones interrégionales de prélèvement et de répartition 2008 |
Recensés pmh |
Prélevés pmh |
Nord-Ouest |
46.9 |
26.1 |
Est |
48.7 |
20.1 |
Sud-Est (+ La Réunion) |
50.3 |
23,0 |
Sud-Méditerranée |
50.3 |
24.5 |
Sud-Ouest |
45.3 |
25.8 |
Ouest |
61.2 |
32.3 |
Île-de-France |
44,0 |
19.9 |
L’écart entre la région la moins active (Île-de-France) et la plus active (Ouest) est de 40 % pour le recensement et de 61 % pour le prélèvement. Autant on peut comprendre des différences régionales s’agissant du prélèvement lié aux différences socio-culturelles de la population, autant on doit reconnaître que le taux de recensement est lié à l’incidence des maladies et devrait être très proche d’une région à l’autre.
Dans la zone interrégionale de prélèvement et de répartition des greffons (ZIPR) du sud-ouest, qui recouvre 16 départements, il n’existe que 4 centres de prélèvements. 5 départements restent sans établissement autorisé : Alpes-de-Haute-Provence, Creuse, Haute-Marne, Haute-Saône et Lozère. La Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux observe dans sa contribution aux États généraux de la bioéthique que certains départements ont des centres autorisés mais ne recensent aucun donneur potentiel et donc ne prélèvent pas. Ainsi en 2008, 7 départements ayant au moins un établissement autorisé n’ont eu aucune activité de prélèvement: le Jura, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Meuse, la Nièvre et les Vosges. De leur côté, des centres autorisés disposant d’équivalents temps plein dédiés au prélèvement n’ont aucune activité de recensement et de prélèvement. Enfin, certains établissements recensent peu de morts encéphaliques alors qu’ils ont un potentiel élevé. On dénombrait en 2008, 74 personnes en état de mort encéphalique prélevées à Lille mais 6 au Havre, 44 à Nancy contre 21 à Reims et 1 à Metz, 1 à Ajaccio, 1 à Bastia et 1 au Val de Grâce. À Lyon depuis le début de 2009, sur 25 donneurs en état de mort encéphalique, seuls 13 ont fait l’objet d’un prélèvement. (848) Comme l’observe une étude récente, « la disparité des taux régionaux de donneurs recensés – de 25, 1 pmh à 64, 9 en 2007 – et l’absence de donneurs recensés dans certains départements permettent de penser que le potentiel de donneurs pourrait être optimisé dans certaines régions » .(849)
Faut-il multiplier pour autant les centres de prélèvement ? Une trop grande dispersion de centres de prélèvement avec une faible activité n’est-elle pas préjudiciable à la qualité de cette même activité ? On pourrait imaginer de constituer des centres de prélèvement à partir d’une taille critique, d’un seuil d’activité raisonnable, ces centres devant être, par ailleurs, dotés d’un service de réanimation et d’un chirurgien viscéral de garde.
Cette impression d’inégalité doit toutefois être atténuée par cinq facteurs :
– D’abord les 5 départements sans établissement autorisé et les 7 départements autorisés mais sans activité déclarée ont, dans leur majorité, organisé cette activité en réseau avec d’autres établissements à proximité, conformément à la loi de 2004.
– Il apparaît évident qu’il y a une corrélation entre le nombre de sujets décédés en mort encéphalique et l’existence d’un centre ou non de traumatologie, de neurochirurgie ou d’urgence neuro-vasculaire. Les hôpitaux équipés de tels centres ont plus de sujets potentiels en mort encéphalique que d’autres.
– La composition des populations dans ces bassins régionaux et leur plus ou moins grande acceptation des prélèvements pour des raisons culturelles et religieuses sont des facteurs explicatifs qui ne sauraient non plus être totalement négligés.
– 12 % des donneurs prélevés le sont en dehors de leur région de résidence avec des différentiels importants d’une région à l’autre. (850)
– Il est un fait aussi que si des équipes de greffe sont particulièrement motivées, les équipes de réanimation peuvent être culturellement plus étrangères aux impératifs de la greffe d’organes et de tissus car cette activité ne constitue pas forcément une priorité pour ces soignants. (851) D’aucuns font valoir que les soins sont toujours privilégiés par rapport au prélèvement et que le prélèvement représente une telle charge psychologique que la tendance naturelle des équipes serait de l’éviter. (852) Cette ambiguïté des fonctions des médecins ne pourra jamais être totalement levée.
De grandes disparités d’une année sur l’autre
On enregistre aussi de grandes disparités d’une année sur l’autre dans les prélèvements. Ainsi le taux de prélèvement était de 27 pmh en 2007 en Bourgogne et de 17,8 pmh l’année suivante, alors qu’il passait dans le même temps en Franche-Comté de 30,4 pmh à 19,1 pmh reflétant l’augmentation du taux d’opposition des familles enregistrée entre ces deux exercices (cf. supra). On ne peut expliquer de telles variations que par l’implication variable des équipes de coordination hospitalière en place d’un exercice à l’autre. Mais en même temps cette adhésion aléatoire des équipes de coordination et cette dépendance majeure de leurs conditions de fonctionnement illustrent la grande fragilité de l’organisation du prélèvement.
Un renforcement nécessaire du maillage territorial du prélèvement et de la transplantation
Cette situation plaide pour un renforcement du maillage territorial de la coordination des équipes de prélèvement et de transplantation. Aujourd’hui l’échelon interrégional est l’espace d’action des réseaux de ces équipes médicales. Au regard des missions des agences régionales de santé (ARS) définies par l’article L. 1431 -1 du code de la santé publique et appelées à voir le jour avant le 1er juillet 2010, il serait souhaitable que celles-ci soient plus impliquées dans la coordination de ces équipes et veillent en particulier à favoriser des dons là où il n’y en a pas. Ces structures n’ont-elles pas vocation à avoir une vision globale sur les insuffisances des greffes ? N’ont-elles pas reçu compétence pour veiller demain à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population, en vertu de l’article L. 1431-2, 2°, c) du code de la santé publique ? Cette amélioration du maillage territorial des prélèvements et des greffes pourrait être effectuée par les ARS en liaison avec l’ABM, à charge pour celle-ci de définir des objectifs à réaliser.
Proposition n° 54. Fixer des objectifs chiffrés de recensement de donneurs en état de mort encéphalique aux agences régionales de santé, afin que la France rattrape son retard dans le recensement.
Proposition n° 55. Renforcer la coordination des équipes de prélèvement et de transplantation sous l’autorité des agences régionales de santé en liaison avec l’Agence de la biomédecine.
Si les régions avec un taux de donneurs recensés inférieur à 50 pmh en 2007 étaient ramenées à 50 %, l’apport serait de 152 donneurs supplémentaires (76 prélevés et 84 greffes). Pour 55 pmh, ces chiffres seraient de 387 recensés ; 195 prélevés et 162 greffes. Pour un taux de 60 pmh, ces chiffres seraient de 657 recensés, 329 prélevés et 275 greffes. (853)
Les programmes Donor Action et Cristal Action
On ne saurait soutenir pour autant qu’aucune campagne de sensibilisation sur les enjeux des prélèvements d’organes n’ait été entreprise. Dans le cadre de ses missions d’information sur le don d’organes, l’Agence de la biomédecine organise régulièrement des campagnes de sensibilisation sur ce thème, le temps fort de ces campagnes étant une journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe qui a lieu habituellement le 22 juin. L’objet de cette journée est d’inciter chaque Français à prendre une décision sur le don d’organes et à partager son choix avec ses proches. En 2009, le Premier Ministre a choisi d’attribuer au don d’organes le label de « grande cause nationale ». Deux films ont été présentés à la télévision et des spots à destination d’un public entre 16 et 25 ans ont été diffusés. Notre collègue Philippe Gosselin, président du Collectif « Don de vie, don de soi » a appelé de ses vœux devant les membres de la mission la nécessité de disposer de relais auprès du grand public. Les médecins généralistes, les infirmières scolaires, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourraient à ses yeux remplir cette fonction, l’objectif étant d’assimiler cette cause à celle du plan cancer ou aux actions en faveur de la sécurité routière. (854)
Le programme « Donor action » s’inscrit dans cette réflexion globale visant à accroître le recensement des donneurs potentiels avec un impact attendu sur le taux de prélèvements en réalisant entre autres une évaluation des pratiques professionnelles. Les équipes de coordination disposent avec ce programme européen, transposé en France par l’Agence de la biomédecine, de moyens pour tendre vers l’exhaustivité du recensement des donneurs potentiels et améliorer leur prise en charge. Sa mise en œuvre repose sur l’implication d’une équipe multidisciplinaire investie dans le prélèvement. Il fournit à cet effet aux hôpitaux des outils d’autoévaluation pour identifier les donneurs. Le principal intérêt du programme « Donor action » est d’estimer le potentiel des hôpitaux d’un même réseau, d’identifier les freins au recensement et d’en tirer les conséquences en termes de formation des équipes médicales et d’équipement, afin de corriger les inégalités entre établissements que l’on a rappelées.
L’étape préalable a pour objectif de mesurer les connaissances, l’implication et les besoins en formation des personnels soignants, en utilisant les résultats d’une enquête rétrospective des décès et d’une enquête d’opinion des personnels soignants. Ces données ont plusieurs effets. Elles permettent :
– d’identifier et de suivre le plus tôt possible tous les patients susceptibles d’évoluer vers la mort encéphalique, offrant ainsi un caractère d’exhaustivité à ces données ;
– de prendre systématiquement contact avec le coordonnateur hospitalier dès qu’un patient répond aux critères de donneur potentiel, dans le cadre d’un système d’alerte ;
– de garantir que la question du don d’organes et de tissus sera abordée avec toutes les membres de la famille et les proches de façon humaine et sensible, en améliorant ainsi l’abord des proches et en favorisant une baisse du taux d’opposition ;
– de maintenir la qualité des organes du donneur et d’assurer enfin le bon déroulement du prélèvement.
Dans les 18 hôpitaux où ce programme a été mis en place entre 2001 et 2004, on constate une augmentation de 69 % des patients signalés et une hausse de 58 % des patients prélevés. Une expérience identique menée depuis 2006 sur le réseau de prélèvement est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse s’est traduite par une augmentation en deux ans de 52,5 % du nombre de donneurs potentiels recensés, de 95,8 % du nombre de donneurs prélevés et de 192 % du nombre d’organes prélevés. (855) Les mêmes résultats positifs ont été enregistrés en Finlande et en Italie. On a relevé en effet 61 % en plus de personnes recensées et plus de 59 % de personnes prélevées dans les services hospitaliers finnois où ce programme avait été introduit. En Emilie-Romagne sur un échantillon de 14 hôpitaux cette progression était respectivement de 34,5 % et de 41,2 %. Les Espagnols ont développé un outil similaire avec un système d’audit très performant des coordinations.
Les capacités financières et les compétences informatiques de la Fondation gestionnaire de « Donor action » se sont avérées cependant ces dernières années quelque peu défaillantes. Aussi a-t-il été décidé de doter l’ABM de son propre outil national, « Cristal action » au 1er janvier 2010. Cette application n’est autre que l’informatisation dans la base de données Cristal du programme Donor Action. Le projet est piloté par l’ABM et le logiciel est réalisé par les équipes de l’Agence. La base de données informatisées interactive Cristal comprend Cristal receveur, cristal donneur décédé, Cristal Immuno pour les données HLA et Cristal donneur vivant.
L’application Cristal est un outil informatique stratégique du prélèvement et de la greffe d’organe, accessible via un accès sécurisé Internet. Elle permet, entre autres, l’enregistrement de l’inscription sur liste nationale d’attente de tous les patients ainsi que de leur dossier clinique. Elle contient aussi tous les donneurs recensés et prélevés tout en assurant leur anonymat et est en mesure d’éditer des listes d’aide au choix des receveurs en fonction des règles de répartition et d’attribution de l’organe concerné. Cet outil donne par ailleurs la possibilité aux équipes médicales de fournir les résultats de la greffe pour chacun des patients, permettant ainsi à l’Agence d’assurer sa mission d’évaluation des résultats à court, moyen et long terme des greffes d’organes.
Actuellement, le recours au programme Donor Action pour l’audit des coordinations n’est pas obligatoire et repose sur le volontariat. Rendre obligatoire le programme « Cristal action » pourrait être un moyen d’action efficace pour améliorer le recensement en France, d’autant que ce programme sera informatisé en 2010. Ce caractère obligatoire serait corrélé à la rémunération du recensement.
Proposition n° 56. Rendre obligatoire le programme « Cristal action » de recensement des donneurs potentiels en état de mort encéphalique, qui repose aujourd’hui sur le volontariat.
La nécessité d’une plus grande autonomie du prélèvement par rapport à la greffe
Aujourd’hui ce sont souvent des chirurgiens de la même équipe chirurgicale qui réalisent le prélèvement et la greffe pour les organes thoraciques, le foie et le pancréas. Le premier greffon est attribué à l’équipe locale qui a effectué le prélèvement. Le second est attribué à l’échelon interrégional ou national. Pour les reins, le second greffon rénal est attribué à un patient selon un score régional intégrant des paramètres d’efficacité et d’équité et non à une équipe. Pour les foies, un tiers des greffons font l’objet d’une attribution à une équipe à l’échelon local, les autres étant attribués à un receveur identifié comme prioritaire puis selon un score national. Pour les organes thoraciques, les greffons sont attribués à l’équipe qui réalise le prélèvement en l’absence de patients en extrême urgence. Cette incitation au prélèvement est pragmatique et est certainement un aspect sur lequel il ne faut pas revenir.
La politique des prélèvements et des greffes s’oriente de plus en plus vers une plus grande autonomie du prélèvement vis-à-vis des greffes en mutualisant et en déléguant le prélèvement à des chirurgiens formés au prélèvement. L’objectif de la mutualisation est de demander par exemple à une équipe de chirurgiens thoraciques de prélever l’ensemble des organes thoraciques et à une équipe de chirurgiens urologues ou digestifs de prélever l’ensemble des organes abdominaux.
D’ores et déjà une convention a été passée en ce sens entre la Société francophone de prélèvements multi organes, la Société francophone de transplantation, la Société française d’urologie, l’association de chirurgie hepato-biliaire et de transplantation ainsi que la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. L’objectif est de former des équipes spécialisées au prélèvement pour les organes thoraciques et abdominaux. L’idée est d’avoir à terme une formation universitaire ou professionnelle validée ; d’instaurer un contrôle de qualité sur les prélèvements et de disposer d’un système de rémunération revalorisé et homogène. Une première session de formation de chirurgie du prélèvement a eu lieu en juin 2009. Elle a été suivie par 22 chirurgiens et devrait être suivie d’une nouvelle formation en juin 2010.
Cette nouvelle orientation donnée au prélèvement et à la greffe présente incontestablement plusieurs mérites :
– Elle diminue le nombre de chirurgiens mobilisés ainsi que les déplacements sur le territoire de plusieurs équipes chirurgicales pour le même donneur. De fait l’intervention d’une équipe extérieure en milieu hospitalier n’est pas toujours une solution optimale, puisqu’elle suppose une adaptation au contexte local du prélèvement. En revanche la mobilisation des compétences chirurgicales locales sous réserve d’une formation appropriée et reconnue est bénéfique. La qualité du geste du prélèvement conditionne la qualité de la greffe, sachant que des lésions iatrogènes sur la greffe au moment du prélèvement peuvent entraîner des pertes de greffes, les greffes de reins perdus pour cette raison étant estimées à 7 % des greffes de rein ;
– Elle sépare bien le prélèvement et la greffe, cette double activité pouvant être source de confusion ;
– Elle diminue le taux de refus d’une équipe pour des raisons logistiques, au motif que cette équipe serait déjà en train d’effectuer une greffe ou parce qu’il n’y aurait pas ce jour là de chirurgiens qualifiés disponibles ;
– Elle réduit les coûts correspondant aux frais de déplacement des équipes et les risques. Rappelons que la France a eu à déplorer la mort de deux chirurgiens transplanteurs et de deux pilotes lors d’un accident survenu à Besançon le 19 octobre 2006. C’est à cette occasion que l’on a découvert que ces transports n’étaient souvent pas assurés. Ce n’est que le 29 avril 2008 qu’a été signée une convention entre le ministère de la santé et la Fédération hospitalière de France pour permettre à celle-ci de souscrire un contrat d’assurance pour le compte des établissements de santé participant aux missions d’urgence ou de prélèvement d’organes et de transplantation. Mais à ce jour cette assurance n’est pas obligatoire et seulement une cinquantaine d’établissements ont adhéré à ce contrat d’assurance ;
– Elle est formatrice pour les chirurgiens qui avec le développement de la chirurgie par coelioscopie ont de moins en moins l’habitude de la pratique de la chirurgie à ciel ouvert.
Cette démarche tendant à séparer le prélèvement de la greffe doit être encouragée par le ministère de la santé, l’accent devant être mis sur l’amélioration de la rétribution du préleveur. Aujourd’hui la rémunération de l’acte chirurgical pour le chirurgien préleveur varie de 0 à 700 € et son montant est à la discrétion de l’hôpital. Il y a donc une absence totale d’homogénéité tarifaire sur tout le territoire.
En réalité la principale motivation du préleveur est l’attribution d’un greffon pour un malade de sa propre équipe. Or on l’a vu l’accès à la greffe dépend souvent largement du taux de décès potentiel par mort encéphalique, c’est-à-dire de la spécificité de l’établissement hospitalier. Quant à la variable du volume de la liste d’attente, elle dépend en grande partie de la politique d’inscription des équipes et pas toujours de la densité de la population. Enfin comme la rémunération du chirurgien est faible et que cette activité n’est pas assimilée à une garde et que dès lors il n’y a pas de repos compensateur, il y a peu de volontaires pour exercer une fonction pénible et jugée contraignante en raison des déplacements qu’elle entraîne et de son caractère souvent nocturne, puisque les entretiens avec les proches se tiennent le plus souvent de jour. Il serait donc opportun de mieux rémunérer cette activité et d’intégrer dans le calcul de cette rémunération les variables d’indemnisation des gardes et des astreintes, le temps de trajet et la fréquence des astreintes.
En dehors de cette revalorisation de l’activité chirurgicale et de la réorganisation des astreintes, il conviendrait de favoriser l’intéressement de l’hôpital du chirurgien préleveur, qui est souvent envoyé sur un autre site pour effectuer le prélèvement.
Proposition n° 57. Développer l’autonomie des équipes de prélèvement par rapport aux équipes de greffes, développer l’école des chirurgiens préleveurs et revaloriser leur rémunération.
Évoquer ces aspects financiers, c’est s’intéresser plus généralement à la tarification financière du prélèvement et des activités liées à la greffe en se concentrant tout particulièrement à la greffe du rein qui représente 64% des greffes réalisées.
c) Une tarification de l’activité des prélèvements d’organes sous évaluée
La corrélation entre les prélèvements d’organes et les dialyses
On ne saurait établir de corrélation directe entre le faible nombre de prélèvements d’organes et le nombre élevé de dialyses. D’ailleurs si l’on en reste à la comparaison entre l’Espagne et la France, le taux de greffe rénale est supérieur en France à celui que l’on enregistre chez notre voisin (46,2 par million d’habitants contre 44,9 pour les donneurs décédés). Il n’en reste pas moins qu’il existe une relation entre le nombre élevé de postes de dialyses, le forfait T2A couvrant les frais de dialyse et l’accès à la liste d’attente des greffes.
Depuis quelques années un registre national de l’insuffisance rénale terminale (Rein ou Réseau épidémiologie et information en néphrologie) relève tous les cas incidents d’insuffisance rénale terminale en France avec des précisions sur les comorbidités et les modalités de dialyse et avec une mise à jour régulière des informations médicales et du devenir des patients. Ce registre a une interface avec la base de données Cristal pour identifier parmi les patients dialysés ceux qui ont pu bénéficier d’une inscription en liste d’attente voire être greffés. C’est par ce biais que l’on apprend que pour les personnes qui commencent une dialyse, la probabilité d’être inscrit sur la liste nationale d’attente de greffe de rein est de 15 % au bout d’un an, tous âges confondus. Ce même registre nous indique aussi qu’une personne sur 2 de moins de 60 ans qui démarre une dialyse est inscrite au bout de 18 mois sur la liste nationale d’attente (médiane d’attente) avec de grandes variations d’une région à l’autre, laissant préjuger des difficultés d’accès à la liste d’attente pour un certain nombre de patients, avant même de pouvoir accéder à la greffe une fois inscrits.
ACCÈS À LA LISTE NATIONALE D’UNE GREFFE DE REIN POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 60 ANS SELON LA RÉGION DE PRISE EN CHARGE (856)
Nombre |
% des patients inscrits sur liste d’attente après 12 mois | |
Aquitaine |
98 |
non observé |
Auvergne |
265 |
32, 1 |
Basse-Normandie |
153 |
37, 1 |
Bourgogne |
169 |
56, 4 |
Bretagne |
483 |
58, 3 |
Champagne Ardennes |
303 |
27, 8 |
Corse |
22 |
45, 1 |
Haute Normandie |
125 |
35, 2 |
La Réunion |
103 |
non observé |
Picardie |
62 |
non observé |
Poitou Charentes |
41 |
non observé |
C’est à cette lecture que l’on comprend que les critères d’entrée sur la liste d’attente ne sont pas homogènes. Certains patients sont inscrits avant même leur entrée en dialyse, une inscription très précoce augmentant leur chance d’obtenir un greffon ; d’autres sont inscrits après plusieurs mois.
Le fait que la moitié des patients dialysés de moins de 60 ans ne soient toujours pas inscrits sur la liste d’attente 18 mois après le début de la dialyse, alors que plus de 22 % des nouveaux patients inscrits sur la liste d’attente le sont avant de commencer la dialyse témoigne également d’une forte inégalité d’information des malades. Par conséquent il est impératif que les délais et les critères d’inscription sur liste d’attente des insuffisants rénaux soient harmonisés, certaines régions inscrivant les patients en liste d’attente avant la dialyse, pendant que d’autres maintiennent plus longtemps leur malade en dialyse. La moyenne nationale d’attente est de 16,2 mois mais recouvre de profondes disparités : 29 mois en Midi-Pyrénées et en Île-de-France contre 6 mois dans le Poitou-Charentes. Comme le relève « Demain la greffe », beaucoup de patients qui pourraient bénéficier d’une greffe n’accèdent pas à la liste d’attente, ce qui constitue une importante perte de chances.
Les critères d’inscription sur la liste d’attente des greffes devraient être homogénéisés. Aujourd’hui l’inscription sur la liste d’attente est à la discrétion des néphrologues. Elle peut intervenir à n’importe quel moment. Or l’égalité dans l’accès aux soins voudrait que les patients soient tous inscrits sur cette liste au même niveau d’insuffisance rénale. Sachant que la clairance de la créatinine est un marqueur reconnu de l’insuffisance rénale, celui-ci pourrait servir comme critère d’inscription sur la liste d’attente, une fourchette pouvant être établie à cet effet par les experts des sociétés savantes concernées en concertation avec l’ABM.
Proposition n° 58. Homogénéiser les critères d’inscription sur les listes d’attente des greffes en retenant des critères objectifs de gravité et de pronostic comparables d’insuffisance rénale.
Les forfaits de financement de la dialyse et du prélèvement d’organes
L’activité de dialyse étant considérée comme plus lucrative, la tarification à l’activité (T2A) devrait être révisée, afin que les forfaits dialyse et les forfaits greffes soient plus cohérents.
On rappellera que le forfait de prélèvement d’organes a vocation à financer les dépenses suivantes : les frais spécifiques de diagnostic de la mort encéphalique ; de mobilisation des équipes ; des bilans biologiques ; de transport du corps, de prélèvement et de conservation des organes. Le tarif va de 606 € pour un prélèvement de pancréas à 7 321 € pour un prélèvement du ou des reins et/ou du foie. À titre d’exemples, le tarif du séjour pour transplantation d’organes est fonction du degré de sévérité de l’opération : 50 885 € en degré 4 – soit le degré maximum de sévérité – pour le foie ; 40 357 € pour le cœur ; 21 147 € pour le rein.
Les études menées entre 2002 et 2004 par l’ABM révèlent que le coût d’une greffe pour la première année est de l’ordre de 43.000 € puis environ 12.000 € les années suivantes, tandis que le coût moyen d’une dialyse se situe entre 45.000 et 60.000 €, sachant que ces coûts varient suivant que la dialyse est à domicile, (50 000 €), qu’il s’agit d’une auto-dialyse en centre (60 000 €) pour les insuffisants rénaux capables de prendre en charge leur séance de dialyse avec une aide limitée ou d’une hémodialyse en centre (80 000 €).
ÉVALUATION DU COÛT DE PRISE EN CHARGE D’UNE COHORTE DE PATIENTS GREFFÉS ET D’UNE COHORTE DE PATIENTS DIALYSÉS
Coût de dialyse /an : 60.000 € |
Coût de dialyse /an : 45.000 € | |||
100 patients greffés |
100 patients dialysés |
100 patients greffés |
100 patients dialysés | |
Coût première année |
4 318 488 |
6 000 000 |
4 318 488 |
4 500 000 |
Coût n+1 |
1 698 885 |
6 000 000 |
1 563 885 |
4 500 000 |
Coût n+2 |
1 840 680 |
6 000 000 |
1 660 680 |
4 500 000 |
Coût n+3 |
1 935 210 |
6 000 000 |
1 725 210 |
4 500 000 |
Coût n+4 |
2 077 005 |
6 000 000 |
1 822 005 |
4 500 000 |
Coût n+5 |
2 218 800 |
6 000 000 |
1 918 800 |
4 500 000 |
Total |
14 089 068 |
36 000 000 |
13 009 068 |
27 000 000 |
Source : ABM, réponse à un questionnaire du Rapporteur
En outre l’ABM reconnaît dans son rapport annuel 2008 que le forfait de coordination des prélèvements d’organes comporte des effets de seuil qui n’incitent pas forcément au prélèvement des tissus. En 2007 sur 197 coordinations, 40 ne prélevaient pas de cornée et 178 ne prélevaient pas d’autres tissus.
Dans tous les cas de figure la dialyse coûte à notre système de santé au minimum plus de deux fois ce que coûte la greffe. D’ailleurs pour prolonger la comparaison avec l’Espagne, on constate que la France à l’inverse de son voisin a investi dans la dialyse alors que l’Espagne a concentré ses efforts sur la greffe. Il faut aussi tenir compte du fait que la greffe améliore tant la qualité de vie que la durée de vie après que se soit déclarée une insuffisance rénale. La prise de conscience de l’intérêt à recourir aux greffes est d’autant plus nécessaire que le vieillissement de la population entraîne automatiquement une augmentation du nombre de malades traités par dialyse.
Pour modifier les termes de cette approche financière, le forfait greffe pourrait être assorti d’une variable qualitative d’indicateurs, afin de ne pas rester dans la logique d’activité inhérente à la T2A. Cette variable pourrait être attribuée en fonction de la survie du greffon à un an. Le remboursement doit combiner quantité et qualité.
Une adaptation du remboursement par la sécurité sociale en fonction de la survie des greffons serait un signal fort donné à la communauté médicale. La greffe est en effet un des seuls domaines de la médecine pour lequel des données qualitatives fiables sont disponibles.
Le rappel de ces données plaide pour le développement des greffes et la revalorisation de leurs actes, afin de rééquilibrer l’importance de ces actes ; ce réaménagement est d’autant plus nécessaire que les comparaisons européennes sur les tarifs révèlent que les tarifs français sont les plus élevés, les allemands par exemple ne connaissant qu’un seul tarif(857). La greffe doit être favorisée. En dehors des propositions déjà formulées, plusieurs éléments peuvent y contribuer :
– La création de postes d’infirmières de coordination des greffes à l’image de ce qui existe dans les équipes de prélèvement pourrait être suggérée. Cela déchargerait les responsables médicaux de nombreuses tâches administratives dans la gestion de la liste d’attente. La tenue des listes d’attente ainsi que l’information des patients pourraient leur être confiées.
Proposition n° 59. Renforcer les équipes de transplantation sur le modèle des équipes de prélèvement, en y adjoignant des infirmières de coordination en transplantation.
– Les malades devraient être informés des différentes formes de traitement des insuffisances rénales terminales, qui incluent également la greffe ainsi que des différentes durées d’attente dans les centres. Par rapport à la dialyse la greffe présente trois avantages incontestés : elle améliore la qualité de vie du malade, elle allonge sa durée de vie et elle est moins coûteuse pour la collectivité. À cet égard les enseignements d’une expérience britannique mériteraient d’être analysés. Des infirmières y ont été formées pour visiter l’ensemble des centres de dialyse du pays et informer les malades sur leur inscription sur les listes d’attente et les possibilités de transplantation d’organes.
Proposition n° 60. Mieux informer les malades souffrant d’insuffisances rénales des avantages de la greffe par rapport à d’autres formes de traitement.
Il est évident que les considérations précédentes ne relèvent pas directement de la compétence du législateur mais si celui-ci a l’ambition d’augmenter le taux de prélèvement d’organes dans notre pays, il ne saurait les ignorer. Elles démontrent également que les progrès susceptibles d’être enregistrés en la matière ne passent pas forcément par la loi. Comme l’observe l’étude britannique déjà citée, les résultats obtenus en matière de dons d’organes résultent d’une combinaison de différents facteurs, à savoir la législation, la disponibilité des donneurs, l’organisation des prélèvements, l’investissement dans la politique de santé publique et l’attitude de l’opinion publique à l’égard des dons d’organes. (858)
d) Une absence de suivi psychologique des familles
Les praticiens déplorent que les familles des personnes décédées ayant effectué un don d’organe ne soient pas suivies psychologiquement. Un tel dispositif serait l’expression de la reconnaissance et du soutien de la collectivité à l’égard de ces familles désemparées à l’occasion du décès de l’un de leur proche contribuerait à favoriser l’image du don dans notre société.
On pourrait imaginer qu’un psychologue ayant un statut d’équivalent temps plein soit attaché aux centres de dons d’organes en fonction du nombre de personnes recensées en état de mort encéphalique (DDME) ou après arrêt cardiaque (DDAC).
Proposition n° 61. Doter les centres de dons d’organes de psychologues pour suivre les familles des donneurs décédés.
3. Les interrogations éthiques soulevées par les prélèvements sur les personnes décédées
L’organisation et le financement des prélèvements d’organes sur les personnes décédées ne sauraient faire oublier les questions éthiques plus spécifiques que les prélèvements soulèvent par ailleurs. Elles portent sur les prélèvements en état de mort encéphalique, les prélèvements après arrêt cardiaque et les prélèvements sur donneurs vivants.
a) Les prélèvements sur donneurs en état de mort encéphalique
La mort encéphalique intervient à l’occasion d’un arrêt brutal ou progressif de la circulation cérébrale à la suite d’un œdème cérébral. Dans ce contexte le cœur de la personne décédée continue de battre, les organes restant irrigués avec du sang oxygéné et ne se détériorant pas. La mort encéphalique se produit principalement à la suite d’un accident vasculaire cérébral (56 % des cas), d’un accident sur la voie publique (12 %), d’un autre traumatisme (12 %) et d’une anoxie cérébrale (7 %). On observe cependant que la part des traumatismes crâniens recule en raison de la diminution importante d’accidents sur la voie publique suite aux restrictions de vitesse tandis que la part des accidents vasculaires cérébraux augmente (55 % des donneurs recensés en 2007 contre 42 % en 1996). Le nombre de décès par accident sur la voie publique (AVP) a diminué de moitié entre 1986 et 2006.
Le nombre de sujets en état de mort encéphalique déclarés à l’Agence de la biomédecine était de 3.181 en 2008 soit 1 % de plus qu’en 2007. Sur une longue période, depuis 1994, les prélèvements sur des personnes en état de mort encéphalique auraient crû de 80 %.
L’âge des donneurs est de plus en plus avancé puisqu’il est estimé à 52 ans en 2008 contre 41 en 2000 et 37,5 ans en 1996. Le pourcentage des donneurs de plus de 65 ans augmente aussi et atteint 25,7 % en 2008 contre 21,8 % en 2007. En revanche, le pourcentage des donneurs dans la tranche d’âge 16-49 ans représente 38 % des donneurs et diminue.
Sur le nombre de donneurs recensés, seule la moitié fait l’objet d’un prélèvement (1582 en 2007), avec en moyenne 3 organes prélevés. Les praticiens s’accordent à reconnaître que les marges de progression sont restreintes sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs : le nombre relativement faible de donneurs en état de mort encéphalique enregistrés, l’avancement en âge des donneurs et l’absence de diminution du taux de refus stabilisé depuis plusieurs années autour de 30 % (30,7 % en 2008), comme on l’a déjà vu. Néanmoins les disparités régionales en la matière gagneraient encore à être atténuées.
Le prélèvement sur donneur en état de mort encéphalique ne soulève pas de problèmes éthiques trop difficiles. Avant le passage en mort cérébrale avéré, la discussion avec les proches porte parfois sur l’opportunité de poursuivre ou non les traitements au regard du principe de la non obstination déraisonnable posé par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Dans ce cas, c’est une décision de non escalade thérapeutique eu égard au pronostic neurologique catastrophique qui peut conduire au passage en mort cérébrale. Une fois le passage en mort cérébrale établi, la discussion avec les proches sur le prélèvement se déroule sur un temps relativement long, à la différence des entretiens intervenant dans le cadre du prélèvement après arrêt cardiaque, qui exige une décision rapide prise en quelques heures. Le constat de la mort cérébrale permet la poursuite de moyens de suppléance artificielle nécessaires à la préservation des organes pendant qu’est vérifiée la non opposition du donneur à des prélèvements.
b) Les prélèvements sur donneurs décédés après arrêt cardiaque
Ces prélèvements s’appliquent à une personne dont le cœur ne bat plus. L’OMS considère que le nombre de ces donneurs pourrait être multiplié par trois. (859) Le processus de prélèvement comprend trois étapes. D’abord il convient de constater le décès de la personne. Cela signifie que malgré les manœuvres de réanimation les battements cardiaques ne reprennent pas. Cinq minutes d’absence d’activité cardiaque malgré une réanimation intensive d’une durée approximative de 30 minutes permettent de diagnostiquer la mort de la personne. Commence alors une deuxième étape au cours de laquelle il convient d’effectuer des opérations identiques à celles de la réanimation comme le massage cardiaque et la ventilation artificielle, non pas en vue d’assurer une reprise de la vie mais afin d’irriguer les organes oxygénés pour assurer le prélèvement. Enfin dans un troisième temps il faut soit remplacer le sang de la personne par un liquide glacé pour garantir un refroidissement qui va garantir sa conservation, soit mettre en place un système d’assistance circulatoire destiné à assurer la circulation du sang appelé circulation régionale normothermique. (860)
Par rapport aux donneurs décédés en état de mort encéphalique, les prélèvements d’organes sur des donneurs décédés après arrêt cardiaque présentent quelques spécificités qu’il convient de rappeler : la brièveté du temps imparti ; la prise en charge essentiellement extra hospitalière de ces donneurs; la décision d’arrêt de poursuites de ressuscitation ou de sauvetage et le regard d’une société souvent tentée de considérer que les possibilités de survie sont infinies. (861)
Les prélèvements après arrêt cardiaque ont été utilisés fréquemment au cours des années cinquante et soixante. Ils ont diminué ensuite notamment à partir de la circulaire de Jean-Marcel Jeanneney du 24 avril 1968 reconnaissant la mort encéphalique. Ils ont été abandonnés après 1970 et ne font pas l’unanimité du corps médical, d’aucuns leur reprochant une forme d’instrumentalisation des cadavres. (862)
Entre 1970 et 1995, alors que la France avait renoncé aux prélèvements après arrêt cardiaque, ce type de prélèvement était effectué par quelques équipes aux Pays-Bas et en Suisse. Les résultats se sont sensiblement améliorés et ont permis d’obtenir des taux de survie des greffons comparables à ceux obtenus avec des greffons issus de donneurs en mort encéphalique.
La diminution du nombre de patients passant dans un état de mort encéphalique et le nombre croissant de patients sur une liste d’attente ont conduit à favoriser les prélèvements sur donneurs après arrêt cardiaque. (863) Un décret du 2 août 2005 autorise de nouveau les dons par donneurs après arrêt cardiaque. Ce texte précise que les prélèvements sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l’Agence de la biomédecine. Ce protocole détermine les catégories de donneurs et de receveurs pouvant être concernés par ce type de prélèvement et de greffe ainsi que les critères d’attribution des greffons. Il décrit les différentes étapes de la prise en charge d’un donneur après arrêt cardiaque et l’utilisation du greffon avec un mode opératoire précis.
Onze conventions ont été signées à ce jour entre l’agence et des établissements hospitaliers publics. Les protocoles de prélèvement de rein sur la base du décret du 2 août 2005 ont été passés d’abord avec 7 sites hospitaliers (La Pitié-Salpêtrière, Kremlin-Bicêtre, Saint-Louis, Lyon, Strasbourg, Angers et Lille) puis Nancy et Nantes en 2008, les centres de Bordeaux et de Marseille ayant signé mais pas encore démarré cette activité. En 2008 neuf centres ont prélevé 47 donneurs et permis de réaliser 52 greffes. L’âge moyen des donneurs est de 41 ans. Sur les 86 donneurs prélevés en 2007 et 2008, 95 greffes rénales ont été effectuées. 73 greffons ont été écartés du fait de leur aspect au prélèvement, des tests de viabilité ou de sérologies positives. Il est à noter que l’utilisation de la circulation régionale normothermique permet d’améliorer de façon très significative la qualité des greffons. L’année qui a séparé la parution du décret des premiers prélèvements a été mise à profit par l’ABM pour informer et former les personnels hospitaliers.
Au niveau international les donneurs sont classés en quatre catégories suivant une classification dite de Maastricht :
La catégorie I fait référence aux personnes qui font un arrêt cardiaque en dehors de tout contexte de prise en charge médicalisée et pour lesquelles le prélèvement d’organes ne peut être envisagé que si la mise en œuvre de gestes de réanimation de qualité a été réalisée moins de 30 minutes après l’arrêt cardiaque.
La catégorie II concerne les personnes qui font un arrêt cardiaque en présence de secours qualifiés, aptes à réaliser un massage cardiaque et une ventilation mécanique efficaces mais dont la réanimation ne permet pas un redémarrage cardiaque.
La catégorie III vise les personnes pour lesquelles une décision d’un arrêt de traitements en réanimation est prise en raison de leur pronostic neurologique catastrophique.
La catégorie IV s’applique aux personnes décédées en mort encéphalique qui font un arrêt cardiaque irréversible au cours de la prise en charge en réanimation.
Le Portugal et la Hongrie ainsi que l’Allemagne et l’Autriche, interdisent le prélèvement sur donneurs décédés après arrêt cardiaque. La France et l’Espagne pratiquent les prélèvements des catégories I et II. La France se refuse de pratiquer des prélèvements dans le cadre de la catégorie III sans que ceux-ci ne soient formellement interdits. Le Royaume-Uni et la côte est des États-Unis, la Belgique et les Pays-Bas privilégient les prélèvements de la catégorie III. S’agissant de la Belgique, celle-ci autorise les prélèvements de catégorie III ainsi que ceux sur les personnes euthanasiées. En 2005-2006, les prélèvements de la catégorie III représentaient 84 % du total des prélèvements en arrêt cardiaque en Belgique, ce taux s’élevant à 93 % aux Pays-Bas.
COMPARAISON EUROPÉENNE DES DONNEURS DÉCÉDÉS APRÈS ARRÈT CARDIAQUE
2006 |
Nombre de donneurs DDAC |
% par rapport à l’ensemble des donneurs |
% Maastricht III par rapport aux patients DDAC |
Taux de donneurs par mort cérébrale pmh |
Belgique |
38 |
11 % |
84% |
28, 1 |
Pays-Bas |
191 |
45% |
93% |
16, 9 |
Royaume-Uni |
237 |
19% |
82% |
13, 2 |
Espagne |
147 |
5% |
0% |
34, 3 |
On constate à la lecture de ce tableau que les deux pays d’Europe qui ont les taux de prélèvement DDAC en Maastricht III les plus élevés sont paradoxalement ceux qui ont les taux les plus faibles de prélèvement sur patient en mort encéphalique.
Le recours aux donneurs de la catégorie III de Maastricht soulève deux difficultés d’importance d’ordre éthique, mises en lumière par l’expérience belge.
La première est le lien établi par cette procédure avec l’euthanasie et les patients susceptibles de relever de celle-ci. Ce danger a été bien perçu par les praticiens belges, qui concluaient un article sur le prélèvement d’organes après l’euthanasie par la nécessité d’une séparation claire entre la demande d’euthanasie, la procédure d’euthanasie et la procédure de prélèvement d’organes. (864)Un Congrès tenu en Belgique en 2008 a rapporté que des organes avaient été prélevés sur 4 personnes euthanasiées, 2 souffrant d’un locked in syndrom et 2 souffrant d’une sclérose en plaques. (865) Mais dans la mesure où ces malades souffraient de pathologies neurologiques sévères, on peut se demander quelle a été la part de facteurs dépressifs dans leur décision.
La seconde est la tentation pour le médecin d’accélérer l’arrêt de traitement pour prélever des organes. Comme l’a dit le Professeur Bruno Riou devant la mission, « Si vous ne faites rien de proactif, vous ne savez pas quand l’arrêt cardiaque interviendra et en attendant les organes risquent de souffrir. Si vous êtes pragmatique comme les belges et les américains pour pallier cet inconvénient, vous descendrez le malade au bloc opératoire, vous faites en sorte que le délai soit le plus court possible et que le prélèvement se fasse au moment où vous l’avez décidé. » (866)
Par ailleurs la communauté médicale a tout intérêt à ne pas s’exposer à des conflits d’intérêts entre le traitement et le prélèvement aussi bien pour les donneurs décédés en état de mort encéphalique que pour les donneurs décédés après arrêt cardiaque. La séparation entre les équipes médicales figure d’ailleurs parmi les principes directeurs des bonnes pratiques élaborés par l’OMS : « Les médecins constatant le décès d’un donneur potentiel ne doivent pas participer directement au prélèvement de cellules, de tissus ou d’organes sur le corps du défunt ni aux étapes ultérieures de la transplantation, pas plus qu’ils ne doivent être chargés de soigner les receveurs potentiels de ces cellules, tissus ou organes. » (867) Cette séparation est régie par l’article L. 1232-4 du code de la santé publique.
Faut-il continuer à interdire les prélèvements de la catégorie III ?
Les arguments à la fois éthiques et médicaux plaidant pour le statu quo ne manquent pas.
D’abord on ne saurait surestimer le nombre de personnes relevant de la catégorie III pouvant être éligibles au prélèvement d’organes. Le nombre de personnes sans obstacle médical pouvant faire l’objet d’un prélèvement à ce titre peut être évalué à 600(868). Il ne faut pas oublier en effet que ce prélèvement n’est médicalement intéressant que si le donneur potentiel a moins de 55 ans et ne présente ni comorbidités associées ni pathologie maligne ni défaillance multiviscérale. En réalité ces conditions sont très rarement réunies chez les patients pour lesquels une décision d’arrêt de traitement est prise en réanimation.
De plus les équipes médicales ne savent pas quand l’arrêt cardiaque est susceptible d’intervenir chez le malade, une fois l’assistance respiratoire arrêtée. Rappelons que pour que les organes soient prélevables, le temps d’ischémie chaude (869) doit être inférieur à une heure. C’est le temps qui précède l’arrêt cardiaque durant lequel le patient présente une hypotension, un bas débit cardiaque qui altère la perfusion des reins ou du foie et donc leur viabilité une fois ceux-ci transplantés.
S’aligner sur les pratiques belges reviendrait non pas à s’en remettre à l’aléa de l’arrêt cardiaque mais favoriserait au besoin celui-ci pour pouvoir prélever un organe à un moment fixé au préalable. S’engager dans cette voie d’arrêt de traitement chez le patient en réanimation, alors même que la France vient de faire le choix d’encadrer l’arrêt de traitement avec la loi du 22 avril 2005 et de le confirmer en 2008, serait risquer d’établir une corrélation entre l’arrêt de traitement et le prélèvement d’organes. Ce type de fin de vie pourrait être vécu comme une « euthanasie utilitaire ». (870)Ne serait-ce pas tout au moins afficher une continuité entre ces étapes, qui n’avait pas été forcément envisagée au départ en 2005 ? Au surplus le risque de conflits d’intérêts auxquels s’exposeraient les médecins qui arrêteraient les traitements pour autoriser par la suite le prélèvement ne serait pas négligeable.
Il n’est pas exclu en effet que le processus d’arrêt de traitement dans ce contexte ne soit pas accéléré par le recours à des substances somme le curare ou des hypotenseurs comme cela se pratique parfois aux États-Unis. Or au moment où à la suite des recommandations du rapport d’évaluation de la loi du 22 avril 2005(871), le code de déontologie médicale va préciser le recours à des traitements antalgiques et sédatifs dans le cadre d’un arrêt de traitement, lorsque la souffrance du patient ne peut être évaluée du fait de son état cérébral, ne serait-ce pas introduire une confusion au sein du corps médical et dans l’opinion ? (872) À cette répercussion possible, il convient d’ajouter le risque d’une diminution de l’acceptation par la société des prélèvements d’organes, entraînant une chute importante du taux de prélèvement chez les patients en état de mort encéphalique.
D’ores et déjà des équipes médicales d’urgentistes et de réanimateurs ont tenu à rappeler les conditions dans lesquelles le prélèvement d’organes sur des malades très sévèrement cérébrolésés et proches d’un état de mort encéphalique pouvait être envisagé au regard de la loi du 22 avril 2005.
Ainsi des recommandations ont été élaborées en ce sens à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière par le service d’accueil des urgences. Elles précisent que l’arrêt de thérapeutiques tout à fait vaines et n’ayant pour seul but que la prolongation de l’agonie est légal et n’est pas contraire à l’éthique. En revanche la mise en place d’actions nouvelles qui auraient pour seul but d’accélérer le passage en état de mort encéphalique n’est pas acceptable. Les actions thérapeutiques ayant pour objet de préserver la fonction des organes ne sont justifiées que dans la mesure où le processus d’évolution vers la mort encéphalique est déjà engagé de manière irréversible. Il ne s’agit pas d’administrer au patient des traitements pour hâter sa mort encéphalique.
Les médecins interrogés sur cette question par la mission ont exprimé leurs réserves sur la levée en l’état de l’interdit du prélèvement d’organes au titre du Maastricht III. Considérant que les recensements de toutes les morts encéphaliques, de tous les arrêts cardiaques Maastricht I et II étaient loin d’avoir avoir été épuisés, ils ont souhaité que ces voies soient exploitées en priorité et que l’on se donne les moyens techniques et humains pour satisfaire ce préalable.
Faut-il pour autant s’interdire toute réflexion sur Maastricht III et souscrire à la position du Conseil d’État, qui propose de prohiber les prélèvements sur des patients faisant l’objet d’un arrêt de traitement par voie réglementaire même lorsque ces patients auraient donné leur accord ? (873)
Le débat mérite d’être ouvert pour apprécier précisément si l’encadrement de l’application des arrêts de traitement de Maastricht III pallierait des risques de dérives.
En tout état de cause les partisans d’une réflexion sur ce sujet ont insisté sur la nécessité d’encadrer très strictement la procédure : « Il faudrait veiller à ce qu’elle soit nationale, transparente, sécurisée au plan médico-judiciaire et régie par un décret pris en Conseil d’État. Il conviendrait que le délai entre l’intubation pour détresse neurologique et la procédure soit inférieur à 7 jours, afin d’éviter les reports de décisions. Les donneurs concernés seraient uniquement ceux présentant l’une des conditions médicales suivantes : anoxies cérébrales sans N 20 (874), traumatisme crânien avec contusions bilatérales du tronc cérébral, hématome du tronc cérébral ou hématome profond avec destruction d’un thalamus et hémorragie intra-ventriculaire massive. L’accord de la famille serait demandé avant l’extubation. Un certificat affirmant la haute probabilité d’un mauvais pronostic neurologique signé par un médecin réanimateur et par un neurologue serait requis. La procédure serait centralisée à l’Agence de la biomédecine, qui tiendrait des registres, et l’évaluation réalisée par un comité d’experts indépendants. Il faut des garde-fous solides, nationaux, avec des procédures fortes de contrôle. » (875) Le texte qui encadrerait cette procédure devrait notamment préciser le point de non retour à la conscience, l’intentionnalité des actes médicaux, les délais et les critères des actes médicaux ainsi que leur dimension éthique. Ce débat peut être ouvert devant les sociétés savantes d’urgentistes, de réanimateurs et de chirurgiens.
Proposition n° 62. Inviter les sociétés savantes à ouvrir un débat sur la procédure de prélèvements après arrêt cardiaque (catégorie Maastricht III).
Ce débat devrait porter sur les critères médicaux du prélèvement, l’intentionnalité des actes médicaux, leur dimension éthique et leur délai.
Comment aborder les proches dans le cadre des catégories de Maastricht 1 et de Maastricht II ?
« En pratique, l’intervention des proches, structure non définie par la loi, leur attribue une responsabilité qu’ils n’ont pas réclamée. Tout se passe comme s’ils avaient connaissance d’un contrat du vivant, oral et encore valide après la mort qu’ils devaient transmettre » (876). Cette observation reflète les difficultés auxquelles sont exposées les équipes de coordination. La particularité de ces situations suppose un personnel formé à l’annonce de la mort, l’existence de locaux spécifiques et un entretien préparé et non improvisé. Le dialogue avec la famille sur le don d’organes a plusieurs dimensions. Les professionnels de santé ont une obligation d’information mais ils doivent tenir compte également des valeurs de la famille, de la variable affective et de la dimension symbolique attachée au don d’organe. Il est clair que la façon dont est conduite ce dialogue par l’équipe de coordination avec la famille est de première importance. (877)Le moment au cours duquel le prélèvement d’organes est abordé est évidemment crucial. Comme l’a rappelé le Professeur Bruno Riou, « les équipes de coordination des prélèvements d’organes s’interdisent de parler de prélèvement à la famille tant que le patient n’est pas en état de mort encéphalique avérée. » (878)
Les rapports avec les proches dans le cadre des donneurs des catégories Maastricht I et II ont été définis par les professionnels de santé. Un groupe de travail a abouti à des recommandations formulées en 2006 par SAMU de France et la Société française de médecine d’urgence (SFMU) pour aborder les proches des donneurs décédés après arrêt cardiaque. Pour Mme France Roussin, coordinatrice de dons d’organes, du service d’anesthésie-réanimation chirurgicale de l’hôpital Saint-Louis, l’information auprès des familles serait aujourd’hui totalement transparente : « On peut expliquer les choses très simplement et complètement, y compris la possibilité d’un éventuel don une fois arrivé à l’hôpital ». (879)
Le dispositif d’accueil des proches et de recueil de la non-opposition du défunt élaboré dans ces recommandations prévoit deux étapes : l’entretien avec les familles et la visite du défunt. L’entretien doit comprendre plusieurs éléments : l’annonce du décès par arrêt cardio-pulmonaire ; l’explication de la mise en place d’une réanimation ; des procédures de préservation des organes ; la recherche de la non-opposition du défunt sur le prélèvement d’organes. Le recueil de l’avis des proches se fait en les informant du délai incompressible pour la mise en place du matériel de perfusion permettant la préservation des greffons, lorsque le défunt de son vivant ne s’est pas inscrit sur le registre des refus. Par ailleurs ce protocole veille à ce que dès l’annonce du décès, le défunt puisse être vu par ses proches soit pendant la période très brève d’arrêt des manœuvres de réanimation, soit après la mise en place des techniques de préservation. Depuis février 2008 un groupe de travail de 20 personnes a été installé à la demande de l’Agence de la biomédecine pour prolonger cette réflexion sur la prise en charge des proches. L’accent devrait être mis dans un premier temps sur les entretiens avec les proches à domicile, ce cas de figure couvrant 20% des décès, la suite de la réflexion portant sur les entretiens relatifs aux décès à l’intérieur de l’hôpital.
Là encore il n’appartient pas au législateur d’interférer dans des pratiques qui relèvent de codes de bonne conduite à définir par les professionnels et l’ABM mais cette dimension est essentielle pour comprendre les enjeux de ce type de prélèvement.
Proposition n° 63. Définir, au sein de bonnes pratiques, les modalités des rapports avec les proches pour la mise en œuvre des prélèvements après arrêt cardiaque des catégories Maastricht I et II.
L’assistance circulatoire thérapeutique
On ne saurait aborder ces problèmes sans évoquer non plus les questions éthiques posées par l’assistance circulatoire thérapeutique sur les patients ayant subi un arrêt cardiaque. Avec cette technique le taux de survie est de 30% pour les arrêts cardiaques ayant une cause médicamenteuse. Un protocole défini à partir d’un certain nombre de critères a été élaboré par les sociétés savantes – y compris les pédiatres –sous la direction du Professeur Bruno Riou. Il a été diffusé et est très utile pour les équipes d’urgence. (880) Notons cependant que l’assistance circulatoire est une technique peu répandue en raison de ses exigences techniques mais efficace sous certaines indications identifiées.
B. LES PRÉLÈVEMENTS SUR DONNEURS VIVANTS
Les prélèvements sur donneurs vivants offrent l’avantage de pouvoir être programmés à l’avance, de diminuer les temps d’attente et de garantir de bons résultats à long terme, s’agissant en particulier de la greffe rénale. Les prélèvements autorisés et les plus fréquents sont le rein (222 en 2008), très rarement le foie et encore beaucoup plus exceptionnellement les poumons.
Les donneurs vivants recouvrent les donneurs apparentés, qu’ils aient des liens génétiques comme les parents et les enfants, les frères et les sœurs ou la famille élargie, ou qu’ils n’en aient pas, comme des époux ou des personnes vivant ensemble depuis un certain temps. L’extension du champ des donneurs vivants opérée en 2004 n’ayant pas été faite en conformité avec l’article 20 de la convention d’Oviedo et avec l’article 14 du protocole additionnel relatif à la transplantation d’organes et de tissus, il conviendrait à tout le moins que lors de la ratification de la convention, la France présente une réserve d’interprétation sur ce sujet tenant compte de la spécificité de son droit interne au regard de la convention.
Relèvent d’une deuxième catégorie les donneurs proches, sans lien génétique ni vie commune, des amis par exemple. À cet égard si le don entre amis ne se pratique pas en France, il est assez développé aux États-Unis. Viennent ensuite les dons croisés où une personne fait don d’un organe à un malade avec qui il est compatible et qu’il ne connaît pas, sachant que le proche de cette personne malade à qui il aurait souhaité donner son organe mais avec laquelle il n’était pas compatible, elle, recevra un organe d’un proche de la personne à qui la première aura fait son don. Cette technique a pour objet de permettre un don croisé entre deux couples donneur-receveur, lorsque le don n’est pas possible au sein de chaque couple en raison d’une incompatibilité de groupes sanguins ou pour des motifs immunologiques. Ainsi le donneur d’un couple A donne un rein au receveur d’un couple B et vice-versa s’il y a compatibilité par croisement entre les donneurs. Le prélèvement est opéré de manière simultanée. Cette pratique est de plus en plus courante en Corée du Sud, aux États Unis et au Japon. En Europe, elle est également permise en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En cinq ans aux Pays-Bas les dons croisés ont concerné 312 couples avec une greffe en donneur vivant compatible pour 129 receveurs. (881)
Il y a également la possibilité de don totalement altruiste et anonyme par des donneurs que les Anglo-saxons appellent « good Samaritans ». (882)
GREFFES RÉNALES DE DONNEURS VIVANTS EN 2007 –
COMPARAISONS INTERNATIONALES
France |
États-Unis |
Allemagne |
Espagne |
Italie |
Pays-Bas |
RoyaumeUni |
Belgique | |
Donneurs vivants |
236 |
6037 |
566 |
137 |
45 |
358 |
671 |
42 |
Rapport ensemble des greffes |
5% |
21,4% |
11,9% |
6,2% |
1,4% |
43,7% |
36,3% |
8,6% |
Comme le relève le Professeur Louis Puybasset, (883) il existe une corrélation entre le taux de donneurs vivants d’un côté et le taux d’état de mort encéphalique et entre le taux de donneurs vivants et le consentement explicite. Moins les donneurs en état de mort encéphalique sont nombreux, plus les donneurs vivants sont représentés. Cela se vérifie avec les exemples allemand, britannique et néerlandais, ces trois États pratiquant le consentement explicite sur les donneurs décédés.
Les greffes à partir de donneur vivant présentent des avantages et des inconvénients. L’une de ces qualités tient à la facilité théorique d’organisation, puisque le prélèvement et la greffe à suivre peuvent être programmés à jour et heure fixes. On constate également que les résultats sont meilleurs qu’avec des donneurs cadavériques, la durée d’ischémie (délai entre le prélèvement et la revascularisation) des organes étant beaucoup plus courte, l’état de santé des donneurs et la qualité des reins étant par définition optimale. La survie à 10 ans du greffon rénal est de 77 % contre 63 % avec donneur cadavérique. Si l’on compare les avantages procurés par la greffe rénale aux traitements substitutifs, ces bénéfices ne sont pas négligeables. Le patient n’est plus soumis aux astreintes de la dialyse ; les restrictions hydriques n’ont plus lieu d’être ; le patient peut reprendre une activité normale. « À long terme les analyses basées sur des questionnaires standardisés montrent que les malades greffés ont une qualité de vie comparable à celle de la population générale. Dans la majorité des cas, ils travaillent alors que beaucoup de dialysés ont réduit ou interrompu leur activité. » (884)
Une étude américaine conclut que 97 % parmi les 100 donneurs s’estimaient en bonne santé sur le plan physique, psychique et social 10 ans après le don. Avec le recul 87 % déclaraient ne pas regretter cet acte, que la greffe ait échoué ou réussi. (885)
L’inconvénient majeur de cette pratique réside dans un taux de mortalité certes très faible chez les donneurs mais qui n’est pour autant pas négligeable. Il serait de 1/2000 ou 1/3000 lors de l’opération ou dans ses suites immédiates pour les dons de rein mais il n’existe pas de statistiques vraiment fiables en Europe sur ce point. Pour les prélèvements de foie, le risque varierait entre 0,2 % pour le prélèvement d’un foie gauche et 0,5 % – 0,8 % en cas de prélèvement d’un foie droit. En France, deux donneurs de foie sont décédés respectivement en 2000 et 2007. Le risque médical n’est donc pas nul. Le taux de complication impliquant un traitement sans lequel le pronostic vital est en jeu est pour le donneur de 18 % pour le don du rein et de 42 % pour le donneur d’un hémifoie.
En 2008, l’activité de prélèvement sur donneur vivant a baissé de 6 % pour le rein et de 44 % pour le foie. Au cours de cette même année, 232 donneurs vivants ont fait l’objet d’un prélèvement dont 222 pour les reins et 10 pour le foie. La baisse pour le foie est particulièrement forte puisqu’elle est de 72 % en deux ans.
Les questions que soulèvent les prélèvements sur donneurs vivants peuvent être regroupées autour de quatre thèmes : la définition du champ du cercle de ces donneurs ; le caractère adapté ou non de la procédure applicable ; la prise en charge financière de ces dons et le suivi des donneurs et des receveurs.
1. Faut-il élargir le cercle des donneurs vivants ?
Il est un fait que l’élargissement de ce cercle par le décret d’application de la loi de 2004 n’a pas apporté le résultat escompté. Dans leur très grande majorité les donneurs appartiennent à la famille au premier degré du receveur, à savoir parents, enfants, frères et sœurs. En 2008 comme en 2006, les donneurs vivants de rein ou de foie sont essentiellement les pères et les mères (31 %), les frères et sœurs (37 %) et les conjoints (21 %). Les fils et filles représentent 5 % et les oncles, tantes et cousins 3 %. Faut-il en rester là ou sortir du cadre familial ? Comme le relève l’Agence de la biomédecine « la restriction du don d’organes au cercle familial ne se retrouve pas dans les pays scandinaves et anglo-saxons qui reconnaissent depuis de nombreuses années la possibilité de faire un don à toute personne ayant « des relations affectives étroites » avec le receveur. » (886)
Cette extension possible du champ des donneurs vivants à partir de critères affectifs difficiles à apprécier a rencontré toutefois peu d’échos lors des auditions de la mission. Des risques importants de pression psychologique ont été mis en avant. (887) Les associations se montrent également très réservées sur l’intérêt de cet élargissement au regard de ses inconvénients. Souscrivant à ces réticences, le Conseil d’État fait valoir qu’en l’état du droit la transplantation entre vivants présente des garanties de respect des principes éthiques, l’enjeu étant de mettre le donneur à l’abri de toute pression, de garantir le caractère autonome de son consentement et l’absence de contrepartie du don soit financière soit en nature. Au surplus on ne saurait surestimer l’importance des dons d’organes de proches n’appartenant pas au cercle familial.
L’expérience norvégienne est éclairante à cet égard. En Norvège, sont considérées comme « amis proches » les personnes amies depuis 5 à 10 ans sous réserve de pouvoir le justifier. Une étude couvrant la période de 1985 à 2002 a recensé 1.300 dons d’organes dans cet intervalle. Les donneurs vivants apparentés constituaient la majorité d’entre eux : 83 %. Les époux chez les donneurs – maris et femmes – représentaient 15 % et les donneurs vivants non apparentés seulement 1,6 %.(888)Pour citer un autre exemple, les donneurs vivants en dehors du milieu familial en Autriche doivent présenter un lien affectif fort et avéré. À l’inverse, certains praticiens ont fait observer que ce risque de pression psychologique était tout aussi réel à l’intérieur qu’à l’extérieur de la famille et qu’il convenait sans doute pour faire échec à ces pressions de réfléchir à un renforcement des procédures de contrôle à travers les comités « donneurs vivants » institués en 2004 et le magistrat du tribunal de grande instance compétent.
Si les principes éthiques précités peuvent être effectivement opposés à un élargissement du cercle des donneurs, ces arguments ont moins de poids au regard de la pratique des dons croisés. La France est avec le Portugal l’un des seuls pays à interdire en Europe cette pratique. Au regard des principes du libre consentement et de la gratuité, elle ne semble pas poser cependant de difficultés, dans la mesure où elle se déroule dans un cadre étroit où les parties prenantes ont des intérêts convergents. Un arrêt de la Cour de cassation sociale allemande exige des relations établies et fortes entre les donneurs et les receveurs notamment si des complications surgissaient a posteriori et considère que le risque de marchandisation du don n’est pas plus élevé dans ce cas que dans le droit commun.(889)
En Italie un registre national des dons croisés a été institué en 2006. Les participants sont sélectionnés sur la base de critères généraux ; une commission nationale vérifie que les conditions sont remplies ainsi que l’âge des bénéficiaires. Aux Pays-Bas depuis 2004 les greffes croisées n’auraient pas posé de problèmes. Aux États-Unis les dons croisés représentent environ 10 % du total des greffes rénales à partir des donneurs vivants. Au vu de ces expériences, on pourrait donc suggérer un élargissement de la législation française aux dons croisés, en confiant le contrôle du respect du libre consentement, de l’équivalence des âges et de la gratuité du geste au Tribunal de grande instance, l’anonymat étant préservé. Une telle extension ne nécessiterait pas de réserve d’interprétation au regard de la convention d’Oviedo lors de sa ratification. En effet l’article 10 de la convention prévoit l’hypothèse où donneur et receveur n’ont pas de « relations personnelles étroites ». Dans ce cas, elle autorise le don à la double condition que la loi en définisse les conditions (ce qui serait le cas) et qu’il soit consenti « après autorisation d’une instance indépendante ».
Proposition n° 64. Autoriser les dons croisés d’organes ayant fait l’objet d’un consentement préalable, exprès, libre et éclairé de chaque membre des deux couples sous le contrôle du Tribunal de grande instance, l’anonymat étant préservé.
2. La procédure actuelle faisant appel à des experts et à un magistrat est-elle adaptée ?
Depuis 2004, le statut de la personne donneuse a été renforcé. Les comités dits « donneurs vivants » ont reçu une double mission d’information et d’autorisation. Neuf comités « donneurs vivants » ont été créés par arrêté en métropole et répartis sur tout le territoire, l’Agence de la biomédecine en assurant le secrétariat au niveau régional pour harmoniser les pratiques entre ces structures. On rappellera que l’autorisation du comité « donneurs vivants » est obligatoire pour le cercle élargi et facultative sur décision du magistrat qui recueille le consentement, pour les donneurs admis par principe comme le père ou la mère. Les comités sont composés de 5 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé : trois médecins, une personne qualifiée en sciences humaines et sociales et un psychologue.
La procédure est la suivante : le comité « donneurs vivants » reçoit le donneur pour l’informer sur les risques qu’il encourt, sur les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du prélèvement, sur les répercussions éventuelles sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. Le comité s’assure que le donneur a bien mesuré tous les risques et les conséquences et répond à toutes ses questions. Le donneur est ensuite entendu par un magistrat du tribunal de grande instance qui s’assure que son consentement est libre et éclairé. En introduisant cette précision en 2004, le législateur a souhaité que le magistrat remplisse un rôle qui aille au-delà d’un simple enregistrement de la volonté du donneur et vérifie notamment l’absence de chantage ou de marchandage. Le donneur effectue une demande d’autorisation auprès du comité qui prend une décision soit d’autorisation, soit de refus d’autorisation du prélèvement. Aucun recours n’est prévu en cas de refus de l’autorisation, le comité n’ayant pas à motiver sa décision. Cette absence de motivation est justifiée par le souci de protéger le donneur des pressions qui ne manqueraient pas de s’exercer sur lui dès lors que les motivations du refus seraient connues. (890)
En 2008, 236 autorisations ont été délivrées par les comités et 7 refus de prélèvement ont été enregistrés.
On peut se demander si cette procédure ne pêche pas par sa lourdeur et si notamment l’intervention du président du TGI est justifiée, alors que les experts ont déjà entendu le donneur. Les experts ne pourraient-ils pas s’assurer de la liberté de ce consentement ? En outre n’y a-t-il pas matière à s’interroger sur la logique d’une procédure où le comité prend une décision quel que soit l’avis du magistrat ? Tout en étant conscient des inconvénients de cette procédure, votre rapporteur estime toutefois que l’implication d’un juge doit être perçue comme une garantie destinée à protéger les donneurs et, de ce fait, doit être maintenue. Madame la garde des sceaux a proposé devant la mission parlementaire que dans des situations d’urgence un magistrat du parquet puisse recueillir le consentement du donneur à la place du magistrat du siège. (891) Cette procédure s’inspirerait de celle applicable aux prélèvements de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse régie par l’article L. 1241-1 du code de la santé publique. Toutefois, dans le cas des dons d’organe entre vifs, le caractère d’urgence n’est pas apparu justifié aux membres de la mission, qui ont insisté sur la nécessité de sensibiliser encore davantage les magistrats du siège à la problématique des dons d’organes.
La composition des comités « donneurs vivants » pourrait être revue. L’Agence de la biomédecine oriente sa réflexion sur le sujet vers une division des comités en deux collèges, l’un composé de représentants de la société civile, l’autre formé d’experts médicaux. Votre rapporteur souscrit à cette proposition justifiée par le souci de séparer ce qui relève de l’éthique de l’évaluation médicale. Dans ce cadre, on pourrait envisager une collaboration entre l’ABM et les sociétés savantes.
Proposition n° 65. Diviser la composition des comités « donneurs vivants » en deux collèges, l’un composé d’experts et l’autre de représentants de la société civile.
3. La prise en charge financière des donneurs vivants est-elle satisfaisante ?
Il ne saurait être question de remettre en cause la gratuité du don d’organe. Celle-ci ne fait pas débat, alors même qu’il existe un véritable marché international du don d’organes. En effet, l’achat d’organes, principalement le rein porterait sur 5 à 10 % des greffes dans le monde. En Europe, plus de 40 000 européens attendent un rein en moyenne pendant trois ans. Les donneurs vivants contre rétribution ont été recrutés ces dernières années en Bulgarie, Géorgie, Moldavie, Roumanie, Russie et en Ukraine, les intéressés ne bénéficiant d’aucun suivi médical. (892) Par nature, les donneurs sont recrutés dans les pays et dans les classes sociales les plus pauvres ou parmi les personnes les plus vulnérables. Une agence comme « Overseas medical services » au Canada propose des transplantations avec des donneurs pakistanais pour 25 000 €. En Chine d’après Amnesty International, le prix d’une cornée prélevée sur le cadavre d’un condamné à mort est estimé à 15 000 €, un rein à 20 000 € et un foie à 40 000 €. (893) On assisterait dans ce pays à une explosion du nombre de donneurs vivants s’expliquant par l’apparition de « revendeurs d’organes » qui s’arrangent pour faire du donneur et du receveur de « faux parents », avec la complicité des administrations et de personnels médicaux. Ce marché perpétue la vente d’organes et attire toute une population.(894)Au demeurant, les données médicales sur les receveurs et les donneurs sont peu nombreuses.
Un rapport du Parlement européen de mars 2008 invite les États membres à veiller à ce que les compagnies d’assurance ne remboursent pas les frais résultant de transplantation illicite d’organes sur un territoire étranger. L’Agence de la biomédecine estime à 30 le nombre de patients greffés dans ces conditions entre 2000 et 2008. Il s’agit de résidents d’origine étrangère qui ont intégré des filières de leur propre pays d’origine. On ne peut que rejoindre le professeur Yves Chapuis qui, dans son rapport pour l’Académie nationale de médecine, suggère d’inviter les spécialistes à apporter leur concours scientifique, médical et technique pour faire reculer ces pratiques dans les pays qui ne respectent pas les droits de l’homme et ne proscrivent pas ces activités. L’OMS invite de son côté les médecins et professionnels de santé à récuser toute participation à des activités lucratives de ce type : « Les médecins et les autres professionnels de santé ne doivent participer à aucune des phases des transplantations et les compagnies d’assurances et autres bailleurs de fonds ne doivent pas couvrir ces procédures, si les cellules, tissus ou organes concernés ont été obtenus par des moyens relevant de l’exploitation ou de la coercition, ou moyennant le paiement d’une somme d’argent à un donneur vivant ou à la famille d’un donneur décédé. » (895)
Si la gratuité du don reste un principe cardinal, il faut se réjouir qu’une meilleure prise en charge financière des dépenses des donneurs ait été mise en place récemment dans notre pays. Le décret n° 2009-217 du 24 février 2009 a modifié en effet le dispositif de prise en charge financière des frais engagés à l’occasion du prélèvement d’organes ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques essentiellement sur trois plans : il a supprimé l’anonymat du donneur vivant dans les relations entre les établissements de santé et les caisses d’assurance maladie afin que les premiers puissent adresser aux secondes les demandes de prise en charge des donneurs; il a exonéré du ticket modérateur les frais d’examen, de traitement, d’hospitalisation, de soins et de suivi des soins liés au prélèvement. Il a fait passer du double au quadruple le plafond d’indemnisation de la perte de rémunération. Ce dispositif respecte les principes posés par l’OMS en la matière : « L’interdiction de la vente ou de l’achat de cellules, de tissus ou d’organes n’empêche pas de rembourser dans des limites raisonnables les frais vérifiables encourus par le donneur, y compris les pertes de revenu ou de régler les dépenses liées au prélèvement, au traitement, à la préservation et à la mise à disposition de cellules, de tissus ou d’organes humains aux fins de transplantation. » (896)
Plusieurs questions restent toutefois pendantes.
– La prise en charge médicale des complications de santé des donneurs vivants continue de se poser.
Le pouvoir réglementaire pourrait améliorer la prise en charge par l’assurance maladie des donneurs vivants. Si les intéressés bénéficient de la gratuité des soins au titre de l’article R. 322-9 du code de la sécurité sociale, il n’est pas précisé que la prise en charge des complications postérieures au don est appelée à se poursuivre et dans la pratique des hôpitaux ne couvrent que les frais de l’hospitalisation initiale. La prise en charge de ces complications varie en réalité d’un hôpital à l’autre. Il serait donc souhaitable que cette prise en charge pour les complications liées au don ait un caractère permanent.
Proposition n° 66. Assurer tout au long de la vie une prise en charge des complications médicales pouvant intervenir postérieurement au don pour les donneurs vivants.
– Le remboursement des frais d’hébergement, de transport et, le cas échéant, de la perte de rémunération des donneurs au titre de l’article R. 1211-2 du code de la santé publique incombe aux établissements de santé effectuant le prélèvement. Aucune disposition ne prévoit le délai dans lequel ce remboursement doit intervenir. Celui-ci est donc laissé à la discrétion des établissements concernés.
Or, comme le constate l’Agence de la biomédecine, les délais de remboursement sont très longs. Il serait souhaitable que pour accélérer ces remboursements, la notion de délai de remboursement soit introduite dans la loi et que le délai lui-même soit fixé par voie réglementaire.
Proposition n° 67. Introduire la notion de délai de remboursement des frais d’hébergement et de transport pour les donneurs vivants dans la loi et fixer ce délai dans un texte réglementaire.
Les complications médicales susceptibles de se produire plusieurs années après le prélèvement ne sauraient être indemnisées au regard du principe du consentement libre et éclairé du patient.
Aujourd’hui la responsabilité des professionnels de santé est engagée en cas d’aléa thérapeutique à l’occasion d’un prélèvement d’organe sur un donneur vivant dans l’une des hypothèses évoquées par l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, à savoir dommage occasionnel par la survenue d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale. L’accident médical est généralement défini comme un « événement imprévu causant un dommage sans rapport avec l’état initial du patient ou son évolution prévisible ». Hormis l’accident médical, les complications immédiates et les cas de responsabilité pour faute, on peut envisager des complications physiques à long terme, des troubles psychiatriques.
Deux lectures du droit en vigueur peuvent être envisagées : considérer ces complications comme un risque normal, une séquelle prévisible dont le donneur vivant a été informé au préalable et qui peuvent donner lieu à une indemnisation, puisqu’un donneur vivant est supposé ne subir, en théorie, aucun préjudice physique, psychologique ou moral à la suite du don ; estimer au contraire que la personne a donné son consentement libre et éclairé et a été informée a priori des risques encourus et des conséquences du prélèvement. C’est l’opinion du Conseil d’État qui juge que « le caractère libre et éclairé du consentement, contrôlé par le juge et délivré après une information préalable, fait obstacle à la mise en jeu des mécanismes classiques d’indemnisation ».
Votre rapporteur suggère de ne pas revenir sur la définition des rapports entre le consentement éclairé et le droit à réparation de la perte de chance. En revanche, il recommande d’améliorer la couverture maladie des donneurs qui n’en bénéficient pas et de garantir de manière pérenne la couverture médicale à 100% de ces donneurs.
Comme le suggère le rapport du professeur Yves Chapuis devant l’Académie nationale de médecine, l’altération de l’intégrité corporelle liée au don ne devrait pas interdire au donneur la couverture assurantielle à laquelle il peut vouloir recourir (897). Dans sa contribution au colloque organisé par le ministère des affaires étrangères et européennes sur la diversité des stratégies de lutte contre la pénurie d’organes en Europe, l’association « Demain la greffe » milite pour écarter l’application de la convention AERAS (« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») au cas d’espèce en le précisant dans la loi. En l’état cette convention négociée entre les pouvoirs publics, les professionnels, les associations de consommateurs et les associations représentant des personnes malades et handicapées ne fait pas référence aux donneurs vivants.
On peut contester au demeurant l’opportunité de soumettre les donneurs vivants à la convention AERAS. D’aucuns font observer non sans raison que les personnes concernées, à savoir essentiellement des donneurs de reins ne présentent pas de risque aggravé voire même sont des personnes qui présentent par définition peu de risques en raison de la sélection dont ils ont fait l’objet. Par ailleurs, cette population ne saurait être comparée à celle couverte par l’AERAS. La première concerne des effectifs très réduits alors que la seconde recouvre les malades porteurs du VIH et devrait s’étendre à toute personne présentant un risque de santé aggravé du fait d’une maladie ou d’un handicap.
4. Comment assurer un suivi des receveurs et des donneurs et exprimer la reconnaissance de la collectivité ?
À l’instar de ce qui se passe en Italie et au Royaume-Uni mais contrairement au droit allemand, hongrois et portugais, en France les donneurs vivants font l’objet d’un suivi. L’article R. 1418-3 du code de la santé publique confie à l’Agence de la biomédecine le soin de suivre l’état de santé des personnes ayant fait un don d’organes. Pour remplir cette mission l’agence dispose d’un répertoire. Les porteurs du virus de l’hépatite B ou C ayant fait l’objet d’un régime dérogatoire font, quant à eux, l’objet d’un suivi particulier.
À partir d’une étude réalisée sur des donneurs de foie le rapport présenté devant l’Académie nationale de médecine souligne les réactions parfois négatives des donneurs. Il décèle plusieurs symptômes chez ces personnes : « sentiment de n’avoir pas fait l’objet d’une attention suffisante contrairement à l’attitude affichée auprès du receveur par les professionnels de santé, souffrance physique découverte et mal assumée, changement relationnel avec l’entourage, éloignement affectif voire conflit avec le receveur ». (898) Derrière ce constat se profile toujours l’ambiguïté du don avec sa double dimension individuelle et altruiste.
Il n’en demeure pas moins qu’en dehors des séquelles médicales éventuelles qui peuvent affecter le donneur l’attention de l’Agence de la biomédecine devrait également se porter sur le volet psychologique du don.
Même si cette problématique dépasse le cadre des donneurs vivants, l’aspect psychologique du don soulève la question de sa reconnaissance par la collectivité. La loi de 2004 a prévu la création de « lieux de mémoires » au sein des établissements hospitaliers autorisés à prélever (Art. L. 1233-3 du code de la santé publique). Or lorsqu’ils existent, ces lieux sont rarement identifiables en tant que tels. Aménagés la plupart du temps dans des enceintes hospitalières, ils s’avèrent peu accessibles. La portée symbolique de cette mesure est donc très limitée. La reconnaissance de la Nation à tous les donneurs d’organes doit être accrue. Faut-il envisager une reconnaissance individuelle ou s’engager dans une démarche collective destinée à contribuer à mieux promouvoir la culture du don dans notre pays ? « Demain la greffe » suggère d’ériger un monument national appelé à être plus connu que les « lieux de mémoire » des hôpitaux. À tout le moins, il serait normal que cette reconnaissance de la collectivité puisse s’exprimer par une lettre du représentant de l’État dans le département adressée à la famille.
C. LES GREFFES DE TISSUS COMPOSITES
L’Agence de la biomédecine assure le suivi des greffes de tissu. Si une greffe de rein, de foie ou de cœur consiste à transplanter du tissu rénal, hépatique ou cardiaque, une greffe composite associe des tissus comme la peau, les muscles, les os, les nerfs, la moelle. La première greffe de main remonte à 1964. En 2000, notre ancien collègue le Professeur Jean-Michel Dubernard a réalisé la première double greffe bilatérale des avant-bras à Lyon. La première greffe simultanée des deux mains et de la face a été effectuée en 2009 chez un patient victime de brûlures.
Si, en vertu de l’article L. 1243-6 du code de la santé publique les greffes composites de tissus vascularisés sont assimilées aux greffes d’organes et relèvent des mêmes dispositions, la greffe des tissus composites présente quelque spécificité. En effet, l’échec d’un transplant vital implique un retour à la situation antérieure, alors que l’échec d’une allogreffe peut conduire à une aggravation de la situation antérieure. Dans son avis du 6 février 2004, le Comité consultatif national d’éthique considère que l’allogreffe de la face relève encore de la recherche et doit être strictement encadrée : « La possibilité d’une allogreffe de tissus composites partielle reconstituant le triangle bouche-nez qui redonne une certaine identité morphologique au visage relève encore du domaine de la recherche et de l’expérimentation à haut risque. Elle ne saurait être présentée comme une solution prochaine accessible et idéale pour les douloureux problèmes des altérations du visage. Et si celles-ci devaient être envisagées, elles ne devraient l’être que dans le cadre d’un protocole précis multi-disciplinaire et multicentrique, soumis pour accord à l’Établissement Français des Greffes ou à d’autres instances ayant les mêmes attributions. »
Les comités de protection des personnes sont consultés sur ce type d’opérations en vertu de l’article L. 1123-6 du code de la santé publique. L’avis de l’ABM est aussi sollicité. Jusqu’à maintenant les projets d’allogreffe ont été définis dans des protocoles présentés à l’AFSSAPS, sachant que le comité qui les examine y associe des membres de l’ABM. Par exemple pour les allogreffes de la face les membres de l’ABM sont détachés pour faire partie des comités d’experts de l’AFSSAPS. On ne peut qu’adhérer à la position exprimée par le CCNE et à l’encadrement juridique existant.
D. LES GREFFES DE CELLULES SOUCHES
Même si elles obéissent depuis 2004 à un régime juridique particulier, les cellules souches hématopoïétiques (CSH) peuvent être rapprochées des prélèvements d’organes dans la mesure où ces deux variétés de prélèvement obéissent à la même finalité.
1. Le statut des greffes de cellules souches hématopoïétiques
Les cellules souches hématopoïétiques sont à l’origine des cellules sanguines. Elles proviennent du sang placentaire ou de la moelle osseuse. Les CSH issues du sang placentaire sont prélevées dans les cordons ombilicaux recueillis après la naissance dans les maternités associées aux banques de sang placentaires publiques ou privées. Les CSH de la moelle osseuse sont prélevées avant la greffe sur des donneurs intrafamiliaux ou inscrits sur un fichier de volontaires français ou étrangers. La greffe de moelle osseuse peut guérir des maladies graves du sang comme les leucémies, le lymphome non Hogkinien, les aplasies médullaires ou les déficits immunitaires congénitaux chez l’enfant. (899) Le prélèvement s’effectue soit directement dans la moelle osseuse soit dans le sang périphérique, c’est-à-dire le sang qui ne se trouve pas dans les organes participant à la formation du sang. La première greffe de sang placentaire a eu lieu en 1988 sur un enfant atteint de la maladie de Fanconi, maladie héréditaire de la moelle osseuse. Les indications thérapeutiques des greffes de CSH sont les pathologies malignes du sang et des pathologies non malignes.
Le prélèvement est qualifié d’allogénique lorsqu’il est destiné à quelqu’un d’autre que la personne sur laquelle il est effectué, qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’une personne étrangère dans le cadre d’un don anonyme. Il est défini comme autologue lorsque les propres cellules du receveur sont prélevées et réinjectées.
Les prélèvements de sang de cordon à usage autologue sont exclusivement proposés par des entreprises privées situées en dehors du territoire français, les plus importantes étant Cryo Save et Future Health alors que les banques allogéniques sont publiques. L’autorisation de création des banques allogéniques publiques est délivrée par l’AFSSAPS après avis de l’ABM (art. L. 1243-2 du code de la santé publique). Sur un total de 4 423 greffes en 2008, on comptait 2 951 greffes autologues et 1 472 greffes allogéniques, ces proportions étant relativement stables depuis 2006. Les 1 472 greffes allogéniques se répartissent ainsi : 789 greffes de sang périphérique, 437 greffes de moelle osseuse et 246 greffes de sang placentaire. Depuis 2004, la source principale des greffons allogéniques est le sang périphérique. L’âge moyen des patients est de 38 ans.
Dans le cas d’un usage autologue du sang de cordon, il s’agit de prélever et de conserver du sang de son nouveau-né au cas où celui-ci en aurait ultérieurement besoin lors d’une maladie. Quelles sont les situations auxquelles cela renvoie ? Soit les personnes sont en bonne santé, il n’y a aucune pathologie génétique particulière dans la famille et les parents assimilent ce geste à une assurance-vie pour leur enfant. Soit les personnes savent qu’il existe dans leur famille certaines pathologies transmissibles.
Il ressort tant des auditions de la mission que de l’analyse du droit et des pratiques existantes que la problématique des greffes de cellules souches hématopoïétiques soulève plusieurs questions : faut-il ouvrir ou non des banques autologues ? Doit-on développer les banques allogéniques ? Convient-il de réformer les règles du consentement des prélèvements ainsi que le régime de l’importation et de l’exportation de ces cellules ?
2. Faut-il autoriser ou interdire les banques autologues ?
Dans son rapport sur l’application de la loi de 2004, l’ABM invite le législateur à prendre position sur les banques autologues de sang placentaire.
Il convient toutefois au préalable de s’interroger sur les vertus médicales des prélèvements autologues. S’agissant des maladies hématologiques l’intérêt médical de l’utilisation de sang de cordon autologue est contesté à plusieurs titres :
– des cellules peuvent être malades dès la naissance et donc congelées avec le sang placentaire conservé et réinjectées lors de l’éventuelle greffe ;
– le greffon ne présente aucune activité immunologique contre la maladie.
Les mêmes réserves peuvent être opposées aux maladies génétiques, en présence de cellules malades à la naissance.
Quant à l’utilisation de ces cellules pour la médecine régénérative on sait que l’on peut faire appel à d’autres cellules que les seules cellules de sang placentaire, comme les cellules souches embryonnaires cultivées in vitro ou les cellules iPS.
Les chercheurs entendus par la mission ont affiché dans leur ensemble un grand scepticisme à l’égard des banques autologues qui, à leurs yeux, promettent des choses « pour l’heure totalement incertaines » (900).
Non seulement ces banques autologues s’apparenteraient pour l’heure à des paris sur l’avenir mais elles appellent de nombreuses questions comme l’a relevé le docteur Marc Benbunan, chef du service Biothérapies cellulaires et tissulaires à l’hôpital Saint-Louis : « Une unité de sang de cordon préparée aujourd’hui aura-t-elle conservé toutes ses propriétés dans cinquante ans ? Le sachet de conditionnement résistera-t-il aussi longtemps ? Les cellules recherchées qui, à l’horizon de vingt ans, paraissent avoir conservé tout leur potentiel, l’auront-elles encore au-delà ? À supposer qu’elles aient survécu à une aussi longue congélation, pourra-t-on les extraire facilement ? Si l’on souhaitait prélever du sang de cordon sur chaque nouveau-né, je vous laisse imaginer la logistique nécessaire avec 800 000 accouchements par an dans notre pays ! Au total, hasardeux sur le plan médical, le prélèvement à grande échelle de sang de cordon à usage autologue est quasiment impossible à réaliser sur le plan matériel. » Dans un communiqué du 8 décembre 2009, la société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire ainsi que la société française d’hématologie invitent à la vigilance sur les sociétés privées incitant à la conservation de sang de cordon à visée autologue.
À ces arguments d’ordre médical que l’on peut opposer à la création de banques autologues peuvent être ajoutés des arguments d’ordre éthique qui ont été avancés par le Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 2007. On peut craindre en effet que la création de sociétés commerciales proposant la conservation de sang placentaire à des fins autologues ne heurte l’exigence de solidarité sur laquelle est fondé notre système de santé et qu’avait rappelée le CCNE dans son avis n° 74 en 2002. Si leur accès était rendu gratuit, il pèserait sur le financement public des soins et « serait d’un coût démesuré », pour reprendre l’expression du CCNE. Le cantonnement de ces banques aux seules personnes pouvant y contribuer financièrement irait également à l’encontre du principe de l’égal accès aux soins.
Aujourd’hui, en France, les banques autologues ne sont pas interdites mais l’AFSSAPS ne délivre aucune autorisation faute d’indication thérapeutique. Faut-il pour autant les interdire expressément ? Plusieurs éléments doivent être pris en considération. L’information délivrée par ces banques autologues serait souvent incomplète voire inexacte. Le professeur Éliane Gluckman a indiqué ainsi que des promesses laissaient accroire que le sang de cordon permettait de guérir pratiquement toutes les maladies. (901)
Dans ce débat, comment se situe la France par rapport aux autres pays ? Nos voisins européens semblent moins sensibles que nous à ces incertitudes scientifiques et à ces risques de dévoiement commercial. Banques privées et banques publiques coexistent en effet en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les banques privées sont autorisées en Espagne et en Italie. Elles sont interdites depuis peu en Belgique.
Par ailleurs il existe actuellement en Europe et aux États-Unis des entreprises commerciales qui prélèvent et stockent des prélèvements, soit dans la seule optique d’un usage autologue, soit pour un usage « solidaire » avec un remboursement des frais de conservation si le sang de cordon est utilisé pour un malade. En Espagne, les banques autologues font l’objet d’une autorisation, afin que les prélèvements puissent figurer sur le registre des greffons allogéniques et afin que si un greffon se révèle utile pour d’autres malades, il puisse être racheté au donneur ou que celui-ci soit obligé de le donner. L’expérience espagnole de banque mixte ne semble pas cependant avoir été concluante, dans la mesure où il apparaît difficile de faire coexister dans une même banque des prélèvements payants et des prélèvements à fins de don anonyme et gratuit. En Italie les décrets d’application de la loi votée le 27 février 2008 permettant la conservation autologue solidaire n’ont pas été pris. Il semble également que les projets de banques européennes solidaires soient au point mort.
Au vu de ces données, deux options sont possibles pour le législateur :
– interdire formellement les banques privées autologues ; d’aucuns craignent cependant qu’une interdiction expresse ne favorise des circuits alternatifs que l’on ne maîtriserait pas. (902)
– maintenir la situation actuelle au risque de voir se développer des banques privées sans aucun contrôle qualitatif mais cette formule ménagerait en même temps l’avenir. S’il n’y a pas, en effet, d’indication thérapeutique aujourd’hui pour le sang de cordon autologue, on ne peut exclure cependant des découvertes dans les prochaines années. Une personne faisant autorité comme le professeur Éliane Gluckman considère que les prélèvements autologues pourraient peut-être avoir à terme un intérêt pour la médecine régénérative.
En l’état les preuves de l’utilisation autologue des cellules de sang de cordon relèvent de la recherche fondamentale. Il n’existe aucun travail scientifique en cours permettant de déboucher sur une nouvelle thérapeutique à base de cellules souches placentaires. (903) Interrogée sur l’intérêt à voir se développer la conservation de sang autologue, Mme Roselyne Bachelot a exprimé les plus vives réserves vis-à-vis de cette perspective devant les membres de la mission : « La proposition de loi de votre collègue Damien Meslot (904)visant à autoriser des banques de sang de cordon à usage autologue comme les offensives auxquelles on assiste de la part de certaines banques privées, à la limite de la légalité, sont contraires à la législation actuelle , aux données médicales et in fine au principe de solidarité , puisque seraient égoïstement détournées d’une conservation utile à des fins allogéniques des prélèvements appelés à ne servir à rien puisqu’il n’y a pas d’indication médicale d’usage autologue » (905). Cette situation invite donc à la prudence tout en ne se privant pas de la possibilité de tirer avantage de ces recherches le jour où leur intérêt ne sera plus mis en doute.
Proposition n° 68. Inviter l’ABM à mener des campagnes d’information afin de mettre en garde le grand public contre les publicités faites en faveur de la conservation autologue du sang de cordon dont l’intérêt thérapeutique n’est en l’état pas prouvé .
3. Faut-il développer les banques allogéniques de sang placentaire?
À la différence des greffes autologues, les greffes allogéniques ont des indications hématologiques reconnues et validées. Le recours à une greffe de sang de cordon allogénique a été admis dans le cas des leucémies aiguës de l’adulte et de l’enfant et des hémopathies malignes. La greffe de sang allogénique est également indiquée dans le cas d’hémopathies génétiques non malignes. La promotion des banques allogéniques est soutenue par nombre d’instances, qu’il s’agisse de l’Académie nationale de médecine dans son avis du 19 novembre 2002, du CCNE dans son avis 74 du 12 décembre 2002, du Groupe européen d’éthique, de la Commission européenne dans son avis de mars 2004, de la World Marrow Donor Association dans une position de mai 2006, des recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie de janvier 2007 et du conseil scientifique de l’ABM dans son avis de novembre 2007 .
Comme l’a souligné notre collègue sénatrice Mme Marie-Thérèse Hermange dans un rapport sur le sang de cordon très documenté (906), la France n’exploite cependant pas dans des conditions optimales les ressources du sang de cordon, alors que les greffons issus du sang de cordon présentent l’avantage d’être immédiatement disponibles et qu’ils ne posent pas de problèmes de compatibilité pour le receveur. En termes de nombre d’unités de sang de cordon disponibles par habitant, la France se situe au seizième rang derrière des pays aussi divers que la Corée du Sud, située à la première place, l’Australie, la Belgique, la Finlande, l’Espagne, Israël, les États-Unis, Singapour, l’Allemagne, le Japon et la République tchèque. Si la France ne dispose aujourd’hui que d’un stock de 7 000 unités placentaires, conservées dans quatre banques publiques (Besançon, Bordeaux, Marseille et Paris Saint-Louis), suite à un appel d’offre lancé par l’Agence de la biomédecine, l’Établissement français du sang a créé une nouvelle banque de sang dans la région Rhône-Alpes en partenariat avec les Hospices civils de Lyon. Une banque devrait ouvrir également très prochainement à Créteil. Les besoins sont cependant estimés à 50 000 unités, l’ABM s’étant fixée un objectif de 10 000 greffons pour 2010. 77 % des greffons de CSH bénéficiant aux patients nationaux proviennent de donneurs non apparentés internationaux et 23 % sont des greffons nationaux. Les greffes françaises sont faites à partir de donneurs européens dont le type caucasien répond aux considérations immuno-génétiques de la compatibilité HLA. Mais il faut savoir qu’un greffon coûte 2 000 €, alors que s’il est acheté à l’étranger, il coûte 25 000 €. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ce retard de la France.
– Des professionnels font valoir que celui-ci est le résultat de choix délibérés. Les créateurs du réseau en 1999 ont imposé des normes de qualité exigeantes afin de disposer d’unités riches sur le plan cellulaire. La responsable des tissus et cellules de l’établissement français du sang, Mme Isabelle Desbois observe : « 30 % des unités prélevées sont inscrites sur le registre France Greffe de moelle. Si nous avions stocké toutes les unités collectées depuis 1998, ce stock atteindrait 25 000 unités. La qualité des unités est essentielle car le premier critère international de choix des greffeurs au-delà de la compatibilité HLA – Human leucocyt antigen – porte sur la richesse cellulaire. » (907)
– Une insuffisance de moyens budgétaires est également à déplorer. Cette préoccupation a été relayée par certains scientifiques, qui ont regretté que l’ABM ne dispose pas de moyens suffisants en la matière, plus les stocks étant importants plus l’investissement pouvant être amorti facilement. (908)
De fait, les professionnels et le Conseil d’État se rejoignent pour plaider en faveur d’une hausse des moyens dédiés à cette cause. Dans le cadre du Plan cancer 2009-2013, il est prévu d’améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer et de lancer un programme d’action en direction des adolescents. A ce titre la mesure 23-5 du plan envisage de financer l’augmentation de la conservation des unités de sang de cordon dont peuvent bénéficier les patients atteints de pathologies malignes ayant une indication de greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. Une dotation de 3 millions d’euros serait allouée à cette action en 2010 et devrait atteindre 10 millions d’euros en 2011. Par ailleurs, 2, 4 millions d’euros sont inscrits en 2010 sur le budget de l’ABM pour les crédits consentis aux banques de sang de cordon, chiffre à comparer aux 700.000 € accordés les années précédentes.
Un des moyens de développer le sang de cordon consisterait à faire davantage appel aux maternités. Alors qu’il y a 800 000 naissances par an on ne réalise dans ce cadre que 1 000 prélèvements. Seules huit maternités sont habilitées à collecter du sang de cordon. Or cette collecte semble d’autant plus facile que les jeunes mères, lorsqu’elles sont sollicitées, acceptent presque toutes le don. (909) Au surplus, l’augmentation du nombre de maternités concernées permettrait de couvrir une population plus diversifiée et, par conséquent, de pouvoir soigner davantage de personnes compatibles. Un arrêté du 14 septembre dernier permet de mieux garantir la qualité des prélèvements en instituant une autorisation pour les maternités habilitées à les pratiquer, les sages-femmes recevant à cet effet une formation ad hoc.910
Il serait souhaitable que l’ABM engage une réflexion en ce sens. En tout état de cause l’agence doit développer le registre national et optimiser le niveau de typage des donneurs dès leur inscription.
Proposition n° 69. Développer les banques allogéniques de sang placentaire.
4. Faut-il modifier le régime juridique du consentement des prélèvements des cellules souches hématopoïétiques ?
Les cellules souches hématopoïétiques (CSH) issues du sang placentaire sont utilisées pour réaliser des greffes allogéniques dans le traitement de maladies malignes hématologiques ou de certaines maladies génétiques tout comme les cellules souches de la moelle ou du sang périphérique.
Suivant qu’ils affectent la mœlle osseuse, le sang périphérique ou le sang placentaire, les prélèvements obéissent aux règles suivantes :
– Les règles régissant les prélèvements de la moelle osseuse sont définies aux articles L. 1241-1 et L. 1242-2 du code de la santé publique. Ces prélèvements en vue d’un don à des fins thérapeutiques ne peuvent avoir lieu qu’à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt, ait exprimé son consentement devant le président du TGI ou son représentant, ceux-ci devant s’assurer du caractère libre et éclairé de ce consentement, le parquet étant compétent en cas d’urgence vitale et le consentement étant révocable à tout moment. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs et aux majeurs faisant l’objet d’une protection légale. Cependant, par dérogation à cette dernière règle en l’absence d’autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur. Par ailleurs, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sur les personnes protégées obéit à des règles particulières.
L’autorisation de prélèvements issus de la moelle osseuse provenant de donneurs mineurs est accordée par un comité d’experts. Celui-ci doit s’assurer au préalable que tous les moyens ont été consentis pour trouver un donneur majeur compatible.
– Les prélèvements des cellules hématopoïétiques dans le sang périphérique en vue d’une utilisation thérapeutique sont subordonnés au consentement écrit du donneur (Art. R. 1221-5). Aucun prélèvement n’est possible sur un mineur ou sur une personne faisant l’objet d’une mesure de protection légale sauf urgence thérapeutique.
– S’agissant des prélèvements de sang placentaire, ceux-ci sont assimilés aux résidus opératoires régis par l’article L. 1245-2 du code de la santé publique. Le prélèvement de sang opératoire en tant que résidu opératoire ne nécessite pas d’autorisation spécifique des établissements et la personne opérée ne peut s’y opposer expressément que si elle a été informée au préalable des finalités de l’utilisation du prélèvement. En d’autres termes, aucun consentement explicite du donneur n’est exigé.
Cette originalité du statut des prélèvements de sang placentaire soulève des questions juridiques et éthiques.
Sur un plan juridique, on peut s’interroger sur la conformité au droit communautaire et à la convention d’Oviedo de ce statut particulier des cellules hématopoïétiques issues du sang placentaire. L’article 13 de la directive 2004/23 du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains autorise le prélèvement de tissus ou de cellules humains, si les exigences obligatoires en matière de consentement en vigueur dans l’État membre sont satisfaites.
L’article 19, alinéa 2 de la convention d’Oviedo impose de son côté un consentement spécifique sans faire de distinction entre les prélèvements d’organes et les prélèvements de tissus. Son article 22 requiert des procédures d’information appropriées et le consentement pour une conservation et une utilisation dans un but autre que celui pour lequel la partie du corps a été prélevée. Interrogée par votre rapporteur sur la conformité de notre législation à la convention d’Oviedo, Madame la garde des sceaux a assimilé l’expression de la non opposition de la personne à un consentement(911). Or si cette interprétation du critère du consentement est applicable à la convention d’Oviedo, elle l’est a fortiori pour la directive européenne qui est moins précise.
Ces analyses conduisent à constater qu’entre ces trois types de greffons la différence de régime de consentement tient plus au degré d’expression de la volonté qu’à la nature du consentement. On touche là à la variété des différentes formes du consentement libre et éclairé, qui va du consentement présumé à la vérification de son caractère libre et éclairé par un magistrat du siège en passant par la simple information du donneur (912). L’absence d’opposition implique en tout état de cause une information imposée par les article L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique.
Ce point de vue juridique n’épuise pas pour autant le débat. On peut en effet se demander si d’un point de vue éthique il ne serait pas légitime de soumettre à des exigences de consentement équivalentes à celles des autres cellules souches hématopoïétiques les cellules du sang placentaire. Elles sont utilisées en thérapeutique pour réaliser des greffes allogéniques dans le traitement de maladies malignes hématologiques ou de certaines maladies génétiques tout comme les CSH de la moelle et du sang périphérique. Par ailleurs, s’agissant de cellules souches, ne serait-on pas fondé à les soumettre à un régime particulier distinct de celui des autres résidus opératoires, en exigeant un consentement libre et éclairé de la mère?
Proposition n° 70. Soumettre les prélèvements de cellules souches hématopoïétiques provenant du sang placentaire à un régime de consentement explicite, libre et éclairé par le biais d’une information adaptée.
5. Faut-il mieux encadrer l’importation et l’exportation des cellules à usage thérapeutique ?
L’importation et l’exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules du corps humain sont autorisées par l’AFSSAPS après avis de l’ABM.
L’article L. 1245-5 du code de la santé publique permet aux établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse d’importer et d’exporter cette moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques. Cependant ces importations et ces exportations s’effectuent sans contrôle sanitaire et qualitatif, alors que l’article 9 de la directive 2004/23 impose aux importations et aux exportations de tissus ou de cellules des normes de qualité et de sécurité. L’article L. 1245-5 précité devrait prendre en compte ces exigences.
Proposition n° 71. Soumettre l’importation et l’exportation des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse à un encadrement sanitaire et qualitatif.
CHAPITRE 8 – LE RESPECT DE L’IDENTITÉ ET DU CORPS
DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE
La bioéthique ne saurait être définie comme étant seulement l’éthique du vivant. Elle implique aussi de définir ce que les vivants doivent s’interdire de faire avec les corps des morts, ces dépouilles qui portent la mémoire du défunt.
Fondé sur le principe de protection de la dignité de la personne, le droit au respect du corps humain après la mort a été expressément consacré par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
Ainsi, le nouvel article 16-1-1 du code civil, issu de l’article 11 de cette loi, dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités « avec respect, dignité et décence ». L’article 16-2 du même code a par ailleurs été complété, afin de permettre au juge de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, « y compris après la mort ».
La notion de respect « garantit que les règles prévues par l’article 16-1 du code civil en matière d’inviolabilité, d’intégrité et d’extrapatrimonialité du corps s’appliqueront intégralement aux restes mortels. » (913)
Le principe de dignité, principe à valeur constitutionnelle, interdit que le cadavre puisse être traité comme une simple chose.
La notion de décence s’impose traditionnellement en matière de traitement des corps morts.
Ces dispositions, en tant qu’elles relèvent du respect du corps humain, sont d’ordre public (914).
C’est ainsi sur le fondement de l’article 16-1-1 précité que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’interdiction d’une exposition de cadavres humains à Paris en avril 2009. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris, au motif notamment que la société organisatrice n’avait pas apporté la preuve qui lui incombait de l’origine licite et non frauduleuse des corps et de l’existence des consentements des personnes avant leur décès (915). Au regard des principes juridiques régissant le statut du corps humain, le juge a estimé que « le législateur, qui prescrit la même protection aux corps humains vivants et aux dépouilles mortelles, a […] entendu réserver à celles-ci un caractère inviolable et digne d’un respect absolu, conformément à un principe fondamental de toute société humaine. » (916)
Le respect dû aux morts trouve son application pénale à l’article 225-17 du code pénal, lequel punit d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende toute atteinte à l’intégrité du cadavre.
Il apparaît cependant que dans deux domaines, les autopsies judiciaires et le don du corps à la science, toutes les conséquences du principe de respect du corps humain après la mort n’ont pas été tirées.
De même, il convient de veiller au respect de ce principe dans le cas de la réalisation de tests génétiques sur une personne décédée.
Enfin, le respect dû aux morts doit aussi se manifester par la mise en œuvre de règles de procédure assurant l’égalité de toutes les situations. En ce sens, le statut juridique des enfants nés sans vie gagnerait à être précisé.
A. RENFORCER L’ENCADREMENT JURIDIQUE DES AUTOPSIES JUDICIAIRES ET DES DONS DU CORPS À LA SCIENCE
Le terme d’autopsie désigne la pratique de différentes incisions sur le corps d’une personne décédée dans le but d’en examiner les organes internes. Elle est dite judiciaire ou médico-légale lorsqu’elle est effectuée sur mandat judiciaire dans le cadre d’une enquête, notamment pour déterminer les origines des décès dont la cause est inconnue ou suspecte.
Lors de son audition par la mission (917), le Médiateur de la République a souligné les lacunes du régime juridique des autopsies judiciaires et les dysfonctionnements auxquels cette situation est susceptible de conduire. Le Médiateur a ainsi indiqué avoir été alerté « sur des pratiques médicales portant atteinte à la dignité du corps du défunt, c’est-à-dire la restitution du corps dans un état totalement inconvenant », et qui, s’ils semblent peu nombreux au regard de l’ensemble des autopsies judiciaires réalisées chaque année, ont pu conduire « à la fermeture de la salle d’autopsie d’un CHU fin 2008 ».
a) L’existence d’un vide juridique
« L’absence de cadre légal ou réglementaire est une caractéristique majeure de la médecine légale française », comme l’a souligné le rapport de janvier 2006 de la mission interministérielle constituée sur ce sujet (918). Les autopsies judiciaires, ne font l’objet d’aucune disposition particulière dans le code de procédure pénale. De fait, comme l’a fait observer le Médiateur de la République « la médecine légale n’est actuellement régie que par huit circulaires peu structurantes et mal articulées entre elles, dont les prescriptions n’ont de surcroît guère été mises en œuvre ».
L’autopsie constitue une atteinte à l’intégrité du cadavre qui peut être vécue douloureusement par les familles Cette absence d’encadrement normatif fait que les autopsies judiciaires semblent s’affranchir du principe portant sur le respect dû au corps mort exigé par le code civil.
Le régime juridique des autopsies médicales menées à fins thérapeutiques ou scientifiques a, par contre, été clarifié par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique.
L’article L. 1211-2 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 6 août 2004, définit les autopsies médicales (919) ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être mises en œuvre. Il prévoit, en particulier, qu’un arrêté précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales malgré l’opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l’absence d’autres procédés permettant d’obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Cet arrêté n’a cependant pas encore été publié.
Par ailleurs, l’article L. 1232-5 du même code dispose que « les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps. »
Ces dispositions ne sont pas applicables aux autopsies judiciaires.
b) Les difficultés qui en résultent
Les lacunes de l’encadrement actuel des autopsies judiciaires soulèvent plusieurs difficultés concernant notamment le contrôle des activités médico-légales, les conditions de restitution de la dépouille et le devenir des prélèvements humains.
– Selon le Médiateur de la République, « 80% des médecins légistes pratiquant des autopsies sont désignés à partir des listes d’experts des Cours d’appel, mais un grand nombre de ces médecins, pourtant répertoriés dans la rubrique « médecine légale », ne sont pas titulaires d’un diplôme attestant de leur qualification dans ce domaine. »
– L’absence de dispositions juridiques relatives au principe et aux délais de la restitution de la dépouille à l’issue d’une autopsie judiciaire a conduit à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en octobre 2001 (920), en raison des négligences des autorités judiciaires françaises, qui attendirent plusieurs mois avant d’autoriser la restitution du corps d’une petite fille à ses parents à la suite d’une autopsie effectuée dans le cadre d’une enquête pour responsabilité médicale. La CEDH a considéré qu’en l’espèce un juste équilibre n’avait pas été aménagé entre le but légitime visé par les décisions d’autopsies et le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiales, reconnu par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. On admet ainsi que la famille a sur le cadavre un droit de « copropriété » familial sur lequel s’est appuyé la cour pour trancher en faveur des parents.
La loi pourrait dès lors être complétée afin de transposer en droit interne la jurisprudence de la CEDH concernant le droit des proches à obtenir la restitution du corps du défunt dans un délai raisonnable.
– Enfin, il n’y a pas actuellement de disposition légale sur la façon dont doivent être traités les prélèvements effectués pendant une autopsie judiciaire, comme l’a souligné notamment la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 28 avril 2009. La Cour de cassation avait dès 2001 (921), rappelé les conditions d’application de l’article 99 du code de procédure pénale relatif à la restitution des objets sous main de justice en jugeant, d’une part, que les prélèvement réalisés sur un corps humain relèvent des objets pouvant être restitués et en précisant, d’autre part, que leur non restitution doit être réservée aux cas spécifiquement mentionnés par la loi, à savoir la manifestation de la vérité, la sauvegarde des droits des parties ou l’existence d’un danger pour les personnes ou les biens. Le Médiateur a également signalé une autre affaire « concernant le devenir des prélèvements humains : « des parents désireux d’incinérer leur fils, qui fut victime d’un meurtre, se sont vus opposer un refus à leur demande de restitution des nombreux organes prélevés sur le corps de celui-ci au moment de l’autopsie, au motif que « les prélèvements effectués aux fins d’analyses dans le cadre d’une procédure judiciaire ne sont pas susceptibles de restitution », selon les termes de la réponse du procureur. En fait, ces organes avaient été détruits par le service hospitalier, sans que la famille n’en ait été informée. » (922)
Ces prélèvement n’entrent pas dans le champ d’application des articles R. 1335-9 à R. 1335-12 du code de la santé publique, qui fixent les règles relatives l’élimination des pièces anatomiques et qui ne concernent que les organes ou membres recueillis à l’occasion des activités de soins ou d’activités assimilées (enseignement, recherche et production industrielle dans les domaines de la médecine humaine ainsi qu’aux activités de thanatopraxie).
Proposition n° 72. Préciser les conditions d’habilitation des praticiens désignés pour effectuer une autopsie judiciaire.
Étendre aux autopsies judiciaires l’obligation faite au médecin de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps.
Transposer en droit interne la jurisprudence de la CEDH concernant le droit des proches à obtenir la restitution du corps du défunt dans un délai approprié.
2. Le don du corps à la science
Si les dons à la science obéissent à une réglementation particulière, à savoir des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales touchant au droit funéraire, la démarche qui les inspire n’est pas éloignée de celle qui est à l’origine des dons d’organes. Aussi a-t-il paru utile à la mission d’évoquer un problème posé par ces pratiques sur lesquelles son attention a été attirée par le Médiateur de la République(923).
Donner « son corps à la science », selon l’expression consacrée, signifie donner son corps à des établissements d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche. Chaque année en France, 2 500 personnes font don de leur corps. Le don du corps permet à des établissements agréés d’effectuer des travaux d’enseignement et de recherche. Il s’agit, d’un point de vue juridique, d’un acte de donation qui peut être engagé par toutes les personnes majeures n’étant pas sous tutelle. Ce qui signifie que la famille n’a aucun droit de regard sur cette démarche.
Le donateur doit tout d’abord en formuler personnellement la demande de son vivant, par une déclaration de don écrite en entier à la main sur papier libre, datée et signée. Cette demande peut être adressée à des facultés de médecine de toute la France comportant un service de don du corps. 28 établissements sont agréés à recevoir des dons.
En vertu de l’article R. 2213-13 du code de la santé publique, l’autorisation est accordée sur production d’un extrait du certificat médical attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n’est pas causé par une maladie contagieuse. Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès, ce délai étant porté à quarante-huit heures lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d’équipements permettant la conservation des corps. L’établissement assure à ses frais l’inhumation ou la crémation du corps. Pour le ministère de la santé, les établissements sont également redevables des frais de transport du corps à partir du domicile. Cependant de nombreux établissements semblent mettre à contribution les donateurs en leur facturant des « frais de participation » ou des « frais de dossier » forfaitaires, qui en réalité correspondent aux frais de transport du corps du domicile du donateur à l’établissement.
Afin de dissiper ces ambiguïtés, il serait souhaitable de compléter le dernier alinéa de l’article R. 2213-3 en mettant à la charge des établissements les frais de transport des corps.
Proposition n° 73. Mettre à la charge des établissements d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche les frais de transport des corps donnés à la science.
B. LES TESTS GÉNÉTIQUES POST MORTEM ET LE RESPECT DÛ AUX MORTS
Le projet de loi de bioéthique présenté à l’Assemblée nationale en 2002 avait déjà proposé d’introduire une disposition qui aurait autorisé le recours post mortem à un test génétique en matière de filiation, sauf opposition expressément manifestée de son vivant par le défunt. Dès la première lecture de ce texte à l’Assemblée nationale, l’argument selon lequel une telle autorisation faisait courir de graves risques de dérive quant au respect dû aux morts avait conduit le législateur, unanime, à interdire ce type d’expertise post mortem, à l’exception du cas où un consentement exprès manifesté du vivant de la personne aurait été donné.
Cependant les conséquences de l’arrêt Jäggi c/ Suisse du 13 juillet 2006 pourraient conduire le législateur à revoir sa position. Dans cette affaire le requérant se plaignait que les autorités judiciaires de son pays s’étaient refusées à effectuer une analyse ADN sur une personne défunte dans le but de déterminer s’il s’agissait de son père biologique ; il alléguait en conséquence avoir subi une violation de ses droits au respect de la vie privée.
A cette occasion, la cour a estimé que « le droit de connaître son ascendance fait partie intégrante de la notion de vie privée dont la protection est garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » et que le droit des tiers à l’intangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts et l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique devaient en conséquence être mis en balance avec ce que la cour a considéré comme « l’intérêt vital » qu’ont les personnes essayant d’établir leur ascendance « à obtenir des informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle. »
Selon l’argumentation de la cour, l’intangibilité du corps du défunt n’est pas absolue au regard du fait notamment qu’une concession funéraire peut ne pas être perpétuelle et qu’un prélèvement ADN « constitue une ingérence relativement peu intrusive ».
En ce qui concerne le respect de la vie privée du défunt, la cour renvoie à sa jurisprudence (924) où elle estimait qu’un prélèvement d’ADN ne pouvait porter atteinte à l’intimité d’une personne décédée.
Pour ce qui est de la sécurité juridique, celle-ci n’était pas menacée puisque le cas jugé n’entraînait par le rétablissement d’une filiation.
De ces circonstances, la cour a conclu qu’en l’espèce l’article 8 de la Convention avait été violé.
En combinant cet arrêt avec la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’expertise biologique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (925), l’interdiction de principe posée par le législateur de procéder à des tests post mortem semble fragilisée selon plusieurs juristes.
Un ensemble d’arguments peut cependant être opposé à l’analyse qui voudrait que la jurisprudence de l’arrêt Jäggi ainsi que l’évolution de la jurisprudence interne doivent conduire le législateur à modifier le choix fait en 2004.
Il est à souligner en premier lieu que l’arrêt Jäggi s’inscrit dans la suite de l’arrêt Odièvre du 13 février 2003 qui avait fait valoir que les personnes « ont un intérêt primordial protégé par la Convention à recevoir des renseignements qu’il leur faut connaître, à comprendre leur enfance et leurs années de formation ». L’intérêt primordial ou vital formulé par la cour ne porte pas sur une action en reconnaissance de filiation. Certes, comme il en a été fait mention, la connaissance d’une origine peut être utilisée comme moyen de preuve. Mais les intérêts à prendre en considération ont un poids différent en matière de filiation, notamment les considérations relatives à la sécurité juridique et à la paix des familles.
Néanmoins, comme l’analyse le Conseil d’État, « le point important au regard de la loi française est le raisonnement qui semble indiquer que la convention oblige à examiner de telles demandes en mettant en balance les différents intérêts en présence. Ceci semble impliquer qu’une impossibilité de principe des tests post mortem, telle que celle prévue par la loi française, serait contraire à la convention. » (926)
On rappellera que l’exhumation d’Yves Montand, ordonnée par la Cour d’appel de Paris le 6 novembre 1997 dans le but de procéder à une expertise ADN de paternité avait pesé sur les débats de 2002. Le fait que l’analyse génétique avait été réalisée en dépit de l’opposition expresse formulée du vivant du défunt et que la procédure avait abouti à prouver que l’action en filiation était infondée avait contribué à nourrir les critiques envers tout dispositif qui aurait ouvert la possibilité de multiplier les tests post mortem et conduit à procéder à autant d’exhumations.
Que ces critiques aient été unanimement partagées en 2002 par les députés révèle que le respect dû au défunt renvoie à des valeurs culturelles qui font prévaloir la paix des morts sur la recherche de la vérité génétique.
En prenant position par rapport à ces valeurs et aux droits subjectifs qui s’y rattachent, la Cour européenne des droits de l’homme a procédé à une balance entre divers intérêts dont on peut se demander, selon le Conseil d’État, si elle « offre prise à un contrôle de conventionnalité au regard de normes avant tout conçues pour garantir la protection des libertés publiques et des droits fondamentaux »(927). Si le système français se voyait contesté devant la cour de Strasbourg, poursuit le Conseil d’État, « il pourrait être possible de plaider que l’équilibre posé par la loi française entre ces différents intérêts, à travers la règle du consentement exprès exprimé du vivant de la personne, correspond à l’exercice par le législateur français de la marge d’appréciation dont dispose chaque État compte tenu de l’équilibre des valeurs propres à sa culture. » (928)
On pourra, par ailleurs, relever l’ambiguïté que présenterait un dispositif qui substituerait à la condition de l’accord exprès pour effectuer un test post mortem la condition d’une opposition expressément manifestée pour y faire obstacle. Une telle opposition susciterait naturellement des interrogations peu propices à assurer le respect de la vie privée du défunt ou du moins la paix des familles. En outre, comme le soulignait le Conseil d’État en 1999, (929) la condition d’une opposition expresse « sera à l’origine d’une dissymétrie entre les morts et les vivants. Lorsque la personne qui refuse de se soumettre à une expertise de filiation est vivante, en effet, le juge peut tirer les conséquences de ce refus et procéder à une affirmation judiciaire de la paternité sur la base de présomptions ». (930)
Certes, comme l’a fait remarquer M. Jean Hauser, professeur de droit privé, se référant à l’affaire Yves Montand, « On raisonne toujours comme si l’expertise post mortem allait être positive. Or elle peut être négative. » (931) En outre, les actions d’état étant désormais soumises à une prescription décennale et non plus trentenaire, une levée de l’interdiction posée par l’article 16-11 du code civil aurait une portée limitée (932).
Que l’expertise post mortem puisse rétablir la vérité en faveur du défunt ne diminue cependant pas la portée de la transgression attachée à la pratique de l’exhumation.
Proposition n° 74. Maintenir en matière civile les dispositions de l’article 16-11 du code civil qui prévoient que : « Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ».
C. LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES FœTUS DÉCÉDÉS, NÉS VIVANTS ET VIABLES
Au cours de son audition devant la mission parlementaire, Monsieur Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République a déploré que la question des enfants sans vie, sur laquelle il interpelle depuis 2005 les responsables politiques, n’ait pas été abordée par le législateur. « C’est un sujet sensible, a expliqué M. Jean-Paul Delevoye, et les politiques se divisent entre ceux qui estiment qu’il est urgent de prendre une décision et ceux qui, par crainte d’un dérapage médiatique, estiment qu’il vaut mieux ne pas aborder le sujet. » (933)
La question a cependant été soulevée à l’Assemblé nationale à l’occasion de la discussion de la proposition de loi relative à la législation funéraire (934) . Une proposition de loi a été déposée sur la procédure d’inhumation des enfants mort-nés (935)et une autre tendant à accorder des droits aux parents d’enfants nés sans vie, qui le souhaitent(936). Au cours de la discussion en commission du projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, le Président de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a saisi le Président de l’Assemblée nationale de ce problème. (937)
Les questions d’éthique que pose la réglementation relative aux actes d’enfant sans vie relèvent du champ de la bioéthique. Quelle reconnaissance accorder à des enfants qui ont vécu quelques instants ou qui sont mort-nés ? A partir de quel stade de développement convient-il de leur accorder une place dans la mémoire de la communauté et de leur attribuer une personnalité juridique ? La mission parlementaire s’est saisie de cette question avec la préoccupation de garantir une égalité de traitement entre toutes les situations et d’assurer le respect dû à ces corps d’enfants, faisant sien le principe formulé par le CCNE en 2005 « être mis au monde, vivant ou mort, c’est être remis entre des mains humaines. » (938)
1. Les actes établis pour les enfants décédés avant leur déclaration à l’état civil
Il s’agit des enfants mort-nés ou décédés dans un délai bref après leur naissance, avant qu’ils aient pu être déclarés à l’état civil. Aux termes de l’article 79-1 du code civil, deux types d’acte peuvent être établis suivant qu’on considère que l’enfant mis au monde aurait pu survivre ou non : un acte de décès si l’enfant est né vivant et viable, un acte d’enfant sans vie si l’enfant est mort-né ou s’il est né vivant mais non viable.
La production d’un certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable permet la délivrance d’un acte de naissance et d’un acte de décès. La déclaration de naissance doit être faite dans les trois jours de l’accouchement conformément à l’article 55 du code civil. L’enfant se voit alors reconnaître une personnalité juridique : un nom et un prénom lui sont attribués, il est obligatoirement inscrit sur le livret de famille ; il lui est reconnu une aptitude à succéder. Son corps doit faire l’objet de funérailles. Les parents conservent les droits sociaux normalement attachés à la naissance d’un enfant. La situation est identique à celle d’un enfant qui est en vie lors de la déclaration de naissance et qui décède ultérieurement.
A défaut du certificat médical précédemment mentionné, à savoir si l’enfant est mort-né ou est né vivant et non viable(939), un acte d’enfant sans vie est établi. La procédure n’étant liée à aucun délai, la démarche est volontaire, le délai de réclamation du corps à l’hôpital étant cependant de 10 jours. Les effets de cet acte sont les suivants : l’enfant peut recevoir un ou des prénoms si les parents en expriment le désir mais pas de nom patronymique ; il peut être inscrit sur le livret de famille et le corps peut être remis aux parents pour des obsèques (940). La mère a en particulier droit à un congé de maternité, à une protection contre le licenciement pendant ce congé et à la reprise du travail. Le père bénéficie, depuis peu, des indemnités pour congé de paternité(941). Si les parents ne sont pas mariés, il leur est délivré un livret de famille sur lequel est portée l’indication de l’enfant sans vie. La personnalité juridique de l’enfant n’est pas reconnue. Il n’a pas d’aptitude à succéder.
Comme le précise l’article 468 de l’Instruction générale relative à l’état civil, « les dispositions de l’article 79-1 du code civil doivent être rigoureusement observées, pour éviter notamment des fraudes en matière de dévolution successorale ou d’allocations à caractère social. »
On comprend que la notion centrale de ce dispositif est celle de viabilité. Comme l’analyse la Cour de cassation (942) « la définition de l’enfant né vivant semble assez unanimement admise comme étant le fait pour l’enfant “de produire aussitôt après l’expulsion du ventre de sa mère une secousse respiratoire qui atteste que de l’air est entré dans ses poumons et qu’il a eu une activité cardiaque” ; la viabilité d’un enfant est plus difficile à définir, c’est sa capacité naturelle de vivre. »
La circulaire DGS n°50 du 22 juillet 1993 et la circulaire interministérielle du 30 novembre 2001 (943) se réfèrent aux recommandations de l’OMS qui fixent la limite basse de la viabilité à 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids de 500 grammes. Tout autre critère, en particulier la présence de malformations, est exclu.
Autrement dit, selon ces textes d’application, un acte de décès est établi si l’enfant est né vivant, d’un poids de 500 grammes ou au terme de 22 semaines d’aménorrhée. Un acte d’enfant sans vie est établi « lorsque l’enfant est né vivant mais non viable ; ou lorsque l’enfant est mort-né après un terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. » (944)
On pourrait s’interroger sur la raison pour laquelle un critère de viabilité est appliqué aux conditions de reconnaissance des enfants mort-nés. Les motivations des trois jugements de la cour d’appel de Nîmes du 17 mai 2005 rejetant des demandes d’établissement d’actes d’enfant sans vie pour des fœtus mort-nés inférieurs aux seuils de l’OMS, sont particulièrement éclairantes : « il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le fœtus avant son extinction ; […] en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du fœtus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints » (945)
Les enfants mort-nés d’un poids inférieur à 500 grammes ou avant le terme de 22 semaines d’aménorrhée sont qualifiés de « pièces anatomiques », de « déchets hospitaliers », de « produits innommés » ou de « débris humains » destinés à l’abandon et devant être incinérés conformément à l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.
2. Les critères de l’OMS ne sont pas des conditions légales
Trois arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 6 février 2008 ont modifié en profondeur ce dispositif. Saisie des trois jugements rendus par la cour d’appel de Nîmes précédemment cités qui confirmaient le rejet de demandes d’inscription à l’état civil de fœtus mort-nés ne présentant pas les critères de viabilité de l’OMS, la Cour de cassation a jugé « qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2 du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé. » (946)
Les modalités d’application de l’article 79-1 du code civil ont été en conséquence modifiées. Le décret n°2008-800 du 20 août 2008, l’arrêté du même jour et la circulaire n°2009-182 du 19 juin 2009 définissent un nouveau cadre réglementaire qui conditionne désormais la délivrance d’un acte d’enfant sans vie à la production d’un certificat attestant de l’accouchement de la mère.
Un tel certificat permet de préciser les conditions qui, dans ce processus continu de la gestation, correspondent à la situation visée à l’article 79-1 du code civil, à savoir celles d’un accouchement. Aux termes de la circulaire « La réalité d’un accouchement relève de l’appréciation médicale des praticiens. En tout état de cause, l’établissement d’un certificat médical d’accouchement implique le recueil d’un corps formé – y compris congénitalement malformé – et sexué, quand bien même le processus de maturation demeure inachevé et à l’exclusion des masses tissulaires sans aspect morphologique. »
Ces conditions conduisent à exclure les situations d’interruption volontaire de grossesse et d’interruption spontanée précoce de grossesse. De fait, la circulaire pose, de façon incidente, une limite temporelle en soulignant que « les interruptions du premier trimestre de grossesse survenant en deçà de la quinzième semaine d’aménorrhée ne répondent pas en principe aux conditions permettant l’établissement d’un certificat médical d’accouchement. »
Le dispositif revient par conséquent à asseoir les conditions de délivrance d’un acte d’enfant sans vie sur le critère du « recueil d’un corps formé », critère déterminant pour considérer qu’il y a eu accouchement. L’indication d’une limite temporelle de quinze semaines d’aménorrhée précise indirectement l’interprétation de cette condition.
Cette solution a pour effet d’élargir la catégorie des enfants mort-nés visés, le corps pouvant être considéré comme formé avant le stade de viabilité. La procédure de délivrance d’un acte d’enfant sans vie est ainsi ouverte à un nombre plus grand de situations.
3. Les difficultés d’interprétation que pose le dispositif mis en place
On peut d’abord s’interroger sur la notion d’accouchement, comme le fait l’Union nationale des associations familiales (UNAF) qui ne voit dans les distinctions opérées par le circulaire du 19 juin 2009 qu’un simple jeu de mots : « en distinguant d’un côté « l’accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale (dont IMG) », qui ouvre la possibilité d’un certificat d’accouchement, de « l’interruption spontanée précoce de grossesse (fausse couche précoce) et interruption volontaire de grossesse », qui n’ouvrent pas la possibilité d’un tel certificat d’accouchement, le législateur a voulu implicitement réintroduire une norme de durée minimale de la grossesse. La fausse couche précoce s’entendrait à moins de 14 semaines d’aménorrhée, qui est également la limite pour procéder à une IVG légale. Mais c’est là jouer sur les mots : il n’y a pas de différence de nature entre « une fausse couche précoce » et un « accouchement spontané », dès lors que n’existe aucune condition de viabilité. » (947)
Il apparaît aussi qu’un dispositif qui reconnaît un statut, même symbolique, à des embryons pris à un stade de développement très proche de celui où ils peuvent encore faire l’objet d’une IVG, pour laquelle le délai est de 14 semaines d’aménorrhée, peut susciter des craintes, d’autant que les critères applicables relèvent seulement d’une circulaire. La disposition législative demeure d’interprétation large une fois écarté tout critère précis de viabilité, ce qui avait amené l’association Choisir la cause des femmes, présidée par Mme Gisèle Halimi, à protester le lendemain du rendu de l’arrêt de la Cour de Cassation, dans les termes suivants : « Ladite juridiction semble indiquer que la vie commence à la conception de l’embryon. « Choisir » entend mettre en garde contre le fait que l’avocat général semble inviter le législateur à emprunter la voie de la régression du point de vue des libertés des femmes et du choix de leur maternité. » (948)
De plus, les progrès de l’imagerie médicale donnent la possibilité aux parents de voir et d’attribuer très tôt une identité à leur enfant, avant le seuil à partir duquel le corps est formé au sens de la circulaire du 19 juin 2009. L’établissement d’un acte d’enfant sans vie ayant pour première motivation d’apporter une reconnaissance symbolique de l’existence de l’enfant, l’impossibilité de faire appel à cette procédure dès la première échographie remboursée par la Sécurité sociale peut susciter l’incompréhension, voire comme l’estime l’UNAF, être source de contentieux.
Mais surtout, comme l’a souligné le Médiateur de la République, « le problème central posé par l’application du premier alinéa de l’article 79-1 du code civil, du fait de l’absence de définition juridique de la notion de viabilité depuis l’invalidation des circulaires ministérielles n’est toujours pas résolu. » (949). En effet, la limite supérieure à partir de laquelle un acte d’enfant sans vie ne peut plus être délivré en raison du fait que l’enfant décédé est né vivant et viable – ou, de façon équivalente, la limite basse à partir de laquelle une personnalité juridique doit être reconnue à l’enfant décédé du fait d’être né vivant et viable – demeure indéterminée. Un cas communiqué par le Médiateur d’un médecin qui n’a pas déclaré viable un enfant de 650 grammes à l’issue de 28 semaines de grossesse est particulièrement inquiétant. L’absence de critère précis conduit à des différences d’appréciation qui créent autant d’inégalités de situations.
4. Instaurer des critères légaux
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de rétablir des critères à même de distinguer les stades de développement du fœtus qui ouvrent droit à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ou à la délivrance d’un acte de décès.
A cette fin, il pourrait être envisagé soit d’inscrire les nouveaux critères directement dans la loi, soit d’en renvoyer la fixation à un décret comme le propose le Médiateur.
Le renvoi à un décret permettrait d’aménager plus facilement les critères retenus en fonction des progrès de la connaissance scientifique.
Cependant la matière relevant de l’état et de la capacité des personnes, il revient à la loi de fixer cette règle, conformément à l’article 34 de la Constitution.
Les critères retenus pourraient être ceux de l’OMS utilisés en France depuis la circulaire du 22 juillet 1993 et qui servent de référence pour les études d’épidémiologie. Même si leur application, comme tout seuil quantitatif, peut susciter des incompréhensions, par exemple dans le cas où le fœtus présente un poids proche de 500 grammes ou est d’un âge gestationnel voisin du seuil fixé, le choix des critères de l’OMS ferait de la législation française celle qui, avec le Danemark et la Suisse, fixerait les limites les plus basses de viabilité. (950)
Un retour aux critères de l’OMS n’aurait pas pour conséquences la remise en cause des dispositions réglementaires récemment mises en application. En effet, comme il en a été fait mention, la procédure consistant à accorder un acte d’enfant sans vie sur présentation d’un certificat d’accouchement délivré dès qu’il y a eu recueil d’un corps formé permet d’inclure dans cette procédure les cas des fœtus nés en dessous des critères de viabilité et d’organiser des rites funéraires.
La référence à des critères précis de viabilité a pour seul but de caractériser plus objectivement les situations qui ouvrent droit à la reconnaissance d’une personnalité juridique et non de réduire les possibilités de reconnaissance symbolique des enfants mort-nés.
De cette sorte, le dispositif serait le suivant :
– la personnalité juridique est reconnue à l’enfant né vivant et entrant dans les critères de viabilité qui auront été retenus.
– l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, permettant en particulier des obsèques, est établi sur présentation d’un certificat d’accouchement attestant que l’enfant est né vivant mais non viable ou que l’enfant est mort-né avec un corps formé.
Comme le rappelle la circulaire du 19 juin 2009, si la famille n’a pas accompli la démarche visant à établir un acte d’enfant sans vie, mais souhaite néanmoins l’organisation de funérailles, « les communes peuvent accompagner cette volonté en autorisant l’inhumation ou la crémation du corps. »
En l’absence de toute manifestation de volonté de la famille, l’établissement de santé prend les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l’enfant ou, lorsqu’une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci.
Enfin, en l’absence de recueil d’un corps formé, il est procédé à une crémation selon les dispositions applicables aux pièces anatomiques d’origine humaine.
Proposition n° 75. Préciser dans la loi les critères de viabilité sur la base desquels un acte de décès d’un fœtus né vivant et viable, peut être établi.
PARTIE IV : COMMENT SE PRÉPARER AUX QUESTIONS ÉTHIQUES POSÉES PAR LES SCIENCES ÉMERGENTES ?
« Nanosciences, biotechnologies et sciences cognitives ouvrent la voie à une espèce améliorée. Non sans risques pour notre humanité. » (951) « Le progrès des connaissances en matière de fonctionnement du cerveau pose déjà des questions éthiques considérables »(952). Les potentialités de ces nouvelles sciences nourrissent de nombreuses inquiétudes. Ces sciences sont cependant encore mal connues du grand public, contrairement aux techniques de procréation médicalement assistée, de diagnostic prénatal ou de greffe d’organe, qui ont alimenté de longue date un débat public et font l’objet d’un encadrement d’ensemble. La mission parlementaire a tenu à dresser un premier bilan de ces techniques du futur afin d’évaluer les problèmes qu’elles poseront dans un avenir proche.
CHAPITRE 9 – NEUROSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES
ET CONVERGENCE DES TECHNOLOGIES
Si les sciences émergentes éveillent de telles appréhensions, c’est qu’elles se distinguent encore mal de la science-fiction. Pourtant, leurs premières applications sont bien réelles : la neuroimagerie est d’ores et déjà utilisée dans les procédures judiciaires, dans certains pays, comme élément à charge ou à décharge. Les molécules pouvant servir de dopants intellectuels font l’objet d’ouvrages à destination du grand public. Une réflexion a été conduite pour savoir si les prothèses que portait un athlète handicapé ne faisaient pas de lui un « homme augmenté », qui ne pourrait pas concourir avec des athlètes valides.
L’état d’avancement et par là même les enjeux des sciences émergentes divergent cependant fortement suivant les domaines. Les neurosciences ont déjà des applications importantes et posent des problèmes éthiques nouveaux appelant des réponses spécifiques. En revanche, les nanotechnologies et la convergence des technologies, apparaissent davantage amplifier les problématiques existantes.
A. LES NEUROSCIENCES SOULÈVENT DES PROBLÈMES ÉTHIQUES NOUVEAUX
« À la différence du thème des mères porteuses, les neurosciences font peu débat, bien qu’elles emportent des conséquences beaucoup plus graves. » (953) a estimé M. Pierre Le Coz au cours de son audition. En effet, le fonctionnement du cerveau, qui est le siège de la conscience et donc de l’identité personnelle, est aujourd’hui exploré grâce à des techniques nouvelles qui offrent des perspectives inédites.
Cependant, prenant appui sur le faible nombre d’applications médicales résultant des progrès des neurosciences, le rapport du Conseil d’État consacré à la bioéthique ne fait pas mention des questions relatives aux neurosciences. Ce choix a été défendu par le rapporteur général de son groupe de travail, M. Luc Derepas : « Il est apparu, lors de nos débats préliminaires, que le sujet n’était manifestement pas mûr. Certes, il existe des orientations de recherche en ce domaine, et certaines applications sont déjà envisagées, mais on n’a pas encore constaté de véritable mise en œuvre, au plan médical, susceptible de poser des problèmes éthiques. Si on peut anticiper des difficultés, celles-ci concernent plutôt les champs industriel et militaire que la médecine. Pour ces raisons, il ne nous a pas paru opportun de traiter le sujet dans le cadre d’un rapport sur l’éthique biomédicale. » (954)
Face à ces différences d’appréciation la mission parlementaire a cherché à évaluer la pertinence à inclure cette nouvelle discipline dans le champ des lois de bioéthique. Plusieurs arguments ont conduit à une réponse positive :
– de nouvelles techniques, notamment d’imagerie cérébrale, ont bouleversé notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain et sont désormais utilisées sur une très large échelle ;
– elles portent sur le cerveau, support de l’identité humaine, ce qui engendre des questionnements éthiques nouveaux ;
– des risques de mésusage de ces technologies, à l’origine médicales, sont déjà apparus, notamment à l’étranger, appelant des régulations nouvelles.
Les organismes chargés d’une mission de veille ont déjà relevé les enjeux éthiques soulevés par les progrès des neurosciences. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technlologiques y a consacré la cinquième partie de son rapport (955) et le Centre d’analyse stratégique(956), plusieurs notes, dans le cadre d’un programme d’ensemble portant sur les neurosciences.
1. Des espoirs médicaux importants
Grâce aux progrès de la recherche fondamentale et des techniques d’imagerie cérébrale, des réalisations scientifiques encore inimaginables il y a quelques années ont vu le jour, engendrant des espoirs importants, tant les personnes atteintes de maladies neurologiques sont actuellement nombreuses.
a) Les progrès de l’imagerie cérébrale et de la connaissance du cerveau
Les neurosciences se sont imposées une première fois quand les progrès de la biologie moléculaire et de la génomique ont permis de comprendre les mécanismes qui sous-tendent la communication entre les neurones. Ont alors pu être développés des médicaments ciblant les transmissions synaptiques impliquées dans certaines maladies psychiatriques tels que les antipsychotiques.
À la source des progrès les plus récents dans le domaine des neurosciences, se trouvent les avancées spectaculaires réalisées par les techniques d’imagerie cérébrale. Se sont notamment développées les techniques telles que l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ou la tomographie par émission de positrons (TEP), qui permettent d’observer le cerveau en activité. Ces outils d’observation assurent une meilleure compréhension des mécanismes cérébraux, qui s’affine à mesure des gains en précision des dispositifs d’imagerie.
b) Les réalisations des neurosciences
Ces progrès ont eu un impact sur les techniques médicales innovantes. Deux exemples sont particulièrement révélateurs de ces avancées thérapeutiques.
Le premier concerne les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. En 1987, alors qu’il traitait la maladie de Parkinson en procédant à la destruction du noyau sous-thalamique par stimulation électrique, le Professeur Alim-Louis Benabid a découvert un traitement dont les effets étaient réversibles et qui n’engendrait pas de lésion. Les effets positifs de ce traitement, qui a déjà profité à 50 000 patients ont été confirmés et ne semblent pas générer de complication majeure, ainsi que l’a précisé M. François Berger, professeur à l’université Joseph Fourier de Grenoble et directeur de l’unité « Nanomédecine et cerveau » de l’Inserm (957). Le même constat a été fait par M. Hervé Chneiweiss, directeur de l’unité de plasticité gliale à l’INSERM, qui a indiqué au cours de son audition : « Les implants cérébraux se sont beaucoup développés depuis une vingtaine d’années. Aujourd’hui, des milliers de parkinsoniens, ne répondant plus aux thérapeutiques classiques, ont pu retrouver une certaine autonomie grâce à une stimulation à très haute fréquence délivrée par des électrodes directement implantées dans leur cerveau. » (958)
Les progrès engendrés par les neurosciences pourraient également profiter aux personnes handicapées. Une expérience portant sur un patient paraplégique, Matt Nagle, a été menée à partir de 2006, avec pour perspective de lui faire réaliser des mouvements contrôlés par son activité cérébrale. Il « s’est vu implanter dans le cerveau des électrodes, d’une taille d’une centaine de microns. Ces électrodes enregistrent l’activité cérébrale du patient, auquel on apprend à induire une activité cérébrale, et cette induction, captée par les électrodes, dirige un dispositif exogène. »(959), a exposé M. Hervé Chneiweiss. À la suite de plusieurs phases d’entraînement et de perfectionnement, il a été en mesure de déplacer un objet en contrôlant un bras robotisé grâce à son activité cérébrale(960). À terme, s’ouvrent ainsi des perspectives de réhabilitation, une personne tétraplégique pouvant retrouver une autonomie accrue grâce à un exosquelette. Dans la même perspective, des bonnets dans lesquels sont enchâssées des électrodes sont en cours d’élaboration, afin de permettre à des personnes tétraplégiques de piloter leur chaise roulante.
c) Les défis des neurosciences impliquent d’accroître l’effort de recherche
Des maladies neurologiques graves et touchant une population nombreuse
Les enjeux des recherches en neurosciences sont considérables. En effet, les affections touchant le cerveau sont très invalidantes et ne peuvent être que difficilement combattues en l’état actuel de la médecine du fait du manque de traitements curatifs ou préventifs.
De surcroît, ces affections sont en nombre particulièrement important et en augmentation en raison du vieillissement de la population et de l’accroissement corrélatif du nombre de cas de maladies neurodégénératives. Le tableau suivant, qui recense certaines affections neurologiques, illustre l’ampleur de ce phénomène.
LES PRINCIPALES AFFECTIONS NEUROLOGIQUES
Cause |
Exemples |
Nombre de cas en France |
Maladie neurodégénérative |
Maladie de Parkinson Maladie d’Alzheimer |
100 000 personnes atteintes 800 000 personnes atteintes |
Pathologie psychiatrique |
Schizophrénie |
500 000 personnes atteintes |
Pathologie vasculaire |
Accident vasculaire cérébral |
150 000 cas par an |
Dysfonctionnement neuronal |
Épilepsie |
500 000 personnes atteintes |
Pathologie inflammatoire |
Sclérose en plaques |
80 000 personnes atteintes |
Pathologie tumorale |
Cancer du cerveau |
4 000 cas par an |
Traumatisme |
Paralysie |
----- |
Maladie infectieuse |
Maladie de Creutzfeldt-Jakob |
Environ 100 cas par an |
Source : Caroline Januel, « Les maladies neurologiques », Agenda Santé, n° 6, avril 2006.
Ainsi que l’a indiqué M. Hervé Chneiweiss, « l’ensemble des pathologies psychiatriques représentent près d’un tiers des dépenses de santé. » (961)
Des enjeux majeurs pour la recherche
Pour traiter ces maladies, les programmes de recherche fondamentale ont pour objectif de mieux connaître le fonctionnement du cerveau humain grâce à l’étude du code neuronal ou à la modélisation des systèmes neuronaux. S’y ajoutent des programmes de recherche appliquée orientés vers certaines maladies.
Deux programmes de recherche dans le domaine des neurosciences
Le réseau FondaMental
Un réseau national thématique de recherche et de soin de santé mentale (FondaMental) a été créé en 2007 afin de structurer la recherche et le soin par pathologie mentale et le couplage entre recherche fondamentale, recherche clinique, soins et formations. Il s’est traduit par la mise en place de centres régionaux experts par pathologie.
Le Plan Alzheimer
Le plan National Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, lancé par le Président de la République le 1er février 2008, a notamment pour ambition d’accroître l’effort de recherche portant sur les maladies neurodégénératives. À cette fin, une fondation de coopération scientifique a été créée, concrétisant la mesure 21 du plan, afin de coordonner et d’animer l’effort de recherche, tant public que privé.
Ces efforts de recherche sur le cerveau et ses maladies sont encouragés au niveau européen, à l’instar du 7ème PCRD (Programme Cadre de Recherche et de développement technologique, 2007-2013) de l’Union européenne. Des actions de coordination européenne des programmes nationaux sont également en cours, en particulier dans le domaine des maladies neurodégénératives et des maladies mentales. Ainsi, la Direction générale de la santé et des consommateurs a mis en œuvre un pacte européen pour la santé mentale articulé autour de cinq sujets prioritaires : la prévention du suicide et de la dépression ; la santé mentale chez les jeunes et l’éducation ; la santé mentale sur le lieu de travail ; la santé mentale chez les personnes âgées et la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion sociale.
Ces programmes de recherche bénéficient actuellement en France d’un budget public d’environ 220 millions d’euros par an, hors masse salariale(962), qui passent principalement par des dotations affectées par des organismes de recherche (INSERM, CNRS principalement) aux laboratoires spécialisés, auxquels vient s’ajouter le CEA. Ces dotations sont complétées par les financements de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et les programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC) Santé.
M. Hervé Chneiweiss a plaidé pour la poursuite de cet effort de recherche : « Il est (…) essentiel de comprendre le fonctionnement du cerveau humain, non seulement sur un plan théorique, mais aussi dans l’espoir de traiter des pathologies pour lesquelles les traitements font aujourd’hui cruellement défaut. La recherche en neurosciences, tant fondamentale que clinique, est donc capitale. » (963)
Néanmoins, pour que ces recherches demeurent acceptées par le grand public, il est indispensable qu’elles soient accompagnées d’une réflexion sur leurs enjeux éthiques.
2. Des interrogations éthiques nouvelles
Si en France l’intérêt pour les neurosciences et les questions éthiques que celles-ci posent demeure modeste, tel n’est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Mme Sarah Sauneron, chargée de mission au Centre d’analyse stratégique a fait état de l’ampleur de l’effort financier engagé par ces pays en ce domaine : « Des programmes de recherche, aux budgets colossaux, sont menés sur ce sujet dans de prestigieuses universités américaines et canadiennes et des séminaires publics sont organisés, fortement relayés par les médias. » (964) Un nouveau terme a d’ailleurs été récemment forgé afin de désigner les problèmes éthiques engendrés par le développement des neurosciences, celui de neuroéthique(965).
a) Leurs applications au cerveau
Si le développement des neurosciences suscite des problèmes éthiques particuliers, c’est en premier lieu parce qu’elles portent sur le cerveau humain.
Le cerveau est d’abord le siège de la conscience et donc de l’identité personnelle de chacun : « avec les neurosciences, on touche à la question de l’identité de l’individu. En effet, qu’est-ce qui définit le mieux l’individu, si ce n’est le fonctionnement de son cerveau ? » (966) s’est ainsi demandé M. Hervé Chneiweiss.
Le cerveau est également considéré comme étant à la source de l’unicité de l’espèce humaine, comme l’a souligné M. Jean-Didier Vincent, professeur à l’université Paris Sud Orsay et membre de l’Académie des sciences : « Les neurosciences constituent un des champs où le domaine de l’éthique est le plus fragile. En touchant au cerveau, on touche au cœur même de l’espèce humaine, à son âme même pour certains. […] C’est donc l’essence même de l’humain qui risque d’être mise en cause. » (967)
Au regard de ces deux caractéristiques, le cerveau se rapproche des données génétiques. Comme elles, il est le support d’informations propres à chacun, tout en étant un caractère de notre espèce. A ce double titre, il doit faire l’objet d’une protection particulière.
b) Leurs applications en imagerie cérébrale
Le cerveau est l’objet actuellement de nombreuses recherches à travers l’imagerie cérébrale. Les résultats scientifiques de ces recherches sont cependant dévoyés et source de surinterprétations quand les images obtenues sont considérées comme des outils d’analyse des processus de pensée du sujet observé. Entre l’image du cerveau et la lecture dans les pensées le pas est en effet vite franchi pour inférer un état mental d’une photographie d’un cerveau. Ainsi, « deux études récentes en psychologie expérimentale ont montré que le fait d’étayer une description, une narration ou l’exposé d’une théorie au moyen d’explications neuroscientifiques et/ou d’images du cerveau augmentait de manière significative le degré de croyance des gens en ce qui était dit… L’utilisation de l’image du cerveau est devenue une version moderne de l’étiquette « testé scientifiquement » » (968), a indiqué, au cours de son audition, M. Olivier Oullier, maître de conférences en neurosciences et coresponsable du programme « Neurosciences et politiques publiques » du Centre d’analyse stratégique.
La tentation est alors grande d’utiliser les techniques d’imagerie médicale à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été conçues. C’est ce qui s’est produit, à l’étranger, dans le domaine judiciaire et dans le monde économique.
L’utilisation de l’imagerie cérébrale dans les procédures judiciaires
Du fait du caractère scientifique que l’on prête à l’interprétation des images cérébrales, leur usage s’est déjà introduit dans certains tribunaux, ainsi que l’a relevé M. Olivier Oullier : « L’utilisation des sciences du cerveau au sein des tribunaux et des procédures de justice est répandue aux États-Unis, où a été développé un programme « Neuroscience and the law », auquel collaborent l’État fédéral, les États et des dizaines d’universités, et qui bénéficie d’un très fort financement. » (969) Il est fait recours à cette technique à deux niveaux de la procédure judiciaire.
– L’utilisation de l’imagerie cérébrale comme détecteur de mensonges. Cette pratique, qui est actuellement interdite en France, est légale dans certains États des États-Unis. En Inde, les techniques issues des neurosciences ont servi de fondement à la condamnation d’une femme pour empoisonnement. La technique utilisée est censée distinguer les ondes électriques émises par le cerveau quand il reconnaît une image ou un son de celles qu’il émet quand cette image ou ce son sont perçus pour la première fois(970). Aux États-Unis, cette technique n’a pas seulement été employée comme élément visant à confondre ou disculper un accusé mais a été aussi utilisée pour vérifier que des jurés n’avaient pas d’a priori défavorable envers l’accusé (971). Or, comme l’a confirmé M. Hervé Chneiweiss, les neurosciences ne sont pas à un stade de développement tel, que l’on puisse déduire avec certitude un état mental d’une image cérébrale (972) ;
– L’utilisation de l’imagerie cérébrale comme preuve de l’irresponsabilité pénale de l’accusé. Cet emploi des images cérébrales entre dans le cadre d’une expertise médicale, qui entend montrer que le comportement déviant en cause est une conséquence de l’architecture fonctionnelle du cerveau de l’accusé. C’est sur le fondement d’un raisonnement de cette nature que la Cour suprême américaine a accepté de retarder l’âge d’application de la peine capitale à vingt ans, au motif que le cerveau continuait d’évoluer jusqu’à cet âge.
L’utilisation de l’imagerie cérébrale à des fins professionnelles
En dehors de ce contexte judiciaire, les neurosciences ont également été utilisées à des fins contractuelles ou professionnelles. Ainsi, plusieurs sociétés de services ont été créées aux États-Unis dans le but de proposer des consultations de détection de mensonges fondées sur l’interprétation d’IRMf. Elles proposent d’intervenir dans les cas de litige avec les assurances ou pour des entretiens d’embauche (973). Cette activité est légale aux États-Unis, dans la mesure où le droit du travail n’y interdit que l’usage des polygraphes et non celle des IRMf.
c) La production en nombre d’images cérébrales
Selon Mme Sarah Sauneron, le recours aux images cérébrales pourrait conduire à la constitution de bases de données à l’initiative des cabinets de recrutement ou des sociétés d’assurance. La protection des données issues des neurosciences deviendrait alors un enjeu d’importance, d’autant plus que des images du cerveau pourraient, à terme, se révéler identifiantes(974). Le groupe de travail de l’OCDE sur la neuroinformatique a ainsi fait observer que la constitution en 2003 du premier atlas du cerveau humain sur Internet, élaboré à partir de plus de 7 000 cerveaux humains, risquait, à terme, de poser des problèmes au regard du respect de la vie privée.
Si ce danger demeure potentiel, en l’état actuel des techniques, il n’en demeure pas moins qu’une attention accrue devra être portée à cet enjeu dans les années qui viennent. Il pourrait ainsi être opportun, le cas échéant, d’étendre le contrôle de la CNIL à la protection des données de la neuroimagerie et de la neuroinformatique, sur le modèle des contrôles qu’elle exerce sur les collections de données génétiques.
3. Des régulations nécessaires
L’inclusion de dispositions relatives aux neurosciences dans les lois de bioéthique ne va pas pour autant de soi. Comme le rappelait Mme Sarah Sauneron, bien que la réflexion en neuroéthique ait été plus précoce et plus engagée dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada, aux États Unis et au Royaume-Uni : « l’approche de cette question demeure essentiellement basée sur la réflexion, l’information et le dialogue et n’a pas donné lieu à des dispositions législatives, ni même à des recommandations ». Elle ajoutait que « l’intégration d’un volet spécifique aux neurosciences dans la loi bioéthique française conférerait à notre pays une position singulière. »(975)
Cependant, tant l’OPECST que le Centre d’analyse stratégique jugent opportun d’inclure des dispositions relatives aux neurosciences dans la loi de bioéthique. Pour ces instances, les problèmes éthiques engendrés par les progrès dans ce domaine de recherche se posent avec suffisamment d’acuité et d’actualité pour appeler une réponse spécifique.
a) Veiller aux enjeux éthiques des neurosciences et de leurs applications
Compte tenu des espoirs de thérapies nouvelles qui sont actuellement placés dans la recherche sur le cerveau, il ne serait pas souhaitable de freiner le travail des scientifiques. Mieux comprendre la portée de ces techniques et mieux évaluer les problèmes éthiques qu’elles posent constituerait une première étape dans l’approche de ces questions.
L’OPESCT recommande ainsi que l’impact des recherches en neurosciences au plan médical mais aussi social et environnemental soit périodiquement évalué(976), sans préciser pour autant par qui cette évaluation devrait être réalisée. Dans le même temps, le Conseil d’orientation de l’ABM a indiqué qu’il « pourrait être souhaitable d’élargir le champ de compétence de l’Agence de la biomédecine aux neurosciences. » (977) Cette extension du champ de compétence de l’ABM aux neurosciences permettrait de remplir l’objectif d’évaluation fixé par l’OPESCT.
S’il paraît prématuré de confier à l’ABM une mission de contrôle administratif sur tout projet de recherches entrepris dans le domaine des neurosciences et sur toute utilisation des techniques qui en sont issues, une mission d’évaluation de ces activités garantirait l’exercice d’une veille éthique pouvant conduire à alerter le législateur dans le cas où des dérives appelleraient une réglementation. Les données résultant de cette veille devraient figurer dans le rapport d’activité de l’agence.
Proposition n° 76. Confier à l’ABM une mission de veille éthique dans le domaine des neurosciences et de leurs applications.
b) Limiter l’usage de certaines techniques portant sur le cerveau humain
« Il ne faut pas avoir peur des neurosciences, mais la loi doit nous protéger de leur usage abusif » (978) a déclaré M. Didier Sicard, président honoraire du CCNE, au cours de son audition. Afin d’éviter les dérives précédemment mentionnées, constatées à l’étranger et notamment aux États-Unis, il apparaît souhaitable dès maintenant de restreindre l’utilisation de certaines techniques médicales portant sur le cerveau humain.
Introduire un nouveau principe général dans le code civil
L’article 16-3 du code civil, qui permet de déroger au principe d’intégrité du corps humain « en cas de nécessité médicale pour la personne, ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui », protège déjà l’intégrité du cerveau humain contre toute technique qui y porterait atteinte pour des fins autres que médicales. En revanche, l’utilisation de techniques telles que l’imagerie cérébrale n’entre pas dans le champ d’application de cet article, dans la mesure où ces techniques ne portent pas atteinte à l’intégrité du corps humain.
Afin de prévenir toute utilisation non médicale des techniques ayant pour objet le cerveau humain, telles que l’utilisation judiciaire de la neuroimagerie ou leur éventuel emploi comme outil de détection des mensonges, l’introduction d’une nouvelle disposition législative peut être suggérée.
Cette demande a été formulée par de nombreuses personnes entendues par la mission. M. Jean-François Mattei a milité en ce sens. Il est « nécessaire de légiférer sur les neurosciences, qui connaissent des avancées inquiétantes […] compte tenu des connaissances actuelles en matière d’imagerie cérébrale fonctionnelle, personne ne peut se prévaloir d’une image pour assumer ou se défaire d’une responsabilité quelconque » (979). La même position a été soutenue par l’OPESCT (980) et par la Conférence de consensus Meeting of minds dont les travaux portaient sur les neurosciences et qui a rendu un avis en novembre 2005 (981).
Le parallèle entre la problématique des neurosciences et la génétique a été particulièrement mis en valeur pas M. Hervé Chneiweiss (982) : « Les neurosciences soulèvent les mêmes questions que la génétique quant à la définition de l’individu et la nécessité d’en rester à des préoccupations thérapeutiques. […] Il faudrait appliquer aux neurosciences et à leur usage la plupart des principes établis à partir des réflexions sur la génétique et protéger les caractéristiques neurales de l’individu autant que ses caractéristiques génétiques, sur lesquelles on s’est peut-être trop focalisé jusqu’à présent. Beaucoup trop d’actes sont aujourd’hui pratiqués dans d’autres buts que le strict intérêt du patient. Il faut réserver toutes ces techniques à des fins thérapeutiques et en restreindre tout usage qui pourrait résulter d’une coercition sociale, fût-elle consentie. »
Pour introduire un nouveau principe restreignant l’utilisation de ces techniques portant sur le cerveau humain, le législateur pourrait s’inspirer de l’encadrement de l’analyse des caractéristiques génétiques, notamment de l’article 16-10 du code civil qui dispose que « l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ».
Pour l’heure, cet encadrement devrait porter sur les techniques consistant à produire des images des états cérébraux. Le fait que ces images peuvent être facilement produites sans porter atteinte à l’intégrité du corps, qu’elles pourraient être collectées et utilisées à des fins de discrimination rend nécessaire d’en restreindre l’utilisation à des seules fins médicales.
L’utilisation de la neuroimagerie dans le cadre de recherches scientifiques qui auraient une finalité autre que le soin doit être exclue pour éviter toute dérive susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne.
Des sanctions pénales devraient sanctionner tout mésusage de ces images, en s’inspirant de l’article 226-25 du code pénal, relatif à l’examen illégal des caractéristiques génétiques (983).
Ce principe pourrait toutefois être assorti d’exceptions, afin d’autoriser certains usages judiciaires de l’imagerie cérébrale, par exemple pour évaluer un préjudice physique dans le cadre d’une action en responsabilité.
Au vu des informations que l’ABM sera amenée à fournir au législateur en ce domaine, il conviendra d’apprécier, au fur et à mesure de l’évolution des techniques, la nécessité d’encadrer plus strictement l’ensemble des techniques portant sur le cerveau.
Proposition n° 77. Limiter l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale à des fins médicales (Article 16-14 nouveau du code civil).
Interdire les discriminations fondées sur les caractéristiques cérébrales
Mettant en exergue la parenté des problèmes de neuroimagerie avec ceux soulevés par l’examen des caractéristiques génétiques, de nombreuses personnes auditionnées ont craint que la neuroimagerie ne puisse justifier des pratiques discriminatoires : « Depuis leur apparition, il y a cinq ou six ans, les neurosciences enregistrent des progrès spectaculaires, mais on voit poindre la tentation de réduire la personne à ce qu’en révèle l’imagerie fonctionnelle. […] c’est pourquoi il est nécessaire de prévoir, dans les lois de bioéthique, des protections en mesure d’éviter tout risque de discrimination à partir d’une imagerie. » (984) a expliqué M. Didier Sicard. Mme Sarah Sauneron a défendu la même position : « Le code du travail, le code de la santé publique ou le code des assurances interdisent d’ores et déjà la discrimination génétique. Des dispositions identiques pourraient interdire la discrimination à partir des données de neuroimagerie que pourraient se procurer des assureurs ou des employeurs. » (985)
L’interdiction de toute discrimination sur le fondement des caractéristiques cérébrales telles qu’objectivées par la neuroimagerie, devrait être inscrite dans le code civil (nouvel article 16-14), dans le code pénal (art. 225-1), dans le code de la santé publique (art. 1141-1), dans le code du travail (art. L. 1132-1 et L. 1321-3) et dans le code des assurances (art. L. 133-1).
Proposition n° 78. Interdire les discriminations fondées sur les caractéristiques cérébrales telles qu’elles résultent de la neuroimagerie.
B. LES NANOTECHNOLOGIES METTENT EN LUMIÈRE DES PROBLÉMATIQUES ÉTHIQUES EXISTANTES
Les nanotechnologies font partie des sciences dites « émergentes », qui n’avaient pas été prises en compte dans les précédentes lois de bioéthique, faute, à l’époque, d’applications pratiques. Il n’existe qu’une seule mention légale des nanotechnologies, à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique. Celui-ci confie à l’ABM la mission de contrôler les activités liées aux « bionanotechnologies » relevant de ses domaines de compétence.
Les différents rapports de l’ABM, du CCNE et du Conseil d’État consacrés à la révision des lois de bioéthique ne font que de brèves mentions des nanosciences, sans préciser la nature des questions éthiques qu’elles soulèvent. On peut ainsi lire dans le rapport du Conseil d’orientation de l’ABM : « De nouvelles perspectives comme le développement des neurosciences, mais aussi de nouveaux domaines techniques (nanotechnologies, xénogreffes, etc.) font émerger de nouvelles questions éthiques au moins aussi importantes que celles traitées jusqu’à présent par le législateur. » (986) L’avis n° 105 du CCNE ne cite les nanotechnologies que de manière elliptique : « De nouvelles perspectives sont ouvertes par les découvertes des neurosciences qui peuvent affecter l’image même de l’homme, de l’idée qu’il se fait de sa place dans le monde et de sa liberté. Les nanotechnologies ou les xénogreffes posent également des problèmes éthiques jusqu’ici inédits ».
Quels sont ces problèmes éthiques inconnus jusqu’à maintenant qui sont évoqués par ces contributions ? Pour les cerner, il est nécessaire de dresser au préalable un bilan des nanotechnologies existantes ou à l’étude dans le domaine médical, sachant que leurs enjeux éthiques ne relèvent pas tous de la bioéthique. Cette analyse conduit à penser que, hormis certains risques liés à la perspective de la convergence des technologies, les problèmes bioéthiques soulevés par les nanotechnologies n’appellent pas, en l’état actuel de leur développement, une régulation particulière.
1. De nombreuses applications dans le domaine médical
Les nanosciences sont une nouvelle discipline dont les potentialités sont très importantes mais dont les applications dans le domaine médical sont aujourd’hui réduites.
a) Les nanosciences, un domaine en progrès rapide
Les définitions des nanosciences sont très variables. L’UNESCO en a recensé plus de dix (987). Leur point commun est de se fonder sur l’échelle de la matière à laquelle les nanosciences s’intéressent. Celle-ci est comprise entre 1 et 100 nanomètres, soit une variation allant de la taille d’un atome (moins de un nanomètre) à celle d’une molécule d’ADN (environ 100 nanomètres). Leur échelle est donc celle des éléments fondamentaux du vivant.
Les nanosciences se définissent également par leur ambition, qui est d’agir sur la matière à l’échelle nanométrique. La définition adoptée par la Nano-Initiative, programme fédéral lancé aux États Unis en 2001, met en avant ce critère en identifiant le caractère propre des nanosciences au fait de « travailler aux échelles atomiques, moléculaires et supra-moléculaires, approximativement entre 1 et 100 nanomètres, afin de comprendre, créer et utiliser des matériaux, des dispositifs et des systèmes possédant fondamentalement de nouvelles propriétés et fonctions à cause de leur petite taille. » (988)
Il est possible aussi de distinguer nanosciences et nanotechnologies. C’est notamment l’approche privilégiée par la Royal Academy dans son rapport Nanosciences and nanotechnologies de 2004 et l’Académie des Sciences.
Les nanosciences s’inscrivent dans deux types de programmes d’action. Le plus ambitieux est qualifié de bottom-up, et consiste, à partir d’atomes, à constituer des structures complexes. Il permettrait de façonner le monde atome par atome. Néanmoins, actuellement, les structures ainsi constituées sont très simples et « aucun chercheur n’a pu mettre au point des machines qui « partent de la base », et ils sont même très peu à y travailler » (989). La seconde approche est dite top-down et ambitionne de réduire au maximum la taille de certains objets. L’informatique en fournit un exemple.
Les nanosciences n’existeraient pas sans les possibilités offertes par de nouveaux instruments, tels que les microscopes par effet tunnel, à force atomique, électronique à haute résolution ou les pinces optiques, qui autorisent la manipulation de la matière atome par atome.
Les recherches menées dans le domaine des nanotechnologies sont en développement rapide. Elles portent aujourd’hui sur un marché de 700 milliards de dollars.
b) Des applications prometteuses dans le domaine médical
Les nanotechnologies concernent de nombreux secteurs d’activité et de production. Les attentes qui en découlent sont très importantes notamment dans le domaine médical où certaines techniques de cette nature sont déjà utilisées. C’est le cas notamment (990) :
– de l’imagerie, qui a été rendue beaucoup plus performante par le recours aux nanotechnologies. « Les nanotechnologies nous offriront un jour la possibilité de voir le cerveau fonctionner et d’en distinguer les fonctions moléculaires. » (991) a pu affirmer M. François Berger, directeur du département Nanomédecine et cerveau à l’Institut des neurosciences de Grenoble ;
– des nanobiopuces, qui commencent à rendre possible un diagnostic personnalisé et donc un traitement adapté ;
– du ciblage des thérapies sur les seules cellules malades. Les molécules de médicaments sont acheminées par une structure nanométrique vers les cellules pathologiques, ce qui autorise une réduction des doses prescrites et donc des effets secondaires. Cette propriété est d’autant plus intéressante que les nanoobjets traversent les barrières du corps et notamment la barrière hématoencéphalique ou l’enveloppe nucléaire isolant le génome ;
– des prothèses qui sont plus performantes et plus solides grâce aux nanotechnologies. L’implantation de bio-senseurs devrait révolutionner le traitement des handicaps. Ainsi que l’a observé M. François Berger, « les nanotechnologies ont permis de développer les prothèses sensorielles, en particulier dans le traitement des maladies oculaires. Le coating (revêtement) au moyen de « nano-outils » comme les nanotubes de carbone, permet une meilleure subsistance de ces dispositifs. » (992) ;
– de l’individualisation des traitements. Selon ce même chercheur, « l’échelon nanométrique, en permettant une détection plus précoce de la maladie, permet une gestion moins invasive et moins lésionnelle. Il aide également à mieux comprendre la maladie, car du fait de leurs caractéristiques intégratives, les nanotechnologies rendent possible d’observer la complexité individuelle de la maladie et de pratiquer une médecine personnalisée – ce que, jusqu’à présent, nous n’avions pas encore réussi à faire. » (993)
Il n’en reste pas moins que tous ces développements n’en sont qu’à leurs balbutiements. Ainsi que le montrent tous les rapports sur les nanosciences, nous ignorons encore les possibilités réellement ouvertes par celles-ci (994). En 2006 le Comité d’éthique du CNRS invitait à la prudence : « Bien que les recherches en nanosciences et nanotechnologies se soient considérablement développées depuis vingt ans, la plupart des réalisations envisagées sont largement futuristes : des promesses de médicaments vectorisés et ciblés, de systèmes invisibles de surveillance, de nanopoussières, de nanorobots… » (995)
Les problèmes éthiques soulevés par les nanosciences exigent donc un effort d’anticipation à partir des réalisations existantes. Mais la réflexion éthique doit être engagée dès maintenant car les investissements financiers en ce domaine sont d’ores et déjà considérables : on estime à 10 milliards de dollars les fonds alloués aux nanotechnologies et le marché mondial des nanoobjets devrait représenter 1 000 milliards de dollars en 2015.
2. Des enjeux qui ne relèvent pas tous des lois de bioéthique
En s’appuyant sur le rapport de la Royal Society, on peut recenser trois problèmes liés à l’utilisation qui pourrait être faite des nanotechnologies(996). Mais seules les perspectives d’intervention directe sur le corps humain relèvent de la loi de bioéthique.
a) La toxicité des nanoparticules
Les incertitudes quant à la toxicité des nanoparticules est actuellement le thème qui soulève le plus de débats. Cette toxicité pourrait être d’autant plus forte que les nanoparticules traversent les barrières du corps (997).
Ces risques concernent au premier chef les personnes qui manipulent des nanomatériaux et impliquent donc de définir de nouvelles normes de sécurité au travail (998). Mais ils entraînent également des menaces pour l’environnement car leur biodégradabilité n’est pas connue. Le spectre de la « gelée grise » a même été évoqué pour désigner un monde détruit par des nanorobots capables de s’autorépliquer, qui coloniseraient progressivement le monde.
Néanmoins, bien que ces enjeux touchent aux rapports entre la santé et les nouvelles technologies, ils n’entrent pas dans le cadre de la bioéthique, du moins tel que celui-ci a été jusqu’à présent défini. S’engager dans cette voie reviendrait à inclure dans la bioéthique toutes les conséquences environnementales des techniques de production, telles que la pollution atmosphérique.
b) Les menaces pesant sur la vie privée
Avec la miniaturisation des technologies au niveau du nanomètre, apparaît la perspective de pouvoir marquer et tracer toutes les choses et toutes les personnes. La technologie de la radio-identification (ou RFID), qui est actuellement millimétrique, fournit la préfiguration de ce que pourraient autoriser les développements des nanotechnologies dans la mesure où « tout produit sur terre pourra être identifié »(999). Les implications dans le domaine du respect de la vie privée sont majeures(1000). Ces enjeux pourraient relever en partie de la bioéthique, puisque les dispositifs servant à tracer les individus seraient implantés dans leur corps. Mais l’on se trouverait alors dans un cas d’intervention sur l’être humain en dehors d’une finalité médicale.
Des budgets importants sont actuellement consacrés à la recherche militaire dans le domaine des nanotechnologies. Celles-ci ont pour but, notamment, de mieux protéger les soldats et d’alléger les charges qu’ils transportent(1001). Là encore, ces enjeux ne relèvent pas de la loi de bioéthique, à l’exception des recherches tendant à améliorer les performances physiques des soldats par une action directe sur leur corps.
3. Des enjeux qui amplifient des problèmes éthiques existants
La miniaturisation des outils d’analyse et d’intervention sur le corps humain conduit à s’interroger sur l’utilisation des renseignements ainsi obtenus et sur la légitimité des actions rendues possibles sur l’organisme.
a) Les possibilités de personnaliser la connaissance du corps humain
Les nanotechnologies devraient, par l’intermédiaire de nanobiopuces, rendre possible la réalisation systématique et pour un coût faible de la carte génétique de chaque individu. Celle-ci pourrait se traduire par l’« identification d’un grand nombre de susceptibilités génétiques de l’individu par des outils diagnostics et des techniques analytiques », selon l’avis n° 95 du CCNE(1002). Pour l’Académie nationale de médecine, la perspective de ces recherches est celle « d’une miniaturisation de laboratoires effectuant le génotypage ou même le séquençage d’un ADN : c’est ainsi que vient d’être décrit un tel dispositif de séquençage de masse (ou pyroséquençage) complet d’un ADN humain ».(1003)
Ces nouvelles techniques ont également été mentionnées par M. Claude Huriet au cours de son audition : « Apparaissent aujourd’hui quantité d’applications diagnostiques et thérapeutiques : capteurs implantables, organes artificiels, micro-laboratoires sur puces – les fameux labs on chip, dont le marché le plus porteur est celui de la puce à ADN, permettant d’effectuer des analyses d’ADN ».(1004)
Aussi nouvelles que soient ces perspectives, elles renvoient à des problématiques éthiques familières, en particulier :
– la question du droit de ne pas savoir. À partir du moment où la technologie rendra réalisable à faible coût la cartographie complète du génome humain, se posera avec davantage d’acuité la question du droit à ne pas savoir, pour le patient et pour sa parentèle (ou à l’inverse, du droit d’être informé). Des dispositions génétiques à telle ou telle pathologie pourraient en effet être repérées alors même qu’il n’existe pas de traitement pour ces dernières ;
– la question du consentement. Le CCNE, dans son avis n° 95, insiste sur le risque de réduire l’homme à son « code barre » génétique(1005). De surcroît, la miniaturisation des technologies permettant une meilleure transmission de l’information, il existe un risque que les données génétiques et médicales recueillies en permanence sur chaque individu ne soient utilisées par des tiers (notamment les sociétés d’assurance), à l’insu de l’intéressé .
b) Les principes éthiques sont-ils remis en cause par cette nouvelle technique ?
A plus long terme, l’intégrité de l’espèce humaine pourrait également être mise en cause par le développement et la maîtrise des techniques de recombinaison de l’ADN. Par exemple, au moyen de ces techniques, le choix de chaque caractéristique de l’enfant à naître pourrait devenir possible.
Si cette dernière question fait l’objet d’une disposition légale spécifique qui interdit de porter atteinte à l’intégrité de l’espèce (article 16-4 du code civil), des débats ont pu s’ouvrir sur la portée de cette interdiction au regard de certains progrès scientifiques. Ainsi les résultats d’expériences de manipulations génétiques sur les souris tendraient à prouver qu’il est possible de rendre celles-ci plus résistantes à certains cancers et à allonger ainsi leur durée moyenne de vie (1006). Des questions éthiques tout à fait nouvelles se poseront-elles le jour où il pourrait être envisagé d’appliquer ces techniques à l’homme ? Cela n’est pas certain du fait que ces techniques, consistant à créer un homme transgénique, devraient passer, en tout état de cause, par une phase d’expérimentation. Une telle perspective supposerait que soit admise comme acceptable la possibilité de réaliser ce que M. Jean-François Mattei a appelé « des essais d’homme » et de déroger à un interdit fondamental.
Ainsi, « Le préfixe nano est-il un changement total de paradigme ou un simple changement d’échelle ? », se demande le CCNE dans son avis n° 96. La même question se pose pour les enjeux bioéthiques soulevés par les nanotechnologies. La réponse apportée n’est pas neutre. Soit on élabore de nouveaux principes pour y répondre, soit on applique les principes prévalant dans d’autres domaines de la bioéthique, s’ils ne font que reprendre, sous une autre forme, des problèmes ayant déjà reçu un encadrement.
Selon le comité d’éthique du CNRS, les « problèmes éthiques [posés par les nanosciences] n’ont rien d’original » car il s’agit d’une « technologie générique », qui va affecter l’ensemble des secteurs de production. Les nanotechnologies « potentialisent » ou redéfinissent les pouvoirs de chaque technologie, comme l’informatique(1007). Aussi nouvelles que soient les données scientifiques de ces nouvelles approches, les questions induites par les nanosciences sont déjà familières.
C. LA PERSPECTIVE DE LA CONVERGENCE DES TECHNOLOGIES, UN DÉFI POUR LA BIOÉTHIQUE DE DEMAIN
Le terme de « convergence » des technologies a été employé dans un rapport de juin 2002, commandé par la National Science Foundation (NSF) américaine(1008). Cette étude dresse l’état des lieux des progrès réalisés dans quatre domaines scientifiques particulièrement dynamiques :
– les nanotechnologies, pour ce qui est de la miniaturisation des dispositifs, à une échelle compatible avec le vivant (N) ;
– les biotechnologies, qui rendent possibles des interventions sur l’ADN (B) ;
– l’informatique, en ce qui concerne la robotique et l’intelligence artificielle (I) ;
– les sciences cognitives, pour les interactions entre la machine et le cerveau (C).
Ces quatre disciplines sont désormais regroupées sous un acronyme (NBIC). Leur interaction possible est ainsi résumée : « Si les Cogniticiens peuvent le penser, les Nanotechniciens peuvent le construire, les Biologistes peuvent le développer, les Informaticiens peuvent le surveiller et le contrôler ».
Chacune de ces quatre disciplines permet d’accroître les résultats obtenus dans les autres, comme l’a fait remarquer M. Jean-Didier Vincent au cours de son audition : « La conjonction de ces quatre disciplines augmente, par un effet d’amplification et d’émergence, les performances de chacune prise isolément. Des budgets importants y sont consacrés au États-Unis ».(1009)
Cette convergence ouvre des perspectives médicales considérables, ainsi que l’a confirmé M. François Berger (1010). Un exemple de cet effet amplificateur lié à la convergence technologique a été fourni par M. Hervé Chneiweiss, dans le domaine de la compensation du handicap : « Déjà, grâce à des électrodes implantées dans leur cortex visuel, des aveugles peuvent s’orienter dans l’espace, de manière certes encore très rudimentaire, mais suffisamment pour pouvoir se déplacer de manière autonome. Les points de stimulation sont aujourd’hui au nombre d’une cinquantaine, mais le développement des nanotechnologies devrait permettre une rapide montée en puissance » .(1011)
Aux États-Unis, le programme de recherche NBIC date de 2002 ; il est explicitement associé aux possibilités d’augmentation des capacités ou des performances humaines.
Il est à noter que l’effort financier de la France en faveur des technologies convergentes est réel. Il se traduit par le financement de pôles d’excellence, tels que le campus Minatec de Grenoble. C’est également dans cette ville que doit être ouvert en 2011 le campus CLINATEC, Centre de recherche biomédicale dédié aux applications des micro et nanotechnologies pour la santé. Ce centre devrait regrouper des équipes pluridisciplinaires et sera centré sur le développement de neuroprothèses pour le handicap moteur ou sensoriel et les dispositifs innovants permettant la neurostimulation, les biopsies et la délivrance de médicaments contre le cancer.
1. La réflexion éthique appelée par cette convergence
a) La convergence des sciences émergentes ouvre de très nombreuses possibilités d’action sur l’humain
Comme l’indique le rapport de la NSF, « c’est un moment unique dans l’histoire des réalisations techniques ; l’amélioration des performances humaines devient possible par l’intégration des technologies. » (1012) Le rapport Beyond Therapy(1013) identifie quatre domaines dans lesquels les applications des sciences convergentes pourraient être employées pour des usages allant au-delà de la thérapie : « l’amélioration » des enfants, l’accroissement des performances physiques, l’allongement de la durée de vie et la modulation de l’humeur et des souvenirs.
Une tentative de synthèse des possibilités ouvertes par les sciences émergentes et des phantasmes qu’elles peuvent susciter a été réalisée par M. Jérôme Goffette dans son livre Naissance de l’anthropotechnie (1014).
PERSPECTIVES D’ACTION SUR L’HOMME
Réalités et perspectives proches |
Horizons lointains | |
Force |
Dopage médicamenteux Auto-greffes |
Modifications génétiques et physiologiques fondamentales Adjonction de prothèses ou de greffes |
Intelligence |
Dopage de différentes capacités : mémoire attention, dynamisme |
Modifications physiologiques du cerveau Implants ; connexions homme-machine |
Procréation |
Anticonceptionnels, avortement FIV, insémination, DPI/DPN, sélection d’embryons, clonage reproductif humain |
Ectogenèse Grossesse masculine Modification de l’embryogenèse Choix des caractéristiques génétiques ; modifications génétiques de l’embryon |
Sexualité |
Substances aphrodisiaques et anti-libido Ablation d’un sexe et greffe de l’autre |
Sexuations autres : changement de sexe avec peu d’effets secondaires Hermaphrodisme, suppression du sexe, sursexuation, troisième sexe |
Esthétique |
Effacement de la laideur, mise en conformité aux formes esthétiques habituelles Modifications chirurgicales de la silhouette, du visage ou de la couleur de la peau |
Transformations plus poussées de l’apparence, possibilité d’obtenir toute forme humaine Esthétiques méta-humaines |
État émotionnel |
Psychotropes actuels modifiant l’humeur (mais effets secondaires) Modifications par certaines pratiques psychologiques |
Psychotropes améliorés, plus puissants, variés et ciblés Orgue d’humeur : programmation de l’humeur et des états émotionnels |
Anti-âge |
Substances ou pratiques retardant le vieillissement ou le masquant (effets modestes) Allongement de l’espérance de vie dû aux conditions de vie, à l’efficacité médicale, à l’alimentation |
Recours à des cocktails anti-âge de plus en plus efficaces, à des modifications génétiques anti-sénescence La mort ne serait plus qu’accidentelle, délibérée ou provoquée par les rares maladies incurables |
Création |
Prothèse s’adjoignant au corps Création d’un embryon à partir de lignées cellulaires |
Cyborg Création d’embryon par synthèse complète Création de chimères Création de méta-humains |
Source : Jérôme Goffette, Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris, Vrin, 2008, p. 158-159.
La convergence NBIC ouvre donc des perspectives considérables, dans lesquelles « la condition humaine n’est plus une donnée, c’est désormais un jeu de possibles, une matière à projets » (1015).
La difficile distinction entre soin et « amélioration »
La convergence de ces techniques brouille la frontière entre soin et « amélioration ». « Les frontières entre la médecine thérapeutique et la médecine d’amélioration sont difficiles à établir, en particulier chez les patients âgés. Ces questions sont extrêmement complexes »(1016) a expliqué M. François Berger. Se pose en effet, dans ce cas, la question de la limite entre la lutte contre la dégradation des facultés corporelles et l’amélioration de ces mêmes facultés.
De fait, les mêmes techniques sont susceptibles d’un double usage, ainsi que le note le rapport Beyond Therapy : « Le « double usage » d’une même technologie les rend attractives y compris pour les personnes qui ne sont pas malades mais qui souhaiteraient les utiliser pour avoir l’air plus jeunes, pour être plus performantes, plus heureuses ou pour devenir plus « parfaites » » (1017)
C’est notre conception de la santé et de la maladie qui se trouve ainsi remise en cause par les sciences émergentes : « Le champ du pathologique correspond actuellement à un organe détruit, ou à un cancer de taille macroscopique. Les nanotechnologies vont nous obliger à définir autrement la pathologie puisqu’elles s’adresseront à une personne saine, qui n’a pas encore ressenti sa maladie. En tant que médecin, je n’ai pas le droit d’aller dans cette direction. Nombreux sont ceux qui souhaitent élargir le champ du pathologique. Ce n’est pas au médecin mais à la société et à ses représentants de définir ce qu’est un homme malade. […] La permission d’utiliser des thérapeutiques interventionnelles, susceptibles d’améliorer sensiblement les fonctions mnésiques des personnes de plus de 70 ans, est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Ces pratiques doivent être encadrées. » (1018)
On remarquera que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté une définition de la santé qui ne se limite pas à l’absence de pathologie : « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité. »(1019). Or en incluant pour partie les conditions de vie à l’aune de ces perspectives « d’amélioration » de la condition humaine, cette définition pourrait revêtir une signification toute différente de son sens originel, puisqu’elle tendrait à légitimer le recours à ces techniques d’amélioration des performances humaines si l’individu y consent.
b) Une réflexion éthique indispensable
« Il faut dès à présent s’interroger sur ces questions, pour lesquelles la recherche précédera sans doute la réflexion » (1020) a fait valoir M. Philippe Pouletty, Président de France Biotech.
Des problèmes éthiques qui commencent à se poser
Certaines substances ou certaines techniques posent d’ores et déjà en elles-mêmes des problèmes éthiques dans la mesure où elles sont utilisées en l’absence de finalité thérapeutique ou scientifique. On peut s’en convaincre en s’appuyant sur des exemples extraits du rapport Beyond therapy :
– l’emploi de ces substances pour répondre à l’aspiration à avoir de « meilleurs enfants » est une bonne illustration de ces pratiques. Plus de quatre millions d’enfants américains sont actuellement traités pour une prétendue hyperactivité par du méthylphénidate, mieux connu sous le nom de Ritaline. En réalité, seule une faible partie de ces enfants répond aux critères de la prescription médicale. Cependant, cette amphétamine est prescrite car elle est réputée améliorer les capacités d’attention et donc les performances scolaires. Mais sa consommation n’est pas sans soulever des problèmes éthiques évoqués par M. Hervé Chneiweiss : « on ne peut pas fermer les yeux par exemple sur cet usage de la Ritaline qui ne relève pas de la science-fiction, du moins aux États-Unis. Quelle garantie avons-nous que l’on n’y viendra pas un jour en France ? Cette substance, qui est en fait une amphétamine, est devenue aux États-Unis l’une des drogues les plus faciles à se procurer parce qu’elle est bon marché. » (1021)
– l’amélioration des performances physiques à l’aide de substances ou de techniques médicales n’est pas récente. Le dopage, dans le domaine sportif, est en effet connu et combattu de longue date, au nom, notamment, de ses effets potentiellement dévastateurs pour la santé des sportifs. Mais ces pratiques se développent dans le domaine militaire où des recherches sont engagées, voire bien avancées, dans le but d’améliorer les capacités physiques des soldats. Ainsi la vision de nuit fait l’objet de recherches approfondies, comme l’a indiqué M. Jean-Didier Vincent (1022), qui est également président du club de réflexion sur l’éthique liée aux NBIC du Centre des hautes études en armement (CHEAr) au ministère de la défense. M. Alain Pompidou, ancien président de l’Office européen des brevets, a fait part aussi de son côté de l’intérêt de ces recherches pour la défense: « On peut par exemple développer la capacité de la rétine pour lui donner des qualités comparables à celles d’une caméra infrarouge. L’introduction de telles techniques en matière de défense, qui sont le résultat des technologies convergentes, permettra de disposer d’avantages compétitifs considérables évidents. Ces applications existent déjà. » (1023) ;
– dans la perspective de la quête de l’éternelle jeunesse, des pratiques telles que la chirurgie esthétique connaissent également un succès croissant, contribuant à généraliser les premières prothèses dépourvues de finalité médicale, telles que les prothèses mammaires. Or, elles constituent des applications à des fins non médicales de techniques chirurgicales. Si elles sont actuellement encadrées en France (par le biais notamment d’entretiens préalables avec un psychologue), des abus ont néanmoins pu être constatés. En tout état de cause, l’augmentation de la population âgée ne pourra que renforcer cette quête. La question se posera de savoir quelles pratiques de « rajeunissement » peuvent être considérées comme acceptables ;
– l’action sur l’activité cérébrale a connu de nouvelles perspectives au cours des dernières décennies. L’emploi de Prozac ou de Ritaline s’est très largement répandu. Des livres à destination du grand public ont même été publiés afin de l’informer sur les molécules les plus efficaces pour améliorer les performances intellectuelles ou physiques. On citera par exemple l’ouvrage 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement (1024), dont le préambule précise qu’« il ne s’agit pas d’un ouvrage de médecine s’adressant à des personnes malades. » ou du Guide des nouveaux stimulants (1025). Les possibilités ouvertes récemment par la recherche démultiplient ces usages dépourvus de finalité médicale : « On peut d’ores et déjà modifier certaines fonctions végétatives de notre système nerveux central comme l’appétit, le sommeil ou la sexualité, mais aussi des fonctions cognitives comme l’humeur ou la mémoire, par le biais de molécules chimiques ou d’autres procédés plus invasifs comme les implants cérébraux, appelés à se développer. […] Il existe des molécules comme l’ocytocine ou le Modafinil qui peuvent modifier non seulement les capacités d’éveil, mais aussi la réactivité et les comportements. Secret de Polichinelle, il n’y a pas de salle de marché aujourd’hui dans le monde où la plupart des acteurs ne prennent un psychostimulant, en particulier de Modafinil » a expliqué M. Hervé Chneiweiss (1026).
C’est donc dès maintenant que commencent à se poser les premiers problèmes éthiques liés à la volonté d’augmentation des capacités humaines par le biais de techniques médicales ou scientifiques : jusqu’où peut-on modifier les fonctions cérébrales d’une personne ? Où se situe la frontière entre dopage et entraînement ? Quelles peuvent être les conséquences sociales de la généralisation de pratiques ayant pour but l’amélioration des performances individuelles ? Le mouvement des transhumanistes apporte à ces questions des réponses qui connaissent un certain écho.
Le transhumanisme et le posthumanisme, des idéologies actives
Le premier objectif des transhumanistes est de faire reculer les limites de la vie, ce qui implique de lutter contre les maladies, avec la perspective, à long terme, de libérer l’homme de la mort.
Mais ce mouvement prône également l’utilisation des technologies modernes à des fins de transformation de l’homme et d’amélioration de ses performances. Selon les explications de M. Alain Grimfeld, président du CCNE, « Les « trans-humanistes » considèrent que la vie humaine dans sa forme actuelle tend vers sa fin et que si on a les moyens technologiques de créer une autre espèce, c’est le moment de le faire. Pour eux, l’espèce humaine a vécu et doit céder place au transhumain » (1027).
À terme, c’est la spécificité de l’espèce humaine qui aurait vocation à disparaître, dans la mesure où la différence entre humains et machines est destinée à s’atténuer progressivement : « Pour eux, l’humanité devra s’élargir au non humain – cyborgs, clones, robots, tous les objets intelligents – l’espèce humaine perdant son privilège au profit d’individus inédits, façonnés par les technologies. […] le transhumanisme assume un certain cynisme : il s’agit en effet d’atteindre […] une intelligence non biologique qui fera rupture »(1028) a indiqué M. Jean-Michel Besnier.
La différence entre posthumanisme et transhumanisme n’est guère fixée et demeure sujette à interprétation. Pour ce philosophe, « le second désigne souvent une phase de transition vers le premier. »
Ce que l’on constate cependant, c’est que l’idéologie transhumaniste est actuellement le seul mouvement structuré à avoir adopté une position publique concernant ces problématiques. Le mouvement mondial du transhumanisme, World Transhumanist Association (devenue depuis Humanity+ ou H+) est apparu en 1998. Théorisé par Nick Bostrom, il prône la convergence NBIC. Inspiré du mouvement des extropiens (1029) – apparu dix ans auparavant dans le sillage de Max More – il est représenté en France par l’association française transhumaniste Technoprog.
Mais ce faisant, cette monopolisation du débat public, cette vision unilatérale des implications de ces perspectives scientifiques ne sont pas sans danger. Aussi est-il nécessaire de promouvoir une discussion pluraliste où tous les points de vue puissent s’exprimer et être informés avec la plus grande précision. La controverse provoquée par le forum de Lille organisé le 17 novembre 2009 dans le cadre du débat public sur les nanotechnologies illustre la nécessité d’un débat public. Celui-ci pourrait prendre la forme d’une conférence de citoyens s’inscrivant dans le cadre des nouveaux pouvoirs du CCNE en la matière(1030).
Proposition n° 79. Inviter le ministère de la santé à organiser une conférence de citoyens sur les enjeux bioéthiques des sciences émergentes et leurs applications aux techniques visant à améliorer les performances humaines.
2. L’évaluation de ces technologies au regard des principes fondamentaux
Les questions éthiques soulevées par l’amélioration des performances humaines semblent pouvoir se résumer à deux problématiques : leur caractère licite ou non et le rôle imparti à la médecine dans ce contexte.
a) Les grandes problématiques éthiques liées à l’amélioration des performances humaines
On peut recenser quatre grandes questions éthiques découlant des possibilités d’intervenir de manière croissante sur le corps humain.
La promotion de techniques tendant à l’amélioration des performances humaines conduit à poser la question de l’égalité entre les individus.
Le sens pris par cette problématique dans ce cadre a été mis en lumière par le cas d’Oscar Pistorius, un sprinteur sud-africain qui a voulu courir avec les athlètes valides aux Jeux Olympiques de Pékin, alors qu’il utilisait des prothèses du fait d’une amputation des jambes subie dans son enfance. Ce droit lui a été dans un premier temps refusé, au motif que ses prothèses lui conféraient un avantage par rapport aux autres concurrents. La règle 144.2 (e) de la Fédération internationale d’athlétisme interdit en effet « l’utilisation de tout dispositif technique incluant des ressorts, des rouages ou tout autre élément qui confère un avantage à un athlète par rapport à celui qui n’en utilise pas. » Or le Tribunal arbitral du sport a jugé que les examens scientifiques pratiqués notamment au regard du métabolisme de l’athlète et de l’analyse de sa foulée, ne permettaient pas de déduire que ces prothèses l’avantageaient par rapport à un athlète valide (1031). Cependant, s’il était démontré que des prothèses assuraient un mouvement plus rapide que l’anatomie de la jambe humaine, le tribunal se réserverait le droit de ne pas autoriser l’athlète qui les porterait à concourir avec les sportifs valides (1032).
A ainsi été jugé admissible le recours à une technique améliorant les performances physiques dans la mesure où celle-ci rétablit une égalité et n’instaure pas une supériorité.
On peut ainsi s’attendre à ce que l’accroissement des possibilités d’amélioration des performances humaines soit porteur, à moyen terme, d’atteintes au principe d’égalité. Tel est d’ailleurs l’objectif explicite de certaines de ces pratiques. L’ouvrage précédemment cité portant sur les médicaments améliorant les performances cognitives ne dissimule pas cette finalité : « Qu’il s’agisse de préparer un concours, de terminer un travail urgent, de se défendre, de survivre dans un milieu hostile, de briller en société ou simplement d’exposer clairement ses idées, avoir la possibilité de puiser dans ses réserves pour disposer d’un ‘‘plus’’ qui fera la différence constitue le facteur déterminant du succès. Ce livre vous indique les règles de bon usage de ce plus. » (1033)
Dans la mesure où ces dispositifs auraient un coût, il est évident qu’ils seraient réservés, au moins dans un premier temps, aux personnes qui auraient les moyens de les acheter. De tels choix pourraient conduire à une société duale où coexisterait une élite aux performances « améliorées », une « aristocratie améliorée biotechnologiquement » (1034) et une majorité qui ne pourrait pas les imiter. Cette perspective habite de nombreux ouvrages de science fiction et a été explicitée par M. Hervé Chneiweiss : « Les discriminations potentielles sont un autre aspect du coût social de l’amélioration des performances. Faudra-t-il créer une Agence nationale de l’amélioration des fonctions cognitives pour garantir que nul ne soit discriminé, évaluer les procédés, leur efficacité réelle, leur accessibilité ? Que fera-t-on quand on aura découvert des molécules améliorant réellement la mémoire ? » (1035)
Si les techniques et les substances permettant d’améliorer les performances de chacun devenaient d’un accès de plus en plus facile, les idéaux d’excellence qui orientent les conduites collectives exerceraient une pression accrue sur les membres de la société. La technique semblerait en effet fournir tous les moyens pour franchir la distance entre le réel et l’idéal : « beaucoup des technologies mélioratives futures seront certainement utilisées pour coller à des notions de l’excellence et de l’amélioration définies socialement ou à la mode, qui seront vraisemblance étroites et conformistes. » (1036)
Cette menace pourrait apparaître en premier lieu dans le domaine de l’éducation s’il était prouvé que l’absorption de certaines substances était susceptible d’améliorer les performances scolaires des enfants. L’exemple précédemment mentionné de la Ritaline atteste de la réalité de ce risque.
De manière plus inquiétante, il serait possible, à moyen ou à long terme, que les techniques portant sur le cerveau soient instrumentalisées à des fins sociales. Celles-ci sont déjà utilisées dans le domaine de la communication publique et de la publicité même si leur efficacité demeure sujette à débat(1037).
Face à ces techniques qui réduisent l’individu à une matière pouvant être transformée et adaptée à des fins réductrices, la liberté de chacun devra être protégée.
L’intérêt individuel et l’intérêt général
La possibilité de divergences entre des intérêts individuels et l’intérêt général doit également être prise en considération. Elle se décline de plusieurs manières dans le domaine de l’amélioration des performances humaines.
– Les effets secondaires sur la santé
La plupart des médicaments actuellement disponibles ont des effets secondaires, au moins chez certaines catégories de malades. Il en va évidemment de même pour les dispositifs médicaux implantables. Ainsi, ceux qui sont utilisés dans le cadre de la maladie de Parkinson sont susceptibles de rejet, comme l’a indiqué M. François Berger. De même, la consommation de Modafinil ou de Ritaline, précédemment évoquée, est susceptible d’entraîner des effets secondaires importants, notamment un risque d’addiction.
Plus fondamentalement, si les techniques améliorant les performances humaines étaient largement disponibles, le risque serait de voir les individus survaloriser le court terme à l’occasion d’un examen, d’une épreuve physique, au détriment de leur santé à long terme.
De surcroît, dans le domaine de la santé, il est illusoire de croire que le mieux soit forcément positif. M. Hervé Chneiweiss a cité l’exemple de la mémoire. L’hypermnésie dont sont victimes certaines personnes constitue un handicap lourd, dans la mesure où leur cerveau est incapable de sélectionner l’information directement pertinente(1038).
Au regard de ces risques, au cas où ces techniques se généraliseraient, il reviendrait à la puissance publique d’en évaluer les effets.
– L’affectation sociale des ressources
La généralisation de ces possibilités soulèverait la question de la meilleure affectation sociale des ressources médicales, qui sont en nombre limité.
Il serait en effet choquant que certains puissent avoir recours à ces techniques, alors que tous n’ont pas accès aux soins qui présentent pourtant une nécessité vitale. Se poserait alors la question de l’opportunité de la prise en charge collective de ces techniques d’amélioration. Une telle problématique se fait déjà jour à propos des opérations de chirurgie plastique. En effet, si la chirurgie réparatrice est prise en charge par la sécurité sociale, tel n’est pas le cas des opérations de chirurgie esthétique à proprement parler.
– La transgression au nom de l’intérêt général
Même si, de manière générale, un consensus se dégageait pour que les techniques d’amélioration des performances humaines ne soient pas utilisées ou soient fortement encadrées, il se peut que, dans certains cas particuliers, celles-ci apparaissent nécessaires. Telle est l’argumentation développée, par exemple, pour justifier le fait que les forces armées bénéficient des technologies les plus avancées, dans un contexte international où il n’est pas envisageable que tous les États renoncent à avoir recours à ces techniques. C’est ce qu’a plaidé M. Jean-Didier Vincent : « Améliorer les performances de l’homme est en effet une nécessité pour les militaires, qu’il s’agisse de combattre la fatigue, d’améliorer les facultés de déplacement ou d’augmenter les capacités sensorielles. Les nanotechnologies permettent de produire des matériaux d’une très grande légèreté et de concevoir des sortes d’armures aux performances exceptionnelles, comme soigner les blessures. » (1039)
Il sera donc nécessaire de définir les technologies acceptables et celles qui ne le sont pas, y compris dans des situations de péril collectif. Ces questions éthiques ont vocation à nourrir un débat de société sur les buts assignés à la science et à la médecine. Ainsi que l’observait M. Hervé Chneiweiss, « la vraie question, qui relève du politique, est celle de la norme sociale. Laisse-t-on libre cours au libéralisme le plus total, chacun étant libre de faire ce qu’il veut de son corps, y compris de son cerveau, dès lors qu’il y consent, ou cherche-t-on à lutter contre les discriminations et souhaite-t-on que les performances, de quelque nature qu’elles soient, demeurent liées à l’effort personnel et non à la prise d’une substance médicamenteuse ? » .
L’identité et la dignité de la personne
Enfin, se pose la question de l’identité personnelle. Qui est habilité à définir l’état à partir duquel l’identité personnelle est modifiée ? À partir de quel niveau de transformation technologique de l’être humain peut-on soutenir que ses « performances » ne peuvent plus lui être attribuées en propre mais résultent de la seule combinaison du corps et de la technique ?
La différence entre transformation artificielle du corps et entraînement ou apprentissage est importante, dans la mesure où l’identité de celui qui améliore ses performances physiques est de plus en plus définie au regard de sa composition organique et de moins en moins en fonction de son « vécu ». D’un point de vue subjectif, il existe une différence importante entre les changements qui résultent d’un travail sur son corps et ceux qui découlent d’un travail que d’autres ont fait sur notre corps.
Néanmoins, il n’existe pas de seuil entre l’un et l’autre : il n’y a qu’une gradation entre actes et non pas une différence de principe. Le seuil séparant l’alimentation saine du dopage est ainsi difficile à établir. M. Jean-Michel Besnier en a donné une illustration : « La « cyborgisation » commence dès l’implantation d’un dispositif électronique : en ce sens, le détenteur d’un pacemaker pourrait être considéré comme un cyborg. Cela n’ira pas sans poser à terme la question de la limite de l’humain et du non humain en nous. » (1040) Ce seuil deviendra de plus en plus difficilement identifiable, ainsi que l’a suggéré M. Alain Pompidou : « Le dopage est interdit pour les sportifs, mais qu’en sera-t-il demain si leurs performances musculaires sont accrues par la neurobiotique, avec l’aide de simples petites puces ? On peut très bien imaginer que leurs fibres musculaires soient stimulées par ces petites puces. […] Une micropuce se substitue au cerveau dans le cadre de l’entraînement. Ce n’est pas de la science-fiction, c’est de la recherche. » (1041)
Se posera donc nécessairement, à terme, la question des valeurs de l’humanité et de ce qui fait le propre de l’homme.
Certaines personnes entendues par la mission ont fait de la préservation de la dignité le critère de légitimité des interventions sur la personne humaine. Ainsi, Mme Corinne Pelluchon a invoqué ce critère dans ces termes: « Cette distinction entre thérapie et amélioration suppose une définition figée de ce qui est normal, considéré comme une moyenne à atteindre. Le critère que je propose est de tenir pour indigne (et ici la dignité devient un adjectif) une pratique qui dégrade le sens d’une activité » (1042). Telle était également la réflexion du rapport Beyond Therapy : « Les animaux courent, souvent vite. […] Le guépard moyen court bien plus vite que le plus rapide des êtres humains et est beaucoup plus beau à regarder courir. Mais nous n’admirons pas le guépard comme nous admirons le champion olympique car le champion olympique court de façon humaine, comme un être humain. Pour le dire simplement, quand on regarde une performance athlétique comme la performance d’un individu, nous ne pouvons pas séparer le résultat (le temps le plus rapide) de l’activité (courir). » (1043)
La question de la préservation de l’identité, support de la conscience et de la dignité de la personne se pose donc avec une particulière acuité dans les applications possibles des sciences émergentes.
b) La médecine face à l’amélioration des performances humaines
Des réponses qui seront apportées à ces différentes questions découlera peut-être un nouveau rôle pour la médecine et les médecins. Il n’en reste pas moins que le rôle de ces derniers est de prévenir la maladie, de la guérir et de soulager le malade. Or, le développement des techniques permettant l’amélioration des performances humaines conduit à penser de nouvelles pratiques, partiellement ou totalement déconnectées du soin.
La médecine et l’anthropotechnie, deux référentiels différents
Le terme d’anthropotechnie a été forgé par M. Jérôme Goffette pour désigner un « art ou une technique de transformation extra-médicale de l’être humain par intervention sur son corps »(1044), qui vise « non plus la restauration de l’état normal, mais l’instauration d’un état surnormal, d’une condition modifiée censée répondre à nos demandes multiples : être plus beau, plus fort, plus intelligent, etc. La médecine réduit des « moins », tandis que l’anthropotechnie tente de donner des « plus » – réels ou illusoires. » (1045)
Sont apparues des pratiques anthropotechniques, qui se déroulent dans un cadre médical, mais qui ne sont pas destinées uniquement à lutter contre des pathologies ou à restaurer un état de santé. Tel est le cas par exemple de la prescription de produits contraceptifs (sauf à considérer que la grossesse est une pathologie), de produits « dopants » physiquement ou intellectuellement ou du recours à la chirurgie esthétique.
Les médecins sont de plus en plus sollicités pour répondre à des besoins qui ne font pas uniquement partie du champ médical. En témoignent les prescriptions très importantes de psychotropes, qui n’ont pas vocation à répondre à des situations pathologiques mais sont demandées par des personnes, alors qu’aucune finalité médicale ne peut être attribuée à ces produits.
Cependant médecine et anthropotechnie répondent à des finalités tout à fait différentes. Alors que le médecin doit lutter contre la pathologie pour rétablir l’état « normal » du patient, l’anthropotechnicien est un prestataire de services qui change le corps d’un client. Si la finalité de la médecine est de lutter contre la maladie, celle de l’anthropotechnie est de répondre à un désir d’altération.
Si la consultation médicale est centrée autour d’un diagnostic et d’un traitement, l’anthropotechnicien doit au contraire présenter à son client les choix possibles d’intervention sur son corps et faire en sorte que le client reste le seul maître de la décision finale. C’est ainsi qu’en matière de chirurgie esthétique, un délai de réflexion minimal de quinze jours est imposé à la personne concernée par l’article D. 6322-30 du code de la santé publique.
TABLEAU COMPARANT LE DÉROULEMENT D’UNE CONSULTATION MÉDICALE ET ANTHROPOTECHNIQUE
Consultation médicale |
Consultation anthropotechnique |
Documentation sur la situation du patient et ses antécédents |
Idem |
Circonstances liées à la pathologie et symptômes |
Expression de la demande du client |
Auscultation |
Idem mais a pour but d’évaluer les risques |
Diagnostic |
Présentation par le médecin des choix possibles, de leurs risques, des effets indésirables et du cadre légal. |
Traitement et pronostic |
Réflexion et choix du client |
Cette problématique née de la délimitation entre le soin et l’amélioration se retrouve également dans le cadre des recherches biomédicales, comme l’a relevé M. François Berger : « Avons-nous le droit de stimuler des patients qui ne présentent aucun symptôme, sachant que cette pratique comporte, comme tout acte neurochirurgical, un certain nombre de risques ? » (1046)
L’anthropotechnie n’est pas conforme aux règles de la déontologie médicale
Plusieurs articles du code de déontologie médicale s’opposent à ce que des médecins pratiquent des actes qui relèveraient de l’anthropotechnie :
– l’alinéa 2 de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, qui prévoit que le médecin « doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. ». La médecine n’a donc pas pour but de créer un état de santé artificiel mais de rétablir un état normal. Le patient est celui qui souffre (patiens) et le médecin, celui qui en prend soin ;
– l’article R. 4127-40 du même code, qui indique que : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » Les pratiques visant l’amélioration des performances ne répondant pas à une situation de détresse ou de maladie et toute intervention créant des risques, même minimes, pour la personne qui la subit, les médecins ne devraient pas y recourir.
Cette différence entre ces deux exercices fait dire à Jérôme Goffette que « la déontologie médicale ne peut pas accepter les pratiques anthropotechniques, car elles lui sont contraires. » (1047) Si ces pratiques sont incompatibles avec la déontologie médicale, elles heurtent également les fondements de la loi bioéthique de 1994.
c) Les principes éthiques de la loi de bioéthique de 1994 peuvent encadrer les sciences émergentes
L’existence des principes fondateurs de la bioéthique dégagés dès 1994 est souvent considérée à raison comme une spécificité française. Elle confère à cette matière une unité qui fait obstacle à l’introduction d’exceptions. Le fait que ces principes soient de portée générale et non pas limités à tel ou tel champ d’activité médicale constitue un atout dans la réflexion sur les sciences émergentes.
Ainsi, en tout état de cause, les actions sur le corps humain réalisées au moyen de techniques issues de la convergence des sciences émergentes demeurent soumises à ces principes déjà reconnus dans le droit positif.
Le principe d’intégrité du corps humain trouve sa source au premier alinéa de l’article 16-3 du code civil, qui prévoit qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. » Une pratique portant atteinte à l’intégrité du corps humain dans un but autre que médical ne saurait donc être admise que si elle est autorisée par la loi (1048).
Le principe d’intégrité de l’espèce humaine consacré à l’article 16-4 du code civil, prévient d’ores et déjà toute technique qui tendrait à modifier les caractéristiques génétiques d’une personne en vue de modifier sa descendance.
Enfin, les principes d’égal accès aux soins et de non-discrimination, énoncés aux articles L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique devraient également permettre, si les techniques d’amélioration des performances humaines devaient être un jour considérées comme des soins, de garantir l’égal accès à ces dernières.
En revanche, il ne semble pas que le principe de précaution, mentionné à l’article L. 110-1 du code de l’environnement (1049) avant d’être inscrit, en 2004, à l’article 5 de la Charte de l’environnement puisse être invoqué dans ce cadre, dans la mesure où il ne concerne que les dommages causés à l’environnement. Son champ d’application n’est pas le même que celui de la loi de bioéthique. On ne saurait toutefois ignorer les perspectives d’évolution que pourrait connaître ce principe au regard de la lecture qu’en fait la Cour de justice des communautés européennes(1050). Par ailleurs une résolution du Conseil annexée au conseil européen de Nice des 7 et 9 décembre 2000 affirme que ce principe est applicable aussi à la santé humaine.
Si les grands principes précédemment évoqués constituent, en l’état actuel de la science, des barrières face aux risques potentiels de dérives, il conviendrait de s’assurer de leur respect dans le domaine des sciences émergentes. Une mission de veille pourrait être confiée en ce sens à l’ABM, afin que le législateur soit informé rapidement de ces évolutions technologiques et qu’il soit en mesure, par conséquent, d’affiner les normes applicables.
Proposition n° 80. Confier à l’Agence de la biomédecine un rôle de veille sur les applications scientifiques qui ouvrent des perspectives d’amélioration des performances humaines.
PARTIE V : COMMENT RENFORCER LA VIGILANCE DES INSTITUTIONS ET FAVORISER LE DÉBAT ÉTHIQUE ?
Ce n’est qu’au terme de l’analyse des différentes thématiques de la bioéthique, des plus encadrées telles que l’assistance médicale à la procréation ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires, aux plus récentes, que la mission a souhaité aborder les problèmes portant sur les institutions et sur les principes de la bioéthique. L’examen séparé des thématiques de la bioéthique ne saurait faire en effet l’économie d’une réflexion générale sur l’encadrement des activités de bioéthique.
CHAPITRE 10 – LA LOI BIOÉTHIQUE DE DEMAIN
S’engager dans la voie d’une réflexion transversale sur les contours de la législation bioéthique de demain, c’est s’interroger sur l’abandon du principe de la révision périodique de la loi et sur l’insertion du droit français dans le droit international.
Pour consolider notre législation et l’adosser à des principes faisant l’objet d’un consensus international, pour dissiper également les malentendus et les doutes que suscite une révision programmée de la loi de bioéthique, il est apparu souhaitable à la mission d’abandonner le principe de révision périodique de la loi, de ratifier la convention d’Oviedo et de réaffirmer la portée de ces deux principes fondamentaux que sont la dignité de la personne humaine et le consentement de cette dernière.
Ces orientations ne doivent pas empêcher pour autant le législateur de moduler et d’adapter l’application de la loi. D’abord, parce que l’information la plus rapide et la plus sûre doit être délivrée par les agences compétentes au Parlement, afin que ce dernier soit en mesure de prendre en compte les problèmes éthiques soulevés par les progrès scientifiques et technologiques. Ensuite parce que la loi bioéthique ne doit pas rester l’apanage de quelques spécialistes. L’expérience réussie des États généraux de la bioéthique a montré en effet le désir des citoyens d’être mieux informés sur ces questions et leur souci de participer davantage à de tels débats de société.
Des grands principes réaffirmés, une plus grande implication du Parlement et une participation plus importante de la société à ces enjeux, telles devraient donc être les grandes lignes du débat bioéthique à venir.
A. CONFORTER LA LÉGISLATION BIOÉTHIQUE
Le législateur ne peut pas encadrer a priori les développements scientifiques et technologiques, dont il ignore par définition la nature et les implications. Dans ces domaines nouveaux de la connaissance, seuls les principes fondateurs de la bioéthique peuvent servir de garde-fous pour délimiter ce qui est éthiquement acceptable de ce qui ne l’est pas.
Posés pour l’essentiel par la loi de 1994 ceux-ci n’ont jamais été remis en cause depuis. Certains ont été légèrement adaptés, lors des modifications législatives successives mais aucun n’a vu sa légitimité mise en doute.
Cette stabilité devrait inciter le législateur à ne plus remettre son ouvrage sur le métier tous les cinq ans. En effet, la clause de révision périodique, qui avait pour but de permettre au législateur de prendre en compte les avancées de la science, affaiblit la portée de dispositions législatives perçues dès lors comme transitoires. Son abandon serait cohérent avec la volonté de ratifier la convention d’Oviedo, dans la mesure où le droit de la bioéthique semble être stabilisé.
1. Opter pour une loi soumise à évaluation
Depuis 1994, les lois de bioéthique ont prévu qu’elles devaient être révisées cinq années après leur vote. Cependant, lors de la phase actuelle de révision, des voix se sont fait entendre pour demander que cette particularité ne soit plus retenue dans la prochaine loi de bioéthique.
a) Écarter l’idée d’une loi-cadre
Deux positions se sont exprimées au cours des auditions. Certains ont plaidé pour une loi-cadre, qui accorderait un pouvoir d’application important aux agences compétentes ; d’autres se sont déclarés partisans d’une révision périodique de la loi, sur le modèle des lois de bioéthique depuis 1994.
Le vote d’une loi-cadre a été proposé à la mission
Les partisans d’une loi-cadre ont insisté sur le fait que réviser les lois de bioéthique de manière périodique contribuait à faire perdre de leur force aux principes qu’elles contiennent. S’ils apparaissent en effet comme provisoires et pouvant être remis en cause, leur portée risque d’en être diminuée. L’universalité des principes adoptés par la loi de bioéthique s’accorde difficilement avec un mécanisme de révision qui paraît renvoyer à une conception relativiste des valeurs.
Par ailleurs, la loi entrerait dans des niveaux de détail trop importants. Il est incontestable que tant dans le domaine de la génétique que dans celui de l’assistance médicale à la procréation ou de la greffe d’organes, la loi ne s’est pas contentée de définir les principes généraux applicables, elle en a aussi fixé certaines des modalités d’application. Or, plus la loi précise l’application des principes, plus elle est susceptible de devenir inadaptée en cas d’évolution technologique ou scientifique.
Ces deux arguments ont été invoqués par M. Axel Kahn au cours de son audition : « Pour ma part, je n’ai jamais été très satisfait du principe d’une révision obligatoire tous les cinq ans. En effet, cela signifie, d’une part, que la loi doit statuer sur toutes les techniques, ce que je ne pense pas, et, d’autre part, que les principes moraux sont partiellement solubles dans l’évolution de la science et des techniques, ce que je ne pense pas non plus » (1051).
Le détail de l’application de la loi serait laissé aux agences spécialisées, et en premier lieu à l’Agence de la biomédecine, qui disposeraient d’un pouvoir normatif renforcé, afin de faire évoluer la mise en œuvre des principes législatifs en fonction des progrès de la science. Le choix de cette formule a les préférences de certains chercheurs. Mme Jacqueline Mandelbaum l’a défendu au regard du rôle imparti à l’ABM : « Dans leur grande précision, les lois de bioéthique ont finalement donné à l’AMP un cadre qui lui a été plutôt bénéfique. Aujourd’hui qu’il existe une Agence de la biomédecine, la loi devrait se cantonner à la définition des grands principes et laisser le soin à l’agence de régulation, plus proche du terrain et plus informée des évolutions techniques les plus récentes, d’entrer dans le détail de son application. » (1052)
Tel a également été la conclusion du raisonnement de M. Axel Kahn : « Je milite au total pour l’adoption d’une loi cadre précisant les modalités d’application de ses principes à la diversité des situations et des innovations. C’est, selon moi, la seule possibilité de suivre en temps réel les évolutions, vu la fertilité de l’imagination des scientifiques, ce qui n’interdit pas de statuer sur un certain nombre de situations fréquentes et bien connues. » (1053)
Mais cette proposition soulève des difficultés
Cette perspective conduirait le législateur à se dessaisir d’une partie importante de ses missions, alors même que les règles concernant l’état des personnes relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le pouvoir réglementaire reconnu au Premier Ministre ne peut être confié à une autorité de l’État autre que le Premier Ministre que dans un cadre strict. Cette autorité doit être habilitée à fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, sous réserve que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu. La voie d’une dévolution d’un pouvoir réglementaire à l’ABM est donc très étroite. Parce que c’est également dans la déclinaison qu’ils acquièrent toute leur signification et parce qu’ils n’existent pas indépendamment de l’application qui en est faite, il est essentiel que le législateur garde la maîtrise de ces principes, ainsi que l’a estimé M. Christian Byk : « l’évolution des normes techniques et des bonnes pratiques ne peut pas relever uniquement d’institutions spécialisées, aussi utiles et performantes soient-elles, telle l’Agence de la biomédecine » (1054)
Au surplus, en se contentant d’affirmer des principes généraux, une loi-cadre risquerait de faire double emploi avec les principes de valeur constitutionnelle ainsi qu’avec ceux qui en découlent et ont été inscrits dans le code civil.
Si ces remarques valent pour l’ensemble des domaines qui sont actuellement couverts par les lois de bioéthique, il n’en va pas de même en ce qui concerne les champs scientifiques où des problèmes bioéthiques sont apparus depuis. Dans la mesure où les applications de ces nouvelles technologies ne sont que peu envisageables en l’état actuel de la science, la loi doit effectivement se limiter à énoncer de grands principes. Ce choix ne lui interdit pas toutefois, quand certaines applications sont clairement identifiées, de les réglementer plus précisément.
b) Écarter le principe d’une clause de révision périodique
À l’inverse, l’insertion d’une clause de révision périodique dans la prochaine loi de bioéthique ne présente pas les inconvénients évoqués précédemment : elle ne contraint pas le législateur à défaire ce qu’il a fait ou à se dessaisir d’une partie de ses compétences. Certaines personnes auditionnées par la mission se sont donc prononcées en faveur du maintien de la clause de révision périodique en invoquant plusieurs arguments.
Les avantages de la révision périodique
Le premier d’entre eux est de susciter, de manière périodique, une réflexion et un débat sur les évolutions et les applications de la science. Cette démarche s’inspire de la Sunset legislation américaine qui permet à terme une évaluation de la législation, afin de décider éventuellement de sa prorogation. En effet, l’expérience des deux lois de bioéthique précédentes et celle de la révision en cours ont montré que leur préparation et leur discussion étaient entourées d’un large débat au sein de l’opinion publique. Ainsi, la présente phase de révision a vu la parution successive d’un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, d’un avis du CCNE, d’un rapport de l’ABM, d’un autre du Conseil d’État et la tenue d’États généraux de la bioéthique. Ces différentes réflexions contribuent à entretenir le débat public et à éclairer le législateur sur les nouveaux enjeux à prendre en considération. On peut penser qu’en l’absence d’une révision périodique, les relais médiatiques et les citoyens seraient moins attentifs aux enjeux bioéthiques qu’ils ne peuvent l’être à l’occasion des révisions et que les débats ne se dérouleraient qu’entre spécialistes.
Le principe de révision périodique a aussi pour avantage de prendre en compte les dernières évolutions scientifiques. Il est à ce titre révélateur que de nouveaux thèmes soient intégrés dans le champ des lois de bioéthique à l’occasion de chaque révision. Ainsi, en 2004, la discussion a également porté sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, domaine qui était absent des lois de 1994. La phase actuelle de révision a permis de prendre conscience des enjeux des sciences émergentes et notamment des neurosciences et des biobanques, ce qui n’avait pas été le cas en 2004.
De surcroît, même dans les domaines qui avaient fait l’objet de la précédente loi de bioéthique, des avancées scientifiques ou les nouvelles applications de la science obligent le législateur à remettre sur l’ouvrage certaines dispositions. Il en va ainsi, bien entendu, de celles qui avaient été prises pour une durée limitée, autorisant la recherche, à titre dérogatoire, sur les cellules souches embryonnaires. À l’occasion des révisions, de nouvelles techniques, telles que la reprogrammation des cellules souches adultes, peuvent être évaluées et la législation adaptée en conséquence. C’est ce qu’a fait valoir Mme Nadine Morano au cours de son audition : « Je juge nécessaire le principe d’une révision tous les cinq ans, au moins pour engager périodiquement un débat au Parlement sur un sujet en permanente évolution, où jamais les choses ne pourront être tranchées une fois pour toutes. » (1055)
L’introduction dans la loi d’une clause de révision n’est plus justifiée
Cependant, la mission n’a pas retenu l’idée d’inscrire dans la loi une nouvelle clause de révision, dans la mesure où les dispositions législatives sont stabilisées et semblent recueillir un assez large consensus. Plusieurs raisons militent en faveur de ce choix.
D’abord, les principes fondateurs n’ont que peu évolué au fil des révisions des lois de bioéthique. Les principaux d’entre eux ont été affirmés dès 1994 et ont servi, lors de la révision de 2004, de fil directeur. À titre d’exemple, le principe de l’intégrité du corps humain, posé par l’article 16-3 du code civil, a été introduit dans le droit par la loi de 1994. Il a été légèrement modifié par la loi du 27 juillet 1999 (1056) qui a substitué le terme médical au terme thérapeutique pour ce qui est des justifications des atteintes pouvant être portées à l’intégrité du corps humain puis par la révision de 2004, qui a introduit le fait qu’il pouvait également y être porté atteinte, « de manière exceptionnelle dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. » Les principes fondateurs n’ont donc pas à être remis en cause à chaque révision des lois de bioéthique mais leurs modalités d’application peuvent être révisées. Mme Nicole Questiaux a plaidé pour cette formule : « Le Parlement fera ce qu’il veut mais le fait de prévoir la révision de la loi tous les cinq ans a, en tout état de cause, peu d’importance. Les principes que nous avons affirmés, comme les mécanismes que nous avons adoptés, doivent être conservés, même s’ils appellent des ajustements. » (1057)
Par ailleurs, si la principale disposition transitoire, qui portait sur le moratoire des recherches sur les cellules souches embryonnaires, n’était pas reconduite, ainsi que le préconise la mission, la nécessité d’une clause de révision périodique perdrait de son intérêt.
L’inconvénient majeur du maintien d’une clause de révision périodique est surtout qu’il affaiblit la portée des dispositions législatives auxquelles elle fait référence. Celles-ci en effet sont perçues comme transitoires. Cet argument a été développé par M. Jean-François Mattei, pour qui procéder de la sorte revient à fixer en quelque sorte à l’avance la « date de péremption » de la loi : « s’engager dans une démarche rituelle, tous les cinq ans, à l’occasion de chaque adoption d’une loi de bioéthique, me paraît dangereux car de nature à affaiblir les principes reconnus en leur conférant une valeur provisoire. » (1058) Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports, a fait sienne cet argument devant la mission, en estimant que ne pas inclure une clause de révision « éviterait de rendre obsolète une loi à date régulière, ce qui implique qu’il y ait des principes fondamentaux qui puissent être revus. » (1059)
Au surplus, si la date de révision est fixée à l’avance, comme l’a relevé M. Jean-François Mattei, le législateur peut avoir tendance à ne légiférer dans ces domaines que lors de la révision de la loi, et ainsi, « à traiter par anticipation des sujets qui ne sont pas encore arrivés à maturité ou à attendre l’échéance pour légiférer sur des sujets pourtant arrivés à maturité »(1060).
Enfin, la clause de révision périodique de la loi incite le législateur à revenir constamment sur son ouvrage et à réexaminer, à intervalles réguliers, l’ensemble de la législation bioéthique, alors que les évolutions scientifiques intervenues ne justifient pas forcément de se livrer à nouveau à cet exercice global.
Compte tenu des inconvénients inhérents tant au concept de loi-cadre qu’au maintien d’une clause de révision périodique, la mission a souhaité privilégier une troisième voie, à savoir ne pas faire de la future loi de bioéthique une simple loi-cadre et ne pas y inclure de clause de révision périodique. Ce double choix a pour effet de renforcer la portée de la loi tout en ne dessaisissant pas le législateur d’une partie de ses attributions. Pour pallier les inconvénients qui pourraient résulter de l’absence de clause de révision périodique, l’information du Parlement devra être renforcée, afin qu’il soit en mesure de modifier la loi lorsque le besoin s’en fera sentir, sans qu’il ne soit contraint d’en réviser l’ensemble pour autant. Si la loi de bioéthique ne sera jamais une loi comme une autre, il convient cependant de la placer comme les autres normes législatives sous un régime d’évaluation continue et d’abandonner un dispositif de révision périodique qui n’est plus justifié.
Proposition n° 81. Ne pas inclure de clause de révision dans la future loi de bioéthique.
2. Ratifier la convention d’Oviedo
« C’est avec une certaine lassitude que les rapporteurs de l’OPECST constatent le sort fait en France à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la biomédecine, Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, dite Convention d’Oviedo, signée le 4 avril 1997. La France qui a joué un rôle non négligeable dans l’élaboration de ce texte, l’a signé, mais ne l’a toujours pas ratifiée, malgré les promesses faites au législateur par les gouvernements successifs » notait l’OPESCT dans son rapport sur l’application de la loi bioéthique (1061).
En effet, si chacun s’accorde à voir dans la convention d’Oviedo un texte fondamental, dans l’ordre international, pour ce qui est de la bioéthique, la France ne l’a pas encore ratifiée. Le principal argument justifiant ces reports résidait dans la conviction que la loi bioéthique étant évolutive et sans cesse remise en débat, la France ne pouvait pas se trouver liée par une convention internationale qui risquait de réduire sa marge de manœuvre en la matière.
Cependant, force est de constater que le droit interne demeure, depuis 1994, en conformité presque totale avec la convention. De surcroît, il a atteint un stade de maturité qui serait compatible avec la ratification d’une convention internationale. Au moment où la mission propose que soit abandonnée la clause de révision périodique de la loi, le temps est venu de ratifier la convention d’Oviedo.
a) La ratification par la France de la convention d’Oviedo aurait une signification importante
Trois arguments militent en faveur d’une ratification par la France de la convention : notre pays l’a fortement inspirée ; sa ratification pourrait inciter d’autres pays à faire de même ; cette décision permettrait de disposer de standards internationaux en matière de bioéthique.
C’est à l’initiative de la France que le Conseil de l’Europe a fourni une contribution décisive au droit international avec l’élaboration de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du 4 avril 1997, dite convention d’Oviedo. En effet, les hommes qui l’ont rédigée, comme les textes qui l’ont inspirée, sont français, comme l’a rappelé Mme Laurence Lwoff, chef de la division bioéthique du Conseil de l’Europe : « Un des textes qui ont le plus influencé l’élaboration de la convention a été la loi bioéthique française. » (1062)
C’est pourquoi, ainsi que l’a indiqué M. Carlos de Sola, « beaucoup d’autres pays ne comprennent pas que la France n’ait pas ratifié un texte dans l’élaboration duquel elle a pourtant pris une part majeure. Cela apparaît presque comme un désaveu de paternité ! » (1063)
La ratification par la France inciterait ses voisins à faire de même
À ce jour, la convention d’Oviedo a été ratifiée par 34 États. La Suisse et la Finlande ont rejoint les États l’ayant ratifiée respectivement le 1er novembre 2008 et le 30 novembre dernier mais la plupart des grands États européens n’ont pas encore franchi ce pas. Il en va ainsi notamment de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni (qui ne l’a pas signée) comme si chacun attendait que son voisin prenne l’initiative.
La raison principale de l’abstention de l’Allemagne ne tient pas à ce que la convention serait contraire à son droit interne mais au fait qu’elle serait en retrait par rapport à ce dernier. En effet, eu égard à son histoire, c’est essentiellement l’inclusion, dans la convention et dans son protocole additionnel sur la recherche de dispositions dérogatoires, permettant, tout en les encadrant strictement, certaines recherches sur les personnes n’ayant pas la faculté de donner leur consentement, qui a été la source d’un blocage politique. Cependant, M. Carlos de Sola a relevé que la ratification de la convention par la France pourrait être décisive dans la décision allemande : « lorsque l’on a demandé au précédent Chancelier de présenter un projet de loi de ratification, il a indiqué que l’on en reparlerait lorsque la France aurait elle-même ratifié le texte. » (1064)
Ces normes internationales permettent de lutter contre le « moins-disant » éthique
À plusieurs reprises ont été soulignés les risques de concurrence entre les législations qui seraient susceptibles d’aboutir à un alignement sur le « moins-disant éthique ». L’augmentation du tourisme procréatif ou la délocalisation des recherches éthiquement douteuses dans des pays moins exigeants sur ce plan en fournissent des exemples.
Les conventions internationales constituent le meilleur rempart contre ce danger. A cet égard, la convention d’Oviedo est le premier et le seul instrument à caractère contraignant portant explicitement sur les droits de l’homme et la bioéthique. À travers ses 14 chapitres et ses 38 articles, elle regroupe les règles fondamentales définissant les pratiques acceptables dans ce domaine. L’objectif de la convention est double, ainsi que l’a exposé M. Carlos de Sola : « le premier volet de la convention est une forme de charte des droits du patient, tandis que le second vise à élaborer des principes applicables aux nouvelles techniques biomédicales. » (1065) Sont ainsi affirmés le principe du consentement libre et éclairé préalable à toute intervention médicale (art. 5), celui du droit à la vie privée concernant les informations médicales (art. 10), celui de l’interdiction des discriminations sur des fondements génétiques (art. 11) ou celui de non-patrimonialité du corps humain et de ses parties (art. 21).
De surcroît, quatre protocoles précisent les principes contenus dans la convention respectivement sur le clonage des êtres humains, la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, la recherche biomédicale et les tests génétiques à finalité médicale.
La perspective, qui aboutirait à faire de la convention une charte éthique commune, est renforcée par le fait que, compte tenu du caractère global du sujet traité, le Conseil de l’Europe envisage de la faire ratifier par des États non membres, comme les États-Unis et le Japon, ainsi que l’indique le rapport de l’ABM sur l’application de la loi (1066). Cette possibilité est ouverte par l’article 34 de la convention. De ce fait, la convention serait susceptible de devenir « un instrument universel » (1067).
Ce mouvement vers l’adoption de principes communs a été renforcé, au niveau mondial, par l’adoption, sous l’égide de l’UNESCO, de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme le 15 octobre 2005. Néanmoins, ce texte a surtout une portée symbolique dans la mesure où il constitue une simple déclaration.
b) Les principaux obstacles à la ratification ont été levés
Si, en dépit d’une volonté souvent réaffirmée de la ratifier, la convention d’Oviedo ne l’a toujours pas été, c’est que des contrariétés effectives ou potentielles entre le texte du Conseil de l’Europe et le droit interne français avaient été invoquées. Or, on peut penser qu’en l’état actuel de notre droit interne, tous ces obstacles ont été levés.
Les grands principes bioéthiques sont stabilisés en droit interne
L’une des réticences majeures opposées à la ratification de la convention d’Oviedo tenait au fait que les lois bioéthiques françaises devaient évoluer au rythme des changements scientifiques. Telle était l’une des raisons qui avait motivé l’avis négatif donné, en 1997, à la ratification de cette convention par le Conseil d’État : « En 1997, lorsqu’il avait examiné le projet de loi autorisant la ratification de cette convention, le Conseil d’État avait émis un avis défavorable, dans un contexte où, peu de temps après l’adoption des lois de 1994, les questions de bioéthique paraissaient évolutives et la fixation par un traité des obligations pesant sur la France peu opportune »(1068).
Les principes qu’affirme la loi de bioéthique étant désormais stabilisés et largement acceptés, cet argument perd une grande partie de sa justification. Ceci explique pour partie le changement de position du Conseil d’État, qui préconise désormais de ratifier la convention « dans les meilleurs délais » (1069).
Le droit interne s’est progressivement rapproché de la convention d’Oviedo
L’autre raison majeure qui a retardé la ratification de la convention par la France tient à ce que des dispositions internes étaient en contradiction avec certains articles de la convention.
« Quant à la convention d’Oviedo, si elle ne fut pas ratifiée, c’est que l’un de ses articles a été jugé par le Conseil d’État trop tolérant en matière d’euthanasie. » a expliqué Mme Nicole Questiaux au cours de son audition (1070). Or, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et celle du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, ont écarté toute ambiguïté en la matière en encadrant l’arrêt des traitements en fin de vie chez les malades conscients et inconscients.
Mais la principale crainte des autorités françaises résidait dans l’interdiction érigée par l’article 18, alinéa 2 de la convention de constituer des embryons humains aux fins de recherche. Il n’était en effet pas exclu que le clonage thérapeutique soit rendu nécessaire par les avancées de la recherche scientifique. Or, dans le contexte actuel marqué notamment par les travaux sur les cellules pluripotentes issues de la reprogrammation de cellules adultes, cette éventualité semble moins prometteuse qu’elle n’a pu l’être. De surcroît, il n’est même pas certain que cet article de la convention y fasse totalement obstacle.
Dans son rapport intitulé Cellules souches et choix éthiques, M. Pierre-Louis Fagniez souligne que la convention d’Oviedo n’empêche pas des évolutions futures dans l’utilisation du clonage thérapeutique ou scientifique, dans la mesure où la question du clonage n’a pas été envisagée par les auteurs de la convention. En effet, la naissance de la première brebis clonée, Dolly, est postérieure à la finalisation du texte de la convention.
Cette appréciation de la portée de l’article 18, alinéa 2 au regard du droit des traités a été présentée en réunion plénière du Comité directeur de bioéthique par le secrétariat de celui-ci en 2007. Elle n’a pas soulevé d’objections de la part des délégations, y compris de la part de celles dont le droit interne, à l’instar du droit français, interdit à la fois la conception d’embryons à fin de recherche et la création d’embryons par transfert nucléaire. On peut noter que c’est en s’appuyant sur ce type d’analyse que l’Espagne et le Portugal, qui ont ratifié la Convention d’Oviedo sans réserve ni déclaration interprétative (respectivement en 1999 et 2001), ont adopté postérieurement des législations admettant la possibilité du clonage à finalité scientifique.
Ainsi, même dans l’hypothèse où la France souhaiterait autoriser le transfert nucléaire, la convention d’Oviedo n’y ferait pas obstacle.
Comme l’a indiqué M. Luc Derepas, rapporteur général du groupe de travail du Conseil d’État sur la révision des lois de bioéthique, lors de son audition : « Les dispositions figurant dans la loi française étant, pour l’essentiel, tout à fait conformes à la convention d’Oviedo, il n’existe plus d’obstacle juridique à sa ratification. » (1071)
c) Les conditions de la ratification de la convention par la France
Il existe cependant encore une divergence mineure entre la convention et le droit interne portant sur le champ des donneurs de tissus régénérables. Cet obstacle levé, il restera à déterminer les modalités de la ratification de la convention.
Une réserve est nécessaire quant au champ des donneurs de tissus régénérables
Ainsi que l’a indiqué Mme Laurence Lwoff : « rien ne s’oppose à la ratification de la Convention par la France dans l’état actuel de sa législation, à une exception près : le don de tissus régénératifs. Vous aviez voté une disposition restrictive en la matière, qui a d’ailleurs inspiré celle de la Convention, mais ensuite vous avez étendu la possibilité de dons, notamment de tissus régénérables, à un cercle familial plus élargi. C’est le seul point, me semble-t-il, qui peut faire l’objet d’une réserve – laquelle peut accompagner une ratification. »
En effet, deux dispositions sont en contradiction :
— L’article 20 de la convention et l’article 14 du protocole additionnel relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine prévoient qu’« à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n’a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies : […] le receveur est un frère ou une sœur du donneur. […] » ;
— À l’inverse, le second alinéa de l’article L. 1421-3 du code de la santé publique indique qu’« en l’absence d’autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce » et le quatrième alinéa de l’article L. 1421-4 dispose qu’« en l’absence d’autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. »
Ainsi, la convention, comme le droit français, pose un principe général d’interdiction des prélèvements sur les mineurs et les majeurs protégés, ce principe n’admettant aucune exception pour les organes. S’agissant en revanche des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, alors que la convention et son protocole ne prévoient une dérogation à cette prohibition que pour des prélèvements effectués au bénéfice d’un frère ou d’une sœur, le droit français a, lors de la révision de 2004, étendu le champ de cette dérogation, en en rendant potentiellement bénéficiaires les cousins germains du mineur et du majeur en curatelle ou sous sauvegarde de justice, ses oncle ou tante et ses neveu ou nièce.
Mais cette spécificité du droit national n’empêche pas une ratification de la convention par la France. En effet, l’article 36 de la convention autorise les réserves au moment de la ratification du traité, « dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. » En l’état actuel de sa législation, la France peut donc ratifier la convention d’Oviedo, en formulant une réserve sur l’article 20 et sur l’article 14 du protocole additionnel.
Si la prochaine loi de bioéthique autorisait les dons croisés d’organes(1072), cette pratique n’entrerait pas en conflit avec l’article 19 de la convention ou avec l’article 9 du protocole additionnel, qui ne définissent que les conditions de l’intérêt thérapeutique d’autrui, de l’absence d’organe disponible et de l’absence de méthode thérapeutique d’intérêt comparable. L’article 10 de la convention prévoit l’hypothèse où donneur et receveur n’ont pas de « relations personnelles étroites ». Dans ce cas, elle autorise le don à la double condition que la loi en définisse les conditions (ce qui serait le cas) et qu’il soit consenti « après autorisation d’une instance indépendante ». La loi devrait donc veiller à respecter cette exigence. Si la France souhaitait rendre également possible le don croisé pour les mineurs ou les majeurs protégés, la réserve précédemment évoquée, portant sur l’article 20 de la convention et sur l’article 14 du protocole additionnel, couvrirait cette différence entre la loi et la convention.
Une ratification est possible en l’état actuel du droit
Aucun argument juridique dirimant ne s’oppose donc à la ratification par la France de la convention d’Oviedo. Néanmoins, afin de laisser au législateur sa pleine liberté lors de la phase actuelle de révision des lois de bioéthique, il serait souhaitable que cette ratification n’intervienne pas en amont de cette révision mais immédiatement après. Cette solution aurait le mérite de la cohérence, dans la mesure où elle laisserait au législateur toute latitude pour modifier les dispositions de la loi bioéthique. Le Parlement ne pouvant pas formuler de réserves d’interprétation, au moment du vote de la loi autorisant la ratification d’un traité, il reviendrait à l’exécutif de le faire, lors de l’édiction du décret de ratification.
En ce qui concerne les protocoles additionnels, tous ne peuvent pas être ratifiés en même temps que la loi. Il faut distinguer à ce titre trois situations distinctes :
– le protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains a déjà été signé par la France, l’autorisation de le ratifier pourra donc être donnée en même temps que pour la convention ;
– le protocole additionnel sur la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine et celui relatif à la recherche biomédicale n’ont pas été signés par la France mais ils sont déjà entrés en vigueur, du fait d’un nombre d’États suffisant ayant procédé à leur ratification. La procédure juridique qui s’impose est donc celle de l’adhésion, qui ne nécessite pas une signature préalable de ces protocoles par la France. Le projet de loi d’autorisation de ratification peut donc procéder à l’autorisation d’adhésion à ces deux protocoles ;
– en revanche, le protocole additionnel relatif aux tests génétiques à des fins médicales n’est pas encore entré en vigueur. Il est donc nécessaire de le signer avant que la ratification ne soit juridiquement possible.
Proposition n°82. Autoriser la ratification de la convention d’Oviedo et de ses trois premiers protocoles additionnels, avec une réserve d’interprétation concernant le champ des donneurs de cellules hématopoïétiques, sans préjudice de l’évolution du débat parlementaire au cas où d’autres motifs de réserves apparaîtraient.
Signer puis ratifier le protocole additionnel relatif aux tests génétiques à des fins médicales.
3. La portée de la dignité de la personne humaine et du consentement
a) La valeur constitutionnelle de la notion de dignité
Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine est incontestablement l’un des principes centraux du droit de la bioéthique. Sa valeur constitutionnelle a d’ailleurs été reconnue par le Conseil constitutionnel en 1994. Compte tenu du fait que les grands principes de la bioéthique semblent être stabilisés, la mission a pu être tentée de considérer que le moment était opportun pour inscrire ce principe dans la Constitution. Cette inscription aurait été, avec la ratification de la convention d’Oviedo, symbolique de l’arrivée à maturité des lois de bioéthique.
La dignité de la personne humaine constitue un principe cardinal de la bioéthique
Ainsi que l’a rappelé M. Henri Atlan au cours de son audition, « la dignité de la personne humaine apparaît comme la valeur de référence pour toutes les questions d’éthique biomédicale. » (1073) .
— Ce principe a été placé en tête des articles du code civil introduits par la loi de 1994, à l’article 16, qui ouvre le chapitre consacré au respect du corps humain : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » ;
— De surcroît, c’est à l’occasion de l’examen de la loi de 1994 que le Conseil constitutionnel a dégagé la valeur constitutionnelle du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en se fondant sur le préambule de la constitution de 1946 : « Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : "Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés" ; qu’il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (1074). Les autres principes fondamentaux de la bioéthique sont considérés comme des « principes sentinelles » du principe de dignité ; selon un commentaire de la décision de 2004 (1075) faisant autorité : « Certaines des notions corrélées à la dignité de la personne humaine constituent ce que la doctrine appelle des « principes sentinelles », c’est-à-dire des principes qui n’ont pas en eux-mêmes rang constitutionnel, mais qui sont les garants de principes constitutionnels. De tels principes ne peuvent être touchés par le législateur sans déclencher une sorte d’« alerte constitutionnelle ». Généralement, il ne pourra y être dérogé sans justification tirée d’exigences constitutionnelles ou de motifs d’intérêt général suffisants. » (1076) La dignité de la personne est donc protégée non seulement en tant que telle mais aussi dans ses applications pratiques, par l’intermédiaire des principes qui contribuent à sa sauvegarde ;
— Enfin, de nombreuses conventions internationales portant sur la bioéthique reconnaissent une place fondamentale à la dignité de la personne humaine. C’est le cas notamment de la convention d’Oviedo dont l’article premier définit ainsi les obligations des États parties à cet accord : « Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. ». D’ailleurs, les cours européennes ont donné valeur au principe de dignité dans de nombreux domaines relevant de la bioéthique. C’est le cas notamment de la CJCE au sujet du contentieux portant sur la directive relative à la protection des inventions biotechnologiques(1077).
Une constitutionnalisation souvent demandée
Bien que chacun s’accorde à reconnaître le caractère polysémique de la notion de dignité de la personne humaine(1078), ceci ne devrait pas être un obstacle à la reconnaissance expresse de ce principe dans notre Constitution, dans la mesure où cette inscription ne changerait rien à sa portée, puisque le Conseil constitutionnel lui a déjà conféré valeur constitutionnelle. Déjà en 1993, le comité présidé par le Doyen Georges Vedel souhaitait ajouter à l’article 66 de la Constitution la reconnaissance de la dignité sous la forme suivante : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et de la dignité de sa personne »(1079).
Cette constitutionnalisation a été demandée également par le Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution présidé par Mme Simone Veil en 2008. Ceci constitue en effet la seule demande de modification de la Constitution formulée par ce comité. Sa présidente l’a clairement indiqué au cours de son audition : « Pour nous tous, il manquait quelque chose au Préambule de la Constitution : la référence à la dignité, une dignité prenant en charge tout ce qui concerne la vie humaine, entendue comme un élément majeur de la relation entre la société et l’individu. »(1080). Retenant l’interprétation qu’en donnent la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la CEDH, le comité préconise que cette reconnaissance explicite soit formulée de la manière suivante au sein de l’article 1er de la Constitution : « [La République] reconnaît l’égale dignité de chacun. » (1081)
Une préconisation similaire a été faite par la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes en juillet 2009, au travers de l’introduction dans le préambule de la Constitution d’une « charte de la dignité de la personne humaine » (1082).
Il est en effet étonnant que « la France, matrice des droits de l’homme et grand promoteur des valeurs humanistes dont dérive pour une large part l’idée moderne de dignité, [soit] l’une des rares démocraties modernes à ne pas afficher, de manière lisible, ce principe au Panthéon de ses principales valeurs de référence. » (1083) De nombreux autres États européens accordent en effet une place centrale à la notion de dignité dans leur texte fondamental, au-delà même des considérations ayant trait à la bioéthique. Tel est le cas notamment de l’Allemagne dont la Loi fondamentale du 23 mai 1949 prévoit, en son article premier, que « la dignité de l’homme est intangible. Tout pouvoir public est tenu de la respecter et de la protéger », ainsi que de l’Espagne ou du Portugal.
Un principe qui a déjà reçu une valeur constitutionnelle dans la jurisprudence
Ces exemples étrangers ne sauraient justifier cependant à eux seuls une modification de notre loi fondamentale. En accord avec la position de l’OPECST, il a semblé à la mission que la jurisprudence du Conseil constitutionnel était suffisante pour garantir le respect du principe de dignité de la personne humaine, d’autant que son introduction dans la Constitution nécessiterait une révision de cette dernière.
b) Veiller au respect du consentement de la personne
La notion de consentement est l’une des plus répandues dans les normes bioéthiques. Il n’est pas un texte national comme international qui ne fasse du consentement de la personne la condition sine qua non de toute intervention sur son corps, quelle qu’en soit la finalité. Le « consentement libre et éclairé » fait ainsi l’objet du chapitre II de la convention d’Oviedo qui se trouve placé en « facteur commun » des dispositions sur le génome humain, la recherche scientifique et le prélèvement d’organes. En droit interne, deux dispositions générales consacrent également ce droit :
– L’article 16-3 alinéa 2 du code civil exige le consentement de la personne à l’intégrité de laquelle il est porté atteinte, par nécessité médicale ou, à titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui : « Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. » ;
– L’article L. 1211-2 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que « le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. »
Le principe de consentement a une portée générale, qui irrigue l’ensemble du droit de la bioéthique. Quelle que soit sa forme, qu’il s’agisse d’une simple information ou d’un consentement exprès, ce principe postule l’effectivité du droit à la révocabilité. Il se décline de manière différenciée selon les domaines où il trouve à s’appliquer. Il est possible de regrouper et de classer les différents régimes de consentement par niveau décroissant d’exigence.
– Un régime de consentement devant le juge
Certaines dispositions prévoient que le consentement de la personne est recueilli par l’autorité judiciaire du fait des risques que l’intervention médicale lui fait courir. Tel est le cas notamment pour les dons d’organes entre vifs, pour lesquels, d’après l’article L. 1231-1 du code de la santé publique, le consentement doit être exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou son représentant, hors cas d’urgence, et doit être « libre et éclairé ». Une information sur les risques encourus doit lui être délivrée préalablement. La procédure est analogue pour les dons de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse.
Dans un autre domaine, un consentement devant le juge ou devant le notaire est également nécessaire. Il s’agit des cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur (article 311-20 du code civil). Cette procédure a un triple but : s’assurer que le couple a connaissance des règles relatives à la filiation qui encadrent le recours à cette technique ; interdire toute action ultérieure ayant pour but d’établir ou de contester la filiation ; permettre d’engager la responsabilité de la personne qui ne reconnaît pas l’enfant issu de l’AMP, alors qu’elle y a donné son consentement, et prononcer judiciairement sa paternité. Dans ce cas, la procédure se justifie donc par la nécessité de sécuriser les relations juridiques issues d’une AMP avec tiers donneur. Le recours à un juge peut d’ailleurs être remplacé par un acte notarié.
L’intervention du juge dans le cadre de la procédure de l’article L. 2141-6, relative à l’accueil d’embryons obéit à une logique différente des deux premières. Elle vise à s’assurer, par analogie avec la procédure d’adoption, que les conditions d’accueil du futur enfant par le couple seront bonnes. Ce n’est donc pas à proprement parler tant le consentement du couple qui est recherché que sa demande qui est analysée, selon la distinction établie ci-dessus.
– Un régime de consentement « de droit commun »
De nombreux textes évoquent la nécessité de recueillir le consentement de la personne en des termes très généraux, parfois sans que les modalités d’information qui doivent l’accompagner ne soient précisément définies. C’est le cas par exemple pour les donneurs de gamètes dont le consentement, conformément à l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, est recueilli par écrit et peut être retiré à tout moment. Les dispositions relatives au diagnostic prénatal (article L. 2131-4 du même code) exigent également que « les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. »
Dans d’autres cas, les informations à délivrer avant l’acte sont explicitement mentionnées dans la loi. Tel est le cas notamment pour les examens génétiques, puisque l’article 16-10, alinéa 2 prévoit que « le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » La mission a d’ailleurs préconisé que la loi précise que les informations nécessaires à l’expression d’un consentement soient délivrées en amont de son recueil (à savoir le devenir possible des embryons), dans le cas de la création et de la conservation d’embryons lors d’une AMP.
Les formalités du consentement peuvent être à l’inverse renforcées quand l’acte est jugé d’importance. C’est le cas notamment pour le don d’embryons pour la recherche, puisque le consentement doit alors être réitéré à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois.
– Un régime de non-opposition
Dans plusieurs circonstances, les dispositions législatives actuelles prévoient un régime de consentement un peu moins exigeant que le consentement exprès. Le consentement peut être réputé acquis en cas de non-opposition.
Tel est le cas lorsqu’un consentement a déjà été donné initialement mais que les circonstances se trouvent modifiées, lui faisant perdre une partie de sa portée. Ainsi l’article L. 1211-2 prévoit-il, de manière générale, que des éléments et produits du corps humain peuvent être utilisés à une autre fin médicale ou scientifique que celle pour laquelle ils ont été prélevés sous réserve que la personne qui y a consenti en soit informée et ne s’y oppose pas.
– Un régime de consentement présumé.
Dans un domaine du prélèvement d’organes sur donneurs décédés, le régime du consentement est particulier, puisque le consentement de la personne décédée est présumé. Ceci se justifie dans la mesure où le premier intéressé n’est plus en mesure de donner expressément son consentement au don. Néanmoins, plusieurs garanties ont été prévues par le législateur : la personne peut faire connaître son refus de son vivant, notamment par l’inscription sur un registre prévu à cet effet et les proches peuvent attester du refus qu’aurait opposé la personne décédée.
Les conditions d’expression du consentement sont donc variables selon les domaines de la bioéthique car proportionnées aux intérêts et aux risques en jeu. Encore faut-il qu’un cadre juridique précis définisse ces modes d’expression et de recueil du consentement, afin de renforcer les garanties de la personne et éviter tout risque de contentieux possible.
Il serait souhaitable de disposer d’un texte réglementaire qui détaillerait les conditions dans lesquelles le consentement doit s’effectuer et qui pourrait contenir des modèles de formulaires destinés à ce recueil. Ce document s’imposerait à toutes les autorités sanitaires compétentes.
A cette fin, ce texte pourrait s’inspirer du rapport explicatif du protocole additionnel à la convention d’Oviedo relatif à la recherche biomédicale. Celui-ci détaille en effet de manière précise les conditions requises pour garantir le caractère éclairé d’un consentement, notamment dans ses paragraphes 71 à 81. Parmi celles-ci figurent notamment des règles générales, applicables à toute forme de consentement : « Ces informations doivent être suffisamment claires et compréhensibles pour la personne appelée à participer à la recherche. Le participant potentiel doit pouvoir, grâce à l’emploi de termes qu’il/elle peut comprendre, formuler un jugement valide. […] Les informations doivent être communiquées d’une façon qui en facilite la compréhension compte tenu du niveau de connaissance, d’instruction et de l’état psychologique du participant potentiel. […] Par ailleurs, les informations données doivent être documentées, et par conséquent consignées. Dans la mesure du possible, elles doivent être communiquées au participant potentiel sous forme de document écrit, de cassette vidéo, de cassette audio, ou de CD-ROM. Quand cela s’avère nécessaire, le participant ou le groupe de participants doit être informé dans une langue différente appropriée ou de façon adéquate pour les personnes souffrant de troubles sensoriels. […] Un laps de temps raisonnable devra être accordé au participant potentiel afin qu’il puisse examiner les informations, envisager sa participation et s’entretenir avec d’autres personnes. »
Proposition n° 83. Recommander au ministère de la santé de rédiger un texte réglementaire définissant les modalités du recueil de consentement pour les dons d’embryons et les dons de tissus et de produits du corps humain.
B. RENFORCER L’IMPLICATION DU PARLEMENT DANS LE CHAMP DE LA BIOÉTHIQUE
Si le législateur s’orientait, ainsi que le préconise la mission, vers un abandon de la clause de révision périodique de la loi, des mécanismes devraient être toutefois prévus pour garantir l’information du Parlement et permettre à celui-ci de faire évoluer la loi en tant que de besoin.
1. Assurer une information permanente du Parlement
Le renforcement de l’information du Parlement, qui compenserait l’absence de clause de révision périodique, pourrait revêtir trois formes.
a) Développer le pouvoir d’alerte de l’ABM
La loi confie à l’ABM la mission « d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu’elles appellent. », en vertu de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique.
Cependant, cette mission d’information permanente ne couvre pas la totalité des champs concernés par la loi de bioéthique. Il en va ainsi notamment des enjeux éthiques soulevés par les cellules souches adultes reprogrammées, qui n’entrent pas, à proprement parler, dans les domaines de compétence de l’ABM. Ainsi que la mission l’a indiqué, il serait donc nécessaire d’ajouter aux missions de l’ABM une activité de veille qui pourrait se traduire par un droit d’alerte, auprès du Parlement et du gouvernement, en cas d’apparition d’un nouvel enjeu éthique, soulevé par les progrès les plus récents de la science, ainsi que l’avait suggéré M. Axel Kahn au cours de son audition : « lorsqu’une révision de la loi sera nécessaire, le CCNE, l’Agence de la biomédecine ou d’autres instances scientifiques doivent pouvoir saisir le législateur. » (1084) Il ne paraît pas souhaitable, en revanche, d’ajouter ces différentes problématiques aux domaines de compétence de l’ABM, dans la mesure où cette activité de veille serait sa seule tâche en la matière et ne consisterait pas en l’institution d’un régime de contrôle ou d’autorisation.
Ce droit d’alerte, qui concernerait aussi les domaines où l’ABM exerce une compétence pleine et entière, pourrait se traduire par une audition du directeur général de l’agence et du président du Conseil d’orientation de cette dernière, devant l’OPECST, organe commun aux deux assemblées du Parlement. L’OPESCT est en effet la mieux à même de recueillir les informations en provenance de l’ABM, dans la mesure où il « a pour mission d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions. À cet effet, elle (1085) recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations », conformément à l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Proposition n° 84. Inscrire dans la loi le principe d’un « droit d’alerte » de l’ABM, lorsque de nouvelles recherches ou avancées scientifiques et technologiques sont susceptibles de poser des questions éthiques particulièrement importantes ;
Prévoir que ce droit d’alerte se traduise par une audition du directeur général et du président du conseil d’orientation de l’ABM, devant l’OPECST.
b) Accroître les obligations d’information de l’ABM
Outre ce droit d’alerte, qui a vocation à demeurer ponctuel, des clauses de rendez-vous devraient également être prévues devant le Parlement à intervalles réguliers. La périodicité annuelle, qui est celle du rapport de l’ABM, peut être retenue.
Compléter le rapport annuel de l’ABM
En vertu du dernier alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, l’information que délivre l’ABM au Parlement et au Gouvernement se traduit aujourd’hui par la publication d’un rapport d’activité annuel, qui contient les éléments obligatoires suivants :
– Une analyse des autorisations et des agréments que l’Agence est autorisée à délivrer ;
– Les avis du Conseil d’orientation ;
– Une évaluation de l’état des recherches sur l’embryon et les cellules souches ;
– Un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics ;
– Une évaluation des conditions de mise en œuvre de l’article relatif au « bébé du double espoir » et un examen de l’opportunité de maintenir ces dispositions.
Si les rapports d’activité de l’ABM contiennent ces éléments obligatoires, ils ne s’y limitent pas. Ils dressent un état des lieux complet de l’activité de l’agence durant l’année écoulée dans l’ensemble de ses domaines de compétence.
Avec la révision de la loi, la liste des éléments compris obligatoirement par le rapport d’activité annuel pourrait être complétée. Ce rapport comprendrait en dehors des mentions visées à l’article L. 1418-1 précité:
– Un état des lieux présentant les principales avancées scientifiques et technologiques intervenues dans les domaines de compétence de l’agence. Si une mission de veille dans de nouveaux domaines lui était confiée, un compte-rendu annuel des résultats de cette veille devrait être ajouté parmi les éléments obligatoires de ce rapport annuel ;
– Un bilan de la mise en application de la loi de bioéthique à venir ainsi que d’éventuelles recommandations en vue de modification de la réglementation.
Instituer une audition annuelle du directeur général et du président du Conseil d’orientation de l’ABM
En vue de permettre une meilleure information du Parlement, une audition annuelle du directeur général de l’ABM par les commissions parlementaires compétentes devrait être introduite dans la future loi. Elle contribuerait à rendre effective l’évaluation des politiques publiques, qui figure désormais parmi les missions que le Parlement tient de l’article 24 de la Constitution.
L’instauration d’une telle procédure relève bien du domaine de la loi, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision du 25 juin 2009 (1086), a estimé qu’il n’appartenait pas au règlement mais à la loi de fixer les modalités dans lesquelles la Cour des comptes apporte son concours à un organe parlementaire. Par analogie, la loi pourrait donc également prévoir une audition annuelle des instances dirigeantes de l’ABM.
D’ailleurs, un tel dispositif prévaut dans le domaine audiovisuel. L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication institue une audition annuelle du président de France Télévisions et de celui de la société chargée de l’audiovisuel extérieur par les commissions compétentes des deux assemblées.
Un dispositif analogue devrait être retenu pour l’ABM. Cette audition ferait suite à la publication du rapport annuel de l’agence et serait l’occasion de présenter aux parlementaires la manière dont l’ABM l’applique et les difficultés éventuelles qu’elle rencontre.
Proposition n° 85. Prévoir tous les ans :
– que l’ABM dans son rapport annuel expose les principaux progrès scientifiques et technologiques dans les domaines dont elle a la charge et dresse le bilan de l’application de la loi ;
– l’audition du directeur général et du président du conseil d’orientation de l’ABM par les commissions parlementaires compétentes et l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques afin de présenter le rapport annuel de l’Agence.
c) Charger le CCNE de procéder à un examen régulier des enjeux éthiques de la loi
Si la mission de l’ABM doit être d’appliquer la loi de bioéthique et d’informer le Parlement et le gouvernement sur sa mise en œuvre, il revient en revanche au CCNE d’analyser les enjeux éthiques engendrés par les progrès de la science. Leur rôle doit donc être complémentaire dans leur mission d’information permanente des pouvoirs publics.
Le CCNE, une instance éthique reconnue
Des personnes entendues par la mission ont souligné le risque de voir se chevaucher les compétences du CCNE et de l’ABM (et notamment de son Conseil d’orientation). Cette crainte a été exprimée notamment par M. Axel Kahn : « certains ont voulu que le CCNE soit uniquement un comité opérationnel, ce qu’il est d’ailleurs car la pensée éthique est une pensée casuiste ne pouvant se nourrir que de cas concrets, si bien qu’il y aura un chevauchement permanent de ses compétences avec celles de l’Agence de la biomédecine. » Tel est d’ailleurs le sens des nombreuses propositions de l’OPECST qui ont pour but de mieux délimiter les compétences respectives de ces deux organismes, le CCNE devant intervenir en amont des activités de l’ABM.
Pourtant, le CCNE remplit d’ores et déjà des missions fort différentes de celles de l’ABM. Sur le fondement de l’article L. 1412-1 du code de la santé publique, il a pour mission de « donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. » Son champ d’action est donc beaucoup plus vaste que les seuls domaines de compétence de l’ABM.
De surcroît, le CCNE ne dispose pas de pouvoirs opérationnels, à la différence de l’ABM. Ainsi que l’a rappelé M. Didier Houssin, l’ABM « est confrontée à des problèmes très concrets, alors que le CCNE est un organisme plus généraliste » (1087). Cette différence est accentuée par le fait que l’ABM est un établissement public, soumis à la tutelle du ministère de la Santé, alors que le CCNE est une autorité administrative indépendante. La mission première de l’ABM est donc d’appliquer la loi de bioéthique, sous le contrôle du gouvernement et du Parlement. À l’inverse, le CCNE a davantage un rôle prospectif. « Nous nous intéressons au comment, le CCNE au pourquoi. » (1088) a résumé le Professeur Sadek Beloucif, président du Conseil d’orientation de l’ABM.
Un exemple tiré du passé récent permet de mieux saisir la différence des tâches qui incombent à ces deux structures, celui des enjeux éthique soulevés par les greffes du visage. Dans un premier temps, le CCNE a rendu un avis sur ce thème (1089), abordant notamment les questions philosophiques et anthropologiques soulevées par ce type de greffe, qui pouvait susciter des interrogations dans la mesure où aucune situation identique ne s’était encore présentée. Il avait été saisi par le professeur Laurent Lantieri qui, par la suite, a réalisé la première greffe de visage. Or, peu de temps après, l’agence a été saisie en urgence du premier projet de greffe du visage, sur lequel elle a dû se prononcer. « Si l’opération a pu être réalisée dans d’aussi bonnes conditions scientifiques mais aussi éthiques, c’est qu’un travail considérable avait été effectué en amont. Le CCNE n’aurait pas pu faire le travail de l’Agence, mais celle-ci a grandement bénéficié de la réflexion de fond du CCNE » (1090), a conclu M. Sadek Beloucif.
Le CCNE remplit donc un rôle de réflexion éthique spécifique, détaché de toute implication pratique sans être coupé des avancées de la science. « Je n’ai jamais eu le sentiment d’un conflit entre les réflexions éthiques du CCNE et celles de l’Agence de la biomédecine, qui portent sur des questions très précises, en lien avec l’activité de l’agence » (1091) a ainsi indiqué M. Didier Houssin, suivi en cela par Mme Carine Camby (1092).
Confier au CCNE l’évaluation éthique de la loi de bioéthique
Cette complémentarité de l’ABM et du CCNE pourrait être exploitée en conférant à ce dernier la mission d’évaluer les enjeux éthiques soulevés par l’application de la loi de bioéthique, tels qu’ils résultent notamment, des rapports annuels de l’ABM, qui dresseront le bilan des avancées scientifiques dans ses domaines de compétence et de veille. Ceci reviendrait à tirer partie de la mission du CCNE qui est « un lieu d’échanges entre représentants de disciplines très diverses – philosophie, sociologie, médecine…–, mais ce type de réflexion transversale exigeant beaucoup de temps, le Comité est toujours en retard sur les avancées de la science » (1093), selon M. Claude Huriet.
Il serait souhaitable que le CCNE établisse un rapport tous les deux ans relatif aux enjeux éthiques nouveaux dans les domaines de la loi de bioéthique. Ce rapport ne serait pas un recueil de ses avis précédents mais une analyse éthique fondée sur les données figurant dans les rapports de l’ABM notamment. Il aurait pour ambition d’aborder ces enjeux dans un cadre plus global que celui de l’activité d’application de la loi qui est celui de l’ABM. Ainsi que l’expliquait M. Axel Kahn, « la mission la plus spécifique du Comité, sans doute sa fonction principale, est de s’interroger, afin d’éclairer le législateur, sur ce qui mérite d’être protégé en l’homme et que pourrait menacer l’évolution de la science et des techniques. Aucune autre instance que lui ne peut remplir cette mission-là, et certainement pas l’Agence de la biomédecine qui se prononce, elle, sur des protocoles ». C’est donc dans le cadre de cette mission générale que s’inscrirait ce rapport qui serait adressé au Président de la République et au Parlement, selon les mêmes modalités que les avis du CCNE.
En contrepartie du caractère global et régulier de la publication de ces rapports, chacun d’entre eux ne devrait pas aborder l’ensemble des problématiques bioéthiques mais aurait intérêt à centrer sa réflexion sur une problématique différente. L’obligation de rédiger ce rapport pourrait être ajoutée à l’obligation de dépôt de son rapport d’activité annuel qu’il tient de l’article L. 1412-3 du code de la santé publique.
Proposition n° 86. Prévoir que le CCNE établisse tous les deux ans un rapport sur les enjeux éthiques des progrès scientifiques et technologiques dans le domaine de la bioéthique, notamment tels qu’ils auront été identifiés dans les rapports annuels de l’ABM. Il serait rendu public et remis au Parlement et au Président de la République.
2. Affirmer la compétence du législateur
L’information permanente que le Parlement est appelé à recevoir, tant des agences concernées que de la part du CCNE, devrait contribuer à l’éclairer sur les évolutions de la science et des techniques et sur leurs enjeux éthiques. Cependant, celle-ci n’est pas suffisante pour garantir une application satisfaisante de la loi.
En effet, le Parlement pourrait voir son rôle conforté dans deux autres domaines ayant trait à la bioéthique : la ratification des ordonnances qui modifient des dispositions issues des lois de bioéthique et la nomination du directeur général de l’Agence de la biomédecine. Enfin, il lui revient également de contrôler la bonne application de la loi.
a) Ratifier les ordonnances modifiant la loi de bioéthique
L’article 38 de la Constitution autorise le gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi, sur habilitation parlementaire en recourant à des ordonnances. Celles-ci sont de plus en plus fréquemment utilisées, notamment pour transposer des directives communautaires en droit interne. Afin d’éviter que le Parlement ne soit dessaisi des enjeux bioéthiques, qui touchent aux libertés de la personne, il serait souhaitable que les ordonnances intervenant dans le champ des lois de bioéthique soient ratifiées par le Parlement. La Constitution ne rend pas obligatoire la ratification des ordonnances. Elle impose seulement, à peine de leur caducité, de déposer dans un délai, prédéterminé par la loi d’habilitation, un projet de loi de ratification.
Par exemple le projet de loi autorisant la ratification de l’ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 a bien été déposé le 23 juillet 2008 sur le bureau de l’Assemblée nationale, empêchant ainsi l’ordonnance de devenir caduque. Mais ce texte n’a pas été ratifié.
Il est donc nécessaire que les ordonnances qui portent sur le champ des lois de bioéthique, notamment celles transposant une directive en droit interne, soient ratifiées par le Parlement, afin que ce dernier ne soit pas dessaisi de ces enjeux, sachant que depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, cette ratification doit être expresse.
Proposition n° 87. Inviter le Gouvernement à faire ratifier par le Parlement toutes les ordonnances relevant du champ de la bioéthique.
b) Consulter le Parlement sur la nomination du directeur général de l’ABM
Le Parlement pourrait également jouer un rôle accru dans la nomination du directeur général de l’ABM. En vertu de l’article R. 1418-15 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé.
Or, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a encadré le pouvoir de nomination du Président de la République en soumettant les plus importantes d’entre elles à l’avis des commissions parlementaires compétentes. Selon le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, « une loi organique détermine les emplois ou fonctions […] pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. »
Lors de la discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, un amendement a été déposé, en commission des Lois, par le rapporteur, M. Charles de La Verpillière, sur la demande du président Pierre Méhaignerie, et en séance publique, par le président et le rapporteur de la présente mission.
Néanmoins, cette proposition a été repoussée, au motif que les missions de l’ABM sont « très techniques » et que les instances dirigeantes de la Haute autorité de santé, du Haut conseil des biotechnologies et de l’INSERM sont déjà soumises à cette procédure. Le fait d’y soumettre le directeur général de l’ABM serait donc « superfétatoire ».
L’expérience a pourtant montré que l’ABM ne dépendait absolument pas de ces trois autres structures et qu’elle exerçait un pouvoir non négligeable aux fortes implications éthiques dans un domaine où le niveau de contrôle du législateur doit être élevé. Il serait donc souhaitable de mieux associer le Parlement à une telle nomination.
Proposition n° 88. Prévoir la nomination du directeur général de l’Agence de la biomédecine (ABM) par décret du Président de la République après avis des commissions parlementaires compétentes.
c) Contrôler l’application de la loi
Le Parlement a également un rôle à jouer dans le contrôle de l’application des lois qu’il vote. Dans le domaine de la bioéthique, ce contrôle porte sur deux domaines principaux : la publication des mesures réglementaires d’application de la loi et la coordination entre agences chargées de l’appliquer.
La publication des mesures réglementaires d’application
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a dressé un bilan mitigé de la mise en application de la loi. Il note en effet que si la publication des décrets et arrêtés a été plus rapide que lors de la loi de 1994, tous n’ont pas encore été pris et certains ont été publiés de manière tardive.
Ainsi, plusieurs mesures réglementaires ont fait défaut pour que puissent être appliquées des dispositions importantes de la loi de 2004.
C’est le cas notamment de l’arrêté qu’aurait dû prendre le ministre chargé de la santé à propos des espaces éthiques régionaux, prévu à l’article L. 1412-6 du code de la santé publique. De ce fait, les espaces éthiques sont contraints de travailler sans base juridique stable, situation qui a été déplorée par de nombreuses personnes auditionnées par la mission. Le ministère de la Santé a indiqué que cet arrêté devait être publié dans les prochaines semaines.
Il en va de même du décret en Conseil d’État qui aurait dû intervenir, en application de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique, en matière d’information de la parentèle. Ce décret aurait dû définir « les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d’accès » aux informations médicales recueillies dans le cadre d’un test génétique. Selon le ministère de la Santé, ce décret est devenu sans objet car l’article L. 1131-1 n’est pas suffisamment bien rédigé pour qu’un décret d’application puisse être publié.
De surcroît, les décrets qui sont publiés le sont généralement avec un retard important, ainsi que l’a indiqué Mme Emmanuelle Prada-Bordenave : « après la promulgation de la loi, il faut encore attendre les décrets d’application. Pour la loi de 2004, certains d’entre eux n’ont été publiés que l’année dernière ! » (1094). De fait la majorité des textes d’application a été publiée à la fin de l’année 2006, soit plus d’un an et demi après la promulgation de la loi de 2004.
Ceci n’est pas sans poser des difficultés. Les scientifiques peuvent être retardés dans leurs travaux par la publication tardive de décrets d’application les concernant. En outre afin de procéder avec suffisamment de recul à l’évaluation des dispositions de la loi précédente, encore faut-il que cette dernière soit pleinement applicable.
Plusieurs agences se sont vues confier la mission de participer à l’application de la loi de 2004.
La première d’entre elles est l’Agence de la biomédecine, qui exerce de nombreuses missions, définies à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique. Elle est compétente « dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l’embryologie et de la génétique humaines », selon ce même article. Mais d’autres agences sont susceptibles d’intervenir, à un titre ou à un autre, dans ses domaines de compétences. En effet, « l’Agence de la biomédecine s’inscrit dans un maillage d’agences sanitaires avec lesquelles elle collabore régulièrement : l’Institut de veille sanitaire, la Haute autorité de santé, l’Institut national du cancer et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » (1095)
C’est le cas en particulier de l’Agence française pour la sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), qui collabore avec l’ABM dans de nombreux cadres :
– C’est à elle que revient, en vertu de l’article L. 5311-1, la mission de vigilance sanitaire. Or, l’Agence de la biomédecine dispose également de compétences dans ce domaine puisque, en vertu de l’article L. 1418-1, « elle promeut la qualité et la sécurité sanitaire » pour les activités relevant de sa compétence ;
– Conformément à l’article L. 1245-5, l’importation et l’exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation et des produits cellulaires à finalité thérapeutique sont soumises à autorisation de l’AFSSAPS après avis de l’Agence de la biomédecine. Leur conservation n’est possible que dans les banques autorisées par l’AFSSAPS après avis de l’ABM ;
– L’AFSSAPS est habilitée à rédiger des guides de bonne pratique à l’usage des professionnels. Des recommandations ont été élaborées en coordination avec l’ABM concernant les médicaments inducteurs de l’ovulation ;
– Dans le domaine des cellules souches, l’AFSSAPS, qui est compétente pour autoriser les protocoles d’essais cliniques, devrait l’être aussi pour ceux qui emploient des cellules dérivées des cellules souches embryonnaires.
L’ABM entretient également des relations institutionnelles avec l’Établissement français du sang, notamment dans le domaine du sang de cordon, puisqu’elle gère le registre France greffe. C’est aussi le cas avec la Haute autorité de santé, pour ce qui a trait à la certification des activités qui relèvent de ses domaines de compétence. C’est ce qu’a rappelé Mme Carine Camby au cours de son audition : « Concernant la Haute autorité de santé (HAS), […] des chevauchements de compétence existent avec l’ensemble des agences sanitaires, en particulier sur l’édiction des règles de bonnes pratiques, mais des solutions pratiques ont pu être trouvées. Ainsi, le président de la HAS a proposé à l’Agence de la biomédecine d’assurer l’interface avec les professionnels pour la rédaction des règles de bonnes pratiques en AMP, sous réserve d’adopter la méthodologie de la HAS. » (1096)
Certains chercheurs ont indiqué à la mission que le fait que des compétences soient partagées entre plusieurs agences pouvait être source de complexité administrative et de ralentissement des protocoles de recherche. C’est notamment ce qu’a fait valoir M. René Frydman : « Lorsque nous lançons un projet de recherche, nous devons passer non seulement par l’ABM, mais aussi par beaucoup d’autres organismes comme l’AFSSAPS, le Comité de protection des personnes, parfois l’Assistance publique… Pour notre dernier projet, toutes ces démarches ont pris quatorze mois […] Autant dire que nous courons un grand risque que des confrères étrangers publient avant nous sur le sujet ! Nous ne remettons pas en cause ces procédures : le problème réside dans leur succession […] L’allongement des délais qui en résulte est préjudiciable à notre recherche. Peut-être faudrait-il un organisme « multi-têtes » s’occupant des questions concernant des recherches sensibles, de façon que les aspects scientifiques, éthiques, de sécurité et de procédure soient examinés en même temps et qu’une réponse unique puisse être donnée sur l’ensemble des problèmes sous six à huit semaines, alors qu’aujourd’hui chaque étape prend à elle seule près de huit semaines, sans compter que si, comme il est normal, une modification nous est demandée, le délai est encore rallongé. » (1097) Son propos a été confirmé par M. Jean-Luc Bresson à propos de l’AMP : « La délivrance des agréments et des autorisations suit également un cheminement d’une complexité qui n’est peut-être pas techniquement indispensable. » (1098)
L’ABM estime également que certaines procédures pourraient être perfectionnées grâce à une meilleure collaboration entre agences. Il en va ainsi de la biovigilance, qui a pour objet la surveillance des incidents et des risques d’incidents relatifs aux éléments et produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques (1099).
C’est pourquoi le rapport de l’OPECST propose de développer les synergies entre l’AFSSAPS, la HAS et l’ABM et de clarifier leurs domaines de compétence respectifs, en confiant à l’ABM la maîtrise des autorisations et des agréments de praticiens pour l’assistance médicale à la procréation. Si dans certains domaines (par exemple l’utilisation de cellules souches humaines ou d’embryons dans des recherches cliniques ou l’agrément des praticiens), une clarification des compétences est justifiée, il serait illusoire cependant de vouloir confier une compétence exclusive à l’une de ces agences dans les domaines relevant de la loi de bioéthique ; sauf à fusionner ces différentes agences en un unique établissement. L’expertise de chacune est nécessaire.
En revanche, il serait opportun de clarifier les procédures, afin de réduire le temps d’attente que doivent supporter les chercheurs avant qu’ils n’obtiennent une réponse à leur demande d’autorisation. A cette fin, une convention-cadre de partenariat devrait être conclue entre l’ABM, l’AFSSAPS, l’Établissement français du sang, voire la Haute autorité de santé. Cette convention ne saurait avoir pour but de préciser la répartition des compétences entre agences, qui relève du domaine législatif, mais de tendre, à chaque fois que des compétences sont partagées, à la mise en place d’un interlocuteur administratif unique (« guichet unique »), afin que l’étude des demandes puisse être faite en parallèle par les différentes agences et non successivement.
Proposition n° 89. Prévoir la conclusion d’une convention-cadre de partenariat entre l’ABM, l’AFSSAPS, l’Établissement français du sang et la Haute Autorité de santé pour renforcer leur coopération et promouvoir les démarches visant à mettre en place un interlocuteur administratif unique pour les praticiens et les promoteurs de recherches.
Réaffirmer les grands principes bioéthiques et prévoir des mécanismes d’adaptation de la loi ne saurait suffire à faire vivre la loi bioéthique. L’organisation des États généraux de la bioéthique a montré que même sur des sujets complexes, la participation des citoyens constituait une expérience très positive pour eux-mêmes, pour les élus et pour les experts, pour peu que les citoyens soient formés au préalable. Les leçons de cette expérience peuvent être tirées sur trois plans : celui du débat dans l’opinion publique, celui de l’enseignement de la bioéthique et celui de la diffusion de la réflexion éthique tant en France qu’à l’étranger.
Ainsi que l’indiquait M. Alain Grimfeld au cours de son audition, « vu la vitesse des progrès dans le domaine des sciences du vivant, il n’est plus possible d’annoncer les dernières découvertes à la population et de décider unilatéralement ce que l’on va faire pour elle. Il n’appartient pas au CCNE de convaincre la population que ce qu’on lui propose est « bon pour elle » ; cela serait inacceptable sur le plan éthique. » (1100) Ce constat repose sur la nécessité croissante de faire participer le grand public au débat éthique, d’autant plus s’il concerne des enjeux de société. Dans le domaine de la bioéthique, ce défi pouvait sembler difficile à relever compte tenu de la technicité des enjeux. Or la réussite des États généraux de la bioéthique (EGB) a ouvert la perspective de son institutionnalisation.
a) Le succès des États généraux de la bioéthique
Les États généraux de la bioéthique ont été engagés à l’initiative du Président de la République en novembre 2008. Dans sa lettre de mission, celui-ci indiquait le but recherché lors de cette consultation du public : « permettre, sur ces questions décisives et sensibles, à tous les points de vue de s’exprimer et aux citoyens d’être associés », afin que « le débat sur la bioéthique ne soit pas confisqué par les experts ; les Français doivent pouvoir être informés et faire connaître leur avis sur des sujets qui engagent la condition humaine et les valeurs essentielles sur lesquelles est bâtie notre société ».
La mission a été étroitement associée à ces États généraux dans la mesure où son rapporteur était également président du Comité de pilotage des États généraux et où son président en était membre. De plus, il a été décidé de permettre aux membres non députés du Comité de pilotage des États généraux d’assister aux auditions de la mission. Enfin, le rapport final des États généraux mentionne les travaux de la mission comme faisant partie intégrante de l’information dont avait pu bénéficier le grand public dans le cadre de la révision des lois de bioéthique (1101).
Ces États généraux ont reposé sur trois piliers, qui constituent autant de modalités de participation du public :
– L’ouverture d’un site Internet etatsgenerauxdelabioethique.fr, réunissait des documents pédagogiques sur les principaux aspects de la loi de bioéthique et permettait aux internautes d’adresser des contributions en ligne. Ce site a été consulté par plus de 70 000 personnes soit 410 000 pages consultées entre février et juin 2009. « Un processus de conquête du grand public s’est indéniablement amorcé. La durée moyenne passée sur le site et le nombre de pages consultées en témoignent : le temps moyen de 5 minutes 12 et la quantité moyenne de pages consultées (6 pages) démontre la motivation des internautes » (1102), relève le rapport final des EGB.
– La tenue de trois conférences de citoyens portant chacune sur des problématiques bioéthiques différentes a reçu un large écho. Celle de Marseille, le 9 juin 2009 a traité de la recherche sur les cellules souches et l’embryon et des diagnostics prénatal et préimplantatoire; celle de Rennes, le 12 juin 2009, s’est penchée sur l’assistance médicale à la procréation ; celle de Strasbourg, le 16 juin 2009, a abordé la problématique de la greffe et du prélèvement et de la médecine prédictive. Des panels de citoyens ont été sélectionnés de manière à ce qu’ils soient représentatifs de la société française. Après avoir été formés aux grandes problématiques éthiques et aux grandes évolutions scientifiques dans le domaine qui les concernait, ces panels ont dû rédiger un avis, qui a été rendu public.
– Les espaces éthiques ont organisé, sur tout le territoire, des rencontres afin d’alimenter le débat éthique. Une soixantaine de manifestations se sont déroulées à ce titre. Ont essentiellement participé à ces débats des personnes directement concernées par les enjeux bioéthiques, à savoir des professionnels de santé, des chercheurs, des juristes et des philosophes.
Ces trois formes de participation des citoyens ont permis de démontrer qu’un débat public pouvait être organisé « sur des sujets qui, à la fois, concernent chacun d’entre nous dans son intimité – donner la vie, être soigné, mourir – et sont d’une extrême technicité »(1103), pour reprendre les mots de M. Didier Houssin. D’autres expériences, précédemment évoquées(1104), ont également donné des résultats remarquables.
Devant le succès rencontré par l’organisation des EGB, la Ministre de la santé et des sports, Mme Roselyne Bachelot, au cours de son discours de clôture des États généraux, a estimé que la participation du public devrait être institutionnalisée sur le long terme. Pour ce faire, elle a proposé que deux axes soient retenus : « Il peut s’agir de prévoir des consultations régulières, similaires à celles des états généraux ou sous une forme différente. […] Parallèlement, les espaces de réflexion éthique, que beaucoup d’entre vous connaissent, sont d’une grande utilité en ce qu’ils rassemblent des personnalités particulièrement compétentes. Cette utilité, je veux la renforcer en les ouvrant davantage à la participation citoyenne. L’organisation de débats publics locaux sur les questions d’éthique de la santé sera ainsi facilitée. »
Ces deux modalités d’organisation de la participation du public ont également retenu l’attention de la mission.
b) Institutionnaliser la participation du public
Il est impératif, sur des sujets de société tels que ceux qui découlent des lois de bioéthique, d’institutionnaliser une forme de consultation du public.
La participation du public a été institutionnalisée dans certains domaines et à l’étranger
Celle-ci existe déjà dans certains domaines. À cette fin, a été introduit dans la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement le principe de la participation du public. C’est d’ailleurs cette même loi qui a créé la Commission nationale du débat public (CNDP), devenue depuis une autorité administrative indépendante. Cette dernière est chargée d’organiser le débat public dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement : elle veille au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. Récemment, c’est également la CNDP qui a été chargée d’organiser le débat public portant sur les nanotechnologies.
À l’étranger, le principe de participation du public est également mis en œuvre. Ainsi au Royaume-Uni, c’est l’Autorité pour la fécondation et l’embryologie humaines (HFEA) qui est chargée d’organiser le débat public dans le domaine bioéthique. Cette dernière emploie différents moyens dans ce but ; ainsi que l’a souligné M. David Gomez, senior legal adviser à la HFEA : « Nous sommes en contact permanent avec les groupes religieux, les réseaux de donneurs, les personnes conçues par donneurs, la communauté scientifique des chercheurs. Nous organisons des conférences annuelles pour parler de l’avenir. Nous développons aussi des consultations sur Internet, et nous organisons des réunions. Nous avons créé un panel qui rend compte du point de vue des patients sur les expériences qu’ils ont vécues. » (1105) Le Danemark peut également se flatter d’une longue tradition en la matière, puisque l’agence danoise chargée de l’évaluation des choix technologiques organise depuis le milieu des années 1980 des conférences de consensus qui portent sur les thèmes les plus sujets à controverse comme les tests génétiques. Les canadiens ont la possibilité d’assister à des assemblées publiques, de participer à des enquêtes, d’adresser leurs commentaires sur des thèmes touchant au système de santé, aux rapports entre la science et la recherche, à l’environnement.
Le CCNE pourrait se voir confier l’organisation de la participation du public dans le domaine de la bioéthique
Plusieurs organismes seraient susceptibles de se voir attribuer la mission de consultation du public dans le domaine de la bioéthique.
En premier lieu, on pourrait penser à la Commission nationale du débat public, qui dispose d’une réelle expertise en matière de participation du public. Sa récente expérience dans le domaine des nanotechnologies, qui ne relèvent pas de ses compétences habituelles, confirme qu’elle dispose du savoir-faire nécessaire à l’organisation du débat public. Cependant, ce choix doit être écarté, parce que la bioéthique est fort éloignée des domaines de compétence de la CNDP, qui organise la consultation du public dans le cadre des grands travaux d’aménagement.
En second lieu, l’Agence de la biomédecine, qui est un acteur incontournable dans le domaine de la bioéthique et qui dispose de l’expertise nécessaire à l’institutionnalisation de la consultation du public, pourrait être la structure la plus qualifiée. Cependant, la mission a considéré que cette fonction devait revenir au CCNE pour plusieurs raisons :
– premièrement, parce que le CCNE dispose d’un domaine de compétence plus large que l’ABM, puisqu’il couvre « les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé », selon l’article L. 1412-1 du code de la santé publique, alors que celui de l’ABM se limite à « la greffe, la reproduction, l’embryologie et la génétique humaines ». Le CCNE serait donc plus apte à organiser le débat public dans l’ensemble des domaines relevant du champ de la loi de bioéthique ;
– de plus, le CCNE est une autorité administrative indépendante, comme l’est la CNDP, alors que l’ABM est un établissement public administratif. Les garanties d’impartialité exigées par l’organisation du débat seraient donc plus grandes ;
– enfin, il semble préférable de confier l’organisation de la consultation du grand public à une structure habituée au débat éthique, telle que le CCNE, alors que l’ABM, qui remplit davantage un rôle opérationnel, pourrait être à la source de conflits d’intérêts en pouvant être à la fois juge et partie.
Il semble donc opportun de compléter les missions du CCNE résultant de l’article L. 1412-1 du code de la santé publique, afin d’indiquer qu’il a aussi pour tâche d’organiser le débat public dans ses domaines de compétence. À cette fin, il serait possible de s’inspirer de l’article L. 1412-6 concernant les espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux, qui « participent à l’organisation de débats publics afin de promouvoir l’information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique. » La décision d’organiser un débat public pourrait être prise à l’initiative du gouvernement, sur le modèle des États généraux de la bioéthique.
Ainsi que la mission l’a indiqué, il serait souhaitable que dans ce cadre le CCNE consacre l’une de ses premières consultations à la problématique des sciences émergentes et à la perspective d’« amélioration » des performances humaines.
Proposition n° 90. Compléter les missions du CCNE en lui permettant d’organiser la consultation du public dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La mission considère également, de manière plus générale, que toute loi qui porterait sur « les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé », qui définit le champ de compétence du CCNE, soit précédée d’une phase de débat. Celle-ci pourrait se concrétiser par une organisation du débat public comparable aux EGB et une saisine du CCNE par le gouvernement ou à son initiative.
Proposition n° 91. Prévoir dans le code de la santé publique que tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé serait précédé d’un débat public sous forme d’états généraux.
c) Promouvoir la réflexion éthique au niveau régional
Le second pilier de la participation du public au débat bioéthique devrait être institué à l’échelon local, à travers les espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux créés par la loi bioéthique de 2004 en lien avec des CHU. Leur dynamisme n’est plus à démontrer puisqu’ils ont été en mesure d’organiser de nombreuses réunions publiques dans le cadre des EGB.
Cependant, il est regrettable que ces espaces éthiques n’aient toujours pas de statut juridique. En effet, l’article L. 1412-6 du code de la santé publique qui les institue prévoit que leurs « règles de constitution, de composition et de fonctionnement […] sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé », après avis du CCNE. Or, en cinq ans, cet arrêté n’a toujours pas été pris. Il devrait néanmoins l’être sous peu, ainsi que l’a indiqué à la mission le ministère de la santé, dans la mesure où le CCNE a déjà été consulté sur cet arrêté.
La mission de ces espaces est, rappelons-le, triple : constituer des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé ; servir d’observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l’éthique ; participer à l’organisation de débats publics et promouvoir l’information et la consultation des citoyens sur le débat éthique.
Dans le cadre de cette dernière mission, ils pourraient servir de relais, comme ils l’ont été dans le cadre des EGB, pour l’organisation d’un débat public initié par le CCNE à l’échelon national et qui se déclinerait dans chaque espace éthique, à l’échelon régional ou interrégional. M. Alain Grimfeld, président du CCNE, a indiqué souhaiter « une intense coopération avec tous les espaces éthiques régionaux »(1106).
Proposition n° 92. Publier l’arrêté prévu à l’article L. 1412-6 du code de la santé publique sur les espaces éthiques régionaux ou interrégionaux, pour lequel le CCNE a émis un avis favorable.
2. Diffuser les principes de la bioéthique auprès des professionnels et du grand public
L’information du grand public et la formation des professionnels revêtent une importance particulière dans le domaine de la bioéthique. Si une participation effective et éclairée aux grands débats de société qui entourent les questions de bioéthique est nécessaire, une pratique scientifique appuyée sur des règles éthiques plus explicites est également souhaitable.
a) La nécessité d’une meilleure formation des citoyens aux questions de bioéthique
Trop souvent, la réflexion sur les grands principes éthiques est occultée à l’école par l’apprentissage des découvertes et des techniques scientifiques. Pourtant, c’est uniquement de cette information que pourront résulter une meilleure application des lois de bioéthique et une plus grande participation du public à leur élaboration. Mme Corine Pelluchon invitait les parlementaires à agir en ce sens: « il faut réfléchir […] à la participation du peuple, c’est-à-dire à l’information et à la formation des citoyens, à l’école et dans les universités – l’éducation étant au cœur de ces questions et de leur traitement démocratique. […] Il faut faire en sorte que les citoyens s’approprient les questions de bioéthique. » (1107)
Une information actuellement insuffisante
Actuellement, l’information du grand public sur les dispositions applicables relatives aux domaines couverts par la loi de bioéthique est insuffisante. Même sur la thématique du don d’organe, qui a pourtant été l’objet de nombreuses campagnes de communication, l’information des citoyens est lacunaire. L’avis du panel de Strasbourg, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, peut en témoigner : « Nous constatons que l’information donnée au grand public sur le prélèvement et la greffe d’organes est insuffisante quantitativement, incomplète qualitativement et irrégulière. Il est d’ailleurs frappant que dans notre groupe seule une infime minorité d’entre nous avait connaissance de l’existence d’un registre du non. Nous avons par ailleurs été étonnés du décalage entre le message transmis dans les campagnes de communication (faites connaître votre choix en matière de don d’organes) et la nullité juridique de la carte de donneur. »
De nombreux praticiens de l’assistance médicale à la procréation ont également appelé de leurs vœux une meilleure information du grand public afin de réduire le taux de recours à l’AMP. M. François Olivennes a ainsi fait valoir : « Une femme de quarante ans est jeune pour la vie, mais pas pour ce qui est de sa capacité de reproduction. Beaucoup de femmes l’ignorent. Une campagne d’information nationale me paraît urgente » (1108).
Plus généralement M. Olivier Oullier a attiré l’attention de la mission sur la nécessité d’informer le grand public tant sur les progrès des neurosciences que sur leurs limites : « À partir du moment où certains vont prétendre décoder la pensée, des gens croiront qu’on décode leur pensée et modifieront leur comportement. Ils auront été manipulés, non pas par les résultats des neurosciences en tant que tels, mais par les gens qui les auront surinterprétés, les neuropportunistes ou les neurocharlatans, pour utiliser deux termes récemment repris dans la presse. » (1109). Le même raisonnement pourrait s’appliquer aux caractéristiques génétiques.
Des citoyens demandeurs d’une meilleure information
Les citoyens interrogés lors des États généraux de la bioéthique insistent sur le fait que seule une information de qualité serait susceptible de les convaincre : « Les campagnes de communication [portant sur le don d’organes] doivent être informatives et non pas promotionnelles : leur objectif doit en effet être de sensibiliser et de faire naître le débat, sans chercher seulement à promouvoir le don d’organes. »
Cette préconisation, qui recommande une meilleure information sur les questions ayant trait à la bioéthique, était l’une des propositions de la réunion européenne sur les neurosciences Meeting of Minds, qui s’est tenue à Bruxelles en janvier 2006. Le panel recommandait en effet de renforcer l’enseignement dispensé à tous les niveaux portant sur le cerveau et de rendre accessibles à des non-scientifiques les résultats des recherches les plus récentes des neurosciences (1110).
Cette information devrait être systématisée tout au long du parcours éducatif. Selon les témoignages recueillis par la mission, les élèves sont réceptifs à ces problématiques. Ainsi, Mme Corine Pelluchon a constaté que « les questions de bioéthique (comme celles d’environnement) intéressent au plus haut point les lycéens et les étudiants, surtout lorsqu’elles sont articulées à d’autres questions de société » (1111) et M. Jean-François Mattei a observé que « les élèves des classes de terminale posent, sur ces sujets, des questions incisives et justes et qu’ils débattent sereinement. » (1112)
De manière générale, chaque fois qu’une théorie ou qu’une pratique scientifique est abordée, ses enjeux éthiques devraient être appréhendés. Il pourrait en être ainsi à propos de l’assistance médicale à la procréation lors des cours de sciences et vie de la terre portant sur la reproduction. Il apparaît difficile également d’évoquer les neurosciences ou la génétique en faisant l’économie de toute réflexion éthique. Mme Sylvie Manouvrier-Hanu, présidente du collège national des enseignants et praticiens de génétique médicale a estimé qu’il fallait « miser sur une formation à la génétique dès le collège et le lycée, les enseignants de sciences naturelles devant être formés à cet enseignement » (1113). Dans le domaine de la greffe, notre collègue M. Philippe Gosselin, président du collectif Don de vie, don de soi, a formulé la même demande(1114). Ces questions, qui touchent à la liberté, au déterminisme, à la dignité, pourraient également être aux programmes des cours de philosophie.
Proposition n° 93. Inclure dans les programmes scolaires un enseignement aux problèmes de la bioéthique.
b) Sensibiliser les professionnels aux enjeux éthiques de leurs disciplines
Les mêmes constats peuvent être dressés à propos de la formation à l’éthique des professionnels : alors que l’éthique de manière générale et la bioéthique en particulier imprègnent des domaines de plus en plus nombreux de la pratique médicale et scientifique, les professionnels sont encore mal formés à affronter ces nouveaux enjeux.
Les lacunes de la formation initiale aux enjeux éthiques des pratiques médicales et scientifiques ont été soulignées par plusieurs intervenants. M. Olivier Oullier a fait ce constat dans le domaine des neurosciences: « Il nous semble primordial d’informer, d’éduquer et d’intégrer ce type d’information dans la formation académique et médicale, où l’on n’étudie aujourd’hui que le fonctionnement du neurone. […] Il est désormais nécessaire d’inclure dans l’enseignement scientifique français une formation à l’éthique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, celle-ci n’est pas systématique, loin s’en faut, notamment en neurosciences »(1115).
Le panel de citoyens de Strasbourg a suggéré de son côté « de renforcer la formation au sujet du don d’organes, en rendant obligatoires les modules universitaires à ce sujet ».
Ces enjeux ont déjà été abordés par la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui avait observé , à la suite du rapport de M. Alain Cordier (1116), que la formation en éthique médicale était très disparate et le plus souvent insuffisante au cours des études médicales.
La mission estime que ces lacunes devraient être comblées dans le cadre de chaque discipline, afin d’éviter que les questions éthiques ne soient traitées de manière déconnectée des pratiques médicales ou scientifiques. Chaque enseignement devrait ainsi comprendre une initiation aux grandes questions éthiques présentes dans le domaine étudié.
Ces lacunes se retrouvent à l’identique dans la formation continue des professionnels de santé et des scientifiques. Celle-ci peut prendre différentes formes. Elle peut passer par des enseignements, ainsi que le préconisait le panel de Strasbourg, concernant la greffe, qui proposait de renforcer « la formation continue des équipes médicales en place pour la prise en charge de la famille et du patient (donneur vivant ou receveur) ».
Elle peut également revêtir des formes plus originales. L’une d’entre elles a été mise en valeur récemment dans la presse : elle consiste à associer un spécialiste venu des sciences humaines aux projets de recherche susceptible de soulever des questions éthiques. Une équipe de jeunes chercheurs français, qui travaille dans le domaine de la biologie synthétique, vient ainsi de recevoir une Médaille d’or et le Prix spécial du jury « pour les approches éthiques et sociétales » lors d’un concours organisé par le MIT car l’équipe de recherche comportait une étudiante en sciences humaines. D’après les témoignages des scientifiques de l’équipe, cette présence a été très profitable et a engendré une importante réflexion éthique(1117). La pratique de ces recherches interdisciplinaires avait déjà été préconisée par l’avis citoyen de Meeting of minds.
Proposition n° 94. Renforcer l’enseignement des questions de bioéthique dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé et des biologistes.
3. Promouvoir une réflexion éthique sur les recherches conduites ou financées par des Français dans des pays étrangers
Le débat éthique ne doit pas se cantonner aux dispositions de nature législative ne concernant que les recherches et les pratiques médicales se déroulant en France.
Il est également nécessaire de promouvoir l’adoption de règles et de déclarations internationales ou européennes dans ce domaine et d’engager une réflexion sur les recherches biomédicales conduites ou financées par des Français dans les pays en voie de développement, ainsi qu’y ont notamment invité le CCNE (1118) et le Conseil d’État, dans son étude sur la révision des lois de bioéthique.
a) Les carences de la législation actuelle en matière d’évaluation éthique
L’article 21 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de l’UNESCO, adoptée le 19 octobre 2005 dispose que « lorsqu’une activité de recherche est entreprise ou menée d’une autre façon dans un ou plusieurs États – État(s) hôte(s) – et financée par des ressources provenant d’un autre État, cette activité de recherche devrait faire l’objet d’un examen éthique d’un niveau approprié dans l’État hôte et dans l’État dans lequel la source de financement est située ».
Dans le même sens, l’article 9 du protocole additionnel à la convention d’Oviedo, qui concerne la recherche biomédicale, stipule que tout projet de recherche doit être soumis à un comité d’éthique pour un examen indépendant de son acceptabilité éthique dans chacun des États où l’une des activités de cette recherche doit avoir lieu. D’autres textes internationaux (1119), juridiquement non contraignants mais qui ont recueilli un large consensus contiennent des dispositions analogues.
Plusieurs instances éthiques, notamment le CCNE et le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) auprès de la Commission européenne (1120) ont également pris position en faveur d’une évaluation éthique des protocoles de recherche biomédicale par un comité du pays promoteur ou financeur. En particulier, le CCNE avait évoqué dès 1993, les garanties nécessaires à la dignité et à la sécurité des personnes se prêtant à des recherches biomédicales entre les équipes françaises et celles de pays en voie de développement.
Notre droit interne ne soumet pas cependant à un examen éthique par une instance française les protocoles de recherche biomédicale conduits à l’étranger. Les articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux recherches biomédicales – c’est-à-dire aux recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales – ne s’appliquent qu’aux projets de recherche mis en œuvre en France.
Cette situation apparaît aujourd’hui problématique, comme l’a fait observer le Conseil d’État (1121), et ce, pour plusieurs raisons, qui ne sont d’ailleurs pas seulement éthiques.
En premier lieu, il apparaît important de veiller à la protection des personnes se prêtant à une recherche mais aussi de permettre aux organismes de recherche français de s’assurer du respect de certains principes éthiques fondamentaux par des équipes françaises. Cela semble d’autant plus nécessaire qu’il n’existe pas de comités d’éthique, nationaux ou locaux, dans certains pays et que ces comités n’offrent pas toujours toutes les garanties requises en termes d’indépendance.
En deuxième lieu, les organismes de recherche (organismes publics mais aussi entreprises pharmaceutiques) doivent pouvoir être en mesure de garantir que les recherches menées hors de France ont fait l’objet d’un examen éthique par une instance nationale. En effet, au niveau international, l’exigence d’une « double revue » éthique tend à se développer comme critère de qualité et de crédibilité scientifique des recherches. Ainsi, certains périodiques de renom refusent de publier les travaux qui n’ont pas fait l’objet d’une double revue. Dans son étude le Conseil d’État indique à cet égard qu’aux États-Unis, la double revue éthique est imposée aux entreprises effectuant des recherches dans les pays en développement et que la Commission européenne subordonne à une évaluation éthique, réalisée en interne par des groupes d’experts indépendants, les projets de recherche financés dans le cadre des programmes-cadres européens.
L’absence d’une instance ayant la possibilité de procéder à l’examen éthique des protocoles de recherches conduites dans les pays en développement peut dès lors s’avérer être un handicap pour les équipes françaises.
Enfin, il est à noter que, pour pallier ces difficultés, des organismes français, par exemple l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ou l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, ont élaboré des chartes ou des recommandations concernant les recherches menées dans les pays en développement ; elles prévoient notamment un examen par un comité d’éthique français mais ces règles ne peuvent aujourd’hui être mises en œuvre. D’autres instances, telles que l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ont mis en place des comités spécifiques accrédités par une autorité américaine.
Il reste que les entreprises et organismes publics de recherche qui souhaitent se conformer aux principes internationaux précités se trouvent actuellement en difficulté. C’est pourquoi le Conseil d’État a proposé, dans le prolongement de la réflexion ouverte par le CCNE dès le début des années 1990, de créer un mécanisme national d’examen éthique pour les recherches menées à l’étranger.
b) Instituer des dispositifs d’examen éthique des recherches menées dans des pays extracommunautaires
Lors de la révision des lois de bioéthique, il pourrait être envisagé d’instituer un dispositif permettant l’examen éthique des protocoles de recherche biomédicale financés, promus ou menés dans les pays extracommunautaires par un Français ou une personne morale de droit français. Dans ce sens, plusieurs options sont concevables : la création d’un comité unique, comme l’avait proposé le CCNE, l’extension de la compétence des comités de protection de personnes (CPP), qui sont actuellement compétents pour les recherches biomédicales mises en œuvre en France ou la création de comités régionaux ad hoc.
Cet examen aurait notamment pour objectif de vérifier que certaines conditions sont remplies, s’agissant par exemple du consentement libre et éclairé des participants à la recherche, de la protection des personnes vulnérables ou encore des conditions de prise en charge à l’issue de la recherche.
Enfin, selon l’option institutionnelle qui serait choisie, plusieurs points devraient être précisés. Il en va ainsi du caractère interdisciplinaire et indépendant de la composition du ou des comités, des relations avec les autres comités sollicités dans le cadre d’une recherche, des critères déterminant le caractère obligatoire ou facultatif de la saisine, du caractère consultatif de l’avis rendu, du champ de l’évaluation ou encore du suivi du déroulement de la recherche par le ou les comités.
Proposition n° 95. Instituer une procédure nationale d’examen éthique des protocoles de recherche biomédicale financés, promus ou appliqués dans les États extra-communautaires par un chercheur français ou une personne morale de droit français (En complétant par exemple l’article L. 1121-1 du code de la santé publique).
DESIR D’ENFANT OU DROIT À L’ENFANT
L’assistance médicale à la procréation
Proposition n° 1. Poser dans la loi que la finalité du recours à l’AMP est d’ordre médical et que la demande parentale d’un couple n’est recevable que dans ce cadre.
Proposition n° 2. Assouplir les conditions que les couples doivent remplir pour accéder à l’AMP : ne plus exiger deux ans de vie commune pour les couples pacsés et, dans les autres cas, admettre des exceptions pour raisons médicales ou d’âge.
La majorité des membres de la mission estime nécessaire de maintenir la condition selon laquelle le couple doit être formé d’un homme et d’une femme.
Une partie des membres de la mission s’est déclarée favorable à l’accès des femmes célibataires infertiles à l’AMP.
Proposition n° 3. Autoriser le transfert post mortem d’embryon à titre exceptionnel lorsque le projet parental a été engagé mais a été interrompu par le décès du conjoint. Encadrer cette procédure par des délais stricts : le transfert pourrait être autorisé par l’Agence de la Biomédecine après trois ou six mois de veuvage et être permis jusqu’à dix-huit mois ou deux ans après le décès du conjoint, afin notamment de permettre éventuellement une deuxième tentative.
Maintenir l’interdiction de l’insémination post mortem.
Compléter la loi pour préciser qu’avant toute autoconservation des gamètes, le couple est informé des conditions légales d’accès à l’AMP et notamment que les gamètes conservés seront détruits en cas de décès.
Proposition n° 4. Prendre en compte dans la loi « l’intérêt de l’enfant à naître » dans les décisions relatives à l’assistance médicale à la procréation.
Une partie des membres de la mission s’est déclarée réservée sur l’opportunité de cette proposition.
Proposition n° 5. Améliorer l’information du public sur l’évolution de la fertilité des femmes avec l’âge et sur les résultats de l’AMP, en suggérant une saisine du CCNE par le ministre chargé de la santé sur les modalités de mise en œuvre de cette information.
Développer la recherche sur les causes de l’infertilité, notamment environnementales et sanitaires et étendre les missions de l’Agence de la biomédecine afin qu’elle puisse lancer des appels à projets dans ce domaine.
Proposition n° 6. Simplifier les contraintes qui pèsent sur les praticiens procédant à des activités d’AMP et de DPN en supprimant l’agrément individuel. Prévoir en conséquence que l’autorisation pour les activités cliniques et biologiques d’AMP et de DPN ne peut être délivrée aux établissements et organismes concernés que s’ils font appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, le respect de cette condition devant être contrôlé lors de la visite de conformité.
Maintenir l’agrément individuel pour les professionnels pratiquant le DPI.
Proposition n° 7. Autoriser les sages-femmes à exercer dans les centres d’AMP, dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État.
Proposition n° 8. Afin d’assurer un meilleur financement des activités d’AMP, inviter le ministre chargé de la santé à saisir l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’un rapport sur les modalités de tarification de ces activités, en étudiant notamment les possibilités de mieux prendre en compte certaines activités connexes aux actes cliniques et biologiques.
Proposition n° 9. Renforcer l’accompagnement psychologique des couples procédant à une AMP en augmentant le nombre de psychologues et de psychiatres exerçant dans les centres d’AMP.
Proposition n° 10. Prévoir la réalisation d’une enquête sur les difficultés rencontrées par les femmes actives suivant des traitements d’AMP. Cette étude pourrait être confiée au ministère de la santé ou à l’Agence de la biomédecine. Au vu des résultats de cette enquête, demander à l’Agence de la biomédecine l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques sur ce sujet à l’attention des centres d’AMP.
Proposition n° 11. Afin de mieux évaluer les résultats des centres d’AMP :
– assurer un recensement plus complet de données individuelles, par patiente et par tentative d’AMP, dans le cadre du déploiement du registre FIV-NAT ;
– compléter les missions de l’Agence de la biomédecine, afin de prévoir la publication régulière des résultats de chaque centre d’AMP, selon une méthodologie prenant notamment en compte les caractéristiques de leur patientèle, en particulier l’âge des femmes ;
– inviter l’Agence de la biomédecine, au vu de ces données, à diligenter des missions d’appui et de conseil dans certains centres, voire à proposer des recommandations d’indicateurs chiffrés à certains centres.
Proposition n° 12. Renforcer le suivi de l’état de santé des personnes ayant eu recours à l’AMP, des enfants ainsi conçus et des donneuses d’ovocytes, en améliorant notamment le recueil des données individuelles relatives aux tentatives de fécondation in vitro (FIV) en France et en envisageant le croisement de différents registres existants.
Proposition n° 13. Publier l’arrêté validant les techniques d’AMP d’effet équivalent.
Cet arrêté devra être complété au fur et à mesure de la conception de techniques nouvelles d’AMP faisant l’objet d’un consensus des professionnels sur la base de critères de qualité, d’innocuité, d’efficacité et de reproductibilité.
Proposition n° 14. Préciser quel est l’organisme chargé de l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne.
Proposition n° 15. Maintenir l’encadrement actuel concernant la conception, la congélation et le devenir des embryons surnuméraires.
Préciser dans la loi que l’information délivrée aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons doit leur être remise préalablement au recueil de leur consentement à la fécondation multiple d’embryons.
Proposition n° 16. Afin de promouvoir le don d’ovocytes et d’améliorer les conditions dans lesquelles les dons sont réalisés :
– poursuivre des actions régulières d’information et de promotion du don de gamètes ;
– améliorer le remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneuses d’ovocytes (y compris les frais de transports et de garde d’enfants) ;
– ouvrir aux donneuses d’ovocytes salariées le droit à une autorisation d’absence ou à un congé spécifique pour se rendre aux examens et consultations nécessaires pour le don ;
– accroître le nombre de centres pratiquant le don d’ovocytes et revoir le financement des actes qui y sont réalisés ;
– préciser les modalités de la prise en charge financière des frais médicaux afférents au don d’ovocytes.
– Proposition n° 17. Afin de s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la donneuse d’ovocytes et afin d’écarter tout don qui ne respecterait pas le principe de gratuité, prévoir dans la loi l’organisation d’un entretien préalable de la donneuse avec l’équipe pluridisciplinaire, comprenant notamment un psychologue. Prévoir également la délivrance d’une information écrite sur l’encadrement légal et les risques que peut présenter le don pour la santé.
Proposition n° 18. Maintenir l’anonymat du don de gamètes.
Certains membres de la mission ont estimé que le débat sur cette question devait rester ouvert
Proposition n° 19. Maintenir la possibilité pour un couple infertile d’accueillir les embryons surnuméraires d’un autre couple. Supprimer la disposition de la loi selon laquelle cette alternative au don à la recherche et à la destruction de l’embryon est ouverte « à titre exceptionnel ».
Simplifier les démarches que le couple donneur doit effectuer. Maintenir l’intervention du juge dans la procédure d’accueil de l’embryon.
Maintenir l’obligation selon laquelle l’embryon doit être conçu avec des gamètes provenant d’au moins un des membres du couple, l’interdiction du double don de gamètes se justifiant par la pénurie d’ovocytes et par un nombre suffisant d’embryons surnuméraires pouvant être accueillis par des couples dont les deux membres sont infertiles.
La gestation pour le compte d’autrui
Proposition n° 20. Maintenir l’interdiction de la gestation pour le compte d’autrui.
QUELLES LIMITES OPPOSER À L’UTILISATION
DES DONNÉES GÉNÉTIQUES ?
Les diagnostics anté-natals
Proposition n° 21. Prévoir que le médecin qui porte à la connaissance de la femme enceinte le résultat d’analyses effectuées dans le but de poser un diagnostic prénatal donne à celle-ci toute information nécessaire à leur compréhension et l’oriente, le cas échéant, vers une prise en charge adaptée, notamment en vue d’apporter un traitement au fœtus ou à l’enfant né.
Proposition n° 22. Faire évaluer par l’ABM les dispositions mises en œuvre pour assurer le suivi psychologique des femmes prises en charge par les CPDPN.
Proposition n° 23. Prévoir que lorsqu’il existe un risque que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, la femme enceinte est reçue, à sa demande, par un ou plusieurs membres d’un CPDPN pour être informée sur les caractéristiques de cette affection, des moyens de la détecter et des possibilités de prévention ou de soin. Lorsque la demande intervient dans un délai compatible avec l’interruption volontaire de grossesse, la femme enceinte est reçue avant le terme de ce délai par le CPDPN.
Proposition n° 24. Renforcer l’information de la femme enceinte sur les échographies prénatales par des personnels formés à cet effet.
Préciser les critères relatifs à la formation et aux pratiques des professionnels procédant à ces échographies.
Proposition n° 25. Renforcer les recherches sur les maladies particulièrement graves détectées sur l’embryon ou le fœtus in utero et poursuivre les actions visant à améliorer la prise en charge des personnes handicapées.
Proposition n° 26. Maintenir l’encadrement actuel du DPI et notamment l’absence de liste a priori des maladies susceptibles de faire l’objet de ce diagnostic.
Permettre qu’à la recherche d’une maladie génétique gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, identifiée dans la famille des parents de l’embryon, soit adjoint le dépistage de la trisomie 21. Cette recherche complémentaire pourrait être entreprise sous réserve de l’existence de facteurs prédisposant à cette anomalie génétique, comme l’âge de la femme, et dans les mêmes conditions que les dépistages effectués dans le cadre du DPN.
Certains membres de la mission ont exprimé leurs réserves sur l’opportunité de ce dépistage.
Proposition n° 27. Afin de guider les CPDPN dans leurs décisions, notamment dans le domaine de l’oncogénétique :
– Prévoir la possibilité pour les CPDPN d’avoir recours à un médecin généticien ou à un oncologue prenant en charge les personnes atteintes de formes héréditaires de cancer ;
– Créer une commission consultative de l’ABM, qui pourrait être aussi placée sous l’égide de l’INCa et qui serait saisie par les CPDPN ;
Cette commission serait notamment chargée : de réaliser des études qualitatives et quantitatives auprès des couples et des associations ; d’assurer une veille sur les progrès de la prise en charge des formes héréditaires de cancer, afin de réévaluer leur gravité et leur curabilité et de concourir à l’harmonisation des pratiques en oncogénétique.
Proposition n° 28. Accroître les moyens des centres de DPI en vue de raccourcir les délais d’attente, en envisageant par exemple la création d’un quatrième centre, ainsi que l’a proposé le CCNE.
Prévoir le dépôt, par le ministère chargé de la santé, d’un rapport au Parlement sur les modalités actuelles de financement des CPDPN, en faisant mieux connaître le recours possible aux MIGAC.
Proposition n° 29. Maintenir les dispositions de la loi relatives au « bébé du double espoir ».
Supprimer le caractère expérimental de ce dispositif.
Proposition n° 30. Suggérer au CCNE d’évaluer la politique de dépistage néonatal et envisager de compléter la loi, afin de prévoir sa saisine obligatoire avant toute extension éventuelle d’un dépistage néonatal à d’autres pathologies.
L’examen des caractéristiques génétiques
Proposition n° 31. Dresser par décret la liste des analyses réalisées aux fins de détermination des caractéristiques génétiques.
Proposition n° 32. Définir des règles de bonnes pratiques dans le cas où des informations d’ordre génétique seraient établies de manière incidente à l’occasion d’examens médicaux.
Proposition n° 33. Inclure dans les bonnes pratiques à suivre pour prescrire des tests génétiques des dispositions relatives à l’utilisation et à l’interprétation des tests pan génomiques.
Proposition n° 34. Soumettre à des conditions plus strictes les autorisations de mise sur le marché des tests génétiques, en mettant en avant le critère de leur utilité clinique et renégocier la directive 98/79/CE sur les dispositifs de diagnostics in vitro.
Proposition n° 35. Confier à l’Agence de la biomédecine le soin d’exercer une veille permanente sur les tests génétiques proposés en particulier sur Internet, en recensant les examens en libre accès, en les évaluant et en diffusant l’information auprès du grand public. Cette veille devra conduire à l’élaboration d’un référentiel qui servira de grille de lecture de la qualité des tests.
Proposition n° 36. Autoriser la personne concernée à lever partiellement le secret médical pour habiliter le médecin prescripteur d’un examen génétique à informer les membres de la parentèle de cette personne, dans le cas où une anomalie génétique grave susceptible de mesures de prévention ou de soins serait détectée. Une lettre serait envoyée aux apparentés pour lesquels la personne testée aura fourni les adresses, les invitant à procéder à une consultation génétique, sans que le nom de la personne testée ni la nature de l’anomalie ne soient mentionnés.
Rappeler dans le document remis à la personne testée que sa responsabilité est engagée en cas de refus d’informer ses apparentés soit directement soit par la voie du médecin prescripteur.
Réserver cette procédure aux médecins spécialisés dans le domaine de l’examen des caractéristiques génétiques.
Proposition n° 37. Proposer au patient qui refuserait d’informer sa parentèle de prendre contact avec une association de malades agréée susceptible d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique dépistée.
Proposition n° 38. Améliorer l’information des personnes qui consentent à des prélèvements d’échantillons biologiques au bénéfice de biobanques, afin que ces personnes donnent un consentement éclairé sur l’utilisation qui sera faite de leur don.
Proposition n° 39. Garantir au donneur d’échantillons qu’il sera informé dans le cas où, au cours de la recherche dont font l’objet des produits de son corps, des données intéressant directement sa santé seraient établies. L’informer en outre des résultats généraux de la recherche que son don a permis.
Proposition n° 40. Assouplir les conditions dans lesquelles une utilisation secondaire des collections d’échantillons biologiques peut être autorisée quand le nouveau projet consiste en des recherches génétiques.
Proposition n° 41. Améliorer l’information des comités de protection des personnes saisis pour rendre un avis sur la création de collections d’échantillons.
Proposition n° 42. Préciser la nature des délits ou des crimes au vu desquels il est procédé à un prélèvement des empreintes génétiques dans le cas où seules des raisons plausibles d’infraction à la loi pèsent sur la personne.
SE SERVIR DU CORPS HUMAIN POUR SOIGNER ET CHERCHER :
TOUT EST-IL PERMIS ?
La recherche sur les embryons humains et les cellules embryonnaires
Proposition n° 43. Maintenir le principe de l’interdiction de la recherche sur l’embryon. Autoriser les recherches à titre dérogatoire, sans encadrer cette dérogation par des délais.
Une partie des membres de la mission s’est déclarée favorable à la levée de l’interdiction pesant sur la recherche sur l’embryon et a plaidé pour l’adoption d’un régime d’autorisation sous conditions.
Il a été reconnu que ces deux options devaient conduire dans les faits à un encadrement réglementaire équivalent.
Proposition n° 44. Poser les critères suivants pour encadrer la recherche sur l’embryon :
– les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles poursuivent une finalité médicale ;
– la pertinence scientifique du projet doit être établie ;
– les conditions de mise en œuvre du projet doivent être conformes aux principes éthiques.
Ne pas retenir la condition limitant les recherches à celles qui ne peuvent pas « être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. »
Proposition n° 45. Prévoir que le Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine rende un avis motivé sur les décisions d’autorisations de recherche, afin d’assurer une meilleure information des ministres de la santé et de la recherche.
Proposition n° 46. Préciser les conditions de transfert, entre équipes de chercheurs, des cellules dérivées des cellules embryonnaires, une fois celles-ci différenciées.
Proposition n° 47. Préciser le régime d’autorisation dont relèvent les essais cliniques de thérapies cellulaires réalisés à partir de cellules embryonnaires différenciées.
Proposition n° 48. Dans le cas où le couple accepte de donner à la recherche des embryons surnuméraires, s’assurer du caractère éclairé du consentement en l’informant de la nature des recherches projetées.
Proposition n° 49. Préciser les conditions dans lesquelles le consentement du couple ayant donné des embryons surnuméraires à la recherche peut être retiré.
Proposition n° 50. Charger l’Agence de la biomédecine d’exercer une veille éthique portant sur les conséquences que peut avoir l’utilisation de tout type de cellules souches.
Proposition n° 51. Maintenir les interdits suivants :
– Interdire les transferts nucléaires : clonages d’embryons humains et cybrides.
Des membres de la mission estiment que la question des transferts nucléaires dans un but de recherche médicale, avec interdiction d’implantation et sous réserve de la disponibilité d’ovocytes humains, doit demeurer en débat.
– Interdire la création d’embryons pour la recherche.
– Interdire la recherche sur les embryons destinés à naître mais autoriser l’introduction de nouvelles techniques d’AMP sous réserve de critères de qualité, d’innocuité, d’efficacité et de reproductibilité.
La brevetabilité du vivant
Proposition n° 52. Conserver en l’état la transposition en droit interne, dans les termes adoptés par le législateur en 2004, de la directive communautaire relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Le don d’organes et de tissus
Proposition n° 53. Valoriser l’activité hospitalière de recensement des donneurs potentiels en état de mort encéphalique. Le recensement pourrait être facturé à 35 % du forfait prélèvement multi-organes.
Proposition n° 54. Fixer des objectifs chiffrés de recensement de donneurs en état de mort encéphalique aux agences régionales de santé, afin que la France rattrape son retard dans le recensement.
Proposition n° 55. Renforcer la coordination des équipes de prélèvement et de transplantation sous l’autorité des agences régionales de santé en liaison avec l’Agence de la biomédecine.
Proposition n° 56. Rendre obligatoire le programme « Cristal action » de recensement des donneurs potentiels en état de mort encéphalique, qui repose aujourd’hui sur le volontariat.
Proposition n° 57. Développer l’autonomie des équipes de prélèvement par rapport aux équipes de greffes, développer l’école des chirurgiens préleveurs et revaloriser leur rémunération.
Proposition n° 58. Homogénéiser les critères d’inscription sur les listes d’attente des greffes en retenant des critères objectifs de gravité et de pronostic comparables d’insuffisance rénale.
Proposition n° 59. Renforcer les équipes de transplantation sur le modèle des équipes de prélèvement, en y adjoignant des infirmières de coordination en transplantation.
Proposition n° 60. Mieux informer les malades souffrant d’insuffisances rénales des avantages de la greffe par rapport à d’autres formes de traitement.
Proposition n° 61. Doter les centres de dons d’organes de psychologues pour suivre les familles des donneurs décédés.
Proposition n° 62. Inviter les sociétés savantes à ouvrir un débat sur la procédure de prélèvements après arrêt cardiaque (catégorie Maastricht III).
Ce débat devrait porter sur les critères médicaux du prélèvement, l’intentionnalité des actes médicaux, leur dimension éthique et leur délai.
Proposition n° 63. Définir, au sein de bonnes pratiques, les modalités des rapports avec les proches pour la mise en œuvre des prélèvements après arrêt cardiaque des catégories Maastricht I et II.
Proposition n° 64. Autoriser les dons croisés d’organes ayant fait l’objet d’un consentement préalable, exprès, libre et éclairé de chaque membre des deux couples sous le contrôle du Tribunal de grande instance, l’anonymat étant préservé.
Proposition n° 65. Diviser la composition des comités « donneurs vivants » en deux collèges, l’un composé d’experts et l’autre de représentants de la société civile.
Proposition n° 66. Assurer tout au long de la vie une prise en charge des complications médicales pouvant intervenir postérieurement au don pour les donneurs vivants.
Proposition n° 67. Introduire la notion de délai de remboursement des frais d’hébergement et de transport pour les donneurs vivants dans la loi et fixer ce délai dans un texte réglementaire.
Proposition n° 68. Inviter l’ABM à mener des campagnes d’information afin de mettre en garde le grand public contre les publicités faites en faveur de la conservation autologue du sang de cordon dont l’intérêt thérapeutique n’est, en l’état, pas prouvé.
Proposition n° 69. Développer les banques allogéniques de sang placentaire.
Proposition n° 70. Soumettre les prélèvements de cellules souches hématopoïétiques provenant du sang placentaire à un régime de consentement explicite, libre et éclairé par le biais d’une information adaptée.
Proposition n° 71. Soumettre l’importation et l’exportation des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse à un encadrement sanitaire et qualitatif.
Le respect et l’identité du corps de la personne décédée
Proposition n° 72. Préciser les conditions d’habilitation des praticiens désignés pour effectuer une autopsie judiciaire.
Étendre aux autopsies judiciaires l’obligation faite au médecin de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps.
Transposer en droit interne la jurisprudence de la CEDH concernant le droit des proches à obtenir la restitution du corps du défunt dans un délai approprié.
Proposition n° 73. Mettre à la charge des établissements d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche les frais de transport des corps donnés à la science.
Proposition n° 74. Maintenir en matière civile les dispositions de l’article 16-11 du code civil qui prévoient que : « Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ».
Proposition n° 75. Préciser dans la loi les critères de viabilité sur la base desquels un acte de décès d’un fœtus né vivant et viable peut être établi.
COMMENT SE PRÉPARER AUX QUESTIONS ÉTHIQUES POSÉES PAR LES SCIENCES ÉMERGENTES ?
Neurosciences, nanotechnologies et convergence des technologies
Proposition n° 76. Confier à l’ABM une mission de veille éthique dans le domaine des neurosciences et de leurs applications.
Proposition n° 77. Limiter l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale à des fins médicales.
Proposition n° 78. Interdire les discriminations fondées sur les caractéristiques cérébrales telles qu’elles résultent de la neuroimagerie.
Proposition n° 79. Inviter le ministère de la santé à organiser une conférence de citoyens sur les enjeux bioéthiques des sciences émergentes et leurs applications aux techniques visant à améliorer les performances humaines.
Proposition n° 80. Confier à l’Agence de la biomédecine un rôle de veille sur les applications scientifiques qui ouvrent des perspectives d’amélioration des performances humaines.
COMMENT RENFORCER LA VIGILANCE DES INSTITUTIONS ET FAVORISER LE DÉBAT ÉTHIQUE ?
La loi bioéthique de demain
Proposition n° 81. Ne pas inclure de clause de révision dans la future loi de bioéthique.
Proposition n° 82. Autoriser la ratification de la convention d’Oviedo et de ses trois premiers protocoles additionnels, avec une réserve d’interprétation concernant le champ des donneurs de cellules hématopoïétiques, sans préjudice de l’évolution du débat parlementaire au cas où d’autres motifs de réserves apparaîtraient.
Signer puis ratifier le protocole additionnel relatif aux tests génétiques à des fins médicales.
Proposition n° 83. Recommander au ministère de la santé de rédiger un texte réglementaire définissant les modalités du recueil de consentement pour les dons d’embryons et les dons de tissus et de produits du corps humain
Proposition n° 84. Inscrire dans la loi le principe d’un « droit d’alerte » de l’ABM, lorsque de nouvelles recherches ou avancées scientifiques et technologiques sont susceptibles de poser des questions éthiques particulièrement importantes.
Prévoir que ce droit d’alerte se traduise par une audition du directeur général et du président du conseil d’orientation de l’ABM, devant l’OPECST.
Proposition n° 85. Prévoir tous les ans :
– que l’ABM dans son rapport annuel expose les principaux progrès scientifiques et technologiques dans les domaines dont elle a la charge et dresse le bilan de l’application de la loi ;
– l’audition du directeur général et du président du conseil d’orientation de l’ABM par les commissions parlementaires compétentes et l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques afin de présenter le rapport annuel de l’agence.
Proposition n° 86. Prévoir que le CCNE établisse tous les deux ans un rapport sur les enjeux éthiques des progrès scientifiques et technologiques dans le domaine de la bioéthique, notamment tels qu’ils auront été identifiés dans les rapports annuels de l’ABM. Il sera rendu public et remis au Parlement et au Président de la République.
Proposition n° 87. Inviter le Gouvernement à faire ratifier par le Parlement toutes les ordonnances relevant du champ de la bioéthique.
Proposition n° 88. Prévoir la nomination du directeur général de l’Agence de la biomédecine (ABM) par décret du Président de la République après avis des commissions parlementaires compétentes.
Proposition n° 89. Prévoir la conclusion d’une convention-cadre de partenariat entre l’ABM, l’AFSSAPS, l’Établissement français du sang et la Haute Autorité de santé pour renforcer leur coopération et promouvoir les démarches visant à mettre en place un interlocuteur administratif unique pour les praticiens et les promoteurs de recherches.
Proposition n° 90. Compléter les missions du CCNE en lui permettant d’organiser la consultation du public dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Proposition n° 91. Prévoir dans le code de la santé publique que tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé serait précédé d’un débat public sous forme d’états généraux.
Proposition n° 92. Publier l’arrêté prévu à l’article L. 1412-6 du code de la santé publique sur les espaces éthiques régionaux ou interrégionaux pour lequel le CCNE a émis un avis favorable.
Proposition n° 93. Inclure dans les programmes scolaires un enseignement aux problèmes de la bioéthique.
Proposition n° 94. Renforcer l’enseignement des questions de bioéthique dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé et des biologistes.
Proposition n° 95. Instituer une procédure nationale d’examen éthique des protocoles de recherche biomédicale financés, promus ou appliqués dans les États extra-communautaires par un chercheur français ou une personne morale de droit français.
CONTRIBUTIONS DE MEMBRES
DE LA MISSION D’INFORMATION
CONTRIBUTION DES DÉPUTÉS DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN
ET DIVERS GAUCHE
M. Alain Claeys, président,
M. Jean-Louis Touraine, Mme Marie Odile Bouillé, vice-présidente M. Armand Jung, Mmes Pascale Crozon, vice-présidente, Patricia Adam, Catherine Genisson, MM. Henri Emmanuelli, Serge Blisko, vice-président, Patrick Bloche, Mme Dominique Orliac, secrétaire
Ce rapport est un travail complet qui aborde de manière exhaustive la plupart des questionnements éthiques suscités par la science, même les plus récents auxquels il faudra répondre lors de la révision des lois bioéthiques. Il n’élude pas les défis à relever, ne masque pas les désaccords exprimés par les membres de la délégation. L’exercice était délicat car il s’agissait de concilier des droits parfois divergents et de rechercher un consensus sur les valeurs qui fondent notre droit et notre «vivre ensemble ».
Toutefois sur certains points nos conclusions sont quelque peu différentes de celles du Rapporteur. Ces divergences portent sur quatre points :
1 – L’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) doit être élargi en supprimant pour tous les couples l’exigence de deux ans de vie commune. De nombreux praticiens admettent que les certificats de concubinage notoire ne servent à rien car ils s’obtiennent très facilement. Cette condition délicate à vérifier, génère des inégalités de traitement. Supprimer totalement cette référence serait moins injuste et plus conforme à la réalité. Les difficultés d’un parcours d’AMP sont suffisamment dissuasives pour que l’on ne s’y engage pas à la légère.
Par souci d’équité, il est souhaitable d’étendre la possibilité de recourir à l’AMP aux femmes célibataires médicalement infertiles quand leur examen médical fait clairement apparaître cette infertilité. En effet, si l’on considère que l’AMP doit être réservée aux personnes médicalement infertiles, on se doit d’admettre qu’une femme stérile aura toujours besoin d’y recourir qu’elle vive en couple, ou qu’elle soit célibataire au moment de sa demande.
Par ailleurs, la proposition levant l’interdiction du transfert d’embryon post mortem doit être soutenue, elle évitera des contentieux douloureux, si ce transfert est encadré.
2 – La levée de l’anonymat sur les dons de gamètes demandée par les enfants issus d’insémination avec donneur (IAD) : une revendication légitime au regard du droit à connaître ses origines.
Le refus catégorique de la mission de lever même partiellement l’anonymat des dons de gamètes, est paradoxal eu égard à la volonté de protéger l’enfant à naître qui figure dans la proposition n° 4. Nous ne pouvons souscrire à cette proposition qui risque de remettre en cause à terme le droit à l’IVG.
Par contre, la levée de l’anonymat sur les dons de gamètes demandée par les enfants issus d’insémination avec donneur (IAD) est une revendication légitime au regard du droit à connaître ses origines. Le maintien de l’anonymat nie la spécificité de ce don, les gamètes alors sont traités comme le sang. Les centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) disposent d’un état civil parallèle qu’ils doivent gérer alors que des conseils de transparence sont à juste titre prodigués aux parents. Le recours toujours possible aux tests génétiques par les enfants devenus adultes, les conséquences parfois néfastes de la découverte d’un secret de plus en plus difficile à protéger conduit à s’interroger sur la pertinence du principe de l’anonymat absolu des dons de gamètes soutenu par la mission.
Si les parents décident de lever le secret, ce qui leur est souvent conseillé, que peuvent-ils dire ? Rien. C’est ce que contestent à juste titre certains enfants nés par IAD devenus adultes. Leur demande ne relève ni d’une volonté de remettre en question leur filiation, ni d’une conception « biologisante » de l’être humain. Ils souhaitent connaître un pan de leur histoire et comprendre les motivations du don dont ils sont issus. Leur requête est comparable à celle des enfants nés sous X qui ont obtenu la réversibilité du secret de l’identité demandé par la mère lors de l’accouchement. La création du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) par la loi du 22 janvier 2002 a permis de répondre à cette demande.
Maintenir l’anonymat absolu édicté par les lois successives de bioéthique pose problème. La compatibilité de cette règle avec la Convention européenne des droits de l’homme est incertaine, comme le relève le Conseil d’État qui se prononce en faveur d’une condamnation du principe d’anonymat absolu.
Un régime combinant un accès de tous les enfants issus d’IAD qui en font la demande à leur majorité à des catégories de données non identifiantes (âge, photographie motivation du donneur, existence d’une fratrie, etc..) et la possibilité d’une levée de l’anonymat serait plus adapté. Comme le proposait l’OPECST, il conviendrait :
« – soit de s’inspirer de la loi espagnole qui permet à tous un accès aux motivations et données non identifiantes sur le donneur, à la majorité, si l’enfant le demande,
– soit de s’inspirer de la législation britannique qui autorise la levée totale de l’anonymat à la majorité si l’enfant le demande, et qui permet à ceux qui ont fait un don avant l’application de la loi de s’inscrire, s’ils le souhaitent, sur un registre pour que leur identité puisse être révélée, si l’enfant en fait la demande à sa majorité,
– de prévoir que l’identification du donneur ou de la donneuse ne peut en aucun cas avoir une incidence sur la filiation de l’enfant issu du don, même si l’enfant ne dispose pas de filiation paternelle ou maternelle ».
3 – Sur l’usage des données génétiques, les analyses et propositions de la mission tiennent compte des évolutions scientifiques et technologiques et des possibilités nouvelles de se procurer des tests génétiques par Internet, les recommandations de la mission sont incomplètes.
Cependant comme l’a montré l’OPECST à plusieurs reprises, une réflexion doit être menée sur la protection des données concernant les caractéristiques génétiques d’une personne, notamment quand elles figurent au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). La liste des infractions justifiant un enregistrement au FNAEG a été allongée par les réformes successives, de sorte qu'elle inclut désormais la plupart des infractions punies d'une peine d'emprisonnement.
L’enregistrement dans ce fichier vise à faciliter la recherche des auteurs de ces infractions à l’aide de leur profil génétique. Il permet également de rechercher les personnes disparues, grâce au profil génétique de leurs descendants ou de leurs ascendants, et de centraliser les empreintes génétiques des personnes non identifiées, dont les empreintes sont issues de prélèvements sur les lieux d’une infraction. Cependant ces empreintes et les informations qui s’y rapportent sont conservées pendant 40 ans pour les personnes définitivement condamnées, et 25 ans pour les personnes mises en cause.
Certes les possibilités d’accès à ce fichier sont limitées mais le volume des données s’accroît avec la liste des infractions, la durée de conservation est très longue, la CNIL ne dispose pas de moyens matériels de contrôle suffisant. Une information concernant les possibilités d’obtenir l’effacement de données indûment conservées doit être délivrée dès qu’elles sont recueillies.
Plusieurs lois (1122) ont soumis à différentes conditions, l’hébergement et le traitement de données de santé à caractère personnel ainsi que leur accès, leur publication ou diffusion pour préserver le secret des informations recueillies et éviter l’identification de la personne. Cependant les risques d’atteintes à l’intimité de la vie privée liées à la circulation de ces données ne sont pas négligeables.
Dans son avis n° 104 du 29 mai 2008, « le dossier médical personnel et l'informatisation des données de santé », le CCNE relevait que « l’informatisation croissante des données médicales de santé s’inscrit dans un contexte culturel de méfiance. … L’histoire des systèmes de communication informatique atteste qu’en dépit des précautions prises par les concepteurs de programmes, des possibilités de subtilisation de données confidentielles existent ». ..La sécurité informatique n’est-elle pas elle-même génératrice d’anxiété aussi bien pour le professionnel que pour le patient (« oubli » d’un code, changement de clé, lieu équipé, temps nécessaire..) ».
« Un autre motif de méfiance, ajoute le CCNE, vient de ce que l’accès au dossier médical informatique pourrait jouer comme un piège pour la personne dans ses relations avec une compagnie d’assurance ou une banque ».
La protection rigoureuse de toutes les données de santé doit être assurée et particulièrement de celles contenant des informations concernant les caractéristiques génétiques.
4 – Les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEH)
Le rapport fait état des positions différentes existantes : nombre de personnalités auditionnées, l’Agence de la biomédecine, le Conseil d’État, ont préconisé la levée du moratoire sur la recherche sur les cellules souches embryonnaire, la mission a souscrit à cette recommandation et c’est judicieux.
Cependant si elle préconise la levée du moratoire, la mission suggère de pérenniser le principe d’interdiction de la recherche sous prétexte que cela conduit dans les faits à un encadrement équivalent malgré les réserves émises par la plupart des juristes et des scientifiques.
Pourtant, la méthode de l’interdit assortie de possibilités d’y déroger à certaines conditions tendrait davantage à banaliser les recherches sur les CESH alors que celle consistant à renforcer la spécificité de ces recherches par un système d’encadrement strict par l’Agence de la biomédecine est plus claire et plus lisible ; Ce système rend mieux compte de la singularité de ces recherches et serait plus adapté aux évolutions récentes.
Le Conseil d’État a recommandé la création d’un régime permanent d’autorisation enserré dans des conditions strictes pour les recherches sur l’embryon humain et les CESH. La réalisation de recherches sans obtention d’autorisation serait interdite et resterait punie par les peines prévues par l’article 511-19 du code pénal. C’est ce régime que l’OPECST a proposé à diverses reprises. C’est celui qu’avait préconisé M Pierre-Louis FAGNIEZ dans un rapport remis au Premier ministre en 2006 « Cellules souches et choix éthiques »
Il ne s’agit en rien de méconnaître la spécificité de l’embryon humain, ni d’autoriser n’importe quelle recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, au contraire, il convient d’autoriser ces recherches en les encadrant strictement.
Le Professeur Axel KAHN, président de l’université Paris-Descartes, estime que la recherche sur les CSEH doit être autorisée parce qu’il n’y a pas d’argument moral important pour l’interdire et que, même si l’on crée des cellules ayant nombre de propriétés des cellules souches embryonnaires, l’étude des maladies du développement humain aux premiers âges de la vie fait partie d’une recherche biologique et médicale totalement et complètement légitime.
Cette position a été largement étayée par le Mme Nicole LE DOUARIN, Professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, qui explique dans son ouvrage « Les cellules souches, porteuses d’immortalité » que les résultats de ces recherches sont aléatoires et que dans ce domaine, la recherche fondamentale nourrit la recherche médicale.
Quant aux critères d’autorisation de la recherche, la mission suggère opportunément la suppression de la référence à « l’impossibilité de poursuivre ces recherches par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques », et substitue à « la finalité thérapeutique », « la finalité médicale » plus précise mais non exempt d’ambiguïté. Elle risque en effet, de susciter des espoirs chez certains patients alors que les progrès qu’ils attendent ne seront pas immédiats.
Les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines ont actuellement, une finalité cognitive d’intérêt thérapeutique et médical certain, comme l’a souligné le conseil d’orientation de l’ABM dans ses leçons d’expérience. Il s’est demandé si : «..la visée thérapeutique était la seule visée possible d’une recherche fondamentale ? N’est-ce pas antinomique ? Faut-il remplacer « motif thérapeutique » par « motif scientifique et médical » ou par « motif médical ? ».
La notion de « motif scientifique et médical » rendrait mieux compte de l’objectif de ces recherches, surtout de celles qui visent à la compréhension de mécanismes cellulaires complexes. Le recours aux CSEH au plan médical et à une large échelle passe par le développement de technologies appropriées encore au stade de prototype, par l’établissement de standards de qualité pour les nouvelles lignées ainsi que pour des protocoles d’amplification et de différenciation.
D’après les chercheurs travaillant sur CSEH dans des laboratoires en France ou à l’étranger, ces recherches sont de facto encadrées par les pairs quelle que soit la réglementation du pays où elles se déroulent. L’obtention des lignées de CSEH importées, une fois la recherche autorisée dans un pays, est soumise à l’agrément de l’université ou du laboratoire qui les a produites et conservées et qui s’assure lui aussi de la pertinence et de la finalité de la recherche. Comme l’a constaté l’ABM, peu d’équipes mènent ce type de recherche, ce qui limite les demandes d’autorisation de moindre valeur scientifique et explique le faible nombre de refus. Ces recherches exigent de plus, des technologies spécifiques parfois mises au point spécialement pour assurer leur progrès.
Les recherches sur les mécanismes de dédifférenciation et les possibilités de reprogrammation des cellules souches adultes sont prometteuses. Elles ont permis la mise au point des cellules souches pluripotentes induites(iPS) et suscitent un grand intérêt, mais elles pourraient poser elles aussi, à terme des problèmes éthiques. S’il est possible d’utiliser les iPS pour améliorer les techniques d’AMP, comment devra-t-on considérer des gamètes issus d’une reprogrammation ?
Toutes les voies de recherche doivent être explorées. Les travaux prometteurs sur les iPS n’ont pu être réalisés que grâce aux recherches sur les cellules souches embryonnaires qui restent indispensables pour mieux comprendre l’embryogenèse et comparer les mécanismes de fonctionnement des cellules iPS et des CSEH.
Pour la plupart des chercheurs, les recherches sur les cellules souches se fertilisent mutuellement : sans les recherches sur les CSEH, celles très prometteuses sur les cellules souches adultes n’auraient pas été possibles. Il n’est donc pas pertinent d’opposer ces recherches les unes aux autres et de délivrer un label éthique aux seules recherches sur les cellules souches adultes quelles que soient leurs origines.
C’est pourquoi, il convient d’encourager la poursuite de la recherche fondamentale à but scientifique et médicale, sans privilégier une approche en particulier, et d’agir en ce sens dans le cadre de l’Agence nationale de la recherche (ANR). Les recherches sur les cellules souches doivent être considérées comme prioritaires ; elles ne sont pas assez encouragées en France. Notre pays risque d’accuser un retard dommageable accru par le manque de lisibilité et de stabilité du régime juridique des recherches sur les CSEH. Cette situation n’encourage ni les nouveaux projets, ni la venue de scientifiques étrangers.
En outre, il ne faudrait pas se priver de voies de recherche au prétexte qu’elles ont actuellement moins la faveur des équipes scientifiques qui optent pour d’autres méthodes. L’évolution des recherches et des découvertes scientifiques est rarement linéaire. Mieux vaut se garder d’interdire le transfert nucléaire et la création de cybrides et autoriser ces recherches en les encadrant strictement.
Comme l’a relevé Mme Anne FAGOT-LARGEAULT, professeur au Collège de France (1123), « la frontière posée par la loi actuelle entre la recherche sur les cellules souches embryonnaires, issues d’embryons humains abandonnés dans les congélateurs de la procréation médicalement assistée, et la recherche sur des cellules embryonnaires que l’on aurait construites artificiellement par transfert de noyaux (interdite et sanctionnée), paraît actuellement paradoxale et obsolète ».
Elle estime que les discussions et évolutions récentes concernant la production pour la recherche d’embryons cybrides, nécessitent une réflexion nouvelle sur la manière de tracer les frontières entre ce que la loi peut ou doit interdire, et ce qui pourrait être autorisé et encadré au titre de la recherche et géré par l’Agence de la biomédecine.
Ainsi devrait-on séparer ce qui peut être envisagé au titre de la recherche fondamentale, à condition qu’il n’y ait pas d’implantation dans un utérus et a fortiori pas d’utilisation thérapeutique immédiate et directe, et ce qui pourrait éventuellement faire l’objet d’une autorisation dans le cadre de la procréation médicalement assistée ou de la thérapie régénérative. C’est pourquoi il n’est pas inutile d’autoriser, sous réserve de la disponibilité des ovocytes humains, la transposition nucléaire assortie d’une interdiction d’implantation avec un dispositif rigoureux de contrôle par l'Agence de la biomédecine.
De même, il faudrait laisser ouvert le débat sur la transposition nucléaire inter espèces sous réserve d’interdire l’utilisation d’ovocytes humains et l’implantation du cybride, et de limiter le développement du cybride à 14 jours.
5 - La mission s’est penchée sur les sciences émergentes proposant ainsi d’élargir le champ des lois de bioéthique. Cette démarche doit être saluée car les neurosciences, la neuroimagerie sont de plus en plus présentes dans notre vie quotidienne. Il s’agira de déterminer la frontière entre l’homme réparé et l’homme augmenté et surtout de veiller, à la demande des scientifiques eux-mêmes, à ce que les découvertes et leurs applications soient conformes à nos valeurs et accessibles à tous.
Au cours de ses travaux la mission a été confrontée au « dumping » juridique aboutissant au recours à des procédés interdits en France mais autorisés ou non régulés dans des pays « moins disants » sur le plan éthique. Ce constat est inquiétant et la ratification d’instruments internationaux comme la Convention d’Oviedo et ses protocoles s’impose. C’est pourquoi il est également essentiel de légiférer, ce qui permet de faire un travail pédagogique d’explication tout en posant les interdits et en encadrant les pratiques afin d’éviter toute marchandisation du corps humain.
* *
CONTRIBUTION DE MM. SERGE BLISKO, VICE-PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION ET PATRICK BLOCHE,
DÉPUTÉS DE PARIS
Du biologique au social
les nécessaires évolutions de l’AMP et de la Maternité Pour Autrui
(assistance médicale à la procréation)
Le très important travail de réflexion assortie de nombreuses auditions effectué par la Mission d’Information sur la révision des lois bioéthiques présidée par M. Alain Claeys, et dont le rapporteur est M. Jean Leonetti doit être salué par l’ampleur de sa réflexion, la précision de ses propositions et son climat de travail sérieux et courtois.
À l’issue de ces travaux, le rapport de la mission d’information nous amène à titre personnel à proposer une opinion divergente en particulier sur certaines des dix huit premières propositions portant sur l’Assistance Médicale à la Procréation et surtout sur la proposition n° 18 qui maintient une interdiction stricte de la maternité de substitution (Gestation Pour Autrui ou GPA).
1. Pour une évolution raisonnable de l’AMP
Les premières inséminations artificielles intra-conjugales sont pratiquées dès la fin du 18ème siècle en Grande-Bretagne et avec don de spermatozoïdes dès la fin du 19ème siècle. C’est en 1978 aux États-Unis que nait le premier enfant après fécondation in-vitro. Amandine est le premier bébé français né grâce à cette technique en 1982.
Plus récemment en 1994, une technique de micro injection de spermatozoïdes dans l’ovocyte, appelée ICSI, a amélioré l’AMP et a permis la naissance de nombreux enfants.
Avec les dons de gamètes masculins ou féminins et la fécondation in-vitro, la procréation est dissociée de la gestation et plusieurs intervenants différents peuvent concourir à la naissance d’un enfant.
Même si les parcours d’AMP, en particulier les Fécondations In Vitro (FIV), restent des expériences douloureuses aux résultats aléatoires, on estime que 2,5 % des naissances enregistrées en France, soit plus de 20 000 par an, sont issues de techniques d’assistance médicale à la procréation.
Le rapport de la Mission d’Information dans sa proposition n°1 réaffirme que seule une finalité médicale est permise pour l’AMP. La proposition n°2 assouplit quelque peu le texte actuel en reconnaissant que le PACS est assimilable au mariage dans ce domaine.
Néanmoins ce principe nous paraît restrictif en exigeant une condition de vie commune (par le mariage, le PACS ou le concubinage). L’accès à l’AMP reste donc réservé au seul couple hétérosexuel. Cela exclut les femmes célibataires atteintes d’infertilité ou souhaitant tout simplement avoir un enfant. Dans cette situation, il y a de fait une rupture d’égalité d’autant plus injuste que l’agrément pour une adoption est licite pour les célibataires (hommes ou femmes).
Nous souhaitons donc que le processus d’autorisation de l’AMP puisse être fondé tant sur une demande médicale que sociale.
Enfin, nous contestons (proposition n°4) la prise en compte de « l’intérêt de l’enfant à naître » qui n’est pas défini et qui n’a aucune base légale.
2. Légiférer en organisant la maternité pour autrui
En étendant le recours à l’AMP, nous abordons le deuxième sujet sur lequel nous voulons une évolution réfléchie des lois bioéthiques : légiférer en organisant la maternité pour autrui.
Cette pratique, déjà citée dès la Genèse (naissance d’Ismaël, fils d’Abraham et d’Agar, servante de Sarah), témoigne de son ancienneté et aussi de son ambivalence puisque la mère de substitution est une servante qui porte l’enfant de la femme stérile.
Le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation a permis de dissocier la reproduction de la sexualité (notamment par le développement de la contraception moderne), et plus récemment grâce à la FIV, la procréation de la gestation puisque l’embryon est formé en dehors de l’utérus de la femme.
Aujourd’hui il est médicalement possible d’implanter dans l’utérus d’une femme tierce un embryon issu des gamètes d’au moins un des parents d’intention.
Il faut bien sûr distinguer la procréation pour autrui de la gestation pour autrui : dans le premier cas, la femme qui porte l’enfant est sa mère génétique ; dans le second, elle n’est que la gestatrice, l’enfant ayant été conçu avec les gamètes du couple demandeur ou de tiers donneurs. Telle est la raison pour laquelle les expressions « maternité pour autrui » et « maternité de substitution » sont souvent employées.
Pour les rédacteurs de cette contribution, la gestation pour autrui déjà pratiquée et encadrée dans un certain nombre de pays développés tels que la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce, le Royaume Uni, Israël et certains États américains, peut être organisée dans le respect de la dignité et dans un souci de responsabilité éthique.
En effet, des formes particulières d’infertilité liées à l’impossibilité de porter un enfant pour des raisons médicales telles qu’une absence (syndrome de MRKH qui touche une fille sur 4500 naissances en France, soit 100 nouveaux cas par an), une malformation ou des lésions acquises de l’utérus, constituent la seule forme d’infertilité à laquelle la loi interdit de remédier.
En d’autres termes, l’accès aux techniques d’AMP est ouvert à la femme privée de la possibilité de concevoir mais capable de porter un enfant et refusé à la femme privée de la possibilité de porter mais pas de concevoir un enfant.
Face à cette inégalité de droit manifeste, nous pensons qu’une réponse doit être apportée dans tous ces cas et qu’il faut résoudre les difficultés de filiation des enfants nés de GPA légalement pratiquées à l’étranger.
Ces difficultés de filiation, au nom d’une « exception française » que nous ne saurions admettre, sont de façon évidente, contraires à l’intérêt de l’enfant tel qu’il est défini par la Convention Internationale des « Droits de l’Enfant » (CIDE) dont nous venons de célébrer le 20ème anniversaire.
Les opposants à la légalisation des mères porteuses avancent trois arguments :
– les dérives marchandes
– l’intérêt de l’enfant
– la dignité de la femme.
Aucun ne nous paraît irréfutable.
Les dérives marchandes existent. Le meilleur exemple concerne le prélèvement d’organes. Il existe un vaste trafic dans le monde, en particulier dans les pays pauvres. Pour autant, l’existence de ces dérives ne condamne pas le don d’organes altruiste en France et personne n’a jamais prôné l’interdiction du don dans notre pays.
L’intérêt de l’enfant ! On ne comprend pas bien cet argument qui présente l’enfant porté par une mère de substitution comme abandonné par celle-ci. Au contraire, il est remis et élevé dès sa naissance par ses parents génétiques. On suivra bien sûr l’avis de tous les psychiatres et psychanalystes pour ne pas lui cacher son histoire peu ordinaire.
Enfin la dignité de la femme. L’expérience des pays étrangers montre que les femmes qui mettent leur capacité reproductive pour les autres ne sont pas des mercenaires avides d’argent mais des femmes, qui de par leur propre histoire, sont engagées dans un processus de don. Il serait hypocrite de ne pas reconnaître la nécessité d’une compensation financière liée aux dépenses d’une telle grossesse. Par ailleurs, nous ne sommes pas choqués par une relation contractuelle avec un orphelinat du tiers monde parfois assorti d’un don conséquent, pourquoi le serions-nous dans ce cas inverse ?
Un quatrième argument existe, c’est celui de vouloir favoriser l’adoption. Nous pensons que cet argument est totalement mensonger.
L’adoption ne constitue pas une véritable alternative à la maternité pour autrui pour la raison essentielle suivante :
La possibilité d’adoption se réduit d’année en année. En effet, les personnes souhaitant adopter sont de plus en plus nombreuses en France : 8 000 agréments par an pour 800 à 900 pupilles de l’État et moins de 4 000 adoptions internationales. Chiffre dont on sait qu’il diminuera constamment du fait de l’augmentation du niveau de vie des pays d’origine qui a permis l’émergence d’une classe moyenne en capacité d’adoption dans leur propre pays (ex : Brésil, Corée...).
En conclusion, « les mères porteuses » sont le signe d’une nouvelle étape. On peut considérer la gestation pour autrui comme un échelon de plus dans la révolution des mœurs qui a d’abord déconnecté l’acte sexuel de la reproduction, puis la reproduction de la gestation, et la gestation de la parentalité.
C’est une marque d’évolution de notre société, liée aux nouveaux rapports hommes/femmes, aux nouveaux rapports amoureux, de parentalité et familiaux.
Dans la révision des lois bioéthiques, la France ne doit pas craindre de s’ouvrir à ces nouvelles évolutions comme d’autres pays européens l’ont déjà fait. Les citoyens français ont le droit de bénéficier d’un élargissement de l’AMP et notre pays, qui a toujours été dans ce domaine une force de progrès, ne peut se fermer.
* *
CONTRIBUTION DE M. XAVIER BRETON, DÉPUTÉ DE L’AIN
La lecture du projet de rapport de la mission d’information, au-delà des échanges que nous avons eus au sein de la mission sur la révision des lois de bioéthique me conduit à faire part des observations suivantes concernant les propositions n° 3, 15 et 26.
Proposition n°3 : « Autoriser le transfert post mortem d’embryon à titre exceptionnel lorsque le projet parental a été engagé mais a été interrompu par le décès du conjoint. (…) ».
Je reste très réticent sur cette proposition qui permettrait, délibérément, la venue au monde d’un enfant privé de père et qui irait ainsi directement à l’encontre de l’intérêt de l’enfant à naître.
De plus, cette proposition renforcerait la notion de « projet parental » dans notre droit ; or nous ne pourrons pas, sans conséquences majeures, continuer à ne voir dans l’enfant à naître que le « produit » d’un projet d’adulte(s).
Certes, la possibilité d’autorisation de transfert post mortem d’embryon resterait exceptionnelle et très encadrée, mais nous devons nous interroger sur la portée d’une telle proposition : se limite-t-elle simplement à répondre à quelques cas de détresse individuelle ou conduit-elle à franchir une nouvelle limite, en l’occurrence celle qui sépare le vivant et le mort ?
Proposition n° 15 : « Maintenir l’encadrement actuel concernant la conception, la congélation et le devenir des embryons surnuméraires ».
Nous savons que la production d’embryons surnuméraires et leur congélation pose, selon l’expression du CCNE, des « problèmes graves », tant psychologiquement pour les couples, que d’un point de vue éthique pour notre société.
Plutôt que de s’en tenir à un statu quo insatisfaisant, nous pourrions proposer que notre pays s’engage dans une démarche progressive et volontaire de limitation de la production d’embryons surnuméraires. Cet objectif pourrait être fixé par la loi et il serait demandé à l’Agence de biomédecine de rendre compte dans son rapport annuel des actions engagées et des résultats obtenus.
Proposition n° 26 : « Maintenir l’encadrement actuel du DPI (…). Permettre qu’à la recherche d’une maladie génétique grave invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, identifiée dans la filiation des parents de l’embryon, soit adjoint le dépistage de la trisomie 21 » ».
Cette proposition préconise donc la possibilité de rechercher une trisomie 21 à l’occasion d’un diagnostic préimplantatoire.
Même si cette démarche devrait rester exceptionnelle, elle marquerait toutefois une inflexion dans la pratique et dans la finalité du DPI, ouvrant alors la porte à des dérives inquiétantes.
De plus, cette proposition, si elle était adoptée, serait un « fléchage » supplémentaire de la trisomie 21 dans les pratiques de dépistage, alors que, comme l’ont dit les citoyens du panel de Marseille dans le cadre des États généraux de la bioéthique, « la solution au handicap passe exclusivement par la recherche sur les maladies et non par l’élimination ».
* *
CONTRIBUTION DE PHILIPPE GOSSELIN, DÉPUTÉ DE LA MANCHE, SECRÉTAIRE DE LA MISSION D’INFORMATION
Au moment de clore les travaux de la mission et d’entrer dans une autre phase, je voudrais saluer la qualité des travaux et de la réflexion menée. La richesse des auditions a été exceptionnelle et au-delà d’approches différentes, cette mission restera une mission passionnante, y compris sur le plan personnel.
Je me réjouis, bien sûr, de la réaffirmation de principes et de valeurs bien admis et partagés en France. Fondés sur l’article 16 du code civil et l’indisponibilité du corps humain, ce sont toujours la gratuité, l’anonymat et la dignité qui assurent le socle commun.
Je voudrais, en revanche, formuler quelques réflexions et observations relatives à certaines des propositions du rapport.
1) Le maintien de l’interdit de la recherche sur l’embryon (proposition n° 43)
C’est un des points qui a été très discuté et les échanges ont été nombreux. Si des dérogations sont envisagées il me semble indispensable de maintenir la symbolique de l’interdit et dans ce sens la proposition me paraît équilibrée.
Il existe cependant des recherches alternatives sur d’autres cellules humaines (cellules souches adultes, cellules souches de cordon ombilical ou les iPS) voire animales et il me paraît important de les encourager et les promouvoir.
2) Le diagnostic préimplantatoire (DPI) (proposition n° 26)
L’encadrement du DPI me paraît nécessaire et l’absence de liste a priori des maladies susceptibles de faire l’objet de ce diagnostic est à saluer.
Mais pourquoi alors cibler la trisomie 21 ? Il y a là une dérive que j’estime dangereuse. Si la recherche sur la maladie est, bien sûr, nécessaire, l’élimination à tout prix (et sur quels critères ?) est porteuse d’un eugénisme qui ne dirait pas son nom. C’est aussi, dès aujourd’hui, stigmatiser les personnes atteintes de cette maladie ainsi que leur famille.
Ce premier pas, qui ouvre la porte ensuite à d’autres handicaps, et pourquoi pas un jour à de simples « anomalies », me semble donc à revoir.
3) Autoriser le transfert post mortem d’embryon (proposition n°3)
J’ai bien noté le caractère exceptionnel de cette proposition. Je ne sous-estime pas, bien sûr la douleur et l’épreuve pour les familles concernées par le deuil du conjoint.
Mais cette proposition me paraît en contradiction totale avec l’intérêt de l’enfant à naître (proposition 4). Elle est par ailleurs discriminatoire. Seule une femme pourrait le cas échéant bénéficier de cette mesure, sauf à considérer qu’un jour la pratique des mères porteuses serait reconnue ce qui, au contraire, a fort opportunément été repoussé.
4) Les embryons surnuméraires (proposition n° 15)
Il est proposé de maintenir le cadre actuel.
Il n’est pourtant pas vraiment satisfaisant. Sans méconnaître les difficultés, d’autres voies sont possibles : l’Allemagne ou l’Italie en constituent de bons exemples. Pourquoi ne pas les imiter ? Une démarche progressive et volontaire de la réduction de la production d’embryons surnuméraires est possible.
5) Oui au don en général !
L’ensemble des propositions sur le don d’organes et de tissus est globalement positif et reste fidèle aux valeurs et au modèle français (propositions n°53 à n° 71).
La pédagogie est cependant un élément essentiel. Si, (proposition n°93), un enseignement aux problèmes de la bioéthique est envisagé, il doit vraiment inclure la problématique, la sensibilisation au don sous toutes ses formes, dans l’optique de la Grande Cause nationale 2009 : « Don de sang, de plasma de plaquettes, don de moelle osseuse, don d’organe et de tissus ». Il est en effet essentiel sur tous ces sujets d’informer, de communiquer et de sensibiliser dès le plus jeune âge, car, au final, c’est un formidable hymne à la vie.
* *
CONTRIBUTION DE M. JEAN-MARC NESME,
DÉPUTÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
La dignité et l’unité de la personne humaine ainsi que la cohérence de sa filiation qui repose sur les trois dimensions, biologique, sociale et affective, constituent des valeurs qui fondent un socle anthropologique commun qui, lui-même, est la base du lien social.
L’intérêt supérieur de l’enfant défini par les conventions internationales signées et ratifiées par la France et par le code civil, est une ligne fondatrice au-delà de laquelle il y aurait transgression. Les lois bioéthiques ne peuvent que se conformer aux principes édictés par les textes fondateurs qui lui sont antérieurs.
Les propositions de la mission parlementaire sont en cohérence avec ces textes (conventions, code civil et droit de la famille) dans les domaines suivants : par exemple, la finalité du recours à l’AMP est d’ordre médical et la demande parentale d’un couple n’est recevable que dans ce cadre étant entendu que le couple est formé d’un homme et d’une femme ce qui exclut l’adoption par des personnes homosexuelles ou par une célibataire ; la non-commercialisation du corps humain et la dignité de la femme exclut la gestation pour autrui (GPA).
Lors des auditions, le principe de vulnérabilité a été, parfois, mis en exergue. C’est à partir des situations de plus grande vulnérabilité que l’on doit aussi interpréter l’existence : l’enfant, le malade, le vieillard, la personne handicapée, la personne dépendante, l’enfant à naître.
Le respect du principe de vulnérabilité exclut la recherche des performances intellectuelles, corporatistes, sociales, économiques et financières.
À une époque où la science connaît des évolutions considérables, le sort fait aux situations de plus grande fragilité doit être un critère de jugement éthique prioritaire.
Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon doit être maintenu. Néanmoins, si dérogation il doit y avoir – transgression – , celle-ci ne peut être possible qu’avec une finalité thérapeutique ce qui est plus contraignant que la finalité médicale et ce, dans des délais encadrés conformément à la loi de 2004, les autorisations données par l’ABM et les contrôles réalisés par l’Agence devant être soumis, au cas par cas, au Parlement qui ne peut être dessaisi en cette matière aussi sensible qu’est la bioéthique où les lobbies de toute nature montent en puissance.
Lors des auditions, des solutions alternatives à la recherche sur l’embryon ont été exposées et les propositions de la mission parlementaire devraient mettre en exergue :
– les recherches sur les cellules souches qui sont déjà utilisées pour des applications thérapeutiques (comme les recherches sur les cellules souches de sang de cordon et les recherches sur les cellules souches adultes) ;
– les recherches sur les cellules reprogrammées (iPS) qui remplacent déjà avantageusement – et sans dommage éthique – les cellules souches embryonnaires (criblage de molécule et modélisation des pathologies) ;
– les recherches sur les cellules souches animales (plusieurs chercheurs ont indiqué à la représentation nationale que les cellules souches embryonnaires humaines sont privilégiées en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des cellules animales), ce qui est un comble.
Les dérives eugéniques sont des tentations, délibérées ou non, proportionnelles à l’évolution de la science. Il importe de ne pas franchir le premier pas et il convient de refuser que la détection de la trisomie 21 soit ajoutée au DPI, ce qui serait en cohérence avec la volonté écrite au paragraphe précédent de la proposition 24 où il est indiqué de ne pas établir de liste a priori des maladies.
Sinon, avec cette proposition, la trisomie 21, déjà première maladie à faire l’objet d’un dispositif de sélection à l’échelon national, deviendra la première maladie listée pour le DPI. Et ensuite ?
Cette proposition grave, (le Pr. Israël Nizan a notamment confirmé à la Mission parlementaire que l’éradication des trisomiques se justifiait économiquement), marque un pas supplémentaire dans l’escalade de l’eugénisme pour deux raisons :
1) Tout d’abord, il s’agit d’introduire un élément d’appréciation subjective dans le recours au DPI. Il ne s’agit plus de considérer le passé familial ou le handicap d’un premier enfant, au regard de l’analyse de patrimoine génétique des parents, mais de prendre en compte le rejet social de la trisomie 21. Car la trisomie, si elle est bien une maladie génétique, n’est pas héréditaire, c’est-à-dire qu’elle est imprévisible au niveau des parents et se produit accidentellement. La recherche systématique de la trisomie 21 à l’occasion d’un DPI pour maladie génétique modifie en conséquence la nature de cet examen.
A l’objectivité d’une maladie héréditaire dûment constatée et recherchée pour un couple, se substituerait la prise en considération de données étrangères à la situation du couple concerné. Si celui-ci court le risque de transmettre telle maladie génétique qui « justifie » le DPI, il n’a pas plus de risque que le reste de la population de donner naissance à un enfant trisomique. Pourquoi donc rendre cette recherche nécessaire ? Ce qui va « justifier » la recherche de la trisomie, c’est seulement le regard d’exclusion posé a priori sur les porteurs de cette affection, exclusion déjà créée, entretenue et financée par l’État à travers sa politique de dépistage généralisé (DPN).
2) La deuxième raison qui rend cette proposition intolérable est qu’elle préjuge du sort réservé à l’embryon qui serait dépisté trisomique : l’élimination. Il est admis d’avance que des parents qui se soumettent au DPI pour éviter la naissance d’un enfant atteint d’une maladie héréditaire grave, déjà présente dans la famille, ne toléreraient pas non plus – par principe – la naissance d’un enfant trisomique.
La mise en œuvre de cette disposition signifie en pratique qu’un enfant trisomique conçu in vitro et soumis au DPI est présumé mort.
L’argument consistant à dire que pour le praticien, il est plus « pratique » de procéder à l’élimination de l’enfant trisomique au stade embryonnaire, plutôt qu’à une IMG, ne concerne que le praticien. Cet argument n’a évidemment aucune valeur éthique et n’est pas respectueux de la famille qui portera in fine ce poids sur la conscience.
De plus, la stigmatisation de la trisomie 21 dans la loi, serait, pour les familles ayant eu ou ayant un enfant trisomique, insupportable. Il ne nous appartient pas de déterminer le seuil d’humanité.
En matière d’AMP, le régime actuel, interdisant la conception d’embryons en vue de la recherche, l’autorise dans les faits de manière détournée en raison de la formulation d’un décret d’application de la loi de 2004 (6 février 2006).
Ce décret dispose que dans le cadre d’une AMP, le couple a la possibilité de « consentir dans le même temps par écrit à ce que les embryons qui ne seraient pas susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche ». Ce consentement pour l’avenir à livrer d’avance certains embryons conçus pour AMP revient à créer des surnuméraires pour la recherche. La loi n’est pas respectée et cette transgression ne peut qu’inciter le Parlement à vérifier l’esprit et la lettre des décrets d’application à venir.
Pour ce qui est des diagnostics anténataux (DPN, DPI), les dérives anglo-saxonnes en matière de prédispositions au cancer doivent nous interpeller. En effet, dans le monde anglo-saxon, il n’existe plus de critère de gravité mais où il est mis en place un dispositif de décision au cas par cas, selon le degré d’acceptation de la famille du handicap considéré.
La mission doit affirmer clairement son opposition à toute forme de clonage (ou transfert nucléaire).
En matière de don du sang de cordon, l’ABM devrait mener des campagnes pour son développement et ne pas se contenter de faire pression contre les banques autologues.
* *
CONTRIBUTION DE M. JEAN-FRÉDÉRIC POISSON,
DÉPUTÉ DES YVELINES
La révision de la loi dite de « bioéthique » de 2004 devait être l’occasion de rompre avec un certain nombre de pratiques dont les limites ont été démontrées par les travaux scientifiques les plus récents, et mentionnées dans un certain nombre de documents officiels,
Les orientations prises par le rapport ainsi que les propositions qu’il avance entrent dans une logique de gestion de l’existant plutôt que dans une logique de remise en cause : j’en prends acte, en marquant toutefois mon désaccord sur un certain nombre de sujets.
Reconnaissons toutefois que le rapport et les propositions n’avancent pas de projet ou de formulations qui conduiraient à une aggravation éthique de la situation d’ensemble des pratiques liées à la bio-médecine dans notre pays . il faut également le signaler. Mais ce « statu quo » est lui-même fondé sur des principes et des pratiques largement contestables, sur lesquels le rapport n’est pas revenu.
Cinq points méritent, en particulier, d’être signalés :
1 – La recherche sur l’embryon
La mission a opportunément retenu le maintien du principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon, en maintenant également la possibilité de demandes de dérogation à cette interdiction, comme actuellement prévu par les textes.
Cette possibilité de déroger constitue en elle-même un problème : dès lors que l’humanité de l’embryon est reconnue (et qui la conteste ?), et que les opérations de recherche ne visent pas à améliorer son propre sort, il est clair que le terme du processus consiste purement et simplement dans la destruction de cet être humain. La dérogation est donc en elle-même, pour cette raison, inacceptable.
I! est, pour finir, à noter que les orientations du rapport ne font quasiment pas mention des opportunités ouvertes par la recherche sur les cellules souches adultes, ou les cellules de sang de cordon, ou les iPS, ou encore les recherches sur les cellules souches animales, techniques pourtant tout aussi prometteuses – et certainement davantage – que les recherches sur les cellules souches embryonnaires.
Enfin, si l’on peut comprendre la volonté de rompre avec la mention de « l’alternative d’efficacité comparable », pourtant incluse sagement par le législateur, contre la volonté de notre collègue Alain Claeys à l’époque, il est évident que cette modification comporte dans son principe une souplesse qui n’interdira plus la recherche embryonnaire que dans la perspective de la cosmétologie : le législateur de 2004 n’avait certainement pas voulu cela, et le Gouvernement d’alors, par la bouche de Jean-François Mattei, non plus.
2 – Le maintien de la pratique de la fécondation d’embryons surnuméraires
La proposition du rapport concernant les modalités de traitement des embryons congelés consacre cette pratique et ses causes : la fécondation d’embryons surnuméraires.
L’impasse totale, sur le plan éthique, que représente le sort des dizaines de milliers d’embryons congelés dans notre pays doit conduire à remettre en cause cette manière de pratiquer l’assistance médicale à la procréation. En ne remettant pas en cause ces modalités de principe, on ferait perdurer inutilement cette impasse éthique..
3 – Le transfert d’embryons post mortem
Le rapport propose d’autoriser le transfert d’embryons post mortem, tout en maintenant l’interdiction de l’insémination dans ces mêmes circonstances.
Ainsi, la proposition concernée se situe en contradiction avec l’orientation de principe voulue par le rapport consistant à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant la référence et l’exigence fondamentale, dont la satisfaction conditionne toutes les autres décisions.
Par ailleurs, et dans ce cas précis, la proposition instaure une inégalité de valeur de principe entre le projet parental qui ne survivrait que par la mère, versus celui qui ne survivrait que par le père en dehors du fait que toutes les inégalités et dissemblances entre l’homme et la femme n’ont pas vocation à être aplanies par la loi, il y a là un doute porté sur la valeur du projet, qui serait satisfait pour l’une et pas pour l’autre. A moins que l’on prenne, afin de supprimer cette discrimination supplémentaire, le risque d’ouvrir la porte à la pratique des mères porteuses, ce que le rapport, fort opportunément, ne propose pas.
4 – L’inclusion de la trisomie 21 dans les maladies dépistées par le DPI
Cette proposition n° 26 est extrêmement problématique. Elle se fonde d’abord sur le ressenti social de cette maladie, et chacun peut comprendre, comme c’est déjà le cas dans le cadre des dépistages de la trisomie 21 réalisés pour les femmes enceintes, que l’utilisation du DPI conduira très vraisemblablement à l’éradication progressive de cette maladie, dans le cadre d’un véritable eugénisme légalisé (le Professeur Israël Nisand le mentionnait d’ailleurs dans son audition devant la mission d’information).
5 – L’absence de volonté d’encadrer davantage le rôle de l’ABM
La posture, tant institutionnelle que scientifique, de l’Agence de la Biomédecine est pour le moins interrogeante.
Premièrement, le rapport d’activité de l’ABM pour 2008 ignore totalement l’ensemble des avancées scientifiques occasionnées par les découvertes portant sur les iPS. Pourtant, de telles découvertes seraient susceptibles d’infléchir considérablement la politique de cette agence, en direction de recherches non seulement plus fructueuses pour les patients, mais également totalement consensuelles sur le plan éthique. Il est étrange que l’ABM n’en tienne aucun compte : on est en droit de se demander les raisons de telles omissions.
Deuxièmement, le même rapport d’activité se permet de considérer comme « superflues » un certain nombre de dispositions prises par le législateur, à propos de la recherche sur les embryons. Ce genre de jugement de valeur qui méprise la souveraineté nationale est proprement inacceptable, et manifeste une volonté d’indépendance qui n’est pas compatible avec l’esprit des lois, ni avec le fonctionnement de nos institutions.
Il est donc nécessaire de faire en sorte que l’activité de l’ABM soit redéfinie, ainsi que les modalités selon lesquelles elle rend compte aux pouvoirs publics.
Pour toutes ces raisons, comme d’autres que le débat parlementaire prochain permettra sans doute de préciser, et en saluant pour autant le remarquable travail de fond et de concertation conduit par la mission, je ne souhaite pas adopter le rapport présenté ce jour, 19 janvier 2010.
* *
CONTRIBUTION DE M. JEAN-SÉBASTIEN VIALATTE, DÉPUTÉ DU VAR, VICE-PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION
Le processus de révision de la loi de bioéthique a eu une vertu pédagogique, il a suscité un large débat, contribué à conforter le rôle des instances créées par le législateur de 2004 comme l’Agence de la biomédecine, (ABM), et montré l’importance du Comité national consultatif d’éthique (CCNE). Les débats au sein de la mission ont souligné combien il était important que le Parlement soit régulièrement informé des avancées scientifiques et technologiques pour évaluer leur impact juridique et éthique sur notre société, le plus en amont possible.
Selon les recommandations de la mission, la loi bioéthique de demain ne contiendra pas de clause de révision, ce qui est judicieux. En revanche, des procédures d’alerte de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et des Commissions parlementaire compétentes sont prévues. L’évaluation de l’application de la loi sera nécessaire, les décrets étant toujours longs à élaborer et sur ce point le rôle de l’OPECST comme celui des commissions compétentes doit être conforté.
La mission comme l’OPECST a pu constater qu’entre 2004 et 2010, l’usage généralisé d’Internet avait modifié considérablement les attentes des citoyens souvent bien informés de l’état de la science ainsi que des législations et pratiques à l’étranger lesquelles ont d’ailleurs selon les pays largement évolué.
Une sorte de « gourmandise technologique » s’est développée, à la faveur d’informations souvent sensationnelles ou trop prometteuses publiées par les médias, à la faveur également de la facilité d’accès par Internet à certains produits (tests génétiques, gamètes, etc..) ainsi qu’à certains sites étrangers encourageants des méthodes d’AMP proscrites en France.
Ces nouvelles facilités potentiellement dangereuses car incontrôlables ne peuvent être traitées par le seul législateur français. Toutefois, les interdits posés par la loi détermineront les limites et les dangers de certaines pratiques autorisées à l’étranger. Les débats ont montré qu’existe un quasi marché du droit biomédical, « un dumping juridique » en quelque sorte qui exige le recours à des normes internationales communes et si possible contraignantes ; tel est l’enjeu de la ratification par la France de la Convention d’Oviedo qui aurait dû intervenir depuis bien longtemps.
Les propositions pour la plupart judicieuses de la mission, auraient pu pour certaines d’entre elles tenir encore plus compte d’évolutions à l’œuvre dans notre société et des défis spécifiques que lancent les recherches sur les cellules souches et les technologies émergentes dont le Rapport fait opportunément état.
– Ainsi, s’agissant de l’assistance médicale à la procréation (AMP) qui renvoie à la sphère de l’intime, met en jeu le désir de procréer de la part des personnes infertiles, l’intérêt de l’enfant à naître, et ceux qui aident à ces naissances, certaines évolutions ne sont pas suffisamment prises en considération. Les conditions d’accès à l’AMP posées par la loi de 2004 vacillent du fait de l’évolution des pratiques et des mentalités, ainsi que des mouvements qui se manifestent dans la société. La multiplication des familles monoparentales est un fait difficile à nier.
Aussi, le maintien de certaines conditions d’accès, comme le concubinage notoire depuis deux ans, est-il caduque. Les certificats de concubinage notoire ne servent à rien car ils s’obtiennent très facilement. Cette condition applicable aux seuls couples vivant en concubinage ne devrait plus du tout figurer dans la loi, elle génère des inégalités et des fraudes.
Certains pays comme la Grèce, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni ou la Hongrie permettent aux femmes célibataires de recourir à l’AMP ce que la mission n’a pas souhaité autoriser. Il est nécessaire d’évoluer sur ce point en permettant à des femmes dont la stérilité est clairement due à des causes médicales d’accéder à l’AMP. On peut à l’évidence entourer cette possibilité nouvelle de conditions plus strictes mais il ne faut pas l’interdire car dans les faits elle encourage des fraudes.
Dans le cadre de l’OPECST un débat sur l’anonymat des dons de gamètes a été organisé et le maintien statu quo n’a pas paru souhaitable. La levée de l’anonymat sur les dons de gamètes demandée par les enfants issus d’insémination avec donneur (IAD) est une revendication légitime au regard du droit à connaître ses origines, d’autant que les enfants adoptés le peuvent désormais. En l’état les gamètes sont traités comme du sang et les CECOS disposent d’un état civil parallèle. Certes, la levée de l’anonymat aurait vraisemblablement des conséquences sur le nombre de donneurs de sperme qui risque de diminuer dans un premier temps, en revanche, elle pourrait inciter au don d’ovocytes qui obéit selon certaines analyses à des motivations différentes.
C’est pourquoi on aurait pu à tout le moins offrir des possibilités d’accès aux motivations et données non identifiantes concernant le donneur, si à sa majorité, l’enfant le demande. Le statu quo ne sera pas tenable comme l’a démontré le Conseil d’État dans son étude sur la révision des lois de bioéthique.
Quant à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), les propositions de la mission visent à pérenniser le système existant qui aurait fait ses preuves. Cela revient à ériger en principe l’interdiction de cette recherche sous prétexte que cela conduit dans les faits à un encadrement équivalent malgré les réserves émises par le Conseil d’État, la plupart des juristes, et des scientifiques sur cette méthode qui se voudrait plus protectrice de l’embryon.
Le moratoire a induit une instabilité juridique peu propice à attirer les jeunes chercheurs et les chercheurs étrangers. Cela a conduit à un ralentissement du nombre des projets de recherche. Sur le plan international, la position de la France est illisible alors que l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni et désormais les États Unis ont des positions très claires et compréhensibles au niveau mondial. Une modification de façade ne donnerait pas une véritable impulsion à ces recherches extrêmement utiles au plan cognitif et dans le futur médical, un système d’autorisation assorti de conditions strictes est largement préférable.
Sur les critères d’autorisation de la recherche, la mission préconise opportunément la suppression de la référence à « l’impossibilité de poursuivre ces recherches par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques », et substitue à « la finalité thérapeutique », « la finalité médicale » ce qui ne manquera pas de susciter des espoirs chez certains patients alors que les progrès pourraient n’advenir que dans le long terme. La notion de « motif scientifique et médical » rendrait mieux compte de l’objectif de ces recherches surtout de celles qui visent à la compréhension de mécanismes cellulaires complexes, comme les mécanismes conduisant à la différenciation et ceux concernant la pluripotence. Les recherches sur les CSEh ont surtout une finalité cognitive, les applications thérapeutiques ne seront pas immédiates.
Le système préconisé par la Mission ne prend pas nécessairement en compte les évolutions très rapides en cours sur les cellules souches pluripotentes induites IPS. Le maintien de l’interdiction des transferts nucléaires et le refus de débattre de l’utilisation de cybrides sont regrettables.
Comme l’ont expliqué à maintes reprises les scientifiques, les recherches sur les cellules souches se fertilisent mutuellement, sans les recherches sur les CSEh, celles sur les cellules souches adultes n’auraient pas connu les mêmes développements. Des résultats majeurs des recherches fondamentales sur les cellules souches de ces dernières années ont ouvert la voie à l’exploitation des propriétés de ces cellules dont les possibilités, notamment en pharmacologie, en médecine régénérative commencent à apparaître. L’utilisation des cellules souches permettrait, à terme, de diminuer le coût de développement des médicaments, de limiter les essais sur les animaux et l’homme. La compréhension plus fine de l’apparition de certains cancers dépend de recherches menées tant sur les cellules souches adultes que sur les CSEh.
Les recommandations que nous avions présentées en tant que rapporteurs de l’OPECST sur l’évaluation de la loi bioéthique, mon collègue Alain CLAEYS et moi-même devraient permettre un encadrement strict des recherches sur les CSEh sans fermer des voies de recherches qui ne sont pas pour l’instant privilégiées par la communauté scientifique.
– Concernant l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ce n’est pas un diagnostic classique, il touche au patrimoine génétique de toute une parentèle, peut concerner outre l’intéressé un descendant des parents, un conjoint, des collatéraux, des enfants à naître. Il vaut pour le présent et peut concerner une part de l’avenir.
Sur la difficile question de l’information de la parentèle en cas de découverte d’une anomalie génétique grave susceptible de mesure de prévention ou de soins, la mission propose une solution équilibrée préservant secret médical, prévention et soin.
Il reste que la protection des données concernant les caractéristiques génétiques d’une personne est essentielle et cette protection n’est pas suffisante actuellement. Ainsi, quand les examens génétiques sont effectués au cours d’une enquête, les empreintes sont conservées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Or les possibilités d’enregistrement dans le FNAEG, à l’origine limitées, ont été élargies à plusieurs reprises par des lois successives qui ont facilité les modalités d’alimentation du FNAEG, ainsi depuis 2003 près de 137 infractions peuvent donner lieu à tests génétiques. Les empreintes et les informations qui s’y rapportent sont conservées pendant 40 ans pour les personnes définitivement condamnées, et 25 ans pour les personnes mises en cause. Le FNAEG créé en 1998 pour les seuls délinquants sexuels pourrait en compter 3 millions en 2010. Or les personnes sont mal informées des modalités d’effacement qui d’ailleurs n’aboutissent pas toujours.
La protection de ses données personnelles est difficile à assurer ; celles figurant dans les fichiers sont difficilement effaçables, le droit à l’oubli n’est plus assuré comme l’a expliqué M Alex TÜRK, président de la commission nationale de l’informatique et des libertés, lors de son audition par l’OPECST le 15 décembre 2009.
La protection des données personnelles notamment celles concernant les caractéristiques génétiques d’une personne et plus généralement ses données de santé est essentielles car elle touche à l’intimité et à la vie privée et à la protection des libertés publiques. On ne fera pas l’économie de cette réflexion d’autant que les progrès des sciences émergentes rendront cette protection de plus encore plus difficile et aléatoire.
– À cet égard, le questionnement sur les défis éthiques que lancent les sciences émergentes était nécessaire et les recommandations de la mission contribueront à une prise de conscience des dangers potentiels pour les libertés publiques de la convergence des technologies. La loi de bioéthique de 2004 n’en traitait pas. Or différents rapports de l’OPECST l’ont montré, l’accélération des recherches en sciences du vivant, dans les domaines des nanotechnologies, des technologies de l’information et des neurosciences induit en même temps une accélération des convergences de ces technologies. Ce double phénomène d’extension du champ des sciences du vivant et d’accélération est susceptible de rendre chacun traçable, ce qui posera de graves interrogations éthiques avec, à terme, la suppression irréversible du droit à l’intimité.
Le développement exponentiel des nanotechnologies, des biotechnologies fait naître des interrogations, des inquiétudes et surtout un besoin de débattre de l’impact de ces recherches et de ces nouvelles technologies sur notre société fascinée par la technologie, mais qui craint les manipulations, les atteintes à la vie privée, à l’autonomie de la volonté. De même, la rapidité avec laquelle les neurosciences conquièrent notre société est déconcertante. Un continent se révèle, il concerne l’exploration des mécanismes cérébraux qui sous-tendent la mémoire, les pensées, les émotions, les comportements.
Les techniques d’imagerie médicale nous montrent le cerveau en construction au stade néonatal et en fonctionnement à tous les stades de la vie humaine. Mais que représentent ces images ? Seront-elles utilisées dans des procès ? L’expertise apportée par les neurosciences est souvent interprétée comme une vérité malgré les précautions prises par les chercheurs qui s’en inquiètent. Aussi la recommandation de la mission confiant à l’ABM une mission de veille éthique sur les neurosciences et leurs applications est-elle utile, mais le législateur sera sollicité car ce sujet fait débat comme le souligne le mécanisme de veille sur les neurosciences d’ores et déjà mis en place dans le cadre du Centre d’analyse stratégique.
En effet, un continent se révèle, il concerne l’exploration des mécanismes cérébraux qui sous-tendent la mémoire, les pensées, les émotions, les comportements. Les possibilités d’intervention sur le système nerveux sont maintenant multiples, que ce soit avec des molécules chimiques ou des procédés plus ou moins invasifs tels que l’imagerie cérébrale, la stimulation magnétique trans-crânienne, les implants ou les neuroprothèses. S’il devient possible de modifier l’humain, ces innovations seront-elles accessibles à tous. Ces recherches suscitent des espoirs de guérison de maladie neurodégénératives et/ou psychiatriques mais aussi des craintes de manipulation, d’atteintes à l’autonomie de la volonté, à l’intimité de la vie privée. Elles génèrent diverses données qui peuvent, si elles ne sont pas protégées nuire.
La mission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du 19 janvier 2010 et l’a adopté.
Elle a autorisé sa publication conformément à l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale.
ABM |
Agence de la biomédecine |
ACT |
Assistance circulatoire thérapeutique |
ADN |
Acide désoxyribonucléique |
AFM |
Association française contre les myopathies |
AFSSAPS |
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
AFM |
Association française contre les myopathies |
AMP |
Assistance médicale à la procréation |
ARH |
Agence régionale de l’hospitalisation |
ARS |
Agence régionale de la santé |
CEC |
Circulation extracorporelle |
CECOS |
Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains |
CCNE |
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé |
CHU |
Centre hospitalier universitaire |
CEDH |
Cour européenne des droits de l’homme |
CPDPN |
Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal |
CNAOP |
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles |
CNAMTS |
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés |
CNIL |
Commission nationale informatique et libertés |
CPP |
Comité de protection des personnes |
CRB |
Centres de ressources biologiques |
CSA |
Cellules souches dites adultes |
CSEh |
Cellules souches embryonnaires |
DDAC |
Donneurs décédés après arrêt cardiaque |
DDME |
Donneurs décédés suite à un état de mort encéphalique |
DGS |
Direction générale de la santé |
DPI |
Diagnostic préimplantatoire |
DPN |
Diagnostic prénatal |
EGBE |
États généraux de la bioéthique |
EME |
État de mort encéphalique |
HAS |
Haute Autorité de santé |
HFEA |
Human Fertilisation and Embryology Authority |
HLA |
Antigènes d’histocompatibilité portés par les cellules des tissus responsables de la réaction de rejet des greffes (human leukocyte antigen) |
IAC |
Insémination artificielle avec les gamètes du conjoint |
IAD |
Insémination artificielle avec les gamètes du donneur |
IMG |
Interruption médicale de grossesse |
IMSI |
Intra Cytoplasmic Morphologocal Sperm Injection |
INCa |
Institut national du cancer |
INSERM |
Institut national de la santé et de la recherche médicale |
IVG |
Interruption volontaire de grossesse |
FIV |
Fécondation in vitro |
iPS |
Cellules souches pluripotentes induites (induced pluripotent stem cells) |
ICSI |
Injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (intracytoplasmic sperm injection) |
IVG |
Interruption volontaire de grossesse |
GPA |
Gestation pour autrui |
MIGAC |
Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation |
Pmh |
Prélèvements par million d’habitants |
PTA |
Produits thérapeutiques annexes |
RNR |
Registre national des refus de prélèvement |
T2A |
Tarification à l’activité |
UNAF |
Union nationale des associations familiales |
UNESCO |
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture |
USP |
Unités de sang placentaire |
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Le 15 octobre 2008
M. Didier HOUSSIN, directeur général de la santé
Le 4 novembre 2008
M. Alain GRIMFELD, président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
Le 5 novembre 2008
M. Axel KAHN, président de l'université Paris V-René Descartes, directeur de recherche à l'INSERM
Le 18 novembre 2008
M. Pierre LE COZ, vice-président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
Le 25 novembre 2008
M. Henri ATLAN, directeur d’études à l’École des Hautes études en sciences sociales, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique
Le 9 décembre 2008
Représentants de la Grande Loge de France, de la Grande Loge Nationale Française, de la Grande Loge Féminine de France et du Grand Orient de France
Le 10 décembre 2008
M. Emmanuel PICAVET, maître de conférences en philosophie politique à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
M. Philippe POULETTY, Président de France Biotech, association française des entreprises de biotechnologies
Mme Carine CAMBY, conseiller maître à la Cour des comptes, ancienne directrice générale de l’Agence de la biomédecine
Le 17 décembre 2008
M. Pierre-Louis FAGNIEZ, conseiller auprès de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Mme Nicole QUESTIAUX, membre du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme
Le 13 janvier 2008
M. André SYROTA, directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et de M. Jean Claude AMEISEN, président du comité d’éthique de l’INSERM, membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine
M. Christian SAOUT, président du Collectif interassociatif sur la santé (CISS)
Le 14 janvier 2009
M. Marc PESCHANSKI, directeur de recherche à l’INSERM
M. Carlos de SOLA, chef du département de bioéthique du Conseil de l’Europe
Le 20 janvier 2009
M. Claude HURIET, sénateur honoraire, membre du Comité international de bioéthique de l’UNESCO et du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine
Mme Corine PELLUCHON, docteur en philosophie
Le 21 janvier 2009
Table ronde avec M. Olivier ABEL, professeur de philosophie éthique à la faculté de théologie protestante de Paris, membre du CCNE, M. Didier SICARD, professeur de médecine, ancien président du CCNE, M. Haïm KORSIA, Grand rabbin, aumônier général israélite des armées et M. Xavier LACROIX, philosophe, théologien, professeur d’éthique à l’université catholique de Lyon, membres du CCNE
Le 27 janvier 2009
M. Jean-François MATTEI, président de la Croix-Rouge française, responsable de l’Espace éthique méditerranéen
M. Géraud LASFARGUES, président de l’Académie nationale de médecine et de M. Jacques-Louis BINET, secrétaire perpétuel
Le 28 janvier 2009
Mme Simone VEIL, présidente du Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution
M. Claude SUREAU, membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, directrice générale et de M. SADEK BELOUCIF, président du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine
Le 3 février 2009
M. René FRYDMAN, professeur de médecine, chef du service de gynécologie-obstétrique à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart
Le 4 février 2009
Mme Hélène LETUR-KONIRSCH, gynécologue, médecin responsable de l’activité de don d’ovocytes à l’Institut Montsouris, présidente du Groupe d’étude des dons d’ovocytes (GEDO) et du Professeur Patrick FENICHEL, coprésident du GEDO
Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL, psychanalyste
Le 11 février 2009
Mme Jacqueline MANDELBAUM, chef du service d’histologie et de biologie de la reproduction et responsable du CECOS de l’hôpital Tenon, membre du CCNE
Mme Hélène GAUMONT-PRAT, professeur de droit des biotechnologies à l’Université Paris-VIII, directrice du laboratoire de droit médical et droit de la santé, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique
Le 18 février 2009
M. Jean-Luc BRESSON, président de la Fédération française des centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), chef du service de biologie du développement et de la reproduction au CHU de Besançon, de M. Jean-Marie KUNSTMANN, vice-président de la fédération des CECOS, praticien hospitalier en médecine de la reproduction à l’hôpital Cochin et de Mme Dominique REGNAULT, présidente de la commission des psychologues de la fédération des CECOS
M. Christian FLAVIGNY, psychanalyste et pédopsychiatre
Le 4 mars 2009
Mme Julie STEFFANN, praticien hospitalier dans le service de génétique médicale de l’hôpital Necker
M. Jean HAUSER, professeur de droit privé et directeur de l’institut européen de droit civil et pénal à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV
M. François OLIVENNES, gynécologue-obstétricien au centre d’assistance médicale à la procréation Eylau-La Muette
Mme Monique CANTO-SPERBER, philosophe, directrice de l’École normale supérieure, ancienne vice-présidente du CCNE
Le 10 mars 2009
Table ronde avec Mme Pauline TIBERGHIEN, présidente, et M. Arthur KERMALVEZEN, porte-parole de l’association Procréation médicalement anonyme (PMA), Mmes Laure CAMBORIEUX, présidente, et Sandra SAINT-LAURENT, membre de l’association Maia, Mmes Marie-Pierre MICOUD, coprésidente, et Marie-Claude PICARDAT, porte-parole de l’association des parents gays et lesbiens (APGL), et Mmes Dominique LENFANT, présidente, et Hortense de BEAUCHAINE, membre de l’association Pauline et Adrien
Mme Françoise HÉRITIER, professeur honoraire au Collège de France
Le 11 mars 2009
M. Pierre LÉVY-SOUSSAN, pédopsychiatre
M. Stéphane VIVILLE, chef du laboratoire de biologie de la reproduction au centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg
M. François FONDARD, président, et de Mmes Chantal LEBATARD et Christiane BASSET, administratrices de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Mme Dominique MEHL, sociologue, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Le 18 mars 2009
M. Jacques TESTART, directeur de recherche honoraire à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
Mme Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, professeur émérite de droit à l’université Lille 2
Mme Nadine MORANO, Secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité
Mme Sylviane AGACINSKI, philosophe, professeur à l’École des hautes études en sciences sociales
Le 24 mars 2009
Mme Sophie MARINOPOULOS, psychanalyste et psychologue clinicienne
M. Pierre JOUANNET, professeur des universités, praticien hospitalier consultant en biologie de la reproduction à l’hôpital Cochin
Le 25 mars 2009
M. François STEFANI, vice-président, et de M. Piernick CRESSARD, membre de la section « éthique et déontologie » du Conseil national de l’Ordre des médecins
M. Jacques MONTAGUT, médecin biologiste de la reproduction et directeur de l’Institut francophone de recherche et d’études appliquées à la reproduction et à la sexologie (IFREARES) à Toulouse
Le 31 mars 2009
Mme Joëlle BELAISCH-ALLART, chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Sèvres, vice-présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)
M. Israël NISAND, gynécologue-obstétricien, chef de service à l’hôpital de Hautepierre, à Strasbourg
Le 1er avril 2009
M. Marc BENBUNAN, chef du service Biothérapies cellulaires et tissulaires à l’hôpital Saint-Louis et du docteur Jérôme LARGHERO
M. Bertrand MATHIEU, professeur à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne, directeur du Centre de recherches de droit constitutionnel
M. David GOMEZ, senior legal adviser de l'Autorité britannique pour la fécondation et l'embryologie humaines (HFEA)
Le 7 avril 2009
M. Xavier MIRABEL, président de l’Alliance pour les droits de la vie
Mme Laure COULOMBEL, directrice de recherche à l’INSERM
Le 8 avril 2009
Mme Marie-Josée KELLER, présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, de Mme Anne-Marie CURAT, trésorière et de Mme Marianne BENOÎT, conseillère nationale
Le 9 avril 2009
M. Philippe MENASCHÉ, professeur de médecine, chirurgien cardiaque à l’hôpital Georges Pompidou et directeur de recherches à l’INSERM sur les thérapies cellulaires en pathologie cardio-vasculaire
M. Jacques HARDY, président, et de Mme Isabelle DESBOIS, responsable des tissus et cellules de l’Établissement français du sang
Le 28 avril 2009
Mme Catherine LABRUSSE-RIOU, professeur émérite à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
M. Alain PRIVAT, directeur de recherche à l’Institut des neurosciences de Montpellier
Le 29 avril 2009
Mme Gisèle HALIMI, présidente de l’association « Choisir la cause des femmes », avocate, et de Mme Barbara VILAIN, membre du bureau de l’association
Mme Éliane GLUCKMAN, professeur d’hématologie, présidente de l’association Eurocord
M. Xavier LABBÉE, professeur de droit à l’université de Lille II, avocat
Le 6 mai 2009
M. Pierre SAVATIER, directeur de recherche à l’INSERM, responsable d’une équipe de recherche à l’Institut Cellule souche et cerveau de Lyon
M. Philippe LAMOUREUX, directeur général des Entreprises du médicament (LEEM), accompagné de Mme Catherine LASSALE, directrice des affaires scientifiques, pharmaceutiques et médicales, Mme Blandine FAURAN, directrice juridique et fiscale, M. Pierre-Yves ARNOUX, chargé de mission recherche et biotechnologies, et Mme Aline BESSIS, directeur en charge des affaires publiques
M. Jean MARIMBERT, directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
Le 13 mai 2009
M. Philippe BAS, conseiller d’État, président du groupe de travail du Conseil d’État sur la révision des lois de bioéthique, ancien ministre, M. Luc Derepas, rapporteur général du groupe de travail.
M. Jean-René BINET, maître de conférences à la faculté de droit de Besançon
M. Jean-François GUÉRIN, chef du service de biologie de la reproduction de l’hôpital de Bron, président du comité d’éthique des Hospices civils de Lyon et membre du conseil d’administration et du groupe d’experts sur la recherche sur l’embryon de l’Agence de la biomédecine
M. Georges UZAN, directeur de recherches au CNRS, unité de recherche de l’INSERM U 602, hôpital Paul Brousse de Villejuif
Le 3 juin 2009
M. Jean-Marie Le MÉNÉ, président de la Fondation Jérôme LEJEUNE
Mme Michèle ANDRÉ, sénatrice, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat
Le 10 juin 2009
Mme Marie-Claire PAULET, présidente de la Fédération des associations pour le don d’organes et de tissus humains (France ADOT), de M. Régis VOLLE, président de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR), de Mme Yvanie CAILLÉ, cofondatrice du groupe de réflexion « Demain, la greffe » et membre du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, et M. Christian BAUDELOT, cofondateur et professeur émérite de sociologie, de M. Jean ACCIARO, président de la Fédération nationale des déficients et transplantés hépatiques (Transhépate) et de M. Jean-Pierre SCOTTI, président de la fondation Greffe de vie
M. Pierre BOYER, biologiste au service de médecine et de biologie de la reproduction de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille
M. Jean-Michel DUBERNARD, professeur au service de chirurgie de la transplantation de l’hôpital Édouard Herriot à Lyon
Le 17 juin 2009
M. Yves CHAPUIS, membre de l’Académie nationale de médecine
Mme Nicole LE DOUARIN, secrétaire perpétuelle honoraire de l’Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France
Le 24 juin 2009
M. Bruno RIOU, chef de service des urgences médicales, chirurgicales et psychiatriques à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, médecin coordonnateur des prélèvements d’organes et de tissus du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, vice-président de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI
Mme Frédérique BOZZI, conseiller à la Cour d’appel de Paris, et de M. Pierre LECAT, vice-procureur chargé du service civil du parquet du tribunal de grande instance de Nantes
Mme Valérie PÉCRESSE, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Le 30 juin 2009
M. Jean-Michel BOLES, chef du service de réanimation médicale du CHU de Brest, co-directeur de l’espace éthique de Bretagne occidentale
M. Louis PUYBASSET, praticien au service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, président du comité d’éthique de cet hôpital et président du groupe de réflexion éthique de la Société française d’anesthésie-réanimation, de M. Laurent JACOB, chef de service adjoint et de Mme France ROUSSIN, coordinatrice de dons d’organes du service d’anesthésie-réanimation chirurgicale de l’hôpital Saint-Louis
Le 7 juillet 2009
Mme Ségolène AYMÉ, médecin généticien et épidémiologiste, directrice de recherche à l’INSERM
Le 8 juillet 2009
Mme Anne CAMBON-THOMSEN, médecin spécialisée en immunogénétique humaine, directrice de recherches au CNRS
M. MENNESSON et Mme MENNESSON, co-présidents fondateurs de l’association Clara
Mme Perrine MALZAC, praticien hospitalier dans le département de génétique médicale de l’hôpital de la Timone à Marseille et coordinatrice de l’Espace éthique méditerranéen
Mme Dominique STOPPA-LYONNET, chef du service de génétique oncologique de l’Institut Curie, membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
Le 21 juillet 2009
M. Philippe GOSSELIN, député, président du collectif « Don de vie, don de soi »
Le 22 juillet 2009
Mme Françoise ANTONINI, déléguée générale de l’Alliance maladies rares, de Mme Viviane VIOLLET, responsable de la commission éthique de l’Alliance, de Mme Catherine AVANZINI, membre de la commission, et de Mme Marie-Christine OUILLADE, administratrice de l’Association française contre les myopathies (AFM)
Mme Sylvie MANOUVRIER-HANU présidente du collège national des enseignants et praticiens de génétique médicale
M. Bernard LOTY, adjoint à la directrice générale, chargé de la politique médicale et scientifique, de Mme Corinne ANTOINE, médecin, responsable du programme de prélèvements sur donneur à cœur arrêté, de M. François THÉPOT, responsable du pôle stratégie, procréation et génétique, et de M. Jean-Paul VERNANT, président du comité médical et scientifique, de l’Agence de la biomédecine
M. Christian BYK, magistrat à la cour d’appel de Paris, secrétaire général de l’Association internationale Droit, éthique et science
Le 9 septembre 2009
M. Josué FEINGOLD, généticien épidémiologiste, pédiatre, consultant à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, directeur de recherche émérite à l’Inserm ; de Mme Nicole PHILIP, médecin coordonnateur au département de génétique médicale de l’hôpital de la Timone-Enfants à Marseille et responsable du master « conseil génétique et médecine prédictive » à la faculté de médecine de Marseille ; et de Mme Marcela GARGIULO, psychologue clinicienne au département de génétique de l’hôpital La Pitié Salpêtrière
M. Philippe BEAUNE, chef du service de biochimie de l’hôpital européen Georges Pompidou, professeur à la faculté de médecine de Paris-Descartes
Table ronde avec M. Jean-Jacques HAUW, membre de l’Académie nationale de médecine, M. Raymond ARDAILLOU, secrétaire-adjoint de l’Académie nationale de médecine, Mme Emmanuelle RIAL-SEBBAG, juriste, INSERM Unité 558 Toulouse, et Mme Anne-Laure MORIN, avocate, docteur en droit
Le 15 septembre 2009
Mme Laurence LWOFF, chef de la division bioéthique du Conseil de l’Europe
M. Hervé CHNEIWEISS, directeur de l’unité de plasticité gliale à l’INSERM
Le 16 septembre 2009
M. Jean-Christophe GALLOUX, professeur du droit de la propriété intellectuelle à Paris II
Le 22 septembre 2009
M. Jean-Michel BESNIER, professeur de philosophie à l’université Paris IV
M. François BERGER, professeur à l’université Joseph Fourier de Grenoble, responsable de l’équipe « Nanomédecine et cerveau »
Mme Sarah SAUNERON, chargée de mission au Centre d’analyse stratégique et de M. Olivier OULLIER, conseiller scientifique et maître de conférences en neurosciences, responsables du programme « Neurosciences et politiques publiques » du Centre d’analyse stratégique
Le 6 octobre 2009
Mmes Cyra NARGOLWALLA, trésorière et Frédérique FAIVRE -PETIT, membre de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et M. Jacques PEUSCET, membre de l’Association des conseils en propriété industrielle
M. Alain POMPIDOU, professeur de médecine, ancien président de l’Office européen des brevets, président de l’Académie des technologies
Mme Christine VANHEE-BROSSOLLET, responsable de la propriété intellectuelle à l’Institut Curie, M. Frédéric FOUBERT, directeur du service Transfert de technologies de la direction de la politique industrielle au CNRS, Mme Isabelle BENOIST, responsable du pôle Nouvelles technologies et responsabilités de la direction des affaires juridiques du CNRS et M. Bernard BIOULAC, directeur scientifique adjoint de l'Institut des sciences biologiques
Le 7 octobre 2009
M. Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République
M. Jean-Didier VINCENT, professeur à l’université de Paris Sud Orsay, directeur de l’Institut de neurologie Alfred Fessard, membre de l’Académie des sciences
Le 3 novembre 2009
Mme Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés
Le 15 décembre 2009
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé et des sports
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Ces auditions ont été gravées sur un CD Rom annexé au présent rapport .
3 () Questionnement pour les États généraux de la bioéthique, 9 octobre 2008.
4 () Bilan d’application de la loi du 6 août 2004, octobre 2008.
5 () Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Rapport n° 1325, Assemblée nationale et 107, Sénat.
6 () La révision des lois de bioéthique, 6 mai 2009.
7 () Rapport final, 1er juillet 2009.
8 () « La sexualité dans l’étiologie des névroses », Sigmund Freud, « Résultats, idées, problèmes », in Naissance et liberté, Monique Canto-Sperber et René Frydman (2009),Plon .
9 () « The Baby business. How money, science and politics drive the commerce of conception », Debora Spar, Harvard business school press (2004).
10 () Audition du 24 mars 2009.
11 () Les diagnostics prénataux font l’objet du chapitre 3 du présent rapport en raison de la proximité des problématiques qu’ils soulèvent avec celles concernant la génétique, bien que le diagnostic préimplantatoire (DPI) implique le recours à des techniques d’assistance médicale à la procréation.
12 () Audition du 4 mars 2009.
13 () Audition du 11 mars 2009 de Mme Dominique Mehl.
14 () Audition du 24 mars 2009 de Mme Sophie Marinopoulos.
15 () Audition du 28 janvier 2009.
16 () Aux termes de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la participation de l’assuré (ticket modérateur) peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM), pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle.
17 () Audition du 4 mars 2009.
18 () « Rapport final des États généraux de la bioéthique », M. Alain Graf, rapporteur général (juillet 2009).
19 () Audition du 13 mai 2009.
20 () Audition du 11 mars 2009.
21 () Table ronde du 10 mars 2009.
22 () Audition du 31 mars 2009.
23 () Audition du 11 février 2009.
24 () Audition du 11 mars 2009.
25 () Table ronde du 21 janvier 2009.
26 () Audition du 4 février 2009.
27 () Audition du 4 mars 2009.
28 () Table ronde du 10 mars 2009.
29 () Audition du 4 mars 2009.
30 () Audition du 4 mars 2009.
31 () Audition du 31 mars 2009.
32 () Audition du 15 décembre 2009.
33 () Cf. infra point 5 du présent chapitre.
34 () Table ronde du 10 mars 2009.
35 () Audition du 11 mars 2009.
36 () Audition du 24 mars 2009.
37 () « Contribution du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine aux débats préparatoires à la révision de la loi de bioéthique », page 8 (20 juin 2008) et délibération n° 2006-CO-31 du 17 novembre 2006 sur les bonnes pratiques cliniques et biologiques en AMP.
38 () En particulier, l’article R. 4127-8 du code de la santé publique prévoit que : « Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. ». Par ailleurs, l’article L. 2141-10 du même code dispose que l’AMP ne peut être mise en œuvre « lorsque le médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître ».
39 () Table ronde du 10 mars 2008.
40 () Audition du 31 mars 2009.
41 () Audition du 4 mars 2009.
42 () TGI de Créteil, 1er août 1984, Parpalaix c/CECOS.
43 () TGI de Toulouse, 26 mars 1991, Galon c/CECOS.
44 () TGI de Rennes, 24 septembre 2009.
45 () Audition du 27 janvier 2009.
46 () Audition du 13 mai 2009.
47 () Audition du 11 mars 2009.
48 () Audition du 18 février 2009.
49 () Audition du 10 décembre 2008.
50 () Il convient en effet de rappeler que le taux de grossesse échographique était de 17 % par tentative de transfert d’embryon congelé en intraconjugal en 2007, selon les données de l’Agence de la biomédecine.
51 () Audition du 18 février 2009.
52 () Audition du 18 février 2009.
53 () Avis n° 40 sur le transfert d’embryons après décès du conjoint ou du concubin, CCNE (décembre 1993).
54 () Audition du 24 juin 2009.
55 () Audition du 5 novembre 2008.
56 () Audition du 4 février 2009.
57 () Auditions du 4 mars 2009 de M. Jean Hauser et du 18 mars 2009 de Mme Françoise Dekeuwer-Defossez.
58 () Audition du 4 mars 2009.
59 () Audition du 11 mars 2009.
60 () Audition du 20 janvier 2009.
61 () Audition du 11 mars 2009.
62 () « The Act requires clinics to consider the welfare of any child who may be born as a result of treatment » La loi exige de tout médecin qu’il prenne en compte le bien –être de l’enfant susceptible de naître à l’issue de l’AMP.site HFEA .
63 () Audition du 3 novembre 2009.
64 () Audition du 11 mars 2009.
65 () INSEE, enquêtes annuelles de 2004 à 2006 (2007).
66 () Table ronde du 10 mars 2009.
67 () Audition du 18 mars 2009.
68 () Audition du 20 janvier 2009.
69 () Audition du 4 février 2009.
70 () Audition du 18 mars 2009.
71 () Idem.
72 () Rapport n° 1325 sur l’évaluation de l’application de la loi du 6 août 2004 de MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte au nom de l’OPECST (17 décembre 2008).
73 () Audition du 28 janvier 2009.
74 () Audition du 1er avril 2009.
75 () La difficile mesure de l’homoparentalité, INED, Fiche d’actualité n°8, juin 2009.
76 () « Contribution de l’APGL dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique », site Internet des États généraux de la bioéthique (mars 2009).
77 () CEDH, 22 janvier 2008, E. B. contre France (requête n° 43546/02).
78 () Audition du 4 février 2009.
79 () Audition du 31 mars 2009.
80 () Audition du 31 mars 2009.
81 () Table ronde du 10 mars 2009.
82 () Idem.
83 () Audition du 18 février 2009.
84 () Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
85 () Audition du 24 mars 2009.
86 () Audition du 31 mars 2009.
87 () Audition du 24 mars 2009.
88 () Audition du 11 mars 2009.
89 () Audition du 18 mars 2009.
90 () Audition du 15 décembre 2009.
91 () Site Internet des États généraux de la bioéthique.
92 () Audition du 11 février 2009.
93 () « Bilan démographique 2008. Plus d’enfants, de plus en plus tard », INSEE Première n° 1220 (janvier 2009).
94 () Audition du 31 mars 2009.
95 () Audition du 4 mars 2009.
96 () « La baisse de la fertilité avec l’âge », INED (octobre 2008)
97 () Audition du 11 février 2009.
98 () Audition du 18 novembre 2008.
99 () Audition du 11 mars 2009.
100 () Idem.
101 () Audition du 13 janvier 2009.
102 () Audition du 18 février 2009.
103 () Au 31 décembre 2008, 187 laboratoires étaient ainsi autorisés pour les activités biologiques d’AMP et 103 centres pour les activités cliniques.
104 () Audition du 31 mars 2009.
105 () Audition du 25 mars 2009.
106 () Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l’AMP et décret n° 2006-1661 du 22 décembre 2006 relatif au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro et modifiant le code de la santé publique.
107 () Audition du 22 juillet 2009.
108 () Directive n° 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains.
109 () Le développement professionnel continu a pour objectif l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins (Article L. 4133-1 du code de la santé publique).
110 () Rapport précité de l’Agence de la biomédecine (octobre 2008).
111 () Audition du 10 décembre 2008.
112 () Audition du 8 avril 2009.
113 () Audition du 8 avril 2009.
114 () Le nombre de fiches spécifiques pour chaque tentative, transfert d’embryons congelés et grossesse représenterait ainsi 65 000 fiches à enregistrer en une année. Le recueil de cette activité, dont le temps de saisie a été estimé entre 20 et 30 minutes par fiche, est aujourd’hui assuré par le personnel existant et ne bénéficie pas non plus de financement spécifique.
115 () Les MIGAC comportent notamment la collecte, la conservation et la distribution des produits d’origine humaine (destinée à financer la conservation des gamètes et des embryons) ainsi que le financement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN).
116 () Audition du 31 mars 2009.
117 () Audition du 4 mars 2009.
118 () Audition du 31 mars 2009.
119 () Table ronde du 10 mars 2009.
120 () Audition du 11 mars 2009.
121 () Audition du 31 mars 2009.
122 () Audition du 4 mars 2009.
123 () Audition du 31 mars 2009.
124 () Audition du 4 mars 2009.
125 () Audition du 31 mars 2009.
126 () Par exemple, pour la grossesse : test de grossesse positif, taux d’HCG plasmatique supérieur à un certain seuil, l’existence d’un embryon repérable à l’échographie ou accouchement. Pour les tentatives : toutes les patientes soumises à une stimulation peuvent être prises ou uniquement celle sur qui est effectuée une ponction, etc.
127 () Table ronde du 10 mars 2009.
128 () Audition du 4 mars 2009.
129 () Audition du 31 mars 2009.
130 () Audition du 18 mars 2009.
131 () Table ronde du 10 mars 2009.
132 () Audition du 24 mars 2009.
133 () Audition du 31 mars 2009.
134 () Audition du 4 mars 2009.
135 () Audition du 11 février 2009.
136 () Institut national d’études démographiques (INED), Population et sociétés n° 451, « 200 000 enfants conçus par FIV en France puis 30 ans », Elise de La Rochebrochard (décembre 2008).
137 () Le dispositif de vigilance couvre l’ensemble des incidents et évènements indésirables qui peuvent survenir dans la pratique de l’AMP. L’obligation de déclarer les évènements indésirables graves est effective depuis le décret du 22 décembre 2006 sur le don de gamètes et l’AMP, mais l’ensemble du dispositif d’AMP vigilance a été finalisé et consolidé dans le décret du 19 juin 2008 transposant la directive n° 2004/23.
138 () Audition du 10 décembre 2008.
139 () Compte-rendu de la séance de l’Assemblée nationale du jeudi 11 décembre 2003.
140 () « Bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004 », Agence de la biomédecine (novembre 2008).
141 () Audition du 24 mars 2009.
142 () Arrêté du 11 avril 2008 de la ministre de la santé relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
143 () Table ronde du 21 janvier 2009.
144 () Concernant les tentatives d’AMP intraconjugale en 2007 : pour la FIV (hors ICSI), 93 493 embryons ont été conçus, 31 396 transférés et 21 709 congelés ; s’agissant de l’ICSI, 141 505 embryons ont été obtenus, 51 883 transférés et 32 413 congelés ; enfin, 36 186 embryons ont été décongelés et 24 499 transférés.
145 () Audition du 13 mai 2009.
146 () Audition du 27 janvier 2009.
147 () Audition du 4 février 2009.
148 () Audition du 10 juin 2009.
149 () Audition du 7 avril 2009.
150 () Audition du 3 juin 2009.
151 () Table ronde du 21 janvier 2009.
152 () Audition du 10 juin 2009.
153 () Audition du 18 mars 2009.
154 () Audition du 27 janvier 2009.
155 () Audition du 13 mai 2009.
156 () Cf. infra, chapitre 5 du présent rapport.
157 () Audition du 11 février 2009.
158 () Audition du 13 mai 2009.
159 () Audition du 11 février 2009.
160 () Rapport précité d’octobre 2008.
161 () Audition du 11 mars 2009.
162 () Audition du 10 décembre 2008.
163 () Ces dispositions ont notamment été introduites afin de ne pas imposer aux couples le recours à des techniques telles que l’ICSI avant d’envisager le recours au tiers donneur.
164 () Audition du 4 février 2009.
165 () Audition du 11 mars 2009.
166 () Audition du 11 février 2009.
167 () Audition du 31 mars 2009.
168 () Table ronde du 10 mars 2009
169 () Audition du 24 mars 2009.
170 () Audition du 20 janvier 2009.
171 () Un don d’ovocytes implique en effet les contraintes du traitement, des analyses, du monitorage, des déplacements et consultations, de l’intervention chirurgicale, sous anesthésie locale ou générale.
172 () Audition du 4 novembre 2008.
173 () Table ronde du 10 mars 2009.
174 () Audition du 14 janvier 2009.
175 () Audition du 31 mars 2009
176 () Audition du 4 mars 2009
177 () Audition du 3 février 2009
178 () Idem.
179 () Audition du 14 janvier 2009.
180 () Audition du 10 décembre 2008.
181 () Audition du 4 mars 2009.
182 () Audition du 18 février 2009.
183 () Auditions du 10 décembre 2008 et du 28 janvier 2009.
184 () Cette campagne d’information (http://www.dondovocytes.fr) a suscité plus de 100 reprises du sujet dans les médias et 800 appels sur le numéro vert de l’Agence de la biomédecine.
185 () Auditions de M. René Frydman du 3 février 2009 et de M. François Olivennes du 4 mars 2009.
186 () Audition du 4 février 2009.
187 () Audition du 28 janvier 2009
188 () Audition du 3 février 2009.
189 () Audition du 4 février 2009.
190 () Audition du 28 janvier 2009.
191 () Table ronde du 10 mars 2009.
192 () Audition du 24 mars 2009.
193 () Idem.
194 () Décret n° 2009-217 du 24 février 2009 relatif au remboursement des frais engagés à l’occasion du prélèvement d’éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques.
195 () Audition du 4 février 2009.
196 () « La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires (…) dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences n’entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise ».
197 () Audition du 4 mars 2009.
198 () Audition du 4 février 2009.
199 () Audition du 4 février 2009.
200 () Le rapport n° 1325 précité au nom de l’OPECST indique en effet que « la pratique de la double liste, qui s’est instituée grâce au don d’ovocytes croisé, a été mise en cause. Ce système n’est pas véritablement contraire à la loi » (page 131).
201 () Audition du 31 mars 2009.
202 () Table ronde du 10 mars 2009.
203 () Compte-rendu de la séance du Sénat du 10 novembre 2003.
204 () Compte-rendu de l’audition publique ouverte à la presse du 10 juin 2008 sur l’AMP.
205 () « Quelques propositions sur l’évolution législative de l’AMP », Bénédicte Rivière, Revue générale de droit médical, n° 28 (2008)
206 () « Mon père, c’est mon père. L’histoire singulière des enfants conçus par insémination artificielle avec donneur », Jean-Loup Clément (avril 2006).
207 () Audition du 15 octobre 2008.
208 () Table ronde du 10 mars 2009.
209 () « Les enfants du don. Procréation médicalement assistée : parents et enfants témoignent », Dominique Mehl (2008).
210 () Audition du 4 février 2009.
211 (2) Audition du 11 mars 2009.
212 () L’article 311-19 du code civil prévoit en effet qu’en cas d’AMP avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. En d’autres termes, toute action en recherche de paternité contre le tiers donneur sera irrecevable, de même que toute reconnaissance volontaire par ce tiers du lien de filiation serait nulle. De plus, l’article L. 1244-3 du code de la santé publique prévoit qu’aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
213 () Rapport sur les États généraux de la bioéthique (juillet 2009).
214 () Audtion du 11 mars 2009.
215 () « L’anonymat des dons d’engendrement est-il vraiment éthique ? », Irène Théry, Esprit, « La filiation saisie par la biomédecine » (mai 2009)
216 () Cf. Audition du 15 décembre 2009.
217 () Audition du 27 janvier 2009.
218 () Audition du 18 mars 2009.
219 () Cf. les articles R. 1244-5, R. 1211-25 et R. 1211-26 du code de la santé publique.
220 () « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »
221 () Audition du 28 janvier 2009.
222 () Audition du 18 février 2009.
223 () Audition du 18 février 2009.
224 () Audition du 27 janvier 2009.
225 () Audition du 11 mars 2009.
226 () Audition du 27 janvier 2009.
227 () Audition du 20 janvier 2009.
228 () Cf. rapport n°1325, Assemblée nationale, 17 décembre 2008.
229 () Décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 relatif à l’accueil de l’embryon et modifiant le code de la santé publique (décret en Conseil d’État), modifié et complété par le décret n° 2006-660 du 22 décembre 2006.
230 () Audition du 18 novembre 2008.
231 () Table ronde du 10 mars 2009.
232 () Audition du 4 février 2009.
233 () « Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation », avis n° 90 du CCNE (24 novembre 2005).
234 () Décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 relatif à l’accueil de l’embryon et modifiant le code de la santé publique, modifié et complété par le décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006.
235 () Audition du 25 mars 2009.
236 () En application du dernier alinéa de l’article L. 2141-5 du code de la santé publique, les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
237 () Audition du 13 mai 2009.
238 () « Contribution du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine », page 14 (juillet 2008).
239 () Audition du 25 mars 2009.
240 () Audition du 13 mai 2009.
241 () Article L. 2141-6 du code de la santé publique.
242 (2) Avis n° 90 du CCNE, « Accès aux origines, anonymat, filiation » (novembre 2005).
243 () Audition du 31 mars 2009.
244 () Audition du 11 mars 2009.
245 () Audition du 18 mars 2009.
246 () Audition du 8 juillet 2009.
247 () Clara – Comité de soutien pour la légalisation de la gestation pour autrui (GPA.)
248 () « Corps en miettes », Sylviane Agacinski, pages 93-94 (mars 2009).
249 () Audition du 18 mars 2009.
250 () Audition du 25 novembre 2008.
251 () Cour de cassation, Assemblée plénière, Alma mater, n° 90-20105, 31 mai 1991.
252 () Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 88-15, 13 décembre 1989.
253 () Articles 325 et 332 du code civil.
254 () Cour de Cassation 1ère chambre civile, no 01-03.927, 9 décembre 2003.
255 () Cour de Cassation, 1ère chambre civile, no 88-15.655, 13 décembre 1989.
256 () Cour de cassation, arrêt précité du 9 décembre 2003.
257 () Décision n° 94-343 DC du 27 juillet 1994 sur la loi relative au respect du corps humain.
258 () Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 07-20.468, 17 décembre 2008.
259 () « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. » (Article 113-6 du code pénal).
260 () Ainsi, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Créteil au bénéfice d’un couple français ayant conclu une convention de mère porteuse en Californie.
261 () Rapport sur la gestation pour autrui de M. Roger Henrion et de Mme Claudine Esper au nom de l’Académie nationale de médecine (10 mars 2009).
262 () Audition du 11 février 2009.
263 () Table ronde du 10 mars 2009.
264 () Audition du 11 février 2009.
265 () Audition du 31 mars 2009
266 () Audition du 3 février 2009.
267 () Audition du 1er avril 2009.
268 () Audition du 29 avril 2009.
269 () Audition du 18 février 2009.
270 () Table ronde du 10 mars 2009.
271 () Audition du 11 mars 2009.
272 () Audition du 31 mars 2009.
273 () Selon l’estimation fournie par M. et Mme Mennesson, lors de leur audition par le groupe de travail sénatorial sur la maternité pour autrui.
274 () Audition du 3 juin 2009.
275 () Table ronde du 10 mars 2009.
276 () Terme désignant la faculté, pour un requérant, de choisir parmi les juridictions potentiellement compétentes celle qui répondra le plus favorablement à sa demande.
277 () Audition du 4 novembre 2008.
278 () Audition du 29 avril 2009.
279 () Libération, 26 juin 2008.
280 () Table ronde du 10 mars 2009.
281 () Audition du 8 juillet 2009.
282 () Audition du 18 mars 2009.
283 () Table ronde du 10 mars 2009.
284 () Audition du 31 mars 2009.
285 () Cf. délibération du 21 septembre 2009.
286 () Table ronde du 10 mars 2009.
287 () « La gestation pour autrui : études et propositions », contribution de l’association C.L.A.R.A. (décembre 2008), disponible en ligne sur le site des États généraux de la bioéthique.
288 () Table ronde du 10 mars 2009.
289 () Audition du 18 mars 2009.
290 () Audition du 4 février 2009.
291 () Audition du 11 février 2009.
292 () Audition du 27 janvier 2009.
293 () Audition du 4 février 2009.
294 () Audition du 24 mars 2009.
295 () Audition du 11 février 2009.
296 () Audition de M. René Frydman du 3 février 2009.
297 () « Les maternités de substitution », Myriam Szejer et Jean-Pierre Winter, Études, mai 2009. Cette étude rapporte le cas d’une mère porteuse qui explique que « lorsqu’elle s’est retrouvée alitée au sixième mois de grossesse parce qu’elle soufrait de contractions, pour faire face aux dépenses de garde de ses enfants qu’entraînait son état, elle a demandé un supplément au couple qui a refusé. À ce moment, elle s’est sentie lâchée. « Je me suis demandé si tout le monde ne me prenait pas pour un sac. Et j’ai commencé à aller mal ».
298 () Audition du 8 avril 2009.
299 () « Propositions complémentaires. Éléments à considérer en cas d’autorisation de la gestation pour autrui », annexe I du rapport précité de l’Académie nationale de médecine.
300 () Audition du 31 mars 2009.
301 () Audition du 24 mars 2009.
302 () Audition du 27 janvier 2009.
303 () « Les maternités de substitution », Myriam Szejer et Jean-Pierre Winter, Études (mai 2009).
304 () Audition du 25 mars 2009.
305 () Audition du 27 janvier 2009.
306 () Audition du 27 janvier 2009.
307 () Audition du 11 février 2009.
308 () Audition du 11 mars 2009.
309 () Sur ce point, cf. le rapport précité de l’Académie nationale de médecine.
310 () Audition du 24 mars 2009.
311 () Audition du 3 juin 2009.
312 () Audition du 11 février 2009.
313 () « Families created through a surrogacy arrangement: parent-child relationships and children’ psychological development at age 2”, Suzanne Golombok, Psychological psychiatry (2006).
314 () Audition du 29 avril 2009.
315 () Audition du 11 mars 2009.
316 () Audition du 4 février 2009
317 () Table ronde du 9 décembre 2008.
318 () Rapport d’information n° 421 (page 66) de Mme Michèle André, MM. Alain Milon et Henri de Richemont fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales (25 juin 2008).
319 () Audition du 8 juillet 2009.
320 () Audition du 15 décembre 2009.
321 () Audition du 18 mars 2009.
322 () cf. par exemple http://www.allaboutsurrogacy.com/sample_contracts.
323 () Audition du 4 mars 2009.
324 () Audition du 28 avril 2009.
325 () Avis du Conseil d’orientation sur la gestation pour autrui, séance du 18 septembre 2009, délibération n° 2009-CO-38.
326 () Tribunal de grande instance de Créteil, no 1988-600527, 23 mars 1988.
327 () Audition du 31 mars 2009.
328 () Audition du 18 mars 2009.
329 () Audition du 4 novembre 2008.
330 () Table ronde du 10 mars 2009.
331 () Audition du 8 juillet 2009.
332 () Audition du 28 avril 2009.
333 () Audition du 13 mai 2009.
334 () Audition du 4 mars 2009.
335 () Table ronde du 10 mars 2009.
336 () cf. notamment sur ce point, le rapport précité de l’Académie nationale de médecine (page 17) ainsi que l’ouvrage de Debora Spar, « The baby businesss ».
337 () Audition du 31 mars 2009
338 () Audition du 3 février 2009.
339 () Audition du 10 mars 2009.
340 () « The body shopping. The economy fuelled by flesh and blood», Donna Dickinson (2008).
341 () Audition du 24 juin 2009.
342 () Audition du 18 mars 2009.
343 () Audition du 4 février 2009.
344 () Audition du 29 janvier 2009.
345 () « La GPA : malaise dans la civilisation. La filiation saisie par la technique », contribution de Mme Marie-Thérèse Hermange, sénateur de Paris, au rapport du groupe de travail sénatorial sur la GPA.
346 () Audition du 24 juin 2009.
347 () Audition du 4 mars 2009.
348 () Audition du 18 mars 2009.
349 () Rapport précité (page 78)
350 () « Sortir du paternalisme moralisateur », Ruwen Ogien, Le Monde, 23 mai 2009.
351 () http://claradoc.gpa.free.fr
352 () Audition du 28 avril 2009.
353 () Audition du 29 avril 2009.
354 () Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 sur la loi relative au respect du corps humain et la loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’AMP et au DPN.
355 () Conseil d’État, 27 octobre 1995, n° 136727, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec.372.
356 () « Fondements de la métaphysique des mœurs », Deuxième section, Emmanuel Kant (1785).
357 () Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001.
358 () Audition du 18 mars 2009.
359 () Audition du 18 février 2009.
360 () Audition du 3 juin 2009.
361 () Audition du 4 mars 2009.
362 () Idem.
363 () Audition du 18 mars 2009.
364 () Table ronde du 21 janvier 2009.
365 () Audition du 29 avril 2009.
366 () Audition du 28 avril 2009.
367 () Audition du 31 mars 2009.
368 () Audition du 24 mars 2009.
369 () Audition du 18 mars 2009.
370 () Audition du 29 avril 2009.
371 () Rapport précité de mars 2009 (page 11).
372 () Libération, 25 juin 2008.
373 () Audition du 4 mars 2009.
374 () Audition du 3 novembre 2009.
375 () Audition du 11 février 2009.
376 () Audition du 1er avril 2009.
377 () Audition du 1er avril 2009.
378 () Audition du 3 février 2009.
379 () « Contribution du conseil d’orientation aux débats préparatoires à la révision de la loi de bioéthique. Leçons d’expérience (2005-2008) et questionnements » (juin 2008)
380 () Audition du 28 avril 2009.
381 () Audition du 3 novembre 2009.
382 () Par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
383 () « La gestation pour autrui à l’étranger », Mme Florence Laroche-Giserot, in L’identité génétique de la personne entre transparence et opacité, Dalloz (2007).
384 () Audition du 18 mars 2009.
385 () Audition du 13 janvier 2009.
386 () « L’Utérus artificiel », Paris, Le Seuil, 2005.
387 () « La recherche scientifique face à la réflexion éthique : entretien avec Henri Atlan », Esprit, octobre 2006.
388 () Audition du 27 janvier 2009.
389 () « Gestation pour autrui : les enfants fantômes de la République », Libération, mercredi 20 mai 2009.
390 () « Repenser la prohibition de la gestation pour autrui » », V. Depadt-Sabag, G. Delaisi de Parseval et M. Bandrac, 2008, in « Maternités pour le compte d’autrui : la main levée de l’interdit ? », Alain Sériaux, Recueil Dalloz n° 18 (2009).
391 () « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant » (article 311-25 du code civil).
392 () Audition du 24 juin 2009.
393 () Cour de cassation, Assemblée plénière, n° 90-20105, 31 mai 1991 (Alma mater).
394 () Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 01-0.927, 9 décembre 2003
395 () En effet, dans un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation a annulé une décision admettant l’adoption de l’enfant par la compagne du père, au motif que cette adoption entraînerait le transfert des droits d’autorité parentale à l’adoptante seule.
396 () Audition du 29 avril 2009.
397 () Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.
398 () Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation CIV 2006-13 C /30-06-2006 de la Direction des affaires civiles et du sceau.
399 () La fraude à la loi consiste à changer l’élément de rattachement de la règle de conflit pour faire varier la règle applicable. Il y a fraude lorsque le changement a été motivé par la volonté d’échapper aux dispositions de la loi compétente.
400 () « À propos de la maternité pour autrui », Aude Mirkovic, maître de conférences de droit privé à l’Université d’Évry, Droit de la famille - Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur (juin 2008).
401 () Dictionnaire permanent Bioéthique et biotechnologies, éditions Francis Lefebvre.
402 () Audition du 24 juin 2009.
403 () Audition du 24 juin 2009.
404 () Audition du 24 juin 2009.
405 () Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil.
406 () Audition du 24 juin 2009.
407 () En réalité, il semble que cette proposition consistait à en revenir à un premier acte dont le parquet avait connaissance, préalable à l’intervention judiciaire désétablissant la mère et son mari ou à un retour à la réalité de l’accouchement par le biais de procédures internes au pays considéré.
408 () Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 juin 1983 (Suhami).
409 () Audition du 8 juillet 2009.
410 () Audition du 3 novembre 2009.
411 () Cour d’appel de Paris, Chambre 1, section C, n° 06/00507, 25 octobre 2007.
412 () Audition du 24 juin 2009.
413 () Cour de cassation, 17 décembre 2008.
414 () Audition du 4 mars 2009.
415 () Audition du 24 juin 2009.
416 () Dans cette affaire, l’acte de naissance litigieux d’un enfant né par GPA aux États-Unis, avait été transcrit sur les registres français au vu de l’acte de naissance américain de l’enfant dressé par les autorités compétentes de l’État du Minnesota en considération des jugements d’abandon et d’adoption prononcés le 4 juin 2001 par la cour du district de Beltrami et dont l’opposabilité en France était contestée.
417 () Cour d’appel de Paris, 1ère chambre civile, 26 février 2009.
418 () Audition du 24 juin 2009.
419 () Audition du 24 juin 2009.
420 () Cour de cassation, 1ère civile, 18 mai et 14 juin 2005.
421 () « La consolidation de situations illicites dans l’intérêt de l’enfant », G. Kessler, Droit de la famille (juillet 2005).
422 () « À propos de la maternité pour autrui », Aude Mirkovic, maître de conférences de droit privé à l’université d’Évry, Droit de la famille (juin 2008).
423 () Audition du 3 novembre 2009.
424 () Audition du 13 mai 2009.
425 () Audition du 3 novembre 2009.
426 () Audition du 24 juin 2009.
427 () Rapport n° 2832 de Mme Valérie Pécresse au nom de la mission d’information sur la famille et les droits des enfants (25 janvier 2006).
428 () « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale. Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle. ».
429 () « S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur. ».
430 () Audition du 20 janvier 2009 de Mme Corine Pelluchon.
431 () Audition du 11 février 2009 de Mme Jacqueline Mandelbaum.
432 () Audition du 29 avril 2009.
433 () « Avis sur les problèmes éthiques liés aux diagnostics anténatales : le diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI) », avis n° 107 du CCNE (novembre 2009).
434 () Diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse, diagnostic pré-implantatoire et formes héréditaires de cancers. Rapport rédigé à la demande de l’Agence de la Biomédecine et de l’Institut National du Cancer.(2007-2008).
435 () Avis n° 5 « Problèmes posés par le diagnostic prénatal et périnatal ».
436 () Audition du 3 juin 2009.
437 () Audition du 11 mars 2009.
438 () Audition du 22 juillet 2009.
439 () Arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 (JO. 3 juillet 2009).
440 () Réponse à un questionnaire du rapporteur.
441 () « État des lieux du diagnostic prénatal en France », rapport de l’Agence de la biomédecine, page 28 (février 2008).
442 () Les principales maladies tumorales dépistées sont le rétinoblastome,la polypose , l’adénomateuse familiale, la maladie de von Hippel Lindau, la neurofibromatose de type 2 ; le syndrome de Li et Fraumeni et la tumeur rhabdoïde.
443 () Rapport final des États généraux de la bioéthique (juin 2009).
444 () L’ABM recommande que « l’équipe pluridisciplinaire s’assure que les informations ont été bien comprises, que la femme ou le couple a pu poser les questions qu’elle ou qu’il souhaite et qu’elle ou qu’il a obtenu des réponses à ces questions. »
445 () Audition du 11 mars 2009.
446 () Avis sur les problèmes éthiques liés aux diagnostics anténatals : le diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI). (15 octobre 2009).
447 () Cette possibilité est mentionnée dans les recommandations professionnelles de l’ABM pour le fonctionnement des CPDPN édictées en 2009. Elle ne figure cependant pas dans le statut législatif des CPDPN.
448 () Arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatal de la trisomie 21.
449 () Idem cf. annexe de l’arrêté.
450 () « Le dépistage de la trisomie 21 est-il bien compris par les femmes ? », Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), janvier 2009. Étude menée sur 391 femmes ayant accouché dans une maternité des Yvelines entre avril et octobre 2005 Cf. http://www.inserm.fr/espace-journalistes/le-depistage-de-la-trisomie-21-est-il-bien-compris-par-les-femmes.
451 () Audition du 11 mars 2009.
452 () Audition du 3 juin 2009.
453 () Idem.
454 () Cette possibilité n’est toutefois devenue effective qu’avec la parution du décret d’application plusieurs années plus tard, en 1998.
455 () Audition du docteur Stephane Viville du 11 mars 2009.
456 () Ainsi, le diagnostic est réalisé sur une seule cellule et les résultats sont obtenus au plus tard le jour suivant le prélèvement, le ou les embryons devant être implantés dans l’utérus avant le sixième jour de développement. Le DPI engage donc une véritable course contre la montre.
457 () Audition du 18 mars 2009.
458 () Rapport Conseil d’État p.31.
459 () Audition du 11 mars 2009.
460 () Audition du 15 décembre 2009.
461 () La loi bioéthique de demain, p.253.
462 () Audition du Docteur Stephane Viville du 11 mars 2009 et audition de Mme Roselyne Bachelot du 15 décembre 2009.
463 () Audition du 18 mars 2009.
464 () Audition du 28 janvier 2009.
465 () Audition du 11 mars 2009.
466 () Interview de M. Pierre Le Coz, vice – président du CCNE dans La Croix du 2 décembre 2009.
467 () Dans sa contribution sur le site des États généraux de la bioéthique, la Fédération française de génétique humaine s’interrogeait ainsi sur la compétence des CPDPN pour juger de la gravité et de l’incurabilité de certaines maladies dans la mesure où les membres des CPDPN ne sont en général pas des spécialistes des maladies à révélation tardive, ni des formes familiales de cancer.
468 () Audition du 11 mars 2009.
469 () Audition du 4 mars 2009.
470 () Idem.
471 () Audition du 11 mars 2009.
472 () « Des moyens pour le diagnostic préimplantatoire », par René Frydman, Samir Hamamah et Nelly Achour-Frydman, professeurs en médecine, Libération, 1er juillet 2009.
473 () Avis n° 107, novembre 2009.
474 () Le système HLA (human leucocyte antigen) vise à identifier les antigènes d’histocompatibilité portés par les cellules des tissus responsables de la réaction de rejet des greffes.
475 () Amendement présenté par M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et Jean-Michel Dubernard, un amendement dans le même sens ayant été déposé par M. Alain Claeys et plusieurs membres du groupe socialiste.
476 () « Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. »
477 () « Réflexions sur l’extension du diagnostic préimplantatoire », avis n° 72 du CCNE (juillet 2002).
478 () Audition du 5 novembre 2008.
479 () Audition du 18 mars 2009.
480 () Compte-rendu analytique de la deuxième séance du mercredi 10 décembre 2003 de l’Assemblée nationale.
481 () L’anémie de Fanconi est une maladie génétique rare faisant partie des syndromes d’insuffisance médullaire héréditaires. L’évolution hématologique se fait vers une aplasie médullaire sévère ou une leucémie. Le traitement peut se faire par une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (CSH), qui corrige l’insuffisance médullaire et peut permettre la survie des patients. Les CSH peuvent provenir du sang de cordon d’un donneur apparenté (frère ou sœur) ou non apparenté.
482 () Audition du 1er avril 2009.
483 () Décret n° 2006-1661 du 22 décembre 2006 précité.
484 () Audition du 4 mars 2009.
485 () Audition du 11 mars 2009.
486 () Audition du 4 mars 2009.
487 () Audition du 4 mars 2009.
488 () « Le sang de cordon : collecter pour chercher, soigner et guérir », rapport d’information n° 79 au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, page 16 (novembre 2008).
489 () Audition du 9 avril 2009.
490 () Audition du 1er avril 2009.
491 () Audition du 7 juillet 2009.
492 () « The changing moral focus of newborn screening », rapport Pellegrino (décembre 2008).
493 () Audition du 22 juillet 2009.
494 () Audition du 15 septembre 2009.
495 () L’article 6 du protocole additionnel, adopté le 27 novembre 2008, prévoit que « l’utilité clinique d’un test génétique doit être un critère essentiel dans la décision de proposer un tel test à une personne ou à un groupe de personnes ».
496 () « Réflexions et propositions de la Fédération française de génétique humaine en vue de la révision de al loi relative à la bioéthique », contribution sur le site Internet des États généraux de la bioéthique (janvier 2009).
497 () Table ronde du 22 juillet 2009.
498 () « Éthique et surdité de l’enfant : élément de réflexion à propos de l’information sur le dépistage systématique néonatal et la prise en charge des enfants sourds », avis n° 103 du CCNE (décembre 2007).
499 () Audition du 7 juillet 2009.
500 () Henri Atlan, Tests génétiques, questions scientifiques, médicales et sociétales, Inserm, 2007, p. XI.
501 () Les données Orphanet dénombrent 5676 maladies rares, au 13 novembre 2009.
Cf. http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/index.php?lng=FR.
502 () Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 pris en application de l’article L. 1131-6 du code de la santé publique.
503 () Articles L. 1131-2 et R. 1131-3 du code de la santé publique.
504 () Agence de la biomédecine, Bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.57.
505 () Assemblée nationale, 2ème séance du 16 janvier 2002.
506 () Cet exemple a été porté à la connaissance du rapporteur de la mission d’information par une lettre en date du 29 septembre 2009 de Mme Dominique Stoppa Lyonnet qui rapporte une situation médicale décrite par le Pr. Marie Germain Bousser, chef du service de neurologie de l’hôpital Lariboisière.
507 () http://infodoc.inserm.fr/test_genetiques/2-principe/3-diversite-application.html)
508 () § 35 du rapport explicatif.
509 () Article L. 1131-2 du code de la santé publique.
510 () Par exemple 5 % des cancers du sein sont liés à des anomalies sur les gènes BRCA1 et BRCA2.
511 () Cf. chapitre 3 du présent rapport.
512 () Audition du 8 juillet 2009.
513 () Audition du 7 juillet 2009.
514 () Un chercheur de l’Université de Standford a annoncé en août 2009 avoir séquencé un génome entier pour un coût de 50 000 dollars.
515 () Audition du 8 juillet 2009.
516 () Idem.
517 () Audition du 8 juillet 2009.
518 () Article L.5221-1 et suivants du code de la santé publique.
519 () Article L. 5221-1 du code de la santé publique
520 () § 58 du rapport explicatif au protocole additionnel à la Convention d’Oviedo relatif aux tests génétiques à des fins médicales.
521 () § 59 du rapport précité.
522 ()http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/recast_docs_2008/responses/responses_public%20consultation_recast.pdf
523 () Article L. 5311-1 du code de la santé publique.
524 () La révision de lois bioéthiques, Conseil d’Etat, mai 2009, p.56.
525 () Avis n° 99, 13 septembre 2007, " à propos d’un test (ISET-Oncologie) visant à détecter dans le sang des cellules tumorales circulantes ".
526 () Cf. avis n°99 précité.
527 () Le laboratoire espagnol Neodiagnostica s’est spécialisé dans les tests de paternité, facturés 280 euros.
528 () Le laboratoire Consumer Genetics vend ainsi un test « pink or blue » visant à déterminer le sexe de l’enfant à 7 jours de grossesse.
529 () Audition du 9 septembre 2009.
530 () Audition du 7 juillet 2009.
531 () An agenda for personalized medicine, Pauline C. Ng1, Sarah S. Murray2, Samuel Levy3 & J. Craig Venter1 ; http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7265/full/461724a.html
532 () Consultation prévue à l’article R.1131-5 du code de la santé publique.
533 () CCNE, avis n° 86 du 4 novembre 2004, Problèmes posés par la commercialisation d’autotests permettant le dépistage de l’infection VIH et le diagnostic de maladies génétiques.
534 () CJCE, affaire n° C-322/01, Deutscher Apothekerverband eV contre 0800 DocMorris, Jacques Waterval
535 () Cf.rapport précité, p.56.
536 () L’Europe compte néanmoins plusieurs laboratoires se consacrant à ce type de commerce, en particulier au Royaume Uni, en Espagne et en Allemagne.
537 () Réflexions et propositions de la Fédération Française de génétique humaine en vue de la révision de la loi relative à la bioéthique (janvier 2009), p.3.
538 () Cf. rapport précité, p.57.
539 () http://www.hgc.gov.uk/Client/document.asp?DocId=214&CAtegoryId=3
540 () Cette profession médicale a été créée par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Le conseiller en génétique exerce sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique. Il est titulaire du master sciences de la santé, mention pathologie humaine, spécialité conseil en génétique et médecine prédictive, délivré par l’Université Aix-Marseille-II.
541 () CCNE, Avis n°76, A propos de l’obligation d’information génétique familiale en cas de nécessité médicale, 24 avril 2003.
542 () Audition du 8 juillet 2009.
543 () Article 223-6 du code pénal.
544 () Rapport Sénat n° 333 (2003-2004) de M. Francis Giraud, fait au nom de la commission des affaires sociales (3 juin 2004).
545 () Assemblée nationale, 1ère séance du jeudi 8 juillet 2004, intervention de M. Pierre Louis Fagniez.
546 () Cf. décision du Conseil constitutionnel n°82-144 DC du 22 octobre 1982 : le législateur ne peut « dénier dans son principe même le droit des victimes d’actes fautifs […] à l’égalité devant la loi et devant les charges publiques. »
547 () Sénat, séance du 8 juillet 2004.
548 () Cf. rapport précité, p.58.
549 () L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose que la « volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de contagion. ». L’exception ne valant pas pour une anomalie génétique, le principe bénéficie aussi bien à la personne testée qu’aux membres de sa parentèle.
550 () Délibération du 6 juillet 2007.
551 () Audition du 28 janvier 2009.
552 () Article. 19 § 3 de la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine, 8 octobre 2004.
553 () Audition du 15 septembre 2009.
554 () § 140 du rapport explicatif.
555 () Audition du 15 septembre 2009.
556 () Fédération Française de génétique humain ( document précité).
557 () Audition du 15 décembre 2009.
558 () Article L.1110-4 du Code de la santé publique.
559 () Audition du 7 juillet 2009.
560 () Audition du 9 septembre 2009.
561 () Idem.
562 () États généraux de la bioéthique, rapport final, Annexe II.
563 () Audition du 9 septembre 2009.
564 () Audition du 8 juillet 2009.
565 () Audition du 22 juillet 2009.
566 () Audition du 22 juillet 2009.
567 () Fédération Française de génétique humaine, document précité.
568 () Audition du 22 juillet 2009.
569 () § 59 du rapport.
570 () Audition du 9 septembre 2009.
571 () CCNE, Avis sur les problèmes éthiques liés aux diagnostics anténatals, Avis n° 107, 15 octobre 2009.
572 () Tests génétiques, Questions scientifiques, médicales et sociétales, Inserm, 2007, p.90.
573 () Par exemple 35 % des patients ne répondent aux béta-bloquants Cf. La pharmacogénétique en 2008 : états des lieux et perspectives. Proposition de création d’un réseau national hospitalier. Décembre 2008.
574 () Audition du 9 septembre 2009.
575 () Cf. La pharmacogénétique en 2008, p. 42.
576 () Il s’agit des tumeurs présentant la mutation du gène K-RAS.
577 () Audition du 9 septembre 2009.
578 () Rapport Inserm précité, p. 98.
579 () Le même rapport de l’Inserm envisage les conséquences que pourront avoir les tests pan génomique « Il est probable que ces génotypages étendus pourront être réalisés dès la naissance. Ces informations seront alors utilisées au cours de la vie, et on peut imaginer qu’en fonction du traitement nécessaire, des logiciels de prescription et/ou d’adaptation de posologie nous indiqueront que ce médicament est contre-indiqué chez ce patient ou qu’il faut réduire les posologies d’un certain facteur ou qu’il faut renforcer la surveillance biologique vis-à-vis de tel ou tel événement indésirable. » (p.99).
580 () Audition du 9 septembre 2009.
581 () Cf. http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/aap/2006/aap-cebs-2006.pdf
582 () Cf. Institut national du cancer, bilan 2008, perspectives 2009 des actions pour la valorisation scientifique des ressources biologiques http://www.e-cancer.fr/Recherche/Ressources-biologiques/Documentation-institutionnelle/Documents-officiels-INCa/op_com_fichiers-it_806-la_1-ve_1.html
583 () http://www.e-cancer.fr/Recherche/Ressources-biologiques/Tumorotheque-Virtuelle-Nationale/op_1-it_751-la_1-ve_1.html
584 () http://www.chu-lyon.fr/internet/chu/directions_centrales_instances/delegation_recherche/crb/sommaire_crb.htm
585 () Biobanking and Biomolecular Ressources Research Infrastructure.
586 () Public Population Project in Genomics
587 () http://www.biobanque-picardie.com/
588 () Audition du 9 septembre 2009.
589 () Article L. 1243-3 du code de la santé publique.
590 () Article L. 1243-4 du code de la santé publique.
591 () Cf. article 54 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés individuelles
592 () Cf. article 54 précité, 5ème alinéa, et décision de la CNIL du 5 janvier 2006 relatif à la méthodologie de référence MR-001.
593 () Audition du 9 septembre 2009.
594 () Article. R. 1243-63 du code de la santé publique.
595 () Article. R. 1243-68 du code de la santé publique.
596 () Article 24 de la Recommandation Rec (2006) 4 du Comité des ministres aux Etats membres sur la recherche utilisant du matériel biologique humain.
597 () Réponse à un questionnaire du rapporteur, 20 octobre 2009.
598 () Avis n°77, Problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique et les données d’information associées : biobanques, biothèques (20 mars 2003).
599 () Articles R.1243-53 et R.1243-66 du code de la santé publique.
600 () Audition du 9 septembre 2009.
601 () Audition du 9 septembre 2009.
602 () Rapport n°1377 sur la proposition de loi n°1372 de M. Olivier Jardé relative aux recherches sur la personne.
603 () La transformation des comités consultatifs de protection des personnes en matière de recherche biomédicale (CCPPRB) en comités de protection des personnes (CPP) en application de la loi du 9 août 2004 ; IGAS, juillet 2005.
604 () Rapport n° 34 (2009-2010) de Mme Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 14 octobre 2009.
605 () Audition du 22 juillet 2009.
606 () Cf. JO Sénat du 08/07/2009 – page 6657 – réponse à la question orale sans débat n° 0571S de M. Jean-Claude Etienne.
607 () Le GIS « IBiSA »(Infrastrutures en Biologie Santé et Agronomie) a été créé en mai 2007 ; Les membres actuels du GIS sont l’INSERM, le CNRS, l’INRA, le CEA, l’INRIA, l’INCa (Institut National du Cancer), la CPU (Conférence des Présidents d’Université), et les deux directions du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche(la DGRI et la DGES).
608 () Cf. rapport cité, p.68.
609 () Les actions d’état sont soumises à une prescription décennale et non plus trentenaire selon l’article 321 du code civil.
610 () Cf. chapitre 8 du présent rapport.
611 () Décision n°2007-557 DC, du 15 novembre 2007.
612 () CCNE, Avis n° 100, Migration, filiation et identification par empreintes génétiques.
613 () Les dispositions légales concernant le FNAEG figurent aux articles 706-54 à 706-56-1 et R. 53-9 à R. 53-21 du code de procédure pénale.
614 () Article 706-56 du code de procédure pénale.
615 () Rapport d’information n° 1548 de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti sur les fichiers de police, déposé le 24 mars 2009.
616 () Article L. 706-54, alinéa 3, du code de procédure pénale.
617 () Cf. proposition n°24 du rapport précité.
618 () Proposition n° 1659 relative aux fichiers de police, déposée le 7 mai 2009
619 () Articles 4 et 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
620 () Article L.1141-1 du code de la santé publique, introduit pas l’article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
621 () Article 62 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
622 () Les articles L.1141-2 à L.1141-4 du code de la santé publique définissent le cadre d’une convention d’assurance en cas de risque aggravé de santé.
623 () Article 1964 du code civil.
624 () Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen, §. 1, 24-04-09.
625 () Loi fédérale sur l’analyse génétique du 8 octobre 2004, article 27.
626 () Article L. 122-45 ancien, introduit par l’article 4 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
627 () n°231869, 236838, 9 octobre 2009.
628 () CCNE, avis n°80, Orientation de travailleurs vers un poste comportant un risque. Rôle du médecin du travail et réflexions sur l’ambiguïté du concept d’aptitude (4 décembre 2003).
629 () Commentaire de l’article 12 de la Convention d’Oviedo, §. 85 du rapport explicatif.
630 () La personnalité juridique apparaît à la naissance de l’enfant, sous réserve qu’il soit vivant et viable. Une atténuation à cette règle est apportée : l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
631 () Audition du 13 mai 2009.
632 () Cf. la partie du présent rapport consacrée à la personnalité juridique des fœtus décédés, nés vivants et viables.
633 () Cf. Arrêts des 30 juin 1999, 29 juin 2001, 25 juin 2002 et 27 juin 2006.
634 () Cass. Crim. 2 décembre 2003.
635 () TA Amiens, 9 mars 2004, n°02145
636 () Le tribunal a fixé à 10 000 euros le montant de cette réparation.
637 () Cour administrative d’appel de Douai, 6 décembre 2005, n° 04DA00376.
638 () Audition du 18 mars 2009
639 () CA Paris, 3e ch. B, n° 03PA00950
640 () Audition du 20 janvier 2009.
641 () Arrêt Vo c. France, considérant 82, 8 juillet 2004.
642 () § 5 du rapport explicatif au protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la bioéthique portant interdiction du clonage d’êtres humains.
643 () Cf. rapport Warnock, 1984.
644 () Lucien Sève, Qu’est-ce que la personne humaine ? Bioéthique et démocratie, p.67,. Ed. La Dispute, 2006
645 () Règle 28 de la Convention sur le brevet européen.
646 () Article 53 a) de la Directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (98/44/CE).
647 () Décision de la Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, G 2/06 WARF/Thomson, 25 novembre 2008.
648 () Sur la question de la brevetabilité du vivant cf. chapitre VI du présent rapport.
649 () Cette anonymisation est réversible lorsqu’une finalité médicale ou de santé publique l’exige.
650 () Du 1er septembre 2004 au 6 février 2006 les dossiers ont été instruits dans le cadre d’un dispositif transitoire reposant sur un comité ad hoc sous la compétence des ministres chargés de la recherche et de la santé.
651 () Cf. ABM, Rapport annuel 2008, p.63.
652 () Article L. 2151-5 du code de la santé publique.
653 () Audition du 28 janvier 2009.
654 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.63.
655 () – une cellule souche engendre une diversité de cellules différenciées pendant une période prolongée (virtuellement indéfinie) ;
– les cellules souches totipotentes sont à l’origine de tous les tissus, y compris les tissus extra embryonnaires ;
– les cellules souches pluripotentes donnent naissance à des dérivés des trois feuillets (ectoderme – plans de couverture du corps et système nerveux –, endoderme – revêtements des appareils digestifs respiratoires – et mésoderme – squelette, tissu conjonctif commun et tissu musculaire) à l’exception des annexes (placenta) ;
– les cellules souches multipotentes donnent naissance à des dérivés d’un seul feuillet ;
– une cellule souche unipotente est une cellule qui ne peut être à l’origine que d’un seul type cellulaire.
656 () Bilan d’application de la loi du 6 août 2004, p.59.
657 () Revue générale de droit médical, n°29, 2008.
658 () Audition du 9 avril 2009.
659 () Cf. La lettre mensuelle Généthique de septembre 2009 ; http://www.genethique.org/parus/lettres/2009/Septembre.asp
660 () Audition du 9 avril 2009.
661 () Unité Inserm 861 : I-stem.
662 () Cf. les travaux menés à l’hôpital des armées de Percy, cités ci-après.
663 () The Lancet, 21 novembre 2009.
664 () Cf. Des cellules souches embryonnaires humaines pour la thérapie cellulaire de la maladie de Huntington, L. Aubry, M. Peschanski, A. L. Perrier, Médecine et science, n°4, vol.25, avril 2009.
665 () Cf. Les cellules souches embryonnaires et la pharmacologie, Delphine Laustriat, Jacqueline Gide, Céline Héchard et Marc Peschanski, Médecine et science,, hors série n°2, vol 25 mai 2009.
666 () Stem celle in productive toxicology. A report of a scoping study from the Stem Cells in Predictive Toxicology Task Force, for the Department of Health and the Department of Trade and Industry http://www.sc4sm.org/downloads/SC4PT-REPORT.pdf
667 () Editorial de M. Marc Peschanski cellules souches : l’heure venue du changement d’échelle, Médecine et Science, n°4, vol. 24, avril 2008.
668 () Cf. Editorial précédemment cité.
669 () Cf.rapport sur les recherches sur le fonctionnement des cellules humaines par M. Alain Claeys, 6 décembre 2006 ; rapport sur la loi de bioéthique de demain par MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte, 17 décembre 2008.
670 () Cf. Cellules souches et choix éthiques, rapport au PremierMministre de Pierre-Louis Fagniez, député, juillet 2006, p.32 et s.
671 () Cf. rapport d’information fait au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le potentiel thérapeutique des cellules souches extraites du sang de cordon ombilical, 4 novembre 2008.
672 () Audition du 29 avril 2009.
673 () Idem..
674 () Cf. La thérapie cellulaire aujourd’hui et demain, Christine Dosquet, Revue générale de droit médical, n°29, 2008.
675 () Inserm Actualités.
http://www.inserm-actualites.com/immunologie-hematologie-pneumologie/botheapies/18-regenerationorganeses.html.
676 () Cf. Laure Coulombel, Cellules souches de quoi parle-t-on ? Revue générale de droit médical, n°29, 2008.
677 () Travaux conduits par des équipes de l’Université d’Harvard sur la sclérose latérale amyotrophique et diverses maladies génétiques. Cf. K. Eggan and al., “Induced pluripotent stem cells generated from patients with ALS can be differentiated into motor neurons”, Science, 29 août 2008, 321 (5893) : 1218-21; G. Daley and al., “Disease specific induced pluripotent stem cell”, Cell, 6 août 2008.
678 () Correction par thérapie génique de cellules cutanées prélevées sur des patients atteints de l’anémie de Fanconi et reprogrammation des cellules indemnes en cellules hématopoïétiques saines ( Nature, 21 mai 2009).
679 () Audition du 24 juin 2009.
680 () Article 26 de la loi du 6 août 2004 : « Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, l’Agence de la biomédecine et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats respectifs des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement ».
681 () Cf. rapport précité, p.16.
682 () Audition du 3 juin 2009.
683 () Rapport de M. Alain Claeys, n°3208, 27 juin 2001.
684 () Audition du 17 juin 2009.
685 () Audition du 17 décembre 2008.
686 () Cf.rapport précité, p. 71.
687 () Audition du 15 décembre 2009.
688 () Audition du 27 janvier 2009.
689 () Audition du 13 mai 2009.
690 () Audition du 21 janvier 2009.
691 () Audition du 24 juin 2009.
692 () Cf. rapport n°3498 du 6 décembre 2006 et rapport n° 1325 du 17 décembre 2008.
693 () Cf. rapport précité p. 22.
694 () Le Conseil d’Etat a déjà recouru à un argument semblable ; il a ainsi jugé que des dispositions rendant obligatoires des vaccinations, si elles ont pour effet « de porter une atteinte limitée aux principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain » sont cependant mises en oeuvre « dans le but d’assurer la protection de la santé, qui est un principe garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958, et sont proportionnées à cet objectif ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. » n° 222741, 26 novembre 2001.
695 () Audition du 15 septembre 2009.
696 () Audition du 13 mai 2009.
697 () Audition du 1er avril 2009.
698 () Audition du 1er avril 2009.
699 () Cf. rapport précité p. 22.
700 () Article R. 2151-1 du code de la santé publique.
701 () Audition du 28 janvier 2009.
702 () Idem.
703 () Cf.rapport p. 67.
704 () Contribution du conseil d’orientation de l’ABM aux débats préparatoires à la révision de la loi de bioéthique, p.31.
705 () Cf.rapport p.67.
706 () Rapport fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthque, rapporteur M. Alain Claeys, 10 janvier 2002
707 () Article. L.1121-2 du code de la santé publique.
708 () Article. L. 1211-1 du code de la santé publique.
709 () Note de l’Ambassade de France en Allemagne, 23 février 2009. http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/base_documentaire/international/allemagne_bioethique.pdf
710 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.68.
711 () Audition du 28 janvier 2009.
712 () Cf. rapport précité p. 24.
713 () On mentionnera pour les cellules souches la question d’égalité aux soins que poserait la création de banque de sang placentaire à usage autologue ; pour les cellules iPS cf. développement ci-après.
714 () Audition du 28 janvier 2009.
715 () Contribution du Conseil d’orientation de l’ABM aux débats préparatoires à la révision de la loi de bioéthique, p.33.
716 () Rapport fait au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique, rapporteur M. Alain Claeys, 10 janvier 2002.
717 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.62.
718 () Désignés ainsi à l’article L.2151-6 du code de la santé publique.
719 () Rapport n° 128 (2002-2003) de M. Francis Giraud, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 15 janvier 2003.
720 () Article L. 1241-5 du code de la santé publique.
721 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.73
722 () Idem.
723 () CA Paris, 3e ch. B, n° 03PA009509 mai 2005 : « les cellules souches pluripotentes prélevées sur des embryons humains au stade du blastocyste ne constituent pas l’embryon et sont insusceptibles de permettre le développement d’un embryon (…) [ elles] ne peuvent par suite donner lieu à des recherches sur l’embryon. »
724 () Audition du 10 décembre 2008.
725 () Unité Inserm 861 : I-stem.
726 () In Medecine News, interview du 30 mai 2008,
http://www.medecinews.com/767/des-cellules-souches-pour-rgnrer-le-coeur.html
727 () Audition du 9 avril 2009.
728 () Audition du 10 décembre 2008.
729 () Réponse à un questionnaire du rapporteur.
730 () À l’exception notoire du formulaire de consentement établi par le service de Biologie de la reproduction du CHU de Strasbourg – Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, sous la responsabilité du Pr. S. Viville. Les couples sont informés de l’objectif de la recherche et du fait que les lignées de cellules souches dérivées sont mises à la disposition de la communauté scientifique. La possibilité de révoquer le consentement n’est cependant pas évoquée.
731 () La dérivation de cellules souches germinales mâles à partir de cellules souches embryonnaires et leur différenciation in vitro ont récemment été réalisées chez la souris. Des premières tentatives, aux résultats disputés par les spécialistes, ont été faites en 2009 par les chercheurs de l’Université de Newcastle et de l’Institut du Nord Est de l’Angleterre sur les cellules souches humaines ; si l’obtention de lointains précurseurs de gamètes paraît possible, celle de spermatozoïdes ou d’ovocytes semble beaucoup plus complexe.
732 () États généraux de la bioéthique, Partie II, Annexe, p.125
733 () Cf. partie IV-B-2 du présent rapport.
734 () Cf. Medical research coucil, 15 septembre 2006 :Code de bonnes pratiques pour l’utilisation de lignées de cellules embryonnaires: http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC003132
735 () Article R. 2151-4, 3°, du code de la santé publique.
736 () Réponse à un questionnaire du Rapporteur.
737 () Rapport précité p. 25.
738 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.72.
739 () Cf. document précité.
740 () Canada : Projet de règlement à la loi sur la procréation assistée
http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0635-f.htm
741 () La disposition législative prévoyant la révocabilité du consentement ne figure qu’en note dans les formulaires de consentement. Il est à regretter que ce droit du couple donneur ne fasse pas l’objet d’une présentation plus explicite.
742 () Audition du 1er avril 2009.
743 () Audition du 6 mai 2009.
744 () Audition du 28 janvier 2009.
745 () Article 16-4 du code civil et articles. L .2151-2 à L. 2151-4 du code de la santé publique.
746 () Article 511-18 du code pénal.
747 () Article 214-2 du code pénal.
748 () Proposition n°2346 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
749 ( Réunion de la commission des lois du 30 novembre 2005.
750 () Audition du 11 février 2009.
751 () Audition du 5 novembre 2008.
752 () Audition du 14 janvier 2009.
753 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.76.
754 () Rapport de l’Opecst, La loi bioéthique de demain, n°1325, p. 260.
755 () Audition du 5 novembre 2008.
756 () Audition du 11 février 2009.
757 () Article L. 2151-2 du code de la santé publique.
758 () Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende
759 () Audition du 5 novembre 2008
760 () Idem.
761 () Audition du 11 février 2009.
762 () Idem.
763 () Article L. 1121-5 du code de la santé publique : « Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :
– soit l’importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l’enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
– soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d’une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
764 () Première lecture Sénat, 29 janvier 2003.
765 () 2ème lecture AN, 2ème séance du 11 décembre 2003.
766 () Cf. rapport précité, p.45.
767 () En ce sens on peut s’interroger sur la base légale de deux dispositions figurant dans l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation. La première dispose que les techniques de préparation, de fécondation, de culture ou de conservation des gamètes ou des embryons, « non validées par la littérature ou par l’usage et qui relèvent de l’innovation sont soumises aux règles relatives aux recherches biomédicales. » La seconde pose que le centre autorisé pour la mise en oeuvre de l’accueil d’embryons tient compte des risques pour l’enfant notamment « lorsque les conditions d’obtention de l’embryon ont fait appel à une technique non validée. »
768 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.70.
769 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.48.
770 () Audition du 18 février 2009. Cf. également la prise de position de la Fédération française des CECOS à l’occasion des états généraux de la bioéthique : http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/base_documentaire/exp/cecos.pdf
771 () Arrêté prévu par l’article L. 2141-1 du code de la santé publique.
772 () Réponse à un questionnaire du Rapporteur.
773 () Réponse à un questionnaire du Rapporteur.
774 () Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2151-5 : « A titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. » Le renvoi aux conditions posées dans ces derniers alinéas fait tomber la distinction entre études et recherches
775 () Le décret n°97-613 du 27 mai 1997 disposait qu’ « aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d’avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l’embryon, ou est susceptible d’altérer ses capacités de développement. »
776 () Audition du 7 juin 2000.
777 () Audition du 12 juillet 2000.
778 () La loi bioéthique de demain, n°1325, p.179.
779 () Cf. rapport précité, p.45.
780 () Une proposition de loi de M. Olivier Jardé, relative aux recherches sur la personne adoptée à l’Assemblée nationale le 22 janvier 2009 et au Sénat le 16 novembre 2009 définit un nouveau cadre de recherche en particulier pour les recherches interventionnelles ne comportant que des risques et des contraintes négligeables et ne portant pas sur des médicaments ainsi que pour les recherches non interventionnelles, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance.
781 () Audition du 22 juillet 2009.
782 () Rapport ABM, bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, p.48.
783 () Article L .2151-2 du code de la santé publique.
784 () Article L. 2151-5 du code de la santé publique.
785 () Cf. rapport précité, p.46.
786 () Cf. art. L.1121-5 du code de la santé publique.
787 () Cf.rapport précité, p.46.
788 () Dans le cadre des techniques d’AMP, entrent dans cette catégorie les dispositifs médicaux agissant par des moyens physiques ou mécaniques et les médicaments dont le mode d’action principal est obtenu par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques.
789 () Audition du 10 juin 2009.
790 () Audition du 3 février 2009.
791 () Audition du 4 février 2009.
792 () Audition du 13 mai 2009.
793 () Audition du 10 juin 2009.
794 () Cf. proposition n° 12, chapitre I du présent rapport.
795 () Audition du 10 décembre 2008, de M. Philippe Pouletty.
796 () Idem.
797 () Audition du 6 octobre 2009.
798 () Audition du 10 décembre 2008.
799 () Audition du 6 octobre 2009.
800 () Audition du 6 octobre 2009.
801 () Audition du 16 septembre 2009.
802 () Jurisclasseur n° 4241, § 51.
803 () Avis sur la non-commercialisation du génome humain, décembre 1991.
804 () Audition du 6 octobre 2009.
805 () Audition du 6 octobre 2009.
806 () Audition du 6 octobre 2009.
807 () Décision du 25 novembre 2008.
808 () Cet article reprend l’article 6 de la directive.
809 () Audition du 6 octobre 2009.
810 () Audition du 14 janvier 2009.
811 () Audition du 6 octobre 2009.
812 () CA Paris, 3e ch. B, n° 03PA00950.
813 () Idem.
814 () Audition du 6 octobre 2009.
815 () Idem.
816 () Ibid.
817 () Audition du 6 octobre 2009.
818 () Cf. Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique et Conseil d’Etat, décision, n°298348 du 30 octobre 2009.
819 () Audition du 16 septembre 2009.
820 () Audition du 6 octobre 2009.
821 () Réponse écrite au questionnaire du rapporteur.
822 () Audition du 13 mai 2009.
823 () Audition du 24 juin 2009.
824 () La révision des lois de bioéthique, mai 2009, p.77.
825 () Anne Dannon-Grilliat, Don, dette et culpabilité, Laennec 2/ 2003.
826 () Loi du 15 novembre 1877 sur la liberté des funérailles et loi n° 49-890 du 7 juillet 1949, dite loi Lafay.
827 () Il semblerait que seuls l’Arabie saoudite et l’Iran rémunéreraient officiellement les donneurs de rein, Rapport ABM, Étude comparative de l’encadrement juridique international, p 9.
828 () Marina Alvarez, le modèle espagnol, Donner, recevoir un organe, Presses universitaires de Strasbourg, p.43, 2009.
829 () Audition de M. Carlos de Sola, chef du département de bioéthique du Conseil de l’Europe, 15 janvier 2009.
830 () Carine Camby, don d’élément du corps humain et gratuité, Revue politique et parlementaire, 1050, janvier, février, mars 2009.
831 () David Rodriguez Arias Vailhen, Lumières et ombres du modèle espagnol de transplantation d’organes, www.ethique.inserm.fr.
832 () David Rodriguez-Arias Veilha, Discussion sur le consentement présumé ou explicite pour le don d’organes, www.ethique.inserm.fr.
833 () Hamm, D. and J.Tizard (2008), presumed consent for organ donation, Bmi 336 (7638):230.
834 () Les dons de foie seraient passés de 10, 9 à 41,3 par million d’habitant sur une période de trois ans.
835 () Demain la greffe, manifeste pour le don et la greffe d’organes www.etats généraux de la bioéthique.fr.
836 () A systematic review of presumed consent systems for deceased organ donation, Health Technology Assesment May 2009, vol.13, n°26.
837 () Dr Elisabeth Lepresle, la dimension philosophique, in La diversité des stratégies de lutte contre la pénurie d’organes en Europe, Ministère des affaires étrangères et européennes et Commission nationale française pour l’Unesco, 5 et 6 mai 2009.
838 () Jean-René Binet, Protection de la personne, art.16 à 16-3, fasc.10, JCL, § 12.
839 () Audition du 28 janvier 2009.
840 () La révision des lois de bioéthique, p.76.
841 () Transplantation d’organes et de tissus humains, OMS, EB123 /5, 18 avril 2008.
842 () Conesa Bernal, C.A. Rios Zambudio, Population attitude toward presumed consent legislation to cadaveric organ donation, Med. Clin 122(2) 67-9.
843 () Audition du 24 juin 2009.
844 () Audition du 30 juin 2009.
845 () P. Tuppin, V. Moysan, A. Tenaillon et M. Kessler, Le nombre de donneurs d’organes en mort encéphalique peut-il augmenter en France ?, Néphrologie et Thérapeutique, 16. 09. 2009.
846 () BA Roza, J.Schirmer, JO Medina-Pestana, Academic community response to the brazilian legislation for organ donation , Transplant Proc., 2002, Mar, 34 (2) 447-8.
847 () P. Tuppin, V. Moysan, A.Tenaillon et M. Kessler, Le nombre de donneurs d’organes en mort encéphalique peut-il augmenter en France ? , Néphrologie et Thérapeutique, 16. 09. 2009.
848 () Audition du Professeur Jean-Michel Dubernard du 10 juin 2009.
849 () P. Tuppin, V. Moysan, A.Tenaillon et M. Kessler, Le nombre de donneurs d’organes en mort encéphalique peut-il augmenter en France ? , Néphrologie et Thérapeutique, 16 .09. 2009.
850 () P. Tuppin, V. Moysan, A.Tenaillon et M. Kessler, Le nombre de donneurs d’organes en mort encéphalique peut-il augmenter en France ? , Néphrologie et Thérapeutique, 16.09.2009.
851 () Dr Patrick Jambou et Dr Daniel Maroudy, l’impact prometteur de la méthode « donor action » en France, in La diversité des stratégies de lutte contre la pénurie d’organes en Europe, Ministère des affaires étrangères et européennes et Commission nationale française pour l’Unesco, 5 et 6 mai 2009.
852 () A. Tenaillon, Aspects éthiques des prélèvements d’organes sur donneurs décédés après arrêt cardiaque, Le courrier de la transplantation, Volume IX , n°2 , avril, mai, juin 2009.
853 () .A. Tenaillon, Aspects éthiques des prélèvements d’organes sur donneurs décédés après arrêt cardiaque, Le courrier de la transplantation, Volume IX , n°2 , avril, mai, juin 2009.
854 () Audition du 21 juillet 2009.
855 () Dr Patrick Jambou et Dr Daniel Maroudy, l’impact prometteur de la méthode « donor action » en France, in La diversité des stratégies de lutte contre la pénurie d’organes en Europe, Ministère des affaires étrangères et européennes et Commission nationale française pour l’Unesco, 5 et 6 mai 2009.
856 () Rapport annuel 2007 Rein.
857 () Propositions de l’assurance maladie sur les charges et produits pour l’année 2009, conseil CNAMTS 9 juillet 2009.
858 () A systematic review of presumed consent systems for deceased organ donation, Health Technology Assesment May 2009, vol.13, n°26.
859 () Transplantation d’organes et de tissus humains, OMS, EB123 /5, 18 avril 2008.
860 () Prélèvements à cœur arrêté, enjeux éthiques, Espace éthique de l’assistance publique –hôpitaux de Paris.
861 () A. Tenaillon, Aspects éthiques des prélèvements d’organes sur donneurs décédés après arrêt cardiaque, Le courrier de la transplantation, Volume IX , n°2 , avril, mai, juin 2009.
862 () Audition de M. Jean-Michel Boles du 30 juin 2009.
863 () Jean-Michel Boles, Questions éthiques à propos des prélèvements d’organes sur des donneurs à cœur arrêté : une modification profonde du rapport à la mort, Etudes, novembre 2008.
864 () D. Ysebaert and others, Organ procurement after euthanasia procedure-belgian experience, Transplantation Centers of Antwerp University hospital, University Hospital Gasthuisberg Leuven and CHU de Liège, University of Liège.
865 () Second belgian meeting on transplantation of organs from non heart beating donors , Brussel 22 may 2008
866 () Audition du 24 juin 2009.
867 () Transplantation d’organes et de tissus humains, OMS, EB123 /5, 18 avril 2008.
868 () Idem.
869 () Le greffon est en ischémie chaude lorsqu’il n’est plus perfusé du fait d’un arrêt cardiaque ou du fait du clampage de l’artère l’irriguant sans mise en hypothermie consécutive.
870 () A. Tenaillon, Aspects éthiques des prélèvements d’organes sur donneurs décédés après arrêt cardiaque, Le courrier de la transplantation, Volume IX , n°2 , avril, mai, juin 2009.
871 () Solidaires devant la fin de vie, Jean Leonetti, Rapport d’information Assemblée nationale n°1287.
872 () Décret modifiant l’article R.4127-37 du code de la santé publique, adopté par le la section sociale du Conseil d’Etat le 27 octobre 2009.
873 () Rapport Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique, p.78.
874 () Le N20 (N pour négative, polarité vers le haut) après 20 ms.
875 () Audition du Professeur Louis Puybasset du 30 juin 2009.
876 () L’abord des proches, Le don d’organe : une ressource fragile et limitée, Alain Tenaillon, La revue du praticien, vol.57, 15 février 2007.
877 () Daniel Maroudy, Organ procurement: proposals for approaching the family of the deceased, Organs, Tissues and cells (3) 187-195, 2008.
878 () Audition du 24 juin 2009.
879 () Audition du 30 juin 2009.
880 () Audition du Professeur Bruno Riou du 24 juin 2009.
881 () P. Willem Weimar, les dons croisés, les bons samaritains, l’expérience des Pays-Bas, La diversité des stratégies de lutte contre la pénurie d’organes en Europe, Ministère des affaires étrangères et européennes, Commission nationale française pour l’Unesco, 5 et 6 mai 2009.
882 () Audition du Professeur Jean-Michel Dubernard du 10 juin 2009.
883 () Audition du 30 juin 2009.
884 () Christian Hiesse, greffe de rein, la revue du praticien, vol.57,15 février 2007.
885 () Yves Chapuis, le recours aux donneurs vivants en transplantation d’organes, rapport adopté le 24 mars 2009 devant l’Académie nationale de médecine.
886 () Bilan d’application de la loi du 6 août 2004.
887 () Auditions du 30 juin 2009.
888 () Anna Varberg Reisaeter, Le modèle scandinave – L’expérience norvégienne, Donner, recevoir un organe, Presses universitaires de Strasbourg, 2009, p.51.
889 () Bundessozialgericht, 10.12.2003, B9VS 1/01R.
890 () Rapport Assemblée nationale, 3528, Bioéthique, 1ère lecture, p.68.
891 () Audition du 3 novembre 2009.
892 () Jean Gustave Hentz, gratuité, anonymat et consentement présumé dans les dons d’organes in Donner, recevoir un organe, Presses universitaires de Strasbourg 2009.
893 () Carine Camby, don d’éléments du corps humain et gratuité, Revue politique et parlementaire, 1050, janvier, février, mars 2009.
894 () Le Monde, 29 août 2009.
895 () Transplantation d’organes et de tissus humains, OMS, EB123 /5, 18 avril 2008.
896 ()Transplantation d’organes et de tissus humains, OMS, EB123 /5, 18 avril 2008.
897 () Yves Chapuis, le recours aux donneurs vivants en transplantation d’organes, rapport adopté le 24 mars 2009 devant l’Académie nationale de médecine.
898 () Idem .
899 () Biolédecinemag.décembre 2009, n°5 , Agence de la biomédecine.
900 () Audition du docteur Marc Benbunan, et du docteur Jérôme Larghero du 1er avril 2009.
901 () Audition du 29 avril 2009.
902 () Audition du docteur Marc Benbunan, et du docteur Jérôme Larghero du 1er avril 2009.
903 () Audition de M. Jacques Hardy et de Mme Isabelle Desbois du 9 avril 2009.
904 () Proposition de loi n° 2058 relative au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du sang de cordon ombilical
905 () Audition du 15 décembre 2009.
906 () Rapport d’information Sénat n°79.
907 () Audition du 9 avril 2009.
908 () Audition de Mme Eliane Gluckmann du 1er avril 2009.
909 () Audition de MM. Bendunan et Larghero du 1er avril 2009.
910 (4) Arrêté du 14 septembre 2009 fixant le contenu du dossier accompagnant la demande d’autorisation ou la demande de renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques (JO du 11 octobre 2009).
911 () Audition du 3 novembre 2009.
912 () Cf. infra, chapitre X.
913 () Assemblée nationale, Rapport n°664 de M. Philippe Gosselin, sur la proposition de loi relative à la législation funéraire (30 janvier 2008.
914 () Article 16-9 du code civil.
915 () Cour d’appel de Paris, 09/09315, Encore Events/association Ensemble contre la peine de mort, 30 avril 2009.
916 () Cour d’appel de Paris, arrêt du 30 avril 2009, n°09/09315.
917 () Audition du 7 octobre 2009.
918 () Mission interministérielle en vue d’une réforme de la médecine légale, rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des services judiciaires (janvier 2006).
919 () Ainsi, les autopsies sont dites médicales lorsqu’elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire, dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès.
920 () CEDH, 3ème section, 30 octobre 2001, requête n° 37794/97, Panullo et Forte contre France.
921 () Cour de Cassation, chambre criminelle, 01-81592, 3 avril 2002.
922 () Audition du 7 octobre 2009.
923 () Audition du 7 octobre 2009.
924 () Succession de Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark, n°1338/03, 15 mai 2006.
925 () Première chambre civile de la Cour de cassation, n° 98-12806, 28 mars 2000.
926 () Cf. rapport précité, p. 68.
927 () Cf. rapport précité, p. 70.
928 () Cf. rapport précité, p. 70.
929 () 25 novembre 1999 : Conseil d’Etat, étude : Les lois de la bioéthique : cinq ans après, p.105-106
930 () L’article 11 du nouveau code de procédure civile dispose que, dans le contentieux entre vifs : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. »
931 () Audition du 4 mars 2009.
932 () Certaines analyses biomédicales demeurent possibles si le défunt a laissé des éléments de son corps prélevés de son vivant. Certains commentateurs y voient une incohérence de la législation : « on pourrait se servir d’un échantillon sanguin prélevé du vivant d’une personne ou même après son décès pour faire procéder à une analyses des sangs ; on ne pourrait pas procéder à une expertise génétique à partir d’échantillons corporels (cheveux, peau, salive, ongles…), prélevés du vivant de cette personne ou recueillis après son décès. » (Jacques Massip, Defrénois, 2007, p. 1644.)
933 () Audition du 7 octobre 2009.
934 () Cf. rapport Assemblée nationale n° 664 du 30 janvier 2008 de M. Philippe Gosselin.
935 () Proposition n° 761, de M. Jean-Claude Bouchet (27 mars 2008).
936 () Proposition n°832, de M. Jacques Remiller, (24 avril 2008).
937 () Cf. rapport Assemblée nationale n° 770 du 2 avril 2008 de M. Gilles Bourdouleix.
938 () CCNE, avis n° 89, A propos de la conservation des corps de fœtus et enfants mort-nés, 22 septembre 2005.
939 () Cf. Instruction générale relative à l’état civil, article 466.
940 () Cf. articles R.1112-75 à R.1112-76-1 du code de la santé publique.
941 () Cf. décret n°2008-32 du 9 janvier 2008 et arrêté du 9 janvier 2008.
942 () Rapport de Mme Trapero, conseiller rapporteur.
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/trapero_conseiller_11186.html)
943 () Circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n°2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.
944 () Circulaire du 30 novembre 2001 précitée.
945 () Cité dans les arrêts de la Cour de cassation rendus le 6 février 2006. cf infra.
946 () Audience publique du 6 février 2008, pourvois n° 06-16498, n°06-16499 et n°06-16500.
947 () Cf. site Internet de l’UNAF : http://www.unaf.fr/spip.php?article7492
948 () Cf. site Internet de Choisir la cause des femmes
http://www.choisirlacausedesfemmes.org/communique10.htm.
949 () Cf. PV du 7 octobre 2009.
950 () La majorité des pays européens fixe de préférence une limite de viabilité autour de 24 semaines de grossesse. Cf. Les enfants sans vie, Législation comparée, Sénat, avril 2008.
951 () Courrier international, 31 janvier 2008.
952 () Les Échos, 16 avril 2009, p. 13.
953 () Audition du 18 novembre 2008.
954 () Audition du 13 mai 2009.
955 () Rapport OPECST, p. 221 et suivantes.
956 () Cet organisme, rattaché au Premier Ministre, a pour mission d’éclairer le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle.
957 () Audition du 22 septembre 2009.
958 () Audition du 15 septembre 2009.
959 () .Audition du 15 septembre 2009.
960 () Cf. la note de veille n° 150 du Centre d’analyse stratégique, « Les interfaces cerveau-machine », rédigée en septembre 2009 par MM. Olivier Oullier et Pierre-Henry Suet.
961 () Audition du 15 septembre 2009.
962 () Source : Ministère de la Recherche.
963 () Audition du 15 septembre 2009.
964 () Audition du 22 septembre 2009.
965 () Cf. notamment Bernard Baertschi, La neuroéthique. Ce que les neurosciences font à nos conceptions morales, Paris, La découverte, 2009.
966 () Audition du 15 septembre 2009.
967 () Audition du 7 octobre 2009.
968 () Audition du 22 septembre 2009.
969 () Audition du 22 septembre 2009.
970 () Cf. note de veille n° 128 du CAS rédigée par Mme Sarah Sauneron portant sur les enjeux éthiques des neurosciences (mars 2009), p. 5.
971 () Audition de M. Olivier Oullier du 22 septembre 2009.
972 () Audition du 15 septembre 2009.
973 () Pour plus de détails, cf. la note de veille n° 128 du CAS, p. 5.
974 () Audition du 22 septembre 2009.
975 () Audition du 22 septembre 2009.
976 () OPECST, p. 236.
977 () Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, Leçons d’expérience 2005-2008, 20 juin 2008, p. 59.
978 () Audition du 21 janvier 2009.
979 () Audition du 27 janvier 2009.
980 () OPECST, p. 236.
981 () Cf. le site Internet : http://www.meetingmindseurope.org/france_site.aspx?SGREF=159
982 () Audition du 15 septembre 2009
983 () « Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l’article 16-10 du code civil, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. »
984 () Audition du 21 janvier 2008.
985 () Audition du 22 septembre 2009.
986 () Cf. p. 152.
987 () UNESCO, « Éthique et politique des nanotechnologies », 2007, p. 4.
988 () Citée par le Comité d’éthique du CNRS dans son avis « Enjeux éthiques des nanosciences et nanotechnologies », 12 octobre 2006, p. 8.
989 () UNESCO, « Éthique et politique des nanotechnologies », 2007, p. 6.
990 () Source : Académie nationale de médecine, Nanosciences et médecine, juillet 2008. L’avis n° 96 du CCNE insiste également sur les possibilités d’imagerie non-invasive, le meilleur repérage des cellules à traiter et un ciblage plus important des médicaments (p. 5).
991 () Audition du 22 septembre 2009.
992 () Idem.
993 () Ibid.
994 () « Le discours ambiant présente un paradoxe, qui pose un problème éthique : on parle de développement révolutionnaire des nanosciences pour le traitement de toute une série de maladies aujourd’hui incurables ou difficiles à traiter... mais pour le moment, ce sont surtout des peintures, des capteurs d’air bag, des revêtements de route, des têtes d’imprimantes à jet d’encre, des cosmétiques… qui sont mis sur le marché par des fabricants. » (Avis n° 96 du CCNE).
995 () Comité d’éthique du CNRS dans son avis « Enjeux éthiques des nanosciences et nanotechnologies », 12 octobre 2006, p. 11.
996 () Identifiés également par M. Louis Laurent au cours de l’audition publique de l’OPECST du 7 novembre 2006 portant sur les nanotechnologies, p. 67, ces thèmes sont largement repris, sous diverses appellations.
997 () Cf. notamment l’avis n° 105 du CCNE : « Le CCNE a relevé à cet égard que les particules ultrafines (nanoparticules) sont, de manière insidieuse, de plus en plus présentes dans notre environnement et pourraient, traversant les barrières biologiques, constituer un facteur de risque de pathologie. »
998 () Cf. notamment le rapport de l’Académie nationale de médecine, Nanosciences et médecine, juillet 2008, p. 20.
999 () Roger Maynard, « Éthique des nanos… ou nanoéthique », in Reflets de la Physique, n° 6, p. 28.
1000 () Cf. notamment la contribution de Philippe Lemoine, « Nanotechnologies, informatique et libertés » à la CNIL du 12 janvier 2006.
1001 () Avis de la commission de l’éthique de la science et de la technologie du Québec, « Éthique et nanotechnologies ; se donner les moyens d’agir », p. 54 et suivantes.
1002 () Cf.p. 5.
1003 () Académie nationale de médecine, Nanosciences et médecine, juillet 2008, p. 5.
1004 () Audition du 20 janvier 2009.
1005 () Cf. p. 12-13. Didier Sicard a également dénoncé cette « biométrisation » de l’humain dans « Les problèmes éthiques posés par les nanotechnologies », in ADSP, n° 64, septembre 2008.
1006 () Cf. les travaux de Miroslav Radman, Généticien, Université Paris 5, faculté de médecine Necker et de Jean-Claude Weill, Immunologiste, Université Paris 5, faculté de médecine Necker, présentés au cours de la conférence « L’homme transgénique, des possibilités infinies », Université de tous les savoirr, 05/07/2008.
1007 () Citée par le Comité d’éthique du CNRS dans son avis « Enjeux éthiques des nanosciences et nanotechnologies », 12 octobre 2006, p. 12.
1008 () « Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive science : Converging Technologies for Improving Human Performance », juin 2002.
1009 () Audition du 7 octobre 2009.
1010 () Audition du 22 septembre 2009.
1011 () Audition du 15 septembre 2009.
1012 () Cité par Le Monde, « NBIC », 17 juin 2002.
1013 () Beyond Therapy (Au-delà de la thérapie). Biotechnology and the pursuit of happiness, 2004, p. 7.
1014 () Jérôme Goffette, Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris, Vrin, 2008.
1015 () Jérôme Goffette, Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris, Vrin, 2008, p. 10.
1016 () Audition du 15 septembre 2009.
1017 () Beyond Therapy. Biotechnology and the pursuit of happiness, 2004, p. XV.
1018 () Idem.
1019 () Préambule de la Constitution de l’OMS adoptée en 1946.
1020 () Audition du 10 décembre 2009.
1021 () Audition du 15 septembre 2009.
1022 () Audition du 7 octobre 2009.
1023 () Audition du 6 octobre 2009.
1024 () 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement, Paris Balland, 1988.
1025 () T. Souccar, Le guide des nouveaux stimulants, Paris, Albin Michel, 1997. Cette littérature est analysée par Jérôme Goffette dans son livre Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris, Vrin, 2008.
1026 () Audition du 15 octobre 2009.
1027 () Audition du 4 novembre 2008. Le même point a été souligné par M. Jean-Marie Besnier : « Le posthumanisme offre la vision – attractive pour les uns, répulsive pour les autres – d’un homme radicalement nouveau, " augmenté " ».
1028 () Audition du 22 septembre 2009.
1029 () Les « extropiens » cherchent à augmenter l’ « extropie », à savoir l’intelligence humaine en tant qu’elle est capable de faire progresser des systèmes.
1030 () Cf. infra., Chapitre 10.
1031 () Cf .la décision du Tribunal arbitral du sport CAS 2008/A/1480 Pistorius v/ IAAF award of 16 May 2008.
1032 () Cf. n° 56 de la décision ci-dessus.
1033 () 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement, Paris Balland, 1988, cité par Jérôme Goffette, Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris, Vrin, 2008.
1034 () Beyond Therapy. Biotechnology and the pursuit of happiness, 2004, p. 282.
1035 () Audition du 15 septembre 2009.
1036 () Beyond Therapy. Biotechnology and the pursuit of happiness, 2004, p. 284.
1037 ( Cf. la note n° 138 de juin 2009 du Centre d’analyse stratégique, rédigée par Mme Sarah Sauneron et M. Ollivier Oullier : « Stratégies de prévention et d’information en santé publique : quel apport des neurosciences ? ».
1038 () Audition du 15 septembre 2009.
1039 () Audition du 7 octobre 2009.
1040 () Audition du 22 septembre 2009.
1041 () Audition du 6 octobre 2009.
1042 () Audition du 20 janvier 2009.
1043 () Beyond Therapy. Biotechnology and the pursuit of happiness, 2004, p. 143.
1044 () Jérôme Goffette, Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris, Vrin, 2008, p. 69.
1045 () Idem, p. 9.
1046 () Audition du 22 septembre 2009.
1047 () Jérôme Goffette, Naissance de l’anthropotechnie. De la médecine au modelage de l’humain, Paris, Vrin, 2008, p. 143.
1048 () Tel est d’ailleurs l’encadrement que préconise M. Jérôme Goffette à la page 150 : « Concernant ce côté législatif, je me bornerai à une seule recommandation personnelle : il m’apparaît éthiquement crucial de suivre cette règle : en matière d’anthropotechnie, seul ce qui est autorisé par le législateur serait licite. »
1049 () Le 1° du II de cet article décrit le contenu du principe de précaution : « Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
1050 () Cf. « Le principe de précaution : bilan de son application quatre ans après sa consitutionnalisation. » Sénat 1er octobre 2009.
1051 () Audition du 5 novembre 2008.
1052 () Audition du 11 février 2009.
1053 () Audition du 5 novembre 2008.
1054 () Audition du 22 juillet 2009.
1055 () Audition du 18 mars 2009.
1056 () Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
1057 () Audition du 17 décembre 2008.
1058 () Audition du 27 janvier 2009.
1059 () Audition du 15 décembre 2009.
1060 () Audition du 27 janvier 2009.
1061 () Rapport OPESCT, p. 239.
1062 () Audition du 15 septembre 2009.
1063 () Audition du 14 janvier 2009.
1064 () Idem.
1065 () Audition du 14 janvier 2009.
1066 () Étude comparative de l’encadrement juridique international, p. 37.
1067 () Idem., p. 37.
1068 () Rapport du Conseil d’État, p. 102.
1069 () Idem.
1070 () Audition du 17 décembre 2008.
1071 () Audition du 13 mai 2009.
1072 () Cf. supra, chapitre 7
1073 () Audition du 25 novembre 2008.
1074 () Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
1075 () Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la bioéthique.
1076 () Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 17, 2004, p. 26.
1077 () CJCE, 9 octobre 2001, Pays-Bas c/ Parlement et Conseil.
1078 () Cf. notamment le rapport du Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution présidée par Mme Simone Veil, décembre 2008, p. 117 et suivantes.
1079 () Rapport au Président de la République, Propositions pour une révision de la Constitution, La Documentation française, 1993, p. 73.
1080 () Audition du 28 janvier 2009.
1081 () Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution présidée par Mme Simone Veil, décembre 2008, p. 135.
1082 () Rapport n° 1799, Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, juillet 2009, p. 12.
1083 () Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution présidée par Mme Simone Veil, décembre 2008, p. 132.
1084 () Audition du 18 novembre 2008.
1085 () L’ordonnance du 17 novembre 1958 désigne l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques comme une délégation.
1086 () Décision 2009-581 DC du 25 juin 2009.
1087 () Audition du 15 octobre 2008.
1088 () Audition du 28 janvier 2009.
1089 () Avis n° 82 sur l’allotransplantation de tissus composites au niveau de la face.
1090 () Audition du 28 janvier 2009.
1091 () Audition du 15 octobre 2008.
1092 () Audition du 10 décembre 2008.
1093 () Audition du 20 janvier 2009.
1094 () Audition du 28 janvier 2009.
1095 () Rapport application loi bioéthique ABM, p. 81.
1096 () Audition du 10 décembre 2008.
1097 () Audition du 3 février 2009.
1098 () Audition du 18 février 2009.
1099 () Rapport application loi bioéthique ABM, p. 15.
1100 () Audition du 4 novembre 2008.
1101 () Rapport final des États généraux de la bioéthique, p. 7.
1102 () Idem, p. 54.
1103 () Audition du 15 octobre 2008.
1104 () Cf. Partie IV, à propos des rencontres Meeting of minds, organisées dans toute l’Europe à propos des neurosciences.
1105 () Audition du 1er avril 2009.
1106 () Audition du 4 novembre 2008.
1107 () Audition du 20 janvier 2009.
1108 () Audition du 4 mars 2009.
1109 () Audition du 22 septembre 2009.
1110 () Voir notamment Meeting of Minds, Rapport final des citoyens européens, Bruxelles, 2006, p. 16-17.
1111 () Audition du 20 janvier 2009.
1112 () Audition du 27 janvier 2009.
1113 () Audition du 22 juillet 2009.
1114 () Audition du 21 juillet 2009.
1115 () Idem.
1116 () Alain Cordier, Éthique et professions de santé, mai 2003.
1117 () Voir notamment Le Monde, « Un gène éthique qui vaut de l’or », 27 novembre 2009.
1118 () Avis n° 17 du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technique auprès de la Commission européenne, « Aspects éthiques de la recherche clinique dans les pays en développement » (février 2003).
1119 () Par exemple, les Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains élaborées par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales, avec la collaboration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), prévoient que l’organisme promoteur extérieur et les investigateurs individuels doivent soumettre le protocole de recherche à une évaluation éthique et scientifique dans le pays de l’organisme promoteur.
1120 () Avis n° 41 du CCNE, « La coopération dans le domaine de la recherche biomédicale entre équipes françaises et équipes de pays en voie de développement économique » (décembre 1993) et avis n° 78 du CCNE, « Inégalités d’accès aux soins et dans la participation à la recherche à l’échelle mondiale » (septembre 2003).
1121 () « La révision des lois de bioéthique », Étude du Conseil d’État, pages 97 à 100 (mai 2009).
1122 () La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 sur l’assurance maladie ayant instauré un dossier médical personnel.
1123 () Audition publique de l’OPECST du 29 novembre 2007.
© Assemblée nationale