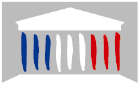N° 3929
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2011.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D’INFORMATION SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE (1)
Président
M. Bernard ACCOYER,
Président de l’Assemblée nationale,
Rapporteurs
MM. Jérôme CAHUZAC et Pierre MÉHAIGNERIE,
Députés.
——
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur la compétitivité de l’économie française et le financement de la protection sociale est composée de :
Président M. Bernard Accoyer (UMP) Vice-présidents M. Christian Blanc (NC) M. Marc Laffineur (UMP) (jusqu’au 28 juin 2011) M. Jean-Claude Sandrier (GDR) M. Alain Vidalies (SRC) Secrétaires M. Jean Grellier (SRC) Mme Laure de La Raudière (UMP) M. Pierre-Alain Muet (SRC) M. Hervé Novelli (UMP) Rapporteurs M. Jérôme Cahuzac (SRC) M. Pierre Méhaignerie (UMP) Rapporteurs suppléants M. Jean-Marie Le Guen (SRC) M. Pierre Morange (UMP) |
Membres M. Olivier Carré (UMP) M. Gérard Cherpion (UMP) M. Christian Estrosi (UMP) M. Nicolas Forissier (UMP) M. Bernard Gérard (UMP) M. Jean-Pierre Gorges (UMP) M. Alain Moyne-Bressand (UMP) M. Bernard Reynès (UMP) M. Jean-Marie Sermier (UMP) M. Jean-Charles Taugourdeau (UMP) Mme Marie-Hélène Thoraval (UMP) M. Éric Woerth (UMP) Mme Sylvie Andrieux (SRC) M. Gérard Charasse (SRC) (jusqu’au 30 janvier 2011) M. Henri Emmanuelli (SRC) (jusqu’au 11 février 2011) M. Albert Facon (SRC) M. Paul Giacobbi (SRC) (depuis le 1er février 2011) M. Marc Goua (SRC) (depuis le 12 février 2011) Mme Monique Iborra (SRC) Mme Marisol Touraine (SRC) (depuis le 18 février 2011) M. Jacques Valax (SRC) M. Jean Dionis du Séjour (NC) |
INTRODUCTION DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, PRÉSIDENT DE LA MISSION 5
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 9
CONCLUSIONS DES TRAVAUX DE LA MISSION 275
INTRODUCTION
DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
PRÉSIDENT DE LA MISSION
Au milieu d’une crise économique mondiale sans précédent depuis la Libération, la France doit affronter de nouveaux défis pour tenir son rang dans la compétition internationale tout en préservant son pacte social. De la capacité de notre pays à adapter sa structure productive, pour générer davantage d’emplois et de croissance, ainsi qu’à maîtriser sa dette publique et ses dépenses de protection sociale, dépendra son avenir économique.
Compte tenu de ces enjeux, j’ai souhaité la création d’une mission rassemblant des députés de tous les groupes, comportant deux rapporteurs, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition, afin d’établir un constat objectif et partagé sur la compétitivité de l’économie française d’aujourd’hui, sans nier ses faiblesses ni occulter ses atouts, et de s’interroger sur les perspectives du financement d’une protection sociale située au cœur du modèle français. Avant les deux rendez-vous politiques majeurs que constituent les élections présidentielle et législatives de 2012, il me semblait en effet essentiel de clarifier les termes du débat. En créant la mission, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, le 11 janvier 2011, a d’ailleurs partagé ce souci.
Dans cet esprit, la mission a entendu plus de soixante-dix personnes de tous horizons au cours de dix-neuf réunions entre février et juin de cette année. Ont été auditionnés des experts économistes, des chefs d’entreprise de petites et moyennes entreprises comme de grands groupes, des fonctionnaires des services économiques de l’État comme des services de la Commission européenne et des services statistiques, et naturellement les partenaires sociaux et le Gouvernement. Alors que d’autres personnalités auraient pu être évidemment entendues, la mission a tenu à travailler dans un calendrier resserré et clore ses auditions avant la suspension des travaux parlementaires de l’été afin que ses objectifs ne soient pas perturbés par les prémisses de la compétition électorale.
Malheureusement, il n’en a pas été ainsi : la politique, dans le mauvais sens du terme, a repris ce qu’elle croit être ses droits sur l’évaluation sereine des faits, et les deux corapporteurs, malgré plusieurs réunions, n’ont pu tomber d’accord sur un rapport commun, même limité aux constats.
Après les difficultés liées à la présence des parlementaires lors des auditions – le président de la commission des finances et corapporteur exigeant des réunions le mercredi après-midi pour n’assister finalement lui-même qu’à, à peine, six réunions sur dix-neuf, son suppléant n’assurant pas pour autant son rôle – , les corapporteurs n’ont pu aborder sereinement, comme il aurait fallu, les questions du temps de travail et du coût du travail, pourtant essentielles.
Je le regrette vivement : ce que les partenaires sociaux ont pu réussir en juin en signant une approche commune de la compétitivité française, constatant une dégradation de la compétitivité du coût salarial, notamment par rapport à l’Allemagne, et un coût horaire de la main-d’œuvre dans le secteur marchand non agricole de 33,60 euros par heure contre 30,30 euros en Allemagne, n’a pu être atteint à l’Assemblée nationale ; le travail effectué sur la compétitivité par le Conseil économique, social et environnemental, sur saisine du Gouvernement, en octobre dernier – un constat partagé sur les risques de la désindustrialisation (part de l’industrie égale à 12,5 % du PIB en France contre 22,4 % en Allemagne et 18,1 % dans l’Union européenne) – n’a pu être mené au Parlement.
Un constat partagé sur le choc des trente-cinq heures, concomitant du décrochage français, facteur de désorganisation du tissu industriel comme de pénibilité au travail en raison des passages aux 2/8 ou aux 3/8, aurait pourtant dû être possible. Plusieurs personnalités auditionnées comme d’autres qui n’ont pu être entendues à l’instar de M. Jean Peyrelevade, ont en effet souligné le coût des trente-cinq heures par-delà l’amélioration faciale et mécanique de la productivité et leur impact inflationniste sur les salaires minimums, pénalisant ainsi les entreprises de l’ensemble des secteurs notamment le secteur agricole, sans parler de l’image dégradée du travail dans l’industrie qu’elles ont induite.
Le lien avec le facteur le plus souvent cité du décrochage français – la faiblesse de la compétitivité hors prix due à l’atonie de l’innovation aurait dû être établi parallèlement : moins de travail, notamment des cadres et des chercheurs, ne peut naturellement conduire à plus de compétitivité.
Les blocages et postures idéologiques l’ont donc emporté et ont ainsi masqué des accords qui auraient dû émerger publiquement : la plupart des personnes auditionnées ont souligné les faiblesses de notre compétitivité hors prix, le désamour traditionnel des Français pour leur industrie – le « mal français » au fond –, la faiblesse du nombre de moyennes entreprises exportatrices, l’accès limité de celles-ci au crédit bancaire, la réduction des marges bénéficiaires des entreprises pour compenser la hausse du coût du travail, la faiblesse de la recherche privée en France, le poids d’une fiscalité trop illisible et changeante sur les petites entreprises, les excès de l’inflation normative et la complexité excessive du droit du travail.
L’ensemble de ces facteurs expliquent pourtant largement le fait que le déficit commercial français soit en passe d’atteindre 75 milliards d’euros cette année, soit 20 milliards d’euros de plus que le précédent record de 2008. Certes la facture énergétique en est responsable à plus de 50 % et l’euro fort à hauteur de 0,6 % mais c’est bien la faiblesse du tissu industriel français qui pose problème.
Faut-il pour autant désespérer ? Nullement : la France garde des atouts sérieux, sur lesquels les corapporteurs auraient pu et même dû tomber d’accord sans difficulté : une démographie soutenue, une importante épargne des ménages et des infrastructures d’une qualité indéniable. Le savoir-faire français demeure, de plus, très valorisé, notamment par les investisseurs étrangers, et suscite même des relocalisations d’activités que trop d’observateurs ignorent. Enfin, le crédit d’impôt recherche – « niche fiscale » que personne ne conteste –, les politiques des filières et les pôles de compétitivité ont été clairement mentionnés par les personnes auditionnées comme d’importants facteurs de développement de l’innovation dans notre pays.
C’est cet ensemble de constats qui devait être partagé par les corapporteurs, chacun d’eux pouvant naturellement exposer dans des contributions leurs approches personnelles divergentes et leurs éventuelles préconisations, au même titre d’ailleurs que tous les groupes parlementaires. S’il n’en a pas été ainsi, il reste que le travail considérable réalisé par la mission est retracé dans le compte rendu des auditions mis en ligne sur le site de l’Assemblée nationale. Il ne doit pas être perdu. Aussi ai-je décidé d’en assurer la publication, le lecteur pouvant juger par lui-même du travail effectué et des convergences qui, finalement, étaient loin d’être hors de portée. Le document devrait ainsi constituer la référence qu’aurait dû être le rapport, et alimenter la réflexion de tous à la veille d’échéances électorales stratégiques pour le pays. C’est bien à une relance de la politique industrielle qu’il invite et tous les partis politiques devraient maintenant se saisir de cette ambition essentielle.
Bernard Accoyer
Président de l’Assemblée nationale
Président de la mission
Audition du 9 février 2011 :
– M. Michel Taly, président de la commission fiscale de l’Institut de l’entreprise, avocat associé chez Arsène Taxand, et M. Eudoxe Denis, directeur des études, M. Henri Lachmann, vice-président et trésorier de l’Institut Montaigne, président du conseil de surveillance de Schneider Electric, M. Nicolas Baverez, économiste, avocat, M. Olivier Ferrand, président de Terra Nova, et M. Thomas Chalumeau, coordinateur du pôle Économie et finances 13
Audition du 16 février 2011 :
– M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, membre du Conseil d’analyse économique, M. Olivier Garnier, chef économiste de la Société Générale, membre du Conseil d’analyse économique, et Mme Mathilde Lemoine, directeur des études économiques et de la stratégie marchés de HSBC France, membre du Conseil d’analyse économique 30
Audition du 2 mars 2011 :
– Mme Anne-Marie Brocas, directrice de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) au ministère du travail, de l’emploi et de la santé, membre du Conseil d’analyse économique et professeur associé à l’École normale supérieure de Cachan, et Mme Catherine Zaidman, sous-directrice des synthèses, des études économiques et de l’évaluation à la DREES, M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), membre du Conseil d’analyse économique et du Conseil d’orientation pour l’emploi, et M. Pierre-Alain Pionnier, chef de la division croissance et politiques macroéconomiques à la direction des études et synthèses économiques à l’INSEE, M. Antoine Magnier, directeur de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) au ministère du travail, de l’emploi et de la santé, M. Sébastien Roux, sous-directeur « salaires, travail et relations professionnelles » et M. Julien Deroyon, chargé de mission 45
Audition du 8 mars 2011 :
– M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes 57
Audition du 9 mars 2011 :
– M. Michel Husson, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales, M. Dominique Plihon, professeur d’économie financière à l’Université de Paris XIII, et M. Christian Saint-Étienne, professeur à l’université Paris-Dauphine, titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et membre du Conseil d’analyse économique 74
Audition du 16 mars 2011 :
– M. Jean-Pierre Clamadieu, président-directeur général de Rhodia, M. Patrick Pélata, directeur général délégué aux opérations de Renault, et M. Jean-Cyril Spinetta, président du groupe Air France-KLM 90
Audition du 23 mars 2011 :
– M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), M. Élie Cohen, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), professeur à SciencesPo et membre du Conseil d’analyse économique, et Mme Bénédicte Zimmermann, directrice de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales 108
Audition du 30 mars 2011 :
– M. Bruno Cercley, président de Rossignol, M. Vincent Delozière, directeur général de Refresco France, M. Edmond Kassapian, président-directeur général de Geneviève Lethu, et M. Didier Sauvage, membre du directoire et directeur de la technologie de 3S Photonics 123
Auditions du 6 avril 2011 :
– Mme Anne Bucher, directrice des réformes structurelles et de la compétitivité à la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, et M. Gwenole Cozigou, directeur Industries chimiques, métalliques, mécaniques, électriques et de la construction ; matières premières à la direction générale Entreprises et industrie de la Commission européenne 138
– Mme Agnès Benassy-Quéré, directrice du Centre d’études prospectives et d’informations internationales, et M. Hervé Boulhol, chef du bureau France au département des affaires économiques de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) 145
Audition du 13 avril 2011 :
– Mme Geneviève Roy, vice-présidente en charge des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), M. Pascal Labet, directeur des affaires économiques et fiscales, et M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales, M. Jean-Bernard Bayard, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Mme Catherine Lion, directrice générale adjointe et Mme Nadine Normand, attachée parlementaire, M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), M. Michel Guilbaud, directeur général et M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques, et M. Jean Lardin, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA), et M. Pierre Burban, secrétaire général 155
Auditions du 4 mai 2011 :
– M. Hervé Drouet, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, M. Dominique Libault, directeur à la direction de la sécurité sociale, et M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 167
– M. David Appia, président de l’Agence française pour les investissements internationaux 181
Audition du 11 mai 2011 :
– M. Michel Godet, titulaire de la chaire de prospective stratégique au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Conseil d’analyse économique, et M. Philippe Weil, président de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), M. Jacques Le Cacheux, directeur du département des études, M. Henri Sterdyniak, directeur du département Économie de la mondialisation, et M. Xavier Timbeau, directeur du département Analyse et prévision 188
Audition du 18 mai 2011 :
– M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor, Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale, et M. Luc Rousseau, directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 204
Auditions du 25 mai 2011 :
– M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière (FO), et M. Pascal Pavageau, secrétaire confédéral chargé du secteur économique 218
– M. Bernard Van Craeynest, président de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) 221
– M. Jacques Voisin, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), et M. Joseph Thouvenel, secrétaire général adjoint 225
Auditions du 1er juin 2011 :
– M. Nasser Mansouri-Guilani, responsable confédéral des questions économiques de la Confédération générale du travail (CGT) 231
– Mme Véronique Descacq, secrétaire nationale en charge des dossiers de la politique de protection sociale et de la politique économique de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral 235
Auditions du 8 juin 2011 :
– M. Jean-François Dehecq, vice-président de la Conférence nationale de l’industrie, M. Yvon Jacob, ambassadeur de l’industrie auprès de l’Union européenne, et M. Jean-Claude Volot, médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance 242
– M. Pierre Gattaz, président du directoire de Radiall, président du Groupe des fédérations industrielles, président de la Fédération des industries électroniques, électriques et de communication 248
Audition du 15 juin 2011 :
– M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation 253
Audition du 22 juin 2011 :
– M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé 263
Audition de M. Michel Taly, président de la commission fiscale de l’Institut de l’entreprise, avocat associé chez Arsène Taxand, et M. Eudoxe Denis, directeur des études, de M. Henri Lachmann, vice-président et trésorier de l’Institut Montaigne, président du conseil de surveillance de Schneider Electric, et M. Nicolas Baverez, économiste, avocat, de M. Olivier Ferrand, président de Terra Nova, et M. Thomas Chalumeau, coordinateur du pôle Économie et finances.
M. Marc Laffineur, président. Je vous prie d’excuser l’absence du Président de l’Assemblée nationale, qui défend la candidature olympique d’Annecy. Notre mission, créée par la Conférence des Présidents à l’initiative du Président de l’Assemblée nationale, s’est fixée pour objectif d’analyser l’évolution de la compétitivité de notre économie au regard de la situation de nos principaux partenaires et concurrents, et de s’interroger sur le niveau des charges sociales en France, lesquelles pèsent sur les entreprises et le pouvoir d’achat des salariés, donc sur l’emploi, sans assurer pour autant l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Nous recevons aujourd’hui des représentants de « laboratoires d’idées ». L’Institut de l’entreprise et l’Institut Montaigne ont produit de nombreux documents de travail sur la compétitivité économique de la France, et Terra Nova conduit, depuis plus d’un an, une réflexion sur la protection sociale française au XXIe siècle.
M. Michel Taly, président de la commission fiscale de l’Institut de l’entreprise, avocat associé chez Arsène Taxand. Nous sommes heureux de pouvoir nous exprimer, à travers cette mission d’information, sur le lien entre la compétitivité et le financement de la protection sociale. Lors des dernières campagnes électorales, la maîtrise de la dépense apparaissait comme une priorité inséparable de la structure de la fiscalité. Or il semble que le niveau de nos dépenses publiques soit désormais considéré comme une donnée a priori, un choix de société qu’il convient d’accepter comme tel, de sorte que le débat ne porte plus que sur le financement de la protection sociale. Ce consensus se retrouve non seulement dans les débats publics, mais aussi, par exemple, dans les derniers rapports du Conseil des prélèvements obligatoires, que sa proximité avec la Cour des comptes devrait pourtant rendre soucieux de maîtrise budgétaire.
Dès lors, l’Institut de l’entreprise considère que la différence entre notre niveau de dépenses publiques et celui d’autres pays doit être financée par les seuls ménages, qui en sont les bénéficiaires, et ce pour deux raisons. La première est que nos entreprises sont en concurrence avec les entreprises de pays où les prélèvements obligatoires sont moins élevés ; la seconde est que, même si des services publics de qualité peuvent offrir un avantage compétitif, comme le soutient le Conseil des prélèvements obligatoires, cet avantage ne compense pas le handicap que représente le surcroît fiscal.
Quoi qu’il en soit, les assiettes reposant sur la comptabilité des entreprises ne sont pas souhaitables. Je pense par exemple à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), taxe à effet de cascade sur le chiffre d’affaires qui, avec un taux de 0,16 %, rapporte plus de 5 milliards d’euros. De tels impôts, d’appréhension difficile en comptabilité analytique, sont particulièrement pernicieux sur le plan économique.
De même, si la valeur ajoutée participe à la création de richesses au niveau national, elle ne peut être l’instrument de mesure de la capacité contributive d’une entreprise : toute autre imputation que le bénéfice représente une charge ; en d’autres termes, un impôt sur la valeur ajoutée reste un prélèvement sur les coûts. C’est aussi le cas de la taxe professionnelle, dont la réforme a été bien accueillie par les entreprises car elle a permis de diminuer la part assise sur le capital physique au profit d’une répartition sur la valeur ajoutée – dont les salaires et les charges sociales constituent la majeure partie. Cependant, appliquer la même logique au financement de la protection sociale reviendrait à taxer, plutôt que les revenus du bénéficiaire de cette protection, les amortissements et les provisions, aux dépens des investissements et donc du développement de l’entreprise.
Si les ménages doivent assumer le surcroît de dépenses publiques qu’exige notre système de protection sociale, la taxation peut porter soit sur les revenus – auquel cas il est sans doute préférable de viser la contribution sociale généralisée (CSG), qui est devenue plus large que l’impôt sur le revenu –, soit sur la consommation, via la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Du point de vue macroéconomique, que l’on prélève 10 milliards d’euros par des cotisations sociales, de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la contribution sociale généralisée ne change pas grand-chose pour les entreprises : leur capacité de vente s’en trouvera diminuée d’autant. Aussi bien de nombreux rapports ont-ils conclu que le choix entre l’une ou l’autre de ces solutions avait peu d’effet sur l’emploi.
Du point de vue microéconomique, en revanche, un transfert de prélèvement des cotisations sociales vers la taxe sur la valeur ajoutée entraîne des effets variés – augmentation des prix, répercussions sur le salaire minimum –, car tous les agents ne diminueront pas leur prix hors taxes à hauteur du montant de l’allégement de cotisations. De même, si certains restaurateurs ont répercuté la baisse de taxe sur la valeur ajoutée en augmentant les salaires, d’autres l’ont fait en augmentant leurs marges.
M. Henri Lachmann, vice-président et trésorier de l’Institut Montaigne, président du conseil de surveillance de Schneider Electric. Les occasions de faire entendre le point de vue des chefs d’entreprise du secteur industriel sont rares ; je me réjouis donc d’être entendu par la mission aujourd’hui. De surcroît, la plupart d’entre eux se sentent très mal représentés par leurs organisations professionnelles.
Premièrement, s’il ne peut y avoir de puissance économique sans industrie, il ne peut y avoir d’industrie sans un certain amour des entreprises. L’entreprise industrielle est mal aimée des Français, qui l’imaginent telle que la décrivait Zola et ignorent que les cols blancs sont désormais plus nombreux que les cols bleus.
Deuxièmement, les rigidités du droit du travail et l’archaïsme du dialogue social freinent davantage notre compétitivité que les charges sociales. À titre personnel, je suis défavorable aux contrats à durée déterminée (CDD), qui, en plus de rompre le lien social entre l’individu et l’entreprise, créent des citoyens de seconde zone.
Troisièmement, la France est un pays trop individualiste, où subsistent de nombreux cloisonnements : entre le secteur public et le secteur privé, entre les politiques et les chefs d’entreprise, entre Paris et la Province, entre le système éducatif et le monde de l’entreprise, et, au sein de celui-ci, entre les grandes entreprises et les moins grandes. Ainsi, les entreprises appartenant à la cotation assistée en continu (CAC 40) n’ont jamais pu entraîner les petites et moyennes entreprises (PME) dans leur développement, de façon que celles-ci atteignent la taille intermédiaire critique.
Quatrièmement, notre système de formation pourtant tant vanté reste défaillant. Si la ressource humaine constitue la force stratégique d’une entreprise, comment accepter que 150 000 jeunes, dont 100 000 ne savent ni lire ni calculer, sortent tous les ans du système éducatif sans qualification ni diplôme ? Cet échec collectif pénalise notre compétitivité, et ce ne sont pas des demi-mesures ou de court terme qui résoudront ce problème.
Cinquième et dernier point : la financiarisation de l’économie conduit les gens à privilégier le court terme, alors que l’entreprise ne raisonne pas à trois mois ou un an, mais à cinq ou dix ans. La finance devient reine alors qu’elle devrait être au service de l’économie, et elle impose son diktat aux entreprises. Il est indispensable de faire marche arrière et de montrer que les entreprises ont une utilité sociale indépendamment de leurs résultats financiers.
Nous devrions nous inspirer du Mittelstand allemand, qui sort plus facilement de la crise que nos entreprises car il a davantage investi en recherche et développement, maintenu le lien social entre les salariés et les entreprises, et les grandes entreprises s’appuient sur les petites dans un réel partenariat.
Nos entreprises, notamment les grandes, investissent 30 à 40 % de moins que les allemandes en recherche et développement. Pourtant, le moteur de notre croissance réside dans l’innovation bien plus que dans la diminution des coûts salariaux – d’autant qu’en ce domaine, la marge est sans doute très réduite. Nous avons besoin de savoir et de savoir-faire.
Enfin, il faudrait une vraie politique industrielle, à l’échelle non seulement française mais aussi européenne. Nous sommes un peu les enfants sacrifiés de M. Mario Monti et de Bruxelles, dont la politique d’ouverture à la concurrence, destinée à protéger le consommateur – ce qui est par ailleurs légitime – se fait au détriment de l’industrie. On a ainsi empêché Schneider de fusionner avec Legrand au motif que leurs chiffres d’affaires respectifs se recoupaient à hauteur de 10 % sur le seul marché français. Les États-Unis ne s’embarrassent pas de règles aussi strictes en matière de monopole.
M. Nicolas Baverez, économiste, avocat. Notre pays affronte depuis vingt-cinq ans trois problèmes fondamentaux : la compétitivité, la dette et le chômage structurel, la compétitivité ayant ceci de particulier qu’elle est la clé des deux autres. S’il n’existe aucune hiérarchie morale entre le secteur public et le secteur privé, la dette ne pourra être remboursée que grâce à la richesse produite par le secteur privé, qui ne représente plus que 44 % de notre produit intérieur brut (PIB). De même, seul un secteur marchand dynamique permettra de réduire de manière significative le chômage.
Le moteur de la croissance française, depuis un quart de siècle, est la consommation, laquelle est soutenue par des transferts sociaux eux-mêmes financés par de l’endettement public. Ce modèle atteint aujourd’hui ses limites. Il faut lui en substituer un autre qui associe production, investissements, innovation et exportations, ce qui ne sera possible qu’à un horizon de dix ou quinze ans. Consensus politique et forte volonté politique pour mener à bien cette évolution indispensable sont donc nécessaire.
Notre pays, tous les partis politiques doivent en être conscients, vit un « Sedan économique » en matière de compétitivité. Pour commencer par des données macroéconomiques, nous créons 1,5 % de croissance au prix d’un déficit structurel de 6 %. Par ailleurs, la part du secteur privé dans le produit intérieur brut ne cesse de diminuer. Enfin, pour la huitième année consécutive, notre balance commerciale est déficitaire – à hauteur de 51 milliards d’euros cette année – ; elle l’est d’ailleurs non seulement vis-à-vis de l’Allemagne, mais aussi de la Belgique – pour 6 milliards –, des Pays-Bas ou de l’Italie. Autrefois, nous étions faibles avec les forts mais forts avec les faibles. Aujourd’hui, nous sommes faibles vis-à-vis de tous, la part de nos exportations dans la zone euro étant passée de 18 % en 1990 à 16 % en 2000 et 12 % aujourd’hui.
L’aspect micro-économique est tout aussi préoccupant. Si la France a une population de 65 millions d’habitants, elle ne compte plus que 195 entreprises de plus de 5 000 salariés et 4 195 entreprises de 250 à 5 000 salariés – 300 ayant été supprimées en 2008 et 2009. De même, le nombre de nos entreprises exportatrices est passé de 105 000 il y a dix ans à 91 000 aujourd’hui.
Si notre pays ne parvient pas à inverser ces tendances, il rencontrera bientôt un problème de solvabilité, d’autant qu’il n’y a pas de raison de croire à une diminution du chômage. Dans ces conditions, notre pays risque d’être mis sous tutelle non seulement par l’Allemagne – ce qui est déjà partiellement le cas, puisque notre notation tient au fait que les marchés notent le couple franco-allemand – mais aussi par la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI).
S’agissant du financement de la protection sociale, il n’existe aucune alternative à la politique de maîtrise des dépenses sociales – lesquelles représentent quelque 35 % du produit intérieur brut –, non seulement parce que nous ne pouvons durablement financer la consommation par de la dette, mais aussi parce que ces dépenses, en cannibalisant l’État régalien, affectent son bon fonctionnement.
Si la taxe sur la valeur ajoutée sociale a renforcé les entreprises en Allemagne, c’est que sa mise en œuvre a été précédée, en 2002 et 2003, par un rétablissement de la compétitivité structurelle, donc d’une offre nationale productive. Sans une telle politique de l’offre, une telle mesure fiscale risquerait de ne profiter qu’aux importations. Il n’y a pas de remède miracle, et il ne faut pas attendre une révolution fiscale : la réforme n’a de sens que si elle est progressive et s’attaque d’abord au problème de la compétitivité des entreprises.
Quant à la protection sociale elle-même, il convient de distinguer ce qui relève de l’assurance et ce qui relève de la solidarité. La famille, qui contribue au capital humain, relève de la solidarité, donc de l’impôt. Les retraites, elles, relèvent assurément du contributif ; elles doivent donc être liées aux salaires ; de même, les accidents du travail concernent directement les entreprises. Quant à la santé, son statut est plus hybride ; elle n’a pas vocation, en principe, à être majoritairement financée par le travail.
Si l’assurance peut être financée par la rémunération et le travail, la solidarité relève plutôt de l’impôt. Pour la partie assurantielle, une partie des cotisations patronales pourraient être transférées vers un salaire brut étendu, quitte à verser les prélèvements à cet assureur public qu’est la sécurité sociale. Pour ce qui concerne la fiscalité, on peut envisager, d’une part, une fusion de la contribution sociale généralisée – en mettant fin au taux privilégié dont bénéficient les retraités – et de l’impôt sur le revenu, et, de l’autre, une légère augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée pour compenser la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Le fil conducteur est d’articuler la compétitivité des entreprises à une organisation cohérente de notre protection sociale, élément fondamental de notre contrat politique.
M. Olivier Ferrand, président de Terra Nova. Le cercle vertueux du modèle français, fondé sur une croissance forte qui finançait la redistribution, laquelle soutenait la consommation qui elle-même générait la croissance, a été cassé par la mondialisation, les gains de productivité des salariés ayant par ailleurs atteint leurs limites. Désormais, la protection sociale gêne la compétitivité internationale de nos entreprises, et la faible croissance empêche son bon financement. La question est de savoir comment sortir de ce cercle vicieux.
Faut-il s’inspirer du modèle allemand ? La politique mise en œuvre par Gerhard Schröder et Angela Merkel depuis dix ans repose sur une compétitivité-prix extrême. Elle a conduit à un gel nominal des salaires pendant sept ans, à la suppression d’une part des cotisations sociales – avec une diminution des prestations correspondantes –, et au transfert d’une autre part de ces cotisations vers la taxe sur la valeur ajoutée – qui a augmenté de 3 points –, ce qui, à taux de change fixe, s’apparente à une dévaluation compétitive.
Cette politique a été efficace pour la balance commerciale, qui, de déficitaire au début des années 2000, est devenue excédentaire d’environ 150 milliards d’euros. L’Allemagne peut ainsi conserver ses parts de marché dans le commerce international – 16 %, ce qui est un exploit compte tenu de la montée en puissance des pays émergents –, alors que les nôtres, qui atteignent aujourd’hui 6 %, ne cessent de chuter.
Toutefois, la balance commerciale n’est pas un objectif en soi : ce qui l’est, c’est la croissance durable. Or, de ce point de vue, la politique allemande est un échec. Si le taux de croissance a atteint cette année 3,6 %, il s’agit d’un rebond technique après la récession de près de 5 % l’année précédente – l’Allemagne ayant été plus exposée, par son ouverture au commerce international, aux effets de la crise mondiale de 2008. En réalité, sur dix ans, le taux de croissance annuel de l’Allemagne est resté l’un des plus faibles de la zone euro : moins de 1 %, contre 1,5 % en France.
Par ailleurs, la politique allemande a consisté à appauvrir les citoyens pour gagner en compétitivité : même avec des syndicats de bonne volonté, cela ne peut constituer un programme durable.
Enfin, cette politique est non coopérative. La balance commerciale allemande reste déficitaire vis-à-vis de la Chine – pour 30 milliards d’euros –, et cette tendance s’aggrave car la compétitivité des prix a un effet marginal au regard des énormes différences de coûts. L’amélioration de la balance commerciale allemande se fait donc au détriment de pays ayant des coûts de production similaires : les pays européens, et tout particulièrement la France. Dans un rapport du Conseil d’analyse économique (CAE), M. Lionel Fontagné a montré que, sur la période concernée, l’amélioration de la balance commerciale allemande est gagée à hauteur de 60 % sur une dégradation bilatérale de la balance commerciale française. Cette politique non coopérative est difficilement soutenable en Europe à moyen terme.
La compétitivité peut être améliorée de deux manières : par les prix, selon le modèle allemand, ou par la qualité technologique et la valeur ajoutée, selon la voie suivie par les pays d’Europe du Nord, une partie des États-Unis, la Corée du Sud ou le Japon. Dans la mesure où la France ne peut concurrencer les pays émergents sur les prix, elle doit s’efforcer de s’imposer selon la seconde voie. Aussi, plutôt que de geler les salaires ou de diminuer les cotisations sociales, il convient, comme le préconisait la commission Juppé-Rocard, de trouver des marges au profit des investissements d’avenir, pour lesquels, selon MM. Jacques Delpla et Charles Wyplosz, nos retards accumulés depuis vingt ans atteignent 400 milliards d’euros.
Les investissements publics restent insuffisants : 97 % du budget de l’État sont consacrés au fonctionnement, dont la moitié financée à crédit. En la matière, les collectivités locales ont pris le relais de l’État de manière très partielle : la rénovation d’une salle des fêtes, par exemple, n’entre pas dans la catégorie des investissements d’avenir. Une première idée simple consisterait à consacrer, chaque année, 1 % ou 2 % de produit intérieur brut supplémentaires aux investissements d’avenir – soit un programme comparable à celui envisagé par la commission Juppé-Rocard –, en isolant cette enveloppe dans le budget de l’État pour la rendre non fongible.
L’investissement privé s’étiole également en raison de la faiblesse du taux de profitabilité des entreprises en France. Aussi proposons-nous un impôt sur les sociétés différencié, avec un taux moindre pour les bénéfices réinvestis.
L’effort d’investissement doit porter sur trois domaines prioritaires. Le premier est l’enseignement supérieur, encore insuffisamment démocratisé puisque seulement 40 % d’une classe d’âge en sont diplômés en France, contre 60 %, voire plus, aux États-Unis, dans les pays nordiques et en Corée du Sud. Nous n’y consacrons de surcroît que 1,5 % de notre richesse nationale, contre 3 %, par exemple, aux États-Unis pour rattraper ceux-ci, 30 milliards d’euros par an sont nécessaires. Je rappelle que le grand emprunt a permis d’investir 11 milliards en une seule fois, soit, en intérêts, quelque 300 millions par an ; soit 1 %. La deuxième priorité est l’innovation. Le crédit d’impôt recherche a permis quelques progrès dans le domaine de la recherche, mais le retard français en matière de recherche et développement est énorme.
Troisième priorité : les grands investissements industriels innovants. La commission Juppé-Rocard a identifié sept grands axes qu’il nous faut développer.
Pour résumer, la première solution en matière de compétivité, bas de gamme, consiste à diminuer le coût du travail par le gel des salaires et la baisse des cotisations sociales ; la seconde, à augmenter les qualifications. Le modèle à suivre est donc bel et bien le modèle allemand existant depuis quarante ans – et non la politique Schröder-Merkel de compétitivité-prix qui s’est greffée sur lui –, fondé sur la recherche et l’investissement industriel.
M. Thomas Chalumeau, coordinateur des questions économiques de Terra Nova. Depuis 2003, la France a amorti la baisse de sa compétitivité-prix en utilisant trois leviers : l’effondrement des marges des entreprises – qui ont diminué de 20 à 25 % depuis 1995 – ; l’explosion du volume des exonérations de cotisations sociales – 22 milliards au sens strict et 38 milliards au sens large – ; enfin, l’ajustement salarial.
Il faut donc réinventer un modèle, tout d’abord en réorientant les moyens de la compétitivité-prix vers la compétitivité-volume, selon la description qu’en a donnée Olivier Ferrand.
Le deuxième levier concerne nos choix budgétaires et fiscaux, qui, depuis 2002, ont été peu favorables à la compétitivité française, en prix comme en volume. Nous devons non seulement colmater les brèches du navire fiscal, notamment en revenant sur certaines niches, mais aussi privilégier, dans nos orientations budgétaires, les investissements d’avenir.
La réforme du financement de la protection sociale est plus complexe. Le modèle économétrique de simulation et d’analyse générale de l’économie, dit Mésange, avait montré, en 1995, que l’instauration d’une taxe sur la valeur ajoutée sociale ne créait, sur la base d’un transfert technique de 2,1 %, que 23 000 emplois en deux ans et en détruisait 32 000 en cinq ans, compte tenu de la rétroaction négative sur l’investissement et la croissance. La taxe sur la valeur ajoutée sociale n’est donc pas un sujet politique mais technique : ses éventuels bénéfices doivent être analysés comme tels.
Le financement de la protection sociale doit être revu dans ses principes mêmes, comme l’a suggéré M. Nicolas Baverez. Dans le cadre d’une vaste réforme fiscale, greffer une part substantielle de ce financement – notamment pour les dépenses non contributives – sur un grand impôt républicain, fusionnant l’impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée, est une piste particulièrement intéressante : cela assurerait un meilleur équilibre entre la taxation du travail et celle des autres facteurs de production, tout en contribuant à la justice sociale.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. L’intérêt d’une telle mission est de faire converger les positions au-delà des sensibilités politiques – toute la question est de savoir si la chose est réalisable à quelques mois d’échéances électorales.
Je pense au mot de Jean-Claude Junker : « Ne me dites pas ce que je dois faire : je le sais. Dites-moi comment le faire. » Quand on parle d’une grande réforme fiscale, je reste prudent. Notre modèle social est aujourd’hui le plus puissant du monde. Nous avons même dépassé la Suède. Son budget atteint 600 milliards d’euros, dont près de 70 % proviennent des cotisations pesant sur le travail, et nous avons fixé l’objectif de progression des dépenses à 2,9 % en 2011 et à 2,8 % en 2012. Cet objectif doit-il selon vous être réexaminé ?
N’est-il pas plus facile de convaincre l’opinion en jouant sur plusieurs leviers ? Je pense à une taxe sur la valeur ajoutée intermédiaire, qui nous donnerait un peu d’oxygène, à l’impôt sur la fortune (ISF) pour rétablir la confiance, à une augmentation de l’impôt sur le revenu – puisqu’il est en moyenne plus élevé de 2,5 % chez nos voisins –, à la maîtrise des dépenses publiques et, suivant les observations de M. Henri Lachmann, à certains assouplissements de notre marché du travail.
M. Marc Laffineur, président. Depuis dix ans, qu’est-ce qui a, selon vous, empiré, et qu’est-ce qui s’est amélioré ?
M. Nicolas Baverez. La croissance potentielle de l’économie française étant de 1,5 %, les dépenses sociales progressent à un rythme bien supérieur.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Non, depuis deux ans, les dépenses sociales ont progressé moins vite que la richesse nationale.
M. Nicolas Baverez. Après un choc tel que celui de la crise de 2008, les économies se relancent toujours à partir des modèles anciens : en l’occurrence l’économie de bulles aux États-Unis, qui ont l’intention de faire évoluer le système dans un second temps. Pour ce qui nous concerne, il n’est pas illogique d’avoir recouru aux stabilisateurs automatiques.
Mais à présent que nous sortons de la récession, il faut évoluer vers un modèle davantage fondé sur la production, l’investissement et l’innovation.
Dans un pays où les dépenses publiques représentent 56 % de la richesse et les prélèvements obligatoires réels 47 %, l’idée d’un grand soir fiscal est illusoire. Il faut donc jouer sur plusieurs leviers : non seulement les dépenses, mais aussi les différents systèmes d’imposition.
Si nous avons constaté de nombreuses difficultés, nous peinons, Monsieur le Président, à percevoir des améliorations. L’augmentation du coût du travail n’est pas liée à celle des rémunérations mais au financement de la protection sociale, lequel a « mangé » les faibles gains de productivité de notre économie, en l’occurrence 0,7 % par an, à rapporter à notre taux de croissance de 1,5 % et aux 2,5 à 3 % de progression annuelle des dépenses sociales. Globalement, notre système économique s’est beaucoup dégradé et il atteint aujourd’hui ses limites, qu’il s’agisse de la compétitivité, des prélèvements ou du financement de la protection sociale.
L’instabilité de la législation sociale et fiscale est enfin un problème majeur. Le crédit d’impôt recherche était une excellente mesure, qu’il est dommage d’avoir dénaturée dans la loi de finances pour 2011, moins de deux ans après sa mise en œuvre, alors qu’elle devait être évaluée en 2013 ou 2014. Pour prendre leurs décisions, les investisseurs, notamment étrangers, doivent s’appuyer sur un système fiscal stable.
M. Henri Lachmann. Nous n’avons pas pris toute la mesure de la globalisation : le monde a changé, pour les entreprises et les personnes morales comme les personnes physiques. Il s’agit d’une vraie révolution, les délocalisations n’étant que la partie émergée de l’iceberg.
Par ailleurs, il me semble absolument nécessaire et urgent de repenser l’entreprise en profondeur, car la financiarisation, le « court-termisme », l’âpreté au gain conduiront notre économie à sa perte. Une entreprise n’est pas seulement conçue pour rémunérer les actionnaires.
M. Olivier Ferrand. S’agissant des dépenses liées à la protection sociale, deux axes sont possibles. Le premier concerne les économies de gestion : la révision générale des politiques publiques (RGPP) a été mise en œuvre pour l’État de manière sévère ; il serait peut-être temps de l’appliquer aux collectivités locales et à la sécurité sociale.
Le second axe, ce sont les politiques publiques elles-mêmes. Or les grandes marges de manœuvre se trouvent au niveau de la sécurité sociale, que l’on attaque en général de façon injuste, par le bas, en rabotant les dépenses destinées aux plus modestes.
On peut inverser la perspective. Notre système est particulièrement luxueux pour les plus aisés car il est, non pas redistributif, mais fondamentalement assurantiel : les prestations dépendent du niveau des revenus. Notre pays est, de loin, celui dans lequel ces prestations sont les plus élevées : les pensions de retraite versées par le système public peuvent atteindre 20 000 euros par mois, et les indemnités de chômage 7 000 euros ! Ne peut-on envisager, dans ces conditions, d’intégrer une dose de redistributivité dans notre système de protection sociale, en d’autres termes d’abaisser le plafond plutôt que de gratter le plancher ? Les partis politiques, chacun pour des raisons différentes, rejettent tous cette idée. Sur les 265 milliards d’euros versés chaque année pour les retraites, seuls les 15 milliards du Fonds de solidarité vieillesse sont de nature redistributive ; le reste est assurantiel. On pourrait augmenter le volume de redistribution, ce qui permettrait au passage une refiscalisation.
S’agissant des recettes, si toutes les niches sociales ont leur légitimité, peu d’entre elles se justifient au regard de nos déficits sociaux. Par ailleurs, ne peut-on envisager de redéployer certaines sommes vers les emplois plus qualifiés, d’autant qu’une partie des 40 milliards d’euros de subventions aux emplois peu qualifiés était destinée à assurer le passage aux trente-cinq heures ?
M. Jean-Claude Sandrier. Monsieur le Président, vous avez commencé cette audition en expliquant que les charges sociales qui pesaient sur les entreprises constituaient un lourd handicap pour notre compétitivité. Ne faisons pas fausse route : 172 milliards d’euros de niches sociales et fiscales aux entreprises ont été supprimés ; la croissance a-t-elle cessé de se réduire pour autant ? La Cour des comptes avait d’ailleurs jugé, il y a quelques années, que l’efficacité en termes d’emploi des exonérations de cotisations sociales – qui atteignent aujourd’hui 38 milliards – restait à prouver.
Il eût été bon d’expliciter préalablement ce qu’on entend par « compétitivité ». Il me semble qu’il y a, derrière ce mot, la notion de concurrence, une concurrence dont M. Joseph Stiglitz estime qu’elle tourne au délire. Alors, comment arrêter le délire ?
La compétitivité, ce sont d’abord des hommes et des femmes ; elle ne se mesure pas à leur coût, mais à leur qualification, à leur niveau de salaire, à leur protection sociale, à la qualité de leur contrat, à la recherche – nous avons beaucoup de retard dans ce domaine, notamment par rapport à l’Allemagne – et aux investissements publics. Aujourd’hui, tout le monde pleure sur l’industrie, mais, il y a vingt ans, on prétendait qu’il ne fallait plus s’en préoccuper, parce que l’avenir de notre économie était dans les services et l’innovation.
Par ailleurs, on n’évoque jamais le coût de la financiarisation. Combien nous coûtent les actionnaires ? Une entreprise fonctionnant uniquement pour eux crée-t-elle beaucoup de valeur ? Que font les actionnaires de l’argent ainsi récolté ? Tant que l’on refusera de poser ces questions, on en reviendra à la diminution des charges sociales et au financement de la protection sociale par d’autres voies que la création de richesses ; et on taxera donc davantage les ménages.
M. Éric Woerth. Pour des raisons culturelles, le niveau des dépenses publiques restera toujours élevé en France, mais cela ne doit pas nous empêcher de rester compétitifs dès lors que les qualifications sont de haut niveau.
Je ne crois pas que l’on puisse augmenter encore les prélèvements obligatoires. On peut réfléchir à d’autres répartitions entre le travail et le capital, entre les niveaux de revenus, rechercher une plus grande équité, mais la pression fiscale et sociale globale a atteint son niveau maximal dans notre pays. La seule solution réside dans la réduction de la dépense publique.
Le sujet n’est guère abordé. Quand on entre dans le détail, on s’aperçoit qu’il est très difficile de trouver des solutions politiquement acceptables, car la population s’est habituée à un haut niveau de dépenses publiques et aux prestations sociales qui en découlent.
La meilleure des solutions serait de geler la dépense publique, ce qui, associé à des transferts de dépenses – car vous avez raison, il faut augmenter les dépenses d’investissement et de formation –, provoquerait en quelques années une réduction substantielle des déficits. Toutefois, sa mise en œuvre s’avère difficile, car l’on a toujours de bonnes raisons de penser que les pensions de retraites et les allocations de logement doivent progresser. Pourtant, cette solution me semble plus douce que la suppression brutale de certaines dépenses.
Une autre solution serait, comme l’a suggéré M. Olivier Ferrand, de réévaluer un certain nombre de nos politiques sociales, car même si l’on essaye d’économiser sur la gestion, notamment grâce à la révision générale des politiques publiques, la plupart des dépenses sont structurelles. Nous fonctionnons aujourd’hui à guichets ouverts : dès lors qu’il y a des droits, les gens les utilisent. Pour reprendre l’image de M. Nicolas Baverez, les politiques sociales ont « cannibalisé » les fonctions régaliennes de l’État. La société française a fait ce choix. Il convient donc de réfléchir au contenu des politiques sociales mais ce sujet est une bombe politique !
On peut sans doute réfléchir à votre proposition de lier le niveau de prestations au niveau de revenu, mais je ne crois pas que cela suffira pour financer la protection sociale. L’incitation à sortir des prestations sociales a déjà été expérimentée avec le revenu de solidarité active (RSA). Le problème, c’est que le dispositif est entré en vigueur en pleine crise, au moment où le chômage augmentait. Il est très difficile d’évaluer le revenu de solidarité active « chapeau » pour le moment.
Quant aux exonérations de charges, on peut considérer qu’il existe une progressivité des charges sociales en fonction du salaire, et qu’il convient de diminuer les charges sociales sur les bas salaires si l’on veut que les personnes les moins qualifiées puissent trouver un emploi. Il s’agit donc plutôt d’une « barémisation » des charges en fonction des qualifications.
M. Alain Vidalies. Cette mission a été créée dans un objectif politique précis : l’harmonisation avec l’Allemagne, pour que la France soit aussi compétitive qu’elle. Cette première réunion est particulièrement intéressante, dans la mesure où elle montre que c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire, car la croissance n’est pas au rendez-vous en Allemagne.
On ne peut pas continuer à faire l’impasse sur la dette souveraine issue de la crise. Le niveau de nos dépenses publiques a des causes non seulement structurelles, mais également conjoncturelles, liées à la crise. La problématique adoptée aujourd’hui conduit à présenter la facture à l’ensemble de la population ; on semble avoir oublié les discours de l’époque, notamment ceux du Président de la République, lorsqu’il appelait à réformer le capitalisme financier. Si l’on continue à accepter la tyrannie des agences de notation, comment voulez-vous que l’on parvienne à renforcer l’industrialisation et à créer des richesses, afin de mieux les répartir ensuite ? Il faut revoir la problématique générale de notre mission. On ne peut pas se contenter de chercher comment payer la facture !
Il existe pourtant des marges de manœuvre, qui résultent, du point de vue du groupe SRC, de l’inefficacité des politiques menées par le Gouvernement. Par exemple, il ne nous semble pas opportun, vu la gravité de la situation, de dépenser chaque année 3 ou 4 milliards pour financer la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée dans la restauration. De même, la défiscalisation des heures supplémentaires pour un montant s’élevant à plusieurs milliards d’euros est considérée à l’étranger comme une folie pure et simple.
Si l’on veut à la fois créer des richesses, soutenir les entreprises et assurer une bonne protection sociale, et si l’on considère que le mérite individuel, quelle que soit la place de chacun dans la société, est un objectif républicain, la marge de manœuvre ne se situe-t-elle pas au moment de la naissance ? Nous devons donc examiner le problème de la transmission du patrimoine. Ce qui aura été prélevé sur les patrimoines importants sera autant de moins à prélever sur l’activité courante des entreprises, et cela n’aura pas le moindre impact sur la conjoncture internationale. Vivre dans une société où certains n’auraient d’autre effort à faire que de naître n’est pas un projet collectif ! Je suis étonné qu’aucun d’entre vous n’ait évoqué cette possibilité.
M. Henri Lachmann a raison : les entreprises sont confrontées à des rigidités. Mais, là encore, il existe des marges de manœuvre. Par exemple, si toutes les entreprises paient des cotisations pour l’assurance chômage, certaines n’ont jamais licencié personne, et ne génèrent pas de droits ; d’autres, en revanche, ont érigé l’embauche en contrat à durée déterminée ou en intérim en mode de management. Ne pourrait-on pas considérer que cette mutualisation aveugle est absurde et qu’il faut, comme pour les accidents du travail, adopter des taux différenciés, de manière à récompenser les entreprises citoyennes et pénaliser celles qui font financer par la société les effets de la précarité de leurs salariés ?
Enfin, il est vrai que la France manque de petites et moyennes entreprises performantes ; comme l’a souligné M. Henri Lachmann, cela relève de la responsabilité non seulement des politiques, mais aussi des grandes entreprises à la différence de ce qui se passe en Allemagne.
M. Michel Taly. Si l’on examine le taux d’efficacité de la taxe sur la valeur ajoutée, qui met en relation son rendement effectif à ce qu’elle rapporterait sans réductions de taux, on constate une grande différence entre la France et l’Allemagne. En effet, l’écart est très important en France entre le taux normal et le taux réduit, à 5,5 %, alors qu’il existe d’autres moyens, dont des taux intermédiaires, qui permettraient d’atteindre les mêmes objectifs. Il est vrai que cela poserait des problèmes de faisabilité, par rapport au corps social ou aux activités professionnelles concernées, mais, d’un point de vue purement technique, il y a en France un problème de rendement de la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant des niches fiscales et sociales, je suis frappé par le glissement sémantique observé depuis quelques années. Autrefois, on considérait comme des « niches » des dispositifs dérogatoires très ciblés, qui représentaient quelques centaines de millions d’euros. Il s’agissait d’un enjeu d’équité. Aujourd’hui, tout est appelé « niche », y compris des mécanismes très lourds de calcul de l’impôt, portant sur 30 ou 40 milliards d’euros. Les niches sont devenues un enjeu de rendement.
De mon expérience à la direction de la législation fiscale, je retire que les niches ne constituent pas une perte de recettes, mais sont le moyen d’augmenter les taux d’imposition jusqu’à des niveaux objectivement déraisonnables, en utilisant ce que les transporteurs aériens appellent la gestion fine (yield management), c’est-à-dire en faisant payer à chacun ce qu’il est capable de supporter. Si l’on supprime les niches, on sera obligé de baisser les taux.
Cela signifie que, contrairement à ce qui est dit, le meilleur moment pour supprimer les niches, c’est quand on baisse les impôts. Mais penser que l’on trouvera des recettes supplémentaires en supprimant les niches est, à mon avis, une grave erreur.
S’agissant de la redistribution et d’un éventuel système contributif assurantiel, je rappelle qu’entre 1981 et 1990, on a déplafonné la quasi-totalité des cotisations sociales en France, alors que les cotisations des Allemands et les Britanniques sont restées plafonnées – ce qui explique l’enjeu des stocks options en France : un dirigeant qui dispose d’un revenu de 2 millions d’euros paye la cotisation maladie sur la totalité de la somme, ce qui n’est pas le cas de son collègue allemand. Il faut en tenir compte lorsque l’on compare les barèmes de l’impôt sur le revenu.
M. Henri Lachmann. L’Allemagne est, selon moi, le meilleur exemple d’une compétitivité qui s’exprime en d’autres termes que les prix. La compétitivité, qu’il s’agisse d’un produit, d’une entreprise, d’un employeur ou d’un territoire, doit s’entendre de manière globale.
Je déplore l’existence des contrats à durée déterminée, mais je condamne surtout les rigidités administratives et l’archaïsme du dialogue social qui sont à leur origine. Il faut corriger le mal en amont.
La financiarisation est un phénomène extrêmement grave, et dangereux pour le système capitaliste. On ne se rend pas compte à quel point les entreprises se sont financiarisées – et pas seulement celles cotées en Bourse. Dans ce contexte, le conseil de surveillance est appelé à jouer un nouveau rôle, qui est de conseiller les dirigeants sur des stratégies de long terme, et les aidant à refuser la dictature court-termiste des marchés. Le temps de l’entreprise n’est ni le trimestre, ni l’année.
Le monde financier a beaucoup trop d’influence de nos jours, notamment sur le monde politique. Il est parfaitement anormal que M. Jérôme Kerviel ait été condamné à verser 5 milliards d’euros de dommages et intérêts tandis que la Société générale était exonérée de toute responsabilité ! Cela signifie que le lobbying de cette banque auprès des pouvoirs publics a été très efficace.
Si je défends l’industrie, ce n’est pas par corporatisme, c’est dans l’intérêt général, parce que je suis persuadé qu’une économie ne peut pas se développer sans une industrie forte. L’économie virtuelle, cela n’existe pas par définition.
S’agissant de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration, il me semble que quand on a fait une bêtise, on doit la réparer. C’est une simple question de bon sens – mais cela suppose un minimum de courage politique.
Les grandes entreprises ont une réelle responsabilité dans le non-développement des petites et moyennes entreprises. Nous ne savons pas chasser en meute et nous n’avons pas su mettre en place un environnement favorable à la croissance, avec un tissu dense de petites et moyennes entreprises en bonne santé.
Pour conclure, la France a suffisamment de génie pour ne pas avoir besoin d’un modèle quelconque, mais il ne me paraîtrait pas idiot de s’inspirer de ce qui a été fait en Allemagne, notamment pour ce qui concerne le modèle industriel fondé sur l’innovation, la qualité et le maillage.
M. Nicolas Baverez. Le terme de « compétitivité » recouvre deux notions : la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Il ne faut pas les opposer de manière trop systématique ; il est inexact de dire que les Allemands ont amélioré uniquement leur compétitivité prix. Ils sont devenus le premier exportateur du monde, en compétition avec la Chine, parce qu’ils ont fait d’énormes efforts sur le hors prix et qu’ils ont considérablement restructuré leurs activités.
Monsieur Éric Woerth, la question n’est pas de savoir comment la France peut rester compétitive, puisqu’elle ne l’est plus du tout ! Nous avons un problème à la fois de compétitivité prix – une heure de travail coûte 37,20 euros en France contre 30,20 en Allemagne – et de compétitivité hors prix, car nous sommes très peu spécialisés. Toutefois, la City de Londres et l’industrie allemande ne se sont pas faites en un jour ! L’économie française repose à la fois sur l’agriculture, l’industrie, les services et le tourisme. Nous devons trouver une formule qui permette de faire fonctionner tous ces facteurs performants en synergie, tout étant attentifs à toujours comparer notre situation avec l’étranger.
Il ne pourra y avoir de convergence rapide avec l’Allemagne, tant les écarts sont importants : les dépenses publiques représentent 48 % du produit intérieur brut chez eux, 56 % chez nous ; le taux de prélèvements obligatoires est de 47 % du produit intérieur brut en France, et 39,5 % en Allemagne.
Monsieur Alain Vidalies, la partie de la dette liée à la crise est réduite puisque, sous l’action des stabilisateurs automatiques, le plan de relance a été limité à 1,2 % du produit intérieur brut. Notre dette est structurelle ; elle est passée de 20 % du produit intérieur brut en 1980 à 88 % aujourd’hui, et elle est appelée à dépasser les 100 %. Il s’agit d’un choix politique : depuis un quart de siècle, les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont choisi la dette plutôt que l’inflation.
S’agissant de la financiarisation, tout le monde est impressionné par les 40 milliards de dividendes distribués par les entreprises du CAC 40, mais il faut garder à l’esprit que cela ne concerne, par définition, que 40 entreprises sur plus de 2 millions que compte la France. Selon les statistiques de l’INSEE sur l’ensemble des entreprises françaises, on s’aperçoit que le taux de marge est, au contraire, en forte baisse. La plupart des petites et moyennes entreprises et la totalité des très petites entreprises (TPE) ne sont pas concernées par la financiarisation, qui ne touche qu’une minorité d’entreprises.
M. Henri Lachmann. C’est faux !
M. Nicolas Baverez. En ce qui concerne le patrimoine, M. Alain Vidalies a raison : si on doit laisser les gens faire fortune – l’impôt sur la fortune étant une absurdité –, il ne faut pas que la fortune puisse se reproduire. L’imposition sur les successions me paraît normale. Il reste que la fiscalité du patrimoine représente déjà 3,4 % du produit intérieur brut en France, contre 0,9 % en Allemagne. Il faut en tenir compte – même si le dispositif actuel peut être amélioré.
Pierre Mendès-France disait que gouverner, c’est choisir. En l’espèce, quelle que soit la configuration politique, on ne pourra pas éviter deux décisions difficiles : d’abord, maîtriser la dépense publique, voire la baisser ; ensuite, compte tenu du déficit, et sachant que l’on ne peut pas augmenter davantage les prélèvements sur les entreprises, demander aux ménages de faire un effort supplémentaire.
Cela ne sera possible que si le projet politique laisse entrevoir un équilibre à moyen terme qui, en échange de cette nouvelle donne économique et fiscale, ouvre de nouvelles perspectives en termes d’emploi, pour les jeunes notamment, et de cohésion sociale.
M. Olivier Ferrand. Il convient en effet de distinguer la compétitivité prix et la compétitivité qualité. Par exemple, l’iPhone est le leader du marché des téléphones intelligents (smartphones), alors que c’est le plus cher. De même, la société chinoise Hua Wei, numéro un mondial sur le marché de la fibre optique et des dérivations (switchs) du réseau internet, vend ses produits extrêmement cher, mais ce sont les meilleurs.
En matière de compétitivité hors prix, la position de la France s’est considérablement dégradée. Il faut remonter aux années 1960 pour trouver de grandes entreprises françaises de taille mondiale apportant de fortes valeurs ajoutées. Les grandes entreprises actuelles ont été fondées par les États-Unis et par les petits pays du nord de l’Europe, qui n’avaient pourtant pas, a priori, la taille critique nécessaire.
Monsieur Éric Woerth, vous avez raison, lorsque les dépenses publiques atteignent 56 % du produit intérieur brut – le record mondial ! –, on peut difficilement continuer dans cette voie. Il serait bon d’adopter un train de vie légèrement décroissant, qui soit conforme à notre richesse nationale. Et cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir à la nature de nos dépenses. Dans les pays nordiques, la qualité des services publics est telle que le niveau élevé de dépenses fait consensus.
Par ailleurs, vu les niveaux de la dette et du déficit, on peut difficilement se contenter de réduire les dépenses, sans chercher à accroître les recettes. D’ailleurs, le Gouvernement a procédé dans la loi de finances pour 2011 à la plus grande augmentation d’impôts depuis vingt ans, avec 11 milliards d’euros d’impôts nouveaux, et la programmation des finances publiques présentée à Bruxelles prévoit une augmentation de 20 milliards d’euros des recettes d’ici à 2013.
Dans le domaine de la protection sociale, comment augmenter les recettes d’une manière qui soit socialement acceptable ? D’abord, en supprimant les niches. Je suis en désaccord sur ce point avec M. Michel Taly : cette méthode a permis au Gouvernement de dégager 11 milliards d’euros de recettes supplémentaires sans soulever un vent important de mécontentement, alors qu’une augmentation du barème de l’impôt sur le revenu mettant en jeu un montant équivalent été très difficile à faire accepter politiquement !
M. Éric Woerth. Il n’y a pas 11 milliards d’impôts en plus, mais un rééquilibrage de la fiscalité.
M. Olivier Ferrand. Qui passe par une augmentation des prélèvements !
M. Éric Woerth. Certes, mais sur une base très différente d’une augmentation structurelle !
M. Olivier Ferrand. Tout à fait, et l’on peut faire la même chose sur les niches sociales : la Cour des comptes estime leur valeur à plus de 60 milliards d’euros !
M. Éric Woerth. Ce montant ne correspond à rien : cela reviendrait à supprimer l’assiette !
M. Olivier Ferrand. Pour ne prendre que ces deux exemples, les courtiers en Bourse ne paient pas de cotisations sociales, et les mannequins non plus. Certes, la suppression de ces niches ne rapporterait pas énormément d’argent, mais si l’on veut vraiment moraliser le capitalisme, on pourrait peut-être commencer par ce type de mesure symbolique !
De même, l’intéressement et la participation bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux, mais les contraintes budgétaires actuelles devraient peut-être nous conduire à réviser nos priorités. Quant au dispositif d’exonération sur les stocks options et les bonus, sa suppression rapporterait 3 milliards d’euros.
La fiscalité du capital doit être revue : une augmentation de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital jusqu’à 10 % rapporterait 3 milliards d’euros. Cela permettrait par ailleurs d’élargir l’assiette au-delà des revenus du travail, ce qui n’est pas illogique dans la mesure où les prestations sociales peuvent être considérées comme des revenus différés.
Enfin, on pourrait remettre en cause les avantages dont bénéficient les retraités sur la contribution sociale généralisée et l’impôt sur le revenu, car ce qui était parfaitement justifié hier, lorsqu’ils étaient les pauvres de la société, ne l’est plus aujourd’hui : le taux de pauvreté est actuellement de 8 % parmi les retraités, contre 11 % dans l’ensemble de la population française et 21 % chez les jeunes. Voilà pourquoi nous proposons d’aligner la fiscalité des retraités aisés sur celle des actifs, ce qui permettrait de dégager 5 milliards d’euros supplémentaires par an.
M. Olivier Carré. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur Olivier Ferrand, que la contribution sociale généralisée s’applique déjà aux revenus du capital, à l’exception des livrets populaires.
En France, les classes moyennes inférieures ont beaucoup de mal à s’élever dans la hiérarchie sociale, alors que dans les pays à forte croissance, l’ascenseur social fonctionne très bien. Ainsi la crainte du déclassement est très forte. Comment y remédier ? La logique de la compétitivité peut-elle être bénéfique pour nos concitoyens ? Quels leviers actionner ?
Vous n’avez pas évoqué la question de la durée du travail. Pourtant, en nombre d’heures travaillées sur la totalité de la vie, il semblerait que l’on travaille moins en France que dans les autres pays. Comment rattraper ce retard ?
M. Jean-Marie Sermier. Si l’on veut augmenter le niveau général de qualification, cela suppose non seulement d’améliorer les formations supérieures, mais aussi de traiter avec une plus grande vigilance les jeunes les moins diplômés.
Par ailleurs, je n’ai entendu parler ni d’environnement, ni d’écologie. Des solutions à nos problèmes de compétitivité peuvent-elles être apportées par la croissance verte ? La prise en considération des émissions de CO2 par l’industrie et par les transports qu’elle induit serait-elle de nature à bouleverser les attitudes économiques, voire l’ensemble des paramètres concernés ?
M. Christian Blanc. M. Nicolas Baverez a évoqué avec raison un « Sedan économique ». Comme la commission Pébereau l’a montré, la dette finance les transferts sociaux, lesquels financent à leur tour la consommation ; si, par je ne sais quel miracle, l’on ne s’endettait plus, nous nous dirigerions tout droit vers la révolte. Il resterait à savoir qui aurait la tête coupée !
De surcroît, M. Henri Lachmann l’a rappelé, du fait de la globalisation, la concurrence est aujourd’hui mondiale ; la France ne peut pas se mettre à l’abri ; la situation est donc bloquée, il faudrait en être conscient.
Ce qui fait notre richesse, ce sont les hommes et les femmes de notre pays, avec leur compétence, leur culture, leur histoire, leur potentiel de qualification et leur sens des responsabilités. C’est vraisemblablement ce qui nous permettra de faire valoir notre différence dans la compétition internationale. Encore faut-il que les priorités soient clairement affichées, qu’elles bénéficient d’une légitimité politique et qu’elles trouvent une concrétisation.
Quelles sont les régions qui tirent l’Allemagne ? Le Bade-Wurtemberg et la Bavière. Pourquoi ? Parce que ces territoires ne fonctionnent pas suivant une logique exclusivement économique, mais qu’ils y associent une dimension culturelle, qu’ils encouragent la responsabilisation et la formation des salariés et qu’ils se dotent d’outils de recherche appliquée, à travers des instituts spécialisés ou l’innovation. Il s’agit d’un mode d’organisation territoriale, que l’on retrouve d’ailleurs au Pays basque et en Catalogne.
En France, du fait de notre histoire, nous ignorons tout de l’économie territoriale et de cette réconciliation de l’économique, du technique et du culturel dans une même volonté collective. De telles modes d’organisation existent, notamment dans la région Rhône-Alpes, autour de Grenoble ou de Lyon, et, dans une moindre mesure, en Bretagne. Je pense par conséquent qu’il est indispensable d’intégrer cette dimension territoriale dans nos travaux.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Monsieur Christian Blanc, il existe déjà de petites Bavière en France – qui pourraient bien essaimer. En outre, prenons garde à ne pas sombrer dans le pessimisme des chefs d’entreprise ! Les chiffres cités plus haut sur le coût de l’heure de travail – 37 euros en France contre 30 en Allemagne – ne valent que pour l’agro-alimentaire et quelques industries utilisant de la main-d’œuvre étrangère ; la grande majorité des entreprises allemandes sont soumises à des conventions collectives, avec des salaires de 10 à 15 % plus élevés que chez nous. Il ne faudrait pas faire accroire que le coût du travail serait beaucoup plus élevé en France qu’en Allemagne.
M. Henri Lachmann. Monsieur le rapporteur, le pessimisme est d’humeur, l’optimisme d’action : les chefs d’entreprise ne sont pas pessimistes !
Personnellement, le coût du travail m’indiffère assez. Ce n’est pas le facteur le plus important ; comme je l’ai dit, la compétitivité ne s’exprime pas exclusivement, ni même prioritairement, en termes de coût.
Il est évident que la dimension territoriale est essentielle. Par exemple, Schneider Electric est une locomotive à Grenoble et cette région se développe grâce à un élan collectif indéniable.
D’ailleurs, pour le Grand emprunt, les projets de campus d’excellence se partagent, pour 90 %, entre les régions d’Île-de-France et Rhône-Alpes. Est-ce parce que les élites ne se rencontrent qu’au Siècle sur la place de la Concorde ? Je pense que le Siècle devrait être supprimé, car la province en pâtit. Il faudrait au contraire soutenir le dynamisme des territoires, en créant un environnement favorable à la croissance et à la compétitivité, sur l’exemple de la région Rhône-Alpes et de Grenoble – où l’on compte de nombreuses locomotives, dont certaines, comme le Commissariat à l’énergie atomique, appartiennent au secteur public : M. Jean Therme est tout sauf un pessimiste !
M. Nicolas Baverez. Un système économique fonctionne sur trois jambes : la consommation, l’investissement et l’exportation ; s’il n’y a pas grand-chose à attendre de la première, on peut agir sur les deux autres.
Les sources de croissance du futur existent : il y a non seulement la croissance verte, mais aussi la consommation des pays du sud – où la classe moyenne atteindra les 2,5 milliards de personnes dans le prochain quart de siècle –, le grey business, c’est-à-dire l’économie du vieillissement dans les pays occidentaux et en Chine, et l’économie de la connaissance. Pour se redévelopper, la France doit se positionner sur ces marchés. Parmi nos atouts, on compte l’épargne très importante en France – qui devrait être davantage orientée vers les entreprises –, les pôles d’excellence et les infrastructures : tout n’est pas à notre désavantage.
La première menace pour les classes moyennes, aujourd’hui, est le chômage : la France est le seul des grands pays développés à n’être jamais sorti de la crise des années soixante-dix. Le taux de chômage n’est plus redescendu sous la barre des 7 % depuis 1977 ! Il faut donc recréer de l’emploi marchand et lutter contre le chômage structurel.
Ce qu’il faut offrir aussi aux classes moyennes, c’est davantage d’éducation et de formation ; je n’y reviendrai pas, car M. Olivier Ferrand en a abondamment parlé. Quand il y a beaucoup de chômage et pas de croissance, non seulement on ne peut plus monter dans l’échelle sociale, mais on risque de descendre. Or tous les gains de productivité ont été absorbés, non par les salaires, mais par l’État, via les augmentations de charges.
M. Olivier Ferrand. La hausse des salaires pour les classes moyennes inférieures ne peut passer que par l’augmentation du niveau de qualification, grâce à la formation initiale et à la formation continue. Dans le secteur de la formation professionnelle, les moyens existent, mais ils sont dépensés en pure perte ! Une réforme rapide s’impose.
Dans un contexte de croissance, on peut demander à ceux qui ont un emploi de travailler davantage pour accroître leur pouvoir d’achat. Mais la France connaît au contraire depuis trente ans une atonie de sa croissance, sur laquelle vient de se greffer une récession majeure.
L’absence de croissance pèse sur l’emploi. Soit l’on ne fait rien, et le chômage augmente : ce fut le choix de la France jusqu’en 1997, la fameuse « préférence française pour le chômage » ; soit l’on partage le travail : c’est ce que tout le monde a fait durant la dernière décennie. Avec les 35 heures, la France a diminué de 154 heures le temps de travail annuel moyen par actif. Les Allemands n’ont pas touché au temps de travail à temps plein, mais ils ont augmenté le temps partiel, ce qui leur a permis de réduire le temps de travail annuel de 154 heures également au cours de la même période.
M. Marc Laffineur, président. Faudrait-il donc réduire encore le temps de travail ?
M. Olivier Carré. Les deux pays n’ont pas tout à fait la même organisation !
M. Olivier Ferrand. Peut-être, mais examinez les conséquences de la crise de 2008 dans les deux pays : alors que la France a perdu 1 million d’emplois privés, en Allemagne, le nombre d’emplois est resté quasiment stable, parce qu’ils ont partagé massivement le travail, grâce à une politique de chômage partiel.
Lorsqu’il faut réduire de 20 % la masse salariale d’une entreprise, il y a deux solutions : soit on licencie 20 % du personnel, soit tout le monde travaille 20 % de moins. La France a choisi la première solution, tandis que les Allemands faisaient le choix inverse. Ce n’est certes pas la panacée, car personne n’a envie de partager son travail et ses revenus, mais la lutte contre le chômage, en période de crise, ne peut passer par une augmentation du temps de travail.
M. Henri Lachmann. Le plus important, pour une entreprise, ce n’est pas le temps de travail, mais la valeur du travail. Or, les 35 heures ont détruit la valeur travail : on parle désormais en termes de réduction de temps de travail et de temps libre. Nous devons revaloriser le travail, qui, loin d’aliéner, libère et protège.
Par ailleurs, les Allemands n’ont pas « partagé le travail », mais leur variable d’ajustement a été le coût salarial, qui permet de conserver un lien social entre le salarié et l’entreprise. Les Français raisonnent toujours en termes d’effectifs, mais cela ne recouvre aucune réalité dans le compte d’exploitation !
M. Marc Laffineur, président. Messieurs, je vous remercie.
*
AUDITION DU 16 FÉVRIER 2011
Audition de M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, membre du Conseil d’analyse économique, de M. Olivier Garnier, chef économiste de la Société Générale, membre du Conseil d’analyse économique, et de Mme Mathilde Lemoine, directeur des études économiques et de la stratégie marchés de HSBC France, membre du Conseil d’analyse économique
M. Marc Laffineur, président. Cette mission a pour objet d’analyser l’évolution de notre compétitivité face à nos principaux concurrents ainsi que l’impact de nos charges sociales. Nous recevons aujourd’hui Mme Mathilde Lemoine qui, outre ses fonctions à HSBC France et au Conseil d’analyse économique, est enseignante à l’Institut d’études politiques de Paris et a été conseiller pour la macroéconomie et la fiscalité auprès du Premier ministre en 2005 et 2006, M. Patrick Artus, économiste reconnu et directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, et M. Olivier Garnier, qui a été économiste auprès du Board des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine et, en France, conseiller auprès du directeur du Trésor et du ministre de l’économie et des finances.
Mme Mathilde Lemoine, directeur des études économiques et de la stratégie marchés de HSBC France, membre du Conseil d’analyse économique. La compétitivité-coût, la compétitivité-prix et la compétitivité à l’exportation sont des notions différentes qu’il convient de définir assez précisément. Pour cela, il faut s’aider des statistiques.
La France a un problème de compétitivité extérieure. Ses termes de l’échange – l’indicateur consacré en la matière – sont stables, ce qui montre qu’elle ne s’enrichit pas par rapport à ses partenaires. Il y a quand même une grande surprise : c’est que dans le secteur manufacturier, les termes de l’échange se sont améliorés de 9 %, contre 10 % en Allemagne. De ce strict point de vue, il n’y a donc pas de grande différence entre les deux pays malgré le mauvais comportement d’un secteur extrêmement important en France, celui de l’automobile, qui explique à lui seul depuis 2003, année du dernier excédent, une grande partie de la dégradation de notre solde commercial.
Cette dégradation de notre déficit commercial – qui, contrairement à ce qu’on entend souvent, n’est en rien un indicateur de perte de compétitivité – résulte à 61 % de celle du solde des produits manufacturés et à 44 % de celle du solde de la seule branche automobile. Le commerce extérieur français est extrêmement concentré : qu’un secteur aille mal et la dégradation est sévère. Il faut donc trouver un secteur relais, ce qui soulève des questions de coût du travail bien sûr, mais aussi d’innovation et de capacité à faire émerger de nouveaux secteurs. Ainsi, contrairement à l’Allemagne qui a su faire émerger son secteur des biotechnologies ex nihilo, la France est très en retard dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, la question va se poser de l’accompagnement de la restructuration et du relais de croissance.
J’en viens à la compétitivité-coût, dont il faut bien garder à l’esprit qu’elle n’est qu’un tout petit aspect de la compétitivité totale. Elle résulte du coût de la main-d’œuvre et d’éléments tels que la valeur des consommations intermédiaires. Si on y ajoute les marges des entreprises, on obtient la compétitivité-prix. Pour ce qui est de la main-d’œuvre, on dispose de plusieurs études. Ainsi, des enquêtes d’Eurostat ont mis en avant une augmentation de son coût de près de 57 % entre 2000 et 2008. Mais un autre indicateur d’Eurostat, le coût horaire, fondé lui sur des bases déclaratives, n’a augmenté que de 28 %, et les comptes nationaux de l’INSEE font état d’un taux encore différent… Il faut donc bien savoir sur quelle donnée on se fonde et pourquoi. Et il ne faut pas oublier que les comparaisons du coût du travail se font au niveau macroéconomique, sans tenir compte de la structure productive du pays. Ainsi, si le secteur automobile est très important et le coût du travail assez faible, cela va influer sur le coût moyen. C’est là une limite importante de ces évaluations statistiques.
La compétitivité totale, elle, dépend largement de la compétitivité hors prix, qui résulte d’un certain nombre de facteurs au premier rang desquels se trouve la capacité du pays à innover. Or celle-ci est très faible en France, ainsi que le démontre un rapport réalisé par Patrick Artus pour le Conseil d’analyse économique. Les entreprises françaises n’investissent que 1,3 % du produit intérieur brut (PIB) dans l’innovation et cette proportion a tendance à reculer, alors qu’elle est de 1,9 % et qu’elle progresse en Allemagne. La capacité à exporter des produits diversifiés, demandés en tant que tels et pas simplement parce qu’ils ne sont pas chers, est assez faible en France. C’est là un élément important.
Il est évident qu’on peut alléger le coût du travail des charges universelles qui y sont rattachées, comme les allocations familiales, en les transférant sur la contribution sociale généralisée (CSG). Cela améliorera les chiffres sur une année, mais cela ne conduira en rien à un gain tendanciel de compétitivité. Pour parvenir à cette amélioration de la productivité tendancielle, c’est-à-dire durable, il faut améliorer l’investissement des entreprises dans l’innovation. Pour cela, il faudrait augmenter la rentabilité des investissements dans l’entreprise et alourdir le coût des investissements financiers. C’est possible grâce à des mesures assez simples, comme une exonération d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis accompagnée d’une forte hausse de ce même impôt sur les bénéfices allant vers des investissements financiers, avec notamment un plafonnement de la déduction pour les intérêts d’emprunt ou une taxation des bénéfices utilisés pour les rachats d’actions. Cela peut vraiment jouer sur la productivité à moyen terme et sur la compétitivité à l’extérieur.
M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, membre du Conseil d’analyse économique. Il faut bien se rendre compte de la gravité de la situation. La part de marché à l’exportation de la France, hors énergie, est passée de 6 % en 1999, lors de l’entrée dans l’euro, à 3,5 % aujourd’hui, soit une perte de plus de 40 %. L’Allemagne, elle, est restée absolument stable, à 9 %, ce qui est d’ailleurs une performance exceptionnelle puisque dans le même temps la part de marché de la Chine passait de 2 % à 12 %. Nous perdons des parts de marché sur tous les produits et sur tous les marchés de façon à peu près homogène. Cela n’a rien à voir, contrairement à ce qu’on lit souvent, avec notre structure productive – le fait que nous produisions moins de biens d’équipement par exemple – ou avec l’orientation géographique des échanges. Le rapport qu’a évoqué Mme Mathilde Lemoine, que j’ai écrit avec M. Lionel Fontagné, détaille tout cela et montre aussi que cette perte de parts de marché n’est pas, ou très peu, attribuable à un problème de coûts. La France est le pays le plus désindustrialisé de la zone euro avec la Grèce et l’Espagne, la part de l’emploi manufacturier dans notre emploi total tournant autour de 11 %. Ce problème de recul de l’industrie manufacturière, très particulier à la France, est extrêmement inquiétant.
Pour ce qui est de la compétitivité-coût, il faut vraiment faire très attention aux chiffres auxquels on se réfère. Ainsi, si les coûts salariaux unitaires ont plus augmenté en France qu’en Allemagne pour l’ensemble de l’économie, ils ont évolué de façon presque identique pour la seule industrie manufacturière. Cela s’explique par un effet de structure : quand la part des services dans l’économie est grande, les salaires y augmentant à peu près comme dans l’industrie, les coûts salariaux unitaires de l’ensemble de l’économie s’accroissent mais cela ne reflète absolument pas une perte de compétitivité de l’industrie. Il n’y a en réalité dans la zone euro que deux pays qui connaissent une perte de compétitivité-coût dans l’industrie : l’Espagne et la Grèce. Pour les quinze autres, elle évolue comme en Allemagne, voire mieux. Les chiffres de compétitivité totale donnent des résultats très différents, mais faux, puisqu’ils mélangent la compétitivité du tourisme, de la restauration, des services aux particuliers ou des transports par exemple, qui sont essentiellement non exportables.
Pour ce qui est de la compétitivité-hors coût, de nombreux travaux concluent que le problème majeur serait le faible nombre de nos PME exportatrices. À ce propos, il faut garder à l’esprit une spécificité de la France : la situation des grandes entreprises cotées n’y reflète absolument pas celle d’ensemble du pays. Si vous observez les entreprises qui composent l’indice de la bourse de Francfort (le DAX) ou celles du Standard & Poor’s (S&P) aux États-Unis, vous verrez à peu près la situation de l’économie allemande ou américaine, tandis que les indicateurs de la cotation assistée en continu (CAC 40) sont non seulement différents, mais à l’opposé complet de ceux des autres entreprises françaises ! Souvent, suivant la thèse qu’ils veulent défendre, les commentateurs se fondent sur l’un ou l’autre de ces chiffres. Il faut y faire très attention.
La France ne compte que 90 000 entreprises exportatrices, et ce nombre diminue, contre 250 000 en Allemagne, où il augmente. Nos petites et moyennes entreprises (PME) sont de taille nettement plus petite, et nos entreprises nouvelles ne connaissent pas de croissance : au bout de cinq ou sept ans, elles ont toujours le même nombre d’emplois que lors de leur création. Autrement dit, si deux types créent Google dans un garage en France, dix ans plus tard ils seront toujours deux dans un garage ! Il en va tout autrement dans les autres pays. Ce fait pèse sans doute sur notre recherche et développement. Nous avons aussi des problèmes dans les relations de sous-traitance, qui ont été bien étudiés par M. Jean-Paul Betbèze. Enfin, les entreprises françaises souffrent de deux éléments très perturbateurs : leur profitabilité est dramatiquement basse – et ne cesse de diminuer – et elles sont financées essentiellement par la dette. Leur taux d’autofinancement, c’est-à-dire le rapport entre les profits et l’investissement, dépasse tout juste 60 %, ce qui est après le Portugal le niveau le plus bas d’Europe – il est de 110 % en Allemagne, de 130 % au Royaume-Uni, de 120 % aux États-Unis. Or quand on est le patron d’une entreprise à la fois peu profitable et très endettée, la seule chose à faire, c’est de ne prendre aucun risque. Cela explique pour l’essentiel l’absence de développement de nouveaux produits, d’efforts à l’exportation et de création d’emplois.
Que faire ? En matière de profitabilité, contrairement à ce qu’on lit parfois, les salaires augmentent en France depuis le début des années 2000 plus vite que la productivité. L’évolution est inverse dans la plupart des autres pays, ce qui peut d’ailleurs être critiqué. Quoi qu’il en soit, les entreprises françaises ont vu leurs marges bénéficiaires comprimées, sauf bien sûr celles du CAC 40, qui se réalisent essentiellement en dehors de France. Quant au financement, il y a pour l’instant très peu de fonds propres accessibles aux petites et moyennes entreprises, malgré les mesures fiscales visant à les accroître. Il y a là matière à réflexion.
Pour ce qui est de la fiscalité, si l’on observe de façon tout empirique l’ensemble des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour savoir quelles caractéristiques fiscales influent sur le taux de l’emploi, la seule qui paraisse extrêmement significative est le poids des charges sociales, en particulier de celles qui pèsent sur les employeurs. C’est elle qui explique la faiblesse du taux d’emploi dans l’ensemble de la population, ou le taux élevé du chômage des jeunes par exemple. Rien d’autre, dans les systèmes fiscaux, ne peut expliquer les différences de structure du marché du travail. Il convient certes de dépasser la stricte observation des chiffres, mais là se situe bien le problème majeur, et non dans ce dont on débat en ce moment dans les médias, comme la progressivité de l’impôt sur le revenu. La façon dont nous finançons la protection sociale, essentiellement sur les salaires, est, de ce point de vue, empirique la seule explication de notre situation en matière d’emploi.
Au total, la situation de la France n’est pas florissante ! Nous avons perdu 40 % de nos parts de marché à l’exportation, et le mouvement s’accélère. Ce n’est probablement pas dû à un problème de coûts, mais au fait que nos entreprises restent petites. Reste maintenant à bien analyser le poids des différents facteurs en jeu, et à travailler sur les charges sociales des employeurs, qui semblent – globalement, sans entrer dans le détail des allégements de charges sur les plus bas salaires – avoir un effet majeur sur la performance du marché du travail.
M. Olivier Garnier, chef économiste de la Société Générale, membre du Conseil d’analyse économique. Même si cela doit démentir la réputation faite aux économistes, je suis d’accord avec ce que viennent de dire mes deux collègues – à une petite réserve près : s’il est clair que nous manquons de petites et moyennes entreprises de taille moyenne, aucune étude n’a démontré de manière convaincante que cela expliquait notre faible performance à l’exportation.
Je vais restreindre mon propos à huit remarques.
D’abord, et c’est une « tarte à la crème », la compétitivité et la performance du commerce extérieur ne sont pas une fin, mais un moyen. Ce qui compte d’abord et avant tout pour un pays, c’est la progression de son niveau de vie, mesuré par exemple par le produit intérieur brut par tête sur moyenne période – ce qui n’a rien à voir avec ses performances relativement aux autres pays : si nous avions 3 % de croissance, nous serions très heureux, même avec une croissance allemande de 5 %. L’enjeu principal est d’améliorer notre niveau de vie, notamment par le biais de la productivité.
Ensuite, quand on réfléchit sur le commerce extérieur, il ne faut pas oublier les importations. Souvent, les pays qui réussissent bien à l’extérieur sont ceux qui savent bien importer. Ils profitent de la mondialisation, qui offre des possibilités d’acheter à de meilleurs prix. L’Allemagne est un bon exemple : elle a su utiliser le vivier de l’Europe de l’est pour faire de la sous-traitance, ce qui a amélioré ses performances à l’exportation. Ainsi, les importations allemandes représentent 36 % du produit intérieur brut, contre 25 % en France. Ce qui montre bien que l’ouverture économique est un sujet d’importance.
De la même manière, on a souvent tendance à se focaliser sur sa capacité à attirer les investissements directs étrangers, mais les études montrent une très forte complémentarité avec le phénomène inverse. Ainsi, les Allemands font beaucoup d’investissements directs à l’étranger, qui participent à leur performance à l’exportation.
Pour ce qui est du financement cette fois, encore une « tarte à la crème » : toutes les questions de structure des prélèvements obligatoires ou de mode de financement de la protection sociale ne sont que des éléments de second ordre par rapport à la question de la taille des dépenses à financer. La première des différences avec l’Allemagne, c’est que le poids de nos dépenses publiques dans le produit intérieur brut tourne autour de 55 %, contre 46 % chez eux !
Dès lors, tous nos débats qui visent à substituer un prélèvement à un autre à recettes constantes – sur la taxe sur la valeur ajoutée (dite TVA sociale) par exemple – se trompent de sujet. Compte tenu de la taille de nos déficits publics, ce qu’il faut se demander, c’est quel serait le moins mauvais prélèvement à augmenter pour les résorber ! Arriver, sur une longue période, à faire progresser les dépenses publiques ne serait-ce qu’en ligne avec la croissance potentielle de l’économie, serait déjà une performance, que nous n’avons jamais réussi à accomplir.
Toujours à propos du financement de la protection sociale, je rappelle qu’il ne reste plus grand-chose à réduire aujourd’hui dans les charges sociales des employeurs sur les bas salaires. Au niveau du salaire minimum de croissance (SMIC), elles sont déjà très basses. Or, c’est sur les bas salaires que les allégements de charges ont le plus d’efficacité en termes d’emploi. Si l’on instaurait brutalement une TVA sociale, cela reviendrait plutôt à baisser les charges sur la partie des emplois qui sont les moins sensibles aux effets de coût.
Quant à l’impôt sur les sociétés, on entend souvent dire que si son taux est plutôt plus élevé en France que dans les autres pays, ses recettes en part du produit intérieur brut sont moindres et qu’il y a donc sans doute matière à optimisation. Mais c’est oublier tous les impôts qui pèsent sur les comptes d’exploitation – une soixantaine de taxes ! – et viennent grignoter l’assiette de cet impôt. Il faut tenir compte de ce premier prélèvement. D’autres éléments, qui peuvent être tout à fait justifiés, comme le crédit impôt recherche, peuvent aussi expliquer ces différences. Il faut donc se méfier de ce constat un peu brutal.
Enfin l’on entend de plus en plus avancer, à droite comme à gauche, l’idée de taxer les revenus du travail et de l’épargne exactement de la même manière, au barème de l’impôt sur le revenu. Cela peut paraître logique, mais aucun pays de l’OCDE ne le fait. La raison en est simple : les revenus de l’épargne sont de la consommation différée. Imaginez deux personnes ayant le même revenu, l’une qui dépense tout immédiatement et l’autre qui en met une partie de côté pour la dépenser plus tard. Dans le système imaginé, la deuxième sera plus taxée. Pour être équitable – ce qui est souvent l’argument avancé en faveur de cette idée –, il faudrait déduire la somme épargnée de l’impôt sur le revenu, et l’on retomberait alors dans une sorte de taxe sur la consommation. Et encore faudrait-il aussi déduire les effets de l’inflation sur les rendements de l’épargne… Le problème est donc plus compliqué qu’il n’y paraît. L’un des pays qui a accompli la réforme la plus achevée, la Norvège, a établi au début des années 2000 un système dual d’impôt sur le revenu. Il y a un premier impôt à 28 % sur tous les revenus, impôt sur les sociétés compris, puis une surcharge progressive sur les revenus du travail qui peut aller jusqu’à 20 % – ce qui fait 48 % au total –, avec une déductibilité pour les revenus des actions afin d’éviter une double imposition entre impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Voilà qui est plutôt pessimiste. Avez-vous mesuré l’influence d’éléments tels que la réduction de la taxe professionnelle sur les entreprises, le crédit impôt recherche, la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée déterminée, l’allégement des charges sur les bas salaires et même le statut de l’auto-entrepreneur, qui est un moyen de développer l’initiative et la responsabilité ?
Quant aux coûts du travail, ils semblent très difficiles à comparer. L’Allemagne a un système fédéral. Il y a des conventions collectives dans certaines branches, mais pas dans d’autres où beaucoup d’emplois sont rémunérés à 8 euros de l’heure, comme l’industrie agro-alimentaire. Au total, les coûts paraissent moins élevés en France dans certains cas, plus dans d’autres… Comment peut-on sortir de ce débat ? Le but de cette mission est d’essayer d’arriver à une convergence sur les diagnostics, à défaut de le faire sur les solutions.
Enfin, la France et les Français aiment-ils leur industrie ? Il y a quelques jours, Le Monde a parlé de ces bassins d’emplois qui ont un grand dynamisme et qui continuent à créer des emplois dans l’industrie. Ils ne sont hélas pas très nombreux. Avez-vous étudié les raisons de leur réussite : une éthique du travail, un environnement favorable à l’esprit d’entreprise ?
M. Jérôme Cahuzac, corapporteur. Contrairement à M. Pierre Méhaignerie, je n’ai pas jugé pessimistes les propos que j’ai entendus. Je me suis même demandé si notre mission avait un sens, dans la mesure où Mme Mathilde Lemoine nous a expliqué que la France n’avait pas de problème de compétitivité-coût dans le secteur industriel, et que nous n’avions pas à rechercher avec l’Allemagne une convergence qui existait déjà – et qui devrait d’ailleurs être mise au crédit de l’Allemagne, puisque, dans un précédent article, Mme Mathilde Lemoine avait indiqué que le coût du travail était plus élevé au Royaume-Uni et en Allemagne qu’en France. Puis, en écoutant M. Patrick Artus, il m’a semblé étonnant que, étant donné la différence de montant des charges sociales, les deux pays puissent avoir la même compétitivité-coût dans le secteur industriel. Serait-ce lié au fait que, si les charges sociales sont plus élevées en France, les salaires sont supérieurs en Allemagne ? Bref, j’aimerais savoir si la France a, oui ou non, un problème de compétitivité-coût.
Monsieur Olivier Garnier, je n’ai pas bien compris votre raisonnement sur la fiscalité de l’épargne et la distinction que vous faites entre le stock, qui ne saurait être imposable, et les revenus. En quoi le fait de taxer de la même manière les revenus du travail et ceux du capital serait-il inéquitable ? Il me semble que c’est au contraire la différence actuelle entre le niveau d’imposition des revenus du travail et celui des revenus du capital qui manque d’équité ! Par exemple, on peut être imposé à 31,2 % sur les plus-values de cessions mobilières et à 20 % ou à 40 % sur le revenu : il ne me paraît pas absurde de vouloir faire converger les deux taux.
M. Patrick Artus. Nous sommes tous les trois d’accord sur un point : quelles que soient les compensations possibles entre le niveau des charges sociales et celui des salaires, la compétitivité-coût n’est pas le principal problème de la France. D’ailleurs, dans les modèles de l’équilibre économique général, la fiscalité est neutre à long terme : si l’on augmente les charges sociales, les salaires baisseront d’autant, et si l’on augmente la taxe sur la valeur ajoutée tout en diminuant les charges sociales, les salaires s’indexeront sur celle-ci. Tout changement de structure de la fiscalité ne peut avoir que des effets transitoires.
En l’espèce, si les charges sociales sont plus lourdes en France, les salaires y sont également plus bas, ce qui revient au même en termes de coût du travail. On peut toujours discuter de la valeur exacte de celui-ci, tous les travaux empiriques – comme celui, particulièrement méticuleux, que M. Lionel Fontagné et moi-même avons mené – montrent qu’il ne s’agit pas du principal facteur explicatif de l’évolution des parts de marché des différents pays ; le problème, c’est la compétitivité hors coûts – et c’est bien ce qui complique les choses.
Par ailleurs, vous avez raison, monsieur le Président Pierre Méhaignerie : il convient d’être prudent lorsqu’on compare le marché du travail en France et en Allemagne. Au cours de la dernière décennie, l’Allemagne a entrepris de créer un marché du travail dual, avec un secteur de l’industrie, majoritairement masculin, aux salaires élevés et un secteur des services, majoritairement féminin, aux salaires faibles. L’explosion des inégalités de revenus dans ce pays est une conséquence directe des lois Hartz, qui comprenaient des incitations très fortes au retour sur le marché du travail, même à un salaire très bas. Ce dispositif a permis à l’Allemagne d’augmenter le taux d’emploi et de préserver de hauts niveaux de salaire dans l’industrie, au prix d’une grande flexibilité dans les autres secteurs.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Le niveau de salaire varie cependant beaucoup d’une industrie à l’autre.
M. Patrick Artus. Globalement, le secteur industriel offre des salaires élevés, même s’il existe des exceptions, comme l’agroalimentaire. C’est dans la distribution et les services à la personne que l’on trouve les plus bas salaires, de l’ordre de 700 à 900 euros par mois, pour des emplois occupés à 80 % par des femmes.
Quand on compare les chiffres, il faut donc distinguer ceux qui se rapportent à l’industrie et ceux qui concernent l’ensemble de l’économie. Ceux qui affirment que les coûts salariaux sont plus élevés en France ne considèrent que les seconds : du fait du salaire minimum de croissance, les salaires dans le secteur non industriel sont moins bas en France qu’en Allemagne.
M. Olivier Garnier. Monsieur Jérôme Cahuzac, exception faite des héritages, le stock vient de l’épargne accumulée, c’est-à-dire de revenus déjà imposés. On peut taxer les transmissions, mais, pour la plupart des contribuables, le stock d’épargne ne tombe pas du ciel. D’où l’argument d’équité que j’évoquais.
Par ailleurs, si l’on veut faire des comparaisons, il faut tenir compte de l’ensemble des prélèvements existants. Que les impôts portent sur les stocks, sur les plus-values ou sur les revenus, d’un point de vue strictement économique, cela revient au même : on taxe la rentabilité de l’actif. L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) peut s’analyser ainsi. La réforme fiscale néerlandaise, si souvent citée en exemple, a supprimé l’impôt sur la fortune, mais elle l’a remplacé par une taxation à hauteur de 30 % des revenus de l’épargne, sur la base d’une rentabilité théorique de 4 % – ce qui revient au même qu’un ISF à 1,2 % !
Mme Mathilde Lemoine. Selon les derniers chiffres publiés par Eurostat, le coût du travail serait, en valeur, identique en France et en Allemagne, à environ 33 euros par heure. Le problème, c’est que les chiffres qui ont servi de base aux publications récentes ont été retirés du site d’Eurostat en raison d’une suspicion d’erreurs de calcul. Il faut donc prendre toutes ces données avec prudence.
Bien entendu, le coût du travail participe de la compétitivité globale d’une entreprise, mais en partie seulement. Pour prendre un exemple polémique, le coût horaire du travail dans le secteur automobile est, d’après les enquêtes, de 41 euros en France contre 43 en Allemagne ; cela n’a pas empêché le déclin de notre industrie automobile, qui joue un grand rôle dans la dégradation de notre déficit commercial depuis 2003.
Par ailleurs, il faut prendre en considération à la fois le niveau et la tendance. On peut d’ores et déjà s’accorder sur un constat : le coût du travail a augmenté plus vite en France qu’en Allemagne, mais les deux pays sont très proches en termes de niveau. Toutefois, la situation variant d’une industrie à l’autre, il convient d’affiner l’analyse : comme la structure n’est pas prise en compte dans les statistiques, on ne peut pour l’instant tirer aucune conclusion en terme de compétitivité.
Il circule beaucoup de chiffres sur le nombre d’heures travaillées. Le débat public s’est saisi des données issues des enquêtes, lesquelles sont, comme on l’a vu, sujettes à caution. Si l’on regarde les comptes nationaux, le nombre d’heures travaillées semble avoir beaucoup moins baissé qu’on ne le dit.
Conséquence du haut niveau des charges sociales, la rémunération par heure travaillée est, selon Eurostat, plus faible en France qu’en Allemagne.
Selon nos calculs, la réforme de la taxe professionnelle aurait provoqué une augmentation moyenne de 3 points de l’excédent brut d’exploitation (EBE), ce qui n’est pas négligeable, même s’il s’agit de données macroéconomiques à manier avec prudence. Le problème est de savoir comment orienter ce gain vers l’investissement productif et l’innovation afin d’améliorer la productivité et la compétitivité : entre 2000 et 2007, les coûts salariaux unitaires, c’est-à-dire le coût du travail divisé par la valeur ajoutée, ont augmenté de 1,5 % en France et diminué de 11 % en Allemagne, tandis que la compétitivité-prix, qui intègre les marges et les consommations intermédiaires, a diminué dans le même temps de 1 % en France et de 0,5 % en Allemagne.
M. Patrick Artus. Si, à coût égal, la production n’est pas de gamme équivalente, les performances à l’exportation s’en ressentent. Toutes les études empiriques sur le commerce extérieur comparé – notamment celles du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) – parviennent à la même conclusion : le niveau de gamme de la France est inférieur à celui de l’Allemagne. Cela se vérifie notamment par les effets des fluctuations du cours de l’euro sur les exportations : quand l’euro s’apprécie de 10 %, les exportations de la France hors de la zone euro diminuent d’environ 8 %, celles de l’Allemagne de 1,5 %. Dans l’autre sens, en Italie, la hausse des coûts salariaux est entièrement attribuable à une montée en gamme. Selon moi, le niveau de gamme est le vrai problème, non les coûts salariaux.
Il existe de nombreux travaux économétriques très sophistiqués relatifs aux charges sur les bas salaires, qui montrent tous l’existence d’une forte sensibilité de l’emploi aux charges et au coût du travail jusqu’à 1,4 ou 1,5 SMIC.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée déterminée, il commence à y avoir des travaux, notamment ceux de M. Pierre Cahuc, qui montrent que ce dispositif est utilisé par les entreprises comme un substitut aux préretraites.
M. Hervé Novelli. Si cette mission arrivait à un constat partagé, ce serait déjà fort utile. Or tout le monde ici a admis une perte de compétitivité des entreprises françaises à partir des années 2000 ; les taux de marge se sont érodés et le coût salarial – quoi qu’on pense de son niveau et de son rôle – ayant crû, nous avons perdu un avantage compétitif important. En revanche, aucune réponse claire n’a été donnée sur les raisons de cette évolution.
S’agissant de la compétitivité hors prix, le président Pierre Méhaignerie a raison : les données fournies par Mme Mathilde Lemoine sur le niveau des dépenses de recherche et développement remontent à 2008, c’est-à-dire qu’elles ne tiennent pas compte des effets, probablement très importants, du crédit d’impôt recherche. Il serait bon que notre mission établisse un bilan chiffré des politiques structurelles mises en œuvre depuis trois ans : outre le crédit d’impôt recherche, la réforme de la taxe professionnelle, la politique des brevets, la mise en place des pôles de compétitivité ou le rôle d’OSÉO.
M. Éric Woerth. Monsieur Patrick Artus, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur les écarts de niveaux de gamme qui semblent jouer un si grand rôle dans la différence de compétitivité entre la France et l’Allemagne ?
Par ailleurs, il conviendrait de ne pas se focaliser sur la comparaison avec l’Allemagne, car nous avons d’autres concurrents. Comment aborder la question de manière plus large ?
M. Marc Goua. Les PME sont bien plus petites en France qu’en Allemagne. Ne s’agit-il pas du principal problème de la France, avec le niveau de gamme ? Quelle en est la cause ? Les banques, auxquelles les chefs d’entreprise reprochent de ne pas les aider à grandir, n’ont-elles pas une responsabilité en la matière ?
M. Jean-Claude Sandrier. À vous entendre, la différence de compétitivité entre la France et l’Allemagne tiendrait, pour une assez grande part, au manque d’innovation des entreprises françaises. Cela soulève la question – fort peu évoquée, au demeurant – de la répartition de la richesse créée par l’entreprise entre, d’une part, l’investissement, l’innovation et la formation, et, d’autre part, les actionnaires.
Total a ainsi annoncé la distribution de la moitié de ses 10 milliards de bénéfices à ses actionnaires, tandis qu’EDF va distribuer des dividendes équivalant au double de son résultat net, en baisse. Cela confirme le déplacement de la richesse nationale vers les patrimoines, au détriment des investissements productifs. On s’étonne aujourd’hui de la faiblesse de l’industrie française, alors que, depuis le premier choc pétrolier au moins, on n’a eu de cesse de la décrédibiliser. Pensez-vous que si l’on modifiait le partage des richesses à l’intérieur des entreprises, cela permettrait d’améliorer la compétitivité ?
M. Olivier Carré. Une remarque, pour commencer : certains produits d’épargne sont en réalité un habillage du salaire à des fins d’optimisation fiscale – ce qui a une influence sur les modèles fiscaux, qui travaillent sur l’imposition marginale.
On nous dit souvent qu’une des grandes différences entre les sociétés françaises et les sociétés allemandes ou italiennes, c’est que les nôtres travaillent souvent seules, alors que le parrainage des PME par de très grandes entreprises renforcerait notre puissance à l’exportation. Qu’en pensez-vous ?
La rigidité du marché du travail français a-t-elle une influence sur notre compétitivité ? Existe-t-il des indicateurs objectifs permettant de la mesurer ?
M. Alain Vidalies. Nous avons engagé nos travaux sur la foi d’une étude qui, après avoir fait le « 20 heures » de TF1 et les grands titres de la presse nationale, après avoir été commentée par des hommes politiques et par de brillants économistes qui y voyaient un encouragement à la réforme structurelle du marché du travail, s’est révélée fondée sur des données erronées – notamment parce que les statisticiens avaient évalué le coût du travail effectué dans le cadre des conventions de forfait sur la base des 35 heures ! Cette erreur grossière a débouché sur une folie collective, ce qui doit nous inciter à la prudence.
Tout le monde semble d’accord pour dire que la question de la compétitivité ne se réduit pas au problème des coûts. Il reste que personne ne conteste que la France a un problème à cet égard et qu’il faut en rechercher les causes pour essayer de trouver des marges de manœuvre.
M. Patrick Artus a ainsi signalé qu’à coûts salariaux quasiment identiques, la rentabilité des entreprises françaises était plus faible que celle des entreprises allemandes, en raison de l’insuffisance de leurs fonds propres et du poids des dettes inscrites à leur bilan. Ce constat doit nous conduire à nous interroger sur les modes de financement de l’investissement industriel dans notre pays, que ce soit en termes d’accession à ces financements ou de règles relatives aux fonds propres.
S’agissant des PME, je note que cela fait deux fois que nous entendons la même chose : la semaine dernière, un grand capitaine d’industrie avait déjà admis que les grandes entreprises françaises n’assumaient pas leurs responsabilités à l’égard des PME. Il ne faudrait pas en rester au stade du discours !
Je ne comprends pas pourquoi, dans certaines entreprises, en particulier dans la métallurgie et dans l’industrie automobile, on fait appel à tant d’intérimaires. Un tel parti pris relève de l’obscurantisme social ; ce mode de management ne vise qu’à fragiliser les salariés, et peu importe que cela ait un coût, dû à l’augmentation des salaires induite par les primes de précarité. C’est absurde !
Il me semble que les pouvoirs publics disposent en la matière de certaines marges de manœuvre, notamment sur la mutualisation des cotisations chômage, dans la mesure où les entreprises qui créent de la précarité accroissent les dépenses de l’Unédic en générant de nouveaux droits, alors que celles qui fidélisent leurs salariés ne sont pas récompensées.
M. Jérôme Cahuzac, corapporteur. M. Hervé Novelli s’est interrogé sur les raisons de l’érosion de la compétitivité de nos entreprises depuis les années 2000. J’ai appris, de mon côté, qu’entre 2005 et 2010, le nombre de voitures fabriquées et immatriculées en France avait baissé de moitié, et celui des poids lourds d’un tiers. Pouvez-vous nous le confirmer ? Comment expliquer une telle dégradation de ce secteur en un laps de temps aussi court ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Monsieur Alain Vidalies, je soumets deux phrases à votre réflexion. La première a été prononcée par le président d’American Express s’adressant à des chefs d’entreprise américains : « Surtout n’allez pas en France, tout y est trop compliqué ». La seconde est due au président de Nestlé : « Je mets tellement de temps en France pour fermer une usine qui ne correspond plus aux besoins des consommateurs que je n’en ai plus pour en créer de nouvelles. » Cela révèle un problème réglementaire franco-français, y compris sur le marché du travail.
Madame, messieurs, vous raisonnez davantage en termes macroéconomiques que microéconomiques. Mais ne croyez-vous pas que le chef d’une entreprise de cinq cents salariés a beaucoup plus intérêt à vendre son entreprise qu’à la transmettre à ses enfants ? Si oui, quel rôle joue l’impôt de solidarité sur la fortune dans sa décision ?
M. Christian Blanc, président. Monsieur Patrick Artus, vous avez remarqué que, dans la compétition internationale, le niveau des gammes de produits avait vraisemblablement plus d’importance que celui des coûts. Pourriez-vous développer votre propos ? L’amélioration de la chaîne de l’innovation ne permettrait-elle pas d’élever le niveau des gammes de produits ?
M. Patrick Artus. Il est extrêmement difficile de mesurer ce niveau. Pour y parvenir, les économistes comparent le prix relatif de milliers de produits dans différents pays. Ils relèvent les variations de prix qui n’ont pas entraîné de variations de parts de marché et s’ils constatent, par exemple, que le verre allemand est devenu plus cher que le verre français sans faire baisser la part de l’Allemagne sur ce marché, ils en concluent que cette hausse de prix s’explique par une meilleure qualité, et donc par un niveau de gamme supérieur. De fait, on ne peut mesurer qu’un niveau de gamme relatif. Or nous déplorons aujourd’hui une baisse de ce niveau pour à peu près tous les produits français, à l’exception du matériel de transport et de la pharmacie.
Les économistes ont observé par ailleurs, en travaillant sur ces données extrêmement fines, que la France avait une logique de montée de gamme par niches, alors que les autres pays avaient adopté une logique de montée de gamme globale. C’est ainsi que les Allemands ou les Italiens peuvent être très bons sur tous les produits et faire du « haut de gamme » dans la chimie, le plastique, le bois, le textile, etc. et pas seulement dans les trains et les avions.
Comment monter en gamme ? Je ne sais pas. Certains pays l’ont fait, comme la Suède, le Japon et surtout l’Italie qui, depuis quinze ans, vend plus cher des produits plus sophistiqués en augmentant ses marges. Et la politique de recherche et développement, s’agissant de ce pays, ne semble pas y être pour grand-chose. La réponse est peut-être à trouver dans la stratégie d’entreprise…
M. Christian Blanc, président. Peut-être dans les modes d’organisation ? Je pense aux grappes d’entreprise, aux clusters, aux distritti italiens, etc.
M. Patrick Artus. Réunir les entreprises a sans doute un effet de synergie. C’est ce qui s’est passé dans le Jura pour la plasturgie, par exemple. Reste que les chiffres français sont assez éloquents : nous sommes en baisse de niveau de gammes relatif par rapport à presque tous les pays : les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, la Finlande, la Slovénie, le Japon, le Canada…
Je tiens à revenir sur le débat opposant les entreprises du CAC 40 aux petites et moyennes entreprises, car il ne me semble pas bien posé.
D’abord, on ne dispose pas de statistiques fiables sur l’origine géographique des profits du CAC 40. L’exercice est d’ailleurs très compliqué en raison des prix de transferts, des localisations des profits à certains endroits, des arbitrages de fiscalité, etc. On sait malgré tout que près 80 % de ces profits sont réalisés hors de notre pays. Par exemple, Total fait « zéro profit » en France. Dans ces conditions, comment mesurer le partage des revenus à l’intérieur des entreprises multinationales ?
Ensuite, si l’on se réfère à l’ensemble des entreprises, il apparaît que la part des salaires dans le produit intérieur brut a augmenté, après avoir été stable dans les années quatre-vingt-dix. Le problème, selon moi, tient à l’insuffisance de l’autofinancement des investissements ou de la recherche – à 60 % de taux d’autofinancement, dans un environnement qui n’incite pas à s’endetter, les entreprises ne peuvent que contracter leurs dépenses – et aux dix années de baisse de profitabilité, plutôt qu’au CAC 40. Certes, les salaires n’ont pas augmenté de façon extravagante en France, mais ils ont augmenté plus vite que la productivité – de 1,2 % ou 1,3 % par an depuis la création de l’euro. La difficulté me semble surtout tenir à la « sous-profitabilité » des entreprises, liée à une insuffisante augmentation de leur productivité.
Je terminerai sur les ventes précoces de petites et moyennes entreprises, évoquées à juste titre par plusieurs d’entre vous. Selon l’INSEE, dans 90 % des cas, les PME françaises sont vendues par leur propriétaire à de grands groupes, ce qui fait qu’elles disparaissent des statistiques. Ce n’est pas le cas en Allemagne, où les PME ont l’opportunité de grandir. Et selon des chiffres venant des banques privées, un créateur de PME vend celle-ci quand elle vaut, en moyenne, entre 15 et 20 millions d’euros.
Il n’y a pas, à ma connaissance, d’études scientifiques sur les raisons de ces ventes précoces. Si je me réfère à certaines interviews, le phénomène serait plutôt lié à la taxation des plus-values en capital qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune.
M. Olivier Garnier. Je remarque moi aussi, monsieur Éric Woerth, que l’on a trop tendance aujourd’hui à faire de l’Allemagne un modèle – alors qu’il y a seulement quelques années, c’était l’inverse. Les Allemands rencontrent eux aussi certains problèmes, et ils ne sont pas exemplaires dans tous les domaines. Il faut donc être prudents dans nos comparaisons.
En termes de coûts salariaux unitaires, nous avons fait mieux que les autres pays de la zone euro, notamment que ceux de la « périphérie » de cette zone, où ils ont connu une forte augmentation.
Il faut plus particulièrement se méfier des comparaisons qui ne portent que sur la dernière décennie. Souvenons-nous que l’Allemagne avait fortement perdu en compétitivité au cours des années quatre-vingt-dix à la suite de la réunification, et qu’elle est entrée dans l’euro avec un taux de change surévalué. L’effort, notamment salarial, accompli dans ce pays au cours des années 2000 est la contrepartie des pertes accumulées au cours de la précédente.
Il n’en reste pas moins que les indicateurs font apparaître, en France, une accélération de la dégradation des performances à l’exportation au cours de ces dernières années. Je ne suis pas sûr que nous puissions l’expliquer. Peut-être est-ce dû au fait, souligné par M. Patrick Artus, que l’économie française est plus sensible que d’autres aux effets du taux de change. Il faudrait donc travailler sur cette hypothèse, en s’en tenant à la partie hors zone euro : au sein de la zone euro – à l’exception de l’Allemagne – nous avons plutôt gagné en compétitivité-coût ; en revanche, à l’extérieur, nous avons subi des pertes liées à l’appréciation du taux de change de l’euro à partir de 2002.
Par ailleurs, les entreprises ne distribueraient-elles pas trop de dividendes ? Elles peuvent choisir d’en distribuer ou non – dans ce dernier cas, le gain de l’actionnaire prend plutôt la forme de plus-values – et les raisons de leur choix sont essentiellement fiscales. Voilà pourquoi, selon les pays, les entreprises distribuent plus volontiers des dividendes ou plus volontiers des plus-values. Pour les économistes, le fait qu’elles optent dans un sens ou dans l’autre n’influence pas la décision d’investissement. Certains d’entre eux considèrent cependant qu’il vaut mieux distribuer les dividendes. En effet, cela inciterait l’entreprise à mieux investir et éviterait que l’argent conservé en son sein ne soit mal utilisé.
Enfin, s’agissant de la fiscalité des revenus du travail et des revenus de l’épargne, l’un de vous a fait remarquer que certaines formes de rémunération pouvaient être déguisées en produits d’épargne. Mais si, pour y faire obstacle, on taxait de la même manière les revenus de l’épargne et ceux du travail, cela obligerait à détaxer au départ les revenus du travail qui sont épargnés…
Mme Mathilde Lemoine. Concernant le secteur automobile, certains chiffres sont assez éloquents. Entre 1995 et 2010, le solde commercial français s’est dégradé de 72 milliards d’euros et celui de l’Allemagne s’est amélioré de 110 milliards d’euros. Le secteur automobile a contribué à ces deux évolutions inverses pour, respectivement, 10 et 63 milliards, de sorte qu’il a contribué pour quelque 40 % à l’écart ainsi creusé entre les deux pays. Certes, le raisonnement est très réducteur, dans la mesure où l’on sait que la balance commerciale ne signifie rien en matière de compétitivité. Mais il fait apparaître qu’il s’est vraiment passé quelque chose dans le secteur de l’automobile.
On peut regretter le détachement avec lequel on observe le phénomène, qui pèse de plus en plus sur la dégradation de la position relative de l’industrie, et risque d’avoir des conséquences très importantes sur l’investissement. En effet, si l’investissement de l’industrie automobile représente à peu près à 9 % de l’investissement des entreprises françaises, il explique 21 % des variations de ces dernières années.
Que se passe-t-il donc ? Faut-il accompagner l’évolution ou la restructuration de ce secteur ? Pour le coup, le raisonnement microéconomique s’impose. Mais est-on capable de développer, par exemple, un secteur des biotechnologies comme l’ont fait les Allemands qui, en cinq ans, ont pris rang parmi les leaders mondiaux ? Pourquoi ne le fait-on pas ? Je ne le sais pas, mais je considère qu’il faudrait regarder de plus près cette question de l’industrie automobile, sans stigmatiser pour autant ce secteur.
M. Christian Blanc, président. Est-ce que nous apprécions le phénomène de la même façon ? Quelles conséquences en tirer ?
Mme Mathilde Lemoine. Les termes de l’échange sont un moyen d’apprécier l’évolution de la compétitivité d’un pays. Sur la période 1995-2010, ils ont été à peu près stables en France, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ils se sont dégradés dans l’industrie automobile.
M. Marc Goua. À côté de chez moi, une fonderie travaillait pour une grande marque automobile française, qui a décidé d’aller produire dans les ex-pays de l’Est, juste au moment où le groupe Volkswagen venait de passer avec cette fonderie des marchés prometteurs. C’est incompréhensible : cette fonderie ne rencontrait ni problèmes de compétitivité ni difficultés techniques !
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. La situation du secteur agroalimentaire, où nous étions puissants, est en train de se dégrader. Un jeune éleveur, parfaitement formé, a besoin de quatre ans pour pouvoir étendre sa porcherie ou son élevage. La pression exercée par certaines associations militant contre la pollution empêche pratiquement tout le secteur de s’adapter. Ainsi, la Bretagne va perdre plusieurs unités de transformation dans les cinq à dix ans à venir.
M. Éric Woerth. Vous avez dit qu’en quelques années, l’Allemagne était arrivée à se hisser très haut dans le secteur des biotechnologies. Est-ce le fruit d’une décision collective ? Quelle part y ont prise les acteurs économiques, le gouvernement et les Länder ?
M. Christian Blanc, président. Je crois avoir la réponse : il y a dix ans, le gouvernement allemand a pris la décision stratégique de s’engager dans les biotechnologies, à l’instar des États-Unis. Il a lancé un concours d’idées en précisant que seraient présélectionnés les dix Länder qui montreraient le plus d’aptitudes à développer ces technologies. Au bout de six mois, il a retenu la candidature de la Bavière et du Bade-Wurtemberg. Finalement, en prenant en compte une multitude de critères, il a restreint le choix définitif à la Bavière et à une partie du Bade-Wurtemberg. Et au bout de cinq ans, l’Allemagne est devenue la première puissance européenne en matière de biotechnologies. Cela signifie que des politiques volontaristes peuvent aboutir.
A contrario, alors que le sud de Paris, entre Orly et Évry jusqu’au périphérique, concentre 60 % de l’industrie pharmaceutique, personne n’a eu l’idée de mener une politique de « fertilisation » prenant en compte cette spécificité. Nous avons essayé, dans le cadre du Grand Paris, mais visiblement, cela prendra du temps.
Mme Mathilde Lemoine. Je souhaiterais donner quelques précisions sur le crédit impôt recherche. Les chiffres que l’on cite régulièrement ne vont pas au-delà de 2008 et nous attendons ceux du ministère de l’économie et des finances concernant les années plus récentes. J’espère que l’impact du dispositif ne se limite pas à contenir le recul de la France. En effet, si la France avait la même compétitivité hors prix que l’Allemagne, ses exportations auraient augmenté de 50 % de plus entre 2004 et 2007. À quoi nos difficultés sont-elles dues ? Il y a de nombreuses pistes et la question est certainement importante.
Par ailleurs, nous avons tous insisté sur le fait que le coût du travail n’était pas suffisant pour expliquer la différence de performances avec l’Allemagne, et que ce n’était qu’une part de la compétitivité extérieure des entreprises et d’un pays que l’on mesurait par les termes de l’échange. Pour autant, si l’on baissait les salaires de 50 %, notre compétitivité extérieure s’améliorerait momentanément. Cela peut paraître caricatural. Il n’en reste pas moins que nous devons nous interroger sur l’amélioration tendancielle que nous voulons obtenir, au-delà du court terme. L’Allemagne va-t-elle continuer à améliorer sa compétitivité-coût relative pour nous dépasser ? Quelles en seront les conséquences ? De telles questions sont elles aussi très importantes.
Enfin, une étude, que nous pouvons vous transmettre, vient d’être réalisée par des économistes du CEPR (Center for economic policy research), un centre de recherches anglais. Elle montre que l’augmentation du nombre de PME et de salariés dans ces entreprises est corrélée à l’importance du rôle joué par l’État dans l’économie. D’autres facteurs comme la définition des droits de propriété ou certains facteurs institutionnels interviendraient, mais la variable la plus significative serait le pourcentage de dépenses publiques dans le produit intérieur brut, lequel mesure la taille de l’État. Et la conclusion de l’étude est que plus l’État prend de la place, moins les entreprises se développent.
M. Jérôme Cahuzac, corapporteur. Les salaires ont évolué plus vite et mieux que la productivité, dites-vous. Or je remarque que le pouvoir d’achat par unité de consommation n’a progressé qu’en raison de la faiblesse de l’inflation et que, si l’on ne prend pas en compte ce dernier facteur, il a plutôt baissé. Comment ces deux évolutions inverses sont-elles possibles ? Apparemment, il y a contradiction.
M. Patrick Artus. Le problème vient de ce que l’on ne prend en compte que la période précédant la crise. Pour 2009, 2010, 2011, des évolutions assez différentes se dessinent.
En 2011, les salaires réels baisseront. Mais ils baisseront en raison de la hausse des prix des matières premières, si vous les calculez avec le prix de la consommation. Si vous les calculez avec le prix du produit intérieur brut – et c’est ce qui compte pour les entreprises –, il n’est pas du tout sûr qu’ils baissent. Il y a donc une grosse différence suivant que vous considérez le pouvoir d’achat du point de vue des entreprises ou du point de vue des consommateurs.
Il y a maintenant des biais énormes entre l’indice des prix à la consommation et celui des prix du produit intérieur brut. Il faut comparer le salaire réel calculé avec les prix du PIB, et la productivité : c’est cela qui mesure l’évolution du partage des revenus. Mais comme depuis le début de 2009, les matières premières augmentent très vite, les prix à la consommation montent énormément par rapport aux prix du produit intérieur brut : vous avez donc une divergence complète entre le salaire réel vu de l’entreprise, et le salaire réel vu du côté des consommateurs.
Cette année, nous risquons de très mauvaises surprises. Si le prix du baril de pétrole reste à 104 dollars, l’inflation sera de 3 % et le salaire réel vu par le consommateur baissera de 1,2 % – le salaire nominal n’ayant augmenté que de 1,8 % – alors que le salaire réel vu par l’entreprise augmentera. Il s’agit donc de faire attention : ces deux concepts sont assez différents et ils peuvent connaître de grosses variations, notamment en raison du prix des matières premières.
Mais nous n’avons pas abordé les problèmes d’emploi et de qualification. Certaines enquêtes, certains travaux académiques, notamment ceux du CEPR précité, révèlent l’importance de la capacité du système éducatif à fournir des diplômés dans les matières scientifiques. En Allemagne en particulier, le nombre de ces diplômés est en augmentation assez forte alors qu’il est en chute libre en France. Le Gouvernement mène d’ailleurs une réflexion sur les moyens d’inciter les jeunes Français à s’engager dans ces disciplines. Quant à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), elle voit dans la difficulté à recruter des diplômés scientifiques une des explications de la faiblesse de notre croissance.
M. Christian Blanc, président. Je vous remercie.
*
AUDITION DU 2 MARS 2011
Audition de Mme Anne-Marie Brocas, directrice de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) au ministère du travail, de l’emploi et de la santé, membre du Conseil d’analyse économique et professeur associé à l’École normale supérieure de Cachan, et Mme Catherine Zaidman, sous-directrice des synthèses, des études économiques et de l’évaluation à la DREES, de M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), membre du Conseil d’analyse économique et du Conseil d’orientation pour l’emploi, et M. Pierre-Alain Pionnier, chef de la division croissance et politiques macroéconomiques à la direction des études et synthèses économiques à l’INSEE, de M. Antoine Magnier, directeur de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) au ministère du travail, de l’emploi et de la santé, M. Sébastien Roux, sous-directeur « salaires, travail et relations professionnelles » et M. Julien Deroyon, chargé de mission
M. Marc Laffineur, président. Nous poursuivons aujourd’hui les auditions de notre mission chargée de réaliser une étude comparative sur la compétitivité de notre économie et de notre système social, en particulier vis-à-vis de nos principaux concurrents et amis au sein de l’Union européenne.
Avant de vous entendre, mesdames et messieurs, je vous remercie d’avoir accepté de modifier la date de votre audition et je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. le corapporteur Jérôme Cahuzac.
M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le financement de la protection sociale affecte-t-il la compétitivité de l’économie française ? Cette question resurgit périodiquement dans le débat public et les économistes ont tendance, dans l’ensemble, à y apporter une réponse négative. Lorsqu’elle s’est posée avec acuité au début des années 1990, elle concernait surtout les charges sociales pesant sur les bas salaires, ce constat ayant conduit à les alléger fortement. Si le coût du travail peu qualifié dans notre pays est jugé relativement élevé par des institutions comme le Fonds monétaire international (FMI) ou l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce n’est pas en raison du poids des charges sociales, qui est quasiment inexistant.
Par ailleurs, lorsque l’on considère la compétitivité-coût de l’économie française dans son ensemble, on n’observe pas de handicap manifeste. Les faiblesses de notre compétitivité se situent ailleurs, du côté de la qualité et de l’adéquation aux attentes des acheteurs.
Le bon révélateur en matière de compétitivité structurelle réside dans la comparaison entre la France et l’Allemagne. Cependant, je voudrais, tout d’abord, revenir sur le diagnostic, établi au cours des années 1990, qui avait conduit aux politiques d’allégement de charges sociales.
Était apparue, alors, une spécificité française en matière de coût du travail peu qualifié : entre les hausses du SMIC et les accroissements de charges patronales, la France semblait compter parmi les pays où le travail peu qualifié était le plus onéreux – en pourcentage du salaire médian – au risque éventuellement de susciter, ou de conforter, un chômage de masse des travailleurs les moins qualifiés. La situation était en revanche différente pour les salaires supérieurs au SMIC où la hausse des charges sociales avait surtout conduit à freiner la progression des salaires nets. D’une certaine manière, le SMIC a été utilisé comme un instrument de politique de revenus, dans le but de stimuler la croissance des salaires, plutôt que comme un seuil défensif visant à éviter la pauvreté au travail.
Face à un tel constat, les pouvoirs publics se sont engagés dans une politique d’allégements des charges sociales sur les bas salaires – allégements dits « Balladur » puis « Juppé » – portant sur la plage salariale comprise entre 1 et 1,3 SMIC. À ces baisses de charges offensives, visant à réduire le coût du travail peu qualifié et à stimuler l’emploi, ont succédé des diminutions de charges défensives tendant à limiter les hausses de coût du travail associées au passage aux 35 heures. La plage salariale des allégements s’étend désormais de 1 à 1,6 SMIC et le taux de ces prélèvements est devenu résiduel au niveau du SMIC. Les effets de ces politiques sur l’emploi sont encore débattus, mais le débat porte désormais davantage sur leur ampleur que sur leur existence. Un certain consensus existe, en effet, pour considérer que ces politiques ont bien soutenu l’emploi des travailleurs non qualifiés, comme en témoigne l’arrêt de la diminution de la part de l’emploi peu qualifié dans l’emploi total qui avait été observée jusque-là.
Si la France a encore un problème de compétitivité lié à son coût du travail, ce n’est plus guère en modifiant le financement de la protection sociale qu’elle peut espérer le résoudre. La seule option envisageable serait d’agir sur le niveau du SMIC lui-même, éventuellement en compensant une diminution de ce dernier par des baisses de charges pour les salariés, mais toute la difficulté serait alors de trouver des sources de financement alternatives. Par ailleurs, la compétitivité ne se réduit pas aux coûts : il faut mobiliser d’autres explications pour rendre compte de la détérioration de notre position sur les marchés extérieurs, en particulier vis-à-vis de l’Allemagne.
Dans le débat public, la notion de compétitivité est souvent limitée à une seule acception : celle de la compétitivité-coût. On se demande alors si les coûts de production français ne sont pas trop élevés et s’ils ne nuisent pas à la capacité de notre pays à exporter. La problématique de la compétitivité ne doit pas être entendue de manière étroite, comme la recherche d’excédents extérieurs : un pays peut être en déficit extérieur et être parfaitement compétitif. Si, par exemple, l’on cherche à investir dans une économie très prometteuse, il en résultera une appréciation du taux de change et un déficit commercial mais qui constituera la contrepartie du mouvement de capitaux entrants.
L’étalon en matière de performance économique demeure la croissance du produit intérieur brut (PIB) et celle du revenu par habitant. Le revenu par habitant permet véritablement, en effet, de comparer le dynamisme de deux économies. De surcroît, la croissance du PIB et du revenu par habitant dépendent, in fine, des gains de productivité et donc de l’innovation. Dans un tel contexte, les performances à l’exportation ne sont pas une fin en soi mais, en raison de l’intensité de la concurrence internationale, elles peuvent être un indicateur pertinent de la capacité d’un pays à innover pour satisfaire la demande. On imagine mal, à long terme, comment une économie pourrait croître rapidement et satisfaire sa demande intérieure tout en étant incapable d’exporter.
Dans cet esprit, la comparaison avec l’Allemagne semble particulièrement instructive pour apprécier l’évolution de la compétitivité française. En effet, nos deux pays sont confrontés à l’appréciation de l’euro et à la concurrence des pays émergents. Ils sont également en concurrence directe sur la plupart des marchés à l’exportation : la probabilité pour un exportateur français d’être en concurrence avec un exportateur allemand vendant le même produit sur le même marché est aujourd’hui proche de 75 %.
Entre 2000 et 2006, on a constaté un décrochage des exportations françaises par rapport aux exportations allemandes. On a observé, en outre, une nette dégradation de la balance commerciale française, qui est passée d’un excédent de 0,9 % du PIB en 2000 à un déficit de 1,3 % du PIB en 2006. Au cours de cette même période, la balance commerciale allemande s’est redressée de façon spectaculaire, passant d’un excédent s’élevant à 0,4 % du PIB en 2000 à 5,7 % en 2006.
Les spécialisations géographique et sectorielle des exportateurs français et allemands sont très proches. En Allemagne, les coûts salariaux unitaires dans l’industrie manufacturière ont baissé entre 2000 et 2006, alors qu’ils sont restés stables en France et ont augmenté dans d’autres États membres de la zone euro : en Allemagne, la baisse a été de 9,3 % ; en France, les coûts ont été stables ; en Italie, la hausse a été de 17,2 % et en Espagne de 16,2 %.
La baisse des coûts salariaux unitaires en Allemagne a été obtenue au moyen d’une politique de modération salariale et de l’externalisation d’une partie de la production vers les pays d’Europe centrale et orientale. Du côté allemand, l’amélioration de la compétitivité résulte donc de processus de marché. En revanche, la stabilisation des coûts salariaux unitaires en France a été obtenue grâce à des allégements de cotisations sociales, des gains de productivité horaire et une modération salariale. L’État est donc intervenu pour préserver la compétitivité des producteurs français, alors qu’en Allemagne les gains de productivité ont eu lieu spontanément, par le libre jeu de la concurrence.
Malgré cette dégradation relative de la compétitivité-coût en France, les exportateurs français se sont efforcés de conserver des prix compétitifs, mais, pour cela, ils ont vraisemblablement sacrifié une partie de leurs marges et d’autres ont simplement disparu. Nous mesurons, donc, en France, la « compétitivité des survivants ».
Même si la France et l’Allemagne exportent globalement des produits identiques vers les mêmes pays, les deux nations ne se positionnent pas toutefois sur la même gamme. L’Allemagne bénéficie d’une part de marché trois fois plus élevée que celle de la France pour les produits haut de gamme. En revanche, ce ratio n’est que de deux pour les produits bas de gamme. Ces écarts de parts de marché pour les produits haut de gamme se sont encore renforcés depuis 2000. Ils pourraient être liés à des différences d’efforts de recherche et de développement à long terme. Les dépenses moyennes de recherche et de développement sur la période 2000-2006 s’élèvent à 2,5 % du PIB en Allemagne contre 2,2 % du PIB en France. Ces écarts sont plus significatifs si l’on se restreint aux seules entreprises privées : les dépenses de recherche et de développement ne s’élèvent alors qu’à 1,1 % du PIB en France, contre 1,7 % en Allemagne.
Une étude menée par l’institut COE-Rexecode permet également d’apprécier, de manière plus qualitative, la perception de l’évolution des produits exportés. Même si le prix des produits français semble globalement compétitif par rapport aux produits allemands, leur contenu technologique et les services rendus par nos entreprises paraissent nettement moins bons. Les entreprises françaises souffrent également d’un déficit de notoriété par rapport à leurs concurrentes allemandes dans le secteur des biens intermédiaires et des biens d’équipement. Il semble qu’il y ait donc eu une dégradation des performances françaises au cours de la dernière décennie pour la plupart de ces critères.
Ces éléments fournissent des pistes pour expliquer nos pertes de parts de marché par rapport à l’Allemagne. Cela étant, l’étalon allemand reste très exceptionnel, ce pays étant le seul à avoir su maintenir ses parts de marché à l’exportation dans un contexte où le marché mondial explosait. Se comparer à lui, c’est peut-être se montrer indûment ambitieux.
La compétitivité-coût de la France semble donc à peu près raisonnable, mais la qualité de nos produits étant sensiblement plus faible, nous souffrons d’un problème de compétitivité structurelle avéré.
M. Antoine Magnier, directeur de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES). L’emploi, le travail et la formation professionnelle constituent le champ de compétence de la DARES. En complément des propos de M. Jean-Philippe Cotis, que je partage largement, je souhaite vous livrer quelques éléments d’appréciation sur la situation conjoncturelle de notre marché du travail.
L’analyse des développements récents doit se faire au regard de la récession, d’une ampleur exceptionnelle, que nous avons subie en 2008 et 2009, même si elle a été moins forte en France que dans la plupart des pays industrialisés. Notre PIB a reculé de 2,5 % en 2009 contre 3,5 % pour l’ensemble des pays industrialisés, 4 % pour la zone euro et près de 5 % pour l’Allemagne et l’Italie.
La récession s’est traduite par d’importantes pertes d’emplois salariés marchands en France : 187 000 postes ont été détruits en 2008 et 334 000 en 2009. Ce recul s’est toutefois révélé nettement moins marqué que ce que laissait envisager le recul de l’activité. Au-delà des mesures ciblées de soutien à l’activité et au pouvoir d’achat, les mesures spécifiques de soutien conjoncturel prises par le Gouvernement dans le domaine de l’emploi, ainsi que celles relatives à l’emploi des seniors, ont limité les pertes d’emplois. La hausse du nombre de contrats aidés et le dynamisme persistant de l’emploi non salarié ont également permis de les atténuer dans l’ensemble de l’économie.
Une particularité notable des évolutions récentes en matière d’emploi, distincte de celle des récessions passées, est la très bonne résistance du taux d’emploi des seniors, qui a continué de croître sensiblement au cours des trois dernières années malgré la récession. Corrigé des effets de structures démographiques, le taux d’emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans a augmenté d’un peu plus de quatre points entre le quatrième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2010. Cette bonne performance doit être corrélée aux mesures vigoureuses que le Gouvernement a prises ces dernières années pour stimuler l’offre et la demande de main-d’œuvre de cette catégorie de la population.
Après une stabilisation à la fin de 2009, l’emploi salarié marchand a commencé à se redresser au début de 2010, les dernières statistiques faisant état de 55 000 créations nettes de ce type d’emplois au premier et au second semestres de l’an passé, soit un total de 110 000 créations nettes sur l’ensemble de 2010. Dans ses dernières prévisions publiées au mois de décembre, l’INSEE estime que les créations d’emplois totales, dans l’ensemble de l’économie, se sont élevées à environ 175 000 l’an passé, après 230 000 pertes en 2009.
De même qu’en début de récession l’essentiel de l’ajustement de l’emploi s’était porté sur l’intérim, le redressement récent de l’emploi a été principalement porté par un rebond soutenu et régulier de l’emploi intérimaire, initié dès le printemps 2009. Ce sont 103 000 postes d’emplois intérimaires qui ont ainsi été créés au cours de l’année passée, soit une hausse de 21 % sur un an. Hors intérim, les destructions d’emplois se sont en outre sensiblement atténuées dans les secteurs de l’industrie et de la construction tout au long de l’année passée. Dans le tertiaire, hors intérim, l’emploi s’est progressivement redressé en gagnant près de 84 000 postes l’an passé.
Certaines évolutions récentes en matière d’emploi ont étonné les économistes et les conjoncturistes.
La première évolution surprenante réside, comme je l’évoquais précédemment, dans la bonne résistance de l’emploi, inattendue au regard du recul de l’activité pendant la récession. Cette résistance demeure, après prise en compte des estimations très conventionnelles que l’on peut faire des effets des mesures de soutien conjoncturel prises par le Gouvernement dans le domaine de l’emploi.
La deuxième évolution qui a étonné la plupart des instituts de conjoncture, c’est qu’à la suite de la récession, l’emploi s’est redressé, à partir du début de l’année 2010, de manière sensiblement plus précoce et plus vigoureuse que ce que laissait envisager le rythme modéré de la reprise d’activité.
Ces deux bonnes surprises en matière d’emploi ont néanmoins une contrepartie : une évolution de la productivité plus faible que celle que l’on pouvait anticiper, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations quant à la capacité des entreprises à restaurer leur profitabilité au cours des prochains trimestres.
Troisième évolution surprenante : le chômage a plus augmenté en 2009 que ne le prévoyaient les estimations d’emplois et l’appréciation de la plupart des conjoncturistes sur le dynamisme de la population active. Cette mauvaise surprise reflète, en contrepartie, une hausse inattendue de l’activité en particulier des seniors, ce qui peut être de bon augure dans une perspective à moyen terme.
Nous manquons encore, cependant, de recul pour interpréter et apprécier les conséquences de ces bonnes surprises en matière d’emploi et de leur contrepartie plus négative en matière de productivité. À ce stade, les estimations de croissance et d’emploi restent provisoires. Nous ne disposons pas encore d’éléments très précis quant à l’ajustement à la baisse des heures travaillées par salarié pendant la récession mais, selon la plupart des indicateurs, il semble qu’il n’ait pas été très marqué – ce qui expliquerait l’essentiel des bons résultats en matière d’emploi. De même, le redressement de l’intérim au cours des derniers trimestres ne suffit pas à expliquer celui de l’emploi en 2010. Ne disposant donc pas d’explications totalement satisfaisantes sur les évolutions récentes de l’emploi et de la productivité, nous nous interrogeons, comme la plupart des instituts de conjoncture, sur les facteurs qui en sont à l’origine et sur le caractère temporaire ou durable de ces dernières.
Pour schématiser à l’extrême, deux pistes d’explication s’offrent à nous.
Sur un registre négatif, on ne peut exclure que les évolutions positives en matière d’emploi soient le reflet d’un affaiblissement plus ou moins durable de notre potentiel de production suite à la crise : elles refléteraient ainsi un redressement conjoncturel de l’activité plus marqué que celui qui avait été estimé par la plupart des instituts de conjoncture, mais autour d’une tendance qui serait à l’inverse moins vigoureuse qu’escompté.
Sur un registre positif, à l’inverse, il est possible que nous ayons assisté, au cours des derniers trimestres, à un réel enrichissement de notre croissance en emplois et que nous ayons sous-estimé l’impact bénéfique sur l’emploi des mesures de soutien qui ont été prises par le Gouvernement ces dernières années ou des réformes de structure qui ont été mises en œuvre avant et pendant la récession : renforcement du dialogue social ; stimulation des revenus liés au travail tout en promouvant une modération du coût du travail pour les entreprises ; renforcement de l’accompagnement et du suivi des demandeurs d’emploi ; fluidification du marché du travail ; stimulation de l’emploi des seniors.
Aujourd’hui, le principal enjeu reste de poursuivre et de parachever ces réformes afin de stimuler les taux d’emploi – en particulier pour les jeunes et les seniors – et de réduire le dualisme de notre marché du travail, dans un contexte de consolidation des finances publiques plus contraignant que celui que nous connaissions il y a quelques années.
Mme Anne-Marie Brocas, directrice de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Si la DREES suit, notamment à travers les comptes de la protection sociale, l’évolution des dépenses de protection sociale et des conditions de leur financement, elle ne dispose cependant pas d’expertise propre quant à l’impact économique de la protection sociale, pas plus que sur les questions de coût du travail qui relèvent de l’INSEE et de la DARES.
C’est pourquoi mon propos sera modeste et se bornera à rappeler quelques constats sur l’évolution de la protection sociale et de son financement.
Premier constat, la France a, rapporté à son PIB, un niveau de dépenses sociales élevé – ce qui est important en matière de compétitivité, la question de la structure des financements étant quant à elle, d’une certaine façon, seconde. Cependant, la croissance de ces dépenses en part de PIB a été relativement maîtrisée depuis le milieu des années 1990.
Avec un ratio de dépenses de prestations sociales de 29,3 points de PIB en 2008, notre pays se situe à un niveau aussi élevé que celui des pays d’Europe du Nord. Toutefois, si l’on raisonne en termes de prestations sociales par tête et en parité de pouvoir d’achat, le diagnostic diffère assez sensiblement puisque nous nous trouvons alors derrière ces derniers, nos dépenses s’étant élevées à 7 900 euros en 2008 contre 9 000 à 10 000 euros dans les pays d’Europe du Nord. Nous situant à un niveau très proche de l’Allemagne – 7 700 euros par tête – sans doute sommes-nous plus confrontés à un problème de production que de niveau de protection sociale.
Les dépenses liées à l’ensemble des prestations sociales – assurance chômage, régimes complémentaires, ensemble des régimes de sécurité sociale – qui représentaient 15 points de PIB en 1959, s’élevaient à 28,6 points en 1993, à 29,3 points en 2008 et à 31,3 points en 2009, cette dernière augmentation étant due à l’évolution du PIB lui-même et à celle des prestations pendant la crise, notamment de chômage. Deux ans après le choc subi par l’économie, nous pouvons nous attendre à un rythme de progression assez proche de celui que nous avons connu antérieurement.
Deuxième constat, la structure du financement de la protection sociale a été fortement transformée au cours des trente dernières années : mesures de déplafonnement des assiettes des cotisations sociales – branches famille, maladie, accident du travail ; création de la contribution sociale généralisée et élargissement de la taxation à des revenus qui ne l’étaient pas, ou faiblement, tels que les revenus de remplacement, certains revenus salariaux et les revenus de l’épargne ; développement à partir des années 1990 des exonérations de cotisations des employeurs portant sur les bas salaires, compensées aujourd’hui par des impôts et des taxes affectés à la protection sociale.
Si l’on considère la structure du financement de la protection sociale par type de ressources en distinguant les cotisations des employeurs et salariés, les impôts et taxes affectés ainsi que les contributions publiques, la part de la protection sociale financée par les cotisations sociales des employeurs et des salariés a baissé de 17 points à partir des années 1990, baisse qui a été compensée par une augmentation de 21 points de la part des impôts et des taxes affectés au financement de la protection sociale, dont il convient de déduire une diminution de 5 points des contributions publiques – des taxes affectées venant compenser des exonérations de charges.
Cette diversification des sources de financement de la protection sociale doit être cependant relativisée, puisque la principale assiette demeure les salaires, avec une part de 72,5 % en 2009 contre 76,5 % en 1990 – cette diminution étant d’ailleurs considérable compte tenu des masses financières concernées. C’est ainsi que, entre 1990 et 2009, la part de financement assurée par la taxation des revenus de remplacement a été doublée, avec 2,5 % du total de la protection sociale, et la part imputable aux revenus de l’épargne des ménages a été multipliée par trois, avec 2,5 % du total, les financements assis sur la consommation des ménages étant stables, représentant environ un dixième du financement de la protection sociale.
D’autres transformations sont également assez sensibles et, tout d’abord, la progressivité des prélèvements sociaux pesant sur les salaires en raison des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, le niveau de taxation s’élevant à 69 points pour le salaire moyen contre 40 points pour le SMIC.
Par ailleurs, la baisse sensible de la part du financement directement payé par les employeurs est notable avec les 17 points que j’ai déjà évoqués.
J’ajoute qu’une certaine convergence est observable entre les différents pays européens, puisque ceux dont le financement était très largement fiscalisé, comme le Danemark, ont augmenté la part de financement sous forme de cotisations sociales tandis que nous, nous augmentions la part assurée par la fiscalité.
En outre, cette évolution de la taxation des diverses assiettes tend à améliorer l’équité des prélèvements sociaux entre les diverses catégories de revenus – salaires et revenus de remplacement –, jusqu’à parvenir à une certaine parité de situation entre les actifs et les retraités.
Troisième constat, enfin : s’interroger sur la compétitivité de l’économie implique de réfléchir au contenu et à l’efficacité des dépenses sociales comparativement aux pays voisins, en particulier l’Allemagne. Or, sur la période récente, la France se distingue des autres pays européens puisque le taux de pauvreté a été réduit alors qu’en Allemagne, il a progressé. Nous nous distinguons également s’agissant du taux de fécondité et du dynamisme démographique, grâce à une prise en charge complète des familles – services de garde d’enfants, congés permettant aux hommes et aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle. Enfin, la protection sociale me semble aussi jouer un rôle important en matière de cohésion territoriale.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. À en croire la presse depuis plusieurs semaines, le différentiel du coût horaire du travail serait de l’ordre de 20 % entre la France et l’Allemagne. Comment se fait-il, Monsieur Cotis, que l’INSEE n’ait pas réagi plus rapidement dès lors que, selon vos propos, le coût horaire dans l’industrie ne serait pas significativement différent ? Serait-il possible de réaliser des microanalyses dans la mesure où la comparaison avec l’Allemagne est extrêmement délicate, tous les secteurs ne bénéficiant pas de conventions collectives et les Länder ayant des politiques très différentes les uns des autres ? En outre, Monsieur Cotis, vous n’avez pas abordé les problèmes liés à la rigidité du marché du travail en France et, plus globalement, au caractère inhibiteur de la réglementation française pour l’esprit d’entreprise.
Madame Brocas, si les prestations par tête s’élèvent à environ 10 000 euros par habitant dans les pays d’Europe du Nord et à 7 900 euros chez nous tout en représentant globalement 31,3 % du PIB – nous avons dépassé la Suède l’année dernière –, comment expliquez-vous une telle différence compte tenu des dépenses de vieillesse, de santé et des 24 prestations que nous délivrons entre la naissance et la mort ? Enfin, alors que ces prestations ont continué à augmenter chez nous au rythme de 3,5 % par an, ont-elles été stabilisées dans les pays scandinaves ?
M. Marc Laffineur, président. La diminution des marges des entreprises à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur Cotis, est-elle continue depuis une dizaine d’années ou s’agit-il d’une adaptation des entreprises à la crise, afin de moins licencier ?
En outre, avez-vous le sentiment que nos entreprises accomplissent des efforts en matière d’innovation et de recherche et de développement depuis trois ou quatre ans ?
Enfin, un taux de pauvreté nettement inférieur dans notre pays à celui de l’Angleterre et de l’Allemagne ne nous a-t-il pas permis de traverser la crise dans de moins mauvaises conditions ?
M. Jean-Philippe Cotis. Nous nous sommes trompés sur le décompte des heures travaillées en envoyant aux responsables de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires (ECMOSS), coordonnée par Eurostat, des chiffres traduisant des coûts salariaux trop élevés par unité produite, tandis que nos collègues d’Eurostat ne semblent pas avoir procédé à l’harmonisation des données qu’ils sont censés réaliser. Outre qu’elles avaient un retard de près de six mois, nos équipes auraient évidemment dû avoir la curiosité d’esprit d’établir un ratio par rapport au coût du travail d’il y a quatre ans – puisque telle est la fréquence de cette enquête – et de constater ainsi combien cette croissance était beaucoup trop élevée. Je précise que l’inspection générale de l’INSEE réalise un audit très approfondi sur ce qui s’est passé et que, lorsque j’en aurai pris connaissance, je reviendrai devant vous, si vous le souhaitez, afin de vous faire part des constats et des solutions envisagées. Incontestablement, un tel épisode ne peut que rendre très modeste un directeur général de l’INSEE.
Par ailleurs, les rigidités du marché du travail pèsent effectivement sur la compétitivité d’une économie et impactent également les performances de notre commerce extérieur.
Si nous pouvons considérer que la France demeure globalement compétitive, puisqu’elle a aligné ses prix sur ceux de ses concurrents, les coûts, eux, demeurent plus élevés et les marges des entreprises en pâtissent. Il importe donc que la compétitivité-prix soit maintenue avec une préservation ou une augmentation des bonnes parts de marché.
Même si l’évolution du commerce extérieur français traduit un problème de compétitivité structurelle qui nous pénalise dans la compétition internationale, la comparaison avec l’Allemagne n’en demeure pas moins problématique puisque, avec des gains de parts de marché exceptionnels, ce pays occupe la première position en ce domaine et que nous ne l’égalerons probablement pas dans les années à venir. Nos problèmes de compétitivité, je le répète, relèvent plus de la qualité de nos produits que de leur coût, les prestations délivrées par l’Allemagne étant en moyenne de bien meilleure qualité que les nôtres. Alors que, compte tenu de la croissance rapide du marché mondial, il est quasiment impossible pour un pays de conserver ses parts de marché, les Allemands y sont, seuls, parvenus.
Par ailleurs, avec 0,6 ou 0,7 point de PIB, les surplus de productivité annuelle globale sont très faibles dans notre pays, ce qui peut être inquiétant. En effet, si les effectifs des entreprises ont été maintenus pendant la phase basse du cycle – les destructions d’emplois ont donc été moindre –, le nombre de recrutements a beaucoup augmenté pendant la phase de redémarrage, ce qui ne laisse pas de surprendre et qui induit que nos gains de productivité, déjà faibles, ont peut-être encore baissé, au point de devenir marginaux.
En outre, les économies émergentes exerçant une pression forte sur la demande en matières premières, leurs prix augmentent considérablement, ce qui laisse augurer de la possibilité d’une croissance sans pouvoir d’achat – je rappelle que, dans le passé, le cycle des matières premières était corrélé avec la situation conjoncturelle en occident. Là encore, je suis inquiet.
Dans ce contexte, caractérisé par des gains de productivité anormalement bas et des prix des matières premières trop élevés, les entreprises françaises réduisent donc leurs marges pour survivre, se plaçant ainsi sur la défensive, à la différence de leurs homologues allemandes.
Mme Anne-Marie Brocas. Les pays qui disposent d’un PIB élevé ont un ratio dépenses de protection sociale rapporté au PIB plus faible que des pays dans lequel le PIB par tête est moins important : tel est le facteur principal expliquant la différence de diagnostic selon que l’on raisonne en part de PIB et en masse financière ou en dépenses par habitant en parité de pouvoir d’achat.
Plus précisément, le montant des prestations de protection sociale par tête est de 8 800 euros en Suède, 10 000 en Norvège, en Suisse et au Luxembourg et 7 900 euros en France. La prestation « vieillesse » est de 3 700 euros par tête en Suède contre 3 630 en France, celle de la maladie de 3 640 euros contre 2 820 euros. Cependant, notre couverture « chômage » demeure plus élevée.
Si, sur les dix dernières années, le ratio des prestations sociales rapporté au PIB des pays d’Europe du Nord et de l’Union européenne est en légère baisse, celui de la France a connu, lui, une petite hausse. Plus précisément, de 1996 à 2006, ce ratio a baissé de 2,6 % en Suède, alors qu’il a augmenté de 0,1 % en France.
M. Paul Giacobbi. Je suis heureux que Monsieur Cotis ait affirmé que l’on comparait la compétitivité des survivants. J’ai également apprécié ses propos sur la compétitivité des prix : l’affaiblissement des marges conduit à long terme à une diminution évidente de notre compétitivité structurelle.
La situation de l’économie française fait songer à ce que disait Sacha Guitry en mourant : « si je comprends bien, messieurs, je meurs guéri ! ». À en croire les commentateurs, tout ne va pas si mal… Nous n’en affichons pas moins un déficit structurel du commerce extérieur de 50 milliards, une croissance minable et une industrie qui s’étiole.
Nous parlons de compétitivité des produits, et même – pour l’essentiel – de compétitivité-prix des produits. Or la compétitivité-prix de l’industrie allemande ne va pas de soi. D’autres facteurs interviennent donc dans la compétitivité allemande. Il s’agit de ce que les économistes appellent la différenciation du produit : les marchés étant imparfaits, la qualité du produit ou les réseaux commerciaux jouent largement autant que la compétitivité-prix.
Nous oublions aussi un débat fondamental : celui de la compétitivité des territoires. Qu’est-ce qui est important ? Est-ce de vendre plus ou mieux, ou de fabriquer chez soi ? Je pense que l’essentiel est que notre territoire reçoive beaucoup d’investissements productifs lui permettant de créer de l’emploi. Prenons le cas de la Chine et du Japon : le Japon possède un tiers de l’industrie chinoise, ce qui est considérable ; mais c’est en Chine que les investissements sont accomplis et les emplois créés, tandis que le Japon connaît une crise sociale et crée moins d’emplois. Peu importe donc, à la limite, qui possède l’industrie. Il m’est indifférent que M. Mittal soit indien, chinois ou turc, pourvu qu’il laisse ses industries chez nous – ce qu’il n’a, hélas, apparemment pas l’intention de faire.
La compétitivité du territoire répond à des critères très différents, beaucoup plus complexes et difficiles, que celle des produits, qui ne doit pas être non plus réduite aux prix. Les notions de stabilité, de sécurité et de psychologie de l’environnement jouent un rôle plus important que la comparaison à un moment donné. Si un investisseur à dix ans a le sentiment que le niveau des charges ne va guère varier au cours des dix prochaines années, il investira ; en revanche, s’il anticipe que ce niveau, même bas, va augmenter brusquement – ce qui sera immanquablement le cas en France –, les choses seront plus délicates. J’ai rédigé dernièrement sur cette question de la compétitivité des territoires un rapport intitulé « L’attrait de la France pour les investisseurs étrangers », que je verse volontiers au débat.
Venons-en au problème des salaires. Certaines choses bougent tout de même, et je me réjouis que Monsieur Cotis nous rappelle que la compétitivité vis-à-vis du reste du monde demeure aussi importante que la compétitivité vis-à-vis de l’Allemagne. Prenons l’exemple de l’Inde et de la France. Je puis vous garantir qu’en Inde, un ingénieur très qualifié a un pouvoir d’achat bien supérieur à son homologue français. De même, un jeune diplômé de l’Indian institute of management d’Ahmedabad gagne pratiquement deux fois plus, en euros ou en dollars, qu’un diplômé d’HEC.
Comparons maintenant les charges sociales avec les États-Unis. Les charges sociales légales sont évidemment plus faibles outre-Atlantique, mais il est probable que dans les années qui ont précédé la crise, les charges sociales réelles – qui tiennent compte des charges conventionnelles – dans l’industrie automobile américaine ont été égales ou supérieures à ce qu’elles étaient en France. Le coût du travail dans l’industrie était à mon avis beaucoup plus lourd aux États-Unis qu’en France, mais les statistiques ne tiennent compte que des charges sociales obligatoires ou légales. Les charges conventionnelles considérables qui existaient dans l’industrie automobile américaine expliquent peut-être qu’on continue encore, un peu, à fabriquer des automobiles en France, alors qu’on n’en fabrique presque plus aux États-Unis et que toutes les industries automobiles américaines aient dû être nationalisées.
Restent les facteurs de compétitivité de long terme, en particulier la recherche et le développement. Je m’insurge contre le raisonnement selon lequel on pourrait sans dommage augmenter l’impôt sur les sociétés et supprimer le crédit impôt recherche. Je crains que nous ne finissions nous aussi par mourir guéris, comme Sacha Guitry.
M. Jean Dionis du Séjour. L’agriculture fait partie intégrante de l’économie française. Charles de Courson et moi-même avons conduit sur ce sujet un travail de huit mois qui a débouché sur une proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l’agriculture française.
Le constat est effrayant. Avec un SMIC horaire de 8,80 euros, et un taux de charges compris entre 41 % et 42 %, l’agriculture française est largement en tête en Europe pour le coût du travail. Non seulement le SMIC est beaucoup plus bas – voire inexistant – dans certains pays, mais, de plus, les autres pays ont mis en place de nombreux dispositifs d’exonérations de charges. Ce constat a des conséquences très concrètes, notamment dans la compétition entre la France et l’Allemagne, sur la répartition des parts de marché agricoles : nous reculons partout. Quelle est votre analyse de la situation ? Quels conseils donneriez-vous au législateur ?
M. Jean Grellier. Les constats que nous dressons s’inscrivent dans le droit-fil de ceux que nous établissions la semaine dernière. Contrairement aux idées reçues, le coût du travail n’est pas nécessairement un facteur fondamental de la compétitivité de l’économie française. Cette dernière souffre en revanche de problèmes structurels majeurs – et bien connus – qui touchent à l’innovation, en particulier dans le secteur industriel, au niveau de gamme des produits – lequel tendrait à baisser par rapport à l’Allemagne –, à la dimension des entreprises, avec un manque de PME performantes, et à un certain problème de formation, en particulier des techniciens supérieurs.
Dispose-t-on d’indicateurs mettant en évidence, par exemple, l’apport des pôles de compétitivité, dont l’objectif était de développer l’innovation et les réseaux d’entreprises ? Pour avoir participé aux états généraux de l’industrie, je sais que cette réflexion est menée à l’échelle nationale mais quid des relations avec les territoires ? Il semble qu’il y ait un vrai décalage entre les réflexions conduites et leur application dans les territoires, là où se construisent les capacités d’innovation, les réseaux d’entreprises et les compétences qui peuvent contribuer à renforcer notre compétitivité.
M. Christian Blanc. J’insiste à mon tour sur l’importance de la dimension territoriale. J’ai été – il y a déjà quelques années – à l’origine des pôles de compétitivité, dont la mise en œuvre n’a, il est vrai, pas été conforme à ce que j’avais imaginé : il y a eu une dissémination, avec près de soixante pôles de compétitivité, là où j’avais proposé de commencer par cinq judicieusement choisis. J’ai donc longuement réfléchi à la territorialité du développement économique. C’est ainsi que je tiens à faire observer combien est considérable le poids du Bade-Würtemberg et de la Bavière dans l’économie allemande. Je vous suggère d’ailleurs, monsieur le président, que nous passions quelques jours en Bavière à la fin de nos travaux pour confronter nos conclusions à la réalité de secteurs dont le fonctionnement est très éloigné de nos habitudes.
L’expression « réseau d’entreprises » m’interroge. Historiquement, nous avons raisonné en France en termes de réseaux, alors que la notion de territoire est bien plus forte pour produire des synergies. Ma question s’adresse à tous, en particulier à M. Cotis que j’avais eu l’occasion d’écouter lorsque nous participions tous deux, il y a quelques années, à la commission « Pébereau » sur la dette publique. Comment appréhendez-vous la notion de territoire dans un pays aussi jacobin que le nôtre, marqué par une structure pyramidale de l’administration ?
M. Jean-Philippe Cotis. L’INSEE n’a pas d’expertise très pointue sur les clusters et la dimension territoriale. Les expériences existantes montrent cependant que la formule peut se révéler adéquate pour améliorer nos performances en termes de commerce extérieur et de développement économique. Toute la question est de savoir comment s’y prendre sur le plan institutionnel pour assurer leur existence propre et leur soutenabilité à long terme. Outre l’Allemagne, on en trouve des exemples en Italie du nord ; mais nous avons du mal à transposer ce type de dispositifs en France.
Je reviens maintenant sur l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires. Nous disposons de données robustes sur les coûts de production et le coût du travail dans les comptes nationaux. Cette enquête, conduite tous les quatre ans et coordonnée par Eurostat, sert surtout à nous renseigner sur la structure des coûts. Sachez, même si cela n’excuse pas le bug qui s’est produit à l’INSEE, qu’il ne s’agit pas d’une source d’information que nous utilisons pour calculer nos coûts.
M. Antoine Magnier. Je ne dispose pas d’expertise particulière sur l’agriculture. Je rappelle simplement que, comme le reste de l’économie marchande, ce secteur est éligible aux allégements de cotisations patronales ciblés sur les bas salaires.
Plusieurs interventions ont mis en avant le fait que le coût du travail n’est qu’un facteur parmi d’autres de la compétitivité. Je souscris à cette analyse. Du point de vue du marché du travail, la maîtrise du coût du travail peu qualifié reste cependant un enjeu essentiel dans la phase de reprise que nous connaissons.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. La proposition de loi du groupe Nouveau centre qui vise à alléger les cotisations sociales pour le secteur agricole ne constitue pas, à mon sens, la bonne réponse. C’est probablement nécessaire pour les fruits et légumes, mais ni pour l’élevage, ni pour les productions céréalières, qui a un taux d’emploi familial très élevé et un système social plus avantageux que chez nos voisins.
Pour les productions d’élevage et les productions hors sol, c’est le système réglementaire qui est facteur de blocage en France. Pour installer un atelier de méthanisation, il faut au minimum quatre ans ! Quant à l’agrandissement d’un atelier hors sol, c’est presque mission impossible avec les enquêtes publiques. Ne nous trompons donc pas de diagnostic.
M. Jean Dionis du Séjour. On peut faire confiance à Charles de Courson pour que cette proposition ne coûte pas un euro aux comptes sociaux. Le financement de la protection sociale est aujourd’hui assuré à plus de 72 % par des prélèvements assis sur les salaires, et la fiscalité tend à s’alourdir. Plus vite on réduira la part des prélèvements sur les salaires, et mieux la France se portera.
Je reconnais, cher Pierre Méhaignerie, que notre proposition intéresse d’abord les secteurs qui, comme ceux des fruits et légumes ou de la viticulture, emploient une nombreuse main-d’œuvre. Pour autant, il y a tout de même des emplois permanents dans le secteur des cultures céréalières. Quand la main-d’œuvre est rémunérée 13 euros de l’heure dans notre pays contre 1,60 euro en Pologne et un euro en Roumanie, se pose un problème de fond depuis que ces pays ont intégré l’Union européenne. Si l’on veut éviter un désastre économique, il faut donc supprimer les cotisations sociales sur le travail agricole. Nous devons rapidement engager ce débat au sein du Parlement.
M. Marc Laffineur, président. Contrairement aux Allemands, qui ont amélioré leur compétitivité, nous n’avons pas su procéder à la restructuration de nos exploitations d’élevage, qui restent trop petites. Je regrette que nous ayons fait le choix de les multiplier.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. J’indique à M. Giacobbi qu’une étude économique de 2009 suggère que l’État providence serait plus développé aux États-Unis qu’en Europe en moyenne, pour des raisons qui tiennent à la fois au traitement des benefits, au rôle des fondations, au montant des dons par habitant – de l’ordre de 700 dollars par an –et au niveau des taxes sur la consommation, dont les taux sont moins élevés que ceux de notre TVA. Ces éléments conjugués font que l’État providence serait plus développé aux États-Unis qu’en Europe. C’est une thèse étonnante, mais qui a sa part de réalité.
Mme Anne-Marie Brocas. Ce que M. Giacobbi a appelé les avantages conventionnels constitue une forme de protection sociale qui revêt parfois un caractère d’obligation aussi fort que notre protection sociale obligatoire. Elle est particulièrement développée aux Pays-Bas, mais aussi dans des pays qualifiés de libéraux, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Sa prise en compte est un élément important dans les débats sur la protection vieillesse que nous avons à l’échelle communautaire. Dans les grandes entreprises britanniques, cette part d’accords conventionnels assure en effet des couvertures sociales dont les caractéristiques sont peu éloignées de celles de notre protection sociale obligatoire. Nous devons parvenir à une vision aussi objective que possible à la fois de la protection assurée aux individus au titre des divers risques sociaux et des charges qui pèsent sur les ménages et les entreprises.
M. Marc Laffineur, président. Mesdames et messieurs, je vous remercie.
*
AUDITION DU 8 MARS 2011
Audition, par la Mission d’information sur la compétitivité de l’économie française et le financement de la protection sociale et la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire réunies, de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur le rapport relatif aux prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne
M. le président Bernard Accoyer. Je souhaite une nouvelle fois la bienvenue à M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, et le remercie d’avoir accepté l’invitation de la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la mission d’information sur la compétitivité de l’économie française et le financement de la protection sociale, créée par la Conférence des présidents le 25 janvier dernier, pour présenter le rapport que la Cour a consacré aux prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne à la suite de la demande que le Président de la République lui a adressée en août 2010.
Cette audition s’inscrit naturellement dans le travail de la commission des finances, mais il touche aussi au cœur du sujet dont traite la mission d’information. Le rapport de la Cour est un document de très grande qualité, extrêmement dense et de première importance pour nourrir la réflexion sur le redressement des finances publiques et la sortie de crise. S’il souligne les points nouveaux qui rapprochent la France et l’Allemagne sur ces questions, il met également en lumière des divergences sérieuses apparues durant les années 2000, en ce qui concerne notamment les charges sociales et fiscales supportées par les entreprises.
Ce travail sera très utile aux responsables politiques et aux élus pour trouver et proposer à nos compatriotes les meilleurs moyens d’assurer l’avenir de l’économie française et le financement de la protection sociale.
M. le président Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances, corapporteur de la mission d’information. Au nom de la commission des finances, j’accueille à mon tour avec grand plaisir le Premier président de la Cour des comptes, dont le rapport sur les prélèvements fiscaux et sociaux en Allemagne et en France nous donne l’occasion de faire le départ entre idées reçues et réalités.
Le constat fait par la Cour des différences entre les deux systèmes, quand elles existent, présente l’intérêt d’aller au-delà des apparences, celle du taux facial des impôts notamment, pour s’intéresser à la structure même des prélèvements, à leur variété, à leur assiette. Ainsi, nos taux de prélèvements obligatoires sont proches : les deux pays se situent assez nettement au-dessus de la moyenne européenne, et l’écart qui les sépare, de 3,5 points en 2008, tient pour une part significative au périmètre du système de protection sociale, étant entendu que des dépenses sociales « conventionnelles » en Allemagne ne sont pas incluses dans le champ alors qu’elles constituent en fait des dépenses obligatoires. Il faut être bien conscient de ces effets de périmètre lorsque l’on compare les taux de prélèvements obligatoires et les charges pesant sur les entreprises.
La Cour relève que les deux pays poursuivent un même objectif : réduire les déficits publics. Mais elle rappelle aussi que le point de départ n’est pas le même : juste avant la crise, l’Allemagne était en excédent budgétaire, alors que la France avait déjà un déficit structurel important. Notre déficit structurel s’est encore aggravé de 0,3 point en 2010, tandis que l’Allemagne continuait à réduire le sien.
Pour maîtriser les déficits publics, la Cour juge « inévitable » le recours à la fiscalité. Il revient bien entendu au pouvoir politique d’en apprécier la nécessité et les modalités mais, si l’on considère que la Cour est en quelque sorte un juge de paix entre les visions des uns et des autres, cette formulation n’est pas anodine. En ce qui concerne la TVA, longtemps citée comme un moyen de maîtriser les déficits en France comme elle l’a été en Allemagne, le raisonnement de la Cour me semble quelque peu différent de ce qu’avancent certains : le rapport fait davantage référence au périmètre choisi pour l’application des taux réduits qu’à une augmentation du taux normal.
Au chapitre des idées reçues à remiser définitivement, on peut ranger tout ce qui a pu être dit à propos de la fiscalité du patrimoine en Allemagne : il n’y a jamais eu de bouclier fiscal chez nos voisins et, si l’ISF n’a pas été appliqué, c’est parce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a considéré que ses bases de calcul devaient être modifiées car, obsolètes, elles rendaient cet impôt injuste. Devant l’impossibilité technique de procéder à l’actualisation des bases, le gouvernement allemand de l’époque a renoncé. L’ISF français ne présente pas ce défaut puisque ses bases sont actualisées mécaniquement tous les ans.
Par ailleurs, atypique en Europe, la fiscalité du patrimoine en Allemagne, ne peut guère servir de « modèle ». Au demeurant, la Cour relève que les différences entre la France et l’Allemagne en la matière n’affectent en rien leur compétitivité relative. Autrement dit, une réforme de la fiscalité du patrimoine serait sans incidence sur la compétitivité de notre pays par rapport à l’Allemagne.
Concernant les entreprises, le poids des prélèvements sur les bénéfices est très comparable dans les deux pays. En France les prélèvements sont plus nombreux mais la taxe sur les salaires, par exemple, qui n’existe pas en Allemagne, ne concerne que les banques et les établissements de santé ; on peut donc difficilement considérer qu’elle compromet notre compétitivité. Peut-être en va-t-il de même pour le versement transport, quoique celui-ci concerne toutes les entreprises.
Il reste à déterminer, du point de vue de l’efficacité économique, le niveau auquel doit se situer l’impôt : sur les facteurs de production, sur la consommation ou sur les bénéfices.
M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances. Je remercie la Cour des comptes pour ce travail très intéressant et très riche qui ne manquera pas de donner lieu à débat. Sur certains points, d’ailleurs, je ne partage pas l’analyse du président de la commission des finances.
Une des grandes qualités de l’approche de la Cour est l’exhaustivité. Elle fait notamment ressortir que, avant de se livrer à des comparaisons, il faut avoir à l’esprit des différences à caractère historique entre nos deux systèmes. Premièrement, la compétitivité hors prix a toujours été meilleure en Allemagne qu’en France, compte tenu du type de biens que nos voisins produisent et des pays où ils exportent. Deuxièmement, la protection sociale française est plus étendue que la protection sociale allemande. Troisièmement, les Allemands ont constamment donné la priorité à l’assainissement des finances publiques et à la lutte contre l’inflation : dès qu’ils sont en situation de redresser les comptes et de revenir à l’équilibre, ils le font.
Lorsque je m’étais rendu en Allemagne avec le précédent président de la commission des finances, peu de temps avant qu’il ne soit nommé Premier président de la Cour des comptes, et alors que l’on ne disposait pas encore des données de sortie de crise, nous avions été frappés par la dureté des mesures de réduction des dépenses sociales – et notamment des allocations parentales, malgré le problème démographique que l’on sait. Je suis retourné en Allemagne au printemps 2010 avec le nouveau président de la commission des finances, puis en septembre avec le président de la commission des affaires sociales, Pierre Méhaignerie : en dépit de l’amélioration de la situation économique, nos interlocuteurs n’envisageaient nullement de revenir sur les mesures prises en matière de réduction de la dépense. C’est dire combien l’assainissement des comptes publics est une préoccupation forte.
Au-delà, il faut souligner une certaine constance dans les choix opérés ces dix dernières années. Ceux-ci respectent les lignes directrices fixées sous le gouvernement Schröder.
La première est une augmentation de la fiscalité sur la consommation et en matière d’environnement.
La deuxième concerne la fiscalité des entreprises et, plus généralement, la fiscalité du patrimoine, dont le taux moyen, très faible – 23,1 % d’imposition du capital, contre 38,8 % en France et 26,5 % de moyenne européenne –, vise à permettre le développement autofinancé et la transmission des entreprises dans les meilleures conditions.
La troisième est de maîtriser les coûts salariaux par la politique salariale beaucoup plus que par des diminutions de cotisations sociales.
Au regard de cette constance, on ne peut qu’être frappé par un certain désordre dans nos choix fiscaux et financiers.
Désordre budgétaire en matière de TVA, par exemple. En Allemagne, la TVA est regardée comme une ressource, dont on affirme clairement qu’elle doit financer des dépenses ; ce n’est pas un outil d’interventionnisme fiscal au profit de certains secteurs professionnels comme la restauration, n’est-ce pas, Monsieur Novelli.
Désordre également en termes de justice fiscale. Comme les Allemands, nous avons amorcé, dès 2000 – le rapporteur général de l’époque se souvient certainement de la réduction « Fabius » de 2003 – une politique de baisse du taux marginal de l’IR. Mais, parallèlement, nous avons continué à développer les niches fiscales.
Désordre, aussi, par allers et retours : aujourd’hui on réfléchit à la suppression du bouclier fiscal, considéré il y a quatre ans comme un point essentiel. On trouverait des exemples analogues lorsque l’opposition actuelle était aux commandes.
Enfin, l’Allemagne fait preuve d’un souci constant de donner aux entreprises une visibilité fiscale. Contrairement au président Cahuzac, je pense que l’on ne peut appréhender le niveau de la fiscalité sur le patrimoine sans tenir compte des effets pervers que celle-ci peut avoir sur le contrôle national des entreprises. L’Allemagne est capable de conserver ce contrôle ; la France, à cause de la fiscalité en général et de l’ISF en particulier, l’a perdu sur beaucoup de ses entreprises, en particulier les entreprises familiales de taille intermédiaire.
M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. Je remercie vivement la commission des finances et la mission d’information sur la compétitivité de l’économie française et le financement de la protection sociale de m’avoir donné la possibilité de leur présenter dans les meilleurs délais le rapport public thématique portant sur les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne. Pour ce faire, je suis accompagné du président Christian Babusiaux et du rapporteur général de cette publication, M. Raoul Briet, qui ont dirigé et mené les travaux, ainsi que des auditeurs Éric Dussoubs et Jérôme Brouillet. J’ai remis ce rapport au Président de la République vendredi dernier et l’ai rendu public immédiatement ; il est en ligne sur le site de la Cour mais je regrette que les délais d’impression empêchent la plupart d’entre vous de l’avoir entre les mains aujourd’hui.
Le Président de la République avait appelé de ses vœux, en août dernier, un vaste travail de comparaison fiscale entre les deux pays. Nous avons décidé d’inscrire cette enquête au programme de la juridiction et nous l’avons conduite en nous appuyant sur les méthodes et procédures habituelles de la Cour, c’est-à-dire dans le respect des principes de contradiction et de collégialité. Nous avons aussi un peu innové, en mettant en place un groupe ad hoc d’experts éclairant les travaux de la juridiction et en organisant de très nombreuses consultations et auditions de responsables économiques, d’experts, sans oublier les partenaires sociaux, organisations d’employeurs et syndicats de salariés. Ce sont des méthodes que nous souhaitons désormais appliquer plus généralement en matière d’évaluation des politiques publiques. D’ailleurs, par certains aspects, notre rapport est une évaluation comparée des politiques fiscales de la France et de l’Allemagne.
Il s’agit bien d’un rapport de la Cour des comptes, non d’un rapport conjoint avec la partie allemande, à savoir le ministère fédéral des finances. Certes, nous avons eu des échanges techniques fructueux et confiants avec nos partenaires allemands, mais le rapport est établi sous notre seule responsabilité. Il s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de nos travaux, qu’il s’agisse de nos rapports sur la situation et les perspectives des finances publiques, du rapport public annuel de février 2011, des rapports sur la sécurité sociale ou encore des rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité du patrimoine ou la comparaison des prélèvements obligatoires.
Ce rapport couvre l’ensemble des prélèvements tant fiscaux que sociaux. Il nous a paru essentiel d’avoir une approche large, qui ne se limite pas aux questions étroitement fiscales. En effet la fiscalité est un outil ; dans des sociétés anciennes et complexes comme les nôtres, elle ne peut être dissociée d’un arrière-plan institutionnel, historique, économique et social. En Allemagne, le fédéralisme, la place des entreprises de taille intermédiaire, le Mittelstand, le modèle économique tourné vers l’exportation et la pratique politique de coalition dans la période récente sont autant de caractéristiques qui expliquent la fiscalité.
L’outil que constitue la fiscalité peut être mis au service de plusieurs objectifs. Traditionnellement, ceux qui lui sont assignés sont le rendement – l’argent rapporté –, l’efficacité économique – l’impact sur l’activité et les acteurs économiques –, la justice – par ses aspects sociaux ou redistributifs. C’est la raison pour laquelle on ne peut procéder par simple transposition ou importation de morceaux de fiscalité étrangère : la fiscalité n’a de sens que dans un contexte et en fonction d’objectifs fixés au préalable. Il nous paraît très important d’y insister : le rapport n’invite pas à copier ou transposer un système qui serait intrinsèquement « meilleur » ; il n’y a pas de hiérarchie ou de classement à y chercher. En revanche, le fait de se comparer produit une sorte d’« effet miroir » et invite à s’interroger sur ses conceptions et ses pratiques.
Nous avons donc procédé non seulement à une comparaison des principaux impôts, mais aussi à une comparaison des politiques fiscales menées dans les deux pays depuis une dizaine d’années, afin d’appréhender le contexte et les objectifs poursuivis.
Il ressort clairement de notre enquête que l’attractivité et la compétitivité globale d’un pays ne dépendent que partiellement de la fiscalité – qui ne constitue que l’un des leviers possibles. Dans la situation comparée de la France et de l’Allemagne, la fiscalité n’apparaît pas comme un facteur décisif.
Il nous a fallu, avant de comparer les dispositions fiscales, les resituer dans un cadre économique, financier et social plus large : c’est l’objet du premier chapitre du rapport. Son élaboration a été délicate, notamment pour des raisons méthodologiques.
Tout d’abord, il faut toujours être prudent lorsque l’on interprète des statistiques. En effet les classifications ont un caractère conventionnel et sont parfois discutables. Pour Eurostat, par exemple, la taxe d’habitation est en partie une imposition du capital alors même que les locataires, vraisemblablement, l’assimileraient plutôt à une charge de consommation, voire à un impôt sur le revenu. Surtout, les statistiques diffèrent d’une source à l’autre : quand nous avons voulu comparer les taux de prélèvements obligatoires entre les deux pays, nous nous sommes aperçu que l’OCDE et Eurostat ne donnaient pas le même chiffre pour l’Allemagne, ou encore que le périmètre de la protection sociale obligatoire, qui n’est pas le même entre les deux pays, avait un fort impact.
Second obstacle, les statistiques françaises se sont révélées beaucoup plus nourries que les statistiques allemandes sur le sujet « redistribution/inégalités », rendant de ce fait difficiles des comparaisons approfondies.
Enfin, le choix du point de départ de la comparaison n’est pas neutre. Selon que l’on choisit 1990, date de la réunification allemande, 2000 ou 2005, on peut en effet aboutir à des lectures différentes des tendances et des trajectoires. De façon générale, nous avons choisi de nous référer au début des années 2000 ; mais nous avons aussi pris du recul pour certains sujets qui le nécessitent, tel le coût du travail.
Venons-en au diagnostic lui-même, qui fait apparaître certaines caractéristiques avec clarté.
S’agissant tout d’abord de la situation des finances publiques, l’écart est manifeste : le déficit structurel de la France est supérieur de plus de trois points à celui de l’Allemagne. Ces trois points-là ont plus d’importance et de gravité que ceux qui séparent les deux taux de prélèvements obligatoires, dont l’explication se trouve surtout dans les périmètres différents des systèmes de protection sociale. Cette différence dans les déficits structurels date d’avant la crise économique : l’Allemagne a profité de la période de croissance relativement forte qui a précédé la récession pour réduire son déficit public ; en 2008, la France a abordé la crise avec un déficit public de 3,3 % du PIB, l’Allemagne avec un excédent de 0,1 %. Cet écart structurel est à l’évidence une donnée qui contraint fortement la politique future de la France en matière de prélèvements.
Seconde caractéristique : en matière de redistribution et d’inégalités, la comparaison n’est pas au désavantage de la France, à la fois dans l’absolu et en dynamique. Ainsi, le taux de pauvreté relative a augmenté de moitié en Allemagne entre 2000 et 2009 alors qu’il a diminué de 20 % en France.
Le diagnostic économique appelle de notre part discernement et lucidité.
S’il est certain que la croissance potentielle allemande de long terme est réduite, étant donné que le vieillissement démographique très rapide pèsera davantage sur les finances publiques et la croissance, il n’en demeure pas moins qu’après le choc de la réunification, l’Allemagne s’est engagée résolument et de façon continue dans une politique de restauration de sa compétitivité dès la fin des années 1990. Cette stratégie, fondée sur un mélange de mesures fiscales, de restructuration du marché du travail et de modération salariale, paraît aujourd’hui avoir porté ses fruits. Qu’il s’agisse de balance commerciale, de chômage ou de croissance, de nombreux indicateurs sont aujourd’hui positifs pour l’Allemagne. Nos contacts avec nos interlocuteurs allemands nous ont montré toute l’importance qu’ils attachent à persévérer dans cette voie – c’est la « constance » dont parlait le rapporteur général.
Pendant ce temps, notre industrie a perdu l’avantage « coût » d’environ 10 % qu’elle avait au début des années 2000, et nos parts de marché à l’exportation ont régressé très sensiblement : elles ont perdu trois points entre 2000 et 2009 pendant que l’Allemagne en gagnait trois. Le fait que les autres pays de la zone euro soient dans une situation voisine de la nôtre en termes d’évolution de la compétitivité coût n’enlève rien à ce constat, d’autant que nous sommes plus sensibles que d’autres pays à l’évolution de notre compétitivité coût vis-à-vis de l’Allemagne – nous sommes souvent concurrents à l’exportation et sur les marchés nationaux.
Pendant longtemps, notre compétitivité coût a compensé en partie notre handicap en termes de compétitivité hors coût, c’est-à-dire les insuffisances structurelles de l’offre industrielle française. La disparition de l’avantage coût est donc une donnée majeure, même si le niveau absolu des coûts est aujourd’hui comparable.
Ce diagnostic est déjà l’occasion de faire apparaître deux lignes qui devront, selon nous, guider la politique de prélèvements future de la France. Je ne surprendrai personne ici en disant que cette politique fiscale doit avant tout contribuer à réduire les déficits et à relever le potentiel de croissance à long terme de la France en améliorant la compétitivité du « site France ».
Dans le chapitre 2 du rapport, la Cour procède à une analyse aussi précise que possible par grands blocs de prélèvements.
Commençons par l’impôt sur le revenu, la CSG et les cotisations.
En Allemagne, l’impôt sur le revenu est un peu plus progressif. Son taux marginal supérieur est de 45 % – porté à 47,5 % du fait de la surtaxe de solidarité – contre 41 % en France. Mais surtout, son assiette est plus large, ce qui s’explique par le penchant français pour des niches fiscales nombreuses et coûteuses.
La France a en revanche un prélèvement social que l’on peut estimer plus solidaire, ou du moins privilégiant davantage la justice fiscale. Les prélèvements sur les revenus du travail sont plafonnés en Allemagne, un peu moins en France, où existe en outre la CSG – qui concerne tous les revenus, y compris ceux du patrimoine et sans aucun plafond.
L’impact global sur les revenus du travail et la progressivité de ces prélèvements sont très proches dans les deux pays. On mesure cet impact par ce que l’on appelle le « coin socio-fiscal » ou « coin fiscalo-social », c’est-à-dire l’écart entre le coût salarial global pour l’employeur et ce qui reste au salarié après cotisations, CSG et impôt sur le revenu.
On le voit, il faut avoir une approche d’ensemble si l’on veut que la comparaison ait un sens. Ainsi, en matière de redistribution, les deux pays n’utilisent pas les mêmes leviers. L’Allemagne a préservé un IR fort, qui y est le symbole de la redistribution, mais elle taxe très peu, comme on le verra, la détention du patrimoine – 0,46 % du PIB, contre 1,13 % pour la moyenne de l’OCDE – et son prélèvement social est clairement dégressif.
Si l’on s’attache aux effets redistributifs, il ne faut pas oublier de prendre en considération les prestations, plus importantes que les prélèvements en termes de redistribution – dont elles représentent les deux tiers, contre un tiers pour les prélèvements. Le prochain rapport du Conseil des prélèvements obligatoires développera cette analyse. La comparaison entre les deux pays en matière d’assurance maladie est éclairante : l’assurance maladie française couvre à titre obligatoire toute la population et elle est financée par tous les revenus ; dans l’assurance maladie allemande, financée par les seuls salaires sous plafond, les 10 % de la population ayant les revenus les plus élevés peuvent ne pas s’affilier.
En ce qui concerne l’imposition du patrimoine, nos pays ont fait des choix très différents. L’Allemagne a choisi de taxer principalement les revenus du patrimoine. La France a choisi de taxer tant la détention que les revenus et la transmission du patrimoine.
En matière de taxation de la détention du patrimoine, le principal écart ne provient pas de notre ISF – environ 3,6 milliards d’euros en 2010 – mais bien de nos taxes foncières – 33 milliards d’euros. La situation allemande est particulière : l’évaluation du foncier qui, comme en France, se caractérise par un certain archaïsme, est à l’origine de la suspension de l’imposition globale de la fortune, consécutive à la décision de la Cour constitutionnelle. D’aucuns pensent que cette jurisprudence pourrait menacer également la solidité constitutionnelle des taxes foncières existantes.
Il faut en outre conserver à l’esprit que l’impôt sur la fortune allemand incluait dans son assiette les biens professionnels et était dû tant par les ménages que par les sociétés. Ce n’est pas le cas de l’ISF qui, s’agissant du foncier, est assis sur la valeur vénale et repose donc sur des bases plus solides. L’ISF souffre cependant d’une assiette étroite. D’autre part, on peut légitimement se demander si les taux sont fixés au bon niveau : le taux actuel de la tranche supérieure est plus élevé qu’à la création de l’IGF en 1982 – 1,8 % contre 1,5 % –, alors même que le rendement nominal des placements financiers et l’inflation ont été divisés par près de quatre – 16 % en 1982 pour le taux des emprunts d’État contre 3,3 % en 2010.
La taxation des revenus du patrimoine est particulièrement complexe en France car elle est le fruit d’une juxtaposition de multiples régimes spécifiques. De plus, il est loin d’être avéré que la fiscalité de l’épargne soit en cohérence avec les objectifs prioritaires du pays.
S’agissant de l’imposition sur les sociétés, les différences entre les deux pays sont moindres, et les rapprochements plus facilement envisageables.
Le travail que nous avons entamé avec le ministère fédéral des finances a permis d’identifier précisément une quinzaine de différences en matière d’assiette, mais en définitive les résultats sont assez voisins. De fait, nous pensons qu’il y a de réelles possibilités de faire converger à terme les assiettes, même si le crédit d’impôt recherche est une différence substantielle. Il nous paraît indispensable que le travail prometteur que nous avons engagé avec le ministère fédéral des finances se poursuive maintenant directement au niveau des ministères concernés.
La spécificité française tient d’ailleurs moins à l’imposition du résultat des sociétés qu’à l’importance des prélèvements qui, en amont, grèvent le résultat et qui n’ont pas d’équivalent en Allemagne. Ces prélèvements représentaient environ 58 milliards d’euros en 2008, dont 26 milliards assis sur la masse salariale. Il s’agit de la taxe sur les salaires, de la contribution économique territoriale – CET –, du versement transport, de la contribution sociale de solidarité des sociétés – C3S–, du versement au Fonds national d’aide au logement – FNAL –, et des divers prélèvements s’ajoutant aux cotisations de sécurité sociale. Tous ces prélèvements, sauf la CET récemment réformée, sont en outre « dynamiques ».
Le débat sur les charges des entreprises doit donc sortir du seul champ traditionnel des cotisations de sécurité sociale, qui ont d’ailleurs été déjà considérablement allégées pour les bas salaires, pour un coût de plus de 30 milliards d’euros. Un inventaire précis ainsi qu’une analyse de la dynamique et de la pertinence de ces prélèvements, dont certains sont assis sur les salaires, seraient très utiles.
La taxe sur la valeur ajoutée n’a pas évolué de la même manière de part et d’autre du Rhin.
Si l’on prend pour base 1990, l’Allemagne a augmenté de cinq points son taux normal de TVA, essentiellement pour réduire les déficits et, dans une moindre mesure, pour alléger les charges pesant sur le travail. Dans le même temps, la France a augmenté son taux d’un point. Dans la période la plus récente, alors que l’Allemagne a augmenté son taux de trois points, la France a, par phases successives, abaissé le produit de cette taxe. La TVA représentait en 2008 18 % des recettes fiscales en Allemagne et 16,4 % en France ; en 1995, la situation était inverse – 1 % de plus pour la France.
Ces évolutions contrastées s’expliquent pour une large part par le fait que les exceptions au taux normal sont sensiblement plus importantes en France, sans que, pour autant, le prélèvement de TVA y soit plus juste : appliquer le taux réduit aux travaux de rénovation et à la restauration, deux consommations qui ne sont pas principalement le fait des ménages modestes, n’est pas à proprement parler une mesure de justice fiscale...
Ainsi – c’est un constat que nous faisons – si l’on se contentait d’un simple alignement sur le niveau et le périmètre du taux réduit appliqués en Allemagne, la France disposerait d’une recette supplémentaire de 15 milliards d’euros. Les deux tiers de ce montant s’expliquent par l’application actuelle du taux réduit, en France, aux travaux dans les logements et à la restauration.
Plus généralement, la France fait preuve en la matière d’une certaine singularité : les pays du Nord de l’Europe et tout récemment le Royaume-Uni, qui a relevé son taux normal de 2,5 points pour un produit d’environ 15 milliards d’euros, sollicitent davantage la TVA et n’hésitent pas à la modifier.
Enfin, nous avons comparé la fiscalité environnementale de la France et de l’Allemagne. Dans les deux pays, elle se situe à un niveau inférieur à celui constaté en Europe. Les politiques menées sont divergentes : l’Allemagne a alourdi progressivement mais de manière continue la taxation des carburants, alors que notre taxe intérieure sur les consommations énergétiques – TICE, ex-TIPP – a vu son rendement stagner ; quant à l’utilisation des véhicules particuliers, elle est moins taxée en France depuis la suppression de la vignette au début des années 2000.
J’en viens aux principaux enseignements à tirer de ce travail de comparaison – qui font l’objet du chapitre 3.
Il ne s’agit nullement d’appliquer ou de copier un modèle, mais de réfléchir à la politique française de prélèvements, à ses finalités et à ses évolutions possibles. Il appartient à la Cour de contribuer à éclairer le débat et, bien sûr, il revient au Gouvernement et au Parlement de décider.
La première leçon porte sur les principes, sur la conception même de la politique fiscale.
L’Allemagne accorde une priorité plus forte au rendement budgétaire, à la préservation de la recette, en un mot à l’équilibre de ses finances publiques. Elle préfère aussi des mesures fiscales économiquement neutres et qui ne distordent pas l’activité. La France, en revanche, a souvent tendance à pratiquer une forme d’interventionnisme fiscal et à agir dans un même domaine à la fois par des dépenses budgétaires et par des régimes fiscaux dérogatoires. Elle a tendance à trop considérer l’impôt comme un outil de politique économique, aux objectifs multiples et souvent mal définis.
La fiscalité allemande fait donc moins de place aux exceptions et aux niches, tant en matière d’impôt sur le revenu qu’en matière d’impôt sur les sociétés et d’imposition des revenus du patrimoine. Dans cette logique, le gouvernement allemand vient d’engager une démarche visant à délimiter de façon encore plus stricte le champ d’application du taux réduit de TVA.
Par ailleurs, le principe d’unité et d’intégration de la politique des prélèvements est plus fort en Allemagne, assez paradoxalement : alors même qu’il s’agit d’un pays fédéral, la règle veut que les impôts soient partagés entre l’État, les Länder et les collectivités territoriales ; et le pouvoir fiscal est partagé entre Bundestag et Bundesrat. En France, au contraire, l’autonomie des collectivités territoriales se mesure traditionnellement au poids de leurs recettes fiscales propres, si bien que le pouvoir fiscal est juxtaposé entre l’État et les collectivités territoriales. Nous invitons la représentation nationale à réfléchir à cette situation.
En matière de finances sociales, l’Allemagne refuse de laisser la sécurité sociale en situation durable de déficit ; à défaut d’autre solution, les déficits sont compensés par le versement d’une subvention du budget général. En France, nous maintenons une séparation de principe entre les comptes sociaux et les comptes de l’État et nous admettons un déficit permanent des comptes sociaux, débouchant sur une dette croissante.
S’il fallait résumer l’approche allemande de la fiscalité, je dirais – sans chercher pour autant à idéaliser – que nos voisins préfèrent une politique fiscale plus lisible, plus prévisible, plus neutre et plus stable, ce qui peut présenter un certain nombre d’avantages pour les agents économiques.
Second point : quels enseignements concrets pouvons-nous tirer, en France, de ces éléments de comparaison ?
Au-delà des débats en cours sur la fiscalité du patrimoine ou sur le rapprochement éventuel de l’IR et de la CSG, le rapport relève que, si l’on s’en tient à la comparaison entre la France et l’Allemagne et si l’on excepte la nécessaire réduction des niches fiscales et sociales, c’est en matière de TVA et de fiscalité environnementale qu’existent les plus fortes marges de rapprochement.
Le rapport souligne aussi la nécessité d’inscrire durablement la politique fiscale dans une double perspective : la réduction des déficits et l’amélioration de la compétitivité et du potentiel de croissance de notre économie. Il mentionne enfin, s’agissant de ce deuxième objectif, la voie à explorer : engager un processus progressif de substitution d’un financement universel à un financement « professionnel » assis sur le facteur travail pour des politiques publiques sans lien direct avec l’entreprise : politique familiale, mais aussi de transport et de logement. Cela rejoint ce que je disais tout à l’heure sur la neutralité économique des impositions.
C’est un débat vaste et sensible qui appelle expertises et concertations. La Cour ne prétend en aucune manière le trancher mais elle est convaincue qu’il est nécessaire et qu’il n’est pas synonyme de renoncement aux préoccupations de justice qui, dans la situation actuelle, sont fortes et légitimes, et qui peuvent se concrétiser soit par des aménagements des prestations sociales, soit par des aménagements de la progressivité de l’impôt.
En tout cas, la France a besoin d’une stratégie fiscale de moyen terme claire et cohérente avec sa stratégie en matière de finances publiques, qui ne saurait se réduire au seul volet « dépenses ». Pourquoi d’ailleurs ne pas inclure à l’avenir, dans les lois de programmation des finances publiques ayant force contraignante, des dispositions clés guidant la politique en matière de prélèvements fiscaux et sociaux et qui, s’agissant des comptes sociaux, reposent sur le refus de principe des déficits ?
Troisième et dernier point : quelles sont les leçons à retenir en matière de convergence fiscale entre les deux pays ?
La France et l’Allemagne ne sont, en aucun domaine, des « concurrents fiscaux ». La comparaison met inévitablement l’accent sur les différences, c’est la loi du genre ; mais cela ne saurait faire oublier que ce qui rapproche les deux pays est beaucoup plus important que ce qui les sépare, dès lors qu’on élargit le champ de l’analyse et que l’on resitue le couple franco-allemand par rapport à la zone euro et à l’Union européenne.
Pour que la France et l’Allemagne continuent sur la route du rapprochement et de la convergence, le rapport suggère trois voies.
Tout d’abord, faire progresser la convergence au quotidien en identifiant puis en résolvant les problèmes pratiques qui subsistent pour ceux qui exercent une activité dans les deux pays, en particulier les chefs d’entreprise. On pourrait ainsi harmoniser les délais de déclaration fiscale ou les modalités d’évaluation des biens en cas de succession ou de transmission d’entreprises, qui sont aujourd’hui source de complexité et de difficultés.
Ensuite, parvenir à la définition d’éléments d’assiette commune en matière d’impôt sur les sociétés. Les deux pays devraient pouvoir s’accorder sur l’essentiel, voire sur la totalité de ces règles. Ce serait un pas important dans la perspective d’une assiette commune au niveau de l’Union européenne – projet que la Commission vient de relancer. Le couple franco-allemand, dans ce domaine comme dans bien d’autres, peut avoir un rôle d’entraînement.
Enfin, il faut veiller à mieux inclure les politiques fiscales dans la coordination économique renforcée dont la France, l’Allemagne et, au-delà, la zone euro ont besoin. C’est le conseil économique franco-allemand qui pourrait naturellement en être le pivot.
J’espère vous avoir convaincus que notre pays a besoin d’une stratégie fiscale de moyen terme. La Cour espère, par ce rapport, contribuer à éclairer le débat fiscal des mois et des années à venir, dont chacun mesure l’importance pour notre pays.
M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires sociales, corapporteur de la mission d’information. Je remercie à mon tour la Cour des comptes et son Premier président d’éclairer le débat. Concernant le diagnostic, il n’y a guère de divergence avec ce que nous dit le président de la commission des finances. Je note un rapprochement des points de vue et quelques ouvertures.
Vous l’avez rappelé, monsieur le Premier président, le modèle social français est le plus développé d’Europe. Il permet de réduire les inégalités, mais au risque de peser soit sur le salaire direct, soit sur le coût du travail. De plus, le paradoxe est que la France, de tous les pays européens, est celui où l’impôt sur le revenu est le plus faible, même si on ajoute la CSG. Cette situation pose problème.
Si l’on considère la répartition des ménages par quintile de revenus, on s’aperçoit qu’entre le premier quintile et le dernier quintile, le rapport est toujours le même – entre 3,2 et 3,4. Cela résulte de deux phénomènes conjugués : les ménages les plus modestes ont bénéficié d’un fort accroissement des prestations sociales – qui ont progressé ces dernières années au rythme de 4 %, alors qu’elles ne bougeaient pas en Allemagne ; quant aux ménages du dernier quintile, ils ont profité de la baisse de l’impôt sur le revenu depuis 1999 ainsi que des niches sociales. Le troisième quintile est celui qui ressent les plus fortes frustrations. Les 20 % de ménages aux revenus les plus élevés ayant un taux d’épargne de 35 %, on comprend qu’une marge d’action est possible sans porter atteinte à la consommation.
J’ai toujours pensé qu’étant donné les multiples atouts dont dispose notre pays, un taux de chômage inférieur à 5 % est à notre portée. Pour cela, des obstacles doivent être levés, dont celui que représente l’ISF appliqué au capital productif – qui empêche les PME de se développer, accroît le chômage et appauvrit la France. J’observe que les deux seuls autres pays européens qui ont conservé un ISF ne l’appliquent qu’aux avoirs immobiliers. Toutes les solutions peuvent être examinées, y compris un impôt minimum alternatif comme le préconisait M. Didier Migaud il y a deux ans, mais il nous faut faire en sorte que le capital productif reste en France. Aidons les PME à grandir, au lieu d’assister à leur vente ! Il en va de la baisse du taux de chômage et de la perspective du plein emploi en France.
M. Hervé Novelli. Monsieur le Premier président, quel a été, selon vous, le facteur déclenchant de la perte de compétitivité-coût de la France par rapport à l’Allemagne depuis 2000 ?
À la page 11 de la synthèse du rapport qui nous a été distribuée, on lit que « l’impact des allègements de charges sur les bas salaires a été neutralisé durant la période par l’augmentation des autres impositions pesant sur les salaires ». Est-ce à dire que ces allègements n’ont eu aucune efficacité ?
Enfin, la Cour souligne que « La France se distingue par une imposition du stock de capital beaucoup plus importante qu’en Allemagne – 4,5 % du PIB contre 1 % » ; cette situation appelle-t-elle selon vous une réforme importante de cette imposition – qui ne se limite pas à l’ISF ?
M. le Premier président de la Cour des comptes. M. Méhaignerie a relevé le paradoxe français : notre modèle social est le plus développé des pays d’Europe et, dans le même temps, l’imposition progressive sur le revenu y est la plus faible. Il faut cependant ajouter que les autres pays dans lesquels la protection sociale est forte, les pays nordiques notamment, ont aussi une TVA élevée – compensée par d’autres dispositions. Autrement dit, un dispositif de protection sociale très fort ne peut reposer exclusivement sur l’impôt sur le revenu, qui prendrait, sinon, un tour confiscatoire. De plus, en France, la redistribution est assurée pour un tiers par la fiscalité, mais pour deux tiers par le biais de prestations.
L’enquête que nous avons menée ne confirme pas ce qui vient d’être dit au sujet de l’imposition du patrimoine. Celle-ci n’est pas, selon nous, un élément de compétitivité déterminant. De surcroît, la comparaison avec l’Allemagne sur ce seul point est peu pertinente, les deux pays ayant à cet égard des positions atypiques en Europe – l’Allemagne parce qu’elle taxe peu la détention du patrimoine, la France parce qu’elle taxe plus. Il convient de s’intéresser aussi à des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Suisse, où il existe une imposition du patrimoine. En tout cas, le législateur que vous êtes a toute latitude pour réformer comme il le souhaite, la Cour ayant pour sa part formulé certaines observations sur l’assiette et les taux de l’ISF.
J’en viens à la question de la perte de compétitivité-coût. En réalité, l’évolution du coût du travail a été comparable en France à ce qu’elle a été dans de nombreux autres pays : c’est en Allemagne que la trajectoire a été différente. Il y a une dizaine d’années, l’Allemagne se considérait comme « l’homme malade » de l’Europe, parce que le coût du travail y était plus élevé qu’ailleurs, et notamment qu’en France. Ce n’est plus le cas : l’Allemagne a agi sur cette différence et désormais, même si l’observation doit être nuancée en fonction des secteurs d’activité, le coût du travail y est globalement le même qu’en France. Pour ce qui est de la compétitivité hors coût du travail, le décrochage s’explique par l’histoire ; la part de l’industrie est bien plus importante en Allemagne qu’en France.
Enfin, nous ne disons pas que la politique d’allègement des cotisations sociales sur les bas salaires a été inefficace mais nous constatons que la multiplication, dans le même temps, de taxes et prélèvements a pu en annuler les effets. À ces taxes et prélèvements multiples pesant sur les facteurs de production, qui n’existent pas en Allemagne, nous invitons le législateur à envisager de substituer des prélèvements plus universels, quitte à les assortir des dispositifs d’accompagnement nécessaires.
M. Pierre-Alain Muet. J’ai écouté avec grand intérêt le Premier président nous présenter le rapport de la Cour des comptes, très riche comme toujours. J’ai retenu que la fiscalité, et notamment la fiscalité du patrimoine, n’est pas un facteur décisif de la compétitivité allemande. C’est ce qui ressort également des auditions menées par notre commission : s’agissant de la fiscalité portant sur l’ensemble du facteur capital, l’Allemagne est dans une situation atypique, avec une imposition inférieure à la moyenne européenne, la France se situant quant à elle dans la moyenne. Selon un ancien directeur des politiques fiscales à la Commission européenne, pour une moyenne de 9 % en Europe, la France est à 9,6 %, l’Allemagne à un peu plus de 6 % et le Royaume-Uni à 12,6 %. Si l’Allemagne est dans une situation atypique, c’est qu’elle a suspendu son imposition du patrimoine, non par souci de compétitivité mais parce que la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les bases foncières, obsolètes, devaient être révisées.
On trouve dans ce rapport la confirmation de ce que la France, quant à elle, est dans une situation atypique pour ce qui est de la fiscalité des revenus. Le poids de l’impôt sur le revenu dans le PIB est de 2,6 % en France, et de 7 % quand on y ajoute la CSG ; il est de 9 % en Allemagne – comme dans tous les autres pays européens, où il s’établit entre 9 et 10 %. D’évidence, une réflexion sur la fiscalité des revenus en France est indispensable.
J’ai retenu aussi l’idée que l’on pourrait avancer assez vite sur la convergence des assiettes de l’impôt sur les sociétés en Europe. Que l’Allemagne et la France y parviennent, alors que leurs systèmes fiscaux sont très différents, serait une bonne nouvelle : cela montrerait que la définition d’une assiette européenne commune peut se concevoir, évitant une inutile concurrence fiscale.
J’ai aussi entendu le Premier président plaider, au nom de la Cour, en faveur d’une imposition plus prévisible, plus neutre et plus stable. Ce sont là des pistes de réforme qui devraient conduire à en finir avec la multiplication de niches qui rendent notre fiscalité incompréhensible.
Enfin, si l’écart de compétitivité entre la France et l’Allemagne ne tient pas à la fiscalité, comment l’expliquer ? Par le temps de travail, diront certains – mais si l’on demandait à la Cour de conduire une enquête comparative à ce sujet, il en ressortirait ce que savent tous ceux qui s’intéressent aux statistiques : le temps de travail hebdomadaire moyen est de 2,5 heures inférieur en Allemagne à ce qu’il est en France, et de 100 heures en moyenne par an.
Le coût du travail n’est pas non plus en cause puisque, selon l’INSEE, il est pratiquement le même dans les deux pays.
Cet écart tient, selon moi, au pragmatisme, au modèle social et la puissance industrielle allemands. Pragmatisme d’abord : M. le Premier président a indiqué que l’Allemagne a abordé la récession avec des comptes publics à l’équilibre, sinon en excédent, ce qui n’était pas le cas de notre pays. Deux ans auparavant, le déficit allemand était supérieur à celui de la France ; l’Allemagne a donc fait l’effort de résorber son déficit en période de croissance alors que nous laissions le nôtre dériver. Pragmatisme encore, et modèle de société que celui qui consiste à aborder la crise avec les mécanismes existants. Si l’Allemagne a réussi à réduire son taux de chômage pendant la récession, cela ne s’est pas fait par miracle mais par un recours accru au Kurzarbeit, le travail à temps partiel, et en diminuant le temps de travail.
Enfin, la part de la production industrielle dans le PIB allemand est double de ce qu’elle est en France ; on ne peut donc s’étonner qu’elle exporte deux fois plus que nous ! L’Allemagne a revendiqué sans discontinuer cette puissance industrielle, considérant fondamental le maintien de son industrie. C’est là que réside la force de l’Allemagne, dans ce vivier d’entreprises qui – au travers de ce que nous appelons chez nous des pôles de compétitivité – se développent en bénéficiant des innovations des plus grandes. On voit d’ailleurs que les régions françaises qui, telle la région Rhône-Alpes, ont conservé une forte base industrielle, demeurent exportatrices. En d’autres termes, il ne faut pas se tromper : notre compétitivité ne passe pas par une action sur le coût du travail ni par la fiscalité, mais par une vraie politique industrielle.
M. Jérôme Chartier. La fiscalité ne me paraît pas dépourvue de toute incidence sur la compétitivité… Si le taux de marge est trois fois moins élevé en France qu’en Allemagne, c’est en raison de l’impact mécanique des prélèvements sociaux.
Monsieur le Premier président, vous avez indiqué que la fiscalité allemande a pour premier objectif le rendement ; mais en choisissant, entre 1999 et 2003, d’augmenter les taxes sur l’énergie et de diminuer de 1,7 % les cotisations d’assurance vieillesse, l’Allemagne a-t-elle privilégié le rendement ou la compétitivité ? De même, en instituant une TVA dite sociale qui n’a eu d’effet social que marginal mais qui a contribué à la réduction de 24 milliards d’euros du déficit public, tout en abaissant fortement et pour la deuxième fois le taux de l’impôt sur les sociétés depuis 1999, à présent établi à 15 %, quelques mois après qu’eut été augmenté de trois points le taux « normal » de TVA, que recherchait l’Allemagne ? La coïncidence de ces mesures ne correspond-elle pas à une recherche de compétitivité, et ne s’agit-il pas davantage de politique économique que de rendement budgétaire ?
Vous avez également évoqué l’unité et l’intégration de la politique des prélèvements en Allemagne. Le lissage des disparités entre les régions est-il transposable en France ?
S’agissant des cotisations sociales, il existe une différence majeure entre France et Allemagne dans la répartition entre la part « employeur » et la part « salarié », la seconde étant presque deux fois plus élevée en Allemagne qu’en France. Pouvez-vous confirmer que le Gouvernement allemand a décidé le principe du plafonnement de l’augmentation des cotisations sociales destinée à compenser le déficit du régime d’assurance vieillesse ?
Enfin, que peut-on dire du rôle joué par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe ? À sa décision de 1997 qui a conduit à la suspension de l’ISF, s’en sont ajoutées d’autres qui ont eu un impact sur la fiscalité allemande – tandis que sur certains sujets, comme l’obsolescence des valeurs locatives, non révisées depuis 1923, elle tarde à se faire entendre. Qu’en pensez-vous ?
Mme Aurélie Filipetti. Merci, monsieur le Premier président, de souligner dans le rapport de la Cour que la fiscalité environnementale, bien plus développée en Allemagne qu’en France, ne freine en rien une politique industrielle dynamique. Vous avez aussi relevé que nous avons trop longtemps compensé la faiblesse structurelle de notre industrie par un coût du travail bas. Pourriez-vous préciser ce que sont ces handicaps structurels ?
En matière de politique familiale, quelles sont les différences entre la France et l’Allemagne quant au financement et à la redistribution ? Il est indiqué dans la synthèse du rapport, concernant la prise en compte des charges de famille, que « des systèmes différents aboutissent, là encore, à des résultats voisins, avec toutefois un avantage relatif en France pour les familles de trois enfants et plus et celles aux revenus élevés. » Est-ce à dire que l’Allemagne privilégie l’aide à d’autres familles, par exemple les familles monoparentales ? S’agissant du financement, vous paraît-il normal que les cotisations soient assises sur les salaires ?
M. Michel Bouvard. Je m’associe aux remerciements adressés au Premier président et la Cour pour ce rapport. Le tissu industriel allemand étant très dense, la part des entreprises industrielles est évidemment importante dans la fiscalité sur les entreprises, qu’elles soient ou non, selon leur statut juridique, assujetties à l’impôt sur les sociétés. La fiscalité et les charges des entreprises allemandes sont-elles homogènes ou existe-il des différences selon les catégories ? Les sociétés de taille intermédiaire, si nombreuses en Allemagne, bénéficient-elles d’un régime plus avantageux que les autres, ou les avantages vont-ils plutôt, comme en France, aux très grandes entreprises ?
Nous souffrons d’un problème de compétitivité alors même que les bas salaires font l’objet d’allègements de charges. Ces allègements coûtent cher au budget de l’État, et des voix s’élèvent pour mettre leur efficacité en doute, ce que fait aussi la Cour des comptes. Quelles pistes envisager pour rendre nos entreprises plus compétitives, tout en supprimant ces allègements ?
M. Charles de Courson. Je voudrais remercier la Cour des comptes pour les 330 pages fort intéressantes de son rapport, qu’au fond elle aurait pu intituler « La divergence franco-allemande ». Nous divergeons en effet sur tout : la France baisse sa TVA, l’Allemagne l’augmente ; la France maintient la taxation du travail, l’Allemagne la baisse ; la France est le pays d’Europe qui taxe le plus la détention et la transmission du capital, l’Allemagne est celui qui les taxe le moins ; la France peine à augmenter sa fiscalité environnementale, l’Allemagne y parvient… Et je pourrais poursuivre la liste.
La vraie question est celle-ci : quelles sont les conséquences économiques et sociales, pour le peuple allemand et le peuple français, de cette divergence entre les politiques fiscales ? La comparaison me semble accablante pour la France. D’un côté, on a fait le choix de l’entreprise, de la compétitivité et du travail et on s’y est tenu, quelles que soient les alternances politiques – et même si cela a pu valoir à certains des périodes dans l’opposition. Chez nous, on a fait preuve d’inconstance et, globalement, fait des choix contre l’entreprise et contre le travail – contrairement à ce qu’on prétend. Le résultat est, pour nous, un faible taux de croissance, un chômage élevé, un déficit structurel avoisinant les cinq points et que l’on ne parvient pas à réduire, alors qu’il est maintenant proche de zéro en Allemagne.
Le rapport de la Cour des comptes est un miroir qui nous renvoie à nos propres faiblesses. Pourquoi la France n’est-elle pas capable de mener une politique constante et d’imiter ceux qui ont réussi ? C’est une question que la Cour s’est gardée de soulever mais que j’aimerais lui poser… Monsieur le Premier président, vous évoquez bien quelques pistes, mais si j’avais un reproche à vous faire, ce serait d’être un peu trop timide. Nous pourrions parler, par exemple, de la TVA sociale : les Allemands ont, en fait, commencé à la mettre en place, en augmentant de trois points le taux de TVA et en baissant les taux de cotisations patronales. La représentation nationale a besoin d’être secouée ! Que faut-il faire pour la rendre sérieuse ?
M. le président Bernard Accoyer. Le Premier président ne va pas répondre à cette question…
M. le rapporteur général Gilles Carrez. L’exercice auquel nous devons nous livrer dans les prochaines semaines est limité à la fiscalité du patrimoine : il ne s’agit pas de grand soir fiscal et social. Mais vous n’avez pas répondu, monsieur le Premier président, à une question essentielle de Pierre Méhaignerie, sur la fiscalisation de l’entreprise.
Votre rapport fait apparaître qu’en Allemagne, il n’y a pas de droits de mutation à titre onéreux sur les parts d’entreprise, et les droits de mutation à titre gratuit sont très inférieurs aux nôtres ; par ailleurs, depuis la suspension de l’ISF, la détention de parts d’entreprise n’est plus imposée. Vous avez répondu à Pierre Méhaignerie sur l’ensemble du patrimoine, mais il est indispensable de faire la distinction entre le patrimoine immobilier et la partie du patrimoine mobilier qui consiste en parts d’entreprise. En Allemagne, on a le profond souci d’assurer la pérennité de l’entreprise d’un double point de vue : contrôle par des résidents allemands, transmission familiale des entreprises ; les belles entreprises familiales n’y sont jamais à vendre. C’est un exemple que nous devrions examiner de près.
À l’inverse, j’ai découvert dans votre rapport l’existence d’une exit tax, taxe sur les plus-values latentes, pour l’Allemand qui, après avoir dirigé une entreprise pendant plus de dix ans, quitte l’Allemagne. J’en suis d’ailleurs un peu étonné car le dispositif que nous avions introduit en 1999 avait été jugé non conforme au droit européen par la Cour de justice des communautés européennes, dans son arrêt Lasteyrie du 11 mars 2004.
La fiscalité n’explique-t-elle pas pour partie la fragilité de nos entreprises familiales, au-delà des problèmes de compétitivité ? C’est une question qui entre dans le champ de la réflexion actuelle.
M. le président Jérôme Cahuzac. La France est plus autonome que l’Allemagne en matière d’énergie. De surcroît, l’énergie y est moins taxée qu’en Allemagne. Comment expliquez-vous que ce facteur, élément de la compétitivité des entreprises, ne joue pas davantage en notre faveur ? N’est-ce pas un paradoxe ?
M. le Premier président de la Cour des comptes. Certaines questions s’adressent à la représentation nationale elle-même …
Pour répondre à Pierre-Alain Muet, tous les chefs d’entreprise, tant allemands que français, avec lesquels nous avons échangé nous ont dit que les différences entre l’Allemagne et la France concernaient moins la fiscalité que le rapport à l’entreprise. En Allemagne, les habitudes de dialogue social sont incontestablement plus grandes. Le blocage que nous observons au Grand Port maritime de Marseille est le résultat de l’absence d’un dialogue social structuré et positif. Bien sûr, il existe aussi quelques différences en matière de fiscalité ; le crédit impôt recherche, par exemple, a suscité beaucoup de questions et d’intérêt de la part des Allemands.
À l’appui de l’observation que le patrimoine et l’ISF ne sont sans doute pas le sujet le plus important sur le plan économique, je rappellerai quelques chiffres.
En valeur nette des passifs, le patrimoine en France représente un total de 9 200 milliards d’euros, et les seuls actifs financiers représentent 3 800 milliards d’euros. L’augmentation des actifs a été plus forte en France qu’en Allemagne ; or dans un cas, il existe un ISF et dans l’autre, il n’existe plus.
J’entends ce qu’ont dit Pierre Méhaignerie et Gilles Carrez sur la transmission des entreprises : notre rapport fait apparaître des différences dans la fiscalité qui, en effet, peuvent expliquer notamment le fait qu’en Allemagne, les entreprises moyennes restent allemandes.
À Jérôme Chartier, je répondrai que beaucoup de prélèvements qui sont hors du champ des cotisations sociales pèsent sur le coût du travail en France, à la différence de l’Allemagne. En indiquant qu’ils représentent 58 milliards d’euros, nous soulignons leur poids. Si en même temps qu’on allège les cotisations sociales, on renforce d’autres prélèvements, le problème demeure. On rejoint la question de la constance dans la politique fiscale menée, vrai sujet pour notre pays. Il me semble nécessaire de réfléchir aux proportions dans lesquelles on veut faire peser l’effort respectivement sur la consommation, sur le travail et sur le patrimoine.
Je confirme que pour les Allemands, le rendement et la compétitivité sont deux objectifs essentiels de la politique fiscale. L’augmentation de la TVA a répondu à un objectif de rendement – afin de réduire le déficit structurel, les Allemands se préoccupant beaucoup plus que nous de l’équilibre de leurs finances publiques –, mais également à un objectif de réduction du coût du travail, cette augmentation ayant permis de réduire les cotisations. Le même raisonnement a prévalu pour la réforme de l’impôt sur les sociétés : les taux ont été sensiblement réduits, mais les assiettes ont été élargies. D’ailleurs, en ajoutant à l’impôt sur les sociétés l’ensemble des prélèvements qui s’en approchent, on constate peu de différences entre nos deux pays.
Je ne reviens pas sur les différences d’approches des fiscalités nationales et locales. En Allemagne, les différences peuvent être fortes entre les Länder en matière de « taxe commerciale », mais il existe une péréquation beaucoup plus poussée qu’en France. L’État fédéral assure un pilotage efficace des finances publiques, tant vis-à-vis des Länder qu’en matière de protection sociale – pour laquelle on veille à l’équilibre des comptes.
S’agissant de la Cour de Karlsruhe, on peut observer une certaine constance dans l’idée qu’un impôt ne doit pas être confiscatoire, ainsi que dans le souci d’égalité – qui a provoqué la suspension de l’ISF, dont les bases ont été considérées comme trop anciennes et donc injustes. En France, les bases du foncier bâti sont elles aussi anciennes et injustes : si le Conseil constitutionnel était saisi, peut-être formulerait-il certaines observations. Je rappelle que les taxes foncières représentent chez nous 33 milliards d’euros.
Pour répondre à la question d’Aurélie Filippetti sur les handicaps structurels de l’industrie française, il faudrait un peu de temps. Nous apportons quelques explications dans le rapport.
Concernant la politique familiale, les deux pays recourent en effet à des moyens différents – fiscal et budgétaire en Allemagne, fiscal et social en France. On constate une différence d’effort global en matière de prestations en nature : pour la garde des jeunes enfants, la France a l’avantage. Le ciblage des aides est également différent : La France aide davantage les familles de trois enfants et plus ; et compte tenu du quotient familial, même plafonné, qui n’existe pas en Allemagne, elle soutient plus que notre voisin les familles dont les revenus sont les plus élevés. L’Allemagne, elle, aide un peu plus les familles d’un et deux enfants.
Michel Bouvard a évoqué la fiscalité des entreprises. Est-elle homogène par tranche d’entreprises, ou y a-t-il des différences selon les catégories – celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu et celles qui relèvent de l’impôt sur les sociétés ? Nous n’avons pas constaté d’effet économique particulier.
Charles de Courson a surtout formulé des observations à destination de ses collègues. Quant à la Cour des comptes, sa façon de dire n’empêche pas, je pense, de comprendre ses messages.
S’agissant des transmissions d’entreprise, je confirme que le régime est beaucoup plus favorable en Allemagne qu’en France mais les conditions à remplir sont très strictes.
Enfin, le prix de l’électricité devrait en effet constituer en France un facteur favorable mais il est à considérer parmi d’autres facteurs, moins favorables, qui peuvent expliquer le résultat global.
M. le président Bernard Accoyer. Monsieur le premier président de la Cour des comptes, je vous remercie, ainsi que la Cour, pour ce rapport, la présentation que vous en avez faite et les réponses que vous avez apportées à nos questions. Votre travail très dense ouvre un débat politique aux enjeux essentiels. Dans cette période de mutations importantes, il est particulièrement opportun d’approfondir ces questions, comme l’a souhaité le Président de la République. Merci encore pour l’excellence de vos travaux.
*
AUDITION DU 9 MARS 2011
Audition de M. Michel Husson, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales, de M. Dominique Plihon, professeur d’économie financière à l’Université de Paris XIII, et de M. Christian Saint-Étienne, professeur à l’université Paris-Dauphine, titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et membre du Conseil d’analyse économique
M. Marc Laffineur, président. Nous accueillons aujourd’hui les trois économistes engagés que sont M. Michel Husson, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales et militant altermondialiste, M. Dominique Plihon professeur d’économie financière à l’Université de Paris XIII mais aussi président du conseil scientifique d’Attac et M. Christian Saint-Étienne, professeur à Dauphine et au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Conseil d’analyse économique et par ailleurs vice-président du groupe « Centre et indépendants » du Conseil de Paris.
Comme vous le savez, messieurs, notre mission d’information, créée par la Conférence des présidents à l’initiative du Président Bernard Accoyer, s’est fixée pour objectif d’analyser l’évolution de la compétitivité de l’économie française au regard de la situation de nos principaux partenaires et concurrents et de s’interroger sur le niveau des charges sociales en France et leur impact sur l’économie. Nous vous entendrons avec intérêt.
M. Michel Husson. Je vous remercie pour cette invitation, que j’interprète comme une reconnaissance de l’intérêt des travaux de l’Institut de recherches économiques et sociales.
Selon certains, si la France perd des parts de marché, c’est que sa compétitivité est en baisse, et il faut la rétablir en réduisant le coût du travail. C’est remettre implicitement en cause un modèle social jugé trop coûteux au regard des exigences de la compétitivité.
Or les indicateurs traditionnels que sont, d’une part, les prix relatifs des productions françaises et, d’autre part, l’évolution de la demande mondiale adressée à l’économie française ne peuvent expliquer le recul des parts de marché de la France à partir du milieu des années 2000. C’est une énigme, mais le fait est que l’équation économétrique classique ne fonctionne plus. Comme le montre l’étude par la Commission européenne des performances comparées des économies des pays membres, la France n’est pas la seule concernée : les cas atypiques abondent. Ainsi, en dépit d’une baisse de compétitivité, les Pays-Bas gagnent en part de marché ; l’Espagne perd en compétitivité mais maintient la sienne ; la dévaluation de la livre est sans effet sur la part de marché du Royaume-Uni, qui continue de baisser. Seule l’évolution de l’Allemagne et de l’Italie est conforme au modèle traditionnel : la première augmente sa compétitivité-prix et gagne des parts de marché, la seconde perd sur les deux tableaux.
D’autres facteurs structurels doivent donc être pris en compte. Au nombre de ces éléments, il y a le taux de change de l’euro. On constate en effet une forte corrélation entre la perte de compétitivité de la France et celle du taux de change entre l’euro et le dollar ; la dévaluation relative du dollar entre 2000 et 2005 a conduit à une perte de compétitivité de l’économie française qui n’a pas été rattrapée depuis lors.
Autre facteur d’importance : l’accélération de la mondialisation. Depuis le début des années 2000, les pays émergents gagnent des parts de marché ; cela signifie qu’en corollaire, d’autres pays en perdent, dont la France – un peu plus que les autres, soit, mais sans que cette évolution la touche spécifiquement. C’est l’Allemagne qui, en maintenant ses parts de marché dans ce contexte, fait figure d’exception.
La structure de la demande constitue un troisième et fort élément d’explication. En Allemagne, la consommation des ménages est pratiquement étale depuis l’an 2000 ; au cours de la même période, elle a augmenté d’environ 20 % en France, où elle est le moteur de l’économie. Que la consommation intérieure soit gelée en Allemagne permet de consacrer les capacités productives du pays aux exportations. Les modèles économiques des deux pays sont donc très différents.
Quatrième élément : les dépenses de recherche et développement (R&D), autre variable à prendre en considération. Dans ce domaine, la France, où elles représentent 2,1 % du PIB, est en retard sur l’Allemagne, où elles s’élèvent à quelque 2,7 % du PIB. De plus, la répartition de cette dépense diffère, la part assumée par le secteur privé étant beaucoup plus faible en France qu’en Allemagne. Un des arguments du rapport de Rexecode sur la compétitivité comparée de la France et de l’Allemagne récemment remis au ministre de l’industrie est que la baisse du taux de marge de l’industrie française au cours de la dernière décennie l’a contrainte à réduire son effort de R&D. C’est omettre l’ampleur prise pendant la même période par un phénomène qui n’est pas propre à la France : la préférence donnée à la finance, qui s’est traduite par l’augmentation considérable de la distribution nette de dividendes. À ce jour, les dépenses de recherche et développement ne représentent plus qu’un quart des dividendes nets versés, contre un tiers en l’an 2000. Autrement dit, les dépenses de R&D ont été plafonnées et les dividendes nets versés augmentés.
Selon Rexecode, il faudrait, pour que la France récupère sa perte de compétitivité face à l’Allemagne, « faire baisser de 5 à 10 % les coûts de production pour l’industrie sur notre territoire par une mesure de réduction des charges pesant sur le travail, financièrement compensée autant que possible par une réduction significative des dépenses publiques. » Cette proposition emblématique, fort peu détaillée, découle d’une analyse incomplète et donc d’un mauvais diagnostic, puisque la compétitivité-prix française n’est pas en cause.
Outre cela, absolument rien ne garantit que des allègements de cotisations supplémentaires seraient consacrés à l’augmentation de la compétitivité mesurée par les prix, car ce type d’incitation est aveugle. Il n’existe aucune manière de cibler ces allégements sur les secteurs industriels exposés à la compétition mondiale, comme le soulignait, en 2006 déjà, un rapport non publié de la Cour des comptes indiquant que tous les allégements bénéficient prioritairement à des activités non directement soumises à la concurrence internationale. Aucun moyen ne permet de maîtriser les effets réels d’une telle mesure.
Par ailleurs, la période actuelle, caractérisée par une très grande difficulté à rééquilibrer le budget, est-elle la mieux choisie pour procéder à des allégements supplémentaires des cotisations sociales des entreprises, que les finances publiques seraient appelées à compenser ?
Une telle mesure présenterait de grands risques. Le premier, alors que notre modèle social a déjà été passablement écorné et que la perspective de créations d’emplois à court et moyen termes ne se dessine pas, est celui de l’aggravation de la régression sociale. Le deuxième risque est celui de la régression économique – quelles seraient les répercussions sur la consommation de l’instauration d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sociale ? Le troisième risque, c’est l’entrée dans une spirale non-coopérative européenne, alors que c’est de la démarche inverse dont l’Union européenne a le plus grand besoin.
M. Dominique Plihon. Je traiterai du modèle allemand et du Pacte de compétitivité avant de décrire la vision alternative du fonctionnement de l’Europe qui me paraît devoir être privilégiée.
Lorsqu’il s’agit de concurrence internationale, nous souffrons d’une tendance au mimétisme. Un temps, le modèle danois de flexisécurité fut donné en exemple ; c’est maintenant le modèle allemand de compétitivité qu’il faudrait importer. Cette tentation peut se comprendre puisque l’Allemagne est notre principal concurrent, mais elle est dangereuse. Trois raisons font que transposer en France le modèle allemand ne serait pas une bonne démarche.
En premier lieu, la théorie institutionnaliste nous apprend que les performances d’un pays donné s’expliquent très largement par son histoire et ses institutions, qui forment un ensemble cohérent, non transposable ; prétendre imiter un pays en lui empruntant celles de ses politiques ou formes d’organisation qui fonctionnent le mieux est à la fois dénué de sens et périlleux.
Ensuite, l’augmentation, réelle, des performances allemandes depuis dix ans résulte d’une vigoureuse politique de l’offre fondée sur un ensemble de facteurs – flexibilité accrue du marché du travail, réduction du coût social du travail par l’instauration d’une TVA sociale, délocalisations… – qui se sont traduits par une précarisation accrue. Or les politiques de l’offre, puisqu’elles supposent de prendre des parts de marché aux pays concurrents, sont par nature des politiques non coopératives : elles n’ont pas un effet « gagnant-gagnant » mais, comme le montre la montée des déséquilibres entre pays membres de l’Union européenne et de la zone euro, un effet « gagnant-perdant ». La politique de l’offre serait-elle généralisée qu’elle tirerait la croissance et l’emploi au sein de l’Union européenne vers le bas, une situation « perdant-perdant ».
Enfin, le modèle allemand est, à bien des égards, peu enviable. Avec un taux de croissance moyen de 1,4 % de 1996 à 2008 contre 2,2 % en France, l’Allemagne a été, dans l’Europe des Quinze, le pays dont la croissance a été la plus faible et celui qui a créé le moins d’emplois depuis vingt ans. Celui, aussi, où la hausse des inégalités de revenus a été la plus élevée d’Europe, Bulgarie et Roumanie exceptées. Celui, encore, où le salaire moyen hors inflation a stagné, où la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé, où le pourcentage de chômeurs indemnisés a fortement chuté – il est passé de 80 % à 35 % –, tout comme la part des investissements dans le produit intérieur brut (PIB). En bref, tous les clignotants ne sont pas au vert en Allemagne.
Certes, le taux de chômage a baissé dans ce pays de 10 % en 2005 à 7,3 % en 2008, mais ce succès politique doit être nuancé : il a été obtenu par l’augmentation du travail à temps partiel, souvent contraint, pour une grande partie des travailleurs – le volume d’heures travaillé a baissé malgré l’amélioration du taux de chômage – et par l’effet d’une décroissance démographique inquiétante pour l’avenir de l’Allemagne. La France est, à cet égard, dans une situation un peu plus favorable.
J’en viens au Pacte de compétitivité proposé par Mme Angela Merkel le 4 février dernier et approuvé par M. Sarkozy, pacte qui a précisément pour objectif de généraliser les préceptes allemands aux autres pays européens en les amenant à conduire une politique salariale et budgétaire restrictive. Il contient deux mesures phares : l’abolition de l’indexation des salaires sur les prix – ce qui, dans une période comme celle que nous connaissons, avec l’augmentation du prix des matières premières importées, conduirait à une perte de pouvoir d’achat – et l’obligation d’inscrire dans la Constitution la limitation de la dette publique.
Dans la droite ligne de la logique ordo-libérale allemande, il s’agit de créer des règles contraignantes pour discipliner les pays membres de l’Union européenne. Ces règles concernent non seulement les politiques publiques mais aussi l’endettement des ménages et des entreprises, que l’on entend contrôler.
Ce document appelle des objections de deux ordres. D’abord, l’application de ces principes aurait des effets pervers pour la zone euro – ce pourquoi le Pacte de compétitivité a été très fraîchement accueilli par un grand nombre de pays membres. Si la politique économique restrictive menée par l’Allemagne depuis dix ans pour améliorer sa compétitivité n’a pas eu de conséquences dramatiques sur la zone euro, c’est parce que dans le même temps l’Espagne, la Grèce, l’Irlande et l’Italie ont connu une croissance forte tirée par leur consommation intérieure. Si, à l’avenir, tous les pays européens devaient adopter la politique restrictive recommandée par le Pacte de compétitivité, certains pays verraient sans doute leurs exportations progresser mais l’anémie européenne serait certaine dans les autres pays de la zone euro, auxquels interdiction serait néanmoins faite de s’endetter pour se procurer des ressources pourtant indispensables.
Ensuite, ce pacte est fondé sur la poursuite de la politique menée jusqu’à présent, celle de l’intégration européenne par les règles voulue par l’ordo-libéralisme allemand. Mais cette approche conduit à une impasse. Brider les politiques économiques nationales, c’est empêcher les États membres de l’union monétaire de mener des politiques contra-cycliques quand elles sont nécessaires et de jouer un rôle d’ajustement et de stabilisation. Les règles communes ne doivent pas être trop restrictives ; il faut laisser aux États des marges de manœuvre.
Un autre mode de fonctionnement de l’Union européenne doit prévaloir, tel que les États membres retrouvent une capacité d’initiative beaucoup plus forte. Cela n’irait pas à l’encontre d’une plus grande efficacité économique, bien au contraire. Or, rien dans ce plan ne permettrait d’instaurer l’indispensable gouvernement politique européen, alors que la sortie de crise et même la survie de l’Union européenne passent par d’autres formes d’organisation. La coordination des politiques économiques fondée sur le principe de la solidarité des pays membres doit l’emporter sur la « méthode ouverte de coordination », autrement dit la concurrence entre les États. La conception néolibérale de la gouvernance européenne qui a prévalu jusqu’à ce jour doit être abandonnée. Il faut créer les mécanismes, les instances politiques et les instruments européens qui permettront de lancer les grands programmes communautaires nécessaires à l’indispensable relance européenne.
Outre que rien ne figure à ce sujet dans le Pacte de compétitivité, les politiques qu’il décrit sacrifient très largement les objectifs sociaux. Or l’Europe ne peut poursuivre son intégration, ni donc se développer, sans approfondir son modèle social, qui ne peut reposer sur la seule logique du marché. Si l’on veut que l’Union européenne survive et prospère, la concurrence sociale et fiscale à tout prix n’est pas une solution ; or le Pacte de compétitivité, en généralisant la politique de l’offre, la renforcerait.
Il faut donc agir sans ce pacte qui aggraverait des politiques dont on a vu qu’elles mènent à une impasse. Alors que, les populations se sentant maltraitées et laissées pour compte, on assiste à la montée menaçante du nationalisme et du populisme, l’adhésion des peuples à la poursuite du projet européen implique une autre vision.
Des mesures – symboliques dans un premier temps – permettraient de créer ce sursaut à court terme : la création d’un salaire minimum européen modulé selon le niveau de PIB par habitant de chaque pays, mais aussi l’instauration de la taxe européenne sur les transactions financières votée hier par le Parlement européen. Si elle était appliquée, cette disposition permettrait d’augmenter, comme il se devrait, le budget européen, et ainsi de financer des politiques coordonnées ambitieuses. De telles mesures sont indispensables pour permettre à l’Union européenne d’affronter les défis auxquels elle se trouve confrontée : définir une politique commune d’éducation et de recherche bien plus vigoureuse qu’elle ne l’est actuellement et financer la transition écologique. Faute de quoi, l’Union européenne doit s’attendre à de graves problèmes. Le Pacte de compétitivité n’est pas à la hauteur des enjeux.
M. Christian Saint-Étienne. Avant d’exposer les points de divergence avec mes collègues, je dirai les quelques points de vue sur lesquels je suis en accord avec eux – en premier lieu sur le fait que l’Allemagne n’est pas un exemple en tout. La France a des atouts considérables ; seulement, ces atouts forment un potentiel dont on ne joue pas, si bien que nos performances demeurent calamiteuses. Au passage, la politique de désinflation compétitive de l’Allemagne nous a coûté en dix ans un demi-point de croissance chaque année selon les calculs de l’OFCE ; il s’agit, j’en suis d’accord, d’une politique de désinflation non coopérative.
Mes collègues se sont livrés à un exercice plutôt normatif, leur analyse de la situation conduisant à dénoncer une organisation politique, comme le montre la condamnation par M. Dominique Plihon de l’ordo-libéralisme allemand. Tous les deux ont contesté les bons résultats de l’Allemagne ; il n’empêche que ces résultats existent et qu’il faut mesurer les conséquences de ce succès peut-être mal acquis. Quelles sont-elles ? D’une part, l’Allemagne a pris le leadership absolu de l’Union européenne, se montrant d’une arrogance impitoyable à l’égard des pays de l’Union aux performances économiques défavorables, ce qui a des conséquences politiques majeures ; d’autre part, la réflexion sur la modification des politiques européennes se fait sur la base de l’agenda allemand.
Je le redis, la France a des atouts considérables : une population nombreuse, un taux d’épargne des ménages particulièrement élevé et des professionnels très qualifiés, qui ont pour particularité de mieux réussir ailleurs que chez nous. C’est le signe d’une crise systémique : si l’on réunit un très bon ingénieur français, un très bon financier français et un très bon spécialiste des biotechnologies français, ils produisent ensemble 5 à l’étranger, mais seulement 2 en France. En d’autres termes, nous formons des individus exceptionnels mais notre organisation fait que la somme de leurs talents produit moins que ce que l’on pouvait espérer.
La situation de notre pays n’est pas bonne ; il y a donc urgence à agir. Pourtant, mes collègues parlent de long terme, comme si nous avions le temps, et comme si nous avions une chance de modifier les équilibres européens. Or la donne européenne est d’une extrême dureté, elle ne va pas changer et elle n’est pas favorable aux intérêts français.
La situation de la France se caractérisée par une triple crise. Avec un déficit structurel de 6 % du PIB, la crise de nos finances publiques est d’une ampleur historique – comparable, selon moi, à celle de la fin de l’Ancien Régime –, et rien n’est fait pour amorcer une décrue. Nous allons, dans les dix-huit mois à venir, au devant d’une crise d’une ampleur inédite et nous connaîtrons plus tôt que nous ne le pensons notre « Octobre grec », puisque notre dette publique est financée à 70 % par des investisseurs étrangers, notamment des fonds américains. On notera incidemment que ceux qui critiquent notre endettement s’empressent d’acheter notre dette…
Par ailleurs, dix-huit des vingt-sept pays membres de l’Union européenne ayant choisi pour stratégie de développement la compétition fiscale, nous sommes engagés dans une crise de compétitivité fiscale majeure. Cette évolution de la construction européenne avait été théorisée par la Grande-Bretagne et inscrite dans le traité de Maastricht négocié pour la France par François Mitterrand. En 2007, l’Allemagne a rejoint le camp de la compétition fiscale et nous évoluons désormais dans un univers européen dominé par ce concept qu’appuie la Commission européenne. Il est vrai qu’à long terme une politique coopérative permettrait d’obtenir des résultats très supérieurs à ceux que nous observons aujourd’hui. Mais, étant donné l’état de nos finances publiques, dans un contexte idéologique où la concurrence fiscale est tenue pour une bonne chose, les Allemands nous considèrent désormais avec condescendance. Ils jugent que la France mène ses affaires de manière scandaleuse et pensent que nous sommes devenus un partenaire très fragile ; ils ont perdu confiance, nous le font sentir, et interprètent chaque discours en faveur du modèle coopératif comme un aveu de faiblesse, ce qui les pousse à accentuer la concurrence.
La troisième crise d’ampleur historique que nous connaissons est celle de notre système productif. Je ne peux partager le diagnostic d’ensemble porté par Michel Husson à ce propos, puisque notre part relative des exportations de la zone euro s’est effondrée elle aussi. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), nous avons perdu un tiers de nos parts de marché en dix ans ; c’est, selon moi, l’équivalent, sur le plan économique, de la défaite militaire de 1940, et c’est ce qui explique les considérables difficultés de la France, ses millions de chômeurs et le déficit de ses comptes.
Pour remédier à cette situation, trois priorités s’imposent. Puisque notre déficit extérieur traduit le fait que, structurellement, notre consommation est supérieure à notre production, nous devons pour commencer rétablir le primat de la production sur la consommation.
Il nous faut aussi réhabiliter la taxation de la consommation, et donc la TVA. Cette réhabilitation est en cours chez nos voisins, en Allemagne comme au Royaume-Uni – où la commission réunie sous la présidence du Prix Nobel d’économie James Mirrlees a publié en novembre 2010 un rapport démontrant le bien-fondé et l’efficacité de cet impôt. Le maintien d’un taux de TVA réduit est une stupidité ; il faudrait au contraire fixer un impôt à la consommation à un taux relativement élevé, à compenser par une allocation directe aux ménages les plus démunis. On éviterait ainsi l’aubaine qui permet aux plus riches de nos concitoyens d’acheter des produits alimentaires en ne payant que 5,5 % de TVA alors qu’ils auraient les moyens de payer une taxe de 19,6 %, voire davantage.
Enfin, nous devons être en mesure de résister à la concurrence fiscale.
Le Conseil d’analyse économique, s’attachant à expliquer les raisons de l’effondrement relatif des exportations françaises, a pointé l’absence, en dépit de tous nos efforts, de ces milliers de grosses PME qui irriguent le tissu industriel allemand. Derrière nos grands groupes industriels – au demeurant de moins en moins français – nous font défaut les quelque 15 000 entreprises de 300 à 400 personnes qui nous donneraient les 3 à 4 millions d’emplois qui nous manquent.
Nous devons mener une indispensable politique de salut public pour faire face à une Union européenne qui, par la somme des initiatives qu’elle prend, tend à déconstruire la République française, ce que nous n’avons pas de raison d’accepter. Nous sommes porteurs d’un message ; nos institutions diffèrent des institutions allemandes mais ne leur sont pas inférieures ; notre taux de natalité et notre taux d’épargne montrent qu’existe en France un dynamisme individuel. Il nous faut donc reconstruire, ensemble, un collectif disparu.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Nous aspirons à réduire le chômage et aussi la dette que nous laisserons à nos enfants. Toutefois, monsieur Dominique Plihon, l’Europe n’est pas un cocon protégé du monde extérieur. Comment concilier le modèle que vous proposez et l’ouverture de l’Union européenne sur le monde ? Monsieur Michel Husson, vous jugez que le modèle social français a été « écorné ». Or nos voisins européens estiment que nos dépenses sociales continuent de s’accroître au rythme de 3,5 % à 4 % par an. En quoi ce modèle est-il donc « écorné » et, au rythme actuel de progression des ces dépenses, ne risque-t-on pas d’étouffer l’emploi ? Enfin, M. Christian Saint-Étienne suggère d’aider les PME à grandir. Cela ne suppose-t-il pas de renoncer à entraver la transmission des entreprises familiales par l’impôt de solidarité sur la fortune, qui pousse ceux des enfants dont ce ne sera pas l’outil de travail à vendre ?
M. Dominique Plihon. Pour concilier la vision de l’Europe que je vous ai proposée et l’ouverture sur le monde, il faut donner à l’Union européenne la « base arrière » forte qui lui permettra de se développer et d’être une puissance reconnue. Pour cela, il lui faut définir des politiques communes qui ne soient pas uniquement fondées sur le principe de la concurrence comme c’est le cas aujourd’hui, mais sur les principes de coordination et de solidarité. Fonder le développement de l’Europe sur la généralisation de politiques de l’offre par essence non coopératives, c’est l’affaiblir, car si l’on poursuit sur cette voie, quelques pays y gagneront, certes, mais il y aura aussi des pays perdants, et pour finir des perdants seulement. C’est une erreur de penser que pour être forts sur la scène internationale, les pays européens doivent se concurrencer d’une manière effrénée sur le marché intérieur, d’autant que cette concurrence porte aussi sur les politiques publiques, fiscales et sociales.
L’Union européenne doit mener des politiques keynésiennes, coopératives, consistant à se tourner davantage vers les besoins internes insatisfaits, qu’il s’agisse d’infrastructures, de ferroutage, d’éducation, de recherche ou des activités liées à la transition écologique. L’Europe retrouverait une unité en fédérant tous ses acteurs, entreprises et ménages, autour d’un projet commun mobilisateur, par des politiques d’investissement coordonnées. Dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire, les politiques doivent être engagées collectivement et non plus à l’échelle d’un seul pays. Ce serait un système « gagnant-gagnant », qui n’est en rien incompatible avec l’émergence d’une Europe forte.
M. Michel Husson. J’ai dit que le modèle social français était écorné, je n’ai pas dit qu’il était laminé. MM. Michel Albert et Jean Boissonnat ont indiqué, il y a longtemps déjà, que l’Union européenne, telle qu’elle a été conçue, est fondée sur la concurrence, y compris celle des modèles sociaux. Mais nous sommes parvenus à un tournant. Au cours des dernières années, l’Allemagne est, de tous les pays européens, celui qui a le plus fortement remis en cause son modèle social ; comme l’a signalé l’OCDE, c’est dans ce pays que la pauvreté a le plus augmenté. L’hypothèse selon laquelle l’Allemagne va poursuivre dans la voie actuelle est fausse : elle va être amenée à revoir ses équilibres. Aussi, vouloir remettre en question notre modèle social, prétendument trop généreux, pour imiter les Allemands, risque de nous entraîner dans une spirale fautive. Mme Angela Merkel n’a-t-elle pas indiqué récemment que les salaires allemands devraient recommencer d’augmenter ? Maintenant qu’elle a retrouvé la position perdue après la réunification, l’Allemagne est, pour des raisons démographiques et de politique intérieure, à la veille d’une inflexion. L’imiter en abaissant le coût du travail pour réduire les problèmes structurels de l’industrie française, c’est faire fausse route.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. La France ne doit-elle pas, cependant, faire des efforts supplémentaires ?
M. Michel Husson. La France ne doit pas se placer à la remorque du pacte de compétitivité mais faire porter ses efforts sur la recherche et le développement. C’est un constat largement partagé depuis vingt ans : nous ne gagnerons pas en jouant sur le coût du travail mais en agissant sur la qualité de nos produits. Je rappelle à ce sujet que si l’économie française se porte mal en termes de compétitivité, les grands groupes multinationaux français sont très bien classés au niveau international.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Mais ils réussissent mieux à l’étranger qu’en France !
M. Michel Husson. Ils réussissent sur le marché mondial aussi bien que tous les autres grands groupes multinationaux. La différence de performance entre l’économie française et les grands groupes français doit donc nous faire réfléchir au bien-fondé de toutes les politiques qui favorisent la compétitivité des groupes tournés vers le marché extérieur, sans favoriser la densification du tissu industriel français – il ne s’agit pas de coût du travail !
Par ailleurs, l’Allemagne pratique la réexportation à grande échelle, ce qui fausse l’appréciation de sa situation. Ainsi, Porsche fait fabriquer en République tchèque des véhicules de luxe qui se vendent très bien dans les pays émergents. Mais, parce qu’elle rapatrie en Allemagne la dernière phase de la fabrication, ces exportations sont comptabilisées dans les exportations allemandes, alors que les Logan que Renault fait intégralement fabriquer en Roumanie sont prises en compte dans les exportations roumaines. Une note récente de Natixis indique que deux tiers des gains de parts de marché de l’Allemagne dans la zone euro sont liés aux réexportations.
M. Christian Saint-Étienne. Étant favorable à des États-Unis d’Europe, je suggère, pour résoudre la crise de l’euro, une fédéralisation de la zone, éventuellement partielle ; sept à dix pays, par nature coopératifs, constitueraient une base intérieure puissante qui pourrait se projeter sur le reste du monde. Mais, en ce moment, la zone euro va si mal que le risque d’un éclatement est patent et, contrairement à M. Dominique Plihon, je suis persuadé que le basculement d’une politique de concurrence à une politique de coordination n’a strictement aucune chance de se produire avant dix ou quinze ans ; comment agir dans l’intervalle ?
J’ajoute que, sur le plan stratégique, nous aurons d’autant plus de chances d’amener les autres pays européens à négocier le passage de la concurrence à la coordination que nous aurons ostensiblement commencé à mettre notre maison en ordre. Nous retrouverons de la crédibilité lorsque nos voisins verront que nous menons, nous aussi, une politique de l’offre et que nous dynamisons massivement nos petites et moyennes entreprises (PME). Aussi longtemps qu’il n’en sera pas ainsi, ils refuseront la coopération puisqu’ils tirent un grand bénéfice de la situation présente.
Cela implique que nous traitions la crise des finances publiques par des mesures appropriées. Pour commencer, ayant été élu local, je sais que nous pourrions économiser un point sur les dix points de PIB consacrés à la dépense locale – seuls les bénéficiaires directs s’en apercevraient. Nous pourrions également réaliser d’importantes économies de dépenses sociales. Je rejoins mes deux collègues pour dire que ces économies ne devraient pas être affectées uniquement à la réduction du déficit budgétaire mais aussi à des investissements stratégiques majeurs. La croissance mondiale se concentre désormais dans les grandes métropoles, mais pour qu’une métropole devienne un support de la croissance, il faut réaliser des investissements stratégiques et investir dans la recherche et le développement. Il faut donc, simultanément, restreindre les dépenses de fonctionnement et augmenter massivement les dépenses d’investissement. Je propose, dans un ouvrage qui paraîtra sous peu, un projet complet de réforme fiscale prévoyant un plan de 900 milliards d’euros de dépenses sur quinze ans – dont 300 milliards d’argent public appelant 600 milliards de partenariats public-privé – plan destiné à reconstruire totalement notre pays, dont les infrastructures souffrent d’un sous-investissement massif.
Je souffre de devoir le dire : outre que nous perdons massivement des parts de marché dans l’industrie, nous en perdons aussi dans les services et dans l’agriculture – un domaine dans lequel l’Allemagne nous a maintenant devancés. Nos parts de marché dans le fret aérien, le fret maritime et le fret terrestre, trois indicateurs de vitalité de l’appareil de production, s’effondrent également. Ce qui se produit actuellement dans nos ports et dans les transports terrestres est particulièrement scandaleux ; cela va provoquer la perte de dizaines de milliers d’emplois. Nous devons réinvestir dans tous ces domaines.
On dénombre trois millions d’entreprises en France, dont celles de la cotation assistée en continu (CAC 40). Mais les trente-trois entreprises industrielles du CAC 40 qui sont totalement internationalisées réalisent les deux tiers de leur chiffre d’affaires et les trois quarts de leurs profits hors de France. Le seul enjeu pour nous est de conserver le contrôle capitalistique de ces têtes de réseau, que nous risquons aussi de perdre. Je vous surprendrai sans doute en vous disant que si j’étais ministre des finances, je ferais l’acquisition en bourse de 10 % du capital de Renault – dont l’État détiendrait alors 25 % – pour m’assurer que lorsque l’entreprise investit, elle le fait dans les usines françaises – comme les Allemands le font dans l’industrie allemande.
Pour revitaliser le tissu des PME françaises, il faut donner une responsabilité aux régions dans le maillage territorial des PME, et pour cela des outils d’intervention. La question est éminemment politique. Pourquoi ne pas en revenir aux sociétés de développement régionales, et mêler acteurs publics et acteurs privés ? Il faut recréer un capitalisme national et un capitalisme régional. Chacun le sait, nous avons, en France, un capitalisme sans capital. Nous devons lui redonner les moyens de se développer par une politique fiscale appropriée mais, en contrepartie, les PME que nous aurons aidé à se développer devront associer les salariés au succès de leur stratégie. Il faut donc une relance énergique des politiques de participation et de formation, allant bien au-delà de ce qui a été fait il y a quarante ans. Enfin, nous ne parviendrons pas à passer de 400 000 jeunes en formation en alternance à un million ou bien davantage, comme il le faut, sans imposer un effort aux entreprises. Dans le cadre d’une politique de reconstruction de notre appareil productif, il faudra donc négocier un package. Puisque 99 % de nos trois millions d’entreprises sont des entreprises familiales, donnons-leur les moyens, en collaboration avec les régions, de réaliser le maillage de notre territoire de telle sorte que cela profite aux populations.
M. Dominique Plihon. J’observe que tout cela est terriblement normatif…
M. Paul Giacobbi. Je suis étonné d’entendre un économiste réduire de manière caricaturale la compétitivité à la seule compétitivité mesurée par les prix… Pour m’intéresser à la compétitivité des territoires, je constate que les plus grandes entreprises françaises n’ont plus grand-chose de français – en tout cas, leur production ne se fait plus en France.
Si je vous entends bien, monsieur Dominique Plihon, l’Allemagne, en diminuant le nombre d’heures travaillées et en partageant le travail par un recours accru au travail à temps partiel, a réussi à réduire d’un quart le taux de chômage sans qu’il en coûte un sou aux finances publiques. Dans le même temps, en France, nous avons partagé le travail en instaurant les 35 heures, ce qui n’a pas diminué significativement le taux de chômage mais qui coûte chaque année quelque 20 milliards d’euros aux finances publiques. Si c’est cela, je préfère le modèle allemand !
Par ailleurs, le crédit impôt recherche appelle un intérêt soutenu dans de nombreux pays étrangers – dont les États-Unis qui en connaissent le fonctionnement en détail. Pourtant, lors de l’examen de chaque projet de loi de finances, nous envisageons de le supprimer ou tout au moins de le limiter !
Il est exact qu’en Europe, les actionnaires, pour une grande part américains, privilégient les dividendes. Ils exigent un rendement de 12 % à 15 %, ce qui oblige les directions générales à obtenir des rentabilités encore supérieures pour pouvoir consacrer une petite part des bénéfices au développement de l’entreprise. Il en résulte que les entreprises qui se financent par le marché n’investissent plus et perdent en compétitivité.
A contrario, les entreprises indiennes Tata et Wipro, des géants dans leur domaine, appartiennent à des familles. Celles-ci ne se distribuent que 2 % des profits et consacrent le reste – des dizaines de millions de dollars – au développement interne de l’entreprise mais aussi à des œuvres d’intérêt général de développement économique. En Inde, la contribution du groupe Tata à l’enseignement supérieur technologique est colossale, comme l’est la contribution de Wipro au développement de la formation dans l’entreprise. De plus, ce groupe vient de consacrer quelque 2 milliards de dollars au financement du développement rural. Dans de tels modèles, non seulement les entreprises considérées grandissent, mais, curieusement, l’économie générale du pays se développe également.
Je remercie M. Christian Saint-Étienne d’avoir souligné qu’avec 150 milliards d’euros de déficit pour 250 milliards de recettes fiscales, la France sera nécessairement confrontée, à brève échéance, à une crise douloureuse. Il est bon qu’un économiste rappelle ce que les responsables politiques disent rarement. J’avais moi-même donné l’alerte dans un article publié en 2002 dans Le Monde et intitulé « Chronique comptable d’une faillite nationale annoncée ».
M. Olivier Carré. Beaucoup de dépenses publiques ont été proposées. Mais tous les récents plans de relance n’ont-ils pas été ainsi fondés ? Le recul manque pour permettre d’apprécier leur succès véritable mais, quoi qu’il en soit, force est de constater que ces politiques n’ont pas permis de résoudre certains problèmes de fond.
Les dépenses de recherche et développement, d’éducation et de formation sont indispensables. À cet égard, l’appétence des entreprises pour le crédit impôt recherche montre que nous sommes sur la bonne voie. De même, par le biais du grand emprunt, la recherche universitaire commence à être bien dotée, voire très bien dotée. Des politiques utiles ont donc été engagées ; pour autant, suffiront-elles à rendre notre modèle soutenable ? En d’autres termes, notre système actuel peut-il perdurer sans que nous réduisions notre dépense ? Comme je n’en crois rien, je vous interroge : sur quelles dépenses pouvons-nous agir ?
Enfin, je rappelle que lorsque Renault a engagé sa stratégie de délocalisation, l’État détenait une part significative de son capital…
M. Jean-Claude Sandrier. Je conviens qu’il ne suffit pas toujours d’étatiser une entreprise pour qu’elle se porte mieux… Monsieur Christian Saint-Étienne, vous insistez beaucoup sur la réussite allemande, mais qu’entendez-vous par là ? La pression sur les salaires, la diminution du pouvoir d’achat, l’augmentation de la précarité, les attaques contre la protection sociale, la baisse de la démographie ? Que représente la « réussite » de l’Allemagne pour les Allemands eux-mêmes ? De même, pour réduire le déficit en France, vous proposez de réduire les services publics et d’augmenter la TVA ; or c’est l’impôt qui pénalise le plus les catégories populaires et moyennes.
Par ailleurs, à quoi sert une Union européenne dont les pays membres se sont engagés dans une guerre économique fratricide de plus en plus dévastatrice, utilisant à cette fin des armes nouvelles, telle la concurrence fiscale ? N’avons-nous d’autre solution que cette guerre économique sans foi ni loi dont il est certain qu’elle nous mènera droit au mur ?
Notre pays ne connaît pas une crise de ses finances publiques mais une crise due à des choix politiques qui ont mis à mal nos finances publiques. Selon le constat de notre rapporteur général, M. Gilles Carrez, sur les 150 milliards d’euros de déficit, 50 milliards seulement sont dus aux conséquences de la crise économique et financière internationale ; 100 milliards correspondent à des cadeaux fiscaux plus ou moins justifiés. On oublie de dire à qui la crise est due – et elle n’est certainement pas due à l’infirmière, à l’enseignant ou au militaire !
Au cours des années 1980, 5 % de la valeur ajoutée était distribuée en dividendes. Aujourd’hui, cette part est passée à 25 %. Quelle est l’utilité de ces fonds ? Contribuent-ils à la création de valeur ? Nous assistons aujourd’hui à l’accaparement des richesses par quelques grosses fortunes, au détriment des autres catégories de la population. Souvenez-vous de ce que disait Warren Buffet : « Notre situation n’a jamais été aussi bonne, vous pouvez nous taxer ! ». Et je ne parle pas des paradis fiscaux !
Pour faire face à la guerre économique mondiale, nous sommes voués à mener des politiques de coopération. Ce matin, la responsable du Mouvement des entreprises de France elle-même soulignait que, de nouveau, les banques, en France, ne font plus leur travail. Leur attitude à l’égard des PME est en effet très différente de ce qu’elle est en Allemagne.
Nous sommes dépassés par l’Allemagne en matière de recherche et développement, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et aussi en effort de formation. Ne serait-il pas préférable de faire des efforts dans ces domaines au lieu de demander aux Français, qui n’en peuvent déjà plus, de moins se chauffer ou de moins se soigner, et au lieu de réduire le nombre d’enseignants ?
M. Christian Blanc. Il est intéressant de constater, au fil des auditions, que les économistes expriment des avis partagés.
L’Allemagne s’est donc engagée dans une politique de l’offre généralisée, au détriment des pays qui mènent une politique de la consommation comme la Grèce et le Portugal mais aussi la France. On voit les dégâts auxquels peut conduire une telle politique menée sur le long terme même si, ce à quoi je crois assez peu, elle est corrigée par des coopérations à venir : dans quinze ans, l’Europe pourrait être allemande. Je ne suis pas certain que ce soit un objectif, ni d’ailleurs un cadeau à faire aux Allemands, mais ceux-ci estiment à juste titre que, compte tenu de la rapidité de la mondialisation, l’Union européenne ne résistera pas – et donc l’Allemagne non plus – si elle ne s’arme pas de politiques efficaces. Voilà qui alimentera notre réflexion.
J’ai par ailleurs retenu des propos de M. Christian Saint-Étienne que ce n’est pas par des politiques sectorielles que nous parviendrons à résoudre ce qui est un problème de cohérence. Qu’il s’agisse de politique économique, éducative ou de recherche, l’État, en France, a un problème fondamental d’organisation. La démultiplication des administrations, des corps et des textes rend l’action illisible. En Europe comme en Chine ou en Inde, la production se fait dans des territoires qui doivent mutualiser leurs efforts. Or les relations des grands groupes avec leur banque ne sont pas les mêmes selon qu’ils ont affaire au Kreditbank de Bavière ou à BNP-Paribas en France : dans le premier cas ils ont un seul interlocuteur, dans l’autre des bureaux et des commissions multiples… Quand on est confronté à une crise systémique, il est essentiel de favoriser la production par une organisation optimale. C’est ce sur quoi nous devrons insister au terme de nos travaux, et il nous faudra faire des propositions en ce sens. Je regrette d’ailleurs que le référendum de 1969 ait eu une issue négative. Étant donné le potentiel de la France, la régionalisation proposée par le général de Gaulle, si elle avait été engagée alors, aurait probablement produit des effets considérables ; Adenauer, en régionalisant l’Allemagne après la guerre, lui a rendu le plus grand des services. Je souhaite connaître votre sentiment, messieurs, sur l’organisation des territoires, régions et métropoles.
M. Nicolas Forissier. J’ai été surpris d’entendre M. Christian Saint-Étienne évoquer ce qui serait le grand retard de la France en matière d’infrastructures. Pour avoir parcouru un certain nombre de pays, j’ai plutôt le sentiment que nous sommes très en avance, qu’il s’agisse de réseau routier, de production d’énergie, de transports ou d’équipements publics. Ces propos me paraissent relever de la tendance française à la « déclinologie ». L’un des principaux problèmes de la France en matière de compétitivité n’est-il pas purement intellectuel, culturel, voire émotif ? Quand tiendrons-nous un discours positif, mettant en avant nos atouts face à la mondialisation ?
Par ailleurs, je suis de ceux qui pensent que les banques, en France, ne font pas leur métier. De temps en temps, elles se font rappeler à l’ordre ; elles changent alors d’attitude pendant six mois, puis reprennent leurs mauvaises habitudes. Les PME sont, de ce fait, insuffisamment financées, et empêchées de grandir pour devenir les entreprises de taille intermédiaire que chacun appelle de ses vœux. Est-ce un problème typiquement français ? Peut-on imaginer le résoudre lors de l’examen du projet de texte sur la fiscalité du patrimoine ?
Enfin, la France dispose d’un réseau diplomatique parmi les plus étoffés, qui a beaucoup évolué ces dernières années, et de l’un des plus importants réseaux de soutien au commerce extérieur, Ubifrance, qui a été entièrement rénové. Mais, en dépit de tous nos efforts, notre commerce extérieur, nos parts de marché et le nombre de nos entreprises exportatrices sont en net recul. Comment l’expliquer ?
M. Christian Saint-Étienne. Monsieur Jean-Claude Sandrier, vous avez répondu à votre propre question sur ce qu’est la réussite allemande en reconnaissant la supériorité de l’Allemagne sur la France en matière de financement des PME, de recherche et développement, et de formation.
Il est vrai que l’on assiste à la montée de la précarité en Allemagne, pour les salariés des entreprises qui ne sont pas profitables, et que les Allemands commencent à s’en inquiéter. Mais la précarité augmente aussi en France où, contrairement à ce qui se passe en Allemagne, nous ne pouvons compter sur les résultats d’une économie de premier rang.
Je le répète, je suis absolument opposé à l’Union européenne telle qu’elle est, à savoir une Europe de la concurrence par les normes fiscales et sociales – je l’ai d’ailleurs écrit dans plusieurs rapports du Conseil d’analyse économique. Je déplore la confusion qui existe entre la concurrence sur les marchés, à laquelle je suis favorable, et la concurrence par les normes, contre laquelle je m’élève. Il n’existe pas de concurrence fiscale et sociale entre les cinquante États qui constituent les États-Unis d’Amérique : un seul système fiscal et social s’impose à tous, avec de légères variations. Aux États-Unis, l’impôt sur le revenu est fédéral, comme le sont le système de retraite par répartition, les infrastructures et la politique de recherche et développement. La concurrence n’affecte pas les normes mais uniquement les marchés de biens et services. Au sein de l’Union européenne, nous avons les deux !
Je considère que la concurrence par les normes à l’intérieur de la zone euro est de vingt à trente fois plus grave pour l’économie française que la concurrence des pays à bas salaires. Ainsi, un taux d’imposition sur les sociétés à 12,5 % représente une grave menace pour nous, et il m’est insupportable que l’Union européenne ait accepté de verser 85 milliards d’euros à l’Irlande sans obtenir qu’elle relève d’un iota ce taux d’imposition. Je rejette ce modèle européen mais, je le redis, les discours en faveur d’une Europe de la coopération demeureront incantatoires aussi longtemps que la France n’aura pas retrouvé sa crédibilité.
Vous considérez, monsieur le député, que 100 des 150 milliards d’euros de déficit public proviennent de « cadeaux fiscaux ». C’est qu’en France, on ne comprend pas à quoi sert l’impôt. Alors que l’impôt sert à financer la dépense publique justifiée, nous l’utilisons pour punir certaines catégories sociales ou pour changer la donne économique et sociale. Tous régimes et tous partis politiques confondus, l’impôt est considéré, en France, comme une arme politique. Il en résulte des taux d’imposition très élevés, si élevés que nous en avons restreint les bases et que ce que vous appelez des « cadeaux fiscaux » sont en réalité des baisses de taux destinées à nous permettre de rester compétitifs. Nous devons engager une grande réforme fiscale, élargir massivement les bases de l’impôt et en abaisser les taux pour financer la dépense publique de la façon la plus intelligente possible.
S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), je considère qu’il est justifié de taxer les ménages riches mais en faisant en sorte qu’ils restent sur notre territoire – c’est la meilleure manière de pouvoir les taxer… Le jour où, m’étant rendu à Genève et à Bruxelles pour y faire des conférences, je me suis aperçu que les Suisses et les Belges étaient horrifiés à l’idée que l’ISF pourrait être supprimé en France, j’ai compris que cet impôt bénéficiait plus à la Suisse et à la Belgique qu’à la France…
D’évidence, les versements de dividendes ont augmenté. Toutefois, des travaux sont en cours pour établir dans quelles proportions exactes, car les grands groupes français ont de très nombreuses filiales, et si toutes les écritures comptables correspondant aux transferts de profits au sein des holdings sont prises en compte par l’INSEE, elles ne se traduisent pas nécessairement par des versements effectifs de dividendes.
Le management français des entreprises du CAC 40 est excellent, mais il s’applique à des capitaux étrangers – des fonds de pension américains par exemple –, pour créer de l’activité hors de France ; quel intérêt y trouve notre pays ? D’autre part, exception faite des 300 grands groupes français dont les profits correspondent aux normes internationales, le taux de productivité des trois millions d’entreprises françaises est, selon Eurostat, inférieur d’un tiers à la rentabilité des PME allemandes, anglaises et américaines. Si les banques françaises ne prêtent pas aux PME françaises, c’est que celles-ci représentent un risque insupportable. Seul des partenariats public-privé, avec apports de fonds régionaux, permettrait de surmonter de tels risques.
J’en viens aux infrastructures. J’ai été amené à rédiger deux rapports à la demande du Président de la République. Le premier portait sur la façon de mettre les territoires au service de la croissance, le second traitait des investissements qu’il faudrait engager pour accélérer la croissance. Les conclusions en étaient que nous disposons en France de hauts fonctionnaires de grande qualité et que si nous définissons une stratégie politique puissante nous pourrions remettre ce pays d’aplomb.
Je ne suis donc pas « décliniste », mais j’observe que sur trois points de PIB destinés aux investissements publics, deux sont affectés à des investissements de confort – ceux qui vous font dire, lorsque vous traversez la France, monsieur Nicolas Forissier, que c’est un beau pays. Il ne reste donc qu’un point de PIB pour les infrastructures de compétitivité, et c’est pourquoi il n’existe plus de ligne de fret sur l’axe Le Havre-Paris-Marseille, qui est pourtant d’une importance stratégique majeure. Il est d’une urgence absolue de reconstruire mille kilomètres de lignes de fret – d’autant que cela correspond à notre souhait de privilégier la croissance durable. Mais le financement public relevant à présent pour l’essentiel des compétences locales, personne ne veut plus financer les infrastructures de transport.
C’est pourquoi je prône le retour à un « État stratège », capable de mobiliser les régions et les métropoles dans une stratégie de reconquête. Les chances de la France sont réelles, mais il faudra privilégier les investissements risqués plutôt que la rente et investir dans la production. Ces choix devront être faits rapidement.
M. Paul Giacobbi. J’aimerais que notre mission torde le cou à la légende tenace du taux de l’impôt sur les sociétés irlandais. Son taux nominal est certes de 12,5 %, mais ce n’est pas le taux effectif : le système fiscal irlandais ne prévoit ni amortissement dégressif, ni crédit d’impôt recherche, ni système de localisation des bénéfices et des déficits. De plus, la part des recettes de cet impôt dans le PIB de l’Irlande est largement supérieure à ce qu’elle est en France. La réalité, c’est que le fisc irlandais présente les choses de manière plus astucieuse que l’administration fiscale française, et qu’il est beaucoup plus souple dans sa pratique.
M. Michel Husson. On peut toujours engager une discussion d’ordre statistique sur le taux de versement des dividendes, mais les calculs se font en dividendes nets, par différence entre les dividendes versés et les dividendes reçus. Il est vrai qu’en Allemagne en particulier la proportion des dividendes dans la comptabilité nationale est extravagante et qu’il y a probablement un problème de mesure. On observe cependant que les entreprises ont très vite recommencé à distribuer des dividendes, avant même la reprise économique. Or, conserver le mode actuel de répartition des revenus, ce n’est pas privilégier la croissance et l’emploi européens. Aux États-Unis, la majeure partie des fruits de la croissance a été captée par une couche extrêmement réduite de la population. Nous n’en sommes pas là, mais nous suivons la même trajectoire. Si nous ne revoyons pas notre mode de répartition, nous aurons peu de marges de manœuvre sur la croissance et l’emploi et nous connaîtrons encore dix ans de chômage de masse parce que les entreprises continueront de distribuer des dividendes avant de lancer des activités moins rentables mais créatrices d’emploi.
En des temps colbertistes, la force industrielle de la France s’appuyait sur des grands groupes capables de réaliser les commandes publiques. Nous avons abandonné ce système en 1986, lorsque l’Acte unique a ouvert les marchés publics à la concurrence. Ensuite, après les avoir nationalisées, nous avons à nouveau privatisé quelques grandes entreprises. L’État s’est ainsi défait de tous les instruments qui lui permettraient de mener une politique industrielle. Au sein de l’Union européenne, le terme même de politique industrielle est considéré comme tabou et la direction générale de la concurrence de la Commission européenne s’est opposée à certaines restructurations. On manque donc de tout outil de politique industrielle, tant en France qu’en Europe.
Sachant que l’excédent commercial allemand se fait pour 83 % en Europe, le discours arrogant de l’Allemagne est absurde : elle ne peut reprocher à ses voisins d’avoir créé le déficit qui lui permet de réaliser cet excédent ! Ses gains de parts de marché ont pour contrepartie les politiques qu’elle juge déraisonnables ; c’est incohérent.
Si le taux de chômage n’a pas augmenté en Allemagne pendant la crise, c’est que les entreprises, sachant qu’elles auraient du mal à retrouver du personnel une fois l’économie rétablie, ont préféré garder leur effectif, au prix d’un compromis – le chômage partiel – qui coûte aux finances publiques. Je maintiens que la pression sur les salaires conduira à un recentrage des deux principaux exportateurs mondiaux, l’Allemagne et la Chine, sur la consommation intérieure ; les derniers discours des responsables du parti communiste chinois l’indiquent, et nous devons anticiper ce mouvement. C’est pourquoi il faut définir un autre projet européen.
Dans le Pacte de compétitivité, l’idée d’unifier les taux d’impôt sur les sociétés est mise en avant, la discussion portant sur le taux à retenir.
M. Paul Giacobbi. Il est bien plus important de définir une assiette qu’un taux !
M. Michel Husson. Certes. On peut aussi se demander pourquoi M. Sarkozy n’a pas proposé à Mme Angela Merkel que la taxe sur les transactions financières figure dans le Pacte de compétitivité alors qu’il en préconise l’instauration dans le cadre du Groupe des vingt (G20) et que le Parlement européen en a voté le principe.
Enfin, l’idée que des politiques pourraient permettre d’accroître le nombre des entreprises de taille intermédiaire me laisse sceptique. Et s’il est une thèse que je considère d’arrière-garde, c’est celle qui voudrait faire de l’allègement du coût du travail le levier principal de l’action. Parvenir à un budget européen suffisant pour permettre de mener à bien des projets communs ambitieux aurait un tout autre effet.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Si, dans un secteur donné, 25 % des PME se vendent à des grands groupes ou à des investisseurs étrangers, n’y a-t-il pas lieu de considérer l’ISF comme un obstacle au développement et à la transmission de ces entreprises familiales ?
M. Dominique Plihon. Plutôt que de mettre l’accent sur un obstacle en particulier, il serait sans doute préférable de dresser la liste de tous les facteurs qui font que les transmissions d’entreprise sont plus compliquée en France qu’ailleurs.
Je souhaite revenir un instant sur la question des territoires. Les régions sont bien sûr essentielles pour la production mais, pour certaines politiques ou pour certains secteurs d’activité, elles n’ont pas la dimension pertinente. Ainsi, le Pas-de-Calais peut mener une politique visant à l’équipement des ports, mais la politique des transports doit s’envisager des Pays-Bas aux pays riverains de la Méditerranée. De même, la construction d’autoroutes empruntées par de très nombreux transporteurs étrangers ne concerne pas que la France. Pour beaucoup de dépenses d’infrastructures et de modernisation, qui sont des facteurs de compétitivité, la dimension pertinente est la dimension européenne, qui permet la mutualisation des investissements.
Par ailleurs, si la concurrence est souhaitable pour les biens et les services, il faut aussi une coopération entre les États ; il est plus important de coopérer que de fonder une compétition sur des règles.
S’agissant des relations entre banques et entreprises, on sait que le succès économique, après-guerre, du Japon, de la Corée du Sud et de l’Allemagne, est dû pour beaucoup à des liens historiques très étroits entre les établissements financiers et l’appareil industriel. En France, la « banque-industrie » est beaucoup moins développée. Selon moi, cela ne s’explique ni par une bureaucratie excessive ni par le fait que les entreprises françaises sont moins rentables que les entreprises allemandes mais, plus sûrement, par un système bancaire beaucoup plus décentralisé en Allemagne, où les établissements financiers présentent par ailleurs une diversité de statuts juridiques qui s’est perdue en France.
Comme M. Michel Husson, je suis convaincu que l’Allemagne changera de voie car celle qu’elle suit actuellement la mène à l’impasse. Si l’Union européenne va vers une politique de rigueur, l’Allemagne, qui réalise les deux tiers de ses excédents commerciaux en Europe, verra ses marchés fondre comme neige au soleil et boira la tasse ! Elle n’a vraiment aucun intérêt à ce que les autres pays européens voient leur croissance ralentir, sauf à réaliser ses excédents avec les pays émergents – mais c’est qu’alors l’Europe n’aura plus de sens.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Votre présentation peut se défendre à condition que la France, prenant la mesure de ses problèmes de compétitivité et de déficit, fasse les justes choix politiques sans lesquels nous ne convaincrons personne.
M. Marc Laffineur, président. Messieurs, je vous remercie.
*
AUDITION DU 16 MARS 2011
Audition de M. Jean-Pierre Clamadieu, président-directeur général de Rhodia, de M. Patrick Pélata, directeur général délégué aux opérations de Renault, et de M. Jean-Cyril Spinetta, président du groupe Air France-KLM
M. le président Bernard Accoyer. Nous recevons aujourd’hui MM. Jean-Pierre Clamadieu, président-directeur général du groupe Rhodia, Patrick Pélata, directeur général délégué aux opérations de Renault, et Jean-Cyril Spinetta, président du conseil d’administration d’Air France-KLM.
En 2010, Rhodia a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros, grâce à quelque 14 000 collaborateurs établis dans vingt-cinq pays. Renault a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires de 38,9 milliards d’euros, est présent dans cent dix-huit pays et emploie plus de 120 000 salariés. Air France-KLM a réalisé, pour l’exercice 2009-2010, un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros et transporté 71 millions de passagers vers 244 destinations. Ce groupe compte plus de 104 000 salariés.
M. Jean-Pierre Clamadieu, président-directeur général de Rhodia. Rhodia est une entreprise de chimie, leader mondial sur plusieurs marchés. La France ne compte que pour 7 % dans son chiffre d’affaires, l’essentiel de celui-ci étant réalisé dans les pays dits émergents, à forte croissance, comme le Brésil, où nous sommes implantés depuis quatre-vingt-dix ans, et la Chine, où nous somme installés depuis trente ans. La France représente environ 30 % de notre production et 50 % de nos activités de recherche et développement.
La chimie demeure un secteur d’activité très capitalistique : les coûts des matières premières et de l’énergie représentent la moitié de notre chiffre d’affaires, contre 15 % seulement pour la main-d’œuvre. Notre approche est donc différente de celle d’un constructeur automobile ou d’une entreprise de services.
La localisation de nos activités se fonde d’abord sur la dynamique de nos marchés : nous cherchons à nous installer dans les zones de croissance de ceux-ci.
Les coûts d’accès aux matières premières et à l’énergie constituent aussi un facteur essentiel de localisation de nos activités. Ils diffèrent considérablement d’une région du monde à une autre. Par exemple, le coût d’accès au gaz – dont Rhodia est le premier consommateur industriel en France – est deux fois plus élevé en Europe qu’aux États-Unis. De même, pour accéder aux matières premières, notamment les terres rares, nous développons nos activités en Chine, qui en est l’un des principaux producteurs.
Enfin, le poids considérable de nos investissements industriels a pour conséquence une inertie très forte de nos implantations. Le coût de la construction d’une usine chimique s’établit à plusieurs centaines de millions, si ce n’est à des milliards d’euros. Un tel investissement est donc réalisé pour trente ou cinquante ans, voire un siècle, car il nous est difficile de délocaliser nos usines une fois construites. Pour cette raison – et nous en sommes très heureux – nous restons un producteur important sur le territoire français et donc un fort exportateur.
Rhodia conduit en France 50 % de ses activités de recherche et développement car l’environnement dans notre pays y est favorable. Nous avons, en effet, la chance de pouvoir nous appuyer sur les organismes de recherche universitaires et publics, avec lesquels nos relations sont étroites. Rhodia a ainsi monté quatre équipes mixtes, associant ses chercheurs et ceux du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur des thèmes de recherche définis en commun.
Le crédit d’impôt recherche, adopté lors de la présente législature, a rendu compétitif le coût d’un chercheur en France par rapport au reste du monde. Rhodia n’a donc plus aucune raison économique d’implanter des activités de recherche en Chine plutôt qu’en France. Les autres groupes industriels partagent cette analyse.
En revanche, si le coût du travail ne représente que 15 % du chiffre d’affaires du groupe, nous constatons qu’un opérateur industriel nous coûte 20 % plus cher en France qu’en Allemagne, du fait des charges patronales, sachant par ailleurs qu’il travaille pendant une durée inférieure de 7 % environ.
Un autre handicap de la France en matière de compétitivité réside dans la moindre flexibilité dans l’organisation du travail. Les nombreuses contraintes que nous impose le code du travail nous empêchent de nous organiser de manière optimale, ni même comme le souhaiteraient nos salariés.
Dans notre activité, le travail posté constitue la règle pour les opérateurs. Or, alors que, dans presque tous les pays du monde, nous collaborons avec des équipes travaillant douze heures par jour, en France nous n’avons pas le droit de leur imposer huit heures de travail par jour. Le plus grand nombre de nos salariés souhaiteraient pourtant travailler sur la base de créneaux horaires plus longs. Dans nos métiers, les opérateurs postés accomplissent pour la plupart des tâches de surveillance et d’intervention ponctuelle, qui seraient donc compatibles avec des durées de travail plus longues, en sachant que des postes de douze heures plutôt de huit permettent de limiter le nombre de jours de travail dans l’année. Seul le code du travail nous interdit d’établir une telle organisation, pourant souhaitée par nos partenaires sociaux et qui nous permettrait de simplifier notre organisation.
Chez Rhodia, un travailleur posté prend environ 180 postes dans l’année : en application du code du travail et des accords d’entreprise, il vient donc travailler huit heures d’affilée un jour sur deux. La mise en œuvre des trente-cinq heures n’a pas eu de conséquences sur cette durée, car le temps de travail des travailleurs postés de Rhodia était déjà inférieur à cette limite.
Quant au taux de recouvrement des travailleurs de jour, il est en France de 1,5 salarié pour un poste assuré à plein temps pour l’ensemble de l’année, contre 1,2 dans la plupart des autres pays où nous opérons.
En France, la flexibilité de moyen terme demeure également limitée. Procéder à des ajustements d’organisation pour faire face par exemple à une chute sérieuse de la demande, nous impose d’affronter des contraintes de mise en œuvre considérables.
Lors de la crise de 2009, Rhodia a fait le choix de faire porter la flexibilité sur les travailleurs intérimaires pour conserver le plus possible ses travailleurs permanents, former un opérateur à un poste dans une usine requérant de plusieurs mois à un an et demi, voire deux dans nos métiers. Pour supprimer quelques dizaines de postes, nous avons dû, afin de respecter le code du travail, élaborer un plan social. De ce fait, entre le début de la procédure et la première mise en œuvre pratique, onze mois se sont écoulés. Ce délai est sans commune mesure avec ceux que nous constatons dans n’importe lequel des pays où nous opérons. La multiplicité des instances représentatives du personnel – comités d’entreprise, délégués du personnel, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – au niveau des sites comme de la direction de l’entreprise complexifie les procédures. Et, au bout du compte, chacun « joue la montre », dans un contexte où la sécurité juridique de l’entreprise reste fragile, car un juge pourra, à un moment donné, donner un coup d’arrêt, entraînant un retard supplémentaire, à un processus au motif que telle ou telle procédure de consultation ou d’information n’aura pas été conduite dans les règles.
Au contraire, dans certains pays comme l’Allemagne, il est possible en quelques mois de négocier un accord, même s’il peut se révéler coûteux, et de le mettre ensuite rapidement en œuvre entre partenaires de bonne foi.
Tout ce qui nous permettrait en France de réagir plus vite face aux variations d’activité nous paraîtrait aller dans le sens d’une meilleure compétitivité de nos entreprises.
M. Patrick Pélata, directeur général délégué aux opérations de Renault. Nous nous réjouissons que la représentation nationale s’empare du thème de la compétitivité de l’industrie française, cruciale pour notre pays.
Les capitalisations boursières, traduisant en théorie l’espoir des profits futurs d’une entreprise et donc la confiance en sa croissance et sa santé financière, appellent à la modestie sur la force de Renault et de PSA Peugeot-Citroën dans la compétition mondiale.
Dans le secteur de l’automobile, au 15 mars 2011 – date peu favorable –, la capitalisation boursière de Toyota est d’un peu moins de 100 milliards d’euros, celles de Volkswagen, Daimler et Honda d’un peu moins de 50 milliards d’euros. Avec 11 milliards d’euros, Renault arrive en douzième position après Nissan, Hyundai et le premier chinois – près de 20 milliards d’euros –, suivi de Tata et de Dong Feng, à plus de 10 milliards d’euros, puis de Porsche, Suzuki, Fiat et BYD, un tout jeune constructeur chinois de voitures électriques, aux environs de 8 milliards d’euros. PSA Peugeot-Citroën occupe la dix-neuvième place du classement avec 6 à 7 milliards d’euros, dans une liste qui comprend encore trois constructeurs chinois dans les vingt-cinq premiers constructeurs mondiaux.
Si, en France, les deux constructeurs nationaux, et notamment Renault, sont considérés comme des entreprises très fortes, leur capitalisation montre qu’ils ne sont pas parmi les plus puissants au niveau mondial.
Grâce à son alliance avec Nissan, et un accord stratégique essentiel avec Daimler, Renault dispose cependant d’autres atouts. Ainsi, le budget de recherche et développement cumulé de Renault, Nissan et Daimler est le plus fort de l’industrie automobile, et supérieur même à celui de General Electric, probablement pourtant l’un des plus considérables de l’industrie mondiale. On voit quel potentiel ouvre une répartition intelligente du travail entre les trois entreprises.
En effet, comme l’a dit M. Jean-Pierre Clamadieu, le premier élément pour rendre une entreprise industrielle compétitive, c’est la recherche et le développement. Si, alors que la France représente pour Renault 25 % de son chiffre d’affaires, nous n’y fabriquons que 21 % ou 22 % de nos voitures en volume, cette production française représente 50 % environ de la valeur de notre production : autrement dit, nous fabriquons en France nos voitures à plus forte valeur ajoutée. C’est là le résultat d’une stratégie : eu égard à leur poids sur la profitabilité et à leur coût élevé, les coûts salariaux, charges comprises, nous poussent à produire en France les produits à plus forte valeur ajoutée.
L’institution du crédit d’impôt recherche a renforcé notre compétitivité. À l’année, nos ingénieurs français nous coûtent en moyenne 79 000 euros chacun. Grâce au crédit d’impôt recherche, ce coût est réduit à 68 000 euros. Celui de nos ingénieurs coréens ou brésiliens est de 38 000 euros ; en Inde, il est de 27 000 euros ; en Roumanie, il est de 21 000 euros. C’est dire l’intérêt de ce dernier pays, membre de l’Union européenne, pour Renault.
Nous avons également signé avec le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) un accord concernant la recherche sur les batteries de nouvelle génération. Nous y consacrons 20 millions d’euros par an. Nous n’avons conclu aucun partenariat équivalent ni en Corée, ni au Japon.
Enfin, la France est en pointe s’agissant du véhicule électrique. D’ailleurs, il y a un an, une mission japonaise est venue examiner son développement.
En matière d’émissions de CO2 dans l’automobile, l’Europe et, au sein de celle-ci, la France, sont en avance sur le reste du monde. Les véhicules vendus en France émettent en moyenne moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre ; en Europe, le chiffre est supérieur à 145 grammes et il est aux États-Unis de 195 grammes. Autrement dit – propos rare de la part d’un industriel –, la force de la taxation « verte », traduisant l’exigence européenne en matière d’émission de CO2 constitue un avantage compétitif. Les constructeurs européens, et en particulier les constructeurs français, du fait de dispositifs comme le bonus-malus environnemental, sont toujours bien placés en matière de techniques de réduction des émissions de CO2.
Le regroupement, à l’initiative de l’État, d’une commande de 100 000 véhicules électriques par les grands groupes, publics et privés, notamment La Poste, est un outil de politique industrielle conciliant fonctionnement du marché et, pour les constructeurs, accès plus rapide à la grande série.
Le principal point faible de l’industrie française demeure cependant le poids des charges sociales, parmi les plus élevées du monde.
Pour y faire face, Renault a décidé de localiser en France ses activités de recherche et développement, 82 % de la valeur de celles-ci y étant produite, ainsi que la production des voitures dont la valeur ajoutée est la plus forte et des voitures qui font l’objet de nouveaux développements : les véhicules électriques, utilitaires, et de haut et de milieu de gamme de Renault sont pour l’essentiel fabriqués en France, pour 50 % de la valeur ajoutée, à comparer avec 25 % du chiffre d’affaires et 21 % du volume produit. Dans cette répartition réside notre stratégie.
Nous avons aussi entrepris d’attirer en France des productions à forte valeur ajoutée pour Daimler et Nissan. Ainsi, les moteurs diesel des Nissan Infiniti vendues en Europe proviennent de l’usine de Cléon en Normandie et ont été développés en région parisienne par les ingénieurs de Renault.
L’accord de coopération stratégique entre Renault et Daimler a comme objectif essentiel de répondre à la menace stratégique considérable représentée par Volkswagen. La production de ce constructeur, cinq à six fois supérieure, lui permet des économies d’échelle très importantes. De plus, son budget de recherche et développement a dépassé largement celui de Daimler, qui a pourtant construit la réputation de sa marque, Mercedes, sur l’avance technologique. Ne pouvant plus suivre, Daimler doit partager ses progrès avec Renault et Nissan, cette démarche conduisant à rapatrier en France un travail de recherche et développement qui s’avère très compétitif avec celui de nos alliés Allemands.
L’adaptation de nos capacités de production en France pour que le taux d’engagement des usines soit désormais au moins de 80 % à 90 % par équipes de deux fois huit devrait être achevée en 2012, et au plus tard en 2013.
Les charges sociales restent le point faible de la compétitivité en France : avec 30 usines environ dans le monde, Renault se trouve bien placé pour en effectuer une comparaison. Les coûts complets, payés dans les usines de Renault à l’heure de travail ouvrier, sont de 28 euros de l’heure en France, de 20 en Espagne, de 10 en Slovénie, de 5 en Roumanie, de 6 en Turquie, de 4 au Maroc, de 16 en Corée du Sud, de 8 au Brésil, et entre 1 et 2 en Inde, dans le sud de laquelle nous détenons une usine commune avec Nissan. Nous n’avons en revanche pas d’usine en Allemagne. Aux États-Unis, où Nissan possède des usines, la comparaison, un peu plus complexe, est défavorable à l’Europe, bien que les produits européens n’y soient pas en compétition avec ceux des États-Unis.
Un document dressant une comparaison entre la France et les États-Unis, établi en coopération avec PSA Peugeot Citroën – ce qui explique les écarts de périmètre avec les autres chiffres de Renault – montre aussi, à partir de données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de l’institut COE-Rexecode, que le poids des charges sociales dans le salaire brut au sein des secteurs exposés – industrie chimique, métallurgie, mécanique, électricité, électronique et automobile – varie en France entre 35 % et 43 % alors que, dans les secteurs abrités – construction, commerce, hôtellerie et restauration -, les taux sont compris entre 22 % et 28 %. Les taux élevés constatés dans les secteurs exposés fonctionnent comme des taux de douane dissimulés, puisque les voitures importées ne les subissent pas, au contraire des véhicules produits en France, qu’ils soient commercialisés en France ou à l’étranger.
Lors des états généraux de l’automobile lancés début 2009 par M. Luc Chatel, alors secrétaire d’État chargé de l’industrie, nous avions établi que l’écart de coût entre un véhicule produit en France et un autre entièrement conçu et produit en Europe de l’Est était de 1 400 euros, dont 1 000 dus aux charges sociales et 400 aux salaires réels. Or, si nous savons compenser ces 400 euros par la logistique, nous ne savons pas comment compenser les 1 000 autres.
Cette situation entraîne des difficultés considérables. Renault vend une Clio moins de 10 000 euros à son réseau. Or, 1 000 euros, c’est 10 % de cette valeur. La marge opérationnelle dans l’industrie automobile étant au mieux de 4 % à 5 %, l’écart représenté par le surcoût de 1 000 euros est celui entre un bénéfice confortable et un déficit dangereux.
Cela étant, une voiture Renault vendue en Europe de l’Est demeure moins chère fabriquée en Roumanie qu’en Inde ou en Chine. La situation face à la Chine n’est donc pas défavorable pour une Europe qui saurait bien gérer ses flux, et qui, comme le Japon le fait avec l’Asie, répartirait ses productions à faible valeur ajoutée dans les espaces où la main-d’œuvre n’est pas chère et concentrerait celles réclamant des qualifications plus fortes dans les espaces où les salaires sont plus élevés.
Enfin, les difficultés que nous rencontrons en matière de flexibilité du travail ne concernent pas le travail ouvrier, notre production en Europe de l’Ouest ne subissant pas de très forte tension, mais l’ingénierie. Le technocentre représente un actif de 1,6 milliard d’euros et 14 000 personnes y sont employées, ce chiffre continuant de s’accroître. Le droit du travail français nous impose des contraintes considérables, alors que la gestion de l’activité courante n’est pas facile. Nous réussissons, avec difficulté, à maintenir un temps d’ouverture de 14 heures par jour cinq jours par semaine, pour un temps d’engagement qui n’est que de 50 %. Au contraire, l’ingénierie de Nissan, comparable en effectifs et en taille à celle de Renault, peut travailler sans difficulté, en cas de besoin, 24 heures sur 24. Le résultat sur l’engagement des actifs n’est évidemment pas le même, non plus que les délais de développement.
M. Jean-Cyril Spinetta, président du groupe Air France-KLM. Les rapports récents de la Cour des comptes, de l’institut COE-Rexecode et du ministère de l’industrie convergent tous : depuis une dizaine d’années, l’économie française a reculé au regard de l’ensemble des indicateurs de compétitivité.
Même si le débat en France a tendance à se concentrer sur la parité monétaire, on voit bien qu’à l’intérieur de la zone euro, l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas ou encore la Suède tirent remarquablement leur épingle du jeu au regard d’un pays comme la France. En 1999, la part des exportations de la France représentait 16,3 % des exportations des seize pays de la zone euro et celle des Pays-Bas 10,9 % ; en 2010, la France était à 13,1 % et les Pays-Bas à 12,4 %.
Les économies européennes, notamment celle de la France, ont pour principale difficulté l’adaptation à la mondialisation. Aborder celle-ci à travers les entreprises et les politiques publiques suppose de distinguer métiers régionaux et mondiaux. Cette grille de lecture est appliquée de façon systématique dans la stratégie du groupe Saint-Gobain, dont je suis administrateur.
Beaucoup de métiers industriels – la production de ciment, de verre ou de plâtre – sont des métiers régionaux. Une entreprise française qui veut vendre du ciment en Chine doit l’y fabriquer et, de même, une entreprise chinoise ne peut vendre du ciment en France qu’en l’y fabriquant, car les coûts de transport, en particulier, imposent ce modèle.
La logique des métiers mondiaux est exactement inverse : dans ces métiers, pour des raisons de coûts relatifs de transport ou de valeur des produits fabriqués, il est possible de fabriquer ailleurs que dans les pays de vente.
Cette distinction, pourtant appliquée par les groupes industriels, n’est pas assez prise en compte. Parmi les métiers régionaux, on ne compte que quelques métiers industriels, comme ceux qu’exerce Air Liquide, la plupart, comme l’hôtellerie et la restauration ou les soins à la personne, étant des métiers de services. Ces métiers régionaux ne sont pas soumis à des impératifs de compétitivité mondiale. Pour chaque mesure prise, le chef d’entreprise ou le décideur public doit se demander si celle-ci constitue bien une réponse adaptée aux problèmes de compétitivité existants, et si elle vise bien des métiers mondiaux et non pas seulement principalement des métiers régionaux.
Les mesures d’exonération de cotisations sociales sur les bas salaires constituent un exemple significatif. Elles ont été prises par trois gouvernements successifs, en 1995, 2000 et 2003, avec beaucoup de constance ; il est pour autant facile de remarquer que leur limitation aux rémunérations inférieures ou égales à 1,6 SMIC fait qu’elles profitent essentiellement, de fait, aux métiers régionaux.
La Cour des comptes a réalisé en 2008 un rapport sur les exonérations de charges sociales en faveur des métiers les moins qualifiés. Le taux apparent d’exonération, c’est-à-dire le montant des exonérations rapporté à la masse salariale, était de 2 % dans le secteur de l’automobile, de 2,8 % dans celui des équipements électriques, électroniques et informatiques, qui sont des métiers mondiaux, et de 9,8 % dans le secteur de la construction, de 7,8 % dans le commerce, de 13,6 % dans celui des cafés et hôtels-restaurants, tous des métiers régionaux.
Il me semble donc que cette distinction entre métiers mondiaux et régionaux devrait être toujours prise en considération, si l’on parle de compétitivité, d’autant qu’il est facile de savoir si une mesure s’appliquera à un métier mondial ou régional. Or, les efforts me semblent devoir être concentrés plutôt sur les métiers mondiaux que sur les métiers régionaux.
Le transport aérien est un métier de services mondial : il n’existe presque pas d’exemple où, pour aller d’un point à un autre du globe, le client n’ait pas le choix entre plusieurs offres de transport – au moins deux –, une compagnie française et une autre du pays desservi. Ce métier présente aussi la caractéristique d’être à très forte intensité capitalistique. Eu égard notamment au coût des avions, pour y rester, il faut pouvoir dégager, au profit de l’investissement, de 10 % à 15 % du chiffre d’affaires chaque année. Ce métier est également très intense en termes de coût de personnel : en Europe, par exemple, celui-ci représente entre 25 % et 30 % des coûts totaux des compagnies.
Le transport aérien avait, de plus, été soumis dans les années 1945 et 1946, à une régulation très spécifique de la part des Américains. Ces derniers ont créé des règles imposant, pour les échanges entre deux pays, des systèmes de droits de trafic, négociés non pas entre compagnies aériennes mais entre États, qui les octroient ensuite aux compagnies relevant de leur nationalité.
Le bilatéralisme, lié au principe de réciprocité qui présidait à ces échanges, protégeait très efficacement les compagnies nationales. Il a volé une première fois en éclats en 1993, lorsqu’un marché intra-européen absolument libre a permis la création des compagnies low cost en Europe. Il vit aujourd’hui ses dernières années. Notre métier sera bientôt régi par les règles habituelles des métiers de services : libertés d’établissement et d’accès au marché sans contraintes spécifiques.
Les compagnies aériennes européennes sont aujourd’hui les premières dans le monde par leurs chiffres d’affaires, leurs résultats sur les dix dernières années et leurs capacités à investir pour l’avenir. Cette position privilégiée s’explique par deux avantages qui vont malheureusement progressivement s’estomper.
Il s’agit, d’une part, d’une rente historique : créées dans les pays les plus développés, les compagnies aériennes européennes ont ouvert les liaisons. Ainsi, entre le Brésil et l’Europe, celles-ci assurent 80 % des liaisons contre 20 % seulement pour les brésiliennes. Mais les pays émergents souhaiteront évidemment assurer à leurs compagnies aériennes la moitié du trafic entre eux-mêmes et l’Europe.
Les compagnies européennes bénéficient, d’autre part, d’une rente de réputation en matière de service et de sécurité. Cette rente est elle aussi en train de disparaître.
Par ailleurs, notre métier n’est pas marqué par des innovations particulières : la seule compétitivité entre les compagnies réside donc dans les prix. Comment les compagnies aériennes européennes peuvent-elles rester les premiers opérateurs mondiaux, avec certes une performance économique acceptable, mais des prix supérieurs ? C’est que, profitant de leurs effets de taille, elles ont été les premières à créer des plateformes de correspondance, la productivité de ces instruments leur ayant permis de compenser un temps leurs déficits structurels liés à la part des salaires dans les coûts d’exploitation. Or, les autres pays atteindront certainement rapidement les mêmes niveaux d’organisation.
Les coûts de personnel, notamment en termes de charges sociales, constituent un handicap considérable en France. Pour un salaire brut de 100, Air France paie ses salariés, charges sociales comprises, 146 en France, mais 119 aux Pays-Bas, 129 en Allemagne, 125 au Royaume-Uni, 121 en Irlande, 129 en Italie et 124 en Espagne. Comparés à ceux versés par Lufthansa ou KLM, les salaires bruts eux-mêmes versés par Air France sont un peu inférieurs pour les pilotes, plus faibles pour le personnel au sol et en revanche supérieurs, hors charges sociales, pour les personnels navigants commerciaux. Alors que les salaires convergent globalement, les charges sociales et autres taxes propres à la France, telles que la taxe professionnelle, la taxe d’apprentissage ou celle sur les salaires, altèrent notre compétitivité au regard des autres pays d’Europe.
M. le président Bernard Accoyer. Pourriez-vous détailler le poids de ces charges annexes ?
M. Jean-Cyril Spinetta. Grâce à la fusion entre Air France et KLM, nous pouvons établir une comparaison très précise. Si Air France était installée à Amsterdam, et régie par le droit néerlandais, sa masse salariale serait, pour les mêmes salaires que ceux qui sont aujourd’hui versés en France, inférieure de 700 millions d’euros. La taxe professionnelle, la taxe d’apprentissage ou celle sur les salaires représentent 130 millions d’euros de plus. Autrement dit, l’écart de coûts salariaux entre une société Air France immatriculée à Paris et une société Air France immatriculée aux Pays-bas est de 800 millions d’euros.
Il nous est aussi parfois reproché de ne pas avoir suffisamment réagi face au développement des compagnies low cost. Nous avons cependant créé, il y a cinq ou six ans, la compagnie Transavia. Néanmoins, celle-ci reste de 5 % à 7 % plus chère qu’Easyjet.
La concurrence avec les compagnies des pays du Golfe ne concerne pas seulement Air France, mais aussi l’ensemble de l’industrie du transport aérien. Dans ce secteur, trois grands opérateurs distants de quelques centaines de kilomètres, Emirates, à Dubaï, Etihad à Abou Dabi et Qatar Airways au Qatar ont des ambitions mondiales et, dans quelques années, mettront en ligne deux fois plus d’avions que Lufthansa, British Airways, Air France et KLM réunies. Cela est d’autant plus préoccupant que ces compagnies ne se soucient absolument pas d’être rentables et qu’aucun métier ne peut résister à ce genre de défi. Il est d’ailleurs fallacieux de faire valoir l’intérêt qu’elles représentent pour l’industrie européenne grâce aux commandes d’avions qu’elles passent : les voyageurs qu’elles transportent, si elles n’existaient pas, utiliseraient aussi bien d’autres compagnies et les commandes seraient exactement les mêmes. Leur donner un droit de trafic parce qu’elles achètent des avions n’a donc aucun sens – les flux de trafics mondiaux en attestent – et l’effet positif sur les fabricants est nul, la demande s’étant simplement déplacée des compagnies habituelles vers leurs concurrentes.
Permettez-moi maintenant de formuler quelques propositions.
Les charges sociales représentent des sommes d’autant plus considérables que notre situation budgétaire est extrêmement contrainte. Alors que les exonérations sont plafonnées en fonction des salaires, à effort budgétaire constant, ne serait-il pas économiquement plus efficace d’uniformiser une baisse des cotisations patronales sur la famille ou la maladie, peu importe, laquelle s’appliquerait à l’ensemble des entreprises ? Dans le secteur de l’automobile, les exonérations de charges sociales passeraient ainsi de 2 % à 4 % et, pour Air France, le gain serait de 4 % par rapport au système actuellement en vigueur. De surcroît, la création d’une « TVA sociale » visant à financer, au-delà de ces quatre points, une partie de la protection sociale qui l’est actuellement par les cotisations patronales et salariales me semble souhaitable, même si j’en mesure les contraintes et la nécessaire progressivité afin de ne pas déstabiliser l’économie.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Vous avez formulé essentiellement deux propositions, en l’occurrence sur les charges sociales et la flexibilité. Or, comme dit le Premier ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker : « Ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais. Dites-moi comment le faire ! »
Nous savons que 5,4 points de cotisations familiales ne devraient plus être financés par les entreprises, mais fiscalisés. Alors que l’impôt sur le revenu rapporte dans notre pays 2,5 points de moins que dans la majorité des autres pays européens, considérez-vous que les entreprises aient un rôle pédagogique à jouer afin de faire accepter le transfert de ces 5,4 points sur ce dernier, en y associant la réduction des niches fiscales et en poursuivant les allégements de charges sur les bas salaires qui, il est vrai, profitent essentiellement aux services ? Un tel dispositif me semblerait préférable à l’instauration d’une TVA sociale, compte tenu de l’attachement des salariés à leur pouvoir d’achat.
Par ailleurs, la création du dispositif de rupture conventionnelle des contrats à durée indéterminée a-t-elle eu des effets positifs ? Nous savons, en effet, que la multiplication des instances représentatives et la complexité de la procédure sont patentes, de même que l’insécurité juridique. D’après vous, monsieur Jean-Pierre Clamadieu, comment peut-on améliorer la négociation salariale et mettre en place des contre-pouvoirs simplifiés et juridiquement sécurisants ?
Enfin, que représente la baisse de la taxe professionnelle dans votre chiffre d’affaires et comment réagissez-vous aux propos récents d’un membre du Gouvernement sur la nécessité d’augmenter les salaires ?
M. Jean-Pierre Clamadieu. Pour Rhodia, la réforme de la taxe professionnelle aurait dû être une bénédiction. Or, compte tenu du plafonnement, le prélèvement est passé de 3,5 % à 3 % de la valeur ajoutée. Cela représente 4 millions d’économies par an – c’est bien, certes, mais ce n’est pas révolutionnaire. J’ajoute que le déplafonnement de la contribution au service public de l’électricité et le projet visant à faire payer une fraction des quotas de CO2 – ce dernier semblant toutefois contraire au droit européen – engloutiraient environ la moitié des économies réalisées grâce à la réforme de la taxe professionnelle. Pour une entreprise qui investit considérablement et qui consomme beaucoup d’énergie, la direction suivie par les pouvoirs publics n’est guère claire.
Nous bénéficions en outre d’un dialogue social de bonne qualité. Un accord concernant une hausse des salaires de 3 % a ainsi été signé cette année avec l’ensemble des partenaires sociaux, y compris la Confédération générale du travail (CGT), en raison de la bonne santé de notre entreprise, laquelle semble d’ailleurs perdurer en 2011.
S’agissant, en revanche, de la flexibilité, nous souhaiterions qu’il soit mis fin au millefeuille social nous obligeant, pour de simples évolutions dont l’impact est très modeste, à passer devant de multiples instances et à respecter des procédures extrêmement complexes. Si les comités d’entreprise ont toujours recouru aux expertises, c’est maintenant aussi le cas des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, sur les mêmes questions, font appel à leurs propres experts. Bref, l’ingénierie est complexe et sa rationalisation serait bienvenue. Ainsi, au premier trimestre, 30 % de notre activité avait disparu : il a fallu onze mois pour que les plans d’ajustements structurels soient mis en place, alors qu’ils l’ont été en deux ou trois mois dans la plupart des autres pays du monde. La simplification de ce millefeuille constitue une telle priorité que j’avancerai que nous serions sans doute prêts à promouvoir des mesures d’accompagnement plus généreuses en échange d’une sécurité juridique et d’une rapidité d’action plus soutenue.
Autre exemple : en 2009, nous avons souhaité maintenir notre force de frappe pour préparer le redémarrage de l’activité après la crise. Dans la région lyonnaise, nous avions deux usines, l’une à Collonges, l’autre à Saint-Fons. Vous n’imaginez pas les difficultés que nous avons rencontrées pour affecter les salariés de celle dont la sous-activité était très forte à celle dont le niveau d’activité, au contraire, était tel que nous y employions un grand nombre d’intérimaires. La complicité était objective entre, d’une part, ceux qui étaient habitués à travailler avec leurs intérimaires et qui n’avaient pas très envie de les voir partir – nous avions fixé comme règle du jeu la préservation d’un emploi permanent – et ceux qui, d’autre part, considéraient que la sous-activité n’était pas si désagréable, dès lors que l’entreprise avait pris quelques engagements sur la façon dont elle serait traitée.
Même si l’année 2009 a, certes, été celle d’une crise majeure, nous devons faire face à des évolutions permanentes. La situation que connaît le Japon, par exemple, aura inévitablement un impact : dans certains secteurs, nous serons obligés de produire plus pour pallier des défaillances et, dans d’autres, de produire moins parce que nos clients auront d’autres priorités. La France, plus que d’autres pays, éprouve des difficultés à s’adapter.
M. Patrick Pélata. Il est en effet indispensable d’améliorer nos procédures de concertation, surtout lorsqu’on les compare avec celles qui sont en vigueur en Allemagne – nous le constatons avec Daimler –, au Japon ou en Corée. Outre que les discussions sont, chez nos voisins, beaucoup plus fréquentes, la rapidité d’action – y compris s’agissant de la transformation de la structure des salaires en fonction des qualifications – y est autrement plus grande.
Par ailleurs, le flux de voitures fabriquées et vendues en France n’étant pas considérable en raison de l’actuelle division internationale du travail, les véhicules seront systématiquement en concurrence avec ceux qui sont produits à l’étranger, y compris par un même groupe. La taxe sur la valeur ajoutée s’appliquant aux voitures importées, nous ne pourrons qu’être favorables à ce double effet et, donc, à son augmentation dès lors que les charges sociales diminueront.
M. le président Bernard Accoyer. Vous êtes donc favorable au transfert d’une partie du financement de la protection sociale sur la consommation.
M. Patrick Pélata. En effet, et ce alors même que l’impact sera réel sur le marché, comme nous avons pu le vérifier lorsque l’Allemagne, en 2008, a augmenté sa taxe sur la valeur ajoutée de deux points. Les différentes estimations montrent, toutefois, qu’il ne s’agit que d’un passage difficile n’excédant pas un an avant que des conséquences positives sur l’emploi ne se fassent ressentir. Pour un véhicule vendu 14 000 euros, on observe un écart de 10 %, soit 1 400 euros, entre une voiture conçue et produite en Europe de l’Est et la même conçue et produite en France, dont 400 euros de différence de salaires, 250 euros de taxe professionnelle – que le Gouvernement français a donc diminuée – et 750 euros d’écart de charges sociales. Sur les 250 euros précités, nous en avons gagné 60 ou 70 : si ce n’est pas négligeable, ce n’est pas à la hauteur du problème.
Par ailleurs, nous souhaiterions contribuer à l’amélioration du moral des ménages et de la productivité en augmentant les salaires, mais les situations ne sont pas toutes identiques. En particulier, il n’est pas possible de gagner de la productivité sur le travail ouvrier quand ce dernier coûte 6 euros horaire en Turquie, 10 euros en Slovénie et 28 en France. En revanche, si une baisse significative des charges sociales peut entraîner une petite redistribution sur le salaire direct, des hausses de salaires de personnels qui sont peu nombreux et dont la qualification est peu répandue à l’étranger sont d’ores et déjà programmées. Nous sommes d’ailleurs favorables à la mise en place d’un tel cercle vertueux permettant d’accroître la productivité en la partageant, même si cette dernière, dans un monde où les marchés étaient fermés, était absolue et qu’elle est désormais relative. Ainsi, aujourd’hui, pour les « cols bleus » travaillant dans l’industrie automobile, elle est à peu près identique partout alors que les écarts de salaires sont très importants.
M. Jean-Cyril Spinetta. La prise de conscience des salariés, au moins dans les grands groupes, est acquise : on ne peut financer les politiques nationales de protection sociale sur les charges sociales acquittées par les entreprises. À Air France, j’ai d’ailleurs eu l’occasion d’exposer les difficultés que nous rencontrions au sein de l’espace européen. En outre, un problème de fonctionnement peut surgir entre cette compagnie et KLM, la performance de la seconde étant meilleure que celle de la première alors que c’est celle-là qui a absorbé celle-ci. Les Néerlandais finiront par refuser de suppléer les défaillances françaises.
Nous souffrons également de la multiplicité des instances de procédure, l’intervention du juge, plus que les textes, contribuant souvent à compliquer davantage les situations. Parmi les grandes réformes récemment réalisées figure celle de la représentativité syndicale, dont les effets – je songe à l’amélioration du dialogue social à travers l’émergence de grandes organisations syndicales, condition d’une meilleure maîtrise des procédures – se feront ressentir progressivement. Si la négociation sociale se déroule dans de bonnes conditions, nous parvenons à respecter des délais convenables pour résoudre les problèmes mais, si les syndicats décident d’utiliser toutes leurs armes, ils peuvent le faire avec une maestria consommée. La situation est aujourd’hui en train de changer, comme nous l’avons constaté à Air France lors des élections qui se sont déroulées la semaine dernière, et qui ont acté les parts d’influence de certains syndicats, la représentation étant désormais de plus en plus circonscrite par de grandes organisations, avec une amélioration sensible du dialogue social à la clé.
La qualité de la concertation, aux Pays-Bas, est quant à elle assez comparable à celle de l’Allemagne. Les comités d’entreprise y disposent d’un véritable droit de veto – lequel paraît inimaginable chez nous –, le Work Council leur permettant, par exemple, d’empêcher une fusion d’entreprises, le juge devant alors déterminer si ce refus est légitime ou non. Cela n’est possible que parce que les syndicats jouent parfaitement le jeu en termes de maintien du secret des informations qui leur sont communiquées longtemps à l’avance, que leur nombre favorise un dialogue de qualité et, enfin, que l’examen des stratégies et des enjeux est commun.
En ce qui concerne la baisse de la taxe professionnelle, que nous avons grandement appréciée, celle-ci a profité à Air France à hauteur d’un peu plus de 30 millions.
S’agissant de l’augmentation des salaires, je ferai une réponse de Normand : tout dépendra de ce qui se passera en Allemagne. J’ai participé récemment à un échange sous l’égide de la Fondation Friedrich-Ebert avec les syndicats allemands DGB et VerDi, dont il ressortait que ce pays semble sorti d’une phase de « désinflation compétitive », soit d’une politique de rigueur assez prononcée en matière salariale. Qu’il s’agisse d’accords d’entreprises ou de branche, la situation évolue assez rapidement. Si l’Allemagne devait s’en tenir aux politiques de rigueur menées ces dix dernières années, les salaires ne pourraient pas augmenter dans notre pays mais, si ce pays relâche effectivement la pression, nous disposerions de quelques marges d’ajustement.
M. Jérôme Cahuzac, corapporteur. Si Air France, monsieur Jean-Cyril Spinetta, s’acquitte de la taxe sur les salaires, j’ignorais qu’à l’instar des banques, des hôpitaux et des sociétés d’assurance, elle fut donc dispensée de taxe sur la valeur ajoutée. La suppression de la première, compensée par l’application de la seconde sur les consommateurs de vos services – laquelle serait assez sensiblement augmentée puisque la suppression des charges de cotisations familiales représenterait 40 milliards, soit une augmentation de 5 points de taxe sur la valeur ajoutée qui, de 19,6 % passerait à près de 25 % – serait-elle neutre en termes de compétitivité pour Air France ?
En outre, si j’ai pris note de l’effet bénéfique de la suppression de la taxe professionnelle pour Air France, celui-ci reste ténu compte tenu de votre chiffre d’affaires. En matière de charges sociales, le transfert d’une assiette d’investissement vers, notamment, une assiette sur les salaires a-t-il alourdi vos coûts, et donc entravé votre compétitivité, puisque la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises inclut les salaires, et donc l’emploi ?
J’ai également pris note des coûts comparés par rapport à la Roumanie et au Maghreb. Un récent rapport de la Cour des comptes a toutefois montré qu’en matière de coûts salariaux, la situation est quasiment identique avec l’Allemagne, dès lors que l’on réintègre dans le périmètre de comptage les dépenses liées aux conventions sociales – obligatoire en France, facultatif en Allemagne – qui sont d’ailleurs importantes dans ce dernier pays compte tenu de la qualité de son dialogue social, comme vous l’avez vous-même souligné. Des mesures correctrices de périmètres permettraient-elles d’obtenir des chiffres moins préoccupants, notamment par rapport aux Pays-Bas ?
Enfin, selon M. Jean-Pierre Clamadieu, les entreprises doivent s’efforcer de garder leur personnel en période de crise afin de disposer des compétences nécessaires au moment de la reprise. C’est ce qu’a fait l’Allemagne avec le « travail réduit » dont 260 000 salariés ont bénéficié pour un coût social d’environ 6 milliards, tandis qu’en France le dispositif équivalent n’a concerné qu’un peu moins de 20 000 salariés pour un coût de 600 millions, alors que nous avons consacré un peu plus de 4 milliards à la défiscalisation et à la désocialisation des heures supplémentaires. Cette dernière mesure a-t-elle été d’un grand secours lorsqu’il s’est agi de traverser la crise ? Est-elle, selon vous, prioritaire en cas de reprise ?
M. le président Bernard Accoyer. Lorsque vous évoquez la baisse de la taxe professionnelle, y incluez-vous la taxation substitutive – contribution foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – que les élus ont instaurée afin de maintenir les recettes des collectivités locales ?
M. Patrick Pélata. En effet.
M. le président Bernard Accoyer. Entre les élus locaux et nationaux, il s’agit bien là d’un « conflit d’intérêts » – la formule est à la mode.
Je suis toujours frappé d’entendre parler de « TVA sociale » puisque l’on ne peut parler de valeur ajoutée dans un transfert fiscal ou de prélèvements obligatoires, fussent-ils à caractère social : nous sommes en présence d’une contribution comme, par exemple, la bien nommée « contribution sociale généralisée ». Il me semblerait donc à la fois plus habile et plus exact d’instaurer une « contribution sociale sur la consommation », sauf si l’on tient à bloquer toute évolution. Je vous invite donc à changer d’expression, pour l’abandonner à ceux qui, pour des raisons politiques, sont opposés à un tel dispositif.
Enfin, le principe de précaution – notamment dans l’industrie chimique – peut-il conduire à certaines hésitations en matière d’investissement ?
M. Paul Giacobbi. J’ai eu l’occasion de travailler dans l’industrie et de réfléchir aux conditions de l’attractivité française sur les investissements étrangers dans le cadre des travaux préparatoires du rapport sur « L’attrait de la France pour les investisseurs étrangers » que j’ai préparé pour M. le Président de la République. Si personne ne m’a parlé du coût du travail – sauf pour m’assurer que notre productivité est très supérieure à celle des États-Unis, par exemple –, il n’en est pas de même de l’effrayante instabilité, complexité et rigidité des règles, procédures, méthodes, habitudes, organisations françaises.
« We do not want to be trapped in France », ai-je entendu : la peur de se trouver prisonnier est bel et bien là car, lorsqu’un dispositif est bon, ce qui est d’ailleurs rare, nous nous empressons de chercher à le supprimer, comme c’est le cas de notre crédit d’impôt recherche, pourtant le meilleur du monde. Que pensez-vous de la mise en place d’un système qui garantirait davantage aux investisseurs étrangers, mais aussi français, une relative stabilité des règles fiscales et sociales applicables au moment où l’investissement est réalisé et, ce, sur une certaine durée ? Nous nous sommes assurés de la constitutionnalité d’une telle possibilité, même si elle ne plaît pas à Bercy ?
Ne pourrait-on pas également mieux informer les investisseurs étrangers sur le gigantisme des procédures auxquelles ils seront soumis s’ils veulent réaliser tel ou tel type d’investissement, y compris en s’engageant sur les délais ? Car ce ne sont pas les primes qui les attirent, même si certains succombent parfois à leurs attraits !
J’ai bien noté l’importance d’une entreprise comme Tata dans le secteur automobile, mais également dans bien d’autres domaines : sixième producteur mondial d’acier, elle compte 100 000 employés en Europe et figure parmi les premières entreprises mondiales dans les domaines de l’horlogerie, de l’hôtellerie et des fibres optiques. Sa structure capitalistique permet son contrôle par un conseil de famille. Avec 24 milliards de dollars, sa capacité d’investissement en Europe est colossale. Comme l’a dit un grand responsable du groupe : « It’s like Olympics games : we will turn every four years. »
Dans le domaine de l’automobile, plus précisément, la compétitivité ne dépend pas des seuls coûts de production : nous sommes confrontés à un combat entre le pot de fer et le pot de terre. Je ne sais pas si Mittal était plus compétitif que Arcelor, mais je sais que le premier avait décidé d’acheter le second et que celui-ci ne pouvait refuser, essentiellement pour des raisons de gouvernance. Pourquoi cela ne se reproduirait-il pas dans le secteur automobile avec une entreprise comme Tata, qui vise explicitement l’Europe, ses entreprises et certains segments de ses marchés ? Comment vous y préparez-vous ?
Enfin, depuis vingt ans, l’évolution des aéroports indiens a été colossale. Si les aéroports de Paris se sont modernisés, leur rigidité institutionnelle et leur réactivité plus que discutable demeurent. Comparer Bangalore et Aéroports de Paris, c’est un choc ! La modernité n’est pas où on le pense ! Fedex nous explique ainsi que si sa présence en France est impérative pour des raisons géographiques et stratégiques, elle essaie d’échapper à Aéroports de Paris en organisant des bases ailleurs en Europe. Voilà l’exemple type de ce qui porte atteinte à notre compétitivité puisque notre système supprime un atout considérable d’un point de vue géographique et économique !
M. Olivier Carré. M. Pierre Méhaignerie était soucieux de savoir si le salaire net et, en conséquence, le pouvoir d’achat des Français serait altéré par l’instauration d’une « contribution sur la consommation » selon l’expression de notre président, à la suite de la diminution des charges patronales. Comment limiter un tel impact sur la feuille de paie ? Faut-il espérer le retour d’un cycle de désinflation, comme celui qui est survenu opportunément par rapport à l’Allemagne et qui a permis d’opérer un certain nombre de rattrapages d’une façon naturelle ? La question du pouvoir d’achat est particulièrement importante même si, statistiquement, la France fait partie des rares pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans lequel il n’a statistiquement pas baissé.
Si je comprends que l’augmentation des salaires est étroitement liée à la situation en Allemagne, il n’en demeure pas moins que la différence de traitement entre les actionnaires et les salariés est frappante. Alors que les taux de distribution des dividendes retrouvent à peu près leur niveau d’avant la crise, les salariés ne profitent guère de l’issue positive qui se profile. Même si des dirigeants font parfois de grands sacrifices face à des difficultés ponctuelles, comme nous l’avons vu récemment à la télévision, les sommes en jeu suffisent à faire croître l’incompréhension, voire le scandale. La situation étant comparable dans le reste de l’Europe, Mme Angela Merkel a fait savoir au mois de septembre dernier que, la crise s’estompant, il était temps de s’intéresser à l’évolution des salaires. J’ai d’ailleurs été satisfait d’entendre certains membres de notre Gouvernement raisonner de la même manière. Le ministère du travail a évoqué un possible nouage entre dividendes et participation, la règle des trois tiers – égale répartition entre actionnaires, investissements et salariés – n’étant quant à elle pas retenue. Indépendamment de toute considération partisane, il convient en effet de réfléchir à une amélioration de cette allocation dans le sens d’une plus grande justice sociale.
Enfin, il semble que les grands groupes français n’entraînent pas suffisamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire dans leur sillage, à la différence par exemple de l’Allemagne, alors qu’il s’agit d’un élément important de notre compétitivité.
M. le président Bernard Accoyer. Sur ce dernier point relatif à la sous-traitance, j’approuve les propos de M. Olivier Carré.
M. Gérard Cherpion. M. Jean-Pierre Clamadieu a insisté sur les difficultés d’application du code du travail, en particulier dans le cadre de plans sociaux ou de restructurations internes, en faisant état d’un délai de onze mois entre la prise de décision et son effectivité. Quelles sont les incidences de notre législation du travail sur le recours au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée ?
M. Jean-Pierre Clamadieu. Gagner en flexibilité nous pousse en effet à recourir au travail temporaire, alors que la nature de nos métiers et la nécessité de former nos collaborateurs nous inclineraient à privilégier les contrats à durée indéterminée. L’ajustement auquel nous avons procédé chez Rhodia en 2009, de surcroît, s’est traduit in fine par des non-remplacements de salariés partis en retraite.
En 2009, le dividende a quant à lui été nul – il est revenu à un niveau normal l’année suivante – car notre priorité a été de traverser la crise, tandis que les salaires, eux, ont bien entendu continué à être versés.
M. Olivier Carré. Quid de la participation ?
M. Jean-Pierre Clamadieu. Nous n’en avons pas. En revanche, si l’intéressement a également souffert en 2009, il a de nouveau atteint un niveau satisfaisant et nous avons signé un accord sur les salaires. Enfin, le bonus des dirigeants a été fortement réduit en 2009 – le mien l’a été de 80 % parce que les performances n’étaient pas au rendez-vous, et il a augmenté en 2010. Certains éléments liés à la rémunération sont donc variables et d’autres beaucoup plus stables.
Le dispositif du chômage partiel est quant à lui excellent et traduit une très bonne utilisation des fonds publics. En 2009, nous avons d’ailleurs été parmi ceux qui ont souhaité le déplafonnement du volume d’heures disponibles, même s’il est parfois difficile d’en faire accepter le principe au sein de l’entreprise. En revanche, la problématique des heures supplémentaires ne nous concerne pas puisque nous travaillons en continu et, étant soumis à un plafonnement, nous ne sommes pas non plus concernés par les questions liées à la taxe professionnelle et aux contributions qui lui ont été substituées.
Les réglementations environnementales n’entraînent aucune délocalisation de notre part, les contraintes réglementaires et morales étant les mêmes en Chine, au Brésil, aux États-Unis et en Europe. Les autorités chinoises, en particulier, se montrent de plus en plus rigoureuses en la matière, surtout pour les entreprises étrangères. L’essentiel, pour nous, demeure la sécurité juridique et la capacité des différentes autorités administratives à instruire rapidement des dossiers.
À cet égard, les situations diffèrent d’un pays à l’autre, même si la France se trouve plutôt bien placée. En revanche, j’ai eu l’occasion de dire à la directrice de cabinet de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, que la définition d’une réglementation française sur les nano-particules, au nom du principe de précaution – alors que l’Europe y travaille également de façon sérieuse – n’est pas opportune : avançons d’une manière coordonnée car nos produits voyagent et traversent les frontières.
Enfin, comme M. Paul Giacobbi, j’ai pu entendre des collègues – anglo-saxons pour la plupart – se plaindre de l’instabilité de la législation française. Il en est ainsi, par exemple, du déplafonnement soudain de la contribution au service public de l’électricité pour des raisons circonstancielles, lequel pèse considérablement sur les industries consommant beaucoup d’énergie et dont les investissements sont lourds. Il en va de même des systèmes de rémunération de type actions gratuites ou stock-options qui concernent nombre de nos cadres, en France comme à l’étranger : pas une année ne passe sans que la réglementation évolue et que nous soyons obligés de consacrer du temps à trouver les moyens de les pérenniser. Peut-on imaginer un système dans lequel les dispositions existantes lors des investissements seraient maintenues ? Hélas, je n’y crois guère.
M. Patrick Pélata. Le contrat social de crise nous a permis de maintenir nos personnels en sécurisant l’intégralité du salaire de base, quel que soit le nombre de jours chômés, et en appliquant aux « cols blancs » un système de cotisation, ce qui a contribué à maintenir un climat serein au sein de l’entreprise.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Qu’en a-t-il été de vos équipementiers ?
M. Patrick Pélata. Nous ne pouvons agir sur ce plan-là même si certains ont utilisé les mêmes dispositifs.
En revanche, s’agissant des investissements et des aides de l’État dans la durée, les pratiques françaises sont loin d’être les meilleures. Alors que nous aurions dû fermer une usine en Espagne, plus de 200 millions ont été débloqués en un an, les syndicats, en accord avec la province et l’État central, ayant négocié un accord salarial sur trois ans portant sur l’ensemble de nos usines espagnoles. Finalement, nous sommes parvenus à une issue économiquement positive, une telle cohérence nous permettant d’y voir clair pendant six ou sept ans. On ne peut en dire autant dans notre pays où, seul constructeur à fabriquer des fourgons en France – en l’occurrence des Kangoo, à Maubeuge –, nous avons bénéficié d’une aide de 7 ou 8 millions d’euros, mais, comme nous n’avons pas produit les volumes prévus en raison de la crise, le remboursement de cet argent nous a été réclamé.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Par les collectivités, non par l’État !
M. Patrick Pélata. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un réel fardeau.
Par ailleurs, notre coût de production en Roumanie étant moindre qu’en Chine, notre business modèle avec Dacia nous semble solide face à Tata et aux menaces chinoises. M. Pascal Lamy, directeur général de l’Organisation mondial du commerce, a déclaré voilà cinq ou six mois qu’un iPod intégralement fabriqué en Asie crée plus de valeur aux Etats-Unis qu’en Asie, le bilan net étant très positif. Il en est de même pour notre pays, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros, s’agissant de la fabrication de la Logan et de la Sandero en Roumanie par des « cols bleus », les « cols blancs » étant quant à eux en France. Et nous importons 100 000 de ces véhicules chaque année.
M. le président Bernard Accoyer. Le solde est positif pour l’ensemble du groupe, pas pour sa balance commerciale.
M. Patrick Pélata. Je parle de la valeur ajoutée réalisée en France, en incluant dans le calcul le coût des pièces de nos fournisseurs ainsi que les dépenses d’ingénierie et de marketing. En tenant compte des importations et des exportations, le solde de notre balance est positif. Cette stratégie fonctionne ailleurs, comme en attestent les relations économiques et commerciales que le Japon entretient avec les autres pays asiatiques et comme l’Europe peut elle-même le faire, par exemple avec le Maroc s’agissant de Renault : ici, haute valeur ajoutée, là, moindre valeur ajoutée.
Depuis 1999, Renault a versé 3,9 milliards d’euros de dividendes, dont 3,4 issus de Nissan, Volvo et Daimler. La valeur ajoutée par Renault distribuée aux actionnaires s’élève donc pour cette période à moins d’un demi-milliard d’euros, ce qui est modeste, et nous avons investi la majeure partie des sommes en cause.
Enfin, je souffre toujours d’entendre que nous n’aiderions pas nos petites et moyennes entreprises. Nous achetons 50 % de notre valeur ajoutée mondiale en France à des entreprises françaises qui, il est vrai, hors quelques grosses structures comme Valeo ou Faurecia, souffrent de faiblesses structurelles, dont une sous-capitalisation. Le Mittlesstand allemand est sans équivalent chez nous, et je ne crois pas que la situation puisse changer. Si nous nous adressons toujours à nos fournisseurs français en premier lieu, comme ce fut encore le cas avec le véhicule électrique, il n’en reste pas moins que le moteur de la petite Twizy, par exemple, sera fabriqué par un industriel étranger faute d’une offre nationale satisfaisante. Inversement, nous produisons notre petit moteur diesel en Espagne, mais c’est le fournisseur français des pièces qui crée le plus de valeur ajoutée.
L’écart de marge brute des industries allemandes et françaises entre 2000 et 2007 est éloquent, puisque nous nous situions à 5 points au-dessus de l’industrie manufacturière allemande et que nous sommes passés à 5 points au-dessous. La situation est identique en matière de charges sociales, ce qui n’est pas un hasard puisque c’est d’abord à ce problème que nous devons nous attaquer.
M. Jean-Cyril Spinetta. La non-application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les voyageurs, monsieur Jérôme Cahuzac, constitue une règle mondiale du transport aérien afin d’égaliser les conditions de la concurrence. L’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 25 % serait désastreuse.
Le chiffre que j’ai cité concernant la baisse de la taxe professionnelle correspond à un résultat net entre les gains et les coûts.
En ce qui concerne le temps partiel, les Allemands ont remarquablement procédé, tant économiquement que socialement. Aucune entreprise de transport aérien n’a toutefois usé du chômage partiel car, en cas de grave problème économique, faute de pouvoir stocker notre production, nous nous efforçons de maintenir nos programmes. Nous enregistrons alors une légère baisse du nombre de passagers et une diminution importante de nos recettes compte tenu de l’excès de l’offre par rapport aux besoins des consommateurs.
Air France n’a pas non plus utilisé le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires pour de nombreuses raisons sur lesquelles je n’ai pas le temps de m’attarder, et nous sommes peu concernés par une éventuelle limitation des investissements en raison du principe de précaution.
La stabilité des règles fiscales et sociales, monsieur Paul Giacobbi, marquerait un progrès considérable, je vous l’accorde. S’agissant de la comparaison avec celui de Bangalore ou d’autres grands aéroports internationaux, Paris-Roissy souffre d’une erreur de conception : au début des années soixante-dix, les constructeurs ont préféré faire accomplir de courtes distances aux voyageurs entre les avions et l’aérogare plutôt que de multiplier les points de contact. Un tel système, quelque peu baroque, n’existe d’ailleurs qu’à Washington et Paris. Ce problème sera toutefois complètement corrigé en 2012 grâce au travail de la direction d’Aéroports de Paris menée par M. Pierre Graff.
Outre qu’Air France, monsieur Olivier Carré, a versé peu de dividendes – aucun depuis trois ans –, ceux-ci ont toujours été à peu près équivalents aux sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation des salariés.
J’ajoute qu’Air France, comme KLM, Lufthansa et British Airways, est une compagnie nationale, dont 95 % des salariés sont des nationaux. Nous sommes le premier employeur privé de la région d’Île-de-France et les délocalisations sont infimes. Nous faisons moins appel à la sous-traitance que nous ne sous-traitons nous-mêmes pour le compte d’une centaine de compagnies aériennes, en particulier s’agissant de l’entretien des avions. Environ 10 000 personnes travaillent dans des métiers exclusivement industriels à très haute valeur ajoutée, et de 3 000 à 4 000 d’entre elles vivent de la sous-traitance.
Enfin, en tant que membre du conseil d’administration d’Alcatel-Lucent – société qui, après des moments difficiles, s’est aujourd’hui redressée à tel point que nous pouvons être raisonnablement optimistes quant à son avenir –, je rappelle que cette entreprise a été sauvée par les groupes Verizon et AT&T qui, pour moderniser leurs systèmes de communication, l’ont choisie alors que les offres du chinois Huawei, par exemple, étaient bien moins chères. Sans aucune consigne industrielle de la part de l’État fédéral américain, ces deux entreprises ont décidé que, pour des raisons stratégiques de long terme, il était préférable de payer plus cher et d’être fidèle à un fournisseur de service ayant un ancrage national, plutôt que d’améliorer ses résultats à court terme et d’aller au-devant de difficultés stratégiques. Certaines compagnies françaises pourraient sans doute s’inspirer d’un tel exemple, y compris Air France.
M. le président Bernard Accoyer. Je vous remercie, monsieur Jean-Cyril Spinetta, de ce message final.
Je vous sais gré, messieurs Clamadieu, Pélata et Spinetta, de la qualité, de la clarté et de la densité de vos exposés, ainsi que de vos réponses. Vous avez vous-mêmes éloquemment illustré le bien-fondé de l’intitulé de notre mission, liant compétitivité économique et financement de la protection sociale. Nul doute que votre aide aura été importante, tant pour la rédaction de notre rapport, qu’en ce qui concerne les différents constats que vous avez dressés. J’espère que ceux-ci seront partagés et je ne doute pas qu’ils seront au cœur des débats politiques qui s’ouvriront prochainement.
*
AUDITION DU 23 MARS 2011
Audition de M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de M. Élie Cohen, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), professeur à SciencesPo et membre du Conseil d’analyse économique, et de Mme Bénédicte Zimmermann, directrice de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
M. Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS, professeur à SciencesPo et membre du Conseil d’analyse économique. Le débat sur la divergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne a été lancé par le dernier rapport du Centre d’observation économique et de recherche pour l’expansion de l’économie et le développement de l’entreprise (COE-Rexecode), mais les thèmes de la compétitivité, de la désindustrialisation et, plus récemment, des délocalisations reviennent à l’occasion de chaque crise : en 1974 comme en 1979, en 1993, en 2002 ou en 2008.
Quelles sont, en la matière, les données les moins contestables ?
La première est que la part de marché de la France dans le commerce international s’est effondrée, passant de 5,8 % en 1995 à 3,8 % en 2010, tandis que celle de l’Allemagne demeurait de 10,1 %. Nous avons donc perdu près de 40 % de nos parts de marché ou, pour le dire autrement, notre produit intérieur brut (PIB) serait supérieur de 150 milliards d’euros à ce qu’il est aujourd’hui si notre part de marché était demeurée la même. On ne peut donc que constater la brutalité et l’accélération récente de cet effondrement, qui affecte tous les secteurs économiques et toutes les parties du monde, au-delà des seuls pays émergents.
Dans la mesure où près des trois quarts des échanges commerciaux internationaux portant sur les produits industriels, le fait que notre industrie ne représente plus que 15 % de notre valeur ajoutée a bien évidemment un impact direct sur nos exportations.
Le Centre d’observation économique et de recherche pour l’expansion de l’économie et le développement de l’entreprise considère que, dans la mesure où il n’y a pas eu de variation majeure en termes de compétitivité hors coût, c’est en matière de compétitivité-coût que nous avons « décroché » au cours des dix dernières années. Cette affirmation a entraîné tout un débat sur la qualité et la fiabilité des statistiques utilisées. Cependant un consensus à peu près général se dégage autour de l’idée que nous avons perdu de 8 à 10 points de compétitivité-coût par rapport à l’Allemagne. Nous nous éloignons donc des leaders que sont l’Allemagne, la Finlande et l’Autriche : le fait que nous demeurions en avance sur des pays qui ont massivement décroché, comme la Grèce, l’Espagne, le Portugal, n’est qu’une piètre consolation.
La France et l’Allemagne ont les mêmes spécialisations et se battent sur les mêmes marchés. Il y a dix ans, il nous arrivait d’emporter des parts de marché grâce à un avantage de compétitivité-coût de 8 à 10 %. Dès lors que cet avantage a disparu, nous perdons systématiquement car l’Allemagne jouit d’une meilleure compétitivité hors coût liée à la plus grande capacité de différenciation de ses produits, qui sont perçus comme étant de qualité.
Pour autant, les dix dernières années, l’évolution du produit intérieur brut par habitant a été sensiblement la même dans les deux pays. Si la France a pu maintenir sa croissance en dépit de différentiels de coûts très importants, parce que celle-ci a été tirée par la consommation, qui a elle-même été surtout portée par des dépenses de redistribution très largement financées à crédit. Un tel système n’est absolument pas soutenable à plus long terme car la conjonction du déficit de balance courante et du déficit budgétaire met la France sur une trajectoire d’insolvabilité. C’est pour cela qu’il faut s’intéresser de près à la compétitivité, en particulier au sein de l’industrie, qui est le moteur de l’exportation.
Dans son dernier rapport en cours de rédaction, intitulé « Crise et croissance », le Conseil d’analyse économique s’est donc efforcé de comprendre le décrochage industriel de la France.
Le Conseil d’analyse économique a constaté que, les dix dernières années, les efforts d’investissement des entreprises non financières ont été similaires en France et en Allemagne. Cela tient peut-être au fait que l’économie française dispose de grosses entreprises remarquables, mais qu’elle n’a que peu d’entreprises de taille intermédiaire, tandis que ses petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) sont moins dynamiques que leurs homologues allemandes. De surcroît, nos entreprises de taille intermédiaire et nos petites et moyennes entreprises sont en situation de sous-investissement. De même, nous sous-investissons dans les secteurs les plus porteurs pour le commerce international, notamment les biens d’équipement, intermédiaires et de consommation. Pis : le fossé se creuse entre les investissements français et allemands dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication, déterminantes pour la productivité de demain. La part de recherche et développement (R&D), des entreprises industrielles dans le produit intérieur brut a régulièrement baissé en France, tandis qu’elle augmentait systématiquement en Allemagne, au Japon et chez plusieurs autres de nos concurrents, ce phénomène ayant même tendance à s’aggraver, en dépit d’une certaine prise de conscience. De 2000 à 2008, l’effort de R&D par rapport au produit intérieur brut a été en moyenne de 2,3 % en France, contre 2,8 % en Allemagne, 3 % aux États-Unis, 3,4 % au Japon. Par ailleurs, la France dépose 2,5 fois moins de brevets que l’Allemagne.
Au total, on observe une sorte d’enchaînement délétère : les entreprises n’osant pas investir pour innover et pour exporter, elles ne croissent pas autant qu’elles le pourraient. Leurs marges s’en trouvent réduites et leur situation financière se dégrade, les contraignant à recourir à des financements externes qu’elles ont de plus en plus de difficultés à se procurer. La fin d’un tel processus est la cession d’une partie de notre tissu industriel à des investisseurs étrangers, tout simplement parce que la rentabilité de nos entreprises industrielles décroît et qu’elle est très inférieure à celle de nos concurrents européens. En insistant tant sur les profits « obscènes » des entreprises de la cotation assistée en continu (CAC 40), on oublie ce grave problème de rentabilité de nos entreprises industrielles.
M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Ma contribution sera davantage centrée sur l’apport de la R&D à l’innovation. Je serai un peu plus optimiste que mon prédécesseur, en lui indiquant que le pourcentage de son produit intérieur brut que la France consacre à la R&D est remonté en 2009 à 2,21 % et devrait être encore meilleur en 2010. Pour autant, on n’atteindra pas avant longtemps le taux de 3 % qui est l’objectif de l’Europe et des États-Unis, le Japon et la Corée ayant des taux encore supérieurs.
En 2009, la France se situait au onzième rang mondial en termes d’intensité de R&D et au sixième – derrière les États-Unis, le Japon la Chine, l’Allemagne et la Corée – en volume de dépenses. Elle demeure le sixième pays déposant de brevets.
Cette faible intensité relative de la R&D s’explique d’une part par la spécialisation sectorielle de notre industrie, principalement composée de filières peu intensives en R&D, et, d’autre part, par une démographie de nos entreprises en déficit de petites et moyennes entreprises importantes et d’entreprises de taille intermédiaire investissant dans la R&D. Combler le différentiel avec les Allemands prendra donc du temps et nécessitera que notre culture comme notre outil de production évoluent.
La France est très bien placée – au troisième rang après la Corée et le Canada, à égalité avec les États-Unis – pour le soutien public à la R&D, en particulier grâce au crédit d’impôt-recherche, qui est aujourd’hui considéré comme le meilleur dispositif au monde, en excellente adéquation avec ses objectifs : améliorer l’attractivité de la France et favoriser à la fois la R&D dans les petites et moyennes entreprises, le partenariat public-privé et l’embauche de jeunes docteurs.
L’efficacité du lien entre amont et aval paraît particulièrement importante pour la dynamique de l’innovation fondée sur la R&D. L’innovation est de plus en plus le fait de grands clusters mondiaux, peu nombreux, qui atteignent une masse critique en matière d’innovation, de recherche et de formation, et qui irriguent les régions limitrophes. En leur sein, l’Île-de-France est au neuvième rang mondial pour le dépôt de brevets et Rhône-Alpes au vingt-neuvième.
J’en viens à l’apport de la R&D à la capacité d’innovation des entreprises. Exerçant le métier spécifique qui consiste à coupler la recherche en amont et en aval, les instituts Carnot et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives représentent respectivement 13 % et 8,5 % de la recherche publique et 45 % et 33 % de la recherche en partenariat public-privé. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est le premier déposant de brevets au monde qui ne soit pas une entreprise. Nous conservons donc quelques points forts dans la compétition internationale, et c’est ce qui m’incite à l’optimisme.
Il est essentiel de couvrir tous les niveaux de maturité de l’innovation technologique, depuis les idées jusqu’aux produits. Les organismes de recherche technologique facilitent le fonctionnement et l’intégration verticale au sein des filières. Ainsi, dans la micro-électronique, le laboratoire d’électronique des technologies de l’information (LETI) soutient, au cœur de l’écosystème d’innovation à Grenoble, un ensemble de 15 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects. En vingt ans, il a bénéficié de 500 emplois publics et l’on en mesure les effets puisque les jeunes entreprises qui ont été créées font aujourd’hui travailler 2 500 personnes. Ce laboratoire et ceux qui travaillent avec lui soutiennent directement la filière nationale de micro-électronique, qui représente pas moins de 70 000 emplois. Le rapport que M. Laurent Malier, directeur du laboratoire, a rendu au précédent ministre de l’industrie, M. Christian Estrosi, montre que cette filière est durablement viable, moyennant un soutien à l’investissement et à la spécialisation d’un certain nombre de sites.
L’exemple du solaire confirme l’importance de couvrir l’ensemble de la chaîne de maturité technologique pour stabiliser toute une filière. Ayant atteint une masse critique de deux cent cinquante chercheurs, l’Institut national de l’industrie solaire, créé en 2005 à Chambéry, figure parmi les trois meilleurs organismes européens et vise rapidement une des trois premières places mondiales. Il compte 156 partenariats actifs avec les entreprises nationales, soit avec les quatre-cinquièmes d’une filière qui représente 25 000 emplois.
Il est également très important d’être présent sur le terrain du développement des technologies clés habilitantes – les key enabling technologies – qui couvrent la micro-nano-électronique, la photonique, les biotechnologies, les matériaux, le manufacturing, les nanotechnologies. L’Union européenne, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la Corée les ont identifiées comme indispensables à l’innovation. Leur marché, qui représentait en 2008 plus de 830 milliards de dollars, conditionne plusieurs millions d’emplois en Europe. Leur combinaison est une des clés de l’innovation, qui bénéficie aussi aux entreprises traditionnelles. Ainsi la société RYB, implantée en Rhône-Alpes et spécialiste des tuyaux en polyéthylène, est la première entreprise au monde capable de maîtriser et de vendre une canalisation plastique détectable et communicante, même enterrée. Une telle avancée devrait se traduire par la création de plusieurs centaines d’emplois.
Outre les avancées technologiques, l’innovation peut permettre d’améliorer l’organisation des entreprises. Ainsi, les constructeurs automobiles utilisent des simulateurs à retour d’effort pour former leurs personnels. Pour leur part, les sociétés d’assurance ont recours à des services liés à la modélisation du climat pour calculer le taux de leurs primes.
Dans le cadre des nouvelles méthodes d’innovation, nous avons créé, il y a dix ans, à Grenoble, un laboratoire d’idées qui fait travailler ensemble sciences humaines et sociales, technologues et usagers. Notre laboratoire de démonstration permet de montrer concrètement aux visiteurs les applications des nouvelles technologies.
Afin de maximiser l’effet de la R&D sur l’innovation, il me semble tout d’abord important que les moyens de soutien soient constants. Il faut ensuite accélérer la constitution des écosystèmes d’innovation, qui a été favorisée par les investissements d’avenir. Il est également indispensable de combler ce que l’on appelle la « vallée de la mort », c’est-à-dire de ne pas oublier qu’il faut passer de l’idée à la technologie, de la technologie au produit et du produit à sa fabrication en grande série. Cela suppose de réaliser les investissements nécessaires, y compris dans l’outil de production, en étant conscient que la recherche technologique est la clé de ces investissements.
Mme Bénédicte Zimmermann, directrice de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales. Je vais m’efforcer d’apporter un éclairage socio-historique sur le modèle allemand et sur l’utilisation qui en est faite dans les débats actuels sur le différentiel de croissance entre nos deux pays.
Après m’être employée à dissiper quelques malentendus relatifs au modèle allemand, j’insisterai sur une dimension qui me paraît décisive dans la dynamique des sorties de crise de l’Allemagne – pas seulement aujourd’hui, mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – et qui, étonnamment, n’est jamais évoquée : il s’agit de la conception même de la relation salariale, de l’entreprise vue comme collectif de travail et, par conséquent, de la place des travailleurs dans le processus de production de valeur et de richesse.
Le modèle allemand tant évoqué depuis quelques mois est selon moi introuvable. En effet, on fait tout à la fois référence à un modèle historique et à toutes ses remises en cause récentes. Ainsi, la croissance allemande repose sur un mélange qui peut devenir explosif entre, d’une part, des pratiques héritées de l’économie sociale de marché, dans laquelle employeurs et salariés font converger leurs efforts en vue du bien commun de la nation lorsque la puissance de cette dernière semble menacée et, d’autre part, des politiques qui révisent à la baisse la protection et l’intégration sociales. Cette confusion fondamentale doit être levée.
D’un point de vue structurel, le modèle historique – qui date de la République de Weimar, qui a été consolidé par la Loi fondamentale de 1949 et qui est resté très actif jusqu’à la fin des années 1990 – s’appuie sur un tissu dense de petites et moyennes entreprises, en particulier au sud et à l’ouest du pays, et sur un système politique fédéral fondé sur le principe de subsidiarité, lequel favorise une gouvernance et une régulation décentralisées susceptibles d’être très finement adaptées à la spécificité des différents bassins d’emploi.
Au-delà, ce modèle repose sur la force du dialogue social dans les branches et dans les entreprises ; sur l’identification des employeurs et des salariés à une communauté de production, au niveau tant national que de l’entreprise ; sur un mode de gouvernance de l’entreprise fondé sur la codétermination et la participation des salariés, dans une optique de recherche de l’intérêt partagé et de la paix sociale ; sur le tripartisme, qui renvoie à une tradition de coopération entre entreprises, représentants de salariés et pouvoirs publics – le dernier pacte tripartite « pour l’emploi, la formation et la compétitivité », conclu en 1998 sous le gouvernement de M. Gerhard Schröder, a volé en éclats en 2002 – ; et enfin sur un système de protection sociale cofinancé par les employeurs et par les salariés au moyen de prélèvements sur les salaires.
Les indices de rupture de ce modèle sont d’abord perceptibles sur le plan structurel : la globalisation, les délocalisations et la sous-traitance ont bousculé la coopération entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises, de telle sorte que le nombre d’entreprises liées par une convention de branche diminue, tout comme celui des salariés couverts. Ce modèle est ensuite menacé sur le plan des principes politiques : en 2003, les lois Hartz ont provoqué un changement de paradigme dans la régulation du marché du travail. En effet, elles ont consacré le passage de l’État social au workfare dans lequel toute prestation sociale appelle un travail ; elles ont aussi marqué un basculement de la responsabilité collective à la responsabilité individuelle, notamment en cas de chômage. L’idée force est d’« activer » les chômeurs. Pour ce faire, l’allocation de chômage a été réduite à douze mois pour les moins de quarante-cinq ans, période à l’issue de laquelle le bénéfice de l’aide sociale est subordonné au retour à l’emploi. Dans le même temps, on a fortement incité à la création massive d’emplois à des conditions dégradées, tels que les emplois à moins de 5 euros nets de l’heure et à moins de 400 euros nets par mois.
Ces mesures ont mécaniquement fait chuter le taux de chômage, mais elles ont aussi considérablement augmenté la précarité et la pauvreté. Moins de chômeurs, mais plus de pauvres : est-ce un modèle enviable pour la France ?
En outre, ce basculement statistique du chômage vers la pauvreté s’accompagne d’une forte stigmatisation des chômeurs. Il en résulte un clivage social marqué entre les salariés en contrats à durée indéterminée et ceux qui évoluent aux marges du marché du travail.
La réduction des prestations sociales est peut-être en passe de devenir la marque d’un modèle allemand renouvelé. Mais est-elle compatible avec les autres aspects du modèle classique, que l’on a vus à l’œuvre lors de la dernière sortie de crise, en particulier avec l’implication des salariés et des employeurs dans une communauté de production solidairement responsable ? On ne peut faire abstraction de cette question lorsque l’on analyse la dynamique de croissance allemande car la compétitivité ne saurait se concevoir sans l’engagement des salariés. Si la France a une chose à apprendre de l’Allemagne, c’est peut-être la capacité à développer des organisations du travail participatives qui favorisent la motivation et l’engagement des salariés plutôt qu’elles ne les découragent. Si les Allemands sont en la matière plus « forts » que nous, c’est parce que leur droit du travail repose sur une autre conception de la relation de travail, dont les juristes weimariens ont posé le socle. Ainsi Potthoff, d’obédience libérale-démocrate, écrivait en 1922 que « la relation de travail n’est pas en premier lieu une relation contractuelle, mais une relation sociale » : voilà une clé pour comprendre l’ensemble du système allemand des relations professionnelles, aujourd’hui remis en cause.
Comment motiver les personnes au travail ? Comment les impliquer solidairement dans un processus collectif de production ? L’Allemagne nous invite à nous poser de telles questions aujourd’hui, en amont des autres sujets, car, dès lors que la solidarité existe dans la communauté de travail, il devient plus facile de négocier sur les salaires et sur la protection sociale. Mais cela suppose d’ouvrir la « boîte noire » de l’entreprise.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Vous avez dit, monsieur Élie Cohen, que le produit intérieur brut aurait pu être supérieur de 150 milliards à ce qu’il est. Combien cela représente-t-il d’emplois qui auraient pu être créés et qui ne l’ont pas été ?
Vous avez aussi beaucoup parlé des petites et moyennes entreprises, dont on dit souvent qu’elles ont du mal à grandir dans notre pays. Quels sont pour vous les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées ? Quel rôle jouent l’impôt de solidarité sur la fortune et les difficultés de transmission des entreprises liées à la fiscalité ?
Vous avez pour votre part, madame Bénédicte Zimmermann, dressé la liste d’un certain nombre de différences entre les modèles allemand et français. J’ai été surpris que vous n’abordiez pas la question culturelle : on dit souvent que l’Allemagne aime son industrie tandis que la France aime mieux l’État que ses entreprises. N’y voyez-vous pas un élément essentiel, que l’on retrouve dans l’éducation, en particulier parce que le système éducatif français, très hiérarchique et aristocratique, fait passer la formation professionnelle tout au long de la vie largement au second plan ?
M. Marc Laffineur, président. La rigidité de notre droit du travail n’est-elle pas également un frein à cette compétitivité ?
M. Élie Cohen. Le chiffre impressionnant de 150 milliards est en fait une construction intellectuelle : il s’agit de la part supplémentaire du produit intérieur brut qui aurait été obtenue si le rapport entre les exportations françaises et allemandes était resté ce qu’il était il y a dix ans. Je cherchais surtout à illustrer à quelle rapidité l’appareil exportateur français s’est atrophié. On peut en trouver un autre indicateur dans le taux d’extraversion, qui mesure l’insertion de nos deux économies dans l’économie mondiale. Les dix dernières années, la France est presque demeurée sur place tandis que l’Allemagne progressait fortement. De même, l’analyse de l’élasticité du commerce extérieur montre que la France réagit beaucoup moins vite que l’Allemagne ou l’Italie. Pourquoi n’avons-nous pas été capables de répondre au décollage de la demande des pays émergents entre 1999 et 2001 ?
Si l’on veut savoir pourquoi l’impact a été tel en matière d’emploi, la réponse à la question est simple : il n’aurait sans doute pas fallu détruire 800 000 emplois industriels depuis une dizaine d’années – le choc, en effet, a été rude. En l’occurrence, la désindustrialisation massive de notre pays s’est effectuée en deux temps. Entre 1979 et 1984, environ un tiers des emplois industriels ont disparu tandis que, les dix dernières années, la situation, pour avoir été moins violente, a perduré. Un tel phénomène n’a pas été observé en Allemagne, ni en Italie, alors que ce dernier pays ne compte pas parmi les plus dynamiques. Cela est d’autant plus bizarre que la France a beaucoup insisté sur la nécessité de développer des politiques industrielles et qu’elle a semblé vouloir en appliquer de nombreuses.
M. Paul Giacobbi. On parle beaucoup, mais on agit peu !
M. Élie Cohen. On parle beaucoup, en effet.
En 2004, j’ai été associé à une réflexion lancée par le Président de la République Jacques Chirac concernant les problèmes de désindustrialisation et de délocalisation. Je me souviens, lors d’une réunion à l’Élysée, de la multiplicité des points de vue qui avaient été émis par de grands industriels et d’importants responsables. Nos problèmes étaient successivement dus : à la perte de la magie du modèle colbertiste de grands projets et programmes – vous aurez reconnu les propos de M. Jean-Louis Beffa, dont le rapport avait entraîné la création de l’Agence pour l’innovation industrielle avant qu’elle ne soit supprimée quelques mois plus tard – ; à l’absence de développement de clusters d’innovation, au lieu, après appels d’offre, de compter cinq ou dix pôles de compétitivité, ce sont soixante et onze qui ont finalement été sélectionnés pour un budget de 500 millions, alors qu’un peu d’attention à la situation de nos voisins aurait montré que l’unité de compte est le milliard de dollars par grand pôle ; enfin, à la faiblesse des moyens permettant aux petites et moyennes entreprises de se développer malgré la fusion de l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) et de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises (BDPME), qui donna naissance à OSÉO. Il ne faut pas s’attendre à de formidables succès si l’on retient l’ensemble de ces orientations en maintenant un budget qui n’est pas « à la hauteur ».
La France a la fibre industrielle et rêve de disposer d’une grande industrie, mais elle a raté plusieurs grands rendez-vous !
Nos efforts en matière de R&D, quant à eux, augmentent peut-être d’un dixième de point, mais il n’en reste pas moins qu’ils demeurent deux fois moins élevés par rapport au produit intérieur brut qu’ils ne l’étaient sous le général de Gaulle.
M. Hervé Novelli. Les interlocuteurs auxquels je m’adresse considèrent tous que notre trajectoire a divergé d’avec celle de l’Allemagne à partir des années 2000. Quel choc est-il à l’origine d’une telle situation ?
M. Élie Cohen. Les facteurs sont nombreux.
D’abord, pour ce qui est de l’attitude vis-à-vis de la mondialisation, alors que la réunification supposait de très importants transferts, les Allemands ont compris que le choc de la globalisation mettait en péril leur modèle industriel et ont opéré un certain nombre de choix inconcevables dans notre pays. Si le taux d’extraversion de l’économie allemande a formidablement augmenté, c’est que les exportations et les importations ont été accrues, contribuant ainsi à réorganiser l’ensemble de la chaîne de production en Allemagne, certes, mais également dans les pays limitrophes. Dans le cadre de ce système de production élargi, la chaîne de valeur a été spécialisée et segmentée, l’intégration globale ayant été quant à elle maintenue. De la sorte, l’Allemagne a pu organiser la défense de son industrie automobile sur un espace étendu. A contrario, nous avons choisi de maintenir en France notre outil de production existant, tout nouveau développement étant organisé hors de notre pays.
Ensuite, nos grandes entreprises ne contribuent guère à tirer vers le haut l’ensemble de notre économie faute de trouver sur notre territoire national un certain nombre de conditions favorables. Ce n’est pas la loi sur les trente-cinq heures à laquelle certain d’entre vous pensent en particulier qui pose des problèmes.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. La dureté des choix opérés par le chancelier Schröder aurait-elle été culturellement acceptée dans notre pays ?
M. Élie Cohen. Comme l’a dit Mme Zimmermann, les idées de communauté de travail et de codétermination ont permis à l’Allemagne de résister au choc de la mondialisation et au transfert de richesses massif de près de 1 300 milliards d’euros induit par la réunification. Ce pays a élaboré des compromis de crise dont nous sommes incapables.
Mme Bénédicte Zimmermann. Une telle situation s’explique par de profondes raisons historiques. La République de Weimar, l’expérience hitlérienne, la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, la réunification… À chaque fois, il a été fait appel à l’idée d’une communauté nationale de production soudée et solidaire.
S’il est certes possible d’évoquer un trait « culturel » allemand, je parlerai plutôt de la consolidation, inscrite dans le temps, d’un certain nombre de pratiques liées aux événements. Je ne crois pas à une conception essentialiste de la culture où l’ « âme » allemande serait plus encline à susciter tel ou tel comportement que l’ « âme » française. La culture d’un pays se forge sur la très longue durée.
M. Élie Cohen. En effet, il n’est pas question de culture, mais d’histoire. Au début du siècle, la conflictualité sociale était extrêmement violente en Allemagne, pays qui était alors bien loin d’une logique de consensus et de communauté de travail. La révolution bolchevique a failli y triompher ! C’est l’expérience historique – chute de la République de Weimar, régime hitlérien, modalités de la reconstruction, problèmes de la réunification – qui a forgé le compromis social de crise.
Mme Bénédicte Zimmermann. Lequel avait été aussi préparé par la Mitbestimmung des assurances bismarckiennes et par la Première Guerre mondiale où les racines du droit du travail allemand doivent d’ailleurs être recherchées.
De plus, si les Allemands, à la différence des Français, semblent préférer les entreprises à l’État, c’est qu’ils ont de bonnes raisons de se méfier de ce dernier, leur histoire récente en atteste. Une telle circonspection a d’ailleurs contribué à développer un tissu associatif ainsi que des formes de concertation et de délibération qui passent par d’autres canaux et qui sont extrêmement productives, y compris dans le domaine du travail.
Pourquoi la France, quant à elle, n’aime-t-elle pas ses industries ? Est-ce en raison d’une hypertrophie de l’État ? Est-ce parce que les travailleurs n’y auraient pas trouvé un moyen de s’affirmer, de participer au développement économique et de faire reconnaître la part qu’ils ont prise à la production de richesses et de valeurs ? Cette question essentielle, à laquelle je n’ai pas de réponse toute faite, mérite en tout cas d’être posée. J’ajoute qu’il conviendrait peut-être aussi de s’interroger sur la gouvernance des entreprises et sur la façon dont, depuis plusieurs décennies, les Français appréhendent leur situation au sein du monde du travail.
À ce propos, la question de la formation et du développement professionnel est cruciale. En Allemagne, les entreprises facilitent ainsi les développements professionnels et les deuxièmes chances indépendamment du diplôme initial quand, en France, notre système est hiérarchisé et cloisonné, le diplôme constituant plus encore l’horizon indépassable de la qualification que ce n’était le cas lors des deux dernières décennies, comme le montrent plusieurs enquêtes.
M. Paul Giacobbi. Je voudrais signaler ici un réel paradoxe : la France est le pays le plus nombriliste du monde et il ne cesse de se chercher des modèles ! Voilà vingt ans, c’était le Japon – excellente référence lorsque l’on voit où se situe ce pays après la « décennie perdue » ! –, puis nous connûmes une petite crise danoise avant, donc, le syndrome allemand qui nous atteint aujourd’hui. J’attends avec impatience que nous succombions demain au syndrome indien.
Il convient également de rappeler que l’Allemagne connaît quelques difficultés : outre que les banques allemandes possèdent 900 milliards de créances recouvrables, la banque immobilière Hypo Real Estate pèse un peu plus sur les finances publiques de l’État allemand que la sécurité sociale sur les nôtres.
Par ailleurs, c’est une erreur d’affirmer que la compétitivité est exclusivement conditionnée par les prix et les coûts et je reconnais qu’aucun d’entre vous ne l’a prétendu. Lorsque je travaillais dans l’industrie, je n’ai jamais eu l’occasion d’entendre un seul industriel se plaindre au premier chef du coût du travail. Un grand industriel de l’équipement automobile m’a confié que, lorsque l’on tient compte d’un certain nombre de facteurs, dont celui de la productivité du travail, le coût du travail de ses 7 000 salariés employés en Inde est globalement égal à celui des Français, le coût des managers y étant en effet deux fois plus important que dans notre pays. J’ajoute que, depuis le début de cette mission et sur un plan plus théorique, la lecture de Nicholas Kaldor et Joan Robinson sur l’élasticité et l’imperfection des marchés me console.
Les industriels, en revanche, mettent en avant les problèmes de financement des petites et moyennes entreprises et de la désaffection des élites. Je veux vous compter une petite anecdote personnelle : si mon propre père était flatté que je fisse l’École nationale d’aministration, il déchanta lorsque je partis travailler dans l’industrie pendant sept ans : premier des Giacobbi à franchir le pas, j’étais un pauvre type perdu pour la République !
De surcroît, si nos exportations ne sont guère florissantes, c’est parce que nous sommes frappés de folie. Nous voulons ainsi vendre en Inde des Rafale – quand tel sera le cas, je serai cardinal – et des centrales nucléaires à Jaitapur – là, je serai pape. Or, cela implique que le gouvernement de l’Union indienne réussisse à faire voter une loi rectificative – alors qu’il n’a pas réussi à faire passer un seul texte depuis six mois – modifiant une loi de 2010 prévoyant la mise en cause du constructeur étranger en cas d’accident nucléaire. Pendant que nous nous concentrons sur l’exportation d’énormes bêtes, les Allemands vendent 10 000 machines-outils ! De la même manière, il n’y a pas de quoi sauter de joie lorsque nous vendons un Airbus quand il serait bien plutôt préférable d’exporter mille pièces qui servent à le constituer !
Enfin, j’invite notre mission à se rendre à Gurgaon, en Inde, entre le Silver Center et les malls, pour y voir éclore la modernité. Ce n’est pas en Allemagne que cela se passe !
L’Occident s’effondre ! Alors qu’en 2005 la production automobile chinoise était loin derrière celle de l’Europe et de l’ensemble États-Unis–Mexique, les prédictions pour 2015 faisaient état d’une production de 17 millions de véhicules pour ces deux derniers pays contre 16 pour l’Europe et 13 pour la Chine. La réalité, en 2010, était la suivante : la Chine a produit 17 millions de véhicules, contre 12 pour l’Europe et 14 pour l’Amérique du Nord.
M. Pierre-Alain Muet. J’ai apprécié ces trois exposés car ils ont bien cerné la nature du modèle allemand : ni la compétitivité-prix ni la durée du temps de travail ne sont en cause. En fait, l’Allemagne innove et investit dans la R&D plus que nous ne le faisons et ses petites et moyennes entreprises en profitent, à la différence de ce qui se passe en France, sauf peut-être au sein des pôles de compétitivité.
Le modèle français d’un État centralisé a été très performant lors de la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, grâce au lancement de grands programmes industriels. Mais alors que la politique industrielle est aujourd’hui plus complexe et s’enracine dans un tissu local, le fédéralisme allemand constitue un avantage certain. De surcroît, même si les Allemands n’en parlent guère, ils ont mis en place des clusters ou des pôles de compétitivité depuis très longtemps, de manière qu’une innovation locale profite à l’ensemble des petites et moyennes entreprises qui gravitent autour des grandes entreprises quand, chez nous, perdure une assez forte division entre très grandes et petites structures. Enfin, le dialogue social, autre point fort de l’Allemagne, constitue un important facteur de compétitivité.
Monsieur Élie Cohen, considérez-vous que l’Allemagne, parce qu’elle a ignoré l’étape des grands projets colbertistes, ait été structurellement plus apte que la France à mener des politiques industrielles fines et complexes ?
Il me semble, par ailleurs, que le problème n’est pas tant le regard porté sur les entreprises que sur les industries. Les Français semblent avoir été beaucoup plus fascinés par les banques et le système financier. L’Allemagne a toujours considéré qu’il est important de maintenir une base industrielle forte. Plus précisément, l’un des atouts de ce pays me semble d’avoir toujours veillé à ne pas dissocier innovation et fabrication. L’Allemagne, en effet, n’a jamais cru que la R&D et l’assemblage suffiraient à maintenir la force de son économie, la production pouvant être quant à elle déléguée à d’autres pays – même si elle a procédé ainsi, à certains égards, avec la Pologne. Globalement, elle a toujours été attentive au maintien de l’ensemble de la chaîne industrielle.
M. Jean Grellier. Au fur et à mesure que se déroulent les auditions, nous parvenons aux mêmes constats quant à la compétitivité de l’économie.
Monsieur Élie Cohen, quelles recommandations formuleriez-vous pour mettre en place une véritable politique industrielle ? La crise que nous traversons étant plus structurelle que conjoncturelle, à quelle échéance une telle politique produirait-elle des résultats ? Quelle suite donneriez-vous aux états généraux de l’industrie et quelle vous paraît devoir être l’évolution des pôles de compétitivité ? Enfin, comment notre politique industrielle pourrait-elle s’intégrer au sein de l’Europe ?
Monsieur Jean-Philippe Bourgoin, comment analysez-vous l’inadéquation entre une remarquable capacité de recherche dans le domaine solaire et une pratique industrielle qui n’est pas compétitive ?
M. Élie Cohen. Quatre types de problèmes doivent être traités.
Le premier est d’ordre macro-économique. Que les résultats de nos entreprises soient les plus faibles d’Europe pénalise l’investissement, l’innovation et l’exportation. Si l’on veut qu’il en soit autrement, nous devons améliorer sensiblement les conditions de leur exploitation, lesquelles passent probablement par des transferts de charges pesant sur le travail vers d’autres assiettes fiscales. On ne peut en effet considérer que le coût du travail dans l’industrie moderne, à la différence de l’économie de variété ou de la différenciation, ne constitue pas un paramètre important. Les chiffres sont très impressionnants : nous sommes confrontés à un problème de court terme en ce qui concerne les niveaux d’activité, de résultats et de taux de marges.
La deuxième difficulté relève de l’écologie d’entreprise : comment faire croître les petites et moyennes entreprises afin qu’elles innovent et exportent ? De véritables maquis de dispositions ont vu le jour avec OSÉO, les financements en fonds propres et le grand emprunt, mais ces mesures doivent être stabilisées et consolidées.
Troisième problème : l’érosion de nos spécialisations, par exemple dans les secteurs automobile, aéronautique, du transport terrestre, de la pharmacie, du nucléaire – nous ne fabriquons plus de machines outils depuis longtemps. Parce que nous avons « perdu la main », notamment en raison de choix malheureux, nous nous devons de renforcer nos compétences. Le grand emprunt me semblant constituer en l’occurrence une méthode assez intelligente et originale plutôt, je me félicite de l’adoption de procédures qui, pour être assez longues et frustrantes, n’en sont pas moins intéressantes.
Quatrième problème, enfin : l’extraversion économique. Les grandes entreprises allemandes n’ont pas choisi de se développer sur un plan international en conservant, sur un plan national, le degré d’intégration qui était le leur : elles ont réfléchi à l’éclatement et à la localisation des différents maillons de la chaîne de valeur en acceptant un certain degré de délocalisation afin de mieux maîtriser les processus d’ensemble. L’économie française, quant à elle, a véritablement connu une panne de développement.
Par ailleurs, ce n’est pas une lubie récente que d’être obnubilé par le modèle allemand. Dès 1870, nous regardions ce qui se passait chez notre voisin. En 1890, nous sommes allés y étudier le système d’apprentissage avec la volonté de l’importer ; à l’issue de la Première Guerre mondiale, les missions Clémentel ont observé la structuration de l’industrie germanique, ses rapports avec la formation et les laboratoires de recherche ; après la Seconde Guerre mondiale, c’était au tour de l’industrie lourde et de la chimie de constituer pour nous de véritables modèles. Bref, depuis un siècle, l’Allemagne est une obsession française : nous essayons de l’imiter, et nous y échouons.
Alors qu’il serait sans doute utile, aujourd’hui, de nous plonger dans le cœur brûlant des économies émergentes, la zone euro et l’Union européenne n’en demeurent pas moins notre espace économique de référence, où se creuse un écart de plus en plus grand entre l’Allemagne et ses satellites, la France, les pays du Sud, ce qui pose des problèmes de compétitivité et de soutenabilité, à terme, de nos finances publiques et de nos déficits. Nous sommes donc contraints de nous intéresser aux évolutions des relations franco-allemandes. L’observation de la balance commerciale montre que nous avons partout perdu des positions à son profit, y compris au sein de la zone euro. Même si la réindustrialisation paraît difficile, elle est donc nécessaire. Faute de pouvoir compenser la dégradation continue de notre balance de biens par une amélioration de la balance des services ou des transferts de revenus, nous sommes condamnés à avoir une balance courante en déficit permanent : nous sommes en conséquence obligés d’accroître notre dette extérieure et d’imaginer une situation dans laquelle les actifs français permettront de régler nos dépenses courantes.
Enfin, nous avons le plus grand mal à gérer le passage d’un modèle économique aux vertus éminentes à un autre que nous ne savons pas encore pénétrer. La France a inventé le modèle des grands programmes – sur lequel j’ai d’ailleurs écrit Le Colbertisme high-tech –, qui a connu un grand succès. Mais ce modèle est devenu obsolète avec l’ouverture économique mondiale dans le cadre de l’Organisation mondiale de commerce, puis de l’intégration européenne, avec la création de l’euro et celle du marché unique. Nous n’avons pas été capables d’opérer un redéploiement vers les écosystèmes d’innovation, non plus que de rendre notre recherche plus efficace et mieux organisée ou de venir en aide aux petites et moyennes entreprises.
M. Jean-Philippe Bourgoin. Les comparaisons internationales en matière de R&D montrent que l’Europe a de grandes forces : une présence traditionnelle en matière de recherche fondamentale, de recherche appliquée et d’industrie. Chacun cherche à disposer de ce modèle, sachant qu’une faiblesse sur le maillon central de la recherche appliquée peut être compensée par un effort supplémentaire en faveur de la recherche fondamentale, comme à Taïwan, à Singapour ou aux États-Unis. De ce point de vue, la France et l’Allemagne doivent être classées dans le même groupe de pays, en dépit de leurs différences.
Mais l’Europe peine à faire émerger de nouveaux champions sur de grands secteurs économiques nouveaux. Si nous nous rapprochons du modèle allemand, nous ferons des progrès dans certains domaines, mais la compétition mondiale restera tout aussi vive !
Du point de vue des écosystèmes d’innovations constituées, l’Europe aujourd’hui n’a pas perdu. Dans certains secteurs, elle a eu tendance à faire produire ailleurs. Mais il reste encore, par exemple, une industrie automobile européenne – même si l’on peut souhaiter que la France y ait une place plus importante.
À ce sujet, je souhaiterais faire deux remarques. La première concerne les normes. La question de savoir qui va réussir à imposer la norme sur le véhicule électrique constitue un véritable enjeu : va-t-on voir émerger une protection vis-à-vis de l’industrie européenne produisant sur notre continent ?
Nous ne faisons pas à cet égard suffisamment d’efforts en France en matière de normalisation et de standardisation. Par comparaison, le Président Obama vient de déclarer qu’il voulait augmenter de 54 % les moyens consacrés à la National Science Foundation dans le domaine de la recherche fondamentale, au Department of Energy dans celui de la recherche sur l’énergie, et au National Institute of Standards and Technology concernant les standards et les normes. De même, j’ai visité un institut à Pékin, l’automne dernier, qui consacrait la moitié de son activité dévolue aux nanotechnologies à l’établissement de standards et de normes.
L’autre remarque est que, du point de vue des innovations, l’ensemble de notre système industriel doit suivre. Car le marché est confronté à l’arrivée de nouveaux « entrants » : le constructeur automobile chinois BYD indique clairement que, s’il n’a aucune chance sur un moteur électrique constitué de 1 400 pièces différentes, il a en revanche toutes ses chances sur un véhicule et un moteur électriques d’une centaine de pièces.
En ce qui concerne les freins à l’industrialisation européenne, la direction générale de la compétitivité n’a pas toujours facilité l’implantation de grands projets industriels sur notre continent. L’Europe a mis quelquefois jusqu’à deux ans pour donner son accord sur les projets relatifs aux applications industrielles et informatiques, risquant ainsi de conduire à une disparition complète de l’activité dans ce domaine, le secteur s’étant entre-temps reconstitué : la direction générale de la compétitivité s’est assuré que la compétition existait entre les pays européens, mais ne s’est pas posé la question de savoir si nous étions en train de perdre pied vis-à-vis de la concurrence extérieure.
Au sujet des exportations que vous qualifiez de « folies », monsieur Paul Giacobbi, il existe des contre-exemples de petites et moyennes entreprises françaises réussissant à vendre en Chine ou au Kazakhstan, tels certains équipementiers d’énergie solaire vendant des fours de fabrication de lingots. La question est de savoir comment on accompagne ces entreprises. À cet égard, la combinaison des pôles de compétitivité, des organismes de recherche technologique et du soutien de l’État, notamment au travers d’investissements d’avenir, va dans le bon sens.
À côté de la réponse macro-économique globale, notre compétitivité repose sur la défense de chaque entreprise, au cas par cas, et nous avons, sur ce point, des chances de gagner.
S’agissant du solaire, il faut prendre en considération la part de carbone qui peut être évitée. Or, la production du silicium coûte très cher en carbone. Les panneaux solaires chinois, largement vendus en France, dans la mesure où ils sont moins chers, sont neutres en carbone au bout de vingt-cinq ans et offrent une garantie d’une dizaine d’années, tandis que les panneaux français, certes un peu plus chers, sont neutres en carbone au bout de trois à cinq ans et sont garantis pour trente ans. Ce point peut constituer une donnée différenciante, même si ce n’est pas celle qui a prévalu jusqu’ici, du fait des incitations existantes.
Le différentiel de prix ne résulte pas d’une différence de coût de main-d’œuvre – celui-ci représentant moins de 10 % du coût de production des modules solaires –, mais d’investissements dans les machines-outils et l’outil de production : les industriels chinois ont consenti ces investissements pour leur marché intérieur et leurs exportations, contrairement à l’industriel français, qui enregistre pourtant des performances remarquables. Nous ne souffrons pas d’un manque de couplage entre la recherche et l’industrie.
M. Marc Laffineur, président. Le fait d’avoir acheté l’électricité au prix initialement prévu a-t-il incité à choisir le matériel chinois plutôt que le matériel français ?
M. Jean-Philippe Bourgoin. L’État a pris conscience de ce différentiel de prix et le problème du taux de rachat a fait l’objet d’une compensation. Les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens : toutes les conditions sont réunies pour que nous disposions d’une filière nationale. La question est de savoir si une puissance de 500 mégawatts est suffisante ou si elle devrait être portée à 800 ou 1 000 mégawatts.
M. Élie Cohen. Je suis en désaccord, pour plusieurs raisons.
D’abord, le différentiel de coût entre le panneau chinois et le panneau Photowatt est important, puisqu’il représente plus du tiers du différentiel de prix. Ce facteur explique que le producteur national Photowatt – lequel dispose de sites vieillots, n’a pas investi, ni été capable d’évoluer comme l’ont fait notamment les industriels chinois – soit aujourd’hui nettement non compétitif.
Deuxièmement, les décisions prises ne vont pas dans le bon sens : elles ont eu pour premier effet de tuer la filière solaire française au moment où elle se constituait, puisque le seul projet d’usine avec des technologies modernes et des coûts permettant de fabriquer en France à des prix compétitifs vis-à-vis des concurrents étrangers a été avorté.
Toujours est-il que la logique consistant à amorcer la pompe du développement du solaire en important des panneaux pour commencer à apprendre le métier, puis à développer une filière industrielle française, a été cassée : on continue aujourd’hui à importer des panneaux chinois, mais sans espoir de développer une telle filière.
M. Marc Laffineur, président. Qu’en pensez-vous, monsieur Jean-Philippe Bourgoin ?
M. Jean-Philippe Bourgoin. La part du panneau dans l’ensemble des ventes n’était pas dominante. De ce point de vue, les rectifications apportées me paraissent effectivement aller dans le bon sens.
Certes, il est regrettable que les propriétaires de l’usine dont vous parlez aient renoncé à l’installer.
M. Élie Cohen. C’est une conséquence…
M. Jean-Philippe Bourgoin. Ils ont pris cette décision rapide parce qu’ils ont jugé que la France adoptait, comme d’autres pays, des mesures tendant à réduire rapidement le tarif de rachat, supprimant ainsi tout effet d’aubaine.
M. Élie Cohen. Pensez-vous qu’on ne crée des entreprises que lorsqu’il y a des effets d’aubaine ?
M. Jean-Philippe Bourgoin. Pour certaines, oui.
M. Élie Cohen. Ne pensez-vous pas que les choix industriels soient fondés sur la prévisibilité d’un marché sur dix ans ?
M. Jean-Philippe Bourgoin. La décision a été prise rapidement en raison de changements rapides et d’une imprévisibilité en matière de retour sur investissement. Je suis plus optimiste que vous sur l’augmentation du parc installé en France.
Mme Bénédicte Zimmermann. Au sujet du modèle allemand, l’articulation entre formation initiale et formation continue m’apparaît comme un enjeu important pour la compétitivité.
À cet égard, le fort clivage existant en France entre les grandes écoles dont sont issus nos cadres dirigeants, politiques ou industriels, et le reste du système de formation destiné à tous ceux qui n’ont pu y accéder, est extrêmement nuisible et peut expliquer le désamour des Français pour leurs entreprises.
On parle beaucoup aujourd’hui de la formation « tout au long de la vie », qui constitue un pilier de la flexicurité selon la Commission européenne, dans une communication consacrée à cette question. Mais cette formation n’existe quasiment plus en France, en dépit du droit individuel à la formation et des réformes portant sur la formation professionnelle.
Selon une enquête, les politiques de formation en France, lesquelles se situent à des niveaux supérieurs à celles des entreprises allemandes au regard notamment des cours suivis ou des taux de fréquentation, ont des effets moins importants qu’outre-Rhin.
Dans notre pays, les politiques de formation continue tendent essentiellement à adapter les compétences des salariés à leurs fonctions ou à leur poste, mais ouvrent peu de perspectives d’évolution ou de développement professionnel ou de carrière. En Allemagne, elles permettent de passer du grade d’ouvrier à celui de chef d’entreprise.
Les formations « sur le tas », liées à l’activité de travail, et les formations professionnalisantes obtiennent de bien meilleurs résultats en Allemagne.
Une réflexion doit être menée sur trois points : le système de production des qualifications, qui, en France, est très compliqué et relativement éloigné des réalités du marché du travail, l’optimisation du système de financement pour la formation continue, et le rôle du dialogue social dans celle-ci et le développement professionnel.
M. Olivier Carré. En ce qui concerne le secteur solaire, qui constitue un bon exemple en matière de compétitivité, la France disposait, dans les années 1970 et 1980, de spin-offs du Commissariat à l’énergie atomique travaillant en collaboration avec la Compagnie générale d’électricité sur des positions de leadership concernant l’optronique ou la photonique, qui déboucheraient plus tard sur le développement de la filière. Nous avions donc la possibilité de développer celle-ci, que toutes les études internationales, y compris le Commissariat général du plan, décrivaient comme une filière d’avenir. En témoigne l’exemple pionnier de Font-Romeu, où a été produit le premier four solaire au monde. Or, il a fallu attendre le Grenelle de l’environnement et que le prix du pétrole dépasse 100 dollars le baril pour que le solaire se développe en France, puis que nous soyons alertés au sein de la Commission des finances sur la nécessité de revoir la dépense fiscale correspondante.
Il est choquant que ce soit une décision fiscale de l’État qui ait été le facteur déclencheur d’une filière, dont les déterminants doivent être appréciés sur le long terme et dont les fondamentaux au départ étaient bons. Il est regrettable que nous ayons en quinze ou vingt ans laissé péricliter nos acquis dans ce domaine, puis que nous ayons brutalement développé ce secteur à l’aide d’un avantage fiscal, qu’il a fallu par la suite revoir.
Quel éclairage pouvez-vous nous apporter sur l’articulation entre les actions de court et de long terme ?
M. Élie Cohen. Le cas du solaire est important, dans la mesure où il est limpide.
L’Allemagne, qui n’a pas d’avantage climatique particulier, a réussi à développer une formidable industrie solaire et éolienne sur son territoire grâce à des politiques adaptées et à un engagement clair en faveur des énergies renouvelables. Elle se situe aujourd’hui au premier rang mondial de l’industrie solaire, dont le développement a été déclenché au départ par une incitation de l’État.
Vous avez eu raison de rappeler les débuts de l’industrie solaire française et les percées technologiques de notre pays à l’époque. Ensuite, du fait de l’évolution du prix du pétrole et de ce que l’énergie solaire coûte dix fois plus cher que l’énergie tirée du nucléaire amorti, la filière n’a pu se développer dans notre pays.
Mais avec le Grenelle de l’environnement et l’engagement en faveur des énergies renouvelables, il a été décidé de créer une filière solaire sur le territoire national à partir d’un système de prix incitatif permettant l’émergence d’un marché. Dès lors, des projets de développement sont nés, comme l’usine de Blanquefort. Comme un partenariat avec Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles garantissait l’achat de la production sur dix ans, il fallait aux industriels une visibilité, que les décisions prises ont supprimée.
Un partenariat existait avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, tendant à développer des filières technologiques sur notre territoire, lesquelles devaient prendre le relais de la technologie First Solar, qui avait déjà fait ses preuves : certaines, comme l’hétérojonction, devaient faire l’objet d’investissements dans le cadre de la commission sur le grand emprunt. Or tout cela est maintenant mis à bas.
M. Jean-Philippe Bourgoin. Je vous rejoins sur l’historique de la filière et les freins qui l’ont empêchée de se développer, liés notamment à la baisse du prix du pétrole.
S’agissant des perspectives de reprise de secteur sur le plan national, les éléments de production – cellules, modules, panneaux, par exemple – avec tout l’outil associé et une politique d’intégration au bâti constituaient un ensemble cohérent.
Certes, il faut que les politiques publiques de l’énergie soient lisibles et se traduisent dans le développement de filières industrielles. Mais il faut aussi que l’ensemble du secteur solaire s’appuie sur une forte production nationale. L’Allemagne n’a pas hésité à importer, et encore récemment, du fait de ses incitations fiscales, des panneaux solaires chinois. Le reste de la filière allemande a fonctionné et les équipementiers ont continué à exporter. Il est nécessaire à cet effet de définir un seuil de marché qui soit suffisant, ce qui n’est probablement pas encore le cas aujourd’hui.
*
AUDITION DU 30 MARS 2011
Audition de M. Bruno Cercley, président de Rossignol, de M. Vincent Delozière, directeur général de Refresco France, de M. Edmond Kassapian, président-directeur général de Geneviève Lethu, et de M. Didier Sauvage, membre du directoire et directeur de la technologie de 3S Photonics.
M. le président Bernard Accoyer. Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui M. Bruno Cercley, président du groupe Rossignol, implanté en Isère. Pour la saison 2010-2011, Rossignol devrait réaliser un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros grâce à quelque 1 200 salariés dont plus de la moitié est employée en France. Votre groupe, c’est notable, a choisi de relocaliser une partie de ses activités dans notre pays.
Nous entendrons également M. Vincent Delozière, directeur général de Refresco France, une filiale du groupe hollandais Refresco située dans la Drôme. Cette entreprise emploie 510 salariés et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros.
M. Edmond Kassapian est quant à lui président-directeur général de Geneviève Lethu, une entreprise dont le siège se trouve en Charente-Maritime mais qui possède 110 magasins dans le monde. Elle emploie une centaine de salariés et son chiffre d’affaires, en 2010, s’élevait à 37 millions d’euros. Comme le groupe Rossignol, Geneviève Lethu a mené une politique de relocalisation de sa production en France.
M. Didier Sauvage, enfin, est membre du directoire et directeur de la technologie du groupe 3S Photonics, situé dans l’Essonne. Cette entreprise, l’un des leaders mondiaux des composants optoélectriques pour les réseaux de télécommunications, a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 57 millions de dollars et employait 365 collaborateurs, dont 170 en France.
Avant de vous donner la parole, messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. Jérôme Cahuzac, président de la Commission des finances, de l’économie général et du plan, et de M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des affaires sociales, qui sera suppléé par M. Pierre Morange.
M. Bruno Cercley, président de Rossignol. Si le groupe Rossignol a traversé une période très difficile ces deux dernières années, il demeure leader mondial dans son secteur avec un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Implanté en Europe de l’ouest, en particulier en France – à Nevers et en Haute-Savoie – où la moitié de son personnel est employée, en Espagne et en Italie où il possède des sites de fabrication de skis et de chaussures alpines, son réseau de sous-traitance s’étend en revanche en Europe de l’est et en Chine. Nous bénéficions donc d’une expérience historique des avantages et des inconvénients de la production de différentes catégories de produits dans plusieurs zones géographiques, ce qui nous permet de prendre rapidement des décisions concernant la localisation de nos productions.
Je tiens à délivrer trois messages aux membres de cette mission d’information.
D’abord, il n’existe pas de pays sans économie et pas d’économie sans industrie. Tout ce qui peut être accompli pour renforcer le secteur industriel doit l’être, afin de consolider nos grands équilibres. Je suis très heureux d’avoir réorganisé la production en France d’un groupe français, mais mon objectif premier n’est pas d’y protéger artificiellement l’emploi. Ma mission consiste à assurer la pérennité et le développement de Rossignol et la décision de relocaliser a été prise car je suis profondément convaincu qu’une forte implantation en Europe de l’ouest et, en particulier, en France – pays majeur dans le métier du ski – est nécessaire pour le bien de l’entreprise.
Ensuite, la compétitivité repose sur deux piliers : d’une part, les coûts – en particulier dans un contexte de mondialisation – dont les structures doivent être adaptées ; d’autre part, l’innovation. L’un sans l’autre serait inutile, comme en atteste l’exemple des développements divergents récents de Ford et de Toyota aux États-Unis. Alors que le premier se désengageait de ce pays en raison de la structure des coûts, le second y investissait massivement, notamment dans l’innovation, ce qui lui a permis de passer devant son concurrent. De ce point de vue là, le dispositif français de crédit d’impôt recherche, qui doit être protégé, se révèle extrêmement positif car notre métier implique des renouvellements de gammes nécessitant de rechercher constamment des idées nouvelles et d’investir fortement dans la recherche et le développement.
On considère souvent la Chine comme un pays où les coûts de production sont bas. Or, en tenant compte du coût de la main-d’œuvre et de celui du transport des produits, s’y délocaliser relève d’une politique de court terme et non d’une stratégie de long terme, sauf si le marché local asiatique devait se développer – dans ce cas, nous y serions d’ailleurs beaucoup plus présents. Aujourd’hui, cependant, nous devons nous méfier de la capacité de plus en plus grande de la Chine à innover : d’ici deux ans, elle publiera plus d’articles dans des revues scientifiques que les États-Unis. Là se trouve le véritable danger pour nos industries, qui ont tout intérêt à ne pas se laisser dépasser. Les entreprises françaises gagneront ou perdront des parts de marché selon qu’elles auront su ou non renforcer l’innovation et la compétitivité intellectuelle.
Enfin, un petit « cocorico », si je puis me permettre : lorsqu’une entreprise comme Rossignol gagne un championnat du monde grâce à Jean-Baptiste Grange dont les skis sont frappés de l’effigie du coq gaulois et que nous contribuons ainsi à la fierté du public, s’engage un véritable cercle vertueux pour notre entreprise, pour notre pays mais également à l’étranger. N’ayons pas peur d’être fiers de notre magnifique pays et de ce que l’on y crée ! Notre productivité est l’une des meilleures du monde !
M. Vincent Delozière, directeur général de Refresco France. Refresco France fabrique des jus de fruits et des boissons sans alcool pour des marques de distributeurs comme U, Leclerc ou Carrefour, et travaille pour des donneurs d’ordres et des opérateurs marketing comme Coca-Cola, Pepsi-Cola ou Orangina-Schweppes. En France, nous employons 500 salariés répartis sur trois sites de production. Nous appartenons à un groupe européen qui compte plus de 3 000 personnes et nous avons trois moteurs de croissance : l’innovation, le développement durable et nos salariés.
Au sujet de la compétitivité de l’industrie agroalimentaire, trois problématiques doivent être évoquées.
La première concerne la croissance et le développement. Nous avons la chance de ne pas pouvoir produire de boissons en Chine, en raison des dates limite de consommation et des modalités de transport qui seraient très contraignantes. Nos concurrents sont donc européens. Nous avons également la chance de bénéficier d’un marché français dynamique, exigeant et innovant. Notre développement nécessite donc des investissements. Si nous créons des emplois et si nous nous efforçons de créer de la valeur, l’accompagnement de notre croissance pâtit néanmoins d’une certaine lenteur administrative. En voici trois exemples.
Il est nécessaire de remplir un dossier d’installation classée pour la protection de l’environnement avant de créer une nouvelle ligne de production, laquelle coûte environ 15 millions d’euros, quand un investissement pour une usine s’élève à 100 millions d’euros. Nous avons déposé un dossier au mois d’octobre 2009 en vue de créer une nouvelle ligne de production sur notre site de Saint-Alban-les-Eaux. Seize mois plus tard, nous n’avons toujours pas reçu l’autorisation ! Toutefois, comme il était essentiel pour nous de ne pas perdre ce marché, nous avons, la semaine dernière, mis en route cette ligne de productions pour le donneur d’ordres PepsiCo, dont nous fabriquons la marque Lipton.
Ensuite, l’accessibilité de ce site, où nous employons environ 150 personnes, demeure difficile alors que chaque jour y arrivent plus de 300 camions. En 2008, le conseil général a décidé de construire un rond-point : à ce jour, il n’est toujours pas construit.
Enfin, en tant que filiale d’un groupe, Refresco France n’est pas considérée comme une entreprise moyenne et ne peut donc plus recevoir d’aides publiques. Or, nous sommes en concurrence avec nos homologues des autres pays européens où notre groupe compte 28 usines. L’une des filiales de Refresco a investi dans un entrepôt situé dans l’est de l’Allemagne à hauteur de six millions d’euros, dont 30 % proviennent d’aides publiques. Dans le Loiret, une PME familiale, réalisant 350 millions d’euros de chiffre d’affaires, a investi 15 millions d’euros dans notre pays et a bénéficié d’une aide à hauteur de 25 %. En ce qui nous concerne, nous avons investi en France ces neuf dernières années 95 millions d’euros et nous avons créé plus de 130 contrats à durée indéterminée sans jamais avoir reçu d’aides publiques. Même s’ils nous ont jusqu’à ce jour toujours suivis, nos actionnaires choisissent malheureusement des projets plus profitables et moins consommateurs de liquidités.
La deuxième problématique concerne la qualification et la formation ainsi que, plus globalement, les ressources humaines.
Avec les investissements que nous réalisons dans de nouvelles lignes de production, nous avons besoin d’une véritable expertise. Or le marché français de l’emploi et de la formation professionnelle n’est pas toujours adapté à nos besoins : des bacheliers professionnels pourraient fort bien occuper des postes d’opérateurs sur machine mais nous sommes contraints de recruter des personnes disposant d’un « bac + 2 » ; les techniciens se recrutant quant à eux entre « bac + 3 » et « bac + 5 » sans qu’ils puissent d’ailleurs pouvoir faire partie de l’encadrement pour des raisons de coûts.
La formation en alternance, en revanche, constitue un excellent moyen pour accompagner les jeunes. Nous embauchons ainsi vingt apprentis par an qui forment un véritable vivier de nouvelles compétences. À Roanne, où nous avons créé la nouvelle ligne de production ainsi qu’une trentaine d’emplois, nous avons mis en place un pôle d’apprentissage en partenariat avec Pôle emploi. Nous nous sommes également regroupés avec d’autres entreprises agroalimentaires afin de mettre en place une véritable filière de formation professionnelle et d’embaucher, finalement, ces jeunes dans nos usines. Chaque année, nous investissons 5 % de notre masse salariale, soit environ un million d’euros, dans la formation – ce qui est cinq fois plus que l’obligation légale. J’ajoute que si, en Rhône-Alpes, nous n’avons reçu depuis dix ans aucun soutien financier pour former nos jeunes, nous avons été aidés en Bourgogne à hauteur de 50 %, soit près de 200 000 euros pour les trois dernières années. Nous ne pouvons bien évidemment que tenir compte de ces différentes pratiques régionales…
La troisième problématique, enfin, concerne l’augmentation du prix des matières premières. En 2010, elle s’est élevée pour nous à environ 10 millions d’euros. La grande distribution refuse de répercuter ces hausses, car elle ne souhaite pas, à ce jour, augmenter le prix de vente aux consommateurs. À ce propos, il me semblerait bénéfique de ne plus légiférer sans cesse sur les relations entre commerces et grande distribution, qui sont d’ailleurs défavorables aux petites et moyennes entreprises, toujours situées entre le marteau et l’enclume. Refresco travaille avec trois fournisseurs brésiliens qui livrent 95 % des jus de fruits en Europe. Ces derniers, inutile de le préciser, se rencontrent régulièrement et leurs prix sont identiques. Si nous voulons continuer de livrer nos six clients de la grande distribution, nous sommes donc contraints d’accepter les hausses de prix. Et si l’on ne veut pas mettre en péril notre tissu économique et nos emplois, la hausse des prix de vente aux consommateurs est inéluctable – elle a d’ailleurs commencé.
M. Edmond Kassapian, président-directeur général de Geneviève Lethu. J’ai la chance de représenter Geneviève Lethu, une petite et moyenne entreprise créée en 1972 à La Rochelle et dont le concept de départ était simple : il s’agissait de vendre dans un même magasin l’ensemble des articles concernant l’art de la table ainsi que des produits à l’unité, pour la première fois dans ce secteur. L’entreprise s’est développée avec un marché de moyenne et haute gamme, notamment à travers ses franchisés – là encore, Geneviève Lethu a eu un rôle de précurseur – tant en France qu’à l’étranger puisque, avec 110 magasins, nous sommes présents dans une trentaine de pays.
Nous exerçons essentiellement trois métiers : la création de collections et l’anticipation des modes de vie ; l’administration d’un réseau à l’échelle mondiale, bien que nous soyons une petite et moyenne entreprise d’une centaine de personnes ; enfin, la maîtrise des flux physiques se rapportant à l’ensemble des échanges.
En 2003, nous avons commencé à relocaliser notre production en France pour trois raisons principales : le non-respect des normes d’alimentarité et, donc, de qualité – notamment par les fabricants chinois ; l’augmentation de la contrefaçon, des coûts en Chine, du prix du pétrole et des importations ; la nécessité, pour développer notre concept d’art de vivre à la française qui plaît tant à l’étranger, de produire en France. Voilà pourquoi nous avons, en 2003-2004, recherché des industries nationales susceptibles de fabriquer nos produits.
Au cours de cette démarche de relocalisation, nous avons identifié trois problèmes.
Le premier porte sur les fonds propres des petites et moyennes entreprises. La relocalisation nous a conduits à collaborer avec des producteurs, qui ne peuvent être compétitifs que s’ils ont la capacité d’investir dans un outil de production. Or, les petites et moyennes entreprises rencontrent de réelles difficultés car le secteur bancaire traditionnel se montre rétif à leur égard et qu’elles n’intéressent pas, en général, les investisseurs en capital risque, qui réclament des rendements élevés. Celles qui le peuvent choisissent plutôt de s’endetter au lieu d’ouvrir leur capital par peur de l’inconnu. Cependant, si la relocalisation n’implique donc pas forcément des créations d’emplois, elle préserve de manière importante le savoir-faire français.
Le deuxième problème concerne la formation des chefs d’entreprises ainsi que l’incitation au groupement et à la fusion des petites et moyennes entreprises. Sur ce point précis, une barrière culturelle subsiste, pouvant d’ailleurs entraîner, à terme, une perte des savoir-faire car si nous faisons aujourd’hui fabriquer notre linge dans les Vosges et nos couteaux à Thiers, le jour où cette production cessera, nous serons contraints de nous fournir en Chine. Le niveau de connaissance économique global des patrons de petites et moyennes entreprises gagnerait quant à lui à être amélioré tant il est parfois difficile de faire comprendre à ces derniers ce que nous voulons en tant que marque mondiale et ce que cela implique en termes d’investissements pour eux. Il est donc dommage que les petits patrons ne puissent pas accéder à la formation – en l’occurrence, dans les domaines du management, du marketing et des finances – avec autant de facilité que les salariés.
Le troisième problème, enfin, a trait au travail et à son organisation. Nous devons faire preuve de créativité et d’adaptabilité dans un contexte socialement insécurisé. Chez Geneviève Lethu, les personnes qui s’en sortent, que ce soit dans les magasins que nous possédons en propre ou ceux qui sont franchisés, sont celles qui travaillent le plus – entre 50 et 70 heures par semaine. Tout développement, s’il n’en va pas ainsi, semble exclu. À cela s’ajoute la complexité du code du travail, laquelle effraie les entrepreneurs car mal rédiger une clause de non concurrence, par exemple, comporte le risque de poursuites judiciaires. Cette complexité est d’ailleurs accrue par une jurisprudence et des décisions prud’homales absolument illisibles : si, par malheur, l’une de nos employées emprunte, par inadvertance, de l’argent dans la caisse du magasin, c’est moi qui serai condamné faute d’avoir installé un système de sécurité assez fiable ! J’ajoute, et c’est une preuve supplémentaire de la nécessité de simplifier les procédures, que la rupture conventionnelle des contrats est plébiscitée autant par les patrons que par les salariés.
Je m’étonne, également, que de nombreux pays comme la Turquie, la Corée, l’Australie ou les États-Unis, érigent des barrières douanières et complexifient notre tâche lorsque nous voulons exporter chez eux. En Algérie, nos produits doivent passer des tests supplémentaires, alors que nos magasins respectent les normes européennes et américaines. Vendre des couteaux dans nos trois magasins marocains implique de s’acquitter d’une taxe douanière de 30 % en raison de l’existence d’une industrie coutelière dans ce pays. À l’inverse, n’importe qui peut vendre en France des produits fabriqués en Chine et qui ne sont pas aux normes, sans rencontrer de difficultés particulières. S’il convient de baisser le coût de la production dans notre pays, grâce, par exemple, à l’instauration d’une taxe à la valeur ajoutée (TVA) sociale, nous gagnerions aussi à taxer en douane des produits qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, comme le font par exemple les États-Unis sans que personne n’y trouve à redire.
M. Didier Sauvage, membre du directoire et directeur de la technologie de 3S Photonics. La société 3S Photonics fabrique les lasers d’émission ou d’amplification utilisés dans les fibres optiques qui permettent d’accéder à internet. Seuls trois producteurs travaillent dans ce secteur, les deux autres étant situés aux États-Unis. Plus précisément, notre société est issue d’une filiale d’Alcatel, Alcatel Optronics, qui a connu une très forte croissance en l’an 2000 avec 400 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 % de résultats nets, et qui employait 3 000 salariés dans le monde entier. En 2001, le marché a été divisé environ par dix avec, à la clé, de profondes restructurations suite à l’éclatement de la « bulle » des télécommunications : une partie de l’entreprise a été vendue aux États-Unis et, après que certaines de ses activités ont été délocalisées en 2005 en Thaïlande, seuls 150 salariés travaillaient encore en France. À la fin de 2006, enfin, la société mère américaine a cédé cette activité, virtuellement en dépôt de bilan. Le président Alexandre Krivine et moi-même l’avons alors rachetée quand le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 10 millions d’euros pour un montant de pertes à peu près équivalent. Nous nous sommes donné un an pour redresser la situation financière de l’entreprise et nous avons décidé d’investir fortement dans l’innovation, la fabrication de semi-conducteurs relevant de la très haute technologie. Outre qu’une usine coûte environ 100 millions d’euros, nous devons absorber des coûts fixes particulièrement élevés. Grâce au redémarrage du marché, nous avons séduit de nombreux clients, surtout à l’étranger où nous réalisons 95 % de notre chiffre d’affaires dont plus de la moitié en Asie. Un an après, notre chiffre d’affaires était de 25 millions d’euros et nous avions à peu près atteint notre équilibre opérationnel.
Alors que la moitié de notre chiffre d’affaires provient de produits dont la création date de moins de dix-huit ou de douze mois, nous avons continué à investir dans la recherche et le développement à hauteur de 15 % de nos ressources. Soucieux d’atteindre un seuil critique en termes de taille, nous avons procédé à une ouverture de notre capital de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros qu’a investis le fonds stratégique d’investissement, tout en veillant à en garder la majorité – il s’agit d’ailleurs là d’un point important pour les petites et moyennes entreprises. 3S Photonics compte désormais 180 salariés en France – contre 110 au mois d’avril 2007 – et 170 au Canada où nous avons acquis une entreprise qui travaille dans un domaine voisin. Notre chiffre d’affaires devrait s’élever à 33 millions d’euros en France et à 20 millions d’euros dans ce dernier pays.
Afin d’accompagner cette croissance et alors que les cycles de production sont assez longs puisqu’ils varient de six à neuf mois, nos besoins en fonds de roulement sont très élevés ; or la trésorerie a souvent du mal à suivre. Il est évident que la crise de 2009 a été difficile à surmonter, les banques ayant fait preuve d’une frilosité certaine à la différence d’OSÉO, partenaire précieux sans lequel nous n’aurions vraisemblablement pas pu réaliser une telle croissance.
Sur le front de l’innovation et de la recherche et le développement, nous travaillons beaucoup avec des laboratoires de recherche académiques et industriels. Les financements sont assurés grâce aux fonds propres mais également par nos clients ainsi qu’à travers des aides publiques. De ce point de vue là, le crédit d’impôt recherche constitue un outil essentiel et très attractif, à tel point que certains de nos concurrents s’y intéressent et envisagent d’investir dans notre pays.
Nous avons également bénéficié du statut de jeune entreprise innovante mais cela ne durera pas compte tenu de notre taille. Travaillant beaucoup avec des petites entreprises de très haute technologie, je considère à ce propos que le plafonnement de l’exonération de charges sociales lié à ce statut a des conséquences dramatiques pour elles et contribue en particulier à freiner considérablement leur croissance. Cette année, l’évolution du crédit d’impôt recherche et du statut de jeune entreprise innovante nous coûte par exemple 1,5 million d’euros, somme grossièrement équivalente au résultat net que nous avions réalisé l’année dernière et qui est anéantie.
M. le président Bernard Accoyer. Pourriez-vous préciser ce point ?
M. Didier Sauvage. Parmi les dépenses retenues pour bénéficier du crédit d’impôt recherche figurent les salaires ainsi que les dépenses de personnels dont le taux forfaitaire est passé de 75 % à 50 %. Les exonérations de charges liées au statut de jeune entreprise innovante sont quant à elles désormais soumises à un plafond de 100 000 euros. L’impact de cette réforme a été considérable pour une entreprise comme la nôtre qui emploie beaucoup d’ingénieurs et de chercheurs puisque nous sommes passés de 700 000 à 100 000 euros d’exonérations.
M. Éric Woerth. Quel a été l’impact de la réforme de la taxe professionnelle ?
M. Didier Sauvage. Elle a changé de nom mais le montant du prélèvement reste identique.
J’ajoute que nous bénéficions d’aides partielles dans le cadre de projets européens ou liés aux pôles de compétitivité, mais aussi de la part de l’Agence nationale de la recherche. Si de tels dispositifs sont bien entendu pertinents, leur multitude les rend néanmoins incompréhensibles pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Issue, donc, d’Alcatel et travaillant avec de grands groupes, 3S Photonics parvient à s’y retrouver, mais la charge administrative de tels processus est très forte et l’on gagnerait à les simplifier et à les alléger. Sans doute les pôles de compétitivité, dont la structure est relativement souple, sont-ils les mieux adaptés aux exigences contemporaines, si l’on excepte toutefois les problèmes de zonages, qui favorisent plus la compétition entre les régions que les synergies. Une telle situation est d’autant plus dommageable que, compte tenu de la taille de notre pays, ce ne sont pas les départements ou les régions qui, en matière de haute technologie, peuvent organiser la concurrence avec les États-Unis.
En Asie, nous employons 150 personnes dans le cadre de la sous-traitance. Cela peut être intéressant pour certains produits mais pas pour ceux dont la valeur ajoutée est très élevée, comme les composants destinés aux liaisons transatlantiques, dont le niveau de fiabilité requis est très important. Si le coût de la main-d’œuvre ne constitue pas forcément une question fondamentale, la relocalisation d’activités peut en revanche coûter très cher - 14 millions d’euros, pour un dossier actuellement à l’étude. Nous examinons avec le ministère de l’industrie ainsi que les régions le moyen de le financer, mais, depuis dix-huit mois et malgré la bonne volonté dont nos interlocuteurs font preuve, nous n’avançons guère en raison notamment de mécanismes administratifs complexes, y compris pour ceux qui sont chargés de les appliquer.
M. Christian Estrosi. Je salue les quatre dirigeants d’entreprise dont les interventions témoignent qu’en 2009 et 2010, au plus fort de la crise, la politique menée dans notre pays les a incités à relocaliser une partie de leurs activités en France, comme cela a d’ailleurs été également le cas de Petrol Hahn à Reims, du Coq sportif, de la chocolaterie Cémoi à Perpignan ou de la fonderie Loiselet en Eure-et-Loir. Pourquoi un tel mouvement ? Vous avez donné quelques éléments de réponse mais, en même temps, vous avez rappelé les difficultés auxquelles vous continuez d’être confrontés en matière de compétitivité. Quoi qu’il en soit, seule la poursuite d’un tel mouvement montrera que vous avez eu raison de revenir.
Vous avez également insisté sur le savoir-faire français et l’intérêt du crédit d’impôt recherche, mais aussi sur les problèmes liés à la planification et à la production. En relocalisant vos entreprises, retrouvez-vous systématiquement la main-d’œuvre qualifiée dont vous avez besoin pour produire, mais aussi pour innover et chercher ?
Lorsque j’ai visité votre entreprise, monsieur Didier Sauvage, vous m’aviez dit que la différence du coût de la main-d’œuvre entre l’Asie et la France ne justifie pas forcément une délocalisation, en raison notamment d’un certain nombre de fragilités quant à la qualité de l’outil de production et aux relations avec la clientèle. Si le fonds stratégique d’investissement a joué un grand rôle d’accompagnement et si vous avez rappelé combien la prudence recommande de conserver la majorité au sein d’une entreprise, il n’en reste pas moins que le premier a vocation à se retirer dès lors que la seconde a trouvé sa vitesse de croisière.
Sur le plan de la fiscalité, je rappelle qu’à l’initiative du Président de la République, nous avons supprimé 11 à 12 milliards d’euros de taxe professionnelle au 1er janvier 2010. Néanmoins, j’ai le sentiment que la suppression de prétendues « niches fiscales » dans le projet de loi de finances pour 2011 a repris une partie du produit des marges de manœuvre qui avait été ainsi dégagées. J’avais demandé à la Commission des finances, de l’économie générale et du plan de se montrer très attentive à ne pas remettre en cause les grands équilibres du crédit d’impôt recherche, mais les critères d’éligibilité n’en ont pas moins été modifiés, fût-ce de façon marginale, ce qui n’a pas manqué d’avoir des répercussions sur les chiffres d’affaires que vous avez réalisés. Ceux qui ont jugé qu’en procédant ainsi on éviterait les effets d’aubaine se sont trompés, d’autant que la recherche et développement et l’innovation sont les clés de la compétitivité de demain. Pourriez-vous nous éclairer un peu plus sur ce point ?
Vous avez attiré notre attention sur le zonage des pôles de compétitivité en soulignant leur décalage avec les clusters américains. Devons-nous réfléchir à un élargissement des périmètres voire à la définition d’un périmètre national ou même européen, sachant que l’établissement des zonages est tributaire des règles européennes de la concurrence ?
La « marque France », quant à elle, comporte-t-elle une valeur ajoutée ? Notre compétitivité internationale n’est-elle pas par exemple accrue lorsqu’une paire de skis Rossignol est fabriquée chez nous avec un maximum de composants français ? J’imagine qu’un sac Vuitton fabriqué en Chine ne rencontrerait aucun succès.
Enfin, monsieur Didier Sauvage, qu’en est-il plus précisément des difficultés administratives auxquelles vous êtes confronté en matière d’aide à la relocalisation ? Le Parlement pourrait peut-être formuler quelques propositions, afin d’alléger les procédures en vigueur.
Mme Marie-Hélène Thoraval. Nous sommes d’accord avec vous, monsieur Bruno Cercley, lorsque vous affirmez que notre pays a besoin d’une industrie forte. Néanmoins, votre intervention comportait un aspect un peu inquiétant puisque, si jusqu’à présent que la Chine était réputée pour sa pratique des contrefaçons, vous avez souligné sa capacité d’innovation. Comment appréciez-vous plus particulièrement cette dernière et comment la gérez-vous sur les court, moyen et long termes ?
Notre politique de formation en alternance a quant à elle été plébiscitée – M. Vincent Delozière s’en est fait l’écho. Toutefois, outre que nous devons évoluer sur ce plan en fonction des demandes des entreprises, qu’en est-il de la formation tout au long de la vie ? Estimez-vous que les dispositifs actuels sont suffisants ? Si tel n’est pas le cas, que préconiseriez-vous ?
Vous avez également rappelé les lenteurs administratives auxquelles vous avez été confrontés et nous devons en prendre bonne note, en particulier s’agissant des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement. Quels sont les atouts dont disposent nos entreprises lorsqu’elles entrent en concurrence avec leurs homologues d’un même groupe – par exemple, en Europe – quel que soit le montant de la subvention qui peut être allouée à ces dernières ?
Enfin, le « Made in France » constitue-t-il un avantage concurrentiel sur le marché mondial ?
M. Christian Blanc. Cette audition est porteuse d’espérances, mais, en tant que chefs d’entreprise, est-ce par patriotisme ou par intelligence que vous procédez à des relocalisations ? La représentation nationale ne doit pas se tromper. En tant que chef d’entreprise français, j’ai plutôt envie de développer mon entreprise en France mais je suis d’abord un responsable et, comme tel, je dois disposer de conditions qui me donnent envie de travailler dans mon pays.
Voilà une dizaine d’années, M. Jean-Pierre Raffarin m’avait confié une mission sur l’économie de l’innovation et j’avais conclu que la création de pôles de compétitivité s’imposait. J’y avais également étudié la situation des couteaux de Laguiole et de Thiers, lesquels, normalement, auraient dû disparaître et dont le rayonnement est pourtant mondial. Comment expliquer cette situation ?
Le groupe Rossignol, quant à lui, délocalisait alors une grande partie de sa production en Italie. Je me suis rendu dans ce pays et j’ai discuté avec les responsables de l’entreprise qui me confièrent que la prochaine étape était la Roumanie. J’ai alors compris que, dans l’économie de l’innovation, c’est l’amont et l’aval de la production qui créent de la valeur et de la richesse. Nous devons être parfaitement au clair sur cette question au terme de nos travaux, car les conséquences sont majeures dans tous les domaines, depuis la formation professionnelle jusqu’à l’organisation globale des entreprises. En amont se situe la recherche, laquelle doit permettre de susciter l’innovation et, en aval, se trouve le client. C’est un cercle vertueux entre ces deux pôles qu’il s’agit d’enclencher.
De plus, la proximité d’un marché de haut niveau de consommation et de sophistication constitue un élément d’innovation tout aussi important que l’innovation spécifiquement technologique. Disposer de tels marchés pouvant contribuer à raccourcir les cycles constitue un véritable atout compétitif pour notre pays.
L’organisation est une de mes marottes, et je crois en effet que la question des territoires est essentielle. Il ne s’agit pas de créer des clusters européens mais, comme à Saclay ou dans la Plaine Saint-Denis, de déterminer, dans tous les domaines, des tailles critiques pour les pôles de compétitivité.
Vous avez parlé de familles au sein d’un même métier. Cela peut se traduire par un essaimage, mais aussi par la nécessité de travailler ensemble, ce qu’ont d’ailleurs fait les Italiens pendant de nombreuses années avec les districts industriels. Quelle organisation territoriale est-elle susceptible de favoriser la compétitivité de l’économie ? Dans ce domaine, certaines collectivités donnent l’exemple, comme la région Rhône-Alpes ou le département de la Vendée, qui obtient des résultats remarquables avec peu de moyens.
M. Éric Woerth. Qu’est-ce que vos concurrents allemands ont de plus ou de moins que vous sur le plan de la compétitivité ? Compte tenu de votre expérience, quelles pistes souhaiteriez-vous nous voir suivre ? Qu’est-ce qui pourrait faire que, dans un avenir proche, des entreprises telles que les vôtres soient plus compétitives qu’elles ne le sont aujourd’hui ?
M. Vincent Delozière. Dans le secteur agroalimentaire, le marché allemand est aujourd’hui dominé par le hard discount. Depuis quatre ans, nous perdons de l’argent en Allemagne, bien que nous soyons très compétitifs. Il s’agit d’une question de marges, et non de coûts. Nous avons fermé deux usines en deux ans, ce qui explique les aides octroyées par le gouvernement allemand pour conserver les emplois locaux. Dans le domaine de la boisson comme dans celui des produits frais, le marché n’y est pas dynamique.
L’innovation, un marché dynamique et les habitudes de consommation en France permettent aux entreprises qui y sont implantées de réaliser des profits. Tout le monde évoque la question du pouvoir d’achat, mais depuis que la marque Nutella est distribuée chez Lidl, les ventes de la pâte à tartiner concurrente proposée par ce distributeur ont été divisées par trois… Si le consommateur accepte de payer deux euros de plus pour acheter la marque Nutella, c’est donc qu’il est en mesure de faire des choix.
En matière de coûts, les Allemands ne peuvent pas aller plus loin. D’une manière générale, il est très compliqué d’innover tout en agissant sur les coûts. Pour créer de l’innovation, il faut de la structure – des ingénieurs, un peu de budget marketing, de la recherche et développement –, ce qui est peu compatible avec la réduction des coûts. En Allemagne, dans le secteur de l’agroalimentaire, la question ne se pose même plus : on réduit les coûts. Si on agissait de même en France, on y gagnerait pendant deux ans, puis on finirait comme les entreprises allemandes.
J’en viens à la formation professionnelle. Dans ce domaine, nous sommes très « court-termistes », car nous sommes très innovants. La place de l’innovation constitue le point commun entre les quatre entreprises participant aujourd’hui à cette table ronde. Pour répondre à l’innovation, nous disposons de trois mois, six mois, un an, mais nous n’avons aucune vision à trois ans – tout au moins dans le secteur agroalimentaire. Les machines utilisées dans nos ateliers progressent en effet d’année en année, notamment sous l’influence de la politique de développement durable : elles consomment moins d’eau, moins d’énergie, etc. Nous avons donc besoin d’un vivier de personnel disponible en amont que nous puissions former en trois ou six mois. C’est pour cela que nous recrutons des personnes diplômées au niveau d’un « bac + 2 » ou d’un « bac + 3 », alors que nous aurions plutôt besoin de titulaires de bac professionnel. Ils occupent pendant deux ou trois ans des postes en usine pour lesquels ils sont surqualifiés mais qui leur donnent une première expérience professionnelle. Nous les formons ensuite à nos propres métiers.
Nous avons besoin de filières de formation professionnelle pour le monde industriel. Qu’est-ce qu’une machine ? Comment travaille-t-on sur un écran ? Nous essayons de mettre en place ces formations de base avec d’autres entreprises du secteur, mais cela nous coûte très cher. Chaque formation n’est suivie, en effet, que par cinq ou six apprentis, alors qu’il nous faudrait des classes de vingt ou vingt-cinq personnes. Or nous avons du travail pour eux !
Dans le bassin rhodanien, où le chômage est important, les pouvoirs publics ont organisé des missions destinées à reconvertir dans le secteur agroalimentaire les travailleurs venant du secteur de la chaussure. Cela a été un échec : il n’a pas été possible de mettre derrière des machines ces gens qui avaient l’habitude d’effectuer des travaux manuels. Cette politique a pourtant coûté beaucoup d’argent. À l’inverse, dans certaines régions, des salariés ayant l’habitude de travailler en usine perdent leur emploi en raison des délocalisations. Nous aurions intérêt à récupérer ces gens et à les former.
La formation pose un vrai problème pour le monde industriel. Nous avons d’importants besoins en ce domaine, mais nous sommes loin des villes.
M. Edmond Kassapian. Nous appartenons au secteur marchand : nous avons des magasins dans le monde entier ; nous créons des collections, nous faisons de belles tables, de belles nappes, de belles assiettes. Et, bien entendu, dans ce métier, le « Made in France » représente un label essentiel. Si nous produisons en France, ce n’est pas par angélisme, mais parce qu’à l’export, les clients veulent non seulement un concept français, mais également des produits français.
Il faut arrêter de se flageller en évoquant les problèmes de la France. Je ne rencontre pas de problème de formation, je n’ai pas de difficulté à recruter. Nous avons de bonnes industries, des gens qui maîtrisent bien leurs savoir-faire. En revanche, la relation avec le monde du travail demeure compliquée dans notre pays. Comme nous voyageons beaucoup, nous connaissons l’image que les étrangers ont de la France : nos interlocuteurs affirment qu’ils seraient ravis de s’y installer, mais ils considèrent que les Français ne savent pas, ou ne veulent pas travailler.
Par exemple, nous disposons d’un site de production en Tunisie, qui a bien sûr été affecté par les événements politiques récents. Mais moins d’une semaine après le début de la révolution, l’usine fonctionnait à nouveau, les salariés se mobilisaient et la production était repartie. Toutefois, après avoir traversé la mer Méditerranée, les conteneurs ont été immobilisés pendant un mois et demi à Marseille en raison d’une grève des dockers. Désormais, nous n’utiliserons plus ce port : la production sera expédiée depuis l’Algérie jusqu’à Rotterdam.
Tel est le rapport des Français avec le travail. Les entreprises fonctionnent à deux vitesses, avec des cadres très impliqués qui ne comptent pas leurs heures de présence, et des salariés qui accomplissent leur tâche dans le cadre strict du droit du travail. Pour autant, nous avons beaucoup de bons jeunes. Les formations qu’ils ont reçues sont de qualité, que ce soit dans les écoles de commerce ou dans les universités. Pour bien faire, nous avons tout ce qu’il faut en France : il faut seulement se remettre au travail, voilà toute la difficulté. Le jour où l’on se remettra au travail, une grande partie de nos problèmes pourra être surmontée.
Dans l’industrie, la situation est sans doute différente, mais dans le commerce, l’investissement est d’ordre intellectuel : nous ne réclamons aucune aide, nous n’avons besoin de rien. En revanche, il est nécessaire d’être vigilant et ne pas céder à l’angélisme en ce qui concerne les importations de marchandises. Pourquoi devrais-je continuer à produire sur place, ce qui entraîne nécessairement un effet d’érosion sur mes marges, alors que n’importe quel importateur peut, sans la moindre difficulté, se rendre en Chine, y remplir des conteneurs et revenir distribuer n’importe quelle marchandise dans notre pays ? Il faut pouvoir répondre à cette question. Mais mis à part cela, je ne réclame aucune aide. Chacun son travail : il n’appartient pas au Gouvernement de se substituer aux entreprises. Il doit seulement nous protéger et remettre tout le monde au travail – même si j’ai bien conscience de la difficulté de la tâche.
M. Didier Sauvage. Pour répondre à la fois à la question concernant les pôles de compétitivité et à celle des relocalisations, j’évoquerai la place de la recherche dans l’industrie. Dans notre secteur, la France occupe des positions très fortes en termes de recherche. La question demeure de savoir combien d’emplois industriels celle-ci génère. Ainsi, le pôle de compétitivité situé en Île-de-France et consacré à l’optique, l’électronique et le logiciel compte 10 000 chercheurs pour 40 000 industriels. Ce ratio, un pour quatre, n’a rien de très élevé.
Sur le fond, le concept de zone d’excellence me semble pertinent. Mais de très bonnes idées peuvent parfois conduire à des effets pervers, par exemple, lorsque l’on ne parvient pas à faire travailler ensemble plusieurs pôles dont les compétences se recouvrent. Les effets sont alors négatifs, car si cela ne rapporte rien à un pôle de collaborer avec d’autres organismes, cela rapporte à la collectivité, ce qui est le plus important. Il convient donc de donner davantage de flexibilité au zonage afin de supprimer ces blocages. Notre entreprise travaille aussi bien avec la région Rhône-Alpes, qui compte de nombreuses compétences, qu’avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle doit pouvoir le faire sans être pénalisée.
Ce travail au niveau de la recherche et du développement permet de créer une filière industrielle. Ce qui m’amène à évoquer les relocalisations : pour qu’une filière de recherche et développement soit légitime dans un pays, il faut qu’elle entraîne la création d’emplois industriels. Nous n’avons pas relocalisé pour le plaisir, mais parce que nous avons constaté que dans notre secteur d’activité, cela ne coûtait pas plus cher de produire en France qu’en Thaïlande, où notre ancienne maison mère américaine avait implanté la production. Dès lors que l’on parvient à payer le coût de cette relocalisation, on obtient un gain en qualité, en proximité et en performance. On y gagne aussi en légitimité, puisque notre filière fait parfaitement le lien entre les emplois de recherche et les emplois industriels. L’octroi d’aides pour soutenir la recherche et le développement n’a donc d’intérêt que si ceux-ci entraînent la création d’emplois. Et dans ce cas, il y a une certaine logique à relocaliser, y compris pour l’industriel lui-même.
Quant aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, elles ne sont pas le fait de nos interlocuteurs : le plus souvent, les administrations ne ménagent pas leurs efforts et font preuve de beaucoup de bonne volonté. Mais les mécanismes sont très lourds. On constitue un dossier pour obtenir une aide à la relocalisation, puis, six mois plus tard, on s’aperçoit que les bases d’éligibilité des dépenses ne sont pas celles que l’on croyait, ce qui conduit à réduire le budget envisagé ; ou que cette aide n’est pas cumulable avec la prime à l’aménagement du territoire ; ou qu’une partie du dossier relève des collectivités territoriales et non de l’État… Bref, on perd ainsi huit ou neuf mois. De même, du côté des collectivités, tout le monde fait preuve de bonne volonté. Il n’en demeure pas moins que le temps qu’un chef d’entreprise peut consacrer aux procédures est perdu pour d’autres tâches. Nous sommes prêts à beaucoup travailler, mais une journée ne dure que 24 heures…
M. Olivier Carré. Je souhaite réagir aux propos de M. Edmond Kassapian. Les trente-cinq heures constituent en effet un élément clé du problème, mais depuis qu’elles ont été instituées, le législateur a créé de nombreux dispositifs visant à les adapter. Par exemple, le compte épargne temps permet de convertir le temps supplémentaire obtenu en pouvoir d’achat. Cependant, quand on interroge les représentants des entreprises ou des collectivités, on s’aperçoit que les candidats sont peu nombreux : la plupart des gens préfèrent tout simplement consacrer ce temps à autre chose. Nous sommes donc au cœur du problème : d’un côté, la comparaison avec les autres pays montre que les trente-cinq heures ont des effets avérés sur la compétitivité ; de l’autre, les politiques sentent bien qu’elles sont entrées dans les mœurs, à l’instar des congés payés, par exemple. C’est un élément qui structure la vie quotidienne de nos concitoyens, et il est donc difficile de revenir dessus, d’autant que le pouvoir d’achat, quoi que l’on puisse en dire, n’est pas si altéré que cela – les statistiques montrent même qu’il est en progression en France depuis un grand nombre d’années. Comment pourrait-on inciter à nouveau nos concitoyens à travailler ?
M. Pierre Morange, rapporteur suppléant. Il n’a pas été répondu précisément à la question de M. Éric Woerth sur les situations respectives de la France et de l’Allemagne, alors que le dynamisme des petites et moyennes entreprises allemandes et leur rôle dans l’équilibre de la balance du commerce extérieur sont donnés en exemple.
Par ailleurs, en ce qui concerne le compte épargne temps, ses dispositions ont été considérablement allégées. Il bénéficie désormais d’un mécanisme d’exonération de cotisations sociales et fiscales à partir du moment où les fonds collectés sont investis sur des placements à moyen et long terme dans le cadre du plan d’épargne retraite populaire ou du plan d’épargne pour la retraite collectif. Ce mécanisme s’est fortement développé dans les grandes entreprises, mais ni dans les petites et moyennes entreprises ni dans les petites et moyennes industries. Il pourrait pourtant répondre à la préoccupation de M. Edmond Kassapian de trouver un potentiel de travail supplémentaire, conformément aux recommandations données par M. Michel Camdessus dans ses différents rapports.
M. le président Bernard Accoyer. Notre mission est consacrée à la compétitivité de l’économie française et au financement de la protection sociale. Vous avez évoqué les problématiques administratives, législatives et réglementaires qui pèsent sur la compétitivité et les insuffisances en termes de formation professionnelle ou de requalification dans les sites confrontés à la désindustrialisation. Mais j’aimerais en entendre davantage sur la question des coûts de production, qu’il s’agisse des coûts de fabrication, des coûts salariaux, du problème du temps de travail ou de celui des charges sociales. En France, le financement de la protection sociale est assis à plus de 75 % sur la production, sur les cotisations patronales et salariales. L’hypothèse d’un transfert progressif et compensé de cette assiette vers la consommation est à l’étude. Une telle démarche a d’ailleurs été engagée en Allemagne et au Royaume-Uni.
Vous n’avez pas non plus évoqué la question du positionnement dans les gammes, sauf pour déplorer que le hard discount et la grande distribution aient la haute main sur votre avenir et sur la localisation des productions.
Enfin, si l’un d’entre vous a salué le crédit d’impôt recherche, je ne vous ai pas entendu parler de la suppression de la taxe professionnelle ni de l’évolution de la fiscalité locale. Cette suppression a-t-elle contribué à réduire vos charges fiscales, et si oui, de combien ? Que pensez-vous des fiscalités de substitution imaginées non loin d’ici ?
M. Nicolas Forissier. Quel jugement portez-vous sur le dispositif français d’appui aux exportations, qui, au dire de beaucoup, peut être considéré comme exemplaire ? Y recourez-vous ? Ce soutien au développement international des petites et moyennes entreprises constitue-t-il un élément favorisant leur compétitivité ?
M. Bruno Cercley. Monsieur Nicolas Forissier, nous n’utilisons pas le dispositif d’appui à l’export. Le groupe Rossignol possédant depuis longtemps des filiales commerciales dans tous les grands pays du ski, nous avons le sentiment de connaître notre marché à l’international.
Vous avez raison, monsieur Christian Blanc, il importe d’apprécier l’amont et l’aval de l’acte de production. On ne relocalise pas par patriotisme. Mais dès lors qu’on est convaincu que, du point de vue économique, il s’agit de la meilleure option pour l’entreprise, autant en tirer profit. Ayant décidé de produire davantage à Sallanches qu’à Taïwan, nous ne nous priverons pas de préciser que nos skis sont « Made in Chamonix Valley » ! Même s’il est difficile d’évaluer la valeur que le consommateur y accordera, rien n’empêche de parier sur des réflexes de fierté. Cela joue autant qu’une simple comparaison de coûts. Comme nous avons la chance de fabriquer des produits attractifs et à la mode, on peut aisément créer une dynamique positive et donner à nos employés l’envie de se rendre au travail plutôt que de leur mettre un pistolet sur la tempe en les obligeant à travailler plus !
Nous avons en Allemagne un concurrent redoutable, Völkl, qui fabrique de très bons skis, avec une forte valeur ajoutée, un positionnement prix plus élevé que la moyenne et des coûts allemands mais si l’on compare avec nos propres coûts, j’ai le sentiment que nous ne sommes pas plus chers.
Transférer la fabrication de nos skis de Taïwan vers la France nous permet d’injecter du polyuréthane et de gagner en productivité : on produit autant en quinze minutes en France qu’en trente ou quarante minutes à Taïwan. Par ailleurs, nous avons la chance que le coût de la main-d’œuvre représente moins de 20 % de l’ensemble de nos coûts de production. Notre système de production nous permet donc de prendre ce risque, à condition de rester très vigilants sur la productivité.
Nous participons à l’organisation « PRO France », sous l’autorité de M. Yves Jégo, car nous pensons que cela peut nous aider. Il faut préalablement définir ce qu’est un « produit français », mais, aux yeux du monde entier, qu’un ski soit « Made in France », berceau historique du ski en Europe, lui donne de la valeur. Pourquoi ne pas en profiter pleinement ?
De quoi avons-nous besoin ? Personnellement, la question des aides publiques m’indiffère. Quand nous avons décidé de relocaliser notre production à Sallanches, notre priorité n’a pas été de solliciter le ministère de l’industrie pour obtenir des aides à la relocalisation, mais de mettre en œuvre notre décision le plus rapidement possible. Nous vivons constamment dans l’urgence et nous aurions plutôt besoin de partenaires qui nous aident à gagner du temps. Malheureusement, les autorités locales semblent évoluer dans un autre monde !
En revanche, nous avons besoin de financements. Quand nous avons repris Rossignol en 2008, l’entreprise se trouvait au bord de la faillite. Il a fallu repartir de zéro. Nous nous sommes adressés à OSÉO, où l’on nous a répondu que, notre actionnaire majoritaire étant étranger, on ne pouvait pas nous aider. Pourtant, nous ne demandions pas d’argent, juste une garantie nous permettant d’emprunter auprès des banques françaises. On croirait qu’il est honteux de vouloir redresser une entreprise française appartenant à des actionnaires étrangers ! Résultat : nous avons sollicité la banque américaine Wachovia et nous avons procédé à du factoring avec Fortis. Et une fois que la validité de notre modèle économique a été démontrée, nous avons vu les banques revenir les unes après les autres ! Lorsqu’on est dans une situation confortable, on peut se permettre d’être prudent. Toutefois, lorsqu’on est confronté à d’importantes difficultés, on doit aller très vite et il faut savoir prendre des risques ; et c’est alors que nous avons besoin de soutien.
S’agissant des coûts de production, il est évident que, par comparaison avec d’autres pays, se pose en France le problème du haut niveau des charges et des salaires. Cela étant, on peut aussi réaliser des gains de productivité. Il faut continuer dans cette dernière voie et, surtout, ne pas augmenter les charges.
Enfin, la réforme de la taxe professionnelle a été neutre pour nous.
M. Vincent Delozière. En ce qui nous concerne, nous avons enregistré pour 2010 un gain – quoiqu’il se soit amoindri avec les modifications ultérieures du dispositif.
Nous avons racheté deux entreprises en difficulté financière, l’une en juin 2007 à Nuits-Saint-Georges, l’autre en septembre 2007 à Saint-Alban-les-Eaux, sans mettre en œuvre de plan social ni demander d’aides. Quand on réalise de telles opérations, on n’a pas le temps de prendre rendez-vous avec le député ou l’administration : d’abord, on accomplit les démarches nécessaires, et ce n’est que dans un second temps qu’on s’en occupe, au risque de s’entendre dire qu’il fallait venir plus tôt.
Alors que nous aurions pu nous contenter de racheter les parts de marché et confier à l’usine de Düsseldorf le soin de livrer l’est du pays, nous avons décidé de rester en France, où nous essayons de mettre en place une filière fruits, pour que l’on ne dise plus « Embouteillé en France », mais « Fabriqué en France ». Je peux vous dire que, depuis six ans, nous accumulons les difficultés ! Bien qu’étant petit-fils de paysans, j’ai cessé d’aller aux réunions avec le monde agricole depuis deux ans, faute de parvenir à un accord. Finalement, nous allons travailler avec un partenaire privé qui achètera la marchandise aux agriculteurs.
Monsieur Christian Blanc, nous essayons de créer cette filière de fruits jaunes dans la Drôme parce que nous avons des clients – dont la grande distribution. Et même s’il nous arrive de prendre des coups, nous faisons des affaires avec eux et nous créons de la valeur. Mais il faut savoir être rapide. Pour cela, nous avons besoin de vous ; or, de toute évidence, nous n’évoluons pas dans le même monde. Au bout de trois ans, le rond-point que j’ai évoqué précédemment n’est toujours pas achevé ! Comment voulez-vous qu’on fasse ? PepsiCo va encore me dire qu’il veut cesser de travailler avec notre site, car ses camions sont coincés sur la nationale et que cela comporte des risques ! Autre exemple : nous n’avons plus d’autorisation de production depuis deux semaines, alors que cela fait dix-huit mois que le dossier d’installation classée pour la protection de l’environnement a été envoyé. C’est désastreux !
M. Edmond Kassapian. Il n’existe pas de modèle allemand correspondant à notre savoir-faire.
Si la suppression de la taxe professionnelle a engendré des gains, ceux-ci ont été compensés par beaucoup de « tracasseries » administratives : en 2007, une taxe sur l’horlogerie et les arts de la table ; en 2009, une taxe sur le linge, rétroactive jusqu’en 2007, et la modification du « forfait social » applicable aux cadres ; en 2010, des cotisations nouvelles par rapport aux conventions collectives ; en 2011, une baisse des réductions dites « Fillon » en raison de l’annualisation des calculs et la majoration de 25 % de la rémunération des heures supplémentaires pour les temps partiels.
Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour nous, évitez-nous les « tracasseries » administratives ! Ainsi, la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement vérifie depuis un an et demi la conformité de nos entrepôts aux normes en vigueur, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a décidé de contrôler la traçabilité de nos produits, alors qu’aucun distributeur français, même de renom, n’est capable de l’assurer.
En ce qui concerne le temps de travail, bien sûr, il existe des dispositifs d’aide, monsieur Pierre Morange, mais nous ne sommes pas nécessairement au courant, et cela ne joue qu’à la marge. Le problème, c’est la modification des relations à l’intérieur de l’entreprise induite par les trente-cinq heures, certaines personnes prévoyant de partir le jeudi soir en week-end. Cela dit, si les trente-cinq heures permettent aux gens de gagner en termes de disponibilité, elles ne leur permettent pas forcément de disposer, en tant que consommateurs, du pouvoir d’achat nécessaire pour acheter nos produits d’art de vivre.
Monsieur Christian Blanc, les produits « Made in France » rencontrent un grand succès dans le monde entier, sauf en France, où le consommateur moyen n’est pas prêt à dépenser davantage pour acquérir nos articles. Nous aussi, nous collaborons avec l’organisation de M. Yves Jégo. Toutefois, les choses avancent doucement, car il faut déjà déterminer les produits que l’on désignera comme fabriqués en France car ceux qui le sont réellement sont peu nombreux.
M. Didier Sauvage. Le modèle allemand nous intéresse pour ce qui concerne les filières de hautes technologies et le lien existant entre la recherche, le développement et l’industrialisation des produits. En définissant quelques grands axes de priorité, l’Allemagne a su générer des petites et moyennes entreprises d’excellence dans un nombre restreint de secteurs, alors qu’en France, elles sont beaucoup plus éparpillées.
Il est évident que, pour les jeunes entreprises innovantes, les charges sociales pèsent lourdement. Toutefois, je ne suis pas compétent pour me prononcer sur la taxe à la valeur ajoutée sociale. Il reste que la différence est nette avec la situation de notre filiale au Canada.
La réforme de la taxe professionnelle n’a eu aucun impact sur nos comptes, nos mécanismes de calcul étant soumis au plafonnement sur la valeur ajoutée.
S’agissant du temps de travail, il faut distinguer deux cas de figure. Les cadres français sont au forfait jour, et, si j’en crois mon expérience, ils travaillent beaucoup plus que les cadres étrangers, même s’ils ne sont pas toujours aussi efficaces. En revanche, la situation des collaborateurs est plus compliquée à gérer, car, même si vous être d’accord avec les partenaires sociaux, il n’est pas toujours possible d’introduire de la flexibilité.
Plus généralement, la vraie difficulté pour les petites et moyennes entreprises réside dans la complexité du cadre réglementaire. Pour être parfaitement honnête, je suis incapable de vous certifier aujourd’hui que, malgré tous nos efforts, nous respectons les réglementations en vigueur en matière de droit du travail et de sécurité. Dans ce domaine, nous aurions vraiment besoin de votre aide.
M. le président Bernard Accoyer. Messieurs, je vous remercie d’avoir participé à cette audition. Nous tiendrons le plus grand compte de vos remarques.
*
AUDITIONS DU 6 AVRIL 2011
Audition de Mme Anne Bucher, directrice des réformes structurelles et de la compétitivité à la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, et de M. Gwenole Cozigou, directeur Industries chimiques, métalliques, mécaniques, électriques et de la construction ; matières premières à la direction générale Entreprises et industrie de la Commission européenne
Mme Anne Bucher, directrice des réformes structurelles et de la compétitivité à la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne. Je remercie tout d’abord votre mission de nous avoir invités. Nous savons votre temps précieux et mesurons donc le privilège de pouvoir nous exprimer devant vous. Débattre avec des législateurs nationaux est toujours pour nous très enrichissant.
J’essaierai de vous donner un éclairage européen sur les questions de compétitivité et de financement de la protection sociale.
La France souffre-t-elle d’un problème de compétitivité ? Hélas, oui, les chiffres sont cruels. Depuis une quinzaine d’années, ses parts de marché se contractent et le déficit de sa balance courante se creuse, y compris dans le domaine des services, ce qui est nouveau.
Peut-on établir un lien entre cette détérioration et l’évolution du coût du travail ? La productivité a évolué de la même manière en France et en Allemagne, mais la politique de modération salariale menée par l’Allemagne, tout à fait exceptionnelle en Europe, explique la meilleure performance en matière de coût du travail outre-Rhin. Les coûts salariaux unitaires ont augmenté plus vite en France qu’en Allemagne, mais au même rythme que dans la zone euro en moyenne. La France étant en concurrence avec des pays à bas salaires, elle a bien entendu perdu en compétitivité de ce point de vue. Néanmoins, une fois pris en compte les taux de change effectifs, la dégradation est moins importante qu’il n’y paraît sur la seule base des coûts salariaux. Cela prouve que les exportateurs français se sont efforcés de préserver la compétitivité prix de leurs produits en réduisant leurs marges à l’exportation – ce qui, soit dit au passage, n’est pas viable à long terme. Le poids des charges sociales, dont le taux est parmi les plus élevés d’Europe, peut-il expliquer ce recul de la compétitivité relative de la France ? S’il peut être à l’origine de la difficulté à pénétrer certains marchés, il n’explique pas la perte de compétitivité constatée depuis une quinzaine d’années, car il n’a quasiment pas varié sur la période. Au total, la mauvaise performance de la France à l’exportation n’est donc pas imputable uniquement à l’évolution du coût du travail.
Il y a d’autres raisons, d’ordre plus structurel. Les indicateurs de compétitivité hors prix révèlent des faiblesses importantes du tissu productif français. Je n’en évoquerai que quelques-unes. Les petites et moyennes entreprises françaises sont beaucoup moins internationalisées que d’autres en Europe : le pourcentage de celles qui exportent est proche de celui des nouveaux États membres, très loin de ce qu’il est en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Ce n’est pourtant pas une fatalité. Toute une série de facteurs entrent en ligne de compte. Prenons l’exemple de la fiscalité. Le taux théorique de l’impôt sur les sociétés en France est le plus élevé d’Europe, avec 34 %, mais le taux effectif d’imposition est beaucoup plus faible du fait des niches fiscales. Il est de surcroît dégressif : proche de 30 % pour les petites et moyennes entreprises, il tombe à 15 %, voire 10 %, pour de très grandes entreprises. Cette fiscalité est pénalisante pour les petites et moyennes entreprises. Je n’ai pas le temps de développer ce point dans le temps qui m’est imparti mais nous analysons de la même manière l’influence d’autres facteurs : politique de recherche, fonctionnement du marché du travail…
De tout cela, quelles conclusions tirer ? La première est qu’une politique de renforcement de la compétitivité qui se focaliserait exclusivement sur les coûts salariaux serait inappropriée. D’une part, parce que la France n’a pas vocation à concurrencer des pays à bas salaires. D’autre part, nous l’avons dit, les faits ne permettent pas d’établir que sa perte de compétitivité soit liée à une évolution particulièrement défavorable des coûts salariaux, cotisations sociales comprises. Si on souhaitait réduire celles-ci pour gagner en compétitivité, il conviendrait d’ailleurs d’être prudent dans le contexte actuel car les prestations sociales ont joué un rôle de stabilisateur automatique durant la crise.
Une autre conclusion est que la France doit engager des réformes structurelles. Avec la loi de modernisation de l’économie, elle a pris diverses mesures qui auront une incidence positive à moyen terme. Ce n’est toutefois pas suffisant. Il faudrait s’attaquer rapidement au chantier de la fiscalité et aussi prendre des mesures complémentaires à la loi de modernisation de l’économie, pour éviter de pénaliser des secteurs nouveaux de croissance.
Enfin, j’y insiste, quoi qu’on fasse pour renforcer la compétitivité en France, la consolidation budgétaire demeure la priorité à très court terme. La France s’est engagée à ramener son déficit budgétaire à 3 % du produit intérieur brut d’ici à 2013. Diverses mesures ont déjà été prises en ce sens. D’autres n’ont pas encore été annoncées sur lesquelles nous pensons qu’une réflexion doit s’engager sans retard. Priorité devrait être donnée au démantèlement des niches fiscales dans les deux années qui viennent. Si on envisageait de réduire les charges sociales pour des raisons de compétitivité, les mesures devraient être neutres pour les finances publiques. Une part de la protection sociale devra donc être financée par d’autres ressources fiscales. Dans une perspective de consolidation fiscale, il faudrait privilégier un impôt du type taxe à la valeur ajoutée plutôt que l’impôt sur le revenu. Comme l’a montré l’expérience allemande, un impôt du type taxe à la valeur ajoutée est d’autant plus efficace que son assiette est large et son taux uniforme. Il faudrait donc s’attaquer aussi aux niches que constituent les taux réduits de taxe à la valeur ajoutée.
La France doit nous adresser le 15 avril son programme national de réformes (PNR), listant les initiatives qu’elle compte prendre pour atteindre les objectifs fixés par l’Union d’ici à 2020. Nous espérons qu’il comportera des mesures d’effet immédiat et des mesures structurelles allant dans le sens de ce qu’attend votre mission d’information.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Il est vrai qu’il n’y a pas de distorsion globale entre la France et l’Allemagne en matière de compétitivité. Il en existe néanmoins de très fortes dans certains secteurs – fruits et légumes, industrie agroalimentaire… –, notamment parce qu’outre-Rhin, toute une main-d’œuvre étrangère est très faiblement payée. Quelles mesures pensez-vous qu’il conviendrait d’adopter pour contrer de telles distorsions ?
Tous les gouvernements sans exception ont approuvé la stratégie de Lisbonne. Quels sont les pays européens qui ont, selon vous, le mieux réussi dans l’application de cette stratégie ? Quelles sont les actions qui ont permis de s’approcher le plus de ses objectifs ?
M. Paul Giacobbi. Je vous remercie, madame, d’avoir souligné que l’impôt sur les sociétés en France, en dépit de son taux théorique élevé, ne pèse pas aussi lourd qu’on pourrait le croire. Ainsi, contrairement à une idée reçue, bien que le taux de l’impôt sur les sociétés ne soit que de 12,5 % en Irlande, la part de son produit dans le produit intérieur brut y était, du moins avant la crise, largement supérieure à ce qu’elle est en France. En Irlande, il n’existe ni crédit d’impôt recherche ni dispositif d’amortissements dégressifs et les entreprises n’ont pas la possibilité de jouer sur la localisation de leurs bénéfices, si bien qu’au final elles paient davantage qu’en France. En dépit de la réalité donc, on continue de dire, y compris parmi les spécialistes de fiscalité, que l’impôt sur les sociétés pèse lourd en France. L’image extérieure d’un impôt est donc considérable. De même, les charges sociales réellement acquittées étaient-elles, avant la crise, supérieures dans l’industrie automobile américaine à ce qu’elles étaient dans l’industrie automobile française. Mais en France elles reposent essentiellement sur des dispositions législatives et réglementaires, et non comme aux États-Unis sur des dispositions conventionnelles, ce qui, dans l’esprit de beaucoup, est tout à fait différent. La représentation d’un impôt finit par peser sur l’attractivité même d’un pays, qui est un élément clé de compétitivité.
Outre qu’on a tendance à réduire la question de la compétitivité à la compétitivité prix, on s’attache de surcroît à la seule part du coût du travail imputable aux salaires les plus bas. Beaucoup d’industriels que je rencontre jugent le coût du travail en Inde par exemple globalement très élevé. Certes, les salaires des ouvriers y sont bas, encore qu’ils ne le soient pas autant qu’on le croit par rapport à d’autres pays, mais ceux des managers y sont si faramineux toutes charges comprises – le double environ de ce qu’ils sont en France – que le coût du travail en devient en moyenne élevé, d’autant que la productivité est moindre et l’intensité capitalistique différente. La compétitivité n’est pas liée seulement au coût des bas salaires. Sinon plus rien ne serait fabriqué en France, ce qui est loin d’être le cas. J’aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet.
Il faut aussi prendre en compte le prix des matières premières. Le prix du coton, qui représente 80 % du coût d’une pièce textile, a triplé. Il est donc beaucoup plus déterminant dans le prix final de cette pièce que le coût du travail qui n’en représente que 5 %. Le cours du dollar non plus n’est pas indifférent. Il a tellement évolué que la donne en est bouleversée. Pour analyser les problèmes de compétitivité, il faut donc construire des modèles plus fins que ceux généralement utilisés, assez caricaturaux. Nul ne nie néanmoins que la France a perdu en compétitivité.
M. Marc Goua. Votre diagnostic, madame, est largement partagé. Vous n’avez pas évoqué le déficit de logistique et de force commerciale des petites et moyennes entreprises françaises, par rapport à leurs homologues étrangères, notamment allemandes et italiennes. Je finis par me demander si toutes les réformes qui se sont empilées au fil du temps, loin d’introduire des facilités, n’ont pas conduit à des dérèglements. Enfin, quid du comportement des banques vis-à-vis des petites et moyennes entreprises en France ?
Mme Anne Bucher. Je l’ai dit, la performance de l’Allemagne est tout à fait atypique au niveau européen. D’une part, le pays pratique une politique exceptionnelle de modération salariale qui a fait l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux. D’autre part, il a relevé son taux de taxe à la valeur ajoutée, ce qui lui a permis de financer pour partie son redressement budgétaire, pour partie une baisse des cotisations chômage. Le pays recueille aujourd’hui les fruits de réformes structurelles qu’il a engagées très tôt. De ce point de vue, la France a pris du retard.
L’Allemagne a résisté à la crise sur les marchés extérieurs et la demande interne commence maintenant d’y être l’un des moteurs de la reprise. S’inscrivant pleinement dans la stratégie de Lisbonne, certains pays ont mené des politiques qui leur ont permis d’échapper à la crise. Je pense aux pays scandinaves ou encore aux Pays-Bas dont les modèles s’appuient sur des dépenses de recherche élevées, une politique de l’emploi évitant la dualité du marché du travail et favorisant la mobilité.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, les chiffres attestent qu’il représente une part plus faible des recettes fiscales en France qu’ailleurs. La perception que cet impôt constitue un poids tient peut-être à sa complexité. D’après la Banque mondiale, la France se classe au vingt-sixième rang dans le monde s’agissant de l’environnement réglementaire pour les entreprises, ce qui est tout à fait honorable. Mais il est des points sur lesquels cet environnement y est considéré comme pénalisant : la fiscalité en est un. La complexité de l’impôt en France et la façon dont les entreprises ont à s’organiser pour tirer profit de toutes les niches fiscales donnent l’impression qu’il est lourd alors qu’il ne l’est pas tant que cela.
Les charges sociales sont élevées en France, c’est un fait. Mais avant de faire des comparaisons, encore faudrait-il veiller à comparer des choses comparables. Ainsi au Royaume-Uni, une part importante des retraites est-elle financée par des systèmes privés, ce qui ne se répercute donc pas sur le coût du travail.
Un mot de la compétitivité prix. La théorie économique invite à prendre en considération plutôt la productivité globale de l’économie que la seule compétitivité prix. Mieux allouer les ressources, faciliter la mobilité entre secteurs ainsi que sur le marché du travail, supprimer les effets dissuasifs de seuil en matière de salaires et d’impôts : autant de mesures économiques structurelles favorisant en général un potentiel de croissance qui se traduit, à terme, par de meilleures performances à l’exportation.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Si le coût du travail n’est pas globalement très différent en France et en Allemagne, la distorsion est néanmoins considérable dans certaines industries à forte intensité de main-d’œuvre, dans la mesure où n’existe pas outre-Rhin de salaire minimum interprofessionnel et où, dans certains secteurs, qui d’ailleurs emploient en nombre des personnes d’origine polonaise ou tchèque, ne s’applique aucune convention collective. La pression est donc forte en France, par exemple dans les abattoirs ou le secteur des fruits et légumes, pour que des mesures soient prises afin que nous ne nous laissions pas trop distancer par notre voisin et concurrent.
Mme Anne Bucher. La France est assez lente à transposer les directives communautaires – c’est toujours elle qui a, aujourd’hui encore, les délais de transposition les plus longs – et lorsqu’il y a des infractions, ce sont toujours les cas français les plus longs à régler. Elle essaie de se protéger de certaines mesures de modernisation adoptées par l’Union européenne et du jeu de la concurrence.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Quand elle transpose les directives, elle le fait avec plus de rigueur que certains de ses voisins.
Mme Anne Bucher. C’est avec plaisir que je le dirai à nos amis britanniques !
M. Hervé Novelli. Dans le document que vous nous avez remis, madame, il est indiqué que « la compression des salaires en partie causée par les réductions de cotisations sociales sur les bas salaires n’est pas favorable à l’investissement dans la formation des jeunes et pourrait avoir des conséquences néfastes sur la productivité ». Pourriez-vous développer ce point ? Pour ma part, je ne suis pas convaincu, tant s’en faut, de l’efficacité de la politique massive d’allègement de charges sur les bas salaires menée en France depuis une quinzaine d’années.
Mme Anne Bucher. De l’étude que nous avons menée sur une dizaine de pays, il ressort que la France a le salaire minimum le plus élevé mais aussi le salaire médian le plus proche de ce salaire minimum, d’où un effet de trappe à bas salaires, entretenu par certains effets de seuil en matière de charges sociales. Que sur les salaires supérieurs à 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), les entreprises doivent s’acquitter des charges patronales à taux plein peut les inciter à maintenir les salaires à un niveau inférieur. Cela décourage à la fois la mobilité et les investissements en capital humain, tant du côté de l’offre que de la demande de travail.
M. Gwenole Cozigou, directeur directeur Industries chimiques, métalliques, mécaniques, électriques et de la construction ; matières premières à la direction générale Entreprises et industrie de la Commission européenne. Si vous le permettez, je traiterai essentiellement de l’industrie, qui est mon domaine de compétences à la Commission.
L’industrie manufacturière représente 20 % du produit national brut européen, les trois quarts des exportations communautaires et emploie un salarié du privé sur quatre. Et ces données sont inférieures à la réalité car des activités auparavant considérées comme industrielles sont désormais comptabilisées dans les statistiques parmi les services, sans compter que les services dépendent eux-mêmes fortement de l’industrie, si bien qu’en réalité l’industrie représente bien davantage. On est donc loin de la société post-industrielle, contrairement à ce qui a pu être affirmé il y a quelques années !
L’industrie est et demeure le moteur de la création de richesses. La productivité du travail dans l’industrie a augmenté en Europe de 46 % de 1995 à 2007 et 80 % de la recherche-développement du secteur privé sont réalisés dans le secteur industriel. L’industrie a certes été, comme le reste de l’activité économique, affectée par la crise. Certains secteurs ont vu leur production baisser de 30 %. Une reprise se dessine mais il faut encore être prudent. Cela étant, certains secteurs sont d’ores et déjà repartis. C’est le cas de l’industrie chimique, tirée d’ailleurs surtout par les marchés asiatiques.
Quelles leçons avons-nous retirées de la crise ? La première est que la mono-industrie est toujours très dangereuse et que lui est préférable une chaîne de valeur industrielle forte, compétitive et diversifiée.
La deuxième est que l’environnement économique mondial s’est profondément modifié : les pays longtemps dits « émergents » ont énormément progressé, y compris dans le domaine des produits à forte valeur ajoutée, et la vision que l’on en a est pour beaucoup dépassée. D’où l’importance croissante de la technologie et des qualifications. Il faudrait absolument qu’au lieu de s’orienter systématiquement vers le secteur financier, des compétences aillent aussi vers l’industrie, ce qui suppose de renforcer son attrait.
Une autre leçon est que le renchérissement du coût de l’énergie et des matières premières n’est pas l’effet seulement de mouvements spéculatifs mais une tendance lourde, du fait de l’accroissement de la demande mondiale.
Enfin, l’interdépendance des économies au niveau mondial est de plus en plus forte. L’idée de secteurs strictement nationaux n’est plus aujourd’hui que théorique. On l’a vu, les problèmes rencontrés au Japon après le tsunami et l’accident de Fukushima ont pu entraîner des difficultés d’approvisionnement dans d’autres pays. Les économies sont très interdépendantes, tout particulièrement dans l’Union européenne qui est encore la première puissance commerciale au monde.
Comment la Commission européenne approche-t-elle la politique industrielle ? Il faut tout d’abord rappeler que s’il s’agit bien d’une compétence communautaire, les instances européennes ne disposent pas de tous les instruments nécessaires, si bien que leurs décisions ont besoin d’être ensuite déclinées au niveau national et infra-national.
Premier volet de notre action : améliorer le cadre général. De ce point de vue, le marché intérieur constitue un outil essentiel. Ainsi la France réalise-t-elle une grande partie de son commerce extérieur avec les autres pays de l’Union et le marché intérieur des services est encore insuffisamment développé. L’environnement réglementaire est un autre élément-clé. La Commission a décidé dorénavant d’évaluer les incidences sur la compétitivité de toute nouvelle mesure législative. Elle souhaite également procéder à l’évaluation de la législation existante de ce point de vue. La même démarche pourrait être adoptée au niveau national. Dans cette démarche, il faut garder présent à l’esprit que les différents secteurs de l’économie ne sont pas cloisonnés : certaines mesures de réglementation financière peuvent ainsi avoir un impact sur l’accès au financement des entreprises. Enfin, lors de la négociation d’accords commerciaux avec des pays tiers, nous analyserons systématiquement le rapport coûts/bénéfices pour l’industrie européenne. Les infrastructures – transports, communications, fourniture énergétique… – sont un autre élément déterminant de la compétitivité. De ce point de vue, la France est assez bien placée. La Commission souhaite améliorer encore les infrastructures au niveau européen. Enfin, l’accès au financement des entreprises joue aussi un rôle essentiel dans le niveau de compétitivité.
Deuxième volet : renforcer les politiques industrielles. Certaines initiatives ont été prises dans différents États membres. Nous souhaitons faire porter l’effort sur les technologies clés comme les technologies de l’information ou les nanotechnologies, et sur les structures, en favorisant les réseaux et les clusters ou grappes d’entreprises. Les pôles de compétitivité tels qu’ils ont été créés en France répondent tout à fait à cette préoccupation.
Troisième volet : accompagner la mondialisation. Plusieurs de nos partenaires commerciaux entravent l’accès à leur marché intérieur par bien d’autres moyens que des barrières tarifaires et les pratiques déloyales sont fréquentes. Nous sommes déterminés à nous saisir du problème. Nous avons revu notre stratégie en ce qui concerne les matières premières et entendons nous attaquer par exemple aux restrictions injustifiées à l’exportation, notamment quantitatives, contraires au règlement de l’Organisation mondiale du commerce.
Quatrième volet : soutenir les transformations et les ajustements structurels. Ainsi, souhaitons-nous, pour relever le défi du changement climatique, accompagner la modernisation du tissu industriel.
J’en viens à la compétitivité française. La France avait encore un avantage comparatif de compétitivité prix il y a une dizaine d’années, qu’elle a perdu, parce que les coûts ont augmenté. La France ne décroche pas par rapport à la zone euro mais elle se situe quand même au-dessus de la moyenne – l’Allemagne, elle, étant très nettement en dessous. Cela dit, serait-il réaliste d’essayer de concurrencer sur les prix des pays comme la Chine ? Plus grave est que cette détérioration de la compétitivité prix n’est pas compensée par une amélioration de la compétitivité hors prix. Plusieurs signaux sont inquiétants. Si les dépenses publiques de recherche-développement sont au niveau de la stratégie fixée par l’Union pour 2020, ce n’est pas le cas des dépenses privées. Il faut absolument trouver les moyens d’orienter le capital privé vers l’investissement et la recherche rentables.
Pour répondre à la question sur le comportement du secteur bancaire en France, je dirais que la crise a certainement, hélas, accru son aversion au risque, mais la réglementation n’est pas neutre non plus. J’entends souvent des industriels français, notamment de petites et moyennes entreprises, se plaindre que les centres de décision sont très éloignés des besoins de l’entreprise – ce qui n’est pas le cas dans tous les États membres.
S’agissant de l’environnement réglementaire, l’important est d’avoir une approche systématique, même si elle est moins visible que des actions ponctuelles. Ce doit devenir une routine que d’évaluer l’impact sur la compétitivité de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire.
Les industriels déplorent un manque de compétences scientifiques et techniques. Ce n’est d’ailleurs pas propre à la France : en Allemagne aussi, on manque de techniciens, d’ingénieurs, de géologues – si précieux dans le secteur des matières premières. Il faudrait donc faire un effort en matière de formation scientifique et technique, d’autant que le système de formation français est réputé. Mais les industriels doivent aussi améliorer l’image de l’industrie pour renforcer son attrait : l’usine n’est pas quelque chose de sale, on ne le sait pas assez.
J’en viens aux difficultés des petites et moyennes entreprises françaises à l’exportation. Lorsqu’on fait des comparaisons, il faut savoir que les petites et moyennes entreprises allemandes fortement exportatrices ne seraient pas classées en France comme des petites et moyennes entreprises. Elles sont souvent plus grandes, sans qu’il soit d’ailleurs facile de déterminer si elles ont pu grandir parce qu’elles exportaient beaucoup ou si elles ont pu exporter parce qu’elles étaient déjà assez grandes.
En politique industrielle, l’important est de jouer sur tous les tableaux à la fois : amélioration constante du cadre général plutôt que des mesures ponctuelles, réglementation, infrastructures, accès au financement.
M. Hervé Novelli. Vous avez mentionné le niveau assez faible de la recherche privée en France par rapport à la recherche publique mais vos chiffres datent de 2008. Depuis lors, le bénéfice du crédit impôt recherche, très utilisé par les entreprises, a été facilité et largement étendu. Disposez-vous de données sur les incidences du nouveau dispositif ?
Vous avez évoqué les effets de la réglementation, en effet déterminants pour les petites et moyennes entreprises, et parlé d’études d’impact. Pourriez-vous nous dire plus précisément ce qui est fait pour évaluer les incidences de la réglementation sur les petites et moyennes entreprises ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Nous manquons de techniciens et d’ingénieurs dans l’industrie et cette pénurie s’aggrave, les compétences s’orientant en effet aujourd’hui plutôt vers le secteur financier. La Commission européenne ou certains pays ont-ils mené des campagnes pour « faire aimer » l’industrie ?
M. Gwenole Cozigou. Le crédit d’impôt recherche est le type même de dispositif bienvenu pour aider à orienter le capital privé vers la recherche et la recherche-développement. Mais le déficit, ancien, était profond et sera donc long à combler.
En matière d’études d’impact, il existe déjà au niveau communautaire un dispositif d’évaluation économique, social et environnemental des mesures prises. Y sera ajouté un volet spécifique pour évaluer leur incidence en matière de compétitivité industrielle.
En dépit de son champ de compétences réduit en matière de politique sociale et de formation, l’Union européenne essaie d’agir en ces domaines. Dans le cadre de nos dialogues sociaux, j’ai ainsi eu l’occasion, il y a quelques années, de faire la promotion de secteurs comme l’équipement maritime, souvent considéré en déclin. Avec les employeurs et les organisations syndicales, nous en avons au contraire montré tout l’attrait. Une des leçons de la crise est précisément qu’il n’y a pas de secteur condamné. Chacun compte des entreprises performantes qui méritent d’être soutenues. La Commission va aussi saisir l’occasion que 2011 soit l’année internationale de la chimie pour mieux faire connaître l’industrie chimique et en revaloriser l’image. Souvent présentée comme polluante et consommatrice d’énergie, c’est pourtant une industrie-clé qui fournit des solutions y compris pour la préservation de l’environnement. Sans industrie chimique, il n’y aurait pas de panneaux solaires, mais qui le sait ? De même, comment fabriquerait-on des éoliennes sans sidérurgie ? Simplement on ne le dit pas assez. La Commission participe activement à ces actions de promotion. Elle regarde aussi ce que fait chaque État membre en fonction de sa propre culture. Des secteurs industriels, avec l’appui de régions particulièrement concernées et d’organisations professionnelles, organisent des visites d’entreprises, engagent des coopérations avec les universités et autres établissements d’enseignement pour adapter les formations et permettre aux jeunes de trouver des débouchés à proximité de leur lieu de formation. C’est tout l’intérêt des clusters et des pôles de compétitivité qui regroupent, dans un même bassin d’emploi, industriels, universitaires et chercheurs.
Un dernier mot, si vous le permettez, pour dire que Bruxelles est souvent critiqué à tort pour des directives handicapant les entreprises alors que ce sont les États qui, lors de la transposition, rajoutent de leur propre initiative des mesures qui ne figuraient pas dans les directives. Cela vaut tout particulièrement pour la France.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Nous aimerions beaucoup disposer d’une liste de tels exemples, qu’il serait très intéressant de faire valoir à notre administration.
M. Christian Blanc, président. Madame, monsieur, je vous remercie.
*
Audition de Mme Agnès Benassy-Quéré, directrice du Centre d’études prospectives et d’informations internationales, et de M. Hervé Boulhol, chef du bureau France au département des affaires économiques de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).
M. Hervé Boulhol, chef du bureau France au département des affaires économiques de l’Organisation pour la coopération et le développement économique. Après avoir posé un diagnostic sur la situation actuelle, je présenterai quelques priorités en matière de politique économique.
Si le diagnostic établi doit s’appuyer sur les excellents rapports du Conseil d’analyse économique – je songe notamment aux travaux de M. Lionel Frontagné –, qui relèvent les obstacles entravant la dynamique des entreprises et soulignent un positionnement en retrait en termes de gammes de produits, je les compléterai néanmoins, d’une part, en insistant sur le caractère général du problème posé par une insuffisance globale de la capacité de production de l’économie française et, d’autre part, en essayant de montrer que le concept de compétitivité appliqué à un pays est peu significatif – ce n’est pas là une simple considération sémantique puisque de ce diagnostic découlent les priorités de la politique économique. En bref, ce sont des réponses d’ordre général qui doivent être apportées à un problème général. Nous avons identifié quatre domaines de priorité : la fiscalité et les finances publiques ; le marché du travail ; l’éducation ; le secteur productif.
Plus que la dégradation du solde commercial, c’est la perte de parts de marché à l’exportation qui doit être au centre de notre réflexion. La situation française est comparable à celle des autres pays du Groupe des sept, l’Allemagne exceptée ; l’évolution pour la France est comparable à celle des autres grands pays développés, et cela s’explique en grande partie en raison du rattrapage salutaire effectué par les pays en développement. Il ne s’agit pas néanmoins de nier nos mauvaises performances à l’exportation, notre recul étant de surcroît plus prononcé que celui de l’ensemble des pays de la zone euro mais, également, que ceux de la Suisse, de la Suède ou du Danemark – seule l’Italie ayant des résultats aussi décevants que les nôtres.
Cela ne doit pas toutefois nous éloigner de l’essentiel : la richesse totale créée, soit le revenu national ainsi que sa répartition. Or, pour l’ensemble des pays développés, le lien entre la croissance des exportations et celle du produit intérieur brut par habitant – donc, le pouvoir d’achat – est peu évident. L’Allemagne, le Japon, le Danemark, la Suisse, le Portugal ont ainsi enregistré depuis dix ou quinze ans de bonnes performances à l’exportation sans que les retombées soient pour autant notables s’agissant du produit intérieur brut par tête. Autrement dit, la production pour l’exportation ne crée pas plus de richesse que celle destinée au marché domestique : il faut abandonner ce fétichisme-là. Depuis 1990, la croissance des exportations en Allemagne a été 20 % supérieure à celle de la France, mais la croissance du produit intérieur brut français a été de 7 % supérieure à celle de l’Allemagne en raison d’une augmentation de la consommation et de l’investissement domestiques 15 % plus élevés chez nous que chez nos voisins d’outre-Rhin. La comparaison avec ce pays est donc parfois fallacieuse. J’ajoute que la persistance d’un surplus élevé du solde commercial allemand suggère une sous-évaluation du taux de change réel – la modération salariale et l’atonie de la demande pourraient être ainsi la conséquence d’un déséquilibre.
S’agissant du diagnostic compétitivité-coût, l’évolution du coût du travail total en France ne semble pas être la cause première du décrochage des exportations, même s’il est vrai que la convergence des salaires minimaux liée aux trente-cinq heures a sans doute pesé. Chez nous, la part des salaires dans la valeur ajoutée est d’ailleurs restée stable, les salaires réels ayant suivi l’évolution de la productivité du travail. La compétitivité-coût ne s’est donc pas dégradée dans notre pays par rapport aux autres pays de la zone euro – à l’exception de l’Allemagne, où la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée peut difficilement être extrapolée. En revanche, le salaire minimum est chez nous élevé – relativement au salaire médian – et le coût du travail pour les bas salaires figure parmi les plus chers des pays de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), malgré les allégements de cotisations. Les conséquences de telles rigidités sur le marché du travail sont sans doute amplifiées par la globalisation, processus impliquant de forts ajustements structurels en fonction des avantages comparatifs.
En ce qui concerne le lien entre compétivité, productivité et production, il convient également de noter que la notion de compétitivité est floue et peu significative sur un plan normatif. La compétitivité-coût peut ainsi être associée à des salaires sous-optimaux et à une demande trop faible, la compétitivité-prix pouvant être quant à elle liée à une réduction trop forte des marges pénalisant l’investissement. La productivité et la production totale résultant de l’emploi et du temps de travail moyen constituent, en revanche, des concepts plus porteurs. L’économie française souffre d’abord d’un problème général de déficit d’emplois et d’un manque de gains de productivité. Dans un tel contexte, certaines mesures qui ont été récemment prises vont dans le bon sens – je vous renvoie à ce sujet au document détaillé que je vous ai communiqué.
Alors que nos finances publiques sont dégradées et que les coûts liés au vieillissement de la population augmentent, des priorités doivent être définies.
La première concerne la réduction de la fiscalité pesant sur le travail.
Le maintien d’un haut niveau de protection sociale – lequel semble faire l’objet d’un assez large consensus – passe par l’amélioration de la situation de l’emploi, une gestion rigoureuse des dépenses publiques ainsi qu’une structure fiscale efficace à la fois redistributive et favorable à la croissance. Dans notre pays, la différence entre le coût du travail et le salaire super net est plus élevée que dans les États membres de l’OCDE à l’exception de la Belgique, de la Hongrie et de l’Allemagne, le salaire minimum n’étant toutefois pas très haut dans ce dernier pays. D’où une double conséquence : d’une part, compte tenu de l’état des finances publiques, la baisse de la fiscalité pesant sur le travail passe par un renforcement de la discipline budgétaire, notamment en ce qui concerne le volet des dépenses ; d’autre part, pour pouvoir maintenir un haut niveau de protection sociale, le financement doit davantage porter sur des bases moins défavorables à l’emploi et à la croissance : propriété immobilière, environnement et consommation – je songe au taux réduit de taxe à la valeur ajoutée.
D’une manière générale, il faut rendre la fiscalité plus lisible et efficace, notre système favorisant ceux qui savent tirer partie de son opacité et de sa complexité. Cela passe par l’élargissement des bases, la suppression des niches fiscales et sociales les moins efficaces, la réduction des distorsions, notamment entre l’investissement résidentiel et l’investissement productif, la diminution du soutien à la construction et l’engagement d’une réflexion sur les distorsions engendrées par la fiscalité de l’épargne.
Deuxième priorité : combler le déficit d’emplois.
Au-delà de la perte d’emplois cyclique liée à la grande récession, le déficit structurel s’élève à environ 8 % des emplois dont 2,5 % de taux de chômage structurel et 5 % voire plus en termes de participation à la population active. Le déficit d’emplois concerne principalement les jeunes et les seniors, le taux d’emploi des trente-cinquante-cinq ans étant supérieur à la moyenne de l’OCDE. En outre, le nombre d’emplois manquants est du même ordre de grandeur que l’emploi industriel manufacturé total – 2 millions d’emplois contre 3 millions. Dans ces conditions, les gains de parts de marché à l’exportation ne suffiront pas : nous devons produire plus et tous azimuts en nous attaquant à un problème global. Je vous renvoie, à ce propos, au graphique qui figure dans le document que je vous ai remis et qui met en évidence le fait qu’il n’y a pas de corrélation entre la taille de l’industrie et le taux d’emploi total : ce graphique montre en effet que si le taux d’emploi et la taille des industries dans notre pays sont relativement faibles, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège, le Canada et les Pays-Bas, qui ont encore moins d’industries que nous, ont un taux d’emploi plus élevé, tandis que la Suisse et la Suède, qui sont des pays plus industriels, ont des taux d’emploi très élevés, l’Italie étant quant à elle un pays très industrialisé dont le taux d’emplois est très faible.
Troisième priorité : l’éducation.
Il convient de mieux former les jeunes pour accroître les perspectives à long terme et assurer une meilleure articulation entre les entreprises et la recherche universitaire. Il faut également limiter les situations d’échec scolaire, notamment à un stade précoce, et, enfin, assurer une meilleure adéquation entre les compétences qui sont requises par les entreprises et celles qui sont acquises à la sortie du système éducatif.
Quatrième et dernière priorité, enfin : l’amélioration de l’offre productive.
Cela passe par une adaptation de la fiscalité – en particulier celle de l’impôt sur les sociétés – et peut-être par le financement des petites et moyennes entreprises. Il convient également d’engager une réflexion sur les réglementations et la concurrence.
Mme Agnès Benassy-Quéré, directrice du Centre d’études prospectives et d’informations internationales. Je concentrerai mon intervention sur nos performances à l’exportation.
En la matière, je suis d’accord avec M. Hervé Boulhol : outre que ce sont les parts de marché et non le solde commercial qui mesurent la capacité d’un pays d’être compétitif à l’extérieur, le dynamisme des exportations constitue plus un révélateur de la bonne santé des entreprises qu’un but en soi.
Seules environ 100 000 entreprises du secteur manufacturé sont concernées par les exportations – leur nombre, d’ailleurs, diminue, ce qui ne laisse pas d’être préoccupant –, 10 000 d’entre elles exportant des services – curieusement, peu d’entreprises de services sont exportatrices. Dans les pays étrangers, le dynamisme des exportations reposant pour les deux tiers sur le nombre des entreprises exportatrices et non sur le volume des exportations, l’un des enjeux importants de la politique économique consiste à multiplier le nombre des entreprises qui exportent. J’ajoute que la plupart de nos entreprises exportant vers une seule destination – la Belgique –, un autre enjeu consiste à leur faire franchir une deuxième frontière.
Notre pays, de surcroît, ne comporte pas assez de « gazelles » ou d’entreprises de taille intermédiaire exportatrices, notamment par rapport à l’Allemagne.
Si nous devrions être bien placés en matière d’exportations de services, une étude réalisée par le Centre d’études prospectives et d’informations internationales montre cependant que le potentiel de développement de ce secteur est très lié à la déréglementation en Europe : si la Grèce, par exemple, alignait sa réglementation en matière de services sur celle qui est en vigueur aux Royaume-Uni, nos exportations en direction de ce premier pays doubleraient. Cela constitue également un enjeu pour les années à venir.
Parmi les clés du succès à l’exportation figurent les coûts de production par unité produite, lesquels doivent être comparables à ceux de nos concurrents dans les pays développés européens – et non par rapport à la Chine ou à l’Inde, bien entendu – ainsi que la capacité de répartir d’une façon optimale la chaîne de production. Nombre de travaux montrent, en effet, que l’importation de produits intermédiaires à bas coût peut considérablement aider les entreprises à finaliser des produits compétitifs sur le plan international. De ce point de vue-là, les Allemands ont mieux réussi que nous.
Il faut également compter avec les capacités d’innovation. Nous exportons essentiellement des hautes technologies et des produits haut de gamme – l’un n’étant pas nécessairement lié à l’autre comme en témoigne le vin. Produire de tels biens et investir massivement dans la recherche et le développement supposent d’associer travail qualifié et capital et, donc, d’envisager leur coût respectif.
Les arbitrages entre compétitivité et emploi ne sont pas encore clairement rendus, mais il faut savoir que ces deux questions ne sont pas nécessairement superposables. J’ajoute que le coût du travail peu qualifié est perçu comme relativement contraignant dans notre pays à cause du salaire minimum.
S’agissant des mesures préconisées afin de favoriser les exportations et, donc, les petites et moyennes entreprises, je me permets de vous renvoyer au rapport de l’OCDE.
Par ailleurs, le débat sur le coût du travail me semble très confus. En effet, il ne faut pas confondre le coût horaire et le coût par unité produite. Depuis une dizaine d’années, le coût du travail dans l’industrie manufacturière en France a augmenté plus vite qu’en Allemagne, mais nous disposions d’un avantage initial. Nous avons donc assisté à un rattrapage mais si la dynamique se maintient, le risque de dépassement est grand.
En revanche, s’agissant du coût unitaire et donc corrigé par la productivité, nous ne pouvons pas réaliser de comparaisons de niveau – la productivité étant un indice, il est par exemple impossible d’effectuer une mesure en euro. Selon l’année de base utilisée, le diagnostic variera. En termes de coût unitaire, nous nous situons au même niveau qu’en 1992 par rapport à l’Allemagne – mais quant à savoir si nous étions alors au-dessus ou au-dessous… En tout cas, il est certain que, depuis 2000, dans l’industrie manufacturière, le coût par unité produite a augmenté dans notre pays par rapport à celui de notre voisin.
Il convient également de différencier salaire de marché et salaire minimum. Pour les professions qualifiées ou hautement qualifiées, les salaires observés relèvent du marché et sont donc comme tels équilibrés sans qu’il soit possible de les considérer comme trop élevés ou trop faibles. S’ils sont plus hauts en France qu’en Allemagne, par exemple, c’est que la productivité est plus importante chez nous. Il n’en va pas de même s’agissant de la main-d’œuvre peu qualifiée et du salaire minimum. Si une diminution des charges sociales patronales se répercuterait immédiatement sur le coût du travail peu qualifié, il n’est pas évident qu’il en irait de même sur le travail qualifié en raison, dans ce dernier cas, de la part de la rémunération liée au partage des gains entre l’entreprise et le salarié. Le salaire net des pays dont les charges sociales sont particulièrement élevées – dont la France – tend d’ailleurs à être relativement plus bas. Par ailleurs, lorsque l’on évoque le coût du travail, il faut tenir compte de l’impôt sur le revenu : un niveau plus élevé, comme c’est le cas en Allemagne par rapport à la France, doit se répercuter sur celui du salaire.
S’agissant de la compétitivité-prix dans le domaine manufacturé, les prix à l’exportation ont évolué d’une manière à peu près comparable entre la France et l’Allemagne sur le marché de l’Union européenne à quinze. Les prix français ont évolué légèrement plus vite que les prix allemands sur les marchés extra-européens mais sans comparaison aucune avec la situation italienne où cette évolution a été nettement plus rapide. Il est en revanche troublant que, malgré une telle situation, à la différence de l’Allemagne, nos parts de marché à l’exportation se soient fortement dégradées. En fait, la dégradation des marges des exportateurs français annonce peut-être la compétitivité-prix de demain puisque moins de marges implique moins d’investissements – un lien existe sans doute entre compétitivité-prix et compétitivité hors prix –, à moins que la hausse des prix en Allemagne ne soit liée à une augmentation de la qualité tandis que celle que nous avons connue en France ne le soit à la dégradation de la compétitivité-prix.
J’ajoute qu’il est moins question du coût du travail dans les services, celui-ci ayant explosé en France au cours des dix dernières années, notamment en raison du poids du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
J’en viens au financement de la protection sociale.
En ce qui concerne la main-d’œuvre qualifiée, le transfert d’un prélèvement sur une autre base – cotisations employeurs ou employés, impôt sur le revenu ou taxe à la valeur ajoutée – ne modifierait guère la donne puisque, je le répète, nous sommes sur un marché avec des offres et des demandes, des pénuries dans certaines professions et des excédents temporaires dans d’autres. Il n’en va pas de même en ce qui concerne la main-d’œuvre peu qualifiée puisque le salaire net est rigide. Une baisse des cotisations versées par les employeurs peut donc contribuer à abaisser le coût du travail, l’impact final dépendant toutefois de l’indexation des salaires sur la taxe sur la valeur ajoutée – dès lors que la protection sociale serait financée par une hausse de cette dernière – et de la façon dont les pensions ou les revenus hors salaires sont indexés sur les prix à la consommation, donc, sur cette même taxe à la valeur ajoutée. Une indexation totale serait sans grand effet, une absence d’indexation rendant quant à elle impropre l’expression de « TVA sociale » puisque les gains de compétitivité obtenus le seraient au détriment du pouvoir d’achat de certaines catégories de la population. Une mesure comme la taxe sur la valeur ajoutée « sociale » doit avoir un effet redistributif entre salariés et non salariés mais, également, entre secteurs d’activité. Quoi qu’il en soit, même non profilée, une baisse de cotisation sociale diminue le coût relatif dans les secteurs qui emploient beaucoup de main-d’œuvre non qualifiée. Si de telles mesures, comme en attestent certaines études, seraient favorables à l’emploi, il ne faut pas trop en attendre en revanche sur le plan de la compétitivité.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Selon le document que vous nous avez remis, monsieur Hervé Boulhol, le déficit de la balance courante pourrait en théorie s’expliquer par une forte attractivité du pays pour les investisseurs étrangers alors que les sorties d’investissements directs étrangers indiquent au contraire que la France souffre d’un problème d’attractivité. Considérez-vous donc que l’attractivité pour les investissements étrangers en France soit faible ou forte ? En outre, lorsque Mme la ministre de l’économie assure que les investissements étrangers en France sont importants et nous classent en deuxième position, s’agit-il d’investissements nets ou relevant d’achats de petites et moyennes entreprises qui, chez nous, se vendent beaucoup plus facilement que chez nos voisins, les investissements nets étant dans ce cas relativement faibles ?
M. Jean Grellier. Le document que vous nous avez remis, monsieur Hervé Boulhol, nous permet d’avoir des idées précises à la fois quant à votre diagnostic et aux propositions que vous formulez, sachant que les modalités d’application de chacune d’entre elles devraient faire l’objet de débats assez longs.
Je note un paradoxe dans vos propos concernant le diagnostic : la puissance d’exportation de l’Allemagne serait liée à la maîtrise des coûts sans que son produit national brut bénéficie pour autant de retombées notables alors que la France soutient ce dernier grâce à sa consommation interne. Comment maintenir une consommation interne permettant de soutenir l’économie et le produit national brut tout en ayant une balance extérieure à peu près équilibrée ?
Enfin, certaines filières économiques et industrielles disposeraient-elles d’une organisation particulièrement vertueuse qui les rendrait emblématiques ?
M. Pierre Morange. Quelle est la part de la dynamique démographique dans la compétition internationale lorsque l’on établit un parallèle entre les pays émergents – devenus « émergés », pour reprendre l’expression de M. Nicolas Baverez – comme la Chine, par exemple, une Europe dont la population vieillit et une France que certains considèrent, sur le plan de la démographie, comme « la Chine de l’Europe » ? Quelles peuvent en être les conséquences à moyen et à long terme en matière de compétitivité et de financement de la protection sociale ?
M. Jean-Claude Sandrier. Monsieur Hervé Boulhol, vous avez évoqué une réduction de la fiscalité sur le travail, qui, en clair, signifie une réduction de l’impôt sur les sociétés ainsi que des cotisations sociales. À moins que cette formule ne recouvre d’autres perspectives, pensez-vous qu’une telle politique – pratiquée depuis des années – ait eu des résultats probants, ou bien qu’il faut aller encore plus loin – avec quelles conséquences fiscales et sociales ?
De plus, je m’étonne que sur la vingtaine d’auditions que nous avons réalisée la question des dividendes n’ait été abordée qu’une seule fois. Il me semble pourtant important de savoir ce que l’on fait des richesses produites et de mettre en évidence l’évolution qui a eu lieu pendant les dernières décennies s’agissant du partage de la valeur ajoutée entre salaires, cotisations sociales, dividendes versés aux actionnaires et intérêts bancaires. Les personnes auditionnées étant en revanche unanimes à considérer que l’amélioration de la compétitivité passe par la recherche et le développement, l’innovation, la formation et la qualification ainsi qu’un meilleur financement des petites et moyennes entreprises, une répartition différente des richesses créées par les entreprises ne s’impose-t-elle pas ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. La part du travail dans la valeur ajoutée s’est effondrée de huit points entre 1983 et 1988.
M. Jean-Claude Sandrier. C’est ce que vous objectez toujours !
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Faire de la politique, c’est comme enseigner : il faut répéter !
Mme Agnès Benassy-Quéré. Une dynamique démographique constitue toujours un facteur d’attractivité pour les entreprises – lesquelles sont avant tout attirées par un marché –, même si un pays comme la Belgique demeure par exemple attractif en dépit de sa faible démographie, sa situation au cœur de ce grand marché qu’est l’Europe expliquant sans doute le phénomène.
De plus, dans le cadre d’un système de financement des retraites par répartition, la croissance démographique constitue le rendement des retraites : plus cette croissance est forte, moins la fiscalité pèse et plus la compétitivité s’accroît. Je précise toutefois, s’agissant de la Chine, que l’on y entend désormais des lamentations quant à la diminution programmée de la population – c’est déjà le cas de la population active qui, à l’horizon de 2050, équivaudra à peu près à celle de l’Inde, soit 700 millions de personnes –, à tel point qu’il est même question de remettre en cause la politique de l’enfant unique.
Enfin, dans un pays vieillissant, poser la question démographique implique de soulever celle de l’optimisation de l’épargne afin de compléter le système de retraite par répartition. L’Allemagne s’y applique rigoureusement puisque le solde extérieur d’un pays n’est rien d’autre que l’excès d’épargne sur l’investissement.
Les différences de soldes extérieurs au sein de l’Europe peuvent également refléter, en partie, des différences démographiques. Disposer d’un certain nombre de normes en la matière permettrait d’éclairer le débat quant à l’équilibre optimal entre demande interne et demande externe. Sans doute éviterions-nous dès lors de « tirer » systématiquement sur les Allemands, dont le problème démographique est bien plus important que le nôtre. Les Chinois, quant à eux, ne se privent pas de dire que leur excédent d’épargne s’explique par leurs problèmes démographiques même si, en l’occurrence, c’est faux.
M. Christian Saint-Étienne a coutume de dire que ce sont les retraités qui, en France, bénéficient des dividendes de la croissance – ce qui constitue d’ailleurs l’une des raisons de notre manque de dynamisme.
S’agissant des bénéfices réalisés par les entreprises, les économistes considèrent qu’il importe de tendre vers une neutralité fiscale entre les différents moyens de financement. Or, la distorsion est aujourd’hui très importante en matière d’investissements puisque les entreprises sont fortement incitées à se financer en s’endettant – cela contribue peut-être à expliquer notre attractivité, les investissements directs comprenant les flux de capitaux intra-entreprises. Une filiale française qui s’endette auprès de sa maison-mère étrangère réalise ainsi un investissement direct entrant, lequel n’est donc pas forcément lié directement à une création d’emplois. Dans ces conditions, outre que les entreprises risquent d’être sous-capitalisées, elles se mettront en quête de la meilleure optimisation fiscale possible en Europe. Il s’agit là d’une question politique dont la signification est claire : il faut « soigner » les actionnaires en faisant en sorte que le financement par actions soit taxé de la même manière que le financement par endettement ou l’autofinancement, même s’il est assez difficile de le faire comprendre.
M. Christian Blanc, président. Puis-je, non sans malice, vous demander de répéter ces propos ?
Mme Agnès Benassy-Quéré. Une entreprise qui souhaite investir peut s’autofinancer avec les bénéfices qu’elle a réalisés, s’endetter ou augmenter son capital sur les marchés ou grâce à un certain nombre de prêts. Or, le traitement fiscal de ces trois modes de financement diffère grandement puisque les intérêts d’emprunt sont déductibles du bénéfice imposable alors que les dividendes versés ne le sont pas. Les économistes préconisent en général un traitement fiscal neutre, ce qui implique une moindre taxation des dividendes perçus par les ménages, lesquels ont déjà été taxés à travers l’impôt sur les sociétés. C’est d’ailleurs ce à quoi tendent les prélèvements libératoires en vigueur dans un certain nombre de pays, même si, je le répète, cela est difficile à faire comprendre puisque seule une partie de la population profite d’un tel dispositif.
M. Hervé Boulhol. En ce qui concerne les flux nets d’investissements directs étrangers, monsieur Pierre Méhaignerie, les sorties nettes en France depuis les années 2000 représentent en moyenne 2,7 points de produit intérieur brut par an – ce qui est beaucoup – alors que, depuis 1995, nous n’avons compté aucune entrée nette.
S’agissant des flux bruts, il semble que 50 à 60 milliards d’euros d’investissements directs étrangers entrent en France contre 70 milliards avant la crise, mais l’étude de référence réalisée par la Banque de France pour l’année 2009 montre qu’il convient de corriger ces données en incluant les flux entre filiales. Dans ce cas-là, le solde net représente une sortie de l’ordre de 70 milliards d’euros, les entrées étant quant à elles nulles, les firmes étrangères rapatriant certains profits.
M. Christian Blanc, président. Une grande entreprise étrangère achetant une entreprise française disposant d’un réseau de distribution en France achète en fait des parts de marché de consommation. Il s’agit donc d’un investissement que nous avons tendance à ne pas mentionner comme tel, notre approche étant limitée aux investissements considérés comme strictement productifs. Comment distinguez-vous ces deux modes d’investissement ?
Mme Agnès Benassy-Quéré. Nous avons en effet tendance à considérer que les investissements directs entrants concernent au premier chef la construction d’usines avec des créations d’emplois à la clé alors qu’ils sont minoritaires. En fait, une partie des investissements entrants correspond, comme cela a été dit, à des prêts entre filiales, une autre partie relevant des rachats d’entreprises françaises par des entreprises étrangères. Ainsi, de plus en plus de travaux économiques dédiés à l’attractivité et aux investissements directs concernent-ils non pas les flux de capitaux entrants ou sortants mais le nombre d’emplois créés dans des filiales d’entreprises étrangères.
M. Christian Blanc, président. Ces travaux sont en cours et les chiffres dont nous disposons ne font pas état de cette nouvelle situation.
Mme Agnès Benassy-Quéré. Ce sont en effet les chiffres issus de la balance des paiements tels qu’ils sont établis par la Banque de France. Les chiffres concernant l’emploi proviennent quant à eux d’enquêtes qui impliquent un système statistique de collecte différent.
M. Christian Blanc, président. L’aspect théorique auquel M. Hervé Boulhol a fait référence dans son document décrit une situation où, pendant dix ans, de très importants investissements ont eu lieu afin d’acheter des entreprises dont les structures, une décennie plus tard, sont devenues très différentes.
Mme Agnès Benassy-Quéré. Il faut être cohérent : si l’on s’émeut parfois des investissements de la Chine en Europe – lesquels accroissent la compétitivité des entreprises chinoises –, il convient également de reconnaître qu’il en est de même lorsque les entreprises françaises investissent à l’étranger. Pas plus que le nombre d’investissements directs étrangers entrants n’est un gage d’attractivité, le nombre d’investissements directs étrangers sortants ne témoigne d’un défaut d’attractivité : investir à l’étranger contribue également à renforcer les entreprises.
M. Hervé Boulhol. S’il convient, en effet, d’user avec précaution du terme d’attractivité, la crainte d’un rachat des entreprises françaises est excessive dès lors que, depuis vingt ans, c’est nous qui avons surtout racheté ou créé des entreprises à l’étranger.
M. Christian Blanc, président. Il n’en est pas moins vrai que les petites et moyennes entreprises qui emploient de 400 à 600 personnes dans des secteurs innovants sont presque systématiquement rachetées, notamment par des entreprises américaines. Les décideurs, quant à eux, ont besoin d’une approche qualitative de ces groupements.
M. Hervé Boulhol. La part des salaires dans la valeur ajoutée ne pouvant baisser indéfiniment, il est difficile d’extrapoler de ce qui s’est passé en Allemagne depuis une dizaine d’années. Mme Agnès Bénassy-Quéré a eu raison de faire état du rattrapage auquel nous avons assisté, l’évolution des salaires ayant été très dynamique en Allemagne après la réunification. En l’occurrence, monsieur Jean Grellier, nous pouvons nous attendre à un rééquilibrage en Allemagne en faveur de la demande domestique, laquelle profiterait beaucoup aux exportateurs français. Si la cause structurelle de la modération salariale relève donc, peut-être, de la correction de différents excès et, donc, d’un rattrapage – dans ce cas-là, nous nous approchons de la limite d’un tel exercice –, elle peut aussi résulter de réformes ayant modifié le rapport de forces en Allemagne à travers notamment l’affaiblissement durable des syndicats. De surcroît, la stratégie allemande reposant sur l’externalisation de la fabrication de certaines pièces intermédiaires, les menaces de délocalisations peuvent également peser sur l’évolution des salaires. Quoi qu’il en soit, la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée témoigne de ce que ces derniers ne suivent pas l’évolution de la productivité, d’où le déséquilibre.
En France, en revanche, nous mettons l’accent sur un renforcement de l’offre productive comme en attestent un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment et qui vont dans le bon sens, par exemple en matière de recherche et développement ou en ce qui concerne l’autonomie des universités.
Si le taux facial de l’impôt sur les sociétés, monsieur Jean-Claude Sandrier, est très élevé, le taux effectif n’en est pas moins, en effet, relativement faible en raison du nombre de niches fiscales. Une mesure budgétairement neutre consisterait à baisser le taux statutaire et à supprimer certaines niches fiscales qui profitent d’ailleurs plus aux grandes entreprises qu’aux petites et moyennes entreprises.
Le dynamisme démographique français, monsieur Pierre Morange, constitue quant à lui un atout. Mais il ne faut pas oublier le rôle des politiques publiques en la matière. À cet égard, une évaluation des politiques publiques familiales me semble néanmoins nécessaire afin de vérifier s’il est possible de parvenir à maintenir ce dynamisme mais à moindre coût. Outre que des économies peuvent être en effet réalisées, il convient d’ajouter que le coût du vieillissement est moins cher chez nous que dans un certain nombre de pays, dont l’Allemagne.
S’agissant de la fiscalité du travail, nous préférons parler de « coin fiscal » pesant sur le travail, soit, de la différence entre le coût du travail supporté par les entreprises et le salaire net des salariés. Cela comprend en l’occurrence l’ensemble des cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. La teneur idéologique de ces questions est importante, mais nous considérons que les allégements de cotisations sociales sur les bas salaires constituent une bonne mesure puisque ces 22 milliards rapportés au coût par emploi brut – tout en tenant compte des effets de bouclage – ont permis de préserver entre 600 000 et 800 000 emplois. Toutefois, il importe qu’une telle politique se limite aux seuls bas salaires afin de contourner les problèmes liés à un salaire minimum relativement élevé par rapport au salaire médian.
Comme l’a dit Mme Agnès Benassy-Quéré, les difficultés principales concernent les services où notre situation diffère grandement de celle de l’Allemagne. Le coût du travail d’un employé dans une boulangerie allemande et celui d’une personne travaillant dans une boulangerie française, par exemple, comporte des écarts extrêmement importants à la différence de ce qui se passe dans l’industrie.
Mme Agnès Benassy-Quéré. Il s’agit davantage d’un problème lié au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) qu’à la fiscalité car si les Français paient plus de cotisations sociales, ils s’acquittent d’un moindre impôt sur le revenu quand les Allemands font l’inverse.
M. Jean Grellier. Existe-t-il donc des filières économiques ou industrielles vertueuses sur lesquelles nous pourrions-nous appuyer ? Cette question me paraît d’autant plus importante que nous sommes à la veille de la construction de nouvelles filières liées aux énergies renouvelables, à l’éco-construction ou aux économies d’énergies.
M. Hervé Boulhol. L’OCDE considère que c’est au marché, et non au politique, d’allouer au mieux les ressources entre les différents secteurs, qu’il s’agisse du capital ou de l’investissement. Si, en l’état, il est très difficile d’identifier ceux d’entre eux qui seraient les plus porteurs, il importe en effet au premier chef d’éviter de créer des distorsions fiscales entre secteurs d’activité ou entre entreprises d’un même secteur.
En revanche – et là, il y a peut-être consensus –, il convient de privilégier la recherche et le développement ainsi que l’innovation afin d’engager une dynamique positive. D’où l’importance de l’autonomie des universités, du rapprochement entre la recherche universitaire et les entreprises ainsi que du crédit impôt recherche – même s’il faut vérifier qu’il n’y a pas d’abus en la matière compte tenu de son coût budgétaire. Quoi qu’il en soit, nous sommes plutôt favorables à ce type de mesures globales.
M. Christian Blanc, président. Madame, monsieur, je vous remercie pour la précision de vos exposés et de vos réponses.
*
AUDITION DU 13 AVRIL 2011
Audition de Mme Geneviève Roy, vice-présidente en charge des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), M. Pascal Labet, directeur des affaires économiques et fiscales, et M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales, de M. Jean-Bernard Bayard, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Mme Catherine Lion, directrice générale adjointe et Mme Nadine Normand, attachée parlementaire, de M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), M. Michel Guilbaud, directeur général et M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques, et de M. Jean Lardin, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA), et M. Pierre Burban, secrétaire général
M. Benoit Roger-Vasselin, président de la commission des relations du travail du Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Depuis une dizaine d’années, la France perd des parts de marché alors que l’Allemagne en gagne. Sur la période 2000-2009, la France a vu sa part diminuer de trois points dans le total des exportations européennes, passant de 12,7 % à 9,8 %. L’Allemagne a, dans le même temps, augmenté la sienne de 2,5 points, passant de 24,8 % à 27,3 %.
Des différences structurelles de compétitivité hors prix existent entre la France et l’Allemagne. Pour faire bref, la qualité des produits allemands est le plus souvent jugée supérieure, mais jusqu’il y a peu la France compensait par un coût du travail moins élevé.
Mais depuis 2000, l’évolution des coûts de production a divergé entre la France et l’Allemagne, et cette dégradation de la compétitivité-prix explique la divergence de compétitivité entre nos deux pays.
Selon les chiffres récents d’Eurostat, le coût du travail a augmenté nettement plus vite en France qu’en Allemagne. En 2000, le coût horaire du travail en France était inférieur de 8 % au coût horaire en Allemagne – 24,4 euros en France contre 26,3 en Allemagne. En 2008, il le dépassait de près de 10 % puisqu’il était de 32,20 euros, contre 29,30 euros en Allemagne.
Ces écarts s’expliquent en grande partie par l’évolution des charges pesant sur le travail. Au cours de la période 2000-2008, les charges annexes – dont les cotisations sociales patronales constituent la part la plus importante – ont augmenté de 39 % en France, contre seulement 2 % en Allemagne.
Au-delà de la période récente, la hausse des taux de cotisation en France est le fruit de la politique continue que nous menons pour faire face à l’accroissement des dépenses de protection sociale – qui représentent une part de plus en plus élevée du produit intérieur brut (PIB) français. La France est le pays de l’Union européenne qui consacre la part la plus élevée de son PIB au financement de la protection sociale – 31,1 % du PIB en 2006.
L’accroissement continu des taux de cotisation renchérit le coût du travail, pénalise la compétitivité-prix et grève la croissance des salaires nets.
Malgré la montée en charge progressive de la contribution sociale généralisée (CSG) depuis vingt ans, le financement de la protection sociale en France est encore majoritairement assuré par les cotisations sociales. D’une part, le pourcentage des contributions publiques dans le financement de la protection sociale reste inférieur en France à ce qu’il est dans les autres pays européens. Même l’Allemagne, modèle bismarckien du fait de son histoire, consacre une part plus grande de contributions publiques au financement de sa protection sociale. D’autre part, les contributions publiques qui servent au financement de la protection sociale correspondent pour l’essentiel à la CSG. Or, si l’assiette de cette dernière est plus large que celle des cotisations – puisqu’elle est également assise sur les revenus de remplacement et sur ceux du patrimoine –, la CSG s’applique aussi aux revenus du travail.
De plus, le vieillissement démographique fait craindre un rythme soutenu de progression des besoins de financement de la protection sociale.
Si l’essentiel du déficit se situe au niveau de l’État, le dynamisme de la dépense relève de la sécurité sociale et des collectivités locales. L’évolution des comptes sociaux est en particulier préoccupante pour deux raisons : d’une part, à cause d’un déficit social structurel qui est incompatible avec le niveau des dépenses sociales souhaitées, lesquelles ne sont pas des dépenses d’investissement, et qui a pour effet de reporter la charge du financement des dépenses sociales actuelles sur les générations futures ; d’autre part, du fait d’un déficit social et de la montée en charge de la dette sociale qui sont en profond décalage avec les perspectives de vieillissement de la population française, qui créeront des besoins de financement supplémentaires – retraite, maladie, dépendance.
Selon les projections démographiques de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de novembre 2010, la France métropolitaine compterait environ 74 millions d’habitants en 2060, soit plus de 11 millions qu’en 2007, mais le nombre de personnes de plus de 60 ans augmenterait à lui seul de 10 millions. En 2060, une personne sur trois aurait plus de 60 ans ! Selon l’INSEE, pour maintenir le ratio de dépendance économique de 2007, il faudrait faire passer l’âge pivot à 68 ans en 2060.
Dès lors, nous devons nous interroger sur le système de financement de notre protection sociale.
Comment financer des dépenses de protection sociale – vieillesse, maladie – qui progressent plus rapidement que le PIB ?
Quelle est la cohérence d’un mode de financement essentiellement bismarckien, assis sur les cotisations, avec l’universalisation des prestations dans les branches Famille et Maladie ?
Quel serait le mode de financement de la protection sociale le plus efficace du point de vue de la compétitivité ? On sait que la France a fait le choix de maintenir un niveau élevé de taxation des facteurs de production et de réduire les prélèvements obligatoires assis sur la consommation.
Dans son Livre blanc ayant pour titre Besoin d’air, le MEDEF proposait de faire financer davantage la protection sociale par la solidarité nationale.
Sur le plan des principes, c’est la distinction entre logique assurantielle et logique de solidarité au niveau des dépenses qui permet de fonder ou non un financement par des cotisations. Toute la question est de savoir quel est le lien qui unit la dépense sociale et l’entreprise ou le statut de salarié.
En matière de politique familiale par exemple, les allocations familiales et les allocations pour personnes handicapées n’ont objectivement aucun lien avec l’entreprise ou le statut de salarié. En Allemagne, il n’existe pas de branche Famille au sein de la sécurité sociale : il s’agit de dépenses qui relèvent du budget de l’État et qui sont intégralement fiscalisées.
La fiscalisation progressive de la branche Maladie depuis le début des années 1990 se justifie également par l’universalisation des prestations – avec la création de la couverture maladie universelle (CMU) –, par l’étatisation de notre système de santé – avec les lois de 2004 puis de 2009 – et par la nature du risque maladie, qui relève davantage d’une logique de solidarité que de l’assurance.
Il conviendrait, en outre, tout en en réduisant le coût, d’améliorer l’efficacité de notre système de protection sociale.
M. Jean-Bernard Bayard, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Je vous remercie de nous donner l’occasion de nous exprimer sur la compétitivité de notre économie et le financement de la protection sociale.
Si la France reste à la tête des pays européens pour les volumes de productions agricoles, elle a été dépassée par l’Allemagne et les Pays-Bas pour ce qui est de l’agro-alimentaire.
La compétitivité d’un pays dépend de plusieurs éléments et, en premier lieu, de l’innovation. À cet égard, notre pays est confronté à des distorsions de concurrence. Ainsi, dans le domaine des biotechnologies par exemple, alors qu’un certain nombre de variétés d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sont autorisées dans le reste de l’Europe, la France maintient son interdiction. Les productions OGM couvrent 80 000 hectares en Espagne pendant que nous ne produisons pas un seul produit de cette nature, tout en continuant naturellement à les consommer. De même, pour ce qui est des produits « bio », les normes ne sont pas identiques dans tous les pays de l’Union européenne. Par ailleurs, en dépit du tarif proposé pour le rachat de l’électricité, notre pays ne compte que 50 unités de méthanisation contre 5 000 unités en Allemagne. J’ajoute que, grâce au recours à la cogénération, les tomates de Belgique bénéficient d’un avantage de 70 centimes par kilo.
S’agissant des installations classées, on note une certaine évolution. Toutefois, si dans notre pays il faut parfois attendre deux à trois ans avant qu’un dossier soit accepté, ce délai n’existe pas dans les pays voisins. Nous avons progressé s’agissant du seuil des élevages laitiers, mais nos productions porcines et avicoles souffrent d’un différentiel important par rapport à celles des pays voisins.
Nos productions sont par ailleurs pénalisées par l’interdiction d’utiliser un certain nombre de produits phytosanitaires qui sont tolérés dans les pays voisins. D’où le risque de disparition de diverses productions.
Quant à la remise en cause de la détaxation des produits énergétiques servant à l’agriculture, elle mettrait le secteur agricole dans une situation extrêmement difficile.
Nous souhaitons par ailleurs la pérennisation du dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIC), qui est adopté chaque année dans la loi de finances.
J’en viens au coût du travail. En 2010, le salaire minimum de croissance (SMIC) en France s’élevait à 1 343 euros bruts mensuels – avec une part de 22 % de cotisations sociales payées par l’employeur. Or, à la même époque, il n’était que de 633 euros en Espagne – le fait que de nombreux étrangers travaillent en Espagne dans le secteur agricole sans le moindre contrôle contribue à y faire baisser encore le coût du travail. Aux Pays-Bas, les agriculteurs qui embauchent des jeunes sont exonérés de cotisations sociales ; or les jeunes représentent un quart de la main-d’œuvre permanente. En Allemagne, les employeurs agricoles ne sont pas contraints à se conformer aux minima conventionnels et leurs cotisations patronales représentent environ 20 % du salaire brut. En outre, depuis les accords germano-polonais de 1990, les exploitations allemandes bénéficient d’une réglementation spécifique qui leur permet de recourir à une main-d’œuvre à bas coût originaire des pays de l’Europe de l’Est – les Polonais représentent aujourd’hui 30 % de la main-d’œuvre agricole en Allemagne.
De telles distorsions emportent un certain nombre de conséquences. Ainsi, en dix ans, la production d’asperges a baissé de 43 % en France pendant qu’elle augmentait de 64 % en Allemagne. Dans le même temps, la production de fraises a diminué de 31 % en France mais progressé de 65 % en Allemagne…
Il faut sortir de cette situation et prendre des mesures concrètes pour abaisser le coût du travail. La FNSEA est prête à participer à tout débat qui pourrait s’engager autour de ces questions. Nous n’avons nullement l’intention de remettre en cause les avantages acquis en matière de protection sociale, mais le coût du travail doit être revu. En tout cas, la compétitivité de l’agriculture française nécessite de prendre des mesures d’urgence. Pour que l’activité agricole ne soit plus pénalisée, il faut asseoir les cotisations sociales non plus sur les revenus du travail mais sur la consommation : de la sorte, les produits importés supporteraient le même coût social que les produits français.
La réponse à nos problèmes est en partie européenne. L’Europe doit renouer avec sa mission initiale de coopération et de convergence entre les États membres, et éviter que n’ait lieu en son sein une compétition stérile favorisant le dumping social et fiscal.
Mme Geneviève Roy, vice-présidente en charge des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Je souscris à un certain nombre de propos qui ont été tenus. Dire que la France est championne d’Europe, voire des pays de de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), en termes de prélèvements obligatoires et que cela a des conséquences sur la compétitivité de nos entreprises est une litote, mais d’autres éléments concourent également à la détermination du coût du travail : le prix des matières premières, la parité entre l’euro et le dollar, entre l’euro et le yuan ou encore le crédit impôt recherche…
Revenir sur les « allégements Fillon » ou la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat provoquerait une augmentation du coût du travail et freinerait l’embauche : plus les charges sont lourdes, moins d’emplois sont créés. Il faut toutefois noter qu’en dépit des charges et de toutes les mesures qui entravent la compétitivité de nos entreprises, près de 3,4 millions d’emplois ont été créés depuis 30 ans dans les entreprises de un à 200 salariés.
J’ajoute que si la protection sociale a un coût, elle est aussi un investissement pour l’avenir et l’un des piliers de notre pacte social. Il faut veiller à ce que chaque euro dépensé le soit au mieux de manière à maintenir ce lien essentiel.
La comparaison avec l’Allemagne est sans doute pertinente parce que ce pays est notre principal concurrent, mais l’Allemagne n’est pas la France : la structure des entreprises y est totalement différente, de même que celle du capital, qui est plus familiale, et les relations avec les banques. Mais cette comparaison nous invite à nous interroger. Sur le plan du coût du travail dans l’industrie, nous sommes quasiment à égalité, à une différence près : les salariés allemands perçoivent un salaire net bien plus important que les salariés français. Nous allons devoir procéder à un transfert, et sur cette question le débat est ouvert. Certes, l’expression de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sociale est souvent vilipendée, mais elle est éloquente. En tout cas, on pourrait faire en sorte que tout ce qui ressortit à la politique familiale ne relève pas des entreprises et soit transféré à la solidarité nationale : de la sorte, les charges des entreprises pourraient être allégées, le transfert s’opérant sur la contribution sociale généralisée sur la TVA dont le taux pourrait être augmenté – c’est d’ailleurs ce qu’a fait l’Allemagne, même si le taux de TVA y était plus faible que chez nous.
De nombreux organismes réfléchissent au financement de la protection sociale, parmi lesquels le Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui rendra sa copie fin juin, après des débats intenses.
M. Jean Lardin, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA). Après sept trimestres consécutifs d’amélioration, la reprise est désormais perceptible dans l’artisanat et le commerce de proximité. Ainsi, la croissance du chiffre d’affaires global de ce secteur s’établit à 1 % en valeur au quatrième trimestre 2010 par rapport au même trimestre de l’année précédente. La tendance annuelle, à l’issue de l’année 2010, est de – 0,5 %, soit cinq points de plus qu’au terme de l’année 2009.
Pour autant, la trésorerie des artisans et commerçants de proximité reste fragile, 21 % d’entre eux faisant encore état d’une détérioration de leur situation financière, contre 34 % à la fin 2009. De même, les chefs d’entreprise continuent d’envisager les prochains mois avec inquiétude. Près d’un quart d’entre eux craignent une baisse de leur chiffre d’affaires au premier trimestre 2011, contre 14 % qui prévoient une hausse.
Les discours récurrents sur la compétitivité ne s’intéressent en réalité qu’à celle des entreprises de grande taille, tournées vers l’international et qui relèvent du secteur industriel. Ce raccourci conduit à occulter le fait que la compétitivité de ces entreprises ne peut se concevoir sans une économie « résidentielle » efficace et solide et, plus généralement, sans compter sur un tissu de petites entreprises, qui représentent la très grande majorité des entreprises de notre pays. Compte tenu du rôle joué par l’économie « résidentielle » comme facteur de développement économique local, ces catégories d’entreprises participent à côté de la « composante mondialisée » à la compétitivité des territoires et contribuent directement à l’attractivité de notre pays. Il ne faut donc pas dissocier les grandes entreprises et les petites entreprises.
Les grandes entreprises industrielles qui ont perdu du terrain en France ont un point commun avec les entreprises artisanales et du commerce de proximité : elles sont utilisatrices de main-d’œuvre. Par conséquent, l’arbitrage défavorable au coût du travail que la France a connu ces dernières années les a donc également pénalisées.
En ce qui concerne la taille des entreprises, l’UPA émet des réserves sur le discours récurrent du « faire grandir » qui vide de son contenu le Small Business Act prôné par ailleurs. Il faut éviter de tenir des discours contradictoires. Nous pensons quant à nous que toutes les entreprises n’ont pas vocation à grandir. Au reste, pour certaines d’entre elles, la principale de leur préoccupation est celle du maintien – notamment en raison de l’âge avancé de certains chefs d’entreprise.
En matière de perspectives à court et moyen termes, les entreprises artisanales et du commerce de proximité sont tout autant que les autres touchées par la hausse des prix des matières premières – pétrole, métaux, denrées agricoles –, dont il est très probable qu’elle va perdurer.
Un marché du travail durablement dégradé, des salaires nominaux en faible progression, une inflation temporairement en hausse qui ponctionne le pouvoir d’achat et pourrait entamer la confiance des consommateurs ainsi qu’une absence de reprise franche du crédit sont autant de facteurs qui font douter de la bonne santé de la consommation des ménages dans l’avenir. Or nos activités s’adressant essentiellement à nos compatriotes, le moral des ménages constitue pour nous un élément très important.
J’en viens à l’imposition des entreprises et à l’état des comptes sociaux.
D’autres avant moi l’ont rappelé, outre que le taux des prélèvements obligatoires sur les entreprises en France est le plus élevé d’Europe, ces prélèvements sont principalement assis sur le travail. Parallèlement à cette forte pression sur les entreprises, le taux de couverture des dépenses des régimes de base de sécurité sociale par les recettes est très défavorable dans notre pays. Je partage ce qu’ont indiqué les autres intervenants à propos du financement de la politique familiale : sur ce point, nous sommes sur la même longueur d’onde.
Il faut donc, tout en maintenant une action forte et déterminée sur la maîtrise des dépenses, poursuivre l’élargissement de l’assiette des prélèvements sociaux, qui est aujourd’hui fortement concentrée sur les seuls revenus du travail.
Quelques mots sur l’état du marché de l’emploi.
Compte tenu du foisonnement des textes, législatifs ou réglementaires, et de la propension des gouvernements à empiler plutôt qu’à simplifier, il est souhaitable que chaque mesure nouvelle soit précédée d’une étude d’impact pour nous permettre d’en mesurer tout à la fois le coût et l’intérêt. Certes, cette demande n’est pas nouvelle, mais je tiens à la renouveler devant vous.
Il est tout aussi souhaitable d’accompagner d’un suivi la mise en œuvre de toute nouvelle disposition.
En outre, et dès lors que le respect des principes fondamentaux fixés par la loi serait garanti, nous pourrions considérer comme positives toutes les initiatives tendant à confier aux branches professionnelles la responsabilité de définir les relations entre entreprises et salariés. Cette gestion au plus près des problématiques permettrait d’instaurer des normes plus efficaces et plus effectives.
J’aborderai maintenant le système d’exonération de charges sociales.
La France est le pays de l’Union européenne où le poids des cotisations sociales par rapport au PIB est le plus élevé. C’est bien pour réduire le coût du travail lié aux charges sociales que les gouvernements successifs se sont engagés depuis de nombreuses années dans des politiques d’allégement de cotisations, faisant de ces dispositifs un des piliers de la politique de l’emploi en France. Ces dispositifs d’allégement de charges ont été mis en place par les pouvoirs publics à partir de 1993 – et non de 1998, comme certains ont essayé de nous en convaincre – afin de réduire le coût du travail des emplois peu qualifiés dans le but d’inverser la tendance, alors observée, à la diminution de ce type d’emplois.
La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et à l’emploi, dite « loi Fillon », a simplifié les dispositifs en vigueur en instaurant une réduction générale dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale de 26 points au niveau du SMIC. Il faut noter que, depuis 1993, les dispositifs d’allégement ont fait l’objet de huit réformes majeures.
Ce qui est certain, c’est que les allégements de charges ont permis de créer des emplois, comme le confirment le rapport du Commissariat général au Plan sur l’application des 35 heures, le dix-neuvième rapport du Conseil national des impôts ou encore le rapport de l’INSEE sur les allégements de charges jusqu’à 1,3 SMIC.
La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) constate dans l’un de ses rapports que la politique d’allégement des cotisations sur les bas salaires a fait la preuve de son efficacité, ajoutant qu’une suppression totale des allégements de charges conduirait à détruire environ 800 000 emplois en quelques années.
Pour faire face à la complexité du dispositif actuel et pour assurer une lisibilité aux entreprises en les préservant de changements incessants, le Premier ministre a avancé la possibilité d’intégrer des allégements de charges dans le barème des cotisations sociales. Le débat ouvert par l’annonce du Premier ministre soulève la question de la conservation de la notion de dérogation pour les dispositifs d’allégement de cotisations patronales par rapport à un taux unique ou, au contraire, celle d’un affichage clair de la progressivité des cotisations sociales en intégrant les allégements dans un barème.
La « barémisation » aurait des effets en termes de simplification des déclarations des entreprises : au lieu de deux opérations – calcul à taux plein puis application de la réduction –, les entreprises ne procéderaient plus qu’à un seul calcul – calcul avec un taux progressif. En dépit de quelques difficultés d’application, notamment pour les plus petites entreprises, cette orientation serait sans doute la meilleure pour pérenniser les allégements de cotisations sociales et éviter d’éventuelles remises en cause, compte tenu du débat actuel portant sur le coût de la politique d’allégement des charges et de la volonté affichée de réduire les niches fiscales et sociales.
Par ailleurs, la réouverture de ce débat devrait s’accompagner d’un autre débat touchant à l’assiette globale du financement de la protection sociale. L’UPA demande en effet de moins faire peser sur les entreprises de main-d’œuvre le financement de la protection sociale, car cela permettrait de réduire le coût du travail et ainsi d’améliorer la compétitivité de nos entreprises.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Globalement, la France n’est pas trop mal placée par rapport aux pays européens en termes d’emplois, de pouvoir d’achat et de consommation des ménages.
Si nous partageons le diagnostic, la question est de savoir comment rendre notre économie plus compétitive. À cet égard, souvenez-vous de la formule du Premier ministre luxembourgeois : « Ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais. Dites-moi comment le faire ! ».
Monsieur Benoît Roger-Vasselin, il serait souhaitable en effet que les 5,4 points de cotisations familiales ne soient plus financés par les entreprises, mais fiscalisés. Mais où placez-vous cette priorité par rapport notamment à la baisse des prestations et des remboursements, à la hausse de la TVA, à la remise en question d’un certain nombre de déductions fiscales ou du niveau de l’impôt sur le revenu ?
Monsieur Jean-Bernard Bayard, je vous remercie d’avoir bien posé les problèmes pour l’agriculture et de ne pas avoir demandé à la Nation des sacrifices trop durs. Je partage totalement vos propos sur les OGM, les normes, la méthanisation ou encore la longueur du délai pour bénéficier d’installations classées. Nous sommes un certain nombre de parlementaires à nous battre pour que notre pays revienne dans la norme européenne.
Madame Geneviève Roy, monsieur Jean Lardin, il est vrai que les cotisations sociales en France sont élevées et pèsent sur le travail. Cependant, les taux des cotisations patronales de sécurité sociale de notre pays – 19 points pour 1 SMIC ; 25 points pour 1,1 SMIC ; 30 points pour 1,2 SMIC – se situent en dessous de la moyenne européenne, qui est de 32 points. Dans ces conditions, pensez-vous que l’arbitrage soit défavorable au coût du travail pour les salaires inférieurs à 1,3 SMIC ?
Par ailleurs, la « barémisation », souhaitée par les uns et les autres, ne va-t-elle pas favoriser les secteurs protégés au détriment des secteurs concurrentiels, en particulier l’industrie – dont les salaires se situent souvent au-delà de 1,4 à 1,5 SMIC – qui n’en bénéficiera pas ?
Enfin, si nous avons légèrement baissé les cotisations des employeurs payant les treizième et quatorzième mois, c’est parce qu’un salarié payé quatorze mois au SMIC est toujours, selon les syndicats, perçu comme un smicard.
Dans ces conditions, êtes-vous favorables à la barémisation ?
M. Marc Laffineur, président. Dans le secteur de l’agriculture, la diminution importante des charges sur les saisonniers, qui représentent à peu près 50 % de la masse salariale, permet-elle à la France de se situer dans la moyenne européenne en la matière ?
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la différence qui existe entre l’Espagne et la France en matière de contribution sociale, élément très important pour le secteur des fruits et légumes ?
Madame Geneviève Roy, pouvez-vous nous préciser ce que vous avez dit sur le crédit impôt recherche ? Il m’a semblé comprendre que, pour vous, c’était un coût.
Mme Geneviève Roy. Je voulais dire que la compétitivité dépend de plusieurs éléments et que le coût du travail n’est pas le seul facteur à prendre en compte.
M. Marc Laffineur, président. Les charges sont sans doute trop élevées. En plus des prestations familiales, quelles charges ne devraient plus être assises sur les salaires ?
M. Benoît Roger-Vasselin. Pourquoi les chefs d’entreprise français préfèreraient-ils de beaucoup payer des charges sociales non allégées en Allemagne plutôt que des charges dites « allégées » en France ? Cherchez l’erreur.
Pourquoi, alors que le salaire brut français est plus élevé que le salaire brut allemand, le salaire net allemand est-il plus important que le salaire net français ?
Pourquoi la Cour des comptes préconise-t-elle une meilleure lisibilité et une stabilité de la fiscalité ? À en croire son Premier président, « la multiplication de taxes et prélèvements a pu annuler les effets de la politique d’allégement des cotisations sociales sur les bas salaires ».
En se posant ces questions, on trouve les réponses.
Monsieur le rapporteur, le MEDEF demande, non pas une remise en question, mais une refonte en profondeur de notre protection sociale. Il est en effet possible de mieux dépenser pour dépenser moins.
Une réflexion commune avec les partenaires sociaux doit donc être menée sur la manière de mieux dépenser l’argent des Français tout en faisant en sorte que notre modèle social soit préservé et devienne plus efficace. Dans la mesure où les dépenses liées à l’augmentation de l’espérance de vie et donc à la santé seront à l’avenir bien plus importantes que la richesse nationale, nous avons le devoir de nous interroger collectivement.
Nous sommes prêts à participer à cette réflexion commune. Après délibération de notre conseil exécutif, nous prendrons la parole sur cette question, dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle.
En tout cas, pour nous, il n’est pas question de revoir à la baisse notre modèle social ; ce qui importe, c’est de l’améliorer tout en en diminuant les coûts.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Au-delà de la suppression des 5,4 points de cotisations familiales pesant sur le travail, on pourrait, en luttant contre les fraudes et en excluant toute baisse des prestations, récupérer 5 à 6 milliards d’euros. Resterait une trentaine de milliards à trouver. Entre la hausse de la TVA, celle des impôts ou la réduction significative des niches, quelle est votre priorité ?
M. Benoît Roger-Vasselin. Cette question, monsieur le rapporteur, est actuellement débattue dans notre organisation. Une fois que notre position aura été entérinée, nous vous en ferons part.
Je précise que le MEDEF ne prend pas position sur la fiscalité des personnes physiques.
Mme Geneviève Roy. La CGPME est favorable à la « barémisation », à condition qu’elle ne soit ni complexe ni coûteuse. À cet égard, je ne suis pas sûre qu’un barème assorti de tranches soit si simple à mettre en œuvre pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME). Il conviendra donc de veiller à ce que le dispositif soit techniquement simple et lisible, la sécurité juridique étant primordiale pour une entreprise.
En outre, les 22 milliards d’« allégements Fillon » devront être intégrés dans la barémisation, sans dépasser le plafond de 1,6 SMIC afin de ne pas générer de coûts supplémentaires pour les plus hauts salaires. De cette manière, nos entreprises adhéreraient plus facilement à ce système.
Par ailleurs, les PME et les TPE ont très souvent recours aux contrats en alternance et aux contrats d’apprentissage et ne voient donc pas dans la « barémisation » une contrepartie.
S’agissant des allocations familiales, j’ai du mal à croire au « grand soir » de la fiscalité. Tout bouleverser en une seule fois me semble compliqué. Peut-être pourrions-nous procéder pas à pas – par exemple, en commençant par basculer trois points sur la TVA –, tout en restant vigilant sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens, puisque notre chiffre d’affaires en dépend.
Enfin, la comparaison avec l’Allemagne – confrontée à un problème démographique – nous est plutôt favorable à l’heure actuelle. Il faut veiller à préserver notre politique familiale qui représente, certes, un coût, mais aussi un investissement et donc notre richesse de demain. Comparaison n’est pas raison.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. En 2006 et en 2007, nos dépenses sociales ont progressé moins vite que nos recettes. Il a alors été prévu d’abandonner un ou un demi point de cotisations par an, mais la crise est passée par là…
M. Benoît Roger-Vasselin. Notre pays a la chance de connaître deux miracles : un fort taux de natalité et un taux élevé d’activité des femmes. Bien évidemment, il n’est pas question de toucher à la politique familiale de la France. Le MEDEF ne souhaite pas une baisse des allocations familiales, ni en volume ni en qualité, mais leur transfert.
Nous explorons deux pistes principales.
D’abord, nous travaillons sur les réformes structurelles à mettre en œuvre en matière de famille et d’assurance maladie, en réfléchissant à la manière de mieux utiliser l’enveloppe financière dans ces deux domaines, sans toucher à la qualité du modèle social français.
Je précise que si la suppression des niches – un des axes de la réflexion en cours – doit se traduire par une augmentation des cotisations, nous y serons opposés.
Ensuite, nous travaillons sur les modes de transfert les plus adaptés.
M. Bernard Reynès. Dans le cadre de la mission que m’a confiée le ministre de l’agriculture sur le financement alternatif du coût du travail dans ce secteur, il nous est apparu que la réflexion doit porter sur des mesures d’urgence, de moyen terme et de long terme.
Les mesures d’urgence sont liées aux problèmes de trésorerie, les marges du monde agricole étant de plus en plus faibles. En 2006, l’arboriculture en France rapportait à peu près 845 euros par hectare, mais le quadruple en Espagne, en Allemagne ou en l’Italie, d’où un taux d’endettement d’environ 45 % en France, contre 1 % en Espagne et 3 % en Italie. Aussi, nombre d’agriculteurs craignent de disparaître avant de devenir compétitifs.
Aussi, l’extension des mesures d’exonérations pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d’emploi, souhaitée par le Premier ministre, est une piste intéressante. Autre piste envisagée : l’extension du « dispositif Fillon », avec une exonération des charges patronales conventionnelles et l’absence de dégressivité grâce à un plafond de 1,6 SMIC pour éviter l’effet de trappe à bas salaire.
Pour les mesures de moyen terme, il faut trouver le moyen de pérenniser le financement alternatif du coût du travail. Monsieur Benoît Roger-Vasselin, il est certainement logique que les dépenses maladies et les prestations familiales soient fiscalisées, et que ne restent à la charge des employeurs que les assurances vieillesse et chômage.
Parmi les pistes de réflexion, on trouve celle de l’instauration d’une TVA sociale expérimentale en agriculture. En portant la TVA sur les produits agricoles de 5,5 % à 7 % ou 8 %, on pourrait non seulement financer le coût du travail, mais aussi créer une sorte de frontière douanière, puisque elle s’appliquerait aux produits importés.
Certains avancent l’argument selon lequel la TVA sociale risquerait d’entraîner une augmentation des coûts qui pèsent sur le consommateur. Monsieur Jean-Bernard Bayard, la FNSEA accepterait-elle qu’une augmentation de la TVA sur les produits alimentaires transformés et non transformés permette une diminution non seulement des charges patronales, mais aussi des charges salariales ? Si tel était le cas, tout le monde serait gagnant.
D’autres pistes sont envisageables, dans la mesure où des marges existent sur les tranches hautes de l’impôt sur les sociétés.
S’agissant des mesures de long terme, je crois qu’il y a unanimité sur la nécessaire harmonisation non seulement des prestations sociales, mais aussi du coût du travail – les coûts du travail chargé variant de 1 à 20 en Europe. Cette harmonisation doit se faire sans affecter la qualité des prestations.
M. Jean Lardin. L’UPA est très attachée à la « barémisation ». Nous avons connu des allégements de charges sur les salaires jusqu’à 1,8 fois le SMIC. Lorsqu’il était candidat à la présidence de la République, M. Nicolas Sarkozy nous avait promis une « barémisation » jusqu’à 2,2 fois le SMIC. C’est la preuve que des marges de manœuvre existent en la matière !
Nous sommes favorables à une « barémisation » jusqu’à 1,6 fois le SMIC car une telle mesure permet de réduire le coût du travail et, ainsi, de consolider et développer l’emploi, de solvabiliser les ménages et de soutenir le marché intérieur. C’est tout simplement ce qui permet aux artisans de vivre au quotidien !
Je rejoins l’ensemble des intervenants sur la qualité des prestations familiales : le niveau de la politique familiale ne doit pas baisser, bien au contraire. De la même manière, en matière de maladie et de vieillesse, il ne faut pas réduire la voilure en termes de qualité : nos compatriotes attendent davantage.
En revanche, il faut se demander si notre modèle économique de protection sociale tel qu’il existe actuellement est encore viable. En effet, la baisse du nombre d’heures travaillées en 2009 – pour la première fois depuis longtemps – a entraîné une diminution des recettes, pendant que, dans le même temps, le nombre de prestataires augmentait. Notre ressource se réduisant, nos bénéficiaires augmentant et les durées de prestations étant de plus en plus longues, nous irons droit vers de grandes difficultés si nous ne trouvons pas de solutions. Peut-on tenir encore longtemps avec un modèle économique qui date de 1946, à une époque où les heures de travail représentaient 82 % de la production de la richesse intérieure alors qu’elles ne représentent plus aujourd’hui que 40 % du PIB ? Pour l’UPA, l’élargissement de l’assiette est une évidence.
Il n’y a pas de mesure miracle. L’amélioration du dispositif passe par une succession de petites mesures. Selon nous, il faut jouer sur la CSG et les revenus du capital. Il faut bien sûr optimiser la gestion des organismes de sécurité sociale, c’est-à-dire faire mieux avec moins d’argent. Il faut également baisser la TVA sur les activités à forte intensité de main-d’œuvre afin de rendre les prestations plus accessibles aux consommateurs et relancer la commande intérieure. Souvenez-vous : à chaque augmentation de la TVA d’un ou deux points, comme dans les années 1990, la consommation des ménages a chuté, alors qu’à chaque baisse du taux de TVA – comme en 1999 avec le taux réduit pour les travaux dans les logements de plus de deux ans –, le niveau d’activité et les créations d’emploi ont augmenté ! Certes, il faut se demander si l’on peut conserver un taux réduit de TVA de 5,5 % ; pour autant, une augmentation d’un ou deux points seulement n’entraînera pas un volume de recettes très important.
Quant à la TVA sociale, nous pouvons l’imaginer à la seule condition qu’elle soit assortie d’une baisse des cotisations sociales, afin de permettre aux entreprises d’équilibrer leurs comptes, aux salariés de conserver leur pouvoir d’achat et aux consommateurs de ne pas être pénalisés.
M. Marc Laffineur, président. En 2009, les ressources ont, certes, chuté, mais nous avons connu la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale.
M. Jean-Bernard Bayard. Dans le secteur agricole, la répartition entre travailleurs occasionnels et travailleurs permanents est globalement d’un tiers/deux tiers. Toutefois, elle est différente selon les secteurs d’activité.
À ce sujet, permettez-moi de faire une comparaison entre la situation en France et en Allemagne : sachant qu’un hectare d’asperges nécessite 1 200 heures de travail, le producteur allemand économise 6 000 euros par rapport à son homologue français grâce au différentiel de coût de la main-d’œuvre saisonnière entre les deux pays.
Nous apprécions évidemment les exonérations pour les travailleurs occasionnels. Pour autant, notre pays ne se situe pas dans la moyenne européenne en la matière.
Nous ne remettons pas non plus en cause le modèle social français.
Enfin, nous souhaitons également un transfert des charges patronales vers une forme de TVA. Actuellement, c’est bien le consommateur qui paye les charges patronales à travers le prix des produits qu’il achète. Une autre assiette modifierait totalement la problématique du coût du travail. Je crois que nous devrons nous poser la question pour l’ensemble des secteurs d’activité au regard de l’intérêt du pays.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur et président. Madame, messieurs, je vous remercie.
Je constate que personne n’a parlé de la modification du dispositif relatif à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pourtant la réduction des taux devrait empêcher des départs d’entreprises ou de capitaux productifs. Dois-je en conclure que tout le monde est d’accord ?
*
AUDITIONS DU 4 MAI 2011
Audition de M. Hervé Drouet, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, de M. Dominique Libault, directeur à la direction de la sécurité sociale, et de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
M. le président Bernard Accoyer. Nous recevons aujourd’hui trois représentants des institutions de sécurité sociale : M. Dominique Libault, directeur à la direction de la sécurité sociale depuis 2002, M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés depuis 2004, et M. Hervé Drouet, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales depuis 2008.
Je tiens à vous remercier tous trois de votre présence, et vous propose de présenter en particulier votre analyse sur l’hypothèse d’une évolution progressive du financement de la protection sociale – comme l’ont engagée notamment l’Allemagne et le Royaume-Uni – avec une contribution sociale sur la consommation, mal nommée « TVA sociale ».
M. Dominique Libault, directeur à la direction de la sécurité sociale. Dans la réflexion sur l’évolution de la protection sociale en France, le sujet de la compétitivité occupe une place fondamentale, tout comme celui de la solidarité. Encore convient-il d’abord d’en distinguer les enjeux à court et à moyen terme.
L’un des enjeux de la compétitivité des pays à moyen terme réside dans le ratio entre population active occupée et population inactive. Le défi du vieillissement actif est, en effet, central : d’ici vingt à trente ans, la compétitivité des pays dépendra pour beaucoup de leur capacité à mobiliser une grande partie de leur population pour produire de la richesse. Concernant d’ailleurs l’accroissement de la population active, l’Institut national de la statistique et des études économiques a reconsidéré ses précédentes évaluations et l’estime à 2 millions d’individus supplémentaires d’ici à quelques années grâce aux politiques de protection sociale visant, en matière de retraite, à accroître le niveau d’activité des seniors et, en matière de politique familiale, à assurer le renouvellement générationnel, disposer de suffisamment d’actifs dans les années à venir et concilier, surtout pour les femmes, vie familiale et vie professionnelle. La protection sociale constitue un tout – un financement et de la redistribution – qui, bien mené – en permettant à un maximum de gens de travailler, qu’ils soient chargés de famille ou avancés en âge –, peut être un atout pour la compétitivité à moyen terme de la France. Elle ne doit pas seulement être considérée comme une charge.
Aussi convient-il, ensuite, de se méfier de paradigmes, certes utiles, mais quelque peu simplistes, comme le niveau des prélèvements obligatoires. Si le coût global des systèmes sociaux demeure une préoccupation fondamentale pour les différents pays développés, le choix de rendre solidaire la protection en matière de santé n’est pas en soi un facteur de moindre compétitivité. Aux États-Unis, les prélèvements obligatoires en matière de protection maladie sont très faibles, ce qui pourrait laisser penser que ce problème de compétitivité est évité. Pourtant, le Président des États-Unis, Barack Obama, défendait ainsi sa réforme de l’assurance maladie : « L’une des plus grandes menaces qui pèse non seulement sur le bien-être de nos familles et la prospérité de nos entreprises, mais également sur les fondations mêmes de notre économie est l’explosion des coûts de la santé en Amérique aujourd’hui. Investir dans la réforme va permettre de réduire les coûts et sera le meilleur moyen de diminuer les déficits à long terme ». En effet, lorsque, dans un système où la protection obligatoire mutualisée à l’échelle de la nation est faible, des protections sociales d’entreprise fortes se créent, sans maîtrise du coût de la santé, ce dernier se reporte sur les entreprises.
Pour nos pays, le vrai défi tient, avec des coûts sociaux en augmentation du fait du vieillissement de la population, à l’efficience de la dépense, ce qui implique de s’interroger également – au-delà de la question de la solidarité – sur son mode de prise en charge : par la nation ou par d’autres circuits de financement. À cet égard, le choix français d’une protection sociale forte n’a pas empêché de très importants progrès ces dernières années quant à l’efficience du système. En matière d’assurance maladie, la progression des dépenses publiques de santé, qui était de 7 % au début de la décennie 2000, est ainsi passée à 3 % aujourd’hui, soit, sur un budget de l’ordre de 170 milliards d’euros par an, une économie de 7 milliards d’euros chaque année et de 40 milliards sur la période considérée, sachant que l’efficience de la dépense elle-même a aussi progressé. L’enjeu n’est pas seulement, en effet, de dépenser moins, mais également de dépenser mieux au bénéfice de la santé de tous, puisque la dépense en matière de protection sociale a pour objet d’améliorer le bien-être et la santé des personnes, notamment au travail. Une société compétitive, c’est aussi une société dans laquelle les gens vont bien, ont une santé qui leur permet de travailler et d’apporter de la richesse au pays.
Pour autant, accroître l’efficience du système de protection sociale passe également par une évolution des comportements individuels. La cohérence entre les politiques de solidarité et de compétitivité tient en effet aussi au bon usage des systèmes sociaux par l’ensemble de nos concitoyens, qu’il s’agisse, par une bonne compréhension des droits et des devoirs, de lutter contre les abus ou d’éviter les usages inutiles.
Enfin convient-il, toujours en termes de compétitivité, d’éviter, en matière de coût du travail et, plus généralement, de financement du système, des taux marginaux élevés qui découragent le travail ou conduisent à des délocalisations. Aussi suis-je favorable à la mise en place d’assiettes larges de prélèvements. Pour avoir participé à la création de la contribution sociale généralisée, je reste en effet convaincu que celle-ci a été une excellente réforme pour la protection sociale et qu’une assiette large et des taux modérés, une fois établi le choix du périmètre du financement, sont la meilleure option possible.
De même est-il important de choisir des modes de gouvernance efficaces. La persistance des déficits sociaux, qui constitue évidemment un handicap, montre que nous devons progresser – l’actuel projet de réforme constitutionnel répond d’ailleurs à cette préoccupation. Alors que nous étions l’année dernière à moins 20 milliards d’euros nous pouvons espérer, avec la réforme des retraites et une dépense d’assurance maladie en progression de 3 %, c’est-à-dire inférieure à celle du produit intérieur brut en moyenne, atteindre l’équilibre de nos finances sociales.
M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Avec des dépenses de santé atteignant 12 % du produit intérieur brut, soit 220 milliards d’euros, la France est l’un des pays qui dépense le plus pour sa santé. Certes, sa position relative par rapport aux autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques varie selon que l’on se réfère au produit intérieur brut ou à la parité en pouvoir d’achat par habitant, mais notre pays accomplit, en tout état de cause, un effort important dans le domaine de la santé. La gestion de son système de couverture obligatoire et, plus largement, des coûts de production des soins, constitue donc un enjeu majeur de compétitivité pour le pays, comme l’indiquait M. Michel Pébereau voilà quelques années dans un rapport toujours d’actualité.
La compétitivité se joue dans le temps, ce qu’ont bien compris nos voisins allemands qui ont lancé sur ce sujet, il y a déjà plusieurs années, une réflexion qui leur a permis d’aborder les questions de compétitivité en termes non seulement de prix, mais également de produits. Même si nous améliorons notre performance en matière d’efficience, il convient de ne pas oublier l’autre moteur de compétitivité qu’est l’innovation des entreprises, sans laquelle nous ne pourrons résister à la compétition internationale malgré tous nos efforts concernant tant le rééquilibrage que le financement des prestations sociales.
L’événement majeur relatif aux dépenses de santé des dix dernières années a été l’inflexion très forte du taux de croissance de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie. Alors que celui-ci était de l’ordre de 7 % sur la période 1998-2003, nous l’avons réduit de manière continue sur la période 2005-2011 sous l’effet d’efforts importants – qui continuent d’ailleurs de susciter des réactions. Aujourd’hui, avec un taux de croissance passé de 7 % à 3 %, c’est 0,7 point de contribution sociale généralisée par an de prélèvements obligatoires évité. Toute réflexion en profondeur sur la compétitivité nécessite donc de bien comprendre que tout se joue dans le temps.
Pour autant, la santé est un secteur producteur de richesses et d’innovations : le niveau de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie est donc tout aussi important que son contenu.
À cet égard, nous avons d’abord accompli un effort de maîtrise des dépenses de santé qui nous met en position compétitive par rapport aux pays qui nous entourent. La direction de la sécurité sociale a ainsi montré, dans son analyse des comptes de la sécurité sociale, que nous maîtrisons mieux à l’heure actuelle les dépenses – à tout le moins de soins de ville – que nos voisins d’outre-Rhin, qui, après avoir réfléchi à la réforme du financement de la protection sociale avant nous, affectent des ressources nouvelles au financement de la santé, tout en maîtrisant les prélèvements obligatoires sur les entreprises. Pour autant, les réformes structurelles en cours dans notre pays sont de nature, me semble-t-il, à améliorer progressivement notre compétitivité.
Nous avons ensuite, conformément à l’une des recommandations que l’Organisation de coopération et de développement économiques formule régulièrement en matière de compétitivité, accru l’information des patients : la transparence est maintenant faite sur la qualité et sur le prix auxquels les soins sont délivrés.
Par ailleurs, le mode de rémunération des offreurs se trouve en cours de réforme profonde. La tarification à l’activité, l’un des leviers d’accroissement de la productivité des établissements hospitaliers, même si elle présente des inconvénients, constitue un moyen d’amélioration de notre compétitivité, de même que la mixité de la rémunération des offreurs de soins libéraux, en particulier des médecins traitants.
La meilleure coordination entre l’État et la sécurité sociale demeure cependant une préoccupation car la mise en place des agences régionales de santé ne résout pas tous les problèmes, même si nous progressons dans ce domaine.
Enfin, l’accompagnement des patients et les programmes anglo-saxons de disease management, qui ont pour objectif de rendre le patient plus actif par rapport à sa santé et donc de mieux maîtriser les volumes de soins et développer la prévention, sont des éléments qui, à terme, sont susceptibles d’améliorer l’allocation des ressources.
Pour autant, d’autres actions doivent être menées. Ainsi, le débat en France reste trop concentré sur le reste à charge. Or, en matière de compétitivité, toutes les entreprises privées savent que la question du coût complet des soins est essentielle. En effet, sans maîtrise de ce coût, il n’y a aucune chance de maîtriser le reste à charge des ménages. Un effort devrait donc être accompli afin d’améliorer la transparence du coût complet des soins, qui évolue en fonction des offreurs de façon importante, et d’étudier dans quelle mesure il peut être amélioré. On le sait, trois leviers principaux existent : optimiser le parcours de soins – grâce à une meilleure allocation de la valeur ajoutée médicale en fonction des pathologies des patients ; améliorer l’usage des produits de santé – des recommandations seront sans doute faites, dans le cadre des réflexions actuellement menées sur les produits de santé, notamment par les parlementaires ; enfin, augmenter la productivité intrinsèque des offreurs de soins. C’est donc bien dans le temps que se joue l’effort de productivité.
Même si les efforts de réduction des dépenses de santé ont permis de réduire à environ 4 milliards d’euros en 2008 le déficit constaté, le niveau de ce dernier demeure élevé et représente l’équivalent de près de 1,2 point de contribution sociale généralisée pour la seule branche Maladie. Aussi sera-t-il difficile de réduire ce déficit par la seule action sur les dépenses, sauf à ce que la croissance du pays s’améliore substantiellement, ce qui semble une hypothèse résolument optimiste. Sachant que, du fait du vieillissement de la population, du progrès médical et de la concentration croissante des dépenses, nous devons économiser au moins 2,5 milliards d’euros chaque année pour pouvoir maintenir un objectif national des dépenses d’assurance maladie en progression de l’ordre de 3 %, la question de la résorption de ce déficit devra donc passer par une réflexion sur le financement de la protection sociale.
Sur ce point, nos voisins allemands ont décidé, en 2007, d’affecter une partie de l’augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée, de trois points, à la réduction des déficits, et une autre à l’allègement, si possible, du coût du travail. C’est un axe que la France a d’ailleurs elle-même choisi depuis de nombreuses années en veillant – avec la réforme « Balladur » de 1993 de budgétisation d’une partie des cotisations d’allocations familiales sur les bas salaires, avec les réformes « Juppé » de 1996 et 1997 d’élargissement de l’assiette de la contribution sociale généralisée, avec les réflexions autour de la retraite et les allégements de charges – à ce qu’il n’y ait pas d’alourdissement inconsidéré sur le coût du travail de la partie des cotisations imputables aux entreprises.
La « TVA sociale » reste, à cet égard, un sujet d’autant plus complexe à aborder que les derniers relèvements effectués en la matière en 1997 ont rappelé que l’augmentation de tout impôt – taxe sur la valeur ajoutée, contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale ou autre – constitue toujours un moment difficile pour nos concitoyens, la taxe sur la valeur ajoutée ayant par ailleurs la caractéristique d’être répartie sur de très nombreux acteurs. Cela étant, elle présente l’avantage, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une cotisation, de taxer les produits importés. Mais sur le fond, quel que soit l’impôt qui devra être éventuellement relevé pour financer les déficits actuels, le gouvernement qui en prendra la responsabilité aura préalablement à justifier de l’efficience de la dépense devant nos concitoyens assurés sociaux.
M. Hervé Drouet, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. Comme l’ont souligné mes deux prédécesseurs, c’est avant tout en termes de performance de la dépense sociale – en l’occurrence la contribution des dépenses de la branche Famille à la compétitivité de l’économie – que le gestionnaire des dépenses de sécurité sociale doit réfléchir.
Il convient, en préambule, de rappeler les grandes composantes des dépenses payées par les caisses d’allocations familiales, qui se sont élevées à près de 74 milliards d’euros en 2010, étant entendu qu’il convient d’isoler dans ce montant les prestations de lutte contre la précarité, la pauvreté ou le handicap versées pour le compte de tiers, c’est-à-dire pour le compte de l’État – allocation adulte handicapé et aides au logement en faveur des personnes sans enfants – ou des conseils généraux – le revenu de solidarité active, qui englobe l’allocation de parent isolé et qui est complété, pour ce qui est le « RSA activité », par un financement de l’État.
La contribution de ces dépenses à la performance de l’économie doit également s’analyser en termes de soutien au pouvoir d’achat, de préservation de la cohésion sociale et d’insertion de publics en difficulté. Des progrès importants ont été réalisés pour leur permettre de mieux contribuer à l’incitation à la reprise d’activité, sachant qu’elles ont par ailleurs un objectif de soutien au pouvoir d’achat. La résistance du pouvoir d’achat pendant la période de crise économique et sociale profonde que nous continuons de traverser montre que ces prestations jouent bien le rôle contracyclique d’amortisseur social qu’on leur assigne et que les caisses d’allocations familiales se situent à cet égard en première ligne.
Financées par l’impôt, les dépenses en compte propre de la branche Famille, que ce soit sur le budget général de l’État ou sur celui des conseils généraux, s’élèvent – une fois isolées les prestations pour le compte de tiers – à 54 milliards d’euros et se décomposent en quatre blocs :
– le bloc des prestations traditionnelles à savoir, d’une part, celles qui compensent les charges supportées par les familles pour l’entretien des enfants – allocations familiales universelles – et, d’autre part, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire – sous conditions de ressources –, qui représente un montant de 15 milliards d’euros environ ;
– le bloc des prestations liées à la petite enfance, destinées à accompagner les familles lors de l’arrivée d’un enfant et à les aider à concilier vie familiale et vie professionnelle s’agissant en particulier du mode de garde des jeunes enfants : la prestation d’accueil du jeune enfant, pour un montant de 12 milliards d’euros, et toutes les dépenses engagées par les caisses d’allocations familiales pour les établissements d’accueil collectif des jeunes enfants, pour un investissement de 2 milliards d’euros, soit un total de 14 milliards d’euros ;
– le bloc des allocations logement en faveur des familles qui comprend l’allocation de logement familiale et la participation de la Caisse nationale des allocations familiales aux aides au logement, en particulier l’aide personnalisée au logement, versées – sous conditions de ressources – à des personnes ayant des enfants, pour un montant de 8 milliards d’euros ;
– le bloc universel des droits familiaux pour la retraite, qui correspond au versement de l’assurance vieillesse des parents au foyer, soit 4,4 milliards d’euros, et au financement des majorations de pension pour enfant à charge, pour un montant de 2,8 milliards d’euros.
Pour ces quatre blocs, qui mêlent prestations universelles et prestations sous conditions de ressources, le financement de la branche est composé, pour deux tiers, de cotisations sociales assises sur les salaires – exclusivement sur la part patronale – de 5,4 points, soit un peu plus de 34 milliards d’euros et, pour un tiers, des impôts et taxes affectés – majoritairement de la fraction de contribution sociale généralisée affectée à la branche Famille, qui a été réduite récemment – ainsi que divers autres impôts, soit un peu plus de 16 milliards d’euros.
Au-delà du soutien aux revenus pour lutter contre la pauvreté des familles et des enfants et pour égaliser les niveaux de vie entre foyers avec enfants et foyers sans enfant, la contribution décisive des dépenses sociales au dynamisme de l’économie tient à l’investissement en faveur du renouvellement des générations et du dynamisme démographique. À cet égard, l’efficacité de la politique familiale française a encore été soulignée la semaine dernière dans un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les politiques familiales comparées des États membres, lequel précisait notamment qu’ « investir de façon précoce dans la politique familiale garantit une meilleure efficacité et permet d’économiser à long terme ». M. Frédéric Van Roekeghem soulignait que la compétitivité se joue dans le temps : c’est spécialement vrai pour les dépenses d’investissement de ce type, les évolutions en matière démographique ne pouvant être évaluées que sur le long terme.
Pour ne citer que quelques chiffres, ce même rapport précise que « La France occupe une position favorable sur plusieurs dimensions des vies familiale et professionnelle : la fécondité est très supérieure à la moyenne de l’OCDE » – comme d’ailleurs de l’Union européenne puisqu’elle est légèrement supérieure à deux enfants par femme contre une moyenne européenne de 1,5 – « et le taux d’emploi des femmes âgées de 25 à 54 ans est, à 76,6 %, lui aussi supérieur à la moyenne » tant de l’Organisation de coopération et de développement économiques que de l’Union européenne. Il en résulte que les perspectives d’évolution de la population active sont orientées en France plus favorablement que dans les autres pays de l’Union européenne, ce qui avait d’ailleurs conduit, en 2009, le comité de politique économique de l’Union européenne à estimer que l’augmentation des dépenses à destination des personnes âgées serait à l’horizon 2050 deux fois moindre en France qu’en Allemagne, soit 4 % de son produit intérieur brut, et l’institut de l’économie allemande de Cologne à considérer, en 2008, que l’économie française serait en 2035 la plus dynamique d’Europe compte tenu de son assise démographique.
Même si les experts peuvent débattre de la quantification exacte de la contribution des politiques familiales au taux de fécondité, il n’en reste pas moins que la performance relative de la France est significativement supérieure à celle de ses voisins. Le différentiel de 0,5 point entre notre taux de fécondité de 2 et celui de l’Union européenne, de 1,5 en moyenne, doit être mis en regard du nombre d’enfants désirés par femme, lequel est relativement homogène et stable au sein de l’Union européenne puisqu’il se situe depuis deux décennies, selon l’Eurobaromètre, entre 2 et 2,5. La France se distingue en réussissant à combler l’écart entre le nombre d’enfants désirés – entre 2 et 2,5 donc – et celui des enfants effectivement mis au monde – soit 2 contre 1,5 en moyenne dans l’Union européenne. Notre pays a réussi à combler son différentiel de 0,5 point environ parce qu’il a créé un environnement favorable aux familles et à l’accueil des enfants ainsi qu’à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Offrir aux couples, et spécialement aux femmes, la possibilité – tout en respectant leur libre choix – de faire garder leurs enfants en bas âge, est en effet depuis les années 1970 un objectif structurant de notre politique familiale.
Tel est, me semble-t-il, l’aspect sur lequel se joue surtout la compétitivité de notre économie, et c’est d’ailleurs à quoi contribuent significativement les politiques familiales mises en œuvre par les caisses d’allocations familiales, politiques d’investissement qui nécessitent, de par leur caractère de long terme, la stabilité de l’environnement des dispositifs et, en termes de financement, la pérennité des recettes affectées.
M. Marc Laffineur. Si les Français sont persuadés de bénéficier d’une bonne protection sociale, cela n’empêche pas d’être le plus économe possible... Cela étant, la « TVA sociale » vous semble-t-elle plutôt une bonne réponse en permettant une meilleure compétitivité grâce à une diminution des charges sur les salaires ? Par ailleurs, les exonérations de charges ciblées sur les bas salaires ont-elles selon vous permis d’augmenter le nombre d’emplois ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Concernant le court et le moyen terme que vous avez bien différencié du long terme dans vos interventions, le poids des dépenses sociales a progressé de 6,1 points de produit intérieur brut en France contre 2,4 en moyenne européenne et en Allemagne, et moins 0,6 en Suède, au point que ce poids peut asphyxier l’emploi et la compétitivité française. Pour préparer les esprits de nos compatriotes, une double pédagogie menée par vous et fondée, d’une part, sur des comparaisons européennes – doit-on par exemple continuer à rembourser les affections longue durée à 100 % eu égard à leur augmentation ? – et, d’autre part, sur une perception claire de la différence entre salaire direct – qui leur paraît faible – et salaire indirect, ne devrait-elle pas être envisagée ?
Par ailleurs, la recherche de la performance vous paraît-elle compatible avec nos systèmes centralisés ? À taux de personnes âgées identiques, ce sont en effet les régions qui ont les meilleures performances économiques et la meilleure cohésion sociale, qui ont les dépenses les plus faibles. C’est ainsi que le rapport en matière d’allocation adulte handicapé peut aller de 1 à 5 selon les départements. Nos systèmes très centralisés appellent-ils à l’esprit de responsabilité – vertu des grands peuples – ou ne devrait-on pas plutôt mettre en place par exemple des objectifs régionaux d’assurance maladie (ORDAM) ?
M. Albert Facon. Si pendant la crise la protection sociale a joué un rôle d’amortisseur social, faut-il pour autant parler aujourd’hui d’économies à réaliser ? À cet égard, je ne peux pas être choqué du différentiel de 1 à 5 selon les départements, souligné par notre corapporteur. Il est normal, malheureusement, que le bassin minier et très ouvrier du Nord de la France, dont je suis l’élu, compte plus de handicapés que l’Ille-et-Vilaine, sachant, en outre, que nombre de mes concitoyens ne vont plus chercher leurs médicaments car ils n’arrivent plus à les payer – quand on ne dispose que de 800 euros par mois pour vivre, la vie est dure.
Surtout, l’injustice gêne les Français. Car à côté de ces gens qui ne peuvent se faire soigner, on observe par exemple de nombreuses personnes, surtout des femmes d’ailleurs – du fait de la silicose, on dénombre un homme pour dix femmes dans les foyers dans ma région –, qui partent en groupe en cure. Et je ne parle pas des soins dentaires : dans une salle d’attente, n’est-il pas insupportable pour une famille qui doit tout compter car elle doit vivre avec 1 200 euros par mois, d’entendre des patients ne rien vouloir se refuser car profitant de la couverture maladie universelle ? Un tel décalage peut permettre de comprendre pourquoi certains choisissent des votes extrêmes – je suis bien placé pour le savoir car au sein de ma communauté d’agglomération se trouve la ville d’Hénin-Beaumont qui a élu une certaine Marine.
Ce que je demande, en tant qu’élu de terrain, c’est donc plus de justice. Certes, une plus grande fécondité permettra de régler bien des problèmes, mais dans vingt ans ! D’ici là, comment faire en sorte d’instaurer plus de justice ?
M. Christian Blanc. Notre protection sociale étant extrêmement performante, nous devrions, à vous entendre mettre en corrélation niveau de protection sociale et niveau économique, et donc avoir l’une des économies les plus prospères au monde !
J’aborderai pour ma part le problème de l’intégration car la protection sociale devrait en constituer un facteur important. Elle l’est peut-être, mais faute pour la représentation nationale de pouvoir faire une évaluation en la matière, pourriez-vous indiquer ce que représente, dans le coût de la protection sociale, la politique d’intégration ?
M. le président Bernard Accoyer. En dépit de la situation de certains de nos compatriotes, je relève que, globalement, le système de protection sociale français est reconnu comme très développé, même si notre taux de fécondité, pour lequel nous sommes enviés, ne dépend pas que des prestations familiales, mais est également le résultat de toutes les politiques conduites, à différents niveaux, par l’État, les collectivités territoriales et les caisses d’allocations familiales notamment en faveur de l’accueil des jeunes enfants.
Pour autant, si le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales a pu souligner l’augmentation à venir du nombre des actifs, il sait mieux que quiconque que c’est surtout le nombre des inactifs qui augmentera dans les années qui viennent, et cela pour une période assez longue. Or, le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés sait quant à lui que le grand âge coûte très cher à l’assurance maladie, les pathologies qui accompagnent le vieillissement étant, d’une part, prises bien souvent en charge au titre des affections de longue durée et, d’autre part, parmi les plus onéreuses du fait de la cherté des technologies nouvelles ou des produits nouveaux – domaines où d’ailleurs la France prend parfois un peu de retard, mais c’est là un autre sujet.
Dans ces conditions, le coût de la protection sociale à laquelle nous sommes tous très attachés va croître de façon importante. Aussi, comment ne pas réfléchir davantage – tout le monde reconnaissant qu’il faut garder de la création de richesse en France et faire en sorte, par notre compétitivité, de mettre un frein et si possible un terme aux délocalisations de production – à la situation dans laquelle nous sommes depuis la création de la sécurité sociale il y a bientôt soixante-dix ans, qui fait reposer plus de 70 % de son financement sur l’appareil de production, le travail, alors que c’est précisément ce que nous voulons sauvegarder et que le nombre de ceux qui travaillent ne cesse de diminuer ?
J’ai compris à demi-mot que le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés avait une solution, mais que celle-ci était impossible à appliquer pour des raisons politiques. La difficulté tient, selon moi, au fait que certains la désignent avec un vocabulaire inadapté, voulant faire peur – et y parvenant. Or, avec l’emploi de l’expression « TVA sociale », on trompe nos concitoyens sur la nature de ce prélèvement nouveau. Il s’agirait en effet d’une contribution sociale – à laquelle d’ailleurs le directeur de la sécurité sociale devrait être attaché puisqu’il a participé à l’invention de la contribution sociale généralisée. La « contribution sociale sur la consommation » serait le pendant de la contribution sociale généralisée. Et, contrairement à ce qui est également avancé, elle ne conduirait pas obligatoirement à une diminution du pouvoir d’achat par une augmentation du coût de la vie. S’il y avait un glissement très progressif, point par point – un point représentant à peu près 10 milliards d’euros –, il pourrait très bien être imaginé que cette somme soit répartie de façon égale entre l’entreprise et le salarié, de telle façon que 5 milliards d’euros de plus soient distribués en salaire net. Tel est bien, en effet, le problème de la France qui voit son coût du travail augmenter alors que les salaires nets y restent inférieurs à d’autres pays.
En outre, puisque l’assiette de la contribution sociale sur la consommation recouvrirait les produits d’importation, son produit permettrait d’équilibrer le pouvoir d’achat. Cette ligne a d’ores et déjà été suivie par d’autres pays, sans qu’il y ait des conséquences significatives sur le pouvoir d’achat.
Paradoxalement, alors que tout le monde s’accorde à sauver la sécurité sociale, on s’interdit, par les mots que l’on emploie, à préparer les conditions politiques d’un glissement progressif, partiel, de l’assiette du financement de la protection sociale. Il y a là un véritable défi pour les politiques sur lequel je souhaiterais que vous vous exprimiez.
M. Hervé Novelli. Je reviendrai sur deux problématiques qui viennent d’être abordées séparément, alors qu’elles devraient selon moi être liées.
La première, soulignée avec raison par notre corapporteur, a trait au rythme soutenu de la progression des dépenses sociales, sachant notamment qu’entre les années 1980 et aujourd’hui, le poids de ces dépenses par rapport au produit intérieur brut est passé de 20 % à plus de 31 %. Un tel rythme ne s’observe pas dans d’autres pays qui ne négligent pas pour autant leur protection sociale. La situation est d’autant plus paradoxale qu’elle tient, parmi d’autres explications, au manque de régulation du système. Ainsi, un système apparemment suradministré serait sous-régulé. C’est un premier problème que l’on doit examiner, de même d’ailleurs que l’on doit s’interroger sur le rythme de création de nouvelles prestations dans la période.
La seconde problématique, soulevée par le président Bernard Accoyer et M. Marc Laffineur, concerne le transfert des charges. Il ne sert à rien de transférer une charge pesant sur le travail vers la consommation si dans le même temps des instruments de ralentissement du rythme de progression des dépenses sociales ne sont pas mis en place. Nous retrouverions sinon les mêmes défauts qu’aujourd’hui sauf que ce ne serait plus le coût du travail qui serait affecté, mais le prix des produits qui supporterait ce transfert, lequel ne serait pas maîtrisé lui non plus du fait du rythme des dépenses.
Il faut donc absolument lier les deux problématiques – rythme de progression des dépenses sociales et éventuel transfert – car, faute de les résoudre en même temps, nous ne ferions que transférer des charges sans aucune régulation. Si, pendant la crise, il était légitime que les dépenses sociales progressent, il devient illégitime que cette croissance perdure ensuite au même rythme.
M. Jean Grellier. Si je comprends qu’il faille sinon ralentir les dépenses sociales du moins les optimiser et les contrôler, quel que soit le niveau auquel elles sont versées, la question de leur financement semble conduire à un choix entre coût du travail et « TVA sociale ». Que penseriez-vous, pour le financement de la protection sociale, d’une péréquation concernant l’ensemble du système productif avec l’instauration, d’un côté, d’un plafond de charges pour les entreprises qui versent des charges sociales élevées et, d’un autre côté, d’un plancher de charges pour celles qui en versent peu ?
M. Dominique Libault. Je partage le sentiment selon lequel l’efficience de la dépense constitue l’enjeu des années à venir. Il n’existe pas en effet de financement miracle : quel que soit le mode retenu, on ne peut s’exonérer d’une meilleure efficience de la dépense. En revanche, je ne peux laisser s’instaurer l’idée que rien n’aurait été fait pour lutter contre l’augmentation des dépenses. Si M. Pierre Méhaignerie a raison concernant les vingt-cinq dernières années, une rupture est apparue depuis une dizaine d’années. Les chiffres d’Eurostat relatifs aux dépenses publiques de protection sociale en pourcentage du produit intérieur brut montrent sur la période, par rapport à la Suède, à l’Allemagne, à l’Italie, à l’Espagne et au Royaume-Uni, une maîtrise de notre pays. Sans revenir sur le taux de croissance de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, passé de 7 à 3 %, les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant les dépenses publiques de santé par habitant sur la période 2005-2008 montrent également que la France les a mieux maîtrisées. Certes, nous partions de haut, et il faut l’assumer. Mais une vraie évolution est intervenue dans les récentes années.
On le constate au vu des statistiques, les efforts des Français, qui ont tendance à désespérer car ils ont l’impression que leurs efforts ne servent à rien, portent leurs fruits : tout ce que l’on a accompli est utile, et l’on assiste à une vraie décélération des dépenses. Encore faut-il que ce processus soit équitable. À cet égard, la question de l’efficience reste liée à celle de l’équité car, je le rappelle, il s’agit de droits objectifs. Les ordonnateurs des dépenses publiques, dans un système de sécurité sociale, sont nos concitoyens eux-mêmes par l’intermédiaire de consultations ou encore d’une demande de médicaments. Aussi faut-il les convaincre que la politique suivie est bien fondée et que les efforts sont équitablement répartis. Nous avons d’ailleurs déjà progressé sur ce plan, puisque nous avons pu convaincre les Français que, par exemple, le générique soignait aussi bien que le médicament princeps. Avec une politique d’adhésion de l’ensemble de nos concitoyens, car la sécurité sociale demeure l’affaire de tous, nous réussirons à maîtriser la dépense avec de l’efficience.
Ainsi que plusieurs d’entre vous l’ont souligné, il existe encore de nombreuses marges de progression, qu’il s’agisse de lutter contre les dépenses inutiles, les abus, la mauvaise organisation ou encore les coûts trop élevés. À la limite, tous ces champs d’intervention possibles me rendent optimistes : malgré le vieillissement de la population, nous pouvons tenir un objectif de progression mesurée de la dépense dans les années à venir grâce à la trajectoire que l’on a commencé à tracer. Tout n’est pas à inventer.
Je connais l’attachement de M. Pierre Méhaignerie à la responsabilisation et, dans cet esprit, à la régionalisation. Mais, au-delà d’une centralisation au niveau local, se trouve en jeu la responsabilité individuelle de chacun. Lorsque l’on travaille avec l’assurance maladie sur le contrat d’amélioration des performances individuelles des médecins, nous cherchons à responsabiliser les prescripteurs individuellement. De même, lorsque l’on travaille sur le parcours de soins ou sur la problématique activité/retraite, notre objectif est d’améliorer les comportements individuels. On peut toujours discuter du mode de pilotage, mais en tout état de cause, c’est bien au moyen d’une responsabilisation individuelle et non pas uniquement de normes que l’on y parviendra.
Concernant le coût du travail, il convient de souligner que, ces dernières années, les cotisations sociales à la charge des entreprises n’ont pas augmenté. Méfions-nous à cet égard des statistiques internationales qui ne reposent que sur les prélèvements obligatoires sans prendre en compte le coût caché de la protection sociale pour les entreprises : lorsque les prélèvements sociaux obligatoires sont faibles, c’est le coût des protections d’entreprise qui augmente et qui pèse alors sur les employeurs. Le travail que nous avons effectué avec la Cour des comptes a ainsi montré qu’une partie de notre différentiel avec l’Allemagne tient au caractère facultatif des systèmes de retraite complémentaire allemands qui, de ce fait, n’apparaissent pas dans les prélèvements obligatoires au niveau des comptes nationaux. Il faut prendre en compte l’ensemble des charges si l’on veut comparer les coûts entre les différents pays.
S’agissant de l’interrogation de M. Christian Blanc sur le coût de l’intégration, je n’ai pas d’éléments pour lui répondre précisément, mais ma conviction est que l’un des enjeux d’une politique de protection sociale est la cohésion sociale, sachant qu’assurer cette dernière constitue un facteur de compétitivité pour l’économie. Pour autant, nous sommes conscients du fait que disposer d’une assurance maladie permettant d’accueillir correctement sous condition de résidence régulière l’ensemble des résidents ne peut résoudre ni tous les problèmes d’intégration ni tous ceux de la compétitivité. Il ne faudrait pas en effet que la protection sociale soit comprise à travers nos propos comme le moyen de résoudre tous les problèmes de compétitivité Le forum de Davos, notamment, l’a montré : la question de l’innovation reste fondamentale dans ce domaine, au-delà du seul coût du travail, et l’on sait bien que la France souffre en la matière de faiblesses, en particulier par rapport à l’Allemagne.
Selon les politiques menées, la protection sociale peut s’avérer un atout plus ou moins fort pour la compétitivité de la France. Ne la voyons pas comme une charge, même si d’autres éléments permettront évidemment à notre pays de jouir d’une bonne compétitivité, car s’il faut maîtriser la dépense en matière de finances sociales, il faut aussi de la croissance. C’est là sans doute le principal aléa pour les finances publiques dans les années à venir
M. Frédéric Van Roekeghem. Les facteurs de compétitivité sont en effet multiples : à côté de l’innovation, la formation et la politique de l’offre sont des sujets majeurs. Si nous voulons résister à la concurrence de pays dont les salaires et la protection sociale sont bien moindres qu’en France, je ne crois donc pas que ce soit uniquement par la réduction de la protection sociale que nous y parviendrons. Comme l’a souligné M. Dominique Libault, une inflexion a eu lieu voilà cinq ou six ans et nous sommes maintenant sur le bon chemin – à l’instar des Allemands qui s’y sont pris un peu plus tôt que nous.
D’après les statistiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques couvrant la période 1997-2007 – laquelle nous désavantage puisque notre effort a porté sur les années 2005-2010 –, le taux de croissance des dépenses de santé a été en termes réels de 4,1 % pour l’ensemble de l’Organisation de coopération et de développement économiques contre 3,7 % en Suède et 2,5 % chez nous. Sur dix ans, cette différence de 1,5 % de croissance de la dépense de santé entre la France et l’Organisation de coopération et de développement économiques équivaut à une trentaine de milliards d’euros. Dans ce contexte, une politique de maîtrise de la dépense sociale ou plutôt favorisant la dépense utile soulève effectivement la question de la régionalisation. À cet égard, les écarts énormes de consommation de soins dans le domaine de la santé entre les différentes régions ne s’expliquent pas totalement par les inégalités de santé – une étude que nous avons publiée sur ce sujet le montre. En tout cas, si la protection sociale ne peut être la solution à la compétitivité, elle peut sans nul doute y participer, le premier levier restant la bonne maîtrise de la dépense.
Notre système centralisé l’empêche-t-il ? Aux États-Unis, si les dépenses de santé correspondent à 18 % du produit intérieur brut, 47 millions de personnes n’étaient pas couvertes avant la réforme. Certes, ce nombre comprend des jeunes et des personnes très riches, mais surtout des personnes pauvres qui ne peuvent se soigner, ce qui a un coût pour la collectivité – payé parfois par les hôpitaux ou les établissements de santé américains au sens large. Au-delà de la croissance inflationniste, il suffit de lire ce qu’écrivent les grands cabinets de conseil internationaux sur la situation de la dépense américaine pour comprendre que la concurrence généralisée entre les offreurs et les assureurs qui caractérise ce marché s’exerce au détriment de la valeur ajoutée produite et du consommateur de soins.
Cela étant, si nous disposons d’avantages compétitifs, nous avons encore des gains de productivité importants à trouver. Dans le domaine du médicament, par exemple, une comparaison entre la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni que nous venons de publier montre, concernant deux classes thérapeutiques qui représentent à peu près 2 milliards d’euros de dépenses pour la sécurité sociale – les statines, médicaments contre le cholestérol, et les inhibiteurs de la pompe à protons, médicaments contre les ulcères qui restent très consommés dans notre pays –, un écart de 900 millions d’euros par rapport à nos deux voisins.
Nous ferons en juin ou juillet prochains des propositions à cet égard après avoir examiné notamment à quel prix exactement les médicaments sont vendus dans notre pays et chez nos voisins, pourquoi les médecins prescrivent tel ou tel médicament et pourquoi nous sommes par ailleurs plus ou moins consommateurs de tels médicaments. Des marges de manœuvre existent donc, même si elles ne sont pas infinies.
En matière d’équité, si la mise en place de la couverture maladie universelle complémentaire s’est traduite par une amélioration de la situation des personnes plus précaires, l’effet de seuil a conduit à ce que les personnes situées au-dessus de ce seuil, bien qu’ayant de très faibles ressources, n’accèdent pas au même niveau de protection sociale que les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire. Nous avons tenté, par des politiques publiques, notamment les aides à la complémentaire santé, de résoudre une partie du problème, mais la situation reste insatisfaisante en dépit des efforts réitérés des différents gouvernements et des caisses d’allocations familiales et d’assurance maladie. Nos prochaines propositions porteront également sur ce problème, le bouclier sanitaire ne nous apparaissant pas répondre à l’ensemble des problèmes posés. Le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie estime ainsi que c’est là une solution qui présente aussi certains inconvénients.
S’agissant du financement, la situation actuelle des déficits publics, tout particulièrement ceux de la protection sociale, nous conduira à aborder le problème de leur résorption. Pour ce qui est de la contribution sociale sur la consommation à propos de laquelle le Parlement s’interroge, je ne trouve pas illégitime à titre personnel que nous nous posions la question de la participation au coût de la protection sociale de la consommation sur les produits d’importation.
Quant à la responsabilité des régions, quel modèle évoquons-nous ? S’il s’agit de mettre en place un système d’objectif régional des dépenses d’assurance maladie sans que la région soit le financeur de la dépense, il n’y aura pas de responsabilité car cette dernière implique certes celle de la dépense, mais aussi la celle du financement et du solde. Je n’ai pas l’impression qu’à ce stade, les réflexions autour de la responsabilité de la région visaient ce modèle. Le système dont nous disposons, qui a ses inconvénients, conduit tout de même à ce que l’État, in fine, partage à un moment donné, par le biais du vote d’une loi de financement, l’ensemble de ses responsabilités en matière de dépenses, de ressources et de déficit. En ce qui me concerne, je ne serais en tout cas pas favorable à un système où les décisions en matière de dépenses seraient prises par les régions et où la responsabilité du financement incomberait à l’État.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Ce n’est pas non plus ce que je demande.
M. Hervé Drouet. Si les facteurs de compétitivité et de croissance sont multiples et débordent largement les seules questions de la performance de la dépense sociale et du modèle de protection sociale, je me bornerai, s’agissant des prestations en faveur des familles, à rappeler cette maxime célèbre de Jean Bodin au XVIe siècle : « Il n’est de richesse que d’hommes ». La croissance démographique constitue, en effet, le premier déterminant de la croissance d’un pays. Encore faut-il évidemment qu’il y ait des emplois qui permettent à la population en âge de travailler d’être active, mais c’est là la responsabilité des politiques en faveur de l’employabilité, du travail, des conditions de travail ou encore de l’innovation.
La problématique en matière de croissance des dépenses de prestations familiales est différente de celle des autres branches de la sécurité sociale, en particulier de celle de l’assurance maladie. Elles sont en effet majoritairement indexées sur l’inflation et croissent donc assez lentement, à législation constante, par rapport aux recettes qui, assises pour les deux tiers sur la masse salariale, évoluent en fonction de la richesse nationale, donc plus rapidement que les dépenses. De ce fait, la branche Famille est structurellement à l’équilibre et même excédentaire. La progression de ses dépenses sur la longue période est en effet due davantage à la création de prestations ou à la forte revalorisation de prestations existantes – ce qui dépend de décisions politiques – qu’à une dynamique propre de progression de la dépense.
Je vous invite d’ailleurs à prendre connaissance des projections financières qui ont été établies par le Haut conseil de la famille et qui font état, malgré la situation financière conjoncturellement dégradée de la branche – comme les autres branches de la sécurité sociale -, d’un retour spontané à l’équilibre, à législation constante, à horizon 2017-2018 pour le compte courant et aux alentours de l’année 2025 pour l’équilibre du bilan – horizon qui est plus ou moins rapproché selon les hypothèses de croissance.
Pour autant, si la branche est structurellement à l’équilibre, il faut bien sûr se poser la question de la maîtrise de ses dépenses et de leur efficience. À cet égard, deux axes nous concernent essentiellement : la lutte – comme pour les autres branches de la sécurité sociale – contre les fraudes et les abus, et l’accroissement de l’efficience de la dépense. Il s’agit, en particulier, d’optimiser le taux d’occupation des établissements d’accueil du jeune enfant que nous finançons. En moyenne – ce qui recouvre évidemment des situations très disparates – leur taux d’occupation financier, c’est-à-dire le rapport entre la capacité théorique d’heures que l’on peut facturer et celles effectivement facturées, est de 65 %, tandis que leur taux d’occupation physique, fondé sur la présence constatée des enfants, est de 55 %. Un tel résultat, pour des établissements coûteux financés sur fonds publics, reste insatisfaisant, ce qui explique que, par la contractualisation avec les partenaires et les collectivités territoriales qui les financent – généralement les municipalités –, nous ayons une action forte en matière d’accroissement de l’efficience de cette dépense.
Concernant la question posée par M. Christian Blanc sur la contribution de la sécurité sociale aux problématiques d’intégration, les prestations sous condition de ressources versées en compte propre par la branche Famille, ainsi que les aides à la lutte contre la précarité et la pauvreté et les aides au logement – aides versées par les caisses d’allocations familiales, mais financées soit par l’État soit par les conseils généraux s’agissant du revenu de solidarité active – concourent non pas à des politiques visant directement l’intégration proprement dite, laquelle fait l’objet d’autres politiques publiques avec des instruments dédiés, mais à l’objectif de préservation de la cohésion sociale par l’inclusion sociale.
Schématiquement, un peu plus de 60 % des dépenses versés par la branche Famille sont sous condition de ressources. Pour autant, laisser penser qu’elle contribue à hauteur de 60 % de ses dépenses à un objectif de politique inclusive serait présenter les choses un peu rapidement. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des programmes de qualité et d’efficience qui sont joints en annexe à la loi de financement de la sécurité sociale. Le fascicule concernant la branche Famille présente des indicateurs que nous avons élaborés pour rendre compte de la réduction des écarts de niveau de vie entre familles selon leur configuration et les déciles de revenus. Il s’agit de mesurer avant toute redistribution – qu’elle provienne de la fiscalité par le biais du quotient familial ou des différentes aides fiscales, ou des prestations sociales familiales ou de lutte contre la pauvreté – la réduction des écarts entre familles selon leur niveau de revenu et selon leur configuration.
Des indicateurs de ce type ont également été repris dans le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les politiques familiales comparées des États membres auquel j’ai fait allusion, et quand on compare les performances de la France à celles des autres pays, il apparaît que le poids de ses dépenses de transfert a un effet levier assez fort sur la réduction des écarts de niveau de vie.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Que pensez-vous de l’impact des personnes étrangères sur les dépenses de santé ? Jusqu’où peut-on aller dans leur prise en charge ?
Qu’en est-il de ce commerçant nantais qui a eu de nombreux enfants de trois femmes différentes ? Quelles ont été les suites de cette affaire ?
Comment peut-on prendre en compte le phénomène de recomposition familiale, dans la mesure où il entraîne souvent la perte de l’aide personnalisée au logement ou de certaines prestations comme l’allocation de parent isolé lorsqu’elle existait encore ?
Enfin, existe-t-il un accord, au sein de la Caisse nationale des allocations familiales, sur la nécessité de regrouper les assistantes maternelles pour limiter le coût des crèches ? Certains conseils généraux sont-ils toujours sources de blocages dans ce domaine ?
M. Marc Laffineur, président. Vous avez évoqué un taux d’occupation financier des crèches de 65 %, et un taux d’occupation physique de 55 %. De tels résultats ne sont-ils pas extrêmement faibles, compte tenu du nombre de nos concitoyens qui se plaignent de ne pas trouver de place ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. La réponse se trouve dans la flexibilité des horaires des personnels, car le nombre d’enfants peut varier beaucoup d’un jour à l’autre.
M. Dominique Libault. En ce qui concerne les taux d’occupation, la question se pose aussi pour les établissements hospitaliers : on a tendance à mettre en avant les situations dans lesquelles l’offre paraît insuffisante par rapport à la demande, mais à y regarder de plus près, de nombreuses structures connaissent plutôt une sous-occupation. Il importe de comprendre pourquoi et de rechercher les moyens d’y remédier. Cela peut venir d’un positionnement géographique inadéquat, ou d’une offre ne correspondant pas à la demande, notamment en ce qui concerne certaines spécialités médicales.
On trouve des assistants maternels au chômage : il ne faut donc pas croire que l’insuffisance de l’offre de garde par rapport à la demande est une réalité en tout point du territoire. Il existe certes des points de tension, mais pas partout.
Par ailleurs, il est exact que pour la collectivité, le coût des assistants maternels est moins élevé que celui des crèches. Nous cherchons donc à développer ce mode de garde, y compris grâce au regroupement mais les politiques d’agrément des assistants maternels demeurent différentes d’un département à l’autre. Ainsi, alors que le Gouvernement a souhaité que l’agrément puisse être donné pour l’accueil de quatre enfants et non de trois, cela reste compliqué dans certains cas. Nous allons travailler avec l’Association des départements de France afin d’harmoniser les pratiques en ce domaine et d’accroître l’offre de garde lorsque les crèches ne permettent pas de répondre aux besoins. Quoi qu’il en soit, cet exemple montre une fois de plus qu’il existe encore des possibilités d’optimiser la dépense sociale.
S’agissant de la protection sociale des étrangers, je rappelle qu’il est nécessaire de se trouver en situation régulière pour pouvoir en bénéficier en France. Par ailleurs, nous sommes attentifs – et cela nous a valu quelques échanges avec la Commission européenne – à ce que la liberté de circulation au sein de l’Union européenne ne s’applique, s’agissant des inactifs, qu’à la condition de disposer au préalable de revenus et d’une protection maladie, afin qu’il soit impossible de s’installer en France au seul motif de vouloir bénéficier de son généreux dispositif de protection sociale.
M. Hervé Drouet. Je communiquerai ultérieurement à M. Pierre Méhaignerie des éléments de précisions sur les maisons d’assistantes maternelles.
Les taux d’occupation représentent une moyenne, et recouvrent des situations très différentes. Lorsqu’un établissement est ouvert sans interruption de huit heures à dix-neuf heures, la journée compte des heures creuses qui font mécaniquement baisser la moyenne. Un taux de 65 % est donc faible, mais pas aberrant.
S’agissant de l’affaire de Nantes, une procédure judiciaire est en cours, dans lequel la Caisse d’allocation familiale s’est portée partie civile. Si la fraude aux aides sociales est avérée, en particulier sur le critère d’isolement, nous demanderons le remboursement des sommes indûment versées.
M. Marc Laffineur, président. Messieurs, je vous remercie.
*
Audition de M. David Appia, président de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII).
M. David Appia, président de l’Agence française pour les investissements internationaux. Les deux notions de compétitivité et d’attractivité sont étroitement liées. Pour les dirigeants de sociétés étrangères que nous rencontrons, tout ce qui renforce l’une a également un effet positif sur l’autre.
La France est depuis longtemps ouverte à l’investissement étranger, si bien que la présence sur son sol d’entreprises issues d’autres pays est significative. L’investissement étranger concerne plus de 20 000 entreprises, réparties sur tout le territoire – même si elles se concentrent surtout dans les grandes villes. Leurs pays d’origine sont essentiellement les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ces entreprises apportent une contribution très importante à notre économie, puisqu’elles représentent plus de 2 millions d’emplois, 22 % de la recherche-développement et environ un tiers des exportations françaises – dans le secteur manufacturier, ce chiffre atteint même 40 %.
Entre pays européens, la concurrence est forte pour attirer ces entreprises étrangères. C’est pourquoi la France, comme la plupart de ses voisins, développe depuis quelques années des politiques d’attractivité qui reposent sur quatre piliers.
Le premier est structurel : il concerne toutes les mesures ayant pour effet de renforcer la compétitivité de l’économie et des entreprises françaises. On peut citer les dispositions visant à introduire plus de flexibilité sur le marché du travail, la politique de soutien à l’innovation – crédit d’impôt recherche, pôles de compétitivité, réforme des universités – ou la suppression de la taxe professionnelle. Toutes ces mesures servent l’image, et donc l’attractivité de notre pays aux yeux des investisseurs étrangers.
Par ailleurs, il faut rester à l’écoute des entreprises étrangères et améliorer sans cesse l’environnement dans lequel elles évoluent, au moment de leur accueil sur notre territoire comme au stade de leur développement. En effet, il ne suffit pas de les convaincre de s’installer en France, encore faut-il qu’elles y restent. À cet égard, depuis la création de l’Agence française pour les investissements internationaux en 2001 – et singulièrement depuis 2003 –, plus de 130 mesures dites « d’attractivité » ont été étudiées et mises en œuvre pour répondre à un besoin, une attente particulière des investisseurs internationaux. Les dernières mesures de cette nature ont été annoncées le 28 mars 2011, lors de la réunion du Conseil stratégique de l’attractivité. Toutes vont dans le sens d’une simplification des procédures.
Ensuite, il faut faire savoir à l’étranger ce qui se passe en France, faire connaître les atouts français, valoriser les éléments de différenciation. Dans un environnement ouvert et concurrentiel, il importe d’identifier les points sur lesquels le site France se distingue des sites concurrents, en particulier européens.
Enfin, pour assurer le maintien et le développement des entreprises étrangères sur notre territoire et l’apport de nouveaux investisseurs étrangers, il est nécessaire de développer une politique très active de prospection et d’accompagnement. L’Agence française des investissements internationaux remplit cette mission avec l’aide de ses partenaires, notamment les agences régionales de développement économique – qui sont elles-mêmes en relation avec l’ensemble des acteurs territoriaux.
Cette activité de prospection nous conduit à nouer des contacts avec des entreprises étrangères et à écouter ce que leurs dirigeants disent de la France. Selon la façon dont ils jugent la compétitivité de l’économie française, nous pouvons ainsi identifier les points forts et les points faibles de notre pays et proposer des mesures d’amélioration.
Auprès des investisseurs étrangers, la France présente notamment deux points faibles, et même si nous nous employons à les corriger depuis quelques années, ces perceptions – voire ces clichés – perdurent. Le premier concerne le marché du travail : la perception demeure d’un manque de flexibilité et de difficultés trop importante à ajuster les effectifs en période de crise économique. Le deuxième est la perception d’une fiscalité non pas trop pesante, mais trop complexe et parfois instable.
J’en viens aux points forts. La France dispose, en matière d’attractivité, d’atouts de nature structurelle, liés au marché, à sa dynamique, à sa profondeur et à sa connexion au marché européen. Sa démographie – élément important d’appréciation du marché dans une perspective de moyen et long terme – est également favorable. De même, là où elles s’implantent, les entreprises peuvent avoir recours à une main-d’œuvre dont la qualification et la productivité sont reconnues hors de nos frontières. Enfin, le pays dispose d’infrastructures de qualité.
Mais notre pays présente également des atouts de nature plus conjoncturelle. Ainsi, dans une période agitée comme celle que nous avons connue depuis le déclenchement de la crise financière, la façon dont les pays réagissent renforce ou affaiblit l’attractivité. En l’occurrence, la France a tiré son épingle du jeu, puisque nous avons observé en 2009 – c’est-à-dire à un moment où l’investissement international était en décroissance – un pallier dans l’apport de nouveaux investissements étrangers dans le pays. En 2010, alors que l’investissement international dans la zone européenne connaissait une baisse de 10 %, le nombre de projets d’investissement créateurs d’emplois en France et provenant de l’étranger a augmenté de 22 %.
En 2010 s’est également confirmée une tendance importante : l’Allemagne, traditionnellement deuxième pays d’origine de l’investissement créateur d’emplois en provenance de l’étranger, est passée à la première place, devant les États-Unis – les deux pays étant toutefois très proches l’un de l’autre. L’Allemagne et l’Amérique du Nord assuraient cette année-là 87 % de l’ensemble des projets d’investissement créateurs d’emplois. Cela montre à quel point la compétitivité française est reconnue à l’étranger, puisqu’en s’installant en France, les États-Unis et le Canada, pays lointains, visent à prendre pied sur le marché européen. Quant à l’intérêt soutenu des entreprises allemandes en faveur d’une implantation ou d’une extension de leurs capacités en France, il traduit également la perception favorable que ce pays a de la compétitivité de l’économie française. C’est en tout cas la lecture que nous en faisons.
Bien entendu, nous nous intéressons de plus en plus aux pays émergents, compte tenu de leurs capacités croissantes d’émission d’investissements vers l’Europe. Mais ils ne représentaient encore que 6 % des nouveaux projets en 2010, soit en tout 47 projets – dont 35 en provenance de Chine.
Je terminerai en rappelant que la mesure de la compétitivité et de l’attractivité est à la fois simple et complexe. Elle est simple si l’on s’intéresse au nombre de nouveaux investissements décidés par des entreprises étrangères en France – 782 décisions nouvelles en 2010, portant création ou maintien de 32 000 emplois. Mais on peut aussi la mesurer au travers de comparaisons internationales et de rapports publiés par des organismes tels que la Banque mondiale – comme la publication annuelle Doing business, qui classe les pays du monde en fonction des facilités d’implantation –, des observatoires tels que l’international institute for management development (IMD) de Lausanne ou le World economic forum, ou des sociétés de consultants comme Ernst & Young. Depuis plusieurs années, la France a gagné quelques places dans la plupart de ces classements. Sa position est même parfois bien meilleure que ce que l’on pourrait imaginer, en particulier en comparaison avec son grand voisin allemand.
M. Marc Laffineur, président. C’est précisément la question que je souhaitais vous poser : en matière d’investissements étrangers, quelle est la position de la France par rapport aux autres pays européens et à ceux de l’Organisation de coopération et de développement économiques ? Avez-vous le sentiment que notre pays a amélioré sa compétitivité depuis dix ans ? Quel est le rôle joué par le crédit d’impôt recherche en la matière ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Le président d’American Express juge qu’en France, tout est trop compliqué. Celui de Nestlé affirme quant à lui qu’il met tellement de temps pour fermer une usine en France qui ne correspond plus aux besoins du consommateur qu’il n’en a plus pour ouvrir de nouvelles unités. Enfin, le directeur de l’usine Sanden de Tinténiac m’a confié que malgré la baisse de 30 % du chiffre d’affaires, il avait eu de grandes difficultés à adapter les effectifs.
L’adaptation doit-elle peser sur les seules entreprises, ou passe-t-elle par une sécurisation des parcours professionnels ? Ne peut-on faire preuve de pédagogie et faire comprendre à l’opinion publique que les plans de sauvegarde de l’emploi nuisent à notre image et sont une entrave à notre attractivité ?
Par ailleurs, il est très facile d’acheter des petites et moyennes entreprises en France – grâce à la technique du leverage buy-out, par exemple –, d’autant que l’existence d’un impôt sur la fortune favorise la vente d’entreprises. Vous recensez les projets d’investissement créateurs d’emploi, mais est-ce que vous observez ce que deviennent les entreprises cinq ou dix ans après leur création ? Dans certains cas, on constate un transfert du siège social, des services administratifs ou de ceux de recherche. Ne faudrait-il pas tenter de savoir combien d’entreprises relocalisent une partie de leurs salariés ?
Enfin, la multiplicité des agences – départementales, régionales, nationales et internationales – constitue-t-elle un avantage ou un inconvénient ? Donne-t-elle de notre pays une image de sérieux ?
M. Jean Grellier. Êtes-vous en mesure de faire la différence entre les entreprises étrangères qui investissent en France et les investisseurs étrangers qui prennent des participations dans les entreprises françaises ? Quel est le rapport entre ces deux formes d’investissement ?
À l’instar de M. Pierre Méhaignerie, je m’interroge sur la multiplication des acteurs en matière d’investissement étranger. J’ai été en charge de l’économie et de l’emploi dans la région Poitou-Charentes, et les six premiers mois, j’ai éprouvé des difficultés à m’y retrouver. Ne faudrait-il pas, dans ce domaine, tendre vers une certaine harmonisation ?
M. David Appia. Si l’on observe l’ensemble des flux d’investissements directs étrangers, tels que recensés par les balances des paiements et rassemblés une fois par an par la la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la France est le troisième pays d’accueil derrière les États-Unis et la Chine – incluant Hong-Kong. Cela étant, des rapports récents – notamment un rapport du Conseil d’analyse économique piloté par Lionel Fontagné – montrent qu’une grande partie des flux entrant en France est interne aux groupes et répondent à des logiques d’optimisation fiscale ou financière. Ils ne sont donc pas nécessairement le reflet de l’attractivité des territoires.
C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur les investissements étrangers créateurs d’emplois, dont nous assurons le suivi au quotidien en accueillant chaque année environ 500 entreprises étrangères venues explorer les possibilités d’implantation. Sur ce critère, et d’après l’étude annuelle réalisée par Ernst &Young, la France est le deuxième pays d’accueil en Europe, derrière le Royaume-Uni, mais devant l’Allemagne. Notre pays est donc bien positionné depuis plusieurs années.
Je le répète : notre pays a bien résisté depuis le début de la crise. Non seulement le nombre de nouveaux projets étrangers créateurs d’emplois a été supérieur à 620 entre 2007 et 2009, mais nous avons même observé un rebond en 2010, avec 782 projets. Cela reflète à la fois la reprise de l’activité et de la confiance des investisseurs et le bon positionnement de la France sur ce terrain.
Le crédit d’impôt recherche est clairement, en Europe, un élément fort de différenciation pour le site France. C’est un élément d’attractivité d’autant plus important qu’il concerne l’innovation. En effet, l’investissement international est le fait d’entreprises à la recherche de nouveaux marchés, mais aussi, et de plus en plus, de sociétés attentives à la qualification de la main-d’œuvre et à un environnement favorable en matière de recherche-développement et d’innovation. De ce point de vue, le crédit d’impôt recherche est très largement considéré à l’étranger comme un atout maître dans la main française.
De nombreux témoignages vont dans ce sens. Je pense par exemple à une entreprise américaine dont les dirigeants étaient divisés au moment du choix de la localisation en Europe. Certains, pointant les rigidités sur le marché du travail et la difficulté d’ajuster les effectifs en cas de nécessité, plaidaient pour une implantation dans un autre pays que la France. D’autres, qui l’ont finalement emporté, faisaient valoir l’avantage constitué par le crédit d’impôt recherche. Le maintien de cette politique est donc un élément fondamental de notre attractivité.
Elle produit, en effet, des résultats remarquables : alors qu’en 2008, nous avions enregistré 21 nouveaux projets d’investissement dans le domaine de la recherche-développement, ce nombre est passé à 42 en 2009 et à 51 en 2010. Une telle progression a certainement un lien direct avec le maintien du crédit d’impôt recherche et avec la plus grande connaissance que les entreprises étrangères ont du dispositif, d’autant que nous en assurons la promotion aussi largement que possible.
En 2010, nous avons demandé à plusieurs dirigeants d’entreprises étrangères, en particulier dans les pays émergents – Chine, Inde, Brésil –, de participer dans leur pays de résidence à une campagne de communication sur la France. Alors qu’ils avaient carte blanche pour identifier le thème de leur intervention, huit sur dix ont choisi l’innovation et la recherche-développement.
Il est cependant vrai que la difficulté à ajuster les effectifs reste perçue comme un point faible de notre pays. Tous les acteurs au contact des investisseurs étrangers s’emploient donc à faire preuve de pédagogie. Nous nous efforçons par exemple de valoriser les dispositions prises depuis quelques années, comme la rupture conventionnelle du contrat de travail – une option qui a connu un certain succès – ou la défiscalisation des heures supplémentaires. Nous expliquons par ailleurs à nos interlocuteurs que la France accueille 20 000 entreprises étrangères dont plus de 4 000 américaines et plus de 3 000 allemandes. Par ailleurs, chaque année, 30 % des nouveaux projets d’investissements portent sur des extensions de capacités, ce qui traduit la satisfaction des entreprises concernées. Nous avons ainsi identifié une dizaine d’entreprises ayant investi sans discontinuer en France depuis cinq ans.
Il est sans doute facile, en effet, d’acheter des petites et moyennes entreprises en France. Ce que nous observons, c’est que 6 % à 7 % du total des investissements étrangers créateurs d’emplois ou permettant de sauvegarder des emplois correspondent à des rachats d’entreprises en difficulté. Cela représente une cinquantaine de cas chaque année. Depuis dix ans, 422 entreprises en cessation de paiement ou en liquidation judiciaire ont ainsi été rachetées. Nous devons en faire une lecture positive, puisque 61 000 emplois ont de cette façon été préservés.
Vous vous demandez ce qu’il advient de l’entreprise ainsi rachetée, mais la question peut se poser pour l’ensemble des investissements étrangers : quand une entreprise annonce son intention de s’implanter en France et de créer des emplois, il est utile d’observer la situation cinq ans plus tard. Nous avons effectué ce travail d’analyse rétrospective au milieu des années 2000 : au bout de cinq ans, le nombre de projets effectivement réalisés était certes légèrement inférieur à celui des projets annoncés, mais le bilan en termes d’emplois était sensiblement le même, certains projets annoncés ayant connu un développement plus rapide que prévu. Nous effectuons aujourd’hui le même travail pour ce qui concerne les années récentes.
Il est par ailleurs légitime de se demander si des déplacements ou des fermetures d’entreprises ont eu lieu. Mais il faut aussi avoir conscience que dans les années récentes, un certain nombre de sociétés étrangères installées en France ont pris des décisions favorables au territoire français, notamment en y rapatriant des activités qui avaient été sous-traitées ou délocalisées à l’étranger. Je pense notamment à une société japonaise du secteur de l’automobile qui a décidé de localiser en France une activité jusqu’alors sous-traitée en Turquie et en République tchèque. Les mouvements se produisent donc dans les deux sens.
Je pense que nous devons nous féliciter de la multiplicité des agences et des acteurs en matière d’investissement international. L’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) dispose d’une petite équipe de direction et d’analyse à Paris, comprenant soixante personnes, et de quatre-vingt-dix agents à l’étranger, implantés dans 22 bureaux placés au sein de nos ambassades. Leur travail quotidien consiste à rencontrer les investisseurs potentiels et à les convaincre de venir en France. En revanche, nous n’avons pas de réseau en France et nous devons nous appuyer sur les acteurs territoriaux. Les correspondants de premier rang sont les agences régionales de développement économique, mais à travers elles, nous travaillons avec les agences départementales ou de métropole. Le risque de dispersion de l’effort français à l’étranger peut certes exister, mais nous y avons répondu en proposant aux agences territoriales d’utiliser le réseau de l’agence à l’étranger. Nous accueillons ainsi dans nos bureaux les représentants des territoires désireux de se projeter à l’international, de façon à faciliter leurs contacts avec les investisseurs étrangers. Lorsque nous avons lancé ces partenariats, les missions conjointes s’effectuaient à un rythme d’une quinzaine par an. En 2009, nous avons modifié nos procédures, et cette année, nous avons décidé de conduire une soixantaine de missions avec les différentes collectivités territoriales françaises. Nous sommes donc capables de coopérer, y compris pour nouer des contacts avec les entreprises étrangères.
M. Marc Goua. Vous dites que les étrangers sont friands de recherche-développement et d’innovation. Je partage le même sentiment qu’à la suite de leur rachat, un certain nombre de petites et moyennes entreprises françaises ont vu leurs technologies être diffusées au-delà de nos frontières. D’une certaine manière, les investisseurs font leur marché et récupèrent ce qui leur paraît le plus intéressant – et cela peut d’ailleurs se comprendre. Le problème est que les Français sont souvent de bons innovateurs, mais qu’ils ont parfois des difficultés à passer à la production de masse.
Par ailleurs, vous avez rappelé que la productivité était considérée comme excellente dans notre pays. Je constate avec satisfaction que l’on ne brandit plus l’épouvantail des 35 heures.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Vous n’avez pas évoqué le cas des entreprises qui font l’objet d’une succession. À cause de l’impôt de solidarité sur la fortune, la tentation de vendre n’est-elle pas plus forte que la volonté de transmettre ?
M. David Appia. Un de nos atouts, qui est fortement valorisé à l’étranger, est la productivité horaire de la main-d’œuvre française, la troisième au monde selon le Bureau international du travail, derrière les États-Unis et la Norvège. C’est un élément important, sachant que la main-d’œuvre française est de surcroît considérée comme très bien formée. Un jour, le représentant d’une grande entreprise américaine du secteur de l’informatique m’a confié qu’il ne fallait pas sous-estimer l’atout que représentait pour l’attractivité de notre pays l’excellence de notre école de mathématique et d’informatique. C’est certainement vrai dans de nombreux autres domaines, puisque nos ingénieurs sont très prisés à l’étranger.
Quant à la transmission d’entreprises, il s’agit d’un vrai sujet. Lorsque nous comptabilisons les investissements étrangers créateurs d’emploi en France, nous nous appuyons largement sur les agences régionales, afin d’approcher la réalité au plus près. Mais il est des domaines dans lesquels ce travail se heurte à des difficultés méthodologiques. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de recenser les prises de participation au capital d’entreprises françaises par des investisseurs étrangers. Nous sommes contraints d’avoir recours aux sources d’information spécialisées. De la même manière, nous ne sommes pas outillés pour dénombrer les rachats d’entreprises françaises bien portantes, quelle que soit la situation – problème au moment de la transmission, volonté des actionnaires de vendre.
Ce que nous comptabilisons en revanche, ce sont les rachats d’entreprises françaises en difficulté. Dans la plupart des cas, en effet, nous sommes alertés soit par l’entreprise elle-même, soit par les pouvoirs publics. Quand une entreprise se trouve en difficulté, et que le rachat par une entreprise française n’est pas envisageable, ces derniers se tournent souvent vers l’Agence française pour les investissements internationaux pour lui demander de rechercher un repreneur à l’étranger. Nous instruisons en permanence une quarantaine de dossiers de cette nature. Environ 15 nouveaux cas sont enregistrés chaque année, mais depuis le début de la crise, ce chiffre est en augmentation.
Il est assez difficile de convaincre un investisseur étranger de racheter une entreprise en dépôt de bilan, mais nous avons toutefois connu des succès. Le dernier est celui de l’entreprise McCormick située à Saint-Dizier et spécialisée dans les transmissions pour tracteurs. Le groupe italien dont elle était une filiale voulait s’en défaire, et ses emplois étaient menacés. Deux sociétés chinoises se sont déclarées intéressées, et le tribunal de commerce a finalement désigné l’entreprise chinoise Yto, qui va investir dans l’usine.
Il est vrai que les entreprises étrangères acquièrent en même temps les brevets, la matière grise, le capital et les outils en matière d’innovation. Mais nous ne devons pas oublier que 30 000 entreprises françaises se sont implantées à l’étranger, soit directement, soit en rachetant des entreprises sur place. En général, elles acquièrent des actifs qui en valent la peine, et parfois même des pépites technologiques. – ce dont elles ne se cachent pas, bien au contraire. C’est pourquoi il ne faut pas s’émouvoir du fait que certaines entreprises étrangères en font autant sur notre territoire.
Le plus important est qu’elles restent, c’est-à-dire que la valeur ajoutée se développe et qu’elles continuent d’investir et de faire travailler la main-d’œuvre française – sans que cela exclue des stratégies d’internationalisation. De nombreuses entreprises étrangères installées en France sont fortement contributrices en matière d’exportations, ce qui se comprend bien : souvent, elles localisent une de leurs bases de production et de commercialisation en France pour gagner d’autres marchés européens.
Depuis deux ans et demi que j’exerce mes fonctions à l’agence, je n’ai pas observé de cas d’entreprise étrangère ayant racheté une entreprise française avant de transférer l’appareil industriel vers son pays d’origine, même si, dans plusieurs cas, le dirigeant de l’entreprise concernée m’a dit avoir songé à le faire. S’ils y ont finalement renoncé, c’est parce qu’ils ont vite constaté que, si les machines ou les brevets faisaient partie des actifs de l’entreprise, le savoir-faire, la qualité des ingénieurs, la connaissance de l’outil de production comptaient également beaucoup. Dans ces conditions, un transfert aurait représenté une perte. Ce témoignage ne signifie pas que des situations moins favorables ne puissent être observées, mais d’une manière générale, je n’ai pas le sentiment que le premier objectif de l’investissement étranger en France soit ce que certains appellent le pillage technologique, ni même le transfert ou la délocalisation d’actifs.
M. Marc Laffineur, président. Je vous remercie pour ces informations très intéressantes.
*
AUDITION DU 11 MAI 2011
Audition de M. Michel Godet, titulaire de la chaire de prospective stratégique au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Conseil d’analyse économique, et de M. Philippe Weil, président de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), M. Jacques Le Cacheux, directeur du département des études, M. Henri Sterdyniak, directeur du département Économie de la mondialisation, et M. Xavier Timbeau, directeur du département Analyse et prévision
M. Marc Laffineur, président. Nous recevons aujourd’hui M. Michel Godet, professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), membre du Conseil d’analyse économique et de la Commission économique de la nation. Il a apporté sa contribution à des rapports importants du Conseil d’analyse économique : La Famille : une affaire publique (2009), Créativité et innovation dans les territoires (2010) et Libérer l’innovation (2010). Nous avons invité également une délégation de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), emmenée par son président, M. Philippe Weil, professeur des universités et spécialiste du marché du travail. Il est accompagné de M. Jacques Le Cacheux, professeur des universités à l’université de Pau et des pays de l’Adour, directeur du département des études, dont les travaux portent principalement sur la macroéconomie appliquée, en particulier à la recherche, la fiscalité ou l’agriculture, et aux aspects économiques de l’intégration européenne ; de M. Henri Sterdyniak, professeur associé à l’université Paris IX-Dauphine, directeur du département Économie de la mondialisation à l’OFCE, qui a notamment mené des travaux sur l’économie financière internationale ; et de M. Xavier Timbeau, directeur du département Analyse et prévision.
Je tiens à remercier chacun d’entre vous, messieurs, de sa participation à cette table ronde qui, compte tenu de la variété de vos profils, s’annonce dense et riche d’informations.
M. Philippe Weil, président de l’Observatoire français des conjonctures économiques. J’analyserai la compétitivité sous l’angle macroéconomique puis microéconomique, avant de répondre à la question de savoir si une réforme de la protection sociale pourrait améliorer la compétitivité française.
La crise n’est pas terminée. À l’aune du produit national brut (PNB) par habitant, la France est dans une position moyenne. Tous les pays ont été frappés, mais seule l’Allemagne a repris un sentier de croissance qui devrait lui permettre de retrouver son niveau d’avant la crise. Pour les autres pays de la zone euro, la perte sera durable et les taux de croissance ne suffiront pas à compenser la chute causée par la crise. L’Allemagne, d’un côté, l’Italie et l’Espagne, de l’autre, affichent des performances extrêmes, la France se situant dans la moyenne supérieure de la classe européenne.
Sans croissance, il sera quasiment impossible de ramener le ratio dette publique/PNB autour de 60 %, conformément aux engagements du pacte de stabilité. Les taux d’intérêt ne peuvent guère baisser, sauf le taux d’intérêt réel si une inflation massive se manifestait, mais les marchés n’y croient pas, tout au moins pour l’instant. Même en cas de stabilité des taux, l’effort fiscal qui serait requis exigerait, pour résorber l’endettement, au moins vingt ans de surplus primaire considérable, ce qui semble politiquement peu probable. La croissance est donc vitale.
L’amélioration de notre compétitivité et une réforme de la protection sociale sont-elles à même de fournir le surplus de croissance dont nous avons besoin ?
Les pertes et gains de compétitivité relative entre pays de l’OCDE, mesurés par les variations de la part à l’exportation de chaque pays en fonction de celles du coût unitaire du travail, révèlent que la France est un élève moyen supérieur. Comme beaucoup d’autres pays, elle a perdu des marchés à l’exportation mais cela tient en grande partie au fait que le développement du commerce international s’est surtout réalisé hors de la zone euro. L’Allemagne caracole en tête avec l’Autriche, leur compétitivité salariale s’étant considérablement accrue, mais la situation française n’a rien de catastrophique par rapport à celle des autres pays de la zone.
Cette dégradation relative de la compétitivité est-elle préoccupante ?
La corrélation entre compétitivité relative du coût unitaire du travail et taux de croissance n’est pas évidente sur la période 1999-2007. L’Allemagne affiche une compétitivité supérieure mais un taux de croissance légèrement inférieur à celui de la France. À partir de 2005 et jusqu’à la crise, la croissance a été plus forte en Allemagne qu’en France ; toutefois, ce résultat a été obtenu au prix d’une stagnation macroéconomique de 2000 à 2005. L’avantage de compétitivité de l’Allemagne tient à l’effondrement de la part salariale dans la valeur ajoutée à partir de 2000.
L’Allemagne est-elle un modèle pour l’Europe ? Peut-on imposer aux autres pays des réformes Hartz ? L’effet serait sans doute catastrophique. Une réduction brutale des salaires et de leur part dans la valeur ajoutée provoquerait une déflation dans l’ensemble de la zone, une appréciation de l’euro et une baisse des parts de marché vis-à-vis du reste du monde, mais une baisse des parts de marché de l’Allemagne par rapport à ses partenaires. De telles politiques d’appauvrissement ne sont ni souhaitables ni soutenables en Europe. Imiter l’Allemagne ne saurait tenir lieu de politique de sortie de crise en zone euro.
Sur un plan microéconomique, il est incontestable que la France souffre d’un déficit de compétitivité vis-à-vis de l’Allemagne qui tient en partie à nos coûts salariaux, mais aussi à notre retard pris dans l’internationalisation de nos activités et dans la recherche-développement. L’avantage comparatif de l’Allemagne est en grande partie lié à l’organisation de son industrie et à son ouverture aux marchés étrangers. La baisse récente du coût unitaire du travail en Allemagne n’a fait que renforcer cet avantage mais il n’en constitue pas l’essentiel. La compétitivité à moyen et long termes dépend plus de la productivité, c’est-à-dire de l’investissement et de l’innovation que des coûts salariaux.
Le handicap de la France vient de ce que ses entreprises exportatrices, comparées aux entreprises allemandes, exportent des parts beaucoup plus faibles de leur chiffre d’affaires. Il n’est pas rare en Allemagne qu’une entreprise exporte 80 % ou 85 % de son chiffre d’affaires. En France, cela reste exceptionnel.
L’essentiel de la recherche-développement (R&D) se fait en Allemagne dans le secteur manufacturier. La désindustrialisation française – très sensible si l’on se réfère au nombre d’emplois – est dommageable à cet égard.
Les objectifs de notre politique industrielle sont donc clairement identifiables et font consensus. Il faut favoriser l’innovation et l’exportation, soutenir la réindustrialisation et l’industrie manufacturière, ne pas rater le virage écologique et veiller certes à la concurrence mais en même temps à la coopération entre les entreprises car la R & D exige de mobiliser des moyens importants. Il faut surtout ne pas sélectionner a priori des activités dont on croit qu’elles seront gagnantes, et davantage encourager l’innovation dans toutes ses dimensions. Les aides à la R&D devraient ainsi être subordonnées à l’exportation et à des engagements de coopération interentreprises. Cela passe par le développement de clusters, de consortiums technologiques, sans oublier l’évaluation des politiques publiques.
Quel rôle peut jouer le financement de la protection sociale dans un tel programme d’amélioration de notre compétitivité à long terme ? Pour ce qui est de la part des cotisations sociales dans le produit intérieur brut (PIB), la France est incontestablement en tête. Cependant, l’étude du lien entre ce pourcentage et le taux de croissance ne permet guère de tirer de conclusions car les données concernant la protection sociale reflètent des différences dans l’architecture du système, propre à chaque pays. Dans certains pays, l’assurance étant obligatoire, elle apparaît dans les prélèvements ; dans d’autres, elle ne l’est pas. Ainsi, le pays qui présente en 2007 à la fois le taux de croissance et le taux de cotisations sociales en pourcentage du PIB le plus bas est le Danemark – avec respectivement 1,5 % et 0,3 % – tandis qu’à l’opposé, on trouve la Suède qui affiche un taux de croissance supérieur à 3 % et une part des cotisations sociales dans le PIB très élevée : 12 %. Ce sont deux pays scandinaves qui financent différemment la protection sociale. Le lien entre protection sociale, prélèvements obligatoires et taux de croissance ne peut pas être interprété.
Une réforme du mode de financement de notre protection sociale permettrait-elle d’améliorer notre compétitivité sans nuire au pouvoir d’achat ? Une « TVA sociale » aurait des effets comparables à une dévaluation : elle attiserait les tensions inflationnistes et ses effets positifs seraient faibles et de courte durée si les salaires et les retraites n’étaient pas bloqués. La « TVA sociale » n’aurait donc que sociale son nom si les salaires et les retraites étaient bloqués. Remplacer les cotisations sociales des entreprises par la contribution sociale généralisée aurait l’avantage de permettre de choisir la victime : les salariés, les retraités ou les rentiers. Mais quel serait l’engagement auquel les entreprises souscriraient en contrepartie et comment être certain de l’obtenir ?
En conclusion, d’une part, les leviers de la compétitivité sont à chercher non dans une politique macroéconomique magique mais dans une politique industrielle de long terme tendant à accroître la productivité. D’autre part, si le financement de la protection sociale peut être amélioré, il n’y a pas non plus de miracle à en attendre sur la compétitivité.
M. Michel Godet, titulaire de la chaire de prospective stratégique au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Conseil d’analyse économique. Je ne partage tout à fait l’analyse qui vient d’être faite.
Si l’on considère l’évolution du PIB par tête, la France était à l’indice 100 en 1980 et la zone euro à l’indice 92. Aujourd’hui, elle est dans la moyenne. La France a donc reculé par rapport à l’ensemble. Le Royaume-Uni nous a dépassés alors qu’il était en retard de 10 points, pour ne rien dire de l’Allemagne. Nous reculons parce que, en partant de l’hypothèse que les productivités et les qualifications sont comparables entre les pays, la création de richesse dépend de la quantité de travail. Or un Français travaille 88 jours par an, soit trois semaines de moins qu’un Anglais et deux de moins que la moyenne européenne.
Le solde du commerce extérieur est excédentaire en Allemagne et déficitaire chez nous. Sans la zone euro, nous aurions dû dévaluer, ce qui aurait été à double tranchant. Au moins aurions-nous été obligés d’engager des réformes car nous vivons au-dessus de nos moyens : notre croissance a été financée par du déficit. Ainsi, l’année dernière, 1,5 point de croissance de PIB a été obtenu au prix de 7 points de déficit public. Autant arroser le désert avec 7 litres d’eau pour ne récupérer que 1,5 litre. Autrement dit, on finance la consommation des Français en prenant dans la poche de leurs enfants en créant toujours plus de dette.
La France se réjouit à juste titre de sa démographie vigoureuse par rapport à l’Allemagne, mais elle oublie que 25 % des naissances ont lieu dans des familles d’origine immigrée – dont 40 % en Île-de-France – et que ces populations ont peu accès à l’éducation, condition de l’intégration à la société. Or, le rapport du Conseil d’analyse économique dont j’ai été en charge La Famille : une affaire publique montre que le coût de l’échec scolaire est exorbitant pour la société. Un enfant placé dans une structure d’accueil coûte 30 000 euros par an à la collectivité, 180 000 euros dans un centre éducatif fermé. Si on régresse, c’est qu’on ne veut pas voir qu’on a concentré les handicaps dans certains quartiers. La compétitivité n’est pas toujours là où on l’attend, c’est-à-dire dans les indicateurs macroéconomiques, comme l’indiquent les rapports produits par le Conseil d’analyse économique sur la famille et sur les territoires.
Pour l’avenir, je suis plutôt optimiste, mais à condition d’entreprendre les réformes qui demandent du courage et de s’inscrire dans le temps. Les hommes politiques sont en contrats à durée déterminée : ils n’ont pas le temps de mener de telles réformes.
En faisant le tour de France à la recherche des initiatives locales, on se rend compte qu’il y a des territoires dynamiques. La Mayenne ou le bocage Bressuirais affichent des taux de chômage deux fois plus faibles que la moyenne nationale. Ils sont là pour prouver que ce ne sont pas les infrastructures qui font le développement mais les hommes dans une société de confiance. Cette confiance n’existe pas au niveau national à cause, entre autres, de l’instabilité fiscale. On a supprimé le bouclier fiscal – à raison – mais sans un regard pour la moitié des bénéficiaires qui n’étaient pas assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune. Ils ont été sacrifiés sur l’autel de la politique.
En 2002, à propos du bilan des 35 heures, j’avais proposé, sous les sarcasmes, d’en sortir par le haut avec des heures supplémentaires non imposables. Malheureusement, on a rajouté l’exonération de charges que je ne réclamais pas. Ou comment d’une bonne idée faire une mauvaise !
Les différences de dynamiques entre croissance démographique et économique sont éloquentes. Les régions au sud de la Loire ont une croissance beaucoup plus forte que celles situées au nord, à l’exception de la Bretagne. L’indice de fécondité est plus fort au nord, mais les territoires les plus attractifs sont au sud d’une ligne Avranches-Genève. Ils attirent les retraités qui fuient sans mot dire les zones urbaines sensibles. L’insécurité des biens et des personnes est un indicateur essentiel de la qualité de vie et les gens votent avec leurs pieds : ils quittent l’Île-de-France pour des raisons d’insécurité, de non-qualité de vie, de coût de la vie et du logement. Au moment où l’on s’apprête à faire le Grand Paris, la question de savoir si l’argent ne serait pas mieux employé à dynamiser le reste de la France mérite d’être posée. Le Grand Berlin, après tout, ne fait que 3 millions d’habitants.
L’innovation est déterminante. Mais l’innovation est à 80 % non technique. Elle est avant tout sociale, organisationnelle, financière et commerciale. Notre retard avec l’Allemagne s’explique en grande partie en raison d’un service de mauvaise qualité. Si on continue à mettre l’accent sur l’innovation technologique, nous persévérerons dans ce qui a fait notre réputation : des succès techniques qui sont autant d’échecs commerciaux. Le fondement du succès est la synthèse créative. Tout le monde sait que dans l’Iphone, aucune idée ne vient de chez Apple. L’important n’est pas tant la R&D high-tech que la valeur ajoutée. Le rapport du Conseil d’analyse économique met en évidence que les trois quarts des innovations viennent des clients ou des fournisseurs. Un crédit d’impôt recherche innovation aurait mieux valu qu’un crédit d’impôt recherche qui ignore les petites entreprises. Celles-ci représentent 96 % des entreprises et 40 % de l’emploi marchand. Nous sommes trop obnubilés par les entreprises du CAC 40, lesquelles n’ont pas besoin de l’aide des pouvoirs publics pour faire des bénéfices ailleurs qu’en France.
Pour innover, il faut cesser d’imposer les réformes d’en haut, annoncées à grand renfort de présentation sur les chaînes de télévision, du type revenu social d’activité (RSA) ou 35 heures. Elles ne marchent que sur le papier. Pour réformer, il faut au contraire mutualiser les bonnes pratiques en s’inspirant de ce qui fonctionne sur le terrain et en organisant la contagion des initiatives. Par ailleurs, le succès est souvent une affaire de temps, y compris dans l’administration. La caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe est dirigée par un directeur qui est en place depuis vingt ans. Il a eu le temps de faire un formidable travail de sensibilisation auprès de la population sur la médecine active et préventive, permettant ainsi de diviser par trois les arrêts maladie. La mesure de la pauvreté aussi n’est pas forcément très significative : la Mayenne est l’un des départements les plus pauvres de France mais les habitants ne sont pas malheureux parce qu’ils gagnent tous autour de 1,3 SMIC. Ce sont les inégalités trop fortes qui rendent les gens malheureux. Nous avons surtout un grand besoin de cohésion sociale et d’harmonie.
Quant aux propositions concrètes, je suggère, en bon libéral interventionniste que je suis, une politique destinée aux jeunes en difficulté dans ce domaine. L’État ne peut pas laisser faire le marché qui ignore le long terme et l’intérêt général. Il faut faire pour les enfants défavorisés des cités ce que l’on a fait pour les enfants d’agriculteurs à partir des années 1920 en leur attribuant des bourses systématiques et même en les scolarisant en internat. Agir en amont coûte moins cher qu’en aval. Le laisser-faire du marché dans ce domaine est catastrophique, d’autant que nous avons des retards en matière éducative. Il faudrait par exemple généraliser la pratique des professeurs associés dans les collèges et les lycées pour enseigner le droit ou l’économie.
J’en terminerai par le régime de retraite qui doit être non seulement à points mais à horloge, de façon à contourner l’écueil des 35 heures. On mettrait la barre à 70 000 heures de travail à répartir à son gré au cours de la vie active. Les Pays-Bas ont un taux de chômage beaucoup plus faible parce que le temps partiel y est très répandu alors qu’il est honni en France. Il faut lever ce tabou ainsi que celui des inégalités, non de revenu mais de statut. Au nom de l’égalité des citoyens, il faut généraliser un seul contrat à durée indéterminée pour tous, et les contrats d’apprentissage pour pouvoir, tout au long de la vie, changer de carrière. L’ascenseur social est peut-être en panne, mais il y a toujours moyen, en travaillant, de construire des échelles et des escaliers. Dans ces conditions, le meilleur outil d’insertion reste de mettre les chômeurs en situation d’apprentissage.
M. Marc Laffineur, président. Comment la France se positionne-t-elle à l’égard des investissements étrangers ? Et pourquoi ont-ils brutalement augmenté en 2010 ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Si l’inégalité majeure est le chômage, pourquoi ne pas suivre l’exemple allemand dont la qualité première est de le réduire et d’améliorer la compétitivité ? Et que faire d’autre pour être efficace, sachant que les mesures en faveur de l’innovation ne peuvent pas se faire sentir immédiatement ?
Je note l’accent mis par Michel Godet sur l’absolue nécessité de la flexibilité. Le directeur d’une entreprise japonaise sur le départ à qui j’avais demandé quelle était, selon lui, la principale critique à adresser à la France, m’a répondu que la perspective du coût du plan de sauvegarde de l’emploi en cas de diminution de 30 % des effectifs dissuadait l’investissement. Qu’en pensez-vous ?
L’empilement des structures n’est-il pas notre premier problème en empêchant l’initiative et la responsabilité ?
M. Jérôme Cahuzac, corapporteur. Monsieur Michel Godet, vous nous avez vanté la politique du temps partiel menée aux Pays-Bas, et M. Pierre Méhaignerie le système en vigueur en Allemagne. La France a fait l’inverse en misant sur une idée qui était apparemment la vôtre, les heures supplémentaires défiscalisées et – ce que vous ne réclamiez pas – « désocialisées ». Quel jugement comparé portez-vous sur chacune de ces deux stratégies ? En Allemagne, le chômage a été réduit pour 5 ou 6 milliards d’euros tandis qu’en France, le chômage a considérablement augmenté malgré les 4 ou 5 milliards d’euros de manque à gagner au titre de la défiscalisation des heures supplémentaires. Devons-nous persévérer dans cette voie ou renoncer ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. J’ai demandé, dans mon bassin d’emploi, leur avis sur les heures supplémentaires à la fois aux salariés et aux entreprises. Les premiers ont exprimé une forte attente, d’autant que les ouvriers sont ceux qui en bénéficient le plus. Les entreprises peuvent utiliser le dispositif pour répondre à une commande ponctuelle pour laquelle elles n’ont pas l’intention d’embaucher. Il leur apporte une flexibilité supplémentaire qui leur permet de moins recourir aux contrats à durée déterminée (CDD). Qui plus est, le salarié accepte aujourd’hui plus facilement les heures supplémentaires parce qu’il est assuré de ne pas perdre l’aide au logement ou d’autres avantages, et de garder la même tranche d’imposition. Je vous fais part de ces observations car le débat ne doit pas être caricatural. Les heures supplémentaires ont procuré aux entreprises une flexibilité indispensable même si les cotisations sociales auraient peut-être dû être traitées différemment.
M. Xavier Timbeau, directeur du département Analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques. Les entreprises ont toujours avantage à la flexibilité, variable qui détermine le partage du risque entre le capital et le travail, et même au-delà entre l’entreprise et ses fournisseurs, voire ses clients. Tout est affaire d’équilibre.
Je m’inscris en faux contre la croyance selon laquelle La France serait un pays rigide. L’Organisation de coopération et de développement économiques établit des indicateurs de protection de l’emploi. Selon ces derniers, la protection que procure un contrat à durée indéterminée fait de la France un pays peu rigide où la législation du travail autorise le licenciement à des coûts qui sont bas par rapport aux autres pays développés. En revanche, le contrat à durée déterminée (CDD) révèle un degré de protection élevé. De manière paradoxale, le CDD est conçu et utilisé en France comme un instrument de flexibilité, alors qu’il apparaît comme un facteur de rigidité dans les comparaisons internationales. Sur le papier, le CDD peut être utilisé si et seulement si le poste à pourvoir est temporaire. La pratique prouve le contraire, et aucune jurisprudence n’est venue la sanctionner. L’application dément la lettre de la loi. Ainsi, en France, depuis une vingtaine d’années, le développement de l’intérim ou des CDD a largement permis d’augmenter la flexibilité.
M. Pierre Méhaignerie vient d’évoquer le cas d’une entreprise qui doit faire face à une chute de 30 % de l’activité. Par bonheur, les chocs d’une telle ampleur sont rares même si la question s’est posée avec la crise de 2008. Le cas est tellement exceptionnel qu’il est difficilement concevable d’adapter la législation en conséquence. Il vaut mieux se demander comment éviter de pareils à-coups. À cet égard, la comparaison avec l’Allemagne est instructive. Face à un choc plus brutal, l’Allemagne a fait preuve d’une plus grande capacité d’adaptation que la France grâce à un chômage partiel largement financé par le Gouvernement et à des mécanismes d’évolution des salaires qui ont permis aux entreprises de reporter une partie du prix de la flexibilité sur les salariés qui ont accepté des baisses de salaire. Ces mesures ont été prises en vue de ne pas porter atteinte au contrat de travail. La conclusion à en tirer pour nous, c’est que la flexibilité peut ne pas être synonyme de précarité. Certains théoriciens de l’économie du travail ont démontré que des contrats fragiles entre une entreprise et ses salariés provoquent des dysfonctionnements. Aucune des deux parties ne s’investit : l’entreprise ne forme pas le salarié et le salarié ne s’implique pas, si bien que la synergie escomptée et qui constitue l’essence même de l’entreprise ne se produit pas. Le débat sur la flexibilité a pris, en France, une mauvaise direction en faisant le choix d’une précarisation destructrice pour les salariés, mais qui, finalement, ne profite pas non plus à l’entreprise.
M. Henri Sterdyniak, professeur associé à l’université Paris IX-Dauphine, directeur du département Économie de la mondialisation à l’Observatoire français des conjonctures économiques. L’Allemagne n’est pas un modèle pour la France, ni pour la zone euro, ne serait-ce que parce que sa population active potentielle diminue. C’est à cette évolution qu’elle doit la baisse de son chômage. Par ailleurs, la France s’est engagée dans une stratégie de report de l’âge de la retraite qui suppose de créer un très grand nombre d’emplois dans les années à venir. Le modèle allemand n’est pas transposable.
Si l’on remonte à 1999, les inégalités se sont profondément creusées en Allemagne au point que ce pays, traditionnellement égalitaire depuis 1945, est devenu l’un des plus inégalitaires avec la précarité ou le développement des emplois à un euro. Du fait de la stagnation de la demande intérieure, la croissance a été obtenue exclusivement par des gains de productivité au détriment de ses partenaires de la zone euro – la France, l’Italie, l’Espagne. Les excédents de l’Allemagne ont pour contrepartie les déficits des autres pays. Aligner tous les pays de la zone sur l’Allemagne en faisant pression sur la demande interne serait une stratégie parfaitement suicidaire.
M. Michel Godet. J’invite M. Marc Laffineur à lire l’ouvrage de M. Lionel Fontagné publié par le Conseil d’analyse économique qui démonte l’illusion de l’attractivité de la France. En s’appuyant sur les chiffres de la Banque de France, il montre que les entrées effectives de capitaux doivent en réalité être divisées par cinq ou six car elles intègrent les profits que les entreprises françaises rapatrient de leurs filiales à l’étranger. Notre attractivité est tout à fait surfaite.
Depuis le début, je pourfends les 35 heures parce que ce n’est pas en ramant moins que le bateau avance plus vite. La quantité de travail mobilisée en France n’est pas suffisante. Nous avons une France qui fonctionne à mi-temps, ce qui perturbe en profondeur les services aux entreprises et le fonctionnement global de l’économie. Par la défiscalisation des heures supplémentaires, mon idée était d’éviter de s’attaquer de front à l’acquis social des 35 heures mais d’inciter le bricoleur qui veut bien poser du carrelage le samedi matin à travailler davantage que celui qui reste dans son lit, en l’autorisant en quelque sorte à travailler au noir officiellement.
En tout état de cause, il n’y a pas, en France, assez de gens qui travaillent. Faute d’emploi, certes. Les trois quarts des créateurs d’entreprises ne font pas le saut de la première embauche. Pourquoi ? Ils n’y sont pas préparés, et ils savent aussi que, s’ils se trompent sur la personne ou s’ils ne décrochent pas le marché espéré, ils risquent fort de mettre la clé sous la porte. Les lois sociales sont ainsi faites que le patron de la petite entreprise est fragilisé par rapport à son employé.
Sur le plan démographique, l’Allemagne perd 300 000 personnes par an et semble suivre, comme le Japon, un modèle suicidaire. Toutefois, notre démographie ne sera un atout que si nous réussissons l’intégration, notamment en Île-de-France. À quoi bon avoir des jeunes s’ils ne sont pas éduqués et si on ne peut pas les embaucher ? La moitié des jeunes qui ne savent pas lire, écrire et compter en entrant en sixième ont été embauchés par les entreprises de moins de vingt salariés. Les entreprises ont surtout et avant tout besoin de savoir-être : le savoir-faire, lui, s’apprend sur le tas. Le vrai problème aujourd’hui, ce sont les 22 % de jeunes des quartiers en difficulté où l’on a concentré les handicaps. Pour la compétitivité future, agir sur les quartiers, surtout en Île-de-France, tient de l’urgence sociale car, à long terme, la compétitivité est le produit du capital humain. Quant à l’autre moitié, celle qui reste, elle n’est pas employable en l’état par manque d’éducation au sens large. Ce cruel manque d’éducation d’une partie de ces jeunes renvoie aux responsabilités de la société envers les familles. En matière éducative, on agit trop en réparation, et pas assez en prévention.
M. Paul Giacobbi. Les statistiques sur les investissements directs étrangers n’ont aucun sens. La perception de la France par l’étranger est assez différente de la réalité, mais elle est décisive. Les industriels étrangers, américains notamment, ont une mauvaise image de la France. Ils n’y vont pas parce qu’ils craignent de payer plus d’impôts qu’ailleurs, alors qu’ils en paieraient plutôt moins.
En tant que législateur, nous devons nous intéresser à l’impact de nos décisions sur la croissance économique et sur l’équilibre des finances publiques. Kenneth Rogoff et Carmen Reinhart ont étudié le lien à moyen et long termes entre croissance et équilibre des finances publiques. Ils reprennent, de manière plus rustique, une thèse ancienne dont Friedman et Schwartz s’étaient, avant eux, fait l’écho en expliquant que ce ne sont pas les déficits budgétaires qui provoquent la croissance mais, à long terme, la tenue de la masse monétaire. Sur le plan statistique, leurs conclusions d’après lesquelles les déficits publics vont de pair avec une faible croissance sont difficilement contestables même s’il s’agit d’une corrélation, et non une causalité. De telles conclusions s’appliquent-elles, d’après vous, à la France et à l’Allemagne ?
Quand on compare l’équilibre des finances publiques de la France et de l’Allemagne, on ne compare qu’un tiers du problème. L’endettement résulte de trois composantes : premièrement, les finances publiques en ne se limitant pas à l’État fédéral – car celles de certains Länder réservent des surprises ; deuxièmement, les provisions résultant des engagements de l’État ; et, troisièmement, l’endettement privé. En somme, la corrélation doit être étudiée en prenant la mesure de l’ensemble des déséquilibres et de l’endettement.
M. Jean-Claude Sandrier. Il me semble que vous optez pour une approche simpliste et brutale de phénomènes complexes. Selon vous, les Français fuiraient la banlieue et l’immigration. C’est inexact. Ils fuient la pauvreté. Ce n’est pas la même chose.
Quant à la durée du travail, calculée en nombre d’heures travaillées par an, la France est dans la moyenne. Arrêtez de brandir ces trois ou quatre semaines de travail en moins. De surcroît, nous sommes l’un des pays d’Europe où la productivité horaire du travail est la plus élevée.
Selon le récent rapport sur l’immigration paru la semaine dernière, l’immigration aurait « rapporté » plus qu’elle n’a « coûté ». Peut-être les chiffres sont-ils contestables mais ils méritent que l’on s’interroge.
S’agissant des déficits, il faut arrêter le chantage aux enfants concernant la dette publique. Les causes du déficit sont connues. Pour un tiers, il s’agit de la crise – qui sont les responsables ? – et les deux tiers restants s’expliquent par les cadeaux fiscaux.
Ceux qui investissent en France invoquent toujours les mêmes raisons : la qualité des infrastructures, la qualité de la formation, la qualité du service de santé, et, plus discrètement, les taux d’imposition. Notre fiscalité en France favorise les riches ménages et les entreprises. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires montre que ce sont les plus fortunés qui sont les plus épargnés par l’impôt sur le revenu. Le 1 % des plus riches sont imposés non pas au taux marginal de 41 %, mais à 15 %, et c’est scandaleux. Et les grandes entreprises non pas à 33 %, mais à 8 %. Il y a donc en France des gens qui investissent pour des raisons fiscales.
La question fondamentale est celle du déplacement de la richesse qui s’est opéré du travail vers le capital ces dernières décennies. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, en dix-huit ans, les salaires ont augmenté de 81 % en France, les dividendes de 355 %. J’ai récemment visité une entreprise dans ma circonscription où il n’est question que de coûts salariaux et de coûts sociaux alors que l’usine fabrique des produits de luxe commercialisés à 300 euros, pour un prix de revient est de 20 euros. Est-ce vraiment le coût du travail qui fait le prix de la marchandise ? Il faudrait commencer par se poser les vraies questions avant de ponctionner les salaires et de rogner sur les prestations sociales, c’est-à-dire de mener une politique qui mène tout droit à la régression sociale et économique.
M. Marc Laffineur. Il n’y a pas tant une fuite du monde urbain vers le monde rural qu’une attractivité de ce dernier. Les études d’opinion révèlent que les Français préfèrent une maison avec jardin à des appartements. C’est ainsi qu’on ouvre des classes en zone rurale et qu’on en ferme en zone urbaine. Nous n’avons pas à décider pour eux de l’endroit où les Français souhaitent vivre.
Le pacte européen de compétitivité permettra-t-il d’améliorer la compétitivité ou, au contraire, risque-t-il de la freiner ? De même, que faut-il attendre en termes de compétitivité des grands programmes européens d’infrastructures souvent évoqués ?
Alors que la France dispose d’un avantage démographique sur l’Allemagne, comment se fait-il que notre croissance soit actuellement moins importante que la sienne ?
M. Alain Vidalies. S’agissant du marché du travail, il faut se méfier des comparaisons hâtives.
Je prends un exemple : nous avons institué les 35 heures et les Pays-Bas le temps partiel généralisé. Il est évident que si trois fois plus de salariés travaillent à temps partiel aux Pays-Bas qu’en France, le taux de chômage y sera moindre. De même, certains pays ont préféré classer un grand nombre de leurs chômeurs comme inaptes au travail : c’est ainsi que la Grande-Bretagne compte deux fois plus de handicapés que la France, ce qui permet de les sortir des statistiques.
Par ailleurs, je suis étonné, monsieur Michel Godet, de vos propos sur la prétendue insertion des jeunes « qui ne savent ni lire ni écrire ». Si seulement vous aviez raison ! Malheureusement, les enquêtes générationnelles révèlent que si, deux ans après la fin de leurs études, la plupart des jeunes connaissent des difficultés, cinq ans après, les bac + 2 sont installés sur le marché du travail alors que les sans diplômes connaissent toujours la précarité et que c’est encore le cas quinze ans plus tard. Les 150 000 « jeunes décrocheurs » qui sortent chaque année du système scolaire sans emploi ni formation constituent un coût collectif considérable puisqu’ils devront être aidés toute leur vie. Ne tenons pas un discours apaisant, contraire à la réalité. Il faut se mobiliser très en amont pour réduire le décrochage, qui est un drame humain et coûte cher à la société sur le long terme.
S’agissant du chômage, thème cher au président Méhaignerie, son coût est aujourd’hui mutualisé entre les entreprises : c’est le système de l’Unedic qui le veut ainsi. 28 % seulement des cotisations génèrent 80 % des droits. En effet, un salarié perçoit des indemnisations lorsqu’il est licencié ou en fin de CDD ou d’intérim. Donc, plus le recours aux CDD et à l’intérim est important, plus le coût est élevé pour l’Unedic. Ainsi, alors que certaines entreprises abusent des CDD et de l’intérim, d’autres, qui n’y recourent jamais, paient leurs cotisations à l’Unedic sans jamais générer de droits. Les entreprises qui abusent sont-elles repérables ? En tout cas, ce n’est pas le carcan juridique du droit du travail qui les empêchera d’abuser, puisque, aux yeux de la Cour de cassation, le surcroît temporaire d’activité, y compris pour la création d’un nouveau modèle chez Peugeot, justifie l’emploi de 10 000 intérimaires. Ne conviendrait-il pas de séparer la caisse de l’Unedic en deux ? Alors que l’emploi permanent d’intérimaires paraît une aberration, puisque ces derniers coûtent aux entreprises quelque 25 % plus cher que les autres salariés, certaines entreprises y recourent toutefois à grande échelle. Si elles sont capables de payer un tel surcoût, pourquoi n’assumeraient-elles pas également les droits au chômage que génère leur politique ? Cela permettrait de diminuer les cotisations des autres entreprises.
L’ouverture d’une négociation sur le sujet susciterait peut-être la seule proposition alternative intéressante : tout faire pour éviter la rupture du lien entre le salarié et l’entreprise. Mettre l’accent sur l’utilisation actuelle des fonds de l’Unédic permettrait en tout cas de dégager des propositions constructives.
M. Henri Sterdyniak. La dernière proposition est appliquée aux États-Unis et en France seulement pour les accidents du travail. Les entreprises paient des cotisations en fonction des risques qu’elles font subir à la collectivité. Cependant, un effet pervers contrebalancerait toutefois l’effet incitatif : cette mesure favoriserait les grandes entreprises stables, qui peuvent se permettre de conserver leurs travailleurs, au détriment de celles qui sont dans des secteurs en difficulté ou qui prennent des risques, en acceptant, par exemple, d’embaucher des chômeurs en réinsertion. Les pénaliser lorsqu’elles les licencient pourrait les décourager.
La dette publique française n’est pas une exception à l’échelle mondiale. Son montant en 2010 est identique à celui de la dette publique allemande. Nos déficits ne constituent donc pas, pour la croissance française, un handicap particulier. Le monde capitaliste dans lequel nous nous trouvons a été frappé par la crise de la globalisation financière. Les responsables de nos difficultés, ce ne sont pas les dépenses publiques, mais bien les marchés financiers qui, en implosant, ont provoqué des déficits élevés. Les travaux de Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, suivant lesquels les dettes et les déficits publics auraient un impact sur la croissance, sont très contestables. Dans le dernier numéro de l’OFCE, une analyse montre qu’il existe, par le passé, très peu de cas où la dette publique a été si élevée : on ignore si c’est la dépression qui l’a engendrée ou l’inverse.
Comment accepter que la globalisation, les marchés financiers et les largesses fiscales accordées aux plus riches continuent de mettre en péril les finances publiques ? Il faut repenser le système pour empêcher le gonflement des dettes et des déficits publics, sinon la zone euro ne survivra pas.
M. Michel Godet a raison de rappeler que la priorité, pour la France, est de retrouver des emplois industriels. Les jeunes des classes populaires ont besoin d’emploi dans l’industrie ou dans le bâtiment. L’apprentissage leur permettait auparavant de s’intégrer dans la société. La disparition de ses emplois industriels est un drame pour la France. Mais nous ne la réindustrialiserons pas en faisant baisser la demande ou en diminuant la protection sociale.
M. le président Bernard Accoyer. S’agissant des situations respectives de la dette publique en France et en Allemagne, je crains que les données précises ne confirment pas vos propos, monsieur Henri Sterdyniak. Il nous faut regarder cela de près.
M. Jacques Le Cacheux. Le pacte européen de compétitivité est en réalité un pacte de stabilité réformé, agrémenté de mesures qui ne sont susceptibles d’améliorer ni la compétitivité de la zone euro, ni celle, a fortiori, de la France. Le pacte prévoit en effet d’augmenter les contraintes sur l’évolution des dépenses publiques nationales et sur celle des salaires alors que ce ne sont pas tant les évolutions salariales qui posent problème que la productivité. En s’attaquant aux symptômes plutôt qu’au mal, on améliorera d’autant moins la situation que, comme l’exposé de M. Philippe Weil l’a montré, le grand problème est la divergence au sein de zone euro entre, d’un côté, l’Allemagne et, de l’autre, les pays du sud de l’Europe. Le pacte de compétitivité ne le réglera pas.
M. Philippe Weil. Je porte beaucoup d’intérêt aux travaux de M. Michel Godet sur les territoires. Le fait que je sois macroéconomiste ne m’interdit pas de penser que nous devrions dépasser les visons strictement macroéconomiques de la compétitivité. Son explication sur les territoires attractifs et répulsifs est à cet égard riche d’enseignements, notamment en matière d’immobilier. Une étude sur les causes, aux États-Unis, de l’immigration intérieure en direction du sud du pays a montré qu’elle avait pour origine la politique foncière et le prix de l’immobilier.
Nous en savons très peu sur les déterminations régionales, voire intrarégionales du chômage. On évoque toujours le taux de chômage moyen d’un pays : il faut savoir qu’il peut varier du simple au triple d’une région à une autre, voire d’un quartier à un autre, à législation et charges sociales égales. En Belgique, la fiscalité du travail est punitive, du fait que, la dette publique étant élevée depuis longtemps, le pays a dû dégager des excédents primaires ; or le taux de chômage en Flandres est inexistant. On ne peut donc accuser systématiquement la fiscalité en matière de chômage. Les niveaux d’activité ou de compétitivité reposent sur d’autres déterminants. Les Flandres ou encore l’Italie du Nord privilégient les marchés spécialisés, les réseaux dédiés à l’exportation ou les clusters d’innovation : ces choix expliquent peut-être que ces régions soient prospères en dépit des problèmes macroéconomiques pesant sur la Belgique ou l’Italie dans leur ensemble.
Si nous devions trouver un terrain d’entente entre M. Michel Godet et nous, ce serait celui-là.
M. Michel Godet. Monsieur Jean-Claude Sandrier, si je partage votre réaction devant des inégalités insupportables, il ne faut pas, toutefois, se voiler la face : dans les territoires, des hommes innovent et sont à même d’entraîner les autres. Les facteurs endogènes du développement, notamment culturels, existent bien.
Dans le cadre de la comparaison avec l’Allemagne, il convient de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la filière automobile est quasiment déficitaire en France alors qu’elle est excédentaire en Allemagne. Comparant la France et l’Allemagne, le rapport du Centre d’observation économique et de recherche pour l’expansion de l’économie et le développement des entreprises (Coe-Rexecode) révèle que la France a perdu douze points de compétitivité en raison de son coût du travail. Notre industrie était moins chère de dix points il y a dix ans, ce qui nous permettait de bien vendre nos produits, alors même que leur qualité globale était inférieure à celle des produits allemands en termes de services, de performances ou d’image. Aujourd’hui, nos produits sont plus chers sans être meilleurs. Or on ne peut vendre plus cher que lorsqu’on est meilleur : c’est à cela que sert l’innovation.
Notre grande différence avec l’Allemagne réside dans la dépense publique, qui est supérieure de dix points en France. Elle a augmenté dans les deux pays en raison de la crise, mais moins en Allemagne que chez nous. Ce sont surtout les charges qui pèsent sur le coût du travail. Il ne faut pas diminuer la protection sociale, mais revoir peut-être certaines charges inutiles. Plus de services publics ne signifie pas nécessairement plus de dépenses publiques. Il ne faut pas confondre non plus le service public avec le statut public des agents qui le rendent. Il y a aujourd’hui un véritable problème de management public. Les préfets ne restent pas suffisamment longtemps en place pour réformer : tout ce qu’ils veulent, c’est ne pas faire de vague. Il en est de même des directeurs d’administration centrale qui ne restent que trois ans dans leur poste. Ce n’est pas un problème d’homme mais de gouvernance.
Pour ce qui est de la formation, la France compte cinq fois moins d’apprentis que l’Allemagne. Le système scolaire français laisse trop longtemps des enfants devant des enseignants qui, eux-mêmes, ne sont jamais sortis de l’école. C’est pourquoi j’ai proposé de faire entrer les actifs du monde économique dans les écoles, comme professeurs associés.
S’agissant de la productivité, il existe un vrai problème de désinformation économique. Vous avez raison de dire que la productivité apparente du travail en France est la plus élevée du monde, mais il n’y a pas lieu d’en être fier puisqu’on se contente de mesurer la valeur ajoutée par actif, ce qui signifie qu’on a éliminé du marché de l’emploi ceux qui ne sont pas assez productifs et qui, de ce fait, sont à la charge de la société. La quantité de travail et les richesses créées dans un pays, selon les indicateurs de l’OCDE, dépendent du nombre de jours travaillés par habitant et non par actif. En France, le nombre de jours est 88 contre 102 aux Pays-Bas, ce qui fait une différence de deux semaines. La quantité de travail y étant plus importante, les Pays-Bas créent plus de richesses.
En ce qui concerne les différences entre les territoires, j’étais à Annecy il y a quelques jours, où le taux de chômage est très faible.
M. Marc Laffineur. Toute une partie de l’Ouest de la France a également un taux de chômage inférieur à 5 %.
M. le président Bernard Accoyer. Je viens de recevoir les chiffres de la dette que j’avais demandés : elle s’élève en France à 1 600 milliards d’euros, soit à 82 % du PIB ; en Allemagne à 74 % du PIB. De plus, le déficit structurel est nettement plus élevé chez nous. Enfin, la dette par habitant s’élève à 23 300 euros en France contre 21 400 euros en Allemagne.
M. Henri Sterdyniak. Ces chiffres sont bien du même ordre de grandeur. Ils corroborent mes affirmations. L’idée que l’Allemagne ne serait pas endettée contrairement à la France est fausse.
M. le président Bernard Accoyer. J’ai tenu à communiquer ces chiffres car les vôtres n’étaient pas tout à fait exacts, monsieur le professeur.
Je tiens également à rappeler que l’évolution du coût du travail entre les deux pays a été divergente. D’ailleurs, si nous avons créé cette mission, c’est pour savoir ce que vous, les économistes, pensiez de cette évolution. Vous l’avez vous-même affirmé : la France doit cesser de perdre des emplois industriels. Elle doit même en créer.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Une étude récente classe les régions en fonction de leurs performances économiques et du degré de cohésion sociale. Les Pays-de-la- Loire et la Bretagne sont aux deux premiers rangs. La principale raison réside, me semble-t-il, dans le système d’urbanisme du Grand Ouest, qui ne repose pas sur deux grandes métropoles mais sur un réseau de villes petites et moyennes intégrées à un réseau rural motivant et responsabilisant.
Si l’industrie, aux États-Unis, passe du nord au sud, c’est aussi en raison du degré de syndicalisation.
Aux États-Unis où les formations en deux ans font florès, du fait que les universités et les collèges sont ouverts en semaine jusqu’à 22 heures 30 et tout le samedi. L’ouvrier peut ainsi devenir technicien, le technicien ingénieur ou l’aide-soignante infirmière. Il n’en est pas de même en France en raison des pesanteurs bureaucratiques et de la longueur des formations.
M. Marc Goua. Nous avons reçu les représentants d’entreprises qui ont relocalisé. Ils nous ont signalé deux difficultés : la première tient au système bancaire, qui ne joue pas son rôle ; la seconde à l’hyperréglementation, qui annihile les initiatives.
Par ailleurs, il arrive que la cessation d’activité d’une entreprise ne soit liée ni à un problème de compétitivité ni à un problème technique, mais tienne à un problème de volonté politique, de management. À cet égard, je peux vous citer le cas d’une fonderie qui travaillait en sous-traitance : dans le même temps que Peugeot lui a retiré ses commandes Volkswagen souhaitait lui en passer, mais elle a tout de même dû déposer le bilan à cause de la différence de montée en charge.
M. Christian Blanc. J’ai lu avec plaisir votre dernier ouvrage, monsieur Michel Godet : le guerrier antiacadémique et iconoclaste que vous êtes se lit mieux qu’il ne s’écoute. Je vous encourage à continuer d’ébranler nos certitudes.
La question des territoires est primordiale. Le fait de croiser différentes problématiques – clusters, zone urbaine, facteurs culturels, problème de formation – me paraît essentiel pour dépasser les limites de l’approche macroéconomique et mieux éclairer la décision politique.
Le projet de Grand Paris m’a permis de le vérifier. Il doit être pensé selon trois dimensions : un système de six ou sept clusters, une identité urbaine qui leur soit adaptée et une forte cohésion sociale, ce qui renvoie à la question de la formation. Or il est très difficile de communiquer sur ces sujets, y compris avec les économistes, parce qu’ils répondent qu’ils n’ont pas les moyens de les évaluer.
Des auditions précédentes nous ont permis de recueillir des informations précieuses sur les « niveaux de gamme » et sur l’innovation scientifique, technique et sociale. M. Pierre Méhaignerie a eu raison d’insister sur les territoires : il en existe effectivement plusieurs modèles. Le tout est de s’inspirer des modèles performants : on en trouve en France comme en Europe. Pour le Grand Paris, l’exemple de ce qui se passe en Bavière est très intéressant. Les modèles ruraux – je pense à la Vendée – le sont également.
M. Jean-Claude Sandrier. À la suite de votre intervention, monsieur le président, je pense qu’il conviendrait de s’entendre, au sein de cette mission, sur une définition de la dette.
Il convient également de se pencher sur la composition de notre déficit budgétaire, pour contrecarrer l’idée reçue selon laquelle il aurait pour origine la dépense publique. C’est faux. Il a pour origine les ressources fiscales et la crise. On peut toujours affirmer qu’on va résoudre le problème de la dette en pesant sur la dépense publique, mais, je le répète, il est faux de prétendre que celle-ci en serait à l’origine.
M. Nicolas Forissier. Avez-vous le sentiment que la politique d’aménagement du territoire conduite en France permet à nos territoires d’exprimer toute leur attractivité ? Le Berry, où le taux de chômage est inférieur à 5 %, est très attractif. Le vrai défi pour ce territoire, c’est le haut débit internet, afin d’éviter la fracture numérique, et le TGV Grand Centre-Auvergne, doublé de l’aménagement de la ligne historique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Le Grand emprunt n’a malheureusement retenu comme prioritaire que le haut débit. Pensez-vous que les efforts consentis soient à la fois suffisants et suffisamment concrets pour permettre aux territoires de développer leur attractivité ?
Par ailleurs, on dit souvent que la France est un pays compétitif parce qu’elle est un grand pays exportateur. Or nous avons perdu quelque 20 000 entreprises exportatrices depuis quinze ans, passant de plus de 120 000 à 100 000 à peine. Et les plus efficaces sont souvent les très grandes entreprises. Certes, elles entraînent parfois avec elles des petites et moyennes entreprises, mais c’est loin d’être toujours le cas.
En matière d’action publique, la création d’UbiFrance et l’unification des missions économiques et financières représentent un progrès indéniable. Cependant, n’existe-t-il pas également un problème d’ordre culturel ? La France ne s’ouvre pas suffisamment au monde. Les petites entreprises hésitent à aller sur les marchés étrangers. En tant que président du groupe parlementaire d’amitié France-Inde, je me bats pour que des entreprises agroalimentaires françaises se déplacent là-bas. C’est un des premiers pays agricoles du monde, qui, de plus, souhaite travailler avec nous, mais nous n’arrivons pas à y emmener d’entreprises françaises. Notre compétitivité ne peut qu’en souffrir.
M. Michel Godet. Dès le cours préparatoire, les enfants en difficulté devraient être repérés. On attend qu’ils soient en échec scolaire pour réagir. Je suis socialisant et volontariste en la matière. Chacun sait que l’enseignement est meilleur en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire en raison de la concurrence qui règne là-bas entre le public et le privé.
Monsieur Christian Blanc, si je suis meilleur à l’écrit qu’à l’oral, c’est que j’ai le temps, à l’écrit, de développer mes arguments.
L’Île-de-France est la seule région française qui connaisse un déficit migratoire, toutes catégories sociales et professionnelles confondues. Si l’Île-de-France ne se vide pas, c’est uniquement en raison de la fécondité des immigrés. Je me réjouis donc de l’apport migratoire, d’autant que l’Europe va manquer de 25 millions d’actifs. Le problème est de réussir l’immigration en intégrant les enfants issus de l’immigration.
Tous ceux qui le peuvent quittent l’Île-de-France et ce n’est pas uniquement pour une question de pauvreté. Pourquoi ne pas lever le tabou du SMIC identique ? Celui-ci ne devrait-il pas varier en fonction des territoires ? Personne ne peut se loger à Paris avec un SMIC.
La notion de « société de la connaissance » est devenue un mythe. La vraie société de la connaissance, c’est lorsque chacun sait lire, écrire et compter et qu’il a acquis un minimum d’éducation. Nous en sommes loin ! Nous manquons évidemment d’ingénieurs, notamment d’ingénieurs femmes, mais il faut commencer par le commencement : le savoir-être.
M. Laurent Davezies nous révèle que les pôles de compétitivité ne comptent que pour 20 % dans les enjeux de revenus d’un territoire, 20 % étant liés à la production marchande au service de la population réellement présente appelée l’économie présentielle. Ce sont donc 40 % seulement des enjeux de revenus qui sont liés à la production marchande, contre 60 % liés aux revenus de transferts, en provenance majoritairement d’Île-de-France, la région la plus riche : 30 % pour les revenus des retraités et 30 % pour les revenus des fonctionnaires et les transferts sociaux. Les pôles de compétitivité et l’industrialisation sont donc secondaires par rapport à la qualité de la vie. M. Pierre Méhaignerie l’a souligné : ce qui compte ce sont les conditions de vie, l’harmonie sociale, l’absence d’insécurité, la vie associative et culturelle. Les retraités fuient les zones urbaines sensibles.
Il faut également améliorer l’efficacité de la dépense publique. Or c’est loin d’être le chemin suivi par les collectivités territoriales, où l’emploi public a fortement augmenté l’an dernier – plus 68 000 créations de postes d’agents publics –, ainsi que l’absentéisme : vingt jours par an. C’est la Cour des comptes qui l’affirme, ce n’est pas moi.
M. Henri Sterdyniak. Parler de dix points d’écarts entre la France et l’Allemagne est très exagéré. En effet, les Allemands dépensent beaucoup moins que nous en matière d’éducation, de crèche, d’allocations familiales – ils ont beaucoup moins d’enfants –, ce qui leur fait économiser deux points de PIB. La France doit-elle s’aligner sur la politique familiale allemande ? Je ne le pense pas. Il faut également prendre en compte les dépenses militaires.
En ce qui concerne les retraites, les entreprises et les salariés allemands doivent payer des primes à des sociétés d’assurance, qui ne sont pas comptées dans les prélèvements obligatoires. Il en est de même de l’assurance-maladie – au-delà d’un certain plafond, les cotisations sont facultatives. C’est pourquoi la Cour des comptes a réduit l’écart réel à quatre points.
De plus, les pays très productifs comme l’Allemagne ou la Chine, qui accumulent des excédents, créent des problèmes à l’échelle mondiale, la Chine aux États-Unis et l’Allemagne à l’Europe. Si les salaires ont été trop élevés dans les pays du sud de l’Europe, ils ont évolué en France en fonction de la productivité : 0,9 % par an sur dix ans, ce qui est raisonnable, alors qu’en Allemagne, ils ont stagné. Cela se traduit évidemment pour la France par une perte de neuf points de compétitivité par rapport à l’Allemagne. Toutefois, suivre le modèle allemand, ne serait-ce pas une catastrophe pour notre consommation ? La bonne stratégie est de coordonner les politiques économiques à l’échelle européenne pour inciter les Allemands, les Autrichiens, les Néerlandais et les Scandinaves à relever les salaires et les revenus sociaux.
M. Xavier Timbeau. Il faut se méfier du rêve suranné d’une France composée de régions harmonieuses se développant de façon équilibrée, alors que, dans le monde, la dynamique d’agglomération repose sur l’attractivité des grandes villes en termes de création de richesses et de compétitivité. Les zones les plus compétitives sont structurées autour de ces lieux de connexion avec le reste du monde, de concentration de la décision et d’échanges culturels, économiques et financiers que sont les mégalopoles.
En Europe il n’existe que trois mégalopoles : la première est Düsseldorf, la deuxième est Londres et la troisième Paris, avec l’Île-de-France. Paris est une chance pour la compétitivité de la France au plan mondial.
Le fait que le prix de l’immobilier en Île-de-France soit deux fois plus élevé que dans le reste du pays a pour origine cette attractivité. Si le prix de l’immobilier était le même à Paris et à Bordeaux, M. Michel Godet n’aurait pas besoin de proposer un SMIC différent selon les régions.
M. le président Bernard Accoyer. Quelle conclusion devons-nous tirer de votre remarque ?
M. Xavier Timbeau. Alors que Paris est, avec l’Île-de-France, une mégalopole à l’échelle mondiale, la ville n’est pas équipée pour recevoir la population qui vient y travailler. Le partage du territoire avec les régions limitrophes n’étant pas organisé, Paris connaît un phénomène de suragglomération qui s’accompagne d’une hausse répulsive de l’immobilier. On fait ainsi l’impasse sur un moteur de développement.
M. le président Bernard Accoyer. Le même problème ne se pose-t-il pas à Londres ou à Tokyo ? Pourquoi critiquer uniquement Paris ?
M. Xavier Timbeau. Ce problème se pose beaucoup moins à Düsseldorf, New York, Chicago ou Los Angeles qu’à Londres, Moscou, Tokyo ou Paris. Seules les mégalopoles en voie de saturation se trouvent dans cette situation.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Paris, comme toutes les mégalopoles, concentrent des revenus très élevés.
Quant à La Californie, n’est-elle pas l’inverse d’une mégalopole ?
M. Xavier Timbeau. La notion de mégalopole peut varier : elle n’implique pas nécessairement une densité très élevée.
M. Michel Godet. Cette question repose sur le mythe de la taille critique. La Finlande a une petite capitale. Le groupe Beaumanoir, que j’ai récemment visité, ne veut surtout pas s’installer à La Défense : c’est beaucoup plus facile de rendre son personnel heureux en Bretagne. On met plus de temps pour aller de Mantes-la-Jolie à Roissy, et dans des conditions moins favorables, que de Nantes à Paris. Les technologies de l’information et les transports rapides rendent caduque ce type de raisonnement, qui ne fait qu’exprimer le jacobinisme traditionnel français. On peut développer des territoires avec des entrepreneurs innovants à partir du moment où le terreau est favorable. Cela dépend de la qualité de vie de ceux qui y travailleront et de la disposition d’esprit de la main-d’œuvre – certains salariés, il est vrai, ne veulent pas quitter la région parisienne.
M. le président Bernard Accoyer. Je vous remercie, messieurs.
*
AUDITION DU 18 MAI 2011
Audition de M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor, de Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale, et de M. Luc Rousseau, directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
M. le président Bernard Accoyer. Mes chers collègues, l’intérêt de cette mission d’information tient à la fois à l’importance des défis auxquels nous confronte l’évolution de l’économie mondiale et à la nécessité de préserver un pacte social dont nous ne pouvons pour autant négliger les implications financières. Je remercie donc la directrice et les directeurs de trois des plus prestigieux services des ministères financiers pour l’éclairage qu’ils vont nous apporter sur ces questions conjointes de la compétitivité de notre économie et du financement de notre protection sociale.
M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor. La France constitue-t-elle une exception en Europe, pour ce qui est de la compétitivité ? Objectivement non : l’exception serait plutôt allemande. Reste que nous sommes à cet égard sur la pente descendante, cependant que nos dépenses sociales restent plus élevées que celles de nos voisins.
Au cours de la dernière décennie, notre pays a perdu des parts de marché à un rythme proche de celui qu’on observe dans le reste de la zone euro – notre performance à l’exportation a baissé en moyenne de 2,4 % par an entre 2000 et 2008, et celle des pays du cœur de la zone euro, hors Allemagne, de 1,9 % –, mais, dans le même temps, l’Allemagne améliorait, elle, ses résultats de 1,2 % par an, si bien que l’écart avec notre voisin s’est creusé.
Ce décrochage, abondamment documenté, s’explique par une divergence des coûts salariaux, liée à un problème de compétitivité-coût. Aujourd’hui, notre coût salarial horaire dans l’industrie manufacturière, qui est de 33 euros, est à un niveau très proche de celui de l’Allemagne, laquelle a fait un effort gigantesque afin de compenser le coût de la réunification. En revanche, le coût des services reste à un niveau significativement supérieur en France. Or l’industrie manufacturière repose aussi sur les services.
Le problème de compétitivité-prix se pose de façon moins criante, notamment parce que nos entreprises ont comblé, en baissant leurs marges, cet écart de compétitivité lié aux coûts. Ainsi, au cours de la même période 2000-2008, notre compétitivité par rapport à l’Allemagne, qui s’est dégradée de 15 % sur les coûts, n’a diminué que de 5 % sur les prix. Mais l’effort consenti sur les marges se traduit par une diminution de l’effort de recherche et développement (R & D) et de l’investissement, ce qui peut expliquer une partie de notre handicap sur les autres déterminants de la compétitivité, la compétitivité hors-coût et hors-prix, où nous avons également perdu du terrain.
En matière de protection sociale, la situation de la France est un peu particulière.
Premièrement, nos dépenses sont notablement plus élevées que chez nos quinze principaux partenaires européens : en 2008, nous y consacrions 31 % de notre PIB, contre 27 % pour eux, en moyenne. Signalons accessoirement que, malgré un mouvement général plutôt orienté à la hausse, quelques pays – dont le Royaume-Uni, les pays nordiques et l’Allemagne – ont stabilisé, voire réduit le poids de ces dépenses de protection sociale au cours des dernières années.
Deuxièmement, notre protection sociale est financée à 65 % par des cotisations, alors que la moyenne chez nos principaux partenaires est de 58 %. Même si cette moyenne masque des différences importantes en fonction de l’histoire de chaque pays et des modèles d’organisation, il reste que notre mode de financement fait peser davantage que les leurs l’effort sur le travail, c’est-à-dire sur l’emploi. Remarquons cependant qu’entre 1997 et 2008, le poids relatif des cotisations a diminué de six points en France, ce qui se traduit par un timide début de convergence avec nos partenaires européens.
Quel lien établir entre notre compétitivité et le financement de notre protection sociale ? D’innombrables rapports ont été produits sur le sujet, notamment en 2007, à la suite de débats qui avaient défrayé la chronique, mais sans apporter de réponse. Où en est-on aujourd’hui ? Faut-il modifier les modalités de financement de notre protection sociale ?
En premier lieu, il convient de maîtriser les dépenses : le poids des prélèvements obligatoires dans notre pays – environ 43 % – est supérieur à la moyenne de nos principaux compétiteurs, qui se situe autour de 39 %. Au reste, la nécessité où nous nous trouvons d’assainir nos finances publiques ne nous laisse guère le choix !
Doit-on, pour parvenir à cette maîtrise, changer les assiettes, ou du moins les faire évoluer ? On peut se demander, par exemple, pourquoi la politique de la famille est financée par des cotisations assises sur le travail. Mais, pour s’en tenir à des considérations strictement économiques, il faut bien voir qu’une réduction des charges pesant sur le travail favoriserait l’emploi et améliorerait la compétitivité des entreprises, dans la mesure, évidemment, où les taxes appelées à compenser ces baisses de cotisation ne viendraient pas en annuler les effets positifs – il ne faut donc pas se tromper dans le choix d’une recette de substitution.
Les pays voisins nous offrent des exemples intéressants. L’Italie a compensé en 1998 la suppression des cotisations santé des employeurs, assises sur le travail, par un nouvel impôt régional sur les activités productives. La Suède s’est engagée sur une autre voie, entre 2001 et 2006, en verdissant sa fiscalité par la hausse des taxes environnementales. L’Allemagne, en 2007, a relevé sa taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de trois points, ce qui lui a rapporté 24 milliards d’euros ; en même temps, elle a baissé de 1,6 point, et de 11,5 milliards, les cotisations sociales. Cette « TVA sociale » a donc servi à la fois à restaurer la compétitivité et à redresser les comptes publics. De la même façon, en fiscalisant une partie des cotisations de sécurité sociale avec la contribution sociale généralisée (CSG), la France a fait évoluer, quoique à un moindre degré, la structure de ses prélèvements.
Quelles seraient les conditions à remplir pour poursuivre dans cette voie ?
D’abord, il faut déterminer si ce sont les cotisations salariales ou les cotisations patronales que l’on souhaite baisser. Les effets ne sont évidemment pas les mêmes dans les deux cas. À court terme, la baisse des cotisations sociales des employeurs, de loin les plus importantes, permettrait de stimuler à la fois l’emploi et la compétitivité. La baisse des cotisations salariales améliorerait, quant à elle, le pouvoir d’achat.
Ensuite, il convient de déterminer quels régimes sociaux seraient concernés. On sait par exemple que, s’agissant des cotisations salariales, les taux appliqués dans les branches Maladie et Famille sont déjà presque nuls. J’éviterai d’entrer trop dans les détails à cet égard, mais il faut au moins distinguer entre les différents étages de notre protection sociale. S’agissant de la sécurité sociale au sens strict, compte tenu des allégements de charges déjà consentis, une nouvelle baisse des cotisations ne pourrait jouer que sur des rémunérations nettement supérieures au salaire minimum de croissance (SMIC) – au-delà de 1,6 SMIC. L’effet sur l’emploi serait, de ce fait, limité. Dès lors, faut-il plutôt agir sur le deuxième étage qui rassemble régimes obligatoires, complémentaire vieillesse, assurance chômage et une myriade de contributions, qui, additionnés, finissent par peser assez lourd comme l’a remarqué récemment la Cour des comptes dans son rapport où elle comparait la France et l’Allemagne ?
L’option couramment avancée consiste à faire baisser les taux de droit commun de sécurité sociale. C’est bon pour la compétitivité, mais ce n’est pas forcément ce qu’il y a de meilleur pour l’emploi, je le répète, en raison des allégements de charges existants sur les bas salaires.
Une autre option consisterait à alléger les charges des employeurs qui financent les grands régimes paritaires. Concevable en théorie, une telle mesure risquerait d’avoir de très lourdes conséquences en termes de gouvernance.
Mais il reste de la place pour des actions plus techniques. Par exemple, on pourrait bouger les curseurs des allégements de charges dans toutes sortes de directions, pour essayer d’avoir un impact plus marqué sur l’emploi.
Pour compenser ces baisses de charges, quelles taxes ou contributions relever ? Chaque solution présente des avantages et des inconvénients. Relever la taxe sur la valeur ajoutée pénaliserait le pouvoir d’achat des actifs dans la mesure où cela aurait nécessairement un impact sur les prix, variable en fonction du contexte plus ou moins inflationniste et du degré de concurrence dans l’économie. Augmenter la contribution sociale généralisée serait s’inscrire dans le prolongement des réformes des années quatre-vingt-dix mais, comme il n’y a pratiquement plus de cotisations salariales pour les prestations de nature universelle, toute hausse de la contribution sociale généralisée réduirait le salaire net et donc le pouvoir d’achat. Enfin, on pourrait agir sur les taxes « carbone » et les taxes comportementales, celles dont on dit qu’elles apportent un double dividende, parce qu’elles procurent des recettes tout en contribuant à faire évoluer les comportements.
En conclusion, il faut d’abord agir sur la dépense, comme l’ont dit ici ceux qui sont en charge des différents régimes ; ensuite, si l’on décide de faire évoluer les recettes, définir clairement les objectifs que l’on poursuit, en les hiérarchisant ou en arbitrant entre eux – par exemple entre pouvoir d’achat, emploi et compétitivité ; enfin, dégager la meilleure des options.
Je laisserai à M. Luc Rousseau le soin de parler de ce que l’on fait, ou de ce que l’on doit encore faire, pour améliorer notre compétitivité économique. Je me bornerai ici à citer quelques outils susceptibles d’y contribuer : la loi de modernisation de l’économie, en particulier son volet « concurrence » ; les incitations à développer la recherche-développement (R&D) – crédit d’impôt recherche, réforme des universités… –, la réforme de la taxe professionnelle et l’accompagnement de nos entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, à l’exportation grâce aux plans Export, à la Coface et à UbiFrance.
M. Luc Rousseau, directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Je partage l’analyse présentée par mon collègue Ramon Fernandez mais, pour ma part, j’insisterai sur la dégradation de notre balance commerciale qui, entre 2000 et 2010, est passée du quasi-équilibre à un déficit de plus de 50 milliards d’euros par an, et peut-être plus encore sur la dégradation de la balance des paiements courants qui, il y a dix ans, était excédentaire d’une vingtaine de milliards et est aujourd’hui déficitaire d’environ 40 milliards. Une telle évolution, insoutenable pour notre pays, traduit une perte de compétitivité de notre appareil économique, notamment de notre appareil productif et, plus spécifiquement, de son secteur industriel. Il ne s’agit pas d’une fatalité, liée par exemple à la montée des pays émergents, puisque l’Allemagne a su améliorer sa balance commerciale au cours de la même période. Je précise qu’en ce domaine, la France se trouve dans une situation sensiblement moins grave que celles de l’Espagne et de l’Italie, comparable à celle du Royaume-Uni.
Quelles sont nos faiblesses ?
Depuis dix ou quinze ans, nos gains de productivité sont relativement modestes, surtout dans les services, puisque la productivité moyenne a augmenté de 0,7 % mais de 3 % dans l’industrie. C’est en tout cas un élément à prendre en considération.
Par ailleurs, la France présente certainement un handicap sectoriel. Au regard de la mondialisation, on peut distinguer quatre catégories : des secteurs très exposés à la concurrence internationale – textile, habillement, électronique grand public, génériques en pharmacie, acier, aluminium –, le coût de la main-d’œuvre y étant majeur ; des secteurs en équilibre instable comme la chimie et la construction automobile ; des secteurs continentaux peu délocalisables – raffinage, production et distribution d’énergie, télécommunications – et, enfin, des secteurs que nous qualifions de « moteurs d’innovation » – industrie aéronautique et spatiale, défense, filière nucléaire, pharmacie, biotechnologie, logiciels. À mesure qu’on passe d’une catégorie à l’autre, la valeur ajoutée par emploi augmente, partant de 55 000 euros pour aller jusqu’à 90 000 euros, comme augmente en principe la participation de ces secteurs à la croissance, dans les pays occidentaux. La France est sans doute un peu faible dans la dernière catégorie, celle des « moteurs d’innovation ». Il conviendrait de renforcer notre structure d’entreprises, notamment notre structure industrielle, dans ces secteurs à forte croissance et à forte valeur ajoutée, soutenues par un fort niveau de recherche et développement. Or, comme l’a remarqué mon collègue, la dégradation des marges des entreprises françaises a freiné l’investissement, notamment en recherche et développement. Celui-ci représentait 7 % de la valeur ajoutée industrielle il y a dix ans, comme en Allemagne. Le taux est resté à 7 %, alors qu’il est passé à 10 % chez notre voisin.
Enfin, l’évolution différenciée des coûts du travail a creusé entre la France et l’Allemagne un écart de dix ou quinze points en une dizaine d’années. Comme il ne nous est plus possible de compenser ce handicap par la monnaie – par des dévaluations –, il a été envisagé de procéder à un recalage par un ajustement des prélèvements obligatoires – mission confiée par deux ministres à M. Jean-François Dehecq, vice-président de la Conférence nationale de l’industrie.
Sachant que les prélèvements obligatoires sur les entreprises sont de 16 % du PIB en France contre 8 % en Allemagne, l’idée est de regarder comment transférer des prélèvements pesant sur le travail et l’investissement vers d’autres assiettes, plus neutres vis-à-vis des importations notamment, voire plus vertueuses du point de vue environnemental – mais en prenant garde alors à de possibles distorsions aux frontières. Il ne faut pas oublier non plus les allocations familiales, issues d’un prélèvement assis sur les salaires, ce qui est une particularité quasi exclusivement française. Dans le même temps, comme l’a conseillé mon collègue, il convient bien sûr de contenir les dépenses et les prélèvements obligatoires, qui pèsent sur la compétitivité nationale.
Cette mesure de recalage est une mesure de court terme. Bien d’autres, plus structurelles, peuvent être envisagées :
– tout d’abord, encourager la montée en gamme pour se différencier d’un certain nombre de pays concurrents. Beaucoup a été fait en ce sens ces dernières années : triplement du crédit d’impôt recherche, développement des pôles de compétitivité et, plus récemment, lancement du programme « investissements d’avenir ». Mais pour qu’elle fasse sentir ses effets sur les investissements des entreprises, une telle politique devrait gagner en lisibilité. En outre, il conviendrait de ne pas s’en tenir à la recherche « amont », mais de développer aussi l’innovation de façon à favoriser l’implantation d’activités manufacturières en France. On pourrait également envisager des mesures complémentaires en faveur de secteurs émergents dynamiques tels que les biotechnologies, les technologies vertes et certaines technologies de l’information ;
– accompagner les entreprises locales, comme savent le faire nos pays concurrents, dans trois domaines : pour l’exportation, en incitant davantage les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à se lancer ; pour l’excellence opérationnelle, ou Lean Management ; pour « l’image qualité » des produits et des services car la qualité, qui se traduit dans le prix qu’accepte de payer le client, est un facteur de différenciation de notre pays par rapport à l’Allemagne ;
– accélérer la diffusion des technologies de l’information, notamment dans les services. La France investit plutôt moins que les autres pays de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) dans ces technologies, ce qui se traduit par des gains de compétitivité moindres. Plus généralement, il convient d’accélérer la diffusion de l’innovation dans notre appareil productif, car c’est un facteur de compétitivité et de productivité ;
– renforcer la concurrence, en particulier dans les services, en s’appuyant sur la directive « Services » et sur la loi de modernisation de l’économie ;
– faciliter les financements sur fonds propres. À cet effet, les entreprises peuvent déjà recourir au Fonds stratégique d’investissement et à son volet France Investissement destiné notamment à développer le capital risque et le capital développement, mais aussi sur des mesures fiscales comme la mesure dite « Madelin » et la mesure « ISF/PME ». Ce sont des outils d’autant plus utiles que l’une de nos grandes différences avec l’Allemagne, s’agissant de la structure des échanges commerciaux, tient à la faible place des entreprises de taille moyenne ou intermédiaire ;
– favoriser le travail en filière – car les Français sont par nature individualistes – en encourageant les coopérations de moyen et long termes et en évitant de se focaliser sur le seul facteur prix. Travailler en filière permet de structurer des offres qui ne peuvent être le fait d’acteurs isolés, et pour lesquelles il convient d’additionner les capacités de donneur d’ordre et de fournisseur ;
– enfin, améliorer la formation et son adéquation aux besoins de l’économie en développant l’alternance, en multipliant les interactions entre les entreprises et l’éducation nationale et en veillant à la qualité de l’orientation. Dans un certain nombre de métiers, le décalage entre les besoins et l’offre constitue encore un frein à la croissance et à l’activité économique.
Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale. Pour la direction de la législation fiscale, des réformes de la structure de nos prélèvements obligatoires peuvent en effet changer la donne sur le terrain économique. Mais si des marges de manœuvre subsistent pour les prochains mois et les prochaines années, elles sont cependant limitées.
Je partirai d’un travail que nous avons préparé avec le prédécesseur de M. Ramon Fernandez à partir de la fin de 2007 et qui a donné lieu à une publication à la mi-2008 : la revue générale des prélèvements obligatoires. Il s’agissait pour nous d’établir, à la demande des autorités publiques, un diagnostic sur la situation de nos prélèvements fiscaux et sociaux afin d’essayer de déterminer les meilleurs choix possibles pour les mois suivants. Une grande partie de ce diagnostic a été reprise dans le rapport de la Cour des comptes comparant la situation de la France et celle de l’Allemagne à cet égard.
Nous avions tenté de caractériser certaines failles de notre système, mais aussi et surtout de cerner les stratégies envisageables pour l’organisation des prélèvements obligatoires, en comparant leurs mérites. Très synthétique, le document ne rendait que partiellement compte de notre travail mais il faisait apparaître clairement que l’on n’aboutissait pas aux mêmes choix suivant que l’on privilégiait une certaine neutralité des prélèvements entre capital et travail, ou la recherche d’une croissance à fort contenu en emplois – ce qui impliquait d’alléger les prélèvements pesant sur le travail –, ou encore des modèles de concurrence fiscale, ce qui amenait à rechercher des assiettes non délocalisables et donc à s’appuyer davantage sur la taxe sur la valeur ajoutée – ou sur les impôts indirects en général – et sur les impôts environnementaux que sur les impôts pesant sur le capital. Nous nous sommes rendu compte, en particulier, que selon l’importance donnée au taux de croissance ou au taux de chômage, on parvenait à des équilibres de prélèvements très différents.
Cela m’amène à appuyer ce que disait tout à l’heure M. Ramon Fernandez, à savoir qu’avant de s’engager dans des réallocations de prélèvements obligatoires, forcément compliquées et difficiles, il importe de clairement identifier les objectifs que l’on poursuit… et de bien vérifier qu’ils restent d’actualité, car les circonstances économiques, politiques ou extérieures peuvent avoir changé la donne entre-temps.
Les choix que proposait le Gouvernement dans le document précité conduisaient à privilégier trois grands objectifs : la justice fiscale ; le développement durable à travers les impôts environnementaux ; et la compétitivité, à travers la réforme de la taxe professionnelle, considérée alors comme devant avoir la priorité dans toute réorganisation de nos prélèvements obligatoires.
Concrètement, dans la période qui s’est écoulée et pour s’en tenir aux mesures phares, vous avez voté cette réforme de la taxe professionnelle, une importante augmentation du crédit d’impôt recherche destinée à favoriser les investissements de croissance et des mesures visant à faciliter le financement de nos entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, qui en avaient bien besoin.
Quatre ou cinq ans plus tard, j’observe que nous avons corrigé quelques-uns de nos défauts, mais que certains pays parviennent à vivre assez bien avec des défauts assez voisins des nôtres ! C’est ainsi que l’Allemagne, qui a peu fiscalisé son financement de la protection sociale, ne paraît pas éprouver, de ce fait, un handicap de compétitivité particulier. La Cour des comptes a noté qu’elle avait su, mieux que nous, mettre sa stratégie fiscale au service de sa compétitivité, sans doute parce qu’elle avait été plus vigilante sur le long terme, ou simplement plus consciente des conséquences que pouvaient avoir sur l’organisation de ses prélèvements obligatoires les contraintes liées à une économie ouverte. Et de manière assez surprenante, alors que nous attendions que la cour nous invite à gérer nos finances publiques avec davantage de prudence, elle a insisté sur l’importance de se tenir à cet objectif de compétitivité et sur la différence notable qui existe, en ce domaine, entre la France et l’Allemagne.
La réflexion que vous menez invite à réfléchir à ce que pourraient être les prochaines étapes. Ces dernières années, pour ce qui est des assiettes, nous avons plutôt axé l’effort sur l’investissement en consolidant les options prises en faveur de l’emploi. Aujourd’hui, la question des choix à faire se pose.
M. Ramon Fernandez s’est interrogé sur la manière dont on pourrait faire évoluer les financements existants de la protection sociale. Pour ma part, je poserai la question suivante : si une réallocation était jugée souhaitable pour des raisons de compétitivité, quelles seraient nos marges de manœuvre et nos contraintes, sachant que notre niveau de prélèvements est déjà assez élevé et que nous sommes soumis à une forte compétition internationale ?
Malgré ce niveau élevé de prélèvements obligatoires et cette compétition féroce, nous avons des marges de manœuvre – les travaux de la Cour des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires l’ont démontré. Il suffit d’ouvrir le tome II de l’Évaluation des voies et moyens pour comprendre qu’une réflexion est en cours sur les dépenses fiscales. Et, qu’il s’agisse des impôts sur la consommation ou des impôts sur les « externalités négatives », le niveau plutôt modeste de nos impôts indirects ouvre la possibilité d’évolutions.
Même s’il ne faut pas généraliser, j’insisterai aussi sur la très grande capacité des contribuables, ménages ou entreprises, à adapter leur comportement en fonction des choix faits en matière de prélèvements obligatoires et en fonction de la gouvernance fiscale. Certaines assiettes sont ainsi très sensibles : pour s’en convaincre, il suffit de consulter les rapports de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, qui ne concernent d’ailleurs pas que la France. Force est de constater, par exemple, qu’aujourd’hui, dans notre pays, le taux de l’impôt sur les sociétés est à un niveau élevé, ce qui constitue un sujet de préoccupation pour le moyen terme. S’ajoutant aux prélèvements sur la détention de capital, les prélèvements de droit commun sur l’épargne atteignent également – surtout en comparaison de ce qui se fait à l’étranger – des niveaux importants qui doivent tout au moins nous inciter à la prudence.
Prudence qui s’impose d’autant plus que la compétitivité et la réorganisation du système des prélèvements obligatoires ne sont pas des problèmes purement économiques ou fiscaux. Au-delà de la description technique des phénomènes mathématiques et économiques à l’œuvre dans ces matières, la dimension psychologique n’est pas à négliger : l’impôt doit être accepté par les citoyens et cela peut constituer une autre limite à l’exercice de réallocation.
M. Marc Laffineur. Quelle évaluation êtes-vous en mesure de faire du crédit d’impôt recherche ? Contribue-t-il à combler notre retard en matière de recherche et d’innovation ?
Notre compétitivité s’est-elle améliorée au cours des trois ou quatre dernières années, par rapport à l’Allemagne et à nos autres partenaires européens ?
Nos entreprises ne dégagent pas suffisamment de marges, contrairement à ce que croit l’opinion publique, aveuglée par celles que réalisent un petit nombre d’entre elles. Comment améliorer la situation ?
M. Pierre Morange, rapporteur suppléant. S’agissant de la maîtrise des dépenses, notre corapporteur Pierre Méhaignerie, qui a dû nous quitter, aurait aimé avoir votre avis sur la baisse dégressive des indemnités de chômage des cadres.
De façon plus générale, quelle hiérarchie établir en vue de cette maîtrise des dépenses, afin d’améliorer notre compétitivité internationale tout en assurant le financement de la protection sociale, conformément à l’objet de la présente mission d’information ?
Comment caractérisez-vous la fiscalité pesant sur nos entreprises, notamment l’impôt sur les sociétés, par comparaison avec celle de nos partenaires européens ?
M. Marc Goua. Le problème de compétitivité de l’économie française aurait-il pour origine le poids de la dette, comme d’aucuns le suggèrent ?
Comment se situe la France au sein de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques pour ce qui est des investissements internationaux ? On dit qu’ils seraient moins importants qu’on ne l’a annoncé, dans la mesure où il s’agirait souvent de rapatriements de fonds placés à l’étranger par des entreprises multinationales.
La multiplicité des acteurs intervenant dans le soutien aux entreprises françaises est-elle un gage d’efficacité ou constitue-t-elle au contraire un handicap ?
Selon les chiffres en notre possession, les capacités de nos entreprises seraient utilisées entre 70 % à 75 % : si tel est le cas, ne doit-on pas craindre une atonie des investissements au cours des prochaines années ?
Que pensez-vous enfin des projections gouvernementales selon lesquelles la part des prélèvements obligatoires repasserait à 43,9 % du PIB en 2013, alors qu’elle est déjà supérieure à celle que connaît notamment l’Allemagne ?
Mme Marie-Christine Lepetit. L’année dernière, plusieurs rapports, émanant notamment de votre assemblée et de l’inspection des finances, ont conclu qu’il était un peu tôt pour évaluer de manière étayée l’efficacité du crédit d’impôt recherche, compte tenu des modifications importantes intervenues en 2008, dont le passage à un dispositif fondé sur le volume des dépenses de recherche et la suppression du plafonnement.
Ces travaux ont toutefois constaté des progrès notables : une croissance des dépenses de recherche plus importante que ne le permettait le seul contexte économique, ce qui paraît indiquer que le dispositif est efficace mais reste à confirmer sur le moyen terme ; une plus grande diffusion de l’effort de recherche au sein de l’économie, au bénéfice de secteurs jusqu’alors peu touchés ; un regain rapide d’attrait du dispositif auprès des petites et moyennes entreprises, qui ont, elles aussi, besoin de recherche et développement pour pénétrer des marchés très concurrentiels.
Les rapports notaient également, de la part des acteurs économiques, le souhait de voir ce dispositif stabilisé pour leur permettre d’inscrire dans la durée leurs stratégies d’investissement. Cette stabilisation est également souhaitable vis-à-vis des investisseurs internationaux, qui ont renoué avec l’investissement à long terme depuis le relèvement du crédit d’impôt recherche.
Même si un complément d’évaluation circonstancié s’impose d’ici deux ou trois ans, Bercy fait donc une évaluation positive de ce dispositif et souhaite le voir s’installer durablement dans le paysage fiscal français, sous un format important. Il fait en effet « coup double » : il favorise une stratégie de croissance à forte valeur ajoutée, liée à un investissement dynamique, tout en tempérant le taux très élevé de l’impôt français sur les sociétés – un des plus élevés des pays de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques. En ce sens, ce dispositif pertinent et puissant permet d’estomper les critiques adressées à l’impôt sur les sociétés.
Il y a quelques semaines, la Commission européenne a présenté un projet de directive visant à harmoniser l’assiette de l’impôt sur les sociétés et à consolider sa répartition au sein des États membres. Certes, cette directive sera difficile à appliquer car elle pose des problèmes politiques importants aux pays anglo-saxons, mais elle permettra à la France et à l’Allemagne, en particulier, de se poser la question des assiettes économiques les plus pertinentes, voire d’améliorer la convergence de leurs systèmes. En la matière, avoir une plus grande transparence et une plus forte pertinence en partage est un gage d’efficacité et de compétitivité externe, du fait de l’amélioration de la lisibilité pour les investisseurs internationaux. Le chantier est donc ouvert…
Pour un fiscaliste, le niveau de prélèvements obligatoires n’est pas un indicateur véritablement significatif. Un système de prélèvements qui, tout en remplissant les caisses de l’État, n’obère pas la compétitivité économique internationale, ne doit pas nécessairement être décrié. Il faut évidemment tenir compte des équations économiques, notamment de la croissance. Un niveau de prélèvements obligatoires élevé n’est pas a priori inquiétant pour la santé d’un pays : tout dépend de leur structure et de la pertinence des dépenses ainsi financées.
S’agissant des dépenses fiscales, qui pèsent elles aussi sur nos déficits publics, nous avons entamé une étude approfondie pour déterminer celles qui sont les plus dynamiques, ou les plus datées, ou les moins pertinentes, ou les plus « exotiques ». Le Gouvernement vous rendra sur le sujet un rapport d’évaluation à la fin de ce premier semestre, conformément à la loi de programmation des finances publiques, en vue d’un réexamen éventuel de ces dépenses.
M. Luc Rousseau. Des entreprises internationalement mobiles sont venues investir ou réinvestir en France grâce au crédit d’impôt recherche. Lors de presque toutes les réunions qu’ils ont avec l’État, les industriels se préoccupent de la lisibilité et de la pérennisation du dispositif, qui est l’un de ceux qu’ils apprécient le plus.
Nous attendons évidemment du crédit d’impôt recherche des retombées en matière de recherche, de développement et d’emploi. Même si l’effet était modeste sur le niveau de la recherche – ce qui ne sera pas le cas, à mon avis –, la réduction d’impôt sur les sociétés ainsi assurée aux entreprises qui conduisent des travaux de recherche profite de toute façon à celles qui sont fortement exposées à la concurrence internationale : ce sont à peu près les mêmes. C’est donc une excellente mesure.
L’investissement des entreprises ne se fait pas forcément en France. Nombre d’entre elles, appartenant notamment à de grands groupes industriels, préfèrent investir dans les pays à forte croissance et certaines entreprises françaises de renom dégagent leurs marges à l’étranger : celles-ci n’ont dès lors aucun impact ni sur l’investissement ni sur l’emploi dans notre pays. Garder un investissement productif en France pour maintenir l’emploi est donc notre souci constant.
Il est techniquement difficile d’établir des statistiques permettant de distinguer entre les investissements selon leur nature – par exemple entre rachats et investissements physiques. Dans les séries qui sont retraitées au niveau national et rapportées aux données d’Eurostat, on observe que le taux d’investissement, rapporté à la même valeur ajoutée industrielle, est légèrement supérieur en France à ce qu’il est en Allemagne mais nettement inférieur à ce qu’on observe en Espagne ou en Italie. Nous nous efforçons de documenter ce point. Par ailleurs, notre investissement dans les technologies de l’information – je parle ici de logiciels d’entreprise, non d’infrastructures – est un des plus bas de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, alors que c’est un facteur de compétitivité. En dépit d’une légère amélioration, nous restons en queue de peloton.
S’agissant du taux d’utilisation de l’outil manufacturier, il s’élevait à 86 % avant la crise de 2008. Il est tombé à 72 % au début de l’année 2009 pour remonter aujourd’hui à 79 %. Nous avons assisté corrélativement à une remontée de la formation brute de capital fixe – l’investissement physique – dans ces mêmes secteurs : alors qu’il s’élevait, avant la crise, à 28 milliards d’euros par an hors secteur énergie, il est tombé durant la crise à 24 milliards pour revenir aujourd’hui à quelque 27 milliards. La décomposition de l’augmentation du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre de cette année révèle que l’investissement y a fortement contribué. À ce rythme, celui-ci devrait avoir retrouvé à la fin de 2011 son niveau d’avant la crise financière.
M. Ramon Fernandez. Les très bons chiffres du premier trimestre sont notamment dus au bon niveau de l’investissement des entreprises.
Le faible taux d’utilisation des capacités de production a-t-il pour effet de retarder la reprise des investissements ? À ce stade, la réponse serait plutôt négative, mais la question demeure légitime. Ce faible taux peut avoir des explications diverses : stockage-déstockage, désinvestissement des entreprises… Cela étant, les chiffres les plus récents constituent plutôt de bonnes nouvelles.
Le crédit d’impôt recherche fait également l’unanimité à la direction générale du Trésor. Il est plébiscité pour ses effets sur les comportements des entreprises – sur leur politique d’implantation sur le territoire national ou sur leur effort de recherche. Il ne se résume pas du reste à l’incitation fiscale : il est également une incitation à une meilleure coopération entre les différents acteurs de la recherche et développement. Il entre dans tout un ensemble de mesures de même sens : autonomie des universités, investissements d’avenir…
Non seulement le taux d’effort de recherche privée par rapport au produit intérieur brut est inférieur en France à ce qu’il est en Allemagne – 1,4 % contre 1,9 % –, mais la productivité de notre recherche est également moindre que celle de nos voisins : un euro de recherche et développement en Allemagne génère 60 % de plus de brevets déposés à la fois dans l’Union européenne, aux États-Unis et au Japon, et 30 % de plus de chiffre d’affaires en produits nouveaux. Notre effort est donc inférieur non seulement en valeur absolue mais également pour la manière dont il s’intègre dans l’« écosystème » et en termes de résultats. En rapprochant les différents acteurs, publics et privés, le crédit d’impôt recherche devrait contribuer à améliorer cette situation.
Les acteurs publics venant en soutien aux entreprises ne sont pas nécessairement plus nombreux en France que chez nos partenaires ; nous avons toutefois un effort à faire en vue de les coordonner pour améliorer leur complémentarité, et de les faire travailler en réseau, notamment au niveau local. Ce serait plus efficace que de réduire cette multiplicité pour disposer d’une institution unique. L’élaboration de chartes régionales de l’export va dans ce sens : organiser la coopération entre les chambres de commerce et d’industrie, les structures publiques représentées au niveau local et, plus généralement, tous ceux qui concourent à l’export.
Vous avez auditionné, je crois, Mme Agnès Bénassy-Quéré, directrice du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), qui a produit un rapport sur les investissements internationaux de la France. Notre pays reste une terre d’accueil comme une terre d’origine des investissements. On peut toutefois faire des lectures diverses des données disponibles sur le sujet.
S’agissant de l’évolution du taux des prélèvements obligatoires, les perspectives pour les prochaines années sont inscrites dans le programme de stabilité transmis à Bruxelles après la consultation du Parlement. Après avoir commencé de baisser au début du quinquennat, ce taux remonte légèrement, en raison de la politique de redressement des finances publiques et par l’effet mécanique des mesures que vous avez votées, en particulier de celles qui visent à réduire les niches fiscales. Comme Mme Marie-Christine Lepetit l’a souligné, à taux de prélèvements obligatoires égal, les effets sur la croissance, sur la compétitivité et sur l’emploi peuvent être différents.
Quant à savoir si notre compétitivité s’est améliorée depuis trois ou quatre ans, il est difficile de l’affirmer en raison de la situation extraordinaire que nous avons vécue durant cette période. Nous y verrons un peu plus clair lorsque l’environnement se sera stabilisé. Cela dit, toutes les réformes évoquées par M. Luc Rousseau, par Mme Marie-Christine Lepetit ou par moi-même, notamment celles qui ont porté sur la compétitivité-coût – je pense aux mesures relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance prises depuis 2007 – ou sur la concurrence dans le secteur de la grande distribution, visant à favoriser un comportement de prix plus favorable, doivent se traduire par un redressement de cette compétitivité. Il convient toutefois de poursuivre les efforts. Si le coût de l’accès à l’énergie est plus favorable en France que chez nos voisins, tel n’est pas le cas de l’accès aux transports. Certains des intrants qui concourent à la compétitivité de nos entreprises représentent des atouts, d’autres non. Nous ne pourrons juger des résultats qu’une fois que nous aurons le recul suffisant.
Quelles priorités arrêter en matière de maîtrise des dépenses ? Il faut être attentif à tous les postes, qu’il s’agisse notamment de l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie (ONDAM) ou des dépenses de retraite à la suite de la réforme, et ce pour tous les acteurs publics : État, sphère sociale, collectivités territoriales. Nos directions se montrent ainsi vigilantes en ce qui concerne leurs crédits de fonctionnement. Nous n’avons pas le choix. Un effort tous azimuts est requis.
M. Christian Blanc. Monsieur Luc Rousseau, vous avez introduit des éléments de stratégie qu’il serait intéressant de développer, s’agissant notamment de la compétitivité-coût.
Un des points importants du rapport de la Cour des comptes est celui qui concerne le pilotage et la cohérence : on y note que les Allemands se tiennent aux décisions stratégiques qu’ils ont prises…
Vous avez également insisté sur la recherche et l’innovation : peut-être pourriez-vous nous fournir quelques compléments d’information sur le sujet.
J’ai été moins convaincu par votre propos sur les filières : n’est-ce pas une notion très française ? Ne conviendrait-il pas de privilégier au contraire la notion de territoire, plus féconde en ce qu’elle favorise les fertilisations croisées ? En effet, si plusieurs de nos voisins, notamment l’Allemagne, ont pris ce parti, c’est qu’elle permet de faire jouer ensemble différents facteurs, d’ordre économique, technique, culturel, au bénéfice d’une dynamique collective que, me semble-t-il, la France n’a pas suffisamment intégrée dans ses systèmes de production de montée en gamme.
Monsieur Ramon Fernandez, vous avez parlé à l’instant d’« écosystème » : n’est-ce pas précisément dans ce cadre que peuvent se développer les nouveaux modes de production ?
Par ailleurs, pensez-vous que les petites et moyennes entreprises profitent du crédit d’impôt recherche autant que les grandes entreprises ?
M. Jean Grellier. S’agissant des prélèvements obligatoires, ne conviendrait-il pas d’établir une péréquation entre les entreprises, en fixant un plafond et un plancher de cotisations en fonction du chiffre d’affaires, ce qui permettrait de rééquilibrer leur participation au financement de la protection sociale, entre celles qui créent de l’emploi et celles qui importent ou ont moins de charges ? Il s’agit à mes yeux de propositions de bon sens qui ne sont, pourtant, jamais reprises parce qu’on préfère s’orienter vers des systèmes d’exonération de charges, qui sont trop compliqués pour les petites entreprises, ou vers la « TVA sociale », laquelle n’est pas sans inconvénients comme vous l’avez vous-même souligné.
M. Jean Dionis du Séjour. Je n’ai pas assisté au début de la réunion mais vous avez été critiques, m’a-t-on dit, sur la « TVA sociale ». Or une précédente audition avait permis de souligner la tendance lourde au recul, dans le financement de la protection sociale, de la part des cotisations reposant sur le travail – 72 % en France à l’heure actuelle – par rapport à celle qui provient de l’impôt – 28 %. Sans pour autant inviter à copier l’expérience limite du Danemark, ne convient-il pas de s’inquiéter du retard pris par la France par rapport à ce mouvement ?
À l’ère de la mondialisation, continuer de financer la protection sociale par le travail ne constitue-t-il pas un grave anachronisme ? Pourquoi la France continue-t-elle de s’accrocher à cette assiette, contrairement à nombre de ses partenaires ?
M. Luc Rousseau. Il est vrai que le territoire est une priorité : en témoignent les moyens qu’il mobilise, au travers notamment des pôles de compétitivité ou d’autres formes de clusters ou grappes d’entreprises.
La coopération entre entreprises au niveau local permet d’additionner les idées, les compétences et les talents. Elle facilite également la coopération de ces entreprises avec les institutions publiques – je pense notamment aux établissements d’enseignement et de recherche. Pôles de compétitivité et investissements d’avenir, au travers notamment des Instituts de recherche technologique, participent de cette démarche.
Cette interaction concerne l’ensemble de l’écosystème : fournisseurs, compétences humaines – il faut anticiper les besoins en qualifications à échéance de cinq ou dix ans –, financements locaux, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises. Du reste, les pôles de compétitivité ont été pensés à l’intention et autour des petites et moyennes entreprises, même si les grandes en sont des acteurs importants.
Toutefois, certains secteurs, tels que le nucléaire ou la fabrication de matériels de transport, se prêtent plus particulièrement à une logique de filière. Il s’agit de secteurs où le nombre de donneurs d’ordre est très limité et celui des fournisseurs de rang 1, 2 ou 3 très important. Les Allemands nous ont montré le chemin avec leur fédération unique de l’industrie automobile, la VDA (Verband der Automobilindustrie), alors qu’en France, le même secteur se partage entre deux ou trois fédérations. Il existe du reste des projets de réunir constructeurs et équipementiers en vue de définir des stratégies communes, comme dans l’aéronautique. Cela permettrait de concevoir l’automobile de l’avenir comme de réfléchir aux consolidations souhaitables ou à la répartition des tâches entre constructeurs et équipementiers de rang 1 ou 2.
Une meilleure coopération est également nécessaire pour exporter et se développer à l’international. Que ce soit dans l’automobile ou dans le nucléaire, le constructeur doit aller en Inde ou en Chine accompagné de ses fournisseurs pour prospecter efficacement le marché. Les actions de filière doivent donc être renforcées. Les Japonais et les Allemands nous ont malheureusement précédés dans cette démarche.
Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont la première priorité non seulement des pôles de compétitivité mais également des politiques de recherche et développement, même s’il ne faut pas les opposer aux grands groupes car, dans les secteurs que j’ai cités, l’existence de petits fournisseurs dépend de constructeurs implantés sur le territoire national. Toutefois, la politique d’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ne se limite pas au crédit d’impôt recherche. Contrairement aux grands groupes, elles peuvent bénéficier de nombreux autres outils : Oséo est le meilleur exemple, ces dernières années, d’un regroupement de structures opéré en vue de diminuer le nombre des acteurs. C’est une agence dédiée aux petites et moyennes entreprises dont les moyens sont importants, notamment au service de l’innovation : dispositif « jeunes entreprises innovantes », dispositif « ISF-PME ». La comparaison entre ce qui est fait pour les petites et moyennes entreprises et ce qui est fait pour les grands groupes ne doit donc pas se limiter au seul crédit d’impôt recherche.
M. Ramon Fernandez. S’agissant du soutien à l’export, il est clair pour l’État que le redressement de notre commerce extérieur passe d’abord par un renforcement de nos petites et moyennes entreprises. La création d’UbiFrance a exigé de notre administration qu’elle se scinde en deux puisque nous avons détaché quelque 1 000 agents auprès de cette agence complètement dédiée aux petites et moyennes entreprises. Si les résultats sont encourageants pour ce qui est de l’organisation de salons et de déplacements, la réforme est encore trop récente pour se traduire plus concrètement : nous achevons à l’heure actuelle la dévolution aux agences d’UbiFrance de l’ancien réseau à l’exportation de la direction générale du Trésor. Il faut savoir que nos agents devaient se disperser auparavant entre une multitude de missions que la création d’UbiFrance a permis de séparerrépartir plus équitablement.
D’autres mesures spécifiques aux petites et moyennes entreprises ont été prises dans le cadre de la Coface : suppression des frais de dossier, avances sur indemnité pour les très petites entreprises (TPE). Le Parlement a même créé la catégorie des entreprises de taille intermédiaires en 2007 et 2008, afin de valoriser le rôle très important que jouent les entreprises de taille intermédiaire entre les TPE-PME et les grands groupes.
Il est vrai que les charges pesant sur le travail sont plus lourdes en France que chez nos voisins et nous ne nous en satisfaisons pas. Toutefois, les solutions pour y remédier présentent toutes des inconvénients et leurs objectifs peuvent être divers : il faut alors faire des choix, par exemple entre compétitivité, emploi et pouvoir d’achat. La question de la « TVA sociale » entre dans ce débat : comme l’a montré le rapport de 2007 de Mme Christine Lagarde et de M. Éric Besson, son instauration ne serait pas sans conséquences et son succès dépend de conditions bien précises.
Je ne me prononce pas sur les mesures prises en la matière par les Allemands, en 2007 : les conditions étaient très particulières, ce qu’on dit rarement. En effet, ils ne se sont pas contentés d’augmenter la taxe sur la valeur ajoutée pour baisser les cotisations : ils ont augmenté leur taxe sur la valeur ajoutée qui était plus basse que la nôtre, partiellement baissé les cotisations et redressé les comptes publics.
M. Christian Blanc, président. Je vous remercie, madame, messieurs. Surtout, n’hésitez pas à être iconoclastes chaque fois que vous le pourrez. Nous avons besoin d’innover.
S’agissant des coûts de production, nous avons reçu des chefs d’entreprise qui disaient y être indifférents parce qu’ils fabriquent des produits à haute valeur ajoutée. Pour d’autres au contraire, la question est vitale. Or nous adoptons des législations et des réglementations qui valent pour tous !
Je voudrais donc soulever une double question – iconoclaste, précisément : afin d’être plus efficaces, ne faudrait-il pas adopter des stratégies complexes, adaptées à la diversité des situations, avec des sous-stratégies en défense et en attaque, comme le pratiquent les entreprises ? Ou devons-nous continuer d’adopter des législations uniformes et indifférenciées, autorisant tout au plus des ajustements ? Nous n’y répondrons toutefois pas aujourd’hui !
*
AUDITIONS DU 25 MAI 2011
Audition de M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière (FO), et M. Pascal Pavageau, secrétaire confédéral chargé du secteur économique
M. le président Bernard Accoyer. Après avoir reçu il y a quelques semaines les organisations représentatives des employeurs, nous entamons aujourd’hui une série d’auditions des dirigeants des cinq principales centrales syndicales de salariés.
M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. La compétitivité est par définition une notion relative et multifactorielle : le coût du travail n’en constitue que l’un des éléments. J’en veux pour preuve la brochure « Sept raisons d’investir en France », éditée par Bercy à l’intention des investisseurs étrangers, qui, parmi les atouts de notre pays, met en avant les infrastructures, les services publics, la qualification des travailleurs, le niveau élevé de la productivité, tous participant de la compétitivité hors-coût, au moins aussi importante que la compétitivité coût. On pointe, hélas, trop souvent le seul coût du travail lorsqu’on évalue la compétitivité d’un pays. Des comparaisons, notamment avec l’Allemagne, sont souvent effectuées, mais comparaison n’est pas toujours raison…
Cette approche de la compétitivité focalisée sur le coût du travail relève d’une idéologie néo-libérale, qui fait l’objet d’un rejet grandissant, comme j’ai pu le constater la semaine dernière au congrès de la Confédération européenne des syndicats où le « Pacte pour l’euro plus » et la logique qui le sous-tend ont été unanimement condamnés par les organisations syndicales. C’est dans le même esprit que Force ouvrière s’est opposée à l’inscription dans notre Constitution d’une « règle d’or » budgétaire.
Quels sont pour nous les facteurs déterminants de la compétitivité ? Tout d’abord, une place suffisante de l’industrie dans l’économie. Depuis 2000, notre pays souffre de désindustrialisation. La part de l’industrie dans la valeur ajoutée ne représente plus que 13 %, contre 17 % en moyenne dans l’Union européenne et 20 % en Allemagne. Notre pays est insuffisamment présent dans le secteur des biens d’équipement de haute technologie et notre tissu industriel ne compte pas assez de grosses PME, à la différence de l’Allemagne.
La stratégie industrielle de l’État est elle aussi insuffisante. La mise en place de la commission nationale de l’industrie et de onze comités de filière avait fait naître de grands espoirs, qui ont été déçus, puisqu’un seul comité, celui des nouvelles technologies de l’information et de la communication, travaille aujourd’hui activement. J’en profite pour indiquer que Force ouvrière souhaiterait la création d’un douzième comité, consacré à la filière nucléaire. Il faut, pour renforcer l’industrie dans notre pays, élaborer une stratégie industrielle, organiser les filières et la sous-traitance et lutter contre les délocalisations. Voilà les défis à relever.
Il faut se garder de certaines idées qui, bien que souvent invoquées, sont fausses. On entend ainsi dire que le taux de l’impôt sur les sociétés serait plus lourd en France que dans les autres pays, mais c’est sans compter les nombreuses « niches » et autres mécanismes d’optimisation fiscale qui permettent de l’alléger considérablement. La comparaison des taux bruts est dénuée de signification.
J’avoue que le titre même de votre mission d’information m’interpelle. Je ne pense pas que notre protection sociale doive être analysée en priorité sous l’angle de la compétitivité de notre économie. Cette question soulève celles des modalités de la construction européenne. Que l’on ne s’y méprenne pas, Force ouvrière est très favorable à la construction européenne, même si elle en conteste les modalités. Mais elle refuse tout dumping social ou fiscal – nous devons garder en tête les abus nés de la directive relative au détachement des travailleurs.
Nous refusons tout aussi fermement que certains pans de la protection sociale collective soient privatisés. Il importe en revanche de clarifier son financement. Les circuits en sont aujourd’hui complexes : une part est financée par l’impôt, une autre par les cotisations salariales et patronales, une autre encore par la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à quoi s’ajoutent diverses mesures d’exonérations. Il faudrait tout d’abord dresser un état des lieux précis, puis se mettre d’accord sur ce qui doit relever des cotisations sociales et ce qui doit relever de l’impôt, à charge pour le Parlement de fixer le montant de l’impôt nécessaire pour assumer les charges dites de solidarité nationale. Une clarification des rôles et des responsabilités constitue un préalable à celle du financement. Ce débat important, que nous réclamons depuis longtemps, n’a, hélas, toujours pas eu lieu. La plus large part de la protection sociale, 56 % en moyenne avec des taux qui diffèrent selon les branches, demeure financée par les cotisations. Pour le grand chantier à venir du financement de la dépendance, il faut se demander ce qui doit relever respectivement de la cotisation et de l’impôt.
Un dernier mot sur l’idée d’une « TVA sociale », évoquée ça et là. Quelque nom qu’on lui donne, il s’agirait bien d’un nouvel impôt et je vois mal comment on pourrait, dans le contexte actuel, augmenter de façon significative le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, toute question touchant à la taxe sur la valeur ajoutée exige d’être traitée non à l’échelle de la France, mais de l’ensemble de la zone euro.
M. Christian Estrosi. Vous avez évoqué les comités de filière qui visent à établir des relations loyales et sincères entre donneurs d’ordre et sous-traitants – il vaudrait d’ailleurs mieux dire entre fournisseurs et clients. Je partage votre analyse selon laquelle la perte de quelque 600 000 emplois industriels que nous avons subie depuis 2000 n’est pas due au coût du travail. Celui-ci est aujourd’hui à peu près le même qu’en Allemagne et, en 1999, il lui était même inférieur. La dimension et la stratégie des entreprises à l’international jouent un rôle déterminant. D’une part, on compte davantage d’entreprises intermédiaires outre-Rhin ; d’autre part, celles-ci sont beaucoup plus tournées vers l’exportation. La part de l’industrie dans la valeur ajoutée y est également plus forte, comme vous l’avez indiqué.
Un mot du secteur de l’aéronautique, notamment du pôle constitué à Toulouse et en région Midi-Pyrénées autour d’Airbus, filiale de l’European Aeronautic Defence and Space Company N.V. (EADS). On se récrie devant les délocalisations hors d’Europe mais on n’en dénonce pas assez d’autres, encore plus critiquables me semble-t-il, surtout quand il s’agit d’un grand groupe franco-allemand, de petites et moyennes entreprises françaises qui se sont volontairement repositionnées autour du pôle Airbus en Allemagne. Pourriez-vous nous faire le point sur la situation, Force ouvrière étant très représentée dans ce secteur ? Le pire serait, au lieu de chercher à additionner les forces au sein de l’Union européenne pour faire face à la compétition internationale, de délocaliser la sous-traitance d’un pays de l’Union dans un autre, en l’espèce de la France vers l’Allemagne, avec les fermetures de petites et moyennes entreprises et les pertes d’emplois qui ne peuvent que s’ensuivre pour notre pays.
Lorsqu’on évoque la compétitivité de nos petites et moyennes entreprises qui, rappelons-le, sont les plus importantes créatrices d’emploi, comment oublier qu’elles paient l’impôt sur les sociétés à son taux maximal ou en tout cas à un taux très élevé, quand beaucoup d’entreprises du CAC 40 peuvent s’en exonérer – en toute légalité ? Qu’en pensez-vous ?
Il a été un moment question d’affecter une part des 1 300 millions d’euros déposés sur les contrats d’assurance-vie au financement de l’industrie par le biais de livrets d’épargne industrie ou innovation. Quel est votre avis sur le sujet ?
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Parmi les facteurs de compétitivité, nous avons, au long de nos auditions, clairement identifié le coût du travail, qui n’en est en effet que l’un des éléments, la flexibilité, la capacité d’adaptation et la capacité d’innovation des entreprises. Le président de Nestlé disait récemment qu’il lui fallait si longtemps pour fermer en France une usine ne correspondant plus aux besoins du marché qu’il n’avait plus de temps pour en créer de nouvelles ! Entre la nécessaire sécurisation des parcours professionnels, en particulier des ouvriers qui n’ont pas à faire les frais des mutations industrielles, et la nécessaire capacité d’adaptation des entreprises, où placez-vous le curseur ? Les contraintes des plans de sauvegarde de l’emploi ne défavorisent-elles pas, à terme, l’emploi en France ?
M. Michel Issindou. La faiblesse actuelle de notre industrie ne s’explique pas par un coût du travail supérieur à celui de nos concurrents. Il n’est que de voir les succès de l’Allemagne où ce coût est à peu près identique.
L’intitulé même de cette mission d’information qui lie par un raccourci compétitivité et protection sociale, peut introduire un biais, laissant penser que si, au nom de la compétitivité, on abaissait le coût du travail, cela se ferait nécessairement au détriment soit du salaire, soit de la protection sociale. Il faut dépasser cette alternative. Les exonérations de charges sur les salaires de 1 à 1,6 fois le salaire minimum représentent aujourd’hui quelque 30 milliards d’euros. Et elles perdurent alors même qu’on est tous les ans à la recherche de plusieurs dizaines de milliards d’euros pour boucler le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Certains assurent que supprimer ces exonérations ferait s’effondrer encore davantage notre compétitivité. D’autres, dont je suis, pensent que même si elles ont pu avoir un léger effet positif sur l’emploi, elles ont constitué dans la plupart des cas un effet d’aubaine. Selon les sources, on parle de 300 000 à 1,5 million d’emplois préservés : la fourchette est si large qu’elle n’a pas de sens ! Ne pensez-vous pas qu’il conviendrait d’envisager de supprimer progressivement ces exonérations de cotisations sociales ? Avec les 30 milliards d’euros qu’elles représentent, nos comptes sociaux seraient quasiment à l’équilibre.
M. Jean-Claude Mailly. L’un des atouts de l’Allemagne en matière industrielle, au-delà du secteur aéronautique, est qu’il y existe une véritable stratégie de filière entre donneurs d’ordre et sous-traitants et que les banques jouent un rôle très actif dans le financement de l’industrie. Lorsqu’une décision est prise dans un groupe franco-allemand comme EADS, elle est déclinée de façon différente dans les deux pays. Il est plus difficile de diminuer les effectifs en Allemagne qu’en France : souvenons-nous du plan Power 8 de restructuration d’Airbus. On assiste en effet, monsieur Christian Estrosi, à des transferts d’activité. Nous jugeons urgent dans le domaine aéronautique de créer en France une grosse entreprise de premier rang, dont le capital serait majoritairement détenu par EADS mais auquel pourraient être associées des entreprises comme Latécoère et Sogerma, à l’instar de Premium Aerotec en Allemagne. Voilà une décision de stratégie que l’État, actionnaire d’EADS, devrait soutenir. Il en va de la préservation sur notre territoire d’un secteur industriel clé en matière de technologie, de chiffre d’affaires et d’exportations.
S’agissant de fiscalité, il n’est pas normal, en effet, que de grandes entreprises du CAC 40 puissent en toute légalité échapper, en tout ou partie, à l’impôt sur les sociétés – pour certaines, son taux ne dépasse pas 8 % – alors que les petites et moyennes entreprises sont taxées au taux maximal. Cette inégalité de traitement n’en rend que plus nécessaire la grande réforme fiscale d’ensemble que Force ouvrière appelle de ses vœux, sachant que l’impôt doit permettre de financer à hauteur nécessaire le fonctionnement de l’État et des services publics, mais aussi tendre à l’équité.
En ce qui concerne le financement de l’industrie, vous avez évoqué le projet d’un livret d’épargne industrielle individuel avec garantie de l’État, sur lequel nous étions, pour notre part, prêts à discuter. Dans cette même logique de stratégie industrielle, nous souhaiterions que l’ensemble des structures concourant aujourd’hui au financement de l’industrie de façon dispersée – Fonds stratégique d’investissement (FSI), OSEO… – coordonnent mieux leurs interventions, sous la responsabilité du ministère de l’industrie.
La législation française relative aux plans de sauvegarde de l’emploi est-elle trop contraignante ? Je ne le pense pas. La flexisécurité, notion très en vogue à une époque, est aujourd’hui critiquée, notamment de la part d’organisations syndicales qui la défendaient auparavant. Au Danemark où elle a été expérimentée, les syndicats disent qu’en a surtout résulté de la flexibilité, et fort peu de sécurité. La crise a bouleversé la donne. L’organisation du travail est aujourd’hui déjà très flexible en France. Je l’ai dit, il est en fait plus difficile de fermer une entreprise en Allemagne. Un grand patron français m’expliquait que les contraintes en matière d’emploi étaient bien supérieures aux Pays-Bas par exemple à ce qu’elles sont chez nous. La négociation ouverte en 2004 sur les garanties réciproques que pouvaient apporter organisations syndicales et employeurs afin de cadrer les délais a échoué. Mais je ne pense pas que cet aspect obère notre compétitivité.
Force ouvrière a, comme d’autres organisations syndicales, demandé à plusieurs reprises que les exonérations de charges sur les bas salaires fassent l’objet d’une évaluation. Un premier problème tient à ce que toutes ne sont pas compensées : 2,5 à 3 milliards d’euros font ainsi défaut chaque année à la Sécurité sociale, ce qui représente près de 10 % de son déficit. Il faudrait réformer progressivement ce dispositif, comme l’a d’ailleurs préconisé la Cour des comptes dans un rapport, suggérant que l’on ramène le salaire maximal ouvrant droit à exonération de 1,6 à 1,3 SMIC. Les économies seraient considérables pour le budget de l’État. Tout dispositif de ce type entraîne en effet inévitablement des effets d’aubaine.
M. le président Bernard Accoyer. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général d’être venu exprimer devant nous le point de vue de Force ouvrière, dont notre mission d’information ne manquera pas de creuser les analyses et les propositions originales.
*
Audition de M. Bernard Van Craeynest, président de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
M. Bernard Van Craeynest, président de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres. Qu’est-ce que la compétitivité d’un pays ? Selon le rapport Jacquemin-Pench « Pour une compétitivité européenne » paru en 1997, elle ne constitue « ni une fin en soi, ni un objectif. Elle est un moyen efficace de relever le niveau de vie et d’améliorer le bien-être social. C’est un outil (…) ». Le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) définit la compétitivité à long terme d’une nation comme sa capacité à améliorer le niveau de vie de ses habitants. Pour l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), elle se définit comme « la mesure dans laquelle un pays peut, dans un contexte de marché libre et loyal, produire des biens et services qui répondent aux normes des marchés internationaux tout en assurant et en augmentant le revenu réel de sa population à long terme ». Cette organisation vient de lancer, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, un indicateur « Vivre mieux », destiné à mesurer le bien-être des citoyens de ses trente-quatre pays membres, incluant onze dimensions : logement, revenus, emploi, liens sociaux, éducation, environnement, gouvernance, santé, sécurité, satisfaction générale et équilibre famille-travail. Les priorités diffèrent selon les pays. En France, l’emploi et la santé sont jugés prioritaires.
L’emploi constitue un sujet récurrent dans notre pays depuis plus de trente ans, au regard notamment de l’évolution du taux de chômage. Notre système peine à inclure les jeunes, signe d’un problème à la fois d’orientation et de formation. La CFE-CGC propose depuis longtemps un passeport emploi-formation, inspiré de ce qui a été mis au point dans l’accord national interprofessionnel sur la formation. Il importerait que dès le collège, puisse être recueilli chaque année l’avis des quatre parties prenantes que sont l’élève, ses parents, ses enseignants, mais aussi les conseillers d’orientation. Il faut, en effet, sortir de la spirale infernale d’un système éducatif qui, bien que mobilisant le premier budget de l’État et d’une qualité indéniable, n’en laisse pas moins sortir tous les ans 150 000 jeunes sans qualification ni donc réelles perspectives d’intégrer le marché du travail. La CFE-CGC est très favorable à la formation en alternance, au développement duquel elle prend d’ailleurs toute sa part. C’est le meilleur moyen d’apprendre à connaître le monde professionnel, son fonctionnement et ses codes, et d’éliminer un critère aujourd’hui très discriminant à l’embauche, le manque d’expérience.
La compétitivité d’un pays comme le nôtre repose largement sur sa capacité à créer des emplois à forte valeur ajoutée et à progresser dans le secteur des hautes technologies. Or, depuis longtemps, les quarante à cinquante mille ingénieurs formés chaque année, y compris dans nos grandes écoles, donnent la préférence au secteur financier. Il faudrait renforcer l’attractivité de certaines filières professionnelles et du secteur industriel.
Aborder parallèlement compétitivité de l’économie et protection sociale n’est pas sans risque car les deux ne s’opposent pas, bien au contraire. Nous avons pu constater depuis 2008 que les stabilisateurs automatiques et les dépenses sociales ont amorti le choc de la crise et aidé à maintenir la cohésion sociale. Elles ont contribué à hauteur de 50 % à la sauvegarde des revenus de nos concitoyens et, partant, à la bonne tenue de la consommation des ménages, principal pilier de la croissance dans notre pays. Notre protection sociale constitue clairement un facteur de compétitivité.
Le niveau de la productivité horaire en France demeure tout à fait concurrentiel par rapport à celui des principaux pays avec lesquels nous sommes en compétition.
L’investissement en recherche et développement représente dans notre pays 2,1 % du produit intérieur brut, niveau qui n’est pas négligeable et même assez élevé par rapport à nos voisins européens. La stratégie de Lisbonne de mars 2000 fixait cependant un objectif de 3 %. La recherche-développement issue des entreprises présente tout particulièrement des faiblesses.
Le niveau des salaires n’obère pas la compétitivité de notre pays. C’est même un facteur d’attractivité pour les emplois des secteurs à forte valeur ajoutée et de haute technologie.
La CFE-CGC souhaiterait qu’on évalue de manière précise l’efficacité des allègements de charges sur les bas salaires. Cela paraît indispensable, compte tenu des montants en jeu et de la part de ces exonérations non compensées à nos organismes de sécurité sociale. Il nous semblerait utile de réfléchir à d’autres mécanismes que ceux existant aujourd’hui, ciblés sur les salaires de 1 à 1,6 SMIC. Nous proposons, pour notre part, un allègement général pour tous les salariés, par exemple sur les trois cents premiers euros de salaire, quitte à maintenir un dispositif spécifique pour les emplois des secteurs soumis à la concurrence internationale. Pour des emplois non délocalisables, comme beaucoup d’emplois de services, tout allègement de charges n’est qu’une aubaine, comme l’a été l’abaissement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans la restauration.
Notre pays ne manque pas d’attrait, comme en atteste la bonne tenue des investissements directs étrangers en France.
Notre système de protection sociale, qui redistribue 416 milliards d’euros par an, a le mérite de maintenir les solidarités, à commencer par la solidarité intergénérationnelle. Au principe fondateur de notre sécurité sociale posé en 1945, selon lequel chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, il semble pourtant qu’on cherche subrepticement à substituer un système dans lequel, aussi bien en matière d’assurance maladie, d’assurance chômage, d’assurance dépendance que de retraite, au-delà d’un certain socle – dont resterait d’ailleurs à déterminer précisément le contenu –, chacun serait invité à se débrouiller en fonction de ses moyens. Une telle évolution ne nous paraît pas envisageable à brève échéance. Il faudrait à tout le moins réfléchir auparavant sur la transition à opérer et sur la nature des protections pour lesquelles un tel modèle pourrait s’appliquer.
Si la CFE-CGC considère notre système de protection sociale comme un investissement qui ne doit pas être remis en cause au motif qu’il coûterait trop cher, elle n’exclut pas une réflexion sur des ajustements possibles et une remise à plat de son financement. Du fait du vieillissement de la population, les dépenses sociales croissent, en effet, plus vite que la richesse nationale et la masse salariale sur laquelle repose encore majoritairement leur financement. Nous proposons, pour notre part, la mise en place d’une cotisation sociale sur la consommation – préférable à un impôt, lequel n’est pas affecté. Or, en l’espèce, nous souhaiterions que cette ressource soit réellement dévolue à la protection sociale.
La CFE-CGC souhaiterait que les entreprises soient mieux informées des dispositifs de financement existants au-delà du secteur bancaire traditionnel : fond stratégique d’investissement, comités de filière, OSEO, Caisse des dépôts et consignations (CDC) Entreprises… Beaucoup de chefs d’entreprise ignorent toutes les possibilités existantes ou, en tout cas, jugent ces outils si complexes qu’ils préfèrent ne pas se lancer dans certaines opérations, trop aléatoires à leurs yeux.
La CFE-CGC souhaiterait aussi qu’on facilite la transmission des entreprises familiales. Celles-ci représentent plus de 80 % des entreprises dans notre pays mais seules 10 % d’entre elles – contre 50 % en Allemagne ou aux Pays-Bas – se transmettent aujourd’hui dans le cadre d’une continuité familiale. Avec le départ en retraite prochain d’un très grand nombre de chefs d’entreprise, le problème prend une acuité particulière. Chacun sait que lorsque la transmission se passe mal, des emplois risquent d’être détruits.
En conclusion, certaines initiatives ont été prises qui vont dans le bon sens. Nous soutenons sans réserve la mise en place d’une commission nationale de l’industrie et de comités de filière. Nous avons récemment demandé au ministre de l’industrie de créer un comité de filière supplémentaire relatif à l’énergie. Nous estimons pertinent le travail réalisé sur le made in France et la création d’un label « Origine France garantie ». Tout cela est positif. Beaucoup reste néanmoins à faire.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Votre proposition d’allègement des charges sur les 300 premiers euros de salaire est audacieuse. Le coût du travail s’en trouverait abaissé de 4 % à 5 % pour un cadre gagnant 3 000 euros par mois mais alourdi de 20 % pour un salarié rémunéré au salaire minimum ou juste un peu au-dessus. Comment une telle mesure pourrait-elle être appliquée ?
M. le président Bernard Accoyer. Vous ne semblez pas hostile à une évolution de l’assiette du financement de notre protection sociale, à laquelle, est-il besoin de le rappeler, nous sommes tous attachés. Il n’est pas question ici de la mettre en balance avec la compétitivité, mais seulement de réfléchir aux moyens de son financement. Celui-ci repose aujourd’hui largement sur les cotisations acquittées par les employeurs et les salariés, pesant donc sur l’appareil productif, alors que chacun s’accorde sur la nécessité de préserver la compétitivité de nos entreprises, afin notamment de conforter l’emploi. Comment envisageriez-vous l’évolution de cette assiette ? Sinon, comment pensez-vous que pourrait être assurée la pérennité de notre protection sociale, dont le coût est appelé à s’accroître du fait de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès médicaux ?
M. Bernard Van Craeynest. L’idée d’une exonération de charges sur les 300 premiers euros de salaire reste à approfondir. Cela n’exclurait pas que puissent continuer d’exister des allègements spécifiques sur les bas salaires – sachant que la Cour des comptes elle-même préconise qu’ils soient dégressifs et limités aux salaires jusqu’à 1,3 fois le salaire minimum.
Si on déplore depuis des années la délocalisation des usines, il faut prêter également attention à celle de la matière grise, facilitée par l’essor des nouveaux moyens de communication. Nous sommes en compétition avec des pays qui n’ont plus d’émergents que le nom, je pense aux « BRIC » – Brésil, Russie, Inde et Chine. L’Inde et la Chine forment chaque année dix fois plus d’ingénieurs que nous, sur les salaires desquels nous ne pouvons pas nous aligner. Certains secteurs de haute technologie, comme ceux des cartes à puce ou des semi-conducteurs, ne créent quasiment plus aucun emploi dans notre pays. Il ne suffira pas de restaurer l’attractivité des filières industrielles auprès des jeunes diplômés de ces secteurs : il faudra trouver le moyen de favoriser leur emploi à un niveau satisfaisant de rémunération. Enfin, est-il normal que des entreprises bénéficient du crédit d’impôt-recherche alors qu’elles délocalisent leur recherche et développement à Singapour, en Inde ou en Chine ? Une évaluation s’impose.
En ce qui concerne l’assiette du financement de la protection sociale, si l’institution de la contribution sociale généralisée a permis de diminuer la part issue des cotisations sociales, 60 % continuent de reposer sur les salaires. C’est d’ailleurs ce qui rend difficiles les comparaisons internationales, notamment avec l’Allemagne, car nos systèmes sociaux sont différents. Nous proposons, pour notre part, d’instituer une cotisation sur la consommation, qui se substituerait aux cotisations maladie et serait totalement affectée à la branche Maladie. Nous ne refusons pas de réfléchir à des recettes alternatives aux cotisations sociales mais posons comme exigence un réexamen global du financement de notre protection sociale. Nous ne pourrions pas, par exemple, cautionner un tour de passe-passe qui aboutirait à réduire les recettes de la branche Famille et donc à en minorer les prestations.
Je voudrais en conclusion insister sur la situation des classes moyennes, encore qu’il faille s’entendre sur ce qu’elles recouvrent. On s’accorde généralement à considérer comme faisant partie des classes moyennes supérieures les personnes gagnant de 2 500 à 4 000 euros par mois. Cette tranche de la population bénéficie fort peu de la redistribution opérée par notre système de protection sociale, alors même qu’elle contribue largement à son financement. S’il est indispensable d’assainir nos finances publiques, les classes moyennes ne peuvent porter seules le poids du redressement.
En dépit d’un effort, indispensable, de maîtrise et d’une lutte renforcée contre la fraude, nos dépenses de protection sociale continuent d’augmenter de 3 % par an. Comment assumer cette augmentation sans diminuer les prestations servies ? Voilà le défi à relever.
M. le président Bernard Accoyer. Nous vous remercions, monsieur le président. Vous avez ouvert des perspectives intéressantes qui ne manqueront pas de nourrir nos échanges à venir.
*
Audition de M. Jacques Voisin, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), et M. Joseph Thouvenel, secrétaire général adjoint
M. Jacques Voisin, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). Pour nous, la compétitivité ne peut être appréciée que dans un marché libre et loyal. C’est la première condition dont il faut s’assurer. La CFTC, convaincue qu’aucun sujet n’est tabou et qu’il convient dans tous les champs du dialogue social de consolider la position des partenaires sociaux, a tenu à participer à la délibération économique lancée avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) sur le sujet. Les travaux en sont quasiment terminés.
La première priorité est la compétitivité de notre industrie. La part de l’industrie est passée de 26,5 % du produit intérieur brut en 1970 à 16 % aujourd’hui. Cela s’explique en partie par un défaut d’investissements productifs. Pour restaurer notre compétitivité, il faut sortir de la logique de court terme qui a conduit, au nom de la rentabilité immédiate, à privilégier les dividendes au détriment des investissements – de production, de recherche et d’innovation – et, partant, à détourner les profits de l’économie réelle. La part des revenus financiers dans les profits est ainsi passée de 15 % en 1993 à 27 % aujourd’hui.
M. Joseph Thouvenel, secrétaire général adjoint de la CFTC. Le coût du travail serait un facteur-clé, nous dit-on. Le problème demeure que, pour l’appréhender, on ne peut se fonder que sur des statistiques. Or, celles-ci sont parfois faussées, parfois même contradictoires, ce qui ne permet pas d’en tirer des conclusions univoques. Ainsi pour l’industrie manufacturière, selon les sources, le coût salarial horaire moyen en 2007 variait de 24,5 euros à 32,2 euros, soit une différence de 25 % ! De même, selon Eurostat, le taux apparent des cotisations patronales aurait augmenté de 0,4 point entre 1996 et 2004, alors que d’après les données de la comptabilité nationale, il aurait diminué de deux points sur la même période. Enfin, d’une manière générale, on ne dispose de statistiques que pour les entreprises de plus de dix salariés, alors que la taille de l’entreprise influe sur le niveau de rémunération des salariés et le niveau des aides dont peut bénéficier l’employeur. Comment, dans ce flou, se prononcer sur le coût du travail ? Qui croire ? Une difficulté de même nature se retrouve pour l’évaluation du temps de travail.
M. Jacques Voisin. Innover, valoriser le capital humain, tirer le meilleur profit de notre situation au niveau européen, dégager les moyens nécessaires au financement de la croissance, dynamiser notre tissu économique : telles sont les cinq priorités que nous retenons. Il faut rattraper notre retard et trouver un équilibre, délicat, entre stimulation de l’économie et rigueur budgétaire. Si la discipline budgétaire demeure indispensable, il l’est tout autant de s’engager sur des perspectives de long terme, susceptibles de rassurer, alors que la reprise économique est encore balbutiante. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons soutenu, en son temps, le grand emprunt.
On ne peut traiter de politique budgétaire sans traiter de fiscalité. La CFTC tient à réaffirmer la légitimité de l’impôt, s’il poursuit un objectif de justice. On entend trop souvent dire qu’il pèse sur la compétitivité. Vous trouverez dans le document que nous vous remettrons, nos propositions en ce domaine. L’impôt sur le revenu doit, selon nous, être l’un des principaux leviers fiscaux. S’agissant de la fiscalité des entreprises, plusieurs pistes méritent d’être examinées. Tout d’abord, des réductions d’impôt pour les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices dans des investissements productifs. Ensuite, le crédit d’impôt recherche. Enfin, l’intégration progressive des objectifs de croissance dans la stratégie de la Banque centrale européenne.
Il faut privilégier les dépenses d’avenir et investir massivement dans l’éducation, la formation, y compris l’apprentissage, la recherche et la recherche et développement, notamment dans le cadre des pôles de compétitivité, et poursuivre la modernisation de nos infrastructures.
M. Joseph Thouvenel. Venons-en à la compétitivité prix. Le coût du travail en France est à peu près le même qu’en Allemagne : il ne saurait donc expliquer la différence de compétitivité entre les deux pays. Celle-ci tient essentiellement à la compétitivité hors prix, avec les services liés au produit – service après-vente, accompagnement du client, maintenance, innovation, design, bon usage des nouvelles technologies… 58 % des entreprises françaises seulement ont un site internet contre 84 % des entreprises allemandes et 13 % seulement utilisent les nouvelles technologies dans leurs relations avec leurs clients. Depuis des années, nous avons cherché en France à tirer les prix vers le bas. Nos entreprises ont donc dégagé moins de marges et moins investi, d’où, in fine, une impossibilité de garantir la même qualité que leurs concurrentes allemandes.
Autre différence entre les deux pays : en France, les entreprises étranglent leurs sous-traitants, lesquels sont contraints de travailler le plus vite possible pour le moins cher possible. Ne peut qu’en résulter une baisse de la qualité. En Allemagne, au contraire, les petites et moyennes entreprises travaillent « en meute », se positionnant par exemple de concert à l’exportation. Les sous-traitants y sont considérés comme des partenaires. D’où les meilleurs résultats en matière de qualité et d’exportations.
M. Jacques Voisin. On entend trop souvent dire que le travail est un coût, une charge. Comment, dans ces conditions s’étonner, que certains salariés s’en désintéressent ou souhaitent partir le plus tôt possible en retraite ? Pour nous, le travail reste un élément essentiel de la performance de l’entreprise. Il faudrait se focaliser sur sa valeur ajoutée plutôt que sur son coût, valoriser les qualifications et les compétences, investir davantage dans la formation. C’est leur performance qui différencie les entreprises les unes des autres, et celle-ci est directement liée à la qualité du travail.
Il faudrait aussi renforcer les liens entre l’école et l’entreprise : chacune doit faire un pas vers l’autre. Les mentalités doivent évoluer sur le sujet. Qui pourrait nier qu’il existe un lien étroit entre diplôme et emploi ? La CFTC a toujours été favorable aux formations en alternance : il ne devrait pas y avoir de formation diplômante sans alternance. Il faut aussi poursuivre l’effort engagé en matière d’apprentissage. Tout cela participe de la revalorisation du travail que nous appelons de nos vœux.
On ne peut traiter de la question du coût du travail sans aborder celle de la redistribution. Nous vous remettrons nos propositions détaillées sur le sujet. Est-on bien conscient de la situation des classes moyennes aujourd’hui dans notre pays et de l’évolution de leur pouvoir d’achat ? Les revenus en 2007 ne représentent qu’une fois et demie ceux de 1983, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas progressé de plus de 1,2 %, alors que dans le même temps, le produit intérieur brut augmentait de 225 milliards à 1 894 milliards d’euros. Les richesses produites et la valeur ajoutée doivent être redistribuées de manière plus équitable, comme s’y est d’ailleurs engagé le Président de la République. Dès 2003 et la réforme des retraites intervenue cette année-là, la CFTC avait formulé le souhait d’une réflexion sur l’avenir du financement de notre protection sociale. Mais personne n’a vraiment voulu depuis lors ouvrir ce dossier. Le Président de la République de l’époque avait souhaité qu’on s’attelle au chantier de la valeur ajoutée et de l’assiette du financement de notre protection sociale. Cela n’a pas été fait. Même si la solution ne réside pas entièrement là, ces pistes restent à creuser.
Il faut aussi trouver les moyens d’endiguer la dégradation continue de l’emploi et la précarité croissante des salariés : il faut évaluer nos politiques de l’emploi, tout comme nos dispositifs d’aides et d’exonérations de charges.
M. Joseph Thouvenel. Les exonérations de charges au bénéfice des entreprises représentent au minimum 25 milliards d’euros par an. Il n’est pas normal que ces dispositifs ne fassent l’objet d’aucune évaluation et que l’on ne sache pas quelle part de ces aides a réellement contribué au maintien d’emplois et quelle part n’a conduit qu’à des effets d’aubaine. Il y a, en outre, fort à parier que les entreprises qui tirent le mieux profit du dispositif, c’est-à-dire les plus grandes d’entre elles, ne sont pas celles qui en auraient le plus besoin. Il y a là un gisement d’économies potentielles.
On ne peut pas, enfin, faire abstraction de l’environnement international. La France et l’Union européenne sont aujourd’hui les marchés les plus ouverts au monde. Comment songer à préserver notre compétitivité à l’avenir si nous abandonnons tous nos secteurs stratégiques à la Chine, qui dispose d’importantes réserves monétaires ? Ce sont les marchés qui ont dicté la reprise de Péchiney par le Nord-américain Alcan, sans qu’on se demande si n’étaient pas en jeu des secteurs stratégiques pour l’aéronautique et la défense, notamment pour Airbus.
Le niveau de l’euro également pose question. La monnaie européenne a été réévaluée de 30 % depuis 1999 et est vraisemblablement aujourd’hui surévaluée. Comment dans ces conditions s’étonner d’avoir perdu en compétitivité ?
Il faudrait, enfin, exiger une réciprocité pour ce qui est de l’ouverture des marchés. À défaut, les conditions d’une compétition libre et loyale ne sont pas réunies.
M. Jacques Voisin. La CFTC considère que l’Union européenne constitue l’échelon le plus pertinent de pilotage de la sphère économique et sociale. Celle-ci doit s’efforcer de faire converger les économies des différents pays membres, ainsi que leurs règles fiscales, comptables et sociales. De manière plus générale, la CFTC porte un projet de traçabilité sociale qui pourrait répondre aux distorsions de concurrence.
M. Joseph Thouvenel. Les coûts d’une entreprise qui respecte les droits fondamentaux des salariés sont nécessairement supérieurs à ceux d’une entreprise qui les enfreint. Or, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) interdit aujourd’hui les clauses sociales : il n’est pas possible par exemple de refuser les importations en provenance de pays qui font encore travailler les enfants. Nous proposons, pour notre part, d’informer le consommateur sur ces aspects, alors qu’il ne peut aujourd’hui arbitrer qu’entre les prix et la qualité.
Il faudrait instituer un label, simple, compréhensible par tous, permettant de s’assurer du respect de quelques grands principes : interdiction du travail des enfants et du travail forcé, niveau décent des salaires et existence d’une protection sociale minimale – selon le niveau de vie du pays –, liberté syndicale. Une telle labellisation serait favorable à notre économie et nos emplois, mais aussi au développement social dans l’ensemble du monde. Le Maroc par exemple, qui a essayé de créer un embryon de protection sociale et institué un salaire minimal, y serait très favorable. Dix centimes d’euros sur le prix d’un tee-shirt, ce n’est rien pour le consommateur, mais cela fait toute la différence entre la production au Maroc ou en Chine. Lorsque les quotas d’importation ont été supprimés dans le secteur textile, tous les efforts marocains se sont trouvé réduits à néant. Une réponse à la mondialisation passe par l’information des consommateurs.
Nous n’avons bien sûr rien contre la « marque France » mais il sera difficile de la faire porter par nos amis allemands, espagnols, italiens ou québécois, alors qu’un projet de traçabilité sociale pourrait être soutenu par tous les pays développés, car il est un moyen de progrès social, poussant par exemple à l’éradication du travail des enfants et du travail forcé. Si les consommateurs ne pèsent pas sur la mondialisation, quoi qu’on fasse pour gagner en compétitivité, cela ne sera jamais assez face à des pays où le travail n’est quasiment pas rémunéré.
M. Jacques Voisin. La CFTC souhaiterait que soit créé dans notre pays un véritable conseil du dialogue social. La qualité du dialogue social, que l’on envie parfois à l’Allemagne ou aux pays d’Europe du Nord, constitue, en effet, un facteur de compétitivité. Nous avons souhaité inscrire la question de l’avenir de notre protection sociale et de son financement dans l’agenda social ouvert avec le mouvement des entreprises de France, estimant que les partenaires sociaux devaient s’en saisir sans tabou.
Sur la question récurrente de la durée du travail, nous ne nous sommes pas montrés rigides, nous efforçant plutôt de rechercher des solutions adaptées à chaque situation. L’abaissement de la durée du travail, nous dit-on, pèse sur la compétitivité de nos entreprises. Là encore, il faudrait savoir exactement de quoi on parle. Pour ma part, j’ai beaucoup apprécié l’intervention du Président de la République devant le Conseil économique, social et environnemental sur le sujet, où il a affirmé que le plus important était de « regarder le travail autrement » et de « repenser la qualité du travail ». Travailler autrement, c’est penser une meilleure organisation du travail, améliorer sa qualité, permettre de mieux concilier les différents temps de la vie. Autant de sujets que nous souhaitons voir mis en avant et sur lesquels nous sommes prêts à dialoguer.
D’une manière générale, nous souhaiterions que l’on porte un autre regard sur l’entreprise. Pour nous, la finalité d’une entreprise repose d’abord dans son projet social et les profits ne constituent qu’un levier au service de ce projet. Dans cette optique, les salariés doivent être mieux associés aux résultats et à la gestion des entreprises : il faut renforcer la participation et l’intéressement, les deux grands mécanismes d’association des salariés à la performance des entreprises. Bref, il faut repenser la gouvernance économique et sociale des entreprises. Vous trouverez nos propositions sur le sujet dans le document que nous vous remettrons.
M. Joseph Thouvenel. Peut-être vous étonnera-t-il que sur les deux thèmes de votre mission d’information, nous n’ayons parlé quasiment que de compétitivité. C’est tout simplement que sans entreprises en bonne santé, notre protection sociale, qui elle-même en retour aide au développement des entreprises, ne pourrait être financée. La priorité reste donc bien d’assurer le meilleur fonctionnement possible de notre économie.
Enfin, gardons-nous de certaines idées reçues, hélas assez répandues. Un rapport sénatorial vantait ainsi il y a quelques années la réussite d’un pays où les charges salariales et les prélèvements sociaux étaient faibles, la flexibilité maximale, les contraintes quant à la durée légale du travail minimales, les licenciements faciles, le taux de l’impôt sur les sociétés très bas. Quel était ce magnifique pays donné en exemple ? L’Irlande, aujourd’hui en faillite.
M. Olivier Carré. Je pense comme vous que ses salariés constituent la première richesse d’une entreprise. Mais les enquêtes montrent qu’en France, les salariés entretiennent une relation avec leur entreprise différente de ce qu’elle est dans d’autres pays. Ils y sont à la fois très attachés – cet attachement s’est d’ailleurs renforcé durant la crise, comme le montrent certaines enquêtes – et doutent d’elle, certaines dérives financières ayant accentué ces doutes. Finalement, leurs rapports à l’entreprise sont assez conflictuels. Comment pourrait-on les pacifier ?
Vous avez souligné la difficulté d’obtenir la réciprocité dans les échanges commerciaux et évoqué le projet d’une traçabilité sociale. Les normes sur l’investissement socialement responsable (IRS) progressent à l’échelle mondiale. Comment les grandes entreprises en tiennent-elles compte ? Comment voient-elles l’évolution des processus de production à travers le monde ? Nous sommes concernés au premier chef car nous faisons partie des premiers producteurs au monde de valeur ajoutée, mais celle-ci est menacée. Pourrait-on, à votre avis, s’appuyer sur ces normes ?
Enfin, ne pensez-vous pas qu’il serait normal que les salariés soient représentés dans les comités de rémunération des grands groupes, à l’heure où l’écart entre les rémunérations les plus élevées et les plus faibles se creuse ?
M. Marc Goua. La prétendue surévaluation de l’euro est un faux problème. L’exemple de l’Allemagne le montre tous les jours, sans compter que l’essentiel de nos échanges commerciaux se font au sein de la zone euro. En outre, un euro faible renchérirait le coût de nos importations d’énergie et de matières premières.
Le label Fabriqué en France constitue l’exemple-type de la fausse bonne idée. Il peut très rapidement conduire à l’asphyxie de nos entreprises, comme j’ai pu le constater dans le secteur de la confection ou bien encore de l’ardoise, puisque dans ma commune on extrait encore du schiste. Les concurrents se sont très vite alignés sur la norme du made in France et cela n’a fait qu’accélérer les destructions d’activités.
M. Joseph Thouvenel. Sur la question, centrale, des relations conflictuelles entre les salariés et leur entreprise, je tiens à dire qu’à nos yeux, le mouvement marxiste aujourd’hui le plus puissant en France n’est autre que le mouvement des entreprises de France, du moins au niveau national, où il en est toujours, au quotidien, à la lutte des classes. J’en veux pour preuve son attitude lors des négociations sur la pénibilité.
Durant deux ans, les syndicats se sont efforcés de faire valoir que la pénibilité avérée de certains métiers use prématurément ceux qui les exercent, lesquels devraient donc se voir reconnu le droit de partir en retraite plus tôt. Le mouvement des entreprises de France a systématiquement objecté, cherchant à couper cour au débat, que la pénibilité était ressentie différemment par chacun et qu’on ne disposait pas, de toute façon, de statistiques sur le sujet. Une attitude responsable aurait été de coopérer à l’élaboration d’une définition, acceptable par tous, de la pénibilité, et d’examiner concrètement avec les syndicats le coût du départ en retraite anticipée des salariés ayant exercé des métiers pénibles. Voilà qui aurait été la marque de relations sociales adultes qui nous font tant défaut en France.
Or un malaise grandissant est perceptible dans les entreprises. Une enquête menée auprès de nos délégués syndicaux en région parisienne a confirmé que l’écart des rémunérations entre dirigeants et salariés ne cessait de se creuser. Tous nous ont dit que cela leur semblait profondément injuste car ce sont les salariés qui supportent les plus gros efforts. Une telle remontée, aussi massive, du terrain, ne peut qu’inquiéter.
Cela étant, tout n’est pas négatif avec le mouvement des entreprises de France. D’une part, il est en général plus facile de discuter avec ses représentants au niveau local ou au niveau des branches qu’au niveau national. D’autre part, certains sujets sont l’occasion d’un véritable échange entre partenaires sociaux. Cela a été le cas de la délibération sur la politique économique et la compétitivité. Les organisations syndicales peuvent elles aussi porter leur part de responsabilité dans le blocage du dialogue social lorsque, privilégiant la posture, elles en arrivent à un déni de réalité. Mais d’une façon générale, l’attitude du mouvement des entreprises de France est handicapante.
M. Jacques Voisin. Sur tous ces points, rappelons-nous comment ont été traités les salariés de Continental à Compiègne.
Pour un dialogue social de qualité dans l’entreprise, il faut une transparence totale. Si une entreprise risque de rencontrer des difficultés, les salariés doivent en être informés. Ils peuvent l’entendre. Hélas, aujourd’hui, on le leur cache.
Au nom du même souci de transparence, il serait normal que les salariés soient représentés – pourquoi pas par le secrétaire du comité d’entreprise– au comité des rémunérations. Pour que puissent s’engager un dialogue et des négociations de bonne foi, il faut d’une part que la transparence soit garantie et, d’autre part, que les salariés soient considérés comme de véritables acteurs de l’entreprise, associés à son projet et à sa gestion.
M. Joseph Thouvenel. Les normes sur l’investissement socialement responsable vont dans le bon sens. Attention toutefois à ne pas créer d’usine à gaz ! L’instabilité juridique nuit considérablement à notre compétitivité. L’inflation des normes tue les normes. Si le dispositif est trop complexe, il est inefficace, incitant aux déclarations d’intention davantage qu’à des actions concrètes. Visons avant tout le pragmatisme.
Pour ce qui est du niveau de l’euro, je suis en désaccord total avec la position exprimée par M. Marc Goua. La France, qui a bâti sa compétitivité sur les prix les plus bas, se trouve très affectée par la surévaluation de la monnaie européenne, alors que l’Allemagne, qui a bâti la sienne sur le hors-prix, y échappe. Les entreprises allemandes peuvent vendre un produit cher car lui sont associés le service après-vente, l’accompagnement du client, la maintenance, le design, la qualité… Nous ne pouvons pas nous battre sur le même terrain.
Nous ne sommes pas du tout favorables au label Fabriqué en France, trop limitatif et qui enferme. Ce que nous proposons est beaucoup plus large.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. L’Allemagne a aussi gagné en compétitivité par le blocage des salaires, au risque d’ailleurs d’une aggravation des inégalités. Les mesures prises par le chancelier Gerhard Schröder ont été extrêmement dures pour les salariés.
M. Joseph Thouvenel. Les écarts ont varié dans le temps mais aujourd’hui le coût du travail est quasiment le même en Allemagne et en France. Et de fortes revendications salariales se font aujourd’hui jour outre-Rhin. Force est aussi de dire que l’engagement des entreprises à ne pas licencier y était une contrepartie de la rigueur salariale. Nous n’avons jamais pu obtenir une telle contrepartie en France.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Le Parlement va bientôt examiner dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale la mesure consistant à verser une prime aux salariés des entreprises de plus de cinquante salariés servant à leurs actionnaires des dividendes en hausse par rapport à la moyenne des deux années précédentes. Ces conditions font que peu de salariés en fin de compte en bénéficieront. Quelles sont les attentes dans les entreprises et comment pensez-vous qu’on pourrait y répondre ?
M. Jacques Voisin. Lorsque le Président de la République avait ouvert le débat sur la répartition de la valeur ajoutée, nous avions demandé que ce sujet figure dans l’agenda social. Son examen a été sans cesse reporté, si bien que le Président de la République a fini par décider unilatéralement qu’une prime devrait être versée. Nous sommes totalement d’accord sur le principe, moins sur les modalités puisque seuls quatre millions de salariés devraient en bénéficier, ce qui n’est pas acceptable. Il faut rouvrir sans délai avec le mouvement des entreprises de France le chantier de la participation et de l’intéressement – ce dernier étant accessible aux entreprises de moins de cinquante salariés et aux entreprises artisanales.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Le président Accoyer ayant dû nous quitter avant la fin de votre audition, c’est à moi que revient l’honneur de vous remercier, messieurs. C’est avec grand intérêt que nous examinerons plus en détail vos propositions.
*
AUDITIONS DU 1ER JUIN 2011
Audition de M. Nasser Mansouri-Guilani, responsable confédéral des questions économiques de la Confédération générale du travail (CGT)
M. Nasser Mansouri-Guilani, responsable confédéral des questions économiques de la Confédération générale du travail (CGT). M. Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, et moi-même vous remercions pour votre invitation.
Le débat sur la compétitivité est d’emblée inscrit dans une perspective de compétition, autrement dit, de mise en concurrence des systèmes socioproductifs, donc des travailleurs. Or pour nous syndicalistes, cette approche n’est pas pertinente : nous pensons que la France aurait intérêt à envisager, non un pacte de compétitivité, mais un pacte pour la solidarité.
Certes, nous n’ignorons pas les réalités de ce monde, en particulier l’intégration de notre pays dans un processus européen et une économie mondialisée. Mais ne pourrait-on voir comment, à partir des expériences du passé, travailler sur une autre problématique ? En effet, l’objectif européen ne pourrait-il pas être de faire de l’économie européenne, non pas la plus compétitive du monde – comme l’a voulu la stratégie de Lisbonne, qui s’est révélée un échec –, mais l’économie la plus solidaire du monde ?
L’approche de la CGT n’est pas seulement microéconomique, liée à l’amélioration de la compétitivité des entreprises ; elle est aussi macroéconomique, par une réflexion sur les moyens d’améliorer l’efficacité globale de notre système productif.
À cet égard, il conviendrait selon nous de travailler sur trois éléments importants.
Le premier est ce que nous appelons « la productivité globale des facteurs ». Dans le débat sur la compétitivité, on insiste beaucoup sur la productivité du travail. Or il faudrait, selon nous, s’interroger également sur la productivité du capital, puisqu’il fait aussi partie du processus productif. La productivité globale des facteurs nous amène à nous interroger sur la capacité du système à produire, avec un minimum de ressources et de pressions sur le monde du travail, un maximum de richesses, tout en respectant l’environnement. Le deuxième élément de réflexion a trait aux prélèvements sur les facteurs de production, y compris sur le facteur capital. Le troisième élément est lié au financement au sens large, notamment au rôle du système bancaire. Dans le cadre de notre débat, d’autres éléments sont souvent avancés. D’abord, le problème de compétitivité de la France est souvent présenté comme celui de notre commerce extérieur. Nous n’acceptons pas cette approche mercantiliste, le solde excédentaire de notre balance commerciale ne pouvant pas être un objectif en lui-même. D’ailleurs, la « bonne performance » de l’Allemagne s’explique surtout par des éléments structurels et non par le seul compromis salarial des années 2000. En effet, non seulement sa modération salariale sévère a provoqué des reculs sociaux importants et des effets négatifs sur la demande intérieure, d’où l’ampleur de la récession dans ce pays, mais il a relevé d’une approche non coopérative dans l’espace européen.
On insiste dans le débat sur la nécessité de l’amélioration de la compétitivité-prix de nos exportations. Or, l’expérience française est éclairante de ce point de vue. Dans les années 1980, la politique de désinflation compétitive a été présentée comme la solution au déficit de notre commerce extérieur. Certes à l’époque, elle a permis à la France d’enregistrer un solde excédentaire, mais celui-ci n’a pu être consolidé dans la mesure où il n’était pas assis sur une base productive solide, comme la CGT l’avait expliqué. De ce fait, notre pays s’est retrouvé confronté dans les années 1990 à 2000 à des pertes importantes d’emplois et de compétences dans l’industrie, c’est-à-dire à une désindustrialisation. Pourtant, on nous propose encore de poursuivre cette politique de désinflation compétitive.
D’ailleurs, la pertinence de l’approche mercantiliste trouve une autre limite lorsque nous regardons à quoi sert l’excédent du commerce extérieur. Or, en France, il a été partiellement utilisé pour financer les sorties de capitaux. Enfin, dans le débat, une liaison est opérée entre l’amélioration de la compétitivité et le financement de la protection sociale. De ce point de vue, nous sommes totalement opposés à la « TVA sociale » car, en aggravant le problème du pouvoir d’achat, elle ne permettra pas de résoudre le problème de compétitivité et sera même contre-productive.
En conclusion, l’amélioration de l’efficacité globale du système productif est un impératif. Elle nécessite de renforcer nos capacités humaines, en termes de qualification et de formation des travailleurs, mais aussi les droits sociaux afin que les salariés puissent intervenir dans les choix stratégiques des entreprises.
Afin de faciliter l’accès au crédit bancaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises, nous proposons la création d’un pôle financier public.
Nous pensons en outre indispensable d’intensifier l’effort en matière de recherche et développement.
Enfin, la question des relations entre les donneurs d’ordre et les entreprises sous-traitantes doit être traitée, en particulier, au regard des droits des salariés des secondes, qui devraient avoir le même niveau d’information, donc de consultation, que ceux des premiers.
M. Jean-Claude Sandrier, président. Vous préconisez un pacte pour la solidarité plutôt qu’un pacte de compétitivité. Évacuez-vous la concurrence, dont on peut penser qu’elle est bénéfique, ou voulez-vous la réguler et de quelle manière, sachant que très peu de pays sont prêts à un revirement politique ?
Un prélèvement trop lourd sur le capital entraînerait une fuite des capitaux et une sous-capitalisation des entreprises. À l’inverse, un moindre prélèvement permettrait-il d’améliorer l’investissement dans les entreprises et dans l’économie réelle ?
M. Nasser Mansouri-Guilani. Nous n’ignorons pas les réalités de ce monde mais le postulat libéral selon lequel la concurrence est bénéfique à tout le monde est discutable.
La politique doit mettre en place des mécanismes pour contrer la problématique de mise en concurrence des travailleurs. Le législateur devrait instaurer des droits garantissant aux travailleurs la possibilité d’intervenir dans les choix stratégiques des entreprises, afin de promouvoir la coopération et la solidarité.
Nous sommes dans une économie mondialisée et, dans le cadre des comités de groupes européens et mondiaux, on pourrait développer les droits des salariés et de leurs représentants, de telle sorte que la stratégie de ces groupes ne soit pas assise sur la mise en concurrence des travailleurs dans les différents pays. Cette démarche permettrait d’aboutir à des schémas plus coopératifs.
Nous sommes également dans un contexte de globalisation financière. Certes, des mesures d’harmonisation, de coordination et de régulation aux niveaux européen et international s’imposent, mais cette nécessité n’interdit pas des mesures au niveau national. Or, au nom de la mondialisation et de la construction de l’Europe, de tels choix ne sont même pas envisagés.
L’hypothèse selon laquelle la réduction des prélèvements sur le capital entraînera une augmentation de l’investissement est discutable. En France, la réduction des prélèvements sur le capital depuis plusieurs années n’a pas entraîné une hausse notable du taux d’investissement des entreprises.
M. Pierre Morange, rapporteur suppléant. En tant que représentant d’une puissante centrale syndicale, vous nous faites part de la nécessité de prendre en compte la productivité globale. Il est incontestable que votre itinéraire personnel en tant que chef de service dans une grande banque centrale, puis économiste et enseignant, vous a confronté à la réalité du monde économique.
Cette réalité est que le marché mondialisé se traduit par un dumping fiscal et social qui est à la source des différentiels de compétitivité et de nombreux phénomènes de désindustrialisation. Parallèlement, la préservation de notre système de protection sociale, qui est une volonté partagée, nécessite une juste répartition des prélèvements et des dépenses entre chacun des membres d’une communauté nationale.
Le niveau européen pourrait être le plus pertinent. Le traité de Lisbonne avait d’ailleurs clairement fait référence à l’établissement de principes de flexisécurité permettant de concilier non seulement la flexibilité nécessaire à toute structure économique et financière dans le cadre de la compétition internationale, mais aussi la sécurité des travailleurs.
Comment expliquez-vous vos réserves concernant la « TVA sociale » ?
Que pensez-vous de la contribution sociale généralisée comme élément de financement de notre protection sociale ?
Enfin, quelle est votre réflexion sur notre système assurantiel de type bismarckien, sachant que le lien devient de plus en plus ténu entre le produit du travail et les prestations sociales ?
M. Nasser Mansouri-Guilani. La CGT n’est pas favorable à la flexisécurité. Nous pensons qu’il faudrait plutôt établir ce que nous appelons une « sécurité sociale professionnelle ». Il est nécessaire, non pas de jouer le rôle de « pompier social », mais d’assurer à chaque individu un droit à un emploi ou, à défaut, à une formation qualifiante lui permettant d’accéder à un emploi.
M. Pierre Morange, rapporteur suppléant. Dans le cadre de la mission d’information qui vous avait auditionné, j’avais fait évoluer l’idée de flexisécurité vers la notion d’assurance professionnelle.
M. Nasser Mansouri-Guilani. Pour nous, le travail est le facteur structurant de la vie sociale. Si l’on parvenait à résoudre le problème d’accès au travail pour l’ensemble des individus, on pourrait régler celui du financement de la protection sociale.
Dans les années 1990 et 2000, le taux de croissance moyen de la France a été divisé par 2 à 2,5. Face à ce problème d’affaiblissement de croissance potentielle, il convient de mettre en œuvre un nouveau mode de développement économique qui ne fasse pas du social un facteur d’ajustement comme cela a été alors le cas et comme on nous propose à nouveau de le faire jouer dans le cadre de ce débat sur la compétitivité. D’ailleurs, le « pacte euro plus » reviendrait à imposer encore plus de sacrifices aux travailleurs, notamment à ceux des pays du Sud de l’Europe.
Une croissance potentielle plus forte permettrait de dégager des ressources supplémentaires, mais aussi de réduire ce que nous appelons « les dépenses d’entretien de la crise ». C’est par cette voie que l’on réglera le problème et non par un recours à la fiscalité, dans la mesure où se poserait également le problème du manque de ressources. Cela reviendrait en outre à étatiser la protection sociale : il n’y aurait alors plus de place pour la gouvernance du système par les travailleurs et leurs représentants.
M. Éric Woerth. Si vous étiez au gouvernement, quelles décisions prendriez-vous pour améliorer la compétitivité structurelle de l’économie française ?
M. Nasser Mansouri-Guilani. Le financement de notre économie est un problème crucial. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, peinent à accéder au crédit bancaire. Notre système bancaire ne finance pas suffisamment l’investissement productif au sens large, y compris en termes de recherche et développement, de qualification des travailleurs, etc. C’est pourquoi nous suggérons que l’on crée, par la mise en réseau des établissements financiers, un pôle financier public qui permettrait à la puissance publique de disposer d’un pouvoir d’intervention. Il s’agirait, par exemple, de profiter du potentiel d’entités comme la Banque de France, la Banque postale, la Caisse des dépôts et consignations, OSÉO, etc.
Nous préconisons également l’instauration d’un système de bonification des crédits bancaires grâce, par exemple, à la création de fonds régionaux.
Ensuite, comme l’a montré la Cour des comptes, les aides accordées aux entreprises au nom de l’emploi et de l’investissement représentent des sommes importantes, plusieurs dizaines de milliards d’euros. Le crédit impôt recherche, par exemple, coûte des milliards d’euros au budget de l’État, mais n’est pas suffisamment performant : il ne bénéficie pas nécessairement à l’industrie, ni aux petites et moyennes entreprises. Nous suggérons donc un meilleur usage de ces aides. Pour ce faire, nous pensons que les représentants des salariés, mais aussi les élus devraient avoir le droit, en amont, de définir les critères d’attribution et, en aval, de décider de la façon dont elles sont utilisées.
M. Gérard Cherpion. La compétitivité est liée aux charges prélevées sur les entreprises.
Faut-il revoir les éléments de calcul de ces charges ? Celles qui sont liées à la politique familiale doivent-elles être prélevées sur les entreprises ou d’une autre manière ?
M. Nasser Mansouri-Guilani. Il y a le discours et la réalité.
La contribution des employeurs à la sécurité sociale a diminué. Les prélèvements sur la part salariale ont, eux, augmenté. Autrement dit, les exonérations accordées aux employeurs ces dernières années n’ont pas réglé le problème de la compétitivité.
Preuve est faite que le problème structurel de la compétitivité n’est pas lié à la notion de charges sociales sur les entreprises.
Je le redis : le problème n’est pas seulement microéconomique, il est aussi macroéconomique. L’ensemble des politiques devrait permettre d’améliorer l’efficacité globale de notre système productif, par exemple, en établissant des liens entre l’industrie et le système financier.
M. Jean-Claude Sandrier, président. Je vous remercie.
*
Audition de Mme Véronique Descacq, secrétaire nationale en charge des dossiers de la politique de protection sociale et de la politique économique de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral
Mme Véronique Descacq, secrétaire nationale en charge des dossiers de la politique de protection sociale et de la politique économique de la CFDT. Ma présentation tient en cinq points principaux.
En premier lieu, le défaut de compétitivité de l’industrie française n’est pas essentiellement lié aux éléments de coût – salariaux ou de protection sociale – mais aux éléments hors coûts constitués par le manque de recherche ou d’innovation, de qualification, d’organisation et d’orientation des filières.
Pour autant, la question du coût du travail se pose dans certains cas : lorsqu’il n’existe pas de salaire minimum chez nos concurrents, allemands notamment ; dans des filières industrielles ou de services où l’offre n’est pas encore solvabilisée, comme dans les start-up, les nouvelles technologies ou les services à la personne ; ou s’agissant de la rémunération des salariés sans qualification ou à faible niveau de qualification.
Pour la CFDT, les allègements de coût du travail devraient être plus ciblés, et conditionnés à certaines exigences, et répondre à des objectifs de formation et de qualification, de pouvoir d’achat et d’emploi à temps plein notamment.
En deuxième lieu, il existe déjà de nombreux dispositifs d’allègements du coût du travail, désordonnés et jamais ou rarement évalués. Il s’agit en particulier des exonérations « Fillon », de la défiscalisation des heures supplémentaires et des dispositifs de défiscalisation pour les services d’aide à la personne. Il est difficile d’en mesurer l’efficacité réelle tant sur la compétitivité que sur l’emploi et le pouvoir d’achat.
La CFDT estime qu’il faudrait mettre un terme à cet empilement désordonné, évaluer ce qui donne des résultats, ce qui suscite des effets d’aubaine, et étudier les effets pervers de certains dispositifs, en particulier les trappes à bas salaire, ou la désincitation à l’embauche à temps plein.
En troisième lieu, mieux partager les revenus et améliorer l’efficacité de la protection sociale sont non seulement des impératifs de justice et de cohésion sociales, mais aussi d’efficacité économique. Il convient, d’une part, de promouvoir une économie de la connaissance, de la haute technologie, du développement durable et, d’autre part, de solvabiliser les emplois de service. Une telle conversion passe par une amélioration du niveau de vie, laquelle exige une meilleure protection sociale.
Il faut sortir de la mécanique duale, qui, d’un côté, maintient les minima sociaux, et, de l’autre, permet aux hauts revenus de capter une grande partie de la valeur ajoutée dans certains secteurs. Il résulte de cette distorsion que l’essentiel du coût de la charge du financement de la protection sociale, comme d’ailleurs de la fiscalité, pèse sur les classes moyennes. Cette situation porte en germe un sentiment de rejet vis-à-vis de la protection sociale, dont le caractère universel est mis en doute. Il faut donc revoir ce financement dans le sens d’une plus grande équité et d’une plus grande progressivité des prélèvements.
En quatrième lieu, on ne peut pas disjoindre la question du financement de celle des garanties offertes par la protection sociale. Les besoins de celle-ci risquent de croître, quels que soient les efforts mis en œuvre pour maîtriser les coûts, en matière de santé du fait du vieillissement de la population. Il faut dès lors repenser le niveau et le contenu des garanties : veut-on notamment maintenir des garanties très contributives ou au contraire les réduire au profit d’une plus grande solidarité ?
Face à ces défis, il faut réfléchir au financement. Les financements ne doivent pas brider la croissance, remettre en cause la cohésion sociale et traiter le problème de la dette.
On pourrait transférer une partie des cotisations vers la contribution sociale généralisée (CSG) en ce qui concerne la santé et la famille, sachant que des contreparties doivent être prévues. Ainsi, le transfert total des cotisations de santé vers la CSG ne peut se faire que si on règle avec les employeurs la question de la pénibilité du travail. De même, s’agissant de la famille, ce transfert doit s’accompagner d’une réflexion sur l’organisation du travail, notamment sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et le droit de garde : une entreprise choisissant par exemple d’avoir des horaires décalés pourrait être responsabilisée compte tenu des modes de garde qui en découlent.
La fusion entre la CSG et l’impôt sur le revenu présente des avantages, mais nous sommes opposés à une réforme qui ferait disparaître la sanctuarisation du financement de la protection sociale. Si cette fusion devait avoir lieu, il faudrait conserver deux mécanismes suffisamment différents pour garder la maîtrise des ressources de la protection sociale.
Nous sommes par ailleurs contre l’instauration d’une « TVA sociale ». D’abord, parce que nous doutons de son efficacité économique – cette mesure ne marche qu’une fois et offrirait des marges de manœuvre limitées par rapport à nos principaux concurrents. De plus, elle pénalise les personnes ayant les revenus les plus faibles, qui consomment la totalité de ceux-ci.
Nous sommes en revanche favorables à une réforme globale de la fiscalité qui se traduirait par une suppression du quotient conjugal et une forfaitisation du quotient familial – préalables indispensables à une refonte des tranches d’imposition de l’impôt sur le revenu –, une progressivité plus grande de ces tranches, et une révision de la fiscalité de l’épargne, tendant à supprimer les prélèvements libératoires et à encourager une épargne longue.
M. Jean-Claude Sandrier, président. Est-il possible d’inverser la tendance à la désindustrialisation de notre pays – laquelle a une incidence évidente sur notre compétitivité ? Le pacte de compétitivité européen peut-il concourir à améliorer la compétitivité de l’économie française ?
Vous avez déploré que les classes moyennes soient largement mises à contribution pour le financement de la protection sociale – ce qui est vrai ; or, vous souhaitez renforcer la part de la CSG, qui concerne l’ensemble des classes sociales et sort le financement de la protection sociale du lieu de la création de richesse, c’est-à-dire des entreprises : n’est-ce pas contradictoire ?
M. Hervé Novelli. Depuis la Libération, le financement de la protection sociale repose sur les cotisations portant sur les revenus du travail. Cela était justifié à l’époque par le fait que l’essentiel des besoins de protection sociale concernait les salariés. Il en a découlé une gestion paritaire des organismes de sécurité sociale entre le patronat et les salariés. Or, depuis quelques années, notamment avec la création de la CSG, la part des cotisations sur les salaires dans le financement de la protection sociale diminue au point d’en représenter 70 % environ, au lieu de la totalité initialement.
Si l’on renonce à l’assiette salariale, il faudra remettre en cause le paritarisme, qui n’aurait dès lors plus de raison d’être. Envisageriez-vous dans ce cas de ne plus participer à la gestion des caisses ?
Quant au transfert des cotisations vers la contribution sociale généralisée ou la taxe sur la valeur ajoutée, il demande au préalable de faire la distinction entre les dépenses assurantielles et les dépenses de solidarité, ce qui n’a pas été fait. Une telle réforme implique un changement complet de philosophie et de régime.
Mme Véronique Descacq. On peut préserver une industrie en France, à condition de faire le contraire de ce qu’on a fait jusqu’à présent.
En soutenant un travail rémunéré au salaire minimum ou proche de celui-ci, les entreprises ont été encouragées à ne pas assez payer et former leurs salariés. Ce faisant, on a tiré l’industrie vers le bas, même si le manque d’organisation des filières industrielles et d’investissement dans la recherche et l’innovation a également joué un rôle. Il faut régler ce problème de manière coordonnée avec nos partenaires européens, en particulier s’agissant de l’organisation des filières industrielles.
Il convient par ailleurs de mettre fin au dogme selon lequel la compétitivité est exclusivement liée au coût du travail. En opérant des allègements généraux, non ciblés – sans considérer les filières ni la concurrence des autres pays –, un mécanisme infernal de bas salaires et de faibles qualifications a été enclenché et a empêché notre économie de s’adapter aux exigences de compétitivité.
Le pacte de compétitivité européen a le défaut de trop se focaliser sur la question du coût du travail. Ce n’est pas ainsi que nous serons en mesure de battre les pays émergents dans la compétition internationale.
S’agissant de la protection sociale, nous souhaitons bien distinguer ce qui relève du volet contributif et ce qui relève de la solidarité. Ce travail préalable est effectivement nécessaire. Il est hors de question de transférer vers la contribution sociale généralisée des cotisations servant à financer des revenus de remplacement, comme l’assurance chômage ou la retraite. Si les politiques familiales relèvent en grande partie de la solidarité, ce n’est pas toujours le cas. Le Haut conseil de la famille a engagé un travail intéressant sur ce point : il faut examiner avec plus de finesse l’architecture d’ensemble de ces politiques. Il convient de différencier les risques et, pour chacun d’eux, distinguer ce qui peut être transféré vers les dépenses de solidarité et ce qui doit rester de la responsabilité des employeurs.
M. Hervé Novelli a rappelé que tous nos régimes de protection sociale sont issus du travail : au cours de l’histoire, des compromis entre les salariés et les employeurs ont conduit à considérer qu’il fallait sécuriser les parcours de vie des premiers – et ce, bien avant le Conseil national de la Résistance –, les uns et les autres y trouvant un intérêt. Les allocations familiales trouvent notamment leur source dans le souhait du patronat de limiter des revendications salariales généralisées. On ne peut donc dissocier financement de la protection sociale et travail. Mais, depuis le XIXe siècle et la Libération, de nouveaux risques et de nouvelles niches de pauvreté sont apparus, engendrant de nouveaux besoins de solidarité. Ceux-ci exigent effectivement de nouveaux modes de financement et de nouvelles ressources, qui ne peuvent reposer seulement sur les revenus du travail. Le débat sur la dépendance en est un exemple. Nous souhaitons d’ailleurs que l’on recoure à un financement plus universel en la matière.
Le paritarisme doit être conservé parce que le lien entre le travail et le financement de la protection sociale demeure, soit en raison de la persistance de régimes essentiellement ou partiellement contributifs, soit du fait de notre légitimité à représenter les salariés en tant que bénéficiaires des prestations. D’ailleurs, le paritarisme a largement évolué depuis la création de la contribution sociale généralisée.
Se pose aussi la question, trop négligée, de la sécurisation des parcours professionnels, laquelle suppose par définition un haut niveau de protection sociale.
M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral chargé de la fiscalité et du financement de la protection sociale de la CFDT. Le différentiel de coût horaire du travail entre la France et l’Allemagne n’est pas dû à une dérive de notre pays mais aux réformes entreprises outre-Rhin pour réduire ce coût et dont a pâti l’ensemble des autres pays européens.
Mais en termes de coût par unité produite, la France est beaucoup mieux placée que des pays comme l’Espagne, l’Italie ou le Royaume-Uni.
Le rapport de la Cour des comptes sur les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne a montré qu la France a, pendant plusieurs décennies, pu pallier les faiblesses de notre industrie par des mesures extérieures au coût du travail, telles que la dévaluation. Avec la mise en place de l’euro, nous ne pouvons plus y recourir.
Parallèlement, le rapport du Coe-Rexecode publié au début de l’année, sur la divergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne, souligne qu’au-delà du coût du travail, la compétitivité de notre économie tient à d’autres facteurs, concernant en particulier à l’organisation de notre industrie.
Lorsque je travaillais au ministère de l’industrie, voici trente-cinq ans, on invoquait déjà à peu près les mêmes facteurs, à savoir l’insuffisance de montée en gamme, de recherche, d’innovation et de formation notamment. À cet égard, l’instauration d’une « TVA sociale » n’améliorerait que ponctuellement le coût du travail, mais ne résoudrait pas les problèmes de fond.
Mme Véronique Descacq. Dans un document, qui devrait être publié très prochainement, portant sur la compétitivité, le coût du travail et le financement de la protection sociale, les partenaires sociaux – MEDEF, CFDT, CGC et CFTC – se sont accordés à dire que d’autres facteurs que le coût du travail devaient être pris en compte.
M. Pierre Morange, rapporteur suppléant. Nous sommes heureux – bien qu’étonnés – de ce consensus en forme d’« union sacrée » entre le MEDEF et les centrales syndicales et avons hâte de lire ce document.
Dans quelle mesure la réglementation du travail en France explique-t-elle le différentiel de compétitivité avec l’Allemagne ? Qu’en est-il en particulier des dispositifs de sécurisation des parcours professionnels, de la formation initiale et continue, qui sont plus étoffés outre-Rhin ?
Mme Véronique Descacq. Le document adopté par les partenaires sociaux ne résulte pas d’une « union sacrée » mais du produit normal du dialogue social, ce qui lui confère d’autant plus d’intérêt.
Les partenaires sociaux ont commencé un travail important sur la modernisation du marché du travail, qui a déjà porté ses fruits, tant en termes de souplesse – avec le dispositif de rupture conventionnelle – que de sécurisation.
Nous allons ouvrir le deuxième volet du débat sur la modernisation du marché du travail. Il faut permettre aux entreprises de reconvertir leurs salariés en favorisant la mobilité géographique et professionnelle tout en faisant en sorte, en contrepartie, que ceux-ci se sentent sécurisés. Les discours tendant à souligner le coût élevé de la protection sociale ou à vitupérer la fraude ne sont pas de nature à les rassurer sur la pérennité du système de protection sociale. Il revient au contraire aux partenaires sociaux comme aux parlementaires de donner confiance aux salariés et aux citoyens dans la solidité de ce système. Sinon, on risque d’encourager chacun à se crisper sur sa position et à le dissuader d’évoluer.
Nous souhaitons par exemple aller plus loin dans la mutualisation de la formation professionnelle et mettre en œuvre des moyens de financement plus transversaux à cet effet, pour permettre aux salariés d’envisager des parcours professionnels entre les filières de même qu’entre le chômage, l’emploi et la formation, sans risquer de perdre par exemple leur assurance complémentaire santé ou leur droit individuel à la formation.
Il faut donc approfondir le travail engagé en 2008 dans le cadre de l’accord sur la modernisation du marché du travail. Nous souhaitons également que dans les prochaines étapes de l’agenda social, nous avancions davantage sur la formation professionnelle mais aussi, s’agissant des complémentaires santé, sur la portabilité des droits et de nouveaux systèmes de mutualisation du financement permettant une accessibilité plus large aux personnes recherchant un emploi ou en formation.
M. Pierre Morange, rapporteur suppléant. La représentation nationale réfléchit aussi à ces questions, compte tenu des quelque 500 milliards d’euros alloués au financement du système sanitaire et social. Par ailleurs, je rappelle que j’ai présenté l’an dernier un rapport d’information sur la flexisécurité à partir d’un travail sur le concept d’assurance professionnelle dans une approche de mutualisation des prestations et de portabilité des droits, passant ainsi d’une logique de statut à une logique de droits.
M. Hervé Novelli. Le différentiel de compétitivité avec l’Allemagne n’est-il pas dû à d’autres facteurs que les réformes structurelles menées dans ce pays dans les années 2000 ? La réduction du temps de travail conduite en France à la même époque et la politique d’unification des SMIC – qui s’est traduite par une augmentation du SMIC et a pesé sur l’échelle des salaires – n’y ont-elles pas contribué ?
La politique d’allègement des charges, commencé dans les années 1990 avec le gouvernement d’Édouard Balladur, coûte aujourd’hui plus de vingt milliards d’euros, pour une efficacité relative : ne faut-il pas la repenser ?
Mme Véronique Descacq. S’agissant de la réduction du temps de travail, vous aurez du mal à convaincre la CFDT qu’elle a nui à notre compétitivité. De tels propos relèvent du slogan. Je rappelle que malgré les tentatives de la remettre en cause, la réduction du temps de travail a été conservée dans les entreprises.
L’unification des SMIC est une des conséquences de la réduction du temps de travail, mais cela ne saurait remettre en cause à nos yeux le principe de cette réduction, qui est une avancée pour les salariés. D’ailleurs, ceux-ci y sont très attachés. Toutes les enquêtes d’opinion le prouve.
Sans le SMIC, on n’arrive pas, au travers des négociations de branche, à avoir des politiques salariales suffisamment dynamiques pour donner de la visibilité aux salariés sur leurs évolutions professionnelles. Le problème du SMIC ne tient pas à son coût, mais au fait qu’on y reste toute la vie, les grilles de classification n’étant pas suffisamment négociées dans les branches et les minimums de branche n’évoluant pas eux-mêmes de façon dynamique et stimulante.
De surcroît, en France, les employeurs sont réticents à faire progresser un salarié dans la grille de rémunération et de classification en fonction de son parcours professionnel, de sa formation et de l’acquisition des compétences.
Beaucoup de salariés ont ainsi le sentiment d’avoir des difficultés à progresser dans leur rémunération, la reconnaissance de leur expérience et de leurs qualifications, et qu’ils supportent seuls le coût de la protection sociale et de la fiscalité, lequel est insuffisamment redistribué.
Le Premier ministre nous a interrogés sur la barémisation de l’allègement des charges. Nous y sommes opposés car nous estimons qu’il faut d’abord évaluer les effets de celui-ci par secteurs – certains ayant bénéficié d’effets d’aubaine, d’autres donnant lieu à des phénomènes contre-productifs comme les trappes à bas salaires. Il serait souhaitable de conditionner cet allègement en fonction des secteurs, au regard, par exemple, d’un effort de formation répondant à un besoin particulier de reconversion dans un domaine donné.
Par ailleurs, dans certains secteurs, l’activité est réduite et le temps partiel contraint. Cela conduit certaines familles – monoparentales notamment – à des situations de pauvreté. Il convient donc de conditionner aussi l’allègement des charges à l’emploi à temps plein. Nous réfléchissons d’ailleurs à des propositions de financement de la protection sociale, notamment pour l’assurance chômage, incitant à l’embauche à plein temps.
M. Philippe Le Clézio. Les questions des 35 heures et de l’allègement des charges – qui représente un peu plus de 22 milliards d’euros portant sur des salaires compris entre 1 et 1,6 fois le SMIC – sont indissociables et doivent être traitées en même temps.
L’effet des 35 heures sur la compétitivité des entreprises françaises a été largement amorti par l’allègement des charges sociales. Je rappelle à cet égard que le temps de travail en Allemagne est toujours inférieur au temps de travail en France.
S’agissant du différentiel de compétitivité coût avec l’Allemagne, il résulte d’un socle industriel bien meilleur et deux fois plus important qu’en France, dont les réformes engagées après la réunification ont accru les performances. La spécialisation de ce pays sur les biens d’équipement lui permet notamment d’être mieux placée dans la concurrence internationale pour répondre aux besoins des pays émergents au sortir de la crise.
Mais l’envers de la médaille est constitué par la forte croissance des « minijobs » outre-Rhin, qui correspondent à des emplois précaires et mal payés. Et c’est en Allemagne que le taux de pauvreté s’est le plus accru au cours des cinq dernières années en Europe, avec une augmentation de 20 %.
M. Hervé Novelli. Les 10 milliards d’euros d’allègement de charges tendant à compenser la perte de compétitivité liée à la réduction du temps de travail vous paraissent-ils encore justifiés aujourd’hui, au regard notamment des progrès d’organisation et de productivité de l’économie française ?
M. Jean-Claude Sandrier, président. S’agissant du partage des revenus, que pensez-vous de la question du décalage entre la rémunération du travail et celle du capital ?
Mme Véronique Descacq. On observe un décalage certain entre la fiscalité du travail et celle du capital. Nous souhaitons que la seconde ne soit pas plus favorable que la première. À cet égard, nous préconisons la suppression des prélèvements libératoires sur les placements financiers.
Nous rejoignons globalement les observations du rapport Cotis sur le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. S’il n’y a pas de déformation considérable dans cette répartition, se pose, à l’intérieur même du salariat, la question de la rémunération des dirigeants, mais aussi celle des métiers de la finance, où on a l’impression qu’une extrême minorité des salariés – 0,01 % d’entre eux – profite de sa situation pour déformer à son avantage le partage de la valeur ajoutée des entreprises. Cet état de fait n’est plus tolérable pour des raisons économiques – on a vu sa part dans la crise financière –, mais aussi de cohésion sociale, dans le pays comme à l’intérieur des entreprises. Elle est malsaine et participe au sentiment d’exaspération et de déclassement des couches moyennes.
Le partage de la valeur ajoutée doit être réalisé en fonction de toute la chaîne de production, de l’entreprise maison mère au fournisseur, en passant par les sous-traitants et l’ensemble des parties prenantes. La question du partage de la valeur ajoutée se pose aussi dans l’entreprise au travers des négociations salariales, qui doivent être plus dynamiques. Enfin, elle se pose pour l’État dans le cadre de la politique fiscale globale, qui devrait être plus progressive.
M. Philippe Le Clézio. Nous sommes favorables à une réorientation des allègements de charges. La réorganisation du travail a, en dix ans, produit beaucoup de gains de productivité et d’effets d’aubaine dans certaines branches. Mais cette réorientation doit se faire de façon progressive ; elle doit aussi reposer sur des contreparties, par exemple en termes de formation ou de reconnaissance des qualifications, même si ce n’est pas toujours simple.
Mme Véronique Descacq. Il faut veiller notamment aux emplois non qualifiés. Une remise en cause trop brutale des allègements pourrait avoir des effets négatifs sur ces emplois ainsi que sur certains secteurs tels que les services d’aide à la personne. Elle doit être conduite avec mesure et assortie de certaines conditions.
M. Jean-Claude Sandrier, président. Je vous remercie.
*
AUDITIONS DU 8 JUIN 2011
Audition de M. Jean-François Dehecq, vice-président de la Conférence nationale de l’industrie, de M. Yvon Jacob, ambassadeur de l’industrie auprès de l’Union européenne, et de M. Jean-Claude Volot, médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance
M. Jean-François Dehecq, vice-président de la Conférence nationale de l’industrie. Les États généraux de l’industrie procédaient d’une volonté conjointe des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, ce qui a été déterminant pour la manière dont ils se sont déroulés et dont fonctionne la Conférence nationale de l’industrie (CNI). Celle-ci rendra au début de 2012 son premier rapport, conformément au décret du Premier ministre cosigné par neuf ministres – nombre de signatures qui montre que ce qui touche à l’industrie n’est pas toujours simple.
La conférence met à parité de droit de dialogue les pouvoirs publics – avec neuf ministres représentés en séance plénière –, les salariés – avec un collège composé de dix syndicalistes représentant les cinq syndicats représentatifs – et les employeurs – avec un collège réunissant quinze dirigeants, représentant les syndicats professionnels de différents secteurs d’activité, auxquels s’ajoutent cinq ou six personnalités qualifiées, ainsi qu’un député, un sénateur et un membre du Parlement européen. Cette enceinte permet aux participants, issus de différents horizons, de se rencontrer et d’échanger dans un cadre qui n’est pas celui d’un face-à-face conflictuel. Comme les États généraux, en effet, la conférence est destinée à formuler des propositions et en aucun cas à mener des négociations – ce que les partenaires sociaux n’auraient jamais accepté.
Les États généraux, qui ont mobilisé cinq mille personnes à travers la France, ont été un grand succès. Ils ont commencé avec des groupes de travail de trente à quarante personnes examinant à Paris une dizaine de sujets. Très vite la démarche s’est étendue aux régions, d’abord avec l’idée de conférences régionales organisées sous l’égide des préfets ; et finalement toutes les régions se sont autosaisies de la question et 183 groupes de travail se sont constitués, produisant en trois mois 7 000 pages de recommandations, lesquelles ont été synthétisées en un document d’une cinquantaine de pages, puis en un résumé de sept pages.
Je ne m’attarderai pas sur les grandes constatations. Le recul de l’emploi industriel et celui de la position de l’industrie française sont des évidences. Nous devons cependant éviter de nous comparer sans cesse aux Allemands, dont la progression a été liée à des raisons très particulières. Il est au moins aussi important de constater que l’emploi industriel et la position de l’industrie ont décru deux fois moins vite en Italie qu’en France, ainsi quand notre pays perdait 10 points, l’Italie n’en perdait que 4 ou 5.
Autre constat : la faiblesse de la dynamique d’investissement. L’industrie a peu investi au cours des dernières années. Quant à la recherche, elle est concentrée dans quelques secteurs ; beaucoup d’autres n’en font guère, ce qui empêche l’innovation, donc la création de marchés.
Nous avons également souligné la difficulté des petites et moyennes entreprises à devenir des entreprises de taille intermédiaire ; du fait des dispositions législatives applicables aux successions, la situation est bien différente de celle de l’Allemagne.
On note également des éléments favorables, comme le rayonnement mondial des grandes entreprises françaises. Cependant ces entreprises créent de l’emploi à l’étranger, vendent à l’étranger et, au titre du bénéfice mondial consolidé, paient des impôts à l’étranger plutôt qu’en France. L’entreprise que j’ai construite s’est, quant à elle, enorgueillie durant des années d’être le plus gros contribuable français – elle l’est du reste toujours – car, si la France ne représentait que 6 % de son marché, elle abritait 35 % des effectifs et 70 % de la recherche. Les profits étaient en France et largement taxés, ce qui est normal et permet de répondre aux besoins de l’État. Oui, nous avons la chance d’avoir de grandes entreprises à rayonnement mondial, mais encore faut-il qu’elles jouent leur rôle dans notre pays.
Les facteurs pénalisants sont avant tout les prélèvements publics. Pour une même somme versée par l’employeur, le salarié perçoit beaucoup moins en France qu’en Allemagne. Mais il ne sert à rien de déplacer vers la fiscalité une part des charges sociales si l’argent ainsi économisé ne va pas à l’investissement ou à l’innovation, voire au pouvoir d’achat. Les décisions qui seront prises devront servir au développement des entreprises.
Autre point très important, souligné dans tous les rapports : l’inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises – de plus en plus criante à mesure que l’on descend vers les petites et moyennes entreprises. Les entreprises auraient besoin de « faiseux », et non pas seulement de « causeux », c’est-à-dire au moins autant de titulaires de brevets industriels ou de certificats d’aptitude professionnelle (CAP) que de diplômés d’écoles d’ingénieurs. Ce défaut de formation professionnelle résulte de ce que l’industrie a perdu son aura, que le secrétariat d’État à l’enseignement technique a été supprimé et que l’instauration du collège unique a fait de l’orientation vers l’enseignement technique une punition pour les moins bons élèves.
Ce constat général étant établi, il faut avancer. À cet égard, la conférence nationale de l’industrie rassemble une équipe dont les membres ont par ailleurs une action fort utile, qu’il s’agisse de M. Jean-Claude Volot, de M. René Ricol ou de M. Yvon Jacob. Il faudra du temps pour remettre l’industrie au cœur d’un grand projet commun. Il faut presque une génération pour faire reprendre sens à l’enseignement technique et aux métiers manuels. Ne doutons pas que les Français aimeraient pouvoir faire réparer sur place et rapidement, par des professionnels compétents installés à proximité, leur machine à laver, leur aspirateur ou leur ordinateur !
Par ailleurs, nous avons besoin d’un pacte européen car nous sommes parfois lourdement freinés par l’absence de politique industrielle européenne.
Pour développer l’emploi et les compétences dans l’industrie, il faut déjà savoir ce que c’est que l’industrie. À l’époque des présidents Charles de Gaulle et Georges Pompidou, on parlait énormément d’industrie. De fait, une nation est fière de ce qu’elle produit – et non de ses banques et autres institutions de service. L’image de la France à l’extérieur est donnée par ce qu’elle fabrique. Rétablir cette image est un travail de longue haleine, qui ne se fera pas en six mois ou en un an. Depuis la période que je viens d’évoquer, le ministère de l’industrie s’est peu à peu étiolé, jusqu’à ce que l’on décide que l’on n’en avait plus besoin. Sans doute M. Jean-Pierre Chevènement a-t-il été un ministre de l’industrie qui souhaitait agir, mais il n’est pas resté longtemps à ce poste. Ses successeurs n’avaient pas sa passion de l’industrie et pensaient que l’on remplacerait les emplois industriels par les emplois de service, alors que les services se délocalisent en quelques jours, bien plus facilement encore que l’industrie. Sans industrie, il n’y a plus besoin de services ni de centres de recherche. Les choses sont donc simples : si on défend l’industrie, il y aura des emplois ; si on ne la défend pas, il n’y en aura pas.
M. Yvon Jacob, ambassadeur de l’industrie auprès de l’Union européenne. Au problème de compétitivité que rencontre la France, assez bien identifié, s’ajoute celui de la compétitivité de l’Europe, moins souvent évoqué. J’aborderai donc la problématique française à travers une approche européenne.
La vie de notre industrie dépend très largement de domaines relevant d’une responsabilité européenne exclusive ou partagée. Il en va ainsi de la politique de la concurrence et du marché unique, partagée mais largement décidée à Bruxelles ; de la politique des normes, notamment environnementales ou sanitaires, également partagée mais dans laquelle l’Union européenne a un poids très important ; enfin, de la politique du commerce et des échanges internationaux de marchandises, pour laquelle l’Union européenne a une compétence exclusive, gérant toutes les négociations internationales pour le compte des États membres. Depuis une trentaine d’années, ces politiques ont été essentiellement tournées vers l’intérêt du consommateur et ont largement oublié l’acte de production et le producteur. C’est ce qui explique sans doute en partie la position de l’Union européenne dans les négociations de l’Organisation mondiale du commerce. Je pense notamment à celles qui, voilà un peu plus d’une dizaine d’années, ont débouché sur l’entrée dans l’organisation de pays occupant aujourd’hui une place majeure mais qui étaient alors considérés comme émergents, et sur un phénomène de mondialisation asymétrique : lors de ces négociations, nous avons fait énormément de concessions, en abaissant la quasi-totalité de nos barrières tarifaires, dans l’espoir, en contrepartie, d’entrer sur ces marchés nouveaux, mais nous avons été quelque peu déçus.
C’est le premier choc que l’industrie française et européenne a eu à subir à la fin des années 1990 et au début des années 2000. La Chine, entrée dans l’Organisation mondiale du commerce en 2001, connaît depuis dix ans un taux de croissance du commerce extérieur de 15 % à 25 % par an – soit de 20 % en moyenne. La part de ce pays dans les échanges mondiaux est passée en moins de dix ans de 7 % à 14 % et devrait atteindre 25 % dans la décennie à venir – évolution cohérente avec l’importance de ce pays, mais d’une grande brutalité pour les autres partenaires mondiaux. L’irruption de la Chine dans le commerce international a en outre créé un fantastique déficit des balances commerciales en Europe. Le déficit cumulé européen s’élève à 1 100 milliards d’euros et pourrait atteindre dans cinq ans 1 800 milliard ou 2 000 milliards d’euros si le rythme actuel se poursuit. À cela s’ajoutent les problèmes que posent le taux de change de la monnaie chinoise et des pratiques commerciales parfois éloignées de nos usages.
Le deuxième choc, à peu près simultané, est l’élargissement de l’Europe, dont nous n’avons pas entièrement mesuré les conséquences : différentiels sociaux très importants avec les anciens pays membres ; divergences d’intérêts en matière industrielle, certains pays assez peu industrialisés voyant bien l’avantage pour eux de profiter d’une production mondiale à bas coût ; extrême complexité de la prise de décision à l’échelle des 27 pays de l’Union européenne ; surveillance du marché intérieur rendue encore plus difficile.
Pour la France, ces deux chocs ont entraîné des délocalisations, en particulier pour les approvisionnements, des pertes d’emplois, une baisse de la rentabilité qui a entraîné une diminution des ressources utilisables pour l’investissement, ainsi que des transferts ou des disparitions de savoir-faire.
L’Europe n’a pas eu de véritable réaction politique face aux effets de ces deux chocs. Malgré les rapports assez nombreux produits par la Commission, le Conseil des ministres n’a pas traité les problèmes. La situation est d’autant plus difficile à régler qu’il faut trouver un consensus à 27. Nous Français, devons nous employer à développer une force de proposition et de conviction ; Gouvernement, parlementaires et industriels doivent fixer des objectifs clairs pour notre industrie, dans une vision de long terme. Tous les acteurs doivent être rassemblés autour d’une stratégie cohérente – la Conférence nationale de l’industrie est là pour cela.
Enfin, au niveau international, nous avons besoin d’une régulation de la concurrence, aujourd’hui inexistante. Il est certes important de réguler l’économie financière, mais il faut aussi réguler l’économie réelle.
M. Jean-Claude Volot, médiateur des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance. Je présenterai un rapport d’étape de ma mission, qui correspond au douzième des 23 points dégagés par les États généraux de l’industrie. Le poste de médiateur a été réclamé, dans toute la France, par les 5 000 personnes qui y ont participé. Mon équipe et moi-même travaillons depuis quatorze mois à améliorer les relations entre les entreprises. Compte tenu du « frottement » constaté entre les entreprises, c’est là un facteur d’amélioration de la compétitivité et de la productivité globales.
Malgré la peur de recourir au médiateur dans un pays où « l’omerta » reste très forte, une véritable bonne volonté se manifeste dans les états-majors des groupes, grands ou moins grands, pour changer les choses. Nous effectuons, je le rappelle, des médiations individuelles, collectives ou de branche, de telle sorte qu’au cours de cette première année, nos actions ont concerné 13 000 entreprises, soit environ 450 000 salariés, avec un taux de succès de plus de 86 %.
Le Gouvernement nous avait également demandé de procéder à un état des lieux des mauvaises pratiques : nous en avons identifié d’abord 35, puis 38 et avons constaté qu’elles étaient toutes illégales. Mais je rappelle la phrase de Churchill : « En Angleterre, tout est permis sauf ce qui est interdit ; en Allemagne, tout est interdit sauf ce qui est permis ; en France, tout est permis, même ce qui est interdit »… Il faudra du temps pour effacer les mauvais plis et faire en sorte que l’intelligence et la créativité soient pleinement utilisées dans l’intérêt de notre pays.
La médiation entraîne de nombreux effets induits, notamment un regain de confiance de la part des fournisseurs. La fonction de médiation, née dans l’industrie, s’étend désormais à tous les domaines des relations entre les entreprises, y compris commerciales et de services, l’industrie représentant aujourd’hui à peine la moitié des missions que nous effectuons. Mon équipe et moi sommes assez fiers de nos performances au service de l’économie française.
Pourquoi notre économie n’a-t-elle pas la compétitivité qu’elle pourrait avoir ? Les entreprises françaises sont très compétitives : 34 grands groupes industriels sont des leaders mondiaux. Mais la compétitivité de la France ne dépend pas seulement des entreprises ; il faut tenir compte de l’ensemble de leur environnement, notamment de l’État. À cet égard, nous attendons du Parlement qu’il remédie à l’insécurité fiscale : les règles changent sans cesse, plus encore qu’en matière sociale. L’insécurité entraîne un manque de confiance qui se traduit, chez les entrepreneurs comme chez l’ensemble des Français, par un comportement d’épargne, préjudiciable à l’investissement.
Ainsi l’exit tax, condamnée par Bruxelles à l’époque du gouvernement de M. Lionel Jospin, est à nouveau évoquée par des parlementaires de tous bords : il n’y a rien de mieux pour effrayer l’entrepreneur français ! De même, il est dramatique que l’on parle, à l’approche des élections, de remettre déjà en cause l’excellent dispositif « Dutreil », qui avait enfin mis la France, en matière de coût des successions, au niveau de l’Allemagne – où nombre d’entreprises du Mittelstand sont dirigées par la troisième génération d’une même famille… Quant au retour à la retraite à 60 ans, même s’il n’a pas lieu, son évocation ne contribue pas non plus à instaurer un climat de confiance.
Il faut savoir aussi, même si personne n’en parle, que les jugements des chambres sociales des cours d’appel sont rendus quasi systématiquement contre les entreprises, même si les tribunaux de prud’hommes leur avaient donné raison. Ce sont malheureusement des statistiques secrètes…
Des décisions assassines de la Cour de cassation, comme celle qui a été rendue voilà deux semaines à propos du délit de marchandage, contribuent à la même insécurité. La pénalisation du délit de marchandage a été instaurée en 1848 pour lutter contre l’esclavage. Et aujourd’hui on sanctionne pénalement le sous-traitant et le donneur d’ordre.
Le fait de revisiter en permanence l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et ses constituants est également un facteur de grande insécurité, qui ne permet pas à l’entreprise d’être performante.
Quant à la réglementation applicable aux jeunes entreprises innovantes, elle a été entièrement modifiée au bout d’un an : comment avoir confiance ? Il en va de même du crédit impôt recherche, modifié et réduit dès l’année suivant sa création. Le dispositif de l’ISF-PME qui, quels que soient ses défauts, a permis d’investir un milliard d’euros au cours des dernières années, n’a pas cessé, lui aussi, de faire l’objet de réductions.
On ne saurait pourtant imaginer que les parlementaires ne disposent pas de la capacité d’anticiper les conséquences de leurs décisions, ni qu’ils regrettent d’avoir permis aux entreprises d’être plus performantes dans la compétition mondiale !
Sur le terrain, je ne fais qu’entendre des témoignages qui corroborent ce qui est exposé dans les 7 000 pages du rapport des États généraux de l’industrie. Le républicain que je suis vous demande d’établir une politique durable en matière de fiscalité et, secondairement, de cotisations sociales.
M. Christian Blanc, président. Pour faire écho aux propos de M. Yvon Jacob sur la nécessité de définir une stratégie et en réponse à M. Jean-François Dehecq, qui recommande d’éviter trop de comparaisons avec l’Allemagne, je rappelle que ce pays a rattrapé en une dizaine d’années son retard dans le domaine des biotechnologies grâce à des décisions stratégiques consistant à concentrer les efforts de recherche fondamentale, de recherche appliquée et d’innovation sur deux Länder – la Bavière et le Bade-Wurtemberg. Comment les chefs d’entreprise et industriels que vous êtes envisagent-ils les questions de stratégie ?
À propos de la compétitivité, je me souviens qu’à Bruxelles, un commissaire allemand prenait rarement une décision sans en avoir discuté avec des représentants de l’industrie allemande, qui étaient sur place ; les Français n’avaient pas les mêmes habitudes. Certes les parlementaires doivent être plus conscients des problèmes que rencontre l’industrie, mais encore faut-il que ses représentants leur parlent. Quelles seraient vos recommandations à la représentation nationale ?
M. Jean-François Dehecq. Sans aborder les sujets sur lesquels vous allez entendre M. Pierre Gattaz, je voudrais souligner que nous n’avons aucune cartographie de l’industrie en France. La définition de quatorze filières constitue une grande nouveauté ; un rapport présentera au début de l’année prochaine la structure et la compétitivité de chacune d’entre elles. L’Algérie, où je me trouvais la semaine dernière avec M. Jean-Pierre Raffarin, a bien compris l’intérêt de ces filières et a entrepris d’en construire. On ne fait pas d’industrie laitière sans savoir comment on nourrit les vaches ni comment on distribue les produits. De nombreuses personnes travaillent sur ces questions et il importe de savoir où l’on va.
Un problème important est celui du financement des petites et moyennes entreprises. En effet, si une grosse entreprise n’a pas de peine à emprunter des milliards, une petite et moyenne entreprise qui n’a plus de fonds propres après la crise n’a pas aussi facilement accès au crédit et ne peut pas suivre ses commandes lorsque l’activité redémarre. Plus les entreprises sont petites, plus le financement est difficile. Il faut orienter l’argent vers l’industrie – ce que permettait autrefois le découplage entre banques de dépôt et banques d’affaires. Ce ne sont pas l’État et les patrons qui redonneront vie à l’industrie française. Il faut que le corps social réalise que, faute d’industrie, il n’y aura plus de travail ni de pouvoir d’achat pour nos enfants et nos petits-enfants.
M. Christian Blanc, président. Le président d’OSÉO indiquait ce matin qu’une partie des personnes acquittant l’impôt de solidarité sur la fortune au profit des petites et moyennes entreprises n’en attendent pas un retour sur investissement, mais considèrent qu’il s’agit d’une contribution de solidarité avec des entreprises qu’elles connaissent, sur un territoire donné. Que pensez-vous de cette notion de solidarité territoriale ?
M. Jean-François Dehecq. Elle est essentielle, et liée à celle de bassin d’emploi. Sans OSÉO, qui est présent sur les territoires, les faillites seraient beaucoup plus nombreuses. Quant aux salariés, ils ne demandent pas que l’État subventionne l’industrie, mais que leurs salaires puissent, tant qu’ils sont en dépôt à la banque, alimenter des prêts à l’industrie, plutôt que la spéculation.
M. Jean-Claude Volot. Le monde de l’industrie a besoin d’un climat de confiance pour investir et se développer. Depuis dix ans, les industriels français se sont comportés comme des épargnants, en augmentant leurs fonds propres. Pour sortir de cette situation, il faut cesser de remettre sans cesse en cause les règles fiscales. Ainsi, la modification des bases de l’impôt de solidarité sur la fortune est propre à attiser les craintes. Il existe d’ailleurs au Sud-est de Bruxelles une grande forêt que les Bruxellois appellent le « ghetto des riches Français » : des entrepreneurs français ont vendu leur entreprise et sont venus y cacher leurs valises de billets…
Il est capital de demander aux filières d’établir des stratégies globales. Ces stratégies devront ensuite être déclinées pour l’ensemble des entreprises, jusqu’à la plus petite. En tant que président du comité consultatif « Industrie et financement des entreprises » au Commissariat général à l’investissement, j’ai dû me battre pour obtenir une enveloppe de 69 millions d’euros, dont le montant prévu était initialement de 300 millions, pour des actions collaboratives de filière et d’agglomération pour chacune des filières. Nous attendons des projets dans ce domaine, qui doivent tous intégrer les trois mots magiques que sont « stratégie », « recherche-développement » et « exportation ». Lorsque ces mots n’apparaissent pas, nous demandons aux auteurs des dossiers de s’efforcer de les y faire figurer. Cela fait aussi partie d’une stratégie de filière.
Les entreprises françaises sont globalement performantes, mais les chefs d’entreprise possédant une stratégie réelle sont peu nombreux – les autres recourant à l’intuition, à la tactique ou à l’itération quotidienne. C’est la raison pour laquelle M. Jean-François Dehecq, M. Christian Estrosi, M. René Ricol et moi-même avions demandé de pouvoir disposer d’une enveloppe permettant un effet de levier. La situation du Commissariat général à l’investissement est exceptionnelle et prometteuse pour l’avenir.
Oui, il y a des choses à faire pour les petites et moyennes entreprises. Oui, il faut pousser les responsables de filière à établir des stratégies. Il faudrait aussi, au moins pour la durée d’une mandature, ne pas trop modifier les règles fiscales s’appliquant à l’entreprise, afin d’assurer un climat de confiance.
M. Yvon Jacob. Ce dont l’industrie française a besoin avant tout, c’est d’un véritable consensus national sur son importance pour l’avenir de notre économie, donc pour l’emploi et pour le bien de tous. Les entrepreneurs ont vraiment besoin de se sentir soutenus par cette conviction collective. Les États généraux ont fixé les grandes lignes de ce qui pourrait être notre ambition, en formulant des propositions touchant aux divers aspects de la vie de l’entreprise. Mais il faut aussi agir au niveau européen : les Français, donc leurs représentants politiques et les acteurs industriels, doivent se mettre d’accord sur les objectifs à atteindre en ce domaine. Depuis quelque temps l’Europe dit vouloir se doter d’une politique industrielle, mais on en est encore au stade du discours ; et ce que nous Français disons sur le sujet n’est pas toujours très bien accueilli par nos partenaires. Sans doute est-ce parce que nous n’avons pas pris la précaution d’aller préalablement nous expliquer auprès de chacun d’eux. Nous en avons 26, aucun ne compte plus qu’un autre – car ils sont tous à égalité dans la prise de décision, même si 70 % ou 75 % de la valeur ajoutée industrielle de l’Union est produite par quatre pays membres.
C’est par des actions convergentes des organisations professionnelles, des entreprises et de l’État que nous pourrons faire bouger les lignes en faveur de l’industrie. Il faut aller convaincre ceux qui en Europe n’ont pas le même point de vue : certains pays, même s’ils ne sont pas nombreux, ne s’intéressent pas aujourd’hui à l’industrie ; et ils peuvent être les vecteurs, en Europe, de l’ambition de pays extra-européens. Il faut donc leur expliquer pourquoi les messages qu’ils relaient ne sont pas bons. Faisons de l’industrie un impératif national, en n’oubliant jamais que la moitié des emplois de service dépendent de l’industrie.
M. Jean-François Dehecq. Je me réjouis que depuis trois ans, on puisse parler d’industrie sans avoir l’air d’un passéiste. On ose parler de politique industrielle, non dans le sens d’un Gosplan, mais dans celui de la fixation d’une stratégie. En outre, les États généraux ont permis non pas d’arriver à un consensus social, ce qui serait impossible, mais de définir des lignes de convergence. La conférence nationale de l’industrie, qui est pérenne, prend le relais. La cohésion sociale dépend de cette démarche collective.
M. le président Bernard Accoyer. Merci à tous de nous avoir présenté vos observations et vos propositions. La cohésion nationale est bien l’objectif poursuivi par cette mission d’information, s’agissant de la création de la richesse, de sa répartition et du financement de la protection sociale. Je retiens de vos propos votre souhait, partagé par beaucoup, que les comportements évoluent à l’égard de l’industrie, afin qu’elle retrouve toute la place qu’elle mérite dans notre économie.
*
Audition de M. Pierre Gattaz, président du directoire de Radiall, président du Groupe des fédérations industrielles, président de la Fédération des industries électroniques, électriques et de communication
M. le président Bernard Accoyer. Nous avons maintenant le plaisir d’accueillir M. Pierre Gattaz, président du directoire de Radiall, président du Groupe des fédérations industrielles (GFI), président de la Fédération des industries électroniques, électriques et de communication (FIEEC), qui a succédé il y a un an à la M. Yvon Jacob à la présidence du GFI. Celui-ci rassemble les plus importantes fédérations industrielles et représente environ 80 % de l’industrie.
M. Pierre Gattaz, président du directoire de Radiall, président du Groupe des fédérations industrielles, président de la Fédération des industries électroniques, électriques et de communication. Je suis en effet le patron de Radiall, société familiale spécialisée dans la connectique. Sur notre site de Château-Renault, trois cent cinquante personnes fabriquent des connecteurs. Nous sommes leaders mondiaux pour approvisionner Boeing et Airbus. Si nous avons pu conquérir le marché de Boeing depuis dix ans, c’est parce qu’en France, l’écosystème Airbus-Safran-Thales nous avait permis de créer de nouvelles technologies et de nous développer. D’où ma première observation : pour se développer à l’exportation, il est fondamental qu’existe une base d’écosystème et de marché en France et en Europe ; quand elle disparaît, il très difficile pour les petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire de survivre. À l’inverse, la crise de la filière des télécommunications en 2001 nous a fait beaucoup souffrir ; nous avons perdu une cinquantaine de clients en France – que nous avons essayé de suivre en Chine. Nous avons fait en sorte de compenser la baisse du chiffre d’affaires dans ce secteur par d’autres marchés – militaire, spatial, aéronautique –, mais d’autres n’y sont pas parvenus : sur les trente connecticiens français qui existaient il y a vingt ans en France, il en reste quatre – Radiall, entreprise familiale, et trois autres qui appartiennent à des groupes financiers. En Allemagne au contraire, il y avait cinquante entreprises familiales de connectique il y a vingt ans, et il y en a toujours autant. Pourquoi cette différence ? Telle est la question à laquelle j’ai voulu réfléchir.
Bien sûr, il y a les problèmes de charges et de compétitivité. Mais avant toute chose, il faut des commandes. À la Fédération des industries électroniques, électriques et de communication, nous avons donc beaucoup travaillé sur les filières d’excellence du futur : il faut une ambition industrielle pour la France. Je mène ce même combat dans le cadre du Groupe des fédérations industrielles depuis un an. Dans notre pays, il ne s’agit plus de produire des vélos et des cafetières mais d’explorer les besoins sociétaux de base. Nos concitoyens, qui vont vivre de plus en plus vieux, ont des besoins de santé, d’accompagnement, de sécurité – aussi bien dans les transactions financières que sur la route ; ils ont besoin aussi, pour vivre mieux, que l’on améliore l’efficacité énergétique. À ces besoins correspondent des opportunités industrielles fantastiques : les réseaux électriques du futur, la route intelligente – qui tuerait moins et provoquerait moins d’accidents –, la santé – avec la « e-santé », la télémédecine, l’imagerie et toutes les solutions imaginables pour améliorer les soins tout en réduisant la facture – ou la rationalisation de l’éclairage urbain. Nous avons tout ce qu’il faut en France – technologies, ingénierie – pour développer ces secteurs, qui comptent déjà des champions capables de jouer le rôle de locomotives, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire et des petites et moyennes entreprises prêtes à accompagner le mouvement. Il y a cinq ans, ce discours était inaudible : on ne va pas revenir à l’époque des plans, me disait-on. Mais il ne s’agit pas du tout de cela : nous ne voulons pas, bien entendu, nous voir imposer par quelques hauts fonctionnaires un choix industriel, comme à l’époque du plan machine-outil ou du plan Calcul ; nous souhaitons que, tel le MITI japonais (Ministry of International Trade and Industry), l’État favorise ces réflexions et que les acteurs que nous sommes se mettent d’accord avec les chercheurs et avec l’Éducation nationale pour développer quelques filières. La Conférence nationale pour l’industrie, où je suis l’adjoint de M. Jean-François Dehecq, essaie de mettre en place ces filières stratégiques. Rappelons une fois encore l’importance de l’industrie : elle représente 85 % de l’innovation, 80 % du commerce extérieur ; un emploi industriel crée deux emplois de service, l’industrie représente 15 % du produit intérieur brut (PIB) mais en ajoutant les services associés ou induits, on atteint 30 % à 35 % du PIB. Si l’industrie va mal, toutes les activités qui lui sont liées iront mal aussi.
La crise aura eu le mérite de nous ouvrir les yeux. À côté de nous, le modèle allemand fonctionne merveilleusement bien : les industriels allemands innovent, exportent, créent des emplois. En France, l’industrie a connu dix années calamiteuses. En tant que dirigeant d’entreprise, j’ai vécu le départ des clients hors de France, j’ai connu le discours, y compris dans les cercles patronaux, selon lequel l’avenir n’était pas dans l’industrie, mais dans les services et « l’économie de l’intelligence ». Or ces services ne peuvent fonctionner qu’avec des infrastructures efficaces – réseaux électriques intelligents, réseaux haut débit…
Notre combat est celui de l’emploi : l’économie française dans son ensemble ne peut bien fonctionner que si le socle industriel ne disparaît pas ; quant à l’emploi industriel lui-même, nous sommes persuadés qu’il est possible de le conserver et même de le développer. L’exemple de Radiall en témoigne : pour pénétrer le marché américain de l’aéronautique, j’ai créé au Mexique une usine de trois cents personnes ; et je me suis aperçu qu’entre deux crises, je créais aussi trente emplois à Château-Renault. Une spirale vertueuse est possible : lorsqu’un marché existe en France ou en Europe, on va conquérir la Chine ou l’Inde ; et grâce à ces parts de marché nouvelles, la rentabilité augmente et permet d’innover. Or l’innovation, qu’il s’agisse de Recherche & Développement ou de process de fabrication, peut se faire en France.
Les propositions du groupe des fédérations industrielles pour redresser l’industrie française s’organisent autour de trois axes.
Tout d’abord, il faut définir une nouvelle ambition pour l’industrie, via la Conférence nationale de l’industrie ; malheureusement, celle-ci ne dispose pas de moyens suffisants. Le lancement de onze filières stratégiques – auxquelles vont sans doute s’en ajouter deux ou trois autres – représente du travail. On ne peut pas faire un MITI avec des bouts de chandelle… Il reste que la conférence, cadre de discussions fructueuses entre le patronat, les syndicats et l’État, est le bon instrument pour définir un cap.
Ensuite, pour concrétiser l’ambition et libérer la croissance, il est indispensable de pérenniser le crédit impôt recherche, de faire en sorte que les entreprises de taille intermédiaire aient accès aux facilités de trésorerie accordées aux petites et moyennes entreprises. Le dispositif, ne l’oublions pas, a permis de garder en France des sociétés telles que Microsoft ou Google. C’est un outil formidable – qu’il faudrait peut-être élargir à l’innovation : sans doute sommes-nous plus créatifs que les Allemands, mais nous sommes défaillants pour le passage de l’idée à la réalisation.
Il faut aussi, pour libérer la croissance, agir sur le coût du travail. En la matière, notre industrie avait il y a dix ans un avantage sur l’Allemagne de 12 % à 15 % ; aujourd’hui, nous sommes tombés à zéro. Si rien n’est fait, il y a fort à craindre que dans cinq ou dix ans, le coût du travail soit bien plus élevé en France qu’en Allemagne, ce qui serait dramatique. Pour réduire le coût du travail, nous ne prônons pas du tout une baisse des salaires nets ; en revanche, nous demandons d’agir sur les charges : s’il y avait une seule mesure à prendre, ce serait de transformer les 33 milliards d’euros de charges qui sont liés à la politique familiale en points de taxe sur la valeur ajoutée – quitte à exempter certains produits de première nécessité – ou de contribution sociale généralisée. Si nous voulons des entreprises dynamiques, qui créent de la richesse et de l’emploi en France, capables d’affronter un environnement mondial très dur, nous devons savoir prendre une décision courageuse comme celle-ci – faute de quoi ce sont les entrepreneurs qui vont se décourager, abandonner et partir à l’étranger. Une telle mesure aurait pour effet de renchérir les importations de Chine ou d’Inde, qui rencontrent fort peu de barrières en Europe – alors qu’à l’inverse, pour exporter dans ces pays, nous sommes confrontés à de multiples contraintes : c’est tout le problème de la réciprocité dans les échanges, qu’il conviendrait également de régler.
Notre objectif est de faire repartir l’emploi industriel en France, grâce à l’innovation. Il faut aussi savoir gérer les effectifs, en pratiquant la flexisécurité : nous ne sommes plus dans le monde des Trente glorieuses, nous allons de crise en crise ; mais le licenciement à l’anglo-saxonne n’est pas notre modèle, il faut plutôt suivre le modèle allemand, négocier avec les partenaires sociaux un chômage partiel, en profiter pour dispenser des formations. En France, les chefs d’entreprise ont encore trop peur d’embaucher, par crainte de ce qu’ils feront de leurs salariés à la prochaine crise. Bien entendu, il est également indispensable de promouvoir l’apprentissage et l’alternance.
Enfin, il me paraît impératif de simplifier et stabiliser la réglementation française – fiscale, sociale et environnementale. Un enfant de cinq ans est capable de se servir d’un iPhone, les ingénieurs d’Apple ayant désormais compris la nécessité d’exempter l’utilisateur des éléments de complexité, en les intégrant dans l’appareil lui-même ou en les laissant dans les réseaux extérieurs. Pourquoi ceux qui établissent les réglementations ne pourraient-ils pas faire de même ? Il y a trois ans, au sujet des heures supplémentaires, il nous a fallu lire et comprendre une note de Bercy de 80 pages… Les chefs d’entreprise ont besoin d’un environnement stable – il ne faut pas changer la loi sans cesse – et simplifié : cela me paraît un bon programme pour les décennies qui viennent.
M. le président Bernard Accoyer. Merci beaucoup pour cette analyse. Je ne doute pas que ce que vous venez de nous dire nourrira d’autres échanges.
M. Jean Grellier. Comment assurer la convergence de toutes les structures existantes – pôles de compétitivité, comités stratégiques de filière, schémas régionaux de développement économique, Médiateur de la sous-traitance, Conseil d’analyse stratégique – ?
S’agissant des charges, que pensez-vous de l’idée d’instituer non seulement un plafond de charges par rapport au chiffre d’affaires, mais aussi un plancher, afin d’assurer une certaine péréquation ? Je m’interroge sur la raison pour laquelle cette proposition faite par des industriels n’a pas été mise à l’étude ; cela permettrait de faire un peu moins peser les charges sur les entreprises qui créent de l’emploi, en assurant un rééquilibrage avec les entreprises qui délocalisent ou importent.
M. Pierre Gattaz. J’aimerais en connaître davantage sur cette proposition. Aujourd’hui le consensus se fait plutôt sur la formule dont j’ai parlé – substitution de prélèvements fiscaux comme la taxe sur la valeur ajoutée ou la contribution sociale généralisée à certaines charges sociales, afin de réduire le coût du travail, et même éventuellement d’augmenter le salaire net –, ce qui permettrait d’endiguer les importations chinoises ou indiennes.
S’agissant des diverses structures mises en place, la Conférence nationale de l’industrie me paraît être l’instrument le plus important au niveau national, dans la mesure où y sont associés patrons, syndicats et Gouvernement ; le problème est le peu de moyens accordés pour la faire fonctionner. Les pôles de compétitivité jouent également un rôle très positif au niveau local. Toutes ces initiatives me paraissent s’articuler naturellement. La conférence essaie de bâtir des filières stratégiques, avec une vision à moyen ou long terme.
Pour le reste, il faut créer des écosystèmes, faire en sorte que les grandes sociétés entraînent les moyennes, prendre exemple sur l’Allemagne pour « chasser en meute ». Une initiative comme « Pacte PME » est à cet égard très intéressante.
M. Christian Blanc, président. Merci beaucoup pour la qualité et l’enthousiasme de vos propos, dont je salue la tonalité optimiste. Nous comptons sur vous pour initier les mouvements nécessaires.
M. Pierre Gattaz. Nous sommes des combattants de l’industrie. Permettez-moi un dernier message car il y a urgence : en France les industriels ont l’impression de ne pas être aimés ; ils auraient besoin que le climat devienne plus favorable. Cela commence par l’éducation : à Radiall, nous avons montré pendant trois jours à des élèves de Première et leurs professeurs ce qui se faisait dans l’entreprise. Ils ont découvert des métiers, et en même temps constaté que l’on était loin de la lutte des classes et que chacun était content de venir travailler le matin. Il faudrait développer ce genre d’initiatives.
M. Christian Blanc, président. Merci.
*
AUDITION DU 15 JUIN 2011
Audition de M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Au préalable, je vous prie d’excuser Mme Christine Lagarde, qui, ne pouvant participer à cette audition, m’a demandé de la remplacer.
Je voudrais également féliciter l’Assemblée nationale d’avoir créé une mission d’information sur un sujet d’une importance majeure pour le Gouvernement et pour l’ensemble de l’économie française. Il est essentiel que tous les acteurs économiques puissent participer à la définition de notre politique économique, en abordant tous les sujets, sans tabou.
Si un consensus semble à notre portée sur le constat, il y aura certainement débat sur les solutions. À cet égard, je salue la contribution que plusieurs syndicats et le patronat ont apportée conjointement, sous la forme d’un document intitulé « Approche de la compétitivité française », dont je partage un certain nombre de conclusions.
Plusieurs études ont mis en évidence un décrochage de la France par rapport à l’Allemagne, en termes de compétitivité et de performances à l’exportation, dans les années 2000. Il convient toutefois de préciser que, si la France a perdu des parts de marché, elle l’a fait à peu près au même rythme que le reste de la zone euro, hors Allemagne.
Si notre compétitivité prix s’est moins dégradée que notre compétitivité coût – sur la période 2000-2008, la première a baissé de 5 %, la seconde de 15 % –, c’est au prix d’un effort important de nos entreprises sur les marges à l’exportation, qui a pesé sur leurs capacités financières ; le recul de 1,3 point du produit intérieur brut (PIB) de la France est à rapporter à la progression de 6,8 points de celui de l’Allemagne. La bonne santé financière des entreprises allemandes leur a probablement permis d’augmenter leurs dépenses en recherche et développement et, plus généralement, d’améliorer leur compétitivité hors prix.
Au fond, en matière de compétitivité, l’exception serait plutôt l’Allemagne. Cette observation ne nous autorise cependant pas à évacuer le problème. Bien que nous disposions de secteurs économiques très dynamiques à l’exportation, comme l’aéronautique, l’agroalimentaire ou le secteur de la santé et de la pharmacie, l’effritement de nos performances dans ces domaines montre que nous avons du pain sur la planche !
Le décrochage de la France par rapport à l’Allemagne s’explique aussi par l’évolution divergente des coûts salariaux. Dans l’industrie manufacturière, le coût salarial horaire est désormais à un niveau quasiment identique dans les deux pays : environ 33 euros en 2008. Mais il faut intégrer dans l’analyse le fait que ces entreprises recourent à des services ; or, dans cette branche, le coût salarial horaire est plus élevé en France – 32 euros – qu’en Allemagne – 26 euros.
Sur la base de ce constat, comment peut-on améliorer la compétitivité de l’économie française ? Il convient de replacer la question dans un contexte plus large.
Le modèle économique allemand a dû faire face, dans les années 1990, au choc de la réunification, qui a provoqué une augmentation des salaires réels beaucoup plus rapide que dans notre pays ; à l’inverse, l’Allemagne a mené, dans les années 2000, une politique de modération salariale. La France a connu une évolution plus conforme à celle de ses autres partenaires économiques.
Par ailleurs, la question du pouvoir d’achat ne peut être balayée d’un revers de la main. Dans notre pays, la consommation a toujours été le moteur de la croissance – y compris dans la période difficile que nous venons de traverser, avec une crise économique mondiale sans précédent. Or, si la divergence des rythmes de progression des salaires en France et en Allemagne a eu des effets négatifs sur notre compétitivité, elle a permis de soutenir durant la crise de 2008-2010 le pouvoir d’achat des ménages français, qui a continué de progresser malgré l’ampleur de la récession mondiale.
Cela est dû, non seulement au plan de relance, dont les mesures ont été ciblées sur les ménages les plus modestes, mais également à la loi de modernisation de l’économie qui a permis à la France d’avoir de meilleurs résultats que l’Allemagne en matière d’évolution des prix. Ainsi, la hausse des prix à la consommation des produits alimentaires est, en glissement annuel, de 0,8 % en France entre février 2010 et février 2011, contre 2,5 % en Allemagne et 2 %, en moyenne, dans la zone euro. Le résultat a été que, durant la crise, le pouvoir d’achat s’est mieux tenu en France que dans le reste de la zone euro, où il était en légère régression.
Il a été émis l’idée d’un transfert de la charge du financement de la protection sociale du travail vers la consommation ; c’est un débat qu’il faut avoir, car, comme je l’ai dit, il ne peut y avoir de sujet tabou. Cependant, le Gouvernement doit prendre en considération le rôle joué par la consommation dans notre pays, ainsi que les attentes de nos compatriotes en matière de pouvoir d’achat. Une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée provoquerait obligatoirement une hausse des prix, ce qui aurait un impact négatif sur le pouvoir d’achat des ménages. Dans le contexte actuel, marqué par un risque inflationniste lié au contexte international, il ne me semble pas opportun de s’engager dans cette voie.
Par ailleurs, avec l’adoption du projet de loi de finances rectificative, nous venons d’achever une longue séquence dominée par d’importantes réformes fiscales et sociales. Nos entreprises aspirent à la stabilisation de leur cadre d’activité – c’est une demande récurrente de leur part. Il convient de ne pas changer en permanence les règles du jeu. En outre, plusieurs dispositions incluses dans la réforme de la fiscalité du patrimoine concourront au renforcement de la compétitivité de notre économie.
En premier lieu, le Gouvernement a veillé à répondre au besoin de financement des petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à la nécessité de renforcer leurs fonds propres et de stabiliser l’actionnariat familial, de manière à éviter les délocalisations. L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été en grande partie responsable du départ de certaines de nos entreprises hors du territoire national, de leur vente, ou de leur faible croissance, faute d’investissement suffisant – autre différence avec le système économique allemand. C’est pourquoi nous avons décidé de laisser inchangé le dispositif de réduction de cet impôt pour souscription au capital d’une PME – qui a permis près d’1,4 milliard d’euros d’investissements dans les petites et moyennes entreprises en 2010 –, tout en allégeant le barème de l’ISF.
Par ailleurs, nous avons assoupli le régime des « pactes Dutreil », qui prévoit, en cas de signature d’un engagement de conservation des titres d’une société, une exonération de 75 % des droits de succession ou de donation, ainsi que de l’impôt de solidarité sur la fortune applicable aux titres concernés : l’entrée de nouveaux actionnaires dans les pactes sera facilitée et les avantages fiscaux seront maintenus en cas de sortie d’un actionnaire.
La suppression de la taxe professionnelle, impôt antiéconomique dont les bases risquaient de s’effriter à moyen terme, et son remplacement par un financement plus stable et plus dynamique contribueront également à améliorer la compétitivité de nos entreprises. Cette réforme sans précédent, qu’aucun gouvernement n’avait osé entreprendre, a été saluée par le Fonds monétaire international, par l’Organisation de coopération et de développement économique et par la Commission européenne. Elle permet d’alléger de quelque 4,7 milliards la charge fiscale globale des entreprises, en priorité au bénéfice des PME et des entreprises industrielles, avec des allégements de charges allant jusqu’à 40 % voire 60 % dans certains secteurs.
En lançant la révision générale des politiques publiques (RGPP), le Président de la République souhaitait simplifier et réorganiser notre administration. Dès que j’ai été nommé, j’ai décidé d’instituer, dans chaque département, un « correspondant PME » – à qui j’ai demandé de réaliser un stage en entreprise –, et j’ai lancé des « Assises de la simplification » ; inutile de vous dire que les premières réunions ont provoqué quelques sourires ironiques chez les acteurs économiques : le coup de la simplification, on leur avait déjà fait plusieurs fois ! Et pourtant, je n’ai pas sorti des projets tout faits des tiroirs de l’administration : les quatre-vingts décisions qui ont été présentées le 29 avril dernier répondent vraiment aux attentes des acteurs Elles résultent d’une démarche nouvelle, à laquelle ont été associés tant le Parlement que le secteur économique. D’ailleurs, le président Jean-Luc Warsmann – à qui le Président de la République a confié une mission de simplification – et M. Jean-Michel Aulas ont coprésidé ces assises. Bref, le 29 avril, les acteurs économiques n’arrivaient pas à y croire : on annonçait enfin des mesures qu’ils réclamaient en vain depuis des années !
Il m’est impossible de toutes les citer. Une circulaire, parue il y a quelques jours, prévoit qu’à partir du 1er octobre prochain, les textes réglementaires concernant les entreprises n’entreront en vigueur que deux fois par an, le 1er janvier et le 1er juillet ; alors que, lors des discussions interministérielles, cette mesure s’était initialement heurtée à une opposition, tout le monde s’y est finalement rallié et travaille à la rendre applicable au jour dit ! Les acteurs économiques et les salariés se plaignaient de ne rien comprendre aux bulletins de paye : à partir du 1er janvier prochain, leur nombre de lignes sera divisé par deux. Au titre des investissements d’avenir, on étudie la mise en place d’une « armoire sécurisée numérique », qui permettra aux acteurs économiques de ne donner qu’une fois par an des informations sur leur entreprise. Enfin, la déclaration sociale nominative permettra de remplacer les trente déclarations différentes aujourd’hui requises.
Toutes ces dispositions permettront d’améliorer la compétitivité de notre économie, notamment par rapport à l’Allemagne. À l’occasion de ces Assises, de nombreux acteurs économiques m’ont signalé que la transposition des directives européennes était souvent plus compliquée en France qu’en Allemagne. Il serait bon de renforcer la cohérence entre les pays européens dans ce domaine.
Au total, le cabinet Ernst & Young estime que ces mesures permettront de rendre aux acteurs économiques l’équivalent de 1 milliard d’euros ; chaque fois que l’on supprime une déclaration sociale, cela représente une économie de 27 millions d’euros pour le secteur concerné !
On pourrait évoquer aussi le crédit d’impôt recherche, qui, dans toutes les enquêtes, est cité comme la première source d’attractivité de la France. Les entreprises allemandes ont pu investir dans la recherche et le développement grâce à leurs marges élevées. Nous, nous avons décidé de mettre en place un crédit d’impôt de 30 % des dépenses de recherche et développement jusqu’à 100 millions d’euros, et de 5 % au-delà de ce montant ; les entreprises entrant pour la première fois dans le dispositif bénéficient d’un taux de 40 % la première année, puis de 35 % la deuxième année. Cette mesure a eu des effets significatifs sur le niveau d’investissement en recherche et développement ; comme 1 euro investi génère une augmentation de 2 euros du produit intérieur brut dans un délai de quinze ans, elle contribue à créer des emplois, du pouvoir d’achat et des ressources pour les collectivités publiques. En 2008, 3 000 entreprises ont bénéficié du dispositif, dont 60 % n’avaient pas d’activité de recherche et développement auparavant. Les PME, qui représentent les deux tiers des nouveaux entrants, sont les principales bénéficiaires de la réforme. L’Allemagne commence d’ailleurs à s’intéresser à cet outil.
Avec le Grand emprunt, le Gouvernement a là encore fait le choix d’investir dans l’avenir, ce qui pouvait paraître risqué au moment de la crise. La contribution de l’État s’élève à 35 milliards d’euros, mais, si l’on tient compte du secteur privé, ce sont au total 60 milliards d’euros qui seront investis, parfois dans l’humain, massivement dans le numérique, dans le développement durable, et, plus généralement, dans tout ce qui concerne la recherche et l’enseignement supérieur. Cela aussi peut contribuer à réduire l’écart de compétitivité avec l’Allemagne.
Nous avons eu raison d’aller jusqu’au bout de la réforme des retraites : l’INSEE l’a montré, il s’agit d’un facteur de compétitivité pour notre pays. Nous ne pouvions pas regarder nos voisins allemands faire des réformes sans réagir ! L’INSEE table aujourd’hui sur une augmentation continue de la population active jusqu’en 2060, alors que les projections précédentes prévoyaient une stagnation.
Enfin, il est essentiel de parvenir à une meilleure maîtrise de la dépense publique, comme les ministres du budget successifs s’y sont employés. Le désengagement de l’État est un facteur important d’amélioration de la compétitivité de notre économie.
J’espère vous avoir convaincu qu’il existe de multiples leviers permettant de réduire l’écart de compétitivité existant entre la France et l’Allemagne – qui est le meilleur élève de la zone euro. Soyez assurés que, depuis quatre ans, le Gouvernement s’applique à tous les utiliser.
M. Paul Giacobbi. J’approuve globalement ces propos.
Cela étant, on a trop tendance à parler de la compétitivité-coûts alors que cette approche est très partielle et sans grande signification économique – à moins que l’on ne considère que le Soudan est le pays le plus compétitif au monde et que la Suède est un pays très défavorisé.
S’agissant de la compétitivité-prix, je rappelle que le prix résulte de nombreux facteurs, dont la variation des changes nette des différentiels d’inflation. C’est ainsi qu’un abaissement de prix de 20 % peut en réalité, sur une durée courte, dépasser ce taux.
La compétitivité des territoires doit également être relativisée. On peut attirer de très nombreuses entreprises mais très peu de valeur ajoutée et assez peu d’emplois : ce sera le cas, par exemple, s’il s’agit de sièges sociaux et non d’unités de production, ou encore s’il y a beaucoup d’input pour beaucoup d’output. Ce qui compte, en dernière analyse, est la concurrence dans la localisation de la valeur ajoutée. À cet égard, on peut se demander si l’Allemagne localise autant de valeur ajoutée que cela. À l’inverse, la Chine en localise beaucoup, mais pour le compte d’entreprises dont le siège est en général au Japon.
Des travaux que j’ai menés à ce sujet, il ressort trois traits dominants concernant la France.
Premièrement, on nous reproche de ne pas être favorables à l’entreprise : les Français ne sont pas business friendly.
Deuxième reproche, nous ne sommes pas stables. Le système du crédit d’impôt recherche est par exemple reconnu, notamment par les think tanks de Washington, comme le meilleur au monde, à ceci près qu’une incertitude pèse sur sa pérennité. Les investissements concernés étant de long terme, la moindre modification inquiète car elle fait présager des changements plus profonds. La France est également perçue comme socialement instable, au point que l’on craint d’y être confronté à des phénomènes violents. Les séquestrations de chefs d’entreprise – le bossnapping – ont eu des effets dévastateurs.
Troisièmement, nous ne sommes pas flexibles. « We don’t want to be trapped in France », ai-je entendu dire à plusieurs reprises aux États-Unis : nous ne voulons pas rester prisonniers en France ! C’est ainsi que M. Azim Premji, une des plus grosses fortunes de la planète, créateur d’une des plus grandes entreprises de logiciels au monde, se trouve confronté à de grosses difficultés pour trois salariés protégés dont il ne peut se défaire, alors qu’il a décidé de faire de la France une de ses cibles d’investissement – ce qui représente 5 000 emplois potentiels au minimum dans les prochaines années.
Cela étant, un article paru récemment dans le Financial Times invoque le Grand emprunt et le Grand Paris pour conclure que la France est un pays qui bouge encore.
M. le président Bernard Accoyer. Le temps du secrétaire d’État étant contingenté, je pense qu’il répondra globalement aux questions que nous lui poserons.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, je partage votre appréciation au sujet du rapport sur la compétitivité signé par trois organisations patronales et trois organisations de salariés. Ce document indique par exemple – en cette semaine où nous avons beaucoup parlé de l’impôt de solidarité sur la fortune – que, parmi les éléments qui ne permettent pas aux petites et moyennes entreprises de grandir, figure la difficulté liée aux modalités de fiscalité de l’ISF dans le transfert de génération.
S’il fallait établir une hiérarchie entre les actions prioritaires en matière de compétitivité – coût salarial, innovation, rigidités excessives du code du travail, formation professionnelle –, quel point feriez-vous ressortir comme le plus important ?
S’il fallait, pour réduire le poids des cotisations sur le travail, transférer les 5,4 points de cotisations familiales, qui représentent 33 milliards d’euros, à quelles recettes de substitution votre préférence irait-elle ?
En matière d’investissements étrangers en France, on a tendance à beaucoup s’autocongratuler alors que le système fiscal français favorise les achats d’entreprises. J’aimerais pour ma part qu’une étude montre ce que celles-ci deviennent cinq ans après. Quel est le solde des emplois réellement créés ? Peut-être arrêterions-nous alors de nous féliciter d’être le deuxième pays pour ce qui est des investissements étrangers.
M. Nicolas Forissier. Par rapport aux pays comparables, les petites entreprises françaises ont des difficultés à se financer dans la période qui suit leur création – c’est ce que l’on appelle l’equity gap. Les fonds propres nécessaires correspondent en général à des sommes limitées – 200 000 euros à 500 000 euros –, mais ils permettent à l’entreprise de prendre son envol et de créer de l’emploi. On a créé un très grand nombre d’entreprises à statut d’auto-entrepreneur ou d’entreprise personnelle, mais très peu qui recrutent par la suite des salariés. Toutes les comparaisons le montrent, et la Commission des finances y a consacré une étude précise.
Une mesure simple pour renforcer les fonds propres de ces entreprises consisterait à harmoniser la réduction d’impôt sur le revenu pour les personnes qui investissent dans une petite entreprise au sens communautaire – chiffre d’affaires ou total du bilan inférieur à 10 millions d’euros. Un couple peut actuellement bénéficier de 22 % de réduction d’impôt pour un investissement maximum de 100 000 euros. Mais, au Royaume-Uni, ce seuil est passé à 1 million d’euros, et les États-Unis sont en train d’affecter beaucoup de moyens à une mesure du même ordre. En dépit d’avancées – la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune et du « bouclier fiscal » notamment –, nous accusons encore un certain retard. La mesure que je préconise n’aurait presque aucune incidence budgétaire puisqu’elle resterait dans le cadre du plafonnement global des niches. Il faut que les personnes se dirigent d’abord vers l’investissement dans l’entreprise et non vers des incitations fiscales moins productives en matière d’emploi.
Pour ce qui est du principal moyen d’aider les exportateurs, à savoir le soutien à la présence des petites entreprises dans les foires et salons, l’effort public français est depuis longtemps trop faible par rapport à celui de nos concurrents, y compris les pays réputés en difficulté comme l’Espagne, le Portugal ou l’Italie. Je m’interroge sur la capacité de l’appareil d’État et du monde politique à comprendre la nécessité de dégager plus de moyens, quitte à faire des choix budgétaires, pour soutenir nos petites entreprises sur les marchés internationaux et émergents. À titre d’exemple, 67 % de nos exportations agroalimentaires se font en direction de l’Union européenne alors que ce marché est saturé et de plus en plus concurrentiel, alors que l’on devrait plutôt se renforcer dans des pays comme l’Inde ou la Chine.
M. Marc Goua. Il faut ajouter à ces arguments que le système bancaire français ne facilite pas le démarrage et la consolidation des entreprises.
En matière de simplification, monsieur le secrétaire d’État, je vous suggère de passer aux travaux pratiques. J’ai reçu une lettre d’une entreprise employant 110 personnes et bénéficiant du crédit d’impôt recherche dans le domaine de l’artisanat. Celle-ci est confrontée au zèle de l’administration fiscale, à tel point que le dépôt de bilan interviendra dans les jours qui viennent si la situation n’est pas débloquée. Je vous remettrai le dossier avant que vous ne partiez.
M. Marc Laffineur. Il est dommage que nous n’ayons pas davantage de temps pour discuter de sujets aussi importants.
M. le président Bernard Accoyer. Ce n’est pas notre fait.
M. Marc Laffineur. En matière de compétitivité, tout ne va pas mal dans notre pays, loin de là. Des améliorations sont intervenues depuis quelques années et il important de le souligner.
Ma question porte sur la concurrence fiscale au niveau européen. L’harmonisation comptable pose une difficulté évidente : s’agissant notamment de l’impôt sur les sociétés, les bases fiscales des filiales d’un même groupe dans différents pays ne sont pas les mêmes, ce qui est un facteur de rigidité et d’accroissement des coûts de fonctionnement.
Par ailleurs, quelles priorités dégagez-vous pour permettre à la France de combler sa différence de compétitivité avec l’Allemagne ?
Outre l’insuffisance de la taille des PME françaises, n’y a-t-il pas aussi un manque de coopération avec les grandes entreprises ? Les pôles de compétitivité apportent une amélioration mais sans doute faut-il faire plus.
M. Gérard Cherpion. Vous êtes en charge des entreprises peu ou pas délocalisables, monsieur le secrétaire d’État. Les petites et moyennes entreprises, l’artisanat et le tourisme, qui sont des secteurs importants à la fois en termes d’emploi et en termes de développement économique, créent une compétitivité de nature endogène.
Le problème de la sous-capitalisation des PME et celui de leur transmission ont déjà été évoqués. Faute de repreneurs, 60 000 entreprises disparaissent chaque année à l’occasion d’une succession.
L’application des normes soulève également de grandes difficultés. Dans le secteur du tourisme, elle risque même de faire disparaître l’hôtellerie familiale tant les délais imposés sont brefs. De même, certains jeunes ne peuvent avoir accès à une formation du fait des règles imposées. Ils ne peuvent travailler en hauteur, par exemple, ce qui rend difficile l’apprentissage du métier de charpentier !
Enfin, le crédit d’impôt recherche est un outil remarquable mais l’administration doit se montrer beaucoup plus réactive pour répondre aux besoins des entreprises.
Mme Marie-Hélène Thoraval. Pour les petites entreprises, l’investissement passe généralement par le concours bancaire et force est de reconnaître que les banques restent frileuses.
En matière de trésorerie, M. Nicolas Forissier souligne à juste titre la difficulté considérable que représente le besoin en fonds de roulement lors des premières années de l’entreprise. Quel accompagnement mettre en place ?
S’agissant des grandes entreprises, les aides à l’investissement dans les outils de production sont nettement moins élevées en France qu’en l’Allemagne, en particulier si l’on pense aux dispositifs mis en place après la réunification. Et cette différence de compétitivité ne tient pas à la compétitivité-coûts, notion qu’il conviendrait à mon sens d’écarter.
Pour ce qui est de l’innovation, la France n’a pas à rougir par rapport à l’Allemagne : les Français sont nettement plus innovants que leurs voisins, et j’aimerais que l’on mette plus souvent cet élément en exergue.
M. Jean Grellier. La faiblesse du tissu des entreprises de taille intermédiaire (ETI) est souvent dénoncée. Quelle est votre appréciation à ce sujet ? Quelles sont les mesures envisageables pour remédier à ce problème structurel ?
Par ailleurs, le développement économique et industriel de la France ne passe-t-il pas par une nouvelle étape de la construction européenne ? Seules des politiques économiques fortes au niveau européen permettront d’équilibrer les effets de la mondialisation. Quelle est la position du Gouvernement ?
Enfin, à l’inverse de Paul Giacobbi, je pourrais produire l’exemple de « salariés protégés » qui, il y a un an, ont sauvé leur entreprise de la défaillance du repreneur, chose bien trop commune dans notre pays.
M. le président Bernard Accoyer. Je ne doute pas, monsieur le secrétaire d’État, que vous saurez répondre de façon synthétique et claire à ces nombreuses questions dans le temps qui nous reste.
M. le secrétaire d’État. J’essaierai d’être compétitif, monsieur le président !
Je partage une grande partie de votre constat, monsieur Paul Giacobbi, et je vous remercie d’avoir salué la politique menée. En effet, sur certains points comme le crédit d’impôt recherche, notre pays est cité en exemple dans le monde entier.
Concernant le risque social, également pointé par le président Pierre Méhaignerie, j’ai bien noté votre appel à plus de flexibilité. Lorsque des groupes ont à arbitrer sur une implantation, ils y regardent à deux fois avant de venir dans notre pays. Nous devrons donc examiner les différentes questions – notamment celle des seuils – avec les partenaires sociaux.
Parmi les priorités que me demande de dégager le président Méhaignerie, je privilégierai peut-être la question de la rigidité du code du travail et celle de la flexibilité. C’est en effet le point sur lequel il est le plus compliqué d’agir car il correspond à un problème de société. Nous sommes très actifs dans tous les autres domaines mais, quel que soit le gouvernement, il faudra fournir un effort considérable pour trouver avec les partenaires sociaux le point d’équilibre en matière de flexibilité. Je n’ai pas retenu la question des seuils dans mes 80 décisions mais il faut y travailler car c’est un sujet très important aux yeux des acteurs économiques et des investisseurs.
Il me semble difficile, je l’ai dit, de transférer les recettes des cotisations familiales vers la taxe sur la valeur ajoutée, tant le pouvoir d’achat et la consommation sont un moteur essentiel. Un transfert vers la contribution sociale généralisée entamerait également le revenu disponible des ménages. Face à cette difficulté, le Gouvernement attend de votre mission d’information qu’elle ouvre des perspectives.
Je remercie M. Nicolas Forissier d’avoir affirmé que beaucoup a été fait en matière d’effort public en faveur des petites et moyennes entreprises. Son intervention et celle d’autres membres éminents de la Commission des finances n’y sont pas étrangères. Nous devons poursuivre dans cette voie. La réforme de la fiscalité du patrimoine représente une avancée considérable pour les PME.
Je suis de ceux qui pensent que l’on doit étudier également les solutions existant aux États-Unis ou en Israël : au lieu de multiplier les dispositifs publics complexes, ces pays favorisent l’« investissement à l’aveugle » via un business angel ou un fonds qui risque son propre argent dans l’investissement et en qui on peut, par conséquent, avoir confiance. Cela permettrait d’aider des acteurs viables et de développer les ETI, dont vous êtes nombreux à avoir relevé qu’elles sont en nombre insuffisant en France. Les entreprises qui se créent dans notre pays sont de taille réduite puisqu’elles comprennent en moyenne seulement 2,8 salariés, alors qu’on en compte 4,5 en Allemagne et 6 aux États-Unis.
En quatre ans, l’effort d’aide à la création d’entreprises a donné des résultats. Nous devons maintenant donner la priorité à l’accompagnement de leur développement. Je suis en train de réfléchir à des outils destinés, par exemple, à faciliter le choix du statut au moment de la création ou de la fusion et à aider l’entreprise à atteindre une taille critique.
Lors de mes fréquents déplacements dans les départements, les artisans, les commerçants et les petits entrepreneurs que je rencontre se plaignent toujours de leurs difficultés à obtenir du crédit, alors même que le médiateur du crédit annonce que les prêts aux petites et moyennes entreprises sont repartis à la hausse. Je me suis penché sur la question et me suis aperçu que les crédits inférieurs à 25 000 euros ne faisaient l’objet d’aucun suivi de la Banque de France. Madame Christine Lagarde et moi-même avons donc missionné le médiateur du crédit pour qu’il établisse un indicateur pour cette tranche. Devant mon insistance, la Banque de France a d’ores et déjà mené une recherche, et il apparaît que les petits crédits évoluent beaucoup moins à la hausse que les autres.
Le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité – EIRL –, que vous avez bien voulu voter, nous aidera à remédier à ce problème dans la mesure où il protège les petits acteurs et met fin à une inégalité devant le risque. Il aura néanmoins fallu que je me batte pour obtenir un accord avec OSÉO et la société interprofessionnelle artisanale de garantie des investissements (SIAGI) sur des garanties à hauteur de 70 %. En outre, j’ai signé il y a dix jours, avec l’ensemble des réseaux bancaires, un accord par lequel ceux-ci s’engagent à ne pas prendre de garanties supplémentaires sur les acteurs économiques.
Vous avez raison, madame Marie-Hélène Thoraval, nous n’avons pas à rougir en matière d’innovation. Nos savoir-faire et notre système de formation sont reconnus dans le monde entier. Il faut y ajouter le crédit d’impôt recherche et le Grand emprunt, qui a permis, pour la première fois depuis bien longtemps, de lancer de grands investissements d’avenir.
Bref, nous avons des atouts. C’est peut-être une maladie française que de toujours essayer de compenser ses faiblesses et d’oublier qu’il faut soutenir ce qui fait notre force : les secteurs qui marchent, les personnes qui entreprennent et qui réussissent.
M. Marc Laffineur soulève à juste titre le grave problème de la concurrence fiscale. Pour ce qui est de l’Irlande, le Président de la République et le Gouvernement se sont engagés à ce qu’une concurrence déloyale ne mette pas à mal nos entreprises et notre système économique. À mon sens, il faut aller vers une harmonisation des assiettes fiscales, comme le prévoit d’ailleurs une directive en cours de discussion. En matière de fiscalité, nous avons besoin de plus d’Europe. Ce n’est pas un hasard si la France et l’Allemagne sont en pointe dans cette évolution.
Les acteurs économiques évoqués par M. Gérard Cherpion ne sont pas délocalisables, en effet, et c’est peut-être ce qui explique que les administrations omettent souvent de les soutenir. Pourtant, les artisans, les commerçants, les métiers du tourisme, jouent un rôle essentiel : aussi faut-il leur donner les moyens d’être concurrentiels et compétitifs. On doit en particulier prendre en compte la mutation profonde que la mondialisation et l’internet ont imprimée à nos modes de consommation : on consomme désormais tous les jours de la semaine.
La question du travail le dimanche a fait l’objet d’un compromis, mais l’équilibre n’est pas toujours satisfaisant. Dans le quartier des Abbesses, à Paris, qui est à l’évidence très touristique, certains commerçants ont le droit d’ouvrir le dimanche parce que la mairie les a classés en zone d’affluence touristique exceptionnelle, mais pas les autres, alors qu’ils sont dans la même rue. Le montant des baux ayant été multipliés par trois, le seul moyen de s’en sortir est pourtant d’ouvrir le dimanche, y compris en embauchant un salarié.
Bref, nous devons garder les yeux ouverts et être réactifs et modernes.
Je vous propose, monsieur le président, que nous poursuivions ultérieurement ce dialogue, soit dans cette enceinte, soit directement avec les parlementaires qui le souhaiteraient. Permettez-moi de saluer encore le travail que votre mission accomplit sur un sujet essentiel pour le pays.
M. le président Bernard Accoyer. Nous aurions naturellement encore des questions à vous poser. Je regrette que nous ne puissions le faire car cette mission d’information est très importante. C’est bien souvent parce que l’on traite les sujets trop rapidement que l’on ne résout pas les problèmes dans notre pays.
M. le secrétaire d’État. C’est bien pourquoi j’ai tenu à être présent devant la mission.
M. le président Bernard Accoyer. Nous vous transmettrons les questions qui n’ont pu être posées aujourd’hui et nous souhaiterions que les différents départements du ministère y répondent car ces éléments sont importants pour nos deux rapporteurs.
*
AUDITION DU 22 JUIN 2011
Audition de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé
M. le président Bernard Accoyer. Nous arrivons au terme des auditions de notre mission. Au cours de 18 réunions, nous avons reçu 90 personnes d’horizon très divers : des économistes, des chefs d’entreprise, des représentants syndicaux, des directeurs d’administration ou des chercheurs en sciences sociales. Le bilan de ce travail est considérable. Après avoir écouté la semaine dernière M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, nous recevons aujourd’hui M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, dont plusieurs domaines de compétence recouvrent le sujet que nous devons traiter : comment assurer le financement de notre protection sociale tout en préservant la compétitivité de notre économie ?
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé. La compétitivité de notre pays et le financement de la protection sociale se trouvent, en effet, au cœur des préoccupations de mon ministère. Et j’ai le sentiment que depuis 2007, conformément aux engagements pris par le Président de la République, nous avons mis en œuvre des réformes importantes en ce domaine. En particulier, nous avons cherché à améliorer le fonctionnement du marché du travail, à ne pas augmenter le coût du travail et à garantir le financement de la protection sociale.
La réforme du fonctionnement du marché de travail visait, tout d’abord, à rendre celui-ci plus compétitif. Mais nous n’oublions pas que, dans la conception française, le droit du travail protège. Il existe des règles complexes – trop complexes sans doute, assorties de multiples seuils et souffrant d’une réelle instabilité juridique, mais dont la vocation reste de protéger les salariés. Nous devons en tenir compte.
Les mesures prises depuis 2007 ont été élaborées dans le cadre d’un dialogue social régulier, conformément à la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, dite loi « Larcher », qui oblige le Gouvernement, lorsqu’il veut engager des réformes dans certains domaines, à organiser préalablement une concertation avec les partenaires sociaux. La rupture conventionnelle, destinée à assouplir la rigidité des rapports de travail, a été adoptée dans cet esprit, de même que la mise en place du service minimum dans les transports qui évite le blocage économique de notre pays en cas de grève. La création de Pôle emploi a par ailleurs facilité la mise en relation des demandeurs d’emploi et des entreprises à la recherche de main-d’œuvre. La fusion entre le réseau des Assedic et l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) devrait permettre de lutter contre un phénomène inexplicable aux yeux de nos concitoyens, celui des métiers en tension. Le fait que près de 260 000 offres d’emplois ne soient pas pourvues dans le délai requis prouve d’ailleurs que la France sort progressivement de la crise et que la création d’emplois est relancée mais si nous ne faisons rien, 36,7 % des offres d’emplois seront très difficiles, voire impossibles à pourvoir naturellement. Cela constitue un frein à la compétitivité, car un salarié que l’on ne trouve pas, c’est aussi un marché que l’on ne peut pas prendre.
Si, sur tous ces sujets, nous avons avancé, nous devons aller plus loin et envisager de nouvelles réformes. Pour cela, je crois à la négociation collective, pas seulement parce qu’elle nous est imposée par la loi « Larcher », mais parce que c’est grâce à cette méthode que nous avons pu entreprendre la réforme du temps de travail et diviser par deux le nombre d’articles du code du travail dans ce domaine.
Le taux de chômage chez les jeunes ne constitue pas seulement un risque social d’une très grande importance mais aussi un frein à la compétitivité. Le développement de la formation en alternance, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage participe donc de la même logique, car les jeunes représentent une véritable force pour le marché du travail.
Au cœur de la crise, le Gouvernement a mis en place le système de l’activité partielle – appelé dans d’autres pays chômage partiel. Il constitue une protection pendant la crise elle-même, mais permet surtout à l’entreprise de ne pas se séparer de salariés dont elle aura besoin sitôt l’économie relancée, et donc de s’épargner de nouveaux recrutements. Cela participe aussi de la compétitivité de notre économie.
Il en va de même de la sécurisation des parcours professionnels ou du système d’indemnisation du chômage. Certes, la convention d’assurance chômage a été reconduite à l’identique par les partenaires sociaux, ce qui était probablement, en période de crise, la meilleure solution. Mais la réflexion se poursuit, au sein de groupes de travail, sur l’élaboration d’un dispositif plus efficace, pour mieux inciter au retour à l’emploi. Les comparaisons internationales ne sont pas là, en effet, à notre avantage.
Ensuite, nous avons pris des mesures pour ne pas accroître le coût du travail. Depuis 2007, nous avons veillé à ce que l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) soit en phase avec celle de l’économie, en rompant avec la pratique démagogique des « coups de pouce » systématiques. Ils donnent le sentiment de faire plaisir à tout le monde, mais ils ne satisfont que 11 % des salariés et produisent un effet d’écrasement sur les autres salaires – sans parler de leur coût économique. La loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, que j’ai fait voter, a modernisé le mode de fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance : un groupe d’experts se prononce désormais en toute indépendance.
J’en viens à la question du temps de travail. Aujourd’hui, les 35 heures n’existent plus comme plafond dans notre pays : nous sommes sortis du système tel qu’il avait été bâti, et la limite maximale du temps de travail est la limite européenne, visant à préserver la santé des salariés. Lorsque l’on veut travailler plus, aucune autorisation administrative n’est nécessaire, il suffit de négocier au sein de l’entreprise. Les 35 heures ne représentent que le seuil de déclenchement de la majoration de salaire liée aux heures supplémentaires, dont profitent plus de 7 millions de salariés. Il en résulte une plus grande souplesse et une amélioration du pouvoir d’achat. Or, dans un pays comme le nôtre, la reprise économique repose certes sur l’investissement des entreprises, mais aussi sur la consommation des ménages. Pour un salarié payé au salaire minimum interprofessionnel de croissance, deux heures supplémentaires par semaine rapportent 100 euros par mois de plus, net de prélèvements, et donc 1 200 euros par an. Cela compte.
J’évoquerai brièvement, enfin, le financement de la protection sociale, qui constitue un droit dans notre pays. On a souvent tendance à la considérer comme une charge, mais elle est aussi un atout en matière de compétitivité, ainsi qu’un facteur de croissance. Le secteur de la santé, s’il est bien géré de façon à éviter les gaspillages et la fraude, participe à la croissance économique. En outre, la protection sociale a joué un rôle indéniable d’amortisseur pendant la crise.
Des réformes demeurent toutefois indispensables pour réduire les déficits et préserver notre système. La réforme des retraites qu’a portée M. Éric Woerth permettra de rétablir l’équilibre financier dès 2018 et sera un gage de croissance économique : nous avons fait le choix d’augmenter notre population active – alors que tant de pays ont du mal à en maintenir le niveau –, et surtout, nous avons refusé la hausse massive des prélèvements, qui nuisent à la compétitivité et à la croissance.
La révolution de l’emploi des seniors suit la même logique : la fin du système des préretraites dans le secteur public, la taxation des préretraites dans le privé, la libéralisation du cumul entre emploi et retraite vont dans le sens d’une meilleure compétitivité.
Il en est de même quand le Gouvernement parvient à tenir l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Certains voudraient une augmentation plus importante, mais je préfère demander des efforts en fixant une progression de 2,8 % plutôt que de devoir, un jour, exiger un véritable sacrifice en imposant une évolution négative.
Sur le long terme, la compétitivité d’un pays dépend également de sa natalité. Le taux de natalité actuel constitue un atout pour l’économie de notre pays, et notre politique familiale n’y est pas pour rien. Nous avons la chance d’avoir l’un des meilleurs taux d’activité des femmes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce que nous envient beaucoup de nos voisins, notamment les Allemands. Nous poursuivons également notre politique en faveur de l’égalité salariale et de la conciliation entre vie familiale et professionnelle.
Si, depuis 2007, plusieurs ministres se sont succédé, la politique de ce ministère est restée la même, et il a apporté sa contribution à la compétitivité de notre économie. Mais tout cela ne suffit pas, compte tenu de la compétition internationale. Nous devons continuer sur la voie des réformes pour que la France conserve sa position enviée dans le peloton de tête des nations industrielles.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. La plupart des personnes que nous avons auditionnées ont bien voulu reconnaître les efforts accomplis en faveur de l’industrie et de la compétitivité : la réforme de la taxe professionnelle, les crédits d’impôts, la souplesse en matière de temps de travail, les valorisations de salaire… Mais tous ont également estimé que d’autres réformes étaient nécessaires, compte tenu de la concurrence mondiale et de ce que l’Allemagne a réalisé au cours des dix dernières années. Divers enjeux ont été identifiés au cours des auditions : l’innovation et la formation professionnelle ; le coût du travail, et en particulier le poids des charges sociales ; les rigidités excessives et la complexité juridique, notamment du code du travail ; l’aspect culturel, enfin : la France aime-t-elle son industrie ? Selon quelle hiérarchie classez-vous ces différentes priorités ?
Par ailleurs, 5,4 %de cotisations familiales pèsent sur le travail. Ne pourrait-on pas les transférer progressivement vers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou l’impôt sur le revenu ?
Enfin, nous avons beaucoup de mal à orienter les jeunes vers l’industrie. Comment la rendre attractive à leurs yeux ? Comment les convaincre que ce secteur a de l’avenir ? La pénibilité n’est-elle pas un élément qui désoriente les familles ?
Je rappelle que dans le bassin d’activité que vous avez récemment visité, 300 offres d’emploi ne font l’objet d’aucune candidature.
M. Marc Laffineur. Des mesures comme la rupture conventionnelle ou le crédit d’impôt recherche ont été très favorables à notre compétitivité. Néanmoins, des efforts restent à accomplir, notamment sur les effets de seuil et la réglementation du travail. Celle-ci n’est-elle pas plus compliquée en France qu’en Allemagne ?
Une évaluation des différents systèmes d’exonération de charges sociales a été réalisée. Ont-ils tous le même effet sur l’emploi ?
Une réflexion est-elle en cours sur l’opportunité de transférer certaines charges vers la taxe sur la valeur ajoutée – ce que l’on appelle la « TVA compétitive » ?
Enfin, j’ai pu lire dans certains programmes politiques l’intention de revenir à la retraite à soixante ans, de créer 300 000 emplois-jeunes, de relancer le recrutement dans l’éducation nationale, la justice ou la police, de mettre en place une allocation d’autonomie pour les jeunes… Pensez-vous que de telles propositions soient en mesure d’améliorer la compétitivité de notre économie ?
M. Éric Woerth. Il existe plusieurs formes de compétitivité : la compétitivité prix – moins dégradée pour la France qu’il n’y paraissait –, la compétitivité hors-prix, et la compétitivité liée à la différence des règles sociales. M. Xavier Darcos, lorsqu’il était ministre du travail, avait lancé l’idée de simplifier le code du travail ; pour ma part, je n’ai pas eu la possibilité de poursuivre dans cette voie. Où en est-on aujourd’hui ? S’agit-il d’un faux sujet ou au contraire d’une piste à explorer ? Et dans ce dernier cas, que faudrait-il modifier ? La rupture conventionnelle a apporté un peu de souplesse, mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant.
M. Olivier Carré. De nombreux travaux ont été réalisés pour comparer les fiscalités et les économies allemande et française. La différence entre les deux systèmes concerne moins le montant global des dépenses, relativement similaire, si on le rapporte au produit intérieur brut (PIB) marchand, que l’origine des recettes. On fait plus appel à la solidarité – et donc à la fiscalité – en Allemagne qu’en France, où l’essentiel des ressources pèse sur la masse salariale. Or, les dépenses vont augmenter en raison de l’évolution démographique : le vieillissement de la population entraîne un accroissement des dépenses de santé. Dans ces conditions, il semble dangereux de faire dépendre des salaires l’environnement social de personnes qui, par définition, ne travaillent pas : l’assiette va fortement se réduire. Quelle assiette faudrait-il donc retenir ?
Par ailleurs, faut-il revisiter certaines politiques ? La politique familiale ne passe pas que par les allocations, puisque l’impôt sur le revenu est fortement lié au quotient familial. De manière générale, toute une série de politiques tournent autour de la famille.
Enfin, en tant que ministre en charge du travail et de la santé, vous discutez en permanence avec les organisations syndicales. Le mode de gouvernance des institutions de sécurité sociale a été établi à un moment historique fort pour notre pays, mais est-il toujours d’actualité ? Même si les lois sur les syndicats ont fait évoluer les choses, le mode de gestion paritaire des grandes organisations se trouve à la croisée des chemins. Faut-il faire évoluer la gouvernance à moyen terme afin de s’assurer du niveau de responsabilité des acteurs et de leur capacité à innover, tant pour ce qui concerne les politiques qu’ils gèrent que leur mode de financement ?
M. Alain Moyne-Bressand. Nous avons réalisé de nombreuses réformes afin de relancer l’activité économique et donc l’emploi : le grand emprunt, le Fonds de soutien à l’innovation, OSÉO… Mais nos banques ne jouent pas le jeu. Elles sont gérées par des financiers, non par des chefs d’entreprise, et ne soutiennent pas l’activité économique. Dans l’ensemble, nous avons de bons résultats, mais ils pourraient être supérieurs si les banquiers avaient une meilleure compréhension de ce qu’est une entreprise. Or, les responsables locaux n’ont aucun mot à dire sur les demandes de prêt : la décision est prise au niveau régional ou national, et les dossiers n’avancent pas. Nous le constatons tous les jours.
Nous avons sauvé les banques, alors qu’elles sont privées. Ne pourrait-on mieux les contrôler ? Les banques constituent une forme d’administration. Mais alors que l’administration publique a beaucoup évolué, on ne peut pas en dire autant de l’administration bancaire, bien au contraire.
M. Christian Estrosi. Comme vous l’avez rappelé, les éléments contraignants liés aux 35 heures ont tous été supprimés. Malgré cela, on assiste à des tentatives récurrentes de relancer ce débat, au risque de nuire à la souplesse acquise. Qu’en pensez-vous ?
De même, certains souhaitent ouvrir un débat sur la « TVA sociale ». Le véritable enjeu, pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, reste plutôt de faire en sorte que notre fiscalité favorise l’innovation et de réfléchir à une réforme de l’impôt sur les sociétés. En la matière, notre taux demeure le deuxième plus élevé d’Europe, après Malte, ce qui dissuade les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), de s’installer dans notre pays. En outre, d’après l’Observatoire français des conjonctures économiques, trois points de taxe sur la valeur ajoutée en plus conduisent à un point d’inflation supplémentaire. Il en résulterait également une réduction de revenu de 1,3 point pour les 10 % de ménages les plus modestes, et de 0,7 point pour les 10 % les plus aisés. Une telle hypothèse me paraît donc dangereuse pour notre croissance, pour le pouvoir d’achat des Français et donc pour la compétitivité des entreprises. J’aimerais connaître votre avis sur ce sujet.
Enfin, nous avons eu raison de supprimer la taxe professionnelle sur les investissements productifs, ce qui a fait baisser de 4,7 milliards, l’an dernier, les charges pesant sur les entreprises. Mais cette année, par d’autres biais, les charges ont de nouveau augmenté de 9 milliards. Le taux des prélèvements obligatoires sur les entreprises en France reste le plus élevé d’Europe : il atteignait 17,2 % du produit intérieur brut en 2006, soit 5,7 points au-dessus de la moyenne européenne. Cela me paraît contraire à la compétitivité, aux relocalisations, à l’emploi, et à tout ce que les États généraux de l’industrie devaient promouvoir. C’est également contraire à l’objectif de convergence fiscale avec l’Allemagne. Certes, je comprends la nécessité de réduire le déficit public, qui s’établissait à 150 milliards en 2010. Mais cela ne doit pas se faire au prix de l’innovation, de la compétitivité et de l’emploi.
M. Christian Blanc. Ce matin, sur Europe 1, un chroniqueur faisait état d’un classement des pays européens en fonction du revenu par habitant et exprimait sa surprise, au moment où nous sortons de la crise, de voir les Pays-Bas figurer en tête, avant l’Allemagne. Or, ce pays se caractérise par l’extraordinaire flexibilité de son organisation du travail, qui fait l’objet d’un consensus social très large. Là-bas, on évite de licencier, mais on n’hésite pas à baisser les salaires. Pensez-vous qu’il existe un lien direct entre les deux phénomènes : la flexibilité et le haut niveau de revenu par habitant ? Notons que la flexibilité a été mise en place à partir de mécanismes simples. Je me méfie toujours de la complexité et de l’avis technique des experts, qui font perdre l’essentiel de vue.
M. Jean Grellier. Il est difficile, sur certains territoires, de mettre en adéquation les offres et les demandes d’emploi, ainsi que l’a relevé tout à l’heure M. Pierre Méhaignerie. Vous avez évoqué, monsieur le ministre, la fusion de l’Agence nationale pour l’emploi et du réseau des Assedic et de leurs cultures respectives, le tout en pleine période de crise. Comment devrait évoluer Pôle emploi pour conforter son action, en particulier s’agissant de l’anticipation des besoins des entreprises et de la meilleure adéquation des formations et des compétences à la demande d’emploi sur les différents territoires ?
D’autres dispositifs ont été mis en œuvre, comme les maisons de l’emploi, intégrant quelquefois les comités de bassin d’emploi et les missions locales. Quel bilan peut-on tirer de ces initiatives ? Est-il possible de renforcer le dialogue social au sein de ces institutions en intégrant les chefs d’entreprises, les élus, les représentants des salariés, les services de l’État, voire les structures d’insertion, de façon à donner plus de cohérence aux mesures prises dans les territoires concernés ?
M. Gérard Cherpion. Depuis quelques années, la compétitivité de notre pays a effectivement été améliorée en matière de formation, de recherche et développement et de l’indemnisation du chômage partiel, qui a permis de sauvegarder de nombreux emplois dans les régions industrielles.
Ce qui m’inquiète, c’est l’endettement de la France : à 86 % du produit intérieur brut, nous sommes dans une zone à risques. Comment s’en éloigner tout en préservant notre compétitivité, c’est-à-dire en continuant à investir dans les domaines essentiels que sont la recherche et développement ou la formation ?
M. le ministre. Je m’exprimerai en tant que ministre du travail, de l’emploi et de la santé, mais pas uniquement, car vous m’avez posé de nombreuses questions ne relevant pas de mes attributions directes. Je vous livrerai donc certaines de mes convictions personnelles, d’autant plus que la compétitivité et le financement de la protection sociale seront, sans doute, au cœur de la campagne présidentielle.
Monsieur Gérard Cherpion, l’enjeu pour la France, dans les années qui viennent, réside à la fois dans la diminution des déficits et de la dette et la réduction du coût du travail, tout en gardant à l’esprit que les dépenses publiques génèrent en elles-mêmes de la croissance. Il faut donc faire très attention à celles que l’on réduit ou que l’on supprime.
Il en va ainsi des niches fiscales et sociales, dont il convient avant tout d’évaluer l’effet de levier. Supprimez l’avantage fiscal sur les emplois à domicile ou le taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit dans le bâtiment, et le travail clandestin se développera aussitôt. Il faut procéder à des évaluations très fines afin de déterminer si, oui ou non, ces mesures ont un effet positif.
Dans le même esprit, il convient de se demander si la puissance publique est la plus apte à gérer une activité au meilleur coût, car ce n’est pas toujours le cas. Les nombreux maires ici présents savent qu’il vaut la peine de « municipaliser » dans certains cas, mais pas toujours. Le pragmatisme doit nous guider dans la recherche d’une réduction des déficits et de la dette.
Nous devons faire face à des enjeux sociétaux : pour être acceptées, les réformes à venir devront être perçues comme justes. Et s’il faut lutter contre l’assistanat, ennemi de la valeur travail, il faut également lutter contre les injustices. Mais il existe aussi un enjeu économique : réduire les déficits et baisser le coût du travail. Les deux orientations ne sont pas antinomiques.
De même, monsieur Jean Grellier, la meilleure connexion entre les besoins des entreprises et les attentes des demandeurs d’emploi constitue un enjeu essentiel. Mais ce que vous appelez de vos vœux existe d’ores et déjà : ce sont les services publics de l’emploi. Il y a encore quelques mois, il s’agissait d’un outil très institutionnel : des réunions se tenaient irrégulièrement autour du préfet pour déterminer les attributions de chacun et évaluer les résultats. Mais nous sommes en train d’en faire une instance fonctionnelle et opérationnelle. Désormais, les services publics de l’emploi auront pour mission, dans chaque bassin d’emploi, de recenser les besoins et les problèmes d’adéquation entre l’offre et la demande. Tous les mois, seront examinés les trois à cinq métiers les plus en tension, afin de savoir qui guide les demandeurs d’emploi vers l’emploi.
J’ai à cœur de réussir jusqu’au bout la création de Pôle emploi et de lui attribuer une nouvelle feuille de route en sortie de crise. Mais si c’est une mission locale ou une maison de l’emploi qui ramène les chômeurs vers l’emploi, cela me va aussi. Pôle emploi demeure certes l’opérateur principal, mais je recherche avant tout l’efficacité. Cette démarche pragmatique est d’ailleurs celle des services publics de l’emploi. J’ai indiqué moi-même aux différents acteurs – et notamment aux sous-préfets – qu’ils ont vocation à être les ministres du travail et de l’emploi dans chacun des bassins, en associant les élus et les partenaires sociaux.
Les propos de M. Christian Blanc me laissent songeur : je ne suis pas pour un arbitrage entre emploi et salaire. En effet, le niveau de salaire dans notre pays est moins élevé qu’ailleurs, à cause de la politique salariale, sans doute, mais surtout parce que nous avons arbitré entre le niveau de protection sociale et celui des salaires. La faiblesse de nombreuses pensions de retraite tient au déroulement des carrières, mais aussi à des niveaux de salaires qui ont pu être très bas – trop bas, dans certains cas. C’est pourquoi je ne crois pas à l’arbitrage entre emploi et salaire. Certes, le salaire pèse directement sur la productivité et la compétitivité, mais je crois profondément à l’extra-salarial : l’intéressement et la participation – sans parler de la « prime contre dividendes ». Il faut, avec les négociations annuelles obligatoires, donner de la visibilité en matière salariale. Mais il faut aussi développer les mesures qui associent réellement les salariés aux résultats et à l’évolution de l’entreprise : intéressement, participation, actionnariat salarié, accès des salariés aux leviers de décision de l’entreprise.
En revanche, il est un point sur lequel on doit continuer à progresser : la « flexisécurité ». Tout le monde est d’accord pour l’évoquer, mais les salariés entendent « flexibilité » plutôt que « sécurité ». Nous avons avancé avec le contrat de transition professionnelle, et désormais avec le contrat de sécurisation professionnelle, qui a été adopté par les partenaires sociaux et qui figurait dans la proposition de loi de M. Gérard Cherpion. Tout cela va dans le bon sens, mais nous devons aller beaucoup plus loin.
Je ne partage pas l’avis de M. Jean-Claude Trichet, qui affirmait qu’il fallait bloquer les salaires. Il est compliqué de dire à des salariés qui se sont serré la ceinture pendant la crise qu’ils devront continuer à le faire au moment où les résultats des entreprises et où certaines rémunérations progressent.
M. Christian Blanc. Ce n’était pas le sens de ma question : je n’ai fait que citer le cas des Pays-Bas.
M. le ministre. Mais nous n’avons pas la même histoire, et surtout pas le même niveau de protection sociale. En France, les dépenses dans ce domaine représentent 31 % du produit intérieur brut, contre 27 % dans les quinze pays de l’Union européenne qui se rapprochent le plus du nôtre. Les cotisations représentent 65 % du financement de la protection sociale, contre 58 % dans ces mêmes pays. Nous sommes donc largement au-dessus, ce qui explique la différence de salaires.
M. Christian Estrosi a évoqué les 35 heures et la « TVA sociale ». Selon moi, nous sommes sortis des 35 heures. Le système des heures supplémentaires que nous avons mis en place permet, grâce aux exonérations de charges sociales, de donner davantage de pouvoir d’achat aux salariés, sans que cela pèse sur les entrepreneurs. En effet, ce n’est pas l’État qui fixe les salaires, et nous n’avions donc pas la possibilité de convaincre qui que ce soit de les augmenter. Il a fallu trouver une façon de donner plus de pouvoir d’achat à ceux qui travaillent plus. Si nous décidons de changer le seuil de référence, en le portant à 37 ou 38 heures, aussi savante soit la négociation, cela aura pour effet de revenir sur la majoration de salaire liée aux heures supplémentaires, au détriment des salariés.
Si on veut alléger le coût du travail, il faut jouer sur le niveau et la composition des charges plutôt que sur le niveau de revenus – salaire et heures supplémentaires des salariés. Dans le cas contraire, non seulement ces derniers seraient pénalisés, mais la consommation s’en ressentirait, ce qui aurait un impact économique.
Le coût du travail n’est pas si différent en France et en Allemagne : si l’on prend en compte aussi bien le coût social que le coût fiscal, il est respectivement de 49,2 % et de 50,9 %. Pour autant, la nécessité de réduire le coût du travail reste une évidence : il faut transférer une partie des charges qui pèsent sur le travail, sans quoi tous les discours que nous tenons sur le sujet atteindront très vite leurs limites.
On peut suivre différentes pistes. Mais si on augmente la taxe sur la valeur ajoutée, on ne peut plus parler de convergence franco-allemande. Le taux en Allemagne est déjà de 19 %, contre 19,6 % en France. Si nous l’augmentons d’un ou deux points, l’écart sera encore plus élevé.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Nous parlons des taux intermédiaires.
M. le ministre. Mais en augmentant les taux intermédiaires, on pénalise les plus bas revenus. Vous aurez du mal à me convaincre de l’effet redistributif de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, M. Christian Estrosi a souligné l’impact d’une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’inflation.
M. Olivier Carré. C’est un effet « one shot ».
M. le ministre. Peut-être. Mais si on sait quand commence l’inflation, on ne sait pas à quel moment elle s’arrête. Cela fait peser un risque sur les salaires.
Du reste, la mise en place d’une « TVA sociale » devrait entraîner non seulement une réduction des cotisations sociales patronales, mais aussi la baisse des cotisations salariales, sans quoi le pouvoir d’achat serait remis en question. De même, les retraités seraient directement pénalisés ; comment interviendrait-on sur leurs pensions ? Lorsque l’on envisage de mettre en place la « TVA sociale », il faut donc en étudier toutes les conséquences. Vous l’avez compris, je suis réservé à ce sujet.
Que faire, alors ? Le transfert des cotisations familiales semble une voie intéressante : sur ce point, tout le monde est plutôt d’accord. Mais il existe d’autres pistes, comme l’alignement de la fiscalité des revenus du capital et du travail – qui n’a jamais été réalisé complètement, alors qu’il y a plusieurs milliards d’euros à la clé – ou le recours à la contribution sociale généralisée (CSG), beaucoup plus redistributive.
Le débat est certes légitime. Mais quel que soit le nom qui lui est donné – « TVA sociale », « TVA anti-délocalisation » –, cette mesure n’est pas une solution miracle. Elle est en outre très difficile à expliquer aux Français. Enfin, dans une économie mondialisée, elle aurait un impact négatif de 20 % à 25 % sur les importations.
Si on examine les chiffres bruts, monsieur Alain Moyne-Bressand, on peut dire que les banques financent l’économie. Mais il est évident qu’elles pourraient le faire davantage. Le problème reste que les centres de décisions sont éloignés des régions et donc du terrain. Dans la grande majorité des cas, les personnes sollicitées pour un prêt sont obligées d’en référer à un niveau supérieur. Sur ce point la France pèche par rapport à l’Allemagne.
Certaines banques, monsieur le Président, sont mieux ancrées dans les territoires et financent davantage le développement économique, par exemple, en Savoie et en Haute-Savoie. À cet égard, on voit parfois de vraies différences entre les réseaux mutualistes ou coopératifs et les grands réseaux.
Cela étant, nous pouvons aller beaucoup plus loin avec OSÉO, qui est sur le point de changer de vocation : elle peut devenir une vraie banque du développement et jouer un grand rôle dans les régions.
M. Olivier Carré s’est demandé s’il fallait revoir certaines politiques de l’emploi. Il est vrai qu’il faut savoir passer au crible certaines aides.
M. Olivier Carré. J’évoquais plutôt les politiques sociales.
M. le ministre. Pour les politiques sociales comme pour les politiques de l’emploi, il faut à chaque fois se poser la question de l’efficacité. Si je suis aussi engagé, depuis 2004, dans la lutte contre les fraudes et les gaspillages, c’est parce qu’elles représentent un coût dont nous ne pouvons plus nous permettre le luxe. Avec ces milliards d’euros dépensés en pure perte, je préférerais diminuer les déficits ou mieux rembourser certains actes. Le chiffre avancé par le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur la fraude sociale ne me surprend pas : j’ai toujours dit que la fraude, au sens large, atteignait 30 à 35 milliards d’euros. Or la fraude fiscale est passée de 15 à 16 milliards d’euros. Quant aux sommes que nous économisons grâce à la lutte contre la fraude, elles ne constituent que la partie émergée de l’iceberg. S’agissant de la pertinence de certaines politiques, le débat n’est donc pas illégitime.
Les systèmes de gouvernance de la protection sociale sont-ils complètement obsolètes ? Je n’en suis pas sûr. Il faut maintenir le paritarisme, voire les négociations tripartites. Lorsque les partenaires sociaux se mettent d’accord entre eux et avec l’État, ils parviennent à trouver de bonnes solutions, comme pour le contrat de sécurisation professionnelle. Le système de gouvernance de l’assurance maladie, qui avait fait couler beaucoup d’encre en 2004, me semble aujourd’hui concilier le respect des partenaires sociaux et l’exigence d’efficacité. Cela étant, des évolutions restent possibles. Faut-il rester dans un strict paritarisme ou faut-il établir des passerelles avec d’autres organisations ? L’essentiel demeure de ne pas adopter une approche idéologique.
La loi « Larcher » nous impose le dialogue social dans tous les cas. Mais il ne s’agit pas d’opposer la légitimité politique et la légitimité sociale. L’élection présidentielle sera l’occasion pour chacun d’exprimer la direction dans laquelle il souhaite aller, mais le meilleur moyen pour y aller reste la négociation. Ce qu’il faut, c’est la volonté d’aboutir.
Les effets de seuil sont un thème sur lequel la négociation doit avancer. Il existe aujourd’hui huit seuils, générant une quinzaine d’obligations différentes. Le fait que les petites et moyennes entreprises allemandes réussissent mieux que les françaises tient à plusieurs facteurs, dont l’efficacité du financement de l’économie régionale et le recours systématique à l’export – notamment vers les marchés émergents. Mais les seuils fiscaux, sociaux, voire psychologiques jouent également pour beaucoup. De nombreux entrepreneurs hésitent à passer de 48 salariés à 52. Ils savent qu’ils devront miser une certaine somme, parce qu’ils seront obligés de se mettre à niveau avant même de savoir s’ils obtiendront des marchés en accroissant leur taille. Faut-il un dispositif de lissage ou de gel temporaire des obligations, de façon à éviter cette mise de départ ? Seule la négociation peut permettre d’avancer sur le sujet. En tout état de cause, les effets de seuil font partie des freins qui entravent la transformation de nos petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire et les empêchent de rivaliser avec leurs concurrentes allemandes.
Nous ne devons pas compliquer la tâche de nos grands groupes, mais au contraire les aider à devenir des leaders mondiaux. Quant aux très petites entreprises, on peut désormais les créer beaucoup plus facilement. L’institution des auto-entrepreneurs a été, à cet égard, une mesure forte. De même, les dispositions prises par M. Renaud Dutreil en direction des « gazelles » ont permis de changer la donne. Mais il faut que les petites et moyennes entreprises deviennent beaucoup plus grandes. Or, elles doivent faire face à de nombreuses résistances.
J’en reviens à la question de la durée du travail. Nous devons augmenter la quantité de travail en France. Mais les règles actuelles en matière de droit du travail ne l’empêchent pas, contrairement à ce qu’affirment certains.
L’instabilité de la norme, qu’elle soit fiscale ou sociale, constitue un autre grand problème, dans notre pays. Chaque projet de loi de finances, chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale est un véritable concours Lépine : les administrations sont souvent tentées de ressortir des projets qui encombrent leurs tiroirs, et de nombreux parlementaires en rajoutent avec leurs amendements. Or, dans notre système médiatique, même si un projet n’aboutit pas totalement, il suffit à susciter une inquiétude et à donner le sentiment de remettre en cause l’état de la réglementation. De nombreux entrepreneurs regrettent que les règles changent aussi souvent, car pour investir, il faut de la visibilité, et donc de la stabilité.
Il faudrait faire en sorte de ne pas modifier les règles pendant une certaine période, sauf événement exceptionnel. Mais comment ? Conventionnellement ? Je n’y crois pas. Constitutionnellement ? Cela semble complexe, comme le montre la difficulté à mettre en place la « règle d’or » en matière de finances publiques. Il faudrait que chacun laisse de côté les réflexes idéologiques et partisans. Quoi qu’il en soit, il faut en finir avec une instabilité chronique dont les effets sont désastreux.
L’application du programme du parti socialiste, monsieur Marc Laffineur, représenterait un danger mortel pour notre économie et notre compétitivité. Je ne sais pas d’ailleurs qui en assume vraiment la responsabilité – on reste dans les grandes déclarations. Le retour à la retraite à soixante ans coûterait 20 milliards d’euros par an, et nous ne sommes pas en mesure de financer des emplois-jeunes, dont le coût serait probablement de plus de 5 milliards d’euros. Dans ces conditions, on peut oublier tous les discours sur la réduction de la dette.
Les exonérations de charges font l’objet de nombreux débats. Mais une étude du Conseil d’orientation pour l’emploi, dont les résultats n’ont jamais été démentis, chiffre à 800 000 le nombre d’emplois maintenus ou créés grâce aux allègements « Fillon ».
M. Pierre Méhaignerie me demande quelle serait ma priorité parmi des sujets tels que l’innovation, la place de l’industrie, la formation professionnelle et le coût du travail. Tout est lié, mais pour moi, le coût du travail reste une question fondamentale, si nous voulons maintenir et créer des emplois. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les autres préoccupations citées ne soient pas importantes.
Cela étant, nous devons aussi mener un combat international en faveur d’un socle de protection sociale et du respect des normes en la matière. Je lisais aujourd’hui une étude selon laquelle de nombreux pays en voie de développement atteindraient en 2017 des niveaux de charges et de salaires tels que la compétition ne serait plus disproportionnée comme elle l’est aujourd’hui. Mais, en attendant, nous devons agir vite sur le coût du travail.
Quant à l’attitude des Français à l’égard de l’industrie, elle ne relève pas de la fatalité. La logique qui a inspiré M. Christian Estrosi avec les États généraux de l’industrie doit être poursuivie. Ce n’est pas que les Français n’aiment pas ce secteur, mais de nombreux responsables économiques ont pensé naguère que l’on trouverait plus de valeur ajoutée dans les services. Les Anglais ont tenu ce raisonnement avec la finance, et les Espagnols avec l’immobilier. Mais dans un pays comme la France, où le secteur primaire compte toujours beaucoup, se priver du maillon essentiel de la chaîne économique qu’est le secteur secondaire serait une folie. Nous l’avons vu pendant la crise : ceux qui avaient mis tous leurs œufs dans le même panier se sont retrouvés à genoux. L’intérêt de notre pays est de conforter son industrie en choisissant les marchés et en se développant dans les pays émergents.
En tout état de cause, on se tromperait lourdement si on pensait que le secteur tertiaire profiterait d’un affaiblissement du secteur secondaire. Si l’emploi industriel a reculé dans notre pays, c’est aussi, en effet, à cause des externalisations. Dans de nombreuses entreprises, la restauration, le gardiennage sont des emplois que l’on considérait hier comme industriels et qui ne le sont plus aujourd’hui. Dans une rue de ma ville, j’ai compté jusqu’à 5 000 emplois liés au textile ; aujourd’hui, il n’y en a plus que 50, tous dans le commerce. Tout a disparu avec l’industrie textile, mais il n’est pas trop tard pour relancer le secteur secondaire.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Vous avez parlé de négociations salariales. Ne serait-il pas possible d’intégrer quelques dispositions de simplification des effets de seuil dans la proposition de loi de simplification du président Jean-Luc Warsmann ? Et pour que les syndicats ne disent pas qu’il n’y a pas eu de négociations, ne pourrait-on entamer quelques approches concrètes sur la simplification du droit du travail et des effets de seuil ?
M. Éric Woerth. Une loi de simplification est par nature un « fourre-tout » et les dispositions qu’elle contient ne sont pas visibles. Or, nous avons besoin d’une approche cohérente de la compétitivité, afin de peser sur l’état d’esprit des entrepreneurs.
M. Pierre Méhaignerie, corapporteur. Cela permettrait de gagner du temps.
M. le ministre. Je crois profondément à la simplification, s’agissant de la vie des entreprises comme pour tous les rapports sociaux. Mais les réformes, dans ce domaine, sont peu visibles et prêtent souvent à sourire. Les entrepreneurs sont souvent inquiets quand on leur parle de simplification, car ils s’attendent à un effet inverse. Ils sont tellement habitués à vivre avec la complexité qu’ils ont du mal à s’en débarrasser.
Le rôle des politiques n’est pas de créer de l’emploi, mais de créer les conditions pour que les entrepreneurs recrutent, ce qui implique de ne pas leur compliquer la vie. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie avait institué, pour la période allant de 2008 à 2010, une atténuation des effets de seuil liés à la participation à la formation professionnelle et au versement transport. Ce dispositif a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2011. Des évolutions sont donc possibles.
Parmi les mesures envisagées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition de loi de M. Gérard Cherpion, figurent la simplification de l’enregistrement des contrats d’apprentissage, la dématérialisation des échanges pour faciliter le recrutement des salariés en alternance, la simplification du bulletin de paie – qui est très facile à mettre en œuvre – et celle du régime d’activité partielle. Mais comme l’a dit M. Éric Woerth, si de telles mesures de simplification sont prises de manière incidente, elles restent ignorées, parce que les administrations ont du mal à faire connaître les allégements de procédure. Nous avons besoin d’un grand mouvement d’ensemble en la matière. À cet égard, une négociation sociale ne ferait pas perdre trop de temps, mais pourrait permettre, de façon très pragmatique, d’atteindre une efficacité qui, en fin de compte, profiterait à tout le monde.
En 2010, nous avons compté 255 000 ruptures conventionnelles, et la moyenne mensuelle atteint 21 700 en 2011. Au total, 560 000 ruptures conventionnelles avaient été homologuées en avril 2011. Ce n’est pas une explosion : les ruptures conventionnelles représentent 10 % des sorties d’emploi, loin derrière les licenciements et les démissions. En proportion, elles ne touchent pas beaucoup plus les seniors. Mais le fait de se mettre autour d’une table pour discuter d’un départ plutôt que de rechercher l’adresse du conseil des prud’hommes le plus proche constitue, en France, une révolution. Cela n’enlève rien aux droits des salariés, mais cela favorise la fluidité du marché du travail. C’est donc une mesure qui va dans le bon sens.
M. le président Bernard Accoyer. Merci, monsieur le ministre, pour cet exposé très complet.
*
CONCLUSIONS DES TRAVAUX DE LA MISSION
La Mission d’information sur la compétitivité de l’économie française et le financement de la protection sociale conclut ses travaux lors de sa réunion du mercredi 9 novembre 2011.
M. le président Bernard Accoyer. Mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour prendre malheureusement acte de l’impossibilité qu’ont les corapporteurs de la mission sur la compétitivité de l’économie française et le financement de la protection sociale, MM. Jérôme Cahuzac et Pierre Méhaignerie, de parvenir à un rapport commun. Les nombreux contacts entre eux n’ont en effet pas pu permettre d’aplanir les difficultés résiduelles, alors qu’un accord global ne semblait pas hors de portée.
Je le regrette évidemment beaucoup. J’avais en effet l’espoir que les enjeux électoraux ne viendraient pas polluer l’objectif fixé par la Conférence des Présidents, qui a créé cette mission au début de l’année, et partagé par les membres de la mission elle-même : parvenir à des constats objectifs sur la situation de la compétitivité de l’économie française et le financement de la protection sociale. Je me doutais qu’il n’était pas envisageable d’aller au-delà, c’est-à-dire de formuler en la matière des préconisations communes aux deux rapporteurs, mais j’osais espérer que les arrière-pensées électorales ne prendraient pas le pas sur l’intérêt général et l’évaluation sereine des faits.
Mes regrets sont encore renforcés après avoir constaté que ce que les syndicats de salariés et les représentants du patronat ont réussi en juin dernier, et ce que le Conseil économique, social et environnemental est parvenu à accomplir en octobre, l’Assemblée nationale n’a pas réussi à le mener à bien. En effet, alors que les syndicats de salariés ont signé un document commun avec le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises qui dresse un tableau complet et exhaustif de la situation de la compétitivité de l’économie française, nos deux rapporteurs n’ont pu aboutir à un résultat équivalent.
Les leçons que je tire de l’expérience sont multiples. Tout d’abord, à l’évidence, il n’est pas raisonnable qu’un rapport soit confié à deux présidents de commission dont l’agenda est naturellement très chargé, bien qu’en l’espèce, l’un des deux rapporteurs ait pu – je tiens à le dire publiquement et à l’en remercier –, assister à presque la totalité des auditions.
Deuxième leçon : la dernière année d’une législature est décidément peu propice au travail d’évaluation bipartisan. Il faudra s’en souvenir en d’autres occasions.
Troisième leçon : nous devons prendre à bras-le-corps la question industrielle. C’est la leçon de fond. Il nous appartient, élus de la Nation, de sensibiliser nos concitoyens sur les enjeux du déclin industriel – évident en France – et de militer en faveur de l’innovation, de la recherche, des pôles de compétitivité, de l’apprentissage et de l’emploi industriel. Je regrette qu’un message en la matière n’ait pu être adressé à nos concitoyens afin d’alimenter le débat démocratique qui va s’ouvrir. Il faudra assurément reprendre le sujet au début de la prochaine législature.
Cela étant, nos auditions ont été aussi nombreuses que riches d’enseignements. Certes, leur compte rendu est disponible sur le site de l’Assemblée nationale, mais il faut aller plus loin et mieux faire connaître le travail que nous avons accompli. Ce travail n’a pas été négligeable, puisque nous avons reçu plus de soixante-dix personnes : toutes doivent savoir que leur présence n’a pas été vaine, que leurs exposés et leurs réponses à nos questions ne sont pas perdus. Aussi je vous propose de publier les comptes rendus des auditions, auxquels s’ajoutera bien entendu celui de la présente réunion. Je me chargerai de présenter l’esprit de notre démarche et d’expliquer, tout en la regrettant, l’absence de rapport.
La réunion d’aujourd’hui doit compléter nos auditions et être l’occasion pour les corapporteurs de présenter leurs constats partagés et d’exposer leurs divergences. Mais, au-delà, chacun des membres de la mission comme chaque groupe doit aussi pouvoir s’exprimer sur les thèmes qui nous ont passionnés au cours de nos dix-neuf réunions. L’objet de nos travaux est en effet stratégique pour l’avenir du pays et tous les points de vue de la Représentation nationale doivent pouvoir trouver une trace dans le document qui sera mis en distribution, sachant qu’il ne saurait, bien entendu, y avoir de « contributions » à proprement parler puisqu’il n’y a pas de rapport.
Le tout devrait permettre au lecteur de prendre la mesure des analyses les plus largement partagées – sur la compétitivité hors-prix, la fiscalité dissuasive, le poids des normes, notamment en matière de droit du travail, la réduction de la durée du travail, la croissance du coût horaire, ou encore la faiblesse du tissu des moyennes entreprises exportatrices dans notre pays – et, a contrario, des postures idéologiques.
M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des affaires sociales, corapporteur. Même si une idée simple mais fausse aura toujours plus de puissance qu’une idée vraie mais complexe, j’ai toujours pensé que la vérité se trouvait dans la nuance. Et sur le thème qui nous occupe aujourd’hui, je n’ai aucune arrière-pensée électorale, monsieur le président, mais des convictions. La circonscription dont je suis l’élu est très industrialisée puisque ce secteur y occupe 45 % des actifs : je peux donc mesurer à quel point la compétitivité de notre économie est un enjeu majeur pour les années à venir. Cet enjeu est aussi, pour moi, une passion, et c’est la raison pour laquelle j’ai suivi l’intégralité des auditions, dont je veux ici rappeler quelques idées maîtresses.
La première est l’importance de nos déficits et de leur aggravation : celui du commerce extérieur atteindra 70 milliards d’euros à la fin de l’année. Si nous avions conservé les mêmes parts de marché qu’en 1995, notre PIB serait supérieur de 150 milliards d’euros, ce qui ne serait évidemment pas sans effet sur le niveau de notre dette ou sur celui du chômage.
Un sujet de désaccord est revenu fréquemment au cours de nos débats concernant le renforcement de la compétitivité en Allemagne. Les uns y ont vu des effets positifs – réduction du déficit, amélioration de l’emploi –, d’autres ont estimé, non sans raison, que l’économie allemande était désormais caractérisée par une aggravation des inégalités et une faible consommation intérieure, en raison de la priorité donnée aux exportations.
L’examen de nos faiblesses, de nos atouts et de nos progrès a, au contraire, conduit à une certaine convergence. Je ne reviens pas sur les premières, révélées par les chiffres. Nos atouts, nombreux, ont été rappelés au cours des réunions de même que les progrès réalisés ces dernières années : crédit d’impôt recherche, pôles de compétitivité, rapprochement entre l’université et le monde de la recherche.
Je ne peux toutefois occulter l’importance de certains éléments expliquant notre déclin industriel – d’autres rapports les ont d’ailleurs cités. Le premier concerne la durée du travail. Les 35 heures, a dit M. Henri Lachmann – et je partage cette conviction –, ont détruit la valeur travail. Le nombre annuel d’heures de travail par habitant nous place au plus faible niveau : 610 heures en France, contre 690 en moyenne dans les pays européens, et 770 au Danemark et en Suède. Je fais mien le jugement de M. Jean Peyrelevade : au moment où d’autres ont mesuré le risque que représentait la concurrence des pays émergents – comme l’Allemagne, qui a été amenée à prendre des décisions difficiles –, nous avons eu tendance à nous assoupir. Notre incapacité à prendre les mesures nécessaires est une des causes de notre perte de compétitivité.
La compétitivité liée aux coûts de production n’est toutefois pas le seul facteur de notre affaiblissement. Les éléments hors coût jouent probablement un rôle plus important, mais c’est un aspect sur lequel nous ne pouvons pas agir rapidement. C’est pourquoi le fait que le coût horaire du travail de la France ait rattrapé celui de l’Allemagne place notre pays dans une position aujourd’hui délicate et lui fait perdre des marchés et des emplois. C’est le deuxième élément d’explication. Et si les coûts salariaux français sont désormais équivalents à ceux de son voisin, ils ne sont pas compensés par une compétitivité hors coûts.
Le troisième élément, rappelé par la quasi-totalité des entrepreneurs que nous avons reçus, est la rigidité de la législation et la judiciarisation des relations de travail. J’ai toujours défendu dans ma circonscription l’idée qu’il ne fallait pas reprocher aux entreprises de licencier. Songeons au processus de « destruction créatrice » cher à Schumpeter : les entreprises doivent savoir s’adapter. Or cette nécessaire adaptation se heurte aux rigidités françaises.
Enfin, il faut également regarder en face les raisons qui poussent les entreprises à ne pas croître : les seuils sociaux, la judiciarisation des relations sociales et d’affaire et l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) – même si la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, dite loi « Dutreil » a réduit l’impact négatif de ce dernier.
Si les divergences qui nous séparent sont compréhensibles d’un point de vue démocratique, elles n’en sont pas moins lourdes. Dans ces conditions, je comprends qu’il soit impossible de présenter un rapport commun sur les raisons de la perte de compétitivité de l’économie française.
M. Jérôme Cahuzac, président de la Commission des finances, corapporteur. En définitive, ce travail apparaîtra original du début à la fin, de sa genèse à sa conclusion. Cette mission résulte en effet d’une décision de la Conférence des Présidents, prise à l’initiative du Président de l’Assemblée nationale, quelques jours après que Jean-François Copé, responsable de l’UMP, a jugé nécessaire de débattre à nouveau de la question du temps de travail, comme on l’avait fait en 2002, puis en 2007, et avant, probablement, de le faire à nouveau en 2012. On peut espérer qu’au bout de dix ans un tel débat parvienne à une certaine maturité.
Originale, également, était la méthode de travail, puisque deux présidents de commission ont été nommés rapporteurs. En ce qui me concerne – et vous avez eu l’élégance de l’admettre, monsieur le président –, cela représentait une vraie difficulté, dans la mesure où de nombreuses auditions ont eu lieu en même temps que des réunions de la commission des finances. L’année 2011, en effet, a été riche en projets de loi dont cette commission a dû se saisir : une loi de finances, initiale ou rectificative, tous les deux mois ou deux mois et demi, selon les calculs du rapporteur général.
Comme M. Pierre Méhaignerie, j’estime qu’en matière de compétitivité, une partie du diagnostic est partagée, et une autre l’est moins, voire pas du tout. En l’écoutant à l’instant, je pensais à une phrase du livre L’insomnie des étoiles de Marc Dugain : « celui qui ne doute jamais a peu de chances d’accéder à la vérité ». Je suis persuadé que M. Pierre Méhaignerie a douté autant que moi sur certains sujets, et je rends hommage à sa sincérité. Cela étant, cette mission s’intéressait à l’ensemble de l’industrie française, et pas seulement au bassin industriel dont il est l’élu – même si cet intérêt particulier est tout à son honneur, et s’il est pour beaucoup dans le nombre d’industries implantées dans sa circonscription.
Nous partageons donc de nombreux constats sur certains aspects liés à la compétitivité hors-coût, mais peut-être pas l’idée selon laquelle il serait trop long et trop compliqué de remédier à nos faiblesses en la matière. Des avancées ont déjà été accomplies, que je n’ai pas manqué de reconnaître : le crédit d’impôt recherche – du moins dans sa nouvelle version – ou les pôles de compétitivité – que pour ma part je n’ai jamais critiqués.
En revanche, je suis moins enclin à faire porter sur la compétitivité-coût la responsabilité du déficit de notre commerce extérieur. Si la balance du commerce extérieur est un indicateur de la compétitivité de nos entreprises, nous devons convenir qu’elle s’est considérablement dégradée depuis dix ans. Encore excédentaire – certes faiblement – en 2001 et 2002, elle est devenue déficitaire par la suite, d’abord légèrement, puis plus gravement à partir de 2005 et, surtout, de 2009 : le déficit était alors de 58 milliards d’euros, avant de reculer à 51 milliards en 2010. En 2012, on le sait, il sera d’au moins 70 milliards d’euros. Or les causes de cette évolution sont nombreuses. On peut douter que la seule compétitivité-coût soit à l’origine d’une telle dégradation, et surtout du différentiel avec l’Allemagne.
S’agissant du temps de travail, la comparaison entre les situations de la France et de l’Europe du nord est exacte. Mais notre collègue aurait également pu citer le cas du Japon, où le nombre d’heures de travail par habitant atteint 850, sans que le pays jouisse d’une économie particulièrement prospère ni que son endettement puisse être érigé en modèle, bien au contraire. Si la durée travaillée a évidemment une importance pour la performance d’un pays, elle n’est pas le critère essentiel de la compétitivité.
Nous sommes donc d’accord sur de nombreux sujets, mais faute d’être d’accord sur tout, il s’est avéré impossible de cosigner un rapport, même si nous nous sommes efforcés d’y parvenir au cours d’une réunion de travail qui a duré près de deux heures.
En juillet, une première version du rapport me convenait. Sur les quinze à vingt points soulignés par M. Pierre Méhaignerie, nous étions parvenus à un accord en modifiant une formulation ou un titre, ou bien, si cela ne risquait pas de compromettre l’intégrité du rapport, en écartant les passages problématiques mais somme toute subalternes.
Restait toutefois la question de la taxe sur la valeur ajoutée sociale, sur laquelle nous ne pouvions nous entendre. En effet, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que faire financer par cet impôt une partie des cotisations sociales dues par les entreprises serait une solution acceptable pour notre pays.
Nous avions finalement deux grands points de désaccord : le temps de travail et la TVA sociale. Nous aurions peut-être pu dépasser le premier – même si je ne crois pas que la réduction du temps de travail puisse être chargée de tous les péchés dont certains veulent l’accabler. Mais il ne pouvait en être de même du deuxième.
Pour finir, je m’inquiète de la situation actuelle de nos entreprises. Nous allons bientôt examiner un projet de loi de finances rectificative prévoyant d’instituer une surtaxe de 5 % calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés payé par les entreprises réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les petites et moyennes entreprises (PME) ne seront donc pas concernées, et c’est tant mieux. Mais rappelons que sur les 45 milliards d’euros de recettes de l’impôt sur les sociétés, les entreprises de la cotation assistée en continu (CAC 40) – et encore : seulement celles qui sont publiques – ne contribuent qu’à hauteur de 3,5 milliards. La somme supplémentaire qu’elles devront verser est donc de 200 000 euros, ce qui signifie que le plus gros du milliard d’euros de nouvelles recettes attendues de cette surtaxe sera versé par les entreprises de taille intermédiaire. Si, avec M. Pierre Méhaignerie, nous étions parvenus à un diagnostic partagé sur l’état de notre économie, je ne pense pas que nous aurions suggéré une telle mesure.
M. Paul Giacobbi. La théorie de la valeur est la base de l’économie théorique. Très ancienne, elle a trouvé son aboutissement il y a une vingtaine d’années avec les travaux de Gérard Debreu – d’origine française, mais naturalisé américain, si bien qu’on ne le compte pas parmi les prix Nobel d’économie dont notre pays peut se prévaloir. Si vous avez des insomnies, je vous conseille son admirable livre, La théorie de la valeur, rempli d’équations… Ces travaux sont remarquables sur le plan intellectuel, mais totalement inutiles : les déterminants des choix des agents, le fonctionnement des marchés sont si complexes qu’aucune théorie, à ce jour, n’est parvenue à une modélisation dont on puisse tirer des enseignements sur le plan pratique.
Il existe de nombreuses idées reçues sur la compétitivité. Je pourrais prendre l’exemple de la production de fournitures pour l’industrie automobile. Avec M. Éric Woerth, nous avons entendu récemment le responsable d’une entreprise américaine qui compte 2 000 employés en France et 7 000 en Inde. Comparant la compétitivité-prix pour les mêmes produits livrés dans une usine de Normandie, il parvient à la conclusion qu’il est préférable de fabriquer une pièce en France qu’en Inde. La première raison est l’importance des coûts de transports, de l’ordre de 12 %. La deuxième est que la productivité du travail en Inde est au moins trois fois inférieure à celle de notre pays, même si la main-d’œuvre coûte dix fois moins cher. Enfin, le nombre de rejet de pièce pour défaut de qualité est de une à trois par million en France, contre 100 à 300 en Inde. Sachant qu’il faut en moyenne 1 500 à 2 000 pièces pour construire un véhicule automobile, un taux médiocre de qualité entraîne nécessairement des coûts considérables.
Un autre exemple d’idée reçue concerne le taux réel d’impôt sur les sociétés en France et en Irlande. Je le redis : parler de dumping fiscal à propos de l’Irlande est une sottise. Le Conseil des prélèvements obligatoires a montré que les grandes entreprises, en France, étaient imposées à un taux effectif d’environ 8,5 %, contre 11 % en Irlande. En raison des parts respectives de recettes de la corporate tax et de l’impôt sur les sociétés, le poids de cet impôt dans le produit intérieur brut (PIB) est supérieur en Irlande – un résultat corrigé de toute analyse sur le taux moyen de profit des entreprises. Avec pratiquement aucun amortissement dégressif, un research & development tax credit qui n’est pas du tout l’équivalent de notre crédit d’impôt recherche, et des règles de localisation du résultat différentes, le pays applique en apparence un taux deux fois et demie inférieur, mais l’assiette est en réalité fondamentalement différente pour la plupart des entreprises. En France, on paye en effet 35 % d’impôt sur les sociétés, mais seulement si on ne réalise aucun investissement, si on n’effectue ni recherche ni développement, et si on est idiot ! Car il faut l’être pour payer autant.
Comme l’a rappelé le président Pierre Méhaignerie, la compétitivité hors-coût est un élément fondamental. La réputation, la fiabilité, le service après vente, le design, le réseau de distribution et les facilités de transport comptent au moins autant que le prix dans le choix d’une automobile, ce qui explique que l’on peut préférer une Mercedes à une voiture chinoise.
Malgré tout, la compétitivité globale d’un pays, et surtout son évolution, ne se mesure de manière relativement objective que si l’on se place en dehors des variations des cours des devises, ce qui est le cas entre la France et l’Allemagne. Dans le cas contraire, cette variation est telle qu’elle dépasse tous les écarts de compétitivité possibles. On le voit dans les pays émergents.
Pour l’apprécier, il existe deux critères fondamentaux : l’évolution moyenne des marges des entreprises à secteur identique, et surtout celle des résultats du commerce extérieur. Je vous laisse donc en tirer toutes les conclusions pour ce qui concerne les compétitivités allemande et française : la deuxième tend à l’évidence à se détériorer.
M. Marc Dolez. Comme Jean-Claude Sandrier vous l’a déjà indiqué par écrit, monsieur le président, notre groupe regrette vivement qu’après plusieurs mois de travail et l’audition de plusieurs dizaines de personnalités, cette mission d’information ne donne finalement pas lieu, comme c’est l’habitude, à la rédaction d’un rapport.
Dans la mesure où il n’est pas possible de présenter de contribution écrite, je souhaite présenter les conclusions que notre groupe tire de cette série de travaux.
La mission d’évaluation s’était donné pour objectif d’analyser l’évolution de la compétitivité de notre économie au regard de la situation de nos principaux partenaires et concurrents.
Mais selon nous, elle visait indirectement à mettre en avant le « modèle » allemand de compétitivité et à souligner que la perte de compétitivité de la France vis-à-vis de son principal partenaire et concurrent tenait à la fois au poids excessif des prélèvements fiscaux et sociaux acquittés par nos entreprises et à l’inadaptation du mode de financement actuel de notre système de protection sociale.
Les auditions organisées dans le cadre de la mission ont mis à mal ces présupposés et apporté un éclairage saisissant sur les limites du « modèle » allemand, le peu de pertinence de la question des coûts salariaux et l’importance cruciale que revêt le développement industriel pour la croissance de notre économie. Cela nous conduit à souligner l’urgence d’une réorientation des politiques industrielles à l’échelle de l’Union européenne.
Le prétendu modèle allemand est parvenu à une impasse. Afin d’accompagner l’entrée de leur pays dans l’Union monétaire avec une monnaie surévaluée, les gouvernements allemands successifs se sont fixés pour tâche, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, de soutenir les grandes entreprises du secteur exportateur dans leur stratégie de restauration de la compétitivité.
Les politiques conduites, en particulier par le gouvernement dirigé par M. Gerhard Schröder dans le cadre de l’« Agenda 2010 », ont ainsi mis l’accent sur la compression des coûts salariaux, la déréglementation du marché du travail et la réduction drastique des dépenses publiques, dont la part dans le PIB a baissé de 10 % entre 1996 et 2007.
Par l’effet combiné d’une faible inflation et du transfert d’une partie des coûts fiscaux des entreprises vers les ménages, avec l’instauration en 2007 d’une TVA sociale, l’Allemagne a acquis en quelques années un énorme avantage compétitif sur l’ensemble des pays de la zone euro. Celui-ci s’est traduit par une explosion des excédents commerciaux. La part des exportations dans le PIB allemand est ainsi passée d’environ 25 % en 1996 à 47,5 % en 2008.
L’Allemagne n’en éprouve pas moins aujourd’hui de graves difficultés. Certaines tiennent à des facteurs historiques ou culturels, comme l’effondrement démographique, mais d’autres nous renseignent utilement sur les impasses où conduisent les politiques économiques fondées exclusivement sur l’offre.
Il importe de rappeler que les « succès » affichés à l’exportation se paient en premier lieu d’une atonie durable de la croissance et de reculs sociaux majeurs : l’Allemagne est le pays qui a créé le moins d’emploi depuis vingt ans. Il est aussi celui où la hausse des inégalités de revenus a été la plus élevée d’Europe ces dernières années, si l’on excepte la Bulgarie et la Roumanie : le ratio entre les 20 % les plus riches et les 20 % les plus pauvres y a en effet augmenté de 33 % entre 1998 et 2008, contre 2 % en France. C’est également le pays où le salaire moyen hors inflation a stagné, où la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé, où le pourcentage de chômeurs indemnisés a le plus fortement chuté – il est passé de 80 % à 35 % –, tout comme la part des investissements dans le produit intérieur brut ; un pays où le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté atteint 17 %, contre 13,5 % en France.
Certes le taux de chômage a baissé en Allemagne, passant de 10 % en 2005 à 7,3 % en 2008, mais cette baisse est avant tout la conséquence de l’augmentation du travail à temps partiel, le plus souvent contraint. Outre-Rhin, un emploi sur trois n’est désormais ni à temps plein ni à durée indéterminée ; et un emploi sur dix est un « job » à moins de 400 euros par mois. Le pourcentage des emplois à bas salaires a augmenté de 6 points et 2,5 millions de personne travaillent, en l’absence de salaire minimum de croissance (SMIC), pour moins de 5 euros de l’heure.
Si l’économie allemande a su en apparence profiter de la reprise du commerce mondial en 2009, et affichait, en 2010, une croissance en rebond de 3,5 %, ses perspectives ne sont guère plus prometteuses et encourageantes que lors des dix dernières années, pendant lesquelles le taux de croissance n’a progressé en moyenne annuelle que de 1,1 %.
En faisant entièrement reposer sa politique économique sur la balance extérieure au détriment de la demande intérieure, l’Allemagne est aujourd’hui dans une impasse. Elle est devenue étroitement dépendante de ses excédents commerciaux et de la demande intérieure de ses voisins européens, avec lesquels elle réalise 75 % de son excédent.
De fait, comme le soulignait l’économiste Jacques Sapir, « si tous les pays de la zone euro avaient une politique similaire, l’excédent commercial allemand serait bien moins fort mais – surtout – nous aurions une crise majeure dans la zone euro en raison de l’addition des politiques récessives sur la demande intérieure. ».
Nous mesurons ici le risque pour la France et pour l’ensemble des pays de l’Union européenne à prendre exemple sur l’Allemagne et à puiser dans son répertoire de recettes néolibérales : entraîner l’Europe entière dans une spirale de récession. C’est pourtant la voie suivie par le « pacte pour l’euro plus » signé en mars dernier, une voie qui encourage les stratégies non-coopératives et la fuite en avant dans la concurrence fiscale et sociale.
De son côté, la France connaît une crise du développement et de l’emploi industriels. Après avoir culminé en 1974 à plus de 5,3 millions d’emplois, notre industrie a perdu, depuis, plus de 40 % de ses effectifs, pour passer en 2008 sous la barre des 3 millions de salariés. La dégradation s’est accélérée dans la dernière décennie : entre 2000 et 2008, l’industrie a perdu 500 000 emplois, et 269 000 emplois supplémentaires, soit près de 8 % des effectifs, ont été détruits avec la crise, entre le début de l’année 2008 et la fin de l’année 2009.
Si le phénomène touche l’ensemble des pays de l’Union, notre pays a été plus gravement affecté que d’autres. En dix ans, la part de l’emploi industriel dans l’emploi général a reculé de 14,3 % au sein de l’Union européenne, et de 19,3 % en France, contre 14,2 % en Allemagne et 11,8 % en Italie. Notre pays est désormais, avec l’Espagne et la Grèce, un des pays les plus désindustrialisés de la zone euro. Le constat est d’autant plus alarmant que l’industrie reste au cœur de notre développement économique en raison de l’évidente asymétrie de taille entre ce secteur et celui des services.
Parmi les facteurs structurels du déclin de l’industrie française figure en premier lieu le faible nombre des entreprises exportatrices – 90 000, alors que l’Allemagne en compte 250 000 – et la petite taille de nos PME, qui pèse sur leur capacité à investir dans la recherche et le développement, sur leur capacité à exporter et sur leur capacité d’autofinancement : cette dernière n’est que de 60 %, soit le taux le plus bas d’Europe après le Portugal. L’autre facteur principal est assurément la trop forte concentration de l’appareil industriel français, qui repose sur un cœur productif très dense, au détriment du reste du tissu industriel.
Outre le manque de petites et moyennes entreprises industrielles, indépendantes et diversifiées, l’un des facteurs économiques du déclin de l’industrie hexagonale est l’essoufflement de la compétitivité de notre appareil productif, qui a notamment eu pour conséquence la dégradation spectaculaire de la balance commerciale : alors que le solde des échanges commerciaux de produits industriels était encore positif en 2002, à hauteur de 20 milliards d’euros, il est devenu négatif pour la première fois en 2007, pour avoisiner les 51 milliards d’euros de déficit en 2010. Principales responsables, les importations croissantes de biens de consommation et de biens intermédiaires en provenance des pays émergents, avec lesquels il est difficile de rivaliser en termes de prix, mais aussi les stratégies des multinationales françaises, qui entretiennent un lien de plus en plus lâche avec leur territoire d’origine et n’hésitent pas à délocaliser leur production ou à faire leurs achats à l’étranger.
La sauvegarde de l’industrie et la préservation de l’emploi industriel exigent, pensons-nous, de rompre avec la logique de fuite en avant préconisée par le patronat, qui ne jure que par la baisse des charges et qui, après avoir obtenu récemment la suppression de la taxe professionnelle, cherche désormais, comme nous l’avons vu avec la réforme des retraites, à réduire toujours davantage le financement des régimes sociaux. C’est dans cette perspective que Gouvernement et majorité envisagent à présent la mise en œuvre d’une TVA sociale, laquelle aurait à leurs yeux pour principal avantage de transférer vers les ménages une partie des charges qui pèsent sur les entreprises, fût-ce, comme en Allemagne, au détriment du pouvoir d’achat des classes moyennes et des moins favorisés.
À rebours de ces orientations, nous considérons que la première des priorités doit consister à conforter les atouts de notre pays : son modèle social, la qualité des services publics, la qualité de ses infrastructures, son tissu de petites et moyennes entreprises, le niveau de qualification de ses salariés – et donc la qualité du système d’enseignement et de formation –, la qualité et l’indépendance de la recherche publique… Ce sont là des facteurs majeurs de l’attractivité de la France et des atouts fondamentaux pour sa prospérité économique. Bien qu’elle ne saurait à elle seule tenir lieu de stratégie industrielle, la création de nouvelles activités dans les secteurs qualifiés d’« avenir », comme l’environnement, représente une seconde piste.
L’urgence est surtout de développer de nouveaux outils d’intervention, telle la création de fonds publics régionaux et d’un pôle financier public national prenant en charge tout ou partie des intérêts des crédits contractés par les entreprises pour financer leurs investissements, à proportion de leur efficacité sociale. Un pôle financier serait constitué autour de la Caisse des dépôts et consignations, avec les caisses d’épargne, les réseaux mutualistes, Oséo et la Banque postale. Nous jugeons également indispensable une remise à plat de la fiscalité des entreprises, de façon à décourager la spéculation par des dispositifs de modulation de l’imposition des entreprises et des cotisations patronales en fonction de l’orientation des bénéfices réalisés, selon que l’entreprise privilégie le versement de dividendes ou bien l’emploi stable, les salaires, l’investissement et la formation.
Autres objectifs prioritaires : séparer, au sein des banques, les activités de dépôt et les activités d’affaires, de façon à replacer les établissements de crédit dans leur cœur de métier – le financement de l’économie – et à les mettre à l’abri des turbulences et des caprices des marchés financiers ; rétablir les moyens de contrôle de l’utilisation des fonds publics ; définir des instruments permettant de s’assurer que la prise de participation de l’État au capital de grandes entreprises industrielles s’accompagne de la transmission de réels pouvoirs décisionnaires.
M. Christian Blanc. Je pensais aussi – mais la période n’était peut-être pas favorable – qu’au terme de cette série d’auditions, nous aurions pu parvenir à un premier état de consensus sur la compétitivité.
Nous avons souvent orienté nos réflexions en prenant l’Allemagne comme élément de comparaison. On peut le comprendre, dès lors que l’addition du PIB de la France et de celui de l’Allemagne équivaut à peu près à la moitié du produit intérieur brut de la zone euro. Tout élément de convergence peut donc produire des effets importants.
Je me sens aujourd’hui pleinement libre de l’affirmer : nous assistons aujourd’hui à un basculement historique. Alors que pendant des siècles, l’économie mondiale s’est concentrée sur les bords de la Méditerranée, puis sur les deux rives de l’Atlantique, elle tend aujourd’hui à s’identifier aux deux rives du Pacifique. Sous nos yeux, le monde bascule vers l’Asie, et ce mouvement a des conséquences majeures sur nos modes de production et nos modes de vie. Nous en sommes encore qu’aux premiers temps de cette situation nouvelle. Il s’agit d’une évolution d’ordre à la fois structurelle et mondiale, qui ne s’arrêtera donc pas au lendemain de l’élection présidentielle.
Des formes de régulation nouvelles sont nécessaires pour accompagner l’essor des nouvelles économies. Lors de sa venue devant l’Assemblée nationale, le président de la République chinoise a dit sans ambages que son pays serait la première puissance mondiale avant le milieu de ce siècle. De tels changements ne doivent pas avoir pour conséquence le suicide de nos économies et de nos modes de vie. C’est un problème historique majeur.
Cette phase d’adaptation va prendre de nombreuses années : deux, cinq, voire dix ans. Dès lors, nous devons parvenir à une convergence d’analyse suffisante si nous voulons pouvoir mettre en place une stratégie. L’absence de stratégie est en effet depuis longtemps – depuis l’après-guerre – ce qui caractérise notre pays.
J’entends dire à juste titre depuis une dizaine d’années que la France vit au-dessus de ses moyens. Pourtant, personne n’y a vraiment attaché d’importance. Le coût de fonctionnement de l’État est pourtant un sujet de préoccupation pour beaucoup, et en particulier pour vous, monsieur le président de la Commission des finances. À l’époque du général de Gaulle, notre pays comptait entre 2 et 2,5 millions de fonctionnaires, et notre administration était vue comme la plus efficace au monde. Aujourd’hui, les effectifs ont doublé, et je n’entends plus exprimer un tel jugement.
S’agissant de la croissance, on érige en modèle la croissance par la consommation, en prenant l’exemple des États-Unis, sans se rendre compte qu’il manque le facteur d’ajustement considérable pour une économie que représente l’émission d’une monnaie d’usage mondial.
De même, personne n’a jamais contredit cette partie du rapport Pébereau qui affirme que la protection sociale, en France, est financée depuis vingt-cinq ans par la dette. Un tel constat mérite pourtant que l’on s’y arrête mais, pour des raisons politiques évidentes, on ne s’est pas demandé si une telle politique pouvait durer. Or nous sommes parvenus à un moment où toutes ces questions doivent se poser faute de voir la situation s’aggraver considérablement d’ici peu de temps.
Comme M. Paul Giacobbi, j’estime que le problème n’est pas tant celui des coûts de production que celui de l’organisation des nouveaux modes de production. Plusieurs personnes auditionnées l’ont souligné, nous sommes confrontés à la nécessité structurelle de passer à d’autres niveaux de gamme. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait – sans trop en parler – les Allemands, mais aussi les Néerlandais, les Suédois et, plus largement, les pays du nord. L’objectif est de donner la priorité aux niveaux de gamme, c’est-à-dire de rendre possible la création d’une valeur susceptible de rendre l’achat d’un produit acceptable par le marché mondial.
Cela nous renvoie à la question de l’organisation, et en particulier de l’organisation par la territorialisation. Ce qui a motivé pour une – petite – part la création des pôles de compétitivité, c’est la volonté de parvenir à une fertilisation d’un territoire par un mode de production. Du point de vue de la production économique, l’Allemagne se résume à deux ou trois grandes régions, dont la Bavière et le Bade-Wurtemberg. Or l’organisation de ces Länder laisse apparaître une fertilisation mutuelle de la recherche, de l’innovation, de la culture, de la formation et de la production au sein d’un lieu donné, grâce à des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble et ont des objectifs communs. Dans ces régions, on n’est pas confronté à l’équivalent de la bureaucratie parisienne, ni à des « je-sais-tout » venus expliquer comment les choses doivent être organisées sur place.
En partant de notre identité, du label France, en exploitant les potentiels que nous avons dans tous les domaines, en développant des synergies, en faisant confiance aux hommes et en les accompagnant le mieux, nous pouvons obtenir des résultats considérables en termes de montée en gamme.
Par exemple, nous venons d’apprendre que la France a retrouvé sa position, un temps perdue au profit de l’Italie, de premier producteur mondial de vin. Interrogé sur ce sujet à la radio, le président d’un syndicat de viticulteurs lançait cet avertissement : nous ne pourrons conserver une position forte dans ce secteur qu’en maintenant une qualité supérieure à celle des vins chiliens ou sud-africains, car l’écart des coûts de production est tel que nous ne pouvons lutter en termes de prix. Comme dans tous les autres domaines, la question de la qualité est essentielle. Elle vient du savoir-faire des viticulteurs, bien sûr, mais aussi de l’innovation. Élever un vin en fût de chêne ne s’improvise pas, c’est le fruit de la recherche. De même, dans tous les secteurs économiques, nous devons développer nos capacités de recherche et d’innovation.
M. Hervé Novelli. Finalement, nous sommes parvenus à un consensus sur l’absence de consensus. Les deux rapporteurs ne pouvaient se mettre d’accord : ils en ont donc pris acte, et ont pointé leurs points de désaccord. Je salue à cet égard le sens de la mesure dont fait preuve – en ces lieux – le président de la Commission des finances. En affirmant que l’on ne peut pas faire des 35 heures la cause unique du défaut de compétitivité dont souffre notre économie, il admet implicitement que cette mesure ne lui apparaît pas aussi positive qu’elle l’est pour d’autres personnes de son parti.
Personne ne peut nier qu’à partir des années 2000, les économies allemande et française ont commencé à diverger : c’est ce que montrent les chiffres. Mais la question est de savoir pourquoi elles l’ont fait. Cela résulte, dans les deux pays, d’un changement dans le dispositif législatif : la réduction du temps de travail en France, et les réformes structurelles de l’économie réalisées en Allemagne. Il est difficile d’évaluer la part de chacun de ces facteurs dans le déficit de compétitivité que nous connaissons depuis cette époque, et qui se traduit par la hausse, en quelques années, du coût du travail en France au niveau de celui de l’Allemagne. Mais les deux ont joué. Cela étant, je partage le sentiment de plusieurs de mes collègues : la durée du travail n’est pas le seul élément à prendre en compte pour juger de la compétitivité de notre économie.
Par ailleurs, nous avons vu au cours des auditions un certain consensus se dessiner sur une autre question, celle du financement de la protection sociale. En particulier, nombre de nos interlocuteurs, y compris des représentants syndicaux, ont jugé qu’il pesait trop lourdement – de l’ordre de 70 % à 75 % – sur le travail. Il n’est par exemple ni naturel ni logique que la branche Famille soit financée par des charges assises sur le travail, et il est dès lors légitime d’explorer d’autres voies. Je regrette donc que nous n’ayons pas été plus loin dans la recherche d’une autre source de financement pour la protection sociale, comme nous y incitait la teneur générale des auditions.
Des pistes auraient donc dû être suivies ; elles n’ont pas pu l’être en raison de l’absence de consensus, qui se nourrit aussi, reconnaissons-le, de la proximité d’échéances électorales. Mais j’étais le rapporteur de la mission d’information sur la réduction du temps de travail et ses conséquences, qui a rendu ses conclusions en 2004, et je constate que les auditions auxquelles nous avons procédé cette année n’ont fait que confirmer mes conclusions d’alors.
M. Alain Vidalies. Je m’interroge : si cette mission a existé, pourquoi ses conclusions n’ont-elles pas été mises en œuvre ?
M. Hervé Novelli. Certaines l’ont été.
M. Alain Vidalies. S’agissant des travaux qui nous occupent aujourd’hui, l’absence d’accord final était prévisible, dès lors qu’un des deux rapporteurs avait depuis longtemps, et avec constance, exprimé sa certitude que tous les malheurs de la France provenaient essentiellement du poids des charges sociales, des effets du mode de financement de la protection sociale sur la compétitivité de nos entreprises et des 35 heures.
Or la réduction du temps de travail ne s’appliquait à l’origine qu’aux entreprises de vingt salariés et plus. Son application aux plus petites entreprises était prévue, mais avait dû être reportée. C’est la droite, reconduite au pouvoir en 2007, qui a décidé de généraliser les 35 heures dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), en faisant de la trente-sixième heure le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. C’était même une des premières dispositions adoptées au cours de la législature.
Je constate donc une certaine incohérence dans le discours public. À ceux qui nous reprochent sans cesse d’avoir institué les 35 heures, je demande non seulement pourquoi ils ne les ont pas supprimées dès qu’ils en ont eu l’occasion, mais surtout pourquoi ils les ont généralisées. Je me pose la question depuis quatre ans.
S’agissant de la compétitivité, le Conseil économique, social et environnemental s’est également emparé du sujet, mais contrairement à nous, il est parvenu à un large consensus : seules deux personnalités qualifiées se sont abstenues lors de l’adoption du rapport, auquel sont jointes des contributions très intéressantes.
Ce rapport aborde également la question de la comparaison avec le modèle allemand : « Le choix a été fait de conforter la compétitivité de l’industrie allemande, notamment en limitant les hausses salariales. La part des exportations s’est accrue dans le PIB tandis que la consommation intérieure baissait ou, au mieux, stagnait. » Les Allemands ont donc décidé, à un moment donné, de pratiquer la déflation salariale. Ils sont ainsi parvenus à réduire à leur profit l’écart de coût du travail entre la France et l’Allemagne.
Le rapport du conseil se poursuit ainsi : « Les salaires allemands partant d’un niveau significativement plus élevé, les coûts sont désormais du même ordre de grandeur. Eurostat estime ainsi que, pour l’année 2008, le coût dans l’industrie, la construction et les services (…) était désormais plus faible en Allemagne (28,91 euros) qu’en France (31,53). Pour la seule industrie manufacturière, en revanche, le coût demeurait légèrement plus élevé en Allemagne (33,37 euros contre 33,16 en France).
« Pour être complète, la comparaison nécessite également de tenir compte de la productivité, c’est-à-dire de la production fournie par chaque salarié à quantité de travail identique. Or, en 2010, selon Eurostat, la productivité de la main-d'œuvre par personne occupée demeurait sensiblement plus élevée en France (indice 120,1 pour une moyenne européenne à 100) qu’en Allemagne (105,2). »
De telles données relativisent l’idée selon laquelle tous nos malheurs trouvent leur origine dans les 35 heures et dans l’écart de compétitivité par rapport à l’Allemagne.
Il est vrai qu’en matière de temps de travail, tous les indicateurs sont discutables. Ainsi, le nombre d’heures de travail par habitant n’est pas un indicateur de la productivité, mais de l’activité économique. Ce qui est important, c’est la productivité et le nombre d’heures travaillées par salarié. Or selon le dernier numéro de la revue de l’Union des industries et métiers de la métallurgie, la durée annuelle effective du travail par salarié est de 1 554 heures au Japon, de 1 620 heures au Royaume-Uni, de 1 469 heures en France et de seulement 1 340 heures en Allemagne.
Il est également intéressant de consulter le bilan conjoncturel publié par la même revue : « Dans les pays de la zone euro, la progression des coûts horaire de la main-d’œuvre, qui était revenue à 1,2 % sur un an à l’été 2006, s’est accélérée depuis lors, atteignant 3,6 % au deuxième trimestre 2011. Ce mouvement est attribuable à la forte montée des coûts allemands : + 4,8 %, après 2,7 % au premier trimestre, un rythme jamais observé depuis au moins 1997. » Ainsi, l’opération effectuée par l’Allemagne a eu certes un effet ponctuel, mais les choses tendent à revenir à leur équilibre initial. Telle est l’évolution que nous observons aujourd’hui – la note de conjoncture date d’octobre 2011 –, et qui devrait nous donner à réfléchir.
Il me semble donc que cette mission d’information aurait pu explorer d’autres pistes, sans parler des problèmes que l’on a écartés parce que les solutions sont sans doute trop complexes : comment réfléchir à la compétitivité sans s’interroger sur la mondialisation ou sur la politique monétaire ? Notre monde actuel est organisé d’une drôle de façon, avec un pays, la Chine, qui pratique le capitalisme d’État et une politique monétaire ne respectant pas les règles du jeu, sans pour autant que l’Organisation mondiale du commerce ne réagisse. Nous sommes engagés dans une compétition dans laquelle chacun fixe ses propres règles ! Les normes minimales internationales, comme celles de l’Organisation internationale du travail ou du Protocole de Kyoto, ne sont même pas intégrées à celles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), alors qu’elles sont pourtant bien peu contraignantes par rapport à nos propres normes. M. Christian Blanc parlait de régulation ; voilà une première réponse à apporter en ce domaine, notamment au niveau européen. Car si le chacun pour soi continue à régner, continuer à batailler ne nous permettra pas d’échapper à nos difficultés. Il en est de même au sujet de la spéculation. Le décalage entre l’économie réelle et l’économie financière est, à l’heure où les ordinateurs spéculent tout seuls, considérable. Pouvons-nous longtemps continuer ainsi ? Toutes ces questions auraient mérité de figurer dans le débat.
M. Christian Blanc a dit que nous financions notre protection sociale par l’emprunt. C’est vrai, mais n’oubliez pas qu’en novembre 2010, la majorité de l’Assemblée nationale a adopté une loi organique faisant peser 130 milliards de dette sociale sur les générations futures, en prévoyant un remboursement entre 2018 et 2022. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois, puisque la même majorité avait adopté une loi similaire en 2005 avant d’être obligée de la défaire. Il est en effet inacceptable de faire payer aux Français de demain nos dépenses de santé actuelles, et à cet égard, la décision prise il y a moins d’un an est particulièrement scandaleuse.
J’en terminerai avec une autre certitude exprimée par M. Pierre Méhaignerie, et qui concerne les relations sociales, un domaine que je connais mieux que celui de l’économie : nos entreprises seraient paralysées par les rigidités sociales. En Allemagne, un comité d’entreprise est créé à partir de cinq salariés ; et quand l’entreprise dépasse les 2 000 salariés, un conseil de surveillance paritaire est élu, qui permet d’associer ces derniers à la stratégie de l’entreprise. C’est un exemple auquel nous ferions bien de réfléchir.
De nombreuses pistes restent donc à explorer. La territorialisation du développement, évoquée par M. Christian Blanc, en est une, même si les pôles de compétitivité constituent un début de réponse. En figeant le débat sur la question du coût du travail – un enjeu dont le rapport du Conseil économique, social et environnemental montre la faible pertinence –, nous n’avons pas été au rendez-vous fixé lors de la création de cette mission. Le débat sera donc tranché lors des échéances politiques à venir.
M. Jean Grellier. Lors de notre dernière réunion, le 22 juin, nous avions déjà commencé à réfléchir aux conclusions de nos travaux : je vous renvoie à ma déclaration d’alors, à laquelle je ne changerais pas une ligne. Je pressentais déjà, compte tenu de l’ampleur des divergences, que le débat devait être tranché dans l’espace politique.
Parler de compétitivité suppose d’évoquer également la notion de productivité, un élément fondamental dans l’application des 35 heures par les entreprises.
De toute façon, les propos tenus par M. Xavier Bertrand lors de son audition – « les 35 heures n’existent plus dans notre pays » – devraient nous mettre tous d’accord. Aujourd’hui, la préoccupation majeure est le dialogue social et la façon dont les salariés sont considérés dans l’entreprise.
Je vous appelle à consulter le rapport publié par le Conseil économique, social et environnemental sur le même sujet, qui est d’un très bon niveau. Non seulement il dresse le même constat que cette mission, mais il propose un certain nombre de pistes intéressantes. M. Pierre Méhaignerie insistait sur la difficulté à agir sur la compétitivité hors-coût : c’est bien pour cette raison que les responsables politiques doivent adopter une vision à plus long terme. Il faut rétablir l’État stratège : c’est une conclusion essentielle du rapport du Conseil économique, social et environnemental. Cela nécessite sans doute de faire preuve de courage politique, mais il n’existe pas d’autres solutions, car les réformes structurelles n’ont que trop duré.
Cette exigence nous est rappelée sans cesse : lors de son audition devant la Commission des affaires économiques, le ministre du commerce extérieur s’est présenté comme le VRP de la France, tout en admettant qu’il manquait de produits à proposer. Cela nous renvoie au problème du niveau de gamme de notre production. De même, nous avons auditionné le Médiateur de la sous-traitance, M. Jean-Claude Volot, qui a insisté sur les difficultés chroniques marquant les relations entre grands donneurs d’ordre et sous-traitants. Si ces derniers devenaient des « co-traitants », comme c’est le cas dans plusieurs filières industrielles en Allemagne, cela pourrait contribuer à résoudre certains de nos problèmes structurels.
M. Olivier Carré. Parmi les points importants abordés au cours de ces auditions, on peut citer les éléments relatifs à la taille, à la marge, à l’autofinancement des entreprises – à leur muscle, en quelque sorte –, des éléments qui nous renvoient moins au débat sur la durée du temps de travail qu’à celui de la fiscalité et de son harmonisation. En ce qui concerne en particulier l’impôt sur les sociétés, évoqué par M. Paul Giacobbi, – même si sa comparaison entre les systèmes français et irlandais me paraît un peu sommaire –, tout dépend du résultat et du point à partir duquel on considère que l’assiette doit converger dans la construction de la valeur ajoutée.
J’ai particulièrement apprécié la partie de nos travaux relative à la compétitivité hors coût – une notion difficile à appréhender quand on n’est pas directement confronté au monde de l’entreprise, et difficile à maîtriser pour les responsables politiques, même si ces derniers peuvent agir par l’intermédiaire de l’organisation territoriale, par exemple.
En ce qui concerne les 35 heures, nous ne devons pas oublier qu’une entreprise sous contrainte n’a d’autre choix que de s’adapter. Dès lors, le niveau élevé de productivité de notre pays, reconnu par dans le monde entier, peut aussi être analysé en creux : ne subsistent que les entreprises les plus productives. Quand on considère la quantité d’entreprises de taille moyenne qui ont disparu, ou l’émiettement du tissu industriel, notamment pendant les périodes où notre commerce extérieur est en déficit, on comprend qu’il faut un niveau de productivité très élevé pour conserver, en France, une marge minimale suffisante pour survivre.
Dans ces conditions, les politiques publiques que nous mettons en œuvre ne doivent pas avoir pour effet de tuer la poule aux œufs d’or. L’entreprise est le lieu de création de la richesse. Si nous voulons pouvoir continuer à financer nos politiques, il faut bien faire en sorte que le PIB marchand puisse se développer. Or la France inflige de sérieux handicaps au développement de la valeur ajoutée, dont les rigidités sur le temps de travail sont un élément.
À ce sujet, nous ne devons pas oublier qu’en Allemagne, le taux d’emploi partiel est beaucoup plus important qu’en France. Cela modifie complètement la lecture des statistiques citées par M. Alain Vidalies. Un salarié à temps plein allemand, lui, travaille plus qu’un Français – il est vrai dans des conditions peu enviables, comme l’ont rappelé les syndicats. J’ai d’ailleurs cru comprendre que Mme Angela Merkel avait décidé d’engager avec ses différents partenaires des discussions sur la question du salaire minimum : c’est sans doute une bonne nouvelle pour la France.
Ce sera ma conclusion : les problèmes de compétitivité rencontrés à l’échelle européenne trouveront une issue quand les différentes politiques économiques seront coopératives. Il y a vingt ou vingt-cinq ans, quand la monnaie unique a été imaginée, on pouvait peut-être compter sur la « main invisible » de l’euro mais, depuis, on s’est aperçu qu’une série de rigidités, d’habitudes, de consensus ou au contraire de divergences politiques s’opposait à l’harmonisation des politiques économiques entre les pays européens. C’est dans ce contexte que la France a été victime d’une forte détérioration de sa compétitivité.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Je crois que la France s’est endormie en 1989. Lors de la chute du mur de Berlin, tous les grands responsables politiques se sont réjouis à l’idée que notre principal concurrent, l’Allemagne, mettrait au moins vingt ans à se remettre de la réunification. Mais elle s’en est remise, et pendant la même période, elle a réalisé des réformes structurelles importantes.
Par ailleurs, le respect du chef d’entreprise ne fait pas partie de la culture française. L’administration – notamment fiscale – a une faible considération à son égard, et nous-mêmes, en tant que législateur, avons tendance à légiférer en ne prenant en compte que les 2 % ou 3 % qui trichent, au risque de paralyser les 97 % restant. En concentrant notre action contre les tricheurs et en laissant les autres tranquilles, nous pourrions contribuer à un réel gain de compétitivité.
Enfin, il faudrait que l’administration s’oblige à répondre dans des délais beaucoup plus courts : le temps, c’est de l’argent, et c’est donc aussi un facteur de compétitivité.
M. Pierre Méhaignerie, rapporteur. M. Alain Vidalies a raison de souligner l’excellente productivité horaire manufacturière des salariés français, mais ce résultat a été obtenu au détriment de leurs conditions de travail – deux-huit, trois-huit, flexibilité à l’intérieur de l’enveloppe de 1 606 heures –, au point qu’un rapport de la médecine du travail lie le développement des troubles musculo-squelettiques (TMS) à la mise en place des 35 heures. En outre, si les ouvriers ont payé cher les 35 heures en termes de productivité, ce n’est pas le cas des salariés des autres secteurs.
Par ailleurs, le nombre d’heures travaillées par habitant est un élément important pour tenir compte de la population la plus jeune, encore en âge d’effectuer sa scolarité, et de la plus âgée, celle des retraités. C’est d’ailleurs l’indicateur utilisé par les organisations professionnelles et syndicales.
S’agissant des rigidités, tous les chefs d’entreprise que nous avons reçus ont jugé qu’elles constituaient un obstacle à leur développement en France. Je citerai en particulier les nombreuses contraintes que leur imposent le code du travail et la judiciarisation, les difficultés d’application des plans de sauvegarde de l’emploi, et le mille-feuille social à l’origine de procédures extrêmement complexes. Dans le classement de notre pays fait par l’Agence des investissements internationaux, cette difficulté d’adaptation des entreprises fait partie des principaux éléments défavorables. Le président de Nestlé dit qu’il met tellement de temps pour fermer, en France, une entreprise qui ne correspond pas aux besoins des consommateurs qu’il n’en a plus pour en ouvrir de nouvelles.
La territorialisation évoquée par M. Christian Blanc est également un élément fondamental du succès. Pourquoi, dans certaines régions françaises, l’industrie s’est-elle beaucoup mieux développée qu’ailleurs ? Les gouvernances locales méritent d’être étudiées.
Enfin, s’il fallait citer un seul facteur parmi les plus importants, je dirais que la France, et son système éducatif, n’aime pas l’industrie. Compte tenu de la gravité de la situation, faire aimer l’industrie est la première chose à faire si nous voulons rétablir une dynamique positive.
M. Jérôme Cahuzac, rapporteur. Un accord se dessine sur les problèmes de compétitivité hors coût, qu’il s’agisse de la question du niveau de gamme de nos produits, de l’insuffisance de la spécialisation, ou des faiblesses de nos organisations à l’export, même si je ne veux pas méconnaître les efforts accomplis aujourd’hui dans ce domaine.
En revanche, le désaccord reste total sur l’opportunité de faire basculer les cotisations patronales sur la taxe sur la valeur ajoutée, en instituant ce que d’aucuns appellent la « TVA sociale ». Les Français trancheront.
Enfin, il existe soit un désaccord, soit un malentendu sur le lien de causalité entre la réduction du temps de travail et l’état actuel de la compétitivité française. À tout le moins, si ce lien existe, la responsabilité devrait être partagée, puisque si certains ont instauré les 35 heures, d’autres les ont généralisées et gravées dans le marbre du code du travail : cela, tout le monde peut l’admettre. Comme l’a dit M. Hervé Novelli, nous pouvons être d’accord pour définir ce qui nous rapproche et ce qui, au contraire, nous divise.
M. le président Bernard Accoyer. Je remercie les membres de cette mission et ses rapporteurs.
Je regrette à nouveau que, face à une évidence – la perte de compétitivité très rapide et très grave que connaît notre économie –, nous n’ayons pas pu trouver un accord sur le diagnostic. Toutefois, le débat qui est en train de s’ouvrir dans le pays pourra se nourrir de nos travaux.
Par ailleurs, il convient d’atténuer la séparation entre compétitivité-coût et compétitivité hors-coût, car les deux s’additionnent. La compétitivité est liée à l’évolution du tissu industriel, mais aussi à celle de la nature, du coût et de la qualité des biens que nous produisons : soit l’innovation et le marketing sont insuffisants, soit le coût est trop élevé, mais tout cela se tient. Le dénominateur commun, c’est que notre système productif est soumis à des charges trop importantes : charges administratives, charges sociales et charges fiscales. En vous écoutant, j’ai cru déceler une certaine convergence sur ce sujet.
Ce qui est en jeu, dans tout cela, c’est la dépense commune de tous les Français, personnes physiques ou personnes morales, et donc, la dépense publique. Or personne ne peut nier l’importance du budget de la nation consacré chaque année – 12 milliards d’euros – au financement des exonérations de charges liées aux 35 heures, le surcoût occasionné par la réduction du temps de travail dans les différentes fonctions publiques – une dizaine de milliards d’euros –, la situation la plus caricaturale étant celle de la fonction publique hospitalière. Ce sont des éléments factuels ; pour le reste, les divergences sont normales, puisqu’elles touchent à nos convictions politiques. Je souhaite simplement que nos échanges permettent de préparer, à l’approche des échéances électorales de 2012, un débat fructueux pour notre pays et pour son avenir.
À cette fin, je pense que personne ne verra d’inconvénient à la publication de l’ensemble des comptes rendus de nos travaux. Il en est donc ainsi décidé.
© Assemblée nationale