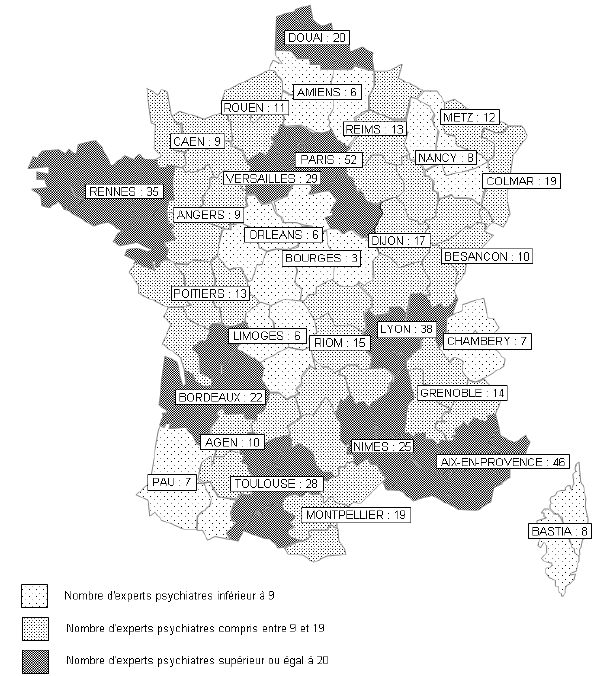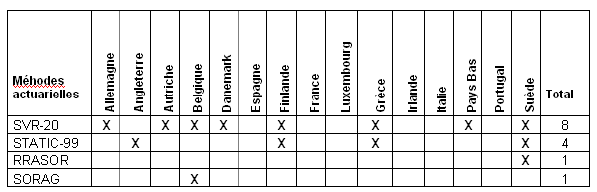![]()
N° 4421
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 février 2012.
RAPPORT D’INFORMATION
déposé
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
Sur le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Étienne BLANC,
Député,
En conclusion des travaux d’une mission d’information relative à l’exécution des décisions de justice pénale
présidée par M. Jean-Luc WARSMANN (1)
Député.
La mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale est composée de :
M. Jean-Luc Warsmann, président ; Mme Delphine Batho, M. Christian Vanneste, vice-présidents ; MM. Étienne Blanc, Michel Zumkeller, rapporteurs ; MM. Jacques Alain Bénisti, Serge Blisko, Marcel Bonnot, François Deluga, Éric Diard, Marc Dolez, Guy Geoffroy, Claude Goasguen, Philippe Houillon, Mmes Maryse Joissains-Masini, Marietta Karamanli, MM. Jean-Christophe Lagarde, Jérôme Lambert, Bruno Le Roux, Dominique Raimbourg, Jean-Jacques Urvoas, Jacques Valax, Manuel Valls, François Vannson, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Vuilque.
INTRODUCTION 9
PREMIÈRE PARTIE : UN DISPOSITIF JURIDIQUE ÉLABORÉ DE SUIVI DES AUTEURS D’INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL 23
I. SURVEILLER : UN DISPOSITIF JURIDIQUE COMPLET 23
A. LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE, UNE MESURE EMBLÉMATIQUE 23
1. Une peine spécifique à destination des auteurs d’infractions à caractère sexuel 23
2. Une injonction de soins consubstantielle à la mesure de suivi socio-judiciaire 26
3. Un dispositif dévoyé ? 28
B. LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE 31
1. Un dispositif transversal qui concerne principalement des auteurs de violences sexuelles 31
a) L’extension régulière des possibilités de placement sous surveillance électronique mobile 31
b) Le placement sous surveillance électronique mobile, un panoptique moderne ? 35
2. D’importants problèmes pratiques qui en font un système largement perfectible 36
a) Un dispositif technique inachevé 37
b) Un effet stigmatisant difficilement compatible avec la réinsertion des personnes placées 39
c) Pour les personnels, une surveillance difficile à mettre en œuvre 41
C. LA DÉFENSE SOCIALE À L’œUVRE : LA RÉTENTION ET LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ 43
1. Des dispositifs récemment introduits en droit français pour les individus présentant un risque très élevé de récidive 43
a) La rétention de sûreté : une mesure « exceptionnelle et subsidiaire » 43
b) La surveillance de sûreté, mesure de sûreté en milieu ouvert 46
2. L’évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité au fondement des mesures de sûreté 48
3. Des garanties procédurales nombreuses, qui assurent la protection des droits des individus 50
II. SOIGNER LES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES : DE L’INCITATION À L’OBLIGATION 54
A. L’INCITATION AUX SOINS EN MILIEU FERMÉ : UNE PREMIÈRE ÉTAPE NÉCESSAIRE 54
B. L’INJONCTION DE SOINS, UN DISPOSITIF PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ 56
1. L’injonction de soins, une mesure transversale en augmentation 56
2. Le médecin coordonnateur au cœur du dispositif 58
DEUXIÈME PARTIE : UN MANQUE DE COORDINATION ET DE MOYENS QUI NUISENT À L’EFFICACITÉ DU SUIVI 63
I. LE JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES ET LE CONSEILLER D’INSERTION ET DE PROBATION : UN DIALOGUE DIFFICILE 63
A. LE JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES : MALAISE DANS LA PROFESSION 63
1. Des charges de travail inadaptées au suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel 64
2. Des marges de manœuvre de plus en plus étroites 65
3. Un rôle limité dans le cadre des mesures de sûreté 67
B. LES CONSEILLERS D’INSERTION ET DE PROBATION EN CRISE 69
1. Une crise de moyens 69
a) Des ressources humaines mal réparties 69
b) Les programmes de prévention de la récidive, un outil à conforter 71
c) La réinsertion des auteurs de violences sexuelles : des moyens insuffisants 73
2. Une crise de méthode 74
3. Une crise d’identité 76
C. JAP ET CIP : UN DIALOGUE IMPOSSIBLE ? 77
1. Des relations parfois difficiles qui compromettent le suivi 77
2. Une répartition des rôles mouvante et source de conflits 79
3. APPI, outil de dialogue inutilisé 80
II. ÉVALUER LA DANGEROSITÉ DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES :
LA RESPONSABILITÉ CROISSANTE DE L’EXPERT 81
A. LA PROFONDE MUTATION DU RECOURS À L’EXPERT PSYCHIATRE 81
1. La question posée à l’expert : de la responsabilité à la dangerosité 82
2. Le saut quantitatif des expertises psychiatriques 83
B. UNE PÉNURIE DE PLUS EN PLUS PRÉOCCUPANTE 84
1. La diminution constante du nombre d’experts psychiatres 84
2. Les multiples causes de ce désintérêt des psychiatres pour la fonction expertale 85
C. LES MÉTHODES EXPERTALES CLASSIQUES REMISES EN QUESTION 87
1. Des méthodes cliniques avant tout fondées sur l’entretien 87
2. Une efficacité de plus en plus discutée 88
a) Une capacité réduite d’évaluation de la récidive 88
b) Des outils d’évaluation accordant une trop grande place à la subjectivité ? 89
III. UNE OFFRE DE SOINS VARIABLE, PEU STRUCTURÉE VOIRE ABSENTE SUR CERTAINS POINTS DU TERRITOIRE 90
A. LA SPÉCIALISATION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES : UN EFFET CONTRASTÉ SUR L’OFFRE DE SOINS AUX AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES 90
1. Des établissements aux missions et aux moyens spécifiques 91
a) L’accueil des auteurs d’infractions à caractère sexuel 91
b) Des moyens humains et financiers renforcés 94
c) Une nouvelle organisation territoriale théoriquement pertinente 96
2. Une offre de soins spécialisée perfectible dans sa mise en œuvre 97
a) Une répartition géographique imparfaite 97
b) Une offre de soins variable d’un établissement pénitentiaire à l’autre 98
B. UN SYSTÈME DE SOINS POST-CARCÉRAL DÉFAILLANT 99
1. Des structures de prise en charge en milieu ouvert insuffisantes 99
a) Un nombre de structures publiques insuffisant pour assurer le suivi psychiatrique et psychologique dans le cadre d’une injonction de soins 99
b) Un accès relativement limité aux thérapeutes exerçant en secteur libéral 100
c) Des réticences d’origines diverses de la part des médecins traitants 101
2. Le médecin coordonnateur : un dispositif à conforter sur l’ensemble du territoire 102
a) Une insuffisante couverture du territoire 102
b) Des conditions d’accès relativement restrictives 104
c) Des fonctions justement rémunérées ? 105
d) Une responsabilité trop lourde à porter 106
3. Les CRIAVS, un dispositif bien conçu mais aujourd’hui peu visible 107
a) Le soutien théorique des centres de ressources aux acteurs du suivi 107
b) Des actions et des publics variables d’une région à l’autre 109
TROISIÈME PARTIE : LES CONDITIONS D’UN SUIVI EFFICACE DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES 111
I. SIMPLIFIER UN DROIT EXISTANT PARTICULIÈREMENT COMPLEXE 111
A. L’IMBRICATION CROISSANTE DES DISPOSITIFS VISANT LES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES 111
B. L’APPLICATION DES PEINES, UNE DISCIPLINE DEVENUE « ABSCONSE ET IMPRATICABLE » ? 114
C. SIMPLIFIER LE DROIT EXISTANT POUR UNE MEILLEURE APPLICATION DES TEXTES 116
D. « RENDRE AU JUGE SON INTELLIGENCE » 117
II. MIEUX COORDONNER L’ACTION DES DIFFÉRENTS ACTEURS 118
A. LE JUGE ET LE CONSEILLER : MIEUX DÉFINIR LES RÔLES POUR FACILITER LES RELATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS DU SUIVI 119
B. FAVORISER LES PARTENARIATS LOCAUX POUR UNE COOPÉRATION SANTÉ-JUSTICE RENFORCÉE 120
C. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 122
D. PARLER LE MÊME LANGAGE : DES REPÈRES COMMUNS 123
E. PARTAGER L’INFORMATION : L’APPORT DE LA DÉMATÉRIALISATION 124
III. ÉLABORER UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE SOINS ET DE PRÉVENTION 125
A. MIEUX UTILISER LE TEMPS CARCÉRAL 125
1. Poursuivre la spécialisation de la prise en charge pénitentiaire des auteurs d’infractions à caractère sexuel 126
2. Systématiser la mise en œuvre des programmes de traitement intensifs à destination des auteurs de violences sexuelles 128
B. ÉLABORER UNE VÉRITABLE OFFRE DE SOINS POST-PÉNALE 130
1. Assurer la continuité des interventions thérapeutiques 130
2. Garantir le développement des consultations post-pénales ouvertes aux auteurs d’infractions à caractère sexuel 131
3. Améliorer le dispositif d’injonction de soins par le recrutement de coordonnateurs 135
4. Conforter le rôle de centres d’appui opérationnel des CRIAVS 137
C. AGIR AVANT LE PASSAGE À L’ACTE 139
1. Mettre en place une ligne téléphonique d’écoute d’urgence 139
2. Expérimenter les cercles de soutien et de responsabilité 140
IV. ÉTENDRE LE CHAMP DE LA CONNAISSANCE : DÉVELOPPER LA RECHERCHE THÉORIQUE ET LES COMPÉTENCES 142
A. FÉDÉRER LA RECHERCHE SUR LES AUTEURS D’INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL 142
B. DÉVELOPPER UNE VÉRITABLE FILIÈRE CRIMINOLOGIQUE 143
C. DÉVELOPPER DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES POUR LES ACTEURS DU SUIVI 145
D. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE RÉALISATION DES EXPERTISES 146
1. Assurer l’attractivité de la fonction d’expert 146
2. Poser les conditions d’un travail pluridisciplinaire dans l’évaluation de la dangerosité 147
E. MIEUX TIRER PARTI DES ÉCHELLES ACTUARIELLES 149
1. Des méthodes qui renouvellent la pratique de l’évaluation 149
2. Une échelle française sophistiquée pour compléter l’entretien clinique 151
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION 155
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 159
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 163
LISTE DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS 167
ANNEXES 171
Pour la session 2011-2012, la mission d’information relative à l’exécution des décisions de justice pénale a souhaité se consacrer au suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel, tant dans sa composante judiciaire et pénitentiaire que dans sa dimension médicale et psychologique.
Les infractions à caractère sexuel, particulièrement choquantes, appellent en effet une double réponse de la part des autorités publiques. Conscients de leurs actes et ne souffrant que pour une faible part d’entre eux de pathologies proprement psychiatriques, les auteurs d’infractions à caractère sexuel sont pénalement responsables ; mais, leurs actes révélant un comportement déviant et, bien souvent, d’importants troubles de la personnalité ou du comportement, ces individus relèvent aussi du soin. Aussi le traitement pénal de ces infractions présente-t-il certaines particularités.
Depuis le début du XIXe siècle, l’institution judiciaire s’est tournée vers le monde médical pour tenter, dans un premier temps, de répondre à la question de la responsabilité de l’auteur d’un acte sexuel déviant, puis dans le but de prévenir la récidive. Un glissement s’est opéré dans la façon dont la société appréhende les violences sexuelles. D’immoraux, ces actes sont devenus pathologiques. Le recours à la science a constitué un moyen, pour la société, de se rassurer face à des atteintes aux personnes et à leur intimité de moins en moins tolérées au fur et à mesure de la « civilisation des mœurs » (2). Le psychiatre, en particulier, est sommé de jouer un rôle de premier plan dans la prise en charge de ces personnes perçues comme particulièrement dangereuses.
Votre rapporteur s’est attaché, en premier lieu, à analyser le bien-fondé de ces représentations. Les auteurs d’infractions à caractère sexuel sont-ils des délinquants comme les autres ? Présentent-ils, comme certaines affaires particulièrement médiatisées le suggèrent, un risque de récidive plus élevé que les auteurs d’autres types d’actes délictueux ? Quelles sont les causes de leurs passages à l’acte et les facteurs susceptibles d’être maîtrisés par l’intervention de la justice ? Répondre à ces questions est un préalable indispensable à la réflexion qui anime ce rapport.
*
* *
L’auteur de violences sexuelles apparaît aujourd’hui comme l’incarnation de la dangerosité criminologique. Il a remplacé le bandit de grand chemin dans l’imaginaire collectif et ses actes appellent une réponse particulière de la part des autorités. De fait, l’histoire montre que « l’horreur s’est déplacée : la figure noire du roman policier mêlant le sang au vol a cédé la place à la figure plus psychologique du pervers tourmenté mêlant le sang au désir et à la sexualité » (3). De la lutte contre les atteintes au droit de propriété, la priorité semble avoir changé, c’est aujourd’hui l’intimité des personnes qui réclame une protection accrue.
Il est vrai que l’attitude de la société à l’égard des violences sexuelles a significativement évolué au cours des derniers siècles. Sous l’Ancien régime, les viols sont punis de peines exemplaires qui, dans les faits, sont peu appliquées, soit parce que la victime ne saisit pas la justice, soit parce que cette dernière ne condamne pas l’auteur de l’acte. De fait, « le crime y étant d’abord blasphème et péché a des conséquences particulières sur la victime du viol : celle qui a commis les gestes réprouvés, fût-ce malgré elle, peut être implicitement et sourdement condamnée pour ce fait même […] La victime craint de parler, le juge de l’innocenter » (4). Les violences sexuelles sont alors tolérées, ce d’autant plus que l’idée est alors largement répandue qu’une femme dispose de la force physique nécessaire pour repousser les assauts d’un éventuel agresseur.
Au contraire, la « civilisation des mœurs » comme l’avènement des droits individuels vont, par la suite, conduire à une plus grande répression de ces violences, nettement moins tolérées. De fait, l’histoire des violences sexuelles suit un cours similaire à celui de l’histoire de la violence en général, de moins en moins acceptée. Les comportements sont de plus en plus policés en raison d’une évolution nette des mentalités et de la montée en puissance de l’État. La société conduit les individus à s’autocontrôler, reléguant les comportements violents à ses marges. Dans ces conditions, la violence sexuelle, auparavant banalisée, devient intolérable.
Un changement culturel d’ampleur est donc à l’origine de l’image que nous avons aujourd’hui des actes de violence sexuelle. Plusieurs facteurs expliquent leur révélation plus fréquente aux autorités :
— « une plus grande égalité entre hommes et femmes rendant toujours plus intolérables les violences anciennes et le modèle de domination qu’elles concrétisent ;
— une recomposition de l’image du père et de l’autorité rendant plus crédibles suspicions ou accusations ;
— une place plus que jamais faite à l’enfant […] ;
— un déplacement d’attention sur l’atteinte intime des victimes transformant en irrémédiable traumatisme ce qui auparavant était d’abord honte morale et offense sociale » (5).
Ces différentes évolutions sont encore plus prégnantes dans la période récente, expliquant ainsi l’explosion des faits de violences sexuelles constatés en France depuis les années 1980.
*
* *
Les violences sexuelles déclarées sont, depuis le début des années 1980, en augmentation régulière. Les faits portés à la connaissance des forces de l’ordre qui étaient, au milieu des années 1970, d’environ 6 000 par an étaient, en 2004, supérieurs à 26 000. Elles ont néanmoins quelque peu diminué au cours des dernières années, les faits constatés étant, depuis 2005, inférieurs à 23 800 par an.
FAITS CONSTATÉS DE VIOLENCES SEXUELLES ENREGISTRÉS DEPUIS 1974
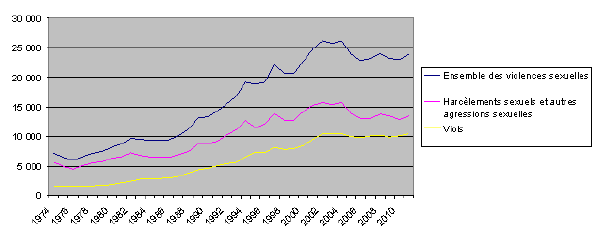
Source : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
Des évolutions similaires peuvent être constatées au travers des condamnations. Si les condamnations pour crimes diminuent depuis les années 1990, elles tendent à augmenter en ce qui concerne les crimes sexuels.
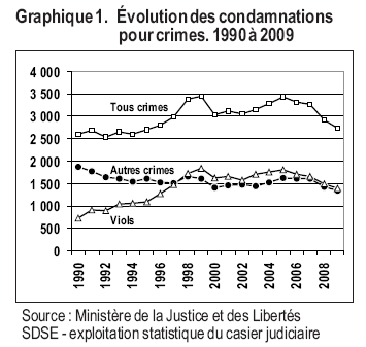
Au cours des trente dernières années, l’augmentation des faits portés à la connaissance des autorités et leur condamnation sont vraisemblablement le fait d’une sensibilité accrue aux violences sexuelles.
Comme le montre une étude de l’Institut national des études démographiques (6), la parole s’est libérée. Les jeunes générations, notamment les femmes, parlent plus ouvertement des violences sexuelles qu’elles subissent, alors que le sujet demeure encore tabou pour les générations plus anciennes : « La reconnaissance sociale de ces violences contribue à une modification du seuil de rejet à l’égard des agressions sexuelles. Les femmes tendent aujourd’hui à appréhender comme des agressions des événements qu’elles n’auraient pas considérés auparavant comme tels. Par ailleurs elles ont plus de facilité à en parler ». Au-delà de ces facteurs culturels, des facteurs juridiques peuvent également être à l’origine de ces évolutions : l’accroissement des peines encourues, l’extension du champ du viol, le report du point de départ de la prescription pour les victimes mineures, l’incrimination de nouveaux faits, comme le viol conjugal à partir des années 1990, ont eu un impact net sur la judiciarisation de ces actes.
En ce qui concerne la tendance à la baisse relative des violences sexuelles portées à la connaissance des autorités constatée depuis 2005, cette évolution récente est également perceptible au travers du nombre de condamnations, en diminution depuis 2005 pour les crimes et délits sexuels.
Les condamnations pour crimes sexuels étaient de 1 802 en 2005, contre 1 386 en 2009. Cette diminution ne peut être expliquée par une quelconque augmentation des correctionnalisations, puisque les condamnations pour des délits sexuels ont également diminué sur la période, passant de 6 668 en 2005 à 6 003 en 2009. Il est en revanche possible que le renforcement récent des peines et mesures de sûreté encourues en matière de violences sexuelles, notamment au sein du couple, ait eu un effet dissuasif sur la commission de ces infractions.
NOMBRE DE CONDAMNATIONS ANNUELLES POUR DES CRIMES ET DÉLITS SEXUELS DEPUIS 2000
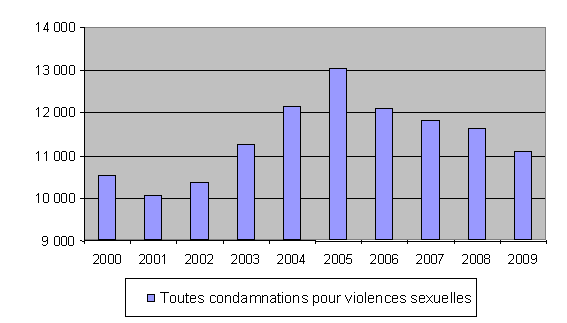
Source : ministère de la Justice.
Les enquêtes de victimation (7) donnent toutefois des résultats très différents. Notamment, les ordres de grandeur sont sans commune mesure avec les chiffres issus des procédures judiciaires. Ainsi, pour les années 2009 et 2010, environ 280 000 personnes auraient été victimes de violences sexuelles en dehors du ménage, dont 60 000 hommes, et 820 000 au sein du ménage (8). Les violences sexuelles sur des victimes de sexe féminin en dehors du ménage ont significativement diminué par rapport à la période précédente. Le taux de victimation des hommes reste stable.
De la comparaison de ces données, deux conclusions peuvent être tirées. D’une part, seule une minorité des infractions sexuelles est portée à la connaissance des autorités, probablement les plus graves. L’enquête de victimation de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) montre que seuls 11,3 % des femmes et 2 % des hommes ont porté plainte pour des infractions à caractère sexuel hors ménage. Cet ordre de grandeur est cohérent avec celui rapporté par d’autres études : seuls 10 % des viols ou tentatives de viols font l’objet d’une plainte (9). Si la parole se libère, comme en attestent les études de victimation, cela ne se traduit pas nécessairement par un recours accru aux autorités judiciaires. D’autre part, un autre fait stylisé se dégage de ces chiffres : les violences sexuelles ont majoritairement lieu au sein du couple.
Ces enquêtes de victimation peuvent également fournir d’autres informations concernant les auteurs de violences sexuelles en France. Les viols et tentatives de viols se produisent majoritairement avant 18 ans, surtout pour les victimes de sexe masculin. L’auteur de ces violences agit seul dans plus de 90 % des cas. Les auteurs d’infractions sexuelles inconnus de leurs victimes sont une minorité, qui tend de plus à décroître avec le temps. Ainsi, « les rapports forcés avant 18 ans sont davantage liés aux univers de socialisation (famille, école, groupes de pairs), alors que ceux qui se produisent plus tard sont assez logiquement marqués par l’univers du couple et du travail » (10).
*
* *
En juillet 2011, le nombre de personnes écrouées pour des infractions à caractère sexuel était inférieur à 8 000, soit 13,9 % de la population carcérale.
NOMBRE D’AUTEURS D’INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL ÉCROUÉS (AICS)
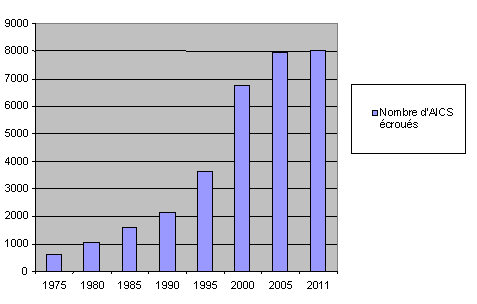
Source : direction de l’Administration pénitentiaire.
Parmi les personnes écrouées pour des faits de violences sexuelles, 1,6 % seulement est de sexe féminin, alors que les femmes représentent 3,2 % de population carcérale dans son ensemble. Les auteurs d’infractions à caractère sexuel judiciarisés sont donc majoritairement des hommes. Toutefois, il est possible que la part des femmes dans la commission d’infractions à caractère sexuel soit sous-évaluée en raison de taux de dénonciation inférieurs à ceux concernant des violences commises par des hommes. En effet, l’inceste maternel étant encore tout à fait tabou, et les représentations sociales n’étant pas favorables à ce que des hommes dénoncent des violences sexuelles commises sur eux par des femmes, le chiffre noir en matière de violences sexuelles commises par des femmes est probablement plus élevé qu’en ce qui concerne les auteurs masculins.
En ce qui concerne la qualification pénale des infractions commises par les auteurs d’infractions à caractère sexuel détenus, 70 % sont de nature criminelle et 30 % de nature délictuelle. La moyenne d’âge de ces détenus est de 44 ans, contre 32 ans pour la population carcérale dans son ensemble. Les auteurs d’infractions à caractère sexuel sont structurellement plus âgés que les autres détenus. Cette tendance risque de s’accentuer dans un futur proche, les peines encourues et prononcées à leur encontre étant plus longues qu’auparavant. Les condamnations prononcées en 2009 sont, en moyenne, de 6,9 années fermes de prison pour un crime de nature sexuelle, et de 1,6 an ferme pour les délits sexuels.
*
* *
Après ces quelques données statistiques, une approche plus psychologique et criminologique est nécessaire. Les auteurs de violences sexuelles, s’ils ne répondent jamais à un profil psychologique unique, ont certains points communs. Depuis les recherches menées par le Dr Claude Balier au milieu des années 1990, les auteurs de violences sexuelles ne sont plus considérés comme des malades mentaux incurables, mais comme des individus souffrant de divers troubles de la personnalité et du comportement.
Une distinction fondamentale a été posée entre la perversion sexuelle, qui consiste à utiliser autrui pour son propre plaisir, et la perversité, qui correspond à une période d’angoisse extrême qui pousse le sujet à l’acte. L’agression sexuelle est alors un moyen de survie psychique utilisé par le sujet pour vaincre cette angoisse. Elle s’accompagne parfois d’une séduction narcissique visant à asseoir son emprise sur la victime. Les auteurs de violences sexuelles sont également enclins au clivage psychologique et au déni : ils peuvent « passer du noir au blanc sans que cela perturbe leur fonctionnement psychique ». Des distorsions cognitives importantes altèrent leur façon d’analyser le comportement de leur victime. Ces individus souffrent également souvent d’un problème de subjectivisation qui les empêche de prendre conscience de leurs actes et de leurs responsabilités.
Pour une certaine partie de la doctrine, il est possible d’établir des typologies des auteurs de violences sexuelles, notamment en fonction de la nature de leurs actes. La littérature distingue ainsi classiquement les pédophiles des parents incestueux, les exhibitionnistes des violeurs de personnes adultes. Les données criminologiques semblent en effet suggérer que ces profils présentent des caractéristiques et des motivations différentes.
Les auteurs d’exhibitionnisme, par exemple, sont les plus susceptibles de récidiver et ce d’autant plus que les sanctions pénales encourues et prononcées sont relativement peu élevées. Une étude (11) distingue ainsi trois formes d’exhibitionnisme :
— l’exhibitionnisme classique, pratiqué par des individus inhibés, parfois dépressifs, qui répondent à leur anxiété par une exhibition compulsive ;
— l’exhibitionnisme masturbatoire, souvent antisocial ou psychopathe, vise plus spécifiquement la satisfaction sexuelle ;
— l’exhibitionnisme satyrique est clairement agressif et peut s’accompagner d’actes plus graves.
En ce qui concerne les infractions sexuelles sur des victimes mineures, il convient de distinguer nettement l’inceste des actes pédophiliques. En effet, les auteurs d’inceste sont rarement pédophiles, mais envisagent un enfant du cercle familial comme un partenaire sexuel normal. D’ailleurs, il est fréquent que l’inceste perdure après la puberté du mineur. L’inceste judiciarisé est porteur d’une dangerosité relativement faible, contrairement aux actes pédophiliques. Dans ce contexte, l’enjeu sera de détecter le plus tôt possible une situation incestueuse.
En ce qui concerne la pédophilie, qui figure au sein de la Classification internationale des maladies (12) établie par l’Organisation mondiale de la Santé comme un trouble de la personnalité, elle n’est pas pénalement répréhensible en tant que telle, dès lors qu’elle ne se traduit pas par un acte. Elle se définit par une attirance sexuelle hétérosexuelle, homosexuelle ou mixte envers un enfant prépubère.
Pour les auteurs d’actes pédophiles, c’est la classification de Groth (13) qui est considérée comme la plus adaptée. Dans le cas d’attentats à la pudeur, ils peuvent être le fait d’une fixation de l’auteur sur l’enfance, qu’il idéalise comme un monde sincère et dénué d’agressivité. Pour leur part, les pédophiles « fixés » sont attirés depuis l’adolescence par des individus plus jeunes, de façon exclusive ou prioritaire. Le pédophile opère alors par la persuasion et la séduction et tente d’avoir une relation affective avec l’enfant. À l’inverse, il peut s’agir d’une « régression » : l’attirance émerge à l’âge adulte et les actes de pédophilie sont liés à un contexte de stress ou d’échec. Pour ce qui est des viols, l’auteur use de la menace, de la force physique ou de l’intimidation et souhaite dominer sa victime. Le motif de l’agression peut alors être la vengeance à l’égard d’injustices que l’auteur estime avoir subies, la volonté de puissance ou le sadisme.
D’autres chercheurs (14) ont dégagé certaines caractéristiques selon le sexe de la victime. Les pédophiles hétérosexuels font en général peu de victimes mais abusent régulièrement de la même personne ; l’agresseur, souvent marié, est également attiré par des femmes adultes ; les agresseurs de victimes féminines récidivent peu. À l’inverse, les pédophiles masculins homosexuels font de nombreuses victimes, mais ne renouvellent pas l’agression sur une même personne ; ils ont généralement une situation socio-économique stable, contrairement aux précédents ; ils sont célibataires et souvent « fixés », n’étant pas attirés par des personnes adultes.
Les auteurs de viols sur adultes forment le groupe le plus hétérogène. De façon générale, les auteurs de viols ne souffrent pas de troubles psychiatriques et ne sont pas sous le coup d’un épisode psychotique aigu au moment de leur passage à l’acte. Plusieurs typologies existent en matière de viols sur des victimes adultes. Selon une première typologie (15), on peut distinguer quatre types de violeurs :
— le violeur de pouvoir ou « power assertive », en général peu agressif, voire attentif à sa victime, qui représenterait près de 75 % des auteurs de violences sexuelles ;
— le violeur machiste ou « power reassurance », qui cherche à éprouver sa virilité aux dépens de sa victime féminine, dont il a généralement une image très dépréciée ;
— le violeur de vengeance ou « anger retaliation », pour lequel il s’agit principalement d’un acte de violence, qui s’exprime sous une forme sexuelle et sur une victime symbolique ;
— le violeur sadique ou « anger excitation », pervers au sens psychanalytique, il prend plaisir à faire du mal à sa victime, sur un mode sexuel ou apparemment non sexuel (actes de barbarie par exemple).
Une autre typologie (16) établie en 2007, distingue le violeur festif, le délinquant sexuel rangé et l’auteur de violences sexuelles isolé. Cette typologie permet d’obtenir plus facilement des données pratiques, mobilisables pour les enquêtes de terrain. En particulier, elle se focalise sur des données objectives en matière de consommation de pornographie, d’hygiène corporelle, d’accès à la propriété ou encore de statut matrimonial. Le violeur festif cherche à satisfaire ses besoins immédiats et à asseoir sa domination sur le sexe opposé. Antisocial, il côtoie cependant fréquemment sa famille immédiate et a au moins un ami intime. Son passage à l’acte est généralement associé à la consommation d’alcool. Le violeur rangé vit souvent en couple, est bien inséré socialement, prémédite son acte mais ne consomme pas de matériel pornographique avant le passage à l’acte. Enfin, le violeur isolé n’a aucune vie sociale et est célibataire. La nature des actes commis varie également en fonction du profil de l’auteur.
Ces typologies, qui ne peuvent fournir, à elles seules, une analyse exhaustive des auteurs de violences sexuelles, présentent l’avantage, pour les praticiens, policiers, juges, conseillers d’insertion et de probation ou médecins, de donner des repères communs qui facilitent la compréhension de l’auteur des faits et le dialogue entre les professionnels œuvrant dans ce domaine.
*
* *
La récidive des auteurs de violences sexuelles fait également débat. D’un côté, le sentiment communément partagé est que ces délinquants au profil psychologique particulier ont une tendance à la récidive plus élevée que les autres. D’un autre côté, les chiffres issus du casier judiciaire démentent cette première impression, pourtant extrêmement vive parmi nos concitoyens. Un premier élément d’explication de cette discordance réside probablement dans l’« effet loupe » créé par les médias sur les affaires les plus graves, il est vrai souvent commises en récidive. Mais il a également été avancé par certains que le taux de récidive officiel, issu des données du casier judiciaire, était, par construction, erroné.
Plusieurs études ont été menées à partir des données issues du casier judiciaire national. Une première étude (17) conduite en 2003 a montré que les personnes condamnées pour viol en 2001 avaient, pour 1,8 % d’entre elles, déjà été condamnées pour un crime dans les 18 années précédentes. Dans 80 % des cas, la première infraction était un viol. Ces chiffres doivent être mis en regard avec ceux qui existent en matière de vols, par exemple. Pour les vols aggravés, l’étude révèle en effet un taux de récidive de 14,7 %.
Les mêmes ordres de grandeur émergent d’une autre étude (18), plus récente, menée pour le compte de l’administration pénitentiaire. Elle fait en effet apparaître les taux de recondamnation des personnes libérées en 2002, en fonction de la nature de l’infraction initiale. Pour les viols sur mineurs, 19 % des personnes libérées en 2002 sont à nouveau condamnées dans les cinq années qui suivent. Mais seuls 0,6 % d’entre elles commettent une infraction suffisamment grave pour justifier une réclusion criminelle. De la même façon, en ce qui concerne les viols sur majeurs, le taux de recondamnation est de 39 %, mais seuls 1,9 % des personnes libérées en 2002 commettent, dans les cinq années qui suivent leur libération, un crime puni d’au moins quinze ans de réclusion.
Ces données coïncident avec les chiffres issus des condamnations annuelles prononcées par les tribunaux. Par exemple, en 2009, parmi les 1 386 crimes sexuels jugés, seuls 3,2 % étaient commis en état de récidive légale, soit 45 % de moins que le taux de récidive des autres crimes. Il en est de même pour les délits sexuels jugés en 2009, dont 3,1 % étaient commis en état de récidive légale, contre 10,5 % pour les autres délits. Le taux de récidive en matière de délits sexuels est donc plus de trois fois inférieur au taux de récidive des autres délits.
Il est vrai que ces chiffres créent une sorte de décalage entre l’état des lieux établi d’un point de vue statistique et la réalité ressentie par nos concitoyens.
La notion de récidive légale est pour le moins restrictive. En effet, en droit français, les délits punis de moins de dix ans d’emprisonnement répondent à une récidive dite « spéciale » : la récidive est acquise si la personne déjà condamnée pour un délit commet, dans les cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive (19). Il est à noter que les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction (20).
En ce qui concerne les crimes et les délits punis de plus de dix ans d’emprisonnement, la récidive est acquise dans trois cas :
— la commission, dans les cinq ans, d’un délit puni d’un à dix ans d’emprisonnement (21) ;
— la commission, dans les dix ans, d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement (22) ;
— la commission, sans limitation de durée, d’un nouveau crime (23).
Ainsi, certains cas de figure peuvent échapper à la comptabilisation, notamment la récidive du délit au crime sexuel. De même, la récidive, en matière criminelle, peut être acquise sans que la première infraction soit de nature sexuelle. Il existe en outre, comme pour toutes les infractions, deux biais principaux : la non-déclaration à la police par la victime et l’absence de poursuites, si l’auteur des faits n’est pas identifié.
Comme les études de victimation le montrent, il existe un « chiffre noir » très élevé en ce qui concerne les infractions à caractère sexuel, les condamnations ne représentant qu’une partie non quantifiable des infractions réelles. Néanmoins, plusieurs éléments militent en faveur d’une tendance à la baisse de ce chiffre noir. En effet, du fait de la vigilance accrue des parents et d’une parole facilitée (24), mais aussi des évolutions techniques en matière d’identification génétique, en lien avec l’instauration du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), les infractions sexuelles sont de plus en plus poursuivies.
Les études internationales réalisées en matière de récidive sexuelle donnent des résultats plus élevés que celles conduites en France. Ainsi, une méta-analyse de 1998 (25), portant sur 61 études et plus de 28 000 auteurs d’infractions à caractère sexuel, montrait que le taux de récidive sexuel s’établissait à 13,4 % en moyenne dans les cinq années suivant la libération des personnes condamnées. Une autre étude canadienne (26), plus récente, portant sur plus de 4 700 auteurs de violences sexuelles anglo-saxons montre que le taux de récidive sexuelle à cinq ans est de 14 %, et de 24 % après 15 ans. Cette étude prenait en compte, au-delà des seules condamnations, les dénonciations ainsi que les renseignements détenus par la police. Enfin, une étude belge de 2008 (27) a montré un taux de récidive de 7,9 % dans les 4,5 années suivant la libération de 231 auteurs d’infractions à caractère sexuel. L’Académie nationale de médecine, sur la base d’études menées à l’étranger, estime que le taux de récidive peut être évalué à 13,8 % (28). Si l’on s’en réfère à ces études, le taux de récidive serait plus élevé que ce que laissent entrevoir les études conduites en France.
Encore faut-il pouvoir comparer ce qui est comparable. En effet, ces études portent sur des sujets pour la plupart non français et recourent à des méthodologies variées.
Le taux de récidive n’existe pas en tant que tel : il répond à une définition plus ou moins large. Plus cette définition initiale sera large, plus le taux de récidive sera élevé. Or, les infractions à caractère sexuel ne sont pas définies de la même façon pour tous les pays. La France, par exemple, a une vision relativement extensive du viol, qui est défini comme tout acte de pénétration sexuelle. Par ailleurs, la période d’observation prise en compte par les études a également un impact indéniable sur le taux de récidive : s’il est avéré que le taux de récidive individuel diminue avec le temps – autrement dit, plus l’auteur de violences sexuelles passe de temps dans la collectivité sans récidiver, moins son risque de récidive est élevé – en revanche, le nombre de récidivistes augmente nécessairement avec l’élargissement de la période d’étude, ce qui a un impact sur le taux de récidive global.
Enfin, ces études ne tiennent pas compte de l’effet de l’environnement social, des traitements et de la législation sur le taux de récidive. Or, il est certain que certaines mesures de sûreté, mises en place à l’issue de la peine, ont un impact sur le taux de récidive. De la même façon, les traitements médicaux ou psychologiques suivis en détention ou à l’issue d’une peine d’emprisonnement ne sont pas sans effet sur la récidive des auteurs de violences sexuelles. Ainsi, ces études ne peuvent être comparées aux chiffres issus du casier judiciaire français.
Néanmoins, ces études apportent certains éléments d’information en matière de récidive sexuelle :
— « la plupart des délinquants sexuels ne commettent pas de nouvelle infraction sexuelle »,
— « ceux qui en sont à leur première infraction sexuelle sont beaucoup moins susceptibles de commettre une nouvelle infraction sexuelle que ceux qui avaient déjà été condamnés pour une infraction sexuelle »,
— « les délinquants de plus de 50 ans sont moins susceptibles de récidiver que les délinquants moins âgés »,
— « à mesure que s’allonge la période que les délinquants passent dans la collectivité sans commettre d’infraction, le taux de récidive sexuelle décroît »,
— « les taux de récidive sont différents pour les violeurs, les auteurs d’inceste, les agresseurs d’enfants qui s’en prennent à des filles et les agresseurs d’enfants qui s’en prennent à des garçons », « le taux le plus élevé ayant été observé chez les agresseurs s’en prenant à des garçons à l’extérieur de la famille […] et le plus faible chez les auteurs d’inceste » (29).
La comparaison de ces données illustre, s’il en était besoin, la nécessité de conduire des études statistiques plus poussées, en France, sur le taux de récidive sexuelle, en prenant en compte un champ plus large que celui de la seule récidive légale.
*
* *
L’objet de ce rapport a nécessité la mise à plat de l’ensemble du dispositif normatif relatif au suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel, tant législatif que réglementaire. Ces délinquants relevant souvent concomitamment de la peine et du soin, votre rapporteur a souhaité étudier et évaluer tous les dispositifs de suivi judiciaire et médico-psychologique disponibles à l’heure actuelle, afin de détecter d’éventuelles failles ou carences. La mission s’est également intéressée aux dispositifs mis en place à l’étranger, dans les pays anglo-saxons notamment, mais également en Allemagne et en Belgique.
Pour remplir ces objectifs, votre rapporteur et les membres de la mission ont entendu l’ensemble des acteurs du suivi : magistrats, psychiatres et psychologues, conseillers d’insertion et de probation, chercheurs, juristes et criminologues. Pour mieux comprendre certaines initiatives locales, la mission s’est déplacée à Bordeaux et Grenoble. Elle a également visité les établissements pénitentiaires de Melun, Fresnes et Lyon-Corbas.
Il ressort des travaux de la mission que le système juridique actuel est particulièrement complet et adapté aux auteurs d’infractions à caractère sexuel. La mise en œuvre de ce dispositif est en revanche perfectible, le manque de moyens et de coordination entre les acteurs étant susceptible de conduire à des blocages néfastes. Plusieurs pistes sont donc analysées pour permettre l’amélioration de l’évaluation et du suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
PREMIÈRE PARTIE : UN DISPOSITIF JURIDIQUE ÉLABORÉ DE SUIVI DES AUTEURS D’INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL
Les auteurs d’infractions à caractère sexuel sont parfois porteurs d’une dangerosité criminologique certaine et nécessitent un suivi plus intense que d’autres personnes ayant transgressé la loi pénale. Mais, bien qu’étant pénalement responsables, ces personnes relèvent également du soin. La réponse pénale se doit donc d’être double : à la fois surveiller ces personnes qui peuvent récidiver et traiter, autant que possible, les déviances dont elles souffrent. Sur ces deux aspects, le droit existant, très élaboré et complet, a probablement atteint ses limites, mis à part quelques perfectionnements ponctuels encore nécessaires.
I. SURVEILLER : UN DISPOSITIF JURIDIQUE COMPLET
Suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, surveillance de sûreté, rétention de sûreté, placement sous surveillance électronique mobile, inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles : les dispositifs ne manquent pas qui permettent d’assurer une surveillance efficace des auteurs de violences sexuelles. Loin d’être le fruit d’une accumulation sans logique de dispositifs normatifs, le droit relatif aux auteurs d’infractions à caractère sexuel n’a cessé de s’étoffer pour atteindre, aujourd’hui, un degré de perfectionnement à la mesure de la gravité de ces infractions.
A. LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE, UNE MESURE EMBLÉMATIQUE
Le suivi socio-judiciaire est, historiquement, la première mesure de surveillance post-carcérale visant spécifiquement les auteurs d’infractions à caractère sexuel. En dépit de son extension à d’autres catégories d’infractions, les statistiques relatives au prononcé de ce dispositif permettent de constater qu’il concerne encore au premier chef ce public particulier.
1. Une peine spécifique à destination des auteurs d’infractions à caractère sexuel
Le suivi socio-judiciaire a été institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Cette mesure, qui marquait, pour certains observateurs de l’époque, un « alourdissement très net du dispositif applicable aux auteurs de ces infractions » (30), reposait sur le postulat que les auteurs de violences sexuelles souffrent, pour la plupart, de troubles de la personnalité dont le traitement est nécessaire à la prévention de la récidive.
Le suivi socio-judiciaire, que certains considèrent, au plan de la philosophie pénale, comme une mesure sui generis, à mi-chemin entre la peine et la mesure de sûreté, ne saurait, au plan juridique, être compris comme autre chose qu’une peine. D’une part, parce que l’intention du législateur de l’époque était claire : placé, dans le code pénal, dans le titre III intitulé « Des peines », le suivi socio-judiciaire peut par ailleurs être prononcé à titre de « peine principale » en application de l’article 131-36-7 du code pénal. D’autre part, parce que son mécanisme le rattache sans aucun doute à une peine : il est prononcé par la juridiction de jugement, ab initio, pour un temps déterminé à l’avance et le fait générateur de la mesure est bien une infraction. D’ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le suivi socio-judiciaire de « peine complémentaire », interdisant ainsi toute application rétroactive (31).
Sur le fond, le suivi socio-judiciaire consiste en l’obligation, pour la personne condamnée, de se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant un temps déterminé par la juridiction de jugement. Ce temps peut être relativement long, comme le montre le tableau ci-dessous.
DURÉE MAXIMALE DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE EN FONCTION DE LA NATURE DES FAITS À L’ORIGINE DE LA CONDAMNATION
Nature de l’infraction |
Durée (cas général) |
Durée (cas spécifique) |
Délits |
10 ans |
20 ans, par décision spécialement motivée |
Crimes |
20 ans |
30 ans, pour les crimes punis d’une réclusion criminelle de 30 ans Durée indéterminée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité |
Source : article 131-36-1 du code pénal.
Dans les faits, le suivi socio-judiciaire atteint rarement des durées excessives. En 2004, alors que le suivi socio-judiciaire ne pouvait excéder dix ans en cas de condamnation pour un délit et vingt ans pour un crime, les mesures de suivi socio-judiciaires prononcées étaient, en moyenne, de 5,3 ans pour un délit et de sept ans pour un crime (32). La durée la plus fréquemment prononcée était de 5 ans pour les délits (44 %) comme pour les crimes (38 %). Seuls 5 % des suivis socio-judiciaires prononcés contre des crimes dépassaient alors 10 ans. Qu’en est-il aujourd’hui ? La durée moyenne d’un suivi socio-judiciaire prononcé ne semble pas avoir changé, puisqu’elle est aujourd’hui de 5,8 ans, crimes et délits confondus (33).
Par ailleurs, le relèvement de la peine de suivi socio-judiciaire est possible (34), ce qui atténue quelque peu la durée théoriquement longue de ce dispositif. Toutefois, dans ce domaine comme dans d’autres, la « politique du parapluie » règne dans l’examen de chaque dossier, ce qui explique que cette possibilité, quoique bien accueillie par les praticiens, soit encore peu utilisée, ainsi que l’ont indiqué des juges d’application des peines à la mission.
Le suivi socio-judiciaire comporte des mesures de surveillance et d’assistance, qui poursuivent deux buts distincts : la prévention de la récidive et la réinsertion du condamné. Les mesures de surveillance peuvent être celles prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal et, notamment, l’obligation de répondre aux convocations du juge de l’application des peines (JAP) ou du travailleur social désigné, l’obligation de prévenir ce dernier de tout changement de situation personnelle (changement d’emploi, de résidence), l’obligation d’obtenir l’autorisation du JAP pour tout déplacement à l’étranger, l’obligation de se soumettre à une injonction thérapeutique, l’obligation de s’abstenir de paraître dans tout lieu spécialement désigné, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, etc.
Par ailleurs, depuis la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté (35), le juge de l’application des peines peut soumettre la personne à l’encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire a été prononcé à une assignation à domicile. Toutefois, cette disposition ne peut être appliquée qu’aux personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour des infractions permettant le prononcé d’une rétention de sûreté (36). Le but du législateur était alors d’éviter le prononcé d’une rétention de sûreté par le renforcement des obligations du suivi socio-judiciaire, dès lors que celles-ci paraissaient suffisantes.
En cas de non-respect des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines peut mettre à exécution l’emprisonnement fixé par la juridiction de jugement, qui ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit et sept ans pour un crime. En 2009, 85 décisions de mises à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement ont été prononcées, et 95 en 2010 (37). Au 1er janvier 2012, 17 personnes étaient écrouées pour non-observation de leurs obligations, pour une durée moyenne de 8,3 mois. Ce chiffre semble particulièrement faible au regard du nombre de suivis socio-judiciaires pris en charge, qui était de 4 241 au 1er janvier 2011 (38).
LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE, FILET DE SÉCURITÉ DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE Instaurée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la surveillance judiciaire avait pour vocation première de permettre le suivi de personnes non susceptibles d’être soumises à un suivi socio-judiciaire du fait de l’application du principe de non-rétroactivité. Cette mesure, qui peut comporter les mêmes obligations que celles prévues dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, mais également un placement sous surveillance électronique mobile, une injonction de soins ainsi qu’une assignation à domicile, concerne deux types de personnes condamnées : § les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ; § les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et commis une nouvelle fois en état de récidive légale. La surveillance judiciaire ne peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire (39) ou ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, sauf si celle-ci a été totalement révoquée. Le but de cette mesure est d’éviter la sortie « sèche » de personnes dont le risque de récidive est relativement élevé et qui ne peuvent bénéficier d’aucune mesure d’aménagement, du fait de leur dangerosité, ou de surveillance, du fait de la non applicabilité de la loi relative au suivi socio-judiciaire. Cette mesure de sûreté, rétroactive, ne saurait cependant avoir les mêmes effets que le suivi socio-judiciaire. En effet, elle est limitée à la durée des réductions de peines acquises par la personne condamnée. La surveillance judiciaire peut déboucher sur une surveillance de sûreté, si la persistance de la dangerosité est constatée par une expertise médicale et que la personne répond, par ailleurs, aux critères de la surveillance de sûreté (article 723-37 du code de procédure pénale), notamment qu’aucune autre mesure ne permet de prévenir la commission de nouvelles infractions. |
2. Une injonction de soins consubstantielle à la mesure de suivi socio-judiciaire
Le suivi socio-judiciaire, tel qu’il a été créé et modifié par le législateur, est intimement lié au soin. L’injonction de soins susceptible de l’accompagner sera, en tant que telle, analysée plus bas. À l’origine, le suivi socio-judiciaire est analysé comme une mesure « judiciaire et si nécessaire médicale » (40). Il s’agit alors, en 1998, « d'augmenter " l'ombrelle pénale " sur les auteurs d'infractions sexuelles » (41), pédophiles en particulier. Dans ce cadre, l’injonction de soins est accessoire et facultative, et ne peut être prononcée que si une expertise médicale établit la réceptivité et l’accessibilité de la personne condamnée à un traitement médical, psychiatrique ou psychologique.
La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive (42) a modifié de façon substantielle la philosophie même du suivi socio-judiciaire. Désormais, l’injonction de soins accompagne de façon systématique le prononcé d’un suivi socio-judiciaire, « sauf décision contraire de la juridiction » (43). Certes, en droit, la juridiction peut toujours écarter l’injonction de soins. De plus, le prononcé du suivi socio-judiciaire est restreint par la nécessité d’obtenir, au moyen d’une expertise, l’assurance que la personne condamnée peut effectivement recevoir un traitement. Toutefois, dans les faits, les magistrats y dérogent assez peu, comme l’ont indiqué des représentants de la magistrature à la mission d’information.
C’est également ce que semblent suggérer les statistiques, même partielles et insuffisantes, dont nous disposons aujourd’hui. Le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des affaires sociales de mars 2011 (44) indique que l’injonction de soins est prononcée dans 66 % des cas par la juridiction de jugement. Bien souvent, l’injonction de soins est d’ailleurs la seule obligation prononcée par la juridiction de jugement, qui focalise toute son attention sur ce dispositif et laisse le soin au juge de l’application des peines d’adapter le contenu du suivi socio-judiciaire en tant que tel (45).
De fait, certains acteurs du monde judiciaire déplorent le caractère automatique du prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. En effet, l’ensemble des interlocuteurs de la mission estiment que certains auteurs d’infractions, même à caractère sexuel, ne présentent pas de troubles de la personnalité ou du comportement, mais nécessitent seulement un suivi de type éducatif. Il en est de même pour d’autres infractions, notamment les incendies volontaires : si certains auteurs sont effectivement pyromanes et nécessitent donc des soins particuliers, d’autres peuvent être qualifiés d’« incendiaires opportunistes ». Dans un tel cas de figure, le prononcé d’une injonction de soins, outre qu’il n’est pas indiqué, encombre inutilement le dispositif.
La mission ne peut que partager cette opinion mais constate que le droit en vigueur permet à la juridiction de jugement de passer outre le prononcé d’une injonction de soins et au juge de l’application des peines de faire cesser l’injonction de soins. Toutefois, il est vrai que la pression des médias et de la société civile, comme l’existence d’expertises psychiatriques concluant trop facilement, pour les mêmes raisons, à la nécessité de soins, peuvent avoir pour effet de limiter le prononcé de suivis socio-judiciaires non assortis d’une injonction de soins.
Le suivi socio-judiciaire concernait, à l’origine, l’ensemble des infractions à caractère sexuel : meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbaries, agressions sexuelles, exhibition sexuelle, atteintes sexuelles sur mineurs, diffusion d’images violentes ou pornographiques, enregistrement d’images pornographiques d’un mineur et corruption de mineurs. Certaines infractions pourtant extrêmement graves, comme le meurtre d’un mineur, n’entraient pas dans le champ du suivi socio-judiciaire, qui était alors entièrement tourné vers les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Les demandes réitérées des praticiens du droit ont, semble-t-il, conduit le législateur à permettre le prononcé de cette peine pour des infractions susceptibles de révéler, chez leurs auteurs, des troubles du comportement ou de la personnalité.
EXTENSION DES INFRACTIONS POUR LESQUELLES LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE EST ENCOURU
Crimes |
Loi du 17 juin 1998 |
- meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie (article 222-48-1 du code pénal), - viol (art. 222-48-1 du code pénal). |
Loi du 12 décembre 2005 |
- meurtre et assassinat (article 221-9-1 du code pénal), - torture ou acte de barbarie (article 222-48-1 du code pénal), - enlèvement ou séquestration (article 224-10 du code pénal). | |
Délits |
Loi du 17 juin 1998 |
- agression sexuelle et exhibition sexuelle (article 222-48-1 du code pénal), - corruption de mineur, fixation, enregistrement, diffusion de l’image pornographique d’un mineur, diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur (article 227-31 du code pénal) |
Loi du 12 décembre 2005 |
- destruction ou dégradation d’un bien sous l’effet d’un incendie ou d’une substance explosive (article 322-18 du code pénal). | |
Loi du 5 mars 2007 |
- violences conjugales (article 222-48-1 du code pénal). | |
Loi du 9 juillet 2010 |
- menaces commises au sein du couple (art. 222-48-1 du code pénal). |
Le suivi socio-judiciaire, du fait de textes réglementaires pris de façon tardive, a connu une montée en charge très progressive, puisqu’en 2000, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, seules 5 % des condamnations éligibles à ce dispositif faisaient effectivement l’objet d’un suivi socio-judiciaire. En 2004, le recours au suivi socio-judiciaire atteignait 12 %. À partir de 2005 cependant, et avec l’entrée en vigueur des lois du 12 décembre 2005, du 5 mars 2007 puis du 9 juillet 2010 étendant considérablement le champ du suivi socio-judiciaire, le taux de prononcé des peines de suivi socio-judiciaire a diminué pour atteindre 4,9 % en 2009.
ÉVOLUTION DU PRONONCÉ DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE DE 2000 À 2009
année |
condamnations « éligibles » |
mesures de suivi socio-judiciaire |
taux de SSJ |
2000 |
5 052 |
258 |
5,1 % |
2001 |
6 041 |
413 |
6,8 % |
2002 |
7 087 |
626 |
8,8 % |
2003 |
7 922 |
836 |
41,6 % |
2004 |
8 910 |
1 024 |
11,5 % |
2006 |
11 170 |
1 181 |
10,6 % |
2008 |
28 252 |
1 313 |
4,6 % |
2009 |
30 376 |
1 303 |
4,3 % |
Source : ministère de la Justice.
Toutefois, il serait erroné de conclure à un insuccès de ce dispositif, la réforme de 2007 ayant conduit au triplement du nombre de condamnations éligibles. Or, pour ces nouvelles infractions, le prononcé d’un suivi socio-judiciaire est nettement plus faible. En valeur absolue, la montée en charge du dispositif est indéniable : d’environ 260 en 2000, les peines de suivi socio-judiciaire prononcées sont passées à 1 300 en 2009.
De nombreux interlocuteurs de la mission d’information ont déploré l’extension récente du champ du suivi socio-judiciaire, qui ferait perdre son sens à cette mesure initialement destinée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il est vrai qu’en 2009, les infractions à caractère sexuel ne représentaient plus que 30 % des condamnations éligibles.
Mais, en étudiant les chiffres de plus près, il semble que, dans son application, cette mesure n’ait en rien perdu de sa philosophie initiale, ses extensions successives n’ayant eu qu’un impact marginal. En effet, en 2009, le suivi socio-judiciaire était prononcé à 87 % à l’encontre d’auteurs d’infractions à caractère sexuel ; en 2010, 974 suivis socio-judiciaires ont été prononcés à l’égard d’auteurs d’infractions à caractère sexuel, ce qui constitue donc une part très majoritaire de l’ensemble des peines de suivi socio-judiciaire prononcées cette même année. Par ailleurs, le taux de recours au suivi socio-judiciaire, en matière d’infractions à caractère sexuel, s’élève à plus de 12 %, d’après la Chancellerie. À l’inverse, les violences conjugales ne donnaient lieu au prononcé d’un suivi socio-judiciaire que dans 0,2 % des cas.
Ainsi, le suivi socio-judiciaire concerne principalement les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il n’est utilisé qu’avec parcimonie par les juges pour les autres infractions entrant dans son champ. Par ailleurs, ces chiffres vont également à l’encontre de l’idée souvent répandue que les juges, dans une application excessive du principe de précaution, se sentent contraints de prononcer de façon systématique le suivi socio-judiciaire. Dans les faits, les magistrats semblent disposer de marges de manœuvre suffisantes pour prononcer cette peine de façon appropriée, à cette réserve près que, comme il a été dit plus haut, l’injonction de soins est peut-être encore trop fréquemment prononcée dans des cas où elle n’est pas nécessaire.
B. LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE
Le placement sous surveillance électronique mobile, qui se distingue du placement sous surveillance électronique introduit en 1999, que l’on qualifiera a contrario de « fixe », est l’une des innovations récentes du droit pénal français. Ce que certains auteurs considèrent comme une « muraille de silicium » (46), qui mêle à la fois modernité des moyens techniques et changement de la philosophie pénale, est un outil théoriquement efficace de surveillance des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
1. Un dispositif transversal qui concerne principalement des auteurs de violences sexuelles
Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) est une mesure de sûreté introduite en droit français par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Principale innovation de cette loi, la mise en place d’une surveillance électronique mobile en France avait, à l’époque, fait l’objet de vifs débats au sein du Parlement. Déjà appliquée dans certains pays anglo-saxons, la mesure avait été préconisée, depuis plusieurs années, par de nombreux rapports (47).
a) L’extension régulière des possibilités de placement sous surveillance électronique mobile
Alors que l’Assemblée nationale entendait en faire une mesure de sûreté autonome, un compromis avait été trouvé avec le Sénat conduisant à assortir la mesure de suivi socio-judiciaire de cette nouvelle obligation. Mais, la Cour de cassation ayant interdit toute application rétroactive de la peine de suivi socio-judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile qui l’accompagnait ne pouvait s’appliquer qu’à des auteurs de faits commis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Aussi, pour permettre, conformément à l’objectif premier de cette loi, de prévenir la récidive de personnes libérées dont on estime qu’elles risquent de transgresser à nouveau la loi, une nouvelle mesure de sûreté a été créée : la surveillance judiciaire.
Ce dispositif, qui se rapproche en de nombreux points du suivi socio-judiciaire, notamment par les obligations qu’il comporte, présente l’intérêt d’être applicable aux faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005. Dans ce cadre, un placement sous surveillance électronique mobile peut être prononcé par le juge de l’application des peines comme obligation de la surveillance judiciaire. Toutefois, les personnes libérées ne peuvent y être soumises que dans le temps correspondant à leurs réductions de peine.
Initialement possible dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un suivi socio-judiciaire et d’une surveillance judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile a ensuite été étendu à la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l’assignation à résidence. Le placement sous surveillance électronique mobile peut, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, accompagner une surveillance de sûreté ainsi qu’une permission de sortie accordée à la personne soumise à une rétention de sûreté. Par ailleurs, la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans le souci de créer une mesure intermédiaire entre la détention provisoire et le simple contrôle judiciaire, a permis l’assignation à résidence de personnes mises en examen, doublée d’un placement sous surveillance électronique mobile pour les infractions d’une certaine gravité (48).
Plusieurs lois sont également intervenues pour élargir les cas de recours déjà existants ou faciliter le prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile. La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a étendu le prononcé d’un placement dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire aux infractions de menaces et de violences commises dans le cercle familial. Par ailleurs, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a également abaissé le seuil à partir duquel peut être prononcé le placement intervenant dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, pour les multirécidivistes. Enfin, la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a supprimé l’article 131-36-11 du code pénal, qui posait plusieurs conditions procédurales au prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile (49).
Le placement sous surveillance électronique a donc pour particularité d’être un dispositif transversal qui ne peut être prononcé que dans le cadre de peines ou de mesures de sûreté strictement définies. Du fait de son rattachement au suivi socio-judiciaire et à toutes les mesures de sûreté existantes, le placement sous surveillance électronique mobile concerne principalement les auteurs d’infractions à caractère sexuel. De fait, 80 % des personnes placées sous surveillance électronique mobile le sont pour des faits de nature sexuelle.
Si des lois successives ont entendu élargir le recours au placement sous surveillance électronique mobile, ce dispositif concerne un nombre limité de personnes et s’exécute majoritairement dans le cadre d’une surveillance judiciaire. En septembre 2011, 53 personnes seulement étaient placées sous surveillance électronique mobile. Cela tient, d’une part, au fait que l’extension de l’application de la loi du 12 octobre 2005 à l’ensemble du territoire national a été précédée d’une phase d’expérimentation du dispositif qui a duré un an et demi (50). D’autre part, ce dispositif n’a qu’un champ d’application relativement restreint.
PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Cadre juridique |
Fondement législatif |
Conditions tenant à l’infraction commise |
Conditions tenant à la peine prononcée |
Pouvoirs du juge |
Durée maximale de la mesure |
Libération conditionnelle |
article 731-1 CPP (Loi du 12 décembre 2005) |
Infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru |
Peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 7 ans |
Possibilité |
4 ans en matière délictuelle et 6 ans en matière criminelle (article 731-1 CPP) |
|
article 730-2CPP (Loi du 10 août 2011) |
Peine de réclusion criminelle supérieure ou égale à 15 ans |
Obligation, sauf semi-liberté ou PSE pendant un à trois ans | |||
— |
Peine de réclusion criminelle à perpétuité | ||||
Infraction pour laquelle la rétention de sûreté est encourue |
Peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 10 ans | ||||
|
Suivi socio-judiciaire |
articles 131-36-9 CP à 131-36-12 et 763-3 CPP (Loi du 12 décembre 2005) |
— |
Peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 7 ans |
Possibilité restreinte par plusieurs conditions cumulatives : 1) Expertise médicale constatant la dangerosité, 2) Caractère indispensable à la prévention de la récidive. 3) Pour le JAP uniquement, faisabilité technique de la mesure |
4 ans en matière délictuelle et 6 ans en matière criminelle (article 131-36-12 CP) |
article 131-36-10 CP (Loi du 14 mars 2011) |
Commise en nouvelle récidive |
Peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans | |||
article 131-36-12-1 CP (Loi du 9 juillet 2010) |
Violences et menaces dans le cercle familial |
Peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans |
Possibilité, si une expertise médicale constate la dangerosité | ||
Surveillance judiciaire |
article 723-30 CPP (Loi du 12 décembre 2005) |
Conditions de la surveillance judiciaire |
Conditions de la surveillance judiciaire |
Obligatoire, après vérification de faisabilité technique |
4 ans en matière délictuelle et 6 ans en matière criminelle |
article 723-38 CPP (Loi du 25 février 2008) |
Infraction pour laquelle la rétention de sûreté est encourue |
Peine de réclusion criminelle supérieure ou égale à 15 ans |
— |
Durée de la mesure de surveillance judiciaire | |
Surveillance de sûreté |
article 706-53-19 CPP (Loi du 25 février 2008) |
Conditions de la surveillance de sûreté |
Conditions de la surveillance de sûreté |
Possibilité, après vérification de faisabilité technique |
Durée de la surveillance de sûreté |
Rétention de sûreté |
article 706-53-22 CPP (Loi du 25 février 2008) |
— |
— |
Possibilité alternative à l’escorte, en cas de permission de sortie |
Durée de la permission de sortie (article R.53-8-70 CPP) |
b) Le placement sous surveillance électronique mobile, un panoptique moderne ?
En 1787, le philosophe anglais Jeremy Bentham imagine une prison d’une architecture particulièrement novatrice, devant permettre de susciter, chez les détenus, une forme d’autocontrôle : le Panoptique. Dans ce modèle carcéral, les détenus sont hébergés dans un bâtiment circulaire et transparent, au centre duquel se trouve la tour abritant les surveillants pénitentiaires, invisibles aux condamnés. Voir sans être vu, tel est la devise du panoptique. Les détenus, ne sachant pas s’ils sont observés ou non, tendent à se comporter de la même façon que si l’on exerçait sur eux une surveillance continue. La simple possibilité d’un contrôle agit sur les consciences.
C’est selon les mêmes principes que fonctionne le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM). Leur surveillance permanente, bien qu’invisible, conduit théoriquement le placé à se conduire de la même façon que s’il était surveillé par une personne physique. Ainsi, comme le note M. Olivier Razac, chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire (CIRAP-ENAP)(51), « l'inspection, la surveillance produite par cet objet high-tech peut ainsi paraître tout à fait inédite selon ses modalités techniques. Elle permet non seulement de savoir précisément où se trouve un individu sur tout le territoire mais aussi de savoir vers où il se déplace et même à quelle vitesse. Elle permet d'induire chez lui un certain nombre de comportements : ne pas entrer ou sortir de certains lieux, mais aussi prendre garde à la nature de ses activités dans la mesure où le journal de ses déplacements est susceptible d'être analysé et interprété. »
Le fait d’être localisé à tout instant sur le territoire semble en effet avoir un effet structurant et contenant chez les placés : structurant, car leurs déplacements doivent respecter des heures de sortie et certaines zones géographiques ; contenant, car les placés seraient irrémédiablement appréhendés en cas de commission d’une nouvelle infraction. C’est ce qui ressort d’une étude du CIRAP d’avril 2009 (52) : « Du fait de la longueur de l’incarcération, de l’instabilité psychique des placés et de leur dénuement quasi total à la sortie, le PSEM peut être considéré, dans un premier temps, comme une aide dans la restructuration d’une vie normale […] Plus profondément, l’aspect cadrant du PSEM reposerait sur la forme " contractuelle " de l’engagement à respecter des contraintes et donc sur l’autocontrôle que cet engagement suppose ». Le fait que certaines personnes souhaitent porter leur bracelet électronique au-delà de la durée ordonnée par le juge, précisément parce que le bracelet cadre leur emploi du temps comme leurs comportements, a d’ailleurs été porté à la connaissance de la mission d’information. Enfin, la surveillance électronique mobile facilite, le cas échéant, l’élucidation des infractions. Ainsi, dans les deux cas, que la personne récidive ou non, le bracelet électronique aura prouvé son utilité.
Dans les faits, il est difficile de mesurer l’efficacité du placement sous surveillance électronique mobile. D’une part, parce que le bracelet électronique concerne encore un nombre réduit de personnes condamnées. En 2011, seules 132 personnes avaient été placées, depuis 2007, sous surveillance électronique mobile. D’autre part, parce qu’il est difficile d’obtenir des données concernant le taux d’échec du placement sous surveillance électronique mobile et ses raisons. En octobre 2011, seuls 33 placements avaient fait l’objet d’un retrait, soit un taux d’échec de 25 %.
Toutefois, il semble que ces décisions de retrait n’aient pas pour origine unique le non-respect des obligations liées au placement, mais résultent également du non-respect d’autres obligations posées par le juge, comme le suivi de soins ou l’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs. Par exemple, dans la région lyonnaise (53), sur cinq placements sous surveillance électronique gérés, seuls deux échecs sont à déplorer : l’une des personnes placées sous surveillance électronique mobile a tenté de récidiver, l’autre s’est rendue coupable de conduite en état d’ivresse.
C’est également ce qui ressort des réponses au questionnaire adressé par la mission d’information aux services pénitentiaires d’insertion et de probation. Peu d’incidents semblent à déplorer. Deux placés seulement n’ont pas respecté leurs obligations de déplacement, une personne a commis une nouvelle infraction à caractère sexuel, un placé n’a pas supporté le caractère stigmatisant du dispositif, un retrait a été ordonné pour ne pas avoir déféré à la convocation d’un juge. Une personne, enfin, ne suivait pas son obligation de soins. De façon générale, les incidents nécessitant un retrait de la mesure sont peu fréquents, ce qui atteste de l’efficacité de ce dispositif en matière de récidive.
2. D’importants problèmes pratiques qui en font un système largement perfectible
Si la surveillance électronique mobile semble être un dispositif efficace en termes de prévention de la récidive, elle est, dans les faits, complexe à mettre en œuvre, tant du point de vue des placés que de celui des personnels chargés de leur surveillance. Pour certains observateurs, les nombreux défauts du placement sous surveillance électronique mobile, tel qu’il existe aujourd’hui, en font une « coquille vide ». Des évolutions techniques comme une plus grande réactivité du système de surveillance devraient permettre à ce dispositif d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés.
a) Un dispositif technique inachevé
Le placement sous surveillance électronique permet, en théorie, la localisation continue et à une dizaine de mètres près de la personne porteuse du dispositif grâce au système GPS (54). Lorsque le signal n’est pas disponible, le réseau GSM (55) prend le relais, avec une précision toutefois nettement moins grande. Comme le notait M. Sébastien Huyghe dans son avis budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (56), cela constitue déjà une avancée importante, par rapport aux débuts du dispositif, qui n’utilisait que la technologie GPS.
Un logiciel de surveillance électronique mobile permet, par la suite, de définir des zones d’inclusion et des zones d’exclusion, des zones « tampons » autour des zones d’exclusion, ainsi que des horaires déterminés. Une alarme se déclenche en cas de non-respect des heures et des lieux d’assignation, des zones d’interdictions et des zones « tampons », mais également en cas de tentative de retrait du bracelet (57). L’alarme se déclenche à la fois sur place, grâce au boîtier électronique, mais est également envoyée au pôle centralisateur, qui peut entrer en contact téléphonique avec le placé via le boîtier.
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE
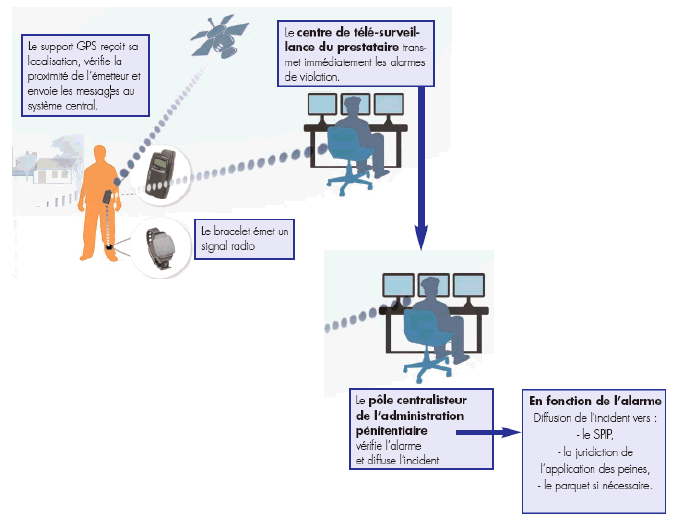
Source : direction de l’Administration pénitentiaire.
Néanmoins, ce fonctionnement est, à l’heure actuelle, loin d’être satisfaisant. Tout d’abord, en ce qui concerne la définition des déplacements autorisés et interdits de la personne placée, il semble que le dispositif actuel n’offre pas autant de possibilités que la technologie GPS le permet. En effet, il a été porté à la connaissance de la mission d’information que, dans le cas où un juge de l’application des peines souhaitait que la personne ne s’approche pas des écoles, seuls trois choix avaient été fournis au magistrat, alors même que cela ne suffisait pas à couvrir l’ensemble des lieux du département.
En effet, pour chaque lieu interdit, quelqu’un doit se rendre sur place afin de « pointer » le lieu pour qu’il puisse être reconnu par le logiciel. En l’état actuel, cela n’est possible, faute de moyens, que pour un nombre limité d’endroits. D’autres problèmes relatifs au « pointage » ont été rapportés à la mission d’information, qui mettent en lumière le caractère inachevé de ce dispositif pourtant prometteur. L’avenue de Choisy à Paris, par exemple, ne peut être « pointée » qu’en son milieu, alors même que le juge pourrait choisir de n’en interdire qu’une portion seulement. Par ailleurs, si le juge de l’application des peines souhaite interdire au placé la sortie d’un département, cela est rendu impossible par l’imprécision des zones, ovales ou rectangulaires uniquement, qui peuvent être définies par le logiciel.
Par ailleurs, le dispositif de localisation et d’alarme ne donne pas satisfaction, pour plusieurs raisons. D’une part, il arrive que le signal GPS comme GSM soit perdu, dans des lieux non couverts par ces réseaux ou ne permettant pas la réception d’un signal. C’est notamment le cas de cinémas, de parkings ou de centres commerciaux. Dans de tels cas de figure, l’alarme peut se déclencher de façon injustifiée, uniquement parce que le signal est perdu par l’appareil. La localisation en temps réel du placé est donc, dans certaines zones, toute relative et ce d’autant plus que, comme toute technologie, celle-ci peut connaître des défaillances. Certaines personnes ont ainsi été localisées à plusieurs centaines de kilomètres de l’endroit où elles se trouvaient en réalité.
D’autre part, le système d’alarme ne fonctionne pas de façon optimale. En effet, dans un certain nombre de cas, l’alarme n’est pas relayée par le prestataire privé, ce qui prive le système entier de son effet. Si le placé a le sentiment qu’il peut pénétrer une zone d’exclusion en toute impunité, alors la définition de telles zones est inutile. Par ailleurs, dans de nombreux cas, l’alarme se déclenche sans raison, alors même que le placé ne se situe pas dans un lieu interdit ou à une heure qui ne correspond pas aux obligations définies. Il est arrivé que le boîtier se mette à sonner alors même que le placé se trouvait dans le cabinet du juge de l’application des peines, ou qu’il doive se poster à la fenêtre du cabinet du juge pour éviter le déclenchement d’une alarme lié à la perte du signal.
Ces éléments d’information, bien qu’ils aient un caractère secondaire, illustrent bien les dysfonctionnements du dispositif technique actuel. Les évolutions technologiques futures comme l’amélioration de la couverture réseau devraient toutefois permettre de parvenir à un fonctionnement plus satisfaisant.
b) Un effet stigmatisant difficilement compatible avec la réinsertion des personnes placées
Au-delà de la technique perfectible actuellement employée, le placement sous surveillance électronique mobile comporte une faille plus fondamentale, à laquelle il faudra s’attacher à répondre rapidement. En effet, le port du bracelet, généralement fixé à la cheville, et du boîtier, que l’on ne peut guère cacher sous des vêtements, manque de discrétion et ce d’autant plus que les alarmes intempestives éveillent facilement l’attention des personnes entourant le placé. Si l’on ajoute à cela le fait que la surveillance électronique mobile est conçue pour les personnes présentant une certaine dangerosité, il est clair que le dispositif peut susciter le rejet au sein de la population.
De façon concrète, cela constitue un frein à l’hébergement et à l’emploi des personnes placées, et donc à leur réinsertion. L’hébergement est rendu difficile, notamment en foyers, les autres personnes hébergées comme la direction de ces foyers ne souhaitant pas accueillir en leur sein des personnes considérées comme dangereuses. Au-delà de l’effet stigmatisant, l’hébergement en foyer peut être impossible du fait de sa situation dans une zone d’exclusion ou encore de la présence de femmes et d’enfants, dont le contact peut faire l’objet d’une interdiction expresse par le juge. C’est notamment le cas des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui peuvent donc difficilement accueillir de personnes placées sous surveillance électronique mobile, surtout lorsqu’il s’agit d’auteurs de violences sexuelles. Au-delà, les foyers ne sont généralement pas en mesure d’accueillir des personnes présentant un risque pour la sécurité des autres résidents.
Il en va de même pour l’emploi des personnes placées. Un service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) a ainsi rapporté à la mission d’information qu’il n’avait pas été possible de fournir au placé un emploi d’entretien d’espaces verts, les parcs en question se situant dans une zone d’exclusion. Bien souvent, les horaires de sortie restrictifs ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle. De façon plus générale, la population des détenus est déjà difficile à réinsérer professionnellement ; le port du bracelet ne fait que rendre la tâche des SPIP plus compliquée.
Par ailleurs, cette stigmatisation est difficilement supportable pour les personnes placées. L’échec d’une mesure de PSEM de la part d’un placé qui devait suivre une formation professionnelle et qui, faisant l’objet d’insultes de la part des autres stagiaires, n’a pas supporté le placement a ainsi été rapporté à la mission d’information. Au-delà, les alarmes empêchent les placés de fréquenter certains lieux et freinent leur resocialisation à tel point, parfois, que la mesure peut être contre-productive. La mission d’information a eu connaissance de l’exemple d’une personne qui est restée enfermée chez elle pendant deux ans, afin d’éviter le déclenchement de l’alarme.
Le Conseil d’État lui-même a reconnu, le 26 octobre 2011, le caractère difficilement supportable du port du bracelet : « le dispositif de surveillance électronique mobile dont M. A a été équipé à partir du mois de novembre 2010 est affecté de nombreux dysfonctionnements, qui se traduisent par de très fréquents déclenchements intempestifs et injustifiés de l'alarme sonore, le jour comme la nuit, le signalant à l'attention des personnes qui se trouvent près de lui, et entraînant des appels répétés des personnels de surveillance, qui perturbent gravement sa vie quotidienne et celle de ses proches ».
Le port du bracelet électronique semble psychologiquement difficile à supporter. Le déclenchement intempestif des alarmes comme la nécessité de procéder à certaines manipulations de l’appareil, est source de stress et d’angoisse pour les placés (58). La définition de zones d’exclusion trop larges, notamment dans les grandes villes, peut littéralement priver le placé de tout déplacement. Par ailleurs, les placés surestiment fréquemment la puissance du dispositif, ce qui conduit, dans certains cas, à des comportements paranoïaques (59). Des épisodes de décompensation psychologique, parfois assortis d’une hospitalisation, ont déjà pu être signalés.
Même si le PSEM peut avoir un effet positif dans un premier temps, du point de vue de la prévention de la récidive et de la réinsertion de la personne, il peut conduire à terme à un comportement de rejet de la mesure et donc compromettre la prise en charge de la personne en vue de sa réinsertion. Il semble que le placement sous surveillance électronique mobile soit moins efficace au-delà de six mois à un an et que les personnes condamnées à de longues peines d’emprisonnement le supportent mieux que la moyenne.
c) Pour les personnels, une surveillance difficile à mettre en œuvre
L’émergence de mesures de sûreté en milieu ouvert et plus particulièrement du placement sous surveillance électronique mobile a, pour certains, un effet sur la profession de conseiller d’insertion et de probation. Travailleurs sociaux à l’origine, les conseillers d’insertion et de probation se sont longtemps consacrés à la réinsertion et à la réalisation de missions éducatives et sociales. L’apparition de la surveillance électronique, comme d’autres mesures de sûreté avant elle, a conduit à renforcer considérablement le rôle d’évaluation et de surveillance du conseiller d’insertion et de probation, changement qui n’est pas anodin et explique en partie les problèmes actuels que rencontrent les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP).
De façon plus concrète, la surveillance d’un placé est relativement lourde pour un SPIP, bien qu’à l’heure actuelle, ceux-ci ne suivent en moyenne qu’un ou deux placés. Tout d’abord, le SPIP doit réaliser une enquête préalable de faisabilité qui devra déterminer, d’une part, si la situation sociale, familiale et matérielle du condamné permet le placement sous surveillance électronique mobile et, d’autre part, la faisabilité technique de la mesure (disponibilité du matériel, détermination des zones d’inclusion et d’exclusion, etc.).
Cette enquête technique de faisabilité, qui consiste notamment, pour le conseiller d’insertion et de probation, à se rendre sur place afin de tester l’ensemble des zones d’exclusion et d’inclusion, peut prendre un temps considérable, comme en atteste cette circulaire du 28 janvier 2008 : « Une fois ces zones déterminées, la qualité de réception des signaux GPS et GSM doit y être méticuleusement vérifiée (réception du signal dans la chambre, dans le lieu de vie, sur le trajet entre ces deux lieux, sur les lieux de travail ou de formation et sur les trajets entre le domicile et le travail). Des tests consistant à laisser l’unité réceptrice au moins dix minutes (afin de s’assurer que le lien GSM perdure) pendant lesquelles le pôle communiquera avec le dispositif (envoi de messages ou appels de bon fonctionnement) devront être effectués afin de s’assurer de la qualité de réception des signaux GSM et GPS, condition indispensable du maintien des liens de communication » (60).
Les personnes placées sous surveillance électronique mobile, notamment lorsqu’elles ont été condamnées pour des faits de nature sexuelle, exigent un suivi plus lourd que les autres personnes suivies par le SPIP. Ces personnes, particulièrement signalées, sont généralement reçues une fois par semaine par le SPIP, par deux conseillers différents, quand cela est possible. Dans un contexte de manque de personnel, cela peut donc représenter une charge de travail importante. Pour beaucoup de conseillers, il s’agit d’un suivi particulièrement lourd à mettre en place, qui empiète, par ailleurs, sur le temps qu’ils pourraient consacrer à d’autres personnes suivies. Certains craignent ainsi de ne pas avoir repéré un danger criminologique chez une autre personne suivie, faute de temps. Pour beaucoup, l’extension du champ du dispositif pourrait avoir un effet pervers si les moyens humains n’étaient pas renforcés. Les placés, moins surveillés, pourraient alors être tentés de récidiver.
Au quotidien, le suivi des personnes placées, même s’il est en partie effectué par des surveillants pénitentiaires du pôle centralisateur, nécessite une vigilance accrue de la part du conseiller d’insertion et de probation. En effet, les placés présentent un risque élevé de récidive et ont souvent des personnalités instables ou borderline, ce qui rend leur prise en charge particulièrement difficile pour les conseillers d’insertion et de probation et ce d’autant plus que la technologie GPS comporte des failles. Par ailleurs, comme on l’a vu plus haut, la réinsertion sociale de ces personnes est rendue plus difficile par le port du bracelet, ce qui nécessite, de la part du conseiller, un travail important de recherche de solutions d’hébergement et d’emploi.
Certains SPIP ont fait part à la mission d’information du caractère aléatoire de l’adhésion du placé à la mesure, qui demande à être régulièrement réaffirmée. En outre, le suivi de cette mesure implique de nombreuses interventions ainsi qu’une forte réactivité aux alarmes de la part des autorités judiciaires, ce qui rend nécessaire une collaboration étroite entre le conseiller référent et le juge de l’application des peines. Cette coopération n’est cependant pas toujours acquise, certains juges de l’application des peines pouvant tarder à rendre une décision de révocation de la mesure en cas de non-respect des obligations. Les SPIP, face à cette mesure nouvelle, que certains n’ont encore jamais eu à mettre en œuvre à ce jour, ne disposent pas encore des repères professionnels suffisants pour l’appréhender avec sérénité.
C. LA DÉFENSE SOCIALE À L’œUVRE : LA RÉTENTION ET LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ
1. Des dispositifs récemment introduits en droit français pour les individus présentant un risque très élevé de récidive
La loi précitée n° 2008-174 du 25 février 2008 (61) a introduit, en droit français, deux nouvelles mesures de sûreté destinées à prévenir la récidive de personnes particulièrement dangereuses. À ce titre, les auteurs d’infractions à caractère sexuel sont particulièrement visés par ces dispositifs.
a) La rétention de sûreté : une mesure « exceptionnelle et subsidiaire »
La rétention de sûreté consiste « dans le placement de ces personnes dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, relevant du ministère de la justice et du ministère de la santé, et dans lequel elles feront l’objet de façon permanente d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à diminuer leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure » (62). En des termes plus clairs, ce dispositif permet de placer certaines personnes dangereuses, reconnues coupables d’infractions particulièrement graves, dans un centre spécialisé, pour une durée illimitée et après qu’elles ont purgé leur peine.
Pour autant, cette mesure nouvelle ne saurait être assimilée à « une peine après la peine », selon l’expression consacrée. En effet, la rétention de sûreté n’a pas le caractère d’une peine : elle n’est pas ordonnée par la juridiction de jugement, qui peut seulement prévoir que la situation de la personne sera examinée à l’issue de sa peine en vue d’une rétention de sûreté ; elle n’a aucun caractère punitif ou disciplinaire puisqu’au contraire, elle a une visée préventive ; elle ne se fonde pas sur la culpabilité de la personne, mais sur sa dangerosité. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008 (63), l’a indiqué de la façon la plus claire qui soit : « la rétention de sûreté n'est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; […] la surveillance de sûreté ne l'est pas davantage ».
Cependant, la rétention de sûreté constitue une privation de liberté extrêmement importante, puisqu’elle peut prendre, si nécessaire, un caractère illimité. C’est pourquoi le législateur a prévu que cette possibilité soit particulièrement restreinte et encadrée et que le Conseil constitutionnel lui a appliqué le principe de non-rétroactivité normalement applicable à la loi pénale. De fait, la rédaction actuelle de la loi fait de la rétention de sûreté une mesure « exceptionnelle et subsidiaire » (64). Exceptionnelle, car elle concerne un nombre de personnes réduit au strict minimum. En effet, quatre critères doivent être réunis pour prononcer cette mesure, portant sur la nature de l’infraction, la peine prononcée, le risque de récidive et l’état psychique de la personne. Ainsi, seules les personnes coupables d’infractions particulièrement graves (cf. infra) et condamnées à une peine de réclusion de quinze ans, présentant un risque de récidive très élevé du fait d’un trouble grave de la personnalité peuvent être soumises à une rétention de sûreté.
INFRACTIONS PERMETTANT LE PRONONCÉ D’UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ
Condition tenant à la récidive |
Infractions rendant possible une rétention de sûreté | |
Victime majeure |
– |
Meurtres, viols, torture et actes de barbarie, enlèvement et séquestration aggravés. |
Victime mineure |
– |
Tous les meurtres, viols, torture et actes de barbarie, enlèvement et séquestration. |
|
– |
Infraction commise en récidive |
Tous les meurtres, viols, torture et actes de barbarie, enlèvement et séquestration. |
Source : article 706-53-13 du code de procédure pénale.
La rétention de sûreté, parce qu’elle est privative de liberté, doit également être une mesure de dernier recours. En effet, elle ne peut être prononcée que si d’autres types de mesures, comme l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes, une injonction de soin ou un placement sous surveillance électronique mobile, sont insuffisantes à prévenir la commission des infractions mentionnées ci-dessus. La rétention doit donc être « l’unique moyen de prévenir la commission […] de ces infractions » (65).
Le Conseil constitutionnel, par une réserve d’interprétation, a conforté cette vision, en indiquant que « le maintien d’une personne au-delà du temps de sa peine pour qu’elle puisse bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée aux troubles de la personnalité dont elle souffre, ne peut apparaître comme une nécessité que si le temps d’exécution de la peine a été mis à profit pour que la personne bénéficie de l’aide et de soins adaptés à son état et que ces derniers n’ont pu produire les résultats suffisants pour atténuer sa dangerosité » (66). Cette condition a d’ailleurs été reprise par le législateur, par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
Le principe de nécessité, en matière de rétention de sûreté, s’exprime donc aussi bien au présent, à l’égard des autres instruments à la disposition des pouvoirs publics, que par rapport au passé, où tous les moyens doivent avoir été mis en œuvre pour atténuer la dangerosité de l’individu. D’ailleurs, le but même du placement dans un centre socio-médico-judiciaire est précisément la fin de la mesure, qui doit résulter de l’efficacité de la prise en charge (67). La rétention de sûreté repose sur quatre piliers, judiciaire, social, psychologique et médical. Loin d’être assimilable à une prison, le centre de rétention est soumis à la double tutelle du ministère de la Justice et de la Santé. Sa direction bicéphale est d’ailleurs confiée à un directeur des services pénitentiaires et un directeur d'établissement public de santé (68). Enfin, le premier centre socio-médico-judiciaire a ouvert au sein de l’établissement public de santé national de Fresnes, marquant sa double appartenance au monde de la santé et à celui de la justice.
Ce centre, que votre rapporteur a visité, a été inauguré le 6 novembre 2008. En effet, même si la rétention de sûreté n’est pas rétroactive, la surveillance de sûreté, d’application immédiate et susceptible de conduire, en cas de non respect des obligations qui l’accompagnent, à un placement dans un centre socio-médico-judiciaire (69), nécessitait l’ouverture précoce d’un tel centre. Dans ce centre, la personne retenue est hébergée dans un studio dont elle possède les clés. Elle dispose d’une liberté de déplacement au sein du centre pendant la journée, de 7 heures à 21 heures. L’établissement comporte dix studios individuels, une salle de sport, une salle informatique et une salle de repos, où les retenus peuvent prendre leurs repas ensemble et regarder la télévision. Les personnes retenues ont également la possibilité d’accéder, de façon très restreinte, à un réseau Internet sans fil sur leur ordinateur personnel. Tant dans la superficie et la qualité des studios que dans la liberté laissée à la personne retenue, ce centre se distingue nettement de l’univers carcéral.
Le décret d’application de la loi du 25 février 2008 (70) a également défini les droits des personnes retenues, bien plus larges que ceux des personnes détenues. En effet, les relations avec des personnes extérieures, que ce soit par téléphone ou par le biais de visites, ont vocation à être les plus fréquentes possible : un droit de visite et de téléphone journalier est ainsi prévu (71). Au-delà, les personnes retenues peuvent recevoir les ministres du culte de leur choix et participer à des activités culturelles, sportives et de loisir en extérieur. La frontière entre le centre et le monde extérieur semble donc plus perméable que celle qui sépare la prison du monde libre.
Une personne, condamnée pour une infraction à caractère sexuel, y est aujourd’hui retenue, faute d’avoir su respecter les obligations liées à une surveillance de sûreté. Neuf autres personnes, sous surveillance de sûreté, sont susceptibles d’y être placées. En 2010, 337 personnes ont été condamnées à une réclusion criminelle de quinze ans pour des infractions pour lesquelles la rétention et la surveillance de sûreté sont possibles. Parmi elles, 56 sont éligibles à une rétention de sûreté ab initio, les faits reprochés ayant été commis après l’entrée en vigueur de la loi, contre 5 en 2009 (72). Toutefois, le système informatique et statistique du ministère de la Justice ne permet pas de savoir combien de décisions de condamnations ont effectivement prévu qu’une rétention de sûreté serait possible à l’issue de la peine. Néanmoins, la rétention comme la surveillance de sûreté pourraient bien concerner, à terme, un nombre non négligeable de personnes.
b) La surveillance de sûreté, mesure de sûreté en milieu ouvert
La surveillance de sûreté, nouvelle mesure de sûreté en milieu ouvert, peut comporter les mêmes obligations que la surveillance judiciaire et le suivi socio-judiciaire et, notamment, l’injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile. Comme la surveillance judiciaire, elle peut s’appliquer de façon rétroactive. Toutefois, par son régime, la surveillance de sûreté se rapproche de la rétention de sûreté : d’une durée potentiellement illimitée, elle concerne les mêmes personnes et peut donner lieu à un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
D’une nature particulièrement hybride, cette mesure peut être prononcée à l’issue d’une rétention de sûreté (73), mais aussi d’une surveillance judiciaire arrivée jusqu’à son terme ou ayant échoué (74), ainsi qu’à la suite d’un suivi socio-judiciaire (75). Dans ces trois cas de figure, la surveillance de sûreté n’est possible que pour les personnes condamnées à quinze ans de réclusion criminelle pour les infractions mentionnées à l’article 706-53-13. Elle est alors de deux ans, renouvelables sans limite. Si les renvois d’un article à l’autre permettent d’unifier a minima le régime de la surveillance de sûreté, le tableau ci-dessous montre qu’il existe néanmoins quelques nuances.
TABLEAU GÉNÉRAL DE LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ
Cadre juridique |
À l’issue d’une rétention de sûreté |
À l’issue d’une surveillance judiciaire |
À l’issue d’un suivi socio-judiciaire |
Procédure |
Avis du juge de l’application des peines transmis au procureur trois mois avant la fin de la mesure Saisine de la commission pluridisciplinaire de sûreté par le procureur Avis de la commission pluridisciplinaire de sûreté Saisine de la juridiction régionale de rétention de sûreté par le procureur, qui se prononce avant la fin de la mesure |
Saisine de la juridiction régionale de la rétention de sûreté par le juge de l’application des peines ou le procureur six mois avant la fin de la mesure Avis de la commission pluridisciplinaire de sûreté Expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité | |
Conditions tenant à l’infraction commise et à la peine prononcée |
Peine de quinze ans de réclusion pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13 du CPP | ||
Conditions tenant au risque de récidive |
« Risque de commettre » les infractions mentionnées à l’article 706-53-13 du CPP |
Seul moyen de répondre à un risque très élevé de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13 du CPP | |
Conditions tenant à l’octroi préalable d’une libération conditionnelle |
Non applicable aux personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a été révoquée |
– |
Applicable aux personnes ayant fait l’objet d’une libération conditionnelle |
Durée maximale de la mesure |
Deux ans, renouvelables sans limite | ||
Conséquence du non-respect des obligations |
Placement en rétention de sûreté si : 1) Non-respect des obligations 2) Risque très élevé de récidive 3) Renforcement des obligations de la surveillance de sûreté insuffisant | ||
De la même façon que l’infraction ayant rendu possible la rétention de sûreté prouve la dangerosité de la personne, le non-respect des obligations liées à la surveillance de sûreté peut justifier le placement de cette personne en rétention de sûreté, si la probabilité qu’elle commette une infraction d’une particulière gravité est à nouveau très élevée. Mais, là encore, la rétention de sûreté ne peut intervenir que si le renforcement des obligations accompagnant la surveillance de sûreté apparaît insuffisant à prévenir la récidive.
La première décision de placement sous surveillance de sûreté a été rendue le 6 avril 2009 par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) de Paris. Rétroactive, la mesure concernait une personne condamnée en 1994 à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de dix ans, pour viol aggravé. Aujourd’hui, neuf personnes sont placées sous surveillance de sûreté.
2. L’évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité au fondement des mesures de sûreté
Les mesures de sûreté qui viennent d’être étudiées visent les personnes présentant une dangerosité certaine, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive. Aussi l’évaluation de cette dangerosité est-elle essentielle. Ses résultats, que cette évaluation conclue ou non à une dangerosité importante, sont particulièrement sensibles puisqu’ils peuvent conduire, en cas d’erreur, à la privation de liberté d’une personne ou, au contraire, à la commission des plus graves infractions de notre droit pénal.
Certes, en matière d’évaluation de la dangerosité, les certitudes n’existent pas. Néanmoins, la procédure mise en place par la loi du 25 février 2008, en ce qui concerne la rétention de sûreté, doit permettre d’approcher au plus près la dangerosité de la personne. Le terme de « dangerosité » désigne bien, ici, la probabilité que la personne commette une infraction d’une particulière gravité. Cette dangerosité peut avoir une origine psychiatrique, qu’une double expertise médicale a vocation à détecter. Mais, plus souvent, elle aura pour origine un trouble grave du comportement, qui relève alors non pas de la psychiatrie, mais bien de la psychologie. De fait, si la personne avait une pathologie mentale réelle, elle relèverait plutôt de l’hôpital psychiatrique et n’aurait pas été déclarée responsable de ses actes.
Ce qui est donc visé ici, ce sont les troubles graves du comportement qui, bien que la personne soit consciente et responsable de ses actes, la pousse à transgresser la loi. Dans le cadre d’une rétention de sûreté, la personne condamnée fait l’objet, au moins un an avant la date de sa libération, d’une évaluation par une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ces commissions, créées par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales pour se prononcer sur le placement sous surveillance électronique mobile, sont actuellement au nombre de huit. Les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort de France accueillent donc ces commissions, qui ont les mêmes ressorts que les juridictions régionales des mesures de sûreté.
Comme leur nom l’indique, ces commissions sont caractérisées par leur pluridisciplinarité. Elles sont en effet composées d’un magistrat chevronné, président de chambre à la cour d’appel, du préfet de région, du directeur interrégional des services pénitentiaires, d’un expert psychiatre et d’un expert psychologue, d’un représentant d’une association d’aide aux victimes et d’un avocat (76). Ces sept personnes aux compétences diverses, mais qui ont en commun une expérience réelle de la criminalité, fournissent un avis motivé proposant, à la juridiction régionale de sûreté, le placement de la personne en rétention de sûreté. La décision de la commission devra donc prouver, grâce aux pièces dont elle dispose (cf. infra) que les autres mesures existantes – inscription au FIJAIS (77), injonction de soins et placement sous surveillance électronique mobile – sont insuffisantes à prévenir la récidive de la personne objet de l’évaluation.
Pour se forger une opinion, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dispose de plusieurs éléments d’information. D’une part, une expertise médicale réalisée par deux experts, dont la dualité constitue une garantie supplémentaire. D’autre part, les résultats de l’observation de la personne détenue, pendant au moins six semaines, dans un centre spécialisé, également pluridisciplinaire. Il est fait référence ici au centre national d’évaluation (CNE) de Fresnes, que votre rapporteur a pu visiter. En 2011, cinq personnes y ont été évaluées au titre d’une possible rétention de sûreté.
Cette structure, créée en 1950 sous le nom de centre national d’observation, a longtemps été unique en France. Elle vient d’être reproduite à Réau, en Seine-et-Marne, dans le récent centre pénitentiaire du sud francilien inauguré en septembre 2011. Outre l’évaluation de dangerosité préalable à une rétention de sûreté, le CNE évalue les détenus en attente d’affectation ainsi que les certains condamnés demandant une libération conditionnelle. La particularité du CNE tient au caractère bicéphale de sa direction, avec un directeur provenant de l’administration pénitentiaire et une directrice adjointe appartenant au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Une autre particularité du CNE est que, du directeur aux surveillants, son personnel a été recruté sur candidature.
Le fonctionnement du CNE repose sur un travail pluridisciplinaire. Le CNE compte ainsi quatre pôles :
— le pôle surveillance, formé d’un officier, de trois gradés et de 21 surveillants pénitentiaires. Il a pour rôle de surveiller les détenus mais également de faire des observations sur leur comportement, à travers une synthèse rédigée en fin de séjour ;
— le pôle psycho-technique, constitué par un responsable, psychologue du travail, et deux surveillants. Ils évaluent les capacités cognitives du détenu au travers de tests portant aussi bien sur les connaissances scolaires du détenu que sur ses aptitudes manuelles ;
— le pôle SPIP, qui comprend six conseillers d’insertion et de probation mis à disposition du CNE. Ceux-ci, à partir d’entretiens et du dossier pénal, analysent le passage à l’acte de la personne ;
— le pôle de psychologie clinique, composé de plusieurs psychologues cliniciens qui évaluent la personnalité du condamné.
Les pôles dialoguent entre eux et chacun participe à la rédaction d’un avis commun sur la personne évaluée. Un réel partage de l’information existe donc. Si l’on tient compte de l’ensemble des acteurs qui concourent à la décision de placement en centre socio-médico-judiciaire – commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, experts psychiatres, CNE, juge de l’application des peines, procureur, juridiction régionale de la rétention de sûreté – et de leur diversité de points de vue, alors il est indéniable que la procédure actuelle garantit au mieux la fiabilité de l’évaluation et permet à la juridiction de s’assurer de la nécessité d’exercer, contre une personne, une privation de liberté.
3. Des garanties procédurales nombreuses, qui assurent la protection des droits des individus
La rétention de sûreté comme la surveillance de sûreté, parce qu’elles privent l’individu de certains droits et libertés, font l’objet d’une procédure particulièrement encadrée. Pour ce qui est de la rétention de sûreté, deux conditions procédurales préalables doivent être remplies afin que la juridiction régionale de la rétention de sûreté puisse effectivement ordonner cette mesure : d’une part, la mention expresse de cette possibilité dans la décision de condamnation prise par la cour d’assises ; d’autre part, le fait, pour le condamné, d’avoir été en mesure de bénéficier d’une prise en charge psychologique, médicale et sociale adaptée à son trouble de la personnalité pendant l’exécution de sa peine. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, alors la juridiction spécialisée ne peut pas ordonner le placement d’une personne dans un centre socio-médico-judiciaire.
Comme le font très justement remarquer certains juristes, « quand on sait la misère de la psychiatrie en prison et les difficultés auxquelles se heurte l’administration pénitentiaire pour faire dispenser les soins qu’elle souhaiterait pouvoir dispenser, on mesure la force du frein au prononcé de la rétention de sûreté qu’imposent les sages de la rue Montpensier » (78). En effet, la mission d’information s’est vu indiquer, à plusieurs reprises, la difficulté à faire bénéficier les personnes détenues de soins psychiatriques en prison. Si certains établissements disposent de psychologues en nombre suffisant, d’autres connaissent des listes d’attente extrêmement longues qui limitent fortement l’accès aux soins des personnes détenues. Ainsi, une attention particulière devrait être portée aux soins proposés ou prodigués aux personnes dont la décision de condamnation fait mention de la possibilité d’une rétention de sûreté. Au-delà, il appartiendra aux juridictions d’établir les critères relatifs au caractère « adapté » de la prise en charge effectuée ou proposée.
La composition de la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) vise également à répondre à certaines critiques qui pourraient être émises à l’encontre de magistrats peu expérimentés. En effet, la JRRS est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, c’est-à-dire des juges chevronnés. Il en est de même pour la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée ici de trois conseillers à la Cour de cassation. Certains critiquent l’instauration d’une juridiction de second degré appelée à statuer au premier degré (79). Néanmoins, ce dispositif semble plus protecteur et tout à fait adapté au caractère renouvelable sans limite de la rétention de sûreté.
En outre, la procédure mise en œuvre par la JRRS répond au droit commun des procédures pénales. Le droit au procès équitable est respecté, la personne susceptible de faire l’objet d’une mesure de rétention participant, avec l’avocat choisi par elle ou commis d’office, à un débat contradictoire. C’est également de plein droit que cette personne peut exiger la réalisation d’une contre-expertise. On peut néanmoins se demander si cette contre-expertise aura suffisamment de poids face à celle réalisée tant par le CNE que les deux experts psychiatres. Par ailleurs, le condamné dispose d’un droit absolu à la publicité, puisqu’aucune exception n’y est prévue (80). Enfin, le droit au recours est entier : la personne faisant l’objet d’une décision de rétention peut faire appel de cette dernière auprès de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, dont la décision est d’ailleurs susceptible de cassation.
La décision de la JRRS doit être « spécialement motivée » (81). Cette exigence de motivation spéciale constitue un garde-fou procédural fort, qui permet de réserver le prononcé d’une mesure de rétention de sûreté aux cas où elle est absolument nécessaire. En effet, la motivation s’exprime par rapport aux conditions posées à la rétention, quelque peu redondantes, qui tiennent à l’insuffisance des dispositifs existants et au fait que la rétention constitue l’unique solution de prévenir la récidive, mais également par rapport à l’exigence de tentative, pendant la détention, de remédier à cette particulière dangerosité.
Par ailleurs, l’article 706-53-17 du code de procédure pénale prévoit que la personne retenue peut, au bout de trois mois à compter de la décision définitive, puis tous les trois mois en cas de rejets successifs, demander à ce que la mesure de rétention prenne fin. Un garde-fou important a été posé par le législateur à une éventuelle lenteur de la Justice : si la juridiction ne s’est pas prononcée dans les trois mois, la personne est libérée d’office (82). Même si la personne retenue ne demande pas à être libérée, la décision de rétention de sûreté n’est valable qu’un an. Sa situation est donc réexaminée de façon très fréquente, de sorte que la personne ne demeure retenue que si les conditions présidant à sa rétention sont toujours remplies. Qui plus est, à la minute où cela ne serait plus le cas, la JRRS doit ordonner de façon immédiate la fin de la rétention de sûreté (83). Il convient également de noter que les mêmes recours sont ouverts contre des décisions de rejet. Nul doute que les avocats des personnes retenues feront bon usage des voies de recours qui leur sont offertes.
Toutes ces dispositions semblent très protectrices au regard de celles de certains pays étrangers qui ont mis en place des mesures similaires à la rétention de sûreté française. C’est notamment le cas de l’Allemagne, condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Depuis la loi du 24 novembre 1933 relative aux délinquants d’habitude dangereux, l’Allemagne met en œuvre un internement de sûreté (84), dont les conditions ont été élargies depuis 1998. Comme la rétention de sûreté, ce dispositif est applicable sans limite temporelle depuis 1998. Mais, contrairement à la France, il a pu être appliqué de façon rétroactive à des personnes qui, à l’époque des faits, n’étaient passibles que d’un internement de dix ans. La CEDH, assimilant l’internement de sûreté allemand à une peine, lui a très justement appliqué le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (85).
Par ailleurs, la France a mis en place des conditions plus restrictives de prononcé d’une rétention de sûreté. En Allemagne par exemple, l’infraction susceptible de donner lieu à une détention de sûreté ordonnée par la juridiction de jugement ab initio est, depuis la réforme du 22 décembre 2010, une infraction sexuelle aggravée pour laquelle la personne a été condamnée à plus de deux ans d’emprisonnement. Un élément relatif au passé judiciaire de la personne tempère quelque peu ce seuil particulièrement bas. Par ailleurs, la situation de la personne n’est réexaminée que tous les deux ans (contre une périodicité annuelle en France) et par un tribunal de l’exécution des peines, juridiction non spécialisée. Enfin, la détention de sûreté n’a pas à être expressément prévue par la juridiction de jugement, mais peut être ordonnée par la suite.
De la même façon, en Suisse, un internement préventif peut être ordonné à l’encontre d’une personne coupable d’une infraction intentionnelle punie de seulement cinq ans d’emprisonnement. La prise en compte de la peine encourue, non de la peine prononcée, qui plus est avec un seuil relativement bas, est moins protectrice que le droit français, pour un champ infractionnel plus large (86). Un internement à vie est également possible (là où la rétention de sûreté française doit faire l’objet de décisions judiciaires annuelles) lorsqu’une thérapie semble vouée à l’échec et que la personne n’apparaît nullement « amendable ».
Les dispositifs français de rétention et de surveillance de sûreté, auxquelles étaient éligibles, au 1er janvier 2012, 4 196 personnes (87) détenues condamnées à 15 ans au moins pour une des infractions visées à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, répondent à des conditions extrêmement restrictives et à une procédure particulièrement protectrice des droits des individus.
LE FICHIER JUDICIAIRE AUTOMATISÉ DES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES Créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles vise à prévenir la récidive des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes déjà condamnés et à faciliter l’identification des auteurs de ces mêmes infractions. Y sont inscrites les personnes condamnées, même non définitivement, à des infractions sexuelles ou violentes ou encore les personnes ayant exécuté une composition pénale, mises en examen par une juridiction d’instruction, ayant fait l’objet d’un non-lieu, d’une relaxe, ou d’un acquittement fondé sur des motifs tenant à l’abolition des facultés de discernement, ou encore s’agissant de ressortissants français ayant été condamnés à l’étranger pour une de ces infractions. Les personnes qui y sont inscrites sont soumises à une obligation de justification d’adresse auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie dont dépend leur domicile. Cette mesure, qui permet aux forces de l’ordre de connaître les personnes condamnées pour des faits sexuels de leur ressort territorial, exerce une forme de contrôle social sur ces personnes qui prévient, dans une certaine mesure, leur récidive. Le rapport relatif à la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux fichiers de police de Mme Delphine Batho et de M. Jacques Alain Bénisti du 21 décembre 2011, a montré que ce fichier était extrêmement utile aux forces de l’ordre. Néanmoins, il est également apparu qu’il comportait un certain nombre de failles, notamment liées à son extension aux personnes violentes, qui provoquaient, sur le terrain, une certaine lassitude. Si d’importantes améliorations ont été apportées par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, ainsi que par le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (88), ce fichier doit encore déployer toutes ses potentialités. |
II. SOIGNER LES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES : DE L’INCITATION À L’OBLIGATION
Que ce soit en milieu carcéral ou dans le cadre d’un suivi en milieu ouvert, la loi offre aux médecins et aux psychologues un cadre plus ou moins ferme, selon qu’il s’agit d’une incitation ou d’une injonction, qui permet la rencontre avec la personne condamnée pour des infractions à caractère sexuel. S’il ne peut y avoir de soins sans consentement du patient, ce cadre judiciaire peut être l’occasion, pour le thérapeute, d’amener la personne à prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités voire, si le patient est volontaire, à entamer une thérapie agissant sur la cause de ses déviances ou sur la maîtrise de celles-ci. Il existe, à l’heure actuelle, une véritable gradation dans les soins s’effectuant dans un cadre judiciaire, de la simple incitation en milieu fermé au placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, en passant par l’injonction de soins qui prend place en milieu ouvert.
A. L’INCITATION AUX SOINS EN MILIEU FERMÉ : UNE PREMIÈRE ÉTAPE NÉCESSAIRE
Depuis plusieurs années, le législateur s’efforce d’inciter les personnes condamnées à accepter de recevoir des soins au cours de l’exécution de leur peine. Mais, par respect de la déontologie médicale et parce que la personne est détenue, il ne peut s’agir, en milieu fermé, d’une obligation de soins, telle qu’elle peut être imposée à la libération du condamné. En effet, dans le cadre de l’injonction de soins (cf. infra), même s’il s’agit d’une obligation judiciaire, la personne condamnée, libre, peut toujours décider de s’y soustraire, en acceptant les conséquences pénales d’un tel refus. En milieu carcéral, une telle attitude serait difficile à tenir, si bien que le soin serait réellement contraint et perdrait son intérêt thérapeutique.
Un premier axe d’incitation réside dans l’information de la personne détenue. À plusieurs reprises dans son « parcours » judiciaire, elle est informée qu’elle peut entamer des soins en détention. C’est notamment le cas :
— Lors du prononcé de la condamnation de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, par le président du tribunal, en application de l’article 131-36-4 du code pénal ;
— Lors de l’exécution de la peine, par le juge de l’application des peines, qui peut proposer un tel traitement à la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru (89) ;
— Lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, l’information est délivrée immédiatement par le juge de l’application des peines puis, en cas de refus, au moins une fois par an, aux termes de l’article 763-7 du code de procédure pénale ;
Le personnel pénitentiaire, lorsqu’il accueille une nouvelle personne condamnée, diffuse également cette information. D’ailleurs, les « circuits arrivants » ayant été labellisés rendent obligatoire la rencontre avec le personnel médical de l’établissement pénitentiaire dans les 48 heures suivant la mise sous écrou. En outre, dans certains établissements spécialisés dans l’accueil des auteurs d’infractions à caractère sexuel, un véritable parcours de soins a été mis en place. Au centre de détention de Melun par exemple, ces détenus sont informés dès leur arrivée, par courrier, d’un rendez-vous avec un psychologue de l’unité de consultations et de soins ambulatoires. En cas de refus de cette rencontre initiale ou de l’évaluation psychologique qui doit lui faire suite, le patient est rappelé dans les trois mois, afin de l’inciter à nouveau à accepter des soins.
Outre l’information du patient et la mobilisation du personnel médical intervenant en prison, l’incitation est également exercée par le biais de ses effets sur la durée de la peine ou l’octroi d’une libération anticipée. Les réductions de peine octroyées aux personnes condamnées pour des crimes ou délits, commis sur mineur, de meurtre ou assassinat, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’agression ou d’atteinte sexuelle peuvent leur être retirées si elles refusent de suivre, pendant leur incarcération, le traitement proposé par le juge de l’application des peines (90). De la même façon, sauf décision contraire du juge, les personnes condamnées pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ne peuvent bénéficier d’aucune réduction de peine supplémentaire si elles ont refusé le traitement proposé (91). Enfin, le juge de l’application des peines ne peut accorder de libération conditionnelle à la personne à l’encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire peut être prononcé si elle refuse le traitement proposé (92).
Le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale le 20 février 2012 (93), renforce encore cette incitation aux soins. En effet, son article 5 prévoit que les mêmes conséquences seront encourues par les personnes qui ne suivent pas régulièrement les soins proposés en détention et qu’elles avaient initialement acceptés. Ainsi, l’incitation aux soins prend une forme continue qui ne peut que renforcer son efficacité.
Mais l’incitation ne saurait prendre une forme uniquement négative. En effet, lorsque la personne condamnée accepte de suivre un traitement en détention, des réductions de peine supplémentaires peuvent lui être octroyées (94). Le suivi d’un traitement est alors assimilé, par le juge, à un effort sérieux de réadaptation sociale qui justifie l’octroi de réductions de peine supplémentaires. Concrètement, ces efforts sont portés à la connaissance du juge par le biais d’attestations délivrées par le médecin ou le psychologue, à charge pour le condamné de les transmettre au magistrat. Là encore, une amélioration du dispositif a été apportée par le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, dont l’article 5 comporte une définition plus précise de la nature de l’attestation ainsi délivrée. Certes, ces attestations ne permettent pas au juge de l’application des peines d’évaluer les progrès réalisés par le condamné. Mais le secret médical exige, pour l’efficacité théorique du traitement, que le juge ne puisse contrôler que le suivi régulier d’un traitement, non ses effets réels. Il pourra cependant le faire, pour les personnes éligibles à une rétention de sûreté, deux ans avant leur libération, en application de l’article 717-1 du code de procédure pénale : le condamné doit alors justifier des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en détention.
Le dispositif juridique d’incitation aux soins en milieu fermé, s’il n’est pas similaire à une injonction, est cependant aujourd’hui suffisamment développé pour atteindre une efficacité maximale, sans pour autant faire peser sur le condamné une obligation légale. La limite de ce dispositif tient donc à la faiblesse des moyens alloués aux soins en milieu fermé (cf. infra) et non à des possibilités législatives inexploitées.
B. L’INJONCTION DE SOINS, UN DISPOSITIF PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ
1. L’injonction de soins, une mesure transversale en augmentation
L’injonction de soins a été instituée par la loi précitée n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Cette mesure pouvait alors être prononcée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, par la juridiction de jugement, comme par le juge de l’application des peines. Par la suite, le prononcé d’une injonction de soins a été rendu possible dans le cadre d’autres mesures : la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire (95), puis la surveillance de sûreté (96). Jusqu’à la loi du n°2010-242 du 10 mars 2010 (97), un sursis avec mise à l’épreuve pouvait également comporter une injonction de soins. Les conditions du prononcé de cette mesure, en fonction du cadre juridique dans lequel elle s’inscrit, figurent dans le tableau ci-dessous.
L’injonction de soins ne saurait être confondue avec l’obligation de « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement et de soins » (98) possible dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un ajournement avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une mesure d’aménagement de la peine, et qui concerne en premier lieu les personnes alcooliques ou toxicomanes.
LES DIFFÉRENTS CADRES JURIDIQUES DE L’INJONCTION DE SOINS
Cadre juridique |
Conditions tenant à l’infraction |
Conditions tenant à la peine prononcée |
Autorité décisionnaire |
Conditions tenant à la réalisation d’une expertise médicale |
Pouvoir du juge |
Libération conditionnelle (art. 731-1 CPP) |
Infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru |
— |
Juge de l’application des peines ou tribunal de l’application des peines |
— |
Obligation, sauf décision contraire de la juridiction |
|
Surveillance de sûreté (art. 732-1 et 706-53-19 CPP) |
Crimes rendant possible une rétention de sûreté |
Réclusion criminelle à perpétuité |
Juridiction régionale de la rétention de sûreté |
Expertise médicale indiquant que le maintien de l’injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive |
Possibilité de placer la personne sous surveillance de sûreté avec injonction de soins à l’issue de la libération conditionnelle avec injonction de soins |
Crimes rendant possible une rétention de sûreté |
Réclusion criminelle de quinze ans |
Juridiction régionale de la rétention de sûreté |
— |
Possibilité de placer la personne sous surveillance de sûreté avec injonction de soins à l’issue d’une rétention de sûreté | |
Suivi socio-judiciaire (art. 131-36-4 CP) |
Conditions du suivi socio-judiciaire |
Juridiction de jugement et juge de l’application des peines |
Expertise établissant que la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement |
Obligation, sauf décision contraire de la juridiction | |
Surveillance judiciaire (art. 723-30 CPP) |
Conditions de la surveillance judiciaire |
Juge de l’application des peines |
Expertise établissant que la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement |
Obligation, sauf décision contraire de la juridiction | |
Au 1er septembre 2011, environ 5 400 mesures d’injonction de soins étaient en cours. En plus de l’extension, par la loi, de la possibilité de prononcer une injonction de soins dans d’autres cadres juridiques que celui du suivi socio-judiciaire, l’injonction de soins a vu son champ largement étendu par l’extension du suivi socio-judiciaire (99) auquel elle est rattachée.
Par ailleurs, l’exigence, pour la juridiction, de disposer d’une expertise établissant que la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement, contrairement au verrou que cela était supposé produire, a vraisemblablement favorisé le prononcé de cette mesure : « Le recours au qualificatif de " susceptible de faire l’objet d’un traitement " ou encore à la notion de traitement possible est porteur d’incertitude scientifique en même temps qu’il peut engendrer des réponses d’une excessive précaution et multiplier, par la suite, des injonctions de soins inutilement nombreuses » (100). La responsabilité qui repose sur les experts psychiatres est, dans ce cadre, extrêmement forte puisque leur diagnostic conditionne l’accès de la personne à des soins pénalement obligés.
S’il est presque impossible d’évaluer avec certitude le nombre d’injonctions de soins dans les années à venir, la durée relativement longue des suivis socio-judiciaires prononcés, l’augmentation de ceux-ci du fait de l’effacement progressif des effets de la non-rétroactivité de la loi, et le fort taux de recours à l’injonction de soins dans le cadre d’une surveillance judiciaire (101), il est certain que le nombre de personnes soumises à une injonction de soins ira croissant.
2. Le médecin coordonnateur au cœur du dispositif
Bien que l’injonction de soins s’exécute en milieu ouvert, en réalité, le processus débute en détention. En effet, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins doivent exécuter leur peine d’emprisonnement ou de réclusion dans un établissement pénitentiaire susceptible de leur « assurer une prise en charge médicale et psychologique adaptée » (102). Ces établissements sont ceux qui sont dotés d’un service médico-psychologique régional (SMPR) ou rattachés à un de ces services, les établissements dans lesquels interviennent le secteur de psychiatrie générale, ou encore un des 22 établissements accueillant spécifiquement des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
L’injonction de soins proprement dite se met en place à la sortie de détention ou de rétention de la personne. Elle fait alors intervenir plusieurs acteurs :
— le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui contrôlent l’effectivité des soins et peuvent éventuellement réincarcérer la personne défaillante ;
— le médecin ou le psychologue traitant, qui prodigue les soins nécessaires ;
— le médecin coordonnateur, qui joue le rôle d’interface entre la justice et la santé.
Ce médecin, dont les missions sont définies par le code de la santé publique (103), joue un rôle extrêmement important dans le dispositif de l’injonction de soins. Désigné par le juge de l’application des peines sur une liste prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique (104), si possible avant la libération de la personne condamnée et de façon obligatoire si cette dernière a commis des infractions rendant possible une rétention de sûreté, ce médecin est distinct du médecin ou psychologue traitant et ne prodigue pas de soins à la personne condamnée.
Même s’il ne participe pas directement à la prescription des thérapies suivies, le médecin coordonnateur joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’obligation de soin.
Vis-à-vis du patient, le médecin coordonnateur assure plusieurs fonctions :
— Après avoir pris connaissance des expertises réalisées au cours de la procédure ou de l’exécution de la peine privative de liberté et des pièces du dossier de la procédure judiciaire qui lui sont communiquées par le juge de l’application des peines (105), il convoque la personne condamnée à une injonction de soins pour un entretien. Au cours de cet entretien initial, il lui explique les modalités d’exécution de cette mesure ;
— Au cours de cette première rencontre, le médecin coordonnateur invite la personne suivie à choisir un médecin traitant (106). En cas de désaccord du patient, le médecin traitant est désigné par le juge de l’application des peines, après avis du médecin coordonnateur. Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir un psychologue traitant soit à la place, soit en plus du médecin traitant ;
— Pour l’exécution de l’injonction de soins, il convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation ; il peut également soumettre au juge des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure (107) ;
— Par la suite, lorsque la mesure arrive à son terme, il informe le patient de la possibilité et, le cas échéant, de la nécessité de suivre des soins en dehors de tout cadre judiciaire.
Vis-à-vis du médecin traitant, le médecin coordonnateur peut lui communiquer, si celui-ci en fait la demande, les rapports d’expertise concernant le condamné ainsi que les éléments du dossier pénal (108). Il lui apporte également son assistance en cas de besoin.
Surtout, le médecin coordonnateur exerce une fonction d’interface avec la justice dans la mesure où, aux termes de la loi, il constitue l’interlocuteur quasi unique du juge de l’application des peines.
Ainsi, le médecin coordonnateur transmet au juge de l’application des peines au moins une fois par an un rapport comportant tous les éléments nécessaires au contrôle du respect de l’injonction de soins, et notamment des éléments d’appréciation sur l’évolution de la personne. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an. En outre, les documents adressés par le juge au médecin traitant transitent par lui. De la même façon, c’est le médecin coordonnateur qui doit informer le juge de l’interruption du traitement contre l’avis du médecin traitant et qui peut lui faire part des difficultés, signalées par le médecin traitant, survenues dans l’exécution du traitement (109). Il peut également en informer le conseiller d’insertion et de probation de la personne suivie.
De façon générale, les praticiens, tant médecins que magistrats, sont satisfaits par le dispositif actuel et considèrent le médecin coordonnateur comme une institution indispensable. En effet, il permet aux uns et aux autres de travailler ensemble et d’échanger des informations essentielles sans pour autant remettre en cause le secret professionnel, notamment médical, qu’il importe, pour les médecins, de maintenir de façon absolue. Dans le cas contraire, de leur point de vue, cela risquerait de « tuer le soin ». De fait, pour accepter de se soumettre à un suivi psychologique, les auteurs d’infractions à caractère sexuel ont besoin d’une confidentialité totale. Le médecin coordonnateur a précisément pour rôle de distiller les informations strictement nécessaires aux autres acteurs du suivi. De même, pour que le traitement fonctionne, le soignant doit conserver son rôle et se préoccuper à titre principal de la souffrance des auteurs d’infractions à caractère sexuel, non pas des risques de récidive, qu’il appartient au médecin coordonnateur et au juge d’évaluer.
LES CENTRES D’APPUI BELGES : ENTRE LE MÉDECIN COORDONNATEUR ET LE CRIAVS (110) Les centres d’appui, mis en place dans chaque région, servent d’interface entre la justice et la santé. Ces centres d’appui ont notamment la charge d’assurer l’orientation thérapeutique des personnes condamnées vers des équipes spécialisées ou des thérapeutes individuels, selon les besoins de l’individu. Si les centres d’appui de Wallonie et de Flandre assurent également le traitement de certains auteurs de violences sexuelles, ce n’est pas le cas du centre d’appui bruxellois (CAB), qui délègue la mise en œuvre du traitement à des équipes spécialisées. Le CAB évalue, à partir de trois entretiens réalisés par des psychologues différents, les besoins de la personne, avant de proposer une orientation thérapeutique. Au cours du traitement, les centres d’appui transmettent à la Justice les rapports de suivi établis par les équipes spécialisées, sans pour autant dévoiler des informations couvertes par le secret médical. En cas d’interruption du traitement, le centre d’appui assure un « filet de sécurité » et convoque la personne pour réajuster le traitement proposé. La vocation des centres d’appui est aussi de faire tomber les appréhensions des professionnels à l’égard de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, par le biais de formations. Le CAB dispose ainsi d’une file active de 250 personnes et se voit confier près de 80 nouveaux mandats par an. Son effectif est composé de trois psychologues et sexologues à mi-temps. Son budget est de 180 000 euros par an. |
*
* *
Le dispositif juridique actuel, tant en matière de surveillance que de soins, semble particulièrement complet. Rares sont les auteurs de violences sexuelles dangereux qui ne seront pas soumis, après leur peine d’emprisonnement, à des mesures de surveillance et de soins, dont le but est de limiter autant que possible les risques de récidive. Parce que ces mesures peuvent aller jusqu’à priver quelqu’un de sa liberté pendant un temps indéterminé, le droit y a apporté un encadrement particulièrement important, qui permet de s’assurer que ces mesures répondent au principe pénal de nécessité.
Mais, en dépit du caractère très élaboré du dispositif actuel, le mirage du « risque zéro » doit être absolument écarté. Parce que les individus conservent leur libre arbitre et qu’ils peuvent choisir sciemment de transgresser la loi, il est impossible de considérer, sauf à garder sous écrou l’ensemble des délinquants, que la récidive peut être définitivement et dans tous les cas, empêchée. Aujourd’hui, tout est mis en œuvre, sur un plan juridique, pour empêcher la récidive des auteurs de violences sexuelles particulièrement dangereux.
DEUXIÈME PARTIE : UN MANQUE DE COORDINATION ET DE MOYENS QUI NUISENT À L’EFFICACITÉ DU SUIVI
Un nombre très important d’acteurs interviennent dans le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Du côté des magistrats, le juge de l’application des peines, le procureur de la République et parfois les membres des juridictions régionales et nationale de la rétention de sûreté, sont amenés à interagir. Du côté des services pénitentiaires, le conseiller d’insertion et de probation, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, mais également les surveillants pénitentiaires qui peuvent être chargés de la surveillance électronique, assurent des fonctions différentes dans le suivi. Enfin, le corps médical et soignant fournit tout à la fois les experts psychiatres amenés à évaluer la dangerosité ou l’accessibilité aux soins des auteurs d’infractions à caractère sexuel, les médecins ou psychologues traitants, en milieu carcéral comme en milieu ouvert, ainsi que les médecins coordonnateurs.
Le dispositif juridique étant en lui-même satisfaisant, l’enjeu réside donc dans sa mise en œuvre. Pour les acteurs judiciaires comme pour les médecins et psychologues qui interviennent dans l’évaluation et le traitement des auteurs de violences sexuelles, deux éléments sont préjudiciables à la qualité du suivi : le manque de moyens humains et financiers et la trop faible coordination de l’action de ces professionnels.
I. LE JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES ET LE CONSEILLER D’INSERTION ET DE PROBATION : UN DIALOGUE DIFFICILE
Le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel, dans son aspect judiciaire, revêt deux visages distincts : celui du juge de l’application des peines, qui incarne la fonction judiciaire, et celui du conseiller d’insertion et de probation, qui relève de l’administration pénitentiaire. Des professionnels aux cultures différentes sont donc amenés à collaborer pour assurer un suivi efficace des auteurs de violences sexuelles. Néanmoins, les obstacles sont nombreux à l’établissement d’un dialogue réel entre les deux principaux acteurs du suivi.
A. LE JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES : MALAISE DANS LA PROFESSION
Les juridictions de l’application des peines sont aujourd’hui dans une situation critique en matière de ressources humaines, qui est susceptible de fragiliser le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Elles disposent par ailleurs, dans ce domaine, de marges de manœuvre particulièrement étroites, quand elles ne sont pas marginalisées au profit de juridictions d’exception.
1. Des charges de travail inadaptées au suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel
Un juge de l’application des peines suit, en moyenne, 800 dossiers. Avec 375 postes localisés en 2011, ce sont ainsi 250 000 dossiers de milieu ouvert et 50 000 dossiers de milieu fermé qui étaient suivis en 2011 (111).
Ces chiffres masquent cependant d’importantes disparités entre les juridictions. Si dans six tribunaux, le nombre de dossiers suivis par juge de l’application des peines est inférieur à 400, une cinquantaine de juridictions connaissent des situations critiques, avec un nombre de dossiers suivis qui peut dépasser 1 500. Certes, le nombre de juges de l’application des peines a augmenté depuis 2 000, où il n’existait que 176 postes localisés. Entre 2006 et 2011, 95 postes de juge de l’application des peines ont été créés (112). Mais c’est sans commune mesure avec l’augmentation progressive du nombre de dossiers à suivre, tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé. Cette évolution est imputable à plusieurs facteurs.
D’une part, l’élargissement continu des compétences des juges de l’application des peines, qui interviennent en milieu fermé, pour décider de l’octroi ou du retrait de réductions de peine par exemple, ou d’une libération conditionnelle, mais également en milieu ouvert, pour ce qui est des aménagements de peine et du suivi de certains condamnés – notamment en ce qui concerne les peines et les mesures de sûreté visant les auteurs d’infractions à caractère sexuel – est à l’origine de l’augmentation du nombre de mesures à suivre. Par ailleurs, ces magistrats se sont vu confier le suivi des personnes placées sous surveillance judiciaire et sous surveillance électronique mobile, en plus des peines de suivi socio-judiciaire, toutes ces mesures impliquant un suivi relativement long après la libération de la personne condamnée.
D’autre part, l’augmentation de la charge de travail des juges de l’application des peines est imputable à l’augmentation du nombre total de condamnations prononcées par les tribunaux et du nombre de personnes écrouées. En 2002, 48 594 personnes étaient écrouées en France. En 2010, ce chiffre s’élevait à 66 089 personnes. Cette même année, 585 000 condamnations ont été prononcées à l’encontre de personnes auteurs de crimes ou de délits, dont 126 650 peines privatives de liberté, parmi lesquelles 91 % sont aménageables (113). L’augmentation du nombre de condamnations à une peine privative de liberté a un impact sur les aménagements de peines qui, combiné à l’extension des possibilités d’aménagement de peines par le législateur, ne peut que conduire à l’augmentation du nombre de dossiers suivis par les juridictions de l’application des peines. Le nombre de peines aménagées a de fait augmenté, accroissant la charge de travail des juges de l’application des peines et sont ainsi passées, entre février 2007 et novembre 2011, de 4 068 à 10 237 (114). Étant situé à la fin de la chaîne judiciaire, le service de l’application des peines est nécessairement soumis aux variations quantitatives qui interviennent en amont.
Un groupe de travail sur les services de l’application des peines a été mis en place au sein du ministère de la Justice en mars 2011, qui a notamment eu pour tâche d’évaluer le nombre optimal de dossiers pouvant être suivis par un juge de l’application des peines. Dans son rapport, le groupe de travail a estimé qu’« un ETPT de JAP [permettrait] de traiter ou de rendre correctement :
- en milieu ouvert: 700 à 800 dossiers, en tenant compte de la nécessaire pondération de certains dossiers particulièrement complexes, au regard de la personnalité du condamné et/ou de la peine prononcée : suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) et surveillance de sûreté. Le groupe considère qu'un dossier de cette nature en vaut deux ou
- en milieu fermé: 700 à 800 condamnés sous écrou à la date du 1er janvier ou
- au titre de l'article 723-15 CPP (115): 700 à 800 décisions par an » (116).
Mais, comme l’ont indiqué à la mission certains interlocuteurs, avec un nombre de dossiers aussi important à suivre, l’erreur est toujours possible.
Au-delà des moyens humains, les moyens matériels font aussi cruellement défaut aux services de l’application des peines. Une anecdote livrée à votre rapporteur a illustré avec force l’impact que peuvent avoir des préoccupations purement matérielles sur le bon déroulement du suivi des personnes condamnées : il arrive fréquemment que les juges soient confrontés à une pénurie de papier qui les empêche de faire des copies des dossiers et de les envoyer aux services pénitentiaires d’insertion et de probation ou au médecin coordonnateur. On mesure ici à quel point le suivi des personnes condamnées tient parfois à peu de choses.
2. Des marges de manœuvre de plus en plus étroites
Au fur et à mesure que la loi a confié plus de tâches aux juges de l’application des peines, elle a aussi encadré ces nouveaux pouvoirs par des délais et des procédures obligatoires. C’est notamment le cas en matière de suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Les expertises obligatoires se sont multipliées, les délais dans lesquels il faut les réaliser sont devenus plus impératifs. Comme l’a souligné un juge de l’application des peines entendu par la mission, « la loi veut tout régler. Elle fait des juges des automates ».
Ainsi, en matière de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines ne peut pas l’accorder à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru si cette personne a refusé d’entamer un traitement en détention (117) ; dans le cas des personnes condamnées à une peine de réclusion de quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ou à une peine d’emprisonnement ou de réclusion supérieure à dix ans pour une infraction éligible à la rétention de sûreté, alors la libération conditionnelle doit être précédée par une évaluation obligatoire de dangerosité ; pour ces mêmes personnes, le placement sous surveillance électronique mobile est la règle, sauf à ce qu’elles aient exécuté une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique fixe pendant une durée comprise entre un et trois ans (118). Si la personne a été soumise à une injonction de soins dans le cadre de sa libération conditionnelle, le fait de refuser de suivre ou continuer le traitement est automatiquement constitutif d’une violation des obligations qui peut entraîner une révocation de la liberté conditionnelle (119).
De façon générale, pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, l’expertise psychiatrique est presque toujours obligatoire : avant une injonction de soins (120), avant un placement sous surveillance électronique mobile (121), avant une surveillance judiciaire (122), avant une rétention de sûreté (123). Bien souvent, le caractère obligatoire de ces expertises vise à protéger les droits de la personne condamnée, en s’assurant qu’elle est effectivement accessible à un traitement, dans le cas de l’injonction de soins, ou qu’elle présente un risque de dangerosité justifiant une mesure de sûreté. Mais ces expertises sont également obligatoires dans le cadre de mesures favorables à la personne condamnée, notamment en matière de libération conditionnelle. Or, dans certains cas, la pénurie d’experts psychiatres a pour effet de retarder démesurément l’élargissement de la personne.
Dans d’autres cas, la décision du juge est fortement orientée par les textes dans un sens déterminé. Il en va ainsi en matière d’injonction de soins. En effet, un changement sémantique intéressant a eu lieu avec la loi du 10 août 2007 (124) : alors qu’auparavant, « le suivi socio-judiciaire [pouvait] comprendre une injonction de soins », la personne est désormais soumise à une injonction de soins « sauf décision contraire de la juridiction » (125). La même technique de suggestion est employée en ce qui concerne la rétention de sûreté : si celle-ci n’a pas été jugée indispensable par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, cette dernière renvoie au juge de l’application des peines le soin d’apprécier « l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire » (126). Comme certains le font remarquer à juste titre, « le magistrat n’est pas contraint de la prononcer, mais l’indication textuelle couplée aux attentes de la population, des médias et des politiques, ne lui laisse guère de marges de manœuvre » (127).
3. Un rôle limité dans le cadre des mesures de sûreté
Les nouvelles mesures de sûreté que sont la rétention et la surveillance de sûreté font une place plus réduite encore au juge de l’application des peines.
En effet, le choix a été fait de confier la majeure partie de la mise en œuvre de ces mesures à des juridictions spécialisées, les juridictions régionales de la rétention de sûreté (JRRS) et, en appel, à la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Si la nature particulière de la rétention et de la surveillance de sûreté, qui tend à les rapprocher des mesures de sûreté, justifie le choix d’un juge spécifique, il n’est toutefois pas cohérent que d’autres dispositions considérées comme des mesures de sûreté, comme la surveillance judiciaire, soient quant à elles confiées au juge de droit commun de l’application des peines.
Le juge de l’application des peines n’est toutefois pas totalement absent de la mise en œuvre de ces mesures. En matière de surveillance de sûreté, si le prononcé de la mesure revient à la JRRS, le juge de l’application des peines doit amorcer la procédure, huit mois avant la fin du suivi socio-judiciaire, de la surveillance judiciaire ou de la rétention de sûreté dont fait l’objet la personne condamnée, en informant le procureur de la République de la situation de l’intéressé. Il formule lui-même un avis motivé sur l’opportunité du placement de la personne sous surveillance de sûreté. S’il estime que la personne peut utilement faire l’objet d’un tel placement, il fait alors procéder à l’expertise requise et saisit la commission pluridisciplinaire et la JRRS (128).
Mais le pouvoir réglementaire a prévu plusieurs garde-fous à l’éventuelle inaction du juge de l’application des peines.
En effet, il oblige le procureur à agir à la place du juge, lorsque celui-ci n’ordonne pas l’expertise obligatoire et omet de saisir la commission alors que « la situation de l’intéressé paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté », ou ne saisit pas la JRRS alors que l’expertise, comme l’avis de la commission, sont favorables à l’application d’une surveillance de sûreté. Ce transfert de responsabilité au profit du parquet apparaît nettement au travers de la circulaire d’application de la loi du 25 février 2008 : « Même s’il appartient au premier chef aux juges de l’application des peines de prendre l’initiative d’informer le parquet, et que l’initiative d’une surveillance de sûreté relève ainsi d’une coresponsabilité entre ces magistrats et les procureurs de la République, il convient que ces derniers vérifient auprès des juges de l’application des peines la situation des personnes susceptibles de faire l’objet d’une surveillance de sûreté, afin d’éviter toute difficulté dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions » (129). À chaque décision confiée au juge de l’application des peines, une sécurité supplémentaire et systématique a été prévue afin de remédier à ses possibles carences. L’esprit même de ces textes entretient une certaine méfiance à l’égard du juge de l’application des peines, qui apparaît comme faillible, si ce n’est négligent.
En ce qui concerne les mesures de surveillance dont fait l’objet la personne soumise à une surveillance de sûreté, celles-ci sont définies, modifiées et complétées par une ordonnance motivée du président de la JRRS, non du juge de l’application des peines. En revanche, la personne surveillée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines. S’il constate que la personne fait défaut à ses obligations, il peut saisir le président de la JRRS afin que celui-ci ordonne la modification des obligations ou le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Le juge de l’application des peines apparaît ici dépourvu des pouvoirs de personnalisation dont il dispose lorsque d’autres peines et mesures de sûreté sont mises en œuvre. Simple exécutant des décisions de la JRRS, « son rôle est réduit à celui d’un super travailleur social » (130).
Le rôle du juge de l’application des peines est encore plus marginal en matière de rétention de sûreté.
Le pouvoir de saisine de la JRRS, avant la libération de la personne condamnée ou préalablement au renouvellement de la rétention de sûreté, est confié au seul procureur. Tout au plus le juge de l’application des peines met-il la procédure en mouvement dix-huit mois avant la libération d’une personne éligible à la rétention de sûreté. Mais, là encore, le procureur de la République peut agir à sa place. Le juge de l’application des peines intervient également lorsque la personne est en rétention, mais dispose de moins de pouvoirs que dans le cadre d’une détention. Il est simplement informé des restrictions portées au droit des personnes retenues par le directeur des services pénitentiaires. Il peut accorder des permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile, mais ne saurait prendre cette décision seul ; en effet, l’avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République est nécessaire (131). Enfin, il saisit le président de la JRRS en cas d’évasion d’une personne retenue, afin que ce dernier délivre un ordre de recherche. Là encore, « le JAP doit saisir des juridictions qui sont, à sa place, compétentes » (132).
La tâche actuelle des juges de l’application des peines, tant au plan juridique que pratique, n’est donc pas aisée. Soumis à des charges de travail excessives, les juges de l’application des peines vivent dans la peur quotidienne de voir un dossier échapper à leur vigilance faute de temps et de moyens.
B. LES CONSEILLERS D’INSERTION ET DE PROBATION EN CRISE
Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) sont aujourd’hui confrontés à une triple crise : une crise de moyens, une crise de méthode et une crise d’identité.
Outre le fait que leurs effectifs sont mal répartis sur le territoire, ce qui contribue à créer d’importants écarts dans la charge de travail de ces personnels, les conseillers d’insertion et de probation manquent aussi d’outils adaptés à la prévention de la récidive et à la réinsertion des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
a) Des ressources humaines mal réparties
Les 103 services pénitentiaires d’insertion et de probation sont aujourd’hui dotés d’environ 4 250 agents pour 4 080 équivalents temps plein, qui assurent le suivi, tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé, de 239 997 personnes, dont seulement 66 975 sous écrou.
Les SPIP suivent donc majoritairement des personnes en milieu ouvert. Mis à part certains SPIP rattachés à un établissement pénitentiaire spécialisé dans l’accueil d’auteurs d’infractions à caractère sexuel, la plupart des SPIP ne suivent en moyenne que 9 % de délinquants de ce type. Certains SPIP en suivent davantage, comme le SPIP de Paris, dont 28 % des personnes suivies sont auteurs d’infractions à caractère sexuel, ou le SPIP de Dordogne, pour qui ce public représente près de 17 % des mesures de suivi en milieu ouvert mais 80 % des personnes suivies en milieu fermé, du fait de la proximité d’un établissement spécialisé.
Les effectifs des SPIP ont, depuis leur création en 1999, connu une augmentation de 119 %, tandis que le nombre de personnes prises en charge par l’administration pénitentiaire n’a cru que de 29 %.
NOMBRE DE PERSONNES PRISES EN CHARGE PAR LES SPIP DEPUIS 2000
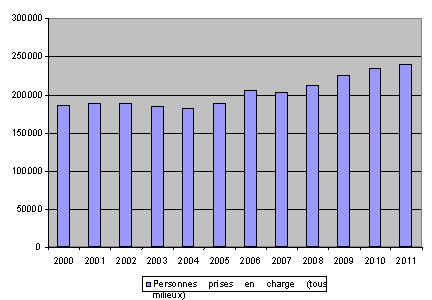
Source : rapport d’activité de la direction de l’Administration pénitentiaire pour 2009.
EFFECTIFS DE SPIP DEPUIS 2000
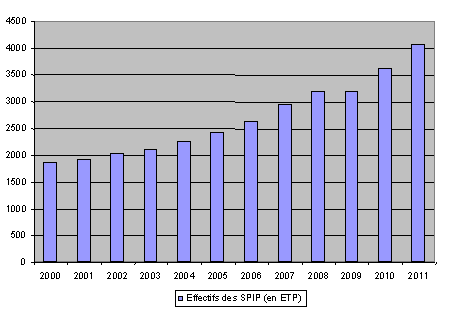
Source : direction de l’Administration pénitentiaire.
Si les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation suivent, en moyenne, entre 80 et 130 dossiers, il arrive, dans certains départements, qu’un conseiller suive plusieurs centaines de dossiers. De fait, l’activité de ces services est soumise à de fortes variations, notamment liées aux pics d’activités des juridictions qui, périodiquement, résorbent le stock de peines fermes exécutoires en attente d’exécution (133), générant ainsi d’importants flux d’entrées et de sorties en détention.
Les divergences constatées dans le nombre de dossiers suivis sont également imputables à l’inégale répartition des personnels sur le territoire.
Ainsi, si le nombre moyen d’équivalent temps plein par SPIP était de 32 en 2010, 28 SPIP sont dotés de 15 équivalents temps plein ou moins, tandis que 20 SPIP disposaient de plus de 50 équivalents temps plein (134). En outre, une surcharge momentanée de travail peut parfois survenir du fait de la gestion d’un plus grand nombre de congés maternités qu’implique la féminisation de la fonction de conseiller d’insertion et de probation. Les taux d’absentéisme sont également variables selon les SPIP, ce qui peut contribuer à expliquer ces écarts.
Par ailleurs, il a été souligné à plusieurs reprises à la mission que, pour effectuer un suivi réel, un conseiller ne devrait pas suivre plus de 50 mesures. Qui plus est, les dossiers des auteurs d’infractions à caractère sexuel nécessitent en général un suivi plus intense que les autres délinquants.
En effet, ces personnes sont généralement suivies dans le cadre de mesures particulièrement lourdes, comme le suivi socio-judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile ou encore la surveillance judiciaire ou de sûreté. La direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est livrée à une évaluation du temps de travail nécessaire à l’accomplissement de ces mesures. Elle estime à 40 heures le temps de travail annuel nécessité par une mesure de suivi socio-judiciaire et à 92 heures une mesure de surveillance judiciaire. Un suivi socio-judiciaire, par exemple, est assuré par le biais d’un entretien qui a lieu toutes les trois semaines ou tous les mois (135). La plupart des autres mesures que sont la libération conditionnelle, le sursis avec mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, ne nécessitent quant à elles qu’une vingtaine d’heures par an.
b) Les programmes de prévention de la récidive, un outil à conforter
En matière de suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel, les SPIP peuvent recourir depuis 2006 à des programmes de prévention de la récidive (PPR), qui sont en réalité des groupes de parole animés par les conseillers d’insertion et de probation, aidés de psychologues. Ces groupes de parole à visée socio-éducative et comportementale, et non thérapeutique, doivent permettre de travailler sur le passage à l’acte. Concrètement, ces PPR prennent la forme de 8 à 12 séances, encadrées par deux conseillers, et regroupent un petit nombre d’auteurs de violences sexuelles qui se réunissent environ une fois par mois. En 2011, 60 programmes de prévention de la récidive sur 190 portaient sur les violences sexuelles.
Les PPR visent, de façon générale, à permettre une prise de conscience de l’acte délictueux et de ses conséquences pour les victimes. L’animateur du groupe doit alors apporter des repères aux participants sur la place de la loi et les amener à confronter leurs expériences. Au-delà, il s’agit également d’assurer la prévention de la récidive en permettant aux participants d’identifier les facteurs de passage à l’acte et les situations à risque et en leur donnant des stratégies d’évitement. Le but est aussi de recréer, pour les participants, un modèle socialisant. Ainsi, une activité, appelée le « Qu’en dit-on », permet au conseiller de donner le point de vue de la société sur une situation donnée. Dans un cadre collectif, il est aussi plus difficile pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, confrontés à leurs pairs, de nier leurs actes. Le groupe libère la parole, et ce d’autant plus que les pairs ont un pouvoir de conviction plus grand que les conseillers, associés au monde judiciaire.
Parce que les personnes se livrent plus facilement dans ce cadre collectif, il est également plus facile de travailler, lors de l’entretien individuel, avec l’auteur d’une infraction à caractère sexuel. Les programmes de prévention de la récidive constituent un nouvel outil qui a, pour beaucoup de professionnels, révolutionné le suivi des personnes condamnées, et des auteurs de violences sexuelles en particulier. Par ailleurs, pour les mesures particulièrement longues, comme le suivi socio-judiciaire, ces groupes de parole peuvent également apporter un second souffle au suivi et le redynamiser en lui donnant une dimension collective. L’intérêt de la démarche est aussi d’aider la personne à « aller vers le soignant ». En effet, pour les personnes suivies en milieu ouvert, qu’elles soient sous surveillance judiciaire ou qu’elles fassent l’objet d’un placement sous surveillance électronique mobile, l’obligation de suivre des soins est difficile à accepter.
Cette démarche présente donc de nombreux intérêts, d’ailleurs saluée par la plupart des professionnels de la filière rencontrés par la mission. Cependant, ces PPR ne sont pas toujours aisés à mettre en œuvre.
Ils nécessitent, en premier lieu, une sélection particulièrement attentive des participants. En effet, certains profils psychologiques ne sont pas compatibles avec un travail collectif, qu’ils risqueraient de mettre volontairement en péril. Les personnes souffrant de déficiences mentales n’y sont pas non plus accessibles. Pour fonctionner, ces groupes de parole reposent sur l’adhésion et l’investissement personnel des participants. Or, une part importante des auteurs d’infractions à caractère sexuel refusent d’y participer ou quittent le groupe après quelques séances. Il n’est pas rare d’enregistrer le départ d’un ou de deux participants en cours de programme. Pour certains participants qui peuvent avoir du mal à verbaliser leurs actes, l’impact du groupe est moins mesurable.
Au plan matériel également, ces PPR soulèvent quelques difficultés. En effet, « à la fois pratiques complémentaires, pratiques supplémentaires et pratiques prioritaires, les PPR pèsent de tout leur poids sur les possibilités d’action des SPIP, tant au niveau individuel que structurel » (136) et rigidifient parfois la gestion des ressources humaines. La mise en œuvre de PPR implique un important travail en amont comme en aval : débriefings avec le psychologue, analyse des séances, préparation des axes de réflexion, entretiens avec les participants, tâches administratives… On peut estimer à 2,5 heures hebdomadaires le temps de travail induit par un PPR (137). À effectifs constants, ces PPR constituent donc une charge de travail supplémentaire non négligeable. La mise en place d’un PPR rend également nécessaire la formation des personnels et le recours à un psychologue, ce qui représente un coût certain. C’est pourquoi ils ont dû, dans certains SPIP, être abandonnés faute de moyens humains et financiers.
LE PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE DU SPIP DE PARIS À raison de dix séances d’une heure et demie toutes les trois semaines, le programme de prévention de la récidive mis en place par le SPIP de Paris à destination des personnes condamnées pour usage d’images pédopornographiques en 2011, concernait une dizaine de personnes suivies en milieu ouvert pour un coût total de 9 000 euros. La première séance est consacrée à la présentation du groupe et à la signature, par chaque participant, d’une charte d’engagement (138), tandis que les séances suivantes portent plus spécifiquement sur le passage à l’acte, les victimes et les stratégies d’évitement. Ces séances ont permis à chaque participant de parler de sa condamnation et de ses actes, mais également d’aborder le thème du soin. Les participants ont fait l’objet d’une sélection par le SPIP en fonction de plusieurs critères : minimisation de l’acte délictuel, relance d’une dynamique de suivi, investissement personnel du condamné dans cette démarche. Pour la mise en œuvre de ce groupe de parole, un psychologue a été engagé qui a supervisé les animateurs, avant et après chaque séance. Les résultats de ce PPR ont été évalués. Du côté des participants, l’estime de soi s’est améliorée, une prise de conscience de la victime a eu lieu. Le groupe a souvent été une passerelle vers le soin. Pour les conseillers d’insertion et de probation, l’animation du groupe a rendu possible une meilleure compréhension du passage à l’acte et l’établissement d’une relation de confiance avec les personnes suivies et ainsi, un accompagnement individuel plus fructueux. |
Source : réponse au questionnaire de la mission d’information à l’attention des SPIP.
c) La réinsertion des auteurs de violences sexuelles : des moyens insuffisants
La réinsertion des auteurs de violences sexuelles, plus que celle de tout autre délinquant, demande du temps et requiert des moyens particuliers. L’insertion professionnelle de ce public est particulièrement complexe. D’une part, parce que les auteurs de violences sexuelles, lorsqu’ils sont suivis en milieu ouvert, sont soumis à de fortes restrictions géographiques, à plus forte raison lorsqu’ils sont placés sous surveillance électronique mobile (cf. supra, première partie). D’autre part, parce que leur profil particulier, qui a, dans l’imaginaire collectif, une connotation extrêmement négative, peut constituer un frein à l’emploi. Ce problème se pose avec d’autant plus d’acuité que le SPIP prend en charge des personnes issues d’un établissement spécialisé. Il est plus difficile, pour les services d’insertion et de probation (SPIP), de créer des partenariats avec des entreprises ou des institutions situées sur le même territoire que l’établissement en question, car ce dernier peut être rapidement stigmatisé.
En ce qui concerne l’hébergement des personnes suivies, qui doit concilier les obligations posées par le juge et les besoins de la personne, notamment en matière de soins, les moyens à disposition des SPIP sont extrêmement réduits. Les foyers classiques, comme les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ne constituent pas une formule d’hébergement appropriée (cf. supra, première partie). Bien souvent, les SPIP se heurtent au refus des personnes responsables de ces foyers, qui ne souhaitent pas mettre en danger les autres personnes accueillies. Il n’est d’ailleurs pas rare que les auteurs de violences sexuelles soient libérés sans qu’une solution de logement ait pu être trouvée par le SPIP.
C’est pourquoi certains SPIP ont mis en place des solutions ad hoc d’hébergement pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Par exemple, le SPIP du Tarn a mis en place un placement extérieur, qui permet d’associer l’hébergement, l’aide éducative du SPIP et le soutien psychologique du centre médico-psychologique partenaire. Pour 30 euros par jour seulement, les personnes sont entièrement prises en charge. Mais la mise en place de telles solutions prend du temps et nécessite des moyens financiers supplémentaires.
Au-delà des problèmes de moyens humains et financiers qui font parfois obstacle à un suivi pleinement efficace des auteurs d’infractions à caractère sexuel, un souci de méthode est également apparu dans ce domaine particulier.
D’une part, les conseillers d’insertion et de probation sont rarement spécialisés dans le suivi de ces délinquants aux profils particuliers.
Certains personnels des SPIP le sont de fait, étant rattachés à un établissement pénitentiaire spécialisé dans l’accueil des auteurs de violences sexuelles. C’est notamment le cas des conseillers d’insertion et de probation du SPIP de Dordogne, du fait de la proximité du centre de détention de Mauzac. Toutefois, les personnels semblent opposés à toute spécialisation. En effet, le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel est relativement lourd. Ces personnalités parfois complexes peuvent être difficiles à gérer, si bien qu’un effet de saturation serait probable.
De façon générale, les conseillers d’insertion et de probation entendus par la mission s’accordent sur l’absence de spécificité de la délinquance sexuelle. Loin de toute volonté d’étiqueter les délinquants, il s’agit d’assurer un suivi individualisé de chaque personne confiée au SPIP. La prise en charge doit débuter par une évaluation, conduite par un conseiller, visant à identifier les besoins d’intervention de la personne suivie, ses problèmes, ses ressources et son degré de réceptivité à l’intervention, cette démarche étant valable pour tous les délinquants. Pour les interlocuteurs rencontrés par la mission, le caractère sexuel de l’infraction ne justifie pas une quelconque « surenchère dans le suivi ».
En effet, la focalisation sur certaines catégories pénales peut conduire à limiter l’attention portée aux autres délinquants, dont certains peuvent récidiver de façon problématique, d’ailleurs parfois sur un mode sexuel. L’exemple d’une personne suivie par un SPIP pour une escroquerie, qui a ensuite violé une jeune femme pensant être montée à bord d’un taxi, a été avancé pour illustrer ce possible effet pervers de l’intérêt excessif porté à la nature de l’infraction. À l’inverse, une personne ayant commis des faits de violences sexuelles peut ne pas présenter de problématique sexuelle à proprement parler, notamment lorsque son acte est lié à l’usage de stupéfiants ou à un handicap mental. Ainsi, il paraît essentiel d’identifier les problématiques de chaque personne suivie, au-delà de l’infraction commise.
Néanmoins, les SPIP ne disposent pas encore d’un outil particulier, au-delà de l’entretien individuel, pour caractériser le risque de récidive de la personne suivie et partant, l’intensité du suivi nécessaire. La responsabilité qui pèse sur les conseillers d’insertion et de probation, qui assument seuls le suivi des personnes, est donc extrêmement forte. Pour y remédier, deux solutions ont commencé à être mises en œuvre par la direction de l’Administration pénitentiaire : d’une part, la mise en place d’un diagnostic à visée criminologique qui, couplée à la « segmentation » des dossiers, doit permettre d’adapter au mieux l’intensité du suivi ; d’autre part, le développement de la pluridisciplinarité, qui permet aux conseillers d’insertion et de probation un exercice moins solitaire de leurs fonctions.
Le diagnostic à visée criminologique (DAVC), créé par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, a vocation à être utilisé par l’ensemble des SPIP (139). Ce diagnostic, réalisé par les conseillers d’insertion et de probation au cours des premiers mois de la prise en charge, doit permettre une meilleure appréhension de la personnalité du détenu. Un logiciel est alors alimenté au fil des premières évaluations par le conseiller, en fonction de plusieurs champs distincts :
— le parcours judiciaire et pénitentiaire de la personne suivie, le contenu des obligations du détenu et le déroulement de son suivi ;
— l’appropriation de la condamnation et la reconnaissance de l’acte commis ;
— les capacités de changement de la personne suivie en fonction de ses ressources sociales et familiales ;
— la situation médicale et sa compatibilité avec le projet d’insertion ;
— la conclusion du diagnostic.
Cet outil, qui doit assurer une harmonisation des modalités de prise en charge au sein du SPIP, constitue un instrument évolutif. En effet, toute évolution significative de la situation et du comportement du détenu est suivie d’une actualisation du DAVC. Si ce DAVC n’est pas spécifique aux auteurs d’infractions à caractère sexuel, il semble qu’il soit particulièrement utile dans ce cadre.
La segmentation qui suit la réalisation du DAVC conduit à organiser la prise en charge d’une personne en fonction des conclusions de l’évaluation initiale. Il s’agit de répartir les condamnés, en fonction de leur profil et des risques de récidive qu’ils présentent, en quatre ou cinq segments, dont les moins problématiques sont confiés à des surveillants pénitentiaires. Cela permet aux conseillers de recentrer leur activité sur la prise en charge des dossiers les plus complexes, où leurs compétences sont le plus utile.
Mais, en ce qui concerne la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel, c’est la pluridisciplinarité qui semble la plus à même d’améliorer le suivi effectué par le SPIP. Certains dossiers particulièrement complexes rendent nécessaire une approche croisée. Dans le cas des auteurs de violences sexuelles, qui peuvent souffrir d’importants troubles du comportement, le concours d’un psychologue peut apporter une réelle plus-value au suivi. Ceci est d’autant plus vrai que certains conseillers peuvent être démunis face à des personnes niant les faits et « peu réactives au face-à-face traditionnel auquel ils ont été formés » (140).
Les services d’insertion et de probation sont des services relativement récents. Mis en place par le décret n° 99-276 du 14 avril 1999 modifiant le code de procédure pénale et portant création des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ils sont en réalité issus de la réunion des équipes socio-éducatives qui intervenaient en milieu fermé et des comités de probation et d’assistance aux condamnés, tout à fait distincts, qui agissaient une fois les personnes libérées. L’objectif était alors de clarifier l’organisation de ces services, d’harmoniser les pratiques professionnelles et d’offrir un interlocuteur pénitentiaire unique aux autres acteurs du suivi.
Mais la réunion, au sein d’un même service, de deux cultures professionnelles différentes ne s’est pas faite partout sans heurt et ces services sont encore trop jeunes pour avoir acquis une culture professionnelle commune. On note encore parfois une opposition, souvent générationnelle, entre ceux qui se considèrent avant tout comme des travailleurs sociaux et ceux qui se perçoivent comme des criminologues. Une partie de la profession craint en effet ce recentrage sur la prévention de la récidive, au détriment de la réinsertion des personnes. Notamment, le DAVC, qui porte mal son nom puisqu’il n’a pas de composante criminologique à proprement parler, est mal perçu par certains conseillers d’insertion et de probation.
L’extension récente du champ d’intervention des SPIP et l’apparition de peines et mesures particulières que sont le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile ou la surveillance de sûreté, donnent le sentiment aux conseillers d’insertion et de probation de ne plus être que des surveillants et de s’éloigner de leur rôle socio-éducatif. Comme le montre M. Olivier Razac, « de ce point de vue, la perspective du développement du PSEM et des mesures de sûreté ou, plus largement, la ligne de pente que ces évolutions dessinent, interrogent fortement l'équilibre qui prévalait jusqu'ici, en faisant de la fonction de surveillance une partie essentielle du métier » (141).
C. JAP ET CIP : UN DIALOGUE IMPOSSIBLE ?
Les relations qui s’établissent, au plan local, entre les juges de l’application des peines (JAP) et les conseillers d’insertion et de probation (CIP) sont loin d’être aisées. Les premiers se sentent dépossédés du suivi, tandis que les seconds ont le sentiment d’être contrôlés et méprisés. L’outil informatique qui devait leur permettre d’échanger des informations et d’instaurer un dialogue a minima, APPI (Application des peines, probation et insertion), n’est d’ailleurs pas utilisé.
1. Des relations parfois difficiles qui compromettent le suivi
Le dialogue entre les juridictions de l’application des peines et les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) est aujourd’hui d’une qualité variable. La mission a pu constater, à plusieurs reprises, qu’une défiance réciproque était palpable. Le changement de rattachement des conseillers d’insertion et de probation, auparavant intégrés aux tribunaux, a vraisemblablement nui à la qualité des contacts que les magistrats pouvaient avoir, au détour d’un couloir, avec ces personnels.
Du côté des magistrats, certains déplorent la trop faible transmission de rapports. Il apparaît que, dans certains cas, les conseillers d’insertion et de probation se contentent des rapports d’évaluation qu’ils doivent remettre périodiquement aux magistrats. Dans d’autres cas, les rapports d’incidents sont envoyés très tardivement au magistrat, qui ne peut alors prendre la décision qui s’impose. Pour certains, plus qu’un outil de collaboration, ces rapports tendent à servir de « police d’assurance » aux SPIP pour se dégager de toute responsabilité. Des magistrats rencontrés par la mission ont également déploré le fait que le directeur du SPIP soit devenu leur unique interlocuteur. Cela fait obstacle à l’établissement un dialogue direct entre le magistrat et le conseiller, ce qui peut conduire à un appauvrissement de l’information reçue par le magistrat.
Les conseillers d’insertion et de probation se sentent quant à eux méprisés par l’institution judiciaire et non appréciés à leur juste valeur. Les conseillers rencontrés par la mission déplorent la rétention d’information organisée par certains médecins et juges, qui se retranchent derrière le secret professionnel. Il arrive également, dans un nombre relativement élevé de cas, que le dossier transmis par le magistrat soit extrêmement pauvre et ne permette pas aux conseillers d’entamer le suivi dans des conditions adéquates. À l’inverse, les SPIP souhaiteraient que les juges accordent davantage de crédit aux évaluations de la situation des personnes suivies qu’ils leur transmettent. Par ailleurs, la mise en œuvre des programmes de prévention de la récidive est parfois mal perçue par les autres acteurs du suivi, notamment les magistrats et les médecins, du fait d’un manque de légitimité des conseillers pour effectuer ce type d’actions. Enfin, les conseillers d’insertion et de probation ont le sentiment que certains magistrats les mettent en concurrence avec le secteur associatif habilité à la gestion de certaines enquêtes présentencielles et mesures pénales.
Cette défiance à l’égard d’un magistrat parfois jugé trop pointilleux et envahissant, s’est d’ailleurs exprimée à l’occasion de la mise en place du diagnostic à visée criminologique (DAVC). Alors que cet outil devait initialement être un instrument interne, permettant aux conseillers de formuler des hypothèses de travail, il est finalement rendu accessible aux magistrats et a vocation à remplacer, à terme, les rapports trimestriels d’évaluation. Les interlocuteurs entendus par la mission sont très opposés à la transmission de ces informations au juge, estimant qu’il n’est pas pertinent que celui-ci fonde ses décisions sur la base d’un travail préliminaire.
Plus largement, c’est le contrôle de l’autorité judiciaire qui semble être à l’origine de ces difficultés communicationnelles. De leur point de vue, les juges de l’application des peines auraient aujourd’hui trop tendance à se comporter à la fois comme l’organe décisionnaire et comme le juge du suivi. Les SPIP ont exprimé leur besoin d’autonomie par rapport au juge de l’application des peines. Notamment, les instructions particulières que celui-ci peut donner au SPIP, alors qu’il n’a qu’une connaissance limitée du dossier, sont mal acceptées. Elles ont pu donner lieu à des décisions incohérentes, par exemple de placement de pédophiles dans des foyers accueillant également de jeunes enfants. Il arrive également que le juge de l’application des peines ne donne que des délais extrêmement contraints aux SPIP pour trouver une solution d’hébergement. Les interventions directes du juge de l’application des peines sont ainsi jugées excessives et inadaptées par certains conseillers.
Sans vouloir dresser un portrait trop noir des relations qui existent entre les juges mandants et les conseillers d’insertion et de probation, il semble que la celles-ci reposent en grande partie sur des liens personnels, ce qui peut donner lieu à une collaboration d’inégale qualité.
2. Une répartition des rôles mouvante et source de conflits
Ces mauvaises relations peuvent être mises en perspective avec les évolutions récentes de la répartition des compétences entre les juges de l’application des peines et les SPIP. Alors que le juge était auparavant un acteur central de suivi, il apparaît que certains de ses pouvoirs ont été progressivement transférés aux SPIP, ce qui est source de conflits interprofessionnels.
En effet, les champs de compétence des juges de l’application des peines et des SPIP ont été récemment redéfinis dans le sens d’une autonomie plus grande donnée aux conseillers d’insertion et de probation dans le suivi des personnes condamnées. Ainsi, le décret n° 2011-1876 du 14 décembre 2011 relatif aux attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du service pénitentiaire d'insertion et de probation et à leurs relations a apporté plusieurs modifications d’ampleur au droit en vigueur.
Tout d’abord, les instructions particulières que le juge peut adresser au SPIP ont fait l’objet d’un encadrement important par le pouvoir réglementaire.
D’une part, alors que le juge pouvait jusqu’alors définir par lui-même, dans le cadre d’une libération conditionnelle, la fréquence des convocations de la personne condamnée par le SPIP, il ne peut aujourd’hui que demander l’application d’un suivi renforcé (142), sans que le contenu de ce suivi puisse être précisé par le juge mandant.
D’autre part, ces instructions particulières ne peuvent plus aujourd’hui viser que la finalité et le contenu des obligations auxquelles la personne condamnée est soumise. Il n’est par exemple plus possible pour le juge, de demander au conseiller d’insertion et de probation de se rendre au domicile de la personne condamnée pour évaluer plus précisément sa situation. Les modalités du suivi appartiennent toutes entières au SPIP, le juge se bornant désormais à un rôle d’orientation générale. Or, pour certains dossiers particulièrement complexes, le regard du juge comme celui du conseiller peut être nécessaire. De même, si un dialogue est permis avec le SPIP sur les modalités de mises en œuvre des orientations générales définies par le juge, en cas de désaccord persistant, le dernier mot revient à l’administration pénitentiaire (143). Le juge semble donc totalement évincé de la définition des modalités de suivi de la personne condamnée.
Toutefois, ces textes de nature règlementaires entrent parfois en contradiction avec la loi, si bien que, pour la mise en œuvre de certaines mesures, le juge de l’application peut effectuer par lui-même le suivi de la personne condamnée. C’est notamment le cas, en application de l’article 763-1 du code de procédure pénale, en matière de suivi socio-judiciaire : la personne condamnée est « placée sous le contrôle du juge de l'application des peines » qui « peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des obligations imposées au condamné » sans y être toutefois obligé. Dans ce cadre précis, le juge de l’application des peines peut se charger lui-même du suivi.
C’est également le choix qui a été fait par le pouvoir réglementaire en matière de surveillance de sûreté, puisque « la personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation » (144). Le juge est même obligé de tenir un dossier relatif au déroulement de la mesure. Toutefois, dans le cas d’une surveillance de sûreté, le juge n’est plus mandant ou seul en charge du suivi, mais bien « assisté » par le SPIP. C’est donc un troisième cas de figure qui semble se dessiner ici dans les relations entre le juge et le SPIP, ce qui ne peut qu’ajouter aux incompréhensions actuelles.
3. APPI, outil de dialogue inutilisé
Le logiciel APPI (Application des peines, insertion et probation) doit permettre au juge de suivre le déroulement de la mesure pénalement ordonnée. Le juge doit normalement y intégrer les données relatives à la condamnation ainsi qu’aux obligations prononcées. Les rapports rédigés à intervalles réguliers par les conseillers doivent y être intégrés, afin que le juge dispose en permanence d’une information actualisée. Dans le cadre de la nouvelle architecture des relations entre le juge et le SPIP, le logiciel APPI est également le support des observations du magistrat sur les modalités de prise en charge décidées par le SPIP.
Dans les faits toutefois, ce logiciel est très peu utilisé. Sa sous-utilisation en fait un support extrêmement pauvre d’information, ce qui contribue, à la façon d’un cercle vicieux, à son absence d’utilisation par les juges de l’application des peines et les conseillers d’insertion et de probation. Plusieurs causes ont contribué à cet état de fait.
D’une part, pour les deux professions, un manque de moyens humains qui ne permet pas l’accomplissement de cette tâche supplémentaire. D’autre part, le recours préférentiel, notamment pour les conseillers d’insertion et de probation intervenant en milieu fermé, à d’autres outils informatiques plus adaptés à leurs pratiques professionnelles. Les informations enregistrées dans ce logiciel par les conseillers d’insertion et de probation sont donc bien souvent lapidaires. Les magistrats, lorsqu’ils renseignent le logiciel, ce qui est rare, référencent mal les obligations auxquelles la personne est tenue.
Mais ceci est également imputable aux failles du logiciel lui-même.
N’étant pas encore interconnecté à GIDE, le logiciel de gestion informatisée des détenus en établissement, ni à CASSIOPÉE (145), l’application destinée à remplacer les applications pénales existantes dans les tribunaux, il ne permet aucun gain de temps. Par ailleurs, de l’avis de la plupart des personnes entendues par la mission, cet outil est particulièrement peu ergonomique. Divers problèmes techniques tenant à la limitation du nombre de caractères autorisés et touchant l’envoi de pièces numérisées sont également à l’origine du désintérêt des acteurs pour cette application. En outre, APPI ne permet pas d’accéder aux données des autres départements ni de réaliser des statistiques sur l’activité des SPIP. Enfin, du fait de la succession des lois et du temps nécessaire à la modification du logiciel, « APPI est toujours en retard d’une mesure », comme l’a confié un magistrat à la mission.
L’interconnexion future d’APPI à CASSIOPÉE devrait remédier à un certain nombre de ces problèmes. Notamment, l’ouverture de la mesure, la transmission des pièces judiciaires et la saisine du SPIP devraient être largement facilitées. Une première expérimentation technique a débuté à la fin de l’année 2011 dans les tribunaux de grande instance de Melun, d’Évry et de Versailles, qui laisse supposer une généralisation prochaine et salutaire.
II. ÉVALUER LA DANGEROSITÉ DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES : LA RESPONSABILITÉ CROISSANTE DE L’EXPERT
Outre les écueils inhérents aux rapports souvent complexes qu’entretiennent le juge de l’application des peines et le conseiller d’insertion et de probation, la problématique de l’efficacité du suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel amène également à s’interroger sur la pertinence de l’évaluation de la dangerosité telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui.
A. LA PROFONDE MUTATION DU RECOURS À L’EXPERT PSYCHIATRE
Les expertises psychiatriques ont fait l’objet, ces dernières années, de changements d’ampleur. Loin de se cantonner à la seule maladie mentale, l’expert psychiatre est désormais sommé de se prononcer sur la dangerosité criminologique des personnes condamnées. En outre, le recours incessant aux expertises obligatoires, associé à des conditions de réalisation particulièrement ingrates, engendre une pénurie de plus en plus inquiétante du nombre de psychiatres remplissant les fonctions d’experts.
1. La question posée à l’expert : de la responsabilité à la dangerosité
Les expertises psychiatriques connaissent, depuis quelques années, une évolution radicale. Alors que les experts devaient initialement se prononcer sur la responsabilité pénale de la personne – il convient de rappeler qu’historiquement, les experts psychiatres sont ceux qui permettaient à des personnes atteintes de troubles mentaux d’échapper à la peine de mort – ils sont aujourd’hui appelés à évaluer leur dangerosité. Le dispositif juridique relatif aux auteurs de violences sexuelles a introduit en France un nouveau type d’expertise psychiatrique. Il s’agit de l’expertise post-sentencielle, dont l’objectif est radicalement différent de l’expertise en phase présentencielle, qui consiste pour l’expert à déterminer si la personne était, au moment des faits, atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Dans le cas de l’expertise post-sentencielle, la personne expertisée est déjà condamnée. Il s’agit alors pour l’expert de donner un pronostic sur l’évolution du condamné en milieu libre, c’est-à-dire sur son risque de récidive. La place de l’expert psychiatre est ainsi passée d’une mission rétrospective – évaluer l’état psychique du délinquant au moment de l’acte – à une mission prédictive. La dangerosité sur laquelle la justice demande aux experts de se prononcer est une notion relativement floue. Elle revêt de fait un caractère relativement nouveau et complexe dans la mesure où elle suppose une appréciation de nature psychiatrique et criminologique.
Au plan psychiatrique, suivant la définition donnée par le rapport de la commission Santé–Justice (146), présidée par M. Jean-François Burgelin, la dangerosité psychiatrique désigne « un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l’activité délirante » (147). C’est là le champ de compétence classique de l’expert psychiatre. En revanche, la dangerosité criminologique se caractérise par l’existence d’un risque de récidive ou de réitération d’une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité. Suivant la commission Santé–Justice, elle se définit comme un « phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens » (148).
De plus en plus, les magistrats requièrent des experts psychiatres qu’ils fournissent un avis criminologique sur les personnes condamnées, alors même que cet aspect de l’évaluation ne fait généralement pas partie de la formation des psychiatres se livrant à des expertises judiciaires. La responsabilité induite par ces expertises est lourde : l’expert est, de plus en plus, un acteur déterminant de l’exécution des peines et mesures de sûreté applicables aux auteurs d’infractions à caractère sexuel. Le caractère insurmontable de la tâche qui leur est assignée pousse d’ailleurs certains experts à ne jamais admettre l’inexistence d’un risque de récidive : celui-ci est toujours « existant », mais rarement quantifié. Il arrive même que certains experts, à l’issue d’une évaluation de dangerosité, recommandent l’observation dans un centre hospitalier ad hoc, de peur de commettre une erreur. En effet, s’il est possible pour un psychiatre d’affirmer que le détenu ne présente plus d’éléments de dangerosité psychiatrique, cela ne signifie pas qu’il n’y ait plus de dangerosité criminologique.
2. Le saut quantitatif des expertises psychiatriques
Mais l’évolution est également quantitative. Comme on l’a vu plus haut, toutes les peines et mesures de sûreté visant les auteurs de violences sexuelles comportent, à un moment de la procédure, la réalisation d’une expertise psychiatrique. Dans ce domaine, on peut distinguer plusieurs types d’expertises, selon le but poursuivi : les expertises relatives aux soins que peut recevoir une personne, les expertises destinées à décider d’une mesure favorable au condamné, les expertises destinées à décider d’un accroissement des contraintes pesant sur la personne condamnée (149). De fait, les objectifs assignés à l’expertise psychiatrique sont multiples : déterminer la responsabilité de l’auteur de l’infraction, évaluer son état psychologique, donner un avis sur sa dangerosité, évaluer son risque de récidive, vérifier son accessibilité aux soins.
Au-delà des seules infractions à caractère sexuel, le nombre d’expertises à réaliser a sensiblement cru au cours des dernières années. Plusieurs facteurs contribuent à expliquer cette évolution. D’une part, le passage d’une simple faculté laissée au juge à une obligation légale. Rares sont aujourd’hui les expertises jadis simplement recommandées que le législateur n’a pas rendues obligatoires. Le caractère obligatoire de ces expertises est si problématique qu’il arrive qu’une correctionnalisation soit décidée afin de passer outre. D’autre part, l’expertise est devenue un enjeu réel du procès, la défense et le ministère public s’employant à multiplier les expertises afin de parvenir à leurs fins respectives. Cette importance croissante de l’évaluation de la dangerosité et de la lutte contre la récidive a entraîné une augmentation significative du nombre d’expertises psychiatriques réalisées entre 2002 et 2009, évaluée à plus de 149 %.
Cette systématisation du recours aux expertises judiciaires est analysée par certains comme une dérive de l’institution judiciaire, liée à une « psychiatrisation de la société ». Il devient en effet tentant, pour le juge, de s’en remettre aux conclusions de l’expert qui est, étymologiquement, « celui qui a fait ses preuves ». La prise en considération par le législateur de la dimension médicale, notamment dans le cadre de l’injonction de soins, résulte d’une volonté louable d’aider et de soigner. De même, l’explication des troubles mentaux aux magistrats, jurés et avocats, permet une meilleure compréhension et participe à l’individualisation de la peine. Néanmoins, elle fait peser une responsabilité trop lourde sur les épaules de l’expert, souvent solitaire. Cela le pousse parfois à agir à la place du juge : il a pu arriver que des experts formulent des recommandations en matière d’aménagements de peines, alors même que c’est là l’apanage du juge. Si c’est anecdotique, cela illustre néanmoins les problèmes de positionnement que la place nouvelle de l’expert peut induire.
L’augmentation du nombre d’expertises psychiatriques requises par les tribunaux, associée à la pénurie croissante d’experts, a conduit à une professionnalisation néfaste de la fonction. Si les experts psychiatres réalisent aujourd’hui en moyenne 150 expertises par an, contre une soixantaine au début des années 2000, certains experts, que d’aucuns qualifient de « serial experts », en effectuent plus de 300. Or, cette évolution n’est pas souhaitable, l’expertise devant demeurer une activité accessoire. Il importe que le psychiatre conserve des activités de soins afin de ne pas être coupé de la réalité clinique.
B. UNE PÉNURIE DE PLUS EN PLUS PRÉOCCUPANTE
1. La diminution constante du nombre d’experts psychiatres
D’année en année, le nombre d’experts psychiatres inscrits sur les listes des cours d’appel diminue, qu’ils démissionnent ou décident de ne pas renouveler leur inscription. Alors qu’ils étaient encore 800 en 2007, seuls quelque 530 experts figurent aujourd’hui sur les listes des cours d’appel. Cette évolution est imputable à la baisse de la démographie médicale et psychiatrique, à la montée en puissance de la psychiatrie libérale et à l’appauvrissement concomitant de la psychiatrie publique, ainsi qu’à un désinvestissement des psychiatres pour l’exercice de ces fonctions.
La Haute-Normandie est représentative des tensions qui traversent la pratique expertale. Elle est sous dotée : l’effectif des psychiatres publics y est inférieur de 40 % à la moyenne nationale. Dans la région, on ne compte que 11 experts psychiatres parmi les 125 psychiatres hospitaliers, qui sont les seuls à accepter d’exercer en tant qu’experts (150). Or, plus de la moitié d’entre eux sont âgés de plus de 55 ans. Dans ces conditions, la psychiatrie publique régionale est menacée d’effondrement.
NOMBRE DE PSYCHIATRES INSCRITS SUR LES LISTES D’EXPERTS DES COURS D’APPEL
Source : données fournies par le ministère de la Justice.
2. Les multiples causes de ce désintérêt des psychiatres pour la fonction expertale
De fait, les conditions matérielles de réalisation de ces expertises sont particulièrement ingrates. Elles nécessitent en effet de se déplacer au sein des locaux de garde à vue, pour les expertises présentencielles, ou d’aller dans des établissements pénitentiaires. Dans ce dernier cas, des contraintes horaires et des démarches administratives existent qui font perdre un temps précieux aux psychiatres. Qui plus est, les locaux mis à disposition pour ces entretiens, les parloirs, ne sont guère compatibles avec une plongée sereine dans la psyché d’autrui. Les expertises psychiatriques demandent du temps pour amener la personne à se confier au psychiatre.
Par ailleurs, les experts disposent de peu d’informations sur la personne expertisée, qui plus est difficiles à obtenir. En effet, en raison du secret médical et du secret de l’instruction, ils ne disposent ni du dossier médical élaboré par le service médico-psychologique régional (151), ni des expertises précédemment établies. Or, en l’absence – très dommageable – de ces dernières, ils ne peuvent juger l’évolution de la personne condamnée en milieu carcéral si bien qu’il leur est difficile de se prononcer sur sa dangerosité. Même si ce constat doit être nuancé en fonction des ressorts (152), les magistrats n’ont aucune obligation de transmettre aux experts ces informations et beaucoup refusent de le faire, invoquant le fait qu’ils souhaitent avoir une image de la situation actuelle, non de l’évolution de la personne. Dans la majorité des cas, les psychiatres doivent se rendre au tribunal ou en prison pour prendre connaissance du dossier de la personne à expertiser.
Cette fonction rebute également un certain nombre de médecins, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer des auteurs de violences sexuelles. Le désintérêt des psychiatres pour ce type de patients s’explique notamment par le fait que leur pathologie est souvent complexe à définir et ne relève pas réellement de la psychiatrie. Plus largement, l’expertise confronte le professionnel à une réalité pénale dure, mais également au procès judiciaire et à ses pratiques parfois déstabilisantes.
La fonction est également peu attractive du point de vue financier. Si la rémunération ne constitue pas la motivation principale des experts, elle demeure faible, malgré sa réévaluation en 2008 (153). Les honoraires des experts psychiatres sont en effet fixés à 257,25 euros, et à 274,40 euros pour une expertise concernant un auteur de violences sexuelles. Aux assises, les experts perçoivent une rémunération de 39,05 euros alors même que cela entraîne la perte d’au minimum une demi-journée d’activité. Par ailleurs, d’importants délais de paiement, qui se transforment parfois en défaut de paiement, ainsi qu’un statut fiscal et social contradictoire, constituent des facteurs dissuasifs.
Des difficultés supplémentaires se posent pour les praticiens hospitaliers, alors même qu’ils sont très largement majoritaires, par rapport aux praticiens libéraux, au sein des experts psychiatres. La réforme introduite par la loi du 21 juillet 2009 relative aux patients, à la santé et aux territoires (154) rend quasi impossible la réalisation d’expertises par les praticiens hospitaliers. En effet, le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, prévoit que les praticiens hospitaliers doivent recevoir l’autorisation de leur supérieur pour exercer une activité accessoire et que celle-ci ne peut être réalisée qu’en dehors du temps de travail. Les expertises devraient ainsi être réalisées en soirée ou durant les jours non ouvrés. Or, comme cela a été relevé plus haut, les experts sont soumis aux contraintes carcérales, les établissements pénitentiaires n’étant pas accessibles en dehors de certaines plages horaires strictement définies. Les dispositions de ce décret sont donc incompatibles avec les conditions réelles de réalisation des expertises.
Fort heureusement, ces dispositions nouvelles font actuellement l’objet d’un moratoire et ne sont donc pas encore appliquées, dans l’attente d’une solution légale pour remédier à ce problème. Si la loi était appliquée dans toute sa rigueur, cela aurait un effet proprement catastrophique sur la disponibilité des experts et, à moyen terme, sur leur inscription sur les listes des cours d’appel.
La fonction d’expert judiciaire apparaît aujourd’hui comme un véritable sacerdoce. Malmenés par les procureurs ou la défense, responsables de décisions extrêmement graves, très faiblement rémunérés, travaillant dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, les experts psychiatres sont chaque année de moins en moins nombreux, alors même que les besoins n’ont jamais été aussi grands.
C. LES MÉTHODES EXPERTALES CLASSIQUES REMISES EN QUESTION
Les expertises psychiatriques sont conduites, dans la grande majorité des cas, par le biais d’un entretien libre avec la personne. Cette méthode, aussi appelée « entretien clinique non structuré », est aujourd’hui remise en cause lorsqu’elle est utilisée à titre exclusif.
1. Des méthodes cliniques avant tout fondées sur l’entretien
Qu’il s’agisse de déterminer la responsabilité pénale de la personne jugée, d’éclairer l’administration pénitentiaire sur l’orientation de la personne condamnée ou de mesurer les risques de récidive, il semble que l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions à caractère sexuel repose aujourd’hui essentiellement, en France, sur la conduite d’entretiens cliniques. Ceux-ci se classent en deux catégories principales :
— l’entretien clinique non structuré : cette méthode consiste en la réalisation d’un ou plusieurs entretien(s) par un psychiatre ou un psychologue de manière complètement libre. Dans ce cadre, le discours du sujet n’est pas analysé au travers d’une trame prédéfinie. À l’issue de ces entretiens, le professionnel évalue la probabilité que présente l’auteur d’infraction de récidiver et établit des préconisations en matière de soins et de suivi ;
— l’entretien clinique structuré : également mené par un psychiatre, l’entretien se déroule toutefois en suivant une grille de lecture et en utilisant des outils rendant compte des connaissances acquises dans le domaine du risque de violence tels que le QICPAAS (155) ; constituée par un ensemble d’« items » commun à tous les entretiens réalisés suivant cette méthode, cette grille de lecture permet d’objectiver le résultat en réduisant la part de l’intervention du clinicien ; cette méthode intègre ainsi des facteurs cliniques évolutifs et poursuit un objectif préventif par la recommandation de mesures adaptées.
Indépendamment de leur spécificité, ces méthodes d’évaluation clinique ont ceci de commun qu’elles consistent à recueillir des faits et des témoignages et se focalisent sur la manière dont les événements ont été vécus et interprétés par l’auteur d’infraction à caractère sexuel. Suivant l’état des lieux établi en 2006 par le rapport de notre collègue Jean-Paul Garraud (156) sur la dangerosité et que corroborent les propres témoignages recueillis par la mission, l’évaluation ainsi réalisée donne notamment lieu à la reconstitution du parcours scolaire et professionnel, du développement psychosocial, sexuel et psychomoteur et prend en considération les antécédents et, le cas échéant, les troubles addictifs. Cela étant, il convient de souligner que la conduite de ces évaluations présente une certaine souplesse, ce qui n’apparaît pas sans conséquence sur la valeur même de l’évaluation de la dangerosité.
2. Une efficacité de plus en plus discutée
Dans l’optique de l’efficacité du suivi de ces personnes tant au sein des établissements pénitentiaires qu’en milieu ouvert, il semble que la méthode de l’entretien clinique comporte des faiblesses majeures, tant du point de vue de sa capacité à évaluer correctement le risque de récidive que de sa trop grande subjectivité.
a) Une capacité réduite d’évaluation de la récidive
La première d’entre elles tient à la faible capacité prédictive de l’entretien clinique en termes de récidive. À l’instar de certaines personnes entendues par la mission, une abondante littérature tend en effet, depuis les années 1970, à apporter la démonstration du caractère aléatoire du diagnostic établi au moyen de l’entretien clinique.
Ainsi, suivant les conclusions de l’étude réalisée par John Monahan, psychologue, aux États-Unis (157), l’utilisation de l’évaluation clinique libre ne fournit un résultat exact que dans un cas sur trois. Ainsi, sur 98 personnes jugées dangereuses par les expertises cliniques classiques, seules 20 personnes ont réellement récidivé, et seules 5 % pour un délit violent. Par ailleurs, il semble que les utilisateurs d’une telle méthode présentent une tendance à surévaluer le nombre de patients présentant un risque de dangerosité, sans doute à titre préventif.
De même, une étude de 2009 (158) portant sur l’exactitude des prédictions sur le risque de récidive a démontré la faible efficacité des méthodes psychanalytiques classiques. En effet, selon cette analyse basée sur 118 études de prédictions, le degré d’exactitude du jugement professionnel structuré est de 0,46, tandis que l’efficacité d’un entretien clinique non structuré est de 0,42, le score de 1 étant attribué à une méthode parfaitement fiable et celui de 0,5 au hasard le plus complet. Ainsi, la méthode structurée est légèrement moins aléatoire que la méthode non structurée, mais ces deux méthodes sont également hasardeuses, puisqu’elles obtiennent un score inférieur à 0,5.
On peut du reste s’interroger sur la valeur scientifique d’une méthode avec laquelle, suivant les éléments communiqués au cours des travaux de la mission, les experts psychiatres ayant évalué un même patient parviennent dans 80 % des cas à des résultats divergents quant à sa dangerosité.
b) Des outils d’évaluation accordant une trop grande place à la subjectivité ?
Pour certains, l’entretien clinique classique constitue une méthode trop subjective. Cette critique récurrente s’explique par le rôle central que jouent respectivement le professionnel évaluateur et la personne évaluée dans le déroulement pratique de l’expertise. Suivant l’analyse que développent certains praticiens, l’entretien clinique s’avère influencé par le contexte dans lequel il est réalisé. Ainsi, « le discours du patient va être influencé par la proximité culturelle, sociale, par l’identité d’âge ou de sexe entre le patient et le clinicien, ou encore par la fonction que remplit ce dernier. L’efficacité d’un entretien dépend de différents facteurs tenant aussi bien aux qualités personnelles du clinicien qu’à son éthique et à ses compétences techniques » (159). De fait, l’entretien clinique peut nécessiter un temps d’échange plus ou moins informel avec la personne, portant sur des sujets anodins, avant d’aborder l’aspect judiciaire de l’évaluation.
L’évaluation repose en grande partie sur un discours potentiellement construit de la part de l’auteur d’infraction à caractère sexuel et dépend de la conduite de l’entretien par le praticien chargé de l’évaluation. Cette part d’aléa apparaît presque inévitable dans la méthode de l’entretien clinique non structuré, dès lors que l’expert ne suit aucune « grille de lecture » dans la conduite de l’échange. Surtout, les éléments recueillis par la mission donnent à penser que les entretiens cliniques ne permettent pas d’exclure catégoriquement une entreprise de manipulation de la part de personnalités retorses.
Ainsi, l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions à caractère sexuel ne paraît plus pouvoir procéder du seul recours aux méthodes de l’entretien clinique, celles-ci ne constituant pas l’instrument le plus fiable dont nous disposons aujourd’hui. Dès lors, il convient d’examiner de manière approfondie les avantages et les inconvénients d’outils d’évaluation encore assez peu utilisés en France, mais qui rencontrent une certaine faveur à l’étranger : les méthodes actuarielles (160).
III. UNE OFFRE DE SOINS VARIABLE, PEU STRUCTURÉE VOIRE ABSENTE SUR CERTAINS POINTS DU TERRITOIRE
L’exécution des décisions de justice pénale à l’encontre des auteurs d’infractions à caractère sexuel ne se réduit pas à la seule sanction des actes commis et à la surveillance de leurs auteurs. Ainsi que le présent rapport l’a précédemment montré, la prise en charge des auteurs de violences sexuelles implique par ailleurs le suivi d’une thérapie ou d’un traitement, soit pendant le temps carcéral, soit en milieu ouvert en cas d’injonction de soins.
Or, le dispositif actuellement en place ne répond pas de manière tout à fait satisfaisante aux besoins recensés dans l’ensemble du pays. En effet, en milieu fermé, si les auteurs d’infractions à caractère sexuel peuvent être accueillis dans des établissements spécialisés, la question se pose de savoir si l’offre de soins est, elle aussi, spécifique. Par ailleurs, en milieu ouvert, il semble que le dispositif d’injonction de soins pâtisse d’un manque de structures de soins adaptées et de la pénurie qui touche aujourd’hui les médecins coordonnateurs.
A. LA SPÉCIALISATION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES : UN EFFET CONTRASTÉ SUR L’OFFRE DE SOINS AUX AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
De manière générale, la politique d’affectation des détenus au sein des différents établissements pénitentiaires repose sur quatre principes :
— la dangerosité de la personne : l’affectation tient compte des risques d’évasion ou d’agression sur des co-détenus ou sur le personnel pénitentiaire ;
— le maintien des liens familiaux, qui représente un élément stabilisateur susceptible de favoriser la bonne exécution de la détention et une meilleure préparation à la sortie ;
— la prise en charge psychologique ou psychiatrique susceptible d’être établie ;
— la possibilité de formation ou d’activités professionnelles.
En ce qui concerne les auteurs d’infractions à caractère sexuel, même si ces quatre principes sont pris en compte dans l’affectation de ces détenus, l’aspect relatif à la prise en charge psychologique ou psychiatrique est devenu prioritaire au fil du temps, afin de leur proposer des soins adaptés, conformément aux dispositions du code pénal relatives à l’injonction de soins.
En 2008, cette préoccupation a conduit la direction de l’Administration pénitentiaire (DAP) à décider d’appliquer une politique plus claire en matière de prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Concrètement, cette politique s’est traduite, depuis mai 2009, par l’identification de vingt-deux établissements pénitentiaires vers lesquels sont prioritairement orientés les auteurs de violences sexuelles.
1. Des établissements aux missions et aux moyens spécifiques
Ainsi, la spécificité de ces vingt-deux établissements tient tant aux caractéristiques particulières des personnes qui y sont accueillies qu’aux missions qui leur sont assignées.
a) L’accueil des auteurs d’infractions à caractère sexuel
La spécialisation de certains établissements pénitentiaires tient, en premier lieu, à la composition des publics qu’ils accueillent. Un objectif de détention de 50% à 80 % d’auteurs d’infractions à caractère sexuel a ainsi été fixé par la direction de l’Administration pénitentiaire (161). Cet objectif n’est aujourd’hui pas atteint puisqu’au 1er novembre 2011 (162), ces établissements accueillaient au total 10 647 personnes, mais seulement 3 401 auteurs d’infractions à caractère sexuel, soit 31,94 % de leur population. Néanmoins, d’après un rapport remis en février 2011par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’inspection générale des services judiciaires (IGSJ), il s’avère que « l’affectation ainsi programmée des auteurs d’infractions à caractère sexuel […] se réalise progressivement » (163).
Par ailleurs, la majorité des auteurs d’infractions à caractère sexuel demeurent encore détenus dans les 167 autres établissements pénitentiaires. On dénombrait ainsi dans ces structures pénitentiaires classiques, au 1er novembre 2011, 5 030 auteurs d’infractions à caractère sexuel sur un total de 8 431 personnes détenues pour ce type d’infraction dans l’ensemble du pays, soit un taux de 59,66 %.
RÉPARTITION DES AUTEURS D’INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL ÉCROUÉS AU 1ER NOVEMBRE 2011
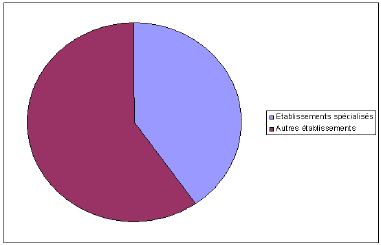
Source : protocole Santé-Justice relatif à la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel dans les établissements pénitentiaires.
Les 22 établissements spécialisés sont répartis de la façon suivante sur l’ensemble du territoire : dans le Nord de la France, les établissements de Val-de-Rueil, Liancourt et Bapaume ; Melun en région parisienne ; Joux-la-Ville dans le centre ; Roanne, Riom et St-Quentin-Fallavier dans la région lyonnaise ; Ensisheim et Toul pour l’Est de la France ; Salon-de-Provence et Perpignan dans le Sud ; Caen, Argentan, St-Martin-de-Ré et Nantes pour l’Ouest; enfin, Poitiers Vivonne, Bédenac, Mauzac, Muret pour le Sud-Ouest ; Casabianda pour la Corse ; Le Port la Réunion pour l’Outre mer.
RÉPARTITION DES AUTEURS D’INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS AU 1ER NOVEMBRE 2011
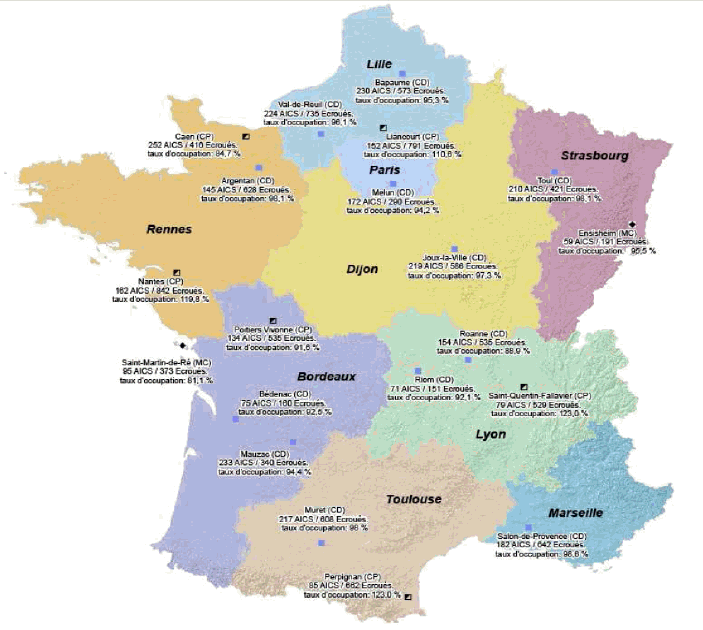
Source : protocole Santé-Justice relatif à la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel dans les établissements pénitentiaires.
Les établissements spécialisés dans l’accueil des auteurs d’infractions à caractère sexuel comptent deux maisons centrales, à Ensisheim et St-Martin-en-Ré, afin de prendre plus particulièrement en compte la dangerosité de certains détenus, tout en leur offrant une prise en charge psychologique adaptée.
D’importantes variations existent entre les établissements pour ce qui est de la proportion d’auteurs d’infractions à caractère sexuel détenus. Ces taux s’échelonnent ainsi de 23 % à Argentan, à 82 % pour le centre de détention de Casabianda (cf. infra). Le centre de détention de Melun où la mission d’information a eu l’occasion de se rendre accueille actuellement 198 détenus dont 119 personnes écrouées pour des infractions sexuelles, soit 60 % de leur population. Ces écarts peuvent en partie être expliqués pour certains établissements, comme celui de Salon-de-Provence, par la volonté de conserver une capacité d’hébergement importante pour le rapprochement familial d’autres détenus.
CASABIANDA, UNE PRISON OUVERTE POUR AUTEURS D’INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL Créé en Haute-Corse en 1862, le centre de détention de Casabianda accueille des auteurs d’infractions à caractère sexuel depuis le milieu des années 1950. Le centre compte aujourd’hui 180 détenus parmi lesquels 147 personnes écrouées pour des faits de nature sexuelle. Son domaine s’étend sur 1 840 hectares. Il se présente comme un modèle d’établissement unique en France. Première singularité, Casabianda est la seule prison ouverte de France, sans murs d’enceinte. Le centre accueille les personnes condamnées à plus de deux ans d’emprisonnement qui présentent les meilleures chances de réinsertion. Autre singularité, n’y sont admis que les auteurs d’infractions à caractère sexuel de nature intrafamiliale justifiant d’un profil strictement sélectionné sur la base de deux critères : l’aptitude au travail agricole (coupe du bois, production de céréales, élevage bovin, ovin ou porcin) et le respect des règles et le sens de l’autonomie dans un établissement « peu contenant et peu structurant ». L’affectation au centre résulte des décisions prises par les directions interrégionales – principalement celle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – et du Centre national de Fresnes. Le profil des détenus est celui de personnes en situation de rupture familiale. Les résultats de Casabianda apparaissent très satisfaisants. L’établissement n’a pas connu d’évasion depuis une quinzaine d’années. Les seuls incidents notables correspondent plutôt à des retards de pointage. En comparaison avec d’autres établissements fermés, le centre n’a pas connu de mouvements collectifs et on y signale très peu d’agressions graves. Cependant, d’après l’opinion exprimée par les différentes personnes entendues au cours de la mission, il n’apparaît pas nécessaire, aujourd’hui, de créer d’autres établissements du même type, l’intégralité de la demande étant actuellement satisfaite. |
b) Des moyens humains et financiers renforcés
L’administration pénitentiaire consacre des financements de plus en plus importants à la prise en charge pénitentiaire des auteurs d’infractions à caractère sexuel, notamment au travers de la mise en œuvre, au sein des établissements pénitentiaires, des programmes de prévention de la récidive. Le ministère de la Santé, en charge de la santé des détenus depuis 1994 (164) a également consenti un effort budgétaire certain en faveur de détenus auteurs de violences sexuelles. Son programme de prévention de la récidive comprend ainsi deux axes :
— le renforcement des équipes soignantes des établissements spécialisés,
— le financement des centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS).
Les établissements spécialisés ont ainsi vu leurs équipes soignantes renforcées, ce renforcement se traduisant par l’allocation, depuis 2008, de 8,74 millions d’euros supplémentaires.
Le financement des CRIAVS est, en partie, destiné à des actions de formation des équipes soignantes intervenant en milieu fermé. Alors que ces centres n’étaient dotés que d’un million d’euros en 2005, ils disposent, depuis 2008, d’une dotation annuelle de 9,55 millions d’euros.
CRÉDITS ALLOUÉS AUX CRIAVS DEPUIS 2005
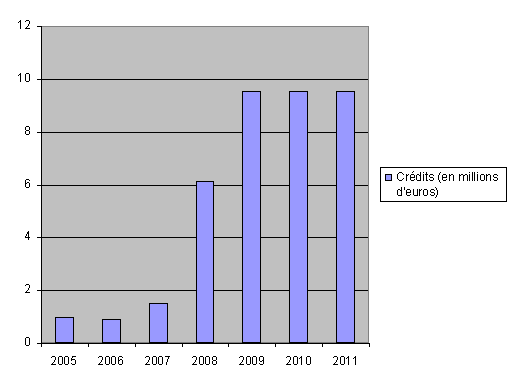
Source : direction générale de l’Offre de soins.
Ainsi, la direction générale de l'Offre de soins (DGOS) consacre aujourd’hui 18,3 millions d’euros à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Cependant, une part importante de ces actions n’est pas chiffrée aujourd’hui. En effet, les crédits alloués aux auteurs d’infractions à caractère sexuel détenus dans des établissements non spécialisés ne sont pas évalués par le ministère de la Santé.
Les moyens humains affectés aux 22 établissements pénitentiaires spécialisés ont ainsi pu être renforcés. La circulaire du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé (165), a prévu que chaque région où il existe un établissement pénitentiaire spécialisé dans l’accueil des auteurs d’infractions à caractère sexuel bénéficie d’un surcroît de dotation « afin d’organiser l’offre de soins de la façon la plus adaptée au contexte régional ». Une dotation minimale de 185 000 euros par équipe spécialisée est prévue, qui doit permettre le recrutement de 0,3 ETP médical, d’un ETP de psychologue, d’un ETP d’infirmier et le financement des frais de fonctionnement. Cette dotation varie selon le nombre d’auteurs de violences sexuelles que la région prend en charge. Une majoration de 545 000 euros est ainsi prévue pour les régions accueillant plus de 700 auteurs de violences sexuelles écroués.
Ces dotations supplémentaires ont permis de renforcer l’ensemble des équipes soignantes intervenant dans ces établissements, par le recrutement de 12 psychiatres, 28 psychologues et 24 infirmiers. Des équipes mobiles ont également pu être mises en place dans quatre établissements spécialisés. Au total, 40 psychiatres interviennent dans ces établissements, 86 psychologues et 95 infirmiers.
Comme que le montre le rapport de l’IGAS et de l’IGSJ, ce renforcement des moyens alloués aux établissements spécialisés se mesurait concrètement, en 2011, dans le rapport entre les effectifs de soignants affectés à ces structures et le nombre de personnes écrouées. D’après cette source, « le ratio psychiatre/100 personnes écrouées passe de 0,26 avant renforcement à 0,38 après renforcement pour les établissements spécialisés tandis que ce ratio demeure à 0,25 pour les établissements non spécialisés » (166). Le constat d’une même évolution prévaut pour les psychologues travaillant dans les centres spécialisés.
c) Une nouvelle organisation territoriale théoriquement pertinente
La spécialisation des établissements pénitentiaires permet, en théorie, de nombreux avantages et, notamment, de tirer profit de la concentration des moyens matériels et humains que la mise en œuvre de cette orientation implique. Autrement dit, elle permet la réalisation d’économies d’échelle importantes et évite un saupoudrage néfaste.
Dans le cadre de la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel, les équipes soignantes doivent remplir en droit un certain nombre de missions qui, aux termes d’une circulaire du 8 décembre 2008 (167), portent sur :
— la réalisation de thérapies collectives et de prises en charge individuelles de détention ;
— une prise en charge renforcée aux moments critiques de la détention (entrée, procès, libération) ;
— la continuité de la prise en charge lors des transferts vers d’autres établissements pénitentiaires ou à la sortie de prison ;
— une articulation forte avec les structures existantes en milieu ordinaire (centres de ressources, consultation spécialisée).
La mise en œuvre de cette nouvelle organisation pénitentiaire a nécessité, de la part du ministère de la Santé, l’identification d’établissements psychiatriques susceptibles de répondre aux besoins de cette population carcérale. Elle a également conduit à un surcroît de formation du personnel de ces établissements en matière de prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Mais si la spécialisation des établissements concourt à une plus grande efficacité et à une véritable professionnalisation de l’offre de soin destinée spécifiquement aux auteurs d’infractions à caractère sexuel, la mise en œuvre de cette orientation demeure cependant problématique car elle comporte des aléas et connaît certaines difficultés.
2. Une offre de soins spécialisée perfectible dans sa mise en œuvre
L’accueil des auteurs d’infractions à caractère sexuel dans vingt-deux établissements spécialisés constitue indéniablement une orientation judicieuse, dont la mise en œuvre est cependant perfectible.
a) Une répartition géographique imparfaite
La répartition géographique des établissements spécialisés, et l’offre de soins qui l’accompagne, n’est pas entièrement satisfaisante. De fait, ainsi que l’ont relevé de nombreuses personnes entendues par la mission, il existe sur le territoire des zones totalement dépourvues d’établissements spécialisés dans l’accueil des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il en va ainsi de certaines régions particulièrement vastes, comme celle du Centre.
Le faible nombre de ces établissements et leur implantation sur le territoire ne permettent pas toujours la conciliation de la prise en compte des besoins sanitaires de la personne écrouée et de l’objectif d’un maintien des liens familiaux. Or, ce problème se pose avec une acuité particulière pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, souvent condamnés à de longues peines, et pour lesquels il est important de construire le parcours de détention en prenant en compte le maintien des liens familiaux. En outre, le fait de ne disposer que de deux maisons centrales rend cette tâche encore plus complexe en ce qui concerne les détenus nécessitant une sécurité renforcée.
b) Une offre de soins variable d’un établissement pénitentiaire à l’autre
Les éléments recueillis par la mission au cours de ses déplacements et de ses auditions donnent à penser que l’implantation des établissements pénitentiaires spécialisés n'a pas nécessairement tenu compte, d’une part, des moyens disponibles dans ces établissements et, d’autre part, de la démographie médicale du territoire.
Ainsi, sur les 22 établissements spécialisés, seuls cinq sont le siège d’un service médico-psychologique régional, susceptible de fournir rapidement des soins adaptés à ce public particulier. Les autres établissements sont, au contraire, souvent éloignés des établissements de santé locaux.
Par ailleurs, la démographie médicale ne semble pas avoir été prise en compte. Cette concertation insuffisante a pu ainsi conduire à des difficultés de recrutement du personnel médical spécialisé, notamment du fait de réticences des médecins à intervenir en milieu carcéral et peut expliquer, dans certains cas, le manque de personnel formé et spécialisé, même au sein des établissements accueillant en majorité des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Cela peut contribuer à expliquer, à une échelle plus globale, la persistance de disparités entre établissements malgré l’augmentation des moyens alloués à la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Ce diagnostic trouve une illustration dans les quelques exemples locaux dont la mission a pu prendre connaissance. Ainsi, alors que l’équipe soignante du centre de détention de Melun dispose de 5 équivalents temps plein (ETP) de psychologues et de 0,4 ETP de psychiatre, celle de Mauzac ne comporte que 0,2 ETP de psychiatre et de 1,5 ETP de psychologue. Cette disparité est encore accentuée par le fait que, si le centre de détention de Mauzac comptait 233 auteurs d’infractions à caractère sexuel en novembre 2011, l’établissement de Melun n’accueille que 172 auteurs de violences sexuelles. Il est donc comparativement mieux doté.
Ces écarts de dotation se traduisent, au plan qualitatif, par un accès plus difficile aux soins et par le caractère parfois partiel de ces derniers. Ainsi, s’il faut ainsi plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous dans certains établissements spécialisés, ce n’est pas le cas dans d’autres. Parfois, le trop faible recrutement de psychiatres ne permet pas aux auteurs d’infractions à caractère sexuel ne présentant pas de maladie mentale à proprement parler de bénéficier d’un suivi par un médecin (168).
Mais la situation est encore plus problématique en ce qui concerne les établissements non spécialisés, qui accueillent la majorité des auteurs de violences sexuelles. Ainsi, sur certains territoires, toutes les possibilités thérapeutiques ne sont pas présentes. En Aquitaine par exemple, trois établissements sur sept ne proposent pas de thérapie groupale, cinq sur sept ne permettent pas le suivi d’une thérapie cognitivo-comportementale et un nombre identique n’est pas en mesure de délivrer de traitement anti-hormonal (169).
De fait, en l’absence d’un référentiel commun, des disparités importantes existent en ce qui concerne la nature des soins proposés au sein des établissements pénitentiaires. La création d’un label pour ces établissements serait susceptible d’uniformiser et de professionnaliser les pratiques à l’échelle du territoire et permettrait de garantir la poursuite de soins de qualité. La distribution prochaine d’un guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, actuellement en cours d’actualisation par le ministère de la Santé, pourrait être l’amorce de cette démarche nécessaire.
B. UN SYSTÈME DE SOINS POST-CARCÉRAL DÉFAILLANT
Tant dans le secteur privé que dans le public, la mise en œuvre de soins pénalement ordonnés se heurte à l’insuffisance des structures de prise en charge en milieu ouvert et à la pénurie de plus en plus préoccupante de médecins coordonnateurs.
1. Des structures de prise en charge en milieu ouvert insuffisantes
Cet état de fait, constaté par la mission, s’explique certes par l’insuffisance des effectifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, mais résulte également de la réticence de certains praticiens à prendre en charge ce public particulier.
a) Un nombre de structures publiques insuffisant pour assurer le suivi psychiatrique et psychologique dans le cadre d’une injonction de soins
Les auteurs d’infractions à caractère sexuel peuvent choisir leur médecin traitant dans le secteur public comme dans le secteur libéral. Mais la pénurie de psychiatres publics est telle qu’il est parfois très difficile, pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, de trouver un médecin traitant. Si cette profession est née dans les établissements hospitaliers publics, les psychiatres tendent de plus en plus à délaisser l’hôpital au profit d’un exercice en cabinet ou en clinique privée. Or, la psychiatrie publique joue un rôle essentiel dans la prise en charge de ces personnes. D’autant que, dans certains cas, le manque de contacts et de repères dont dispose la personne soumise à des soins, lorsqu’elle ne vit plus dans sa région d’origine, freine l’accès aux soins.
Dans le secteur public, les auteurs d’infractions à caractère sexuel peuvent notamment être accueillis et suivis, en ambulatoire, au sein des centres médico-psychologiques (CMP) rattachés aux hôpitaux publics. Ces structures regroupent différents spécialistes – psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux, ergothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés… –pour offrir une prise en charge adaptée des troubles mentaux de la population. Pour la plupart d’entre eux (170), ils ne s’adressent donc pas particulièrement à des auteurs de violences sexuelles.
De nombreuses difficultés d’accès à ces centres spécialisés dans les soins psychiatriques et psychologiques, qu’il s’agisse d’importants délais d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous, de refus nets, de la part des personnels de ces établissements, de prendre en charge des personnes dans le cadre de soins pénalement ordonnés, ou de consultations trop espacées ou irrégulières, qui nuisent à la qualité du suivi, ont cependant été rapportées à la mission d’information.
Ces difficultés s’expliquent en grande partie par l’insuffisance des moyens humains de ces centres. Il semble également que certains CMP soient réticents à l’idée de prodiguer des soins sous contrainte, surtout lorsqu’il s’agit d’auteurs d’infractions à caractère sexuel. De fait, les personnels de ces établissements ne sont pas toujours formés à la prise en charge de ce public particulier.
En outre, les auteurs d’infractions à caractère sexuel peuvent se tourner vers les structures spécialisées qui existent sur le territoire, comme l’unité PARI à l’hôpital de St Egrève, dans la région grenobloise, ou bien encore l’unité ÉRIOS de l’hôpital Charles Perrens de Bordeaux (171). Ces structures, tournées vers les auteurs de violences sexuelles, sont toutefois trop peu nombreuses pour constituer une offre de soins réellement structurée sur le territoire.
b) Un accès relativement limité aux thérapeutes exerçant en secteur libéral
Si l’accès à un psychiatre public est difficile pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, il n’est guère plus aisé pour eux de se tourner vers un médecin ou un psychologue libéral. En effet, l’accès limité à ces professionnels tient au coût financier que peut représenter une consultation dans ce cadre.
Pour ce qui est des psychiatres, les dépassements d’honoraires pratiqués de manière chronique en certains points du territoire par les médecins exerçant en secteur libéral limitent fortement le recours de personnes sortant de prison à leurs thérapies.
En ce qui concerne les psychologues, il convient de mettre en exergue le problème de l’inégal remboursement des consultations par la sécurité sociale suivant la spécialité du thérapeute. Ainsi que l’établit le rapport de l’IGAS et de l’IGSJ (172), rien n’a été prévu pour le remboursement de la consultation d’un psychologue par les organismes de l’assurance maladie. Les actes réalisés par les psychologues ne figurent pas en effet parmi les actes des professionnels de santé donnant lieu à remboursement par l’assurance maladie. Compte tenu du coût de ces consultations, l’accès aux psychologues exerçant en libéral est ainsi compliqué pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. C’est d’ailleurs pourquoi l’expérience montre que dans le secteur privé, les auteurs d’infractions à caractère sexuel s’adressent en premier lieu aux médecins psychiatres, leur consultation étant remboursée au moins partiellement par la sécurité sociale.
c) Des réticences d’origines diverses de la part des médecins traitants
De nombreux médecins ne souhaitent pas prendre en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Plusieurs éléments sont avancés pour expliquer cet état de fait.
Une première série de causes est à rechercher dans la perception qu’a le médecin du patient lui-même. D’une part, en l’absence de maladie mentale avérée, de nombreux psychiatres refusent de traiter ces patients. D’autre part, le déni fréquent de ces personnes quant aux actes commis semble également motiver un refus de prise en charge. Certains psychiatres jugent que l’attitude de déni rend vaine toute démarche de soins, tandis que d’autres considèrent que le travail entre le thérapeute et le patient ménage la possibilité, à terme, d’amener l’auteur d’infraction à une reconnaissance au moins partielle des faits. Enfin, il existe au sein de la profession un débat sur la capacité des personnes à s’approprier réellement un soin contraint et à en tirer parti.
Une seconde explication concerne le contexte dans lequel se déroulent ces soins. Notamment, la nécessité de délivrer régulièrement au patient des attestations de suivi de traitement afin que celui-ci puisse justifier auprès du juge de l’application des peines du suivi de l’injonction de soins, comme l’obligation de prévenir le juge ou le médecin coordonnateur en cas d’interruption des soins, indisposent un certain nombre de praticiens qui souhaiteraient exercer leur art en dehors de tout contrôle extérieur.
Enfin, un manque de formation est à l’origine de la réticence de la plupart des praticiens à accepter de prendre en charge ces personnes. Dans le secteur public comme dans le secteur privé, il convient de souligner l’existence d’un problème de spécialisation des médecins et psychologues traitants dans la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Cette absence de connaissances spécifiques résulte pour partie de l’absence de réel consensus sur les protocoles à appliquer à ce type de patient mais tient également au fait que les formations initiales ou continues n’abordent pas nécessairement, de manière suffisante, la problématique de leur prise en charge. On notera que cette absence de formation vaut également s’agissant des obligations et des prérogatives des thérapeutes dans le cadre de l’injonction de soin prononcée par la justice. En l’absence de spécialisation, les praticiens ne s’estiment pas compétents. Ce défaut de connaissances est également à l’origine d’une certaine défiance à l’égard des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
La désignation de médecins traitants, de psychiatres justifiant d’un diplôme ou d’une formation adaptée, notamment acquise auprès d’un centre de ressources et d’information sur les auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) serait de nature à garantir la qualité du suivi de ces patients particuliers.
2. Le médecin coordonnateur : un dispositif à conforter sur l’ensemble du territoire
Créé par la loi précitée du 17 juin 1998 (173), le dispositif de médecin coordonnateur se présente comme une mesure pertinente dans l’organisation de l’offre de soins destinés aux auteurs d’infractions à caractère sexuel. De fait, les interlocuteurs de la mission semblent, dans l’ensemble, tout à fait satisfaits par la présence et les fonctions assumées par les médecins coordonnateurs, tout du moins lorsqu’ils existent. En effet, la pénurie actuelle soulève la question de l’attractivité de cette fonction.
a) Une insuffisante couverture du territoire
Si l’instauration du médecin coordonnateur constitue une avancée indéniable aux yeux de tous les acteurs de la chaîne pénale, les auditions et déplacements effectués par la mission d’information ont révélé qu’en pratique le dispositif rencontre de grandes difficultés liées à la pénurie de médecins coordonnateurs.
D’après les informations recueillies par la mission, on recensait 5 398 mesures d’injonction de soins en cours d’exécution au 1er janvier 2011, à l’échelle nationale, pour seulement 237 médecins coordonnateurs. En 2011, compte tenu d’un manque de médecins coordonnateurs estimé à 119 praticiens, 1 750 mesures n’étaient pas mises en œuvre. Au total, 17 départements ne disposent d’aucun médecin coordonnateur. D’après certains chiffres communiqués à la mission par des organisations représentatives des magistrats, 21 tribunaux de grande instance ne disposent pas de médecins coordonnateurs. Ainsi, en dépit de l’augmentation constante du nombre de médecins coordonnateurs depuis 2006, un problème récurrent de manque de médecins volontaires se pose.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉDECINS COORDONNATEURS DEPUIS 2006
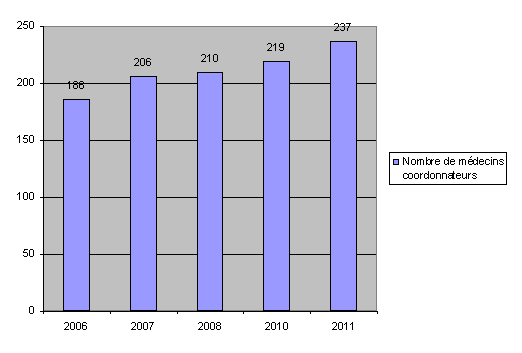
Source : direction générale de l’Offre de soins.
À cela s’ajoutent de réelles disparités entre les différentes régions. Au cours de son déplacement au centre de détention de Melun par exemple, la mission d’information a ainsi appris qu’il n’existait qu’un seul médecin coordonnateur pour tout le département de la Seine-et-Marne. Cette situation conduit d’ailleurs à orienter les anciens détenus vers d’autres départements et régions. À l’inverse, lors du déplacement au centre de détention de Lyon Corbas, il est apparu que le département ne manquait pas de médecins coordonnateurs. Au nombre de cinq, ils parviennent à prendre en charge l’ensemble des personnes soumises à une injonction de soins.
Les conséquences de ces disparités régionales sont encore aggravées par le fait qu’il manque souvent des médecins coordonnateurs dans les zones géographiques qui en nécessitent le plus, comme le Nord ou Cayenne. Comme le montre la carte ci-dessous, certains départements sont même totalement dépourvus de médecins coordonnateurs (174).
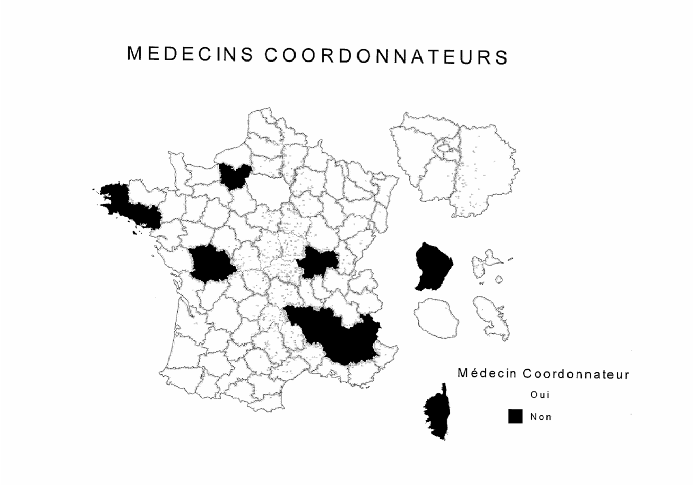
Source : direction générale de l’Offre de soins.
La pénurie de médecins coordonnateurs doit être replacée dans une perspective plus globale dont on ne saurait s’abstraire : celle de la désertification médicale. Ainsi, dans ces zones, les médecins ont une charge de travail bien trop importante pour pouvoir prendre en charge, en plus de leur activité, des personnes soumises à une injonction de soins. Par-delà le défaut d’information et de communication sur le dispositif à destination des professionnels qui explique, dans certaines régions, la pénurie, ce constat pose la question du manque d’attractivité de cette fonction.
b) Des conditions d’accès relativement restrictives
L’exercice des fonctions de médecin coordonnateur exige de remplir certaines conditions qui, si elles sont légitimes, peuvent néanmoins avoir pour effet de limiter les candidatures. Notamment, la durée minimale d’exercice de la spécialité de psychiatrie, de trois ans pour les médecins en exercice et de cinq ans pour les médecins retraités, fait obstacle à ce que de jeunes médecins exercent cette fonction.
Ensuite, la fonction de médecin coordonnateur comporte un certain nombre d’incompatibilités. Ce médecin ne peut présenter de lien familial, d’alliance ou d’intérêts professionnels avec la personne condamnée. En outre, il ne peut ni être le médecin traitant de la personne suivie, ni avoir été désigné comme expert dans le cadre de la procédure impliquant cette même personne. Dans certains départements ne disposant que de peu de praticiens acceptant de travailler avec la justice, cette disposition peut soulever un réel problème.
Enfin, cette fonction exige certaines compétentes garanties par une formation obligatoire. En effet, l’arrêté du 24 mars 2009 (175) a prévu, pour les médecins non psychiatres qui souhaiteraient se porter candidat, une formation de cent heures, permettant d’acquérir à la fois des connaissances sur le contexte juridique de l’injonction de soins et l’organisation de ce dispositif ainsi que des connaissances médicales sur la clinique, le passage à l’acte, le diagnostic et la thérapeutique des auteurs de violences sexuelles. On notera toutefois qu’afin de faciliter l’acquisition de ces compétences, l’arrêté permet de comptabiliser des formations délivrées par plusieurs universités ou organismes agréés de formation médicale continue.
Il convient de noter que ces exigences à l’égard des candidats aux postes de médecins coordonnateurs se traduisent, concrètement, par la réunion de différentes pièces nécessaires au dépôt de la candidature du médecin : renseignements et documents concernant la nature des activités professionnelles, les lieux et dates de leur exercice, de la copie des titres et des diplômes, d’une attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 3711-3, ainsi que de suspension au titre de l'article L. 4122-3, et le cas échéant, une attestation de formation.
Par ailleurs, les délais d’inscription sur les listes établies par le procureur de la République peuvent s’avérer dissuasifs. En effet, cette inscription peut être sensiblement différée en raison des avis que le procureur de la République doit solliciter, au préalable, auprès de l’ordre des médecins et de l’agence régionale de santé (176). Ces délais peuvent ainsi atteindre, dans des cas extrêmes, plus d’une année et demie et décourager les bonnes volontés.
c) Des fonctions justement rémunérées ?
Fixée à 426,86 euros en 2001, la rémunération versée aux médecins coordonnateurs pour chaque personne suivie a été portée à 700 euros bruts par année civile par l’arrêté du 24 janvier 2008. Cette somme s’ajoute à la valorisation des actes eux-mêmes. Cependant, si le nombre de consultations données, au cours de l’année, est inférieur à trois par personne suivie, le montant de cette indemnité forfaitaire est divisé par deux.
Cette récente revalorisation de leur rémunération ne semble pas avoir eu l’effet incitatif attendu. Deux explications sont possibles : soit la rémunération n’entre pas en ligne de compte dans la décision des médecins de se porter candidat ; soit la revalorisation a été insuffisante à susciter les vocations. Il est probable que la réalité soit entre les deux. En effet, comme des médecins coordonnateurs l’ont indiqué à la mission, l’argent n’est pas leur unique motivation. Par ailleurs, le rapport de l’IGAS et de l’IGSJ relève en effet que le montant de la rémunération peut être jugé, par certains des professionnels concernés, comme suffisant eu égard au temps réellement consacré à la tâche de médecin coordonnateur. Si l’on peut sans doute s’interroger sur l’impact de la revalorisation envisagée par le Gouvernement (177), qui souhaiterait porter le montant de la rémunération versée aux médecins à 900 euros bruts, il est néanmoins possible que cette piste doive être explorée plus avant, notamment pour inciter des psychiatres exerçant dans le secteur privé à assumer ces fonctions. Une telle mesure pourrait permettre, a minima, le maintien des effectifs actuels.
Enfin, un dernier obstacle qui peut dissuader l’exercice des fonctions de médecin coordonnateur réside dans les délais de paiement généralement excessifs par les agences régionales de santé (178). Il s’agit là non seulement d’un sujet de mécontentement chronique mais également d’une cause de découragement qui ne contribue pas à l’attractivité des fonctions de médecins coordonnateur, le retard pris dans le règlement des missions accomplies pouvant atteindre un an en moyenne.
d) Une responsabilité trop lourde à porter
Plus fondamentalement, la faiblesse des effectifs semble trouver son origine pour partie dans la situation plus générale de l’exercice de la médecine en France et dans le positionnement particulier des médecins coordonnateurs, notamment vis-à-vis des services de la justice.
La pénurie de médecins coordonnateurs traduit manifestement des réticences vis-à-vis de fonctions qui amènent à s’occuper de patient ayant commis des infractions singulières par leur gravité.
Au demeurant, le rôle d’interface inhérent au statut de médecin coordonnateur suppose une collaboration avec les services de la justice qui semble ne pas aller de soi pour tous les praticiens. Suivant le constat déjà établi par l’IGAS et l’IGSJ (179), on peut déceler chez certains praticiens, « un refus par principe de devenir des auxiliaires de la justice et de la défense sociale ». En effet, participer à l’exécution des peines de cette façon constitue une responsabilité particulièrement lourde. Entre le médecin traitant et le juge, le médecin coordonnateur est l’acteur central du suivi, celui qui doit alerter les autorités en cas de problème. Il est également celui qui fournit aux différents acteurs, juge et médecin traitant, les informations qu’il estime, lui et lui seul, pertinentes. Aussi sa responsabilité est-elle grande dans la prévention de la récidive, alors même qu’il est avant tout un médecin, dont l’activité est normalement orientée vers le soin.
Par ailleurs, il existe sans doute chez certains professionnels une inquiétude quant à la possibilité de voir mise en cause leur responsabilité pénale, civile, professionnelle ou administrative dans l’exercice des fonctions de médecins coordonnateurs. Avec l’IGAS et l’IGSJ (180), la mission peut, de fait, constater que la circulaire DGS/MC4 du 18 juin 2008 (181) ne répond que partiellement à la question en se contentant de rappeler qu’en tant que collaborateurs occasionnels du service public, les médecins coordonnateurs peuvent bénéficier, à l’instar des agents publics non titulaires, d’une protection juridique assurée par la collectivité publique dont ils dépendent.
Dans ce contexte, la mission ne peut que noter avec intérêt l’existence d’une réflexion menée par la Direction générale de l’offre de soins ainsi que des mesures esquissées en termes de revalorisation des rémunérations versées au médecins coordonnateurs.
3. Les CRIAVS, un dispositif bien conçu mais aujourd’hui peu visible
Des centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) interrégionaux ont progressivement été mis en place depuis 2005.
a) Le soutien théorique des centres de ressources aux acteurs du suivi
Après l’expérimentation d’un centre pilote en Rhône-Alpes en 2005, une circulaire du 13 avril 2006 (182) a prévu la création de centres interrégionaux et leur a fixé comme principales missions le soutien aux équipes médicales de proximité, la formation de professionnels et la promotion de réseaux de prise en charge. Puis, en 2008, une seconde circulaire (183) revient en partie sur le choix opéré en 2006 en conférant à ces structures une assise régionale et en leur attribuant un rôle en matière de prise en charge des cas les plus complexes. La France compte aujourd’hui 25 CRIAVS ayant souhaité nouer, entre eux, une collaboration active.
RÉPARTITION DES CRIAVS ET DE LEURS ANTENNES
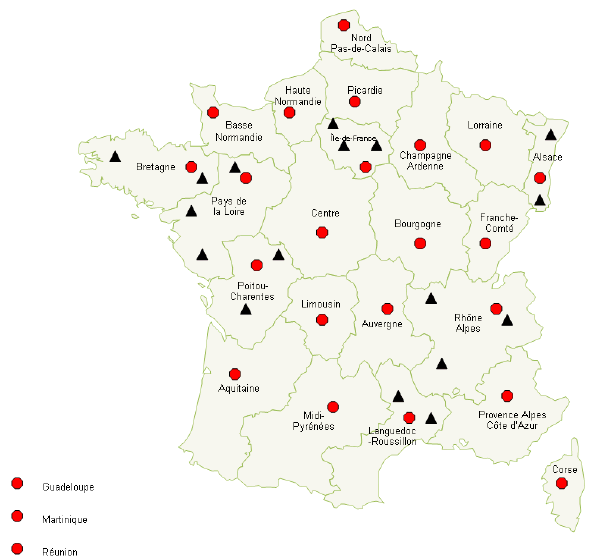
Source : site Internet du CRIAVS Rhône-Alpes.
Les objectifs assignés à ces centres de ressources sont pour le moins ambitieux. Ils ont pour tâche de soutenir et conseiller les équipes de proximité qui prennent en charge ce type de public et d’animer un réseau de praticiens, médecins ou psychologues, qui opèrent dans ce domaine. Cela se traduit notamment par la mise à disposition d’un espace expertise : censés intervenir à l’échelon régional en différents lieux du département par le biais d’équipes mobiles, les CRIAVS peuvent, s’agissant de cas complexes, prendre part à l’élaboration d’une thérapie avec l’équipe soignante. Les centres de ressources doivent également développer la prévention de la récidive comme du premier passage à l’acte et structurer les liens institutionnels entre l’ensemble des acteurs du suivi. Ils ont également un rôle de formation des professionnels de santé, experts, médecin traitant ou coordonnateur, mais également des acteurs du monde judiciaire.
Enfin, le développement de la recherche portant sur le fonctionnement psychique et psychologique des auteurs de violences sexuelles, sur l’évaluation des risques, sur l’amélioration des traitements et sur l’accompagnement de ces personnes fait partie de leurs prérogatives. Ainsi, le CRIAVS de Basse Normandie mène actuellement une action de recherche pluri-partenariale ayant pour but l’établissement d’un observatoire régional sur les mineurs auteurs d’infractions à caractère sexuel faisant l’objet d’une procédure judiciaire.
b) Des actions et des publics variables d’une région à l’autre
Cependant, il apparaît que les CRIASV remplissent ces missions de manière assez inégale à l’échelle du territoire. De fait, l’implantation et le rayonnement des structures se révèlent assez disparates suivant les régions.
Ainsi, certaines régions sont mieux dotées que d’autres et plusieurs d’entre elles bénéficient même d’antennes locales. C’est notamment le cas de la région Rhône-Alpes (184), qui constitue historiquement un important foyer de praticiens spécialisés, mais aussi des Pays de la Loire (185) et de l’Île-de-France (186). Dans ce dernier cas, l’existence de trois antennes se justifie par l’importance démographique de la région. Ainsi, des territoires pourtant vastes, comme la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne compte qu’une seule antenne. Cela étant, il convient de remarquer que même le CRIAVS Rhône-Alpes, qui se présente comme une structure motrice dans le mouvement des centres de ressources, concentre ses actions sur une partie du territoire de sa région, en l’occurrence sur les départements de l’Isère, du Rhône et de la Loire, l’éloignement géographique pouvant compliquer la conduite d’action dans les autres départements de la région.
D’autre part, le dispositif des CRIAVS se trouve manifestement confronté, dans son ensemble, à un problème de visibilité et de formalisation des missions qui leur sont assignées. Il s’avère que les actions conduites par les centres de ressources peuvent varier assez sensiblement suivant les priorités locales et les moyens dont disposent les CRIAVS et doivent beaucoup aux initiatives et relations personnelles.
Sur ce plan, certains CRIAVS fournissent une illustration de la grande diversité des rôles que les centres de ressources jouent à l’échelle régionale. Ainsi, dans le cadre des orientations tracées par l’unité ÉRIOS, le CRIAVS Aquitaine semble plus facilement envisager de prendre part concrètement à l’administration des soins dispensés aux auteurs d’infractions à caractère sexuel, en faisant sienne la recommandation n° 46 du rapport de l’IGAS et de l’IGSJ (187) tendant à « systématiser la participation des centres de ressources à l’offre de soins spécialisés à des auteurs de violence sexuelle ». En Seine-et-Marne, le CRIAVS Picardie est intervenu pendant un an auprès des conseillers d’insertion et de probation pour les former à la prise en charge d’auteurs de violences sexuelles.
Il s’avère également que certains publics sont plus concernés que d’autres par l’action des CRIAVS. Dans certaines régions, il leur est reproché de proposer des formations aux acteurs sanitaires et médicaux du suivi, et de délaisser quelque peu les acteurs judiciaires, notamment les magistrats.
TROISIÈME PARTIE : LES CONDITIONS D’UN SUIVI EFFICACE DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
Il ressort de l’analyse qui précède que le dispositif de suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel est, en de nombreux points, perfectible. Aussi la mission a-t-elle souhaité formuler un certain nombre de recommandations susceptibles d’améliorer les conditions de ce suivi.
Tout d’abord, simplifier le droit existant apparaît primordial pour assurer l’application d’un dispositif ambitieux mais aujourd’hui extrêmement complexe. Ensuite, il convient de donner aux acteurs du suivi les moyens humains, techniques, juridiques et financiers de mieux coordonner leurs actions. Par ailleurs, aucun suivi ne saurait être efficace si les soins qui doivent l’accompagner ne sont pas prodigués, faute de moyens, ou mal réalisés, faute de structures spécialisées. Aussi la mission estime-t-elle indispensable le développement d’une offre de soins spécialisée à destination de ce public particulier. Enfin, il est apparu à la mission que la recherche en criminologie et la formation des acteurs du suivi devait absolument être renforcées.
I. SIMPLIFIER UN DROIT EXISTANT PARTICULIÈREMENT COMPLEXE
Si le dispositif juridique est complet, cela n’est pas sans conséquence sur son accessibilité et son intelligibilité, qui pâtissent d’un enchevêtrement et d’un empilement législatif particulièrement problématique qui rendent malaisée la tâche du juge de l’application des peines, chargé de la mise en œuvre de ces textes.
A. L’IMBRICATION CROISSANTE DES DISPOSITIFS VISANT LES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
Les auteurs d’infractions à caractère sexuel font l’objet de peines et de mesures particulières, issues d’une succession de lois qui, depuis plus de dix ans, tentent de remédier au problème posé par la récidive de crimes et délits sexuels. Il convient d’admettre que le résultat de ces entreprises successives est aujourd’hui un édifice juridique particulièrement complexe, que les juges peinent à appliquer correctement et dont certaines ressources demeurent méconnues et donc inutilisées.
La complexité de ces dispositifs tient, en premier lieu, à leur totale imbrication. Tout d’abord, le droit existant comporte, notamment à destination des auteurs de violences sexuelles, deux mesures transversales : l’injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile. Ces mesures ne peuvent être prononcées de manière autonome : elles se rattachent nécessairement à un cadre juridique particulier qui peut consister en une peine, comme le suivi socio-judiciaire, une mesure de sûreté, comme la surveillance de sûreté ou encore une mesure d’aménagement de peine, comme la libération conditionnelle, soit trois dispositifs philosophiquement distincts.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que les obligations du suivi socio-judiciaire, de la surveillance judiciaire et de la surveillance de sûreté sont sensiblement les mêmes, puisque le code de procédure pénale fonctionne ici par renvois. Les obligations du suivi socio-judiciaire comme celles de la surveillance judiciaire sont prévues par renvoi aux obligations du sursis avec mise à l’épreuve (188). Pour sa part, la surveillance de sûreté « comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30 » (189). Cela nuit à la clarté de l’ensemble puisque ces mesures ne se distinguent finalement, outre leur nom, que par leurs critères d’éligibilité et par leur durée maximale.
On note également le caractère redondant de l’obligation de soins, qui figure à l’article 132-45 du code pénal, et de l’injonction de soins, qui peuvent être prononcées de façon concomitante dans le cadre de ces trois dispositifs, la loi étant muette sur ce point. Si des progrès ont été accomplis à la suite d’un précédent rapport de la mission relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues (190), cette distinction mériterait d’être encore clarifiée. Il conviendrait notamment de définir plus avant les critères nécessitant le recours à l’un ou à l’autre de ces dispositifs, qui ne répondent pas à la même procédure (191).
Au-delà, chacune des peines et mesures de sûreté visant les auteurs de violences sexuelles peut déboucher sur au moins l’une d’entre elles, si ce n’est plus (cf. tableau infra). Il est ainsi possible d’imaginer le parcours d’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, puis placée sous surveillance de sûreté, puis en rétention de sûreté ou, à l’inverse, placée en rétention de sûreté dès la fin de sa peine, puis sous surveillance de sûreté à l’issue de sa rétention, puis exécutant son suivi socio-judiciaire à la levée de cette dernière mesure. C’est d’ailleurs le but poursuivi par le législateur : permettre au juge de maintenir dans le circuit judiciaire des personnes qui présentent une dangerosité criminologique persistante. Néanmoins, cet objectif, louable au demeurant, pourrait probablement être atteint par des moyens plus simples.
L’IMBRICATION DES DIFFÉRENTES PEINES ET MESURES VISANT LES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
Suivi socio-judiciaire |
Injonction de soins |
Surveillance judiciaire |
Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) |
Surveillance de sûreté |
Rétention de sûreté | |
|
Suivi socio-judiciaire (SSJ) |
Sauf décision contraire, une IS doit être ordonnée dans le cadre d’un SSJ (Art. 131-36-4 CP) |
Une SJ ne peut être ordonnée à l’encontre d’une personne condamnée à un SSJ, sauf si l’infraction a été commise avant le 13 décembre 2005 |
PSEM possible comme obligation du SSJ, si une expertise constate la dangerosité et pour certaines condamnations seulement (7 ans ou 5 ans en récidive) (Art. 131-36-9 CP) |
Un SSJ peut déboucher sur une SS, si les conditions de cette dernière mesure sont remplies (Art. 763-8 CPP) |
Possible en cas d’échec d’une SS prononcée à l’issue d’un SSJ | |
Injonction de soins (IS) |
Sauf décision contraire, une IS doit être ordonnée dans le cadre d’un SSJ (Art. 131-36-4 CP) |
Sauf décision contraire, une IS doit être ordonnée dans le cadre d’une SJ (Art. 723-30 CPP) |
– |
La SS a des « obligations identiques » à la SJ, notamment l’IS (Art. 706-53-19 CPP) |
– | |
Surveillance judiciaire (SJ) |
Une SJ peut prendre la suite d’un SSJ, si les conditions de cette dernière mesure sont remplies (Art. 763-8 CPP) |
Sauf décision contraire, une IS doit être ordonnée dans le cadre d’une SJ (Art. 723-30 CPP) |
PSEM possible comme obligation de la SJ, après vérification de la faisabilité technique de la mesure (Art. 723-30 CPP) |
Une SJ peut déboucher sur une SS, si les conditions de cette dernière mesure sont remplies (Art. 723-37 CPP) |
Possible en cas d’échec d’une SS prononcée à l’issue d’une SJ | |
Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) |
PSEM possible comme obligation du SSJ, si une expertise constate la dangerosité et pour certaines condamnations seulement (7 ans ou 5 ans en récidive) (Art. 131-36-9 CP) |
– |
PSEM possible comme obligation de la SJ, après vérification de la faisabilité technique de la mesure (Art. 723-30 CPP) |
La SS a des « obligations identiques » à la SJ, notamment le PSEM (Art. 706-53-19 CPP) |
– | |
Surveillance de sûreté (SS) |
Un SSJ peut déboucher sur une SS, si les conditions de cette dernière mesure sont remplies (Art. 763-8 CPP) |
La SS a des « obligations identiques » à la SJ, notamment l’IS (Art. 706-53-19 CPP) |
Une SJ peut déboucher sur une SS, si les conditions de cette dernière mesure sont remplies (Art. 723-37 CPP) |
La SS a des « obligations identiques » à la SJ, notamment le PSEM (Art. 706-53-19 CPP) |
Une surveillance de sûreté peut prendre la suite d’une rétention de sûreté (Art. 706-53-19 CPP) | |
Rétention de sûreté (RS) |
Exécution du SSJ à l’issue de la rétention de sûreté |
– |
Une RS est possible en cas d’échec d’une SS ordonnée à l’issue d’une SJ |
– |
Possible en cas d’échec d’une surveillance de sûreté (Art. 706-53-19 CPP) |
B. L’APPLICATION DES PEINES, UNE DISCIPLINE DEVENUE « ABSCONSE ET IMPRATICABLE » ?
Si la critique peut parfois sembler sévère, elle est néanmoins justifiée. Certains évoquent une « complexification maladive de l’exécution des peines » qui, « de subdivision en subdivision, de distinction en opposition […] est devenue totalement absconse et impraticable » (192). Des juges de l’application des peines rencontrés par votre rapporteur ont déclaré : « Nous devenons fous, nous passons notre temps à nous poser des questions sur l’application des textes, à essayer de comprendre où l’on en est ». La fréquence des lois associée à l’absence d’actualisation des codes utilisés par les praticiens, qui ne prennent pas en compte les lois votées au cours des derniers mois précédant leur publication, ne facilitent pas la tâche des magistrats.
Il suffira, pour s’en convaincre, d’étudier la disposition transitoire prise en matière de surveillance judiciaire par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (193). En effet, la surveillance judiciaire ne s’applique normalement pas aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire. Cela serait sans intérêt, puisque les obligations de ces deux dispositifs sont proches, et illogique, puisque la surveillance judiciaire a été créée pour remédier au caractère non rétroactif du suivi socio-judiciaire. Toutefois, le législateur a prévu, par la loi du 12 décembre 2005, que cette exclusion ne s’applique pas aux personnes ayant commis les faits incriminés avant l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, les personnes condamnées pour des faits commis avant le 13 décembre 2005 peuvent être soumises à une peine de suivi socio-judiciaire comme à une mesure de surveillance judiciaire.
En effet, comme l’indique une circulaire du 16 juin 2006 (194) : « Cette disposition transitoire – même si elle va en pratique s’appliquer pendant plusieurs années – est justifiée par la volonté de permettre, lorsque cela s’avèrera nécessaire, le prononcé d’une surveillance judiciaire avec placement sous surveillance électronique mobile à l’égard de personnes condamnées avant le 14 décembre 2005, y compris si ces personnes, parce que les faits commis étaient postérieurs à la loi du juin 1998, ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire. Dans un tel cas en effet, il ne sera pas possible de compléter les obligations du suivi socio-judiciaire par celles du placement sous surveillance électronique mobile en application des nouvelles dispositions de l’article 763-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale, dont le législateur n’a pas souhaité prévoir l’application immédiate (ces dispositions, plus sévères, ne pourront donc concerner que des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire pour des faits commis à compter du 14 décembre 2005). Or il aurait été paradoxal que l’auteur d’un crime sexuel commis par exemple en 1999 et condamné alors à un suivi socio-judiciaire ne puisse être placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une surveillance judiciaire, alors que cela serait possible pour l’auteur d’un même crime commis la même année mais n’ayant pas été condamné à un suivi socio-judiciaire ».
Cet exemple, qui n’a rien d’anecdotique, démontre combien le droit de l’application des peines, en ce qui concerne les auteurs de violences sexuelles en particulier, peut être d’une extrême complexité. Cette situation est encore aggravée par ce que certaines appellent « l’hybridation des mesures » (195). Tel le jardinier, le législateur et le pouvoir réglementaire opèrent un « bouturage » du droit positif. Mme Martine Herzog-Evans, professeur de droit à l’Université de Reims, cite ainsi l’exemple des permissions de sortie sous escorte (196) accordées aux personnes retenues : « Il y avait là un beau galimatias. En effet, en droit commun, il y a soit permission de sortir, soit autorisation de sortir sous escorte ».
La diversité du vocabulaire employé par les textes de lois et les décrets est en effet source d’inquiétudes pour les juges de l’application des peines. Le terme de « psychologue », par exemple, est employé à plusieurs reprises dans le droit relatif aux auteurs de violences sexuelles, mais sous des formes différentes : « expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie » (197) pour les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté, « psychologue traitant » (198) dans le cadre de l’injonction de soins. Le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines évoque quant à lui, dans sa version issue de l’Assemblée nationale, un « expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie » (199).
Par ailleurs, le droit est tellement complexe que certaines de ses ressources sont ignorées. C’est notamment le cas du dispositif entourant l’injonction de soins, dont certaines dispositions s’appliquent également au milieu fermé. L’article 717-1 du code de procédure pénale, qui porte sur les soins en détention, opère un renvoi aux articles L. 3711-1 à L. 3711-3 du code de la santé publique, qui régissent l’injonction de soins. L’article L. 3711-1 du code de la santé publique définit le mode de désignation ainsi que les missions du médecin coordonnateur, tandis que l’article L. 3711-2 porte sur les documents transmis au médecin traitant et sur les attestations que celui-ci délivre afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l’accomplissement de son injonction de soins. Enfin, l’article L. 3711-3 indique les informations que le médecin traitant peut ou doit délivrer au juge ou au médecin coordonnateur, ainsi que la nature des traitements auxquels il peut recourir.
Toutefois, le renvoi à ces articles ne signifie pas qu’un médecin coordonnateur doive être nommé chaque fois qu’une personne condamnée accepte les soins proposés en détention. D’après la circulaire d’application (200) de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 qui a introduit ces dispositions, « ce n’est évidemment que lorsque le suivi socio-judiciaire a été prononcé […] qu’une telle désignation demeure nécessaire ». De la même façon, le renvoi à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique ne permet pas de faire peser sur le médecin traitant l’obligation d’informer le juge de l’application des peines en cas d’interruption des soins contre avis médical. Toutefois, ce renvoi permet théoriquement au juge de l’application des peines de transmettre au médecin traitant de la personne détenue copie de certains documents. Mais bien souvent, les juges ignorent cette possibilité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a modifié, dans le cadre du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, la rédaction de l’article 717-1 du code de procédure pénale, afin d’éliminer le renvoi en question.
C. SIMPLIFIER LE DROIT EXISTANT POUR UNE MEILLEURE APPLICATION DES TEXTES
Si quelques tentatives ponctuelles ont récemment contribué à simplifier de façon marginale le droit de l’application des peines en matière d’auteurs de violences sexuelles et, plus largement, de personnes dangereuses, cette méthode ne saurait être pleinement satisfaisante. En effet, en même temps que quelques menues dispositions sont clarifiées pour les praticiens, le législateur ajoute à l’édifice un nouveau cas à ceux déjà existants. Certes, il le fait à raison. Mais il conviendrait, maintenant que le dispositif juridique est arrivé à maturité, d’entreprendre une simplification générale des dispositions visant les auteurs de violences sexuelles et, au-delà, de tout le droit de l’exécution des peines.
C’est pourquoi votre rapporteur propose de confier à un comité ad hoc composé de magistrats du siège et du parquet, d’avocats pénalistes, de professeurs de droit et de personnalités qualifiées la clarification et la simplification du droit existant.
Recommandation n° 1 Simplifier et clarifier le code de procédure pénale, en confiant cette mission à un comité composé de magistrats, d’avocats, de professeurs de droit et de personnalités qualifiées dont les propositions ne seront pas nécessairement faites à droit constant. |
Plusieurs options devraient être étudiées, qu’il s’agisse de créer un nouveau code de l’application des peines ou de rénover certaines parties du code de procédure pénale. Les peines et mesures visant les auteurs de violences sexuelles et au-delà, les personnes dangereuses, doivent absolument être « désimbriquées » pour plus de lisibilité, de clarté et d’intelligibilité. Rappelons ici qu’il s’agit là d’un objectif à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel (201) et que les atteintes portées aux droits et libertés des personnes dans le cadre de ces mesures nécessitent que ces dernières les comprennent au mieux. Certes, les objectifs à valeur constitutionnelle ne sont pas revêtus de la même valeur normative que les principes constitutionnels eux-mêmes. Néanmoins, ils représentent un but à atteindre pour le législateur, qui a, dans ce domaine, une obligation de moyens (202).
D. « RENDRE AU JUGE SON INTELLIGENCE »
Comme on l’a vu plus haut, le juge de l’application des peines dispose de marges de manœuvre de plus en plus étroites ; peu de choses sont encore laissées à son appréciation. Outre que le caractère obligatoire de certaines décisions encombre parfois inutilement les cabinets, il convient, comme l’a indiqué un juge de l’application des peines entendu par la mission, de « rendre au juge son intelligence » pour un meilleur suivi des auteurs de violences sexuelles.
En premier lieu, il conviendrait d’entamer une réflexion sur les expertises psychiatriques obligatoires et de limiter au strict minimum le recours obligé à l’expertise. En effet, les effectifs actuels des experts psychiatres ne sont pas compatibles avec les demandes trop nombreuses émanant des autorités judiciaires. Au-delà de cet aspect purement matériel, il faut admettre que la multiplication des expertises non nécessaires vide celles-ci de leur substance et peut même contribuer, par le faible intérêt qu’elles présentent pour le praticien, au désengagement de ces derniers.
Par ailleurs, l’expertise psychiatrique n’est pas toujours adaptée aux besoins de la justice, notamment lorsqu’il est clair que la personne ne souffre pas de troubles psychiatriques. Dans un certain nombre de cas, une expertise médico-psychologique pourrait lui être préférée par le magistrat. Il conviendrait donc de permettre au magistrat de substituer une expertise médico-psychologique à une expertise psychiatrique, lorsqu’elle semble plus appropriée.
Recommandation n° 2
Limiter le recours obligatoire à l’expertise psychiatrique et rendre possible sa substitution, sous certaines conditions, par une expertise psychologique ou médico-psychologique.
De la même façon, il faudrait permettre au juge de requérir une évaluation de dangerosité poussée, se traduisant par le placement de la personne condamnée pendant plusieurs semaines au sein d’un centre d’évaluation, lorsqu’il l’estime nécessaire, et non pas seulement dans les cas aujourd’hui prévus par la loi, c’est-à-dire à l’entrée et avant la sortie de détention. Il peut notamment être utile au juge, pour les personnes condamnées à des peines relativement longues, de marquer le parcours de détention par une étape supplémentaire, afin d’évaluer les progrès réalisés par la personne condamnée et d’adapter ses conditions de détention aux évolutions constatées.
Recommandation n° 3
Permettre au juge de l’application des peines de demander une évaluation de dangerosité non seulement avant une éventuelle libération conditionnelle mais à tout moment au cours de la détention.
Enfin, le juge doit disposer de pouvoirs accrus en matière de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM). Aujourd’hui, ses décisions sont limitées non pas par la loi, mais par un dispositif technique peu performant. Pour pousser la logique du PSEM jusqu’au bout, le juge doit pouvoir désigner de façon très précise les zones d’exclusion et d’inclusion auxquelles sera soumise la personne placée. Par ailleurs, il faudrait également qu’il puisse demander une analyse rétrospective des déplacements de la personne placée sous PSEM au cours des derniers mois, afin de détecter d’éventuels schémas suspects.
Recommandation n° 4
Faire évoluer le dispositif technique de placement sous surveillance électronique mobile afin de permettre au juge d’utiliser de façon optimale cette possibilité.
II. MIEUX COORDONNER L’ACTION DES DIFFÉRENTS ACTEURS
La mission a pu constater à de nombreuses reprises que l’enjeu principal, en matière de suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel, résidait dans la qualité du dialogue et de la coopération s’établissant entre les différents professionnels qui interviennent, directement et indirectement, dans le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
A. LE JUGE ET LE CONSEILLER : MIEUX DÉFINIR LES RÔLES POUR FACILITER LES RELATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS DU SUIVI
Le nombre élevé d’interlocuteurs potentiels ne permet pas l’établissement spontané d’un dialogue fécond, alors même que c’est là une condition sine qua non de la qualité du suivi. Par ailleurs, les textes législatifs et réglementaires qui tentent de définir les relations de ces acteurs sont d’une grande complexité. En outre, un certain nombre d’entre eux ne semblent pas satisfaits par la situation actuelle et le rôle que leur assignent les textes en vigueur. Aussi une évolution semble-t-elle nécessaire.
En premier lieu, la relation des juges de l’application des peines et des conseillers d’insertion et de probation doit être facilitée. Il importe qu’un dialogue direct puisse s’établir entre eux. Le filtre du directeur du service d’insertion et de probation n’est pas toujours pertinent, dans la mesure où il ne suit pas lui-même les dossiers attribués aux conseillers d’insertion et de probation et qu’il ne dispose dès lors pas de toutes les informations. Il ne devrait donc intervenir qu’en cas de problème dans le suivi, pour apporter son assistance au conseiller en difficulté, ou en cas de relations détériorées entre le juge et le conseiller.
Au-delà, le nœud du problème tient à la répartition des compétences organisée par les textes. Notamment, les juges de l’application des peines se sentent dépossédés du suivi, tandis que les conseillers d’insertion et de probation peinent à se positionner. Il est clair que l’idée d’un juge mandant, qui donnerait des consignes complètes sur les mesures de suivi n’est ni réaliste, du fait de leur charge de travail, ni souhaitable. Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ont acquis une réelle compétence dont il convient de tirer partie.
Cependant, l’exclusion totale du juge de la définition de ces mesures de contrôle ne semble pas tenable, tant elle vide le suivi de sa substance et instaure un climat de défiance réciproque. Le juge doit pouvoir avoir le dernier mot dans ce domaine, comme il a pu le conserver, du reste, pour ce qui est du suivi socio-judiciaire. Mais il doit aussi écouter le conseiller qui, bien souvent, a une connaissance plus fine de la personnalité de l’auteur et peut donc apporter un autre point de vue sur les mesures de suivi. Il convient donc de permettre une prise de décision partagée.
Concrètement, l’implication du juge dans le suivi des dossiers devrait être proportionnelle à la complexité du dossier et au risque de récidive que présente la personne suivie. De la même façon que la segmentation permet aux conseillers d’ajuster l’intensité du suivi à la personnalité de l’auteur, le juge devrait pouvoir moduler sa participation directe à l’élaboration des mesures de suivi.
En conséquence, le positionnement du SPIP pourrait être celui d’une assistance apportée au juge dans l’exécution du suivi. Ce sont d’ailleurs les termes retenus par le dispositif de surveillance de sûreté. Il convient a minima de procéder à une harmonisation des compétences de chacun dans les différents cadres juridiques possibles.
Recommandation n° 5
Harmoniser la répartition des compétences entre le juge de l’application des peines et le conseiller d’insertion et de probation et favoriser l’établissement d’une relation directe entre ces deux acteurs.
B. FAVORISER LES PARTENARIATS LOCAUX POUR UNE COOPÉRATION SANTÉ-JUSTICE RENFORCÉE
Au-delà, il est nécessaire de donner un cadre clair aux échanges que peuvent avoir les différents acteurs du suivi. Le caractère impersonnel et écrit des relations entre les acteurs ne constitue pas un facteur favorable à l’établissement d’une synergie réelle. Aussi plusieurs initiatives, développées au plan local, ont-elles entendu remédier à ce défaut.
Il peut ainsi être utile d’organiser, au plan local, des rencontres physiques, pas nécessairement fréquentes mais régulières, entre les acteurs d’un même dossier. C’est par exemple le cas dans les Landes, où des réunions de triangulation ont lieu, une à deux fois par an, qui réunissent les psychiatres, les psychologues, le médecin coordonnateur, le juge de l’application des peines, le directeur du SPIP et les conseillers, afin de faire la synthèse du suivi des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire. Développée par l'antenne de Mont-de-Marsan, cette pratique devrait également voir le jour au sein de l'antenne de Dax.
Enfin, la voie du contrat est souvent le support efficace d’une coopération poussée entre les acteurs.
Dans les Deux-Sèvres par exemple, le dispositif TAAGS (203) assure une coopération Santé-Justice exemplaire. Le SPIP, saisi d’une mesure, oriente systématiquement la personne soumise à une injonction de soins vers l’hôpital de Niort, avec lequel une convention est signée et renouvelée tous les trois ans. La personne est alors vue très rapidement et à plusieurs reprises par un psychiatre et un infirmier psychiatrique. Une réunion associe la personne suivie, le personnel soignant et le conseiller d’insertion et de probation au cours de laquelle une proposition concrète est faite au patient (suivi individuel, thérapie groupale, etc). Après la mise en place des soins, une réunion mensuelle, réunissant le patient, un personnel soignant qui n’est pas directement impliqué dans le soin et le conseiller d’insertion et de probation, fait le bilan des soins.
C’est également le moyen juridique employé dans les Landes pour assurer un suivi efficace des auteurs de violences sexuelles. Un protocole vient ainsi d’être rédigé, à l’initiative du SPIP, pour assurer la coordination des différents signataires : présidents des tribunaux de grande instance, juges de l’application des peines, responsables des associations de contrôle judiciaire, directeur du SPIP, directeur de l’hôpital du Mont-de-Marsan, médecin psychiatre de l’Unité médico-psycho-légale de psychiatrie (UMPLP) créée en 2011. Ce protocole, plus large que la convention TAAGS, permet ainsi d’inclure tous les acteurs du suivi.
Plusieurs pratiques existent qui permettent l’établissement d’un dialogue entre les acteurs, voire d’une franche coopération. Votre rapporteur ne peut qu’y souscrire et souhaiter le développement, sur l’ensemble du territoire, de telles initiatives. S’il importe d’encourager ces partenariats, par exemple par l’allocation de moyens supplémentaires et l’échange de bonnes pratiques, il convient de laisser les acteurs locaux trouver la formule qui leur semble la plus appropriée.
Recommandation n° 6
Favoriser la signature de conventions ou de protocoles entre les acteurs locaux du suivi des auteurs de violences sexuelles, afin de mieux coordonner l’action des différents professionnels intervenant dans ce domaine.
Il serait également opportun, dans des cas où le risque de récidive sexuelle est manifeste, de pouvoir mettre en place un suivi renforcé, fondé sur une coopération plus large entre les acteurs du suivi. Une cellule de suivi pourrait ainsi être mise en place, qui réunirait le juge de l’application des peines, le procureur de la République, le conseiller d’insertion et de probation, mais également la police ou la gendarmerie, et l’autorité municipale voire préfectorale. Par la vigilance accrue de tous ces acteurs, un suivi particulièrement efficace pourrait alors être mis en œuvre. Certains auteurs d’infractions ont en effet besoin de faire l’objet de mesures d’assistance et de contrôle plus fréquentes pour ne pas récidiver. Mieux entouré et mieux surveillé, l’auteur d’infraction à caractère sexuel sera moins tenté de commettre une nouvelle infraction ou, s’il est sujet à des pulsions difficilement contrôlables, aura les ressources nécessaires pour prévenir sa propre récidive. Le déclenchement de la mise en œuvre de ce dispositif pour le moins lourd devrait revenir au juge de l’application des peines et au procureur.
Recommandation n° 7
Rendre possible la mise en place d’une cellule de suivi renforcé, réunissant le juge de l’application des peines, le procureur, le conseiller d’insertion et de probation, la police ou la gendarmerie, ainsi que les autorités municipales et préfectorales dans les cas où le risque de récidive apparaît particulièrement élevé.
C. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conditions dans lesquelles travaillent les acteurs judiciaires du suivi, magistrats et conseillers d’insertion et de probation, sont susceptibles de limiter leur implication dans le suivi des mesures et la concertation avec les autres acteurs. Aussi semble-t-il nécessaire d’alléger les charges de travail individuelles, afin de consacrer le temps ainsi dégagé à l’amélioration du suivi des auteurs de violences sexuelles.
Plusieurs solutions sont aujourd’hui avancées pour faire évoluer les fonctions de conseiller d’insertion et de probation, en recentrant leur activité sur la prévention de la récidive. Il s’agit, d’une part, de déléguer certaines de leurs tâches à d’autres personnels ou structures : les enquêtes présentencielles aux associations et personnes physiques habilitées ; les tâches administratives à des agents administratifs ; le suivi des dossiers les moins complexes aux agents pénitentiaires ; les mesures d’assistance à des assistants sociaux. Toutes ces pistes doivent être explorées, afin de permettre aux conseillers d’insertion et de probation d’utiliser leurs compétences là où elles sont le plus utiles.
Par ailleurs, le projet de loi de programmation, dans son rapport annexé (204), envisage la mise en place d’équipes mobiles destinées à renforcer les effectifs des SPIP qui se trouveraient momentanément en difficulté. 88 équivalents temps plein (ETP) seraient affectés à ces nouvelles équipes mobiles. Au-delà de cette initiative, que votre rapporteur ne peut que saluer, il semble qu’un rééquilibrage général des charges de travail et des effectifs soit nécessaire.
Recommandation n° 8
Assurer une meilleure répartition des effectifs de conseillers d’insertion et de probation sur le territoire et recentrer ces personnels sur leur cœur de métier.
Par ailleurs, il importe d’aménager des espaces de dialogue entre conseillers. La charge de travail actuelle de certains conseillers ne leur permet pas de discuter d’un dossier avec un collègue, alors même que ces échanges informels sont susceptibles d’enrichir les pratiques professionnelles. Comme l’a indiqué un conseiller d’insertion et de probation à la mission : « C’est aujourd’hui un luxe de pouvoir discuter d’un dossier avec un collègue ». Au-delà, il conviendrait, dans le cas de personnalités complexes, de permettre à deux conseillers de suivre l’exécution de la mesure, comme c’est le cas au sein du SPIP de la Vienne. Le suivi de certains dossiers exige en effet qu’un double regard puisse y être porté.
Recommandation n° 9
Généraliser la possibilité de confier les dossiers particulièrement complexes à deux conseillers d’insertion et de probation.
Il en va de même pour les juges de l’application des peines, qui ne devraient pas suivre simultanément plus de 700 mesures. Par ailleurs, pour reprendre la préconisation du groupe de travail mentionné précédemment (205), il conviendrait que les dossiers particulièrement complexes et les mesures relativement lourdes, comme le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile, soient comptabilisés à leur juste valeur.
D. PARLER LE MÊME LANGAGE : DES REPÈRES COMMUNS
La nécessité, pour les acteurs du suivi, de disposer de référentiels communs en matière d’auteurs d’infractions à caractère sexuel a été soulignée à plusieurs reprises à la mission. Notamment, la participation à des actions communes de communication et de formation semble nécessaire pour que ces professionnels puissent « parler le même langage ».
Les associations assurent parfois la réunion et la formation des acteurs. Dans les Landes, l’association Raisonance a pour objet de créer un réseau entre les acteurs du secteur sanitaire, judiciaire et social. Elle organise ainsi des temps de réflexion communs, par le biais de colloques ou d’études de cas sur des thèmes particuliers. À Melun, en Seine-et-Marne, l’association française de traitement des violences sexuelles (AFTVS) a organisé des modules ponctuels sur divers thèmes comme « Comment parler de sexualité ? », « La compréhension du profil des auteurs », « La violence sexuelle » à destination des professionnels du suivi.
Les CRIAVS, qui assurent d’ores et déjà la formation de nombreux professionnels – parmi lesquels les magistrats semblent toutefois moins présents –, semblent être le support privilégié de cette évolution et devraient voir leurs moyens renforcés afin de mener plus d’actions de formation.
Recommandation n° 10
Mettre en place des modules de formation communs à l’ensemble des intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, par le biais des CRIAVS.
E. PARTAGER L’INFORMATION : L’APPORT DE LA DÉMATÉRIALISATION
En matière de suivi des auteurs de violences sexuelles, l’information est une ressource capitale pour les professionnels. Si certains se retranchent ponctuellement derrière le secret professionnel pour ne pas avoir à divulguer d’informations aux autres acteurs du suivi, dans la majorité des cas, les juges, les conseillers d’insertion et de probation, les médecins et les psychologues travaillent en bonne intelligence.
Néanmoins, il arrive que les informations que les différents acteurs du suivi peuvent légalement partager circulent de façon peu satisfaisante. Notamment, il est fréquent que les conseillers d’insertion et de probation ne reçoivent, de la part de leurs collègues du milieu fermé ou du juge, que des informations parcellaires ou des dossiers vides. Les médecins coordonnateurs ont parfois du mal à obtenir les expertises réalisées au cours de la procédure de la part du juge, de même que les experts psychiatres, à qui des fins de non recevoir sont parfois opposées. Dans ces différents cas de figure, la dématérialisation et la mise en place de nouveaux fichiers constituent une solution adéquate.
L’interconnexion d’APPI, le logiciel utilisé par les conseillers d’insertion et de probation, à CASSIOPÉE, le fichier de la justice, doit assurer la transmission des informations judiciaires aux SPIP. La meilleure alimentation d’APPI par l’ensemble des acteurs, notamment les conseillers œuvrant en milieu fermé, devrait également permettre d’assurer la continuité de la prise en charge entre le milieu ouvert et le milieu fermé, et un meilleur dialogue entre le juge et le conseiller. Cependant, pour atteindre cet objectif, il pourrait s’avérer utile de rénover ce logiciel actuellement sous-utilisé en raison de ses faibles fonctionnalités.
Recommandation n° 11
Rénover le logiciel APPI afin qu’il soit effectivement utilisé par les juges et conseillers d’insertion et de probation et qu’il assure un gain de temps réel à ses utilisateurs.
Par ailleurs, il importe que les acteurs du suivi, en particulier les médecins psychiatres, les experts et les psychologues traitants aient facilement accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) (206), issu de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale doit précisément répondre à cette préoccupation pour les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. La consultation de ce fichier, qui recueille les évaluations et examens psychiatriques, médicaux et psychologiques réalisés au cours de la procédure judiciaire, doit assurer aux magistrats, mais également aux personnels chargés de l’évaluation de la dangerosité des personnes condamnées, une meilleure connaissance de la personnalité du condamné. Cependant, deux ans après le vote de la loi qui a présidé à sa création, ce fichier n’est toujours pas en place, du fait de difficultés techniques. Il convient donc d’accélérer autant que possible sa mise en service, afin de permettre la consultation et la diffusion de ces informations aux professionnels auxquels elles sont nécessaires.
Recommandation n° 12
Accélérer la mise en service du Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires.
III. ÉLABORER UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE SOINS ET DE PRÉVENTION
L’objectif premier des dispositifs de suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel demeure la prévention de la récidive, laquelle suppose notamment que la personne condamnée comprenne la sanction qui lui est infligée et, surtout, puisse surmonter les troubles de la personnalité ou du comportement l’ayant conduit à commettre des actes pénalement réprimés. Dans cette optique, il importe d’élaborer un dispositif de soins et de prévention susceptible de répondre aux enjeux spécifiques de la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Cette orientation implique le développement de prestations, de structures et d’encadrements thérapeutiques, tant en milieu pénitentiaire qu’en milieu ouvert.
C’est pourquoi la mission préconise : en premier lieu, de mieux utiliser le temps carcéral ; en deuxième lieu, de développer une véritable offre de soins post-pénale ; en dernier lieu, d’éviter le passage à l’acte par l’organisation de moyens de prévention primaire.
A. MIEUX UTILISER LE TEMPS CARCÉRAL
Il ne semble pas d’usage, aujourd’hui, dans les établissements pénitentiaires, de mettre à profit la durée de l’exécution de la peine entre leurs murs pour œuvrer à la réduction des risques de récidive, comme c’est le cas, par exemple, au Canada.
Par-delà la question du manque de moyens en personnels qualifiés, cette situation peut s’expliquer par le fait que certains praticiens, médecins ou psychologues, considèrent que le milieu carcéral n’est pas propice au suivi d’une réelle thérapie. Ainsi, lorsque les personnes sont détenues, seule une action pré-thérapeutique, qui vise à préparer le suivi post-carcéral d’un traitement, est mise en œuvre. Il s’agit alors avant tout de permettre aux auteurs d’infractions à caractère sexuel de reprendre leur position de sujet, afin qu’ils reconnaissent leurs actes et prennent conscience de leurs responsabilités.
Cependant, l’expérience semble montrer que peu de personnes refusent les soins en milieu fermé et que certains détenus auteurs de violences sexuelles souhaitent même entamer le plus rapidement possible un traitement.
Par ailleurs, si l’on suit les recommandations émises en 2000 par le Conseil de l’Europe (207) suivant lesquelles « une attention particulière devrait être accordée à la conception de programmes et d’intervention destinés aux délinquants qui ont gravement récidivé ou qui risquent de le faire », il convient de mieux utiliser le temps carcéral qu’on ne le fait actuellement en poursuivant, d’une part, la spécialisation de la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel en milieu pénitentiaire et, d’autre part, en mettant en œuvre de façon systématique, en milieu fermé, des programmes intensifs à destination de ce public.
1. Poursuivre la spécialisation de la prise en charge pénitentiaire des auteurs d’infractions à caractère sexuel
La poursuite de la spécialisation de la prise en charge pénitentiaire des auteurs de violences sexuelles suppose, en premier lieu, qu’un nombre plus élevé de détenus y soient effectivement affectés. Cet objectif n’est en effet pas atteint, ces établissements n’accueillant à l’heure actuelle que 40 % des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Il importe également de repenser la répartition géographique des établissements pénitentiaires. La répartition des établissements spécialisés doit permettre, conformément aux principes de la politique d’affectation des détenus, le maintien des liens familiaux. Il importe donc de reconsidérer l’implantation des établissements ou de pallier l’absence de ces structures dans certaines régions. C’est notamment le cas en matière de maisons centrales, dont deux seulement sont spécialisées dans l’accueil d’auteurs d’infractions à caractère sexuel. Par ailleurs, l’insertion des établissements spécialisés dans le contexte local des structures et moyens de santé nécessaires la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel doit permettre d’assurer une meilleure répartition des établissements pénitentiaires spécialisés. Dans cette perspective, il importe donc de procéder, de manière régulière et si possible dans la concertation, à un diagnostic actualisé des besoins et des ressources à l’échelon local, ce qui implique d’évaluer les résultats obtenus par les établissements pénitentiaires spécialisés.
Ensuite, la poursuite de cette politique implique la constitution d’équipes composées de praticiens spécialement formés. À cette fin, il peut apparaître souhaitable d’organiser le recrutement des personnels de préférence sur dossier ou profil, en prenant en considération, dans la mesure du possible, les formations spécifiquement reçues ou les expériences acquises en rapport avec la prise en charge des auteurs de violences sexuelles (208). Même si cette structure remplit une mission particulière, on notera ainsi qu’au centre national d’évaluation (CNE) de Fresnes, le personnel, du directeur aux surveillants, a été recruté suivant le profil des personnes et sur candidature, avec manifestement pour résultat un travail d’équipe assez efficace.
Cette préconisation conduit par ailleurs à mieux appréhender l’efficience du dispositif des établissements spécialisés au plan thérapeutique, eu égard aux ressources humaines et matérielles locales et à inscrire pleinement ces établissements dans les schémas régionaux de soins (SROS).
La spécialisation des conditions de prise en charge implique par ailleurs le développement de protocoles, labels ou référentiels de soins pour la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Cette mesure apparaît en effet de nature à favoriser un échange des bonnes pratiques observées sur le terrain et, par conséquent l’égale qualité des soins. Elle pourrait donner lieu à la formalisation des compétences professionnelles et des acquis de l’expérience, dans le cadre par exemple des plans de prévention de la récidive. C’est pourquoi, la mission appelle de ses vœux la conclusion rapide de protocoles à l’échelon régional destinés à formaliser les modalités d’intervention des personnels de santé et des personnels pénitentiaires dans la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel, en tenant compte des documents qui existent déjà.
Enfin, la mission se félicite de la mise en place prochaine de plusieurs indicateurs de résultats dans l’optique d’une évaluation du Protocole Santé-Justice (209) conclu entre le ministère de la Justice et le secrétariat d’État à la Santé. Ces indicateurs de résultat et de ressources apparaissent en effet de nature à permettre un examen circonstancié de l’apport des établissements spécialisés dans la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
LES INDICATEURS DE RÉSULTAT PRÉVUS PAR LE PROTOCOLE SANTÉ-JUSTICE Ces indicateurs portent notamment sur : — nombre de consultations psychiatriques individuelles réalisées pour des personnes condamnées pour infraction à caractère sexuel et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; — nombre de personnes condamnées pour infraction à caractère sexuel et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ayant bénéficié de consultations psychiatriques individuelles ; — nombre de séances de groupe thérapeutique (hors PPR) réalisées en lien spécifiquement avec la problématique de dysfonctionnement sexuel ; — nombre de personnes condamnées pour infraction à caractère sexuel et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ayant participé à ces groupes. |
Le suivi de ces critères devrait permettre une affectation optimale des moyens humains et matériels de sorte que la spécialisation des établissements pénitentiaires et des équipes soignantes en milieu carcéral permette un accueil adapté des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Recommandation n° 13
Poursuivre la spécialisation des établissements pénitentiaires et des équipes soignantes en milieu carcéral, tout en respectant le principe de maintien des liens familiaux par une meilleure répartition des établissements sur le territoire.
2. Systématiser la mise en œuvre des programmes de traitement intensifs à destination des auteurs de violences sexuelles
Afin de mettre à profit le temps carcéral, de réels traitements doivent être proposés aux personnes condamnées pour des faits de violences sexuelles. Les pouvoirs publics pourraient ainsi utilement généraliser l’exemple fourni par l’unité psychiatrique d’hospitalisation (UPH) de Fresnes, laquelle met en œuvre depuis de nombreuses années des programmes combinant avec une certaine efficacité plusieurs approches thérapeutiques.
Si l’on ne dispose pas de chiffres concernant le taux de récidive des personnes ayant suivi ces programmes (210), les quelques éléments d’évaluation disponibles tendent à démontrer que l’état psychologique des personnes ainsi prises en charge pouvait présenter une nette amélioration en termes de psychopathie, de responsabilité et de capacité à assumer ses actes, d’empathie ou d’impulsivité.
LE TRAVAIL DE L’UNITÉ PSYCHIATRIQUE D’HOSPITALISATION (UPH) DE FRESNES Créée en 1994 sur une initiative du docteur Sophie Baron-Laforêt, l’UPH de Fresnes se présente comme une structure fonctionnelle du service médico-psychologique régional de Fresnes au sein de la maison d’arrêt. Le personnel y est affecté sur une base volontaire. Depuis septembre 2007, elle offre douze places pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel dans un étage qui leur est réservé. En revanche, l’unité n’accueille pas les personnes souffrant de maladie mentale, ni celles qui ne peuvent pas intellectualiser leurs actes. En 2011, 22 détenus ont bénéficié de la prise en charge assurée par l’UPH. Le programme consiste d’abord en une phase d’évaluation qui porte sur les structures psychologiques de l’individu. S’y ajoute une évaluation psychométrique en début et fin de session, qui utilise notamment l’échelle psychopathique de Hare. L’équipe utilise également pour ses évaluations les échelles actuarielles Static-99 et SORAG. Suite à cette évaluation, un contrat de soin est établi avec le SMPR. Le contrat doit reposer sur la lucidité du patient et sur la confidentialité, ce dernier point étant fondamental. Le travail mené avec les auteurs d’infractions à caractère sexuel dure douze mois. Les patients sont affectés dans deux groupes fermés avec lesquels ils travaillent successivement six mois. Ces groupes se composent de six patients et de trois thérapeutes. Les thérapies mises en œuvre reposent, d’une part, sur des entretiens individuels et, d’autre part, sur un travail en groupe. Les patients peuvent également suivre un traitement médicamenteux, par exemple un traitement inhibiteur de libido. Le travail de groupe porte sur trois thématiques complémentaires : les aspects criminologiques (passage à l’acte, etc.) ; les habilités sociales ; l’identité et les habitudes sexuelles. La thérapie de groupe vise à donner au patient les moyens de gérer ses fantasmes, ses pulsions et de parvenir à le faire réfléchir sur son rapport à l’autre, en travaillant sur deux aspects : l’aspect cognitivo-comportemental et l’aspect psychodynamique. Les soins au sein de l’UPH de Fresnes se déroulent en plusieurs phases qui correspondent à l’évolution de l’état des patients : 1° l’observation (6 à 8 semaines) : tant pour les soignants que pour les patients, elle permet notamment d’établir un lien de confiance au sein du groupe et de régler le mode de prise de parole ; 2° la « mobilisation » (7 à 10 semaines) : il s’agit d’une phase éprouvante puisqu’elle donne lieu à une complète immersion thérapeutique avec une forte mobilisation psychique qui laisse les soignés en général déstabilisés ; on constate ainsi pendant cette phase des épisodes de fatigue, de déséquilibre de la posture voire de décompensation chez les soignés ; 3° la mutation : à ce stade, est effectuée une mise en perspective de l’acte, des contextes dans lesquels le soigné est amené à reproduire celui-ci. Toutefois, après cette phase, les soignés ont besoin de poursuivre leur travail. |
Il importe que ces programmes intensifs de soins s’adressent uniquement aux détenus volontaires. Ce choix se justifie, d’une part, par la nécessité de prendre en considération la capacité propre à chaque détenu de recevoir des soins et, d’autre part, par un souci de pragmatisme : tant que l’offre de soins en détention n’atteindra pas un niveau correspondant aux besoins, il vaut mieux se concentrer sur des personnes volontaires pour un usage efficient des ressources disponibles.
Par ailleurs, la mission n’ignore pas que la mise en œuvre de ce type de programmes mobilise des moyens humains et financiers relativement importants.
Recommandation n° 14
Mettre en place, en milieu fermé, des programmes intensifs volontaires à destination des auteurs de violences sexuelles dans chaque établissement spécialisé sur le modèle de l’Unité psychiatrique de Fresnes.
B. ÉLABORER UNE VÉRITABLE OFFRE DE SOINS POST-PÉNALE
Le développement d’une véritable offre de soins post-pénale destinée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel suppose, du point de vue de la mission, de poursuivre les efforts entrepris sur un plan quantitatif et qualitatif par l’augmentation et la structuration d’une offre de soins adaptée.
1. Assurer la continuité des interventions thérapeutiques
Les auteurs d’infractions à caractère sexuel pouvant être vulnérables lorsqu’ils recouvrent leur liberté, la poursuite après la détention des soins entrepris dans le cadre de l’exécution de la peine en milieu fermé constitue un impératif. Or, ces personnes rencontrent souvent de grandes difficultés à obtenir une prise en charge thérapeutique auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue exerçant en libéral (211). Par ailleurs, il s’avère que le suivi des soins exige une véritable « alliance thérapeutique » entre le soignant et le soigné.
Dans ces conditions, il paraît souhaitable que, sous réserve du libre choix des intéressés, de la déontologie des professionnels et de leurs obligations à l’égard du service public de la justice, les thérapeutes puissent continuer, dans la mesure du possible, à suivre les patients qu’ils accompagnaient en détention.
Cette mesure comporte l’avantage de poursuivre les soins en milieu ouvert en tirant parti du climat de confiance entre soignant et soigné nécessaire au succès de ces thérapies. La continuité des soins ainsi organisée pourrait sans doute permettre aux auteurs d’infractions à caractère sexuel de vaincre les appréhensions inhérentes à la prise de contact avec un nouveau thérapeute. Du reste, le thérapeute présenterait les garanties nécessaires en termes de formation et d’expérience concrète pour un suivi au long cours de ce type particulier de patients. Enfin, cela assurerait une meilleure transmission des informations entre le milieu fermé et le milieu ouvert, sans pour autant porter atteinte au secret médical.
Recommandation n° 15
Permettre aux thérapeutes de continuer à suivre en milieu ouvert les patients qu’ils accompagnaient en détention, dans un souci de continuité des soins et d’efficacité au long cours des thérapies suivies grâce au maintien de l’« alliance thérapeutique ».
Cela étant, la mission ne méconnaît pas les difficultés pratiques, notamment en termes de disponibilité des thérapeutes, que peut induire une telle mesure. En réalité, la qualité des soins exige également qu’existent des capacités d’offre de soin en milieu ouvert susceptibles de répondre aux besoins des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
2. Garantir le développement des consultations post-pénales ouvertes aux auteurs d’infractions à caractère sexuel
Le développement des consultations post-pénales constitue l’axe essentiel de l’augmentation de l’offre de soins destinée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel. Les résultats obtenus par les quelques structures identifiées sur le territoire et assurant ce type de prestations plaident en faveur de la multiplication des consultations post-pénales ouvertes aux auteurs d’infractions à caractère sexuel. Ces consultations post-pénales constituent des modèles à généraliser dans la mesure où elles constituent le cadre de mise en œuvre de thérapies innovantes et adaptées.
D’après le recensement établi par la mission, trois structures s’illustrent tout particulièrement dans l’organisation des consultations post-pénales :
— la consultation externe du secteur d’activité intra-pénitentiaire du service médico-psychologique régional de Fresnes : lancée, en 2003, par le Dr. Christiane de Beaurepaire à l’établissement public de santé Paul Guiraud (Villejuif), fonctionnant à moyens constants avec deux psychologues et une infirmière, cette consultation post-pénale s’adresse aux personnes sortant de prison avec ou sans obligation judiciaire de soins et assure les interventions médicales et psychologiques dans trois centres pour peine aménagée (212) ; les personnes reçues sont pour près de 80 % d’entre elles orientées par le SPIP dans le cadre de soins pénalement ordonnés ;
— l’unité Psychothérapies Applications Recherches Intersectorielles (PARI) à Grenoble : centre de psychothérapie psychanalytique du centre hospitalier de Saint-Égrève, ouverte à tout type de profil, l’unité PARI assure la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel depuis le milieu des années 1990, dans le sillage des recherches entreprises par le Dr. Claude Balier sur le profil des auteurs de violences sexuelles ; il possède aujourd’hui le statut de plateforme référentielle ; il assure la prise en charge des auteurs de violences sexuelles soumis à injonction ou à obligation de soins mais accueille également des personnes consultant spontanément la structure parce qu’elles connaissent l’un de ses thérapeutes et sont confrontées à des épisodes de détresse psychologique ; il travaille en étroite collaboration avec le SPIP de l’Isère mais également avec le centre de ressources pour les intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) de Rhône-Alpes ;
— l’unité ÉRIOS à Bordeaux : avant tout unité médicale rattachée au centre hospitalier Charles Perrens, elle se compose d’une équipe pluridisciplinaire, se consacrant aux soins destinés aux auteurs de violences sexuelles et aux soins pénalement ordonnés. L’unité a trois modalités d’intervention : une équipe mobile de soins pour les auteurs de violences sexuelles incarcérés dans les centres de détention d’Aquitaine ; une équipe de soin ambulatoire pour les adultes dans le cadre du dispositif intersectoriel de soins pénalement ordonnés en Gironde ; un centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles en Aquitaine (CRIAVS Aquitaine).
UN EXEMPLE DE PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE D’UNE CONSULTATION POST-PÉNALE : LES THÉRAPIES CONDUITES À L’UNITÉ PARI DE GRENOBLE D’après les éléments recueillis par la mission au cours de son déplacement à Grenoble, l’unité PARI suivait, à la fin de l’année 2011, une file active de 53 personnes en obligation ou en injonction de soins (contre une file active globale de 422 patients pour l’ensemble de l’année 2010). Les modes de traitement appliqués consistent d’une part en l’organisation de plusieurs types de groupes suivant des fonctionnements et des finalités spécifiques : — des groupes thérapeutiques ; — un groupe de parole : les patients y parlent d’eux devant 7 à 8 autres participants ; — un groupe de « psychodrame » : on y met en scène la situation d’un patient puis les participants en discutent ; dans ce cadre, est ainsi utilisée la technique du changement de rôle, les patients se caractérisant, pour la plupart d’entre eux, par une certaine incapacité à l’empathie et à l’identification. La formation des groupes résulte aujourd’hui d’une méthode que les échanges entre les membres de l’unité PARI ont permis de dégager et d’affiner. Les groupes visent ainsi à ce que chaque participant, en entendant un récit sur des faits identiques à ceux qu’il a commis, retrouve sa propre mémoire et prenne en considération la perception d’autrui. Entendre le membre du groupe expliquer le passage à l’acte peut provoquer un déclic, amener à établir pour soi-même des gardes fous , éviter les risques de récidive même si l’on ne comprend pas réellement pour soi-même les raisons du passage à l’acte. D’autre part, l’unité donne des consultations et réalise également des psychothérapies individuelles en nombre plus limité dans la mesure où sont privilégiées les psychothérapies de groupe. L’unité PARI dispose d’un budget de 300 000 euros (pour l’essentiel consacré au paiement des salaires). Le fonctionnement de la structure repose sur : 2 mi-temps médico-psychiatres, 4 psychologues 1 animateur travaillant en psychologie, 2 personnes pour animer les groupes de thérapies (70 % de leur activité en privé, 30 % dans le cadre hospitalier), 1 secrétaire (à 80 %). |
D’autre part, indépendamment de leur rattachement formel à un établissement hospitalier, comme dans le cas de l’unité ÉRIOS, ou d’un statut administratif adapté permettant des liens plus relâchés avec ce type d’établissement, à l’instar de l’unité PARI, les structures de consultation post-pénale ouvrent la possibilité d’un travail pluridisciplinaire et d’une démarche n’apparaissant pas comme la stricte exécution d’une mesure de justice, en l’occurrence l’injonction de soin. Par leur protocole d’accueil ouvert aux personnes placées sous main de justice mais également aux personnes susceptibles d’éprouver le besoin d’une prise en charge, ces structures peuvent s’insérer dans un dispositif de prise en charge plus global permettant de mettre avant tout l’accent sur le soin.
L’UNITÉ ÉRIOS : UN DISPOSITIF SANITAIRE D’ENVERGURE Appartenant au pôle 3-4-7 de l’hôpital Charles Perrens de Bordeaux, l’unité ÉRIOS remplit trois missions qui se répartissent entre, d’une part, le soin pour les auteurs de violences sexuelles (57,84 % de son activité) et, d’autre part, la ressource pour les professionnels (avec le CRIAVS Aquitaine). Elle gérait une file active de 156 personnes en décembre 2011. Ses activités de soins reposent sur : — le fonctionnement d’une équipe mobile de soins pour les auteurs de violences sexuelles incarcérés dans les centres de détention (44,14 % de son activité) : l’équipe concourt aux incitations aux soins, anime les groupes thérapeutiques de concert avec l’UCSA et le SMPR, participe à la préparation de la libération et à la continuité des soins ; elle intervient notamment aux centres de détention de Neuvic et de Mauzac (Dordogne) ainsi qu’au centre pénitentiaire de Gradignan (Gironde) : cette activité présente donc une dimension régionale ; — la mise en œuvre du dispositif intersectoriel de soins pénalement ordonnés de Gironde (13,70 % de son activité) : dans ce cadre l’unité assure des suivis psychiatriques individuels, parfois avec traitement anti-hormonal chez des sujets volontaires, en traitant des demandes ressortissant de l’obligation de soins, de l’injonction de soins, voire de la demande spontanée ; depuis 2009, l’offre de soins a été élargie, grâce à de nouveaux moyens, avec l’organisation d’un suivi en binôme, de suivis complémentaires, d’un groupe d’adolescents auteurs de violence sexuelle, de deux groupes ambulatoires thérapeutiques (depuis 2011). L’accomplissement des missions de l’unité ÉRIOS s’inscrit dans le cadre d’un dispositif régional décloisonné. En effet, les activités santé et ressources pour les professionnelles sont menées de concert et se déploient à la fois sur un plan local (l’unité médicale ÉRIOS et son activité de santé) et sur un plan régional (avec l’équipe intervenant dans les centres de détention). À ce niveau, l’unité entretient des rapports de collaboration qualifiés de fructueux auprès de la mission avec l’agence régionale de santé (ARS). Par ailleurs, ÉRIOS agit dans le cadre d’un réseau de soignants hospitaliers, des libéraux, d’associations qui, peu à peu, s’affirme. Elle entretient des relations étroites par le biais des formations qu’elle réalise avec la Justice et ses institutions : la magistrature en tant que telle (siège et parquet), la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP), les établissements pénitentiaires, les SPIP, les écoles nationales (ENM, ENAP). L’unité ÉRIOS se présente enfin comme pluridisciplinaire dans ses effectifs et ses approches. En termes d’effectifs, elle compte 2,6 ETP de psychiatre, 3,5 ETP de psychologue, 2 ETP d’infirmier, 1 ETP de psychomotricien, 1 ETP de secrétaire, 0,2 ETP de cadre de santé). En termes d’approches, tous les courants théoriques sont représentés et l’unité s’interroge de manière assez ouverte sur l’usage des méthodes actuarielles aux fins d’évaluation. |
Toutefois, il convient de ne pas sous-estimer la difficulté de la tâche pour ces structures de consultation post-pénale. Ainsi, les structures ne disposent pas nécessairement de moyens que mériterait le développement de leurs activités, à l’instar de l’unité ÉRIOS ou de la consultation post-pénale de Villejuif.
Faire face aux besoins de la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel exige de conforter ces initiatives souvent locales qui ne sauraient prospérer sur une base aussi précaire. Aussi, la mission préconise le développement plus systématique d’une offre de soins fondée sur le soutien des consultations post-pénales dans le cadre du schéma régional de santé (SROS).
Recommandation n° 16
Favoriser l’émergence et le développement de consultations post-pénales identifiées et spécialisées dans le traitement des auteurs de violences sexuelles, sur le modèle de l’unité ÉRIOS de Bordeaux ou de l’unité PARI de Grenoble.
Cela dit, la mission a conscience que les troubles dont souffrent certains de ces auteurs de violences sexuelles présentent une telle complexité que la définition d’un protocole de soins exige des compétences approfondies et une certaine expérience. Aussi, convient-il de favoriser la création de centres post-peines spécialisés afin de garantir le suivi médical, psychologique et psychiatrique des troubles de la personnalité et des pathologies les plus complexes. Dans cette perspective, elle ne peut que soutenir des initiatives telles que celle de M. Serge Stoléru, Mme Sophie Baron-Laforêt et M. Christian Hervé de création d’un centre qui, en plus du développement de l’offre d’enseignement et de formation au plan national et international, traiterait des situations cliniques difficiles adressées par des structures de proximité.
Recommandation n° 17
Confier à un centre post-peine spécialisé le suivi médical, psychologique et psychiatrique des cas les plus complexes.
3. Améliorer le dispositif d’injonction de soins par le recrutement de coordonnateurs
Remédier à l’insuffisance des effectifs de médecins coordonnateurs constitue une nécessité pour améliorer le suivi des auteurs de violences sexuelles. Cela implique d’accroître le nombre de professionnels à même d’exercer cette tâche d’interface essentielle entre les services de la justice et les thérapeutes.
Outre le relèvement récent du nombre de dossiers pouvant être suivi simultanément par les médecins coordonnateurs (213), plusieurs pistes sont actuellement à l’étude, dont deux devraient aboutir par le biais du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines :
— La création d’un contrat d’engagement, qui vise à inciter les internes en psychiatrie, en contrepartie d’une allocation mensuelle, à assurer la prise en charge psychiatrique des personnes sous main de justice en s’inscrivant sur une liste d’experts judiciaires et une liste de médecins coordonnateurs pour une durée minimale de deux ans ;
— l’atténuation des dispositions de la loi du 21 juillet 2009 dite loi hôpital, patients, santé et territoires (214), étendant aux praticiens hospitaliers titulaires ou contractuels employés à plein-temps les règles qui, dans le reste de la fonction publique hospitalière, encadrent le cumul d’activités (215).
Cela étant, la mission estime que l’on pourrait élargir plus sûrement le vivier des médecins coordonnateurs en permettant aux médecins coordonnateurs en place de déléguer certains dossiers à des psychologues, sous certaines conditions de formation et d’expérience professionnelle en matière de suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
En effet, ainsi que le relevait le rapport de l’IGAS et de l’IGSJ, « il peut paraître dommage de se priver d’élargir le vivier des coordonnateurs, puisqu’on dénombre dans les seuls secteurs de psychiatrie générale, 2 400 psychologues pour 3 200 psychiatres ». Par ailleurs, les psychologues peuvent d’ores et déjà être désignés comme médecins traitants de personnes soumises à une injonction de soins. Surtout, ils disposent des compétences nécessaires à la prise en charge des troubles de la personnalité ; ils connaissent et mettent en œuvre des approches thérapeutiques de groupe et ont l’habitude de travailler en réseau.
Dès lors, du point de vue de la mission, il convient de ne pas exclure leur recrutement en tant que coordonnateurs. Cependant, la mission a conscience que des efforts de formation doivent être accomplis afin que les psychologues acquièrent un bagage théorique et pratique suffisant pour exercer les fonctions de coordonnateurs. Il en va de même, d’ailleurs, pour les médecins non psychiatres qui souhaiteraient devenir médecins coordonnateurs.
Recommandation n° 18
Permettre à des psychologues spécialisés dans les auteurs de violences sexuelles d’exercer les fonctions de coordonnateur, sous la responsabilité d’un médecin psychiatre, afin de répondre à la pénurie de médecins coordonnateurs.
Enfin, la diffusion de documents qui, d’une part, renseignent les candidats sur les prérogatives et les responsabilités pratiques des coordonnateurs et, d’autre part, établissent les relations qu’ils entretiennent avec les thérapeutes et les services de la Justice pourrait s’avérer utile. Cette initiative contribuerait sans doute à l’harmonisation des pratiques sur le terrain et pourrait dissiper les appréhensions que peut susciter l’exercice de ces responsabilités et qui dissuadent l’engagement de certains thérapeutes.
Recommandation n° 19
Formaliser les conditions d’exercice des fonctions de coordonnateurs et les relations avec les services de la Justice par la diffusion d’un vade-mecum et référentiel des pratiques ainsi que par la conclusion d’un protocole de collaboration institutionnalisée.
4. Conforter le rôle de centres d’appui opérationnel des CRIAVS
Le renforcement des CRIAVS pourrait, à de nombreux égards, favoriser l’émergence d’une offre de soins adaptée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel sur l’ensemble du territoire. Du fait de leur rôle d’expertise, les CRIAVS devraient plus systématiquement servir de centres d’appui opérationnel pour l’ensemble des personnes intervenant dans la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Alors que sa fédération nationale, constituée assez récemment (216), a tenu sa première journée à Rouen le 20 janvier 2012, le dispositif des CRIAVS paraît achever son déploiement. Cependant, le dispositif des centres de ressource manque encore de lisibilité et de visibilité. Aussi, afin d’y remédier la mission préconise l’établissement d’indicateurs de ressources et de résultats qui prendraient notamment en compte l’exercice de la mission d’appui systématique et de coordination.
Une telle recommandation procède avant tout de la volonté de mesurer plus exactement les besoins respectifs des centres de ressource et, par le biais de cette évaluation, de formaliser ensuite des objectifs permettant de mieux assurer le rayonnement des CRIAVS dans l’ensemble des régions. Les indicateurs de résultats pourraient ainsi intégrer les actions conduites, les relais créés dans la région, les formations dispensées aux acteurs du suivi, les publications de recherche assurées.
La mise en place de ces indicateurs implique un vaste travail de concertation avec les autorités sanitaires qui rend d’autant plus nécessaire le renforcement de la fédération des CRIAVS. Celle-ci pourrait contribuer en effet à la définition de critères tenant compte, avec pragmatisme, de la situation de l’ensemble des centres de ressources. De fait, la fédération entreprend actuellement la réalisation d’un répertoire des actions menées par les différentes structures (217) susceptible de conduire, à terme, à un échange de bonnes pratiques et à l’harmonisation de ces dernières.
Recommandation n° 20
Établir des indicateurs de ressources et de résultats afin d’évaluer l’action des CRIAVS, qui prendraient notamment en compte l’exercice systématique de la mission d’appui opérationnel et de coordination de l’offre de soins destinée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel.
D’autre part, dans une optique de structuration des soins et de propre visibilité des centres, la mission estime que les CRIAVS devraient établir des conventions avec des centres de consultation post-pénale, afin de formaliser les finalités de la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Ces conventions reposeraient sur la signature d’un cahier des charges comportant des exigences en termes de prise en charge pour la structure et en termes d’appui et d’expertise pour le CRIAVS. L’établissement de ces conventions permettrait d’assurer la pleine visibilité des centres de ressources auprès des professionnels et d’établir des synergies entre capacités de soins et ressources en expertise des CRIAVS. Du point de vue de la mission, les relations de partenariat établies par le CRIAVS Rhône-Alpes avec l’unité PARI pourraient représenter un exemple à suivre.
LES PLATEFORMES RÉFÉRENTIELLES CLINIQUES : L’EXEMPLE DE RHÔNE-ALPES Tout en gardant son statut de centre psychothérapeutique généraliste, l’unité PARI a souhaité affirmer son statut de structure assurant une prise en charge spécifique des auteurs de violences sexuelles en nouant un partenariat étroit avec le CRIAVS Rhône-Alpes. Dans ce cadre, a été créée une plate-forme référentielle clinique qui constitue un réseau entre centre de ressource et unité de soin. D’après les éléments fournis à la mission par le CRIAVS Rhône-Alpes, il convient de signaler l’existence des plates-formes référentielles cliniques établies avec les CMP à Bonneville (Haute-Savoie), à Roanne (Loire), à Lyon (à l’hôpital Édouard Herriot notamment), ces plateformes ayant pour vocation de recevoir les adultes auteurs d’agressions sexuelles. Après la validation obtenue auprès de l’ARS en janvier 2012, une structure devrait voir le jour dans le sud du département de l’Isère, concrétisant la réalisation d’un projet de prise en charge des mineurs auteurs d’infractions à caractère sexuel placés sous mains de justice. |
Recommandation n° 21
Accorder aux CRIAVS la compétence de principe de constituer des plateformes référentielles cliniques avec les structures assurant les consultations post-pénales ouvertes aux auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Il pourrait être également envisagé d’inclure parmi les missions des CRIAVS des actions d’information en vue du recrutement des médecins coordonnateurs. Tant par la vue d’ensemble de l’offre de soin dont ils disposent que par l’animation du maillage santé-justice qu’ils mettent en œuvre, les centres de ressources disposent en effet d’éléments pratiques qui pourraient éclairer les candidats à l’exercice des fonctions de coordonnateur et lever quelques appréhensions pour favoriser leur recrutement.
Par exemple, le CRIAVS d’Aquitaine s’implique dans le recrutement des coordonnateurs par des actions de sensibilisation des conseils départementaux de l’Ordre des médecins, en participant à des réunions comme la conférence semestrielle sur l’aménagement des peines à la cour d’appel, ou encore en organisant une journée annuelle régionale des médecins coordonnateurs. Outre une démarche d’accompagnement dans le cadre d’une veille juridique et documentaire (par exemple, en transmettant par courriel des nouveaux textes de lois ou de règlements, des références de nouvelles publications), il propose aux aspirants coordonnateurs de rencontrer des professionnels en activité.
Recommandation n° 22
Charger les CRIAVS d’une mission d’information et de sensibilisation destinée à inciter les thérapeutes à l’exercice des fonctions de médecins coordonnateurs.
C. AGIR AVANT LE PASSAGE À L’ACTE
Au-delà d’une amélioration du fonctionnement de la justice pénale et de l’amélioration de l’organisation des soins auxquelles sont soumis les auteurs de violences sexuelles, il faut agir avant même le passage à l’acte. Dans cet esprit, la prévention pourrait reposer sur la mise en œuvre de deux mesures : la création d’un dispositif d’accueil téléphonique d’urgence destiné à prévenir la récidive ; la mise en œuvre d’un accompagnement social fort par le biais de « cercles de soutien ».
1. Mettre en place une ligne téléphonique d’écoute d’urgence
Cette mesure vise à permettre aux auteurs d’infractions à caractère sexuel de prendre contact, par téléphone, avec un interlocuteur qualifié s’ils sentent les prémices annonciatrices d’un passage à l’acte. Il s’agirait de mettre à leur disposition un numéro d’écoute, anonyme et gratuit, disponible 24 heures sur 24 heures, pour prévenir le passage à l’acte et orienter rapidement les personnes en demande de soins vers des structures d’accueil d’urgence.
Toutefois, la mission n’entend pas occulter des questions d’importance pour que ce dispositif offre une réponse adéquate en cas de possibilité de récidive. L’accueil téléphonique doit être confié à des psychiatres et à des psychologues possédant une formation appropriée à la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. L’accueil dans une situation d’urgence doit consister dans l’écoute des personnes et leur orientation vers des CMP, des hôpitaux psychiatriques ou des consultations post-pénales pouvant les accueillir en urgence, en application de procédures formalisées.
S’agissant du financement et des moyens matériels, la création d’une ligne d’écoute d’urgence pourrait s’inscrire dans la mise en œuvre du concept de prévention et d’aide à distance en santé promu, depuis quelques années, par les pouvoirs publics. À ce titre, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) assure le financement de 17 dispositifs de lignes téléphoniques répondant à cet objectif. Le dispositif de prévention primaire à l’intention des auteurs d’infractions à caractère sexuel pourrait dès lors bénéficier d’un double financement santé-justice.
Recommandation n° 23
Mettre en place un numéro d’écoute d’urgence, anonyme et gratuit, disponible 24h sur 24h, pour prévenir le passage à l’acte et orienter rapidement les personnes en demande de soins vers des structures d’accueil d’urgence.
Une objection légitime peut conduire à s’interroger sur la propension et la capacité des auteurs de violences sexuelles à utiliser spontanément ce numéro téléphonique, qui plus est en cas d’épisode de détresse psychologique où ils sont incapables de maîtriser une pulsion. Une réponse consiste à apprendre à ces personnes, pour autant qu’il est possible, à identifier les signes avant-coureurs d’une telle crise. De fait, d’après les éléments recueillis par la mission, cette connaissance intime des mécanismes du passage à l’acte et l’apprentissage de stratégies d’évitement du risque font partie des éléments abordés dans le cadre des thérapies de groupe développées par de nombreuses structures de soins.
2. Expérimenter les cercles de soutien et de responsabilité
Les cercles de soutien sont un dispositif innovant qui donne lieu à des expériences assez nombreuses au Canada, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis. De manière générale, ces expériences consistent, pour les associations, à accompagner les auteurs d’infractions à caractère sexuel à leur sortie de détention et pendant une période de temps relativement longue, en étroite collaboration avec les pouvoirs publics.
Les cercles de soutien visent à tisser autour du délinquant sexuel un réseau social composé de plusieurs personnes bénévoles, dont la tâche est de prévenir l’isolement, facteur essentiel de la récidive pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Trois à quatre personnes bénévoles s’engagent à soutenir émotionnellement et de manière pratique un auteur d’infraction à caractère sexuel qui réintègre la société après une peine d’emprisonnement. Cette action est complétée par celle d’un second cercle, composé de professionnels et qui entoure le premier. Alors que la Belgique vient de mettre en place une telle initiative à Anvers, le Canada dispose aujourd’hui d’environ 150 cercles dans 19 villes et 9 provinces.
LE FONCTIONNEMENT DES CERCLES DE SOUTIEN ET DE RESPONSABILITÉ AU CANADA Les bénévoles sont sélectionnés : ils doivent présenter certaines garanties (stabilité, maturité, disponibilité, vie équilibrée) et avoir suivi une formation (portant notamment sur le système pénal, le modèle du cercle, la sexualité humaine et la déviance, les dynamiques d’un groupe, les ressources à leur disposition). La formation se décompose en une formation de base de 15 heures et en plusieurs formations complémentaires durant une année. Par ailleurs, les bénévoles sont secondés par des spécialistes et travaillent en collaboration avec des organismes communautaires et des professionnels, tels des psychologues, des agents de libération conditionnelle ou de probation, la police et les tribunaux. Avant la libération, les bénévoles rencontrent une première fois le membre principal qui parle de ses délits. À la fin de cette première rencontre, tous les participants décident s'ils sont prêts à s'engager. Après la libération de l’auteur d’infractions à caractère sexuel, le cercle se rencontre chaque semaine. Le partage commence toujours par les bénévoles afin d'habituer le membre principal à écouter les autres. Entre les réunions, les bénévoles restent disponibles aux besoins du membre principal de façon à fournir une présence au moment où elle pourrait le plus compter. Le cercle de soutien et de responsabilité assure également un suivi sur les décisions et les engagements. Le cercle contribue au développement d'une confiance entre ses membres et d'empathie, choses primordiales pour aider le membre principal à vivre en société. |
D’après différentes études et, notamment, un rapport publié en 2008 par le Service correctionnel du Canada (SCC)(218), la prise en charge par les cercles de soutien et de responsabilité contribue à la baisse du taux de récidive. Les délinquants qui ont participé à un cercle de soutien et de responsabilité présentent un taux notablement inférieur à celui des délinquants du groupe témoin qui n'y ont pas participé. Plus précisément, on trouve chez les premiers un taux de récidive sexuelle de 2,1 %, de 83 % inférieur à la récidive sexuelle du groupe témoin.
Certes, le recours à un tel dispositif semble peu séparable d’une culture associative profondément ancrée et d’une adhésion au principe de la justice réparatrice, laquelle suppose d’admettre une redéfinition des rôles au sein du système de justice pénale et repose sur une conception accordant à la victime une place centrale. Cela étant, les résultats en termes de taux de récidive tendent à montrer l’efficacité de ce dispositif et la nécessité d’expérimenter cette pratique en France.
Recommandation n° 24
Expérimenter l’accompagnement des auteurs d’infractions à caractère sexuel par des cercles de soutien et de responsabilité impliquant, avec une certaine sélection, des associations bénévoles.
IV. ÉTENDRE LE CHAMP DE LA CONNAISSANCE : DÉVELOPPER LA RECHERCHE THÉORIQUE ET LES COMPÉTENCES
Le constat établi par les travaux de la mission met en lumière la nécessité d’un rassemblement et d’un approfondissement des acquis théoriques, tant sur le plan de l’évaluation de la dangerosité des individus et leur propension à la récidive que sur celui des protocoles de soins susceptibles de leur être prodigués.
Répondre à cette exigence amène assez logiquement à prôner quatre orientations : en premier lieu, le développement de la recherche sur les auteurs d’infractions à caractère sexuel ; ensuite, la création d’une véritable filière criminologique en France qui accorde toute l’importance qu’elle mérite à l’étude des auteurs d’infractions à caractère sexuel ; en troisième lieu, la formation plus poussée de l’ensemble des professionnels œuvrant dans ce domaine ; enfin, une évolution des pratiques expertales destinées à l’évaluation de la dangerosité et à la prévention de la récidive, notamment par un recours accru aux échelles statistiques.
A. FÉDÉRER LA RECHERCHE SUR LES AUTEURS D’INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL
Il importe de rassembler les acquis d’une recherche qui, pour aborder, souvent de manière innovante, de nombreux thèmes relatifs aux auteurs d’infractions à caractère sexuel, ne se caractérise pas moins par une certaine profusion qui l’empêche d’être pleinement valorisée. Or, l’exemple du Canada montre l’intérêt de structurer la connaissance et la recherche autour de grandes structures travaillant à la fois sur la théorie, les statistiques, les traitements et la création d’outils pour les professionnels. Aussi, la mission juge-t-elle indispensable la création d’un centre public de recherche fondamentale et appliquée spécialisé dans les violences sexuelles.
Un tel organisme devrait associer l’ensemble des disciplines, juridique, psychologique, criminologique et médicale, intervenant dans ce champ. Il se donnerait pour mission principale de collecter et d’assurer la diffusion des connaissances et des avancées de la recherche en matière de droit, de psychiatrie, de psychologie et de criminologie, auprès de l’ensemble des intervenants dans la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Cet établissement pourrait être adossé à l’une des grandes structures de recherches existant en France, tel que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ou constituer une entité à part entière.
Recommandation n° 25
Créer un centre public de recherche fondamentale et appliquée spécialisé dans le traitement et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles qui s’attache à produire et à collecter une réflexion théorique portant à la fois sur les soins et de formation, en associant l’ensemble des acteurs du monde judiciaire et médical.
Par ailleurs, les travaux de la mission ont montré le caractère totalement insatisfaisant des incertitudes qui entourent le taux de récidive de cette population pénale. De fait, les pouvoirs publics ne disposent pas réellement de statistiques exploitables compte tenu même de la définition de la récidive et de sa comptabilisation dans les chiffres de la délinquance.
Aussi, aux yeux de la mission, il importe que les infractions à caractère sexuel fassent l’objet d’un traitement statistique spécifique. Ceci implique notamment que l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) traite spécifiquement de la problématique sexuelle dans le tableau général de la criminalité et de la délinquance et les études particulières qu’il établit périodiquement. En sa qualité d’organisme chargé de rendre compte de l’évolution des phénomènes criminels et délinquants ainsi que des politiques pénales suivies, l’ONDRP pourrait ainsi, en produisant des études à l’intention des pouvoirs publics, éclairer tant le pouvoir exécutif que le Parlement dans la définition d’une réponse adaptée.
Recommandation n° 26
Intégrer la problématique des infractions à caractère sexuel parmi les axes de travail de l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONRDP), notamment sous l’angle de l’étude des cas de récidive.
B. DÉVELOPPER UNE VÉRITABLE FILIÈRE CRIMINOLOGIQUE
Cet objectif ressort de l’analyse recueillie par la mission auprès des nombreuses personnes entendues au fil de ses travaux et rejoint les constatations renouvelées par notre collègue Jean-Paul Garraud, tant dans le cadre de l’examen du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle (219) que dans celui portant sur le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines (220) : alors que le droit pénal intègre désormais pleinement le concept de dangerosité, il manque à notre pays une véritable filière criminologique.
Au regard des pays européens et anglo-saxons, la France se singularise par son incapacité à produire des chercheurs en criminologie. De fait, comme le rapportent des professeurs d’universités, « nous sommes, vis-à-vis du reste du monde, parfaitement ridicules. Pas un Français […] dans les publications internationales ; pas un Français ou presque dans les conférences internationales ; pas un Français ou presque dans la recherche véritablement scientifique. Lors du dernier congrès de l’European society of criminology, il y avait près de sept cents criminologues européens, dont les travaux étaient de haute volée et pointus ; il ne s’y trouvait que quatre Français, dont aucun n’était véritablement criminologue » (221).
À l’heure actuelle, il n’existe pas, à proprement parler, de formation en criminologie. Toujours rattachés à un cursus de droit pénal ou de psychologie, la quarantaine de modules pseudo-criminologiques qui existent aujourd’hui ne permettent pas à la science criminologique de s’épanouir de façon autonome, comme c’est le cas dans d’autres pays. Ainsi, comme l’a souligné notre collègue Jean-Paul Garraud à l’occasion de l’examen du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines (222) : « notre pays souffre cruellement d’une insuffisance d’offre de formations professionnalisantes en criminologie. […] Dans les universités, des formations existent mais elles sont trop éparses et trop souvent éloignées de la réalité du terrain et de l’expérience des praticiens ».
C’est pourquoi, la mission demande la création d’unités de formation et de recherche (UFR) en criminologie, accessible en formation initiale comme en formation continue.
Si la mission note avec intérêt la création d’une unité d’enseignement au sein du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), elle estime nécessaire de compléter l’action de ce futur « pôle national de référence en criminologie » par un cursus universitaire complet, allant jusqu’au doctorat, et indépendant d’autres disciplines. En effet, la formation qui sera bientôt proposée par le CNAM vise à fournir les éléments d’une introduction générale à la criminologie de haut niveau et à donner accès à des éléments actualisés et appliqués. Elle est a priori destinée à un assez large public : titulaires d’une licence ou d’un Master 1 Droit, Science Politique, diplômés des écoles de police, de gendarmerie, de la magistrature, de l’administration pénitentiaire ; professionnels de la sécurité et du droit (avocats, officiers de police et de gendarmerie, officiers des armées, magistrats, journalistes). Si ce pôle sera assurément utile, il ne saurait dispenser les pouvoirs publics de la création de véritables UFR de criminologie.
Recommandation n° 27
Développer une véritable filière universitaire de criminologie en France, accessible en formation initiale comme en formation continue.
C. DÉVELOPPER DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES POUR LES ACTEURS DU SUIVI
Il faut également accorder toute sa place à la problématique des auteurs d’infractions à caractère sexuel dans le cadre de la formation initiale et continue de l’ensemble des professionnels intervenant dans le traitement et la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel : magistrats, conseillers d’insertion et de probation, psychiatres, psychologues.
Aux yeux des membres de la mission, cette thématique particulière doit notamment être abordée de façon plus poussée dans les programmes de la formation initiale dispensée par l’ensemble des écoles des métiers de la justice, à savoir les écoles nationales de la magistrature, de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, il importe que les magistrats disposent plus particulièrement d’éléments actualisés en criminologie, notamment dans le cadre de la formation continue.
Recommandation n° 28
Aborder la délinquance sexuelle dans le cadre de la formation initiale de l’ensemble des professionnels intervenant dans l’exécution de la peine et la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel : juges, personnels de l’administration pénitentiaire, psychiatres et psychologues.
Recommandation n° 29
Favoriser l’accès des magistrats à des éléments précis et actualisés de criminologie par le biais de la formation continue.
Il s’avère en effet que si nombre de psychiatres ne disposent pas de formation en criminologie, certains ont complété leur formation médicale en l’élargissant, de leur propre initiative, au champ de la psychocriminologie. Il importe donc de formaliser ces savoirs et d’en assurer la transmission aux jeunes psychiatres qui pourraient éprouver des réticences à s’engager dans l’expertise. Aussi la mission retient-elle l’idée de la création d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) de psychiatrie médico-légale, fondement d’une formation alliant la pratique du terrain et un tutorat assuré par des psychiatres expérimentés.
Recommandation n° 30
Créer un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) de psychiatrie médico-légale ainsi qu’un tutorat pour les internes en psychiatrie désireux de s’engager dans l’expertise, le suivi ou le traitement notamment des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Disposer d’éléments fondamentaux et actualisés en matière de criminologie concernant les auteurs d’infractions à caractère sexuel représente d’autant plus un impératif que les avancées de la recherche théorique permettent de mieux appréhender les modalités de la prise en charge et du soin de cette population, aux différents stades de l’exécution des décisions de justice pénale. Cette extension du champ de la connaissance affecte également l’expertise, l’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, les avancées du savoir devant conduire en toute logique au renouvellement des pratiques en ce domaine.
D. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE RÉALISATION DES EXPERTISES
1. Assurer l’attractivité de la fonction d’expert
Remédier à la pénurie actuelle d’experts psychiatres implique d’améliorer les conditions d’exercice de la fonction d’expert sur plusieurs plans.
Du point de vue du recrutement, la mission soutient les différentes initiatives tendant à favoriser l’exercice des missions d’expertise par les psychiatres au début de leur carrière. Ainsi, le contrat d’engagement, prévu par le projet de loi de programmation sur l’exécution des décisions de justice (223), constitue un outil intéressant en ce qu’il incite les internes en psychiatrie à se tourner vers la psychiatrie médico-légale et à s’inscrire, une fois devenus médecins, sur les listes d’experts judiciaires. Il devrait être assorti d’un tutorat assurant l’encadrement des jeunes experts par des experts confirmés.
D’un point de vue administratif, il convient peut-être d’alléger les modalités de la demande de renouvellement d’inscription sur les listes des cours d’appel, notamment du point de vue des justificatifs à fournir en application de l’article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires. Il convient également de veiller à ce que les praticiens hospitaliers puissent, sans formalités excessives, concilier la réalisation d’expertises judiciaires avec leurs obligations de service, conformément à l’esprit de l’article 7 ter du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines (224) qui a pour effet d’adapter l’application des règles de la fonction publique concernant le cumul d’activité.
D’un point de vue financier, il importe de mieux rémunérer les missions accomplies par les experts dans le cadre judiciaire. À cette fin, il conviendrait, d’une part, de revaloriser le montant des honoraires versés aux experts psychiatres pour la réalisation des expertises concernant les auteurs d’infractions à caractère sexuel de sorte que, dans la mesure du possible, celui-ci corresponde au temps passé à l’étude d’un dossier et aux frais engendrés par la participation à audience, notamment en cours d’assises.
D’autre part, il conviendrait de clarifier les conditions d’imposition des indemnités perçues au titre de la réalisation des expertises, s’agissant notamment des modalités d’assujettissement aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. De manière pratique, il importe de réduire les délais de paiement de ces indemnités.
Enfin, aux yeux de la mission, l’attractivité de la fonction d’expert doit être confortée par la possibilité d’un travail pluridisciplinaire. Dans cette optique, elle appelle les pouvoirs publics à favoriser la réalisation des expertises par deux psychiatres, de sorte de favoriser l’établissement d’un diagnostic étayé par la confrontation de deux points de vue. Par ailleurs, il serait utile de permettre aux psychiatres, notamment lorsqu’ils débutent dans ces fonctions, de travailler à plusieurs, au sein d’un pool de psychiatres, afin d’enrichir les pratiques professionnelles.
Recommandation n° 31
Revaloriser le statut des experts pour orienter vers cette fonction des praticiens libéraux et de jeunes psychiatres : revalorisation financière, raccourcissement des délais de paiement, mise en place d’un tutorat, révision du statut des praticiens hospitaliers, simplification des démarches administratives, possibilité d’un travail collégial.
2. Poser les conditions d’un travail pluridisciplinaire dans l’évaluation de la dangerosité
Il importe que l’évaluation mette pleinement à profit le savoir des différentes disciplines qui permettent d’appréhender le fonctionnement psychique des auteurs d’infractions à caractère sexuel et de mobiliser, dans la réalisation de l’expertise, tous les professionnels susceptibles de fournir, par un savoir spécialisé, un éclairage pertinent sur la dangerosité de ces personnes.
Dans cette optique, la mission estime que constitue une mesure utile la faculté, pour le juge de l’application des peines (225), de recourir à un psychologue et à un psychiatre pour l’expertise conditionnant la libération conditionnelle des personnes condamnées à un crime pour lequel le placement en rétention de sûreté est possible.
Cette disposition favorise en effet la mise en place d’un travail pluridisciplinaire en permettant d’appréhender le fonctionnement de l’auteur d’une infraction à caractère sexuel dans toutes ses dimensions, suivant deux approches distinctes mais utilement complémentaires, entre le psychiatre et un psychologue. L’expertise psychologique apporte d’autres éléments concernant la personnalité de l’auteur d’infraction qui complètent l’expertise psychiatrique, laquelle porte une analyse et un diagnostic quant à la dangerosité proprement psychiatrique de la personne. De façon plus pragmatique, ce dispositif permet, en réduisant les besoins en experts psychiatres, de remédier au problème posé par l’augmentation des expertises que requiert la procédure pénale dans un contexte marqué par des effectifs insuffisants.
Le même souci de promotion d’un travail pluridisciplinaire dans la conduite des expertises justifie d’envisager la création de nouveaux centres régionaux d’évaluation pluridisciplinaire intégrant des psychiatres et des psychologues spécialisés.
Il s’agit, d’une part, de prendre toute la mesure de l’augmentation des besoins en expertise induits par l’évolution du droit pénal et, d’autre part, de tirer au mieux les enseignements de l’expérience très positive du centre national d’évaluation de Fresnes en matière d’expertise. Ces centres régionaux pourraient fonctionner suivant une démarche analogue à celle suivie dans cette structure, c'est-à-dire en organisant l’élaboration en commun des évaluations et de l’orientation des personnes condamnées entre psychiatres, psychologues, psychologues du travail ainsi qu’éventuellement des personnels d’insertion et de probation.
Ces centres doivent véritablement permettre le développement d’une offre de proximité en matière d’expertise et d’évaluation des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Certes, le projet de loi de programmation relative à l’exécution des peines prévoit la création de trois centres nationaux d’évaluation qui viendront s’ajouter aux capacités d’évaluation de la dangerosité qu’offrent le centre de Fresnes ainsi que le centre tout récemment ouvert de Réau (Seine-et-Marne) (226). Toutefois, il apparaît que les capacités de ces centres ne permettront sans doute pas de répondre à l’ensemble des demandes. D’où la nécessité de développer davantage de structures de ce type.
Recommandation n° 32
Développer de nouveaux centres régionaux d’évaluation pluridisciplinaires, afin de répondre à l’augmentation des besoins expertise et intégrer des psychiatres spécialisés au sein des équipes.
E. MIEUX TIRER PARTI DES ÉCHELLES ACTUARIELLES
1. Des méthodes qui renouvellent la pratique de l’évaluation
Les méthodes dites « actuarielles » se distinguent de l’entretien clinique en ce qu’elles visent à évaluer la dangerosité ou le risque de récidive à partir de l’étude de probabilités statistiques. Cette méthode s’inspire des enquêtes menées par les compagnies d’assurances et leurs actuaires visant à établir une prévision en fonction d’une combinaison d’informations et de données brutes. À partir de l’étude de données statistiques relatives à une population délinquante, des facteurs de récidive apparaissent, qui peuvent ainsi servir de base à l’évaluation d’une personne particulière. Elles fournissent ainsi une indication, en fonction de facteurs objectifs, sur la probabilité qu’une récidive.
La méthode Static-99, créée en 2000 par deux chercheurs canadiens, Karl Hanson et David Thornton, est la plus couramment utilisée. Au travers de dix facteurs de risque, elle permet d’établir une « cotation » (227), déterminant une probabilité quant au comportement futur de la personne condamnée pour infraction sexuelle. Les principaux facteurs de risques identifiés par les différentes échelles actuarielles existantes sont : l’âge de l’auteur, la cohabitation passée avec un adulte, les antécédents de violences sexuelles et non sexuelles, les antécédents judiciaires en général, une victime sans lien de parenté, une victime inconnue, une victime de sexe masculin, la révocation d’une mesure de probation. D’autres méthodes existent, comme la SORAG, qui prennent en compte des facteurs de risque supplémentaires : consommation d’alcool, troubles de la personnalité, troubles psychiatriques, évaluation phallométrique, psychopathie sur l’échelle de Hare (228), adaptation scolaire, avoir vécu ou non avec les deux parents biologiques jusqu’à l’âge de 16 ans.
Couramment utilisées à l’étranger, les méthodes actuarielles suscitent en France sinon un sentiment de défiance, du moins une réticence nette de la part de la majorité des praticiens.
L’UTILISATION DES ÉCHELLES ACTUARIELLES À L’ÉTRANGER Aux États-Unis, pays où elles ont vu le jour au début du XXe siècle, les méthodes actuarielles apparaissent très fréquemment utilisées dans le cadre de la lutte contre la récidive. Ainsi, en 2008, vingt-huit États américains en faisaient usage pour fonder des décisions de condamnation et d’aménagements de peine mais également pour l’élaboration de profils-types de délinquant justifiant des pratiques policières ciblées sur certaines populations (229). Au Canada, si l’évaluation clinique occupa une place prédominante jusqu’à la fin des années 1980, elle s’est vue progressivement compléter, depuis les années 1990, par des échelles actuarielles établies, pour les mêmes usages, sur le modèle de celles élaborées aux États-Unis. De même, de nombreux pays d’Europe recourent, de manière assez fréquente, aux méthodes actuarielles. En atteste notamment une étude comparative (230) réalisée dans 15 pays de l'Union européenne sur l’utilisation des échelles actuarielles.
Source : D. Giovannangeli, J. Ph Cornet, Ch. Mormont, « Étude comparative réalisée dans les 15 pays de l'Union européenne sur les méthodes et les techniques d'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive des personnes présumées ou avérées délinquants sexuels », 2000. |
Par contraste, la France se présente comme l’un des seuls pays dont les professionnels expriment en majorité une méfiance envers les méthodes actuarielles puisqu’elle ne recourt à aucune des différentes échelles existant dans le monde pour l’évaluation du risque de récidive. Ce bilan, établi à l’orée des années 2000, vaut encore aujourd’hui puisque l’emploi des méthodes actuarielles demeure très minoritaire en France. Seuls une trentaine d’experts psychiatres sur un peu plus de 500 recourent à ces méthodes pour compléter leur analyse. De fait, peu d’experts psychiatres sont formés à l’usage de ces outils, pourtant libre d’accès.
2. Une échelle française sophistiquée pour compléter l’entretien clinique
Certes, les échelles actuelles donnent lieu à quelques critiques, que la mission n’ignore pas. En particulier, l’efficacité des méthodes actuarielles dépend intrinsèquement de la représentativité des échantillons sur l’étude desquels elles reposent. Or, dans un certain nombre de cas, l’échantillon s’avère peu représentatif, soit qu’il porte uniquement sur des délinquants étrangers, soit qu’il ait été recueilli au sein de structures psychiatriques qui accueillent une minorité non représentative des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il pourrait donc être utile de valider une échelle actuarielle française qui évite ces deux écueils méthodologiques.
Les échelles actuarielles sont également critiquées en ce qu’elles figent un individu dans un état de dangerosité donné non susceptible d’évoluer puisque basé sur des facteurs objectifs intangibles. Dès lors, elles ne peuvent pas permettre d’évaluer l’évolution de la personne condamnée et ne tiennent pas compte des traitements et thérapies qu’il aurait pu suivre. C’est pourquoi, il importe de préférer à ces échelles dites de première génération des outils plus sophistiqués qui prennent en compte des « facteurs de protection » en plus des facteurs de risque, mais également des facteurs dits dynamiques, susceptibles d’évoluer au cours du temps.
Les échelles dites semi-structurées s’inscrivent dans une perspective quelque peu différente de celle des échelles actuarielles, dans la mesure où ces outils incorporent dans l’analyse des facteurs liés à des aspects cliniques et au contexte futur de l’individu. Suivant la définition donnée par les docteurs Alexandre Baratta, Pauline Schwarz et George-Alin Milosescu (231), « les échelles dynamiques consistent en des entretiens cliniques structurés permettant l’évaluation du risque de récidive et de la gestion du risque futur de violence ».
Les échelles HCR-20 ou START, par exemple, répondent à cette méthodologie. Elles reposent sur l’examen systématique d’éléments permettant d’apprécier le degré de protection ou de sûreté que présentent l’environnement et les modalités de suivi des personnes condamnées. L’analyse des facteurs de risque comporte l’étude :
— du passé, soit d’aspects historiques statiques relativement classiques (antécédents personnels comme victime de violence, antécédents de violence, âge du premier de passage à l’acte, stabilité des relations intimes, problèmes liés à l’emploi, échec d’une mesure de probation) ;
— du présent, soit d’aspects cliniques susceptibles d’évoluer au cours du temps (gravité des symptômes, dépression, impulsivité, hostilité, résistance aux traitements, distorsions cognitives …) ;
— du futur, soit d’aspects relatifs à la gestion du risque, sur lesquels l’action des pouvoirs publics peut avoir un impact (inscription dans un suivi rapproché, suivi d’un traitement…) ou, en tout cas, dynamiques (isolement, soutien familial, précarité ou dépendance financière).
Enfin, par-delà la pratique même de l’expertise, une telle démarche suscite la crainte de voir la justice pénale se déshumaniser et, en particulier, de remettre en cause le principe cardinal de l’individualisation des peines. Dans cette optique en effet, si les décisions de justice venaient à dépendre de statistiques considérées comme objectives, la justice n’appréhenderait plus l’individu dans sa singularité mais ne se prononcerait que sur des catégories de sujets désincarnés. Aussi convient-il de limiter l’usage de ces outils à l’expertise psychiatrique ou psychologique et de ne pas permettre leur utilisation directe dans le cadre de décisions judiciaires de jugement ou d’aménagement de peine, comme c’est le cas dans certains pays étrangers.
Du point de vue des résultats, les expériences empiriques et les études académiques dont la mission a eu connaissance tendent à montrer une plus grande fiabilité des évaluations conduites au moyen d’échelles qu’avec les entretiens cliniques. Ainsi, une étude réalisée en 2009 (232) par Karl Hanson et Kelly Morton-Bourgon sur l’exactitude des prédictions sur le risque de récidive laisse à penser que les échelles sont plus efficaces que les entretiens cliniques. En effet, selon cette analyse basée sur 118 études de prédictions, alors que le degré d’exactitude de la prédiction faite par un jugement professionnel structuré s’élève à 0,46, la méthode actuarielle obtient un indice de 0,67. De surcroît, il s’avère que l’utilisation d’outils statistiques peut aider les praticiens dans leur travail en leur facilitant leur prise de décisions. On notera du reste que dans des recommandations publiées en juin 2010, l’Académie nationale de médecine préconisait l’emploi des méthodes actuarielles.
Du point de vue de la mission, ces méthodes ne sauraient être tenues pour des outils infaillibles qui dispenseraient les professionnels chargés de l’expertise de réaliser une évaluation circonstanciée, prenant en considération le dynamisme psychique de l’individu sous main de justice. Mais l’on peut raisonnablement penser que les échelles actuarielles « représentent des balises essentielles dans le développement de méthodes d’évaluation permettant de prédire la récidive sexuelle» (233). Il reste néanmoins à désigner les outils les plus performants qui relèvent de cette méthode et à établir une doctrine appropriée pour leur emploi qui permette d’appréhender les individus dans leur singularité et tienne compte des avancées de la recherche en matière d’évaluation de la dangerosité et de la récidive.
Recommandation n° 33
Valider une échelle actuarielle française prenant en compte des facteurs de protection ainsi que des facteurs dynamiques, dans le cadre des expertises psychiatriques en complément des entretiens cliniques.
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION
Au cours de sa réunion du 29 février 2012, la Commission procède à l’examen du rapport de la mission d’information présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur.
M. Étienne Blanc, rapporteur. Mes chers collègues, c’est dans l’optique des travaux de la mission d’information créée en 2007 que je vous présente aujourd’hui mon rapport, qui a pour thème le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Ce rapport poursuit deux objectifs : tout d’abord, établir un état des lieux du droit applicable et de l’exécution concrète des peines de ces condamnés ; ensuite, formuler des recommandations susceptibles de remédier aux dysfonctionnements qui émaillent parfois le suivi d’individus dont les infractions réclament, par leur singularité, une réponse spécifique.
Il s’agit à l’évidence d’un sujet délicat en raison même de sa complexité et de la diversité des considérations pénales, criminologiques, médicales et psychologiques qui entrent en jeu.
Il ressort des constatations établies par le rapport une idée centrale : le traitement et la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel ne sauraient se limiter à des mesures d’emprisonnement ou de surveillance.
Il convient de prendre en considération la particularité même du profil de ces individus. Ceux-ci ne souffrent que rarement d’une pathologie proprement psychiatrique et conservent donc, pour la plupart d’entre eux, la conscience de leurs actes. Aussi les auteurs d’infractions à caractère sexuel sont-ils pénalement responsables. Mais leurs actes procèdent également de comportements déviants et, bien souvent, de troubles de la personnalité. C’est pourquoi la réponse pénale doit généralement comporter l’administration de soins.
En deuxième lieu, il importe de répondre à un certain nombre de questions que nous avions évoquées dès le lancement de nos travaux.
Premièrement, quels sont les vrais chiffres de la récidive sexuelle ? On observe une discordance profonde entre les chiffres fournis par le ministère de la Justice et ceux publiés par certaines associations de défense des victimes. Deuxièmement, nous nous sommes interrogés sur les failles éventuelles que notre droit pouvait comporter et sur la manière d’y remédier. Nous disposons aujourd’hui d’un dispositif juridique particulièrement complet, qui permet de répondre à l’ensemble des situations qui relèvent de la délinquance sexuelle. Troisièmement, nous nous sommes demandés quelles étaient les solutions les plus efficaces pour traiter ces individus et leur permettre de maîtriser leurs pulsions. Enfin, nous avons abordé l’épineux problème de la récidive et de l’évaluation de son risque.
C’est en s’efforçant de répondre à ces interrogations que le présent rapport a été conduit.
Dans sa première partie, il évalue le dispositif juridique peu à peu mis en place depuis la loi fondatrice du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Le rapport fait le constat d’un système très complet, qui associe, de manière pertinente, des mesures de surveillance et des obligations de soins. D’où cette conclusion que l’ensemble des membres de la mission partagent de manière unanime : il n’existe pas un instrument juridique qui pourrait être ajouté à ce droit positif déjà très complet.
Dans sa deuxième partie, le rapport aborde l’exécution des décisions de justice pénale sous l’angle de la mise en œuvre pratique du dispositif prévu par la loi. Il met en lumière, tout d’abord, un manque de coordination et de moyens des acteurs judiciaires et pénitentiaires qui nuisent à l’efficacité du suivi. Ensuite, nous avons relevé des difficultés inhérentes à l’expertise psychiatrique et à l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Nous avons d’ailleurs pu constater l’existence de divergences entre les différentes écoles de psychiatrie, qui recouvrent d’ailleurs parfois des conflits générationnels. C’est notamment le cas des méthodes actuarielles.
Enfin, nous avons relevé l’insuffisance de l’offre de soins à destination de ce public particulier. La France soutient mal la comparaison avec les dispositions d’autres pays européens. Ailleurs au sein de l’Union européenne, les dispositifs de soins sont mieux organisés, spécialisés et plus efficaces.
Dans la troisième et dernière partie, le rapport présente quelques pistes d’améliorations susceptibles d’améliorer le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Nous avons souhaité articuler ces mesures suivant trois axes.
Le premier axe porte sur la nécessaire simplification du droit applicable. C’est d’ailleurs le message que nous ont adressé de nombreux magistrats. Notre droit est en effet d’une rare complexité – ainsi que le montrent les tableaux insérés dans le rapport. Cela rend son application par les juges extrêmement périlleuse, notamment en matière d’application des peines, et fragilise les décisions qu’ils prennent.
Le deuxième axe consiste à mieux coordonner l’action des différents acteurs du suivi que sont le juge de l’application des peines, le conseiller d’insertion et de probation, le médecin coordonnateur et les structures de santé. Nous avons mis l’accent non seulement sur l’organisation des rapports entre les différents intervenants mais également sur la nécessité, par-delà la spécificité des cultures professionnelles, de développer un langage commun et d’améliorer les échanges d’information, sans pour autant remettre en cause le secret professionnel. C’est là le principal enjeu de la pluridisciplinarité de la prise en charge pénitentiaire et sanitaire des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Le dernier axe tient à l’élaboration d’un dispositif de soins et de prévention adapté. Dans cette perspective, il convient de mieux utiliser le temps carcéral et d’entamer en détention, chaque fois que cela est possible, un véritable traitement. Il faut ensuite élaborer une véritable offre de soins post-carcérale, notamment grâce à un réseau de consultations spécialisées et au recrutement de médecins coordonnateurs en nombre suffisant. Une carte insérée dans notre rapport montre en effet qu’un certain nombre de départements en sont totalement dépourvus.
Il faut enfin donner à la puissance publique les moyens d’agir avant le passage à l’acte. C’est dans cet esprit que le rapport, en s’inspirant de pratiques en vigueur sur le territoire national et à l’étranger, propose la mise en place d’une ligne téléphonique d’écoute d’urgence et l’expérimentation de « cercles de soutien » avec le concours du milieu associatif.
Poser les conditions d’un suivi efficace des auteurs de violences sexuelles suppose par ailleurs de mieux les connaître. Aussi le rapport conclut-il à la nécessité de développer la recherche fondamentale et appliquée et de créer, en France, une véritable filière de criminologie, en coopération avec d’autres pays, notamment européens, qui délivrent déjà de telles formations universitaires.
Le rapport comporte ainsi 33 recommandations. Elles sont certes d’importance inégale. Certaines d’entre elles pourraient faire l’objet d’une application rapide. D’autres susciteront davantage de réserves et méritent peut-être des approfondissements. Cependant, ces propositions permettent d’aborder des sujets majeurs, notamment celui du secret médical indispensable à la protection des droits.
Je crois que nous disposons d’un panorama large et précis des problèmes et des enjeux de la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel. En cela, nous aurons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. C’est pourquoi, je vous propose d’adopter le rapport de la mission.
M. Dominique Raimbourg. Je souhaiterais, d’une part, dire tout le bien que je pense de ce rapport et, d’autre part, exprimer un regret.
Ce rapport a le mérite de se pencher sur la réalité des faits en mesurant notamment l’importance quantitative du nombre de récidivistes.
Sa conclusion est qu’il n’est pas besoin de lois nouvelles mais qu’il suffirait – cela n’est d’ailleurs pas si facile ! – de rendre effectifs les dispositifs existants et de se donner les moyens de développer les mesures de contrôle, de suivi et de prévention. Il met ainsi en avant le fait que l’enfermement n’est pas la seule solution.
Ce rapport, particulièrement réaliste, est l’exemple même d’un bon travail parlementaire. Néanmoins, je déplore son caractère tardif.
Ces cinq dernières années, le mille-feuille législatif n’a en effet cessé d’être enrichi de nouvelles couches, dans l’idée que l’aggravation des sanctions pénales pouvait constituer une réponse à la délinquance sexuelle. Nous avons fait du délinquant sexuel une figure d’épouvante, alors qu’il doit avant tout être considéré comme une personne qui a besoin d’être suivie et parfois soignée.
C’est donc avec satisfaction que je lis ce rapport, mais à regret que je constate qu’il aurait dû être rendu plus tôt, ce qui nous aurait épargné de débats stériles et inutiles.
M. Jean-Paul Garraud. Je salue le travail réalisé par Étienne Blanc, non seulement pour ce rapport, mais également pour la mission d’évaluation de l’exécution des peines qui se poursuit depuis cinq ans.
Permettez-moi de faire remarquer que le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines discuté aujourd’hui traite précisément de plusieurs questions évoquées dans le présent rapport, qu’il s’agisse de l’évaluation de la dangerosité, de la mise en place des médecins coordonnateurs ou des mesures en faveur des experts psychiatres.
Je m’insurge donc contre les propos tenus par mon collègue Dominique Raimbourg, qui insinue que nous avons voté une succession de textes sans lien entre eux. Loin d’être un mille-feuille, notre action, depuis ces cinq dernières années – et même depuis dix ans –, traduit la volonté de la majorité actuelle de traiter sous tous ses aspects le problème de l’effectivité de l’exécution des peines.
Évidemment, il reste beaucoup à faire. La proposition encourageant le développement d’une véritable filière de criminologie me paraît, par exemple, très importante. Sur ce sujet, j’ai d’ailleurs déposé une proposition de loi visant à mettre en place une école de psychocriminologie. Je rappellerai aussi qu’un important effort budgétaire a accompagné l’ensemble des réformes qui ont été réalisées ces dernières années.
Il est regrettable que l’opposition tienne toujours un discours négatif. Pourtant, qui remettrait aujourd’hui en cause les dispositions qui ont permis de donner toute son efficacité au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ou au fichier des empreintes génétiques ? Ou encore, qui souhaiterait revenir sur l’ouverture des centres d’éducation fermés, hier si critiqués, et auxquels le candidat socialiste à l’élection présidentielle se dit maintenant favorable ?
En cette fin de législature, la situation d’ensemble apparaît donc beaucoup plus positive qu’il y a quelques années. Sur tous les sujets, des progrès ont été réalisés, et cela pour le bien de nos concitoyens.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Je tiens à remercier notre collègue Étienne Blanc pour le travail très important qu’il a réalisé tout au long de cette législature.
La Commission autorise ensuite à l’unanimité le dépôt du rapport de la mission d’information relative à l’exécution des décisions de justice pénale en vue de sa publication.
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
Recommandation n° 1 : simplifier et clarifier le code de procédure pénale, en confiant cette mission à un comité composé de magistrats, d’avocats, de professeurs de droit et de personnalités qualifiées dont les propositions ne seront pas nécessairement faites à droit constant.
Recommandation n° 2 : limiter le recours obligatoire à l’expertise psychiatrique et rendre possible sa substitution, sous certaines conditions, par une expertise psychologique ou médico-psychologique.
Recommandation n° 3 : permettre au juge de l’application des peines de demander une évaluation de dangerosité non seulement avant une éventuelle libération conditionnelle mais à tout moment au cours de la détention.
Recommandation n° 4 : faire évoluer le dispositif technique de placement sous surveillance électronique mobile afin de permettre au juge d’utiliser de façon optimale cette possibilité.
Recommandation n° 5 : harmoniser la répartition des compétences entre le juge de l’application des peines et le conseiller d’insertion et de probation et favoriser l’établissement d’une relation directe entre ces deux acteurs.
Recommandation n° 6 : favoriser la signature de conventions ou de protocoles entre les acteurs locaux du suivi des auteurs de violences sexuelles, afin de mieux coordonner l’action des différents professionnels intervenant dans ce domaine.
Recommandation n° 7 : rendre possible la mise en place d’une cellule de suivi renforcé, réunissant le juge de l’application des peines, le procureur, le conseiller d’insertion et de probation, la police ou la gendarmerie, ainsi que les autorités municipales et préfectorales dans les cas où le risque de récidive apparaît particulièrement élevé.
Recommandation n° 8 : assurer une meilleure répartition des effectifs de conseillers d’insertion et de probation sur le territoire et recentrer ces personnels sur leur cœur de métier.
Recommandation n° 9 : généraliser la possibilité de confier les dossiers particulièrement complexes à deux conseillers d’insertion et de probation.
Recommandation n° 10 : mettre en place des modules de formation communs à l’ensemble des intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, par le biais des CRIAVS.
Recommandation n° 11 : rénover le logiciel APPI afin qu’il soit effectivement utilisé par les juges et conseillers d’insertion et de probation et qu’il assure un gain de temps réel à ses utilisateurs.
Recommandation n° 12 : accélérer la mise en service du Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires.
Recommandation n° 13 : poursuivre la spécialisation des établissements pénitentiaires et des équipes soignantes en milieu carcéral, tout en respectant le principe de maintien des liens familiaux par une meilleure répartition des établissements sur le territoire.
Recommandation n° 14 : mettre en place, en milieu fermé, des programmes intensifs volontaires à destination des auteurs de violences sexuelles dans chaque établissement spécialisé sur le modèle de l’Unité psychiatrique de Fresnes.
Recommandation n° 15 : permettre aux thérapeutes de continuer à suivre en milieu ouvert les patients qu’ils accompagnaient en détention, dans un souci de continuité des soins et d’efficacité au long cours des thérapies suivies grâce au maintien de l’« alliance thérapeutique ».
Recommandation n° 16 : favoriser l’émergence et le développement de consultations post-pénales identifiées et spécialisées dans le traitement des auteurs de violences sexuelles, sur le modèle de l’unité ÉRIOS de Bordeaux ou de l’unité PARI de Grenoble.
Recommandation n° 17 : confier à un centre post-peine spécialisé le suivi médical, psychologique et psychiatrique des cas les plus complexes.
Recommandation n° 18 : permettre à des psychologues spécialisés dans les auteurs de violences sexuelles d’exercer les fonctions de coordonnateur, sous la responsabilité d’un médecin psychiatre, afin de répondre à la pénurie de médecins coordonnateurs.
Recommandation n° 19 : formaliser les conditions d’exercice des fonctions de coordonnateurs et les relations avec les services de la Justice par la diffusion d’un vade-mecum et référentiel des pratiques ainsi que par la conclusion d’un protocole de collaboration institutionnalisée.
Recommandation n° 20 : établir des indicateurs de ressources et de résultats afin d’évaluer l’action des CRIAVS, qui prendraient notamment en compte l’exercice systématique de la mission d’appui opérationnel et de coordination de l’offre de soins destinée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Recommandation n° 21 : accorder aux CRIAVS la compétence de principe de constituer des plateformes référentielles cliniques avec les structures assurant les consultations post-pénales ouvertes aux auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Recommandation n° 22 : charger les CRIAVS d’une mission d’information et de sensibilisation destinée à inciter les thérapeutes à l’exercice des fonctions de médecins coordonnateurs.
Recommandation n° 23 : mettre en place un numéro d’écoute d’urgence, anonyme et gratuit, disponible 24h sur 24h, pour prévenir le passage à l’acte et orienter rapidement les personnes en demande de soins vers des structures d’accueil d’urgence.
Recommandation n° 24 : expérimenter l’accompagnement des auteurs d’infractions à caractère sexuel par des cercles de soutien et de responsabilité impliquant, avec une certaine sélection, des associations bénévoles.
Recommandation n° 25 : créer un centre public de recherche fondamentale et appliquée spécialisé dans le traitement et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles qui s’attache à produire et à collecter une réflexion théorique portant à la fois sur les soins et de formation, en associant l’ensemble des acteurs du monde judiciaire et médical.
Recommandation n° 26 : intégrer la problématique des infractions à caractère sexuel parmi les axes de travail de l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONRDP), notamment sous l’angle de l’étude des cas de récidive.
Recommandation n° 27 : développer une véritable filière universitaire de criminologie en France, accessible en formation initiale comme en formation continue.
Recommandation n° 28 : aborder la délinquance sexuelle dans le cadre de la formation initiale de l’ensemble des professionnels intervenant dans l’exécution de la peine et la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel : juges, personnels de l’administration pénitentiaire, psychiatres et psychologues.
Recommandation n° 29 : favoriser l’accès des magistrats à des éléments précis et actualisés de criminologie par le biais de la formation continue.
Recommandation n° 30 : créer un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) de psychiatrie médico-légale ainsi qu’un tutorat pour les internes en psychiatrie désireux de s’engager dans l’expertise, le suivi ou le traitement notamment des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Recommandation n° 31 : revaloriser le statut des experts pour orienter vers cette fonction des praticiens libéraux et de jeunes psychiatres : revalorisation financière, raccourcissement des délais de paiement, mise en place d’un tutorat, révision du statut des praticiens hospitaliers, simplification des démarches administratives, possibilité d’un travail collégial.
Recommandation n° 32 : développer de nouveaux centres régionaux d’évaluation pluridisciplinaires, afin de répondre à l’augmentation des besoins expertise et intégrer des psychiatres spécialisés au sein des équipes.
Recommandation n° 33 : valider une échelle actuarielle française prenant en compte des facteurs de protection ainsi que des facteurs dynamiques, dans le cadre des expertises psychiatriques en complément des entretiens cliniques.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Mardi 20 septembre 2011
Direction de l’administration pénitentiaire
M. Stéphane Scotto, sous-directeur de l’état major de sécurité,
M. Benoît Grandel, adjoint au sous-directeur des personnes placées sous main de justice,
Dr Dominique de Galard, conseiller santé.
Centre médico-psychologique pour adultes de la Garenne Colombe
Dr Roland Coutanceau, psychiatre.
Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles
Mme Caroline Legendre Boulay, vice-présidente,
M. Jean Boitout, vice-président,
M. Alain Harrault, trésorier.
Mardi 27 septembre 2011
M. Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au CNRS,
Dr Arnaud Martorell, psychiatre des hôpitaux et expert auprès des tribunaux,
Mme Julie Bonneau, doctorante à l’Institut des sciences criminelles de l’Université de Poitiers
Jeudi 6 octobre 2011
Cabinet du garde des Sceaux
Mme Bénédicte Bertrand, conseillère pénale,
M. Bruno Clément, conseiller pénitentiaire.
Office central pour la répression des violences faites aux personnes (OCRVP)
M. Frédéric Malon, commissaire divisionnaire, chef de l’OCRVP,
M. Florent Gatherias, psychocriminologue.
Mardi 18 octobre 2011
Syndicats du personnel pénitentiaire d’insertion et de probation
M. Sylvain Roussilloux, secrétaire général adjoint du syndicat SNEPAP-FSU
M. Thierry Poux, membre du SNEPAP-FSU,
M. Fabrice Dorions, délégué de la CGT pénitentiaire.
Institut pour la Justice
M. Xavier Bébin, criminologue, délégué général,
Me Stéphane Maître, avocat,
Mme Alexia Robinet, responsable des relations institutionnelles.
Syndicats de la magistrature
Mme Virginie Valton, vice-présidente de l’Union syndicale de la magistrature
Mme Virgine Duval, secrétaire générale de l’Union syndicale des magistrats,
Mme Marie-Blanche Régnier, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature,
M. Benoist Hurel, secrétaire général adjoint du Syndicat de la magistrature.
Mardi 25 octobre 2011
Association l’Ange bleu – Association nationale de prévention et d’information concernant la pédophilie
Mme Latifa Bennari, présidente.
Personnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation
M. Philippe Arhan, directeur du SPIP de l’Ain,
Mme Isabelle Dauchez, chef du SPIP de Dordogne,
M. Alexandre Bastardo de Nascimento, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, SPIP de Dordogne,
M. Jean-Bernard Cazenave, chef du SPIP de Charente,
Mme Sophie Silvestrini, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, SPIP de Charente,
Mme Catherine Lupion, directrice du SPIP du Tarn,
M. Philippe de Castro, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, SPIP du Tarn.
Ministère de la Santé
Mme Annie Podeur, directrice générale de l’offre de soins.
Mardi 8 novembre 2011
Mme Josefina Alvarez, chercheuse.
Table ronde « Santé et prison »
Dr Bernard Lachaux, psychiatre à l’unité pour malades difficiles Henri Colin,
Dr Walter Albardier, responsable du Centre ressources pour intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles Midi-Pyrénées,
Dr Cyrille Canetti, responsable du service médico-psychologique régional de la prison de La Santé,
Dr Sophie Baron Lafôret, psychiatre, responsable du centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle d’Île-de-France.
Mardi 29 novembre 2011
M. Paul-Roger Gontard, doctorant de l’Université Aix-Marseille.
Représentants des experts psychiatres
M. Gérard Rossinelli, président de l’Association nationale des psychiatres experts judiciaires,
M. Norbert Skurnick, président de l’intersyndicale de psychiatres publics.
Académie de médecine
M. Edwin Milgrom, endocrinologue, directeur de recherche à l’INSERM,
M. Philippe Bouchard, professeur d’endocrinologie.
INSERM
M. Serge Stoléru, directeur de recherche.
Mardi 6 décembre 2011
M. Alexandre Baratta, psychiatre.
Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire
M. Olivier Razac, enseignant-chercheur.
Agence régionale de santé de Haute Normandie
M. Claude d’Harcourt, directeur.
Mardi 17 janvier 2012
Mme Martine Lebrun, présidente de l’Association nationale des juges de l’application des peines,
Mme Christine Lazerges, directrice de l’École doctorale de droit comparé de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
M. Bernard Cordier, psychiatre et expert près la Cour d’Appel de Versailles.
LISTE DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS
Vendredi 4 novembre 2011
UHSA du Vinatier
M. Hubert Meunier, chef d’établissement,
Dr Pierre Lamothe, chef du service de l’UHSA
Maison d’arrêt de Lyon-Corbas
M. Julien Morel d'Arleux, directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas,
M. Lefebvre, major pénitentiaire en charge du pôle PSE,
Mme Jacqueline Giraud-Sauveur, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au SPIP 69,
M. Jean-Pierre Bailly, DSPIP,
Mme Agnès Rauber, adjointe au DSPIP,
Dr Pierre Lamothe, médecin coordonnateur,
M. Jean-Pierre Salvarelli, Président le la commission médicale d'établissement du Vinatier.
Mercredi 9 novembre 2011
Centre de détention de Melun
Mme Valérie Stempfer, directrice du centre de détention,
Mme Nicole Breton, directrice interrégionale de Seine-et-Marne,
Mme Stéphanie Pélégrini, directrice du SPIP de Melun,
Mme Noémie Brûlé, CPIP au SPIP de Melun.
Mercredi 30 novembre 2011
Unité de Psychothérapies Applications Recherches Intersectorielles (PARI) -Centre hospitalier de Saint-Égrève (Grenoble)
M. Pascal Mariotti, directeur de l’établissement,
Dr. Pierre Murry, chef de pôle,
Dr. Sidney Cohen, médecin psychaitre, chef d’équipe à l’unité PARI,
Dr. Anne Laredo, psychiatre,
Dr. Anne-Laure Borel, psychologue.
CRIAVS Rhône-Alpes
M. André Grépillat, psychologue,
M. Donat Campanale, psychologue,
Mme Frédérique Laveze, psychologue clinicienne,
M. Pierre-Yves Emeraud, infirmier,
Mme Sylvie Espeil-Marc, infirmière,
Mme Claire Lambrinidis, documentaliste.
Mercredi 7 décembre 2011
Établissement public de santé national de Fresnes
M. Éric Moretti, directeur.
Centre national d’évaluation de Fresnes
Mme Decroix, directrice du centre pénitentiaire de Fresnes,
M. Tesse, directeur du CNE,
Mme Deyts, adjointe au directeur du CNE,
M. Provenier, chef de détention,
M. Planes, major,
M. Ravaino, surveillant,
Mme Clavandier, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation,
Mme Lopez, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation,
M. Petitzon, psychologue,
M. Cleva, psychologue,
Mme Lemarchand, psychologue du travail,
Mme Izard, surveillante orientrice,
Mme Monet, secrétaire.
Vendredi 9 décembre 2011 : visite de travail à Bordeaux
Centre aquitain ÉRIOS – Centre hospitalier Charles Perrens (pôle 3-4-7)
Centre hospitalier Charles Perrens-Unité ÉRIOS
M. Antoine de Riccardis, Directeur du Centre hospitalier Charles Perrens,
Dr Florent Cochez, psychiatre, responsable de l'unité ÉRIOS,
Dr Emmanuelle Floris, psychiatre,
Dr Virginie Mandon (Psychiatre),
Mle Florence Mulliez (psychologue),
M. Pierre Suquet (psychologue),
Mme Hélène Labeyrie (psychologue),
M. Eric Rouveyrol (psychomotricien),
M. François Decory (cadre de santé),
M. Eric Antona (secrétaire, documentaliste),
M. Sébastien Damour (psychologue stagiaire),
Mle Adèle Fabre (interne en psychiatrie),
M. Loïc Vergnolle (interne en psychiatrie).
Médecins coordonnateurs, Tribunal de grande instance de Bordeaux
Dr Michel Geffrault, médecin généraliste libéral,
Dr Régis Goumilloux, psychiatre à la retraite.
Agence régionale de santé d’Aquitaine
Dr Anne-Marie de Belleville, conseillère médicale de la direction générale de l’Agence régionale de Santé Aquitaine
Préfecture de la Gironde
M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité à la Préfecture de la Gironde
Direction interrégionale des Services pénitentiaires de Bordeaux
Mme Marie-Line Hanicot, directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux,
M. Jean-Michel Camu, directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Gironde.
Lundi 16 janvier 2012
Ministère de la Justice belge
Mme Ariane Deladriere, service de la politique criminelle,
Mme Margot Taeymans, service de la politique criminelle,
M. Alex Delvaux, juge de l’application des peines.
Centre d’appui bruxellois
Mme Michèle Janssens, psychologue et coordinatrice du CAB,
Mme Martine Mertens, psychologue,
M. Aziz Harti, psychologue.
Annexe 1 : Évolution des condamnations pour crimes ou délits selon le caractère sexuel ou non de l’infraction 173
Annexe 2 : Charte d’engagement du groupe de parole du SPIP de Paris 174
Annexe 3 : Protocole Santé-Justice relatif à la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel dans les établissements pénitentiaires 176
Annexe 4 : Formulaire de cotation de la méthode Static- 99 188
Annexe 5 : Les traitements inhibiteurs de libido : quelques repères médicaux et juridiques 189
Annexe 6 : Cadres juridiques de l’expertise psychiatrique 191
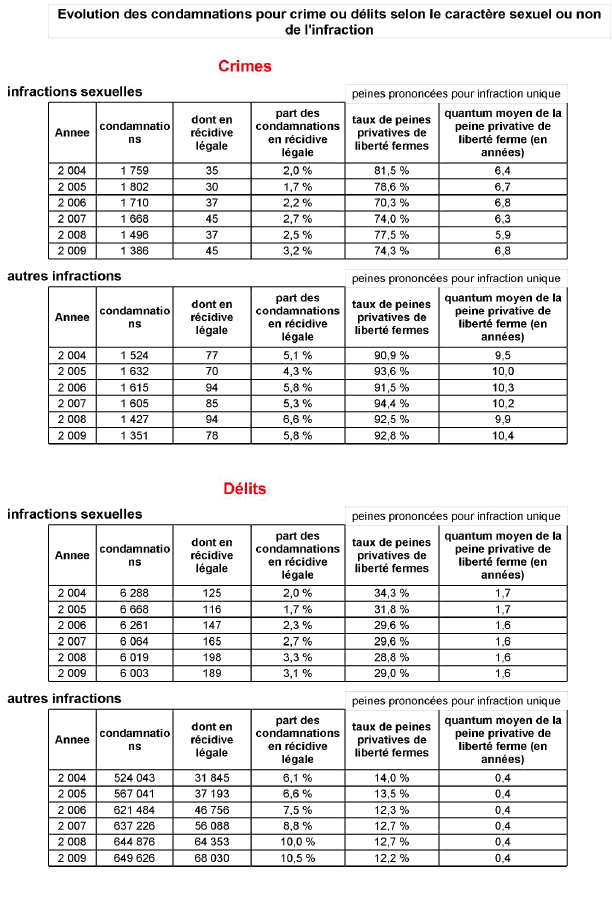
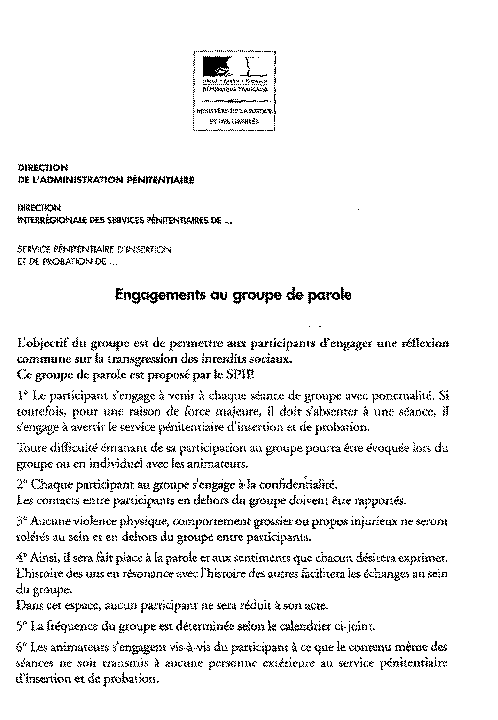
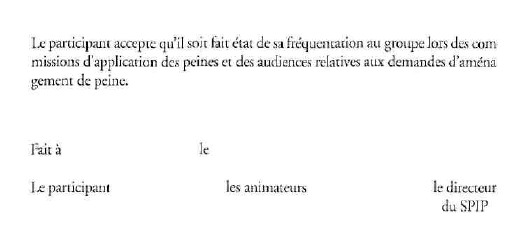
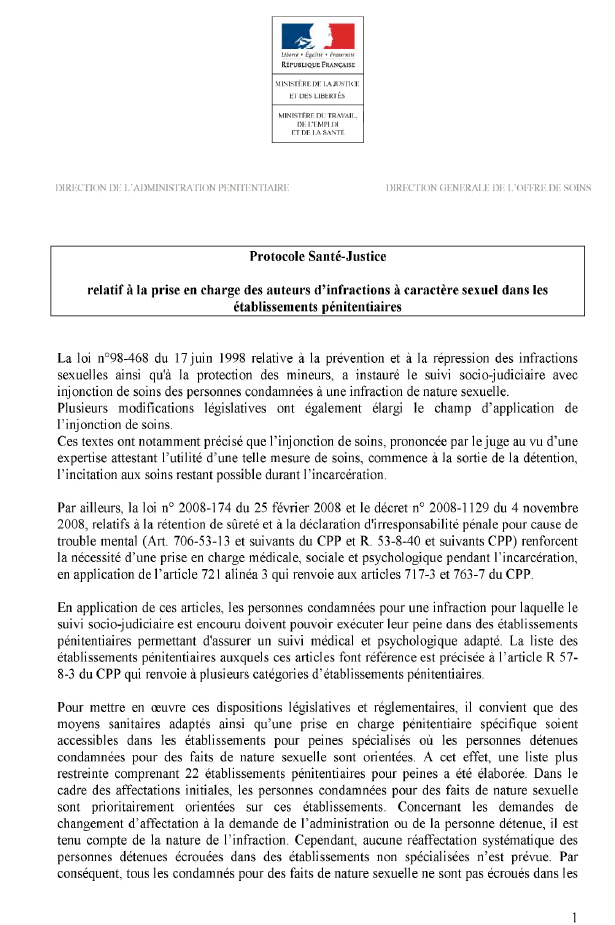
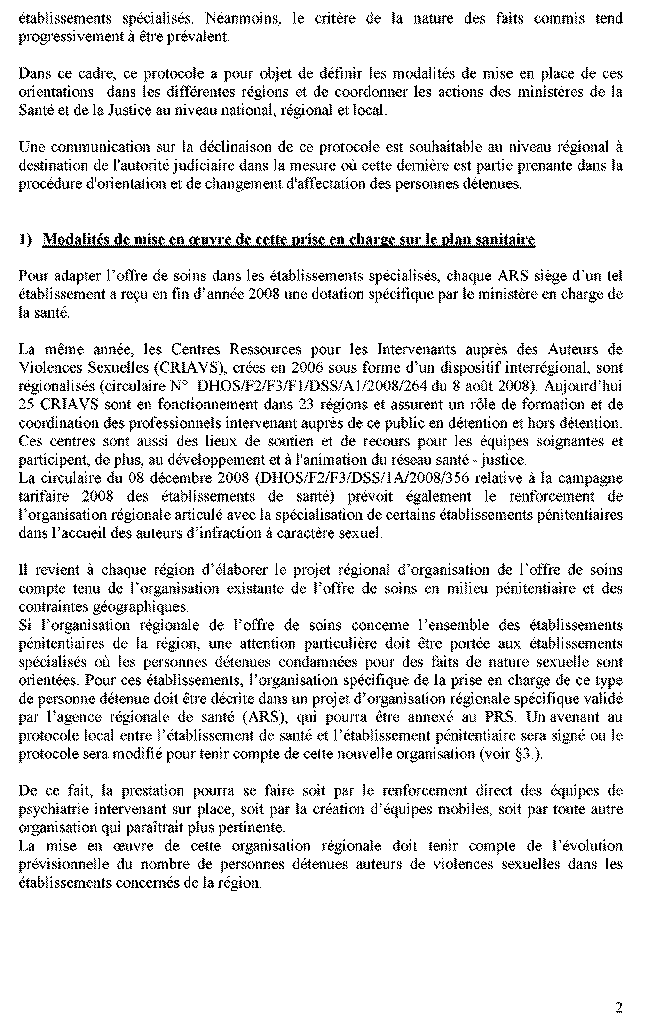
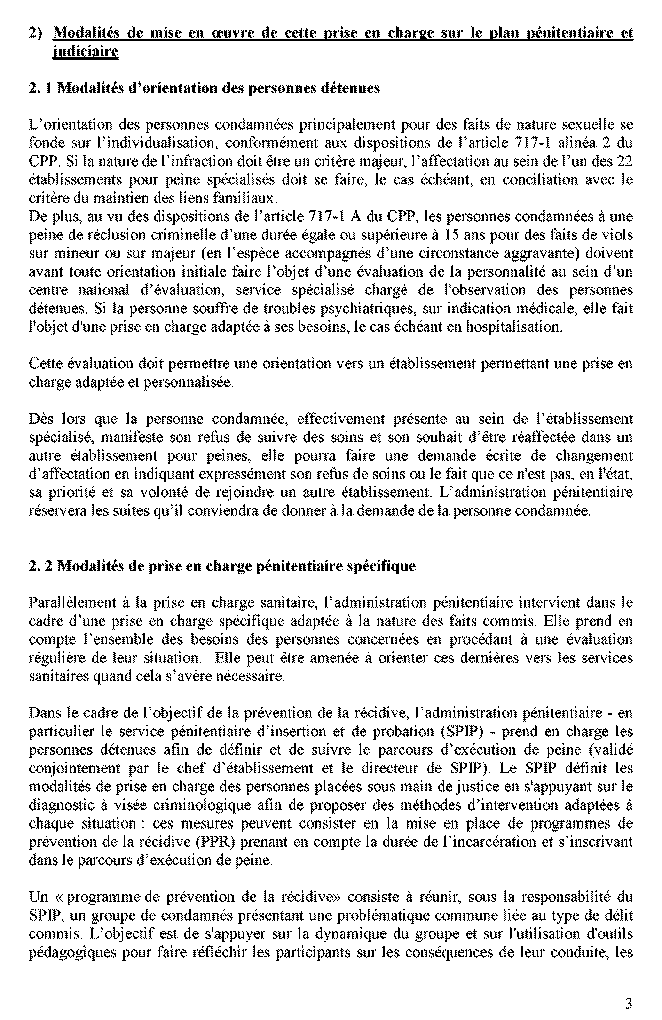
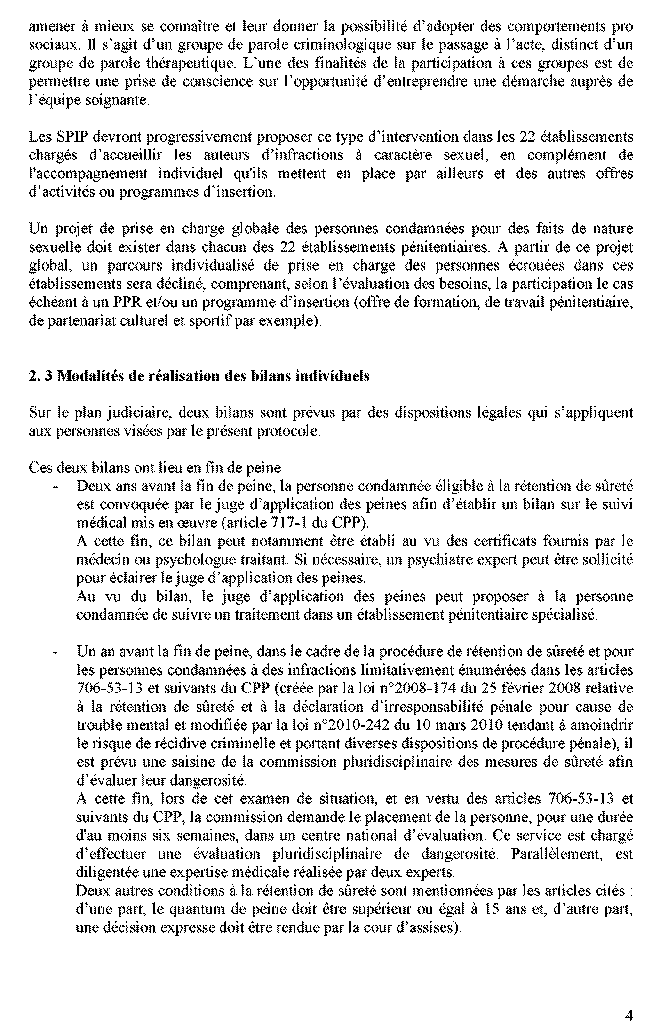
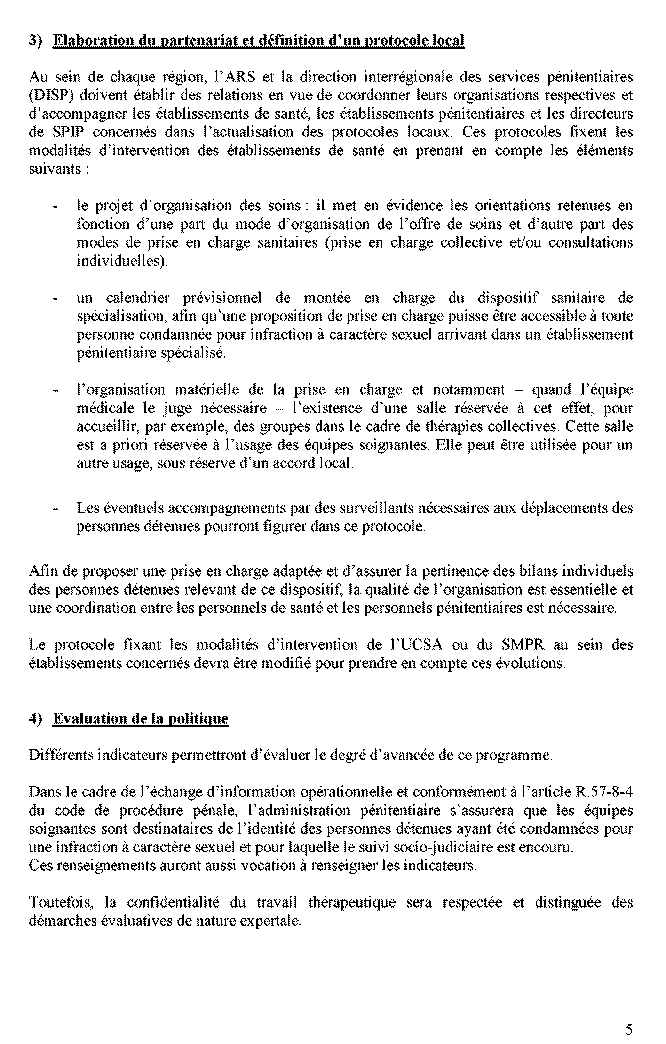
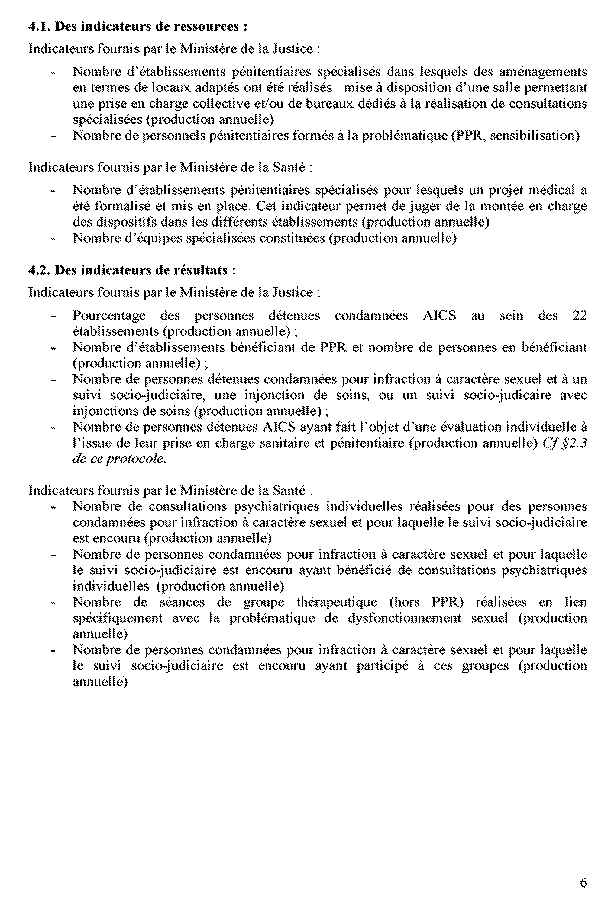
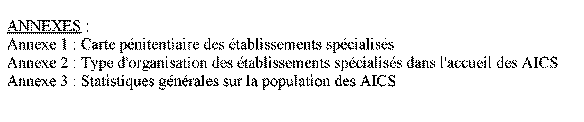
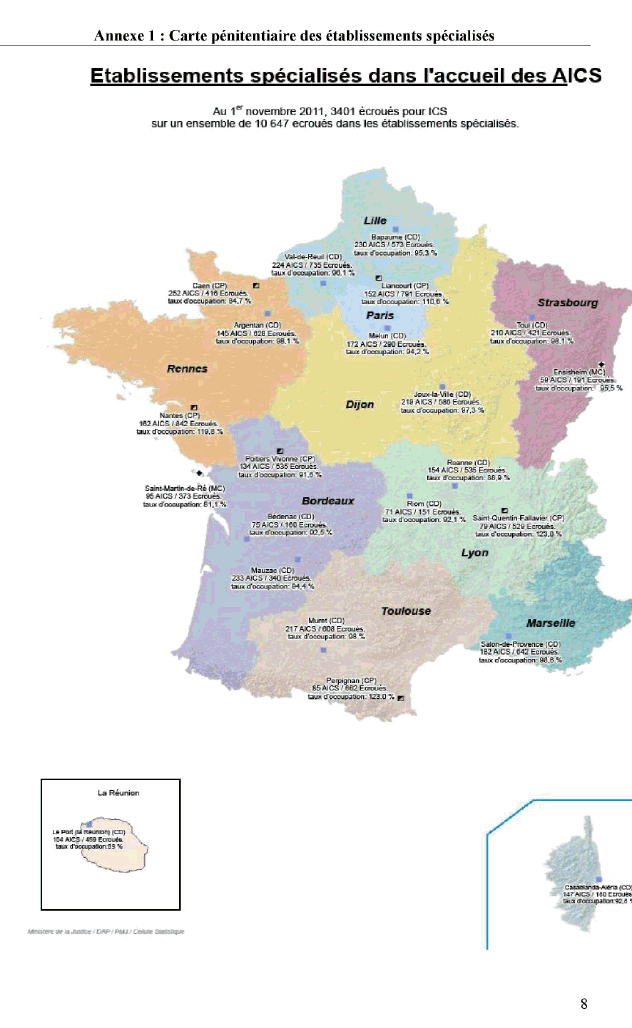
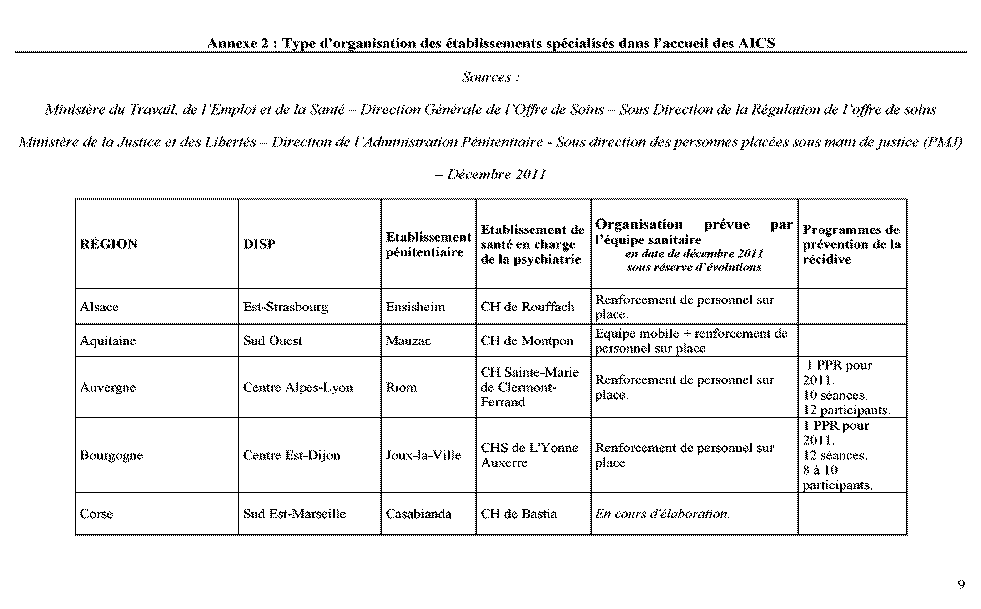
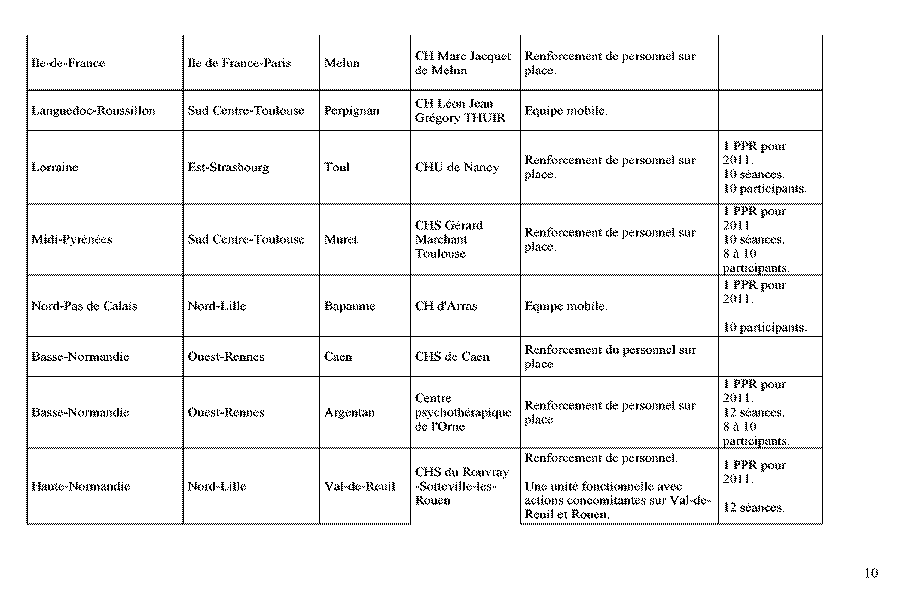
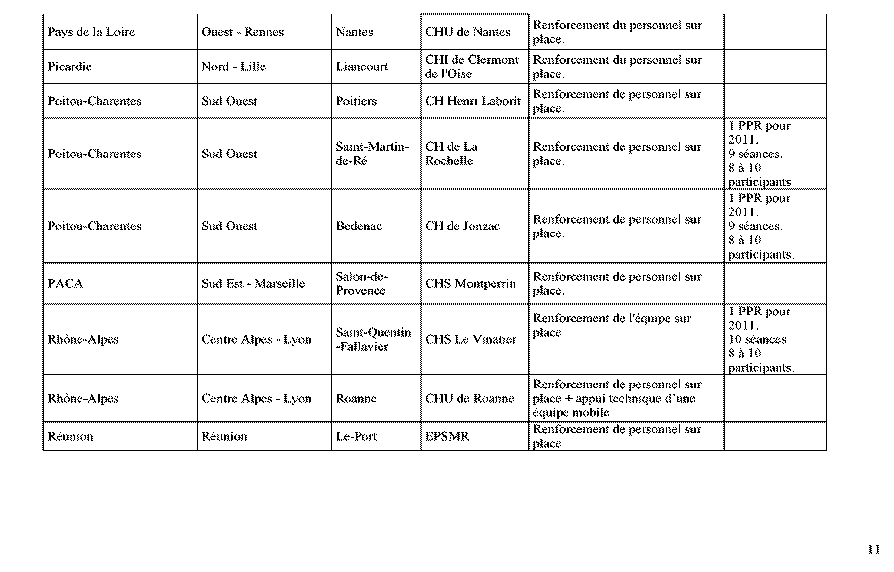
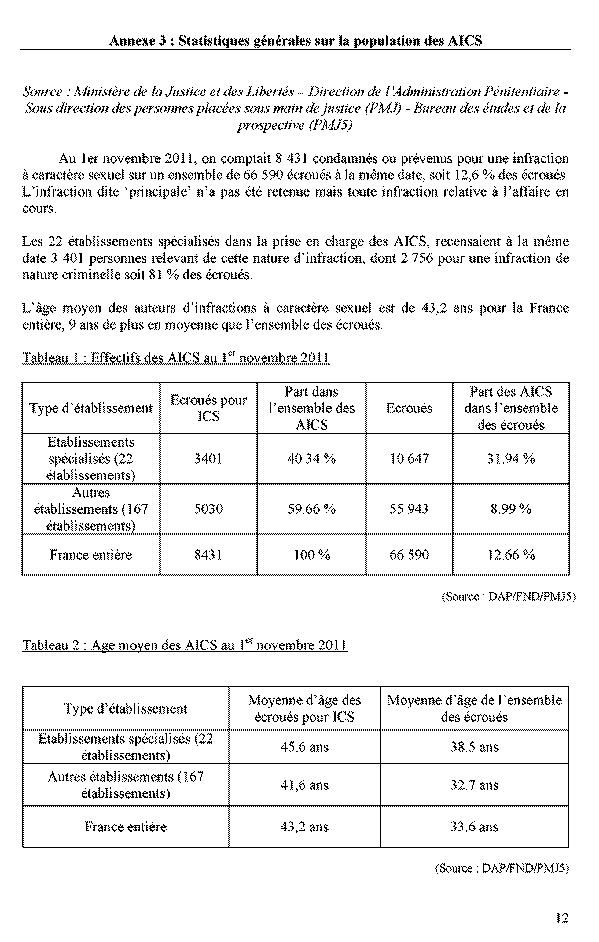
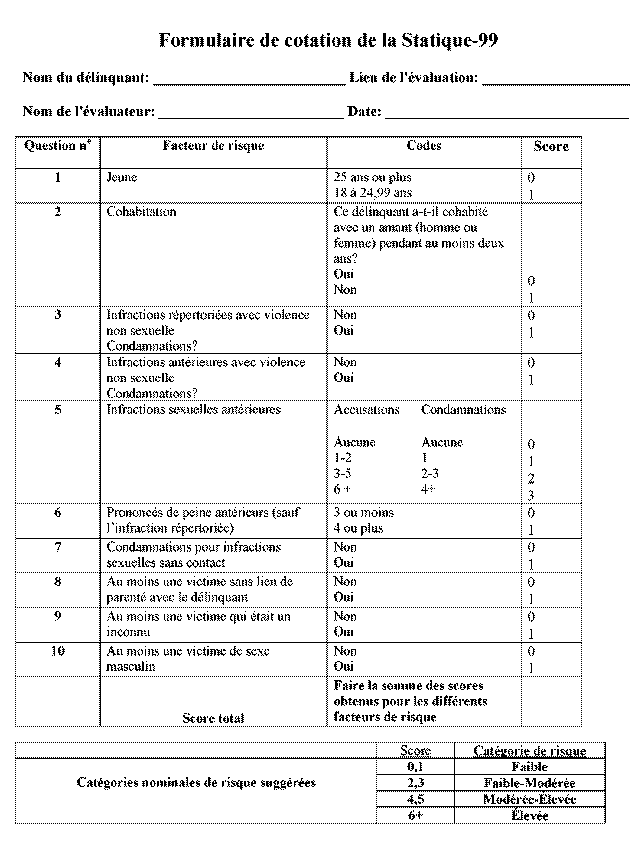
LES TRAITEMENTS INHIBITEURS DE LIBIDO : QUELQUES REPÈRES MÉDICAUX ET JURIDIQUES
Agissant sur la sécrétion des hormones à l’origine du désir sexuel, les traitements inhibiteurs de libido se rangent en deux catégories :
— les médicaments destinés à supprimer ou à réduire la production de testostérone : il s’agit par exemple de l’agoniste du GNrH ;
— les médicaments destinés à empêcher la production de testostérone sans la supprimer : ces traitements court-circuitent en l’occurrence le message transmis par la testostérone à l’hypophyse ; l’une des formules utilisées est l’Acétate cyproétone.
I. Les effets médicaux des traitements inhibiteurs de libido
Au plan médical, il s’avère que ces traitements peuvent présenter une certaine efficacité sous certaines conditions relativement restrictives : l’exclusivité du choix d’objet, son caractère obsédant, et l’intensité de l’ego. Ces conditions remplies, on constate une baisse importante de l’activité sexuelle déviante chez la personne soignée.
Toutefois, la durée minimale du traitement nécessaire pour minimiser le risque de rechute dans le comportement déviant ainsi que les modalités d’interruption du traitement demeurent inconnues. D’après quelques études, dans 2 cas sur 3, l’interruption du traitement s’accompagne de la réapparition du comportement déviant deux à trois mois après l’arrêt. Du reste, d’autres évaluations tendent à montrer que seuls 10 % à 15 % des auteurs d’agressions extra-familiales sur mineurs sont concernés par les traitements inhibiteurs de libido.
En réalité, l’efficacité du traitement dépend évidemment de la volonté du sujet de s’y astreindre et la qualité de l’accompagnement psychologique, le but étant à terme que l’individu puisse s’affranchir de ce traitement. Le traitement nécessite ainsi un suivi au long cours, avec une approche psychothérapique et psychosociale. Le suivi peut être plus ou moins facile, suivant les modalités de son administration. Ainsi, la prise d’agoniste apparaît plus facile à surveiller puisque la prise se fait par injection en milieu médical, alors que la prise d’acétate de cyprotérone se fait par comprimé, ce qui rend plus difficile le contrôle de son suivi.
Par ailleurs, il convient de signaler que les traitements inhibiteurs de libido peuvent induire des effets secondaires : ostéoporose, gynécomastie (234) ou encore cytolyse (235) hépatique. De même, le traitement n’est pas compatible avec certaines pathologies médicales, telles que le diabète, la dépression chronique ou une affection hépatique.
II. Le cadre juridique de la prescription
Au plan juridique, par renvoi à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique, les médicaments inhibiteurs de libido font partie des soins que le médecin traitant peut prescrire dans le cadre de l’application des différentes mesures comportant une injonction de soin :
— le suivi socio-judiciaire (art. 131-36-4 du code pénal) ;
— la libération conditionnelle (art. 731-1 du code de procédure pénale) ;
— la surveillance judiciaire (art. 723-30 du code de procédure pénale) ;
— la surveillance de sûreté (art. 706-53-19 du code de procédure pénale).
Le consentement de la personne condamnée à l’injonction de soin est requis. Néanmoins, le médecin traitant peut informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation, ainsi que le médecin coordonnateur de l’interruption du traitement, sans encourir les sanctions pénales prévues pour violation du secret professionnel (prévues à l’article 226-13 du code pénal).
CADRES JURIDIQUES DE L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
Objectif de l’expertise |
Fondement législatif |
Caractère pré ou post-sentenciel |
Expertise |
Caractère obligatoire |
Conditions particulières |
Expertises destinées à évaluer la pertinence des soins imposés au condamné |
article 131-36-4 CP |
Pré-sentenciel |
Injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire Le prononcé d’une injonction de soins accompagnant un suivi socio-judiciaire par une juridiction de jugement est subordonné à une expertise médicale établissant que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. |
Obligatoire |
(Avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2077, expertise réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie). |
article 723-30 CPP |
Post-sentenciel |
Injonction de soins dans le cadre d’une surveillance judiciaire Expertise conditionnant le prononcé d’une injonction de soins à l’encontre d’une personne placée sous surveillance judiciaire |
Obligatoire |
___ | |
article 731-1 CPP |
Post-sentenciel |
Injonction de soins dans le cadre d’une libération conditionnelle Expertise conditionnant le prononcé d’une injonction de soins à l’encontre d’une personne bénéficiant d’une libération conditionnelle et ayant commis une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru |
Obligatoire |
___ | |
article 732-1 CPP |
Post-sentenciel |
Injonction de soins dans le cadre d’une surveillance de sûreté faisant suite à une libération conditionnelle Expertise conditionnant le prononcé d’une surveillance de sûreté avec injonction de soins |
Obligatoire |
___ | |
article 763-3 CPP |
Post-sentenciel |
Suivi socio-judiciaire initialement dépourvu d’une injonction de soins Expertise requise pour la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire qui non accompagné, ab initio, d’une injonction de soins. Si l’expertise établit que la personne peut faire l’objet d’un traitement, alors la personne est soumise à une injonction de soins. |
Obligatoire |
___ | |
article 763-4, alinéa 1er, CPP |
Post-sentenciel |
Suivi socio-judiciaire avec injonction de soins Expertise médicale préalable à la libération d’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. |
Facultatif, sauf si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant. |
Expertise réalisée par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l’application des peines | |
article 763-4, alinéa 2, CPP |
Post-sentenciel |
Suivi socio-judiciaire Expertise médicale visant à informer le juge de l’état médical ou psychologique de la personne exécutant un suivi socio-judiciaire. |
Facultatif |
Expertise réalisée par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l’application des peines | |
|
Expertises destinées à décider d’une mesure favorable au condamné |
article 720-4 CPP |
Post-sentenciel |
Relèvement de la période de sûreté Expertise relative à l’état de la dangerosité de la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour laquelle la cour d’assises a décidé de ne pas permettre l’octroi de certaines mesures favorables (suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle) préalable au relèvement de cette période de sûreté |
Obligatoire |
Expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux.près la Cour de cassation |
article 706-53-10 CPP |
Post-sentenciel |
Effacement des données personnelles du FIJAIS Expertise préalable à la rectification ou à l’effacement des données personnelles figurant au FIJAIS |
Facultatif, sauf s'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur |
___ | |
article 712-21 CPP |
Post-sentenciel |
Réduction de peine et permissions de sortir Expertise psychiatrique préalable à l’octroi de ces mesures à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. L’expert se prononce sur le risque de récidive si la personne a été condamnée pour une infraction sexuelle ou violente. |
Obligatoire |
Expertise réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. | |
article 730-2 CPP |
Post-sentenciel |
Libération conditionnelle des personnes condamnées à plus de quinze ans lorsque le suivi socio-judiciaire est encouru ou à plus de dix ans pour une infraction éligible à une rétention de sûreté Avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (évaluation pluridisciplinaire au CNE et expertise médicale) préalable à l’octroi d’une libération conditionnelle |
Obligatoire |
S’il s'agit d'un crime mentionné à l’article 706-53-13, la double expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement inhibiteur de libido | |
article 763-6 CPP |
Post-sentenciel |
Relèvement du suivi socio-judiciaire Expertise médicale préalable au relèvement du suivi socio-judiciaire. |
Obligatoire |
Expertise obligatoirement réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie | |
Expertises destinées à décider d’un accroissement des contraintes pesant sur le condamné |
article 706-53-14 CPP |
Post-sentenciel |
Placement en rétention de sûreté Expertise préalable à un placement en rétention de sûreté visant à évaluer la dangerosité du condamné. |
Obligatoire |
Expertise obligatoirement réalisée par deux experts. |
article 723-37 CPP |
Post-sentenciel |
Placement sous surveillance de sûreté Expertise constatant la persistance de la dangerosité du condamné. |
Obligatoire |
___ | |
article 723-31 CPP |
Post-sentenciel |
Placement sous surveillance judiciaire Expertise faisant apparaître la dangerosité du condamné et son risque de récidive, préalable à un placement sous surveillance judiciaire. |
Obligatoire |
Expertise réalisée par deux experts si le juge de l’application des peines ou le procureur l’ordonne (art. 723-31-1 CPP) | |
article 763-10 CPP |
Post-sentenciel |
Placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire Examen, par le juge de l’application des peines, destiné à évaluer le risque de récidive et la dangerosité de la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire avec PSEM. Il doit être réalisé au moins un an avant la date de libération du condamné. |
Obligatoire |
Pour réaliser cet examen, le juge peut requérir l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et faire procéder, entre autres, à une expertise médicale. | |
article 131-36-10 CP |
Post-sentenciel |
Placement sous surveillance électronique mobile (cas général) Expertise médicale constatant la dangerosité du condamné préalable au prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile. |
Obligatoire |
___ | |
article 131-36-102-1 CP |
Post-sentenciel |
Placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées pour des violences intrafamiliales Expertise médicale constatant la dangerosité du condamné préalable au prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile. |
Obligatoire |
___ |
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Expression empruntée à Norbert Elias qui désigne le processus de domestication des pulsions.
3 () G. Vigarello, Histoire du viol, Points Histoire, p. 7.
4 () G. Vigarello, op. cit, p. 33.
5 () G. Vigarello, op.cit, p. 9.
6 () N. Bajos, M. Bozon, « Les violences sexuelles en France: quand la parole se libère », Population et sociétés, Bulletin mensuel de l’Institut national d’études démographiques, mai 2008.
7 () Les enquêtes de victimation consistent à interroger un échantillon représentatif de la population sur les infractions commises à son encontre.
8 () Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, Enquête 2011, sous la direction d’Alain Bauer.
9 () N. Bajos, M. Bozon, « Les violences sexuelles en France: quand la parole se libère », Population et sociétés, Bulletin mensuel de l’Institut national d’études démographiques, mai 2008.
10 () Ibid.
11 () P. Carrière et Y. Tyrode, « Existe-t-il des caractéristiques cliniques et psychopathologiques des auteurs d'exhibitionnisme et d'autres conduites d'agression sexuelle que pédophilie et viol ? » Conférence du consensus, Psychopathologie et traitement actuels des auteurs d'agression sexuelle, Fédération française de Psychiatrie, 2001.
12 () International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.
13 () AN Groth, WF Hobson, TS Gary, “The child molester : clinical observations”, J Soc Work Hum Sex, 1982.
14 () Voir N. McConaghy.
15 () RD. Keppel et R. Walter, 1999.
16 () C. Blanchette, M. St Yves et J. Proulx, « Les agresseurs sexuels. Motivation, modus operandi et habitudes de vie », Psychologie de l’enquête criminelle. La recherche de la vérité, 2007.
17 () C. Lecomte, O. Timbart, « Les condamnés de 2001 en état de récidive », Infostat Justice n° 68, juillet 2003.
18 () A. Kensey, A. Benouada, « Les risques de récidive des sortants de prison, une nouvelle évaluation », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques n° 36, mai 2011.
19 () Article 132-10 du code pénal.
20 () Article 132-16-2 du code pénal.
21 () Article 132-9 du code pénal.
22 () Article 132-9 du code pénal.
23 () Article 132-8 du code pénal.
24 () Cf. supra.
25 () R.K. Hanson et M.T. Bussière, « Predicting relapse : a meta-analysis of sexual offender recidivism studies », Journal of consulting and clinical psychology, 1998.
26 () A. J. R. Harris et R.K. Hanson, « La récidive sexuelle : d’une simplicité trompeuse », Sécurité publique et protection civile canada, mars 2004.
27 () T. Pham, C. Ducro, B. Pihet, M. Martin, « Evaluation des taux de récidive des auteurs d’infractions à caractère sexuel suivis au sein d’équipes de santé spécialisées en région wallonne », Journal de médecine légale droit médical, 2010.
28 () E .Milgrom, P. Bouchard et J. P. Olié, « La prévention médicale de la récidive chez les délinquants sexuels », Bulletin de l’Académie nationale de médecine,. 2010, Tome 194, juin, n° 6, p 1033-1044.
29 () A. J. R. Harris et R.K. Hanson, « La récidive sexuelle : d’une simplicité trompeuse », Sécurité publique et protection civile canada, mars 2004.
30 () B. Lavielle, « Surveiller et soigner les agresseurs sexuels, un des défis posés par la loi du 17 juin 1998 », Revue de science criminelle, 1999.
31 () Crim., 18 février 2004, Bulletin n° 47.
32 () V. Carrasco, « Le suivi socio-judiciaire : bilan de l’application de la loi du 17 juin 1998 », Infostat Justice n° 94, mai 2007.
33 () Rapport des inspections générales des services judiciaires et des affaires sociales sur l’évaluation du dispositif d’injonction de soins, février 2011, p.40.
34 () Article 763-6 du code de procédure pénale.
35 () Loi n° 2008-74 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
36 () Article 763-3 du code de procédure pénale.
37 () Rapport des inspections générales des services judiciaires et des affaires sociales sur l’évaluation du dispositif d’injonction de soins, février 2011, p.30.
38 () Contribution écrite de l’Union syndicale des magistrats, 18 octobre 2011.
39 () Toutefois, une disposition transitoire prévoit que peut être placée sous surveillance judiciaire la personne ayant commis les faits incriminés avant le 13 décembre 2005, même si elle a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, afin de permettre le placement sous surveillance électronique mobile de cette personne.
40 () B. Lavielle, « Surveiller et soigner les agresseurs sexuels, un des défis posés par la loi du 17 juin 1998 », Revue de science criminelle, 1999.
41 () Ibid.
42 () Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
43 () Article 131-36-4 du code pénal.
44 () Rapport des inspections générales des services judiciaires et des affaires sociales sur l’évaluation du dispositif d’injonction de soins, mars 2011, p.31.
45 () Ibid.
46 () « Les murailles de silicium – La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales », Étude dirigée par Jacques-Henri Robert, La Semaine juridique, 1er mars 2006.
47 () Notamment, J.-F. Burgelin, « Santé, justice et dangerosité : pour une meilleure prévention de la récidive », Doc. Fr. 2005 ; P. Clément et G. Léonard, Mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales. « Vingt mesures pour placer la lutte contre la récidive au coeur de la politique pénale », Ass. nat., 2004 ; G. Fenech, « Mission de réflexion et de proposition sur le thème du placement sous surveillance électronique mobile des criminels les plus dangereux », avril 2005.
48 () Infractions punies de plus de sept ans d’emprisonnement pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru (article 142-5 du code de procédure pénale) et violences et menaces commises dans un contexte familial punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement (article 145-12-5 du code de procédure pénale).
49 () « Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée. Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine. »
50 () Le placement sous surveillance électronique est devenu applicable sur l’ensemble du territoire à partir de la publication du décret n° 2007-1169 du 1er août 2007.
51 () O. Razac, « La placement sous surveillance électronique : un nouveau modèle pénal ? », CIRAP, septembre 2010, p. 100.
52 () O. Razac, « Le vécu des personnes placées sous surveillance électronique mobile, premières impressions », Les chroniques du CIRAP, avril 2009.
53 () Déplacement à la maison d’arrêt de Lyon Corbas le 4 novembre 2011.
54 () Global positioning system.
55 () Global system for mobile communications.
56 () Avis présenté au nom de la commission des Loos constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775), tome IV : « Justice administration pénitentiaire et protection judiciaire de jeunesse », par M. Sébastien Huyghe, Député, pp. 48-52.
57 () Un détecteur thermique vérifie en permanence la proximité du corps du placé.
58 () O. Razac, « Le vécu des personnes placées sous surveillance électronique mobile, premières impressions », Les chroniques du CIRAP, avril 2009.
59 () O. Razac, « La placement sous surveillance électronique : un nouveau modèle pénal ? », CIRAP, septembre 2010, p. 102.
60 () Circulaire de la direction des Affaires criminelles et des grâces, n° CRIM 08-05/E3 du 28 janvier 2008 relative au placement sous surveillance électronique mobile.
61 () Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
62 () Circulaire de la DACG n° Crim-08-17-E8-17.12.08 JUS-D-08-30031C du 17 décembre 2008 relative à la présentation générale des dispositions relatives à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté.
63 () Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, considérant n° 9.
64 () Circulaire de la DACG n° Crim-08-17-E8-17.12.08 JUS-D-08-30031C du 17 décembre 2008 relative à la présentation générale des dispositions relatives à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté.
65 () Article 703-53-14 du code de procédure pénale.
66 () Commentaire de la décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 24.
67 () Dernier alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale.
68 () Article R. 53-8-56 du code de procédure pénale.
69 () La non rétroactivité de cette possibilité de placement en rétention de sûreté s’explique par le fait que la personne est informée de son éventuel placement en cas de non respect des obligations accompagnant la surveillance de sûreté. Par construction, les faits conduisant à la rétention sont donc nécessairement postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.
70 () Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté.
71 () Article R. 53-8-68 du code de procédure pénale.
72 () Source : direction des Affaires criminelles et des grâces.
73 () Article 706-53-19 du code de procédure pénale.
74 () Article 723-37 du code de procédure pénale.
75 () Article 763-8 du code de procédure pénale.
76 () Article R.61-8 du code de procédure pénale.
77 () Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, cf. infra.
78 () C. Lazerges, « La rétention de sûreté : le malaise du Conseil constitutionnel », Revue de Science criminelle, 2008.
79 () M. Herzog-Evans, « Les textes d’application de la loi rétention de sûreté. L’enracinement des nouvelles orientations de l’exécution des peines », Recueil Dalloz, 2008.
80 () Circulaire de la DACG n° Crim-08-17-E8-17.12.08 JUS-D-08-30031C du 17 décembre 2008 relative à la présentation générale des dispositions relatives à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté.
81 () Article 706-53-15 du code de procédure pénale.
82 () Article 706-53-17 du code de procédure pénale.
83 () Article 706-53-18 du code de procédure pénale.
84 () Sicherungsverwahrung.
85 () CEDH, 17 décembre 2009, M. contre Allemagne.
86 () L’article 64 du code pénal suisse vise « un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui ».
87 () Ce chiffre comprend l’ensemble des personnes éligibles, à leur libération, à une surveillance de sûreté et, par conséquent, à une rétention de sûreté en cas de non-respect de ses obligations.
88 () Projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, le 20 février 2012 , TA n° 859.
89 () Article 717-1 du code de procédure pénale.
90 () Article 721 du code de procédure pénale.
91 () Article 721-1 du code de procédure pénale.
92 () Article 729 du code de procédure pénale.
93 () Projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, le 20 février 2012 , TA n° 859.
94 () Article 721-1 du code de procédure pénale.
95 () Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
96 () Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
97 () L’article 10 de la loi a abrogé l’article 132-45-1 du code pénal.
98 () Article 132-45 du code pénal.
99 () Cf. supra.
100 () B. Joseph-Jeanneney, G. Coq, P. Beau, P. Gallier, « L’évaluation du dispositif de l’injonction de soins », Rapport de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des services judiciaires, février 2011, p.28.
101 () 90 % d’après le rapport précité.
102 () Article 763-7 du code de procédure pénale.
103 () Articles L.3711-1 à L.3711-5.
104 () Cette liste est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins et du préfet.
105 () Examens médico-psychologiques réalisés pendant l’enquête d’instruction, réquisitoire définitif, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou décision renvoyant l’accusé devant la cour d’assises, jugement du tribunal ou de la cour d’assises.
106 () Article R3711-12 du Code de la Santé publique.
107 () Article R3711-21 du code de la santé publique.
108 () Article L3711-2 du code de la santé publique.
109 () Article L3711-3 du code de la santé publique.
110 () Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, cf. infra.
111 () Réponse du ministère de la Justice à la question écrite n° 17210 de M. Marcel Rainaud, publiée dans le JO Sénat du 19 mai 2011.
112 () Avis présenté au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2012, Tome XIII, Justice judiciaire et accès au droit, par Mme Catherine Tasca.
113 () Projet de loi de programmation pour l’exécution des peines, p. 19.
114 () Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France, direction de l'Administration pénitentiaire
115 () Mesures d’aménagement de peines pour les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans ou dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans.
116 () Rapport du groupe de travail sur le service de l’application des peines, juin 2011, p. 11.
117 () Article 729 du code de procédure pénale.
118 () Article 730-2 du code de procédure pénale.
119 () Article 733 du code de procédure pénale.
120 () Par exemple, article 723-30 du code de procédure pénale.
121 () Par exemple, article 131-36-12-1 du code pénal.
122 () Article 723-31 du code de procédure pénale.
123 () Article 706-53-14 du code de procédure pénale.
124 () Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
125 () Article 131-36-4 du code pénal.
126 () Article 706-53-14 du code de procédure pénale.
127 () M. Herzog-Evans, « Les textes d’application de la loi rétention de sûreté. L’enracinement des nouvelles orientations de l’exécution des peines », Recueil Dalloz, 2008.
128 () Article R. 53-8-46 du code de procédure pénale.
129 () Circulaire de la DACG n° CRIM 0817/E8 du 17 décembre 2008 relative à la présentation générale des dispositions relatives à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté.
130 () M. Herzog-Evans, « Les textes d’application de la loi rétention de sûreté. L’enracinement des nouvelles orientations de l’exécution des peines », Recueil Dalloz, 2008.
131 () Article R. 53-8-71 du code de procédure pénale.
132 () M. Herzog-Evans, op. cit.
133 () « Les services pénitentiaires d’insertion et de probation », Rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des services judiciaires, juillet 2011.
134 () Ibid.
135 () Ibid.
136 () E. Brillet, « Une nouvelle méthode d’intervention auprès des personnes placées sous main de justice :les programmes de prévention de la récidive », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques n° 31, août 2009, p. 3.
137 () Ibid.
138 () Cf. Annexe n° 4.
139 () Circulaire JUSK1140051C du 8 novembre 2011 relative au diagnostic à visée criminologique (DAVC).
140 () J. Alvarez, N. Gourmelon, « La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles. État des lieux et analyse des nouvelles pratiques », Dossiers thématiques, Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire, 2007, p 41-42.
141 () O. Razac, « Le placement sous surveillance électronique mobile : un nouveau modèle pénal ? », Synthèse, septembre 2010, p. 7.
142 () Article D. 533-1 du code de procédure pénale.
143 () Circulaire du 16 décembre 2011 relative aux attributions respectives du juge de l’application des peines, des autres magistrats mandants et du service pénitentiaire d’insertion et de probation et à leurs relations.
144 () Article R. 53-8-49 du code de procédure pénale.
145 () Chaîne Applicative Supportant le Système d'Information Opérationnel pour le Pénal et les Enfants.
146 () En 2004, le ministre de la justice et le ministre de la santé et des solidarités ont confié à une commission Santé-Justice le soin d'étudier les voies d'amélioration de la prise en charge médico-judiciaire des auteurs d'infractions qui sont atteints de troubles mentaux ou qui présentent un profil dangereux.
147 () « Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive », rRapport de la Commission santé-justice présidée par Monsieur Jean-François Burgelin, juillet 2005, p. 10.
148 () Ibid.
149 () Cf. Annexe n° 6.
150 () Les psychiatres libéraux y représentent la moitié de l’effectif total et ne sont pas inscrits sur la liste d’experts près la cour d’appel.
151 () L’accès au dossier médical de la personne expertisée nécessite son accord exprès.
152 () À Toulouse, les magistrats essaient de transmettre aux psychiatres les expertises établies sur les quinze dernières années.
153 () Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 relatif au recouvrement des amendes forfaitaires et à certains frais de justice criminelle ou assimilés.
154 () Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
155 () Le Questionnaire d’Investigation Clinique pour les Auteurs d’Agression Sexuelle (QICPAAS) est un questionnaire élaboré en 1997 par Claude Balier, Martine Gérard-Khayat et André Ciavaldini, testé et validé en situation pénitentiaire auprès d’agresseurs sexuels.
156 () « Réponses à la dangerosité », rapport sur la mission parlementaire confiée par le Premier ministre à M. Jean-Paul Garraud, député de la Gironde, sur la dangerosité et la prise en charge des individus dangereux, octobre 2006, pp. 43 à 45.
157 () J. Monohan « Predicting violent behavior : an assessment of the clinical techniques ». In: Sage, Monohan J, Steadman HJ, editors. Violence and mental disorder: developments in risk assessment. University of Chicago press, 1996.
158 () R. Karl Hanson and Kelly E. Morton-Bourgon, « The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: a meta-analysis of 118 studies», Psychological Assessment, 2009.
159 () A. Baratta, P. Schwartz, G-A Milosescu, « Place et méthodes de l’expertise post-sentencielle dans le dispositif de libération conditionnelle. Comparaison des procédures en France et en Belgique », Médecine et droit, Information éthique et juridique du praticien, juillet-août 2011, n° 109.
160 () Cf. infra, troisième partie.
161 () Note DAP du 25 juin 2009.
162 () D’après les chiffres contenus dans les annexes du Protocole Santé-Justice relatif à la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel dans les établissements pénitentiaires conclu entre la direction de l’Administration pénitentiaire et la direction générale de l’Offre de soins.
163 () Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des services judiciaires, « Rapport sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de soins », février 2011, p. 49.
164 () Loi n°94-43 du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et à la protection sociale.
165 () Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A n° 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé.
166 () Inspection générale des Affaires sociales et Inspection générale des services judiciaires, « Rapport sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de soins », mars 2011, p. 65.
167 () Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A n° 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé.
168 () Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des services judiciaires, « Rapport sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de soins », mars 2011.
169 () Ibid.
170 () Le CMP de La Garenne-Colombes, sous la direction du Dr Roland Coutanceau, s’adresse en particulier aux auteurs de violences sexuelles. Il accueille également un CRIAVS.
171 () Cf. infra, troisième partie.
172 () Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des services judiciaires, « Rapport sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de soins », mars 2011, p. 98.
173 () Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
174 () Il convient de noter que la juridiction peut recourir aux médecins coordonnateurs inscrits sur les listes d’autres juridictions du même département ou d’un département limitrophe.
175 () Arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins, autres que les psychiatres, pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique.
176 () Inspection générale des affaires sociales et inspection générale des services judiciaires, « Rapport sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de soins », mars 2011, p. 91.
177 () Projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, rapport annexé.
178 () En application de l’article L. 3711-4 du code de la santé publique, « les agences régionales de santé prennent en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs ».
179 () Op. cit. p. 89.
180 () Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des services judiciaires, « Rapport sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de soins », mars 2011.
181 () Circulaire DGS/MC 4 n° 2008-213 du 18 juin 2008 relative à l’évolution du dispositif de l’injonction de soins.
182 () Circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et à la création de centres de ressources interrégionaux.
183 () Circulaire DHOS/DSS du 8 août 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 dans les établissements de santé.
184 () Lyon, Saint-Étienne.
185 () La Roche-sur-Yon, Les Ponts de Cé.
186 () Trois CRIAVS : Paris, La Garenne-Colombes, Neuilly-sur-Marne.
187 () Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des services judiciaires, « Rapport sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de soins », mars 2011.
188 () Articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
189 () Article 706-53-19 du code de procédure pénale.
190 () La loi du 10 mars 2010 ayant supprimé la possibilité d’une injonction de soins dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, afin de rendre plus claire la distinction entre obligation et injonction de soins.
191 () Cf. Rapport d’information (n° 1811) de M. Étienne Blanc, rapporteur de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale.
192 () M. Herzog-Evans, « Les textes d’application de la loi rétention de sûreté. L’enracinement des nouvelles orientations de l’exécution des peines », Recueil Dalloz 2008.
193 () Article 41.
194 () Circulaire relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et du décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 relatives à l’exécution et à l’application des peines.
195 () M. Herzog-Evans, « Les textes d’application de la loi rétention de sûreté. L’enracinement des nouvelles orientations de l’exécution des peines », Recueil Dalloz 2008.
196 () Article 706-53-22 du code de procédure pénale.
197 () Article R.61-8 du code de procédure pénale.
198 () Article L.3711-3 du code de la santé publique.
199 () Article 6 du projet de loi.
200 () Circulaire du 16 juin 2006 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et du décret n° 2006-835 du 30 mars 2006 relatives à l’exécution et à l’application des peines.
201 () Décision n° 99–421 DC du 16 décembre 1999 qui a fait de l’intelligibilité et de la clarté de la loi un « objectif à valeur constitutionnel ».
202 () M. Guillaume, « La question prioritaire de constitutionnalité », Justice et cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 2010.
203 () Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles.
204 () Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 20 février 2012, TA n° 859.
205 () Cf. supra, deuxième partie.
206 () Article 706-56-2 du code de procédure pénale.
207 () Recommandation Rec (2000) 22 du Comité des ministres aux États membres concernant l’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les sanctions et les mesures appliquées dans la Communauté.
208 () Cf. infra III, B, 2.
209 () Cf. annexe n° 5.
210 () Le parcours à la sortie de l’UPH ne donne pas lieu à un suivi.
211 () Cf. supra, deuxième partie.
212 () Il s’agit du quartier de semi-liberté de Fresnes, d’un centre de semi-liberté et d’un centre pour peine aménagée à Villejuif.
213 () L’arrêté du 8 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs porte de vingt à soixante le nombre maximal de dossiers pouvant être suivis de façon simultanée par un même médecin coordonnateur.
214 () Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
215 () En application du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, les praticiens hospitaliers doivent recevoir l’autorisation de leur supérieur pour exercer une activité accessoire et ne peuvent exercer celle-ci qu’en dehors de leurs lieux et horaires de travail.
216 () Il s’agit d’une association type loi 1901 déclarée au Journal officiel le 15 octobre 2010.
217 () Ce répertoire devrait être finalisé en mars 2012, d’après les informations communiquées par le CRIAVS Rhône-Alpes.
218 () Service correctionnel du Canada, « Cercles de soutien et de responsabilité : Reproduction à l'échelle nationale des résultats obtenus », 2008, No R-185.
219 () Rapport (n° 2007, XIIIe législature) de M. Jean-Paul Garraud au nom de la commission des Lois sur le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, novembre 2009.
220 () Rapport fait au nom de la commission des Lois, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de programmation (n° 4300) modifié par le Sénat, relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par M. Jean-Paul Garraud.
221 () M. Herzog-Evans, R. Cario, L. Villerbu, « Pourquoi est-il urgent de créer des UFR de criminologie ? », Recueil Dalloz 2011, p. 766.
222 () Rapport fait au nom de la commission des Lois, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de programmation (n° 4300) modifié par le Sénat, relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par M. Jean-Paul Garraud.
223 () Article 7 du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 20 février 2012, TA n° 859.
224 () Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 20 février 2012, TA n° 859.
225 () Article 6 du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 20 février 2012, TA n° 859.
226 () Rapport annexé à l’article 1er du projet de loi de programmation (n° 4300) modifié par le Sénat relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre pénitentiaire.
227 () Cf. Annexe n° 4.
228 () Cette échelle se définit comme une procédure d’évaluation destinée à permettre de mesurer les composantes affectives, interpersonnelles et comportementales caractéristiques de la psychopathie au moyen d’une entrevue semi structurée. Dans ce cadre, le patient est interrogé sur les différents domaines de sa vie afin de mettre à jour des facteurs de la psychopathie (loquacité et charme superficiel, besoin de stimulation et tendance à s’ennuyer, surestimation de soi, insensibilité et manque d’empathie, etc.).
229 () N. Jeanne, V. Maquet, J. Megan, « Les nouvelles figures de la dangerosité aux États-Unis », in La dangerosité saisie par le droit pénal, sous la direction de G. Giudicelli - Delage et Ch. Lazerges, PUF, p 232, 1ère édition, octobre 2011.
230 () D. Giovannangeli, J. Ph Cornet, Ch. Mormont, « Étude comparative réalisée dans les 15 pays de l'Union européenne sur les méthodes et les techniques d'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive des personnes présumées ou avérées délinquants sexuels », psychiatrieviolence.ca, septembre 2000.
231 () Alexandre Baratta, Pauline Schwartz, George-Alin Milosescu, « Place et méthodes de l’expertise post-sentencielle dans le dispositif de libération conditionnelle. Comparaison des procédures en France et en Belgique », Médecine et droit, juillet-août 2011, n° 109.
232 () R. Karl Hanson and Kelly E. Morton-Bourgon “The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: a meta-analysis of 118 studies”, , Psychological Assessment, 2009, Vol 21 n°1,1-21.
233 () J.Proulx et P. Lussier, « La prédiction de la récidive chez les agresseurs sexuels », Criminologie, vol. 34, n° 1, 2001, pp. 9-29.
234 () Chez l’homme, ce terme désigne un développement exagéré des seins.
235 () Il s’agit de la destruction d’une cellule vivante par dissolution des éléments dont elle est formée.
© Assemblée nationale