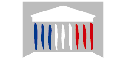______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 février 2016
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)
sur le règlement des différends Investisseur - État
dans les accords internationaux
ET PRÉSENTÉ
PAR Mme Seybah DAGOMA
Députée
——
(1) La composition de la commission figure au verso de la présente page.
La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; M. Christophe CARESCHE, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; M. Philip CORDERY, Mme Sandrine DOUCET, MM. Arnaud LEROY, André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Kader ARIF, Philippe BIES, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, MM. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Rémi PAUVROS, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.
___
Pages
INTRODUCTION 9
I. FONDEMENTS ET MISE EN œUVRE DU MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS ET LES INVESTISSEURS (RDIE) 13
A. LE RDIE : UN MÉCANISME VISANT À PROTÉGER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS DE L’ARBITRAIRE DES ÉTATS 13
1. Une protection des investisseurs étrangers qui repose principalement sur les traités bilatéraux d’investissement (TBI) 14
a. Jusqu’à l’apparition des TBI, la difficile protection des investisseurs étrangers par le droit international 14
i. Les mécanismes traditionnels de protection : protection diplomatique et commissions mixtes 14
ii. L’apparition des TBI, réponse au blocage politique sur le contenu du droit international de l’investissement 16
iii. Le lent développement des TBI jusqu’à leur multiplication à partir des années 80 18
b. Après l’échec de l’Accord multilatéral sur l’investissement en 1998, la protection des investissements dans les traités plurilatéraux est géographiquement et/ou matériellement limitée 20
i. L’échec des tentatives de multilatéraliser le droit international des investissements 20
ii. Les accords limités à une zone géographique 22
iii. Un accord géographiquement et matériellement limité : le traité sur la Charte de l’énergie 24
2. Le mécanisme de règlement des différends entre les États et les investisseurs prend aujourd’hui la forme d’un arbitrage privé 25
a. Les alternatives au RDIE 25
i. Le règlement extra-judiciaire des différends 25
ii. L’assurance ou la garantie des investissements 28
b. Le RDIE repose sur le consentement des États à voir leurs différends avec les investisseurs réglés par l’arbitrage 29
c. Le fonctionnement de l’arbitrage d’investissement 31
i. Les différentes instances d’arbitrage 31
ii. Le règlement des différends entre les États et les investisseurs dans le cadre du centre international de règlement des différends sur l’investissement (CIRDI) 33
B. LE RDIE, PRÉSENT DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES TRAITÉS, EST DE PLUS EN PLUS FRÉQUEMMENT MIS EN œUVRE, NOTAMMENT CONTRE LES PAYS DÉVELOPPÉS 36
1. Une présence quasi-constante du RDIE dans les traités bilatéraux et plurilatéraux d’investissement 37
a. Une présence massive, y compris dans les traités signés par et entre les États-membres de l’Union européenne 37
i. Les TBI conclus par les États-membres restent en vigueur, pour autant qu’ils soient compatibles avec le droit européen 38
ii. L’articulation du droit européen et des TBI : une question encore non résolue 41
b. La tendance actuelle : l’apparition de RDIE dans les accords entre pays développés et le refus du RDIE par les pays en développement 43
i. Les pays développés acceptent désormais le RDIE dans certains traités plurilatéraux 43
ii. Le rejet des TBI et du RDIE par les pays en voie de développement 45
2. Des plaintes en forte augmentation, y compris d’investisseurs européens contre des États-membres de l’Union européenne 47
a. Une forte augmentation du nombre de plaintes, pour l’essentiel d’investisseurs issus de pays développés 47
b. La concentration des plaintes sur un petit nombre d’États, incluant des pays développés 48
i. Présentation générale 48
ii. L’exemple de l’ALENA 49
iii. L’exemple du traité sur la Charte de l’énergie 49
iv. Le cas des États-membres de l’Union européenne 50
3. Les compensations importantes accordées aux investisseurs par les tribunaux arbitraux 52
a. Des condamnations importantes pour les pays en développement (ou anciennement en transition) mais dont l’exécution est incertaine 52
b. Des conséquences bien plus limitées pour les pays développés 58
II. LES DÉRIVES DU MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L’ORIGINE D’UN LARGE DÉBAT EN EUROPE 63
A. UN DÉBAT EUROPÉEN QUI A PRIS UNE DIMENSION POLITIQUE 64
1. Les termes du débat 64
a. Une discrimination inutile au profit des investisseurs étrangers ayant les moyens d’assumer le coût d’un arbitrage 64
b. Une atteinte au droit à réguler des États 65
c. Un mécanisme qui dysfonctionne 66
i. La partialité des arbitres 67
ii. Le manque de transparence 68
iii. La longueur des procédures 69
iv. Les risques de contradictions entre les sentences 70
v. Le « treaty shopping » 72
2. Des débats sur le RDIE d’une intensité différente selon les pays et les époques 73
B. LA QUESTION DU RDIE ENTRE PAYS DÉVELOPPÉS : L’EXEMPLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT (PTCI) 77
1. La problématique de l’invocabilité d’un traité dans l’ordre juridique interne des États 78
a. En France, les traités ne sont invocables qu’à la condition d’avoir un effet direct reconnu par le juge 79
b. Aux États-Unis, l’effet direct des traités est soumis à l’appréciation des autorités politiques 80
2. La nécessité de garantir un règlement efficace, dépolitisé et impartial des différends 83
a. Le cas de l’Union européenne : les TBI en vigueur entre les États-membres sont largement mis en œuvre par les investisseurs européens 83
b. Le cas des États-Unis : une justice coûteuse et largement politisée 86
3. La bataille des futures normes internationales en matière de protection des investissements 90
C. LES RISQUES QUE REPRÉSENTE LE RDIE 91
1. Les risques que peut représenter le RDIE pour les investisseurs 91
a. Les investisseurs n’utilisent le RDIE qu’en ultime recours compte tenu de ses inconvénients 91
b. La qualité de la justice française limite les risques, pour notre pays, d’être poursuivi dans le cadre d’un RDIE 92
2. Des risques que les États ont la faculté de prévenir 93
a. Le RDIE n’est qu’un mécanisme de règlement des différends auquel les États donnent la forme qu’ils veulent 94
b. Les différents moyens à la disposition des États 95
i. L’éthique des arbitres et la prévention des conflits d’intérêt 95
ii. La stricte délimitation des droits des investisseurs 95
iii. Les exemptions et les exceptions 97
iv. Les règles procédurales 98
III. SI L’AECG DANS SA VERSION INITIALE ET LE PTCI PRESENTENT DEUX VOIES POSSIBLES D’AMELIORATION DU MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, SEULE UNE JURIDICTION INTERNATIONALE EST SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE UN RÈGLEMENT EFFICACE ET LEGITIME DES DIFFÉRENDS ENTRE LES INVESTISSEURS ET LES ÉTATS 101
A. DEUX VOIES DIFFÉRENTES D’AMÉLIORATION DU RDIE 101
1. Des RDIE sommaires, dépassés et risqués dans les TBI européens et français 102
2. L’amélioration du mécanisme arbitral dans la version initiale de l’AECG 103
a. La substance du traité protège le droit à réguler des États en contraignant fortement le pouvoir d’interprétation des arbitres 103
i. Le droit des États à réguler 103
ii. L’investissement, l’investisseur et ses droits sont précisément définis 104
iii. La présence d’exceptions 111
b. Les garanties procédurales 115
3. La proposition de la Commission européenne de créer une juridiction bilatérale dans le PTCI 122
a. La proposition européenne de créer une Cour permanente dans le cadre du PTCI constitue un changement de paradigme 122
i. La proposition française conservait les tribunaux arbitraux en les soumettant à une juridiction d’appel 122
ii. La Commission européenne propose un système juridictionnel à double niveau se substituant totalement aux tribunaux arbitraux 124
B. DEUX VOIES QUI, MALGRÉ DES AVANCÉES CERTAINES, RESTENT INSATISFAISANTES MAIS POUR DES RAISONS DIFFÉRENTES 127
1. Toutes les améliorations apportées aux tribunaux d’arbitrage n’ont pas supprimé son défaut majeur : la présomption d’illégitimité 127
a. La présomption d’illégitimité du système arbitral 127
b. Les tribunaux arbitraux ont disparu au profit de l’ICS dans la version finale de l’AECG 128
2. Les risques de la création d’une cour bilatérale dans le PTCI (et, désormais, dans l’AECG) 130
a. Les incertitudes juridiques de l’ICS 131
b. La position des États-Unis sur l’ICS 132
c. Les conséquences positives pour les États de l’ICS par rapport à un tribunal arbitral ne doivent pas être surestimées 135
i. Les avantages supposés de l’ICS sont incertains 135
ii. Les améliorations encore possibles de l’ICS 136
3. La création d’une cour multilatérale est le seul moyen permettant un règlement légitime et efficace des différends entre les États et les investisseurs 139
Mesdames, Messieurs,
Le 14 juin 2013, le Conseil européen a donné mandat à la Commission européenne de négocier un Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (ci-après : « PTCI »), plus connu sous les acronymes TAFTA ou TTIP.
Jamais en Europe, la perspective d’un accord bilatéral de libre-échange n’aura suscité autant d’intérêt et de réaction, tant de la société civile que des responsables politiques européens et nationaux.
Le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États (ci-après : « RDIE ») est sans doute le sujet qui cristallise le plus de contestations. Il a pour objet de permettre à un investisseur étranger d’attraire un État devant une instance internationale, en pratique un tribunal arbitral, à qui il appartiendra de juger si ce dernier a violé ou non ses obligations internationales en matière de protection des investissements ; si tel est le cas, les compensations peuvent atteindre des montants très élevés.
Depuis le début des négociations du PTCI, l’inquiétude vis-à-vis de ce mécanisme est allée grandissante et s’est muée en une franche opposition qui est apparue clairement dans les résultats de la consultation publique lancée en mars 2014 par la Commission européenne sur ce RDIE : 97 % des réponses étaient négatives, insistant sur les risques considérables sur le droit à réguler de l’Union européenne et des États-membres. Cette hostilité s’est par la suite étendue à l’Accord économique et commercial global avec le Canada (ci-après : « AECG ») – dont les négociations sont achevées depuis le 26 septembre 2014 –, qui contient, lui aussi, un RDIE.
Pourtant, le mécanisme d’arbitrage Investisseur État est loin d’être une nouveauté en droit international des investissements ; institutionnalisé avec la Convention de Washington de 1965, il est présent, depuis 1959, dans la quasi-totalité des traités bilatéraux d’investissement (TBI) ainsi que dans certains traités plurilatéraux majeurs comme l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ou le Traité sur la Charte de l’énergie (TCE). Actuellement, on dénombre près de 3 300 TBI dont 93 % incluent un RDIE. Les États membres de l’Union Européenne ont, quant à eux, signé près de 1400 TBI, y compris entre eux (1).
Si ce mécanisme suscite aujourd’hui le débat en Europe et notamment en France, c’est parce que l’introduction d’un RDIE dans l’AECG et, le cas échéant, dans le PTCI constitue une nouvelle étape pour l’Union Européenne.
En effet, conçu dans un contexte d’investissements directs étrangers Nord-Sud, le RDIE avait, à l’origine, pour objet de protéger les investisseurs des pays développés investissant dans les pays en développement qui n’offraient pas de garanties suffisantes en matière d’efficacité et d’indépendance de la justice. Le recours à une justice privée, jugée libérée de toute influence étatique, apparaissait donc comme étant la solution adaptée. C’est pourquoi, alors même que plusieurs pays en développement qui ont fait l’objet de lourdes condamnations mettaient en lumière les dysfonctionnements de ce dispositif, les États développés considéraient au contraire qu’il était impératif d’en maintenir l’existence. En pratique, on observe d’ailleurs que ces derniers n’ont été que peu poursuivis, encore moins condamnés, et ce malgré les centaines de TBI qu’ils ont signés.
Actuellement, nous assistons à une évolution de la position des pays développés, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, d’aucuns s’interrogent sur la pertinence de maintenir un RDIE dans les échanges Nord-Nord. En effet, dès lors que les flux d’investissement ont lieu entre pays développés disposant a priori d’une justice efficace et indépendante, la conservation de ce mécanisme dans un TBI est-elle légitime ? Votre rapporteure considère qu’il s’agit d’une question complexe à laquelle il convient de répondre au cas par cas.
Par ailleurs, le Canada et, surtout, les États-Unis figurent parmi les principaux investisseurs étrangers en Europe. De ce fait, les États-membres s’exposeraient aux éventuelles plaintes de ces derniers, lesquelles seraient désormais tranchées non par les juridictions nationales mais par des tribunaux arbitraux internationaux dont l’impartialité n’est pas considérée comme certaine. En outre, l’absence de transparence, le coût de la procédure, le montant des sommes réclamées, la perception d’imprévisibilité des résultats ou encore le défaut de cohérence de la jurisprudence sont également dénoncés. Le risque apparaît d’autant plus grand que, récemment, des recours portés en arbitrage par des investisseurs étrangers contre des pays développés ont mis en exergue les dérives du dispositif.
Un exemple récent, le plus fameux en Europe, est celui de l’Allemagne. À la suite de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011, le gouvernement allemand a pris la décision d’abandonner progressivement la production d’électricité d’origine nucléaire sur son territoire ; l’année suivante, un investisseur suédois, la société Vattenfall, propriétaire de deux centrales nucléaires en Allemagne, a estimé que cette décision violait les dispositions du TCE relatives à la protection des investissements et porté le différend devant un tribunal arbitral, réclamant des compensations à hauteur de 4,7 milliards d’euros.
Le cas australien est également éloquent. En effet, après l’adoption en 2011 d’une loi imposant le « paquet neutre » afin de lutter contre l’addiction au tabac, le fabricant américain de cigarettes Philip Morris a attaqué l’Australie, sur le fondement de son TBI avec Hong Kong, via sa filiale hongkongaise qui avait acheté des actions de sa filiale australienne. L’entreprise réclamait plusieurs milliards de dollars pour « expropriation indirecte ».
Ces affaires emblématiques particulièrement choquantes mettent en évidence la crainte qui s’est emparée de nombreuses personnalités politiques européennes et d’une partie de l’opinion publique : avec le RDIE, les États perdraient leur droit à réguler compte tenu des risques financiers découlant de la possibilité offerte notamment aux entreprises multinationales d’attaquer des choix politiques dictés par l’intérêt général. Ce sentiment de dépossession au profit des arbitres s’étend au-delà de l’Europe. On observe, en effet, comme il a été évoqué précédemment, un mouvement de plusieurs pays en développement opposés au RDIE allant jusqu’à la dénonciation de TBI et /ou de la Convention de Washington. C’est le cas par exemple de l’Équateur, l’Afrique du Sud, le Venezuela ou encore la Bolivie.
Il apparaît donc que le RDIE traverse aujourd’hui une crise de légitimité.
Consciente de celle-ci et dans la prolongation de son travail sur le mandat de négociation de l'accord de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne conclu par l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’une résolution européenne en date du 29 mai 2013, votre rapporteure a souhaité donner un double objectif au présent rapport :
– le premier est pédagogique. Ce rapport présentera donc, dans une première partie, les fondements et la mise en œuvre du RDIE depuis l’origine jusqu’à la période la plus récente ;
– le deuxième est politique. Votre rapporteure examine les deux réformes du RDIE actuellement en débat. La première vise à améliorer le fonctionnement des tribunaux arbitraux privés : il s’agit de la voie envisagée initialement dans l’AECG. La seconde a pour objet de substituer aux tribunaux arbitraux une Cour juridictionnelle bilatérale permanente (ICS) dont les décisions, rendues par des juges professionnels, seraient susceptibles d’appel. Il s’agit de la réforme suggérée par la Commission Européenne, qui reprend en partie les propositions françaises. Elle est envisagée dans le cadre du PTCI et d’ores et déjà adoptée dans l’AECG. En effet, le 29 février 2016, le gouvernement canadien et la Commission européenne ont annoncé à la fois la fin du « toilettage juridique » et l’intégration des « principaux éléments » de l’ICS. En dépit du fait que ces réformes constituent des avancées certaines par rapport aux clauses de RDIE incluses dans les TBI européens, y compris français, elles ne sont toutefois pas satisfaisantes, et ce pour différentes raisons analysées par votre rapporteure.
C’est pourquoi, bien que lucide sur le fait que le chemin soit long et semé d’embuches, votre rapporteure milite en faveur de la création d’une Cour multilatérale d’investissement, seule à même de garantir un règlement efficace et légitime des différends entre les États et les investisseurs.
I. FONDEMENTS ET MISE EN œUVRE DU MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS ET LES INVESTISSEURS (RDIE)
En droit international de l’investissement, il n’existe pas de définition du RDIE. Toutefois, on peut tenter de le définir comme un mécanisme qui ouvre à des investisseurs étrangers la possibilité d’attraire un État devant une instance internationale, en pratique un tribunal arbitral, à qui il appartiendra de juger si ce dernier a violé ou non ses obligations internationales en matière de protection des investissements ; si tel est le cas, les compensations peuvent atteindre des montants considérables.
Conçu dans un contexte d’investissements directs étrangers Nord-Sud, le RDIE visait initialement à protéger les investisseurs des pays développés investissant dans des pays en voie de développement qui n’offraient pas de garanties suffisantes en matière d’efficacité et d’indépendance de la justice. Le RDIE a une histoire et votre rapporteure, pour mieux en comprendre les enjeux, a entrepris de la retracer en préalable de toute analyse de son fonctionnement (A).
Quasiment jamais mis en œuvre avant les années 80, le RDIE a été utilisé de plus en plus fréquemment à partir des années 90, pour l’essentiel à l’initiative d’investisseurs des pays développés contre des pays en développement. Pour autant, ce mécanisme a également été invoqué contre des pays développés tels que le Canada dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ou certains États-membres de l’Union européenne, notamment dans le cadre du Traité sur la charte de l’énergie (TCE). Dans ce second cas de figure, cependant, les conséquences pour les pays mis en cause ont été moindres. (B).
Les investissements se distinguent des exportations sur plusieurs points. Les échanges commerciaux sont un flux alors que l’investisseur lui, stocke du capital sur un territoire étranger. Si l’interruption des échanges commerciaux est dommageable, elle n’entraîne pas forcément une perte pour l’exportateur qui peut réorienter ses flux ou réduire sa production. En revanche, immobilisé sur un territoire étranger, l’investissement est dépendant des décisions de l’État d’accueil et, en cas d’expropriation sans juste compensation et sans recours judiciaire efficace, l’investisseur peut tout perdre.
C’est pourquoi les pays européens ont, dès le 18ème siècle, cherché à protéger la personne et les biens de leurs ressortissants à l’étranger en les soumettant au droit international, via plusieurs moyens qui, tous, subsistent aujourd’hui. Toutefois, c’est seulement après la deuxième guerre mondiale que la substance du droit international s’est réellement formalisée avec l’apparition des traités bilatéraux d’investissement. Complétés par plusieurs traités plurilatéraux, l’ensemble de ces instruments ont défini le corpus de droits dont bénéficient les investisseurs étrangers (1). Afin que ces droits ne restent pas lettre morte, les traités ont également institué une procédure particulière pour le règlement des différends entre les États et les investisseurs, ces derniers ayant la possibilité de les voir réglés par un tribunal arbitral international de préférence aux tribunaux nationaux de l’État concerné (2).
1. Une protection des investisseurs étrangers qui repose principalement sur les traités bilatéraux d’investissement (TBI)
a. Jusqu’à l’apparition des TBI, la difficile protection des investisseurs étrangers par le droit international
La protection des investisseurs à l’étranger est une réalité ancienne qui, historiquement, relevait de la responsabilité de l’État d’origine, via deux mécanismes que sont la protection diplomatique et les commissions mixtes. C’est seulement avec le développement des contrats entre un État et un investisseur étranger qu’est apparue la nécessité d’aller au-delà et de définir précisément la substance de cette protection dans le droit international. En l’absence de consensus sur ce point entre les pays développés et les pays en voie de développement, les premiers ont fait le choix du bilatéralisme et signé avec ces derniers des traités bilatéraux d’investissement (TBI) qui, aujourd’hui, forment l’essentiel du corpus des règles constituant le droit international de l’investissement.
Si les différends entre les États et les investisseurs ont pu, ces dernières années, faire les gros titres des journaux – on pense évidemment à la sentence condamnant la Russie à 50,2 milliards de dollars dans l’affaire Ioukos-, il ne faut pas oublier qu’ils ont une longue histoire qui remonte au moins, sous des formes par ailleurs toujours en vigueur aujourd’hui, au 18ème siècle.
Lorsqu’un individu s’estimait maltraité, au sens propre, par un État étranger sur le territoire de celui-ci, deux moyens s’offraient à lui pour tenter d’obtenir réparation de son préjudice, hormis le recours aux tribunaux dudit État : la protection diplomatique de son État d’origine et, dans certains contextes particuliers, les commissions mixtes instituées conjointement par ce dernier et l’État étranger concerné.
La protection diplomatique est le droit, pour un individu, de demander la protection de l’État dont il a la nationalité en cas de différend avec un État étranger qui l’aurait traité, lui et/ou ses biens, d’une manière non conforme au droit international. En effet, le droit des gens comme les traités d’amitié, de commerce et de navigation protégeait la personne de l’individu en territoire étranger, contre par exemple les arrestations arbitraires ou la violence, mais également ses biens. C’est le cas par exemple du traité entre la France et les États-Unis de 1778 qui, entre autres, contenait une clause de la nation la plus favorisée (2). Ce droit et ces traités définissaient ainsi un véritable « standard minimal » à respecter par l’ensemble des États vis-à-vis des étrangers sur leur sol, au point qu’ils apparaissent comme les précurseurs des actuels TBI.
Saisi d’une telle demande de protection, l’État peut décider de prendre fait et cause pour son ressortissant et d’intervenir auprès de l’État qui l’a maltraité. Toutefois, ce faisant, l’État transforme un différend entre un individu et un État en un différend interétatique. Il ne défend pas son ressortissant contre l’État étranger mais son propre droit, tiré du droit international, à voir ses ressortissants traités correctement à l’étranger, c’est-à-dire en conformité avec le « standard minimal » précité qui, lui-même, découle du droit des gens et, le cas échéant, des traités d’amitié, de commerce et de navigation.
Une fois la réclamation portée à la connaissance de l’État étranger, plusieurs voies de règlement sont possibles. Le plus souvent, le différend se règle par la négociation ou, éventuellement, par l’arbitrage d’un tiers étranger, généralement un Chef d’État (3), sans oublier le recours, toujours possible, à la force. Néanmoins, la nécessité s’est progressivement fait sentir de juridictionnaliser cet arbitrage, nécessité qui a abouti à la création, en 1899, de la Cour permanente d’arbitrage qui, sans être une véritable cour (malgré son nom) a permis pour la première fois de donner une structure pour le règlement pacifique des différends entre les États (4).
La protection diplomatique en matière d’investissement comporte toutefois des limites évidentes. Elle laisse la protection de l’investisseur à la discrétion de son État d’origine qui peut la lui refuser. De plus, même s’il décide d’intervenir, c’est la réparation de son propre préjudice qu’il recherchera et non celui de son ressortissant ; or, une telle réparation, dans les relations internationales, est très souvent symbolique (excuses officielles, engagement à ne pas recommencer…), bien loin de la compensation sonnante et trébuchante qu’espère généralement le plaignant. Enfin, elle soumet le règlement des différends aux rapports de force entre États, souvent inégaux.
Les commissions mixtes sont, historiquement, l’autre moyen à la disposition des investisseurs étrangers pour obtenir réparation de leur préjudice. Elles sont apparues dans le contexte particulier de la guerre d’indépendance américaine afin de régler les différends liés, notamment, à l’indemnisation des pertes subies par les ressortissants des États-Unis et de la Grande-Bretagne. En effet, le traité de Jay (1794) institua des commissions bipartites qui apparaissent comme la première juridiction internationale de l’Histoire contemporaine. Leur présidence était ainsi confiée à un « surarbitre » qui était le ressortissant d’un État tiers. En outre, elles ont été créées pour examiner des réclamations d’individus contre des États, première manifestation de l’idée qu’une personne privée pouvait avoir accès à des mécanismes permettant de faire valoir les droits qu’elle tire du droit international et obtenir une compensation monétaire de son préjudice. Toutefois, leurs décisions devaient faire l’objet d’un accord entre les deux États et leur compétence était limitée à un contexte historique particulier (5).
Ce rappel historique qui s’appuie, comme certains des développements à suivre, sur l’ouvrage de M. Arnaud de Nanteuil (6), s’imposait. Non seulement ces deux moyens de protection des investisseurs sont à l’origine de certaines caractéristiques de l’arbitrage moderne mais ils sont toujours d’actualité dans les différends entre les investisseurs et les États. C’est ainsi que l’Iran et les États-Unis ont institué en 1982 un équivalent de commission mixte (toujours active) pour régler les différends, notamment financiers, liés à la révolution iranienne et impliquant des ressortissants américains. De même, des investisseurs italiens ont demandé, il y a quelques années, la protection de leur État dans un différend avec Cuba (7). Par ailleurs, le mécanisme de règlement des différends de l’OMC s’apparente, par plusieurs points, à la protection diplomatique, dans la mesure où seuls les États sont parties devant l’Organe de règlement des différends (ORD).
ii. L’apparition des TBI, réponse au blocage politique sur le contenu du droit international de l’investissement
Même s’ils ont permis de mieux protéger les investissements étrangers et de régler pacifiquement des différends entre les investisseurs et les États, les deux moyens précités se sont toutefois révélés inadaptés pour protéger les investissements toujours plus importants à mesure que l’économie s’internationalisait ; dans de nombreux cas, les investisseurs étaient à la merci des États d’accueil et de leurs tribunaux. En effet, à partir du 20ème siècle, et plus encore après la deuxième guerre mondiale, se sont développés les contrats d’État, signés entre une entreprise privée, généralement occidentale, et un État, généralement un pays en voie de développement, en particulier dans le secteur des mines ou des hydrocarbures.
Ces contrats sont en principe soumis au seul droit interne et, en cas de différend, aux seuls tribunaux de l’État d’accueil de l’investissement, en application des règles du droit international privé (8), avec tous les risques qui en découlent pour l’investisseur. C’est pourquoi, très rapidement, celui-ci a exigé que le contrat comporte une clause compromissoire lui permettant de saisir directement un tribunal arbitral en cas de difficulté dans l’exécution du contrat. Cependant, un tel tribunal applique, sauf accord contraire des parties, le droit de l’État. Le problème reste donc entier car c’est généralement ce droit qui est directement à l’origine du litige, notamment dans les cas d’expropriation. Il apparaissait donc dans l’intérêt de l’investisseur que le droit de son propre État soit applicable à son contrat, ce que l’État d’accueil ne pouvait pas accepter. Dans ces conditions, le seul choix possible est celui du droit international, auquel il est par ailleurs reconnu depuis longtemps qu’il peut créer des droits directement aux personnes privées (9).
Or, si les parties à un contrat d’État pouvaient inclure dans celui-ci une clause compromissoire et prévoir que les différends seraient tranchés par un tribunal arbitral selon les règles du droit international, encore fallait-il que l’investisseur soit sûr des garanties qui en découlent. Or, ces règles étaient loin d’être certaines car le droit coutumier de l’investissement, s’il a pu définir par le passé un « standard minimal », s’est trouvé, après la deuxième guerre mondiale, au cœur d’une controverse politique majeure entre les pays développés exportateurs de capitaux, soucieux de protéger leurs investisseurs, et les pays en voie de développement importateurs de capitaux, désireux de conserver leur souveraineté. Cette opposition a rendu impossible l’élaboration de règles claires concernant les garanties que les investisseurs tiraient du droit international.
Cette opposition, déjà latente au 19ème siècle avec la doctrine Calvo (10), s’est en effet exacerbée après la deuxième guerre mondiale dans un contexte marqué par la guerre froide et la décolonisation. De politique, le combat est devenu idéologique, les investissements directs étrangers apparaissant comme un moyen d’asservissement des pays nouvellement indépendants par les anciennes métropoles capitalistes ; les débats à l’ONU, notamment ceux ayant abouti à la résolution 1803 (XVII) en 1962 affirmant la « souveraineté permanente » des États sur leurs ressources naturelles, la primauté du droit interne pour l’encadrement et le règlement des différends relatif à l’investissement comme les multiples expropriations témoignent de la violence de cette opposition (11).
Conscientes de l’impossibilité de parvenir à un consensus sur le contenu du droit international de l’investissement comme des dangers à voir les différends relatifs aux investissements réglés par les tribunaux des États d’accueil, les parties contractantes au GATT ont adopté, en 1955, une résolution incitant à conclure des accords bilatéraux afin d'assurer la protection des investissements étrangers. À partir de ce moment, les pays développés ont privilégié la signature de traités bilatéraux, dans lesquels figurent des clauses à la fois substantielles et procédurales destinées à protéger les investisseurs, des insuffisances du système judiciaire des pays en voie de développement, en donnant un contenu clair au droit international de l’investissement. Bien que les TBI soient tous différents, outre une définition de l’investisseur et de l’investissement, quatre protections sont généralement offertes aux investisseurs:
– la protection contre la discrimination avec la clause de la nation la plus favorisée et la clause du traitement national ;
– la protection contre l’expropriation, directe ou indirecte, sans une juste compensation;
– la protection contre un traitement injuste et inéquitable ;
– la garantie de la possibilité de transférer des capitaux à l’étranger.
Les TBI comprennent enfin un mécanisme de RDIE, permettant la mise en œuvre effective des protections susmentionnées via la saisine d’un tribunal arbitral.
Il est frappant de constater que l’on retrouve, dans ces TBI, les dispositions en vigueur dans les traités d’amitié, de commerce et de navigation du 18ème siècle, avec cette différence qu’ils sont exclusivement signés avec des pays en voie de développement.
Le développement des TBI fut lent. Le précurseur a été l’Allemagne, qui a signé le premier TBI en 1959 avec le Pakistan. Ce pays s’est montré particulièrement actif puisqu’en 1972, il disposait de 46 TBI, tous signés avec des pays en voie de développement. D’autres pays ont suivi, plus ou moins rapidement : la Belgique à partir de 1966, la France à partir de 1972 et le Royaume-Uni à partir de 1975. Du point de vue géographique, la plupart des premiers TBI ont été conclus entre des pays d’Europe de l’ouest et les pays africains. Ainsi, 26 pays africains ont signé des TBI dans les années 60, mais seulement 10 pays asiatiques. Les pays latino-américains, adhérant à la doctrine Calvo, étaient plus réservés, avec seulement deux TBI dans les années 60. Au total, entre 1959 et 1969, 75 TBI ont été conclus.
Les États-Unis n’ont, quant à eux, signé leur premier TBI (avec l’Égypte) qu’en 1982. En effet, ce pays préférait signer des accords de garantie, notamment avec les pays d’Amérique latine, en complément à l’assurance contre les risques politiques fournie par l’Orverseas Private Investment Corporation. La première puissance commerciale mondiale, a donc, pendant longtemps choisi de privilégier d’autres systèmes de protection des investissements.
Le tableau suivant retrace le nombre de TBI signés par an ainsi que le nombre total de ceux-ci depuis le début des années 60 :
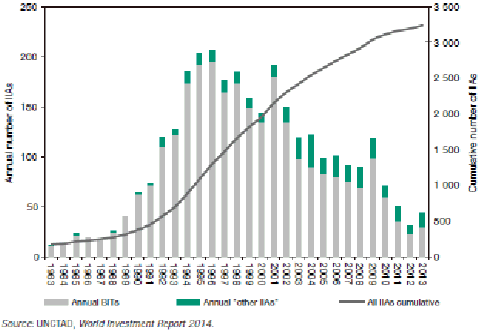
On observe que le mouvement a commencé à s’accélérer à partir des années 80. Le second choc pétrolier, la mondialisation croissante de l’économie et la crise de la dette ont amené de plus en plus de pays à vouloir attirer des investissements étrangers. La réussite économique d’anciens pays très pauvres, notamment asiatiques, qui avaient très tôt fait le choix de les accueillir a semblé valider cette option.
Ayant identifié les investissements étrangers comme une possibilité majeure de croissance, les pays en développement ont donc commencé à multiplier les TBI, dont le nombre atteignait 386 à la fin des années 80 (dont 322 avec des pays développés).
C’est toutefois au cours de la décennie suivante que le nombre de TBI a véritablement explosé. Vers la fin de l’année 1996, il y avait un total de 1 332 traités, dont 824 conclus par les pays développés. Le nombre de TBI conclus entre les pays en développement et les économies en transition a également augmenté pendant les années 90. En effet, de 64 traités signés à la fin des années 80, ils sont passés à 508 à la fin de l’année 1996.
Enfin, c’est également à partir des années 90 et la signature de l’ALENA qu’un nouveau modèle de TBI a émergé, répandu ensuite par les États-Unis et le Canada via tous les TBI qu’ils ont signés. À leur initiative, les TBI contiennent désormais des dispositions relatives à l’environnement, à la santé et au développement durable, garantissant en principe le droit à réguler des États dans ces domaines, tout en définissant les droits des investisseurs, qu’il s’agisse des quatre protections énoncées plus haut ou de la procédure arbitrale, désormais plus transparente et encadrée. Les États-Unis et le Canada ont ainsi totalement repensé leur pratique et éliminé de leur nouveau modèle les éléments les plus risqués qui figuraient traditionnellement dans leurs TBI.
En revanche, rien de tel en Europe. Les pays d’Europe de l’ouest ont continué à signer des TBI, notamment avec les pays d’Europe de l’Est dans les années 90, inspirés d’un modèle de l’OCDE remontant à 1952. N’ayant été que très exceptionnellement, jusqu’à une période récente, défendeurs ou condamnés dans une procédure d’arbitrage liée à un investissement étranger, peut-être ont-ils eu une conscience moins aigüe que les États-Unis et le Canada des risques que les clauses sommaires et vagues de leurs traités pouvaient leur faire encourir. Les 96 TBI signés par la France actuellement en vigueur, que votre rapporteure a consultés, se caractérisent ainsi par leur brièveté et l’imprécision de leurs termes, notamment s’agissant de l’investisseur et de l’investissement.
Parmi les grands pays, un seul s’est montré constamment hostile aux TBI : le Brésil. Certes, il en a signé 14 (dont un avec la France en 1995) mais aucun d’entre eux n’est semble-t-il actuellement en vigueur.
b. Après l’échec de l’Accord multilatéral sur l’investissement en 1998, la protection des investissements dans les traités plurilatéraux est géographiquement et/ou matériellement limitée
Si les TBI ont connu un tel essor, en particulier depuis les années 90, c’est, comme pour leur apparition, en raison de l’échec répété des négociations visant à élaborer un cadre multilatéral pour la promotion et la protection des investissements. Toutefois, ces échecs n’ont pas empêché l’apparition d’un droit international des investissements « régionalisé », le cas échéant limité aux investissements réalisés dans un secteur particulier.
L’ambition d’un véritable droit international de l’investissement est ancienne puisqu’elle remonte à la Charte de la Havane, négociée parallèlement au GATT, juste après la deuxième guerre mondiale. L’intérêt d’un système de règles multilatérales est double, à la fois pour les États et les investisseurs :
– d’une part, il harmoniserait le droit des investissements internationaux qui, aujourd’hui, est éclaté en de très nombreux accords bilatéraux et régionaux ;
– d’autre part, par un mécanisme centralisé de règlement des conflits, il donnerait à l’application de ce droit une cohérence qui n’est pas possible avec le système des tribunaux arbitraux ad hoc (voir infra).
Première tentative pour définir un cadre multilatéral pour les investissements internationaux, la Charte de la Havane a cependant échoué en raison du refus du Sénat américain de la ratifier après que les États d’Amérique latine eurent obtenu des amendements jugés contraires aux intérêts des investisseurs des pays développés.
Quelques années plus tard, le cadre des négociations s’est déplacé à l’OCDE, n’impliquant dès lors que les pays développés. Le premier projet visant à négocier une convention sur la protection des biens étrangers échoue en 1967. Les négociations reprennent en mai 1995 (12) avec pour objectif de libéraliser les régimes d’investissement, d’améliorer la protection de l’investissement étranger et d’instituer un mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États.
Dans les faits, cet Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) a été négocié en secret pendant deux ans avant qu’en avril 1997, les sociétés civiles canadiennes, américaines et européennes n’en mesurent les conséquences ; ainsi disséqué et analysé, il a suscité une mobilisation active des réseaux associatifs, en particulier dans les secteurs culturels et audiovisuels, et des campagnes de sensibilisation des citoyens et de leurs élus.
Face à cette mobilisation, le gouvernement français a confié à une députée européenne, Mme Catherine Lalumière, un rapport sur l’AMI rendu public à l’automne 1998. Le constat qu’elle a fait dans ce rapport a frappé votre rapporteure par son actualité dans le contexte de la négociation du PTCI (13). « C’est une grande erreur d’avoir traité la négociation AMI comme une opération purement technique. Beaucoup des difficultés rencontrées par la suite en découlent : le sentiment, largement répandu, d’une négociation secrète, voire clandestine, l'incapacité de l'organisation à détecter à l'avance les difficultés et à y remédier et la surprise éprouvée, dans plusieurs pays, devant l'ampleur des oppositions ». À la suite de ce rapport, la France s’est retirée des négociations, entraînant leur suspension définitive.
Peu suspecte de sympathie pour les multinationales et la libéralisation des investissements, l’auteure du rapport reconnaît pourtant que « renoncer à tout accord international sur l’investissement n’est pas souhaitable. Dans le désordre actuel de la mondialisation, il y a un intérêt de tous les pays à l’établissement de règles stables et équitables. Un accord peut offrir l’occasion de franchir une étape dans la voie d’une meilleure régulation de l’économie mondiale en établissant des régimes d’investissement et en réalisant des progrès sur les normes environnementales et sociales ». Si votre rapporteure considère que l’AMI était un mauvais accord négocié dans de mauvaises conditions, il n’en reste pas moins que sur le strict plan du droit, il a constitué la dernière tentative de multilatéraliser le droit des investissements en donnant des définitions de ses concepts clés aujourd’hui éclatées dans une mosaïque de traités bilatéraux et régionaux (14).
Contrairement à ce qu’imaginaient probablement ses opposants, l’échec de l’AMI n’a pas sonné le glas des tentatives de parvenir à un accord multilatéral sur l’investissement. En effet, le cadre de négociation s’est déplacé de l’OCDE à l’OMC. C’est ainsi que la première conférence interministérielle de la nouvelle organisation, qui s’est tenue à Singapour en 1996, avait défini plusieurs priorités (dites « sujets de Singapour ») parmi lesquelles l’investissement. Cependant, les négociations sur lesdits sujets ont échoué lors de la conférence de Cancun en 2003, faisant par conséquent disparaître l’investissement de l’agenda du cycle de Doha.
L’échec à multilatéraliser ne doit pas faire oublier le fait que plusieurs traités plurilatéraux ont institué des mécanismes de règlement des différends entre les États et les investisseurs, bien que la promotion et la protection des investissements ne soient pas leur objet principal. Votre rapporteure s’est ainsi penchée sur quatre d’entre eux : L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’Accord d’association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le marché commun sud-américain (MERCOSUR) et l’accord de libre-échange entre les États-Unis, la République Dominicaine et les États d’Amérique centrale (CAFTA DR).
L’ALENA a été signé le 17 décembre 1992 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, se substituant à l’Accord de libre-échange signé en 1988 par les États-Unis et le Canada. Il visait à libéraliser, en dix ans, à la fois le commerce des biens et des services, via l’élimination des entraves tarifaires et non tarifaires, et les investissements.
L’ALENA présente un intérêt particulier dans le cadre de ce rapport et votre rapporteure le prendra comme exemple en de nombreuses occasions. En effet, c’est la première fois qu’un accord incluant des dispositions relatives à l’investissement réunit deux pays développés et un pays en voie de développement. En effet, l’accord précurseur entre les États-Unis et le Canada ne comportait pas de RDIE. C’est seulement parce qu’il a été élargi au Mexique – pays qui, a priori, n’était pas considéré comme présentant à l’époque toutes les garanties pour les investisseurs – que les États-Unis ont exigé et obtenu la présence d’un RDIE. Enfin, ainsi qu’il a été dit, les dispositions relatives à l’investissement sont devenues un modèle pour les TBI des États-Unis et du Canada, ainsi que les accords régionaux signés ultérieurement (voir infra).
Par ailleurs, a été signé le 26 mars 1991 l’accord sur le MERCOSUR ou marché commun de l’Amérique du Sud. Il vise à instaurer une zone de libre-échange et une union douanière entre quatre pays : l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le Brésil. Ce traité a été complété par de nombreux protocoles dont le protocole de Colonia sur la promotion et la protection réciproque des investissements à l’intérieur du Mercosur, signé le 17 janvier 1994. Ledit protocole s’inspire très fortement de l’ALENA, notamment dans son article 1er qui reprend la définition économique de l’investissement établie par l’ALENA dans son article 1139. Se retrouvent également les notions de traitement national, de la nation la plus favorisée et de norme minimale de traitement qui sont présentes dans l'ALÉNA, sans toutefois la même précision ni la même clarté que ce dernier. Il reprend aussi les principes de compensation prompte, juste et équitable et garantit le libre transfert des capitaux. Enfin, comme dans l’ALENA, le protocole ouvre la possibilité pour les investisseurs de recourir à l’arbitrage privé pour le règlement de leurs différends avec les États parties. Ce protocole n’est cependant jamais entré en vigueur et n’a donc donné lieu ni à des différends ni à des sentences arbitrales.
Quant à l’accord de libre-échange entre les États-Unis, la République Dominicaine et les États d’Amérique centrale (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua), signé le 28 mai 2004, il inclut un RDIE qui a été mis en œuvre à cinq reprises. Si deux plaintes ont été rejetées, les tribunaux arbitraux ont, dans deux affaires, condamné le Guatemala à indemniser des investisseurs américains pour un montant total de 43,6 millions de dollars. Par ailleurs, la dernière plainte s’est réglée par une transaction à l’avantage des investisseurs américains qui ont touché 26,5 millions de dollars de la République Dominicaine.
L’ASEAN est une organisation politique, économique et culturelle regroupant dix pays d'Asie du Sud-Est (15). Signé en 1967, cet accord a été complété, comme le MERCOSUR, par divers instruments permettant d’améliorer l’intégration économique. C’est ainsi que le 15 décembre 1987, les membres de l’association ont conclu un accord de promotion et de protection des investissements, auquel s’est substitué l’Accord sur l’investissement du 26 février 2009. Quatre fois plus long que l’accord qu’il remplace, il est également beaucoup plus précis dans ses définitions qui s’inspirent fortement de celles de l’ALENA. En outre, il ne se contente pas, s’agissant de la procédure arbitrale, de renvoyer aux règles du CIRDI, de la CNUDCI ou d’un autre centre d’arbitrage. En effet, ces règles ne s’appliquent que pour autant qu’elles ne sont pas modifiées par l’Accord qui les complète sur plusieurs points et, notamment, en matière de transparence.
La Charte Européenne de l’Énergie (1991) était initialement conçue comme un instrument non contraignant destiné à approfondir la coopération entre l'ex-URSS, les pays d'Europe centrale et orientale et l’Occident dans le secteur de l'énergie. Toutefois, afin de donner un cadre juridique plus contraignant à cette coopération et de la renforcer, un traité sur la Charte de l'Énergie (TCE) a été signé le 17 décembre 1994 par 51 pays et les Communautés européennes (CEE et Euratom), reprenant largement les dispositions de la Charte elle-même (16).
Toutefois, cinq États ne l’ont pas ratifié et, s’agissant de la Russie, elle a mis fin à l’application provisoire du traité en 2009 à la suite de l’affaire Ioukos, déclenché justement sur le fondement de ce texte. Ce traité vise avant tout à promouvoir le commerce ainsi que les investissements dans le secteur de l’énergie, lesquels bénéficient des protections rappelées supra contre la discrimination, contre un traitement injuste et inéquitable, contre l’expropriation sans juste compensation ainsi que la garantie de la possibilité de transférer des capitaux. La mise en œuvre de ces protections est garantie par un RDIE. De manière classique, les investisseurs peuvent porter leur différend avec un État partie au traité devant un tribunal arbitral.
Bien que ce Traité sur la Charte de l’Energie ait un objet restreint au seul secteur de l’énergie, il n’en est pas moins très important à un double titre : il constitue le premier traité plurilatéral dont l’objet est explicitement la promotion et la protection des investissements et il reste, avec l’ALENA, le seul traité incluant un RDIE entre pays développés. Il a été le cadre de très nombreux recours contre les États-membres de l’Union Européenne, les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) en particulier mais également l’Allemagne et, surtout l’Espagne (voir infra).
En conclusion de cette présentation de la protection des investisseurs étrangers dans le droit international, on ne peut qu’être frappé par l’éparpillement des règles. Le droit international de l’investissement, contrairement au droit international du commerce des biens et services, régi par les règles de l’OMC, est une mosaïque faite de milliers d’accords bilatéraux, régionaux ou plurilatéraux ayant chacun leurs propres définitions des concepts clés que sont l’investisseur, l’investissement et les protections dont ils bénéficient ; en outre, ces concepts sont interprétés par une jurisprudence établie au cas par cas par les sentences de tribunaux arbitraux ad hoc et par conséquent fragmentée, voire contradictoire, en raison de l’absence d’une instance unique d’appel. En définitive, le seul consensus entre les États porte sur la procédure de règlement des différends entre les États et les investisseurs elle-même, ce fait expliquant par ailleurs la nature largement prétorienne du droit international de l’investissement.
2. Le mécanisme de règlement des différends entre les États et les investisseurs prend aujourd’hui la forme d’un arbitrage privé
Les près de 3 300 TBI actuellement en vigueur (au 31 décembre 2014) ont été négociés par des États qui, souverains, leur ont donné le contenu qui leur convenait le mieux compte tenu des garanties qu’ils voulaient apporter (ou non) aux investisseurs étrangers. Au-delà de leur diversité, les TBI présentent néanmoins des traits communs dans les protections qu’ils apportent aux investisseurs et, surtout, parce qu’ils incluent, pour la quasi-totalité d’entre eux, un mécanisme de règlement des différends identique prenant la forme de tribunaux d’arbitrage ad hoc (saisis directement par l’investisseur et réglant le litige en droit).
En d’autres termes, à défaut de s’accorder sur le contenu du droit international des investissements, le choix a été fait, dès les années 60, de définir une procédure considérée comme sûre, prévisible et neutre pour résoudre les différends entre les États et les investisseurs. Une telle approche était pragmatique compte tenu des oppositions idéologiques très fortes de l’époque (voir supra) et présentait l’avantage de protéger l’investisseur, d’une part, de l’arbitraire de son État d’origine – qui pouvait lui refuser sa protection pour ne pas nuire à ses relations bilatérales – et, d’autre part, de l’arbitraire de l’État d’accueil et de ses tribunaux.
En raison de l’ampleur du stock des investissements directs étrangers (IDE), les différends entre les investisseurs et les États sont inévitables et doivent pouvoir être réglés de manière efficace. Pour ce faire, le RDIE constitue l’une des voies possibles parmi d’autres.
C’est le terme utilisé par la CNUCED, qui lui a récemment consacré une étude (17), pour désigner l’ensemble des modes de règlement des différends « alternatifs aux méthodes principales de règlement des différends que sont le règlement par voie d’arbitrage et la décision rendue par une juridiction nationale ». Sont ainsi considérés comme tels :
– la conciliation est généralement un processus relativement formalisé. Elle fait ainsi l’objet d’un règlement du CIRDI et de ses équivalents, notamment la CNUDCI ou la Chambre de commerce international, l’ensemble de ces institutions offrant par ailleurs un appui logistique et administratif aux parties. Lorsqu’elle est fructueuse, la conciliation aboutit à une décision en bonne et due forme. C’est pourquoi elle a pu être décrite comme une sorte d’arbitrage non contraignant ; elle suppose l’intervention d’un tiers – le conciliateur – dont la fonction est d’instaurer une relation harmonieuse entre les parties et d’améliorer la communication entre elles tout en essayant, par ses conseils, de régler les problèmes de fond à l’origine du différend ;
– la médiation suppose, comme la conciliation, l’intervention d’un tiers mais elle est moins formalisée. À la demande des parties et selon les conditions qu’elles ont fixées, le médiateur intervient dans le litige pour contribuer à élaborer une solution viable. Son rôle consiste à réunir les parties pour les aider à trouver un compromis. Sa participation est variable, allant de l’encouragement au dialogue à la présentation concrète d’une proposition viable de règlement et des moyens de l’appliquer. Il s’efforce avant tout de comprendre où sont les intérêts de chacune des parties, de recadrer les positions en présence et d’examiner une série de solutions possibles pour régler le litige. La médiation est souvent assimilée à une procédure de négociation assistée.
– enfin, le dernier mode de règlement extrajudiciaire des différends est la négociation directe entre l’investisseur et l’État qui, en tant que telle, n’appelle pas de commentaire particulier.
Ces trois modes de règlement extrajudiciaire des différends entre les États et les investisseurs, bien que plus anciens que le recours à des tribunaux arbitraux, font aujourd’hui l’objet d’un retour en grâce, en particulier dans la doctrine, en raison des dysfonctionnements croissants de ces derniers :
– le coût élevé des procédures arbitrales qui, en moyenne, atteint 8 millions de dollars ;
– l’imprévisibilité des sentences arbitrales et les risques de contradiction de jurisprudence, au détriment à la fois des États et des investisseurs ;
– l’augmentation considérable de la durée des procédures arbitrales, alors même que la rapidité était traditionnellement l’un des atouts majeurs ;
– enfin, le recours à des tribunaux arbitraux, parce que ceux-ci ne peuvent qu’accorder ou refuser une compensation à l’investisseur, à l’exclusion de toute autre solution au différend, se traduit nécessairement par la rupture des liens d’affaires entre celui-ci et l’État.
Les avantages des modes de règlement extrajudiciaire des différends sont le reflet des inconvénients de l’arbitrage. Le principal est leur souplesse. En effet, rien n’interdit aux parties, le cas échéant guidées par le médiateur ou le conciliateur, de régler leur différend sur d’autres fondements que le droit, ouvrant la voie à une solution allant au-delà du versement d’une compensation et permettant ainsi la poursuite de leur relation d’affaires. Ces modes de règlement sont également plus rapides et moins onéreux sans priver l’investisseur de la possibilité d’intenter un recours juridictionnel en cas d’échec.
Le droit international de l’investissement n’ignore pas les possibilités offertes par ces modes alternatifs de règlement des différends. Nombreux sont d’ailleurs les traités qui les intègrent. Les TBI et autres traités plurilatéraux imposent ainsi très souvent à l’investisseur et à l’État concernés de rechercher préalablement un règlement à l’amiable de leur différend, via des consultations de bonne foi avant de pouvoir valablement, en cas d’échec, recourir à l’arbitrage international. C’est le cas par exemple de tous les TBI signés par les États-Unis. Ce sera le cas également pour l’AECG dont l’article 8.19 stipule que « tout différend devrait, dans la mesure du possible, être réglé à l’amiable. Il est possible d’accepter un tel règlement à tout moment, y compris après le début de l’arbitrage ». De même, ils peuvent, aux termes de l’article 8.20, avoir recours à un médiateur, nommé conjointement. C’est seulement après un délai de 90 jours de consultations (ou 60 jours de médiation) infructueuses que l’investisseur pourra valablement porter son différend devant un tribunal arbitral.
Toutefois, malgré leurs avantages réels, les procédures de règlement extrajudiciaire des différends présentent des insuffisances. C’est pourquoi, pour être efficaces, elles doivent nécessairement être complétées par la possibilité d’un recours juridictionnel, national ou international. En effet :
– le résultat d’une négociation, d’une médiation ou d’une conciliation n’est jamais contraignant pour les parties ;
– les modes de règlement extrajudiciaire peuvent aboutir à une perte de temps et d’argent lorsque l’une des parties n’est pas de bonne foi ;
– ils ne conviennent pas à tous les différends. Ainsi, il n’est généralement pas possible à un État de négocier, et de transiger, sur les effets de règles ou de lois en faisant une exception pour les investisseurs étrangers. Si c’était le cas, ces modes de règlement extrajudiciaire seraient à juste titre dénoncés comme une discrimination scandaleuse à leur avantage ;
– ils seraient enfin d’autant plus dénoncés que ces modes de règlement extrajudiciaire sont généralement confidentiels, bien plus que les procédures d’arbitrage dont on a vu qu’elles avaient récemment évolué vers une plus grande transparence, laquelle sera quasi-totale dans l’AECG.
Au final, il est impossible de savoir en pratique si ces modes de règlement extrajudiciaire des différends ont pu être efficaces. En effet, comme le relève la CNUCED, « compte tenu du caractère généralement confidentiel de ces règlements à l’amiable, il n’existe pas de statistiques précises et complètes sur le règlement négocié des différends opposant un investisseur à un État ». Toutefois, l’accroissement considérable du nombre de mise en œuvre du RDIE est un indice de son caractère incontournable dans le règlement de ces différends.
Parce qu’elle peut couvrir des risques non-commerciaux, les effets de l’assurance privée sont largement similaires à la mise en œuvre d’un RDIE pour l’investisseur : l’assureur lui versera en effet une compensation en cas de perte liée à une expropriation (directe ou indirecte), des troubles politiques ou encore la rupture abusive d’un contrat, autant de risques qui, de toute évidence, recoupent largement les garanties apportées par les traités d’investissement. Par rapport au RDIE, l’assurance privée présente des avantages importants dont la rapidité, la prévisibilité et la simplicité, sans être forcément d’un coût supérieur compte tenu des coûts élevés d’une procédure arbitrale.
Des mécanismes d’assurance des opérations d’investissement international ont été créés au départ par les États pour leurs seuls investisseurs. Ils devaient pallier l’absence de protection efficace des investisseurs par le droit international. C’est le cas par exemple de l’Overseas Private Investments Corporation, créée par les États-Unis en 1971, ou encore de la COFACE française, créée en 1946. Bien que publiques ou parapubliques, ces agences fonctionnent en tous points comme des assurances privées : l’investisseur leur verse une prime annuelle et elles n’interviennent qu’en cas de sinistre.
À ces mécanismes d’assurance nationaux s’est ajouté un mécanisme international de garantie des investissements. Le 11 octobre 1985 a été signée la convention de Séoul créant l’Agence multilatérale de garantie des investissements (Multilateral investments guarantee agency – MIGA). Intégrée comme le CIRDI au groupe de la Banque mondiale, elle assure les investisseurs contre les risques non-commerciaux précités et exclusivement ceux-ci. Les pertes d’un investisseur, même importantes, résultant d’un mauvais choix stratégique, d’une crise économique ou d’une analyse de marché défaillante ne sont jamais couvertes par la MIGA, pas plus d’ailleurs que par les assurances nationales.
Toutefois, pour séduisants qu’ils soient, ces mécanismes d’assurance et de garantie présentent des limites importantes qui empêchent de les considérer comme des alternatives au RDIE. Celles-ci sont au nombre de trois :
– compte tenu de l’ampleur du stock des investissements directs internationaux aujourd’hui (29 000 milliards de dollars selon la CNUCED), il est absolument impossible pour les mécanismes précités, tant nationaux que multilatéraux, de porter dans leur bilan l’ensemble des risques qui leur sont associés. Les règles prudentielles s’y opposent autant que le bon sens ;
– par ailleurs, tous les investissements ne sont pas assurables, en particulier les investissements à très long terme. La COFACE limite ainsi sa garantie à vingt ans. Or, nombreux sont les différends portant sur des concessions dont la durée est très supérieure. Les entreprises auditionnées par votre rapporteure ont été unanimes à souligner l’inadéquation des mécanismes d’assurance pour garantir leurs investissements ;
– enfin, la limite majeure réside dans le lien existant entre ces mécanismes et le RDIE. En effet, les TBI prévoient généralement, dans l’hypothèse d’un investisseur disposant d’une assurance, la subrogation de l’assureur dans les droits de l’investisseur, lui permettant de se retourner contre l’État d’accueil. C’est ainsi que les agences précitées – dont la COFACE – n’assurent les investissements que dans les pays liés par un TBI avec l’État de leurs clients. En l’absence de TBI, elles refusent d’assurer l’investissement.
b. Le RDIE repose sur le consentement des États à voir leurs différends avec les investisseurs réglés par l’arbitrage
Le consentement d’un État partie à un traité de promotion et de protection des investissements (ou un contrat d’État) à voir ses différends avec les investisseurs (ou avec son cocontractant privé) réglés via un RDIE ne se présume pas ; il doit être inscrit en tant que tel dans le traité, le contrat d’État ou, éventuellement, dans une loi interne.
Toutefois, comme en droit civil, la question de la rencontre des consentements se pose. En effet, en dehors du contrat d’État incluant une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, les parties à un différend relatif à un investissement – qui implique une personne privée – ne sont par définition pas les mêmes que celles à un traité. Cette question délicate a été réglée par la sentence célèbre rendue dans l’affaire Asian agricultural products ltd. (AAPL) c/ Sri Lanka (1990).
Cette sentence est capitale et mérite d’être présentée plus en détail. En effet, ainsi qu’il a été rappelé supra, les TBI sont apparus dans les années 50 dans le cadre des contrats d’État qui, en outre, pouvaient être « couverts » par un traité spécifique entre l’État de l’investisseur et l’État d’accueil de l’investissement stipulant que ce dernier devait respecter les engagements contractés à l’égard des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre Partie contractante. C’est ainsi que les premiers TBI ont été qualifiés de « traités parapluies » en ce qu’ils avaient pour objet de « couvrir » des relations contractuelles en transformant une éventuelle violation d’une clause d’un contrat en la violation d’un traité engageant, par conséquent, la responsabilité internationale de l’État. Il s’ensuit que jusqu’en 1990, seuls les différends relatifs à un contrat entre un État et un investisseur pouvaient être réglés par un tribunal arbitral. En l’absence de clause compromissoire ou de compromis d’arbitrage, d’un traité parapluie ou éventuellement d’une loi de l’État par lequel celui-ci s’engage unilatéralement à accepter l’arbitrage en cas de différend avec un investisseur étranger (18), celui-ci déclinait sa compétence pour défaut de consentement de l’État.
C’est dans ce contexte qu’intervient la sentence AAPL. En 1987, la société Asian Agricultural Products Ltd (AAPL), immatriculée à Hong Kong (à l’époque colonie britannique), avait pris une participation minoritaire dans le capital d’une entreprise du Sri lanka, Serendib Seafood Ltd, exploitant une usine de crevettes. Or, ce pays était alors en proie à des troubles liés à l’insurrection tamoule, avec pour conséquence que l’usine précitée fut détruite lors d’une opération militaire. Le requérant, cherchant à voir son préjudice indemnisé, se tourna alors vers le Centre international de règlement des différends entre les États et les investisseurs (CIRDI), principale instance d’arbitrage dans ce domaine, qu’il saisit sur le fondement du TBI du Sri Lanka avec le Royaume-Uni de 1980.
Or, APPL n’avait pas de lien de droit avec le Sri Lanka et encore moins de contrat. Par conséquent, en l’absence de contrat incluant une clause compromissoire, d’un compromis d’arbitrage comme d’une loi sri-lankaise formalisant le consentement de l’État à l’arbitrage en cas de différend avec un investisseur étranger, la saisine aurait dû être rejetée, l’État Sri Lankais n’ayant jamais consenti à un arbitrage avec APPL.
Le tribunal arbitral reconnut pourtant sa compétence. En effet, ce TBI comme la majorité d’entre eux contenait une clause type stipulant que « les parties contractantes consentent à soumettre au Centre international de règlement des différends entre les États et les investisseurs tout différend entre une partie contractante et une personne ou une entreprise de l’autre partie contractante concernant un investissement sur le territoire de cette dernière ». Le tribunal a donc interprété cette clause non pas comme un engagement des États à soumettre au CIRDI leurs différends avec un investisseur mais comme un consentement unilatéral à l’arbitrage prenant la forme d’une offre permanente et anticipée faite à l’ensemble des investisseurs de l’autre État partie. Ceux-ci n’ont plus qu’à l’accepter pour que l’accord de volontés soit parfait. Une fois le TBI ratifié, le consentement de l’État n’a donc plus besoin de se traduire par une manifestation de volonté expresse et spécifique.
Aujourd’hui, la question du consentement de l’État ne se pose plus puisque les TBI actuels prévoient explicitement la possibilité, pour les investisseurs étrangers, de saisir un tribunal arbitral pour régler leurs différends avec l’État d’accueil. Toutefois, il ne fait pas de doute que cette décision a, dans une mesure certaine, participé à l’augmentation du nombre de saisines à partir des années 90. Elle est la preuve, si besoin en était, du bouleversement qui peut découler de l’interprétation large d’une norme juridique imprécise.
Parce qu’il est maître des traités, l’État est en mesure de donner à son consentement à l’arbitrage la portée qu’il souhaite et, ainsi, de poser les limites qu’il estime nécessaire à celui-ci. C’est ainsi que, d’une manière générale, l’investisseur ne peut saisir le tribunal arbitral qu’après avoir négocié de bonne foi avec l’État et essayé de trouver avec lui un règlement amiable de son différend. Ces négociations sont enserrées dans un délai, - par exemple six mois pour l’AECG ou l’ALENA - dont le respect conditionne la compétence du tribunal arbitral. C’est seulement en cas d’échec et après le délai imparti que ce dernier pourra être valablement saisi.
Les TBI peuvent également imposer à l’investisseur d’avoir épuisé les voies de recours internes avant de pouvoir saisir le tribunal arbitral. C’est le cas avec la protection diplomatique et les premiers TBI c’est-à-dire ceux des années 60 qui pouvaient subordonner la saisine du tribunal arbitral à ce préalable. Aujourd’hui, la quasi-totalité des traités permettent à l’investisseur de saisir immédiatement le TBI (après la période de médiation précitée) ; en revanche, ils imposent généralement à l’investisseur de faire un choix irrévocable entre la procédure arbitrale et les voies de recours internes. Une telle clause de renonciation aux autres voies de recours est également prévue par l’article 26 de la convention de Washington.
Les États peuvent également réduire la portée de leur consentement au RDIE par plusieurs autres moyens: en définissant précisément les investissements concernés ainsi que l’investisseur, en excluant du RDIE les différends relatifs à certaines matières et/ou secteurs jugés sensibles ou en instituant un filtre interétatique à la saisine du tribunal arbitral.
Une fois le consentement des États parties donné à ce que leurs différends avec des investisseurs soient réglés par un RDIE, les traités ne fixent généralement pas eux-mêmes le mécanisme mais se contentent de renvoyer à des systèmes de règles extérieurs au traité qui, tous, ont en commun d’instituer un arbitrage privé international. C’est un point sur lequel il convient d’insister. Le RDIE n’est, comme son nom l’indique, qu’un mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États. S’il prend aujourd’hui la forme d’un arbitrage privé ad hoc, c’est par la volonté des États qui auraient pu lui en donner une autre, par exemple d’une Cour internationale permanente.
Les TBI comme les traités plurilatéraux portant sur l’investissement ouvrent à l’investisseur le choix entre plusieurs instances d’arbitrage qui ont toutefois, en pratique, une importance variable. La première et la plus importante est le Centre international de règlement des différends entre les États et les investisseurs (CIRDI). Contrairement aux autres, il a été créé en 1965 par un traité – la convention de Washington – signée par 159 États (au 31 décembre 2014), soit quasiment autant d’État que l’OMC (19).
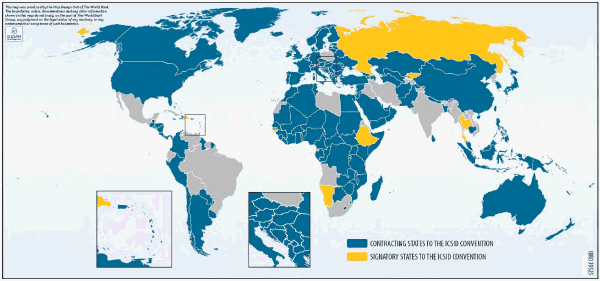
Rattaché à la Banque Mondiale, le CIRDI n’est pas une juridiction. Pas plus que les autres instances qui seront présentées infra, il n’arbitre pas lui-même les différends. Il propose des règles d’arbitrage et met à disposition des parties sa logistique, y compris des listes d’arbitres, mais il appartient à celles-ci de constituer un tribunal d’arbitrage ad hoc pour régler leur différend. Dans le cadre du CIRDI, deux systèmes de règles sont possibles :
– le mécanisme général de règlement des différends applicable lorsque l’État défendeur et l’État de l’investisseur sont tous les deux parties à la convention de Washington ;
– le mécanisme supplémentaire qui s’applique lorsque seulement un des deux États a ratifié cette convention. Le cas est plus fréquent qu’on le pense, notamment dans le cadre de l’ALENA, puisque le Canada ne l’a ratifiée qu’en 2013. En outre, à l’exception de la Chine, les quatre autres États du groupe des BRICS, c’est-à-dire la Russie, le Brésil (par ailleurs réticent à l’égard des TBI), l’Inde et l’Afrique du sud ne l’ont pas signée ou pas ratifiée, de même que de nombreux pays asiatiques (Birmanie, Laos, Vietnam et Thaïlande) et latino-américains (20). En Europe, la Pologne est le seul pays qui ne soit pas partie à la Convention de Washington.
Parmi les autres instances d’arbitrages pouvant être choisies par l’investisseur, si du moins le TBI lui ouvre cette possibilité, figurent :
– la Cour permanente d’arbitrage de La Haye qui, comme il a été dit supra, n’est pas une juridiction mais, comme le CIRDI, une organisation internationale facilitant l’organisation de l’arbitrage. N’ayant pas de règles propres, elle utilise le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations-Unies pour le développement du commerce international (CNUDCI) ;
– l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm ;
– la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris ;
– la Cour d’arbitrage de Londres.
Enfin, il est à noter que les parties peuvent décider de ne pas recourir à ces instances et rédiger elles-mêmes leurs propres règles d’arbitrage.
Mais en pratique, les TBI de nouvelle génération comme l’AECG, sans fixer l’intégralité des règles d’arbitrage, complètent ou précisent les règles d’arbitrage des instances auxquelles ils renvoient. C’était déjà le cas dans l’ALENA qui ne se contente pas, à l’article 1120, de renvoyer à la convention CIRDI, au règlement du mécanisme supplémentaire de ce dernier ou aux règles d’arbitrage de la CNUDCI, mais pose d’emblée que ces règles sont applicables, « sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section ».
ii. Le règlement des différends entre les États et les investisseurs dans le cadre du centre international de règlement des différends sur l’investissement (CIRDI)
Le CIRDI est aujourd’hui le principal cadre de règlement des différends entre les États et les investisseurs et les TBI comme les traités plurilatéraux le proposent quasi-systématiquement aux investisseurs. Votre rapporteure a donc fait le choix de présenter ces règles d’arbitrage, sachant que celles-ci ont de nombreux points communs avec celles des autres instances d’arbitrage précitées.
En préalable, il convient de souligner qu’à l’inverse de la protection diplomatique et des commissions mixtes, le règlement d’un différend par l’arbitrage repose exclusivement sur le droit. L’article 42 de la convention de Washington stipule ainsi que « le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties ». En outre, les règles devant être interprétées, le traité peut également guider l’interprétation des arbitres. Ainsi, en application de l’article X.27 du chapitre 10 de l’AECG, ils doivent rendre leur sentence « conformément au présent accord, tel qu’il est interprété en conformité à la Convention de Vienne sur le droit des traités, et à d’autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties ».
Une fois le CIRDI valablement saisi, c’est-à-dire conformément à la convention de Washington et aux règles du traité concerné, il appartient aux parties de désigner les arbitres, en principe à partir d’une liste établie par le CIRDI. Ceux-ci sont généralement au nombre de trois : chacune des parties en désignent un, le troisième étant désigné d’un commun accord. En cas de désaccord, les arbitres peuvent être désignés par le Secrétaire général du CIRDI. Les parties ont toutefois la possibilité de récuser un arbitre dès lors qu’il ne présenterait pas toutes les garanties en matière d’impartialité, en particulier s’il est prouvé qu’il est en situation de conflit d’intérêts.
D’une manière générale, on observe que les Européens occupent une place très importante parmi les arbitres, médiateurs et membres de comités ad hoc désignés dans le cadre de différends réglés par le CIRDI, comme le montre le diagramme suivant :
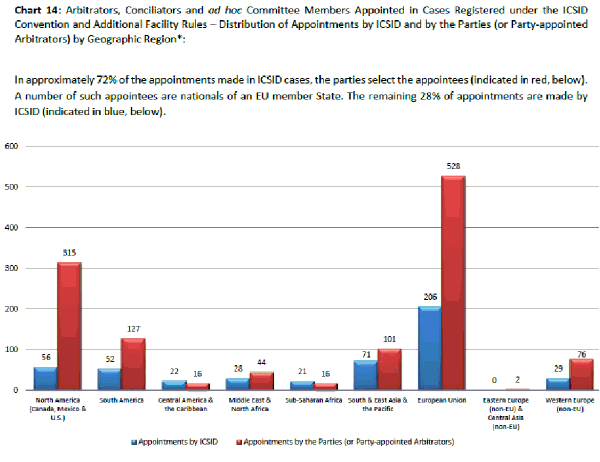
Une fois le tribunal arbitral constitué, l’investisseur doit prouver non seulement la violation d’une garantie mais également la réalité de son préjudice. La procédure est écrite (avec échange de mémoire) puis orale, contradictoire et, en principe, confidentielle. Toutefois, à l’inverse d’autres instances d’arbitrage, le CIRDI fait preuve d’une volonté de transparence qu’il convient de souligner, matérialisée par une importante réforme de son règlement en 2006. Les cas dont il est saisi sont désormais systématiquement répertoriés sur son site, de même que le nom des parties et des arbitres ainsi que les différents actes de procédure. De plus :
– sauf si l’une des parties s’y oppose, le tribunal arbitral peut autoriser des tiers à assister aux audiences et définit, dans ce cas, des procédures pour la protection des informations confidentielles ou protégées ;
– le tribunal arbitral peut, après consultation des parties (qui ne peuvent donc s’y opposer), et sous conditions, autoriser des tiers à intervenir dans la procédure comme amicus curiae ;
– enfin, si les parties doivent consentir à la publication des sentences, à supposer qu’elles refusent, le CIRDI publie systématiquement des « extraits du raisonnement des arbitres ».
Toutefois, malgré les améliorations apportées par cette réforme, on observe que, même dans le cas du CIRDI, la confidentialité d’une procédure d’arbitrage est largement entre les mains des parties et/ou des arbitres, quel que soit le retentissement du cas concerné. Dans le cas Vattenfall c/ Allemagne, malgré l’importance des enjeux, le secret entourant cette procédure est quasiment absolu puisque rien n’a été publié sur le site du CIRDI, sans d’ailleurs que l’on sache qui a imposé la confidentialité. Non seulement la société civile ne sait rien des arguments des uns et des autres, mais les Parlementaires allemands eux-mêmes ne disposent pas d’informations supplémentaires, à l’exception d’un bref résumé que leur a fourni le gouvernement (21).
Si l’État d’accueil est reconnu responsable d’une violation du traité qu’il a signé avec l’État d’origine de l’investisseur, le tribunal arbitral détermine les compensations qu’il devra verser à ce dernier, mais ne peut exiger le retrait de la décision contestée. La sentence, rendue après une procédure qui a pu durer plusieurs années, est définitive et sans appel. Elle est exécutoire de plein droit sans que l’exequatur par un juge national ne soit nécessaire. En effet, en application de l’article 54 de la convention de Washington, « chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État ». Une telle disposition, inédite s’agissant de l’arbitrage, explique pour une large part le succès du CIRDI (22).
La sentence peut toutefois faire l’objet d’un recours en annulation devant un comité ad hoc, composé de trois personnes nommées par le directeur du conseil administratif du CIRDI, conformément à l’article 52 de la convention de Washington. Toutefois, ce recours n’est possible que pour des motifs limitativement énumérés :
– vice dans la constitution du tribunal ;
– excès de pouvoir manifeste du tribunal ;
– corruption d’un membre du tribunal ;
– inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure ;
– défaut de motivation (23).
Ces dispositions relatives à l’annulation sont, comme celles relatives à l’exécution, spécifiques au règlement des différends dans le cadre de la convention de Washington. Pour les autres instances d’arbitrage, incluant le mécanisme supplémentaire du CIRDI, le contrôle de la sentence est exercé par les juridictions nationales du lieu de l’arbitrage, ce qui rend donc particulièrement stratégique le choix de ce dernier.
L’ensemble du coût de la procédure est à la charge des parties prenantes et peut être très lourd. Au cours des auditions qu’elle a menées, votre rapporteure a pu se faire une idée plus précise du coût de l’arbitrage. Si le coût de la logistique fournie par le CIRDI est relativement limité (100 000 dollars), ainsi que celui des arbitres (100 à 150 000 $ par arbitre selon le nombre de jours de travail, sur la base de 3 000 $ par jour), il n’en va pas de même pour les frais d’avocats qui peuvent atteindre un million de dollars pour une affaire simple. Si l’affaire représente des enjeux importants, les honoraires peuvent atteindre des sommes colossales : 70 millions de dollars, par exemple, pour l’affaire Ioukos. Selon la CNUDED, le coût moyen est de 8 millions de dollars.
En conclusion de cette présentation du fonctionnement du RDIE, on remarque qu’il s’agit d’un mécanisme de règlement des différends décentralisé, non hiérarchisé et fonctionnant de manière ad hoc, les tribunaux étant constitués pour régler un différend déterminé. Il se distingue ainsi d’un autre mécanisme international de règlement des différends : l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC. L’ORD ne peut être saisi que par un État pour obtenir l’annulation d’une décision prise par un autre État, qu’il estime incompatible avec les règles de l’OMC. En revanche, il ne peut par ce biais obtenir des compensations, ni pour lui, ni pour les entreprises qui, généralement, sont à l’origine de la saisine. Enfin, les décisions de l’ORD, rendues après une procédure largement transparente, sont susceptibles d’appel et systématiquement publiées.
B. LE RDIE, PRÉSENT DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES TRAITÉS, EST DE PLUS EN PLUS FRÉQUEMMENT MIS EN œUVRE, NOTAMMENT CONTRE LES PAYS DÉVELOPPÉS
Le RDIE est une clause incontournable, présente dans la quasi-totalité des traités bilatéraux et plurilatéraux d’investissement, notamment ceux signés par les États-membres de l’Union européenne, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des problèmes de compatibilité de ceux-ci avec le droit européen (1). Toutefois, jusqu’aux années 90, il était rarement mis en œuvre. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Non seulement le nombre de traités d’investissement a explosé mais les flux d’investissement eux-mêmes ont considérablement augmenté. Les cas de mise en œuvre du RDIE ont donc suivi cette évolution et connu un accroissement vertigineux, y compris contre les pays développés, États-Unis et Canada, mais également États-membres de l’Union européenne depuis qu’ils ont signé des traités plurilatéraux incluant un RDIE (2). Toutefois, les plus lourdes sanctions ont, pour l’essentiel, frappé les pays en voie de développement ou en transition (3).
1. Une présence quasi-constante du RDIE dans les traités bilatéraux et plurilatéraux d’investissement
a. Une présence massive, y compris dans les traités signés par et entre les États-membres de l’Union européenne
Près de 3300 traités d’investissement sont actuellement en vigueur dans le monde. Selon les chiffres de l’OCDE (24), le RDIE est présent dans 93 % d’entre eux, et dans la quasi-totalité de ceux signés entre pays développés et pays en voie de développement, conformément d’ailleurs à sa vocation initiale (25).
Pour impressionnants qu’ils soient, ces chiffres ne doivent pas faire oublier qu’il n’y a pas, d’une manière générale, de TBI – ni, a fortiori, de RDIE –entre pays développés, lesquels représentent encore aujourd’hui la très grande majorité des flux entrants et sortants d’investissements. Par conséquent, seule une part très limitée des flux d’investissements internationaux sont couverts par de tels accords. L’exemple des États-Unis est éloquent : s’ils ont signé des traités d’investissement avec 57 pays, ces derniers ne couvrent que 21 % de leur stock d’investissements.
Il est intéressant par ailleurs de constater que les États-membres de l’UE (qui, on le rappelle, sont à l’origine des accords d’investissement) ont à eux seuls signé environ 1400 TBI (26). Précurseur des TBI en 1959, l’Allemagne est également le pays qui en a signé le plus, suivi par le Royaume-Uni et la France (27). En revanche, un pays comme l’Irlande n’a jamais signé de TBI.
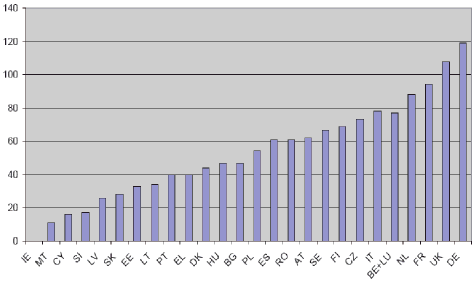
Ce nombre considérable ne devrait toutefois plus augmenter, puisqu’en application de l’article 207 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette dernière s’est vue confier une compétence exclusive sur les investissements. Il devrait même diminuer car les TBI signés par l’Union européenne ont vocation à se substituer aux traités bilatéraux des États-membres signés avec l’État concerné. Le rythme sera toutefois lent. Depuis 2009, l’Union européenne n’a conclu que deux traités contenant un RDIE, respectivement avec Singapour en décembre 2012 et avec le Canada en septembre 2014, qui ne sont pas encore ratifiés. D’autres accords bilatéraux et plurilatéraux sont également en cours de négociation, notamment le PTCI qui, comme le prévoit le mandat de négociation, contient un RDIE.
Le transfert de la compétence en matière d’investissement à l’Union européenne pose deux délicates questions concernant les TBI des États-membres :
– quel avenir pour ces traités dans le nouveau cadre institutionnel découlant du traité de Lisbonne ?
– comment ces TBI s’articulent-ils avec le droit européen ?
i. Les TBI conclus par les États-membres restent en vigueur, pour autant qu’ils soient compatibles avec le droit européen
Les 28 États-membres ont signé de très nombreux TBI avec des pays tiers, pour l’essentiel des pays en voie de développement. Toutefois, le cas des nouveaux États-membres doit être traité à part. Parce qu’ils n’ont adhéré qu’à partir de 2004, les anciens pays de l’Est ainsi que Malte et Chypre ont signé, avant cette date, de nombreux TBI avec les États-membres de l’Union européenne, dont la France (28), ainsi qu’avec les États-Unis (29) et le Canada (30).
La question des TBI signés par les États-membres de l’Union européenne avec des pays tiers a été réglée par le règlement (UE) n° 1219/2012 du 12 décembre 2012, établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers. Ces traités peuvent être maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord bilatéral d’investissement entre l’Union et ce même pays tiers. De nouveaux TBI pourront même être signés, mais sur autorisation de la Commission européenne (31). En effet, ces TBI ont tous vocation à disparaître, remplacés par des traités négociés par l’UE qui mettraient tous les États-membres à égalité dans leurs relations avec les pays tiers. Toutefois, il est évident que la Commission européenne ne peut mener de front des dizaines de négociations, d’où la nécessité de laisser subsister, pour un temps, les traités bilatéraux des États-membres avec des pays tiers.
Cependant, bien que maintenus en vigueur, ces traités doivent être conformes au droit européen. En effet, l’article 351 du TFUE stipule que « dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, le ou les États-membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées ». C’est sur ce fondement qu’en 2009, la Cour de justice a condamné pour manquement trois États-membres (Suède, Finlande et Autriche), dont les TBI protégeaient le transfert des capitaux dans des conditions contraires aux règles européennes (32).
Par conséquent, il pèse sur les États-membres une obligation de renégocier certains TBI afin de les rendre compatibles avec le droit européen. Toutefois, cette obligation se heurte à la réalité des rapports de force internationaux. Il est en effet difficilement envisageable que l’un des États-membres ayant signé un TBI avec les États-Unis puisse leur imposer de renégocier une clause qui peut être plus favorable à leurs investisseurs que le droit européen.
C’est d’ailleurs pour cette raison que la Commission européenne avait négocié elle-même, en 2003, un mémorandum d’accord avec les États-Unis et les futurs États-membres liés avec eux par un TBI, afin de restreindre la liberté totale de transfert des capitaux que ceux-ci prévoyaient. Néanmoins, si les États-Unis ont accepté certaines règles européennes, comme les restrictions adoptées pour lutter contre les activités terroristes, ils ont refusé d’intégrer dans les TBI concernés la règle autorisant les restrictions en cas de graves difficultés pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne, probablement en raison des pertes subies par les investisseurs américains des suites des troubles économiques et monétaires en Argentine. Ces TBI sont donc contraires, sur ce point, au droit européen mais la Commission ayant elle-même échoué à les faire modifier, n’a pas introduit de recours en manquement contre les États concernés.
La deuxième question, plus épineuse encore, est celle des TBI intra-européens dont le nombre s’élève, selon la Commission européenne, à 194. Or, ces TBI sont, pour la Commission européenne, à la fois inutiles et contraires au droit européen « puisque tous les États membres sont soumis aux mêmes règles au sein du marché unique, y compris en matière d’investissements transfrontières (en particulier, la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux). Le droit de l’Union (qui interdit, par exemple, toute discrimination fondée sur la nationalité) garantit pareillement la même protection à tous les investisseurs. Par opposition, les TBI intra-UE confèrent des droits aux investisseurs de certains États membres uniquement, sur une base bilatérale. Or, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, une telle discrimination fondée sur la nationalité est contraire au droit de l’Union ».
Par conséquent, ils devraient être dénoncés et la Commission fait pression en ce sens. Elle se heurte toutefois à l’hostilité persistante des États-membres, si bien qu’en juin 2015, seule l’Italie avait mis fin à l’ensemble de ses TBI intra-communautaires (33). C’est pourquoi la Commission a décidé, le 18 juin 2015, d’engager des procédures d’infraction à l’encontre de cinq États membres, pour qu’ils mettent fin aux accords bilatéraux d’investissement intra-européens. Dans le même temps, elle a demandé des informations aux 21 autres États membres qui maintiennent encore en vigueur des TBI intra-UE et engagé un dialogue administratif avec eux. La Commission a en outre organisé, en octobre, une réunion avec tous les États membres pour les aider à mettre fin à leurs TBI intra-européens de façon coordonnée. Malgré cet activisme des institutions européennes, il est probable qu’il faille des années encore pour que ces TBI disparaissent effectivement du paysage juridique européen.
La réaction de la Commission européenne est d’autant plus compréhensible que les tribunaux arbitraux refusent de considérer que l’adhésion à l’UE entraîne l’extinction des TBI intracommunautaires (34),comme de se reconnaître incompétents pour juger d’un contentieux entre deux États-membres de l’Union européenne (35). En effet, il ne peut y avoir de hiérarchie entre des normes découlant toutes de traités internationaux, sauf si une telle hiérarchie a été prévue par les parties. Si le droit européen affirme sa primauté et que la Commission européenne la soutient dans ses amicus curiae, celle-ci n’a pas d’effet sur le droit international.
La question des relations entre le droit européen et le droit international est ainsi, selon les termes d’un professionnel du droit auditionné par votre rapporteure, l’une des plus complexes qui agite aujourd’hui la doctrine ; aussi n’a-t-elle pas la prétention de trancher ici le débat. Toutefois, il lui semble important de mettre en évidence les enjeux de celui-ci, notamment dans la perspective des futurs traités d’investissement négociés par la Commission européenne.
Le fait que les TBI des États-membres, qu’ils soient signés avec des États tiers ou d’autres États-membres, restent en vigueur, pose deux questions délicates tenant aux conséquences d’une éventuelle contradiction avec le droit européen en cas de mise en œuvre du RDIE. Cette question n’est pas théorique puisqu’elle a trouvé une illustration très concrète – et onéreuse – dans l’affaire désormais bien connue Micula brothers et autres c/ Roumanie.
Afin d’inciter les investisseurs étrangers à investir dans des régions défavorisées de son territoire, le gouvernement roumain avait adopté en 1999 un programme d’aides, incluant des exonérations fiscales et douanières, valables dix ans, dont avaient profité des investisseurs suédois. Toutefois, ce programme a été supprimé de manière anticipée en 2005 dans le cadre de la réforme fiscale et douanière du pays exigée par la Commission pour l’adhésion à l’Union européenne. Les investisseurs ont poursuivi la Roumanie sur le fondement du TBI roumano-suédois, lequel garantissait « un environnement juridique stable ». Bien que la Commission européenne soit intervenue en soutien de la Roumanie, rappelant que c’est le droit européen qui avait exigé la suppression de ce programme, le tribunal arbitral, constitué dans le cadre du CIRDI, a considéré, le 11 décembre 2013, que ce dernier ne peut justifier qu’un État se soustrait aux obligations découlant d’un traité. Par conséquent, la décision de la Roumanie de supprimer avant terme son programme d’aides violait les « attentes légitimes » des investisseurs suédois, lesquels se sont vus attribués 250 millions de dollars.
Cette sentence « a produit un résultat que la Commission juge incompatible avec le droit de l’Union, puisque la sentence arbitrale octroie une aide d’État illégale ». Il ne pouvait en être autrement puisque les arbitres, désignés pour constituer un tribunal compétent pour un seul différend, n'ont pas à s'occuper de la cohérence des ordres juridiques. La sentence, rendue sur le fondement d’un instrument de droit international, n’a ainsi pas à tenir compte du droit européen ; elle se borne à vérifier si les droits que les investisseurs tirent du droit international n’ont pas été violés. Sous réserve de l’issue du recours en nullité, la Roumanie pourrait donc se retrouver face à un dilemme : soit elle exécute la sentence et, de ce fait, viole le droit européen, avec un éventuel recours de la Commission devant la Cour européenne de justice, soit elle ne l’exécute pas et s’expose à voir sa responsabilité internationale engagée sur le fondement de la Convention de Washington.
L’autre question, non moins délicate, est celle du partage de la responsabilité financière entre les États-membres et l’Union européenne en cas de violation avérée d’un TBI signé par cette dernière. La réponse a pris la forme du règlement (UE) n° 912/2014 du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords auxquels l’Union est partie. En application de ce règlement, l’exécution de la sentence et le paiement de la compensation à l’investisseur incomberont à l’entité responsable du traitement qui a été jugé non conforme aux dispositions du traité. Ce principe posé, trois cas de figure sont distingués :
– l’Union européenne sera responsable du paiement de la compensation financière lorsque le traitement en cause a été le fait d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union ;
– en revanche, c’est à l’État membre de payer cette compensation financière lorsqu’il a lui-même accordé le traitement en cause ;
– enfin, par dérogation, dans le cas où l’État membre a agi d’une manière prescrite par le droit de l’Union européenne, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union elle-même devrait assumer la responsabilité financière de ce traitement.
Les principes sont donc clairement posés mais aux termes de l’article 1er du règlement, ce dernier « s’applique à la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et engagée par un demandeur d’un pays tiers ». Par conséquent, il n’a pas vocation à s’appliquer dans les différends impliquant un État-membre et un investisseur déclenchés sur la base d’un TBI auquel l’Union européenne n’est pas partie, c’est-à-dire l’un des 1 400 TBI actuellement en vigueur.
Or, il est évident que le cas se produira où la plainte d’un investisseur trouvera son fondement dans le traitement accordé par un État-membre en application du droit européen. Ainsi, lorsque l’Union européenne adopte une directive, par exemple dans le domaine environnemental, celle-ci est transposée dans le droit interne des États-membres ; or, elle peut violer les droits qu’un investisseur étranger tirerait des traités précités, le poussant à porter plainte. Encore une fois, c’est l’État-membre qui supportera les conséquences du droit européen, alors même qu’il s’y sera peut-être opposé au Conseil, et non l’Union européenne. En outre, ce règlement ne concerne que les traités auxquels l’UE est partie. Par conséquent, même si le règlement avait été en vigueur, l’Union européenne n’aurait pas supporté les conséquences de la sentence Micula puisqu’elle n’est pas partie au TBI entre la Roumanie et la Suède.
Enfin, votre rapporteure se fait l’écho des interrogations de certains juristes sur la compatibilité entre le RDIE et le droit européen. En effet, selon leur analyse, présentée par exemple dans une récente étude de l’ONG ClientEarth (36), la Cour européenne de justice a une compétence exclusive pour interpréter le droit européen au sein de l’ordre juridique européen. Or, les tribunaux arbitraux devront nécessairement interpréter la règle de droit européenne contestée pour juger de sa conformité au TBI concerné, empiétant ainsi sur la compétence de la CEJ. Cette dernière pourrait donc être utilement consultée sur ce point.
b. La tendance actuelle : l’apparition de RDIE dans les accords entre pays développés et le refus du RDIE par les pays en développement
Alors que la présence de TBI, et, a fortiori, de RDIE entre les pays développés était autrefois une exception, on observe qu’ils acceptent désormais un RDIE dans le cadre de traités plurilatéraux portant sur l’investissement. A l’inverse, on observe dans le même temps un mouvement des pays en voie de développement contre les TBI et le RDIE, allant jusqu’à la dénonciation de ces derniers, et de la convention de Washington.
Ainsi qu’il a été dit, les TBI, avec les garanties qu’ils apportent aux investisseurs et le RDIE destiné à les faire respecter, se justifiaient historiquement par la volonté des pays développés de protéger les investissements de leurs nationaux dans des pays où ils pouvaient craindre l’arbitraire de l’État. Dans ces conditions, tant les TBI que le RDIE apparaissaient superflus entre pays développés. Si des TBI incluant un RDIE ont été signés avec des États-membres de l’Union européenne, ils l’ont été bien avant leur adhésion, à une époque où, sortant du régime communiste, ils ne présentaient pas les mêmes garanties pour les investisseurs que les autres pays européens.
Deux cas sont particulièrement frappants :
– lorsque les États-Unis ont signé en 1988 un accord de libre-échange avec le Canada portant également sur l’investissement, celui ne comportait pas de RDIE. C’est seulement lorsque les négociations ont débuté avec le Mexique afin d’élargir cet accord bilatéral que la question du RDIE s’est posée, car ce pays n’était pas considéré par les deux autres comme présentant à l’époque toutes les garanties en matière d’indépendance de la justice ;
– de même, l’accord de libre-échange entre l’Australie et les États-Unis signé en 2004 (AUSFTA), bien qu’il inclue les clauses de protection habituelles des investissements, ne comporte pas de RDIE. Selon le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères et du Commerce australien, un tel mécanisme n’était pas nécessaire « considérant le fait que les deux pays ont un système judiciaire robuste pour résoudre les différends entre les États et les investisseurs étrangers ».
Comme l’ont expliqué à votre rapporteure les représentants de l’Ambassade d’Australie à Paris, le refus du RDIE dans l’AUSFTA était la conséquence d’une mobilisation de la société civile australienne qui a poussé le gouvernement travailliste à refuser également cette clause dans les autres accords. Toutefois, le retour au pouvoir des conservateurs en 2011 a entraîné l’adoption d’une approche plus pragmatique ; désormais, l’Australie examine au cas par cas l’utilité du RDIE.
C’est ainsi que l’accord de libre-échange de l’Australie avec la Corée du sud, signé en 2013, intègre bien un RDIE. En revanche, l’accord de libre-échange avec le Japon ne comporte qu’un mécanisme interétatique de règlement des différends. Pourtant, il ne semble pas a priori que la Corée du sud présente plus de risque pour les investisseurs australiens que le Japon. L’explication de la différence de traitement entre les deux pays était à chercher dans les négociations du partenariat transpacifique (ci-après « TPP ») (37). En effet, la Corée du sud s’est tenue à l’écart du TTP, au contraire du Japon. Dès lors que le TPP, dont les négociations sont désormais achevées, contient un RDIE, une même clause dans l’accord avec le Japon aurait été superfétatoire.
L’accord de partenariat transpacifique met ainsi en évidence le fait que désormais, les pays développés acceptent la présence d’un RDIE mais uniquement dans les accords plurilatéraux, dès lors que sont parties à ceux-ci des États qui, à leurs yeux, ne présentent pas toutes les garanties en matière d’efficacité et d’indépendance de la justice. C’est le cas avec le TPP (auquel sont parties des pays comme le Vietnam) comme ce fut le cas avec l’ALENA et le traité sur la Charte de l’énergie, signés par l’ensemble des pays européens dits en transition mais également l’Afghanistan, la Géorgie ou le Kazakhstan. En d’autres termes, l’objet du RDIE dans ces accords plurilatéraux est rigoureusement le même que dans les TBI avec les pays en voie de développement. Il n’en reste pas moins que désormais, les pays développés peuvent faire l’objet de plaintes d’investisseurs qui, comme on le verra, ne s’en sont pas privés, donnant ainsi au RDIE une tout autre portée que sa vocation première.
Si les pays développés acceptent désormais le RDIE dans certains traités plurilatéraux, on observe que parallèlement, plusieurs pays en développement ont récemment rejeté le RDIE et mis un terme à leurs TBI et/ou dénoncé la convention de Washington.
C’est ainsi que, poursuivie en 2007 pour ses dispositions relatives à l’habilitation économique des Noirs (38), l’Afrique du Sud a annoncé en 2010 une réforme en profondeur de sa politique commerciale : non seulement elle ne signe plus de nouveaux accords d’investissement,mais elle a décidé de mettre fin à certains de ceux en vigueur. C’est ainsi que les TBI avec l’Autriche (1996), la Belgique (1998), l’Allemagne (1995), les Pays-Bas (1995), l’Espagne (1998) et la Suisse (1995), qui incluaient tous un RDIE, ont été dénoncés. Le fait que l’Afrique du Sud ait choisi de mettre fin en priorité à des TBI avec des pays européens, connus pour être particulièrement vagues, et donc susceptibles d’interprétations préjudiciables pour elle, n’est peut-être pas innocent. À terme, l’Afrique du Sud souhaite que les investisseurs étrangers sur son territoire soient soumis à une loi de promotion et de protection de l’investissement reprenant les principes du droit international, mais ne leur donnant plus l’accès à l’arbitrage international pour le règlement de leurs différends.
De même, l’Équateur – qui est, avec l’Argentine, un des pays faisant l’objet du plus grand nombre de plaintes d’investisseurs sur le fondement d’un TBI et l’un des plus lourdement condamnés (voir infra), a lui aussi entrepris de réorienter sa politique. Alors qu’aucun TBI n’a été signé depuis 2002, l’Ambassadrice d’Équateur a confirmé à votre rapporteure que, non seulement les TBI étaient inutiles pour attirer des investissements, mais que le RDIE qu’ils contenaient tous était contraire à l’intérêt de son pays. Cet État a donc institué en 2013 une Commission « pour l’audit intégral citoyen des Traités de protection réciproque des investissements et du système d’arbitrage international en matière d’investissements » (CAITISA), afin d’examiner la légitimité, la légalité et l’impact des TBI ainsi que la validité et la pertinence des sentences.
Enfin, en mars 2014, l’Indonésie a également annoncé vouloir mettre un terme à ses 67 TBI, en commençant par le TBI avec les Pays-Bas. Comme pour l’Afrique du Sud et l’Équateur, cette décision est la conséquence directe d’une sentence arbitrale ayant été très largement critiquée en Indonésie : Churchill Mining c/ Indonésie, rendue le 24 février 2014. Certes, par cette décision, le tribunal arbitral ne fait que reconnaître sa compétence à trancher le différend opposant cette société minière britannique à l’autorité locale suite à la révocation de son permis d’exploitation. Il n’en reste pas moins que l’énormité de la somme demandée en compensation – plus d’un milliard de dollars – a frappé les esprits.
La volonté de ces trois États de remettre en cause le cadre international de protection des investissements se heurte toutefois à deux obstacles :
– l’Afrique du Sud appartient à la Communauté de développement de l’Afrique australe (SACD) qui, en 2006, a adopté un protocole sur le commerce et l’investissement ouvrant l’accès des investisseurs étrangers à l’arbitrage international en cas de différends avec les États parties. S’agissant de l’Indonésie, elle est membre de l’ASEAN et, à ce titre, soumise à l’accord sur l’investissement de 2009 (voir supra). Par conséquent, malgré la dénonciation en cours ou à venir de leurs TBI, ces deux pays pourraient toujours être poursuivis par les investisseurs d’un pays membre de la SACD ou de l’ASEAN ;
– les TBI contiennent, pour la quasi-totalité d’entre eux, des « clauses de survie » qui permettent aux investisseurs de continuer à bénéficier, pendant une durée de 10 à 20 ans après leur dénonciation, des garanties qu’ils contiennent et, en particulier, du RDIE.
- la volonté de la Bolivie (en 2007), de l’Équateur (2009) et du Venezuela (2012) de se retirer du CIRDI en dénonçant la convention de Washington pourrait se heurter selon la doctrine à un écueil : le consentement à l’arbitrage, y compris dans le cadre du CIRDI, subsisterait dans les TBI qu’ils ont signés et qui n’ont pas été dénoncés.
Enfin, si les États sud-américains sont, avec l’Afrique du Sud mais paradoxalement sans l’Argentine (dont l’ambassadrice a confirmé à votre rapporteure la volonté de son pays de respecter ses TBI et la convention de Washington), à la pointe de la contestation du RDIE, les pays en voie de développement ou en transition ne sont plus les seuls à considérer celui-ci avec suspicion. Ainsi, la Russie a mis fin à l’application provisoire du Traité sur la Charte de l’énergie à la suite de l’affaire Ioukos. C’est également le cas pour l’Italie qui a annoncé son retrait de ce même traité. Si, officiellement, ce retrait est dicté par la nécessité d’économiser les 370 000 euros qu’elle lui coûte en participation aux frais de fonctionnement de son secrétariat, il n’est pas interdit de penser que les multiples contentieux engagés sur son fondement ont pesé dans sa décision.
2. Des plaintes en forte augmentation, y compris d’investisseurs européens contre des États-membres de l’Union européenne
Les plaintes des investisseurs ont fortement augmenté au cours des dernières années, conséquence de la double augmentation du nombre de traités incluant un RDIE et du stock des investissements directs internationaux (multiplié par dix en 20 ans). Une analyse plus précise révèle que, de manière peu surprenante, ce sont pour l’essentiel des investisseurs des pays développés, en particulier des États-membres de l’UE, qui recourent le plus au RDIE (a). Il convient de noter que ces derniers attaquent aussi bien les pays en développement que les pays développés, et que les plaintes visant ces derniers s’appuient quasi-exclusivement sur les traités plurilatéraux que sont l’ALENA et le TCE (b).
a. Une forte augmentation du nombre de plaintes, pour l’essentiel d’investisseurs issus de pays développés
Il est inutile de revenir sur la formidable croissance du nombre de traités bilatéraux et plurilatéraux incluant un RDIE qui a déjà été longuement analysé supra. Toutefois, il faut rappeler que cette croissance va de pair avec le développement encore plus rapide du stock des investissements directs internationaux dans le monde. Le stock extérieur d’IDE a en effet été multiplié par dix en 20 ans, passant de 2 400 milliards de dollars en 1992 à 29 000 milliards de dollars en 2014 selon les chiffres de la CNUCED. Ces deux facteurs sont très logiquement à l’origine de la très forte augmentation du nombre de différends, comme le montre le graphique suivant :
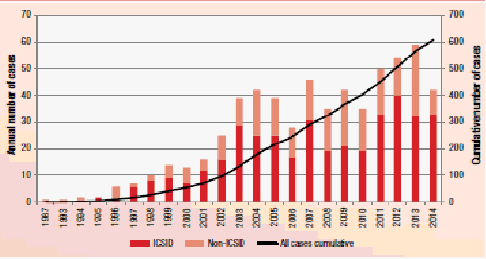
En 2014, le total des différends entre les États et les investisseurs portés devant les tribunaux arbitraux internationaux a atteint 608. En 1996, ils n’étaient que 38. S’il apparaît clairement que la majorité de ces différends ont été ou seront tranchés dans le cadre du CIRDI, il convient de souligner qu’en matière d’arbitrage d’investissement, l’opacité est de mise. Certes, le CIRDI publie l’intégralité des cas dont il est saisi mais il est le seul à le faire, si bien qu’une large part des différends (évaluée parfois à 30 %) n’est connue qu’indirectement, voire n’est jamais portée à la connaissance du public.
Les statistiques établies par la CNUCED mettent également en évidence dans le graphique suivant la part considérable que représentent les investisseurs européens dans l’origine des différends. En effet, les investisseurs américains sont les premiers utilisateurs du RDIE en nombre de plaintes (127). Toutefois, les plaintes déposées par l’ensemble des investisseurs de l’Union européenne (327) sont largement plus nombreuses puisqu’elles représentent 53 % du total, soit près du triple des Américains. Plus précisément, les investisseurs des Pays-Bas, d’Allemagne, du Royaume-Uni, de France, d’Italie et d’Espagne sont à l’origine, à eux seuls, de 236 cas, soit 72 % de tous les cas impliquant un investisseur européen et 39 % de tous les différends État-investisseur. Américains et Européens représentent donc, à eux seuls, les trois quarts du total des saisines connues de tribunaux arbitraux.
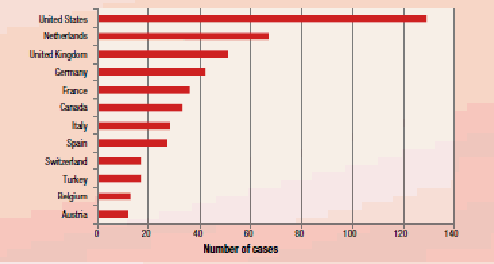
Enfin, les secteurs concernés par ces plaintes sont traditionnellement des secteurs impliquant une forte intervention étatique (propriété de l’État, forte régulation et/ou subventions) : pétrole et gaz, mines, forêt, agriculture, construction et gestion d’infrastructures, télécommunications, énergie, finances, tourisme, gestion de l’eau et des déchets, médias, etc.
Si les plaintes sont le fait d’investisseurs appartenant à un petit nombre de pays développés, elles visent des États qui ne sont pas tous des pays en voie de développement, comme le montrent une nouvelle fois les chiffres de la CNUCED. Si l’Argentine est, de loin, le pays le plus poursuivi avec le Venezuela, on remarque que le Canada est en cinquième position ; en outre, figurent dans ce classement les États-Unis mais également deux pays membres de l’Union européenne : la République Tchèque et la Pologne.
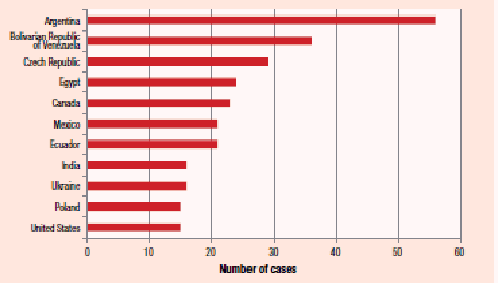
Votre rapporteure tient donc à souligner le fait que, créé pour protéger les investisseurs des pays développés dans les pays en voie de développement, le RDIE est désormais fréquemment mis en œuvre par les investisseurs contre ces mêmes pays développés, à la faveur des deux traités plurilatéraux incluant un RDIE que sont l’ALENA et le TCE. Plus étonnant encore, les pays développés sont plus poursuivis que les pays en voie de développement.
Ainsi qu’il a été dit supra, l’ALENA comporte un RDIE en raison de la présence du Mexique, sachant que le TBI entre les États-Unis et le Canada n’en contenait pas. Vingt ans après l’entrée en vigueur de cet accord, le Canada a pourtant fait l’objet du plus grand nombre de plaintes avec 35 poursuites. Par ailleurs, il apparaît que les États-Unis n’ont été poursuivis que 20 fois et le Mexique 22 fois. Par conséquent, avec 35 plaintes sur 77, le Canada représente à lui seul 45 % du total des plaintes.
Votre rapporteure s’est également penchée sur les plaintes déposées dans le cadre du TCE qui, comme il a été mentionné précédemment, est le seul traité plurilatéral de protection et de promotion de l’investissement liant ensemble les États-membres de l’Union européenne. Ce traité est le fondement de 68 plaintes qui ont été enregistrées par son secrétariat.
Les plaintes les plus nombreuses ont été enregistrées contre l’Espagne (16, incluant celles de 2015) en raison du changement en 2013, avec effet rétroactif, de sa politique de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable. Viennent ensuite la République Tchèque (7) et le Kazakhstan (5). Si l’on fait maintenant une distinction entre les anciens pays de l’Ouest et les anciens pays de l’Est membres de l’UE, on observe que les premiers totalisent 19 plaintes (dont 16 pour l’Espagne, 2 pour l’Allemagne et 1 pour l’Italie), et les deuxièmes 19, la quasi-totalité étant concernée.
Par conséquent, comme pour l’ALENA, on observe que ce ne sont pas les États présentant a priori le plus de risque pour les investisseurs qui sont les plus poursuivis.
Votre rapporteure est consciente que le RDIE suscite aujourd’hui un large débat en Europe. S’il est sain, dans une démocratie, de débattre de sujets à forts enjeux comme le RDIE, il est préférable que ce débat repose sur des faits avérés. C’est pourquoi votre rapporteure s’est spécialement intéressée à la mise en œuvre du RDIE en Europe à travers deux questions :
– combien de différends ont impliqué un État-membre de l’Union européenne et quels États font principalement l’objet des plaintes des investisseurs ?
– qui sont les investisseurs ayant porté plainte contre les États-membres ?
• Les États-membres les plus poursuivis par les investisseurs sont principalement les anciens pays d’Europe centrale et orientale
Le nombre total de différends impliquant un État-membre de l’Union européenne répertoriés dans la base de données de la CNUCED (qui, on le rappelle, est incomplète et s’arrête à 2014) s’élève à 128, en très forte augmentation depuis 2012 (49 plaintes ayant été déposées après cette date) (39). Par conséquent, les États-membres de l’Union représentent 21 % du total des différends connus entre un État et un investisseur.
Toutefois, cette présentation globale doit être complétée par une analyse des différends par État-membre.
Rép. Tchèque |
29 |
Lituanie |
5 |
Chypre |
2 |
Danemark |
0 |
Pologne |
15 |
Croatie |
5 |
France |
1 |
Pays-Bas |
0 |
Espagne |
14 |
Estonie |
4 |
Italie |
1 |
Malte |
0 |
Hongrie |
12 |
Slovénie |
3 |
Belgique |
1 |
Autriche |
0 |
Slovaquie |
12 |
Lettonie |
2 |
Royaume-Uni |
1 |
Luxembourg |
0 |
Roumanie |
11 |
Allemagne |
2 |
Irlande |
0 |
Portugal |
0 |
Bulgarie |
5 |
Grèce |
2 |
Finlande |
0 |
Suède |
0 |
Il ressort de ce tableau, lui aussi établi à partir de la base de données de la CNUCED, que les États-membres se répartissent en trois catégories :
– 9 États-membres n’ont jamais été poursuivis par les investisseurs étrangers. À l’exception de Malte, ce sont tous des pays d’Europe occidentale ;
– 13 États-membres ont été impliqués dans un à cinq différends avec un investisseur étranger. Ce sont à la fois des pays d’Europe de l’ouest et d’Europe de l’est. À noter que la France n’a été poursuivie qu’une fois, en 2013, par un ressortissant turc, sur le fondement du TBI avec la Turquie (40) ;
– enfin, 6 États-membres ont été poursuivis à plus de dix reprises par les investisseurs étrangers. À l’exception de l’Espagne, ce sont tous des pays d’Europe centrale et orientale. En particulier, le pays le plus poursuivi, la République Tchèque, totalise à lui seul 29 différends, soit plus du double de l’Espagne et près du quart du total des différends impliquant un État-membre de l’Union européenne.
Il s’ensuit qu’en matière de mise en œuvre du RDIE, tous les États-membres de l’union européenne ne sont pas dans la même situation, la ligne de fracture recoupant presque parfaitement celle de l’ancien rideau de fer. Alors que les 15 États-membres de l’Union européenne pré-2004 ont été visés par 22 plaintes d’investisseurs, les États ayant adhéré après cette date l’ont été à 106 reprises. Au total, les pays d’Europe centrale et orientale sont impliqués dans 83 % des différends impliquant un État-membre de l’Union européenne.
• Les investisseurs européens sont à l’origine de la plupart des plaintes contre les États-membres de l’Union européenne
Selon la Commission européenne (41), les investisseurs appartenant à un pays tiers sont présents dans seulement 29 différends, soit 23 % des différends impliquant un État-membre de l’Union européenne. En particulier, les investisseurs américains sont à l’origine de 11 plaintes, visant dans tous les cas un pays d’Europe centrale et orientale (PECO). Quant aux investisseurs canadiens, ils ont utilisé le RDIE à trois reprises, uniquement contre un PECO.
En conclusion de cette analyse de la mise en œuvre du RDIE par les investisseurs, on aurait pu s’attendre à ce que ceux-ci soient, conformément à l’objet même du mécanisme, originaires des pays développés et qu’ils attaquent des pays en voie de développement dans lesquels la justice est supposée défaillante. Or, votre rapporteure observe que :
– si les investisseurs sont bien, pour les trois quarts d’entre eux, originaires de l’Union européenne et des États-Unis, force est de constater qu’ils attaquent autant les pays en voie de développement que les pays développés ;
– dans le cadre des traités plurilatéraux incluant un RDIE, celui-ci est majoritairement utilisé contre les pays développés et non contre les pays en voie de développement qui, initialement, avaient justifié son inclusion ;
– les États-membres de l’Union européenne ne représentent qu’une part limitée des cas connus de différends États-investisseurs, avec cette précision que ces cas impliquent généralement un pays d’Europe centrale et orientale et qu’ils sont majoritairement initiés par des investisseurs eux aussi européens.
En préalable, il convient de souligner que les tribunaux arbitraux, saisis dans le cadre de la mise en œuvre d’un RDIE, ne peuvent qu’accorder des compensations financières aux investisseurs en cas de violation avérée, par un État, de ses obligations. Il n’est pas en leur pouvoir d’exiger le retrait de la mesure contestée. Sur ce point, comme sur d’autres (voir supra), le RDIE se différencie du mécanisme de règlement des différends de l’OMC.
Selon les statistiques de la CNUDED (42), au 31 décembre 2014, sur un total de 356 différends réglés, 37 % l’ont été favorablement pour l’État, 25 % pour l’investisseur et 28 % ont été réglés à l’amiable (sans que l’on ait plus de détails sur les modalités de la transaction puisque celle-ci est, généralement, confidentielle). Dans 8 % des cas, la plainte a été retirée et dans les 2 % restants (soit 7 cas), une violation a été reconnue mais aucun dommage n’a été accordé. S’agissant des seuls différends réglés dans le cadre du CIRDI et impliquant des États-membres de l’Union européenne, 64 % ont fait l’objet d’une sentence et 36 % ont été réglés à l’amiable. Parmi ceux qui ont été tranchés par un tribunal arbitral, la sentence n’a été favorable aux investisseurs que dans 31 % des cas. En d’autres termes, lorsqu’un État-membre est défendeur, la sentence du tribunal arbitral lui est favorable dans plus des deux tiers des cas.
Toutefois, il n’en reste pas moins que lorsque les tribunaux arbitraux donnent raison à l’investisseur, les compensations qui lui sont accordées peuvent être très lourdes. Il convient néanmoins de noter que les compensations les plus élevées ont été accordées aux investisseurs dans des différends impliquant un pays en voie de développement (ou en transition). En outre, dans tous les cas, elles sont systématiquement inférieures au montant réclamé.
a. Des condamnations importantes pour les pays en développement (ou anciennement en transition) mais dont l’exécution est incertaine
Les pays en voie de développement (ou en transition) ont, au cours des dernières années, été condamnés à verser des compensations très lourdes aux investisseurs étrangers, en particulier l’Équateur, l’Argentine, la Pologne, la Slovaquie, la République Tchèque et la Russie. Cependant, malgré leur montant impressionnant, on peut s’interroger sur la réelle portée de ces sentences ; en effet, leur exécution apparaît particulièrement incertaine compte tenu des immunités dont disposent les États.
Les États-membres de l’Union européenne concernés sont, à ce jour et sous toutes réserves, uniquement les anciens pays de l’Est (à la seule exception de l’Espagne). Votre rapporteure s’est donc efforcée de collecter l’information disponible pour les différends impliquant des États-membres de l’Union européenne. À sa connaissance, celle-ci ne l’est que dans quatorze cas, tous retracés dans le tableau suivant :
État |
Investisseur |
Montant de la |
Montant de la compensation accordée 1 |
Pologne |
Eureko |
10 265 000 000 € |
2 196 000 000 € |
Slovaquie |
Ceskolovensko Banka |
1 209 000 000 € |
545 790 000 € |
République Tchèque |
Sakula Nomura |
1 000 000 000 $ |
236 000 000 € |
République Tchèque |
CME |
366 622 000 € |
198 830 000 € |
Roumanie |
Micula |
450 000 000 € |
183 311 000 € |
Hongrie |
ADC |
179 185 000 € |
55 873 000 € |
Slovaquie |
Archmea |
100 000 000 € |
22 1000 000 € |
Estonie |
OKO |
ND |
10 134 000 € |
Pologne |
Laboratoires Servier |
219 973 000 € |
4 000 000 € |
République Tchèque |
Eastern Sugar |
88 537 000 $ |
2 4000 000 € |
Lettonie |
Swembalt |
4 115 000 € |
1 837 000 € |
Lettonie |
Nycomb |
10 099 000 € |
1 124 000 € |
Pologne |
Saar paper |
1 175 000 € |
1 175 000 € |
Espagne |
Maffezini |
180 000 € |
180 000 € |
1 Sous réserve du taux de change retenu. Ce montant peut ne pas prendre en compte les intérêts ni les coûts mis à la charge de l’État
Outre la Roumanie, condamnée en 2013 à verser 250 millions de dollars dans l’affaire Micula précitée, il ressort de ce tableau que trois autres pays d’Europe centrale et orientale ont dû verser de lourdes compensations aux investisseurs à la suite soit d’une sentence arbitrale, soit d’un règlement amiable :
– la Pologne a versé près de 2,2 milliards d’euros dans l’affaire Eureko suite à un règlement amiable en 2009, consécutif à une procédure arbitrale sur le fondement du TBI avec les Pays-Bas. Les faits sont les suivants. En 1999, l’assureur néerlandais Eureko avait racheté à l'État polonais une participation de 30 % dans la compagnie d’assurance polonaise PZU. Le contrat comportait une clause par laquelle le gouvernement s’engageait à lui vendre 21 % supplémentaires, lui donnant ainsi le contrôle de l’entreprise. Toutefois, critiqués pour avoir accepté de vendre la première compagnie d’assurance du pays à des étrangers, les gouvernements successifs ont toujours refusé d’achever la privatisation de PZU, entraînant la saisine d’un tribunal arbitral, saisine retirée à la suite du règlement amiable précité ;
– la plus lourde compensation jamais accordée par un tribunal arbitral dans un différend impliquant un État-membre l’a été sur le fondement du TBI entre la République Tchèque et la Slovaquie. Condamnée dans l’affaire Ceskoslovenska Obchodni Banka (2004), la Slovaquie a dû verser plus de 545 millions à la banque tchèque CSOB. En 1993, la Slovaquie, la République tchèque et CSOB ont conclu un « accord de consolidation » afin d’assainir le bilan de cette dernière. Aux termes de cet accord, chaque pays a créé deux entités auxquelles ont été transférées les créances de CSOB qui, en échange, leur accordait des prêts d’un montant équivalent ; comme certaines créances étaient douteuses, les revenus qu’elles généraient ne pouvaient par définition pas couvrir le remboursement des prêts. L’accord de consolidation prévoyait donc que les deux États couvriraient les pertes des entités précitées afin qu’elles puissent rembourser CSOB. Or, la Slovaquie ne l’a pas fait pour la sienne ; incapable de rembourser ses prêts, la faillite de l’entité slovaque a entraîné de lourdes pertes pour CSOB ;
– dans l’affaire CME c/ République Tchèque (2001), cette dernière a été condamnée à verser 198 millions d’euros sur le fondement de son TBI avec les Pays-Bas. Les faits sont les suivants : la société de droit néerlandais CME a investi en 1991 dans un projet de création d'une chaîne locale privée de télévision. L'investissement a été effectué en association avec un partenaire local, CET21, par la création d'une société commune CNTS. En 1996, le Conseil des médias, organe de contrôle du secteur audiovisuel, change les conditions relatives à la licence et exige des modifications dans la structure sociétaire de l'entreprise commune. Les nouvelles exigences du Conseil des médias obligent CME et son partenaire à remplacer l'accord de joint-venture par un contrat de prestation de service. Les relations entre les deux partenaires se sont détériorées jusqu'à la séparation que le tribunal arbitral a imputée au comportement du Conseil des médias.
Cette analyse des cas impliquant des États-membres est éclairante sur plusieurs points. Ces compensations, pour importantes qu’elles soient, découlent de comportements intervenus dans les années 90, quelques années seulement après que ces pays aient abandonné le régime communiste et avant leur adhésion à l’Union européenne.
En outre, on observe que ce sont des investisseurs européens, sur la base d’un TBI intra-européen, qui sont à l’origine des plaintes contre la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la République Tchèque et ont obtenu de celles-ci ces compensations. Dans la plupart des cas, celles-ci ont sanctionné le comportement du pouvoir exécutif ou de l’une de ses entités, en particulier pour le non-respect de ses engagements contractuels, dans des domaines très éloigné de l’environnement, de l’énergie ou de la santé puisque les différends portaient sur le secteur financier (OKO, Ceskoslovenska Obchodni Banka, Eureko, Archmea), les médias (CME), les aides au développement régional (Micula) des activités aéroportuaires (ADC), les quotas de sucre (Eastern sugar) ou la perte d’un navire (Swembalt c/ Lettonie). Au final, seules les affaires Nycomb c/ Lettonie, Saar Paper c/ Pologne, Laboratoire Servier c/ Pologne et Maffezini c/ Espagne avaient un rapport avec l’un des secteurs qui, aujourd’hui, suscitent les craintes de l’opinion publique. Le montant total des compensations versées dans ces affaires est de 6,48 millions d’euros.
D’une manière générale, bien que la comparaison soit quelque peu biaisée par les taux de change et leur variation, il est frappant de constater la disproportion entre le montant réclamé par l’investisseur et la compensation finalement mise à la charge de l’État. Hors les affaires Oko c/ Estonie et Eureko c/ Pologne, les investisseurs réclamaient 3,458 milliards d’euros. Les États leur ont versé 1,262 milliard d’euros, soit près de trois fois moins. Quant à la Pologne, elle a versé à Eureko près de cinq fois moins que ce que l’investisseur lui avait réclamé.
Au-delà du cas des États-membres de l’Union européenne, la Russie, l’Équateur et l’Argentine figurent parmi les pays qui, à plusieurs titres, sont incontournables dans l’analyse du RDIE.
La Russie est le pays qui a fait l’objet de la plus lourde condamnation prononcée par un tribunal arbitral dans le cadre de l’affaire Ioukos sur le fondement du Traité sur la Charte de l’énergie. La compagnie pétrolière russe Ioukos a en effet été mise en faillite et démantelée au profit du groupe public Rosneft en 2006 à la suite d’accusations de fraude fiscale et d’escroquerie, son président, M. Mikhaïl Khodorkovski ayant quant à lui été emprisonné pour les mêmes faits. Or, le tribunal a considéré que le traitement infligé à Ioukos avait été motivé par des raisons politiques et a condamné l’État russe à verser 50,2 milliards de dollars aux ex-actionnaires de Ioukos.
L’Argentine est, quant à elle, le pays qui a fait l’objet du plus grand nombre de plaintes d’investisseurs étrangers via la mise en œuvre du RDIE. Au début des années 90, ce pays a privatisé ses entreprises publiques tout en s’ouvrant largement à l’investissement étranger ; afin d’attirer les investisseurs, il a multiplié les TBI, notamment avec les États-Unis, le Canada et les États-membres de l’Union européenne, lesquels incluaient tous un RDIE. Or, après une décennie de politique ultralibérale, le pays a été frappé par une grave crise financière qui culmina avec la loi d’urgence économique du 6 janvier 2002 qui entérina la disparition de la parité –artificielle – entre le peso et le dollar, gela les tarifs des services publics et abolit les mécanismes d’indexation de ceux-ci.
Ces mesures ont été considérées par les investisseurs, notamment par les concessionnaires tels que Suez, comme une expropriation indirecte et/ou une violation de l’obligation de traitement juste et équitable en ce qu’elles ruinaient l’équilibre économique de leur contrat. Dans le cas de Suez, qui avait obtenu en 1993 la concession de la distribution de l’eau à Buenos Aires, la loi a entraîné une multiplication par quatre de la dette – contractée pour moderniser le réseau de distribution d’eau – sans possibilité d’augmenter les tarifs. Au total, 37 plaintes ont été déposées à la suite de ladite loi, portant le total des différends impliquant l’Argentine à 53.
Pour le moment, l’Argentine a été condamnée à 16 reprises (dont 4 à l’initiative d’une entreprise française) dans le cadre d’un différend avec un investisseur pour un montant total de 1 800 millions de dollars (hors intérêt et hors le montant de la compensation dans l’affaire Total en 2013 dont la sentence n’a pas été rendue publique).
Plaignant |
Montant de la compensation (hors intérêt) |
Plaignant |
Montant de la compensation |
EDF |
136 000 000 $ |
Azurix |
165 000 000 $ |
B.G Group |
185 000 000 $ |
Sempra |
128 000 000 $ |
CMS |
133 000 000 $ |
National Grid |
39 000 000 $ |
Vivendi |
105 000 000 $ |
LG&E |
57 000 000 $ |
Siemens |
238 000 000 $ |
Impregilo |
21 000 000 $ |
Enron |
106 000 000 $ |
El Paso |
43 000 000 $ |
SAUR |
40 000 000 $ |
Suez |
405 000 000 $ |
Continental Casualty |
2 800 000 $ |
Total |
ND |
Même s’il a été moins poursuivi que l’Argentine, totalisant selon la CNUCED 20 plaintes d’investisseurs étrangers (Américains pour 14 d’entre eux), et qu’il a été condamné à seulement quatre reprises par les tribunaux arbitraux, l’Équateur s’est vu infligé une compensation de 2,4 milliards de dollars (incluant les intérêts), soit la plus élevée après celle prononcée à l’encontre de la Russie dans l’affaire Ioukos.
Les faits sont les suivants : en 1999, la compagnie américaine Occidental Petroleum, a contracté avec la compagnie nationale Petroecuador pour exploiter un champ pétrolifère en Amazonie (dit « Block 15 »).
En 2000, elle décide de céder 40 % de ce « Block 15 » à une compagnie canadienne. Or, selon la loi équatorienne, une telle décision exigeait une autorisation ministérielle qui n’a jamais été accordée. Le gouvernement équatorien découvre cette opération en 2006 et, soumis à une forte pression populaire, met fin au contrat de Petroecuador avec Occidental Petroleum, l’expropriant de fait. Saisi par cette dernière en 2006, le tribunal arbitral a, dans sa décision rendue le 5 octobre 2012, estimé que l’Equateur avait violé les termes de son TBI avec les États-Unis en apportant une réponse disproportionnée à la violation – reconnue – de la loi équatorienne. Cette sentence fait actuellement l’objet d’un recours en nullité.
Les tribunaux arbitraux ont à plusieurs reprises condamné les États à verser des compensations très élevées aux investisseurs. Mais encore faut-il que ces sentences soient exécutées par lesdits États. Certes, ainsi qu’il a été dit supra, l’article 54 de la convention de Washington stipule qu’une sentence rendue dans le cadre du CIRDI est exécutoire de plein droit. Cependant, toutes les autres sentences arbitrales, y compris celles rendues dans le cadre du mécanisme supplémentaire du CIRDI, exigent, pour être exécutoires sur le territoire d’un État, d’être reconnues par les juridictions de celui-ci conformément à la convention de New York (voir supra) et aux règles nationales en la matière (43). Par conséquent, l’exécution des sentences rendues par les tribunaux arbitraux contre les États est étroitement liée à l’efficacité du système judiciaire national et, en particulier, à son indépendance vis-à-vis du gouvernement.
Ce lien est incontestablement la principale faiblesse de la convention de New York comme de l’arbitrage en général. Institué pour préserver l’investisseur des défaillances des juridictions nationales dans le règlement de son différend avec l’État, il peut se retrouver à nouveau confronté à ces mêmes juridictions et à leur éventuelle mauvaise volonté lorsque, fort d’une sentence favorable, il cherche à la faire exécuter sur le territoire de cet État ou d’un autre.
Dans la majorité des cas, l’État accepte de payer, non sans avoir généralement exercé un recours en nullité devant un comité ad hoc du CIRDI ou une autre forme de recours devant les juridictions nationales du lieu de l’arbitrage. Néanmoins, deux autres situations peuvent se présenter.
La première est le refus ferme de payer. C’est le cas de la Russie dans l’affaire Ioukos où, on le rappelle, elle a été condamnée à payer 50,2 milliards de dollars aux ex-actionnaires de cette compagnie pétrolière russe. Selon le ministre du Développement économique, « le paiement de la dette est hors de question », le Président russe ayant quant à lui déclaré que « la Russie ne reconnaît pas l’autorité de ce tribunal ». Or, en droit international, l’État bénéficie d’une immunité d’exécution qui interdit toute mesure de contrainte contre ses biens sans son consentement, y compris lorsque la sentence est exécutoire. En effet, l’exequatur n’est pas, contrairement à son intitulé, une mesure d’exécution mais le préalable à celle-ci et, même accordée, elle peut se heurter à l’immunité de l’État.
Néanmoins, l’article 19 de la convention des Nations-Unies sur les immunités des États et de leurs biens prévoit la possibilité de mesures d’exécution contre les biens d’un État « spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales ». Toutefois, la question se pose de la nature des biens concernés et surtout, s’il est possible de saisir les biens d’une autre entité que l’État ou, inversement, si après la condamnation d’une telle entité, il est envisageable de saisir les biens de l’État. Le droit international est ambigu et, une fois de plus, l’application de ces dispositions repose exclusivement sur l’interprétation qu’en font les juridictions nationales.
Dans le cas de l’affaire Ioukos, confrontés au refus de la Russie de reconnaître et d’exécuter la sentence, les investisseurs n’ont d’autre choix que chercher à faire exécuter la sentence dans les 150 États parties à la convention de New York. Non seulement l’identification des biens susceptibles d’être saisis pourrait prendre des décennies, mais encore faut-il que les juridictions de ces États admettent les prétentions de ces investisseurs contre l’immunité de la Russie. Enfin, on peut raisonnablement se demander si un État prendra le risque de compromettre ses relations avec la Russie pour satisfaire la demande d’investisseurs étrangers, même appuyée sur une sentence arbitrale (44).
La deuxième situation est le refus de payer pour forcer les investisseurs à accepter une réduction de leur compensation. C’est le cas de l’Argentine qui, non seulement demande systématiquement la nullité des sentences arbitrales prononcées à son encontre, et refuse de les exécuter en cas de rejet de son recours.
C’est ainsi que l’Argentine a, en 2013, réglé à l’amiable l’exécution des sentences rendues en faveur de cinq investisseurs : Vivendi, National Grid, Continental Casualty, Azurix et CMS. Même si les détails de l’arrangement n’ont pas été rendus publics, les journaux argentins ont rapporté que les investisseurs précités ont accepté une réduction de 15 % du montant brut de leur compensation et de 45 % du total des intérêts dus, soit un discount total de 25 %. Surtout, les compensations seraient versées sous la forme d’obligations de l’État argentin, ce qui ne manque pas d’ironie compte tenu du fait que l’Argentine fait l’objet de plusieurs procédures suite au défaut sur sa dette souveraine. Enfin, toujours selon les journaux argentins, trois des sentences ayant fait l’objet de ce règlement amiable auraient été rachetées par le hedge fund américain Gramercy.
L’analyse des différends impliquant les pays en voie de développement ou en transition n’est toutefois pas suffisante pour estimer la portée du RDIE dans le cadre des accords impliquant des pays développés. Votre rapporteure s’est donc intéressée à la mise en œuvre du RDIE dans le cadre de l’ALENA. Or, dans ce cadre, selon une étude réalisée en 2015 par le Centre canadien de politiques alternatives, il apparaît que 77 plaintes ont été déposées au total (au 31 décembre 2014).
– Le Canada a été poursuivi à 35 reprises depuis 1994et a versé des compensations à cinq investisseurs (suite à deux sentences et trois règlements à l’amiable) pour un montant total (sous réserve des variations de taux de change CAD/USD) d’environ 156 millions de dollars (172 millions de dollars canadiens). Le Canada a en outre été condamné à verser 13,7 millions de dollars à Mobil et Murphy mais la sentence fait actuellement l’objet d’un recours en annulation. 130 millions de dollars canadiens ont été versés pour le seul règlement à l’amiable de l’affaire Abitidi Bowater. Huit plaintes sont aujourd’hui encore actives.
– le Mexique a quant à lui fait l’objet de 22 plaintes d’investisseurs canadiens ou américains. Il a été condamné à cinq reprises par les tribunaux arbitraux pour un total de 204,2 millions de dollars. Il fait aujourd’hui l’objet de deux plaintes ;
– enfin, les États-Unis ont été poursuivis à 20 reprises, essentiellement par des investisseurs canadiens, mais n’ont jamais été condamnés par les tribunaux arbitraux, pas plus qu’ils n’ont versé de compensation dans le cadre d’un règlement à l’amiable. Deux plaintes sont encore actives.
Par ailleurs, votre rapporteure a été frappée par le nombre élevé de plaintes inactives ou retirées. Ainsi, sur un total de 77 plaintes, 6 ont été retirées par les investisseurs et 22 sont restées inactives après avoir été déposées.
En outre, la disproportion entre les compensations réclamées et celles qui sont accordées est encore plus importante dans le cadre de l’ALENA que pour les différends analysés supra. Le tableau suivant compare, pour chacun des différends ayant donné lieu à versement d’une compensation, le montant de celle-ci avec le montant initialement réclamé par l’investisseur :
Investisseur(s) |
État |
Compensation réclamée |
Compensation accordée 1 |
Ethyl Corporation |
Canada |
250 000 000 $ |
13 000 000 $ |
S.D. Myers |
Canada |
20 000 000 $ |
6 050 000 CAD |
Pope § Talbot |
Canada |
508 000 000 $ |
460 000 $ |
Abitibi Bowater |
Canada |
467 500 000 $ |
130 000 000 CAD |
St Mary VCNA |
Canada |
275 000 000 $ |
15 000 000 $ |
Mobil invesments & Murphy Oil |
Canada |
60 000 000 $ |
13 700 000 $ 2 |
Metalclad |
Mexique |
90 000 000 $ |
15 600 000 $ |
Corn Products Int. |
Mexique |
325 000 000 $ |
58 350 000 $ |
Archer Daniel Midlands & Tate and Lyle ingrédients |
Mexique |
100 000 000 $ |
33 510 000 $ |
Cargill |
Mexique |
100 000 000 $ |
90 700 000 $ |
Marvin Roy Feldman Karpa (CEMSA) |
Mexique |
50 000 000 $ |
1 900 000 $ |
1 Hors coûts de l’arbitrage et intérêts.
2 Sous réserve d’un recours en annulation.
On observe ainsi que le total des montants réclamés au Canada s’élevait, pour les six affaires définitivement tranchées (incluant Mobil et Murphy), à 1 520,5 millions de dollars, pour un montant total de compensation accordée de 156 millions dollars, soit près de dix fois moins. L’écart peut parfois être plus important encore comme dans l’affaire Pope § Talbot. L’investisseur réclamait 508 millions de dollars et s’est vu accordé par le tribunal 460 000 dollars. S’agissant du Mexique, l’écart est moindre puisque le total des compensations réclamées s’élève à 665 millions de dollars et le montant accordé à 204,2 millions de dollars, soit plus de trois fois moins, en ligne avec l’écart relevé dans le cas des différends impliquant un État-membre de l’Union européenne.
Les investisseurs ne peuvent jamais, par le RDIE, obtenir d’un État qu’il retire la mesure contestée. À supposer que Vattenfall l’emporte, l’Allemagne n’aurait aucune obligation de renoncer à l’abandon du nucléaire. Il n’en reste pas moins que la perspective de verser des compensations de plusieurs milliards d’euros pourrait inciter les États à ne pas adopter des mesures les exposant à la mise en œuvre du RDIE, voire à les retirer dans le cadre d’un règlement à l’amiable. Cet effet de « gel règlementaire » du RDIE, s’il a pu être avéré, appelle les précisions suivantes.
Mis à part le cas de la Nouvelle-Zélande dans l’affaire du paquet de cigarettes « neutre », le « gel règlementaire » allégué par les opposants au RDIE est difficile à prouver, y compris dans les cas fréquemment évoqués. Certaines affaires montrent au contraire l’utilisation qu’un État peut faire de la règlementation environnementale à des fins protectionnistes, utilisation que les traités d’investissement visent justement à empêcher. Dans l’affaire Ethyl, le Canada a, dans un règlement à l’amiable, accepté de retirer une mesure d’interdiction d’un additif chimique dans l’essence. Toutefois, on peut douter que les 13 millions de dollars versés à l’investisseur – ou même les 200 millions de dollars qu’il réclamait – soient à l’origine de cette décision ; selon plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteure, cette interdiction avait un objet clairement protectionniste et avait été attaquée par plusieurs provinces canadiennes elles-mêmes devant les tribunaux fédéraux. C’est seulement après que ces derniers aient jugé l’interdiction illégale que l’État a accepté de transiger avec Ethyl, lui évitant ainsi une procédure coûteuse et perdue d’avance.
Un autre cas fréquemment invoqué n’a, quant à lui, pas donné lieu à la saisine d’un tribunal arbitral. En 2003, considérant la hausse des primes exigées par les assureurs privés, la province du Nouveau Brunswick envisagea officiellement de fournir aux automobilistes une assurance automobile publique ; si tous les assureurs dénoncèrent cette éventualité, les assureurs américains menacèrent quant à eux de mettre en œuvre le RDIE, jugeant qu’une telle assurance publique violerait les dispositions de l’article 1114 de l’ALENA. L’année suivante, le Premier ministre de la province annonça le retrait du projet, amenant les opposants au RDIE à voir un lien entre celui-ci et la menace des assureurs américains.
Toutefois, cette hypothèse est infirmée par le comportement même des autres provinces canadiennes. En effet, le Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie britannique et le Québec ont des programmes publics d’assurance automobile depuis plus de trente ans qui n’ont jamais fait l’objet de recours, preuve qu’ils sont bien conformes au droit canadien comme au droit international. De même, l’Ontario a rejeté un tel programme en 1991 non par crainte du RDIE – qui n’existait pas – mais de licenciements dans les compagnies privées d’assurance. L’explication du revirement du Nouveau Brunswick n’est donc pas forcément la menace d’un recours au RDIE.
Enfin, l’argument du « gel réglementaire » entraîné par le RDIE se heurte au fait que les différends État-investisseurs concernent pour l’essentiel des mesures individuelles (contrats, permis, autorisations administratives, licences, etc.), prise par le pouvoir exécutif, et non des mesures d’ordre général comme une loi. Dans une étude très récente de l’Université américaine Columbia, portant sur 163 sentences arbitrales, il apparaît que seuls 14 différends portaient sur une loi, soit 9 % du total (45).
D’une manière générale, votre rapporteure est frappée par le fait que dans certains des cas les plus emblématiques du RDIE impliquant un État-membre de l’Union européenne, l’État a pu ouvertement violer ses propres obligations, non seulement internationales mais également contractuelles, notamment dans les affaires Ceskoslovenska Obchodni Banka ou Eureko précitées. Il s’ensuit que s’il n’avait pas versé de compensations aux investisseurs concernés, c’est l’État de droit qui aurait été remis en cause. En effet, un État peut heureusement toujours revenir sur sa parole, y compris lorsqu’elle est inscrite dans un contrat, pour des raisons d’intérêt général mais à condition d’en assumer les conséquences financières.
Ce point n’a d’ailleurs rien d’original. C’est la position du Conseil d’État français qui, depuis plus d’un siècle, admet que l’État, pour des raisons d’intérêt général, puisse modifier ou résilier unilatéralement un contrat administratif, pour autant qu’il indemnise son cocontractant. C’est fort de cette jurisprudence qu’Ecomouv’ a obtenu 840 millions d’euros suite à l’abandon de l’écotaxe, une somme sept fois supérieure à ce que le Canada a versé en vingt ans.
Comme évoqué précédemment, pendant des décennies après 1959, les États ont signé des TBI sans que ceux-ci n’aient attiré l’attention de l’opinion publique. Le RDIE lui-même, que la quasi-totalité d’entre eux incluaient, n’a jamais ou presque suscité de débat. C’est seulement dans les années 90, avec la signature de l’ALENA et de l’AMI, que l’opinion publique, des deux côtés de l’Atlantique, s’est intéressée à l’investissement international et aux modalités de protection des investisseurs étrangers pour les contester. Toutefois, les quinze années qui suivirent ces mouvements de protestation n’ont en rien changé le cours des choses : des milliers de TBI ont continué à être négociés, signés et appliqués sans débat ; les lourdes compensations versées aux investisseurs des pays développés par des pays en voie de développement n’ont intéressé que les médias de ces derniers. Ainsi, le RDIE est revenu sur le devant de la scène politique et médiatique à la faveur de plusieurs faits marquants :
– la médiatisation de différends hautement symboliques que sont les procédures lancées par Philip Morris contre l’Australie et Vattenfall contre l’Allemagne, qui ont frappé l’opinion par leurs enjeux financiers bien sûr mais également et surtout politiques car touchant au droit à réguler dans des domaines aussi sensibles que la santé ou l’environnement ;
– l’ouverture des négociations relatives au PTCI, qui a entraîné une mobilisation de la société civile et des politiques tant sur les conséquences possibles de celles-ci que sur le secret qui les entourait, avec un effet collatéral sur l’AECG.
Votre rapporteure pense qu’il est heureux que ces débats aient lieu car effectivement, les enjeux du PTCI et de l’ensemble des négociations commerciales en cours sont importants. Le temps est révolu où les négociations pouvaient se dérouler dans le secret et leur résultat être ratifiés sans que ni les négociateurs, ni les responsables politiques, ne rendent compte à l’opinion publique de leurs décisions. Toutefois, il est impératif que ce débat repose sur les faits car l’approximation affaiblit les critiques pointant les dysfonctionnements réels du RDIE (A). Cependant, l’introduction d’un mécanisme de règlement des différends entre les États et les investisseurs peut avoir du sens, notamment dans le PTCI (B). Enfin, même si des dérives sont avérées, les États restent les auteurs et les maîtres des traités. Par conséquent, ils disposent de tous les moyens de les conjurer (C).
Les débats actuels autour du RDIE en Europe, qui rappellent d’ailleurs fortement les débats ayant eu lieu dans les années 90 dans le cadre de l’ALENA, sont désormais suffisamment nourris pour qu’il soit possible de classer les critiques qui lui sont adressés en trois catégories.
a. Une discrimination inutile au profit des investisseurs étrangers ayant les moyens d’assumer le coût d’un arbitrage
Le premier argument contre le RDIE est un argument de principe. Le RDIE entraînerait une triple discrimination : entre les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers, entre les investisseurs étrangers eux-mêmes et entre les États selon qu’ils ont les moyens ou non de supporter le coût de l’arbitrage et, enfin, entre les investisseurs et les autres parties prenantes à l’investissement.
Pour ses contempteurs, les investisseurs étrangers sont doublement favorisés par les droits supérieurs aux investisseurs nationaux que leur confèrent les TBI. Non seulement ils bénéficient seuls des garanties inscrites dans ces derniers mais ils disposent surtout d’une voie de recours privilégiée, leur permettant d’obtenir des compensations pour une décision de l’État légale et applicable à tous, pour autant qu’un tribunal arbitral la considérerait comme contraire au traité concerné. Et cela conformément à l’application d’un des principes cardinaux du droit international public, « Pacta sunt servanda » : les traités doivent être respectés. Cette discrimination serait d’autant plus dommageable aux investisseurs nationaux que ces investisseurs étrangers sont souvent leurs concurrents directs.
Ce fait est parfaitement exact car les seules actions pour les entreprises nationales sont les voies de recours internes.
Pour ses défenseurs, s’il crée une discrimination au profit des investisseurs étrangers, en leur ouvrant une voie de recours ad hoc contre les décisions de l’État, c’est pour éviter que ceux-ci ne soient victimes de l’arbitraire de ses tribunaux internes et permettre qu’ils puissent obtenir réparation de leur préjudice. En effet, si l’État ne respecte pas sa signature en violant les droits des investisseurs étrangers, par exemple en les expropriant sans juste compensation, comment ceux-ci pourraient-ils les faire valoir si les seuls recours possibles sont devant des juridictions de ce même État défaillant ? Ils sont conscients que la défaillance de ces derniers peut également affecter les investisseurs nationaux mais même dans ce cas, ils considèrent qu’on ne peut reprocher aux investisseurs étrangers d’en être protégés par le RDIE.
La deuxième discrimination alléguée porte sur le coût de l’arbitrage. Selon la CNUCED, il s’élève en moyenne à 8 millions de dollars, constitué pour l’essentiel par des frais d’avocat. Peu d’entreprises semblent à même de supporter une telle charge, à moins d’être multinationales. De même, les plus pauvres des États pourraient avoir du mal à payer les frais très importants qu’implique une défense efficace contre des entreprises qui, au contraire, bénéficient de moyens considérables.
Cette critique doit toutefois être nuancée. Il convient de se méfier des moyennes qui peuvent être poussées à la hausse par quelques contentieux à forts enjeux. Comme l’a rappelé une étude de l’OCDE portant sur plus d’une centaine de différends entre un État et un investisseur, entre 2006 et 2011 (46), 8 % des différends impliquaient une grande entreprise, 40 % une entreprise de taille intermédiaire (ETI) et 22 % des individus ou des très petites entreprises (47). La France elle-même, dans l’unique différend qui l’oppose à un investisseur sur le fondement de son TBI avec la Turquie, a été poursuivie par un individu. Le coût de l’arbitrage n’a de toute évidence pas dissuadé des individus et des petites entreprises de porter leurs différends avec un État devant un tribunal arbitral.
Troisième critique, le RDIE introduirait une discrimination : les investisseurs étrangers disposeraient d’un outil privilégié pour poursuivre les États devant des tribunaux internationaux alors qu’en matière de droits de l’homme, il n’est pas possible aux victimes de leur agissement de faire de même. En effet, lorsque c’est possible, par exemple avec la Cour européenne ou la Cour interaméricaine des droits de l’homme, il est obligatoire d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes. De même, les victimes nationales de l’investissement d’une entreprise étrangère ne peuvent pas saisir un tribunal arbitral pour la faire condamner. Seules leur sont ouvertes les voies de recours internes, sachant qu’une condamnation peut entraîner la saisine, par l’entreprise concernée, d’un tribunal arbitral, comme Chevron à la suite de sa condamnation à 9,5 milliards de dollars pour pollution en Équateur.
Enfin, le RDIE serait largement inutile puisqu’aucune corrélation n’a jamais été établie entre la signature d’un TBI et la variation des flux d’investissement, y compris dans les pays en voie de développement. Pour ne prendre qu’un exemple déjà cité, le Brésil, selon le dernier relevé de sa Banque centrale (2012), dispose d’un stock d’IDE de 737,3 milliards de dollars, sans avoir jamais ratifié de TBI. Les États-membres de l’Union européenne représentent 62 % du stock d’investissement étranger aux États-Unis (1 600 milliards de dollars) et les États-Unis 38 % des investissements étrangers dans l’Union européenne (1 900 milliards de dollars). Enfin, les 57 traités signés par les États-Unis ne couvrent que 21 % de leur stock d’investissements.
La deuxième catégorie d’arguments contre le RDIE est celle qui revient le plus souvent dans les débats. Les opposants au RDIE mettent en avant le fait qu’en cas de violation avérée d’un traité d’investissement, les États peuvent se voir infliger par les tribunaux arbitraux des dommages-intérêts pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars, payés par le contribuable national, si bien qu’ils pourraient hésiter à adopter les règlementations, notamment environnementales ou sanitaires, susceptibles d’entraîner une plainte des investisseurs étrangers. En d’autres termes, le RDIE menacerait donc directement leur droit souverain à réguler.
Ce risque de « gel règlementaire » (voir supra) est en pratique difficile à prouver. Il est avéré dans le cas de la Nouvelle-Zélande qui a suspendu son projet d’instaurer un paquet de cigarette « neutre » à la suite de la plainte de Philip Morris contre l’Australie. De même, Vattenfall a obtenu de l’Allemagne, en 2010, après avoir déposé une plainte sur le fondement du TCE, le droit de construire sa centrale électrique au charbon en revenant sur les mesures supplémentaires relatives à la qualité de l’eau imposée par la ville de Hambourg dans le permis de construire.
Selon les ONG rencontrées par votre rapporteure, de nombreux cas de « gel règlementaire » à la suite de menaces de plaintes d’investisseurs existeraient mais, ils sont très difficiles à démontrer car les pressions sont officieuses et les projets de règlementation retirés avant d’être rendus publics.
A supposer que l’État ne cède pas à la menace et adopte, malgré les pressions, une règlementation qui déplaît aux investisseurs, il s’expose à une plainte de ceux-ci sur le fondement d’un éventuel TBI avec leur État d’origine. Or, les garanties qu’ils retirent des TBI sont, dans de nombreux cas, sommaires et vagues, laissant un large pouvoir aux tribunaux arbitraux pour les interpréter en faveur des investisseurs dans des sentences qui, on le rappelle, sont sans appel.
Au final, le RDIE tel qu’il est mis en œuvre sous sa forme actuelle de tribunal arbitral aboutit, selon ses critiques, à une situation insupportable sur le plan des principes démocratiques : des arbitres choisis et payés (au moins pour l’un d’entre eux) par des entreprises multinationales ont le pouvoir de remettre en cause, par leurs sentences et les compensations colossales qu’elles peuvent comporter, les choix de politiques publiques, et ainsi, faire prévaloir l’intérêt privé des investisseurs sur les objectifs d’intérêt général que les États poursuivaient.
Si la première série de critiques vise le principe même du RDIE comme moyen de règlement des différends entre les États et les investisseurs, c’est la seconde qui suscite les peurs les plus nombreuses dans l’opinion publique car elle touche directement ses préférences collectives. Or, le risque de voir celles-ci remises en cause n’est pas seulement théorique mais bien réel car le système arbitral dysfonctionne largement.
Le RDIE a, depuis 1959 et le premier TBI, toujours pris la forme d’un arbitrage international. Plus précisément, l’État et l’investisseur désignent des personnes privées pour constituer un tribunal arbitral afin de régler leur différend et uniquement celui-ci. Le risque majeur que présente cette forme de RDIE est celui du conflit d’intérêt et, plus généralement, de la partialité des arbitres.
En préalable, il convient de souligner qu’en matière de règlement des différends entre État et investisseur, il est tout à fait admis que les arbitres soient également avocats et universitaires. Par conséquent, non seulement un même arbitre peut l’être dans plusieurs affaires simultanément mais il peut également conseiller à la fois des États ou des investisseurs dans d’autres affaires, tout en commentant les sentences dans des revues spécialisées (48) ; enfin, il est courant qu’un arbitre soit appelé comme expert dans une affaire et donne son point de vue de ce que devrait être la bonne interprétation d’une clause.
Cette multitude d’activités pose évidemment la question des conflits d’intérêt auxquels s’exposent les arbitres. Elle est d’autant plus épineuse que ceux-ci forment un club restreint. Comme l’a mis en évidence l’étude de l’ONG Corporate European Observatory précitée, une « élite » de quinze arbitres, tous anglo-saxons ou liés à des cabinets anglo-saxons, est impliquée dans 55 % du total des différends, 64 % des différends portant sur plus de 100 millions de dollars et 75 % des 16 différends portant sur plus de 4 milliards de dollars. Cette concentration se retrouve aussi dans les cabinets d’avocats puisque trois d’entre eux (Freshfields Bruckhaus Deringer, White & Case et King & Spalding) étaient, au cours de la seule année 2011, impliqués dans 130 différends.
Depuis quelque temps, on observe qu’un certain nombre d’arbitres ont tendance à quitter les grands cabinets d’avocats et à monter leur propre structure afin, justement, de limiter les risques de conflits d’intérêt découlant de cette appartenance, il n’en reste pas moins que leur impartialité est de plus en plus remise en cause. En effet, en raison même de leur petit nombre comme de leurs multiples activités donnant lieu à des prises de positions publiques, il est facile de savoir s’ils sont plutôt favorables aux États ou aux investisseurs (49).Ces derniers en tirent les conséquences qui s’imposent : dans les nombreux différends qu’ils ont eus à trancher comme arbitres, l’un de ces quinze arbitres était désigné dans 94 % des cas par un investisseur et un autre dans 79 % des cas par un État.
Certes, des garde-fous existent contre les conflits d’intérêt mais ils sont jugés insuffisants compte tenu du fait que le système lui-même les génère. L’article 6 du Règlement d’arbitrage du CIRDI n’impose ainsi aux arbitres qu’une déclaration solennelle d’indépendance et d’impartialité complétée par une déclaration concernant leur relations professionnelles d’affaires et autres (s’il en existe) avec les parties, passées et actuelles, et toute autre circonstance qui pourrait conduire une partie à mettre en cause leur indépendance.
Au-delà du conflit d’intérêt lié à une affaire particulière, la même ONG a mis en évidence le biais que, d’une manière générale, les arbitres ont en faveur de l’investisseur. Une étude récente, basée sur l’analyse de 140 cas (50), a montré que les arbitres ont tendance à interpréter largement certaines clauses mal définies dans les TBI, en particulier la définition de l’investissement qui, bien souvent, décide de la compétence du tribunal arbitral. Pour l’ONG, ce biais s’expliquerait par le fait que les arbitres sont nommés et payés par les parties pour un seul et unique différend. Plus il y a de différends, plus leur revenu est important. Ils auraient donc un intérêt pécuniaire objectif à voir se multiplier les différends, d’autant plus qu’ils sont souvent, dans le même temps, également avocats (lesquels sont dix fois plus payés que les arbitres – voir supra). Dès lors, il semble logique, pour cette ONG, qu’ils favorisent les investisseurs car ce sont eux et eux seuls qui sont à l’origine des différends. Ils attaqueront en effet d’autant plus les États que leur plainte aura de chance d’être recevable par un tribunal arbitral et, le cas échéant, satisfaite par une sentence en leur faveur.
Toutefois, malgré cet intérêt objectif, il convient de rappeler que dans le cas des pays européens, comme l’a constaté le CIRDI dans son étude précitée, la proportion de sentences favorables à l’État est de 69 %. En outre, l’augmentation du nombre des différends doit être corrélée à l’accroissement considérable des TBI et des investissements directs internationaux.
L’arbitrage est, historiquement, une procédure secrète. Le secret va de soi lorsqu’il s’agit d’un arbitrage commercial impliquant deux personnes privées. Toutefois, il n’en va pas de même dès lors qu’un État est partie au différend, surtout lorsqu’est en jeu une décision de politique publique pouvant affecter directement les citoyens dudit État.
Or, même si les différends entre un État et un investisseur s’inscrivent souvent dans un cadre contractuel, la mise en œuvre d’un RDIE peut parfois impliquer des mesures législatives générales à très forts enjeux politiques. C’est le cas évidemment pour les deux différends faisant l’objet de la plus large médiatisation actuellement : Philip Morris et Vattenfall. Si la plainte de Philip contre la loi australienne imposant le paquet de cigarette « neutre » a été rejetée, celle de Vattenfall est toujours en cours. L’énergéticien suédois, qui exploite deux centrales nucléaires en Allemagne, considère que la décision du gouvernement allemand de « sortir » du nucléaire constitue une expropriation indirecte. Compte tenu des conséquences, qui se chiffrent en milliard de dollars, le moins serait que les citoyens soient informés des procédures en cours.
Or, ce n’est pas le cas. En effet, un « blackout » quasi-complet est de mise et même les parlementaires allemands n’ont pas accès à l’information. Malgré les progrès intervenus en 2006 en matière de transparence, les règles du CIRDI permettent toujours aux parties de s’opposer à la divulgation des informations comme à l’intervention des tiers dans la procédure. En outre, même si les règles de la CNUCDI ont également été améliorées, il n’en va pas de même pour les autres instances d’arbitrage qui sont très attachées à la confidentialité de leurs procédures.
Notons qu’un progrès significatif vers plus de transparence pourrait résulter de la nouvelle convention des Nations-Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur les traités précités. Celle-ci garantit l'accès du public aux documents et la publicité des audiences, à la seule exception des informations confidentielles ; elle permet également aux tiers de présenter des observations aux procédures. Néanmoins, pour s’appliquer, encore faut-il qu’elle soit signée par un nombre important d’État afin que, dans un différend, à la fois l’État de l’investisseur et l’État défendeur soient parties à cette convention.
Enfin, il faut être conscient que la confidentialité peut, parfois, être nécessaire pour dépolitiser les différends, conformément d’ailleurs à l’objet même du RDIE, en les soustrayant à d’éventuelles pressions de l’opinion publique et des médias notamment.
Le choix de l’arbitrage est souvent celui de la rapidité, ne serait-ce qu’en raison de règles de procédures très souples et d’absence d’appel. C’est d’ailleurs l’un de ses avantages majeurs par rapport aux tribunaux internes. Cependant, il n’en va pas de même pour le règlement des différends entre les États et les investisseurs et, au cours de ses auditions, votre rapporteure a été frappée par la longueur des procédures qui peuvent fréquemment atteindre dix ans. Les raisons avancées montrent que l’ensemble des parties prenantes à l’arbitrage ont une responsabilité dans ce fait, révélant un certain dévoiement de ce dispositif.
Les premiers responsables de la durée de la procédure sont, de l’avis général, les arbitres eux-mêmes. Les investisseurs comme les États choisissant en pratique leurs arbitres parmi un « club » très restreint, ceux-ci travaillent simultanément sur de très nombreuses affaires – jusqu’à une vingtaine ; plus d’affaires signifie en effet plus de revenus pour eux-mêmes et, le cas échéant, leur structure. Toutefois, même s’ils se font aider par des assistants, il leur faut néanmoins se plonger dans des dossiers très volumineux et complexes et réussir à se coordonner avec les co-arbitres pour fixer les dates d’audiences, lesquelles exigent la présence des trois arbitres. En raison des contraintes des uns et des autres, le délai pour fixer celles-ci peut atteindre jusqu’à un an, retardant d’autant l’avancement de la procédure.
Les avocats portent également une lourde responsabilité dans l’allongement considérable de la durée des arbitrages et, comme pour les arbitres, ils en tirent un intérêt financier. En effet, les avocats sont rémunérés à l’heure, jusqu’à 1000$ pour un associé d’un grand cabinet. Il est donc dans leur intérêt de demander des délais plus longs afin de multiplier les recherches, les envois de documents et les incidents de procédure. Il convient de signaler que ce constat vaut tant pour les conseils des États que pour ceux des investisseurs.
Enfin, l’État lui-même est en cause ; non seulement les processus décisionnels sont plus longs, mais par principe défendeur, il utilise généralement tous les moyens à sa disposition pour retarder la procédure. Il peut le faire au début, en contestant la compétence du tribunal, comme à la fin, en faisant un recours en nullité contre la sentence. Enfin, même si celui-ci est rejeté, il peut toujours refuser d’exécuter la sentence, contraignant l’investisseur à saisir les juridictions nationales ou à négocier un compromis (voir supra).
La forme donnée au RDIE par les TBI et autres traités plurilatéraux a pour conséquence que les tribunaux arbitraux sont des tribunaux ad hoc, constitués pour régler un différend et un seul entre un État et un investisseur. Si ce principe ne pose pas de difficulté dans les arbitrages commerciaux entre personnes privées, il n’en va pas de même lorsqu’est impliqué un État, et en cause, une mesure d’intérêt général. En effet, une seule et même décision d’un État peut susciter plusieurs dizaines de différends. Or, dans le cadre du RDIE actuel, chacun de ces différends, bien que portant sur des faits semblables, sera réglé par un tribunal différent, entraînant un risque évident de contradiction dans l’interprétation de ces faits.
Le cas qui vient immédiatement à l’esprit est celui de l’Argentine qui, à la suite de l’adoption de sa loi d’urgence économique en 2002, a été attaquée par plusieurs dizaines d’investisseurs, chacun de ces différends ayant entraîné la constitution d’un tribunal arbitral ad hoc. Pourtant, même si les investisseurs comme les TBI étaient différents, la question posée était toujours la même : la crise subie par l’Argentine au début des années 2000 était-elle constitutive d’un état de nécessité à même de justifier, les mesures prises, incluant la loi d’urgence économique ? Dans l’affaire CMS précitée, les arbitres ont répondu non ; en revanche, dans l’affaire Continental Casualty (2008), leur réponse a été, au moins partiellement, oui. Le même fait a donc pu recevoir une qualification juridique différente. Le même risque de contradiction entre les sentences existe aujourd’hui pour l’Espagne, confrontée à plus d’une dizaine de plaintes à la suite de sa décision de modifier les règles relatives aux subventions accordées à la production d’électricité d’origine renouvelable en 2013.
Est également bien connue la contradiction entre les sentences CME c/ République Tchèque et Lauder c/ République Tchèque. Les deux cas portent sur les mêmes faits, évoqués supra. La société de droit néerlandais CME a investi en 1991 dans un projet de création d'une chaîne locale privée de télévision. L'investissement a été effectué en association avec un partenaire local, CET21, par la création d'une société commune CNTS. En 1996, le Conseil des médias, organe de contrôle et de supervision du secteur audiovisuel, change les conditions relatives à la licence et exige des modifications dans la structure de l'entreprise commune. Ces nouvelles exigences obligent CME et son partenaire à remplacer l'accord de joint-venture par un contrat de prestation de service. Les relations entre les deux partenaires se sont alors détériorées jusqu'à la séparation.
En 1999, Ronald Lauder, coactionnaire de la CME, a engagé une procédure contre la République tchèque auprès de la Cour internationale d’arbitrage de Londres, sur le fondement de l’accord de soutien mutuel à l'investissement conclu en 1991 entre les États-Unis et la République fédérale tchécoslovaque. Six mois plus tard, la société CME s'est quant à elle fondée sur le TBI République tchèque/ Pays-Bas pour introduire une autre demande d'arbitrage, cette fois devant la Cour arbitrale de Stockholm. Par conséquent, les deux différends portaient sur les mêmes faits avec les mêmes arguments de droit et les mêmes moyens de preuve. Les deux tribunaux ont pourtant affirmé qu’étant saisis sur le fondement de deux traités différents par deux investisseurs distincts, l'existence d'une procédure portant sur les mêmes faits ne les empêchait pas de se déclarer compétents, le risque de double compensation devant être, le cas échéant, pris en considération lors de l'évaluation du dommage.
Deux sentences, en conséquence, ont été rendues. La première (Lauder) le 3 septembre 2001, la deuxième (CME) dix jours plus tard. Or, les deux tribunaux, s'agissant de violations relatives à des règles quasiment identiques, ont rendu deux sentences contradictoires et inconciliables. Si la Cour arbitrale de Londres n’a rien trouvé à redire au comportement de l’État Tchèque, les mesures prises par celui-ci ont été considérées comme une expropriation indirecte par la Cour de Stockholm qui, en conséquence, l’a condamné à verser près de 200 millions d’euros au plaignant.
La République tchèque a alors introduit une demande d'annulation contre la sentence CME devant les juridictions suédoises, considérant que la sentence Lauder devait se voir reconnaître l’autorité de la chose jugée. Le 15 mai 2003, la Cour de Seva a rejeté la demande d'annulation. En effet, l'application du principe de l'autorité de la chose jugée suppose une identité du litige. Or, il ne peut y avoir deux litiges identiques que s'ils ont le même objet, la même cause et s'ils opposent les mêmes parties, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et ne peut en pratique jamais l’être dans les différends entre un État et un investisseur.
Ce risque de contradiction entre des sentences arbitrales existe aussi dans l’ordre juridique interne. En France, il est fréquent que deux TGI ou deux cours d’appel se contredisent ; toutefois, la contradiction ne dure qu’un temps puisque la Cour de cassation (51) est chargée d’unifier la jurisprudence en fixant une interprétation de la loi qui s’impose à toutes les cours et tribunaux du pays. Or, une telle Cour n’existe pas pour le droit international de l’investissement. Les sentences sont définitives, sans recours autre qu’un recours en nullité strictement encadré s’agissant du CIRDI (voir supra) et les tribunaux arbitraux, ne sont pas liés par les précédents. L’insécurité juridique est donc grande pour les États comme pour les investisseurs qui, en pratique, ne peuvent savoir dans quel sens tranchera le tribunal. D’où l’importance majeure pour les parties du choix des arbitres qui, par leurs décisions antérieures, leurs publications et leurs déclarations, donnent des indications sur ce que pourraient être leurs interprétations des clauses concernées.
Les TBI sont nés à une époque où les entreprises étaient bien moins internationalisées qu’aujourd’hui. Dès lors, ils ne protégeaient que les investisseurs appartenant aux deux États parties et non les autres. Cette époque est désormais révolue et il est possible actuellement pour un investisseur de « faire son marché » entre les traités et d’investir via une structure ayant la nationalité de l’État lui offrant les meilleures garanties en matière de protection de son investissement. Certaines pratiques sont ainsi très contestables, par exemple celle mise en œuvre par Philip Morris dans le différend l’opposant à l’Australie. Comme on le sait, le TBI entre les États-Unis et l’Australie ne comporte pas de RDIE. Le sachant, la filiale hongkongaise de Philip Morris a racheté quelques mois avant la promulgation de la loi imposant le « paquet neutre » la filiale australienne, lui permettant de faire jouer les clauses du TBI signé entre Hong Kong et l’Australie en 1993, lequel inclut un RDIE.
Non seulement les investisseurs peuvent « faire leur marché » avant et après l’investissement, en choisissant la protection du TBI le plus avantageux, mais ils peuvent également faire de même en cas de différend en jouant de la clause de la nation la plus favorisée (NPF). Dans l’affaire Maffezini c/ Espagne (2000), le TBI signé entre l’Argentine et l’Espagne exigeait de l’investisseur, avant qu’il puisse saisir le CIRDI, qu’il saisisse les juridictions internes et leur laisse 18 mois pour se prononcer. Or, le TBI signé entre l’Espagne et Chili se contentait lui d’exiger que l’investisseur attende six mois sans obligation de saisir les juridictions internes. S’appuyant sur la clause NPF du TBI argentino-espagnol, le tribunal arbitral a « importé » la clause du TBI précité et accepté la saisine au bout d’un délai de six mois. Toutefois, le tribunal a mis un garde-fou en précisant que « l’utilisation de la clause NPF en matière de RDIE ne peut faire obstacle à des considérations d’ordre public que les parties contractantes auraient pu envisager comme des conditions fondamentales de leur acceptation de l’accord ».
En conclusion, les critiques visent non seulement le RDIE en tant que tel mais également les dérives de l’arbitrage qui n’est que l’une des formes qu’il peut prendre. Votre rapporteure tient en effet à souligner que le RDIE n’est pas forcément synonyme de tribunal arbitral et que d’autres formes sont possibles telles que celle adoptée dans l’AECG et proposées dans le cadre du PTCI.
Lors de ses entretiens avec des personnalités canadiennes, américaines ou australiennes, votre rapporteure a été frappée par le fait que les débats qui agitent aujourd’hui les pays européens concernant le RDIE dans l’AECG et le PTCI reprennent quasiment les mêmes termes que ceux auxquels a donné lieu l’ALENA. En effet, la ratification de ce traité a donné lieu, dans ces trois pays, à des controverses passionnées qui ont duré bien après son entrée en vigueur.
Aux États-Unis, dans un contexte préélectoral, ce sont les conséquences de l’ALENA sur l’emploi qui préoccupaient à la fois les candidats, les syndicats et l’opinion publique. Compte-tenu du niveau des coûts de production au Mexique, la crainte était générale que la suppression des barrières douanières n’entraîne la délocalisation des emplois américains vers les maquiladoras mexicains. Quant aux écologistes, ils redoutaient les conséquences pour l’environnement du développement économique. Le Mexique ayant des normes environnementales bien moins élevées que les États-Unis, le risque leur apparaissait majeur que l’industrialisation et l’urbanisation accélérée de ce pays suite à l’accord ne transforment le Rio Grande et toutes les terres frontalières en vaste poubelle. Au final, la ratification n’a été obtenue qu’avec l’engagement du futur Président Clinton de négocier trois accords parallèles (supplemental agreements) sur l'environnement, les droits du travail et des clauses de sauvegarde en cas de difficultés économiques.
S’agissant du Canada, les controverses ont été fortes et ce, dès la signature du traité de libre-échange avec les États-Unis en 1987. Les élections générales de 1988 ont ainsi exclusivement porté sur la ratification de ce traité comme, en 1993, sur celle de l’ALENA. Comme aux États-Unis, ce sont les conséquences économiques de l’ALENA qui ont concentré toute l’attention et non le mécanisme de règlement des différends lui-même. La raison en est simple. Le RDIE n’a été introduit dans l’ALENA que pour protéger les investisseurs canadiens et américains des défaillances supposées de la justice mexicaine. Mis à part quelques universitaires et ONG, personne n’avait véritablement envisagé qu’il puisse être utilisé par ces mêmes investisseurs contre les États-Unis ou le Canada. Le RDIE n’a pas fait débat car jusqu’alors, il n’avait tout simplement jamais été utilisé contre un pays développé.
Néanmoins, dans les années qui ont suivi les premiers cas impliquant les États-Unis et le Canada, ces derniers ont pris conscience avec les ONG des conséquences potentiellement dommageables du RDIE, notamment en matière environnementale et sanitaire. Toutefois, cette prise de conscience n’a pas entraîné de remise en cause du RDIE en tant que tel malgré l’activisme de certaines ONG et syndicats (52) ; ces deux pays ont simplement modifié leur modèle de TBI afin de renforcer leur droit à réguler et prévenir les éventuels dévoiements de ce mécanisme par les investisseurs.
Aujourd’hui, le RDIE ne fait pas réellement débat aux États-Unis qui, on le rappelle, n’ont jamais été condamnés par un tribunal arbitral. De même, bien que le Canada ait été poursuivi 35 fois par les investisseurs et plusieurs fois condamné, seuls des partis minoritaires contestent le chapitre 11 de l’ALENA. Les partis de gouvernement que sont le NDP, le Parti conservateur et le Parti libéral ne l’ont même pas évoqué lors de la campagne de 2011. Quant au RDIE dans l’AECG, il n’est plus contesté au Canada que par certaines ONG (53).
Si le RDIE n’a pas été au cœur des débats de l’ALENA ou d’autres TBI américains ou canadiens, il n’en va pas de même en Australie. En effet, les négociations de l’accord avec les États-Unis ont déclenché le plus large débat qu’ait jamais connu l’Australie sur le libre-échange. Celui-ci s’est noué autour du RDIE, de son utilité dans un accord avec un pays comme les États-Unis et de ses conséquences pour le droit à réguler de l’État australien. Soumis à une pression très forte de l’opinion publique et de la majorité du Sénat qui ne lui était pas favorable, le gouvernement libéral de M. John Howard a finalement rejeté la demande américaine et refusé qu’un RDIE soit inclus dans l’AUSFTA. Celui représente donc l’un des seuls exemples d’un accord portant sur la protection des investissements n’incluant pas de RDIE.
Un temps mis en sommeil, le débat sur le RDIE a resurgi à la suite de la plainte de Philip Morris, dans les conditions évoquées précédemment, contre la loi australienne imposant le « paquet de cigarettes neutre ». Le 12 avril 2011, le gouvernement travailliste de Mme Julia Gillard a publié une déclaration selon laquelle il n’y aurait plus de RDIE dans les traités signés par l’Australie. Cette prohibition fut de courte durée puisque deux ans plus tard le nouveau gouvernement libéral de M. Tony Abbott définit une nouvelle politique en matière de RDIE qui, selon les cas, pourrait ou non être inclus dans un accord. Cette politique du cas par cas s’est concrétisée par un RDIE dans l’accord avec la Corée du sud mais pas dans l’accord avec le Japon qui, toutefois, sera à terme remplacé par le TTP qui, lui, inclura un RDIE.
Le débat a connu un dernier développement avec une proposition de loi déposée au Sénat australien et visant à bannir le RDIE des accords signés par l’Australie. La lecture du rapport fait par la commission des affaires étrangères, de la Défense et des négociations commerciales sur cette proposition, publié en août 2014, est très instructive. En effet, il souligne que « la plupart des risques pour la souveraineté australienne et le droit à réguler de l’État soulevés par le RDIE sont exagérés et ne reflètent pas l’expérience de l’Australie en matière d’accord de libre-échange. Bien que la commission reconnaisse que les expériences passées ne présument pas de l’avenir, elle souligne que le mécanisme de règlement des différends État investisseur a évolué de manière positive pour les États, et notamment l’Australie, du fait des exemptions limitant son champ d’application et d’une rédaction plus précise des accords. La commission est ainsi d’avis qu’il est bien plus important pour l’Australie de chercher à maîtriser les risques du RDIE que de mettre seule un terme à une pratique de longue date ».
C’est en effet une politique pragmatique qui est suivie par l’Australie aujourd’hui. Les représentants de l’Ambassade australienne à Paris ont ainsi longuement expliqué à votre rapporteure les précautions prises par le gouvernement australien, dans la rédaction de l’accord avec la Corée du sud, afin de prévenir les risques associés au RDIE, notamment par la multiplication des exemptions générales (par exemple sur l’énergie) et une rédaction aussi précise que possible des diverses clauses, lesquelles comportent elles-mêmes des exceptions (par exemple la clause sur le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée).
Au final, les arguments soulevés dans le cadre de l’ALENA et de l’AUSFTA apparaissent très proches des termes du débat actuel en Europe autour du RDIE : préservation du droit des États à réguler, exclusion de certains champs sensibles, légitimité des poursuites. Toutefois, les seuls débats concernant aujourd’hui le RDIE au Canada, aux États-Unis et en Australie ne portent plus tant sur son principe que sur les améliorations à lui apporter.
Alors que les débats autour du RDIE ont surgi dès les années 90 aux États-Unis et au Canada, il serait tentant de dire que l’Europe a été à la traîne de l’Amérique et n’a saisi que récemment les véritables enjeux du RDIE. C’est à la fois vrai et faux. C’est faux car l’Europe et notamment la France ont elles aussi connu un très large débat, portant sur l’investissement en général, incluant le RDIE, lors de la négociation de l’Accord multilatéral sur l’investissement dans les années 90 (voir supra). Mais c’est également vrai car les débats autour du RDIE et de l’investissement sont largement retombés en Europe. La meilleure preuve de ce désintérêt est la signature, par les pays européens, de plus d’un millier de TBI depuis 1998, incluant tous ou presque un RDIE, sans qu’aucun d’entre eux ne suscite de discussions dans l’opinion publique.
L’explication est fort simple. Après la signature de l’ALENA, les États-Unis et le Canada ont, très rapidement, été poursuivis par les investisseurs sur la base du chapitre 11, obligeant les partis politiques à se positionner et les gouvernements, sous pression notamment de la société civile, à réfléchir au moyen de préserver leur droit à réguler. En revanche, le RDIE restait, pour les pays d’Europe de l’ouest, un non-sujet. N’ayant jamais été poursuivis car n’ayant jamais signé de TBI qu’avec des pays en développement ou en transition, ils n’avaient pas de raison de s’y intéresser. Ils ont donc continué à signer à tour de bras des TBI brefs et imprécis appartenant à un modèle depuis longtemps dépassé outre-Atlantique. Quant à l’Union européenne, elle n’était pas, jusqu’en 2009, compétente en matière d’investissements directs étrangers.
Les choses auraient pu continuer ainsi sans la conjonction récente de plusieurs facteurs qui ont abouti à une prise de conscience générale des enjeux du RDIE en Europe. Nous avons évoqué supra :
– la médiatisation de différends hautement symboliques que sont les procédures lancées par Philip Morris contre l’Australie et Vattenfall contre l’Allemagne ;
– l’ouverture des négociations relatives au PTCI ;
– enfin, le fait que ces négociations soient, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, menées par la Commission européenne, a renforcé la méfiance d’une partie de l’opinion publique européenne.
Ces éléments ont ainsi contribué à faire du RDIE le cœur des débats actuels sur le PTCI. Il faut également insister sur le fait que la Commission européenne a répété, quinze ans plus tard, les mêmes erreurs que celles faites par l’OCDE lors de la négociation de l’AMI. Alors que nous vivons, aujourd’hui plus encore qu’en 1998, dans une société interconnectée avide d’informations et particulièrement exposée à la manipulation médiatique, la Commission européenne a cru pouvoir négocier comme elle le faisait généralement, dans le secret, adoptant une approche procédurale et technique des enjeux alors qu’ils sont, en matière d’investissement, éminemment politiques.
Cette erreur, que tente de corriger l’actuelle Commission par un effort de transparence que votre rapporteure tient à saluer, a aussi eu un effet collatéral sur l’AECG, lui aussi contesté en raison de la présence d’un RDIE.
En conclusion, c’est un fait que le RDIE, créé pour protéger les investisseurs des pays développés investissant dans des pays en voie de développement qui n’offraient pas de garanties suffisantes notamment en matière d’efficacité et d’indépendance de la justice, est de plus en plus utilisé, y compris, contre les pays développés. Les débats qu’il suscite aujourd’hui découlent de ce retournement et, avec lui, la prise de conscience tant des gouvernements que des opinions publiques qu’avec le RDIE, les États peuvent se voir condamner, par des tribunaux arbitraux indépendants, à verser de lourdes compensations à la suite de décisions de politiques publiques parfaitement légitimes. D’une manière paradoxale, alors que le RDIE a pour principal avantage de dépolitiser le règlement des différends entre État et investisseur, il se trouve lui-même au cœur d’une vaste controverse politique en Europe.
B. LA QUESTION DU RDIE ENTRE PAYS DÉVELOPPÉS : L’EXEMPLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT (PTCI)
L’un des arguments les plus fréquemment avancés contre le RDIE, en particulier, dans le cadre du débat sur le PTCI, est son inutilité entre des pays développés ou « ensemble de pays développés » comme le sont l’Union européenne et les États-Unis. S’appuyant sur une des raisons d’être du RDIE, à savoir pallier la défaillance (supposée) des tribunaux internes d’un État, cet argument met en avant le fait que les juridictions des États-Unis comme celles de l’Union européenne présentent toutes les garanties en termes d’efficacité et d’indépendance.
Si cet argument s’appuie sur des faits solides, il ne donne à voir qu’une vision partielle du RDIE et ignore les trois faits suivants qui le nuancent :
– les États-Unis comme l’Union européenne ne sont pas des entités homogènes. La qualité de la justice, son indépendance et son efficacité ne sont pas forcément de même niveau dans l’ensemble des États américains et des États-membres de l’Union ;
– la justice américaine se caractérise par un coût et une complexité parfois plus importants que ceux des tribunaux arbitraux ;
– au-delà du PTCI, l’Union européenne négocie et devra négocier avec des partenaires puissants au sein desquels l’indépendance de la justice n’est pas avérée. Inscrire le RDIE dans le PTCI donnera à l’UE un avantage majeur dans la définition des normes internationales en matière de règlement des différends État- investisseur tout en renforçant sa position pour les imposer auxdits partenaires.
L’attractivité d’une économie pour les investisseurs étrangers ne se résume pas aux seules règles de protection des investisseurs et, en particulier, à la présence ou non d’un RDIE dans un traité bilatéral. À cet égard, il convient de noter que la CNUCED comme de nombreux chercheurs, tout en soulignant les difficultés d’un calcul économétrique sur ce point, ne parviennent pas à établir une relation statistique évidente entre les TBI et l’augmentation des investissements étrangers (54). Notons toutefois qu’une étude néerlandaise récente a démontré que la signature d’un TBI augmente les stocks bilatéraux d’investissement de 35 % en comparaison des stocks de ceux qui n’en ont pas signé ; surtout, il apparaît que ce sont les pays à bas ou moyen revenu qui profitent le plus de cet accroissement du stock d’investissement.
Il est aussi intéressant d’évaluer l’effet de l’absence de TBI. C’est ainsi qu’une étude récente du FMI (55) a mis en évidence le fait que « l’inefficacité du système judiciaire italien a contribué à réduire les investissements, ralentir la croissance et créer un environnement difficile pour les affaires ». On peut penser que l’effet de l’absence de TBI peut être plus important encore pour un pays moins développé que l’Italie.
Par conséquent, sans avoir la prétention de trancher le débat, votre rapporteure préfère souligner la contradiction entre les études sur l’effet des TBI sur les flux d’investissement et se concentrer sur l’analyse juridique du mécanisme.
Le recours aux tribunaux internes pour faire respecter les dispositions d’un TBI, alternative au RDIE dans le cas de pays supposés disposer d’une justice efficace et indépendante, repose sur un postulat qui n’est jamais évoqué, à savoir que le TBI concerné peut être valablement invoqué par les investisseurs devant les juridictions nationales de l’État d’accueil. Or, la question de l’invocabilité ou non des traités par les personnes privées et celle de leur place dans la hiérarchie des normes sont complexes et entièrement réglées par les dispositions constitutionnelles des États, interprétées le cas échéant par ces mêmes juridictions nationales. En d’autres termes, il faut être conscient que l’application par ces dernières du droit international ne va pas de soi et que, dans certains pays développés, celle-ci n’est pas toujours possible.
Classiquement, s’agissant de l’application du droit international en droit interne, la doctrine oppose les pays de tradition dualiste et ceux de tradition moniste. Les premiers considèrent le droit interne et le droit international comme deux ordres juridiques distincts ayant des sujets de droit différents, au point qu’il appartient au premier de déterminer les conditions dans lesquelles le second est applicable aux sujets de droit interne que sont, par exemple, les individus et les entreprises. Par conséquent, dans ces pays, le droit international n’a d’effet en droit interne qu’à la condition d’avoir été transposé dans une norme nationale.
À l’inverse, s’appuyant sur une conception hiérarchique des normes, les pays de tradition moniste considèrent que les règles de droit international, comme celles du droit interne, s'appliquent aux juridictions nationales et, par conséquent, aux sujets de droit interne. La transposition n'est alors pas une condition nécessaire de la validité du droit international en droit interne, les juridictions pouvant par ailleurs écarter une norme nationale si elle contredit une norme internationale ratifiée par l'État.
Ces deux traditions coexistent au sein de l’UE sans conséquence toutefois sur l’applicabilité directe du droit européen. Au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Italie, les traités ne sont pas directement applicables dans l’ordre juridique interne. A l’inverse, ils le sont aux Pays-Bas ou en Pologne. Le cas de la France mérite quant à lui une attention particulière, comme celui des États-Unis.
a. En France, les traités ne sont invocables qu’à la condition d’avoir un effet direct reconnu par le juge
En France, l’article 55 de la constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Notre pays se rattache donc plutôt à la tradition moniste puisque l’application du droit international en droit interne n’est pas subordonnée à un acte de transposition et que celui-ci a une valeur supérieure à celle des lois, même postérieures.
Néanmoins, pour claires qu’elles semblent être, les dispositions de cet article ont été diversement appliquées par le Conseil d’État, institution qui serait en première ligne en cas de différend avec un investisseur, compte tenu de sa compétence exclusive en matière de responsabilité contractuelle de l’État comme de responsabilité du fait des lois et des règlements.
Votre rapporteure s’est donc intéressée à sa jurisprudence relative à l’application du droit international et, en particulier, à l’effet direct de celui-ci. Dans son arrêt rendu le 11 avril 2012, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a jugé que « les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ». A l’exception du droit européen, l'effet direct d'une disposition d'un traité ou d’un accord, est subordonné à trois conditions :
– l’intention exprimée par les parties ;
– l’économie générale du traité, son contenu et ses termes, qui n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre États ;
– le caractère inconditionnel de la disposition concernée qui n’exige pas d’acte normatif supplémentaire pour son application effective.
Par conséquent, un TBI ne sera invocable devant une juridiction par un investisseur s’estimant victime d’une violation de celui-ci qu’à la condition expresse d’être d’effet direct. Avant d’analyser plus en profondeur cette question, votre rapporteure considérait que les critères de l’effet direct étaient forcément remplis s’agissant d’un TBI. Toutefois, le Conseil d’État en a décidé autrement dans un arrêt qui a été vivement critiqué lors des auditions. En effet, dans un arrêt du 21 décembre 2007, il a considéré que « les stipulations de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Alger le 13 février 1993, ne crée d’obligation qu’entre les deux États signataires ; que M. A ne peut donc utilement s’en prévaloir ». Or, cet article 3 porte sur le traitement juste et équitable, c’est-à-dire une protection fondamentale accordée par ce TBI aux investisseurs algériens en France.
Par conséquent, force est de reconnaître qu’en France, la jurisprudence du Conseil d’État a pu au moins une fois refuser de reconnaître l’effet direct d’un TBI, interdisant ainsi à un investisseur étranger de s’en prévaloir dans un différend contre l’État français. En l’espèce, le TBI contient toutefois un RDIE ouvrant à l’investisseur concerné une voie alternative de recours devant un tribunal arbitral afin de faire valoir ses prétentions.
Néanmoins, dans le cas de l’AECG, du PTCI et des autres traités auxquels l’UE elle-même est (ou sera) partie, à moins que ces traités ne précisent eux-mêmes s’ils sont ou non d’effet direct, il appartiendra à la Cour européenne de justice, saisie par un investisseur contre une mesure prise par l’Union européenne, de décider de l’invocabilité ou non de ces traités. La jurisprudence de la Cour en la matière rappelle celle du Conseil d’État puisque l’invocabilité n’est possible qu’à deux conditions : que l’économie générale, le contenu et les termes du traité concerné ne s’y opposent pas et que la disposition invoquée remplisse les conditions de l’effet direct, c’est-à-dire qu’elle comporte une obligation claire et précise qui n’est pas subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l’adoption d’un acte normatif.
Dans le cas où c’est une mesure nationale qui serait contestée sur le fondement d’un traité d’investissement, il appartiendra en revanche au Conseil d’État de se prononcer sur l’invocabilité. Même si celui-ci peut poser une question préjudicielle à la Cour de justice, il n’en reste pas moins qu’il est possible, en l’absence d’une telle procédure, que les mêmes clauses puissent être interprétées différemment au sein de l’Union européenne.
L'article VI de la constitution américaine stipule que « la présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les juges dans chaque État seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'un quelconque des États ». Les États-Unis semblent donc se rattacher aux pays de tradition moniste dans lesquels les normes internationales sont d’effet direct.
Toutefois, si tel est l’esprit de leur constitution, il n’en va pas de même de la pratique de leurs juridictions. En effet, d’une manière générale, les juridictions américaines conditionnent traditionnellement l’effet direct des traités – et donc leur invocabilité – à trois conditions qui recoupent en partie celles exigées par la Cour européenne de justice (et par le Conseil d’État) :
– le caractère « self-executing » de la disposition invoquée, qui est plus ou moins l’exigence européenne d’une norme claire, complète et précise ;
– le fait que la disposition invoquée crée des droits subjectifs pour les particuliers qui en seraient donc les destinataires directs ;
– enfin, le fait que la disposition invoquée crée un droit d’action individuel devant un tribunal interne.
L’exigence du caractère « self-executing » est ancienne puisqu’elle remonte à la décision de la Cour suprême Foster v/ Neilson (1829). Dans un considérant de principe, celle-ci affirma qu’un traité qui nécessite des mesures internes de mise en œuvre, qu’elles soient du ressort du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, ne peut être directement appliqué par le juge.
Or, les règles en la matière ne sont pas fixées par la Cour suprême ni par une autre institution publique mais par le paragraphe 111 du Restatement of the foreign relations law of the United States. Cet ouvrage, rédigé par l’American Law Institute, association privée composée de praticiens et de professeurs de droit américains, codifie le droit international du point de vue américain. Il constitue de fait la base des décisions des juges lorsqu’ils sont confrontés à un traité. Or, cet ouvrage considère qu’un traité n’a pas de caractère « self-executing » dans les trois cas suivants :
– lorsque le traité lui-même exige des mesures internes de mise en œuvre pour être applicable ;
– lorsque le Congrès des États-Unis exige des mesures internes de mise en œuvre. C’est donc la volonté du législateur américain qui prime sur le contenu du traité lui-même comme, d’ailleurs, sur l’esprit moniste de la constitution ;
– lorsqu’une législation de mise en œuvre est requise par les règles constitutionnelles américaines, en particulier lorsqu’il porte sur une matière réservée au pouvoir législatif.
Par conséquent, alors qu’en France, le juge décide seul de l’effet direct d’un traité, guidé le cas échéant par son contenu ou l’intention des parties, le caractère « self-executing » d’un traité repose très largement sur l’appréciation des autorités politiques américaines. En effet, « le rôle des juges américains en la matière est largement restreint par une attitude d’autolimitation : ils considèrent qu’il revient au pouvoir politique d’interpréter a priori la qualité de la norme conventionnelle internationale. Le respect de la séparation des pouvoirs les conduit ainsi à une réticence extrême envers l’utilisation des normes internationales » (56).
En pratique, c’est le Sénat qui, au moment de la ratification, détermine si un traité est « self-executing » ou non. Il est ainsi fréquent qu’il utilise des déclarations interprétatives qui ressemblent à des réserves privant d’effet direct des traités. Ainsi, la Cour suprême, dans sa décision Sosa v/ Alvarez-Machain (2004), a refusé l’invocabilité du Pacte international sur les droits civils et politiques car le Sénat avait décidé qu’il ne créait pas de droits invocables devant les cours fédérales. C’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
En l’absence de déclaration du Sénat, le juge s’appuie sur la seule intention du pouvoir exécutif américain. Cette position est conforme au paragraphe 111 du Restatement précité qui précise que « l’intention des États-Unis détermine si un traité est d’effet direct aux États-Unis ou s’il doit attendre une mise en œuvre par une mesure administrative ou législative appropriée ». Par conséquent, le juge n’analyse pas le caractère clair, complet et précis de la norme internationale concernée, pas plus que l’intention des parties, mais se réfère à la seule intention unilatérale du gouvernement américain.
Toutefois, le caractère « self-executing » d’un traité ne suffit pas à le rendre invocable devant les tribunaux américains. Une deuxième condition doit être satisfaite. Comme l’explique le Restatement, « savoir si le traité est d’effet direct est une question différente de celle de savoir si le traité crée des droits individuels ». Par conséquent, « si tous les traités qui créent des droits individuels sont d’effet direct, tous les traités d’effet direct ne créent pas nécessairement des droits individuels » (57). Il appartient donc au juge de rechercher si le traité a un objet exclusivement interétatique ou s’il crée des « judicially enforceable individually rights ». Il convient de souligner que le juge américain est très réticent à reconnaître de tels droits et l’a fréquemment refusé s’agissant, par exemple, du droit à l’information consulaire prévu par la convention de Vienne.
Toutefois, même si c’est le cas et contrairement à la jurisprudence française, le traité n’est pas pour autant invocable devant les tribunaux. En effet, la jurisprudence américaine exige que le traité, en plus de créer un droit subjectif individuel, confère un « private right of action » de nature procédurale ouvrant le droit à un individu d’invoquer une norme internationale devant un tribunal américain. Or, la Cour suprême, dans une décision de principe Medellin v/ Texas (2008), a affirmé que « même lorsque les traités sont d’effet direct en ce sens qu’il crée une loi fédérale, il est présumé que les accords internationaux, même ceux qui bénéficient directement aux individus, ne créent généralement pas de droits subjectifs pas plus qu’ils ne confèrent un droit d’action devant les juridictions internes ».
L’exigence de ce droit d’action est de nature à contrecarrer toute invocabilité des TBI devant les tribunaux américains, surtout qu’il peut être refusé non seulement par les juges mais également par une autorité politique comme le Sénat. C’est ainsi qu’en ratifiant le TBI avec le Rwanda en 2010, le Sénat a déclaré que les articles 3 à 10 de ce traité, relatifs aux garanties apportées aux investisseurs (traitement national, traitement juste et équitable…), sont « self-executing ». Toutefois, il a affirmé qu’ « aucune des dispositions de ce traité ne confère un droit individuel d’action » aux investisseurs devant les tribunaux américains. Certes, cette déclaration a une portée limitée compte tenu du fait que ce traité contient un RDIE ; mais qu’en serait-il si ce n’était pas le cas ?
Au final, l’invocabilité d’un TBI devant les juridictions internes reste incertaine et repose sur l’appréciation souveraine des juges, voire des autorités politiques dans le cas américain. En l’absence de RDIE, les investisseurs confrontés à une éventuelle violation des droits qu’ils tirent du PTCI pourraient donc se retrouver désarmés pour les faire valoir devant les juridictions européennes ou américaines, n’ayant pour seul recours que la protection diplomatique, avec toutes les limites de cette dernière. Dans ces conditions, même entre pays développés, le RDIE peut être utile en permettant de contourner les obstacles à l’invocabilité des traités dans l’ordre juridique interne des États concernés.
Les critiques du RDIE considèrent que les tribunaux américains et européens sont tout à fait à même, s’ils devaient être saisis d’une violation alléguée du PTCI, de garantir aux investisseurs un règlement efficace, dépolitisé et impartial de leur différend compte tenu du fait que ces pays disposent d’une justice indépendance et efficace.
Toutefois, cette position ignore le fait que ni les États-Unis, ni l’Union européenne ne constituent des entités homogènes et que la qualité de la justice n’est pas forcément la même au sein de certains États-membres comme de certains États fédérés américains.
a. Le cas de l’Union européenne : les TBI en vigueur entre les États-membres sont largement mis en œuvre par les investisseurs européens
L’Union européenne compte aujourd’hui 28 États-membres. Depuis 2004, elle s’est élargie aux anciens pays d’Europe centrale et Orientale ainsi qu’à Chypre et Malte. Or, avant que ceux-ci ne deviennent membres à part entière de l’Union européenne, ils avaient signé avec les quinze « anciens » États-membres (mais également entre eux et avec, notamment, les États-Unis et le Canada) de nombreux traités bilatéraux d’investissement. Aujourd’hui, on compte 194 TBI intra-européens. En effet, après leur sortie du communisme, ces pays ne présentaient pas toutes les garanties en termes d’indépendance et d’efficacité de la justice et les pays d’Europe de l’ouest ont souhaité protéger leurs investisseurs, notamment en leur permettant de voir leurs différends réglés par des tribunaux arbitraux. Ces TBI contiennent en effet tous un RDIE sous forme de tribunal arbitral.
Plus de vingt ans ont passé depuis la signature de ces TBI. Les pays d’Europe centrale et orientale concernés non seulement se sont considérablement développés mais ont tous adhéré à l’Union européenne, reprenant ainsi l’ensemble de l’acquis communautaire en matière d’État de droit. Toutefois, force est de reconnaître que depuis leur adhésion, les cas de mise en œuvre du RDIE par des investisseurs européens n’ont cessé de croître.
S’appuyant sur la base de données de la CNUCED, le tableau ci-dessous récapitule, par an, les différends impliquant ces treize (nouveaux) États-membres avec des investisseurs de l’Union européenne et des pays tiers. On observe en particulier que sur les trois dernières années, le nombre de différends s’élève à 39 contre 56 sur les huit années précédentes :
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
Différends avec un investisseur européen |
3 |
8 |
6 |
4 |
8 |
5 |
2 |
2 |
8 |
18 |
6 |
Différends avec un investisseur tiers |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
1 |
3 |
0 |
4 |
Total |
6 |
9 |
9 |
7 |
10 |
7 |
5 |
3 |
11 |
18 |
10 |
En d’autres termes, loin d’avoir mis un terme à la mise en œuvre du RDIE, l’adhésion de ces pays à l’UE s’est accompagnée d’un accroissement du nombre des différends, tant avec les investisseurs européens que des pays tiers. Certes, on peut interpréter cette évolution à l’aune de l’augmentation du stock d’investissement dans ces pays, surtout après leur adhésion à l’Union européenne ; il n’en reste pas moins que même ces dernières années, les investisseurs étrangers ont préféré recourir au RDIE, malgré tous ses défauts, à commencer par le coût, que recourir aux tribunaux internes de ces pays.
En effet, même s’il est parfois malvenu de l’évoquer publiquement, le fonctionnement de la justice dans certains États-membres de l’Union européenne peut légitimement faire l’objet de critiques. Ce fait est connu en Europe mais également aux États-Unis et au Canada qui font bien la distinction entre la qualité des différents systèmes juridiques dans l’Union européenne. Votre rapporteure a ainsi pris connaissance avec intérêt du « US Investment Climate Statements 2015 », équivalent d’une analyse des risques-pays publié chaque année par le Département d’État américain. Ce dernier est ainsi particulièrement sévère pour au moins trois États-membres de l’Union européenne :
– en Bulgarie : « la corruption au sein du système judiciaire constitue un sérieux problème. Les institutions judiciaires sont aujourd’hui les moins fiables du pays, faisant face à de larges accusations de népotisme et d’opacité dans les procédures de nomination et de promotion ainsi que d’influence des milieux politiques et économiques ». Malgré les réformes décidées par le gouvernement, « leur mise en œuvre a été contrecarrée par de fortes pressions des milieux d’affaires en faveur du statu quo, les résistances internes au changement comme le manque de volonté politique pour mettre effectivement en œuvre l’indépendance de la justice. Par conséquent, la jurisprudence est incohérente et des années de procédure sont la norme. Les juridictions de Sofia sont encombrées, disposent de ressources limitées et souffrent de procédures inefficaces qui empêchent une administration rapide et efficace de la justice » ;
– en Roumanie : « les compagnies étrangères engagées dans des opérations commerciales ou des investissements en Roumanie expriment souvent des inquiétudes à propos du manque d’expertise des juridictions locales en droit commercial. Les juges ont généralement une expérience limitée s’agissant du fonctionnement d’une économie de marché, des relations d’affaires internationales, des droits de propriété intellectuelle. L’incohérence et l’imprévisibilité de la jurisprudence restent un problème majeur pour les investisseurs étrangers comme nationaux ainsi que pour la société dans son ensemble. Même lorsque les jugements sont favorables, leur exécution est défaillante [en particulier] dans les cas où les pouvoirs publics contestent de manière injustifiée les décisions judiciaires, au point de remettre en cause la nature obligatoire de celles-ci ». Quant à la corruption dans le pays, le Département d’État constate qu’ « elle reste un sérieux problème » ;
– en Slovaquie : « plusieurs indices montrent que le système judiciaire est l’un des principaux problèmes du pays : Le Transparency International Index, par exemple le considère comme “l’une des plus faibles institutions du pays ”. La loi slovaque garantit l’indépendance judiciaire. Toutefois, en pratique, les problèmes de corruption, d’intimidation des juges, d’inefficacité, de manque d’intégrité et de responsabilité continuent à miner l’indépendance judiciaire. Dans le dernier classement Compétitivité du the World Economic Forum, la Slovaquie a atteint son pire rang depuis 1997. Dans des domaines spécifiques relatifs à la corruption, comme le détournement de fonds publics, la confiance dans les politiques, le gaspillage d’argent public et l’efficacité du cadre réglementaire, la Slovaquie est classée au 112ème rang ou pire. Dans le rapport de la Banque mondiale intitulé “Doing Business 2013”, la Slovaquie a récemment reçu des notes bien pires que la plupart de ses homologues européens dans des domaines aussi fondamentaux que la protection des investisseurs (pour laquelle elle est classée 117ème) ou l’exécution des contrats. De même, dans le classement Forbes publié en 2012 “Best Countries for Business” List, la Slovaquie a été particulièrement mal notée dans le domaine de la protection des investisseurs, (99ème sur 100), des charges administratives et de la corruption ».
Par conséquent, il peut apparaître difficile à la Commission européenne d’exiger des États-Unis ou du Canada qu’ils renoncent au RDIE dans le PTCI et l’AECG alors que, dans le même temps, la France et d’autres États-membres ont des TBI protégeant leurs investisseurs contre les défaillances des tribunaux internes en Roumanie, en Slovaquie et en Bulgarie, pour ne citer que ceux-là. Certes, la Commission européenne a entrepris de mettre fin à ces TBI intra-européens, mais c’est un processus qui peut prendre des années tant les réticences de certains États-membres sont grandes, preuve de leur méfiance vis-à-vis de certains pays. En outre, la fin de ces TBI ne règlera en rien les dysfonctionnements des systèmes judiciaires dans un certain nombre de pays de l’Union européenne dont les États-Unis comme le Canada voudront, à juste titre et comme actuellement dans leurs TBI, protéger leurs investisseurs.
Le système judiciaire américain se caractérise par une différence majeure par rapport aux systèmes en vigueur dans l’Union européenne : l’élection d’une partie des juges. En effet, dans 38 des 50 États fédérés, ils ne sont pas nommés mais élus (58). L’élection est largement considérée, aux États-Unis, comme le meilleur moyen d’assurer l’indépendance de la justice, en particulier vis-à-vis du pouvoir exécutif qui, dans la tradition américaine, est perçu comme la véritable menace pour la liberté des citoyens ; c’est également une nécessité dans un pays de Common Law où les juges font, réellement, la loi en l’absence d’intervention du pouvoir législatif. Considérant que les tribunaux et cours des États fédérés jugent quelque 33 millions de contentieux par an, contre 800 000 seulement pour leurs équivalents au niveau fédéral, il est plus probable pour un investisseur étranger de voir son différend réglé par un tribunal d’un État fédéré que par la justice fédérale.
Ces élections prennent des formes variées et ne sont pas toujours ouvertes à plusieurs candidats, notamment celles où les électeurs se prononcent simplement sur le maintien ou non du juge à son poste. Elles peuvent être partisanes ou non, selon que les candidats revendiquent ou non publiquement leur appartenance politique (59). Ces derniers doivent en outre satisfaire certains critères de qualification, tels qu'être praticiens du droit depuis plusieurs années ; la plupart d’entre eux sont effectivement d’anciens avocats. En revanche, l’élection suffit à leur nomination comme juge qui n’exige ni formation ni examen spécifiques.
Si l’élection protège les juges de l’interférence des pouvoirs législatif et exécutif, elle présente toutefois de nombreux inconvénients pour le justiciable, notamment parce que les campagnes électorales, aux États-Unis, exigent des moyens financiers importants, pouvant s’élever à plusieurs millions de dollars ; les candidats sont également obligés d’adopter publiquement des positions susceptibles de plaire aux électeurs comme, naturellement, aux contributeurs.
C’est ainsi que, sous réserve de la dernière décision de la Cour suprême (60), la campagne électorale des juges est largement financée par les avocats et les entreprises, parfois sans limite (61), conduisant à des conflits d’intérêt qui ont pu être considérés comme des dénis de justice. Le cas le plus fameux est celui du producteur de charbon Massey Coal, qui a dépensé 3 millions de dollars pour faire élire un juge à la Cour Suprême de Virginie Occidentale. Or, cette Cour a par la suite cassé un jugement infligeant à cette entreprise une amende de 50 millions de dollars, cassation à laquelle a participé ledit juge qui, malgré l’évidence du conflit d’intérêt, avait refusé de se déporter.
Or, sans aller jusqu’à des exemples aussi extrêmes, il est facile d’imaginer le cas d’une entreprise européenne dont l’investissement, par exemple dans le secteur impliquant des effets sur l’environnement, est contesté par la population ; soumis à une forte pression de celle-ci, l’État fédéré adopte une loi environnementale qui, disproportionnée et injustifiée, équivaut en pratique à une expropriation indirecte et, par conséquent, à une violation du PTCI (dont on suppose qu’il serait invocable). L’investisseur conteste cette loi devant un tribunal local dont le juge, parce qu’il est élu, sera confronté au dilemme suivant : s’il donne raison à l’investisseur étranger contre la loi de l’État, évidemment présentée comme d’intérêt général, il risque de déplaire à la population qui lui reprochera sa décision lors de la prochaine élection, lui faisant perdre son poste et avec lui, ses revenus. Dans ces conditions, rejeter le RDIE en raison d’un risque de partialité des arbitres en faveur des investisseurs et préférer les voir réglés par des juges américains élus et, à ce titre, potentiellement aussi partiaux en faveur de leur État, est pour le moins paradoxal.
Le cas n’est pas le simple fruit de l’imagination et ses conséquences peuvent être aggravées par le fait que les questions de fait peuvent être tranchées, même en matière commerciale, par des jurys populaires. Dans ces conditions, le traitement injuste et inéquitable d’un investisseur étranger peut non seulement être le fait d’une loi ou d’un règlement mais également de la décision judiciaire elle-même. Un tel cas s’est ainsi réellement produit il y a quelques années dont les faits sont les suivants. Ils concernent un litige d’ordre commercial entre le groupe canadien Loewen, deuxième entreprise de soins funéraires d’Amérique du nord, et une entreprise familiale du Mississipi, portant sur la rupture alléguée, par l’entreprise canadienne, d’un contrat d’environ 10 millions de dollars. Ledit litige a été jugé par un tribunal local de cet État dont le jury a accordé au plaignant américain des dommages-intérêts punitifs de 500 millions de dollars. Or, la loi de cet État impose, pour interjeter appel, que l’équivalent de 125 % des dommages-intérêts soient consignés soit, en l’espèce, 625 millions de dollars que le groupe Loewen n’avait pas. Le tribunal, comme la Cour suprême de l’État, ont refusé de réduire ce montant.
Le groupe Loewen a donc saisi un tribunal arbitral, sur le fondement du chapitre 11 de l’ALENA, arguant que la décision du tribunal du Mississipi était constitutive d’un déni de justice enfreignant les dispositions de ce traité et, en particulier, de son article 1105 stipulant que « les parties accordent aux investissements des investisseurs de l’autre partie un traitement conforme au droit international, incluant un traitement juste et équitable ». Dans sa sentence, rendue en 2003, le tribunal a considéré, en se fondant sur les comptes-rendus du procès, que le juge avait failli à garantir à Loewen une procédure équitable « en permettant que le jury soit influencé par des appels récurrents [des avocats de la partie américaine] au favoritisme local contre la partie étrangère ». Par conséquent, « le procès dans son ensemble ainsi que le verdict sont clairement abusifs et déshonorants et ne peuvent pas être considérés comme conformes avec les standards minimaux du droit international et du traitement juste et équitable ». Pour autant, le tribunal a refusé de condamner les États-Unis, rejetant la plainte de l’entreprise Loewen pour des raisons procédurales.
En outre, la procédure judiciaire américaine peut se révéler lourde et complexe pour un investisseur étranger, en particulier en comparaison des règles d’arbitrage bien plus simples et plus souples. Votre rapporteure a par ailleurs eu son attention attirée sur une de ses spécificités, potentiellement problématique pour nos entreprises, de cette procédure : le « discovery ». Considérée comme indispensable à la recherche de preuves, cette procédure, est quasi systématique dans les pays de Common law (62).
La procédure de « discovery » impose aux parties de produire tous les documents en relation avec le litige, qu’ils leur soient favorables ou non. Une partie peut ainsi exiger de l’autre qu’elle produise tous les documents qu’elle estime nécessaire à sa défense ou, au contraire, à son action. Ce sont ainsi des centaines, voire des milliers de mails, contrats et documents en tout genre qui sont transmis à l’adversaire.
Cette procédure s’oppose ainsi directement à la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents ou renseignements d’ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, « qui interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuve en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ».
Néanmoins, la Cour suprême, dans une décision de principe impliquant l’entreprise française Aérospatiale, a jugé que cette « loi de blocage » « ne privait pas une juridiction américaine du pouvoir d’ordonner à une partie soumise à sa juridiction de produire des preuves, même si cette production pouvait constituer une violation de la loi de blocage » (63). Les entreprises françaises se trouvent ainsi prises, en quelque sorte, entre le marteau et l’enclume : elles risquent des sanctions pénales en France si elles communiquent à la partie américaine (et/ou au juge) les renseignements requis dans le cadre d’une procédure de « discovery », et des sanctions aux États-Unis si elles s’y refusent ; celles-ci peuvent être très lourdes puisqu’à la décision défavorable du tribunal peuvent s’ajouter des amendes et, surtout, l’interdiction de toute activité sur le territoire américain.
Dans ces conditions, le RDIE apparaît plus protecteur des entreprises européennes que la procédure américaine. En effet, ainsi qu’il a été dit, les règles de l’arbitrage international sont souples et les traités peuvent compléter, sur ce point comme sur les autres, les règlements d’arbitrage (64). En outre, à supposer que le tribunal arbitral exige la divulgation de documents confidentiels menaçant les intérêts de l’investisseur, voire ceux de son État, les conséquences seraient plus limitées que les voir remises à un tribunal américain. En effet, ce sont des tribunaux arbitraux indépendants qui prendraient connaissance de ces documents et non un tribunal de l’État américain.
Enfin, si l’un des inconvénients majeurs du RDIE est son coût et, dans une moindre mesure, sa durée, il n’est absolument pas certain que le recours aux juridictions américaines allège le premier et réduise la seconde. En effet, s’agissant d’une procédure accusatoire comme celle en vigueur aux États-Unis, les avocats jouent un rôle essentiel et ils ne coûtent pas moins cher que les conseils spécialisés en arbitrage d’investissement. Surtout, contrairement à une sentence arbitrale, la décision d’un tribunal américain peut faire l’objet de multiples appels, non seulement au sein des États fédérés mais également au niveau fédéral et ce, jusqu’à la Cour suprême. Il ne fait guère de doute qu’en cas de différend avec un investisseur étranger avec de forts enjeux politiques et/ou économiques, l’État fédéré concerné ou l’État fédéral ne renoncerait pas avant que cette dernière ne se soit prononcée. C’est donc une erreur de croire qu’un recours aux tribunaux internes serait, de ce seul fait, plus accessible aux PME que le RDIE. Ce serait peut-être le cas en France pour les PME américaines, notamment du fait de la procédure inquisitoire en vigueur dans notre pays, de frais d’avocat moindre et de l’absence de « discovery », mais l’inverse ne le serait pas.
Votre rapporteure a parfaitement conscience que ces caractéristiques de la justice américaine ne sont pas nouvelles et qu’elles n’ont pas empêché le développement des investissements européens outre-Atlantique. Toutefois, ce fait n’infirme en rien les avantages du RDIE par rapport au recours aux juridictions américaines ; il n’est en outre pas interdit de penser que des entreprises européennes ont pu, dans le passé, renoncer à poursuivre un État fédéré ou même l’État fédéral considérant leurs faibles chances de l’emporter, le coût et la durée prévisible de la procédure ou encore le risque de devoir divulguer des informations hautement confidentielles.
Si le PTCI focalise l’attention politique et médiatique, il ne faut pas oublier que l’Union européenne négocie actuellement des accords de libre-échange, incluant l’investissement, avec de très nombreux pays. Les négociations sont achevées avec le Vietnam et en voie de l’être avec le Japon. Des négociations ont également été ouvertes notamment avec la Birmanie et la Chine centrées, s’agissant de cette dernière, sur la seule protection des investissements.
En effet, les partenaires économiques de l’Union européenne ne disposent pas forcément d’une justice indépendante et efficace. Dès lors, les négociations en cours du PTCI prennent une importance particulière et ne peuvent être conduites sans avoir à l’esprit celles à venir. Si les Américains et les Européens s’accordent pour intégrer un RDIE dans le PTCI, il pourrait devenir le standard du RDIE au niveau international.
C’est un fait qu’il faut souligner : la bataille des normes est aujourd’hui mondiale. Ces normes ne s’appliquent pas seulement en matière sanitaire ou environnementale mais également dans le domaine de la gouvernance au sens large. Non seulement les normes ainsi définies s’imposeront dans les futurs accords, tant des États-Unis que de l’Union européenne, mais si un jour est créé un organe multilatéral de règlement des différends entre État et investisseur, elles ont une forte chance de constituer le modèle de cet organe. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la proposition de la Commission européenne, rendue publique le 16 septembre dernier, de créer dans le cadre du PTCI un Investment Court System (ICS).
Cet enjeu n’est pas nouveau et, dès 1998, dans le débat de l’AMI, il a été mis en avant par Mme Catherine Lalumière dans son rapport. Celle-ci, tout en contribuant à faire rejeter l’AMI par le gouvernement français, relevait que « dans le désordre actuel de la mondialisation, il y a un intérêt de tous les pays à l’établissement de règles stables et équitables. Un accord peut offrir l’occasion de franchir une étape dans la voie d’une meilleure régulation de l’économie mondiale en stabilisant les régimes d’investissements et en réalisant des progrès sur les normes sociales et environnementales ».
Enfin, la signature d’un PTCI incluant un RDIE amélioré présenterait un intérêt pour les 9 États-membres ayant actuellement un TBI avec les États-Unis. En effet, lesdits TBI reposent sur un modèle ancien d’une qualité très inférieure au standard actuel des traités d’investissement signés par l’Union européenne (par exemple l’AECG). Pour ces pays, le PTCI se substituant aux TBI actuels avec les États-Unis ne peut que leur être favorable. A l’inverse, ne pas le signer les laisserait à la merci de clauses imprécises et d’un RDIE dépassé bien que fréquemment mis en œuvre. Le même raisonnement s’applique aux pays qui ont signé un TBI avec le Canada en cas de ratification de l’AECG. En d’autres termes, ce sont les pays les plus exposés au risque du RDIE qui profiteraient le plus de l’amélioration promise du mécanisme par ces traités.
Bien que créé dans le cadre de traités bilatéraux avec des pays en voie de développement, le RDIE peut présenter des avantages par rapport aux juridictions internes y compris dans les TBI signés entre des pays développés. Toutefois, encore faut-il que lesdits avantages ne soient pas remis en cause par les risques qu’un tel mécanisme ferait courir aux États et, en particulier, à leur droit à réguler. Sans revenir sur les développements de la première partie du présent rapport, votre rapporteure souhaite attirer l’attention sur le fait que le RDIE est également risqué pour les investisseurs eux-mêmes (1) et que les États disposent des moyens de se protéger contre ses dérives (2).
C’est un fait que le débat actuel sur le RDIE met l’accent sur le risque qu’il constitue pour le droit à réguler des États. Cependant, il est également vrai qu’il ne constitue qu’un ultime recours pour les investisseurs compte tenu des inconvénients qu’ils présentent pour eux.
Dans leur critique du RDIE, en particulier dans la perspective du PTCI, ses opposants agitent la menace d’une multiplication des différends avec les investisseurs, laquelle ferait peser un risque considérable sur le droit à réguler des États. Toutefois, cette menace doit être appréciée à sa juste mesure.
En effet, toutes les entreprises auditionnées par votre rapporteure ont indiqué que la mise en œuvre du RDIE était pour elles l’ultime recours. Très souvent, les entreprises sollicitent leur État pour chercher à régler sur le plan diplomatique le différend alors même qu’une telle étape n’est pas prévue par le traité (65). En effet, l’arbitrage est une procédure coûteuse, longue, imprévisible et dont l’issue ne peut être, dans le meilleur des cas, qu’une compensation financière et, encore, à supposer que l’État exécute la sentence. Par ailleurs, l’éclatement de la jurisprudence arbitrale rend les sentences relativement imprévisibles et leur exécution, malgré les conventions de Washington et de New York, n’est pas forcément facile. C’est pourquoi, au RDIE, les entreprises préfèrent de loin un règlement à l’amiable moins coûteux, plus rapide et, surtout, de nature à leur permettre de préserver de bonnes relations avec l’État concerné. En effet, les investisseurs ont souvent plusieurs investissements dans le pays ou des perspectives de développement. Dans ces conditions, le RDIE n’est qu’un pis-aller de nature à nuire, au-delà du différend avec l’État, à leur situation globale dans le pays, aujourd’hui et pour le futur.
b. La qualité de la justice française limite les risques, pour notre pays, d’être poursuivi dans le cadre d’un RDIE
Ces mêmes inconvénients expliquent que, dans le cadre du PTCI et de l’AECG et malgré la présence d’un RDIE, les investisseurs pourraient préférer recourir aux juridictions internes, du moins dans certains des États-membres. Ce sera probablement le cas en France, pour des raisons tenant aux garanties d’ores et déjà reconnues aux investisseurs dans notre droit.
En effet, le droit français garantit les droits des investisseurs, en particulier dans le cadre contractuel. Votre rapporteur rappelle que, lorsque le gouvernement a fait le choix d’abandonner l’écotaxe, il a accepté d’indemniser la société Ecomouv’ à hauteur de 840 millions d’euros et ce, sans même qu’elle ait eu besoin de saisir la juridiction administrative. La jurisprudence du Conseil d’État, établit depuis plus de 150 ans que l’État a toujours le droit de résilier unilatéralement un contrat administratif, même dans le silence du contrat, pour des raisons d’intérêt général, à condition toutefois que le préjudice du co-contractant soit intégralement compensé (66).
De plus, cette protection vaut aussi dans le cadre extracontractuel, lorsque le préjudice résulte d’une mesure de portée générale comme une loi ou une règlementation. C’est ainsi que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et à la croissance verte comporte plusieurs dispositions qui, ensemble, visent à réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité, parmi lesquelles un plafond de capacité totale de production fixé à 63,2 gigawatts (GW), valeur qui représente la capacité actuelle totale du parc nucléaire français en service. Ce plafond ne tient, en revanche, pas compte de l’autorisation de construire l’EPR de Flamanville, installation nucléaire de base autorisée par le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007. Par conséquent, une fois que ce dernier sera en service, la puissance de production d’électricité d’origine nucléaire d’EDF s’élèvera à 64,85 GW de sorte que, pour se conformer aux dispositions de la loi précitée, EDF aura le choix entre renoncer à la mise en service de l’EPR ou mettre un terme au fonctionnement d’un nombre suffisant de réacteurs actuellement exploités pour respecter ce plafond de 63,2 GW.
Dans sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que cette loi porte atteinte non pas aux autorisations légalement détenues par EDF – qui, en l’état actuel de leur exploitation, ne conduisent pas l’entreprise à dépasser le plafond de 63,2 GW – mais aux effets qui pouvaient légitimement être attendus de ces autorisations, à savoir la possibilité d’exploiter les réacteurs autorisés pour un total de puissance, après mise en route de l’EPR, de 64,85 GW. Si le Conseil a considéré que cette atteinte était justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants, cette loi « ne fait pas obstacle à ce que les titulaires d’autorisations de création d’installations nucléaires de base déjà délivrées au jour de l’entrée en vigueur de la loi déférée, privés de la possibilité de demander une autorisation d’exploiter une installation pour laquelle ils disposent d’une telle autorisation de création ou contraints de demander l’abrogation d’une autorisation d’exploiter afin de respecter le plafonnement [de 63,2 GW], puissent prétendre à une indemnisation du préjudice subi ».
Par conséquent, si Ecomouv’ avait été une société américaine, elle n’aurait pas eu besoin du PTCI ni du RDIE pour obtenir la compensation intégrale du préjudice résultant, pour elle, du choix de politique publique fait par le gouvernement français d’abandonner l’écotaxe. De même, si Vattenfall avait disposé de centrales nucléaires en France, la décision de les fermer ouvrirait le droit, pour cette entreprise, à demander une indemnisation de son préjudice. Il est tout à fait possible qu’EDF – entreprise cotée en bourse – fasse une telle demande en cas de fermeture imposée de la centrale de Fessenheim. Le droit à réguler de l’État français ne serait dès lors pas plus contraint par le PTCI qu’il ne l’est aujourd’hui par la jurisprudence administrative et constitutionnelle. C’est l’État de droit lui-même – dont font partie et le droit international et le droit interne – qui limite les choix de politique publique possibles de notre pays au nom de valeurs supérieures comme, par exemple, le droit de propriété, droit de l’homme reconnu comme tel depuis 1789.
Dans ces conditions, considérant la protection dont l’investisseur étranger dispose dans le droit français comme de l’indépendance et l’efficacité reconnue de longue date de ses juridictions, on peut raisonnablement se demander si ledit investisseur ne préfèrerait pas une procédure sûre, rapide et peu coûteuse devant le juge national à la mise en œuvre d’un RDIE long, onéreuse et imprévisible.
Les risques du RDIE sont bien réels et votre rapporteure les a longuement présentés. Sans revenir sur ces développements, elle tient à rappeler trois faits pertinents pour l’évaluation des risques que peut présenter le RDIE, étant entendu que les expériences passées ne présument pas de l’avenir :
– les sentences CIRDI sont favorables aux États européens dans 69 % des cas, étant précisé que ces différends impliquent, pour 83 % d’entre eux, un pays d’Europe centrale et orientale ;
– dans le cas des différends impliquant l’un des quinze « anciens » membre de l’Union européenne, seule l’Espagne a été condamnée par un tribunal arbitral, en 1997, pour un montant de 180 000 € ;
– depuis vingt ans qu’ils sont exposés, dans le cadre de l’ALENA, au risque du RDIE, les États-Unis n’ont jamais été condamnés par un tribunal arbitral ; quant au Canada, poursuivi à 35 reprises, il ne l’a été que trois fois (auxquels s’ajoutent trois règlements à l’amiable) pour un montant de 156,1 millions de dollars.
Les États, auteurs et maîtres des traités, disposent de tous les moyens pour conjurer ces risques. Ils ne se sont pas privés de les utiliser dans les TBI les plus récents, à commencer par l’AECG, ou à les évoquer dans le débat actuel du PTCI. Ces dispositions prévues par l’AECG seront, comme celles du PTCI, analysées infra dans les développements consacrés à ces traités dans la troisième partie. Toutefois, il n’est pas inutile, dès à présent, de présenter lesdits moyens à disposition des États.
a. Le RDIE n’est qu’un mécanisme de règlement des différends auquel les États donnent la forme qu’ils veulent
Un point a frappé votre rapporteure tout au long de son travail sur le RDIE : c’est l’amalgame quasi-systématique entre celui-ci et les tribunaux d’arbitrage privé. En effet, le RDIE est un mécanisme juridique, prévu par un traité bilatéral ou plurilatéral, permettant à un investisseur étranger et à lui seul, en cas de différend sur le respect, par un État partie, d’une clause dudit traité, de voir celui-ci réglé par une instance internationale de préférence aux tribunaux de l’État partie concerné. Le RDIE n’est donc qu’un mécanisme et les tribunaux d’arbitrage privés ne sont qu’une des formes que celui-ci peut prendre. Or, s’il a pris la forme des tribunaux d’arbitrage privé, c’est en raison d’une évolution historique (retracée dans la première partie du présent rapport) validée et reprise par les États dans leurs premiers TBI, ceux-ci ayant jugé, dans le contexte de cette époque et jusqu’à une période récente, que cette forme était indiscutablement la meilleure.
Ce n’est donc pas tant le RDIE qui est objet du débat actuel mais la forme qu’il a prise. L’amalgame avec les tribunaux arbitraux est donc un facteur de confusion car il est possible d’être favorable au RDIE et à sa présence dans les TBI tout en dénonçant les tribunaux arbitraux tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui. Or, le fait aujourd’hui de se déclarer favorable au RDIE suscite immédiatement des critiques qui, en réalité, visent les tribunaux d’arbitrage.
Sur ce point, il est d’ailleurs frappant que, dans sa résolution du 8 juillet 2015 relative aux recommandations sur les négociations du PTCI, le Parlement européen propose de « remplacer le système RDIE par un nouveau système de règlement des différends entre investisseurs et États conforme aux principes démocratiques, dans lequel les différends seraient réglés de manière transparente par des juges professionnels indépendants, au cours d’audiences publiques, qui inclura un mécanisme d’appel, où la cohérence des décisions serait assurée, la compétence des juridictions européennes et nationales préservées, et où les intérêts privés ne pourraient pas prévaloir sur les choix de politique publique ». Le nouveau système de règlement des différends » qu’appelle de ses vœux le Parlement européen sera toujours un RDIE, mais prenant une forme différente de celle actuellement en vigueur dans les TBI.
Parce que les arbitres sont également, pour nombre d’entre eux, des avocats et qu’ils peuvent intervenir simultanément, comme arbitre ou avocat, dans plusieurs différends, le risque de conflit d’intérêts est majeur. Ce risque, encore aggravé par le fait que les arbitres sont choisis et payés par les parties, est l’une des principales critiques portées – non sans raison – au RDIE sous sa forme actuelle de tribunaux d’arbitrage privés. Il a fortement contribué aux doutes de l’opinion publique quant à sa légitimité, en particulier en France. Non seulement le fait que des justiciables puissent choisir et rémunérer leur juge est à l’opposé de notre conception de la justice, mais il fait peser un soupçon de partialité aggravé dans notre pays par le précédent de « l’affaire Tapie », bien que cette dernière n’ait rien à voir avec le RDIE (67).
Pourtant, plusieurs moyens s’offrent aux États pour renforcer l’éthique des arbitres, prévenir les conflits d’intérêts et, au final, rendre plus légitime le RDIE et ce, quelle que soit la forme de celui-ci :
– imposer aux arbitres le respect d’un code de conduite existant (comme celui de l’American Bar Association) ou spécialement élaboré par les États leur interdisant, par exemple, d’être à la fois arbitre et conseil ;
– imposer aux parties, à commencer par les investisseurs, de choisir leurs arbitres au sein d’une liste préétablie, composée de personnalités dont la compétence juridique et l’indépendance sont incontestables.
La Commission européenne remarque à juste titre que « les décisions prises par les arbitres ne peuvent pas être meilleures que les règles qu’on leur demande d’appliquer. Par définition, des règles vagues sont sujettes à interprétation » (68). Votre rapporteure estime donc la critique des sentences arbitrales parfois facile, en particulier lorsque sont en cause les définitions imprécises des droits des investisseurs. Les TBI signés par la France, aussi courts que vagues, apparaissent ainsi particulièrement risqués et il est heureux qu’aucun tribunal arbitral n’ait eu, jusqu’à présent, à les appliquer à notre détriment. Par conséquent, les États devraient accorder une attention particulière à la substance des traités qui, s’agissant de la protection de leur droit à réguler, est aussi importante voire plus que la forme prise par ledit mécanisme de règlement des différends.
Plusieurs moyens sont à leur disposition. Les États peuvent ainsi, dès le préambule d’un traité d’investissement mais plus certainement dans un article dédié, affirmer leur droit à réguler de manière à contraindre l’interprétation des arbitres. En effet, l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités exige que ceux-ci soient interprétés conformément à l’intention des parties. Il est donc dans l’intérêt de celles-ci que leur traité, comme le modèle de TBI des États-Unis (2012), protège les investisseurs « d’une manière compatible avec la santé, la sécurité et l’environnement, ainsi qu’avec la promotion des droits sociaux internationalement reconnus ». Les États-Unis, avec le Canada, ont été précurseurs dans ce domaine avec l’ALENA. Même si l’affirmation du droit à réguler est succincte dans le préambule de ce dernier (69), elle a suffi à convaincre les arbitres, dans l’affaire S.D Meyers, à interpréter les dispositions du traité à la lumière « du droit d’établir un haut niveau de règlementation environnementale ».
Une fois ce droit affirmé et guidant l’interprétation du traité, encore faut-il que ses dispositions soient clairement écrites afin d’éviter qu’elles puissent être utilisées de manière imprévisible par les investisseurs et dommageables pour les États. Les États doivent donc mettre un soin particulier dans la définition de l’investissement et de l’investisseur, afin notamment d’empêcher des détournements comme celui mis en œuvre par Philip Morris en réservant le bénéfice de la protection à des investisseurs et des investissements réels. De même la nécessaire protection des « attentes légitimes » des investisseurs doit-elle être limitée au cas où ces derniers bénéficient d’engagements spécifiques de l’État. Enfin, toujours à titre d’exemple, il doit être clair que la protection contre l’expropriation indirecte ne saurait empêcher les États d’adopter des mesures à finalité environnementale ou sociale, quand bien même celles-ci se traduiraient par une perte financière pour les investisseurs.
Enfin, les États ont le moyen de contraindre plus directement encore l’application des traités d’investissement par les tribunaux arbitraux en adoptant eux-mêmes ce qu’ils estiment être la bonne interprétation d’une disposition. Ainsi, l’article 2001 de l’ALENA a-t-il institué une Free Trade Commission, composé de représentants des trois États parties, qui a notamment pour mission de « régler les différends qui pourraient survenir concernant l’interprétation et l’application du traité ». Les décisions de la FTC « lient » les tribunaux arbitraux chargés de régler les différends entre États et investisseurs en application du chapitre 11 du même traité. En d’autres termes, l’ALENA ainsi que, d’une manière générale, l’ensemble des TBI signés par le Canada et les États-Unis, prévoit un mécanisme spécifique d’interprétation en dehors des tribunaux arbitraux qui a d’ailleurs été mis en œuvre afin de contrecarrer une interprétation potentiellement dangereuse du traitement juste et équitable. L’OMC prévoit également un tel dispositif (70).
En effet, dans plusieurs sentences rendues au début des années 2000, (Metelclad c/ Mexique, S.D Myers c/ Canada et Pope & Talbot c/ Canada) les tribunaux arbitraux ont retenu une interprétation extensive du traitement juste et équitable, considérant que ce dernier constituait un droit autonome s’ajoutant au standard minimal de traitement. La décision de la FTC a infirmé cette interprétation et imposé la sienne aux tribunaux arbitraux. C’est ainsi que dans l’affaire ADF c/ États-Unis (2003), le tribunal s’est incliné, considérant que cette interprétation était à la fois « la plus authentique et la plus autorisée de l’intention des parties » dans l’ALENA.
Par conséquent, les États ont tout à fait la possibilité de contredire, pour l’avenir, une interprétation des tribunaux arbitraux qui ne leur conviendrait pas, en adoptant une position commune sur la disposition concernée, plus ou moins assimilable à un amendement du traité (71).
Un autre moyen à la disposition des États pour prévenir les risques du RDIE est tout simplement d’exclure du champ du traité certaines mesures adoptées pour des raisons d’intérêt général. C’est ainsi que de nombreux TBI, notamment ceux signés par l’Australie, le Canada ou la Corée du sud, contiennent une clause d’exemption générale reprenant les dispositions des articles XX du GATT et XIV du GATS. Ces deux articles visent les mesures destinées à « protéger l’ordre public » ou à « protéger l’homme, l’animal, les végétaux et la santé ». De telles mesures ne pourront être contestées par les investisseurs pour autant qu’elles soient nécessaires et proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
Outre cette clause d’exemption générale, de nombreux TBI, à commencer par ceux signés par les États-Unis, excluent du champ de la protection des investisseurs les services financiers, laissant ainsi la possibilité aux États d’assurer la stabilité de leur système financier et la protection des déposants par les moyens qu’ils jugent les plus appropriés, sans que ces moyens puissent être contestés sur le fondement desdits traités. À cette exception s’ajoute généralement l’exception fiscale.
Enfin, le dernier moyen à la disposition des États est d’exclure les investissements étrangers dans certains secteurs sensibles, tels que la Défense. De manière moins radicale, l’investissement peut être autorisé mais l’investisseur ne peut, alors, se prévaloir de la protection du traité ni recourir au RDIE. Ils bénéficient de la même protection que les investisseurs nationaux et peuvent, comme eux, accéder aux tribunaux internes. Par conséquent, un État qui voudrait prévenir les différends internationaux dans des secteurs comme les mines ou la recherche d’hydrocarbures pourraient les exclure du champ du RDIE. Votre rapporteure souligne ainsi que dans le cadre du TPP, l’Australie a obtenu l’exclusion des investissements dans l’industrie du tabac du champ du RDIE.
De nombreuses critiques ont été adressées à la procédure arbitrale actuelle, à commencer par le fait que, largement secrète, elle manquerait de la transparence nécessaire lorsque sont en jeu des intérêts publics. Si cette critique était parfaitement fondée il y a quelques années, c’est moins le cas aujourd’hui puisque le règlement d’arbitrage du CIRDI et, surtout, celui de la CNUDCI ont considérablement amélioré la transparence de la procédure d’arbitrage. Toutefois, il est loisible aux États d’aller plus loin et de fixer eux-mêmes, dans leurs TBI, les règles applicables en matière de transparence. C’est ainsi que, sans attendre la réforme des deux règlements d’arbitrage précité, les trois parties à l’ALENA ont convenu que toutes les plaintes seraient publiquement enregistrées et les sentences publiées. En outre, dans la décision interprétative du 31 juillet 2001 précitée, la FTC a affirmé qu’il n’y avait pas de principe général de confidentialité dans le chapitre 11 du traité. Par conséquent, toute demande de confidentialité doit reposer sur une décision procédurale spécifique. De même, dans une autre décision, les trois parties ont imposé aux tribunaux arbitraux d’accepter les demandes d’amicus curiae et défini une procédure à cette fin.
De plus, le fait que le RDIE prenne la forme de tribunaux arbitraux ad hoc expose les États – comme les investisseurs d’ailleurs – à des risques de sentences contradictoires dans une même affaire. Votre rapporteure a cité plusieurs exemples en deuxième partie du rapport. Toutefois, il est possible, par exemple dans le cadre de l’ALENA, qu’un tribunal arbitral ordonne, après audition des parties contestantes, la jonction de toutes les plaintes « portant sur un même point de droit ou de fait » et ce, « dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes » (article 1126). Dès lors, le risque de sentences contradictoires sur un même point de droit ou de fait est supprimé.
Enfin, toujours pour améliorer les aspects procéduraux du RDIE, il est dans le pouvoir des États – sinon dans leur intérêt – d’adopter les mesures suivantes dans leurs TBI :
– imposer aux investisseurs, avant toute saisine d’un tribunal arbitral, l’épuisement des recours internes. Dans ces conditions, ce dernier fonctionnerait comme une instance d’appel des tribunaux nationaux, avec le risque toutefois d’un allongement considérable des délais, sans parler des coûts supplémentaires pour l’investisseur ;
– introduire dans le traité une clause imposant à l’investisseur un choix irréversible entre le recours aux tribunaux internes et le RDIE. Contrairement à la mesure précédente, il n’en résulte pas de coût supplémentaire pour l’investisseur ;
– créer un mécanisme de filtre permettant aux tribunaux arbitraux de rejeter les saisines abusives ; les TBI signés par les États-Unis incluent systématiquement un tel filtre. Il est également présent dans le règlement d’arbitrage du CIRDI (article 41).
Par cette présentation non exhaustive, votre rapporteure souhaitait démontrer que les risques du RDIE, bien que réels, ne sont pas inévitables et que les États peuvent, s’ils le veulent, les prévenir par un ensemble de moyens à leur disposition. Il n’en reste pas moins que le meilleur moyen de les conjurer est d’améliorer le fonctionnement de leur justice, afin que les investisseurs délaissent d’eux-mêmes ce mécanisme.
III. SI L’AECG DANS SA VERSION INITIALE ET LE PTCI PRESENTENT DEUX VOIES POSSIBLES D’AMELIORATION DU MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, SEULE UNE JURIDICTION INTERNATIONALE EST SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE UN RÈGLEMENT EFFICACE ET LEGITIME DES DIFFÉRENDS ENTRE LES INVESTISSEURS ET LES ÉTATS
Tous les éléments rappelés dans les deux premières parties du présent rapport visent à éclairer le débat actuel sur le RDIE. Cet objectif pédagogique du rapport n’est toutefois pas le seul. Votre rapporteure estime en effet nécessaire que l’Assemblée nationale porte une analyse des propositions présentées par le gouvernement le 27 mai dernier et de celles de la Commission européenne, publiées le 16 septembre. Par conséquent, cette troisième partie examine les deux voies d’évolution possible du RDIE actuellement en discussion :
– l’amélioration du système arbitral, tel qu’il a été mis en œuvre dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG) dans sa version du 26 septembre 2014 ;
– la substitution, à ce système arbitral, d’un système de cour permanente d’investissement, tel que le propose la Commission européenne dans le cadre des négociations du PTCI et tel qu’il a été intégré dans la version finale de l’AECG.
Le constat est partagé par tous, y compris par votre rapporteure, que le RDIE actuel, prenant la forme de tribunaux d’arbitraux, souffre de nombreux dysfonctionnements qui le rendent critiquable. La Commission européenne elle-même en a conscience. Le 16 septembre 2015, elle a ainsi proposé de substituer aux tribunaux d’arbitrage ad hoc une cour permanente pour régler les différends entre les États et les investisseurs (Investment Court System ci-après : « ICS »). Toutefois, cette proposition ne valait que pour les accords à venir, incluant le PCTI dont les négociations sont en cours. S’agissant de l’AECG, la Commission, pas plus que le Canada, ne souhaitait rouvrir les négociations, insistant sur les améliorations apportées au RDIE dans cet accord qui en faisaient le mécanisme le plus protecteur du droit à réguler des États jamais conçu dans un accord de libre-échange négocié par l’Union Européenne. Cependant, le 29 février 2016, le gouvernement canadien et la Commission européenne ont finalement annoncé l’intégration des « principaux éléments » de l’ICS dans la version définitive de l’AECG. Votre rapporteure présentera successivement les deux voies de réforme que sont : le RDIE dans la version initiale de l’AECG, d’une part, et l’ICS adoptée dans la version définitive de l’AECG et en négociation dans le cadre du PTCI, d’autre part.
Ainsi qu’il a été dit supra, les TBI ont une longue histoire. Sous l’impulsion notamment des États-Unis et du Canada, ils ont considérablement évolué. En effet, ces pays liés par l’ALENA ont, les premiers parmi les pays développés, expérimenté les dangers que le RDIE pouvait comporter pour le droit à réguler des États et mesurer les risques d’une définition imprécise des droits des investisseurs.
C’est pourquoi, après les premières plaintes d’investisseurs et les premières sentences arbitrales, ils ont modernisé leur modèle de TBI au début des années 2000. Ceux-ci contiennent désormais des dispositions relatives à l’environnement, à la santé et au développement durable, garantissant le droit à réguler des États dans ces domaines, tout en définissant les droits des investisseurs, qu’il s’agisse des quatre protections précitées ou de la procédure arbitrale, désormais plus transparente et encadrée. Les États-Unis et le Canada ont ainsi totalement repensé leur pratique et éliminé de leur nouveau modèle les éléments les plus risqués qui figuraient traditionnellement dans leurs TBI.
En revanche, n’ayant été que très exceptionnellement, jusqu’à une période récente, défendeurs dans une procédure d’arbitrage liée à un investissement étranger et quasiment jamais condamnés sur le fondement d’un TBI, les pays d’Europe de l’ouest ont continué à signer des TBI, inspirés d’un modèle de l’OCDE remontant à 1952. Ils n’avaient pas la même conscience que les États-Unis et le Canada des risques que les clauses sommaires et vagues de leurs traités pouvaient leur faire encourir. Les 96 TBI signés par la France et actuellement en vigueur, que votre rapporteure a consultés, se caractérisent ainsi par leur brièveté et l’imprécision de leurs termes, notamment s’agissant de l’investisseur et de l’investissement, sans parler de l’absence totale de disposition relative à l’éthique des arbitres.
Votre rapporteure s’étonne que notre pays continue de ratifier ce type de traité sans prendre en compte les enseignements des expériences américaines et canadiennes, pas plus que des débats en cours sur le RDIE. En effet, l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé en 2010 avec l’Irak, même s’il comporte des améliorations par rapport au 96 TBI précités, n’en conserve pas moins quelques dispositions problématiques, comme une définition imprécise du traitement juste et équitable dont on a vu, avec l’exemple de l’ALENA, qu’elle a pu justifier des interprétations larges et contestables de la part des tribunaux arbitraux au tournant des années 2000. De même, ce traité ne comporte pas de disposition particulière s’agissant de la transparence ou de l’éthique des arbitres, renvoyant simplement aux règles d’arbitrage existantes et aux dispositions de celles-ci.
Quels que soit les avantages que l’Union européenne retirerait de l’AECG, le fait que sa version initiale contenait un RDIE sous forme arbitrale a suscité l’inquiétude en Europe en raison du risque qu’il ferait peser sur le droit à réguler des États. Les craintes étaient telles, relayées jusqu’au Parlement européen, qu’elles étaient susceptibles de rendre la ratification de ce traité incertaine. Pourtant, par l’attention portée à la substance du traité (a) et les garanties procédurales qu’il contient (b), l’AECG était, dans cette version qui sera la seule analysée infra, le traité le plus protecteur du droit à réguler des États jamais signé par l’Union européenne et les États-membres (y compris la France).
a. La substance du traité protège le droit à réguler des États en contraignant fortement le pouvoir d’interprétation des arbitres
Conscients qu’une rédaction imprécise des droits des investisseurs n’est pas favorable aux États, le Canada et l’Union européenne ont mis en œuvre trois moyens différents afin de contraindre le pouvoir d’interprétation des tribunaux arbitraux et de préserver autant que possible leur droit à réguler :
– l’affirmation du droit à réguler des États ;
– la précision dans la rédaction des droits des investisseurs ;
– la présence d’exceptions.
En préalable, il convient de signaler que le droit international de l’investissement, via les sentences arbitrales, reconnaît d’ores et déjà le droit à réguler des États. Le tribunal arbitral a ainsi considéré, dans le cas Saluka Investments BV c/ République Tchèque (2006), qu’ « il est désormais établi en droit international que les États ne sont pas tenus d’indemniser un investisseur étranger lorsque, dans l’exercice normal de leurs pouvoirs règlementaires, ils adoptent des règlementations de bonne foi et de manière non-discriminatoire pour le bien-être général ». De même, dans l’affaire Meltanex c/ États-Unis (2005), il estime qu’ « en matière de droit international général, une règlementation non-discriminatoire à des fins d’intérêt public, qui est adoptée dans le respect de la légalité et qui affecte notamment un investisseur étranger, ne peut pas être considérée comme donnant lieu à une expropriation et à des mesures de compensation, sauf si des engagements spécifiques avaient été pris par le gouvernement en question à l’égard de l’investisseur, précisant qu’il n’aurait pas recours à une telle règlementation ». Enfin, dans l’affaire Chemtura c/ Canada (2010), le tribunal arbitral a expressément reconnu le droit de l’État canadien à réguler l’usage des pesticides et, le cas échéant, à les interdire en cas de menace avérée pour la santé publique.
Pour autant, il est préférable d’inscrire ce droit à réguler dans le traité lui-même que de s’en remettre, pour son application, à des tribunaux arbitraux ad hoc qui, comme on sait, ne sont pas tenus par les précédents. C’est ainsi que dans le préambule de l’AECG, le Canada et l’Union européenne « reconnaissent que les dispositions de l’accord préservent leur droit à réguler sur leur territoire et préservent leur marge de manœuvre pour atteindre des objectifs légitimes de politique publique tels que la santé publique, la sécurité, l’environnement, la moralité publique et la promotion et la protection de la diversité culturelle ».
Inscrit dès le préambule, ce droit à réguler des États se retrouve dans
deux autres chapitres importants de l’AECG, l’un relatif au droit du travail
et l’autre à l’environnement. C’est ainsi que le Canada et l’Union européenne reconnaissent :
– aux termes de l’article 2 du chapitre 24, « le droit de chaque partie de définir ses priorités en matière de travail, d’établir ses niveaux de protection des travailleurs et d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques, conformément à ses engagements internationaux en matière de travail, y compris ceux pris dans le présent chapitre, chaque Partie [s’efforçant] d’améliorer continuellement cette législation et ces politiques de manière à assurer un niveau élevé de protection des travailleurs » ;
– aux termes de l’article X.4 du chapitre 25, « le droit de chaque partie d’établir ses propres priorités environnementales et niveaux de protection de l’environnement sur son territoire ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques en matière d’environnement, conformément au présent accord et aux accords multilatéraux sur l’environnement dont elle est signataire, les parties [veillant] à ce que leurs lois et politiques assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et s’efforcent de continuer à améliorer ces lois et politiques de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent ».
Par conséquent, les dispositions précitées sont toutes de nature à contraindre fortement toute velléité des tribunaux arbitraux de remettre en cause le droit à réguler du Canada et de l’Union européenne, d’une manière générale et, plus précisément, dans les domaines de l’environnement et des droits sociaux.
En outre, votre rapporteure rappelle que, même si une violation des dispositions de l’AECG devait être reconnue, le tribunal arbitral ne pourrait pas ordonner le retrait de la mesure concernée mais seulement une compensation qui, aux termes de l’article X.36 du chapitre 10, ne pourra être supérieure à la perte subie par l’investisseur.
L’AECG comporte, à l’instar de tous les TBI, les garanties classiquement offertes aux investisseurs que sont la protection contre la discrimination, la protection contre l’expropriation sans une juste compensation, que celle-ci soit directe ou indirecte et la protection contre un traitement injuste et inéquitable. Toutefois, contrairement aux TBI d’ancienne génération, l’AECG définit de manière précise l’ensemble des concepts que recouvrent ces protections de manière à limiter autant que possible le pouvoir d’interprétation des arbitres et, par conséquent, de mieux protéger le droit à réguler des États.
• La définition de l’investissement et de l’investisseur
Il n’existe pas, aujourd’hui, de définition internationale de l’investissement ou de l’investisseur même s’il est possible d’observer des points de convergence.
Or, ces deux définitions ont une importance considérable en cas de différend car elles délimitent le champ d’application matérielle du traité, c’est-à-dire le champ de la protection qu’il offre aux investisseurs. Pourtant, certains TBI ont pu, dans le passé, ne pas contenir de définition de l’investissement (72). Or, en l’absence d’une telle définition, ce sont les tribunaux arbitraux eux-mêmes qui délimitent ledit champ et, notamment, leur propre compétence.
Pour prévenir ce risque, l’article X.3 du chapitre 10 de l’AECG définit précisément ce qu’il faut entendre par « investissement ». Les investissements sont « des actifs de toute nature détenus ou contrôlés directement ou indirectement par un investisseur, qui ont les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits ou l’acceptation du risque, et qui sont d’une durée définie ». L’investissement comporte donc trois critères qui s’inspirent d’ailleurs de ceux utilisés dans l’affaire Salini c/ Maroc (2001) (73). Cette définition générale de l’investissement est complétée par une liste non exhaustive d’exemples (74).
Toutefois, cette définition n’est pas opérante seule. Elle est inséparable de celle de l’investisseur. Ensemble, elles définissent le champ d’application matérielle de l’AECG. Aux termes de ce traité, l’investissement s’entend « d'une Partie, d’une personne physique ou d'une entreprise d’une Partie, autre qu’une succursale ou un bureau de représentation, qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement sur le territoire de l'autre Partie ». Quant à l’entreprise elle-même, elle est définie comme :
– « une entreprise qui mène des activités commerciales importantes sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée » ;
– « une entreprise constituée ou organisée selon les lois de cette Partie et qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique de cette Partie ou par une entreprise » susmentionnée.
La conjonction de ces deux définitions est de nature, comme les ONG le reconnaissent, à « prévenir les abus flagrants du traité par des entreprises à boîte postale » (75), réservant la protection de l’AECG aux seules entreprises disposant « d’activités commerciales importantes » dans l’Union européenne ou au Canada. Cette solution s’inspire d’ailleurs de la jurisprudence arbitrale qui, d’une manière générale, autorise les États à dénier la protection à un investisseur s’il apparaît que celui-ci est une entité qui, d’une part, n’exerce pas d’activité substantielle sur son territoire et, d’autre part, appartient à des ressortissants d’un État tiers (76).
• Le droit à un traitement non discriminatoire
Ainsi défini, l’investisseur a droit à un traitement non-discriminatoire de la part de l’État d’accueil de son investissement. Ce droit est double. Il se compose à la fois du droit au traitement national et du droit à bénéficier du traitement de la nation la plus favorisée.
Le droit au traitement national implique classiquement – et l’article X.6 de l’AECG ne fait pas exception sur ce point - un engagement de l’État à ne pas traiter les investisseurs étrangers, dans des circonstances similaires, d’une manière moins favorable que les investisseurs nationaux. Par conséquent, le contenu de cette clause est relatif. Il n’est pas défini par le traité lui-même et ne peut pas l’être puisque la clause renvoie à la manière dont l’Union européenne et le Canada (incluant les États-membres et provinces canadiennes) traitent leurs propres investisseurs.
Dans la continuité directe du droit au traitement national, qui interdit toute discrimination entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers, le droit à bénéficier du traitement de la nation la plus favorisée, prévue par l’article X.7 de l’AECG, interdit toute discrimination entre les investisseurs étrangers en harmonisant par le haut la protection de ceux-ci. L’État d’accueil s’engage en effet à ne pas accorder aux investisseurs d’un État un traitement moins favorable que celui octroyé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Toutefois, cette disposition est largement neutralisée par le quatrième alinéa de ce même article qui interdit, en pratique, aux investisseurs d’invoquer dans un différend la violation de dispositions substantielles contenues dans d’autres traités d’investissement et accords de libre-échange, notamment ceux conclus par les États-membres.
Néanmoins, parce que ces deux dispositions ont une portée relative, découlant directement de la pratique de l’État concerné en matière de traitement des investisseurs nationaux et étrangers, elles ne peuvent à elles seules garantir la protection des investisseurs étrangers. Elles doivent être complétées par des droits dont le contenu est, lui, défini par le traité lui-même.
• Le droit à un traitement juste et équitable
Contrairement au droit à un traitement non-discriminatoire, le droit à un traitement juste et équitable (TJE) est défini par le droit international coutumier à travers la notion de « standard minimum de traitement ». Cependant, découlant de la pratique des États, cette notion est par elle-même évolutive. Depuis qu’il est apparu dans le droit international par l’arrêt de la Cour internationale de justice Neer c/Mexique (1926), le contenu du TJE s’est ainsi progressivement enrichi, à l’initiative des tribunaux arbitraux, au-delà des composantes traditionnelles du « standard minimum de traitement » que sont l’interdiction du déni de justice et des mesures arbitraires ou discriminatoires, le respect de la bonne foi et des procédures légales et la prohibition du harcèlement.
La question s’est donc posée des rapports entre le TJE et le « standard minimum de traitement », notamment dans le cadre de l’ALENA. Confrontée à des interprétations extensives des tribunaux arbitraux, la Free Trade Commission est intervenue et a imposé une interprétation de l’article 1105 faisant du TJE une composante du « standard minimum de traitement ». Par conséquent, le TJE ne peut pas, dans le cadre de l’ALENA, apporter d’autres garanties aux investisseurs que celles reconnues par le droit international coutumier.
Il n’en reste pas moins que le TJE oblige aujourd’hui les États à traiter de manière transparente les investisseurs étrangers ainsi qu’à protéger leurs attentes légitimes.
C’est la sentence Metalclad c/ Mexique (2000) qui a reconnu pour la première fois que le TJE impliquait une obligation de transparence pour l’État d’accueil de l’investissement et, par conséquent, condamné le Mexique pour la violation de l’article 1105 de l’ALENA. Même si la sentence a incité la FTC à intervenir et qu’elle a par la suite été annulée (77), l’inclusion de la transparence dans le droit international coutumier ne fait plus guère de doute considérant la jurisprudence arbitrale (78) et l’importance que les États lui accordent. Par conséquent, l’État doit rendre accessibles toutes les informations liées à l’activité économique de l’investisseur en termes d’autorisations, de normes ou de procédures à respecter, afin qu’il puisse mesurer les risques qu’il encourt pour son investissement.
En outre, les tribunaux arbitraux ont jugé que le traitement juste et équitable implique aujourd’hui que l’État respecte les attentes légitimes des investisseurs. Cette évolution de la notion de TJE est très problématique compte tenu des difficultés à définir ce qu’il faut entendre par « attentes légitimes ». Le risque pour le droit à réguler des États est évident si les tribunaux arbitraux retiennent une définition subjective de celles-ci par les investisseurs eux-mêmes et l’imposent aux États dans le règlement de leurs différends avec ces derniers.
L’Union européenne et le Canada ont parfaitement cerné le risque que peut présenter un TJE imprécis dont le contenu serait laissé à l’initiative des tribunaux arbitraux. Si l’article X.9 de l’AECG leur impose bien d’accorder aux investisseurs « un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales », il ne contient pas de référence au droit international. Bien au contraire, ce même article liste de manière exhaustive les mesures qui, au sens de ce traité, constituent un traitement injuste et inéquitable, ce qui n’est pas le cas, par exemple, dans le TBI franco-irakien. Celles-ci sont au nombre de cinq et recouvrent parfaitement les composantes traditionnelles du TJE :
– un déni de justice dans le cas d’une procédure criminelle, civile ou administrative ;
– un manquement essentiel à l’application régulière de la loi, y compris sur le plan de la transparence dans le cadre d’une procédure criminelle ou administrative ;
– un acte manifestement arbitraire ;
– une forme de discrimination ciblée pour des motifs manifestement injustifiés, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses ;
– un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement.
Par ailleurs, l’AECG définit ce qu’il faut entendre par « protection et sécurité intégrales » : la sécurité physique des investisseurs et de leurs investissements sur le territoire d’une Partie, que doit garantir l’État en faisant usage des pouvoirs, notamment de police, qui sont les siens. Cette précision est utile, même si elle est conforme à la « jurisprudence arbitrale » résultant, par exemple, de la sentence Saluka investments c/ République Tchèque (2006) précitée.
Enfin, les « attentes légitimes » des investisseurs font l’objet d’un encadrement spécifique. Le §4 de l’article X.9 stipule ainsi qu’« un tribunal peut tenter de déterminer si une Partie a effectué une représentation particulière auprès d’un investisseur, en vue de susciter un investissement visé, laquelle aurait créé une attente légitime, et sur laquelle un investisseur aurait fondé sa décision d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé avant d’être contrarié par la Partie en question ». Par conséquent, une violation du droit à un traitement juste et équitable ne sera reconnue qu’à une triple condition :
– que l’État ait pris des engagements précis vis-à-vis de l’investisseur de nature à l’inciter à réaliser l’investissement concerné ;
– que ces engagements spécifiques de l’État, créant une attente légitime de l’investisseur, aient fondé la décision de celui-ci de réaliser ou de maintenir son investissement ;
– que ledit investissement a, par la suite, été contrarié par une mesure mise en œuvre par la même Partie.
Enfin, si l’article X.9 tient compte du fait que le TJE est une notion évolutive, son évolution ne sera pas décidée par les tribunaux arbitraux. Le §3 stipule ainsi que « les Parties passeront en revue, de façon régulière ou à la demande d’une Partie, le contenu de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable. Le Comité sur les services et l’investissement peut formuler des recommandations à cet égard et les présenter au Comité du commerce, pour décision ». Par conséquent, le contenu du TJE est précisément défini par l’AECG et s’il peut évoluer, ce sera sur décision conjointe du Canada et de l’Union européenne.
• Le droit à compensation en cas d’expropriation
En préalable, il convient de souligner que la protection contre l’expropriation est d’une nature fondamentalement différente des autres protections que les investisseurs tirent du droit international. En effet, l’expropriation n’a jamais été et ne peut pas être interdite en soi car elle est une prérogative inhérente au pouvoir de l’État. Ce que le droit international encadre, ce sont les conditions de l’expropriation qui, par principe, doit :
– être justifiée par un motif d’intérêt général ;
– être non-discriminatoire ;
– être conforme à la procédure légale ;
– s’accompagner d’une juste compensation.
Ces quatre conditions, bien établies dans le droit international de l’investissement, comme d’ailleurs dans de nombreux droits nationaux dont le droit français, figurent telles quelles à l’article X.11 de l’AECG.
Les expropriations directes sans compensation sont aujourd’hui exceptionnelles dans les pays développés. Toutefois, un cas est fameux. Entreprise américaine de production de papier, Abitibi Bowater avait été expropriée sans compensation en 2008 de toutes les possessions (essentiellement des droits de coupe et d’harnachement de rivière) qu’elle détenait dans la province de Terre-neuve-et-Labrador. Or, la loi d’expropriation a été adoptée par le parlement provincial 12 jours après que cette société, confrontée à de graves problèmes financiers, ait annoncé la fermeture d’une usine dans la province et le licenciement de ses 800 salariés. Cette loi niait également à Abitibi le droit de s'adresser aux tribunaux de la province pour obtenir une compensation. Convaincue d’être victime de représailles et qu’un tel traitement violait les dispositions de l’ALENA, Abitibi Bowater a porté son différend devant un tribunal arbitral. Toutefois, persuadé lui-même de l’illicéité de cette expropriation, le gouvernement fédéral, responsable des agissements des provinces sur le plan international, a préféré transiger et payer au requérant la somme de 130 millions de dollars canadiens.
Si les expropriations directes comme dans le cas d’Abitibi Bowater sont exceptionnelles et relativement simples du point de vue juridique, il n’en va pas de même des mesures constituant des expropriations indirectes qui, aujourd’hui, constituent l’essentiel des différends entre États et investisseurs. Ces mesures se caractérisent par le fait qu’elles ne sont pas, par elles-mêmes, des expropriations mais qu’elles produisent le même effet. Elles relèvent donc du régime juridique de l’expropriation mais ne peuvent être reconnues comme telles qu’a posteriori puisque seul leur effet permet de les qualifier. De manière schématique, elles constituent une expropriation de facto, par opposition aux expropriations de jure que sont les expropriations directes.
Toute la difficulté des mesures constituant des expropriations indirectes est donc de savoir comment les identifier et, ainsi, les soumettre au régime juridique de l’expropriation. La jurisprudence arbitrale a donc défini deux critères, notamment dans l’affaire Tecmed c/ Mexique (2003), pour considérer qu’une mesure étatique constitue une expropriation indirecte :
– un effet équivalent à une expropriation, avec cette précision qu’il n’implique pas un transfert de propriété à l’État mais une simple privation des avantages de cette dernière ;
– un effet disproportionné à l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’État avec cette mesure.
Il revient donc aux tribunaux arbitraux d’apprécier l’effet de la mesure et si celle-ci est proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’État. Ce pouvoir d’appréciation est toutefois très précisément encadré par l’AECG. En effet, aux termes de l’annexe X.11, l’expropriation indirecte « résulte d'une mesure ou d'une série de mesures prises par une Partie et ayant un effet équivalent à celui d'une expropriation directe, en ce sens qu'il prive de façon substantielle l'investisseur des droits fondamentaux de propriété associés à son investissement, y compris le droit d'user, de jouir et de disposer de son investissement, et ce, sans transfert officiel de titres ni saisie définitive ». Cette définition, qui reprend en grande partie la jurisprudence précitée est cependant complétée par quatre critères qui guideront les tribunaux arbitraux :
– « les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures », étant précisé que « l’effet défavorable de la mesure ou de la série de mesures sur la valeur économique d’un investissement ne prouve pas à lui seul qu’il y a eu expropriation indirecte » ;
– « la durée de la mesure ou de la série de mesures » ;
– « l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes définies et raisonnables sous-tendant l’investissement » ;
– « la nature de la mesure ou de la série de mesures, notamment l’objet, le contexte et l’intention ».
Ce dernier point fait l’objet d’une précision supplémentaire. En effet, l’AECG stipule clairement que « sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou la série de mesures est si rigoureuse au regard de son objet qu'elle semble manifestement excessive, les mesures non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte ». Par conséquent, sauf si elle est manifestement excessive, une mesure, à condition d’être non discriminatoire, ne pourra être qualifiée d’expropriation indirecte au sens de l’AECG.
Votre rapporteure estime que cette rédaction, qui s’inspire largement du modèle canadien de TBI de 2004 (79), est de nature à prévenir d’éventuels abus comme ceux de Philip Morris dans le différend qui l’oppose à l’Australie à propos du paquet de cigarettes « neutre » (voir supra). C’est aussi la position de certaines ONG. L’une d’entre elles, Droits et Démocratie, considère en effet que le modèle canadien de TBI est formulé « de nature à éviter que les mesures réglementaires légitimes répondant à des objectifs d’intérêt public puissent être qualifiées d’expropriation indirecte au sens du traité » (80).
Les exceptions permettent d’exclure l’application des dispositions de l’AECG, en particulier celles relatives au règlement des différends, à certains secteurs ou certaines mesures.
• L’exception générale de l’article XX du GATT
L’article XX du GATT autorise les États-membres de l’OMC à adopter les mesures contraires aux règles de l’OMC pour autant qu’elles soient nécessaires, notamment, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux (b) ou à la conservation des ressources naturelles épuisables (g), et ne constituent pas une discrimination entre les pays ou une restriction déguisée au commerce international.
L’article X.02 du chapitre 32 de l’AECG incorpore l’article XX précité en le rendant applicable aux chapitres 3 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), 4 (Règles d’origine, Procédures d’origine), 8 (Régime douanier et facilitation des échanges) et 7 (Mesures SPS). S’agissant du chapitre 10, l’article XX sera applicable aux sections 2 (Établissement d’investissements) et 3 (Traitement non discriminatoire). Ce même article X.02 précise que :
– les mesures susmentionnées visées au b de l’article XX « englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » ;
– les mesures susmentionnées visées au g de l’article XX « s’appliquent aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques ».
Outre cette référence à la clause d’exception générale du GATT, le même article autorise le Canada et l’Union européenne, pour l’application des chapitres 11 (Commerce transfrontalier des services), 17 (Télécommunications), 12 (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles) ainsi que pour les sections 2 et 3 du chapitre 10 sur l’investissement, à adopter une mesure nécessaire :
– à la protection de la sécurité publique, de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public ;
– à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
– pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats, à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels et à la sécurité.
• L’exception fiscale
Cette exception est très fréquemment présente dans les TBI. La fiscalité est en effet une matière sensible que les États sont réticents à soumettre au droit international, d’autant plus qu’elle fait très souvent l’objet de conventions ad hoc avec lesquelles les TBI doivent d’ailleurs s’articuler. Souvent – notamment dans l’AECG, en cas d’incompatibilité d’un traité avec une convention fiscale, ce sont les dispositions de ces dernières qui priment.
L’article X.06 du chapitre 32 de l’AECG préserve de manière à la fois large et précise le droit à réguler des États en matière fiscale. Son §5 stipule en particulier que « le fait qu’une mesure fiscale constitue une modification majeure à une mesure fiscale existante, qu’elle prenne effet au moment même de son annonce, qu’elle clarifie l’application prévue d’une mesure fiscale existante ou qu’elle ait une incidence inattendue sur un investisseur ou un investissement visé ne constitue pas, en soi, une violation de l’article X.9 » du chapitre 10, c’est-à-dire du droit à un traitement juste et équitable.
En outre, si un différend devait surgir entre un investisseur et l’État concernant une mesure fiscale qui, selon lui, violerait les droits qu’il tire de l’AECG, le §7 du même article X.06 crée une procédure particulière avant que l’investisseur ne puisse valablement saisir un tribunal arbitral. En effet, pendant la période obligatoire de consultation, la partie visée par la plainte a la possibilité de renvoyer la question pour examen et décision conjointe des Parties qui devront déterminer :
– si la mesure attaquée est une mesure fiscale;
– si la mesure attaquée, qui s’avère une mesure fiscale, contrevient à une obligation prévue à la section 3 (Traitement non discriminatoire) ou à la section 4 (Protection de l’investissement) du chapitre 10 ;
– s’il y a incompatibilité entre les obligations de l’AECG dont le manquement est allégué et les obligations prévues à une convention fiscale.
Si les Parties n’examinent pas la question dans un délai de 180 jours ou si elles ne prennent pas de décision conjointe, l’investisseur pourra introduire sa plainte devant le tribunal arbitral. En d’autres termes, les différends portant sur une mesure fiscale peuvent faire l’objet d’un filtre préalable à la saisine du tribunal arbitral. C’est seulement en cas de désaccord entre le Canada et l’Union européenne sur la nature et l’éventuelle justification de la mesure que l’investisseur pourra valablement introduire sa plainte. Une telle disposition permet aux États d’avoir la main sur la qualification à donner à une mesure fiscale puisque leur décision « lie le tribunal ».
• L’exception prudentielle
Depuis la crise de 2008 et les faillites d’établissements financiers qu’elle a entraînées dans le monde entier, les États sont particulièrement attentifs à la stabilité de leur système financier et, par conséquent, à préserver leurs marges de manœuvre s’agissant des mesures à adopter à cette fin. C’est pourquoi le Canada et l’Union européenne ont fait en sorte que l’AECG ne les empêche pas de réguler comme ils l’entendent leur secteur financier par trois dispositions cumulatives prévues à l’article 15 du chapitre 15 du traité.
En premier lieu, le texte du traité est très clair sur le fait qu’il n’empêche pas les parties d’adopter ou de maintenir des mesures visant notamment à :
– la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes à l’égard desquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a des obligations fiduciaires ;
– le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières, des fournisseurs de services financiers transfrontières ou des fournisseurs de services financiers ;
– la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier.
De plus, ce même article stipule que, sous réserve des dispositions relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée, une Partie peut, pour des raisons prudentielles, interdire une activité ou un service financier particulier.
Enfin, en cas de différends portant sur un investissement dans les services financiers, une procédure particulière est prévue par l’article 20 de ce même chapitre 15 qui rappelle fortement le « filtre » applicable s’agissant des différends relatifs à une mesure fiscale (voir supra). En effet, si l’État visé par la plainte estime que la mesure contestée relève de l’exception prudentielle, il peut « renvoyer une question par écrit au Comité des services financiers, pour décision, afin de déterminer si et dans quelle mesure l’exception prévue à l’article 15.1 constitue une défense valable contre la plainte ». Si ce comité, composé de représentants canadiens et européens, estime que la mesure contestée constitue une défense valable et donc que l’exception prudentielle est applicable, l’investisseur est réputé s’être désisté de sa plainte.
Par conséquent, le droit des États à réguler le secteur financier apparaît particulièrement bien protégé, notamment en cas de différend puisque le Canada et l’Union européenne pourront, par une décision conjointe, dénier le droit à un investisseur de saisir un tribunal arbitral en interprétant eux-mêmes les dispositions relatives à l’exception prudentielle.
• L’exception des dettes publiques
Certaines décisions arbitrales ont pu, récemment, reconnaître la souscription d’une obligation d’État comme un investissement au sens du TBI concerné. C’est notamment le cas pour certains différends opposant l’Argentine à des investisseurs contestant la restructuration de sa dette (81). Le risque que des « fonds vautours », parmi d’autres investisseurs, puissent attaquer les différends « plans de sauvetage » d’un État-membre de la zone Euro justifie que l’AECG exclut largement les restructurations de dette publique du champ du RDIE.
C’est ainsi qu’en application de l’annexe X du chapitre 10, aucune plainte d’un investisseur portant sur une restructuration négociée de dette publique ne sera recevable, sauf si ladite restructuration a contrevenu au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée, c’est-à-dire qu’elle a discriminé entre les créanciers nationaux et étrangers, d’une part, ou entre les créanciers étrangers, d’autre part.
Par ailleurs, la même annexe définit la restructuration négociée comme une restructuration ou une réorganisation d’un titre de créance qui a été effectué par l’un des éléments suivants :
– l’apport d’une modification ou d’un amendement à pareil titre de créance, comme le prévoient ses dispositions ;
– un échange de dette exhaustif ou tout autre procédé du même genre par lequel les propriétaires d’au moins 75 % de la somme principale combinée de la dette impayée conformément aux titres de créances en question ont accepté pareil échange de dette ou un procédé semblable.
Par conséquent, si les TBI signés par l’Argentine dans les années 90 avaient contenu une telle exception, les plaintes auxquelles ce pays est confronté n’auraient pas été recevables, considérant le fait qu’elle a renégocié 93 % de sa dette.
• L’exception culturelle
Aux termes de l’article X.08 du même chapitre 32, le Canada et l’Union européennes réitèrent les exceptions s’appliquant aux industries culturelles telles qu’elles sont mentionnées dans les chapitres 11 (Commerce transfrontaliers des services, 14 (Réglementation intérieure), 21 (Marchés publics), 10 (Investissement) et 9 (Subventions). En particulier, l’article X.1 du chapitre 10, portant sur le champ d’application de celui-ci, exclut les mesures liées aux services audiovisuels de la protection que les investisseurs tirent de la section 2 relative à l’établissement et de la section 3 relative au traitement non discriminatoire.
La substance de l’AECG, c’est-à-dire les clauses qu’il contient et la manière dont elles sont rédigées, n’est pas le seul moyen utilisé par l’Union européenne et le Canada pour protéger leur droit à réguler. En effet, ce traité non seulement profite de l’expérience acquise par le Canada dans le cadre de l’ALENA mais intègre des dimensions désormais incontournables que sont l’éthique et la transparence pour les appliquer au RDIE. D’une manière générale, l’AECG contient de très nombreuses dispositions procédurales qui, conjuguées, garantissent un traitement impartial et transparent des différends et préviennent les abus que pourraient être tentés – et ont déjà tenté – d’en faire des investisseurs.
L’une des critiques majeures aujourd’hui portée contre le RDIE sous sa forme de tribunal arbitral – que partage votre rapporteure – est le risque de conflits d’intérêt auquel sont exposés les arbitres. Successivement, voire simultanément arbitre et avocat, parfois expert ou enseignant commentant leurs propres sentences, ils forment un microcosme qui, en tant que tel, ne présente pas l’apparence d’impartialité qu’un justiciable est en droit d’attendre de ses juges. En outre, au-delà du conflit d’intérêt lié à une affaire particulière, dès lors que les arbitres sont nommés et payés pour un seul et unique différend, ils pourraient avoir tendance à favoriser les investisseurs car ce sont eux qui sont à l’origine des différends dont dépend leur revenu. Certes, des garde-fous existent contre les conflits d’intérêt – notamment l’article 6 du règlement d’arbitrage du CIRDI – mais ils sont jugés insuffisants compte tenu du fait que c’est l’organisation actuelle du système arbitral qui les génère.
Toutefois, même si elle partage cette critique, votre rapporteure tient à rappeler que les tribunaux arbitraux donnent plus souvent raison aux États qu’aux investisseurs dans le cadre des sentences rendues à l’encontre des États-membres de l’Union européenne. Il n’en reste pas moins que l’arbitrage apparaît biaisé et, en matière judiciaire, l’apparence compte autant que la réalité pour assurer la légitimité d’un système. C’est donc à raison que, pour la première fois dans un traité d’investissement, l’AECG impose aux arbitres de respecter un code de conduite contraignant figurant en annexe du traité. S’inspirant des règles de l’International Bar Association, il vise à prévenir les conflits d’intérêt, notamment en imposant aux arbitres de divulguer « tout intérêt, toute relation ou toute question qui serait susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourrait raisonnablement créer une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris dans la procédure ».
Toutefois, la véritable portée de ce code de conduite est ailleurs. En effet, en cas de doute sur l’impartialité d’un arbitre, une partie pourra contester sa nomination directement auprès du Secrétaire général du CIRDI. Par conséquent contrairement à la convention de Washington (article 58) qui confère ce pouvoir au tribunal arbitral lui-même, ce sera à un tiers de décider de la suite à donner à la demande de récusation d’une partie.
Outre le risque de conflit d’intérêt auquel sont exposés les arbitres, nombreux sont les contempteurs du RDIE à avoir souligné le caractère opaque de la procédure arbitrale. Bien que la transparence de celle-ci ait été améliorée dans les Règlements d’arbitrage du CIRDI et de la CNUDCI, elle reste largement entre les mains du tribunal, voire des seules parties. Or, il n’est pas légitime aujourd’hui que des différends impliquant des choix de politique publique aux enjeux considérables pour les peuples européens et canadiens puissent être réglés dans le secret.
Conscients que la légitimité du RDIE exige la plus grande transparence possible de la procédure arbitrale, l’Union européenne et le Canada ont rédigé l’article X.33 du chapitre 10 de l’AECG dans le sens d’une transparence totale de cette dernière, seulement limitée, comme en droit interne, par la nécessité de protéger les informations confidentielles et, en particulier, les secrets d’affaires. À cette fin, le traité rend applicable aux futurs différends le nouveau règlement de la CNUDCI sur la transparence tout en le précisant et le complétant sur certains points. Il apparaît ainsi que la transparence joue à tous les stades de la procédure et dans toutes les dimensions de celle-ci, orale et écrite :
– dès la saisine, sont rendus publics la demande de consultations, l’avis requérant la désignation de la Partie visée par la plainte, l'avis de désignation de la Partie visée par la plainte, le consentement à la médiation, l'avis d'intention de contestation, la décision relative à la contestation d'un arbitre et la demande de jonction sont inclus dans la liste de documents ;
– par la suite, sont rendus publics la notification d’arbitrage, la réponse à la notification d’arbitrage, le mémoire en demande, le mémoire en défense et toutes autres déclarations ou conclusions écrites de l’une ou l’autre des parties au litige; un tableau énumérant toutes les pièces afférentes aux documents susmentionnés et aux rapports d’experts et déclarations de témoins, les pièces afférentes elles-mêmes, toutes observations écrites d’une partie (ou de parties) au traité non parties au litige et de tiers, les transcriptions d’audiences, si elles sont disponibles et les ordonnances, décisions et sentences du tribunal arbitral ;
– au-delà des documents, toutes les audiences sont en principe publiques ; le tribunal peut toutefois décider de siéger à huis clos après consultation des parties, qui ne sont donc pas décisionnaires ;
– enfin, le tribunal peut autoriser un tiers à présenter des observations écrites après consultation des parties. C’est donc le tribunal qui décidera et non les parties elles-mêmes qui ne pourront s’y opposer.
Par conséquent, le tribunal arbitral conserve un certain pouvoir discrétionnaire en matière de transparence. Toutefois, le Règlement de la CNUCDI précise que, dans l’exercice de ce pouvoir, il doit tenir compte :
– de l’intérêt que le public porte à la transparence de l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités et de la procédure arbitrale en question ;
– de l’intérêt qu’ont les parties au litige de voir ce dernier réglé équitablement et efficacement.
Au final, la procédure arbitrale telle qu’elle est définie dans l’AECG n’aura rien à envier, s’agissant de la transparence, à une procédure judiciaire de droit interne.
C’est un fait que le RDIE a pu, dans une période récente, être mis en œuvre d’une manière qui a sapé sa légitimité, tant auprès de certains États européens que de leur opinion publique. Instrument de protection des investisseurs contre l’arbitraire des États et les défaillances de leurs juridictions internes, il a été détourné par Philip Morris, via un montage juridique abusif, afin de contester un choix légitime de politique publique de l’État australien. De même, la République Tchèque a été la victime d’une défaillance majeure du RDIE qui a vu deux tribunaux arbitraux, saisis des mêmes faits, rendre deux sentences parfaitement contradictoires. Enfin, le RDIE a été instrumentalisé, notamment contre le Canada dans le cadre de l’ALENA, par des demandes de compensation aussi exorbitantes qu’infondées afin de faire pression sur un gouvernement pour qu’il retire la mesure contestée.
De tels abus sont scandaleux et votre rapporteure les dénonce avec force. Elle se réjouit donc que l’AECG inclue de nombreuses clauses de nature à prévenir la répétition de tels abus de la part d’investisseurs mal intentionnés :
– l’interdiction du cumul d’un recours national avec le RDIE ;
– la prohibition de l’abus de droit ;
– le rejet accéléré des plaintes infondées ;
– la jonction des procédures ;
– le rôle des États dans l’interprétation du traité.
Avant d’analyser plus en détail chacune de ces clauses, votre rapporteure souligne que l’AECG contient un garde-fou général empêchant que ces clauses ne soient contournées par le biais de la clause de traitement de la nation la plus favorisée. L’article X.7 souligne en effet que le terme « traitement » « ne vise pas les procédures de règlement des différends entre les investisseurs et l'État prévues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux ».
• L’interdiction du cumul d’un recours national avec le RDIE
Par principe, le RDIE constitue une voie de recours ouverte aux seuls investisseurs étrangers, laquelle s’ajoute aux voies de recours internes dont ils disposent, à l’instar des investisseurs nationaux. Confrontés à une mesure nationale qu’ils estiment être une violation de leur droit, il leur est donc possible – en théorie – de demander une compensation à la fois à un tribunal arbitral et à une juridiction interne, sur le fondement du droit international bien-sûr mais également, éventuellement, du droit interne lorsque celui-ci offre une protection équivalente (par exemple en matière d’expropriation). Le risque est ainsi :
– que la mesure soit considérée comme une violation d’un TBI par le tribunal arbitral et le tribunal interne avec, en conséquence, le versement d’une double compensation ;
– que le tribunal arbitral considère la mesure comme une violation d’un TBI et pas le tribunal interne, ou inversement.
Un tel risque n’est pas acceptable pour les finances publiques et contradictoires avec l’objectif d’un règlement juste et efficace des différends entre les États et les investisseurs. C’est pourquoi, en application de l’article X.21 du chapitre 10 de l’AECG, l’investisseur ne peut, simultanément, demander réparation devant une juridiction nationale et internationale. La plainte ne sera en effet recevable par le tribunal arbitral que si « l’investisseur renonce à son droit de déposer une plainte ou d’engager une instance dans le but de solliciter une indemnisation ou des dommages-intérêts devant un tribunal ou une cour relevant du droit national ou international en ce qui concerne toute mesure dont le manquement est allégué dans la plainte soumise à l’arbitrage ».
Par conséquent, non seulement l’investisseur devra choisir entre un recours interne et la mise en œuvre du RDIE mais ce choix sera définitif.
• La prohibition de l’abus de droit
Comme tout droit, le recours au RDIE peut faire l’objet d’un abus et être détourné de sa vocation initiale de protection des investisseurs vers d’autres objectifs moins légitimes. C’est pourquoi l’article X.17 de l’AECG constitue une clause anti-abus de portée générale qui interdit à un investisseur de soumettre au tribunal arbitral une plainte « quand l’investissement a été fait au moyen de déclarations frauduleuses, de dissimulation, de corruption ou d’une conduite équivalant à un abus de droit ».
Par conséquent, lorsque Philip Morris rachète l’intégralité de sa filiale hongkongaise dans l’unique objectif de poursuivre l’Australie, un tel montage aurait selon toute probabilité été considéré comme un abus de droit au sens de l’AECG, conduisant à l’irrecevabilité de sa plainte. Cette disposition constitue, avec d’autres, la preuve que le Canada et l’Union européenne ont appris des mauvaises expériences passées et cherché à éviter qu’elles se renouvellent.
• Le rejet accéléré des plaintes infondées
Même si, d’une manière générale le RDIE n’est mis en œuvre par les investisseurs que lorsque toutes les autres possibilités de règlement du différend avec l’État ont échoué, il n’en reste pas moins que les États ont pu être exposés à des plaintes infondées déposées dans l’unique objectif de faire pression sur eux pour qu’ils retirent la mesure contestée. L’ALENA offre ainsi de nombreux exemples de plaintes assorties d’une demande de compensation colossale qui sont inactives depuis des années. Ainsi, si les violations alléguées de ce traité par les États-Unis étaient fondées et le préjudice de l’entreprise canadienne Domtar réel, on peut supposer que cette société se serait préoccupée de donner une suite à sa plainte, surtout avec 200 millions de dollars en jeu.
Conscients de ce risque et de l’effet que de telles plaintes, même totalement infondées, pourraient avoir sur leur opinion publique, le Canada et l’Union européenne ont prévu, dans l’AECG, deux procédures différentes pour permettre de les écarter très rapidement.
– l’article X.29 du chapitre 10 vise les plaintes manifestement dénuées de fondement juridique. Aux termes de cet article, « la Partie visée par la plainte peut, au plus tard 30 jours après la constitution du tribunal et, quoi qu’il en soit, avant la première séance du tribunal, déposer une objection portant que la plainte est manifestement dénuée de fondement juridique ». Cette objection est alors examinée prioritairement, dès la première séance, par le tribunal qui rend sa décision après avoir entendu les parties. S’il accepte l’objection, la procédure s’arrête immédiatement ;
– l’article X.30 vise quant à lui les plaintes infondées en droit. Aux termes de cet article, « le tribunal traite et tranche, à titre préliminaire, toute objection soulevée par la Partie visée par la plainte portant que la plainte soumise en vertu de la présente section, ou une partie de celle-ci, n'est pas, d'un point de vue juridique, une plainte à l'égard de laquelle une sentence en faveur du plaignant peut être rendue en vertu de l'article X.22, même si les faits allégués étaient considérés comme avérés ». Par opposition à la procédure de l’article X.29, cette objection se limite aux conditions de recevabilité de la plainte sans que les arbitres aient besoin d’analyser les faits ou leur qualification juridique.
• La jonction des procédures
L’une des dispositions les plus novatrices de l’ALENA (article 1126), à l’époque, était la possibilité pour un tribunal arbitral, de joindre dans une même procédure des plaintes portant sur un même point de droit ou de fait. Une telle disposition est dans l’intérêt des États comme des investisseurs qui, tous, veulent un règlement efficace et juste de leurs différends. Surtout, elle est de nature, à supprimer l’un des dysfonctionnements du RDIE mis en évidence supra : le risque de contradiction entre les sentences, inhérent à un mécanisme de tribunaux arbitraux ad hoc.
L’Union européenne et le Canada ont intégré cette procédure de jonction des plaintes à l’article X.41 de l’AECG. Aux termes de cet article, fortement inspirés de l’article 1126 de l’ALENA précité, « quand deux plaintes ou plus, soumises à l'arbitrage séparément en application de l'article X.22 (Présentation d'une plainte à l'arbitrage), portent sur une même question de droit ou de fait et découlent des mêmes situations ou circonstances, une des parties au différend ou les parties au différend peuvent conjointement demander la constitution d'un tribunal distinct en vertu du présent article et demander que ce tribunal rende une ordonnance de jonction des plaintes ». Une fois celui-ci constitué, s’il « est convaincu que les plaintes soumises à l'arbitrage […] portent sur une même question de droit ou de fait, découlent des mêmes situations ou circonstances et que la jonction des plaintes servirait le mieux l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, y compris eu égard à l'uniformité des sentences arbitrales, le tribunal peut décider par ordonnance de se saisir de certaines ou de l'ensemble des plaintes, en tout ou en partie ».
Par conséquent, l’Union européenne ou le Canada, confrontés à une multitude de plaintes d’investisseurs à la suite d’un seul et même fait générateur – comme l’a été l’Argentine ou comme l’est aujourd’hui l’Espagne – pourront demander la jonction de ces plaintes, la décision du tribunal s’imposant à l’autre partie. Cette procédure de jonction éloigne le RDIE de l’arbitrage commercial dans lequel la jonction doit être acceptée par l’ensemble des parties. Ce faisant, elle renforce l'efficacité et la cohérence des procédures, tout en en limitant les coûts de celles-ci.
• Le rôle des États dans l’interprétation du traité
Les États sont les auteurs et les maîtres des traités. Même lorsqu’ils délèguent leur application à des organismes comme les tribunaux d’arbitrage, eux seuls sont susceptibles de produire une interprétation authentique de leurs dispositions. Jusqu’à présent, comme le note la CNUCED (82), les États ont largement négligé cette faculté ; toutefois, ainsi qu’il a été dit supra, la FTC de l’ALENA n’a pas hésité à contrecarrer, par une décision contraignante, l’interprétation extensive du traitement juste et équitable par les tribunaux arbitraux.
L’AECG s’inscrit dans la droite ligne de l’ALENA et intègre plusieurs clauses qui donnent un rôle de premier plan aux États quant à l’interprétation de ce traité. C’est ainsi que l’article X.27 du chapitre 10 rappelle que le tribunal arbitral « rend sa décision conformément au présent accord, tel qu’il est interprété en conformité à la Convention de Vienne sur le droit des traités, et à d’autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties ». Après ce rappel des règles internationales classiques d’interprétation des traités, l’AECG institue une procédure particulière d’interprétation dans les cas « où de graves préoccupations sont soulevées relativement à des questions d'interprétation susceptibles d'avoir une incidence sur les investissements ». Dans ce cas, « le Comité des services et de l'investissement peut recommander au Comité des échanges commerciaux d'adopter une interprétation de l'Accord » qui, en tant que telle, liera les tribunaux arbitraux. C’est une disposition particulièrement importante compte tenu du fait que les différends peuvent porter sur un choix de politique publique et que, malgré le soin apporté à la rédaction des dispositions relatives à l’investissement, il reste toujours une marge irréductible d’interprétation de celle-ci par les arbitres.
De plus, on rappelle que, s’agissant des différends portant sur une mesure prudentielle ou fiscale, ce peut être aux États et non aux tribunaux arbitraux de dire si elle relève ou non du champ de l’exception fiscale ou prudentielle.
Enfin, l’article X.35 du chapitre 10 institue une procédure qui permet d’associer au différend l’État non visé par la plainte. L’État visé par la plainte a en effet l’obligation, dans les 30 jours suivant le dépôt de la plainte, de lui transmettre « une demande de consultations, un avis requérant la désignation de la Partie visée par la plainte, un avis de désignation de la Partie visée par la plainte, la plainte soumise à l’arbitrage, une demande de jonction, et tout autre document annexé à de tels documents ». Sur la demande de la partie, elle doit par la suite lui communiquer toute une série de documents. Il revient ensuite au tribunal, après avoir consulté les parties, de recevoir les observations de la Partie à l’accord non partie au différend en ce qui concerne l’interprétation de l’accord. La Partie non partie au différend peut également assister aux audiences.
Après le vaste débat suscité par le RDIE, en particulier suite à la consultation publique lancée par la Commission en 2014, dont les résultats ont révélé une forte opposition de la société civile aux tribunaux d’arbitrage, elle a rendu publique ses propositions de réforme du mécanisme le 16 septembre 2015. Inspirée par les propositions de la France qui a été la première à soutenir la juridictionnalisation du RDIE, la Commission européenne propose de changer de paradigme en substituant aux tribunaux arbitraux ad hoc un système juridictionnel à double niveau composé de juges nommés par les États.
a. La proposition européenne de créer une Cour permanente dans le cadre du PTCI constitue un changement de paradigme
La France a contribué au débat sur le RDIE en transmettant, dès mai, ses propositions à la Commission. Celles-ci, qui s’inscrivaient dans les pistes dégagées par la Commissaire au commerce, Mme Cecilia Malmström, conservaient au RDIE sa forme de tribunaux arbitraux ad hoc mais les soumettaient tous à une Cour permanente d’appel. Les propositions de la Commission, quant à elles, tout en reprenant l’idée d’une Cour permanente, intègrent celle-ci dans un système juridictionnel à double niveau, dont le corollaire est la suppression pure et simple des tribunaux arbitraux en première instance.
i. La proposition française conservait les tribunaux arbitraux en les soumettant à une juridiction d’appel
En préalable, il convient de souligner que les propositions françaises ne se limitaient pas à la seule forme du RDIE. En effet, elles portaient également sur la protection du droit à réguler des États, appelant :
– à clarifier les notions clés du droit des investissements, en particulier les « attentes légitimes » des investisseurs et l’expropriation indirecte ;
– à renforcer les pouvoirs d’interprétation des États ;
– à élargir la portée des exceptions générales, notamment en appliquant l’article XX du GATT non seulement aux dispositions relatives à l’établissement et à la non-discrimination mais également à celles portant sur la protection des investissements ;
– à garantir le respect des règles nationales par les investisseurs étrangers ;
– et, enfin, à préserver la souveraineté financière des États.
Toutefois, la plupart des propositions françaises avaient pour objectifs de renforcer la légitimité du RDIE par la création d’une instance d’appel prenant la forme d’une Cour permanente composée de juges nommés par les États. Cette Cour aurait coexisté avec les tribunaux arbitraux dans une procédure mixte – mi-arbitrale mi-juridictionnelle – pouvant être schématisée comme suit :
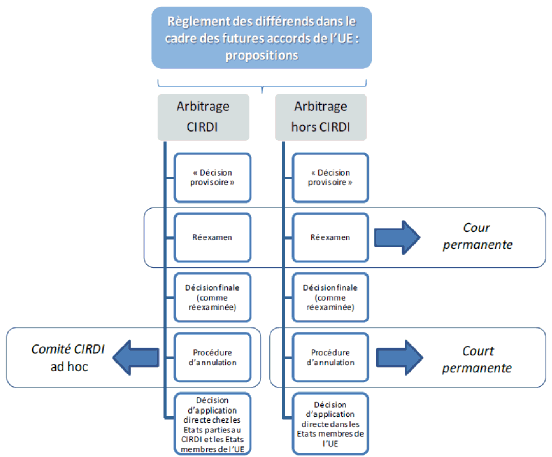
Comme le montre ce schéma, la Cour permanente s’insère dans une procédure qui reste largement arbitrale. En effet, que ce soit dans l’arbitrage CIRDI ou hors CIRDI, une sentence provisoire serait rendue par les tribunaux arbitraux. Celle-ci ferait l’objet d’un appel à l’initiative d’une partie qui saisirait la Cour permanente; si elle confirmait la sentence, celle-ci serait définitive. Mais en cas d’avis négatif, c’est-à-dire si la sentence contenait des erreurs de droit ou de fait manifestes, le tribunal arbitral devrait en tenir compte pour la sentence définitive (83). Cette dernière, rendue dans le cadre du CIRDI, pourrait être contestée devant un comité ad hoc. En revanche, la Cour permanente examinerait les recours en nullité pour les sentences rendues hors CIRDI
Conservant les tribunaux arbitraux en première instance, la proposition française s’attachait également à renforcer leur légitimité. C’est ainsi que les parties n’auraient plus eu le libre choix de leurs arbitres mais auraient dû les choisir (ou les faire choisir par le secrétaire général du CIRDI) sur une liste gérée par la Cour permanente. Lesdits arbitres, présentant toutes les garanties d’indépendance, seraient inscrits pour six ans sur la liste et n’auraient plus été autorisés, pendant la durée de leur mandat, à faire office de conseil ; ils seraient en outre soumis à un code de déontologie comportant, outre l’interdiction d’exercer une fonction de conseil le temps de leur mandat, une « période de quarantaine » : le mandat de six ans serait précédé et suivi d’une période de cinq ans. En effet,
– l’arbitre ne devra pas, dans les cinq années précédant la présentation de la plainte, avoir fait fonction de conseiller juridique de l’une des parties au différend ou d’une tierce partie impliquée dans un différend antérieur portant sur des faits similaires ;
– l’arbitre ne pourra faire fonction de conseiller juridique d’une partie au différend ni conseiller d’une quelconque partie au différend impliqué dans une autre procédure judiciaire portant sur des faits similaires sur lequel le tribunal a statué à moins que cinq ans ne se soient écoulés entre la sentence définitive et la nomination de l’ancien arbitre comme conseiller juridique.
ii. La Commission européenne propose un système juridictionnel à double niveau se substituant totalement aux tribunaux arbitraux
La proposition française présentait la Cour permanente d’appel du PTCI comme « l’ossature d’une future cour permanente multilatérale chargée, quant à elle, des sentences en première instance et des appels ». Elle constituait donc une première étape vers une juridictionnalisation complète du RDIE dans un cadre non plus bilatéral mais multilatéral. Si la Commission européenne a retenu de cette proposition l’idée d’une Cour permanente, elle ne l’a pas limitée au seul appel des sentences arbitrales. En effet, elle propose de créer un système de cour d’investissement (ICS) bilatéral à double niveau, constitué d’un Tribunal de première instance et d’un Tribunal d’appel. Par conséquent, contrairement à la proposition française, la Commission européenne propose de supprimer totalement les tribunaux arbitraux dans le RDIE, en appel bien sûr, mais également en première instance.
Le tribunal de première instance serait composé de 15 juges nommés pour six ans, renouvelable une fois, par l’Union européenne et les États-Unis : cinq auraient la nationalité d’un État-membre de l’Union européenne, cinq celle des États-Unis et les cinq derniers celle d’un État tiers. Quant aux 6 juges du tribunal d’appel, également nommés pour six ans, ils se répartiraient selon les mêmes proportions. Tous devraient satisfaire aux conditions pour être juges dans leur pays ou disposer d’une expérience reconnue en droit international. Une formation de trois juges, désignés par le président du Tribunal et présidé par le juge ressortissant d’un État tiers, jugerait en première instance et en appel des plaintes des investisseurs alléguant une violation des droits qu’ils tirent du PTCI.
Les quinze juges du Tribunal d’instance seraient payés 1/3 de ce que touchent les membres de l’organe d’appel de l’OMC, soit 2000 euros par mois environ de salaire de base, auquel s’ajouteraient les frais tels que fixés par l’article 14 du Règlement administratif et financier du CIRDI, notamment des indemnités par jour de travail. Quant aux six juges du Tribunal d’appel, ils recevraient une rémunération équivalente à celle des membres de l’organe d’appel de l’OMC, à laquelle s’ajouterait une indemnité par jour de travail.
Tous les juges de l’ICS seraient soumis au code de conduite figurant à l’annexe II. Ils seraient en particulier obligés de divulguer leurs intérêts passés et présents, leurs relations et tout ce qui pourrait affecter leur impartialité ou créer un doute à ce sujet. En outre, après leur nomination, il leur serait interdit d’être avocat dans tous les différends et ce, quel que soit le traité ou la loi nationale concerné.
Bien que se situant en dehors du cadre du CIRDI, l’Investment Court System proposé par la Commission européenne n’est pas dénué de tout lien avec lui. En effet, l’article 6 de la sous-section IV de la proposition permet à l’investisseur de saisir le Tribunal de première instance (comme, le cas échéant, le Tribunal d’appel) sous l’empire de l’un des systèmes de règles suivants :
– la convention de Washington ;
– le mécanisme supplémentaire de règlement des différends du CIRDI, applicable si l’un des États n’est pas partie à la convention précitée. C’est le cas par exemple de la Pologne ;
– le règlement d’arbitrage de la CNUDCI ;
– tout autre système de règle accepté à la fois par l’investisseur et l’État.
En d’autres termes, la Commission européenne propose que le Tribunal de premier instance comme le Tribunal d’appel continuent à appliquer les règlements d’arbitrage actuellement en vigueur, modifiés le cas échéant par les règles de procédure du traité lui-même ou celles établies par les Tribunaux précités. En particulier, l’article 18 de la sous-section IV impose, quel que soit le système de règles choisi, l’application du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
En outre, même si la rédaction n’est pas claire, il semblerait, aux termes des articles 9 et 10 de la même sous-section, que le Secrétariat du CIRDI pourrait être également celui de l’ICS et lui apporter le soutien logistique nécessaire. Toutefois, les dépenses relatives à celui-ci seraient à la charge exclusive des États-Unis et de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 29, il sera possible d’interjeter appel des décisions du Tribunal de première instance dans les 90 jours. L’appel pourra s’appuyer sur les moyens suivants :
– une erreur dans l’interprétation ou l’application de la loi ;
– une erreur manifeste dans l’appréciation des faits, y compris l’appréciation de la loi nationale pertinente ;
– l’un des cas de recours en nullité prévus par l’article 52 de la convention de Washington, pour autant qu’ils ne sont pas couverts par les deux moyens précédents.
Si le Tribunal d’appel confirme la sentence, celle-ci devient définitive. À l’inverse, il peut infirmer ou modifier la décision, en tout ou partie. Il peut aussi rejeter l’appel sans délai lorsque celui-ci apparaît manifestement infondé.
S’inspirant de la procédure d’appel de l’OMC, celle de l’ICS serait enserrée dans des délais très stricts puisqu’elle ne pourrait, en principe, excéder 180 jours. Ce délai relativement court est un point fondamental pour les entreprises qui ne sont favorables à un appel – qui n’existe pas dans l’arbitrage commercial – qu’à la condition qu’il ne rallonge pas inconsidérément la procédure. Dans des cas exceptionnels toutefois, dont les parties seraient informées, un délai supplémentaire de 90 jours pourrait être accordé, portant la durée totale de la procédure d’appel à 270 jours au maximum.
Par conséquent, cet ICS respecte parfaitement les recommandations de la résolution du Parlement européen du 8 juillet dernier. Maintenant le RDIE dans le PTCI, cette résolution appelait la Commission européenne à « remplacer le système RDIE par un nouveau système de règlement des litiges entre investisseurs et États, soumis aux principes et contrôle démocratiques, où les affaires éventuelles seront traitées dans la transparence par des juges professionnels indépendants, nommés par les pouvoirs publics, en audience publique, et qui comportera un mécanisme d'appel, dispositif qui garantira la cohérence des décisions de justice et le respect de la compétence des juridictions de l'Union européenne et de ses États membres et qui évitera que les objectifs de politique publique soient compromis par des intérêts privés ». Il n’est donc pas étonnant que cette proposition ait été favorablement reçue par la majorité des groupes du Parlement européen, à la seule exception du groupe Écologiste et de quelques eurodéputés du groupe S&D.
B. DEUX VOIES QUI, MALGRÉ DES AVANCÉES CERTAINES, RESTENT INSATISFAISANTES MAIS POUR DES RAISONS DIFFÉRENTES
Si les réformes du mécanisme arbitral dans le cadre de l’AECG (version initiale) ainsi que les initiatives de la France et de la Commission européenne visant à améliorer un RDIE qui, de l’avis général, dysfonctionne, constituent des avancées certaines, force est de reconnaître que les deux voies possibles d’amélioration du RDIE sont également insatisfaisantes mais pour des raisons différentes :
– toutes les améliorations possibles de l’arbitrage ne répondront jamais à la critique concernant la présomption d’illégitimité d’un tribunal arbitral privé pour régler des différends impliquant des choix de politique publique. C’est sans doute la raison pour laquelle les tribunaux arbitraux ont disparu de la version finale de l’AECG au profit de l’ICS (1) ;
– si la proposition de la Commission européenne de créer une cour bilatérale permanente dans le PTCI supprime cette présomption d’illégitimité, sa mise en œuvre pratique se heurte à des difficultés (2).
1. Toutes les améliorations apportées aux tribunaux d’arbitrage n’ont pas supprimé son défaut majeur : la présomption d’illégitimité
La légitimité du RDIE ne se déduit pas de son utilité. Bien qu’il soit très certainement utile dans le cas des pays ne présentant pas toutes les garanties d’efficacité et d’indépendance de la justice, la légitimité du RDIE découle, dans les faits, de sa forme et des modalités de son fonctionnement. Or, quel que soit l’angle d’analyse, on retrouve toujours, dans le RDIE actuel dont la forme est celle d’un tribunal arbitral, des personnes privées, nommées et payées par les parties, dont un investisseur privé, investies du pouvoir de régler, hors de tout contrôle démocratique, un différend portant sur un choix souverain de politique publique.
Bien sûr, votre rapporteure est la première à reconnaître que le fonctionnement du système arbitral peut être amélioré en vue de supprimer les défauts identifiés supra. L’AECG, dans sa version initiale, était un bon exemple des améliorations qu’il est possible d’apporter au système. Il est d’ailleurs tout à fait concevable que, mises bout à bout, l’ensemble de ces améliorations finissent par aboutir à un système tout à fait satisfaisant du point de vue de son fonctionnement.
Toutefois, même si l’ensemble de ces améliorations du système arbitral étaient mises en œuvre, elles ne changeraient rien à la présomption d’illégitimité qui pèse sur ce système. En effet il ne doit pas seulement être objectivement impartial mais également avoir l’apparence de l’impartialité. En effet, depuis que la théorie de l’apparence a été formulée par le Lord Chief Justice of England dans l’arrêt The King c/ Sussex Justices (1923), une grande importance est accordée à l’apparence d’impartialité. En effet, est impartial le tribunal qui non seulement ne manifeste aucun parti pris (impartialité subjective) et offre toutes les garanties procédurales (impartialité objective), mais ne laisse en outre aucun doute quant à son impartialité, même en apparence. La Cour européenne des droits de l’homme l’a reprise à son compte dès l’arrêt Delcourt c/ Belgique (1970) et l’a défendue depuis lors en raison de « l’importance fondamentale qu’il y a à ce que les tribunaux d’une société́ démocratique inspirent confiance aux justiciables » (arrêt Farhi c/ France 2007) (84).
Or, quelles que soient leurs qualités et leur attachement à l’indépendance, les arbitres feront toujours l’objet d’une suspicion de partialité en raison, non de leur personne mais du fait qu’ils sont nommés et payés par les parties, y compris un investisseur privé. Pour de nombreux Européens, ce simple fait, consubstantiel à l’arbitrage, mine la légitimité du tribunal arbitral pour trancher des différends impliquant un État.
Votre rapporteure est donc animée par une double conviction. Oui, le RDIE sous la forme arbitrale peut, à force d’améliorations, être rendu objectivement impartial mais l’apparence d’impartialité lui fera toujours défaut, le rendant difficilement acceptable par une partie de l’opinion publique.
Pendant des mois, la Commission européenne comme le Canada ont dit et répété que les négociations de l’AECG étaient closes depuis le 26 septembre 2014 et qu’ils n’étaient pas question de les rouvrir. Certes, un « toilettage juridique » de l’accord était en cours mais celui-ci ne pouvait apparemment pas être utilisé pour modifier de manière substantielle ses dispositions.
Toutefois, trois changements sont intervenus au cours de l’année 2015 qui ont abouti, sans le formuler clairement, à une renégociation du RDIE de l’AECG dans un sens cohérent avec la position européenne dans le PTCI.
Le premier changement est l’entrée en fonction de la nouvelle Commission présidée par M. Jean-Claude Juncker, au sein de laquelle le portefeuille du Commerce a été attribué à Mme Cecilia Malmström. Celle-ci s’est montrée plus ouverte que son prédécesseur aux inquiétudes du Parlement européen, des Parlements nationaux et de la société civile s’agissant des risques du RDIE en général comme du manque de transparence des négociations du PTCI. Parallèlement, M. Justin Trudeau est devenu le nouveau Premier ministre du Canada et d’emblée, a fait savoir sa volonté d’aller vite dans la mise en œuvre de l’AECG, y compris en levant l’hypothèque que pouvait constituer les tribunaux arbitraux. Le fait qu’il n’ait pas négocié lui-même cet accord rendait évidemment plus facile un tel changement de position.
A ce changement dans les instances dirigeantes de l’Union européenne et du Canada s’est ajoutée la clarification de la position du Parlement européen. Dans sa résolution du 8 juillet 2015, celui-ci a énoncé ce qui pouvait apparaître comme des « lignes rouges » en matière de règlement des différends, montrant sa préférence pour un système juridictionnel par rapport à des tribunaux arbitraux. Certes, cette résolution concernait, d’une manière générale, le PTCI mais la position affirmée par le Parlement européen était tout à fait applicable à l’AECG. La ratification par celui-ci de cet accord contenant un RDIE sous forme arbitrale apparaissait donc hautement incertaine.
Enfin, prenant acte de la position du Parlement européen, la Commission a élaboré une proposition d’International Court System dans le cadre du PTCI dont elle a fait savoir qu’elle était désormais la position européenne pour tous les accords d’investissement à venir. Le statu quo sur le RDIE de l’AECG devenait ainsi intenable, d’autant plus que le Vietnam avait accepté, in extremis, juste avant la conclusion des négociations, d’intégrer l’ICS dans son accord de libre-échange avec l’Union européenne.
Dans ces conditions, il a bien fallu se rendre à l’évidence, de part et d’autre de l’Atlantique, qu’il était difficile de conserver les tribunaux arbitraux dans l’AECG, sauf à lui faire courir un risque majeur au Parlement européen. C’est pourquoi le 29 février 2016, la Commission européenne et le gouvernement canadien ont annoncé à la fois la fin du « toilettage juridique » de l’AECG et l’intégration en son sein de « l’ensemble des principaux éléments» de la proposition européenne relative à l’ICS.
Votre rapporteure a comparé la proposition européenne d’ICS dans le cadre du PTCI avec les nouvelles dispositions relatives au RDIE dans la version finale de l’AECG et confirme que les tribunaux arbitraux ont bien été supprimés au profit de l’ICS, système juridictionnel composé d’un tribunal de première instance et d’un tribunal d’appel dont les membres, nommés pour cinq ans par le comité mixte de l’AECG, ne pourront être simultanément avocats ou experts dans d’autres différends.
Toutefois, votre rapporteure a relevé une substantielle différence s’agissant du tribunal d’appel. En effet, alors que, dans la proposition européenne présentée dans le cadre du PTCI, le tribunal d’appel est directement opérationnel, il n’en va pas de même dans l’AECG. L’article 8.28 du chapitre 8 stipule que le Comité mixte « devra adopter rapidement une décision établissant les dispositions suivantes relatives à l’organisation et l’administration du tribunal d’appel », notamment « les procédures pour l’introduction et la conduite des appels » ou encore « la rémunération des membres du tribunal d’appel ». Dans la proposition européenne présentée dans le cadre du PTCI, la rémunération des membres du tribunal d’appel est fixée dans son texte même et les procédures seront établies non par un comité mixte mais par le tribunal lui-même. Par conséquent, comme l’indique la Commission dans son communiqué de presse du 29 février dernier, cette décision du comité mixte est « nécessaire pour rendre opérationnel le tribunal d’appel ».
Enfin, par rapport à la version initiale de l’AECG, la section du chapitre 8 sur la protection de l’investissement s’ouvre par un nouvel article 8.9 dont le premier alinéa stipule que « pour l’application de ce chapitre, les parties réaffirment leur droit à réguler sur leur territoire pour réaliser leurs objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé publique, la sécurité, l’environnement ou la moralité publique, la protection des consommateurs et de la société et la promotion et la protection de la diversité culturelle ». Cet alinéa est complété, « pour davantage de certitude », par trois alinéas :
– « le simple fait qu’une partie réglemente, y compris par une modification de ses normes juridiques, d’une manière qui affecte négativement un investissement ou interfère avec les attentes d’un investisseur, y compris ses attentes de profits, ne constitue pas une violation des dispositions de cette section » ;
– « la décision d’une partie de ne pas accorder, renouveler ou maintenir une subvention, en l’absence d’un engagement spécifique par la loi ou par contrat d’accorder, renouveler ou maintenir cette subvention, ou conformément aux termes ou conditions attachés à cette subvention, ne constitue pas une violation des dispositions de cette section » ;
– enfin, « rien dans cette section ne doit empêcher une partie de cesser d’accorder une subvention ou d’exiger son remboursement si une telle mesure est nécessaire pour se conformer aux obligations internationales entre les parties ou a été ordonnée par une cour, un tribunal administratif ou une autorité compétente, ou d’imposer à la portée de compenser l’investisseur ».
En conclusion, non seulement le texte final de l’AECG a fait disparaître les tribunaux arbitraux intrinsèquement illégitimes de son RDIE mais il a, parallèlement, encore renforcé la protection du droit à réguler des États.
En préalable, votre rapporteure prend acte de l’initiative de la Commission européenne de proposer, dans le cadre du PTCI, de supprimer les tribunaux arbitraux et de leur substituer un système de cour d’investissement. Toutefois, elle s’interroge sur les nombreux obstacles auxquels la Commission européenne va se heurter, dans le PTCI, dont les négociations sont toujours en cours, mais également pour la mise en œuvre de cet ICS dans l’AECG.
La proposition française présentait une faiblesse majeure par ailleurs identifiée comme telle par le gouvernement : « la possibilité que cet avis [négatif de la Cour permanente d’appel] soit juridiquement contraignant pour le tribunal arbitral ne va pas nécessairement de soi au regard de la convention de Washington ». Les professionnels du droit auditionnés sur ce point par votre rapporteure ont clairement indiqué qu’une telle disposition n’était pas compatible avec la convention de Washington aux termes de laquelle une sentence est définitive (article 54).
Parce qu’elle propose un changement de paradigme en supprimant les tribunaux arbitraux, on pourrait penser que l’ICS ne comporte pas la même faiblesse juridique. Or il n’en est rien, en raison des fréquents renvois de celle-ci à la convention de Washington et, surtout, de l’un d’entre eux. En effet, l’article 6 de la sous-section 3 de la proposition de la Commission stipule que parmi les systèmes de règles d’arbitrage en vertu desquels une plainte peut être valablement soumise au Tribunal de première instance figurent la convention de Washington. Une disposition identique se retrouve à l’article 8.23 de l’AECG. Le même risque d’incompatibilité tenant, notamment à l’instance d’appel, se retrouve donc dans la proposition européenne.
Une éventuelle porte de sortie serait d’appliquer l’article 41 de la convention de Vienne pour déroger à la convention de Washington. En effet, aux termes de cet article, deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité ou si la modification en question n’est pas interdite par le traité. La convention de Washington ne prévoyant pas une telle dérogation, celle-ci ne serait possible qu’à condition de n‘être pas interdite, c’est-à-dire qu’elle :
– « ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations ; et
– ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensemble ».
En l’espèce, c’est cette dernière condition qui pourrait poser des difficultés. En effet, dès lors que la Convention de Washington vise à instaurer une procédure rapide et efficace de résolution des différends et, à cette fin, interdit de faire appel des sentences, la compatibilité d’une instance d’appel rallongeant et compliquant la procédure avec cet objet apparaît délicate.
Une autre porte de sortie serait la possibilité que l’article 52 de la convention de Washington soit interprété de manière large : le fait qu’un tribunal commette une erreur de droit manifeste pourrait, si un comité ad hoc le décidait, constituer un « défaut de motivation ». Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de modifier la convention de Washington et un appel en droit des sentences arbitrales deviendrait juridiquement possible. Évidemment, il faudrait qu’un comité ad hoc prenne une décision en ce sens, ce qui ne va déjà pas de soi selon les professionnels du droit consultés et, surtout que les autres comités le suivent dans leur examen des futures sentences. Il n’en reste pas moins qu’après la sentence APPL c/ Sri Lanka précitée, qui a reconnu à un investisseur la possibilité de mettre en œuvre le RDIE en dehors du cadre contractuel, ce serait la deuxième fois que des arbitres transformeraient radicalement le fonctionnement du RDIE.
En outre, une modification de la Convention de Washington pourrait être nécessaire pour consolider juridiquement l’éventuel ICS.
Enfin, la dernière incertitude juridique que soulève la création de cet ICS, comme d’ailleurs le RDIE lui-même, est sa compatibilité avec le droit européen. L’étude précitée de l’ONG ClientEarth considère que ce n’est pas le cas, compte tenu notamment de l’exclusivité reconnue à la Cour de justice (et au TPI) pour « assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ». En revanche, pour la Commission, cette exclusivité n’est pas menacée puisque les tribunaux arbitraux (ou l’ICS, le cas échéant) n’interprètent et n’appliquent pas tant le droit européen que les dispositions de l’accord, sans d’ailleurs d’effet dans l’ordre juridique européen puisqu’ils ne peuvent imposer le retrait de la mesure contestée, quand bien même elle violerait ledit accord.
Votre rapporteur n’a pas la prétention de trancher ici un problème juridique éminemment complexe. Toutefois, elle rappelle qu’aux termes de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités ». Par conséquent, la Commission ayant déjà fait savoir, selon la presse (85), qu’elle ne saisirait pas la Cour sur cette question de la compatibilité du RDIE avec les traités, il appartiendra au Parlement européen ou au gouvernement français, s’ils le souhaitent, de lui donner l’occasion d’apporter une réponse définitive à cette question.
Les États-Unis, comme la France d’ailleurs et de nombreux
États-membres de l’Union européenne, n’ont jamais été condamnés par un tribunal arbitral suite à un différend avec un investisseur, ni dans le cadre de l’ALENA ni d’un quelconque autre TBI.
En conséquence, ont-ils intérêt à voir le RDIE sous forme de tribunal arbitral réformé ? Ne s’accommodent-ils de cette forme et de l’absence de mécanisme d’appel des sentences ? Il convient de souligner que s’agissant de ce point, la possibilité de créer un tel mécanisme figure explicitement dans nombre de TBI signés par les États-Unis, depuis 2002 (par exemple avec le Chili, le Maroc ou Singapour). Toutefois, elle n’a jamais été concrétisée pour une raison qui a été très clairement expliquée à votre rapporteure : ouvrir la possibilité d’un appel des sentences arbitrales n’est pas dans l’intérêt des États-Unis mais dans celui des seuls investisseurs puisque toutes les sentences arbitrales ont été défavorables à ces derniers. Contrairement à l’Union européenne, qui soutient cette possibilité d’appel dans l’ICS, les États-Unis ont depuis longtemps rejeté cette éventualité sur le seul fondement de leur intérêt propre.
Votre rapporteure a d’ailleurs été très sensible à cette différence de culture qui voit les Européens réfléchir à un RDIE idéal, conforme à l’idée qu’ils se font de la justice, et les Américains défendre un RDIE favorable à leurs seuls intérêts. Ainsi, pour ces derniers, un appel est peut-être une bonne chose dans l’absolu mais une mauvaise pour eux qui gagnent à tous les coups.
D’une manière générale, les États-Unis ne semblent pas avoir fait un accueil favorable à la proposition européenne. En effet, d’après M. Mauro Petriccione, directeur général adjoint du commerce à la Commission du commerce international du Parlement européen le 21 septembre, « les États-Unis sont inquiets des coûts supplémentaires [de l’ICS] pour les entreprises, de la complexité du système et d’un bénéfice moindre pour les investisseurs américains que ce qu’ils avaient en tête ». La Chambre de commerce américaine a été quant à elle plus brutale : selon sa vice-présidente pour les affaires européennes, M. Marjorie Chorlins, « les milieux d’affaires américains ne peuvent en aucun cas adhérer à la proposition européenne ». Bien plus, elle considère que « les réformes [du RDIE] que les États-Unis ont mises en œuvre ces dernières années dans leurs propres TBI sont une base de négociation plus intéressante ».
En effet, c’est un autre point qu’il convient de souligner. Les États-Unis ont eux aussi, dans les premières années de mise en œuvre de l’ALENA, été confrontés aux mêmes questions qui se posent aujourd’hui à l’Union européenne, qu’il s’agisse de la protection du droit à réguler des États ou de la procédure arbitrale elle-même. Les modèles de TBI successifs des États-Unis ainsi que leurs TBI eux-mêmes reflètent les réponses qu’ils ont apportées à ces questions.
Ce serait donc une erreur que de croire que les États-Unis ne partagent pas la volonté européenne de protéger le droit à réguler ou d’améliorer la procédure arbitrale pour la rendre plus efficace et légitime. Leurs réponses sont juste différentes et, contrairement à l’Europe, ils croient qu’il n’est pas nécessaire de remettre en cause le RDIE sous sa forme arbitrale pour atteindre ces objectifs.
Ce fut le propos de l’Ambassadeur américain auprès de l’Union européenne, M. Anthony Gardner, lors d’une récente interview (86). Rappelant que la résolution du Parlement européen appelait à un « nouveau système de règlement des litiges entre investisseurs et États », il répond : « nous sommes d’accord ». Mais il précise aussitôt que « nous avons eu le même cheminement il y a quelques années ; Après trois ans de consultations, le résultat a été un nouveau modèle de TBI qui inclut ce que nous pensons être un RDIE réformé ».
Enfin, dans l’accueil circonspect fait à la proposition européenne d’Investment Court System, deux facteurs, l’un structurel et l’autre conjoncturel, sont à prendre en considération :
– les États-Unis sont historiquement méfiants vis-à-vis des institutions internationales et, plus encore, des juridictions internationales. Ce pays a ainsi signé mais jamais ratifié la convention de Rome (1998) créant la Cour pénale internationale et, lorsqu’ils ratifient un traité multilatéral comportant des clauses juridictionnelles, c’est toujours en l’assortissant de réserves qui, en pratique, les rendent inapplicable contre eux (87).
– les négociations du TPP ont été achevées le 5 octobre et ce traité, maintenant que son texte a été rendu public, comporte un RDIE sous sa forme arbitrale. C’est un RDIE amélioré comme l’annonçaient les autorités américaines, prenant en compte, comme celui de l’AECG, les (mauvaises) expériences passées afin de protéger le droit à réguler des États.
Stratégique ou pas, cet accueil mitigé de la part des Américains laisse présager une négociation difficile sur ce point. En effet, la Commission européenne doit alors convaincre les Américains de se rallier à sa proposition. Or, ainsi qu’il a été dit supra, ceux-ci se satisfont parfaitement du RDIE sous sa forme arbitrale, il semble donc difficile qu’ils acceptent l’ICS, du moins sans obtenir d’importantes concessions de la part de l’Union européenne.
Par conséquent, l’effet de cette proposition d’ICS pourrait être pour le moins paradoxal : pour conjurer le risque hypothétique du RDIE sur le droit à réguler, l’Union européenne pourrait être contrainte, en contrepartie de l’adoption de l’ICS et pour sortir d’une éventuelle impasse, d’accepter de satisfaire davantage d’intérêts offensifs américains au détriment des siens. Or, il va sans dire que le « prix à payer » détermina la position des États-membres, du Parlement européen et, le cas échéant, des Parlements nationaux en cas de mixité du PTCI.
c. Les conséquences positives pour les États de l’ICS par rapport à un tribunal arbitral ne doivent pas être surestimées
La proposition de la Commission européenne est motivée avant tout par la nécessité de répondre aux critiques du RDIE formulées par certains États-membres – dont la France, le Parlement européen et la société civile. De fait, la proposition atteint cet objectif. Avec l’ICS, la critique portant sur la présomption d’illégitimité des tribunaux arbitraux n’a plus lieu d’être et votre rapporteure s’en félicite.
Toutefois, il n’est pas certain qu’un système juridictionnel en matière de différend État-investisseur se révèle à la hauteur des attentes que les États, en particulier européens, placent en lui. En effet, les avantages de l’ICS par rapport aux tribunaux arbitraux, mise à part l’apparence d’impartialité – élément fondamental - ne sont pas évidents. Votre rapporteure prendra trois exemples.
Le premier est l’éthique des juges de l’ICS. La différence majeure entre les règles qui leur seront applicables et celles applicables aux arbitres est l’incompatibilité, tout le temps de leur mandat, avec une quelconque fonction de conseil d’un investisseur. Rien n’interdit d’imposer la même obligation aux arbitres. C’est d’ailleurs exactement le sens de la proposition française : les arbitres inscrits sur la liste ne pouvaient en effet pas, « pendant la durée de leur mandat, faire office de conseillers juridiques pour l’une des parties au différend découlant d’accords relatifs aux investissements internationaux ou d’accords commerciaux internationaux ». L’ICS n’est donc pas une condition nécessaire pour renforcer les règles éthiques des arbitres ainsi que celles relatives à la prévention des conflits d’intérêt.
Le deuxième est la protection du droit à réguler des États. Il n’est pas plus certain dans le cadre d’un système juridictionnel car rien ne dit que les juges de l’ICS lui seront plus favorables en tant que tels que les arbitres. Une extension du filtre préalable - comme c’est le cas dans l’AECG pour les mesures fiscales et, plus encore, les mesures prudentielles (voir supra) - pourrait être plus efficace. Les États-Unis, sensibilisés depuis 2001 au risque posé par le pouvoir d’interprétation des arbitres, n’ont pas hésité à imposer, via la FTC, une interprétation contraire à la leur d’une disposition de l’ALENA. Ce pays pourrait donc accueillir favorablement une telle extension.
Enfin, troisième exemple, l’un des avantages majeurs attendus de l’appel est la possibilité qu’il offre de réparer d’éventuelles erreurs de droit ou de fait dans les sentences arbitrales. C’est d’autant plus important que celles-ci peuvent avoir des conséquences financières considérables pour les États. Un exemple d’erreur de droit est la sentence rendue dans l’affaire CMS c/ Argentine (2005). Cette sentence d’un tribunal CIRDI a fait l’objet d’un recours en annulation devant un comité ad hoc. Sa décision du 25 septembre 2007 mérite d’être largement citée : « la sentence contenait des erreurs de droit manifestes. Toutes ont été identifiées et soulignées par le comité. Cependant, le Comité est conscient que sa juridiction s’exerce dans les limites étroites du mandat confié par l’article 52 de la convention CIRDI. Le champ de ce mandat ne permet l’annulation que si des conditions spécifiques sont remplies. [Or], dans les circonstances présentes, le comité ne peut pas simplement substituer son interprétation du droit et son appréciation des faits à ceux du tribunal ». Votre rapporteure attire l’attention que l’appel n’est pas forcément une solution parfaite puisque, comme l’a rappelé un des professionnels du droit auditionné par votre rapporteur, une cour d’appel est tout autant susceptible de commettre de telles erreurs que le Tribunal de première instance. Enfin, l’appel est présenté à l’opinion publique comme un progrès dans le sens d’un meilleur règlement des différends, votre rapporteure s’interroge sur la réaction de celle-ci dans le cas, de condamnation en appel d’un État qui l’aurait emporté en première instance.
Si l’ICS améliore le RDIE tel qu’il existe en Europe, il est possible d’aller plus loin. Votre rapporteure attire ainsi l’attention sur trois dispositions qu’il serait utile de mettre en œuvre.
• Un mécanisme de soutien juridique aux PME pour leur rendre accessible le RDIE
Le coût moyen d’un différend entre un État et un investisseur atteint 8 millions de dollars, l’essentiel de ce coût découlant des frais d’avocat. Par conséquent, même si la Commission européenne affirme, s’appuyant sur une étude de l’OCDE (88), que les PME et les individus, représentent 22 % des cas de mise en œuvre du RDIE, il est évident que l’accès à l’ICS, mais surtout à des conseils spécialisés très expérimentés, leur est plus difficile compte tenu du coût de la procédure, et en particulier des honoraires d’avocats.
En l’absence d’alternative, votre rapporteure estime donc important que les PME, à l’instar des grandes entreprises, puissent elles aussi accéder au RDIE sans être contrainte par ledit coût. À cette fin, l’Union européenne pourrait proposer à ses partenaires – ou, le cas échéant, agir seule – de s’inspirer du centre consultatif sur la législation de l’OMC (Advisory Center for WTO Law – ACWL). Cet organisme, créé en 2001 et indépendant de l’OMC, a pour mission de fournir aux pays en voie de développement une aide juridique à la fois dans la compréhension des règles de l’OMC que dans leur application, en particulier dans le cadre d’un différend devant l’ORD ou l’Organe d’appel, qu’ils soient plaignants, défendeurs ou tierce parties.
Il convient de préciser que l’assistance de l’ACWL n’est pas gratuite. Toutefois, son coût est infiniment moins élevé que les honoraires d’un avocat spécialisé puisque, bien que facturé à l’heure, il ne peut pas dépasser les montants suivants, variables selon la catégorie à laquelle appartient le pays :
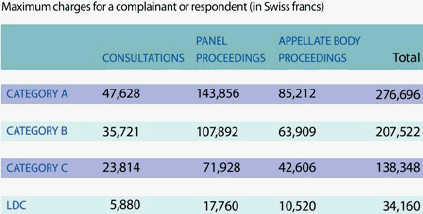
En 2014, l’ACWL a fourni aux pays en voie de développement 204 analyses des règles de l’OMC et fourni une aide juridique dans 8 différends. Depuis 2001, il est intervenu dans 45 différends, soit environ 20 % du total.
À supposer que l’Union européenne soit réticente à constituer un tel organisme, l’accès des PME au RDIE reposerait pour beaucoup d’entre-elles au recours à des tiers-financeurs. En effet, ces derniers financent la procédure arbitrale d’un investisseur en échange d’un pourcentage, plus ou moins important, de la compensation en cas de décision favorable. Toutefois, ces tiers-financeurs représentent un risque de dévoiement du RDIE en introduisant dans la procédure arbitrale une logique qui n’est pas juridique mais exclusivement financière.
Consciente de ce risque, la proposition de la Commission européenne contient ainsi une disposition (article 8 de la sous-section III) qui, sans interdire les tiers-financeurs, oblige la partie qui en bénéficie à indiquer son nom et son adresse à l’autre Partie et au tribunal. Une disposition identique figure désormais à l’article 8.26 de l’AECG. Cette obligation est très en retrait de la proposition française qui, elle, exigeait que les tiers-financeurs :
– n’interviennent pas dans la sélection des arbitres et veillent à ne pas mettre les arbitres en situation de conflit d’intérêt ;
– n’interviennent pas dans la procédure arbitrale ;
– préservent la confidentialité de tous les documents et de toutes les audiences auxquelles ils auraient accès.
Il est regrettable que la Commission européenne n’ait pas retenu cette proposition qui va dans le sens d’un meilleur encadrement d’une pratique qui, si elle peut présenter l’avantage de favoriser l’accès des PME au RDIE, fait néanmoins courir un risque pour le bon déroulement de la procédure.
Enfin, votre rapporteure attire l’attention sur l’article 8.39 de l’AECG qui permet aux tribunaux de l’ICS de mettre à la charge de la partie perdante les coûts de l’arbitrage, y compris les honoraires des avocats de la partie victorieuse. Les États l’emportant plus souvent que les investisseurs, cette clause leur est favorable et est de nature à décourager les plaintes abusives. Toutefois, il ne faut pas exclure que certaines PME soient découragées d’introduire une plainte si, in fine, elles devaient assumer non seulement leurs propres frais d’avocat mais également ceux de l’État qui, compte tenu de ses moyens, pourraient être très supérieurs. Il faut donc espérer que le tribunal fera une application raisonnable de cet article lorsque le plaignant sera une PME.
• Une amende pour procédure abusive
De la même manière que les tribunaux peuvent mettre à la charge de la partie perdante la totalité des coûts de l’arbitrage, la France a proposé que cette possibilité soit doublée par une amende en cas de procédure abusive. En effet, aujourd’hui, un tribunal arbitral (et demain, l’ICS) ne peut, en principe, rendre que deux types de sentence : soit il rejette la demande de l’investisseur, soit il l’accueille et, ce faisant, lui accorde une compensation équivalente au préjudice subi assortie, le cas échéant, d’intérêts.
Or, les plaintes abusives ont non seulement un coût pour l’État, obligé de payer arbitres et avocats, mais également un coût politique et médiatique qui, lui, ne peut être pris en compte dans une éventuelle sentence de rejet.
Dans l’ordre juridique interne, notamment français (89) et américain (90), lorsqu’il considère une action en justice comme abusive, le juge peut prononcer une amende civile à l’encontre de son auteur, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.
La France proposait que, dans le cas de plaintes manifestement dénuées de fondement juridique, une pénalité au plaignant pouvant atteindre 50 % de la compensation demandée puisse être infligée au requérant. Une telle disposition aurait incontestablement découragé les plaintes abusives et les demandes de compensation disproportionnées qui, en tant que telles, ne visent généralement qu’à faire pression sur l’État pour qu’il retire sa mesure. Il est donc regrettable que cette proposition n’ait pas été retenue par la Commission européenne.
• Un filtre préalable à la saisine
Les États sont les auteurs et maîtres des traités. Il s’ensuit qu’il leur est toujours possible de préciser le sens qu’ils souhaitent donner à telle ou telle clause. Dans les TBI de nouvelle génération – tels que l’AECG – cette possibilité est formalisée par la constitution d’un comité conjoint entre les parties qui, entre autres pouvoirs, peut adopter des interprétations contraignantes.
Ainsi qu’il a été dit supra, l’AECG préserve le droit, pour le Canada et l’Union européenne, d’interpréter eux-mêmes ce traité et, partant, de contrecarrer les interprétations des juges qu’ils estimeraient aller au-delà de leurs intentions. En outre, dans le cas de différends portant sur une mesure fiscale ou une mesure de régulation du système financier, une procédure spécifique est prévue préalablement à la saisine du tribunal arbitral. L’État visé par la plainte a la possibilité de demander à un comité conjoint de considérer que la mesure fiscale est conforme aux dispositions du traité et que la mesure de régulation du système financier relève bien de l’exception prudentielle prévue par l’article 15 du chapitre 15, devenu l’article 13.21 du chapitre 13. Dans le premier cas, la décision liera le tribunal et, dans le second, l’auteur de la plainte sera réputé s’être désisté.
Ainsi, le Canada et l’Union européenne ont limité ce filtre interétatique aux mesures fiscales et aux mesures de régulation du système financier. Ce choix est, d’une certaine manière, compréhensible puisqu’il s’agit de protéger deux domaines très sensibles que sont les ressources publiques, d’une part, et le système financier national, d’autre part.
Une telle extension à d’autres domaines est toujours envisageable et présenterait de nombreux avantages :
– les États garderaient la main sur l’interprétation que font les arbitres ou les juges de mesures portant sur des questions politiquement très sensibles ;
– le filtre n’entraîne pas de perte de temps pour l’investisseur, pour autant que sa mise en œuvre soit encadrée dans des délais stricts, comme c’est le cas pour l’AECG ;
– c’est seulement en cas d’accord entre les deux États sur le sens à donner à une disposition que leur interprétation s’imposerait. En cas de désaccord, l’investisseur pourrait valablement saisir le tribunal.
3. La création d’une cour multilatérale est le seul moyen permettant un règlement légitime et efficace des différends entre les États et les investisseurs
Les débats concernant le RDIE se focalisent aujourd’hui sur l’ICS. Toutefois, celui-ci malgré l’avantage majeur qu’il présente par rapport aux tribunaux arbitraux ad hoc, n’est qu’un palliatif à l’absence d’une cour multilatérale qui est, pour votre rapporteure, la véritable solution.
En effet, le choix de l’Union Européenne de multiplier les accords bilatéraux avec ses principaux partenaires résulte de l’enlisement des négociations multilatérales. S’agissant des règles relatives à l’investissement, la dernière tentative sérieuse de multilatéraliser le droit international en la matière remonte à l’AMI (voir supra). Le multilatéralisme semble donc figé depuis les années 90 alors même que l’économie mondiale a connu depuis cette époque de formidables transformations.
En effet, la multiplication des TBI à travers le monde cumulée à l’explosion et la transformation des flux d’investissement conduisent, plus que jamais, à la nécessité d’élaborer des règles multilatérales. Or, ces règles communes aux États sont inséparables d’un mécanisme unique de règlement des différends qui, logiquement, doit prendre la forme d’une Cour internationale.
Par conséquent, créer une telle Cour dans un cadre bilatéral, comme le propose la Commission européenne, ne peut être qu’une première étape, à supposer qu’elle soit franchie, ouvrant la voie à une Cour multilatérale. L’article 12 de la sous-section 4 relative à l’ICS le reconnaît d’ailleurs explicitement : « à partir de l’entrée en vigueur entre les parties d’un accord international comportant un tribunal multilatéral d’investissement et/ou un mécanisme d’appel multilatéral applicable aux différends fondés sur [le PTCI], les dispositions concernées de cette section cesseront de s’appliquer ». Une disposition similaire figure d’ailleurs désormais à l’article 8.29 de l’AECG qui, en outre, stipule que « les parties poursuivront avec leurs partenaires commerciaux l’objectif de l’établissement d’une cour multilatérale d’investissement et d’un mécanisme d’appel pour le règlement des différends portant sur l’investissement ».
Toutefois, avant d’en arriver à la Cour multilatérale, la commission européenne ne fait pas mystère de sa volonté d’introduire l’ICS dans tous les accords de libre-échange et/ou d’investissement en cours et à venir. Elle l’a d’ailleurs déjà fait avec l’AECG et dans l’accord de libre-échange avec le Vietnam.
À supposer qu’elle parvienne à convaincre tous ses partenaires actuels et futurs, les cours bilatérales d’investissement se multiplieront, ce qui n’ira pas sans poser quelques problèmes pratiques, à commencer par le recrutement du nombre nécessaire de juges dans un vivier relativement limité et avec de fortes contraintes en terme d’incompatibilité et de rémunération. Autrement dit, cette multiplication des cours bilatérales ne peut être que temporaire.
Créer une cour multilatérale imposera de résoudre un certain nombre de difficultés parmi lesquelles :
– le choix du cadre de négociation : compte tenu du précédent de l’AMI, il est douteux que l’OCDE puisse être retenu, d’autant plus que les pays en voie de développement et en transition, ne peuvent être écartés d’une réforme ambitieuse. L’OMC peut être une hypothèse envisageable. Par ailleurs, une modification de la convention de Washington pourrait également être pertinente, ce qui impliquerait un accord entre ses 159 signataires.
– les modalités de nominations des juges. S’agissant d’une juridiction multilatérale, les juges qui la composeraient seraient nécessairement, à l’instar de leurs homologues nationaux, tous nommés par les États. Toutefois, compte tenu du nombre d’États parties, ceux-ci ne pourraient pas avoir « leur » juge comme c’est le cas aujourd’hui dans les tribunaux d’arbitrage ou, le cas échéant, dans les éventuelles cours bilatérales. Dans ces conditions, le risque n’est pas exclu de nominations « politiques », résultant d’un marchandage entre les États et ce, alors même que l’objectif premier du RDIE est de dépolitiser les différends ;
– le partage des coûts. Une juridiction comme une cour multilatérale, compétente pour l’ensemble des différends entre les investisseurs et les États, représentera un coût annuel probable de plusieurs dizaines de millions d’euros qu’il faudra partager;
– le lieu du siège. La question du siège du CIRDI ne se pose pas puisqu’il relève de la Banque mondiale sise à Washington. Toutefois, même si la cour multilatérale était créée dans le cadre de la convention de Washington, les pays en voie de développement ou en transition plaideront probablement pour qu’elle ne soit pas située sur le territoire de l’un des États dont les investisseurs sont à l’origine du plus grand nombre de différends.
Outre ces problèmes très pratiques mais néanmoins surmontables, la création d’une telle cour multilatérale pourrait se heurter à deux types d’opposition plus fondamentale.
La première a déjà été évoquée supra. Certains États, à commencer par les États-Unis, sont historiquement opposés à toute juridiction supranationale. On rappelle qu’ils ont signé mais jamais ratifié la convention de Rome (1998) créant la Cour pénale internationale et, lorsqu’ils ratifient un traité multilatéral comportant des clauses juridictionnelles, c’est toujours en l’assortissant de réserves qui, en pratique, les rendent inapplicable contre eux. De même, ils ont toujours refusé la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Enfin, un dernier argument est évoqué par la Heritage Foundation dans une note récente (91) : « une cour internationale d’investissement consolidera le pouvoir diffus de tribunaux arbitraux aujourd’hui temporaires et ad hoc, créant de ce fait une cour mondiale surpuissante qui supervisera seule les 2 640 milliards de dollars annuels des flux d’investissement direct. Non seulement la responsabilité de cette cour sera limitée mais elle n’aura que peu de contre-pouvoirs. Aujourd’hui, les tribunaux arbitraux sont dissous après chaque sentence, précisément pour prévenir leur trop grande puissance. Une juridiction permanente aurait quant à elle un pouvoir impérial ». On retrouve dans cette citation l’obsession américaine des « Checks and balances », profondément enracinée dans leur histoire et leur droit, qui voient les Américains craindre les abus de pouvoir, quel qu’il soit, s’efforcer de le limiter par des contre-pouvoirs.
Ainsi, de la même manière qu’ils sont a priori défavorables à la cour bilatérale proposée par la Commission européenne dans le cadre du PTCI, ils risquent a fortiori de s’opposer à la cour multilatérale.
L’autre type d’opposition qu’il faut prévoir est celle des investisseurs eux-mêmes. En effet, l’ICS est ouvertement présenté comme le moyen d’assurer une meilleure protection du droit à réguler des États que celle actuellement permise par les tribunaux arbitraux. C’est pourquoi les juges de la Cour de première instance et de la Cour d’appel seront tous, choisis, nommés et payés par les États qui définiront seuls les règles procédurales applicables. Or, le choix des juges par les États et, plus encore, des présidents des deux tribunaux, sera fondamental dans l’orientation de leur jurisprudence. C’est un point sur lequel les États devront être attentifs : préserver l’apparence d’impartialité de la Cour par des nominations incontestables.
Votre rapporteure attire enfin l’attention sur la seule juridiction internationale permanente compétente en matière d’investissement : la Cour arabe des investissements. Créée par la convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de 1980, cette Cour, qui siège au Caire, est composée de cinq juges choisis par le conseil économique de la Ligue Arabe à partir d'une liste de proposition établie par les États membres. Contrairement à l’ICS, sa compétence en matière de différends relatifs à l'investissement est facultative. Or, il est intéressant de noter qu’opérationnelle depuis 1985, elle a rendu sa première décision en 2004 et n’est que très rarement saisie par les investisseurs arabes qui lui préfèrent le CIRDI. Par conséquent, il apparaît que lorsqu’ils ont le choix, les investisseurs préfèrent de loin une instance d’arbitrage à une cour permanente.
Le chemin vers la création d’une Cour multilatérale pour régler les différends entre les États et les investisseurs est donc long et semé d’embûches. Cependant, celle-ci doit être l’objectif ultime poursuivi par l’Union européenne.
La Commission s’est réunie le 2 février 2016, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.
L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat
La Présidente Danielle Auroi. Je tiens à remercier Seybah Dagoma pour son travail très précis sur ce sujet complexe. Ce midi, j’ai rencontré avec mes collègues sénateurs l’Ambassadeur des États-Unis à l’OMC, M. Michael Punke qui, très transparent, nous a dit que de son point de vue, les négociations du PTCI étaient suspendues au résultat de la prochaine élection présidentielle. En outre, les États-Unis, après avoir été mobilisés par les négociations du TPP, le sont aujourd’hui par la ratification de ce traité et, au-delà, par leurs rapports avec la Chine. Nous avons donc un peu de temps pour réfléchir aux modalités de réforme du RDIE.
Je voudrais maintenant attirer l’attention sur l’AECG dont les négociations, je le rappelle, sont aujourd’hui achevées. Comme le soutiennent les ONG, je pense qu’il serait pertinent que la Cour de justice se prononce sur la compatibilité du RDIE avec le droit européen préalablement à la ratification de ce traité.
Par ailleurs, si l’expérience canadienne de la négociation de l’AECG est intéressante, elle découle du fait que le Canada est un État fédéral, contrairement à l’Union européenne. Il peut donc être difficile de trouver une méthode qui satisfasse l’ensemble des États-membres qui, par ailleurs, sont divisés.
Mme Nathalie Chabanne. Je voudrais féliciter la rapporteure pour la qualité de son rapport. Le RDIE est un sujet important et j’aimerais revenir sur plusieurs points. La Commission européenne a proposé, dans le cadre du PTCI, de créer une cour bilatérale et permanente d’investissement pour régler les différends entre les États et les investisseurs, incluant un mécanisme d’appel. Or, il semble qu’elle ait renoncé à intégrer une telle Cour dans les autres traités, à commercer par l’AECG qui, comme on l’a dit, contient un RDIE classique sous forme de tribunal arbitral. Or, nombreuses sont les entreprises américaines présentes au Canada qui, de ce fait, pourraient en profiter pour attaquer les États-membres devant les tribunaux arbitraux et non devant la Cour bilatérale. Le risque est réel. Il suffit de voir le comportement d’entreprises américaines comme Philip Morris qui, après avoir racheté sa filiale hongkongaise, s’est appuyé sur le TBI entre Hong Kong et l’Australie pour attaquer la décision de cette dernière d’imposer le paquet de cigarettes « neutre ».
En outre, la proposition européenne ne me semble pas régler le problème de l’impartialité des juges de cette cour. Leur rémunération continuera à dépendre du nombre de plaintes d’investisseurs. Elle ne plafonne pas non plus le montant des compensations pouvant leur être versées, lesquelles peuvent être très supérieures à l’investissement réel puisque sont également prises en compte leurs « attentes légitimes ». Je rappelle que l’énergéticien suédois Vattenfall réclame pas moins de 4,7 milliards d’euros à l’Allemagne pour avoir programmé la fin du nucléaire avec cette précision que ses concurrents allemands, eux, n’ont accès qu’aux seuls tribunaux allemands.
Enfin, il est regrettable que la proposition européenne n’ait pas retenu la proposition française d’imposer des amendes aux investisseurs en cas de plainte abusive.
Mme Seybah Dagoma, rapporteure. La question de la saisine de la Cour de justice pour s’assurer de la compatibilité de l’AECG et des autres accords avec le droit européen ne relève pas des Parlements nationaux. Aux termes de l’article 218 du TFUE, seuls le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États-membres peuvent introduire une telle requête.
Je rappelle que la Commission européenne a bien l’intention d’introduire l’ICS dans l’ensemble de ses accords d’investissement à venir. La question est plus délicate, en effet, pour l’AECG, dont les négociations sont achevées.
Il va de soi que les exemples de Vattenfall et de Philip Morris sont scandaleux et je reviens longuement, dans mon rapport, sur ces affaires et sur les critiques qu’elles ont suscitées contre le RDIE. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait qu’en décembre dernier, le tribunal arbitral a rejeté, pour incompétence, la plainte de Philipp Morris contre l’Australie.
S’agissant de la possibilité, pour les filiales canadiennes des entreprises américaines, de profiter de l’AECG pour poursuivre des États-membres devant un tribunal arbitral, encore faut-il que ces filiales soient à l’origine de l’investissement dans l’Union européenne et qu’elles y aient donc une activité réelle. L’AECG contient en outre des dispositions « anti-abus » afin d’éviter ce genre de pratique.
Les compensations ne sont effectivement pas plafonnées. Toutefois, même si les demandes des investisseurs peuvent apparaître colossales, on constate que dans les faits, ce qu’ils obtiennent des tribunaux arbitraux est très inférieur.
Enfin, comme vous, je regrette que la proposition française concernant les amendes pour plaintes abusives n’ait pas été retenue par la Commission.
Mme Nathalie Chabanne. L’un des avantages fréquemment avancés concernant l’arbitrage est la confidentialité qu’il offre aux investisseurs, notamment s’agissant des sommes qu’ils réclament. Une telle confidentialité nourrit évidemment les critiques contre le RDIE.
Mme Seybah Dagoma, rapporteure. Je suis très favorable à la transparence et, d’ailleurs, l’AECG prévoit une transparence totale de la procédure arbitrale, sous la seule réserve de la protection du secret des affaires.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
Ø Investisseurs
– M. Philippe ANDRAU : directeur des affaires juridiques du groupe Suez, M. Bruno HERVET, vice-président exécutif (division internationale) et Mme Anne GOURAULT, Directrice Déléguée aux Relations institutionnelles France
– M. François TRIBOT-LASPIERE : directeur-adjoint des affaires publiques du groupe Total et M. Thierry REVEAU DE CYRIERES, directeur grands contentieux
– M. Pierre EYMERY : directeur des affaires publiques de Veolia Environnement, M. David BERMAN, juriste et Marie-Thérèse SUART-FIORAVANTE, directrice des relations institutionnelles
– M. François DRIESEN : directeur juridique international du groupe EDF, Mme Delphine JACQUEMONT, directeur juridique international adjoint et Mme Véronique LOY, directrice-adjointe des affaires publiques
Ø États
– M. Lawrence CANNON : ambassadeur du Canada en France
– M. Pierre-Marc JOHNSON : négociateur de l’Accord économique et commercial global (AECG) pour le gouvernement du Québec
– Mme Yvonne STINSON : ministre-représentante du Mexique auprès des institutions de l’Union européenne
– Mme María DEL CARMEN SQUEFF : ambassadrice de l’Argentine en France
– Mme María de la PAZ DONOSO : ambassadrice de l’Équateur en France
– M. George MINA et M. Anton ABLAS, adjoint au chef de mission et Premier secrétaire de l’Ambassade d’Australie en France
– M. Jai MOTWANE : directeur des services et de l’investissement au département américain du commerce, négociateur du PTCI en charge des aspects liés à l’investissement
– M. François RIEGERT, conseiller à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, ancien ambassadeur de France à l’OMC
– M. Pierre HAUSSWALT, conseiller « Affaires commerciales multilatérales et européennes » au cabinet du Secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français de l’étranger
– M. Dan MULLANEY : négociateur américain du PTCI
Ø CIRDI, Arbitres, avocats et professeurs de droit
– Mme Anna JOUBIN-BRET : avocate et arbitre, ancienne conseillère juridique de la Division de l’investissement, de la technologie et du développement des entreprises de la CNUCED
– M. Arnaud de NANTEUIL : professeur de droit à l’Université du Maine
– M. Diego FERNANDEZ ARROYO : arbitre et professeur de droit à l’Institut d’études politiques de Paris.
– M. Gilbert GUILLAUME : arbitre, membre de la Cour permanente d’arbitrage et ancien Président de la Cour internationale de justice
– Mme Meg KINNEAR : Secrétaire générale du Centre international de règlement des différends sur les investissements (CIRDI)
– M. Alain PELLET : professeur de droit à l’Université de Paris Ouest (Nanterre), avocat et arbitre.
Ø Personnalités qualifiées
– Mme Amélie CANONNE, présidente de l’association internationale des techniciens, experts et chercheurs (AITEC)
– M. Pascal LAMY : président de l’Institut Jacques Delors, ancien Directeur général de l’OMC et ancien Commissaire européen au Commerce
– M. Nicolas ROUX, animateur du groupe TAFTA de l’association « Les amis de la Terre » et Mme Karine JACQUEMART, Directrice générale de FoodWatch
– Mme Catherine LALUMIERE : ancienne ministre et députée européenne
Ø Institutions européennes
– M. Jean-Luc DEMARTY : directeur général du commerce (DG Trade), Commission européenne
– M. Dietmar KÖSTER : député européen, membre de la commission des affaires juridiques du Parlement européen
– M. Emmanuel MAUREL : député européen, membre de la commission du commerce international du Parlement européen.
Ø Personnalités rencontrées au Canada
– M. Louis BELANGER : professeur de science politique
– M. Hervé PRINCE : directeur de l’Observatoire de l’intégration économique de la Faculté de droit de l’Université de Montréal,
– M. Thierry WARIN : professeur agrégé au Département d’affaires internationales d’HEC Montréal, et vice-président Stratégie et économie internationales au CIRANO
– Me Yves FORTIER : avocat spécialiste en arbitrage international
– Mme Françoise BERTRAND : présidente-directrice général de la Fédération des chambres de commerce du Québec
– M. Guillaume HEBERT : chercheur de représentant de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques
– Mme Johanne WHITTOM : directrice de cabinet associée et conseillère principale au cabinet du premier ministre du Québec,
– M. Éric THEROUX : sous-ministre adjoint aux politiques et affaires francophones et multilatérales
– M. Marcelin JOANIS : spécialiste d’économie politique et d’économie publique, Ecole polytechnique
– Mme Christine SAINT-PIERRE : ministre des Relations internationales et de la Francophonie
– Mme Sophie SCHRAM : doctorante en études européenne, Université de Trèves
– M. Jacques CHAGNON : président de l’Assemblée nationale du Québec
MM. Marc TANGUAY, Michel MATTE, Jean-François LISE, Donald MARTEL, Maka KOTTO et Mme Claire SAMSON : députés (Assemblée nationale du Québec)
– M. Jean CHAREST : ancien premier ministre du Québec
– M. Charles VALLERAND : directeur général de la Coalition pour la diversité culturelle
– M. Nicolas CHAPUIS : Ambassadeur de France
– M. Serge JOYAL : sénateur, Association inter-parlementaire Canada-France
– MM. Yvon GODIN et Jacques GOURDES, Mme Elaine MICHAUD : députés (Chambre des communes)
M. Perrin BEATTY : président de la Chambre de commerce du Canada
Mme Susan SCOTTI : vice-présidente adjointe du Conseil canadien des chefs d’entreprise
M. Ed FAST : ancien ministre du Commerce international
M. Randy HOBBACK : Président du comité permanent du Commerce International de la Chambre des Communes
M. Matthew LEVIN : directeur général Europe Asie du MAECD
M. Patrick FAFARD : professeur à l’Université d’Ottawa
M. Steve VERHEUL : négociateur Canada du CETA
Mme Karen KENNEDY : directrice au Secrétariat de l’ALENA
Mme Sylvie TABET : directrice du droit des services d’investissements au ministère des affaires étrangère et du commerce du Canada
1 () La France a par exemple 11 TBI avec des États-membres de l’UE : la Bulgarie, la Croatie, les Républiques Tchèque et Slovaque, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, Malte et la Hongrie. Il convient de souligner que, d’une manière générale, la Commission européenne considère les TBI intra-européens comme contraires au droit européen. Le 18 juin dernier, elle a décidé de poursuivre devant la Cour européenne de Justice 5 États-membres pour avoir maintenu de tels TBI.
2 () « Les sujets du Roi Très Chrétien ne paieront, dans les ports, havres, rades, contrées, îles, cités et lieux des États-Unis ou d’aucun d’entre d’autres ni plus grands droits et impôts que ceux que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer et ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunités et exceptions en fait de négoce, navigation et commerce dont les nations susdites jouissent ou jouiront ».
3 () C’est ainsi que Louis Napoléon Bonaparte, alors Président de la République, a rendu une sentence d’arbitrage dans un différend entre les États-Unis et le Portugal sur l’indemnisation par celui-ci de ressortissants américains.
4 () Il convient de préciser toutefois que malgré son nom, cette Cour fonctionne plus à la manière d’un secrétariat administratif facilitant le recours à l’arbitrage par les États qu’à une véritable juridiction. Les membres de la Cour sont ainsi des arbitres nommées par les États (4) pour six ans, les parties pouvant choisir parmi eux pour constituer un tribunal adhoc.
5 () D’autres commissions mixtes ont par la suite été créées, notamment par la France. Par exemple, la commission France/Venezuela en 1903 ou la commission France/Mexique en 1924, toutes les deux pour régler des différends consécutifs aux troubles politiques qu’avaient connus ces pays à cette époque et ayant causé des préjudices à des ressortissants français.
6 () Droit international de l’investissement (2014).
7 () Affaire République d’Italie c/ République de Cuba (2008).
8 () Comme le dit la CIJ dans son arrêt Emprunts serbes et brésiliens (1928), « tout contrat qui n’est pas contrat entre États en tant que sujets de droit international a son fondement dans une loi nationale ».
9 () Cour internationale de justice : Compétence des tribunaux de Dantzig (1928).
10 () La doctrine Calvo, est une doctrine du droit international selon laquelle les personnes vivant dans un pays étranger doivent faire valoir leurs droits dans le cadre de la compétence des tribunaux locaux, en évitant le recours à la pression diplomatique ou l'intervention militaire de son propre État ou de gouvernement. Cette doctrine a été recueillie dans plusieurs constitutions de pays de l'Amérique latine.
11 () Les données statistiques sur l’expropriation d’IDE montrent qu’elles se sont multipliées dans les années 1960 et 1970 et ont été beaucoup plus rares par la suite. Il y aurait eu 136 expropriations dans les années 1960 et 423 dans les années 1970 mais plus que 17 en 1980, 22 dans les années 1990 et 27 de 2000 à 2006.
12 () Il convient toutefois de signaler que la Commission européenne avait milité, à l’époque, pour que les négociations aient lieu dans le cadre de l’OMC. Dans sa communication intitulée « L’uniformisation à l’échelle mondiale des règles applicables à l’investissement direct », rendue publique le 22 mars 1995, elle considérait que « l’OMC est déjà compétente pour des questions liées directement ou indirectement à l’investissement. Compte tenu des relations multiples et étroites entre le commerce et l’investissement, la matière serait aussi compatible avec le mandat de l’Organisation ». En d’autres termes, la Commission soutenait l’ouverture d’un « Uruguay round de l’investissement » afin d’élaborer un instrument multilatéral de libéralisation et de protection des investissements. Aux yeux de la Commission, l’enceinte la plus adaptée à cette négociation n’était pas l’OCDE mais bien l’OMC. Toutefois, elle n’a pas été suivie sur ce point par le Conseil qui a préféré la solution de l’OCDE. Parce que cette organisation rassemble les seuls pays développés, lui confier les négociations devait permettre une libéralisation et une protection plus élevée des investissements qu’en y associant les pays en voie de développement.
13 () Même si, pour la négociation du PTCI, des progrès ont été accomplis pour la transparence des négociations par rapport à celles de l’AECG.
14 () Une autre tentative, certes moins large, est le projet de zone de libre-échange des Amériques, qui aurait comporté un chapitre sur l’investissement. Il a lui aussi échoué suite à la mobilisation de la société civile.
15 () Cet accord, initialement signé par cinq États, comporte aujourd’hui dix parties.
16 () Ce Traité ne se limite pas aux seuls pays européens mais inclut également des pays non européens comme l’Australie, le Japon ou encore des pays d’Asie centrale.
17 () « Différend entre investisseurs et États : prévention et mode de règlement autres que l’arbitrage » (2010).
18 () Dès lors qu’une telle loi est adoptée, l’investisseur n’a plus qu’à accepter les éventuelles conditions
posées par l’État d’accueil pour rendre parfait le consentement de celui-ci à l’arbitrage. De telles lois
ont été adoptées par des pays comme l’Égypte, le Mozambique ou la Mauritanie.
19 () À noter que la Canada ne l’a signée qu’en 2006 et ratifiée qu’en 2013.
20 () S’agissant des pays latino-américains, la situation est toutefois un peu différente puisque l’Équateur, la Bolivie et le Venezuela, après l’avoir signée et appliquée, ont dénoncé la convention de Washington.
21 () En revanche, les règles de la CNUCDI apparaissent plus favorables que celles du CIRDI s’agissant de l’intervention des tiers ou de la publication des documents puisque les parties sont simplement consultées, la décision appartenant au seul tribunal. En effet, en 2013, un nouveau paragraphe a été ajouté à l’article 1er du Règlement de 2010 afin d’incorporer le nouveau Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités. Le Règlement sur la transparence s’applique aux arbitrages entre investisseurs et États fondé sur des traités initiés en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI survenant dans le cadre de traités conclus le 1er avril 2014 ou après cette date, sauf convention contraire des parties au traité. Le Règlement sur la transparence s’applique aussi aux litiges survenant dans le cadre de traités conclus avant le 1er avril 2014 si les parties à l’arbitrage ou les parties au traité d’investissement conviennent de son application après le 1er avril 2014. S’agissant des traités multilatéraux d’investissement conclus avant le 1er avril 2014, le Règlement sur la transparence s’applique si l’État du demandeur et l’État défendeur sont convenus de son application.
22 () En revanche, les sentences rendues dans le cadre d’autres instances d’arbitrage s’exécutent dans les conditions définies par la convention de New York de 1958. En particulier, elle exige la reconnaissance de la sentence par les juridictions de l’État concerné.
23 () Ce dernier motif est toutefois interprété très strictement par les comités adhoc. C’est l’absence totale de motivation dans la sentence qui justifiera son annulation et non son caractère insuffisamment étayée en droit et/ou en fait, pas plus qu’une véritable erreur de droit.
24 () OECD, “Investor-State Dispute Settlement”, Public Consultation Document (2012).
25 () Quelques exceptions sont à signaler parmi lesquelles le TBI entre le Japon et les Philippines (2006) ou le traité entre l’Australie et la Malaisie (2012).
26 () Protection des investissements et règlement des différends entre investisseurs et États dans les accords de l’Union européenne, synthèse de novembre 2013.
27 () Notre pays a signé 107 accords incluant un RDIE dont 96 sont aujourd’hui en vigueur.
28 () La France a signé 11 traités incluant un RDIE avec des États devenus par la suite membres de l’UE : Lettonie (1992), la Lituanie (1992), la Hongrie (1986), l’Estonie (1992), la Bulgarie (1989), la Pologne (1989), la Croatie (1996), la Roumanie (1995), les Républiques Tchèque et Slovaque (1990), Malte (1976).
29 () Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.
30 () Le Canada est lié par un TBI avec la République Tchèque, la Hongrie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, Malte, la Roumanie et la Slovaquie.
31 () La France a été autorisée à ouvrir des négociations avec les Territoires palestiniens et les Comores.
32 () Les articles 64, 66 et 75 du TFUE permettent au Conseil, dans des circonstances exceptionnelles, d’adopter des mesures restrictives relatives au mouvement de capitaux et aux paiements à destination ou en provenance d’États tiers. Or, les TBI organisaient une liberté totale de circulation des capitaux.
33 () L’Irlande n’a quant à elle pas de TBI intra-européen.
34 () Certains États-membres, confrontés à des plaintes d’investisseurs européens sur le fondement de TBI intracommunautaires, ont par ailleurs soutenu que leur adhésion à l’Union européenne avait entraîné la dénonciation automatique de ces traités. C’est le cas de la République Tchèque dans l’affaire Eastern Sugar B.V. c/ République Tchèque. Le Tribunal arbitral lui a cependant donné tort dans sa sentence du 27 mars 2007. Se fondant sur le TBI avec les Pays-Bas, il précise que l’extinction d’un traité bilatéral n’est pas automatique et que les États doivent pour ce faire le dénoncer.
35 () Affaire Eureko c/ Slovaquie. La Slovaquie et les Pays-Bas sont, tous deux, des États membres de l’UE. La question de l’arbitrabilité du différend devait donc naturellement se poser. Le tribunal s’est reconnu compétent pour connaître de l’affaire après avoir pris connaissance des observations de la Commission qui l’invitaient à se déclarer incompétent. Selon les arbitres, la juridiction prévue par le TBI, en l’occurrence le tribunal arbitral, a une compétence prima facie pour statuer.
36 () “Legally of the ISDS under EU law” (2015).
37 () Le TPP est un accord plurilatéral de libre-échange en cours de négociation visant à intégrer les économies des régions Asie et Pacifique. Un premier traité a été signé le 3 juin 2005 par Brunei, le Chili, la Nouvelle-Zélande et Singapour. En 2010, cinq autres pays négocient une extension de ce traité : Australie, Malaisie, Pérou, États-Unis et Vietnam. Le 14 novembre 2010, les chefs de gouvernement des neuf pays ont accepté la proposition du Président américain Barack Obama de compléter les négociations pour le sommet de l'APEC de 2011. En novembre 2011, le Canada, le Japon et le Mexique rejoignent les négociations, en partie grâce à l'intérêt de plus en plus soutenu que lui ont porté les États-Unis. Les négociations se sont achevées en octobre 2015.
38 () Affaire Piero Foresti et autres c/ Afrique du sud. Les investisseurs italiens estimaient discriminatoire le traitement résultant de la loi sur le développement des ressources pétrolières et minières, laquelle visait notamment à augmenter la part des Noirs dans la propriété des entreprises pétrolières et minières et dans celle des terres. L’affaire a fait l’objet d’une transaction en faveur des investisseurs.
39 () En excluant le contentieux impliquant la France et le Royaume-Uni sur le fondement du traité de Canterbury du 12 février1986 concernant le tunnel sous la Manche.
40 () Par un ressortissant turc, Erbil Serter. Les détails de cette affaire qui, a priori, porte sur les coques de bateaux, n’ont pas été rendus publics, pas plus que l’affaire n’a encore été jugée.
41 () « ISDS, some facts and figures », mars 2015.
42 () « Recent trends in International investment agreements and ISDS », février 2015.
43 () Ainsi, les articles 1514 à 1517 du code de procédure civile transposent en droit les français les principes de la convention de New York. Le tribunal de grande instance de Paris est, en France, seul compétent pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, après avoir vérifié l’authenticité de la sentence ainsi que sa conformité à l’ordre public international français.
44 () Ainsi, on se souvient de l’affaire du voilier Sedov, saisi dans la rade de Brest sur demande d’un investisseur suisse s’appuyant sur une sentence arbitrale de la Chambre de commerce de Stockholm. Toutefois, le TGI de Brest a estimé que le voilier, propriété de l’Université de Mourmansk, appartenait à une entité distincte de l’État russe et, par conséquent, ne pouvait pas être tenue pour responsable des dettes de ce dernier.
45 () Caddel, Jeremy & Jensen, Nathan M., “Which Host Country Government Actors are Most Involved in Disputes with Foreign Investors?”, Columbia FDI Perspectives: Perspectives on topical foreign direct investment issues by the Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (avril 2014)
46 () Gaukrodger & Gordon: “ Investor-State dispute settlement: a scoping paper for the investment policy community ” (2012).
47 () Pour les 30 % restants, on ne dispose pas d’informations sur le plaignant.
48 () Selon une étude de l’ONG Corporate Europeran Observatory (« Profiting from injustice : How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom »), il apparaît ainsi que le comité de direction des principales revues d’arbitrage est majoritairement ou totalement constitué d’arbitres et/ou d’avocats spécialisés dans l’arbitrage.
49 () M. Paulsson a ainsi dénoncé en 2009 les États qui tentent de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles et qui critiquent les règles accordant des droits supérieurs aux investisseurs étrangers.
50 () Gus van Harten : « Pro-investor or pro-State bias in investment-treaty arbitration ?Forthcoming study gives cause for concern ” Investment treaty news (avril 2012).
51 () Comme le Conseil d’État dans l’ordre administratif.
52 () Le syndicat des travailleurs et travailleuses de postes et le Conseil des Canadiens ont attaqué la constitutionnalité du chapitre 11 devant les juridictions canadiennes. Celles-ci les ont déboutés.
53 () Des ONG canadiennes ont, de concert avec des ONG européennes, signé le 28 novembre 2013 une déclaration protestant contre l’inclusion du RDIE dans l’AECG.
54 () Tobin, Jennifer & Susan Rose-Ackerman, « Foreign Direct Investment and the Business Environment in Developing Countries: the impact of bilateral Investment treaties », Yale Law School Center for Law, Economics and Public Policy Research Paper No. 293, Yale University, New Haven, CT, 2005.
55 () Tobin, Jennifer & Susan Rose-Ackerman, « Foreign Direct Investment and the Business Environment in Developing Countries: the impact of bilateral Investment treaties », Yale Law School Center for Law, Economics and Public Policy Research Paper No. 293, Yale University, New Haven, CT, 2005.
56 () Bérangère Taxil : « Les critères de l’applicabilité directe des traités internationaux aux États-Unis et en France », revue international de droit comparée, 1-2007.
57 () Oona A. Hataway, Sabria McElroy et Sara Aronchick-Solow : « International law at home : enforcing treaties in US court », Yale Journal of international law (2012).
58 () En revanche, les quelques 900 juges fédéraux sont nommés par le Président, après approbation du Sénat.
59 () Sept États fédérés élisent ainsi leurs juges à la Cour suprême par des élections partisanes.
60 () William Yulee v/ Florida Bar (2015). Par cette décision, la Cour suprême des États-Unis a confirmé une décision de la Cour suprême de Floride validant une règle du bureau de cet État interdisant aux candidats à une fonction de juge de solliciter personnellement des fonds pour leur campagne.
61 () Parmi ces 38 États, 9 n’ont pas fixé de limite aux contributions individuelles.
62 () Le droit français applique la maxime nemo contra se edere tenetur, en vertu de laquelle on ne peut exiger que les parties produisent les pièces qui leur sont défavorables. La communication des pièces se fait de manière spontanée et ne recouvre que les seules preuves permettant aux parties d’asseoir leur argumentation.
63 () Aérospatiale c/ US district Court of the southern district of Iowa (1987).
64 () L’article 43 de la convention de Washington stipule ainsi que « sauf accord contraire des parties, le Tribunal, s’il l’estime nécessaire, peut à tout moment durant les débats, demander aux parties de produire tous documents et autres moyens de preuve ».
65 () Lequel ne prévoit, généralement, qu’une période de consultation entre l’investisseur et l’État.
66 () L’arrêt du 17 mars 1874 Paul Dupont a reconnu pour la première fois ce droit de résiliation unilatérale, devenue une règle générale du droit des contrats administratifs dans l’arrêt du 2 mai 1958 Distillerie de Magnac-Laval.
67 () Cette affaire découle, en effet, d’un différend d’ordre commercial strictement privé entre l’ancien Crédit Lyonnais et l’homme d’affaires Bernard Tapie au sujet de la revente, par ce dernier, de la société Adidas dans les années 90.Elle n’implique ni TBI, ni RDIE mais le terme « arbitrage », utilisé dans les deux cas, peut prêter à confusion.
68 () « Protection des investissements et règlement des différends entre les États et les investisseurs dans les accords de l’Union européenne » (2013).
69 () Les parties se sont accordées à « s’acquitter de tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement ».
70 () L’article IX de l’accord de Marrakech stipule ainsi que « la conférence des ministres ainsi que le conseil général ont l’autorité exclusive pour adopter des interprétations de l’Accord ainsi que des différends accords multilatéraux de commerce ».
71 () Ce point fait toutefois l’objet d’une controverse doctrinale.
72 () C’est le cas notamment du TBI franco-tunisien de 1972 qui est resté en vigueur jusqu’en 1997.
73 () À noter toutefois que le tribunal a complété ces trois critères par un quatrième concernant la participation au développement économique de l’État d’accueil. L’importance donnée à ce dernier critère a varié par la suite, certains tribunaux en faisant un critère essentiel pour définir l’investissement (par exemple dans l’affaire Malaysian historical Salvador SDN, BHD c/ Malaisie en 2007), d’autres au contraire l’écartant (par exemple dans l’affaire Saba Fakes c/Turquie en 2010).
74 () Notamment des actions d’une entreprise, des droits de propriété intellectuelle, des biens immobiliers.
75 () « Marchander la démocratie » (novembre 2014), publié par un collectif d’ONG incluant AITEC, le centre canadien des politiques alternatives ou l’observatoire européen des entreprises.
76 () Par exemple l’affaire Generation Ukraine c/ Ukraine (2003).
77 () La Cour d’appel de Colombie-Britannique a en effet estimé que la transparence n’était pas mentionnée par le chapitre 11 de l’ALENA.
78 () Y compris dans le cadre de l’ALENA, avec la sentence Waste Management c/ Mexique (2004).
79 () Celui-ci stipule que « à moins de circonstances rares, les mesures réglementaires non discriminatoires élaborées et appliquées dans un but de protection légitime du bien-être public concernant par exemple la santé, la sécurité et l’environnement ne seraient pas considérés comme menant à une expropriation indirecte ».
80 () Droits humains et traités bilatéraux d’investissement : le rôle du droit relatif aux droits humains dans l’arbitrage des différends entre investisseurs et États (2014).
81 () Voir notamment les sentences Abaclat c/ Argentine (2011) et Ambiente Ufficio SPA c/ Argentine (2013).
82 () Interpretation of International investment agreements : what States can do (décembre 2011).
83 () Ce mécanisme rappelle fortement celui institué par l’article 33 du règlement de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI. Cet article prévoit en effet un système de contrôle a priori de la qualité de la sentence dénommé « examen préalable de la sentence de la Cour ». Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, attirer son attention sur les points intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour ». La Cour ne peut donc imposer au tribunal de modifier sur le fond la forme de la sentence.
84 () C’est d’ailleurs sur le fondement de cette théorie (et de l’article 6§1 de la CEDH) que la France a été à condamnée en raison de la participation du rapporteur public au délibéré dans les juridictions administratives (arrêt Kress c/ France 2001).
85 () Voir Euractiv du 9 septembre 2015.
86 () “Does the European parliament want a better ISDS ? We agree!” La voix du Collège (oct-nov 2015).
87 () La réserve américaine à la clause de règlement juridictionnel de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (l’article IX) a emporté l’incompétence de la Cour prononcée à la suite d’une saisine de la Yougoslavie.
88 () Gaukrodger, D. et K. Gordon : "Investor-State Dispute Settlement: A Scoping Paper for the Investment Policy Community", OECD Working Papers on International Investment, 2012/03.
89 () Article 32-1du code de procédure civile.
90 () Lawsuit Abuse Reduction Act (2013).
91 () « The Proposed Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Mechanism: U.S. Should Oppose EU Demand to Abandon It” (juillet 2015).