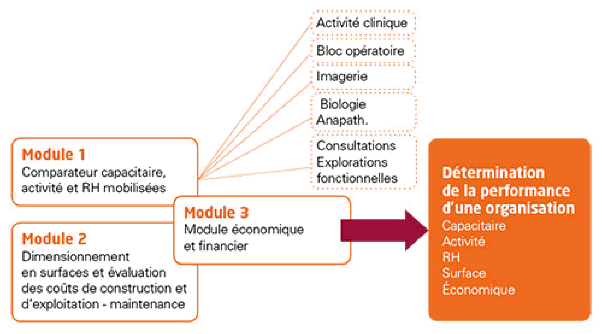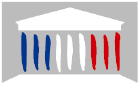
N° 2944
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2015.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et
de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
sur la dette des établissements publics de santé,
ET PRÉSENTÉ PAR
Mme Gisèle BIÉMOURET,
Députée.
——
SOMMAIRE
___
Pages
SYNTHÈSE 7
LISTE DES PRÉCONISATIONS 11
INTRODUCTION 15
I. L’ENDETTEMENT MASSIF DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PÈSE SUR LA MODERNISATION DE L’OFFRE DE SOINS 19
A. DES ÉTABLISSEMENTS LÉGÈREMENT DÉFICITAIRES EN 2013 19
B. UN NIVEAU D’ENDETTEMENT ÉLEVÉ RÉSULTANT DES PLANS HÔPITAL 2007 ET HÔPITAL 2012 21
1. Le paysage de l’endettement des établissements de santé 22
2. L’investissement des hôpitaux publics sur la même période 24
3. Des procédures d’emprunt trop souples qui ont permis des dérives 28
4. Des emprunts toxiques dont il est difficile de se désengager 32
5. Le cas limite des centres hospitaliers sous administration provisoire 39
a. Le régime de l’administration provisoire 39
b. Le cas du centre hospitalier de Roanne 43
c. Le cas de l’hôpital André Grégoire à Montreuil 45
C. UN ACCÈS AU CRÉDIT CONTRASTÉ SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS 47
1. Des difficultés pour le financement à court terme et la gestion de la trésorerie 47
2. Des inégalités croissantes entre établissements pour financer les investissements de modernisation ou de renouvellement 48
II. UNE MEILLEURE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS ET UN ASSAINISSEMENT FINANCIER SONT INDISPENSABLES POUR CONFORTER LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER 51
A. LES PREMIÈRES MESURES POUR ENCADRER LE CHOIX ET LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS DOIVENT ÊTRE CONFORTÉES 51
1. Mieux cibler et évaluer les projets d’investissement 51
2. Le rôle du COPERMO 56
a. Les projets d’investissement 56
b. L’amélioration de la performance des établissements de santé 62
3. Les schémas régionaux d’investissement en santé pour hiérarchiser les priorités 64
4. Encadrer le recours à l’emprunt de manière optimale 66
a. Le droit en vigueur 66
b. L’amendement au projet de loi de modernisation de notre système de santé limitant le recours aux emprunts en devises ou à taux variables 69
B. MIEUX PROGRAMMER LES PROJETS D’INVESTISSEMENT 70
1. Permettre un financement régulier des investissements 70
2. Mieux calibrer les grands projets d’investissement 71
3. Diffuser la doctrine du COPERMO 74
4. Renforcer la mutualisation des moyens 75
C. UNE SORTIE CONCERTÉE DES EMPRUNTS TOXIQUES AVEC UN PARTAGE DE LA CHARGE FINANCIÈRE ENTRE LES BANQUES ET LES ÉTABLISSEMENTS 78
1. La priorité donnée au désengagement et à la renégociation des emprunts toxiques 78
a. Qui supporte le coût du désengagement des emprunts toxiques ? 78
b. Le devoir de conseil des banques 81
c. La réaction des banques face aux demandes de sortie des emprunts toxiques 84
2. Un dispositif d’accompagnement financier spécifique aux établissements de santé 88
D. DE MEILLEURES COMPÉTENCES FINANCIÈRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS 93
1. Permettre aux hôpitaux de disposer d’une expertise financière indépendante 93
2. Améliorer encore la formation des cadres dirigeants des centres hospitaliers et des ARS en matière de gestion financière 99
E. REVOIR CERTAINS MÉCANISMES FINANCIERS POUR POURSUIVRE L’EFFORT D’INVESTISSEMENT 104
1. Des modifications importantes dans la T2A (tarification à l'activité) 104
2. Faut-il dissocier le financement des investissements immobiliers et des équipements médicaux ? 108
3. Les relations entre les établissements et les agences régionales de santé (ARS) 111
4. Diversifier les financements possibles ? 112
a. Interdire l’accès des hôpitaux publics aux crédits de trésorerie ? 112
b. Permettre aux hôpitaux d’émettre des billets de trésorerie ? 114
c. Aller vers une plus grande mutualisation des trésoreries ? 115
TRAVAUX DE LA COMMISSION 117
ANNEXES 131
ANNEXE 1 : COMPOSITION DE LA MISSION 131
ANNEXE 2 : RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES PROPOSÉES À L'ISSUE DE SON ENQUÊTE SUR « LA DETTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ » 133
ANNEXE 3 : CRÉDITS STRUCTURÉS OU TOXIQUES : DE QUOI PARLE-T-ON ? 135
ANNEXE 4 : LISTE DES PROJETS VALIDÉS OU EN COURS D’INSTRUCTION PAR LE COPERMO 137
ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 141
ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES DÉPLACEMENTS 145
ANNEXE 7 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 147
Les établissements de santé sont confrontés aujourd’hui au double défi de gérer un endettement massif tout en ayant l’obligation de poursuivre la modernisation de l’offre de soins hospitalière qui doit faire face à des évolutions majeures : progrès accélérés dans le matériel biomédical, extension de l’informatique médicale et évolution des techniques de soins avec la montée en puissance de la chirurgie ambulatoire. Dans le même temps, les maladies chroniques et le vieillissement de la population induisent de nouvelles problématiques dans la prise en charge des patients.
Après une période de sous-investissement dans la deuxième moitié des années 1990, la Conférence des directeurs généraux de CHU a alerté le Gouvernement au début 2002 sur l’obsolescence des équipements hospitaliers et a recensé des besoins urgents d’investissement tout en soulignant qu’un meilleur entretien du bâti aurait sans doute permis de ralentir son vieillissement.
Soucieux de faire face à ce constat, le Gouvernement a lancé, dès 2002, deux grands programmes d’investissements, les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 qui ont comblé ce retard mais qui ont eu aussi pour conséquence de faire tripler la dette de moyen et long terme des hôpitaux qui a ainsi atteint près de trente milliards d’euros à la fin 2013. En raison des contraintes financières pesant sur les finances publiques, cet effort d’investissement a été fondé sur un recours substantiel aux emprunts bancaires, dont une part est constituée d’emprunts structurés dits « toxiques ». Certains gestionnaires hospitaliers ont parfois mal mesuré les risques à terme de ces produits financiers complexes, alors qu’ils présentaient l’avantage de proposer des taux d’intérêt très intéressants au début de la période de remboursement.
À la suite de la crise financière de 2008 et du démantèlement de la banque Dexia, un des principaux financeurs du secteur hospitalier, les pouvoirs publics ont réagi en faisant intervenir la Caisse des dépôts et consignations et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour éviter une trop forte contraction des crédits bancaires aux hôpitaux et des défaillances dans le remboursement des prêts.
Les emprunts structurés les plus risqués dits « hors charte Gissler » (1)représentent de l’ordre d’un milliard d’euros et sont concentrés sur moins d’une centaine d’établissements hospitaliers.
Le Gouvernement a cherché à définir une démarche de « désensibilisation » de ces emprunts toxiques pour permettre aux hôpitaux de se défaire de ces produits, notamment grâce à l’intervention d’un dispositif spécifique aux établissements publics de santé, financé au départ essentiellement par des fonds publics et pour une faible part par les banques, avant qu’un second dispositif ne vienne l’accroître très sensiblement après la « crise du franc suisse » du début de l’année 2015.
Les premières mesures adoptées en urgence visant à rendre plus difficile le recours à l’emprunt en le soumettant à une autorisation préalable des ARS et à interdire la souscription de produits dérivés doivent être confortées, sans excès de rigidification, et un amendement en ce sens a d’ores et déjà été adopté, à l’initiative de la rapporteure et du coprésident de la mission pour interdire les emprunts en devises et encadrer les emprunts à taux variable. Il faut en revanche accélérer la mise en place effective du dispositif de désensibilisation dont la dotation devrait être majorée suite à l’aggravation de la situation financière des hôpitaux causée par le renchérissement du franc suisse, les taux de certains emprunts structurés étant indexés sur le cours de cette monnaie.
La rapporteure a été frappée par la disparité des réactions des établissements hospitaliers, certains allant même jusqu’à refuser de renégocier leurs emprunts structurés car ils offrent aujourd’hui encore un taux d’intérêt intéressant ! D’autres apparaissent bien isolés pour négocier une sortie de leur emprunt et se voient parfois opposer un refus bancaire car le nouvel emprunt à contracter à taux fixe pour compenser le non-paiement de l’indemnité de sortie anticipée aurait un taux d’intérêt supérieur au taux de l’usure.
Les établissements bancaires mettent en avant la responsabilité partagée des autorités de tutelle et des directeurs d’établissement qui ont profité de l’effet d’aubaine de taux artificiellement bas en début de période d’endettement. La rapporteure reconnaît une chaîne complexe de responsabilités mais estime que les banques ne peuvent se dédouaner de toute responsabilité dans ce marketing offensif en faveur des emprunts structurés.
L’essentiel est cependant aujourd’hui de sortir au plus vite de cette phase d’endettement avec des emprunts structurés et de trouver des moyens équitables pour surmonter cette crise financière.
Les établissements bancaires ont reçu des aides massives de la puissance publique lors de la crise financière de 2008 et ont tout avantage à financer le secteur hospitalier dans des conditions assainies. C’est pourquoi la MECSS estime très important que les établissements hospitaliers et les banques partagent le coût financier de cette sortie de crise. La question des indemnités de sortie anticipée doit être réglée de manière homogène et faire l’objet d’une négociation globale pour éviter que des établissements de santé ne soient dans l’impossibilité de sortir de leurs emprunts toxiques en raison du coût parfois exorbitant de cette indemnité dont le montant varie avec une forte instabilité. La confiance entre les établissements de santé et les banques a été fortement ébranlée par les emprunts toxiques, parvenir à une sortie honorable pour les deux parties est fondamentale pour refonder un véritable partenariat pour moderniser l’offre hospitalière.
La question de l’endettement doit être aussi considérée au regard de l’ampleur des investissements à financer.
La rapporteure voudrait insister sur la mobilisation tout à fait remarquable des équipes de direction des hôpitaux et des personnels soignants pour continuer à assumer leurs missions de service public dans un contexte financier très contraint.
Au cours de ses déplacements en région marseillaise, à Saint-Étienne et à Roanne, ainsi qu’en région parisienne, la rapporteure a été frappée par le pragmatisme des équipes pour réussir à soigner tous les patients sans aucune sélection des risques, tout en faisant le maximum pour que les établissements continuent à se moderniser. Les choix au quotidien sont parfois douloureux : faut-il privilégier l’achat d’un appareil de radiologie plus moderne mais reporter des dépenses pourtant urgentes de mise aux normes des installations électriques par exemple ? Ces décisions sont d’autant plus complexes à prendre que les règles du jeu budgétaire sont changeantes, avec les fluctuations de tarifs liés à l’évolution de l’ONDAM annuel et les efforts de productivité demandés chaque année. Les médecins comme les directeurs semblent parfois découragés par l’opacité de certaines règles qui affectent directement leurs moyens de fonctionner au quotidien. Les ARS ont un rôle crucial à jouer pour épauler les établissements et expliquer la stratégie territoriale de l’offre de soins. Sans cet effort pédagogique, surtout lorsque des gains de productivité sont exigés, les hôpitaux publics ont l’impression d’être soumis à de très fortes contraintes et de jouer à armes inégales avec les établissements de l’hospitalisation privée qui orientent beaucoup plus facilement leurs activités vers de la médecine de pointe.
Aujourd’hui, certains hôpitaux peinent à financer leurs investissements courants en raison de leur fragilité financière. Concernant les grands projets de rénovation, il faudrait améliorer la planification des investissements pour intégrer cette programmation dans une réflexion sur la composition de l’offre territoriale hospitalière. En comparaison avec l’Allemagne par exemple, la France dispose d’une offre beaucoup plus dense, mais souvent mal répartie sur le territoire.
Les schémas régionaux d’investissement en santé (SRIS) doivent être améliorés pour tenir compte de l’évolution prévisible de l’offre de soins et la procédure devant le COPERMO (Comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins) doit gagner en transparence.
L’instauration des groupements hospitaliers de territoire (GHT) constitue une occasion opportune de renforcer la coopération entre établissements et de mutualiser certaines fonctions de support, dont la gestion de la dette et de la trésorerie.
De grandes questions doivent par ailleurs encore être résolues pour conforter un investissement hospitalier soutenable et en phase avec le progrès médical. La tarification à l’activité a montré ses limites pour permettre de dégager des marges financières suffisantes pour les investissements lourds ; il faudra sans doute trouver des modes de financement différenciés pour financer les investissements immobiliers et les équipements biomédicaux.
Plus généralement, la tarification à l’activité ne permettant pas de financer convenablement l’investissement, il y a lieu de prévoir d’autres sources de financement qui ne soient pas uniquement des emprunts bancaires. Après la période récente de déstabilisation financière des établissements de santé, il ne faut pas craindre d’innover en cherchant des modes de financement alternatifs aux emprunts bancaires, sans perdre de vue la prudence qui s’impose naturellement en la matière. Certains acteurs économiques disposent de ressources de long terme et pourraient, sous conditions, contribuer à l’investissement hospitalier.
S’appuyant sur la communication de la Cour des comptes (2), portant sur l’endettement des établissements de santé et sur la souscription d’emprunts structurés, demandée par la commission des Affaires sociales, remise aux parlementaires en avril 2014 et présentée à la commission le 8 octobre 2014, la rapporteure a élaboré 13 préconisations présentées ci-après, grâce auxquelles elle souhaite proposer des perspectives pour l’avenir et éviter de laisser leur dette empêcher les hôpitaux publics de poursuivre leur nécessaire modernisation. Ces préconisations complètent les recommandations formulées par la Cour des comptes, retranscrites en annexe au présent rapport.
Au-delà, le présent rapport voudrait permettre de poser des questions urgentes, qui sont cependant souvent éludées : le réseau hospitalier n’est-il pas surabondant ? Ne faut-il pas clairement hiérarchiser les équipements des hôpitaux, pour constituer un réseau de soins avec des hôpitaux de proximité, des établissements généralistes et enfin des établissements de haute technicité ?
Préconisation n° 1 : Garantir un montant minimal et régulier d’investissement de renouvellement
Demander aux ARS d’autoriser les établissements de santé à consacrer au moins 3 % de leur budget pour permettre de réaliser chaque année un montant minimum d’investissements de renouvellement et éviter ainsi une obsolescence de l’offre de soins.
Préconisation n° 2 : Diffuser les enseignements tirés de l’instruction des dossiers d’investissement et d’amélioration de la performance présentés au COPERMO :
– Améliorer la transparence de la procédure devant le COPERMO pour les décisions concernant les projets d’investissement en explicitant notamment la décision finale et les écarts entre les aides à l’investissement attribuées par rapport à celles demandées.
– Communiquer une synthèse sur les principaux enseignements à tirer des dossiers présentés, en termes de recherche de financement et d’adaptation de l’offre de soins aux nouveaux besoins sanitaires, réalisée par la cellule de la DGOS, chargée de l’instruction des dossiers devant le COPERMO.
Préconisation n° 3 : Gérer en commun la trésorerie et l’endettement
Prévoir que les établissements, constituant un GHT puissent gérer de manière commune certains aspects de leur politique d’endettement et de leur gestion de la trésorerie, afin de disposer d’une masse critique plus importante pour accéder aux marchés financiers et négocier avec les banques.
Préconisation n° 4 : Sortir des emprunts toxiques en partageant le coût de la désensibilisation entre établissements bancaires et établissements hospitaliers
– Rendre rapidement opérationnels les deux volets du dispositif de désensibilisation des emprunts pour les hôpitaux et trouver un « véhicule législatif » rapide pour permettre la modification du taux de la taxe de risque systémique perçue sur les banques pour le financer.
– Mener, en concertation avec les ARS, un travail de persuasion pour convaincre les directeurs d’établissements hospitaliers de sortir des emprunts structurés car, même si les taux actuels sont faibles, les risques latents demeurent élevés.
– Veiller à l’adoption définitive de l’article 26 bis du projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours de navette parlementaire, qui interdit les emprunts en devises et impose que les emprunts à taux variables répondent à ces critères de simplicité ou de prévisibilité des clauses financières pour les hôpitaux qui les souscrivent, et renvoie la définition de ses conditions d’application à un décret simple.
– Clarifier la question de savoir si les établissements de crédit peuvent opposer ou non le respect du taux de l’usure dans leurs renégociations de prêt. À titre conservatoire, obtenir des établissements bancaires d’écrêter, au niveau du taux de l’usure, les taux d’intérêt fixes qu’ils proposent pour sortir des emprunts toxiques.
– En complément du dispositif de désensibilisation, engager une négociation avec les établissements bancaires, associer le ministère chargé des finances au ministère des affaires sociales, pour que les établissements de crédit renoncent collectivement à la perception de la totalité ou de la majeure partie des indemnités de sortie. Cette renonciation serait négociée au cas par cas et prendrait la forme d’une transaction avec les établissements emprunteurs.
Préconisation n° 5 : Renforcer la communication institutionnelle sur l’assainissement financier des établissements hospitaliers
Renforcer la confiance entre partenaires suppose que les banques aient une claire connaissance de l’ensemble des efforts menés depuis 2012 pour réduire le risque financier du secteur hospitalier. Il convient donc de renforcer la communication institutionnelle du ministère chargé de la santé et du COPERMO pour présenter de manière didactique l’ensemble des dispositions normatives visant à encadrer l’investissement et les mécanismes de financement des hôpitaux.
Préconisation n° 6 : Développer une expertise financière mutualisée
Favoriser le développement d’une expertise financière mutualisée, dans le sens de ce qu’a réalisé la mission MARTAA en région Pays-de-la-Loire, afin que les établissements de santé disposent d’une expertise indépendante capable de les appuyer dans différents aspects de leur gestion et de contribuer notamment à la diffusion d’outils de gestion comme les logiciels Ælipce ou Hospi Diag, conçus en tenant compte des contraintes spécifiques du service public hospitalier.
Cette expertise pourrait s’appuyer sur les ARS, sur l’Agence nationale compétente, ou, dans l’attente, sur des structures plus empiriques, telles que la mission MARTAA.
Préconisation n° 7 : Diversifier le recrutement des directeurs d’hôpitaux
Faire évoluer les épreuves du concours externe de recrutement des directeurs d’hôpitaux pour attirer des profils formés aux techniques de gestion.
Préconisation n° 8 : Renforcer les compétences en gestion financière
Renforcer la formation en techniques de gestion et culture financière des cadres des ARS appelés à instruire les dossiers de financement des investissements ou à exercer la tutelle financière sur les centres hospitaliers.
Préconisation n° 9 : renforcer la formation continue et le partage d’expérience entre pairs
Renforcer l’offre de formation continue en matière financière pour les directeurs hospitaliers, cadres des ARS en privilégiant une approche pratique. Encourager une nouvelle coopération entre le CNG et l’EHESP pour mettre en place des formations en ce sens, et développer la mise en place de groupe de travail pour promouvoir le partage de bonnes pratiques entre pairs.
Préconisation n° 10 : anticiper les recrutements de directeurs d’hôpitaux et développer le coaching
Développer la pratique du coaching individuel notamment pour les prises de fonction les plus délicates pour les directeurs. Mieux anticiper certains recrutements notamment à l’issue des périodes d’administration provisoire pour susciter des candidatures avec l’assurance que le candidat retenu sera accompagné par un coach ou des référents expérimentés.
Préconisation n° 11 : Clarifier et stabiliser les règles de la tarification à l’activité :
– Accélérer les travaux en cours sur la réforme de la T2A pour clarifier le devenir de cette tarification et lui faire gagner en stabilité, des décisions d’investissement de long terme ne pouvant être prises sur la base de règles tarifaires changeantes. Les tarifs doivent par ailleurs intégrer le financement de la dotation aux amortissements.
– Pour acter cet objectif de stabilité, la démarche contractuelle doit être renforcée : en contrepartie d’engagements sur des objectifs de productivité ou d’amélioration de l’offre de soins, les hôpitaux doivent disposer d’une visibilité au moins de trois ans sur les aides à l’investissement dont ils peuvent effectivement bénéficier.
– Poursuivre dans la voie engagée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui a modifié le financement des hôpitaux de proximité. L’article 52 de cette loi prévoit de faire bénéficier les « établissements de proximité » d’un financement mixte, associant tarifs nationaux de prestations et dotations forfaitaires pour les activités de médecine. La spécificité des petits établissements contribuant à l’aménagement du territoire doit être réaffirmée et leur mode de financement doit être adapté.
Préconisation n° 12 : Faire évoluer les règles de financement des investissements :
– Engager une réflexion avec les professionnels sur l’évolution du financement des investissements, en s’inspirant notamment des expériences étrangères.
– Veiller à dégager des marges financières suffisantes pour permettre le financement des grands projets immobiliers lorsqu’ils sont indispensables.
– Compte tenu du risque d’obsolescence rapide du parc de matériel biomédical lourd, du fait du progrès médical et des moyens financiers contraints, inciter à trouver des modes alternatifs de financement, inspirés par exemple du mécanisme du crédit-bail.
Préconisation n° 13 : Diversifier les modes de financement des investissements hospitaliers
Rechercher des modes de financement alternatifs au financement bancaire, en associant des spécialistes de la finance et de la gestion hospitalière, mais aussi des directeurs d’hôpitaux de terrain. Sous réserve d’une grande prudence, pour éviter de réitérer les choix hasardeux des emprunts toxiques, encourager à la réflexion en faveur de solutions innovantes, en analysant notamment les expériences étrangères pour trouver d’autres angles d’approche du financement de l’offre de soins et recenser les pratiques nouvelles pertinentes, qui ont pu être réalisées localement par des gestionnaires très pragmatiques et soumis à de fortes contraintes budgétaires.
La crise financière de 2008 et le démantèlement de DEXIA, principal établissement financier prêteur pour le secteur de la santé, sont intervenus alors que les établissements hospitaliers avaient lancé de grands projets d’investissement grâce aux plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012, en les finançant essentiellement par l’emprunt.
Le recours à des produits financiers complexes dont les risques avaient été mal appréciés a eu des conséquences dramatiques pour un certain nombre d’établissements qui ont connu parfois des situations proches de la cessation de paiement.
Il est apparu clairement qu’il fallait d’urgence réduire les projets d’investissement et surtout inciter les établissements à renégocier leurs emprunts structurés qualifiés depuis de « toxiques » tellement leurs conséquences en termes de frais financiers sont apparues délétères.
Le dernier et brutal soubresaut de cette crise a eu lieu en janvier 2015, la brusque envolée du franc suisse par rapport à l’euro ayant eu pour conséquence de doubler ou même tripler les taux d’intérêt de certains prêts indexés sur la parité de cette monnaie. En l’espace de quelques jours, certains établissements hospitaliers ont vu leur endettement augmenter de plusieurs millions d’euros, annulant tous leurs efforts de redressement réalisés dans le cadre de contrats de retour à l’équilibre pourtant très contraignants.
Les pouvoirs publics ont pris des mesures en urgence, comme la création en deux temps d’un dispositif spécifique aux établissements de santé pour les aider à renégocier leurs prêts structurés ou encore le contrôle a priori des autorisations d’emprunts pour les hôpitaux les plus endettés. Ces mesures doivent être confortées mais elles méritaient d’être complétées par une réflexion sur la manière optimale de financer les investissements, indispensables pour moderniser l’offre hospitalière.
La présidente de notre commission des affaires sociales, Mme Catherine Lemorton, et les coprésidents de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), MM. Pierre Morange et Jean-Marc Germain ont sollicité, en application de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières et par lettre du 16 octobre 2012, l’assistance, l’expertise et les moyens de la Cour des comptes.
La communication de la Cour (3), portant sur l’endettement des établissements de santé et sur la souscription d’emprunts structurés, se situe dans le prolongement des travaux menés par la Cour sur les emprunts toxiques contractés par les collectivités locales et sur son analyse de la faillite de DEXIA. Elle a été remise aux parlementaires en avril 2014 et présentée à la commission des Affaires sociales le 8 octobre 2014.
Cette étude témoigne une fois encore du caractère fructueux de l’assistance apportée par la Cour au Parlement dans sa mission constitutionnelle de contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale et d’évaluation des politiques publiques prévu par l’article 47-2 de la Constitution.
La Cour a notamment relevé que les établissements de santé ont fait le pari risqué d’augmenter leurs recettes et de compter sur les dotations en capital de l’assurance maladie et de l’État pour être en mesure d’assumer les charges de remboursement des emprunts. Or il s’avère que les prévisions d’exploitation ont été trop optimistes et l’évaluation du coût des travaux assez peu rigoureuse. La Cour a aussi souligné que les investissements réalisés n’étaient pas toujours inspirés par une recherche d’efficience ni de retour sur investissement. Ils n’ont pas toujours été non plus été le levier d’une reconfiguration de l’offre de soins qui reste souvent surdimensionnée au plan immobilier ou mal adaptée à l’évolution des techniques de soins.
S’appuyant sur les principaux constats de la Cour, la MECSS a souhaité approfondir certains aspects de son analyse. Elle a ainsi procédé à seize auditions depuis décembre 2014, en recueillant l’avis des principaux acteurs du monde hospitalier mais aussi des établissements bancaires ayant financé les plans d’investissement. Elle s’est aussi intéressée à la formation des directeurs d’hôpitaux en gestion financière, à l’évolution de la tutelle financière sur les établissements de santé confiée aux agences régionales de santé et à la gouvernance des grands projets immobiliers dans le cadre du COPERMO notamment.
Ayant suivi les différents travaux des corps de contrôle sur l’endettement et l’accès au crédit des établissements de santé, la rapporteure a choisi de se rendre auprès d’établissements en difficulté financière, comme l’Assistance publique de Marseille, le CHU de Saint-Étienne, le centre hospitalier de Roanne à la fin de sa période de mise sous administration provisoire ou encore plusieurs établissements d’Île-de-France, comme l’hôpital intercommunal de Montreuil ou le groupe hospitalier du Nord-Essonne. Elle a tenu aussi à rencontrer des responsables dans les ARS, chargés d’instruire les projets d’investissements.
Ces déplacements ont conforté la rapporteure dans son souci de soutenir l’hôpital public, dont la spécificité doit être soulignée. Le service public hospitalier doit continuer à relever le défi consistant à être à la fois un modèle de médecine de pointe, mais aussi le lieu où il est possible d’accueillir n’importe quel patient, fût-il en situation précaire et sans couverture sociale. Il faut reconnaitre que l’hôpital public est soumis à des contraintes contradictoires et que sa force est justement de savoir les concilier. Les déplacements de la rapporteure ont permis de rencontrer des équipes ayant connu des périodes de crise très graves, parfois la quasi cessation de paiement, mais, malgré ces difficultés, les personnels ont réussi à poursuivre leur mission, même si des inquiétudes se sont exprimées sur les risques d’obsolescence de l’hôpital public incapable de financer des équipements de pointe et qui perd certains praticiens découragés de devoir se battre au quotidien pour avoir les moyens d’offrir une médecine de qualité.
Des choix importants doivent être faits pour financer la modernisation hospitalière et il faut éviter que le poids de la dette n’obère le futur.
Ce rapport présente plusieurs recommandations pour sortir au plus vite des emprunts structurés qui handicapent la modernisation des établissements de santé et ont gravement entamé la confiance qui existait entre les centres hospitaliers et les établissements financiers partenaires.
Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle moteur pour favoriser une sortie rapide et équitable de cette crise en veillant à ce que les coûts de la « désensibilisation » soient équitablement répartis.
Ce rapport incite aussi à explorer de nouvelles pistes pour diversifier les outils financiers permettant de lancer de nouveaux projets d’investissement. Il faut aussi changer de regard et éviter de penser à des établissements toujours plus grands alors que la qualité passe aujourd’hui plutôt par des plateaux techniques très modernes mais utilisés de manière continue avec des patients rapidement réorientés vers un parcours de soins extra-hospitalier.
I. L’ENDETTEMENT MASSIF DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PÈSE SUR LA MODERNISATION DE L’OFFRE DE SOINS
Après une période de forte dégradation des comptes des établissements de santé en raison de la brusque remontée des taux d’intérêt des emprunts structurés lors des années 2009-2011, la situation s’est stabilisée mais reste préoccupante car l’endettement et la détention d’emprunts toxiques sont concentrés sur un petit nombre d’établissements, dont certains ont une faible marge de négociation du fait de leur petite taille.
A. DES ÉTABLISSEMENTS LÉGÈREMENT DÉFICITAIRES EN 2013
Selon les informations publiées par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) en septembre 2014 (4), les soins hospitaliers publics et privés (hors soins de longue durée aux personnes âgées) représentaient 85,1 milliards d’euros en 2013, soit 46,6 % de la consommation individuelle de soins et biens médicaux française ce qui place la France en 2e position par rapport aux autres pays de l’OCDE,
La situation financière des hôpitaux s’était avérée légèrement excédentaire en 2012. Elle est repassée en léger déficit en 2013 (de - 100 millions d’euros, soit 0,2 % de leur chiffre d’affaires), dans une situation bien meilleure que de 2006 à 2011, mais également contrastée : beaucoup d’établissements sont légèrement déficitaires, mais 40 établissements cumulent 50 % du déficit. Pour mémoire, ce déficit était de 345 millions d’euros en 2008, de 223 millions en 2009, de 227 millions en 2010 et de 354 millions en 2011.
La dégradation en 2013 serait totalement imputable à la dégradation du budget principal (5) qui présenterait un déficit de 320 millions d’euros contre 140 millions d’euros en 2012. En 2013, les hôpitaux seraient encore plus nombreux dans cette situation : près de la moitié des hôpitaux publics (46 %) seraient en situation de déficit, avec un déficit cumulé de 476 millions d’euros. Les centres hospitaliers de bonne taille affichent un très léger déficit de 8 millions d’euros et s’accommodent mieux de la tarification T2A : leur activité connaît une dynamique suffisante, et leur taille leur permet d’absorber leurs effets de structure.
Le nombre d’établissements publics de santé déficitaires continue d’augmenter en 2012 et 2013 malgré l’amélioration observée en 2012 et le niveau assez bas du déficit constaté en 2013 : 420 hôpitaux déficitaires en 2013 contre 361 en 2012 et 350 en 2011. La part d’établissements déficitaires est ainsi passée de 37 % en 2011 à 46 % en 2013, avec un déficit cumulé de 476 millions d’euros. Toutefois, ce déficit reste concentré sur un petit nombre d’établissements : la moitié de ce déficit cumulé est imputable à près de 40 établissements en 2012 et en 2013.
Quant aux établissements excédentaires, leur résultat net comptable positif s’élevait à 374 millions d’euros en 2013 contre 431 millions d’euros en 2012.
La progression des charges résulte principalement de l’accélération des dépenses de personnel (+ 2,7 % en 2013 contre + 2,3 % l’année précédente) qui s’explique essentiellement par une hausse des charges sociales (+ 4,6 % en 2013 contre + 2,4 % en 2012), la masse salariale n’évoluant que plus modérément (+ 2,2 %). Les autres charges, notamment médicales, hôtelières et générales, connaîtraient une décélération, avec + 2,5 % en 2013 contre + 4,6 % en 2012. La progression des recettes résulte principalement de celle des produits versés par l’assurance maladie. Ces derniers, y compris le fonds d’intervention régional (FIR), auraient augmenté de + 2,4 % en 2013 contre + 2,7 % l’année précédente.
Le volume des investissements est resté limité : 4,1 milliards d’euros en 2012 pour 3,8 en 2013, ce qui génère tout de même un ralentissement de la croissance de l’encours de la dette qui s’établirait à 29,1 milliards d’euros. La part des dépenses d’investissement au sein des produits a diminué de 10,9 % en 2009 à 8,7 % en 2012 pour s’établir à 7,6 % en 2013. Le taux d’indépendance financière, mesurant la part des dettes au sein des ressources stables, atteint près de 50 %. Ce ralentissement très net de l’investissement est lourd de conséquences pour l’avenir. La DREES constate toutefois que « la vétusté du parc hospitalier peut générer un effet rebond à cette austérité et relancer le cycle de l’endettement d’ici quelques années ».
Au total, la marge brute d’exploitation (6) des établissements diminuerait en 2013 pour s’établir à 4,7 milliards d’euros. Corrélée à la faiblesse de l’investissement, donc à une réduction des charges d’amortissement, cette situation est favorable à un résultat équilibré mais obère l’avenir. Corrélativement, la capacité d’autofinancement diminuerait de près de 300 millions d’euros pour n’atteindre que 3,8 milliards d’euros en 2013. Le taux d’autofinancement continuerait de baisser en 2013). Le seul point positif à retenir semble donc le ralentissement de la croissance de l’encours de la dette, sous l’effet conjugué de la baisse des taux et de l’absence de programmes soutenus d’investissement.
Cette situation est préoccupante. Il semblerait que les hôpitaux publics aient exploité les gisements de productivité et d’efficience dont ils pouvaient disposer sans devoir recourir à des investissements productifs. Aujourd’hui, la réfaction tarifaire, le gel des enveloppes et les politiques publiques générant un enchérissement de la dépense rendent plus difficile de dégager des marges suffisantes pour financer des investissements pour restructurer l’offre de soins. Si ces facteurs perdurent, il est probable que les hôpitaux auront beaucoup de difficultés à se moderniser et risquent de creuser leur déficit, entrant dans une infernale spirale d’endettement.
La problématique financière de l’hospitalisation privée est très différente. Le secteur lucratif a opéré un mouvement très important de concentration et de réduction du nombre de lits. De plus, comme l’a expliqué M. Lamine Gharbi, président de la Fédération hospitalière privée, lors de son audition par la mission, les établissements privés ont anticipé le développement de la chirurgie ambulatoire et de la réduction de la durée moyenne de séjour : « en vingt ans nous sommes passés, dans le secteur privé de 2 000 à 1 000 établissements et d’une taille moyenne modeste de 70 lits à 120 lits ». Leur endettement a été contenu et n’atteint que 2 milliards d’euros. Dans le même temps, la gestion de l’immobilier a été rationalisée : beaucoup d’établissements ont cédé la propriété de leurs murs pour ne pas avoir à supporter la charge de leur entretien et se concentrent sur la gestion médicale en payant un loyer au propriétaire des murs, ce qui représente une garantie de stabilité.
Les cliniques privées à but lucratif ont réalisé en 2012 un chiffre d’affaires d’environ 13,6 milliards d’euros, en progression de 500 millions d’euros par rapport à 2011 (soit + 4,1 %). Le chiffre d’affaires ne prend pas en compte les honoraires des praticiens libéraux qui y exercent. Dans leur ensemble, les cliniques privées ont dégagé un résultat excédentaire en 2012, comme lors des exercices précédents.
Cette situation économique, globalement satisfaisante, reste toutefois marquée par de fortes disparités. Plus d’un tiers des cliniques subissent des pertes alors qu’une sur dix affiche un taux de rentabilité nette supérieur à 10 %. En outre, les niveaux de rentabilité sont très variables selon le secteur d’activité. Les cliniques psychiatriques demeurent les plus rentables en 2012 (5,2 %, mais avec une diminution de – 0,6 point), devant les cliniques de SSR – soins de suite et de réadaptation – dont la rentabilité (3,2 %) repart à la hausse (+ 0,3 point) après deux années de baisse. Les cliniques MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) demeurent les moins rentables (à 1,2 %, en baisse de – 1,2 point).
B. UN NIVEAU D’ENDETTEMENT ÉLEVÉ RÉSULTANT DES PLANS HÔPITAL 2007 ET HÔPITAL 2012
Partant du constat d’un retard d’investissements dans le secteur hospitalier, les pouvoirs publics ont mis en place deux plans d’investissement ambitieux : Hôpital 2007 et Hôpital 2012.
Or, comme l’ont constaté l’ensemble des interlocuteurs entendus par la MECSS, l’ampleur de ces plans d’investissement et les modalités de financement choisies ont conduit à un accroissement important de l’endettement des établissements publics de santé.
Comme l’a souligné M. Yves Gaubert, responsable du pôle Finances et Banque de données hospitalières de la Fédération hospitalière de France (FHF), la dette des hôpitaux est devenue préoccupante à partir de 2003-2004. Ensuite les gouvernements ont en effet promu des plans d’investissements qui ont fait passer son montant de 10 milliards d’euros à près de 30 milliards d’euros en dix ans. Pour les hôpitaux publics, le financement de ces grands plans, notamment ceux de 2007 et 2012, reposait quasi exclusivement sur des dettes contractées auprès du secteur bancaire classique à des taux d’intérêt supérieurs d’environ 1 % à ceux de la dette de l’État.
Ces prêts avaient de plus une durée longue puisque leur durée de vie résiduelle est encore aujourd’hui de dix-huit ans. Ce niveau d’endettement, même s’il a tendance à se réduire depuis 2013, a de fâcheuses conséquences pour la modernisation de l’offre hospitalière. Pour M. Gaubert ces emprunts « obèrent en conséquence une partie de la capacité d’autofinancement des hôpitaux : 2,5 milliards d’euros sur les 3,5 milliards d’autofinancement dégagés annuellement sont aujourd’hui destinés à l’amortissement de la dette. Ce sont autant de fonds qui manquent pour la modernisation et la restructuration des établissements. »
1. Le paysage de l’endettement des établissements de santé
À fin 2013, la dette des hôpitaux publics s’élevait à 29,3 milliards d’euros.
Elle se répartissait comme suit :
● entre catégories d’établissements :
Catégorie d’établissement |
Encours fin 2013 (en millions d’euros) |
Proportion |
Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) |
2 238 |
7,7 % |
CH Régionaux |
8 634 |
29,7 % |
CH budget > 70 millions d’euros |
10 675 |
36,7 % |
CH budget 20-70 millions d’euros |
3 602 |
12,4 % |
CH budget < 20 millions d’euros |
518 |
1,8 % |
CH de proximité (ex HL) |
1 655 |
5,7 % |
CHS |
1 569 |
5,4 % |
GCS |
28 |
0,1 % |
Autres |
191 |
0,7 % |
Total |
29 111 |
100,0 % |
Source : DGFiP, retraitements DGOS.
CH : centre hospitalier
CHS : centre hospitalier spécialisé
GCS : groupement de coopération sanitaire
● entre régions :
Région |
Encours fin 2013 (en millions d’euros) |
Alsace |
617 |
Aquitaine |
980 |
Auvergne |
686 |
Basse-Normandie |
625 |
Bourgogne |
1 117 |
Bretagne |
1 416 |
Centre |
1 166 |
Champagne-Ardenne |
529 |
Collectivités d’outre-mer |
70 |
Corse |
111 |
Franche-Comté |
736 |
Guadeloupe |
282 |
Guyane |
84 |
Haute-Normandie |
772 |
Ile-de-France |
4 640 |
La Réunion |
338 |
Languedoc-Roussillon |
1 136 |
Limousin |
199 |
Lorraine |
1 331 |
Martinique |
386 |
Mayotte |
58 |
Midi-Pyrénées |
1 074 |
NDA |
0 |
Nord-Pas-de-Calais |
1 834 |
Pays de la Loire |
1 226 |
Picardie |
1 266 |
Poitou-Charentes |
685 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
2 561 |
Rhône-Alpes |
3 187 |
Total |
29 111 |
Source : DGFiP, retraitements DGOS.
De 2003 à 2012, la dette hospitalière a triplé, passant de 9,8 milliards d’euros courants à 29,3 milliards. Elle a encore progressé d’un milliard d’euros en 2013. Elle a connu sur cette période une dynamique particulièrement élevée – augmentant parfois jusqu’à 19 % d’une année à l’autre. Pour la période 2006-2009, elle a crû en moyenne de 16 % par an. Ce rythme s’est néanmoins sensiblement infléchi à la baisse puisqu’il est revenu à une hausse moyenne annuelle de l’ordre de 10 % dans les années récentes et de 6 % aujourd’hui.
2. L’investissement des hôpitaux publics sur la même période
C’est afin de remédier à la problématique de la nécessaire modernisation des hôpitaux – développement de la médecine ambulatoire et renouvellement des équipements – que le plan Hôpital 2007 et le plan Hôpital 2012 ont été mis en œuvre.
– Le plan Hôpital 2007, dont l’initiative est partie du constat d’une grande vétusté dans de nombreux établissements, prévoyait le financement de 10 milliards d’euros d’investissement sur cinq ans, grâce à une aide nationale de 6 milliards, dont 1 milliard a été versé sous forme de capital par le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), et 4,7 milliards sous forme d’aide en fonctionnement, c’est-à-dire avec le versement d’une part de dotation permettant de couvrir des annuités de remboursement des emprunts des établissements.
Le rythme de financement des subventions en capital attribuées au titre du FMESPP, initialement prévu à 300 millions d’euros par an, a été revu en cours de plan. Dès l’année 2006, il y a eu substitution partielle entre les deux modes de financement et 428 millions d’euros ont été convertis de FMESPP en ONDAM. Au total, le soutien financier attribué depuis le lancement du plan Hôpital 2007 s’élève, en capital versé par le FMESPP, à 1,061 milliard d’euros.
Comme l’a rappelé le directeur général de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), M. Jean Debeaupuis, lors de son audition : « Ce mécanisme, qui n’était pas celui initialement prévu par le gouvernement de 2002, puisqu’une part plus large en capital avait été envisagée, s’est révélé efficace en termes de modernisation des installations, de regroupement de sites, d’amélioration de l’hôtellerie hospitalière, de renouvellement des plateaux techniques. En revanche, il a présenté l’inconvénient majeur, pointé tant par les acteurs de santé que par les pouvoirs publics et la Cour des comptes, d’alimenter l’endettement des établissements, qui s’est accru sur la période. »
Aujourd’hui, le montant total des investissements correspondants est estimé à 16,8 milliards d’euros. L’aide apportée via ce plan a permis un accroissement de l’ordre de 40 % des investissements hors plan entre 2002 et 2007.
INVESTISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ DE 2001 À 2007
(en milliards d’euros)
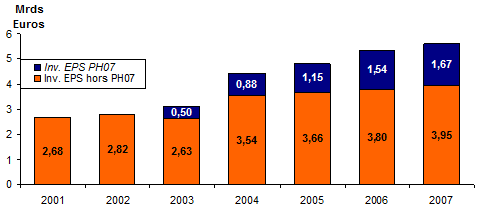
Source : Direction générale de la compatibilité publique (devenue DGFiP) et Sidonih 2008.
– Le Plan Hôpital 2012 avait pour objet de permettre l’amélioration de l’efficience des établissements de santé, tout en maintenant un niveau d’investissement permettant la poursuite de la modernisation du patrimoine (7).
L’effort d’investissement visé par ce plan était de 10 milliards d’euros sur cinq ans. Ce montant plafond s’entendait comme un effort supplémentaire s’ajoutant aux investissements courants. Il devait permettre de maintenir, sur la période 2008-2012, un niveau comparable à celui du plan précédent.
Le gouvernement de l’époque n’en a lancé que la première tranche, à hauteur de 4,6 milliards d’euros, dont 2,2 milliards d’euros d’aides versés avec des ratios légèrement améliorés en part en capital, à hauteur de 626 millions d’euros, et le reste également sous forme d’aide couvrant le coût du recours à l’emprunt.
– L’effet d’accumulation des dossiers d’investissement s’est traduit entre 2002 et 2009 par un doublement du niveau d’investissement des établissements publics de santé, qui est ainsi passé de 3 milliards à 6,6 milliards d’euros sur la période. Ce pic historique de 2009 s’est révélé insoutenable, si bien que la ministre a prévu, pour la période 2012-2022, de ramener ce niveau à 4,5 milliards d’euros par an. Il devrait être atteint en 2014, après avoir progressivement décru, à 5 milliards d’euros en 2013.
En matière d’investissements, on peut distinguer trois périodes sur les deux dernières décennies.
La période 1992-2001 s’est caractérisée par un investissement de l’ordre de 2,5 milliards d’euros par an.
Entre 2002 et 2011, l’investissement a « explosé », pour passer à 6 milliards par an en moyenne, et même à 7 milliards en 2009, encouragé par les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012.
Enfin, à partir de 2011, avec une décélération très progressive et un investissement ramené à moins de 5 milliards en 2013, l’objectif a été fixé à 4,5 milliards d’euros par an.
Quant à l’endettement, il est passé de 9 milliards en 2002 à 30 milliards d’euros en 2013, rythme de croissance deux fois plus rapide que celui des collectivités locales. Or les comptes des établissements montrent très nettement que le triplement de l’endettement ne s’est en rien appuyé sur une augmentation de la capacité d’autofinancement. D’où une symétrie parfaite entre la courbe de l’endettement net et celle de l’investissement annuel, celui-ci entraînant celui-là.
Plusieurs personnes auditionnées par la MECSS ont ainsi constaté les limites de cette méthode de financement par « plan » avec des objectifs de dépenses, conduisant à des investissements souvent rapidement réalisés et faisant l’objet de trop peu d’études préalables.
Ainsi, M. Yves Gaubert, responsable du pôle Finances et Banque de données hospitalière de la Fédération hospitalière de France (FHF), a constaté : « Puisque j’évoque ce plan, il faut également dire que les choses se sont faites à l’époque dans une certaine précipitation. Au-delà de la volonté de moderniser les hôpitaux, il s’agissait, en 2007, d’afficher des résultats en termes de relance économique. Les premiers dossiers de ce plan ont donc été lancés extrêmement rapidement, parfois par des structures qui ne disposaient pas d’autofinancement. On peut parler d’une fuite en avant. Une fois le projet mis en œuvre, il fallait bien le faire fonctionner ce qui, surtout à l’époque, était encore plus coûteux qu’aujourd’hui car on ne lésinait pas sur les mètres carrés. Ces conditions expliquent que la volonté de diminuer la charge de la dette en première période ait conduit à la souscription d’emprunts dangereux. »
M. Michel Rosenblatt, secrétaire général du syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT), a analysé ainsi les raisons du recours à l’endettement lors de son audition par la MECSS : « Pourquoi la situation est-elle tendue aujourd’hui ? L’endettement des hôpitaux n’est pas né par hasard. C’est la conséquence d’un choix déterminé de relance des investissements hospitaliers à partir de 2002 à travers le plan Hôpital 2007 qui a été prolongé par le plan Hôpital 2012. Le constat était à l’époque que les hôpitaux qui avaient, pour des raisons essentiellement financières, limité leurs efforts d’investissements en infrastructures et en équipement, étaient dans une situation de désolation et qu’il fallait donc relancer la machine, ce qui pouvait d’ailleurs contribuer à relancer la croissance, soit par des subventions d’investissements, soit par le recours à l’emprunt, soit par des partenariats public-privé (PPP). (…) On a privilégié le financement par l’emprunt par rapport à la dotation directe en capital parce que cela permettait un effet de levier ; et on a imposé des normes techniques très optimistes et exagérément exigeantes, ce qui fait qu’on a construit trop grand et trop cher. La compensation du coût des investissements qui était promise n’a pas été assurée. Les dotations des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) devaient compenser le surcoût des amortissements et des frais financiers. Or cela a très souvent été oublié, notamment lorsqu’on est passé à l’intégration dans les fonds d’intervention régionale (FIR). Souvent, des promesses de financement sur le long terme – dix, vingt, voire trente ans – se sont perdues en cours de route lors du changement de système. Les hôpitaux se sont retrouvés sans l’assurance des ressources qui leur étaient promises. »
Ces investissements ont été dans leur grande majorité dirigés vers des projets immobiliers et très peu centrés sur les systèmes d’information, la performance ou les projets de restructuration, occasionnant dans certains cas un surdimensionnement des structures. Les opérations immobilières ont ainsi représenté près de 95 % de ce plan, les opérations d’équipements et de systèmes d’information hospitaliers (SIH) seulement 5 %.
Tel est le constat dressé par M. Gautier Bailly, sous-directeur à la direction du budget au ministère des finances et des comptes publics : « La question a été posée de la nécessité de cet investissement. On sait que les besoins étaient extrêmement importants au regard de la vétusté de certains établissements, des mises aux normes nécessaires en matière de sécurité et d’incendie, mais aussi de la concurrence entre établissements liée à la T2A (tarification à l’activité). Pour autant, l’investissement a été concentré sur l’immobilier, l’accroissement des surfaces et des capacités hospitalières. Ainsi, l’investissement immobilier lourd est le principal contributeur à la croissance des investissements, puisqu’il est passé de 1,4 milliard d’euros en 2002 à 4,2 milliards d’euros en 2009, soit là encore un triplement. »
Celui-ci a fait part du constat suivant que, pour les CHU, qui représentent un quart du patrimoine immobilier hospitalier, la part du bâti neuf ou réhabilité a augmenté de 70 % et les surfaces globales de 30 % durant la même période, alors que le nombre de mètres carrés obsolètes ou vétustes, lui, n’a pas toujours diminué. Ainsi, les opérations ont été réalisées sans réel effort de densification et dans le sens d’une extension globale des surfaces.
En outre, la capacité hospitalière a augmenté de 5 % entre 2010 et 2011, alors que l’activité était stable, voire en léger recul, que la durée moyenne de séjour a baissé et que le recours à la chirurgie ambulatoire a progressé. Des exemples de projets surdimensionnés ou mal adaptés à cette évolution des pratiques médicales sont mentionnés dans le rapport de la Cour des comptes sur le plan Hôpital 2007.
Au total, les taux d’occupation des structures hospitalières restent relativement faibles, à hauteur d’environ 75 % en MCO, et entre 10 000 et 11 000 lits ont un taux d’occupation de moins de 50 %.
En définitive, cet investissement, présenté comme nécessaire, voire indispensable, s’est appuyé sur l’encouragement à l’emprunt, conduisant parfois à une sélection trop rapide des projets, ainsi que sur des sous-jacents médico-économiques parfois trop ambitieux.
Ces conclusions ont conduit le Gouvernement actuel à abandonner cette logique de plan et à installer, fin décembre 2012, le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO), chargé de la supervision financière des établissements (cf. infra).
Ces orientations, conjuguées à la décision d’abandonner la deuxième tranche du plan Hôpital 2012, ont permis une légère amélioration des indicateurs financiers. En effet, entre 2009 et 2013, le montant des investissements annuels est revenu à un niveau plus raisonnable, passant de 6,7 milliards d’euros à 4,9 milliards ; les emprunts nouveaux sont passés de 5 milliards d’euros à 3 milliards ; et l’endettement net n’a progressé que de 0,9 milliard d’euros, passant de 28 milliards d’euros à 29 milliards en 2013. La phase de désendettement n’est pas encore amorcée, mais elle le sera sans doute vers 2016-2017 si les perspectives fixées par le gouvernement sont respectées.
3. Des procédures d’emprunt trop souples qui ont permis des dérives
Le dynamisme de l’investissement hospitalier a été entretenu par l’abondance des projets présentés par les établissements eux-mêmes, ce qui a donné, dans le contexte de la mise en œuvre de la tarification à l’activité (T2A) et d’un regain d’activité des hôpitaux qui était source de recettes supplémentaires, le sentiment que le recours à l’emprunt était un moyen de financer dans de bonnes conditions ce surplus d’investissements. Au total, de 2003 à 2012, l’emprunt représentait le tiers des ressources consacrées à l’investissement par les établissements hospitaliers, soit bien davantage que ce qui avait été projeté par les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012.
La seconde raison de l’emballement constaté a été l’allégement progressif des contrôles de l’administration sur les stratégies de dette des établissements publics hospitaliers. Jusqu’en 2005, ces derniers devaient soumettre leurs emprunts à leur conseil d’administration, donnant à l’agence régionale d’hospitalisation (ARH), saisie des délibérations du conseil d’administration, la possibilité de réagir. Même si les ARH intervenaient rarement, au moins étaient-elles informées de la stratégie d’endettement des hôpitaux. Or une ordonnance de 2005 a modifié ce régime en donnant davantage de latitude aux établissements hospitaliers dans la souscription de leurs emprunts, et la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a encore élargi cette marge d’autonomie en donnant aux directeurs des hôpitaux une compétence pleine et entière en la matière.
Cette forme de libéralisation du recours à l’emprunt a eu lieu au moment où le levier de la dette était le plus fortement mobilisé. La perspective d’un surcroît d’activité lié à l’entrée en vigueur de la T2A a facilité le recours à la dette. De ce fait, l’attention portée au choix des projets d’investissements a peut-être été moins vigilante qu’il n’eût fallu. La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes ont ainsi constaté à de nombreuses reprises que ces choix n’avaient pas été guidés par un souci d’efficience, et qu’on avait construit des établissements surdimensionnés par rapport à la réalité de leur activité.
L’emballement de la dette hospitalière a longtemps été négligé, ce qui explique le caractère tardif de la réaction des pouvoirs publics. Ce n’est qu’à partir de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 que le Gouvernement a cherché à mieux réguler l’appel à l’emprunt. Un décret a été pris à l’automne 2011 pour soumettre à autorisation d’emprunt les établissements les plus endettés ; il ne permet toutefois de réguler qu’une partie de l’appel à l’emprunt, compte tenu des dispositions qui définissent les établissements surendettés et du fait que ces derniers soumettent aux agences régionales de santé (ARS) non pas leurs emprunts mais leurs plans prévisionnels d’endettement, c’est-à-dire le volume d’emprunts qu’ils envisagent de souscrire.
Ce fort recours à l’endettement s’explique aussi par un marketing offensif des établissements bancaires. M. Patrice Chatard, directeur de Finance active, a ainsi expliqué lors de son audition par la mission :
« (…) le marché commercial était guidé par les banques – dont certaines comportaient des équipes de plus de 300 commerciaux – et, toute la journée, les directeurs financiers des collectivités locales et des établissements publics de santé étaient sollicités pour réaliser ce type de produit. Il n’y a donc aucune ambiguïté ; le marché était parfaitement organisé par les banques à l’époque : Dexia en tête, Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland (RBS), etc. »
Une très forte offensive a été menée pour avoir des coûts très attractifs :
« Dans tous les cas, la politique commerciale des banques était claire : il s’agissait de remporter l’appel d’offres sur le financement et donc l’encours, si bien qu’elles étaient prêtes à casser les prix. Les commerciaux ont annoncé aux hôpitaux avoir “mieux” à leur proposer que du “Euribor trois mois sans marge”, à savoir des produits structurés dont certains se sont révélés très toxiques. C’est ainsi que les choses sont arrivées. »
Pour les banques, les produits structurés répondaient à deux objectifs.
Le premier était de créer davantage de rémunération. Le marché du secteur public local au sens large est peu rémunérateur du fait de la règle de dépôts des fonds au Trésor, alors que la « bancarisation », c’est-à-dire la gestion des flux, est le nerf de la guerre pour les banques. Au surplus, la concurrence avait fait baisser les marges sur les crédits standards à des niveaux très bas. Par conséquent, des produits complexes, avec de l’ingénierie financière, assuraient de facto davantage de rémunération.
Ensuite, le second objectif était d’avoir la « mainmise » sur les encours. Il était très difficile, voire impossible aux clients de sortir d’un encours en produit structuré – des produits indexés sur le franc suisse, notamment.
Cela explique l’impact commercial très important de ces produits. On peut même dire que cette offre a créé sa demande : un taux facial faible pouvait rencontrer une demande en raison des plans d’investissement très importants et de la nécessité de chercher des marges de manœuvre.
L’appréciation de l’implication de chacun des acteurs est cependant divergente selon les personnes que la MECSS a pu auditionner.
Il apparaît à la rapporteure que les responsabilités sont largement partagées entre la tutelle, les établissements hospitaliers et les établissements bancaires.
Lors de son audition, M. Guillaume Wasmer, représentant le syndicat des manageurs publics de santé (SMPS), a bien cerné la responsabilité respective des acteurs : « …la dette est la résultante d’un système “pousse au crime”, puisque les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 n’ont pas été des plans d’investissement au sens strict, mais des plans d’aide à l’emprunt. Sur les 6 milliards d’euros du plan Hôpital 2007, il n’y avait qu’un milliard sous forme de subventions. On a donc poussé les établissements à s’endetter. Les agences régionales de santé qui avaient une marge de manœuvre qui n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui ont accompagné le système avec exactement le même type de financement, c’est-à-dire non sous forme de subventions mais sous forme d’aide au remboursement des seuls frais financiers. Les dossiers ont été choisis sur des critères de rapidité de réalisation et non d’endettement ».
M. Éric-Alban Giroux, directeur d’hôpital, au cours de cette même audition a souligné que les plans Hôpitaux avaient fortement favorisé les banques :
« Les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 ont été vécus comme un soutien davantage au monde bancaire qu’au monde hospitalier public. Le privé a bénéficié de subventions tandis que le public a eu le droit d’emprunter moyennant la couverture de ses intérêts d’emprunt ou de faire des partenariats public-privé. En fait, on a demandé au public, soit de s’endetter définitivement sur une longue période, soit de supprimer complètement son titre IV, c’est-à-dire les amortissements et les frais financiers, au profit d’un bâtisseur privé, c’est-à-dire d’avoir les pieds et poings liés à un bâtisseur privé qui faisait payer cher le moindre changement de cloison ».
Cet emballement de la dette, depuis 2003, a mis certains hôpitaux dans une situation critique.
L’alourdissement de la dette a eu, très logiquement, une incidence forte sur les ratios habituellement utilisés pour apprécier la situation financière des établissements. Le ratio de dépendance financière, c’est-à-dire la part de la dette dans les capitaux permanents, a augmenté de moitié et approche désormais 50 %. Le taux d’endettement, à savoir l’encours de la dette sur le total des produits d’activité, a lui-même doublé en dix ans et avoisine 40 %. Cet endettement élevé compromet le financement des investissements courants et des investissements incompressibles de renouvellement des équipements.
La marge brute des établissements, autrement dit le surcroît de recettes que leur activité dégage par rapport à leurs dépenses, s’élevait en 2011 à 5,1 %. Sur ces 5,1 %, ils doivent en moyenne consacrer 4,1 % au remboursement de leurs emprunts ; il ne leur reste donc qu’une marge nette de 1 %, alors que 3 %, au moins, seraient nécessaires pour financer leurs investissements courants comme le renouvellement des équipements. Aussi, compte tenu du poids de la dette, les établissements ne sont-ils pas à même de financer leurs investissements courants sans aides complémentaires de la part des pouvoirs publics.
ÉVOLUTION DE LA DETTE À MOYEN ET LONG TERMES DES EPS
(en milliards d’euros)
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Encours de la dette |
9,8 |
10,9 |
12,0 |
13,5 |
15,9 |
18,9 |
21,9 |
24,2 |
26,5 |
29,3 |
Évolution N/N-1 |
10 % |
11 % |
10 % |
13 % |
18 % |
19 % |
16 % |
10 % |
10 % |
10 % |
Source : Direction générale des finances publiques et direction générale de l’offre de soins.
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG ET MOYEN TERMES DES EPS EN 2011 ET 2012
(en millions d’euros)
2011 |
2012 | |
Chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées |
26 758 |
29 382 |
Dont 163 – emprunts obligataires |
1 606 |
1 695 |
164 – emprunts auprès des établissements de crédit |
24 551 |
25 930 |
167 – emprunts assortis de conditions particulières |
377 |
1 503 |
Dont 1675 – dettes – partenariats public-privé |
30 |
1 179 |
168 – autres emprunts et dettes assimilés |
205 |
234 |
Source : Comptes financiers des EPS. Extraction Cour des Comptes.
La charge de la dette a heureusement progressé moins rapidement que son encours en raison du faible niveau des taux d’intérêt. Le montant global des intérêts est cependant passé de 403 millions d’euros à 928 millions entre 2003 et 2012 et représentait en 2012 1,4 % des charges d’exploitation.
ÉVOLUTION DES RATIOS D’ENDETTEMENT DES EPS
2003 |
2007 |
2011 |
2012 | |
Dépendance financière |
33 % |
40 % |
49 % |
50 % |
Taux d’endettement |
19 % |
27 % |
37 % |
39 % |
Durée apparente de la dette (dette/CAF) |
3,4 |
5,6 |
6,3 |
7,1 |
Charges d’intérêt sur charges exploitation |
0,9 % |
1,0 % |
1,3 % |
1,4 % |
Service de la dette sur produits d’exploitation |
3,8 % |
3,7 % |
4,1 % |
4,7 % |
Source : Cour des comptes (à partir de données transmises par la direction générale des finances publiques).
PART DE L’ENDETTEMENT DANS LE FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS DE 2003 À 2012
(en milliards d’euros)
Emplois |
Ressources | |||
Investissements |
55,0 |
Endettement net |
18,7 |
32 % |
Abondements fonds de roulement |
3,3 |
Capacité d’autofinancement |
34,8 |
59 % |
Autres emplois |
0,6 |
Subventions et cessions |
5,4 |
9 % |
Total |
58,9 |
Total |
58,9 |
100 % |
Source : Direction générale des finances publiques et direction générale de l’offre de soins (calculs Cour des comptes).
Sur la période 2003-2012, les subventions et les cessions ont représenté moins de 10 % des ressources d’investissement des établissements publics de santé, tandis que la capacité d’autofinancement en a constitué près de 60 %. Le recours à l’endettement a finalement représenté près du tiers (32 %) des moyens mobilisés par les établissements publics de santé pour financer leurs investissements et, de manière plus marginale, pour abonder leur fonds de roulement, durant ces dix années de très forte modernisation des équipements et du parc immobilier des hôpitaux.
4. Des emprunts toxiques dont il est difficile de se désengager
Bien plus que le niveau d’endettement, c’est le type d’emprunts souscrits qui a fortement obéré la situation financière des établissements de crédits. Pour profiter de taux apparemment attractifs et en raison d’une politique commerciale très offensive de certaines banques, les établissements de santé ont souscrit massivement des emprunts structurés que l’on a qualifiés ultérieurement de « toxiques » tant leurs conséquences furent déplorables pour la stabilité financière de ces établissements.
Les emprunts structurés (cf. annexe 3) sont des prêts combinant dans un seul et même contrat un prêt bancaire classique et un ou plusieurs dérivés, dont les intérêts sont déterminés selon l’évolution d’un indice sous-jacent non standard (8) (taux de change, différentiel entre un taux long et un taux court, écart de valeur entre deux indices d’inflation…) ou sont calculés selon des formules complexes pouvant être non linéaires de sorte que l’évolution des taux supportés peut être plus que proportionnelle à celle de l’index lui-même (c’est notamment le cas des produits affectés de coefficients multiplicateurs).
L’une des caractéristiques des produits structurés tient à la présence de plusieurs périodes de taux successives :
– la première, en général de deux ou trois ans, est marquée par un taux d’intérêt fixe bonifié (en dessous du cours du marché, voire nul) ;
– la deuxième période, très longue, est assortie d’un taux qui résulte d’une formule arithmétique contenant un ou plusieurs produits dérivés du contrat assis sur des indices non standards ;
– une troisième période peut éventuellement exister, de courte durée (un ou deux ans), assortie d’un taux fixe égal ou proche du taux de la première période.
En raison du caractère attractif des taux bonifiés et des difficultés d’appréhension des risques encourus, un nombre significatif de collectivités territoriales et d’établissements publics locaux ont eu recours aux produits structurés depuis leur introduction au début des années 1990 et plus particulièrement au cours des années 2007 et 2008. La crise financière de 2008, qui a entraîné des niveaux de volatilité de forte amplitude des indices utilisés dans les formules de calcul des taux des emprunts structurés, a révélé la réelle dangerosité de certains des emprunts contractés.
La signature en 2009 d’une charte de bonne conduite dite « charte Gissler » entre les établissements bancaires et les collectivités locales et la diffusion de la circulaire du 25 juin 2010 ont permis de mettre fin à la commercialisation des produits structurés à risque.
La mise en place dans le cadre de la charte de bonne conduite d’une classification des produits structurés et la rénovation des annexes budgétaires des collectivités territoriales relatives à la dette ont permis d’améliorer de façon significative l’information des élus et des citoyens sur la dette publique locale, notamment sur les risques liés aux emprunts structurés.
La classification Gissler permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la Charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser.
Dans un climat de concurrence exacerbée, les établissements de crédit ont sollicité les établissements de santé pour qu’ils souscrivent des emprunts sophistiqués avec, dans un premier temps, une phase de bonification – donc avec un intérêt immédiat à la souscription –, mais, dans un second temps, une indexation les exposant à des risques considérables.
Dans l’encours des dettes hospitalières, les emprunts à risque élevé représentent 2,5 milliards d’euros, soit 9 % de l’encours total Les emprunts particulièrement délétères représentent pour leur part environ un milliard d’euros, soit 4 % des encours. Selon les données de la Société de financement local (SFIL), qui a repris à Dexia son portefeuille d’emprunts, les hôpitaux connaissent un niveau de risque équivalent à celui des collectivités locales : 34 % des encours des établissements publics de santé auprès de la SFIL correspondent à des emprunts structurés, contre 35 % pour les collectivités locales. Ces emprunts structurés représentent donc une part importante de l’encours de la dette hospitalière, et sont d’autant plus dangereux qu’ils sont concentrés sur un nombre limité d’établissements. Une centaine d’entre eux sont très fortement « chargés » en emprunts toxiques, certains importants comme le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne, d’autres bien plus modestes comme le centre hospitalier intercommunal de Montreuil.
Cette situation, marquée par l’importance des emprunts toxiques, n’est pas encore totalement visible dans la comptabilité des hôpitaux, qui n’ont été tenus de provisionner leurs risques qu’à partir de l’exercice 2014. Or ces risques sont importants. Les éléments d’information recueillis montrent que le coût de sortie des emprunts structurés – soit le rachat des options liées à ces emprunts toxiques – représente, en cas de remboursement anticipé, une dépense de l’ordre de 1,5 milliard d’euros, dont un milliard pour certains emprunts parmi les plus risqués, que les établissements bancaires ne consentent plus aujourd’hui ni aux collectivités locales ni aux établissements publics de santé car ils sont particulièrement dangereux.
Pour les établissements de crédit, les établissements publics de santé sont considérés comme moins rassurants que les collectivités locales : s’ils ont la même structure d’emprunt, ils n’ont pas, contrairement à elles, la possibilité de lever l’impôt. Aussi les établissements de crédit relèguent-ils en deuxième position les demandes d’emprunts des établissements hospitaliers.
Cette situation a été en partie palliée par la montée en puissance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui a dégagé des enveloppes de crédit en faveur des établissements publics de santé, sous réserve que ces crédits soient d’une durée assez longue.
Selon une enquête menée par la DGOS, avec l’appui de l’ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation), auprès des établissements début 2014 sur leur encours à fin 2013, 84,3 % de l’encours de dette était composé de prêts dits non structurés (classé 1A dans la matrice de risque Gissler), soit environ 24,5 milliards d’euros.
Parmi les emprunts structurés (soit 15,7 % de l’encours de dette), le niveau de risque de taux varie selon la nature du contrat de prêt (formule d’indexation du taux). Les emprunts structurés dits hors charte, les plus risqués, représenteraient presque 1 milliard d’euros, soit 3,4 % de l’encours. Les prêts structurés très sensibles mais conformes à la charte dite Gissler (cotés 3E, 4E et 5E) représenteraient 2,7 % de l’encours soit environ 800 millions d’euros. Enfin, les autres emprunts structurés, dits moins sensibles, représenteraient 9,7 % de l’encours soit 2,7 milliards d’euros.
En conclusion, le niveau de risque des emprunts est globalement en diminution entre 2012 et 2013. Il est possible de présenter la décomposition des emprunts selon le degré de risque :
– l’encours des emprunts non structurés (1A : non risqués) a augmenté de + 4,4 %, passant de 20,9 milliards d’euros en 2012 (81,7 % des encours) à 21,8 milliards d’euros en 2013 (84,0 %) ;
– en parallèle, l’encours des emprunts structurés (autres catégories de risque : de faible à très élevé) a diminué de 11,1 %, passant de 4,7 milliards d’euros en 2012 (18,3 %) à 4,2 milliards d’euros en 2013 (16,0 %). En particulier l’encours des emprunts structurés à risque très élevé (6F, dits « hors charte ») a diminué de 5,0 %, passant de 906 millions d’euros en 2012 (3,5 %) à 861 millions d’euros en 2013 (3,3 %).
EMPRUNTS STRUCTURÉS « HORS CHARTE GISSLER »
PAR EPS, CLASSÉS PAR RÉGION
(en euros)
Raison sociale |
Région |
Catégorie D’EPS |
Encours 6F au 31/12/2013 ou 2014 quand l’information est disponible |
Centre hospitalier de Sélestat |
Alsace |
CH |
8 176 017 |
Centre hospitalier de Mulhouse |
Alsace |
CH |
1 928 571 |
Hôpitaux universitaires de Strasbourg |
Alsace |
CHU |
25 301 727 |
Centre hospitalier de Brioude |
Auvergne |
CH |
3 073 296 |
Centre hospitalier de Vichy |
Auvergne |
CH |
14 188 931 |
Centre hospitalier de Montluçon |
Auvergne |
CH |
6 359 945 |
Centre hospitalier d’Autun |
Bourgogne |
CH |
6 385 986 |
Centre hospitalier de Clamecy |
Bourgogne |
CH ex HL |
2 101 939 |
Centre hospitalier spécialisé de Sevrey |
Bourgogne |
CH ex CHS |
1 950 000 |
Centre hospitalier universitaire de Dijon |
Bourgogne |
CHU |
57 923 998 |
Centre hospitalier de Paimpol |
Bretagne |
CH |
2 529 453 |
Centre hospitalier des Pays de Morlaix |
Bretagne |
CH |
1 815 159 |
Centre hospitalier de Dreux |
Centre |
CH |
1 528 920 |
Centre hospitalier de Bonneval |
Centre |
CH ex CHS |
2 400 000 |
Centre hospitalier de Chartres |
Centre |
CH |
4 236 239 |
Centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz (Saint-Dizier) |
Champagne-Ardenne |
CH |
7 600 000 |
Hôpital local de Bonifacio |
Corse |
CH ex HL |
2 500 000 |
Centre hospitalier d’Ajaccio |
Corse |
CH |
7 500 000 |
Centre hospitalier de Haute-Comté |
Franche-Comté |
CH |
7 056 321 |
Centre hospitalier de la Haute-Saône |
Franche-Comté |
CH |
8 851 351 |
Long séjour du centre de gérontologie Chevreuse |
Île-de-France |
USLD |
3 392 00 |
Centre hospitalier André Grégoire (Montreuil) |
Île-de-France |
CH |
24 809 901 |
Centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge |
Île-de-France |
CH |
12 160 714 |
Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges |
Île-de-France |
CH |
8 226 666 |
Centre hospitalier de Rambouillet |
Île-de-France |
CH |
11 304 996 |
Centre hospitalier de Meaux |
Île-de-France |
CH |
20 000 000 |
Centre hospitalier du parc-Sarreguemines |
Lorraine |
CH |
16 484 070 |
Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines |
Lorraine |
CH ex CHS |
2 756 074 |
SlNCAL |
Lorraine |
SIH |
11 045 385 |
Centre hospitalier Pierre Delpech de Cazeville |
Midi-Pyrénées |
CH |
1 666 729 |
Centre hospitalier de Villefranche de Rouergue |
Midi-Pyrénées |
CH |
5 495 275 |
Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège |
Midi-Pyrénées |
CH |
5 159 559 |
Centre hospitalier « Hôpital Jacques Puel » de Rodez |
Midi-Pyrénées |
CH |
14 440 594 |
Centre hospitalier Le Cateau-Cambresis |
Nord-Pas-de-Calais |
CH |
8 051 198 |
Centre hospitalier d’Arras |
Nord-Pas-de-Calais |
CH |
49 968 367 |
Centre hospitalier de Denain |
Nord-Pas-de-Calais |
CH |
2 603 037 |
Centre hospitalier de Dunkerque |
Nord-Pas-de-Calais |
CH |
3 232 804 |
Centre hospitalier de Douai |
Nord-Pas-de-Calais |
CH |
3 232 804 |
Centre hospitalier du Havre |
Haute-Normandie |
CH |
4 958 243 |
Centre hospitalier universitaire de Rouen |
Haute-Normandie |
CHU |
7 000 000 |
Hôpital intercommunal Sèvre et Loire |
Pays-de-la-Loire |
CH ex HL |
6 058 273 |
Pôle santé Sarthe et Loir |
Pays-de-la-Loire |
CH |
25 666 667 |
Hôpital local du sud-ouest mayennais |
Pays-de-la-Loire |
CH ex HL |
2 920 111 |
Centre hospitalier de Fontenay-la-Cointe |
Pays-de-la-Loire |
CH |
2 800 000 |
Centre hospitalier de La Ferté-Bernard |
Pays-de-la-Loire |
CH |
2 359 774 |
Centre hospitalier universitaire de Nantes |
Pays-de-la-Loire |
CHU |
90 536 555 |
Centre hospitalier du Mans |
Pays-de-la-Loire |
CH |
6 592 000 |
Centre hospitalier de Loire Vendée Océan à Challans |
Pays-de-la-Loire |
CH |
6 080 000 |
Centre hospitalier de Saint-Valéry-sur-Somme |
Picardie |
CH ex HL |
3 485 931 |
Centre hospitalier de Saintonce |
Poitou-Charentes |
CH |
4 200 000 |
Centre hospitalier de Briancon |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
CH |
10 365 250 |
Centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
CH |
24 000 000 |
Centre hospitalier de Salon-de-Provence |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
CH |
4 417 238 |
Centre hospitalier d’Orange |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
CH |
2 600 000 |
APHM |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
CHU |
70 463 862 |
GCS-ES Institut cancérologie Lucien Neuwirth |
Rhône-Alpes |
CH |
11 182 248 |
Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne |
Rhône-Alpes |
CHU |
90 793 209 |
Centre hospitalier de Roanne |
Rhône-Alpes |
CH |
9 528 952 |
Hôpital de Gier |
Rhône-Alpes |
CH |
3 848 795 |
Hôpitaux des pays du Mont-Blanc |
Rhône-Alpes |
CH |
5 267 387 |
Centre hospitalier Saint-Jean-de-Maurienne |
Rhône-Alpes |
CH |
3 608 667 |
Centre hospitalier Vals d’Ardèche |
Rhône-Alpes |
CH |
4 069 893 |
Hôpitaux du Léman |
Rhône-Alpes |
CH |
5 575 692 |
Centre hospitalier universitaire de Grenoble |
Rhône-Alpes |
CHU |
11 001 976 |
Centre hospitalier de Mayotte |
Z-Réunion |
CH |
19 200 000 |
EPSMR |
Z-Réunion |
CH ex CHS |
1 964 286 |
GH Est-Réunion |
Z-Réunion |
CH |
18 846 614 |
Centre hospitalier de Basse-Terre |
Z-Guadeloupe |
CH |
13 000 000 |
Centre hospitalier universitaire de Martinique |
Z-Martinique |
CHU |
26 270 327 |
Total |
882 883 173 |
Source : Direction générale de l’offre de soins – février 2015.
CH : centre hospitalier ; CHU : centre hospitalier universitaire ; HL : hôpital local ; CHS : centre hospitalier spécialisé ; USLD : unité de soins de longue durée.
L’appréciation des responsabilités respectives des établissements bancaires et des établissements hospitaliers dans la souscription massive des emprunts structurés fait l’objet d’analyses divergentes selon les acteurs.
Pour les représentants de la profession bancaire et les établissements de crédits eux-mêmes on ne peut pas affirmer que les établissements ont failli à leur devoir de conseil en incitant les centres hospitaliers à souscrire à des produits financiers très risqués.
M. Richard Boutet, représentant la Fédération bancaire française, a souligné lors de sa deuxième audition par la MECSS, la responsabilité partagée (9) de tous les acteurs et a indiqué que la Cour des comptes faisait ce même constat.
« La Cour explique que la responsabilité de ces emprunts risqués est partagée par les pouvoirs publics qui portent la responsabilité au premier chef puisqu’ils ont privilégié le levier de la dette pour financer un plus grand nombre d’opérations sans avoir instauré de procédure de choix rigoureux des investissements et tout en allégeant leur contrôle sur la nature et le montant des emprunts souscrits.
Les gestionnaires hospitaliers ne sont pas non plus sans responsabilités, l’argent de la dette a pu leur paraître un argent facile dans un contexte réglementaire permissif et dans un climat de concurrence entre les établissements bancaires qui a favorisé le développement d’offres de crédits structurés dont les risques considérables ne sont apparus qu’ensuite.
La Cour des comptes n’incrimine donc pas les banques comme seules responsables de cette situation, mais insiste sur une responsabilité partagée entre différents acteurs, aggravée par les options de gouvernance des hôpitaux publics. »
M. Hervé Leroux, directeur des entreprises et du secteur public au Crédit Agricole, a souligné lors de la première table ronde des banques tenue le 27 janvier 2015 que sa « banque n’avait pas cherché à orienter tel ou tel prêt structuré vers tel ou tel client. Les hôpitaux qui ont souscrit ces emprunts avaient des tailles très significatives et avaient la capacité de comprendre parfaitement les produits proposés. »
Cette absence de stratégie délibérée pour « placer » des emprunts toxiques a été confirmée par M. Cédric Mignon, directeur du développement des Caisses d’épargne du groupe BPCE. Il a souligné que « pour chaque demande de financement, sa banque proposait deux produits, l’un à taux fixe, l’autre sous forme de crédit structuré. Il a d’ailleurs considéré que durant plusieurs années ces produits structurés avaient correspondu à un financement usuel chez certains acteurs économiques dont certains d’ailleurs étaient assistés de conseils tout à fait experts dans le domaine. ».
Les directeurs des établissements hospitaliers font valoir qu’ils ont été très fortement incités à souscrire de tels emprunts par les discours rassurants des établissements bancaires. A posteriori, il est difficile d’apprécier, si les responsables hospitaliers et de la tutelle avaient conscience des caractéristiques de ces emprunts structurés et des risques latents qu’ils représentaient. Il est certain en revanche, que dans un contexte financier contraint, les établissements avaient tout intérêt à souscrire des emprunts qui dans une première phase permettait de bénéficier de taux d’intérêt intéressants.
Le cabinet « Finance active » a bien souligné lors de son audition qu’il avait tenté de dissuader certains établissements de s’engager dans un tel processus en raison des risques potentiels ultérieurs mais le marketing offensif des banques et les autorités de tutelles qui n’ont fait aucune objection à ces souscriptions expliquent le succès de ces produits structurés.
La rapporteure estime que les responsabilités sont largement partagées entre les différents acteurs, les autorités de tutelle ayant singulièrement manqué de prudence dans l’appréciation des produits financiers proposés.
5. Le cas limite des centres hospitaliers sous administration provisoire
Certains établissements particulièrement fragilisés par leur endettement ont été mis sous administration provisoire, ce qui a permis souvent de revoir en profondeur leur mode de gestion. Cette décision est prise en cas de situation très grave et fait parfois suite à une mission d’appui et de conseil, réalisée par des membres de l’IGAS, lorsque cet accompagnement s’est révélé insuffisant.
a. Le régime de l’administration provisoire
L’administration provisoire des établissements publics de santé est encadrée par des conditions légales et réglementaires prévues par le code de la santé publique. Son article L. 6143-3-1 prévoit que le directeur général de l’ARS peut placer sous administration provisoire un établissement, « en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement ».
Au total, le placement sous administration provisoire reste une décision exceptionnelle : sur plus de 3 000 établissements, 15 administrations provisoires ont été déclenchées depuis 2008, dont une procédure n’a pas abouti, pour des durées allant de 6 mois à 24 mois et essentiellement pour des motifs financiers. Cette décision intervient le plus souvent après un plan de redressement infructueux (déficit de plus de 2 % ou 3 % du total des produits ; CAF insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts…).
L’analyse des situations de fin de mise sous administration provisoire amène le constat de l’amélioration systématique des situations budgétaires des établissements, de leur gouvernance, des relations sociales et des orientations stratégiques d’activité. Les transformations importantes constatées portent notamment sur les impacts financiers qui permettent le redressement.
ÉTABLISSEMENTS PLACÉS SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE DEPUIS 2008
Établissement placé sous MSAP |
Année de déclenchement |
Durée |
Motifs (endettement ou autres critères) |
Modalités |
Résultats |
Ajaccio |
2008 |
12 mois puis renouvelée 12 mois |
Absence de production d’un plan de redressement assurant le retour à l’équilibre |
3 CGES (conseillers généraux des établissements de santé) nommés avec les attributions du directeur et du conseil d’administration |
Le CH a retrouvé le chemin de l’équilibre financier. Développement de nouvelles activités et dialogue social renoué. Pilotage du projet de reconstruction de l’hôpital de la Miséricorde |
2012 |
12 mois prorogée de 12 mois |
Gravité et urgence de la situation financière ; 30 millions d’euros de dettes institutionnelles et 50 millions d’euros de dettes financières |
IGAS/CGES ayant les attributions de directeur | ||
CH de Lens |
2011 |
12 mois |
Objectifs du plan de redressement non respectés et urgence de la situation ; en position critique vis-à-vis des établissements bancaires |
DH (directeur d’hôpital) puis CGES ayant les attributions de directeur |
Retour à l’équilibre progressif et amélioration de sa situation financière |
HOSPITALOR (association hospitalière Lorraine) |
2011 |
6 mois |
Le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation financière de l’établissement ; tensions de trésorerie et difficultés à obtenir des prêts bancaires ; impossibilité d’assurer ses engagements financiers fin 2010 et notamment le versement des salaires |
1 IGAS et 1 CGES nommés avec les attributions de directeur |
Amélioration de la situation financière. Augmentation de l’activité. Établissement qui fait partie du projet de recomposition de l’offre de soins en Moselle Est |
SIH Montceau Le Creusot |
2011 |
12 mois |
Article L. 6143-3-1 CSP ; remise des créances de l’ordre de 40 % du montant total des dettes de la fondation |
3 CGES nommés avec les attributions du secrétaire général du SIH |
Amélioration même si l’établissement continue de rencontrer des difficultés financières. Accompagnement de l’ANAP pour consolider le retour à l’équilibre dans le cadre d’une approche territoriale |
CICH Unisanté (Forbach St Avold) |
2011 |
6 mois puis renouvelée 12 mois |
Pian de redressement qui ne permet pas de redresser la situation financière |
1 DH nommé avec les attributions de directeur |
Amélioration de la situation financière. Établissement qui fait partie du projet de recomposition de l’offre de soins en Moselle Est |
CH de Colson |
2012 |
6 mois |
Poursuite de la dégradation financière malgré la présentation d’un plan de redressement ; endettement excessivement élevé |
1 IGAS et 1 CGES nommés avec les attributions de directeur |
Signature d’un CREF (contrat de retour à l’équilibre financier) et retour à l’équilibre progressif |
Basse-Terre |
2012 |
6 mois |
Le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation financière |
2 CGES et 2 IGAS ayant les attributions du directeur |
Plan de retour à l’équilibre arrêté par l’administrateur provisoire en juin 2013 et traduit dans un CREF dans le cadre du CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) qui prévoit une résorption complète du déficit pour 2015 |
CH André Grégoire – Montreuil |
2012 |
12 mois puis renouvelée 6 mois |
Le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation financière ; dysfonctionnement de la gouvernance et de l’organisation médicale |
1 DH ayant les attributions du directeur |
Stabilisation de l’organisation et redressement de la situation financière. Mise en place d’un PREF (plan de retour à l’équilibre financier) depuis 2013. Gouvernance restaurée. Refonte du projet médical |
CH de Montluçon |
2013 |
6 mois puis renouvelée 6 mois |
Plan de redressement insuffisant et partiellement mis en œuvre. Urgence de la situation financière et difficultés de trésorerie |
2 IGAS et 1 CGES ayant les attributions du directeur et du conseil de surveillance |
Situation qui s’est améliorée suite à l’administration provisoire. Appui de l’ANAP dans l’élaboration de la feuille de route de retour à l’équilibre. Établissement qui continue d’être suivi en Copermo performance |
CH de Sarrebourg |
2013 |
6 mois |
La situation financière de l’établissement est fortement obérée et le plan de redressement proposé dans le délai réglementaire ne permet pas de redresser la situation |
1DH ayant les attributions de directeur |
Rétablissement du fonctionnement institutionnel et amélioration de la situation financière. Présentation du projet d’établissement |
CH de Roanne |
2014 |
12 mois |
Article L. 6143-3-1 CSP : non-exécution du plan de redressement qui ne permet pas de redresser la situation financière de l’établissement |
2 CGES et 1 DH ayant les attributions de directeur |
En cours. Amélioration de la situation financière et validation d’un plan de retour à l’équilibre à l’horizon 2016 |
CH de Briançon |
2014 |
12 mois |
Déséquilibre financier important et l’établissement n’a pas présenté un plan de redressement dans les délais réglementaires |
1 IGAS et 1 CGES ayant les fonctions de directeur |
Mission en cours |
CH de Chauny |
2014 |
12 mois |
Le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation financière de l’établissement |
2 DH ayant les attributions de directeur |
Mission en cours |
Source : Direction générale de l’offre de soins – février 2015.
Votre rapporteure s’est rendue dans deux centres hospitaliers ayant connu ce statut d’administration provisoire et a pu constater que cette période avait permis de redéfinir la stratégie et les modes de gestion de ces établissements.
b. Le cas du centre hospitalier de Roanne
L’exemple du centre hospitalier de Roanne qui a été mis sous administration provisoire le 28 mai 2014 pour une durée d’un an, montre tout l’intérêt d’une telle décision. Auparavant, l’établissement avait bénéficié d’un suivi attentif par le ministère durant plusieurs années. L’IGAS a procédé en 2011 à une mission de contrôle et a fait des préconisations qui ont été complétées par l’avis du Comité des risques qui, en mars 2011, conseillait un durcissement du plan de redressement. Courant 2013, un nouveau plan de redressement a été élaboré à cause de l’aggravation de la situation financière. La chambre régionale des comptes a aussi mené une enquête très détaillée et a conclu en avril 2014 que ce deuxième plan serait insuffisant.
Devant la dégradation de la situation financière avec des déficits cumulés atteignant à la fin 2013, 24,6 millions d’euros et un taux de marge brute ayant baissé de 5,2 % en 2012 à 3,2 % en 2013, il a été décidé de confier l’administration provisoire du centre hospitalier à trois conseillers généraux des établissements de santé qui avaient une expérience opérationnelle de la direction d’établissement.
Leur lettre de mission fixait des objectifs précis de redressement, notamment en termes de gouvernance et de redéfinition du projet médical.
La reconstruction et l’extension de l’établissement, qui sont intervenues en plusieurs étapes entre 2009 et mai 2015 pour les urgences, permettent de disposer d’un outil modernisé mais qui est aujourd’hui surdimensionné, les prévisions de hausse d’activité ayant été exagérément optimistes. Les travaux ayant été mal supervisés, ils ont abouti à un dépassement très important, passant de quatre-vingts millions estimés à près de cent cinquante millions réalisés, ce qui a contribué à dégrader l’endettement de l’hôpital malgré des subventions d’investissement de 6 millions d’euros versés annuellement par l’ARS (sur une durée de vingt ans dans le cadre d’un contrat de retour à l’équilibre) et une aide ponctuelle supplémentaire de 6 millions d’euros pour 2014 afin de limiter le recours à l’emprunt.
Les administrateurs provisoires ont donc eu pour première mission de retrouver des marges de manœuvre financière avec pour objectif de dégager un taux de marge brute d’exploitation de 8,9 % à l’horizon de 2017 tout en définissant un projet stratégique permettant d’atteindre cet objectif. Le conseil de surveillance a adopté le 12 mars 2015 les orientations stratégiques de l’établissement pour la période 2015-2020, qui a été approuvé à l’unanimité par la commission médicale d’établissement.
Un des chantiers les plus importants a consisté à rétablir une gouvernance apaisée de l’établissement car les derniers mois de la direction précédente avaient été marqués par un blocage des instances de concertation avec les partenaires sociaux et avec le conseil de surveillance.
Le positionnement de l’hôpital de Roanne doit être redéfini car il se caractérise par un environnement défavorisé en termes d’offre médicale libérale surtout pour les médecins spécialistes. Cette carence de la médecine ambulatoire conduit à ce que l’hôpital joue un rôle de soins de premier recours alors que ce n’est pas sa véritable vocation.
À terme, l’ARS devra décider clairement si l’hôpital de Roanne accroît sa coopération avec le CHU de Saint-Étienne en développant par exemple des services accueillant des permanences de médecins hospitaliers de Saint-Étienne venant opérer ou consulter régulièrement à l’hôpital de Roanne ou si cet hôpital devient plutôt l’hôpital de référence pour le nord du département de la Loire en développant un soutien aux hôpitaux locaux et aux EHPAD, situés à proximité.
Afin de dynamiser l’ensemble des équipes, les administrateurs provisoires ont lancé une grande consultation interne pour aboutir à un projet médical rénové qui puisse attirer de nouveaux praticiens car l’hôpital peine à recruter et est actuellement pénalisé par le départ de trois chirurgiens viscéraux. La situation devrait s’améliorer en 2016 car des recrutements sont en cours en gynécologie et pour la chirurgie digestive.
Un gros effort a été mené pour réduire la durée moyenne de séjour qui est plus élevée que dans des établissements comparables du fait de la population vieillissante mais surtout d’une mauvaise coordination avec les lits d’aval.
En effet, la chambre régionale des comptes notait qu’en 2012 la durée moyenne de séjour était supérieure de 20 % à celle des établissements comparables à celui de Roanne les moins performants. La situation s’est cependant améliorée en 2014.
Un cadre infirmier a donc été chargé de se consacrer à ce problème crucial pour éviter d’encombrer des lits « aigus » alors que les patients pourraient être orientés vers des établissements de rééducation ou de long séjour plus ou moins médicalisés.
Des lits de médecine ont été réouverts à effectifs constants pour permettre une meilleure fluidité de la prise en charge post-urgences et l’année prochaine il est prévu que l’hôpital ouvre des lits saisonniers en médecine gériatrique avec recrutements de personnel soignant en contrat à durée déterminée pour s’adapter aux flux de malades durant la période hivernale. Cette réorganisation a été rendue possible grâce à la fermeture de lits de chirurgie et à la fusion de certaines unités chirurgicales avec un développement de la chirurgie ambulatoire, ce qui a permis de réorganiser les équipes de personnel paramédical.
Le plan de retour à l’équilibre 2014-2016 a prévu de se focaliser sur la baisse des dépenses qui représente 80 % du plan et qui se traduit par une suppression de 84 postes sur 2 000 et une réduction de dix postes médicaux.
Les premiers résultats positifs sont déjà enregistrés : le déficit de fin 2014 a été plus modeste que prévu atteignant 2,8 millions d’euros contre six millions attendus. De sérieuses économies ont été réalisées sur les achats (3 millions) et sur la pharmacie (un million d’économie) et il est vraisemblable que les objectifs de redressement fixés pour 2017 pourraient être atteints avec un an d’avance.
La principale difficulté est aujourd’hui pour le nouveau directeur de continuer sur cette lancée de réorganisation profonde dans un contexte financier très contraint. Il a été dit à la rapporteure par plusieurs interlocuteurs, qu’il était dommage que le Centre national de gestion (CNG) n’ait pas mieux anticipé le recrutement du nouveau directeur arrivé début juin 2015. Le CNG n’a pas eu d’attitude « pro active » pour rechercher un profil adapté à cette gestion de crise. Après un appel à candidature très classique, deux candidats seulement répondaient aux critères demandés. De plus, il est dommage que le nouveau directeur n’ait pu bénéficier d’une période plus longue de mise au courant avec la présence effective des administrateurs provisoires pour permettre un « tuilage » efficace.
a. Le cas de l’hôpital André Grégoire à Montreuil
La rapporteure s’est rendue également en région parisienne à l’hôpital André Grégoire à Montreuil.
Le bilan de la mise sous administration provisoire de cet hôpital durant un an et demi, jusqu’à la fin avril 2014, y est plus mitigé.
Ce sont aussi des raisons financières qui ont conduit à cette décision après de gros travaux réalisés dans le cadre du plan Hôpital 2007 (passage d’une surface immobilière de 38 000 m² à 52 000 m² avec aujourd’hui des locaux vides sur plus de 4 000 m²).
Le positionnement de l’hôpital est complexe car il est à la fois un hôpital de proximité pour certaines spécialités mais aussi un établissement de pointe pour le pôle mère-enfant avec une maternité de niveau 3, un service de cardiologie qui fait référence et un service de néphrologie qui est le seul à permettre des soins de dialyse pour le secteur public dans ce département. La problématique des coopérations est donc essentielle pour gagner en qualité des soins et en efficience.
Cet établissement a repositionné son offre de soins et augmenté son activité (+ 8 % en 2013 et 2014). Des lits supplémentaires ont été ouverts dans plusieurs services. Ainsi, le nombre de naissances annuelles est passé de 3 200 à 3 500 environ. L’hôpital a renforcé des spécialités de proximité comme la médecine interne, la gériatrie, la cardiologie et la néphrologie. Le site a par ailleurs noué des partenariats pour des consultations avec le Groupe hospitalier universitaire Paris Seine-Saint-Denis (regroupant les hôpitaux Avicenne-Jean Verdier et René Muret de l’AP-HP), permettant de proposer aux patients des parcours de soins adaptés à leur état de santé et à proximité de leur domicile. Une autre collaboration s’est engagée avec l’hôpital Robert-Ballanger d’Aulnay pour y transférer les urgences de nuit concernant la neurologie.
La rapporteure a pu rencontrer plusieurs médecins siégeant à la CME qui lui ont fait part des difficultés de nouer des coopérations entre hôpitaux de taille trop disparates comme c’est le cas avec les hôpitaux dépendant de l’AP-HP. C’est pourquoi ils préféreraient développer des liens avec celui de Montfermeil avec qui des liens interpersonnels entre équipes médicales existent déjà.
Le plan de retour à l’équilibre des finances a été présenté en décembre 2013 et comporte une trajectoire dynamique avec des prévisions de hausse d’activité. Il a en partie porté ses fruits avec une réduction du déficit qui est passé de 13,7 millions d’euros en 2012 à 5,9 en 2013. En augmentant son activité, et en développant les consultations externes, l’hôpital a pu dynamiser ses recettes. Toutefois la situation de l’hôpital reste fragile car l’hôpital n’a aucune capacité d’autofinancement et doit supporter une dette de 99 millions d’euros, soit un taux d’endettement de 92 %. Selon la directrice de l’hôpital, la situation est devenue encore plus grave depuis le renchérissement du franc suisse qui va annuler par les charges d’intérêt nouvelles, tous les efforts d’économies menés depuis deux ans.
Ces nouveaux frais financiers vont rendre sans doute indispensable la définition d’un nouveau plan de redressement à l’équilibre car le plan de 2013 reposait sur des hypothèses de croissance d’activité trop optimistes et difficiles à tenir sur plusieurs années. De plus, ce plan ne comportait pas assez de mesures visant à générer de nouvelles économies. Selon la directrice, des marges peuvent être trouvées comme le prouvent les économies déjà réalisées sur les frais de laboratoire notamment pour le service de réanimation où ils ont été divisés par deux. Le service de restauration va être profondément remanié avec un volet de réduction d’effectifs tandis que le service de facturation peut gagner beaucoup en efficacité. Il sera sans doute nécessaire de fermer certaines capacités qui avaient été créées récemment, l’objectif étant de densifier les services existants et de regrouper les services de médecine. Certaines consignes nationales comme le développement de la chirurgie ambulatoire se heurtent à Montreuil à des facteurs sociologiques : il est impossible de réaliser certaines opérations si le patient vit dans un habitat précaire ou est totalement isolé.
À la différence de beaucoup autres hôpitaux, l’établissement de Montreuil est un équipement nécessaire pour la médecine de premier recours, particulièrement en pédiatrie car il n’y a que deux pédiatres libéraux à proximité. Les urgences sont ainsi encombrées de patients qui devraient relever de soins ambulatoires ou qui restent plus longtemps en hospitalisation faute de structures d’accueil pour les personnes âgées dépendantes.
Dans le cas de Montreuil, il s’avère que la période de l’administration provisoire a permis d’impulser une réorganisation, mais les résultats attendus sont parfois plus longs que prévus à se matérialiser et la fragilité financière rend la gestion quotidienne très complexe car il n’existe aucune marge de manœuvre pour faire de petits investissements courants.
L’établissement fait toujours partie du programme d’accompagnement des hôpitaux en difficulté financière de l’ARS, parmi une quinzaine en Île-de-France. La directrice a aussi souligné l’intérêt d’être accompagnée par un cabinet de consultants privés qui lui permet de suivre et d’apprécier l’évolution du risque des emprunts toxiques. Ce cabinet lui permet aussi de disposer d’une meilleure visibilité sur l’état des finances de l’hôpital à l’échéance d’un an, ce qui est primordial pour mener à bien certains projets. Cette projection dans l’avenir est indispensable pour mobiliser les équipes soignantes qui ne doivent pas avoir l’impression que l’hôpital prépare son désengagement ou un repli vers une simple activité de proximité.
C. UN ACCÈS AU CRÉDIT CONTRASTÉ SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS
1. Des difficultés pour le financement à court terme et la gestion de la trésorerie
Dans son rapport, la Cour des comptes fait état des difficultés de trésorerie rencontrées par plusieurs établissements sur la période récente (2011 et 2012). Elles se sont traduites par l’allongement des délais fournisseurs et le gonflement des dettes sociales.
La situation est aujourd’hui très contrastée : certains établissements profitent à plein d’un crédit à taux très bas et d’autres déjà fortement endettés éprouvent des difficultés à accéder à toute forme de crédit même à une simple ligne de trésorerie, comme le centre hospitalier d’Aubagne par exemple.
Pour éviter toute rupture de trésorerie, les pouvoirs publics ont octroyé des aides d’urgence aux hôpitaux les plus concernés par les tensions de trésorerie en 2012 puis en 2013. Parallèlement, le ministère a mis en place un dispositif de veille régionale sur la trésorerie des hôpitaux.
En 2013 comme en 2014, les ARS ont travaillé, notamment dans le cadre des comités de veille active des situations de trésorerie, à résorber les situations les plus compliquées en contractualisant avec les établissements des plans de redressement. Les aides nationales exceptionnelles de soutien aux établissements en difficulté viennent soutenir la mise en œuvre de ces plans et servent en priorité à réduire les dettes non financières.
En 2013 et 2014, les difficultés de trésorerie ont sensiblement diminué. Les situations de rupture brutale de trésorerie ont disparu, la gestion des flux de trésorerie ayant été optimisée et l’utilisation des lignes de trésorerie rationalisée. Les aides exceptionnelles versées par le niveau national ont été revues à la baisse. Il ressort que le dispositif mis en place a permis de sensibiliser les ARS et les établissements aux enjeux d’une meilleure gestion de la trésorerie dans un contexte de désengagement des banques dans le financement de court terme. Le dispositif se poursuit en 2015.
L’accès au crédit de court terme pour les hôpitaux est un sujet controversé : un rapport de l’IGF de mars 2013 préconisait de supprimer cet accès. Ce point qui pose une question de principe est évoqué infra.
Depuis 2013, est constatée une rationalisation de l’utilisation des lignes de trésorerie. Les plafonds de tirage autorisés par les établissements de crédit pour 2013 s’élevaient à 1,75 milliard d’euros contre un plafond estimé à 3 milliards d’euros en 2011. En outre, les montants tirés à fin d’année sont passés, selon les données fournies par la DGFiP, de 1,1 milliard d’euros à 400 millions d’euros entre 2011 et 2013.
2. Des inégalités croissantes entre établissements pour financer les investissements de modernisation ou de renouvellement
Après une période de rétractation des liquidités bancaires, court et long terme, au cours des exercices 2011 et 2012, le marché est revenu à peu près à la normale.
Les hôpitaux ont un recours à l’emprunt en baisse régulière depuis 2009, le montant emprunté étant passé de 5 à 3 milliards d’euros entre 2009 et 2013. La pression sur le marché est donc moindre et les banques de nouveau en forte concurrence entre elles. En 2014, la tendance baissière se confirme.
L’offre bancaire s’est fortement réorganisée en 2012 et 2013, avec le retrait des banques classiques (Dexia, Crédit Agricole et Société Générale) et l’arrivée de deux nouveaux acteurs, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Postale (LBP). Ces deux établissements ont pénétré le marché des prêts aux hôpitaux à « marche forcée » et ont permis de diversifier l’offre et d’abaisser les conditions financières. En parallèle, la Banque européenne d’investissement (BEI) a ouvert une enveloppe de financements intermédiés dédiés au secteur hospitalier, ce qui a donné un signal positif pour ce marché.
Lors de leur audition devant la mission, les consultants de Finance active ont souligné que la part des financements alternatifs avait tendance à croître comme celle du financement obligataire, celle de la Banque européenne d’investissement (BEI), et tout particulièrement celle de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui a augmenté de manière importante sur la même période, ce qui traduit une intervention déterminante des pouvoirs publics. L’une des conséquences en est toutefois maintenant que les banques acceptent de financer certains établissements à condition que la CDC s’engage elle-même à le faire
– celle-ci apparaissant comme un déclencheur nécessaire.
Certains analystes considèrent qu’il y a un excès d’offre sur le marché du financement du secteur public local, où les offres des banques représentent entre 25 et 30 milliards d’euros, mais la plus grande part est consacrée aux collectivités locales alors que les établissements de santé ne « profitent » que d’une part excédentaire de 2 à 2,5 milliards d’euros.
Il faut par ailleurs distinguer deux marchés à l’intérieur de ce marché apparemment en excès d’offre. D’un côté, les grands établissements hospitaliers, relativement en meilleure santé que les autres, peuvent mettre les banques en concurrence, bénéficier des financements de la CDC, de ceux de la BEI au titre des grands projets, éventuellement d’un financement obligataire. Ils pourront donc bénéficier de cette liquidité excédentaire. À l’inverse, les plus petits établissements, en difficulté, rencontrent beaucoup de difficultés à trouver des financements. Certains sont même obligés de reporter des projets d’investissement, comme la rapporteure a pu le constater sur place.
Ainsi, pour M. Mathieu Colette de Finance active, l’accès au crédit risque de devenir plus inégalitaire selon les établissements : « même si la liquidité est disponible et assez peu onéreuse aujourd’hui, un marché à deux vitesses est en train de se créer, si bien que le retour de la concurrence sur ce marché ne bénéficie pas à tout le monde. »
Il semble que le recours au crédit est un peu plus difficile pour les établissements publics de santé que pour les collectivités. Même ceux qui arrivent à boucler leurs appels d’offres sont obligés de s’adresser à plusieurs banques. Par exemple, un établissement qui recherche 10 millions d’euros recevra 2 millions d’euros de la Caisse d’épargne, 2 millions du Crédit Agricole, 4 millions d’euros de la CDC, etc. C’était tout à fait différent en 2007, où il y avait une surabondance d’offres. Aujourd’hui, les établissements, même les plus gros, sont obligés de panacher, et certains établissements plus petits ne trouvent pas de financement et sont obligés de reporter les investissements – même si ce n’est pas la majorité.
II. UNE MEILLEURE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS ET UN ASSAINISSEMENT FINANCIER SONT INDISPENSABLES POUR CONFORTER LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
Face à la dégradation des finances des établissements publics de santé, le Gouvernement a pris des mesures pour mieux encadrer les décisions d’investissement et le recours à l’emprunt. Ces premières mesures doivent être confortées et complétées pour parvenir à une meilleure programmation des investissements et à dégager des financements qui n’hypothèquent pas l’avenir.
A. LES PREMIÈRES MESURES POUR ENCADRER LE CHOIX ET LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS DOIVENT ÊTRE CONFORTÉES
1. Mieux cibler et évaluer les projets d’investissement
Afin de mieux encadrer les opérations d’investissement, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures depuis 2011 pour mieux suivre les projets. En partenariat avec les ARS, la DGOS a mis en place une démarche de revue annuelle des plans nationaux d’investissement afin de s’assurer de la bonne exécution des projets et de l’adéquation des financements proposés.
• La première circulaire en ce sens a été l’instruction DGOS/PF1/MSIOS n° 2010-460 du 27 décembre 2010 relative à l’organisation des revues de projets des plans nationaux d’investissement 2011.
Dans cette instruction (10) était précisée la nature des investissements concernés par cet inventaire.
Pour le volet immobilier, les revues de projets concernaient les opérations de la première tranche du plan Hôpital 2012, les opérations du plan Hôpital 2007 non livrées, le plan de santé mentale PRISM, ainsi que les opérations des autres plans d’investissement (UMD (11), UHSA (12)). Pour le volet système d’information (SI), elles concernaient les projets de la première tranche du plan Hôpital 2012.
Pour faciliter ce recensement et l’exploitation des données recueillies, un outil informatique a été créé, intitulé : dossier de revue projet investissement. Chaque établissement hospitalier devait compléter une grille informatique où étaient décrites les caractéristiques suivantes des projets d’investissement :
– présentation du projet, regroupant les données relatives aux informations générales du projet, et le suivi des conditions suspensives de validation ;
– avancement du projet : calendriers prévisionnels et réalisés, avancement physique du projet, suivi des dépenses et évolution des surfaces ;
– suivi du financement du plan : tableau de financement du projet et suivi des financements, subvention du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESSP), délégations de crédits par les établissements.
Les ARS devaient renseigner les données sur la délégation de crédits et le plan de financement,
La DGOS devait, quant à elle, regrouper les données financières et créer des fiches de projet. Elle devait aussi élaborer des tableaux de bord permettant de suivre l’avancement des projets, y compris financier, ainsi que des synthèses régionales.
Chaque projet devait être classé selon trois catégories :
– les projets sans observations ;
– les projets à surveiller ;
– les projets à risques.
La dernière circulaire parue relative aux investissements souligne les réformes apportées depuis 2011. L’instruction DGOS du 13 février 2014 précise ainsi que la stratégie de soutien à l’investissement en santé a pour objectif de « mieux insérer les projets d’investissement dans les territoires » et que les investissements doivent « être mis au service du parcours des patients ». Cette stratégie doit intégrer les investissements immatériels via les programmes « hôpital numérique » et « territoires de soins numériques ».
Cette approche territoriale et transversale des investissements est formalisée et mise en œuvre par les ARS dans le cadre des schémas régionaux des investissements en santé (SRIS) dont une première version a été produite en 2013 et qui seront enrichis progressivement.
L’instruction rappelle aussi que, dans ce cadre, une révision du pilotage des investissements portés par les établissements de santé a été engagée autour de deux principes directeurs, tendant à :
– conduire un effort régulier d’investissement de l’ordre de 4,5 milliards d’euros par an pour soutenir la modernisation continue de l’offre de soins sans recourir à des plans de relance ;
– centrer la politique nationale d’intervention pilotée par le COPERMO (Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soin) sur un nombre limité de projets particulièrement structurants. Le montant des investissements aidés au niveau national était fixé à titre indicatif à 300 millions d’euros pour l’année 2014.
Cette nouvelle procédure s’accompagne également d’un effort d’évaluation de ces investissements publics.
• L’évaluation des projets
Le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics, pris en application de l’article 17 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 du 31 décembre 2012, crée une nouvelle procédure d’évaluation pour les projets d’investissements de l’État, de ses établissements publics et établissements publics de santé.
Pour tous les projets d’investissement publics dont le montant est supérieur à 20 millions d’euros, la réalisation d’une expertise socio-économique, communicable à sa demande au Commissaire Général à l’Investissement, est rendue obligatoire.
En outre, pour les projets d’investissement dont le montant excède 100 millions d’euros, une contre-expertise socio-économique, produite par un tiers indépendant nommé par le Commissaire Général à l’Investissement, doit être réalisée.
La principale nouveauté de cette procédure tient au fait qu’elle s’applique à l’ensemble des investissements publics quel que soit leur mode de réalisation alors que, jusqu’à présent, la procédure d’évaluation préalable en vigueur était réservée aux seuls projets réalisés en contrat de partenariat public-privé (PPP).
L’évaluation préalable introduite par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 prévoyait en effet une justification du contrat de partenariat. Dans ce cadre, les projets devaient faire l’objet d’une analyse comparative de faisabilité juridique, technique et financière, incluant une analyse des risques, des modes de portage envisageables, ainsi que la justification du recours à ce mode dérogatoire de la commande publique. Toutefois, l’évaluation préalable ne permettait pas de se prononcer sur le bien-fondé économique d’un projet. Elle visait à comparer et à justifier le mode contractuel retenu.
Un autre texte est venu renforcer le mécanisme d’évaluation en amont. Le décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 a étendu de manière significative l’évaluation préalable pour les projets à réaliser en contrat de partenariat, bail emphytéotique hospitalier ou autorisation d’occupation temporaire, par une analyse des conséquences budgétaires du projet d’investissement sur les finances du porteur du projet.
Suite aux difficultés générées par des décisions d’investissement sans réflexion aboutie sur leurs modalités de financement, le décret du 23 décembre 2013 précité apporte une nouvelle dimension à la démarche de l’État en tant qu’investisseur. Les décrets précédents encadrant le recours aux PPP au stade où la décision d’investissement était déjà prise par les donneurs d’ordres publics, les études consistaient donc à choisir le mode de portage et à vérifier la soutenabilité budgétaire du projet pour la personne publique considérée. Ce nouveau décret impose, à partir de 20 millions d’euros de financement, l’étude de variantes et alternatives au projet, une analyse des risques ainsi qu’une étude de la performance et de l’utilité du projet. L’attention porte donc à présent sur la pertinence de l’investissement, quel que soit son mode de portage. Le législateur a voulu introduire une réflexion en amont visant à mieux orienter l’investissement public vers les projets les plus pertinents au regard de leur utilité socio-économique.
Ce décret distingue le type d’analyse à réaliser en fonction du montant de financement public apporté par les personnes morales. Les seuils déterminant la procédure à conduire sont les suivants :
– montant inférieur ou égal à 20 millions d’euros ;
– montant supérieur à 20 millions d’euros ;
– montant de financement supérieur à 100 millions d’euros et dont la participation des autres personnes morales que l’établissement porteur du projet dépasse 5 % du financement global.
Les seuils sont ainsi appréciés en tant que niveau de financement public par les personnes morales et non en fonction du montant d’investissement total du projet, ce qui permet d’inclure dans le champ de l’étude des projets portés par des tiers (collectivités territoriales par exemple) dont le financement est en partie assuré par l’État ou les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaires.
Pour les projets inférieurs à 20 millions d’euros de financement public, l’évaluation socio-économique est obligatoire, mais le décret ne donne pas de précisions sur le contenu du dossier d’évaluation ; il est uniquement précisé que l’évaluation doit permettre de déterminer les coûts et bénéfices attendus des projets concernés.
Pour les projets d’au moins 20 millions d’euros de financement public, la procédure se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, il est demandé d’informer en amont de toute dépense, en dehors des frais d’études préalables, le Commissaire général à l’investissement par une description générale du projet incluant des informations sur son financement.
Dans un deuxième temps, il est demandé de réaliser l’étude d’évaluation socio-économique dont le contenu précisé par ledit décret inclut les éléments suivants :
– exposé détaillé du projet d’investissement intégrant les variantes et alternatives au projet ;
– dimensionnement et calendrier de réalisation ;
– indicateurs socio-économiques pertinents ;
– analyse comparée des modes de financement ;
– analyse des risques juridiques ;
– cartographie des risques.
Le décret ne précise toutefois pas le contenu attendu pour chaque critère, notamment ceux relatifs aux indicateurs socio-économiques et de performance dont le choix est laissé aux personnes morales initiatrices du projet.
Le dossier d’évaluation socio-économique n’est transmis au Commissaire général à l’investissement que sur demande de ce dernier. Cependant, il est demandé de déclarer à l’inventaire annuel de ce dernier l’ensemble des projets supérieurs à 20 millions d’euros de financement.
• Instauration d’une contre-expertise au rapport socio-économique
Pour les projets supérieurs à 100 millions d’euros, et sauf si la nature des travaux à réaliser concerne une mise en conformité avec les normes de sécurité, le décret rend obligatoire une contre-expertise indépendante de l’évaluation. Cette contre-expertise est également obligatoire dans le cas où pour des projets portés par des tiers, la participation financière des personnes morales représente plus de 5 % du financement. Le décret précise que la contre-expertise est réalisée dans un délai maximal de quatre mois par un expert désigné par le Commissaire général à l’investissement. Les modalités de désignation de l’expert ne sont quant à elles pas précisées, ce qui pose la question des modalités de contrôle par le Commissaire général à l’investissement et de la garantie de l’indépendance des experts nommés.
À l’issue de la contre-expertise, le Commissaire général à l’investissement émet un avis qui fait l’objet d’une transmission au Premier ministre. Le ministre chargé de la santé, exprime alors les suites qu’il souhaite donner à l’avis exprimé par le Commissaire général à l’investissement.
L’ensemble des frais d’expertise et de contre-expertise sont à la charge de la personne publique porteuse du projet.
• Le caractère public du rapport d’expertise et de contre-expertise
Une particularité du décret réside également dans le caractère public du rapport d’expertise et de contre-expertise.
Le décret prévoit la réalisation d’un inventaire des projets supérieurs à 20 millions d’euros de financement qui fait l’objet d’une publication synthétisée au sein du rapport annuel du commissariat général à l’investissement. Le décret ne précisant pas les éléments de synthèse qui doivent figurer au sein du rapport, il y a lieu de s’interroger sur l’impact de cette publication sur la conduite des négociations dans le cadre de la réalisation des projets.
Par ailleurs, pour les projets dont le montant est supérieur à 100 millions d’euros, et s’ils sont soumis à enquête publique, le rapport de contre-expertise et l’avis du Commissaire général à l’investissement sont versés au dossier d’enquête publique.
Pour garantir des décisions optimales en matière d’offre de soins, le Gouvernement a décidé en 2013 de créer le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO).
Ce comité a deux fonctions qui sont fortement imbriquées : il évalue les projets d’investissements et décide du montant des subventions d’investissement mais il a aussi pour mission d’aider les établissements de santé à améliorer leur performance (qualité, efficience économique, modernisation de l’offre de soins…). Ces deux fonctions sont étroitement liées car certains conseils reçus dans le cadre de l’accompagnement à la performance auront une traduction en termes d’investissement. Dans certains cas, comme pour l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille le respect du plan de retour à l’équilibre, négocié par le COPERMO dans son volet performance, conditionnera l’examen ultérieur des projets d’investissement devenus éligibles car la trajectoire financière de l’investissement se sera améliorée.
a. Les projets d’investissement
Pour l’aspect investissement, il s’agit d’améliorer la prise de décision en matière d’investissements des établissements de santé aussi bien en termes de soutenabilité financière et de juste dimensionnement que de valeur ajoutée pour l’offre de soins.
Le COPERMO a aussi pour mission de recommander les mesures nécessaires au retour à l’équilibre financier de certains établissements en difficulté.
La circulaire interministérielle DGOS/PF1/DSS/DGFiP n° 271 du 5 juin 2013 relative à la mise en place du Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers fixe ainsi les objectifs prioritaires :
– valider, en lien avec les ARS, les projets d’investissement, les modalités de leur réalisation et la trajectoire financière correspondante ;
– diffuser les référentiels et les outils susceptibles de faire progresser les modalités d’évaluation des projets et de favoriser la mise en œuvre des SRIS par les ARS ;
– assurer la coordination des programmes nationaux d’amélioration de la performance des établissements de santé (programme PHARE, gestion des lits, projets performance…) ;
– arrêter, en lien avec les ARS, les modalités du retour à l’équilibre financier des établissements les plus en difficulté et du respect de la trajectoire fixée.
Ce comité s’est substitué au comité des risques financiers, au comité national de validation des projets d’investissement et au comité de pilotage des projets performance.
Son originalité est de rassembler des spécialistes des questions hospitalières et des finances publiques. Il est composé en l’espèce des personnes suivantes :
– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
– le directeur général de l’offre de soins ;
– le directeur de la sécurité sociale ;
– le directeur général des finances publiques ;
– le directeur du budget ;
– le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
– le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
– le délégué général à l’Outre-Mer ;
– le directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
– le Commissaire général à l’investissement.
Le comité peut décider de recourir à des personnalités qualifiées ne disposant pas de voie délibérante, en fonction des sujets abordés, notamment des personnalités qualifiées dans le domaine des investissements hospitaliers.
La Direction générale de l’offre de soins assure le secrétariat du comité.
Les décisions du comité sont préparées sous la responsabilité d’un groupe technique interministériel.
Le COPERMO intervient pour les projets suivants portés par les établissements de santé :
– À titre principal, les projets d’un montant supérieur à 50 millions d’euros HT de travaux quel que soit leur mode de financement.
– À titre exceptionnel, les projets d’un montant inférieur à 50 millions d’euros HT de travaux et pour lesquels les ARS jugent que le plan de financement ne peut manifestement pas être équilibré sans un soutien national sous forme de subventions ou de conditions d’emprunt préférentielles.
• La procédure applicable devant le COPERMO
– Le rôle des ARS dans l’évaluation socio-économique préalable
Le processus d’évaluation socio-économique préalable des projets d’investissement est de la responsabilité des services de la DGOS, qui en assure la supervision en lien étroit avec les ARS et les établissements concernés.
Cette évaluation socio-économique, validée par l’ARS considérée, doit répondre a minima aux objectifs suivants :
– vérifier la justesse du dimensionnement capacitaire du projet d’investissement. Une attention particulière doit être accordée par les ARS aux hypothèses d’activité sous-jacentes au programme capacitaire proposé par l’établissement, tenant compte de l’évolution des modes de prise en charge, notamment en faveur de l’ambulatoire ;
– vérifier l’opportunité du projet au regard de l’organisation territoriale de l’offre de soins. L’ARS doit s’assurer de la nécessité du projet et de son dimensionnement envisagé au regard de l’offre de soins dans les domaines d’activité concernés, des projets d’investissements et du patrimoine des autres établissements du territoire ;
– vérifier la pertinence de la conception technique du projet, notamment de son organisation spatiale et fonctionnelle ainsi que la conformité et la pertinence du dimensionnement physique des locaux et des circulations au regard des référentiels et outils de l’ANAP ;
– garantir la soutenabilité financière du projet, en s’assurant notamment que l’établissement mobilise au maximum l’autofinancement et que le niveau d’endettement prévu dans le plan de financement du projet est acceptable, compte tenu de la marge brute non aidée de l’établissement.
Cette démarche d’évaluation doit s’articuler avec la mise en place des schémas régionaux de l’investissement en santé (SRIS), de façon à garantir que les projets soutenus par les ARS sont performants non seulement pour l’établissement concerné mais surtout du point de vue de la réponse au besoin territorial. Ils doivent s’insérer dans l’offre de soins, d’accompagnement social et médico-social sans générer de surcapacités coûteuses pour les finances publiques. Ils doivent être financièrement soutenables par les établissements qui les portent. Enfin, leur conception doit répondre aux exigences de qualité architecturale et environnementale en vigueur. La démarche d’élaboration du SRIS doit ainsi permettre de hiérarchiser et d’analyser les priorités de soutien parmi l’ensemble des projets hospitaliers déjà recensés notamment en vue d’un examen par le COPERMO.
– Concernant le stade d’avancement des projets soumis au COPERMO :
Les décisions du comité sont prises pour des projets pour lesquels aucun ordre de service n’a encore été passé par l’établissement. Les projets doivent donc être soumis au plus tard durant la phase de pré-programmation et en tout état de cause avant la passation des contrats de maîtrise d’œuvre ou des contrats avec le groupement entreprises et maîtrise d’œuvre en cas de conception-réalisation.
Le COPERMO juge d’abord de l’éligibilité du projet, après transmission par l’ARS à la DGOS du dossier d’évaluation socio-économique préalable.
La première décision (éligibilité) a pour objectif de valider l’entrée du projet dans le dispositif. Cette décision ne contient pas d’engagement ni sur la validation finale ni sur le montant de l’engagement financier.
En vue de la seconde décision (validation) du comité, l’ARS transmet à la DGOS un dossier d’évaluation socio-économique préalable complété au regard des remarques formulées par le COPERMO à l’occasion de la décision d’éligibilité initiale. C’est sur la base de ce dossier que se fondera soit la contre-expertise indépendante pour les projets d’un montant de travaux supérieur à 50 millions d’euros HT, soit l’analyse du groupe technique pour les projets d’un montant de travaux inférieur à 50 millions d’euros HT.
– Pour l’ensemble des projets, la décision d’éligibilité est prise au regard des critères suivants :
– le degré de maturité : les projets doivent pouvoir être soumis à une évaluation préalable ;
– le soutien de l’ARS matérialisé par l’inscription du projet dans les priorités du SRIS dès leur établissement ;
– le caractère d’urgence notamment au regard des mises aux normes de sécurité exceptionnelles.
– Pour les projets de moins de 50 millions d’euros HT de travaux :
– le respect du principe de subsidiarité : les projets doivent justifier une intervention nationale ;
– l’opportunité d’une aide nationale au regard de la situation financière de l’établissement, de l’effort d’autofinancement de l’établissement, de la disponibilité de financements régionaux.
– La deuxième décision (validation) consiste à émettre un avis sur la réalisation ou non du projet et le cas échéant de formuler une recommandation sur le montant de l’accompagnement financier consenti par l’État.
Les aides à l’investissement sont octroyées :
– en tenant compte de la situation financière de l’établissement. Les aides sont prioritairement attribuées aux établissements dont la situation financière est dégradée et ne leur permet pas de faire face à des investissements de sécurité. Une aide ne sera octroyée que s’il est établi que l’établissement ne peut supporter le coût du projet malgré les gains de productivité qui en sont attendus, l’optimisation de sa situation patrimoniale et les gains d’efficience obtenus dans le cadre du retour à l’équilibre financier et si l’ARS a mobilisé l’ensemble de ses marges de manœuvre ;
– sous condition de leur compatibilité avec le cadrage financier d’ensemble et de la trajectoire de l’ONDAM qui ne permet de financer qu’un nombre très limité de projets.
Dans le cas de l’attribution d’une aide, l’établissement bénéficiaire doit respecter les conditions validées par le COPERMO (coût, calendrier, surfaces, hypothèses de gains). Ces dernières font l’objet d’une notification détaillée dont le respect conditionne les délégations des crédits. Le projet est suivi tous les ans dans le cadre des revues de projets d’investissement afin de surveiller la trajectoire définie.
• Le premier bilan de l’action du COPERMO
Depuis sa création, le COPERMO a validé 29 projets pour un montant d’investissement évalué à 3,266 milliards d’euros.
La rapporteure a pu rencontrer la cellule de la DGOS qui étudie les dossiers qui feront l’objet d’une décision du COPERMO. Il est apparu que les dossiers soumis font l’objet d’un long travail de redéfinition entre l’établissement, l’ARS et la cellule compétente de la DGOS, ce qui conduit à améliorer le contenu des projets notamment pour mieux dimensionner les travaux immobiliers ou pour « densifier » l’offre de soins suite à une réorganisation des services.
Cette phase d’instruction permet de replacer le projet d’investissement dans un contexte plus large et de voir comment il s’intègre dans l’offre de soins de proximité. Il s’agit d’un travail largement interministériel, l’IGAS participant par ailleurs systématiquement à l’analyse des dossiers notamment pour apprécier les questions de projets médicaux. Le Commissariat général à l’Investissement permet une analyse extérieure avec le recours à la fois à des experts issus du milieu hospitalier mais aussi à des économistes ayant des compétences plus financières.
Un exemple : La procédure devant le COPERMO
de la reconstruction du CHU de Rouen
L’examen du dossier du CHU de Rouen permet d’analyser comment un projet initial est amélioré au cours de la procédure devant le COPERMO et quel peut être l’apport de la contre-expertise du Commissariat général à l’investissement.
Le projet de restructuration du CHU fait suite à de premiers travaux importants réalisés dans le cadre du plan Hôpital 2007 et intervient après un plan de retour à l’équilibre qui a démontré la capacité de l’établissement à suivre un plan d’économies sur plusieurs années.
Le projet consiste à regrouper les activités de court séjour sur un seul site ainsi que les activités externes (consultations, explorations…) L’objectif est aussi de réduire le nombre de lits (réduction de 118 lits sur 848 avant travaux) en développant la chirurgie ambulatoire (dont le nombre de places passerait ainsi de 83 à 132) Il est prévu la construction d’un nouveau plateau technique lourd et mutualisé. Les locaux dégagés par le regroupement du court séjour seraient transformés en un établissement de soins de suite. Au total la surface utile de l’établissement serait réduite de 66 532 m² à 56 032 m².
Lors de l’examen de l’éligibilité du projet, il a été demandé à l’établissement de présenter les scénarios alternatifs à celui retenu, de préciser le devenir des locaux libérés avec la possibilité ou non de cessions, Le premier projet présenté a été jugé insuffisant dans sa réduction capacitaire et les objectifs de développement de la chirurgie ambulatoire pas assez ambitieux. Il était aussi demandé des précisions sur l’évolution des outils informatiques envisagés avec présentation des gains d’efficience attendus. Enfin il était demandé de prévoir un cadre pour optimiser la fonction achat notamment durant la période des travaux.
La contre-expertise du CGI a noté un réel effort d’optimisation du coût des travaux qui sont passés de 147 à 122 millions d’euros et la rigueur avec laquelle les travaux qui doivent s’étaler sur 9 ans ont été décomposés en trois phases, ce qui permettra d’évaluer la tenue des engagements pris lors de chaque phase et d’éventuellement en reconfigurer certains aspects. Le CGI a insisté sur la nécessité d’adapter la politique de recrutement avec l’avancée des travaux et de tenir compte des gains de productivité avec le regroupement des blocs opératoires par exemple. Il a été proposé de conditionner le versement échelonné des aides à l’investissement au respect du plan d’économies et de réorganisation des services.
Le CGI a souligné la durée très longue des travaux qui peut entraîner un certain dérapage dans le coût et les délais et a considéré que le récent redressement financier de l’établissement rendait la situation délicate. La conduite de ce projet devra donc se faire avec une grande prudence pour éviter que l’endettement ne s’accroisse au-delà du plan initial. Le projet de cession immobilière devra être mené à bien pour ne pas déséquilibrer le plan financier.
La décision finale du COPERMO a donc été d’accorder une aide à l’investissement représentant 15 % de l’investissement soit 22 millions d’euros (au lieu des 29 millions d’euros demandés). Cette aide sera versée pour 50 % sous forme de capital et pour 50 % sous la forme d’un emprunt aidé sur vingt ans.
Au total, ce projet permettra de conforter la modernisation de l’offre de soins et de positionner le CHU de Rouen comme centre hospitalier de référence. La qualité des soins sera améliorée et la densification de l’offre sera tout à fait notable par rapport au projet initial. 118 postes devraient être économisés, 8 blocs opératoires sur 36 seront supprimés pour une capacité opératoire supérieure. Les coûts de fonctionnement devraient être maîtrisés avec une réduction de 8,5 % de la surface et une masse salariale gérée de manière rigoureuse.
b. L’amélioration de la performance des établissements de santé
Les établissements rencontrant de graves difficultés financières pourront faire l’objet d’un suivi par le COPERMO. Concernant le suivi individuel de certains établissements, le comité conduit sa mission dans le strict respect du principe de subsidiarité, c’est-à-dire en traitant uniquement des situations pour lesquelles une intervention de l’échelon national est absolument nécessaire et utile et dans le respect des missions confiées aux ARS, échelon de droit commun pour traiter ces sujets.
La supervision nationale est réservée aux situations les plus complexes et à fort enjeu.
Le comité intervient ainsi en priorité pour les établissements ayant un budget annuel supérieur à 80 millions d’euros.
La sélection des établissements s’appuie par ailleurs notamment sur les indicateurs issus du dispositif du réseau d’alerte mis en place par la DGOS et la DGFiP (13), ainsi que sur la liste des établissements suivis dans le cadre du comité de veille active sur la situation de trésorerie.
Pour solliciter l’expertise du COPERMO, l’ARS compétente établit un diagnostic des difficultés du centre hospitalier et arrête un plan d’actions avec des mesures de retour à l’équilibre. Ce plan est préparé en concertation avec l’établissement concerné. Le diagnostic est conduit sur la base d’une méthodologie commune comprenant une synthèse de la situation de l’établissement portant notamment sur les thèmes suivants :
– le positionnement dans le territoire ;
– l’évolution des activités ;
– l’attractivité ;
– la qualité et la sécurité et des soins, notamment le positionnement de l’établissement dans la procédure de certification par la Haute Autorité de santé ;
– la performance des organisations et des prises évaluées par rapport aux référentiels nationaux existants ;
– la gestion des ressources humaines ;
– la situation budgétaire et financière actuelle et les perspectives financières intégrées dans le plan global de financement pluriannuel.
Ce diagnostic a pour principal objectif de déterminer l’effort budgétaire attendu de l’établissement pour parvenir à un équilibre financier structurel. Il doit permettre d’aboutir à la conclusion d’un plan d’actions fixant des objectifs précis et évaluables et garantissant l’atteinte du niveau de marge brute d’exploitation nécessaire à la soutenabilité de la charge de la dette et des investissements courants. Pour l’élaboration de ce plan, les établissements peuvent bénéficier d’un appui de l’ANAP.
La décision du comité doit permettre de fixer la trajectoire de redressement à court terme (3 ans) et de déterminer les jalons annuels ou infra-annuels que doit respecter l’établissement pour atteindre la cible fixée c’est-à-dire le retour à l’équilibre financier structurel.
L’instruction précitée liste les axes clefs pour parvenir à établir un plan de redressement.
Elle indique également que la mise en œuvre de mesures de redressement doit prioritairement porter sur des économies. Les recettes supplémentaires issues du développement d’activité doivent être précisément justifiées par l’ARS et l’établissement en fonction du contexte territorial.
Tout au long du processus de retour à l’équilibre des établissements, les comités régionaux de veille active interviennent notamment pour surveiller les plans de trésorerie des établissements afin d’éviter tout incident de paiement et de veiller à ce que les établissements paient leurs dettes à leur échéance.
Ces établissements ainsi suivis au plan national le sont également au niveau régional pour mener à bien leur redressement. Le plus souvent, dans le mois qui suit la réunion du comité, le plan d’actions fait l’objet d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) passé entre l’ARS et l’établissement. Les engagements pris au titre du retour à l’équilibre financier des établissements correspondent à la mise en œuvre d’un plan de redressement. L’avenant ainsi signé se substitue aux contrats de retour à l’équilibre financier (CREF) déjà mis en œuvre le cas échéant.
Un rapport trimestriel est réalisé par l’ARS sur l’exécution du plan d’actions et des contrôles sur pièces et sur place sont réalisés systématiquement par l’IGAS dans un délai de 6 mois après la conclusion du contrat pour apprécier l’efficience des actions engagées par l’établissement sur sa situation présente et son évolution potentielle.
Si un écart substantiel est constaté avec la trajectoire fixée, l’IGAS peut intervenir dans une mission d’assistance renforcée.
3. Les schémas régionaux d’investissement en santé pour hiérarchiser les priorités
Certains projets d’investissement ont été financés alors qu’ils étaient manifestement surdimensionnés car les ARS ne disposaient pas d’outils de planification pour déterminer les projets d’investissements prioritaires.
L’instruction DGOS/PF1/DGCS n° 216 du 28 mai 2013 relative au cadrage général de la démarche d’élaboration du schéma régional d’investissement en santé (SRIS) explique les raisons pour lesquelles ces nouveaux instruments de planification ont été mis en place, de façon à garantir la meilleure allocation des ressources et contribuer à la bonne prise en charge de chaque personne, malade ou en perte d’autonomie, au coût le plus faible et pour le meilleur résultat possible en termes de qualité.
Cette démarche stratégique et transversale, placée sous la responsabilité des agences régionales de santé (ARS), concerne l’ensemble des acteurs de l’offre de soins au cours des dix prochaines années, dans les domaines de l’immobilier, des équipements et des systèmes d’information.
Elle doit garantir que les investissements futurs seront cohérents avec la stratégie nationale de santé et participeront à la qualité des parcours des patients.
Il s’agit, ce faisant, de passer d’une approche déclinée projet par projet à une approche stratégique et territoriale, qui dépasse la dichotomie entre établissements sanitaires et établissements médico-sociaux.
Chaque projet d’investissement devra ainsi être directement mis au service de la politique de santé déterminée dans le projet régional de santé (PRS), répondre à un besoin clairement identifié et tenir compte de l’offre et du patrimoine existants.
Dans cette perspective, l’instruction définit ainsi les SRIS : « les schémas régionaux d’investissement en santé (SRIS) garantiront la mise en cohérence de l’ensemble des investissements à l’échelle d’un territoire. Ces schémas régionaux devront également contribuer à optimiser les décisions d’investissement en fixant à tout projet porté aussi bien par les établissements des secteurs sanitaire et médico-social que par les acteurs des soins de ville, des critères exigeants quant à leur valeur d’usage présente et future et leur contribution à la réponse aux besoins de la population. Ces schémas, enfin, devront assurer la soutenabilité financière de long terme des projets d’investissements, dans le cadre de l’enveloppe nationale dévolue. »
S’agissant de leur contenu, les SRIS comprennent plusieurs parties :
● Un inventaire du patrimoine existant faisant apparaître un bilan des opérations d’investissement réalisées depuis 10 ans ainsi que les capacités foncières ou immobilières mobilisables disponibles pour répondre aux besoins identifiés par les ARS ou par des acteurs de l’offre de soins sanitaire ou médico-sociale.
Tout projet de reconstruction ou de développement d’un établissement de santé devant répondre à des besoins nouvellement identifiés devra par exemple être conditionné à l’analyse des capacités existantes et du potentiel de mobilisation d’investissements déjà réalisés pour y répondre. L’évolution des techniques ou des modalités de prise en charge des patients à l’hôpital (comme la diminution des durées d’hospitalisation en chirurgie ou l’optimisation du fonctionnement des blocs opératoires) doivent être particulièrement analysées pour assurer que les investissements déjà réalisés ne sont pas en mesure de répondre à des besoins futurs.
● Une analyse stratégique des besoins d’investissements menée en référence aux orientations du PRS, fondée sur l’étude des besoins de santé et visant à l’optimisation des parcours des patients. Cette démarche doit conduire à identifier les investissements les plus adaptés pour répondre à ces besoins, quels que soient leur nature (immobilier, équipements médicaux, systèmes d’information) et leur secteur (ville, hôpital, médico-social). Son objectif est de promouvoir dès à présent une approche territoriale des projets d’investissement susceptibles d’être conduits dans les 10 prochaines années par les établissements des secteurs sanitaire et médico-social et par les acteurs des soins de ville tout en tenant compte des investissements déjà réalisés ou en cours.
À titre d’illustration, les besoins d’investissements en faveur de la prise en charge des personnes âgées ou des personnes handicapées, qui peuvent relever des secteurs sanitaire (soins de suite et réadaptation et soins de longue durée) ou médico-social (établissements pour personnes âgées dépendantes, maisons d’accueil spécialisé), doivent être évalués de manière transversale dans le cadre de ces schémas, conformément aux orientations du PRS.
● Une cartographie présentant, par ordre de priorité, l’ensemble des projets programmés sur les champs sanitaire et médico-social comportant notamment des indications synthétiques sur leur opportunité, leur coût et leur plan de financement prévisionnel.
● Une étude d’impact financier global contenant notamment une analyse de la soutenabilité des scénarios au regard de la capacité d’autofinancement actuelle et prévisionnelle des établissements et des structures ainsi que des financements susceptibles d’être mobilisés sur les dotations régionales ou auprès des collectivités territoriales.
Ces nouveaux outils sont encore en voie de gestation car dans beaucoup d’ARS, il n’existe qu’une photographie de l’existant, le travail prospectif restant à mener, mais cette initiative doit être encouragée.
4. Encadrer le recours à l’emprunt de manière optimale
L’ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé a supprimé les emprunts de la liste de leurs décisions soumises à la délibération du conseil d’administration. Le recours à l’emprunt est donc devenu de la seule compétence du directeur. Le conseil de surveillance n’est informé qu’a posteriori des emprunts souscrits par l’établissement.
Suite aux nombreux emprunts toxiques contractés par les établissements hospitaliers et les collectivités locales, des mesures, tout d’abord réglementaires puis législatives, ont cependant été prises pour encadrer plus strictement leur recours à l’emprunt.
Le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 et la circulaire interministérielle DGOS-DGFIP n° 195 du 9 mai 2012 relative aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé ont précisé ces nouvelles règles.
● L’article D. 6145-70 du code de la santé publique crée un régime d’autorisation préalable pour les établissements publics de santé dont la situation financière est caractérisée par au moins deux des trois critères suivants :
– leur ratio d’indépendance financière excède 50 %. Le ratio d’indépendance financière mesure le poids de l’endettement dans l’ensemble des ressources stables ou capitaux permanents (apports, réserves, subventions d’investissement, report à nouveau et provisions) de l’établissement. Cet indicateur mesure le niveau de dépendance financière de l’établissement vis-à-vis de ses prêteurs et permet d’apprécier les marges de manœuvre réellement disponibles ;
– le ratio de durée apparente de leur dette excède 10 ans. Le ratio de durée apparente de la dette rapporte le total de l’encours de la dette à la capacité d’autofinancement (CAF). Il permet de mesurer, au 31 décembre de l’année N, le nombre d’années d’autofinancement qui serait nécessaire pour éteindre l’encours de la dette si l’intégralité de la CAF était consacrée à cet objectif. Cet indicateur permet d’apprécier la capacité d’un établissement à rembourser sa dette, compte tenu des excédents potentiels de trésorerie issus de ses opérations ;
– leur ratio de l’encours de la dette rapporté au total de leurs produits annuels toutes activités confondues excède 30 %.
Le directeur de l’établissement public de santé, dont les ratios répondent aux critères précités, doit obtenir l’accord du directeur général de l’ARS avant de recourir à l’emprunt. La demande porte sur le montant global d’emprunt auquel l’établissement public de santé envisage de recourir au cours de l’exercice budgétaire.
De plus, lorsque la demande d’autorisation n’est pas présentée en même temps que l’état des prévisions de recettes et dépenses (EPRD), le directeur de l’établissement transmet une proposition de mise à jour du dernier PGFP (plan global de financement pluriannuel) approuvé, afin de tenir compte de l’impact prévisionnel de nouveaux emprunts sur l’équilibre financier.
● La deuxième mesure restrictive mise en œuvre par les deux textes précités consiste à proscrire les emprunts reposant sur des mécanismes de financement trop complexes, ceux-là mêmes qui ont abouti à la crise des emprunts toxiques.
– En application de l’article D. 6145-71 du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent souscrire auprès des établissements de crédit des emprunts à taux d’intérêt fixe ou variable. Les emprunts à taux variable doivent néanmoins répondre à des conditions précises en termes d’indices sous-jacents utilisés et de formule d’indexation pour limiter les risques financiers qui en découlent.
Deux types d’indices sous-jacents sont autorisés, qui peuvent éventuellement se combiner entre eux :
– les emprunts ayant une clause d’indexation sur l’indice du niveau général des prix, ou sur l’indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l’article D. 112-1 du code monétaire et financier ;
– les emprunts avec clause d’indexation sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro ou du marché des valeurs de l’État français.
Les emprunts à taux d’intérêt variable souscrits auprès des établissements de crédit par les établissements publics de santé sont autorisés dans deux cas définis à l’article D. 6145-71.
Dans le premier cas, le taux d’intérêt variable est défini comme la simple addition d’un indice usuel (de taux ou d’inflation) et d’une marge fixe exprimée en point de pourcentage.
Dans le deuxième cas, le taux d’intérêt variable est défini par une formule plus complexe. Dans cette hypothèse, l’établissement ne peut souscrire l’emprunt que s’il est prévu un plafond dans la fixation du taux, afin d’éviter une évolution non soutenable du taux variable. Ce plafond est au maximum égal au double du taux d’intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l’emprunt.
Par exemple, si la formule de l’emprunt variable implique un taux d’intérêt contractuel de 3 % lors de la première période de remboursement, la formule d’indexation prévue par le contrat d’emprunt doit être plafonnée au maximum à 6 % pour chacune des périodes de remboursement ultérieures.
– Le recours aux « produits dérivés » est aussi strictement encadré.
En application de l’article D. 6145-72 du code de la santé publique, les contrats financiers (dits également produits dérivés) souscrits à l’occasion d’un emprunt bancaire sont autorisés lorsqu’ils sont relatifs à des taux d’intérêt. Les contrats financiers autorisés sont cependant limités à certaines catégories de contrats et doivent répondre à des conditions précises en termes d’indices sous-jacents utilisés et d’évolution des taux d’intérêt.
ÉTABLISSEMENTS SOUMIS À AUTORISATION DE L’ARS
POUR LEUR DÉCISION D’EMPRUNT
Catégorie |
2 critères |
3 critères |
2 ou 3 critères |
% du total de la catégorie |
Assistance publique de Paris |
0 |
0 |
0 |
0 % |
Hôpitaux de proximité (ex-HL) |
47 |
44 |
91 |
27 % |
CH (centres hospitaliers), budget < 20 M€ |
18 |
9 |
27 |
28 % |
CH, budget> 70 M€ |
42 |
38 |
80 |
49 % |
CH budget 20-70 M€ |
44 |
42 |
86 |
43 % |
CH Régional |
6 |
9 |
15 |
48 % |
CH spécialisé |
10 |
4 |
14 |
15 % |
Groupements de coopération sanitaires |
1 |
0 |
1 |
50 % |
Divers |
13 |
8 |
21 |
48 % |
Total général |
181 |
154 |
335 |
35 % |
Source : Direction générale de l’offre de soins (à partir des comptes 2012).
b. L’amendement au projet de loi de modernisation de notre système de santé limitant le recours aux emprunts en devises ou à taux variables
Lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de modernisation de notre système de santé, les deux coprésidents de la MECSS ont présenté un amendement visant à limiter, pour les établissements publics de santé, la possibilité de recourir aux emprunts en devises ou à taux variables.
Cet amendement, adopté en commission des Affaires sociales, prévoit d’étendre aux établissements de santé les dispositions restrictives adoptées pour les collectivités territoriales, elles aussi très affectées par la souscription d’emprunts toxiques.
Les dispositions adoptées pour les collectivités territoriales à l’initiative du précédent rapporteur général de la commission des Finances de notre Assemblée, avec l’article L. 1611‑3‑1 du code général des collectivités territoriales, ont été adaptées au cas des hôpitaux publics.
Il apparaît en effet que, sur les 30 milliards d’euros de dette des hôpitaux publics, les emprunts toxiques représentent de l’ordre d’un milliard et demi d’euros de capital restant dû, et au moins autant en termes de coût de sortie de ces emprunts. La récente décision des autorités monétaires helvétiques en janvier dernier d’abandonner la défense d’une parité fixe du franc suisse contre l’euro a eu pour conséquence immédiate de renchérir considérablement les frais financiers dus au titre d’un certain nombre de ces emprunts toxiques, dont les formules d’indexation tenaient compte de cette parité. Par ailleurs, un certain volume d’emprunts avaient été contractés par des hôpitaux en francs suisses, avec un relèvement consécutif immédiat de leur valeur en euros.
Il convenait donc, sans délai et sans attendre les conclusions du présent rapport, d’interdire, pour l’avenir, aux hôpitaux publics de contracter à nouveau de tels emprunts toxiques, en s’inspirant, tout en les rendant plus rigoureuses encore, des règles prévues pour les collectivités territoriales. Il importait notamment d’exclure la possibilité pour les hôpitaux d’emprunter en devises, cette faculté n’ayant pas lieu d’être pour cette catégorie de personnes morales publiques dont la politique de financement doit être particulièrement encadrée.
Ce dispositif, devenu article 26 bis du projet de loi précité, a été adopté par l’Assemblée nationale sous forme d’un nouvel article L. 6145-16-1 du code de la santé publique, qui interdit les emprunts en devises et impose que les emprunts à taux variables répondent à ces critères de simplicité ou de prévisibilité des clauses financières pour les hôpitaux qui les souscrivent, et renvoie la définition de ses conditions d’application à un décret simple.
B. MIEUX PROGRAMMER LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
1. Permettre un financement régulier des investissements
Le gouvernement a pris conscience des graves conséquences des plans hôpitaux de 2007 et 2012 qui ont favorisé des vagues massives d’investissements et encouragé le surdimensionnement de certains projets. Depuis 2011, la doctrine du ministère chargé de la santé est clairement d’éviter ces mouvements de stop and go tout en veillant à ce que les établissements puissent financer un flux régulier d’investissements.
Même si cette prise de conscience est indéniable, de nombreux établissements ont du mal à assurer le renouvellement de leurs investissements courants.
La rapporteure partage la recommandation présentée par M. Christian Béréhouc, directeur associé de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), lors de son audition devant la MECSS. Celui-ci a ainsi proposé de « sanctuariser » ce qui est du domaine des investissements courants, de la maintenance, du gros entretien, « en fixant un minimum de 3 % du budget, au-dessous duquel on considère que l’établissement prend un risque de dégradation à terme de son patrimoine. Il faut fixer un seuil évitant à l’établissement d’arriver, après dix ans d’incurie, à une dégradation telle qu’il faille nécessairement tout reconstruire. »
Durant ses déplacements, la rapporteure a recueilli plusieurs témoignages, notamment de soignants, qui lui ont expliqué, comme à Roanne, que le laboratoire de biologie était devenu totalement obsolète. Ce blocage du renouvellement des équipements conduit d’ailleurs à des décisions qui peuvent paraître anti-économiques car certains appareils plus modernes seraient rapidement amortis en permettant de faire des économies sur les produits consommables. Les sommes nécessaires ne sont pas considérables puisque les besoins les plus urgents s’élèveraient à 200 000 euros (sur un budget d’investissement courant de 8 millions d’euros), pour le centre hospitalier de Roanne.
Au centre hospitalier de Montreuil, comme à celui de Roanne d’ailleurs, certains praticiens hospitaliers ont quitté leur poste ou certains postes restent vacants car le plateau technique ou le matériel pour les explorations fonctionnelles est devenu trop vétuste. Le président de la CME (Commission médicale de l’établissement) a d’ailleurs signalé à la rapporteure qu’il craignait qu’à court terme, de nombreux établissements dont celui de Montreuil, se trouvent dans une situation de « paupérisation technologique » notamment à cause de l’importance des investissements à venir pour l’informatique médicale et le développement de la télémédecine.
Le professeur Fabrice Zeni, doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne, et M. Frédéric Boiron, directeur général du Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, ont d’ailleurs insisté sur l’importance de la réorganisation de l’hôpital qui va regrouper au nord de l’agglomération tous les services aigus et la recherche clinique afin de disposer d’équipements de pointe. Le CHU rénové se situant à proximité de la Faculté de médecine, une véritable synergie devrait pouvoir s’opérer entre enseignement et recherche clinique. Le développement de la recherche clinique reste un critère essentiel pour l’attractivité du CHU tant pour les patients que pour le corps médical.
Préconisation n° 1 : Garantir un montant minimal et régulier d’investissement de renouvellement
Demander aux ARS d’autoriser les établissements de santé à consacrer au moins 3 % de leur budget pour permettre de réaliser chaque année un montant minimum d’investissements de renouvellement et éviter ainsi une obsolescence de l’offre de soins.
2. Mieux calibrer les grands projets d’investissement
Même si des progrès significatifs ont été faits pour mieux planifier l’offre de soins au plan régional, via les SRIS, des progrès restent à accomplir. M. Michel Rosenblatt, secrétaire général du Syndicat des cadres de direction, et médecins des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS CFDT), dans son audition devant la MECSS a souligné le caractère encore balbutiant de la planification de l’offre qui est indispensable pour éviter des investissements surdimensionnés : « Il est tout à fait paradoxal que dans la période passée, alors qu’il aurait fallu une planification fine, on se soit contenté d’une logique de simple régulation de l’offre, ce que nous avions critiqué du point de vue syndical. Nous avions dit qu’il fallait, au contraire, définir de manière plus stricte et plus précise les modalités et les décisions de répartition de l’offre sanitaire sur le territoire. La régulation a conduit à préparer des contrats pluriannuels alors même que les ARS n’avaient connaissance de leurs capacités financières que chaque année successivement. Les modalités de travail étaient donc structurellement peu opérationnelles. Très souvent, nous ne connaissons nos ressources qu’après le 31 décembre de l’année. Il ne faut donc pas s’étonner que les capacités de prévision fine des gestionnaires hospitaliers soient parfois insuffisantes ».
La rapporteure a été frappée lors de son déplacement à Roanne de constater que, malgré l’attention des autorités de tutelle sur le fonctionnement de cet hôpital, des travaux manifestement surdimensionnés ont été menés sans réelle justification. Lors de la rencontre avec les administrateurs provisoires, il a été impossible de savoir pourquoi une telle augmentation de capacité avait été décidée. Les membres de la CME ont en revanche expliqué que la direction précédente avait un projet de coopération avec la principale clinique de la ville et qu’il avait été envisagé que la clinique utilise des locaux du centre hospitalier. Aucune archive ne permet cependant de corroborer ces informations. Il n’en demeure pas moins que le centre hospitalier de Roanne a dû fermer quatre salles opératoires sur douze et dispose de locaux flambant neufs vacants, ce qui alourdit ses coûts de fonctionnement alors que l’établissement est dans une situation financière par ailleurs très délicate.
M. Gautier Bailly, sous-directeur à la direction du budget au ministère des finances et des comptes publics, a confirmé lors de son audition que les derniers grands plans d’investissement avaient conduit à étendre le parc immobilier des hôpitaux. Pour les CHU, qui représentent un quart du patrimoine immobilier hospitalier, la part du bâti neuf ou réhabilité a augmenté de 70 % et les surfaces globales de 30 % sur la période 2002-2010, alors que le nombre de mètres carrés obsolètes ou vétustes, lui, n’a pas toujours diminué. Ainsi, les opérations ont été réalisées sans réel effort de densification et dans le sens d’une extension globale des surfaces.
Il a aussi souligné que : « la capacité hospitalière a augmenté de 5 % entre 2010 et 2011, alors que l’activité était stable, voire en léger recul, que la durée moyenne de séjour a baissé et que le recours à la chirurgie ambulatoire a progressé. Des exemples de projets surdimensionnés ou mal adaptés à cette évolution des pratiques médicales sont mentionnés dans le rapport de la Cour des comptes sur le plan hôpital 2007.
Au total, les taux d’occupation des structures hospitalières restent relativement faibles, à environ 75 % en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), et 10 000 à 11 000 lits ont un taux d’occupation de moins de 50 %. »
Il concluait que : « en définitive, cet investissement, présenté comme nécessaire, voire indispensable, s’est appuyé sur l’encouragement à l’emprunt, conduisant parfois à une sélection trop rapide des projets, ainsi que sur des sous-jacents médico-économiques parfois trop ambitieux. »
Pour éviter de prolonger cette tendance à toujours plus construire comme si les extensions immobilières étaient, à elles seules, un gage de modernisation, il convient de mieux analyser l’évolution de la demande de soins.
Il faut donc accentuer la politique engagée consistant à graduer l’offre de soins sur les territoires. M. Jean Debeaupuis, directeur général de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a souligné lors de son audition l’importance de la planification territoriale : « Les notions de régionalisation et de territorialisation de l’offre de soins – reprises par le projet de loi de santé – signifient que les établissements ne peuvent pas faire tout et n’importe quoi dans leur coin. D’où la nécessité d’une politique régionale, d’une part, et d’une coopération au niveau des territoires, d’autre part, gages de qualité et de sécurité des soins au bénéfice des patients. »
Il a aussi insisté sur la nécessité de structurer le réseau hospitalier en trois niveaux : les hôpitaux de proximité (ex-hôpitaux locaux), les établissements moyens, qui disposent d’un plateau technique plus important et proposent une offre de soins développée pour le deuxième niveau et enfin, les 32 établissements dits « régionaux », lieux de formation et de recherche, qui constituent le niveau le plus élevé.
La médecine hospitalière a déjà connu de grands changements technologiques mais doit faire un réel effort pour anticiper certaines évolutions. Elle devra surmonter la contradiction existante entre le temps long nécessaire à l’investissement immobilier et la nécessité de s’adapter rapidement pour disposer de matériels lourds incorporant les dernières innovations biomédicales.
M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), a souligné lors de son audition devant la MECSS la nécessité de revoir la stratégie d’investissement pour s’adapter à des réalités nouvelles. Il a ainsi déclaré : « La fréquentation de l’hôpital a peut-être été à son apogée dans les années 1990-2000. Demain, il y aura sans doute de plus en plus de prises en charge télé-réparties, parce que les moyens technologiques permettront l’éducation thérapeutique chez soi. L’enjeu n’est donc pas forcément de construire des murs. Aujourd’hui, 40 % des prescriptions médicamenteuses ne sont pas suivies par les patients, ce qui nécessite de l’éducation thérapeutique à distance. À ce jour, le développement de la télémédecine en est encore à ses débuts. Peut-être faut-il cesser d’investir dans les murs pour investir dans les technologies de l’information parce que c’est ce qui permettra de maintenir les gens chez eux, où ils se sentiront mieux qu’à l’hôpital ou dans une maison de retraite. Il faut donc plutôt miser sur cet investissement immatériel. »
L’ANAP joue en l’espèce déjà un rôle majeur pour aider les ARS et établissements à avoir une vision dynamique de l’adaptation de l’offre de soins.
M. Christian Béréhouc, directeur délégué de l’ANAP, a également expliqué que son organisme apportait son concours à certaines ARS pour dynamiser les SRIS : « il faut fournir des éléments de projection aux établissements et aux ARS. On s’est aperçu que les établissements avaient tendance, peut-être parfois sous la pression des personnels, à toujours envisager des projets visant à simplement améliorer l’existant, en reprenant pour une bonne part les modes de prise en charge du jour, voire de la veille, ce qui, de temps en temps, peut poser problème.
Aussi, nous avons, dans le cadre des SRIS, proposé des éléments de projection concernant les prises en charge, les évolutions techniques, voire technologiques, pour aider les établissements et les ARS à les anticiper pour le projet dès son ouverture plutôt que de constater a posteriori que celui-ci est conforme à ce que l’on faisait en 2005 ou en 2010. »
3. Diffuser la doctrine du COPERMO
Au cours des auditions de la MECSS et lors des déplacements de la rapporteure, un consensus est apparu pour estimer que si le COPERMO avait l’incontestable avantage d’objectiver les critères permettant de recevoir des aides à l’investissement, sa procédure pouvait paraître manquer de transparence.
Les praticiens ont aussi critiqué sa lourdeur, sans qu’ils aient l’impression d’être réellement associés à la prise de décision. Même si la procédure d’instruction laisse place à une certaine négociation sur la définition du futur projet d’investissement, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas vraiment contradictoire, certains échanges se déroulant directement entre l’ARS et la cellule de la DGOS qui instruit les dossiers du COPERMO, sans que le directeur concerné ne puisse connaître les arguments échangés. De plus, même si les experts qui travaillent pour le Commissariat général à l’investissement sont souvent issus de la communauté des directeurs d’hôpitaux, les praticiens de terrain ont l’impression d’être « jugés » par des spécialistes qui méconnaissent parfois les contraintes très particulières de la gestion d’un établissement de soin.
Ce sentiment est encore plus vif pour les établissements qui font l’objet d’un suivi en procédure « performance ». Ce sont les ARS qui décident quels établissements seront accompagnés et cette procédure est souvent perçue comme une sorte de désaveu de l’équipe de direction. Compte tenu du caractère centralisé de la procédure, les fonctionnaires experts qui font des recommandations au titre de la performance ignorent souvent la réalité concrète des établissements et certaines pesanteurs locales.
L’ensemble des dossiers examinés en COPERMO a en revanche permis de recueillir une masse considérable d’informations sur les projets d’investissement, les difficultés de financement ou sur la difficulté de suivre les contrats de retour à l’équilibre pour le volet performance. Il est dommage que la DGOS n’ait pas encore fait un travail d’analyse sur ces dossiers pour essayer d’évaluer la valeur ajoutée apportée par cette procédure en termes de densification des structures de soins, de réorganisation des services ou de réduction de lits. Cette procédure permet aussi de repérer un certain nombre de bonnes pratiques dans l’évaluation de la demande future de soins, dans la mutualisation de certaines fonctions support, dans la négociation avec les établissements bancaires… Toutes ces informations gagneraient à être mieux exploitées.
Même si la DGOS a affiché l’intention de procéder à une analyse qualitative de toutes ces données et de produire un rapport d’activité du comité, la rapporteure estime très important d’améliorer la transparence de la procédure afin qu’elle soit plus contradictoire avec l’établissement bénéficiaire. De plus, la DGOS devrait exploiter régulièrement ces informations pour synthétiser une forme de doctrine sur l’amélioration des procédures d’investissement. Après deux ans de fonctionnement, il doit être possible de tirer un certain nombre d’enseignements des dossiers présentés et de les communiquer à la communauté hospitalière.
Préconisation n° 2 : Diffuser les enseignements tirés de l’instruction des dossiers d’investissement et d’amélioration de la performance présentés au COPERMO
Améliorer la transparence de la procédure devant le COPERMO pour les décisions concernant les projets d’investissement en explicitant notamment la décision finale et les écarts entre les aides à l’investissement attribuées par rapport à celles demandées.
Communiquer une synthèse sur les principaux enseignements à tirer des dossiers présentés, en termes de recherche de financement et d’adaptation de l’offre de soins aux nouveaux besoins sanitaires, réalisée par la cellule de la DGOS, chargée de l’instruction des dossiers devant le COPERMO.
4. Renforcer la mutualisation des moyens
L’effort de coordination entre établissements et recherche d’une d’offre de soins graduée, qui s’est imposé depuis de nombreuses années, doit être poursuivi et approfondi pour mettre en place des réseaux d’établissements avec des coopérations opérationnelles.
M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital, a insisté devant la mission sur l’importance de la coopération entre établissements et sur la mutualisation des moyens comme de certaines fonctions support : « Cela suppose de renoncer à certaines prérogatives et à certains symboles parfois artificiels d’autonomie. Dans le système de santé, les hôpitaux ont besoin les uns des autres : il faut que le petit puisse s’appuyer sur le gros et inversement. Les équipements de biologie médicale, chers et de plus en plus complexes en raison des normes de certification, ne peuvent être déployés partout. Nous avons intérêt à regrouper nos plateaux de biologie et à définir le niveau de compétence de tel établissement par rapport à tel autre ».
Ces politiques territoriales appellent des décisions qui dépassent le seul cadre des établissements.
Le rôle des autorités de tutelle est essentiel mais les acteurs locaux contestent parfois leur légitimité. M. Boiron a ainsi ajouté : « Et les élus eux-mêmes doivent accepter que des autorités mises en place par l’État fassent des choix de répartition territoriale d’activités qui peuvent être vécus comme défavorables au niveau local mais qui sont justifiés au niveau national. Dans dix ans, nous pourrions envisager des regroupements hospitaliers associant plateaux techniques coûteux et établissements dont la prise en charge n’impliquera pas ce type d’équipement, ce qui aura un impact sur la gestion de l’investissement et de l’endettement. »
Un premier aspect de cette mutualisation des moyens pouvait consister à créer des directions communes entre établissements ou prévoir une gestion commune de diverses fonctions support.
Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), lors de son audition a expliqué qu’au cours des cinq dernières années, le CNG avait incité à la création de directions communes, qui permettent de regrouper soit plusieurs établissements hospitaliers, soit des établissements hospitaliers avec des établissements sociaux et médico-sociaux – on parle alors de directions communes mixtes.
Ce dispositif préserve l’autonomie des établissements, ce qui est un point très sensible pour les acteurs politiques locaux. Le directeur qui est retenu pour prendre la tête de la direction commune doit de ce fait participer à un grand nombre d’instances, puisque chaque établissement conserve les siennes.
Elle a ainsi déclaré : « Les directions communes permettent de combiner unité de direction – avec une équipe un peu plus étoffée – et responsabilisation des acteurs. Les établissements portent un projet médical commun et peuvent développer des coopérations pertinentes en matière d’administration, de logistique, d’ingénierie, de gestion des ressources humaines, de développement de certaines activités. Cette forme de travail en équipe est de plus en plus prisée, notamment par les D3S (14) qui, sinon, exercent souvent leurs fonctions dans un certain isolement. Ils apprécient la dimension de partage et le sens du compagnonnage. »
Aujourd’hui, on compte environ 400 directions communes.
Certaines compétences techniques coûteuses pourraient être gérées en commun, par exemple l’ingénierie des grands projets de travaux, ce qui éviterait aux établissements d’être en position d’infériorité technique vis-à-vis des entreprises du bâtiment, pour suivre les travaux complexes. M. Guillaume Wasmer, représentant le Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS), a ainsi suggéré devant la mission que « pour les décisions d’investissements lourds on pourrait aussi mettre en place des outils pour faire face à des montages complexes. Sur le plan technique, on pourrait aussi avoir une équipe d’ingénieurs, de techniciens, qui soit centralisée par région ou au niveau national et qui pourrait intervenir sur certaines opérations particulières. On a essayé de le faire, au niveau des tutelles. Or, cela devrait être plutôt fait au niveau des dirigeants hospitaliers car les tutelles doivent rester, à mon sens, dans le champ de la régulation et du contrôle beaucoup plus que dans celui de l’appui. Elles ne peuvent pas jouer à la fois le rôle de régulateur et d’accompagnant. ».
Lors de son audition, M. Gautier Bailly a souligné tout l’intérêt d’une gestion commune, pour les petits établissements notamment, de certaines compétences. Il s’est déclaré favorable « à la mutualisation des fonctions supports entre les hôpitaux ». Cette analyse est partagée par M. Yves Gaubert de la fédération hospitalière de France pour qui « le développement des directions communes et la mutualisation des compétences permettent de sécuriser le fonctionnement des établissements ».
Le projet de loi de modernisation de notre système de santé, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, propose ainsi d’instituer, avec son article 27, les groupements hospitaliers de territoire (GHT), une nouvelle forme de coopération entre établissements en lieu et place des actuelles communautés hospitalières de territoire.
Le GHT vise à rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties devraient élaborer un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours.
Selon les informations du rapport intermédiaire de mai 2015 de la Mission de préfiguration confiée à Mme Jacqueline Hubert et M. Frédéric Martineau, il est prévu que certaines fonctions transversales soient gérées en commun, comme la mutualisation des services médico-techniques (laboratoire d’analyses médicales, imagerie, pharmacie…)
Il paraît en effet difficilement envisageable de bâtir de véritables filières inter-hospitalières de prise en charge sans que l’ensemble des activités support soient homogénéisées, de même qu’il est primordial de veiller à la convergence des systèmes d’information hospitaliers et de disposer d’un département de l’information médicale de territoire (DIM).
La rapporteure estime que ces GHT doivent aussi pouvoir gérer certains aspects de la gestion financière. Il serait ainsi très intéressant de prévoir la possibilité de mécanismes de solidarité financière entre les établissements de santé d’un même GHT. On pourrait à ce titre s’inspirer des mécanismes de gestion centralisée de la trésorerie ou cash pooling qui permettent d’équilibrer les comptes des filiales d’un groupe, économisant ainsi des frais financiers en évitant de recourir aux marchés. De plus, elle donne à un groupe relativement important, mais constitué de sociétés de faible taille, la possibilité d’accéder aux marchés financiers.
Cette solidarité de trésorerie supposerait une adaptation des règles comptables actuelles, mais serait de nature à générer des économies en homogénéisant les processus relatifs aux opérations comptables et permettrait aux petits établissements de disposer de compétences techniques de gestion financière notamment pour négocier avec les établissements bancaires.
Préconisation n° 3 : Gérer en commun la trésorerie et l’endettement
Prévoir que les établissements, constituant un GHT puissent gérer de manière commune certains aspects de leur politique d’endettement et de leur gestion de la trésorerie, afin de disposer d’une masse critique plus importante pour accéder aux marchés financiers et négocier avec les banques.
C. UNE SORTIE CONCERTÉE DES EMPRUNTS TOXIQUES AVEC UN PARTAGE DE LA CHARGE FINANCIÈRE ENTRE LES BANQUES ET LES ÉTABLISSEMENTS
Devant la gravité de la situation financière de certains hôpitaux, le Gouvernement a pris en urgence des mesures dont l’objectif essentiel est que les établissements ne puissent plus à l’avenir contracter d’emprunts structurés et disposent des moyens financiers pour se désengager au plus vite des emprunts toxiques déjà souscrits.
La rapporteure estime qu’il faut accélérer le rythme de sortie de ces emprunts et obtenir que tous les établissements aient une attitude déterminée de désengagement. Reste la question délicate du partage des conséquences financières de la sortie de ces emprunts toxiques. Pour l’instant, l’essentiel du coût a été supporté par les finances publiques, les banques devant apporter une contribution limitée, quoique croissante, dont les modalités ne sont pas encore totalement fixées.
Comme le soulignait la Cour des comptes dans sa contribution précitée, une « stratégie de désendettement s’impose » d’autant plus que « la contrainte que va faire peser l’ONDAM sur le secteur hospitalier va vraisemblablement peser plus lourdement. »
Elle indiquait qu’une démarche de désensibilisation mieux organisée était souhaitable afin de neutraliser non seulement les risques avérés portant sur les emprunts structurés qui sont déjà entrés en phase de majoration de taux d’intérêt mais également de ceux dont la probabilité de concrétisation génère un risque qu’il faut anticiper.
1. La priorité donnée au désengagement et à la renégociation des emprunts toxiques
a. Qui supporte le coût du désengagement des emprunts toxiques ?
Lors de son audition en décembre 2014, avant la « crise du franc suisse », M. Jean Debeaupuis, directeur général de l’offre de soins (DGOS) au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a expliqué que l’objectif prioritaire était d’inciter les établissements à se désengager des emprunts structurés.
Pour les établissements les plus importants, la solution la plus efficace paraît être de « faire évoluer les taux d’intérêt pour sortir de ces prêts structurés, notamment à l’occasion de la souscription d’un nouvel emprunt. En effet, la souscription d’un nouveau prêt permet à l’hôpital de négocier avec l’établissement bancaire, notamment la Société de financement local (SFIL), la sortie du mode structuré afin de sécuriser la dette.
La deuxième action, davantage ciblée sur les petits établissements, est la mise en place d’un fonds d’intervention de 100 millions d’euros, sur trois ans, dont 25 millions d’euros seront apportés par les banques elles-mêmes. Ce dispositif sera surtout destiné aux petits hôpitaux, dont les moyens techniques et les capacités de négociation sont limités par rapport à ceux des plus gros établissements. Cela ne résoudra pas tous les problèmes, mais aidera ceux en grande difficulté à sortir de ces emprunts sensibles ».
Le directeur général de l’offre de soin n’a pas exclu qu’un accompagnement complémentaire pour les établissements grands ou moyens confrontés à des difficultés spécifiques puisse être envisagé.
Cette stratégie a été inspirée notamment par les conclusions du rapport de l’IGF (15) sur « Les conditions de financement des établissements publics de santé auprès du secteur bancaire » de mars 2013.
Ce rapport conseillait de « procéder au remboursement anticipé des emprunts structurés les plus sensibles, dans les meilleurs délais, y compris si cela doit entraîner un coût budgétaire certain ». Il ajoutait : « Il convient de préciser que la négociation avec les banques doit se traduire par un remboursement effectif de l’emprunt et donc par la disparition totale du risque correspondant et non par un simple report dans le temps de certaines échéances. De tels reports entraînent un paiement supplémentaire d’intérêts pour l’emprunteur et ne diminuent aucunement le risque latent. »
L’inconvénient majeur de cette solution de sortie des emprunts toxiques est que l’emprunteur supporte ainsi la totalité du surcoût de l’emprunt toxique qui lui a été vendu par sa banque.
La recommandation de l’IGF aboutit donc à la prise en charge totale de ce surcoût par l’emprunteur, et à une prise en charge immédiate, au motif que les établissements de santé ne doivent pas prendre le risque d’une dégradation ultérieure supplémentaire de leur situation.
D’autres interlocuteurs ont aussi fait remarquer que la solution de réemprunter pour solder un emprunt toxique précédent conduit en quelque sorte à une fuite en avant qui entraîne de nouvelles charges financières tout en hypothéquant l’avenir. L’appréciation de l’opportunité du nouvel investissement est par ailleurs parfois biaisée par l’urgence de trouver une solution pour se désengager d’un emprunt toxique. Malgré d’incontestables inconvénients, les grands établissements ont estimé que cette solution était la moins mauvaise. Lorsque la rapporteure a ainsi rencontré les responsables du groupe hospitalier Nord-Essonne qui va regrouper les hôpitaux de Longjumeau, Juvisy et Orsay. M. Wasmer, son directeur, a attiré son attention sur la solution trouvée pour désensibiliser un emprunt très toxique de l’hôpital de Jusivy. Cette solution va d’ailleurs contribuer à accélérer le travail de regroupement des différentes composantes de ce groupe hospitalier.
La restructuration de la dette du Groupe hospitalier Nord-Essonne
La situation financière du centre hospitalier de Juvisy est profondément affectée par des emprunts structurés, particulièrement toxiques, à hauteur de 12,8 millions d’euros de capital, (100 % de la dette). Ces emprunts sont emblématiques à de nombreux points de vue (établissement de petite taille, emprunts particulièrement toxiques indexés sur le taux de change euro-franc suisse pour un taux d’intérêt de l’ordre de 15 %, durée résiduelle longue jusqu’en 2038, pénalité de sortie élevée de 21 millions d’euros). De surcroît, ils ont été conclus pour mettre en œuvre un projet d’investissement validé par l’ARH, puis abandonné à la demande des pouvoirs publics. Ils sont donc devenus sans objet.
Cet hôpital, qui a survécu à la fermeture de sa maternité et de sa chirurgie en 2009, accueille chaque année avec un plateau technique minimal, 27 000 passages aux urgences. Sa pérennité est menacée par ces emprunts toxiques dont la charge deviendra insoutenable au plan financier dès 2015.
Un projet de fusion entre les centres hospitaliers de Longjumeau, Juvisy et Orsay est en cours. Ce projet permettra une réorganisation importante de l’offre de soins, la fluidification des filières de prise en charge et donc la stabilisation financière des deux établissements. Cette fusion est conditionnée par la sortie préalable de ces emprunts, pour un coût qui était évalué en octobre 2014 à 21 millions d’euros. Un tiers de cette somme devait être permis par la désensibilisation des emprunts liée au processus de fusion, un tiers par des aides de l’ARS, un tiers par une inscription au fond de soutien. Les évolutions récentes des taux de change sont venues bouleverser ce dispositif.
Suite aux décisions récentes de la banque nationale suisse, les ordres de grandeurs financiers qui avaient servi de base de travail au scénario de désensibilisation de l’emprunt toxique du CH de Juvisy ont considérablement évolué. Il faut également noter que depuis l’annonce de la mise en place du dispositif de soutien, les abandons de créances consentis par le passé au CH par la SFIL ont été abandonnés. Ils représentaient 805 000 euros en 2013.
– Le taux d’intérêt annuel recalculé sur la base des nouveaux taux de change a doublé. Il est en effet passé de 13 % à 26 %. Soit un coût annuel pour l’hôpital de l’ordre de 2,6 millions d’euros, soit 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.
– En ce qui concerne l’indemnité de remboursement anticipée qui avait été estimée à l’automne 2014 à hauteur de 21 millions d’euros, elle a aussi considérablement évolué, cependant la SFIL se refuse à donner une évaluation compte tenu de la volatilité des cours. Avec l’appui du conseil financier de l’établissement, un chiffrage raisonnable a été effectué à hauteur de 35 millions d’euros, soit une hausse du montant de la soulte de 66 %.
Ce constat remet en cause le schéma de désensibilisation qui avait été imaginé.
Le directeur du groupe propose de reconduire une solution similaire à celle imaginée au CH de Juvisy en 2011, et qui, développé à grande échelle et sécurisé juridiquement, pourrait apporter une solution aux emprunts structurés sans coût pour le contribuable.
L’établissement détenait un emprunt structuré (CMS) d’un montant de 8 millions d’euros auprès de la Société générale. Cet emprunt devait être mobilisé par l’établissement au plus tard en décembre 2011, mais était devenu sans objet du fait de l’abandon des projets d’investissement. Dans le même temps, le CH Sud Francilien rencontrait des problèmes de liquidités et d’accès au crédit. L’emprunt toxique a été désensibilisé (transformé en taux fixe) et un flux nouveau a été apporté comme support de la désensibilisation, puis transféré juridiquement au CH Sud Francilien. Cela a été possible réglementairement car le produit de l’emprunt n’avait pas été encaissé par l’établissement.
Compte tenu des statuts réglementaires de la SFIL et de sa capacité à prêter des liquidités à prix coûtant dans le cadre des opérations de désensibilisation, la possibilité de transférer une partie d’emprunts toxiques d’un établissement sur un autre, qui présenterait d’importants besoins d’emprunts permettrait de désensibiliser la dette, à moindre coût, voire même de répondre aux besoins de liquidité de cet établissement.
Les établissements pour lesquels l’autorisation de recourir à l’emprunt est soumise à l’autorisation préalable de l’ARS pourraient être des partenaires privilégiés.
Cette proposition de risque partagé et dilué au sein d’une région devrait être étudiée en détails pour préciser les modifications réglementaires indispensables à sa mise en œuvre.
b. Le devoir de conseil des banques
La rapporteure s’interroge sur l’attitude de certaines banques qui n’ont pas vraiment éclairé leurs clients sur les risques encourus et qui n’ont pas pleinement respecté leur devoir de conseil.
Dans bon nombre de dossiers d’emprunts contractés par des hôpitaux, est révélée l’existence de manœuvres dolosives au sens de l’article 1109 du code civil ayant vicié le consentement des emprunteurs car les banques ont usé de procédés commerciaux pouvant être qualifiés de tromperies caractérisées.
Ces banques ont omis délibérément d’expliquer à leurs clients qu’en contractant des « prêts structurés », ils contractaient aussi un ou des contrats financiers de type " produits dérivés " qui, pour la plupart, étaient des produits extrêmement spéculatifs exposant les clients à des risques financiers très élevés.
C’est en particulier le cas pour les options de change incluses dans les opérations indexées sur les parités de change.
Enfin, ces emprunteurs avaient fini par se convaincre que si leurs conditions d’emprunt venaient, en dépit des assurances de leurs banques, à se dégrader, la « gestion active de leur dette » leur permettrait de sortir de ces opérations en contractant de nouveaux produits à des conditions plus favorables.
Ces banques se sont en particulier délibérément affranchies des obligations de conseil, d’information et de mise en garde qui s’imposent à elles lorsque comme en l’espèce elles agissent non seulement comme prêteurs mais comme prestataires de services d’investissement.
De plus, les contrats signés n’indiquaient pas toujours le taux effectif global.
Depuis 1966, la loi fait obligation au prêteur de communiquer à l’emprunteur le taux effectif global (TEG) de l’opération de crédit. Ce taux effectif global est censé refléter le coût total du crédit, permet de vérifier que le taux du prêt n’est pas usuraire, et, le cas échéant, de comparer diverses propositions.
Cette information a néanmoins été généralement omise au moment de la formation des contrats d’emprunt structuré.
Le jugement rendu récemment par le tribunal de grande instance de Nanterre dans l’affaire opposant le conseil général de la Seine-Saint-Denis à Dexia l’a révélé : la télécopie de confirmation adressée par la banque (suite à l’accord opéré lors d’un échange téléphonique entre la salle des marchés du prêteur et l’emprunteur) et sur les termes de laquelle le client devait donner son accord constitue l’instrumentum de l’échange de consentements sur les conditions essentielles du prêt.
La télécopie aurait dû comporter l’indication du taux effectif global de ce prêt, conformément aux dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier (qui reprennent celles du code de la consommation). Cette indication a pourtant été omise. Ce qui, comme le tribunal de grande instance de Nanterre l’a jugé, constituait une violation des dispositions légales sur le taux effectif global.
Enfin, pour certaines catégories de crédit, et notamment pour les prêts consentis aux collectivités territoriales, la loi a conservé le principe de la prohibition de l’usure. Si bien que de nombreux prêts de refinancement, qui intègrent dans leur taux le coût du remboursement anticipé des opérations qu’ils refinancent, sont actuellement contractés à des taux supérieurs au seuil de l’usure.
La rapporteure s’interroge sur l’injonction qui a été faite aux établissements publics de santé d’exécuter pleinement leurs obligations contractuelles, sans chercher à déterminer si une action collective de certains établissements de santé n’aurait pas permis une véritable renégociation des conditions d’emprunt tout en évitant de longs contentieux juridiques qui par ailleurs ont été vivement découragés par les ARS.
Pour éviter que lors de contentieux ultérieurs, l’État ne soit appelé en garantie notamment pour les litiges concernant Dexia, établissement financier qui fut un des principaux pourvoyeurs d’emprunts toxiques, un dispositif législatif est venu sécuriser rétroactivement les emprunts structurés qui ne comportaient pas de mention explicite de TEG. En effet l’État est désormais actionnaire à 75 % de la SFIL, la Société de financement local, qui a repris l’essentiel des actifs français de Dexia.
La loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, composée de quatre articles, valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats de prêts structurés souscrits par l’ensemble des personnes morales de droit public en tant que leur validité serait contestée soit par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global (TEG), du taux de période ou de la durée de période, soit par le moyen tiré de la mention d’un TEG, d’un taux de période ou d’une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation.
Le gouvernement a aussi demandé aux établissements d’abandonner la voie contentieuse pour résoudre le problème du désengagement des emprunts toxiques. La DGOS estime cependant à une vingtaine le nombre de contentieux menés par les établissements de santé mais elle n’est pas tenue informée systématiquement de ce type de démarche qui reste de l’entière responsabilité du directeur de l’hôpital.
Fin octobre 2014, la SFIL a informé la DGOS avoir 12 assignations de la part d’hôpitaux, de taille très variable (par exemple le CHU de Saint-Étienne ou le centre de gérontologie de Chevreuse). À ce jour, aucun des contentieux conduits par un établissement public de santé n’a fait l’objet d’un jugement définitif.
M. Olivier Grimberg, directeur de la médiation à la Société de financement local (SFIL), a d’ailleurs expliqué lors de son audition que « Mme la présidente du TGI a décidé de laisser leur chance au fonds de soutien pour les collectivités locales et au dispositif d’aide pour les hôpitaux ; elle conseille donc aux avocats des hôpitaux, des collectivités et des banques d’essayer de trouver une solution à travers ces structures. »
La DGOS a souligné auprès de la rapporteure qu’elle demandait systématiquement à l’hôpital de signer un protocole transactionnel avec l’établissement bancaire, s’il souhaitait bénéficier du dispositif d’accompagnement de désengagement des emprunts toxiques.
La DGOS a aussi fait remarquer que la cellule de médiation, mise en place sous l’égide de M. Gissler, pour mettre au point des plans de désensibilisation aux emprunts toxiques, initialement au profit des collectivités locales avait été étendue aux hôpitaux fin 2011. La cellule a été sollicitée dans le cas où des petits hôpitaux ayant souscrit un emprunt hors charte, c’est-à-dire les plus toxiques, avaient épuisé toutes les voies de négociation avec la banque. Sur la période 2012-2014, la DGOS a incité une douzaine d’établissements à saisir la médiation. L’action du médiateur a essentiellement consisté à réinstaurer le dialogue entre l’hôpital et la banque et à obtenir de cette dernière de nouvelles propositions de sécurisation… Le médiateur a ainsi obtenu de la SFIL et de Dexia que les établissements en médiation bénéficient d’abandons de créance de manière à ce que le taux d’intérêt effectivement payé soit de l’ordre de 6 à 8 %. Fin 2014, M. Gissler a mis fin à la Médiation, le dispositif d’accompagnement prenant, en principe, le relais de son activité.
c. La réaction des banques face aux demandes de sortie des emprunts toxiques
La rapporteure tient cependant à souligner que toutes les banques n’ont pas eu la même stratégie face aux demandes de renégociation.
Jusqu’à fin 2014, la SFIL a accordé des abandons de créance aux petits hôpitaux, de manière à ramener leur taux d’intérêt payé à un niveau soutenable (6 à 8 %) en attendant la mise en place du dispositif d’aide. M. Olivier Grimberg a rappelé : « nous avons soutenu les établissements les plus fragiles, petits hôpitaux à surface financière et budgétaire limitée, notamment touchés par les crédits sensibles indexés sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse… Cette opération a coûté à peu près 26 millions d’euros à la SFIL, dont 5 millions pour les hôpitaux. »
Son conseil d’administration a décidé de mettre un terme à cette politique en raison de la mise en place du dispositif d’aide à la sortie des emprunts structurés en 2015 qui a pour objectif prioritaire d’aider ces mêmes petits établissements. À noter que la SFIL contribue au dispositif (18 millions d’euros sur 3 ans).
La SFIL a par ailleurs défini, avec l’État, une politique de désensibilisation : il s’agit de transformer ces crédits sensibles en crédits à taux fixe, supprimant l’aléa financier sur toute la durée des prêts. Un tiers de l’encours de crédits sensibles des établissements publics de santé ont été désensibilisés : trente-deux d’entre eux ont été totalement désensibilisés et bénéficient désormais de taux fixes avec la SFIL/Caisse française de financement local (CAFFIL) ; une centaine gardent des crédits sensibles à hauteur de 900 millions d’euros et doivent encore faire l’objet d’une désensibilisation.
Pour transformer les crédits des établissements publics de santé en crédits à taux fixe, la SFIL consent d’importants efforts. Le représentant de la SFIL a expliqué : « Ainsi, comme nous parvenons, sur les marchés financiers, à obtenir des taux proches de ceux que l’on offre à l’État français, nous apportons aux hôpitaux de la liquidité à prix coûtant, en les faisant bénéficier d’un taux fixe de 1,20 % sur quinze ans. Ces ressources permettent aux établissements publics de santé de financer leurs investissements ou une partie des indemnités liées aux crédits sensibles. Pour la SFIL, fournir de la liquidité à prix coûtant représente une perte d’opportunité d’environ 70 millions d’euros, dont une vingtaine de dossiers concernent les établissements publics de santé et le reste, les collectivités territoriales. »
Lors de la deuxième audition des établissements de crédit par la mission, le représentant de la SFIL a précisé, en réponse à la question des délais à prévoir pour que la centaine d’établissements encore porteurs de 900 millions d’euros de crédits sensibles soient désensibilisés : « Cela dépendra des délais de versement du deuxième dispositif d’aide, qui sera crucial pour la désensibilisation de la trentaine d’établissements touchés par l’envolée du franc suisse, dont le cas est le plus compliqué. Si les aides sont versées fin 2015 ou début 2016, nous espérons en désensibiliser une bonne partie. Pour les autres, il faut continuer à faire œuvre de pédagogie ».
La difficulté pour accélérer le mouvement de désensibilisation tient à ce que certains établissements hospitaliers concernés, mais qui ne paient pas encore de taux d’intérêt trop élevés, ne souhaitent pas renégocier. M. Grimberg a poursuivi en indiquant « …il y a encore des établissements publics de santé qui détiennent des crédits sensibles, mais qui ne paient pas de taux dégradés, voire qui paient des taux très bas. Malgré l’aléa financier inhérent à leurs crédits, ces établissements se montrent réticents à les transformer en crédits à taux fixe – certes un peu plus élevé que ceux dont ils bénéficient aujourd’hui, mais dépourvu d’aléa. Nous avons déjà convaincu une bonne partie de ces établissements, mais il faut continuer à inciter les autres, dans les prochains mois, à purger leurs crédits sensibles et à rendre leur dette la plus prévisible et la moins variable possible. Si l’État – à travers le ministère, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) ou les agences régionales de santé (ARS) – pouvait appuyer notre effort de pédagogie, cela aiderait la SFIL dans sa tâche. »
Pour Dexia crédit local, les emprunts hors charte sont au nombre de huit et représentent à peu près 80 millions d’euros d’encours dont 40 millions sont éligibles au dispositif de désensibilisation. M. Pierre Vérot, directeur de la gestion de l’encours a estimé devant la mission que les crédits hors charte pourraient être soldés d’ici fin 2015. Il a également précisé : « Tous les établissements qui ont voulu maintenir avec nous des relations amiables bénéficient d’une prise en charge de leurs échéances dégradées, parfois depuis quatre ans, cet effort venant s’ajouter à notre contribution volontaire et fiscale au fonds de soutien (20 millions). Nous faisons donc le nécessaire pour que les problèmes soient résolus dans des conditions raisonnables et espérons y parvenir dans le courant de l’hiver. »
Quant à M. Jean-Pierre Rosello, directeur des marchés de l’économie publique de la Société Générale il a insisté sur la nécessité d’une démarche concertée de l’ensemble des acteurs pour sortir des emprunts structurés :
« La désensibilisation n’implique pas seulement des efforts de la part des banques, mais de la compréhension et des efforts du côté des structures concernées. Il n’est pas rare que certains de nos interlocuteurs, adoptant une posture rigide, refusent le taux fixe d’origine et les produits désensibilisés que nous leur proposons. ».
Les efforts consentis par les établissements de crédit
Les banques françaises ont été interrogées par écrit par la MECSS pour préciser la situation de leur encours en prêts structurés et en prêts toxiques, ainsi que pour indiquer les efforts qu’elles ont consentis pour permettre aux hôpitaux publics en sortir.
Ces efforts peuvent se décliner ainsi :
a) Pour ce qui concerne l’avenir, la signature de la Charte de bonne conduite élaborée en décembre 2009, exclut de poursuivre la distribution de prêts structurés aux collectivités territoriales, avec une extension aux EPS ;
b) Des propositions de sortie des emprunts toxiques :
– la SFIL a indiqué avoir conclu 48 opérations de désensibilisation avec 44 clients pour un montant de 238 millions d’euros ;
– BPCE a indiqué avoir, depuis 2011, « sécurisé » totalement 115 millions d’euros d’encours pour 17 prêts hors charte, et partiellement 181 millions d’euros pour 22 prêts ;
– le Crédit Agricole a indiqué formuler des propositions de désensibilisation à tous les hôpitaux publics concernés, qu’ils n’ont cependant pas tous retenues. 10 prêts ont fait l’objet d’une désensibilisation totale depuis 2011 pour 65 millions d’euros, et 3 pour 19 millions d’euros, avec évolution vers des taux fixes, ou des taux variables mais indexés sur les taux monétaires ;
– la Société générale n’a plus de prêts hors charte à son bilan, mais, entre 2011 et 2014, elle a sécurisé totalement 171 millions d’euros pour 23 opérations, avec retour à taux fixe, et, partiellement ou temporairement, 107 millions d’euros pour 18 opérations ;
– Dexia est la seule à n’avoir pas répondu sur ce point.
c) L’apport de liquidité pour refinancer à taux bas les indemnités de remboursement anticipé (IRA) : la SFIL refinance ainsi les IRA à 1 %.
d) Des abandons de créance.
La SFIL a abandonné 1,30 million d’euros en 2013 et 3 millions d’euros en 2014 pour des hôpitaux publics de moins de 250 lits. Les autres banques n’ont pas évoqué d’abandons de créance.
e) Le financement du fonds d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de leurs prêts structurés, mis en place par l’instruction interministérielle du 22 décembre 2014, en contrepartie de la validation par la loi des contrats de prêts.
Malgré les propositions des banques dans une dynamique proactive pour sortir par le haut de situations de blocage, c’est, dans certains cas, la pénalité de remboursement anticipé qui emprisonne les établissements publics concernés et qui a bloqué le processus de désensibilisation.
Les indemnités de sortie sont parfois d’un montant totalement prohibitif. La rapporteure a reçu plusieurs témoignages indiquant que les indemnités de sortie représentaient souvent plus de trois fois le montant du capital emprunté, à l’instar du CHU de Saint-Étienne pour lequel un emprunt structuré de 37,5 millions d’euros s’accompagnait d’une soulte estimée à plus de 100 millions d’euros. De plus, ces indemnités de sortie sont d’un montant très volatil pour l’hôpital du Nord-Essonne par exemple (cf. supra) : l’effet d’un produit structuré indexé sur le franc suisse a conduit la soulte à passer de 21 millions d’euros à 35 millions de fin 2014 à mars 2015 !
Plusieurs personnes auditionnées ont indiqué que, lors de la renégociation de l’emprunt pour sortir d’un emprunt toxique, la banque ne poursuivait pas les discussions car le nouveau prêt devrait être proposé à un taux supérieur au taux de l’usure.
Le cabinet « Finance active » a ainsi témoigné de ce problème complexe au plan juridique car il n’est pas certain que le taux de l’usure soit une notion pertinente pour des relations contractuelles entre professionnels. M. Mathieu Colette a ainsi déclaré : « Les cas que j’évoque, certes pas très nombreux, mais tout de même très problématiques, correspondent à des établissements de santé qui décident de sortir de leur emprunt toxique et qui sont prêts à y consacrer les crédits nécessaires. Ils demandent à la banque, souvent la SFIL, de leur faire une proposition, mais ils se heurtent à un refus parce que le taux de retournement, le taux de sortie, serait supérieur au taux d’usure.
Pourtant, la réglementation actuelle sur l’usure ne s’applique pas forcément entre deux professionnels. Dans notre domaine, les choses devraient donc être clarifiées pour savoir où placer le curseur, afin que ces opérations puissent être réalisées. Sinon, c’est se priver d’une possibilité de sortie : à partir du moment où un établissement décide d’accepter un effort financier pour sortir de l’emprunt qu’il a contracté, cela devrait pouvoir se faire. ».
On peut citer l’exemple de l’hôpital de Roanne qui a consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations les frais financiers au-delà du taux de l’usure (5,29 %), concernant un emprunt structuré géré par la SFIL d’un montant de 9,5 millions d’euros et portant un taux de 12 % en 2014. Le montant consigné en 2014 a été de 670 000 euros.
Interrogé sur ce point, le ministère de la santé a souhaité relativiser l’impact de ce problème. Tout en reconnaissant qu’il y avait bien une incertitude juridique pour savoir si le taux de l’usure s’appliquait aux hôpitaux, il a précisé que dans la pratique, les banques aujourd’hui ne prenaient plus le risque de proposer un taux de refinancement supérieur au taux de l’usure pour éviter tout contentieux ultérieur, les taux proposés étant, alors, écrêtés pour le respecter.
Pour favoriser des relations de confiance entre hôpitaux et établissement bancaires, il serait cependant utile que cette question juridique de l’application aux hôpitaux du taux de l’usure dans leur contrat de prêt de long terme soit éclaircie.
La rapporteure, comme M. Pierre Morange, coprésident de la MECSS, souhaitent que la sortie de crise se fasse dans les délais les plus brefs, de sorte que les établissements de santé retrouvent une capacité d’autofinancement et donc d’investissement en ressources humaines et matérielles au bénéfice des patients. La restructuration de la dette des établissements publics de santé et le rétablissement de l’équilibre des comptes sont des éléments essentiels de la pérennité de notre système de protection sanitaire et sociale. Or, les établissements de crédit connaissent aujourd’hui une situation favorable, puisque les taux pratiqués par la Banque centrale européenne (BCE) sont singulièrement attractifs et que, au sortir de la crise internationale de 2008, ils ont bénéficié d’apports financiers massifs, à tel point que le système bancaire français a pu s’autoriser à absorber une part substantielle de la dette toxique d’un pays ami, la Grèce. À l’époque, la place bancaire s’était vue renflouer par la richesse nationale.
On pourrait donc imaginer que, au-delà de leur tribut au dispositif de soutien – initialement alimenté principalement par la prospérité nationale –, les banques apportent une contribution particulière pour secourir les établissements de santé que les pénalités à payer prévues dans les contrats de prêt empêchent de sortir du piège des emprunts toxiques.
À titre transitoire, avant que le dispositif spécifique ne soit pleinement opérationnel, il serait très utile que les établissements bancaires ne bloquent pas les négociations de désensibilisation en raison de taux d’intérêt qui seraient alors supérieurs au taux de l’usure. Les établissent doivent poursuivre une démarche qui était courante il y a quelques mois, c’est-à-dire écrêter les taux fixes qu’ils proposent au niveau du taux de l’usure et considérer que la priorité est de sortir au plus vite des emprunts toxiques.
La MECSS souhaite donc que les banques renoncent en grande partie à faire payer des pénalités de sortie afin d’accélérer le mouvement de désensibilisation des emprunts toxiques restants.
2. Un dispositif d’accompagnement financier spécifique aux établissements de santé
Pour aider les établissements de santé à se désengager des emprunts structurés, le gouvernement a décidé de créer un dispositif spécifique à ces établissements, dont la mission est centrée sur l’accompagnement des établissements de taille modeste qui disposent de peu de moyens financiers et en compétences techniques pour renégocier des contrats de prêts avec les établissements bancaires. Ce dispositif est dissocié du fonds destiné aux collectivités territoriales.
Cette démarche d’ensemble de désensibilisation a été préconisée par la Cour des comptes dans sa contribution précitée où elle a insisté sur l’importance de la définition de priorités, tous les emprunts structurés ne pouvant être soldés simultanément.
• Le dispositif s’appliquant aux collectivités territoriales
L’article 92 de la Loi de Finances initiale pour 2014 a créé un fonds de soutien, doté de 100 millions d’euros par année pendant quinze ans, afin d’accompagner les communes, les départements, les régions et leurs groupements qui ont souscrit auprès de banques des emprunts structurés devenus « toxiques ».
Le coût pour le budget général est compensé pour moitié par le relèvement du taux de la taxe sur les risques systémiques, porté de 0,5 % à 0,539 % par la même loi de finances. Ainsi, le financement du fonds sera assuré, pour moitié, soit pour 50 millions d’euros, par le secteur bancaire et précisément par une vingtaine d’établissements de crédit situés en France, qui représentent 96 % des exigences en capitaux propres du secteur.
Les aides du fonds prendront la forme d’une subvention annuelle correspondant à une fraction de l’indemnité de remboursement anticipé (IRA).
Le dispositif impose toutefois une contrepartie rigoureuse aux collectivités sollicitant l’aide du fonds en prévoyant que le bénéfice de l’aide au titre d’un contrat de prêt souscrit auprès d’un établissement de crédit est subordonné à la conclusion d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil. Concrètement, une collectivité sollicitant une subvention pour un emprunt structuré devra, pour bénéficier de l’aide, renoncer à contester devant les juridictions civiles les contrats de prêt conclus avec cette banque, dès lors qu’ils font effectivement l’objet du versement d’une aide par le fonds de soutien.
Un plafond de prise en charge par le fonds a également été fixé à 45 % du montant des indemnités pour chaque contrat tandis que les modalités de calcul des aides individuelles ont été renvoyées à un décret, pris après avis du comité d’orientation du fonds.
Il a enfin été prévu un délai de trois ans à compter du dépôt de la demande durant lequel l’aide peut être versée sous forme de simple bonification destinée à alléger la charge financière des collectivités. Cet allongement devait permettre aux collectivités d’attendre des conditions de marché plus favorables pour procéder au remboursement anticipé des emprunts souscrits. Au terme de cette phase initiale, la poursuite du versement de la bonification sera appréciée au cas par cas en fonction des conditions de marché.
• Un dispositif d’accompagnement des hôpitaux élaboré en deux temps
Le 23 avril 2014, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un dispositif ad hoc d’accompagnement des hôpitaux les plus exposés aux emprunts structurés, les emprunts toxiques représentant, pour ces derniers, un encours de 1,1 milliard d’euros, soit 4 % de leur encours total, au 31 décembre 2012. Les indemnités de remboursement anticipé (IRA) correspondant à ces prêts s’élevaient, quant à elles, à 1,4 milliard d’euros.
– Le premier dispositif d’accompagnement
Le montant des aides accordées par ce nouveau dispositif d’accompagnement devrait atteindre 100 millions d’euros, soit un calibrage comparable à celui du fonds de soutien des collectivités territoriales proportionnellement au montant relatif des encours toxiques. La durée du dispositif devait initialement être comprise entre 3 et 7 ans. Ce dispositif était financé par un abondement volontaire des banques les plus concernées – la SFIL et Dexia – à hauteur de 25 millions d’euros et pour les trois autres quarts par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), à hauteur de 75 millions d’euros.
Les aides accordées abonderont le Fonds d’intervention régional (FIR) par des crédits nationaux délégués aux agences régionales de santé (ARS).
L’instruction interministérielle relative au dispositif d’accompagnement des établissements dans la sécurisation de leurs prêts structurés, datée du 22 décembre 2014, précise les conditions d’éligibilité au dispositif ainsi que la procédure d’instruction des demandes d’aides.
Les établissements éligibles au dispositif sont les EPS ayant un budget inférieur à 100 millions d’euros et ayant au moins un contrat de prêt classé hors charte en cours d’amortissement fin 2014.
Les établissements éligibles doivent transmettre un dossier de demande d’aide à l’ARS qui le communiquera à la DGOS accompagné de son avis et d’une analyse financière de la DRFiP avant le 30 avril 2015. La DGOS dispose de 4 mois pour instruire les demandes d’aide et pour proposer un montant d’aide.
Enfin, la doctrine d’attribution sera proche de celle du fonds de soutien aux collectivités territoriales. Un suivi des situations individuelles des hôpitaux et des aides attribuées sera assuré par le COPERMO. Les aides versées seront ciblées sur les établissements les plus exposés, c’est-à-dire des hôpitaux locaux, de petite taille, dont les emprunts risqués forment une part importante de leur encours et pour lesquels les coûts de sortie du prêt sont hors d’atteinte de leur budget. L’attribution des aides sera conditionnée à une transaction globale sur l’ensemble des prêts souscrits et à la renonciation à tout recours contentieux. Le montant des aides versé à chaque établissement sera plafonné à 45 % des IRA, comme pour les collectivités.
– L’élargissement du dispositif
Suite au renchérissement du franc suisse en janvier 2015, la situation de certains hôpitaux s’est considérablement dégradée. Il a donc été décidé d’augmenter la capacité du dispositif dédié aux établissements de santé, en ajoutant 300 millions d’euros sur 10 ans au soutien aux hôpitaux affectés par les emprunts toxiques du fait de l’« envolée » du franc suisse et seront intégralement financés par les banques, par une nouvelle majoration du taux de la taxe de risque systémique payé par celles-ci. Cette aide sera donc financée en dehors de l’ONDAM.
Les surcoûts liés à l’appréciation du franc suisse ont été estimés entre 200 et 400 millions d’euros pour les hôpitaux.
M. Richard Boutet, représentant de la fédération bancaire française, a fait part à la MECSS du mécontentement de la profession bancaire suite à l’annonce du 2e volet du dispositif pour les hôpitaux. Il a ainsi déclaré : « En effet, le 24 février dernier, le Gouvernement a annoncé, sans aucune concertation préalable avec les institutions bancaires, sa décision d’augmenter de 300 millions d’euros les sommes mobilisables au titre des dispositifs d’aide aux hôpitaux ayant contracté des emprunts structurés, cette somme étant intégralement financée par la seule contribution des banques. Cette décision est en totale contradiction, d’une part, avec le fonds de soutien pour les hôpitaux tel qu’il avait été décidé à l’origine, puisqu’il était essentiellement pris en charge par les pouvoirs publics, et, d’autre part, avec le fonds destiné aux collectivités territoriales financé par les banques et l’État à parts égales.
Ce choix de faire porter sur les banques la totalité du financement du relèvement du montant des fonds pour les hôpitaux est donc étonnant et incohérent, sachant que la responsabilité est partagée par les pouvoirs publics et les gestionnaires hospitaliers et les quelques établissements ayant souscrit ces produits. La profession a fait part de ces remarques aux pouvoirs publics. »
Malgré leur opposition de principe au mécanisme de financement du deuxième volet les représentants des banques ont indiqué qu’il conviendrait de connaître au plus vite les modalités concrètes d’instruction des dossiers pour pouvoir accélérer le rythme de sortie des emprunts toxiques.
La rapporteure soutient cette démarche de dispositif spécifique aux hôpitaux mais attire l’attention sur le dimensionnement du deuxième volet du dispositif, consacré aux emprunts indexés sur le franc suisse. La dotation de 300 millions d’euros risque d’être insuffisante et il conviendrait peut-être de revoir la clé de répartition des contributeurs entre la profession bancaire, l’assurance maladie et les hôpitaux, qui seront eux aussi soumis à d’importants efforts financiers pour réussir leur désensibilisation.
Préconisation n° 4 : Sortir des emprunts toxiques en partageant le coût de la désensibilisation entre établissements bancaires et établissements hospitaliers
– Rendre rapidement opérationnels les deux volets du dispositif de désensibilisation des emprunts pour les hôpitaux et trouver un « véhicule législatif » rapide pour permettre la modification du taux de la taxe de risque systémique perçue sur les banques pour le financer.
– Mener, en concertation avec les ARS, un travail de persuasion pour convaincre les directeurs d’établissements hospitaliers de sortir des emprunts structurés car, même si les taux actuels sont faibles, les risques latents demeurent élevés.
– Veiller à l’adoption définitive de l’article 26 bis du projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours de navette parlementaire, qui interdit les emprunts en devises et impose que les emprunts à taux variables répondent à ces critères de simplicité ou de prévisibilité des clauses financières pour les hôpitaux qui les souscrivent, et renvoie la définition de ses conditions d’application à un décret simple.
– Clarifier la question de savoir si les établissements de crédit peuvent opposer ou non le respect du taux de l’usure dans leurs renégociations de prêt. À titre conservatoire, obtenir des établissements bancaires d’écrêter, au niveau du taux de l’usure, les taux d’intérêt fixes qu’ils proposent pour sortir des emprunts toxiques.
– En complément du dispositif de désensibilisation, engager une négociation avec les établissements bancaires, associer le ministère chargé des finances au ministère des affaires sociales, pour que les établissements de crédit renoncent collectivement à la perception de la totalité ou de la majeure partie des indemnités de sortie. Cette renonciation serait négociée au cas par cas et prendrait la forme d’une transaction avec les établissements emprunteurs.
Préconisation n° 5 : Renforcer la communication institutionnelle sur l’assainissement financier des établissements hospitaliers
Renforcer la confiance entre partenaires suppose que les banques aient une claire connaissance de l’ensemble des efforts menés depuis 2012 pour réduire le risque financier du secteur hospitalier. Il convient donc de renforcer la communication institutionnelle du ministère chargé de la santé et du COPERMO pour présenter de manière didactique l’ensemble des dispositions normatives visant à encadrer l’investissement et les mécanismes de financement des hôpitaux.
D. DE MEILLEURES COMPÉTENCES FINANCIÈRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS
Lors de son déplacement à l’École des hautes études en santé publique (EHESP), la rapporteure a pu mesurer les efforts entrepris depuis plusieurs années pour améliorer les compétences financières des élèves directeurs ainsi que dans le cadre de la formation continue. Des progrès pourraient néanmoins être faits pour favoriser les partages d’expérience et inciter à l’accompagnement personnalisé lors de certaines prises de fonctions délicates.
1. Permettre aux hôpitaux de disposer d’une expertise financière indépendante
L’accès à une expertise financière indépendante serait un véritable progrès pour les établissements qui ont pu voir les limites du devoir de conseil des établissements bancaires.
Une première solution consiste à mutualiser les compétences financières pour permettre à de petits établissements de disposer d’une ressource de qualité que chaque établissement ne peut pas recruter. L’idée de favoriser des référents financiers au sein de chaque ARS ne répond pas parfaitement au problème car ces référents seraient à la fois juges et parties dans les décisions d’investissement notamment.
Parmi les établissements qui ont témoigné auprès de la rapporteure de l’importance de pouvoir recourir à une expertise indépendante, le centre hospitalier de Montreuil a dû s’entourer à la sortie de sa période d’administration provisoire des conseils d’un cabinet spécialisé pour mener à bien sa réorganisation et respecter les termes de son contrat de retour à l’équilibre financier.
L’expérience du cabinet Finance active est particulièrement intéressante car elle montre les attentes des établissements hospitaliers, tant publics que privés, en matière d’accompagnement financier. M. Patrice Chatard, son directeur, a d’ailleurs insisté sur le fait que son cabinet, créé en 2000, avait dissuadé les établissements de souscrire des emprunts structurés et que, sur les 15 000 propositions de prêts adressés aux établissements suivis par Finance active, 500 emprunts toxiques avaient cependant été signés. Le travail de pédagogie a permis d’améliorer certaines formules d’indexation ou d’éviter des contrats risqués malgré la pression commerciale des banques et l’encouragement des agences régionales de l’hospitalisation de l’époque.
Actuellement, ce cabinet aide les établissements à se désengager en surveillant les périodes propices pour négocier une sortie. M. Patrice Chatard a ainsi expliqué qu’une équipe de collaborateurs très expérimentés et spécialisés dans la désensibilisation jouait un rôle permanent de « sonar » : « tous les emprunts sont « scannés » en permanence aux conditions des marchés financiers, et sitôt que des fenêtres s’ouvrent, des alertes sont adressées à nos clients et nos consultants. Nous avons d’ailleurs réussi quelques opérations de désensibilisation l’année dernière, à l’occasion de gros mouvements sur le yen. ».
Ce cabinet essaie aussi de diffuser de l’information auprès de ses clients quand une négociation favorable a été conclue. M. Mathieu Colette, responsable des études, a aussi insisté sur l’importance de la mutualisation des informations : « Vous parliez de mutualisation. Une partie du métier de Finance active consiste à essayer de réduire l’asymétrie d’information – nerf de la guerre en économie –, notamment en mutualisant l’information. Quand un de nos clients réussit à réaliser une opération, nous essayons d’en informer les autres, via nos publications, sans forcément nommer l’intéressé. Ensuite, nous suivons les portefeuilles au quotidien et nous envoyons de nombreuses alertes pour que nos clients puissent relancer leur banque, demander des cotations. Cela passe donc par cette mutualisation, même si nous n’allons pas forcément jusqu’à la négociation. ».
L’expérience de la Mission d’appui régional à la tarification à l’activité (MARTAA) a paru aussi très intéressante à la rapporteure car il s’agit là d’une sorte de conseil personnalisé à des conditions moins onéreuses que le recours à un cabinet privé d’expertise.
● Cette mission est née en 2005, à l’occasion de la mise en place de la tarification à l’activité (T2A). À la demande des fédérations hospitalières, l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire voulait en effet que les établissements de santé de son ressort puissent bénéficier de l’appui d’une structure capable de les aider à passer ce cap et à réaliser ce que d’aucuns ont appelé un changement de paradigme.
Initialement localisée au centre hospitalier de Challans (Vendée), la mission fut recentrée en 2007 au CHU de Nantes. Comme établissement de grande taille, il dispose d’une direction du contrôle de gestion dont l’activité permet de réaliser des économies d’échelle grâce à la mutualisation des compétences. Les axes de travail de la mission sont consignés dans un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) entre le CHU et l’ARS, qui lui apporte son soutien financier. La mission ne jouit pas de la personnalité juridique. Son comité de gestion, qui rassemble les fédérations hospitalières et l’ARS des Pays de la Loire, fait le point régulièrement sur ses activités.
La MARTAA est fondée sur quelques principes simples. Elle assure une veille documentaire, économique et technique au profit des établissements de santé. Son site Internet est un lieu d’information et de conseil. Récemment remodelé, il est très consulté, tant au niveau régional que national. La mission apporte des réponses concrètes et immédiates aux demandes des établissements de santé. Ce sont les plus petits qui la sollicitent de préférence, mais une interaction existe aussi avec les établissements plus grands, notamment dans le domaine de la certification des comptes. La mission porte également au niveau national ses travaux en matière de comptabilité analytique.
De manière générale, elle joue un rôle de facilitateur, à l’interface entre l’Agence régionale de santé et les établissements de santé. Jouissant à la fois de la confiance de l’une et des autres, suscitant même leur adhésion, elle réalise un travail que l’Agence régionale de santé n’aurait pu prendre en charge avec ses propres moyens. Elle occupe une position à mi-chemin entre les acteurs de santé et l’autorité de tutelle.
● Le deuxième axe de travail de la Mission a été l’appui aux établissements pour la certification des comptes puis la connaissance du patrimoine hospitalier.
En effet, l’ARS des Pays de la Loire s’est portée volontaire pour être région pilote en matière d’utilisation du logiciel OPHELIE (Outil de pilotage du patrimoine hospitalier des établissements de santé, législation-indicateurs-environnement), outil indispensable à la connaissance du patrimoine hospitalier et de ses coûts. Elle a donc chargé la MARTAA, qui avait déjà mené une mission de conseil sur le logiciel précédent dénommé GENEPI, d’accompagner les établissements de santé pour qu’ils apprennent à maîtriser cet outil. À la fin de 2014, ses bases de données étaient alimentées à 73 % dans la région, contre 16 % au niveau national. La conjonction d’un accompagnement de la MARTAA et de l’incitation de l’ARS a donc fait ses preuves.
L’ARS exige en effet que les 123 établissements de santé de la région, notamment le CHU de Nantes, ne puissent, à partir du 30 juin 2015, déposer de projet d’investissement qu’à la condition d’avoir rempli au moins le premier socle des données dans la base OPHELIE.
● L’accompagnement à la gestion de la dette et de la trésorerie constitue le dernier axe de travail de MARTAA. L’ARS s’est rendu compte que les établissements de santé peinaient à en développer une vision prospective, notamment lorsqu’il s’agissait d’établir les plans globaux de financement pluriannuel.
La gestion de la dette constitue une nouvelle demande formulée, au cours d’une réunion du conseil d’administration, par le directeur régional de la FHF. Il s’agit de connaître la situation réelle dans la région et d’accompagner les établissements de santé qui ont souscrit des emprunts structurés ou toxiques.
Un recensement exhaustif de la dette et de sa structure va être mené auprès des établissements sanitaires comme médico-sociaux. La MARTAA pourra ensuite proposer un plan d’action, préconisant l’institution d’un observatoire régional, d’un espace collaboratif dédié et le développement d’outils d’analyse. Cette mission envisage d’ailleurs de lancer un appel d’offres pour apporter la meilleure expertise aux établissements, dont les plus petits ne sauraient mener un audit externe et sécuriser seuls leurs emprunts.
Enfin, la MARTAA participe au comité de veille des emprunts à risque récemment mis en place par la FHF (Fédération hospitalière de France).
Lors de son audition, le président de la MARTAA a aussi envisagé une évolution de son rôle avec le développement des GHT (groupements hospitaliers de territoires) : « Pour l’avenir, nous réfléchissons à développer une offre de services auprès des GHT, en chiffrant à l’appui les gains d’opportunité à en attendre. Cette offre pourrait couvrir les systèmes d’information, la logistique, l’administration, la gestion financière, dont la dette… Nous devrions pouvoir présenter, pour chacun de ces domaines, un bilan coûts-avantages d’une mutualisation qui fasse l’économie d’un recours à un cabinet d’audit externe. La CHT44, communauté hospitalière de territoire de Loire-Atlantique, a ainsi déjà mandaté le groupement de coopération sanitaire (GCS) e-Santé pour développer un plan d’informatisation unique pour le futur GHT. ».
Il a aussi estimé que l’expérience de la MARTAA pourrait être étendue à dans d’autres Régions : « En tout état de cause, la MARTAA peut être dupliquée dans d’autres régions. La mutualisation d’activités logistiques, administratives, comptables et de ressources humaines mériterait d’être aussi expérimentée. ».
Un des aspects très positif de l’intervention de la mission MARTAA est d’inciter les établissements à avoir une démarche d’analyse de leur activité et de mesure objective de leurs forces et de leurs faiblesses.
La rapporteure estime qu’il faudrait valoriser et mieux faire connaître des logiciels d’aide à la décision tels que OPHELIE pour répertorier le patrimoine immobilier ou Ælipce et Hospi Diag pour disposer d’outils permettant de comparer les performances et de simuler les conséquences de réorganisation ou de nouveaux investissements. Elle se félicite que les données d’Hospi Diag soient depuis juillet 2014 accessibles sur la plateforme Etalab, elle-même hébergée sur le site : www.data.gouv.fr.
De nouveaux outils au service de la performance des établissements :
le Logiciel Ælipce
Conçu avec l’aide des ARS de Bretagne et d’Aquitaine, d’une cinquantaine de professionnels – cadres de santé, médecins, directeurs, ingénieurs, DIM (directeur de l’information médicale), cadres gestionnaires, contrôleurs de gestion – et testé dans une quinzaine d’établissements tant publics que privés de toutes tailles, l’outil Ælipce est un logiciel d’aide à la décision pour l’amélioration de la performance des organisations à destination des établissements de santé publics et privés, des ARS et des chefs de pôles. Il permet de modéliser l’activité de soins : activité clinique et plateau techniques (RUM, DMS, capacitaire, ressources humaines…), de tester des hypothèses d’organisation et d’en évaluer les conséquences en termes de capacité, de ressources humaines (personnel soignant), de recettes, de dimensionnement en surface et économique.
L’outil comprend plusieurs modules permettant de :
– modéliser l’activité clinique et le plateau technique : bloc opératoire, imagerie, laboratoires, consultations externes et explorations fonctionnelles ;
– prévoir le dimensionnement en surface d’un projet d’investissement, évaluer le coût d’investissement, d’exploitation et de maintenance d’un projet avec le calcul du temps de retour à l’équilibre du projet.
Cet outil est composé de 3 modules indépendants accessibles via internet :
En juillet 2013, une journée de lancement de l’accompagnement Ælipce s’est tenue au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille avec une présentation notamment de la démarche et du dispositif d’accompagnement proposé en régions, auprès des responsables de pôles, auprès des professionnels en charge d’un projet de réorganisation et de leurs équipes (3 personnes désignées par établissement). À l’issue de la première vague d’appel à candidatures, 77 établissements publics et privés et ARS ont candidaté pour un accompagnement qui a débuté en décembre 2013. Lors du premier semestre 2014, un nouvel appel à candidatures a été lancé via le site internet de l’agence de l’ANAP. Chaque établissement candidat doit définir un projet d’investissement ou de réorganisation sur lequel il testera l’apport de ce logiciel.
Le logiciel Hospi Diag
Hospi Diag est un outil d’aide à la décision, lancé en 2011, permettant de mesurer la performance d’un établissement de santé qui pratique de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique (MCO), en comparaison avec d’autres établissements de santé. Il permet à chaque établissement d’identifier ses forces et ses faiblesses et donc les gisements de performance dans 5 domaines : qualité des soins, pratiques professionnelles, organisation des soins, ressources humaines et finances.
Porté par l’ANAP, Hospi Diag résulte d’un accord de 41 experts métiers et de 5 institutions (ANAP, DGOS, HAS, IGAS, ATIH (16)).
Hospi Diag permet de :
– mieux se connaître (69 indicateurs et une carte d’identité de 80 données), avec la possibilité d’accéder à des informations triées issues du croisement de 12 bases de données nationales (PMSI, SAE…) ;
– mieux se comparer (avec une base de 1 350 établissements de MCO). Chaque établissement est comparé avec les établissements de sa région, les établissements de même profil d’activité (typologies nationales) et les établissements de même catégorie. L’outil mesure la performance de 1 350 établissements à partir de 69 indicateurs en comparant chacun d’entre eux avec les 20 % les plus performants et les 20 % les moins performants sur trois niveaux (région, catégorie juridique et typologie nationale) ;
– mieux dialoguer en interne et avec les ARS, en soutien d’un dialogue interne entre les directeurs, médecins et soignants dans le cadre d’une aide au pilotage interne et d’un positionnement stratégique, et en soutien du dialogue des établissements avec les ARS. Son utilisation est notamment préconisée pour l’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre ARS et établissements, pour le bilan social.
Indicateur de performance – Volet financier
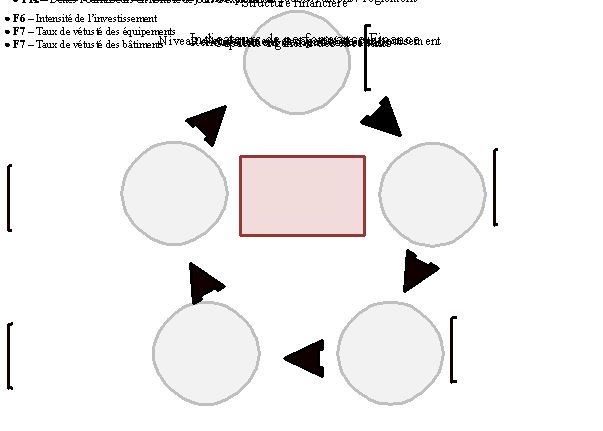
Source : ANAP – logiciel Hospi Diag.
Préconisation n° 6 : Développer une expertise financière mutualisée
Favoriser le développement d’une expertise financière mutualisée, dans le sens de ce qu’a réalisé la mission MARTAA en région Pays-de-la-Loire, afin que les établissements de santé disposent d’une expertise indépendante capable de les appuyer dans différents aspects de leur gestion et de contribuer notamment à la diffusion d’outils de gestion comme les logiciels Ælipce ou Hospi Diag, conçus en tenant compte des contraintes spécifiques du service public hospitalier.
Cette expertise pourrait s’appuyer sur les ARS, sur l’Agence nationale compétente, ou, dans l’attente, sur des structures plus empiriques, telles que la mission MARTAA.
2. Améliorer encore la formation des cadres dirigeants des centres hospitaliers et des ARS en matière de gestion financière
De nombreuses personnes auditionnées ont fait part de la bonne qualité de la formation reçue dans le cadre de l’École des hautes études en Santé publique (EHESP) qui a été d’ailleurs assez profondément remaniée après la révélation de la crise des emprunts toxiques.
Mme Danielle Toupiller, directrice du Centre national de gestion (CNG), a ainsi expliqué que l’EHESP avait renforcé ses formations financières sous trois aspects :
« Dans le cadre de la formation initiale, l’EHESP forme chaque année une cinquantaine de directeurs d’hôpital, contre une centaine historiquement. Le nombre de places au concours a été diminué mais il va de nouveau augmenter à nouveau compte tenu de l’évolution démographique du corps. Les lauréats du concours sont issus, à plus de 70 %, des instituts d’études politiques ou de cycles complémentaires en droit. Peu d’entre eux sont donc économistes ou formés aux stratégies financières. Les élèves directeurs d’hôpital suivent une formation à caractère polyvalent complétée par des modules de spécialisation. L’un de ces modules porte sur l’analyse et le pilotage financiers, sur la gestion des risques dans les projets d’investissement, sur la négociation et la gestion de la dette, ainsi que sur certains éléments de mathématiques financières. Il est suivi notamment par les élèves qui ont vocation à occuper, à la sortie de l’école, des postes de direction dans les services chargés de la stratégie économique et financière, des investissements et du contrôle de gestion. L’EHESP a plus particulièrement mis l’accent sur ce module à partir de 2010 et 2011.
Depuis quelques années – tel n’était pas le cas auparavant –, l’EHESP forme également les attachés d’administration hospitalière. Ceux-ci sont les premiers collaborateurs des directeurs, auxquels ils apportent leur expertise technique dans différents domaines, notamment financier. Ils ont une formation de très bon niveau et suivent, eux aussi, un module de spécialisation en matière de gestion financière des établissements.
Des efforts ont aussi été faits pour améliorer la formation continue : l’institut du management de l’EHESP a développé deux programmes de formation continue à la demande du ministère de la santé, en lien avec le CNG. Il propose, d’une part, un cycle qui aboutit à la délivrance du diplôme de « gestion financière d’un établissement de santé ». Celui-ci s’adresse à des profils pluridisciplinaires, non seulement aux directeurs d’hôpital, mais aussi aux médecins – notamment aux médecins directeurs de l’information médicale, qui sont de véritables « capteurs » d’informations utiles à l’analyse financière et à la stratégie –, aux attachés d’administration hospitalière, aux contrôleurs de gestion des établissements hospitaliers et aux cadres des services centraux et déconcentrés de l’État. Les programmes de formation continue de l’EHESP présentent l’intérêt d’être suivis à la fois par des cadres supérieurs et intermédiaires de la fonction publique hospitalière et par des agents appelés à rejoindre les agences régionales de santé (ARS) ou leurs délégations territoriales. Ces deux catégories de professionnels y apprennent les mêmes références, partagent les mêmes expériences et travaillent sur les mêmes cas concrets.
L’institut du management de l’EHESP propose, aussi un module spécialisé portant sur le diagnostic financier appliqué, sur le financement des investissements, ainsi que sur la gestion de la trésorerie et de la dette. Les programmes de formation continue n’ont, bien sûr, pas de caractère obligatoire : ils sont suivis par des agents déjà en fonction, sur la base du volontariat, dans le cadre du plan de formation de chaque établissement. »
Déplacement à l’École des hautes études en santé publique
Lors d’un déplacement de la rapporteure à l’École des hautes études en santé publique (EHESP), son directeur, M. Laurent Chambaud, a souligné que la formation « socle » en matière financière des élèves directeurs d’hôpitaux était très complète car elle représentait 103 heures sur un volume total d’enseignement de 602 heures. La spécialisation financière permet d’ajouter 190 heures d’enseignement supplémentaires pour ceux qui choisissent cette orientation. Cette formation concerne la comptabilité mais aussi la stratégie financière, l’élaboration et la gestion d’un budget avec la T2A, le contrôle de gestion et la mise en place d’un financement pluriannuel.
De même, une formation à la gouvernance de la gestion hospitalière vient d’être mise en place pour les receveurs hospitaliers au moment de leur prise de poste.
M. Laurent Chambaud a indiqué que la formation des agents de l’État, notamment au sein des agences régionales de santé, était particulièrement cruciale et devait être développée, et ce d’autant plus que selon la taille de ces agences, le nombre de personnes chargées des questions financières était variable et qu’il n’y avait pas toujours des services spécifiques pour suivre les projets d’investissements.
De même, une formation pourrait utilement être mise en place pour les membres des conseils de surveillance des hôpitaux, afin de leur permettre de savoir analyser un compte financier.
Par ailleurs, il a considéré que la formation continue devait être développée afin d’accompagner les changements de poste, particulièrement lorsqu’ils concernaient des domaines aussi techniques que les questions financières.
En effet, depuis la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, une formation est obligatoire pour les directeurs d’hôpitaux qui deviennent chef d’établissement. En revanche, pour les directeurs qui changent de poste, passant par exemple des ressources humaines aux affaires financières, la formation repose sur le volontariat. Le développement du caractère systématique de la formation continue pour ces changements de poste serait donc une piste de réforme.
Au-delà, depuis 2012, l’EHESP organise chaque année un colloque national avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels du groupe Crédit Mutuel. La troisième édition de ce colloque, qui s’est déroulée le 27 juin 2014, a porté sur les stratégies de financement des investissements dans les établissements publics de santé et sur les incidences de la certification des comptes hospitaliers.
Des progrès restent cependant à faire notamment pour former les ex-inspecteurs des DDASS et des DRASS (anciennes directions respectivement départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales) qui exercent aujourd’hui des fonctions de tutelle financière dans les ARS alors que leur niveau de technicité financière est encore perfectible. M. Jean Yves Grall, directeur général de l’ARS Nord-Pas-de-Calais et président du Collège des directeurs d’ARS a insisté sur cet aspect en indiquant que les ARS manquaient de compétences « pointues » en gestion financière. Il a fait part des difficultés de recrutement de tels profils et de la nécessité d’approfondir la technicité des agents chargés d’instruire les dossiers d’investissement.
Il conviendrait aussi de veiller à la diversification des élèves passant le concours de directeurs d’hôpitaux pour attirer des profils issus d’école de commerce ou ayant des compétences dans les techniques quantitatives de gestion. Mme Danielle Toupillier a d’ailleurs précisé lors de son audition devant la MECSS : « Avec le ministère de la santé et l’EHESP, nous cherchons actuellement à diversifier les parcours. C’est pourquoi nous allons ouvrir, à partir de 2015, un troisième concours, en plus des concours interne et externe. »
Préconisation n° 7 : Diversifier le recrutement des directeurs d’hôpitaux
Faire évoluer le concours externe de recrutement des directeurs d’hôpitaux pour attirer des profils formés aux techniques de gestion.
Préconisation n° 8 : Renforcer les compétences en gestion financière
Renforcer la formation en techniques de gestion et culture financière des cadres des ARS appelés à instruire les dossiers de financement des investissements ou à exercer la tutelle financière sur les centres hospitaliers.
Pour parvenir à des formations plus en prise avec les problématiques financières actuelles, il pourrait être envisagé de renforcer la coopération entre le CNG et l’EHESP pour former de manière ciblée aux problématiques financières, y compris les cadres des établissements médico-sociaux.
Interrogée sur ce point, Mme Danielle Toupillet a répondu que cette préconisation pourrait tout à fait être retenue. Elle a précisé : « Le décret du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du CNG prévoit, dans son article 2, que le CNG peut définir des actions de formation au profit des praticiens hospitaliers, des directeurs d’hôpital, des D3S et des directeurs des soins. À ce jour, cette compétence n’a jamais été utilisée. À la lumière des conseils que pourrait formuler la MECSS à l’issue de ses auditions, le CNG pourrait, le cas échéant, définir des actions de formation dans le cadre de son partenariat avec l’EHESP – la convention en cours pourrait être complétée à cette fin – et en lien avec la DGOS et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Ainsi, ces programmes pourraient s’adresser d’abord aux hôpitaux, puis être étendus, dans un deuxième temps, aux quelque 1 800 établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la DGCS. Si ces derniers ont une surface financière moindre que les hôpitaux, ils sont très proches des collectivités territoriales, lesquelles ont été elles-mêmes très affectées par les emprunts toxiques. ».
Au cours de la deuxième audition des établissements bancaires, a été évoquée l’idée de la participation des banques à des modules de formation sur l’ingénierie financière pour les directeurs d’hôpitaux.
En réponse, M. Richard Boutet, parlant au nom de la profession bancaire, a précisé : « La Fédération bancaire française n’a pas mis au point de module de formation à proprement parler, mais l’information des entreprises publiques et privées à ce sujet, sur papier et par le biais d’internet, est l’une de nos priorités. Nous pourrions travailler avec vous à une action visant plus particulièrement les établissements de santé. »
Pour améliorer la réactivité des équipes de direction et faire évoluer les techniques de gestion selon les nouvelles problématiques, notamment celle des nouveaux produits financiers, on peut aussi penser au développement de groupes de travail entre pairs pour échanger des expériences.
Mme Danielle Toupillier a indiqué lors de son audition que le CNG avait pour objectif de développer cette forme de formation continue et d’échanges sur les bonnes pratiques : « le CNG a mis en place des ateliers de co-développement, pratique qui s’est beaucoup développée au Canada il y a une quinzaine d’années. Il s’agit d’échanges d’expérience entre pairs, en petit groupe, à propos de situations imaginées ou vécues. Certains ont été confrontés, par exemple, à des situations financières très tendues ou à des plans de retour à l’équilibre qui les ont particulièrement perturbés. Ce dispositif d’accompagnement professionnel permet aux participants de réaliser des progrès très sensibles. Nous avons actuellement plusieurs ateliers très actifs, qui impliquent notamment des D3S, lesquels sont souvent les plus isolés dans l’exercice de leurs fonctions. Nous avons l’intention de poursuivre et d’intensifier ce programme, le cas échéant en partenariat avec l’EHESP et en lien avec la DGOS et la DGCS. »
Plusieurs personnes rencontrées lors des déplacements de la rapporteure lui ont fait part de la nécessité de développer des formes de coaching personnalisé notamment pour les directeurs qui changent de fonction pour passer d’une direction des Ressources humaines à celle des affaires financières ou qui reprennent une direction de plein exercice dans un établissement en grave difficulté financière ou à l’issue d’une période d’administration provisoire.
Le CNG développe aussi des formes de coaching ou d’accompagnement collectif. Il s’agit parfois d’aider à implanter de nouvelles techniques de travail ou parfois d’un accompagnement plus psychologique pour aider à la conduite du changement.
Le CNG développe ainsi des projets pilotes stratégiques avec les ARS, comme avec l’ARS de Rhône-Alpes, et la branche régionale de la Fédération hospitalière de France et six établissements expérimentateurs de la région afin de mettre en place un système d’échange d’informations sur les temps médicaux. L’objectif est d’avoir une image complète des temps médicaux à l’hôpital public, en faisant remonter au niveau national les données concernant les praticiens contractuels gérés au niveau de chaque établissement. Ceux-ci représentent environ 30 % des praticiens hospitaliers. L’objectif est ainsi d’évaluer les postes vacants et de mieux cerner les contraintes d’organisation pour essayer de mieux coordonner les plannings infirmiers et ceux des praticiens. Le même travail sera fait ensuite pour les équipes de direction.
Le CNG va développer, à partir de cette année, des programmes d’accompagnement collectif dans un ou deux CHU volontaires. Il s’agira d’accompagner une équipe entière de direction ou de praticiens hospitaliers, en matière de management et de conduite du changement, ou pour développer certaines compétences spécifiques.
Préconisation n° 9 : renforcer la formation continue et le partage d’expérience entre pairs
Renforcer l’offre de formation continue en matière financière pour les directeurs hospitaliers, cadres des ARS en privilégiant une approche pratique. Encourager une nouvelle coopération entre le CNG et l’EHESP pour mettre en place des formations en ce sens, et développer la mise en place de groupe de travail pour promouvoir le partage de bonnes pratiques entre pairs.
Préconisation n° 10 : anticiper les recrutements de directeurs d’hôpitaux et développer le coaching
Développer la pratique du coaching individuel notamment pour les prises de fonction les plus délicates pour les directeurs. Mieux anticiper certains recrutements notamment à l’issue des périodes d’administration provisoire pour susciter des candidatures avec l’assurance que le candidat retenu sera accompagné par un coach ou des référents expérimentés.
E. REVOIR CERTAINS MÉCANISMES FINANCIERS POUR POURSUIVRE L’EFFORT D’INVESTISSEMENT
L’application de la tarification à l’activité semble parfois rendre plus difficile le financement régulier des investissements.
Ces conséquences négatives avaient déjà été signalées par la mission commune IGAS/IGF dans son rapport de mars 2013 (17) : « La mission a pu démontrer que les coûts d’investissements ne sont pas intégralement inclus dans les tarifs et que cette inclusion est purement théorique. Au demeurant, la régulation prix/volume, aboutissant à la fixation du niveau des tarifs, ne permet pas de prendre en compte le niveau des charges. Plus préoccupant, la mission a mis en évidence un décrochage entre les tarifs et la couverture des charges, qui menace la situation financière des établissements… Au final, les tarifs couvrent l’investissement courant et n’ont couvert que partiellement, étant donné le faible niveau des marges brutes passées, les charges d’investissements immobiliers lourds. Les opérations immobilières lourdes relevant de la recomposition de l’offre de soins peuvent donc justifier un financement par dotations ou subventions ».
La rapporteure tient à témoigner que, dans certains établissements, notamment ceux où elle s’est rendue, les tarifs actuels ne permettent même pas de financer les investissements de renouvellement, la situation de certains établissements étant encore plus grave que celle analysée par la mission commune précitée.
1. Des modifications importantes dans la T2A (tarification à l’activité)
L’application combinée de la tarification à l’activité et une gestion rigoureuse de l’ONDAM hospitalier conduisent à compromettre le financement des investissements, notamment pour le renouvellement du matériel. En effet comme l’ont souligné plusieurs personnes auditionnées, dont M. Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, il est très difficile pour les hôpitaux de dégager une capacité d’autofinancement : « Il est d’autant plus difficile de dégager une capacité d’autofinancement qu’il nous est demandé de réaliser un effort de productivité de 3 % par an, ce qui est considérable : peu d’acteurs économiques sont soumis à de telles exigences. Nous devons en effet couvrir nos charges avec des recettes de plus en plus contraintes, compte tenu de la diminution des tarifs. ».
M. Éric-Alban Giroux, directeur d’hôpital et représentant l’Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens (UFMICT-CGT), a aussi donné à la MECSS une explication très imagée du mécanisme : « dans le mécanisme de la T2A, on prend par exemple comme année de référence l’année 2014 et l’on dit que la Nation autorise la réalisation de dix prothèses de hanche payées chacune 10 euros. L’ONDAM hospitalier pour l’année 2014 pour les prothèses de hanche est donc de 100 euros et on n’a pas en principe le droit de le dépasser. Mais à la fin de l’année, s’il s’avère que l’on a fait non pas dix mais douze prothèses de hanche, on a donc dépassé l’ONDAM de vingt euros. Premier mécanisme : en 2015, on réduit la valeur de l’opération pour la prothèse de hanche de dix euros à huit euros, c’est-à-dire que l’on diminue le prix de l’unité pour conserver un volume d’ONDAM inchangé.
Deuxième mécanisme : on demande de rendre les deux euros dépensés en plus. Cet effet prix-volume, qui était un système de régulation de l’ONDAM, n’est pas lié à une attractivité, qui serait magique, des dirigeants hospitaliers mais à l’augmentation des besoins de populations qui sont venues massivement et de plus en plus vers les structures d’urgence. Cet effet prix-volume a fait chuter complètement nos bases de calcul de retour sur investissement. Pour notre part, nous avions prévu les augmentations de populations, mais l’ONDAM n’a pas été relevé en conséquence. »
Pour M. Daniel le Ray, coordinateur de la MARTAA, la question du financement se pose en effet surtout pour les établissements de taille petite et moyenne, notamment pour ceux qui vont bientôt passer à la tarification à l’activité (T2A). Il a cependant noté un facteur d’optimisme : « Le modèle T2A-SSR (18) serait cependant plus favorable aux établissements que le modèle T2A retenu pour le secteur MCO. Grâce à la notion de socle, les charges fixes pourraient être prises en compte dans la tarification, par exemple les charges d’emprunt. Cela représenterait un progrès par rapport à l’actuelle facturation selon les groupes homogènes de séjour (GHS), en permettant une meilleure prise en compte de la notion d’investissement. Encore faut-il espérer que la grille tarifaire soit plus stable pour la T2A-SSR que pour la T2A-MCO. Adoptée il y a dix ans, cette dernière a connu depuis cette date non moins de vingt versions différentes. »
La rapporteure tient à souligner que certaines règles de tarification devraient être modifiées comme l’a suggéré M. Jacques Grolier, maître de conférences hors classe à la Faculté des sciences économiques de l’Université de Rennes 1 et fondateur du master d’économie et de gestion des établissements sanitaires et sociaux (EGESS). Dans la contribution écrite qu’il a bien voulu lui faire parvenir, il insiste sur la nécessité de renforcer la capacité d’autofinancement des établissements et sur l’importance des dotations aux amortissements.
Il a ainsi estimé que : « … il convient que les dotations aux amortissements soient prises en compte dans les tarifs, ce qui devrait en toute rigueur être le cas puisque nous sommes bien là en présence d’une composante des coûts. Dans la facture que me présente mon plombier, il y a les pièces et la main‐d’œuvre, mais il y a aussi une petite quote‐part du prix d’achat du véhicule qu’il a utilisé pour se rendre à mon domicile. De la même façon, un tarif de GHS devrait prendre en compte, au‐delà du temps du personnel soignant et des médicaments, une quote‐part des équipements et bâtiments utilisés dans le cadre de l’hospitalisation : c’est le rôle des dotations aux amortissements. Mais les tarifs T2A n’intègrent pas la prise en compte des dotations aux amortissements, restreignant par là même la capacité d’autofinancement. »
Selon lui, ce mécanisme est aggravé par la répartition actuelle de l’ONDAM. Le terme de « tarification à l’activité » est un trompe l’œil qui cache la réalité d’un ONDAM limitatif. Le financement des établissements de santé correspond à une dotation globale au niveau macroéconomique, dotation répartie proportionnellement à l’activité au niveau microéconomique.
« Les tarifs des GHS se sont progressivement éloignés des coûts et ils ne favorisent pas le dégagement de marges brutes d’autofinancement, donc de couverture des investissements. De plus, leurs variations fréquentes suscitent des difficultés prévisionnelles fortes. »
M. Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, a lui aussi insisté sur l’importance de la visibilité et sur la stabilité des règles du jeu pour financer l’offre de soins. Il a rappelé que les recettes dépendaient de l’activité et relevaient donc de la responsabilité du gestionnaire de l’hôpital, mais que ces recettes étaient « écornées par des baisses de tarifs ». Tout en reconnaissant que certaines baisses de tarifs poussaient l’AP-HP à la vertu, à l’instar du développement de la chirurgie ambulatoire, il a déploré que « …d’autres baisses de tarif sont décidées pour des raisons d’opportunité. Nous les subissons parfois de plein fouet, car nous y sommes particulièrement sensibles compte tenu de notre taille et de l’importance de nos missions sociales : plus que les autres établissements, nous recevons de nombreux patients précaires ou bénéficiant de l’aide médicale de l’État (AME). Lorsque ces missions sont moins bien prises en compte dans les tarifs, les effets induits se chiffrent en millions, voire en dizaines de millions d’euros, ce qui a un impact très fort sur notre capacité à agir et à investir. »
Il a ajouté que la problématique de la dette devait être appréhendée de « manière contractuelle » :
« Or, au cours des dernières années, nous avons constaté un écart de plus de deux points entre l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) voté par le Parlement et celle de l’enveloppe qui nous est attribuée au titre des MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation) – celle-ci a même parfois diminué. Nous comprenons, bien sûr, les mécanismes de rebasage et de comparaison qui peuvent conduire à un tel décrochage, mais le développement de nos missions est rarement pris en compte. Je plaide donc pour que nous bénéficiions d’une visibilité en la matière : en face de notre engagement en termes d’efforts doit être affiché un engagement en termes d’accompagnement.
Le troisième pilier du contrat doit être l’accompagnement de nos investissements, qui est indispensable pour que nous puissions élaborer et mener à bien nos opérations. »
Il a aussi fait part de sa crainte de voir l’hôpital public se faire distancer par l’offre privée qui sait montrer son attractivité : « … lorsque les établissements privés font de la publicité en présentant les robots qu’ils achètent pour 3 millions d’euros, ainsi que vous avez pu le voir hier dans Le Parisien, ils attirent les praticiens hospitaliers. Nous risquons d’assister à un « débobinage » de l’hôpital public si nous ne faisons pas en sorte qu’il puisse continuer à investir dans des conditions soutenables. »
Le caractère spécifique des petits établissements dits de « proximité » ou dans des zones en déprise démographique doit par ailleurs être mieux pris en compte. M. Yves Gaubert, représentant de la Fédération hospitalière de France, a bien analysé la situation en soulignant que : « La faiblesse des capacités d’autofinancement constitue un véritable handicap dont l’explication se trouve dans l’application du système de tarification à l’activité (T2A) fondé essentiellement sur le volume des actes. Dans ce cadre, les établissements qui se situent dans des zones à faible croissance démographique ne parviennent pas à générer l’activité minimale permettant de leur allouer des ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins de financement. ».
Préconisation n° 11 : Clarifier et stabiliser les règles de la tarification à l’activité :
– Accélérer les travaux en cours sur la réforme de la T2A pour clarifier le devenir de cette tarification et lui faire gagner en stabilité, des décisions d’investissement de long terme ne pouvant être prises sur la base de règles tarifaires changeantes. Les tarifs doivent par ailleurs intégrer le financement de la dotation aux amortissements.
– Pour acter cet objectif de stabilité, la démarche contractuelle doit être renforcée : en contrepartie d’engagements sur des objectifs de productivité ou d’amélioration de l’offre de soins, les hôpitaux doivent disposer d’une visibilité au moins de trois ans sur les aides à l’investissement dont ils peuvent effectivement bénéficier.
– Poursuivre dans la voie engagée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui a modifié le financement des hôpitaux de proximité. L’article 52 de cette loi prévoit de faire bénéficier les « établissements de proximité » d’un financement mixte, associant tarifs nationaux de prestations et dotations forfaitaires pour les activités de médecine. La spécificité des petits établissements contribuant à l’aménagement du territoire doit être réaffirmée et leur mode de financement doit être adapté.
2. Faut-il dissocier le financement des investissements immobiliers et des équipements médicaux ?
Plusieurs des personnes auditionnées ont estimé qu’il faudrait prévoir des modalités spécifiques pour les grands projets immobiliers alors que l’équipement lourd bio-médical pourrait être financé différemment.
Cette question est particulièrement complexe et la rapporteure tient surtout à engager le débat sans pouvoir apporter de solutions toutes faites.
M. Éric-Alban Giroux, représentant l’Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens (UFMICT-CGT), a ainsi rappelé : « Du temps de la dotation globale hospitalière, la part liée aux investissements « exceptionnels », c’est-à-dire les investissements de renouvellement des parties immobilières, n’était pas prévue. Avec la T2A, c’est exactement la même chose. Dans la construction initiale de la T2A, les tarifs n’intégraient pas la part liée aux investissements qui devaient être négociés dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Il devait s’agir de nouvelles dotations exclues des tarifs. Aujourd’hui, le système nous demande de dégager des marges permettant de réaliser nos investissements. Mais ces marges n’ont jamais été intégrées aux tarifs. On est donc face à un système qui se “mord la queue”. »
Un consensus s’est dégagé pour constater que les règles actuelles de la tarification à l’activité ne permettaient pas de dégager de marges de manœuvre financières suffisantes pour l’investissement.
La Fédération hospitalière de France préconise en conséquence de déconnecter au moins le financement des investissements lourds du modèle de la tarification T2A qui dépend trop aujourd’hui du volume d’activité alors que, dans certains territoires, il est indispensable de maintenir une offre de soins même si le dynamisme démographique ne permet pas d’engranger les recettes nécessaires.
Certains ont fait valoir que l’hôpital public pourrait s’inspirer de certaines méthodes de gestion de l’hospitalisation privée à but lucratif qui a opéré ces dernières années un fort mouvement de concentration et surtout une dissociation entre les gestionnaires de l’activité médicale et les propriétaires de l’immobilier qui, via des sociétés civiles immobilières, sont désormais responsables de l’entretien du bâti, qu’ils mettent à disposition des équipes soignantes en contrepartie du paiement d’un loyer.
Ce modèle économique ne semble cependant pas facilement transposable au secteur public.
M. Jacques Grolier, expert précité, a ainsi, pour sa part, considéré, en réponse aux questions de la rapporteure, que la dissociation entre gestion médicale et gestion de l’immobilier risquait de démobiliser les équipes médicales qui ne peuvent se désintéresser des contraintes de l’immobilier en termes d’organisation. « L’évolution constante des pratiques hospitalières semble nécessiter une naturelle fusion entre l’exploitation et l’investissement : la dilution, voire la dissolution de responsabilités résultant de la coexistence de deux organismes complémentaires serait, à mon avis, préjudiciable à une bonne prestation de service public. Concernant les établissements privés, la lecture peut être différente. La stratégie d’externalisation de l’investissement permet en effet de dégager des liquidités favorisant l’acquisition de groupes concurrents. Mais cette politique conduit à générer des charges fixes de loyer importantes et elle limite l’indépendance et la flexibilité organisationnelles. »
Le recours au « Partenariat Public-Privé » ainsi qu’au crédit-bail (sauf pour ce qui concerne le crédit-bail concernant les équipements à renouveler plus rapidement que de besoin sanitaire, pour des motifs de recherche, par exemple) présente par ailleurs de sérieux inconvénients.
Ces modes de financement interdisent en effet tout amortissement, alors que les dotations aux amortissements constituent la source essentielle de l’autofinancement. Se couper de cette source signifie, à terme, s’interdire toute possibilité d’investissement. Les méthodes de financement hors bilan sacrifient effectivement les finances futures à long terme à un présent budgétaire contraint : remplacer une dépense immédiate d’investissement, certes importante, par des loyers futurs apparemment moins contraignants, peut paraître attrayant, mais cela favorise un engagement de l’investisseur au-delà de sa capacité réelle de financement et limite considérablement ses décisions futures.
Les gestionnaires d’établissement doivent néanmoins disposer d’une panoplie diversifiée d’outils financiers. Or, pour éviter certains mécanismes risqués, les pouvoirs publics sont allés trop loin dans la restriction des initiatives financières des gestionnaires hospitaliers.
L’article 34 de la loi n° 2004-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 avait interdit aux hôpitaux et aux structures de coopération sanitaires, certains contrats, au 1er janvier 2015, comme les contrats de partenariat public-privé, les autorisations d’occupation temporaire, les baux emphytéotiques et les contrats de crédit-bail.
Lors de ses déplacements, la rapporteure a reçu le témoignage de plusieurs médecins exprimant leur inquiétude suite aux décisions restrictives relatives au crédit-bail. Le responsable du Pôle Imagerie de l’hôpital à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a ainsi expliqué combien l’obsolescence des appareils d’IRM et de scanner était préoccupante dans un contexte de concurrence très vive entre le public et le privé pour les actes de radiologie et les explorations fonctionnelles. Il a indiqué que la France gagnerait à s’inspirer de modèles étrangers où les établissements de santé peuvent faire financer par certains industriels en matériel bio-médical les investissements préalables à l’installation d’un scanner ou d’une IRM dans des services hospitaliers publics. Il est fréquent, en Allemagne par exemple, que les sociétés mettent à disposition des hôpitaux des matériels de pointe, l’hôpital payant une redevance qui comprend un loyer et une sorte de forfait pour l’entretien et l’assistance en cas de dysfonctionnements.
Un amendement gouvernemental au projet de loi de modernisation de notre système de santé a proposé de revenir sur les aspects les plus rigoureux de cette restriction. Le crédit-bail pour les équipements et les autorisations d’occupation temporaire du domaine public devrait ainsi redevenir possible, s’agissant des établissements soumis au code de la santé publique, dans les conditions qui prévalaient antérieurement, permettant la poursuite de leur utilisation.
La rapporteure se félicite à cet égard que les établissements aient de nouveau la possibilité de recourir au crédit-bail pour procéder à des acquisitions de matériel lourd comme les appareils d’imagerie.
La rapporteure tient enfin à évoquer un thème complexe qui a été évoqué à de multiples reprises lors de ses déplacements. Certains établissements sont dans l’incapacité de faire face aux investissements nécessaires pour respecter les normes en matière d’incendie ou de sécurité pour les immeubles de grande hauteur. L’AP-HM est ainsi contrainte, à Marseille, de laisser ouverts deux établissements très importants qui ne répondent plus aux normes de sécurité. Cette situation est préoccupante en termes de responsabilité car, en cas d’incident, la responsabilité pénale des directeurs serait engagée, mais de manière plus générale, il conviendrait de mener une réflexion sur la définition de ces normes de sécurité incendie et sur les installations électriques. Comment sont-elles fixées ? Comment peuvent-elles s’appliquer indifféremment à des bâtiments neufs mais aussi à des bâtiments plus anciens dans lesquels cette mise aux normes entraîne parfois des travaux surdimensionnés au regard de la durée de vie future des bâtiments.
Dans la réflexion en cours menée par le Gouvernement sur la simplification, la question des normes techniques est très importante car l’instabilité des règles applicables conduit à une insécurité juridique pour les directeurs d’établissement qui conduisent les travaux et l’on peut parfois s’interroger sur le fait de devoir renoncer à moderniser certains plateaux techniques pour respecter des normes de sécurité toujours plus drastiques, les moyens financiers consacrés aux investissements étant globalement très contraints.
Préconisation n° 12 : Faire évoluer les règles de financement des investissements :
– Engager une réflexion avec les professionnels sur l’évolution du financement des investissements, en s’inspirant notamment des expériences étrangères.
– Veiller à dégager des marges financières suffisantes pour permettre le financement des grands projets immobiliers lorsqu’ils sont indispensables.
– Compte tenu du risque d’obsolescence rapide du parc de matériel bio-médical lourd, du fait du progrès médical et des moyens financiers contraints, inciter à trouver des modes alternatifs de financement, inspirés par exemple du mécanisme du crédit-bail.
3. Les relations entre les établissements et les agences régionales de santé (ARS)
Les relations entre les établissements de santé et les ARS sont assez hétérogènes et résultent de facteurs historiques comme sociologiques. Les régions françaises où la densité hospitalière est très forte ont des relations souvent plus distantes avec les autorités de tutelle que dans les zones moins peuplées.
La rapporteure a néanmoins été frappée, lors de ses déplacements, de constater que les praticiens de terrain se plaignaient souvent d’une présence tatillonne de la tutelle dans le quotidien avec la demande de multiples renseignements chiffrés très détaillés mais avec simultanément un manque de visibilité des grandes orientations stratégiques.
Les représentants de l’hôpital d’Aubagne ont par exemple indiqué n’avoir qu’une faible visibilité sur la stratégie des pouvoirs publics à son égard : soit les liens logistiques et médicaux se renforcent avec l’AP-HM pour définir une réelle offre publique de proximité, soit le centre hospitalier intensifie sa coopération avec la clinique privée avec qui il pourrait trouver des synergies intéressantes. L’ARS mène pour l’instant une politique attentiste, en partie pour des raisons de contexte politique local, mais cette absence de choix aggrave la situation financière de l’hôpital d’Aubagne qui ne peut pas par exemple proposer une offre de médecine gériatrique suffisante faute de décision sur la réorganisation de ses services. Pendant ce temps, des patients se détournent de l’hôpital de proximité et vont se faire soigner dans les établissements de l’AP-HM situés à peu de distance.
Les ARS sont elles-mêmes tributaires de certaines règles des finances publiques qui rendent très difficile une programmation pluriannuelle sérieuse des financements. Plusieurs établissements ont ainsi déploré que, malgré des engagements contractés dans le cadre de projets d’investissements, ils n’ont reçu au final qu’une partie des aides à l’investissement promises. De même, il est très préjudiciable que certains tarifs ou aides financières ne soient arrêtés qu’en toute fin d’exercice budgétaire, ce retard provenant souvent de mise en réserves de certains crédits qui sont ainsi débloqués dans la précipitation et dans une certaine opacité.
Les directeurs d’hôpitaux qui ont été auditionnés ont regretté d’être passés d’un extrême à l’autre dans l’instruction des décisions financières. Après une période de trop forte autonomie des directeurs d’hôpitaux, notamment dans les décisions d’emprunt, les conseils d’administration n’ayant plus à en délibérer, il est aujourd’hui nécessaire de demander une autorisation d’emprunt au préalable à l’ARS dès lors que l’établissement est considéré comme surendetté ou a de mauvais indices de financement.
M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital (ADH), a ainsi regretté la situation actuelle qui crée de grandes rigidités pour les gestionnaires d’établissements : « Nous appelons de nos vœux une évolution de la réglementation. Nous considérons que le dispositif gagnerait en efficacité si le contrôle s’exerçait non plus sur chaque emprunt individuellement, mais sur une année, voire sur plusieurs années s’agissant de grosses opérations, avec possibilité de reports et de modifications de la décision si nécessaire. Cela permettrait à la politique de gestion de la dette d’être active tout en étant bornée. »
Les ARS, en particulier celles qui sont devenues des entités importantes comme celle de la région PACA, gagneraient à améliorer leur transparence. De nombreux témoignages ont été donnés à la rapporteure mettant en exergue la difficulté à disposer d’une prise de position claire de l’ARS sur certains projets d’investissement par exemple, les antennes régionales des ARS n’ayant parfois pas la même analyse que les services du siège de la même agence. De plus, pour les établissements faisant l’objet d’un suivi dans le cadre de la procédure « performance » du COPERMO, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est parfois déstabilisant de faire l’objet d’un audit non contradictoire de la part de l’ARS qui communique des éléments d’information au COPERMO sans que le directeur concerné ne sache ce que l’on reproche à sa gestion. Ces méthodes ne contribuent pas à établir des relations de confiance entre les ARS et les établissements.
4. Diversifier les financements possibles ?
La nécessité de diversifier les sources de financement des hôpitaux fait consensus pour tenter de limiter leur dépendance vis-à-vis des établissements bancaires, mais les voies possibles pour y parvenir sont beaucoup plus discutées.
La Cour des Comptes a fait notamment remarquer dans sa communication précitée que, compte tenu du contingentement de l’offre bancaire et de la persistance de marges bancaires extrêmement élevées, il est tout à fait souhaitable que les établissements cherchent à diversifier leur financement notamment par des émissions obligataires. Cette possibilité, complémentaire du financement bancaire concerne essentiellement les grands établissements, mais certaines émissions groupées pourraient permettre un accès plus large au financement obligataire.
a. Interdire l’accès des hôpitaux publics aux crédits de trésorerie ?
Dans sa communication, la Cour des comptes incite les établissements à professionnaliser leur gestion de la dette tout particulièrement la dette à court terme. Les établissements doivent progresser afin de mieux adapter leurs financements de court terme à leurs besoins qui doivent être calculés au plus juste et « minimisés par une gestion active des encaissements et décaissements ». La Cour recommande d’ailleurs de rendre obligatoire un plan prévisionnel de trésorerie sur six mois glissants et la présentation par les directeurs d’établissement de présenter annuellement au conseil de surveillance la stratégie de gestion de la dette avec notamment un point sur la désensibilisation des emprunts structurés.
L’Inspection générale des finances s’est, pour sa part, prononcée dans son rapport précité de mars 2013 pour l’interdiction des lignes de trésorerie.
Les personnes auditionnées ont cependant toutes estimé que cette position était trop rigoureuse.
M. Jean Debeaupuis, directeur général de l’offre de soins, a tenu à nuancer cette position.
Dans son rapport, l’IGF considérait que les hôpitaux bénéficiant pour majorité de ressources stables aux versements fixés réglementairement (produits versés par l’assurance maladie) et de charges dont le décaissement est connu pour leur majorité à l’avance (traitement des agents), l’utilité d’une ligne de crédit de trésorerie apparaissait fortement réduite.
Cette analyse doit toutefois être nuancée car les hôpitaux doivent faire face à des encaissements comme à des décaissements parfois difficilement prévisibles en termes de montants comme de dates. Il en est ainsi notamment des factures des fournisseurs d’immobilisations, des produits d’assurance maladie non notifiés, des ressources à l’activité (du fait de problèmes de codages ou de changements de logiciels, etc.) ou encore de l’obtention d’une subvention ou d’un prêt. Il peut donc exister des décalages entre encaissements et décaissements que peut couvrir utilement une ligne de crédit de trésorerie.
Retirer aux établissements la possibilité de recourir aux financements bancaires de court terme emporterait des conséquences préjudiciables, non citées dans le rapport précité. Une telle décision serait en contradiction avec l’autonomie de gestion des hôpitaux et obligerait les hôpitaux à disposer d’une trésorerie très excédentaire et non rémunérée sous peine d’incident de paiement, les hôpitaux perdant aussi en souplesse de gestion financière.
Le problème n’est pas tant la possibilité d’avoir un découvert que de sa juste utilisation. Force est de constater que des hôpitaux ont eu accès pendant des années à des lignes de crédit de trésorerie très importantes couvrant jusqu’à plus de 2 mois de dépenses courantes mais avec l’assentiment des banques jusqu’en 2011. Des hôpitaux, en difficultés financières depuis plusieurs années, ont usé de ces facilités pour résoudre leurs tensions de trésorerie, sans que les banques ne modifient leur offre de service.
b. Permettre aux hôpitaux d’émettre des billets de trésorerie ?
La possibilité d’émettre des billets de trésorerie a été prévue par le 13 de l’article L. 213-3 du code monétaire et financier.
L’évaluation préalable de cette disposition législative nouvelle a souligné que ce type de financement peut présenter des avantages, notamment un gain de 200 points de base par rapport aux lignes de trésorerie ou aux autres crédits de court terme accordés par les banques, grâce à l’économie réalisée sur l’intermédiaire bancaire, une certaine flexibilité dans le choix des échéances (entre un jour et un an), ou encore une flexibilité du montant. Comme pour les émissions obligataires, ce type d’outil présente néanmoins de nombreuses contraintes : un montant minimum de 150 000 euros, la nécessité d’établir une documentation financière précise sur l’activité de l’établissement, sa situation économique et financière et son programme d’émission, l’obligation de recourir à une notation par une agence agréée.
Ce mécanisme, nécessairement ciblé du fait de ces contraintes, a été évoqué par l’Inspection générale des finances pour les trois plus grands CHRU. La direction du Budget, dans le cadre des arbitrages en cours, a plaidé pour une limitation de l’émission des billets de trésorerie aux établissements ayant une surface financière suffisante, un compte de résultat principal à l’équilibre et une capacité d’autofinancement satisfaisante.
M. Mathieu Colette de Finance active a souligné, pour sa part, les aspects positifs de ce type de financement : « Dans le contexte de taux d’intérêt actuel, cet outil de financement est clairement beaucoup moins cher que les lignes de trésorerie qui peuvent être souscrites auprès des banques – celles-ci se négocient avec des marges entre 150 et 200 points de base sur l’EONIA (Euro overnight index average – taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une échéance d’un jour) sur l’ensemble de l’année 2014 et encore en début d’année. En effet, les dernières statistiques publiées par la Banque de France fin décembre 2014 montrent un taux fixe à un jour négatif, à moins 0,2 % en moyenne, soit, toutes qualités de signature, tous secteurs confondus, entreprises, collectivités locales – dont une vingtaine émettent déjà sur ce marché – et sur douze mois, un taux payé de 0,52 % en moyenne, soit quatre fois moins que la marge appliquée par la banque.
Cette situation est néanmoins conjoncturelle, liée à l’excédent de liquidités. Peut-être les banques pourront-elles demain proposer des crédits de trésorerie moins chers, mais je n’en suis pas sûr, notamment à cause des réglementations qu’elles appliquent. »
Le décret n° 2015-353 du 27 mars 2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux a ainsi prévu, pour l’application du 13 de l’article L. 213-3 du code monétaire et financier, de limiter les possibilités d’émettre des billets de trésorerie à cinq établissements, caractérisés par un total de produits supérieurs à 750 millions d’euros, un compte de résultat principal supérieur à – 2 % du total de ses produits, une capacité d’autofinancement suffisante, une trésorerie nette du dernier exercice supérieur à – 2 % du total de ses produits et pas d’emprunts toxiques, soit les établissements suivants : AP-HP, CHR de Bordeaux, Lille et Montpellier, et Hospices civils de Lyon
c. Aller vers une plus grande mutualisation des trésoreries ?
La rapporteure souhaite également évoquer une suggestion qu’avait faite l’IGF dans le rapport précité, relative à la possibilité pour l’ACOSS d’accorder des avances de trésorerie aux établissements confrontés à un risque d’incident de paiement sur un produit bancaire, cette possibilité étant subordonnée à l’autorisation de l’ARS.
La proposition d’une mutualisation de la trésorerie des établissements hospitaliers entre eux se heurte pour sa part à de fortes résistances, notamment de la part de l’IGF qui considère que cela pourrait fragiliser la trésorerie de l’État, les hôpitaux ayant obligation de déposer leurs fonds au Trésor (art 47 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012), mais la raison essentielle avancée est que cela inciterait à une gestion laxiste de la trésorerie, la ressource devenant trop facilement accessible. La direction du Budget, lorsqu’elle a été auditionnée par la MECSS, a elle aussi mis en avant le risque de déresponsabilisation des établissements.
La rapporteure estime qu’il serait plus réaliste et équitable de s’orienter vers une mutualisation de la trésorerie entre établissements qui ont choisi de coopérer et de gérer certains aspects de leur politique financière en commun (voir préconisation supra sur les GHT).
La rapporteure voudrait clore ce développement sur les financements alternatifs en soulignant la nécessité de faire preuve d’imagination sans pour autant oublier la prudence.
L’un des responsables hospitaliers auditionné, M. Michel Rosenblatt, secrétaire général du Syndicat des cadres de direction, et médecins, des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS CFDT), a ainsi proposé de recourir à des établissements publics qui recueillent des fonds sur du long terme : « Certains établissements publics n’ont pas le statut bancaire mais collectent des fonds et peuvent réaliser des placements financiers dans la durée. Je pense, par exemple, à l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) qui recueille des cotisations pour des montants élevés et qui doit diversifier ses placements. Il est bien évident que l’on pourrait, sous réserve d’adapter la loi, imaginer des « circuits courts » pour financer la dette à long terme des hôpitaux par des placements à long terme de l’ERAFP. »
Cette idée devrait certes faire l’objet d’une analyse approfondie préalable pour en vérifier la faisabilité, mais présente le mérite de poser le problème de la diversification des sources de financement des établissements de santé.
Préconisation n° 13 : Diversifier les modes de financement des investissements hospitaliers
Rechercher des modes de financement alternatifs au financement bancaire, en associant des spécialistes de la finance et de la gestion hospitalière, mais aussi des directeurs d’hôpitaux de terrain. Sous réserve d’une grande prudence, pour éviter de réitérer les choix hasardeux des emprunts toxiques, encourager à la réflexion en faveur de solutions innovantes, en analysant notamment les expériences étrangères pour trouver d’autres angles d’approche du financement de l’offre de soins et recenser les pratiques nouvelles pertinentes, qui ont pu être réalisées localement par des gestionnaires très pragmatiques et soumis à de fortes contraintes budgétaires.
La Commission des affaires sociales examine le rapport d’information de Mme Gisèle Biémouret en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la dette des établissements publics de santé au cours de sa séance du mercredi 8 juillet 2015.
M. Christian Hutin, président. À la demande de son précédent coprésident, représentant la majorité, M. Jean-Marc Germain, la MECSS s’est saisie du sujet de la dette des hôpitaux publics. Elle a travaillé à partir d’une communication de la Cour des comptes demandée par la commission des affaires sociales en application de l’article L.O. 132-3-1 du code de la sécurité sociale. Ce document remis par la Cour des comptes en avril 2014 a été présenté devant notre commission le 8 octobre dernier. Cette étude témoigne, une fois encore, du caractère fructueux de l’assistance apportée par la Cour au Parlement dans sa mission constitutionnelle de contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale et d’évaluation des politiques publiques prévu par l’article 47-2 de la Constitution.
La MECSS s’est ensuite réunie régulièrement sur ce thème entre la fin du mois de novembre 2014 et le 1er juillet 2015, date à laquelle ses conclusions ont été discutées avec les représentants de la Cour des comptes. Elle a adopté hier, à l’unanimité, le projet de rapport d’information que Mme Biémouret va nous présenter.
Mme Gisèle Biémouret, coprésidente de la MECSS, rapporteure. Après plusieurs mois de travaux, je vous présente aujourd’hui les conclusions de mon rapport d’information sur le thème de l’endettement hospitalier. La Cour des comptes a été sollicitée pour apporter son expertise. Sa communication sur l’endettement des établissements de santé se situe dans le prolongement des travaux qu’elle a menés sur les emprunts toxiques contractés par les collectivités locales, et sur son analyse de la faillite de Dexia.
Avant de parler des principaux constats de la Cour des comptes et des travaux de la MECSS sur des questions financières très techniques, j’évoquerai les moyens de conforter les hôpitaux publics dans leur mission alors qu’ils connaissent une situation financière et un endettement très préoccupants.
Au cours de mes déplacements en région, j’ai été frappée par le pragmatisme des équipes pour réussir à soigner tous les patients sans aucune sélection des risques, tout en faisant le maximum pour que les établissements continuent à se moderniser. Les choix au quotidien sont parfois douloureux. Ce constat a conforté mon souci de soutenir l’hôpital public, qui présente la spécificité de devoir relever sans cesse le défi d’être à la fois un service à la pointe de la médecine et un lieu où l’on accueille n’importe quel patient, fût-il en situation précaire et sans couverture sociale. Il faut reconnaître à l’hôpital public cette force de savoir concilier les contraintes contradictoires auxquelles il est soumis.
Mes déplacements m’ont aussi permis de rencontrer des équipes qui, tout en traversant des périodes de crise parfois très graves, ont réussi à poursuivre leur mission. J’ai entendu des inquiétudes sur les risques d’obsolescence de l’hôpital public qui, incapable de financer des équipements de pointe, perd des praticiens, découragés de devoir se battre au quotidien pour avoir les moyens d’offrir une médecine de qualité. Des choix importants doivent être faits pour financer la modernisation hospitalière et éviter que le poids de la dette ne compromette le futur, tant il est vrai qu’endettement et financement des investissements sont étroitement liés.
Longtemps, l’endettement hospitalier n’a pas été un sujet de préoccupation, car l’idée prévalait que les pouvoirs publics devaient dégager les moyens pour moderniser l’hôpital public. Depuis 2009, le niveau d’endettement de celui-ci et les dangers présentés par les emprunts structurés dits « toxiques » très concentrés sur certains établissements ont fait l’objet d’une prise de conscience. La Cour des comptes a donné des repères chiffrés très parlants : de 2003 à 2012, la dette hospitalière a triplé, passant de 9,8 milliards d’euros courants à 29,3 milliards. Elle a encore progressé d’un milliard d’euros en 2013. Durant une période particulièrement dynamique entre 2006 et 2009, elle a crû en moyenne de 16 % par an. Ce rythme s’est sensiblement infléchi, revenant à une hausse moyenne annuelle de l’ordre de 10 % dans les années récentes, et de 6 % aujourd’hui. Deux raisons expliquent cet emballement jusqu’en 2009.
La première est l’effort d’investissement considérable auquel les hôpitaux ont été appelés dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012, qui ont couvert respectivement les périodes 2002-2007 puis 2007-2012. Ces deux plans, qui répondaient à un besoin de modernisation des hôpitaux publics, ont été financés non par des apports en capital ou par des subventions, comme prévu initialement, mais de plus en plus largement par des appels à l’emprunt, des dotations de l’assurance maladie couvrant les charges d’intérêts. Ces plans se sont caractérisés par une relance considérable des investissements hospitaliers qui sont passés de 3,6 milliards d’euros en 2003 à 6,7 milliards en 2009, puis à plus de 6 milliards en 2010 et en 2011, avant de revenir à 5 milliards annuels en 2012 et 2013.
Ce dynamisme de l’investissement hospitalier a été entretenu par l’abondance des projets présentés par les établissements eux-mêmes. Les risques d’un recours massif à l’emprunt ont été ignorés. La période était à l’optimisme, car le regain d’activité des hôpitaux était source de recettes supplémentaires et devait permettre de rembourser ces emprunts.
La seconde raison de l’emballement constaté a été le désarmement progressif des contrôles de l’administration des stratégies de dette des hôpitaux. Jusqu’en 2005, ces derniers devaient soumettre leurs emprunts à leur conseil d’administration, donnant à l’agence régionale d’hospitalisation (ARH), saisie des délibérations du conseil d’administration, la possibilité de réagir. Or une ordonnance de 2005 a modifié ce régime en donnant davantage de latitude aux établissements dans la souscription de leurs emprunts. La loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) du 21 juillet 2009 a encore élargi cette marge d’autonomie en donnant aux directeurs des hôpitaux une compétence pleine et entière en la matière.
La perspective d’un surcroît d’activité lié à l’entrée en vigueur de la tarification à l’activité (T2A) a facilité le recours à l’emprunt. La Cour des comptes a souligné qu’à de nombreuses reprises, les choix d’investissement n’avaient pas été guidés par un souci d’efficience et que l’on avait construit des établissements surdimensionnés par rapport à la réalité de leur activité. Les pouvoirs publics ont réagi tardivement, et la crise financière a révélé les risques des emprunts structurés qui paraissaient à court terme intéressants.
Un décret a été pris à l’automne 2011 pour soumettre à autorisation d’emprunt les établissements les plus endettés ; il ne permet toutefois de réguler qu’une partie de l’appel à l’emprunt, car cette contrainte ne s’exerce que sur les établissements surendettés.
Le niveau d’endettement des établissements publics de santé est devenu critique. Le taux d’endettement, à savoir l’encours de la dette sur le total des produits d’activité, a lui-même doublé en dix ans et avoisine 40 %. Cet endettement élevé compromet le financement des investissements courants de renouvellement des équipements. La part des emprunts toxiques aggrave le phénomène d’endettement, mais il faut bien garder à l’esprit que le taux d’endettement global est trop élevé.
Dans un climat de concurrence exacerbée, les établissements de crédit ont sollicité les hôpitaux pour qu’ils souscrivent des emprunts sophistiqués avec, dans un premier temps, une phase de taux d’intérêt très bas mais, dans un second temps, une indexation les exposant à des risques considérables. Selon l’estimation de la Cour des comptes, les emprunts à risque élevé représentent 2,5 milliards d’euros dans l’encours des dettes hospitalières, soit 9 % de l’encours total des emprunts. Les emprunts particulièrement délétères, dits « hors charte Gissler », représentent, pour leur part, 1 milliard d’euros, soit 4 % des encours. Ces emprunts structurés sont d’autant plus dangereux qu’ils sont concentrés sur un nombre limité d’établissements. Une centaine d’entre eux sont très fortement « chargés » en emprunts toxiques : certains sont de grande taille, comme le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne, d’autres sont bien plus modestes, comme le centre hospitalier intercommunal de Montreuil.
La Cour des comptes a estimé que le coût de sortie des emprunts structurés, c’est-à-dire le rachat des options liées à ces emprunts toxiques, représente, en cas de remboursement anticipé, une dépense de l’ordre de 1,5 milliard d’euros, dont 1 milliard pour certains emprunts parmi les plus risqués. Cette somme ne tient pas compte de l’effet du renchérissement du franc suisse, qui a considérablement fait augmenter le montant des indemnités de remboursement anticipé.
Au début de la crise, certains établissements avaient des difficultés à continuer d’emprunter ou même à obtenir des lignes de trésorerie. Cette situation a été en partie palliée par la montée en puissance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui a dégagé des enveloppes de crédits en faveur des établissements publics de santé, sous réserve que ces crédits soient d’une durée assez longue.
Les premières mesures décidées par le Gouvernement doivent être saluées, mais il faut aller plus loin pour parvenir à désendetter les établissements tout en trouvant des moyens plus diversifiés de financer les investissements.
Les premières mesures adoptées en urgence visant à rendre plus difficile le recours à l’emprunt en le soumettant à une autorisation préalable des agences régionales de santé (ARS) et à interdire la souscription de produits dérivés doivent être confortées. Un amendement en ce sens a d’ores et déjà été adopté dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, à l’initiative des deux coprésidents de la MECSS, pour interdire les emprunts en devises et encadrer au niveau législatif les emprunts à taux variable.
Certaines mesures doivent être adoptées d’urgence afin de sortir des emprunts toxiques. À court terme, il faut accélérer la mise en place effective du dispositif de désensibilisation des emprunts toxiques, dont la dotation devrait être majorée suite à l’aggravation de la situation financière des hôpitaux causée par le renchérissement du franc suisse. Le Gouvernement a annoncé que la dotation serait portée à 400 millions d’euros et que le deuxième volet serait financé par une nouvelle majoration du taux de la taxe de risque systémique payée par les banques. Or celle-ci nécessite une modification législative, qui ne devrait intervenir qu’en fin d’année dans le cadre de la loi de finances. Je trouve dommage que ce deuxième volet ne soit pas opérationnel avant, et je m’interroge sur le dimensionnement du dispositif : la somme de 400 millions d’euros sera insuffisante, ce qui conduira des établissements de taille moyenne à être écartés du dispositif alors que leurs capacités de négociation avec les banques sont faibles.
Parmi nos recommandations, nous indiquons qu’il faut que tous les établissements mènent une stratégie collective homogène de sortie des emprunts toxiques. Les ARS doivent convaincre les directeurs réticents de se désengager, même si certains emprunts toxiques présentent encore des taux favorables. Le risque potentiel est trop grand, et seule une stratégie d’ensemble permettra une démarche globale cohérente et fiable.
Nous demandons aussi qu’un point soit clarifié : les établissements de crédit peuvent-ils opposer aux hôpitaux publics le respect du taux de l’usure dans leurs renégociations de prêt pour passer à des taux fixes ? À titre conservatoire, nous souhaitons que les établissements bancaires écrêtent au niveau du taux de l’usure les taux d’intérêt fixes qu’ils proposent pour sortir des emprunts toxiques.
Enfin, et cette préconisation sera la plus difficile à mettre en œuvre, il faut que les pouvoirs publics engagent une négociation avec les établissements bancaires, pour que ces derniers renoncent collectivement à la perception de la totalité ou de la majeure partie des indemnités de sortie des emprunts toxiques. Cette renonciation serait négociée au cas par cas et prendrait la forme d’une transaction avec les établissements emprunteurs. Cela permettrait de partager équitablement le coût de la sortie de ces emprunts car, jusqu’à présent, les banques y ont contribué faiblement malgré leur participation au dispositif de soutien.
Nous devons regarder vers l’avenir. Seule une démarche de négociation globale permettra de sortir rapidement de cette crise et de rétablir la confiance entre hôpitaux et établissements bancaires.
Nous recommandons de réfléchir à de nouvelles formes de financement des investissements. La Mission a entendu de multiples spécialistes qui ont surtout montré la complexité des mécanismes et la nécessité de stabiliser les règles du jeu. Ces dernières années, les modifications des règles de la T2A, l’instabilité des tarifs, ou encore l’évolution très contraignante de l’ONDAM ont profondément déstabilisé les directeurs hospitaliers. Les tarifs doivent, par ailleurs, intégrer le financement de la dotation aux amortissements pour permettre de réaliser les investissements courants.
Pour acter cet objectif de stabilité, la démarche contractuelle doit être renforcée : en contrepartie d’engagements sur des objectifs de productivité ou d’amélioration de l’offre de soins, les hôpitaux doivent disposer d’une visibilité d’au moins trois ans sur les aides à l’investissement dont ils peuvent effectivement bénéficier.
La spécificité des petits établissements contribuant à l’aménagement du territoire doit être réaffirmée, et leur mode de financement doit être adapté, comme cela vient d’être décidé dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
En raison de la crise des emprunts toxiques, les corps de contrôle, tels que l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou l’Inspection générale des finances (IGF), qui sont chargés de réfléchir à l’évolution des modes de financement de l’hôpital, semblent aujourd’hui peu enclins à des solutions innovantes. Il faut pourtant diversifier les modes de financement en s’inspirant notamment de bonnes pratiques locales. On doit se féliciter que les gros établissements aient été autorisés à émettre des billets de trésorerie.
Il faut aller plus loin et prévoir, par exemple, de mutualiser certaines fonctions ou compétences pour gagner en force de négociation financière. Les établissements constituant un groupement hospitalier de territoire (GHT) doivent pouvoir décider de gérer de manière commune certains aspects de leur politique d’endettement et de trésorerie afin de disposer d’une masse critique plus importante pour accéder aux marchés financiers et négocier avec les banques.
Les auditions ont révélé que les directeurs d’hôpitaux et les cadres des ARS devaient renforcer leurs compétences en gestion financière, aussi bien lors de leur formation initiale que dans le cadre de la formation continue. Il faut inciter à la constitution de groupes de travail entre pairs pour partager les bonnes pratiques et accroître ainsi l’expertise des équipes de direction. Le Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière (CNG) et l’École des hautes études en santé publique (EHESP) doivent renforcer leur coopération pour mettre sur pied des formations vraiment proches des problématiques de terrain. Nous recommandons également de développer la pratique du coaching individuel, notamment pour les fonctions les plus délicates des directeurs, et de mieux anticiper certains recrutements, notamment à l’issue des périodes d’administration provisoire, pour susciter des candidatures et assurer que le candidat retenu sera accompagné par un coach ou des référents expérimentés.
Pour répondre à la crise financière des emprunts toxiques, de gros efforts ont été faits pour rationaliser les critères d’investissement et évaluer la pertinence des projets. À ce titre, la mise en place du Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) doit être saluée. Cette cellule interministérielle qui instruit les demandes d’aides à l’investissement de plus de 50 millions d’euros a mené un long travail d’instruction des dossiers. Cette procédure manque de transparence. C’est dommage, car il faudrait diffuser les enseignements tirés de l’instruction des dossiers d’investissement présentés.
Il est urgent de trouver une solution équitable pour sortir des emprunts toxiques et des solutions pour diversifier le financement des investissements qui ne peuvent pas seulement reposer sur des emprunts bancaires.
Ce rapport d’information aura aussi le mérite de poser des questions essentielles et pressantes qui sont cependant souvent éludées. Le réseau hospitalier n’est-il pas surabondant ? Ne faut-il pas clairement hiérarchiser les équipements des hôpitaux pour constituer un réseau de soins avec des hôpitaux de proximité, des établissements généralistes et des établissements de haute technicité ?
Il faut aussi changer de regard et éviter de penser à des établissements toujours plus grands alors que la qualité passe aujourd’hui plutôt par des plateaux techniques modernes mais utilisés de manière continue avec des patients rapidement réorientés vers un parcours de soins extra-hospitalier. L’hôpital public doit se moderniser tout en gardant sa vocation d’hôpital de référence pour les techniques de pointe mais aussi d’hôpital ouvert à tous les patients, même sinon surtout les plus vulnérables.
M. Pierre Morange, coprésident de la MECSS. Je félicite la rapporteure et la coprésidente Gisèle Biémouret qui a acquis très rapidement la maîtrise d’un sujet extrêmement complexe, et je remercie les administrateurs qui ont accompli un travail remarquable.
En lançant la MECSS sur le sujet de la dette des hôpitaux, notre collègue Jean-Marc Germain était tout particulièrement préoccupé par l’explosion de cette dette dont le volume a triplé au cours des dix dernières années. Une partie de ces montants, certes mineure, même s’il s’agit tout de même d’un milliard d’euros, est qualifiée par Mme Biémouret « d’emprunts particulièrement délétères ». En ce qui les concerne, le déplafonnement de la parité du franc helvétique et l’actualité récente en Grèce n’ont fait que rendre la situation plus instable et les négociations avec les banques plus aléatoires.
L’analyse en silo vertical des charges d’emprunts liées à des investissements qui répondaient à la volonté de moderniser un parc hospitalier commençant à devenir obsolète dans les années 90 doit désormais être intégrée dans une vision plus horizontale qui tienne compte de la réorganisation de notre offre de soins et d’une meilleure connaissance du patrimoine et des coûts de fonctionnement des hôpitaux.
Lors d’une table ronde assez « sensible » réunissant des interlocuteurs des milieux bancaires, la MECSS a rappelé que la responsabilité des directeurs d’établissement hospitalier ayant contracté des prêts structurés était partagée, non seulement avec les autorités de tutelle comme les ARS, mais aussi avec les banques qui avaient proposé les prêts en question. Ces mêmes banques avaient été bien aises, lors de la crise de 2008, de voir d’une certaine manière les travailleurs français apporter leur caution pour éviter l’effondrement d’un système financier déstabilisé par la totale déconnexion de l’économie financière virtuelle et de l’économie de production. J’ai également rappelé à ces banquiers que leurs établissements avaient absorbé une bonne partie des emprunts toxiques de la Grèce. À tout le moins, on pourrait leur demander de consentir un effort similaire en faveur de nos concitoyens et des établissements de soins qui prennent en charge la santé des travailleurs qui participent à la création des richesses.
Enfin, la situation financière actuelle, qui résulte d’une politique monétaire très souple de la Banque centrale européenne (BCE), permet l’octroi de prêts à des taux historiquement bas. Ce sont autant d’opportunités pour les établissements hospitaliers de sortir de situations difficiles qui se traduisent de manière extrêmement concrète. L’asphyxie financière pour un hôpital, ce sont des pompes à morphine, des scanners, des réanimateurs et des infirmières en moins, et, hélas, peut-être aussi des décès en plus qui auraient pu être évités avec plus de moyens. Les institutions bancaires ont donc une responsabilité morale. C’est la raison pour laquelle elles doivent entendre l’exigence des représentants de la Nation que les pénalités de sortie des emprunts toxiques soient annulées.
M. Christophe Sirugue. Le sujet est délicat, explosif même. Dans cette situation, quelle est la part du conjoncturel et quelle est celle du structurel ?
On peut imputer au conjoncturel le défaut d’investissements qui a prévalu durant de très nombreuses années, qui a nécessité d’engager les plans Hôpital 2007 puis Hôpital 2012. Sans aucune acrimonie, je souligne que ces plans ont laissé les établissements chercher seuls des financements, ce qui s’est majoritairement traduit par un recours à l’emprunt. Nous ne pouvons pas faire aujourd’hui comme si nous découvrions la situation dans laquelle nous avons nous-mêmes placé les hôpitaux. Concomitamment, la crise financière, qui a rendu totalement incertains les montages financiers construits par les équipes des centres hospitaliers, a également constitué un facteur conjoncturel.
Au-delà de ces réalités, des éléments structurels entrent aussi en jeu sur lesquels il est indispensable de s’interroger. Très sincèrement, peut-on demander à des gestionnaires d’établissement de travailler sérieusement sur la base d’un principe de tarification qui n’est toujours pas stabilisé, ou de répondre aux demandes formulées par l’État via les ARS alors que les participations financières correspondantes ne suivent pas ? Quel système hospitalier public voulons-nous en France, et qu’est-ce que cela signifie en termes d’organisation pour l’État et la sécurité sociale ?
Tenter d’établir un équilibre financier sur la base d’une tarification qui ne repose que sur l’activité ne peut que poser des problèmes. Cela conduit à faire des choix plus ou moins avoués d’activité, ce qui n’est pas acceptable pour un établissement public, et à pratiquer des tarifs fluctuants dans un ONDAM que chacun sait extrêmement contraint. Dans la suite que nous donnerons, je l’espère, au rapport de Gisèle Biémouret, le premier sujet qu’il nous faudra traiter sera celui d’une bonne tarification de l’activité.
Un autre élément à modifier est la carte hospitalière. Les groupements hospitaliers de territoire ont été vus par certains comme le moyen d’ « assécher » les établissements qui n’étaient pas pivots, mais comment fonctionner sans les CHU ni les établissements d’un autre niveau ? La question de la structuration est fondamentale.
Pierre Morange souhaite contraindre les banques à jouer un rôle plus proactif. À nouveau, je m’interroge sur la nature de ce rôle : conjoncturelle ou structurelle ?
Mme Isabelle Le Callennec. Dans certains hôpitaux, en effet, la situation devient explosive. Voulu, à l’origine, pour évaluer la situation financière des hôpitaux publics confrontés aux emprunts toxiques, ce rapport d’information a été élargi à la dette de tous les établissements publics de santé, ce qui nous sera fort utile. Dans notre pays, 420 hôpitaux sont déficitaires, 40 d’entre eux cumulant à eux seuls 50 % du déficit. En 2013, le déficit cumulé s’élevait à 476 millions d’euros.
L’endettement massif des établissements de santé pèse sur la modernisation de l’offre de soins. Il en résulte un accès au crédit contrasté selon la taille des établissements et, parfois, selon le bon vouloir des ARS, des difficultés de financement à court terme et des problèmes de trésorerie dans nombre d’hôpitaux, ainsi que des inégalités croissantes entre les établissements pour financer les investissements : certains hôpitaux qui ont de réels besoins paient aujourd’hui le surdimensionnement d’hôpitaux voisins, ces « cathédrales » où avaient été construits plusieurs blocs opératoires finalement fermés peu de temps après faute d’activité.
Le rapport relève que l’expertise financière peut faire défaut dans les établissements. Avec un certain courage, vous osez même proposer d’améliorer la formation en la matière des cadres dirigeants des centres hospitaliers mais aussi des équipes des ARS. La question est, en effet, clairement posée à l’École des hautes études en santé publique.
Vous soulignez également les conséquences de la mise en œuvre de la T2A. Pour ma part, je reste convaincue que si cette tarification à l’activité a pu profiter à certains établissements, elle en a très fortement pénalisé beaucoup d’autres en rendant leurs déficits structurels, ceux-ci se creusant paradoxalement avec l’activité. Cette évolution est sans doute également due au fait que les hôpitaux ne dissocient pas le financement des investissements immobiliers et celui des petits équipements médicaux. Votre rapport comporte une préconisation pour y remédier. La question est singulièrement posée aux hôpitaux de référence, ceux qui comportent des unités de chirurgie, de maternité et de réanimation. Cette tarification devrait, à elle seule, faire l’objet d’un rapport d’information, ainsi que le pense mon voisin Henri Guaino.
Pour ce qui est de celui qui nous est soumis aujourd’hui, il comporte treize préconisations, dont on espère qu’elles seront suivies. J’en retiens quatre :
Améliorer la transparence de la procédure devant le COPERMO : le moins que l’on puisse dire est que ses décisions restent très opaques, ce qui laisse libre cours à toutes les interprétations.
Renforcer la confiance entre les établissements de santé et les banques afin que ces dernières aient conscience les efforts consentis par les hôpitaux pour un retour à l’équilibre : je peux témoigner que ces efforts sont réels et ne vont pas sans créer des tensions chez les personnels.
Clarifier et stabiliser les règles de la tarification à l’activité : je me demande s’il ne serait pas opportun d’étendre aux établissements de référence qui en ont besoin le mécanisme prévoyant, à l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, de faire bénéficier les établissements de proximité d’un financement mixte.
Engager une réflexion sur l’évolution des règles de financement des investissements : vous évoquez le crédit-bail et les expériences étrangères. Je citerai le cas du CHU de Rennes, pour lequel le fonds Nominoë concourt à des investissements plus qu’utiles pour la santé.
Le rôle des ARS est indispensable pour la mise en œuvre de ces préconisations. Rien ne se fera sans leur implication forte et leur capacité à dialoguer de façon constructive avec les établissements de santé. La préconisation n° 3 du rapport de gérer en commun la trésorerie et l’endettement des établissements qui constitueront à terme un groupement hospitalier de territoire n’a pas cependant fini de nous mobiliser sur le terrain, et d’occuper les ARS et les établissements hospitaliers.
M. Jean-Philippe Nilor. Les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 se sont traduits par un emballement de la dette hospitalière, celle-ci progressant à un rythme pouvant atteindre 20 % par an, et triplant sur une période de dix ans. Les pouvoirs publics en portent la responsabilité au premier chef : ils ont privilégié le levier de la dette pour financer un plus grand nombre d’opérations sans l’assortir de procédures rigoureuses, tout en allégeant les contrôles sur la nature et le montant des emprunts souscrits.
Le pari de la dette reposait sur la capacité des établissements, aidés par des dotations spécifiques de l’assurance maladie et par la nouvelle tarification à l’activité, à engager une dynamique de croissance de leurs recettes d’exploitation leur permettant d’assumer les charges de remboursement. Les gestionnaires hospitaliers ne sont pas non plus exempts de responsabilité. L’argent de la dette a pu leur paraître facile dans un contexte réglementaire permissif et dans un climat de concurrence entre les établissements bancaires, qui a favorisé le développement d’offres de crédits structurés dont les risques considérables ne sont apparus qu’ultérieurement.
En outre, les investissements ainsi réalisés ne se sont pas réellement inscrits dans une logique d’efficience et de retour sur investissement. Ils n’ont pas toujours été le levier d’une rationalisation et d’une reconfiguration destinées à améliorer l’efficacité de l’offre de soins. Les mesures d’encadrement progressivement prises depuis deux ans ne témoignent que de la prise en compte tardive de ce phénomène par les pouvoirs publics.
L’encours de la dette hospitalière, qui représente aujourd’hui 1,4 % du PIB, a créé une situation grave tant pour les finances publiques que pour nombre d’établissements qui n’ont plus les marges d’exploitation suffisantes pour couvrir leurs charges de remboursement. Une stratégie de désendettement s’impose, mais pas au prix de la santé publique ni d’une fracture sanitaire à l’échelle du territoire.
Pour que le ralentissement récent de la progression de la dette débouche sur une stabilisation, puis une diminution de l’encours, les pouvoirs publics doivent amplifier la réorientation engagée de la politique de soutien à l’investissement désormais plus sélective et davantage fondée sur les aides en capital. Leur action a permis de contrer récemment le risque d’assèchement des crédits offerts aux hôpitaux à la suite de la crise financière, mais les établissements demeurent pénalisés par le montant élevé des marges bancaires aussi bien pour les crédits à court qu’à moyen et long terme. Ces difficultés plaident en faveur d’un recours direct au marché pour les établissements qui jouissent d’une bonne qualité de signature et qui disposent de la surface financière et de l’organisation administrative suffisante pour émettre des billets de trésorerie ou des obligations.
Au final, l’offre de crédit du secteur hospitalier ne retrouvera un équilibre satisfaisant qu’à terme, avec l’amélioration générale des conditions de crédit. Il faudra aussi juguler les risques propres au secteur. La mise en place d’un fonds spécifique pour l’hôpital, à l’image de celui créé pour les collectivités territoriales, avec des modalités de financement et des critères d’éligibilité et de conditionnement des aides rigoureux, pourrait également faciliter ce rétablissement.
J’ajoute qu’un tel dispositif n’aurait de sens que si l’ensemble du monde hospitalier prend conscience du poids de la dette qui l’asphyxie et de ses répercussions sur les conditions de soins de nos concitoyens, et si l’ensemble de ce monde se mobilise pour réussir les réformes structurelles et courageuses qui s’imposent.
Enfin, les engagements de l’État devraient à l’avenir être davantage marqués du sceau de la cohérence. Nous ne comprenons pas, par exemple, pourquoi le Gouvernement s’entête à vouloir annoncer l’installation d’un cyclotron en Martinique et d’un autre en Guadeloupe. Deux rapports d’experts commandés par le ministère de la santé préconisent pourtant l’implantation d’un seul cyclotron interrégional en Martinique. Alors qu’au niveau national, on compte un cyclotron pour cinq Tep-scanners, c’est-à-dire pour environ quatre millions d’habitants, il y en aurait un pour 400 000 habitants dans chacun des territoires ultramarins. Cela exigerait un investissement de 12 millions d’euros, voire de 18 si l’on en implantait un en Guyane – au point où nous en sommes ! Cela induirait surtout un déficit d’exploitation structurel et exponentiel. L’État acceptera-t-il que la sécurité sociale supporte le remboursement de ces examens à un coût dépassant de 300 euros le tarif de référence ? Il est permis d’en douter. Surtout, d’autres besoins en santé de nos territoires d’outre-mer, déjà en grande souffrance sur ce plan, risquent d’être sacrifiés, et les difficultés financières ses établissements hospitaliers de s’aggraver. J’en appelle à un minimum de cohérence dans les décisions des pouvoirs publics.
Mme Luce Pane. L’analyse qui nous est présentée de la situation des établissements publics de santé est à la fois pertinente est inquiétante. Parmi les préconisations du rapport d’information, j’ai particulièrement retenu celle qui porte le numéro 6, consistant à développer une expertise financière mutualisée. Les établissements de santé sont confrontés à un double défi puisqu’ils doivent gérer un endettement massif tout en ayant l’obligation de poursuivre la modernisation de l’offre de soins. Cette obligation contribue d’ailleurs à creuser l’endettement des établissements hospitaliers, ce qui renforce la difficulté de la gestion de la dette.
Sur ce sujet, l’expérience de la mission d’accompagnement régionale à la tarification à l’activité (MARTAA), proposée par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, est particulièrement intéressante, notamment dans son axe d’accompagnement de la gestion de la dette et de la trésorerie. Cette formule répondrait à la demande d’un certain nombre de directeurs d’établissement public de santé. Une telle expérimentation mériterait d’être étendue et d’impliquer tous les acteurs intervenant dans le financement des établissements.
M. Gérard Bapt. Ce rapport d’information constitue un socle de travail inestimable.
Madame Biémouret, vous avez eu raison de séparer la question de l’endettement général et celle du traitement des emprunts toxiques. Concernant ces derniers, un point m’étonne : le Gouvernement avait refusé un de mes amendements tendant à faire bénéficier les établissements de santé du fonds de soutien mis en place en 2013 pour les collectivités locales, mais aucune action volontariste n’a encore été mise en place pour l’hôpital, à l’exception de l’aide de 25 millions d’euros par an pendant quatre ans, destinée aux petits établissements.
Aucune action n’a, en particulier, été entreprise en direction des banques. Sur ce sujet, je soutiens le raisonnement de M. Morange : ceux qui ont proposé ces crédits aux établissements hospitaliers doivent participer activement à leur redressement puisqu’ils ont fortement contribué à leur endettement et aux dérives constatées.
S’agissant du caractère structurel de l’endettement, la situation des établissements est en fait extraordinairement contrastée alors qu’ils sont placés dans les mêmes conditions de fonctionnement. Ainsi, le fait que le CHU de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille soit très endetté n’exclut pas le besoin d’investissements massifs, par exemple pour la maternité ou pour ces tours desservies par deux ascenseurs seulement – le record d’attente pour les brancardiers qui acheminent les malades a été établi à trente-cinq minutes !
L’équipement hospitalier français est peut-être surdimensionné, mais cet aspect est à rapprocher de la façon dont la médecine de ville sera adaptée. Tant que la révolution du premier recours n’a pas eu lieu et que l’accès au soin et le suivi des patients ne seront pas assurés en ville comme ils le devraient, la question de l’hôpital restera difficile à traiter.
Mme la rapporteure. Je souhaite que ce rapport ait une suite, d’abord pour les patients évidemment, mais aussi pour les directeurs d’hôpitaux et les équipes médicales qui sont très motivés et font le maximum pour soutenir l’hôpital public. Nous devons les aider ! Ces cadres hospitaliers vivent au quotidien des situations parfois inextricables qui ont des retombées sur les équipes de soignants. Comme le disait Christophe Sirugue, la situation est explosive.
Le GHT constitue certes une solution pour l’organisation des soins sur les territoires, mais je constate dans ma circonscription qu’il fait appel à la bonne volonté de personnes qui n’en font pas toujours preuve. Les ARS doivent jouer un rôle pour fluidifier l’organisation du territoire.
Pour conclure, permettez-moi de préciser que nous souhaitons intituler ce rapport d’information : L’hôpital public malade de sa dette ?
*
* *
La Commission décide, à l’unanimité, en application de l’article 145 du Règlement, d’autoriser la publication du rapport d’information sur la dette des établissements publics de santé.
ANNEXE 1 :
COMPOSITION DE LA MISSION
Coprésidents
Mme Gisèle Biémouret (SRC)
M. Pierre Morange (UMP)
Membres
Socialiste, républicain et citoyen
Mme Martine Carrillon-Couvreur
Mme Joëlle Huillier
Mme Bernadette Laclais
Les Républicains
M. Jean-Pierre Door
Mme Isabelle Le Callennec
Mme Bérengère Poletti
M. Dominique Tian
Union des démocrates et indépendants
M. Hervé Morin
M. Francis Vercamer
Écologiste
M. Jean-Louis Roumegas
Radical, républicain, démocrate et progressiste
Mme Dominique Orliac
Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Philippe Nilor
ANNEXE 2 :
RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES PROPOSÉES À L’ISSUE DE SON ENQUÊTE SUR « LA DETTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ »
1. réserver le financement des investissements par l’emprunt exclusivement aux projets permettant aux établissements publics de santé d’atteindre un taux de marge d’au moins 8 % ;
2. généraliser à l’ensemble des établissements publics de santé l’obligation de construire un plan prévisionnel de trésorerie sur six mois glissants ;
3. permettre l’expérimentation par les trois plus grands centres hospitaliers régionaux de l’émission de billets de trésorerie ;
4. définir au niveau central une démarche d’ensemble claire et organisée de désensibilisation des emprunts structurés souscrits par les établissements publics de santé, faisant apparaître les priorités et les modalités de la sécurisation des encours des hôpitaux ;
5. envisager pour le secteur hospitalier la création d’un dispositif spécifique de soutien partageant l’allègement du coût de la neutralisation des risques attachés aux emprunts structurés entre les banques et les emprunteurs ;
6. obliger les directeurs des établissements à présenter annuellement au conseil de surveillance la stratégie de gestion de la dette de l’établissement, précisant, le cas échéant, la démarche de sécurisation des emprunts structurés, avant transmission à l’agence régionale de santé pour approbation.
ANNEXE 3 :
CRÉDITS STRUCTURÉS OU TOXIQUES : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les crédits « structurés » sont constitués par la combinaison d’un prêt et d’un ou plusieurs instruments financiers. Parmi ces crédits structurés, on trouve différents produits :
– les produits structurés à barrière : crédits dont le taux demeure fixe et inférieur aux taux fixes classiques, tant que le taux de référence (l’Euribor) ou l’Indice sous-jacent (écart de valeur entre deux indices d’inflation ou entre deux monnaies par exemple) ne dépasse pas une barrière consistant en un taux déterminé ;
– les produits de pente : produits dont le taux est fonction d’une fourchette de variation entre les taux courts et les taux longs ;
– les produits de courbe : produits dont le taux est déterminé par l’écart entre deux indices exprimés dans des devises différentes et/ou sur des marchés distincts sans avoir nécessairement la même maturité ;
– les produits à effet de structure cumulatif (« snow-ball ») : produits présentant un effet cliquet dans la mesure où le taux payé à chaque échéance est déterminé sur la base d’une incrémentation cumulative par rapport au taux de la ou des échéances précédentes, qui servent ainsi de base pour la détermination des taux suivants, de telle sorte que le taux supporté ne peut qu’augmenter ou se stabiliser.
La notion de crédits « sensibles » désigne certains crédits structurés dont la formule de taux présente un risque particulier ou des crédits libellés ou Indexés sur des monnaies étrangères classés hors de la Charte « Gissler ». Les crédits structurés sensibles sont des crédits dont le taux calculé dépend de références éloignées de celles usuellement employées par les emprunteurs publics français (un cours de change. un écart entre deux Indices de taux. un français l’autre étranger) et selon une formule de calcul comportant, dans la plupart des cas, des barrières et des effets de levier.
Adoptée le 7 décembre 2009, la Charte de bonne conduite dite « Charte Gissler », prévoit que les banques ne commercialisent plus que des produits correspondant à la typologie suivante :
Indices-sous-jacents |
Structures | |||
1 |
Indices zones euros |
À |
– Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement – Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique) – Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | |
2 |
Indices inflation française ou inflation Zone euro ou écart entre ces indices |
B |
Barrière simple sans effet de levier | |
3 |
Écarts d’indices Zone euro |
C |
Option d’échange (swpation) | |
4 |
– Indices hors Zone euro – Écart d’indice dont l’un est un indice hors zone euro |
D |
– Multiplicateur jusqu’à 3 – Multiplicateur jusqu’à 5 et taux plafonné | |
5 |
Écart d’indices hors Zone euro |
E |
Multiplicateur jusqu’à 5 | |
Source : Mission IGF-IGAS.
Toutefois, des prêts ne répondant pas à ces critères ont été commercialisés par les banques avant l’entrée en vigueur de la Charte (au plus tard le 1er janvier 2010). Ils sont qualifiés de prêts « hors Charte » et recouvrent les produits financiers :
– qui comportent un risque de change pour les emprunteurs qui n’ont pas de ressources dans la devise d’exposition ;
– dont les taux évoluent en fonction d’index tels que les indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions ;
– dont les taux évoluent par une référence à la valeur relative de devises ;
– dont la première phase de bonification d’intérêt est supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l’Euribor à la date de proposition et d’une durée supérieure à 15 % de la maturité totale ;
– qui ont des effets de structure cumulatifs ou qui présentent un risque sur le capital.
Source : Mission IGF-IGAS de mars 2013, Évaluation du financement et du pilotage de l’investissement hospitalier n° RM2013-032P.
ANNEXE 4 :
LISTE DES PROJETS VALIDÉS OU EN COURS D’INSTRUCTION PAR LE COPERMO
Région |
Établissements |
Projets |
Date de l’éligibilité |
Date de la décision finale |
Montant des projets d’investissement validés en milliers d’euros |
Aquitaine |
CHU de Bordeaux |
Projet HGE (Hépato-gastro-entérologie) |
29 janvier 2013 |
2 avril 2013 |
48 700 |
Franche Comté |
CH Belfort Montbéliard |
Construction du site médian |
29 janvier 2013 |
28 mai 2013 |
267 000 |
Franche Comté |
CHU de Besançon |
Institut Régional Fédératif du Cancer IRFC-Labos |
29 janvier 2013 |
28 mai 2013 |
65 651 |
Nord Pas de Calais |
CHRU de Lille |
Projet Lille sud |
29 janvier 2013 |
28 mai 2013 |
162 000 |
Corse |
CH d’Ajaccio |
Projet des Urgences et reconstruction |
29 janvier 2013 |
22 octobre 2013 |
138 733 |
Auvergne |
CHU de Clermont Ferrand |
Désamiantage |
29 janvier 2013 |
2 avril 2013 |
91 000 |
Basse Normandie |
CHU de Caen |
Désamiantage |
29 janvier 2013 |
16 juillet 2013 |
45 600 |
Basse Normandie |
CHU de Caen |
Reconstruction du CHU |
29 janvier 2013 |
||
Guadeloupe |
CHU de Pointe à Pitre |
Reconstruction parasismique |
29 janvier 2013 |
3 mars 2015 |
590 000 |
Martinique |
CHU de Martinique |
Plateau technique parasismique |
29 janvier 2013 |
16 juillet 2013 |
169 000 |
PACA |
CH d’Avignon |
Mise en sécurité risque inondation |
29 janvier 2013 |
2 avril 2013 |
20 500 |
La Réunion |
CH Gabriel Martin |
Projet pôle sanitaire ouest (PSO) |
29 janvier 2013 |
16 juillet 2013 |
131 000 |
Nord Pas de Calais |
CH de Roubaix |
Reconstruction de la maternité « Paul Gellé » |
2 avril 2013 |
16 juillet 2013 |
55 000 |
Pays de la Loire |
CHU de Nantes |
Reconstruction sur l’île de Nantes |
2 avril 2013 |
16 juillet 2013 |
867 690 |
Rhône-Alpes |
HCL-HEH |
Modernisation de l’hôpital Édouard Herriot HEH |
2 avril 2013 |
26 novembre 2013 |
120 000 |
Île de France |
Ch de Melun/Centre Hospitalier Marc Jacquet |
Projet de plateforme publique privée de Melun |
2 avril 2013 |
22 octobre 2013 |
174 000 |
Île de France |
Ch de Melun/Centre Hospitalier Marc Jacquet Polyclinique Saint-Jean |
Projet de plateforme publique privée de Melun |
2 avril 2013 |
22 octobre 2013 |
62 000 |
Poitou-Charentes |
CH Nord Deux Sèvres |
Construction du nouvel hôpital : Regroupement des activités MCO sur un site unique |
2 avril 2013 |
17 décembre 2013 |
90 126 |
Corse |
CH de Bastia |
Projet de mise aux normes, restructuration et modernisation du centre hospitalier |
22 octobre 2013 |
25 février 2014 |
23 100 |
Basse Normandie |
CHU de Caen |
Projet de mise aux normes urgente des réseaux d’électricité et des fluides médicaux |
16 juillet 2013 |
22 octobre 2013 |
16 800 |
Guyane |
CHOG |
Projet de reconstruction de l’hôpital – Saint-Laurent du Maroni |
16 juillet 2013 |
25 février 2014 |
112 310 |
Guyane |
CHAR |
Projet de réhabilitation et d’extension des locaux libérés suite à la construction du pôle mères-enfants |
25 février 2014 |
||
Rhône-Alpes |
CH Voiron |
Projet de construction d’un pôle hospitalier public-privé du Voironnais |
17 décembre 2013 |
25 février 2014 |
99 500 |
Alsace |
Cliniques Adassa, Diaconesses et Sainte-Odile (Strasbourg) |
Projet Rhéna (ex Tamaris) : regroupement des trois cliniques sur un site unique |
22 octobre 2013 |
17 décembre 2013 |
100 879 |
Rhône-Alpes |
Hospices Civils de Lyon (HCL) - Hôpital Louis Pradel |
Mise en sécurité de l’hôpital cardiologique Louis Pradel |
22 octobre 2013 |
26 novembre 2013 |
77 500 |
Limousin |
CHU de Limoges |
Projet de modernisation et de mise en sécurité du CHU |
17 décembre 2013 |
||
Champagne Ardenne |
CHU de Reims |
Projet de modernisation du CHU |
17 décembre 2013 |
||
Bretagne |
CH de Saint-Brieuc |
Projet de construction d’une 5e aile et rénovation Yves Le Foll |
17 décembre 2013 |
29 avril 2014 |
40 650 |
Haute-Normandie |
CHU de Rouen |
Projet de nouvel Hôpital Charles Nicolle |
17 décembre 2013 |
11 décembre 2014 |
138 011 |
Lorraine |
Projet médical Moselle-Est (PMME) |
Recomposition de l’offre en Moselle Est |
28 janvier 2014 |
27 janvier 2015 |
27 000 |
Aquitaine |
CH de Périgueux |
Réalisation de la tranche 2 du plan directeur |
25 février 2014 |
30 septembre 2014 |
48 637 |
Picardie |
CHSI Clermont de l’Oise |
Restructuration des capacités d’hospitalisation du Centre Hospitalier Spécialisé Interdépartemental de Clermont de l’Oise (CHSI) |
|||
Lorraine |
CHR Metz-Thionville |
Projet de reconstruction de la maternité de Thionville |
24 juin 2014 |
28 octobre 2014 |
36 000 |
Bourgogne |
CH de Mâcon |
Projet de restructuration du site des Chanaux |
27 janvier 2015 |
||
Lorraine |
CHU de Nancy |
Projet de regroupement des laboratoires en un plateau unique de biologie |
15 juillet 2014 |
||
Aquitaine |
Institut Bergonié |
Projet de construction neuve d’un pôle chirurgical « Tribondeau » |
30 septembre 2014 |
11 décembre 2014 |
29 030 |
Languedoc-Roussillon |
CHU Montpellier |
Regroupement des activités de laboratoire de biologie et pathologie médicale sur un site unique |
30 septembre 2014 |
||
Rhône-Alpes |
CHU Grenoble |
Nouvel Hôpital Nord (blocs et ambulatoire, Nouveau plateau technique, restructuration nouvel hôpital Michallon) |
30 septembre 2014 |
31 mars 2015 |
160 000 |
Île de France |
AP-HP |
Hôpital Nord – volet 1 Nouveau Lariboisière |
11 décembre 2014 |
||
PACA |
Hôpital Saint-Joseph |
Projet de restructuration/construction neuve de l’Hôpital Saint Joseph |
27 janvier 2015 |
||
PACA |
AP-HM |
Mise en sécurité IGH |
|||
PACA |
AP-HM |
Maternité de la Timone |
|||
PACA |
CH d’Aix-Pertuis |
Reconfiguration du centre hospitalier |
|||
Nord Pas de Calais |
CH de Lens |
Reconstruction de l’hôpital de Lens sur un nouveau site |
27 janvier 2015 |
||
Nord Pas de Calais |
CH de Maubeuge |
Projet nouvel Hôpital |
Source : COPERMO, interrogé par la rapporteure
ANNEXE 5 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Pages
– M. Philippe Mills, président-directeur général de la Société de financement local (SFIL), et M. Olivier Grimberg, directeur de la médiation au sein de la direction de la gestion de l’encours 147
– M. Corso Bavagnoli, sous-directeur « banques et financement d’intérêt général » à la direction générale du Trésor au ministère des finances et des comptes publics et au ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 155
– M. Jean Debeaupuis, directeur général de l’offre de soins (DGOS) au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 162
– M. Yves Gaubert, responsable du pôle « Finances et Banque de données hospitalière de France » de la Fédération hospitalière de France (FHF) 170
– M. Didier Hoeltgen, vice-président du Syndicat national des cadres hospitaliers (CH-FO), directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, M. Guillaume Wasmer, représentant le Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS), directeur des centres hospitaliers de Juvisy, Longjumeau et Orsay, M. Michel Rosenblatt, secrétaire général du Syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT), et M. Éric-Alban Giroux, directeur d’hôpital, et M. Jean-Luc Gibelin, représentant l’Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens (UFMICT-CGT) 176
– M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital (ADH), et M. Christophe Got, vice-président 192
– M. Lamine Gharbi, président de la Fédération hospitalière privée (FHP), accompagné de M. Emmanuel Daydou, directeur de la prospective économique, médicale et juridique, et de Mme Béatrice Noëllec, responsable des relations institutionnelles et de la veille sociétale 200
– M. Richard Boutet, directeur du pôle Banques des particuliers et des entreprises, Affaires publiques France de la Fédération bancaire française (FBF), M. Hervé Leroux, directeur des entreprises et du secteur public, directeur de la clientèle patrimoniale au Crédit Agricole SA, et M. Philippe Barraud, responsable Grandes collectivités et ingénierie financière, M. Cédric Mignon, directeur du développement des Caisses d’Épargne du Groupe BPCE, et M. Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du marché Secteur public et partenariats public-privé, M. Pierre Vérot, directeur de la gestion de l’encours de Dexia crédit local, et M. Jean-Pierre Rosello, directeur des marchés de l’économie publique de la Société Générale 211
– M. Gautier Bailly, sous-directeur à la direction du budget au ministère des finances et des comptes publics, accompagné de M. Fabrice Perrin, chef du bureau des comptes sociaux et de la santé 219
– M. Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Mme Carine Chevrier, directrice économique, financière, de l’investissement et du patrimoine, et M. Philippe Rouvrais, chef du service financement et trésorerie à la direction économique, financière, de l’investissement et du patrimoine 228
– Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) 241
– M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), et M. Christian Béréhouc, directeur associé, directeur de pôle 249
– M. David Causse, coordonnateur du pôle santé-social de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) 263
– M. Patrice Chatard, directeur général et cofondateur de Finance active, et M. Matthieu Collette, responsable des études économiques et de la formation 273
– M. Éric Manoeuvrier, président de la Mission d’accompagnement régionale à la tarification à l’activité (Mission MARTAA), et M. Daniel Le Ray, coordinateur 286
– M. Richard Boutet, directeur du pôle Banques des particuliers et des entreprises, Affaires publiques France de la Fédération bancaire française (FBF), Mme Véronique Lofaso, responsable Secteur public et économie sociale du Crédit Agricole SA, Mme Ivelina Venchiarutti, responsable Dossiers complexes du Crédit Agricole corporate & investment bank, M. Cédric Mignon, directeur du développement des Caisses d’Épargne, et M. Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du marché Secteur public et PPP du Groupe BPCE, M. Pierre Vérot, directeur de la gestion de l’encours de Dexia crédit local, M. Jean-Pierre Rosello, directeur des marchés de l’économie publique de la Société Générale, M. Olivier Grimberg, directeur de la médiation, et M. Lionel Guineton, directeur de l’ingénierie financière de la Société de financement local (SFIL) 295
PERSONNES AYANT ADRESSÉ UNE CONTRIBUTION ÉCRITE
– Professeur Guy Moulin, président de la Conférence des présidents de CME de CHU et de la commission médicale d’établissement de l’AP-HM
– M. Jacques Grolier, maître de conférences hors classe à la Faculté des sciences économiques – Université de Rennes 1
– M. Jean-Yves Grall, directeur de l’ARS (agence régionale de santé) du Nord-Pas de Calais et président du Collège des directeurs généraux des ARS
ANNEXE 6 :
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES DÉPLACEMENTS
Ø À Aubagne et Marseille, les 8 et 9 février 2015
Centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne
– M. Alain Tessier directeur général
– Dr Claude Marblé, président de la CME (Commission médicale d’établissement)
Agence régionale de santé de la région PACA
– M. Paul Castel, directeur général
– M. Norbert Nabet, directeur adjoint et les cadres chargés des questions financières
Assistance publique de Marseille
– M. Jean-Marc Viguier, secrétaire général, et M. Antony Valdez, directeur en charge des financements
– Pr Jean Michel Bartoli, chef du pôle Imagerie médicale
Ø –À Rennes, les 8 et 9 Avril 2015
École des hautes études en santé publique (EHESP)
– M. Laurent Chambaud, directeur général
Ø À Saint-Étienne et Roanne, les 4 et 5 Mai 2015
Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne
– M. Frédéric Boiron, directeur général
– Pr Éric Alamartine, président de la CME
– Pr Fabrice Zeni, doyen de la Faculté de médecine
Centre hospitalier de Roanne
– M. Hubert de Beauchamp, administrateur provisoire
– Mme Marie-Ange Desailly-Chanson, administrateur provisoire
– Dr Serge Mirlicourtois, président de la CME
– Dr Michelle Boyer, membre de la CME
– Dr Guy Jeannoel, membre de la CME
– Dr Thomas Guerin, membre de la CME
– Dr Hocine Merrad, membre de la CME
– Dr Didier Raou, membre de la CME
– Dr Fabrice Moschetti, membre de la CME
Ø À Montreuil, le 6 Mai 2015
Centre hospitalier Intercommunal André Grégoire
– Mme Isabelle Leclerc, directrice générale
– Dr Jean Louis Pallot, président de la CME
– Dr Patrick Daoud, chef du pôle Femme-enfant
– Dr Dominique Méry, chef du pôle Médico-technique, chef du service Pharmacie, stérilisation et hygiène
Ø À Longjumeau, le 6 Mai 2015
Groupe hospitalier Nord-Essonne
– M. Guillaume Wasmer, directeur général
– Mme Anne Carli-Cham, directrice des affaires financières et de l’activité
ANNEXE 7 :
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Audition de M. Philippe Mills, président-directeur général de la Société de financement local (SFIL), et M. Olivier Grimberg, directeur de la médiation au sein de la direction de la gestion de l’encours
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. En accueillant ce matin des représentants de la Société de financement local (SFIL), la MECSS aborde une nouvelle thématique : la dette des établissements publics de santé.
La dette hospitalière représente 1,4 % du PIB et 29 milliards d’euros. Ce sujet est très préoccupant, d’autant que les hôpitaux sont aussi touchés par les emprunts toxiques.
M. Philippe Mills, président-directeur général de la Société de financement local (SFIL). Mon intervention s’articulera, à l’image du fascicule que nous venons de vous distribuer, en quatre chapitres : présentation de la SFIL, bilan du financement en 2013 et en 2014, déploiement de l’activité de financement de la Banque postale, gestion du portefeuille de prêts sensibles sur le secteur de la santé.
La Société de financement local (SFIL) a été créée le 1er février 2013, à la suite de la faillite au début de l’année 2011 de Dexia, dont les prêts au secteur public local représentaient avant la crise financière entre 7 et 8 milliards d’euros par an, soit environ 40 % du marché du financement du secteur public local.
Au début de l’année 2011, les autres acteurs, essentiellement des banques privées, n’ont pas compensé la disparition de Dexia, ce qui a obligé l’État à se tourner vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour lui demander d’accorder, non pas des prêts usuels de très long terme, mais des prêts d’urgence d’une durée de vie de quinze ans environ en vue d’un financement budgétaire général. Cette année-là, le besoin a représenté 5 milliards d’euros et à nouveau 5 milliards d’euros en 2012, année à partir de laquelle les pouvoirs publics ont jugé inenvisageable de demander tous les ans à la CDC d’intervenir de cette façon.
En effet, l’absence d’offre de financement de la part des acteurs privés, y compris des réseaux mutualistes – Caisse d’épargne et Crédit agricole – va clairement perdurer du fait de la mise en œuvre par les banques généralistes, après la crise de 2008, des règles de solvabilité dites de Bâle III. Ces règles rendent plus rigoureux les ratios prudentiels que doivent respecter les banques, notamment en termes de liquidité et de solvabilité, si bien qu’il devient plus coûteux pour elles de prêter à des acteurs économiques qui ont besoin de prêts à long et à très long termes.
M. le coprésident Pierre Morange. Les règles de Bâle III sont adossées à une assiette modifiée, notamment en termes de prise en compte des conditions obligataires et de financements publics. La situation dégradée des finances publiques d’un certain nombre de pays n’entretient-elle pas une fragilité du système ?
Les conditions d’éligibilité pour l’accès au crédit fixées par la Banque centrale européenne (BCE), au travers des nouvelles dispositions prises par son président M. Mario Draghi, permettent des taux d’intérêt particulièrement attractifs.
Enfin, le différentiel actuel entre l’euro et le dollar ne laisse-t-il pas entrevoir des conditions opportunes pour sortir de ces fameux prêts « toxiques » autrement dénommés prêts structurés ?
M. Philippe Mills. La première année où les financements aux collectivités et aux hôpitaux ont commencé à manquer, le pays a été affecté par la crise aiguë des dettes souveraines, qui a sévi entre août 2011 et novembre 2011. Ensuite, ce manque de financement de la part des banques privées a perduré, puisqu’il s’agit d’une tendance de long terme. Les nouvelles règles vont s’appliquer à échéance 2016, 2017 ou 2018, mais comme les analystes financiers les appliquent d’ores et déjà pour établir leur cours de bourse, les banques les mettent en œuvre dès maintenant dans leur politique d’octroi de crédit. Ainsi, la situation de tension en matière de finances publiques a joué à la marge, car le pic des difficultés est intervenu entre fin 2011 et début 2012, mais le phénomène n’a pas disparu pour autant, y compris dans d’autres pays où les banques privées sont également réticentes à prêter davantage au secteur public local.
S’agissant des conditions d’accès au crédit, la BCE agit de deux manières. D’abord, de manière très active afin de permettre un flux de crédit plus important, essentiellement pour l’Italie et l’Espagne. Ensuite, sur un plan réglementaire. C’est ainsi que la SFIL fait partie des 10 banques françaises et des 130 banques européennes qui, depuis le 4 novembre dernier, ont vocation à être contrôlées directement par la BCE. Toutes les banques présentes sur ce marché en 2011-2012 sont d’ores et déjà contrôlées. Ces nouvelles réglementations sont très claires : elles visent à séparer le plus possible les banques des États, afin que les États n’aient pas à nouveau à les soutenir, et que ce soit les actionnaires des banques qui supportent d’éventuels risques associés. Ces contraintes restent valables même si la BCE accorde par ailleurs des liquidités abondantes pour le financement des octrois de crédit.
M. le coprésident Pierre Morange. Le revers de la médaille dans ce processus de séparation des États et des banques, c’est que la réinjection de masses monétaires favorise une économie spéculative.
M. Philippe Mills. Tout dépend de ce qu’on appelle économie spéculative. Les conditions de plus en plus avantageuses proposées par la BCE servent surtout aux banques italiennes et espagnoles à acheter la dette de leur pays. Cela a donc un effet positif sur la stabilité de la zone euro et, par ricochet, sur les conditions financières qui peuvent être accordées y compris aux hôpitaux publics français, sachant que l’unification monétaire voit sa concrétisation dans la mise en place de l’Union bancaire. En termes d’octroi de crédit, il faut regarder les perspectives d’évolution de la croissance à long terme. Actuellement, malgré une offre de crédit abondante en France pour tous les types d’acteurs, le volume de crédit accordé est inférieur car la demande n’est pas aussi importante.
Selon les analyses extrêmement détaillées de la BCE dont les résultats ont été publiés fin octobre – 6 000 personnes ont été mobilisées pour étudier 120 000 comptes au niveau européen, 96 % des actifs bancaires français et 83 % des actifs bancaires européens –, le résultat global des banques françaises est très bon. Les banques françaises sont donc en bonne santé et la liquidité à disposition est abondante. Les banques privées – y compris les réseaux mutualistes – font plus d’offres aux collectivités et aux hôpitaux en 2014 qu’en 2011 et 2012, mais c’est parce qu’elles en font moins aux ménages pour des crédits immobiliers
– du fait de l’évolution du marché immobilier – et encore moins aux petites et moyennes entreprises, car le risque associé à un prêt pour une PME augmente avec la stagnation économique. D’où l’ambivalence de la situation actuelle avec, d’un côté, une BCE qui joue son rôle en matière de politique monétaire, et, de l’autre, des banques qui se montrent davantage prudentes. Pour autant, ce mouvement n’a rien de permanent : une fois la situation économique et financière française et européenne améliorée, les banques se déporteront vers les ménages et les entreprises. Par contre, la contrainte réglementaire est permanente, d’où la création de la SFIL pour répondre à la raréfaction de l’offre de financement aux collectivités et aux établissements de santé.
Enfin, concernant les évolutions récentes des changes, ce n’est pas tant l’évolution dollar/euro qui est importante que l’évolution dollar/yen. Dans une des catégories des prêts sensibles, un grand nombre d’entre eux sont indexés sur la relation dollar/yen. Mais la nouvelle politique économique japonaise mise en place depuis le printemps 2013 joue positivement, ce qui nous aide à renégocier les crédits et nous aidera aussi en 2015. Les équipes de la direction de l’encours de la SFIL signalent aux hôpitaux l’intérêt de saisir ce type d’opportunité.
L’action de la SFIL présente trois caractéristiques.
D’abord, ce nouveau dispositif ne concerne que les financements à long terme, c’est-à-dire des prêts à quinze ans ou plus pour le financement des hôpitaux et des collectivités. L’accord conclu avec la Commission européenne fin 2012 indique quinze ans, ou plus si nous sommes capables de nous refinancer nous-mêmes à long terme, ce qui est le cas. Nous sommes ainsi en mesure d’accorder des prêts entre quinze et vingt-cinq ans, très complémentaires des prêts très longs de la Caisse des dépôts et consignation ou de la Banque européenne d’investissement (BEI). Par contre, ce dispositif public ne concerne pas les prêts de trésorerie – seules les banques les accordent, y compris la Banque postale, notre partenaire commercial, mais pas dans le cadre du dispositif public.
Ensuite, l’offre du dispositif public est simple. En effet, dans une décision du 28 décembre 2012, la Commission européenne a fixé une liste limitative de ce que peut faire ce dispositif : prêt à taux fixe, prêt à taux variable avec une référence, passage de l’un à l’autre éventuellement au cours de la durée de vie du prêt, phase de mobilisation. Si le dispositif devait proposer autre chose, il faudrait renégocier avec la Commission européenne.
Enfin, le dispositif public doit présenter des offres de prêt au prix du marché. En effet, nous dérogeons à la concurrence européenne, mais cette intervention publique, qui n’est pas considérée comme une aide d’État, ne doit pas désinciter encore plus les financements pour les acteurs privés.
Pour l’assister dans l’analyse des aides d’État, la Commission européenne a fait appel au cabinet de conseil Duff & Phelps, dont les rapports montrent que la SFIL et la Banque postale respectent tous ces critères.
Soumise à la réglementation bancaire et au contrôle de la Banque centrale européenne, la SFIL n’est pas cotée en bourse. Elle est une banque à 100 % publique dont l’État est l’actionnaire principal, à hauteur de 75 %, aux côtés de la CDC, à 20 %, et de la Banque postale, à 5 %. L’État est notre actionnaire de référence, conformément à un article du code monétaire et financier, et son soutien précisé par une lettre concerne l’ensemble du bilan de la SFIL et sans limitation de durée. Cela est très important vis-à-vis des investisseurs, a fortiori s’agissant des prêts structurés à risque.
La SFIL n’est pas l’agent commercial du dispositif public, mais elle fait tout le reste. La Banque postale fait les offres de prêts, dont l’analyse est réalisée dès le départ en commun par elle et par nous, car les offres ont vocation à être cédées au bout de quelques mois vers le bilan de la SFIL. Ainsi, toutes les offres de prêt de long terme sont conçues avec la Banque postale, puis nous sont cédées. C’est la première exclusivité.
Deuxième exclusivité : nous ne pouvons prendre que les prêts commercialisés avec la Banque postale, puisque ce sont ceux que nous avons analysés et conçus avec elles.
Troisième exclusivité : nous refinançons les prêts en émettant des « obligations foncières ».
Pourquoi cette séparation entre le commercial et le financier ? Créée en 2006, la Banque postale a vocation en tant que banque publique à développer le financement au secteur local, ce qui a rendu inutile la création d’un deuxième réseau de distribution pour le même type de prêt aux mêmes acteurs. Pour une fois, il n’y a pas eu de doublon ! Le réseau incomparable des bureaux de poste distribue ces prêts – le groupe La Poste a souhaité faire de tous ses postiers des banquiers –, ce qui permet d’atteindre tous les types de collectivités et d’hôpitaux.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Je suppose que La Banque postale s’est restructurée pour mettre en place ce type d’offres.
M. Philippe Mills. La Banque postale a créé six directions territoriales, implantées dans des métropoles régionales, auxquelles s’ajoutent des équipes situées dans des villes de moindre importance. Ces équipes démarchent les collectivités depuis début 2013 et les hôpitaux depuis l’été 2013. Ainsi, le dispositif public est effectif pour les hôpitaux depuis le mois de juillet 2013 et plus nettement depuis septembre 2013.
La SFIL s’est vue confier trois missions essentielles.
La plus importante consiste à refinancer les prêts commercialisés. En étant soumises à la même réglementation que la Caisse d’épargne et le Crédit agricole, la Banque postale et la SFIL ont potentiellement les mêmes problèmes de ratio, de liquidité et de solvabilité. La SFIL finançant uniquement le secteur local français, toute l’efficacité du dispositif repose sur notre capacité à prêter long et à nous refinancer long, ce qui évite que les ratios de liquidité et de solvabilité viennent contraindre l’offre ainsi proposée. À titre d’exemple, pour proposer des prêts à quinze ans ou un peu plus, nous devons nous refinancer en émettant des obligations foncières d’une durée de vie moyenne de neuf à dix ans.
Notre deuxième mission est d’apporter une prestation de service à la Banque postale afin de l’aider à concevoir les prêts qu’elle commercialise.
Notre troisième mission, la plus médiatique, consiste à transformer les prêts structurés à risque, dont nous avons hérité au titre du portefeuille de Dexia, en prêts simples.
Nous sommes notés par les trois principales agences de notation. En tant qu’entreprise, nous sommes notés par Moody’s et Fitch à un niveau en dessous de l’État
– respectivement Aa2 et AA contre Aa1 et AA+ – et par Standard & Poor’s (S & P) au même niveau que l’État, à AA. Comme émetteur de dettes, nous sommes mieux notés : la Caisse française de financement local (CAFILL), société détenue à 100 % par la SFIL, est notée Aaa par Moody’s – soit deux niveaux au-dessus de notre propre notation –, et AA+ par S & P et Fitch, soit un niveau au-dessus de notre propre notation.
Cette notation s’explique par la nature même du type de dette que nous émettons : les obligations foncières. Émises pour la première fois par le Crédit foncier de France, puis dénommées « foncières » par le législateur en 1999, les obligations foncières sont des obligations sécurisées. Cela signifie que tout ou partie du bilan sert de manière explicite à garantir le remboursement de la dette émise. Pour notre stock de prêts aux hôpitaux et collectivités hérité de Dexia, auxquels s’ajoutent les nouveaux prêts de la Banque postale intégrés à notre bilan, le flux d’intérêt et le remboursement du capital servent de garantie de manière explicite au remboursement de la dette que nous émettons. Deux éléments juridiques sont attachés à ce type de dette. D’abord, les investisseurs qui achètent ces obligations sont des créanciers privilégiés, car ils sont remboursés avant tout le monde, y compris avant le Trésor public. Ensuite, les investisseurs ont une garantie absolue sur ce qu’ils achètent. À titre d’exemple, notre émission à dix ans lancée en début d’année est assortie d’un taux fixe et d’un coupon payé chaque année aux investisseurs, et ces trois caractéristiques – remboursement dans dix ans, paiement à taux fixe et paiement chaque année – ne peuvent être modifiées. C’est cette sécurité offerte aux acheteurs qui nous permet d’être très bien notés.
J’en viens au bilan du financement 2013/2014.
Le marché international en question, dénommé covered bonds en anglais, représente plus de 900 milliards d’euros, ce qui en fait le deuxième marché après celui de la dette des États, avec des émetteurs principalement situés en France, en Espagne et en Allemagne. Être un émetteur français est donc plutôt positif, a fortiori s’il est bien noté, car les investisseurs connaissent bien les caractéristiques de ce type de dette.
En 2013, la CAFFIL a levé plus de 3 milliards d’euros de financements à destination du secteur public local. Elle s’est distinguée notamment avec une émission publique de maturité à quinze ans, lancée en septembre, d’un montant de 500 millions d’euros, qui est venue compléter la transaction inaugurale, lancée en juillet, qui portait sur une maturité de sept ans et un montant d’un milliard d’euros.
Dès notre première émission, nous avons vu apparaître une catégorie d’investisseurs habituellement absents de ce marché, à savoir les banques centrales et les fonds souverains, qui n’achètent pas ou achètent très peu de dettes émises par les banques, notamment depuis la crise – ils achètent surtout la dette des États ou des agences publiques. Grâce à notre actionnariat exclusivement public, avec l’État comme actionnaire de référence et notre mission de refinancement des actifs publics, ces investisseurs considèrent que nous sommes comparables à une agence publique, telle la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale) pour la France ou la BEI au plan européen. La présence des banques centrales et des fonds souverains sur ce marché est intéressante à plusieurs titres. D’abord, ils viennent s’ajouter aux investisseurs usuels, ce qui accroît le nombre d’investisseurs. Ensuite, une fois qu’elle a commencé à acheter, une banque centrale devient un acheteur régulier. En outre, une banque centrale qui achète détient les titres jusqu’à la maturité de la dette correspondante, elle ne revend pas entre-temps, si bien qu’elle stabilise le cours de la dette. Enfin, dans son arbitrage entre absence de risque et prix intéressant, la banque centrale choisit l’absence de risque ; autrement dit, elle est prête à payer plus cher pour avoir moins de risques. Ainsi, la présence des banques centrales et des fonds souverains oblige les autres investisseurs à accepter des prix un peu plus chers et des taux un peu plus bas, ce qui aboutit in fine à des conditions plus avantageuses pour les hôpitaux et les collectivités.
M. le coprésident Pierre Morange. Alors que le budget alloué aux hôpitaux atteint 75 milliards d’euros, la masse salariale représente les deux tiers de leurs coûts et aucune majoration de tarification n’est possible pour augmenter leurs recettes. A contrario, en maîtrisant la fiscalité locale, les collectivités locales peuvent jouer sur le montant de leurs recettes. Dans ce contexte, la préférence des fonds souverains pour racheter ces dettes va-t-elle aux collectivités locales, qui présentent un moindre risque, ou aux hôpitaux, dont la marge de manœuvre est relativement étroite ?
M. Philippe Mills. Dans notre cas, ils regardent le bilan global, sans entrer dans le détail. En clair, ils achètent toutes les garanties financières et juridiques associées à notre bilan global, qui s’élève à 62 milliards d’euros de prêts, dont 42 milliards d’euros aux collectivités et aux hôpitaux. Avec 18 000 contreparties, notre bilan est le plus complet de toutes les banques françaises – c’est le côté positif de l’héritage de Dexia – sur les collectivités et les hôpitaux publics. Le résultat global de ces deux secteurs montre un très faible taux d’impayé – il n’y a jamais d’impayé définitif, jamais de perte en capital sur ce type de prêt, quelquefois des rééchelonnements ou des intérêts payés plus tard. Notre niveau de risque est ainsi bien plus faible que le niveau de risque moyen d’une banque généraliste – les impayés sur des prêts immobiliers ou des prêts aux entreprises sont beaucoup plus élevés et peuvent être plus définitifs que les impayés sur des prêts aux hôpitaux et aux collectivités.
M. le coprésident Pierre Morange. Certains hôpitaux universitaires empruntent même pour payer les salaires de leurs personnels, ce qui augure de leur fragilité financière. Selon la Cour des comptes, le triplement de la dette hospitalière en dix ans tient à la quasi-autonomie des directeurs d’établissement qui ont, de ce fait, été amenés à prendre des risques financiers.
En outre, la MECSS a mis en évidence la totale méconnaissance de la valorisation patrimoniale du parc hospitalier français, qui compte 60 millions de mètres carrés. Nous avons été stupéfaits d’entendre la direction du Trésor estimer le parc hospitalier français à quelques dizaines de milliards d’euros, sans plus de précision. Le dernier rapport de la Cour des comptes a évalué le patrimoine privé du parc hospitalier à un demi-milliard d’euros, mais sans produire une estimation du patrimoine public. Or c’est la moindre des choses, lorsque l’on recourt à l’emprunt, de connaître cette valeur patrimoniale.
M. Olivier Grimberg, directeur de la gestion de l’encours. Le secteur public local et celui des hôpitaux étaient considérés sans risque, ils sont toujours considérés comme apportant une certaine sécurité, mais l’analyse des banques a probablement changé depuis la crise. En effet, après la disparition de Dexia, il a été difficile de trouver des financements bancaires. En outre, les budgets des hôpitaux sont de plus en plus contraints – les recettes d’activité ne jouent pas et les dépenses de fonctionnement sont principalement des frais de personnels. Les budgets des collectivités deviennent eux-mêmes de plus en plus contraints. Ainsi, le changement de perception du risque par les banques vis-à-vis du secteur hospitalier a eu un impact sur l’apport des financements bancaires.
Concernant le triplement de la dette ces dix dernières années dans le secteur hospitalier, outre l’autonomie laissée aux directeurs des hôpitaux pointée par la Cour des comptes, le plan Hôpital 2007 et le plan Hôpital 2012 ont incité les établissements à rénover l’immobilier hospitalier, principalement par du financement bancaire et non par l’autofinancement.
M. Philippe Mills. Cela m’amène au troisième chapitre de notre présentation : le déploiement de l’activité de financement de la Banque postale.
L’activité de la Banque postale sur ce marché a débuté en juillet 2013, et plus de 100 établissements de santé ont été financés depuis cette date, pour un total de 590 millions d’euros. En 2014, le secteur de la santé représente 13 % de la production de prêts, soit 276 millions d’euros. Les hôpitaux publics et les CHR-CHU (centres hospitaliers régionaux et universitaires) restent les deux principaux emprunteurs sur ce secteur.
J’en viens maintenant au dernier chapitre : la gestion du portefeuille de prêts sensibles sur le secteur de la santé.
Au 31 janvier 2013, sur les 6,5 milliards d’euros de prêts en stock, 1,3 milliard d’euros correspondaient à des prêts structurés à risque, soit 20 % du total. Au 31 octobre 2014, ces encours structurés sensibles s’élevaient à 1 milliard d’euros sur un volume de 6,1 milliards d’euros, soit 16 % du total. Nous avons donc réduit ces prêts de 300 millions d’euros.
À sa création, la SFIL comptabilisait 1 188 emprunteurs du secteur public hospitalier, dont 133 étaient concernés par des prêts à risque, soit 11 %. Aujourd’hui, elle compte 1 096 emprunteurs, dont 113 concernés par ces prêts à risque, soit 10 %. Cette proportion est supérieure à celle des collectivités, à hauteur de 4 %. Le plan Hôpital 2007 a abouti à un surcroît d’investissement de la part des hôpitaux, dont un nombre important ont contracté des prêts structurés à risque.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Ces prêts ont-ils été proposés essentiellement par Dexia ?
M. Philippe Mills. Non, ils ont été proposés par tout le monde. Et les pires des pires ne l’ont pas été par Dexia, mais par la Caisse d’épargne, le Crédit agricole et les banques étrangères. Une fois que ces prêts-là – dits snowball dans le jargon financier –, entrent dans la phase activée, on ne peut pas revenir en arrière, même si les conditions financières ont changé et sont devenues moins défavorables. Car vous savez que si les ratios de change deviennent plus favorables, il est alors plus facile de renégocier, ce qui n’est pas le cas pour ces prêts snowball que Dexia n’a jamais commercialisés.
Nous avons ventilé l’encours des crédits sensibles sur la santé publique en cinq catégories. La catégorie S1 correspond aux petits hôpitaux qui ont dans leur dette au moins un prêt « hors charte Gissler », c’est-à-dire indexé sur le change euro/franc suisse. L’encours est de 0,06 milliard d’euros pour 12 emprunteurs. Ce sont les prêts les plus compliqués hérités de Dexia. Sachant que les petits hôpitaux ont moins de surface financière pour renégocier, ce sont eux qu’il convient d’aider en priorité.
M. le coprésident Pierre Morange. On sait que certains coefficients multiplicateurs et indices des prêts sensibles sont extrêmement élevés, ce qui laisse témoigner du caractère hautement toxique de ce type de prêts.
M. Philippe Mills. Les responsabilités sont objectivement partagées.
La catégorie S2 correspond aux hôpitaux plus importants qui ont, eux aussi, des prêts « hors charte Gissler » indexés sur le change euro/franc suisse. L’encours est de 0,16 milliard d’euros pour 18 emprunteurs.
La catégorie S3 réunit les prêts « hors charte Gissler » indexés sur d’autres cours de change. L’encours s’élève à 0,31 milliard d’euros pour 16 emprunteurs.
Ces prêts présentent donc un risque avéré : ils sont dans la phase activée, l’indemnité de remboursement anticipée est importante par rapport au capital restant dû, et le niveau de taux payé est assez élevé ou élevé. Au total, ces trois catégories représentent 500 millions d’euros d’encours pour 46 emprunteurs. C’est vers eux que le fonds de soutien aux hôpitaux devra concentrer son aide.
Les deux autres catégories – S4 et S5 – sont de nature différente. Ces prêts sensibles sont inscrits dans la charte Gissler, ils sont liés à une formule de taux – un écart entre un taux court et un taux long –, et non à une relation de change, et ils ne sont pas dans la phase activée. Les taux payés par les hôpitaux sont actuellement assez bas, bas ou très bas. Pour sortir de ces prêts, l’indemnité de remboursement anticipée est assez faible, faible ou très faible. L’encours de 500 millions d’euros pour ces deux catégories concerne 67 emprunteurs.
Lorsqu’ils paient des taux faibles, certains hôpitaux refusent de renégocier. Or les prêts peuvent avoir une durée de vie longue – la plupart ont une durée de vie restante de quinze à vingt ans en moyenne. Les équipes de la SFIL s’efforcent donc, et c’est toute la difficulté, de convaincre les ARS (agences régionales de santé) puis les hôpitaux de la nécessité de renégocier maintenant.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est le service annuel de la dette pour les trois premières catégories ? Pour les deux autres, quelles sont les conséquences pour les budgets hospitaliers ?
M. Olivier Grimberg. Les taux d’intérêt des deux premières catégories, qui correspondent aux prêts les plus compliqués, sont compris entre 12 % et 15 %. Ils sont de 6 % et 8 % pour la catégorie S3.
Pour les catégories S4 et S5, les niveaux sont très bas, de 2 % à 3 %, d’où la difficulté. Car il faut convaincre les hôpitaux qu’ils ont tout intérêt à transformer leur prêt à 2 % – faible mais qui présente des aléas financiers, puisque le taux peut augmenter – en un prêt à taux fixe, à 3 %, supérieur mais totalement sécurisé.
M. Philippe Mills. Les frais financiers de l’ensemble de la dette héritée de Dexia sont nettement plus bas : le taux moyen pour l’ensemble des collectivités et des hôpitaux qui ont des prêts de cette nature, toutes catégories confondues, est de 4,9 %. Cela signifie que 70 % des institutions considérées payent moins de 4,9 %. Ainsi, certaines situations difficiles sont très concentrées, mais la majorité se trouvent dans une situation gérable.
Il faut se débarrasser de ces prêts en raison de leur potentielle nocivité ou de leur nocivité constatée et, surtout, parce que leur durée de vie est encore longue. Personne aujourd’hui ne peut dire ce que seront les conditions monétaires et financières dans cinq ans, sept ans, dix ans. C’est un vrai sujet pour nous : les raisonnements de court terme, purement budgétaires, se heurtent aux raisonnements de nature financière. Si la renégociation est possible, la dette est légèrement augmentée, mais totalement sécurisée. Et la sécurisation de la dette au cours des quinze ou vingt prochaines années pèsera moins lourd que l’augmentation de la dette sur les deux ans qui viennent.
Depuis le 28 février 2013, nous avons conclu 41 opérations de désensibilisation avec 40 établissements publics de santé pour un encours de 187 millions d’euros, dont 23 opérations en 2014 pour un encours de 100 millions. Sur les 133 hôpitaux concernés, 25 ont été totalement débarrassés de ces prêts sensibles, notamment le CHU de Nancy, l’AP-HM (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille), les CHU de Caen et de Dijon, et le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.
Ainsi, l’encours sensible dans le secteur de la santé s’élève à 1 milliard d’euros au 31 octobre 2014, contre 1,3 milliard au 31 décembre 2012. Il devrait baisser à 900 millions en janvier 2015, soit 400 millions d’euros de moins qu’à la création de la SFIL.
Il est important que le fonds de soutien de 100 millions d’euros devienne opérationnel le plus rapidement possible, car nous avons des difficultés à renégocier pour les deux premières catégories de prêts. Cet après-midi, Olivier Grimberg va rencontrer des représentants de la DGOS (direction générale de l’offre de soins) pour discuter de cette question.
D’ailleurs, le fonds de soutien aux collectivités locales est totalement opérationnel. Le montant fixé devra être dépensé sur trois ans ; un décret précise les prêts éligibles ; un service a été créé pour gérer le calcul de l’aide ; un arrêté détaille la liste des pièces à fournir à la DDFIP (directions départementales des finances publiques) pour recevoir cette aide ; et la doctrine d’emploi des fonds est publique, elle se trouve sur le site de la DGCL (direction générale des collectivités territoriales). Aujourd’hui, les conditions sont réunies pour accélérer le rythme des renégociations de prêts sensibles avec les collectivités locales.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. J’imagine que tous les hôpitaux n’entrent pas en contact avec vous. Les établissements qui le font sont-ils ceux qui sont le plus en difficulté ?
M. Philippe Mills. Nous finançons l’ensemble des hôpitaux, mais de deux manières différentes, comme je vous l’ai indiqué au début de mon propos. Nous finançons tous les hôpitaux via le contact commercial de la Banque postale. Par contre, pour les hôpitaux qui ont une dette structurée à risque, nous ne passons pas par le circuit de la Banque postale, conformément à un accord avec cette dernière.
Si un hôpital doit réaliser des investissements par ailleurs, nous lui accordons les financements en même temps que nous renégocions le prêt, et ce à prix coûtant, c’est-à-dire sans marge. Ainsi, la marge du financement nouveau offerte à l’hôpital vient diminuer le montant de son indemnité de sortie. Il s’agit là d’un levier important pour les hôpitaux – car ils ont souvent des financements nouveaux à réaliser en même temps que la renégociation des prêts en cours –, auquel s’ajoutera l’aide du fonds de soutien. Nous avons ainsi pu réaliser des opérations avec les hôpitaux de Marseille et de Dijon, en proposant des financements nouveaux associés à des conditions défiant toute concurrence.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Les investissements nécessaires peuvent-ils être refusés aux hôpitaux les plus en difficulté ?
M. Philippe Mills. Oui. Sur les quelque 1 100 établissements publics de santé figurant dans notre base clients, il en est 70 – soit une minorité – auxquels nous ne prêtons plus, soit parce qu’ils sont dans une situation de grande fragilité financière – ils sont 30 dans ce cas –, soit parce qu’ils sont fragiles et que nous sommes déjà très exposés vis-à-vis d’eux.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Merci infiniment pour cette présentation.
*
* *
Audition de M. Corso Bavagnoli, sous-directeur « banques et financement d’intérêt général » à la direction générale du Trésor au ministère des finances et des comptes publics et au ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Monsieur Bavagnoli, soyez le bienvenu. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
M. Corso Bavagnoli, sous-directeur « banques et financement d’intérêt général » à la direction générale du Trésor. En tant que sous-directeur chargé du secteur bancaire et du financement d’intérêt général à la direction générale du Trésor, je m’occupe des problématiques bancaires, des pratiques de financement et de celles, plus spécifiques, liées à la mise en place d’outils publics tels que le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), lequel est notamment au service du financement des entreprises et des collectivités.
Diverses instances, comme la Cour des comptes ou l’Inspection générale des finances, se penchent sur la dette des établissements publics de santé. Notre administration n’ayant pas la tutelle des hôpitaux, son premier souci n’est pas la gestion des hôpitaux ni leur logique budgétaire. Elle possède en revanche une connaissance précise des marchés de crédits et de la mobilisation des financements publics et privés en faveur du secteur hospitalier.
J’évoquerai l’accès des établissements de santé au financement à moyen et long terme, puis les problèmes de trésorerie, enfin les émissions obligataires, qui forment un compartiment du financement à moyen et long terme, et se développent tant pour les collectivités territoriales que pour les hôpitaux. Si vous le souhaitez, je répondrai à vos questions sur la pratique spécifique des emprunts structurés.
À l’automne 2008, puis en 2011, lors du second épisode de la crise, qui a été très sévère pour le secteur bancaire français, les pouvoirs publics, craignant un assèchement du financement à moyen et long terme des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, ont décidé d’intervenir en urgence. Ils ont mobilisé le fonds d’épargne de la CDC, au sein duquel ils ont ouvert, en 2011 et 2012, des enveloppes exceptionnelles en faveur du secteur hospitalier. Grâce à ce fonds consacré aux financements de moyen et long terme, les hôpitaux ont continué à bénéficier d’un flux de financement, dans une période où le risque qu’ils représentaient, au même titre que les collectivités territoriales, était perçu de manière plus négative que par le passé.
Par la suite, les financements ont été pérennisés, puisque le Gouvernement a mis en place sur le long terme – au-delà de vingt ans – une enveloppe de 20 milliards d’euros, dont les hôpitaux bénéficient également. On considère que 10 % à 12 % des montants distribués par le fonds d’épargne ont été octroyés à des hôpitaux, pour que ceux-ci restent financés dans un contexte de tension de l’offre bancaire.
Le Gouvernement a souhaité créer un dispositif destiné à prendre le relais de Dexia, dont les parts de marché se composaient pour 30 % du marché des collectivités locales et pour 40 % de celui des hôpitaux. La faillite de cette banque, qui s’est jouée en deux temps, en 2008 puis en 2011, a provoqué un trou dans le financement des hôpitaux tant à court terme qu’à moyen et long terme, puisque l’offre s’est asséchée dans un contexte de crise où les hôpitaux inspiraient une défiance particulière aux établissements de crédit. Le Gouvernement a recréé, grâce à La Banque postale et au lancement de la Société de financement local (SFIL), une offre bancaire dont le volume a été calibré pour se substituer globalement au financement de Dexia. Ces outils sont désormais opérationnels. Toutefois, il n’est pas certain que La Banque postale SFIL finance exactement les mêmes hôpitaux que Dexia. Les situations particulières doivent être étudiées au cas par cas.
En 2012 et 2013, nous avons connu des épisodes difficiles, notamment sur les crédits de court terme. Je me souviens que, le 1er juillet 2012, les crédits de court terme de Dexia, dont le nombre avait déjà diminué, ont tous été interrompus. Par anticipation, nous avions alors mobilisé La Banque postale également sur le court terme. La SFIL couvre tous les segments de maturité, du court terme au moyen et au long terme.
L’offre proposée étant commensurable à celle que Dexia déployait avant la crise, le ministère considère qu’il n’existe pas d’insuffisance globale de financement, ce que confirment plusieurs indicateurs.
La dette des hôpitaux a augmenté de 15 % entre 2011 et 2013, ce qui pose au demeurant plusieurs questions, comme celle de la tutelle des hôpitaux et des raisons de cette augmentation. Le montant du compte du Trésor sur lequel les hôpitaux doivent centraliser leur trésorerie a augmenté de 40 % pendant la période. En somme, aucun indicateur ne révèle l’existence d’un stress de financement pour les hôpitaux, ce qui n’exclut pas l’existence de difficultés ponctuelles.
La question de la tarification nous a vivement préoccupés, les taux d’intérêt payés par les collectivités et les hôpitaux ayant beaucoup augmenté en 2009 et plus encore en 2011. Notons d’ailleurs qu’avant cette période, les taux d’endettement étaient trop bas, ce qui explique en partie la faillite de Dexia. Pour offrir des taux faciaux très bas, cette banque a développé une structuration qui lui permettait de gagner, grâce aux commissions, l’argent qu’elle ne gagnait pas sur les taux d’intérêt, et à rechercher des ressources moins chères. L’établissement s’est ainsi retrouvé en situation de financer des prêts de moyen et long terme avec un bilan reposant sur des ressources courtes, ce qui créait un écart important entre un actif long et un passif court avec un risque de taux structurel. Ce modèle, fondamentalement déséquilibré et malsain, a conduit à la faillite la plus lourde et la plus coûteuse pour les finances publiques que la France ait connue depuis celle du Crédit lyonnais.
De ce fait, nous n’avons jamais pensé qu’il fallait revenir à la situation d’avant 2008. Des études ont d’ailleurs été menées pour établir les responsabilités et comprendre les causes d’une situation qui a perduré sans que des alertes se déclenchent. Le ministère accepte le principe d’un rehaussement des taux de crédit, qui accompagne un assainissement du marché du prêt aux collectivités locales et aux établissements de santé. Le rééquilibrage de l’offre et des tarifs ne doit cependant pas aller trop loin, notre but n’étant pas que la tarification devienne prohibitive. En 2011, nous avions d’ailleurs remarqué que les tarifs avaient beaucoup augmenté, ce qui nous a préoccupés, dès lors qu’ils dépassaient le rééquilibrage nécessaire.
Pour détendre le marché, nous avons fait intervenir la CDC, qui propose une tarification plus adaptée, sans marge, correspondant à celle du Livret A plus cent points de base. Nous avons également incité à la création d’un nouvel acteur. Des banques sont revenues à des degrés divers sur le marché des collectivités locales et des hôpitaux, où certaines, comme la Caisse d’épargne, sont allées plus loin qu’auparavant.
Autant de facteurs qui ont induit une baisse sensible des taux depuis deux ans. Pour les collectivités locales, le spread, soit le différentiel de taux, est de cinquante points de base sur l’Euribor, taux de référence du marché monétaire interbancaire européen. Compte tenu du niveau très faible des taux de référence – Euribor, taux de la BCE (Banque centrale européenne) –, les taux d’endettement sont historiquement faibles, avec des spreads de crédit qui semblent raisonnables, signe que le marché s’est assaini.
Le superviseur bancaire n’observe plus d’offres comparables à celles de 2008, non seulement parce qu’elles ne tentent plus les établissements de crédit, mais parce que l’encadrement réglementaire les interdit, depuis la loi de séparation de juillet 2013. La situation actuelle se caractérise par une baisse du coût du crédit. Si le montant de celui-ci est plus élevé qu’avant 2008, c’est en raison d’un rééquilibrage nécessaire ; il est sensiblement plus faible qu’en 2011 et 2012.
On constate enfin une progression des émissions obligataires. Celles des collectivités locales atteignent 2 à 3 milliards d’euros par an. Les hôpitaux suivent la même évolution. Collectivités locales et hôpitaux s’unissent de plus en plus souvent pour lever des émissions obligataires groupées, évolution que nous encourageons, car elle leur permet de diversifier leurs sources de financement et de mieux négocier avec les banques. Le développement de ce marché se heurte toutefois à des limites intrinsèques, car ces émissions obligataires prévoient un remboursement in fine, et non au fil de l’eau, ce qui n’intéresse pas tous les investisseurs.
M. le coprésident Pierre Morange. Ne faut-il pas distinguer la situation des collectivités de celle des hôpitaux ? Si les unes peuvent maîtriser leurs recettes – en jouant sur la fiscalité locale –, ce n’est pas le cas des autres, qui, de surcroît, ont plus de mal à maîtriser leurs dépenses, liées à masse salariale ou aux achats.
Par ailleurs, comment apprécier la valeur patrimoniale du parc hospitalier public ou privé ? Je m’étonne qu’aucune réflexion sur le sujet n’ait été menée en amont.
M. Corso Bavagnoli. Cette question se pose quand des banques demandent un gage pour un crédit, mais les émetteurs obligataires n’envisagent pas de saisir des biens. Ils s’intéressent surtout à la capacité de remboursement de l’hôpital, qui dépend de ses recettes, de sa gestion et des garanties qu’offrent les collectivités de rattachement. L’existence d’un gage constitué par le patrimoine mobilier ou immobilier de l’hôpital n’intervient pas en première ligne dans l’analyse d’un crédit.
M. le coprésident Pierre Morange. Certains hôpitaux empruntent pour payer leur personnel, ce qui donne le vertige.
M. Corso Bavagnoli. Cette situation mérite d’être regardée, mais c’est à la tutelle de l’hôpital de se prononcer sur le sujet.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. On a l’impression que l’encours de la dette a grossi au fil des années sans qu’aucun contrôle se soit exercé. Les autorités de tutelle des hôpitaux étaient jadis les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), auxquelles ont succédé les agences régionales de santé (ARS). Le ministère des finances peut-il jouer, à leur égard, un rôle de mise en garde ?
M. Corso Bavagnoli. Nous ne disposons pas d’un tel pouvoir. La direction générale du Trésor adapte la réglementation bancaire aux problématiques des collectivités et des hôpitaux. Le superviseur bancaire, c’est-à-dire la Banque de France, vérifie que les établissements de crédit se conforment à la réglementation. À défaut, elle les sanctionne. N’étant pas l’autorité de tutelle des hôpitaux, nous n’avons pas à émettre d’agrément sur leurs investissements ou leur budget, tâche qui incombe à la direction générale de l’offre de soins (DGOS) ou à la direction du budget ou à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Enfin, nous n’avons aucune prise sur leur comptabilité, donc sur leur décision de financer leur fonctionnement par l’emprunt.
M. le coprésident Pierre Morange. Quand on connaît la valeur du patrimoine hospitalier, il est plus facile non seulement de conclure un investissement, mais aussi de répondre au problème du stock de la dette, qui place certains établissements dans une dépendance financière inquiétante.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Quels seront les contours du fonds de soutien destiné à désensibiliser les encours sensibles des établissements ?
M. Corso Bavagnoli. En avril dernier, la décision a été prise de mettre en place un fonds de soutien aux établissements publics de santé, sur le modèle du fonds dédié aux collectivités locales, qui a d’ores et déjà reçu ses premiers dossiers, et pourra décaisser certaines sommes avant la fin de l’année.
Pour des raisons d’organisation, il existe en effet deux fonds différents de soutien. Le fonds de soutien aux établissements publics de santé, dont le principe a été arrêté, sera opérationnel en 2015. Il faudra que l’on tienne cette date. Doté de 100 millions d’euros, qui seront décaissés sur trois ans, il a été abondé tant par Dexia et par la SFIL – qui portent près de 80 % des emprunts structurés des hôpitaux – que par des ressources budgétaires. L’équilibre entre les ressources d’origine bancaire et les financements budgétaires est le même qu’au sein du fonds dédié aux collectivités locales.
La DGOS en est train d’élaborer la doctrine de fonctionnement de ce fonds. Elle se demande notamment quels seront les emprunts éligibles, quel sera leur montant et quel sera le montant de l’aide publique. Le dispositif s’inspirera cependant des principes qui régissent le fonds consacré aux collectivités locales.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Un bilan de l’activité du fonds de soutien aux collectivités locales a-t-il été dressé ?
M. Corso Bavagnoli. Un tout premier fonds, créé il y a deux ans, a bien fonctionné. Son montant a été déboursé, mais selon des critères d’attribution trop imprécis. Pour le deuxième fonds, nous avons mis en place un comité de pilotage présidé par le sénateur Jean Germain et rassemblant des représentants des collectivités locales, des membres du Parlement et des représentants du Gouvernement. Le niveau d’aide est établi par une grille qui détermine le montant dont peut bénéficier une collectivité locale, compte tenu de sa situation financière et du type d’emprunts structurés qu’elle a souscrits.
M. le coprésident Pierre Morange. De combien le premier fonds était-il doté ?
M. Corso Bavagnoli. Ce fonds d’urgence, que l’on peut considérer comme une amorce, disposait de 30 millions d’euros. Le second a été doté de 1,5 milliard d’euros sur dix ans, au fil de l’eau. Sa mise en place apporte la véritable solution au problème.
La situation des collectivités locales est contrastée. L’intervention publique doit bénéficier d’abord à celles qui ont conclu des emprunts très structurés et souffrent d’une grande fragilité financière. Sans entrer dans le débat moral ou dans l’examen des torts ou des responsabilités de chacun, on sait qu’un défaut de paiement est toujours mauvais. En raison du modèle interne des banques, qui régit la tarification du risque, tout défaut fait changer de catégorie non seulement la collectivité concernée mais toutes les collectivités similaires, ce qui a des effets considérables sur l’accès au crédit ou le coût de celui-ci. Notre but est d’éviter tout incident, dans l’intérêt même de l’ensemble des emprunteurs.
M. le coprésident Pierre Morange. La création du fonds de soutien se traduira-t-elle, pour les établissements de santé, par un renforcement de l’exercice de la tutelle et un encadrement plus strict du contrôle des dépenses, par des rationalisations ou par la mise en œuvre d’une réforme structurelle des établissements ? Aider les hôpitaux les plus fragiles ne suffit pas : le dispositif ne deviendra pas vertueux si l’on ne résout pas les problématiques structurelles.
M. Corso Bavagnoli. Il faut distinguer la problématique spécifique des emprunts structurés et la pratique globale de l’endettement. Sur un plan général, notre mission est de vérifier que les marchés de crédit fonctionnent le mieux possible. Désormais, les conditions d’accès des hôpitaux au crédit sont plus encadrées, puisque les ARS doivent systématiquement délivrer une autorisation. L’endettement n’est pas mauvais en soi, si l’on est certain de pouvoir rembourser et que l’emprunt est bien adossé au projet qu’il finance.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est à quoi veille normalement le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO).
M. Corso Bavagnoli. Oui. L’endettement sert à financer des projets de moyen et long terme, et non à régler des dépenses de fonctionnement ou de court terme. Il faut aussi ajuster les engagements aux ressources. L’analyse financière est faite par la direction de l’hôpital et par l’établissement prêteur, qui doivent dialoguer, après quoi elle est supervisée par l’autorité de tutelle.
M. le coprésident Pierre Morange. En dix ans, la dette des établissements de santé a triplé. Pensez-vous que les directeurs d’établissement ou le personnel des ARS aient les compétences suffisantes pour contracter des engagements financiers à moyen et long terme ? Le modèle est-il devenu plus satisfaisant sur le plan financier et bancaire ?
M. Corso Bavagnoli. La question est fondamentale tant sur le plan financier que sur celui de la responsabilité. On le mesure en cas de contentieux.
M. le coprésident Pierre Morange. Certains directeurs d’établissement ou d’ARS évoluent dans un climat d’irresponsabilité effrayant : ils ignorent qu’ils peuvent être poursuivis pendant plusieurs années pour certaines décisions.
M. Corso Bavagnoli. La réglementation du crédit impose une mise en garde à l’égard des établissements, qui n’a pas la même portée pour un petit hôpital et pour un établissement dont la direction financière est très structurée. Leur situation est aussi hétérogène que celle des collectivités locales ou des entreprises. Elle dépend notamment du contrôle de gestion et de la direction financière interne. C’est pourquoi il faut être prudent quand la réglementation ouvre aux hôpitaux l’accès à de nouveaux produits, comme les obligations et les billets de trésorerie.
Un débat s’est ouvert sur ce point. À mon sens, il faut réserver ces outils très utiles à des gens qui savent les manier. Le fait que les obligations doivent être remboursées in fine crée à terme un risque de refinancement. Pour prendre le relais, il faudra soit des crédits bancaires soit une émission obligataire. Autant dire que ces outils ne peuvent intéresser que des gens qui savent planifier leur trésorerie à long terme et qui possèdent une surface financière suffisante.
Les billets de trésorerie doivent être réservés aux gros hôpitaux qui, au vu de certains critères, semblent dotés d’une capacité suffisante. Moins chers en terme de taux qu’un crédit bancaire, ces billets sont cependant très coûteux en frais de gestion, puisqu’ils exigent de réaliser un prospectus et un appel public à l’épargne, et d’avoir des auditeurs particuliers. Ces coûts, auxquels on ne pense pas immédiatement, mais qui peuvent se prolonger, doivent être intégrés au calcul global. La complexité du produit comme la nécessité de le maîtriser dans la durée et de calculer son coût d’utilisation justifient la mise en place d’un contrôle. Il faut expérimenter le dispositif étape par étape, en élargissant progressivement son périmètre d’application.
M. le coprésident Pierre Morange. Combien représentent ces coûts financiers collatéraux ?
M. Corso Bavagnoli. Je rechercherai le chiffre, que je vous transmettrai.
M. le coprésident Pierre Morange. Il serait bon que tous les décideurs le connaissent.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Qu’arrivera-t-il, à plus ou moins long terme, si un établissement n’arrive pas à obtenir la ligne de trésorerie dont il a besoin pour continuer à fonctionner ? Comment fera-t-il pour payer son personnel ?
M. Corso Bavagnoli. Il est arrivé que des établissements de crédit interrompent leur ligne de trésorerie, comme l’a fait Dexia en juillet 2012. Cependant, il existe, au niveau global, un marché de lignes de trésorerie bancaire pour les hôpitaux.
Un rapport de l’Inspection générale des finances daté de mars 2013 préconise d’interdire à moyen terme le recours aux lignes de trésorerie, mais la recommandation ne semble pas relayée par la Cour des comptes. Le recours à la dette paraît légitime à moyen et long terme, puisque certaines opérations, comme l’achat d’un nouvel équipement médical, doivent être lissées sur plusieurs années. Le court terme, lui, dépend essentiellement d’un effort de gestion. Les hôpitaux doivent rendre leurs plans de financement plus robustes. Quand ils y seront parvenus, ils devront réduire les besoins de financement à court terme.
Le raisonnement est générique. Il faut établir des distinctions entre les différents types de structures. Quoi qu’il en soit, la décision ne peut pas être prise du jour au lendemain. Elle devra sanctionner un effort d’amélioration structurelle.
M. le coprésident Pierre Morange. Malheureusement, il faut généralement attendre cinq ans avant que les réformes structurelles produisent leurs effets. L’État mène-t-il une réflexion sur le secteur médico-social, dont la situation patrimoniale et financière est encore plus mal connue que celle du secteur médical ? A-t-on évalué la dette des établissements de soins et de prise en charge au titre de la dépendance et du handicap ?
M. Corso Bavagnoli. C’est une analyse que nous n’avons pas menée.
M. le coprésident Pierre Morange. On doit parfois financer des équipements sans savoir combien coûte le fonctionnement de l’établissement, dont le budget reste une boîte noire. Est aussi souvent ignorée la valeur de son patrimoine, parfois issu de legs. Ni les instances sollicitées, comme la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), ni les collectivités ne disposent de cette information.
M. Corso Bavagnoli. Je ne connais pas le financement du secteur médico-social, et je ne suis pas sûr que les banques y jouent un rôle important. Sa gestion et son mode de tarification nous échappent en partie.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. En tant que députée du Gers, je préside le conseil de surveillance d’un centre hospitalier, qui comporte un service d’urgence, mais pas de plateau technique. La perceptrice représente les finances publiques lors des conseils d’administration ainsi que dans le suivi du budget.
M. Corso Bavagnoli. Cet agent de la direction générale des finances publiques, ancienne direction de la comptabilité publique, est chargé de la comptabilité du secteur local, donc des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent.
Au niveau national, les percepteurs fixent les normes comptables pour les collectivités locales. Au niveau local, ils sont chargés du contrôle des comptes. Reste à savoir quelle est leur efficacité, quelle est la qualité de leur contrôle et quel dialogue on peut engager avec eux. J’imagine que, sur ce point, les avis sont divergents.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie.
*
* *
Audition de M. Jean Debeaupuis, directeur général de l’offre de soins (DGOS) au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Monsieur Debeaupuis, pourriez-vous nous présenter la direction générale de l’offre de soins (DGOS) ?
Quel constat général dressez-vous sur les conditions de financement du secteur public hospitalier ? Connaissez-vous le montant de la dette des établissements publics de santé à la fin 2013 ?
M. Jean Debeaupuis, directeur général de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. La DGOS est chargée de l’ensemble de l’offre de soins, c’est-à-dire de tous les professionnels de santé des établissements publics et privés. Son action intègre aussi bien l’organisation des soins, que la coopération, la formation initiale et continue, le droit des autorisations, le financement. Elle travaille en lien avec les autres directions du ministère et sous l’autorité de la ministre Mme Marisol Touraine.
La DGOS comprend trois sous-directions. La sous-direction de la régulation de l’offre de soins, chargée de la construction de la politique de premier recours et de la synthèse organisationnelle et financière. La sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins, qui suit la situation financière de chaque établissement, en particulier leurs investissements, évalue la performance des systèmes d’information, et veille à la qualité et à la sécurité des soins. Enfin, la sous-direction des ressources humaines du système de santé, dont la mission essentielle est de veiller à l’adéquation des ressources humaines – des professionnels, libéraux ou salariés – aux besoins de la population.
La DGOS est particulièrement vigilante sur la situation financière des établissements, en particulier sur la dette hospitalière. En lien avec la direction générale des finances publiques, qui centralise les comptes des établissements publics de santé et le dernier suivi infra-annuel disponible au premier trimestre de l’année suivante, nous établissons la synthèse des comptes d’exploitation principaux et annexes des établissements, ainsi que de leurs tableaux de financement et de leur bilan. Cela nous permet de suivre l’évolution de l’investissement et les modes de financement correspondants – autofinancement, emprunt ou subventions.
C’est afin de remédier à la problématique de la nécessaire modernisation des hôpitaux – développement de la médecine ambulatoire et renouvellement des équipements –, que le plan Hôpital 2007 et le plan Hôpital 2012 ont été mis en œuvre. Le premier, parti du constat d’une grande vétusté dans de nombreux établissements, prévoyait le financement de 10 milliards d’euros d’investissement sur cinq ans, grâce à une aide nationale de 6 milliards, dont 1 milliard a été versé sous forme de capital par le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, et 4,7 milliards sous forme d’aide en fonctionnement, c’est-à-dire par le versement d’une part de dotation permettant de couvrir des annuités de remboursement des emprunts des établissements.
Ce mécanisme, qui n’était pas celui initialement prévu par le gouvernement de 2002, puisqu’une part plus large en capital avait été envisagée, s’est révélé efficace en termes de modernisation des installations, de regroupement de sites, d’amélioration de l’hôtellerie hospitalière, de renouvellement des plateaux techniques. En revanche, il a présenté l’inconvénient majeur, pointé tant par les acteurs de santé que par les pouvoirs publics et la Cour des comptes, d’alimenter l’endettement des établissements, qui s’est accru sur la période.
Pour le plan suivant, Hôpital 2012, qui prévoyait également 10 milliards d’euros d’investissement sur cinq ans, le gouvernement de l’époque n’en a lancé que la première tranche, à hauteur de 4,6 milliards d’euros, dont 2,2 milliards d’euros d’aides versés avec des ratios légèrement améliorés en part en capital, à hauteur de 626 millions d’euros, et le reste également sous forme d’aide couvrant le coût du recours à l’emprunt.
Le gouvernement actuel a établi le constat que les plans induisent des effets d’accumulation ou des effets d’aubaine et, par conséquent, des à-coups dans la gestion des dossiers d’investissement. Il a donc pris la décision d’abandonner cette logique de plan, ce qui a amené la ministre à installer, fin décembre 2012, le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO), chargé de la supervision financière des établissements. Cet organisme étudie l’accompagnement des établissements les plus en difficulté sur le territoire national, de préférence les plus gros, en termes de performance et de retour à l’équilibre financier – les plus petits étant davantage suivis par les agences régionales de santé. Le nombre d’établissements concernés au niveau national est très limité, puisque nous en suivons 45, dont une vingtaine sont accompagnés activement. Le retour d’expérience montre que l’accompagnement actif des établissements les plus en difficulté, avec l’aide de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) et des ARS (agences régionales de santé), se révèle efficace, en leur permettant de revenir à une situation plus soutenable en termes de fonctionnement et d’investissement.
Ce comité traite également des opérations majeures d’investissement pour deux types d’établissements. D’une part, les établissements en difficulté financière qui ne sont pas capables d’autofinancer leurs opérations majeures, en particulier celles présentant des risques particuliers – risque sismique en outre-mer, risque lié à l’amiante –, ce qui nécessite des reconstructions complètes. Ces dossiers sont fortement soutenus par les pouvoirs publics et font l’objet d’un examen très attentif. D’autre part, les établissements investis dans des opérations exemplaires en termes de reconfiguration de l’offre de soins, très fortement tournées vers l’ambulatoire et qui préfigurent l’hôpital de demain, comme l’opération de reconstruction majeure du CHU de Nantes. La vingtaine d’opérations financées par le COPERMO dans ce cadre concernent des établissements dont la situation financière est correcte et l’effort de modernisation important.
Le COPERMO tient des réunions tous les deux mois sur le volet « investissement », en alternance avec celles consacrées au volet « performance ». De la sorte, l’effet d’accumulation est évité. Les dossiers sont instruits régulièrement en lien avec les ARS, lesquelles soutiennent les opérations moyennes et petites, c’est-à-dire qui correspondent à leur capacité financière.
À ce jour, 26 opérations majeures ont été approuvées par le Gouvernement, et ce dans un cadre interministériel puisque tous les projets d’investissement ont été soumis à un processus d’évaluation socio-économique préalable, sous l’autorité du Premier ministre et la supervision du Commissariat général à l’investissement.
L’effet d’accumulation des dossiers d’investissement s’est traduit entre 2002 et 2009 par un doublement du niveau d’investissement des établissements publics de santé, qui est ainsi passé de 3 milliards à 6,6 milliards d’euros sur la période. Ce pic historique de 2009 s’est révélé insoutenable, si bien que la ministre a prévu, pour la période 2012-2022, de ramener ce niveau à 4,5 milliards d’euros par an. Il devrait être atteint en 2014, après avoir progressivement décru, à 5 milliards d’euros en 2013.
L’endettement des établissements résulte, d’une part, des souscriptions d’emprunts nouveaux, et, d’autre part, des emprunts précédents. Au sein de cette dette à long terme, la part obligataire est marginale. Ce moyen de financement, à échéance de dix ans et parfaitement sécurisé, a été utilisé en premier lieu par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, puis un certain nombre de CHU ont procédé à trois émissions obligataires.
Sur la période 2008-2013, les remboursements d’emprunt ont été à peu près stables, à hauteur de 2 milliards d’euros, mais le niveau des emprunts nouveaux souscrits par les établissements a régulièrement décru, passant de 5 milliards d’euros en 2008-2009 à 3 milliards d’euros en 2013. Ainsi, le niveau d’endettement des établissements a progressivement ralenti : le solde net des emprunts nouveaux – de 3 milliards d’euros en 2008-2009 – a également décru pour atteindre 1 milliard d’euros en 2013, pour une dette qui est passée de 28 milliards à 29 milliards d’euros en 2013. Ces chiffres provisoires, issus de l’analyse des bilans des établissements et utilisés par la Cour des comptes pour son rapport 2012, seront publiés sur le site du ministère dans les semaines à venir. Cette progression de l’endettement de 28 à 29 milliards d’euros, soit moins de 3 % d’augmentation, correspond à la progression des produits d’exploitation des établissements. Je rappelle à cet égard que, conformément au décret du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé, le recours à l’emprunt par les établissements dont la situation financière présente au moins deux caractéristiques sur les trois mentionnées par ce décret est subordonné à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. Ces caractéristiques sont : un encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, supérieur à 30 % ; un ratio d’indépendance financière, qui résulte du rapport entre l’encours de la dette à long terme et les capitaux permanents, excédant 50 % ; et une durée apparente de la dette excédant dix ans.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Que pensez-vous de la proposition du rapport de l’IGF (Inspection générale des Finances) de mars 2013 préconisant de supprimer l’accès au crédit de court terme pour les hôpitaux ? Cela ne risque-t-il pas de mettre les établissements en difficulté ?
M. Jean Debeaupuis. Les financements à court terme relèvent de la gestion de trésorerie des établissements. En accumulant des déficits année après année, certains établissements détériorent leurs paramètres financiers fondamentaux, mais aussi leur trésorerie car ils sont contraints de « piocher » dans leur fonds de roulement. Ils finissent par ne plus trouver plus d’établissement bancaire pour leur consentir des prêts à court terme comme à long terme. En effet, les établissements bancaires sont devenus plus sélectifs et refusent de financer les établissements dont la situation est très dégradée. D’où la démarche d’accompagnement des établissements visant à les ramener progressivement et sur une durée raisonnable à un mode de financement soutenable à la fois sur le court terme et le long terme.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Pouvez-vous présenter la stratégie de désensibilisation des encours sensibles pour les hôpitaux publics ?
M. Jean Debeaupuis. Selon la dernière enquête réalisée sur la dette des établissements, 84 % de l’encours de la dette – soit 24,5 milliards sur 29 milliards – correspondent à des emprunts non structurés, c’est-à-dire sans risque, à la fin 2013.
Les emprunts structurés au sens large, y compris ceux dépourvus de risque, représentent ainsi seulement 16 % de l’encours de la dette. Quant aux emprunts structurés à risque, ils représentent 10 % de la dette, soit 2,9 milliards d’euros – les plus risqués, dénommés « hors charte Gissler », atteignent 1 milliard d’euros, soit 3,4 % de la dette des établissements.
La part des emprunts les plus dangereux est en baisse. D’une part, parce que le nombre d’établissements concernés est relativement limité – ils sont 70 à avoir souscrit ces emprunts, à des hauteurs très variables, parmi lesquels de grands comme de petits établissements. D’autre part, parce que la stratégie mise en place par le ministère, en lien avec les organismes bancaires – Banque postale, Caisses d’épargne, mais aussi Banque européenne d’investissement – permet de conseiller et d’accompagner les établissements pour sortir de ces prêts à risque. Cette stratégie se décline en deux actions conjointes.
La première, particulièrement adaptée aux « gros » établissements, consiste à faire évoluer les taux d’intérêt pour sortir de ces prêts structurés, notamment à l’occasion de la souscription d’un nouvel emprunt. En effet, la souscription d’un nouveau prêt permet à l’hôpital de négocier avec l’établissement bancaire, notamment la Société de financement local (SFIL), la sortie du mode structuré afin de sécuriser la dette. Cette action est progressive, mais efficace, auprès d’un certain nombre d’établissements. Une vingtaine seulement ont engagé un contentieux.
La deuxième action, davantage ciblée sur les petits établissements, est la mise en place d’un fonds d’intervention de 100 millions d’euros, sur trois ans, dont 25 millions d’euros seront apportés par les banques elles-mêmes. Ce dispositif, annoncé au printemps dernier, sera finalisé à la fin de l’année, comme l’a confirmé la ministre, qui a fait le choix de l’orienter plus spécialement vers les petits hôpitaux, dont les moyens techniques et les capacités de négociation sont limités par rapport à ceux des plus gros établissements. Cela ne résoudra pas tous les problèmes, mais aidera ceux en grande difficulté à sortir de ces emprunts sensibles. Néanmoins, la ministre n’exclut pas un accompagnement complémentaire pour les établissements grands ou moyens confrontés à des difficultés spécifiques.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Pouvez-vous détailler l’évolution de la tutelle des agences régionales de santé s’agissant des décisions de financement des établissements de santé ? Comment les ARS ont-elles pu laisser les établissements s’endetter à ce point ? Leurs missions doivent-elles évoluer ?
M. Jean Debeaupuis. Les investissements en vue de reconstructions complètes, portées par l’ensemble de la communauté hospitalière, sont des décisions lourdes validées par les pouvoirs publics. En effet, les agences régionales de santé approuvent l’état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements, ainsi que leur plan global de financement pluriannuel (PGFP) qui détermine, sur une période de cinq à dix ans, leur trajectoire financière et permet de vérifier la soutenabilité des opérations d’investissement.
Les conditions de soutenabilité pour un établissement sont doubles. Il s’agit, d’abord, de préparer l’avenir, en assurant sa modernisation ou sa reconversion, ce qui s’avère très souvent nécessaire au regard de l’offre de soins. Ces décisions ont une légitimité forte, mais elles doivent s’inscrire dans une trajectoire financière soutenable, même si le modèle de financement des établissements peut évoluer en fonction des décisions politiques – fin de la dotation globale, tarification à l’activité, politique d’investissement, etc.
Il s’agit, ensuite, d’assurer à l’établissement un cycle d’exploitation équilibré et sécurisé. Le fait de s’endetter modérément peut être soutenable, pour peu que les conditions d’exploitation soient solides. À l’inverse, cumuler un endettement excessif, éventuellement lié à des emprunts structurés, et des déficits budgétaires est fatalement insoutenable.
En 2012, la ministre a souhaité que l’ensemble des opérations d’investissement portées en région soient désormais inscrites dans un schéma régional d’investissement en santé (SRIS), élaboré par le directeur général de l’ARS, dans l’objectif d’identifier les priorités les plus importantes de chaque région. C’est la première action des ARS.
La deuxième, qui s’est imposée en 2011 en raison de la crise financière et du risque d’endettement, est la mise en place des comités régionaux de veille active sur la situation de trésorerie des établissements publics de santé. Ces comités réunissent non seulement le directeur général de l’ARS, mais aussi toutes les autorités compétentes en matière de financement – organismes de sécurité sociale, direction régionale des finances publiques (DRFIP) notamment.
Ainsi, le travail de vigilance et de prévention, premier pilier de la soutenabilité, est réalisé par les ARS soit au titre de l’autorisation explicite des emprunts pour les établissements entrant dans les critères prévus par le décret de 2011, qui représentent 35 % des établissements ; soit au titre de la surveillance de la trésorerie, grâce au réseau des comités régionaux qui font remonter aux ARS et aux DRFIP, voire au niveau national, les difficultés des établissements. En tout état de cause, dans le cadre du soutien de trésorerie assuré par la ministre depuis fin 2012, l’accompagnement est strictement calibré pour ceux qui en ont le plus besoin.
Cette action préventive est primordiale au regard du risque de défaillance potentielle des établissements.
Je rappelle que la situation des établissements, après une période de déficits importants dans les années 2008 à 2011, s’est traduite par un quasi-équilibre en 2012 et 2013 – les chiffres pour 2014 ne sont pas encore disponibles. En effet, le résultat global – tous budgets confondus – des établissements publics s’établit plus ou moins à 0,1 % du budget hospitalier.
Ainsi, cette action renforcée depuis 2012, et davantage ciblée sur les établissements ayant accumulé des difficultés particulières entre 2008 et 2011, a permis d’obtenir des résultats tout à fait probants. Les dispositifs d’accompagnement peuvent aller jusqu’à l’administration provisoire. Ce dispositif d’exception, appliqué à la demande de l’ARS et dans lequel un membre de l’IGAS ou un autre fonctionnaire assure provisoirement, pour une durée de six à douze mois, voire de dix-huit mois, l’administration d’un établissement dont la situation est devenue ingérable pour les pouvoirs publics, permet de préparer les conditions du retour à l’équilibre de l’établissement.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Que pensez-vous de la formation des équipes dirigeantes des hôpitaux en matière financière ?
Dans les petits hôpitaux, le directeur assume toutes les fonctions. En tout cas, celui de l’hôpital dont je suis présidente du conseil de surveillance assure la direction des ressources humaines, la direction financière, la direction des soins. Cela est très lourd et compliqué. Mais j’imagine que les problèmes sont démultipliés dans les grands hôpitaux.
M. Jean Debeaupuis. L’École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes dispense la formation de directeur d’hôpital et celle de directeur d’établissement sanitaire, social ou médicosocial. Ce sont des métiers exigeants, pour lesquels la formation inclut de nombreux modules : qualité et sécurité, gestion des ressources humaines, gestion budgétaire et financière, gestion des fonctions logistiques, médicales, techniques, économiques, etc.
Les plus petits établissements ne sont pas nécessairement les plus en difficulté, et il faut avoir une approche différenciée des catégories d’établissement. C’est la raison pour laquelle la ministre a fait adopter dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 un dispositif dérogatoire selon lequel les hôpitaux de proximité – dont font partie les ex-hôpitaux locaux – qui ne peuvent assurer leur soutenabilité en raison d’un volume d’activité insuffisant bénéficient d’un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations et d’une dotation forfaitaire. Ce dispositif sera déployé en 2015 et 2016.
Une autre orientation, déjà largement mise en œuvre, est la coopération entre les établissements de toute taille et la mutualisation des compétences sur les territoires, en matière de qualité et de sécurité, de traitement de l’information, de logistique, d’achats, de finances. Cette logique est proposée dans le cadre du projet de loi de santé, à travers les groupements hospitaliers de territoire, où les établissements conserveront leur personnalité morale. La pratique des années récentes a, en effet, montré que le développement des directions communes et la mutualisation des compétences permettent de sécuriser le fonctionnement des établissements.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La Cour des comptes propose de permettre l’expérimentation, par les trois plus grands centres hospitaliers régionaux, de l’émission de billets de trésorerie. Cette proposition vous semble-t-elle pertinente ? Quels seraient les avantages et les inconvénients de telles émissions, dont le coût de gestion – du fait des frais accessoires à l’émission – est jugé élevé par la direction du Trésor que nous avons auditionnée la semaine dernière ?
M. Jean Debeaupuis. J’en profite pour compléter ma réponse sur votre question relative à l’accès au crédit de court terme. Comme je vous l’ai dit, les financements à court terme contribuent au bon fonctionnement des établissements, comme pour tout acteur économique. Le ministère de la santé ne voit donc aucune raison d’interdire les lignes de trésorerie aux établissements, sauf difficulté particulière – je vous ai rappelé les différents points de vigilance assurés conjointement par le réseau des ARS, des DRFIP et par le niveau national.
Les billets de trésorerie, pour les financements de court terme, sont l’équivalent des émissions obligataires pour les financements à long terme. Ce type de financement très spécifique est autorisé pour des acteurs économiques publics ou privés de grande taille, notamment les collectivités locales, conformément au code monétaire et financier. Comme pour les émissions obligataires, l’émission de billets de trésorerie requiert un volume de demandes qui soit suffisant.
À la demande du ministère de la santé, la loi bancaire a modifié le code monétaire et financier pour inclure les établissements publics de santé dans la catégorie des acteurs autorisés à émettre des billets de trésorerie. Nous sommes en discussion avec la direction du Trésor pour déterminer les conditions d’application de cette disposition, qu’elle souhaite restreindre aux trois plus grands établissements de santé. Nous plaidons pour une application plus large – pas nécessairement à la totalité des centres hospitaliers régionaux – car cela irait dans le sens de cette mutualisation des compétences dont j’ai parlé. En effet, le retour d’expérience sur les émissions obligataires montre que les établissements sont obligés de se grouper – seule l’AP-HP a la taille suffisante pour émettre seule sur le marché obligataire. Aussi, pour les billets de trésorerie, une action groupée du même type devrait-elle être possible. Au demeurant, le critère de bonne situation financière vaut autant, à notre sens, que le critère de taille. J’ajoute que les billets de trésorerie, comme les émissions obligataires, sont totalement exempts de risque, du fait de la supervision du ministère des finances et de la Banque de France.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Comme beaucoup de Français, je suis très attachée à l’hôpital public et à la qualité de soins. Les difficultés financières de certains hôpitaux – soixante-dix sont dans cette situation – peuvent-elles peser sur leur offre de soins et les amener à abandonner des activités ou des spécialités ?
M. Jean Debeaupuis. Le système de soins français repose, à la fois, sur l’offre de premier recours et les plateaux techniques des établissements de santé publics et privés. L’offre hospitalière en France est plutôt dense, y compris en comparaison avec les pays européens. Dans le cadre du projet de loi santé, la ministre a indiqué que le système de santé devait évoluer vers davantage de prévention, de coopération entre les professionnels autour du parcours de soins, et entrer dans une nouvelle phase de développement de la démocratie sanitaire.
Par définition, l’organisation des soins ne peut pas être figée. Si les investissements hospitaliers visent à moderniser les établissements pour les vingt-cinq ans à venir, l’art médical se transforme : les modes de prise en charge se tournent de plus en plus vers l’ambulatoire, les traitements évoluent. Les chimiothérapies, par exemple, seront le plus souvent orales à l’avenir, même si elles resteront prescrites en établissement. Dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire, le premier recours sera davantage assuré par les hôpitaux de proximité, mais l’accès aux plateaux techniques restera possible si une prise en charge l’exige. En tout état de cause, un système de santé où les patients pourront retourner à leur domicile, bénéficier de soins de suite ou de proximité, ne s’en portera que mieux.
Ainsi, l’action du ministère vise depuis deux ans à soutenir les établissements dont l’offre de soins sur le territoire est indispensable. En revanche, cela ne dispense pas les établissements d’évoluer, de réorganiser leurs activités, de coopérer entre eux. De cette façon, la qualité et la sécurité des soins seront maintenues, sachant que certains établissements peu attractifs, qui ont du mal à assurer ces standards de qualité et de sécurité des soins, sont contraints d’abandonner certaines activités. Celles qui exigent une certaine technicité, par exemple la chimiothérapie ou la chirurgie, devraient être réalisées soit en coopération avec un établissement plus important, soit sur un plateau technique un peu plus éloigné, mais où la qualité et la sécurité des soins seront mieux garanties.
Mme Joëlle Huillier. Cette crise de l’endettement n’est-elle pas l’élément déclencheur permettant d’amener les hôpitaux publics à stopper leur fuite en avant pour recentrer leur offre de soins ?
M. Jean Debeaupuis. Toute l’action de la ministre vise à graduer l’offre de soins sur les territoires. Les notions de régionalisation et de territorialisation de l’offre de soins – reprises par le projet de loi de santé – signifient que les établissements ne peuvent pas faire tout et n’importe quoi dans leur coin. D’où la nécessité d’une politique régionale, d’une part, et d’une coopération au niveau des territoires, d’autre part, gages de qualité et de sécurité des soins au bénéfice des patients.
Les établissements de proximité, au nombre de 300 sur les 700 établissements de court séjour, assureront des soins davantage tournés vers la gériatrie et la médecine courante. Ils représentent une première échelle de soins gradués.
Mme Joëlle Huillier. Je suppose que vous parlez de l’hôpital local.
M. Jean Debeaupuis. Je parle des ex-hôpitaux locaux, dont l’appellation a disparu en 2009. La ministre a proposé celle d’« hôpital de proximité », qui correspond aux établissements assurant moins de 1 000 séjours de médecine par an, incluant les anciens hôpitaux locaux.
Le deuxième niveau est celui des établissements moyens, voire des têtes de département, qui disposent d’un plateau technique plus important et proposent une offre de soins développée.
Enfin, les 32 établissements dits « régionaux », lieux de formation et de recherche, constituent le recours le plus élevé.
Cette dimension de coopération et de gradation des soins, qui s’est imposée depuis de nombreuses années, est très importante. Chacun peut y trouver sa place, mais personne ne peut être exonéré d’une adaptation permanente aux besoins de la population. C’est tout le sens des projets régionaux et des projets territoriaux de santé, portés par le texte du projet de loi, avec un accent plus fort sur la prévention et le parcours de soins. Les manques ou les ruptures dans le parcours de soins seront ainsi évités grâce à une coopération accrue entre les différents réseaux d’établissement.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Pensez-vous utile que la MECSS auditionne le directeur de l’EHESP sur la formation des directeurs d’hôpitaux ?
M. Jean Debeaupuis. Tout à fait son actuel directeur, M. Laurent Chambaud pourrait vous apporter des précisions sur la formation des directeurs et des autres professionnels, à la fois en matière de santé publique et de management, sachant que le volet sur les aspects financiers est régulièrement actualisé – il intègre des enseignements sur la tarification à l’activité, l’analyse financière et les acteurs bancaires notamment. Ainsi, les compétences des directeurs d’établissement sont tout à fait solides sur ces aspects. Connaître les conditions de soutenabilité financière à court et long termes est indispensable lorsqu’on assume une telle responsabilité. Pour en avoir discuté avec lui, je peux vous dire que le directeur de l’EHESP y est particulièrement attentif.
Mme Joëlle Huillier. Il faudrait prévoir une formation analogue pour les ex-inspecteurs des DDASS et des DRASS (directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales), qui travaillent aujourd’hui dans les ARS. Pour avoir exercé une tutelle hospitalière pendant quarante ans, je peux vous dire que mes anciens collègues se sentent incompétents en matière financière : ils savent globalement ce qu’est un budget, mais ils n’ont pas de connaissances sur la capacité d’un établissement à faire face au remboursement du capital et des intérêts – ils n’en avaient pas non plus sur les emprunts toxiques au moment où cette problématique a émergé.
M. Jean Debeaupuis. Vous pourrez utilement poser la question à M. Chambaud, puisque son école forme également les fonctionnaires du ministère exerçant leurs fonctions dans les ARS.
Sans doute les compétences dans les ARS sont-elles inégalement réparties. Ce métier de supervision nécessite un grand professionnalisme. Les personnels des agences ont beaucoup appris avec la mise en place des EPRD (état des provisions de recettes et des dépenses), la crise financière, le risque structuré. Les directeurs généraux d’agence et les équipes avec lesquelles je travaille sont particulièrement mobilisés et actifs sur ce point. Mais il est vrai que les compétences devraient être actualisées par le biais de la formation initiale dispensée par l’EHESP.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Et la formation continue également. Quel est le poids de l’intérim dans le budget hospitalier ? Notre collègue M. Olivier Véran a rédigé un rapport important à ce sujet.
M. Jean Debeaupuis. Ce rapport fournit des estimations sur l’intérim à l’hôpital. Le montant et les coûts unitaires étant jugés trop élevés, la ministre a proposé une mesure correctrice dans le projet de loi de santé. La dépense en intérim médical ou paramédical des établissements les moins attractifs est très élevée. Il convient de la ramener à un niveau plus normal, ce qui suppose d’améliorer l’attractivité des établissements.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Merci, monsieur le directeur général, de votre contribution, que nous vous demanderons de compléter par un questionnaire écrit.
*
* *
Audition de M. Yves Gaubert, responsable du pôle « Finances et Banque de données hospitalière de France » de la Fédération hospitalière de France (FHF)
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Monsieur Yves Gaubert, après nous avoir présenté brièvement la Fédération hospitalière de France (FHF), nous souhaiterions que vous nous donniez votre sentiment sur l’état de la dette des établissements publics de santé, et sur les instruments financiers mis en place par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes pour aider ces établissements et les accompagner dans leur sortie des emprunts structurés.
M. Yves Gaubert, responsable du pôle Finances et Banque de données hospitalière de France de la Fédération hospitalière de France (FHF). La Fédération hospitalière de France, association relevant de la loi de 1901, a vocation à représenter les établissements publics de santé. La totalité des établissements du secteur sanitaire adhère de fait à l’association. Je suis adjoint au délégué général, en charge du « pôle financier et banque de données ».
La dette des hôpitaux est devenue préoccupante à partir de 2003-2004. Depuis cette période, les gouvernements ont promu des plans d’investissements qui ont fait passer son montant de 10 à 30 milliards d’euros en dix ans. Pour les hôpitaux publics, le financement de ces grands plans, par exemple ceux de 2007 et 2012, reposait quasiment exclusivement sur des dettes contractées auprès du secteur bancaire classique à des taux d’intérêt supérieurs d’environ 1 % à ceux de la dette publique.
Ces prêts avaient de plus une durée longue puisque leur durée de vie résiduelle est actuellement de dix-huit ans. Ils obèrent en conséquence une partie de la capacité d’autofinancement des hôpitaux : 2,5 milliards d’euros sur les 3,5 milliards d’autofinancement dégagés annuellement sont aujourd’hui destinés à l’amortissement de la dette. Ce sont autant de fonds qui manquent pour la modernisation et la restructuration des établissements.
Il y a deux ans, nous estimions que 1,5 milliard d’euros sur les 30 milliards était souscrits sous la forme d’emprunts toxiques ou très risqués. Même si ce montant a baissé, il reste préoccupant, notamment pour un certain nombre d’établissements. Malgré le vote de la loi du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, nous continuons d’orienter ces établissements vers le contentieux. La mise en place d’un fonds de soutien de 100 millions d’euros nous a finalement assez peu rassurés puisque ce montant est financé à 75 % par une forme de mutualisation d’une enveloppe destinée aux hôpitaux – le système bancaire contribuant à hauteur de 25 millions d’euros. D’autant que, contrairement à ce qui avait été annoncé, nous constatons également un désengagement de la Société de financement local (SFIL) en matière d’aide aux plus petits hôpitaux.
Aujourd’hui, la capacité d’investissement des grosses structures hospitalières suscite des inquiétudes. Si l’on applique les ratios d’endettement classique, l’on s’aperçoit que la moitié d’entre elles ont déjà atteint les limites admissibles en termes d’endettement alors même que les besoins d’investissements sont plus forts en période de restructurations et de modernisation médicale. La faiblesse des capacités d’autofinancement constitue un véritable handicap dont l’explication se trouve dans l’application du système de tarification à l’activité (T2A) fondé essentiellement sur le volume des actes. Dans ce cadre, les établissements qui se situent dans des zones à faible croissance démographique ne parviennent pas à générer l’activité minimale permettant de leur allouer des ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins de financement.
Annoncé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le plan de 45 milliards d’euros sur dix ans aurait pu nous rassurer, mais ses modalités de financement ne nous ont pas convaincus. Elles reposent en effet sur une dotation en capital d’environ 2,1 milliards et, pour le reste, sur l’emprunt, à hauteur de 19 milliards d’euros, et sur l’autofinancement. Compte tenu de la dette en cours, ces 19 milliards d’euros constituent un objectif très ambitieux. De la même façon, les marges d’autofinancement de l’hôpital ne semblent pas permettre de dégager annuellement 2,4 milliards d’euros.
La Fédération hospitalière de France préconise en conséquence de déconnecter au moins le financement des investissements lourds du modèle de la tarification T2A qui dépend trop aujourd’hui du volume d’activité alors que, dans certains territoires, il est indispensable de maintenir une offre de soins même si le dynamisme démographique ne permet pas d’engranger les recettes nécessaires.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Monsieur Gaubert, il est inutile que je vous dise notre attachement à l’hôpital public. Pour ce qui le concerne, l’offre de soins actuelle pourra-t-elle être maintenue ? Nous avons conscience que l’on peut raisonner en termes d’offre globale, mais il nous importe de mesurer l’impact des difficultés financières que rencontre l’hôpital public sur son avenir.
M. Yves Gaubert. Des problèmes se posent déjà dans un certain nombre de territoires même si l’on tient compte de la totalité de l’offre de santé – d’autant que l’offre commerciale choisit de s’installer où elle le veut.
Nous ne contestons pas la nécessité de regrouper les plateaux techniques mais, sur le terrain, il n’est pas possible de raisonner uniquement en termes d’activité. De nombreux établissements se trouvent dans la situation de celui avec lequel j’étais en contact il y a quelques jours. Dans un environnement plutôt rural, ce centre hospitalier, site pivot de territoire, constitue la seule offre majeure à 90 kilomètres à la ronde et correspond donc à une offre minimale de soins. En termes démographiques, sa perspective de progression est quasi nulle pour l’obstétrique et de 1,5 point au maximum pour le reste de son activité essentiellement en raison du vieillissement de la population locale. Cette progression d’activité ne correspond pas aux exigences minimales de notre modèle actuel de financement, soit 2,8 % pour 2014. Dans le système en vigueur, un tel établissement ne pourra en conséquence jamais générer une ressource suffisante pour investir et se moderniser. Cet exemple montre qu’il faut cesser de ne considérer que la seule régulation économique au travers de la T2A, pour assurer que l’investissement corresponde aux nécessités réelles d’équipement du territoire en fonction des besoins de la population.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Existe-t-il une typologie des établissements en difficulté ? Les mêmes causes ont-elles eu les mêmes effets pour tous les hôpitaux ?
M. Yves Gaubert. Une situation déficitaire est généralement causée par la conjonction de plusieurs facteurs. Par exemple, certains investissements ont parfois été supérieurs à ce qui était nécessaire. Certains effectifs pouvaient supporter une rationalisation – aujourd’hui ils sont globalement stabilisés alors même que l’activité croît de 2 à 3 %.
Une constante existe cependant pour tous les établissements concernés : la déconnexion entre les produits de l’activité et les coûts de fonctionnement minimaux. Il est en effet impossible de descendre sous certains seuils de dépenses sans cesser de répondre aux besoins de la population et l’obliger à parcourir des distances supérieures à 60 ou 70 kilomètres.
Aujourd’hui, la voilure se réduit partout : l’enveloppe annuelle est respectée, et les ONDAM (objectif national de dépenses de l’assurance maladie) successifs se situent sous l’évolution naturelle des charges – qui est moins le fait des coûts de personnel désormais maîtrisés que des dépenses liées aux progrès médicaux et notamment aux produits très innovants.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Comment expliquer que les hôpitaux publics aient pu souscrire des emprunts toxiques ?
M. Yves Gaubert. Les petites structures ont probablement été poussées à choisir des produits qu’elles ne maîtrisaient pas. Les plus grosses ont sans doute été tentées, en situation financière tendue, par un allégement des frais financiers sur la première période de ces engagements alors qu’elles allaient faire face à de fortes dépenses d’équipement et de fonctionnement liées à leur reconstruction ou leur restructuration. Globalement, les hôpitaux n’ont pas été plus sujets que les collectivités locales à cette vision de court terme destinée à accompagner des modernisations nécessaires.
Évidemment, aujourd’hui, notre analyse de ces choix a évolué. Rappelons qu’en leur temps, ces options n’ont pas été prises sans une large contribution des pouvoirs publics, des agences régionales de l’hospitalisation (ARH) de l’époque, puis des agences régionales de santé (ARS). Jusqu’en 2005, ces emprunts étaient même soumis à la tutelle. Et puis, je le répète : les comportements des hôpitaux ont été assez semblables à ceux des collectivités territoriales.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Ces dernières ont reçu une aide substantielle de l’État pour sortir des emprunts structurés – nous avons appris aujourd’hui que le département de Seine-Saint-Denis venait de renégocier la partie la plus toxique de sa dette. Estimez-vous que le soutien de l’État aux établissements hospitaliers se situe au même niveau ?
M. Yves Gaubert. Aujourd’hui il est clair que ce n’est pas le cas. Les 100 millions d’euros dégagés ne permettent pas de régler le problème posé par 1,5 milliard d’euros de dettes. En fait, il s’agirait surtout de « désensibilisation » car, pour les hôpitaux, les coûts de sortie des emprunts seraient exorbitants et correspondraient quasiment à l’encours de la dette. Pour régler le problème du milliard et demi, il faudrait dépenser 2 ou 3 milliards d’euros, ce qui ne serait pas raisonnable. Cela dit, même pour désensibiliser les emprunts les plus risqués, 100 millions d’euros, c’est un peu juste, d’autant que, je le rappelle, 75 % des sommes engagées proviendront des enveloppes hospitalières globales et seront en conséquence indisponibles pour l’investissement.
C’est bien pourquoi nous incitons encore les établissements, en particulier les petites structures, à engager des contentieux. Je rappelle que ces dernières reçoivent de moins en moins le soutien de la SFIL qui les aidait à couvrir le différentiel entre le taux de l’usure et celui des emprunts toxiques.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Connaissez-vous le nombre d’établissements hospitaliers qui ont engagé un contentieux ?
M. Yves Gaubert. Ils sont peu nombreux à ce jour : une vingtaine, voire une trentaine. Certains attendaient beaucoup du fonds. À l’avenir, il existe un risque qu’ils s’inscrivent en nombre dans cette démarche.
Mme Joëlle Huillier. Qui est concerné par ces contentieux ?
M. Yves Gaubert. Les établissements engagent des contentieux contre les banques qui leur ont prêté. La SFIL gère les dossiers impliquant Dexia.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La formation des équipes dirigeantes des hôpitaux en matière financière vous paraît-elle suffisante ?
M. Yves Gaubert. Pour avoir participé à l’enseignement de l’École des hautes études de santé publique (EHESP), j’estime que le niveau de formation est aujourd’hui objectivement tout à fait satisfaisant.
L’argument ne me semble pas pouvoir être utilisé pour expliquer les choix des directeurs d’établissements hospitaliers qui n’ont pas réagi autrement que les directeurs de service des nombreuses collectivités locales ayant souscrit des emprunts toxiques. Et puis, je vous l’ai déjà indiqué, les équipes dirigeantes n’étaient pas seules : les tutelles étaient engagées – au début du plan Hôpital 2007, il existait même une mission ministérielle chargée de suivre les investissements.
Puisque j’évoque ce plan, il faut également dire que les choses se sont faites à l’époque dans une certaine précipitation. Au-delà de la volonté de moderniser les hôpitaux, il s’agissait, en 2007, d’afficher des résultats en termes de relance économique. Les premiers dossiers de ce plan ont donc été lancés extrêmement rapidement, parfois par des structures qui ne disposaient pas d’autofinancement. On peut parler d’une fuite en avant. Une fois le projet mis en œuvre, il fallait bien le faire fonctionner ce qui, surtout à l’époque, était encore plus coûteux qu’aujourd’hui car on ne lésinait pas sur les mètres carrés. Ces conditions expliquent que la volonté de diminuer la charge de la dette en première période ait conduit à la souscription d’emprunts dangereux.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Quel regard portez-vous sur la tutelle des ARS par rapport aux décisions de financement des établissements hospitaliers ? Leurs missions doivent-elles évoluer ?
M. Yves Gaubert. En 2005, le contrôle était plus léger, puis le balancier est reparti dans l’autre sens. Aujourd’hui, l’investissement est très encadré. Pour les investissements lourds, l’ARS sert de relais vers le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO). Ces contrôles donnent des résultats puisque l’investissement décroît très rapidement : il est passé de 6,5 à 5 milliards d’euros en trois ans.
Mais les ARS doivent aussi jouer un rôle en termes de stratégie, et favoriser les investissements qui, selon les territoires, répondront aux besoins actuels et futurs de la population. Or les leviers utilisés par les ARS sont aujourd’hui extrêmement réduits puisque prédomine le modèle de financement à l’activité. Elles ne disposent donc pas des moyens qui pourraient leur permettre d’aider les établissements à investir.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Le contrôle financier exercé par les ARS serait-il au contraire devenu trop strict ?
M. Yves Gaubert. Tout dépend des ARS, mais il est vrai qu’il a pu être reproché à certaines d’entre elles de trop s’immiscer dans la gestion quotidienne des établissements au détriment de la stratégie, et de ne pas assez soutenir ceux qui, pour se moderniser, avaient besoin d’aide pour accéder au financement.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Des réformes vous paraissent-elles nécessaires afin d’améliorer les contrôles en matière de financement des établissements de santé ?
M. Yves Gaubert. Aujourd’hui, les risques de dérapage financier sont quasi-nuls. Je crois qu’en matière de contrôle on ne peut guère faire plus, sauf à bloquer totalement le système.
Les évolutions à venir devraient plutôt concerner l’investissement hospitalier. À ce sujet, nous attendons beaucoup des travaux du comité de réforme de la tarification hospitalière (CORETA) au sein duquel nous siégeons.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Les ARS jouent-elles leur rôle en matière de stratégie ? Celles qui sont mises en œuvre répondent-elles vraiment aux besoins des populations des territoires ?
M. Yves Gaubert. Les résultats des stratégies d’incitation au regroupement sont variables.
Globalement, les ARS ne disposent pas véritablement des moyens pour aider les restructurations sur la durée. Certains financements manquent de pérennité et les ressources font défaut alors que l’amortissement d’une modernisation ne se fait pas sur le court terme. On se souvient par exemple qu’au moment de la création du Fonds d’intervention régional (FIR), en 2012, des engagements fermes pris par les ARH concernant des restructurations n’avaient pas pu être tenus.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Pouvez-vous nous en dire plus sur le CORETA ?
M. Yves Gaubert. Installé par la ministre, en décembre 2012, le CORETA a vocation à faire des propositions concernant l’évolution du système de tarification hospitalière.
La tarification à l’activité a des mérites – elle a notamment permis de redynamiser l’hôpital public en particulier en ce qui concerne la chirurgie – mais, comme tout système de financement, elle a des effets pervers, car il n’en est pas d’idéal. D’une part, elle favorise les zones à évolution démographique dynamique, d’autre part, elle crée une prime au volume qui peut générer un certain nombre d’activités inutiles. Ce constat a poussé la ministre à créer le CORETA pour lui faire des propositions d’évolutions concernant en particulier le mode de régulation. Ses travaux se poursuivent même si à ce jour aucune évolution majeure du système n’a été proposée. Vous votez chaque année des ajustements, et des modes de régulation nouveaux sont proposés – la notion de « pertinence » a ainsi été introduite par amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Le CORETA, constatant par exemple l’évolution rapide des médicaments de la liste dite « en sus » malgré la régulation par les prix et par les contrats de bon usage, a aussi imaginé un troisième mode de régulation.
Ce qui est sorti du comité jusqu’à aujourd’hui a sans doute souvent ajouté un peu à la complexité du système sans que l’essentiel du dossier n’ait encore été abordé. Sans rompre le lien entre activité et financement, nous considérons qu’il ne faut pas donner uniquement une prime au volume. Il faut pouvoir examiner la situation géographique et démographique de chaque territoire et sortir de l’approche exclusive qui est aujourd’hui en vigueur. Dans les conditions actuelles, aucune réponse ne peut être apportée aux besoins spécifiques des populations – l’installation médicale est évidemment aussi en cause. Nous ne disposons pas aujourd’hui de moyens de correction pour favoriser l’égalité d’accès aux soins, et des « files d’attente » se forment dans certaines zones pour prendre rendez-vous avec des spécialistes.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Le coprésident de la MECSS, M. Pierre Morange, vous aurait sans doute interrogé sur l’évaluation du patrimoine des hôpitaux publics. Une telle évaluation permettrait-elle de mieux apprécier la situation financière des établissements ?
M. Yves Gaubert. Le patrimoine non affecté aux soins est beaucoup moins considérable que certains ont tendance à l’imaginer. Ce patrimoine est important s’agissant de Paris et de Lyon – dans le passé, il l’était à Marseille ou à Beaune. En tout état de cause, il se réduit de façon rapide. À Paris, le déclassement et la revente progressive ont eu lieu – Boucicaut, Broussais et Laennec ont permis de construire l’hôpital Georges Pompidou – ou sont en cours. À Lyon, la vente du patrimoine « privé » se fait progressivement pour ne pas déséquilibrer le marché. En dehors de ces deux territoires, je crains que nous n’ayons affaire à un patrimoine limité. La valorisation de cette dotation non affectée est par ailleurs complexe et dépend des règles d’urbanisme et de dispositions légales comme celles de la loi Duflot, qui obligent à vendre à des prix inférieurs à ceux du marché…
Le patrimoine affecté est en cours de recensement. Dans le cadre d’une future certification des comptes, les plus gros hôpitaux devront valoriser leurs actifs, ce qui peut poser de nombreux problèmes. Comment valoriser un actif historique inestimable comme l’Hôtel-Dieu au centre de Paris ?
Mme Joëlle Huillier. Les hôpitaux détiennent-ils encore beaucoup de bons du Trésor ?
M. Yves Gaubert. Les excédents de trésorerie des hôpitaux peuvent être placés auprès du Trésor public. Les grosses structures hospitalières ont aujourd’hui peu de trésorerie alors que les plus petits établissements disposent d’une trésorerie abondante. Après la crise de liquidités de 2012, nous sommes un peu revenus du dogme de la trésorerie zéro qui était encore enseigné il y a peu de temps. La trésorerie circulante, tous établissements confondus, peut être importante – l’impossibilité de diriger cet argent vers l’investissement fait partie de l’inconvénient de la séparation de l’ordonnateur et du comptable –, mais il n’existe pas de patrimoine immatériel dont nous pourrions attendre un réel secours financier.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Monsieur Gaubert, nous vous remercions pour vos interventions.
*
* *
Audition de M. Didier Hoeltgen, vice-président du Syndicat national des cadres hospitaliers (CH-FO), directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, M. Guillaume Wasmer, représentant le Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS), directeur des centres hospitaliers de Juvisy, Longjumeau et Orsay, M. Michel Rosenblatt, secrétaire général du Syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT), et M. Éric-Alban Giroux, directeur d’hôpital, et M. Jean-Luc Gibelin, représentant l’Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens (UFMICT-CGT)
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation.
Avant de vous laisser vous présenter, je vous rappelle que la MECSS souhaite vous interroger sur la dette des établissements publics de santé. C’est un dossier très technique. Les chiffres sont froids et montrent les difficultés des établissements.
M. Guillaume Wasmer, représentant le syndicat des manageurs publics de santé (SMPS), directeur des centres hospitaliers de Juvisy, Longjumeau et Orsay. Je représente le syndicat des manageurs publics de santé qui a été récemment affilié à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et qui regroupe l’ensemble des manageurs de santé, qu’ils soient directeurs d’hôpital, directeur d’établissement médico-social, ingénieurs, cadres techniques et administratifs. Je suis par ailleurs directeur des centres hospitaliers de Juvisy, Longjumeau et Orsay.
M. Michel Rosenblatt, secrétaire général du syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT). Le syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) représente 42 % des directeurs d’hôpital et 52 % de l’ensemble des membres des corps de direction.
M. Éric-Alban Giroux, directeur d’hôpital. Je suis directeur des finances et de la stratégie au centre hospitalier d’Argenteuil, affilié SYNCASS-CFDT, président de la conférence des directions des affaires financières (DAF) de la région Île-de-France.
M. Jean-Luc Gibelin, représentant l’Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens (UFMICT-CGT). Je représente les directeurs affiliés à la CGT qui relèvent de l’ensemble du champ sanitaire, médico-social et social, public et privé.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Quel constat dressez-vous sur les conditions de financement du secteur public hospitalier ? Quelle comparaison faites-vous avec le secteur privé ? Qu’en est-il de la formation des cadres et directeurs en matière financière ?
M. Michel Rosenblatt. La dette hospitalière a été multipliée par trois en dix ans, passant de 10 milliards d’euros à la fin de 2003 à 30 milliards à la fin de 2012. Une partie de cette dette est constituée d’emprunts structurés. Les évolutions récentes, notamment du fait des changements de parité du franc suisse, peuvent inquiéter.
L’un des thèmes qui vous intéressent concerne la capacité des hôpitaux publics à emprunter et à rembourser, les deux sujets étaient bien évidemment liés. Les prêteurs ne vous prêtent que s’ils ont une certitude raisonnable de revoir leur argent, majoré des intérêts.
Pourquoi la situation est-elle tendue aujourd’hui ? L’endettement des hôpitaux n’est pas né par hasard. C’est la conséquence d’un choix déterminé de relance des investissements hospitaliers à partir de 2002 à travers le plan Hôpital 2007 qui a été prolongé par le plan Hôpital 2012. Le constat était à l’époque que les hôpitaux qui avaient, pour des raisons essentiellement financières, limité leurs efforts d’investissements en infrastructures et en équipement, étaient dans une situation de désolation et qu’il fallait donc relancer la machine, ce qui pouvait d’ailleurs contribuer à relancer la croissance, soit par des subventions d’investissements, soit par le recours à l’emprunt, soit par des partenariats public-privé (PPP).
Les subventions d’investissements ont essentiellement bénéficié aux cliniques. C’était la formule la plus avantageuse puisqu’elle permettait de s’affranchir des suites, notamment dans le temps.
Les PPP ont été assez rapidement abandonnés ou réduits en raison de leurs surcoûts. Ils avaient l’avantage de faire échapper les établissements à l’endettement puisque ces partenariats pouvaient donner lieu à un loyer et non à une dette, y compris lorsque l’établissement prenait des engagements de très longue durée. Au regard des ratios comptables de la France et de l’endettement global du secteur public, les PPP permettaient d’échapper au périmètre de la dette.
Les hôpitaux publics ont été très fortement concernés par le recours à l’emprunt. Ensuite, la machine s’est emballée parce que le mécanisme a été doublement pervers. D’une part, les investissements ont été organisés sur des paramètres économiques considérés comme stables alors qu’en définitive ils ne l’étaient pas. D’autre part, tout a incité à faire trop grand. On a ainsi conçu des usines à déficit.
On a privilégié le financement par l’emprunt par rapport à la dotation directe en capital parce que cela permettait un effet de levier ; et on a imposé des normes techniques très optimistes et exagérément exigeantes, ce qui fait qu’on a construit trop grand et trop cher. La compensation du coût des investissements qui était promise n’a pas été assurée. Les dotations des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) devaient compenser le surcoût des amortissements et des frais financiers. Or cela a très souvent été oublié, notamment lorsqu’on est passé à l’intégration dans les fonds d’intervention régionale (FIR). Souvent, des promesses de financement sur le long terme – dix, vingt, voire trente ans – se sont perdues en cours de route lors du changement de système. Les hôpitaux se sont retrouvés sans l’assurance des ressources qui leur étaient promises.
La T2A (tarification à l’activité) évolue chaque année à la baisse, ce qui impose des volumes d’activité croissants pour conserver le même niveau de ressources. Lorsque le territoire ne permet pas cette augmentation d’activité, on se retrouve avec des diminutions de ressources et donc des déficits, à dépenses inchangées.
Le système s’est dégradé sensiblement assez rapidement et la situation actuelle n’incite pas à davantage d’optimisme. On peut estimer que la moitié des hôpitaux connaissent actuellement des difficultés d’investissements au regard des trois ratios imposés : le résultat déficitaire du compte de résultat principal qui doit rester inférieur à 2 % des recettes ; la capacité d’autofinancement qui doit être supérieure à 2 % du total des produits ; la capacité d’autofinancement qui doit être supérieure au coût du remboursement de la dette. À cela s’ajoute ce que la Cour des comptes a préconisé, à savoir un taux de marge brute supérieur à 8 %. Ces paramètres sont de moins en moins assurés, et l’effet de ciseau qui s’est produit fait que la situation est aujourd’hui durablement dégradée. Les perspectives à venir – le plan triennal et les autres mesures – conduisent à penser que la situation ne s’améliorera pas.
M. Éric-Alban Giroux. Du temps de la dotation globale hospitalière, la part liée aux investissements « exceptionnels », c’est-à-dire les investissements de renouvellement des parties immobilières, n’était pas prévue. Avec la T2A, c’est exactement la même chose. Dans la construction initiale de la T2A, les tarifs n’intégraient pas la part liée aux investissements qui devaient être négociés dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Il devait s’agir de nouvelles dotations exclues des tarifs. Aujourd’hui, le système nous demande de dégager des marges permettant de réaliser nos investissements. Mais ces marges n’ont jamais été intégrées aux tarifs. On est donc face à un système qui se « mord la queue ».
M. Guillaume Wasmer. Je partage assez largement l’analyse qui vient d’être faite. Se concentrer sur la dette des hôpitaux sans la mettre en perspective revient un peu à soigner les symptômes d’une maladie sans s’interroger sur ses causes.
Le patrimoine hospitalier est relativement vaste puisqu’il représente 47 millions de mètres carrés, contre 24 millions de mètres carrés pour la défense et 15 millions pour les universités.
M. le coprésident Pierre Morange. Il me semble que c’est plutôt 60 millions de mètres carrés et non 47 millions de mètres carrés.
M. Guillaume Wasmer. On arrive peut-être à 60 millions en intégrant les cliniques privées.
À mon sens, le triplement de la dette est la conséquence d’une double résultante.
D’une part, celle de la nécessité absolue d’investir. Les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 ont été décidés pour répondre à la vétusté du patrimoine hospitalier. Investir, c’est survivre d’une certaine façon. Les normes qui nous sont imposées en matière de sécurité incendie, de sécurité électrique, de ratio de personnels, le progrès médical notamment dans sa dimension diagnostic mais aussi en ce qui concerne l’évolution des thérapies ciblées, nous imposent d’investir pour maintenir un niveau de qualité de prise en charge élevé. Si nous ne le faisons pas, notre investissement biomédical devient rapidement vétuste, nos médecins partent, nos recettes baissent et nous entrons dans une spirale relativement infernale. L’investissement est donc une nécessité absolue pour assurer la survie des établissements, d’autant qu’avec la T2A, le système est devenu concurrentiel.
D’autre part, la dette est la résultante d’un système « pousse au crime », puisque les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 n’ont pas été des plans d’investissement au sens strict, mais des plans d’aide à l’emprunt. Sur les 6 milliards d’euros du plan Hôpital 2007, il n’y avait qu’un milliard sous forme de subventions. On a donc poussé les établissements à s’endetter. Les agences régionales de santé qui avaient une marge de manœuvre qui n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui ont accompagné le système avec exactement le même type de financement, c’est-à-dire non sous forme de subventions mais sous forme d’aide au remboursement des seuls frais financiers. Les dossiers ont été choisis sur des critères de rapidité de réalisation et non d’endettement. On souhaitait en effet que les projets puissent voir le jour dans les cinq ans. La façon dont ont été retenus les projets n’avait pas grand-chose à voir avec l’idée selon laquelle il fallait désendetter les structures hospitalières sur une longue période.
À côté de la tutelle réglementaire prévue par les textes est en train de s’instaurer une forme de tutelle bancaire. Les banquiers considèrent que les structures hospitalières sont des moutons à cinq pattes car si elles sont autonomes et qu’elles ont le droit de recourir à l’emprunt, elles ne peuvent pas fixer librement leurs tarifs. Par ailleurs, 70 % de leurs dépenses sont constituées par la masse salariale qui est très encadrée et sur laquelle ils n’ont pas vraiment la main puisqu’elle relève de la fonction publique.
Les hôpitaux ne sont pas faits pour supporter un endettement lourd puisque ce sont des structures avec des capitaux propres peu importants. Pour un banquier, prêter à un établissement, même si c’est une structure publique, comporte un certain risque. Les taux des prêts accordés aux hôpitaux sont supérieurs à ceux consentis aux collectivités locales par exemple.
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS a évoqué à de nombreuses reprises, et avec une certaine perplexité, la méconnaissance sidérale de la valeur patrimoniale des hôpitaux publics français. On ne peut être que frappé par les affirmations de la direction générale du Trésor dont nous avions sollicité l’expertise, qui estimait le patrimoine hospitalier français à plusieurs dizaines de milliards d’euros. Cette formulation nous avait plongés dans des abîmes de réflexion. C’est la raison pour laquelle nous nous étions tournés vers la Cour des comptes. Une estimation du patrimoine privé des hôpitaux publics a été réalisée – il est de l’ordre de 0,5 milliard – mais il n’y a pas eu de véritable valorisation foncière de leur domaine public. On ne peut être que surpris, quand on a pour vocation à contracter un emprunt, de ne pas avoir connaissance de son propre patrimoine. Il n’est pas illogique qu’une démarche, qui se fait normalement sans trop de difficultés à titre individuel, puisse se faire à titre collectif.
Vous évoquez les contraintes et les particularités des établissements hospitaliers qui sont dans une posture où ils ne contrôlent pas véritablement leurs recettes du fait de l’encadrement et de toutes les inerties liées notamment à la masse salariale et aux autorités de tutelle. À tout le moins, il est surprenant qu’une personne morale ne s’intéresse pas à la valeur patrimoniale réelle de ses propres biens dans la mesure où elle engage fondamentalement son avenir à travers des emprunts.
Vous indiquez être en position de faiblesse. On l’est d’autant plus lorsque l’on ne connaît pas la valeur de son patrimoine. Quelles mises en concurrence recherchez-vous ?
M. Guillaume Wasmer. Le patrimoine des hôpitaux s’est constitué au cours des siècles. Il y a de véritables pièces d’histoire qui sont très difficilement estimables, mais ce n’est pas propre aux hôpitaux. Je ne suis pas sûr que la connaissance du patrimoine historique de certains ministères soit beaucoup plus étayée.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce n’est pas le genre de réponse que nous attendons. Je préférerais que vous nous disiez que vous n’avez pas eu les moyens de procéder à cette évaluation plutôt que de vous comparer à d’autres qui ne feraient pas mieux.
M. Guillaume Wasmer. Je crois que chaque structure connaît relativement bien la valeur de son propre patrimoine. Pour ce qui concerne les hôpitaux que je dirige, je pourrais vous donner une estimation de la valeur des différents logements de fonction par exemple, des différents terrains ou des différentes structures. C’est peut-être le cumul de ces différentes valeurs qui n’est pas fait. Cela dit, les chiffrages sont certainement assez difficiles à faire en ce qui concerne les anciens hôtels-Dieu par exemple. Mais, à mon sens, la grande majorité des établissements français connaît assez bien la valeur de son patrimoine.
M. le coprésident Pierre Morange. N’est-il pas possible d’additionner cette connaissance qui est finalement assez fine, pour reprendre votre propos ? On peut imaginer que c’est une opération mathématique simple.
M. Guillaume Wasmer. Sauf erreur de ma part, ces chiffres existent dans le cadre des schémas régionaux immobiliers qui ont été réalisés par les agences régionales l’an dernier, qui sont disponibles.
M. Éric-Alban Giroux. La réponse que je vais vous proposer ne vous conviendra pas forcément plus, mais c’est ce que je pense.
La certification des comptes des hôpitaux est une obligation récente, ce qui n’est pas le cas pour les structures privées qui doivent le faire depuis leur constitution. Cette certification nous oblige à réaliser une évaluation de notre patrimoine, ce qui est particulièrement difficile. Tous les responsables hospitaliers doivent mettre des casques et des lunettes de fond pour reconstituer le chiffrage historique de leur patrimoine. Dans le champ de la certification, on ne cherche pas à avoir le patrimoine valorisé à la valeur du jour mais le patrimoine tel qu’il a été valorisé il y a deux, trois, cinq siècles en écus, en sols, voire en sel… lorsque les biens s’y sont progressivement incorporés.
Je crois que vous souhaitez plutôt savoir quelle est la valorisation actuelle du patrimoine, le problème étant qu’elle ne nous est pas demandée. Au titre de la certification, on nous demande la valeur historique que nous sommes tous en train de chercher. Avant-hier, nous n’avions pas à procéder à cette valorisation. Au moment où je vous parle, je ne suis pas sûr que nous soyons capables de vous donner la valorisation des Hospices de Beaune à l’époque où ils ont été construits. C’est un vrai problème qui ne se pose pas pour un hôpital neuf ou récent, monolithique et implanté sur un terrain foncier limité. Mais c’est sûrement un sérieux casse-tête pour l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) par exemple.
On peut s’étonner de notre incapacité à procéder ou non à cette évaluation, mais les règles que l’on nous demande d’appliquer pour ce faire sont parfois étonnantes.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous nous dites que vous n’étiez pas tenus à cet exercice de spéléologie foncière, ce qui signifie que l’ensemble des emprunts qui ont été contractés ne sont pas adossés sur un minimum de connaissances de la valeur du patrimoine de vos établissements. Je vous dis cela parce que votre collègue vient de nous dire à l’instant que la plupart des directeurs d’établissement en avaient une connaissance relativement bonne. Je me permets donc de souligner le caractère qui me semble contradictoire de votre propos. Il ne s’agit ici que d’un questionnement légitime de la part des représentants de la Nation.
J’ai déjà abordé cette question en séance publique puisque j’avais déposé un amendement sur ce sujet. Mme la ministre m’avait répondu en séance que les établissements étaient supposés remplir spontanément le logiciel OPHELIE, qui devait être actualisé pour l’année 2016. Je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas le cas, puisque c’est la ministre elle-même qui le dit, mais cela me semble une gageure dans la mesure où la spéléologie à laquelle vous nous conviez dans le cadre de l’estimation foncière me semble difficile à intégrer dans l’agenda cité par la ministre.
M. Michel Rosenblatt. Il n’y a pas eu de réévaluation des actifs pendant des décennies, y compris dans des périodes de très forte inflation. Je suis persuadé que si l’on demandait à un certain nombre d’agents immobiliers de venir expertiser ce que les bâtiments peuvent représenter, leur appréciation ne serait pas liée aux investissements passés mais plutôt à la valeur du marché. C’est le rôle de France Domaine aussi que d’apporter sa contribution.
Si vous avez le sentiment qu’il y a une certaine négligence, elle tient peut-être au fait que les responsables hospitaliers n’ont guère eu la main sur le bâti ancien dont la réutilisation s’est avérée soit difficile, soit coûteuse en termes de transformation, parce que le devenir des bâtiments historiques a toujours été considéré avec attention, à la fois par l’État et les responsables des collectivités territoriales.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous sommes d’accord. Nous connaissons nous aussi l’histoire de la constitution du patrimoine hospitalier qui est issu de legs et qui était conditionné notamment par le respect de leur affectation. Nous avons en mémoire un certain nombre de cas particuliers où des opérations de valorisation foncière au travers de cessions de bâtiments anciens n’ont pas pu être réalisées parce que les conditions du legs exigeaient que ces bâtiments soient affectés à un objectif précis ayant pour vocation la protection sanitaire et sociale. Il est évident que cela dévalorise de fait le bien.
Comprenez que la MECSS se soit toujours interrogée sur ce sujet dans la mesure où il n’est pas suffisamment clarifié. C’est en tout cas ce qui a été dit par les uns et par les autres. Le terme de spéléologie qui a été employé ici sous-entend la nécessité d’un effort de recherche, ou du moins une connaissance insuffisante qui nécessite d’être approfondie.
M. Michel Rosenblatt. Les pratiques et les règles comptables ont été moyennement adaptées à l’usage. Les investissements et les acquisitions ont souvent été financés sur le long terme alors qu’ils relevaient du moyen terme. On a dû parfois finir de rembourser des opérations alors que l’équipement en question avait cessé d’être utile.
M. Éric-Alban Giroux. Le calendrier dont fait état la ministre est calé sur celui des certifications hospitalières puisque l’écrasante majorité des hôpitaux seront certifiés en 2016. Les deux calendriers n’ont peut-être pas été montés au hasard.
M. Didier Hoeltgen, vice-président du syndicat national des cadres hospitaliers (CH-FO), directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Les emprunts sont essentiellement adossés au budget d’activité, c’est-à-dire à la valeur travail qui représente la création de richesse de l’établissement. Actuellement, la valeur patrimoniale ne sert pas à adosser les emprunts.
Le patrimoine des établissements est d’ailleurs extrêmement inégal. On ne peut pas comparer les Hospices civils de Beaune et l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges par exemple. L’évaluation de notre patrimoine, en dehors de la possibilité classique que cela soit fait par France Domaine, suppose aussi l’évaluation d’un outil de travail. Or l’outil de travail de l’hôpital public est relativement spécifique et son évaluation en tant que structure qui permet de « produire » des soins avec le cortège de productions annexes qui leur sont liées n’est pas aisée. On ne peut pas l’évaluer comme un patrimoine traditionnel d’un ministère ou d’une activité traditionnelle. C’est l’une des problématiques que l’on rencontrerait si l’on se penchait plus précisément sur cette question.
M. Jean-Luc Gibelin. Nous sommes des établissements autonomes et nous avons des histoires, des trajectoires et des réalités très différentes. Il n’y a jamais eu de volonté ministérielle de sortir de cette situation. Qu’il y ait un intérêt à additionner les valeurs est certain, mais je note que cette démarche n’a jamais été entreprise. Je rappelle que les établissements n’ont pas eu d’autres solutions que d’emprunter. Aujourd’hui, on peut s’interroger sur la façon dont l’histoire a été écrite, penser légitimement qu’on n’aurait pas dû faire les choses de cette manière, mais je me souviens, pour avoir été dans des équipes de direction, que la latitude de choix était nulle. On nous disait : si vous n’avez pas de crédits d’aide à l’emprunt vous ne pourrez pas investir et si vous n’investissez pas, vous tombez sous le coup d’une constatation de non-conformité avec le risque de l’arrêt de l’activité. Voilà comment cela s’est traduit concrètement sur le terrain. J’indique au passage que les projets de reconstruction lancés par les établissements ont tous été approuvés par leur autorité de tutelle. Aucun établissement n’a réalisé de projet de reconstruction sans l’accord financier et architectural des ARH (agences régionales de l’hospitalisation) puis des ARS (agences régionales de santé).
M. le coprésident Pierre Morange. Vous avez raison. Je me souviens d’une opération particulière qui a été validée par ces mêmes autorités de tutelle qui ensuite en ont contesté l’évidence. Cela montre bien leur hypocrisie et leur incompétence. Je parle d’une certaine ARS d’Île-de-France. L’exemple est historique et particulièrement exemplaire. J’ajoute qu’il s’inscrivait dans un fond particulier de manque d’orthodoxie budgétaire, pour ne pas parler d’orthodoxie judiciaire.
M. Jean-Luc Gibelin. Il y a eu d’autres affaires dans d’autres régions.
Les représentants des directeurs d’établissements que nous sommes ne peuvent pas, quelle que soit notre appréciation sur ces différentes lois, être considérés comme les responsables de la situation. Certes, ce sont eux qui ont organisé les opérations, mais parce que c’était leur travail, et ils l’ont fait dans un cadre tout à fait contrôlé et validé, à la fois au plan financier mais aussi architectural puisque les ARH puis les ARS avaient fait valider les projets importants par l’ingénieur régional qui confirmait le dimensionnement des établissements. Qu’on nous dise ensuite que c’était trop grand, pas adapté, qu’il ne fallait pas, d’accord, mais tout cela a été décidé par les représentants de l’État.
M. Didier Hoeltgen. Au niveau de l’avant-projet sommaire.
M. le coprésident Pierre Morange. Je suis tout à fait d’accord. Et je pense, là encore, à l’exemple que je viens de rappeler.
M. Guillaume Wasmer. Pour résumer, si vous nous demandez si les hôpitaux connaissent la valeur de leurs terrains, la réponse est oui. Si vous nous demandez s’ils connaissent la valeur des logements et de leur patrimoine privé, la réponse est oui. Si vous nous demandez s’ils connaissent globalement la valeur de leur outil de travail, et s’ils sont capables de la valoriser très précisément, la réponse est non. Si vous nous demandez s’ils sont capables d’estimer des pièces d’histoire qui ont plusieurs siècles, la réponse est non.
La connaissance de notre patrimoine n’est donc pas exhaustive, d’une part, parce que c’est très difficile à faire, d’autre part, parce que cela ne nous a pas été demandé jusqu’à maintenant.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous aspirons à ce que cette agrégation de données comptables simples soit faite dans de brefs délais.
Il faut que vous compreniez que la MECSS n’est pas une chambre d’inquisition. C’est un organe parlementaire qui a vocation à comprendre puis à tirer des enseignements afin de les décliner sur le plan législatif ou réglementaire. Nous avons parfaitement compris que le sujet ne peut pas se réduire à la responsabilité d’un directeur d’établissement mais qu’il se trouve inscrit dans une chaîne d’autorité dans laquelle chacun doit prendre sa part de responsabilité.
M. Michel Rosenblatt. Vous l’avez parfaitement formulé.
Permettez-moi un clin d’œil : Il y a eu la génération des directeurs bâtisseurs, celle des Trente Glorieuses. Elle est maintenant à la retraite depuis un nombre respectable d’années. Elle avait vu grand en phase d’expansion, de croissance économique et de croissance de la population. Elle a laissé des établissements relativement peu endettés, parce que les robinets étaient encore largement ouverts et que l’inflation a gommé une partie de la dette des établissements. Puis le contexte est devenu totalement différent. Aujourd’hui, on est davantage à guichets fermés, avec l’inertie de la machine et la pression de la nécessité. Comme je l’ai dit tout à l’heure, on a fait trop grand et on a construit des usines à déficit. Mais j’insiste aussi sur le fait que les règles ont été modifiées en cours de route. Des dossiers économiquement équilibrés ont été élaborés et validés comme tels. Ensuite les établissements ont suivi les modifications de ces paramètres économiques, et ils se retrouvent dans des situations complexes et parfois désespérées.
M. Éric-Alban Giroux. Les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 ont été vécus comme un soutien davantage au monde bancaire qu’au monde hospitalier public. Le privé a bénéficié de subventions tandis que le public a eu le droit d’emprunter moyennant la couverture de ses intérêts d’emprunt ou de faire des partenariats public-privé. En fait, on a demandé au public, soit de s’endetter définitivement sur une longue période, soit de supprimer complètement son titre IV, c’est-à-dire les amortissements et les frais financiers, au profit d’un bâtisseur privé, c’est-à-dire d’avoir les pieds et poings liés à un bâtisseur privé qui faisait payer cher le moindre changement de cloison. Par bonheur pour lui, le secteur privé a eu du cash. Nous sommes tous désolés de ne pas avoir eu le même traitement de faveur. Peut-être fallait-il le faire – ce n’est pas à moi d’en juger –, mais d’une certaine manière il s’est agi d’un détournement de l’argent de la Sécurité sociale vers des fonds bancaires qui ne sont pas des fonds publics.
En ce qui concerne le dimensionnement des structures, les « sages de la rue Cambon » disent qu’à l’excès d’optimisme de la tutelle s’est ajouté un excès d’optimisme des dirigeants hospitaliers sur le devenir de leurs structures. Plusieurs de mes collègues ont rappelé que l’excès d’optimisme a souvent été dû à l’exigence du respect des normes. Soyons très clairs : quand on impose à un secteur des normes dispendieuses, il ne faut pas s’étonner ensuite qu’elles le soient ! La plupart des dirigeants hospitaliers sont choqués par le niveau de sécurité incendie exigé, le nombre de mètres carrés demandé par chambre, le ratio de personnel qu’on nous impose. Que faut-il faire ? Fermer toutes les structures publiques en refusant catégoriquement d’assumer ce que l’on nous impose ? Car si l’on ne suit pas les normes, on n’ouvre pas. Donc, on les assume. Ensuite, il est légitime de calculer le retour sur investissement (ROI return on investment). C’est ce que font le public et le privé. Le public n’a pas attendu bien longtemps pour faire ses propres business plans. Chez nous, cela s’appelle un état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD), un plan global de financement pluriannuel (PGFP), une programmation pluriannuelle des investissements (PPI). Le système est exactement calé sur les mêmes principes que ceux appliqués par le secteur privé et cela dénote la même volonté de projection. On nous dit que nous avons mal calculé, que nous avons été trop optimistes. Nous avons en effet été optimistes sur l’appréciation des augmentations d’activités mais, au bout du compte elles se sont cependant avérées justes : vieillissement de la population, démographie médicale en berne en ce qui concerne la médecine libérale de ville, afflux massif de la population peu « monétisable » aux urgences, ainsi que de personnes âgées, de patients polypathologiques, avec éventuellement des problèmes sociaux. Pardonnez-moi de dire que l’on sait où va cette population : elle vient chez nous. En réalité, nous n’avons pas été optimistes, nous avons calculé que nous affronterions cet afflux massif de population et c’est ce qui s’est produit. Et ce n’est pas fini : les projections que l’on peut faire sur les quinze ans à venir montrent que ce phénomène continuera.
Comme on a construit trop grand, on n’arrive pas à avoir un bon retour sur investissement, il faut en effet tenir compte du mécanisme dit de l’effet prix-volume. Je vous l’explique : dans le mécanisme de la T2A, on prend par exemple comme année de référence l’année 2014 et l’on dit que la Nation autorise la réalisation de dix prothèses de hanche payées chacune 10 euros. L’ONDAM hospitalier pour l’année 2014 pour les prothèses de hanche est donc de 100 euros et on n’a pas en principe le droit de le dépasser. Mais à la fin de l’année, s’il s’avère que l’on a fait non pas dix mais douze prothèses de hanche, on a donc dépassé l’ONDAM de vingt euros. Premier mécanisme : en 2015, on réduit la valeur de l’opération pour la prothèse de hanche de dix euros à huit euros, c’est-à-dire que l’on diminue le prix de l’unité pour conserver un volume d’ONDAM inchangé. Deuxième mécanisme : on demande de rendre les deux euros dépensés en plus. Cet effet prix-volume, qui était un système de régulation de l’ONDAM, n’est pas lié à une attractivité qui serait magique des dirigeants hospitaliers mais à l’augmentation des besoins de populations qui sont venues massivement et de plus en plus vers les structures d’urgence. Cet effet prix-volume a fait chuter complètement nos bases de calcul de ROI. Pour notre part, nous avions prévu les augmentations de populations, mais l’ONDAM n’a pas été relevé en conséquence.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous savons naturellement ce qu’est un effet prix-volume.
Vous avez évoqué l’inertie liée à la masse salariale et son impact sur les budgets hospitaliers. La Cour des comptes a publié des rapports sur ce sujet, évoquant les disparités d’effectifs pour les mêmes disciplines, les mêmes pathologies, qui sont bien évidemment à prendre en compte.
Un certain nombre de structures et d’agences ont identifié des méthodologies de travail que l’on ne peut pas contester et qui peuvent aboutir, au travers d’une meilleure utilisation tout à la fois des locaux et des matériels, éventuellement à un redimensionnement des équipements hospitaliers. C’est tout de même l’une des conclusions majeures de ce type d’expérimentation qui, si elle était généralisée, ne conduirait pas nécessairement au parc hospitalier actuel, dont l’ampleur a été accentuée dans la mesure où l’on a souhaité mettre en place une logique de parcours de soins avec une articulation entre l’ambulatoire et l’hospitalier.
Actuellement, les taux d’intérêt sont particulièrement bas. Cela vous a-t-il conduits à renégocier les taux d’intérêt élevés qui vous avaient antérieurement été imposés par le secteur bancaire et avez-vous retrouvé des marges de manœuvre ?
Quelles procédures utilisez-vous dans le cadre de la passation de ces emprunts, en termes de mise en concurrence ? Y a-t-il une sorte de cahier des charges standard pour des appels d’offres, ou bien chaque établissement hospitalier a-t-il ses méthodes particulières ?
Bien évidemment, les emprunts structurés ne recouvrent pas le total de la dette de 30 milliards d’euros – mais seulement environ 1 milliard. Savez-vous quelle est l’incidence du récent « déplafonnement » du franc suisse par rapport à l’euro sur les emprunts à taux variable indexés sur des parités monétaires impliquant cette monnaie ? Avez-vous déjà fait « marcher vos calculettes » après ce dernier événement ? Le sujet est en effet dans toutes les têtes, qu’il s’agisse des hôpitaux, des communes, des syndicats intercommunaux qui se sont hasardés parfois de façon parfaitement opaque à utiliser ces espèces d’hydres tentaculaires incontrôlables que sont les prêts toxiques.
M. Guillaume Wasmer. Lorsque les établissements sont amenés à emprunter, ils élaborent bien évidemment un cahier des charges et mettent en concurrence l’ensemble des partenaires bancaires. Mais je ne parle là que pour les hôpitaux dans lesquels j’ai travaillé. Parmi les trois établissements dont j’ai pris récemment la direction, l’un avait contracté des emprunts structurés indexés sur la parité du franc suisse. On avait imaginé un mécanisme de sortie de ces emprunts fondé notamment sur la fusion de deux établissements, qui aurait pu permettre de désensibiliser une partie des emprunts toxiques en faisant porter de nouveaux investissements par une structure plus importante et avec une demande au fonds de soutien qui a récemment été créé par les pouvoirs publics. Ce fonds de soutien, doté de 100 millions d’euros sur trois ans, je crois, est financé majoritairement par le FIR…
M. Éric-Alban Giroux. Il est donc financé à 100 % par l’assurance maladie.
M. Guillaume Wasmer. …alors qu’il est de 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour les collectivités territoriales.
Bien évidemment, les conséquences de l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro remettent en cause une partie des éléments qui avaient été préparés. Nous sommes en train de réfléchir à la façon dont nous allons pouvoir faire évoluer ce processus de fusion pour les établissements que je viens d’évoquer. Ce qui est presque certain, c’est que le dispositif envisagé qui nous semblait déjà très sous-dimensionné avec 100 millions d’euros n’a plus aujourd’hui aucune signification par rapport aux montants en jeu. Les conséquences de ce qui s’est passé la semaine dernière vont être redoutables.
M. le coprésident Pierre Morange. Les prêteurs étaient-ils des établissements bancaires français ou étrangers ?
M. Guillaume Wasmer. Des établissements français.
M. le coprésident Pierre Morange. Est-ce la règle ?
M. Guillaume Wasmer. Il s’agit très majoritairement de Dexia et des Caisses d’épargne.
M. Éric-Alban Giroux. L’enjeu de la problématique hospitalière de l’emprunt structuré était la semaine dernière de 3 milliards d’euros, mais aujourd’hui on ne sait plus. Par ailleurs, il convient de rappeler que ces 100 millions d’euros sont prélevés dans nos propres poches puisqu’ils proviennent de l’assurance maladie, des hôpitaux et du FIR.
M. Michel Rosenblatt. Nous nous sommes empressés de lire l’instruction interministérielle du 22 décembre 2014 qui régit le fonds évoqué pour le secteur hospitalier. Elle prévoit qu’il est possible de bénéficier de l’enveloppe de 100 millions d’euros à condition que le capital ne soit pas libellé en devises étrangères. Il faut donc vérifier le périmètre exact du dispositif tel qu’il a été mis en place par l’instruction interministérielle. Nous nous demandons également si le délai de traitement des dossiers prévu pourra être réellement tenu dans la mesure où il se fera à marche forcée après avoir eu une longue période de réflexion pour l’élaboration du dispositif.
Il est tout à fait paradoxal que dans la période passée, alors qu’il aurait fallu une planification fine, on se soit contenté d’une logique de simple régulation de l’offre, ce que nous avions critiqué du point de vue syndical. Nous avions dit qu’il fallait, au contraire, définir de manière plus stricte et plus précise les modalités et les décisions de répartition de l’offre sanitaire sur le territoire. La régulation a conduit à préparer des contrats pluriannuels alors même que les ARS n’avaient connaissance de leurs capacités financières que chaque année successivement. Les modalités de travail étaient donc structurellement peu opérationnelles. Très souvent, nous ne connaissons nos ressources qu’après le 31 décembre de l’année. Il ne faut donc pas s’étonner que les capacités de prévision fine des gestionnaires hospitaliers soient parfois insuffisantes.
Quand un bâtiment a été conçu d’une certaine manière, par exemple en réalisant des unités de trente lits, il est difficile ensuite de revenir en arrière. Les coûts de revient et de personnel sont en effet cristallisés pour longtemps.
Au sein de la dette, il convient également de distinguer ce qui relève du marché obligataire et ce qui relève davantage du marché monétaire, ce qui est à long terme pour financer les investissements et ce qui est à court terme pour des lignes de trésorerie ou pour une dette qu’il s’agit de rembourser rapidement. Là encore, les paramètres diffèrent évidemment.
Bien sûr, les établissements ont tenté toutes sortes de modalités. Certains procèdent à des mises en concurrence et sont heureux lorsqu’ils ont ne serait-ce qu’une réponse. Dans un passé récent, certains centres hospitaliers ont parfois peiné à trouver un prêteur pour achever leur programme de construction alors que les murs étaient debout, que le gros œuvre était terminé, qu’il fallait mobiliser des crédits pour construire une autre tranche. Mais après la crise financière, il n’y avait plus personne pour prêter de l’argent. Nous n’étions pas alors en position de force pour négocier. Certains CHU (centres hospitaliers universitaires) se sont alors regroupés pour essayer de lever des fonds en commun dans des conditions financières plus favorables. L’imagination peut aussi être mobilisée.
M. Éric-Alban Giroux. Lorsque l’on cherche à emprunter, on recourt à une procédure d’appel d’offres. Suivant le moment où on le fait, on peut ne pas obtenir de réponse. La situation s’est améliorée, et c’est tant mieux. Était-ce dû à la frilosité des banques à prêter aux établissements publics ou à une stratégie de groupe leur permettant d’augmenter leur point de base sur leurs marges ? Je ne le sais pas. Je me souviens qu’avant le mois de septembre 2008, je négociais entre cinq et sept points de base de marge bancaire et que depuis, on est subitement passé à 100, 200, jusqu’à 350 points de base de marge financière pour les banques alors que je n’ai pas connaissance – mais peut-être me trompé-je – de défaut de paiement d’un établissement public hospitalier en France auprès d’une banque. Le prêt d’argent d’une banque à un établissement hospitalier public de santé est sécurisé. Je ne sais donc pas à quoi était réellement due la frilosité des banques après la crise. À la nécessité d’une recapitalisation pour respecter les ratios prudentiels ? Peut-être. Mais je n’ai pas l’impression que c’était juste en raison d’un défaut de connaissance patrimoniale ou d’une insécurité financière croissante de nos structures.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Y a-t-il des établissements qui sont à la limite de ne plus pouvoir continuer à exister ?
M. Éric-Alban Giroux. Nous vous répondons tous les cinq : oui !
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Vous éclairez la question sous un jour un peu différent de ce que l’on a entendu jusqu’à maintenant. Notre souci est d’essayer de trouver des solutions. Vous demandez un soutien financier plus important de l’État, et je le comprends parfaitement car je ne vois pas objectivement comment sortir de cette situation autrement.
Pour ma part, je suis très attachée à l’hôpital public. Je suis présidente du conseil de surveillance d’un petit centre hospitalier qui, s’il n’a plus de plateau technique, a encore des urgences. J’ai vu ce qui s’est passé pendant plusieurs années et je retrouve les mêmes difficultés à avoir un soutien efficace des tutelles que celles que vous soulignez. Le soutien technique de cet établissement est d’autant plus important que c’est une petite structure. Il a connu quelques déboires. Heureusement, le premier directeur général de l’ARS de Midi-Pyrénées nous a beaucoup aidés.
Comment certains établissements peuvent-ils aujourd’hui continuer à fonctionner ?
M. Didier Hoeltgen. Oui, il y a un nombre significatif d’établissements qui sont dans une situation d’impasse ou de très grande difficulté.
S’agissant du titre IV, l’incidence de la situation de l’endettement est majeure, ce qui conduit à ce que nous n’ayons plus de marge de manœuvre. Bien sûr, de ce fait les investissements à venir sont obérés. Pourtant, il faut adapter le service public à de nouvelles activités. On ne peut pas travailler dans des services d’urgences qui ont été conçus pour 30 000 visites s’il y en a 90 000 par an. Cette augmentation d’activité conduit à adapter, rénover nos locaux, y compris pour répondre aux mises aux normes qui ont un effet inflationniste marqué. Il faut savoir qu’au bout de dix ou quinze ans, les locaux hospitaliers sont dans un grand état de vétusté du fait de la nature de l’activité et de l’ampleur des flux qui se présentent aux portes de nos hôpitaux.
La situation a un impact sur la section de fonctionnement à un point tel que nous n’avons plus du tout, soit de capacité d’amortissement, soit de marges de manœuvre, ce qui, par définition, a des répercussions sur l’investissement à venir. Parfois, certaines ARS nous empêchent même formellement d’investir. Mon établissement devait investir pour répondre aux normes d’incendie, mais j’ai reçu l’injonction de ne plus le faire parce que ma section d’investissement ne me le permettait plus.
Cela a également un impact sur la qualité des soins parce que, quand on n’a pas de marge de manœuvre, le poids de l’investissement est porté directement par l’exploitation : ainsi, là où l’on devrait avoir une infirmière et deux aides-soignantes la nuit pour trente-quatre lits et alors qu’il y a chaque nuit entre six et huit entrées, on n’a plus qu’une infirmière et une seule aide-soignante. Nous sommes à la corde de la corde. La qualité s’en ressent, sans oublier l’épuisement du personnel et l’absentéisme éventuellement consécutif.
Des tensions sociales apparaissent également au sein de l’établissement. Quand on n’a pas de marge de manœuvre, un déménagement devient un véritable problème. Cela crée aussi des tensions avec l’ARS puisque la relation avec l’ARS n’est pas une relation d’accompagnement, même s’agissant de nos grands investissements. Lors de la reconstruction d’un hôpital par exemple, nous aurions pu mettre en place pendant quelques années une équipe de reconstruction avec l’ARS à côté de l’équipe de fonctionnement nécessaire pour continuer d’assurer le tout-venant. Mais ce type d’accompagnement technique n’existe pas. Nous avons plutôt un rapport de tutelle et de défiance qui vient complexifier les choses. J’ajoute que le partenariat est certainement gage de qualité et qu’il permet de résoudre des problèmes extrêmement complexes, ce qu’une équipe de quatre, cinq ou six adjoints avec un ou deux ingénieurs ne peut pas faire.
Le grand groupe qui reconstruisait mon hôpital avait mobilisé quatorze ingénieurs, alors que, pour ma part, je n’en disposais jusqu’alors que d’un. J’en ai recruté un autre pour faire face à ces quatorze ingénieurs. Mais le service public hospitalier n’était pas en mesure de contrôler efficacement l’ingénierie proposée par ce grand groupe. Cela explique que nous étions structurellement « à la remorque » pour réagir aux solutions techniques qu’il proposait.
Si un établissement qui se reconstruit pour un budget d’environ 200 millions d’euros avait la possibilité de recourir à une banque d’investissement ou à une forme de bonification, cela lui permettrait de bénéficier d’un taux d’emprunt de l’ordre de 2 % et donc de dégager chaque année une marge de manœuvre de 4, 5, voire 10 millions. Le dispositif a permis à certaines collectivités locales d’emprunter et de participer à la relance globale de l’activité économique de la Nation. Le recours à une banque d’investissement spécifique à l’hôpital permettrait de participer à la relance de l’économie, tout en assurant aux banques une rémunération satisfaisante.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons conscience de la situation extrêmement tendue de nombre d’établissements hospitaliers. Certains sont même obligés d’emprunter pour payer les salaires.
Tout cela a des incidences sur les investissements au quotidien, soit de matériel, soit de mise aux normes. Certains établissements ont d’ailleurs reçu des services des sapeurs-pompiers des avis de conditions de sécurité défavorables mais ils continuent à être ouverts.
Il existe aussi des hôpitaux qui sont amiantés, ce qui fait peser une responsabilité pénale sur le directeur. Les mises aux normes conduiraient à réaliser des travaux, donc à percer des cloisons ce qui libérerait de l’amiante. Ce sont des mélanges de « collèges Pailleron » et de Jussieu sanitaires auxquels vous êtes confrontés. Vous partagez cette responsabilité pénale avec le directeur de l’ARS.
M. Éric-Alban Giroux. Non, la responsabilité est entièrement hospitalière.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est la raison pour laquelle les directeurs généraux d’ARS vous y obligent avec autant de facilité.
M. Didier Hoeltgen. Ou nous interdisent d’investir.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous ai demandé s’il y avait eu renégociations d’emprunts compte tenu du fait que les taux d’intérêt actuels sont exceptionnellement bas. En raison de vos rapports un peu particuliers avec les établissements bancaires, quelles sont vos marges de manœuvre ? Le volume des refinancements octroyés par la Banque centrale européenne ayant été favorable aux établissements bancaires, il paraît étonnant qu’ils ne prêtent pas une oreille plus attentive à vos préoccupations.
M. Éric-Alban Giroux. Bien sûr, il y a des renégociations au vu des taux d’intérêt extrêmement bas. Nous négocions. Seules les grandes structures ont toutefois la possibilité de mettre en place un dispositif de veille sur les taux d’intérêt et les renégociations.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur les quelque 30 milliards d’euros qui constituent globalement la dette des hôpitaux français, savez-vous si ces renégociations ont permis de dégager une marge significative à l’échelle nationale, de redonner un ballon d’oxygène à l’échelon local et d’engager de nouvelles opérations d’investissement, ne serait-ce que pour le fonctionnement quotidien des établissements de soins ?
M. Éric-Alban Giroux. Je vous ferai la même réponse que s’agissant du patrimoine. Au niveau local, on sait quels sont nos encours d’emprunts et quel argent on doit débourser quand on veut renégocier, mais on ne sait pas ce qu’il en est au niveau national. Il faudrait faire cette somme algébrique qui, au bout du compte, s’avère plus compliquée qu’il n’y paraît.
M. le coprésident Pierre Morange. La somme de 1,5 milliard d’euros intègre-t-elle les pénalités de sortie ou non ?
M. Éric-Alban Giroux. Non. Pour sortir de ces emprunts, jusqu’à la semaine dernière, il fallait ajouter 1,5 milliard d’euros. Mais depuis, on ne sait plus.
M. le coprésident Pierre Morange. Mais dans l’hypothèse de conditions stables des marchés financiers, la somme de 1,5 milliard intègre-t-elle les pénalités de sortie ?
M. Éric-Alban Giroux. Non.
M. le coprésident Pierre Morange. En fait, il s’agit donc d’un volume minimal sans comptabiliser les pénalités de sortie, les soultes liées à ces emprunts toxiques. Je n’ai pas l’impression que cette question a été abordée par les experts financiers lors des auditions auxquelles nous avons procédé précédemment.
M. Éric-Alban Giroux. Cela change tous les jours ! Pensez à ce qui s’est passé la semaine dernière.
M. le coprésident Pierre Morange. Lorsque les emprunts structurés étaient estimés à 1,5 milliard d’euros, a-t-on mesuré quelles seraient les pénalités de sortie ?
M. Michel Rosenblatt. Les dirigeants hospitaliers ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. C’est l’autorité publique centrale qui peut collecter les données. Or, celle-ci s’est plutôt efforcée de brouiller les cartes dans la mesure où personne ne devait être responsable de tout cela, et où était jugée préférable la discrétion. Et nos autorités nous ont interdit d’aller au contentieux. Certains collègues souhaitaient aller au contentieux, y compris contre Dexia par exemple, mais ils ont eu la ferme instruction de n’en rien faire.
M. le coprésident Pierre Morange. On vous a interdit d’utiliser la fameuse casuistique d’atteinte au devoir d’information. Voilà qui est intéressant ! Je suppose que ce genre de consigne est toujours oral ?
M. Michel Rosenblatt. Pour conclure, je dirai qu’il n’existe pas une catégorie unique d’hôpitaux avec un type unique de problèmes. Certains hôpitaux sont dynamiques, et leur taille est adaptée à leur territoire. Ils ont un recrutement médical suffisant parce qu’ils sont adaptés à la situation de là où ils se trouvent, ils suivent une dynamique de développement et sont éventuellement en situation de monopole sur leur territoire. Ils recrutent, équilibrent leur budget et remboursent. Mais d’autres sont déficitaires et endettés, soit parce qu’ils sont surdimensionnés, soit parce qu’ils sont vétustes, soit parce qu’ils connaissent des difficultés de recrutement médical liées à la faible attractivité ou au manque de médecins sur leur territoire, soit encore parce qu’ils sont soumis à une concurrence plus forte. Ceux-là suppriment des emplois, ce qui entraîne des rigidités sociales très fortes qui bloquent les évolutions. Bien évidemment, entre ces deux extrêmes, il y a une gradation intermédiaire. Mais cela veut dire que chaque fois que l’on raisonne en faisant des moyennes, on se trompe et on passe à côté de la diversité de la gravité des situations.
Peut-être faut-il nous autoriser et autoriser d’autres interlocuteurs à faire preuve d’imagination. Certains établissements publics n’ont pas le statut bancaire mais collectent des fonds et peuvent réaliser des placements financiers dans la durée. Je pense, par exemple, à l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) qui recueille des cotisations pour des montants élevés et qui doit diversifier ses placements. Il est bien évident que l’on pourrait, sous réserve d’adapter la loi, imaginer des « circuits courts » pour financer la dette à long terme des hôpitaux par des placements à long terme de l’ERAFP.
M. Didier Hoeltgen. De même pour les prêts de trésorerie.
M. Michel Rosenblatt. N’oublions pas non plus les caractéristiques propres au secteur médico-social public qui affrontent, à beaucoup plus petite échelle, les mêmes difficultés. Ils ont peut-être moins souvent contracté des emprunts structurés parce qu’ils n’avaient pas la taille critique, mais certains ont aussi un niveau d’endettement élevé et un niveau de ressources qui s’est tari au cours des dernières années.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Lorsque je vous écoute, je me rends compte que les aspects financiers sont compliqués. La formation des directeurs d’hôpitaux est-elle suffisante pour vous permettre de faire face à toutes ces problématiques financières ?
M. Didier Hoeltgen. Vous avez raison, un problème de formation se pose. L’univers financier n’est pas non plus facile à aborder et il requiert beaucoup de rapidité et de conseils dans des délais très courts.
Cependant, nous ne travaillons pas seuls, mais en nous appuyant sur des conseils. Nous travaillons aussi parfois avec les services déconcentrés du Trésor public. Nous bénéficions également de multiples audits, accompagnements comptables, contrôles, etc., qui mériteraient peut-être d’être plus orientés dans une perspective de soutien.
Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur l’expérience de collègues. Par exemple, au sein de la Fédération hospitalière de France, un groupe de travail nous aide à mieux appréhender des difficultés qui ne sont pas seulement locales.
L’une des caractéristiques du métier de directeur d’hôpital tient à ce qu’il doit être un généraliste alors que ses interlocuteurs sont toujours spécialistes. Par exemple, vous pourrez aussi bien travailler avec un ingénieur spécialisé en climatisation qu’avec un médecin anesthésiste. C’est ce qui fait que ce métier est intéressant mais aussi parfois difficile, ce qui pourrait justifier plus de soutien de la part des pouvoirs publics.
M. Guillaume Wasmer. Je partage les propos de M. Hoeltgen. Globalement, les directeurs des affaires financières sont bien formés et ont toutes les compétences nécessaires pour assurer la gestion quotidienne des établissements et mettre en œuvre des formules financières que je qualifierai de classiques.
Dès lors que vous êtes confrontés pour la première fois à des PPP ou à des emprunts structurés, qui par définition sont des montages complexes, alors que nos interlocuteurs les manient en permanence et savent faire preuve d’une certaine opacité, vous êtes un peu démunis.
De la même façon que la communauté hospitalière a su se structurer pour créer la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), la société d’assurance, ou la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), la complémentaire santé, je pense que nous pourrions collectivement mettre en place des services transversaux nous permettant de faire face à des situations complexes.
Il est également un peu facile de se demander, dix ans après, ce qui s’est passé alors qu’entre-temps les règles ont changé. Si l’on a voulu un plan d’aide à l’endettement plutôt qu’un plan d’aide à l’investissement, c’était un choix permettant de « saupoudrer » un peu dans tous les établissements plutôt que de donner seulement à quelques-uns, pour maintenir le maillage hospitalier français. Souhaite-t-on maintenir le maillage hospitalier français tel qu’il existe aujourd’hui ? Si la réponse est oui, alors il faut soit accepter un fort niveau d’endettement, soit subventionner les établissements, auquel cas il faudra faire preuve d’imagination.
S’agissant des emprunts structurés, la réponse ne peut pas être individuelle. Comme j’ai la chance de diriger trois établissements, j’ai essayé d’en fusionner deux pour permettre une désensibilisation des emprunts de l’un dans un ensemble plus large. Mais il faudrait à la limite envisager ce même système sur l’ensemble de l’investissement français, pour qu’une réelle solidarité hospitalière s’exerce. De la même façon, pour les décisions d’investissements lourds on pourrait aussi mettre en place des outils pour faire face à des montages complexes. Sur le plan technique, on pourrait aussi avoir une équipe d’ingénieurs, de techniciens, qui soit centralisée par région ou au niveau national et qui pourrait intervenir sur certaines opérations particulières. On a essayé de le faire, au niveau des tutelles. Or, cela devrait être plutôt fait au niveau des dirigeants hospitaliers car les tutelles doivent rester, à mon sens, dans le champ de la régulation et du contrôle beaucoup plus que dans celui de l’appui. Elles ne peuvent pas jouer à la fois le rôle de régulateur et d’accompagnant.
M. Jean-Luc Gibelin. Je souhaiterais revenir sur la question de la formation. Nous sommes souvent face à la conséquence de décisions politiques, et pas seulement face à des questions techniques ou à l’appréciation du comportement des chefs d’établissement ou de leurs adjoints. Les formations ont cependant été renforcées et aujourd’hui les équipes en place sont capables de faire face. Elles peuvent surtout avoir recours à des conseils pertinents quand c’est utile. Mais nous pensons qu’on ne pourra sortir de la situation actuelle sans des décisions politiques qui soient du même niveau que celles qui ont conduit à ce qu’elle est.
Ne doit-on pas par ailleurs dissocier le coût de l’investissement hospitalier de celui des soins ? Ne doit-on pas considérer que l’investissement hospitalier relève de l’État et qu’il n’a pas à interférer avec le coût des soins ? Nous n’avons pas de solution miracle, mais nous pensons que des évolutions sont nécessaires surtout au vu de ce qui s’est passé la semaine dernière.
M. Éric-Alban Giroux. Cette dernière remarque est extrêmement juste et elle renvoie à ce que je vous disais tout à l’heure, à savoir que l’investissement hospitalier n’a jamais fait partie ni de la T2A ni de la dotation globale hospitalière.
M. Michel Rosenblatt. L’École des hautes études de santé publique assure la formation financière de base des promotions qui s’y succèdent. Jean-Luc Gibelin et moi-même sommes administrateurs de l’école et nous suivons ces questions de près. Les enseignants et les formations dispensées sont de qualité. Je pense que nos collègues sortent de cette école en disposant des outils de base leur permettant de faire face à leurs responsabilités quelle que soit leur affectation. D’ailleurs, ils acquièrent une spécialisation dans la dernière période de formation au sein de l’école en fonction du poste qu’ils vont occuper à leur sortie.
L’endettement est la conséquence de difficultés qui se situent en amont. Il ne suffit pas de dire qu’il faut mobiliser davantage d’argent pour en sortir. Ce raisonnement serait simpliste. Ce qu’il faut, c’est un système enfin stable. Pour faire une prévision solide dans un monde plein d’incertitudes, il faut un certain nombre de points fixes sur lesquels construire cette prévision. C’est ce qui nous fait finalement le plus défaut.
Comme le contexte va continuer à changer, il faut disposer d’une souplesse juridique dans les limites du raisonnable, une souplesse organisationnelle et managériale, la capacité à évoluer et à supprimer certaines rigidités excessives. Les solutions durables au problème de l’endettement ne relèvent pas en premier lieu de la finance, mais de l’organisation, de la conception, de la planification et de l’activité.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Si nous avons besoin d’autres éléments, nous vous demanderons de compléter par un questionnaire écrit. Nous nous déplacerons sûrement aussi sur le terrain pour rencontrer des chefs d’établissement.
M. le coprésident Pierre Morange. Notre collègue Martine Carrillon-Couvreur a réalisé un remarquable travail pour notre travail sur la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), ses modalités de fonctionnement et son évolution depuis sa création. Elle a mis clairement en évidence la méconnaissance complète à la fois du patrimoine immobilier du secteur et de ses coûts de gestion. L’architecture complexe et hétérogène du secteur médico-social – qui associe des structures associatives, privées, mais aussi des structures liées aux collectivités territoriales – fait que la carence est évidente, ce qui nous renvoie au manque d’outils de gestion, de gouvernance, qui aboutit là encore à des situations financières potentiellement fragiles. Si la question de la dette des hôpitaux publics est prégnante, il n’est pas interdit pour autant d’espérer progresser dans son analyse, comme nous l’avons fait pour la CNSA.
*
* *
Audition de M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital (ADH), et M. Christophe Got, vice-président
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale aimerait vous entendre, monsieur Boiron, monsieur Got, sur les solutions à apporter au problème de la dette des établissements publics de santé, problème si profond qu’il menace aujourd’hui la poursuite de l’activité de certains d’entre eux.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital (ADH) et M. Christophe Got, qui en est le vice-président.
Au-delà de l’analyse brute des données chiffrées, les différentes auditions que nous avons menées nous ont fait prendre la mesure de la gravité du problème de la dette des hôpitaux : le taux de dépendance financière place certains établissements dans des situations de quasi-asphyxie, qui met en question leur capacité même à fonctionner. De surcroît, la complexité du système hospitalier français tend à restreindre plus encore les marges de manœuvre. Les gouvernements successifs prônent, depuis plusieurs années voire plusieurs décennies, une concentration et une rationalisation. Diverses structures comme l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) ont fait émerger, à travers des expérimentations, des bonnes pratiques pour une meilleure utilisation des matériels et des locaux ainsi qu’une meilleure affectation des personnels, sachant que les dépenses de personnel représentent 60 % du budget des établissements.
Compte tenu de la situation des comptes sanitaires et sociaux de la Nation qui rend hypothétique une aide supplémentaire de l’État, quels leviers pourraient selon vous être actionnés ? Le volume des aides ne peut suffire aux établissements pour sortir de leurs emprunts structurés, dont les taux ont tendance à déraper du fait de l’évolution du change, particulièrement depuis l’envolée récente du franc suisse. Ne ressentez-vous pas la nécessité d’une accélération des réformes structurelles prônées de longue date ? Nous le savons, le système hospitalier est marqué par une grande inertie et aussi, pour dire les choses de manière policée, par quelques résistances, qui ont pu aboutir à pérenniser la situation financière fragile des établissements.
M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital (ADH). Permettez-moi tout d’abord, madame la présidente, monsieur le président, de vous présenter l’Association des directeurs d’hôpital : réunissant les élèves et anciens élèves de l’École nationale de la santé publique devenue École des hautes études en santé publique, elle s’est réformée au tournant des années 2000 pour devenir une association professionnelle s’intéressant au système de santé avec pour domaine de prédilection l’hôpital public, institution parmi les plus emblématiques de notre pays puisqu’elle est fondée sur le principe de solidarité, particulièrement structurant dans notre République. Notre association s’est toujours efforcée de tenir un discours le moins corporatiste possible sur les thématiques liées à la modernisation du service public, qui ne saurait être pour nous synonyme d’inefficacité, de surcoût et de problèmes financiers.
L’ADH a aussi tenté de contribuer au débat sur l’endettement des établissements de santé dans le milieu hospitalier. Vous avez souligné le poids de la dette, sujet amplement abordé par votre mission sur lequel il n’est sans doute pas utile pour nous ici de revenir en détail. C’est un phénomène que je connais bien puisque le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne dont je suis directeur est l’un des plus concernés par l’endettement, notamment par l’endettement toxique.
Il me paraît important de souligner que la dette n’est pas mauvaise en soi. Bien géré, un endettement correspond au financement d’un investissement qui constitue un pari sur l’avenir. Il est consubstantiel au système de santé : en effet, a contrario les hôpitaux et autres structures de santé qui n’investissent pas ou qui n’investissent plus disparaissent ou deviennent inutiles. La santé nécessite un effort d’investissement qui passe forcément, entre autres moyens, par un financement complété ou assuré majoritairement par de l’endettement, ce qui a été le cas dans les années 2000.
M. le coprésident Pierre Morange. La dette est cependant mauvaise en soi si elle sert à financer des dépenses de fonctionnement.
M. Frédéric Boiron. En effet, l’endettement qui aurait vocation à financer des dépenses de fonctionnement courant engendre bien des problèmes. C’est d’ailleurs une question que se pose l’État lui-même dans son propre fonctionnement et dans ses relations avec les institutions européennes.
Une dette bien gérée ou supportable, même si, comme toute dette, elle comporte une part de risque, contribue à l’évolution positive du système hospitalier et permet de développer des technologies innovantes et de nouvelles modalités de prise en charge des problèmes de santé ou des problèmes associés aux thématiques sanitaires, notre activité s’étendant, au-delà des soins en tant que tels, au domaine social.
Puisque vous nous suggérez d’évoquer des pistes de travail, je soulignerai l’importance qu’il y a à distinguer dans le pilotage de l’investissement hospitalier – et donc potentiellement de l’endettement –, l’investissement dans le biomédical et l’investissement immobilier, qui a été l’un des éléments les plus lourds de l’endettement ces dernières années. Si les difficultés financières actuelles persistent, nous pourrions nous retrouver dans dix à quinze ans devant la nécessité de rénover de manière massive l’immobilier des établissements de santé. Pour éviter les écueils du passé, il importe d’établir des modalités spécifiques pour le financement des dépenses consacrées au biomédical, à l’informatique, aux investissements courants, qui sont liées au développement de la mission principale des établissements, et, d’autre part, pour le financement des investissements immobiliers lourds qui ne peut reposer – les années récentes nous en ont apporté la démonstration – exclusivement sur l’endettement et sur les tarifs de prestation de soins. Ces derniers n’ont pas vocation à supporter les charges immobilières. Cette question se pose dans des pays voisins comme l’Allemagne qui connaît une problématique similaire du fait du développement de la tarification à l’activité.
Les plans d’investissement hospitalier sont intervenus à une époque où les hôpitaux avaient besoin de rénover leur patrimoine pour restreindre le nombre de chambres à quatre ou trois lits ou pour permettre une mise aux normes de confort, voire de sécurité. Ce nécessaire investissement, qui s’est traduit par une amélioration significative pour les patients, a eu pour cadre des schémas qui encourageaient assez fortement à l’emprunt. La logique de l’endettement a été portée par l’ensemble du système, sans que l’on puisse identifier de responsabilités particulières, ce qui, du reste, ne servirait pas à grand-chose.
Toutefois, l’ADH tient à souligner l’aspect immoral du contenu de certains contrats de prêts structurés. Les banques, dans leur ensemble, ne sont pas coupables ou condamnables d’avoir prêté, pas plus que les établissements hospitaliers ne le sont d’avoir emprunté. Le fonctionnement du système nécessite des établissements hospitaliers solides et bien armés pour gérer leurs finances comme il nécessite des banques solides et bien armées pour soutenir l’activité.
Des dysfonctionnements ont toutefois conduit certaines banques, à l’époque la plus critique du développement des prêts structurés, à suivre des stratégies commerciales – que la Cour des comptes a pointées bien mieux que nous ne le ferions – visant à placer des produits comportant un niveau de risque excessif par rapport à l’intérêt des établissements de santé. C’est une responsabilité sociale partagée que de considérer qu’il ne faut pas faire courir de risques inutiles à de grandes structures de service public qui servent la population dans un objectif non pas marchand mais d’intérêt général. L’endettement et l’investissement hospitaliers ne sont pas seulement l’affaire des hôpitaux et des autorités de tutelle qui les entourent, c’est aussi l’affaire des institutions financières, qui doivent contribuer à une gestion raisonnable de nature à diminuer les risques pour nos établissements.
Faisons un parallèle sanitaire. Un patient demande à un médecin hospitalier d’être ouvert au dialogue et de le considérer comme un acteur de son parcours de soins mais il lui demande aussi d’être un expert, à même de lui fournir tous les éléments nécessaires à un consentement éclairé, désormais inscrit dans le droit. De même, en matière de gestion financière, l’institut bancaire doit fournir tous les éléments permettant aux établissements de prendre des décisions éclairées.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous en sommes d’accord. Un simple principe de bon sens veut que tout responsable de deniers publics se doit de les gérer dans l’intérêt général et sans aucune prise de risques, en bon père de famille, par exemple en souscrivant des prêts à taux fixe. Cela n’a malheureusement pas été le cas dans toutes les collectivités territoriales de France. Les exemples ne manquent pas.
De façon concrète, monsieur Boiron, vous qui dirigez un important CHU, quelles ont été les conditions dans lesquelles les emprunts structurés que vous avez évoqués ont été contractés ? Quel est votre plan pour essayer d’en sortir, compte tenu de la situation extrêmement instable des marchés monétaires ? Quel est le coefficient multiplicateur de ces emprunts ? Est-il supérieur aux valeurs de 1, 2 ou 3 que l’on rencontre habituellement ?
M. Frédéric Boiron. Précisons tout d’abord que je n’ai pas moi-même contracté les emprunts structurés que je suis amené à gérer à la tête du CHU de Saint-Étienne, remarque qui n’emporte pas de jugements sur les décisions qui ont été prises par le passé, dans un contexte bien particulier.
Les contrats structurés toxiques comportent deux phases. La première inclut la vente d’options financières assises sur des variations de taux de change, sans aucun rapport avec l’activité de soins : entre le dollar et le yen, par exemple, ou encore entre l’euro et le franc suisse, comme c’est le cas pour l’un des contrats que je gère, ce qui a engendré une explosion des coûts financiers en quarante-huit heures la semaine passée, du fait de l’envolée du franc suisse. Ces options, une fois vendues, servent à bonifier la première phase des contrats. Certains d’entre eux ont été « capés » et limités pour réduire ensuite les effets des coefficients multiplicateurs, d’autres ne l’ont pas été, ce qui est le cas de contrats signés par mon établissement. Le taux d’intérêt peut alors excéder 20 % à 25 % sur la durée restante.
M. le coprésident Pierre Morange. Je connais le cas d’un syndicat intercommunal de traitement des déchets urbains pour qui le taux est monté jusqu’à 70 %.
M. Frédéric Boiron. Pour l’anecdote, je préciserai que l’un des contrats en question s’intitulait « Tofix » : prononcé à l’anglaise – « to fix » –, il signifie « à fixer » ; mais à la française, il se rapproche du rassurant « taux fixe ».
Ces contrats constituent une leçon pour l’avenir. Certes, la charte dite « Gissler » et bien d’autres dispositions sont intervenues depuis. Mais il faut aussi mettre en avant une dimension morale impliquant une responsabilité commune de la société : les instruments financiers doivent permettre aux établissements hospitaliers de rendre le service public qui est attendu d’eux, notamment à travers des argumentaires construits selon des règles déontologiques.
Certains contrats ont pu devenir explosifs. Ma collègue du centre hospitalier d’Arras m’informait ces derniers jours que le changement de politique de la Banque centrale helvétique avait engendré un coût supplémentaire de 800 000 euros pour l’emprunt structuré que son établissement a contracté à hauteur de 8 millions d’euros. Pour le CHU de Saint-Étienne, les récentes variations de la parité entre l’euro et le franc suisse ont entraîné un surcoût de 2,5 millions d’euros pour un seul contrat.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est son coefficient multiplicateur ?
M. Frédéric Boiron. Il repose sur une formule plus complexe, qui comprend des variations de change entre l’euro et le franc suisse. Le taux d’intérêt atteint près de 20 %.
M. le coprésident Pierre Morange. A-t-il été conclu avec une société prestataire de services ou avec une banque ?
M. Frédéric Boiron. L’ensemble des emprunts structurés de cet établissement a été souscrit auprès d’une banque bien connue, la banque Dexia, qui a proposé des refinancements successifs sur plusieurs années à partir d’argumentaires construits sur le thème de la « sécurisation des aléas » ou de « l’amélioration du taux de la dette sur la longue période ».
Il n’y a pas de jugements à formuler mais simplement des leçons à tirer. Ces instruments financiers complexes ont appelé le développement de compétences nouvelles. L’ingénierie financière a beaucoup changé en vingt ans : les banques proposent aujourd’hui des produits qu’elles ne proposaient pas il y a vingt ans et les gestionnaires se sont adaptés à ces évolutions. De la même manière, les directeurs d’établissements hospitaliers doivent s’y adapter.
Dans les années 2000, de nombreux responsables hospitaliers, mais aussi d’autres structures publiques, ont souscrit des emprunts structurés en pensant qu’ils étaient utiles. Il faut se replacer dans le contexte de l’époque : les établissements devaient investir pour se moderniser mais ils ne recevaient que des aides pour l’amortissement de l’endettement et pas de subventions en capital. La logique commandait qu’ils optimisent l’intérêt de la dette. Or plus le taux d’intérêt est facialement intéressant, plus la marge supplémentaire pour investir est grande. C’est pour ces raisons – outre les effets de mode qu’il ne faut pas négliger – que ces contrats structurés ont attiré les responsables, séduits par la possibilité de consacrer des millions supplémentaires à l’investissement et non pas à l’amortissement.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Ces décisions, les chefs d’établissement ne les ont pas prises seuls ; ils devaient les soumettre à leurs autorités de tutelle.
M. Frédéric Boiron. Effectivement. L’un des crédos de l’ADH est qu’à l’hôpital, on ne fait rien seul. C’est une activité de service public quasi-entrepreneuriale dont le fonctionnement n’est pas pyramidal ou autocratique. Nombre de dossiers font l’objet de discussions. L’investissement et l’endettement, questions plus complexes, concernent sans doute moins d’acteurs, mais ont toujours fait l’objet de validations, selon des modalités changeantes depuis le début des années 2000. Après une phase où tous les emprunts faisaient l’objet d’une délibération en conseil d’administration a succédé une courte période de grande autonomie des chefs d’établissement à la fin des années 2000. Aujourd’hui, le conseil d’administration a été transformé en conseil de surveillance et les emprunts, dans un grand nombre d’établissements, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, opération par opération. Le processus de verrouillage est, on le voit, poussé assez loin.
Avec d’autres, Christophe Got et moi-même appelons de nos vœux une évolution de la réglementation. Nous considérons que le dispositif gagnerait en efficacité si le contrôle s’exerçait non plus sur chaque emprunt individuellement, mais sur une année, voire sur plusieurs années s’agissant de grosses opérations, avec possibilité de reports et de modifications de la décision si nécessaire. Cela permettrait à la politique de gestion de la dette d’être active tout en étant bornée.
À ma connaissance, les décisions d’emprunt n’ont jamais été prises dans le secret d’un bureau par un homme seul, même si l’on peut dire – et l’ADH ne s’est jamais gênée pour le souligner – qu’il y a eu des comportements individuels déviants ou anormaux chez certains directeurs d’hôpital comme il y en a eu parmi les responsables d’autres structures publiques ou d’établissements financiers.
Les décisions d’emprunt ont donc fait l’objet de discussions : soumissions à autorisation, délibérations au sein d’instances, validations par les autorités dites de tutelle de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ou du plan global de financement pluriannuel. Plus récemment, elles ont été soumises à autorisation préalable dans la plupart des cas.
M. le coprésident Pierre Morange. Considérez-vous que le dispositif du Comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO) est trop rigide ?
M. Frédéric Boiron. Selon nous, il apporte une amélioration par rapport à la situation antérieure, marquée par le morcellement des comités – comité des risques financiers, comité des investissements, etc. Il rassemble l’ensemble des acteurs au plus haut niveau et exerce un suivi mieux ciblé sur un petit nombre d’établissements, les plus concernés. L’expertise en est renforcée tout comme la possibilité de la partager. Nous considérons donc qu’il s’agit d’un bon dispositif dans son principe et, souvent, dans son fonctionnement.
Nous avons toutefois ce défaut en France de vouloir mettre en place un système parfait après qu’il y a eu des dysfonctionnements. Or le système parfait n’existe pas, ce dont on peut se réjouir d’une certaine manière car cela nous permet de continuer à évoluer. Il ne faudrait pas que cette instance aille trop loin dans le détail de la gestion des opérations de redressement financier qui, pour être efficaces, doivent être pilotées par les acteurs locaux.
Ainsi, un plan de retour à l’équilibre mis en place contractuellement avec l’État et l’agence régionale de santé ne devrait pas fixer à l’avance intangiblement les opérations nécessaires au redressement financier car elles sont appelées à varier. Il faut que le management et la communauté médicale puissent se montrer réactifs et procéder à des ajustements, dans les limites des fourchettes préétablies, en fonction de l’évolution de la technique ou de la demande.
C’est ce risque d’entrer trop dans le détail qu’il nous paraît important de souligner à l’ADH, que ce soit dans les relations avec le COPERMO ou avec les agences.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Que pensez-vous de la stratégie d’investissement à l’échelle du territoire ? Fait-elle l’objet d’une concertation approfondie ?
M. Frédéric Boiron. Je ferai une comparaison entre le système actuel et celui que j’ai connu en commençant ma carrière, il y a une vingtaine d’années à Paris. Il y a eu beaucoup de progrès dans la possibilité d’avoir une approche territoriale ou régionale. Les outils de la concertation restent complexes – est-il nécessaire qu’un plan régional d’organisation et de santé comporte mille pages ? – car il y a toujours cette tendance à l’exhaustivité, mais, de manière générale, les structures de discussion sont plus nombreuses.
Peut-on dire qu’il y a moins d’établissements poursuivant des stratégies autonomes ? Oui, sans doute, mais il me semble que l’on peut aller plus loin. À l’ADH, nous estimons que les établissements doivent résolument suivre l’évolution qu’a connue le modèle communal, qui, même s’il n’est pas parvenu au plein développement de ses potentialités, a su apporter de la valeur ajoutée aux communes et à la population grâce à une bonne association des responsabilités et une bonne répartition des compétences.
Nous devons être les coauteurs de cette évolution car si les établissements résistent à la coopération, cela générera des délais. Il faut oser le dire. Cela suppose de renoncer à certaines prérogatives et à certains symboles parfois artificiels d’autonomie. Dans le système de santé, les hôpitaux ont besoin les uns des autres : il faut que le petit puisse s’appuyer sur le gros et inversement. Les équipements de biologie médicale, chers et de plus en plus complexes en raison des normes de certification, ne peuvent être déployés partout. Nous avons intérêt à regrouper nos plateaux de biologie et à définir le niveau de compétence de tel établissement par rapport à tel autre.
Ces politiques territoriales appellent des décisions qui débordent le seul cadre des établissements. Les autorités dites de tutelle – un terme que nous n’apprécions guère car il renvoie pour nous à la notion de majeurs sous tutelle, autrement dit d’incapables majeurs –, qui sont nos partenaires, doivent pouvoir arbitrer. Et les élus eux-mêmes doivent accepter que des autorités mises en place par l’État fassent des choix de répartition territoriale d’activités qui peuvent être vécus comme défavorables au niveau local mais qui sont justifiés au niveau national. Dans dix ans, nous pourrions envisager des regroupements hospitaliers associant plateaux techniques coûteux et établissements dont la prise en charge n’impliquera pas ce type d’équipement, ce qui aura un impact sur la gestion de l’investissement et de l’endettement.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La loi dite HPST pour « Hôpital, patients, santé, territoires » a modifié la gouvernance des établissements : d’une part, le directeur d’établissement peut fort bien ne pas tenir informé le président du conseil de surveillance ; d’autre part, le président du conseil de surveillance ne peut plus exercer la même pression qu’auparavant sur le directeur.
M. Frédéric Boiron. Un directeur d’établissement qui imaginerait pouvoir vivre dans la confrontation avec le représentant de la population du bassin qu’il dessert se tromperait de métier, tout comme un directeur d’établissement qui imaginerait pouvoir être en guerre avec le représentant des médecins de l’établissement.
Toute la difficulté de notre métier est de trouver un équilibre entre la capacité à prendre des décisions – et à en assumer les conséquences, le cas échéant – et la qualité de la relation avec le représentant de la population. Cette qualité, il est normal que le directeur d’un hôpital la recherche ; il est normal aussi, d’un autre côté, que le président du conseil de surveillance n’ait pas à intervenir trop directement dans la gestion interne de l’établissement, n’en étant pas responsable, même s’il peut, à tout moment, se faire communiquer des informations s’y rapportant. Des deux côtés, il convient d’entretenir une relation saine, reposant sur la confiance.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Parlons franchement : il n’est pas impossible de penser que, compte tenu de l’enjeu que présente un établissement hospitalier au niveau local, il y ait eu avant la loi HPST des pressions exercées par les élus, notamment concernant l’emploi. Les responsables politiques doivent aussi assumer leurs responsabilités dans la dégradation de la situation de certains établissements.
M. Frédéric Boiron. Il est certain que de telles pressions ont existé s’agissant de l’emploi. Aujourd’hui, le représentant légal de l’établissement est le chef d’établissement, cela n’a pas toujours été le cas. Il est bon qu’il y ait une clarification des responsabilités mais il est nécessaire aussi que les directeurs exercent leur métier selon des principes moraux, qui impliquent notamment d’établir un lien de confiance avec le représentant, élu, de la population. L’hôpital est dans la cité, il est dans les territoires. La répartition de responsabilités étant maintenant plus claire, il est possible pour un maire ou un président de conseil de surveillance d’exercer une influence, au bon sens du terme, sur des projets et de participer à des décisions.
M. Christophe Got, vice-président de l’Association des directeurs d’hôpital. Certaines personnes que vous avez auditionnées vous l’ont déjà dit mais je tiens à le redire au nom de l’ADH : on ne saurait se satisfaire d’une approche strictement financière en matière d’endettement, lequel doit aussi soutenir la nécessaire capacité des établissements hospitaliers à investir.
Le COPERMO a fixé comme critère d’éligibilité un taux de marge de 8 % – on sait comme cette contrainte peut être douloureuse lorsqu’elle est opposée à des communautés ayant travaillé durant des mois à des plans de redressement leur ayant permis difficilement d’atteindre 6 %. Mais nous considérons que les établissements hospitaliers de service public n’ont pas pour seule vocation de viser un certain niveau de taux de marge comme un grand groupe privé se doit de le faire à l’égard de ses actionnaires.
Certains établissements, du fait de leur isolement géographique – zones de montagne, territoires ruraux –, d’une démographie médicale particulièrement faible, ou du poids des décisions passées, n’ont plus la capacité d’investir. N’investissant plus, ils risquent de devenir vétustes.
Mon expérience m’a permis de mesurer l’incidence des choix en matière d’investissement.
J’ai exercé dans un CHU situé au nord de la Loire, d’un budget annuel de 600 millions d’euros, dont les responsables, qui s’étaient fait vertu de ne pas dépenser l’argent qu’ils n’avaient pas, n’allaient voir les banques que pour affiner un plan de financement. Résultat de ce refus de l’endettement : chambres à trois lits, absence de moyens pour investir dans un plateau ambulatoire digne de ce nom nécessitant de casser des murs et de regrouper des spécialités, incapacité à assurer le renouvellement des équipements pour attirer de très bons médecins et conserver les chefs de clinique en fin de formation. Autrement dit le choix de la vertu financière a conduit l’établissement à une forme de vétusté dont la population a subi les conséquences.
Aujourd’hui, j’exerce dans un établissement qui a rattrapé un très grand retard en matière d’équipement dû à une absence d’investissement. Il y a une dizaine d’années, quand un nouveau directeur est arrivé, il a trouvé des chambres délabrées et des ascenseurs ne montant plus jusqu’au dernier étage. Il a alors ouvert les vannes de l’investissement pour rénover – ce qui est sa mission. Il a été encouragé dans cette voie par les plans nationaux successifs – Hôpital 2007, Hôpital numérique, Hôpital 2012 – et par l’État qui offrait un effet de levier avec la fameuse couverture des frais financiers d’amortissement. L’endettement a augmenté alors que le taux de l’ONDAM est passé en quelques années de 5 % à 2 %. Résultat : cet établissement figure parmi les trois les plus endettés de France. Le poids de la dette y est asphyxiant. Dans la mesure où les recettes liées à l’activité stagnent, les marges de manœuvre sont extrêmement restreintes : le budget est principalement consacré à payer l’augmentation annuelle des charges de personnel de 1,5 % à 2 %, laquelle n’est pas décidée localement par le directeur mais au niveau national, et à supporter la charge galopante des frais financiers.
Le COPERMO a été créé dans le but de ralentir certains projets. À cette fin, il a mis au point plusieurs critères, dont le fameux taux de marge de 8 % auquel ne peuvent se conformer que les établissements en bonne santé : les subventions sont finalement ainsi octroyées à ceux qui ont la capacité d’être autonomes. Que deviennent dans ce schéma les hôpitaux isolés, ceux qui ont une activité restreinte du fait d’une faible démographie médicale ou ceux qui ont un patrimoine vétuste n’attirant plus les patients ? S’ils ont en plus la malchance d’être endettés, on ne peut leur prédire un avenir très brillant.
Cette situation me contrarie. Dans une même ville, il peut exister d’autres établissements dont les règles de fonctionnement sont totalement différentes. Tel établissement privé se verra attribuer 20 millions d’euros pour sa rénovation par un grand groupe coté en bourse, doté de capitaux australiens et italiens. Tel établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) pourra, comme il en a le droit, choisir les segments de clientèle lui permettant d’équilibrer les plans de retour sur investissements exigés par le COPERMO. L’hôpital public, lui, n’a ni les facilités de l’actionnaire, ni les facilités du choix : il devra continuer à prendre en charge l’ensemble des pathologies. Toutes les études de la Fédération hospitalière de France le montrent, les hôpitaux publics reçoivent des patients plus âgés, plus précaires, plus isolés socialement, et couvrent le plus large éventail de groupes homogènes de séjour (GHS).
Si les établissements publics veulent rester fidèles à leur vocation, qui est de soigner tout le monde sans discrimination, en assurant l’accessibilité financière et géographique aux soins, ils n’ont pas d’autre choix que d’investir pour maintenir des activités sous-rentables. Or, aujourd’hui, si un équilibre peut être établi à travers la compensation entre tarifs excédentaires et tarifs non excédentaires voire déficitaires, cela ne vaut pas pour l’investissement qui n’est guère possible. La tarification à l’activité ne pouvant soutenir les investissements immobiliers, certains hôpitaux publics sont donc condamnés à la vétusté et à la fuite des patients.
M. Frédéric Boiron. Or, on ne doit pas faire supporter à ces tarifs les gros investissements immobiliers mais on ne doit pas non plus réaliser des investissements qui ne seraient pas légitimes. En dehors des cas particuliers qui nécessitent de maintenir un service dans les établissements isolés, ces problématiques doivent faire l’objet d’une approche territoriale. Un petit établissement se trouvant dans la situation décrite par Christophe Got a besoin de partenaires pour se restructurer.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. J’espère que cette mission nous permettra de trouver des solutions aux problèmes que vous soulevez et à maintenir au plus près des citoyens le service public hospitalier, dont la mission repose sur une valeur
– l’égalité de l’accès aux soins – qui structure notre pays.
M. Frédéric Boiron. Permettez-moi pour finir d’évoquer le fonds de soutien mis en place pour sortir des emprunts structurés. Avec beaucoup d’autres, nous estimons que le niveau de sa dotation est absolument insuffisant. Il suffit pour s’en convaincre de comparer son montant, 100 millions d’euros, aux 19 millions d’euros qui seraient nécessaires à l’institut de cancérologie dont j’assure depuis plus d’un an la direction par intérim pour sortir d’un seul des deux petits emprunts structurés qu’il a contractés. Il est indispensable que la dotation du fonds de soutien soit augmentée.
L’ADH estime également que les institutions financières ayant vendu ces contrats de prêts structurés doivent être appelées à contribuer. Les recettes qu’ils retireront des variations de parité entre l’euro et le franc suisse pourraient aussi servir à débarrasser tous les établissements hospitaliers de ces mauvais contrats de prêt.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Nous vous remercions, monsieur Boiron, monsieur Got, pour vos contributions.
*
* *
Audition de M. Lamine Gharbi, président de la Fédération hospitalière privée (FHP), accompagné de M. Emmanuel Daydou, directeur de la prospective économique, médicale et juridique, et de Mme Béatrice Noëllec, responsable des relations institutionnelles et de la veille sociétale
M. le coprésident Pierre Morange. La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale reprend le cours de ses travaux sur la dette des établissements publics de santé, dont le triplement en l’espace de dix ans nous a amenés à solliciter une enquête de la Cour des comptes.
Nous avons le plaisir d’accueillir M. Lamine Gharbi, président de la Fédération hospitalière privée, Mme Béatrice Noëllec, responsable des relations institutionnelles et de la veille sociétale, et M. Emmanuel Daydou, directeur de la prospective économique, médicale et juridique.
Mme Gisèle Biémouret, coprésidente de la Mission, est également rapporteure.
Nous allons vous demander de commenter l’analyse de la Cour des comptes sur la situation hospitalière française, s’agissant notamment de l’hôpital public. Quelle analyse faites-vous monsieur Gharbi, du point de vue de l’hospitalisation privée ? Quelle est la situation des établissements de votre fédération en matière de dette hospitalière et d’emprunts structurés ?
M. Lamine Gharbi, président de la Fédération hospitalière privée. Monsieur le président, madame la présidente, je commencerai par rappeler quelques chiffres.
En 2013, la dette hospitalière représentait 29 milliards d’euros, soit 1,4 % du PIB. Elle a été multipliée par trois en dix ans. L’évolution de la dette, qui était à deux chiffres jusqu’en 2012, progresse encore, mais moins fortement, avec une augmentation de 4 % en 2013. Le taux d’endettement a augmenté de cinq points en cinq ans, porté notamment par les centres hospitaliers affichant un budget de plus de 110 millions d’euros.
La Cour des comptes rappelle, dans son rapport d’avril 2014, la situation du CHU d’Amiens, qui est significative, avec un taux d’endettement de 85 %, celle de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), dont le taux d’endettement atteint 71 % ou encore celle du Centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, endetté à hauteur de 132 %. Pis encore, le Centre hospitalier de Briançon a été menacé en 2012 d’une procédure d’inscription en impayés à la Banque de France. Au total, 35 % des établissements publics ont recours à un emprunt encadré, donc surveillé, en raison de leur situation financière, dont la moitié des CHU et des Centres hospitaliers ayant un budget de plus de 70 millions d’euros.
Il faut savoir que le budget d’un établissement de grande taille qui pratique les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) au sein du secteur privé dépasse rarement 50 millions d’euros. Le budget moyen est de 20 à 25 millions d’euros pour les établissements de taille médiane et de l’ordre de 10 millions pour les plus petites structures. Je ne parle pas des établissements de soins de suite ni des établissements psychiatriques, qui ont un chiffre d’affaires nettement inférieur, de 5 à 10 millions d’euros.
Selon l’enquête réalisée sur la dette des établissements, 84 % de l’encours de la dette, soit 24 milliards, correspond à des emprunts non structurés, c’est-à-dire sans risque, ce qui est assez rassurant. Parmi les prêts structurés, les plus risqués représentent tout de même un montant de 1 milliard d’euros. Les taux d’intérêt des prêts les plus complexes sont au-delà des standards actuels. Nous n’avons pas eu de dévaluation, mais les taux allaient de 5 à 10 %. Je n’aurais jamais pu imaginer la récente évolution de la parité du franc suisse. Je ne savais pas que les hôpitaux allaient de l’autre côté de la frontière, même si c’est tout à fait légal…
M. le coprésident Pierre Morange. Je me permets de rappeler, monsieur le président, que certains emprunts structurés sont indexés sur des écarts de niveaux de taux de change, notamment entre l’euro et le franc suisse ou le dollar. C’est ce différentiel accentué par un coefficient multiplicateur qui peut aboutir à des taux d’intérêt faramineux. Il est clair que le déplafonnement de la parité du franc suisse avec l’euro aboutit à une réévaluation de la monnaie helvétique qui était artificiellement maintenue en deçà de sa valeur pour des raisons stratégiques, essentiellement en matière d’exportation, mais qui étaient considérées comme relativement asymétriques, notamment vis-à-vis des travailleurs frontaliers.
M. Lamine Gharbi. Le surcoût serait évalué – selon une information imparfaite, pas une donnée statistique sourcée – à 20 millions d’euros.
J’en viens aux facteurs aggravants.
Les plans Hôpital 2007 et 2012 ont accentué la situation, car l’envolée du nombre de projets d’investissements, à enveloppe identique, a entraîné la baisse du taux d’accompagnement par l’État – 37 % en moyenne –, ce qui est un peu paradoxal. Par conséquent, des financements bancaires ont été sollicités par les établissements pour compléter les fonds de financement. Le plan Hôpital 2012 a amélioré la situation puisque 51 % des établissements ont été accompagnés. La mise en œuvre de la T2A (tarification à l’activité) a également mis sous tension les budgets des hôpitaux publics, notamment les CHU, les obligeant à trouver de nouvelles ressources.
Que dit la FHP d’une dette hospitalière de 29 milliards d’euros, après une multiplication par trois en dix ans ? Est-ce tenable ?
D’abord, on constate que les hôpitaux publics ont poursuivi la mise en œuvre de projets trop souvent surdimensionnés : je pense au Centre hospitalier sud francilien, au Centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans ou au Centre hospitalier de Chambéry. J’ai cru comprendre qu’il y avait également un projet à Nantes, évalué à environ 1 milliard d’euros.
Je peux citer, par comparaison, l’exemple de la clinique de Courlancy, à Reims, issue de la fusion de trois cliniques de la région champenoise, qui comptera 600 lits et qui réalisera 60 à 70 % de la chirurgie, ainsi que la chirurgie lourde, car elle est détentrice de toutes les autorisations. Le coût du projet est de 130 millions d’euros.
Dans le même temps, les cliniques et hôpitaux privés ont fait des choix stratégiques très différents. Nous avons refusé de céder aux sirènes des emprunts structurés et nous avons choisi de rationaliser notre immobilier.
Deux illustrations très concrètes : le retard du public dans l’engagement à la baisse du nombre de lits et les difficultés de gestion du parc hospitalier.
De manière générale, nous réduisons nos capacités dans nos nouvelles constructions, comme Capio, à Bayonne, qui passe de 400 à 250 lits, ou l’hôpital privé de Dijon, sous l’égide de la Générale de santé, qui passe de 400 à 300 lits. En vingt ans, nous sommes passés, dans le secteur privé, de 2 000 à 1 000 établissements et d’une taille moyenne, modeste, de 70 lits à 120 lits.
Au contraire, les projets publics accroissent le plus souvent leur capacité, comme le Centre hospitalier régional d’Orléans.
Alors que nous sommes en plein développement de la chirurgie ambulatoire et que l’on pourrait s’attendre à des réductions de capacité, il n’en est rien. J’ai également été étonné de voir que le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) pour 2015 prévoyait des financements pour les hôtels hospitaliers. C’est un non-sens idéologique et économique. Dans une structure logique de fonctionnement, lorsque nous décidons de réduire notre activité d’hospitalisation complète, c’est très simple : il nous suffit de remplacer, dans le service concerné, le panneau sur lequel figure l’inscription « Hospitalisation de chirurgie » par un panneau indiquant la mention « Chirurgie ambulatoire ». Comme ce sont les mêmes locaux qui servent à faire de l’ambulatoire, cela permet de réduire les capacités d’accueil.
On dit que les hôpitaux publics doivent faire de la chirurgie ambulatoire, mais on va tout de même bâtir des hôtels hospitaliers, dans la mesure où il y a de la place libre. Je ne comprends pas le raisonnement. Il est vrai que le chiffre que m’ont fourni mes équipes sur le parc hospitalier public fait rêver puisqu’il s’agit de 60 millions de mètres carrés.
M. le coprésident Pierre Morange. Lors d’une précédente audition, des représentants de syndicats et autres structures représentatives des cadres hospitaliers et des directeurs d’hôpitaux ont cité le chiffre de 47 millions de mètres carrés, sachant que ce chiffre n’est pas complètement stabilisé. La Cour des comptes, quant à elle, fait état de 60 millions de mètres carrés.
M. Lamine Gharbi. Si l’on se place du point de vue du contribuable, il paraît inconcevable que le Fonds d’investissement pour la modernisation des hôpitaux soit détourné pour partie de sa mission première. Nous nous sommes aperçus que 100 millions d’euros servaient à financer les établissements publics qui ont joué avec des produits indexés sur le cours du franc suisse ou d’autres devises. Or 100 millions d’euros correspondent à une augmentation de nos tarifs de 1,5 point, du moins en MCO.
Bien entendu, si les décideurs ont été trompés sur la nature des prêts contractés, il conviendra de privilégier la voie du contentieux. Mais s’il s’agit d’erreurs notoires de gestion, l’accompagnement par un financement, même partiel, pour renégocier les contrats de prêt est un très mauvais signal envoyé aux directions d’hôpitaux. Lorsque nous nous trompons sur nos investissements, la sanction est beaucoup plus directe et beaucoup plus rapide. Une erreur de gestion dans nos établissements, c’est un appel à l’actionnaire ou une mise en sauvegarde. Malheureusement, on voit cela tous les jours.
Par ailleurs, certains contrats de prêt des établissements publics bénéficient aujourd’hui de conditions financières très favorables, avec des taux variables faibles. Mais si les taux remontent, cela pourrait aggraver encore la santé financière des hôpitaux, déjà lourdement endettés. Que se passera-t-il dans cinq, dix ou quinze ans ?
Nous n’avons pas mordu à cet « hameçon », car notre survie en dépend. Nous ne sommes donc pas concernés par la problématique des emprunts toxiques. Nous nous efforçons de prendre en considération deux grands enjeux, et d’abord, un enjeu d’efficience. Avec le développement de la professionnalisation de la fonction de directeur financier, les groupes régionaux et nationaux sont de plus en plus attentifs à cette dimension. Le deuxième enjeu est celui de la sécurité face à la complexité de ces produits, complexité qui ne permet pas d’estimer le degré de risque à moyen terme.
Enfin, la progression de la dette est une problématique partagée avec le secteur privé, avec la question du financement des investissements dans le système de tarification à l’activité. À l’heure actuelle, la T2A ne permet pas de soutenir l’investissement, compte tenu des imprécisions de l’Étude nationale de coûts. Dans le contexte tendu de la recherche de financements bancaires, il n’est pas anodin de constater que les cliniques et hôpitaux privés utilisent plus régulièrement la mécanique du crédit-bail. Mais au-delà de cette mécanique, nous nous apercevons que la rentabilité de nos investissements n’est plus confortée par le rendement de nos SCI, comme antérieurement. C’était la critique que les hôpitaux publics faisaient de notre gestion, car selon eux, si nous avions une exploitation déficitaire, nos comptes n’étaient pas le « reflet exact » de la réalité économique de l’établissement, car nous avions des SCI bénéficiaires, générant des loyers et donc des revenus pour les actionnaires.
Aujourd’hui, la suspicion qui portait sur notre fédération est levée, car nous vendons nos murs à des sociétés d’État, comme ICADE. Nous ne pouvons plus entretenir les bâtiments et le rendement sur la partie hôtelière n’est plus de mise aujourd’hui. Nous sommes donc passés à des crédits-baux souvent financés par ICADE ou un équivalent, avec un loyer qui est pour nous la garantie d’une stabilité, situé entre 7 et 8 % du montant de l’investissement.
Les récentes plus-values réalisées par des grands groupes financiers, comme la Générale de santé, proviennent pour la plupart de la vente de leurs murs parce qu’ils ne pouvaient plus pourvoir à leur entretien. Cela étant, notre vocation n’est pas la gestion des lits ou des murs, mais la gestion de l’activité médicale.
Il faut arrêter de refinancer la renégociation des emprunts structurés à risque. C’est un aléa moral évident. Il faut que les établissements publics renégocient les prêts à taux variable, aujourd’hui faibles, mais porteurs de risque demain. Aujourd’hui, les marchés financiers sont porteurs. C’est donc aujourd’hui qu’il faut investir. Nous avons tous de grandes facilités pour porter des projets avec des taux exceptionnellement bas, de l’ordre de 1 à 1,2 % sur du moyen terme – de cinq à sept ans – et de 2 % sur quinze ans.
Il faut également recenser le patrimoine immobilier du secteur public et rationaliser en vendant, notamment, les bâtiments non utilisés. C’est ce que nous avons fait pour ce qui nous concerne.
Plus de projets de reconstruction devraient connaître une baisse significative des capacités. C’est de bon sens. Les avis d’expertise de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), dans le cadre des comités interministériels de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO), devraient être rendus publics. En effet, les décisions se prennent parfois de manière feutrée. Des travaux sur le financement des investissements doivent être menés dans le cadre de l’évaluation de l’évolution de la tarification. Le rapport de la Cour des comptes contient certaines recommandations de bon sens visant à l’efficience et à l’amélioration des règles de gestion financière. Mais nous refusons catégoriquement que soient financées les erreurs de gestion des hôpitaux publics. C’est un message fort, nous ne pouvons plus accepter que ces erreurs soient payées par la collectivité, au détriment des autres secteurs, privé et associatif.
Voilà le message que je voulais, en guise de préambule, vous faire parvenir.
S’agissant de notre mode de financement, il est très simple. Nous sommes soutenus par des organismes bancaires, par de l’autofinancement, par des prêts à moyen ou long terme ou par des crédits-baux. Les banques sont aujourd’hui extrêmement sensibles au projet médical et au projet d’établissement, et surtout, à la pérennité de nos établissements, qui est liée aux autorisations détenues par nos sociétés, mais qui sont sous la « coupe » des ARS. Aujourd’hui, les reconstructions se font par le biais de sociétés publiques nationales, comme ICADE, qui financent la totalité. Mais le détenteur de l’autorisation n’est jamais propriétaire. Il s’agit d’une location perpétuelle, et le locataire a le statut de propriétaire, c’est-à-dire qu’il doit entretenir le bâtiment comme si c’était le sien. C’est un type de location très particulier.
Nous sommes naturellement responsables de nos investissements et, lorsqu’il y a une difficulté, nous faisons appel à l’actionnaire pour combler le déficit ou pour restructurer l’établissement.
Notre dette privée s’élève à 2 milliards d’euros et, dans la mesure où 20 % de nos établissements sont en déficit, le déficit MCO s’élève à 100 millions d’euros. Il est structuré sur une partie des établissements MCO et il n’y a pas d’établissement type qui soit fragile ou en difficulté. De petits établissements avec un chiffre d’affaires de moins de 10 millions d’euros peuvent être rentables. De gros établissements peuvent l’être également. Inversement, petits et gros établissements peuvent être dans une situation très difficile. Il n’y a pas de cas standard. Sinon, nous l’aurions dupliqué et nous ciblerions ce modèle. Cette configuration est liée à la structure de l’actionnariat ou aux compétences du capitaine. Il en va de même dans les hôpitaux publics : il y a de bons et de mauvais gestionnaires, dans le public comme dans le privé.
Il y a par ailleurs la notion de réseau, de groupe et de filière. S’il est seul, l’établissement, quelle que soit sa taille ou son positionnement, est condamné parce qu’il est à la merci de la perte d’une autorisation ou de la perte de deux ou trois praticiens de renommée régionale. Dans ce cas, l’établissement connaîtra des difficultés à très court terme.
Il y a aujourd’hui trois types d’établissements : l’indépendant pur, qui est isolé sur un territoire et qui, à mon sens, connaîtra inéluctablement des difficultés ; les groupes régionaux, qui ont tendance à se développer fortement, et les groupes nationaux qui subissent une phase de concentration entre eux. Vous avez pu le constater dans la presse avec l’arrivée du groupe Ramsay, qui a racheté Générale de santé, mais qui existait déjà sur le territoire.
Je rappelle que, depuis cinq ans, non seulement nous n’avons pas eu de hausse tarifaire, mais nous avons à l’inverse subi une baisse, accentuée depuis deux ans par la récupération du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Aujourd’hui, on nous explique que le pacte de responsabilité va également être récupéré ! Je ne sais pas jusqu’où cela va aller, mais on nous explique que nous n’avons pas droit aux baisses de charges sociales liées au pacte de responsabilité, qu’il serait mal venu d’en bénéficier en tant qu’entreprise et que ce sera récupéré dans la campagne tarifaire, qui va s’ouvrir en même temps que l’examen du projet de loi relatif à la santé. Cela laisse augurer des débats intéressants…
M. le coprésident Pierre Morange. Vous évoquez l’emprunt de 2 milliards d’euros contracté par l’hospitalisation privée. Quel est le montant global du chiffre d’affaires ?
M. Lamine Gharbi. 10 milliards.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur ces 2 milliards, quelle fraction pourrait être éventuellement affectée aux emprunts structurés ?
M. Lamine Gharbi. Aucune. Ce n’est absolument pas notre culture. J’ai découvert ces emprunts en entendant parler des problèmes liés au franc suisse.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Il se dit que, dans le privé, vous pouvez choisir vos patients, et donc, choisir des activités plus rémunératrices, tandis que l’hôpital public accueille souvent des patients âgés, avec de multiples pathologies exigeant des hospitalisations longues.
Avez-vous effectivement le choix de vos patients, ou plutôt des pathologies ? Est-ce la réalité ou un fantasme dans l’esprit collectif – plutôt à gauche ?
M. Lamine Gharbi. Il y a deux types d’établissements.
S’agissant de la médecine et de la chirurgie, il y a des établissements qui ont développé une hyperspécialisation, avec des praticiens hyperspécialisés sur un organe, par exemple l’épaule, qui n’auront effectivement que des patients relevant d’une chirurgie du membre supérieur. Pour ce type d’établissement, qui est minoritaire, il y aura, non pas une sélection des patients, c’est-à-dire un refus, mais une activité centrée sur des activités spécifiques.
Pour autant, la majeure partie de nos établissements, et notamment les 130 établissements qui ont des services d’urgences, accueille toutes les pathologies, jour et nuit, y compris le samedi et le dimanche. Je ne nie pas qu’il puisse y avoir des difficultés dans certains endroits. Nous devons, au sein de la fédération, identifier les difficultés que nous pouvons avoir dans la prise en charge permanente des patients des urgences.
Cela étant, l’hôpital public estime qu’il accueille des patients plus âgés, avec des pathologies plus importantes et qu’il doit donc bénéficier d’un tarif différent. Je lui donne raison, sauf que la T2A, dans sa grande logique mathématique, a prévu 2 400 tarifs. Pour une appendicite, par exemple, il y a quatre niveaux, qui partent de l’appendicite simple jusqu’à la péritonite. Il n’y a aucune différence entre un malade de niveau 3 ou 4, qu’il soit dans le public ou dans le privé, parce que, selon la classification T2A, les critères sont les mêmes. Si l’hôpital public estime qu’il a plus de malades lourds, de niveau 3 ou 4, je ne le conteste pas. Il n’y a pas lieu à débattre. Mais les tarifs intègrent cet aspect.
Vous ne pouvez pas dire, dans le secteur public, que l’hôpital accueille des pathologies plus lourdes que dans le privé et qu’il continue à assumer le fardeau de la nation. Vous continuez à le faire, comme nous, parce qu’il y a des tarifs en adéquation. L’âge moyen des patients hospitalisés pour une fracture du col du fémur est le même, qu’il s’agisse du public ou du privé. On ne peut donc pas dire qu’il y a plus de personnes âgées à l’hôpital public qu’en clinique privée. Les soins de longue durée seront plutôt assurés par l’hôpital public parce que nous n’avons pas les agréments, mais en termes d’urgences, nous voulons prendre en charge les mêmes types de patients. Ce que dit l’hôpital public est vrai pour partie, parce qu’il y a des cliniques spécialisées, mais cela ne concerne pas l’immense majorité de la profession. Ce que je prône, en tant que président de la fédération, c’est l’ouverture de nos établissements aux services d’urgences pour pouvoir assurer des missions de service public.
J’en profite pour rebondir sur la future loi de santé, qui tend à nous exclure des missions de service public et des urgences, et pour dire que le service public hospitalier doit être assuré de façon équivalente par le public et par le privé.
Mme Isabelle Le Callennec. Si j’ai bien compris, le budget des hôpitaux publics s’élève à 110 milliards et la dette à 29 milliards, tandis que les hôpitaux privés ont un chiffre d’affaires de 10 milliards et une dette de 2 milliards.
M. le coprésident Pierre Morange. Le budget de l’hospitalisation publique est de 74 milliards.
Mme Isabelle Le Callennec. Quelle est la part de marché du secteur privé, monsieur le président Gharbi ?
M. Lamine Gharbi. Nous réalisons plus de 60 % de la chirurgie et de la chirurgie ambulatoire, un tiers des accouchements, 15 % de la médecine et 50 % de la cancérologie. Nous avons des parts de marché dominantes en chirurgie curative et une faiblesse dans le secteur de la médecine, d’où la critique des hôpitaux publics. La médecine gériatrique est la plus évoquées à la télévision ou dans des reportages. Nos aînés malades, c’est une image forte. Nous avons, depuis une dizaine d’années, la volonté de nous investir dans ce domaine. La loi dite Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) nous a permis de nous investir dans le champ de la médecine, en permettant le salariat des médecins internistes et gériatres. Nous n’arrivions pas à trouver des médecins libéraux dans ces spécialités, qui sont sinistrées en termes de revenus.
Le fait de pouvoir salarier les médecins et de récupérer leurs honoraires a permis de développer l’activité de médecine. Pour nous, la filière gériatrique est une filière d’avenir, car, comme l’obstétrique, la médecine est un réel service à la population. Je ne cesse de répéter à mes adhérents que leur établissement verra renouveler ses autorisations s’il correspond à un besoin. Nous sommes tous conscients de la raréfaction des finances publiques. Si nous ne correspondons pas à un besoin ou si ce besoin est assuré par un autre acteur, en l’occurrence l’hôpital public, qui a l’éternité devant lui, nous serons, nous, toujours dans la précarité. C’est pour cette raison que nous devons investir des champs qui ne sont pas aujourd’hui majoritaires chez nous, et notamment la médecine polyvalente gériatrique.
Mme Isabelle Le Callennec. À vous écouter, j’ai le sentiment que, pour vous, big n’est pas beautiful. Vous semblez plutôt favorable aux petits établissements. Sont-ils bien implantés sur le territoire ? Car, demain, nous aurons un défi à relever. Il y a une contradiction entre l’implantation des gros établissements publics hospitaliers dans les grandes capitales régionales ou départementales et la volonté – vous parliez du vieillissement – d’avoir des établissements bien répartis pour un accès aux soins de proximité. Si l’on se dirige vers la chirurgie ambulatoire, il faudra avoir des établissements de taille modeste, mais présents sur tout le territoire. Vous faites un lien entre la taille de l’établissement et la capacité de répondre aux besoins de services médicaux. Pensez-vous que ce point fasse partie des préoccupations du Gouvernement et qu’attendez-vous de la part du législateur ?
Personnellement, j’estime qu’il est préférable d’avoir des établissements de petite taille ou de taille moyenne bien implantés sur le territoire, plutôt que des mastodontes. Cela étant, il faut que cela se traduise dans le bon sens en termes budgétaires et financiers.
S’agissant des taux d’emprunt, avez-vous la capacité de renégocier facilement ? Savez-vous si les hôpitaux publics ont la même capacité à renégocier leurs prêts ? Ce n’est pas toujours simple pour eux, car ils ne peuvent pas placer d’argent. Lorsqu’ils doivent faire un investissement et qu’ils ont des difficultés financières, on leur dit que ce ne sera pas possible.
En ce qui concerne la T2A, que faut-il faire pour que ce ne soit pas une charge, mais qu’au contraire, elle serve les hôpitaux ? Vous avez évoqué l’existence de 2 400 tarifs. Comment sont-ils réévalués ? Qui décide ? Est-ce toujours juste et efficace ?
M. Lamine Gharbi. Pour répondre à votre question sur la taille des établissements, la concentration a aujourd’hui des effets délétères. S’agissant de l’obstétrique privée, trente départements n’ont plus de clinique privée, du fait du regroupement et de la volonté de faire toujours plus grand et toujours plus beau. Je suis surpris de voir que le Gouvernement a introduit la notion de maisons de naissance. On nous a expliqué que les maternités qui procédaient à moins de 300 accouchements par an étaient dangereuses. Aujourd’hui, on nous parle des maisons de naissance, adossées à un hôpital ou à une clinique, mais sans médecin. Permettez-moi de m’étonner lorsqu’on dit qu’une maison de naissance sans gynécologue est plus sure qu’un établissement pratiquant moins de 300 accouchements par an !
C’est le secteur privé qui est implanté dans les zones reculées, isolées ou excentrées. C’est le secteur privé qui peut maintenir les activités de chirurgie dans des établissements de petite taille. Avec deux chirurgiens viscéraux, deux chirurgiens orthopédistes et deux anesthésistes, vous assurez une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Pour ce qui est de l’hôpital public, avec les 35 heures, il faut cinq praticiens de chaque spécialité, ce qui est impossible, sauf à faire appel à des médecins « mercenaires ».
Les établissements doivent s’adapter et être réactifs pour être capables de fonctionner dans des zones géographiques où l’hôpital public ne peut pas aller. J’en suis, avec d’autres, l’un des fervents défenseurs.
La taille optimale pour la chirurgie et la médecine se situe entre 250 et 300 lits, mais un établissement de 100 ou 150 lits arrive aussi à fonctionner. Dans la mesure où il y a un basculement total d’activité, nous faisons aujourd’hui 70 % de chirurgie ambulatoire. Nous faisons des prothèses de hanche en ambulatoire et nous ferons demain des prothèses de genou en ambulatoire. C’est un bouleversement total des structures d’hébergement et de prise en charge. Un travail fantastique est fait en amont comme en aval, et nous allons encore réduire les capacités d’hébergement.
Ceux qui se plaignent de la T2A sont peut-être ceux qui en sont les victimes, dans la mesure où elle permet une comparaison avec l’hôpital public. Avant l’instauration de la T2A, on ne pouvait pas comparer les deux secteurs. Il y avait, en 2005, 600 tarifs, soit 600 actes chirurgicaux ou techniques identifiés. On est passé à 2 400 parce qu’on a introduit quatre niveaux.
Vous allez comprendre le drame que nous vivons, le 1er mars de chaque année. Au-delà de la baisse globale des tarifs – moins 0,8 % l’an dernier –, il y a une redistribution complète de ces 2 400 tarifs. Selon une Étude nationale de coûts, les variations peuvent aller, chaque année, de 15 à 20 %. L’opération du canal carpien, l’an dernier, a représenté une baisse de 16 % de nos activités. Lorsqu’une clinique spécialisée dans la chirurgie orthopédique connaît une baisse de chiffre d’affaires arbitraire de 10 à 15 %, c’est une catastrophe. D’où la volonté de se déployer sur d’autres activités, notamment la médecine.
Nous avons donc deux difficultés, la première étant la baisse des tarifs. Il y avait, dans la loi de 2005, la notion de convergence intersectorielle…
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous prie de m’excuser, monsieur le président. La convergence est, certes, un sujet essentiel, mais nous nous éloignons de l’objet de la Mission, à savoir la dette des hôpitaux.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Monsieur le président, quelles sont vos relations avec les agences régionales de santé ? Quelle part prenez-vous dans la stratégie et la planification de l’offre au niveau régional ? Vous nous avez fait part des difficultés de certains hôpitaux, qui sont quasiment en cessation de paiement. Dans le cas d’une fermeture, l’hospitalisation privée pourrait-elle prendre le relais ?
M. Lamine Gharbi. Nous le pourrions, et j’ai même fait la proposition que l’hospitalisation privée puisse assurer la gestion de certains hôpitaux publics. Nous nous engageons alors au maintien de l’emploi et nous proposons une baisse des tarifs de 10 %, sachant qu’il existe un écart de 25 % entre le public et le privé.
S’agissant des ARS, nous sommes outrés de servir de variable d’ajustement par rapport au service public. À Montluçon, on va fermer les urgences du privé pour que l’hôpital public récupère de l’activité. Chaque fois qu’un hôpital public est en difficulté et qu’il y a en face une activité privée, c’est cette dernière qui est sur la sellette. Je pense à Aurillac et à ses deux services de réanimation, public et privé. Je ne porte pas de jugement médical, car les deux activités sont de qualité.
Les ARS ont un très grand pouvoir de nuisance vis-à-vis du secteur privé. Nous ne pouvons plus accepter la mainmise de l’autorité de tutelle qui, insidieusement, lors des renouvellements d’autorisations, supprime prioritairement celles dont bénéficient les établissements privés. Je place de grands espoirs dans la loi sur un seul point, les groupements hospitaliers de territoire, qui vont permettre, au sein des hôpitaux publics – du moins, je l’espère –, de supprimer 100 à 150 services qui, aujourd’hui, ne sont plus en adéquation avec les qualifications médicales, et d’en finir avec le recours aux mercenaires qui, chaque jour, alourdissent les comptes de l’assurance maladie.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Vous parlez sans doute des médecins intérimaires dans le secteur public. Avez-vous, dans le secteur privé, les mêmes difficultés que l’hôpital public pour recruter ? Avez-vous également recours à l’intérim ?
M. Lamine Gharbi. L’intérim médical n’existe pas chez nous, car ce sont des médecins libéraux qui exercent. Un médecin libéral doit assurer la continuité des soins et son remplacement pendant ses congés.
En psychiatrie, il y a également beaucoup de médecins libéraux.
Les soins de suite étant assurés par des médecins salariés, nous devons pourvoir à leur remplacement. Mais les difficultés que nous rencontrons sont plus liées au positionnement géographique des établissements qu’au statut. Pour nous, l’intérim médical n’est pas une difficulté majeure, dans la mesure où nous arrivons à être attractifs et à avoir les médecins qu’il faut aux postes qui conviennent.
Par ailleurs, la concentration du secteur fait que, dans le cas d’un regroupement de plusieurs cliniques, disposant chacune, par exemple, de deux ou trois anesthésistes, on se retrouve avec un pool conséquent d’anesthésistes, avec une réelle activité. Cette concentration nous permet d’avoir aujourd’hui une densité médicale et un renouvellement médical relativement satisfaisants. En outre, l’équivalence des diplômes européens permet de recruter, en mode libéral, des praticiens originaires des pays de l’Est.
M. Dominique Tian. Le chiffre d’affaires des hôpitaux publics s’élève à 74 milliards d’euros et la dette à 29 milliards, soit 40 % du chiffre d’affaires. Le secteur privé a un chiffre d’affaires de 10 milliards et une dette de 2 milliards. Comment expliquez-vous la différence d’endettement entre les deux structures ?
Y a-t-il également dans l’hospitalisation privée, des emprunts toxiques qui pourraient mettre les établissements en difficulté ?
M. Lamine Gharbi. Ce qui explique la différence d’endettement, c’est que, lorsque nous contractons une dette, nous savons que nous serons obligés de la rembourser. Dans ce cas, on est plus attentif à l’emprunt que l’on va contracter.
Ensuite, nous ne construisons que les surfaces dont nous avons besoin, car au-delà des locaux qui sont, dans le public, pour une même activité, 20 à 30 % supérieurs à ceux du privé, le fonctionnement est coûteux. Lorsqu’on construit raisonnablement, l’emprunt est moins élevé. Mais avant tout, je le répète, nous remboursons.
M. le coprésident Pierre Morange. Même dans le secteur public, on rembourse !
M. Lamine Gharbi. J’avais compris qu’il y avait chaque année, 100 millions d’euros…
M. le coprésident Pierre Morange. 100 millions d’euros sont crédités pour abonder ou consolider la gestion des emprunts structurés contractés par les hôpitaux publics français. Il faut savoir que ces 100 millions d’euros sont bien faibles au vu de l’accumulation des emprunts structurés dont le dérapage – notamment lié aux évolutions du taux de change du franc suisse – a fait une hydre tentaculaire en plein développement, qui terrorise le parc hospitalier public français, ses responsables et le ministère de tutelle. Nous allons recevoir dans quelques instants les établissements bancaires pour qu’ils nous fassent part de la pertinence de leur analyse, s’agissant des taux qu’ils ont délivrés.
M. Dominique Tian. Monsieur le président Gharbi, vous venez de dire que le secteur privé était responsable et qu’il faisait attention aux emprunts qu’il contractait. Voulez-vous dire que les hôpitaux publics sont allés chercher de l’argent un peu n’importe comment parce qu’il fallait trouver des moyens de financement, quitte à prendre quelques risques ?
M. Lamine Gharbi. Je vais commencer par retirer ce que j’ai dit à propos des hôpitaux publics qui ne remboursaient par leur dette ! Cela étant, je ne répondrai pas à votre question, monsieur Tian, car je ne suis pas le porte-parole de la Fédération hospitalière de France (FHF).
S’agissant des emprunts toxiques, je vous rassure de nouveau, dans le secteur privé, nous n’en avons pas contractés.
Par ailleurs, nous renégocions nos dettes. J’ai, à titre personnel, des emprunts qui datent de 2011, avec un taux de 4 %. Même la BPI (Banque publique d’investissement) accepte de renégocier. Je suis arrivé, à titre personnel, pour mon groupe, à un taux de 2,70 %. En termes d’investissements, sur du moyen terme, à cinq ans, je suis arrivé à un taux compris entre 0,9 et 1,1 %.
Mme Isabelle Le Callennec. Les hôpitaux publics ont-ils accès à la BPI ?
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La Société de financement locale (SFIL) aide les hôpitaux publics à se débarrasser des prêts structurés. Pour ce qui est de la BPI, je ne sais pas ce qu’il en est.
Que pensez-vous, par ailleurs, monsieur le président, de la formation des dirigeants des hôpitaux publics ? Quelle différence y a-t-il avec la formation ou le recrutement des dirigeants des hôpitaux privés ?
M. Lamine Gharbi. Aujourd’hui, le dirigeant d’un hôpital public et le dirigeant d’une clinique privée se ressemblent comme deux gouttes d’eau. La caricature n’a pas de sens. Ce sont des professionnels, d’un côté comme de l’autre.
Quant à la formation des directeurs d’hôpitaux, je crois qu’elle est assurée par l’École des hautes études de santé publique de Rennes.
Pour ce qui nous concerne, des formations de troisième cycle sont dispensées à l’ESSEC, à HEC ou à Montpellier. Je le disais lors d’une précédente table ronde, la clinique idéale ou l’hôpital idéal, ce sera lorsque l’hôpital ressemblera à la clinique et que la clinique ressemblera à l’hôpital. Outre le combat que nous menons en faveur de l’égalité, de l’équité et de la transparence, nous contribuons, vous et nous, à une même mission, et la guerre public-privé n’a plus aucun sens. Nous n’avons plus les moyens, aujourd’hui, d’avoir des structures hospitalières publiques, associatives et privées générant des clivages. Je pense que vous participez de cette prise de conscience. C’est pour cette raison que nous sommes confiants dans la complémentarité de nos offres.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. J’en viens à une autre question. De combien de mètres carrés disposez-vous ?
M. Lamine Gharbi. S’agissant du secteur privé, il y a 10 millions de mètres carrés.
M. Emmanuel Daydou, directeur de la prospective économique, médicale et juridique. D’un point de vue macro-économique, notre secteur, toutes spécialités confondues, représente 17 % des ressources de l’assurance maladie consacrées à l’hospitalisation.
Si l’on totalise en moyenne les chiffres que le président a donnés sur l’activité, nous approchons les 25 %. Il y a donc un ratio intéressant entre le financement qui nous est consacré et l’activité déployée. Il est bon d’avoir ces chiffres en tête, car ils font écho aux questions que vous nous avez posées, notamment sur les niveaux d’endettement des deux secteurs.
Le président a rappelé la rapidité avec laquelle le nombre d’établissements privés a baissé, notamment en MCO, et le fait que, concomitamment, ils ont une taille relativement modeste, mais qui leur permet de se rapprocher de ratios de gestion raisonnables, malgré les baisses tarifaires. Même si, en 2012, plus de 30 % de nos établissements MCO étaient en déficit, globalement, le secteur s’est restructuré, ce qui nous a permis de maîtriser le recours à l’endettement.
Le président l’a rappelé, nous avons été aidés. Aujourd’hui, quand une banque prête à un actionnaire indépendant, elle mesure le risque qu’elle prend. Le président a cité le recours très fréquent au crédit-bail. Cela explique aussi le fait que, globalement, dans notre secteur, nous n’avons pas de difficulté à accéder au financement. Il n’en demeure pas moins que les établissements bancaires sont très attentifs au risque. Du coup, nos établissements ont procédé à un ajustement de leur attitude par rapport à l’endettement, ce qui les place aujourd’hui dans une situation plus favorable que celle du secteur public.
C’est un faisceau de facteurs qui a permis d’arriver à cela : restructuration et gestion du risque. Tout à l’heure, on parlait de la formation. On trouve très fréquemment, dans nos établissements, des profils formés dans des écoles de commerce, qui viennent parfois d’autres secteurs économiques et qui ont une approche solide des contraintes de gestion, ce qui est un atout quand on s’attaque à des questions aussi compliquées que celles du financement et du crédit.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Vous faites-vous aider, pour la gestion financière, par des sociétés extérieures spécialisées ? Je suis présidente du conseil de surveillance d’un tout petit hôpital où il n’y a pas de plateau technique, mais des urgences. C’est une agence extérieure qui aide à la facturation de la T2A.
M. Lamine Gharbi. Historiquement, nous avons toujours produit une facture pour pouvoir être remboursés des soins prodigués. C’étaient les prix de journée. C’est pour cela que nous sommes passés en 24 heures d’un système de facturation à un autre. Nous n’avons pas besoin d’aide pour apprendre à facturer, parce que, pour nous, c’est naturel.
Dans les hôpitaux publics, cela n’est pas naturel, puisqu’ils fonctionnent à partir d’un budget global. Il y a donc un temps d’adaptation et je comprends que ce temps soit long. Cela étant, je ne cautionne pas le report perpétuel de la facturation individuelle du séjour par les hôpitaux publics.
Pour ce qui est des conseils de gestion, je vous rappelle que nous avons des comptes certifiés par des commissaires aux comptes et que ces derniers éclairent aussi le gestionnaire notamment sur les ratios d’endettement.
Les meilleurs de nos établissements ont une procédure d’analyse des écarts de budget et un reporting tous les dix jours, pour pouvoir avoir une action immédiate. Notre gestion, qui est extrêmement précise, serait possible pour les hôpitaux publics, car si les grands groupes qui génèrent un chiffre d’affaires de 2 milliards ont des reportings à dix jours, un hôpital, avec un budget de 600 ou 700 millions d’euros, devrait aussi pouvoir le faire. Il faudra peut-être un peu plus de temps, mais je suis persuadé que les hôpitaux publics y arriveront, parce qu’ils ont les capacités et les compétences. Ils en auront aussi forcément l’envie, car la recherche d’économies et d’efficience est la vocation de tout manager public ou privé. Comme je vous l’ai dit, il n’y a pas de différence entre les deux.
Je reprendrai l’exemple du directeur du CHU de Montpellier, qui a toujours eu la volonté d’être un manager. Aujourd’hui, il affiche un CHU à l’équilibre, il le dit haut et fort et il explique comment il est arrivé à rétablir un équilibre par l’activité, par la maîtrise des charges et par un gel de la masse sociale. Je me réjouis que la rentabilité ne soit plus un mot banni pour le public.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, raporteure. Nous vous remercions, monsieur le président Gharbi, pour votre contribution à nos travaux.
*
* *
Audition de M. Richard Boutet, directeur du pôle Banques des particuliers et des entreprises, Affaires publiques France de la Fédération bancaire française (FBF), M. Hervé Leroux, directeur des entreprises et du secteur public, directeur de la clientèle patrimoniale au Crédit Agricole SA, et M. Philippe Barraud, responsable Grandes collectivités et ingénierie financière, M. Cédric Mignon, directeur du développement des Caisses d’Épargne du Groupe BPCE, et M. Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du marché Secteur public et partenariats public-privé, M. Pierre Vérot, directeur de la gestion de l’encours de Dexia crédit local, et M. Jean-Pierre Rosello, directeur des marchés de l’économie publique de la Société Générale
M. le coprésident Pierre Morange. Nous accueillons à présent les représentants de banques concernées par les prêts structurés à risque consentis aux hôpitaux publics.
M. Richard Boutet, directeur du pôle Banques des particuliers et des entreprises, Affaires publiques France de la Fédération bancaire française (FBF). La Fédération bancaire française (FBF) et les établissements bancaires ont très volontiers répondu à votre invitation, qui va nous permettre de faire le point sur le financement des hôpitaux. Tout le monde a bien conscience que la situation financière des hôpitaux dans notre pays est fragile, du moins pour une partie d’entre eux. La problématique est double : elle porte sur l’endettement et sur le financement. Dans un contexte de contrainte budgétaire forte, les hôpitaux ont besoin de financements importants.
Depuis la crise, les établissements de crédit se sont plus encore rapprochés de leurs clients, y compris ceux du secteur public, pour trouver des solutions adaptées, en prenant en compte les contraintes réglementaires nouvelles qui pèsent sur l’activité bancaire en général. Les banques estiment que les besoins de financement des hôpitaux se sont réduits, et elles confirment ne pas avoir de difficultés réelles à les financer. En effet, nous avons constaté en 2014 une baisse de leur demande de crédit de moyen et long termes.
Sur le financement des hôpitaux publics, dont la situation financière actuelle et la capacité de remboursement nourrissent des inquiétudes légitimes, je tiens à souligner une chose. Les banques peuvent continuer à prêter dans les conditions actuelles dans la mesure où l’État offre une garantie. Sans cette garantie de l’État, le paysage de l’offre de crédits serait bien différent, tant par son volume que par ses conditions. Pour les banques, un prêt à un hôpital peut donc être assimilé à un risque d’État. Le financement des hôpitaux est aussi possible grâce à l’existence de mécanismes qui traitent systématiquement les divergences de situation financière de certains d’entre eux.
Pour évaluer la situation financière des hôpitaux, il faut se référer aux travaux de la Cour des comptes, qui a établi plusieurs critères en la matière. On observe ainsi qu’un tiers d’entre eux dépassent les critères d’alerte de la Cour. Les établissements financiers prêteurs arrivent aux mêmes analyses et travaillent sur les mêmes chiffres que la juridiction financière. Il est important de rappeler que les hôpitaux peuvent également avoir recours aux financements de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque européenne d’investissement (BEI) comme à ceux des banques commerciales.
Les spécialistes qui m’accompagnent sont les représentants des plus grands acteurs bancaires qui financent au quotidien des hôpitaux. Ils vont répondre à vos questions.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Comment des prêts structurés aussi dangereux, c’est-à-dire avec une dimension spéculative, ont-ils pu être proposés au secteur public ?
M. Hervé Leroux, directeur des entreprises et du secteur public, directeur de la clientèle patrimoniale au Crédit Agricole SA. Les produits structurés – qui ne sont pas tous des prêts sensibles toxiques – ont pour objectif de permettre une gestion dynamique de la dette. Si de tels prêts sont proposés, c’est parce que le client recherche une gestion dynamique et une performance de sa dette supérieure à celle qu’il pourrait obtenir dans des conditions standards. Dans la plupart des cas, ces produits permettent aux clients de réduire le coût de leur dette.
Notre métier est de qualifier le risque tout en conseillant nos clients. Le Crédit Agricole a très largement respecté ce devoir de conseil, en soulignant le risque pour chaque proposition. Cela étant dit, l’évolution récente de la parité euro/franc suisse nous a pris de court, comme tous les opérateurs. Il est clair que ces produits présentent une part de risque que nous essayons de documenter.
M. Dominique Tian. La dette cumulée des hôpitaux publics s’élève à 30 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires de 74 milliards, soit un taux d’endettement de 40 %. D’après ce que vous venez de dire, un tiers des établissements ne devraient pas obtenir ces prêts sans la garantie de l’État. Vos prêts structurés n’ont-ils pas été davantage proposés à ces établissements en difficulté ?
M. Hervé Leroux. Ce n’était absolument pas notre volonté : nous n’avons pas cherché à orienter tel ou tel prêt structuré vers tel ou tel client. Les hôpitaux qui ont souscrit ces emprunts ont une taille très significative : ils avaient la capacité de comprendre parfaitement les produits proposés.
M. Dominique Tian. Quels sont ces directeurs qui étaient partants pour gérer la dette de leur établissement de manière dynamique ? Nous voulons comprendre pourquoi les banques en sont arrivées à financer certains établissements hospitaliers publics avec ce type de financement !
M. Hervé Leroux. Ce type de prêt structuré représente 1 % de l’encours du Crédit Agricole, contre 3 % à 3,5 % pour l’ensemble du marché. Nous sommes donc loin d’avoir diffusé massivement ce type de produit.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Le plan Hôpital 2007 et le plan Hôpital 2012 ont probablement amené les directeurs d’établissement à engager des investissements qui ne se sont pas toujours révélés judicieux. Les directeurs des hôpitaux sont-ils suffisamment informés en matière de montages financiers et ont-ils besoin de l’aide de structures extérieures dans ce domaine ?
M. Cédric Mignon, directeur du développement des Caisses d’Épargne du Groupe BPCE. L’endettement des hôpitaux est passé de 10 milliards d’euros en 2003 à plus de 30 milliards fin 2013. Les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 ont, en effet, relancé l’investissement et donc le besoin de financement. Pour le Groupe BPCE, les Caisses d’épargne et le Crédit Foncier sont très présents pour le financement des hôpitaux, à hauteur de 7,2 milliards, soit un quart de nos encours de financement aux hôpitaux.
Pour notre part, nous n’avons pas proposé de crédits structurés plus spécifiquement à une catégorie d’hôpital. Pour chaque demande de financement des hôpitaux, dont des demandes de crédit structuré, nous avons proposé les deux cotations, à taux fixe et à taux variable, en crédit classique ou sous forme de crédit structuré. Ces propositions ont donc été faites à l’ensemble des hôpitaux, quelle que soit leur taille, quand ils nous l’ont demandé.
Sur ces 7,2 milliards d’encours, 247 millions d’euros concernent des crédits structurés dits hors Charte Gissler, soit moins de 3,3 % de nos encours, et surtout des hôpitaux de moyenne et grande tailles – les hôpitaux de petite taille étant au nombre de trois seulement, soit 0,01 % du montant des prêts à rembourser. Nos offres de prêts structurés n’ont donc pas été concentrées sur les petits hôpitaux. Par contre, il est beaucoup plus compliqué de retravailler ces produits avec les petits hôpitaux car leur marge de manœuvre pour sécuriser tout ou partie de leur dette est moins importante que celle des établissements plus grands.
Nous avons eu affaire à des gens qui avaient des compétences. Les prêts structurés ont été introduits dès 1995, notamment par des banques étrangères. Le groupe BPCE a commencé à s’y intéresser à la demande de ses clients – collectivités comme hôpitaux – à partir de 2004-2005, puis il a arrêté toute proposition de ce type de crédit dès le 1er janvier 2008. Ainsi, pendant de nombreuses années, ces produits ont correspondu à un financement usuel de certains acteurs économiques : des clients, dont certains même avaient été assistés d’un conseil, nous ont demandé de leur en proposer. La responsabilité est donc partagée.
M. le coprésident Pierre Morange. Cette coresponsabilité est indéniable. Mais il faut garder à l’esprit que les pertes colossales subies par les établissements bancaires à partir de 2008 ont amené le Gouvernement – et donc le peuple français – à soutenir ces derniers pour éviter un effondrement systémique.
Alors que la BCE a décidé de baisser ses taux d’intérêt, pour relancer l’économie, à des niveaux historiquement bas, il serait malvenu de discuter ou de tergiverser sur la question des emprunts structurés. L’heure est venue de sortir de cette crise des hôpitaux publics, qui ont au cœur de leur mission la santé du peuple français. En clair, les établissements bancaires se doivent d’intégrer cette question, à la fois éthique et morale, dans leur stratégie de renégociation de ces prêts pour revenir à des taux fixes.
Sur un sujet aussi emblématique que la santé du peuple français, les membres de la MECSS et plus généralement la représentation nationale ne comprendraient pas qu’une sortie de crise ne soit pas trouvée rapidement afin de remédier à l’asphyxie financière d’un tiers de ces hôpitaux publics. Car derrière cette crise, il y a des souffrances, il y a des vies.
Nous attendons donc de votre part des éléments extrêmement précis en termes d’agenda et de taux d’intérêt. Sur ce sujet vital – la santé des Français –, il y a urgence. Cette urgence est, à mes yeux, de même niveau que l’a été celle du sauvetage de la Grèce.
M. Cédric Mignon. Nous sommes conscients du problème depuis le départ, et la restructuration est engagée depuis de nombreuses années. Au cours des quatre dernières années, nous avons restructuré 80 millions d’euros de nos crédits structurés, soit en sortant les établissements hospitaliers de ces prêts, soit en reportant la date de mise en place de l’indexation à taux variable. Ainsi, sur les 28 crédits structurés de la Caisse d’épargne et du Crédit Foncier, un seul est encore en période active.
M. le coprésident Pierre Morange. La restructuration des emprunts toxiques vous ramène donc à un taux fixe. À combien s’élève ce taux en moyenne ?
M. Cédric Mignon. La plupart de nos crédits sont encore à taux garanti, c’est-à-dire à taux fixe. Pour les prêts hors charte Gissler, le taux moyen du groupe BPCE est de 4,80 %, contre 3,50 % pour les prêts classés dans la Charte.
M. le coprésident Pierre Morange. La représentation nationale attend de l’ensemble des établissements bancaires qu’ils s’engagent de façon claire et nette à régler ce problème des emprunts toxiques une bonne fois pour toutes. Il faut en finir avec ces emprunts « pourris » pour revenir à un taux fixe, conforme au marché, quitte à vous asseoir sur des soultes, car on sait bien que la ligne de crédits dégagés par le Gouvernement à hauteur de 100 millions d’euros par an sera insuffisante.
M. Hervé Leroux. Le Crédit Agricole partage entièrement votre préoccupation à propos du système de santé français.
Comme l’a dit M. Mignon, nos établissements bancaires mènent depuis sept ans une politique très volontariste de désensibilisation, c’est-à-dire de renégociation des prêts. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) suit cette question de près : ce que je viens de vous dire n’est donc pas une simple déclaration.
Bien entendu, nous voulons renégocier l’ensemble des prêts toxiques pour les raisons évidentes que vous venez de souligner, monsieur le coprésident. Mais encore faut-il que les établissements hospitaliers veuillent également le faire, ce qui n’est pas si simple dans certains cas. En effet, certains d’entre eux ne répondent pas positivement à nos propositions de réaménagement de prêt.
Pour ce qui concerne le Crédit Agricole, sur 4,7 milliards d’euros d’engagements sur les hôpitaux, l’encours des prêts toxiques ne s’élève qu’à 84 millions – volume certes significatif, mais pas aussi massif qu’on le dit. Je peux donc dire que nous avons alimenté très faiblement le mouvement par rapport à d’autres. L’engagement citoyen, auquel vous faites allusion, de groupes tels que le nôtre, qui paient leurs impôts sur le territoire, est aussi celui-là.
M. le coprésident Pierre Morange. J’entends parfaitement votre propos. La représentation nationale souhaiterait entendre le même discours citoyen de la part de l’ensemble des établissements bancaires français.
M. Dominique Tian. Il serait utile à la représentation nationale d’avoir des éléments chiffrés, en particulier le nombre d’hôpitaux en danger, le nombre de ceux qui ont commencé une démarche de remboursement anticipé ou de modification du taux, mais aussi celui des établissements concernés par des partenariats publics-privés (PPP), dont certains sont susceptibles de présenter un danger pour ces derniers.
M. Richard Boutet. Nous vous fournirons ces éléments statistiques une fois que nous les aurons réunis.
M. Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du marché Secteur public et partenariats public-privé du secteur public – Groupe BPCE. Le groupe BPCE réalise 30 % des opérations en partenariat public-privé en France, essentiellement pour des projets supérieurs à 100 millions d’euros. Nous avons ainsi participé à la construction du site de Balard, de prisons, d’écoles, d’universités, etc. Côté hôpitaux, je peux vous affirmer que nous n’avons pas de problème concernant les PPP, mais je vous communiquerai ultérieurement le nombre de clients hospitaliers concernés.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Un fonds d’intervention de 100 millions d’euros a été mis en place pour les petits hôpitaux les plus endettés en emprunts toxiques. Vos banques financent-elles ce fonds et à quelle hauteur ?
M. Pierre Vérot, directeur de la gestion de l’encours de Dexia crédit local. Deux banques financent ce fonds à hauteur de 25 millions d’euros : la Société de financement local (SFIL), d’une part, et Dexia à hauteur de 8 millions, d’autre part. Autrement dit, via Dexia, le peuple belge prend en charge une partie de cette situation qui ne le concerne pas directement.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’on soit Belge ou Français, le sang est de la même couleur quand on parle de santé.
M. Pierre Vérot. Nous sommes tout à fait d’accord avec vous, monsieur le président : les contrats financiers structurés à risque sont appelés à sortir du système. Cependant, il faut savoir que 70 % à 75 % des hôpitaux, qui paient encore aujourd’hui des taux bas, et ce depuis le début, hésitent à passer à taux fixe. Nous souhaitons donc que l’État intervienne également pour les inciter à renégocier ces prêts, d’autant que les indemnités seront proches de celles des taux fixes, c’est-à-dire assez basses. D’ailleurs, il me semble qu’un décret de 2012 fixe à 2017 l’échéance à laquelle les hôpitaux devraient passer à taux fixe.
M. le coprésident Pierre Morange. La coresponsabilité est actée. C’est la raison pour laquelle nous adresserons à chacun d’entre vous une lettre vous demandant de nous communiquer – noir sur blanc – les informations suivantes : le montant des emprunts toxiques contractés par les hôpitaux ; vos échéanciers de sortie ; vos propositions de négociation. Nous connaîtrons ainsi ceux des directeurs d’établissement qui n’auront pas eu la sagesse de renégocier pour passer à taux fixe et nous vous réinviterons à la fin de la mission pour faire le bilan des avancées que vous aurez pu consentir.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Des contentieux ont-ils été engagés par des hôpitaux contre vos établissements bancaires ? Si oui, quels en sont les résultats ?
M. Hervé Leroux. Le groupe Crédit Agricole n’a pas de contentieux.
M. Cédric Mignon. Le groupe BPCE n’en a aucun.
M. le coprésident Pierre Morange. Des contentieux ont été déclenchés par des collectivités locales. Aucune de vos banques n’a fait l’objet d’un contentieux de la part d’un hôpital ?...
M. Pierre Vérot. Il reste à Dexia environ 60 millions d’encours susceptibles de présenter des taux dégradés aujourd’hui, c’est-à-dire indexés sur la parité euro/franc suisse ou sur la parité euro/dollar. Pour l’heure, un seul établissement a engagé un contentieux, et ce pour une raison simple. C’est que, comme nous l’a demandé un gouvernement précédent, nous avons dit aux établissements que nous les accompagnerions, en évaluant année après année leur capacité à régler leurs échéances. Ainsi, tous nos clients – sauf un – ne paient pas de taux dégradés.
Certes, les indemnités de sortie de ces taux sont élevées, mais nous avons réussi à dénouer un grand nombre de situations, comme l’ont fait plusieurs de nos confrères. Dans certains cas, cela n’a malheureusement pas été possible.
Dans l’attente de la mise en place du fonds, auquel nous contribuerons, nous avons fait en sorte que nos huit clients sur les neuf concernés ne paient pas plus de 8 %. Nous maintenons cette orientation en 2015, la différence entre ce taux de 8 % et ce qu’ils pourraient payer étant à notre charge.
Notre stratégie a été simple. Nous avons proposé aux établissements, s’ils ne souhaitaient pas que le juge tranche le problème, de gérer avec nous cette difficulté, soit de manière transitoire – c’est ce que nous avons fait et continuons de faire –, soit dans le cadre d’une sortie pérenne organisée par les pouvoirs publics, initiative prise par le Gouvernement en avril 2014.
Une grande partie des clients n’a jamais payé de taux dégradé parce que le contrat n’en a jamais appelé. Pour les autres – soit une minorité –, nous avons réussi à trouver des solutions de passage à taux fixe, mais sans y parvenir pour une partie résiduelle de cette minorité. Je crois pouvoir dire que la profession a essayé de gérer ces difficultés de manière responsable, en acceptant quelques pertes, et en travaillant avec la DGOS (direction générale de l’offre de soins) au calibrage d’une solution pérenne.
Certes, les choses sont plus compliquées aujourd’hui puisqu’un nouveau paramètre est intervenu le 15 janvier dernier. Néanmoins, un dispositif existe, et nous sommes confiants. Le fonds de soutien, dont l’instruction qui le régit est sortie au mois de décembre, va être mis en place. Sous l’impulsion des ARS, il permettra la rencontre dans chaque région des prêteurs, des emprunteurs et des pouvoirs publics. À l’instar de nos confrères, nous pensons que les difficultés seront dénouées rapidement.
Je pense que ce dispositif s’adresse à tous les établissements, et que tous cherchent à être traités par ce biais. Nous souhaitons nous orienter vers une résolution du problème, et pensons qu’elle sera possible grâce à un effort organisé par les ARS, de la même manière que le fonds de soutien aux collectivités locales contribue d’ores et déjà à résoudre des situations, y compris pour celles ayant choisi la voie du contentieux.
En définitive, je crois que tout le monde, y compris la plupart de ceux ayant choisi le contentieux, préférerait une résolution collective raisonnable, ce que les instruments mis en place par l’État devraient permettre.
M. le coprésident Pierre Morange. La voie raisonnable est toujours préférable. Dans la mesure où le peuple français a consenti des efforts pour assurer la stabilité du système bancaire, il serait juste que ce dernier fasse lui-même un effort pour stabiliser une bonne fois pour toutes ces situations et contribuer à cette sortie de crise que la représentation nationale appelle de ses vœux.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Les hôpitaux publics ont-ils accès aux ressources leur permettant de financer leurs investissements ?
M. Cédric Mignon. Comme banques responsables, le groupe BPCE et quelques autres ont compensé la défaillance de certains établissements, en restant présents, voire en augmentant leur part de marché tant pour les collectivités que pour les hôpitaux publics, avec des crédits simples et basiques. Les Caisses d’épargne sont ainsi restées très présentes durant la période la plus tendue, c’est-à-dire entre 2011 et 2013.
Depuis, la situation s’est nettement détendue, si bien que les Caisses d’épargne n’ont prêté que 400 millions d’euros aux établissements publics de santé en 2014, contre 800 millions en 2013, non que nous ayons réduit notre capacité à produire des crédits, mais parce que d’autres sources de financement sont apparues entre-temps. Ainsi, les établissements publics de santé trouvent des ressources financières, et certainement plus facilement qu’il y a trois ans.
M. Hervé Leroux. Le Crédit Agricole fait le même constat. D’une part, nous avons largement compensé la défaillance de certains établissements pendant la période difficile. D’autre part, depuis deux à trois ans, nous constatons une diminution de nos encours, puisque de nouveaux opérateurs sont apparus.
Nous avons en outre proposé aux hôpitaux des émissions obligataires. Ce mode de financement alternatif – non risqué – intéresse plus particulièrement les établissements de grande taille.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est le volume financier de ces émissions obligataires ?
M. Hervé Leroux. S’agissant du Crédit Agricole, les émissions obligataires représentent 40 millions d’euros pour les hôpitaux en 2013, et 400 à 600 millions pour l’ensemble du secteur public.
M. Cédric Mignon. Pour le groupe BPCE, les émissions obligatoires sont de 70 millions avec l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) au 1er décembre 2014.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Selon la Cour des comptes, certains établissements dépassent le taux d’endettement admissible et rencontrent parfois des difficultés même pour faire face à leurs dépenses de personnel. Y a-t-il eu des restrictions sur les lignes de trésorerie qui permettent aux établissements de payer leurs dépenses courantes ?
M. Cédric Mignon. Au groupe BPCE, les engagements en lignes de trésorerie aux établissements publics de santé n’ont quasiment pas bougé : ils s’élèvent à 520 millions d’euros fin décembre 2014, un tiers seulement étant utilisées. Depuis la mise en place de solutions d’État, les choses sont moins compliquées pour nous qu’il y a trois ans.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’en est-il des frais de gestion pour les émissions obligataires ?
M. Philippe Barraud, responsable Grandes collectivités et ingénierie financière au Crédit Agricole SA. Ce sont les frais d’arrangement d’opération, liés au coût de courtage pris par les arrangeurs d’opération puisque les banques assistent les établissements hospitaliers pour émettre les obligations et les distribuer aux investisseurs institutionnels. Les frais annexes payés par les hôpitaux sont les frais des agences de notation et les frais d’avocat. S’agissant des frais de notation, par exemple, les coûts globaux sont inférieurs à 100 000 euros pour une émission obligataire d’une centaine de millions d’euros. L’AP-HP a payé ses frais juridiques en une seule fois, ce qui lui permet d’aller régulièrement sur le marché sans surcoût. Les émissions groupées des CHU, qui ne sont pas solidaires, ont en revanche donné lieu à un nouveau contrat juridique à chaque émission.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. J’ai l’impression, et j’aimerais que vous me la confirmiez, que vous accompagnez les établissements publics hospitaliers avec la volonté de ne pas les laisser dans une situation impossible.
M. Hervé Leroux. Je vous le confirme. Un des domaines d’excellence du groupe Crédit Agricole est la santé. Même aux périodes les plus difficiles, nous avons toujours été là pour accompagner le secteur public, nous avons même augmenté nos lignes d’encours, y compris pour les hôpitaux.
M. Cédric Mignon. Le groupe BPCE réunit des banques de territoire : la proximité est notre ADN. Dans les petites et moyennes collectivités, le premier employeur est souvent l’hôpital. Nous n’avons pas eu besoin de recommandation pour nous atteler à la problématique des crédits structurés, même si nous aimerions que les choses avancent plus vite. Nous souhaitons continuer à prêter au secteur public, ce que nous faisons : nous sommes toujours présents dans les territoires, et je rends hommage à nos 120 conseillers « secteur public » qui proposent régulièrement aux hôpitaux et aux collectivités une sécurisation de leur dette. Notre image est restée très propre auprès des hôpitaux et des collectivités territoriales. Ainsi, les banques de proximité font leur travail, pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais elles le font avec cœur, avec engagement, en continuant à accompagner leurs clients.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Je suppose que les prêts toxiques n’existent plus.
M. Cédric Mignon. Ils n’existent plus pour la BPCE depuis janvier 2008.
M. Hervé Leroux. Même chose pour le Crédit Agricole, qui est aussi une banque de territoire. Le territoire est notre code génétique.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci, messieurs.
*
* *
Audition de M. Gautier Bailly, sous-directeur à la direction du budget au ministère des finances et des comptes publics, accompagné de M. Fabrice Perrin, chef du bureau des comptes sociaux et de la santé
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Pouvez-vous nous présenter les missions de votre sous-direction dans le domaine qui nous intéresse ?
Pensez-vous que les établissements publics de santé disposent des financements adaptés pour mener à bien leur politique d’investissement ?
A-t-on la garantie que les hôpitaux ne pourront plus à l’avenir être à nouveau confrontés à une crise comme celle déclenchée par la souscription d’emprunts toxiques ?
M. Gautier Bailly, sous-directeur à la direction du budget au ministère des finances et des comptes publics. La sixième sous-direction de la direction du budget est compétente sur l’ensemble du champ des finances sociales : d’une part, pour les politiques de l’emploi et de la solidarité, et, d’autre part, pour les dépenses relevant du champ des administrations de sécurité sociale. Nous avons également un rôle de contre-expertise vis-à-vis des administrations sociales directement en charge de la production du PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) et du cadrage de l’ONDAM (objectif national des dépenses d’assurance maladie).
La direction du budget est présente dans les principales instances exerçant la tutelle du secteur hospitalier, en particulier le conseil national de pilotage (CNP) des ARS et le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO). Nous sommes également présents dans les conseils d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), du Centre national de gestion (CNG) et de l’École des hautes études en santé publique (EHESP).
Ces missions sont donc transversales, mais un seul ETP (équivalent temps plein) est en charge à la direction du budget de l’ensemble des questions hospitalières : cadrage financier, préparation de la campagne tarifaire, régulation, construction de l’ONDAM, préparation du COPERMO, suivi des dossiers.
Je centrerai mon propos liminaire sur la première partie de la communication de la Cour des comptes, à savoir sur la parfaite corrélation qui existe entre l’investissement hospitalier et l’accroissement de la dette. Pour nous, la question de fond est avant tout celle de l’encadrement de l’investissement et de la maîtrise des charges des hôpitaux, dans le cadre d’un ONDAM toujours plus contraint.
En matière d’investissements, on peut distinguer trois périodes. La période 1992-2001, avec un investissement de l’ordre de 2,5 milliards d’euros par an. Entre 2002 et 2011, période durant laquelle l’investissement a explosé pour passer à 6 milliards par an en moyenne, et même à 7 milliards en 2009, encouragé par les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012. Enfin, à partir de 2011, avec une décélération très progressive et un investissement ramené à moins de 5 milliards en 2013, l’objectif étant de s’acheminer vers 4,5 milliards d’euros par an.
Quant à l’endettement, il est passé de 9 milliards en 2002 à 30 milliards d’euros en 2013, rythme de croissance deux fois plus rapide que celui des collectivités locales. Or les comptes des établissements montrent très nettement que le triplement de l’endettement ne s’est en rien appuyé sur une augmentation de la capacité d’autofinancement. D’où une symétrie parfaite entre la courbe de l’endettement net et celle de l’investissement annuel.
La question a été posée de la nécessité de cet investissement. On sait que les besoins étaient extrêmement importants au regard de la vétusté de certains établissements, des mises aux normes nécessaires en matière de sécurité et d’incendie, mais aussi de la concurrence entre établissements liée à la T2A (tarification à l’activité). Pour autant, l’investissement a été concentré sur l’immobilier, l’accroissement des surfaces et des capacités hospitalières. Ainsi, l’investissement immobilier lourd est le principal contributeur à la croissance des investissements, puisqu’il est passé de 1,4 milliard en 2002 à 4,2 milliards d’euros en 2009, soit là encore un triplement.
Pour les CHU, qui représentent un quart du patrimoine immobilier hospitalier, la part du bâti neuf ou réhabilité a augmenté de 70 % et les surfaces globales de 30 % durant la même période, alors que le nombre de mètres carrés obsolètes ou vétustes, lui, n’a pas toujours diminué. Ainsi, les opérations ont été réalisées sans réel effort de densification et dans le sens d’une extension globale des surfaces.
En outre, la capacité hospitalière a augmenté de 5 % entre 2010 et 2011, alors que l’activité était stable, voire en léger recul, que la durée moyenne de séjour a baissé et que le recours à la chirurgie ambulatoire a progressé. Des exemples de projets surdimensionnés ou mal adaptés à cette évolution des pratiques médicales sont mentionnés dans le rapport de la Cour des comptes sur le plan Hôpital 2007.
Au total, les taux d’occupation des structures hospitalières restent relativement faibles, à environ 75 % en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), et 10 000 à 11 000 lits ont un taux d’occupation de moins de 50 %.
En définitive, cet investissement, présenté comme nécessaire, voire indispensable, s’est appuyé sur l’encouragement à l’emprunt, conduisant parfois à une sélection trop rapide des projets, ainsi que sur des sous-jacents médico-économiques parfois trop ambitieux.
Les leçons tirées de cette situation ont conduit à la création du COPERMO, accompagnée de la mise en place d’une doctrine d’investissement qui présente plusieurs caractéristiques.
La première est l’abandon d’une logique de plan d’investissement au profit d’un processus annuel de sélection. La procédure de sélection du plan Hôpital 2007 avait en effet provoqué une inflation des projets, alors même que les financements publics étaient stables.
La deuxième caractéristique est la sélection plus rigoureuse des projets, qui s’appuie sur les priorités définies par les ARS dans le cadre des schémas régionaux d’investissement en santé (SRIS). Cette procédure intègre une phase d’examen de l’éligibilité qui permet d’engager un dialogue avec l’ARS et l’établissement sur les sous-jacents financiers, les ratios d’indépendance financière notamment.
La troisième caractéristique est la mise en place d’une doctrine en matière d’accompagnement financier. Le taux d’accompagnement, entre 10 % et 50 %, est corrélé au poids de l’endettement des établissements.
Quatrièmement, l’effort budgétaire est très largement réorienté vers les aides en capital, et non vers les aides à la contractualisation ou à l’exploitation. On se rappelle que le plan Hôpital 2007 prévoyait, sur 6 milliards d’aides publiques, 5 milliards d’aides à l’investissement qui étaient en réalité autant d’encouragements à l’emprunt.
En outre, le lien est maintenant systématiquement fait entre la performance de l’établissement et les projets d’investissement. Le COPERMO comporte un volet performance, pour les établissements en situation financière très dégradée, et un volet investissement, pour les hôpitaux qui portent des projets d’investissement. Dans les deux cas, nous veillons à la fixation d’un taux de marge brute de 8 % – certes, contesté par des hôpitaux, mais préconisé par la Cour des comptes et par l’IGF. Il ne s’agit pas d’une référence absolue, mais nous la mettons systématiquement en avant car elle peut être adaptée et être appréciée sur plusieurs années. En tout cas, quelques règles transversales simples peuvent constituer une boussole utile aux établissements pour les conduire vers l’efficience. Nous ne sommes pas allés aussi loin que l’IGF (Inspection générale des finances) ou l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales), qui proposaient d’en faire une condition juridique d’accès à l’emprunt.
Une attention particulière est également apportée, dans les plans de redressement, comme dans les projets d’investissement, à la crédibilité des hypothèses d’activité. Ce point fait l’objet d’une contre-expertise par les administrations, ou par le CGI (commissariat général à l’investissement) avec une contre-expertise indépendante. Nous nous référons à des indicateurs simples, notamment les indicateurs démographiques de l’INSEE, afin de limiter les perspectives, parfois trop optimistes, de certains établissements.
Le dernier point d’attention porte sur la restructuration hospitalière. Pour quasiment tous les projets d’investissement que nous choisissons de financer, un effort d’efficience est demandé en termes de réductions du nombre de lits, de densification des surfaces, de coopérations entre établissements d’un même territoire, voire de mutualisations. Dans tous les cas, un effort est attendu sur la maîtrise des charges, ce qui est généralement nécessaire pour atteindre le taux de marge brute de 8 %, actuellement en moyenne plutôt de 5 %.
Au-delà du COPERMO, il convient de rappeler la mise en place du mécanisme d’encadrement du recours à l’emprunt par le décret du 14 décembre 2011 à cet effet. Ce sujet a été porté en son temps par le ministère du Budget, puisque la disposition a été inscrite dans la loi de programmation des finances publiques – par référence à la règle d’interdiction d’endettement des ODAC (organismes divers d’administration centrale) à plus de douze mois. Nous avons cherché à étendre cette règle aux hôpitaux, mais elle reste beaucoup plus souple puisqu’il ne s’agit pas d’une interdiction générale.
Ces orientations, conjuguées à la décision d’abandonner la deuxième tranche du plan Hôpital 2012, ont conduit à une légère amélioration des indicateurs financiers. En effet, entre 2009 et 2013, les investissements sont revenus à un niveau plus raisonnable, passant de 6,7 milliards à 4,9 milliards ; les emprunts nouveaux sont passés de 5 milliards à 3 milliards ; et l’endettement net n’a progressé que de 0,9 milliard d’euros, puisqu’il n’est passé que de 28 à 29 milliards d’euros en 2013. La phase de désendettement n’est pas encore amorcée, mais elle le sera sans doute vers 2016-2017 si les perspectives fixées par le gouvernement sont respectées.
Ainsi, la première réponse au problème d’endettement des hôpitaux consiste à encadrer les nouveaux projets d’investissement.
Le deuxième chantier primordial à nos yeux est la maîtrise des charges des hôpitaux dans le cadre de l’ONDAM, qui doit contribuer à hauteur de 20 % à l’effort d’économies de 50 milliards sur l’ensemble du champ des administrations publiques. C’est notre point d’attention majeur car, dans le cadre d’un ONDAM dont la croissance sera en moyenne de 2 %, l’effort d’économies demandé à l’hôpital sera sensiblement plus élevé à l’avenir, du fait notamment de la contrainte pesant sur les soins de ville et de la moindre mise à contribution de l’hôpital au cours des années précédentes.
Cela suppose d’agir sur plusieurs leviers que sont le développement de la chirurgie ambulatoire, la baisse de la durée moyenne de séjour, la poursuite des économies sur les achats dans le cadre du programme PHARE (performance hospitalière par des achats responsables), la mutualisation dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Ces réformes ne pourront pas passer par un simple ajustement des tarifs : elles devront se traduire par une diminution des charges des hôpitaux, donc des réductions capacitaires, et par une maîtrise accrue des charges de personnel. Sans ces mesures, la réduction de l’ONDAM risquerait de se traduire uniquement par des baisses de tarif et un déficit accru du secteur hospitalier, la situation financière des hôpitaux n’étant pas votée en PLFSS.
Tels sont les aspects structurels auxquels la direction du budget porte une grande attention.
Les pouvoirs publics ont pris la mesure des graves difficultés financières liées à la crise financière de 2008 et à la crise de liquidité de 2011-2012, en autorisant une offre de crédits dédiés de la Banque postale refinancés par la SFIL, ainsi que le déblocage des enveloppes sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, qui a permis en 2012 un financement de l’hôpital à hauteur de 40 % par la sphère publique.
S’y ajoutent les aides en trésorerie de l’État, de 400 millions d’euros en crédits AC (aides à la contractualisation) en 2012 et 300 millions en 2013. Ce soutien, particulièrement ciblé sur des établissements en très grande difficulté, notamment en outre-mer, constitue l’une des réponses immédiates que les pouvoirs publics ont apportées au problème d’accès au financement et au crédit.
Il faut également noter l’anticipation du versement de la T2A en 2012, ainsi que la mise en place récente du fonds de désensibilisation pour les emprunts structurés.
Pour conclure, le traitement de situations parfois très difficiles en matière de trésorerie a conduit à des réponses ponctuelles et adaptées. Pour autant, l’enjeu me semble être, non pas la multiplication des instruments de financement alternatif, mais bien l’efficience et la maîtrise des charges des établissements publics de santé.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Que retirez-vous des recommandations de la Cour des comptes ?
Ne pensez-vous pas que les hôpitaux ont bénéficié d’un traitement beaucoup moins favorable que les collectivités en matière d’emprunts structurés ?
M. Gautier Bailly. Nous partageons la plupart des constats de la Cour des comptes, dont certaines des recommandations ont connu une traduction concrète. L’encadrement du recours à l’emprunt est ancien. Je viens de parler de l’encadrement du recours à l’investissement dans le cadre du COPERMO. S’agissant de la stratégie de suivi des établissements en difficulté financière avec la fixation de critère objectifs, le taux de marge brute de 8 % préconisé par la Cour a été repris par les administrations. La Cour des comptes et l’Inspection générale des finances débattent actuellement de la nécessité d’inclure ou non dans ce taux les aides, sachant que l’investissement n’est pas directement intégré dans les tarifs. Nous plaidons pour un taux de marge brute hors aides, mais rien n’empêche de le moduler en fonction de la situation de chaque établissement.
Par ailleurs, la Cour des comptes avait préconisé l’accès des hôpitaux au fonds de désensibilisation des collectivités locales. Le choix fait a été différent, avec la distinction des deux instruments, sans doute en raison de la nature des financements – il n’y a pas de raison que l’État supporte un transfert de charges de la part de la sphère sociale.
Le recours aux crédits de trésorerie est également un thème mis en avant par la Cour des comptes, l’Inspection générale des finances ayant recommandé une interdiction pure et simple de l’accès aux lignes de trésorerie. Je ne suis pas persuadé qu’il faille aller aussi loin et vite, d’autant que l’Inspection des finances elle-même avait évoqué comme contrepartie la mise en place de plans de trésorerie structurés dans un délai évalué à trois ans dans son rapport, mais qui se révélera sans doute un peu plus long. Ainsi, il sera difficile à très court terme de mettre en place une telle interdiction.
L’émission de billets de trésorerie est un sujet sur lequel la direction du Budget a été amenée à travailler récemment avec les administrations sociales. Le législateur a souhaité diversifier les sources de financement dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de 2013. Le décret est en cours de préparation. L’évaluation préalable a montré que ce type de financement peut présenter des avantages : un gain de 200 points de base par rapport aux lignes de trésorerie ou aux autres crédits de court terme accordés par les banques, une certaine flexibilité dans le choix des échéances (entre un jour et un an), une flexibilité du montant. Comme pour les émissions obligataires, ce type d’outil présente néanmoins de nombreuses contraintes : un montant minimum de 150 000 euros, la nécessité d’établir une documentation financière précise sur l’activité de l’établissement, sa situation économique et financière et son programme d’émission, l’obligation de recourir à une notation par une agence agréée.
Ce mécanisme ciblé a été évoqué par l’Inspection des finances pour les trois plus grands CHRU. La direction du Budget, dans le cadre des arbitrages en cours, plaide pour une limitation de l’émission des billets de trésorerie aux établissements ayant une surface financière suffisante, un compte de résultat principal à l’équilibre et une capacité d’autofinancement satisfaisante. Nous souhaitons ajouter le critère selon lequel la dette n’est pas constituée d’emprunts structurés, ce qui me paraît une évidence... En définitive, ce genre de produit ne peut concerner qu’un nombre très limité de très grands CHU.
M. le coprésident Pierre Morange. À ces critères de bon sens, en ajouteriez-vous d’autres en matière de masse salariale, de mètres carrés, de bonnes pratiques préconisées par l’ANAP, etc. ?
M. Gautier Bailly. Il est très tentant d’ajouter des critères ! La maîtrise de la masse salariale, la perspective à cinq ans, etc., sont cependant des critères structurels : ils trouveraient à s’appliquer davantage dans le cadre d’emprunts de long terme que dans le cadre d’émissions de billets de trésorerie qui répondent plutôt à une logique de cycle d’exploitation.
En tout état de cause, nous veillons à préserver le principe de l’autonomie de gestion et de responsabilité des établissements. C’est une des raisons pour lesquelles nous sommes défavorables aux mécanismes de mutualisation de trésorerie ou de recours à des prêteurs en dernier ressort. L’Inspection des finances a clairement mis en lumière les risques liés à un crédit trop facile et à la déresponsabilisation des établissements dans l’accès à une ressource moins chère.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Il est demandé aux directeurs financiers des hôpitaux de faire des choix judicieux, mais je m’interroge sur le rôle des banques qui leur ont conseillé des emprunts structurés en vue d’une « gestion dynamique de la dette ». À cet égard, la mutualisation des compétences n’est-elle pas une piste intéressante ?
Nous savons aussi que les hôpitaux recourent à l’intérim. En définitive, les choses ne sont pas si simples.
M. Gautier Bailly. Je ne me prononcerai pas sur la responsabilité en ce qui concerne les emprunts structurés : il est clair qu’elle est partagée entre les directeurs d’établissement, la tutelle – les ex ARH – et le secteur bancaire. Une leçon a été tirée, le marché du prêt structuré ne devrait pas rebondir avant quelques années. Le fonds de désensibilisation mis en place doit permettre d’en sortir.
Il est certain que les plus petits établissements ont été davantage confrontés à une asymétrie d’information que les plus grands en matière d’offres commerciales bancaires. Nous sommes favorables à la mutualisation des fonctions supports entre les hôpitaux. Les groupements hospitaliers de territoire (GHT), portés par la loi santé, pourraient constituer le cadre d’exercice de compétences financières, mais le projet de loi en préparation ne prévoit pas qu’il s’agit d’une compétence obligatoire des GHT. Les compétences obligatoires des GHT sont le système d’information, le département d’information médicale, la politique d’achat, la formation paramédicale. Cela étant dit, si l’on arrive à créer cette dynamique de coopération, l’expertise financière gagnerait à être mutualisée.
Le calibrage du fonds de désensibilisation est une question essentielle du fait de l’évolution de la devise suisse. Le secrétaire d’État chargé du budget, M. Christian Eckert, a récemment apporté des réponses en séance publique au Parlement, en expliquant que le point principal est le recensement précis des encours, extraordinairement complexe, et le volume des annuités de remboursement anticipé, non arrêté à ce jour.
La stratégie a été clairement affichée par le gouvernement. Il s’agit d’aider prioritairement les plus petits établissements, ceux qui sont asphyxiés par des taux d’intérêt de 20 % ou 25 % et pour lesquels l’IRA (indemnité de remboursement anticipé) dépasse très largement les capacités d’autofinancement. L’objectif n’est donc pas de se substituer à tous les établissements qui ont souscrit des emprunts structurés toxiques – les 100 millions d’euros n’y suffiraient pas.
Un deuxième volet de la stratégie de désensibilisation doit être la renégociation des emprunts, assise sur la très forte baisse des taux permise par le marché. J’y vois la solution principale pour les établissements de taille moyenne ou importante qui ont des emprunts toxiques dans leur bilan.
M. le coprésident Pierre Morange. Lors d’auditions précédentes, nous avons évoqué la valorisation foncière du patrimoine public et privé des hôpitaux publics ; certains représentants des établissements nous ont dit connaître parfaitement leur patrimoine, d’autres en avoir une connaissance imparfaite. Au total, il en est ressorti que cette valorisation foncière n’était pas évaluée. Pensez-vous que le logiciel OPHELIE et la date butoir de 2016 contribueront à une connaissance complète de cette valorisation foncière ?
M. Gautier Bailly. Nous sommes moins bien placés que nos collègues de France Domaine pour répondre à cette question. Je crois que les directeurs d’hôpitaux que vous avez auditionnés ont mis en avant les raisons pour lesquelles ce patrimoine est mal connu, ce qui est effectivement un problème.
D’abord, il est difficile de l’évaluer, notamment dans le cadre du patrimoine historique. Surtout, ce n’est pas un exercice obligé, ni dans le cadre de la construction budgétaire ni dans le cadre du recours à l’emprunt, dès lors que ce patrimoine affecté est d’une nature assez particulière et que ce n’est pas le critère…
M. le coprésident Pierre Morange. Ce sujet n’est nullement polémique : il a été évoqué par la MECSS sous la mandature précédente. Lors d’une audition, un directeur d’établissement a même récemment évoqué la nécessité de mener une mission de « spéléologie foncière » !
M. Gautier Bailly. Le logiciel OPHELIE, en cours d’élaboration, constitue une avancée significative. Néanmoins, il présentera des fragilités car il reposera toujours sur des bases déclaratives – je ne suis pas sûr que l’on puisse faire autrement. En outre, son déploiement prendra du temps : je ne suis donc pas certain que nous aurons en 2016 une image fidèle de l’ensemble des sites, notamment des sites très spécifiques, grevés d’obligations ou légués à des fins d’exploitation strictement médicale. Et, je le redis, cette donnée n’est pas une obligation et ne le sera pas non plus dans le cadre de la certification des comptes. Aussi la valorisation financière prendra-t-elle du temps.
D’autres initiatives présentent un intérêt, notamment la mise à disposition par l’ANAP du logiciel d’aide à la gestion ÆLIPCE, qui vise à diffuser de nouveaux standards aux hôpitaux en matière de dimensionnement capacitaire. OPHELIE s’appuie sur une logique de recensement du stock, ÆLIPCE plutôt sur les flux sur la base des projets d’investissement et sur la démarche des établissements.
M. le coprésident Pierre Morange. L’amélioration de la logique du flux et l’application des prescriptions de l’ANAP permettraient de rationaliser le stock et, ainsi, de libérer des espaces dont la valorisation contribuerait au rééquilibrage budgétaire.
M. Gautier Bailly. Cela contribuerait également au désendettement. Car outre le défaut de connaissance, la valorisation foncière actuelle est relativement faible. Nous examinons ce sujet dans le cadre du COPERMO, dans une logique de flux, dossier par dossier, projet par projet. Ainsi, nous ne traitons pas l’ensemble du patrimoine, mais étudions la possibilité de valoriser même un petit bloc, un bout de terrain, pour contribuer à l’équilibre financier du projet.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Pouvez-vous nous décrire la procédure suivie par le COPERMO ? Quel premier bilan peut-on tirer de cette nouvelle instruction des dossiers d’investissement ? Est-il envisagé de rendre publics les enseignements qui se dégagent de ces premiers dossiers en termes d’amélioration du financement des investissements ?
Les dossiers d’investissement qui passent devant le COPERMO sont d’une certaine ampleur. Pour les investissements moins importants, je suppose que c’est l’ARS qui prend la décision ?
M. Gautier Bailly. Les projets qui passent en COPERMO sont ceux dont le montant est supérieur à 50 millions d’euros. Il s’agit soit de projets de restructuration lourde ou de modernisation, soit de dossiers de remise aux normes (désamiantage, risque sismique, « vétusté profonde »). Les autres continuent d’être instruits par l’ARS, choix qui a été fait dès l’origine. Une quarantaine de dossiers passeront en COPERMO pour l’investissement.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’entendez-vous par « vétusté profonde » ?
M. Gautier Bailly. J’atteins les limites de ma compétence, mais je pense à des images présentées en COPERMO qui montrent des états de délabrement très avancés, souvent faute d’investissements courants.
M. le coprésident Pierre Morange. S’agissant de la rénovation des bâtiments amiantés, la situation est impossible car il faut vider ces bâtiments. On risque de se retrouver face à de véritables « Jussieu sanitaires » !
M. Gautier Bailly. Le COPERMO, dans une première étape, est centré sur ce type d’opération. L’hôpital de Caen, concerné par cette problématique, a été immédiatement intégré comme établissement prioritaire.
Le COPERMO sélectionne les projets au regard, d’abord, du caractère d’urgence (mises aux normes, désamiantage, risque sismique), et, ensuite, de l’inscription dans le cadre d’un SRIS. Au vu de l’enveloppe contrainte allouée au plan de financement de l’investissement, les premières instructions portaient toutes sur de gros établissements dans l’incapacité de faire face à un investissement non rentable, ce qui est le cas pour les bâtiments amiantés où l’activité devra être stoppée progressivement, ce qui engendrera des pertes importantes de recettes.
Les dossiers dont le montant est supérieur à 50 millions d’euros examinés par le COPERMO sont en phase de préprogramme – il ne s’agit pas de projets déjà lancés pour lesquels un effet d’aubaine pourrait être recherché en termes de financements publics.
La procédure se décline en plusieurs étapes. D’abord, une phase d’éligibilité, au cours de laquelle nous regardons si les critères standards – dimensionnement du projet, inscription dans un schéma territorial d’offre de soins pertinent, soutenabilité financière – sont respectés. Si les premiers éléments apportés ne satisfont pas à ces critères, nous déclarons le dossier non éligible, nous l’avons fait à plusieurs reprises, ou bien nous reportons la décision d’éligibilité en demandant à l’hôpital de revoir sa copie sur la base de recommandations précises.
Deuxième étape : pour les projets les plus importants – à partir de 100 millions d’euros – une contre-expertise indépendante du Commissariat général à l’investissement (CGI) est prévue.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette expertise indépendante ?
M. Gautier Bailly. Le recours au CGI vise précisément à garantir l’indépendance par la procédure qu’il met en place : c’est lui qui définit sa procédure. En pratique, après avoir constaté que l’investissement est supérieur à 100 millions d’euros, nous transférons le dossier au CGI qui organise la contre-expertise indépendante. Sans connaître leurs noms, nous nous doutons que les experts sont probablement issus de l’ANAP et de l’IGAS.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce sont donc des experts publics, et non des sociétés prestataires ?
M. Gautier Bailly. J’ignore si le CGI recourt à des prestataires privés.
Lors de l’étape de l’éligibilité, nous ne discutons pas avec l’établissement du montant des aides qui vont lui être accordées, nous étudions seulement le fond du dossier, sa qualité intrinsèque, sa logique médico-économique, sa rentabilité. La contre-expertise est soit une contre-expertise indépendante par le CGI, soit, pour les projets dont le montant est inférieur au seuil, une contre-expertise administrative réalisée par le groupe technique du COPERMO. Cette seconde expertise est plus classique, mais elle n’en est pas moins utile puisqu’elle permet de nouer la discussion, notamment autour de l’atteinte des objectifs standards appuyés par l’ANAP.
Dernière étape : la décision finale est prise par le COPERMO. Les décisions les plus importantes sont validées au niveau ministériel, voire – mais j’ignore s’il y a eu des cas – soumises à l’arbitrage du Premier ministre.
Sans doute cette procédure souffre-t-elle de défauts liés à sa jeunesse. Elle constitue néanmoins une vraie rupture. Les établissements se plaignent souvent qu’elle retarde les projets, ce qui est probablement vrai, mais c’est que nous nous laissons le temps d’instruire au fond les dossiers. En deux ans, 29 projets ont ainsi été validés. Ce nombre n’est certes pas très élevé, mais ces projets sont particulièrement structurants pour l’organisation de l’offre de soins, en représentant plus de 3,3 milliards d’euros et 1,2 milliard d’aides. Nous sommes donc clairement dans une logique de concentration de l’effort de la tutelle sur les projets prioritaires.
Cette procédure offre à la direction du Budget une visibilité bien plus importante que celle permise par les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 lorsque nous ne faisions que constater, année après année, le montant des investissements. Ainsi, la concertation interministérielle, le recours à l’expertise indépendante le cas échéant, et le temps laissé à l’instruction, constituent un gage de sécurité dans la mesure où les projets peu cohérents ou non pertinents ne seront pas financés par l’argent public.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Quel constat dressez-vous de la dette à court terme ? Quelles actions sont envisagées par l’État pour aider les établissements à y faire face ?
M. Gautier Bailly. La dette sociale, qui s’élève à 3 milliards d’euros, est un des combats de la Direction de la sécurité sociale (DSS). Elle est liée à des difficultés de liquidité, puisqu’il s’agit de retards de paiement et non d’impayés. Cette situation, certes moins médiatisée que celle des emprunts structurés, ne peut perdurer car il est invraisemblable que l’hôpital public ne paie pas ses cotisations sociales dont le produit contribue à la financer.
Cette dette est devenue un des critères mis en avant dans le cadre des plans d’accompagnement et des programmes de performance pour éviter que des établissements en difficulté n’utilisent cette facilité au détriment du renforcement de l’efficience. Elle est un point d’attention très important, principalement porté par la DSS.
La communication de la Cour des comptes met en lumière une extrême hétérogénéité des situations. En effet, on observe une augmentation des dépôts sur le compte du Trésor, qui ne traduit évidemment pas une difficulté d’accès aux ressources de trésorerie. Ce gonflement résulte notamment de la constitution de réserves de précaution par certains établissements, qui ont accès au crédit moyen terme avec des lignes de trésorerie associées, afin de se prémunir contre d’autres crises de liquidité.
Sur le très court terme, la contrainte a été globalement assouplie par rapport à 2011-2012. Aujourd’hui, même si elles sont soumises à des contraintes de liquidité et de ratios prudentiels plus importantes, les banques abaissent les plafonds des lignes de trésorerie, mais les établissements les utilisent moins également. J’ai donc le sentiment qu’il n’y a pas de crise de liquidité sur le court terme et que l’on a passé le cap des années noires, grâce à une intervention publique très importante.
Je rappelle que les aides en trésorerie accordées par la voie budgétaire, c’est-à-dire via les missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC), représentent encore des sommes extrêmement importantes. Or ces aides aux MIGAC n’ont pas vocation à constituer la trésorerie des établissements. Aussi souhaitons-nous, dans le cadre de la construction des futurs ONDAM, limiter progressivement le montant de ces aides en trésorerie.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous donner le cas type d’un dossier crédible ?
M. Gautier Bailly. Un cas type est un établissement dont le taux d’endettement s’établit à 50 %. Dans ce cas, le rapport entre les aides en capital du FMESPP (fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés) et les aides à la contractualisation pourra aller de 80 %/20 % à 50 %/50 %.
Le critère est le taux d’endettement : c’est lui qui va déterminer la part apportée en aide en capital. Avec un taux d’endettement supérieur à 60 %, au moins 80 % d’aides en capital seront apportées. Si l’établissement est très peu endetté, le recours aux aides à la contractualisation peut s’avérer pertinent.
En résumé, je dirais deux tiers d’aides en capital et un tiers d’aides à l’investissement pour la partie qui sera financée par l’État, à laquelle peuvent s’ajouter des aides de l’ARS puisque, depuis 2013, la marge régionale est intégrée au FIR (fonds d’intervention régional) pour 1 milliard d’euros en aides à la contractualisation (AC). D’ailleurs, lorsqu’une ARS soutient un dossier, nous lui demandons aussi de consentir un effort financier.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle serait la répartition totale ?
M. Gautier Bailly. Il n’y a pas de participation publique au-delà de 50 %, sauf cas exceptionnels, comme la présence d’amiante, pour lesquels l’investissement est impératif et financièrement insupportable pour les établissements. Dans la très grande majorité des cas, je pense que nous sommes autour d’un tiers de financement public réparti en deux tiers d’aides en capital et un tiers d’aides à l’emprunt.
M. le coprésident Pierre Morange. Avec une répartition entre l’État et l’ARS ?
M. Gautier Bailly. Je ne peux vous répondre précisément sur la part des ARS, mais elle est à l’intérieur de ce tiers.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Merci. Nous vous enverrons éventuellement des questions supplémentaires écrites.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci beaucoup de cette présentation.
*
* *
Audition de M. Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Mme Carine Chevrier, directrice économique, financière, de l’investissement et du patrimoine, et M. Philippe Rouvrais, chef du service financement et trésorerie à la direction économique, financière, de l’investissement et du patrimoine
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation, monsieur le directeur général. Vous avez été nommé à ce poste récemment, mais vous connaissez parfaitement le milieu hospitalier et le problème de la dette hospitalière. Au-delà de ce sujet technique, que nous appréhendons mieux désormais grâce à nos premières auditions, je suis avant tout préoccupée par la question – primordiale – de la place de l’hôpital public au sein de notre système de santé.
Nous souhaitons mieux connaître la situation de l’AP-HP et recueillir votre sentiment, notamment en ce qui concerne les perspectives pour l’avenir : comment réorganiser l’hôpital et comment sortir de l’endettement actuel, qu’il va nous falloir de toute façon assumer ? Les problèmes financiers pèsent très fortement sur certains établissements de santé, à tel point que l’on se pose parfois la question de leur fermeture.
M. Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Je commencerai par rappeler le contexte : si l’hôpital public est endetté, c’est parce qu’il est vital pour lui d’investir. S’il n’investissait pas, il serait condamné à disparaître.
Pour un groupe hospitalier de la taille de l’AP-HP, il est d’abord nécessaire d’investir pour améliorer le confort de patients et pour humaniser l’hôpital. N’oublions pas qu’il existe encore des chambres à trois ou quatre lits dans certains établissements, ce qui n’est ni conforme aux normes fixées par la Haute autorité de santé (HAS), ni respectueux de la dignité des patients.
Notre politique d’investissement vise aussi à tenir compte des nouvelles normes énergétiques et à combattre la vétusté, ce qui essentiel dans nos établissements historiques, qui datent, pour la plupart, du XIXe siècle et, pour un petit nombre d’entre eux, du XVIIIe.
Nous avons également besoin d’investir pour adapter notre réponse médicale, par exemple pour basculer vers la chirurgie ambulatoire ou pour prendre en compte les nouvelles technologies en matière de traitement du cancer. L’AP-HP est en retard par rapport à certains établissements privés en ce qui concerne le remplacement des appareils de radiothérapie, car nous sommes amenés à faire des arbitrages entre les investissements patrimoniaux et les investissements dans les équipements.
Il nous faut investir, enfin, pour acquérir le petit matériel médical, élément essentiel et coûteux, auquel nous consacrons plus de 100 millions d’euros par an. C’est indispensable tant du point de vue des patients que de celui des médecins : nous veillons à ce que ces derniers disposent d’un matériel qui ne soit pas moins avancé ni de moindre qualité que dans les établissements privés.
Pour toutes ces raisons, l’AP-HP est un gros investisseur : nos investissements sont supérieurs à 400 millions d’euros par an. Ils comprennent notamment quelques très grosses opérations, que nous avons programmées afin de rééquilibrer notre offre au profit du nord de Paris, lequel a plutôt fait figure de parent pauvre jusqu’à ce jour, alors que les besoins y sont très forts, que l’on se place du point de vue démographique, médical ou social. Nous disposons de l’excellence nécessaire pour répondre à ces besoins, mais pas des bâtiments adéquats.
Nous finançons nos investissements de trois manières principales : grâce à notre capacité d’autofinancement, grâce à des subventions et grâce à l’emprunt. Il est d’autant plus difficile de dégager une capacité d’autofinancement qu’il nous est demandé de réaliser un effort de productivité de 3 % par an, ce qui est considérable : peu d’acteurs économiques sont soumis à de telles exigences. Nous devons en effet couvrir nos charges avec des recettes de plus en plus contraintes, compte tenu de la diminution des tarifs.
Les subventions proviennent soit de l’État, soit des collectivités territoriales. L’AP-HP fait partie des établissements qui reçoivent relativement peu de subventions de la part des collectivités. Cette situation est en partie héritée de l’histoire : la région Île-de-France finance davantage la recherche que les établissements hospitaliers, et la ville de Paris les finance traditionnellement moins que d’autres métropoles. Nous avons accès aux subventions de droit commun versées par l’État, notamment à travers le mécanisme du Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO). Le COPERMO examine actuellement un dossier très important que nous lui avons soumis, qui concerne l’hôpital Lariboisière.
Le produit des cessions immobilières constitue un levier de financement important, mais nous ne pourrons pas y recourir de manière illimitée, car notre patrimoine n’est pas illimité. De plus, les acheteurs avec lesquelles nous sommes en discussion, la plupart du temps des collectivités territoriales, à commencer par la ville de Paris, ont leurs propres contraintes, qu’elles cherchent parfois à nous imposer, notamment lorsqu’elles souhaitent réaliser des opérations sociales au meilleur coût possible. Notre objectif est d’atteindre un volume de cessions immobilières d’environ 40 millions d’euros par an, afin de couvrir 10 % de nos investissements.
Notre dernier levier est l’emprunt. L’AP-HP y a recouru de manière régulière au cours des dernières années, avec une accélération depuis sept ou huit ans : notre dette est ainsi passée de 1 à 2,4 milliards d’euros.
Mme Carine Chevrier, directrice des affaires économiques et financières, de l’investissement et du patrimoine de l’AP-HP. La dette a atteint ce pic de 2,4 milliards en 2012. Au cours des deux dernières années, nous l’avons fait baisser et l’avons ramenée à 2,115 milliards.
M. Martin Hirsch. Notre taux d’endettement avoisine les 30 %. La période d’accroissement de la dette a correspondu à de grosses opérations tout à fait justifiées, entre autres la réalisation du nouvel hôpital Necker et de la nouvelle maternité de Port-Royal. Mais la conséquence de ces investissements est aussi que nous devons aujourd’hui maîtriser notre dette et que nos marges d’endettement supplémentaire sont désormais réduites.
Au cours de la période récente, nous avons davantage recouru à l’emprunt obligataire, de manière à équilibrer la structure de notre endettement. Aujourd’hui, notre dette est constituée, à grands traits, d’une moitié d’emprunts bancaires et d’une moitié d’emprunts obligataires. À ce titre, nous dépendons du jugement des agences de notation, notre note étant identique à celle de l’État depuis plusieurs années. Nous bénéficions actuellement de conditions d’accès au marché plutôt favorables. Nous exerçons une vigilance particulière : au sein de notre dette, nous détenons une faible quantité de produits structurés, dont très peu peuvent être considérés comme potentiellement toxiques. Nous n’avons donc pas eu besoin d’émarger aux différents dispositifs mis en place par l’État pour aider les établissements en situation difficile.
Nous accordons une grande attention à notre politique de gestion de la dette : quand nous le pouvons, nous saisissons les occasions de nous dégager de nos emprunts. Au cours des dernières années, nous nous sommes désendettés sans diminuer notre effort d’investissement, qui est vital, notamment pour combattre la vétusté. Compte tenu des contraintes qui pèsent sur chacun des leviers que j’ai évoqués, nous ne pouvons pas aller plus loin dans cet effort sans bénéficier de soutiens supplémentaires. À cet égard, je répète mon premier message : il est sain que l’hôpital public investisse, car, s’il ne le fait pas, il est voué à mourir.
Deuxième message : l’hôpital public a besoin de visibilité. Nous devons financer à la fois des investissements récurrents et de grosses opérations structurantes, lourdes à conduire. Nos recettes dépendent de notre activité et relèvent donc de notre responsabilité. Néanmoins, elles peuvent être écornées par des baisses de tarifs.
Certaines de ces baisses visent à nous pousser à la vertu. Ainsi, les pouvoirs publics ont fait le choix de développer la chirurgie ambulatoire et décidé d’une évolution des tarifs en conséquence, qui a été connue à l’avance. Nous nous inscrivons dans cette démarche de conversion de l’activité vers l’ambulatoire, et nous ne serons perdants que si nous ne sommes pas capables de tenir les engagements que nous avons pris en la matière.
Cependant, d’autres baisses de tarif sont décidées pour des raisons d’opportunité. Nous les subissons parfois de plein fouet, car nous y sommes particulièrement sensibles compte tenu de notre taille et de l’importance de nos missions sociales : plus que les autres établissements, nous recevons de nombreux patients précaires ou bénéficiant de l’aide médicale de l’État (AME). Lorsque ces missions sont moins bien prises en compte dans les tarifs, les effets induits se chiffrent en millions, voire en dizaines de millions d’euros, ce qui a un impact très fort sur notre capacité à agir et à investir.
Nos recettes proviennent à près de 30 % de subventions, notamment des dotations affectées au financement des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Rappelons que nos missions hospitalo-universitaires sont particulièrement importantes, l’AP-HP pesant 40 % de la recherche clinique en France. Une fluctuation des subventions peut avoir, elle aussi, un impact majeur sur nos activités.
Par exemple, il est question actuellement de réformer le financement du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) dans le cadre des dotations affectées aux MIGAC, et l’application des schémas élaborés dans les ministères risque de déstabiliser totalement notre modèle économique. Il s’agirait désormais de compter le nombre d’« événements » qui nécessitent l’intervention du SAMU. Or l’activité que nous avons déployée la deuxième semaine de janvier a compté pour trois événements seulement, alors que nous avons mobilisé des forces considérables pendant cinq jours ! Comme nous ne pouvons pas renoncer à nos investissements, nous serons amenés à compenser par un recours à l’endettement le fait que nous ne sommes pas suffisamment appuyés dans nos missions de service public, c’est-à-dire à « faire de la mauvaise dette ».
De mon point de vue, dans mes fonctions actuelles – l’AP-HP représente, je le rappelle, 10 % de l’hôpital public en France –, la problématique de la dette doit être appréhendée de manière contractuelle. Le contrat que nous concluons avec les pouvoirs publics doit porter, en premier lieu, sur nos engagements. D’abord, celui de prendre en charge toutes les catégories de patients, notamment pour des actes que nous sommes les seuls à pouvoir réaliser. Cet engagement transcende tous les autres. Ensuite, celui de réaliser des efforts de productivité. Nous tenons cet engagement, même si cela passe par des discussions difficiles avec nos équipes médicales et paramédicales.
L’accompagnement de nos missions nationales doit se poursuivre et constituer le deuxième pilier du contrat. Or, au cours des dernières années, nous avons constaté un écart de plus de deux points entre l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) voté par le Parlement et celle de l’enveloppe qui nous est attribuée au titre des MIGAC – celle-ci a même parfois diminué. Nous comprenons, bien sûr, les mécanismes de rebasage et de comparaison qui peuvent conduire à un tel décrochage, mais le développement de nos missions est rarement pris en compte. Je plaide donc pour que nous bénéficiions d’une visibilité en la matière : en face de notre engagement en termes d’efforts doit être affiché un engagement en termes d’accompagnement.
Le troisième pilier du contrat doit être l’accompagnement de nos investissements, qui est indispensable pour que nous puissions élaborer et mener à bien nos opérations. Pour peu que les dossiers que nous présentons soient corrects, l’État s’est engagé à financer à hauteur de 30 % les deux opérations majeures que nous projetons, l’une des deux étant la construction d’un grand hôpital au nord de Paris, que le Président de la République lui-même a soutenue. Nous devons donc trouver les 70 % restants, en répartissant l’effort entre les trois leviers de financement que j’ai évoqués précédemment.
Dans les années de très fortes contraintes mais aussi de très fortes transformations qui viennent, les pouvoirs publics doivent confirmer qu’ils ne se désengagent pas du secteur public hospitalier et donner une visibilité à ses responsables, en leur disant : « Vous faites des efforts, mais nous vous accompagnons dans l’exercice de vos missions nationales et nous reconnaissons que l’investissement est fondamental. » C’est là le facteur clé, notamment si nous voulons éviter un effet boule de neige que nous connaissons bien. Par exemple, lorsque les établissements privés font de la publicité en présentant les robots qu’ils achètent pour 3 millions d’euros, ainsi que vous avez pu le voir hier dans Le Parisien, ils attirent les praticiens hospitaliers. Nous risquons d’assister à un « débobinage » de l’hôpital public si nous ne faisons pas en sorte qu’il puisse continuer à investir dans des conditions soutenables.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Compte tenu de votre taille, quelles sont vos relations avec l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France ? Celle-ci intervient-elle dans les autorisations d’emprunt ? Quelles compétences peut-elle vous apporter en matière financière ?
Mme Carine Chevrier. Le budget de l’AP-HP s’élève à 7 milliards d’euros, ce qui représente 4,5 fois le budget du deuxième centre hospitalier universitaire (CHU) de France. L’AP-HP est autonome pour la gestion tant de son endettement à long terme que de sa trésorerie à court terme. D’une part, l’AP-HP s’est structurée afin de disposer d’une équipe propre chargée de cette gestion. Celle-ci comprend deux experts, dont M. Rouvrais. D’autre part, les opérations courantes de l’APHP ne sont pas soumises à autorisation de l’ARS. En application du décret du 14 décembre 2011, l’ARS peut se substituer à un établissement de santé s’agissant de la décision de recourir à l’emprunt lorsque deux des trois ratios « à risque » – ratio d’indépendance financière, durée apparente de la dette et taux d’endettement – dépassent les seuils fixés par le décret (19). La situation financière de l’AP-HP est saine, et nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous avons donc conservé, à ce stade, une pleine autonomie dans la gestion de notre dette.
Néanmoins, nous présentons chaque année à l’ARS notre état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), c’est-à-dire notre budget annuel, ainsi que notre plan global de financement pluriannuel (PGFP). Dans ce cadre de cet examen, nous faisons part de nos grands équilibres en termes d’investissement, de subventions demandées, d’endettement, de capacité d’autofinancement et de produit des cessions immobilières. Ces engagements font l’objet d’une contractualisation à cinq ans avec l’ARS. De plus, l’ARS approuve le PGFP de l’AP-HP après avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. La procédure budgétaire est donc encadrée.
Par ailleurs, nous avons souhaité compléter cet encadrement en adaptant notre gouvernance interne : toute décision concernant la dette à long terme – par exemple, le remboursement anticipé d’une partie de la dette ou encore le passage à un taux variable ou à un taux fixe pour l’un de nos emprunts – fait systématiquement l’objet d’une note adressée par le service « financement et trésorerie » à la directrice des affaires économiques et financières et au directeur général, qui est ensuite soumise au directoire de l’AP-HP. En outre, nous faisons un point d’information annuel au conseil de surveillance de l’AP-HP sur l’état de la dette au 31 décembre de l’année, notamment sur sa structure et sur la nature des emprunts contractés. Ces procédures ne sont pas prévues par les textes, mais nous avons souhaité les mettre en place pour garantir la transparence des décisions importantes que nous prenons en matière de gestion active de notre dette. Le directeur général a pleinement souscrit à cette démarche.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. L’AP-HP a un programme d’investissement pour l’ensemble de ses hôpitaux. Rencontrez-vous des difficultés en matière d’autorisation des travaux ? Êtes-vous bridés dans vos investissements ? Ou bien tout se passe-t-il sans problème particulier ?
M. Martin Hirsch. L’investissement hospitalier est toujours compliqué, particulièrement en Île-de-France et à Paris, notamment pour ce qui est des questions relatives au foncier et à l’organisation des travaux. Il est toujours difficile de ménager des transitions, dans la mesure où l’activité de nos hôpitaux ne s’arrête jamais. À cet égard, nous rencontrons les mêmes problèmes que partout ailleurs, mais à plus grande échelle.
Nous n’avons pas encore de recul sur la procédure d’autorisation suivie par le COPERMO, qui est compétent pour les investissements supérieurs à 50 millions d’euros. Le COPERMO examine actuellement le premier dossier que nous lui avons soumis. Il a déjà validé un dossier présenté par l’ARS d’Île-de-France, qui concerne Melun-Sénart, mais qui n’est pas de la même ampleur. Dans le cadre de la négociation, nous essayons de faire prendre conscience que nous avons besoin de réponses rapides, la réalisation des opérations en question s’étalant sur de nombreuses années.
Mme Carine Chevrier. La première question qui se pose est celle de notre capacité d’investissement, qui dépend des différentes sources de financement mobilisables, au premier chef de la capacité d’autofinancement que nous dégageons en interne.
Dans le cadre du PGFP pour les années 2014 à 2019, nous avons essayé de distinguer, d’une part, les investissements courants et, d’autre part, les investissements transformatifs ou qui visent à accompagner les restructurations – vous avez eu, je crois, des débats sur ce point. Pendant les cinq prochaines années, sur notre enveloppe annuelle de 400 millions d’euros d’investissements, 275 millions en moyenne seront consacrés aux investissements courants, c’est-à-dire, entre autres, à la résorption de la vétusté, à la mise aux normes, au renouvellement des équipements médicaux courants et à la modernisation du système d’information. Cette somme représente 3,5 à 4 % de nos produits d’exploitation et correspond au montant de notre capacité d’autofinancement. Dans notre vision, le contrat est clair : l’investissement courant doit être couvert par notre capacité d’autofinancement. Le reste de l’enveloppe, soit 125 millions d’euros par an, ira aux investissements de transformation, notamment à la création d’unités de chirurgie ambulatoire et à la construction de grands bâtiments dans le nord de Paris. Il nous paraît légitime de financer ces investissements grâce à l’emprunt, grâce aux subventions issues du budget de la sécurité sociale et grâce au produit de nos cessions immobilières – ce dernier levier devant permettre de financer 10 % de nos investissements totaux.
Cet équilibre est compliqué à trouver. Aujourd’hui, la structure des taux et l’existence de liquidités sur le marché rendent l’endettement à long terme relativement facile. De plus, nous sommes actuellement le seul émetteur obligataire sur le marché. Notre dette – qui s’élève, je le rappelle, à 2,115 milliards d’euros – est constituée à 58 % de dette obligataire et à 41 % d’emprunts bancaires. Au cours des dernières années, nous avons inversé ces proportions. Nos emprunts sont à 68 % en taux fixe et à 31 % en taux variable. Au début du mois de décembre 2014, nous avons procédé à une émission obligataire de 70 millions d’euros sur la place de Paris. Il s’agit de la dernière en date. Les titres ont été négociés avec une marge de 36 centimes par rapport à l’Euribor 3 mois, c’est-à-dire 15 centimes au-dessus de l’obligation assimilable du Trésor (OAT).
M. le coprésident Pierre Morange. Le taux variable de l’obligation est-il « capé » ?
M. Philippe Rouvrais, chef du service « financement et trésorerie » de l’AP-HP. Non, mais il est indexé sur l’Euribor, qui est un indice parfaitement connu.
Mme Carine Chevrier. Il est de 0,46 % sur huit ans avec une partie variable indexée sur l’Euribor 3 mois. Nous avons hésité avant de choisir un taux variable, mais nous avons la possibilité de passer à un taux fixe, ce que nous envisageons de faire dans le courant de cette année.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous vous êtes fixé un objectif de 40 millions d’euros de cessions immobilières par an. Pendant combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ce rythme ? D’autre part, l’AP-HP a-t-elle une connaissance exhaustive de son patrimoine, tant privé que public ? Au cours de nos auditions, certains directeurs d’établissement nous ont avoué avoir une connaissance incertaine de leur patrimoine. D’aucuns ont même parlé de « spéléologie foncière »…
Mme Carine Chevrier. Nous avons identifié un volume de cessions de 40 à 50 millions d’euros par an pour les sept ou huit prochaines années au moins. Nos prévisions vont donc déjà au-delà de notre plan stratégique. Les dossiers se préparent longtemps à l’avance, dans le cadre de schémas directeurs, car il faut libérer certains espaces, en concentrer d’autres, etc.
Nous avons une connaissance exhaustive de notre patrimoine, tant du domaine public que du domaine privé. Les actes de propriété sont inventoriés. En revanche, il est compliqué de valoriser cet actif. Nous sommes engagés dans une démarche de certification des comptes pour 2016. Bien évidemment, nous nous y préparons d’ores et déjà. À l’occasion de la mise en place du progiciel de gestion intégré SAP en 2010 et 2011, l’AP-HP a bénéficié d’un état des lieux préalable : l’ensemble de son actif a fait l’objet de fiches. Aujourd’hui, le bilan de l’AP-HP recense et valorise tous les éléments de l’actif, mais à des valeurs historiques, qui présentent donc un écart par rapport à la valeur vénale ou à la valeur de marché. Aussi, lorsque nous vendons une propriété que nous détenons depuis plus de cent vingt ans, nous réalisons généralement une plus-value importante au moment de l’opération. L’actif net de l’AP-HP est évalué, en valeurs historiques, à 3,4 milliards d’euros, dont 2,6 milliards pour les bâtiments et 140 millions pour les terrains.
M. le coprésident Pierre Morange. Ces estimations concernent-elles à la fois le domaine public et le domaine privé ? Quelle est la ventilation entre les deux domaines ?
Mme Carine Chevrier. Ces chiffres concernent bien les deux domaines. La répartition est la suivante en surface : 3,8 milliards de mètres carrés pour le domaine public et 5,5 milliards pour le domaine privé. Je vous communiquerai ultérieurement la répartition en valeur.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La tarification à l’activité (T2A) permet-elle de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour investir ? Qu’en est-il non seulement pour l’AP-HP – dont l’activité est très importante –, mais aussi, plus généralement, pour les autres établissements de santé, à votre connaissance ?
M. Martin Hirsch. Au regard des chiffres que nous venons de vous communiquer, la réponse est oui : nous dégageons une capacité d’autofinancement d’environ 275 millions d’euros par an. Or nous sommes passés à la T2A pour la plupart de nos activités, hormis pour certains actes de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation (SSR) et de soins de longue durée (SLD). Mais il va de soi que la situation actuelle serait remise en cause si les tarifs devaient baisser. Tout dépend donc de la manière dont ces tarifs sont fixés et de ce qu’ils prennent ou non en compte. Du point de vue de l’investissement, la T2A n’est pas, en soi, un mode de financement plus mauvais qu’un autre, à condition que l’on admette que l’investissement d’un établissement de santé ne peut pas être financé en totalité par sa capacité d’autofinancement, c’est-à-dire reposer uniquement sur l’historique de son activité. En d’autres termes, les grands centres hospitaliers ne peuvent pas se passer des subventions pour investir. Une suppression du subventionnement serait mortelle pour eux.
Mme Carine Chevrier. Avec notre capacité d’autofinancement, nous parvenons à financer nos investissements courants, mais pas les investissements de transformation, pour lesquels nous avons besoin de sources de financements additionnelles : les subventions, l’emprunt et le produit de nos cessions immobilières. Ces ressources complémentaires garantissent l’avenir de l’hôpital public.
M. Martin Hirsch. La T2A présente de nombreux défauts, mais elle a une vertu non négligeable : pour les projets d’investissement petits ou moyens, elle permet de calculer des retours sur investissement. Cela peut nous amener à valider plus facilement un projet d’investissement de quelques millions d’euros présenté par une équipe médicale, qui explique en quoi il permettra de mieux répondre à une demande de soins et quel sera le retour sur investissement au bout de quelques années. Ainsi, nous jouons moins un rôle de censeur qu’à l’époque du budget global.
M. Philippe Rouvrais. Nous encaissons les recettes issues de l’activité environ cinquante jours après l’activité elle-même. Notre trésorerie est donc déficitaire au quotidien. C’est pourquoi je vais chercher chaque jour un peu d’argent sur le marché pour financer le court terme.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est le pourcentage de recettes non recouvrées à l’AP-HP ? Compte tenu de votre périmètre de compétence très large, avez-vous calculé un ratio moyen ? Est-il comparable aux ratios que l’on peut trouver ailleurs en France ? Dans de nombreux établissements de santé, le non-recouvrement des frais de consultation et d’hospitalisation, encore aggravé lorsque le système informatique est défaillant, est à l’origine de déficits qui peuvent avoir un impact sur les équilibres budgétaires, en particulier sur la capacité d’autofinancement et sur la dette.
M. Martin Hirsch. Je ne suis pas en mesure de vous communiquer des éléments précis aujourd’hui, mais nous le ferons ultérieurement. En tout cas, nous avons une marge de progrès en la matière. Nous avons des difficultés de recouvrement non seulement auprès des patients, mais aussi, ce qui est plus surprenant, auprès des organismes de sécurité sociale et des complémentaires santé. Or il n’y a pas de raison que des organismes publics passent ainsi leur temps à se courir après pour des justificatifs ! Les pouvoirs publics peuvent certainement faire quelque chose pour assainir ces relations. S’agissant des patients, nous allons accomplir un progrès important cette année : le paiement en ligne sera possible à partir du mois d’avril prochain. Cela nous déchargera d’une partie de la paperasserie et nous évitera un certain nombre de critiques de la part des patients. Je suis convaincu que la qualité du recouvrement constitue un gage de confiance pour les patients : un hôpital qui recouvre bien est a priori un hôpital bien géré et qui soigne bien. D’autre part, nous étudions la possibilité de demander aux patients l’empreinte de leur carte bancaire. Les hôtels le font, et il n’y a pas de raison qu’un service public ne puisse pas le faire également.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce point a-t-il été validé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ?
M. Martin Hirsch. Oui. Nous avions d’ailleurs d’autres questions pendantes avec la CNIL, que nous avons traitées au cours du deuxième semestre de 2014. Nous sommes désormais à jour de ce point de vue.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans les informations que vous nous communiquerez, pourrez-vous préciser la ventilation entre les impayés qui résultent d’un comportement intentionnel de la part du patient et ceux qui revêtent un caractère non intentionnel ? Le taux de non-recouvrement varie considérablement d’un établissement de santé à l’autre : un chiffre de 3 à 5 % est considéré comme quasi normal, mais ce taux peut atteindre 10 voire 15 % dans certains hôpitaux. Comment peut-on stabiliser une situation budgétaire et traiter le problème de la dette avec une telle perte de recettes ? Et il s’agit non pas de faire la chasse aux créances, mais de mettre en place un mécanisme vertueux.
M. Martin Hirsch. Vous avez tout à fait raison. Nous devons d’ailleurs être vigilants non seulement sur la question du recouvrement, mais aussi sur celle du codage des diagnostics et des actes médicaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Justement, où en est-on en matière de codage, ainsi qu’en matière d’identification des prescripteurs, question importante également du point de vue de la responsabilité médicale ?
Mme Carine Chevrier. L’identification des prescripteurs fonctionne plutôt bien. L’enjeu est plutôt de professionnaliser le codage, afin qu’il se fasse en temps réel et de manière exhaustive, notamment avec la cotation des comorbidités associées. Tel n’est pas encore le cas dans tous les services de l’AP-HP. L’amélioration du processus de codage, de facturation et de recouvrement est un axe majeur et prioritaire du projet de l’AP-HP. La première étape est de systématiser le codage au moment du compte rendu d’hospitalisation. Nous faisons un travail de pilotage et de suivi régulier en la matière, tant au niveau de chacun de nos sites qu’à un niveau plus « macro ». En particulier, nous mesurons ce que nous appelons nos « gisements de codage », c’est-à-dire le nombre de sorties non codées, qui se traduisent par des écarts de 4 à 9 millions d’euros en trésorerie chaque mois, et nous adressons à chaque site son « taux de non-exhaustivité ». D’autre part, nous nous sommes dotés de techniciens de l’information médicale, qui accompagnent les directeurs de l’information médicale sur chaque site. Compte tenu de la complexité de la nomenclature, il n’est pas toujours aisé de coter les comorbidités.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous évalué le pourcentage de recours aux outils d’identification des prescripteurs au sein de l’AP-HP ? Il s’agit d’une question stratégique au regard des recommandations de la HAS. En outre, c’est le nœud gordien de la rationalisation des moyens et des dépenses.
M. Martin Hirsch. Nous ne sommes pas en mesure de vous répondre tout de suite sur ce point.
M. le coprésident Pierre Morange. Il serait intéressant que vous nous communiquiez des éléments à ce sujet, compte tenu de la position phare et de l’exemplarité de l’AP-HP.
Mme Carine Chevrier. Nous travaillons beaucoup également sur la prescription des transports sanitaires : nous avons un plan d’action et nous sommes pilotes sur cette question avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), notamment en matière d’informatisation et d’identification des prescripteurs.
En ce qui concerne la prescription en général, nous vous apporterons des éléments plus précis ultérieurement.
M. le coprésident Pierre Morange. Les établissements de santé ont la possibilité d’expérimenter la budgétisation des dépenses de transport par voie conventionnelle. L’AP-HP envisage-t-elle de le faire ?
M. Martin Hirsch. C’est une hypothèse tout à fait sérieuse sur laquelle nous travaillons. Cela irait dans le sens de l’intérêt général. Mais nous ne pouvons pas prendre cette décision à la légère, car les enjeux sont considérables.
L’AP-HP n’est pas encore exemplaire en matière d’informatisation. Or celle-ci a un impact sur toutes les questions que nous avons évoquées : le codage, le suivi de l’activité, etc. Nous investissons environ 80 millions d’euros par an pour moderniser notre système d’information, mais nous sommes encore en phase de transition en la matière.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Comment faire pour que les établissements de santé deviennent plus efficients ? Il s’agit d’une question importante pour l’avenir de l’hôpital public. L’AP-HP dispose de toutes les compétences nécessaires en matière de gestion, mais tel n’est pas le cas de tous les établissements, notamment parce que leur budget ne le leur permet pas toujours. Avez-vous en tête des exemples étrangers qui pourraient nous aider dans notre réflexion sur le financement et le fonctionnement des hôpitaux ?
M. Martin Hirsch. Nous travaillons sur plusieurs leviers pour gagner en efficience. La variable clé dans un hôpital, c’est l’organisation du temps. Il y a, d’une part, des questions d’organisation et, d’autre part, des questions de gestion du temps.
S’agissant des questions d’organisation, les grands hôpitaux universitaires tels que l’AP-HP se sont beaucoup focalisés, traditionnellement, sur l’excellence des soins délivrés, mais moins sur les autres aspects du fonctionnement de l’hôpital. Prenons l’exemple de l’hôpital de Garches. Il s’agit d’un établissement historique, dont les locaux sont vétustes, mais qui constitue une référence nationale dans le domaine du handicap. Sa rénovation fait partie des projets d’investissement majeurs inscrits dans notre plan stratégique pour les années 2015 à 2019. Or nous commençons par revoir complètement l’organisation des rendez-vous, la prise en charge et le parcours du patient. Il y a là des gains importants à réaliser en termes d’efficience. Au cours de ces dernières années, tout le monde a sous-estimé certaines tâches de base, pourtant majeures, telles que la gestion des plannings de rendez-vous et de consultations, au point de créer des files d’attente, que les patients ont subies. Dans le même temps, de nombreuses grandes entreprises publiques et privées, notamment dans les secteurs du transport et de la téléphonie, sont parvenues à régler ces problèmes.
Autre exemple : je n’ai pas hésité à m’engager sur un objectif de division par deux du délai de prise en charge dans nos services des urgences. Les prévisions de fréquentation de ces services sont impressionnantes, mais elles sont parfaitement connues. Nous sommes donc a priori capables de nous adapter pour gérer ces flux sans imposer de longs délais d’attente. Directement ou indirectement, cela aura un impact majeur en termes d’efficience : les patients seront mieux pris en charge, l’aval des urgences sera mieux organisé, etc.
L’amélioration de l’organisation est un levier essentiel pour gagner en efficience. Cependant, n’oublions pas que, tout service public qu’il soit, l’hôpital est un univers hautement individualiste et que, parmi les quelque 100 000 personnes qui travaillent à l’AP-HP, peu s’intéressent de près aux questions d’organisation.
Deuxième levier important : la gestion du temps. Il s’agit d’un des grands chantiers de l’AP-HP pour 2015. Nous examinons la répartition du temps de travail du personnel paramédical, d’une part, et du personnel médical, d’autre part, pour voir si nous pouvons gagner en efficience. Il s’agit non pas de rayer telle ou telle disposition d’un trait de plume, mais de déterminer si nous pouvons demander au personnel un effort supplémentaire en termes de temps donné à l’hôpital en contrepartie d’engagements sur la stabilité des plannings et de l’encadrement, laquelle constitue un aspect fondamental de l’organisation.
Les investissements et les réorganisations que nous avons évoquées au début de cette audition constituent le troisième levier. Dans notre plan stratégique pour les années 2015 à 2019, nous nous sommes fixé un objectif de réduction des surfaces exploitées, qui repose sur le développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoires, ainsi que sur la rationalisation des sites. Cela aura un impact majeur à la fois sur nos effectifs – médicaux et, surtout, paramédicaux – et sur notre facture énergétique. Celle-ci s’élève à 100 millions d’euros par an. Nous avons décidé de profiter de la dynamique créée par la conférence Paris Climat 2015 pour lancer un grand chantier de maîtrise de nos consommations d’énergie sur les prochaines années. Nous espérons obtenir des résultats intéressants dans ce domaine.
Mme Carine Chevrier. Un autre levier important est l’amélioration de la fonction achat dans le cadre du programme « Performance hospitalière pour des achats responsables » (PHARE). L’AP-HP dispose de deux centrales d’achat assez matures, qui gèrent plus de 1,9 milliard d’euros d’achats par an. Néanmoins, nous avons encore quelques marges de progrès en la matière.
M. Martin Hirsch. Nous essayons de faire en sorte que ces leviers soient aussi considérés comme des moyens d’améliorer les conditions de travail de l’ensemble du personnel – médecins, infirmiers, aides-soignants, etc. J’ignore si nous allons gagner ce pari. Tel est, en tout cas, le travail que nous allons mener cette année et que nous avons préparé l’été dernier en signant, avec la majorité des organisations syndicales, un protocole d’accord-cadre sur le dialogue social, afin de pouvoir discuter en confiance de ces sujets très difficiles.
M. le coprésident Pierre Morange. Les questions d’organisation du travail sont essentielles pour améliorer l’efficience, rationaliser les moyens et dégager des marges de manœuvre, non seulement en termes de ressources humaines, mais aussi de locaux. Vous avez notamment évoqué les délais d’attente dans les services des urgences, qui sont en effet un élément très important : c’est la première image de l’hôpital, et ces délais entraînent une série de conséquences, notamment un engorgement des services.
M. Martin Hirsch. Ainsi que des risques sanitaires.
M. le coprésident Pierre Morange. Tout à fait. D’où la nécessité de resserrer autant que possible ces délais. En 2004 et 2005, à mon initiative, le cabinet McKinsey a mis en œuvre, aux urgences de l’hôpital Beaujon, la technique dite de réduction des muda, ce qui a permis de réduire les délais d’attente de 40 % en quatre mois.
M. Martin Hirsch. Cette expérience a été transposée à l’hôpital européen Georges-Pompidou.
M. le coprésident Pierre Morange. En effet. Mais elle remonte maintenant à dix ans, et il ne faudrait pas prendre encore plusieurs dizaines d’années pour l’étendre à l’ensemble des établissements de l’AP-HP ! À l’époque, il y avait eu un blocage intellectuel, pour ne pas dire idéologique, parce qu’un cabinet étranger pénétrait dans la gestion du temps de l’hôpital français. Pourtant, nous avions recueilli l’accord des représentants syndicaux. Souvent, nous connaissons les bonnes pratiques, mais elles ne sont pas généralisées en raison d’une gouvernance défaillante, notamment du fait d’un manque de volonté ou de ténacité. Ce constat est partagé non seulement par les membres de la MECSS, mais aussi par un certain nombre de praticiens et d’experts des questions sanitaires.
D’autre part, en ce qui concerne la gestion du temps, la question du compte épargne-temps (CET) est souvent occultée, alors qu’il s’agit d’une véritable bombe à retardement pour certains établissements hospitaliers qui n’ont pas budgété les provisions suffisantes. Au passage, si le CET avait été correctement conçu, il aurait permis de financer davantage les retraites complémentaires, dont nous connaissons le déséquilibre actuel, à travers les plans d’épargne retraite populaire (PERP) et les plans d’épargne collectif pour la retraite (PERCO). Avez-vous, à l’AP-HP, une bonne connaissance de la problématique du CET ? Les provisions suffisantes ont-elles été prévues ? Ou bien avez-vous hérité d’une situation préoccupante à cet égard ? Lorsque l’on exerce des responsabilités, on est toujours amené à gérer un héritage.
M. Martin Hirsch. Lorsque l’on s’engage à l’AP-HP, il faut en effet le faire dans la durée. En nous appuyant sur l’expérience de l’hôpital Beaujon, que nous connaissons bien, ainsi que sur celle de quelques autres établissements, nous avons adopté une stratégie globale pour les urgences, qui engage toute l’AP-HP. Afin de nous assurer qu’elle sera mise en œuvre rapidement, nous mobilisons l’ensemble des acteurs et nous contractualisons avec les établissements : dans les accords que nous avons passés avec les hôpitaux qui hébergent des services d’urgences, nous avons introduit un intéressement aux résultats en termes d’amélioration des délais de prise en charge aux urgences. Nous prenons en considération toute une série de paramètres : l’organisation de filières rapides, le délai de rendu des examens biologiques, le temps d’accès à l’imagerie médicale, etc. Et nous pouvons être amenés à tenir compte des besoins d’équipement de certains hôpitaux, par exemple de l’opportunité de financer un scanner dédié au service des urgences, si l’on se rend compte qu’il s’agit d’un élément déterminant pour réduire les délais et permettre à l’établissement de tenir ses engagements. Nous raisonnons donc en termes de retour sur investissement non seulement d’un point de vue financier, mais aussi du point de vue de la qualité de la prise en charge. Ainsi que vous l’avez souligné, la réduction des délais dans les services des urgences est un point clé. Nous atteindrons l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixé en la matière.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans quel délai ?
M. Martin Hirsch. Nous nous sommes engagés à le faire dans le cadre de notre plan stratégique, donc d’ici à 2019. En 2014, nous avons stabilisé les délais de prise en charge, et nous espérons commencer à les réduire à partir de cette année.
Je souhaite évoquer deux leviers qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont importants pour nous. Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit que les CHU soient autorisés à créer des filiales dans deux domaines : la valorisation de la recherche et l’offre d’expertise médicale à l’étranger.
S’agissant de la recherche, l’AP-HP fait partie des cinq premiers producteurs de connaissances au monde dans le domaine de la santé. Or nous ne valorisons pas tous nos résultats. Pour le faire, nous avons besoin des outils juridiques dont disposent les universités et les établissements publics à caractère scientifique et technologique. C’est très important pour nos brevets et pour nos partenariats. En outre, il s’agit d’une source potentielle de revenus.
Quant à notre expertise, elle est très demandée à l’étranger. Je parle non pas des patients étrangers qui sont accueillis dans les établissements de l’AP-HP, mais des pays qui souhaitent acheter notre savoir-faire, par exemple de l’Algérie qui va construire des CHU sur son sol. Il faut que nous puissions vendre notre expertise, non seulement pour des raisons financières, mais avant tout dans l’intérêt du rayonnement de la médecine française. Nos équipes considèrent qu’il s’agit d’un point important.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous sommes d’accord : la santé peut être le « cheval de Troie » de la renaissance de l’influence de la France à travers le monde. Telle était la conclusion du rapport que j’avais remis sur l’évaluation de l’action de la France en faveur de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la santé.
M. Martin Hirsch. Tout à fait. Je me suis rendu il y a quelques jours à Pondichéry, où l’on m’a parlé des valves Carpentier, ainsi que du savoir-faire que nous avons dans différents domaines. Il n’y a aucune raison que les autres pays se fassent payer, et pas nous ! Je suis le premier à défendre notre action humanitaire, mais elle n’est pas nécessaire dans des pays dont le taux de croissance atteint 8 ou 9 % et dont le PIB rattrape le nôtre !
En ce qui concerne les comparaisons internationales, nous avons reçu dernièrement les Suédois, qui ont estimé, après avoir examiné rapidement nos ratios, que nous étions plus efficients qu’eux, alors même qu’ils ont une organisation de grande qualité. D’autre part, les Allemands, que j’ai rencontrés récemment à Berlin, ont fait des choix originaux en termes d’organisation : ils ont créé une filiale, dont ils sont actionnaire principal, qui gère notamment une grande partie de leur activité logistique. Cela leur a permis de réduire considérablement leurs coûts, sans créer pour autant de précarité. Les modèles suédois et allemand sont l’un et l’autre intéressants, pour des raisons différentes. Selon moi, le modèle français est un bon modèle, à condition de l’hybrider avec des initiatives qui viennent d’autres pays.
Mme Carine Chevrier. S’agissant du CET, nous publions depuis deux ans les comptes financiers de l’AP-HP, dans un souci de transparence. En 2012, au vu de certaines données dont nous disposions sur la montée en charge des CET, nous avons décidé de provisionner assez lourdement. J’ai demandé l’appui d’un cabinet externe pour nous aider à déterminer le montant de la provision, tant pour le personnel médical que pour le personnel paramédical. Nous avons provisionné de manière exhaustive pour les jours de CET, ainsi que pour les jours de repos restant en fin d’année qui n’étaient pas comptabilisés jusqu’alors. L’estimation du volume d’heures a résulté d’un traitement informatisé pour le personnel paramédical, mais elle a été faite sur la base de déclarations pour le personnel médical, ce qui reste une faiblesse de notre provision. Néanmoins, du point de vue de la certification de nos comptes, l’enjeu du CET est aujourd’hui en grande partie derrière nous.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Je vous remercie pour vos interventions très intéressantes. En tant qu’élue rurale, je mesure ce qui sépare le centre hospitalier de Condom de l’AP-HP ! Au-delà de la question de la dette hospitalière, je souhaite que nous trouvions une organisation efficiente qui permette aux hôpitaux d’être présents sur tous les territoires. J’espère que notre rapport aidera notamment les « petits » établissements, qui sont indispensables à nos territoires ruraux.
M. Martin Hirsch. Je souhaite faire deux remarques finales. Je reviens d’abord sur la question que vous avez posée concernant nos relations avec l’ARS, madame la rapporteure. L’AP-HP est, certes, un très grand hôpital public, mais elle est complètement rentrée, aujourd’hui, dans le droit commun. Elle ne bénéficie plus du tout du régime d’exception qui lui était encore appliqué il y a vingt ans, quand j’y ai travaillé pour la première fois. Elle est confrontée aux mêmes difficultés et soumise aux mêmes contraintes que les autres établissements de santé, certes à une autre échelle. La nécessité de réaliser un effort de productivité de 3 % représente, pour nous aussi, un défi gigantesque. Notre taille et notre solidité peuvent donner l’impression que l’enjeu est moins immédiat, mais il est bien réel : nous devons faire décroître des courbes de dépenses qui, traditionnellement, ne faisaient que croître.
Ensuite, dans le questionnaire que vous nous avez adressé, vous avez évoqué la question des billets de trésorerie. Nous attendons vraiment de pouvoir utiliser cet instrument, car nous avons à la fois des lignes de financement à long terme et des besoins de trésorerie à court terme, ainsi que Philippe Rouvrais vous l’a expliqué. Tout euro économisé grâce à des conditions plus favorables est précieux pour nous. Quand une loi est adoptée, il faut parfois un peu de temps pour que les décrets d’application soient pris.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous le formulez de manière très diplomatique ! Madame, messieurs, je vous remercie.
*
* *
Audition de Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG)
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Je vous souhaite la bienvenue, madame la directrice générale. Je vous remercie d’avoir accepté de répondre à nos questions et vous prie d’excuser le coprésident Pierre Morange, qui n’a pas pu se libérer pour cette audition.
Nous souhaitons faire le point sur l’endettement des centres hospitaliers publics et sur les difficultés actuelles à financer les investissements, en complément du travail d’analyse mené par la Cour des comptes à notre demande. Comment peut-on améliorer les compétences financières des dirigeants hospitaliers et faire connaître les bonnes pratiques de certains établissements qui ont mieux réussi que d’autres à financer leurs investissements ? Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) et son fonctionnement ?
Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Je vous remercie de m’accueillir ce matin. Le CNG est au cœur du fonctionnement des 2 800 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur public : hôpitaux, maisons de retraite, centres pour personnes handicapées et établissements relevant du champ de l’enfance et de la famille gérés en lien avec les collectivités territoriales. Le CNG est un établissement public national de l’État placé sous la tutelle exclusive du ministère de la santé. Il a été créé à la fin de l’année 2007 et a commencé à exercer pleinement ses missions à partir de 2008.
À l’origine, le CNG était chargé de gérer les praticiens hospitaliers à temps plein – médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes – et les cadres supérieurs du système sanitaire, social et médico-social, c’est-à-dire tous les directeurs relevant de la fonction publique hospitalière. Il lui était demandé de moderniser cette gestion. Mais, progressivement, des missions complémentaires lui ont été attribuées.
L’extension de notre périmètre a ainsi connu trois grands tournants. En 2009, la gestion des praticiens hospitaliers à temps partiel, titulaires ou stagiaires – c’est-à-dire lauréats du concours national en période probatoire –, qui était assurée jusque-là par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, a été transférée au niveau national et confiée au CNG. En outre, deux événements intervenus également en 2009 ont eu des répercussions importantes pour le CNG dans les années qui ont suivi : l’adoption de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé, et aux territoires (loi HPST) et la transformation de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins en direction générale de l’offre de soins (DGOS) dans le cadre du recentrage du pilotage stratégique de la politique hospitalière. La DGOS a alors transféré au CNG la gestion de la procédure d’autorisation d’exercice.
Ainsi, depuis sa création, le CNG a connu un doublement de ses activités, lequel ne s’est pas accompagné, toutefois, d’un doublement des moyens correspondants : ses effectifs s’élèvent actuellement à 117 équivalents temps plein, contre 91 à l’origine. Nous avons donc beaucoup travaillé pour améliorer la performance de notre organisation, de manière à assumer ces importants transferts d’activité et à s’acquitter de nos missions dans les délais, lesquels sont souvent impartis par la loi.
Pour résumer, le CNG gère actuellement, d’une part, 54 000 praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers – professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers – et, d’autre part, près de 6 000 directeurs qui relèvent de trois corps distincts : environ 3 100 directeurs d’hôpital, quelque 1 900 directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social (D3S) et un peu plus de 800 directeurs des soins. La gestion de ces derniers, qui était assurée auparavant au niveau local, a été transférée au CNG par la loi HPST au nom de l’unité de l’équipe de management général des hôpitaux. Les directeurs des soins assurent en effet le management des activités médicales aux côtés des directeurs généraux et des chefs d’établissement, en lien avec le président de la commission médicale d’établissement (CME) et avec les autres directions de l’hôpital.
Précisons que 446 directeurs d’hôpital et 1 085 D3S sont chefs d’établissement. Le maillage du territoire par les établissements sociaux et médico-sociaux est donc relativement serré. Il s’agit généralement de structures plus petites que les hôpitaux. Les conseils régionaux ou généraux sont souvent très impliqués dans leur gestion, en lien avec les Agences régionales de santé (ARS).
Le CNG est chargé, en outre, d’organiser vingt concours nationaux : douze concours médicaux – notamment les huit concours d’internat, dont le plus important est l’internat de médecine, qui attire chaque année 8 000 candidats – et huit concours administratifs – notamment les concours qui mènent aux trois corps de directeurs que nous gérons, les concours d’accès aux cycles préparatoires et aux cycles de formation correspondants, ainsi que le concours d’attaché d’administration hospitalière.
Environ 22 000 candidats se présentent à l’ensemble de ces concours chaque année. Nous faisons appel à 1 400 membres de jury. L’organisation des concours mobilise le CNG onze mois sur douze. Nous nous efforçons de la moderniser, notamment de la sécuriser et de l’informatiser.
Le CNG gère également la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) pour les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes – bien que nous ne gérions pas ce dernier corps. Les professionnels de ces quatre catégories qui ont obtenu leur diplôme hors de l’Union européenne et qui souhaitent être habilités à pratiquer leur activité en France avec la plénitude d’exercice doivent d’abord réussir l’examen ou le concours de la PAE, puis obtenir une autorisation d’exercice. Le CNG et les conseils nationaux des ordres professionnels interviennent dans la procédure.
Le CNG a aussi développé, depuis 2008, un dispositif d’accompagnement professionnel personnalisé pour les directeurs et les praticiens hospitaliers. Il peut s’agir de faciliter une reconversion, de soutenir une mobilité ou d’accompagner le changement, parfois sur des fonctions cibles spécialisées. L’accompagnement est réalisé par des conseillers en développement – coaches –, dont une partie est issue du secteur privé et l’autre a été formée dans le secteur public. Ce dispositif, très original au sein de la fonction publique, est monté progressivement en puissance : près de 900 professionnels en ont déjà bénéficié.
Enfin, le CNG est chargé de nombreuses autres missions, plus accessoires. L’une d’entre elles est néanmoins très importante : au nom de l’État, le CNG conclut, avec les étudiants et les internes en médecine ou en odontologie, les contrats d’engagement de service public par lesquels ceux-ci s’engagent à exercer, après leur diplôme de spécialité, dans des régions ou des spécialités dans lesquelles l’offre de soins est déficitaire.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Nous avons rencontré un certain nombre de directeurs d’hôpital. Plusieurs établissements connaissent une situation financière très compliquée. Nous essayons de déterminer la chaîne des responsabilités. Quelle est, en particulier, la responsabilité des directeurs d’établissement dans cette situation ? Au moment où les prêts structurés ont été proposés aux hôpitaux, avaient-ils les connaissances et les qualifications suffisantes en matière financière pour prendre les décisions qui s’imposaient – qui n’ont malheureusement pas toujours été prises ? Les auraient-ils aujourd’hui ? Selon vous, quels aspects conviendrait-il d’améliorer dans la formation des cadres dirigeant des hôpitaux en matière financière ?
Mme Danielle Toupillier. Le CNG travaille de manière permanente avec l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et a développé une relation partenariale très poussée avec elle. Nous allons d’ailleurs conclure prochainement une convention ensemble.
Les lauréats des concours organisés par le CNG suivent le cycle de formation dispensé par l’EHESP. Nous assurons un suivi conjoint des élèves directeurs pendant toute la durée de leur formation, notamment de ceux qui rencontrent, le cas échéant, des difficultés. Je suis membre, aux côtés de représentants de la DGOS, du jury de validation de la formation. Dans le cadre de ce jury, nous nous posons la question de l’adaptabilité des élèves sortants, de leur capacité à exercer un métier devenu de plus en plus complexe, en particulier dans le domaine financier, compte tenu de la mondialisation des marchés de capitaux. Les futurs directeurs doivent être aptes à assurer un rôle de pilotage et de management, ce qui suppose non seulement un certain nombre de connaissances mais aussi un comportement adéquat. En effet, le cœur de métier des directeurs d’établissement est non pas l’administration, mais la stratégie institutionnelle, dans tous les grands domaines fonctionnels : finances, ressources humaines, qualité et sécurité des soins, etc.
À la suite de la révélation de l’endettement massif des hôpitaux publics, l’EHESP a réagi très rapidement, à la demande de la DGOS. Elle a ainsi renforcé ses formations en matière financière, à trois niveaux.
Premièrement, dans le cadre de la formation initiale. L’EHESP forme chaque année une cinquantaine de directeurs d’hôpital, contre une centaine historiquement. Nous avons en effet diminué le nombre de places au concours, mais allons l’augmenter à nouveau compte tenu de l’évolution démographique du corps. Les lauréats du concours sont issus, à plus de 70 %, des instituts d’études politiques ou de cycles complémentaires en droit. Peu d’entre eux sont donc économistes ou formés aux stratégies financières. Avec le ministère de la santé et l’EHESP, nous cherchons actuellement à diversifier les parcours. C’est pourquoi nous allons ouvrir, à partir de 2015, un troisième concours, en plus des concours interne et externe.
Les élèves directeurs d’hôpital suivent une formation à caractère polyvalent complétée par des modules de spécialisation. L’un de ces modules porte sur l’analyse et le pilotage financiers, sur la gestion des risques dans les projets d’investissement, sur la négociation et la gestion de la dette, ainsi que sur certains éléments de mathématiques financières. Il est suivi notamment par les élèves qui ont vocation à occuper, à la sortie de l’école, des postes de direction dans les services chargés de la stratégie économique et financière, des investissements et du contrôle de gestion. L’EHESP a plus particulièrement mis l’accent sur ce module à partir de 2010 et 2011.
Depuis quelques années – tel n’était pas le cas auparavant –, l’EHESP forme également les attachés d’administration hospitalière. Ceux-ci sont les premiers collaborateurs des directeurs, auxquels ils apportent leur expertise technique dans différents domaines, notamment financier. Ils ont une formation de très bon niveau et suivent, eux aussi, un module de spécialisation en matière de gestion financière des établissements.
Deuxièmement, l’institut du management de l’EHESP a développé deux programmes de formation continue à la demande du ministère de la santé, en lien avec le CNG. Il propose, d’une part, un cycle qui aboutit à la délivrance du diplôme de « gestion financière d’un établissement de santé ». Celui-ci s’adresse à des profils pluridisciplinaires, non seulement aux directeurs d’hôpital, mais aussi aux médecins – notamment aux médecins directeurs de l’information médicale, qui sont de véritables « capteurs » d’informations utiles à l’analyse financière et à la stratégie –, aux attachés d’administration hospitalière, aux contrôleurs de gestion des établissements hospitaliers et aux cadres des services centraux et déconcentrés de l’État. Les programmes de formation continue de l’EHESP présentent l’intérêt d’être suivis à la fois par des cadres supérieurs et intermédiaires de la fonction publique hospitalière et par des agents appelés à rejoindre les agences régionales de santé (ARS) ou leurs délégations territoriales. Ces deux catégories de professionnels y apprennent les mêmes références, partagent les mêmes expériences et travaillent sur les mêmes cas concrets.
L’institut du management de l’EHESP propose, d’autre part, un module spécialisé portant sur le diagnostic financier appliqué, sur le financement des investissements, ainsi que sur la gestion de la trésorerie et de la dette. Les programmes de formation continue n’ont, bien sûr, pas de caractère obligatoire : ils sont suivis par des agents déjà en fonction, sur la base du volontariat, dans le cadre du plan de formation de chaque établissement.
Troisièmement, depuis 2012, l’EHESP organise chaque année un colloque national avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels du groupe Crédit mutuel. La troisième édition de ce colloque, qui s’est déroulée le 27 juin 2014, a porté sur les stratégies de financement des investissements dans les établissements publics de santé et sur les incidences de la certification des comptes hospitaliers.
Que pourrait faire le CNG en vue d’améliorer encore les compétences des responsables des hôpitaux en matière financière ? Le décret du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du CNG prévoit, dans son article 2, que le CNG peut définir des actions de formation au profit des praticiens hospitaliers, des directeurs d’hôpital, des D3S et des directeurs des soins. À ce jour, cette compétence n’a jamais été utilisée. À la lumière des conseils que pourrait formuler la MECSS à l’issue de ses auditions, le CNG pourrait, le cas échéant, définir des actions de formation dans le cadre de son partenariat avec l’EHESP – la convention en cours pourrait être complétée à cette fin – et en lien avec la DGOS et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Ainsi, ces programmes pourraient s’adresser d’abord aux hôpitaux, puis être étendus, dans un deuxième temps, aux quelque 1 800 établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la DGCS. Si ces derniers ont une surface financière moindre que les hôpitaux, ils sont très proches des collectivités territoriales, lesquelles ont été elles-mêmes très affectées par les emprunts toxiques.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Comment les directeurs d’hôpital sont-ils nommés ? Le CNG intervient-il dans la procédure ?
Mme Danielle Toupillier. Il existe trois modes de recrutement différents pour les directeurs d’hôpital, d’où une diversité intéressante dans les profils.
Le premier mode de recrutement est le concours. Il reste majoritaire – 53 % des recrutements –, même s’il est progressivement rattrapé par les deux autres. Le nombre de places au concours est fixé chaque année par la DGOS, sur proposition du CNG. Nous réalisons des projections démographiques – nous achevons actuellement notre travail de projection pour la période courant de 2015 à 2030 – afin d’avoir une vision et une stratégie pluriannuelles.
Le CNG organise trois types de concours de directeur d’hôpital. Le concours externe est, historiquement, le principal des trois, puisqu’environ 67 % des places étaient offertes à ce concours. Les candidats qui s’y présentent ont généralement suivi une formation universitaire poussée : alors qu’il leur suffit d’un diplôme de niveau II, beaucoup d’entre eux ont un diplôme de niveau I. Le concours interne s’adresse, de manière classique, aux cadres de catégorie A des trois fonctions publiques. Le troisième concours, que nous organisons pour la première fois en 2015, est ouvert principalement à des personnes qui ont exercé, pendant au moins huit ans, un mandat ou une activité professionnelle dans le milieu associatif.
Le deuxième mode de recrutement est le tour extérieur. Il est ouvert aux agents de catégorie A des trois fonctions publiques. Les candidats passent devant un jury professionnel présidé par un membre de l’Inspection générale des affaires sociales. Le nombre de places attribué au tour extérieur est, là aussi, fixé à l’avance. Afin de prendre leurs fonctions dans des conditions optimales, les lauréats suivent un cycle d’adaptation à l’emploi dispensé par l’EHESP. Il existe un cycle long et un cycle court, que nous sommes en train de rapprocher.
Le troisième mode de recrutement est le détachement. Il s’agit d’une voie d’accès originale, qui s’est beaucoup développée ces dernières années, notamment depuis la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Le détachement se fait entre corps de niveau comparable, la comparabilité s’appréciant au regard des conditions d’accès au corps, notamment de la formation, ou de la nature des missions. Cela a conduit à restreindre le vivier des candidats possibles pour un détachement dans le corps des directeurs d’hôpital. Ainsi, les anciens élèves de l’École nationale d’administration, les administrateurs territoriaux, les ingénieurs de très haut niveau, les directeurs d’hôpital et des D3S peuvent être détachés, indifféremment, dans le corps des administrateurs civils, des administrateurs territoriaux, des directeurs d’hôpital ou des D3S. L’intégration dans le corps d’accueil peut intervenir à plus ou moins long terme. En accord avec le ministère de la santé et les organisations professionnelles, nous avons considéré qu’une durée de deux ans était suffisante pour apprécier l’aptitude à exercer les fonctions de directeur d’hôpital et décider, le cas échéant, de l’intégration.
La commission administrative paritaire nationale se prononce sur le détachement après avoir examiné le parcours du candidat et l’adéquation de son profil avec le poste. Les publications de postes sont toutes assorties d’une fiche de poste détaillée. Nous travaillons beaucoup sur l’adéquation entre le profil et le poste, le ministère de la santé nous ayant demandé de développer les parcours professionnel. À cet égard, nous « faisons dans la dentelle » : nous essayons de repérer les hauts potentiels, notamment les agents qui ont développé des aptitudes particulières, par exemple en matière de pilotage et de stratégie financière, ou ceux que nous serions susceptibles de solliciter pour renforcer une équipe ou pour accompagner un établissement en difficulté. Pour faire ce travail de repérage, nous nous servons notamment des évaluations annuelles. Celles des directeurs chefs d’établissement sont réalisées par les directeurs généraux des ARS, et celles des directeurs adjoints par les chefs d’établissement.
Certains postes de chefs d’établissement hospitalier sont d’un niveau très élevé. Depuis la loi HPST, les postes de directeurs généraux des établissements les plus importants – centres hospitaliers universitaires (CHU) et centres hospitaliers régionaux (CHR) – ne sont plus des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière : les nominations à ces postes se font par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le Gouvernement est libre de désigner qui il souhaite, ce qui lui permet le cas échéant de faire appel à des personnes ayant exercé des activités dans les domaines les plus divers, y compris dans le secteur privé. À ce jour, ce sont surtout de hauts fonctionnaires de l’État ou des directeurs d’hôpital de très haut niveau qui ont accédé à ces fonctions.
S’agissant des autres hôpitaux, les postes de directeurs chefs d’établissement et de directeurs adjoints ne sont des emplois fonctionnels que si le budget est supérieur à 60 millions d’euros. Sur les 958 établissements hospitaliers français, nous comptons 355 emplois fonctionnels répartis en trois groupes : le groupe III correspond aux établissements dont le budget est compris entre 60 et 125 millions d’euros ; le groupe II à ceux dont le budget est compris entre 125 et 250 millions ; et le groupe I à ceux dont le budget dépasse 250 millions, c’est-à-dire à des centres hospitaliers non universitaires dont les activités sont à peu près équivalentes à celles d’un CHU.
Pour ces emplois fonctionnels, nous effectuons une sélection particulière. Conformément à ce qui nous a été demandé, nous sommes d’une très grande exigence. Les candidats doivent répondre à un certain nombre de critères fixés par voie réglementaire, notamment en matière de parcours professionnel. Cependant, dans la mesure où la règle ne peut pas tout prévoir, nous complétons ces critères au fur et à mesure, en accord avec les organisations professionnelles. Ils sont publiés, en toute transparence, sur notre site internet. Nous avons ainsi augmenté encore le niveau d’exigence, tant en matière de déontologie que de parcours professionnel.
Un comité de sélection intervient dans la procédure de nomination aux emplois fonctionnels, à double titre. Sa première fonction est de délivrer des agréments. Ainsi, lorsqu’un directeur d’hôpital présente sa candidature à un emploi fonctionnel, quel qu’en soit le niveau, le comité de sélection décide, au regard de son parcours professionnel, de ses évaluations et des éventuelles formations qu’il a suivies, de l’agréer ou non pour les emplois fonctionnels des groupes I, II ou III. Sur les 3 100 directeurs d’hôpital, environ 20 % sont agréés pour les emplois fonctionnels du groupe III, un nombre un peu moins important pour ceux du groupe II, et un nombre restreint pour ceux du groupe I.
Pour obtenir un agrément pour le groupe I, les directeurs doivent avoir acquis une grande légitimité à la faveur d’un parcours professionnel riche et diversifié. Ils doivent avoir occupé plusieurs postes de chef d’établissement et pouvoir justifier d’une expérience dans les différents domaines fonctionnels : finances et stratégie financière – un des domaines les plus importants –, ressources humaines, qualité et sécurité des soins, etc. En effet, lorsqu’ils prennent une décision en matière de financement, d’investissement ou de ressources humaines, les chefs d’établissement doivent avoir une vision suffisamment large pour en apprécier toutes les conséquences en termes financiers et humains, mais aussi en termes de stratégie, de développement et de coopération.
La deuxième fonction du comité de sélection est d’établir les listes restreintes de candidats – shorts lists – pour les emplois fonctionnels. S’agissant des postes de directeurs chefs d’établissement, conformément aux textes réglementaires, le comité peut retenir au maximum six candidats sur l’ensemble de ceux qui se sont présentés – vingt à trente généralement. Les critères de sélection sont principalement le parcours professionnel, l’adaptabilité et l’adéquation entre le profil du candidat et le poste. Des candidats très brillants peuvent ne pas être retenus pour un poste donné parce que leur parcours les qualifie moins que d’autres pour ce poste.
Ensuite, le CNG adresse la liste restreinte au directeur général de l’ARS compétent s’il s’agit d’un poste de chef d’établissement ou au directeur départemental de la cohésion sociale s’il s’agit d’un poste de D3S. Ledit directeur général ou directeur départemental classe au moins trois candidats parmi les six par ordre de préférence et adresse ses propositions au CNG, qui a alors compétence liée. Pour les postes de chefs d’établissement, le directeur général de l’ARS recueille au préalable l’avis du président du conseil de surveillance de l’établissement. En liaison avec le directeur général de l’offre de soins et avec le cabinet du ministre chargé de la santé, je propose l’un des trois noms, qui est soumis pour avis à la commission administrative paritaire nationale. À l’issue du processus, je procède à la nomination du directeur chef d’établissement par arrêté, au nom du ministre chargé de la santé.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Le département rural où je suis élue présente la particularité de compter huit hôpitaux locaux. Or les postes de directeurs de ces établissements sont régulièrement vacants. Je suis présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier de Condom. Celui-ci comprend plusieurs services – urgences, médecine, soins de suite –, mais ne dispose pas de plateau technique. Est-il aisé de trouver des directeurs pour de petits centres hospitaliers de ce type ? Dans un tel établissement, le directeur doit s’occuper lui-même de tout : des ressources humaines, du budget, des finances, des travaux, etc.
Mme Danielle Toupillier. C’est une excellente question. Il s’agit de l’une de nos préoccupations. Pour diriger les petits établissements non seulement hospitaliers, mais aussi sociaux et médico-sociaux, il faut des profils à la fois spécialisés et polyvalents. La polyvalence est un critère majeur, car les chefs de ces établissements ne sont souvent assistés que par un nombre très restreint de cadres administratifs.
Il y a en effet aujourd’hui un certain nombre de postes vacants dans les établissements de ce type. Lorsque l’on superpose les cartes des postes vacants relevant des différents corps de l’encadrement supérieur médical et administratif – praticiens hospitaliers, directeurs d’hôpital, D3S, directeurs des soins –, on se rend bien compte que certaines régions sont particulièrement touchées et que d’autres, moins affectées, rencontrent des problèmes au niveau infra-régional, notamment pour de petits établissements tels que celui de Condom. Les professionnels sont moins enclins à accepter des postes dans ces établissements parce qu’ils savent que la charge de travail y est très lourde. De plus, au cours des dernières années, le nombre de départs à la retraite a beaucoup augmenté. Après avoir réduit le nombre de places aux concours d’accès à l’EHESP, nous nous efforçons désormais d’assurer une meilleure adéquation entre les recrutements et les besoins institutionnels.
Au cours des cinq dernières années, nous avons beaucoup développé les directions communes, qui permettent de regrouper soit plusieurs établissements hospitaliers, soit des établissements hospitaliers avec des établissements sociaux et médico-sociaux – on parle alors de directions communes mixtes. Ce dispositif préserve l’autonomie des établissements, ce qui est un point très sensible pour les acteurs politiques locaux. Le directeur qui est distingué pour prendre la tête de la direction commune doit participer à un grand nombre d’instances, puisque chaque établissement conserve les siennes.
Les directions communes permettent de combiner unité de direction – avec une équipe un peu plus étoffée – et responsabilisation des acteurs. Les établissements portent un projet médical commun et peuvent développer des coopérations pertinentes en matière d’administration, de logistique, d’ingénierie, de gestion des ressources humaines, de développement de certaines activités. Cette forme de travail en équipe est de plus en plus prisée, notamment par les D3S qui, sinon, exercent souvent leurs fonctions dans un certain isolement. Ils apprécient la dimension de partage et le sens du compagnonnage. D’autant que nous essayons de nommer, à la tête des directions communes, des directeurs seniors très expérimentés à même d’aider les agents les plus jeunes à prendre leurs marques et d’accompagner ceux qui sont plus avancés dans la carrière à passer d’un domaine de compétence à un autre, par exemple des finances aux ressources humaines.
Aujourd’hui, environ 400 directions communes se sont constituées. Seul un petit nombre d’entre elles a été dénoncé, souvent pour des raisons de stratégie ou de politique locale. Le dispositif est plutôt prometteur : beaucoup de directions communes sont dans une dynamique ascendante et ont fait la preuve de leur efficacité. Elles permettent à différentes personnes de partager leurs compétences, de croiser leurs regards et, le cas échéant, de prêter main-forte à des établissements en difficulté qui, s’ils étaient restés isolés, n’auraient sans doute pas attiré un candidat au potentiel suffisant pour ce faire.
Par ailleurs, le CNG a mis en place des ateliers de co-développement, pratique qui s’est beaucoup développée au Canada il y a une quinzaine d’années. Il s’agit d’échanges d’expérience entre pairs, en petit groupe, à propos de situations imaginées ou vécues. Certains ont été confrontés, par exemple, à des situations financières très tendues ou à des plans de retour à l’équilibre qui les ont particulièrement perturbés. Ce dispositif d’accompagnement professionnel permet aux participants de réaliser des progrès très sensibles. Nous avons actuellement plusieurs ateliers très actifs, qui impliquent notamment des D3S, lesquels sont souvent les plus isolés dans l’exercice de leurs fonctions. Nous avons l’intention de poursuivre et d’intensifier ce programme, le cas échéant en partenariat avec l’EHESP et en lien avec la DGOS et la DGCS.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Vous avez évoqué des programmes qui s’adressent à la fois aux directeurs d’hôpital, aux cadres hospitaliers et aux agents qui travaillent dans les ARS. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces formations communes ? Quelles sont vos relations avec les ARS ?
Mme Danielle Toupillier. Le CNG entretient des relations étroites et permanentes avec les ARS pour mener à bien l’ensemble de ses missions.
Chaque année, les directeurs généraux des ARS évaluent les directeurs chefs d’établissement et fixent le montant de leur prime de résultat au regard des objectifs qu’ils leur avaient assignés. Le CNG fait un bilan de cette campagne d’évaluation et de modulation des primes, afin notamment d’identifier, si possible en amont, les éventuels problèmes qui se posent. En outre, les directeurs généraux des ARS nous informent régulièrement des difficultés que peut rencontrer tel ou tel directeur : situation d’épuisement professionnel – burn-out –, nécessité de développer telle ou telle compétence. Nous essayons alors d’être aussi réactifs que possible et de proposer, le plus souvent hors recherche d’affectation, un programme d’accompagnement personnalisé adapté, en lien avec l’EHESP ou, le cas échéant, avec un autre organisme – rappelons que 900 professionnels ont déjà bénéficié d’un tel accompagnement.
Les directeurs peuvent aussi être placés en position de recherche d’affectation, notamment en cas de restructuration hospitalière. Il s’agit d’un dispositif original qui n’existe pas dans les autres fonctions publiques : l’agent est dégagé de ses obligations professionnelles et rattaché au CNG. Nous lui proposons alors un programme de reconversion ou de réactualisation des connaissances visant à le repositionner professionnellement. Nous nous efforçons, avec les ARS, d’anticiper au maximum ces mouvements afin d’accompagner les directeurs concernés dans les meilleures conditions possibles. Nous faisons un gros travail en la matière.
Nous travaillons aussi en étroite relation avec les ARS dans le cadre du dispositif des contrats d’engagement de service public. Ce sont les ARS qui déterminent les zones à faible densité médicale.
Enfin, le CNG développe des projets pilotes stratégiques avec les ARS. D’une part, nous avons conclu un partenariat avec l’ARS de Rhône-Alpes, la branche régionale de la Fédération hospitalière de France et six établissements expérimentateurs de la région afin de mettre en place un système d’échange d’informations sur les temps médicaux. Il s’agit d’une première en France. L’objectif est d’avoir une image complète des temps médicaux à l’hôpital public, en faisant remonter au niveau national les données concernant les praticiens contractuels gérés au niveau de chaque établissement. Ceux-ci représentent environ 30 % des praticiens hospitaliers. Nous pourrons ainsi faire véritablement le point sur les postes vacants. Nous ferons ensuite le même travail pour les directeurs.
D’autre part, le CNG va développer, à partir de cette année, des programmes d’accompagnement collectif dans un ou deux CHU volontaires. Il s’agira d’accompagner une équipe entière de direction ou de praticiens hospitaliers, en matière de management et de conduite du changement, ou pour développer certaines compétences spécifiques. Nous avons déjà une expérience d’accompagnement collectif en cours, mais qui relève davantage du soutien à un établissement en difficulté. En lien avec l’ARS compétente, nous intervenons dans un centre hospitalier à la suite du suicide d’une praticienne hospitalière, anesthésiste-réanimatrice – un des pires moments que puisse connaître un hôpital. Le programme que nous développons dans cet établissement concerne une centaine de professionnels – médicaux, paramédicaux et administratifs – impliqués dans l’activité du bloc opératoire.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Chaque année, le président du conseil de surveillance doit donner son avis sur le directeur de l’établissement. Cette procédure n’est-elle pas quelque peu obsolète ? A-t-elle toujours sa raison d’être ?
Mme Danielle Toupillier. Le conseil de surveillance est une institution majeure de l’hôpital. Son président est bien placé pour faire le lien entre la vie interne de l’établissement et l’environnement proche. Son appréciation est donc très importante pour nous : il s’agit d’un deuxième regard, complémentaire de celui du directeur général de l’ARS, lequel est force de proposition. Cela nous aide dans nos évaluations et nous permet, le cas échéant, de repérer certains problèmes. Tel est notamment le cas lorsque nous constatons un écart entre les deux appréciations, ce qui peut nous amener à rencontrer le directeur concerné afin de recueillir son opinion sur son positionnement et sur ses difficultés éventuelles. Nous pouvons ainsi prévenir certains risques, notamment psychosociaux, et mieux accompagner les professionnels. Nous travaillons beaucoup sur ces risques actuellement et allons développer un programme avec l’EHESP en la matière.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Je vous remercie, madame la directrice générale.
*
* *
Audition de M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), et M. Christian Béréhouc, directeur associé, directeur de pôle
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Je vous prie d’excuser mon collègue Pierre Morange, coprésident de la MECSS, qui n’a pas pu se libérer aujourd’hui.
Nous avons le plaisir d’accueillir M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et M. Christian Béréhouc, directeur associé.
La MECSS souhaite faire le point sur l’endettement des centres hospitaliers publics et sur les difficultés actuelles à financer les investissements, en complément du travail d’analyse mené, à notre demande, par la Cour des comptes.
Je vais vous laisser la parole pour présenter les missions de votre organisme et nous dire en quoi elles peuvent être utiles aux établissements de santé pour améliorer la gestion financière et patrimoniale, ainsi que les investissements.
En tant que présidente du conseil de surveillance de l’hôpital de Condom, je sais que le directeur de l’hôpital est venu présenter le plan de financement devant l’ANAP, qui a donné son aval, et je me félicite que les travaux aient débuté.
M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Je suis, au départ, directeur d’hôpital. J’ai travaillé dans le secteur public, dans le secteur privé et dans le secteur des établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Je vais laisser à Christian Béréhouc le soin de se présenter.
M. Christian Béréhouc, directeur associé de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Je suis, pour ma part, ingénieur de formation. Je travaille depuis trente ans dans le secteur de la santé, avec une expérience au ministère de la santé, puis à la Caisse des dépôts et consignations, à la Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier, et enfin, à l’ANAP. Ces trente dernières années m’ont permis d’acquérir une bonne connaissance des investissements hospitaliers.
M. Christian Anastasy. L’ANAP est un groupement d’intérêt public (GIP) qui associe l’État, représenté par des directions de l’administration centrale du ministère des affaires sociales et du ministère du budget. L’Agence a un budget de 25 millions d’euros et un plafond d’emplois de 98 équivalents temps plein (ETP). Son objectif principal est de diffuser une culture de la performance de l’organisation auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux, la performance étant entendue au sens de tout ce qui contribue à améliorer la prise en charge des personnes malades ou hébergées en établissement de moyen et long séjour, de tout ce qui contribue à la satisfaction des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, au sens, enfin, de tout ce qui peut générer une meilleure utilisation des ressources.
J’en viens aux thèmes que vous nous avez indiqué souhaiter aborder aujourd’hui.
Vous souhaitez savoir dans quels cas l’Agence signe des contrats de performance avec les établissements, si c’est plutôt pour des interventions longues et pour mieux suivre la mise en œuvre de ses préconisations.
Les contrats de performance, tels qu’ils ont été conçus dans les années 2009, ont été circonscrits dans le temps puisque définis pour la période 2009-2012. Ils avaient un caractère expérimental et visaient à créer de nouvelles modalités et méthodes de transformation des organisations de santé en promouvant une vision globale et priorisée de l’ensemble des problématiques. Jusqu’alors, on avait tendance à ne considérer qu’un aspect des problèmes, comme l’organisation des blocs, l’organisation des systèmes d’information ou encore l’organisation des investissements. Puisque tout interagit, cette approche se voulait globale et hiérarchisée. Des murs trop importants ou mal adaptés, par exemple, induisent une mauvaise organisation en matière de ressources humaines ou en termes de systèmes d’information.
Cette approche était intéressante dans la mesure où elle concernait vingt-huit grands établissements français, soit environ 10 % des lits en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO). Elle a permis de promouvoir une vision multidimensionnelle des problématiques des organisations de santé et de faire ressortir que les raisonnements en silos verticaux n’étaient pas les plus probants, qu’il fallait, au contraire, avoir une approche globale.
Nous sommes partis d’un diagnostic partagé avec les acteurs.
Pour prendre l’exemple de l’hôpital de Condom, il est inutile que l’ANAP dise comment faire en l’absence d’accord du directeur, du président du conseil de surveillance et du corps médical. Il faut partir d’un diagnostic partagé. Une fois que nous sommes tous d’accord, nous pouvons définir une feuille de route et, dès lors que nous sommes d’accord sur le diagnostic et la feuille de route, nous savons quel plan d’action élaborer, ce qui doit être fait en lien avec les équipes. Cette méthode a permis des transformations importantes et de générer de réelles économies pour le système hospitalier dans son ensemble puisque le projet était étudié et valorisé par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et les services de l’État et présenté dans le cadre du Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO). Nous avons investi dans ce projet 60 millions d’euros, tout compris, pendant une période de trois ans, et nous avons généré 300 millions d’économies pérennes. Le rapport est donc plutôt positif.
Nous avons pris en compte les attentes des soignants, et notamment des cadres soignants responsables d’unités ou de services. Ce sont eux qui ont induit le mouvement à grande échelle. Il faut toujours les facteurs déclenchants des directions et des présidents de commissions médicales d’établissement (CME), mais il faut également que les personnels suivent.
La capitalisation des connaissances issues de la réalisation de ces projets a permis de contribuer à définir de nouvelles méthodes. Aujourd’hui, par exemple, le projet « gestion des lits », lancé récemment par la ministre chargée de la santé, est issu de la capitalisation des projets de performance. On s’est aperçu, au travers des projets de performance, que la bonne gestion des lits, c’est-à-dire le rapprochement entre les gens qui attendent dans les services d’urgence et les lits vides, était indispensable dans les organisations. Le sujet a été mal exploré antérieurement. Aujourd’hui, à la demande de la ministre, 164 établissements sont accompagnés. Cette vision globale, qui s’appuie aussi sur une vision holistique pour lancer le mouvement dans un grand nombre d’établissements simultanément, a permis de transformer les mentalités des acteurs.
En ce qui concerne le choix de nos intervenants, vous souhaiteriez savoir si ce sont essentiellement des praticiens des domaines de la santé et du médico-social ou si nous recourons également à d’autres profils.
Nous avons 98 collaborateurs, mais sur ce plafond d’emplois, nous avons affecté l’équivalent de deux ETP à des missions d’expertise. Quand nous avons travaillé sur le sujet de la chirurgie ambulatoire, nous avons recruté vingt experts nationaux des secteurs public et privé, ainsi que des ESPIC, principalement des chirurgiens et des anesthésistes, mais aussi des soignants, qui nous ont aidés à préciser nos propositions afin qu’elles soient fondées, en termes d’organisation, sur des pratiques véritables.
Nos collaborateurs sont tous issus d’établissements de santé et ont des profils très diversifiés. Ils ont deux caractéristiques ou missions.
D’abord, ils sont représentatifs des établissements qu’ils ont vocation à conseiller. Si je me rends au Centre hospitalier (CH) de Condom, je peux ainsi dire à votre directeur que j’ai été moi-même directeur de l’hôpital de Royan, ce qui, d’entrée, crée des connivences.
La deuxième mission des collaborateurs est de contribuer au décloisonnement des secteurs, en proposant une vision large de l’aspect MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) par rapport au secteur médico-social, mais également par rapport au secteur privé. Elle a aussi pour objectif de contribuer au décloisonnement des métiers. Il ne doit pas y avoir, d’un côté, la direction, de l’autre, les responsables des systèmes d’information. Les systèmes d’information sont un des éléments incontournables de la stratégie des établissements. Les deux parties doivent pouvoir communiquer et travailler de concert.
Si un directeur d’établissement ou un chef de bloc est confronté à une réorganisation majeure de son unité, cela ne lui arrivera qu’une fois dans sa vie, peut-être deux. Reconstruire un hôpital est, pour un directeur, une expérience unique, qui durera de cinq à dix ans. S’appuyer, au sein de l’ANAP, sur des personnes qui ont des profils différents et qui ont accumulé des expériences diversifiées permet de mettre cet ensemble d’expériences diversifiées au service de professionnels qui, eux, n’ont jamais – ou rarement –vu ce type de transformation.
L’Agence recourt également à des consultants, mais ils ne sont pas là pour agir à la place de l’ANAP. Lorsque nous recourons à des consultants, un professionnel de l’ANAP encadre systématiquement leur mission. Les consultants ne peuvent jamais décider eux-mêmes de la façon de conduire un projet. En revanche, ils démultiplient notre capacité d’agir sur un territoire puisqu’ils nous permettent de toucher un plus grand nombre d’établissements. Il est évident que 98 ETP ne suffiraient pas par exemple à accompagner 450 établissements dans le programme Hôpital numérique. Il faut avoir la possibilité de s’appuyer sur des consultants.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Existe-t-il des collaborations entre l’École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes et votre établissement ?
M. Christian Anastasy. Nous avons développé avec cette école des relations positives. Cela étant, l’ANAP est une agence encore jeune. Nous arrivons à une forme de maturité, au sens où nous avons produit environ soixante-dix outils dont il est nécessaire d’assurer maintenant la diffusion. Leur appropriation par les organismes de formation initiale et de formation continue est l’un de nos objectifs. C’est avec l’EHESP que nous avons initié récemment des accords pour diffuser nos outils à plus grande échelle, en formation initiale et en formation continue. Nous avons créé, par exemple, un outil d’analyse, dénommé « Hospi Diag », qui permet d’analyser l’activité et la productivité des établissements publics et privés sur un territoire, ce qui est très utile pour les recompositions à venir. Cet outil mérite d’être développé. Le comité de direction de l’ANAP s’est déplacé à Rennes et nous avons tenu, sous la présidence de Laurent Chambaud et de moi-même, un comité de direction conjoint avec les cadres de l’EHESP. La réciproque est en cours puisque des représentants de l’EHESP vont venir au siège de l’ANAP. Ces relations méritent d’être approfondies, mais il est logique qu’elles n’aient pas été formalisées plus avant parce que nous n’avions pas atteint un niveau de maturité suffisant.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Vous avez, ces dernières années, accompagné des établissements en grave crise financière, qui avaient souscrit des emprunts structurés. Avez-vous remarqué des problématiques communes ?
M. Christian Anastasy. Lorsque nous avons accompagné ce type d’établissements, notre mission portait principalement sur l’organisation d’un certain nombre de points qui apparaissaient dans le bilan des projets de performance comme devant être traités en priorité, en particulier ce qui concerne la gestion des lits et l’organisation des pharmacies, des blocs opératoires et de la facturation.
En ce qui concerne l’appui à la facturation, je précise que nous ne nous intéressons pas au codage des actes. En revanche, nous avons aidé des établissements à facturer mieux, c’est-à-dire de façon plus juste. Parfois, les établissements facturent trop tard ou ne facturent pas la totalité des examens. Il leur arrive également de facturer trop au détriment de l’assurance maladie.
S’agissant de la gestion de la dette et de la gestion économique et financière, celles-ci relèvent de l’agence régionale de santé (ARS) qui intervient seule, en lien avec l’État, et notamment la DGOS, qui suit ces questions. Notre rôle est circonscrit à l’organisation. J’appelle toutefois votre attention sur le fait que l’organisation est un élément déterminant pour un établissement de santé.
À titre d’illustration, un article, publié en mai 2011 dans une revue scientifique de haut niveau, The New England journal of medicine, et écrit par deux médecins, le professeur Victor Fuchs et le professeur Arnold Milstein, montrait ainsi que si la plupart des hôpitaux ou des services s’alignaient sur les établissements les mieux organisés en termes de production de soins, la part des dépenses de santé dans le PIB des États-Unis, qui est très élevée, diminuerait de quatre points.
Les problèmes d’organisation se voient immédiatement. Quand vous entrez dans l’hôpital de Condom, Madame la présidente, vous pouvez voir tout de suite si les gens attendent ou non, et donc s’il y a un problème d’organisation. Ce n’est pas une question de moyens, c’est une question de vision des choses et de modalités d’organisation des flux dans une organisation de santé complexe. Dans certains hôpitaux, il n’y a pas d’attente aux urgences. À l’inverse, il y a des hôpitaux où l’on peut attendre quatre heures. Si les établissements les moins bien organisés s’alignaient sur les établissements les mieux organisés, on dégagerait des marges de manœuvre considérables. Et quand on travaille avec les médecins et les soignants, on crée du consensus.
Il est très rare, pour donner un exemple, que les temps médicaux soient parfaitement concordants avec les temps des professionnels soignants. Les soignants sont à sept heures et demie dans la salle d’opération tandis que le chirurgien arrive parfois avec un petit temps de retard. S’il n’a pas fini d’opérer alors que la soignante a fini sa journée, elle doit être payée en heures supplémentaires. La non-concordance des temps entre les soignants et les docteurs induit des surcoûts pour l’organisation hospitalière. Si tout le monde arrivait en même temps, ce serait préférable pour les finances de l’établissement et cela contribuerait à diminuer le stress des professionnels.
Les établissements sont en grave crise financière parce que, parfois, ils ne facturent pas du tout. Sans modifier la nature du codage – j’insiste sur ce point, car ce n’est pas notre rôle –, mais en facilitant la facturation au fil de l’eau et en la rendant plus rapide, on améliore la trésorerie des établissements, et donc, leur équilibre financier. Il est anormal d’envoyer des factures quatre ou cinq mois après, et cela a pour conséquence d’énormes impayés pour les hôpitaux.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Vous intervenez donc très peu en matière de financement et de gestion financière ?
M. Christian Anastasy. En effet. Nous ne sommes pas un organisme d’ingénierie financière.
Jusqu’à la création de la T2A (tarification à l’activité) en 2004, les équipes hospitalières n’avaient pas une vision très prégnante de l’impact de l’investissement immobilier sur l’exploitation. Lorsque les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), à l’époque, ou les organismes de tutelle arrêtaient les budgets, les dépenses de maintenance servaient souvent de variables d’ajustement. Ce qui fait que, de fil en aiguille, la situation s’est dégradée.
À partir des grands plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 et en lien avec la réforme de la tarification, des comportements et des besoins nouveaux sont apparus puisqu’on a fait le lien entre l’impact de la tarification et le financement des investissements.
M. Christian Béréhouc. Au début des années 2000, cela faisait déjà une vingtaine d’années que l’investissement était très faible puisqu’il s’élevait à moins de 3 milliards d’euros par an dans les établissements publics de santé, dont une grosse moitié consacrée aux investissements immobiliers, le reste étant affecté aux investissements biomédicaux et aux systèmes d’information.
Peu de grands établissements ont été ouverts entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Le plan Hôpital 2007 a conduit à des projets de reconstruction à neuf. Alors que les besoins étaient relativement limités, certains établissements se sont retrouvés face à des projets de reconstruction complète dont le coût représentait une fois et demie, voire deux fois le montant du budget annuel de l’établissement, d’où les niveaux d’emprunt.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. À votre connaissance, existe-t-il une structure extérieure pour aider les hôpitaux en matière financière ?
M. Christian Anastasy. Non.
À la question « Organisez-vous des accompagnements individuels pour préparer à certaines prises de fonction ? », la réponse est non. C’est le Centre national de gestion (CNG) qui est responsable en la matière.
J’en arrive à une de vos questions, qui entre dans notre cœur de métier : « Votre agence peut-elle aider des professionnels à mettre en place des groupes ressources pour permettre des échanges d’expérience entre “pairs” ? Ce genre d’initiative vous paraît-il souhaitable et possible pour inciter les directeurs financiers à partager leur expérience dans la gestion des emprunts à risques ? »
Je ne répondrai pas spécifiquement à la question s’agissant des directeurs financiers, mais d’une façon générale, nous aidons les professionnels à mettre en place des groupes ressources, que l’on appelle des cercles de professionnels. C’est un cercle de professionnels qui a mis au point le projet de gestion des lits, qui est aujourd’hui, à la demande de la ministre, déployé à grande échelle. Une soixantaine de directeurs d’établissements, de médecins et de soignants ont travaillé ensemble, d’abord au sein de l’ANAP, puis ont pris progressivement leur autonomie et ont constitué un cercle indépendant qui rend compte à l’ANAP et travaille en lien avec celle-ci.
L’apprentissage par les pairs est déterminant pour conduire des politiques de transformation. On peut faire le parallèle avec le compagnonnage chez les artisans, car il s’agit de valeurs qui transcendent tous les métiers. Nous disposons ainsi, au sein de l’Agence, du concours d’une dizaine de collaborateurs médecins.
De même, en matière d’organisation des pharmacies, nous avons créé un outil intitulé « Inter diag Médicaments ». Cet outil a été approprié par un certain nombre de pharmaciens, de médecins, de directeurs, qui n’avaient pas l’habitude de parler ensemble. Ces cercles de pairs, au sein d’une organisation un peu informelle, ont fait avancer les réflexions en matière d’achat et de ressources humaines.
Je citais tout à l’heure les efforts à faire en matière de concordance des temps de travail des uns et des autres. Nous procédons toujours de la même façon : nous allons voir les acteurs sur place, nous travaillons avec eux dans les établissements et quand quelque chose fonctionne dans un établissement, on en parle dans deux ou trois autres établissements de façon à élargir la réflexion et à nourrir une expérience plus solide. Lorsque le modèle a été généralisé dans trois ou quatre établissements, il peut être progressivement étendu.
Si nous allons vous voir, Madame la présidente, ce ne sera pas pour vous expliquer ex cathedra comment gérer votre hôpital. C’est à vous de nous expliquer les problèmes auxquels vous êtes confrontée. De notre côté, nous essaierons de trouver des solutions avec d’autres présidents de conseils de surveillance.
Nous avons notamment travaillé, avec l’ARS de Bourgogne, à des coopérations territoriales entre différents établissements. Les présidents des conseils de surveillance ont participé à nos réflexions et, l’intérêt des populations et des personnes étant primordial, un consensus s’est progressivement installé.
Nous avons de même bâti, avec l’ARS de Bretagne, un projet permettant d’établir un diagnostic confirmé du cancer du sein en moins de 24 heures. Aujourd’hui, les examens de radiologie, et notamment l’imagerie lourde, ne sont pas rapidement accessibles. Certaines femmes peuvent attendre jusqu’à cinquante ou soixante jours pour avoir confirmation du diagnostic, ce qui n’est pas acceptable. Lorsque nous avons suscité ce projet collectif, les clivages politiques, politiciens, statutaires ou syndicaux sont tombés, car tout le monde a été mû par l’idée de progresser utilement. Le travail collaboratif entre pairs est déterminant. Nous sommes en quelque sorte les maïeuticiens du changement, nous essayons « d’accoucher les bonnes idées » et de promouvoir des modes de comportement collectif qui permettent d’autant mieux de diffuser les bonnes pratiques qu’elles sont appropriées par les acteurs de terrain.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Est-ce l’ARS qui vous saisit pour un projet du type de celui que vous avez mené en Bourgogne ou en Bretagne ? Comment la décision se prend-elle ?
M. Christian Anastasy. L’ANAP est un groupement d’intérêt public, dirigé par un conseil d’administration qui inclut l’État, l’assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et les fédérations hospitalières. Chacune des parties prenantes émet des souhaits concernant les travaux à confier à l’Agence. Nous synthétisons ces demandes et nous les hiérarchisons à l’aune de plusieurs critères. Nous nous demandons d’abord si nous sommes capables, ou non, de répondre à ces demandes. Par exemple, si on me pose des questions relatives à la qualité des soins, je renvoie à la Haute autorité de santé. Ensuite, nous nous demandons si ce que nous allons faire ensemble est susceptible d’intéresser un grand nombre d’établissements ou si cela répond à une problématique si ténue qu’en fin de compte, elle n’intéressera presque personne. Si nous pouvons répondre affirmativement à ces deux questions, nous revenons devant notre conseil d’administration. La gestion des lits nous semblait ainsi constituer un sujet majeur. À la demande de la ministre, nous accompagnons 160 établissements parce que ce mode de transformation va générer un bénéfice pour les patients, mais aussi pour les professionnels, ainsi qu’un surcroît d’efficience.
Nous ne faisons que ce pour quoi nous sommes compétents et qui peut avoir un impact en termes d’amélioration pour les patients. Parvenir à un délai d’attente réduit à zéro dans les couloirs des urgences pour les personnes âgées est un objectif pertinent. Une infirmière confrontée à une salle où attendent, depuis trois heures, quatre-vingts personnes, sera inévitablement stressée. Il y a beaucoup de stress dans ce milieu et la durée de vie professionnelle n’y est pas très longue. Quand on améliore la fluidité des arrivées aux urgences, on facilite aussi la vie des professionnels.
Une meilleure utilisation des moyens induit une plus grande efficience du système et l’on évite ainsi de gâcher des ressources au détriment des cotisations des salariés. N’oublions pas ce sont nos cotisations sociales qui financent cette réussite qu’est, depuis soixante-dix ans, la sécurité sociale. Je ne suis pas là pour dégager du profit ou faire du New public management à la façon de Milton Friedman. Je suis là pour éviter des dépenses publiques inutiles. Lorsqu’on est mieux organisé, on dépense mieux.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Votre intervention nous permet de mieux comprendre le rôle de votre agence. J’observe toutefois que la dette des établissements publics est considérable et je m’inquiète de savoir comment nous pourrions sortir de cette situation, comment l’hôpital public pourrait en sortir renforcé et comment il pourrait continuer à investir. Le rôle de l’Agence est primordial en la matière. Nombre d’établissements, par exemple, ne sont pas aux normes en matière de sécurité. Comment vont-ils faire pour investir ? Par ailleurs, la T2A est sans doute adaptée à l’activité et aux soins, mais elle n’est pas conçue pour dégager des bénéfices pour les investissements.
M. Christian Anastasy. Nous avons vécu, dans tous les domaines, d’extraordinaires progrès médicaux. En 1970, la durée moyenne de séjour à l’hôpital était de vingt et un jours. En 1990, elle était aux alentours de dix jours. Elle est aujourd’hui d’environ quatre jours pour ce qui est de l’hospitalisation complète, mais de moins de douze heures pour 50 % des actes de chirurgie. Cela est dû aux formidables progrès qu’il y a eus sur le plan de la chirurgie, de l’imagerie, de l’anesthésie et de la prise en charge de la douleur, progrès qui ont permis aux patients de faire des séjours de plus en plus courts. Tous ces progrès ont été très rapides. Ce temps très rapide du progrès médical a été confronté au temps très long des investissements hospitaliers, car entre le moment où l’on prend une décision et le moment où les murs sortent de terre, dix ans se sont écoulés, et ensuite, les murs sont amortis sur trente à cinquante ans.
Les plans ont rattrapé un peu le retard de maintenance, mais ils n’ont concerné qu’un nombre faible d’établissements puisque 15 % seulement ont été rénovés. Vous avez raison de dire, madame la présidente, que cette problématique se pose dans beaucoup d’établissements.
Je vais laisser la parole à Christian Béréhouc, qui est un grand témoin de cette évolution.
M. Christian Béréhouc. Ayant connu le plan Hôpital 2007 et le plan Hôpital 2012, je vous propose d’en retracer les grandes étapes et les enseignements que nous avons pu en tirer.
Pendant deux décennies, il y a eu peu d’investissements. Dans les années 2000 l’endettement des établissements s’élevait à 7 milliards d’euros, contre 30 milliards aujourd’hui. L’objectif du plan Hôpital 2007 était de moderniser et de sécuriser – je pense à la sécurité incendie – et surtout d’aller très vite. Tels étaient les termes employés à l’époque.
Au départ, le plan prévoyait le financement de 10 milliards d’euros de projets d’investissements, dont 60 % d’aides. Puis, il est passé progressivement à 13 milliards d’euros, pour atteindre quasiment 17 milliards, le niveau des aides n’ayant pas bougé. Des facteurs exogènes, comme les indices de révision qui avaient dépassé 6 % par an, le secteur du bâtiment ayant enregistré à cette époque une forte activité, ont eu un effet sensible.
Le fait que le montant des aides n’avait pas évolué et qu’une partie de l’aide en capital a été transformée en aide à l’emprunt, a constitué l’un des premiers moteurs de dérapage de la dette, qui a résulté d’un cumul de plusieurs facteurs.
Le plan Hôpital 2012 en conséquence a davantage mis l’accent sur la notion de retour sur investissement. La primauté n’était plus à la vitesse de réalisation de l’investissement, mais à la démonstration qu’il était justement calibré. Sur ce plan, les hypothèses initiales se sont retrouvées le plus souvent corroborées par les faits. Il n’y a pas eu le décalage entre la volonté initiale et le résultat obtenu, que l’on avait pu constater pour le plan Hôpital 2007. Néanmoins, l’opération s’est arrêtée à la première tranche, dont le montant s’élevait tout de même à 5 milliards d’euros. Elle comportait un volet sur les systèmes d’information, ce qui était nouveau par rapport aux plans précédents qui concernaient uniquement l’immobilier. C’était un volet quasi obligatoire, sachant que la transformation d’un établissement passe aussi par la transformation des organisations, qui ne peut se faire sans l’adaptation des systèmes d’information.
Suite au retour d’expérience du plan Hôpital 2012, un mécanisme nouveau, le COPERMO, a été mis en place, afin de structurer démarche et dialogue entre les établissements et leur ARS.
Le premier élément de cette démarche commune consiste à bien appréhender qu’un investissement se conçoit sur le long terme. Or aujourd’hui, les plans régionaux de santé (PRS) sont à court terme. Il est nécessaire de dépasser le court terme pour que l’investissement ait le plus de chances possibles de satisfaire aux besoins de la population. Il faut prendre en compte un ensemble d’éléments tels que le territoire de santé, l’établissement porteur du projet, l’évolution du projet à cinq ou dix ans, ainsi que celle de l’offre de soins globale du territoire et l’évolution des parts de marché, sachant que certaines idées reçues selon lesquelles, avec un hôpital neuf, on récupère tous les patients qui ont déserté l’hôpital lorsqu’il était vétuste, sont souvent erronées. Il est très difficile, en effet, même si l’on a construit un bel hôpital tout neuf, de faire revenir des gens qui ont pris des habitudes ailleurs.
Il faut essayer de rationaliser l’approche en termes d’activité, et surtout tenir compte de la réalité de l’offre de soins publique et privée sur un territoire pris globalement, et pas uniquement centrée sur un établissement donné. De même, ce n’est pas parce que l’on a fait 3 % de plus d’activité pendant une année que l’on aura nécessairement 3 % de plus par an sur les dix ans à venir. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité d’une appréhension raisonnable des données de volumes d’activité. À cet égard, nous avons mis à la disposition des établissements et des ARS l’un de nos outils phares, intitulé « Hospi Diag », qui permet d’analyser les parts de marché et, parfois, de tempérer certains enthousiasmes, s’agissant de zones où l’activité stagne manifestement, voire régresse.
C’est là l’un des points majeurs de la démarche initiée par le COPERMO.
Hôpital 2007 mettait l’accent sur la rapidité, ce qui a souvent signifié « constructions neuves », car la restructuration prend du temps. Mais les temps ont changé. Aujourd’hui, quand on projette un investissement, il y a toujours plusieurs scénarios, et nous insistons sur la nécessité de démontrer en quoi la solution proposée est optimale pour l’établissement et la collectivité.
Il est important de préciser que nous apportons appui, outils et méthodologie et que nous n’intervenons en rien dans les choix eux-mêmes. Ceux-ci relèvent des ARS, et la décision d’aider, ou non, l’investissement, et à quelle hauteur, appartient au COPERMO.
Toujours dans une logique d’optimisation, nous avons travaillé sur la première génération des schémas régionaux d’investissement en santé (SRIS). On peut imaginer qu’il y en aura plusieurs versions, comme pour les autres schémas régionaux. Il s’agit à ce stade d’une sorte de prototype, avec des objectifs assez simples, auxquels les gens peuvent adhérer.
D’abord, il faut fournir des éléments de projection aux établissements et aux ARS. On s’est aperçu que les établissements avaient tendance, peut-être parfois sous la pression des personnels, à toujours envisager des projets visant à simplement améliorer l’existant, en reprenant pour une bonne part les modes de prise en charge du jour, voire de la veille, ce qui, de temps en temps, peut poser problème. Aussi, nous avons, dans le cadre des SRIS, proposé des éléments de projection concernant les prises en charge, les évolutions techniques, voire technologiques, pour aider les établissements et les ARS à les anticiper pour le projet dès son ouverture plutôt que de constater a posteriori que celui-ci est conforme à ce que l’on faisait en 2005 ou en 2010.
Ensuite, il s’agit d’une approche territoriale, et non d’une approche centrée sur les établissements pris individuellement. La prise en charge sera de plus en plus un sujet territorial, qui ne se cantonnera pas à l’établissement en tant que tel, mais concernera un établissement – qu’il soit public ou privé – sur son territoire, ainsi que le domaine médico-social. S’agissant des éléments qui vont servir à bâtir les schémas, la connaissance du secteur médico-social reste un enjeu assez fort, notamment sur le plan immobilier.
Nous sommes en train de tester le dispositif du SRIS avec deux régions pilotes, sachant que le dispositif doit s’étendre à l’ensemble des régions dès la fin de cette année.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Quelles sont ces régions pilotes ?
M. Christian Béréhouc. Il s’agit de l’Auvergne et du Languedoc-Roussillon.
J’en viens à votre question sur la T2A et les investissements. En général, dans une organisation, c’est l’exploitation qui finance l’investissement. De nombreux travaux, d’ailleurs, montrent l’impact direct de l’une sur l’autre. Le logiciel ÆLIPCE, qui est un outil de simulation permettant de simuler les conséquences de différentes hypothèses en termes d’activité, d’équipes soignantes, de dimensionnement et de coûts, nous a permis de démontrer le lien fort qui existe entre l’exploitation et le financement de l’investissement. Une rupture complète entre les deux poserait problème.
À l’inverse, on comprend bien que reconstruire complètement un hôpital avec, pour seule source de financement, l’exploitation financée par la T2A n’est pas adaptée non plus. Cela étant, « couper complètement le cordon » représenterait un certain risque et, à ce titre, on peut penser que la méthode COPERMO, avec un petit volant d’aides réservées à des opérations d’exception et de grandes ampleurs, peut être un bon compromis pour financer tout ce qui relève de la « vie courante » d’un établissement. Je pense qu’il faut associer étroitement la notion de responsabilisation à l’exploitation et à l’investissement, sans pousser la logique jusqu’au systématisme, autrement dit, sans devoir tout financer avec les tarifs.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Le président de la Fédération hospitalière privée, que nous avons auditionné récemment, nous a expliqué qu’on était en train de séparer l’exploitation immobilière du soin, les établissements étant gérés par des sociétés immobilières. Pensez-vous que ce soit possible au niveau de l’hôpital public ? Serait-ce une bonne chose ?
M. Christian Anastasy. J’ai dirigé des établissements privés au sein desquels on distinguait l’immobilier de l’exploitation. Sur le principe, cette dichotomie est vertueuse. D’un côté, une personne morale s’occupe des murs. En contrepartie, elle perçoit un loyer et si elle veut continuer à le percevoir, il faut qu’elle présente à l’exploitant des murs en bon état. Cette pratique peut donc induire un aspect vertueux, l’exploitant se concentrant en effet sur son métier, qui consiste à accueillir les gens pour les soigner.
Je l’ai dit tout à l’heure, dans un système où l’on mélange exploitation et investissement, on peut être tenté d’équilibrer l’exploitation au détriment de l’investissement, en utilisant, notamment, la variable d’ajustement que constituent les crédits de maintenance. On n’entretient pas les murs pendant des années et on aboutit aux plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012. Il y a une réflexion à mener, sachant que mon propos est nuancé et ne vise pas à « faire la révolution », mais à faire comprendre qu’il y a, d’une part, un cycle d’exploitation, d’autre part, un cycle de maintien de l’investissement, et que les deux domaines doivent être relativement étanches et mis en perspective.
En ce qui concerne le secteur public, apparaît régulièrement l’idée d’une grande « foncière » qui gérerait l’ensemble du patrimoine des établissements. Nous y réfléchissons, mais nous n’y sommes pas favorables. Qu’une telle société foncière soit seule responsable des murs des établissements hospitaliers pourrait induire, me semble-t-il, le risque que les exploitants des établissements se désintéressent totalement de la partie immobilière. Il faut trouver le juste compromis entre le maintien de relations étroites et équilibrées entre l’exploitant de production de services de santé et le gestionnaire des murs. En même temps, il faut veiller à conserver une forme d’étanchéité, afin que le gestionnaire d’exploitation ne soit pas tenté de se « servir » sur les murs, ou inversement. On pourrait aussi imaginer que le gestionnaire des murs soit tenté de facturer des loyers trop importants par rapport à l’exploitant.
M. Christian Béréhouc. En complément, à propos du COPERMO, nous avons fait des propositions visant à sanctuariser, tout ce qui est du domaine des investissements courants, de la maintenance, du gros entretien, en fixant un minimum de 3 % du budget, au-dessous duquel on considère que l’établissement prend un risque de dégradation à terme de son patrimoine. Nous restons dans la logique d’un seuil évitant à l’établissement d’arriver, après dix ans d’incurie, à une dégradation telle qu’il faille nécessairement tout reconstruire.
Je précise que les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, ont un immobilier très évolutif. On n’y fait pas la même chose pendant quinze ans. Il doit donc y avoir une réelle proximité entre l’exploitation et l’investisseur. Il faut en avoir conscience, c’est une des particularités du secteur de la santé, qui est beaucoup plus mobile que d’autres secteurs où les constructions sont plus monolithiques tout au long de leur vie.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. La particularité des hôpitaux publics est que les bâtiments peuvent être très anciens, certains datant du XIIe ou du XIIIe siècle. Cela étant, nombre de constructions des années soixante-dix semblent être en mauvais état.
La semaine dernière, nous sommes allés à Marseille. Si l’hôpital de la Timone dispose de services extraordinaires, qu’il s’agisse des urgences ou de l’imagerie médicale, il n’en demeure pas moins que cet immense bâtiment de onze étages, où la sécurité incendie n’est pas assurée, aurait besoin d’être rénové, voire reconstruit.
Tout à l’heure, vous parliez de l’offre de soins sur le territoire. Voilà précisément un territoire où la pression du privé est importante. Or l’offre privée est beaucoup plus importante que l’offre publique. Quel est le risque pour ce type d’hôpital ? On nous a expliqué qu’une maternité avoisinante avait fermé du jour au lendemain et que l’hôpital public avait récupéré les patientes. Comment doit-on aider un hôpital de 1 000 lits qui a besoin d’investir au niveau des bâtiments pour continuer à proposer une offre de soins soutenant la comparaison avec le privé ? Quelle fiabilité peut-on accorder à l’hospitalisation privée qui, du jour au lendemain, peut décider de fermer un service ? Comment arriver à gérer cette situation et permettre à l’Assistance publique de Marseille d’investir ?
M. Christian Anastasy. Nous l’avons dit, deux temps se confrontent : le temps du progrès médical, qui est très rapide, ce qui fait que les gens restent quelques heures à l’hôpital pour une intervention dans 50 % des cas, et le temps de la construction, avec des cycles d’amortissement très longs. Certains établissements sont, encore aujourd’hui, amortis sur une durée de cinquante ans.
Comment adapter ces deux temps l’un à l’autre ? On dépense plus pour les pathologies chroniques qui ne sont pas prises en charge à l’hôpital. Il y a aujourd’hui, dans notre pays, 15 millions de personnes porteuses de pathologies chroniques qui sont prises en charge, pour l’essentiel, en dehors de l’hôpital. Nous dépensons 80 milliards d’euros pour cette prise en charge et 76 milliards pour les établissements de santé en général. Où sont les enjeux ? Faut-il construire davantage d’hôpitaux ? Dans les années quatre-vingt-dix, il y avait 40 millions de mètres carrés construits et les durées de séjour étaient de dix jours, contre, aujourd’hui, 60 millions de mètres carrés construits et des durées de quatre jours. Faut-il en tirer la conclusion que nous avons trop construit ? La réponse vous appartient.
Le comportement d’un gestionnaire public et celui d’un gestionnaire privé ne sont pas tout à fait les mêmes, le premier n’ayant pas les mêmes contraintes d’exploitation immédiate. Si l’établissement privé entretient des murs inutiles qui lui coûtent très cher, il ferme. D’ailleurs, nombre d’entre eux ont fermé. Aujourd’hui, les gestionnaires privés sont très attentifs à la façon dont ils gèrent leurs mètres carrés inutiles. Je ne veux pas dire que le secteur public ne l’est pas, mais les temps ne sont pas les mêmes, les cycles d’autorisation et les contraintes non plus, et la réactivité induite est sans doute différente.
Ainsi qu’il a été dit, il y a beaucoup de mètres carrés construits, qui coûtent très cher à entretenir ; le temps de construction et celui du cycle d’exploitation des murs sont très longs et ne tiennent pas forcément compte de celui des progrès médicaux. Or, les progrès ont été tels que les gens peuvent se faire soigner aujourd’hui en moins de douze heures. La ministre promeut, à juste titre, le virage de l’ambulatoire, parce que c’est un facteur de progrès pour les établissements. Si de moins en moins de personnes entrent à l’hôpital, il y a nécessairement de moins en moins besoin de murs. Par conséquent, avant de se demander s’il faut rénover la totalité du parc immobilier, soit les 60 millions de mètres carrés construits, il faut se demander s’il ne vaudrait pas mieux réformer une partie de ce patrimoine afin de répondre avant tout aux besoins sanitaires de la population.
Les personnes restent moins de douze heures dans un établissement et repartent sur leurs jambes, ce qui est mieux pour elles parce qu’elles ne contractent pas d’infections nosocomiales et qu’elles récupèrent plus vite après un acte chirurgical. Les hôpitaux publics ont gagné des parts de marché, car ils ont fait des efforts considérables en matière de chirurgie ambulatoire. Il est probable que, demain, 65 % des actes seront faits en ambulatoire, tant dans le public que dans le privé. Les gens entreront de moins en moins longtemps à l’hôpital. En revanche, ils seront pris en charge de plus en plus longtemps à leur domicile. Les 15 millions de personnes porteuses de maladies chroniques auront nécessairement besoin d’un accompagnement personnalisé.
Alors, faut-il maintenir en permanence un patrimoine immobilier qui sera de moins en moins fréquenté ou faut-il aider les gens à rester chez eux, avec des conditions de vie qui les satisferont davantage ? La problématique est tellement complexe que je n’aurai pas l’outrecuidance d’y apporter une réponse définitive. Cela étant, lorsqu’on met en perspective ces éléments de raisonnement, on se dit que notre pays doit peut-être cesser d’investir toujours plus dans des surfaces nouvelles, pour investir davantage dans la prise en charge des pathologies chroniques. C’est un discours de raison, mais peut-être politiquement incorrect, car on sait que nous sommes tous, dans notre culture, attachés aux murs. Nous n’avons pas envie de voir disparaître les hôtels-Dieu, qui sont dans notre paysage depuis le Moyen Âge. Mais il faut comprendre que les contraintes du cycle de l’investissement et de la nécessité d’entretenir les équipements sont parfois difficilement compatibles avec la tendance consistant à assurer des prises en charge dans des délais très resserrés.
L’ANAP n’a pas à elle seule la prétention de répondre à ces questions. Nous mettons simplement en perspective deux phénomènes : un cycle de l’investissement immobilier très long et un cycle du progrès médical très rapide. Les gens iront de moins en moins à l’hôpital pour des séjours longs. Tout se passera comme si nous revenions au début du siècle précédent, époque à laquelle la fréquentation de l’hôpital était très rare, puisqu’on opérait les gens chez eux. Bien entendu, ce n’est pas ce que je souhaite ! La fréquentation de l’hôpital a peut-être été à son apogée dans les années 1990-2000. Demain, il y aura sans doute de plus en plus de prises en charge télé-réparties, parce que les moyens technologiques permettront l’éducation thérapeutique chez soi. L’enjeu n’est donc pas forcément de construire des murs. Aujourd’hui, 40 % des prescriptions médicamenteuses ne sont pas suivies par les patients, ce qui nécessite de l’éducation thérapeutique à distance. À ce jour, le développement de la télémédecine en est encore à ses débuts. Peut-être faut-il cesser d’investir dans les murs pour investir dans les technologies de l’information parce que c’est ce qui permettra de maintenir les gens chez eux, où ils se sentiront mieux qu’à l’hôpital ou dans une maison de retraite. Il faut donc plutôt miser sur cet investissement immatériel.
C’est en tant que citoyen que je vous livre, en toute franchise, cette réflexion. Je pense que l’évolution doit aller dans ce sens plutôt que de vouloir maintenir à tout prix des murs parfois sous-exploités.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Le coprésident de la mission, M. Pierre Morange, pose régulièrement cette question : le patrimoine hospitalier est-il répertorié ? Existe-t-il des documents répertoriant ces 60 millions de mètres carrés ? Et, pour faire suite à ce que vous venez dire, que pourrait-on en faire ?
M. Christian Béréhouc. Nous avons conçu, il y a deux ou trois ans, un outil dédié à la gestion du patrimoine, qui a été repris par la DGOS. Cet outil, dénommé OPHELIE, a pour but de faciliter la gestion du patrimoine hospitalier, avec un certain nombre de données consolidées au niveau national.
Aujourd’hui, certains établissements ont une connaissance exacte de leur patrimoine, mais beaucoup n’en ont qu’une connaissance empirique. Pour bâtir une politique immobilière, il nous a semblé important d’avoir un outil consacré à sa gestion. C’est un projet à long terme dont nous avons lancé les prémices et que la DGOS est en train de déployer. Nous pourrons ainsi vérifier s’il y a bien 60 millions de mètres carrés, car ce chiffre n’est qu’une hypothèse, même si l’ordre de grandeur est sans doute correct. Nous pourrons surtout envisager, dans le cadre des SRIS, d’avoir une politique globale par établissement visant à l’optimisation du patrimoine.
En ce qui concerne le traitement du passé, le budget global n’incitait pas à désaffecter les surfaces abandonnées par les établissements qui ont été historiquement constructeurs. Il y a donc aujourd’hui des écarts énormes entre des établissements qui ont quarante ou cinquante ans d’histoire, dont les bâtiments sont tous occupés, et d’autres qui sont beaucoup plus compacts. Avec la T2A, l’optimisation va devenir une obligation pour tous les établissements. Dans le cadre de la démarche interne d’un établissement, il sera utile, une fois que son patrimoine sera connu, de mettre en œuvre des réflexions de type « schéma directeur d’établissement » dans le cadre des SRIS, pour optimiser ce patrimoine.
M. Christian Anastasy. Répondre à votre question, madame la coprésidente, est très compliqué, car tout dépend de l’endroit où se situent les murs. Dans le cas d’un hôpital construit sous Louis XIV, à Valognes, dans la Manche, peu d’entreprises pourront y installer leur siège social et le conseil général n’en fera pas un hôtel du département.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret. Cependant, dans le Lot-et-Garonne, l’hôtel du département s’est installé dans les murs de l’ancien hôpital Saint-Jacques.
M. Christian Anastasy. Il y a, certes, des exemples, mais il n’en demeure pas moins qu’il est plus facile de reconvertir du patrimoine immobilier à Paris, et j’ai peu d’inquiétudes sur l’avenir du site de Saint-Vincent-de-Paul. Quant aux Hospices civils de Lyon, ils ont transformé une partie de leur patrimoine historique en grand hôtel. Il y a, à l’évidence, des inégalités géographiques. Pour cette raison, la question que vous posez ne permet pas de donner une réponse immédiate.
En revanche, il est probable qu’il faut se poser la question de savoir si l’on maintient indéfiniment du patrimoine inutilisable ou inutilisé à des fins sanitaires. Travailler dans des hospices qui datent du Moyen Âge n’est pas toujours facile. L’ANAP a accompagné un certain nombre d’opérations de valorisation patrimoniale pour engager une dynamique de changement. Nous conduisons aujourd’hui une vingtaine d’opérations en France pour assouplir l’appréhension de l’utilisation du patrimoine. Il faut se résoudre à vendre les murs inutiles, puisque les besoins de la population ne seront plus forcément à satisfaire dans le cadre de murs immuables, mais progressivement de plus en plus à domicile.
Enfin, aura lieu à Paris, cette année, la Conférence sur le climat. L’ANAP a créé un événement centré sur le développement durable, pour une raison simple : le patrimoine immobilier hospitalier consomme énormément d’énergie fossile et il sera soumis, demain, au paiement d’une taxe carbone très élevée. Certains pays s’interrogent et protègent leurs établissements dans cette perspective. En France, nous n’avons pas encore une conscience très aiguë de ces problématiques, mais la dimension écologique et citoyenne doit être intégrée.
Je ne parle pas du secteur médico-social dont le patrimoine est, dans l’ensemble, encore plus ancien. Le développement de la prise en charge à domicile, la télémaintenance, le télé-service, la télé-radiologie, la télé-imagerie, la télé-éducation sont vraisemblablement des voies d’avenir. Dans le cadre d’une culture immobilière qui n’est pas seulement hospitalière, car nous vivons dans un pays où l’on aime le patrimoine et où l’on restaure les vieilles maisons avec amour, il est difficile d’avoir une vision « libérée » du poids des murs. Il faudrait arriver à se dire que l’on va moins investir dans les murs pour se désendetter et investir davantage dans les nouvelles technologies.
Cela pourrait être motivant pour les acteurs. Il est difficile de parler de dette, car on a toujours l’air de culpabiliser des gens qui ont été pris dans un mouvement très rapide puisque le plan Hôpital 2007 préconisait de construire très vite, ce qui a, très vite aussi, généré une dette. Aujourd’hui, le discours est stigmatisant : « Vous avez trop de dettes et ce n’est pas bien ! » Si l’on pouvait sortir de ce discours négatif pour envoyer un message positif, comme « Investissons davantage sur les nouvelles technologies parce que c’est l’avenir », nous pourrions faire évoluer positivement l’état d’esprit en la matière dans notre pays.
*
* *
Audition de M. David Causse, coordonnateur du pôle santé-social de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP)
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Causse, je vous souhaite la bienvenue à l’Assemblée nationale. La situation financière des hôpitaux a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes, dont le constat, largement partagé, fait état d’un triplement de la dette en dix ans et d’une proportion non négligeable d’emprunts toxiques, à hauteur de quelque 1,5 milliard d’euros, montant qui a sensiblement augmenté à la suite du déplafonnement de la parité du franc suisse ; ce qui nous amène naturellement à solliciter l’analyse de la FEHAP. Nous avons entendu les établissements bancaires ; je les ai interpellés assez vigoureusement au sujet de la responsabilité partagée entre celui qui accorde un prêt et celui qui le contracte – en l’occurrence, celle du système bancaire français est d’autant plus particulière qu’il s’agit de la santé du peuple français, donc de sa capacité à produire des richesses et de sa puissance de travail, qui lui ont permis de résister à la crise mondiale de 2008 et même de s’autoriser à absorber une part substantielle de la dette toxique de la Grèce… On aurait pu imaginer, ne serait-ce qu’au titre du parallélisme des formes, que ce système bancaire adoptât une démarche similaire à l’égard du peuple français qui était légitimement en droit de s’y attendre, au lieu de se voir considérer comme une simple poule aux œufs d’or.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Quelle est la situation financière générale des établissements privés à but non lucratif ? Quels sont les principaux mécanismes d’investissement et quelles en sont les règles ? Quels rapports entretenez-vous avec les agences régionales de santé (ARS) ?
M. David Causse, coordinateur du pôle santé-social de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif. Je vous remercie d’associer la FEHAP à vos travaux. Il existe trois grandes fédérations hospitalières : la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), la Fédération hospitalière de France (FHF) pour les hôpitaux publics et la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP). Cette dernière est la maison commune des associations, des fondations, des unions mutualistes mais aussi d’institutions de prévoyance et de retraite complémentaire telles Humanis ou PRO BTP, qui relèvent du livre IV du code de la mutualité. Toutes peuvent gérer des établissements relevant tant du champ sanitaire que du champ social et médico-social, parfois de manière mixte. Nous comptons 1 600 personnes morales adhérentes qui regroupent environ 4 000 établissements et services de tailles très diverses. La FEHAP peut ainsi rassembler des établissements de santé en tête de palmarès par la réputation de leurs équipes médicales, tels l’Institut Montsouris ou le centre chirurgical Marie Lannelongue, par exemple, mais également une association précieuse qui gère une petite équipe mobile de soins palliatifs et d’hospitalisation à domicile ainsi que des petites structures, plus modestes par leurs budgets et le nombre de leurs salariés, mais qui rendent des services importants de suite et de réadaptation, notamment dans le domaine gériatrique.
Il est évident que, du fait même de leur variété, toutes ces structures ne sont pas professionnellement armées de la même manière pour conduire les négociations, voire les renégociations, avec le système bancaire qui est toujours plus complexe. Si la plupart des grands établissements ont des directeurs financiers techniquement très affûtés et dont l’expérience professionnelle, acquise dans des cabinets de conseil d’expertise comptable notamment, a permis de se préserver de certains produits bancaires, d’autres adhérents étaient moins armés pour résister aux séductions auxquelles ils ont été exposés ces dix dernières années, mais également pour renégocier, alors même que ces produits bancaires toxiques, vous l’avez souligné, se caractérisent par une grande évolutivité : c’est leur dégradation récente, liée notamment à l’évolution de la parité du franc suisse, qui a conduit les pouvoirs publics à engager des programmes de soutien de plus grande ampleur qu’ils ne l’avaient envisagé. Mais le problème se pose également en termes de capacité de dialogue entre les emprunteurs et le système bancaire.
Les neuf dixièmes de nos établissements, à but non lucratif, exercent des missions de service public ; leurs relations avec les ARS (agences régionales de santé) sont donc à peu près de mêmes natures que celles des établissements du secteur public. Ils sont tenus de remettre leur plan global de financement pluriannuel (PGFP), qui donne l’évolution des grands équilibres de l’investissement ou leurs états des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), qui sont relatifs aux comptes d’exploitation et à leurs résultats. Les autres, pour des raisons historiques, ont conservé des relations de droit privé avec les autorités de contrôle, à l’instar des cliniques de droit commercial ; leur gestion relève alors d’une responsabilité institutionnelle et économique pleine et entière, sans rapport tutélaire avec les ARS.
Afin de bien mettre en proportion les chiffres que je vais donner, il faut garder à l’esprit que, dans le domaine sanitaire des soins de court séjour, à côté des deux grands ensembles publics et privés de statut commercial, nos établissements non lucratifs représentent 9 % de l’offre. Autrement dit, notre contribution est importante, parfois emblématique, mais demeure limitée même si elle représente aussi 13 % de l’offre de psychiatrie et 40 % de celle des soins de suite et de réadaptation.
Les établissements privés à but non lucratif ont été beaucoup moins exposés aux produits structurés et à l’endettement toxique que ceux du secteur public, ce qu’a montré la cartographie établie par la banque Dexia. Des renégociations ont certes eu lieu depuis mais, pour la sphère du secteur privé non lucratif, on atteint un montant total consolidé qui n’excède pas 100 millions d’euros. Reste que certains de nos adhérents ont été bel et bien exposés – il faut rappeler que certaines banques, dont Dexia, bénéficiaient d’une image quasi publique, tutélaire, du fait de leur présence auprès des collectivités territoriales.
L’endettement global consolidé des établissements privés à but non lucratif, en consolidé, s’élève à 1,6 milliard d’euros, ce qui représente un taux de dépendance financière très saine de 36 % seulement alors que les ratios prudentiels dans l’ensemble du secteur sont de l’ordre de 50 %. Cela étant, ces 36 % sont une moyenne et je suis prêt à vous fournir des éléments plus détaillés. Les emprunts toxiques ne représentent que 100 millions d’euros, dont une part a été renégociée depuis. Bien des adhérents de la FEHAP qui n’ont pas pris de risque éprouvent un sentiment d’injustice devant les dispositions de soutien aux établissements exposés aux emprunts structurés apportées par les pouvoirs publics aux seuls hôpitaux publics. « Pourquoi eux et pas nous ? » On peut y voir le réflexe classique de jalousie du petit frère vis-à-vis du grand frère qui fait l’objet de plus d’attention de la part des ARS et des pouvoirs publics, mais il n’empêche que cette différence de traitement ne se limite pas à l’aide aux établissements victimes d’emprunts toxiques : cela vaut aussi pour le soutien à l’investissement. Force est de constater que les capacités en fonds propres des fondations et des associations se sont singulièrement affaiblies. Il en va de même pour la dynamique de gestion de l’immobilier, de la cession d’actifs, particulièrement en ce qui concerne la modernisation du patrimoine ; les capacités d’investissement sont devenues très tendues et l’on remarque une progression inquiétante du taux de vétusté. Le taux d’aide publique aux opérations de restructuration en faveur de notre secteur est plus faible que celui du secteur public. Cette inégalité de traitement étonne nos adhérents puisque notre secteur est soumis à toutes les contraintes et obligations de service public – sinon plus, car nos praticiens hospitaliers n’ont pas d’activité libérale : ainsi mon président a-t-il coutume de dire qu’ils sont les vrais héritiers de la mission de service public originelle. Qui plus est, cette dissymétrie dans la distribution des aides publiques ne risque-t-elle pas précisément de favoriser une situation de surendettement ?
M. le coprésident Pierre Morange. En ce qui concerne les règles de financement des établissements, dans le plan Hôpital 2012, on s’attachait finalement à aider à payer les intérêts d’emprunt ; la philosophie depuis a changé, on raisonne désormais en dotations en capital. Ce changement de doctrine vaut-il également pour la FEHAP ?
M. David Causse. Lorsque l’on monte un plan d’investissement, on regarde quel est le niveau de financement gratuit ou bonifié que l’on peut espérer. Nos établissements relèvent de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; à ce titre, ils ont potentiellement vocation à bénéficier des financements favorables de la Banque publique d’investissement, mais celle-ci commence tout juste à concevoir ses schémas d’intervention. La question du taux d’épargne se pose aussi, autrement dit de ce que l’établissement peut supporter en termes de charges d’exploitation mais aussi d’amortissement. Les commissaires aux comptes nous interdisent les durées d’amortissement « baroques » – dans le secteur public, on a observé des durées d’amortissement qui n’avaient plus rien à voir avec les normes prudentielles et la Cour des comptes en a fait état. En ce qui nous concerne, du fait de la certification de nos comptes, nous ne pouvons pas minorer artificiellement nos charges d’exploitation – ce qui, au passage, donne d’autant plus de crédit aux chiffres que je vous ai donnés, ce qui n’est pas le cas des chiffres de tous les établissements publics.
Aucune opération dans la première liste examinée par le Comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO) – pour restituer les échanges que nous avons eu avec la ministre à l’occasion du changement de doctrine – ne concernait le secteur privé à but non lucratif. Le problème se pose surtout en termes d’asymétrie – ou de dissymétrie – culturelle : le ministère regarde les hôpitaux publics comme son propre prolongement et peine à appréhender la globalité de l’offre. Lorsque je veux taquiner mes interlocuteurs, je leur dis que j’apprécierais que la Direction générale des hôpitaux devienne réellement la Direction générale de l’organisation des soins… Certains mécanismes ne sont pas d’ordre technique mais d’ordre culturel : il est naturel pour le ministère comme pour les ARS de s’occuper de la situation des établissements publics de santé, beaucoup moins des opérations du secteur privé à but non lucratif. Certes, celles-ci sont moins importantes et cela n’est pas une mauvaise chose : certaines très grosses opérations du secteur public ont pu amener à un surinvestissement que tout le monde regrette de devoir supporter ensuite pendant des années.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Au fil des auditions, nous nous rendons compte que des établissements publics se trouvent dans une situation financière très compliquée. Est-ce également le cas pour des établissements du secteur privé ?
M. le coprésident Pierre Morange. Au risque de nous éloigner de notre sujet, le secteur social et médico-social est-il, lui aussi, concerné par les emprunts toxiques ?
M. David Causse. Je vous remercie de me tendre cette perche : les activités de la FEHAP sont transversales et il est bon de ne pas oublier le secteur médico-social que vous connaissez bien.
Hélas oui, Madame la présidente, certains de nos établissements, qui heureusement se comptent sur les doigts d’une seule main, connaissent de grandes difficultés financières alors qu’ils sont indispensables à l’offre dans les territoires, mais ces difficultés ne sont pas nécessairement liées aux emprunts structurés. De fait, le premier risque pour le secteur privé réside dans la rupture de trésorerie. Parfois, la hausse de la tarification à l’activité (T2A), mal gérée par l’établissement, ou l’évolution tarifaire annuelle se trouvent à l’origine de ces difficultés, encore aggravées par l’asymétrie que j’évoquais à l’instant dans la distribution des crédits hors tarif des missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation, dont 97 % sont affectés au secteur public. Du coup, la marche budgétaire ou tarifaire à franchir chaque année conduit les intéressés régulièrement sur le fil du rasoir.
Cette année, par exemple, le Parlement a voté un objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) plutôt généreux : pour l’ensemble du secteur sanitaire et médico-social, son taux de progression est de 2,1 % alors que le PIB en 2014 n’a progressé que de 0,4 %. On pourrait considérer que l’arbitrage, tant du Parlement que du Gouvernement, est très favorable pour le secteur. Malheureusement, du fait de combinaisons techniques diverses, le tarif est amené à connaître une évolution de - 1 % pour le court séjour hospitalier en 2015 – peut-être seulement - 0,65 % si on estime qu’il est possible de restituer le coefficient prudentiel qui est précisément mis de côté pour éviter de dépasser l’ONDAM, du reste maîtrisé depuis plusieurs années. À cela s’ajoute l’évolution mécanique des charges diverses, salaires, énergie, etc., sans aucune décision particulière, estimée à au moins 2 %. Autrement dit, l’ensemble nous oblige à réaliser un gain de productivité de 3 % en 2015, et c’est la même chose depuis plusieurs années ! C’est à la lumière de cette très forte pression qu’il faut apprécier la situation financière des établissements, particulièrement, de court séjour. La trésorerie des établissements publics, elle, peut compter sur la vigilance de la trésorerie-paierie générale et de la solidarité de l’ensemble des établissements publics, dans la mesure où une consolidation globale s’effectue tous les jours à Bercy ; et si un établissement se retrouve en quasi-défaut de paiement, comme ce fut le cas du CHU (centre hospitalier universitaire) de Caen l’année dernière, le ministère prend les dispositions pour faire l’avance de trésorerie nécessaire, ce qui permet à l’établissement considéré de « s’en sortir », même si cela fait des années qu’il connaît de très graves difficultés. Pour les établissements privés, fussent-ils non lucratifs, le grand risque, c’est la barre du tribunal après exercice de son droit d’alerte par le commissaire aux comptes… C’est en cela que je parlais d’établissements sur le fil du rasoir. Nous ne demandons rien d’autre aux pouvoirs publics que de nous manifester la moitié au moins de la bienveillance et de l’attention dont ils font montre à l’égard des établissements publics.
En ce qui concerne les établissements médico-sociaux, ce sont en tant que personnes morales qu’ils s’adressent aux banquiers lors de leur recherche de financement, pas en tant que gestionnaires d’un établissement de santé ou médico-social. De fait, certaines de ces personnes morales gestionnaires d’établissements, faute de personnel suffisamment compétent, n’ont pas su négocier comme il convenait et ont contracté des emprunts toxiques.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous communiquer des chiffres plus précis que « quelques établissements » ?
M. David Causse. Le montant consolidé est de 110 millions pour l’ensemble de nos établissements, chaque établissement concerné connaissant un endettement de 3 à 6 millions. Cela représente des proportions très modérées, tout à fait négociables pour des banquiers, pour autant que les pouvoirs publics consentent à nous intégrer dans le périmètre de l’action qu’ils entendent conduire. Les montants en jeu sont parfaitement gérables.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels sont ces montants, quels sont les taux d’intérêt ?
M. David Causse. Pour que je puisse vous répondre, il faudrait étudier de près chaque contrat. En revanche, je pourrais vous adresser un exemple ; votre question est bienvenue car la FEHAP souhaite qu’un regard transversal soit posé sur l’ensemble de ses activités, y compris médico-sociales. Notre présence dans ce secteur est très importante, d’autant plus que la FHP n’est pas concernée et la FHF ne l’est que pour les maisons de retraites rattachées au secteur gérontologie des hôpitaux. Heureusement, il n’y a pas eu de grandes actions emblématiques emportant des programmes très lourds d’investissement tels des reconstructions d’établissements publics de santé mais seulement quelques petites opérations. Celles-ci ont d’ailleurs opportunément bénéficié, à l’occasion des plans vieillissement et solidarité, après la canicule en 2004, et solidarité grand âge, de financements gratuits de la part de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui ont constitué un levier considérable. Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit d’ailleurs la poursuite de ces plans pour l’activité des personnes âgées et des personnes handicapées dans les activités de la CNSA, ce qui est une excellente chose.
En définitive, nos adhérents ont été bien moins exposés aux emprunts toxiques que les établissements du secteur public et très peu d’entre eux sont concernés. Reste la question de l’équilibre des politiques d’aides publiques ; certaines ARS nous apportent d’ailleurs leur soutien pour des dossiers et s’en font l’avocat devant le ministère. Nous constatons un décrochage progressif puisque, au début, le plan Hôpital 2007 respectait les composantes de l’offre ainsi que la proportionnalité de sa répartition. Mais au fil du temps, le taux d’aide aux établissements non publics a fléchi.
M. le coprésident Pierre Morange. Notre rapporteure s’est interrogée au sujet de l’évaluation du patrimoine hospitalier. La FEHAP, qui connaît très bien le secteur social et médico-social, a-t-elle conduit une réflexion sur ce thème ? Au nom de notre mission, notre collègue Martine Carrillon-Couvreur a dressé un bilan de l’action de la CNSA et a, de même, des zones d’ombre ont été constatées au sujet de l’évaluation du patrimoine hospitalier public. Des évaluations ont pourtant été établies à la demande de la MECSS et un rapport du Sénat a été consacré à ce sujet. Disposez-vous de quelques chiffres en ce qui vous concerne ?
M. David Causse. Je ne pourrais pas vous donner une telle évaluation dans la seconde ; cependant, pour avoir été délégué général adjoint de la FHF lorsque MM. Gérard Larcher et Claude Évin se sont succédé à sa présidence, je suis quasiment certain que la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) dispose de tous les comptes.
M. le coprésident Pierre Morange. Sous la mandature précédente, au cours des travaux du rapporteur de la mission, M. Jean Mallot, sur le fonctionnement interne de l’hôpital, la direction générale du Trésor avait estimé devant nous ce patrimoine à « plusieurs dizaines de milliards d’euros » ! Un tel degré d’approximation laisse les représentants du peuple perplexes et, entendu par notre mission, un directeur d’hôpital a utilisé le terme d’enquête « spéléologique » pour qualifier cette évaluation…
M. David Causse. La métaphore de la spéléologie me fait songer au système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM), qui contient toutes les données relatives aux soins de ville, un véritable continent – pratiquement l’équivalent en volume d’investissements et de dépenses publiques des deux secteurs hospitalier et médico-social confondus. C’est un outil extraordinaire, mais malheureusement, le nombre de spéléologues capable d’explorer une telle grotte peut se compter sur les doigts d’une main… Il faut avoir de bons chefs de cordée pour lire le SNIIRAM ! De même, M. Jacques Grolier, qui a enseigné pendant des années à l’École des hautes études en santé publique était sans doute un des seuls experts à être capable de faire parler la DGCP qui a en main tous les comptes.
Cela dit, il faut savoir distinguer entre valeur comptable et valeur de marché. Certains bâtiments peuvent avoir perdu toute valeur comptable dans les comptes d’établissements publics et constituer cependant de véritables pépites dans le cadre de la reconversion, de la rénovation urbaine ou de la promotion immobilière. À l’inverse, certains châteaux en Espagne dont la valeur comptable est encore élevée peuvent avoir une valeur dérisoire en termes de foncier ou d’implantation. La question de l’évaluation patrimoniale suppose une contextualisation dans le territoire, un examen des séries chronologiques établies par les notaires et retraçant l’évolution de la valeur de l’immobilier, bref, un regard professionnel d’une autre nature qui, à lui seul, justifierait une méthodologie particulière.
M. le coprésident Pierre Morange. Cela serait sage.
M. David Causse. On découvrirait des choses étonnantes, des valeurs zéro dans des bilans qui sont de véritables pépites et l’inverse, de la même manière qu’il peut arriver à des particuliers de supporter des charges extrêmement lourdes de remboursement d’emprunt pour des appartements ou des maisons qui, pour des raisons diverses, ont perdu beaucoup de leur valeur.
Nous disposons d’études sur les patrimoines et les comptes d’exploitation de nos adhérents, car un échantillon très large des personnes morales répond à nos enquêtes. Je vous les communiquerai bien volontiers.
Dans le secteur médico-social, pour des raisons assez similaires à celles relevées dans le secteur sanitaire, nous constatons que la capacité des opérateurs à gérer leurs investissements courants de renouvellement et d’entretien a fléchi au cours des dernières années. Cela s’accompagne, dans un cas comme dans l’autre, d’une baisse de leurs fonds propres et d’une augmentation préoccupante du taux de vétusté. Ils subissent la pression des ARS et des conseils généraux qui, de leur côté, connaissent leurs propres contraintes liées à l’aide sociale. Bien entendu, les grandes opérations de reconstitution, de délocalisation ou de transformation du patrimoine ne sont pas concernées. Un des risques encourus est de voir des exploitants indispensables contraints de recourir à des requalifications de patrimoine afin de pouvoir répondre à certaines exigences qui s’imposent, comme celles de l’accessibilité et de la mise en conformité rendue nécessaire par l’évolution des normes. La capacité de nos gestionnaires à faire face aux dépenses d’entretien courant s’est clairement dégradée, alors même que nos établissements ne peuvent s’installer dans des déficits accumulés faute de bénéficier de l’immunité qui semble prévaloir dans le secteur public. Les gestions demeurent prudentes, les taux d’indépendance financière restent satisfaisants, mais au détriment des investissements courants.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. En ce qui concerne la formation des équipes dirigeantes de vos établissements en matière financière, vos méthodes de recrutement sont-elles différentes du secteur public ? Vous revenez souvent sur la « sécurité » dont bénéficieraient quelque part les établissements publics même si on se doute bien que le ministère ne peut pas les laisser en situation de cessation de paiement.
M. David Causse. Cela est également sous-entendu dans l’objet de votre mission dans la mesure où l’endettement public comme le recours public à des emprunts toxiques engagent nécessairement les finances publiques ; force est d’admettre que les établissements publics bénéficient d’une garantie de l’État implicite, pas nous. Sécurité pour le secteur public, insécurité pour le nôtre, pour dire les choses avec un peu d’humour triste…
Pour ce qui est de la gouvernance des établissements et de leurs finances, la différence est fondamentale : dans les établissements privés non lucratifs, la responsabilité devant les tiers n’engage pas un dirigeant salarié mais le président de l’association, de la fondation ou de l’union mutualiste, voire le trésorier. Cela nous amène à organiser chaque année des sessions de formation sur la responsabilité des administrateurs, sur la responsabilité personnelle en cas de faute de gestion, cela participe des mesures de prudence. Nos responsables sont souvent des personnes issues de ce que j’appellerai l’élite républicaine, anciens hauts fonctionnaires, personnes issues de l’entreprise ou du champ médical libéral qui estiment qu’après avoir beaucoup reçu, ils se doivent d’œuvrer pour le bien public en prenant des responsabilités au sein de conseils d’administration d’associations et de fondations. Mais en cas de faute de gestion ou de déficit important ne faisant l’objet d’aucunes mesures correctives, nos dirigeants engagent leur responsabilité personnelle, ce qui n’est pas le cas des membres du conseil de surveillance d’un établissement public. C’est ce que dit mon président, M. Antoine Dubout : les maires tiennent à présider les conseils de surveillance des établissements publics de santé ; bien que ce ne soit plus obligatoire dans les textes, c’est devenu un réflexe sociologique. Nul doute que leur analyse changerait si les charges déficitaires n’étaient plus mises au compte de l’Assurance maladie, mais à la charge de leur commune ! C’est ce qui explique la prudence de la gestion de nos administrateurs : certains de nos établissements de santé en sont à leur quatrième ou cinquième plan de retour à l’équilibre.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle est la traduction pratique de l’exercice de ces responsabilités de gestion ? Arrive-t-il réellement à des dirigeants de vos établissements d’être poursuivis à titre personnel ?
M. David Causse. Oui, nous en avons eu un cas tout à fait dramatique : un de nos dirigeants a été poursuivi sur ses biens propres et a perdu tout son patrimoine. Il s’agissait d’une opération lourde ; du reste, les habitants des communes avoisinantes ont vu leurs impôts locaux augmenter, car les collectivités locales s’étaient portées garantes d’un certain nombre d’emprunts. Ce dirigeant, persuadé du caractère indispensable de son association, a cru que les pouvoirs publics viendraient mettre au pot, confondant un réflexe favorable à un établissement public avec la réalité d’un établissement privé non lucratif…
Bien évidemment, ces présidents ou trésoriers délèguent à des salariés, directeur général et secrétaire général, qui eux-mêmes s’entourent de collaborateurs : dans les grands établissements, ce sont souvent d’anciens experts-comptables ou même cadres d’organismes bancaires et de cabinets de conseil. Mais nos établissements plus modestes ne peuvent pas acquérir ces compétences, faute d’avoir les moyens de les y attirer. Cela étant, comme l’a rappelé M. Morange, les banques sont tenues à des obligations de conseil, elles doivent adapter leurs outils et leur langage à la capacité d’appréciation des risques de leur interlocuteur. Dans le cas d’espèce que j’ai évoqué, des produits très complexes ont été proposés à une équipe qui n’était pas capable d’en mesurer les risques.
M. le coprésident Pierre Morange. Il a été indiqué à la mission que les établissements publics de santé n’ont pas été autorisés à former des recours à l’encontre des établissements bancaires, alors que certaines collectivités territoriales ont pu s’appuyer sur la jurisprudence pour agir. Compte tenu de la complexité des produits proposés et de l’hétérogénéité des niveaux de formation de vos gestionnaires, et dans la mesure où il s’agit, de la part des banques, de montages visant ni plus ni moins à faire de la spéculation financière à partir d’un argent socialisé, la FEHAP a-t-elle étudié la possibilité de déposer des recours ?
M. David Causse. Je suis heureusement surpris par cette question et j’avoue ne pas avoir pensé à la poser à notre réseau. Des renégociations ont eu lieu, mais nous ne sommes pas au courant d’actions au niveau judiciaire. Cela étant, mon expérience de juriste me porte à penser que, sous réserve de dispositions contractuelles que d’aucuns auraient pu consentir, les obligations de conseil font parties des griefs susceptibles d’entrer en ligne de compte si la voie de la renégociation des emprunts s’avérait bouchée.
M. le coprésident Pierre Morange. Une négociation n’a d’efficacité que s’il existe un rapport de force, autrement dit si vous êtes en mesure de menacer votre interlocuteur de mesures de rétorsion, par exemple judiciaires, afin de l’amener à comprendre la situation de dépendance financière dans laquelle se trouve l’établissement de soins. Cela n’est pas prévu pour la sphère hospitalière publique stricto sensu, ce qui a conduit la MECSS à essayer de porter la question. Cela nous étant malaisé, nous avons entrepris, avec Mme la rapporteure Gisèle Biémouret, d’essayer d’engager directement ce dialogue avec les établissements bancaires en leur rappelant leur responsabilité morale, du fait de leur implication dans la crise financière mondiale et alors même qu’ils avaient accepté d’absorber une part de la dette grecque toxique… Compte tenu, au surplus, des facilités dont ils disposent aujourd’hui avec les volumes considérables injectés dans le marché monétaire par la Banque centrale européenne (BCE), nous leur avons fait valoir qu’ils avaient tout loisir de revenir à des taux d’intérêt fixes et raisonnables au lieu d’en rester aux taux exorbitants découlant de ces emprunts à taux variable.
M. David Causse. Je trouve votre idée d’une renégociation globale tout à fait bien venue, car si certaines de nos équipes de direction n’ont pas su analyser la sophistication démesurée de certains produits bancaires, elles ne seront pas plus capables de mener à bien leur renégociation. Au regard de l’enjeu pesant sur le secteur public, je mesure les difficultés rencontrées par le secteur privé non lucratif, même si celui-ci s’est montré plus prudent, lorsque je vois les montants concernés et le nom des banques, UBS, Deutsche Bank…
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Causse, dans cette salle, à votre place, il y avait en janvier des représentants d’établissements bancaires. Je puis vous assurer que, lorsque nous les avons interpellés, ils étaient mal à l’aise. Je vous invite à revoir l’enregistrement vidéo, particulièrement révélateur. Nous les avons saisis par écrit afin qu’ils nous adressent un tableau exhaustif retraçant tous les emprunts consentis ainsi que leur engagement à en sortir par le haut en proposant des taux d’intérêt fixes raisonnables, compte tenu de la modicité des taux dont ils bénéficient eux-mêmes pour leur refinancement. Dans ces conditions, on pourrait imaginer que la FEHAP pallie la faiblesse technique de certains de ses adhérents en proposant une mutualisation de la renégociation dans le cadre d’un rapport de force plus favorable, voire en y associant les autres fédérations, afin de contraindre les établissements bancaires en leur rappelant que le peuple français n’est pas qu’une poule aux œufs d’or, qu’il en va de la santé de ses travailleurs qui produisent de la richesse et que, au-delà de la morale, ils auraient tout intérêt à préserver ce réservoir de rentabilité. Car, derrière les chiffres, il y a des vies.
M. David Causse. J’entends parfaitement votre recommandation, de même que votre souci d’efficacité. Plus la négociation est globale, plus elle est efficace et susceptible de concerner le secteur privé non lucratif : dans le train des emprunts toxiques, nous ne sommes qu’un petit wagon…
M. le coprésident Pierre Morange. Wagon après wagon, on forme un grand train !
M. David Causse. Face à des Goldman Sachs, Deutsche Bank, Crédit Suisse, HBSC, Morgan, Dexia, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland… même une action collégiale, menée par notre petit effectif mais pour des montants somme toute modestes, serait sans effet. Encore une fois, il s’agit des banques comptant parmi les plus puissantes au monde et dont certains cadres dirigeants auraient du mal à localiser la France.
M. le coprésident Pierre Morange. Je suis convaincu qu’une action collective conduite devant les banques, fussent-elles de rang international, par les trois fédérations aurait un poids certain dans la négociation, autrement plus pertinent que le point de vue d’un dirigeant d’établissement isolé face à une banque, qu’elle soit américaine ou française. Nous avons eu droit à des réponses qui valaient leur pesant d’or ; un établissement bancaire franco8belge célèbre nous a fait valoir que le peuple belge lui aussi avait cautionné ces emprunts toxiques… À cela, j’ai répondu que, des deux côtés de la frontière, la souffrance était la même et que le sang qui coulait avait la même couleur. Il faut les remettre face à leur responsabilité morale, ce qui permettra à une négociation de qualité de s’engager.
M. David Causse. Il me faut examiner, sur le plan statutaire, la capacité de nos établissements à former un recours. Dans la cartographie établie par Dexia que j’ai mentionnée, les montants concernés n’apparaissent pas plus que les éventuelles renégociations. Je vous les communiquerai par écrit. Pour ce qui est d’éventuels recours, il va me falloir revenir auprès de nos adhérents.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La tarification à l’acte permet-elle aux établissements, publics ou privés, de faire face à la fois aux investissements et au remboursement de la dette ?
M. David Causse. C’est la question clé. Les tarifs pour les activités de court séjour ont baissé cette année en moyenne de 0,65 % – 1 % en intégrant la réserve prudentielle. Mais certains établissements, du fait de leur activité, seront encore plus exposés : certains d’entre eux, assez grands, font état d’une baisse de l’ordre de 3 à 4 %. Cela dans le contexte d’une évolution mécanique des charges de 2 %, cela donne une idée de la hauteur de la marche à gravir.
Les gestionnaires hospitaliers sont confrontés à un véritable supplice de Sisyphe : il faut chaque année repousser les déficits au prix de nouvelles réorganisations qui épuisent les équipes, y compris les équipes soignantes. Certes, certaines réorganisations s’imposaient, mais d’autres participent d’une répartition sur tous les opérateurs d’efforts dont sont exemptés des établissements qui concentrent à eux seuls une bonne part des déficits qui pèsent sur l’ensemble. Ainsi, chaque année, quatre ou cinq établissements bien connus, à eux seuls et de façon récurrente, absorbent presque 500 millions d’euros sur une marge de manœuvre de 1,6 milliard d’euros, ce qui est considérable. Un rapport d’une mission de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), dirigée par l’inspecteur général Patrice Legrand, a considéré que les tarifs permettaient de faire face à l’investissement courant, mais pas aux grandes opérations de recomposition de l’offre.
Les gestionnaires constatent une hausse constante du taux de vétusté ; les plus prudents freinent sur les investissements courants. Nos établissements sont en mesure d’investir et de rembourser leurs dettes, mais pas d’engager des opérations de rénovation structurantes et, pour quelques-uns d’entre eux, la situation financière devient très angoissante.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous indiquer à la MECSS les noms des établissements fortement endettés ?
M. David Causse. Les CHU de Caen, de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France et d’Évry-Corbeil particulièrement sont en butte à des difficultés chroniques depuis des années : je ne parle pas de leur dette, mais de leur déficit d’exploitation, qui oblige à un comblement permanent réduisant d’autant les marges de manœuvre de l’État.
Est-ce la T2A qui est responsable de cette situation ? Tout dépend du niveau des tarifs ; une logique d’enveloppe peut aussi conduire à des situations budgétaires tout aussi pénalisantes. Lorsque le sage regarde la lune en la montrant du doigt, l’imbécile regarde le doigt, dit l’adage. Le tarif ou l’enveloppe ne sont que la traduction de l’arbitrage générique voté par le Parlement puis de l’allocation des ressources par le Gouvernement. Des établissements de soins psychiatriques ou de suite et réadaptation du service public (SSR) sont ainsi financés par une dotation annuelle, dont une baisse globale de 0,6 % est annoncée. Il n’y a donc pas de magie, tout dépend de l’équation initiale.
M. le coprésident Pierre Morange. On peut y ajouter les préconisations des structures chargées de l’amélioration des pratiques hospitalières qui visent, par le biais de la rationalisation de la masse salariale, à dégager des marges de manœuvre. La Cour des comptes l’a noté, selon les disciplines, notamment obstétrique, cardiologie ou pneumatologie, les ratios d’encadrement et d’effectifs varient de un à cinq. La masse salariale représentant 70 % du budget d’un hôpital, ces sujets, au-delà de la question de la T2A, ne sont pas neutres.
M. David Causse. Les établissements sous gestion du secteur privé ont justement cet aiguillon, sous peine de perdre toute autonomie et de se soumettre complètement à l’arbitrage des pouvoirs publics. La partie de la Cour des comptes accompagnant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et consacré à l’hospitalisation privée non lucrative, a du reste montré que les établissements de santé de la FEHAP ont fait des efforts non négligeables et affichent des niveaux de productivité et d’organisation excellents.
Pour en revenir à notre dilemme, des décisions difficiles et, certes respectables, ont été prises qui concernent des investissements lourds, dont le coût est supporté par tous, ce qui se traduit par une pression indifférenciée du tarif sur l’ensemble des opérateurs qui ne tient pas compte de la capacité de recomposition ou des efforts particuliers demandés à certains d’entre eux. Ainsi, alors que Rouen dispose d’un CHU parmi les plus importants de France, situé à un quart d’heure d’hélicoptère de Caen et que le centre hospitalier du Havre atteint pratiquement le niveau d’un CHU, la décision de reconstruire le CHU de Caen a été prise. Ne conviendrait-il pas de s’interroger sur l’opportunité de cette opération ? Qu’il faille respecter les habitants de Caen, répondre aux inquiétudes des élus, je le conçois. Qu’il faille reconstruire un établissement, c’est certain. Mais faut-il que ce soit un CHU, sans se poser de question sur l’existence de spécialités ou de sur-spécialités qui ne devraient être qu’à Rouen ? C’est là l’exemple caractéristique de décisions qui, certes, ont leur logique à l’échelon territorial mais qui, additionnées les unes aux autres,…
M. le coprésident Pierre Morange. C’est ce qu’on appelle l’autorité de l’État !
M. David Causse. …font peser des contraintes sur tout le monde, peu importe, à cet égard, que l’on se place dans une logique de financement global ou tarifaire. Qu’on la prenne par des enveloppes budgétaires, de type MIGAC ou dotation annuelle, ou par des tarifs d’activité, l’équation initiale reste la même : dès lors que l’enveloppe de l’ONDAM est fixée à 2 % pour le secteur sanitaire et que les prévisions en volume du besoin de soins s’élèvent, pour le secteur public, à 2,8 %, l’évolution ne peut qu’être négative. La T2A a le dos large : ces problématiques renvoient à des choix de politique publique. Au demeurant, la FEHAP et ses dirigeants préfèrent de beaucoup l’allocation de ressources par les tarifs, beaucoup plus objective car liée à des services rendus à un moment donné. Les dotations par enveloppe impliquent une fixité historique, une sorte de « rayonnement fossile » lié à l’histoire, mais aussi à la capacité de peser dans les antichambres. À l’occasion de chaque campagne budgétaire, y compris pour 2015, la direction générale de la FEHAP me demande d’insister pour préserver la masse tarifaire. Les enveloppes renvoient à une gestion plus volontariste, politique, de la répartition de la ressource.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Au fil des auditions, nous entendons des points de vue différents au sujet de cette question du financement.
M. David Causse. Les établissements de soins de suite et de réadaptation comme les établissements psychiatriques, qui sont placés sous le régime de la dotation globale, vont vivre une année 2015 particulièrement difficile. Ils n’ont pas la possibilité de réaliser des gains de productivité en augmentant leur activité – cela serait même malsain car ce serait pour ceux la triple peine. Premièrement, s’ils augmentent leur activité afin de répondre aux besoins de la population, dans le cadre d’une logique de dotation globale, leurs recettes n’augmentent pas. Le ministère des finances adore les dotations globales : cela se régule facilement, cela se « rabote » à volonté, cela donne un sentiment de maîtrise totale, mais en termes d’organisation et de dynamique des équipes, c’est très stérilisant. Deuxièmement, le surcroît d’activité reste neutre sur la masse salariale mais il induit des charges supplémentaires liées à la médication ainsi qu’à d’autres prestations telles la biologie ou l’imagerie ; contrairement aux établissements de court séjour, les établissements de SSR et psychiatriques ne peuvent jouer sur la seule marge de dépassement qui reste : la facturation en sus des molécules onéreuses. Le seul traitement de l’hépatite C représente un coût en médicaments de 65 000 euros sur douze semaines par patient, c’est un coffre-fort dont il faudrait s’équiper pour ranger ces lingots… C’est ce qui va interdire, du reste, le transfert de patients atteints de cancer des centres de court séjour vers les établissements de soins de suite et de réadaptation, puisque ceux-ci seront incapables de supporter le surcoût de ces médications initiées en court séjour.
L’état de nos finances publiques et sociales justifie que la pression économique s’exerce sur tous et personne n’a lieu d’en être exempté. La vraie question est celle du vecteur à utiliser pour qu’elle s’exerce de manière saine, au bon endroit, et qu’elle produise les bonnes réflexions. Or la politique de pression sur les seuls tarifs, sans s’interroger sur les enveloppes de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), fait qu’elle s’exerce très fortement sur tous les acteurs, de manière totalement indifférenciée ; il n’est pas certain qu’elle produise les effets pédagogiques ou d’incitation à l’orientation des choix attendus, ni qu’elle soit la plus lisible. Ce n’est donc pas la T2A qui pose question, mais le rééquilibrage des efforts ainsi que les moyens mis en œuvre pour y procéder.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Causse, nous vous remercions de nous avoir répondu de manière aussi exhaustive et nous attendons les compléments d’information que vous vous êtes engagé à nous fournir.
*
* *
Audition de M. Patrice Chatard, directeur général et cofondateur de Finance active, et M. Matthieu Collette, responsable des études économiques et de la formation
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Dans le cadre de nos travaux sur la dette des établissements publics de santé, nous nous sommes interrogés sur la formation des directeurs d’hôpitaux en matière financière et sur le devoir de conseil des banquiers qui semble avoir été insuffisant compte tenu de la souscription de nombreux emprunts toxiques.
Vous accompagnez les établissements hospitaliers depuis plusieurs années. Comment expliquez-vous que de nombreux établissements aient souscrit des emprunts structurés en sous-estimant le risque de tels produits ? Comment parvenir à un financement des investissements plus adapté aux contraintes sanitaires ?
Mais au préalable, nous aimerions vous entendre présenter votre société, dont nous avons découvert l’existence au cours de nos auditions.
M. Patrice Chatard, directeur général et cofondateur de Finance active. Créée en 2000, la société Finance active fournit aux directions financières des entreprises et des collectivités publiques des services d’accompagnement dans la gestion de la dette et des risques financiers. Nous proposons une approche qui combine, d’une part, des plateformes collaboratives de gestion en ligne, grâce auxquelles les hôpitaux, par exemple, peuvent suivre l’ensemble de leurs emprunts et, d’autre part, un accompagnement personnalisé d’un consultant dédié, que chacun de nos clients peut appeler afin de lui poser des questions sur sa dette ou encore pour connaître l’offre bancaire la plus intéressante parmi toutes celles qu’il a reçues.
Depuis sa création, Finance active connaît une croissance régulière et a réalisé un chiffre d’affaires en 2014 de 16 millions d’euros. Chaque année, 25 % de son chiffre d’affaires est réinvesti en R & D technologique et financière. Nos équipes regroupent plus de 140 collaborateurs : nous créons un emploi par mois.
Nous travaillons avec un large panel de clients publics et privés. Dans le secteur public, nous accompagnons la plupart des communes et des régions en France et même en Europe – Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Suède –, ce qui fait de nous une entreprise européenne. Nous accompagnons également une large part d’établissements publics de santé : la grande majorité des CHU, hôpitaux locaux, et même certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC).
Dans le secteur privé, notre clientèle se compose de grandes entreprises, y compris du CAC 40, de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) en région, en France et à l’international.
Nous avons également des clients parmi les bailleurs sociaux.
Chaque année, nous publions un observatoire, c’est-à-dire des moyennes statistiques sur la base des emprunts de nos clients, que nous fournissons à la direction générale du Trésor, à Bercy, et à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS). S’agissant des établissements publics de santé, vous allez avoir la primeur de ces éléments pour l’année 2014.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Quelles différences voyez-vous en matière de gestion entre un établissement privé et un établissement public, ainsi qu’en matière de formation des dirigeants des établissements ? Je pose cette question, car, comme l’a montré l’audition précédente, on peut supposer que l’État ne laissera pas tomber un établissement public.
M. Patrice Chatard. Nous sommes compétents pour parler de la gestion du risque financier, de la gestion de la dette – et non des grands équilibres en termes de déficit.
Matthieu Collette anime des formations à l’intention aussi bien du secteur public que du secteur privé. Finance active existe car nous exerçons un métier de spécialistes auprès de clients publics comme privés, qui ont besoin d’informations et d’un accompagnement au moment de réaliser des programmes d’investissement, car ils ne connaissent pas forcément le marché bancaire, le niveau des marges, le type de produit, les banques actives, etc.
Enfin, il nous arrive de croiser des directeurs financiers très brillants aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
M. Matthieu Collette, responsable des études économiques et de la formation financière. En matière de gestion, je vois deux grandes différences entre le secteur public et le secteur privé. Premièrement, les contraintes sont plus importantes dans le secteur public. Les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 étaient très lourds : on voit rarement dans le secteur privé des investissements aussi importants sur des durées aussi longues. Deuxièmement, les contraintes sont différentes avec, d’un côté, une mission d’intérêt général et, de l’autre, la recherche d’investissements rentables.
Dans plusieurs de ses rapports, l’OCDE préconise une plus grande professionnalisation dans la gestion des finances publiques et locales au sens large, et ce pour tous les pays membres.
Sur le terrain, nous n’observons pas de différences très importantes, si ce n’est que nous formons plutôt des dirigeants généralistes dans le secteur public, et plus souvent des spécialistes sur des questions clés dans le secteur privé, même si les grandes collectivités et les grands établissements de santé comportent des chargés de mission spécialisés sur ces questions.
En tout état de cause, nous exerçons un métier de spécialistes, et cela le restera car il s’agit de questions financières potentiellement complexes, et qui renvoient à des enjeux très importants.
M. Patrice Chatard. En termes de produits, c’est la durée qui fait la différence. Un établissement public de santé peut obtenir des financements à trente ans, alors qu’un établissement privé les aura beaucoup plus difficilement.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Comment expliquez-vous que des emprunts toxiques aient pu être contractés par des hôpitaux publics ? Que faudrait-il modifier pour garantir que cela ne se reproduise plus ?
M. Patrice Chatard. Ce n’est pas la première fois que la question nous est posée, puisque nous avons participé sur ce sujet aux travaux de la Cour des comptes, du Sénat, de la commission Gissler, ainsi que de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, conduite par MM. Claude Bartolone et Jean-Pierre Gorges.
Chez Finance active, tout est tracé : à chaque fois qu’un directeur financier appelle son consultant pour l’interroger sur un nouvel emprunt ou un réaménagement, la demande est immédiatement enregistrée dans notre système de gestion ainsi que la réponse. Je peux donc vous fournir des éléments statistiques : sur la période 2004-2008, nous avons reçu de l’ensemble de nos clients – collectivités locales et secteur public de santé – 8 000 propositions de réaménagement et 7 000 propositions de nouveaux financements comportant des produits structurés ! En l’espace d’environ cinq ans, ce sont donc 15 000 propositions bancaires de ce type qui ont été adressées à nos clients du secteur public.
Autrement dit, le marché commercial était guidé par les banques – dont certaines comportaient des équipes de plus de 300 commerciaux – et, toute la journée, les directeurs financiers des collectivités locales et des établissements publics de santé étaient sollicités pour réaliser ce type de produit. Il n’y a donc aucune ambiguïté ; le marché était parfaitement organisé par les banques à l’époque : Dexia en tête, Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland (RBS), etc.
Cela étant, sur ces 15 000 propositions, à peine 500 ont été souscrites par nos clients. Nous estimons donc que notre travail n’a pas été inutile : nous en avons arrêté un grand nombre, la grande majorité. Les choses auraient pu être pires. Certes, une partie a été souscrite, et elle n’est pas neutre. Mais à l’époque, de grands plans d’investissement, notamment Hôpital 2007, avaient amené les hôpitaux à chercher des financements – et certains financements ont comporté un volet « produit structuré ». D’ailleurs, les hôpitaux ont été les premiers à se voir accorder des financements sans marge – de mémoire, Crédit Agricole Indosuez a été le premier à proposer du « Euribor + 0 % » –, mais avec possibilité pour le directeur financier de changer d’index, de réaménager le prêt comme il le souhaitait, sans passer par une délibération : tout était prévu dans le contrat dès le départ. Dans tous les cas, la politique commerciale des banques était claire : il s’agissait de remporter l’appel d’offres sur le financement et donc l’encours, si bien qu’elles étaient prêtes à casser les prix. Les commerciaux ont annoncé aux hôpitaux avoir « mieux » à leur proposer que du « Euribor trois mois sans marge », à savoir des produits structurés dont certains se sont révélés très toxiques. C’est ainsi que les choses sont arrivées.
Dans nos publications, dont nous venons de vous distribuer un exemplaire daté de 2006, vous constaterez que nous avons lancé des alertes à destination de nos clients, intitulées par exemple « Rejetez les propositions liées (multi-index + structuré) » ou encore « Les dangers des indexations conditionnées au change euro/franc suisse ». Nous nous sommes efforcés de sensibiliser nos clients, par des événements, des formations, des publications. Il n’en reste pas moins que nous avions en face de nous des banquiers pas mauvais qui trouvaient les arguments pour convaincre le directeur financier, par exemple, de ne pas prendre l’indexation fixe ou variable, que conseillait Finance active, mais plutôt de panacher avec du franc suisse… Pour avoir travaillé sur des financements hospitaliers, je me souviens que nous avions élaboré un mélange parfait entre le taux fixe et le taux variable, mais la banque est ensuite passée voir le directeur financier et ils ont tout modifié… C’est un des établissements aujourd’hui touché.
M. Matthieu Collette. Pour les banques, les produits structurés répondaient à deux objectifs.
Le premier était de créer davantage de rémunération. Le marché du secteur public local au sens large est peu rémunérateur du fait de la règle de dépôts des fonds au Trésor, alors que la « bancarisation », c’est-à-dire la gestion des flux, est le nerf de la guerre pour les banques. Au surplus, la concurrence avait fait baisser les marges sur les crédits standards à des niveaux très bas. Par conséquent, des produits complexes, avec de l’ingénierie financière, assuraient de facto davantage de rémunération.
Ensuite, le second objectif était d’avoir la « mainmise » sur les encours. Il était très difficile, voire impossible aux clients de sortir d’un encours en produit structuré – des produits indexés sur le franc suisse, notamment. En fait, les banques avaient des politiques de restructuration quasiment tous les six mois, ce qui permettait de rechercher à nouveau de la rentabilité sur un encours déjà existant.
Cela explique l’impact commercial très important de ces produits. On peut même dire que cette offre a créé sa demande : un taux facial faible pouvait rencontrer une demande en raison des plans d’investissement très importants et de la nécessité de chercher des marges de manœuvre.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Les collectivités locales se sont organisées plus rapidement que les hôpitaux : elles sont en procès contre certaines banques, alors que les établissements de santé n’ont pas l’autorisation de le faire. Qu’en pensez-vous ?
M. Patrice Chatard. C’est bien un problème d’autorisation, et nous ne comprenons pas vraiment pourquoi les hôpitaux ne l’ont pas eue… Les prêts toxiques ont touché aussi bien les collectivités locales que les établissements publics de santé : il s’agissait des mêmes banques, des mêmes commerciaux, des mêmes offres, des mêmes produits. Les collectivités locales et les élus sont montés assez vite au créneau pour dénoncer ce qui s’était passé, s’organiser et s’engager dans des contentieux. S’agissant des hôpitaux, on n’a pas entendu parler du problème durant de nombreuses années ; aujourd’hui, ils rattrapent un peu ce retard.
M. Matthieu Collette. À partir du moment où cette question est devenue politique, les choses ont avancé. Les élus montés au créneau ont trouvé des relais bien plus facilement que le directeur général d’un centre hospitalier et ont réussi à faire bouger les lignes en obtenant un premier fonds de soutien, certes peu utilisé, alors que la solution d’État est intervenue beaucoup plus tardivement pour les hôpitaux.
M. Patrice Chatard. Mais je ne suis pas certain qu’un directeur général qui aurait voulu monter au créneau assez tôt aurait eu l’autorisation…
Que faut-il faire pour que cela n’arrive plus ? Aujourd’hui, la situation est radicalement différente : ces produits n’existent plus, ils ne sont plus commercialisés par les banques, à la faveur de la mise en place de chartes ou de réglementations ; on voit mal comment ils pourraient réapparaître.
M. Matthieu Collette. Le dispositif existant avec, d’un côté, la charte Gissler, qui permet de tracer les produits, et, de l’autre, les restrictions sur les possibilités d’emprunt – emprunts possibles à taux fixe ou à taux variable et éventuellement opérations de couverture type « cap » – empêcheront, quasiment de manière réglementaire, les établissements de santé de souscrire à nouveau des produits structurés.
Nous allons maintenant vous présenter quelques éléments de méthodologie.
Au 31 décembre 2014, sur un peu plus de 420 établissements de santé, 7 700 lignes d’emprunt étaient traitées dans nos systèmes, pour un encours total de 22,9 milliards d’euros. Je rappelle que la dette cumulée des hôpitaux publics s’élève à près de 30 milliards d’euros.
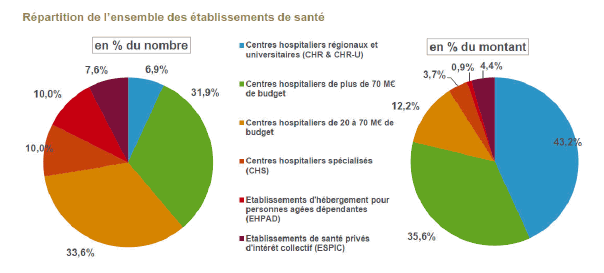
Nous couvrons quasiment l’ensemble des établissements de santé et la moitié de la dette des CHR (centres hospitaliers régionaux) et CHU (centres hospitaliers universitaires).
Le taux moyen de la dette fin 2014 reste relativement faible : 3,36 % en moyenne, tous établissements confondus. L’inertie observée depuis 2009 s’explique par le fait que les établissements de santé ont davantage recours au taux fixe, certaines banques refusant de prêter à taux variable, en Euribor simple, à des établissements plus petits. Cette évolution maîtrisée donne une lisibilité à moyen terme sur le coût de la dette.
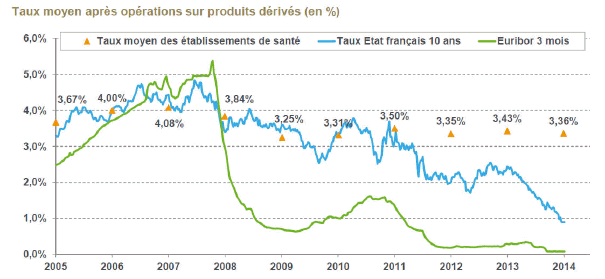
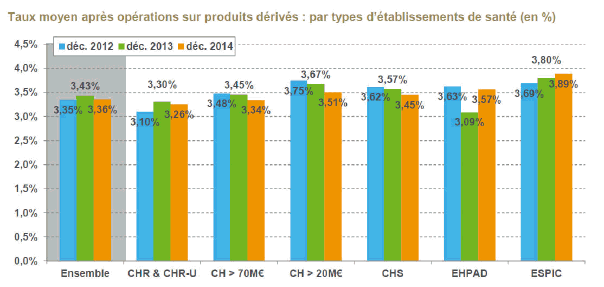
Les différences selon les types d’établissement s’expliquent par la structure de la dette, à taux variable ou à taux fixe ; les plus grands centres hospitaliers ont les taux moyens les plus faibles car leur part de taux variable simple est la plus importante, ce qui permet de bénéficier de niveaux de taux extrêmement faibles – les Euribor sont proches de zéro et le coût de l’emprunt correspond pratiquement à la marge de la banque. Elles s’expliquent aussi par la nature même des établissements : les ESPIC, établissements plus jeunes, ont des projets à durée de vie plus longue.
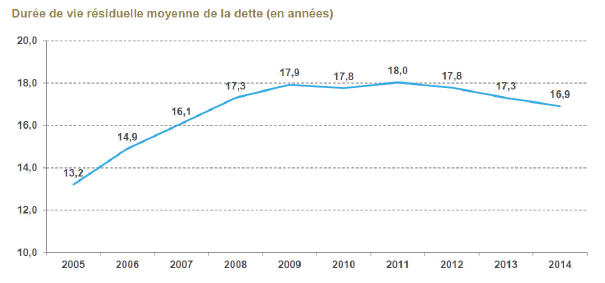
Les grands plans d’investissement se sont accompagnés d’un rallongement de la durée de vie de la dette, puisque le financement de l’immobilier exige des maturités plus longues. Depuis 2011, le léger infléchissement s’explique par le ralentissement de ces investissements très longs, mais aussi par le fait que les banques ont été pendant un moment réticentes à prêter sur des maturités au-delà de quinze ans.
Cela étant, cette durée de dix-sept années devrait-elle être mise en regard avec la durée d’amortissement moyenne des investissements hospitaliers ? Il s’agit certainement d’une voie à privilégier, c’est-à-dire un meilleur adossement entre la durée d’amortissement des biens financés et la durée d’amortissement des emprunts – même si l’on sait que l’absence de marges budgétaires conduit souvent à l’allongement de la durée de l’emprunt pour alléger la charge annuelle de la dette…
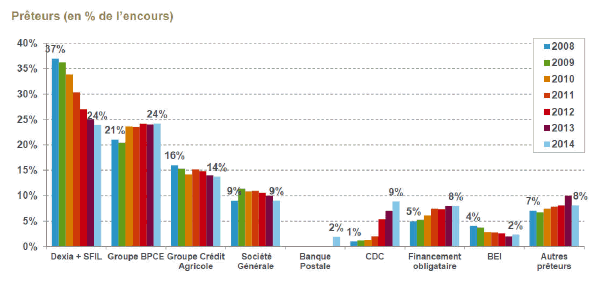
Parallèlement à la baisse très importante, entre 2008 et 2014, de la part de l’agrégat Dexia-Société de financement local (SFIL), appelée à se poursuivre du fait de l’extinction programmée de Dexia, les parts dans l’encours de dette des autres banques restent relativement stables, ce qui signifie qu’il n’existe pas de stratégie de leur part pour devenir le premier prêteur des établissements de santé.
À l’inverse, la part des financements alternatifs tend à croître, celle du financement obligataire, celle de la Banque européenne d’investissement (BEI), celle de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ayant crû de manière très importante sur la même période, ce qui traduit une intervention déterminante des pouvoirs publics. L’une des conséquences en est que les banques acceptent de financer certains établissements à condition que la CDC s’engage elle-même à le faire – celle-ci apparaissant comme un déclencheur. On sait que les banques doivent gérer le risque, mais de là à s’entourer d’autant de « pare-feu », et qui plus est de celui de la Caisse des dépôts… Il y a là matière à s’interroger. On parle d’un excès d’offre sur le marché du financement du secteur public local, où les offres des banques représentent entre 25 et 30 milliards d’euros, mais ils sont pour les collectivités et les établissements de santé respectivement de 18 milliards d’euros et de 2 à 2,5 milliards d’euros : l’écart est très important. Cet excès d’offres sur le marché public local résulte pour l’essentiel, de l’intervention de la Caisse des dépôts – 4 à 5 milliards d’euros annuellement jusqu’à 2017 – et de la BEI, qui a beaucoup augmenté ses engagements et joue souvent un rôle de déclencheur sur des dossiers délicats.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Pensez-vous que les établissements publics de santé ont un accès aux ressources leur permettant de financer leurs investissements nécessaires ? Certains sont-ils en danger ?
M. Matthieu Collette. Notre champ d’expertise porte sur les moyens de financer l’investissement, moins sur l’avenir de l’investissement.
Comme le montrent les évolutions du marché ces trois dernières années, très difficiles pour les établissements – sauf pour les très grands –, puisque des interventions exceptionnelles de la Caisse des dépôts et consignations ont été nécessaires, les choses se sont stabilisées à nouveau : la Banque postale est présente, la CDC de façon pérenne, au moins jusqu’en 2017. Néanmoins, il faut distinguer deux marchés à l’intérieur de ce marché apparemment en excès d’offre. D’un côté, les grands établissements, relativement en meilleure santé que les autres, peuvent mettre les banques en concurrence, disposer des financements de la CDC, des grands projets de la BEI, éventuellement du financement obligataire. Ils pourront donc bénéficier de cette liquidité excédentaire. À l’inverse, les plus petits établissements, en difficulté, ont beaucoup de mal à trouver des financements. Certains sont même obligés de reporter des projets d’investissement, comme nous l’avons encore constaté fin 2014. Et ceux qui en trouvent sont clairement des établissements que la CDC a décidé de suivre ; les banques comme la Caisse d’épargne et le Crédit Agricole suivent, mais à hauteur de leurs engagements dans les encours pour ne pas faire augmenter leur taux d’emprise.
Ainsi, même si la liquidité est disponible et assez peu onéreuse aujourd’hui, un marché à deux vitesses est en train de se créer, si bien que le retour de la concurrence sur ce marché ne bénéficie pas à tout le monde.
M. Patrice Chatard. Il nous semble que les choses sont un peu plus difficiles pour les établissements publics de santé que pour les collectivités. Même ceux qui arrivent à boucler leurs appels d’offres sont obligés de s’adresser à plusieurs banques. Par exemple, un établissement qui recherche 10 millions d’euros recevra 2 millions d’euros de la Caisse d’épargne, 2 millions du Crédit Agricole, 4 millions d’euros de la CDC, etc. C’était tout à fait différent en 2007, où il y avait une surabondance d’offres. Aujourd’hui, les établissements, même les plus gros, sont obligés de panacher, et certains établissements plus petits ne trouvent pas de financement et sont obligés de reporter les investissements – même si ce n’est pas la majorité.
M. Matthieu Collette. Ces derniers établissements étaient déjà très prudents sur les investissements, car ils se savaient en difficulté et pressentaient qu’ils auraient du mal à trouver des financements. Pour autant, fin 2014, plusieurs de nos clients dans ce cas ont dû reporter des investissements, faute d’être suivis par le secteur bancaire.
On remarque que, pour les plus petits établissements, la part de la Caisse des dépôts et consignations – entre 12 % et 14 % – est plus importante et le panel des prêteurs moins large.
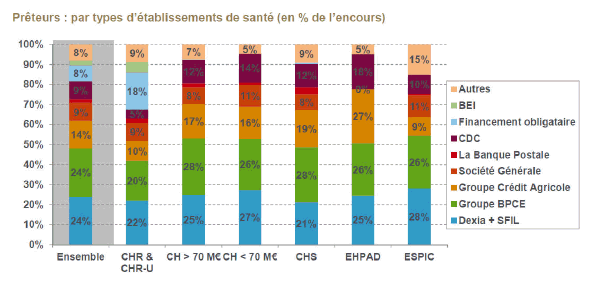
À l’échelle macroéconomique, la dette des établissements de santé est moins risquée aujourd’hui, puisque la part des produits structurés les plus risqués, classés 6 ou F selon la cotation de la charte Gissler, est passée de 6,3 % de l’encours en 2010 à 2,5 % fin 2014. Cela étant, en nombre de produits et en montants, l’évolution est relativement faible dans la mesure où la part de l’encours structuré a diminué via la dilution dans les nouveaux encours – ces dernières années ont vu quasiment uniquement des financements en 1A, à taux fixe ou à taux variable.
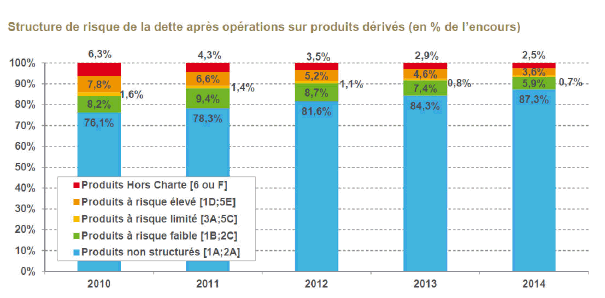
Pour l’année 2014, 5,7 % de la diminution de l’encours structuré total s’explique par l’amortissement des emprunts – les encours diminuant en conséquence –, 6,7 % par l’achèvement de phases dites structurées, le produit étant prévu pour rebasculer dans une phase à taux variable sur la fin de l’emprunt, et 4,9 % par les remboursements anticipés des encours les plus risqués, c’est-à-dire les opérations de désensibilisation proprement dites. Et surtout, ces opérations de désensibilisation ont concerné ceux des produits les moins risqués – emprunts à taux variable hors zone euro, indexés sur le LIBOR, un taux suisse ou britannique, ou les produits « annulables » permettant de passer à taux fixe ou à taux variable avec une dette d’exercice – parce que cela était plus facile, notamment du côté des banques.
M. Patrice Chatard. Les produits hors charte Gissler, qui concernent des produits de change la plupart du temps, sont les plus problématiques. Sur un encours global de 23 milliards d’euros, 2,5 % représentent tout de même 580 millions d’euros net et concernent un assez grand nombre d’établissements. C’est un réel problème pour ceux qui sont touchés, surtout avec la dégradation du franc suisse qui peut porter les coupons d’intérêt à 15 % voire 20 %.
Je pense qu’il faudra faire une distinction entre les petits et les grands établissements. Généralement, la SFIL parvient à désensibiliser ces produits en profitant d’un nouveau programme d’investissement : on propose un paquet avec un nouvel emprunt plus cher, mais des pénalités diminuées pour l’ancien emprunt. Ces opérations de désensibilisation, que nous accompagnons parfois, nous paraissent quelquefois opportunes.
M. le coprésident Pierre Morange. Compte tenu de votre compétence technique, avez-vous adopté une posture de négociation avec les établissements touchés ou les avez-vous sollicités pour cela ? Bref, y a-t-il une mutualisation dans la stratégie de renégociation des emprunts toxiques, que vous l’ayez suggérée ou qu’elle vous ait été demandée par les intéressés ?
M. Patrice Chatard. Nous les suivons tout particulièrement, grâce à notre équipe dédiée, composée de collaborateurs très expérimentés, qui a construit un « sonar » : tous les emprunts sont « scannés » en permanence aux conditions des marchés financiers, et sitôt que des fenêtres s’ouvrent, des alertes sont adressées à nos clients et nos consultants. Nous avons d’ailleurs réussi quelques opérations de désensibilisation l’année dernière, à l’occasion de gros mouvements sur le yen.
M. Matthieu Collette. Il y a une contrainte aujourd’hui : les banques appliquent systématiquement le taux d’usure. Pour certaines opérations il y a quelques années, le taux d’usure n’était pas appliqué, si bien que l’on pouvait voir des opérations de désensibilisation avec un taux à 6,5 % ou 7 %. Cela avait le mérite d’amener l’établissement à faire l’opération et à sortir du risque une bonne fois pour toutes. Ce n’est plus possible désormais.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’est-ce qui justifie la pratique de ce taux d’usure : une réglementation posée par les accords bancaires internationaux, des règles prudentielles ? Les calculs actuariels sont-ils « entrés dans la danse » au titre des mécanismes de réassurance ? Cela serait difficilement compréhensible, vu l’injection colossale de masse monétaire décidée par la Banque centrale européenne. Cela relativise quelque peu le discours sur le taux usuraire…
M. Matthieu Collette. C’est une question que nous nous posons nous-mêmes. Certains de nos clients ont décidé « politiquement » de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces produits ; mais comme la SFIL indique que le réaménagement engendrera le dépassement du taux d’usure, l’opération ne se fait pas. Autrement dit, les opérations réalisées au cours de l’année écoulée l’ont été avec des taux de 4,5 % à 5 %, pas plus.
M. le coprésident Pierre Morange. Si je comprends bien votre propos, cette notion de taux usuraire est finalement portée par la SFIL, alors que des établissements de santé seraient prêts à clore ce passif… En clair, les banques utilisent-elles cet argument pour refuser toute renégociation ? Avez-vous le sentiment que, sans cet élément de doctrine, dont il faut trouver la justification, les choses pourraient se faire ?
Je pose cette question, car les établissements bancaires ayant absorbé 70 % de la dette grecque, je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas le même effort pour la santé du peuple français, qui participe à la prospérité de notre pays.
M. Matthieu Collette. Les cas que j’évoque, certes pas très nombreux, mais tout de même très problématiques, correspondent à des établissements de santé qui décident de sortir de leur emprunt toxique et qui sont prêts à y consacrer les crédits nécessaires. Ils demandent à la banque, souvent la SFIL, de leur faire une proposition, mais ils se heurtent à un refus parce que le taux de retournement, le taux de sortie, serait supérieur au taux d’usure.
Pourtant, la réglementation actuelle sur l’usure ne s’applique pas forcément entre deux professionnels. Dans notre domaine, les choses devraient donc être clarifiées pour savoir où placer le curseur, afin que ces opérations puissent être réalisées. Sinon, c’est se priver d’une possibilité de sortie : à partir du moment où un établissement décide d’accepter un effort financier pour sortir de l’emprunt qu’il a contracté, cela devrait pouvoir se faire. Cet argument du taux d’usure a été avancé avant les contentieux, sans décision sur le sujet.
M. le coprésident Pierre Morange. Cette position pourrait être reconsidérée à la faveur d’un rapport de forces plus favorable aux hôpitaux.
M. Matthieu Collette. Absolument. Dans la mesure où ce sont des produits de gré à gré, c’est-à-dire contractés entre deux contreparties, si ces dernières ne sont pas d’accord sur les conditions de sortie du produit, il n’y a pas de possibilité de sortie, contrairement à un produit négocié sur un marché où sont organisées les liquidités.
En clair, si la SFIL, ou une autre banque, donne un argument pour bloquer la négociation, il n’y a aucune possibilité de sortie. D’ailleurs, les collectivités se sont vu conseiller d’attendre que le fonds de soutien soit opérationnel pour que leur soient proposées des cotations. Ainsi, les choses étaient systématiquement repoussées, en dépit d’une volonté claire de « couper les positions ».
En définitive, la discussion n’est pas toujours équilibrée, car même si la collectivité ou le centre hospitalier met le chèque sur la table, si la contrepartie avance un argument pour le refuser, la transaction ne se fera pas…
M. le coprésident Pierre Morange. Votre capacité de négociation pourrait donc être sollicitée, compte tenu de votre compétence technique et de la masse des emprunts que vous suivez. Cela constituerait une sorte d’action pédagogique face à la SFIL et aux autres établissements bancaires.
M. Patrice Chatard. Nous sommes prêts à le faire. Nous le faisons d’ailleurs un peu, mais souvent pour des sorties au cas par cas et avec un nouveau financement derrière : il n’y a pas une approche globale de liquidation de ces produits.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce n’est pas suffisamment organisé et conceptualisé.
M. Patrice Chatard. Tous les jours, nous suivons la valorisation des produits, nous alertons nos clients dès qu’une possibilité de sortie apparaît. Nous avons la difficulté évoquée avec le taux d’usure. Nous en avons une autre puisque, jusqu’à présent, tous les réaménagements au taux variable n’ont pas été acceptés par la SFIL. Or un taux variable peut être un « Euribor trois mois », c’est-à-dire pratiquement le taux de la BCE ; soit aujourd’hui presque rien. Il peut donc être judicieux pour un établissement de santé, qui dépense beaucoup d’argent en pénalités, de sortir d’un produit pour repartir en taux variable indexé sur l’Euribor s’il est très exposé à taux fixe. Mais aucune banque ne veut réaménager les produits structurés sur du taux variable, fût-ce du « Euribor trois mois ».
M. Matthieu Collette. Vous parliez de mutualisation. Une partie du métier de Finance active consiste à essayer de réduire l’asymétrie d’information – nerf de la guerre en économie –, notamment en mutualisant l’information. Quand un de nos clients réussit à réaliser une opération, nous essayons d’en informer les autres, via nos publications, sans forcément nommer l’intéressé. Ensuite, nous suivons les portefeuilles au quotidien et nous envoyons de nombreuses alertes pour que nos clients puissent relancer leur banque, demander des cotations. Cela passe donc par cette mutualisation, même si nous n’allons pas forcément jusqu’à la négociation.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La faiblesse des capacités d’autofinancement des petits hôpitaux vous paraît-elle constituer un handicap dont l’explication se trouverait dans l’application du système de tarification à l’activité ?
M. Patrice Chatard. Cette question dépasse notre champ de compétence. Notre métier est de proposer des plateformes de suivi de la dette et d’accompagner nos clients dans la gestion de cette dette.
M. le coprésident Pierre Morange. Parallèlement à cette logique d’accompagnement, avez-vous une approche d’évaluation du patrimoine hospitalier de vos clients ? Une vision globale serait intéressante pour proposer un plan de sortie pertinent et susceptible de rassurer les établissements bancaires au regard d’un taux fixe raisonnable.
M. Matthieu Collette. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, mais je pense que c’est le futur de notre métier.
M. Patrice Chatard. Nous ne procédons pas à l’analyse du patrimoine immobilier des établissements : ce sont eux qui nous fournissent cet élément. Sur cette base, nous pouvons leur faire des recommandations sur leur programme d’investissement en termes de durée notamment.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. La Cour des comptes propose de permettre l’expérimentation par les trois plus grands centres hospitaliers régionaux de l’émission de billets de trésorerie. Cette proposition vous semble-t-elle pertinente ? Quels seraient les avantages et les inconvénients de ces émissions ?
M. Matthieu Collette. Le décret autorisant plusieurs centres hospitaliers à émettre ce produit a été publié la semaine dernière. Cette possibilité nous semble pertinente. Il ne s’agit pas de dire que les centres hospitaliers doivent se lancer dans une logique de financement de marché. Mais cet outil existe depuis longtemps, il est encadré par la Banque de France, il est transparent, il fonctionne bien et n’engendre pas des coûts de gestion important. Il serait donc dommage de ne pas s’autoriser à l’utiliser. Nous ne pouvons que l’accueillir positivement.
Dans le contexte de taux d’intérêt actuel, cet outil de financement est clairement beaucoup moins cher que les lignes de trésorerie qui peuvent être souscrites auprès des banques – celles-ci se négocient avec des marges entre 150 et 200 points de base sur l’EONIA (Euro overnight index average – taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une échéance d’un jour) sur l’ensemble de l’année 2014 et encore en début d’année. En effet, les dernières statistiques publiées par la Banque de France fin décembre 2014 montrent un taux fixe à un jour négatif, à moins 0,2 % en moyenne, soit, toutes qualités de signature, tous secteurs confondus, entreprises, collectivités locales – dont une vingtaine émettent déjà sur ce marché – et sur douze mois, un taux payé de 0,52 % en moyenne, soit quatre fois moins que la marge appliquée par la banque.
Cette situation est néanmoins conjoncturelle, liée à l’excédent de liquidités – vous parliez des injections d’argent de la BCE. Peut-être les banques pourront-elles demain proposer des crédits de trésorerie moins chers, mais je n’en suis pas sûr, notamment à cause des réglementations qu’elles appliquent – il me semble que les accords de Bâle III ne sont pas totalement appliqués et ne le seront pas forcément entièrement…
M. le coprésident Pierre Morange. Ne faudrait-il pas revisiter les conditions de Bâle III, dans la mesure où la dette publique – qui enfle telle la grenouille de la fable – risque à terme d’engendrer une bulle financière susceptible de fragiliser à nouveau le système ?
M. Matthieu Collette. Les travaux d’analyse financière le montrent clairement : les périodes marquées par des taux extrêmement bas – comme celle que nous connaissons actuellement – sont souvent suivies d’une période de crise financière. C’est un fait historiquement prouvé. Mais je suis incapable de vous dire quels segments de marché seront concernés.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Merci beaucoup, messieurs, de votre éclairage très intéressant.
M. le coprésident Pierre Morange. Messieurs, nous vous remercions.
*
* *
Audition de M. Éric Manoeuvrier, président de la Mission d’accompagnement régionale à la tarification à l’activité (Mission MARTAA), et M. Daniel Le Ray, coordinateur
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Éric Manoeuvrier, président, et à M. Daniel Le Ray, coordinateur de la Mission d’accompagnement régionale à la tarification à l’activité (Mission MARTAA).
La MECSS souhaite faire le point sur l’endettement des centres hospitaliers et sur les difficultés actuelles à financer les investissements. Au cours de nos auditions, nous nous sommes interrogés sur les ressources extérieures dont pouvaient disposer les hôpitaux pour être conseillés dans leur stratégie d’investissement.
Le devoir de conseil des banquiers semble avoir été défaillant compte tenu de la souscription de nombreux emprunts toxiques. Comment mieux armer les établissements hospitaliers pour négocier au mieux avec les banques et prendre les bonnes décisions de financement des investissements ? Dans la formation des équipes de direction, voyez-vous des points à améliorer, notamment sur les aspects de gestion financière ?
Je vous laisse la parole pour nous présenter votre démarche de conseil auprès des établissements et nous livrer votre analyse. Dans un deuxième temps, nous vous poserons des questions pour essayer de trouver des pistes d’amélioration.
M. Éric Manœuvrier, président de la mission d’accompagnement régionale à la tarification à l’activité (MARTAA). Outre mes activités comme président de la mission, je suis directeur des affaires financières et des systèmes d’information au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes.
M. Daniel Le Ray, coordinateur de la mission d’accompagnement régionale à la tarification à l’activité (MARTAA). Outre mes activités comme coordinateur de la mission, je suis adjoint au directeur des affaires financières et des systèmes d’information au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, où je suis également en charge du contrôle interne, comptable et financier, ainsi que de la certification des comptes.
M. Éric Manœuvrier. Notre mission est née en 2005, à l’occasion de la mise en place de la tarification à l’activité (T2A). À la demande des fédérations hospitalières, l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire voulait en effet que les établissements de santé puissent bénéficier de l’appui d’une structure capable de les aider à passer ce cap et à réaliser ce que d’aucuns ont appelé un changement de paradigme. Pour la diffusion du codage, un médecin en charge du département d’information médicale (DIM) travaille ainsi pour la mission à raison d’un demi-équivalent temps plein travaillé. Un contrôleur de gestion aide en outre les établissements de santé, à raison d’un équivalent temps plein travaillé, à parfaire leur maîtrise des nouveaux outils financiers.
Initialement localisée au centre hospitalier de Challans (Vendée), la mission fut recentrée en 2007 au CHU de Nantes. Comme établissement de grande taille, il dispose d’une direction du contrôle de gestion dont l’activité permet de réaliser des économies d’échelle grâce à la mutualisation des compétences. Les axes de travail de la mission sont consignés dans un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) entre le CHU et l’ARS, qui lui apporte son soutien financier. La mission ne jouit pas de la personnalité juridique. Son comité de gestion, qui rassemble les fédérations hospitalières et l’ARS des Pays de la Loire, fait le point régulièrement sur ses activités.
La MARTAA est fondée sur quelques principes simples. Elle assure une veille documentaire, économique et technique au profit des établissements de santé. Son site Internet est un lieu d’information et de conseil. Récemment remodelé, il est très largement consulté, tant au niveau régional que national. La mission apporte des réponses concrètes et immédiates aux demandes des établissements de santé. Ce sont les plus petits qui la sollicitent de préférence, mais une interaction existe aussi avec les établissements plus grands, notamment dans le domaine de la certification des comptes. La mission porte également au niveau national ses travaux en matière de comptabilité analytique.
De manière générale, elle joue un rôle de facilitateur, à l’interface entre l’Agence régionale de santé et les établissements de santé. Jouissant à la fois de la confiance de l’une et des autres, suscitant même leur adhésion, elle réalise un travail que l’Agence régionale de santé n’aurait pu prendre en charge avec ses propres moyens. Elle occupe une position à mi-chemin entre les acteurs de santé et l’autorité de tutelle. Cette absence de démarche hiérarchique se retrouve par exemple dans les dispositifs de politique générale de sécurité des systèmes d’information du domaine de la santé (PGSSI-Santé).
La mission dispose d’une petite équipe relativement étoffée. Forte de presque six équivalents temps plein, elle suit plus de cent cinquante établissements de santé publics et privés. Pour l’heure, seuls les établissements de la Fédération hospitalière de France (FHF) et ceux de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP) participent à cette démarche coopérative. Mais peut-être les établissements de la Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France (FHP) y seront-ils plus intéressés, quand les travaux s’étendront au développement d’un schéma régional d’investissement.
M. le coprésident Pierre Morange. Quand vous évoquez les établissements de la FEHAP, englobez-vous les établissements médico-sociaux ?
M. Éric Manœuvrier. La MARTAA est plus spécifiquement en charge du secteur sanitaire. Mais l’Agence régionale de santé a structuré une mission d’appui régionale au secteur social (MARS) comparable à la MARTAA. Les deux missions coopèrent du reste étroitement et partagent leur personnel. Le délégué régional de la FEHAP s’implique également dans les activités des deux missions.
L’équipe de la MARTAA bénéficie d’un financement négocié avec l’ARS. Il a évolué au fil des années en fonction des différents projets et missions confiés à notre structure. Le budget prévisionnel annuel atteint ainsi environ un demi-million d’euros en 2015, sur lesquels sont financés nos sept axes de travail et de coopération.
M. Daniel Le Ray. L’ARS a souhaité dès le départ que la mission travaille non seulement à la certification, mais aussi à la fiabilisation des comptes, au profit non seulement des six établissements de santé devant faire l’objet d’une certification, mais encore de l’ensemble des soixante établissements du ressort de la mission. Mais le groupe de travail dédié, où chaque établissement envoyait deux représentants, prenait une ampleur trop importante. Aussi un comité restreint a-t-il regroupé deux grands centres hospitaliers et cinq référents départementaux pour chacun des départements de la région des Pays de la Loire. Ce « G7 » se fait ensuite le relais des thématiques et des directions de travail de la mission auprès des établissements qui ne sont pour l’instant pas certifiables.
Les référents régionaux de l’ARS et la direction régionale des finances publiques (DRFIP) participent systématiquement aux réunions trimestrielles de ce groupe de travail restreint, auquel assistent aussi les trésoriers des établissements de santé. Une habitude de mutualisation s’est ainsi créée, qui a pu être étendue à d’autres secteurs d’activité et se prolonger au-delà des deux à trois ans initialement prévus.
Le coût de cette opération se limite à 126 000 euros, car le cabinet d’analyse comptable (CAC) retenu par appel d’offres rend le même service pour les six établissements certifiables qu’il le ferait pour un seul d’entre eux.
M. Éric Manœuvrier. Je précise seulement que les CHU d’Angers et de Nantes ont développé un accompagnement complémentaire au tronc commun proposé. Constitué de référentiels et de fiches techniques partagées, ce dernier sert au développement d’une démarche commune de simplification, devant conduire à la certification des comptes.
M. le coprésident Pierre Morange. Ces 126 000 euros sont-ils inclus dans la dotation du CHU que vous avez évoquée ?
M. Daniel Le Ray. L’idée de départ était de laisser les établissements de santé certifiables prendre en charge le coût de l’opération. Mais l’ARS finance finalement ces 126 000 euros à hauteur de 90 000 euros, les établissements de santé se partageant le reste de la charge, à hauteur de 4 500 euros pour chacun d’entre eux.
Dans le cadre de cette préparation à la certification des comptes, la mission a développé l’outil régional d’accompagnement à la certification des comptes (ORACC). Il a évolué et bénéficie d’un taux élevé de satisfaction des utilisateurs. Il sera repris au niveau national par la direction générale des finances publiques (DGFIP) et par la direction générale de l’offre de soins (DGOS).
La comptabilité analytique hospitalière constitue notre deuxième axe de travail. La DGOS a publié en 2013 une instruction faisant suite à la parution du guide de comptabilité analytique, à l’élaboration duquel la mission avait au demeurant participé en 2011. Dans le fil de cette démarche, l’ARS a chargé la mission de soutenir les établissements de santé (ES) et les établissements de santé privé à but non lucratif (ESPIC) dans leurs efforts pour développer une comptabilité analytique hospitalière fiable et conforme au guide de 2012.
Il aurait été difficile de traiter d’un coup la demande des 79 ES et ESPIC concernés, puisqu’il faut consacrer en moyenne quatorze jours à chaque établissement. Aussi la mission a-t-elle décidé de procéder en trois vagues.
M. le coprésident Pierre Morange. Devons-nous comprendre que votre comptabilité est une comptabilité de type 2, dite de base d’Angers ? Notre mission d’évaluation et de contrôle en préconise depuis longtemps l’usage.
M. Daniel Le Ray. La base d’Angers est un outil qui repose sur la comptabilité analytique. Ses responsables font partie de la MARTAA. Nous avons précisément pour objectif que les 79 établissements participent à terme à la base d’Angers.
M. Éric Manœuvrier. Nous avons cependant pour premier souci que les établissements développent une comptabilité analytique fiable permettant d’établir des comparaisons ou encore un coût par séjour.
M. Daniel Le Ray. La deuxième vague commence cette année sur deux chantiers : la psychiatrie et la tarification à l’activité des soins de suite et de réadaptation (T2A-SSR). La troisième vague aura pour objectif de développer la participation des établissements de santé aux études nationales de coût (ENC) de la médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) ou des SSR (soins de suite et de réadaptation). Une enquête de coûts sera menée en psychiatrie, même si la tarification à l’activité n’est pas encore pratiquée dans ce secteur. Cinq établissements sont aussi déjà engagés dans l’étude nationale de coût concernant les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Notre espoir est de développer une analyse du rapport entre soins et coût qui puisse servir de base à l’évolution de la grille tarifaire.
M. le coprésident Pierre Morange. Bien évidemment !
M. Daniel Le Ray. Dans le cadre de la phase 1, l’ARS a alloué des crédits à 28 établissements pour qu’ils s’outillent, organisent des sessions de formation professionnelle et pour qu’ils recrutent des contrôleurs de gestion partagés, compétents pour plusieurs hôpitaux locaux sur une même zone.
M. Éric Manœuvrier. Dans l’immédiat, la comptabilité analytique hospitalière lève toute suspicion sur la situation des établissements de santé, allant ainsi dans leur intérêt comme dans celui de l’ARS. Car leurs résultats sont ainsi présentés sur une base fiable et objective.
M. Daniel Le Ray. La préparation du passage à la comptabilité analytique ne fonctionne pas seulement avec des crédits de la MARTAA. Les responsables de la base d’Angers travaillent aussi sur ce projet. Un comité technique régional se tient tous les deux mois ; l’ARS y participe.
Le troisième axe de travail de la mission touche de près à l’investissement, puisqu’il s’agit de connaître et de suivre le patrimoine hospitalier. Vous connaissez sans doute les rapports de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur le manque de connaissances du patrimoine hospitalier français.
M. le coprésident Pierre Morange. Lors d’une audition, un directeur d’établissement a même récemment évoqué la nécessité de mener une mission de « spéléologie foncière » ! Plutôt que de rejeter la faute sur le ministère de tutelle, mieux vaudrait accélérer la manœuvre dans ce domaine, car une bonne maîtrise de la question de la dette et du coût du fonctionnement n’est possible qu’à cette condition. C’est pourquoi nous saluons le professionnalisme et le pragmatisme d’une démarche comme la vôtre, qui met au jour les difficultés des ARS à accompagner les établissements de soins.
M. Daniel Le Ray. Disons plutôt que leur champ de responsabilité est si large qu’elles ne peuvent pas tout faire.
M. Éric Manœuvrier. Il faut au demeurant souligner que l’investissement sera bientôt l’un des seuls leviers d’action pour les ARS.
M. Daniel Le Ray. Pour en revenir à notre troisième axe de travail, l’ARS Pays de la Loire s’est portée volontaire pour être région pilote en matière d’utilisation du logiciel OPHELIE (Outil de pilotage du patrimoine hospitalier des établissements de santé, législation-indicateurs-environnement), outil indispensable à la connaissance du patrimoine hospitalier et de ses coûts. Elle a donc chargé la MARTAA, qui avait déjà mené une mission de conseil sur le logiciel précédent dénommé GENEPI, d’accompagner les établissements de santé pour qu’ils apprennent à maîtriser cet outil. À la fin de 2014, ses bases de données sont remplies à 73 % dans notre région, contre 16 % au niveau national. La conjonction d’un accompagnement de la MARTAA et de l’incitation de l’ARS a donc fait ses preuves.
L’ARS exige en effet que les 123 établissements de santé de la région, notamment le CHU de Nantes, ne puissent, à partir du 30 juin 2015, déposer de projet d’investissement qu’à la condition d’avoir rempli au moins le premier socle dans la base OPHELIE.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est le bon sens ! La MECSS avait préconisé dès 2009 une mesure de ce type.
M. Éric Manœuvrier. Cela semble en effet un prérequis pour une véritable définition de l’offre. Car le système d’autorisation en termes de lits paraît atteindre ses limites. Il ressort de mes discussions avec l’ARS que seul un schéma directeur régional permettra une maîtrise des investissements.
M. Daniel Le Ray. Mais la MARTAA travaille aussi, en appui de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), à diffuser l’utilisation du logiciel d’aide à la gestion, ÆLIPCE. L’ARS nous a désigné 23 établissements à accompagner dans leur démarche d’amélioration de leur capacité à mener des audits de leurs projets d’investissements.
Notre quatrième axe de travail porte sur la facturation, en particulier la facturation individuelle des établissements de santé (FIDES).
M. Éric Manœuvrier. L’ARS a constaté en effet une absence totale de pilotage régional en ce domaine. Nous développons donc en ce moment un accompagnement que nous déploierons prochainement.
M. Daniel Le Ray. Depuis dix ans, la MARTAA travaille également à actualiser la formation des « médecins DIM », médecins en charge des départements d’information médicale. L’enjeu actuel est de préparer le passage à la tarification à l’activité des soins de suite et de réadaptation (T2A-SSR).
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Concernant cette tarification à l’activité, certains établissements utilisent-ils des conseils extérieurs pour la facturation et pour le recodage ?
M. Éric Manœuvrier. Oui. C’est le cas par exemple au CHU de Nantes depuis des années. Il s’agit d’une solution intéressante, qui rend le codage plus fiable en vue d’optimiser les recettes.
M. le coprésident Pierre Morange. Mais ce recours à des cabinets n’a-t-il pas fait réfléchir les médecins DIM, qui sont précisément rémunérés pour former à la maîtrise des instruments informatiques ?
M. Éric Manœuvrier. Le recours à des cabinets vise souvent à apporter un soutien direct aux médecins soignants. Dans d’autres cas de figure, il est vrai que l’intervention extérieure pallie certaines défaillances des médecins DIM.
M. Daniel Le Ray. L’ARS nous a demandé d’élargir la formation des médecins DIM, qui sont hélas trop peu nombreux.
M. Éric Manœuvrier. L’informatisation de la production des soins constitue également un enjeu fort. Au CHU de Nantes, nous avons retenu comme opérateur l’entreprise américaine Cerner, qui a développé un logiciel appelé Millenium. À moyen terme, chaque patient devrait disposer d’un dossier interopérable et multimodal. Cette production automatisée des actes et des diagnostics devrait faciliter la production autonome du codage tarifaire.
M. Daniel Le Ray. L’accompagnement à la gestion de trésorerie constitue notre dernier axe de travail. L’ARS s’est rendu compte que les établissements de santé peinaient à en développer une vision prospective, notamment lorsqu’il s’agissait d’établir les plans globaux de financement pluriannuel. L’IGF a publié un rapport sur les besoins en fonds de roulement (BFR) des établissements de santé. Espérons que la tarification à l’activité et la facturation individuelle leur apporteront des facilités dans la gestion de leur trésorerie.
La gestion de dette constitue une nouvelle demande formulée, au cours d’une réunion du conseil d’administration, par le directeur régional de la FHF. Il s’agit de connaître la situation réelle dans la région et d’accompagner les établissements de santé qui ont souscrit des emprunts structurés ou toxiques.
Nous allons commencer par un recensement exhaustif auprès des établissements sanitaires comme médico-sociaux. Il arrive que de tous petits établissements continuent d’évaluer l’évolution de leurs charges financières sans recourir à la notion d’emprunt structuré ou toxique. La MARTAA doit proposer un plan d’action, préconisant l’institution d’un observatoire régional, d’un espace collaboratif dédié et le développement d’outils d’analyse. Peut-être faudra-t-il ouvrir un appel d’offres auprès de prestataires comme Analis, Finance Active ou Riskedge pour apporter la meilleure expertise aux établissements, dont les plus petits ne sauraient mener un audit externe et sécuriser seuls leurs emprunts.
Enfin, la MARTAA participe au comité de veille des emprunts à risque récemment établi par la FHF.
M. Éric Manœuvrier. Pour conclure, je dirais que notre action est très appréciée des établissements de santé, mais aussi de l’ARS, puisqu’elle continue à nous confier des missions. Nous nous interrogeons cependant sur l’évolution de la MARTAA au vu de la prochaine restructuration autour des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Il devrait rester possible d’articuler le travail de missions régionales transversales avec le niveau opérationnel.
M. Daniel Le Ray. Votre audition de M. Gautier Bailly, sous-directeur à la direction du budget au ministère des finances et des comptes publics, a attiré notre attention, car il préconisait une mutualisation accrue, en faisant valoir qu’elle permet de réaliser d’importantes économies. C’est précisément la démarche de la MARTAA, qui joue aujourd’hui un rôle de formateur, de facilitateur, d’accompagnement et de conseil des établissements de santé, mais sans se substituer à eux.
Avec la création des GHT, peut-être pourrait-elle évoluer vers un équivalent d’un centre de gestion agréé ? Cela présenterait des avantages considérables. En tout état de cause, la MARTAA peut être dupliquée dans d’autres régions. La mutualisation d’activités logistiques, administratives, comptables et de ressources humaines mériterait d’être aussi expérimentée.
M. Éric Manœuvrier. Je tiens cependant à ajouter que la MARTAA fonctionne sur la base du principe de subsidiarité qui respecte l’autonomie de gestion des établissements. Selon les sujets, il faut donc réfléchir au niveau le plus adéquat de coopération : local, départemental (GHT) ou régional.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous déjà chiffré les économies dégagées par la mutualisation ? La MECSS la préconise depuis dix ans. Notre collègue Gérard Bapt préside par ailleurs un groupe d’études sur la santé et le numérique.
La généralisation des bonnes pratiques, au titre de l’ANAP ou de la MARTAA, dépend des autorités de tutelle qui doivent les décliner sur l’ensemble des territoires. Avez-vous déjà réalisé quelques simulations ? Il faudrait mettre au point un argumentaire identifiable sur la pertinence du dispositif. Cela pourrait aider l’exécutif à accélérer la manœuvre.
M. Éric Manœuvrier. Sur les missions qui nous ont déjà été confiées, des gains de productivité et des économies ont sans conteste été dégagés, qu’il s’agisse de la préparation à la certification des comptes ou de la mise en place de la comptabilité économique. Des démarchées séparées de chaque établissement auraient été beaucoup plus onéreuses.
Pour l’avenir, nous réfléchissons à développer une offre de services auprès des GHT, en chiffrant à l’appui les gains d’opportunité à en attendre. Cette offre pourrait couvrir les systèmes d’information, la logistique, l’administration, la gestion financière, dont la dette… Nous devrions pouvoir présenter, pour chacun de ces domaines, un bilan coûts-avantages d’une mutualisation qui fasse l’économie d’un recours à un cabinet d’audit externe. La CHT44, communauté hospitalière de territoire de Loire-Atlantique, a ainsi déjà mandaté le groupement de coopération sanitaire (GCS) e-Santé pour développer un plan d’informatisation unique pour le futur GHT.
M. le coprésident Pierre Morange. Il importe en effet de mettre en valeur, au travers d’estimations, la valeur ajoutée d’une mutualisation qui pourrait s’étendre jusqu’aux ressources humaines.
M. Éric Manœuvrier. En Loire-Atlantique, si on fusionnait les fonctions support de l’ensemble des établissements, cela correspondrait seulement à un pôle supplémentaire de plus à gérer pour le CHU de Nantes, autant dire proportionnellement assez peu. Mais les gains seraient importants, puisque l’essentiel des effectifs dévolus à la gestion des ressources humaines dans les autres établissements pourraient être redéployés.
M. Daniel Le Ray. Les directions des affaires financières des établissements de santé ont déjà compris que la centralisation des fonctions financières apporterait également des retours sur investissement. Peut-être leur réflexion est-elle due aux résultats apportés par la MARTAA. Elle a du moins le mérite de faire naître des habitudes de travail en commun entre les établissements de santé, sur des sujets transversaux.
M. Éric Manœuvrier. Ce n’est d’ailleurs pas simplement dans l’air du temps, c’est aussi devenu une contrainte incontournable si l’on veut tenir le plan triennal, car les sources d’économie sont de moins en moins nombreuses. Depuis quinze ans, le secteur privé a procédé à de nombreux regroupements, par exemple au sein de holdings. Des freins subsistaient à ce mouvement dans le secteur public, mais il faut les débloquer.
M. le coprésident Pierre Morange. Englobez-vous aussi le secteur médico-social dans cette réflexion ?
M. Daniel Le Ray. Assurément. Plus récente, la MARS des Pays de la Loire prend le relais dans ce secteur, comme vous l’a exposé tout à l’heure mon collègue. Car l’ARS a préféré créer une mission spécifique, plutôt qu’ajouter simplement un volet médico-social aux missions de la MARTAA. Il n’en demeure pas moins que ce sont les mêmes administrateurs et les mêmes participants qui sont présents dans les deux missions régionales.
Dans le cadre du chantier OPHÉLIE/SRIS (schéma régional d’investissement en santé), l’ARS a mandaté la MARTAA pour travailler avec les établissements médico-sociaux. Il devrait en sortir une version 2 d’OPHÉLIE.
M. Éric Manœuvrier. En bémol, je soulignerais cependant combien le secteur est éclaté. De l’aveu même des autorités de tutelle, les connaissances sont disparates quant au suivi des coûts des établissements médico-sociaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans l’un des précédents rapports de la MECSS, notre collègue Martine Carrillon-Couvreur concluait en effet à une notable insuffisance de l’information sur leurs coûts de fonctionnement.
M. Daniel Le Ray. Grâce à l’emploi de contrôleurs de gestion partagés par moitié entre la MARTAA et la MARS, des tableaux de bord médico-sociaux ont pu être établis. À terme, les états financiers des établissements médico-sociaux devraient également pouvoir être fiabilisés.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Quelle est la part des conseils départementaux dans cette démarche ? Les prix de journée sont en effet définis en concertation avec eux.
M. Daniel Le Ray. La MARS les intègre nécessairement dans son organisation.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Pour en revenir à la situation financière plus générale, quel constat dressez-vous sur les conditions de financement des établissements de votre région ? Estimez-vous que les hôpitaux publics aient maintenant un accès convenable aux ressources leur permettant de financer leurs investissements nécessaires aujourd’hui, en termes de volumes et de coût financier ?
Sur les trente milliards d’euros de dette globale, les emprunts structurés ne représentent qu’une faible part. Comment les établissements qui en ont souscrits peuvent-ils cependant continuer d’investir ?
M. Éric Manœuvrier. Quant à l’accès au financement externe des établissements sur le marché bancaire, il faut, d’une part, relever une amélioration par rapport à la raréfaction de crédits connue en 2008-2009. Les analystes financiers sont certes plus restrictifs aujourd’hui, car les banques font plus attention à la situation réelle des établissements qui envisagent d’emprunter. Mais l’étau du crédit s’est desserré, malgré une prudence accrue. D’autre part, les établissements jouissant d’une bonne santé financière et pouvant fournir des indicateurs et des ratios corrects n’ont pas de difficulté pour emprunter. Ainsi, le CHU de Nantes emprunte sans difficulté au vu de ses indicateurs et de la masse globale de son budget. Mais la situation s’apprécie naturellement de manière particulière à chaque établissement.
M. Daniel Le Ray. La question du financement se pose en effet surtout pour les établissements de taille petite et moyenne, notamment pour ceux qui vont bientôt passer à la tarification à l’activité (T2A). Le modèle T2A-SSR serait cependant plus favorable aux établissements que le modèle T2A retenu pour le secteur MCO (T2A-MCO). Grâce à la notion de socle, les charges fixes pourraient être prises en compte dans la tarification, par exemple les charges d’emprunt. Cela représenterait un progrès par rapport à l’actuelle facturation selon les groupes homogènes de séjour (GHS), en permettant une meilleure prise en compte de la notion d’investissement. Encore faut-il espérer que la grille tarifaire soit plus stable pour la T2A-SSR que pour la T2A-MCO. Adoptée il y a dix ans, cette dernière a connu depuis cette date non moins de vingt versions différentes.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. S’agissant des emprunts structurés, le fonds de soutien en faveur des établissements publics de santé vous semble-t-il suffisamment doté ? L’on sait que le rachat de dette structurée peut aussi coûter très cher.
M. Daniel Le Ray. Les agents de la MARTAA ont rencontré à ce sujet des experts de la gestion financière, appartenant à Analis, Finance Active ou Riskedge. La dotation du fonds ne paraît pas suffisante, mais les établissements ont surtout besoin de davantage de souplesse et de temps. Il s’agit d’une décision politique, mais la renégociation paraît juridiquement difficile. Elle conduit parfois à souscrire d’autres engagements pour couvrir les premiers, générant ainsi une nouvelle dette pour rembourser la dette antérieure. S’agissant des emprunts structurés, il faut reconnaître au demeurant la double responsabilité des établissements de santé et des banques.
Ces dernières s’en tirent à bon compte quand le fonds de soutien intervient. Certaines banques ont pourtant commencé à partager avec les établissements de santé les coûts d’un refinancement, mais ce n’est le cas ni de Dexia ni de la Société de financement local (SFIL).
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons conduit une audition des banques, dont Dexia qui a fait l’objet d’échos médiatiques. Il revient à l’Assemblée nationale d’exercer une pression morale sur les banques pour s’efforcer de faire évoluer les choses. Le sujet majeur est naturellement celui des primes de sortie. Nous ne voulons pas que les établissements de santé en paient ! Grâce à la politique monétaire dynamique de la Banque centrale européenne, le coût de l’argent a suffisamment baissé pour que les banques puissent proposer des solutions sans pratiquer de prix confiscatoire. Seriez-vous vous-même en mesure de porter des contentieux avec les banques ?
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. En vérité, les banques n’ont pris aucun risque.
M. Daniel Le Ray. Seulement 40 établissements de santé ont sollicité le fonds de soutien à ce jour. Ils nourrissent surtout la crainte d’être abusés une seconde fois. Dans la région Pays de la Loire, l’ARS ne veut pas de contentieux. Mais certains petits établissements de santé présentent un compte d’exploitation en déficit du fait du remboursement d’emprunts structurés. Il n’y a de risque de contentieux que pour l’un d’entre eux.
M. Éric Manœuvrier. D’une manière générale, les établissements de santé eux-mêmes ne souhaitent pas de contentieux. L’ARS déconseille la démarche et préconise plutôt la renégociation. Si une action de groupe (class action) devait être introduite, le CHU de Nantes serait prêt à se joindre à une démarche collective concertée, plutôt que d’entreprendre une démarche individuelle. Car nous voulons tout de même conserver de bonnes relations avec les établissements bancaires.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est le statut juridique de la MARTAA ? N’avez-vous pas songé à l’organiser sous la forme d’une association ?
M. Éric Manœuvrier. Son existence repose sur une convention entre les fédérations hospitalières et l’ARS, mais elle est dépourvue de la personnalité juridique. Peut-être pourrait-elle cependant devenir à terme une structure ad hoc.
M. le coprésident Pierre Morange. Puisque la mission travaille sur fonds publics, il serait sans doute plus transparent qu’elle constitue une structure juridique propre. Une construction juridique, même a minima, pourrait lui donner une crédibilité supplémentaire.
M. Éric Manœuvrier. Les GCS (groupements de coopération sanitaire) e-Santé disposent d’une structure juridique dont nous pourrions nous inspirer.
M. Daniel Le Ray. La question du statut juridique de la mission est en effet souvent abordée lorsque nous présentons ses travaux.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Merci beaucoup, messieurs, pour vos interventions.
*
* *
Audition de M. Richard Boutet, directeur du pôle Banques des particuliers et des entreprises, Affaires publiques France de la Fédération bancaire française (FBF), Mme Véronique Lofaso, responsable Secteur public et économie sociale du Crédit Agricole SA, Mme Ivelina Venchiarutti, responsable Dossiers complexes du Crédit Agricole corporate & investment bank, M. Cédric Mignon, directeur du développement des Caisses d’Épargne, et M. Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du marché Secteur public et PPP du Groupe BPCE, M. Pierre Vérot, directeur de la gestion de l’encours de Dexia crédit local, M. Jean-Pierre Rosello, directeur des marchés de l’économie publique de la Société Générale, M. Olivier Grimberg, directeur de la médiation, et M. Lionel Guineton, directeur de l’ingénierie financière de la Société de financement local (SFIL)
M. le coprésident Pierre Morange. Gisèle Biémouret, coprésidente de la MECSS et rapporteure de la mission sur la dette des établissements publics de santé, et moi-même souhaitons la bienvenue aux représentants des différentes institutions et structures bancaires qui nous ont fait le plaisir de répondre à cette deuxième invitation.
Il avait été prévu, à l’issue d’une première table ronde le 27 janvier dernier, d’établir un bilan de la progression des renégociations de la dette toxique des hôpitaux publics. Nous ne pouvons que regretter que les banques étrangères aient décliné l’invitation, soit qu’elles aient considéré qu’elles n’étaient pas concernées, soit qu’elles aient refusé de répondre au téléphone ou aux courriers – je pense particulièrement à la banque HSBC : nous saurons nous en souvenir.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Je remercie nos invités d’être présents après notre rencontre du 27 janvier dernier, car des évolutions ont été constatées entre-temps : l’État a élargi le périmètre et le montant du fonds de soutien aux établissements de santé ; en revanche, le déplafonnement du franc suisse a eu d’importantes conséquences pour certains établissements.
M. Richard Boutet, directeur du pôle Banques des particuliers et des entreprises, Affaires publiques France de la Fédération bancaire française (FBF). La Fédération bancaire française a été entendue par votre mission une première fois au mois de janvier dernier. Nous avons pu alors vous exposer la double problématique de la situation financière des hôpitaux, celle de l’endettement et celle du financement, les hôpitaux ayant besoin de financements importants dans un contexte d’allocation budgétaire sous forte contrainte. Nous avions pu alors également vous expliquer que, depuis la crise, les établissements de crédit se sont encore plus rapprochés de leurs clients, y compris ceux du secteur public, pour trouver des solutions adaptées en prenant en compte également les contraintes réglementaires nouvelles pesant sur l’activité bancaire. Aujourd’hui, la mobilisation des banques pour proposer aux hôpitaux concernés de les « désintoxiquer » des emprunts structurés qu’ils ont souscrits est toujours aussi forte. Nous espérons que cela sera pris en compte par les députés membres de la mission, de même que l’effort constant des banques pour trouver des solutions acceptables par toutes les parties à ces situations financières difficiles pour les quelques hôpitaux concernés.
Il convient en effet de rappeler que, à notre connaissance, le nombre d’hôpitaux publics concernés par ce type de situation est très réduit. Au regard de l’ensemble des hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, les encours les plus risqués sont concentrés sur un nombre très limité d’établissements, seuls quelques-uns d’entre eux ayant décidé, dans le cadre de leur gouvernance publique, d’avoir recours à ces produits financiers. Il n’a donc pas existé, à notre connaissance, de politique générale de la part des banques françaises pour commercialiser ce type de produits auprès de l’ensemble des hôpitaux.
Pour évaluer plus justement la situation financière des hôpitaux publics, il faut se référer aux études de la Cour des comptes, notamment à la communication intitulée La dette des établissements publics de santé, publiée au mois d’avril 2014. La Cour explique que la responsabilité de ces emprunts risqués est partagée par les pouvoirs publics qui portent la responsabilité au premier chef puisqu’ils ont privilégié le levier de la dette pour financer un plus grand nombre d’opérations sans avoir instauré de procédure de choix rigoureux des investissements, tout en allégeant leur contrôle sur la nature et le montant des emprunts souscrits.
Toujours selon la Cour des comptes, les gestionnaires hospitaliers ne sont pas non plus sans responsabilités, l’argent de la dette a pu leur paraître un argent facile dans un contexte réglementaire permissif et dans un climat de concurrence entre les établissements bancaires qui a favorisé le développement d’offres de crédits structurés dont les risques considérables ne sont apparus qu’ensuite.
La Cour des comptes n’incrimine donc pas les banques comme seules responsables de cette situation, mais insiste sur une responsabilité partagée entre les différents acteurs, aggravée par les modalités de gouvernance des hôpitaux publics.
Par ailleurs, depuis la précédente table ronde, le fonds de soutien des établissements publics de santé a été créé par la circulaire interministérielle du mois de décembre 2014. Il était alors doté de 100 millions d’euros sur trois ans, financés pour l’essentiel sur fonds publics et pour une partie par une contribution volontaire de la SFIL et de Dexia. Ce montant a depuis été quadruplé. En effet, le 24 février dernier, le Gouvernement a annoncé, sans aucune concertation préalable avec les institutions bancaires, sa décision d’augmenter de 300 millions d’euros les sommes mobilisables au titre des dispositifs d’aide aux hôpitaux ayant contracté des emprunts structurés, cette somme étant intégralement financée par la seule contribution des banques. Cette décision est en totale contradiction, d’une part, avec le fonds de soutien pour les hôpitaux tel qu’il avait été décidé à l’origine, puisqu’il était essentiellement pris en charge par les pouvoirs publics, et, d’autre part, avec le fonds destiné aux collectivités territoriales financé par les banques et l’État à parts égales.
Ce choix de faire porter sur les banques la totalité du financement du relèvement du montant des fonds pour les hôpitaux est donc étonnant et incohérent, sachant que la responsabilité est partagée par les pouvoirs publics et les gestionnaires hospitaliers et les quelques établissements ayant souscrit ces produits. La profession a fait part de ces remarques aux pouvoirs publics. C’est donc dans ce contexte que la FBF et les établissements bancaires répondent à nouveau à votre invitation. Nous serons bien entendu à l’écoute du bilan de vos travaux et sommes prêts à faire avec vous le point des évolutions intervenues depuis la dernière table ronde.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous savons gré de cette volonté de communication dont nous avons pris acte, même si, dans mon propos liminaire, j’ai dû rappeler l’attitude assez insultante de la HSBC vis-à-vis de la représentation nationale.
Mme Véronique Lofaso, responsable Secteur public et économie sociale du Crédit Agricole SA. Nous répondons volontiers à votre sollicitation qui est bien naturelle, même si le Crédit Agricole est très peu impliqué dans cette situation. C’est pour cela qu’il serait intéressant pour nous que vous puissiez nous faire part des informations qui ont pu vous parvenir afin que nous ayons une vue plus précise et que nous puissions établir une comparaison avec notre activité.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Monsieur Boutet, vous avez souligné que tous les établissements bancaires n’avaient pas proposé ces prêts structurés. Au fil des auditions, je me suis en effet rendu compte qu’il serait trop simple de faire porter toute la responsabilité sur les établissements bancaires : la chaîne de responsabilité va de l’État à ces établissements, et j’ai par ailleurs observé une forte localisation des prêts structurés. Cependant, au moment où les établissements bancaires concernés ont proposé ces prêts toxiques, étaient-ils ou non au fait des conséquences potentielles des prêts qu’ils commercialisaient ? Je comprends que les chefs d’établissements hospitaliers y aient vu un intérêt, puisque, au départ, les taux de remboursement étaient très bas. Chacun sait que les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers ne vont pas être déclarées en faillite du jour au lendemain : aussi le risque était-il moindre pour les banques qui leur proposaient des prêts potentiellement dangereux.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avions souhaité avoir des indications au sujet du taux indicatif des indemnités de remboursement anticipé (IRA) des prêts. La BPCE ne nous les a pas communiqués, alors qu’il s’agit du nœud du problème.
M. Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du marché Secteur public et partenariats public-privé du Groupe BPCE. C’est une information que nous ne communiquons pas.
M. le coprésident Pierre Morange. Les autres banques interrogées l’ont communiquée…
M. Jean-Sylvain Ruggiu. C’est leur interprétation de la loi. Cela relève de nos services juridiques : je ne suis pas compétent pour vous répondre.
M. le coprésident Pierre Morange. Les services juridiques des autres banques n’ont pas la même conception de la confidentialité commerciale, ce qui, vous le comprendrez, nous rend perplexes quant à la solidité de votre argumentation.
M. Jean-Sylvain Ruggiu. Il peut y avoir des écarts entre banques dans les analyses de leurs services juridiques.
M. le coprésident Pierre Morange. L’explication est un peu courte, vous l’admettrez, et vous comprendrez qu’elle ne nous satisfasse pas entièrement.
M. Jean-Sylvain Ruggiu. Je le comprends.
M. le coprésident Pierre Morange. La dette des hôpitaux est pour nous un grave sujet de préoccupation, particulièrement pour cette fraction – certes marginale au regard du montant global de la dette hospitalière de 30 milliards d’euros – constituée par les prêts dits toxiques, c’est-à-dire hors charte Gissler, les plus instables. Au-delà de la coresponsabilité évoquée par M. Boutet, nous aboutissons à la situation suivante : ces établissements, qui portent la responsabilité d’avoir engagé les deniers publics dans des emprunts fondés sur la spéculation financière – dont j’observe que les banques se sont retirées à temps –, se trouvent piégés par la soulte, les pénalités de sortie. Ils sont ainsi confrontés à un mécanisme qui bloque la possibilité de purger ces prêts toxiques. Quelle est l’analyse de la BPCE à ce sujet ?
M. Jean-Sylvain Ruggiu. J’observe que, pour secourir les collectivités territoriales, l’État a recouru à une loi de validation – dont le dispositif doit d’ailleurs être complété –, alors que, pour les établissements de santé, il a créé un fonds de soutien qui est financé aux deux tiers par les établissements bancaires.
M. le coprésident Pierre Morange. Le fonds de soutien a été constitué sur initiative publique et intervient dans une situation qui, certes, relève du droit privé, mais concerne des établissements de santé et les enferme dans une dette liée à des emprunts toxiques dont, je le répète, les banques se sont retirées à cause de l’extrême instabilité qui les caractérise.
Lors de l’audition précédente où nous avions eu le plaisir de vous accueillir, j’avais indiqué que les établissements de crédit connaissent aujourd’hui une situation favorable, puisque les taux pratiqués par la Banque centrale européenne (BCE) sont singulièrement attractifs et que, au sortir de la crise internationale de 2008, ils ont bénéficié d’apports financiers massifs, à tel point que le système bancaire français a pu s’autoriser à absorber une part substantielle de la dette toxique d’un pays ami, la Grèce. À l’époque, la place bancaire s’était vue renflouer par la richesse nationale, produite par le travail des Français.
On aurait donc pu imaginer que, au-delà de leur tribut au fonds de soutien
– initialement alimenté principalement par la prospérité nationale –, les banques apportent une contribution particulière pour secourir les établissements de santé que les pénalités à payer prévues dans les contrats de prêt empêchent de sortir du piège des emprunts toxiques.
M. Jean-Sylvain Ruggiu. Je laisserai la FBF répondre au sujet de la position des banques sur le fonds de soutien. À ma connaissance, un quart est fourni par l’État et la SFIL, les trois autres quarts par les banques.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous ne répondez pas à ma question. Les ressources du fonds de soutien ne sont pas à la hauteur des enjeux. Je rappelle que le volume des emprunts hospitaliers a été multiplié par trois en dix ans. Il est en partie composé de prêts toxiques qui se sont majorés du fait du déplafonnement de la parité du franc helvétique. Je rappelle que, pour le Crédit Agricole, le taux moyen des pénalités de sortie s’élève à 24 millions d’euros ; pour Dexia, aux alentours de 79 millions ; pour la SFIL, à 617 millions ; le Groupe BPCE ne communique pas ces chiffres et la Société Générale ne se trouve pas dans ce cas. La BPCE conduit-elle toutefois une réflexion pour permettre à un nombre limité d’établissements hospitaliers de sortir de cette prise d’otage bancaire en envisageant l’annulation de la soulte ? Cela pourrait éventuellement se fonder sur l’octroi de prêts à taux fixes restant à définir. Les banques pourraient jouer sur le différentiel résultant de la possibilité dont elles disposent d’emprunter auprès de la BCE à des taux quasi nuls, voire négatifs. Elles auraient ainsi la possibilité de dégager des marges de rentabilité et de ne pas tuer la « poule aux œufs d’or ».
M. Jean-Sylvain Ruggiu. La BPCE travaille depuis presque quatre ans avec les hôpitaux, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), l’État et les Agences régionales de santé (ARS) afin de tuer l’ensemble de ces produits. Depuis le début de l’année, nous avons encore pratiqué une désensibilisation partielle et nous avons définitivement sorti un des produits du dispositif. Nous vous avons communiqué les taux moyens qu’acquittent les établissements hospitaliers par tranches de risque. La quasi-totalité de nos dossiers est sécurisée. Nous travaillons depuis toujours avec les hôpitaux et nous allons continuer de le faire. Vous avez eu communication de l’encours, qui est de 355 millions d’euros, à mettre en regard des 7 milliards d’euros que le Groupe BPCE a accordés – et continue d’accorder chaque année – au secteur public hospitalier, ainsi que des lignes de trésorerie, ce que peu de banques font. Ce travail facilitera certainement la sortie des cas les plus critiques. Dans le cadre du fonds de soutien, pour les collectivités territoriales comme pour le secteur public hospitalier, il est toutefois demandé un protocole transactionnel au sens du code civil afin que chacun puisse s’y retrouver.
M. le coprésident Pierre Morange. On pourrait imaginer, en mettant en parallèle les masses financières engagées et la modicité de l’IRA, que les banques annulent la pénalité de sortie et reviennent à un taux fixe, bien évidemment supérieur à ceux pratiqués actuellement, mais qui serait rentable pour elles tout en permettant aux quelques établissements de soins concernés de ne plus être asphyxié.
M. Jean-Sylvain Ruggiu. Sur ce point, je laisse la FBF répondre.
M. Richard Boutet. J’imagine que ce sera l’une des propositions du rapport…
M. le coprésident Pierre Morange. Nous aurons à cœur de lui donner la résonance médiatique qu’elle mérite en recourant à la multiplicité des structures représentatives
– fédérations, associations, syndicats –, pour qu’elle revête toute la légitimité nécessaire.
M. Jean-Pierre Rosello, directeur des marchés de l’économie publique de la Société Générale. Nous avons 2,4 milliards d’euros d’encours dont 50 millions sont concernés par les emprunts structurés pour douze opérations et dix établissements. Nous sommes très peu impliqués dans ces emprunts difficiles et n’avons pas d’emprunts hors charte Gissler. Comme nos collègues, nous misons sur la sortie de ces emprunts la plus rapide possible. Notre objectif est de proposer aux hôpitaux concernés le retour aux taux fixes qu’ils auraient pu contracter à l’origine du produit structuré. En trois ans, nous avons désensibilisé un montant de 273 millions d’euros, en partie en revenant aux taux fixes d’origine, et en partie – pour une centaine de millions d’euros – en revenant à des taux variables moins sensibles.
Je confirme que, comme l’ensemble des banques, la Société Générale participe au fonds de soutien, aussi bien celui des collectivités territoriales que celui destiné aux établissements publics de santé. Cette participation est fondée sur une taxe de risque systémique prenant en compte la totalité du bilan et des fonds propres. Notre participation nous semble assez importante au regard de l’encours que nous avons à gérer en termes de produits sensibles. Au demeurant, nous sommes solidaires des autres établissements bancaires pour participer à ce fonds de soutien et trouver des solutions le plus rapidement possible.
Il serait toutefois utile que tous les acteurs aient la même démarche économique. La désensibilisation n’implique pas seulement des efforts de la part des banques, mais de la compréhension et des efforts du côté des structures concernées. Il n’est pas rare que certains de nos interlocuteurs, adoptant une posture rigide, refusent le taux fixe d’origine et les produits désensibilisés que nous leur proposons.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous en donnons acte. Nous avons par ailleurs observé que Dexia n’a pas répondu à la question portant sur la nature de ses efforts pour sortir les hôpitaux des emprunts toxiques. Malgré les propositions que vous faites dans une dynamique proactive pour sortir par le haut de situations de blocage, c’est, dans certains cas, la pénalité de remboursement anticipé qui emprisonne les établissements publics concernés. C’est la raison pour laquelle nous insistons sur le sujet, tout en reconnaissant que la Société Générale ne se trouve pas dans ce cas de figure.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Il nous a parfois été indiqué que la négociation d’un accord de désensibilisation est difficile, car les taux de retournement fixes qui pourraient être proposés à la sortie des emprunts toxiques conduiraient à des niveaux de taux d’intérêt supérieurs à l’usure. Avez-vous été confronté à ce problème et, le cas échéant, quelle solution pensez-vous pouvoir y apporter ?
M. Jean-Pierre Rosello. Nous n’avons pas eu à connaître de telles situations. Il est vrai que, lorsque l’on propose comme base de négociation le taux fixe, il doit souvent s’avérer supérieur au taux d’usure actuel. C’est là une configuration de taux tout à fait exceptionnelle à laquelle s’ajoute l’intervention de la Banque centrale européenne qui « inonde » le marché de liquidités et crée ce type de situation. Nous maintenons cependant nos propositions de taux fixe, car il nous semble juste de renvoyer à une renégociation et de repartir de la situation d’origine. Je n’ai donc pas de réponse particulière à apporter à cette question qui est aussi posée au fonds de soutien, que nous avons interrogé sur sa doctrine.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans le contexte actuel d’octroi de prêts à taux fixe, l’application du taux usuraire justifierait que les banques absorbent la fameuse pénalité de sortie, dont le montant apparaît dérisoire face à l’importance des prêts consentis. Ce geste permettrait de sortir de cette situation détestable.
Comment la SFIL, principal acteur concerné en termes de volumes d’emprunts toxiques, analyse-t-elle la situation ?
M. Olivier Grimberg, directeur de la médiation à la SFIL. Retenu par d’autres impératifs, notre président M. Philippe Mills vous prie de bien vouloir accepter ses excuses ; il aurait été ravi de répondre à vos questions.
Banque publique détenue par l’État français à hauteur de 75 %, la SFIL est un établissement à part dont une des missions consiste à désensibiliser les crédits sensibles. À la création de la SFIL, en février 2013, nous avons ainsi récupéré 8,5 milliards d’euros de crédits sensibles de Dexia, dont 1,3 milliard concernait les établissements publics de santé. La SFIL a défini, avec l’État, une politique de désensibilisation : il s’agit de transformer ces crédits sensibles en crédits à taux fixe, supprimant l’aléa financier sur toute la durée des prêts. Depuis, nous avons réussi à réduire d’à peu près un tiers l’encours de crédits sensibles des établissements publics de santé : trente-deux d’entre eux ont été totalement désensibilisés et bénéficient désormais de taux fixes avec SFIL/Caisse française de financement local (CAFFIL) ; une centaine gardent des crédits sensibles à hauteur de 900 millions d’euros et doivent encore faire l’objet d’une désensibilisation.
Pour transformer les crédits des établissements publics de santé en crédits à taux fixe, la SFIL consent d’importants efforts. Ainsi, comme nous parvenons, sur les marchés financiers, à obtenir des taux proches de ceux que l’on offre à l’État français, nous apportons aux hôpitaux de la liquidité à prix coûtant, en les faisant bénéficier d’un taux fixe de 1,20 % sur quinze ans. Ces ressources permettent aux établissements publics de santé de financer leurs investissements ou une partie des indemnités liées aux crédits sensibles. Pour la SFIL, fournir de la liquidité à prix coûtant représente une perte d’opportunité d’environ 70 millions d’euros, dont une vingtaine de dossiers concernent les établissements publics de santé et le reste, les collectivités territoriales.
Deuxième effort : en attendant la mise en place du dispositif d’aide, nous avons soutenu les établissements les plus fragiles, petits hôpitaux à surface financière et budgétaire limitée, notamment touchés par les crédits sensibles indexés sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse. Nous avons procédé à des abandons de créances, leur faisant payer un taux de 6 % au lieu du taux contractuel qui se situait entre 10 et 15 % avant le choc du 15 janvier 2015. Cette opération a coûté à peu près 26 millions d’euros à la SFIL, dont 5 millions pour les hôpitaux.
Enfin, la SFIL a contribué à hauteur de 18 millions d’euros au premier dispositif d’aide à l’attention des établissements publics de santé, dont le montant total s’élevait à 100 millions. Nous ne connaissons pas encore les sommes qui seront demandées à la SFIL pour les 300 millions supplémentaires ni les modalités de sa future contribution.
Dans les prochains mois, nous continuerons à œuvrer à la désensibilisation des hôpitaux. Le dispositif d’aide permettra aux établissements les plus fragiles, touchés par les crédits les plus compliqués – notamment ceux indexés sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse –, de s’en débarrasser.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous venez de formuler un espoir de sortie de crise ! Sur la centaine d’établissements encore porteurs de 900 millions d’euros de crédits sensibles, quelle fraction pensez-vous pouvoir sortir de cette situation d’ici à la fin de l’année, et pour quel montant ?
M. Olivier Grimberg. Cela dépendra des délais de versement du deuxième dispositif d’aide, qui sera crucial pour la désensibilisation de la trentaine d’établissements touchés par l’envolée du franc suisse, dont le cas est le plus compliqué. Si les aides sont versées fin 2015 ou début 2016, nous espérons en désensibiliser une bonne partie. Pour les autres, il faut continuer à faire œuvre de pédagogie. En effet, il y a encore des établissements publics de santé qui détiennent des crédits sensibles, mais qui ne paient pas de taux dégradés, voire qui paient des taux très bas. Malgré l’aléa financier inhérent à leurs crédits, ces établissements se montrent réticents à les transformer en crédits à taux fixe – certes un peu plus élevé que ceux dont ils bénéficient aujourd’hui, mais dépourvu d’aléa. Nous avons déjà convaincu une bonne partie de ces établissements, mais il faut continuer à inciter les autres, dans les prochains mois, à purger leurs crédits sensibles et à rendre leur dette la plus prévisible et la moins variable possible. Si l’État – à travers le ministère, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) ou les agences régionales de santé (ARS) – pouvait appuyer notre effort de pédagogie, cela aiderait la SFIL dans sa tâche.
M. le coprésident Pierre Morange. Reprenons les chiffres. Une centaine d’hôpitaux détiennent encore quelque 900 millions d’euros de crédits sensibles. Une trentaine d’entre eux sont concernés par le problème du déplafonnement du franc helvétique ; à combien s’élèvent leurs crédits ?
M. Olivier Grimberg. À 200 millions d’euros environ.
M. le coprésident Pierre Morange. Une grande partie des quelque soixante-dix établissements de soins restants seraient susceptibles de reprendre un taux fixe pour sortir de cet aléa financier. Combien d’hôpitaux se retrouveraient dans cette philosophie ? Trente ou quarante ?
M. Olivier Grimberg. Sur les trente établissements dont les crédits sont liés au franc suisse, vingt-cinq sont éligibles au premier dispositif d’aide ; quand il sera débloqué, nous pourrons donc les désensibiliser. Nous verrons ensuite si les cinq hôpitaux restants peuvent bénéficier de la deuxième vague du dispositif. Enfin, nous espérons désensibiliser au moins la moitié des soixante-dix hôpitaux restants d’ici à 2016.
M. le coprésident Pierre Morange. À quel encours cela correspond-il ?
M. Olivier Grimberg. Il restera quelque 250 millions d’euros.
Tels sont nos objectifs, mais les hôpitaux doivent également faire un effort.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous ferons nous aussi de la pédagogie !
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Vous avez choisi de soutenir les petits hôpitaux ; mais des centres hospitaliers universitaires (CHU) rencontrent également des problèmes importants. Ne devraient-ils pas, eux aussi, bénéficier d’aides ?
M. Olivier Grimberg. En effet, certains CHU et gros hôpitaux sont touchés par ces prêts euro/CHF, mais ils profitent de la liquidité à prix coûtant que nous leur apportons s’ils ont besoin de financer des investissements. Pour les petits hôpitaux, ce paramètre joue moins, car, en général, ils n’ont pas beaucoup d’investissements ni de financements à faire. C’est pourquoi le conseil d’administration de la SFIL a fait ce choix.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Y a-t-il eu, ces derniers temps, des décisions importantes en matière de recours contentieux ?
M. Olivier Grimberg. Les contentieux avec les hôpitaux sont bien moins nombreux qu’avec les collectivités locales – la SFIL est ainsi concernée par dix contentieux avec des établissements de santé et un avec un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – et ils n’ont fait l’objet d’aucune décision de justice. Les dernières décisions ont été rendues en février 2013 par le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre dans l’affaire qui a opposé Dexia et SFIL/CAFFIL au conseil général de la Seine-Saint-Denis. Elles portaient sur la question du taux effectif global (TEG) ; mais une loi de validation est intervenue en 2014. Depuis, le TGI n’a pas pris d’autres décisions importantes. Mme la présidente du TGI a décidé de laisser leur chance au fonds de soutien pour les collectivités locales et au dispositif d’aide pour les hôpitaux ; elle conseille donc aux avocats des hôpitaux, des collectivités et des banques d’essayer de trouver une solution à travers ces structures. Nous verrons ensuite comment régler les contentieux qui resteront. Mais, avant même que l’aide ne se mette en place, nous avons réussi à résoudre quelques contentieux avec les collectivités locales et avec deux hôpitaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Boutet, avez-vous des informations sur l’agenda de la mise en place de la deuxième phase du dispositif d’aide ?
M. Richard Boutet. Malgré les effets d’annonce au mois de février, nous n’avons malheureusement pas plus de détails à ce sujet.
M. le coprésident Pierre Morange. Même pas une vague idée de calendrier d’ici à la fin de l’année ?
M. Richard Boutet. Non.
M. le coprésident Pierre Morange. Dommage, car le sujet est important !
Monsiur Vérot, nous évoquions le sujet sensible des pénalités de sortie des prêts structurés, notamment hors charte ; le tableau récapitulatif mentionne ainsi, pour Dexia, un montant global pour les indemnités de remboursement anticipé de 79 millions. Or Dexia n’a pas répondu à nos questions sur les opérations de sortie des emprunts toxiques. Pourquoi ?
M. Pierre Vérot, directeur de la gestion de l’encours de Dexia crédit local. À la fin de 2014, il nous restait onze prêts hors charte ; aujourd’hui, il ne nous en reste plus que huit, puisque, depuis le début de l’année, nous en avons désensibilisé trois, y compris celui d’un CHU important. Fin 2012, nous avions trente-cinq prêts structurés sensibles ; aujourd’hui, nous n’en avons plus que vingt, dont huit hors charte. Aucun de ces prêts ne concerne d’ailleurs les CHU : prenant acte du fait que ceux-ci ne seraient pas aidés dans le cadre du dispositif annoncé le 22 décembre – auquel nous contribuerons pourtant de manière importante –, nous nous sommes efforcés de trouver d’autres solutions.
Douze établissements n’ont jamais payé de taux dégradé et ne donnent pas suite à nos propositions de passage au taux fixe ; le fait de payer des taux bas depuis dix ans valide leur choix, et nous le respectons. Mais les pouvoirs publics devraient leur faire comprendre que, s’il est heureux que leur stratégie ait été récompensée pendant la première partie du prêt, c’est aujourd’hui le moment d’en changer car l’avenir reste très incertain.
À cette date, les huit prêts hors charte qui nous restent ne sont pas tous indexés sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse ; les plus importants le sont sur celui entre le dollar et le yen, qui ne pose aucun problème. Ces huit prêts représentent à peu près 80 millions d’euros d’encours ; 40 millions sont éligibles au dispositif annoncé le 22 décembre, et nous coûtent quelque 20 millions d’euros. Nous attendons l’actualisation de l’instruction du 22 décembre, mais, depuis cette annonce, nous avons résolu un certain nombre de cas. Pour les huit prêts restants, le dispositif d’aide sera utile ; leur cas aurait pu être résolu plus tôt, mais j’espère qu’il le sera d’ici à la fin de l’année. Tous les établissements qui ont voulu maintenir avec nous des relations amiables bénéficient d’une prise en charge de leurs échéances dégradées, parfois depuis quatre ans, cet effort venant s’ajouter à notre contribution volontaire et fiscale au fonds de soutien. Nous faisons donc le nécessaire pour que les problèmes soient résolus dans des conditions raisonnables et espérons y parvenir dans le courant de l’hiver.
Nous déplorons que le dispositif d’aide exclue les hôpitaux dont le budget dépasse 100 millions d’euros, mais nous en avons pris acte et tentons de résoudre leurs difficultés par nous-mêmes. Nous regrettons également – et nous l’avons indiqué à la ministre – l’exclusion des hôpitaux de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) subissant les mêmes contraintes que les hôpitaux publics, voire des contraintes plus lourdes encore puisqu’ils paient plus de charges de personnel. Nous devrons ainsi trouver des solutions par nous-mêmes pour les trois ou quatre ESPIC concernés de la FEHAP. Quoi qu’il en soit, à la fin de l’hiver, la quasi-totalité des prêts résiduels hors charte devraient avoir disparu.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle est la taille de ces huit établissements ?
M. Pierre Vérot. Les grands établissements étant exclus du dispositif – pour des raisons que nous n’avons pas à commenter –, nos dirigeants ont dû régler leur cas sans compter sur cette aide. Il s’agit donc de dossiers d’établissements de petite taille, notamment de petits hôpitaux – dits d’aménagement du territoire – de la région Midi-Pyrénées que nous portons depuis des années et que nous porterons jusqu’à trouver une solution équilibrée et partagée. Nous nous rendons régulièrement à l’ARS de Toulouse pour suivre l’avancement du dossier ; j’ai bon espoir que les choses seront réglées avant la fin de l’année.
M. le coprésident Pierre Morange. Le taux moyen des prêts proposés par Dexia en 2014 s’élevait à 7,67 %. Quelles sont les valeurs extrêmes de la fourchette à laquelle correspond cette moyenne ?
M. Pierre Vérot. Tous les taux, sauf un qui fait l’objet d’un contentieux, ont été écrêtés à 7 %.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est donc ce qui fait remonter la moyenne au-dessus de 7 %. Et la valeur minimale ?
M. Pierre Vérot. Pour les prêts hors charte indexés sur le taux de change dollar/yen, la valeur inférieure devait être à 3,30 %. Un établissement qui n’a pas voulu préserver une relation constructive avec nous a conservé, je crois, un taux non écrêté ; un ou deux paient 3 % depuis très longtemps et n’ont pas envie de changer, mais je pense qu’ils finiront par s’y résoudre ; enfin, les autres, notamment en Midi-Pyrénées, paient 6 % ou 7 % en attendant que le dispositif d’aide commence à fonctionner cet hiver. La ministre a annoncé des mesures fiscales qui devraient figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou dans le projet de loi de finances que vous adopterez juste avant Noël.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Au-delà du problème immédiat, il faut aussi regarder vers l’avenir. Pensez-vous que la profession bancaire pourrait contribuer à la formation professionnelle des chefs d’établissements ou des directeurs financiers des hôpitaux ? En effet, les établissements sont conseillés par des cabinets extérieurs, mais nous avons pu constater, à l’École des hautes études de santé publique (EHESP) de Rennes, que si les formations ont évolué, certains produits restent très complexes. Il faudrait sortir de la relation purement « commerciale » dans laquelle on vend un produit, pour privilégier la formation et le conseil.
M. Pierre Vérot. L’EHESP dispense une formation sérieuse et la plupart de ceux qui, sortis de cette école, deviennent directeurs d’hôpital savent gérer des dettes très importantes et négocier, dans des domaines divers, des contrats bien plus complexes que ceux dont nous parlons aujourd’hui. La difficulté ne tient pas à un manque supposé de compétences : elle relève d’une responsabilité collective. Pour appliquer les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012, dont je ne conteste pas le bien-fondé, les directeurs d’hôpital ont, avec l’aval des agences régionales de santé, signé des contrats périlleux – en ce qu’ils prévoyaient des programmes de reconstruction ou de modernisation massive du parc hospitalier – qui, en réalité, ne pouvaient être menés à bien que si les emprunts étaient souscrits sur toute leur durée au taux de 2 %. Il n’était pas besoin d’avoir suivi des formations spécifiques à l’EHESP pour se rendre compte, et il n’aurait dû échapper à personne, que le niveau de dette accepté était élevé. Heureusement, la très grande majorité des travaux a pu être réalisée grâce à des taux d’intérêt bas, mais certaines anticipations peu réalistes ont conduit aux infortunes dont nous partageons le coût aujourd’hui. À l’avenir, la question ne se posera plus, les dispositions prises, pour certaines par des amendements récemment adoptés à votre initiative, faisant qu’il n’y aura plus guère d’ingénierie financière possible en ce domaine.
Sur le fond, il ne faut pas mésestimer le professionnalisme de ceux qui sortent de l’EHESP – mais je reconnais volontiers que cette observation ne s’applique peut-être pas à tous les directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de petits centres hospitaliers.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Ma question concernait les équipes en poste à l’époque, d’ailleurs renouvelées depuis lors. Celles qui leur ont succédé, arrivées dans un contexte ardu, font preuve de beaucoup de courage et d’un sens aigu du service public, et elles témoignent de compétences dont je ne doute pas. La situation que nous connaissons résulte effectivement d’une chaîne de responsabilités et illustre les errements d’une époque où l’on pensait que la finance pouvait tout régler.
M. le coprésident Pierre Morange. Il s’agit en effet d’une responsabilité partagée. Mais qu’il ait fallu, dans la région nantaise, créer une structure associative pour « compléter » la réflexion des gestionnaires de l’établissement sur sa nécessaire restructuration financière et budgétaire traduit, pour le moins, quelques faiblesses conceptuelles en matière de comptabilité analytique et de programmation des investissements. Cette structure mutualisée suscite l’intérêt de nombreuses autres ARS, ce qui fait comprendre la nécessité évidente d’une montée en charge. Le souligner, ce n’est pas critiquer des hommes ou des femmes, mais dire que, lorsque des mécanismes financiers particulièrement complexes sont mis en œuvre, un professionnalisme est nécessaire, que peu de personnes maîtrisent, notamment dans la sphère publique, ce qui est assez normal.
Notre mission souhaite que la sortie de crise se fasse dans les délais les plus brefs, de sorte que les établissements de santé retrouvent une capacité d’autofinancement et donc d’investissement en ressources humaines et matérielles au bénéfice des patients. La restructuration de la dette des établissements publics de santé et le rétablissement de l’équilibre des comptes sont des éléments essentiels de la pérennité de notre système de protection sanitaire et sociale, schéma le plus abouti de la solidarité nationale. Chacun doit y contribuer, les établissements bancaires pouvant faire le deuil des pénalités de sortie.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Constatez-vous des tensions de trésorerie – un gonflement des dettes non financières ou des financements à court terme plus difficiles à mobiliser ?
M. Jean-Sylvain Ruggiu. Le groupe BPCE, qui finance quelque 800 hôpitaux, constate que, de septembre 2014 à mars 2015, le taux moyen de tirage – c’est-à-dire l’utilisation moyenne des lignes de crédits accordés aux hôpitaux – est tombé de 49 % à 32 %. Toutefois, les écarts sont très marqués puisque ces taux s’étagent de 5 % à 95 % selon les établissements, ce qui traduit la disparité de leurs trésoreries. Quoi qu’il en soit, à ce jour, nous n’avons pas d’impayés.
M. le coprésident Pierre Morange. Je suppose que la Fédération bancaire française dispense des formations relatives à l’octroi de prêts. Pourrait-elle concevoir, éventuellement en liaison avec l’EHESP, un court cycle de formation à ce sujet, destiné à renforcer les connaissances des équipes dirigeantes des établissements de santé sur les mécanismes les plus complexes ? Une telle mesure, qui permettrait d’éviter bien des aléas, pourrait figurer au nombre des recommandations de notre mission.
M. Richard Boutet. La Fédération bancaire française n’a pas mis au point de module de formation à proprement parler, mais l’information des entreprises publiques et privées à ce sujet, sur papier et par le biais d’internet, est l’une de nos priorités. Nous pourrions travailler avec vous à une action visant plus particulièrement les établissements de santé.
Mme la coprésidente Gisèle Biémouret, rapporteure. Mesdames, messieurs, je vous remercie d’avoir contribué à notre réflexion. Notre rapport devrait être présenté à la Commission des affaires sociales le 15 juillet. Nous souhaitons évidemment qu’aucun des établissements publics de santé, dont nous avons si grand besoin, ne se trouve à nouveau dans une situation aussi compliquée qu’aujourd’hui, et nous espérons, pour le bien des patients, que vous trouverez avec ceux des hôpitaux qui sont encore en grande difficulté des solutions de sortie de crise.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous suivrons ce dossier en espérant qu’il soit définitivement réglé à la fin de l’année et nous vous demanderons de nous faire savoir par courrier l’évolution des encours de dettes. Vous aurez compris que, pour clore l’exercice budgétaire 2015 sur une note positive, au bénéfice de la santé de nos concitoyens, nous souhaitons tout particulièrement l’effacement des pénalités de sortie.
*
* *
1 () Du nom de l’Inspecteur général des finances, M. Éric Gissler, sous l’égide de qui a été élaborée la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales publiée en décembre 2009.
2 () http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/La-dette-des-etablissements-publics-de-sante. Voir en annexe n° 2 le récapitulatif des recommandations formulées par la Cour des comptes.
3 () http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/La-dette-des-etablissements-publics-de-sante. Voir en annexe n° 2 le récapitulatif des recommandations formulées par la Cour des comptes.
4 () Publication annuelle de la DREES « Les comptes nationaux de la santé 2013 », 8 septembre 2014.
5 () La comptabilité hospitalière distingue le budget principal et les budgets annexes tels que les écoles paramédicales, les EHPAD…qui reversent des sommes au budget principal au titre des charges communes.
6 () La marge brute d’exploitation (MBA) permet de mesurer l’excédent dégagé par l’exploitation courante pour financer prioritairement la charge de la dette (intérêts des emprunts et amortissement du capital) et l’investissement courant. Cet indicateur de gestion traditionnel met en évidence le caractère excédentaire de l’activité de l’établissement et sa capacité à investir.
7 () Les circulaires DHOS/F2/248 du 15 juin 2007 et DHOS/F2/2007/438 du 12 décembre 2007 ont défini ses modalités de mise en œuvre.
8 () Par opposition aux indices standards tels que l’Eonia (Euro overnight index average, ou taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro à échéance d’une journée), ou l’Euribor (Euro interbank offered rate, ou taux d’intérêt interbancaire en euros).
9 () Audition du 4 juin 2015 par la MECSS à l’Assemblée nationale, compte rendu n° 12.
10 () DGOS/PF1/MSIOS n° 2010-460 du 27 décembre 2010 – http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-01/ste_20110001_0100_0116.pdf
11 () UMD : unités pour malades difficiles.
12 () UHSA : unité hospitalière spécialement aménagée (pour les détenus).
13 () Circulaire DGOS/DGFiP du 10 février 2010 relative à la mise en place d’un dispositif automatisé de détection des établissements publics de santé qui rencontrent des difficultés financières.
Circulaire DGOS/DGFiP du 14 septembre 2012 relative à la mise en place des comités régionaux de veille active sur la situation de trésorerie des établissements publics de santé.
14 () Directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
15 () Rapport de l’IGF n° 2012-M-072-02 sur « Les conditions de financement des établissements publics de santé auprès du secteur bancaire », mars 2013.
16 () ATIH : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
17 () Rapport de la Mission IGAS/IGF sur l’évaluation du financement et du pilotage de l’investissement hospitalier n° RM 2013-032, mars 2013.
18 () SSR : soins de suite et de réadaptation.
19 () Respectivement 50 %, 10 ans et 30 %.
© Assemblée nationale