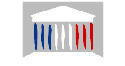
N° 4485
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 février 2017.
RAPPORT D’INFORMATION
Fait
en application de l’article 145 du Règlement
AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION (1)
sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations
Président-Rapporteur,
M. Claude BARTOLONE
——
(1) La composition de la commission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations est composée de : M. Claude Bartolone, président-rapporteur ; Mme Élisabeth Guigou, M. Philip Cordery, M. Daniel Fasquelle, M. Pierre Lequiller, vice-présidents ; M. François Asensi, Mme Valérie Fourneyron, M. Joël Giraud, M. Rudy Salles, secrétaires ; Mme Nicole Ameline, M. Guillaume Bachelay, M. Christophe Caresche, M. Luc Chatel, Mme Karine Daniel, M. Éric Elkouby, Mme Marietta Karamanli, M. Pierre Lellouche, M. Jean Leonetti, M. Jacques Myard, M. Michel Piron (suppléant), M. Christophe Premat, M. Gilles Savary, M. Michel Vauzelle.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE PRÉPARE LE RETRAIT BRITANNIQUE 11
A. CLARIFIER LES MODALITÉS DU RETRAIT 11
1. Une procédure prévue par le traité de Lisbonne pour régler une situation inédite 11
a. Un cadre juridique qui laisse une importante marge à la négociation 12
b. Un accord de retrait distinct de l’accord sur les relations futures 14
c. Les différentes étapes de la procédure de retrait 18
i. Une procédure déclenchée par la notification de l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne 18
ii. L’engagement de la négociation de l’accord de retrait 18
iii. Des modalités d’approbation spécifiques 22
d. Le Royaume-Uni, membre de l’Union à part entière jusqu’à sa sortie effective 24
e. Les conséquences juridiques du retrait 26
i. La fin de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni 26
ii. La modification des accords internationaux dont l’Union européenne est partie 27
iii. Des décisions difficiles à prendre par les Vingt-Sept consécutives au Brexit 28
2. Des acteurs de la négociation qui donnent le ton 31
a. Au Royaume-Uni, un ministère dédié au Brexit, une Première ministre chargée des négociations 31
b. Pour l’Union européenne, une négociation menée par la Commission sous le contrôle étroit des États membres 34
c. Le Parlement européen, un acteur, un partenaire 36
3. Le cadre de négociations, premier enjeu des discussions : la maîtrise du calendrier et la détermination du champ de l’accord 38
a. Une initiative qui revient au Royaume-Uni 38
b. Des délais encadrés par le traité et maîtrisés par l’Union européenne 40
c. La détermination du champ de l’accord, première étape de la négociation 42
B. ÊTRE PRÊTS À NÉGOCIER DÈS L’ACTIVATION DE L’ARTICLE 50 45
1. Des principes cardinaux posés par les Vingt-Sept dès le lendemain du référendum 45
a. Pas de négociations sans notification 45
b. L’acceptation de chacune des quatre libertés, condition de l’accès au marché unique 46
c. Les négociations ne sauraient aboutir à ce qu’un État tiers bénéficie d’un régime aussi avantageux qu’un État membre 47
2. Un important travail de préparation : l’identification des enjeux et la mise en ordre de marche des administrations 47
a. Au Royaume-Uni, une administration à réorganiser 47
b. En France, un travail interministériel coordonné par le Secrétariat général des affaires européennes 49
c. Pour l’Union européenne, un travail préparatoire mené par la Commission 51
3. Le Royaume-Uni, de la fermeté sur le principe de la sortie à la définition des positions de négociation 52
a. Vers un Brexit « dur », incluant la maîtrise des frontières et la restauration de la souveraineté juridique 53
i. Un semestre de grand flou sur la stratégie du Gouvernement britannique 53
ii. Les grandes lignes exposées par Theresa May lors de son discours de Lancaster House du 17 janvier 2017 : des confirmations et beaucoup d’interrogations 55
b. Une attitude offensive qui masque un intérêt britannique à un accès le plus large possible au marché unique et à l’union douanière 58
i. Une économie tournée vers le marché unique 58
ii. Le cas particulier des services financiers 60
c. Des difficultés politiques qui n’en sont pas moins fortes pour le Gouvernement May 63
i. Le rôle du Parlement dans le processus de négociation 63
ii. Les entités dévolues en première ligne 67
II. ABORDER LES NÉGOCIATIONS SUR DES BASES CLAIRES, ALLANT À L’ESSENTIEL, TOUT EN PERMETTANT À L’UNION D’AJUSTER SA POSITION SUR LA DURÉE 71
A. CONSERVER L’UNITÉ DES VINGT-SEPT AUTOUR DU PRINCIPE DE L’INTÉGRITÉ DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 72
1. La liberté de circulation des personnes, marqueur d’un projet construit au bénéfice des citoyens 73
a. Une liberté fondamentale et non négociable du projet politique européen 73
b. Des droits proportionnés aux avantages de l’accès, total ou partiel, au marché unique 76
c. De la mobilité à l’émergence d’une communauté : l’exemple de l’enseignement supérieur et de la recherche 78
i. Le dispositif Erasmus + 78
ii. Les fonds européens pour la recherche 80
2. Préserver la cohérence et l’originalité de l’édifice juridique européen 82
a. Un droit issu d’un système complexe, reflet d’une construction originale 82
b. Un droit soumis à des processus de contrôle, de régulation et de supervision 87
i. Les institutions européennes garantes de l’ordre juridique européen 87
ii. L’enjeu de l’espace juridique unique dans les négociations 89
3. Éviter l’écueil d’une négociation segmentée et clivante et préserver les perspectives d’avenir de l’Union européenne 91
a. L’intégrité de la construction européenne, une vision politique du projet européen et un rempart contre les divisions 92
b. Un risque de dispersion et de dilution quand l’Europe doit avancer 95
c. Éviter la désunion et le délitement en conservant la perspective de refondation de l’Europe 98
B. SOUTENIR DES NÉGOCIATIONS OUVERTES ET CONSTRUCTIVES SUR DES SUJETS D’INTÉRÊT COMMUN 100
1. Une obligation de résultats : régler dès la sortie ce qui a trait aux droits des citoyens 101
a. Une véritable insécurité juridique pour les citoyens des deux côtés de la Manche, à laquelle il conviendra de répondre en priorité 102
b. Les fonctionnaires européens de nationalité britannique 108
2. Des possibilités d’accès partiel au marché unique qui existent déjà 109
a. Des relations commerciales déjà privilégiées entre l’Union européenne et certains pays tiers 110
b. Des mécanismes juridiques déjà existants 116
3. La poursuite d’une coopération étroite pour la protection des Européens 118
a. Pour préserver notre sécurité intérieure, une association la plus complète possible du Royaume-Uni à la coopération policière et judiciaire européenne 119
b. Un allié précieux de l’Union européenne et de la France sur la scène internationale 127
CONCLUSION : LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 133
EXAMEN DU RAPPORT 139
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA MISSION 165
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 175
DÉPLACEMENTS 177
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 180
Les écoliers des pays de l’Union européenne apprennent avec application l’histoire de leurs nations respectives. À une étape de leurs cours, ces histoires rencontrent une histoire commune à tous, l’histoire de l’Europe, puis l’histoire de l’Union européenne. L’abbé de Saint-Pierre, Victor Hugo ou Aristide Briand la rêvèrent, Winston Churchill invitait déjà les États continentaux à l’établir sans le Royaume-Uni, puis nos Pères fondateurs la construisirent. Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak, Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Konrad Adenauer, Altiero Spinelli nous léguèrent une exigence plus philosophique qu’économique, plus civilisationnelle que gestionnaire. Comme le dit un jour Jean Monnet, c’est par l’Europe que nos États deviendront solidement « libres, vigoureux, pacifiques et prospères ». Les écoliers européens identifient l’histoire de leur continent et de ses institutions à des étapes régulières d’approfondissement, de progrès et d’ambition.
Or, pour la première fois de son histoire, un peuple a jugé qu’il serait mieux protégé à l’extérieur de l’Union européenne qu’en son sein. L’Union européenne vit pour la première fois de son histoire l’expérience du rétrécissement. Le vote des Britanniques en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne s’inscrit ainsi à rebours de la construction européenne engagée à la sortie du second conflit mondial. À dire vrai, les demandes exprimées par David Cameron, élu en 2015 sur un programme prévoyant la tenue d’un référendum, s’inscrivaient déjà à rebours du projet politique européen, précisément en déniant son caractère intrinsèquement politique. Dérogation en matière monétaire devenant une règle commune, réforme du principe de l’union sans cesse plus étroite des peuples, limitations à la liberté de circulation des personnes, trois demandes qui conduisaient à un changement de nature profond de l’Union européenne. Plusieurs forces politiques eurosceptiques ne s’y étaient pas trompées, en espérant d’un maintien du Royaume-Uni dans l’Union la légitimité et l’occasion de demander les mêmes dérogations pour leur propre pays. Le Premier ministre David Cameron, en annonçant le 23 janvier 2013 qu’en cas de réélection deux ans plus tard, il organiserait un référendum sur l’avenir de l’Union, porte, pour des raisons politiques internes, une responsabilité écrasante.
« Notre conviction était qu’il était préférable que le Royaume-Uni soit dans l’Union européenne, mais la construction européenne pourra se poursuivre sans lui, si nous savons répondre à la fois à des défis nouveaux et à des questions anciennes », a déclaré Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes lors de son audition par la mission.
Le Royaume-Uni a toujours occupé une position particulière, « un pied dehors un pied dedans », au point que l’émergence d’une demande pressante de réforme de l’Union européenne au nom de la restauration de la souveraineté nationale semblait relever d’une certaine irrationalité. À mesure que le processus d’intégration était conduit, particulièrement dans les volets de souveraineté les plus sensibles, le Royaume-Uni obtenait des dérogations. Les exemples les plus manifestes sont la politique en matière de justice et d’affaires intérieures, à laquelle le Royaume-Uni ne participe que partiellement par application d’options (de participation ou d’exclusion) (1), et l’union monétaire. L’approfondissement de l’Union économique et monétaire depuis la crise financière n’a pas concerné le Royaume-Uni, qui n’a pas été soumis au renforcement des mécanismes de coordination économique et budgétaire. A contrario, le Royaume-Uni a fortement contribué à modeler le marché unique européen, qu’il devrait quitter dans quelques mois.
Il est à cet égard paradoxal de constater que la Première ministre Theresa May, dans un discours prononcé à Lancaster House le 17 janvier 2017, a opté pour une sortie du marché intérieur qui avait pourtant motivé l’entrée dans la CEE, avec tous les risques que cela comporte pour l’économie britannique et son attractivité, en demandant une coopération étroite pour les domaines les plus politiques que sont la sécurité intérieure et la défense. Ce choix étonnant, qui a émergé de plus en plus clairement depuis le 23 juin 2016, ne signifie pas un renoncement à l’accès au marché intérieur. Et c’est bien sûr ce volet que le Royaume-Uni entend conduire des négociations intenses et offensives. Le flou demeure sur les intentions précises du Gouvernement May.
Face aux négociateurs britanniques qui y voient certainement une habileté, l’Union peut y opposer une clarté et une résolution qui pourraient engendrer une cohésion au sein des peuples d’Europe. Nous devons être clairs de notre côté sur la méthode et les objectifs que nous souhaitons proposer et mettre en œuvre. Telle était l’ambition de cette mission créée dès juillet 2016 par la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale : informer, notamment par la conduite d’auditions dont le compte rendu est annexé au présent rapport, identifier les grands enjeux, économiques, politiques, stratégiques, citoyens posés par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et contrôler l’élaboration du cadre général de la position française. En ce mois de février 2017, aucune négociation n’a été enclenchée dans l’attente d’une notification de retrait du Royaume-Uni et le travail de notre mission parlementaire n’aura guère pu couvrir le volet « suivi des négociations ». Néanmoins, des positions se sont révélées et le présent rapport en livre une analyse et formule des recommandations.
Les vingt-sept États membres ont fait valoir une conception commune du cadre juridique acceptable au regard des intérêts de l’Union européenne. Le Royaume-Uni, par la voix de sa Première ministre, a fait part d’un certain nombre d’orientations concernant les relations souhaitées après la sortie. L’article 50 du traité sur l’Union européenne prévoit – certes de manière assez imprécise – la procédure de sortie d’un État membre. Cet article distingue les modalités de retrait de la détermination d’une relation future. Or l’acte de sortie soulève en lui-même de nombreuses questions juridiques et pratiques à régler indépendamment d’éventuelles mesures de transition vers le statut futur. Cet ordre doit être respecté, ce qui n’empêche pas de réfléchir dès à présent aux conditions dans lesquelles il convient d’examiner les demandes britanniques et, notamment, de tracer les lignes rouges du cadre de négociation et des modalités d’association d’un État tiers de l’importance du Royaume-Uni, situé à côté de l’Union européenne.
La ligne rouge première, aux multiples déclinaisons, est la préservation de notre patrimoine commun : l’Union européenne. Il convient en effet de restituer le paradoxe du choix britannique dans le contexte plus large de la crise du projet européen. Comme toute rupture historique, le Brexit est un symptôme d’une tendance profonde, en l’espèce une fracture bien plus grave : celle entre l’Union européenne et les citoyens. L’absence de réponse à ce défi majeur est au mieux une faute coupable, au pire une marque de mépris à l’égard des peuples. La montée des populismes et des replis nationaux signe notre échec collectif à faire vivre dans le cœur des hommes et dans leur réalité le projet philosophique des Pères fondateurs de l’Europe. L’Europe devait incarner l’affirmation de valeurs universelles qui ont inspiré sa fondation et convaincu les autres continents de son originalité, de sa valeur et de sa solidité. Devenu à bien des égards un projet comptable, déshumanisé, comment ne pas comprendre qu’en ces temps incertains on le conteste puisque le compte n’y est pas ?
C’est à cette interrogation principale qu’il nous faudrait répondre même si les Britanniques avaient voté en faveur d’un maintien dans l’Union : quelle Europe voulons-nous ? L’Union européenne est une construction téléologique, celle d’une appartenance collective à un « monde » européen dont les limites sont floues, une construction dont chaque étape questionne cette destinée construite. Il nous faudra beaucoup d’inventivité et de détermination pour être en mesure, à la fois d’organiser la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, et de reprendre le fil d’un récit européen progressiste, pour redonner un sens à ce qui devrait être une évidence : l’idéal d’une Europe de femmes et d’hommes libres vivant en paix, dans la liberté et la diversité, dans des conditions de sécurité physique et matérielle propices à l’épanouissement de chacun, acceptant pour l’atteindre de renoncer à une part de souveraineté nationale. Les peuples d’Europe ne peuvent attendre de leurs États de disposer, seuls, des ressources capables de répondre aux nouveaux défis de l’économie numérique, de la transition écologique et énergétique, des immenses enjeux que posent et poseront des migrations de populations fuyant la guerre et la misère.
Le choix de sortie du peuple britannique n’advient pas sans contexte, et il ne peut être considéré comme un coup de tonnerre dans un ciel serein européen. Les signaux d’alarmes populaires se multiplient partout en Europe, même dans les pays réputés les plus favorables à l’intégration. Si l’existence de l’Union européenne n’est, bien entendu, pas le premier objet du courroux populaire, la nécessité d’un changement est partagée. Non seulement la sortie du Royaume-Uni ne doit pas affaiblir la puissance historique de la construction européenne, mais elle doit inciter nos États et l’Europe à retrouver le chemin de la confiance populaire.
Citons Paul Valéry, c’était il y a près d’un siècle et c’était hier : « Un frisson extraordinaire a couru la moelle de l’Europe. Elle a senti, par tous ses noyaux pensants, qu’elle ne se reconnaissait plus, qu’elle cessait de se ressembler, qu’elle allait perdre conscience – une conscience acquise par des siècles de malheurs supportables, par des milliers d’hommes du premier ordre, par des chances géographiques, ethniques, historiques innombrables. », pour poser cette question : » L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire : un petit cap du continent asiatique ? » (2) .
La mission d’information a entendu à l’Assemblée nationale trente personnes et a effectué quatre déplacements à l’étranger (à Londres, Bruxelles, Berlin et Francfort). Le rapport qui est issu de ces travaux n’a pas pour objet de contribuer à la réflexion sur la refondation de l’Union européenne. En revanche, son analyse des enjeux des négociations à venir et les recommandations qu’il avance sont élaborées en regard de la question centrale de l’avenir du projet européen, dans la conviction du bien-fondé du projet originel des Pères fondateurs et, a contrario, dans le refus de considérer que la réponse du Royaume-Uni à l’affaiblissement actuel de notre union est une solution d’avenir. Il reviendra à l’Assemblée nationale issue des prochaines élections législatives de reprendre et de poursuivre ce travail.
Quel qu’il soit, notre avenir européen ne doit dépendre que de nous.
I. LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE PRÉPARE LE RETRAIT BRITANNIQUE
A. CLARIFIER LES MODALITÉS DU RETRAIT
La question du droit de retrait d’un État membre de l’Union européenne a longtemps été controversée, ainsi que Jean-Claude Piris, ancien jurisconsulte du Conseil européen, l’a rappelé lors de son audition (3). On pourrait ajouter qu’elle restait aussi théorique que controversée.
Certains juristes estimaient que, dans la mesure où la durée de validité des traités était illimitée, un pays ne pourrait pas sortir de l’Union ; d’autres insistaient au contraire sur le fait que le droit de retrait était indispensable à la préservation de la souveraineté nationale et que, si un pays voulait sortir de l’Union, on ne pourrait guère l’en empêcher. En l’absence de disposition explicite dans les traités, la volonté d’un État de se retirer de l’Union aurait été source de nombreuses incertitudes juridiques et de tensions politiques exacerbées.
1. Une procédure prévue par le traité de Lisbonne pour régler une situation inédite
Le droit d’un État membre de se retirer de l’Union européenne a été explicitement introduit pour la première fois dans le traité de Lisbonne (4). Le texte de ce qui est le désormais célèbre article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE) résulte des travaux de la Convention sur l’avenir de l’Europe, créée en 2001 et dont l’une des missions était de rédiger le traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Les motivations et les intentions des auteurs de cette disposition apparaissent clairement dans les travaux préparatoires du projet de traité constitutionnel : « Le Praesidium (5) considère que la Constitution doit contenir une disposition sur le retrait volontaire de l’Union. En effet, bien que beaucoup estiment que la possibilité de retrait de l’Union existe même en l’absence d’une disposition spécifique dans ce sens, le Praesidium estime que l’introduction dans la Constitution d’une disposition spécifique sur le retrait volontaire de l’Union clarifie la situation et permet d’introduire une procédure pour la négociation et la conclusion entre l’Union et l’État membre concerné d’un accord régissant les modalités du retrait et le cadre de leurs relations futures. En outre, l’existence d’une telle disposition constitue un signal politique important pour ceux qui soutiendraient que l’Union est une entité rigide de laquelle il est impossible de sortir. » (6)
Le texte rédigé pour le traité constitutionnel, rejeté par référendum par les électeurs français le 29 mai 2005 et néerlandais le 1er, a été repris sans modification dans le traité de Lisbonne et intégré au traité sur l’Union européenne. On n’imaginait pas alors qu’il serait utilisé moins de dix ans plus tard par l’un des principaux membres de l’Union, au regard de son économie et de sa population. Selon Danuta Hübner (7), présidente de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen, cet article avait plutôt été introduit pour permettre aux nouveaux États membres ayant rejoint l’Union européenne en 2004 (8) de faire, le cas échéant, machine arrière.
L’intégration dans le traité sur l’Union européenne d’une disposition permettant explicitement le retrait d’un État membre avait une double vocation :
– juridique, en adaptant les traités aux besoins de l’Union européenne et de ses États membres, plutôt que de s’en remettre au droit international, et en traçant les grandes lignes de la procédure de retrait ;
– politique, en indiquant que l’appartenance à l’Union résultait d’un choix ou, pour reprendre l’expression employée par Yves Bertoncini, directeur de l’Institut Jacques Delors, lors de son audition que « l’Union européenne n’est pas une prison » (9).
a. Un cadre juridique qui laisse une importante marge à la négociation
L’article 50 a un caractère strictement procédural. Encore n’épuise-t-il pas toutes les questions de procédure, laissant aux négociateurs une marge d’interprétation. La doctrine a ainsi pu considérer que, « soucieux de rendre le retrait volontaire plus crédible par son caractère unilatéral, les auteurs du traité de Lisbonne n’ont pas été très prolixes sur ses modalités, le rendant ainsi, paradoxalement, plus difficile à envisager concrètement » (10).
L’article 50 ne définit que des conditions de procédure et un délai. Il ne dit rien du contenu possible de l’accord de retrait, dont la conclusion n’est d’ailleurs pas indispensable au retrait, ni de ce que pourraient être à l’avenir les relations entre l’Union européenne et l’ancien État membre.
Les silences du texte et l’absence de précédent de sortie d’un État membre de l’Union européenne font peser un certain flou sur l’accord de retrait qui devra être négocié entre l’Union et le Royaume-Uni et laissent une grande liberté à la négociation entre les deux parties. Pour Michel Barnier, négociateur en chef responsable du groupe de travail de la Commission européenne chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni, « nous entrons dans des eaux inconnues, le travail sera légalement complexe, politiquement sensible et aura des conséquences importantes pour nos populations et nos économies » (11).
L’organisation de la négociation au sein de l’Union européenne méritait également d’être clarifiée, ce que les chefs d’État ou de Gouvernement des Vingt-Sept ont commencé à faire en marge du Conseil européen du 15 décembre 2016 (cf. infra). Si certaines dispositions de l’article 50 ne soulèvent aucune difficulté d’interprétation, d’autres appelaient des précisions afin d’éviter que des divergences d’interprétation sur le rôle de chacune des institutions européennes et des États membres dans la négociation n’affaiblissent la position de l’Union.
Article 50 du traité sur l’Union européenne
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.
Certains débats juridiques restent encore ouverts, notamment sur la question de savoir si le Royaume-Uni pourrait, en fonction de l’évolution de sa situation politique intérieure ou des négociations, revenir sur son intention de se retirer après l’avoir notifiée au Conseil européen.
Dans une tribune (12), Jean-Claude Piris avait estimé que le terme « intention » utilisé à l’article 50 ne pouvait être interprété comme une décision irrévocable et que, par conséquent, il serait possible au Royaume-Uni de suspendre la procédure.
Le représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne, Pierre Sellal, a au contraire soutenu, lors de son entretien avec une délégation de membres de la mission (13), que, selon la majorité des juristes, une fois engagée, la procédure ne pouvait être interrompue. Cette analyse juridique ne fermerait toutefois pas la porte à un traitement politique de cette question, par exemple dans l’hypothèse, aujourd’hui improbable, où des élections anticipées aboutiraient à l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle majorité élue sur la promesse de rester dans l’Union.
Dans les contentieux devant la Haute Cour de justice et la Cour suprême britanniques sur la « prérogative royale » dont le Gouvernement se prévalait pour activer l’article 50 sans acte du Parlement, il a été admis par les parties que, une fois adressée au Conseil européen, la notification ne pouvait être retirée (14). Les cours n’ont par conséquent pas statué sur ce point. Seule la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait, si elle était saisie, interpréter l’article 50, alors même que l’une des motivations du retrait britannique est de se soustraire à sa juridiction…
b. Un accord de retrait distinct de l’accord sur les relations futures
L’article 50 dispose que l’Union conclut avec l’État décidant de se retirer de l’Union « un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ».
Depuis le référendum britannique, et sans doute encore pour de long mois, cette expression a donné lieu à de nombreuses exégèses sur l’articulation entre l’accord fixant les modalités de retrait et l’accord sur les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Ce sera, à n’en pas douter, un des premiers sujets abordés lorsque la négociation commencera.
Le seul fait de s’interroger sur l’articulation entre ces deux sujets montre toutefois que l’article 50 établit clairement une distinction entre la conclusion de l’accord de retrait, qui fixe les modalités de la sortie, et le ou les accords régissant les relations futures de l’Union avec l’ancien État membre.
La négociation qui se déroule selon la procédure et les modalités prévues à l’article 50 porte uniquement sur les modalités du retrait sur les plans institutionnel, budgétaire et administratif. L’accord visé à l’article 50 ne statue pas sur les relations futures en tant que telles, même s’il est conclu avec l’État concerné « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ».
La distinction entre les deux accords obéit à une triple logique juridique, politique et technique.
Juridiquement, la méthode et le champ de la négociation sur les modalités du retrait diffèrent de ceux auxquels sera soumise la négociation des relations futures. Dans le premier cas, l’Union conclut un accord avec l’un de ses États membres, dans le second elle négocie avec un pays tiers ; la base juridique de la négociation est donc différente et elle dicte la chronologie d’approbation des accords. C’est une évidence, l’Union européenne ne peut pas conclure un accord avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers s’il est encore membre de l’Union. C’est un point sur lequel le Parlement européen avait insisté dès sa résolution du 28 juin 2016, dans laquelle il rappelait « qu’il ne peut y avoir d’accord sur toute relation nouvelle entre le Royaume-Uni et l’Union avant la conclusion de l’accord de retrait » (15).
La négociation sur les relations futures ne relèvera pas de la procédure de l’article 50 du TUE, mais de celle prévue aux articles 216 à 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatifs aux accords internationaux, ainsi qu’à l’article 207 du TFUE pour les accords de libre-échange.
L’accord de retrait et le ou les accords sur les relations futures feront, par conséquent, l’objet de modalités d’approbation différentes. L’accord de retrait doit être adopté dans les conditions, prévues à l’article 50 (cf. infra). Il s’agira d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qui n’appellera pas de ratification par les États membres.
Pour ce qui concerne les relations futures, Jean-Claude Piris a estimé lors de son audition qu’ » il sera possible de diviser le travail en plusieurs accords, notamment en concluant séparément un accord commercial et un accord d’association sur les autres aspects ». Les conditions d’approbation du ou des accords conclus pour déterminer les relations futures du Royaume-Uni et de l’Union européenne dépendront du type d’accord choisi, mais, selon toute vraisemblance, il devrait s’agir d’un accord mixte engageant à la fois l’Union européenne et les États membres. Il devrait, dans ce cas, être ratifié par les vingt-sept États membres. Pour la lisibilité du partenariat futur avec le Royaume-Uni et pour que les Parlements nationaux puissent se prononcer sur un accord global, il serait préférable d’éviter que ce partenariat soit divisé en plusieurs accords.
Politiquement, selon l’analyse de Philippe Léglise-Costa, secrétaire général des affaires européennes, « se contraindre à conclure un accord avec le Royaume-Uni sur les relations futures pour qu’il puisse se retirer de l’Union serait se mettre entre ses mains, puisqu’il déciderait lui-même du moment où il serait satisfait de ces relations futures avant de se retirer effectivement » (16). En permettant aux Vingt-Sept de maîtriser le calendrier du retrait (cf. infra), l’article 50 est de nature à inciter le Royaume-Uni à proposer pour son propre statut futur des solutions plus acceptables par l’Union européenne.
La distinction entre les deux négociations se justifie également pour des questions de délai. Même s’il est relativement court, le délai de deux ans prévu par l’article 50 devrait être suffisant pour négocier les modalités de retrait du Royaume-Uni sur les plans institutionnel, budgétaire et administratif. Il ne paraît en revanche pas envisageable de conclure pendant le même délai un accord sur la relation future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, comme le Gouvernement britannique en a affiché l’ambition, rappelée par Lord Llewellyn, Ambassadeur de Grande-Bretagne en France, lors de son audition (17). L’accord sur le partenariat futur donnera en effet lieu à une négociation dont les auditions de la mission d’information ont donné un aperçu de la complexité. À titre d’exemple, il faut rappeler qu’il s’est écoulé sept ans entre l’ouverture de la négociation de l’accord économique et commercial global avec le Canada et la signature de l’accord. Il a pourtant une portée relativement limitée sur la question des services et, pour de simples raisons géographiques, les enjeux en termes de concurrence ne sont pas les mêmes qu’avec le Royaume-Uni. De plus, s’il s’agit d’un accord mixte, l’accord sur les relations futures devra être ratifié par tous les États membres, ce qui allonge substantiellement les délais avant son entrée en vigueur.
Les considérations précédentes sur la distinction juridique entre les deux accords et leur chronologie éclairent la portée de l’expression « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ». S’il n’est ni souhaitable ni possible de conclure concomitamment l’accord de retrait et l’accord sur les relations futures, les discussions sur les deux sujets ne peuvent pas non plus être complètement dissociées, dès lors qu’il y a accord sur les principaux points de l’accord de séparation. Il est en effet nécessaire d’avoir une idée du statut futur du Royaume-Uni, le « point d’atterrissage », pour bâtir certains éléments de cet accord. Si le cadre des relations futures est suffisamment précis et fait l’objet d’un accord de principe entre les deux parties, même s’il n’est pas encore finalisé, l’accord de retrait pourra prévoir des mesures transitoires permettant d’éviter une rupture trop brutale (18) pour les citoyens et les entreprises, de l’Union européenne comme du Royaume-Uni, lorsque celui-ci passera du statut d’État membre à celui de pays tiers.
Ainsi que Philippe Léglise-Costa l’a relevé lors de son audition, il y a, pour les deux parties, « un intérêt à avoir en tête ces relations futures durant la négociation. Si, par exemple, nous savons que l’objectif est de conclure un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, futur pays tiers, nous pouvons décider d’une période de transition qui évitera de devoir reconstituer des droits de douane et de subir les à-coups subséquents » (19).
La négociation pourrait par conséquent s’articuler en trois volets :
– l’accord de retrait prévu à l’article 50, qui devrait avoir un champ limité (cf. infra) ;
– la définition d’une éventuelle période transitoire, qui ne pourra être envisagée qu’à partir d’une vision suffisamment claire des relations futures et ne pourra qu’être limitée à la fois dans le temps et sur le fond – il ne saurait s’agir de proroger le statut de membre – pour qu’elle ne devienne pas un régime permanent par défaut. Si une forme d’accès au marché unique était maintenue pendant cette période de transition, elle devrait évidemment être soumise au respect par les Britanniques de l’indivisibilité des quatre libertés du marché intérieur et de la compétence de la CJUE, ainsi qu’au versement d’une contribution au budget de l’Union pendant toute la durée de la transition ;
– l’accord sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni, dont la forme et le contenu sont encore, à ce stade, indéterminés et dépendront à la fois des demandes présentées par les Britanniques et de leur capacité à accepter les conditions posées par l’Union, notamment pour préserver l’intégrité du marché intérieur et les conditions d’une concurrence équitable. Cet accord ne pourra pas être conclu dans la période de deux ans prévue à l’article 50, mais le travail pourra commencer parallèlement à la négociation de l’accord de retrait.
Comme les modalités du retrait, les dispositions transitoires devront être arrêtées, sauf en cas de prorogation, avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 50. Elles pourraient être divisées en deux types de mesures :
– des mesures visant à organiser l’extinction progressive de l’application du droit européen au Royaume-Uni (phasing out), dans l’intérêt des deux parties. L’ensemble des législations et règlementations et des politiques communes doivent être examinées à cette fin : les droits des personnes, le marché intérieur des biens et services, des tarifs aux règlementations (protection du consommateur, sécurité, normes environnementales, certification, droit des sociétés, fiscalité, commerce électronique, compétence des juridictions…) ;
– des mesures permettant de fluidifier le passage du statut d’État membre au statut futur (phasing in), pour autant que, avant le terme de la négociation sur l’accord de retrait, un accord sur ce statut futur se dégage.
c. Les différentes étapes de la procédure de retrait
i. Une procédure déclenchée par la notification de l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne
La procédure de retrait ne débute officiellement que lorsque l’État membre souhaitant se retirer notifie au Conseil européen son intention de le faire. Même s’il constitue indéniablement un événement international majeur, le résultat du référendum du 23 juin 2016 n’emporte, en lui-même, aucune conséquence juridique à l’égard de l’Union européenne.
L’article 50, qui constitue l’unique cadre du retrait de l’Union, ne définit aucune condition de fond à l’exercice, par un État membre, de son droit de retrait. Il est en cela plus souple que l’article 62 de la convention de Vienne, qui exige un « changement fondamental de circonstances » pour qu’un pays puisse se retirer d’un traité.
La décision de se retirer de l’Union relève de la souveraineté nationale de chaque État membre ; elle est prise « conformément à ses règles constitutionnelles » et ce sont ses instances nationales qui vérifient la conformité de la décision de retrait à ces règles, comme l’ont illustré les débats devant la Haute Cour de Londres puis devant la Cour suprême du Royaume-Uni (20) sur la question de savoir si l’activation de l’article 50 relevait de la « prérogative royale » ou nécessitait un acte du Parlement.
L’article 50 n’impose pas davantage de condition de forme à cette notification, si ce n’est qu’elle est adressée au Conseil européen. La notification pourrait prendre la forme d’une lettre de la Première ministre britannique au président du Conseil européen. L’article 50 ne dit rien non plus du contenu de la notification et ne prévoit pas de motivation de la décision de retrait. Cependant, en prévoyant que l’accord de retrait est conclu « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union », il invite implicitement l’État souhaitant se retirer à préciser les contours de la relation future qu’il envisage avec l’Union européenne, comme la Première ministre Theresa May a commencé de le faire lors de son discours du 17 janvier 2017, puis avec la publication d’un Livre blanc le 2 février 2017 (21).
ii. L’engagement de la négociation de l’accord de retrait
Comme Harlem Désir l’a souligné lors de son audition (22), si certaines étapes du processus prévu par l’article 50 ne laissent aucun doute sur les modalités d’organisation, d’autres soulèvent des questions juridiques et pratiques qui ont provoqué des débats entre la Commission et le Conseil, notamment sur le point de savoir qui devait mener la négociation.
Le rôle assigné par l’article 50 à la Commission européenne dans la procédure de retrait n’est en effet pas parfaitement défini. Il renvoie au 3 de l’article 218 du TFUE, qui dispose uniquement que la Commission présente des recommandations au Conseil en vue de l’ouverture des négociations.
C’est en principe la Commission qui négocie les accords avec les pays tiers au nom de l’Union, mais l’article 218 du TFUE ménage au Conseil la possibilité de désigner un autre négociateur. Une hésitation a pu naître du fait que le retrait d’un État membre donne lieu à une négociation très spécifique et que, précisément, à l’inverse des négociations habituellement menées par la Commission, l’autre partie n’est pas encore un pays tiers, mais toujours un État membre de l’Union.
Article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 207, les accords entre l’Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.
2. Le Conseil autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.
3. La Commission, ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l’accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l’accord envisagé, le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l’entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord.
Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord :
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants :
i) accords d’association ;
ii) accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération ;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union ;
v) accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai pour l’approbation ;
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de l’Union ainsi que pour les accords d’association et les accords visés à l’article 212 avec les États candidats à l’adhésion. Le Conseil statue également à l’unanimité pour l’accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de Justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.
Réunis en marge du Conseil européen du 15 décembre 2016, les chefs d’État ou de Gouvernement des Vingt-Sept ont adopté une déclaration commune sur l’organisation de la négociation de retrait qui a tranché cette question, puisqu’ils ont indiqué que le Conseil serait invité à désigner la Commission en tant que négociateur au nom de l’Union. Ils ont également précisé le dispositif de négociation pour l’Union européenne, en fonction des différentes étapes prévues aux articles 50 du TUE et 218 du TFUE.
● Une fois l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union notifiée au Conseil européen, celui-ci fixera, par consensus (23) et sans la participation du représentant du Royaume-Uni, des orientations de négociation. Chaque État membre aura donc de fait un droit de veto sur ces orientations. La décision du Conseil européen devra cependant être rapide, le « compte à rebours » du délai de deux ans prévu pour la négociation étant lancé dès la réception de la notification. C’est pourquoi le président du Conseil européen a mis en place dès le 25 juin 2016 un groupe de travail, dirigé par Didier Seeuws, destiné à préparer les décisions du Conseil sur le sujet du Brexit.
L’exercice étant inédit, on ne sait pas encore précisément quels seront la nature et le degré de précision de ces orientations. Selon Pierre Sellal (24), ces orientations devraient aller un peu au-delà des principes exprimés jusqu’ici par les Vingt-Sept, sans pour autant entrer trop précisément dans les détails. Elles pourraient ainsi être ajustées en permanence au cours des négociations.
Les orientations du Conseil européen pourraient contenir trois volets encadrant globalement les négociations :
– préciser le dispositif et le pilotage de la négociation ;
– identifier les sujets qui devront faire l’objet de l’accord de retrait selon les termes de l’article 50 pour permettre une séparation ordonnée dans les domaines administratif, institutionnel, juridique et budgétaire ;
– à la lumière de ce qu’aura proposé le Royaume-Uni, et en fonction des intérêts des Vingt-Sept, poser des principes pour les relations futures entre l’Union européenne à vingt-sept et le Royaume-Uni. Même si ces relations ne sont pas négociées dans le cadre de l’article 50, des discussions sur le sujet pourront se tenir parallèlement. Il est dans l’intérêt de tous de pouvoir disposer de la plus grande clarté possible sur ce que pourraient être ces relations, afin de permettre à chaque État de se préparer, de donner la visibilité nécessaire aux acteurs économiques, et de prévoir une période de transition.
● Conformément au paragraphe 3 de l’article 218 du TFUE, auquel l’article 50 du TUE renvoie, la Commission européenne présentera ensuite, à la lumière de ces orientations, une recommandation sur l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni. Cette recommandation abordera des sujets plus techniques que les orientations du Conseil.
Sur la base de cette recommandation, le Conseil des affaires générales, qui réunit les ministres chargés des affaires européennes, adoptera, à la majorité qualifiée, une décision d’ouverture des négociations et désignera le chef de l’équipe de négociation de l’Union. Il pourrait compléter les orientations générales du Conseil européen par des directives de négociation, qui devraient rester transversales et ne pas entrer dans une logique consistant à élaborer une position de négociation dans chacun des secteurs, qui mettrait à coup sûr en péril l’unité des Vingt-Sept avant même le début de la négociation avec les Britanniques. Loin de constituer un carcan pour le négociateur, un mandat de négociation précis lui servira d’appui dans les négociations, par exemple sur la question du règlement financier à présenter aux Britanniques.
Le traité prévoit que cette négociation doit se dérouler dans un délai maximum de deux ans à compter de la notification. À l’issue de ce délai, trois hypothèses sont envisageables : soit un accord de retrait est conclu, soit le Conseil européen décide, à l’unanimité et en accord avec le Royaume-Uni, de proroger ce délai, soit le retrait du Royaume-Uni est automatiquement officialisé, même en l’absence d’accord, ce dernier n’étant pas une condition du retrait.
Bien que les deux parties aient objectivement un intérêt à conclure un nouveau partenariat, cette dernière hypothèse, correspondant à une sortie « sèche » sans accord sur les modalités de retrait, ne peut être exclue. Theresa May a en effet estimé que « l’absence d’accord pour la Grande-Bretagne serait toujours mieux qu’un mauvais accord pour la Grande-Bretagne (25) ». Le risque d’une absence d’accord a également été évoqué par Didier Seeuws, directeur en charge de la « task force sur le Royaume-Uni » du Conseil de l’Union européenne, au cours de son entretien avec les membres de la mission (26).
iii. Des modalités d’approbation spécifiques
Si un accord de retrait est conclu, il doit être approuvé, à la majorité simple, par le Parlement européen (27) – qui dispose donc d’un droit de veto –, avant d’être conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Un seul État membre qui ne serait pas d’accord avec la solution adoptée ne pourrait en bloquer l’adoption.
Pour Jean-Claude Piris, « les auteurs du traité de Lisbonne, conscients des difficultés engendrées par un retrait, étaient également conscients de la nécessité politique que l’Union Européenne ne puisse être perçue comme faisant obstacle à la mise en œuvre d’un éventuel retrait » (28). C’est pourquoi, d’une part, les règles d’approbation de l’accord de retrait sont moins contraignantes que celles d’un accord d’adhésion ou de modification des traités, et, d’autre part, un retrait peut avoir lieu même en l’absence d’accord de retrait : une fois le processus enclenché par la notification, il ne peut plus être interrompu par l’Union européenne.
La majorité qualifiée requise au Conseil est celle qui est prévue au b du 3 de l’article 238 du TFUE, c’est-à-dire au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants (c’est-à-dire les Vingt-Sept, à l’exclusion du Royaume-Uni), réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Selon les indications fournies par Jean-Claude Piris lors de son audition, les conditions de majorité seraient remplies avec l’accord de vingt États membres, réunissant environ 330 millions d’habitants.
Article 238 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
1. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.
2. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
3. À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit :
a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
b) Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
4. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l’unanimité.
L’accord de retrait est conclu avec le Royaume-Uni par l’Union européenne seule. Contrairement à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union (29), le retrait d’un État n’est pas ratifié par les autres États membres. Le président-rapporteur estime qu’il n’en restera pas moins indispensable que les gouvernements, qui auront à approuver l’accord au Conseil, entretiennent un dialogue soutenu avec les parlements nationaux. Quel que soit le résultat des prochaines échéances électorales en France, l’Assemblée nationale et le Gouvernement qui en seront issus auront à définir les modalités de ce dialogue.
Compte tenu de l’importance de cette négociation, de sa complexité et des inquiétudes qu’elle peut faire naître, un principe de transparence doit s’imposer, dans les limites que l’efficacité du travail des négociateurs impose. Les exemples des négociations commerciales récentes ont montré que les populations et les parlements nationaux n’acceptaient plus l’opacité totale qui avait pu prévaloir auparavant.
De plus, même si elle n’est pas appelée à autoriser la ratification de l’accord de retrait, l’Assemblée nationale votera sur l’accord définissant le nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Or les deux questions sont étroitement liées. Aussi, le Parlement devrait non seulement être tenu informé de l’avancement des négociations, ce qui est indispensable, mais pouvoir s’exprimer sur l’accord de retrait avant son adoption par le Conseil, comme le permet l’article 50-1 de la Constitution. Une association insuffisante des parlements nationaux en amont, comme du Parlement européen, ferait courir un risque de déconvenue lors du vote final.
Enfin, l’accord de retrait devra être approuvé par le Royaume-Uni selon ses règles nationales. Dans son discours du 17 janvier 2017, Theresa May a précisé que le Gouvernement soumettrait l’accord final négocié entre le Royaume-Uni et l’Union européenne à un vote dans les deux chambres du Parlement avant qu’il n’entre en vigueur.
d. Le Royaume-Uni, membre de l’Union à part entière jusqu’à sa sortie effective
Juridiquement, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, en l’absence d’accord, jusqu’à la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne deux ans après la notification de son intention de se retirer, celui-ci reste membre à part entière de l’Union européenne, avec l’intégralité de ses droits et obligations. Il doit continuer de contribuer au budget, transposer les directives et appliquer les règlements et reste sous la juridiction de la Cour de Justice de l’Union européenne. Il continue également de participer aux réunions et délibérations du Conseil européen et du Conseil. Ses représentants dans ces organes et les membres du Parlement européen élus au Royaume-Uni participent comme auparavant à l’élaboration de la législation européenne. Les représentants français au Parlement européen rencontrés par la mission lors de son déplacement à Bruxelles lui ont ainsi indiqué que les représentants britanniques partisans du Remain restaient actifs, ce qui pouvait donner le sentiment que rien ne s’était passé. L’une d’entre eux, Jean Lambert, avait même été désignée candidate à la présidence du Parlement européen, qui s’est déroulée le 17 janvier 2017, par le groupe des Verts. Dans le même esprit, sa compatriote Vicky Ford a été réélue à la présidence de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
Malgré le résultat du référendum, le Royaume-Uni continue, comme il en a le droit, à utiliser les possibilités offertes par le droit européen pour participer aux politiques dont il considère qu’elles lui sont utiles. Le Gouvernement britannique a par exemple annoncé au Parlement, le 14 novembre 2016, son choix de faire valoir son droit « d’opt back in » pour participer à certains éléments du règlement révisé d’Europol (30) et confirmé son intention de ratifier l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (31).
L’article 50 permet en fait de distinguer deux périodes pour ce qui concerne la situation du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne :
– jusqu’à la notification de son intention de se retirer, le Royaume-Uni reste un État membre comme les autres, ce qui explique que les réunions ayant déjà eu lieu au Conseil européen entre les vingt-sept autres États membres, comme celles des 29 juin et 15 décembre 2016, n’ont pu avoir qu’un caractère informel ;
– après la notification de son intention de se retirer, l’article 50 apporte un seul tempérament à l’exercice de ses droits d’État membre : ses représentants au Conseil européen et au Conseil, ainsi que, par extension, dans leurs comités préparatoires, ne peuvent participer aux délibérations concernant son retrait. Il ne peut évidemment pas se trouver des deux côtés de la table des négociations.
La notification ouvre donc une nouvelle période où le Conseil européen et le Conseil pourront officiellement se réunir à vingt-sept États membres, par exemple pour arrêter les orientations de négociation, fixer le mandat de négociation ou conclure l’accord. Il s’agit cependant d’une exclusion du Royaume-Uni de portée réduite : l’État souhaitant se retirer continue à prendre part aux décisions du Conseil européen et du Conseil sur tous les autres sujets.
Il faut souligner qu’aucune disposition analogue n’est prévue pour les membres du Parlement européen. Les traités n’empêchent pas les membres du Parlement européen élus au Royaume-Uni de prendre part au scrutin relatif à l’accord de retrait. Selon l’ancien président du Parlement européen Martin Schulz (32), ce qui pourrait être considéré comme une faille des traités s’explique en fait par la nature du mandat des membres du Parlement européen : si les sièges sont répartis entre les États membres et le scrutin organisé en fonction de lois électorales nationales, les membres du Parlement européen représentent l’ensemble des citoyens de l’Union (33), et non pas seulement ceux de leur État d’élection.
Le départ programmé du Royaume-Uni le place dans une position particulière, puisque les traités lui permettent de se prononcer sur des réglementations qu’il n’aura pas à appliquer, ou qui lui seront appliquées sous un autre statut, comme celui de pays tiers. Il pourrait donc être tenté d’influencer les décisions européennes pour les rendre plus favorables au futur État tiers qu’il deviendra, par exemple en matière de services financiers.
Comme l’a souligné Harlem Désir lors de son audition (34), en tant que membre de l’Union, « il lui appartient néanmoins de faire de ses droits un usage qui respecte un esprit de coopération loyale (35). Le renoncement à sa présidence au deuxième semestre 2017 était à cet égard une décision importante et, pour tout dire, incontournable ». Cet impératif de loyauté devra être explicitement rappelé.
Les Vingt-Sept et la Commission devront faire preuve d’une vigilance constante et de cohésion pour faire prévaloir les intérêts de l’Union et s’assurer du respect de cet esprit. Pierre Sellal a ainsi indiqué à la mission que, alors que les dispositions relatives aux pays tiers dans les projets de textes européens faisaient auparavant l’objet d’un examen relativement rapide en fin de négociation, elles changeaient de nature dès lors qu’elles étaient destinées à s’appliquer au Royaume-Uni, et non à des partenaires plus éloignés comme le Japon, et devaient désormais faire l’objet d’un examen approfondi.
e. Les conséquences juridiques du retrait
i. La fin de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni
En application de l’article 50, le retrait a pour conséquence juridique la fin de l’application des traités (36) dans l’État membre concerné, qui acquiert le statut d’État tiers à l’Union européenne. À défaut d’accord sur les relations futures entre les deux parties ou de dispositions transitoires, leurs relations seraient fondées sur les cadres juridiques prévus par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) –avec application de la clause de la nation la plus favorisée et du tarif extérieur commun –, le Conseil de l’Europe ou l’Organisation des Nations Unies (ONU).
À partir de la date de son retrait de l’Union, le Royaume-Uni n’aura plus à mettre en œuvre le droit de l’Union et ne sera plus soumis à la juridiction de la CJUE. Réciproquement, l’Union européenne et ses vingt-sept États membres ne seront plus tenus de respecter le droit de l’Union vis-à-vis du Royaume-Uni.
La fin de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni constituera un bouleversement juridique pour le Royaume-Uni. Si les actes nationaux adoptés au fil des ans pour mettre en œuvre ou transposer le droit de l’Union européenne restent applicables jusqu’à ce que les autorités nationales décident de les modifier ou de les abroger, ce n’est pas le cas du droit européen d’application directe.
Pour combler le vide juridique laissé par l’inapplicabilité du droit de l’Union européenne, notamment dans le domaine de la compétence exclusive de celle-ci, le Royaume-Uni devra adopter un nombre important de nouvelles lois nationales, comme, par exemple, en matière de concurrence, de protection des consommateurs et de l’environnement, d’agriculture ou de pêche.
Afin de faciliter la transition en conservant l’acquis communautaire, Theresa May a annoncé, le 2 octobre 2016, qu’une grande loi d’abrogation (Great Repeal Bill) serait soumise au Parlement. Pour minimiser les ruptures, ce texte devrait transposer tout le droit européen d’application directe en droit britannique afin que, au lendemain de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les mêmes règles continuent à s’appliquer. Le Parlement de Westminster pourra ensuite examiner quelle part de cette législation conserver, amender ou abroger.
Pour l’Union européenne, la fin de l’application des traités au Royaume-Uni n’emportera pas de remise en cause de l’ordre juridique de la même ampleur, mais les conséquences juridiques pour l’Union et ses institutions n’en seront pas moins nombreuses. Elles devront être traitées, pour certaines, dans le cadre de l’accord de retrait négocié avec les Britanniques (cf. c du 3 du présent A), pour d’autres par les Vingt-Sept (cf. iii du présent e).
ii. La modification des accords internationaux dont l’Union européenne est partie
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne aura pour conséquence sa sortie de tous les accords internationaux auxquels il est partie via l’Union européenne, ce qui est susceptible d’affecter les deux parties dans leurs relations avec les pays tiers. Afin d’éviter une rupture brutale, cette question pourrait être, au moins partiellement, traitée dans l’accord de retrait ou faire l’objet de dispositions transitoires.
C’est pour le Royaume-Uni que les conséquences seront les plus importantes, puisque ce sera l’Union européenne à vingt-sept qui succédera à l’Union à vingt-huit pour l’application de ces accords. Le Royaume-Uni perdra le bénéfice des accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers ou des organisations régionales. Il devra par conséquent chercher à négocier d’autres accords, en particulier en matière commerciale, compétence exclusive de l’Union, sans bénéficier du poids reconnu à l’Union européenne dans les négociations internationales, ni des arguments économiques qu’elle peut mettre en avant. Étant lié jusqu’à sa sortie effective de l’Union par les traités européens, il ne pourra engager de telles négociations qu’après cette date.
L’Union européenne devra pour sa part se livrer à l’exercice inédit qui consiste à informer ses partenaires dans les quelque mille sept cents accords multilatéraux et bilatéraux dont elle est partie, dans tous les domaines (climat, coopération judiciaire, énergie, environnement, transport, etc.), du retrait du Royaume-Uni, de sa date de prise d’effet et de la modification du champ d’application de l’accord qui en découle. Pour de nombreux accords, cette modification n’engendrera pas de conséquences négatives pour les partenaires de l’Union et ne devrait donc pas soulever de difficultés.
La question sera en revanche particulièrement complexe et sensible pour les accords commerciaux. Harlem Désir a souligné lors de son audition que « un certain nombre de partenaires tiers de l’Union européenne ont un accord avec elle passé en fonction d’un marché de cinq cents millions d’habitants qui ne comprendra plus le marché britannique, ce qui peut conduire à des renégociations ». Ces partenaires pourraient demander des compensations du fait de la réduction de la taille du marché de l’Union européenne. Ce pourrait en particulier être le cas de pays dont les intérêts sont très liés au Royaume-Uni et qui ont besoin d’un accès préférentiel au marché britannique. Pour certains auteurs, il n’est en outre pas impossible qu’un État tiers utilise le prétexte du retrait britannique pour chercher à renégocier un accord et obtenir des avantages supplémentaires (37).
Enfin, la sortie du Royaume-Uni posera la question de la révision des contingents (38) affectés à l’Union européenne dans le cadre des accords commerciaux et, plus globalement, des engagements quantitatifs pris par l’Union européenne à vingt-huit.
iii. Des décisions difficiles à prendre par les Vingt-Sept consécutives au Brexit
Parallèlement ou consécutivement à la négociation de l’accord de retrait avec le Gouvernement britannique, l’Union européenne à vingt-sept aura également des décisions à prendre en son sein en conséquence du Brexit.
L’article 50 ne prévoit pas que l’accord de retrait puisse contenir des amendements aux traités. Une révision modeste des traités, fondée sur l’article 48 du TUE, sera donc nécessaire. Il s’agira par exemple de modifier l’article 52 du TUE relatif au champ d’application territoriale des traités, qui énumère les États membres, l’article 355 du TFUE, qui cite un certain nombre de territoires d’outre-mer, ainsi que les protocoles concernant le Royaume-Uni. Ces modifications ne devraient pas soulever de difficultés. De plus, en pratique, un éventuel retard pris dans la modification de ces dispositions serait sans réelles conséquences.
D’autres décisions risquent en revanche de s’avérer plus difficiles pour les Vingt-Sept.
● Ce sera le cas en matière budgétaire. Les Vingt-Sept devront tirer les conséquences du retrait britannique sur le budget de l’Union européenne, qui dépendront de l’accord trouvé ou non avec le Royaume-Uni dans le cadre de l’accord de retrait et du maintien ou non d’une contribution britannique au budget de l’Union après son retrait pour financer sa participation à certaines politiques.
Le départ du Royaume-Uni amputera le budget européen de la contribution nette britannique. Le montant à combler pourrait s’élever à environ 10 milliards d’euros par an (39). Les Vingt-Sept auront par conséquent des décisions extrêmement difficiles à prendre pour adapter le budget européen à cette perte de recettes. Les options ouvertes, qui portent toutes en germe un risque de division des États membres, sont les suivantes :
– augmenter les contributions nationales, ce qui pourrait faire porter une grande partie de la charge sur les contributeurs nets ;
– réduire les dépenses, ce qui pourrait pénaliser les pays qui bénéficient le plus de la politique de cohésion et de la politique agricole commune ;
– combiner les deux options précédentes.
Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et la suppression, en conséquence, du « rabais britannique », ainsi que des « rabais sur le rabais », offrent l’opportunité de réformer le budget de l’Union afin de le rendre plus lisible et plus équitable. Cette opportunité a d’ailleurs été soulignée par le groupe de haut niveau sur les ressources propres créé en février 2014 (40) pour réfléchir à des moyens de financement de l’Union européenne plus transparents, simples, équitables et responsables sur le plan démocratique. Dans son rapport de décembre 2016, le groupe présidé par Mario Monti souligne que le retrait du Royaume-Uni offre une occasion unique de revoir la manière dont nous mesurons les coûts et les bénéfices réels de l’Union et préconise, notamment, l’abolition de tout mécanisme de correction au niveau des recettes (41).
La contribution du Royaume-Uni au budget de l’Union européenne En 2015, le Royaume-Uni a été le second contributeur au budget de l’Union européenne, derrière l’Allemagne, avec un montant de contribution nette exceptionnellement élevé de 21,4 milliards d’euros (prenant en compte les ressources propres traditionnelles telles que les droits de douane, la ressource TVA, la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB) et le rabais britannique). Sur la période 2007-2014, le montant moyen de contribution versé par le Royaume-Uni s’est élevé à 13,7 milliards d’euros. Le Royaume-Uni se place au sixième rang des bénéficiaires en volume des politiques de l’Union, avec des retours estimés à 7,5 milliards d’euros en 2015. Le Royaume-Uni est donc fortement contributeur net au budget européen. Avec un solde net comptable de – 14 milliards d’euros en 2015 (solde le plus bas jamais enregistré par le Royaume-Uni), il est devenu le deuxième contributeur net au budget européen, alors qu’il occupait la troisième place, derrière la France, en 2014. Sur la période 2007-2014, le solde net comptable (42) du Royaume-Uni s’est en moyenne élevé à environ 7 milliards d’euros. ÉVOLUTION DES SOLDES NETS PAR ÉTAT MEMBRE (en millions d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Allemagne – 11 947 – 10 994 – 13 969 – 16 320 – 17 659 – 17 112 France – 6 476 – 6 455 – 8 406 – 9 052 – 7 489 – 6 138 Royaume-Uni – 7 914 – 7 255 – 9 244 – 10 760 – 7 088 – 13 952 Source : annexe au projet de loi de finances pour 2017 Relations financières avec l’Union européenne. |
● Les Vingt-Sept devront trouver un accord sur la relocalisation des agences européennes actuellement localisées au Royaume-Uni, à savoir l’Agence européenne du médicament, la plus importante (43), et l’Autorité bancaire européenne (44). Ces discussions sont traditionnellement difficiles, plusieurs pays ayant des arguments à faire valoir pour justifier l’implantation d’une agence sur leur sol.
● L’Union à vingt-sept devra statuer sur la question de l’emploi de fonctionnaires et agents britanniques au sein des institutions européennes.
Le statut des fonctionnaires européens (45) prévoit en effet que « nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il n’est ressortissant d’un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination » (article 28, point a) et que le fonctionnaire peut être démis d’office dans le cas où il cesse de satisfaire à cette condition (article 49). L’Union devra donc décider de la date à laquelle les Britanniques ne pourront plus se présenter aux concours de la fonction publique européenne et du sort de ceux qui seront en fonction lors de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Depuis le référendum britannique, on observe à cet égard qu’un certain nombre de fonctionnaires de la Commission européenne ou du secrétariat du Conseil européen ont entrepris des démarches pour acquérir la nationalité belge ou celle de leur conjoint, si il ou elle n’est pas britannique.
● Enfin, il conviendra de tirer les conséquences du départ des eurodéputés britanniques sur la composition du Parlement européen. Le paragraphe 2 de l’article 14 du TUE ne fixe que le nombre maximal de membres du Parlement. La composition du Parlement européen relève d’une décision du Conseil européen, qui doit être adoptée à l’unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation.
Plusieurs solutions sont envisageables :
– les effectifs du Parlement pourraient être diminués du nombre de sièges (73) qui revenaient au Royaume-Uni ;
– tout ou partie de ces sièges pourraient être redistribués entre les autres États membres, sachant qu’il ne pourrait y avoir, sans modification du traité, dépassement du nombre maximum de députés pouvant être attribué à un État membre, fixé à 96. Or l’Allemagne dispose déjà de 96 sièges au Parlement européen.
Lors de sa rencontre avec les membres de la mission (46), Martin Schulz, alors Président du Parlement européen, a estimé que le nombre actuel de membres du Parlement européen (751) était trop élevé. Le président-rapporteur souscrit à cette analyse et estime qu’il ne serait pas opportun de maintenir ce nombre par redistribution des sièges jusqu’ici attribués aux eurodéputés britanniques, a fortiori dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis des institutions européennes. De plus, l’article 14 du TUE disposant que « la représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle », une telle redistribution paraît incompatible avec l’impossibilité d’augmenter le nombre d’eurodéputés élus en Allemagne sans modifier le traité.
2. Des acteurs de la négociation qui donnent le ton
a. Au Royaume-Uni, un ministère dédié au Brexit, une Première ministre chargée des négociations
À la suite du résultat du référendum du 23 juin 2016, le Premier ministre britannique David Cameron, qui avait négocié en février un accord, aujourd’hui caduc (47), accordant de nouvelles dérogations au Royaume-Uni dans l’Union européenne pour convaincre les électeurs de voter pour le Remain, a présenté sa démission à la Reine le 13 juillet.
Il a été remplacé par son ancienne ministre de l’Intérieur, Theresa May, qui a immédiatement confirmé sa volonté de mettre en œuvre la sortie de son pays de l’Union européenne et donné des gages aux Brexiteers. Elle a ainsi placé les partisans de la sortie de l’Union européenne aux postes clés de la négociation en leur confiant les trois ministères les plus impliqués dans les négociations à venir, dont un ministère chargé spécifiquement du Brexit.
À ce triumvirat s’ajoute le chancelier de l’échiquier, Philip Hammond, ancien Bremainer, qui, même s’il n’est pas directement en charge des négociations de sortie du Royaume-Uni, bénéficie d’un poids politique important, d’une administration puissante et de liens étroits avec les milieux économiques, en particulier avec la City.
Un nouveau ministère entièrement dédié au Brexit (48) a été créé et confié à David Davis, eurosceptique convaincu, très engagé dans la campagne du référendum. David Davis a une réputation de négociateur intransigeant qui lui aurait valu le surnom de « Monsieur non » lorsqu’il était secrétaire d’État aux affaires européennes, de 1994 à 1997.
Ce ministère, par nature éphémère, aura un rôle central dans le dispositif britannique de négociations ; il aura compétence, dans les limites de ce qui lui sera délégué par la Première ministre, pour les négociations de l’accord de retrait et de l’accord sur la relation future avec l’Union européenne, y compris sur son volet commercial. Son rôle va au-delà des négociations sur le Brexit, puisque c’est David Davis qui représente le Gouvernement aux réunions du Conseil des affaires générales.
Il travaille en lien avec tous les ministères et les différents acteurs concernés (milieux économiques, syndicats, entités dévolues, etc.) pour établir une cartographie de la relation du Royaume-Uni avec l’Union européenne préalable à l’élaboration de la position de négociation. Cette tâche est considérable, dans la mesure où aucun plan n’avait été prévu par le Gouvernement précédent, ni par ceux qui avaient fait campagne en faveur du Brexit.
C’est également David Davis qui, au quotidien, intervient au Parlement sur les questions relatives au Brexit. Il est l’interlocuteur naturel de la nouvelle commission de la Chambre des Communes chargée de suivre le Brexit, présidée par le travailliste Hilary Benn.
Un second ministère nouvellement créé, le ministère du commerce international, a été attribué à une figure importante de la campagne en faveur du Brexit, Liam Fox. Ce ministère sera chargé des négociations commerciales avec les pays tiers, qui ne pourront réellement commencer que lorsque le Royaume-Uni ne sera plus membre de l’Union européenne, la politique commerciale étant une compétence exclusive de l’Union. La création de ce ministère s’inscrit dans la volonté du Gouvernement britannique de faire du Royaume-Uni un leader mondial du libre-échange. Elle pouvait être vue comme un signe avant-coureur d’une sortie de l’union douanière, en faveur de laquelle Liam Fox s’est d’ailleurs rapidement exprimé.
Enfin, l’ancien maire de Londres et grande voix de la campagne pour le Brexit, Boris Johnson, a été nommé Foreign Secretary. Le Foreign Office ne devrait toutefois exercer qu’un rôle marginal dans les négociations de sortie. Il pourrait se limiter à la définition de la position de négociation sur les volets externes du Brexit (politique étrangère et de sécurité commune et politique de sécurité et de défense commune), à apporter son éclairage sur les positions des autres États membres et à utiliser le réseau des ambassades britanniques pour, d’une part, valoriser l’image du Royaume-Uni dans la perspective de la préparation des accords commerciaux avec les pays tiers, et, d’autre part, faire du lobbying auprès des secteurs clés pour les négociations à venir dans les États membres de l’Union.
Très rapidement, différentes approches se sont exprimées au sein du Gouvernement, notamment entre ceux qui privilégiaient la souveraineté et une sortie rapide de l’Union européenne – avec une restriction à la liberté de circulation –, et ceux, comme Philip Hammond, qui étaient plus sensibles au souhait des milieux économiques de conserver une relation étroite avec l’Union européenne, incluant le maintien de l’accès au marché intérieur et du passeport européen, et d’éviter une sortie brutale de l’Union européenne.
Quelles qu’aient été les expressions publiques des différents membres du Gouvernement, il est apparu clairement que la Première ministre dirigerait directement les négociations, avec l’appui de David Davis, qui devrait être l’interlocuteur de Michel Barnier au quotidien. Theresa May devrait probablement, pour sa part, chercher à discuter directement avec les chefs d’État et de Gouvernement des Vingt-Sept les grands paramètres politiques de la négociation et à effriter le bloc que les Vingt-Sept ont réussi jusqu’ici à préserver intact.
Elle rend ses arbitrages dans le cadre d’un comité gouvernemental (European Union Exit and Trade Committee) qu’elle préside et qui rassemble douze membres du Gouvernement. Elle a rappelé à l’ordre à plusieurs reprises les ministres qui exprimaient des positions personnelles et les a invités à ne pas se livrer à un commentaire en continu sur le Brexit.
b. Pour l’Union européenne, une négociation menée par la Commission sous le contrôle étroit des États membres
Dès les lendemains du référendum, chacune des institutions européennes a désigné un représentant pour les négociations, avant même que le rôle de chacune ne soit précisé, l’article 50 laissant une marge d’appréciation en la matière. La mission d’information a pu s’entretenir avec ces trois personnalités, soit à Paris, soit à Bruxelles.
Le 25 juin 2016, le président du Conseil européen a mis en place une « task force sur le Royaume-Uni », placée sous l’autorité du secrétaire général du Conseil et de la présidence du Conseil européen et dirigée par Didier Seeuws, directeur des départements transports, télécommunications et énergie du Conseil européen.
Le 27 juillet 2016, le président de la Commission européenne a nommé Michel Barnier à la fonction de négociateur en chef responsable du groupe de travail de la Commission chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.
Enfin, le 8 septembre 2016, la Conférence des présidents a nommé Guy Verhofstadt comme représentant du Parlement européen pour les négociations.
Le 15 décembre 2016, à l’issue d’une réunion informelle en marge du Conseil européen, les chefs d’État ou de Gouvernement de vingt-sept États membres, ainsi que les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, ont précisé les modalités de procédure applicables aux négociations et le rôle de chacune des institutions.
Tout en confortant le rôle de la Commission et de Michel Barnier, la déclaration commune des Vingt-Sept prévoit les modalités du pilotage de la négociation par les États membres : le Conseil européen sera pleinement informé tout au long de la négociation et une organisation ad hoc est mise en place pour assurer le suivi permanent de la négociation par le Conseil.
Ce sera logiquement la Commission, qui détient toute l’expertise et l’infrastructure administrative nécessaires, la seule interlocutrice du Royaume-Uni pour la négociation. Didier Seeuws a ainsi précisé à la mission que le groupe de travail qu’il dirigeait avait un rôle essentiellement interne au Conseil : sa mission est d’aider Donald Tusk, le président du Conseil européen, à préparer les travaux du Conseil européen ayant trait au Brexit, par exemple en étudiant les différents scénarios possibles et en préparant les orientations de négociation. Seuls les Britanniques auraient un intérêt à ce que des discussions avec le Conseil européen s’engagent parallèlement à celles qui seront menées par la Commission.
Michel Barnier a pris ses fonctions le 1er octobre 2016. Lors de son déplacement à Bruxelles, la mission a pu constater que sa nomination comme négociateur en chef bénéficiait d’un accueil favorable. Aussi bien Didier Seeuws, pour le Conseil européen, que Guy Verhofstadt, pour le Parlement européen, ont souligné qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec lui. Comme les différents interlocuteurs de la mission, le président-rapporteur estime que son expérience solide, sa parfaite connaissance des institutions européennes – comme ancien membre du Conseil au titre de ses fonctions ministérielles en France, ancien commissaire européen et ancien membre du Parlement européen –, et sa maîtrise des questions liées au marché intérieur constituent autant d’atouts pour mener une négociation qui devra inclure, à des degrés divers, les différentes institutions européennes, et respecter les sensibilités des États membres.
Son état d’esprit au moment où les négociations devraient s’engager est également celui de la mission : ne faire preuve d’aucun esprit de punition, ne pas proférer de menaces, mais se garder de toute naïveté au moment de défendre les principes fondamentaux du projet européen et l’unité des Vingt-Sept.
Comme l’a rappelé Harlem Désir lors de son audition, il n’y aura pas un négociateur par État membre. Cependant, compte tenu du caractère exceptionnel de cette négociation et de son importance, aussi bien pour l’avenir de l’Union que pour chaque État membre pris individuellement, la Commission agira sous le contrôle étroit du Conseil européen, qui restera saisi en permanence de la question, et du Conseil.
Le pilotage de la négociation par les États membres se manifestera à toutes les étapes de la négociation.
Dès son lancement, le travail du négociateur de l’Union sera encadré par les orientations du Conseil européen et le mandat de négociation arrêté par le Conseil. Les directives du Conseil, qui porteront à la fois sur le contenu de la négociation ainsi que sur les modalités détaillées régissant les relations du Conseil avec le négociateur, pourront être modifiées et complétées tout au long des négociations afin de tenir compte de l’évolution des orientations du Conseil européen.
Des représentants du président du Conseil européen participeront en outre, « dans un rôle de soutien » à toutes les sessions de négociation et le négociateur rendra systématiquement compte au Conseil européen, au Conseil et à ses instances préparatoires. L’équipe du négociateur de l’Union devrait également intégrer un représentant de la présidence tournante du Conseil. Il s’agit d’un élément important pour la confiance et le maintien de la cohésion des Vingt-Sept. Les États membres seront ainsi en contact permanent avec l’équipe de négociation et seront informés de toutes les étapes de la négociation. Il reviendra à chaque État membre d’organiser le dialogue indispensable avec son Parlement national.
De plus, un groupe de travail ad hoc sera créé auprès du Conseil et du Comité des représentants permanents (Coreper) afin de les aider à s’assurer, entre les réunions du Conseil européen, que les négociations sont conduites conformément aux orientations du Conseil européen et aux directives de négociation du Conseil, et fournir des indications au négociateur. Pour plus d’efficacité, les différents pays devant présider l’Union européenne au cours de la période prévisible des négociations (Malte, Estonie et Bulgarie) ont accepté que ce groupe de travail dispose d’une présidence permanente.
Enfin, les représentants des vingt-sept chefs d’État ou de Gouvernement seront associés à la préparation du Conseil européen. Les représentants du Parlement européen seront invités à ces réunions préparatoires.
c. Le Parlement européen, un acteur, un partenaire
La place accordée au Parlement européen dans le dispositif de négociation a fait l’objet de controverses avant le Conseil européen du 15 décembre 2016, le Parlement se jugeant insuffisamment associé à la négociation, alors qu’il devra se prononcer sur l’accord négocié. Les États membres s’en tenaient à une lecture stricte de l’article 50, aux termes duquel il revient au Parlement européen d’approuver l’accord, et estimaient qu’il ne devait pas être représenté dans l’équipe de négociation. Schématiquement, selon l’interprétation résumée par Pierre Sellal, il revient au Conseil européen de piloter, à la Commission de négocier et au Parlement d’approuver.
Les modalités finalement retenues par les Vingt-Sept prévoient l’information du Parlement européen à toutes les étapes du processus : outre sa participation aux réunions préparatoires au Conseil européen, le Parlement européen sera tenu étroitement informé tout au long des négociations par le négociateur, son président sera invité à s’exprimer au début des réunions du Conseil européen et la présidence du Conseil sera prête à procéder à un échange de vues avec le Parlement avant et après chaque session du Conseil des affaires générales. Selon Martin Schulz et Guy Verhofstadt (49), le Parlement européen aurait eu en outre l’assurance d’être représenté dans l’équipe de négociation formée par la Commission.
Pour le président-rapporteur, le Parlement européen ayant un droit de veto sur l’accord de retrait, il est primordial qu’il puisse faire valoir ses positions et être informé tout au long de la négociation afin de ne pas prendre le risque d’un rejet de l’accord en fin de processus. Sa participation à l’équipe de négociation ne paraîtrait par conséquent pas illégitime.
Même si le Règlement du Parlement européen confie une responsabilité particulière à la commission des affaires constitutionnelles (AFCO), compétente sur l’accord de retrait, la question du Brexit a été prise en charge par la Conférence des présidents (50), qui a estimé que c’était à son niveau que l’on pouvait parvenir à dégager une majorité la plus large possible. L’exigence d’un large accord est d’autant plus grande que les eurodéputés britanniques pourront participer au vote sur l’accord de retrait ; il serait pour le moins inopportun que leurs suffrages soient décisifs.
Le rôle confié par la Conférence des présidents à Guy Verhofstadt, qui est à la fois membre de la Conférence des présidents en tant que président du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe et membre de la commission AFCO, est avant tout un rôle d’information et de coordination. Il tiendra la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions informées au fur et à mesure de l’avancement des négociations et travaillera sur le fond en étroite collaboration avec la présidente de la commission des affaires constitutionnelles et les membres des autres commissions pour les questions sectorielles.
Dès la notification de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, le Parlement européen votera une résolution précisant ses « lignes rouges » pour la négociation, sur la base des travaux effectués par les différentes commissions concernées. Au-delà du vote de cette résolution, chaque commission poursuivra son travail d’inventaire, secteur par secteur.


![]()
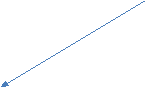
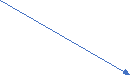
![]()
![]()
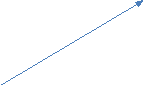
![]()

![]()
![]()
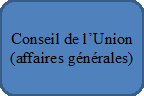
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
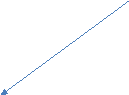
![]()
![]()
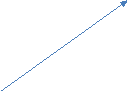
![]()

négocient
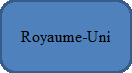
![]()
![]()
Schéma : le rôle des institutions dans le processus de négociation de l’accord de retrait
3. Le cadre de négociations, premier enjeu des discussions : la maîtrise du calendrier et la détermination du champ de l’accord
a. Une initiative qui revient au Royaume-Uni
La date de déclenchement de la procédure de retrait a constitué le premier objet de discussion entre le Royaume-Uni et les vingt-sept autres États membres de l’Union européenne. Les Européens ont en effet fait savoir très rapidement, par la voix des Vingt-Sept (51) et celle du Parlement européen (52) qu’ils estimaient que la notification devait intervenir aussi rapidement que possible, la résolution du Parlement européen évoquant même la date de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin 2016.
Tout en comprenant que les autorités britanniques aient besoin de temps pour se préparer aux négociations de sortie et sur les relations futures, ils ont souligné que la période d’incertitude était nuisible aux économies britannique et européenne.
La rédaction de l’article 50 laisse au seul État membre concerné le choix du moment de la notification au Conseil européen de son intention de se retirer. Comme la décision elle-même, le choix de la date de déclenchement du processus de sortie de l’Union revêt un caractère unilatéral. Les autres États n’ont aucun moyen autre que politique d’influencer ce choix.
Alors que les Européens avaient fait connaître leur souhait que les négociations puissent commencer le plus rapidement possible, Theresa May leur a indiqué dès sa prise de fonctions qu’elle n’envisageait pas d’activer l’article 50 avant la fin de l’année 2016, ayant besoin de temps pour mettre en place le dispositif de négociation, de réfléchir aux différentes options et de définir une stratégie de négociation. Comme elle l’a déjà montré dans le dossier du projet nucléaire d’Hinkley Point, elle ne prend pas de décision de manière hâtive et souhaitait tout connaître du statut du Royaume-Uni au sein de l’Union avant d’activer l’article 50.
Le calendrier de déclenchement de la procédure de retrait a finalement été clarifié sous la triple pression des partisans du Brexit, des parlementaires britanniques et, dans une moindre mesure, des partenaires européens. Dans son discours à la conférence du parti conservateur, le 2 octobre 2016, Theresa May a affiché sa détermination à ne pas retarder le Brexit et annoncé qu’elle activerait l’article 50 avant la fin du mois de mars 2017.
Le calendrier annoncé est compatible avec l’un des objectifs des Européens, qui est que le Royaume-Uni soit sorti de l’Union avant les élections européennes de 2019, afin qu’il n’y ait lieu ni d’élire de nouveaux représentants britanniques au Parlement européen ni de désigner un nouveau membre britannique à la Commission européenne. Le Royaume-Uni est, pour sa part, soumis à une autre contrainte électorale, d’échéance plus lointaine, à savoir les élections générales de 2020.
Le Gouvernement britannique a affiché sa détermination à respecter le calendrier annoncé, malgré la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni du 24 janvier 2017 imposant le vote d’une loi (act of Parliament) comme préalable à la notification. L’agenda parlementaire a été dégagé et un texte très court déposé dès le 26 janvier 2017 afin que le débat parlementaire ne retarde pas l’activation de l’article 50. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des Communes le 8 février 2017 et son adoption définitive, selon une procédure accélérée, devrait intervenir dans des délais permettant au Gouvernement de respecter le calendrier annoncé.
La Cour suprême n’a en revanche pas imposé la consultation des entités dévolues, ce qui aurait, à n’en pas douter, conduit à reporter la notification.
b. Des délais encadrés par le traité et maîtrisés par l’Union européenne
Si le déclenchement du processus de négociation est à l’initiative de l’État qui souhaite se retirer, une fois l’article 50 activé, le traité fixe un délai de deux ans – qui démarre au jour de la notification –, au terme duquel les traités cessent de s’appliquer à l’État concerné, qu’un accord fixant les modalités de son retrait ait été conclu ou non.
Compte tenu de la complexité de la question, le traité a toutefois prévu l’hypothèse où la durée de deux ans s’avérerait insuffisante et permet sa prorogation. Cette prorogation doit toutefois être décidée à l’unanimité du Conseil européen. Il suffit donc qu’un seul État membre considère que la négociation a suffisamment duré pour qu’elle s’interrompe. Une prorogation du délai de négociation aurait pour conséquence de prolonger l’incertitude, sans garantie sur l’aboutissement des négociations ; elle ne paraît donc opportune ni politiquement ni économiquement. Elle conduirait en outre à reporter la fin de la négociation après les élections européennes de 2019.
Comme Harlem Désir l’a souligné lors de son audition, « une fois l’article 50 activé, le calendrier est balisé et l’Union européenne maîtrise de fait la procédure et la négociation ». La maîtrise du calendrier constitue un atout pour les Vingt-Sept, qui sera d’autant plus fort qu’ils resteront unis.
Le délai de deux ans pour aboutir à un accord peut paraître court au regard de l’ampleur de la tâche, et ce d’autant plus que la négociation elle-même durera en fait moins de deux ans, cette durée incluant :
– en amont de la négociation, le temps nécessaire au Conseil européen pour fixer les lignes directrices et au Conseil pour autoriser la négociation, sur la base de la recommandation de la Commission ;
– en aval de la négociation, le temps nécessaire à la révision juridique et linguistique des textes, ainsi qu’à l’approbation de l’accord par le Parlement européen, le Conseil et le Royaume-Uni.
Selon Michel Barnier, la négociation devra donc durer moins de 18 mois. Si l’article 50 est activé en mars 2017, pour respecter le délai de deux ans, un accord devra être atteint d’ici octobre 2018.
Calendrier de la négociation de l’accord de retrait
Dans l’hypothèse d’une activation de l’article 50 au mois de mars, comme annoncé par Theresa May, le calendrier des principales étapes de la procédure prévue à l’article 50 pourrait être le suivant :
– mars 2017 : notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer ;
– avril 2017 : adoption des orientations du Conseil européen ;
– avril 2017 : recommandation de la Commission au Conseil ;
– mai 2017 : adoption par le Conseil, à la majorité qualifiée, du mandat de négociation et désignation du chef de l’équipe de négociation ;
– au plus tard en septembre 2018 : transmission par le négociateur d’un projet d’accord au Conseil ;
– au plus tard à la fin de l’année 2018 : révision de l’accord par les juristes-linguistes ;
– au plus tard en février 2019 : approbation de l’accord par le Parlement européen ;
– avant mars 2019 : adoption par le Conseil, à la majorité qualifiée, de la décision portant conclusion de l’accord et ratification de l’accord par le Royaume-Uni ;
– mars 2019 : retrait du Royaume-Uni à défaut d’accord et de prorogation du délai à l’unanimité des Vingt-Sept.
Source : encadré réalisé à partir des informations fournies par la Commission européenne.
À ce stade, le Gouvernement britannique a exprimé son accord avec ce calendrier et estimé qu’il ne serait pas nécessaire de demander une prolongation. Lors de son discours du 17 janvier 2017, Theresa May a même affiché l’ambition de parvenir à un accord sur les relations futures dans le délai de deux ans prévu par l’article 50, ce qui paraît peu réaliste.
L’encadrement de la négociation dans le temps était nécessaire pour plusieurs raisons. Il est d’abord dans l’intérêt de tous de mettre fin à l’incertitude et de donner de la visibilité et des certitudes aux citoyens et aux acteurs économiques. Pour le président-rapporteur, il est en outre nécessaire que le Brexit se concrétise rapidement ; rien ne serait pire vis-à-vis des populations européennes – et pas seulement britanniques – que de donner à penser qu’il n’est pas tenu compte des résultats du référendum, quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur ces résultats et sur le déroulement de la campagne qui y a conduit.
Outre le problème, déjà évoqué, des élections européennes de 2019, il faut également être attentif à préserver le bon fonctionnement de l’Union européenne. Une négociation trop longue risquerait d’obérer la capacité des Vingt-Sept à avancer sur les sujets prioritaires pour l’Union, tels que ceux qui ont été mis en avant lors du sommet de Bratislava en septembre dernier. À cet égard, on ne peut que se féliciter du fait que, depuis le mois de juin 2016, le Brexit n’ait pas dominé l’agenda des conseils européens.
Enfin, au fil des mois, la participation du Royaume-Uni aux décisions d’une Union européenne qu’il s’apprête à quitter et avec laquelle il est en négociation deviendra de plus en plus problématique et un risque pourrait exister qu’il utilise cette position comme levier pour faire pression sur les Vingt-Sept dans la négociation. S’assurer de sa « coopération loyale » sera de plus en plus difficile au fur et à mesure de l’avancée des négociations, surtout si le climat de la négociation se détériore.
c. La détermination du champ de l’accord, première étape de la négociation
S’il fixe le cadre et le calendrier de sa négociation, l’article 50 n’énumère pas les matières faisant partie de l’accord de retrait. La détermination du champ de l’accord de retrait constituera par conséquent la première étape des discussions avec les Britanniques. Cette discussion posera les bases de la répartition des sujets entre l’accord de retrait et l’accord sur les relations futures, ces deux accords étant, le cas échéant, articulés au moyen de dispositions transitoires.
Les divergences sur la manière d’engager la négociation sont déjà affichées : alors que l’Union européenne pose la conclusion d’un accord de retrait comme une condition préalable aux négociations sur le partenariat futur, Theresa May a affiché sa volonté, dans son discours du 17 janvier 2017, « que nous soyons parvenus à un accord sur notre partenariat futur d’ici à la conclusion de la procédure de deux ans de l’article 50 ». Les Britanniques ont un intérêt à lier le plus possible les négociations de retrait stricto sensu et les négociations sur les relations futures, afin de ne conclure d’accord sur les modalités, notamment financières, du retrait qu’en fonction du résultat obtenu sur les relations futures.
Selon la position française, qui rejoint l’analyse de la Commission européenne, l’accord de retrait devrait se limiter à traiter les sujets nécessaires pour que le retrait soit ordonné, dans les domaines institutionnel, administratif, juridique et budgétaire ; il fixera également la date de sortie du Royaume-Uni et ses modalités d’exécution.
Les deux sujets les plus susceptibles de faire apparaître des tensions entre négociateurs européens et britanniques devraient être abordés par les négociateurs européens dès le début de la négociation. Il s’agit de la « facture » du Brexit et du sort des citoyens européens au Royaume-Uni et des citoyens britanniques dans l’Union européenne. Selon Didier Seeuws, on ne peut exclure qu’elles conduisent les Britanniques à mettre un terme prématuré à la négociation avant le délai de deux ans prévu par l’article 50, créant une situation d’insécurité juridique totale et une crise politique majeure.
● La question financière sera l’un des principaux enjeux de la négociation de l’accord de retrait. Au-delà de la question du maintien d’une contribution financière du Royaume-Uni en échange de sa participation à certains programmes, qui dépendra d’un accord éventuel sur les relations futures, il s’agira de s’assurer qu’il s’acquitte de l’ensemble de ses obligations et de tous les paiements correspondant aux engagements contractés.
Selon l’analyse des institutions européennes, présentée à la mission par Didier Seeuws, les sommes dues par le Royaume-Uni à l’Union européenne lors de sa sortie sont évaluées entre 55 et 60 milliards d’euros et recouvrent trois grands types de dépenses :
– les obligations souscrites par le Royaume-Uni pour la durée du cadre financier pluriannuel 2014-2020, ainsi que dans le cadre de la politique de cohésion ;
– les restes à liquider, c’est-à-dire la différence entre les engagements contractés tant que le Royaume-Uni est membre de l’Union et les paiements effectués. Les engagements pris jusqu’en 2019 devraient donner lieu à des paiements étalés bien après le Brexit ;
– la part britannique de la contribution budgétaire aux pensions des fonctionnaires européens pour tous les droits totalisés durant la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l’Union européenne. Les fonctionnaires européens travaillant au service de tous les États membres, le Royaume-Uni doit contribuer au paiement des pensions de tous ces fonctionnaires (53), et non des seuls fonctionnaires de nationalité britannique.
Il existe en outre des engagements plus complexes comme les garanties données pour le plan Juncker, l’aide macroéconomique à des pays tiers, comme l’Ukraine, ainsi que l’actif et le passif de la Banque centrale d’investissement.
La négociation portera à la fois sur le montant, que les Britanniques s’efforceront de réduire, et sur les modalités de paiement.
● La question des droits des personnes physiques et morales devra également être examinée dans le cadre de l’accord de retrait afin qu’il n’existe ni incertitude ni risque de contentieux lors de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cette question est particulièrement sensible pour ce qui concerne les droits des 3,2 millions de citoyens européens aujourd’hui installés au Royaume-Uni et ceux des 1,2 million de Britanniques installés dans les vingt-sept autres États membres, qu’il s’agisse des droits au séjour, au travail, aux études, aux soins, à la retraite ou de la coordination des régimes de sécurité sociale. Comme la question budgétaire, elle devrait être abordée rapidement dans la négociation.
● Sur les plans institutionnel et administratif, l’accord devra préciser dans quelles conditions les représentants du Royaume-Uni quitteront, au jour de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, leurs fonctions au Conseil européen, à la Commission européenne, au Parlement européen, à la Cour de justice de l’Union européenne, au Comité économique et social, au Comité des régions ainsi que dans les agences et organes de l’Union.
Cette question est distincte de celle des fonctionnaires et agents britanniques exerçant au sein des institutions européennes, qui n’y représentent par leur État. Le cas des fonctionnaires ne relève pas a priori de la négociation avec le Royaume-Uni – sauf s’il demandait à y intégrer ce sujet –, mais de décisions de l’Union à vingt-sept États membres (cf. supra).
● L’accord de retrait devra prévoir les modalités d’aboutissement des procédures administratives et contentieuses en cours devant la Commission européenne, le Tribunal ou la Cour de justice, qui peuvent concerner le Royaume-Uni lui-même, mais aussi des entreprises ou collectivités locales du Royaume-Uni.
● Sauf modification des traités, la sortie du Royaume-Uni aura également pour conséquence sa sortie du capital de la Banque européenne d’investissement (BEI), puisque l’article 308 du TFUE dispose que « les membres de la Banque européenne d’investissement sont les États membres ». Les pays tiers peuvent avoir des accords de coopération avec la BEI, mais ne peuvent plus faire partie du capital. L’enjeu est d’importance pour la BEI. Le Royaume-Uni fait partie, au même titre que l’Allemagne, la France et l’Italie, de ses principaux actionnaires : il détient 16,1 % de son capital (39,2 milliards d’euros sur un total de 243,3 milliards d’euros) et a reçu en 2016 plus de 5,5 milliards de livres de prêts.
● Le Brexit aura pour conséquence un rétrécissement des frontières de l’Union qui soulèvera des difficultés devant être traitées dans l’accord de retrait. Outre la question de Gibraltar, il y a celles des bases militaires britanniques situées sur territoire souverain britannique à Chypre et, surtout, de l’Irlande, où la seule frontière terrestre entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sépare l’Irlande du Nord de la République d’Irlande. Le retour d’une frontière dont le franchissement serait contrôlé constitue un enjeu majeur dans un territoire dont une large partie de la population se définit comme irlandaise plutôt que britannique et où une Common travel area existe depuis 1922 (cf. infra).
● Concernant la relocalisation des agences européennes situées au Royaume-Uni (Agence européenne du médicament et Autorité bancaire européenne), si le choix de leur nouveau siège relève d’une décision des Vingt-Sept, les modalités et le calendrier de leur déménagement devraient faire l’objet de négociations avec le Royaume-Uni. Outre celui de ces deux agences, il conviendra de traiter celui de la section de la division centrale du tribunal de première instance de la juridiction unifiée des brevets, qui devait s’établir à Londres (54). Pour le président-rapporteur, il serait inconcevable qu’un organe de l’Union européenne conserve un siège en dehors de l’Union.
● Enfin, comme cela a déjà été évoqué, le traitement des accords internationaux dont l’Union européenne est partie sera complexe et pourrait faire l’objet de négociations avec le Royaume-Uni dans le cadre de l’accord de retrait. En effet, comme l’a souligné Philippe Léglise-Costa lors de son audition, « lorsque le Royaume-Uni sortira de l’Union, les pays avec lesquels nous avons collectivement contracté pourront demander des compensations, le territoire de l’Union et le nombre de consommateurs se réduisant. Il ne serait pas acceptable pour les Vingt-Sept de payer pour la sortie du Royaume-Uni ; il faudra donc prévoir dans l’accord de retrait que le Royaume-Uni assumera le règlement de ces compensations » (55).
B. ÊTRE PRÊTS À NÉGOCIER DÈS L’ACTIVATION DE L’ARTICLE 50
1. Des principes cardinaux posés par les Vingt-Sept dès le lendemain du référendum
Quelques jours après le vote des électeurs britanniques en faveur de la sortie de l’Union européenne, en marge du Conseil européen des 28 et 29 juin 2016, les chefs d’État ou de Gouvernement des vingt-sept États membres autres que le Royaume-Uni se sont réunis de manière informelle pour poser quelques principes généraux nécessaires à l’organisation ordonnée du retrait du Royaume-Uni. La mission d’information a pu constater avec satisfaction au cours de ses auditions et déplacements que l’unité des Vingt-Sept autour de ces principes, auxquels le président-rapporteur adhère pleinement, ne s’était pas démentie.
a. Pas de négociations sans notification
Le premier de ces principes est que l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE) est l’unique base juridique du processus de retrait d’un État membre de l’Union européenne. Il ne peut y avoir par conséquent aucune négociation tant que le Royaume-Uni n’a pas notifié au Conseil européen son intention de se retirer. Il est primordial d’éviter que le Royaume-Uni puisse poser des conditions à sa notification et que puissent s’engager des « pré-négociations » visant à obtenir des Vingt-Sept ou de tel ou tel État membre – ce qui serait destructeur pour l’unité des Vingt-Sept et la défense des intérêts de l’Union – des garanties préalables à l’ouverture des négociations. C’est le sens de la réponse que le président du Conseil européen, Donald Tusk, a adressée aux parlementaires britanniques qui lui avaient demandé que le Conseil européen se saisisse dès le mois de décembre de la question de l’avenir des citoyens européens au Royaume-Uni et des citoyens britanniques dans l’Union européenne. Il leur a, à cette occasion, rappelé que « le seul moyen de dissiper les craintes et les doutes de tous les citoyens concernés est le déclenchement le plus rapide possible des négociations ».
Ce principe a également été rappelé par la Première ministre polonaise lors de sa visite à Londres du 28 novembre 2016, lors de laquelle le Gouvernement britannique s’est livré à une véritable opération de séduction. Si le Brexit a été évoqué lors des entretiens et un « bon compromis » souhaité, Beata Szydlo a insisté sur le fait que les négociations ne pourraient commencer que lorsque le Royaume-Uni aurait engagé la procédure pour sortir de l’Union. Cette preuve de fermeté de la part d’un pays dont on pouvait craindre qu’il soit l’un des plus sensibles aux pressions britanniques est un signe encourageant de l’unité des Vingt-Sept, à ce stade, sur les principes arrêtés en juin 2016. Cette unité a été confirmée par l’échec de la tentative du Royaume-Uni, en décembre 2016, de proposer à huit pays membres un accord au sujet de leurs ressortissants.
b. L’acceptation de chacune des quatre libertés, condition de l’accès au marché unique
Tout en déclarant espérer que le Royaume-Uni resterait un partenaire proche de l’Europe, les Vingt-Sept ont fixé des limites à ce partenariat en rappelant que tout accord qui sera conclu avec le Royaume-Uni comme pays tiers devra être équilibré en ce qui concerne les droits et les obligations.
En particulier, l’accès au marché unique passe obligatoirement par l’acceptation de chacune des quatre libertés du marché intérieur (libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux). Il ne saurait par conséquent y avoir d’accès du Royaume-Uni au marché intérieur européen sans liberté de circulation des citoyens européens au Royaume-Uni.
Le caractère indissociable des quatre libertés doit en outre être compris comme incluant tous les mécanismes qui permettent d’assurer leur effectivité, en particulier les pouvoirs de contrôle de la Commission européenne et la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). On pourrait également ajouter, même si ce n’est pas explicite dans la déclaration commune des Vingt-Sept, que, lorsqu’ils seront sortis de l’Union européenne, les Britanniques ne pourront plus participer à l’élaboration de ses décisions.
Enfin, l’accès au marché intérieur, comme à certaines politiques, suppose le respect dans le temps de toutes les réglementations correspondantes dans l’Union européenne, ainsi qu’une contribution suffisante au budget européen. Ces principes, qui s’appliquent par exemple à la Suisse et à la Norvège, doivent également s’appliquer au Royaume-Uni, quel que soit le type de relation future envisagée.
Lors de son discours du 17 janvier 2017, Theresa May a pris acte de la fermeté et de l’unité des Vingt-Sept sur ces principes, constatant qu’ils ne permettaient pas le maintien du Royaume-Uni dans le marché unique. Les représentants de la City avaient déjà, dans les jours précédents, semblé renoncer à espérer le maintien du passeport européen pour les services financiers.
c. Les négociations ne sauraient aboutir à ce qu’un État tiers bénéficie d’un régime aussi avantageux qu’un État membre
Comme les dirigeants européens l’ont rappelé avec constance depuis le résultat du référendum, « la sortie de l’Union ne saurait être une meilleure option que l’appartenance à celle-ci » (56). Le président-rapporteur est particulièrement attaché à ce principe : il ne s’agit pas de faire preuve d’une quelconque attitude punitive à l’égard d’un État qui a démocratiquement pris une décision relevant de sa souveraineté nationale, mais de préserver les intérêts, l’intégrité et la cohésion du projet européen. Il y a – et cela doit rester le cas – un saut qualitatif entre le statut d’État membre et celui de partenaire de l’Union européenne, quelle que soit la forme de ce partenariat. Le président-rapporteur estime que tout doit être mis en œuvre pour que ce qui constituera le premier rétrécissement de l’Union européenne depuis sa création ne marque pas le début de sa dislocation. Il faut pour cela veiller à ce qu’aucun autre pays ne se sente mieux protégé à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Union.
2. Un important travail de préparation : l’identification des enjeux et la mise en ordre de marche des administrations
Défaire les liens tissés pendant plus de quarante ans entre le Royaume-Uni et la Communauté – puis l’Union – européenne constituera un exercice inédit et éminemment complexe, aussi bien d’un point de vue technique que politique. Il suppose un important travail préalable de préparation pour en identifier tous les enjeux.
a. Au Royaume-Uni, une administration à réorganiser
L’administration britannique n’était, pas plus que les dirigeants politiques, préparée au résultat du référendum du 23 juin 2016, même si de nombreux rapports sur les conséquences d’un éventuel Brexit avaient été produits, notamment par le Trésor, dans les mois qui ont précédé le référendum. En l’absence de plan préalable, aussi bien du Gouvernement de David Cameron que des hérauts du Brexit pendant la campagne, les différentes options, fondamentales pour l’avenir du pays, n’ont pu être anticipées.
La création de nouveaux ministères, dont le Department for Exiting the EU, s’est en outre accompagnée d’une réorganisation d’ampleur de l’administration destinée à mener le travail d’identification des enjeux et de négociation pour le Royaume-Uni. Des difficultés d’ordre administratif, inhérentes à une réorganisation de cette importance, sont donc venues s’ajouter aux incertitudes politiques sur la stratégie à suivre. Lors de son entretien avec les membres de la mission, David Davis a d’ailleurs pu donner l’impression d’être plus préoccupé par des questions de ressources humaines, devant embaucher des centaines de personnes, qu’en mesure de donner des orientations précises.
Dès la création du nouveau ministère, son administration a intégralement absorbé la direction Europe – l’équivalent de notre Secrétariat général des affaires européennes – ainsi que la EU referendum unit du Cabinet Office. Ses effectifs ont rapidement été renforcés par le rattachement au nouveau département des agents traitant des questions internes et institutionnelles de l’Union au sein de la direction Europe du Foreign office, puis par des redéploiements de fonctionnaires issus de tous les ministères (Treasury, Foreign office, Home office, Department for Environment, Food & Rural Affairs, etc.), sur la base du volontariat.
L’objectif de la création de cette nouvelle administration n’est toutefois pas de se substituer à la compétence des ministères responsables du fond de la politique considérée, mais de coordonner leurs positions pour aboutir à l’élaboration d’un diagnostic partagé des enjeux du Brexit. Une partie significative de l’expertise est donc demeurée au sein des ministères, qui rassemblent les données et préparent des analyses transmises au ministère du Brexit.
Le ministère est organisé en six directions, dont trois correspondent aux questions clés de la négociation : justice, sécurité et immigration ; commerce et partenariats ; accès au marché et budget. Ces trois directions coordonnent le travail interministériel avec les ministères concernés. Les trois autres directions sont consacrées à des analyses stratégiques, notamment économiques ; à l’examen des conséquences domestiques des options envisagées par les trois directions sectorielles ; à l’élaboration du plan et aux questions législatives et parlementaires.
Au 14 décembre 2016, les effectifs du ministère comptaient trois-cent-trente (57) personnes à Londres, auxquels s’ajoutaient les cent-vingt personnes travaillant à la représentation permanente du Royaume-Uni à Bruxelles, sur lesquelles le ministère peut également s’appuyer. La représentation permanente rapporte au Foreign office pour ce qui concerne les relations bilatérales avec les autres pays de l’Union européenne et au Department for Exiting the EU pour les questions relatives à l’Union européenne.
Des recrutements sont encore en cours, qui pourraient s’étendre en dehors de la sphère administrative. La compétence exclusive de l’Union européenne en matière commerciale a notamment conduit à une diminution de l’expertise de l’administration britannique en ce domaine.
L’administration du Department for Exiting the EU est dirigée par Oliver Robbins, qui était directeur de l’immigration au Home office lorsque le ministère était dirigé par Theresa May. Oliver Robbins est par ailleurs « sherpa » de la Première ministre, ce qui lui permettra d’assurer la cohérence entre les positions du ministre du Brexit et celles de Theresa May, et témoigne de la volonté de celle-ci de contrôler étroitement le déroulement des négociations.
Dans un premier temps, la mission de ce ministère consiste à travailler à l’établissement d’une cartographie de la relation du Royaume-Uni à l’Union européenne. Un vaste processus de consultation a été engagé, avec, notamment, les acteurs économiques, les représentants de la société civile, les administrations dévolues, les gouvernements d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, les universités et les centres de recherche.
Ces consultations sont complétées par le travail des experts de tous les ministères, qui mènent des analyses sectorielles et réglementaires pour bien identifier les enjeux de la sortie de l’Union européenne dans chaque domaine et évaluer les opportunités qu’il s’agira de rechercher. Lors de son audition du 14 décembre 2016 devant la commission parlementaire en charge du Brexit, David Davis a indiqué que le Gouvernement avait déjà mené cinquante-sept études sectorielles, couvrant près de 85 % de l’économie.
L’ampleur de la tâche et l’absence de ligne directrice claire du Gouvernement ont conduit à un décalage inhabituel entre le Gouvernement britannique et son administration. Il faut rappeler que le défi pour l’administration britannique que constitue le Brexit intervient dans un contexte de baisse des effectifs qui plaçait déjà, avant le référendum, les administrations sous tension. Selon l’Institute for Government, les effectifs du civil service seraient à leur plus bas niveau depuis la Seconde Guerre Mondiale et inférieurs de 20 % à ce qu’ils étaient en 2010 (58).
À plusieurs reprises, les fonctionnaires britanniques en charge de la préparation de la négociation ont exprimé un malaise, dont la démission d’Ivan Rogers (59), le représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’Union européenne, a donné une illustration récente. Cette démission, ainsi que les motivations qui l’ont accompagnée, témoignent des hésitations et d’une certaine impréparation des autorités britanniques.
b. En France, un travail interministériel coordonné par le Secrétariat général des affaires européennes
Contrairement au Royaume-Uni, ni la France ni les autres États membres de l’Union européenne n’ont procédé à des réorganisations ministérielles ou administratives d’ampleur dans la perspective du Brexit. Ils s’organisent avec des équipes restreintes et des réseaux dans l’administration.
Le dispositif mis en place par la France pour préparer les négociations à venir repose sur les structures existantes. Le travail de cartographie des intérêts de la France est mené sous l’égide du Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) et associe tous les ministères concernés, la négociation touchant un nombre très vaste de sujets relevant d’administrations différentes. Une concertation avec les acteurs économiques a également été engagée afin d’évaluer leur exposition à l’apparition, qui paraît inévitable, d’obstacles aux échanges. Quel que soit le partenariat futur conclu avec le Royaume-Uni, il y aura en effet pour les acteurs économiques une différence avec la situation actuelle.
L’objectif de cette organisation est de permettre l’élaboration des positions françaises, à chaque étape de la négociation, à partir d’une information et d’analyses aussi complètes et réactives que possible.
Lors de son audition, le secrétaire général des affaires européennes a décrit un dispositif organisé en trois cercles :
– une petite équipe qui se consacrera pleinement à la négociation avec le Royaume-Uni ;
– une quinzaine de référents sectoriels au sein du SGAE ;
– un groupe de travail interministériel regroupant environ quarante-cinq dirigeants d’administrations ou leurs représentants, qui peut se réunir en réunion plénière ou dans des réunions spécialisées animées par les référents sectoriels du SGAE. Ces responsables d’administrations peuvent en outre mobiliser les ressources de leurs ministères respectifs en tant que de besoin.
Le travail interministériel a été organisé autour de plusieurs blocs de sujets, représentant les différents enjeux de la négociation, qui font l’objet d’une expertise approfondie : les aspects juridiques et budgétaires du retrait du Royaume-Uni ; la liberté de circulation des personnes ; la liberté de circulation des marchandises ; les libertés d’établissement et de prestation de services, hors services financiers ; la liberté de circulation des capitaux et des services financiers ; les politiques communes ; la politique commerciale commune ; la coopération policière et judiciaire ; les sanctions au titre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) et les aspects communautaires de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).
Chaque administration concernée doit évaluer, dans son domaine de compétence, les enjeux de la négociation, tant au regard des intérêts français que de ceux de l’Union à vingt-sept, et les différentes options envisageables. Ces évaluations sectorielles ont permis d’aboutir à une analyse d’ensemble et permettront d’engager des discussions techniques spécifiques avec la Commission européenne et les Vingt-Sept, avec le souci d’aboutir à des analyses convergentes.
En complément de ce travail interministériel technique, le ministère des affaires étrangères a constitué au sein de son administration un groupe de travail dédié regroupant les agents les plus directement concernés de la direction de l’Union européenne et de la direction des affaires juridiques, chargé notamment d’animer un réseau de points de contacts au sein du ministère et d’assurer un contact quotidien avec les ambassades concernées, en particulier l’ambassade à Londres et la représentation permanente auprès de l’Union européenne.
c. Pour l’Union européenne, un travail préparatoire mené par la Commission
L’organisation mise en place par la Commission européenne pour l’identification des enjeux de la négociation est comparable à celle de la France, avec une équipe relativement réduite, qui s’appuie sur l’expertise existant au sein des directions générales de la Commission.
Le groupe de travail pour la préparation et la conduite des négociations avec le Royaume-Uni au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne prend la forme d’un service de la Commission européenne. Ce service est dirigé par Michel Barnier, qui a le rang de directeur général et rapporte directement au président de la Commission. Ce statut administratif est un des éléments qui ont favorisé l’acceptabilité par les États membres de son rôle de chef de l’équipe de négociation, le négociateur de l’Union ne pouvant apparaître comme étant le représentant d’un État membre.
L’allemande Sabine Weyand, directrice générale adjointe du commerce à la Commission européenne, a été désignée négociateur en chef adjoint, et directrice générale adjointe du groupe de travail. Dans ses fonctions précédentes, elle a acquis une expertise sur des questions qui seront primordiales dans la négociation du partenariat futur avec le Royaume-Uni, en travaillant sur les questions relatives à l’OMC, à la politique de voisinage, au partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et à la défense commerciale.
Le groupe de travail se compose d’une équipe d’une trentaine de personnes, issues des différentes directions générales de la Commission. Il peut s’appuyer sur l’ensemble des services de la Commission et coordonne leurs travaux sur tous les aspects stratégiques, opérationnels, juridiques et financiers liés aux négociations. Il a examiné l’ensemble de l’acquis communautaire pour identifier les sujets qui devront être abordés pendant les négociations.
Parallèlement à cette préparation technique, Michel Barnier a entrepris une tournée des capitales des Vingt-Sept pour rencontrer les responsables gouvernementaux. Une deuxième série de déplacements est entamée pour rencontrer d’autres acteurs, dont les parlements nationaux.
Sur les différents enjeux de la négociation, la mission a pu constater lors de son déplacement à Bruxelles une convergence de vue entre les analyses de la Commission européenne, de l’équipe que Didier Seeuws dirige pour préparer le travail du Conseil européen, ainsi que du Parlement européen. Ces analyses convergent également avec celles de la France, telles qu’elles ont été présentées à la mission par le secrétaire d’État aux affaires européennes et le secrétaire général des affaires européennes.
3. Le Royaume-Uni, de la fermeté sur le principe de la sortie à la définition des positions de négociation
Il est clairement apparu au lendemain du référendum que personne n’avait préparé la suite à donner à un tel résultat. L’effarante impréparation a laissé place à l’absolue incertitude. Dès sa prise de fonction, la Première ministre Theresa May a affirmé sa détermination à mettre en œuvre la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, répétant « Brexit means Brexit » et déclarant vouloir faire de cette décision un succès pour son pays. Elle a donc rapidement écarté toute idée de second référendum et affirmé sa détermination à repousser toute tentation de rester au sein de l’Union européenne par une voie détournée.
La question « What Brexit means ? » (« que signifie Brexit ? ») a fait les titres de la presse dès septembre dernier. Selon le professeur Kevin Morrell, de l’université de Warwick, cette expression de « Brexit means Brexit » constituait un formidable outil rhétorique pouvant être utilisé pour justifier toutes les options que le Gouvernement déciderait de privilégier (60). Le ministre de la sortie de l’Union européenne David Davis insistait également beaucoup sur une sortie de l’Union européenne qui se fasse en douceur et de manière ordonnée (61). Le résultat du référendum s’est vite révélé une occasion inespérée pour des tenants d’une certaine position politique de défendre une voie particulière pour le Royaume-Uni. Par exemple, plusieurs personnalités, connues pour leurs discours anciens de soutien à une baisse massive des impôts pour les entreprises, ont saisi une occasion historique de défendre un Royaume-Uni se distinguant des pays continentaux par son attractivité fiscale et son environnement favorable aux affaires.
La position de négociation du Royaume-Uni demeurait toutefois brumeuse et l’on s’interrogeait sur la question de savoir si elle était établie ou en passe de l’être. La démission brutale du représentant permanent auprès de l’Union européenne Ivan Rogers début janvier 2017 avec pour motifs les « arguments mal fondés et la pensée confuse » de son Gouvernement dans la négociation du Brexit, n’a fait qu’accentuer cette impression de flou complet, au point que The Economist faisait début janvier sa couverture sur « Theresa Maybe ».
Le 17 janvier 2017, dans un discours prononcé à Lancaster House, en présence des ambassadeurs en poste à Londres, la Première ministre est sortie de sa réserve pour tracer les grandes lignes des positions de négociations du Royaume-Uni, confirmant le retrait « dur » du Royaume-Uni.
a. Vers un Brexit « dur », incluant la maîtrise des frontières et la restauration de la souveraineté juridique
Ayant fait campagne pour le maintien au sein de l’Union européenne, sans doute plus par pragmatisme que par conviction, Theresa May a affiché sa détermination sans faille à organiser la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, accordant une grande place aux anciens Brexiteers autour d’elle. En atteste la désignation de ses ministres, mais aussi la composition du comité gouvernemental qu’elle préside sur le Brexit (European Union Exit and Trade Committee) et dont plus de la moitié des douze membres sont des ministres qui avaient fait campagne pour le Brexit. Malgré l’importance des aspects juridiques du retrait, l’Attorney general Jeremy Wright n’en fait pas partie et les ministres chargés de l’Écosse et de l’Irlande du Nord (et du pays de Galles) ne seront pour leur part associés que de manière ponctuelle aux réunions.
Dès l’automne 2016, le paysage politique britannique avait pris un tour nouveau : il n’y avait déjà presque plus de Bremainers, partisans du maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, mais une polarisation du débat entre hard Brexiteers, plaidant pour une rupture franche et rapide, jusqu’à la renonciation à l’union douanière et au marché unique, et soft Brexiteers, souhaitant maintenir un statut le plus proche possible de l’existant tout en respectant la demande entendue dans le vote des Britanniques notamment d’un contrôle de l’immigration. Néanmoins, la distinction entre hard et soft Brexit, que récuse d’ailleurs le Gouvernement May, est essentiellement rhétorique, comme la mission a pu le constater lors de son déplacement à Londres à la mi-novembre 2016.
Peu à peu, les divisions internes au camp conservateur se sont avérées quasiment indépassables : Theresa May faisait face à une forte pression de la part des Brexiteers de son parti, alors qu’aucune pression ne s’exerçait véritablement du côté des anciens Bremainers qui peinaient à s’organiser pour faire entendre une voix différente. Le temps jouait lentement mais sûrement en faveur des partisans de la ligne la plus dure et, pour certains chercheurs rencontrés à Londres en novembre 2016, seule une dépréciation de la situation économique pouvait replacer la pression en faveur d’un soft Brexit. Or les scénarii d’effondrement économique ne se sont pas avérés, l’économie britannique faisant preuve d’une grande robustesse en dehors de la dépréciation de la livre sterling.
i. Un semestre de grand flou sur la stratégie du Gouvernement britannique
Dès la fin 2016, il apparaissait que l’on s’acheminait vers une position dure, l’ensemble des acteurs rencontrés à Londres ayant fait état de cette certitude, pour s’en réjouir ou s’en inquiéter selon le cas. Il est intéressant de noter que tous interprétaient le résultat du référendum comme une demande de restauration d’une maîtrise, d’abord des frontières, ensuite des processus juridiques. Même le chef de file travailliste Jeremy Corbyn, dans un discours prononcé le 10 janvier 2017, a déclaré qu’il n’était « pas marié avec le principe de la libre circulation des citoyens européens » et que les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne devraient prévoir une réforme des règles de l’immigration afin d’aboutir à « une gestion raisonnable ».
Les parlementaires britanniques n’échappent pas à la règle. Très majoritairement favorables au maintien dans l’Union européenne (62), ils semblaient dans une situation délicate lorsqu’il s’est agi d’organiser concrètement leur positionnement par rapport au processus de sortie. En réalité, la quasi-totalité des parlementaires travaillistes et conservateurs considèrent que le résultat du référendum doit se traduire par l’activation de la procédure de sortie de l’Union européenne, d’une part, que le Gouvernement a pleine compétence pour négocier, d’autre part.
La délégation de la mission qui s’est rendue à Londres en novembre 2016 a pu constater ce consensus lors de son entretien à la Chambre des Communes avec des membres de la nouvelle commission parlementaire spécifiquement dédiée à la sortie de l’Union européenne (Exiting the EU Select Committee), autour de son président, l’ancien ministre fantôme travailliste Hilary Benn. Il était également frappant de relever la proximité de vue entre travaillistes et conservateurs membres de la Commission sur la sortie de l’Union européenne, sous réserve du placement du curseur en matière de contrôle de l’immigration.
Comme le soulignait notre Ambassadeure à Londres au cours de son audition le 29 septembre 2016, « le lien établi par le parti nationaliste pour l’indépendance du Royaume-Uni, United Kingdom Independance Party (UKIP), entre l’immigration incontrôlée et l’Union européenne, a conduit la majorité des votants à s’exprimer, en fait, contre l’immigration. Or il faut garder à l’esprit que le solde migratoire net est aujourd’hui de 327 000 personnes par an au Royaume-Uni […]. »
Il convient de préciser que le rejet de l’immigration n’est pas orienté en direction de ressortissants de pays tiers mais de l’Union européenne, particulièrement à l’encontre des Polonais qui ont cristallisé les violences verbales et physiques, et que la concomitance avec la crise des réfugiés ne doit pas, de ce point de vue, induire en erreur : c’est bien contre le droit des citoyens européens de venir travailler et vivre au Royaume-Uni que la majorité des électeurs britanniques s’est prononcée.
Lors de son discours de Birmingham début octobre, Theresa May avait fixé les grandes lignes suivantes : le contrôle de l’immigration ; le retrait de la juridiction de la CJUE, avec l’intégration en droit national de l’acquis européen au moment de la sortie de l’Union européenne (Great Repeal Bill) ; un accord qui permette de continuer de commercer avec et au sein du marché européen.
Le principe de l’intégrité du marché intérieur ayant été rappelé par les chefs d’État et de Gouvernement des Vingt-Sept, excluant de facto l’appartenance au marché intérieur et un statut de type suisse ou norvégien, la mission a pu constater à Londres que les débats portaient surtout sur des questions d’organisation de la transition vers un statut d’État tiers et de perception des possibilités d’obtenir un partenariat très étroit de type accord d’association enrichi, c’est-à-dire incluant le plus haut degré de libre-échange et la participation à des politiques communes. Certains estimaient que s’il s’agissait d’aboutir à la situation d’un pays pleinement en dehors de l’Union européenne, le mieux était d’accélérer le processus, quitte à subir des conséquences économiques incertaines.
Sur le volet économique justement, demandé par les milieux d’affaires et soutenu par le ministre Hammond, ancien Bremainer, la nécessité d’un accord de transition faisait débat. Interrogé par les députés britanniques, le ministre de la sortie de l’Union européenne David Davis a depuis reconnu que des mesures transitoires pourraient être nécessaires, mais qu’il ne faudrait y avoir recours qu’en cas de nécessité absolue et uniquement si l’on avait une idée précise du type de relation future. Sur le volet politique, David Davis avait rappelé à la mission l’objectif d’avoir un accord avec le maximum d’accès au marché, mais aussi développé le thème de la continuité sur les aspects relatifs à la sécurité.
La délégation de la mission était revenue assez circonspecte sur l’existence d’une stratégie gouvernementale et celle de propositions alternatives à un Brexit dur de plus en plus nettement assumé.
ii. Les grandes lignes exposées par Theresa May lors de son discours de Lancaster House du 17 janvier 2017 : des confirmations et beaucoup d’interrogations
Début janvier, deux informations nouvelles étaient données par la Première ministre Theresa May. En premier lieu, elle souhaitait garantir les droits des ressortissants européens, sur une base réciproque, dans un accord au début des négociations. En second lieu, réagissant à la démission du Représentant permanent Sir Ivan Rogers, Theresa May rejetait les accusations sur la position confuse du Gouvernement et laissait entendre qu’entre les deux priorités non conciliables selon l’Union, le contrôle de l’immigration primerait sur l’accès au marché unique.
Finalement, dans un discours du 17 janvier 2017, Theresa May est venue apporter des éléments de clarification devenus indispensables, mais essentiellement d’ordre méthodologique :
– la confirmation que le Royaume-Uni sortira du marché intérieur et mettra fin au principe de libre-circulation des travailleurs européens par la fixation de règles nationales de contrôle ;
– l’annonce d’une sortie de l’union douanière européenne, tout en souhaitant des accords. Theresa May avait précédemment qualifié cette question comme n’étant pas binaire, ce qui laissait entendre qu’elle pourrait rechercher une solution intermédiaire ou par secteurs. Or une sortie de l’union douanière était incontournable pour conclure des accords de libre-échange avec les pays tiers ; c’est donc la voie prônée par Liam Fox qui l’a emporté. Theresa May souhaite faire du Brexit une opportunité pour le Royaume de développer ses relations commerciales avec le Large (États-Unis, Commonwealth) ;
– la fin de la contribution au budget européen sous réserve d’accords ponctuels sur tel ou tel programme. David Davis avait laissé entendre début décembre que cela pourrait être considéré, soutenu par Philip Hammond ;
– la priorité accordée à la garantie des droits des citoyens européens résidant au Royaume-Uni et des Britanniques résidant dans l’Union européenne ;
– la poursuite du travail en commun sur les questions liées au crime, au terrorisme et aux affaires étrangères ;
– le souhait d’un processus en douceur, « par étapes », avec l’objectif de conclure un accord dans les deux ans qui traite des questions sensibles comme l’immigration, l’industrie automobile et le secteur financier ;
– la confirmation du vote du Parlement sur l’accord final. Le porte-parole de Downing Street avait déjà indiqué qu’il serait normal que le Parlement ait son mot à dire sur la ratification de l’accord final, au regard des règles constitutionnelles internes.
Une écoute attentive du discours permet de constater qu’il laisse des pans entiers de zones d’ombre. Rien n’est dit des modalités du partenariat en matière de sécurité et d’affaires étrangères : participation à des politiques communes, aux organes communs, relations privilégiées, utilisation d’outils communs notamment accès aux bases de données … ? Or si cela semble aller de soi dans le discours de la Première ministre, des problèmes politiques et juridiques devront être traités, par exemple les processus décisionnels, l’équivalence des règlementations et le contrôle relevant des institutions européennes et de la Cour de justice de l’Union européenne (cf. infra). Les politiques en matière universitaire et de recherche sont peu évoquées. Le contenu d’un accord douanier avec l’Union européenne est un grand point d’interrogation. Quelle sera la stratégie concernant les secteurs sensibles évoqués, l’industrie automobile et la City ? Comment entendre la notion de contribution raisonnable au budget de l’Union européenne ? Rien n’est détaillé et l’on sait que le diable se cache dans les détails.
En réalité, comme le dit la Première ministre elle-même : « ce sont les objectifs qui comptent, pas les moyens » et de ce point de vue, les objectifs sont inchangés ; la seule clarification concerne les vecteurs juridiques (sortie du marché unique, négociations d’un accord de libre-échange, d’un accord douanier et de participations ciblées).
Lorsque la Première ministre énonce « il ne s’agit ni d’être un membre partiel, ni d’être un membre associé ou encore quelque chose qui nous laisserait un pied dedans un pied dehors. Nous n’envisageons pas d’adapter un modèle dont bénéficient déjà d’autres pays. Nous n’aspirons pas non plus à nous accrocher à certains éléments propres aux États membres alors que nous sortons », elle n’évoque en réalité que le format de partenariat.
Sur le fond, il n’y a qu’une confirmation du souhait d’obtenir des avantages de l’Union européenne autant que les autres États membres sont prêts à les concéder, sans endosser les contreparties. Cela revient à avoir deux pieds dehors en recherchant les avantages d’être dedans pour les intérêts offensifs définis, notamment l’industrie automobile et de transport, les services financiers, la coopération en matière de sécurité intérieure, ou la recherche.
L’ensemble de ces interrogations ne sont guère levées par la publication d’un Livre Blanc, le 2 février 2017, malgré la longueur assez inattendue du document. Présenté pour répondre à une demande des parlementaires, annoncé le 31 janvier au cours des débats qui ont vu l’approbation massive des députés à la poursuite de l’examen du projet de loi déposé en vue du déclenchement de la procédure de l’article 50, ce Livre Blanc reprend les principaux points développés dans le discours du 17 janvier et les objectifs que la Première ministre avait fixés. Il passe notamment sous silence le contenu de l’accord de sortie lui-même, les modalités d’accès au marché intérieur et à l’union douanière, les modalités des périodes transitoires et précise uniquement que le temps nécessaire pour la mise en œuvre de nouveaux arrangements dans des domaines tels que le contrôle de l’immigration ou le système douanier pourra différer selon les sujets.
On relèvera cependant avec intérêt, voie amusement, qu’une grande partie du document est consacrée aux relations économiques et commerciales avec le reste de l’Union européenne, avec une présentation axée sur l’intérêt des Vingt-Sept à un accord de libre-échange très ambitieux. La City y est également présentée comme la seule plate-forme financière mondiale dont continuera de dépendre l’Union européenne, qui aura donc intérêt à des arrangements mutuels. En d’autres termes, le Livre Blanc suggère que les Vingt-Sept ont trop à perdre pour que le résultat des négociations ne soit pas ce que souhaite le Gouvernement britannique.
Reste qu’un État tiers est un État tiers, ce qui rend illusoire la position du Gouvernement britannique, au point de pousser la Première ministre dans une agressivité menaçante dans son discours du 17 janvier. Se présentant comme flexible sur les moyens, elle apparaît inflexible sur les objectifs et menace d’une sortie sèche jugée pénalisante pour les Européens, comme le souhaitent d’ailleurs certains de ses alliés du parti conservateur, en faisant savoir que l’absence d’accord pour la Grande-Bretagne serait toujours mieux qu’un mauvais accord. Vraiment ?
b. Une attitude offensive qui masque un intérêt britannique à un accès le plus large possible au marché unique et à l’union douanière
Dans son discours du 17 janvier dernier, Theresa May a construit son argumentaire autour de l’idée centrale d’un Royaume-Uni qui serait au cœur du système de libre-échange mondial (global Britain), développant des relations commerciales « non seulement avec l’Union européenne » mais également avec « de vieux amis et de nouveaux alliés de l’extérieur de l’Europe ».
Ce discours offensif masque le fait que le marché intérieur de l’Union était précisément, en offrant une taille critique, un moyen approprié de développer des relations commerciales avec l’Europe et avec le reste du monde, dans l’équité et la réciprocité. Comme l’a souligné Mme Thaima Samman, avocate aux barreaux de Paris et de Bruxelles, lors de son audition par la mission (63), « chaque pays tirant avantage du marché unique dans ses rapports avec les pays tiers, si le Royaume-Uni n’y a plus accès, ce sera forcément pour lui une source de faiblesse ». Sur le plan économique, l’Union européenne perdra un pays de poids, mais, surtout, le Royaume-Uni perdra la profondeur offerte par le marché de vingt-sept pays, dont l’Allemagne et la France.
i. Une économie tournée vers le marché unique
Il ne s’agit évidemment pas de nier que le Royaume-Uni occupe une place centrale dans l’économie de l’Union : sixième économie mondiale, l’économie britannique représente aujourd’hui 6 % des exportations de biens et 12 % des exportations de services intra-Union européenne (10,2 et 11 % des importations) (64).
Mais la consolidation du marché intérieur reste, pour nos entreprises, plus importante que le maintien des débouchés britanniques. Les entreprises allemandes ont d’ailleurs clairement exprimé ce point de vue lors de la rencontre organisée à Berlin à l’occasion du déplacement d’une délégation de la mission. Lors de son audition par la mission (65), Michel Guilbaud, directeur général du MEDEF, a également fait de la consolidation du marché intérieur et de la zone euro la priorité de l’Union pour les années à venir.
À l’inverse, l’économie britannique est extrêmement dépendante de ses partenaires européens.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2015, 44 % des exportations britanniques étaient dirigées vers l’Union, et 53 % de ses importations en provenaient, ainsi que 48 % des investissements directs étrangers au Royaume-Uni (66). En comparaison, les États-Unis, la Chine et l’Inde représentent seulement 19,6 %, 3,2% et 1,3 % des exportations britanniques (67).
Il faut conserver cette asymétrie à l’esprit, sans se laisser prendre au piège d’un discours de politique intérieure britannique : l’intérêt économique du Royaume-Uni à un accès le plus large possible au marché intérieur est évident.
Les acteurs économiques britanniques sont d’ailleurs, dans l’ensemble, très inquiets des négociations à venir. Des interlocuteurs de la City rencontrés à Londres ont évoqué le risque d’une perte de 70 000 emplois. À Londres, tous les grands groupes s’organisent pour mettre en place des task force Brexit ou des points de contact, et les entreprises se tournent vers des consultants pour mieux se préparer aux conséquences du Brexit. La plupart se préparent au pire, suivant en cela le conseil donné par les grands cabinets de conseil.
Il n’est donc pas étonnant que les milieux économiques et financiers britanniques soient les initiateurs du débat sur un accord de transition, pour éviter le choc d’une rupture trop brutale. Une grande préoccupation porte sur le temps nécessaire pour s’adapter à la nouvelle situation, une fois l’accord conclu sur la relation future. Par ailleurs, l’accès à la main-d’œuvre est probablement le point le plus crucial pour les groupes multinationaux et une période de transition pourrait constituer une solution. Si l’une des explications du vote est le souhait d’un contrôle par le Royaume-Uni de sa politique migratoire, il y aura toujours un fort besoin de main-d’œuvre, en particulier dans le secteur financier, mais pas seulement, et y compris pour les emplois moins qualifiés (notamment les secteurs agro-alimentaire, de la santé et du bâtiment).
Ces milieux sont aussi les plus avertis des conséquences économiques du Brexit, les bons chiffres de l’année 2016 ayant sans doute fait perdre de vue les risques à terme. Pour les entreprises, le retour de l’inflation est synonyme de baisse des marges, qui sont déjà impactées par la hausse de la livre sterling et du coût des importations. Un tassement significatif de la croissance potentielle est à prévoir à moyen terme, avec une productivité plus basse encore.
Les relations économiques bilatérales : le Royaume-Uni, premier excédent commercial de la France
Le Royaume-Uni est le cinquième partenaire commercial de la France, et son premier excédent bilatéral dans le monde (12,2 milliards d’euros en 2015). Cet excédent est particulièrement important pour les produits agroalimentaires (2,7 milliards d’euros) et les produits chimiques ou cosmétiques (2 milliards d’euros).
La France était en 2015 le 3e client du Royaume-Uni (6,3 % des exportations) et son 5e fournisseur (6 % des importations britanniques, derrière l’Allemagne, la Chine, les États-Unis et les Pays-Bas). À l’inverse, le Royaume-Uni était en 2015 le 5e client de la France (7,1 % des exportations, derrière l’Allemagne, les États-Unis, l’Espagne et l’Italie) et son 8e fournisseur (3,2 % des importations). Le Royaume-Uni absorbe également 11 % des exportations françaises de services.
La France est le deuxième investisseur au Royaume-Uni, avec un stock d’investissements directs étrangers d’environ 100 milliards d’euros, soit 10 % du total investi par la France à l’étranger.
Source : direction générale du Trésor
Certains secteurs de l’économie britannique sont plus particulièrement dépendants de l’Union européenne, et, dans son discours de Lancaster House, la Première ministre d’ailleurs fait explicitement référence à l’industrie automobile et aux services financiers, deux des secteurs de l’économie britannique qui auraient le plus à perdre à un Brexit. Mais d’autres secteurs seraient particulièrement touchés par la fin de l’accès au marché unique : l’Union européenne représente 35 % des exportations britanniques dans le secteur automobile, 56,6 % pour l’industrie chimique, 30,7 % pour les machines et 60 % pour l’alimentation, les boissons et le tabac (68). Les services constituent, quant à eux, 42 % des exportations britanniques vers l’Union.
ii. Le cas particulier des services financiers
Le sort qui sera réservé aux services financiers revêt évidemment une importance cruciale pour les Britanniques.
Londres est aujourd’hui la première place financière d’Europe : à titre d’illustration, plus de la moitié des actions européennes y sont échangées, et le Royaume-Uni détient 22 % des parts de marché de l’Union en matière d’assurance et de réassurance, 26 % des prêts bancaires et 35 % des financements interbancaires (69).
Ces services financiers occupent une place centrale dans l’économie britannique. En 2015, ils représentaient 7 % du produit intérieur brut (PIB), 4 % de l’emploi (70) et 11 % des recettes fiscales britanniques (71). En y intégrant les activités proches, la fédération professionnelle TheCityUK estime même que l’industrie financière représente 11,8 % du PIB britannique (72). Deux tiers des emplois liés directement ou directement aux services financiers au Royaume-Uni se situeraient en dehors de la capitale (73).
Par ailleurs, si les grandes banques britanniques sont dominantes sur le marché de détail, il faut également garder en mémoire que les cinq plus grandes banques américaines ont leur siège européen au Royaume-Uni, et y emploient plus de 40 000 personnes (74), en grande partie à Londres mais pas uniquement (JP Morgan est par exemple le plus gros employeur privé du Dorset). L’accès au marché unique est un élément déterminant de l’installation des banques de financement et d’investissement extra-européennes.
Le principe de libre installation permet aujourd’hui aux établissements de crédit, mais aussi aux entreprises d’investissement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements d’assurance d’un autre pays membre de s’installer librement dans tout autre État membre de l’Union. Ainsi, la directrice générale du Trésor, lors de son audition par la mission (75), a rappelé que « notre pays compte aujourd’hui 75 assureurs, 21 établissements de crédit et 46 entreprises d’investissement britanniques, qui exercent dans notre pays grâce à des succursales ».
Par ailleurs, sans même ouvrir une succursale dans un autre État de l’Union, toute entité soumise à agrément peut aujourd’hui assurer la prestation de services dans tout autre État membre depuis son pays d’origine. Selon TheCityUK, environ un quart des revenus générés par le secteur financier britannique proviendrait des transactions effectuées avec le reste de l’Union européenne (76).À titre d’exemple, la directrice générale du Trésor a indiqué lors de son audition par la mission que 87 entités londoniennes, dont 40 % sont détenues par une maison mère britannique, exercent dans ce cadre des activités bancaires en France, ainsi que 218 assureurs. Réciproquement, les quatre grandes banques françaises disposent de 70 autorisations de fournir des services financiers outre-Manche.
Dans la pratique, les principes de libre installation comme de libre prestation de services permettent aux institutions financières européennes d’obtenir des « passeports financiers ».
Grâce à ce « passeport financier », une société financière ayant obtenu un agrément par l’autorité de son pays d’origine peut exercer ses activités dans toute l’Union européenne ou dans un État de l’Espace Économique Européen (EEE). Concrètement, il existe non pas un mais plusieurs passeports financiers européens, dont l’objet est limité à celui de la directive qui le prévoit, et dont les modalités exactes diffèrent.
L’importance de ces passeports financiers varie considérablement selon le secteur concerné. C’est pour le secteur bancaire qu’ils sont les plus importants : selon Open Europe, un cinquième des revenus des banques au Royaume-Uni serait lié au passeport financier. Ils le sont en revanche moins dans le domaine de la gestion d’actifs, secteur où l’harmonisation règlementaire européenne a été moins forte que pour le secteur bancaire et pour lequel une partie des activités échappe à l’exigence d’un passeport. Enfin, c’est dans le secteur de l’assurance que la perte du passeport européen aurait l’impact le plus faible, car la plupart des sociétés d’assurance disposent de filiales dans les autres pays de l’Union, et il n’y a pas encore de véritable marché unique européen dans ce domaine.
En l’absence d’accord spécifique, le retrait du Royaume-Uni du marché intérieur priverait donc les institutions financières qui y sont établies de ce « passeport financier ».
Enfin, la sortie du Royaume-Uni de l’Union relancera également la délicate question de la localisation des chambres de compensation en euros au Royaume-Uni.
Les chambres de compensation londoniennes (LCH Clearnet, ICE Clear Europe, etc.) effectuent 40 % du total des opérations de compensation en euros, et jusqu’à 80 % pour les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré. La Banque centrale européenne (BCE) avait tenté, en 2011, d’imposer la localisation des organismes de compensation intervenant dans le cadre de transactions en euros au sein de la zone euro. Cette décision avait alors été annulée par le tribunal de l’Union européenne, qui a considéré que la BCE n’avait pas la compétence nécessaire pour imposer une telle exigence (77).
La sortie du Royaume-Uni constituerait évidemment un changement de circonstance. En effet, comme l’a rappelé Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, lors de son entretien avec une délégation de la mission d’information, toutes ces opérations en euros doivent être supervisées par la Banque centrale européenne, et, aujourd’hui, cette supervision est possible grâce à un accord avec la Banque d’Angleterre. C’est également l’analyse qu’en a fait le Gouverneur de la Banque de France (78) lors de son audition par la mission d’information, soulignant que « le fait que les transactions soient compensées via un organisme qui échappe totalement à notre supervision présenterait à l’évidence un risque accru dont il faudrait tirer les conséquences prudentielles » (79).
Qu’est-ce qu’une chambre de compensation ?
Depuis la crise financière, le droit européen (règlement EMIR) impose une obligation de compensation à l’essentiel des contrats dérivés de gré à gré via une contrepartie centrale dénommée chambre de compensation.
Les chambres de compensation jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des marchés financiers en apportant une garantie en cas de faillite d’un intermédiaire financier qui adhère à la chambre. Les chambres de compensation participent ainsi à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique. Toutefois, du fait du rôle accru qu’elles exercent sur les marchés financiers, elles concentrent aujourd’hui elles-mêmes une partie du risque systémique.
D’une manière simplifiée, la chambre de compensation s’interpose entre l’acheteur et le vendeur en devenant le vendeur face à l’acheteur et l’acheteur face au vendeur. Elle s’intercale entre ses adhérents compensateurs, qui sont les intermédiaires financiers devant régler et livrer les transactions négociées et assume le risque de défaillance de l’une des contreparties en se substituant à celles-ci. Si l’adhérent compensateur ne livre pas les titres, la chambre les acquerra en lieu et place de celui-ci afin de livrer la partie non défaillante. Elle apporte la garantie réciproque au vendeur.
c. Des difficultés politiques qui n’en sont pas moins fortes pour le Gouvernement May
Les difficultés pour le Gouvernement May, outre les divisions internes au camp conservateur qui n’ont pas disparu, sont de deux ordres : associer le Parlement et traiter la situation particulière des entités dévolues.
i. Le rôle du Parlement dans le processus de négociation
Le Gouvernement May doit faire face à la pression des parlementaires britanniques qui chercheront à ce que le pays obtienne le meilleur accord possible. Cette pression a pris de l’ampleur au cours des derniers mois.
Il est naturellement de la compétence du Parlement d’abroger le European Communities Act de 1972 et d’intégrer l’ensemble de l’acquis en droit national. De même, la ratification de l’Accord de sortie était acquise. D’après le Constitutional Reform and Governance Act de 2010, le Parlement britannique a 21 jours pour réagir après la conclusion par le Royaume-Uni d’un accord international. À l’issue de ces 21 jours, soit il ne se prononce pas, en donnant ainsi implicitement son accord à la ratification de l’accord, soit il décide de son propre chef de procéder à un vote formel.
Toutefois, les représentants élus de la plus ancienne démocratie parlementaire du monde ne pouvaient s’en tenir à entériner les conséquences d’une décision mise en œuvre par le Gouvernement. En outre, la restauration de la pleine puissance de la démocratie parlementaire britannique face à « Bruxelles », objectif des Brexiteers, l’aurait contredit.
Le premier sujet de confrontation avec le Gouvernement a concerné le déclenchement de la procédure de sortie.
Un certain trouble a été jeté lorsque la Haute Cour a jugé que l’accord du Parlement était requis pour activer l’article 50. La décision de la Cour suprême en appel le 24 janvier 2017 (80) a confirmé la nécessité d’obtenir préalablement l’accord des deux chambres. Le Gouvernement a déposé un très court projet de loi – 137 mots – dont l’examen a débuté le 31 janvier 2017.
Néanmoins, l’accord de principe sur la notification du retrait était déjà acquis, comme l’avait démontré le vote, mercredi 7 décembre 2016, à une très forte majorité (448 en faveur, 75 contre) de la motion travailliste demandant au Gouvernement de présenter un plan de négociations avant activation de l’article 50, y compris l’amendement du Gouvernement par lequel il reconnaît qu’il ne s’opposera pas à son activation ni au calendrier annoncé par lui (81). Cette position a été confirmée le 8 février par l’adoption du projet de loi à la Chambre des Communes, par 494 voix contre 122 (dont 52 membres du parti travailliste). Le texte a été transmis à la Chambre des Lords, où il sera examiné à partir du 20 février.
L’opposition travailliste est divisée, et manifeste un contraste entre une vie militante renouvelée et une représentation parlementaire fragmentée. Jeremy Corbyn a appelé à voter le déclenchement de l’article 50 ; les députés ne disposent d’aucun levier ou moyen de pression sur la substance de cet accord. Les amendements déposés ont dès lors peu de chances d’être adoptés au cours des débats. Le parti libéral démocrate appelle, quant à lui, à la tenue d’un second référendum sur l’accord de retrait lorsqu’il aura été négocié avec l’Union européenne, mais il manque de poids (moins de dix députés).
Seule la Chambre des Lords, où les Conservateurs ne sont pas majoritaires, pourrait perturber le processus. Son Speaker, Norman Fowler, a déclaré à la presse que la chambre ne saboterait pas le Brexit (82), reconnaissant que la Chambre des Communes, dont les membres sont élus, avait la primauté et avait voté en faveur du déclenchement des négociations. Néanmoins, il est possible que les Lords cherchent à amender le texte pour y introduire des éléments sur le maintien dans le marché intérieur, les programmes de recherche et de coopération universitaire, sur des dispositions relatives au statut des ressortissants européens et sur un contrôle parlementaire étroit.
Dans ces conditions, il apparaît que la décision des juridictions britanniques d’un accord préalable du Parlement conforte paradoxalement la position du Gouvernement en lui offrant une assise juridiquement et politiquement plus robuste pour mettre en œuvre la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, alors même que le contenu de cette sortie est loin de faire l’objet d’un consensus chez des parlementaires majoritairement en faveur du maintien dans le marché intérieur ou à défaut d’un accès très étendu.
Le deuxième sujet de confrontation, concerne la demande des députés comme des Lords de disposer d’un accès le plus large possible à l’information et d’une maîtrise la plus grande possible du processus de sortie, notamment s’agissant de l’accès au marché intérieur dans le statut futur et de la gestion de la transition. On notera que pour les interlocuteurs rencontrés à Londres, la distinction entre l’accord de sortie et le statut futur n’a aucun sens.
Les deux chambres se sont organisées :
– comme mentionné précédemment, au sein de la Chambre des Communes, une nouvelle commission parlementaire spécifiquement dédiée à la sortie de l’Union européenne (Exiting the EU Select Committee) a été mise en place et s’est réunie pour la première fois le 2 novembre 2016. Elle est présidée par l’ancien ministre fantôme travailliste Hilary Benn et composée de 21 membres, dont une grande partie de Brexiteers (83) ;
– toujours à la Chambre des Communes, une nouvelle commission parlementaire chargée du commerce international (International Trade Committee) a également la charge de contrôler l’action du Secretary of State Liam Fox. Elle est présidée par le député SNP Angus Brendan MacNeil ;
– la Chambre des Lords a demandé, dans un rapport publié le 20 octobre 2016, la mise en place d’un système de contrôle parlementaire spécifique (transmission des informations, y compris durant les négociations, réponse aux questions des commissions parlementaires, prise en compte des recommandations du Parlement dans sa position de négociation, etc.). Désormais, environ une trentaine de commissions parlementaires (« select committees ») ont entrepris des travaux d’enquête et mènent des auditions sur les conséquences et l’impact du Brexit dans tous les domaines. Leurs conclusions sont publiées au fur et à mesure et sont de grande qualité.
Lors de son compte rendu du Conseil européen devant la Chambre des Communes le 24 octobre 2016, Theresa May avait promis aux parlementaires des « débats généraux » sur la future relation du Royaume-Uni à l’Union européenne avant et après les fêtes de fin d’année, y compris un débat avec le Parlement sur les grands principes que le Gouvernement devra suivre dans les négociations à venir. Le Secretary of State chargé du Brexit David Davis avait, quant à lui, promis à la Chambre des Communes qu’elle aurait le même niveau d’information que le Parlement européen.
Dans tous les cas, les débats qui porteront, sur le projet de loi d’activation de l’article 50, puis sur l’examen du Great Repeal Bill, qui devrait être déposé au Parlement après le discours de la Reine, fin mai ou début juin 2017, seront l’occasion pour Westminster de faire entendre ses vues sur les négociations en cours, si ce n’est que la marge des parlementaires demeure très étroite, juridiquement et politiquement.
Il est très difficile de savoir à ce jour comment les parlementaires comptent exercer leurs prérogatives pour peser sur le processus de négociations avec certes l’arme de la ratification mais qui ne peut être employée que s’il y a un accord, l’absence d’accord provoquant un retrait « sec ». Or la Première ministre l’a de nouveau dit dans son discours du 17 janvier, la négociation sera délicate et cela induit à ses yeux une certaine confidentialité : « ceux qui nous incitent à en dire plus – sur la séquence détaillée de notre stratégie, sur les compromis et les concessions possibles – n’agissent pas dans l’intérêt national ».
Le doute est d’autant plus permis que les députés sont globalement en phase avec le Gouvernement. Il est intéressant à cet égard de lire le premier rapport publié par la nouvelle Commission de la Chambre des Communes en charge de la sortie de l’Union européenne, en date du 14 janvier 2017 (trois jours avant le discours de Theresa May) :
– sur la méthode, les députés demandent un vote formel sur l’activation de l’article 50 ; la présentation d’un plan de négociation mi-février au plus tard (white paper) ; une information tout au long des négociations au même titre que le Parlement européen ; des évaluations précises et chiffrées sur les implications et les coûts des différents scenarii, en particulier en cas de sortie du marché intérieur et de l’union douanière ; un vote formel sur l’accord de sortie et la relation future ; une association, sans droit de veto, des entités dévolues. Toutes choses déjà plus ou moins acquises ;
– sur le fond, les demandes sont notamment la clarification des intentions sur le marché intérieur, le maintien dans ce dernier des services financiers ou à défaut l’obtention d’un système d’équivalence efficace ; le traitement dès le début de la négociation du statut des ressortissants européens ; la négociation d’un accord assurant la continuité et une relation la plus étroite possible en matière de sécurité et de défense ; la préservation de la stabilité de l’Irlande du Nord et des relations avec la République d’Irlande ; la conduite parallèle des négociations sur la sortie et sur le statut futur avec un accord-cadre des futures relations commerciales avant la sortie et l’introduction d’une période transitoire. Toutes choses que l’on trouve peu ou prou dans le discours de la Première ministre.
En publiant un Livre Blanc le 2 février 2017, comme il l’avait annoncé deux jours avant lors de l’ouverture de l’examen du projet de loi d’activation de l’article 50 à la Chambre des Communes, le Gouvernement entend clore la phase d’information préalable au déclenchement de la procédure de sortie et répondre ainsi à une des demandes formulées par les parlementaires. Comme indiqué précédemment, ce Livre blanc n’apporte quasiment aucune précision supplémentaire au discours de Theresa May du 17 janvier, ce que n’a pas manqué de souligner l’opposition travailliste. Le Livre Blanc réaffirme en revanche sans ambages que, dans un souci d’efficacité, le Gouvernement n’entend pas répondre à la transparence demandée mais fera preuve de prudence dans ses commentaires publics et « gardera scrupuleusement pour lui [ses] positions ».
ii. Les entités dévolues en première ligne
Le risque le plus sérieux réside en réalité dans la question des équilibres internes au pays avec les régions où le vote en faveur du maintien dans l’Union européenne l’a emporté. Sans doute la question de Londres pourrait-elle être posée. À ce jour, c’est surtout les cas de l’Irlande du Nord et de l’Ecosse qui sont au centre de l’attention. Il est important de souligner qu’une grande partie du discours de Theresa May du 17 janvier porte sur l’unité du Royaume-Uni. Elle y énonce notamment que « notre principale priorité sera de protéger notre Union, qui est au cœur de tout ce que nous faisons. Car c’est seulement en restant unis dans une grande union des nations et des peuples que nous pourrons saisir les opportunités qui s’offrent à nous ».
Bien que la Cour suprême, dans son arrêt rendu le 24 janvier 2017, ait énoncé qu’il n’était pas nécessaire de consulter les gouvernements des entités dévolues avant d’engager la procédure de sortie de l’Union européenne, le spectre d’une crise constitutionnelle est loin d’être dissipé du fait de l’opposition forte de l’Écosse à la sortie du marché intérieur. Le Parlement écossais a ainsi voté symboliquement, le 7 février, à une forte majorité de 90 voix contre 34, contre le projet de loi du Gouvernement britannique autorisant Theresa May, à activer l’article 50. Ce vote n’emporte pas de conséquences juridiques.
La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, indépendantiste, est une forte personnalité qui saura plaider la cause de l’Écosse. Elle écartait jusqu’à présent la tenue d’un nouveau référendum sur l’indépendance, dont les Écossais ne veulent d’ailleurs pas, mais demande à rester dans le marché intérieur et à maintenir la libre circulation avec un statut différencié pour l’Écosse.
C’est ainsi que Nicola Sturgeon a publié en décembre 2016 un document de travail sur l’avenir de l’Ecosse en Europe faisant état de propositions détaillées, tranchant fortement avec l’imprécision des déclarations de Theresa May. Sa proposition principale est le maintien pour la seule Écosse des quatre libertés et de la participation au marché unique, dans le cas de figure où le Gouvernement britannique ne parviendrait pas à négocier un statut proche de l’existant. Cette demande revient en pratique à solliciter des transferts de compétences majeurs. Elle s’appuie sur des travaux d’experts faisant état de la perte de 80 000 emplois et sur le besoin migratoire (l’Écosse a un solde démographique défavorable), ainsi que sur le taux de votants en faveur du maintien dans l’Union européenne : 74 % !
En Irlande du Nord, la situation n’est pas moins délicate. 56 % des électeurs y ont voté en faveur du maintien dans l’Union européenne. Cette province est la seule à disposer d’une frontière terrestre avec l’Union – et une frontière qui fut au centre d’un des conflits majeurs du territoire européen. Au Nord comme au Sud, l’inquiétude est bien réelle depuis juin 2016. Néanmoins, la question de l’indépendance demeurait largement taboue, tant le spectre de la guerre rôde. Cela restera-t-il ainsi ? Bien entendu, l’état d’esprit à Belfast dépendra très largement des modalités de la sortie du Royaume-Uni et en particulier du maintien ou non d’une frontière ouverte. La question est là-bas plutôt celle d’une « frontière soft ou hard ».
Toutefois, dès ce début d’année, le contexte politique évolue en Irlande du Nord. En effet, à la suite d’un désaccord au sein de la coalition sur un scandale lié aux énergies renouvelables, le 9 janvier 2017, le vice-premier ministre d’Irlande du Nord, Martin McGuinness, a démissionné. La décision inattendue de cette figure historique de la province, ancien chef de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) et chef des négociateurs du Sinn Fein pendant le processus de paix, ouvre une période d’incertitude politique.
Les accords de paix de 1998 prévoient la chute du Gouvernement si l’un des deux membres du binôme exécutif fait défection. Or le Sinn Fein n’ayant pas décidé de remplacer M. McGuinness, des élections à l’assemblée régionale doivent être convoquées. Elles auront lieu le 2 mars 2017. Alors que le Parti unioniste démocrate (DUP) de la Première ministre Arlene Foster avait pris position en faveur du Brexit, le Sinn Fein, seul parti à être représenté dans les deux Irlande, militait pour le maintien dans l’Union européenne et, par la voix de son leader Jerry Adams et de Martin McGuinness, prône la tenue d’un référendum sur l’ » unité irlandaise ». En s’appuyant notamment sur le cas du Groenland qui est sorti de l’Union européenne alors que le Danemark y est resté, Jerry Adams entend défendre l’expression démocratique majoritaire en Irlande du Nord.
Le scrutin régional à venir pourrait ainsi jouer en faveur du retour au centre du débat public irlandais, au Nord comme au Sud, de la question de la réunification dans une Europe post-Brexit.
Ce que le cas particulier de l’Irlande du Nord souligne, c’est que l’intérêt britannique au maintien de l’accès au marché intérieur ne se pose pas uniquement sur le plan économique, commercial et financier. Il concerne aussi et surtout la libre-circulation des personnes. Le retour de limitations à la circulation des personnes entre le nord et le sud de l’Irlande aurait des conséquences politiques difficiles à établir. La zone de circulation existante – la Common Travel Area – préexiste à l’entrée de l’Irlande et du Royaume-Uni dans l’Union européenne. Elle explique d’ailleurs en partie le fait que l’Irlande n’ait pas intégré l’espace Schengen.
La Common Travel Area (zone de voyage commune)
entre l’Irlande et le Royaume-Uni
Établie en 1923 après la création de l’Irish Free State, la Common Travel Area (CTA, ou « zone de voyage commune ») a défini, sur la base de principes coutumiers, un espace de libre-circulation entre le Royaume-Uni et l’Irlande (par la suite élargi à l’Île de Man et aux îles anglo-normandes). Les deux États s’engageaient à appliquer la politique douanière et migratoire de l’autre sur son territoire en échange d’une liberté de mouvement entre les deux pays. Les Irlandais ont ainsi accepté de continuer à faire appliquer la politique migratoire et douanière du Royaume-Uni comme ils le faisaient précédemment.
Son application a été suspendue entre 1940 et 1952, d’abord en raison de la neutralité de l’Irlande pendant la Seconde Guerre mondiale, puis en raison de la décision des autorités britanniques. C’est avec l’Aliens Order (britannique) de 1953 que la notion de CTA a été mentionnée pour la première fois et que l’arrangement entre les deux pays a été défini juridiquement. Deux accords de coopération ont été conclus en 2011 et 2014 entre les autorités britanniques et irlandaises.
Le traité d’Amsterdam de 1997, intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, a mentionné explicitement pour la première fois la CTA dans le droit communautaire via l’article 2 du Protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande. Ces dispositions ont été intégralement reprises en 2007 dans l’article 2 du Protocole no 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le Protocole rappelle tout d’abord dans son préambule « l’existence, depuis de nombreuses années, d’arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l’Irlande ». L’article 2 stipule pour sa part que : « Le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la « zone de voyage commune »), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l’article 1er, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l’article 1er du présent protocole s’appliquent à l’Irlande dans les mêmes conditions qu’au Royaume-Uni. »
La notion de double citoyenneté (« dual citizenship ») pour les Irlandais du Nord a été inscrite dans l’Accord du Vendredi saint de 1998, qui a ouvert la possibilité d’un choix. Pour mémoire, cet accord également appelé accord de Belfast et officiellement nommé accord de paix pour l’Irlande du Nord, a été signé le 10 avril 1998 par les principales forces politiques d’Irlande du Nord acceptant une solution politique pour mettre fin aux trente années (de 1969 à 1998) de troubles sanglants qui firent 3 480 morts. Il tire son nom de la date de signature, le vendredi précédant Pâques, Vendredi saint célébré par tous les chrétiens.
Le régime de la Common Travel Area excède la simple libre-circulation. Les citoyens nationaux britanniques et irlandais se voient reconnaître un statut spécial dans le pays de destination et n’y sont pas considérés comme des étrangers. Des facilités existent en matière d’établissement, de droit au travail, d’accès aux régimes sociaux et découlent du statut spécial que se reconnaissent les deux pays pour leurs citoyens respectifs.
Maintenir la Common Travel Area est une volonté commune exprimée par Theresa May et Enda Kenny dès leur rencontre du 25 juillet 2016.
II. ABORDER LES NÉGOCIATIONS SUR DES BASES CLAIRES, ALLANT À L’ESSENTIEL, TOUT EN PERMETTANT À L’UNION D’AJUSTER SA POSITION SUR LA DURÉE
Il n’est encore guère possible de préjuger des conditions dans lesquelles se dérouleront les négociations, de la manière dont le débat se structurera, des scenarii qui pourraient être élaborés et de l’évolution des positions des uns et des autres, sur la méthode comme sur le fond. Le présent rapport n’aura donc pas pour objet dans cette seconde partie de fixer les grandes lignes d’une solution future, que les parlementaires estimeraient conforme aux intérêts de l’Union européenne et de la France, ces intérêts ne pouvant être définis ceteris paribus. Cette tentation contreviendrait d’ailleurs au principe communément défini par les Vingt-Sept de ne pas anticiper sur les négociations et qui constitue, dans la situation actuelle, l’intérêt de l’Union.
Pour autant, au-delà d’une présentation de la complexité et de l’étendue des enjeux que le compte rendu des auditions effectuées, constituant annexe, permet de saisir, et qui s’avérera d’une utilité informative précieuse à mesure que les négociations se dérouleront, la mission s’est forgé une certaine idée de la manière dont notre pays doit aborder les négociations et y participer.
Il a semblé d’autant plus important au président-rapporteur de s’attacher à la présenter qu’il s’avère utile d’éviter que se mette en place un jeu de rôle pénalisant pour notre pays, avec une image aussi infondée que politiquement coûteuse à terme : celle du pays dogmatique et intransigeant. Au Royaume-Uni, l’idée partagée est que les Français ont une attitude punitive, qu’ils chercheront à « faire payer le Brexit », espérant ainsi faire taire les euroscepticismes par l’exemple d’un désastre outre-Manche. Les pays du groupe de Višegrad, les pays scandinaves et l’Allemagne sont perçus comme plus compréhensifs.
Or la France n’a pas aujourd’hui une position différente de celle de ses partenaires européens sur les lignes rouges des négociations, précédemment rappelées, ce qu’elle doit mettre en avant et consolider en travaillant au maintien de la cohésion. La France n’a pas non plus une attitude différente à l’abord des négociations, à savoir que, dans les limites qui résulteront de la priorité à accorder à la préservation du projet européen, il conviendra de rechercher les meilleurs accords possibles, puisque tel est l’intérêt des citoyens du continent européen.
L’heure est à la cohésion et la cohérence, d’où l’importance pour notre pays de rester en phase avec l’Allemagne, sans naturellement négliger aucun des autres pays et, dans la perspective de la rencontre du 25 mars 2017 à Rome à l’occasion du 60e anniversaire des traités fondateurs du projet européen, de favoriser autant que possible une concertation franco-italo-allemande, dans une année où la coopération italo-allemande sera pour sa part renforcée par les présidences respectives du G7 et du G20 par l’Italie et l’Allemagne.
Voilà ce qui, aux yeux de la mission, devra être le fil conducteur de la politique européenne de la France dans les mois à venir. C’est aussi par ce biais, dans le maintien d’une dynamique unitaire commune qui préserve les intérêts de l’Union européenne, que nous pourrons absorber les effets du Brexit notamment sur les équilibres internes à l’Union, dissiper les craintes et assurer des perspectives d’avenir au projet européen.
A. CONSERVER L’UNITÉ DES VINGT-SEPT AUTOUR DU PRINCIPE DE L’INTÉGRITÉ DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
De par sa nature d’objet politique original, le projet européen rend difficile tout exercice explicatif autre que rhétorique et c’est une des difficultés qu’il convient de lever dans le cadre des négociations qui s’ouvrent. Les reproches exprimés à l’encontre de l’Union européenne telle qu’elle existe aujourd’hui sont parfaitement audibles, souvent pertinents, parfois franchement justifiés. La complexité et les limites de l’édifice sont le marqueur de l’ambition du projet, qui a débouché, il est vrai, sur une structure technocratique peu attractive.
Pour autant, l’Union européenne est ce que nous avons bâti pour répondre aux aspirations des peuples et non pas l’origine de leurs frustrations. Il ne faut surtout pas renoncer au projet philosophique des Pères fondateurs, mais au contraire le réorienter dans cette direction en consolidant ses fondations.
Ainsi, l’Union européenne est un tout. Cela ne signifie pas qu’elle soit figée, bien au contraire. Elle est un tout au regard d’une perspective commune et elle progresse moyennant des efforts communs en vue d’un équilibre général, jamais parfait bien sûr. Le Royaume-Uni a décidé de sortir de cette dynamique commune. Pour citer la directrice générale du Trésor, Mme Odile Renaud-Basso, lors de son audition : « Les autorités britanniques ont d’ores et déjà indiqué vouloir suspendre la liberté de circulation des personnes ; ils souhaitent également se retirer de l’aire de compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). De telles conditions nous paraissent tout à fait incompatibles avec un accès plein et direct au marché intérieur, dont les principes fondamentaux sont les quatre libertés – circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux –, mais aussi un ordre juridique intégré où un droit commun s’applique de façon égale sur tout le territoire, sous la supervision de CJUE. » Cette remarque vaut pour un accès étendu à des pans du marché intérieur.
En tout état de cause, il convient de ne pas penser l’avenir de l’Union européenne en fonction des termes de la négociation avec le Royaume-Uni. Vouloir réexaminer dans ce cadre, de manière dissociée, les éléments qui composent l’ensemble européen, qu’il s’agisse des principes, du fonctionnement ou des secteurs est à la fois dangereux pour la solidité de l’édifice et limitant pour notre capacité dans l’Union européenne à conduire, dans notre intérêt, les politiques et réformes à venir.
1. La liberté de circulation des personnes, marqueur d’un projet construit au bénéfice des citoyens
La cristallisation du débat sur la liberté de circulation des personnes, tant au Royaume-Uni depuis la campagne pour les élections générales en 2016 que dans le reste de l’Union européenne, est hautement représentative d’un choc de conception des tenants et aboutissants d’une communauté européenne. Or cette liberté de circuler à travers l’espace européen est le principal acquis populaire de l’Europe, acquis que la jeunesse européenne, entre autres, s’est totalement approprié.
De fait, le vote des jeunes Britanniques, l’explosion des demandes de passeport européen parmi les Britanniques résidant dans d’autres États, les fortes inquiétudes exprimées au Royaume-Uni à l’égard de la fin de l’accès aux programmes universitaires et de recherche, les interrogations des entrepreneurs, professions indépendantes et milieux d’affaires qui se déplacent et contractent sans barrières, témoignent de cet attachement à la dimension humaine de l’Union européenne et de la perte que représente la fin de cette liberté.
a. Une liberté fondamentale et non négociable du projet politique européen
Lors des échanges avec les interlocuteurs rencontrés à Londres, notamment avec des universitaires, l’incompréhension était parfois réelle sur l’importance accordée à la libre circulation des travailleurs, au motif que cette liberté, comme la libre prestation de services par exemple, n’était de toute façon pas pleinement assurée. C’est parfaitement exact mais ce n’est pas le sujet leur répondait-on, ce qu’ils traduisaient comme un souhait d’éluder le débat pour des raisons de politique intérieure notamment.
Or ce sujet n’est pas tabou et le rôle de la France dans la négociation sur la directive relative aux travailleurs détachés en atteste. En revanche, il s’agit bien d’une pierre angulaire du projet européen, comme les autres libertés consacrées par le traité qui en sont les compléments indissociables. Les principes de libre circulation des travailleurs et de liberté d’établissement sont révélateurs de la nature téléologique du projet européen : construire un espace européen sans frontières intérieures offrant à tous les Européens, tous les agents économiques, la liberté de choix au regard notamment des possibilités offertes par le marché unique.
Le traité de Maastricht a introduit l’article 18, devenu l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui a étendu la liberté de circulation et de séjour sur le territoire de l’Union européenne à tout citoyen de l’Union, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application. La libre circulation a ainsi été consacrée comme un droit consubstantiel de la citoyenneté européenne. À partir de 1998, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a affirmé le caractère fondamental de ce droit et a notamment lié le statut de citoyen avec le principe de non-discrimination et d’égalité dans l’État de résidence.
La libre circulation des travailleurs implique ainsi, notamment, l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Il est le socle, non seulement d’une liberté, celle de se déplacer, mais aussi d’une égalité au sein des pays d’accueil, avec en arrière-plan la volonté d’une harmonisation des conditions de vie dans l’ensemble de l’espace européen.
Au fil de sa construction, l’Union européenne a œuvré à consolider les droits fondamentaux sur lesquels elle était fondée, des droits nouveaux permettant de s’approcher peu à peu d’un idéal de non-discrimination total : conditions de travail égales à celles des ressortissants nationaux, accès à certaines prestations, droit à l’éducation, droit de faire venir sa famille. S’y sont joints des droits politiques, tels que le vote pour les élections municipales et européennes dans l’État de résidence et la protection consulaire à l’étranger d’un autre État de l’Union européenne en cas d’absence de représentation diplomatique de son propre pays.
Article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
b) le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;
d) le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.
Article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.
Article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre (…).
Les citoyens ayant légalement résidé dans un autre État membre pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, peuvent demander un droit de séjour permanent dans l’État membre. Soumis à aucune autre condition, ce droit, une fois acquis, ne se perd qu’en cas d’absence d’une durée supérieure à deux ans de l’État membre d’accueil. Les membres de la famille peuvent aussi conserver, sous certaines conditions, leur droit de séjourner dans le pays concerné en cas de décès ou de départ du territoire du citoyen de l’Union. De nombreux citoyens européens résident ainsi dans un autre État sans n’avoir plus aucune formalité à accomplir. C’est un apport extraordinaire de l’Union européenne.
Les droits conférés en matière de protection sociale sont également caractéristiques de cette réalité d’un espace européen. Ils accompagnent la libre circulation en neutralisant les effets liés au changement de pays. Les règlements no 883/2004et no 987/2009 (84) déterminent les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale entre les États membres qui mettent en œuvre le principe de non-discrimination, y compris dans une dimension de lutte contre les abus. Elles incluent les principes de totalisation des périodes et d’exportation des prestations dans toute l’Union européenne. Ces règles sont même applicables avec les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l’Espace économique européen (EEE), soit l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ainsi que, par une décision de 2012, avec la Suisse.
Tous ces droits ont profondément transformé nos pays et nos territoires. Rappelons, si l’on prend l’exemple des citoyens britanniques vivant en France, qu’ils sont fortement intégrés dans les communautés locales, qu’ils contribuent à notre économie, à la vie de nos collectivités et, par exemple, qu’ils sont un peu plus de 800 à être conseillers municipaux, en majorité dans des petites communes (85).
L’Union européenne est-elle un espace économique ou une construction d’un projet politique et citoyen ? Telle est la question. Cette difficulté d’un échange où s’opposent une idée et un raisonnement économique n’est pas nouvelle, mais elle ne traduit pas une opposition entre dogmatisme et pragmatisme. Car les droits conférés sont régulés et proportionnés à l’objectif d’un marché économique unique. C’est en revanche la conception même de l’Union européenne dans sa finalité qui est en cause si l’on considère que le principe de la liberté de circulation peut en lui-même constituer un abus.
b. Des droits proportionnés aux avantages de l’accès, total ou partiel, au marché unique
Les écarts de richesse au sein du marché commun ont toujours eu pour corollaire une certaine prudence, avec des restrictions et ajustements pour limiter les abus ou parer les risques de déstabilisation. Car la libre circulation est le corollaire du marché intérieur des biens, des services et des capitaux et doit donc l’accompagner efficacement. Les limites introduites, dès l’origine ou en réaction à des difficultés d’application, qui sont ci-dessous esquissées, démontrent qu’il n’y a aucune raison, même économique, de revenir sur les principes fondateurs de l’Union européenne. On conçoit mal dans ces conditions d’ouvrir, même partiellement, le marché intérieur, sans accepter la libre circulation des personnes pour les pans concernés.
La libre circulation des travailleurs, avant une période de cinq ans, est largement encadrée et ce depuis l’origine, c’est-à-dire dès le Traité de Rome. Les termes de l’ancien article 48 du Traité n’ont pas été modifiés et figurent aujourd’hui à l’article 45 du TFUE s’agissant de la libre circulation des travailleurs. Cet encadrement concerne aussi bien les limites d’ordre public, que l’inscription de ce droit dans le contexte de l’accès à l’emploi. Quant à la liberté d’établissement, fondée sur le principe de non-discrimination, des règles fixent les modalités d’exercice d’une activité.
La directive no 2004/38 du 29 avril 2004 (86) relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres précise les conditions d’exercice de la liberté de circulation des personnes. Indiquons déjà que tout citoyen de l’Union européenne ou membre de sa famille peut être expulsé de l’État membre d’accueil pour des raisons « d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ».
Pour les séjours de moins de trois mois, la seule exigence imposée aux citoyens de l’Union et à leur famille (conjoints, parents et enfants à charge) est de posséder un document d’identité ou un passeport en cours de validité. L’État membre d’accueil peut exiger que les personnes concernées signalent leur présence dans le pays dans un délai « raisonnable et non discriminatoire ». En revanche, pour les séjours de plus de trois mois, le droit de séjour est soumis à certaines conditions : les citoyens de l’Union doivent disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil durant leur séjour. Les États membres peuvent demander aux citoyens de s’inscrire auprès des autorités compétentes. Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre doivent demander une carte de séjour.
Ajoutons que des périodes de transition ont pu être introduites lors des élargissements de l’Union européenne. Le traité d’adhésion signé le 16 avril 2003 permettait aux « anciens » États membres de l’Union d’instaurer des mesures transitoires pour les ressortissants des nouveaux États membres. Le Royaume-Uni a été le seul pays, avec la Suède et l’Irlande, à ne pas imposer de telles mesures transitoires, ce qui s’est traduit par une immigration massive en provenance des pays de l’Est.
Une autre limite concerne l’accès aux prestations sociales. Les États membres ont la possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à des personnes qui exercent leur droit à la libre circulation dans le seul but d’obtenir de l’aide sociale des États membres, alors même qu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour. Les États membres peuvent aussi rejeter les demandes d’aide sociale qui émanent de citoyens de l’Union originaires d’autres États membres qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour ou qui sont autorisés à séjourner sur leur territoire uniquement à des fins de recherche d’emploi.
Arrêtons-nous enfin sur l’exercice de la libre prestation de services. Sans revenir sur les débats en cours concernant la directive sur les travailleurs détachés (87) dont la modification est à l’ordre du jour, il convient de souligner qu’elle démontre par son existence, même si elle est imparfaite, que la libre prestation de services doit s’accompagner du respect d’un certain nombre de règles, notamment de l’application d’un noyau dur de droits du pays d’accueil, afin de limiter le « dumping fiscal ». La directive doit ainsi permettre de garantir une concurrence loyale et le respect des droits des travailleurs, afin que les entreprises et les travailleurs puissent tirer pleinement parti des possibilités offertes par le marché unique.
c. De la mobilité à l’émergence d’une communauté : l’exemple de l’enseignement supérieur et de la recherche
Au contraire de ce que le débat actuel laisse à penser, la mobilité des travailleurs demeure aujourd’hui relativement faible par rapport à la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Il est un domaine en revanche où la mobilité des hommes a pris une ampleur certaine et a constitué le socle du développement de véritables communautés humaines : celui de l’enseignement supérieur et de la recherche. La densité des liens créés et la qualité des collaborations permises vont bien au-delà des seules possibilités de circuler et d’accéder à des institutions et programmes d’autres pays.
Aucune visibilité ne peut être donnée sur les conditions de la mobilité universitaire après le Brexit et seule la période transitoire actuelle a entraîné à des prises de positions officielles. La Commission européenne a confirmé que le Brexit n’aura aucun impact pour les étudiants en mobilité Erasmus + pour l’année universitaire 2016-2017 et, plus généralement, jusqu’à ce que la Grande-Bretagne ne soit plus membre de l’Union européenne (88). De même, le Gouvernement britannique a indiqué que le Brexit n’aurait pas de conséquences immédiates dans ce domaine (89) et rassuré sur le fait que les étudiants de l’Union européenne paieront le même montant que les étudiants britanniques pour l’année universitaire 2017-2018.
Au-delà, la question sera de savoir s’il est cohérent de mettre au point un accord spécifique sur ces programmes européens alors que dans les autres domaines le Royaume-Uni ne respecterait pas la libre circulation des personnes.
Depuis 1987, année de sa création, près de 4 millions d’étudiants européens sont partis à l’étranger, en échange universitaire ou en stage, grâce à Erasmus, donnant naissance au phénomène des « générations Erasmus », popularisé par le film L’Auberge espagnole, de Cédric Klapisch, sorti en 2002. De plus, si l’harmonisation des cursus universitaires n’est pas le fruit d’une initiative communautaire, de même que la mobilité étudiante et professorale n’est pas le propre des établissements d’enseignement supérieur européens, le dispositif Erasmus a accéléré ces évolutions et produit une dynamique exceptionnelle de travail en commun au sein de l’enseignement supérieur européen.
Erasmus est devenu bien plus qu’un programme de bourses, dont le niveau de financement est d’ailleurs sans doute insuffisant. Il est porté par un tissu dynamique, de plus en plus resserré, et accompagné par les aides complémentaires accordées par les États, les régions et parfois les établissements eux-mêmes. Le programme, devenu Erasmus + et doté pour la période 2014-2020 de 16,4 milliards d’euros de fonds européens, s’articule autour de trois actions clés : le soutien à la politique de mobilité et de coordination des États membres dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse ; la coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques ; et enfin la plus connue, la mobilité à des fins d’apprentissage. Concernant ce dernier volet, le plus visible, son champ ne cesse de s’élargir et couvre désormais l’apprentissage, la mobilité des professeurs, la recherche, la formation professionnelle, l’enseignement scolaire, l’aide au handicap.
Selon la dernière étude de la Commission européenne, le Royaume-Uni constituait pour l’année 2013-2014, la quatrième destination des étudiants dans le cadre du programme Erasmus (90). La présence d’étudiants européens dans les universités britanniques engendrerait un revenu de 3,7 milliards de livres pour l’économie du pays et assurerait la pérennité de 34 000 emplois (91). Plus de 15 000 étudiants britanniques sont partis étudier en Europe dans le cadre du programme Erasmus durant l’année universitaire 2013-2014, soit le cinquième contingent le plus important (92).
Pays de destination |
Nombre d’étudiants (Programme Erasmus) |
Espagne |
39 277 |
Allemagne |
30 964 |
France |
29 621 |
Royaume-Uni |
27 401 |
Italie |
20 204 |
Pays d’origine des étudiants |
Nombre d’étudiants (Programme Erasmus) |
Espagne |
37 235 |
France |
36 759 |
Allemagne |
36 257 |
Italie |
26 331 |
Royaume-Uni |
15 610 |
Le Royaume-Uni étant particulièrement impliqué, du fait de la notoriété de ses établissements et du poids de la langue anglaise, la sortie du pays de l’Union européenne n’est pas anodine et, encore une fois, ne doit pas s’analyser au regard de la seule question de l’aide européenne au financement des mobilités, mais bien au regard de la dynamique universitaire collective. L’association des universités britanniques a pris position pour le maintien du Royaume-Uni dans ce programme dès les premiers mois (93).
En outre, sur le plan de l’attractivité du Royaume-Uni, les étudiants participant au programme Erasmus + ne paient que les droits d’inscription de leur université d’origine et bénéficient d’une bourse d’étude forfaitaire, calculée en fonction du coût de la vie du pays d’accueil, d’une valeur d’environ 250 euros par mois. Dans un pays où les coûts universitaires sont élevés, c’est loin d’être négligeable. Les étudiants ressortissants de l’Union européenne voulant s’inscrire dans une université britannique hors cadre Erasmus + bénéficient, quant à eux, d’un tarif préférentiel par rapport aux étudiants internationaux puisqu’ils s’acquittent des mêmes droits que les étudiants anglais (8 000 euros en moyenne contre 15 000 euros pour les étudiants internationaux). Avec le Brexit, tous ces étudiants seront considérés comme des étudiants internationaux et devront acquitter les droits d’inscription correspondants.
ii. Les fonds européens pour la recherche
Horizon 2020 est le programme unique de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union européenne pour la période 2014–2020, doté d’un budget de 79 milliards d’euros. Le Royaume-Uni a largement profité des financements proposés par ce programme, avec près de 2,47 milliards d’euros obtenus, soit 15,2 % du total des subventions allouées par le programme Horizon 2020 (à savoir 16,18 milliards d’euros). À titre de comparaison, la France a reçu près de 1,69 milliard d’euros, soit 10,4 % des subventions d’Horizon 2020 (94).
La recherche britannique bénéficie, en plus du programme Horizon 2020, de fonds provenant des fonds structurels et d’investissement européens (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEADER, FEAMP,…). Pour la période 2014–2020, la Grande-Bretagne s’attendait, avant le référendum, à recevoir 1,78 milliard d’euros (1,6 milliard de livres) pour des projets de recherche et de développement (95).
Au total, la recherche scientifique britannique bénéficie d’une aide financière importante de la part de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni est un contributeur net à l’Union européenne, ce n’est pas le cas pour le secteur de la recherche, ayant perçu, sur la période 2007-2013, 8,8 milliards d’euros contre une contribution de 5,4 milliards. Cette subvention européenne correspond à 3 % du montant total de la R&D britannique. Les 24 meilleures universités de Grande-Bretagne (regroupées dans le Russel Group) ont affirmé qu’elles reçoivent environ 400 millions de livres par année de la part des fonds de recherche européens soit 11 % de leur budget de recherche (96). Il est incontestable que les fonds européens représentent pour les universités non pas un « bonus » mais une part essentielle des moyens consacrés à la recherche en Grande-Bretagne.
À court et moyen terme, la sortie de l’Union européenne pose des difficultés au regard des fonds européens reçus par les universités britanniques. Celles-ci craignent que les financements d’ores et déjà octroyés mais qui sont débloqués sur plusieurs années ne soient pas versés. Le Gouvernement britannique a confirmé que ces fonds (Horizon 2020 et fonds structurels et d’investissement) seront pris en charge par la Grande-Bretagne (« will be guaranteed by the Treasury »), y compris pour les projets se prolongeant au-delà de la sortie de l’Union européenne (97).
Au-delà des seuls aspects financiers, l’importance des réseaux de connaissances et de compétences qu’apportent des programmes comme Horizon 2020 est reconnue par la communauté des chercheurs et par les petites et moyennes entreprises (PME). Par ailleurs, il est important de rappeler que 16 % du personnel des universités britanniques (soit environ 30 000 chercheurs et lecteurs), sont des ressortissants d’autres États membres de l’Union.
La Commission européenne (98) et le Gouvernement britannique (99) ont indiqué que les universités britanniques pourront postuler au programme Horizon 2020 tant que le Royaume-Uni est membre de l’Union européenne. En revanche, lorsque le retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne sera effectif, les universités ne pourront pas, en principe, postuler pour une demande de fonds émanant de l’Union européenne sauf accord entre ce dernier et la Grande-Bretagne. D’ores et déjà, certains scientifiques britanniques ont le sentiment d’être marginalisés dans les projets scientifiques européens, estimant que leurs collègues européens évitent de les inclure compte tenu des risques liés au Brexit (100).
La mobilité des chercheurs étant le ferment de ces programmes et coopérations, la même question se posera d’une libre circulation proposée et acceptée uniquement sur ce volet au regard de la cohérence globale du partenariat. Doit-on autoriser la libre circulation à l’égard d’un État tiers seulement dans le cas où il y trouve avantage ? Cet avantage est-il suffisamment partagé pour raisonner ainsi ? Quelles contreparties financières faut-il dans ce cas prévoir en gardant à l’esprit que le Royaume-Uni est aujourd’hui un bénéficiaire net de la politique de recherche européenne et qu’il serait assez curieux que l’Union européenne se retrouve à puiser dans ses finances, par ailleurs amputées, au bénéfice d’un État devenu tiers ?
2. Préserver la cohérence et l’originalité de l’édifice juridique européen
L’intégrité de la construction européenne concerne également l’ordre juridique européen, qui organise et met en œuvre un principe de supranationalité. Montesquieu évoquait déjà au XVIIIe siècle le principe de supranationalité dont l’Union européenne peut être considérée aujourd’hui comme l’exemple le plus abouti et c’est même la seule organisation reconnue comme disposant d’un pouvoir supranational officiel. À partir de l’initiative de Robert Schuman de créer la Communauté européenne du charbon et de l’acier, un ordre juridique européen s’est construit autour d’un mode de décision partagée, d’une hiérarchie des normes spécifique et d’un contrôle d’application original.
D’un abord complexe, cet ordre juridique qui s’affirme au fil du temps est indissociable des politiques européennes et consubstantiel au fonctionnement de l’Union européenne. Il procède de et donne corps à la constante recherche d’équilibre et de compromis entre les États membres. Dès lors, la possibilité pour un État tiers d’être associé à l’Union européenne pose trois problématiques juridiques, indépendamment des conséquences en termes de légitimité : la fragilisation des équilibres internes, l’efficacité de la production de la norme et l’effectivité du droit. Ce dernier volet est assuré notamment par la compétence des juges européens et le rejet de cette supranationalité constitue un point central du vote britannique.
a. Un droit issu d’un système complexe, reflet d’une construction originale
Les États membres de l’Union européenne ont accepté de transférer certaines de leurs compétences dans des domaines précis aux institutions de l’Union, lesquelles peuvent prendre des décisions contraignantes au cœur de leurs procédures législatives et exécutives, ou encore budgétaires. Certaines compétences restent à l’inverse exclusivement réservées aux États membres. Ce principe de subsidiarité est devenu un enjeu de débats, notamment sous l’impulsion des Britanniques, afin d’inverser la logique d’intégration pour qu’il conduise à faire « redescendre » à l’échelle nationale des compétences exercées, de manière prétendument abusives, au niveau européen.
Cette bataille contre la logique de « l’union sans cesse plus étroite » n’est pas sans importance. La réalité de l’exercice du pouvoir européen est celle d’une cohabitation des légitimités et compétences, tant du fait de l’existence de domaines mixtes, que de la pertinence de l’exercice en commun de prérogatives nationales, sous des formes variées : harmonisation, coordination, coopérations renforcées, coopérations structurées, etc… On relèvera à cet égard que les accords de libre-échange conclus par l’Union européenne avec des États tiers comme le sera le Royaume-Uni demain sont des accords mixtes et pas uniquement des accords commerciaux relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne. De manière plus générale, la bonne dynamique de l’Union européenne requiert de permettre les initiatives communes.
Il conviendra donc de veiller à ce que les solutions qui seront mises au point avec le Royaume-Uni n’affectent pas le processus de décision tel qu’il résulte du système de l’Union européenne, notamment en lui concédant une forme de droit de regard.
L’architecture institutionnelle de l’Union européenne Le traité de Maastricht de 1992 faisait cohabiter les trois piliers suivants : le premier communautaire à tendance fédérale qui comprenait les acquis de la Communauté économique européenne (1957), de l’Acte unique (1986) et de l’Union économique et monétaire (1990), le second qui concernait la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et le troisième focalisé sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale – dont le mandat d’arrêt européen est par exemple une avancée importante. Le premier pilier était relatif aux politiques intégrées de type union douanière ou politique agricole commune et pour lesquelles les États membres ont transféré une partie relativement importante de leurs compétences à l’Union européenne. La PESC consistait quant à elle en une coopération intergouvernementale en matière d’affaires étrangères et de sécurité. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009, l’architecture institutionnelle de l’Union européenne s’est vue transformée et simplifiée. La structure en piliers a désormais disparu et le caractère supranational ou intergouvernemental des décisions varie en fonction de la compétence dont elles relèvent : compétences exclusives (art. 3 du TFUE), compétences partagées (art. 4 du TFUE) et compétences de coordination (art. 6 du TFUE). Pour les premières, seule l’Union est en mesure de légiférer et d’adopter des actes juridiquement contraignants à moins qu’elle n’habilite les États membres à le faire par eux-mêmes. Les domaines concernés sont les règles de concurrence au sein de l’Union ou encore l’union douanière pour n’en citer que deux. Les compétences partagées signifient que l’Union et les États membres sont en mesure de légiférer et d’adopter des actes juridiquement contraignants dans ces domaines, les États membres exerçant leurs compétences dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. On peut citer comme exemples la politique agricole, les transports ou le marché commun. Enfin le dernier axe de compétences (art. 6 du TFUE) a trait aux affaires culturelles ou encore à la politique industrielle et touristique. En l’occurrence, l’Union dispose d’une compétence afin d’appuyer, de coordonner ou de compléter l’action des États membres. |
La complexité du système décisionnaire européen est en effet d’abord le produit d’une addition de points d’équilibre.
Le premier de ces points est naturellement entre le niveau européen et l’échelon national (et infranational). Il intervient aussi bien dans la détermination de la répartition des compétences (niveau de souveraineté), que dans le rôle des États au travers des institutions européennes dans lesquelles ils sont représentés (Conseil et Conseil européen) ou encore le mode de décision selon que l’intérêt général européen (vote à la majorité) ou national (unanimité) doit primer.
Un deuxième point d’équilibre concerne le contrôle démocratique, avec le partage de légitimité entre les représentants des gouvernements, issus de processus démocratiques, les parlements nationaux qui les contrôlent, le Parlement européen issu d’une élection directe et la Commission en ce qu’elle est responsable devant ce dernier. Par exemple, la procédure de codécision est devenue depuis le traité de Lisbonne la « procédure législative ordinaire » (art. 294 du TFUE). Cette procédure garantit un principe de parité entre le Parlement et le Conseil afin que tout acte législatif ne puisse être adopté sans le consentement mutuel de ces deux institutions. De fait, la grande majorité des normes européennes sont adoptées via cette procédure. On retrouve parmi les domaines d’action principaux la gouvernance économique, les transports, l’énergie ou encore la protection des consommateurs.
Un troisième point d’équilibre concerne le rapport de force entre les États membres, au moyen notamment de la cohabitation de procédures de consensus, de majorité simple et de majorité qualifiée incluant la prise en compte du facteur démographique ou encore les clés de répartition liées au produit national brut.
Il convient de souligner que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne affectera déjà les équilibres actuels entre États membres (101), compte tenu :
– de l’importance du Royaume-Uni (poids économique, population…) : le poids des autres « grands États » de l’Union (et donc de la France) augmentera sous l’effet mécanique du critère démographique, d’une part, du fait de la polarisation du jeu des alliances par suite de la réduction des possibilités d’option, d’autre part ;
– de ses positions historiques (libre-échange, approfondissement, maîtrise du budget…). Ainsi, des pays comme l’Irlande, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, qui votent régulièrement dans le même sens que le Royaume-Uni, pourraient être relativement affaiblis. La vision développée par l’Europe en matière de politique économique et de libre-échange, qui constitue un des moteurs de la proximité entre les États du Nord, au premier rang desquels le Royaume-Uni et l’Allemagne, pourrait être plus nuancée à l’avenir, voire poser quelques difficultés à l’Allemagne et favoriser un couple franco-allemand plus équilibré.
Un quatrième point d’équilibre concerne la conciliation entre respect de l’ensemble des équilibres et efficacité. Du point de vue de la Commission, l’exercice des compétences d’exécution qui lui sont conférées est encadré par ce que l’on appelle la comitologie, autrement dit une procédure de prise de décisions normatives européennes. Ainsi, la Commission exerce ses pouvoirs d’exécution assistée de comités de représentants des États membres. Ces mêmes comités sont présidés par un membre de la Commission et sont chargés de donner leur avis sur les actes d’exécution proposés par la Commission (art. 291 du TFUE). Les textes – règlements d’application – adoptés in fine par la Commission sont de même niveau que ceux adoptés par la procédure législative ordinaire (102).
Un dernier point d’équilibre concerne la possibilité pour un groupe d’États de conduire une politique ou une action commune dans le cadre de l’Union européenne, sans toutefois nuire aux intérêts des États non participants, avec des procédures de consentement, de mise en œuvre, de contrôle et d’association. C’est le cas des coopérations renforcées et structurées, de l’espace Schengen et de l’Union économique et monétaire. C’est aussi le cas des dérogations aménagées au profit d’un ou plusieurs États membres.
Tant que le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne, son opposition quasi-systématique à l’approfondissement de l’Union a conduit à concéder, parfois très avantageusement, des mécanismes permettant de lever les blocages ainsi générés. Exemptions, dérogations, dans les traités comme les règlements ou le budget, droits de regard, prise en compte des effets induits…, des solutions ont toujours été trouvées, à l’issue le cas échéant de très longues négociations pour des concessions importantes.
L’exemple le plus récent relatif aux effets induits concerne la création d’un mécanisme de supervision unique des banques (MSU) (103). Les États non membres de la zone euro intéressés par le MSU escomptaient des garanties quant à une relative égalité de traitement, tandis que ceux qui souhaitaient rester à l’écart, c’est-à-dire essentiellement le Royaume-Uni, souhaitaient éviter d’être affectés par les décisions prises dans le cadre du MSU. Des solutions techniques ont été trouvées pour que l’articulation fonctionne entre l’Autorité bancaire européenne, en charge de la régulation du secteur bancaire et qui concerne l’ensemble de l’Union européenne, et la BCE. L’Autorité bancaire européenne continue d’être chargée de rédiger des corpus de règles européennes pour les banques mais un système de double majorité permet d’éviter que les participants au MSU n’imposent des décisions aux autres pays. Pour qu’une décision contraignante soit adoptée au sein de l’ABE, une majorité doit ainsi se dégager au sein de chacun des deux groupes : participants au MSU et non participants. Au cas où un pays s’opposerait à une décision de l’ABE, un comité composé de deux représentants de chaque groupe et du président de l’ABE serait chargé de trancher.
De tels compromis pour faire avancer la construction européenne sont-ils acceptables dans une relation avec un pays tiers ? Bien sûr que non. Il s’agit d’une question de principe et d’efficacité. C’est la raison pour laquelle l’accord du Conseil européen de février 2016 est caduc, de même que les demandes de participation aux politiques européennes seront examinées sans tenir compte des avantages dont bénéficiait antérieurement le Royaume-Uni lorsqu’il était membre. Puisque l’image est celle du divorce, disons qu’on ne fait pas les mêmes concessions dans la conduite de ses projets de famille pour un ex-époux que pour un conjoint.
Or c’est un point essentiel car dans l’Union Européenne, les normes ont la primauté sur le droit national des États membres, doivent être transposées en droit interne (directives) ou s’appliquent directement dans l’ensemble des États membres (règlements). Cette primauté du droit de l’Union et son contrôle par les juges nationaux se sont imposés à partir des années 1970, y compris au Royaume-Uni (104). La spécificité du droit de l’Union européenne a été progressivement reconnue : dans les rapports entre droit national et droit de l’Union, il y a une dimension d’intégration qui n’existe pas de la même manière à l’égard du droit international, y compris celui de la Convention européenne des droits de l’homme.
Comment imaginer que ce droit primant sur le droit national et qui est produit dans le respect de multiples équilibres internes, puisse résulter d’une transaction avec un État tiers ?
b. Un droit soumis à des processus de contrôle, de régulation et de supervision
Cette primauté du droit européen s’accompagne de moyens de faire respecter son application. L’effectivité de l’ordre juridique européen est assurée non seulement par la transposition et l’application directe, mais également par des procédures institutionnelles et juridictionnelles de contrôle, assurées d’abord par l’exécutif européen, ensuite par une Cour, seul juge de dernier ressort en matière de droit de l’Union européenne, outre les juges nationaux.
i. Les institutions européennes garantes de l’ordre juridique européen
La Commission européenne est la gardienne des traités et de l’acquis communautaire. Les traités confèrent à la Commission des pouvoirs d’exécution étendus pour assurer la réalisation des objectifs qu’ils fixent : le bon fonctionnement du marché unique et de l’Union économique et monétaire, le contrôle des règles de concurrence, la gestion du budget de l’Union et, surtout, l’exécution de tous les actes arrêtés par les organes de prise de décisions (105). Une de ses missions essentielles est de veiller au respect par les États membres de leurs obligations et à la correcte application des dispositions des traités et du droit dérivé – directives, règlements, décisions (article 258 du TFUE).
À ces fins, elle dispose d’un pouvoir d’enquête qu’elle exerce de sa propre initiative, à la demande d’un gouvernement ou à la suite de la plainte d’un particulier. Si, après son enquête, la Commission estime qu’il y a infraction aux dispositions de l’Union européenne, elle invite l’État incriminé à lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si l’État en cause ne se met pas en règle ou si les explications qu’il fournit ne convainquent pas la Commission, celle-ci émet un avis motivé auquel l’État membre est tenu de se conformer dans le délai prescrit.
La Commission contrôle l’octroi des aides (articles 107 à 109 du TFUE), eu égard au principe de concurrence libre et non faussée, pour enjoindre les États à mettre fin aux aides incompatibles, essentiellement indirectes de nos jours, ou encadrer leur octroi, notamment en cas d’aide d’urgence (106). La Commission a activement suivi les procédures stipulées par l’article 260 du TFUE lui permettant de demander à la CJUE d’imposer des montants forfaitaires et pénalités aux États membres ayant échoué à recouvrer les aides d’État incompatibles (107).
L’existence d’une Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) disposant de l’autorité de jugement est un des éléments fédéraux les plus marquants de la construction européenne car ses décisions s’imposent aux États membres et que la responsabilité des États peut être directement engagée. C’est d’ailleurs la jurisprudence de cette Cour qui affirmera la première l’applicabilité directe du droit communautaire (arrêts de la Cour de justice « Van Gend en Loos », 1963 (108), et « Van Duyn », 1974) et la primauté de ce droit, y compris du droit dérivé, sur les droits nationaux (arrêts « Costa contre ENEL », 1964 et « Simmenthal », 1978). La Cour peut être saisie par la Commission, par un État, par un juge national, aux fins d’application et d’interprétation du droit.
L’article 226 du TFUE autorise la Commission à décider à tout moment d’engager une procédure devant la CJUE contre un État membre qui manquerait à ses obligations, ou contre un État, une collectivité locale ou une entreprise publique qui manquerait au respect des règles communautaires (109). Les États membres ont également la possibilité de saisir la Cour, cette procédure demeurant moins usitée pour des raisons évidentes. S’ajoute enfin le contrôle de conventionalité du juge national saisi par les citoyens, le cas échéant au moyen d’une question préjudicielle adressée à la CJUE, effectué donc en application de la jurisprudence européenne. Au cours de l’année 2015, la Cour a été saisie de 713 affaires nouvelles – un record (110) –, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2014 (622), et en a par ailleurs clôturé 616 (en baisse par rapport à 2014). 80 % des affaires n’aboutissent pas sur la saisine de la Cour car le simple fait que la Commission établisse un avis public signifiant le manquement suffit à emporter rectification.
Les fonctions de régulation et de surveillance exercées à un niveau « supranational » ou exécutées sous le contrôle de la Commission européenne ne concernent pas seulement les États et leurs collectivités, mais aussi l’ensemble des personnes physiques et morales. La Commission a beaucoup contrôlé le respect du droit de la concurrence, qui relève historiquement de sa compétence exclusive. Elle peut mener des investigations et le cas échéant recourir à des sanctions. Un recours peut être porté devant le tribunal de l’Union européenne ou la CJUE. La législation européenne interdit ainsi aux entreprises (présentes dans l’EEE) de s’entendre sur les prix ou de se répartir les marchés, d’abuser d’une position dominante et de fusionner si cela permet de contrôler un marché. Quelques exemples récents illustrent les prérogatives de la Commission : amende de 430 millions d’euros pour entrave à la concurrence sur les prix en 2014 à l’encontre du laboratoire pharmaceutique français Servier et d’autres fabricants de médicaments génériques, procédures d’infraction ouvertes contre Google en 2016 (111).
ii. L’enjeu de l’espace juridique unique dans les négociations
Cette supranationalité, toujours sous le contrôle de la CJUE, est le corollaire de l’intégration des compétences : à règlementation intégrée, surveillance intégrée. Ce sont ainsi dans les secteurs de compétences exclusives de la Commission européenne et les volets les plus intégrés des politiques communes que ses pouvoirs de contrôle sont les plus développés.
Or ces transferts de compétence au niveau européen (à une juridiction, la Commission, la banque centrale ou les agences) sont aussi un facteur d’approfondissement de l’Union européenne par l’uniformisation des conditions de mise en œuvre des règles et des pratiques : à exercice unique du contrôle, espace unique.
On entrevoit les problèmes que poserait la reconnaissance d’équivalences à un pays tiers, sans possibilité, non seulement de contrôler la transposition effective des normes et leur mise en œuvre, mais encore d’assurer partout des modalités de mise en œuvre uniformes, selon l’interprétation d’une autorité unique de l’Union européenne, agissant sous le contrôle d’une juridiction unique de l’Union européenne.
Ainsi, « pour chaque secteur, et de manière générale, il faut assurer des conditions d’échange dont l’équité peut être vérifiée dans la durée, de manière dynamique. Il faut en effet s’attendre, une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union européenne, s’il n’est pas dans le marché intérieur, à l’apparition progressive de divergences réglementaires. Chacune peut former une distorsion de concurrence potentielle. Dès lors que nous devrons permettre des échanges avec le marché intérieur, il faudra vérifier qu’il n’y a pas de distorsions. Cela vaut pour les normes de produits, mais aussi pour les normes sur les processus de production que nous nous imposons en Europe, par exemple sur le plan environnemental. Il existe également des réglementations fiscales, en matière d’aides d’État, de propriété intellectuelle, de protection des données, des règles d’origine (permettant de s’assurer que des composants provenant de pays tiers n’entrent pas en Europe par le Royaume-Uni de manière détournée).
« Cela signifie que nous devons vérifier cette équité pour tous les biens ou tous les services qui viendraient du Royaume-Uni vers l’Europe, avec un dispositif institutionnel suffisamment robuste pour réagir à tout défaut d’application. Afin de prévenir de tels cas, l’Union européenne à vingt-sept devra se doter des instruments lui permettant de reconstituer des échanges équitables (112). »
L’ensemble de l’ordre juridique européen est fondé sur l’unicité du droit et son application effective dans l’espace européen, il en va de sa viabilité. Concernant le marché des biens, le refus de se soumettre aux vérifications en matière de normes relatives à la protection des consommateurs ou en matière d’environnement constituerait un problème majeur. Concernant le marché des services, l’on songe notamment à la réglementation en matière de services financiers, de fonds propres des établissements de crédit, de prévention et résolution des crises bancaires.
Comment concilier l’accès au marché avec le non-respect potentiel de ses normes ? La directrice générale du Trésor, évoquant le marché unique, insistait : « Pour nous, la priorité est d’éviter qu’un acteur économique non membre de l’Union – et beaucoup plus puissant que la Suisse, en l’occurrence – puisse accéder facilement à nos marchés sans que ses entreprises, financières ou non, soient soumises aux mêmes règles que les entreprises européennes. Pour se prémunir contre l’émergence d’un tel centre offshore – qui, de surcroît, poserait un réel problème de souveraineté –, il est indispensable de préserver nos acquis juridiques (113). »
La question des services financiers est sensible, en raison du poids de la City, de la place des institutions financières britanniques dans le financement de l’économie des Vingt-Sept et de l’avantage que confèrerait au Royaume-Uni, en ces matières, un accès au marché intérieur sans être tenu à l’ensemble des contreparties qui s’imposent dans l’Union Européenne. Or ces contreparties ne concernent pas uniquement le processus décisionnel en souveraineté partagée, mais aussi toutes les régulations européennes, d’une part, et toutes les garanties de leur application effective, qui relèvent essentiellement de la Cour de justice et de la supervision bancaire, d’autre part.
Pourrait-on concevoir que les institutions financières britanniques continuent de disposer d’un « passeport européen » et conservent leur place dominante sur le continent sans se plier à l’ensemble de ces contreparties ? Compte tenu du poids de la place financière de la City, il ne fait guère de doute que le rapport de forces serait trop déséquilibré pour que l’effort de régulation au sein de l’Union européenne résiste à d’éventuels coups de boutoir.
La question se pose aussi des politiques communes. On notera avec intérêt les clauses du projet d’accord de coopération opérationnelle entre Europol et le Danemark, rendu nécessaire par le régime spécifique du Danemark qui l’empêche d’être soumis au nouveau règlement d’Europol qui entrera en vigueur le 1er mai 2017. Le projet comporte des dispositions contraignantes, notamment la compétence de la CJUE et du contrôleur européen de la protection de données pour son application.
3. Éviter l’écueil d’une négociation segmentée et clivante et préserver les perspectives d’avenir de l’Union européenne
Comme rappelé en introduction de ce rapport, le vote en faveur du maintien l’aurait-il emporté, que la nécessité de refonder l’Union européenne n’en eut pas été moins grande. Avec les négociations de la sortie du Royaume-Uni, une vigilance supplémentaire s’impose. La conduite des négociations comporte trois risques majeurs.
Le premier est que les négociations accaparent l’Union européenne, mobilisent toute son énergie et que l’Union européenne réponde encore moins aux demandes des citoyens. Ce risque de dispersion doit être combattu et prévenu. Néanmoins, il apparaît essentiel de limiter les dommages collatéraux en restant sur des schémas simples et en évitant les discussions interminables sur des détails aux seules fins de permettre au Royaume-Uni d’obtenir un accord le moins pénalisant possible.
Le deuxième risque est le risque de divisions voire de désintégration, c’est-à-dire que les négociations fassent émerger ou accusent des divisions entre États membres qui mettent en péril la capacité à travailler ensemble, pour la conduite des politiques actuelles comme pour la capacité d’initiative. Non seulement l’Union européenne serait paralysée, mais elle n’apparaîtrait même plus comme une partie de la solution aux problèmes. Il serait déraisonnable de balayer d’un revers de la main, comme le font les Brexiteers londoniens pour accompagner leurs demandes d’un statut privilégié, l’hypothèse que le Royaume-Uni devienne l’avant-garde d’une Europe ultralibérale et génératrice d’une guerre civile économique et fiscale, emportant dans son sillage le délitement de l’Union européenne.
Le troisième risque est que l’accord ou les accords conclus avec le Royaume-Uni contraignent les évolutions futures de l’Union européenne, le cas échéant, dans un sens contraire aux intérêts de la France. C’est le risque de glaciation. Dans quelle mesure la politique européenne de la France a à perdre et à gagner, compte tenu des conceptions différentes qui peuvent exister et aussi des évolutions politiques et économiques en Europe ? Si nos partenaires ne souhaitent pas travailler aujourd’hui à l’approfondissement de l’Union européenne, notamment l’Union économique et monétaire, comment néanmoins préserver cet horizon ? L’Union européenne pourra-t-elle être le vecteur de la défense de nos intérêts stratégiques ? Sera-t-elle le cadre dans lequel la France définira son avenir ? Autant de questions que les gouvernants français devront conserver à l’esprit dans les mois qui viennent pour que ces négociations ne signent pas un échec programmé du projet européen tel que nous pourrions le concevoir.
Pour détourner une citation de Theresa May dans son discours du 17 janvier 2017 : l’absence d’accord pour la Grande-Bretagne serait toujours mieux qu’un mauvais accord pour l’Union européenne.
a. L’intégrité de la construction européenne, une vision politique du projet européen et un rempart contre les divisions
Le principe d’une Union inclut l’acceptation de contreparties au gain que procure l’appartenance à la communauté. Le transfert de souveraineté implique un renoncement à la prévalence systématique de l’intérêt national. L’Union européenne est un ensemble de politiques dont les bénéfices sont collectifs mais la répartition des coûts inégale. Les droits et avantages conférés par la profondeur du marché intérieur, les libertés économiques et les programmes existants coexistent avec des obligations de participation. À cet égard, peut-être la sortie du Royaume-Uni constituera-t-elle enfin le moyen de sortir de la logique comptable des retours budgétaires.
Notamment, outre les libertés consacrées par le traité qui ont ouvert des droits aux citoyens européens, un des piliers originels de l’Union européenne est la solidarité des territoires. Le traité de Rome (1957) mentionne dans son préambule, parmi les objectifs que s’engagent à atteindre les États membres de la future Communauté européenne, celui « de renforcer l’unité de leurs économies et d’en assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés ».
Alors qu’il n’existait que deux Fonds structurels (FSE et FEOGA section orientation), le choc pétrolier et les premiers élargissements ont jeté les bases d’une véritable politique de solidarité régionale. En 1975, juste après l’entrée du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark, le Fonds européen de développement régional (FEDER) est créé. Surtout, l’Acte unique européen fera de la cohésion économique et sociale une nouvelle compétence de la Communauté et en fixe les objectifs et les moyens, au travers notamment de l’utilisation systématique des Fonds structurels. Le traité de Maastricht (1992) et le traité instituant la Communauté européenne tel que modifié (TCE) mettront en place le Fonds de cohésion, ainsi que le Comité des régions.
Approfondie au fur et à mesure des élargissements et des chocs économiques, cette politique de cohésion et de solidarité est un marqueur de l’Union européenne, une composante de la volonté commune de créer un espace européen économiquement et socialement avancé. Participer aujourd’hui à des politiques communautaires sans contribuer à cette composante est difficilement concevable et susciterait une remise en cause de la participation à ces mécanismes par des États contributeurs. On voit déjà à quel point le développement des mécanismes de solidarité se heurte à des réticences voire des oppositions franches. L’actualité n’est pas avare d’illustrations : crises de la dette, accueil des migrants, opérations extérieures…, pour qu’il ne soit besoin de battre en brèche le principe même d’une solidarité européenne en ouvrant la voie à une logique de buffet (pick and choose), c’est-à-dire une Europe à la carte qui se réduirait in fine au plus petit dénominateur commun.
Cette dimension intégrée de la construction européenne, organisation solidaire faite d’interdépendances, des politiques, des droits et des obligations, est évidemment une conception politique du projet européen. Elle n’est pas nécessairement celle que privilégient d’autres États, dont on sait pour certains qu’ils voyaient d’un bon œil la présence du Royaume-Uni dans l’Union européenne pour cette même raison. Il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence c’est cette vision qui nous prémunira du risque principal de la division entre Européens. Il est fort probable que le Royaume-Uni tentera de négocier au maximum secteur par secteur, pour obtenir le maximum d’accès au marché et aux politiques qui l’intéressent.
Les vingt-sept États-membres ont très tôt fixé comme limite aux négociations le fait de ne pas aboutir à une situation plus avantageuse pour le Royaume-Uni qu’aujourd’hui. Il convient de compléter ce principe de bon sens :
– par correction vis-à-vis de nos autres partenaires, il convient de veiller à ce que le Royaume-Uni ne bénéficie pas d’un régime plus avantageux qu’un pays tiers dans une situation comparable ;
– il convient aussi d’éviter que le régime mis au point, certes moins avantageux, n’en produise pas moins une situation globalement défavorable à l’Union européenne. Comme l’énonçait très justement le Secrétaire général des Affaires européennes Philippe Léglise-Costa : « [l’] équilibre des droits et des obligations vaut à la fois pour chaque secteur et pour la relation d’ensemble. Il ne peut y avoir une segmentation qui amènerait le Royaume-Uni et l’Europe à négocier une série d’accords sectoriels, chacun ayant une logique mais dont l’ensemble serait déséquilibré, par exemple s’il privilégiait des secteurs où le Royaume-Uni considère avoir un avantage comparatif (114) ».
Effectivement n’accorder « que » un régime très favorable aux services financiers et une participation à l’union douanière pour quelques secteurs, y compris d’ailleurs avec une liberté de circulation des personnes concernées par ces champs, ne saurait produire un accord équilibré.
Cette question appelle d’autant plus de vigilance que l’intégration se traduit certes par une diminution des coûts de transaction, mais s’accompagne de coûts, de souveraineté mais aussi de règlementation, d’administration... On peut faire l’analogie avec un marché bancaire et financier composé d’une Union économique et monétaire fortement régulée et d’États qui conservent l’arme de leur monnaie tout en bénéficiant des transactions effectuées dans la monnaie commune… En d’autres termes, faire partager le gain sans partage des coûts revient à accorder à un État tiers les faveurs d’un régime de passager clandestin.
Concernant plus spécifiquement l’accès au marché unique, le principe d’intégrité s’entend à la fois de l’intégrité pour chaque secteur et de l’intégrité de l’ensemble. C’est ce que le Gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, soulignait lors de son audition en évoquant le marché financier : « Deux intégrités sont absolument essentielles dans la négociation. Tout d’abord, l’intégrité du marché unique financier lui-même. […] La deuxième intégrité, c’est celle du marché unique entre les différents secteurs. Nous parlons aujourd’hui des services financiers, mais il y a aussi l’agriculture, l’industrie et les services. Cette deuxième intégrité est extrêmement importante. Il ne faudra pas accorder de concessions secteur par secteur ; il est probable que les négociateurs britanniques soient tentés de saucissonner le sujet, mais il sera au contraire très important de maintenir cette deuxième intégrité et l’équilibre d’ensemble du marché unique. »
L’intégrité de chaque secteur a pour objet de garantir la préservation de l’acquis et de parer aux effets en chaîne susceptibles de survenir du fait d’appétits de déconstruction aiguisés. Si l’on reprend l’exemple du secteur financier, il s’agit notamment de ne pas reculer sur les avancées considérables en matière de régulation et de supervision qui ont été obtenues depuis 2008. L’intégrité de l’ensemble, au-delà des considérations de principe précédemment rappelées, constitue un rempart contre une politique britannique de divisions et de recherche de compromis en jouant les secteurs les uns contre les autres et les États contre les autres dans le but d’obtenir le maximum de brèches.
Le risque existe d’assister à un retournement du rapport de force. Le Royaume-Uni est l’État qui quitte l’Union européenne, celui qui subit l’essentiel des conséquences de ce départ et qui est en position de demande pour bénéficier d’un certain nombre d’avantages que procurait son appartenance à l’Union européenne. Cela ne signifie pas que l’impact sur les autres États soit négligeable ou qu’il sera identique quelle que soit la solution négociée. Néanmoins, le rapport de force est à l’avantage de l’Union européenne, surtout avec vingt-sept États membres qui récusent de manière unanime la possibilité pour un pays tiers de bénéficier du marché unique et de l’union douanière, dans un certain nombre de programmes et de politiques, sans se soumettre aux règles fondamentales et au processus de contrôle, c’est-à-dire qui refusent ce que le Royaume-Uni espère.
Cette unité est bien plus sujette aux fissures qu’au renforcement et ouvrir des négociations sectorielles revient à permettre aux désaccords de s’infiltrer. Il est probable que le Royaume-Uni segmentera habilement les discussions dans le but d’aviver les différences d’intérêts entre les États. La qualité des négociateurs britanniques n’est plus à démontrer et s’il est déjà complexe de concilier les intérêts d’entités infranationales et de groupes d’acteurs, la complexité est démultipliée à vingt-sept États.
Or, en annonçant qu’elle ne cherchera pas à obtenir le maintien au sein du marché intérieur, Theresa May déplace le problème. Elle tente de sortir de la logique d’intégrité du marché unique sur laquelle les Européens ont su rester fermes au regard de l’indissociabilité des quatre libertés fondamentales, pour obtenir en qualité d’État tiers des modalités d’accès au marché intérieur et à l’union douanière qu’on lui refusait en y appartenant.
Lorsque s’engageront des négociations sectorielles, secteur par secteur, de nombreuses coopérations avec les Britanniques pourront apparaître comme gagnant à être prolongées. En recherchant ainsi de l’extérieur des accords sur mesure sur chacun des sujets – commerce, sécurité et défense, immigration – avec pour chacun une sélection opérée en fonction des intérêts britanniques, la Première ministre ouvre la voie à des négociations sectorielles et des compromis fondés sur un marchandage tout à fait périlleux pour l’unité des Vingt-Sept.
Cela aurait en outre potentiellement un effet dévastateur au sein des États et il est donc autant de l’intérêt européen que national de s’attacher à conserver une approche globale. Comme l’a exprimé Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, lors de son audition : « Nous ne voudrions pas d’un Brexit à la découpe dans lequel la pêche française serait la variable d’ajustement d’accords dans d’autres secteurs. » Cette prudence doit être généralisée.
b. Un risque de dispersion et de dilution quand l’Europe doit avancer
Le risque d’enlisement ne saurait être totalement évité compte tenu de la masse des sujets et politiques impactés, directement ou indirectement, par le Brexit. La machinerie juridique européenne est si complexe, qu’une sortie du Royaume-Uni même sèche (hard Brexit) requerra une énergie et des ressources humaines considérables. Pour mémoire, plusieurs blocs devront être traités : les questions institutionnelles et administratives, les décisions de conséquence, les législations et règlementations et les politiques communes qui pourraient faire l’objet de mesures transitoires, les conséquences sur les accords commerciaux conclus, sans oublier toute la myriade des sujets sectoriels qui constituent aujourd’hui des compétences partagées ou mixtes, de l’agriculture et la pêche à la coopération judiciaire en matière pénale en passant par l’espace et l’énergie.
Dans ce contexte, il convient d’accentuer le virage pris par les enceintes européennes pour concentrer l’action sur des priorités resserrées et concrètes sur lesquelles il est possible d’avancer à court et moyen terme. Cette approche, cohérente avec la méthode de travail instituée par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker depuis sa prise de fonction et en phase avec son discours devant le Parlement européen le 14 septembre, est précisément celle du consensus trouvé par les chefs d’État et de gouvernement au Sommet de Bratislava du 16 septembre 2016.
Ce sommet informel, premier sommet à vingt-sept, au-delà de la capacité à démontrer leur unité, a abouti à un programme de travail immédiat, indépendamment de la négociation à venir sur les modalités du Brexit. Il était important de marquer que cette négociation ne saurait accaparer l’agenda européen, de même que nous devrons veiller à ce que nos relations bilatérales avec les vingt-six autres États ne perdent en substance.
Il l’était tout autant que cet agenda comporte des orientations et propositions concrètes, en phase avec les attentes des Européens. La feuille de route de Bratislava affirme un consensus autour de quelques thèmes forts, leur traduction en mesures concrètes et précises et la définition d’un calendrier court pour l’adoption des décisions correspondantes et l’obtention de résultats tangibles. Elle comporte trois chapitres : migrations et frontières extérieures, dont le renforcement est érigé en objectif central ; sécurité intérieure, pour laquelle la priorité s’attache aux mesures opérationnelles relevant des services de sécurité des États membres, et sécurité extérieure et défense, avec un engagement en matière de capacités ; développement économique et social, par des actions ciblées (investissement par l’amplification du fonds Juncker, marché unique, programmes à destination de la jeunesse).
Il convient d’ajouter à la feuille de route la nouvelle Stratégie Globale de l’Union européenne sur la politique étrangère et de sécurité. Présentée au Conseil européen le 28 juin 2016 par la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, soit cinq jours après le référendum britannique, elle a été endossée sans équivoque dans les conclusions du Conseil des ministres des Affaires étrangères du 17 octobre 2016. Ses cinq priorités constituent le socle d’initiatives concrètes appelées à voir le jour avant la fin du premier semestre 2017, un premier rapport de mise en œuvre étant attendu pour juin 2017.
Ces priorités concernent le domaine de la sécurité et de la défense, l’élaboration d’un document stratégique sur la résilience afin de placer ce concept au cœur des politiques extérieures de l’Union européenne, des mesures opérationnelles pour promouvoir l’approche intégrée dans la réponse aux conflits, de nouvelles stratégies régionales ou thématiques, ainsi qu’une volonté de repenser la communication publique. Notamment, entre le 14 novembre et le 6 décembre 2016, un paquet de mesures significatif dans le domaine de la sécurité et la défense a été adopté et confirmé au Conseil européen du 15 décembre 2016 (115).
Or toutes ces questions relèvent d’un traitement à vingt-huit. L’un des enjeux est de progresser voire de mener les travaux à leur terme avant que la négociation avec le Royaume-Uni n’altère les capacités de mobilisation des institutions. Un autre enjeu est d’obtenir de ce dernier une « coopération loyale » dont l’une des dimensions devra être de ne pas entraver des décisions dont la mise en œuvre ne le concernera plus. Car à la limite des capacités matérielles et humaines à travailler sur d’autres sujets, il convient d’ajouter les blocages ou interférences néfastes que pourrait provoquer le Royaume-Uni pendant cette période de transition où il est encore membre de l’Union européenne, avec ses droits et obligations, mais raisonne comme un État sur le départ et anticipe sa situation future d’État tiers.
Ce n’est pas seulement l’agenda qui pourrait être perturbé par le retrait britannique, mais également les travaux de l’Union européenne sur les sujets à l’ordre du jour. Il existe naturellement quelques inquiétudes quant à la loyauté qui pourrait être celle des représentants britanniques, notamment en matière commerciale puisque se met en place une politique de négociation d’accords commerciaux à conclure une fois le pays sorti de l’Union, qui est sur le fil au regard de la compétence exclusive de la Commission européenne en matière de politique commerciale. On peut effectivement supposer que la perspective de sanction laisse le Royaume-Uni de marbre et l’utilisation d’autres moyens ne manquerait pas d’envenimer le climat des négociations à venir.
Même en demeurant parfaitement loyal, nous savons bien que les positions du Royaume-Uni, grand État de l’Union, ont fortement imprégné certaines négociations, alors même que la voix britannique était isolée ou relativement. Ayant en tête le statut d’État tiers à venir, pourquoi le Royaume-Uni se priverait-il d’intervenir pour peser dans la continuité de ses positions antérieures ? Si en matière de défense européenne, le processus décisionnel des coopérations structurées ne lui permet pas de faire obstacle aux initiatives, il n’en est pas de même en matière de renforcement des instruments de défense commerciale. Or ce sujet devient urgent.
Comment réagiront les députés européens britanniques s’agissant des décisions faisant intervenir le Parlement européen ? Le Royaume-Uni renoncera-t-il d’ailleurs à disposer d’élus au Parlement européen en 2019, le délai de deux ans ayant la possibilité d’être prolongé ? Quel sera le poids que souhaiteront avoir les représentants britanniques dans la négociation du futur cadre financier pluriannuel pour cette même raison et dès lors qu’il n’est pas exclu que le pays souhaite continuer à bénéficier de certains programmes et à participer à certaines politiques après sa sortie ? Le coût de sa sortie pour le budget de l’Union européenne sera alors dans tous les esprits…
c. Éviter la désunion et le délitement en conservant la perspective de refondation de l’Europe
Il apparaît très nettement que la capacité à conserver la cohésion entre les États membres est un prérequis pour des négociations en faveur d’une autre Europe, qui emporte l’adhésion des citoyens européens, bâtie sur des fondations consolidées : ses valeurs. Si le projet est philosophique, téléologique, les moyens de sa mise en œuvre ne sont que des états transitoires et aucun grand artisan de l’Union européenne n’a jamais souhaité qu’il en fût autrement. Les enjeux sont ceux de l’efficacité et du caractère démocratique, qui ne sauraient être assurés, ni par un système apolitique et largement technocratique rejeté par les citoyens, ni par la concertation et la coordination, mécanismes intergouvernementaux qui n’ont jamais démontré la preuve de leur capacité à faire face aux grands enjeux communs à autant d’États.
« L’Europe se demandait hier encore comment elle pouvait concilier l’ambition de certains d’être un acteur, et la volonté de la plupart de se contenter d’un modèle. Aujourd’hui, soyons réalistes : elle n’est plus véritablement ni l’un ni l’autre, et ceci au moment même où l’Amérique et à travers elle le monde démocratique connaît la crise la plus grave de son histoire récente, qu’illustre le spectaculaire retour des populismes. » (116)
La fédération d’États-nations, chère à Jacques Delors, demeure le cadre intellectuel le plus pertinent. Si l’espace national, par le biais de la subsidiarité et du débat public, doit sans doute retrouver une place plus marquée, cela ne doit pas mettre un coup d’arrêt à l’objectif fixé par les traités d’une « union sans cesse plus étroite », seule voie qui permettra à l’Union européenne d’être plus efficace.
S’agissant de l’Union économique et monétaire, des progrès devront être faits. Cela concerne le pilier monétaire, puisque l’union bancaire demeure amputée d’une garantie commune des dépôts reportée sine die. Cela concerne surtout le pilier économique qui s’apparente encore à l’organisation d’une simple coopération. Le pragmatisme commande d’assurer la convergence et la cohérence des politiques économiques des États de la zone euro, ce qui passe par une véritable coordination macro-économique orientée vers la croissance et l’emploi. Un gouvernement économique aurait pour mission de conduire une telle politique véritablement européenne. Elle suppose un Trésor européen, une capacité d’investissement dont le fonds dit « Juncker » pourrait être la préfiguration, des outils de stabilisation économique contra-cyclique ou d’accompagnement et, sans doute, une convergence fiscale et sociale qui prémunisse la zone euro contre le risque d’une surenchère en matière de dumping, surtout si nos principaux partenaires extérieurs s’engagent effectivement sur la voie de telles politiques.
L’agenda décidé au Sommet des Vingt-Sept de Bratislava n’impulse pas de nouvel élan en faveur de l’approfondissement des politiques et la question des améliorations indispensables de l’Union économique et monétaire a pratiquement disparu du débat. On aurait tort cependant de le regarder comme un minimum syndical. L’Union européenne doit dans un premier temps œuvrer à sa consolidation et la dynamique commune de Bratislava, qui était loin d’être acquise, constitue une assise non seulement opportune, mais également indispensable. Les citoyens européens demandent que l’Europe réagisse à leurs attentes et déploie ses capacités sur un agenda de propositions concrètes et utiles. La feuille de route de Bratislava propose une première série de réponses ; elle doit aussi permettre de créer les conditions d’émergence de consensus sur l’avenir de l’Union européenne qui à ce jour ne sont pas établies, y compris d’ailleurs au sein des dix-neuf États membres de la zone euro.
Les dix années qui viennent de s’écouler ont vu les divisions s’accroître autour de lignes de fractures de plus en plus nombreuses, qui ont ravivé les nationalismes, permis aux régimes autoritaires d’exercer une certaine fascination, toutes choses qui ne peuvent non plus trouver réponse dans le cadre de l’État-nation libéral et démocratique sur lequel l’idée européenne a été bâtie.
La cassure opérée par le vote britannique rappelle cette obligation de colmater les fissures qui partout s’élargissent, entre les peuples et leurs gouvernants, entre les États du Nord et ceux du Sud, entre la France et l’Allemagne, entre les États fondateurs et ceux que l’on continue à désigner, souvent avec une pointe de mépris, comme les « nouveaux États ». Pour tous, l’analyse du vote britannique est celle d’un symptôme, d’une manifestation supplémentaire d’une crise du projet européen, marquée par la défiance des peuples vis-à-vis du projet commun et de ses institutions. L’analyse des responsabilités et des causes, cependant, révèle des lignes de clivage nettes, en particulier autour de la question des flux migratoires.
L’Union européenne ne peut se construire contre une partie d’elle-même. La restauration de la confiance au sein de l’Union européenne, la capacité à travailler en commun sur des questions essentielles pour les citoyens, comme la sécurité intérieure et extérieure, c’est-à-dire le contrôle du destin européen, est sans nul doute la voie à suivre.
Elle est d’autant plus précieuse que la tâche à accomplir à plus longue échéance est difficile et requerra des compromis douloureux. Ils le seront pour des pays très réticents à tout nouveau transfert de souveraineté, même compensé par une revalorisation de pouvoirs d’ordre national. Ils le seront pour notre pays, qui porte haut son ambition européenne et a du mal à intégrer que le monde a changé, que l’Europe, qui n’en est plus au centre, a évolué et que le projet européen ne peut pas être tenu à l’écart de ces transformations. Un consensus émerge progressivement, notamment à la faveur du Brexit, pour que se mette en place une Europe différenciée, qui ne soit ni une Europe à la carte, ni une Europe constituée de cercles figés. Cette voie seule offre un cadre opérationnel pour concilier l’hétérogénéité de l’espace européen et apporter la meilleure réponse qui soit au Brexit, à savoir faire progresser notre Union européenne.
Dès lors, d’une part, l’effort de reformulation du projet européen doit constituer un enjeu du débat public national dès à présent pour préparer l’avenir. D’autre part, les négociateurs français et notre Parlement, dans sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement, devront être mus par le souci impérieux de préserver le potentiel d’avenir de l’Union européenne.
B. SOUTENIR DES NÉGOCIATIONS OUVERTES ET CONSTRUCTIVES SUR DES SUJETS D’INTÉRÊT COMMUN
Les négociations qui vont s’ouvrir seront immanquablement difficiles. Néanmoins, le souhait de parvenir à des accords les meilleurs possibles est partagé, compte tenu de notre histoire commune, de notre proximité et surtout du fait que tel est l’intérêt des citoyens européens. Pour le président-rapporteur, s’il est un objectif prioritaire, c’est que les citoyens européens ne soient pas sacrifiés sur l’autel du Brexit, ni ne servent de monnaie d’échange.
Comme il a été rappelé, la construction européenne est avant tout un projet générateur de droits et d’avantages pour les citoyens européens : la sortie du Royaume-Uni de l’Union les affectera très directement. Dans son arrêt du 3 novembre 2016, la Haute Cour de Londres a d’ailleurs largement insisté sur l’impact potentiel d’une sortie de l’Union sur les droits individuels.
En la matière, seront touchés en premier lieu les Européens expatriés au Royaume-Uni et les Britanniques expatriés dans les autres pays de l’Union. Juridiquement, des solutions existent pour préserver le plus possible les droits de ces citoyens, et il conviendra de faire preuve de la plus grande volonté politique pour que cette question soit réglée dès le début des négociations.
Ne pas négocier au détriment des citoyens, c’est aussi continuer à assurer leur sécurité de la façon la plus efficace possible. Le Royaume-Uni est aujourd’hui un partenaire fondamental de la France et un pilier de l’Union européenne en matière de défense, de renseignement, de lutte contre le terrorisme. Nous devrons continuer à coopérer étroitement pour assurer ensemble la sécurité de notre continent et les discussions à ce sujet devront être conduites indépendamment des négociations sur les autres volets du partenariat. On ne négocie pas la sécurité de nos compatriotes.
Sur ces deux volets, des négociations séparées pourront s’engager et aboutir à des accords positifs de part et d’autre. De ce point de vue, le Brexit n’est pas un jeu à somme nulle pour reprendre l’expression employée outre-Manche.
Enfin, l’intérêt des citoyens européens est aussi que nous assurions les meilleures conditions de vie et de travail possibles, incluant la situation économique générale et les conditions d’exercice des entreprises et professions indépendantes. Nous entendons les inquiétudes des acteurs économiques des deux côtés de la Manche, et nous mesurons l’impact potentiel du Brexit pour les travailleurs, les consommateurs et tout simplement les habitants de nos pays.
À la différence des questions liées au statut des citoyens expatriés et à la sécurité, il ne sera pas possible d’obtenir une situation équivalente à celle d’aujourd’hui. Cependant, nous avons vis-à-vis de nos citoyens la responsabilité de faire preuve d’une approche constructive en vue du meilleur accord possible en matière économique et commerciale entre le Royaume-Uni et le continent, un accord qui favorise la croissance économique de l’Union, sans compromettre l’intégrité et la cohérence du marché unique.
1. Une obligation de résultats : régler dès la sortie ce qui a trait aux droits des citoyens
Il est totalement inconcevable, tant juridiquement que politiquement, d’accorder aux citoyens britanniques qui le demanderaient la citoyenneté européenne ou une « citoyenneté européenne associée », idée qui a émergé au cours des derniers mois au Parlement européen et que Guy Verhofstadt a évoquée lors de son entretien avec une délégation de la mission. Comme l’a souligné Jean-Claude Piris, permettre aux Britanniques de conserver leur citoyenneté européenne ou une partie des droits liés à celle-ci aurait « des conséquences absurdes, puisque cela pourrait inclure le droit à la liberté de circulation à destination ou en provenance de tous les États membres, ainsi que le droit de voter et de se porter candidat au Parlement européen » (117).
En revanche, ce serait une faute inacceptable de ne pas trouver des solutions appropriées pour les personnes dont la situation individuelle sera directement affectée par le Brexit.
a. Une véritable insécurité juridique pour les citoyens des deux côtés de la Manche, à laquelle il conviendra de répondre en priorité
En premier lieu et de manière prioritaire, il faudra trouver le plus tôt possible un accord protégeant les citoyens expatriés de l’autre côté de la Manche, parfois depuis très longtemps, pour éviter des situations humaines qui pourraient être très douloureuses.
À cet égard, l’une des questions fondamentales sera de définir la date butoir à partir de laquelle les citoyens pourraient bénéficier de droits garantis – la date du référendum britannique, de l’activation de l’article 50, de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union ou de la fin d’une éventuelle période transitoire ?
Plus de quatre millions de citoyens sont ainsi concernés au premier chef par le Brexit. Environ 1,2 million de Britanniques résident dans un autre pays de l’Union, dont 800 000 seraient des travailleurs et leurs ayants droit. La grande majorité de cette communauté britannique réside en Espagne, en Irlande, en France et en Allemagne (118). À l’inverse, 3,2 millions de citoyens de l’Union résident au Royaume-Uni sans en avoir la nationalité. Parmi eux, environ 984 000 Polonais et 300 000 Français.
Communauté française au Royaume-Uni et communauté britannique en France
Au 31 décembre 2014, 126 804 Français étaient inscrits au Registre des Français établis hors de France, mais la communauté française au Royaume-Uni est cependant évaluée à plus de 300 000 personnes en prenant en compte les personnes non inscrites. Cette communauté française est particulièrement concentrée dans les principaux centres urbains du pays, dont évidemment Londres et les villes universitaires que sont Oxford et Cambridge.
À l’inverse, on estime qu’environ 200 000 Britanniques vivent aujourd’hui en France.
Le « profil type » de ces expatriés est très différent. Alors que la communauté française résidant au Royaume-Uni est jeune, principalement constituée d’étudiants et d’actifs (un tiers des inscrits ont entre 25 et 45 ans), la communauté britannique en France est en grande partie constituée de retraités. Selon une étude de l’Institut britannique pour la recherche en matière de politique publique citée par Christopher Chantrey, président de l’association « British in France », lors de son audition par la mission, ces Britanniques en France seraient environ 45 % à la retraite et 10 % à suivre des études. Le directeur de la sécurité sociale, auditionné par la mission, a indiqué que « 9 000 retraités français sont installés au Royaume-Uni et ont perçu 22 millions d’euros des régimes français en 2014, contre 64 000 retraités britanniques vivant en France qui ont reçu 370 millions d’euros des régimes britanniques ».
La situation actuelle et l’incertitude qui prévaut depuis le référendum génèrent déjà de nombreuses inquiétudes pour ces ressortissants, dont la mission a pu prendre la mesure en rencontrant la communauté française à Londres et en auditionnant Christopher Chantrey, président de l’association British in France (119). D’après une enquête et un sondage du Financial Times parus le 29 octobre 2016 et menés sur les deux mois qui ont suivi le référendum, près d’un cinquième des ressortissants européens résidant au Royaume-Uni réfléchiraient à quitter le pays dans les deux ans à venir, du fait de l’incertitude sur leur statut futur et l’économie.
Ce climat anxiogène a été aggravé par la multiplication d’agressions à caractère xénophobe au lendemain du référendum, visant plus particulièrement les communautés polonaises et roumaines.
L’une des principales incertitudes qui pèse aujourd’hui sur ces ressortissants concerne évidemment le maintien de leur droit au séjour.
Les citoyens européens vivant dans un autre État membre depuis plus de cinq ans peuvent demander un droit de séjour permanent dans cet État membre, et la plupart des citoyens européens résidant au Royaume-Uni seraient éligibles à ce droit de séjour permanent : en 2015, 39 % des citoyens de l’EEE expatriés au Royaume-Uni y résidaient depuis plus de dix ans, et 32 % depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans (120).
Mais dans la pratique, bien peu d’expatriés demandaient jusqu’alors ce droit de séjour permanent – souvent, cette demande est faite pour favoriser le rapprochement d’un membre de la famille n’ayant pas lui-même la citoyenneté européenne. Par ailleurs, selon un rapport de la Chambre des Lords (121), il semblerait que nombre de citoyens européens résidant depuis plus de cinq ans au Royaume-Uni sans pour autant y exercer une activité professionnelle soient actuellement dans l’incapacité d’obtenir ce titre de séjour permanent, car ils doivent notamment prouver qu’ils ont bénéficié d’une assurance maladie complète durant ces cinq ans. Selon Christopher Chantrey, des difficultés pour obtenir ce droit au séjour permanent auraient également été répertoriées en France.
Obtenir un titre de séjour en tant que citoyen d’un État tiers après la sortie du Royaume-Uni de l’Union garantirait bien moins de droits à ces citoyens, et serait souvent conditionné à des critères beaucoup plus restrictifs, en premier lieu la maîtrise de la langue.
Lors de la campagne référendaire, les partisans du Leave ont à plusieurs reprises affirmé que les droits des expatriés étaient des « droits acquis », citant régulièrement l’article 70 de la Convention de Vienne, qui prévoit que :
« 1. À moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :
« a) libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité ;
« b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin.
« 2. Lorsqu’un État dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet État et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet. »
Or l’existence de tels « droits acquis » est loin d’être évidente. Comme l’a souligné Myriam Benlolo-Carabot lors de son audition par la mission (122), la convention de Vienne ne concerne que les relations interétatiques, et la transposition de cette théorie au droit de l’Union semble difficile. Quant au droit de l’Union lui-même, il ne prévoit pas non plus de mécanisme qui protégerait explicitement les droits de ces citoyens. Cette analyse est également celle de Jean-Claude Piris, ancien directeur juridique du Conseil, qui considère qu’ » il n’y a aucune disposition dans les traités de l’Union qui pourrait être utilisée pour permettre l’existence de droits acquis » (123).
Le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment son article 8 qui garantit le respect de la vie privée et familiale et du domicile, constituera un filet de sécurité pour les citoyens expatriés au Royaume-Uni et les citoyens britanniques expatriés en France. Ainsi, selon Myriam Benlolo-Carabot « dès lors qu’on a noué une vie familiale ou une vie privée intense – notion interprétée très souplement par la Cour –, cet article peut être invoqué afin d’éviter que le pire ne se produise ». Mais le droit de la Convention, s’il protège les droits les plus fondamentaux des citoyens concernés, ne couvrira pas la multiplicité des droits qui découlaient de la citoyenneté européenne.
Il faudra donc trouver dès le début des négociations – mais en aucun cas avant – un accord protecteur et pleinement réciproque sur cette question.
La volonté de faire de ce sujet une priorité est partagée par le Royaume-Uni. Lors de son discours du 17 janvier 2017, Theresa May a d’ailleurs déclaré vouloir garantir les droits des citoyens de l’Union vivant déjà en Grande-Bretagne et les droits des citoyens britanniques dans d’autres États membres dès que possible. Le Livre Blanc publié le 2 février 2017 fait notamment de l’accès aux soins des Britanniques vivant dans l’Union une priorité.
Les dispositions adoptées en ce sens devront être parfaitement réciproques et ne pas faire l’objet de négociations bilatérales. Selon Myriam Benlolo-Carabot, lors de son audition par la mission, le Royaume-Uni « ne pourra pas choisir, comme il souhaiterait le faire, entre les États membres en signant des accords bilatéraux avec certains et pas avec d’autres, à cause des règles qui unissent les pays de l’Union européenne entre eux et qui excluent toute discrimination en la matière ».
En effet, une convention internationale conclue entre deux États membres postérieurement à l’adhésion de ces deux États doit obligatoirement être compatible avec le droit de l’Union (124). Or un accord bilatéral que le Royaume-Uni conclurait avec un État membre dans le domaine des visas et de la libre circulation serait directement contraire au principe de non-discrimination entre les citoyens européens consacré par les traités. Même après la sortie du Royaume-Uni de l’Union, la négociation par les États membres d’accords bilatéraux avec les Britanniques portant sur les droits des citoyens, et notamment sur la libre circulation et la délivrance de visas, sera strictement encadrée par le droit de l’Union.
Ce principe de non-discrimination a également été rappelé par Pierre Sellal lors de son entretien avec une délégation de la mission.
Les dispositions adoptées devront être le plus protectrices possibles de la situation de ces citoyens, afin d’éviter des situations humaines très douloureuses mais aussi les incertitudes et le risque de contentieux au moment de la sortie du Royaume-Uni.
De multiples aspects de ces « droits acquis » devront être abordés, parmi lesquels le droit au séjour, le permis de travail et la liberté d’installation, la coordination des régimes de sécurité sociale et les droits à pension et l’accès aux soins.
Le président-rapporteur considère que, d’une part, la continuité du droit au séjour devrait être garantie sans conditions aux expatriés résidant depuis plus de cinq ans dans leur pays d’accueil. D’autre part, des droits spécifiques devront être octroyés aux citoyens ne répondant pas à cette condition mais s’étant installés dans un autre État de l’Union européenne avant que ne soit établi le choix du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne. La date retenue pourrait être celle du déclenchement de la procédure de sortie et, en tout état de cause, ne saurait être antérieure au 23 juin 2016.
Une attention particulière devra être accordée au droit au séjour des étudiants européens ayant déjà commencé leurs études au Royaume-Uni, et vice-versa.
Enfin, se posera la question de la continuité de la protection sociale de ces citoyens européens.
En effet, le droit de l’Union prévoit aujourd’hui une coordination des règles de sécurité sociale, corollaire de la liberté de circulation, qui repose sur quatre règles principales :
– l’unicité de la législation applicable. Le travailleur migrant est assujetti à la sécurité sociale du pays dans lequel il exerce son activité ;
– l’égalité de traitement. Les bénéficiaires ont les mêmes droits et obligations que les ressortissants du pays où ils sont couverts ;
– le principe de totalisation des périodes. Afin de ne pas créer de « trous » dans la couverture sociale des citoyens européens du fait d’une mobilité transnationale, les périodes d’assurance, de travail ou de résidence dans d’autres pays sont prises en compte lors du calcul des prestations – en particulier pour la liquidation et le calcul des retraites ;
– le principe de l’exportation des prestations. Les citoyens européens peuvent, s’ils ont droit à des prestations en espèces dans un pays où ils ne vivent pas, toucher ces prestations dans n’importe quel pays de l’Union européenne où ils résident.
Le régime de l’assurance-maladie pour les citoyens de l’Union européenne
en France
Le régime de l’assurance maladie en France des citoyens issus d’un pays membre de l’Union européenne, et donc du Royaume-Uni, résidant en France diffère selon différentes catégories :
– les étudiants issus d’un pays membre de l’Union européenne sont considérés en séjour temporaire. Dès lors, ils sont affiliés au régime d’assurance maladie de leur pays d’origine. Pour bénéficier d’une prise en charge des soins de santé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, en Norvège, au Liechtenstein, en Islande ou en Suisse, les étudiants doivent se munir au préalable de la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM). À défaut, ils devront cotiser au régime étudiant de la sécurité sociale française ou prendre une assurance privée ;
– les citoyens de l’Union européenne travaillant en France en tant que salarié ou indépendant doivent cotiser au régime français de sécurité sociale et sont donc assurés en France. Au préalable, ils doivent néanmoins remettre à la caisse d’assurance maladie française un formulaire dit « E 104 » remis par l’organisme d’affiliation du pays d’origine. La remise de ce document leur permet de faire valoir en France les périodes d’assurance accomplies dans le pays d’origine ;
– les travailleurs détachés temporairement par leur employeur (24 mois maximum sauf dérogation) et les fonctionnaires d’un autre pays membre, continuent, quant à eux, à relever du régime de sécurité sociale du pays d’origine. Néanmoins, ils peuvent demander le remboursement des soins médicaux effectués en France s’ils remettent le document dit « S1 » à leur caisse d’assurance maladie (ce document permet l’inscription auprès de l’institution d’assurance maladie de leur lieu de résidence afin de bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie) ;
– les demandeurs d’emploi originaires d’un autre pays membre, indemnisés et autorisés à transférer leur résidence en France, restent affiliés au régime d’assurance chômage dans leur pays. Ils peuvent néanmoins se voir rembourser leurs dépenses de santé en France s’ils disposent d’une CEAM ;
– les retraités d’un autre pays membre résidant en France ont la possibilité de transférer leur droit à l’assurance maladie. À cette fin, ils doivent demander à la caisse du pays débitrice de leur pension le document dit « S1 » et l’adresser à leur caisse d’assurance maladie en France.
En ce qui concerne plus particulièrement les droits à pension, comme l’a rappelé le directeur de la sécurité sociale Thomas Fatome lors de son audition par la mission (125), « en l’absence de dispositions spécifiques sur cette question, les trimestres cotisés par les Français au Royaume-Uni ne pourraient plus être cumulés, ce qui conduirait de fait à des retraites décotées. Les cotisations chômage seraient également perdues en cas de mobilité. » En revanche, la sortie du Royaume-Uni n’aura pas d’impact sur les retraites déjà liquidées, quelle que soit la teneur des accords à venir.
Plusieurs solutions sont envisageables pour garantir la continuité des droits des citoyens expatriés en matière de droits sociaux.
Une première solution serait le retour du Royaume-Uni dans l’Association européenne de libre-échange (AELE), où ces règles de coordination s’appliquent. Pour le directeur de la sécurité sociale, « cette solution offrirait une assez large continuité pour les Britanniques, à ceci près que le Royaume-Uni ne pourrait plus peser sur la définition de ces politiques », solution écartée d’emblée par le Gouvernement britannique.
L’Union européenne pourrait également signer un accord spécifique avec le Royaume-Uni, ou détailler les modalités de coordination de la protection sociale directement dans l’accord de retrait.
En dernier recours, en l’absence d’arrangement entre l’Union et le Royaume-Uni, les pays de l’Union européenne pourraient négocier séparément des conventions bilatérales de sécurité sociale avec le Royaume-Uni. Dans ce cas, une attention particulière devra alors être portée à l’inclusion de la totalisation des périodes d’assurance en France et au Royaume-Uni dans la convention bilatérale puis, à la « trilatéralisation » de la convention avec les autres États de l’Union (afin d’écarter la règle coutumière de « non cumul des conventions » actuellement appliquée par la sécurité sociale française).
b. Les fonctionnaires européens de nationalité britannique
Le Royaume-Uni est significativement sous-représenté au sein du personnel des institutions européennes : alors que les Britanniques représentent 12,5 % de la population de l’Union, ils ne représentent que 4 % du personnel de la Commission européenne. 1 164 fonctionnaires britanniques travaillent actuellement à la Commission européenne, environ 300 au Parlement européen et 53 au Secrétariat général du Conseil.
Ces fonctionnaires ne sont pas des fonctionnaires britanniques, mais des fonctionnaires européens.
Toutefois, le statut des fonctionnaires européens prévoit que « nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il n’est ressortissant d’un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination » (article 28, point a) et que, dans le cas où il cesse de satisfaire à cette condition, le fonctionnaire peut être démis d’office (article 49). Une exception a déjà été faite à cette règle de nationalité, pour les quelques fonctionnaires norvégiens recrutés au moment du processus d’adhésion – finalement interrompu – de leur pays à l’Union.
Les fonctionnaires britanniques des institutions européennes pourraient donc être démis d’office lors du départ du Royaume-Uni de l’Union. Or comme l’a souligné Félix Gérardon, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale-Bruxelles, lors de son audition par la mission, « aucune couverture sociale (…), aucune indemnité de chômage, aucun préavis » n’est prévu pour ces fonctionnaires démis d’office (126).
Les institutions européennes, directement concernées par la situation de leur propre personnel, ont affirmé leur soutien à ces agents : le président de la Commission européenne a ainsi déclaré au lendemain du référendum que « d’après notre statut, vous êtes des « fonctionnaires de l’Union ». Vous travaillez pour l’Europe. (…) Vous pouvez être sûrs que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, comme Président de la Commission, pour vous soutenir et vous aider dans ce processus difficile. Notre statut sera lu et appliqué dans un esprit européen. »
Dans le cas de leur maintien en poste, des questions sensibles se poseraient toutefois sur l’évolution des carrières des fonctionnaires britanniques et sur l’application du principe de non-discrimination.
Pour le président-rapporteur, il conviendra de traiter cette question rapidement et d’éviter une rupture trop brutale pour ces fonctionnaires. Des instructions claires et communes à toutes les institutions et à tous les organes de l’Union européenne devraient être données. Dans le cas contraire, les seules règles du statut des fonctionnaires européens continueraient à s’appliquer, et la décision de procéder à d’éventuelles démissions d’office reviendrait à chaque institution.
La question de la participation du Royaume-Uni aux engagements financiers pris pour financer la retraite des fonctionnaires européens devra en revanche être posée (cf. supra).
2. Des possibilités d’accès partiel au marché unique qui existent déjà
Pour mener à bien le projet de « global Britain » prôné par la Première ministre britannique, le Royaume-Uni aura évidemment besoin de redéfinir ses relations commerciales avec l’Union européenne.
Dans son discours du 17 janvier 2017, Mme May a très clairement exclu d’adhérer au marché unique, tout en faisant état de son souhait de conclure avec l’Union un accord de libre-échange « large et ambitieux », permettant au Royaume-Uni de disposer à la fois d’un accès le plus grand possible au marché intérieur et d’un accord douanier – tout en garantissant l’autonomie commerciale du Royaume-Uni.
Ces demandes visent évidemment à obtenir ou conserver des avantages compétitifs tout en préservant au maximum l’existant, sans subir les contraintes liées à une inclusion dans le marché unique. Aucun pays tiers ne dispose à l’heure actuelle d’un tel statut, et pour cause : ce serait inacceptable. Toutefois, aucun pays bénéficiant d’une relation privilégiée avec l’Union européenne ne dispose d’un poids équivalent à celui du Royaume-Uni dans l’économie européenne et mondiale.
De nombreux exemples de relation commerciale privilégiée entre l’Union européenne et des pays tiers peuvent nous aider à imaginer ce que pourraient être les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, car ils sont fondés sur un équilibre des droits et des obligations. Bien sûr, compte tenu des souhaits et du poids du Royaume-Uni, cet équilibre devra être adapté et le contenu également. Toutefois, il conviendra de s’appuyer sur ces régimes déjà existants comme base de négociation et pour définir ce qui est acceptable pour l’Union.
a. Des relations commerciales déjà privilégiées entre l’Union européenne et certains pays tiers
Membre de l’UE |
EEE (modèle « norvégien ») |
Suisse |
Union douanière (Turquie) |
Accord de libre-échange avec l’Ukraine |
Accords de libre-échange avec le Canada |
Règles de l’OMC | |
Accès total au marché unique |
Oui |
Partiel |
Limité |
Limité |
Limité |
Non |
Non |
Libre circulation des biens |
Oui |
Partielle (limité pour la pêche et l’agriculture) |
Partielle (limité pour les produits agricoles) avec des accords de reconnaissance mutuelle |
Oui |
Tarifs préférentiels. Reconnais-sance mutuelle limitée |
Tarifs préférentiels. Reconnais-sance mutuelle limitée |
Non (seulement clause de la nation la plus favorisée) |
Libre circulation des services |
Oui |
Oui |
Limitée |
Non |
Limitée |
Limitée |
Non (seulement les engage-ments du GATS) |
Liberté d’établissement |
Oui |
Partielle, quelques exceptions |
Très limitée |
Non |
Limitée |
Limitée |
Non (seulement les services sous le GATS) |
Capital |
Oui |
Oui |
Non |
Non |
Limitée |
Limitée |
Non |
Personnes |
Oui |
Oui |
Oui (mais extension aux nouveaux États membres pas automatique) |
Non |
Limitée |
Limitée |
Non |
Influence dans le processus de décision communautaire |
Oui |
Limitée (consultation) |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
Adoption des acquis communautaires |
Oui |
Oui |
Limitée |
Limitée |
Limitée (domaines de la convergence règlementaire) |
Non |
Non |
Contribution au budget de l’UE |
Oui |
Oui |
Limitée |
Non |
Non |
Non |
Non |
Absence de formalités douanières absence d’autonomie de la politique commerciale |
Oui |
Non |
Non |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Sujet à l’examen de la CJUE |
Oui |
2 piliers : CJUE et cour de l’AELE Autorité de surveillance de l’AELE |
Non |
Non |
Limité (domaines de la convergence règlementaire) |
Non |
Non |
Source : Tableau réalisé à partir des données de la Commission européenne.
La possibilité pour le Royaume-Uni de quitter l’Union européenne tout en intégrant l’EEE a rapidement été écartée par le Gouvernement britannique.
Rejoindre l’EEE donnerait pourtant au Royaume-Uni un accès extrêmement large au marché unique, en lui permettant de continuer à jouir des quatre libertés. Intégrer l’EEE lui permettrait notamment de continuer à échanger avec les États membres de l’Union sans acquitter de droits de douane (sauf pour certains produits agricoles et de la pêche) et d’avoir accès au « passeport européen » pour les services financiers.
Le choix de cette option permettrait d’éviter des négociations complexes, même si, pour pouvoir adhérer à l’EEE, le Royaume-Uni devrait d’abord adhérer à l’Association européenne de libre-échange et donc recueillir l’unanimité des membres de l’association, avant que sa candidature soit approuvée par les membres de l’EEE. La Norvège a d’ailleurs fait part de ses réticences sur une telle adhésion, qui bouleverserait l’équilibre actuel de l’EEE.
L’Espace économique européen (EEE) et
l’Association européenne de libre-échange (AELE)
L’AELE, créée en 1960, est une organisation intergouvernementale qui vise à promouvoir le libre-échange et l’intégration économique au profit de ses quatre États membres que sont l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le Royaume-Uni était un membre fondateur de l’AELE, qu’il a quittée au moment de rejoindre l’Union.
Depuis 1994, tous les États de l’AELE, sauf la Suisse qui a rejeté l’adhésion par votation populaire, appartiennent également à l’Espace économique européen formé avec l’Union européenne.
Depuis l’adhésion de l’Islande, du Lichtenstein et de la Norvège à l’EEE, et avec le développement des accords entre l’Union et la Suisse, l’AELE est aujourd’hui une « coquille vide », pour reprendre l’expression de Jean-Claude Piris.
En intégrant l’EEE, le Royaume-Uni devrait notamment :
– accepter les quatre libertés, dont la liberté de circulation ;
– reconnaître les compétences conférées à l’Autorité de surveillance de l’AELE et à la Cour de Justice de l’AELE ;
– contribuer au budget de l’Union (selon Open Europe, la contribution norvégienne par habitant au budget de l’Union équivaut à 88 % de la contribution britannique par habitant) (127) ;
– intégrer dans sa législation toutes les nouvelles dispositions juridiques de l’Union affectant le marché intérieur – la Norvège a ainsi intégré trois quarts de la législation européenne (128) – sans pouvoir participer directement à leur définition ;
– intégrer l’acquis communautaire ou une partie de celui-ci dans d’autres domaines (concurrence et aides d’État, protection des consommateurs, environnement, politique sociale, entre autres).
En l’absence d’adhésion du Royaume-Uni à l’EEE, plusieurs autres options peuvent servir de modèle lors de la négociation des futures relations commerciales de l’Union européenne avec le Royaume-Uni.
En dehors de l’EEE, la Suisse est aujourd’hui le pays tiers avec lequel l’Union européenne entretient la relation économique la plus complète. En plus de l’accord de libre-échange signé en 1972, la Confédération a conclu avec l’Union, à la suite de son refus d’intégrer l’EEE, un ensemble d’accords sectoriels signés en 1999 (129), puis une autre série d’accords en 2004 (130). Plus d’une centaine d’accords nous lient aujourd’hui.
Ces accords permettent un large accès de la Suisse au marché intérieur, grâce notamment :
– à la reconnaissance mutuelle des normes pour les produits ;
– à l’ouverture des marchés dans certains secteurs clés : appels d’offres publics, transport aérien et terrestre.
Aujourd’hui, à l’exception de certains produits agricoles, les biens circulent entre la Suisse et l’Union en franchise de douane, et avec des barrières non tarifaires réduites.
En revanche, les services ne sont que partiellement couverts par ces accords. C’est notamment le cas des services financiers, pour lesquels seul un accord relatif à l’assurance-vie a été conclu.
La Suisse contribue également au budget européen : selon Jean-Claude Piris, sa contribution par habitant équivaut actuellement à 55 % de la contribution nette par habitant du Royaume Uni.
Ni les États de l’EEE ni la Suisse ne font en revanche partie de l’Union douanière, et des formalités douanières perdurent donc avec ces États.
Dans son discours de Lancaster House, Mme May a plaidé pour la conclusion d’un « accord douanier » avec l’Union, en précisant que cet accord pourrait signifier « un accord douanier complètement nouveau », « devenir un membre associé de l’union douanière » ou bien « de rester signataire de quelques-uns de ses éléments ». Elle a toutefois exclu que le Royaume-Uni reste lié au tarif douanier commun, qui constitue le volet externe de cette Union douanière.
Il est tout à fait envisageable qu’un pays non membre de l’Union européenne fasse partie de l’union douanière. Ainsi, depuis 1995, la Turquie forme avec l’Union européenne une union douanière pour les biens et les produits agricoles transformés (les services ne sont pas concernés).
La participation à cette union douanière limite en revanche considérablement l’autonomie de la politique commerciale turque. En effet, la Turquie est contrainte d’aligner ses droits de douane vis-à-vis des pays tiers sur ceux appliqués par l’Union européenne : tout accord commercial conclu par l’Union avec des pays tiers, s’il prévoit une réduction des droits de douane, s’impose à la Turquie. À l’inverse, la Turquie ne bénéficie pas des accords commerciaux négociés par l’Union et doit négocier ses propres accords bilatéraux.
La Première ministre britannique a indiqué vouloir un « accord de libre-échange nouveau, complet, audacieux et ambitieux » avec l’Union européenne.
Les accords commerciaux de « nouvelle génération » aujourd’hui négociés par l’Union européenne prouvent qu’un tel accord pourrait couvrir des pans très importants de nos échanges, et aller bien au-delà de la seule réduction des barrières tarifaires.
À titre d’exemple, l’accord d’association paraphé en 2012 avec l’Ukraine contient à la fois un volet politique et une intégration économique avec l’Union européenne, notamment via un « accord de libre-échange complet et approfondi » (ALECA) qui prévoit :
– une libéralisation de la quasi-totalité des échanges – avec pour objectif une réduction d’environ 99 % des droits de douane imposés sur les produits industriels échangés ;
– la reprise par l’Ukraine d’une partie significative de l’acquis européen.
L’accord ne traite donc pas que de tarifs douaniers, mais couvre toutes les autres questions liées au commerce, comme les procédures douanières, les obstacles dits « techniques » au commerce (notamment les normes techniques et les évaluations de conformité à ces normes), les règles sanitaires et phytosanitaires, la liberté d’établissement des entreprises et de prestation de services, les paiements et la circulation des capitaux, la réglementation des marchés publics, le droit de la concurrence ou l’amélioration de la protection de la propriété intellectuelle.
Contrairement à l’EEE et aux accords avec la Suisse, cet accord concerne une grande partie des produits agricoles.
L’accord conclu avec le Canada pourrait également servir de référence. Le Canada a en effet conclu, en septembre 2014, un accord de libre-échange avec l’Union européenne – dit accord économique et commercial global – qui devrait être ratifié au cours de l’année 2017.
Cet accord couvre une grande part de nos échanges : ainsi, 92 % des produits agricoles et alimentaires pourront être exportés librement. Certains produits sensibles seront en revanche soumis à des quotas au-delà desquels les droits de douane seront maintenus.
Bien au-delà de la seule réduction des tarifs douaniers, il prévoit également l’ouverture des marchés publics, la protection d’indications géographiques et une harmonisation des règles de la propriété intellectuelle. L’ouverture des marchés est également prévue pour certains services, comme les télécommunications, l’énergie ou encore le transport maritime.
Si l’on s’appuie sur les deux exemples précédents, on peut toutefois penser que des difficultés pourraient émerger au moment de la ratification d’un tel accord :
– dans le cas de l’accord avec l’Ukraine : aux Pays-Bas, après un vote parlementaire favorable à la ratification, un référendum d’initiative citoyenne a été organisé le 6 avril 2016. Après une campagne moins centrée sur l’Ukraine que sur la construction européenne, le « non » l’a emporté à près de 62 %. Pour ratifier l’accord, les Pays-Bas doivent désormais obtenir un nouveau vote parlementaire ;
– dans le cas de l’accord avec le Canada : le Gouvernement de la région belge de Wallonie, s’appuyant sur une résolution adoptée par son Parlement le 27 avril 2016, a refusé de donner les pleins pouvoirs au ministre fédéral du commerce afin qu’il puisse valablement autoriser la signature de l’accord, empêchant ainsi l’unanimité au Conseil. Après des mois d’intense activité diplomatique entre Bruxelles, Namur et Ottawa, un compromis a été trouvé le 27 octobre 2016 entre les différentes entités belges et le Gouvernement fédéral.
Accord avec… |
Durée des négociations |
Corée |
4 ans |
Pérou, Colombie et Équateur |
5 ans |
Mexique |
4 ans |
Australie |
3 ans |
Canada |
5 ans |
En l’absence de tout accord, les relations commerciales avec le Royaume-Uni pourraient être définies par les seules règles de l’OMC. Cela constituerait évidemment une solution par défaut, qui impliquerait que le Royaume-Uni renégocie l’ensemble de ses engagements au sein de l’OMC. Comme l’a souligné le directeur général de l’Organisation, ces engagements ne pourraient évidemment pas être un simple « copier-coller » de ce dont bénéficie le Royaume-Uni en tant que membre de l’Union (131).
Dans ce cas, les exportations britanniques vers les États membres – et inversement – feraient l’objet de droits de douane, la seule condition étant que ces droits de douane soient « aussi avantageux » que ceux pratiqués vis-à-vis du pays tiers ayant la situation la plus favorable (clause dite de « la nation la plus favorisée »). L’Union européenne ne pourrait donc pas offrir au Royaume-Uni des tarifs douaniers plus faibles que ce qu’elle offre déjà aux autres membres de l’OMC, et vice-versa. La libéralisation des échanges de services, définie par l’accord dit « GATS » (accord général sur le commerce des services) resterait relativement limitée.
MOYENNE DES DROITS APPLIQUÉS PAR L’UNION EN VERTU DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
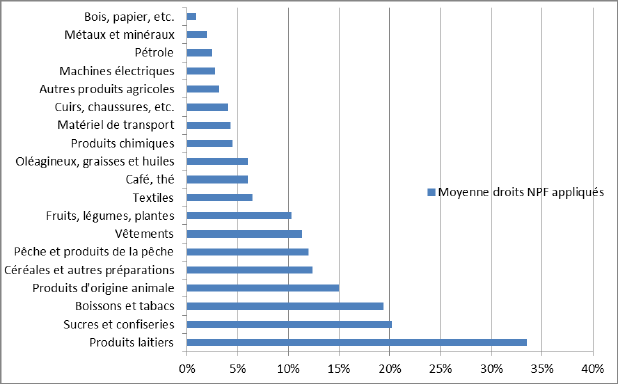
Source : OMC, Profils tarifaires dans le monde 2016.
b. Des mécanismes juridiques déjà existants
Aucun des « modèles » précédents ne devrait s’appliquer tel quel au Royaume-Uni : aucun ne répond aux grandes lignes exprimées à Londres et notre proximité géographique, l’interconnexion de nos marchés et l’uniformité de nos législations au moment du Brexit nous conduiront à innover.
Toutefois, l’intérêt de ces différents « modèles » est de nous permettre d’identifier des instruments juridiques déjà existants qui pourront être utilisés pour définir cette relation commerciale nouvelle, car ils ont été construits de telle sorte à être compatibles avec l’ordre juridique européen et respectueux des intérêts de l’Union européenne.
De nombreux mécanismes pourraient ainsi faciliter le plus possible les relations commerciales entre le Royaume-Uni et le continent. L’accord relatif à l’EEE est innovant de ce point de vue, puisqu’il présente la particularité d’être mis à jour continuellement, par l’incorporation des nouveaux actes de l’Union européenne.
Sans forcément aller aussi loin, le futur accord commercial avec le Royaume-Uni pourrait par exemple inclure des mécanismes de « reconnaissance mutuelle ». L’Union européenne a en effet conclu à de multiples reprises des accords ne portant pas directement sur une homogénéisation des normes applicables aux produits mis sur le marché, mais sur la reconnaissance de leur certification : ces accords prévoient que les produits d’un certain nombre de secteurs peuvent être certifiés par des organismes d’évaluation de la conformité reconnus dans l’Union européenne et être introduits sur le marché d’un pays tiers sans devoir y subir d’autres procédures d’homologation, et inversement.
Actuellement, il n’existe toutefois pas d’accord de reconnaissance mutuelle « général » avec un État tiers : chaque accord vise spécifiquement une liste de produits concernés.
Dans certains domaines, le droit de l’Union prévoit également – dans certains accords internationaux ou dans le droit dérivé – la possibilité pour la Commission européenne de prendre des « décisions d’équivalence » à l’égard de pays tiers. En prenant de telles décisions, la Commission reconnaît qu’un niveau de protection analogue existe entre la réglementation de ce pays tiers et celle de l’Union dans certains domaines (par exemple, la protection des données personnelles).
De telles décisions d’équivalence existent notamment dans le domaine financier, et pourraient servir de base à la réflexion sur l’avenir de la place de Londres.
Ainsi, certaines directives relatives à la régulation financière prévoient d’ores et déjà un régime de « pays tiers » permettant aux institutions financières implantées et autorisées hors de l’EEE d’obtenir ce passeport financier, si les régulations financières britanniques sont reconnues comme « équivalentes » à celles de l’Union.
Toutefois, comme l’ont souligné le Gouverneur de la Banque de France, la directrice du Trésor et le président de l’Autorité des marchés financiers, auditionnés par la mission :
– ces régimes sont aujourd’hui très hétérogènes ;
– ils n’ont pas du tout été imaginés pour un acteur de la taille du Royaume-Uni ;
– ils concernent surtout le domaine des marchés et ne couvrent ni les activités de crédit ni celles d’assurance.
Surtout, ces régimes d’équivalence, en matière financière notamment, ne prévoient aucun régime de suivi ou de contrôle. Or la question qui se posera est principalement celle du suivi de l’évolution dans le temps de la législation britannique. Il est évident qu’au moment même de la sortie du Royaume-Uni de l’Union, nos réglementations seront équivalentes. Mais comment s’assurer qu’elles le resteront ? Pour éviter tout dumping réglementaire, mais aussi pour protéger les consommateurs européens, des mécanismes de suivi et de surveillance efficaces devront être mis en place si l’on décidait de recourir à ce type de dispositif. Dans son Livre Blanc du 2 février 2017, le Gouvernement britannique lui-même a souligné que des mécanismes de règlements des différends devraient être mis en place dans le cadre de la future relation entre l’Union et le Royaume-Uni.
À ce titre, l’exemple de l’évolution récente des relations entre l’Union européenne et la Suisse est éclairant.
En effet, l’Union européenne considère aujourd’hui que la multiplication d’accords sectoriels a atteint ses limites, et ne garantit pas une interprétation et une application homogènes des règles du marché intérieur. Depuis 2014, des négociations sont donc en cours en vue d’un accord rénovant le cadre institutionnel de ces relations. L’objectif poursuivi par l’Union est d’assurer l’homogénéité juridique dans les aspects du marché intérieur auxquels la Suisse participe, par l’adaptation permanente de ces accords à l’évolution de l’acquis communautaire et par l’interprétation et l’application uniforme de ces accords (en conférant un rôle de surveillance à la Commission européenne et de contrôle à la CJUE dans les secteurs concernés par les accords).
Si l’Union devait in fine conclure un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, il conviendrait donc de tirer les leçons des limites du « modèle suisse ». Une solution envisageable pourrait, par exemple, consister dans la mise en place d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de Justice ad hoc, inspirées de ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de l’AELE (132).
3. La poursuite d’une coopération étroite pour la protection des Européens
Le Royaume-Uni est aujourd’hui un pilier de l’Union et un allié majeur de la France pour assurer la sécurité des citoyens européens. N’oublions pas que c’est, avec la France, le seul État membre de l’Union disposant d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, le seul doté de l’arme nucléaire et le seul à fournir un effort de défense à la hauteur de nos ambitions stratégiques (légèrement au-dessus de 2 % du PIB pour les Britanniques ; 1,81 % pour la France).
Dans un contexte où des menaces graves pèsent sur la sécurité de notre continent, il est dans l’intérêt de tous qu’il reste un partenaire privilégié de l’Union européenne et de la France dans ce domaine, quelles que soient les modalités de sa sortie.
Nous devrons donc trouver les moyens d’une coopération intense sur les sujets de sécurité intérieure et extérieure, à la fois entre le Royaume-Uni et l’Union et dans nos relations bilatérales. Cette volonté de continuer à œuvrer ensemble dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité est pleinement partagée par le Gouvernement britannique, comme l’a rappelé Theresa May, affirmant que le « global Britain » qu’elle appelle de ses vœux « continuera à coopérer avec ses partenaires européens dans des domaines importants tels que le crime, le terrorisme et les affaires étrangères ».
Pour le président-rapporteur, la sortie du Royaume-Uni de l’Union ne devra pas pour autant empêcher les vingt-sept autres États membres d’avancer vers une Europe de la sécurité, bien au contraire : la sortie du Royaume-Uni de l’Union ne fera que rendre ce besoin plus criant. Dans la continuité de la déclaration de Bratislava, il est plus urgent que jamais d’approfondir notre coopération policière et en matière de renseignement, de créer un parquet européen, de se doter d’une véritable défense européenne et d’affirmer la place de l’Europe sur la scène internationale.
a. Pour préserver notre sécurité intérieure, une association la plus complète possible du Royaume-Uni à la coopération policière et judiciaire européenne
La coopération judiciaire et policière est l’un des exemples les plus éclatants de l’attitude ambiguë du Royaume-Uni vis-à-vis de l’Union européenne, « un pied dedans, un pied dehors ».
Le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l’espace Schengen, bénéficie en effet d’un « opt-out » global sur toutes les mesures de l’ancien « troisième pilier » relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sauf pour trente-cinq mesures pour lesquelles le Royaume-Uni a demandé un « opt-back in ». Parmi ces trente-cinq mesures, on trouve notamment Europol, Eurojust, les équipes communes d’enquête, le mandat d’arrêt européen, la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation et des peines d’emprisonnement, les échanges d’informations issues du casier judiciaire, certaines dispositions de la Convention de Schengen et le Système d’information Schengen rénové.
Sans accord sur le sujet, une fois sortis de l’Union, les Britanniques ne pourront plus participer à ces instruments, au sein desquels ils occupent parfois une place importante.
« Opt-in » et « opt-out » du Royaume-Uni dans l’espace de liberté,
de sécurité et de justice
Lors de l’adoption du traité d’Amsterdam en 1997, certains domaines du « troisième pilier » (les politiques liées aux visas, à l’asile, à l’immigration et toutes celles en lien avec la libre circulation), ont été intégrés au premier pilier communautaire. En conséquence, la règle de la majorité qualifiée au Conseil est devenue le principe et les États ont été privés de leur droit de veto. Dans le même temps, « l’acquis de Schengen », c’est-à-dire les accords de Schengen et la convention d’application de 1990, a été intégré dans le cadre de l’Union européenne (protocole no 2 intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne de 1997).
En réaction à la possibilité de se voir imposer des décisions, le Royaume-Uni a alors demandé puis obtenu un statut spécial dans ce domaine, lui conférant à la fois un droit d’ » opt-out » pour les sujets du troisième pilier transférés au premier pilier, et un droit d’ » opt-in » pour les mesures de l’acquis de Schengen.
Le traité de Lisbonne a maintenu et renforcé les dérogations dont disposait déjà le Royaume-Uni dans le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. En effet, le protocole no 21 du traité de Lisbonne sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice étend à l’ensemble de cet espace la dérogation dont ces deux pays bénéficient, y incluant donc désormais la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Dans ce cadre, le protocole no 36 du traité de Lisbonne prévoyait que le Royaume-Uni pouvait notifier au Conseil jusqu’au 1er juin 2014 sa sortie globale (« block opt-out ») des mesures de l’ancien troisième pilier, ce qu’il a fait en juillet 2013.
Cette faculté est accompagnée (art. 10 par. 5 du protocole no 36) d’une possibilité pour le Royaume-Uni de notifier « à tout moment par la suite » son intention de rejoindre certaines de ces mesures (« opt-back-in »). C’est ce qu’a fait le Royaume-Uni en décembre 2014, en rejoignant trente-cinq mesures, dont six relevant de l’acquis Schengen.
Il convient notamment de souligner que le Royaume-Uni n’a pas été admis à participer à Frontex, au motif que l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures constitue un développement de dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles il ne participe pas. En matière d’asile, le Royaume-Uni a opté pour l’application de la convention de Dublin sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile et du règlement Eurodac (système de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile).
Pour le président-rapporteur, il conviendra de s’interroger au cas par cas sur l’association du Royaume-Uni à ces différentes mesures, en privilégiant une approche ouverte. Des mécanismes d’association sont déjà prévus par certains dispositifs : il conviendra d’en tirer parti au maximum. Pour d’autres instruments, en revanche, la participation d’un État non membre de l’Union ni même de l’espace Schengen semble impensable.
L’une des principales questions qui devra être réglée sera celle de la participation britannique à Europol, l’Office européen de police, qui appuie les autorités nationales dans la lutte contre la criminalité internationale et le terrorisme. Le Royaume-Uni joue aujourd’hui un rôle majeur au sein de cette agence – dont le directeur est d’ailleurs britannique –, et il est notamment l’un des États membres fournissant la plus grande quantité d’informations à sa base de données.
En annonçant en novembre 2016 leur volonté d’ » opt-in » au nouveau règlement Europol, les Britanniques ont montré, après le référendum, leur volonté de continuer à contribuer à la coopération policière européenne : en cas d’absence d’ » opt-in », le Royaume-Uni aurait en effet cessé d’appartenir à Europol dès l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement en mai 2017. Mais dès sa sortie de l’Union, le Royaume-Uni devra quitter l’agence, qui pourrait dans le même temps perdre toutes les données fournies par les Britanniques.
Il est en effet difficilement envisageable qu’une fois sorti de l’Union, le Royaume-Uni reste membre d’une agence de l’Union supervisée par les institutions européennes et soumise au contrôle juridictionnel de la Cour de Justice.
Deux types d’accords existent aujourd’hui entre Europol et des pays tiers :
– des accords dits « stratégiques », signés avec la Russie, la Turquie, l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine. Ces accords permettent des actions de coopération, mais excluent tout échange de données personnelles ;
– des accords dits « opérationnels », signés notamment (133) avec les États-Unis, le Canada, la Suisse ou la Norvège. Ces accords permettent l’échange de données personnelles, mais ils ne permettent pas aux États tiers d’accéder à la base de données d’Europol.
Une attention particulière devra être portée à l’évolution de la situation du Danemark au sein d’Europol. En effet, tirant les conséquences du « non » danois au référendum du 3 décembre 2015 sur l’ » opt-out » dont le pays dispose pour l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le Danemark n’a pas souhaité être lié par le règlement de 2016 relatif à Europol, qui entrera en application le 1er mai 2017. Les États membres et le Parlement européen doivent donc se prononcer dans les mois à venir sur l’inclusion du Danemark à la liste des pays tiers et organisations avec lesquels Europol peut conclure des accords.
Après l’entrée en vigueur du nouveau règlement Europol, un tel accord de coopération avec le Royaume-Uni devrait être négocié exactement comme n’importe quel autre accord entre l’Union et un État tiers, sur la base de l’article 218 du TFUE. Pour pouvoir conclure un tel accord, le Royaume-Uni devra notamment prouver qu’il garantit un niveau suffisant de protection des données personnelles.
Dans une moindre mesure, le Brexit aura une incidence sur d’autres instruments de notre coopération policière :
– le Système d’information Schengen (SIS II) facilite l’échange d’informations entre les autorités nationales chargées des contrôles aux frontières, les autorités douanières et la police, et contient notamment des signalements se rapportant à des personnes portées disparues ainsi que des informations sur certains biens (véhicules ou papiers d’identité volés par exemple). Aucun accord avec des pays tiers n’est actuellement prévu. La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein en font partie… mais tous sont membres de l’espace Schengen. C’est une base de données importante, mais le Royaume-Uni n’y est relié que depuis avril 2015, et n’a pas accès aux données relatives aux étrangers signalés aux fins de non admission dans le territoire Schengen. Il n’en est que le 7e contributeur, mais la consulte régulièrement (4e place) ;
– le PNR européen permettra l’utilisation des données des dossiers des passagers aériens à des fins répressives, grâce à une directive européenne adoptée en 2016, après plus de dix ans de négociations. La directive laisse la possibilité de transférer des données à des autorités de pays tiers, au cas par cas et pour des besoins opérationnels. Le Royaume-Uni, qui dispose d’un système d’exploitation des données PNR depuis 2008, pourrait conclure un accord avec l’Union, comme il en existe déjà avec le Canada, l’Australie et les États-Unis ;
– le traité de Prüm facilite la coopération transfrontalière en matière de police, et régit notamment l’échange de données ADN, d’empreintes digitales et d’immatriculation des véhicules. Le Royaume-Uni n’a intégré ce mécanisme qu’en mai 2016, et son maintien pourrait être facilité par la nature de cet instrument, initialement créé en dehors du cadre communautaire.
Comme l’a rappelé le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux lors de son audition par la mission (134), les échanges d’informations resteront naturellement possibles dans le cadre d’Interpol. Le Brexit n’affectera pas non plus les conditions de notre coopération policière bilatérale.
Les accords du Touquet
Les accords du Touquet du 4 février 2003 constituent le fondement de la coopération franco-britannique en matière de lutte contre l’immigration clandestine. Ils permettent la création de bureaux de contrôles nationaux juxtaposés dans des zones de contrôle des ports maritimes français et britanniques de la Manche et de la Mer du Nord, dispositif similaire à celui des contrôles aux terminaux français et britanniques du tunnel sous la Manche, créé par le protocole de Sangatte du 25 novembre 1991. Par cet accord, chaque État autorise ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État, et, au sein de la zone de contrôle délimitée sur le territoire de l’État de départ, la réglementation de l’État d’arrivée est applicable de la même façon que sur son propre territoire.
Le traité fixe également le partage du traitement des demandes d’asile entre l’État de départ et l’État d’arrivée au moment du départ du navire. Il prévoit explicitement que si la demande d’asile est formulée après les contrôles mais avant le départ du navire, son traitement relèvera de l’état de départ, concrètement de la France pour les demandes exprimées dans le port de Calais.
L’article 25 de ce traité prévoit un préavis de deux ans en cas de dénonciation.
Dans le nouveau contexte de crise migratoire en Europe, les gouvernements français et britanniques ont renforcé cette coopération (feuille de route définie par la déclaration des deux ministres de l’Intérieur du 20 août 2015). Cette coopération se traduit notamment par l’aide financière apportée par le Royaume-Uni pour la sécurisation du port du Calais et du tunnel transmanche (100 millions d’euros engagés).
Suite au référendum britannique, le Président de la République comme le ministre de l’intérieur ont souligné que le Brexit n’entraînera aucune modification de la frontière entre les deux pays, « puisque le Royaume-Uni était et demeure une frontière extérieure de Schengen », et que le traité du Touquet n’est aujourd’hui « en rien remis en cause par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ».
Le 30 août 2016, dans une nouvelle déclaration conjointe, les ministres de l’Intérieur de nos deux pays ont réaffirmé « leur engagement à coopérer encore plus étroitement en matière de lutte antiterroriste, de sécurité et de migration », et leur engagement à « collaborer de manière étroite pour renforcer la sécurité de notre frontière commune, afin de réduire substantiellement la pression migratoire à Calais ». Dans cette déclaration, le Royaume-Uni s’engageait notamment à « accepter l’entrée d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile sur le territoire britannique dans les cas où ceci est dans leur intérêt, conformément au règlement Dublin III ».
Le Royaume Uni s’était en effet engagé à accepter sur son territoire les mineurs isolés ayant un lien de parenté dans le pays et ceux « en situation de vulnérabilité dont l’intérêt supérieur serait de rejoindre le pays » (amendement dit « Dubs », du nom du député travailliste Alf Dubs, à l’ » Immigration Act » de mai 2016). À ce jour, le Royaume-Uni a recueilli plus de 750 mineurs isolés ayant des liens familiaux avérés sur son sol, d’après Lord Llewellyn, Ambassadeur du Royaume-Uni en France, lors de son audition par la mission (135). Malgré cela, il reste aujourd’hui plus de 1 200 mineurs isolés dans les centres dédiés en France. En décembre 2016, le Gouvernement britannique a annoncé que les autres demandes étaient rejetées (« les jeunes restants sont en sécurité, aux bons soins des autorités françaises »). Le Royaume-Uni a finalement accepté de réexaminer au cas par cas les situations de ceux qui ont indiqué contester les décisions de refus. Lors de son audition par la mission d’information, le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a indiqué que le dialogue franco-britannique sur cette question se poursuivait afin de s’assurer que les engagements britanniques seraient respectés.
En ce qui concerne la coopération judiciaire, l’autre pilier de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, c’est avant tout la fin du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice qui bouleversera nos relations avec le Royaume-Uni. Ce principe fondamental, affirmé par le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, avant d’être consacré par le traité de Lisbonne (article 81 TFUE en matière civile ; article 82 TFUE en matière pénale) est la pierre angulaire de l’Europe de la justice. Il repose sur un très haut degré de confiance réciproque et de loyauté, et implique que toute décision judiciaire, tant civile que pénale, prise par les autorités d'un État membre soit exécutée par les autorités d'un autre État membre comme si elle avait été rendue par ce dernier.
La réalisation la plus importante de ce principe de reconnaissance mutuelle a été l’adoption, le 13 juin 2002, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen. Entré en vigueur en 2004, le mandat d’arrêt européen a fait disparaître entre les États membres de l'Union la procédure traditionnelle d'extradition au profit d'un mandat d'arrêt directement transmis d'autorité judiciaire à autorité judiciaire : comme l’a souligné Frédéric Baab, membre national d’Eurojust pour la France, lors de son audition par la mission (136), en passant d’une « demande » à une « décision », il a permis une « révolution copernicienne » dans le domaine de l’extradition.
Une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union, la justice britannique n’aura donc plus accès au mandat d’arrêt européen, dont l’efficacité est manifeste, malgré les difficultés liées à une transposition restrictive de la décision cadre par le Royaume Uni (avec l’introduction en 2014 d’un « test de proportionnalité » (137), et une jurisprudence également peu favorable à la mise en œuvre des mandats d’arrêt aux fins de poursuite. Depuis l’entrée en vigueur du mandat d’arrêt européen en 2004, 8 000 individus ont été extradés par le Royaume-Uni vers un autre État membre (138).
Pourtant, dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, le mandat d’arrêt européen semble irremplaçable, en raison notamment de l’obligation qu’il fait aux États membres d’extrader même leurs propres nationaux – révolution directement liée à l’émergence de la citoyenneté européenne –, mais aussi des délais raccourcis de mise à exécution qu’il offre. La décision cadre de 2002 prévoit ainsi que la décision d'exécution du mandat doit être prise dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, éventuellement prolongée de trente jours. N’oublions pas que l’extradition de Rachid Ramda, le cerveau des attentats commis au cours de l’été 1995 à Paris, n’a été accordée par la Grande-Bretagne à la France qu’après dix ans de procédure… À l’inverse, Osman Hussain, l’un des auteurs de la tentative d’attentat du 21 juillet 2005 dans le métro londonien, a été extradé depuis l’Italie en moins de deux mois.
D’autres instruments de reconnaissance mutuelle, moins connus, permettent la saisie ou le gel d’avoirs bancaires ou leur confiscation ou même l’obtention de preuves (décision d’enquête européenne).
Frédéric Baab, membre national d’Eurojust, a considéré lors de son audition par la mission qu’il serait extrêmement problématique d’accorder l’accès aux Britanniques à ces instruments de reconnaissance mutuelle, rappelant que cette reconnaissance mutuelle nécessite un niveau de confiance qui ne peut exister qu’au sein de l’espace judiciaire européen, « puisque les autorités judiciaires doivent exécuter quasiment les yeux fermés la décision qu’elles reçoivent », et que par ailleurs, « des missions d’évaluation mutuelle sont régulièrement réalisées par des magistrats et des fonctionnaires de la Commission européenne qui vont mesurer dans chaque État membre la manière dont les instruments en question ont été transposés en droit interne et sont appliqués par les autorités judiciaires ».
Le retour à l’application de la Convention européenne d’extradition de 1957, adoptée par le Conseil de l’Europe, serait loin d’être satisfaisant, et rallongerait considérablement les délais de ces extraditions. Pour le président-rapporteur, il serait donc souhaitable d’envisager un accord d’extradition spécifique entre l’Union et le Royaume-Uni (139).
De même, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), c’est-à-dire l’interconnexion électronique des casiers judiciaires au niveau européen, permet de connaître les antécédents judiciaires d’un ressortissant européen dans un délai de dix à vingt jours. C’est un dispositif propre à l’Union européenne, auquel le Royaume-Uni ne pourra probablement plus avoir accès. Notre coopération en la matière devra donc s’appuyer sur la Convention du Conseil de l’Europe de 1959 d’entraide judiciaire en matière pénale, qui permet des échanges beaucoup moins efficaces et rapides.
En revanche, notre collaboration étroite pourra continuer au sein de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale Eurojust, qui apporte aujourd’hui un soutien primordial à la coopération entre les autorités judiciaires nationales dans le cadre d’enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant plusieurs États de l’Union ou exigeant une poursuite sur des bases communes.
En effet, la possibilité de disposer d’un « procureur de liaison » pourra être offerte au Royaume-Uni, s’inspirant de ce qui existe déjà avec la Suisse, la Norvège et les États-Unis.
La décision Eurojust de 2008 – dont une révision est en cours de négociation – prévoit en effet qu’Eurojust peut conclure des accords avec des États tiers qui peuvent porter, en particulier, sur l’échange d’informations, y compris de données personnelles, et sur le détachement d’officiers ou de magistrats de liaison auprès d’Eurojust.
En pratique, Frédéric Baab, lors de son audition par la mission, a estimé que « ces procureurs de liaison ont à peu près les mêmes capacités d’action que les membres nationaux : ils peuvent ouvrir un dossier, organiser des réunions de coordination et les présider, et participer à une équipe commune d’enquête. La Suisse ayant ratifié le deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire de 1959, le procureur de liaison suisse ne se distingue presque pas, sur le plan opérationnel, d’un membre national. La seule différence avec les membres nationaux est que les procureurs de liaison ne participent pas aux réunions du Collège d’Eurojust, c’est-à-dire à la gouvernance de l’organisation. ».
Le Royaume-Uni, en vertu de son « opt-out », n’avait pas souhaité participer au projet de parquet européen qui doit être institué à partir d’Eurojust, et dont la mise en œuvre constituera un pas en avant considérable pour la coopération judiciaire européenne, puisque l’action publique pourrait désormais être, dans certains cas, enclenchée au niveau européen.
En tout état de cause, dans le contexte du Brexit, le président-rapporteur estime que notre coopération bilatérale en matière de coopération judiciaire et policière, déjà importante, devra être renforcée.
b. Un allié précieux de l’Union européenne et de la France sur la scène internationale
La sortie du Royaume-Uni conduira à son exclusion de la définition de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, qui était pourtant l’un des vecteurs principaux, au cours des dernières années, de l’expression de sa politique étrangère (sanctions contre la Russie, négociations sur le nucléaire iranien, lutte contre le changement climatique…).
En dehors de ce cadre institutionnel, l’Union européenne a toutefois un intérêt majeur à continuer à coopérer étroitement avec le Royaume-Uni en matière de politique étrangère.
C’est aussi l’intérêt de la France. Au sein de l’Union, les Britanniques sont aujourd’hui ceux qui partagent le plus notre approche des enjeux stratégiques et nos intérêts diplomatiques, sans oublier que nous sommes les deux seuls pays européens à disposer d’un siège au Conseil de sécurité des Nations-Unies et à être dotés de l’arme nucléaire. Disposant d’outils diplomatiques – en premier lieu le réseau remarquable qu’est le Foreign Office – et militaires analogues, le Royaume-Uni reste notre partenaire européen le plus volontaire pour s’engager à nos côtés sur la scène internationale et un allié stratégique pour la conduite de notre diplomatie générale. Son départ ne fera qu’accentuer le rôle déjà majeur de notre pays, mais aussi sa responsabilité, dans la conduite de la politique étrangère de l’Europe et dans la défense de notre continent.
Nos deux pays sont aujourd’hui engagés ensemble dans de nombreux grands dossiers internationaux, qu’il s’agisse des crises ou des enjeux globaux.
Le Royaume-Uni est tout d’abord l’un de nos partenaires majeurs dans la lutte contre le terrorisme : nous sommes, après les États-Unis, les deux pays les plus actifs au sein de la coalition de lutte contre Daech, et les forces britanniques participent, au côté des forces françaises, aux frappes aériennes contre Daech en Irak et en Syrie. Suite à l’invocation de l’article 42.7 du traité sur l’Union européenne (clause d’assistance en cas d’agression armée) par la France en novembre et en juillet dernier, le Royaume-Uni s’est notamment engagé à soutenir davantage l’armée nigériane dans sa lutte contre Boko Haram.
C’est également notre partenaire privilégié dans le dossier syrien, au sujet duquel nos deux pays partagent une vision analogue tant sur le diagnostic que sur les solutions à y apporter. En Afrique, Londres est le premier de nos partenaires à avoir fourni une assistance logistique lors de l’opération Serval au Mali, et le seul allié européen à nous fournir un appui à la fois en transports et en renseignements. En République centrafricaine, le Royaume-Uni a également soutenu le lancement de l’opération Sangaris par une aide de transport logistique et une aide humanitaire majeure.
Enfin, le Royaume-Uni, engagé depuis longtemps dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, est un soutien important de l’Union européenne et de la France dans la lutte contre le changement climatique. Des réflexions devront être engagées sur la manière dont il pourrait continuer à être associé aux outils européens dans ce domaine, avec pour objectif de préserver le même niveau d’ambition, sans pour autant que le Brexit n’entraîne des efforts supplémentaires pour les autres États membres.
À première vue, cette proximité, enracinée dans l’histoire, ne devrait pas être affectée par le Brexit. Le vote de juin dernier a d’abord fait craindre une tentation isolationniste, le risque étant également celui d’un Royaume-Uni qui jetterait toutes ses forces dans les négociations avec l’Union, reléguant de ce fait son action sur la scène internationale au second plan. Mais le nouveau ministre des affaires étrangères Boris Johnson, dans son premier discours de politique étrangère en décembre 2016 à Chatham House, a livré une vision internationaliste et ambitieuse de ce que pourrait être la politique étrangère britannique à l’ère du Brexit, insistant notamment sur la stabilisation du Moyen-Orient et sur le refus de toute normalisation avec la Russie.
Cependant, l’évolution de la politique étrangère britannique sera profondément liée aux inflexions de Washington. Sous le mandat de Donald Trump, et à l’heure du Brexit, il est aujourd’hui difficile de prédire comment évoluera la « relation spéciale » transatlantique si chère à Londres. Le Royaume-Uni choisira-t-il de se rapprocher de la nouvelle politique étrangère américaine pour s’assurer d’un renforcement de la relation économique et commerciale transatlantique, au point d’en faire une priorité de rang supérieur à la défense d’intérêts jusqu’à présent identifiés comme communs ? C’est ce que l’attitude du Royaume-Uni lors de la Conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient du 15 janvier 2017 pourrait laisser craindre.
À ce stade, les positions affirmées par Londres et la nouvelle administration américaine divergent sur la plupart des sujets sensibles : rôle de l’OTAN, relations avec la Russie, Moyen-Orient, etc. Lors de sa première rencontre avec le président américain le 27 janvier 2017, Theresa May a réaffirmé l’importance de l’Alliance atlantique, tout en souhaitant qu’elle fasse davantage dans la lutte contre les cyber-attaques et le terrorisme, et invitant les États européens à respecter leur engagement à consacrer 2 % de leur PIB aux dépenses de défense. Elle a également rappelé la position de Londres sur la Russie, affirmant son appui au maintien des sanctions tant que les accords de Minsk n’auront pas été pleinement mis en œuvre.
Cette nouvelle donne américaine pourrait au contraire inciter le Royaume-Uni à privilégier le développement d’une « relation spéciale » avec l’Europe en matière de politique étrangère et de défense. C’est ce que souhaite le président-rapporteur.
Enfin, en matière de défense, le Brexit devrait nous conduire, d’un côté, à donner une impulsion nouvelle à l’Europe de la défense, et de l’autre, à préserver nos relations bilatérales.
L’impact potentiel du départ britannique sur l’évolution de la politique européenne de défense est ambivalent. Il lève en principe un obstacle à cette évolution, mais sans que l’on puisse en espérer des résultats spectaculaires car d’autres obstacles demeurent.
Actuellement, des forces armées britanniques sont déployées dans cinq missions ou opérations militaires menées par l’Union européenne (environ cent vingt militaires britanniques engagés) (140). Le Royaume-Uni a notamment souhaité donner une grande visibilité à l’implication de son pays au sein de l’opération EUNAVFOR Med (dite « Sophia ») au large des côtes libyennes, et fournit depuis le début de l’opération un navire océanographique, le HMS Enterprise.
Mais si le Royaume-Uni contribue en pratique à la PSDC, il a surtout été un frein pour la construction d’une véritable Europe de la défense.
Les espoirs soulevés par la déclaration franco-britannique de Saint-Malo en décembre 1998 ont vite été déçus. Cette déclaration évoquait « le développement progressif d’une politique de défense commune » en même temps qu’une « capacité autonome d’action, appuyée sur des forces crédibles ». Elle permettait au Premier ministre britannique d’affirmer la volonté du Royaume-Uni de contribuer au projet européen alors que l’Union économique et monétaire se construisait sans lui et était en phase avec un certain nombre d’avancées conceptuelles réalisées, du traité de Maastricht en 1992 au traité de Lisbonne en 2007. Un an après la déclaration de Saint-Malo, au Conseil européen d’Helsinki de décembre 1999, les membres adoptèrent des conclusions selon lesquelles « les États membres devront être en mesure, d’ici 2003, de déployer dans un délai de 60 jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 personnes, capables d’effectuer l’ensemble des missions de Petersberg ». C’est aussi à cette époque, en juillet 2000, que fut créé EADS à la suite d’une déclaration commune de la France, de l’Allemagne et du Royaume Uni, et que, en décembre 2003, le Représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère, Javier Solana, publia un rapport définissant une stratégie européenne de sécurité. En 2004, une initiative franco-britannique-allemande, a permis d’élaborer le concept de groupement tactique qui était supposé mettre à disposition de la PSDC un vivier de forces capables de se déployer rapidement dans des zones lointaines en cas de crise.
Cependant, comme le reconnaît un rapport d’information publié par la commission des affaires étrangères en novembre 2013 (141), « ces potentialités n’ont pas été exploitées jusqu’à présent. La force projetable est toujours dans les limbes, et ses succédanés, les groupements tactiques européens, créés en 2004, n’ont pas répondu aux attentes. Les industries de défense européennes sont en crise, du fait notamment des restrictions budgétaires et de l’apparition de nouveaux centres de production, et ne parviennent pas à constituer un front commun ; le nombre de programmes militaires en coopération a baissé et si l’Union a engagé quelques opérations militaires, celles-ci sont demeurées d’un niveau modeste. »
L’une des raisons de cette situation est que la PSDC a toujours été perçue par les Britanniques comme une politique complémentaire et auxiliaire de l’OTAN, centrée principalement sur la dimension civilo-militaire, et dont le développement institutionnel et les initiatives capacitaires devaient être limités. Les Britanniques ont toujours veillé scrupuleusement à ce que les initiatives européennes ne dupliquent pas l’Alliance Atlantique, et se sont notamment opposés à l’extension, demandée par la France, du mécanisme de financement des opérations militaires Athena, qui permet de mutualiser aujourd’hui à peine 10 % des dépenses des missions militaires de l’Union, à la création d’un état-major européen permanent et à l’augmentation du budget de l’Agence européenne de défense.
Sur ces trois sujets, on peut sans doute espérer des avancées, mais là n’est pas l’essentiel pour créer les conditions d’une relance alors que les citoyens attendent de l’Europe qu’elle réponde à un défi stratégique majeur, celui du terrorisme, qui menace directement leur sécurité.
Une vraie relance supposerait, tout d’abord, que les membres de l’Union partagent une analyse commune des menaces et une doctrine commune d’emploi de la force. L’élaboration par la Haute Représentante d’une nouvelle stratégie européenne est sans doute le signe que les Européens ont perçu qu’il était nécessaire de forger un cadre de réflexion commun. L’engagement de la clause de solidarité prévue à l’article 42-7 du Traité sur l’Union européenne est certainement aussi un signe positif qui a permis d’affirmer la solidarité des alliés européens après les attentats de Paris, mais ses conséquences pratiques sont restées modestes.
Il faudrait aussi que les membres de l’Union consentent un effort capacitaire conséquent pour atteindre l’objectif de 2 % du PIB consacré à la défense et s’engagent sur la voie de programmes d’équipement européens. Là encore, les Vingt-Sept évoluent dans le bon sens, mais insuffisamment. Certains budgets militaires européens sont à la hausse, mais restent en deçà de l’objectif. Quant aux programmes européens, ils sont encore trop peu nombreux. Il faudrait sans doute définir les principes d’une mutualisation partielle des dépenses d’équipement militaire. Tout d’abord, en orientant une partie de l’effort de recherche européen vers l’équipement militaire, ensuite en créant un fonds européen de défense permettant de mutualiser une partie du financement de ces équipements comme l’a proposé récemment le Président de la République.
Enfin, au plan industriel, une Europe de la défense suppose que ses membres reconnaissent la spécificité des marchés de défense comme un élément essentiel de l’autonomie stratégique de l’Union et que les industries de défense européenne se regroupent.
Quelle sera l’attitude du Royaume-Uni vis-à-vis de la PSDC d’ici sa sortie de l’Union ? En septembre 2016, en amont d’une réunion des ministres de la Défense de l’Union à Bratislava, Michael Fallon, ministre britannique de la Défense, a déclaré : « nous sommes d’accord sur le fait que l’Europe doit faire davantage pour répondre aux défis du terrorisme et de l’immigration, mais nous allons continuer à nous opposer à toute idée d’une armée européenne ou d’un quartier général pour une armée européenne, qui reviendrait simplement à saper [l’autorité de] l’OTAN ». Mais comme l’a souligné le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian lors de son audition, les Britanniques ont fait preuve, au cours des mois qui ont suivi le référendum, d’une plus grande souplesse, et « ne se sont pas opposés, en particulier, à l’établissement, au sein de l’Union européenne, d’une capacité opérationnelle permanente de planification et de conduite dans le domaine stratégique » ni « à la mise en œuvre du principe de financement de la défense européenne, que ce soit dans le domaine de la recherche ou qu’il s’agisse de la révision des mécanismes permettant le financement des actions de défense de l’Union européenne par le dispositif Athena » (142).
Le départ du Royaume-Uni de l’Union doit donc être l’occasion pour la France de relancer l’Europe de la défense. Pour ce faire, l’Allemagne devra être notre principal appui : c’est d’ailleurs le sens de l’initiative franco-allemande de septembre 2016 initiée par les ministres de la défense de nos deux pays, Jean-Yves Le Drian et Ursula von der Leyen, ensuite rejoints par l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la République tchèque, qui a été reprise lors du Conseil européen de décembre dont votre rapporteur a présenté les résultats plus haut.
Jean-Yves Le Drian, lors de son audition par la mission, a d’ailleurs souligné trois inflexions dans la vision stratégique allemande au cours des derniers dix-huit mois : « une volonté affichée d’augmenter le budget de défense et une augmentation réelle de celui-ci, qui est toutefois encore loin d’atteindre 2 % du PIB », « une réactivité et un engagement beaucoup plus fort sur de nombreux théâtres » et « un intérêt récent mais marqué pour l’Afrique ». Ces inflexions sont de bon augure pour le développement d’une défense européenne ambitieuse, sous l’impulsion du couple franco-allemand.
En dehors de la défense européenne, qui doit rester notre priorité, il est évidemment primordial de préserver notre coopération bilatérale avec le Royaume-Uni. Nos deux espaces de souveraineté se jouxtent directement, et nous devons continuer à les protéger ensemble.
Cette coopération bilatérale très intense est permise par les traités de Lancaster House de 2010, avec un volet conventionnel et un volet nucléaire.
Dans le cadre de ces accords, nos deux pays coopèrent dans les technologies liées à la gestion des arsenaux nucléaires et partagent des installations communes dédiées à la simulation des essais.
Dans le cadre de ces accords, nos deux pays travaillent aussi à la mise sur pied d’une force expéditionnaire commune interarmées (Combined Joint Expeditionary Force). L’exercice final Griffin Strike en avril 2016 a permis de confirmer la capacité opérationnelle de cette force pouvant aller jusqu’à 10 000 hommes mobilisables très rapidement et pouvant mener des opérations de haute intensité, sur des théâtres d’opérations menées sous l’égide de l’ONU, de l’OTAN ou de la PSDC, au sein d’une coalition ou dans un cadre bilatéral.
Sur le plan capacitaire, cette coopération permet le développement de projets essentiels aux capacités militaires européennes (développement en commun de plusieurs nouveaux missiles et du système de combat aérien futur). Cette coopération constitue le terreau de partenariats majeurs pour notre industrie de défense, notamment autour de MBDA et Thalès.
Le ministre de la défense, lors de son audition par la mission, a réaffirmé le caractère essentiel de ces accords, qui ne seront « en rien affectés par la décision de sortie de l’Union européenne, du point de vue du ministère français de la défense comme de M. Fallon, conforté par le discours de Mme May ».
Ce point de vue est très largement partagé par la représentation nationale, comme en témoigne le fait que l’Assemblée nationale a autorisé, une semaine après le référendum britannique, la ratification de l’accord franco-britannique relatif aux centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles. Cet accord, sans équivalent, vise à permettre à des équipes franco-britanniques de MBDA, partagées entre des sites de recherche et de production des deux pays, de travailler ensemble dans une logique de rationalisation. Paradoxalement, cette forme de coopération est un modèle pour tous ceux qui souhaiteraient que l’Europe de la défense prenne corps ; elle doit absolument être préservée.
CONCLUSION : LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION D’INFORMATION
Compte tenu de la phase dans laquelle les travaux de la mission se sont déroulés, à savoir en amont du déclenchement de la procédure de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, le présent rapport s’est attaché à restituer le contexte dans lequel les négociations vont s’ouvrir. Ce faisant, il a mis en exergue plusieurs points de vigilance qui conduisent le président-rapporteur à formuler trois types de recommandations.
Un premier bloc de recommandations concerne la manière d’entrer dans les négociations.
1. Débuter par la négociation de divorce pour mettre au point une sortie ordonnée : lorsque les interlocuteurs britanniques affirment que certains secteurs, notamment les services financiers, constitueront le cœur des négociations, ils manifestent le souhait de focaliser les négociations dès le départ sur le statut futur. Or ce n’est ni le texte de l’article 50, ni l’intérêt de l’Union européenne. Il conviendra de veiller à ce que les négociations portent dans un premier temps sur les aspects liés au divorce lui-même, y compris la charge financière pesant sur le Royaume-Uni du fait de sa sortie. Le mandat de négociation confié à la Commission européenne devra être parfaitement clair sur ce point. L’obtention d’accords sur de nombreux sujets évoqués dans ce rapport devra constituer le préalable à toute discussion sur la relation future.
2. Régler rapidement la question du statut des citoyens européens : parmi les modalités de sortie qui nécessiteront des mesures transitoires, la question des droits des citoyens devra constituer la priorité absolue. D’une part, la continuité de leur droit au séjour devrait être garantie sans conditions aux expatriés résidant depuis plus de cinq ans dans leur pays d’accueil. D’autre part, des droits spécifiques devront être octroyés aux citoyens ne répondant pas à cette condition mais s’étant installés dans un autre État de l’Union européenne avant que ne soit établi le choix du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne. La date retenue pourrait être celle du déclenchement de la procédure de sortie et en tout état de cause ne saurait être antérieure au 23 juin 2016.
3. Dans un deuxième temps, négocier les grandes lignes de la relation future en utilisant les instruments existants comme base de négociation : des mesures provisoires d’anticipation de la relation future devront être discutées ; c’est le sens de l’expression figurant à l’article 50 « en tenant compte de la relation future ». Il va de soi qu’on ne saurait entrer dans la négociation en proposant une solution essayant de répondre aux demandes du Royaume-Uni, dont on voit bien aujourd’hui qu’elles visent à obtenir des avantages compétitifs en maintenant au maximum l’existant dans les domaines d’intérêt national, sans subir les contraintes liées à la participation à d’autres politiques, ni à la soumission à l’ordre juridique communautaire fondé sur le partage de souveraineté et le contrôle supranational. Compte tenu du poids du Royaume-Uni dans l’économie et la politique mondiales, il va de soi qu’un accord final – s’il y en a un – sera nécessairement sur mesure. Pour autant, l’Union européenne dispose d’instruments compatibles avec son ordre juridique et il convient de les utiliser comme base de négociation.
4. Faire progresser l’Union européenne : les Vingt-Sept ne doivent pas entrer dans ces négociations en considérant qu’elles constituent et rythment leur agenda européen. Nous savons qu’une grande partie de notre énergie sera absorbée par ces négociations. Néanmoins, les négociations seront conduites par la Commission et nous avons tout à fait la possibilité de progresser dans la mise en œuvre de la feuille de route de Bratislava. Plus encore, c’est un impératif de crédibilité de l’Union européenne et de restauration du lien avec ses citoyens. Cela peut être fait à droit constant : approfondissement du marché intérieur, notamment numérique, investissements, politique énergétique, politique industrielle, mobilité, gestion extérieure des frontières, défense européenne… La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ne doit rien suspendre.
Un deuxième bloc de recommandations concerne la conduite des négociations.
5. Faire prévaloir l’intérêt de l’Union européenne en maintenant la cohésion : la cohésion des vingt-sept États membres constituera la clé d’un bon accord pour l’Union européenne ; il sera donc essentiel de maintenir l’approche unitaire qui a prévalu jusqu’à présent. Les négociations bilatérales devront être exclues et des modes de concertation régulière définis, qui permettent à tous les États de prendre pleinement leur part dans la définition des positions et de rester en phase avec les négociateurs.
6. Travailler et agir en collaboration étroite avec l’Allemagne : pour fermenter cette cohésion, le rôle du couple franco-allemand sera fondamental. Sans être exclusive de ses partenaires, la relation entre nos deux pays, dont le poids sera mécaniquement revalorisé dans l’Union européenne amputée du Royaume-Uni, aura la tâche difficile de produire des positions de compromis acceptables par tous et de le faire au moyen d’un travail de consultation et de conviction des pays dont ils sont les plus proches. À cet égard, les incertitudes résultant des séquences électorales qui s’ouvrent dans nos deux pays devront être surmontées ; l’ancienneté de nos liens, la singularité des relations personnelles entre nos dirigeants, la profondeur de nos coopérations sectorielles, la régularité de nos relations le requièrent.
7. Maintenir le bien-fondé du choix en faveur de l’Union européenne : aucun compromis ne devra aboutir à une situation qui octroierait le même avantage au Royaume-Uni et a fortiori un avantage supérieur à celui qu’il avait en étant membre de l’Union européenne. À défaut, l’appartenance à l’Union européenne serait privée de sens. Le statut futur devra être fondé sur un équilibre des droits et des obligations. Notons que c’est aussi une question de respect des autres États tiers avec lesquels l’Union européenne dispose d’une relation privilégiée.
8. Promouvoir une approche globale des négociations : autant que possible, les négociations devront éviter de se dérouler secteur par secteur, car cela pourrait aboutir à l’octroi d’avantages compétitifs au Royaume-Uni, quand bien même il ne bénéficierait pas d’une situation équivalente ni a fortiori meilleure que celle dont il dispose aujourd’hui. Cela mettrait aussi en péril notre Union par le développement immaîtrisable de divisions entre États membres et entre secteurs d’activités au sein de nos pays. Lorsque des négociations sectorielles se tiendront, il conviendra de veiller à l’équilibre des droits et obligations pour chaque secteur, mais aussi au regard de la relation d’ensemble.
9. Faire preuve d’une attitude respectueuse dans l’intérêt des citoyens européens : alors que le discours de Mme May du 17 janvier 2017 brandit l’arme du dumping fiscal, les Vingt-Sept devront s’abstenir de toute forme de représailles au Brexit, de menaces ou de chantage. En respectant le choix fait par la majorité des électeurs du Royaume-Uni et l’interprétation qui en est donnée par le Gouvernement britannique, nous devrons rester concentrés sur l’essentiel : parvenir à organiser de la manière la plus intelligente possible ce départ. Le Brexit n’est effectivement pas un jeu à somme nulle. Il ne peut cependant être un jeu dans lequel tout le monde gagne. Il y aura des perdants. Les intérêts supérieurs des peuples devront prévaloir, notamment en évitant l’appauvrissement généralisé et l’accroissement des risques sécuritaires.
10. Préserver les perspectives d’avenir de l’Union européenne : au-delà du souci de faire progresser l’Union européenne dès à présent, notre pays devra tout au long de ces négociations conserver à l’esprit les perspectives d’évolution future de l’Union européenne. Il convient de veiller à ce que le résultat des négociations n’affaiblisse pas la capacité à faire progresser le projet européen mais qu’au contraire l’on puisse capitaliser sur cette expérience douloureuse.
11. Conduire la négociation dans un temps limité : la négociation de l’accord de divorce doit se dérouler dans un délai de deux ans, sauf prorogation à l’unanimité des Vingt-Sept. Une telle prorogation n’est pas souhaitable. Il faut rapidement clarifier la situation pour les citoyens et les agents économiques, éviter que ne perdure la situation dans laquelle le Royaume-Uni négociera avec l’Union tout en continuant de participer à l’élaboration de ses décisions et conclure l’accord de retrait avant les élections européennes de 2019. Si une période transitoire vers un partenariat futur s’impose, elle devra marquer une différence nette avec le statut de membre et être limitée dans la durée. Cette limitation de la période transitoire imposera de conclure l’accord sur les relations futures dans des délais raisonnables.
Enfin, le dernier bloc de recommandations concerne le travail parlementaire.
12. Associer les députés français : la mission émet le vœu qu’un travail de suivi des négociations se mette en place sous la prochaine législature afin que l’Assemblée nationale puisse disposer des informations utiles et ainsi contrôler l’action du Gouvernement. Il appartiendra à la prochaine Assemblée de déterminer les formes que pourrait prendre cette association, mais il serait tout à fait incompréhensible, dans une période où la légitimité démocratique des processus européens est mise en cause, que les représentants de la nation soient tenus à l’écart des détails d’une aventure historique aux conséquences aussi marquées.
13. Permettre au Parlement de s’exprimer sur le résultat des négociations : sur le plan juridique, il existe une différence entre les négociations de sortie et la relation future. La sortie est négociée au niveau européen et un accord devra obtenir l’accord du Parlement européen. Un accord avec un État tiers prenant la forme – a priori – d’un accord mixte, doit être ratifié par le Parlement européen et les parlements nationaux. Sur le plan politique, la mission souhaite que le Parlement français puisse s’exprimer sur les deux accords, et s’agissant de l’accord de sortie, au moyen d’un débat avec vote. Il ne s’agit pas uniquement d’une question de principe, mais aussi d’intégration pleine dans le débat public national.
14. Intensifier la diplomatie parlementaire européenne : dans cette phase de négociations, de manière complémentaire à l’action gouvernementale, le rôle des parlementaires peut être particulièrement utile pour accompagner le processus. L’Assemblée nationale a développé des liens forts avec ses partenaires européens, y compris naturellement avec le Royaume-Uni, et ces dialogues, s’ils sont intensifiés, pourront être mis à contribution pour faciliter la compréhension mutuelle et lever les éventuels malentendus ou crispations d’une part, pour faire avancer les projets que nous avons en commun, dans le cadre européen ou bilatéral, d’autre part. Au-delà des négociations, l’Assemblée nationale devra être à l’avant-garde des initiatives permettant de tirer les leçons du Brexit et de conduire une réflexion sur l’avenir de l’Union européenne.
Les Britanniques insistent sur le fait qu’ils ne sortent pas de l’Europe. Bien évidemment ! Nous demeurons nous aussi attachés aux valeurs européennes, à la démocratie, à notre histoire commune, à notre culture et à une certaine conception du monde. Nous en sommes dépositaires et responsables. Sachons pour notre part trouver la ligne de crête qui nous permettra, d’une part, d’agir en faveur des citoyens européens, de leur liberté et de leur sécurité économique et physique, d’autre part, de préserver le projet d’Union européenne, de lui donner sens dans ce monde déstabilisant et de démontrer que c’est un atout formidable pour parvenir à l’objectif de mieux-être des peuples.
Si la géographie européenne demeure, la puissance du rêve européen, dont le ressort est l’amélioration des conditions de vie des pays d’un continent qui pense collectivement son destin, fait l’objet de doutes. Nous faisons pourtant le pari que l’Union européenne, en tant que construction historique et philosophique, est la projection politique d’un désir de solidarité populaire dont l’actualité est évidente. Dans un monde marqué par un accroissement exponentiel des inégalités, par des reconfigurations importantes du monde du travail dont les mutations technologiques recomposent les emplois, leurs destructions et leur automatisation, par des bouleversements démographiques générateurs de migrations, les réponses aux défis ne sauraient se satisfaire de confuses tentations d’isolement ou de prises de participation d’influence solitaires.
Penser l’avenir des relations du Royaume-Uni et de l’Union européenne revient à dépasser la contradiction au cœur du vote référendaire de juin 2016 : si le Brexit est généralement présenté depuis comme l’affirmation de travailleurs, de familles et de citoyens britanniques en mal de protections, il a surtout donné de la voix, au sein de la classe politique britannique, aux partisans d’une évolution vers ce qui ressemble à un programme de dumping fiscal et social. Au cœur de cette contradiction, il y a notre exigence et notre vigilance : l’Union européenne ne peut se réduire à offrir à ses partisans une zone de libre-échange de services et de capitaux que ne régule aucun effort fiscal, social ou réglementaire.
La défiance aujourd’hui constatée envers les institutions européennes ne résulte d’ailleurs que de l’incohérence politique affichée par des représentants européens qui, en s’engageant dans une voie politique génératrice d’austérités sociales, de contractions budgétaires et de remises en cause des services publics, heurtent de front la réelle légitimité de l’Union à améliorer les infrastructures sociales par de puissantes et fécondes interventions. « Un mot dit à temps vaut mieux que de longs et beaux discours » dit un antique proverbe des provinces de l’Angleterre. Face à l’efficacité des négociateurs britanniques qui sauront proposer un agenda préservant leurs intérêts, l’Union devra rappeler ces simples exigences, fruits d’une volonté politique populaire partagée.
Contre les risques de guerre civile économique européenne, l’humanisme bâtisseur des Pères fondateurs doit de nouveau inspirer nos travaux et nos projets. Du développement des infrastructures à l’éducation, de l’égalité de soins au développement urbain, des transports à l’effort de recherche, des protections contre les risques de l’existence à la politique salariale, les domaines qui enrichiront l’avenir et redonneront chair, corps, intensité et grandeur à l’Europe attendent notre engagement, nos veilles et notre union.
Au cours de sa réunion du mercredi 15 février 2017, la mission d’information procède à l’examen du présent rapport.
M. le président Claude Bartolone. Chers collègues, je suis très heureux de vous présenter ce matin le rapport issu de nos travaux, alors que le Royaume-Uni s’apprête à notifier sa volonté de quitter l’Union.
Depuis le mois de septembre dernier, nous avons auditionné trente personnes à Paris, dont quatre membres du Gouvernement, et avons effectué quatre déplacements à l’étranger, à Londres, à Bruxelles, à Berlin et à Francfort.
Tout au long de ces travaux, nous avons pu observer l’évolution progressive de la position britannique. Lorsque la mission a été créée en juin dernier, au lendemain du référendum, nous nous demandions encore si, un deuxième scrutin était organisé, si le Royaume-Uni adopterait plutôt le modèle « norvégien » ou le modèle « suisse ». Mais la Première ministre Theresa May a rapidement écarté l’hypothèse d’un second scrutin et rejeté l’idée de rester au sein de l’Union européenne par une voie détournée, répétant inlassablement que « Brexit means Brexit », sans pour autant préciser ses intentions. À l’automne, nous avons pu observer, à l’occasion de notre déplacement à Londres, une polarisation du débat entre les partisans d’un Brexit « dur », plaidant pour la renonciation à l’union douanière et au marché unique et ceux d’un Brexit « doux », souhaitant maintenir un statut le plus proche possible de l’existant. Le 17 janvier, la Première ministre est enfin sortie de sa réserve pour tracer les grandes lignes des positions de négociations du Royaume-Uni, confirmant l’hypothèse d’un Brexit « dur », orientations réaffirmées par le Livre Blanc transmis au Parlement britannique le 2 février. Ce discours n’a rien apporté de véritablement nouveau, même s’il a fourni quelques clarifications indispensables. La Première ministre a en fait explicitement confirmé ce que nous savions déjà : le gouvernement britannique souhaite obtenir le plus possible des avantages de l’Union européenne, mais sans en endosser les contreparties. La question de l’association de Westminster au déclenchement de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne a d’ailleurs fait l’objet de multiples rebondissements. La Haute Cour puis la Cour suprême ont en effet statué sur la nécessité d’obtenir préalablement l’accord des deux chambres, contre l’avis du Gouvernement. Après ce semestre de grand flou, le Gouvernement britannique devrait déclencher la procédure de retrait au mois de mars.
Que se passera-t-il une fois cette étape décisive franchie ?
Le Conseil européen devra d’abord, par consensus et sans la participation de Mme May, fixer des orientations de négociation. Chaque État membre aura donc de fait un droit de veto sur ces orientations. Sur la base d’une recommandation de la Commission européenne, le Conseil adoptera ensuite, à la majorité qualifiée, le mandat de négociation qui sera confié à Michel Barnier. Son équipe, chargée de la conduite des négociations, travaillera sous le contrôle étroit du Conseil européen et, donc, des États membres. La négociation doit se dérouler dans un délai maximum de deux ans à compter de la notification. À l’issue de ce délai, trois hypothèses sont envisageables : soit un accord de retrait est conclu, soit le Conseil européen décide, à l’unanimité, de proroger ce délai, soit le retrait du Royaume-Uni est automatiquement avalisé, même en l’absence d’accord.
Je souhaite insister sur la distinction claire que nous devons faire entre l’accord de retrait lui-même et l’accord sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union.
La négociation qui se déroule selon la procédure et les modalités prévues à l’article 50 devra porter uniquement sur les modalités du retrait sur les plans institutionnel, budgétaire et administratif. La question de la « facture » du Brexit sera sans doute le point le plus sensible de ces négociations. Lorsque nous nous sommes rendus au Parlement européen, nous avons déjà senti à quel point les positions des uns pouvaient être éloignées de celles des autres.
Cet accord sur le « divorce » n’a pas vocation à régler la question des relations futures, même si le traité prévoit qu’il est conclu avec l’État concerné « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ».
Politiquement, lier les deux accords ne serait pas souhaitable car cela permettrait au Royaume-Uni de soumettre son accord sur les modalités, notamment financières, du retrait à l’obtention de conditions avantageuses sur la relation future.
Techniquement, il semble totalement impossible de conclure ces deux accords en deux ans, au vu de la durée nécessaire pour conclure à vingt-huit des accords de libre-échange pourtant beaucoup moins complexes – les travaux des membres de la commission des affaires étrangères le montrent bien. Nous devrons cependant nous efforcer de conduire les négociations le plus rapidement possible, pour mettre fin aux incertitudes dont souffrent les citoyens et les agents économiques. Il faut aussi éviter que le Royaume-Uni encore membre de l’Union européenne jusqu’à la fin des négociations de sortie n’influence de l’intérieur une Union européenne dont il a décidé de sortir. N’oublions pas non plus les élections européennes de 2019 : l’accord de retrait devra être conclu auparavant.
C’est la première recommandation issue de ce rapport. Dans l’intérêt de l’Union et dans le respect des traités, il conviendra de veiller à ce que les négociations portent dans un premier temps sur les aspects liés au divorce lui-même. Il faudra que le mandat de négociation confié à la Commission européenne soit très clair sur cette question.
Évidemment, les discussions sur les deux sujets ne peuvent pas non plus être complètement dissociées. Il est en effet nécessaire d’avoir une idée du « point d’atterrissage », pour bâtir certains éléments de l’accord de retrait et prévoir, le cas échéant, des dispositions transitoires. Si période transitoire il y a, elle devra être limitée sur le fond, c’est-à-dire marquer une vraie différence avec le statut d’État membre, et dans le temps.
Enfin, en ce qui concerne le processus de négociation en lui-même, je veux insister sur un point qui est fondamental et qui fait l’objet de plusieurs recommandations du rapport : la question de l’association des parlements nationaux. Nous avons évoqué à de multiples reprises cette question ensemble. Pierre Lellouche m’en a expressément saisi par courrier, et je partage pleinement ses préoccupations. En effet, il serait incompréhensible, dans une période où la légitimité démocratique des processus européens est mise en cause, que les représentants de la nation soient tenus à l’écart des détails d’une aventure historique aux conséquences aussi marquées.
Contrairement à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union, le retrait d’un État ne nécessite certes pas la ratification des autres États membres. Si un accord de retrait est conclu, il devra être approuvé par le Royaume-Uni, par le Parlement européen, à la majorité simple, et par le Conseil, à la majorité qualifiée.
L’approbation des parlements nationaux ne sera pas juridiquement nécessaire, mais il me semble indispensable que les gouvernements entretiennent un dialogue soutenu avec leurs parlements. Même s’ils ne sont pas appelés à autoriser la ratification de l’accord de retrait, les Parlements nationaux voteront sur l’accord définissant le nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, puisqu’il s’agira très probablement d’un accord mixte. Une association insuffisante, en amont, des parlements nationaux, comme du Parlement européen, ferait courir un risque inutile sur l’issue du vote final. Aussi notre Parlement devrait-il non seulement être tenu régulièrement informé de l’avancement des négociations, mais également pouvoir s’exprimer sur l’accord de retrait avant son adoption par le Conseil, au moyen d’un débat avec vote, comme le permet l’article 50-1 de la Constitution.
Après avoir rappelé la procédure en elle-même, je voudrais maintenant évoquer avec vous la manière dont, à mon sens, nous devons aborder ces négociations.
Tout d’abord, il faut lutter contre l’idée reçue, qui semble particulièrement répandue outre-Manche, selon laquelle la France aurait une attitude « punitive ». La France n’a pas aujourd’hui une position différente de celle de ses partenaires européens sur les « lignes rouges » des négociations.
Quelles sont-elles ? Trois principes fondamentaux ont été affirmés par les Vingt-Sept depuis le mois de juin : premièrement, pas de négociations sans notification ; deuxièmement, l’acceptation de chacune des quatre libertés est une condition de l’accès au marché unique ; troisièmement, les négociations ne sauraient aboutir à ce qu’un État tiers bénéficie d’un régime aussi avantageux qu’un État membre. Ces principes n’ont qu’un seul but, qui devra être notre fil conducteur dans les négociations à venir : préserver l’intérêt de l’Union avant tout.
Préserver l’intérêt de l’Union avant tout, c’est ce que nous avons déjà réussi à faire en conditionnant l’accès au marché unique à l’acceptation des quatre libertés fondamentales. Ce principe, répété tout au long du semestre avec une unité remarquable, a finalement été entendu par les Britanniques. Il ne s’agit pas d’une position dogmatique : la liberté de circulation est une liberté fondamentale du projet politique européen, le principal acquis populaire de l’Europe, que les jeunes de nos pays se sont pleinement approprié. Cette liberté n’est pas négociable. L’affirmation de l’indivisibilité de ces quatre libertés était un préalable nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant. Il nous faudra rappeler sans cesse, au cours de ces négociations, que l’Union européenne est un tout, qu’elle est issue d’une addition de différents points d’équilibre.
Prenons l’exemple de la Cour de justice de l’Union européenne – j’ai intégré dans le rapport des remarques faites par Mme la présidente Élisabeth Guigou sur le volet « justice » de la question. Le Royaume-Uni souhaite s’en émanciper, mais comment accepter dans ce cas qu’il continue à faire partie intégrante de certaines politiques européennes ? Depuis les Lumières, il n’y a pas d’espace politique sans ordre juridique. L’ordre juridique européen est fondé sur l’unicité du droit et sur son application effective dans l’espace européen : remettre ce principe en cause menacerait sa viabilité.
La cohésion des Vingt-Sept sera une condition absolument déterminante de la réussite de ces négociations pour l’Union. Il sera donc essentiel de maintenir l’approche unitaire qui a prévalu jusqu’à présent. Les négociations bilatérales devront être exclues, et il faudra définir des modes de consultation régulière pour permettre à tous les États de rester en phase avec les négociateurs. Pour prévenir ce risque de division, il me semble également primordial de promouvoir une approche globale des négociations et d’éviter autant que possible de conduire des négociations « secteur par secteur » qui pourraient raviver inutilement certaines tensions. Il faudra de toute façon veiller non seulement à l’équilibre des droits et obligations, mais aussi à ce que l’addition des différents volets produise un équilibre général satisfaisant pour l’Union.
Le couple franco-allemand devra être le ferment de cette unité des Vingt-Sept. Nos deux pays, dont le poids sera mécaniquement revalorisé dans une Union européenne amputée du Royaume-Uni, auront naturellement vocation à produire des positions de compromis acceptables par tous, grâce à un travail de préparation et de conviction des pays dont ils sont le plus proches.
Pour préserver la construction européenne, il faudra en outre éviter de jeter toutes nos forces dans ces négociations, car l’Union européenne doit aujourd’hui se battre sur beaucoup d’autres fronts. Avec ou sans Brexit, l’Union doit continuer à progresser pour le bien-être des citoyens européens.
Au-delà du souci de faire progresser l’Union européenne dès à présent, nous devrons également, tout au long de ces négociations, conserver à l’esprit ses perspectives d’évolution future. Il faudra veiller très attentivement à ce que le résultat des négociations n’affaiblisse pas notre capacité à faire progresser le projet européen.
La colonne vertébrale des quatorze recommandations que je vous soumets est donc claire : préserver avant tout la cohérence et la solidité de l’édifice européen, patiemment construit pierre par pierre depuis plus de cinquante ans. Il est si difficile de construire, et si facile de détruire…
Une fois cette limite posée, nous devrons chercher à obtenir les meilleurs accords possibles. Bien sûr, nous avons intérêt à trouver un accord avec les Britanniques pour faciliter le plus possible nos relations commerciales. Aujourd’hui, aucun pays tiers entretenant une relation privilégiée avec l’Union ne bénéficie d’un statut tel que le souhaite le Royaume-Uni, mais je n’oublie pas non plus qu’aucun de ces pays ne dispose d’un poids équivalent à celui du Royaume-Uni dans l’économie européenne et mondiale. Il va donc de soi qu’un accord final – s’il y en a un – sera nécessairement sur mesure.
Pour autant, l’Union européenne dispose déjà d’instruments compatibles avec son ordre juridique, et il conviendra de les utiliser comme base de négociation.
En effet, l’erreur serait d’entrer dans la négociation en proposant une solution essayant de répondre aux demandes du Royaume-Uni, dont on voit bien aujourd’hui qu’elles visent à obtenir des avantages compétitifs tout en maintenant au maximum l’existant dans les domaines d’intérêt national. Rappelons tout de même que 44 % des exportations britanniques sont aujourd’hui dirigées vers le marché intérieur. Quels que soient les contacts noués par le Royaume-Uni avec l’Australie, l’écart, du point de vue du Royaume-Uni, entre ce que représente l’Australie et ce que représente le marché intérieur est considérable. Ne nous laissons donc pas prendre au piège d’un discours de politique intérieure, qui tenterait de nous faire croire que l’Union a autant besoin de l’économie britannique que l’économie britannique a besoin de l’Union. Ces négociations sur l’accès au marché unique seront les plus difficiles : il y aura inévitablement des perdants. Il nous incombera de nous assurer qu’elles ne conduisent pas à l’appauvrissement généralisé de nos peuples.
En revanche, ce rapport identifie deux sujets sur lesquels les négociations avec le Royaume-Uni peuvent et doivent aboutir à une situation « gagnant-gagnant ».
La priorité absolue sera de trouver le plus tôt possible un accord protégeant les citoyens expatriés des deux côtés de la Manche, parfois depuis très longtemps, pour éviter des situations humaines qui pourraient être très douloureuses. Je vous rappelle que 3,2 millions d’Européens vivent au Royaume-Uni et que 1,2 million de « Grands-Bretons », pour reprendre l’expression d’un membre de cette mission, vivent sur le continent. Plus de quatre millions de citoyens sont donc aujourd’hui directement concernés par le Brexit, et nous devons mettre un terme le plus rapidement possible à l’incertitude dans laquelle ils vivent aujourd’hui. Je propose dans le rapport que la continuité du droit au séjour soit garantie sans conditions aux expatriés résidant depuis plus de cinq ans dans leur pays d’accueil. Par ailleurs, des droits spécifiques devront être octroyés aux citoyens qui ne répondent pas à cette condition mais se sont installés dans un autre État de l’Union européenne avant que les Britanniques ne choisissent de quitter l’Union.
Enfin, dans un contexte où des menaces graves pèsent sur la sécurité de notre continent, il est dans l’intérêt de tous que le Royaume-Uni reste un partenaire privilégié de l’Union européenne et de la France dans ce domaine, quelles que soient les modalités de sa sortie. N’oublions pas que c’est, avec la France, le seul État membre de l’Union disposant d’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, le seul doté de l’arme nucléaire et le seul à fournir un effort de défense à la hauteur de nos ambitions stratégiques. Nous devrons donc trouver les moyens d’une coopération intense sur les sujets de sécurité intérieure et extérieure, aussi bien entre le Royaume-Uni et l’Union que dans nos relations bilatérales.
Je vous cède maintenant la parole, chers collègues, pour que nous puissions débattre ensemble de ces conclusions.
Mme Élisabeth Guigou. Je veux d’abord vous remercier, monsieur le président, d’avoir réuni cette mission d’information ; c’était très important. Nous avons travaillé de façon intensive, dans un excellent climat, évidemment avec le souci, d’abord et avant tout, au-delà de nos différences, de faire prévaloir les intérêts de la France dans cette négociation et notre leadership en Europe. J’ai trouvé ce travail passionnant et très utile. Le projet de rapport que vous nous soumettez, monsieur le président, me paraît en tous points excellent.
Il importait, d’abord, que nous puissions exprimer nos exigences avant même que les négociations commencent et, ensuite, que nous restions très vigilants sur la suite des événements, ainsi que vous venez l’indiquer. Je suis tout à fait d’accord avec la réponse que vous avez apportée à la lettre de M. Lellouche : il faudra en effet que notre Parlement puisse, d’une façon ou d’une autre, donner son point de vue sur le déroulement des négociations, ainsi que sur leur aboutissement, car il en va de notre avenir et de celui de l’Union européenne, à plus forte raison dans le contexte international actuel – nous allons être soumis à un certain nombre de secousses ; cela a d’ailleurs déjà commencé avec les déclarations de M. Trump. Ce rapport clarifie considérablement les données que les négociateurs et nous-mêmes aurons à prendre en compte.
Indépendamment des sujets techniques, la négociation sera très difficile. D’une part, il n’y a pas de précédent. D’autre part, ainsi qu’on pouvait le prévoir, le Gouvernement, le Parlement et les diplomates britanniques vont essayer d’avoir « le beurre et l’argent du beurre ». Cela me paraît absolument évident à la suite du discours de la Première ministre britannique. Mme Theresa May n’a clarifié qu’une seule chose : elle a pris acte de la position très ferme exprimée de manière unanime par les Vingt-Sept au sommet de Bratislava sur le caractère indissociable des quatre libertés, ce qui impliquait de refuser au Royaume-Uni l’accès au marché unique s’il n’acceptait pas la libre circulation des personnes et le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne ; elle en a tiré la seule conclusion possible, à savoir que le Royaume-Uni se retirerait du marché unique, ainsi, d’ailleurs, que de l’union douanière. Si ce point est parfaitement clair, son discours laisse en revanche planer un maximum d’incertitudes sur tout le reste. En particulier, elle a déclaré vouloir un accès maximal au marché unique, en mentionnant expressément les secteurs de l’industrie automobile et des services financiers, qui correspondent aux intérêts offensifs de son pays. On voit très bien que les Britanniques vont essayer d’obtenir, sur les éléments qui sont importants pour eux, des négociations qui leur donnent satisfaction.
C’est pourquoi il est très important, ainsi que vous l’avez souligné, de tenir une ligne extrêmement ferme sur quelques points, sans esprit punitif, naturellement. Il s’agit de rechercher le meilleur accord possible sans brader nos intérêts ni ceux de l’Union européenne.
D’abord, il ne faut pas commencer les négociations sur le statut futur tant qu’un accord n’aura pas été trouvé sur les aspects institutionnel, administratif, juridique et budgétaire de la sortie du Royaume-Uni. Il y a trois grands sujets à cet égard, dont le plus difficile sera la question budgétaire, ainsi que vous l’avez souligné. Il faut vraiment tenir bon sur le principe d’une négociation en deux phases. Les dispositions transitoires figurant dans l’accord de retrait devront être mises au point, elles aussi, indépendamment du futur statut. Si ces dispositions transitoires, demandées par le Royaume-Uni, sont conçues comme des dispositions d’application de l’accord de retrait, pourquoi pas, mais il ne saurait être question de poursuivre indéfiniment les négociations.
La question des droits des citoyens est évidemment l’une des premières à régler, dans un souci de réciprocité. En la matière, je le souligne, il ne peut y avoir qu’une solution européenne, car des accords bilatéraux seraient contraires au droit européen. Raison supplémentaire pour nous de rechercher un accord sur ce point dès le début.
Nous devrons exercer notre vigilance pour que le mandat de négociation donné à la Commission européenne soit parfaitement clair sur le principe d’une négociation en deux temps et très ferme sur les éléments financiers, sachant que l’accord de retrait devra être approuvé par le Conseil à la majorité qualifiée et qu’il ne sera pas soumis, en tout cas formellement, à la ratification des États membres, même si – je suis entièrement d’accord avec vous – nous devons avoir notre mot à dire sur les résultats de la négociation.
Le Royaume-Uni va évidemment essayer de battre en brèche l’unité qui s’est formée à Bratislava et qui est la condition de notre succès. Pour rester uni, il faut à tout prix éviter de se laisser entraîner dans des négociations secteur par secteur ou politique par politique. Si tel est le cas, nous nous ferons couper en tranches ! Les négociations doivent embrasser l’intérêt général commun, l’ensemble de nos intérêts en tant qu’Union européenne.
Cette unité tiendra-t-elle si la menace d’une sortie sèche est brandie ? On ne peut pas tout à fait écarter cette hypothèse, qui est l’une des trois que vous avez évoquées. Au sein de notre mission, nous avons discuté à plusieurs reprises de l’inquiétude que l’on peut nourrir à propos de la fragilité de l’unité européenne. En la matière, nous en sommes réduits à des spéculations. De toute façon, il faut tenir bon sur nos positions.
Un certain nombre d’États membres ont un intérêt évident au maintien de la solidarité, ne serait-ce que du point de vue économique et financier. Je pense notamment aux nouveaux adhérents, qui n’ont pas nécessairement la même conception que nous, Français, de ce que doit être l’Union européenne. Car de nombreux pays du Nord et de l’Est de l’Europe partagent aujourd’hui ce qui a toujours été le point de vue du Royaume-Uni, à savoir que l’Europe doit être une zone de libre-échange et rien d’autre. Pour notre part, nous avons toujours plaidé – cela remonte au général de Gaulle – en faveur de politiques et de normes communes, de mesures de régulation, etc. Nous devrons être très vigilants en la matière. La tentation sera grande, chez nombre de nos partenaires, de démembrer le marché intérieur. Faisons notamment attention à ce qui va se passer avec l’Irlande, qui va essayer d’éviter la constitution d’une frontière avec l’Irlande du Nord, avec toutes les implications que cela pourrait avoir pour nos intérêts. Notons au passage que le Brexit suscite beaucoup d’agitation à l’intérieur du Royaume-Uni, surtout en Écosse et, dans une moindre mesure, au pays de Galles.
Ne nous laissons pas piéger par la menace britannique de chercher ailleurs ce qu’ils n’auront plus à partir du moment où ils quitteront l’Union européenne. Vous l’avez rappelé, chiffres à l’appui : l’économie britannique est fortement dépendante du reste de l’Union européenne. S’agissant des services financiers, il nous a été indiqué que la City subirait de plein fouet l’absence d’accord et de mesures transitoires. Lors de notre déplacement à Londres, les représentants de la City ont évoqué la perte de 70 000 emplois. En dépit d’une révision à la baisse des perspectives de croissance, le Royaume-Uni peut se vanter, pour l’instant, que son économie résiste plutôt bien au Brexit. C’est exact, mais le Brexit n’a pas encore eu lieu. Il ne faut pas se laisser impressionner : le Royaume-Uni sera la première victime du Brexit, même si l’Union européenne en souffrira elle aussi, bien entendu.
Il faudra suivre de très près les difficultés intérieures du Gouvernement britannique. Mais nous ne devons surtout pas donner l’impression, nous Français, que nous adoptons une attitude punitive. Nous devrons le dire au Gouvernement, qui va continuer à négocier après la suspension de nos travaux. Nous n’avons d’ailleurs pas d’attitude punitive. Nous aurions évidemment préféré que le Brexit n’ait pas lieu, nous sommes tout à fait désolés de la situation, mais on ne peut pas non plus nous demander de brader les intérêts de l’Union européenne.
Selon moi, nous devons être très fermes à l’égard des Britanniques, en leur faisant valoir qu’ils n’ont probablement pas intérêt à brandir la menace du dumping, qu’il soit fiscal ou social. D’une part, ils sont eux-mêmes dans une situation de fragilité à cet égard : l’un des principaux arguments de M. Boris Johnson en faveur du Brexit, on s’en souvient, était que le Royaume-Uni allait pouvoir réaffecter le montant de la contribution britannique au National Health Service, qui est en très mauvais état. D’autre part, il est absolument indispensable que nous renforcions l’Union européenne dans des domaines qu’elle a très peu explorés jusqu’ici. Le rapport se conclut – nous l’avons un peu revu en ce sens, et j’en suis heureuse – sur la nécessité de ne pas négliger les éléments fondamentaux qui peuvent être liés, en bien ou en mal d’ailleurs, au vote en faveur du Brexit. Cela impose à l’Union européenne de continuer à se renforcer pour résister à d’éventuels chocs.
Il est nécessaire, d’abord, d’aller au bout de l’union économique et monétaire, avec l’union bancaire. L’union monétaire, nous le savons, reste encore fragile. Si un autre choc se produisait, il serait probablement très difficile d’y faire face, peut-être plus encore que la fois précédente.
Il faut, ensuite, une véritable union économique pour résister à un éventuel dumping fiscal. Pour ce faire, il faut justement empêcher l’utilisation des méthodes de dumping fiscal et social au niveau européen. Nous devons adopter une attitude beaucoup plus ferme en la matière. Nous l’avons fait sur les abus en matière de travail détaché – Gilles Savary a beaucoup travaillé sur ce point –, mais il faut le faire aussi sur les questions fiscales. Et, naturellement, une véritable union économique implique que l’on tienne compte des effets des politiques menées par chaque pays sur tous les autres – je pense évidemment à l’Allemagne.
Si nous voulons parvenir à nous protéger et à protéger nos intérêts, il est absolument indispensable de maintenir, vous l’avez dit, une cohésion très forte avec l’Allemagne au cours de la période qui s’ouvre. Cela sera peut-être plus facile qu’au cours de la période qui s’achève, car l’Allemagne a beaucoup plus besoin de la France aujourd’hui que ce n’était le cas il y a quelques années : elle a compris que sa sécurité dépendait en partie de ce que nous faisons en Afrique, voire au Moyen-Orient, même si nous y avons obtenu moins de résultats positifs ; elle a aussi compris que, pour maîtriser les flux migratoires, elle avait besoin d’un prolongement en matière de politique extérieure, notamment de l’action que nous menons – vous avez pu noter les évolutions qui ont eu lieu sur ce point depuis trois ou quatre ans.
En résumé, il importe de travailler sur l’union économique et monétaire, l’Europe de la sécurité et de la défense et, bien entendu, l’Europe de la justice, sur laquelle vous avez vous-même insisté, et d’être bien en phase avec l’Allemagne.
De ce point de vue, je trouve les dernières déclarations de Mme Merkel très encourageantes : pour la première fois, elle a admis qu’il allait certainement falloir construire une Europe différenciée, que le Brexit nous imposait d’être enfin plus allants dans cette démarche. Celle-ci consiste non pas à exclure tel ou tel, mais, comme nous l’avons fait avec l’euro ou Schengen, à dire ce que nous voulons faire, si nécessaire à quelques-uns, tout en invitant ceux qui le veulent et le peuvent à nous rejoindre. J’espère en tout cas que, quels que soient les résultats des élections à venir, notre pays pourra mener une politique européenne de nature à préserver nos intérêts et à résister aux offensives du Royaume-Uni dans l’immédiat, et à celles de M. Trump qui vont sûrement durer, quelles que soient les vicissitudes de ses déclarations successives.
M. Pierre Lellouche. Je vous remercie à mon tour, monsieur le président, d’avoir entrepris cet exercice utile et salutaire, qui a abouti à un rapport tout à fait excellent – je rejoins Mme Guigou sur ce point. Le groupe Les Républicains n’aura aucune difficulté à l’adopter s’il est soumis à un vote.
Je fais néanmoins une série de remarques touchant au rapport lui-même.
Commençons par évoquer ce qui se passe aujourd’hui à Strasbourg : le Parlement européen va ratifier l’accord économique et commercial global – Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) – avec le Canada. J’ai longuement protesté, la semaine dernière, contre cette ratification. Le 1er mars prochain, cet accord sera appliqué à titre provisoire sans avoir été ratifié par les parlements nationaux, ni même examiné en détail par notre assemblée. C’est consternant…
M. Jacques Myard. Absolument !
M. Pierre Lellouche. …et problématique, y compris au regard de cet exercice. C’est pourquoi je vous ai adressé la lettre que vous avez mentionnée. Je vous remercie d’avoir accepté de l’annexer au rapport, sur lequel nous sommes, je crois, tous d’accord.
Dans cette lettre, je soulève trois problèmes.
Premier problème : le mandat. Le mandat qui sera confié à Michel Barnier doit faire l’objet d’un consensus associant les parlements nationaux. Il ne faut pas que nous nous retrouvions dans une situation analogue à celle que nous avons connue avec le traité de libre-échange transatlantique – Trans-Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA) – avec les États-Unis : le mandat avait été plus ou moins bricolé à la dernière minute ; on s’est aperçu, en cours de négociation, qu’on ne pouvait plus continuer à discuter, et on a demandé l’arrêt de ladite négociation. Or, dans le cas présent, ce sera impossible : une fois que le mandat sera donné, il sera trop tard pour y revenir. Il est donc très important que le Parlement soit associé à sa préparation. J’ignore comment vous procéderez pour ce faire, monsieur le président, ou comment votre successeur procédera, mais ce point me paraît essentiel.
Deuxième problème : la ratification du premier accord. Je suis heureux de constater que nous sommes tout à fait sur la même ligne à ce sujet : même si l’article 50 du traité sur l’Union européenne ne prévoit pas de ratification nationale, je ne vois pas très bien comment il pourrait être ratifié par la Chambre des communes sans l’être par le Parlement français et les autres parlements nationaux ; il est politiquement impensable qu’il en soit ainsi, notamment en raison de toutes les conséquences juridiques, financières et autres qui en découleront pour nos nations.
Troisième problème : la ratification du deuxième accord. En l’espèce, il faut vraiment éviter la situation que nous avons connue avec le CETA, c’est-à-dire de se retrouver avec un accord mixte, vu la façon dont la Commission européenne joue avec cette notion. Pour ma part, je n’accepterai aucun jeu de ce genre. Vous avez vu comment la Commission s’est comportée dans l’affaire du CETA : dans un premier temps, elle a affirmé que cet accord commercial n’était pas un accord mixte ; puis, les ministres ayant estimé, au mois de mai dernier, qu’il s’agissait bien d’un accord mixte, M. Juncker a fini par ravaler sa copie.
Toutefois, d’après son interprétation, il est possible de « couper » un tel accord mixte. Ainsi, une partie du CETA, à savoir l’essentiel du texte, peut être ratifiée immédiatement par le Parlement européen seul – ce qui va se passer aujourd’hui à Strasbourg – et, pour ce qui est du reste du texte, on verra plus tard avec les parlements nationaux. Il n’est tout simplement plus possible de continuer de la sorte ! Cela contribue massivement, à mon sens, au divorce entre les peuples et l’Union européenne. J’ai rappelé l’exemple du CETA, car il est, selon moi, directement transposable à l’affaire qui nous occupe.
J’en viens à quatre points d’ordre technique, soulevés au fil du rapport, sur lesquels il conviendrait d’apporter des précisions.
Il s’agit, premièrement, du rôle du Royaume-Uni au cours de la période transitoire. Nous allons être dans une situation quelque peu ubuesque : tout au long de la période de négociation, le Royaume-Uni restera associé à toutes les discussions, sauf dans le cas où elles porteront sur l’accord de sortie lui-même ; autrement dit, il sera présent autour de la table même lorsqu’il s’agira d’élaborer des textes législatifs européens. Je me demande si cela a du sens et si, dans le cadre de notre mandat, nous, parlementaires français, n’aurions pas intérêt à dire que cela doit être corrigé. Il me paraît ubuesque, je le répète, qu’un État engagé dans des négociations de sortie continue à travailler à l’élaboration de la législation européenne avec les États qui resteront membres. C’est à n’y rien comprendre.
Quid, ensuite, des milliers de fonctionnaires européens britanniques ? Je parle sans agressivité, mais, dans la logique de la construction européenne, pourquoi la Commission européenne les garderait-elle, à moins bien sûr qu’ils ne prennent une autre nationalité ?
Le rapport précise que le Parlement européen aurait obtenu d’être représenté au sein de l’équipe de négociation. Le mandat devrait à mon sens prévoir également l’association des parlements nationaux.
Quant à l’ardoise que nous allons présenter aux Britanniques à la sortie, vous évoquez un montant de 55 à 60 milliards d’euros. Compte tenu de la dynamique interne de la politique britannique, je ne vois pas comment nous allons récupérer cette somme – cette demande pourrait précipiter de vrais désaccords, voire une sortie plus rapide. Il me semble que le rapport pourrait insister sur cette question.
Le problème des frontières de l’Europe – Mme Guigou a déjà cité Gibraltar et l’Irlande – est essentiel. Il faudrait également y insister.
Vous soulevez la question des conséquences du retrait britannique sur l’équilibre politique entre les nations, en raison du nouveau calcul des votes à la majorité qualifiée. C’est un sujet majeur – qui rejoint d’ailleurs celui de la coopération franco-allemande. Toutefois, je ne suis pas sûr qu’il faille le faire figurer dans notre rapport : avons-nous intérêt à souligner ce point ? Un tel argument pourrait se révéler contre-productif ; si nous voulons conserver l’unité des Vingt-Sept, nous pourrions avoir intérêt, plutôt que de jouer cartes sur table, à garder quelques atouts dans notre manche. Les conséquences du nouveau calcul seront importantes, et certains pays qui soutenaient traditionnellement le Royaume-Uni vont être orphelins, surtout si nous arrivons à constituer une équipe franco-allemande restreinte.
Je souligne d’ailleurs que l’Espagne a déjà brisé l’unité et adopté la rhétorique britannique en souhaitant la négociation d’un seul accord et non pas de deux accords distincts.
Vous reprenez les chiffres de soldes migratoires donnés par Mme Sylvie Bermann. Or, pour la France en tout cas, ils sont contredits par ceux du ministère de l’intérieur. Il y a chaque année dans notre pays 200 000 entrées légales, ainsi que 100 000 migrants accueillis au titre de l’asile. Le solde migratoire est donc à peu près équivalent.
J’en terminerai avec les quatorze recommandations du rapport. Elles sont pertinentes, mais à mon sens il en manque une. Une chose est de dire, comme Mme Guigou ; « Europe, Europe, renforcement de l’Europe ! » ; une autre est de se rendre compte que nous ne nous trouvons pas par hasard dans une telle situation. Si les Britanniques partent, ce n’est pas parce qu’ils sont « affreux » et qu’ils ont depuis toujours un pied dedans et un pied dehors : si nous organisions en France un référendum de ce type, nous ne serions pas bien du tout non plus ! Si nous voulons sérieusement sauver la construction européenne, nous aurions donc intérêt à réfléchir aux leçons à tirer de cette affaire, ainsi qu’aux rendez-vous manqués dans la négociation avec David Cameron.
Je serais donc favorable à une quinzième recommandation : pourquoi ne pas proposer la création d’un comité des sages qui aurait pour mission de s’interroger sur les changements, institutionnels et autres, nécessaires pour poursuivre l’entreprise européenne ? Pour ne pas jouer toujours en défense, la prospective est indispensable. Il faut repenser les frontières de l’Europe, la question migratoire, le gouvernement économique de la zone euro ; il faut redéfinir les négociations commerciales pour qu’elles ne soient pas hors-sol, simplement confiées à un commissaire européen, et pour ne pas entendre à nouveau « circulez, il n’y a rien à voir » ; il faut forcer l’union militaire de l’Europe. Voilà des thèmes auxquels nos gouvernements pourraient réfléchir ensemble, à partir de l’épreuve que nous traversons avec le Brexit. Sans cette réflexion sur l’avenir, tout cela n’aura servi à rien – sinon, certes, à préparer cette négociation si complexe. Nous sommes tous ici attachés à l’effort de rassemblement européen : voilà pourquoi nous devons penser au coup suivant. Ce rapport peut y contribuer, et c’est pourquoi je milite fortement pour cette quinzième recommandation.
M. Philip Cordery. Mme Theresa May l’a dit : « Brexit means Brexit ». Ce Brexit sera complet et assumé ; c’est une décision souveraine du peuple britannique et de ses représentants, dont nous ne pouvons que prendre acte. Face à cette situation sans précédent, tout doit être fait pour que la sortie britannique soit aussi peu douloureuse que possible, pour notre pays comme pour toute l’Union.
Je remercie à mon tour notre président Claude Bartolone de son initiative. Le rapport dresse un tableau exhaustif des enjeux du Brexit et fixe nos lignes rouges. Je me retrouve dans ses conclusions ; il est en effet impératif de maintenir l’unité des Vingt-Sept dans la phase de négociations, afin de préserver les fondements de l’Union, et notamment les quatre libertés. Nous pouvons, je crois, faire confiance à Michel Barnier.
Je voudrais insister sur cinq points.
Tout d’abord, il est indispensable qu’un accord soit trouvé très rapidement sur la question des ressortissants européens au Royaume-Uni, et inversement sur la question des ressortissants britanniques qui résident dans l’Union européenne. Leurs droits sociaux doivent être préservés. Axelle Lemaire et Christophe Premat nous alertent régulièrement sur les inquiétudes des Français vivant au Royaume-Uni. À Bruxelles, j’ai pu constater aussi, lors des quatre dernières cérémonies d’accueil, un grand nombre de ceux qui acquièrent la nationalité française étaient des citoyens britanniques. Les fonctionnaires européens ne deviennent pas seulement belges…
Ensuite, le Royaume-Uni doit payer son dû. Ce n’est pas un divorce à l’amiable, mais un départ unilatéral : les engagements financiers pris par les Britanniques doivent être respectés. Aux 60 milliards d’euros que vous évoquez, on aurait d’ailleurs pu ajouter des dommages et intérêts pour préjudice moral, quand on voit le temps passé par les fonctionnaires européens, et par nous tous, à négocier le Brexit ! Ce sont des heures que nous ne passerons pas à approfondir l’Union européenne.
Je voudrais également insister sur la question de la paix. L’Union européenne, c’est la paix. Il n’est que de rappeler le rôle de l’Union européenne dans le processus de paix en Irlande du Nord. Nous devons être très vigilants pour préserver cette paix, ce qui ne sera pas facile : les divisions nord-irlandaises lors du référendum reflètent exactement les anciens camps belligérants. L’Europe aura, malgré le Brexit, une grande responsabilité.
S’agissant de l’arme que pourrait constituer le dumping – fiscal, social et réglementaire – nous devons nous montrer intransigeants. Il y va de la survie de notre modèle social. Le Parlement français doit rester vigilant : une menace de dumping doit interdire tout accord.
Enfin, nous ne devons pas nous détourner de notre objectif, qui est la réorientation et l’approfondissement de l’Union européenne. Le Brexit, en l’occurrence, peut se révéler favorable. Si l’Union est si impopulaire aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle n’est pas aboutie, parce qu’elle est bloquée au milieu du gué. Nous devons approfondir l’union économique et monétaire, mais aussi Schengen, les politiques en matière de sécurité, de transition écologique et énergétique, de numérique… Il faut aller jusqu’au bout de la logique de la construction européenne et mettre en place des politiques communes.
J’ai ici une phrase de désaccord avec le rapport – ce sera la seule. Vous faites de l’unité un préalable à l’approfondissement ; je crois au contraire que, s’il ne faut pas cesser de rechercher l’unité, il faudra aussi construire des majorités. Dans les décennies au cours desquelles il a appartenu à l’Union européenne, le Royaume-Uni a bloqué l’approfondissement et d’autres, demain, comme le Danemark ou la Pologne, pourront jouer ce rôle de trublion. Nous devons donc trouver des majorités pour avancer, car l’unité ne sera pas possible sur tous les sujets.
Il me paraîtrait opportun que la prochaine législature instaure un suivi de cet excellent travail. Je présenterai ce travail à la commission des affaires européennes, et je proposerai la mise en place d’une cellule de veille jusqu’à la fin de cette législature.
M. le président Claude Bartolone. Si les travaux en séance publique sont suspendus, les commissions continuent en effet de travailler jusqu’à la fin du mandat des députés.
M. Jacques Myard. Je salue le travail de fond que constitue ce rapport. Je partage nombre de vos conclusions, monsieur le président. Il faut évidemment défendre nos intérêts, et la distinction entre les deux procédures – l’une prévue par l’article 50, l’autre par les articles 216 à 218 – devrait nous permettre de négocier pied à pied avec nos amis anglais.
Notre objectif doit être, ce que souligne d’ailleurs le rapport, de conserver des liens forts avec le Royaume-Uni. Vous connaissez la fameuse phrase de Talleyrand, qui, à ceux qui lui reprochaient de se rapprocher de l’Angleterre, avait répliqué d’un ton sec et métallique : « Je fais la politique étrangère de ma géographie. » Le Royaume-Uni quitte une organisation internationale, mais il n’a pas bougé !
Je suis donc de ceux qui pensent que nous devons rechercher une union douanière, notamment pour préserver nos exportations. Nous devons bien sûr régler le problème des personnes : les citoyens européens qui le demeureront, comme ceux qui deviendront les citoyens d’un État tiers, ne doivent pas être pris en otage.
Nous devons aussi, et le rapport le souligne, conserver des liens avec différentes agences – Europol, notamment. Cela me paraît possible, sur la base d’accords bilatéraux, de même qu’il me paraît important de préserver le mandat d’arrêt européen. La négociation se fera au cas par cas.
S’agissant du passeport européen, je rejoins entièrement les conclusions du rapport : nos amis anglais ne peuvent pas avoir à la fois « le beurre, l’argent du beurre et la crémière ! » J’appelle votre attention sur le fait que le passeport européen est fonction de l’entreprise financière en cause, banque ou assurance. Si nous parvenons à un accord, celui-ci doit être très clair : si la législation européenne progresse, alors l’autre partie devra appliquer ces avancées. J’insiste donc sur la précarité de ces accords – je vous renvoie à ma contribution écrite. Il faudra être très ferme sur ce point.
En matière de défense, tout a été dit : le Royaume-Uni est en effet un partenaire incontournable, qu’il s’agisse d’équipements militaires ou de coopération dans la lutte contre le terrorisme.
Quant à associer les parlements nationaux, cela devrait aller de soi. Nous ne pouvons pas transiger sur ce point : il y va de notre crédibilité. Je partage entièrement ce que Pierre Lellouche a écrit.
Mais le rapport omet un point central : le Brexit est un révélateur, celui de la crise de l’Union européenne. Je l’avais dit naguère : l’Europe s’étant élargie, elle doit maintenant s’amaigrir et s’en tenir à l’essentiel. Il y a d’autres crises au sein de l’Union européenne, beaucoup d’autres. Il y a une crise de la gouvernance – le ministre de l’agriculture dit lui-même qu’il a mis un an à convaincre le commissaire européen qu’il y avait un problème dans son secteur. Pour modifier une directive européenne en matière de TVA, il faut dix ans, et même plus ! Il y a une crise de l’euro, et je ne partage évidemment pas sur ce point les conclusions d’Élisabeth Guigou : c’est une crise qui est devant nous, et pas derrière. Nous sommes sur un volcan ! Il y a une crise du contrôle des frontières.
À ce titre, je regrette que ce rapport, notamment dans ses recommandations, présente l’Union européenne un peu comme une Europe assiégée : on se replie sur soi-même, on défend bec et ongles les principes sur lesquels a été fondé un logiciel qui a fonctionné pendant des années et a été très novateur, a fait tomber le chauvinisme économique et l’hyper-réglementation des économies de guerre, mais qui ne fonctionne plus aujourd’hui car nous sommes entrés dans la mondialisation ; le monde a changé. Nous manquons la réflexion que nous devons avoir sur cette organisation internationale.
Certains mots trahissent cette fuite en avant, à l’instar du terme « téléologie ». Ce terme employé dans sa jurisprudence par la Cour de justice, et notamment par le grand juriste Pierre Pescatore, représente pour moi la captation démocratique par excellence : les juristes avancent masqués. Je pense que c’est une erreur.
Vos conclusions parlent de rêve européen. Non, nous ne devons plus rêver, nous devons être matter-of-fact, objectifs, savoir à quoi ça sert et combien ça coûte, comme disait le vieux Dassault. Cela signifie que nous devons traiter des points précis. Si l’Union européenne n’est qu’un rêve utopique, nous allons dans le mur. Nous n’échapperons pas à une refondation de l’Union européenne, qui est aujourd’hui une construction « kelsénienne » de hiérarchie des normes – ce qui est adopté en haut s’applique jusque sur les trottoirs de Salonique ou de Paris. Il faut sortir de l’intégrisme kelsénien pour retrouver de la coopération européenne. C’est le seul moyen de sauver cette organisation internationale et ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain.
M. Christophe Premat. Merci, monsieur le président, d’avoir lancé cette mission d’information très rapidement, au mois de juillet dernier, au lendemain du vote du 23 juin. Comme mes collègues, je salue un rapport clair, précis, riche, qui sera utile pour la position de la France. Ce rapport fait honneur à notre Parlement car nous avons grand besoin d’une clarification des positions, des moyens et des fins, et c’est ce à quoi il contribue. Quel que soit le Gouvernement que nous aurons demain, vous avez raison de dire qu’il faut une feuille de route rigoureuse.
Vous avez employé la métaphore du divorce en soulignant que, dans une instance de divorce, il faut aboutir à un accord et en même temps protéger l’avenir. C’est la difficulté de notre mission d’information, qui doit à la fois assurer un moyen terme dans la sortie du Royaume-Uni et montrer que l’Union européenne est capable de surmonter ce divorce et d’aller au-delà.
Je ne sais s’il convient d’entrer dans un débat pour savoir si l’on doit être rusé ou non. La ruse peut être intéressante dans le court terme, mais à long et à moyen terme c’est beaucoup plus délicat, et je pense que la France a au contraire eu raison d’adopter une position très claire. L’Allemagne était au départ dans l’attente. Or nous avons besoin de clarté, comme cela s’est avéré par la suite dans les sommets européens : les derniers Conseils ont montré qu’il y avait unité sur la nécessité de préparer l’avenir en saisissant l’opportunité de resserrer le projet européen sur des politiques communes, peut-être des coopérations. Il faut aussi de la clarté dans le couple franco-allemand.
Un mot sur l’approche culturelle de la Grande-Bretagne dans cette négociation. Le rapport rappelle le débat politique dans ce pays, les tergiversations, l’intervention de la Haute Cour et du Parlement. C’est l’esprit de la Common Law qui domine du côté britannique – « les principes d’abord et nous verrons plus tard pour les modalités » – tandis que notre position est plutôt d’examiner comment déconstruire les traités pour faire en sorte que cette sortie soit viable. Il est important de bien appréhender ce différentiel culturel. Culturellement, le droit européen n’est pas compris des Britanniques.
J’apprécie ce que vous avez dit au sujet de la réciprocité, notamment dans la question des Britanniques présents en France et dans le reste de l’Europe et des Français et Européens présents au Royaume-Uni. Il est important d’obtenir, notamment par rapport aux conditions de résidence, non seulement le respect des quatre libertés mais aussi et surtout la réciprocité. Le Home Office britannique avait tout d’abord compliqué les procédures administratives mais il est revenu sur ce durcissement en annonçant qu’il ne demanderait plus de justificatifs de domicile et autres, mais se baserait sur les impôts.
Il existe par ailleurs de nombreux couples franco-britanniques ; ma contribution au rapport a été de tenter de mesurer concrètement les implications du Brexit pour eux. Cela pose des questions d’impatriation, de transfert de capitaux, de transfert de fonds de pension… Beaucoup d’Européens comptaient avoir une retraite complémentaire par capital et cela devient plus compliqué.
Dans la fin de votre rapport, il est question de la diplomatie européenne. Je parlerais même, quant à moi, de médiation européenne, une médiation pour évoluer d’un accord à l’autre, parvenir à un accord de sortie. Je pense que de nouvelles complications vont se présenter très rapidement dans la discussion sur les principes. L’association des Parlements nationaux me paraît fondamentale. Une question qui se posera également est de savoir s’il faut un secrétaire d’État affecté à la question du Brexit et j’aimerais connaître votre avis sur ce point.
M. Pierre Lequiller. À mon tour, monsieur le président, je vous remercie d’avoir constitué cette mission. Le travail que nous avons conduit, avec de multiples auditions, déplacements et consultations, a été passionnant. Le rapport est extrêmement approfondi.
La situation n’est pas figée, ni d’un côté ni de l’autre. Nous pensions que la Chambre des Communes n’aurait pas à être consultée mais les choses ont évolué et Theresa May a finalement été obligée de la consulter. Je perçois une autre évolution en ce moment en Grande-Bretagne. Nous ne discutons plus du Brexit mais de l’option que Mme May a choisie et qu’elle appelle le hard Brexit ; or des personnes en Grande-Bretagne y sont opposées et le font savoir, à la Chambre des Communes, mais aussi en Écosse, en Irlande du Nord, au Pays de Galles. Notre interlocuteur va connaître des évolutions. C’est pourquoi je suis attaché à la consultation du Parlement national mais aussi à ce que cette mission continue de travailler.
J’ai remarqué combien Michel Barnier était prudent quand nous l’avons auditionné. Il a décliné un certain nombre de problèmes : fonctionnaires britanniques, répartition des députés européens, répartition financière… Ce sont des questions qu’il conviendra d’étudier plus tard ; je pense que nous n’avons pas intérêt à les poser dès aujourd’hui.
Je trouve très bien que vous ayez placé en deuxième position le règlement rapide de la question du statut des citoyens européens, mais je m’interroge sur la formulation d’une certaine phrase. Le problème n’est pas entre Britanniques et Français mais entre Britanniques et Européens. Vous écrivez : « La continuité de leur droit au séjour devrait être garantie sans condition aux expatriés résidant depuis plus de cinq ans dans leur pays d’accueil », mais nous n’avons pas consulté les Polonais, qui sont les premiers concernés. Ne transposons-nous pas là une question qui se situe entre les Britanniques et nous, et ne prenons-nous pas position par rapport aux pays qui sont les principaux concernés, comme la Pologne ou la République tchèque ?
Dans les quatorze propositions, il faudrait insister bien davantage sur la défense européenne, dont il n’est question qu’à travers une énumération avec la politique énergétique, la politique industrielle, la mobilité, la gestion extérieure des frontières... Je pense que cela demanderait un quinzième point. On ne parle pas de l’évolution des États-Unis depuis l’élection de Donald Trump, évolution très inquiétante en matière de défense. De même, on omet quelque chose de très important dans le discours de Theresa May, qui a déclaré qu’elle souhaitait maintenir la coopération entre la France et la Grande-Bretagne, dans le cadre des accords de Lancaster House. C’est un point positif, affirmé dès l’abord par la Grande-Bretagne. Je ferais donc un point élargi et précis sur la défense européenne. D’autant plus que l’Allemagne a changé de position sur le sujet, augmente son budget de défense et souhaite, selon les déclarations de Mme Merkel et de Mme Ursula von der Leyen, une coopération plus importante dans ce domaine. De même, je me suis rendu à la grande réunion du Partido Popular en Espagne : les Espagnols sont très demandeurs.
Je suis totalement d’accord avec Mme Guigou sur le fait qu’il ne faut pas se montrer punitif. Avant même que nous ayons commencé nos travaux, j’avais été frappé de constater qu’il existait chez les Britanniques le sentiment que la France était dure et que l’Allemagne était plus souple. L’Allemagne n’a pas pris position avant le déclenchement de l’article 50 ; c’est ce qui a donné l’impression que l’Allemagne était moins « punitive » que nous. J’insisterais donc bien plus sur le fait que notre position n’est pas punitive ; il faut que la coopération franco-allemande soit très forte et nous sommes d’ailleurs à présent sur les mêmes positions.
À cet égard, la rédaction du point 9 des conclusions du rapport me met mal à l’aise. On y lit en effet : « Le Brexit n’est effectivement pas un jeu à somme nulle. Il ne peut cependant être un jeu dans lequel tout le monde gagne. Il y aura des perdants ». Que signifient ces phrases ? Qu’allons-nous perdre ?
M. le président Claude Bartolone. Nous, non. Mais, précisément pour ne pas paraître « punitif », je n’ai pas voulu dire qui allait perdre.
M. Pierre Lequiller. Le Royaume-Uni devrait donc absolument perdre ? Dans l’esprit de ce que j’ai dit précédemment, je ne suis pas favorable à cette formulation qui anticipe les négociations. Je n’en perçois pas l’intérêt.
M. le président Claude Bartolone. Je comprends parfaitement que, pour des raisons diplomatiques, on souhaite ne pas insister sur ce point. Mais ces conclusions sont dans l’axe du rapport, qui fixe de la manière la plus nette qu’un État quittant l’Union européenne ne peut avoir les mêmes avantages que les États qui en restent membres.
M. Pierre Lequiller. Mieux vaudrait écrire les choses de cette manière plutôt que de mentionner de façon vague « des perdants », sans spécifier de qui il s’agit.
M. le président Claude Bartolone. C’est dit plusieurs fois dans le corps du rapport.
M. Joël Giraud. Ce rapport de grande qualité appelle deux commentaires. Pour commencer, j’ai été frappé de constater combien nos interlocuteurs, qu’ils soient membres d’institutions européennes ou de gouvernements, ont apprécié le fait qu’un parlement national se saisisse du sujet. C’est la démonstration du rôle essentiel – et il devra sans cesse être rappelé – que doivent jouer les parlements nationaux dans le contrôle de l’action des gouvernements européens au cours du processus qui s’engage, pour porter la voix des citoyens. Si cela n’est pas fait, on aboutira au rejet croissant de la démocratie représentative et à la prise de pouvoir d’autres formes de « démocratie » qui relèvent parfois davantage de la dictature, telle celle des réseaux sociaux, ou de l’exercice de minorités de blocage. C’est pourquoi la recommandation de Pierre Lellouche me semble devoir être entendue.
Ensuite, le rapport dit, à raison, la nécessité de poursuivre l’approfondissement de l’Union. Mais on semble s’en tenir un peu trop à l’application de la feuille de route établie dans la déclaration de Bratislava. Or, elle est au minimum évasive, puisque l’harmonisation sociale et fiscale, qui compte pour les Européens et sans laquelle l’Union ne pourra fonctionner durablement, n’y est pas précisément évoquée. Mieux vaudrait citer explicitement les grands chantiers qui nous attendent.
M. Daniel Fasquelle. Je salue le travail accompli. J’approuve les grandes lignes du rapport et les propositions qu’il contient. Je partage le point de vue que les Vingt-Sept doivent rester unis face à un Royaume-Uni qui cherchera à les diviser et à engager des négociations bilatérales ; il en va de l’avenir de l’Union. J’approuve aussi l’idée qu’un État sorti de l’Union ne saurait bénéficier des mêmes avantages que ceux qui y restent. En serait-il autrement que d’autres pays nous quitteraient. La division, d’une part, l’éventualité qu’un État ayant quitté l’Union soit mieux loti en dehors d’elle qu’en son sein, d’autre part, sont pour l’Europe deux dangers mortels. Aussi importantes que soient les modalités techniques de la négociation, elles ne doivent pas masquer la question essentielle, celle de l’avenir de la construction européenne.
Sur un autre plan, en ma qualité de député du Pas-de-Calais, j’invite à tenir compte de l’impact du Brexit sur les zones frontalières du Royaume-Uni. On n’a pas suffisamment conscience des liens très forts qui nous unissent ; ils font que nous sommes particulièrement concernés par le Brexit. On ne saurait, c’est vrai, se lancer dans une négociation secteur par secteur. Cependant, je me dois de tirer la sonnette d’alarme au sujet de l’impact du Brexit pour la pêche : 85 % des poissons ramenés par les marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer et de la Côte d’Opale proviennent de la zone de pêche britannique.
On ne peut davantage mésestimer les conséquences potentielles du Brexit sur le tourisme, dont de nombreux emplois dépendent, et sur l’économie « résidentielle ». Le rapport évoque les Britanniques qui, ayant choisi de vivre en France, contribuent à son économie. Mais il y a aussi les touristes « ordinaires », et se pose donc la question de l’avenir des accords du Touquet. Il ne faudrait pas que la négociation ait pour conséquence l’allongement des files d’attente aux frontières, car nous serions immédiatement sanctionnés : les touristes britanniques seraient découragés de séjourner dans le Pas-de-Calais, alors qu’ils constituent présentement le quart de la clientèle des hôtels du Touquet.
D’autre part, le problème de Calais n’a été réglé que momentanément : la question du traitement des demandeurs d’asile qui veulent se rendre en Grande-Bretagne se reposera puisque, par le traité du Touquet, on a déplacé les frontières britanniques en France. Au-delà se pose la question des accords de Dublin, dont on ne sait quel sera l’avenir. Comment va-t-on traiter les demandeurs d’asile qui veulent franchir la Manche et qui, en attendant que leur demande d’asile soit examinée, doivent être hébergés ? Certes, le traité du Touquet est un accord de coopération franco-britannique, mais cette très grave question, qui peut empoisonner les relations entre nos deux pays, devra quoi qu’il en soit être réglée au cours de la négociation du Brexit.
Il faudra aussi déterminer comment la France se positionnera pour récupérer l’une au moins des institutions européennes dont le siège est actuellement au Royaume-Uni.
Il est dommage que, comme l’a souligné Mme Guigou, nous subissions le Brexit faute d’avoir suffisamment réfléchi au projet européen. Nous devons à nouveau prendre des initiatives. J’avais dit lors de notre visite à Bruxelles qu’il convient, à mon sens, de réfléchir à une Europe constituée en trois cercles. Autour d’un premier cercle politique formé autour du couple franco-allemand, il y aurait ensuite une zone plus large de pays voulant être dans une zone de libre-échange – ce que souhaitait le Royaume-Uni dès l’origine et qui explique que le Brexit était en réalité en germe dès l’adhésion de ce pays à l’Union européenne. Le troisième cercle serait constitué par une zone encore plus large d’États ayant vocation à coopérer avec l’Europe mais pas nécessairement à l’intégrer ; elle pourrait inclure des pays tels que la Turquie ou l’Ukraine, voire la Russie avec laquelle nous devons construire une relation durable. Il faut non seulement débattre de la manière de négocier le Brexit mais aussi relancer le projet européen.
M. Gilles Savary. Mes compliments s’ajoutent à ceux qui ont été adressés, à juste titre, aux auteurs de ce rapport qui débroussaille la complexe négociation à venir et en éclaire les termes.
Il n’est pas inutile d’associer les parlements nationaux aux accords de sortie de l’Union et pour cela de les consulter. Leur permettre de s’exprimer sur le résultat des négociations ne doit pas les conduire à revendiquer trop fortement la participation à la décision. Procéder de la sorte serait inviter le Royaume-Uni à rejouer les Horaces et les Curiaces, avec le risque qu’un parlement national provoque le blocage de la négociation. La garantie de l’unité des Vingt-Sept est le mandat le plus impératif donné à la Commission et au Parlement européen. Demander que la négociation soit approuvée par des ratifications nationales affaiblirait considérablement la position des négociateurs européens car le Royaume-Uni s’empresserait de conclure des accords bilatéraux avec tel pays ou tel autre. Cela pourrait avoir pour conséquence que, pour une tout autre raison, un pays s’oppose par exemple à l’interdiction du bénéfice du passeport financier européen pour la City, rendant cette interdiction impossible. Gardons à l’esprit que les diplomates britanniques sont de redoutables négociateurs.
Il aurait été judicieux de demander que la conférence interparlementaire prévue par l’article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire soit saisie d’une mission de suivi de la négociation. Cette conférence a toute son utilité : elle permet de prendre la température, en même temps, des différents groupes politiques de l’ensemble des parlements nationaux, et de tisser des liens. Que la position de chacun soit ainsi éclairée permet d’orienter puissamment la diplomatie parlementaire, j’en ai été témoin pour d’autres sujets – le budget et les travailleurs détachés.
Les remarquables travaux qui ont été conduits dans notre instance ne pouvaient, à ce stade, aller plus loin, mais ils ne s’adressent qu’à des spécialistes des questions européennes. Il serait bon de créer un observatoire chargé de mesurer l’impact socio-économique du Brexit pour la France. Pour la raison dite par Daniel Fasquelle, le Brexit est un sujet de panique pour la pêche française, et en ce cas l’impact ne sera pas forcément négatif pour les Britanniques. Le discours selon lequel ils s’abîmeront avec le Brexit est réducteur : ils peuvent aussi nous faire mal.
Ainsi, les principales compagnies aériennes européennes ont demandé que mandat soit confié à la Commission européenne de négocier avec les pays du Golfe, dont les compagnies leur livrent une concurrence résolument déloyale pour les longs courriers. La négociation ne peut être menée que par l’Union ; si elle était faite par chaque État membre séparément, des autorisations de trafic seraient délivrées à nos portes et les compagnies aériennes européennes s’effondreraient toutes, au bénéfice de celles des pays du Golfe. Quand, demain, le Royaume-Uni ne sera plus partie à ce mandat de négociation, l’aéroport de Gatwick s’ouvrira-il massivement à Etihad, Qatar Airways et Emirates ? Voilà une question à suivre de près. Quel sera d’autre part l’avenir d’Airbus, et que deviendra Easyjet, société de droit britannique au poids considérable dans le secteur aérien ? D’innombrables questions de cet ordre se posent à nous, s’agissant de l’impact du Brexit sur nos économies. Celle de nos exportations n’est pas la moindre puisque l’on nous dit que si notre déficit commercial a atteint 48 milliards d’euros en 2016, c’est en partie parce que le Royaume-Uni a importé moins de nos produits. En bref, il ne s’agit pas de surveiller seulement la technostructure bruxelloise mais aussi l’impact du Brexit sur l’ensemble de notre économie. Pour ce faire, l’observatoire du Brexit dont je propose la création devrait, tout au long de la négociation, entendre les représentants socio-professionnels nous éclairer sur leurs inquiétudes.
M. Éric Elkouby. L’excellent rapport qui nous est soumis évoque le déménagement à venir des agences européennes installées au Royaume-Uni. Il serait bon de préciser que l’Agence européenne du médicament aurait vocation à s’installer en France, et plus précisément à Strasbourg. Cela renforcerait le rôle européen de la ville, et par ricochet son importance pour le Parlement européen. La question est cruciale.
Mme Élisabeth Guigou. Je pense, comme Philip Cordery, que l’on pourrait atténuer la phrase selon laquelle « conserver la cohésion des États membres est un prérequis pour les négociations en faveur d’une autre Europe ». Il faut montrer que cette unité peut être préservée justement par la différenciation : nous ne sommes pas obligés d’être d’accord absolument sur tout, mais, pour les négociations avec le Royaume-Uni, il faut tenir sur les lignes fermes exposées dans le rapport.
J’ai la ferme intention que la commission des affaires étrangères suive les étapes de la négociation, et je suis décidée à la convoquer, le cas échéant, d’ici la fin de la législature si quelque chose tournait mal. Je suppose que la commission des affaires européennes et la commission des finances sont dans le même état d’esprit.
La suggestion qui vient d’être faite est bonne. Le Secrétariat général des affaires européennes va établir précisément le tableau des intérêts français et suivre les négociations pas à pas pour chacun. On pourra avoir plusieurs dispositifs.
Je partage les réserves exprimées par Gilles Savary au sujet des modalités d’expression des parlements nationaux. Les Britanniques ne manqueront pas d’entrer en contact avec chacun d’eux et l’on ne peut risquer des surenchères au moment de la ratification de l’accord de sortie. Je suis donc favorable à ce que notre Parlement se prononce et débatte mais défavorable à un mandat impératif – ce que le traité ne permet d’ailleurs pas pour l’instant – aux parlements nationaux. Ce serait périlleux au regard de la ligne à tenir au cours de la négociation.
Enfin, il est vrai que nous restons quelque peu sur notre faim s’agissant de ce que le Brexit dit de l’avenir de l’Union européenne. Le rapport traite de l’union économique et monétaire, de l’Europe de la justice avec le mandat d’arrêt européen et de l’Europe de la défense. Peut-être une proposition complémentaire serait-elle effectivement bienvenue, pour exprimer plus fortement que nous allons non seulement suivre la négociation mais aussi être à l’initiative sur l’avenir de l’Union, tant il est vrai que le Brexit met en lumière une crise préexistante. Il n’importe pas de se prononcer dès à présent sur la formule retenue – comité des sages, conférence, observatoire ? – mais il faut en tout cas manifester que nous, Parlement national, voulons continuer de travailler à l’avenir de l’Union européenne.
Je rejoins Pierre Lellouche : il va falloir travailler sur les frontières et sur nos politiques communes, non parce que c’est notre rêve mais parce que c’est notre intérêt. Par là, je n’entends pas seulement les politiques internes : il est de l’intérêt de la France d’amener tous les Européens à s’intéresser à la politique extérieure de l’Union européenne, à sa politique de sécurité et de défense. Il est aussi de son intérêt de donner une dimension extérieure à toutes ses politiques internes – l’extraterritorialité de l’application des lois américaines met la question à l’ordre du jour.
Peut-être cela pourrait-il faire l’objet d’un dernier paragraphe, sans que soit forcément précisée la forme que cela prendrait, car nous ne disposons plus du temps nécessaire pour en débattre.
M. le président Claude Bartolone. Merci à tous, chers collègues. Vous avez abordé un certain nombre de questions et nous allons voir comment intégrer vos remarques. Cela dit, des développements sont déjà consacrés à la question de la relance de l’Union européenne. Je précise à mes amis de la majorité que je n’ai pas voulu en rajouter en insistant sur ce qui aurait pu être fait depuis le début de la législature, notamment dans le cadre franco-allemand et au moment de la crise de la zone euro. Tout ne date pas du Brexit, et si celui-ci représente un défi pour l’Union européenne, c’est parce que l’enjeu excède le seul accord de retrait du Royaume-Uni. Nous devons faire en sorte que l’Union européenne fasse de nouveau envie. Rendez-vous compte : un pays estime qu’il sera mieux protégé à l’extérieur de l’Union qu’à l’intérieur ! L’idée est assez insupportable.
M. Pierre Lequiller. Monsieur le président, selon des sondages réalisés après le Brexit, notamment en France et en Allemagne, le sentiment européen semble plus fort qu’avant le Brexit. Non seulement les citoyens européens interrogés n’ont aucune envie de quitter l’Union européenne, mais le Brexit fait figure de repoussoir pour un certain nombre d’entre eux.
M. le président Claude Bartolone. C’est évident. Prenons un exemple franco-français : si un certain parti populiste est désormais plus réservé sur l’idée d’une sortie de l’espace protecteur de la zone euro, c’est notamment parce que de nombreux retraités ont compris que cela entraînerait une dévaluation, avec tout ce que cela implique. Alors, bien sûr, la situation dans laquelle nous nous trouvons résulte du choix de nos amis britanniques, mais nous devons aussi nous demander que faire maintenant. Reconnaissons-le les uns et les autres, c’est aussi un document testamentaire que nous laissons. Nous léguons un certain nombre d’indications à la prochaine majorité, quelle qu’elle soit.
Il faudra notamment être très attentif aux efforts diplomatiques que pourront déployer les Britanniques – nous connaissons leur talent en la matière. Prenons-y garde : ils pourraient chercher à profiter de la séquence électorale qui s’ouvre en France et en Allemagne. Cela étant, notre travail et le document qui en est issu témoigneront, pour les spécialistes, de l’existence d’un « centre de gravité » qui nous est commun.
Le défi qui nous est lancé conduira peut-être cette « Assemblée du non-cumul » qui naîtra des prochaines élections législatives à revoir sa propre organisation. Nous mesurons l’importance de la question européenne, une importance qui tient à des facteurs internes, à des facteurs internationaux, à des questions de frontières, à des raisons de sécurité, et à un certain nombre de politiques verticales. À cet égard, j’ai bien entendu les remarques faites par Gilles Savary et Daniel Fasquelle, et je suis bien conscient de certaines préoccupations, que suscite notamment la pêche, mais veillons à ne pas nous laisser entraîner dans un piège. Imaginez quelles possibilités s’ouvrent au Royaume-Uni si nous commençons à négocier politique par politique ! Il faut l’avoir à l’esprit.
Il faut aussi trouver le bon mode d’association des parlements nationaux. La sortie du Royaume-Uni relève d’une décision européenne, mais, comme le suggère Pierre Lellouche dans sa lettre, il ne saurait être question de dire aux parlements nationaux : « Circulez, il n’y a rien à voir ! » Ou alors nous irions au-devant de graves difficultés, notamment lorsqu’il sera question d’envisager la suite. Ce serait une erreur de considérer que la question n’est l’affaire que de l’échelon européen.
Il est bon aussi que ce débat repose la question de l’Europe à plusieurs cercles, de la zone euro à l’Europe des Vingt-Sept, et même au-delà. Songeons au message adressé à l’Ukraine, à un certain nombre de pays d’Afrique du Nord. Il nous faut envisager, c’est inéluctable, quels espaces de coopération sont possibles.
M. Pierre Lellouche. Pensez à cette quinzième recommandation : sortir par le haut !
M. le président Claude Bartolone. C’est un peu l’âme de ce rapport : nous ne dressons pas simplement un constat, à la manière d’un huissier, nous voulons faire quelque chose de tout cela pour donner une espérance européenne.
Mes chers collègues, chacun s’étant exprimé, il revient à notre mission, en application de l’article 145 du Règlement, de voter sur le rapport qui vous est aujourd’hui soumis.
La mission d’information adopte à l’unanimité, moins une abstention, le rapport, autorisant ainsi sa publication (143).
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA MISSION
CONTRIBUTION DE M. PIERRE LELLOUCHE, DÉPUTÉ DE LA 1re CIRCONSCRIPTION DE PARIS
Courrier adressé au Président-Rapporteur M. Claude Bartolone le 1er février 2017
Monsieur le Président,
J’ai, comme vous le savez, l’honneur de servir comme membre de la mission d’information spéciale créée sous votre présidence, sur l’évaluation du Brexit.
Dans un discours récent du 17 janvier 2017, Mme Theresa May annonçait la décision du Gouvernement britannique de mettre en œuvre l’article 50 du traité de l’Union, qui donnera le signal du début des négociations conduisant à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, dans un délai de deux ans.
Si à l’issue de cette période, aucun accord n’est trouvé entre les parties, c’est-à-dire entre l’Union d’une part et le Royaume-Uni d’autre part, la sortie du Royaume se fera donc de façon « sèche » en mars 2019.
D’ici là, une négociation extrêmement complexe, comme nous avons pu le mesurer au fil de nos travaux, va donc s’engager. Cette négociation sera conduite par un négociateur européen, en l’occurrence Michel Barnier, qui sera doté d’un mandat des États membres, et qui négociera avec les moyens de la Commission européenne, au nom de l’Union.
Si j’ai bien compris, notre objectif politique – et il me parait fondé – consiste à aboutir à l’issue de ce processus à deux accords distincts :
- un accord sur les conditions de sortie du Royaume-Uni assorti, le cas échéant, de mesures transitoires ;
- un accord douanier, voire de libre-échange, comprenant sans doute des clauses politiques, qui régira les relations futures entre le Royaume-Uni devenu État tiers, et l’Union européenne.
À ce stade, il me paraît nécessaire d’insister auprès de vous pour que le rôle de l’Assemblée nationale soit clairement défini dans le processus qui commence, afin que la Représentation nationale soit pleinement associée à chaque étape de celui-ci. Et ce, en particulier dans les trois moments clefs que seront :
– premièrement, la définition précise du mandat confié au négociateur européen. Il est indispensable que les parlementaires soient non seulement informés, mais consultés, sur le mandat qui sera confié par l’Exécutif à Michel Barnier. Et ce, afin que les objectifs et la stratégie qui seront ceux de la France et de l’Union soient connus, compris et partagés par tous, avant le début de la négociation.
Ainsi évitera-t-on ce qui s’est passé dans les négociations du TAFTA où, en raison de l’impréparation évidente du mandat (notamment du côté français) confié à la Commissaire européenne chargée du commerce extérieur, on aboutisse à une situation où le Gouvernement français estime que les négociations avec les États-Unis ont échoué ; qu’elles devraient donc être suspendues voire terminées, alors même que celles-ci en fait continuent, et que la France ayant confié son mandat, n’a pas le pouvoir d’interrompre la négociation conduite en son nom (et au nom de l’ensemble des autres états membres) avec les États-Unis.
– en plus de la question du mandat, se pose la question de la ratification du premier accord éventuellement conclu avec le Royaume-Uni, à savoir l’accord de sortie. Le Gouvernement britannique a annoncé que cet accord sera soumis à la ratification de la Chambre des Communes, ce qui est d’ailleurs parfaitement normal. En revanche l’article 50 ne prévoit pas une telle ratification, autrement que par le Parlement européen.
Il est toutefois difficile d’imaginer que ce premier accord, qui entrainera de très importantes conséquences financières, politiques et juridiques pour la République française, puisse entrer en vigueur sans être ratifié par le Parlement français. J’attire donc dès à présent votre attention sur le fait qu’un tel processus de ratification doit être envisagé. Il serait inconvenable qu’un acte aussi grave que les conditions de sortie du Royaume-Uni ne puisse être discuté et approuvé devant notre Assemblée.
– Il en va naturellement de même pour le deuxième accord, qui déterminera les conditions du futur statut du Royaume-Uni par rapport à l’Union européenne, une fois que celui-ci sera sorti de l’Union. Là encore, cet accord engagera une multitude de points politiques, financiers, juridiques voire stratégiques, qui intéressent directement la souveraineté de la République. Il va de soi à mes yeux qu’un tel accord devra lui aussi être discuté et ratifié par notre Assemblée.
Je mesure naturellement le fait qu’en raison du calendrier électoral, les considérations qui précèdent seront examinées, voire mises en application, sous la prochaine Législature et par la future Assemblée nationale qui sera élue le 18 juin prochain.
Je tenais néanmoins à vous faire part de ces préoccupations, partagées par mon Groupe, afin, je l’espère, de connaître vos réactions et de les inscrire comme l’un des axes de travail pour votre successeur.
CONTRIBUTION DE M. JACQUES MYARD, DÉPUTÉ DE LA 5e CIRCONSCRIPTION DES YVELINES
Brexit : soyons lucides !
Le 23 juin 2016, les Britanniques se sont prononcés par Référendum en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Ce résultat redouté a provoqué la consternation chez les thuriféraires de l’actuel projet européen, consternation doublée parfois d’une volonté de punir ces maudits Anglais coupables de crime de lèse-Europe, pour ne pas dire de lèse-utopie.
Comme toujours, il convient de raison garder et surtout d’éviter la politique du pire au regard de nos intérêts nationaux bien compris qui ne s’identifient pas toujours à ceux de nos partenaires européens, voire aux principes défendus par l’Union européenne.
1) Le Brexit, un révélateur
Les raisons du Brexit sont multiples et il convient d’être prudent pour ne pas privilégier une cause par rapport aux autres.
De nombreux analystes pensent que la question des travailleurs venant des pays de l’Est (notamment de Pologne) a été l’un des facteurs déterminants, alors même que la liberté de circulation des personnes est l’une des quatre libertés de l’Union européenne.
En réalité, les raisons du Brexit doivent être recherchées dans un ensemble d’éléments qui relève de la conscience collective des Britanniques qui perçoivent dans l’Union européenne un processus aliénateur et captateur de leur souveraineté démocratique, voire de leur identité.
Or il serait vain de feindre qu’ils sont les seuls à avoir ce jugement sur l’Union européenne.
Bien au contraire, nombre de peuples européens ont le sentiment d’être entraînés dans un projet intégriste qui ne se justifie pas. Le rejet en France et aux Pays-Bas du Traité Constitutionnel en 2005 l’atteste.
Le Brexit est bien un révélateur de la crise de l’Union européenne, un rappel aux réalités pour les utopistes.
De plus, si le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne qui est une organisation internationale prévoyant expressément qu’un État puisse se retirer de l’Union (article 50 du Traité), le Royaume-Uni est toujours en Europe. La géographie reste une donnée intangible.
Comme le rappelait à juste titre Talleyrand, on fait toujours la politique étrangère de notre géographie, ne l’oublions pas, au nom de nos intérêts bien compris.
2) Les enjeux économiques
Ils sont de deux ordres :
• les enjeux commerciaux ;
• les enjeux financiers : le passeport européen.
Les enjeux commerciaux relèvent de l’Union douanière et de la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Le Marché commun est à l’origine du projet européen, il est au fondement même de l’Union européenne.
La France a un excédent commercial avec le Royaume-Uni de plus de 12 milliards d’euros qui représente le plus important excédent commercial de la France. De plus, la France est le quatrième investisseur au Royaume-Uni, le Royaume-Uni est le troisième investisseur en France.
48 000 Français travaillent à Londres et représentent 2 % des employés de la Cité dans les banques d’investissement et opérations de marchés.
Notre objectif doit être clair, maintenir cet avantage et faire adopter dans le futur accord l’absence de droits de douane avec le Royaume-Uni.
Les enjeux financiers : le passeport européen
Dans le cadre de la législation européenne actuelle, une entreprise, notamment financière, installée à la Cité de Londres, peut agir sur tout l’espace de l’Union européenne sans discrimination ; c’est le passeport européen.
L’expérience des banquiers de la Cité, leur expertise internationale, donne à cette place financière une force redoutable avec le concours de jeunes et brillants mathématiciens français… La Cité a tiré un immense avantage des possibilités d’action, on comprend dès lors pourquoi elle s’est opposée au Brexit.
Il ne saurait être question que la Cité puisse toujours bénéficier du passeport européen pour des montages financiers.
Si un accord de reconnaissance mutuelle dans le domaine financier est possible, il ne doit être que sectoriel et sur une base précaire afin qu’en cas de nouvelle législation dans le domaine financier de l’Union européenne, il puisse être vérifié si elle est appliquée par le Royaume-Uni.
Mais surtout, la sortie de la Cité des dispositions du « passeport européen » nécessite des efforts d’adaptation de la France pour recevoir les entreprises financières qui souhaiteraient s’établir sur le continent.
Paris doit, à ce titre, établir un statut de l’impatrié afin d’être concurrentiel face à d’autres places européennes. Il est urgent d’agir !
Le statut des personnes, acteurs économiques
Réglons aussi dans le meilleur esprit le sort des milliers de nationaux de part et d’autre de la Manche qui apportent chacun en ce qui le concerne, une valeur ajoutée à leur pays de résidence. Ils ne doivent pas être pris en otage.
3) Les enjeux géostratégiques
Le Royaume-Uni est notre allié et le demeure plus que jamais.
Membre permanent du Conseil de Sécurité, membre de l’Alliance atlantique, il est avec la France le seul pays à disposer en Europe occidentale de forces armées crédibles, même si sa force de frappe nucléaire ne bénéficie pas d’une totale indépendance en raison d’équipements américains, à la différence de la France.
La France entretient avec le Royaume-Uni une étroite coopération militaire depuis les Traités de Lancaster House de 2010 : mutualisation des matériels et équipements, utilisation des porte-avions, entretien mutuel de l’ A 400M, recherche commune en matière industrielle.
En matière de lutte contre le terrorisme islamique, la coopération est très étroite entre les services compétents.
Conclusion
Tout en défendant fermement nos intérêts, rien ne sert de courir « sus à l’Anglais » !
Nos intérêts diplomatiques, politiques et économiques sont étroits et mutuels avec le Royaume-Uni.
Toute volonté de vouloir punir Londres au nom d’un projet européen en question aujourd’hui et rejeté par les peuples, serait contre-productive et vouée à l’échec.
L’Europe doit être refondée non sur des utopies mais sur la réalité des Nations.
Nous devons, en conséquence, trouver des solutions de compromis dans nos relations avec le Royaume-Uni et dépasser le stade du ressentiment.
Nous pourrons alors en toute sérénité continuer à dire du mal de nos chers amis Anglais, ce qui reste un sport national !
CONTRIBUTION DE M. CHRISTOPHE PREMAT, DÉPUTÉ DE LA 3e CIRCONSCRIPTION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (ROYAUME-UNI ET EUROPE DU NORD)
Le Brexit vécu au quotidien par les Français établis au Royaume-Uni : analyse des témoignages reçus.
Plus de sept mois après le vote choc du Brexit, les Français établis au Royaume-Uni sont toujours aussi inquiets. Dès l’annonce de la date du référendum par l’ancien Premier ministre David Cameron, j’avais commencé à recevoir des questions de la part de nos concitoyens au Royaume-Uni qui s’inquiétaient d’une éventuelle victoire du « non ». Les inquiétudes portaient sur l’éventuelle nécessité d’obtenir un permis de travail, la hausse des frais de scolarité dans les universités britanniques ou encore l’éventuel retrait des aides sociales pour les ressortissants européens. Au lendemain du vote, les questions se sont multipliées avec beaucoup d’interrogations, notamment sur l’opportunité de faire une demande de carte de résident permanent et/ou de nationalité britannique.
J’ai décidé en fin d’année 2016, de donner la parole à ces citoyens français résidant sur le sol britannique, pour qu’ils puissent s’exprimer librement sur cette situation qu’ils vivent au quotidien. Nous avons, depuis fin décembre, recueilli et publié 27 témoignages de Français nous faisant part de leur colère et de leurs frustrations, de leur tristesse et de leurs angoisses et de leur souhait d´influencer le débat public en France sur les conséquences du Brexit.
C’est sur ces portraits de Françaises et Français que je souhaite aujourd’hui vous faire un bref retour, portraits étayés par les 500 interpellations reçues depuis juin dernier (courriels, échanges lors de permanences téléphoniques ou de réunions publiques sur le terrain, conférences), et qui dressent un bilan provisoire de la situation à laquelle sont confrontés nos concitoyens suite au vote du 23 juin 2016.
Les motifs d’inquiétude sont nombreux, notamment en raison de l’incertitude qui pèse comme une épée de Damoclès sur les ressortissants européens vivant au Royaume-Uni.
De l’ensemble des témoignages et des interpellations reçues, se dégagent plusieurs thèmes : les inquiétudes liées aux prestations sociales, aux questions financières, aux questions de vie quotidienne, familiale et/ou professionnelle, aux négociations et aux démarches à entreprendre.
a) Les principales préoccupations des Français établis au Royaume-Uni
La première ministre britannique Theresa May a confirmé, dans son discours du 17 janvier dernier, son intention de s’engager dans la voie d’un hard Brexit, avec sortie du marché unique européen, abandon du principe de libre circulation des personnes et contrôle étroit des flux d’immigration au Royaume-Uni. Ce discours était très attendu par les Français et autres ressortissants européens résidant dans le pays, pour qui les enjeux sont grands. Si, dans la présentation de ses points clés, la première ministre a assuré vouloir défendre les droits des Européens en Grande-Bretagne et des Britanniques dans l’Union européenne, elle n’a donné aucune garantie et n’a présenté aucun élément nouveau sur cette préservation des droits des expatriés, que le gouvernement britannique compte utiliser comme monnaie d’échange dans les négociations de sortie. C’est une des grandes craintes des Français, que l’on retrouve dans la plupart des témoignages reçus : « être pris en otage dans les négociations avec l’Europe ». Cela les révolte profondément. Ils ont construit une vie au Royaume-Uni, ont contribué activement à l’économie du pays et ont désormais l’impression d’être considérés comme « a bargaining chip » ou « monnaie d’échange » (expression reprise par le groupe des « 3 millions », qui s’est constitué au lendemain du vote et qui se présente comme le porte–parole des ressortissants européens au Royaume-Uni).
Cette situation est difficile et angoissante pour les ressortissants français, qui souhaitent obtenir plus de garanties sur leur avenir en Grande-Bretagne, principalement sur leur liberté de circulation, sur la préservation de leur vie de famille (notamment pour les familles binationales, réellement désemparées : « en cas de perte d’emploi quid de la possibilité de rester avec ma compagne et mes enfants britanniques sur le territoire ? »), le versement de leur retraite, l’accès aux soins (NHS, carte européenne de santé), l’autorisation de travailler, le maintien des prestations sociales et le transfert de capitaux.
b) Une inquiétude amplifiée pour certains par la recrudescence d’actes à caractère raciste
La recrudescence des actes à caractère xénophobe est réelle, après le vote du Brexit mais elle reste à nuancer, car les témoignages reçus évoquent bien souvent des actes isolés.
Lors d’une réunion publique en Ecosse en janvier, qui rassemblait 10 personnes, 2 d’entre elles (soit 20% de l’assemblée) ont rapporté avoir subi des agressions verbales à caractère raciste, ce qui ne leur était jamais arrivé auparavant (après respectivement 8 ans et 15 ans passés sur le sol britannique). Ce chiffre correspond en moyenne aux témoignages reçus par ailleurs : par exemple, sur les 27 portraits, 6 personnes (22 %) disent avoir vécu et/ou avoir été témoin de propos ou d’actes désobligeants à une ou plusieurs reprises, depuis le vote « Leave ».
Peu parlent de racisme ouvert, mais plutôt d’une parole désormais « déliée » et d’un sentiment de « ne plus être le bienvenu ». Lors d’un échange, un Français m’expliquait comment un de ses collègues était venu lui exprimer sa surprise de voir que le service communication de son entreprise avait choisi de le faire parler sur une vidéo destinée à des clients, alors qu’il avait un « accent français prononcé » et qu’un Britannique aurait clairement mieux fait l’affaire.
L’ambassadeur de France au Royaume-Uni Sylvie Bermann, auditionnée par cette mission d’information, avait par ailleurs déjà alerté la Chambre des Lords, en octobre dernier, au sujet de l’augmentation de commentaires agressifs voire racistes, et d’un sentiment de malaise diffus.
Comme souligné précédemment, les motifs d’inquiétude sont nombreux et les conséquences du Brexit sont encore floues. Nos concitoyens sont souvent désemparés. Ma toute première action, au lendemain du vote, a été de les inviter à ne pas céder à la panique. Le Brexit n’aura pas lieu demain et la situation des ressortissants devrait peu à peu se clarifier. Nous avons toutefois reçu de nombreuses demandes de conseils, sur les démarches à suivre suite au vote en faveur du Brexit, et notamment sur la nécessité de demander un permis de résidence permanente.
Les démarches entreprises par les Français établis au Royaume-Uni depuis juin
À l’heure actuelle, plusieurs options s’offrent aux Français du Royaume-Uni, en attendant une sortie officielle du pays de l’Union européenne, prévue pour 2019 :
• n’engager aucune démarche et attendre que la situation se clarifie ;
• entamer les démarches pour demander une carte de résident permanent ;
• entamer les démarches pour demander la nationalité britannique ;
• préparer son départ du pays (pour un retour en France ou une expatriation dans un autre pays).
c) Rester au Royaume-Uni…
Rester vivre au Royaume-Uni est l’option la plus largement envisagée par les Français ayant témoigné, comme le montre le graphique ci-dessous :
Les courriels et les appels reçus montrent la même tendance. Mais si l’option de rester vivre sur le sol britannique a la préférence des Français qui ont construit leur vie dans ce pays, les témoignages montrent également que nombreux sont ceux qui se refusent à demander la carte de résidence ou la nationalité, par principe.
Ainsi, sur les 27 portraits reçus, la moitié affirme ne pas souhaiter engager de démarche particulière pour le moment, alors que 5 personnes confirment avoir entamé les démarches pour obtenir une carte de résidence et que 2 personnes ont l’intention de demander la nationalité britannique, comme le montre le graphique ci-dessous :
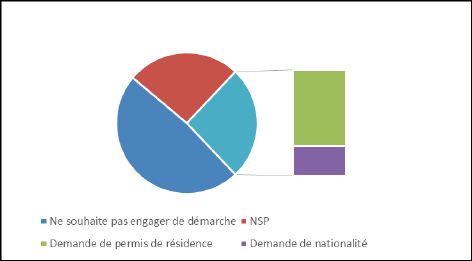
Quant aux 200 personnes nous ayant contactés suite au référendum, plus d’une quarantaine des courriels reçus (soit un peu plus de 20 %) portaient sur la demande de permis de résidence (est-ce une nécessité ? difficultés rencontrées pour remplir le questionnaire, rejet de la demande par les autorités britanniques) et 8 d’entre eux portaient sur la demande nationalité britannique.
Certains témoignages, assez nombreux, insistent sur leur attachement profond aux valeurs républicaines françaises et à l’Union européenne pour étayer leur choix de ne pas demander la nationalité britannique : « Je n’ai aucune intention de prendre la nationalité britannique, sous aucun prétexte que ce soit. Le choc mental du Brexit, le sens de la trahison, et devenir sujet de la couronne sont totalement contraires mes principes. Je suis fidèle à la République qui pour moi n’est pas un vain mot. Je souhaite tout simplement qu’en tant que Française et citoyenne européenne, je ne sois pas traitée comme une citoyenne de seconde zone ». D’autres estiment avoir contribué à l’économie et à la vie du Royaume-Uni depuis assez longtemps pour être reconnus de façon automatique, ou en ayant accès à des démarches simplifiées pour obtenir un permis de résidence : « La Grande-Bretagne ayant causé cet état de fait par le référendum, j’estime que c’est à elle de régulariser unilatéralement la situation des EU migrants, sans attendre de voir ce que vont faire les autres pays européens de leurs British migrants, et ce par un moyen simple et rapide (et non en remplissant un formulaire de 85 pages accompagné de nombreux autres documents et justificatifs) ».
Suite à ces témoignages sur la complexité des démarches administratives, j’ai d’ailleurs envoyé fin janvier un courrier à la secrétaire d’état Amber Rudd pour lui demander de simplifier l’accès à la résidence permanente pour les ressortissants européens. J’estime qu’il est injuste voire humiliant pour les ressortissants européens établis de longue date et éligibles à la résidence permanente de devoir présenter au ministère de l’intérieur britannique des documents non exigés par le droit européen. J’encourage tout de même les Français établis au Royaume-Uni à en faire la demande tout en les invitant à me contacter en cas de difficultés ou de refus de la part du ministère de l’intérieur britannique. Je vais en effet collaborer avec le groupe de travail qui est en train de se mettre en place au Parlement européen pour mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les Européens établis au Royaume-Uni souhaitant obtenir ce statut.
d) …ou rentrer en France ?
Dans les témoignages reçus, 30% des personnes se disent prêtes ou tentées de rentrer en France, dans les 2 années à venir. Notons toutefois que la plupart d’entre elles avaient prévu un retour en France, souvent avec leur conjoint, pour y passer leur retraite. Ils accélèrent aujourd’hui leur projet.
Une personne nous a par ailleurs déclaré, par courriel, son retour immédiat en France, au lendemain du vote.
Beaucoup de Français s’inquiètent cependant du résultat des élections présidentielles de mai et craignent une arrivée au pouvoir du Front national. Ceux-ci attendent donc mai pour prendre leur décision finale.
Par ailleurs, certains prévoient un retour mais s’inquiètent du soutien et de l’accueil qu’ils y recevront : « Je suis arrivée au Royaume-Uni avec Erasmus il y a 27 ans et ne suis jamais retournée vivre en France. Suite au Brexit, je pense rentrer en France d’ici deux ans. Je me demande si le gouvernement français envisage de mettre en place un soutien pour ces expatriés tels que moi. Je ne vois pas de communication du gouvernement français vers nous, les victimes de la bêtise Brexit (…) Où se renseigner ? À qui parler ? Qui est responsable de quoi ? ». Nous renvoyons ces personnes sur le rapport de la sénatrice Hélène Conway-Mouret sur le retour en France, ainsi que sur l’outil d’aide au retour en France mis en place par le ministère des Affaires étrangères mais il semble essentiel que les Français qui prendront la décision de rentrer en France suite au Brexit soient entendus et conseillés par le gouvernement français.
Les témoignages étudiés dans cette courte note ont été publiés et sont accessibles sur mon blog et nous en attendons d’autres (145). Il convient de préciser que cette analyse n’a pas de caractère exhaustif et que les interpellations et des témoignages reçus proviennent majoritairement de personnes installées depuis plusieurs années sur le sol britannique.
La situation est difficile et angoissante pour la plupart d’entre eux, et ils souhaitent obtenir rapidement plus de garanties sur leur avenir en Grande-Bretagne. Il est impératif que leurs retours puissent être pris en compte dans les négociations à venir. Le malaise est réel et il me paraît important ne pas sous-estimer le caractère traumatisant, pour certaines personnes, d’être considérées comme étrangères sur le sol britannique après avoir vécu parfois depuis plus de 40 ans dans un pays qu’elles considèrent comme leur pays d’adoption. Certains mots utilisés dans les témoignages sont très forts : « tristesse, malaise, incompréhension, sentiment de rejet, dégoût, trahison ».
Enfin, la plupart des témoignages reçus insistent également sur la position de la France dans les négociations avec le Royaume-Uni. Pour la grande majorité, ils font part de leur souhait de voir la France adopter une position ferme face au Royaume-Uni, mais dans laquelle ils ne seront pas considérés comme une monnaie d’échange.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Mercredi 21 septembre 2016
Auditions
– M. Harlem Désir, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé des Affaires européennes ;
– M. Philippe Léglise-Costa, secrétaire général aux Affaires européennes.
Jeudi 29 septembre 2016
Auditions
–Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France au Royaume-Uni ;
– M. Jean-Claude Piris, consultant en droit européen et en droit international public, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne.
Jeudi 20 octobre 2016
Table ronde : les effets du « Brexit » sur les droits et avantages des citoyens européens
– Mme Myriam Benlolo-Carabot, professeure des universités, spécialiste de droit européen ;
– M. Christopher Chantrey, président de l’association « British in France » ;
– M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale ;
– M. Denis Despreaux, chef de la mission Europe et international pour la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
– M. Félix Géradon, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale-Bruxelles.
Jeudi 3 novembre 2016
Table ronde : l’impact du « Brexit » sur les activités bancaires et financières, les monnaies et les investissements
– M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France ;
– Mme Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor ;
– M. Gérard Rameix, président de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ;
– M. Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace.
Jeudi 24 novembre 2016
Table ronde : l’incidence du « Brexit » sur les entreprises.
– M. Michel Guilbaud, directeur général du MEDEF ;
– M. David Hubert Delisle, directeur adjoint Invest de Business France ;
– Mme Thaima Samman, avocate aux barreaux de Paris et de Bruxelles et experte dans les politiques et les régulations financières ;
– M. Philippe Coq, secrétaire général des Affaires publiques d’AIRBUS Group ;
– M. Pierre Todorov, secrétaire général du Groupe EDF, et membre du Comité exécutif du Groupe ;
– M. Hubert Carré, directeur général du Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins.
Jeudi 15 décembre 2016
Table ronde : l’avenir de l’Union européenne après le « Brexit ».
– M. Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie ;
– M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman ;
– M. Marcel Grignard, président de Confrontations Europe et Mme Anne Macey, déléguée générale ;
– M. Yves Bertoncini, directeur de l’Institut Jacques Delors.
Audition
– M. Frédéric Baab, membre national d’Eurojust pour la France.
Jeudi 19 janvier 2017
Auditions
– M. Michel Barnier, négociateur en chef responsable du groupe de travail de la Commission chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni ;
– M. Jean-Yves le Drian, ministre de la Défense.
Jeudi 26 janvier 2017
Auditions
– Lord Llewellyn, ambassadeur de Grande-Bretagne en France ;
– M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international.
Jeudi 2 février 2017
Audition
– M. Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur.
Dimanche 13 et lundi 14 novembre 2016
Londres
v Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France au Royaume-Uni, et ses collaborateurs.
v Réunion des représentants de la communauté française :
M. Samir Assaf, CEO Global Banking and Markets, HSBC Holding plc ;
M. Maxime Holder, président de Paul international ;
M. Albin Serviant, CEO, Easyroommate.com ;
M. Olivier Morel, président des conseillers du commerce extérieur ;
Mme Florence Gomez, directrice générale de la Chambre de commerce franco-britannique ;
Mme Catherine Palmer, association des juristes franco-britanniques ;
Mme Morgane Marot, conseiller consulaire ;
M. Olivier Bertin, conseiller consulaire ;
Mme Anne Faure, présidente des associations françaises au Royaume-Uni ;
Mme Carole Rogers, présidente de l’Union des Français de l’étranger ;
Mme Catherine Smadja, présidente de l’association française du monde (ADFE) ;
Mme Mireille Rabaté, proviseure du Lycée international Winston Churchill ;
Mme Sylvaine Carta – Le Vert, consule générale de France à Londres.
v Séquence à la City de Londres :
M. Mark Boleat, chairman of policy and resources committee ;
Sir Simon Fraser, managing partner, Flint Global ;
M. Jeremy Browne, représentant spécial de la City auprès de l’Union européenne ;
M. Mikes Celic, chief executive officer, the City UK ;
M. Edward Bowles, managing director, Group public affairs, Standard Chartered ;
M. Urban Funered, director of public policy fidelity ;
M. Alan Houmann, directeur des affaires publiques de Citigroup ;
M. André Villeneuve, anglo-french UK chair, ICE ;
M. Nick Collier, global head of Government relations, Thomson Reuters ;
M. Michael O’Shea, european policy adviser, city of London Corporation.
v Échange de vues avec la Commission parlementaire de la Chambre des Communes en charge de suivre la sortie de l’Union européenne :
M. Hilary Benn, président de la Commission ;
Mme Johanna Cherry, membre ;
M. Peter Lilley, membre ;
M. Michael Gove, membre ;
M. Pat Macfadden, membre ;
M. Dominic Raab, membre ;
Mme Emma Reynolds, membre ;
M. Stephen Timms, membre.
v Entretien avec M. John Bercow, Speaker de la Chambre des Communes.
v Rencontre avec des think tanks londoniens :
M. Robert Niblett, directeur de Chatham House ;
M. Stephen Booth, directeur de Open Europe ;
M. Renaud Thillaye, directeur adjoint de Policy Network ;
M. Charles Grant, directeur du Center for European Reform ;
M. Vincenzo Scarpetta, Open Europe, spécialiste des questions relatives aux marchés financiers.
v Entretien avec M. David Davis, ministre de la sortie de l’Union européenne (Secretary of State for Exiting the European Union).
v Entretien avec M. Greg Hands, secrétaire d’État au commerce et aux investissements (Minister of State for Trade and Investment).
Jeudi 1er décembre 2016
Berlin
v M. Philippe Étienne, ambassadeur de France en République Fédérale d’Allemagne, et ses collaborateurs.
v Petit-déjeuner à la Résidence à l’invitation de l’Ambassadeur avec la communauté d’affaires berlinoise :
Mme Valérie Ross, senior manager research, BDI (fédération allemande de l’industrie ;
M. Jens Pawlowski, directeur de la représentation de la Fédération nationale des transporteurs allemands à Berlin (BGL) ;
M. Stephan Schraff, directeur Liaison Office Germany, Bayer AGM, Alexander Reinhardt, Airbus Group Office ;
M. Volker Stehmann, public affairs / energy, RWE ;
M. Manuel Kallweit, directeur du bureau des marchés à la fédération de l’Industrie automobile allemande ;
Mme Nicole Brüning, directrice de la représentation en Allemagne ; BMW Group.
v Rencontre avec les fondations FES, KAS et Jacques Delors :
M. Valentin Kreilinger, chercheur à la Fondation Jacques Delors ;
M. Alexander Kallweit, directeur de l’Europe de l’Ouest et M. Ulrich Storck, directeur à Londres, à la Fondation Friedrich Ebert ;
M. Lars Hänsel, directeur Europe et Amérique du Nord et M. Olaf Wienzek, coordinateur de la politique européenne à la Fondation Konrad Adenauer ;
M. Olaf Boehnke, Associate Fellow du Centre Alfred von Oppenheim à la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) ;
M. Julian Rappold, chercheur (auteur d’une publication sur le Brexit).
v Réunion avec la commission des affaires de l’Union européenne du Bundestag, présidée par M. Gunther Krichbaum.
v Entretien avec M. Michael Roth, ministre délégué en charge des Affaires européennes
Mercredi 14 décembre 2016
Francfort
v Entretien avec M. Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, et ses collaborateurs.
Jeudi 12 janvier 2017
Bruxelles
v Entretien avec M. Pierre Sellal, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne.
v Entretien avec M. Didier Seeuws, directeur en charge de la task force sur le Royaume-Uni du Conseil de l’Union européenne.
v Échange de vues avec une délégation de parlementaires européens français :
M. Jean Arthuis, Mmes Pervenche Beres, Sylvie Goulard et Sylvie Guillaume, MM. Alain Lamassoure et Emmanuel Maurel, Mmes Elisabeth Morin-Chartier, Christine Revault D’Allones-Bonnefoy et Virginie Rozière.
v Échange de vues avec les membres de la commission des Affaires constitutionnelles du Parlement européen :
Mme Danuta Maria Hübner, présidente, Mme Barbara Spinelli, vice-présidente, M. György Schöpflin, coordinateur du groupe Parti populaire européen, et M. Pascal Durand.
v Entretien avec M. Martin Schulz, président du Parlement européen.
v Entretien avec M. Guy Verhofstadt, représentant du Parlement européen pour les négociations dans le dossier du Brexit.
– Audition, ouverte à la presse, de M. Harlem Désir, secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes (mercredi 21 septembre 2016) 182
– Audition, non ouverte à la presse, de M. Philippe Léglise-Costa, secrétaire général des affaires européennes (mercredi 21 septembre 2016) 198
– Audition, non ouverte à la presse, de Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France au Royaume-Uni (jeudi 29 septembre 2016) 209
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Claude Piris, consultant en droit européen et en droit international public, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne (jeudi 29 septembre 2016) 219
– Table ronde, ouverte à la presse, sur les effets du Brexit sur les droits et les avantages des citoyens européens avec la participation de Mme Myriam Benlolo-Carabot, professeure des universités, spécialiste de droit européen, M. Christopher Chantrey, président de l’association « British in France », M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale, M. Denis Despreaux, chef de la mission Europe et international pour la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et M. Félix Géradon, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale-Bruxelles : (jeudi 20 octobre 2016) 230
– Table ronde, ouverte à la presse, sur les effets du Brexit sur les activités bancaires et financières, les monnaies et les investissements avec la participation de M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, Mme Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor, M. Gérard Rameix, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), M. Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace (jeudi 3 novembre 2016) 252
– Table ronde, ouverte à la presse, sur l’incidence du Brexit sur les entreprises, avec la participation de M. Michel Guilbaud, directeur général du MEDEF, M. David Hubert Delisle, directeur-adjoint d’Invest de Business France, Mme Thaima Samman, avocate aux barreaux de Paris et de Bruxelles et experte en matière de politiques et de régulations financières, M. Philippe Coq, secrétaire général des affaires publiques d’Airbus Group, M. Pierre Todorov, secrétaire général du groupe EDF et membre du comité exécutif du groupe et M. Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (jeudi 24 novembre 2016) 275
– Table ronde, ouverte à la presse, consacrée à l’avenir de l’Union européenne après le « Brexit », rassemblant : M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, M. Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, M. Marcel Grignard, président de Confrontations Europe et Mme Anne Macey, déléguée générale ainsi que M. Yves Bertoncini, directeur de l’Institut Jacques Delors (jeudi 15 décembre 2016) 297
– Audition, ouverte à la presse, de M. Frédéric Baab, membre national d’Eurojust pour la France (jeudi 15 décembre 2016) 315
– Audition, non ouverte à la presse, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense (jeudi 19 janvier 2017) 325
– Audition, non ouverte à la presse, de Lord Llewellyn, ambassadeur de Grande-Bretagne en France (jeudi 26 janvier 2017) 337
– Audition, non ouverte à la presse, de M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du développement international (jeudi 26 janvier 2017) 348
– Audition, non ouverte à la presse, de M. Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur (jeudi 2 février 2017) 358
Séance du mercredi 21 septembre 2016
La mission d’information procède à l’audition, ouverte à la presse, de M. Harlem Désir, secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes
M. le président Claude Bartolone. Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation. Vous ouvrez le cycle des auditions de la mission d’information que nous avons créée pour nous pencher sur la question des conséquences, pour le pays et pour l’Europe, du référendum britannique sur la sortie de l’Union européenne. À l’occasion de la réunion constitutive, je me suis exprimé sur les raisons qui nous ont conduits à sa création.
L’on voit bien qu’il y a aujourd’hui beaucoup d’interrogations, ne serait-ce que sur le calendrier. J’ai entendu les déclarations de la porte-parole de la première ministre britannique, qui évoque maintenant 2017. Différentes questions vont se poser sur ce délai ; plusieurs décisions devront être prises pour évaluer les conséquences du référendum non seulement au niveau français, mais aussi au niveau européen.
Je propose que vous nous éclairiez sur l’attitude du Royaume-Uni, sur le principe des négociations, sur les intérêts français en jeu et sur l’état de l’unité des Européens. Mes chers collègues, il est convenu que le ministre prenne la parole pendant quinze minutes, avant que vous ne l’interrogiez.
M. Harlem Désir, secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes. Je vous remercie de cette invitation et je me réjouis que l’Assemblée nationale ait décidé de créer une mission d’information sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations qui vont maintenant s’engager entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
Cet événement sans précédent, la décision d’un pays de sortir de l’Union européenne, et qui concerne l’une des plus grandes économies et l’un des principaux partenaires de la France dans tous les domaines est d’une portée considérable pour l’Europe et donc forcément pour la France.
La relation franco-britannique est très dense dans tous les domaines. Le Royaume-Uni est notre cinquième partenaire commercial, absorbe 8 % des exportations françaises et constitue notre premier excédent commercial dans le monde – douze milliards d’euros – pour 31 milliards d’euros d’exportations, dont 11 % de nos exportations de services. La France est le deuxième investisseur au Royaume-Uni, avec un stock d’investissements directs étrangers d’environ 100 milliards d’euros, soit 10 % du total investi par la France à l’étranger. 300 000 Français au moins vivent au Royaume-Uni et 200 000 Britanniques vivent en France.
Les coopérations industrielles, aéronautiques et énergétiques, notamment à Hinkley Point, mais aussi les coopérations universitaires et de recherche ou encore la coopération en matière de défense qui repose sur les accords de Lancaster House, sont nombreuses et remarquables.
Ces échanges, ces coopérations ne sont pas tous liés au cadre européen, mais tous ou presque en bénéficient et peuvent être impactés. Il faudra veiller à ce que cet impact ne soit pas négatif.
Pour l’Europe, en même temps qu’un choc historique, puisque désormais la construction européenne n’est plus irréversible, le référendum a agi comme un révélateur. Il est révélateur de la coupure entre les peuples et l’Europe, car beaucoup des fractures sociales, géographiques, générationnelles, des peurs, - de l’immigration, de la mondialisation – qui se sont exprimées lors de ce référendum, pourraient s’exprimer dans tous les États membres. Même si le Royaume-Uni entretient une relation particulière à l’Union européenne, ce qui s’est exprimé à l’occasion de ce référendum aurait pu s’exprimer aussi dans d’autres États membres.
Il est révélateur aussi des divisions entre les États membres sur la nature même du projet européen, sur les valeurs qui le fondent, sur le degré d’intégration ou de solidarité futures, sur les compétences de l’Union européenne.
Ces divisions viennent s’ajouter à celles préexistantes, qui sont liées aux effets de la crise économique, en particulier entre le Nord et le Sud du continent.
C’est donc le projet européen lui-même et son avenir qui sont en jeu, car le choc du Brexit intervient sur un corps déjà lézardé par une multitude de crises, crise des réfugiés, menace terroriste, crise économique, montée des populismes.
L’Europe doit d’autant plus aborder de façon ordonnée, cohérente, claire, le défi que représente la sortie d’un de ses États membres, qu’elle doit apporter des réponses collectives fortes à la crise européenne, et en particulier à l’attente de protection des citoyens, des frontières, de l’économie, et de notre modèle de société, dans un monde et un environnement troublés. C’est le sens de la feuille de route de Bratislava ainsi que du travail qui est engagé sur l’avenir de l’Union européenne et qui va se poursuivre au cours des prochains mois.
La question du retrait britannique doit donc être traitée dans la clarté. Je veux redire que nous regrettons le choix des Britanniques de quitter l’Union mais nous le respectons. C’est un choix libre, souverain, démocratique quel que soit le jugement que l’on porte sur les arguments qui ont été utilisés.
Nous comprenons que les autorités britanniques aient besoin d’un certain temps – vous avez, monsieur le président, évoqué cette question du calendrier – pour se préparer à la négociation de sortie et à celle ou celles qui, parallèlement, portera ou porteront sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, mais la période d’incertitude est nuisible à l’économie britannique comme à l’économie européenne. Le plus tôt sera donc le mieux.
C’est pourquoi, le Président de la République a tenu, à ce que plusieurs principes soient rappelés par les vingt-sept États membres collectivement dès le lendemain du référendum. Ce qui fut fait à l’occasion du premier conseil européen qui s’en est ensuivi.
Premièrement, il y a une procédure pour quitter l’Union européenne et il n’y en a qu’une, c’est l’article 50 du traité sur l’Union européenne.
Deuxièmement, il ne peut y avoir de négociation hors de cette procédure, donc pas de pré- négociations qui viseraient à obtenir de tel ou tel État membre ou des Vingt-Sept des garanties préalables avant l’ouverture de la négociation de retrait dans le cadre de l’article 50. Cela nous entraînerait dans une logique délétère et dans un processus interminable.
Ce point est particulièrement important, puisqu’une fois l’article 50 activé, celui-ci prévoit un délai de deux ans maximum au terme duquel l’État concerné n’est plus membre de l’Union, sauf accord unanime des autres États membres pour proroger le délai de négociation. Une fois l’article 50 activé, le calendrier est donc balisé et l’Union européenne maîtrise de fait la procédure et la négociation.
Troisièmement, pour les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, il y aura un lien entre les quatre libertés du marché unique : la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. L’accès du Royaume-Uni au marché intérieur européen sera donc conditionné à la liberté de circulation des citoyens européens au Royaume-Uni. C’est un point important à rappeler avant même l’ouverture des négociations.
L’accès au marché intérieur comme à certaines politiques communes sera lié au respect d’un certain nombre d’obligations et à une contribution financière.
Il ne s’agit pas de punir mais de préserver les intérêts de l’Union européenne, son intégrité et sa cohésion.
Sur ces bases, une négociation va donc s’engager dès lors que l’article 50 sera activé.
Quand ? Theresa May a affirmé, cet été, à plusieurs reprises, sa détermination à mettre en œuvre le Brexit, « Brexit is Brexit », ajoutant qu’elle voulait en faire un succès.
Pour autant, la future position de négociation du Royaume-Uni n’est pas établie à ce stade et un débat a vu le jour au sein du gouvernement britannique entre différentes approches notamment entre ceux qui défendent une sortie rapide de l’Union européenne avec une restriction à la liberté de circulation et ceux qui souhaitent conserver la relation la plus étroite possible avec l’Union européenne incluant le maintien de l’accès au marché intérieur.
Vous entendrez notre ambassadeur au Royaume-Uni, qui vous donnera un éclairage, pris depuis Londres, sur l’état d’esprit qui y règne. L’automne sera consacré à Londres à l’élaboration d’une position de négociation consolidée, car l’on voit aujourd’hui des positions différentes du ministre en charge du Brexit, du ministre en charge de la négociation des accords commerciaux et d’autres qui, sans être directement en charge de la question, ont néanmoins, comme l’actuel ministre des affaires étrangères, joué un rôle très direct dans la campagne du référendum. L’automne sera aussi consacré à recruter des personnels qualifiés pour la négociation future et mon homologue britannique m’a confirmé hier à Bruxelles que l’article 50 ne devrait pas être activé avant la fin de l’année, donc au plus tôt au début 2017. Déclencher la procédure avant le milieu de l’année 2017 est en effet tout à fait souhaitable, compte tenu du renouvellement de la Commission européenne et du Parlement européen à la mi-2019.
Jusqu’à la fin des négociations de sortie, le Royaume-Uni reste membre de l’Union européenne, avec la plénitude de ses droits et de ses obligations. Il contribue au budget, doit transposer les directives, appliquer les règlements, respecter les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il lui appartient néanmoins de faire de ses droits un usage qui respecte un esprit de coopération loyale. Le renoncement à sa présidence au deuxième semestre 2017 était à cet égard une décision importante et, pour tout dire, incontournable.
Quelles sont les étapes prévues une fois la notification de sortie effectuée ? Conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne et à l’article 218 – paragraphe 3 – du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mentionné dans l’article 50, la procédure suivra les étapes suivantes :
1°) le Royaume-Uni notifie au Conseil européen, par exemple sous la forme d’une lettre du Premier ministre britannique au président du Conseil européen, son intention de se retirer de l’Union ;
2°) le Conseil européen, à vingt-sept, fixe des orientations de négociations ;
3°) à la lumière des orientations du Conseil européen, la Commission européenne présente au Conseil une recommandation sur l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni concernant les modalités de son retrait de l’Union européenne, « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union » ;
4°) le Conseil adopte une décision d’autorisation d’ouverture des négociations et désigne le chef de l’équipe de négociation ;
5°) l’accord est négocié dans un délai de deux ans maximum à compter de sa notification ;
6°) le Parlement européen approuve l’accord de retrait, à la majorité simple ;
7°) le Conseil adopte l’accord au nom de l’Union à la majorité qualifiée. Un seul État membre, qui ne serait pas d’accord avec la solution adoptée, ne pourrait en bloquer l’adoption.
Certaines étapes, à savoir la première, la troisième et la sixième, ne laissent aucun doute quant à leurs modalités d’organisation. D’autres en revanche font naître des questions juridiques et pratiques qui ont provoqué des débats entre la Commission et le Conseil au lendemain des résultats du référendum britannique, notamment la question de savoir qui négocie.
Notre lecture, qui est également celle qui prévaut désormais dans les institutions européennes, est que :
– le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union émane de la Commission européenne ; c’est un membre du collège, ou une personnalité nommée par lui, qui négocie au nom des États membres ;
– l’équipe de négociation pourrait en revanche comprendre des représentants du Conseil européen, du Conseil ou même du Parlement européen ;
– le Conseil européen pourrait demander, dans ses orientations, à être consulté tout au long de la négociation. En tout état de cause, il assure une surveillance et un suivi de la négociation.
L’intérêt de la France et de l’Union est en effet de trouver le bon équilibre entre la nécessité de garantir une position de négociation unique et claire d’une part, et la prise en compte du caractère exceptionnel de cette procédure et de l’importance pour les États membres de pouvoir garantir un plein contrôle d’autre part.
C’est cette analyse du processus de négociation qui a conduit le président de la Commission à nommer, le 27 juillet dernier, Michel Barnier, à la fonction de négociateur en chef responsable du groupe de travail de la Commission chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, à compter du 1er octobre 2016. Mais, en réalité, il faudra ensuite une décision pour confirmer qu’il est bien le négociateur au nom du Conseil européen.
L’article 50 établit expressément la distinction entre la conclusion de l’accord de retrait et ses modalités d’une part, et celle d’un accord régissant les relations futures, ce qui implique donc deux négociations distinctes, même si l’article dit que l’un est négocié en tenant compte de l’autre. Cela n’empêche pas qu’il s’agisse du même négociateur, mais il y aura deux accords différents :
– l’accord de retrait devrait régir les modalités institutionnelles et administratives du retrait, y compris d’éventuelles dispositions transitoires ;
– l’accord régissant les relations futures pourra prendre des formes diverses, selon l’option qui sera retenue par le Royaume-Uni et l’Union européenne.
L’articulation entre ces deux accords pourrait se faire au moyen d’un régime intermédiaire.
La deuxième question qui se pose est bien sûr celle de la relation future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a vocation à devenir un pays tiers vis-à-vis de l’Union européenne. Il n’aura plus de droit de regard sur le fonctionnement de l’Union européenne.
De nouvelles relations de partenariat étroit seront donc établies, et cela est évidemment nécessaire et souhaitable. Mais nous, Européens, devons penser cette relation future en fonction de nos intérêts, notamment dans les domaines les plus sensibles, en matière économique, de commerce, de régulation financière, de coopération policière et judiciaire, de lutte contre le terrorisme, de migrations, de politique étrangère et de défense.
Quels sont les modèles existants de relations entre l’Union européenne et des États tiers qui sont parfois évoqués, à Londres, à Bruxelles ou dans les États membres, pour les envisager ou pour les écarter ?
Le premier, le plus intégré, souvent qualifié de modèle norvégien, implique une adhésion à l’accord sur l’espace économique européen, entré en vigueur en 1994 et qui lie l’Union européenne, les vingt-huit États membres et trois des quatre membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, mais non la Suisse, qui a refusé d’y participer.
Il s’agit en fait d’un stade intermédiaire d’intégration économique entre l’Union européenne et l’AELE. Cette formule serait une réponse évidente à certains objectifs du Royaume-Uni, tels que le passeport en matière de services financiers ou la réduction du coût économique lié à la sortie de l’Union, mais elle se caractérise également par certains éléments qui sont en porte-à-faux direct avec les positions des tenants du Leave lors de la campagne.
S’il retenait le modèle norvégien, le Royaume-Uni ne serait pas en mesure de contrôler comme il l’entend les flux de ressortissants de l’Union, devant appliquer l’ensemble des quatre libertés, y compris la liberté de circulation. De même, il serait tenu d’appliquer le droit de la concurrence de l’Union européenne.
L’espace économique européen est un accord juridique dynamique, qui s’enrichit à mesure que l’acquis communautaire s’accroît. Aussi, si le Royaume-Uni devait opter pour ce modèle, le paradoxe serait qu’il se retrouverait à appliquer les mêmes règles qu’avant, et toutes les législations futures de l’Union, sans pour autant peser sur la prise de décision.
Alors qu’un certain nombre de partisans du Leave avaient fait campagne en dénonçant le caractère intrusif de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’adhésion à l’espace économique européen aurait pour effet de maintenir la prééminence de celle-ci sur le droit britannique.
Enfin, la participation à l’espace économique européen se traduirait pour le Royaume-Uni par l’obligation de continuer à contribuer de façon importante au financement de l’Union européenne. Ainsi, sur la période de 2008 à 2014, la contribution de la Norvège a représenté 0,16 % de son PIB, contre 0,25 % pour le Royaume-Uni. C’est donc moins pour la Norvège que pour le Royaume-Uni, mais c’est tout de même significatif.
Le deuxième modèle évoqué est le modèle suisse. La Suisse ayant refusé par référendum en 1992 d’adhérer à l’espace économique européen, elle a développé ses relations avec l’Union européenne sur une base bilatérale, avec la signature d’environ 120 accords qui lui permettent de participer aux politiques de l’Union européenne sur une base négociée au cas par cas.
Ce modèle, appliqué au Royaume-Uni, pourrait lui permettre de préserver davantage sa souveraineté, dans la mesure où chaque accord est négocié de manière bilatérale. Toutefois, la participation de la Suisse à certaines politiques, notamment au marché intérieur, implique une adaptation de la législation suisse afin de la rendre compatible avec la législation de l’Union européenne. En pratique, ils transposent, en matière économique, quasiment toute la réglementation européenne. La Suisse est tenue de respecter la liberté de circulation. Elle se trouve ainsi un peu dans la même situation que la Norvège : elle ne participe pas aux décisions, mais doit transposer les réglementations.
Enfin, la Suisse contribue au financement des politiques européennes auxquelles elle participe, par exemple au programme Horizon 2020. Par ailleurs, l’Union cherche à réformer ce modèle de relations très lourd à gérer. Il serait donc peut-être paradoxal de l’étendre au Royaume-Uni.
Le troisième modèle-type, c’est l’accord de libre-échange doublé d’un partenariat stratégique, ce que l’on appelle parfois le modèle canadien ou le modèle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Fondé sur une double association, à la fois politique et commerciale, il repose sur un accord de libre-échange complet et ambitieux. Encore faut-il, pour pouvoir en parler comme d’un modèle existant, que cet accord économique et commercial global, le Comprehensive Economic and Trade Agreement ou CETA, soit ratifié.
C’est un cadre qui correspond à des économies et des pays qui veulent à la fois des échanges commerciaux et économiques importants et des partenariats étroits avec l’Union européenne tout en étant plus éloignés, moins intégrés, que dans les modèles de partenariat continentaux. Un accord de libre-échange est long et complexe à négocier. L’accord avec le Canada a été négocié pendant sept ans. La période transitoire durant laquelle le Royaume-Uni aurait le statut d’État tiers sans que les nouveaux accords soient finalisés pourrait donc être très importante, longue de plusieurs années.
Dans la période transitoire, le Royaume-Uni se retrouverait dans une situation où tous les accords de libre-échange de l’Union cesseront de s’appliquer à lui. Dès lors, ne bénéficiant plus que de la clause de la nation la plus favorisée, le Royaume-Uni devrait négocier tous les accords existants entre l’Union et les autres membres de l’OMC.
Il est vraisemblable que le Royaume-Uni cherche à échapper aux modèles existants de relations entre l’Union européenne et les pays tiers pour obtenir un statut ad hoc, seul à même de résoudre le triangle d’incompatibilités au sein duquel le Royaume-Uni s’est placé, en recherchant à la fois la pleine souveraineté nationale dans l’adoption du droit matériel, l’intégralité du bénéfice économique lié à l’intégration et la sélectivité dans l’application des règles du marché intérieur.
En réalité le Royaume-Uni va sans doute devoir s’engager dans la négociation d’au moins six accords différents : l’accord de retrait de l’Union européenne ; l’accord commercial futur avec l’Union européenne ; un accord intérimaire couvrant la période entre la sortie de l’Union européenne et l’entrée en vigueur des arrangements définitifs ; la ré-adhésion à l’OMC en tant que pays non membre de l’Union européenne ; les nouveaux accords de commerce avec la cinquantaine de pays dans le monde qui ont des accords de commerce bilatéraux avec l’Union européenne, auxquels s’ajouteront sans doute de nouveaux accords avec d’autres pays, en particulier les États-Unis ou la Chine ; un ou des accords de coopération policière, judiciaire, de politique étrangère, avec l’Union européenne.
Pour la partie qui concerne spécifiquement l’Union européenne, nous devrons, dans cette négociation, veiller à l’équilibre entre accès au marché et obligations, et à ce qu’un État tiers n’obtienne pas plus qu’un État membre, ce qui serait le début d’un détricotage dangereux. Il y a un enjeu de cohésion des Européens.
La France se prépare. Dès le résultat du référendum connu, le gouvernement a mis en place le dispositif lui permettant de se préparer aux négociations à venir. Un travail de cartographie de l’ensemble de nos intérêts est mené sous l’égide du secrétariat général des affaires européennes (SGAE). Je sais que vous allez en entendre le secrétaire général dans quelques instants. Il implique des correspondants dans tous les ministères concernés. Il permettra des arbitrages au plus haut niveau le moment venu. Vous aurez toutes les informations nécessaires lors de votre prochaine audition.
Le ministère des affaires étrangères et du développement international a constitué une task-force dédiée regroupant les agents sectoriels les plus directement concernés de la direction de l’Union européenne et de la direction des Affaires juridiques, chargée notamment d’animer un réseau de points de contacts au sein du ministère et d’assurer un contact quotidien avec les ambassades concernées, en particulier Londres et la représentation permanente auprès de l’Union européenne à Bruxelles. Cette task-force, conduite par le directeur de l’Union européenne et placée sous l’autorité du secrétaire général du ministère, assure le suivi quotidien de la situation.
À ce stade, les différents sujets à traiter paraissent pouvoir s’ordonner selon les catégories suivantes : les sujets pour lesquels le retrait doit être a priori organisé de manière directe et irréversible, par exemple les contributions au budget telles qu’elles existent aujourd’hui, même s’il y en aura peut-être d’autres, dans un cadre juridique différent ; les politiques et réglementations pour lesquelles doivent être envisagées les conséquences du retrait – à cet égard, les options envisageables pour le cadre des relations futures peuvent avoir un impact significatif sur la nature de ces conséquences, qu’il s’agisse de commerce, d’agriculture, d’acier, de la participation à certains programmes, tel Horizon 2020, ou de la liberté de circulation ; les décisions qui reviendront aux Vingt-Sept en raison du retrait britannique : il peut s’agir des choix à faire concernant le budget européen – comment se répartir la charge nouvelle née de l’absence de la contribution britannique ? – ou le capital de la Banque européenne d’investissement, principal instrument du plan Juncker, mais aussi de la relocalisation des agences européennes actuellement situées sur le territoire britannique, de la révision de certains textes normatifs, tels que l’accord sur la juridiction unifiée des brevets, du traitement des contingents affectés à l’Union européenne dans le cadre des accords commerciaux et des éventuelles compensations demandées. Un certain nombre de partenaires tiers de l’Union européenne ont un accord avec elle passé en fonction d’un marché de cinq cents millions d’habitants qui ne comprendra plus le marché britannique, ce qui peut conduire à des renégociations.
Afin d’organiser les travaux interministériels, plusieurs blocs ont été définis et font l’objet d’une expertise approfondie : les aspects juridiques et budgétaires ; la liberté de circulation des personnes ; la liberté de circulation des marchandises ; les libertés d’établissement et de prestation de services, hors services financiers ; la liberté de circulation des capitaux et des services financiers ; les politiques communes ; la politique commerciale commune ; la coopération policière et judiciaire ; les sanctions au titre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) et les aspects communautaires de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).
Le dispositif en place doit permettre de garantir la meilleure information, l’analyse, la réactivité et l’élaboration des positions françaises à chaque étape de la négociation, en tenant compte de l’intérêt général européen et de nos intérêts nationaux ainsi que de nos accords bilatéraux avec le Royaume-Uni, en particulier en matière de sécurité et de défense.
Voilà, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, les premiers éléments que je souhaitais vous présenter à l’occasion de cette audition. Il y en a évidemment beaucoup d’autres, qui peuvent par exemple concerner, pour la France, des effets d’aubaine, comme la relocalisation des activités financières, mais aussi être des effets négatifs à redouter.
Je me réjouis que l’Assemblée nationale se soit organisée pour suivre de très près ces négociations pour lesquelles elle aura un rôle très important à jouer, car elles auront des conséquences sur le plan législatif, sur le plan budgétaire et sur le plan de nos accords internationaux. Je vous remercie.
Mme Élisabeth Guigou. Monsieur le ministre, vous avez donné une vision très utile et très précise de la façon dont les procédures vont être suivies et de ce que la France attend à cet égard. L’on voit bien – et c’est logique – qu’il y aura un mixte, dans l’équipe de négociation, entre représentants de la Commission et représentants du Conseil. L’on ne saurait avoir que la Commission, comme en matière d’accords commerciaux, ni seulement le Conseil, malgré l’importance politique du sujet.
Du côté français, comment opérera-t-on la synthèse ? Qui sera le chef négociateur français dans ce cénacle autour du représentant nommé par la Commission ? Vous nous annoncez que ce dernier sera le chef de négociation : est-ce décidé ou est-ce la vision française des choses ?
Dans ce dispositif et parmi ces six catégories d’accords, il y a en fait trois grands blocs : la négociation dans le cadre de l’article 50, prévoyant une sortie au plus tard deux ans après son activation ; le statut futur, qui prendra plus de temps ; la renégociation de tous les accords commerciaux. Sur ces deux derniers blocs, avez-vous réfléchi au calendrier possible ? Cette négociation va, sous ces différentes formes, s’étaler longtemps.
Même si j’ai confiance dans la capacité d’organisation de notre pays, comment va-t-on éviter, devant la masse des sujets, d’être noyé politiquement et de ne plus réfléchir à l’avenir de l’Union européenne à vingt-sept ?
Pouvez-vous aussi nous en dire un peu plus sur les lignes rouges françaises ? Certes, j’espère que nous continuerons à tenir bon sur le caractère indissociable des quatre libertés, notamment la liberté de circulation. Mais il est évident que le Royaume-Uni essaiera d’avoir le beurre et l’argent du beurre ou, comme l’on dit là-bas, d’avoir le gâteau et de le manger en même temps. Ce sera le point d’achoppement principal.
Quelle sera l’attitude de nos partenaires ? À Bratislava, l’unité affichée au mois de juin s’est maintenue sur les quatre libertés. Mais cela va-t-il durer et quelle sera la position de Berlin ? La semaine prochaine, la commission des affaires étrangères que je préside se réunira à Berlin avec ses homologues polonaise et allemande. Mon homologue allemand a signé le papier du centre de réflexion Bruegel élaboré notamment par Jean Pisani-Ferry. Avant même qu’aucune négociation ne soit engagée, un statut ad hoc y est déjà envisagé pour le Royaume-Uni, avec des dérogations substantielles à la liberté de circulation, mais aussi un droit de regard sur les activités de l’Union européenne. Or nous savons comment ce simple droit de regard finit souvent par être utilisé à des fins de réelle participation. Voilà ce que j’ai dit à mon homologue allemand, avec lequel j’ai d’ailleurs l’habitude de signer des positions communes. N’y a-t-il pas un risque que l’Allemagne dévie de ses positions de départ, en entraînant la Pologne avec elle ?
M. Pierre Lequiller. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la cohérence et la clarté qui ressortaient à Bratislava. Pour ma part, je n’ai pas l’impression que cela ait été un sommet très réussi.
J’espère que l’on ne va pas maintenir aux Britanniques le passeport nécessaire aux services financiers. Quant à la situation à Calais, je voudrais que l’on cesse d’aider le Royaume-Uni à tenir ses frontières et qu’il les assure lui-même.
En somme, tout le calendrier dépend du Royaume-Uni, puisque c’est lui qui choisit quand appliquer l’article 50. J’imagine aussi très bien qu’une fois l’article 50 enclenché, il sache obtenir une prolongation du délai de deux ans fixé par celui-ci. J’en conçois une inquiétude énorme pour les élections au Parlement européen de 2019. Car j’espère que nous n’aurons plus de députés britanniques au cours de la prochaine législature du Parlement européen.
Lorsque le Royaume-Uni est entré dans ce qui était alors les Communautés européennes, il y eut un référendum consultatif, suivi d’un vote de la Chambre des Communes dans le même sens. Moi qui suis à moitié britannique, je suis choqué que la décision de sortir de l’Union européenne puisse être prise sans accord de la Chambre des Communes.
Quant au chèque britannique, que devient-il ? Nous n’allons pas continuer à l’appliquer ? Il devrait tomber de soi, ce me semble.
L’issue de ce référendum devrait avoir pour conséquence le renforcement immédiat de la zone euro. Or nous ne répondons pas assez vite et assez fort à ce défi, faute d’animer suffisamment le couple franco-allemand. Il faut un président de la zone euro, ainsi que des politiques nouvelles dans le domaine industriel et énergétique. Ce serait la meilleure réponse à donner.
Au cours d’un déplacement que nous avons effectué en Grande-Bretagne, nous avons souvent entendu de nos interlocuteurs qu’ils n’avaient pas cru à la création de l’union monétaire, mais qu’ils devaient constater qu’elle existe désormais bel et bien. Les Vingt-Sept devraient répondre de la même manière aujourd’hui à l’euroscepticisme britannique.
M. Jacques Myard. » Je m’envole vers un Orient compliqué », avait un jour déclaré le général de Gaulle… Mais ici, monsieur le ministre, il va falloir faire simple !
Vous avez dit vous-même que la consultation britannique était intervenue sur fond d’un édifice lézardé. Oui, l’Europe est à bout de souffle. Nous devons sortir du logiciel fédéraliste au profit d’une coopération accrue entre les États.
Dans la liste des enjeux bilatéraux, je regrette que vous n’ayez pas cité la défense et la lutte contre le terrorisme, même si nous devons avant tout éviter de casser les relations économiques et commerciales bilatérales.
Le Royaume-Uni a quitté l’organisation internationale qu’est l’Union européenne. Or les organisations internationales ont pour destin de croître, de stagner, puis de péricliter. Il va donc falloir faire différemment. La présidente Élisabeth Guigou évoque le risque qui pèse sur les quatre libertés. Mais le Conseil européen de février 2016 les a lui-même remises en cause, en acceptant que soient restreints les droits des Polonais établis au Royaume-Uni à percevoir les allocations familiales, et en annonçant aussi des modifications à la directive sur la sécurité sociale… Le logiciel européen est à bout de souffle : profitons de cette occasion pour nous poser les bonnes questions.
M. Philip Cordery. Devant ce gâchis, une seule parole nous échappe : tout ça pour ça ! Voilà que, pour des raisons internes à un parti politique au Royaume-Uni, l’Europe entière se trouve devant une tâche immense…
J’ai trois séries de questions à poser.
D’abord, comment faut-il envisager l’attitude du Royaume-Uni pendant la période de transition ? Son commissaire a démissionné, mais un autre est arrivé, qui a pris un portefeuille important, celui de la sécurité. Au Parlement européen, les députés britanniques continuent à voter, tandis qu’au Conseil, les Britanniques sont tantôt présents, tantôt non. Tant que le Royaume-Uni reste membre de l’Union européenne, il continue de détenir un droit de veto sur les décisions, par exemple dans le domaine de la défense, évoqué au sommet de Bratislava. Y a-t-il eu des discussions avec les Britanniques pour être sûrs qu’ils ne bloquent rien ?
Ensuite, il n’est certes pas question d’éjecter le Royaume-Uni de toute forme de coopération. Quelles sont les alternatives envisagées, en matière de défense, en matière d’immigration et en matière économique ? Il me semble que les relations bilatérales devront être renforcées pour remplacer ce qui existe dans le cadre de l’Union européenne : le ministère des affaires étrangères réfléchit-il à des accords bilatéraux ?
Enfin, quel est l’avis de nos partenaires européens sur la question ? Certes, des positions claires ont été prises au dernier sommet. Mais certains ont semblé plus faibles sur la question des quatre libertés. Vont-ils tous tenir bon, ne risque-t-on pas d’assister à un affaiblissement de certaines positions ?
Pour ma part, je regrette que le renforcement de l’union économique et monétaire ait été absent du sommet de Bratislava, comme du discours sur l’état de l’Union européenne tenu à Strasbourg par le président de la Commission européenne. Même s’il faut éviter de briser la dynamique des Vingt-Sept, il faut prendre des décisions, car là gît la solution.
Mme Marietta Karamanli. Je voudrais rester sur les aspects politiques. À l’issue du sommet de Bratislava, le premier ministre italien a déclaré qu’il aurait dû marquer un tournant, mais que cela n’avait pas été le cas. Ce constat d’une forme d’impuissance est-il pertinent ?
Tandis que le Royaume-Uni ne déclenche toujours pas la procédure de l’article 50, il donne aussi son feu vert à la construction de deux réacteurs EPR par un géant européen de l’électricité, à savoir EDF. Ces décisions contrastées ne témoignent-elles pas, selon vous, d’une volonté de dire et de ne pas faire ?
M. Gilles Savary. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour avoir fait la lumière sur une procédure qui apparaît, en vérité, d’une très grande lourdeur.
Où en sont les Britanniques ? Des amis anglais m’ont confié que Theresa May ne fait qu’atermoyer. Les trois ministres en charge de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne n’étant pas d’accord entre eux, ne faudra-t-il pas sans doute trancher ultérieurement entre eux à la Chambre des Communes ? Tout sera-t-il prêt et la procédure de l’article 50 déclenchée d’ici mars ou avril 2017, de façon à éviter que le Royaume-Uni ne doive participer au renouvellement des institutions européennes en 2019 ?
Ne peut-on envisager de fixer, sur le plan politique, une date-butoir pour le déclenchement de l’article 50 ? Les Britanniques ont marqué leur volonté de sortir, mais ils sont maîtres du calendrier, sur lequel les Vingt-Sept n’ont pas de prise. Ce ne serait donc pas extravagant de fixer une limite dans le temps, quitte à faire trancher la question par la Cour de justice de l’Union européenne en cas d’opposition britannique. Car le Royaume-Uni a mis les Vingt-Sept dans le fossé en les prenant en otage à force de surenchères populistes.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué une continuité pleine et entière des droits et obligations du Royaume-Uni tant qu’il reste membre de l’Union européenne. Le contenu de l’accord passé en février 2016 est-il aussi toujours valable ? J’espère qu’il tombe.
Comment pourrons-nous suivre, au niveau parlementaire européen ou national, la défaisance des liens du Royaume-Uni avec l’Union européenne ? Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire contient, en son article 16, des dispositions sur sa défaisance dont nous pourrions nous inspirer. Le diable est dans les détails et il me semble qu’une surveillance parlementaire secteur par secteur serait nécessaire.
Dans le domaine de l’aviation civile, par exemple, la Commission européenne a enfin reçu un mandat pour négocier avec les pays du Golfe sur les pratiques concurrentielles de leurs compagnies à bas coût. Le Royaume-Uni ne pourrait-il aujourd’hui tirer profit de la situation, en signant des accords directs avec les pays du Golfe, sinistrant ainsi ce mandat de négociation communautaire visant à la protection de toutes nos compagnies historiques ?
M. Christophe Premat. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre rappel aussi précis qu’efficace. Je ne ferai que deux commentaires, avant de poser une question.
La complexité de la situation tient à la nécessité de tenir en parallèle deux agendas, l’un britannique, l’autre à la fois français et européen. Du côté britannique, le déclenchement et la mise en œuvre de l’article 50, requérant le cas échéant un vote de la Chambre des Communes, s’apparente à une délicate prise en otage. Car l’agenda français et européen impose dans le même temps de reconstruire les politiques existantes.
Cet été, des visites bilatérales ont eu lieu, notamment celle du ministre des affaires étrangères britanniques, M. Boris Johnson, à Paris fin juillet. À ceux qui aspirent à plus de lisibilité, le statement budgétaire du mois de novembre fournira un point d’appui, laissant entrevoir, par les investissements annoncés, sur quel socle est envisagé l’avenir des politiques sectorielles au Royaume-Uni. Ce sera le début d’une orientation.
Quel sera finalement le modèle retenu pour les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ? Le modèle suisse, reposant sur l’accord fondateur de 1992, mis à mal par le référendum de 2014, permet d’envisager une période intermédiaire dans le cadre des accords de mobilité, qui prévoit la possibilité de moratoires, de trois à cinq ans, je crois. Cette option helvétique d’un régime intermédiaire servira-t-elle de précédent ? Mais vous avez évoqué de préférence le modèle norvégien.
M. Joël Giraud. Mon inquiétude vient de la perception par l’opinion publique de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Certains rêvent de voir la France suivre le même chemin en posant la question de son appartenance à l’Union européenne. Pour beaucoup de Français, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est déjà effective… Je regrette que le processus en cours ne soit pas davantage vulgarisé, ni par la presse, ni par des prises de position nationales, ni même par nos eurodéputés, très discrets sur le sujet.
Ayant un pied à la fois en France et en Italie, je m’aperçois que c’est tout le contraire qui se passe dans ce pays : le président du Conseil Matteo Renzi, et même le président de la République, malgré son statut particulier, évoquent la question, tout comme les eurodéputés italiens, comme je m’en aperçois en lisant quotidiennement La Stampa.
En France, une sortie de l’Union européenne est perçue comme ne provoquant aucune catastrophe, ni pour le pays concerné, ni pour l’organisation elle-même. Même le risque lié aux devises est méconnu, malgré l’effondrement de la livre sterling, qui paraît avoir atteint un plancher. Je voudrais qu’il y eût plus de prises de parole et une meilleure prise de conscience. Car il ne faudrait pas que cet enjeu soit biaisé par une méconnaissance complète de la situation. Si vous faites une recherche sur internet au sujet de la chute de la livre sterling, sur les trois derniers mois, vous ne trouverez que trois occurrences, contre 450 pour la presse italienne… Il me semble que le Gouvernement devrait s’exprimer davantage.
Sur le fond, comme l’a dit la présidente Élisabeth Guigou, il faudra éviter d’accorder in fine un statut dérogatoire au Royaume-Uni une fois dehors, après lui en avoir accordé un quand il était au-dedans. Cela décrédibiliserait définitivement l’Union européenne au niveau national.
M. Éric Elkouby. Monsieur le ministre, comme notre collègue Gilles Savary, je serais heureux de savoir s’il est envisagé de fixer une date-butoir à l’activation de l’article 50, pour éviter toute possibilité de blocage de la part de la Grande-Bretagne. Je souhaiterais également connaître votre sentiment sur la présence des institutions européennes au Royaume-Uni à l’avenir, s’agissant par exemple du siège de l’agence européenne en charge du médicament. Des négociations ont-elles été entamées pour savoir si les accords Erasmus, qui permettent à de nombreux étudiants d’aller étudier au Royaume-Uni, paraissent ou non susceptibles d’être maintenus ?
N’est-il pas souhaitable d’accélérer la mise en place du gouvernement de la zone euro souhaité par le président de la République et annoncé à Strasbourg ? Quelle est la position du Gouvernement sur cette question ?
M. Luc Chatel. Monsieur le ministre, dans votre propos liminaire, vous avez évoqué des visions différentes du projet européen et la nécessité d’apporter des réponses collectives fortes à la crise européenne. Mais quelle est la vision exprimée par la France ? À Bratislava, nous avons assisté à un sommet défensif. Va-t-on renforcer l’aspect économique de la construction européenne ?
La répartition obligatoire de quotas de migrants n’était pas une bonne chose. Voilà que le président de la République a opéré un virage 180° sur la question, après l’Allemagne et la Commission européenne… En vérité, la France est affaiblie parce qu’elle ne tient pas ses engagements. En outre, le couple franco-allemand est contourné par des actes comme la participation au sommet des partenaires méridionaux.
Qu’en est-il de l’avenir des agences européennes au Royaume-Uni ? Je voudrais qu’une étude soit menée également sur l’implantation des sièges sociaux de grands groupes internationaux. Un groupe de travail devrait être mis en place à Bercy, pour savoir comment en bénéficier davantage par des rapatriements vers le territoire français de ces centres de décision.
Par ailleurs, j’ai été choqué par un événement pour ainsi dire passé sous silence. Dans la dignité, le commissaire anglais Jonathan Hill a démissionné à l’annonce des résultats du référendum. Pour la bonne application des traités, la Commission européenne a exigé que le Royaume-Uni désigne de nouveau un membre du collège : ce fut Sir Julian King, certes connu et apprécié chez nous pour son ambassade à Paris, mais à qui fut tout de même attribué le portefeuille de la sécurité, objectif prioritaire de l’Union européenne si l’on en croit les conclusions du dernier sommet de Bratislava… Comment nos concitoyens peuvent-ils, dans ces conditions, adhérer au projet européen ? La France doit faire entendre sa voix et s’opposer à ce type de décision.
M. Bruno Le Roux. Je n’aurais rien à ajouter à la deuxième partie de l’intervention de notre collègue Luc Chatel.
La question de la cellule de suivi nous rappelle qu’il faut bien distinguer entre la question des suites directes du référendum britannique et celle, plus institutionnelle, des négociations à entamer. La perspective du Brexit a forcément entraîné un certain nombre d’anticipations liées à l’éventualité de ce qui pourra se passer. Les acteurs économiques n’attendent pas de prise de décision officielle pour envisager des implantations nouvelles ou une relocalisation d’une part de leurs activités. Dans un domaine que je connais bien, celui de l’aviation, les compagnies songent d’ores et déjà à prendre des licences dans d’autres pays. Telles sont les suites concrètes du référendum britannique. De ce point de vue, y a-t-il une cellule de suivi qui permette de compiler ces questions et de faire le point sur notre attractivité ? Car il faudra anticiper et accompagner les décisions des acteurs économiques. En tout état de cause, les suites du référendum britannique ne seront pas seulement de nature institutionnelle.
Par ailleurs, qu’est-ce qui est mis en place pour rassurer les nombreux ressortissants français sur le territoire britannique, à un moment où il est question de remettre en cause la liberté de circulation ? Un fil permanent d’information devrait être assuré, même si leurs inquiétudes peuvent aussi s’exprimer par la voix de leurs représentants élus.
Mme Élisabeth Guigou. Je voudrais dire un mot en réaction à notre collègue Luc Chatel. Heureusement que la France est là et que, depuis quelques années, elle tient mieux ses engagements qu’il y a trois ou quatre ans. Elle peut être ainsi le pays le plus ferme, pour refuser notamment d’accorder au Royaume-Uni le bénéfice de l’accord antérieurement accordé à David Cameron. Je m’associe sur ce point aux demandes de notre collègue Jacques Myard.
La meilleure façon de faire pression sur le Royaume-Uni est de faire avancer l’Union européenne. Quels types de moyens de pression avons-nous sur le Royaume-Uni pour qu’il ne diffère pas indéfiniment l’activation de l’article 50 ? Je trouve fâcheux qu’il n’ait pas été question, à Bratislava, du renforcement de la zone euro.
M. le président Claude Bartolone. Le Financial Times faisait état hier des déclarations surprenantes du premier ministre slovaque, M. Robert Fico, qui a annoncé que les conditions de sortie seraient très douloureuses pour le Royaume-Uni et que l’Union européenne saisirait l’occasion de dire ainsi : « Maintenant vous allez voir pourquoi il est important de rester dans l’Union européenne », ajoutant que « même si la Grande-Bretagne est la cinquième économie mondiale, ce sera très douloureux pour le Royaume-Uni ». Cet avis est-il partagé au Conseil européen ? Quel degré d’unité entre les chefs d’État et de gouvernement y ressentez-vous ?
M. le secrétaire d’État. Dans l’Union européenne, l’unité est un combat, où le couple franco-allemand joue d’ailleurs un rôle décisif.
S’agissant de la négociation, il est clair qu’elle se déroulera au niveau européen et qu’il n’y aura donc pas un négociateur par État membre. Pour coordonner la position française, la synthèse qui devra s’opérer en France se fera autour du président de la République et du premier ministre, pour une meilleure préparation des arbitrages. Selon le type du groupe de travail retenu au niveau européen – et nous souhaitons qu’il se mette en place sous l’égide de Michel Barnier, nous verrons s’il y aura un représentant de la France.
Quant au passeport nécessaire pour les services financiers au sein de l’Union européenne, il n’est pas possible que des établissements bancaires qui ont un siège au Royaume-Uni continuent à opérer dans les mêmes conditions, alors qu’ils seront désormais hors de la supervision de l’Union européenne. Malgré les réticences de la Banque centrale européenne, la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé qu’il est possible que les compensations en euros aient lieu hors de la zone euro, mais seulement si elles se font dans l’Union européenne. Elles ne seront donc plus possibles à Londres.
Il y aura des lignes rouges, comme la liberté de circulation. Si jamais le Royaume-Uni veut un accès au marché intérieur, il devra la respecter pleinement.
Pour l’accord de février, il est caduc ! Les dispositions en cause, acceptées comme conditions d’un maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, ne tiennent plus. Elles ne remettaient d’ailleurs pas en cause la liberté de circulation, mais posaient seulement des conditions à l’attribution de certaines prestations sociales.
J’en viens à la position de nos partenaires et aux réactions du premier ministre slovaque. Elles montrent que la ligne de la fermeté est suivie, même par des pays qui pouvaient, par exemple en Europe centrale, sembler plus sensibles aux pressions britanniques. Nous avons été d’emblée les plus clairs et les plus fermes sur le calendrier ; nous partageons aujourd’hui cette position avec l’Allemagne.
Certains m’ont demandé comment forcer les Britanniques à activer l’article 50. Mais la question est plutôt de tenir bon sur le fait qu’une sortie de l’Union européenne ne peut avoir lieu sans activation de l’article 50. Theresa May a déclaré qu’elle a reçu un mandat pour sortir de l’Union européenne. Les Vingt-Sept l’ont invité à le faire, en rappelant que la sortie de l’Union européenne passait par l’article 50 et qu’elle était alors inéluctable au plus tard deux ans après. Tant que le Royaume-Uni n’est pas sorti, il reste sous la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne, il doit continuer de transposer les directives et de respecter la liberté de circulation… Il faut donc être clair sur la question de l’article 50 et le refus de toute pré-négociation.
Concernant un vote de la Chambre des Communes sur la notification, même si des députés nationaux en réclament un, le cabinet britannique ne le juge pas nécessaire. Mon homologue me l’a dit encore hier à Bruxelles, en m’assurant que l’activation de l’article 50 ne serait pas soumise à un vote parlementaire. Mais l’accord de retrait le sera naturellement, puisqu’il devra être ratifié par la Chambre des Communes.
Cette négociation ne doit pas cependant pas résumer l’agenda européen et absorber toutes les énergies. L’essentiel, c’est ce que nous allons faire à vingt-sept.
M. Pierre Lequiller. Et à dix-neuf !
M. le secrétaire d’État. Nous n’avancerons pas si le cœur de l’Union européenne ne progresse pas en matière de cohésion sociale, en accroissant la prospérité et le plein emploi. Aujourd’hui, la protection apportée par l’Union européenne n’est pas suffisante en termes d’emploi, de croissance et d’investissements. En tout état de cause, l’essentiel se joue désormais entre les vingt-sept États membres présents à Bratislava et les dix-neuf États membres de l’union économique et monétaire.
Oui, Monsieur Luc Chatel, nous devons en effet avancer. Mais ne nous plaignons pas que la France soit au cœur de nombreux formats de discussion qui ont eu lieu pour préparer le sommet de Bratislava, tantôt avec l’Allemagne, tantôt avec l’Allemagne et l’Italie, à Berlin puis à Ventotène, tantôt avec les partenaires d’Europe du Sud, à Athènes, où Mariano Rajoy était d’ailleurs également présent : nous avons en effet en commun une vision de l’engagement européen autour de la Méditerranée, mais aussi dans le domaine économique et monétaire. Oui, la France est, dans l’Union européenne, au cœur du dialogue entre Nord et Sud, entre Est et Ouest, entre membres et non membres de la zone euro.
Monsieur Myard, nous voyons aujourd’hui ce que signifie pour un pays la sortie de l’Union européenne. Ceux qui l’ont proposé au Royaume-Uni sont bien en peine de voir comment cela peut se passer. Or des gens proposent en France de faire la même chose, sans avoir d’idée plus claire sur la suite. Notre conviction était qu’il était préférable que le Royaume-Uni soit dans l’Union européenne, mais la construction européenne pourra se poursuivre sans lui, si nous savons répondre à la fois à des défis nouveaux et à des questions anciennes.
Ainsi, l’Europe de la défense peut connaître aujourd’hui de nouvelles avancées, sous l’impulsion de la France. Non, Monsieur Philip Cordery, le Royaume-Uni ne saurait user en ce domaine d’un droit de veto. Car le format de la coopération structurée permanente qui peut y être utilisé ne requiert pas l’unanimité, ni des Vingt-Huit, ni des Vingt-Sept. Les ministres français et allemand de la défense, Ursula van der Leyen et Jean-Yves Le Drian ont signé à ce sujet un document commun fixant des objectifs précis. Mais d’autres États membres veulent aussi prendre part à ces avancées, notamment pour protéger les frontières communes.
Est-ce vraiment nous qui avons opéré un virage à 180° sur la question ? Nous avons au contraire dit dès le début que la solution passait par une réponse globale à la question migratoire, un contrôle des frontières, un corps européen de garde-côtes et de gardes-frontières, un dispositif semblable à l’electronic system for travel authorization (ESTA) américain pour les entrées et sorties au sein de l’Union européenne, et une coopération accrue avec les pays d’origine et de transit.
Monsieur Cordery, la France a en effet de nombreux accords bilatéraux avec le Royaume-Uni. L’issue du référendum n’aura par exemple pas d’impact sur l’accord du Touquet, relatif à la surveillance de Calais et aux questions migratoires. Négocié par la précédente majorité, il a été révisé au cours du dernier sommet franco-britannique pour prévoir une contribution financière plus importante du Royaume-Uni. Mais nos accords bilatéraux les plus importants sont ceux de Lancaster House, en matière de défense : passés hors du cadre de l’Union européenne, ils seront préservés, quoi qu’il arrive.
S’agissant de la coopération en matière de recherche ou d’aéronautique, par exemple de la participation au programme Horizon 2020, il faudra voir si le Royaume-Uni veut que ses universités et ses centres de recherches continuent d’y participer. Mais des accords bilatéraux complémentaires sont certainement à envisager aussi dans le domaine de la recherche.
En ce qui concerne la réaction de l’Italie, je voudrais rappeler que la situation y est dominée par la crise des réfugiés et par le sentiment que l’Europe centrale ne pratique pas toujours la solidarité ; nous avons en effet observé une absence d’engagements nouveaux à Bratislava. Maintenant que l’accord avec la Turquie est en place et a réduit les passages dans la mer Égée, l’Italie est le principal pays d’accueil dans l’Union européenne, et même dans le monde, en recevant de manière contrôlée chaque année 150 000 personnes. Cela est lié à la situation en Libye et à l’application du droit de la mer que l’Union européenne reconnaît et pratique, notamment en déployant la force navale de l’Union européenne en Méditerranée, dans le cadre de l’opération Sophia.
Monsieur Savary, le cabinet de Theresa May estime qu’il n’a pas à obtenir de vote de la Chambre des Communes pour activer l’article 50. Ses membres paraissent regarder toutes les options qui sont devant eux, sans y avoir encore fait de choix à ce stade. Certains espèrent que, dans l’intervalle, une prise de conscience se produise et qu’un nouveau référendum ou de nouvelles élections législatives permette de revenir sur les résultats du référendum de juin. Mais ce n’est pas l’intention du gouvernement britannique actuel.
Le taux de participation au référendum était en effet très élevé et semble rendre inéluctable une sortie. Il s’agit d’un fait historique qui ne pourra pas être remis en cause par le gouvernement britannique. Peut-être qu’il en ira différemment dans une ou deux générations. Mais, pour l’instant, nous n’en sommes certainement pas là.
Oui, j’approuve la suggestion d’une surveillance parlementaire sur le suivi des négociations, dans les différents secteurs. Monsieur le président Le Roux, vous avez tout à fait raison d’évoquer en particulier le secteur de l’aviation.
S’agissant de la Suisse, les relations entre elle et l’Union européenne sont compliquées depuis le référendum de 2014. La confédération constate aujourd’hui qu’elle doit trouver une formule constitutionnelle interne pour apporter à ce dernier une réponse sans remettre en cause le principe de la liberté de circulation, sous peine de perdre son accès au marché intérieur.
Il faut certes penser aux intérêts français, notamment dans le domaine des services financiers. Des retombées positives sont possibles, car certaines activités pourraient être relocalisées en France. Le 6 juillet 2016, le premier ministre a annoncé des mesures fiscales sur l’impatriation et une baisse de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la création d’un point d’entrée unique pour ceux qui voudraient s’installer en France. Il a annoncé que des sections internationales seraient ouvertes autant que nécessaire dans les établissements scolaires. Car nous devons être conscients que, vu les enjeux, il y aura de la compétition.
En ce qui concerne le commissaire britannique, nous sommes dans une situation contradictoire, puisque la démission de Jonathan Hill a seulement conduit à la désignation d’un nouveau commissaire britannique. Au sein du collège de la Commission européenne, tous les commissaires ont toujours eu une responsabilité... Par ailleurs, nous apprécions, pour sa personnalité, le nouveau commissaire Julian King. Évitons seulement qu’en 2019, le Parlement européen et la Commission européenne soient renouvelés en tenant compte du Royaume-Uni, qui veut et qui doit sortir.
Pour nous, l’essentiel reste cependant de faire avancer l’Union européenne à vingt-sept, de même que l’union économique et monétaire.
M. le président Claude Bartolone. Vos propos apportent pleinement sa justification, s’il en était besoin, à la création de notre mission d’information. En effet, l’on comprend bien la nécessité d’associer le Parlement au suivi des négociations et des conséquences du référendum, qui peuvent être aussi bien positives que négatives pour notre pays.
La mission d’information procède ensuite à l’audition, non ouverte à la presse, de M. Philippe Léglise-Costa, secrétaire général des affaires européennes.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur le secrétaire général, soyez le bienvenu. Les auditions que nous menons aujourd’hui tendent à faire le point sur la question du Brexit, trois mois après le référendum. Nous venons d’interroger le secrétaire d’État chargé des affaires européennes sur les lignes rouges fixées par la France et sur la position des autres États membres de l’Union. Nous souhaitons maintenant vous entendre traiter des aspects techniques et juridiques de la question.
Comment s’organise l’administration française pour préparer ces négociations ? Une structure spécifique a-t-elle été installée ? Quelles ressources seront mobilisées ? Quels travaux ont été engagés ? Comment les autres États membres ont-ils décidé de s’organiser ? Comment envisagez-vous les modalités et le format de la négociation ? Comment s’articuleront la négociation du retrait et celle des relations futures ? Quels contacts avez-vous avec vos homologues des autres États membres et qu’en retirez-vous ? Au Royaume-Uni, l’ancienne direction EGIS du Cabinet Office, l’équivalent du secrétariat général aux Affaires européennes, a été intégrée au nouveau ministère du Brexit ; comment vos relations s’organisent-elles ?
M. Philippe Léglise-Costa, secrétaire général des affaires européennes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les députés. Le champ à couvrir étant très vaste, nous avons constitué dès le début du mois de juillet un groupe de travail interministériel qui réunit environ 45 dirigeants d’administrations ou leurs représentants. Ils peuvent se retrouver soit en réunion plénière, comme nous l’avons fait en juillet, soit dans des réunions spécialisées. Pour animer le groupe dans ces formats spécialisés, nous avons désigné des référents par domaine au sein du secrétariat général des affaires européennes (SGAE) – ils sont une quinzaine – et nous recrutons de surcroît une petite équipe qui se consacrera pleinement à la négociation avec le Royaume-Uni. C’est donc une architecture en trois cercles : cette équipe, avec un responsable à sa tête placé auprès du secrétaire général des affaires européennes et chargé d’animer les travaux au sein de l’administration française, les réflexions au sein du SGAE et enfin les correspondants dans chaque administration, qui peuvent eux-mêmes mobiliser des ressources… . En tout, une soixantaine de personnes forment ainsi cette structure interministérielle.
Nous sommes à la première étape de nos travaux : la préparation de la négociation. Nous avons demandé à chaque administration de présenter, pour leur domaine respectif, l’évaluation de l’enjeu tant au regard des intérêts français que de ceux de l’Union à vingt-sept et, c’est possible puisqu’une part d’indétermination demeure, les options envisageables pour la négociation. En nous fondant sur ces évaluations sectorielles, nous pensons élaborer pour le mois d’octobre une première analyse d’ensemble. Elle sera soumise au président de la République et au Gouvernement qui nous donneront leurs orientations. Cela nous permettra d’engager des discussions techniques spécifiques avec nos interlocuteurs dans les capitales des Vingt-Sept et avec la Commission européenne afin de faire converger nos analyses sur la manière dont cette négociation inédite se présente.
Dans les autres États membres, les dispositifs sont plus ou moins avancés. Les Allemands ont créé une structure comparable à la nôtre, logée au ministère des affaires étrangères puisqu’il n’y a pas de SGAE en Allemagne. Les pays plus petits se concentrent sur certains intérêts, et chacun a en tête le même calendrier : il faudra, à la fin de l’année, avoir les idées claires sur les orientations politiques, de manière que si le Royaume-Uni notifiait son retrait de l’Union au début de 2017, ce qui est notre hypothèse de travail, le Conseil européen soit prêt à arrêter les orientations qui permettront d’engager la négociation. Dans cet esprit, nous avons commencé à vérifier, avec l’Allemagne et avec la Commission européenne en particulier, que notre méthodologie est la même. La Commission européenne s’organise de manière comparable à la nôtre sachant que, dès lors qu’elle sera directement chargée de conduire la négociation, les ressources mobilisées seront plus importantes : une équipe d’une vingtaine de personnes a été constituée autour de M. Michel Barnier et elle pourra mobiliser l’expertise nécessaire dans l’ensemble des directions générales. Au secrétariat général du Conseil, une équipe plus restreinte a été constituée, dirigée par M. Didier Seeuws que nous connaissons bien car il a été le chef de cabinet de M. Herman Van Rompuy. Elle pourra suivre directement les travaux de la Commission européenne. La situation du Royaume-Uni est beaucoup plus complexe : outre qu’il devra mener pour son compte cette négociation, il lui faudra mener en profondeur sa stratégie administrative et économique dans de nombreux domaines. Les Britanniques sont en train de constituer une administration spécialisée pour le Brexit. Elle sera dirigée par M. Oliver Robbins, haut fonctionnaire proche de Mme Theresa May qui connaît en partie les affaires européennes mais qui est surtout un spécialiste de la sécurité. Il aura une double casquette : il sera responsable de cette administration sous l’autorité du ministre chargé de la sortie de l’Union européenne M. David Davis d’une part, et il est en même temps amené à être sherpa de la Première ministre d’autre part.
L’organigramme de l’équipe britannique est encore lacunaire. On y voit des directions horizontales et trois directions sectorielles. L’une est chargée du marché intérieur et une autre de la justice, de la sécurité et des migrations ; la troisième du commerce. Le gouvernement du Royaume-Uni compte aussi outre M. Boris Johnson, ministre des affaires étrangères dont les ressources administratives chargées des affaires européennes seront pour une grande part transférées à l’administration de M. Davis, un ministre du commerce international en la personne de M. Liam Fox.
Constituer une administration n’est pas chose aisée, si bien que le Royaume-Uni rencontre des difficultés administratives qui s’ajoutent, comme le ministre vous l’a sans doute dit tout à l’heure, à des divisions politiques sur la stratégie à suivre. S’ensuivent une forme de désarroi et une certaine désorganisation, si bien que, du fait de cette relative impréparation, nos contacts avec les Britanniques en sont à un stade très préliminaire. Comme vous le savez, les Etats membres à Bruxelles interdisent toute pré-négociation avant que le Royaume-Uni ait notifié son retrait de l’Union – c’est de bonne pratique, puisqu’il n’y a pas dans cette période de position à vingt-sept à développer, les seuls contacts envisageables devront être destinés à favoriser une préparation britannique qui aboutisse à une stratégie compatible avec les conditions posées par les Vingt-Sept dès la fin du mois de juin dernier.
J’en viens à la durée et au format des négociations. Comme le prévoit l’article 50 du Traité, aussitôt que le Royaume-Uni aura notifié son intention de se retirer de l’Union européenne, le Conseil européen à vingt-sept arrêtera des orientations sur les négociations visant à la conclusion d’un accord fixant les modalités de ce retrait. L’exercice étant inédit, on ne sait pas encore précisément quelles seront ces orientations. On peut toutefois imaginer qu’elles définiront les structures et le processus de la négociation, l’équipe qui la mènera – très vraisemblablement dirigée par la Commission européenne mais à laquelle pourront éventuellement être associés des membres du secrétariat général du Conseil – ainsi que les modalités de son suivi. Ce suivi, nécessairement étroit, pourrait impliquer les Représentations permanentes des États membres à Bruxelles chargées d’assurer la circulation des informations entre les négociateurs et les capitales des Vingt-Sept ainsi que des correspondants dans ces capitales, probablement les sherpas des chefs d’État et de Gouvernement ou leurs représentants, le Conseil européen étant lui-même amené à être particulièrement engagé.
Les orientations du Conseil européen porteront donc pour partie sur la structure et le pilotage de la négociation. Il arrêtera également les principes qui devront la guider, à la lumière de ce qu’aura proposé le Royaume-Uni, mais qui seront évidemment fondés sur les intérêts des Vingt-Sept. Les sujets plus techniques feront l’objet d’une recommandation de la Commission européenne qui, une fois adoptée par le Conseil, formera un mandat détaillé pour engager la négociation avec le Royaume-Uni.
Une fois engagée, la négociation devrait en principe se dérouler en deux ans. Trois hypothèses sont en principe envisageables. La première est que nous parvenons effectivement à conclure dans ce délai un accord avec le Royaume-Uni ; dans ce cas, le retrait se fera aux conditions convenues avec, éventuellement, une période de transition. La deuxième hypothèse est que la négociation n’a pu aboutir en deux ans et qu’un ou plusieurs États membres considèrent qu’elle a assez duré ; dans ce cas, elle peut s’interrompre. C’est un facteur de pression pour conclure en deux ans, et le rapport de forces restera d’autant plus favorable aux Vingt-Sept qu’ils resteront unis. La troisième hypothèse, théorique à ce stade, est que la négociation est inaboutie au terme de deux ans, mais que les Vingt-Sept considèrent unanimement qu’il vaut la peine de la poursuivre, pour une durée à déterminer.
Notre hypothèse de travail est donc que la négociation s’engagera au début de l’année 2017 pour s’achever début 2019. C’est une durée courte, mais raisonnable et logique étant donné les contradictions que peut provoquer au fil des mois la participation du Royaume-Uni à une Union européenne dont il se prépare dans le même temps à sortir, et elle correspond également aux échéances internes à l’Union. En 2019 se tiendront en effet les élections européennes, le renouvellement des institutions et le parachèvement du futur cadre financier pluriannuel. Il y aurait une sorte de paradoxe à négocier ces sujets et à procéder à des élections européennes à vingt-huit avec le Royaume-Uni.
Vous m’avez interrogé sur l’articulation entre la négociation du retrait et la question des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. La négociation qui se déroule dans le cadre de l’article 50 du Traité porte sur les modalités du retrait, non sur les relations futures en tant que telles. C’est logique sur le plan juridique : la méthode et le champ de la négociation sur les modalités du retrait diffèrent de ceux qui vaudront pour la négociation des relations futures avec un État qui sera devenu un pays tiers ; un autre mandat sera donc nécessaire. C’est logique aussi sur le plan politique, car se contraindre à conclure un accord avec le Royaume-Uni sur les relations futures pour qu’il puisse se retirer de l’Union serait se mettre entre ses mains, puisqu’il déciderait lui-même du moment où il serait satisfait de ces relations futures avant de se retirer effectivement. Ce n’est pas envisageable, et le Traité est plutôt bien rédigé de ce point de vue, puisqu’il permet aux Vingt-Sept de garder la main, de décider quand le Royaume-Uni se retirera et, donc, de l’amener à proposer des solutions raisonnables pour son propre statut futur. Cela dit, il y a un intérêt à avoir en tête ces relations futures durant la négociation. Si, par exemple, nous savons que l’objectif est de conclure un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, futur pays tiers, nous pouvons décider d’une période de transition qui évitera de devoir reconstituer des droits de douane et de subir les à-coups subséquents.
Pour autant, ce n’est pas une obligation, et l’on ne peut exclure une sortie sèche. C’est d’ailleurs l’une des options discutées à Londres, où se confrontent plusieurs écoles de pensée et où certains responsables qui avaient milité en faveur de la sortie pendant la campagne référendaire considèrent que leur pays y a intérêt. Selon eux, le Royaume-Uni devrait se limiter à être membre de l’Organisation mondiale du commerce, du Conseil de l’Europe et de l’Alliance atlantique et élaborer une stratégie économique fondée sur l’établissement d’une plateforme dérégulée aux portes de l’Union européenne – ce qui nous amènerait à prendre d’autres protections pour les Vingt-Sept. Il peut y avoir, pour certains, une logique économique à procéder de la sorte, et si ce n’est pas nécessairement le choix de Mme Theresa May, il ne faut pas exclure que tel soit l’aboutissement de cette négociation.
Une autre logique, moins radicale, consiste à prévoir de futures relations structurées entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, en respectant le principe de l’équilibre entre les droits et les obligations. Dans ce cas, l’accord sur les modalités de retrait devrait prévoir des modalités de transition, ce qui donnerait le temps de négocier les relations futures une fois le Royaume-Uni sorti. L’articulation entre les deux négociations dépend donc pour beaucoup du choix du Royaume-Uni et de l’état d’avancement de la négociation sur les modalités de retrait au terme de deux ans, celle-ci pouvant définir une période de transition vers des relations futures qui seraient donc envisagées mais non encore conclues.
Voilà pour le cadre et la méthode. Sur le fond, le travail interministériel a été réparti en blocs de sujets. Le premier bloc a trait aux questions institutionnelles et administratives, ce qui est au cœur du retrait d’un État membre. Il y aura bien sûr le départ des parlementaires européens et du commissaire britanniques, mais d’autres questions complexes devront être réglées, dont celle du sort des fonctionnaires européens britanniques qui ont des droits et dont il faudra déterminer le statut. Le retrait britannique signifie également la cessation de la contribution du Royaume-Uni au budget européen. Des paiements ont lieu qui correspondent à des engagements pris ; il faut prévoir une période de transition et s’assurer que le Royaume-Uni ne demandera pas des paiements sur son territoire alors qu’il aura mis fin à sa contribution. De même, le Royaume-Uni devrait sortir du capital de la Banque européenne d’investissement (BEI). Dans un autre domaine, une série de contentieux sont en cours devant la Commission européenne, la Cour de justice ou le Tribunal, qui peuvent concerner les droits des personnes établies dans l’Union Européenne à vingt-sept ; il faudra prévoir le bon aboutissement de ces procédures dans les modalités du retrait britannique. Il faudra aussi trancher le cas de l’Agence bancaire européenne et de l’Agence européenne des médicaments, sises au Royaume-Uni, et celui de la section de la division centrale du tribunal de première instance de la juridiction unifiée des brevets, qui devait s’établir à Londres.
Ainsi, en conséquence du premier bloc qui concerne le retrait au sens strict, un deuxième bloc de sujets devra être examiné : les décisions, à prendre à vingt-sept, entraînées par le retrait. La plus concrète est celle du déménagement des agences européennes installées au Royaume-Uni : où migreront-elles ? Traditionnellement, ces discussions sur les sièges ne sont pas simples. De même, le budget européen sera amputé de la contribution britannique nette, qui s’établit, bon an mal an, à 7 milliards d’euros. Réduira-t-on la voilure sur les fonds structurels, la politique agricole commune, les politiques européennes en général, ou bien les autres États membres compenseront-ils ? Y aura-t-il un compromis ? Ces décisions doivent être discutées parallèlement aux modalités de retrait de manière qu’au moment où le Royaume-Uni sortira effectivement, l’Union européenne soit en ordre de marche.
Le troisième bloc a trait à l’ensemble des législations et réglementations, les politiques communes. Sur ces sujets, il est possible d’envisager une transition vers un autre statut, pour le Royaume Uni comme pays tiers aujourd’hui indéterminé, et qui peut être plus ou moins proche du corpus européen selon ce que le Royaume-Uni acceptera comme obligations et ce que les Vingt-Sept décideront. Au nombre des grands sujets à traiter, il y a le droit des personnes : ceux des Européens installés au Royaume-Uni – où l’on dénombre environ 300 000 Français – et ceux des citoyens britanniques installés sur le territoire des Vingt-Sept – ils sont quelque 200 000 en France. Tous ont des droits liés à l’Union européenne pour leur séjour, l’accès aux soins, l’accès au travail, la coordination des régimes de sécurité sociale… Faudra-t-il, ou non, prévoir une phase de transition vers un autre statut ? Si ce statut est celui de pays tiers, les personnes concernées pourraient évidemment perdre une partie de leurs droits.
Autre sujet d’ampleur : le marché intérieur des biens et des services – j’écarte pour l’instant les services financiers, sur lesquels je reviendrai. Il s’agit de questions très complexes qui ne se limitent pas aux échanges et aux droits de douane puisqu’il faudra traiter aussi de la protection des consommateurs, des questions de sécurité, des normes environnementales, de la certification, du droit des sociétés, de la fiscalité, de la TVA, des droits d’accise et d’autres sujets très difficiles, tels que le commerce électronique et la compétence des juridictions. L’enjeu est complexe et lié à l’avenir des échanges entre le Royaume-Uni et l’Union européenne en matière de biens et de services. Dénouer l’écheveau constitué en plus de quarante ans sera redoutablement compliqué et conduira à des choix de lourde portée si l’on devait en venir, ce qui est le plus probable, à des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qui ne soient pas celles du marché intérieur mais définies par un accord spécifique.
Les services financiers seront traités à part, même s’il y a bien sûr une logique d’ensemble à respecter. La question est en effet particulièrement sensible, en raison du poids de la City, de la place des institutions financières britanniques dans le financement de l’économie des Vingt-Sept et de l’avantage que confèrerait au Royaume-Uni, en ces matières, un accès au marché intérieur sans être tenu à l’ensemble des contreparties qui s’imposent dans l’Union Européenne et qui sont très importantes, puisqu’il s’agit de l’application de toutes les régulations européennes et de toutes les garanties de leur application effective – la Cour de justice et la supervision bancaire. On ne peut concevoir que les institutions financières britanniques continuent de disposer d’un « passeport européen » et conservent leur place dominante sur le continent sans devoir se plier à l’ensemble de ces contreparties. Mais, disent les Britanniques aujourd’hui, le principe qui a sous-tendu le référendum est qu’ils n’acceptent pas certaines de ces contreparties. Il faudra donc imaginer un autre régime, qui devra très solidement protéger les intérêts des Vingt-Sept. L’analyse du Trésor français est que même le régime de « pays tiers » actuellement octroyé aux États-Unis serait trop léger pour permettre aux places financières de l’Union d’affronter la compétition d’une place aussi puissante, sophistiquée et proche que celle de Londres. Des modalités particulières devront donc être définies pour garantir l’équité entre des places dont l’une est, aujourd’hui, clairement dominante.
Le quatrième bloc de sujets concerne le commerce international, domaine également complexe. L’Union européenne a contracté 53 accords commerciaux. Cela signifie que lorsque le Royaume-Uni sortira de l’Union, les pays avec lesquels nous avons collectivement contracté pourront demander des compensations, le territoire de l’Union et le nombre de consommateurs se réduisant. Il ne serait pas acceptable pour les Vingt-Sept de payer pour la sortie du Royaume-Uni ; il faudra donc prévoir dans l’accord de retrait que le Royaume-Uni assumera le règlement de ces compensations. D’autre part, le Royaume-Uni ne pouvant plus exporter sur ces contingents, les pays membres de l’Union européenne bénéficieront de contingents améliorés dans les pays tiers, le Canada par exemple ; mais, dans le même temps, les importations canadiennes se feront sur un territoire plus petit, puisqu’amputé du Royaume-Uni. L’imbrication des sujets explique la constitution d’un bloc spécifique : il faudra analyser ces questions une à une pour négocier dans de bonnes conditions.
À cela s’ajoutent des sujets sectoriels. L’acquis européen se traduit par des coopérations dans un grand nombre de domaines. Il faut les étudier tous, mais certains ont un intérêt direct plus sensible que d’autres. Ainsi de la pêche, car certains ports sont très dépendants de l’accès aux eaux britanniques : en volume global, 20 % de la pêche française en dépend, mais pour certains de nos ports la proportion monte à 70 %. En contrepartie, nous importons des produits de la pêche britannique : un équilibre s’est constitué au fil des ans. Il y aura donc une négociation spécifique qu’il faudra suivre attentivement.
La vigilance s’imposera aussi en matière spatiale. Le Royaume-Uni est l’un des acteurs de ce secteur, acteur avec lequel nous entretenons des coopérations dans de nombreux domaines qui dépendent en partie de l’acquis européen. Il en va de même pour le nucléaire, le transport aérien – avec Airbus et la certification par l’Agence européenne de sécurité aérienne –ou la recherche : le Royaume-Uni, très grand acteur de la recherche européenne, bénéficie en partie des programmes européens. En matière de sécurité enfin, le Royaume-Uni applique certains instruments européens dont le mandat d’arrêt européen – ce qui signifie des centaines d’échanges de personnes appréhendées – et renseigne un certain nombre de fichiers. Des coopérations bilatérales existent en matière de lutte contre le terrorisme, aussi liées à ces instruments européens dont il faudra déterminer l’évolution.
Je conclurai par quelques mots sur la question du comportement du Royaume-Uni pendant les quelque deux ans et demi qui nous séparent de la fin de la négociation. Il est très difficile de maîtriser ce comportement alors que le Royaume-Uni prépare sa sortie. Cela est flagrant aujourd’hui déjà en matière commerciale. Les Britanniques ont commencé à nouer des contacts avec l’Australie. Or, au regard du droit européen, il est illégal d’engager des discussions puisque le commerce est une compétence exclusive de l’Union. Si le Royaume-Uni devait rester un État membre, il serait condamné par la Cour de justice européenne et cesserait probablement d’agir ainsi. Mais il est possible que la perspective d’une condamnation par la Cour, qui interviendrait dans deux ou trois ans, ne dissuade pas son gouvernement. Si le Royaume-Uni persiste, il faudra donc trouver d’autres moyens – pression politique ou contreparties ; l’une des mesures de rétorsion possibles à étudier, serait de l’exclure des enceintes de l’Union où l’on discute des questions commerciales, qui ne seraient plus négociées qu’à vingt-sept. Sans accréditer un procès d’intention systématique à l’encontre du Royaume Uni, l’on observe que dans certaines négociations sur des instruments liés à des services financiers, il commence à favoriser le régime du pays tiers – c’est-à-dire celui qui lui serait appliqué lorsqu’il sera sorti … Nous devons donc vérifier avec vigilance le maintien de ce que l’on appelle en droit européen la coopération loyale et, s’il apparaît que le Royaume-Uni poursuit certaines pratiques, appliquer des mesures de rétorsion et des contreparties. Nous avons commencé d’en discuter avec la Commission européenne et avec l’Allemagne de manière à nous organiser : les Vingt-Sept doivent s’accorder unanimement sur le fait qu’il ne peut y avoir d’impunité pour le Royaume-Uni pendant toute la période au cours de laquelle, selon les traités, il conserve l’ensemble des droits et des obligations d’un État membre, s’il commence à en dévier.
Mme Elisabeth Guigou. La précision des indications que vous nous avez apportées m’a rassurée, qu’il s’agisse de la liste des sujets et de l’organisation décidée pour les traiter ou de la fermeté qui prévaudra. Cette fermeté a déjà été exprimée au plus haut niveau politique et il est bon qu’elle existe aussi aux niveaux plus techniques. Je n’ai pas de doute sur la capacité du SGAE à maîtriser ces questions complexes. Ce sera un surcroît de travail mais avec vos services nous sommes bien armés, et mieux armés que les pays qui n’ont pas de structures équivalentes, chargées de recenser les enjeux et de préparer les pré-arbitrages interministériels.
En revanche, la réponse que m’a donnée le ministre sur l’aspect politique de la question n’a pas dissipé mes interrogations. À Bruxelles, m’a-t-il dit, il y aura un organe présidé par le représentant de la Commission européenne et, avant chaque Conseil européen, un représentant de chaque État membre et peut-être aussi du Parlement européen. Soit, mais comment cela va-t-il s’organiser précisément pour ce qui nous concerne ? Quel sera le rôle du ministre des affaires étrangères qui, en principe, organise la coordination politique et qui est la voix de la France ? Y aura-t-il à Bruxelles des sherpas personnels des chefs d’État et de gouvernement ? Qu’est-il prévu à ce stade ?
La complexité et la lourdeur de la négociation relative au retrait du Royaume-Uni emportent un risque d’enlisement de tout le reste. Or la législation européenne doit continuer de se faire, d’être décidée, adoptée et appliquée. Comment fera-t-on ? Le Royaume-Uni sera-t-il associé aux discussions ? L’expérience politique montre que la meilleure manière de faire pression sur le Royaume-Uni est, pour ses partenaires, d’avancer selon leur propre calendrier. Quel est notre calendrier pour la zone euro ? Le président de la République et Mme Merkel se sont exprimés plusieurs fois ensemble à ce sujet, il y a un an encore, mais je déplore qu’il n’y ait plus véritablement de prise de parole franco-allemande commune en ce domaine.
M. Christophe Premat. Gardons-nous de sous-estimer la faculté de résilience des Britanniques. La France s’apprête à organiser méthodiquement le retrait mais, au Royaume-Uni, l’approche de la common law continue de prévaloir et l’on s’organise pour certaines séquences sans entrer très avant dans le détail. Il ne faut pas faire l’impasse sur un certain déphasage culturel, et se rappeler que tous les États veillent à préserver leurs intérêts.
Avant le référendum, les questions le plus souvent posées dans nos permanences par les membres de la communauté française établie au Royaume-Uni portaient sur les visas de travail et les allocations familiales, mais depuis que le vote en faveur du retrait l’a emporté, l’interrogation principale est devenue : « Dois-je ou non choisir la nationalité britannique ? ». Si la pression sur le consulat de France ne s’est pas trop ressentie à Londres, elle est très forte en Irlande du Nord et en Écosse. Or nos services consulaires étaient en voie de constriction, particulièrement en Écosse. Étant donné le contexte, pourrait-on envisager une réorganisation leur donnant la capacité réelle d’éclairer nos compatriotes expatriés ?
La question de la réciprocité des accords de mobilité a été évoquée dès cet été. Qu’il y ait ou non réciprocité, envisage-t-on des accords intermédiaires à ce sujet ?
Certaines conventions fiscales seront renégociées, mais aussi des accords relatifs à la sécurité sociale et aux retraites. Étant donné l’importance de la communauté française installée au Royaume-Uni, ces questions complexes sont cruciales ; on peut en effet imaginer, dans quelques années, un retour massif de français, qu’il faut anticiper. Comment est-ce appréhendé ? Dans le même ordre d’idées, un accord permettait jusqu’à présent à des Britanniques de se faire soigner à l’hôpital de Calais ; qu’en sera-t-il ?
Enfin, mes interlocuteurs au sein des universités britanniques m’ont indiqué que les universités, autonomes, n’envisagent pas d’augmenter les frais de scolarité pour les étudiants européens. Pour ce qui est au moins de la coopération en matière de recherche, un nuage noir s’éclaircit et l’horizon semble plus dégagé …
M. Jacques Myard. Nous avons la chance, nous avez-vous dit en substance, que l’article 50 du traité soit écrit de telle manière que l’on peut conclure un accord de sortie sans avoir défini les relations futures. Or ce n’est pas exactement ce que dit cet article, dont le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. (…) ». Les accords internationaux se lisant au sens littéral et devant être interprétés de bonne foi, cela signifie que, même si les deux négociations ne sont pas directement liées, on verra dans l’accord de sortie vers quoi l’on se dirige pour les relations futures ; je pense que c’est mieux ainsi, même si vous avez raison de dire qu’il faudra un peu accélérer les choses.
Mais pourquoi devrait-on se presser de faire sortir le Royaume-Uni du capital de la BEI ? Ce serait une erreur : mieux vaudrait qu’il y reste et continue d’investir. Il faut seulement trouver un modus vivendi permettant d’associer le Royaume-Uni à cette banque si peu sollicitée en dépit du plan Juncker, cautère sur jambe de bois au regard de l’ampleur des investissements nécessaires en Europe.
Pour ce qui est du statut des personnes, l’Union européenne n’est pas la seule qui garantisse le droit des étrangers : les relations franco-britanniques préexistaient à l’Union et avec elles des accords qui doivent permettre de laisser les Britanniques venir en France et les Français aller au Royaume-Uni. Mais c’est cela la réalité ! Il faut un peu d’humain, ne pas laisser les technocrates tout pervertir, et dire que les Britanniques sont toujours les bienvenus en France, et réciproquement.
À propos des services financiers, vous avez raison : on constate que le Royaume-Uni, bien que n’appartenant pas à la zone euro, a réussi à capter la compensation. L’explication en est, vous l’avez dit, la force technique de la City. Nous devrons nous armer pour récupérer les banques qui reviendront sur le continent. La place de Paris y travaille fortement, et nous devons nous battre.
M. le président Claude Bartolone. Nous avons compris quel pouvait être le niveau d’organisation ou de désorganisation de nos amis britanniques, et comment, à l’inverse, un État qui a une tradition jacobine est capable de mettre sur pied très rapidement une organisation centrale. Mais qu’en est-il plus précisément pour les autres pays et notamment pour nos amis allemands ? Quelles sont vos relations avec eux et comment s’organisent-elles ?
M. Philippe Léglise-Costa. Je suppose que le ministre vous a parlé du volet politique de l’organisation de la négociation. Pour l’instant – mais, bien entendu, les capitales se coordonnent et tout dépendra de la nature de la négociation –, il a été jugé inopportun de désigner une sorte de « ministre du Brexit » dans les capitales, à la fois parce que ce serait contredire la volonté affirmée que ce sujet ne perturbe pas l’ensemble des travaux de l’Union européenne et parce que les Vingt-Sept ne sont pas dans la situation du Royaume-Uni. Mais, cela va sans dire, l’organisation administrative que j’ai décrite ne fonctionnera que s’il y a un pilotage politique. Le président de la République et le Premier ministre y sont attachés et sont convenus d’organiser des réunions régulières à leur niveau avec les Ministres concernés. Au cours de cette période, l’interlocuteur désigné de M. David Davis est, tout naturellement, le ministre des affaires étrangères, voix politique de la France à ce sujet. Si, au fil de la négociation, les enjeux devenaient très politiques et qu’une organisation européenne différente se mettait en place, les capitales s’adapteraient. Pour l’heure, la Commission sera chargée de la négociation pour le compte des Vingt-Sept, elle devrait y associer une équipe du Secrétariat général du Conseil, dotée des ressources nécessaires et sera étroitement suivie par les Vingt-Sept, sans que cette question déstabilise les instances européennes, le Conseil en particulier.
Sans avoir la même structure administrative que la nôtre, les Allemands procèdent comme nous le faisons, une petite équipe étant chargée au sein du ministère des affaires étrangères de coordonner les administrations et de procéder à une première évaluation des enjeux. Comme il n’y a ni structure centrale pour les affaires européennes ni tradition en ce sens, l’organisation est encore plutôt décentralisée mais, à mesure que la négociation se concentrera sur des enjeux clairement définis, on peut penser qu’il y aura un pilotage plus direct de la Chancelière et un engagement des principaux ministres. Dans les autres États membres, la situation varie. Les petits pays, telles l’Estonie et la Slovénie, se concentrent sur quelques enjeux. D’autres, plus grands, ne sont pas encore très organisés – l’Italie par exemple, ou l’Espagne pour des raisons conjoncturelles. En revanche, l’Irlande, pour laquelle les enjeux du Brexit sont fondamentaux, a réorganisé une partie de son administration des affaires européennes autour de cette question.
Pour ce qui est du risque d’enlisement, des contradictions politiques peuvent en effet apparaître si le Royaume-Uni ne se comporte pas loyalement pendant la période où nous devrons traiter avec lui dans les enceintes du Conseil puisqu’il sera toujours membre de plein droit de l’Union. J’en ai signalé certaines, mais des difficultés peuvent surgir alors même que les Britanniques ne sont pas nécessairement déloyaux. Ainsi du renforcement des instruments de défense commerciale. Cet enjeu, depuis longtemps porté par la France, devient crucial. Le président Juncker, plus conscient de cette nécessité que ses prédécesseurs, a demandé, à juste titre, qu’ils soient renforcés. Que se passera-t-il si le Royaume-Uni parvient à réunir une minorité de blocage ? On ne pourra le taxer de déloyauté puisqu’il s’est toujours dit défavorable à cette évolution – l’Allemagne hésitant et allant désormais dans un sens peut-être plus proche de celui de la France – mais le problème politique serait patent. Un système d’alerte sera donc créé et, dès que le Royaume-Uni aura notifié sa décision de retrait, un rapport de forces s’exercera sur lui.
Le ministre vous a sans doute présenté les engagements pris à Bratislava. Nous avons six mois pour trouver un accord sur la traduction concrète des priorités centrales pour l’Union et pour débloquer certains sujets qui ont fini par empoisonner les relations entre les États, qu’il s’agisse de la question des travailleurs détachés ou de l’accueil des migrants. La question de la zone euro n’a pas été au centre des travaux parce qu’il fallait reconstituer un accord à vingt-sept et parce que l’Allemagne ne souhaite pas actuellement avancer à ce sujet.
M. Jacques Myard. Et pour cause !
M. Philippe Léglise-Costa. Cela s’explique par des raisons politiques internes, mais cela ne signifie pas que l’Allemagne ne soit pas consciente de la nécessité d’avancer. Elle y viendra, mais elle considère qu’elle aurait des difficultés à le faire aujourd’hui dans des conditions compatibles avec ce que souhaite la France. Les travaux se poursuivent : la Commission européenne prépare un Livre blanc qu’elle présentera au premier trimestre 2017. La discussion à ce sujet n’est donc que suspendue mais elle devra être reprise ultérieurement au niveau politique.
La capacité de résilience des Britanniques est en effet impressionnante. Ils sont sous l’effet d’un choc intense qu’ils n’avaient pas anticipé et ils parviennent à faire bella figura, avec le sentiment qu’ils vont s’en sortir, ce qui n’est pas garanti et demandera des choix stratégiques fondamentaux. Une fois leur administration restructurée, ils seront de bons négociateurs, mais l’on ne doit mésestimer ni la désorganisation dans laquelle ils se trouvent ni le fait qu’il y a des écoles de pensée très tranchées sur ce que doit être l’avenir du Royaume-Uni. Pour les uns, il faut un choc de dérégulation accentuant encore ce qui a déjà été fait depuis des années. Pour les autres, il faut tendre à un rééquilibrage, dans la mesure de la culture britannique ; c’était plutôt l’orientation initiale de Mme Theresa May. Ces choix sont étroitement liés à la manière dont est envisagée la relation future avec l’Union européenne. Le choc de dérégulation peut amener le Royaume-Uni à choisir une relation distante – il y aurait intérêt, mais cela nous amènerait à nous protéger de tout ce qui pourrait être inéquitable. En revanche, une forme de continuité avec des rééquilibrages internes, peut amener le Royaume-Uni à rester plus proche de l’Union, mais nous avons nos conditions en termes de respect des droits et des obligations.
Le statut des personnes sera un sujet d’intérêt particulier, singulièrement pour les Français établis au Royaume-Uni, mais la pression administrative à laquelle vous avez fait allusion s’exerce aussi en France, où des résidents britanniques souhaitent par exemple obtenir rapidement un titre de séjour pour garantir l’avenir, ou même la nationalité française. La question des ressources consulaires n’est pas directement de la compétence du SGAE, mais l’enjeu est bien connu des administrations compétentes.
Pour ce qui est des relations bilatérales garantissant certains droits, nous pourrons faire ce que nous voulons dès lors que nous nous accordons avec le Royaume-Uni. Comme cela est vrai dans tous les domaines, le risque de cette négociation est de considérer que, des intérêts s’étant constitués en 43 ans, il faut, secteur par secteur, maintenir les relations les plus étroites possibles. On se trouverait en ce cas dans une situation politique paradoxale : qui ne voit qu’il y aurait un avantage à sortir de l’Union européenne si, nonobstant, toutes les coopérations sont maintenues ? Si le Royaume-Uni, devenu un pays tiers, peut continuer à bénéficier de prêts de la BEI, pourquoi les autres États resteraient-ils membres de l’Union quand cette appartenance emporte pour eux des obligations ? Les prêts de la BEI accompagnent des projets régionaux, une convergence liée à la solidarité entre les États membres. Si l’on prolonge toutes les coopérations avec les Britanniques en matière de recherche, d’universités, de projets d’infrastructure, la question peut légitimement se poser de savoir pourquoi ce pays, une fois sorti de l’Union, peut bénéficier des avantages induits par ces coopérations sans devoir se plier aux obligations qui s’imposent aux États membres. Un équilibre politique devra être trouvé ; beaucoup d’intérêts sectoriels gagneront à être préservés, mais à condition que cet équilibre soit viable politiquement.
L’article 50 du Traité prévoit que l’on envisage le cadre des relations futures et il en sera ainsi dans tous les cas. Mme Theresa May dit qu’elle prend le temps de préparer la notification pour qu’elle comporte son projet de relations futures avec l’Union européenne. Elle souhaite engager le Royaume-Uni dans la négociation avec l’Union sur la base de ce qu’elle juge être bon pour l’avenir de son pays ; pour leur part, les Vingt-Sept escomptant que cette vision sera compatible avec les conditions qui ont été formulées. Une fois connue la teneur de la notification, nous analyserons si le cadre présenté est viable, en fonction de l’équilibre des droits et des obligations proposé. Sur le plan juridique, on ne peut arguer que la négociation ne peut être interrompue au bout de deux ans parce que l’on n’a pas tenu compte du cadre des relations futures. Il en sera tenu compte mais, au terme de ce délai, chaque État membre sera en droit de considérer que la négociation ne peut se poursuivre si elle a peu de chance d’aboutir ou si le Royaume-Uni ne se comporte pas de manière qu’elle aboutisse dans de bonnes conditions. L’idéal serait que l’accord de retrait organise non seulement le retrait, irréversible, sur les plans institutionnel et administratif mais aussi des transitions vers les relations futures ; mais il est possible que le processus soit plus brutal. Quoi qu’il en soit, le Royaume-Uni ne doit pas penser qu’il a un droit de tirage sur la durée de la négociation, qui s’engagerait alors dans des conditions défavorables pour les Vingt-Sept.
Je vous trouve bien critique à l’égard du plan Juncker, qui n’a pas été conçu pour satisfaire tous les besoins d’investissement de l’Union européenne mais pour donner un signal d’orientation. Et nous avons obtenu que le Président de la Commission européenne en propose le doublement…
M. Jacques Myard. Le doublement de zéro !
M. Philippe Léglise-Costa. Ce n’est pas exact : le plan Juncker prévoyait la mobilisation de 315 milliards d’euros d’investissements en trois ans et, un an plus tard, nous en sommes à un peu plus de 100 milliards. La mise en œuvre de ce plan n’est donc pas impossible mais demande que la mobilisation se poursuive.
Enfin, l’organisation française en matière de services financiers est hors de la compétence du SGAE mais nous participons aux discussions. La place de Paris est à l’œuvre. Une stratégie durable devra être élaborée car il faudra plusieurs années pour que notre place financière parvienne à se doter de la panoplie diversifiée d’instruments que seule Londres, pour l’instant, propose aux entreprises et aux acteurs économiques. Vous avez raison : il est temps de commencer.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie pour ces explications.
Séance du jeudi 29 septembre 2016
La mission d’information procède à l’audition, non ouverte à la presse, de Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France au Royaume-Uni
M. le président Claude Bartolone. J’ai le plaisir d’accueillir Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France au Royaume-Uni. Cette audition n’étant pas ouverte à la presse, vous allez pouvoir, madame Bermann, vous sentir très libre de vos propos.
Sans doute vos fonctions antérieures vous ont-elles habituée aux casse-tête chinois, mais ils vous paraîtront sans doute bien simples au regard de celui auquel vous êtes confrontée aujourd’hui.
Votre point de vue nous intéresse tout particulièrement étant donné que vous êtes une observatrice privilégiée de la situation britannique.
Ainsi aurons-nous le plaisir de vous entendre sur les suites du congrès du Parti travailliste, qui donne une certaine idée de ce que sera la position des travaillistes vis-à-vis du Premier ministre Theresa May.
Quelle est, ensuite, la situation au Royaume-Uni ? Car à écouter les déclarations de l’ancien maire de Londres ou celles des collaborateurs de Mme May, la date de l’application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne n’est pas la même.
Enfin, la situation britannique peut avoir des prolongements en France. Certains responsables politiques de haut niveau évoquent ouvertement l’idée qu’il pourrait y avoir à court terme – ce qui me paraît difficile – un changement de position de la part du Royaume-Uni.
Chacun perçoit la réalité britannique en fonction des informations qu’il peut recueillir mais vous êtes, j’y insiste, un témoin privilégié. Vous allez ainsi pouvoir nous en dire davantage sur la manière dont les Britanniques s’organisent ou encore sur l’état d’esprit des Écossais.
Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France au Royaume-Uni. Je vous remercie pour votre invitation et je serai heureuse de recevoir votre mission au mois de novembre à Londres, en espérant que la situation aura quelque peu avancé.
Trois mois après le référendum, il n’y a plus de Bremainers, partisans du maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne, ni de Brexiteers, partisans de sa sortie. Nous avons désormais, d’un côté, les hard Brexiteers et, de l’autre, les soft Brexiteers. Les premiers souhaitent une rupture immédiate et une renonciation à tout, y compris à l’union douanière, au marché unique européen, pour s’en tenir au cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les soft Brexiteers, pour leur part, entendent que le Royaume-Uni reste au plus près de l’Union européenne, tout en tenant compte de la contrainte liée à l’immigration.
En effet, le référendum n’a pas réellement porté sur l’Union européenne mais bien sûr l’immigration – l’Union européenne, il y a quelques années, figurait ainsi au neuvième rang des préoccupations des Britanniques. Le lien établi par le parti nationaliste « pour l’indépendance du Royaume-Uni, United Kingdom Independence Party (UKIP), entre l’immigration incontrôlée et l’Union européenne, a conduit la majorité des votants à s’exprimer, en fait, contre l’immigration. Or il faut garder à l’esprit que le solde migratoire net est aujourd’hui de 327 000 personnes par an au Royaume-Uni, alors qu’il n’est que de 30 000 personnes en France. Il convient de prendre également en considération le fait qu’il y a des villes où les affiches sont en polonais, les instructions sur les chantiers données en polonais, et où les Polonais, dans certaines écoles, sont majoritaires ; je prends l’exemple des Polonais car ce sont eux qui ont été le plus victimes du racisme au lendemain du référendum – au point que l’un d’eux a été assassiné –, certains Britanniques exigeant le retour chez eux de « cette vermine ».
D’autres éléments ont également compté. Au sein du parti Tory, des députés étaient très hostiles à l’Union européenne et estimaient que le Parlement de Westminster devait avoir le dernier mot – alors que paradoxalement – il ne pourra pas se prononcer sur le déclenchement de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.
Parmi les hard Brexiteers, on trouve le ministre chargé du Brexit, David Davis, et le ministre chargé des négociations d’accords de libre-échange, Liam Fox. Quant à Boris Johnson, s’il est plus difficile à classer, il a rejoint un groupe de pression réclamant un Brexit rapide.
La situation est par conséquent très confuse. Le Gouvernement en est à établir une cartographie – mapping, pour reprendre leur terme. À ce stade, il en est encore à recruter du personnel jusqu’au mois de décembre et n’en est donc pas au stade de la définition d’options.
En ce qui concerne le déclenchement de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, Theresa May a indiqué, sans plus de précision, qu’il n’aurait pas lieu avant 2017. Au ministère du Brexit, on évoque le premier semestre 2017. Quand Boris Johnson a parlé des mois de janvier ou février, il s’est fait taper sur les doigts. La semaine prochaine aura lieu la conférence du parti Tory à Birmingham, et Theresa May sera sans doute obligée d’en dire un peu plus.
C’est sur l’immigration, je l’ai mentionné, que Theresa May a besoin d’obtenir des résultats. Les discussions en cours portent sur la possibilité d’établir un permis de travail afin d’avoir une immigration choisie, mais aussi sur la possibilité d’activer un « frein d’urgence » en cas d’arrivée massive de migrants pour, notamment, soulager les services sociaux. Theresa May a déclaré au président Hollande, à Angela Merkel et aux autres dirigeants européens qu’on ne pouvait pas, compte tenu du message populaire, ne pas aboutir à une limitation de l’immigration. Elle n’a certes pas indiqué qu’elle serait prête à passer l’accès au marché unique par pertes et profits, mais c’est bien autour de l’immigration que se fera sans doute le compromis.
Outre, d’un côté, le groupe de pression des Brexiteers, existe, de l’autre, un groupe de pression nommé Open Britain regroupant les anciens Bremainers, la City et les organisations patronales qui ont besoin de l’accès au marché unique et du passeport européen mais aussi de l’immigration : quand des offres d’emploi, dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l’agriculture, dans les services de santé – National Health Service (NHS) – sont publiées, les Britanniques ne se présentent pas et ce sont des immigrés qui travaillent comme médecins, comme infirmiers. La pression est forte non seulement de la part des grands patrons mais aussi des petites et moyennes entreprises (PME) et du monde des affaires.
J’en viens aux entités dévolues. J’étais la semaine dernière à Edimbourg pour rencontrer le premier ministre d’Écosse, Nicola Sturgeon, et la principale députée de l’opposition au Parlement écossais, Ruth Davidson, qui souhaitent que les intérêts de l’Écosse soient pris en considération pendant la négociation. Je n’ai pas connaissance de position arrêtée sur la tenue d’un référendum ou non.
La question est beaucoup plus sensible en Irlande du Nord : un contrôle de l’immigration suppose une forme de rétablissement d’une frontière. Si cette dernière est fixée entre l’Irlande du Nord et l’Irlande du Sud, ce sera catastrophique pour le processus de paix – du reste très largement financé par l’Union européenne à travers le programme PEACE. Quand vous allez en Irlande du Nord, vous avez l’impression d’un climat qui n’est pas totalement apaisé après des années de guerre civile.
On peut ajouter la situation de Londres, dont le nouveau maire travailliste est l’une des personnalités politiques les plus fortes au Royaume-Uni – il s’est d’ailleurs opposé violemment à la politique de Jeremy Corbyn. Londres n’est pas une entité dévolue, certes, mais si l’on considère que c’est Londres qui fait la richesse du Royaume-Uni, on doit prendre la position de la ville en considération. Le maire est très actif, notamment quant à la protection des étrangers : vous avez pu lire dans la presse que de nombreux actes xénophobes avaient été commis, jusqu’à la commission, j’y ai fait allusion, d’un meurtre ; dans le métro, il arrive qu’on demande à des personnes parlant une langue étrangère « ce qu’ils font encore là dans la mesure où l’on a voté pour qu’ils partent ».
D’autres questions se posent, notamment sur les échanges universitaires, les échanges scientifiques. Non seulement ces derniers représentent 30 % des fonds alloués par l’Union européenne mais le Brexit risque de conduire à la destruction des réseaux constitués.
Dans le domaine de la défense, vous avez pu prendre connaissance des déclarations du ministre britannique compétent, qui s’opposera à la création d’une défense européenne visant à dupliquer l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), à savoir instituer un état-major à Bruxelles et fonder une armée européenne. Le Brexit va donc à l’encontre des intérêts britanniques, puisque le Royaume-Uni participe, à hauteur de soixante-dix personnes et d’un navire, à l’opération Sophia en mer Méditerranée, destinée précisément à contenir l’afflux de migrants. Ce sont en outre les Britanniques qui commandent l’opération Atalante contre la piraterie. C’est donc via l’Union européenne qu’ils exercent une influence dans le monde. Je mentionnerai, pour finir sur ce point, leur focalisation sur la Russie, selon eux la première menace dans le monde, et donc l’importance qu’ils accordaient aux sanctions de l’Union européenne.
Encore une fois, personne, au Royaume-Uni, ne sait quelles options seront proposées. Theresa May prend des décisions informées, comme on a pu le constater à propos du projet d’EPR sur le site de Hinkley Point, puisqu’elle a réfléchi pendant plusieurs semaines avant de signer – une signature qui doit avoir lieu cet après-midi même. Ainsi, la décision d’invoquer l’article 50 dépend non pas de la volonté de faire traîner les choses mais de son souhait de disposer d’une position claire.
Mme Élisabeth Guigou. J’avais cru déceler, début juillet, une nette différence entre le parti travailliste, qui venait de réélire triomphalement Jeremy Corbyn à sa tête, et le groupe parlementaire travailliste, plutôt critique à l’encontre de Jeremy Corbyn et majoritairement Bremainer. Une réconciliation vous paraît-elle aujourd’hui possible ?
D’autre part, comme vous l’avez montré, nous sommes dans une incertitude maximale quant à l’application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne : en réalité, les Britanniques ne savent pas quel équilibre ils veulent négocier.
À cet égard, quel est votre avis sur les perspectives économiques au Royaume-Uni ? À la suite du résultat du référendum, le cours de la livre a chuté, avant de remonter ; aujourd’hui, les inquiétudes concernent davantage les investissements, non seulement au Royaume-Uni mais aussi en Afrique où opèrent des fonds d’investissement britanniques. En outre, dans ce contexte, comment évoluent nos compatriotes ?
Ensuite, les élections européennes prévues pour juin 2019 sont-elles perçues comme une date-butoir ? Il semblerait en tout cas que cela commence à être le cas du point de vue des Vingt-Sept…
En ce qui concerne le statut, il est évident que les Britanniques vont vouloir le beurre et l’argent du beurre, à savoir la limitation de l’immigration et l’accès au marché unique. Ils vont vouloir le négocier mais sur qui, à votre avis, vont-ils pouvoir compter ? Probablement les pays scandinaves, certes… À titre d’information, j’ai conduit hier une délégation de la commission des affaires étrangères à Berlin pour rencontrer nos homologues allemands et polonais. D’ordinaire, nous nous entendons très bien ; or, cette fois, je me suis inquiétée des positions de mon homologue allemand : il campe sur l’idée développée dans l’article qu’il a cosigné l’été dernier avec, notamment, Jean Pisani-Ferry. Je note donc plus qu’un flottement de la part des chrétiens-démocrates. Les sociaux-démocrates, quant à eux, sont silencieux. Les seuls à rester sur nos positions d’amitié et de fermeté sont les Verts et Die Linke. Comment percevez-vous cette situation depuis Londres, madame l’ambassadeur ?
J’en viens, pour finir, à la situation à Calais où la pression va augmenter. Je sais que les associations britanniques y sont très actives : je l’ai constaté sur place au mois de juin dernier. Mais moi qui soutiens la position de Bernard Cazeneuve parce qu’elle me semble la seule raisonnable, je me demande si elle va pouvoir perdurer compte tenu, j’y insiste, de l’accentuation des pressions politiques. Le gouvernement britannique y réfléchit-il d’ores et déjà ou pas encore ?
M. Luc Chatel. Dans le débat que vous avez décrit, madame l’ambassadeur, entre les soft Brexiteers et les hard Brexiteers, est-il acquis que les Britanniques n’auront pas, pour reprendre l’expression d’Elisabeth Guigou, le beurre et l’argent du beurre, à savoir qu’ils n’obtiendront pas à la fois le Brexit et ce qu’avait négocié David Cameron en cas de maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne ?
Vous avez mis l’accent, madame l’ambassadeur, sur le fait que c’est l’immigration qui a orienté le vote des Britanniques, ce qu’on a peu évoqué en France. Où en est donc le gouvernement de Mme May concernant la frontière avec la France, à Calais ? Discute-t-il de la révision des accords du Touquet ? En somme, y a-t-il une ouverture du gouvernement britannique sur la situation à Calais ?
M. Jacques Myard. Pouvez-vous, madame l’ambassadeur, nous dresser un portrait de Theresa May, que nous connaissons peu ? Vous avez indiqué qu’elle était méthodique… fort bien, mais de toute façon un Britannique défendra toujours ses intérêts.
Mme Sylvie Bermann. Bien sûr !
M. Jacques Myard. Surtout, maîtrise-t-elle son gouvernement, au sein duquel il semble y avoir de fortes têtes ?
Avez-vous perçu, par ailleurs, dans vos discussions avec les Britanniques, qu’ils avaient l’intention de jouer sur le fait que le solde commercial de la France vis-à-vis du Royaume-Uni est positif ?
Enfin, vous avez mentionné le fait que l’argent de l’Union européenne n’alimenterait plus la recherche britannique. C’est un faux problème : le Royaume-Uni est le troisième contributeur net au budget de l’Union européenne – à hauteur d’environ 6 milliards d’euros contre 8 milliards d’euros pour la France. Ils vont donc pouvoir récupérer cet argent, à moins que l’accord qui sera négocié ne prévoie, comme c’est le cas avec la Suisse et l’Association européenne de libre-échange (AELE), que le Royaume-Uni continue à contribuer au budget de l’Union européenne en contrepartie d’avantages comme le passeport européen.
Mme Valérie Fourneyron. Je reviens sur la première cause du Brexit, qui est selon vous, madame l’ambassadeur, l’immigration. À Calais, quelle est la réalité des chiffres et ceux, en particulier, des mineurs isolés qui se trouvent dans une bien difficile situation ?
Ensuite, vous avez bien montré que Theresa May n’était pas en mesure, aujourd’hui, de demander l’application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Quels sont, à votre avis, les outils, les acteurs qui vont la conduire à cette décision ? Qu’est-ce qui va peser dans les semaines et les mois à venir ?
Mme Sylvie Bermann. Le parti travailliste n’est plus un parti mais un mouvement de masse : environ 300 000 personnes se sont inscrites essentiellement pour voter en faveur de Jeremy Corbyn, qui n’a aucune chance de jamais arriver au pouvoir. Ses idées remontent aux années 1970 et il est en confrontation avec le groupe parlementaire. Les membres de ce dernier ont même envisagé une scission et la constitution d’un nouveau parti avec les libéraux-démocrates, mais ils y ont renoncé à cause des échecs passés et parce qu’ils restent assez loyaux non pas à l’égard de Jeremy Corbyn, mais envers le parti lui-même. Il n’y en aura pas moins, à mon avis, de nouvelles tentatives de prendre la relève de Jeremy Corbyn.
Au passage, il n’est pas exclu, même si Theresa May a déclaré qu’il n’y en aurait pas avant 2020, que des élections générales anticipées soient néanmoins organisées, car la situation risque d’être difficile pour elle, compte tenu des divisions sur le Brexit. Élue par 199 députés, dans les conditions que l’on sait, et non par les membres du parti conservateur, elle pourrait donc – même si ce n’est pas le plus probable aujourd’hui – être tentée par la convocation des électeurs.
Les conservateurs, pour en revenir à eux, ont pu considérer qu’avoir Jeremy Corbyn avec eux serait un avantage dès lors que le parti Tory serait au pouvoir pour plusieurs générations. Or ils constatent aujourd’hui qu’il est pire d’avoir une opposition intérieure que d’avoir à affronter une opposition extérieure.
M. Jacques Myard. C’est une histoire connue.
Mme Sylvie Bermann. Pour ce qui concerne les perspectives économiques, les Brexiteers font valoir qu’une catastrophe avait été annoncée au lendemain du Brexit, alors qu’en fait, en dehors de la chute de la livre – qui a tout de même été de plus de 10 % –, tout va bien. En effet, le taux de chômage est de 4,9 % de la population active, la plus faible proportion jamais atteinte et, plus globalement, sur le plan économique, la situation n’a guère évolué. Seulement, le Brexit n’est pas encore effectif. Et la situation va probablement se détériorer d’ici à la fin de l’année : de nombreux investissements – y compris lourds – ont été gelés et la confiance risque de s’en trouver entamée. La croissance devrait atteindre 1,7 % du PIB pour 2016 et, l’année prochaine, selon les dernières prévisions, 0,7 % ; or, quand je suis arrivée au Royaume-Uni, en 2014, elle était de 3 %.
M. le président Claude Bartolone. On évoque beaucoup l’activisme du ministre du commerce extérieur, qui essaie de négocier des accords avec des pays tiers.
Mme Sylvie Bermann. Il s’est en effet rendu dans différents pays pour essayer de négocier des accords, et ces pays ont répondu qu’il fallait attendre de savoir quelles seraient les relations du Royaume-Uni avec l’Union européenne. L’Australie, membre du Commonwealth, pays ami, qui s’était prononcé pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne, a ainsi été approchée, mais il faut savoir que les échanges commerciaux entre les deux États représentent moins de 1 % de la totalité des échanges britanniques. La déclaration qui a été faite à ce sujet relève par conséquent plus de l’affichage que de la réalité. Nombreux sont ceux qui affirment que le ministre en question risque même de ne pas rester au Gouvernement quand il se rendra compte qu’il ne peut rien négocier.
J’en viens à nos quelque 300 000 compatriotes vivant au Royaume-Uni. Ils ne sont pas les plus inquiets. Je pense qu’il y aura une négociation sur les droits acquis aussi bien pour les Britanniques en Europe que pour les étrangers au Royaume-Uni. Pour l’heure, le climat n’est, il est vrai, pas très sympathique et beaucoup qui se sentaient Londoniens avant le 24 juin se sentent aujourd’hui étrangers à Londres.
Les prochaines élections européennes ont également été évoquées. Theresa May les prend certes en considération mais le butoir des Britanniques est plutôt l’échéance électorale de 2020, étant entendu qu’on peut imaginer une formule transitoire en 2019. Les Britanniques sont en effet bien conscients de l’aberration que constituerait le fait d’élire des députés européens après avoir voté le Brexit ; reste que Mme May lancera les négociations quand elle s’estimera prête et que, comme elle l’a déclaré au Président de la République, elles s’engageront d’autant mieux que les deux parties seront prêtes.
Pour ce qui est du statut, bien sûr que les Britanniques veulent le beurre et l’argent du beurre. Il faut tenir compte de ce que 48 % des votants ont souhaité rester au sein de l’Union européenne et que les parlementaires sont plus largement pro-européens encore ; or David Cameron a précisé au Président de la République, à Thiepval, le jour des commémorations de la bataille de la Somme, que le Royaume-Uni souhaitait rester au plus près de l’Union européenne. Les Britanniques vont donc chercher des solutions en sachant que leur principal problème est l’immigration.
Sur qui vont-ils compter ? Eh bien, d’abord sur les divisions entre les Vingt-Sept. De ce point de vue, ils ont noté le fait que Matteo Renzi, à l’issue du sommet de Bratislava, a fait part de son désaccord. Les Britanniques compteront sur les Scandinaves et sur une Allemagne – celle, en tout cas, de Mme Merkel – qu’ils perçoivent plus compréhensive que ne l’est la France. Selon eux, les Français ont une attitude punitive, au point que, au début des vacances, les Britanniques nous ont attribué la responsabilité des files d’attente de plusieurs heures pour embarquer dans leur ferry, alors qu’elle incombait en partie à la police britannique. L’idée que nous chercherions à leur faire payer le Brexit est bien ancrée. Il convient donc pour nous de rester en phase avec les Allemands.
Pour ce qui est de la situation à Calais, quoi qu’il arrive, nous sommes considérés comme coupables, soit parce que nous serions incapables d’assurer la sécurité et le contrôle des frontières, soit parce que nous traiterions les réfugiés de manière inhumaine. C’est ce que j’ai perçu à chaque fois que j’ai été interrogée à la télévision sur le sujet : l’idée est que nous ne sommes pas capables de gérer la situation, et cela bien avant que nous n’ayons pris conscience du problème en France. Quand je suis arrivée en poste, on montrait déjà les camions pris d’assaut. Il existe néanmoins, sur le sujet, une grande différence entre la presse et l’opinion publique, d’un côté, et le gouvernement, de l’autre. Celui-ci est conscient du risque d’une demande de transfert de la frontière à Douvres. Aussi le Royaume-Uni nous aide-t-il en matière financière et de sécurité avec la construction de barrières, de murs. Sur la question particulière des mineurs isolés, Theresa May et la nouvelle ministre de l’intérieur, Amber Rudd, ont fait une réponse ouverte. Bernard Cazeneuve doit se rendre prochainement à Londres pour recueillir les propositions d’un groupe de travail franco-britannique. Dans le même temps, compte tenu de l’importance du problème migratoire, les Britanniques ne veulent pas créer d’appel d’air et ont accueilli ces mineurs non accompagnés au compte-gouttes. En outre, il n’est pas question pour nos voisins d’une révision des accords du Touquet, même s’ils sont bien conscients que, du côté français, le sujet va compter à l’occasion des prochaines élections.
Vous m’avez par ailleurs demandé si le Royaume-Uni avait entériné le fait qu’il ne pourrait bénéficier de ce qu’avait négocié David Cameron tout en procédant au Brexit. En fait rien n’est décidé. Les Britanniques sont d’excellents négociateurs et vont tâcher d’obtenir le maximum.
Jacques Myard est revenu sur les fonds dédiés à la recherche. Les Brexiteers ont promis que l’agriculture, la recherche, la santé, de même que les entités dévolues récupéreraient les fonds aujourd’hui consacrés au budget européen. Or il y aura des priorités. En fait, ce que craignent le plus les Britanniques n’est pas un manque à gagner mais la perte de la coopération scientifique…
M. Jacques Myard. Elle sera maintenue.
Mme Sylvie Bermann. Elle sera maintenue parce qu’elle fera partie de la négociation.
M. Jacques Myard. Les scientifiques continueront de coopérer. Ce qui me frappe, chez les scientifiques, c’est que, quel que soit le type de gouvernement, ils continuent de coopérer. Au moment du nazisme, Otto Hahn et Frédéric Joliot-Curie discutaient de leurs travaux en toute liberté. Il existe toujours une communauté internationale des scientifiques.
M. le président Claude Bartolone. Ce sont des financements dont il est ici question.
M. Jacques Myard. Ils vont récupérer leur argent, c’est tout !
Mme Sylvie Bermann. Les Britanniques vont mettre l’accent sur la coopération bilatérale et la poursuivre, mais ce qu’ils veulent, c’est l’accès aux réseaux, qui leur sera beaucoup plus difficile après le Brexit. Pour ce qui est du financement, ils envisagent non pas de contribuer directement au budget de l’Union européenne, ou en tout cas pas de manière visible, mais de payer au cas par cas. Autrement dit, s’ils veulent garder des avantages dans le domaine de la coopération universitaire, de la coopération scientifique, mais aussi les avantages liés au dispositif Erasmus, ils paieront, mais ils ne voudront pas donner l’impression qu’il s’agit, je le répète, d’argent versé au budget européen.
De même, ils seraient prêts à payer en matière de défense, que ce soit en nature ou en argent.
On m’a demandé de dessiner un portrait de Theresa May. Je l’ai beaucoup vue parce qu’elle rencontrait Bernard Cazeneuve tous les deux ou trois mois et ils s’entendaient d’ailleurs très bien. Elle est quelqu’un de très sérieux et, comme on dit au Royaume-Uni, control freak : elle ne laisse rien sans réponse. J’ai mentionné le cas de la centrale de Hinkley Point. Elle a posé de très nombreuses questions aux experts avant de prendre sa décision. À chaque fois que les experts lui apportaient des dossiers – de très nombreuses réunions ont été organisées au 10 Downing Street –, elle posait de nouvelles questions. C’est pourquoi l’élaboration d’une position sur le Brexit risque de prendre un peu de temps.
Il est intéressant de noter qu’elle a nommé Boris Johnson ministre des affaires étrangères. Beaucoup ont vu cette décision comme une mise en œuvre du principe selon lequel « you break it, you own it » : vous l’avez cassé, eh bien, maintenant cela vous appartient et vous devez le réparer.
On m’a par ailleurs demandé ce qui allait peser dans les semaines et les mois à venir. Ce sera évidemment l’intérêt du pays. La Confederation of British Industry (CBI), équivalent chez nous du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), les hommes d’affaires, les financiers mettent tous en garde contre les conséquences du Brexit et, surtout, contre la fin du passeport européen et de l’accès au marché unique, ce qui pèsera d’autant plus que la situation économique connaîtra une dégradation. Il n’est pas impossible qu’à l’avenir ceux qui, dans l’Angleterre profonde, ont voté pour le Brexit constatent une aggravation de leur situation parce que ce seront les premiers à perdre leur emploi. Et quand on évoque la City comme une élite de banquiers et de gens qui s’enrichissent, c’est oublier les centaines de milliers d’emplois, près de deux millions au total, qui en dépendent dans l’ensemble du pays et à tous les niveaux.
Le nouveau chancelier de l’échiquier, Philip Hammond, ancien ministre des affaires étrangères, est un ancien eurosceptique devenu, pendant la campagne, partisan du maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne après en avoir constaté les avantages en matière de politique étrangère (par exemple à l’égard de la Russie ou de l’Iran). Nous disposerons de premiers éléments sur la situation économique au moment de l’Autumn Statement, au mois de novembre. Quoi qu’il en soit, Philip Hammond comptera beaucoup dans la décision.
M. le président Claude Bartolone. Vous nous avez livré un panorama réaliste de la situation politique au Royaume-Uni. Pour certains milieux économiques, l’incertitude peut jouer. Vous avez évoqué la City ; certains établissements financiers commencent déjà à regarder ailleurs. Avez-vous entendu parler de démarches visant à mettre les places financières européennes en concurrence ?
Mme Sylvie Bermann. L’excédent commercial de la France vis-à-vis du Royaume-Uni est le plus important de ses excédents, puisqu’il est de 12,5 milliards d’euros ; il est même en augmentation par rapport à l’année précédente. Les Britanniques nous feront dès lors valoir que nous aurons toujours besoin de leur exporter notre vin, nos produits alimentaires, et aux Allemands qu’ils auront toujours besoin de leur vendre leurs voitures.
J’ai rencontré la semaine dernière le directeur de la City, où l’on est très inquiet du fait de la prévisible perte d’emplois car, si le Brexit a lieu, des délocalisations seront nécessaires, non pas pour les sièges mais pour les chambres de compensation, pour les régulateurs… Toutes les entreprises, toutes les associations économiques se sont par conséquent pourvues d’une « cellule Brexit » afin de savoir si ce dernier, à cause des délocalisations qu’il provoquera, va leur faire perdre 50 000 emplois ou davantage. Pour ce qui concerne la chambre de compensation, tout dépendra de la position de la Banque centrale européenne (BCE), car si la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pris une décision en faveur des Britanniques, c’était avant le référendum. Francfort, Amsterdam, Luxembourg, Dublin, Paris font des démarches en direction de la City pour récupérer certains établissements ; Paris Europlace s’y prépare. Les Britanniques espèrent malgré tout ne pas tout perdre dans la négociation : Londres offre tout de même de nombreux avantages et la délocalisation prend beaucoup de temps – il a fallu trois ans pour délocaliser la banque de détail de HSBC à Birmingham.
La principale interrogation concernant Paris est la variabilité de la fiscalité et, surtout, la rigidité du marché du travail.
M. Luc Chatel. C’est donc Amsterdam qui tient la corde ?
Mme Sylvie Bermann. Non, personne, pour le moment, ne tient la corde, et tout dépendra des banques ; mais ce que craignent les responsables de la City, c’est que la place de New York récupère la plupart des services et des personnes plutôt que le continent européen. Encore une fois, rien n’est encore décidé, mais telle est la réaction des banques en général.
M. le président Claude Bartolone. Nous avons bien compris ce qui s’était passé chez les travaillistes après leur congrès, avec la fin de l’articulation entre le parti, devenu mouvement de masse, le groupe parlementaire et le shadow cabinet, conduisant les conservateurs à considérer qu’ils occuperaient le pouvoir pour longtemps. Y a-t-il un débat sur le fait de savoir si, malgré tout, passez-moi l’expression, on peut « s’asseoir » sur le résultat du référendum ? J’ai constaté en France que le président Sarkozy avait déclaré que les Britanniques devaient à nouveau voter afin de rester au sein de l’Union européenne.
Mme Sylvie Bermann. Ce n’est pas un élément de discussion, mais cette idée traverse l’esprit des 48 % qui ont voté en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne, ce qui est le cas en particulier du monde des affaires. Néanmoins, y compris parmi les parlementaires les plus pro-européens, les Britanniques savent qu’ils ne peuvent pas remettre en cause la décision du peuple, même si elle a été fondée très largement sur de nombreux mensonges. On n’insiste ainsi pas trop sur une éventuelle saisine du Parlement sur l’application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne – d’autant qu’il s’agit a priori d’une prérogative « royale », donc d’une prérogative du Premier ministre. En revanche, les parlementaires souhaitent absolument se prononcer au moment où l’accord sera conclu. Et là, ce que certains espèrent – j’emploierai l’expression wishful thinking, plus forte que celle de « vœu pieux » –, c’est que, comme l’accord pourrait être moins bon que la situation actuelle, le Parlement demande un nouveau référendum avec plusieurs options, dont celle du maintien au sein de l’Union européenne. Au reste, le référendum est consultatif et il est très étonnant que, dans un pays qui est un modèle de démocratie représentative et dans lequel Westminster doit avoir le dernier mot sur tous les sujets, celui du Brexit lui ait très largement échappé.
Aussi, pour l’heure, on s’en tient au mot de Theresa May : « Brexit means Brexit », ce qui donne lieu à de nombreuses plaisanteries. David Cameron avait parlé de saut dans l’inconnu, nous y sommes : une telle négociation n’a pas de précédent. Ce qui est arrivé était absolument inattendu. Rien n’est donc exclu et je ne pense pas qu’il faille parier sur l’hypothèse que j’ai évoquée : je suis frappée par le fait que nombre de mes collègues me font part de ce que dans leur capitale on considère – en général des intellectuels, des hommes politiques et des hommes d’affaires – que les Britanniques vont de toute façon trouver un moyen de rester au sein de l’Union européenne et qu’il n’y aura donc pas de vraies négociations. C’est là ne considérer que les 48 % qui souhaitaient le maintien de leur pays au sein de l’Union européenne.
M. le président Claude Bartolone. Au cours du G7 parlementaire, j’ai discuté avec mon homologue britannique qui était favorable au maintien. Selon lui, la remise en cause des résultats du référendum provoquerait un mouvement de révolte, même de la part d’une partie de ceux qui ont voté contre le Brexit, attachés au respect de la décision du peuple.
On voit bien que les travaillistes veulent éviter ce débat, y compris au Parlement. Du coup, quel est le rapport de force au sein du groupe des députés conservateurs et quelle est la tonalité des échanges ?
Mme Sylvie Bermann. Vous avez raison : il n’est absolument pas question, aujourd’hui, de revenir sur le référendum. Le peuple a voté et, donc, le gouvernement appliquera l’article 50 du traité sur l’Union européenne et lancera les négociations prévues. Néanmoins, dans deux ans, l’accord sera bien soumis au Parlement et nous ne savons pas, alors, ce qui se passera. Reste, je le répète, que, pour l’heure, même pour les plus pro-européens, il ne saurait être question de revenir sur le résultat de juin.
Mme Élisabeth Guigou. Il me semble que notre intérêt à nous est de solder au plus vite cette affaire et de tâcher de maintenir la cohésion des Vingt-Sept, notamment, vous l’avez très justement souligné, madame l’ambassadeur, en restant d’accord avec les Allemands, ce qui ne sera pas facile. Nous devons nous montrer fermes car nous ne pouvons pas nous laisser ballotter par l’indécision.
Et procéder de la sorte est peut-être le moyen de signifier aux pro-européens avec lesquels nous avons des affinités et qui aimeraient que nous tergiversions et laissions une porte ouverte, qu’ils ont sans doute intérêt eux aussi à montrer ce que représente la sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni.
J’essaie de réfléchir à la manière d’affiner mais aussi de renforcer, avec nos partenaires, nos positions de négociations. Or, si nous nous montrons fermes dans la négociation, nous serons, avec les opposants britanniques au Brexit, donc pro-Européens, en position de force pour proposer éventuellement au Royaume-Uni de revenir. Il ne faut en effet pas exclure, à terme, qu’après avoir vécu l’expérience de notre fermeté, ils reviennent.
Mme Sylvie Bermann. C’est également une question de temps. Les mois, les années vont passer et les Britanniques vont essayer, malgré tout, de négocier le mieux possible pour leur pays. Ils espèrent savoir quelles seront, au bout de deux ans, les relations avec l’Union européenne. Tout ne sera pas clair à ce moment-là et pour éviter un divorce brutal et ils vont sans doute essayer d’obtenir un accord intérimaire qu’ils peuvent « prendre sur étagère », qu’il s’agisse de l’AELE ou autre.
M. le président Claude Bartolone. Nous entrons là dans un autre monde. Nous avons déjà pu constater le regard acéré qu’ils ont pu porter sur le groupe de Visegrád.
M. Jacques Myard. Le Parlement de Westminster a-t-il déjà rejeté un accord international présenté par un gouvernement ?
Mme Sylvie Bermann. Je ne pense pas, cela reste à vérifier. Toutefois, l’idée n’est pas que le Parlement rejette l’accord, mais qu’il le soumette au peuple.
Encore une fois, nous sommes en terre inconnue et l’on spécule beaucoup.
M. Jacques Myard. Je suis persuadé, comme Elisabeth Guigou – qui va néanmoins bondir en entendant la suite de mes propos –, que nous pourrions garder les British, mais seulement si c’est l’Union européenne qui évolue. Je l’ai déjà dit maintes fois : je pense que l’Union européenne va s’affranchir d’un logiciel intégriste et fédéraliste pour aller vers beaucoup plus de coopération interétatique. Telle est à mes yeux la solution, même si je sais bien que vous n’êtes pas d’accord.
Mme Sylvie Bermann. C’est en tout cas ce qu’espèrent les Britanniques pro-européens…
M. Jacques Myard. Et c’est le seul moyen d’associer la Turquie.
Mme Sylvie Bermann. Beaucoup nous disent que nous allons évoluer sur la libre circulation. Je réponds souvent que le paradoxe est que nous aurons une Europe qui ressemblera bien plus à ce que souhaitait le Royaume-Uni avant de la quitter,…
M. Jacques Myard. Bien sûr !
Mme Sylvie Bermann. …à savoir une Europe plus intergouvernementale,…
M. Jacques Myard. Plus souple !
Mme Sylvie Bermann. …plus flexible, oui, organisant des coopérations par cercles.
M. le président Claude Bartolone. C’est une autre histoire. Nous vous remercions, madame l’ambassadeur, de cet éclairage. Nous aurons donc l’occasion de vous revoir à Londres, où nous rencontrerons un certain nombre de responsables britanniques.
La mission d’information procède ensuite à l’audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Claude Piris, consultant en droit européen et en droit international public, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur Piris, vous avez été directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne et jurisconsulte du Conseil européen de 1988 à 2010. La semaine dernière, nous avons auditionné le Gouvernement, avec qui nous avons évoqué le fameux article 50 du traité sur l’Union européenne. Nous souhaiterions approfondir ces aspects juridiques avec vous. Vous avez également été jurisconsulte des conférences intergouvernementales qui ont négocié les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne. Votre connaissance des traités, mais aussi des négociations européennes, nous apportera un éclairage précieux. Nous nous posons un certain nombre de questions sur l’articulation entre la négociation de l’accord de retrait et celle d’un nouveau statut, sur le contenu et le statut de l’accord de retrait, sur le déroulement des négociations et sur la révision des traités.
Vous avez écrit un certain nombre d’articles sur ce que pourrait être la suite de la construction européenne. Dans un de ces articles, vous avez d’ailleurs longuement décrit ce qu’elle ne pourra pas être, avant d’essayer de déterminer ce qu’elle pourrait être. Cet éclairage peut aussi nous aider à envisager ce que pourrait être la stratégie du Royaume-Uni non pas à court terme, mais à moyen ou long terme.
M. Jean-Claude Piris, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l’Union européenne. C’est un honneur de m’exprimer devant vous. Le Brexit est un dossier extrêmement complexe dont nous pourrions parler pendant des heures. En tant que juriste, je me concentrerai sur les questions juridiques et institutionnelles.
Le texte de l’article 50 du traité de l’Union européenne a été rédigé par la Convention européenne qui a négocié le traité constitutionnel – ont participé des hommes politiques tels que M. Valéry Giscard d’Estaing, M. Alain Lamassoure, M. Giuliano Amato ou M. Elmar Brok –, puis repris tel quel dans le traité de Lisbonne. Il a fait l’objet d’une discussion en profondeur. Il y avait alors des disputes entre juristes : certains prétendaient que, dans la mesure où la durée de validité des traités était illimitée, un pays ne pourrait pas sortir de l’Union ; pour ma part, j’estimais que, si un pays voulait sortir de l’Union, personne ne pourrait l’en empêcher. Mais un tel retrait serait source de nombreuses incertitudes et ne manquerait pas de provoquer un certain chaos juridique – on constate déjà un certain chaos politique au Royaume-Uni. D’où l’intérêt de cet article, qui trace les grandes lignes de ce que l’on doit faire et de ce qu’il est possible de faire, afin d’éviter une multitude de questions et de procès.
Les choses vont se passer de la façon suivante. D’abord, nous attendons que le Royaume-Uni « appuie sur le bouton » en déclenchant la procédure de l’article 50. Il s’agit d’une décision unilatérale. En l’absence de constitution écrite, une cour de justice britannique vient de préciser que cette prérogative appartient au gouvernement ; il n’est donc pas nécessaire de passer devant le Parlement.
L’accord prévu par l’article 50 vise à régler les conditions de la sortie, non les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. L’article 50 précise néanmoins que l’Union négocie et conclut cet accord avec l’État concerné « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union », membre de phrase dont la signification n’est pas claire. Quoi qu’il en soit, les deux parties semblent d’accord sur le fait qu’il y aura, d’une part, l’accord fondé sur l’article 50 traitant de la sortie ou, si l’on veut, du divorce et, d’autre part, un ou d’autres accords traitant des relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union. Le gouvernement britannique l’a admis avant même la tenue du référendum, ainsi que cela ressort de documents qu’il a publiés. À mon avis, le membre de phrase que j’ai cité pourrait permettre, si l’Union européenne le veut bien – elle n’y est pas contrainte –, que l’accord fondé sur l’article 50 prévoie des mesures transitoires, à condition que l’on sache exactement où l’on va, c’est-à-dire comment se dessine ledit cadre futur. Or, pour l’instant, le gouvernement britannique est, vous le savez, tout à fait divisé sur cette question : nous n’avons pas encore la moindre idée de la direction que l’on va prendre.
Une fois la procédure déclenchée par le Royaume-Uni s’ouvrira un délai de deux ans maximum – qui pourra être prolongé à l’unanimité par les Vingt-Sept en accord avec le Royaume-Uni, si besoin est – pendant lesquels sera négocié l’accord de divorce. Si jamais on ne parvient pas à un accord au cours de ces deux ans, le Royaume-Uni quittera l’Union de manière automatique. Les deux parties ont néanmoins intérêt à trouver un accord pour éviter un chaos juridique.
Quel sera le contenu de cet accord de divorce ? À mon avis, il traitera, entre autres : de toutes les procédures en cours, par exemple en matière de concurrence ou d’aides d’État ; de questions budgétaires telles que les subventions agricoles et les fonds structurels ; des programmes et des projets de recherche, en substance et du point de vue budgétaire ; des divers traités, accords et contrats qui engagent les États ou les entreprises ; du sort des quelques millions de citoyens européens qui résident au Royaume-Uni et, inversement, des citoyens britanniques qui vivent dans l’Union à vingt-sept ; de celui des fonctionnaires de nationalité britannique qui travaillent au sein des institutions de l’Union.
En revanche, il ne devrait pas comporter de dispositions relatives aux relations commerciales. À cela, il y a une bonne raison non seulement politique, mais aussi juridique : l’Union européenne est soumise au principe d’attribution des compétences : l’Union ne dispose pas d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par les traités, et selon les procédures fixées par les articles de ces traités – ce qu’on appelle les « bases juridiques » dans le jargon de l’Union européenne.
L’accord de retrait sera négocié et conclu, selon les procédures fixées par l’article 50. Selon l’article 218, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, auquel fait référence l’article 50, ces procédures sont les suivantes : la Commission européenne négocie, le Conseil statue à la majorité qualifiée – 72 % des membres du Conseil, soit vingt États membres sur vingt-sept et 65 % de la population – et le Parlement européen a un droit de veto à la majorité simple. En tout cas, l’accord sera conclu par l’Union européenne seule : à la différence du ou des accords futurs, sur lesquels je vais revenir, il n’est pas prévu qu’il soit conclu par les États membres. Donc, en France, le Parlement sera saisi par le Gouvernement selon les voies consultatives normales.
Ainsi que je viens de l’indiquer, le négociateur sera la Commission, mais, en réalité, tout commencera par des « orientations » adoptées par le Conseil européen, par consensus, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. N’importe lequel des Vingt-Sept pourra donc s’opposer à ces directives. D’après ce que j’entends à Bruxelles, le Conseil européen a bien l’intention de garder cette affaire en main, compte tenu de sa nature très politique. Il faut donc s’attendre à ce qu’il continue à jouer un rôle par la suite. Mais ce sont bien évidemment la Commission, son négociateur M. Michel Barnier et ses services techniques qui seront en première ligne. Les questions que j’ai citées tout à l’heure sont pour certaines très techniques, notamment les questions budgétaires.
Pour ce qui est du ou des accords futurs, des procédures différentes s’appliqueront : celles qui sont prévues par les articles 216 à 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union. Il sera possible de diviser le travail en plusieurs accords, notamment en concluant séparément un accord commercial et un accord d’association sur les autres aspects. Rappelons que certains accords de commerce sont adoptés à la majorité qualifiée et d’autres à l’unanimité. En l’espèce, je pense qu’il s’agira d’un accord adopté à l’unanimité. Quant à l’accord d’association, il s’agira probablement d’un accord mixte engageant à la fois l’Union européenne – dans la mesure où il concernera ses compétences telles qu’elles sont décrites dans les traités – et les États membres. Il faudra donc que les Vingt-sept le ratifient, soit par la voie référendaire, soit par la voie des parlements nationaux – sachant que, en Belgique, compte tenu du partage des compétences entre l’État fédéral, les trois communautés et les trois régions, sept parlements devront probablement se prononcer.
En tout cas, le commerce sera le sujet central du ou des traités, car c’est un domaine d’intérêt majeur pour le Royaume-Uni. Certains ministres britanniques chantent que le Royaume-Uni va conclure des accords avec l’Inde, le Canada ou la Chine, et que tout ira très bien, mais l’Union européenne occupe une place beaucoup plus importante que celle des autres pays en matière de relations commerciales du Royaume Uni. D’après les données de la Chambre des Communes, en 2014, l’Union européenne à vingt-sept représentait 44 % des exportations de biens et services du Royaume-Uni et 53 % de ses importations. Ces chiffres étaient respectivement : 3,7 et 6,9 % pour la Chine ; 1,7 et 1,9 % pour l’Inde ; 1,2 et 1,6 % pour le Canada ; 1,7 et 0,8 % pour l’Australie.
On mesure donc l’urgence et l’importance extrêmes de s’entendre avec l’Union européenne pour le Royaume-Uni, qui fait actuellement partie du marché intérieur, où il n’y a ni droits de douane, ni règles d’origine, ni paperasserie – il s’agit presque du marché intérieur d’un État, même s’il n’est pas entièrement réalisé dans le domaine des services. Il aura donc intérêt à se tourner vers l’Union européenne. Les Britanniques sont d’ailleurs en fâcheuse posture, car ils sont demandeurs : leur pays compte beaucoup moins pour l’Union européenne que celle-ci ne compte pour lui, l’Union exportant vers lui moins de 10 % de ses biens et services. Pour l’Union, ce n’est pas vital, même s’il faut nuancer selon les secteurs.
Prenons l’exemple du secteur automobile. Depuis une quinzaine d’années, le Royaume-Uni a réussi à rebâtir, en faisant appel à des capitaux étrangers, une industrie fabriquant des pièces détachées et des moteurs, qui exporte et fournit des emplois. Or les droits de douane pratiqués par l’Union européenne sont de 10 % sur les voitures et les parties de voiture – contre 3 à 4 % en moyenne. S’ils étaient appliqués au Royaume-Uni, cela changerait tout, le marché automobile étant extrêmement compétitif. Notons que cela affecterait aussi des fabricants tels que Mercedes et BMW, qui vendent beaucoup au Royaume-Uni.
S’il y a des années d’intervalle – gap years – entre l’accord de retrait et l’accord sur le commerce, le Royaume-Uni « tombera » dans les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui n’est pas bon du tout pour lui : il sera alors obligé de négocier avec les 164 membres de l’OMC, devra établir sa propre liste d’engagements et sera tenu par la clause de la nation la plus favorisée. Ainsi, s’il souhaite appliquer un tarif douanier nul aux pays de l’Union européenne, il sera obligé d’en faire bénéficier tous les autres pays. Les règles de l’OMC prévoient des exceptions à cette clause, notamment les zones de libre-échange et les unions douanières, mais le Royaume-Uni n’aura pas eu le temps d’en mettre en place. Les Britanniques ont donc tout intérêt à négocier avec les Vingt-Sept quelque chose qui se tienne. Cependant, ils sont divisés et ne se sont pas encore fait leur religion : ils ne savent pas encore s’ils vont quitter l’union douanière, ni s’ils vont demander ou non à participer au marché intérieur.
En termes de choix politiques, les Britanniques font la distinction entre le hard et le soft Brexit. Ce dernier consisterait à garder le maximum de liens possible avec l’Union européenne en matière économique et commerciale, afin de limiter les conséquences du Brexit pour les entreprises exportatrices, en particulier pour celles qui vendent des services financiers. Les services, en particulier les services financiers, représentent désormais près des trois quarts de l’économie britannique. Il y a au Royaume-Uni environ 5 500 entreprises financières, qui ont besoin du passeport bancaire de l’Union européenne.
Pour ma part, je pense que l’on se dirige plutôt, en ce moment – cela peut changer –, vers un hard Brexit. Première raison à cela : on estime, dans les milieux politiques britanniques, que c’est principalement la question de l’immigration qui a déterminé le vote au référendum – lequel a été une surprise pour beaucoup, y compris pour ceux qui ont fait campagne en faveur du Brexit. Au Royaume-Uni, on fait depuis des années un mélange savant entre l’immigration issue de l’Union européenne et celle qui vient des pays tiers, en rendant l’Union européenne responsable des deux. Pourtant, l’Union n’a pas encore de politique commune concernant l’immigration en provenance des pays tiers, et le Royaume-Uni pourrait donc être beaucoup plus dur en la matière, en pratiquant davantage de contrôles ou en prévoyant des règles plus strictes pour la délivrance des cartes de séjour. Quoi qu’il en soit, l’opinion publique voit les choses ainsi que je les ai décrites, et c’est donc un problème politique de premier ordre pour les responsables britanniques.
Deuxième raison : ce que l’on ne veut plus admettre au Royaume-Uni, ce sont les jugements de la Cour de justice de l’Union européenne et les lois de l’Union sur le marché intérieur qui ont la primauté sur le droit national.
Si le Royaume-Uni s’engage dans la voie du hard Brexit, il va nécessairement y perdre. Lors des négociations, la position de départ des Britanniques sera probablement de dire qu’ils veulent le maximum du marché intérieur – en tout cas le passeport bancaire pour les services financiers – tout en demandant un certain nombre de dérogations à la libre circulation des personnes. Or, du point de vue des Vingt-Sept, il ne fait guère de doute que les quatre libertés du marché intérieur – libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes – sont indivisibles et qu’il faut les appliquer toutes les quatre, même si la libre circulation des services n’est pas encore complète. Cette position des Vingt-Sept est relayée de la même manière au sein de la Commission et du Parlement européen.
À mon avis, il est peu probable que l’on ait un accord commercial séparé qui serait conclu par l’Union européenne seule, sans ratification des Vingt-Sept. Rappelons que la Commission comptait faire adopter l’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada – qui a été négocié pendant neuf ans et finalement signé – à la majorité qualifiée, sans ratification par les États membres. Finalement, elle a décidé qu’il s’agissait d’un accord mixte et que les parlements nationaux devraient le ratifier. J’imagine que l’accord avec le Royaume-Uni sera lui aussi un accord mixte.
Mme Élisabeth Guigou. L’accord avec le Canada devra-t-il être ratifié en totalité par les États membres ?
M. Jean-Claude Piris. Oui, car c’est un tout qu’il n’est pas possible de diviser, même si certains y ont parfois pensé.
Il est probable que l’accord mixte avec le Royaume-Uni autorisera en outre ce pays à participer à un certain nombre de programmes, actions, politiques et agences de l’Union européenne. S’agissant des politiques, on peut penser notamment à la lutte contre le changement climatique et à la lutte contre le terrorisme, avec une participation à Europol. En ce qui concerne les actions, on peut penser aux sanctions politiques, tant contre des individus, notamment des terroristes, que contre des pays tiers tels que la Russie, ou encore aux opérations civiles ou militaires menées par l’Union dans différents pays. Pour ce qui est des programmes, on peut penser aux programmes de recherche scientifique ou d’échanges d’étudiants, notamment à Erasmus. Quant aux agences européennes, qui sont à peu près comparables aux agences fédérales américaines, il y en a désormais une trentaine, dont deux ont d’ailleurs leur siège à Londres et devront déménager – l’Agence européenne du médicament et l’Autorité bancaire européenne. Sur le fond, le Royaume-Uni pourrait être intéressé à participer à certaines de ces agences. L’Union européenne a, elle aussi, intérêt à ce que le Royaume-Uni participe à certaines de ces politiques, actions, programmes et agences, notamment à la lutte contre le terrorisme. En tout état de cause, cette participation, qui sera assortie le cas échéant d’une contribution au budget correspondant, se fera sans participation à la prise de décision, comme c’est le cas actuellement pour certains pays tiers, par exemple la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
J’entends dire que le Royaume-Uni devrait continuer à participer aux politiques étrangère et de défense. Toutefois, cela soulèverait des difficultés, car ces politiques sont discutées d’abord au Comité politique et de sécurité (COPS) – qui comprend des représentants permanents des États membres et se réunit souvent trois fois par semaine –, puis au Conseil des affaires étrangères et lors des réunions des ministres de la défense et, enfin, très souvent, au Conseil européen. Or les Britanniques ne seront représentés dans aucune de ces institutions.
Le choix entre hard et soft Brexit relève, bien entendu, des Britanniques. Pour ce qui est de l’Union européenne, le chancelier de l’Échiquier, M. Philip Hammond, a déclaré qu’elle devait faire preuve de « morale » et être « gentille » avec le Royaume-Uni, mais telle n’est pas la question. D’abord, les relations entre États ne sont pas les relations entre individus : ce sont davantage les intérêts que les sentiments qui jouent. Surtout, il y a une logique du marché intérieur : un même acte est pris par les institutions européennes – proposé par la Commission, puis adopté par le Conseil et par le Parlement européen –, est appliqué par tous les États membres et fait l’objet d’une même interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne ; il y a un mécanisme de surveillance et des sanctions financières éventuelles. Or on voit mal comment les Britanniques, qui ne seront membres d’aucune des institutions que je viens de citer, pourraient adhérer à cette logique, à moins qu’ils n’acceptent le modèle de l’Espace économique européen (EEE) tel qu’il a été offert il y a vingt-quatre ans.
À cet égard, je fais une parenthèse : si l’on devait renégocier aujourd’hui l’accord sur l’EEE, je suis certain qu’il serait beaucoup moins généreux. En effet, dans le cadre des négociations en cours avec la Suisse, Monaco, Andorre et Saint-Marin, l’Union européenne est beaucoup plus exigeante qu’elle ne l’a été lors des discussions sur l’EEE. J’en veux pour preuve les directives de négociation avec la Suisse, adoptées par le Conseil en mai 2014 sur proposition de la Commission, qui sont théoriquement secrètes, mais qui ont fuité dans la presse helvétique. Dans le cadre de l’EEE, lorsque la Norvège, l’Islande ou le Liechtenstein tardent à appliquer les lois de l’Union sur le marché intérieur – il y a eu des retards sur des centaines de textes, y compris sur des textes importants, jusqu’à cinq ou six ans –, il n’y a pas véritablement de sanctions, les compétences en la matière étant exercées par une autorité de surveillance et une cour de justice propres à l’EEE, qui comprennent des membres norvégiens, islandais et liechtensteinois. En revanche, dans les directives de négociations avec la Suisse – certes, ces négociations ne sont pas finies –, l’Union européenne demande que les sanctions soient automatiques et que la Commission et la Cour de justice de l’Union, avec leurs vingt-sept ou vingt-huit membres, soient seules compétentes.
Mme Élisabeth Guigou. Vos propos montrent que, du point de vue juridique, les Vingt-sept ont toutes les raisons d’être fermes, du fait notamment de l’unicité du marché intérieur et de la dépendance commerciale du Royaume-Uni à l’égard de l’Union européenne. Du point de vue politique, c’est une autre histoire car, même si la France, je l’espère et je le pense, persistera dans cette attitude, encore faut-il que les Vingt-Sept maintiennent leur cohésion.
Au Royaume-Uni, on fait en effet un amalgame en ce qui concerne l’immigration. De plus, l’opinion s’insurge non pas contre l’immigration venant du Commonwealth, mais principalement contre l’immigration interne à l’Union européenne. C’est d’ailleurs une raison supplémentaire pour nous de tenir bon sur l’unicité du marché intérieur. Pour l’instant, je ne vois pas les pays du groupe de Visegrád céder sur ce point. En la matière, la Pologne est franchement notre alliée, ainsi que j’ai pu le constater hier à Berlin lors d’une rencontre avec mes homologues allemand et polonais.
Je reviens sur la procédure prévue par l’article 50. Vous avez indiqué que le Conseil européen allait adopter des directives par consensus. Sur la base de quel article du traité ?
M. Jean-Claude Piris. De l’article 15, paragraphe 4 : « Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. » Or l’article 50 ne prévoit pas de disposition particulière.
Mme Élisabeth Guigou. Mais qui a dit que le Conseil européen devait obligatoirement donner des directives de négociation ?
M. Jean-Claude Piris. En vertu de l’article 50, paragraphe 2, l’Union négocie « à la lumière des orientations du Conseil européen ». Celles-ci sont d’ailleurs en cours de préparation.
Mme Élisabeth Guigou. Le Conseil doit adopter l’accord à la majorité qualifiée, qui est une double majorité, à la fois d’États membres et en termes de population. Pouvez-vous préciser de quelle majorité qualifiée il s’agit ?
M. Jean-Claude Piris. À l’article 50, paragraphe 4, alinéa 2, il est écrit explicitement : « La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Or celui-ci précise : « Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. »
D’après mes calculs, 72 % des membres, cela fait vingt États membres, et 65 % de la population, cela fait environ 330 millions d’habitants – sachant que l’on ne compte pas le Royaume-Uni.
Mme Élisabeth Guigou. Que se passera-t-il si les Britanniques déclenchent tardivement la procédure de l’article 50 et que l’échéance des deux ans arrive après la date des prochaines élections européennes ?
M. Jean-Claude Piris. Ce serait très fâcheux. C’est pour cette raison qu’un certain nombre de personnes essaient de pousser les Britanniques à déclencher la procédure. Mais nous n’avons aucun pouvoir : c’est une décision absolument unilatérale, qu’ils peuvent prendre à la date qu’ils souhaitent.
À ce stade, Mme Theresa May a indiqué en privé au président du Conseil européen, M. Donald Tusk, et aux dirigeants du pays de Galles, qu’elle le ferait en janvier ou février 2017. Si tel est le cas, l’échéance arrivera avant mai 2019, date des prochaines élections européennes. En revanche, si, ainsi que certains le prétendent à Londres, le Royaume-Uni attend la tenue des élections en France et en Allemagne, cela nous amènera à septembre 2017. À ce moment-là, les Britanniques participeront aux élections européennes, sachant que le président de la Commission est désormais choisi en tenant compte des résultats à ces élections.
Mme Élisabeth Guigou. Juridiquement, nous n’avons pas de moyens de pression pour que le Royaume-Uni déclenche la procédure de l’article 50. En revanche, politiquement, nous pourrions en avoir, à condition que les Vingt-sept en soient d’accord, car on ne peut pas dissocier complètement l’article 50 du futur statut.
M. Jean-Claude Piris. Absolument.
M. le président Claude Bartolone. En octobre 2015, vous avez écrit une note sur le Brexit, à certains égards, prémonitoire, pour la fondation Robert Schuman. Vous aviez une interprétation tout à fait intéressante : vous souteniez que l’article 50, paragraphe 2, décrivait une procédure facultative.
M. Jean-Claude Piris. On m’a reproché plusieurs fois cette phrase, qui était une maladresse d’écriture. La procédure de l’article 50 est obligatoire tant en droit international qu’en droit européen. Ce que je voulais dire par là, c’est que le Royaume-Uni n’est pas tenu de conclure un accord de retrait : c’est une option. Si le Royaume-Uni ne veut pas négocier d’accord et qu’il laisse s’écouler le délai de deux ans, il sortira automatiquement de l’Union européenne à l’issue de ce délai.
M. Jacques Myard. Lorsque le Royaume-Uni a souhaité adhérer à la Communauté économique européenne, le président Pompidou a organisé un référendum en France – auquel j’ai voté non. A contrario, vous avez indiqué que, en tout état de cause, les parlements nationaux n’auraient pas à se prononcer sur l’accord de retrait. Or cet accord va modifier notamment les clés budgétaires de l’Union européenne et, partant, l’économie générale du traité de Lisbonne, lequel a bien été ratifié par les États membres – là encore, j’ai voté non. Je ne vois donc pas pourquoi le Parlement ne serait pas consulté sur l’accord de retrait. Rappelons que l’Union européenne est une organisation internationale et qu’elle n’a pas « la compétence de sa compétence ». Je suis intimement convaincu que la compétence du Parlement français doit être sauvegardée. Je ne vois pas pourquoi cela resterait une affaire uniquement bruxelloise et que seul le Parlement européen serait consulté.
Par ailleurs, le Royaume-Uni sort de l’Union européenne, mais pas de l’Europe. Malgré les chiffres que vous avez cités, notre intérêt est de ne pas couper complètement le cordon ombilical avec le Royaume-Uni en matière commerciale, sous réserve du respect d’un certain nombre de principes, dont les quatre libertés. Ainsi que cela a été souligné à plusieurs reprises, notamment par notre ambassadeur à Londres, la France a un excédent commercial de 12 milliards d’euros avec le Royaume-Uni. Quel est votre sentiment à cet égard ?
M. Jean-Claude Piris. L’Union européenne est une communauté de droit : nous sommes tenus par les traités. L’accord prévu par l’article 50 ne va aucunement modifier les traités. Il est d’ailleurs impossible de modifier les traités sur la base de l’article 50. Quant aux clés budgétaires, elles ne figurent pas dans le traité : c’est de la législation secondaire, négociée et prise par les institutions.
Il est exact que le traité devra être modifié, mais d’une manière extrêmement légère. Tel est le cas de l’article 52 du traité sur l’Union européenne, qui dispose que les traités s’appliquent au Royaume-Uni. Mais, si on ne le fait pas à temps, ce ne sera pas bien grave, car le Royaume-Uni aura entre-temps abrogé l’European Communities Act de 1972 et n’appliquera plus le droit européen. Il faudra aussi modifier l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui cite un certain nombre de territoires d’outre-mer, ainsi que quelques protocoles. On le fera sur la base de l’article 48 du traité sur l’Union européenne, comme il convient. On ne convoquera probablement pas de convention, et le processus sera très rapide, car cela consistera seulement à supprimer les quelques dispositions que j’ai citées.
Quant aux autres textes fixant la composition et le siège des différentes institutions ou organes – par exemple le protocole sur le statut de la Cour de justice, les statuts de la Banque centrale européenne (BCE) ou ceux de la Banque européenne d’investissement (BEI) –, ils sont modifiables, le plus souvent par une décision du Conseil à l’unanimité, sans qu’il soit besoin de toucher aux traités. On avait pris cette précaution.
Enfin, d’après une étude que j’ai lue, le Brexit ne devrait guère prêter à conséquence en ce qui concerne le budget de l’Union.
Je suis tout à fait d’accord avec votre second point, monsieur Myard : à l’évidence, le Royaume-Uni ne va changer ni sa position géographique, ni l’histoire, ni les relations économiques très étroites qu’il entretient avec les autres pays européens.
Je suis d’accord avec Mme Guigou sur le fait que nous devons être très fermes sur certains principes. À mon avis, on ne bougera pas d’un millimètre sur la libre circulation des personnes, car c’est une question non seulement économique, avec la libre circulation de la main-d’œuvre, mais aussi politique. Il en va de la dignité des pays de l’est de l’Europe. Rappelons que 800 000 à 1 million de Polonais vivent au Royaume-Uni. D’ailleurs, c’est le Royaume-Uni lui-même qui a décidé d’ouvrir immédiatement son marché du travail aux ressortissants des États qui ont adhéré à l’Union en 2004, alors que la France et l’Allemagne ont appliqué, comme cela était possible, des restrictions à leur circulation pendant quelques années – sept ans, s’agissant de l’Allemagne. De même, le Royaume-Uni était le principal partisan de l’adhésion de la Turquie à l’Union, et cela a été utilisé ensuite comme un argument en faveur du leave.
Nous ne pouvons pas bouger de la logique du marché intérieur. Des personnes sans doute très bien intentionnées, en France et en Allemagne, ont proposé de créer deux cercles, en permettant aux États du deuxième cercle, à savoir le Royaume-Uni et, plus tard, des pays tels que l’Ukraine ou la Turquie, de participer à l’élaboration des décisions pour le marché intérieur de l’Union. Ces idées sont inapplicables en pratique et juridiquement, et elles sont inacceptables politiquement, d’ailleurs pour les deux Parties. Elles mettraient l’Union européenne en danger. Il faut faire très attention à ces idées et être extrêmement ferme sur ce point.
Cela dit, nous sommes naturellement ouverts à l’égard du Royaume-Uni. S’il demande à adhérer à l’EEE, je ne vois pas comment nous pourrions nous y opposer, même si le processus est très long. D’une part, il faudrait que l’accord soit ratifié par l’Union européenne et par trente et un États, à savoir les vingt-sept États membres de l’Union, la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse (pour l’AELE). D’autre part, ainsi que je l’ai indiqué, l’Union n’est guère satisfaite des règles de fonctionnement de l’EEE et a tendance à être désormais plus sévère. Mais si le Royaume-Uni accepte le système du marché intérieur, c’est encore mieux ! Les Vingt-sept étaient favorables à ce qu’il reste dans l’Union. Il va donc de soi que nous voulons garder des relations commerciales étroites avec lui. D’ailleurs, l’Allemagne exporte beaucoup, elle aussi, vers le Royaume-Uni.
M. Jacques Myard. Dans les conclusions du Conseil européen de février dernier, un certain nombre d’avantages ont été accordés au Royaume-Uni – la décision correspondante mentionne d’ailleurs non pas « le Royaume-Uni », mais « les États membres ». À cette occasion, certaines règles ont été écornées, notamment celle que fixe la fameuse directive sur la sécurité sociale. Cela prouve bien que, contrairement à ce que vous venez de dire, il y a parfois des assouplissements.
M. Jean-Claude Piris. Il est vrai que l’accord du 18 février 2016 avait été jusqu’à l’extrême limite de ce qui pouvait être accordé au Royaume-Uni. Certains États membres avaient d’ailleurs avalé la chose avec beaucoup de difficultés.
Mme Élisabeth Guigou. Cet accord est aujourd’hui caduc.
M. Jean-Claude Piris. En effet. Il avait bien été entendu qu’il en serait ainsi en cas de Brexit.
M. le président Claude Bartolone. La Cour de justice de l’Union européenne devra-t-elle être consultée sur l’accord de retrait ?
M. Jean-Claude Piris. En vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice peut être consultée soit par un État membre, soit par l’une des trois institutions, mais ce n’est pas obligatoire.
M. Jacques Myard. Heureusement !
Mme Karine Daniel. Compte tenu du calendrier juridique, à quels moments et à quel rythme les différents éléments que vous avez cités, par exemple le déménagement des agences, deviendront-ils visibles pour les citoyens ? Selon moi, rien ne serait pire que de ne pas donner de visibilité aux conséquences du Brexit, à la fois pour les citoyens britanniques et pour ceux des vingt-sept États membres.
Les opinions publiques sont également très sensibles à tout ce qui concerne les fonctionnaires européens et leur statut particulier. De nombreux mythes circulent à ce propos, et il pourrait y avoir un certain buzz sur ces questions. Qu’en est-il, concrètement, pour les fonctionnaires européens de nationalité britannique ? Les concours continuent-ils à leur être ouverts ? Qu’adviendra-t-il des fonctionnaires déjà en place ? Seront-ils intégrés dans l’administration britannique ? Ces questions sont à la fois politiques et juridiques.
Je termine par une question qui peut paraître anecdotique, mais qui est éminemment symbolique : qu’en sera-t-il de la langue anglaise au sein des institutions européennes ? Il me semble que seuls les Britanniques avaient insisté pour qu’elle soit langue officielle de l’Union européenne, les Irlandais ayant pour leur part défendu le gaélique.
M. Jean-Claude Piris. Un certain nombre d’étapes donneront de la visibilité : d’abord, les orientations du Conseil européen, qui seront, à l’évidence, rendues publiques ; ensuite, la position du Royaume-Uni, qui devra être rendue publique elle aussi, car il faudra bien que les responsables britanniques disent à leur population dans quelle direction ils souhaitent aller.
Les fonctionnaires de l’Union européenne sont dans une situation non pas contractuelle, mais statutaire, à l’instar des fonctionnaires français – le système européen a été calqué sur le système français. Du fait de la diminution des salaires intervenue à l’occasion de la réforme des institutions, il est très difficile, depuis plusieurs années, de recruter des ressortissants de certains États membres, notamment des Britanniques et des Danois, pour certaines fonctions. J’avais moi-même des difficultés à recruter des juristes britanniques, car ils sont beaucoup mieux payés dans le privé que dans les institutions européennes. Dès lors, on compte seulement un millier de fonctionnaires britanniques au sein des institutions, alors que le Royaume-Uni aurait droit à davantage au regard des quotas par nationalité.
La question des fonctionnaires va faire partie des négociations avec le Royaume-Uni. Je ne conçois pas que l’on mette à la porte les fonctionnaires déjà en place. En revanche, ils savent que leur carrière sera bouchée : on ne pourra pas les nommer à des postes très importants ou sensibles. Je note que deux directeurs généraux britanniques, MM. Jonathan Faull et Robert Madelin, ont annoncé leur démission.
Selon moi, il y a une question beaucoup plus importante, qui touche non pas un millier, mais 4 à 5 millions de personnes : que va-t-il se passer pour les quelque 2 millions de citoyens des Vingt-Sept qui travaillent au Royaume-Uni et, inversement, pour le nombre à peu près équivalent de Britanniques qui travaillent ou passent leur retraite dans les pays de l’Union ? Je suppose qu’il n’y aura pas beaucoup de changements pour ceux qui se trouveront dans l’une ou l’autre situation à une date à fixer lors de la signature de l’accord de retrait. En revanche, d’autres règles s’appliqueront probablement à l’avenir, sans doute beaucoup plus restrictives du côté britannique et, par conséquent, beaucoup plus restrictives également du côté de l’Union. Car c’est alors la réciprocité propre au droit international qui prévaudra.
Au sein de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’EEE, la seule langue officielle est l’anglais. Pourtant, l’anglais n’est la langue officielle d’aucun des quatre pays principalement concernés – la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
M. Jacques Myard. C’est scandaleux !
M. Jean-Claude Piris. D’après les statistiques du Conseil, en 1988, date à laquelle j’ai commencé à travailler pour les Communautés européennes, 85 % des textes législatifs originaux étaient rédigés en français, contre 12 à 13 % en anglais et 2 à 3 % en allemand. Aujourd’hui, c’est sans doute la proportion inverse : environ 85 % des textes originaux sont rédigés en anglais. Je serais étonné que la pratique des institutions change fondamentalement : l’anglais est devenu la principale langue de travail au sein de l’Union. D’autre part, deux États membres – l’Irlande et Malte – ont deux langues officielles dont l’anglais.
M. le président Claude Bartolone. Vous avez rédigé une autre note très intéressante après le référendum. Selon vous, la sortie du Royaume-Uni peut-elle être, comme la langue selon Ésope, « la meilleure et la pire des choses » ? Cette sortie peut-elle amener une nouvelle prise de conscience chez les Européens ?
M. Jean-Claude Piris. Je l’espère vivement. Malheureusement, cela paraît très difficile pour le moment, car les crises graves qui ont touché l’Europe ont suscité de nombreuses divisions : la crise de l’euro a provoqué des divisions entre États créditeurs et États débiteurs, entre le nord et le sud ; la question de l’immigration a créé des divisions entre anciens et nouveaux États membres, entre l’ouest et l’est.
Il y a toujours une solidarité et un attachement à l’Union européenne, mais l’euroscepticisme monte dans tous les États membres, y compris en France. C’est à ce populisme qu’il faut s’attaquer. Il faut essayer de démontrer que l’Union européenne est utile, en pratique et à court terme, à la résolution des problèmes les plus graves auxquels les citoyens ont à faire face, en particulier du chômage. Le taux de chômage des jeunes en Grèce et en Espagne est scandaleux. C’est une génération perdue, et il n’est pas possible de continuer de la sorte. L’Union européenne doit agir dans ce domaine dans la mesure où elle le peut. Rappelons que la majorité des pouvoirs en la matière appartient non pas à l’Union, mais aux États membres. L’euro a eu des conséquences très positives, notamment des taux d’intérêt très faibles pour tous les pays, mais a, dans le même temps, éliminé les possibilités de dévaluation. Il faut faire face à ces problèmes, établir des règles, créer une véritable union bancaire et un véritable marché unique des capitaux. D’autre part, l’Union européenne doit agir en matière d’immigration, d’autant qu’elle a, selon moi, davantage de capacités d’action dans ce domaine que dans d’autres. Mais, encore une fois, ce sera difficile. La note que vous avez mentionnée, monsieur le président, et que j’ai intitulée « Comment rendre l’Europe à nouveau populaire ? », peut paraître un peu pessimiste.
M. le président Claude Bartolone. C’est le moins que l’on puisse dire !
M. Jean-Claude Piris. Ainsi que je l’ai écrit dans cette note, attendons les élections en France et en Allemagne, pour voir si nous pouvons rebondir. Pour ma part, je garde espoir. Je pense que l’Union européenne constitue un progrès et une aventure extraordinaires. Il faut continuer ; il ne faut pas lâcher dans les moments difficiles tels que celui que nous traversons actuellement.
M. le président Claude Bartolone. Merci, monsieur Piris.
Séance du jeudi 20 octobre 2016
La mission d’information organise une table ronde, ouverte à la presse, sur les effets du Brexit sur les droits et les avantages des citoyens européens avec la participation de Mme Myriam Benlolo Carabot, professeure des universités, spécialiste de droit européen, M. Christopher Chantrey, président de l’association « British in France », M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale, M. Denis Despreaux, chef de la mission Europe et international pour la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et M. Félix Géradon, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale-Bruxelles
M. le président Claude Bartolone. Madame, messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation. Il nous a paru important de vous écouter sur les conséquences du Brexit sur les droits et les avantages des citoyens européens. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne n’aura pas uniquement des conséquences politiques, économiques ou commerciales : elle affectera directement la vie des ressortissants britanniques, notamment ceux qui se trouvent sur le continent européen, comme celle des ressortissants de l’Union européenne qui résident au Royaume-Uni. Ces derniers seront peut-être pris en otage lors des futures négociations de sortie, comme les discours prononcés lors du dernier congrès du parti conservateur peuvent le laisser craindre. L’impact de cette sortie pourrait également toucher les ressortissants d’États tiers : si le débat se focalise sur la liberté de circulation, c’est parce que l’Union européenne est d’abord, même si elle l’a parfois oublié, un projet construit pour les citoyens. Or la campagne référendaire au Royaume-Uni s’est cristallisée sur la question migratoire, ce qui favorise la ligne d’un Brexit dur, confirmée par les récentes déclarations de la Première ministre britannique, Mme Theresa May. Nous devons analyser les conséquences d’une telle option et déterminer les éléments à négocier dans l’accord transitoire et dans les accords post-Brexit et bilatéraux.
Madame Myriam Benlolo-Carabot, vous êtes professeure des universités et spécialiste de droit européen ; vous nous dresserez un panorama général des droits des citoyens européens et de l’impact juridique de la sortie d’un État de l’Union européenne, en intégrant les enjeux de réciprocité et en revenant sur la notion fragile de droits acquis.
Monsieur Christopher Chantrey, vous présidez l’association British community committee of France et vous aborderez les conséquences du Brexit pour les quelque 200 000 Britanniques résidant en France en vous faisant l’écho de leurs interrogations, craintes et souhaits.
Monsieur Thomas Fatome, vous êtes directeur de la sécurité sociale et vous examinerez la question des régimes de protection sociale pour les ressortissants communautaires résidant, ou de passage, dans notre pays et pour nos compatriotes vivant au Royaume-Uni.
Monsieur Denis Despréaux, vous êtes chef de la mission « Europe et international pour la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur » au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Vous nous éclairerez sur les programmes européens, particulièrement ceux de recherche et de mobilité étudiante ou professorale.
Monsieur Félix Géradon, vous êtes secrétaire général adjoint de l’Union syndicale-Bruxelles et vous traiterez de la question des fonctionnaires européens britanniques.
Mme Myriam Benlolo-Carabot, professeure des universités. Je suis honorée de pouvoir m’exprimer devant vous et très heureuse que l’Assemblée nationale ait créé une mission d’information sur cette question.
La citoyenneté de l’Union a été consacrée en 1992, et tout ressortissant d’un État membre est formellement citoyen de l’Union européenne ; mais cette reconnaissance symbolique et politique importante n’a fait qu’entériner ce que prenait déjà en compte le droit communautaire.
Le traité a consacré des droits accordés au titre de la citoyenneté, dont le plus essentiel est celui de la libre circulation et de séjour dans le territoire des États membres dès lors que vous êtes citoyen d’un de ces États. Certaines catégories disposaient déjà de ce droit avant 1992, notamment les travailleurs, puis les retraités et les inactifs. À partir de 1998, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a affirmé le caractère fondamental de ce droit et a notamment connecté le statut de citoyen avec le principe de non-discrimination et d’égalité dans l’État de résidence. Cette décision a donné à tout citoyen européen un égal traitement juridique avec le national, quel que soit l’endroit où il réside dans l’Union européenne ; elle a ainsi considérablement élargi la palette des droits du citoyen, qui peut bénéficier de conditions de travail égales à celles des ressortissants nationaux, de l’accès à certaines prestations, du droit à l’éducation et de celui de faire venir sa famille dans l’État membre où il réside. La citoyenneté de l’Union procure également des droits politiques, notamment celui de voter pour les élections municipales et européennes dans le pays de résidence.
Les citoyens ont également le droit de recourir à un médiateur, de signer des pétitions et d’adresser des courriers aux institutions de l’Union européenne. Ces droits de bonne administration sont accordés non seulement aux citoyens européens, mais également à toute personne résidant dans le territoire de l’Union. Par ailleurs, les citoyens européens se trouvant à l’étranger peuvent faire appel aux services consulaires d’un autre État membre en cas d’absence de représentation diplomatique de leur propre pays.
D’un point de vue strictement juridique, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne équivaut à une rupture avec la communauté politique et juridique de l’Union. Le Royaume-Uni n’appliquera plus le droit de l’Union européenne, si bien que les ressortissants britanniques ne possédant pas une autre nationalité d’un État membre ne seront plus citoyens européens. Ils seront donc des étrangers comme les autres dans les États membres où ils résident et seront soumis aux règles de l’immigration ; de même, les citoyens européens vivant au Royaume-Uni seront régis par les règles britanniques applicables en la matière. On imagine le cataclysme que cela provoquera en termes de droits acquis, mais ce bouleversement doit être prévu et pris en compte dans l’accord qui résultera de la négociation avec le Royaume-Uni. L’article 50 du traité de Lisbonne n’a pas encore été activé, mais, quand il le sera, une négociation s’ouvrira, qui pourra durer deux ans – ce délai pouvant être prolongé sur décision unanime du Conseil européen, perspective fortement probable dans le cas du Brexit.
Qu’en est-il des droits acquis ? On a peine à croire que des citoyens puissent devenir ainsi, du jour au lendemain, des étrangers sur le territoire de l’État où ils résidaient jusqu’alors. Mais ces droits acquis reposent malgré tout sur une théorie très fragile, contestée par de nombreux spécialistes de droit international mais déjà appliquée pour des successions d’États. Quand bien même on peut y voir des similitudes avec la question du retrait, le contexte n’en est pas moins très différent. Le droit international s’appuie beaucoup sur la convention de Vienne sur le droit des traités, dont l’article 70 évoque bien les droits acquis, mais les droits acquis des seuls États, cette convention ne concernant que les relations interétatiques. La transposition de cette théorie au droit de l’Union semble donc difficile. Quant à l’article 50 du traité de Lisbonne, il ne fait aucune référence aux droits acquis, si bien que ce sera à l’accord de résoudre ces questions. En attendant, le droit de l’Union n’oblige pas à prendre en compte la situation de ces citoyens, ce qui semble logique : dans la mesure où le peuple britannique a décidé souverainement de quitter l’Union européenne, on ne saurait lui imposer le statut de la citoyenneté européenne.
Se pose la question de la réciprocité, et c’est là où l’on sent toute l’ambiguïté de la position britannique : les Britanniques désirent quitter l’Union, mais en cherchant à préserver leurs intérêts économiques et ceux de leurs ressortissants, très nombreux à résider dans un pays de l’Union européenne. Du coup, ils se retrouvent dans une position très difficile, car la libre circulation a occupé le cœur des débats de la campagne référendaire ; ainsi, le Royaume-Uni souhaiterait refuser la libre circulation des citoyens européens dans leur territoire, en s’inspirant des modèles suisse ou norvégien, mais si les ressortissants britanniques bénéficiaient d’un traitement favorable en Europe, il devra garantir une parfaite réciprocité. Il ne pourra pas choisir, comme il souhaiterait le faire, entre les États membres en signant des accords bilatéraux avec certains et pas avec d’autres, à cause des règles qui unissent les pays de l’Union européenne entre eux et qui excluent toute discrimination en la matière. Tout dépendra des positions politiques des acteurs de la négociation : il y a le droit, mais il y a aussi ce que la décision politique donnera… Mais en droit en tout cas, une telle position est extrêmement ardue.
M. Christopher Chantrey, président de l’association British community committee of France. Je remercie vivement l’Assemblée nationale d’avoir créé cette mission d’information sur les suites du référendum britannique. Les Britanniques en France sont représentés par l’association British community committee of France (BCC), créée en 1937, et dont la marque est British in France. Mes compatriotes sont, j’en suis certain, très touchés par cette marque de sympathie du Parlement français et de leur pays de résidence, la France. Du fond du cœur, merci la France !
Nous avons d’abord représenté les intérêts de Britanniques en région parisienne avant d’étendre notre action à l’ensemble du pays. Le BCC fédère un peu plus d’une centaine d’associations locales – écoles, clubs et cercles sportifs, amicaux, professionnels et politiques – dans tous les domaines imaginables. Elles rassemblent les Britanniques résidant en France ou leur font bénéficier de leurs prestations, souvent à caractère charitable.
La communauté britannique en France est relativement modeste par rapport aux Italiens, aux Espagnols ou aux Portugais, mais également par rapport au nombre de Français établis au Royaume-Uni. Reste que la communauté française vivant au Royaume-Uni partage malheureusement les perturbations, les haines et les incertitudes dans lesquelles nous vivons.
Quel est le profil des Britanniques résident en France ? Selon une étude de l’Institut britannique pour la recherche en matière de politique publique, nous sommes grosso modo 55 % à travailler, 45 % à la retraite et 10 % à suivre des études. Par comparaison, la communauté française au Royaume-Uni compte bien plus d’actifs, les retraités français semblant moins apprécier le temps, la gastronomie et les vins de mon pays… Sans parler du soleil.
Le résultat du référendum, connu le 24 juin 2016 au matin, nous a étonnés, dépités et frappés droit au cœur. Pour les Britanniques établis à l’étranger, le Brexit n’est pas une opportunité, contrairement à ce que l’on a entendu au cours d’une campagne longue, imprécise, remplie d’exagérations, de xénophobie et de mensonges, mais bel et bien une menace, voire une catastrophe.
Ce ne fut pas un vote en connaissance de cause : quand on analyse le scrutin par catégories socioprofessionnelles, on s’aperçoit que les catégories supérieures ont voté en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne. Ainsi, les gens instruits, les hommes et les femmes d’affaires et les Britanniques entretenant des liens réguliers avec les autres pays ont refusé le Brexit. Londres, où de très nombreux étrangers résident, ce qui ne gêne aucunement les Londoniens, l’Écosse, l’Irlande du Nord, Oxford et Cambridge ont voté très largement pour le maintien dans l’Union européenne. Qui plus est, les Britanniques résidant à l’étranger depuis plus de quinze ans ont été exclus du scrutin, malgré la promesse du parti conservateur, formulée lors de la campagne pour les législatives de 2015, de déposer un projet de loi destiné à abolir cette règle arbitraire et antidémocratique. Le Gouvernement n’a pas tenu cet engagement, et le nouveau ministre britannique de la constitution estime qu’environ deux millions de Britanniques sont exclus des scrutins nationaux par cette loi disgracieuse qu’il veut faire abroger. Rappelons que 5,6 millions de Britanniques vivent à l’étranger, dont 1,2 million dans les pays de l’Union européenne.
Nous ignorons toujours la nature du Brexit choisie par le Gouvernement, de même que le Parlement ne sait pas s’il pourra se prononcer sur un texte de loi autorisant la Première ministre à invoquer l’article 50 du traité de Lisbonne, ou si Mme Theresa May pourra se contenter, comme elle l’a dit à plusieurs reprises, d’un arrêté ministériel… C’est la raison pour laquelle bon nombre de mes concitoyens ont demandé à la Haute Cour de Londres et à celle de Belfast d’imposer l’adoption par le Parlement d’une loi. Le vote de plusieurs lois me paraît nécessaire pour que le Gouvernement agisse dans l’intérêt de l’ensemble des Britanniques.
Le sujet le plus important pour les Britanniques résidant à l’étranger concerne la perte de la citoyenneté européenne, incluant notamment la liberté de s’établir dans tout pays de l’Union européenne. Beaucoup de Britanniques habitant en France nous ont témoigné de leur engagement financier et émotionnel envers la France ; la grande majorité de notre communauté s’est installée ici par amour de la France et de sa culture ; certains y ont investi toutes leurs économies.
Les Britanniques participent de manière remarquable à la vie civique française et sont conseillers municipaux ou bénévoles dans les communes ; ils contribuent ainsi très souvent à la vie de leur communauté d’adoption, tout comme les Français établis au Royaume-Uni. Plusieurs villages français survivent ou revivent grâce aux bénévoles britanniques, notamment dans le Lot ou en Dordogne.
J’ai reçu de nombreux témoignages de membres d’associations du BCC, du mensuel The Connexion, voix des Britanniques en France, et de l’association promouvant les droits des citoyens expatriés dans l’Union européenne (ECREU — Expat Citizen Rights in EU), créée, comme plusieurs autres, au lendemain du résultat du référendum. L’ECREU a rassemblé un échantillon de 2 333 Britanniques vivant en France, soit 10 à 11 % du total, pour les interroger : il ressort de cette enquête que 84 % des personnes se soucient de leur couverture santé, principalement les retraités et les préretraités qui n’ont pas cotisé au système français ; 81 % craignent la suppression des hausses des pensions de retraite britanniques prévues pour compenser l’augmentation du coût de la vie et s’interrogent également sur le régime d’imposition et de prélèvement social sur des pensions versées par un État qui ne serait plus membre de l’Union européenne ; 74 % évoquent l’évolution du taux de change ; 74 % s’inquiètent d’éventuelles restrictions en matière de voyage ; 70 % sont préoccupés par le maintien du droit de posséder des biens immobiliers en France et d’y habiter ; 65 % souhaitent acquérir le droit de vote aux élections britanniques même après quinze ans de résidence à l’étranger, mais s’inquiètent également de la perte du droit de voter et d’être candidat aux élections municipales et européennes en France ; 58 % s’interrogent sur les nouvelles règles de succession internationales ; 56 % refusent la perspective d’échanger les permis de conduire comme il fallait le faire avant ; 52 % veulent avoir la possibilité de prendre leur retraite dans le pays de leur choix ; 44 % se soucient des conditions de résidence au Royaume-Uni des citoyens d’autres pays de l’Union européenne ; 29 % sont inquiets de l’emploi en France ; 19 % citent le droit de fonder et de faire fonctionner une entreprise en France et 18 % parlent de l’immatriculation des voitures en France. J’ajoute à cette liste les sujets complémentaires communiqués par les membres des associations du BCC et par les lecteurs de The Connexion : le programme Erasmus, les passeports pour les animaux domestiques, les allocations pour les handicapés et l’ensemble des allocations versées par le Royaume-Uni, l’emploi et les droits à la retraite des fonctionnaires britanniques dans les institutions européennes.
Je m’attarderai sur cinq de ces sujets.
Sur le droit à la citoyenneté européenne et le droit de s’établir librement sur le territoire de l’Union européenne, je reçois des témoignages sur l’effet désastreux du Brexit sur la vie des familles. Des époux d’âge différent, dont l’un est resté au pays et l’autre est venu en France, voient leur projet de passer leur retraite en France remis en cause. De nombreux correspondants insistent sur l’importance de sauvegarder les droits des citoyens du Royaume-Uni vivant dans des pays de l’Union européenne. D’autres demandent s’il ne serait pas possible de créer une citoyenneté associée, ou d’imaginer une procédure rapide pour acquérir la nationalité française.
Autre problème posé, celui de la carte de séjour Union européenne ou de la carte de séjour permanent. Le couperet tombera deux ans après l’invocation de l’article 50 du Traité. Une personne qui n’aura pas totalisé cinq ans de résidence en France pourra-t-elle obtenir une carte de séjour permanent ? Les cartes de séjour n’étant plus obligatoires depuis 2004, la plupart des Britanniques de France n’en ont pas ; ils doivent donc en demander, mais certains essuient des refus en préfecture. Quelles garanties auront mes compatriotes que les mêmes règles soient appliquées dans tous les départements ? J’ai ici plusieurs témoignages : certains services de l’État, des préfectures ou la mutuelle sociale agricole (MSA) du Languedoc, considèrent d’ores et déjà que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne et refusent de recevoir les Britanniques pour leur délivrer des cartes de séjour ou des cartes européennes d’assurance maladie. Pourquoi faut-il fournir de nouvelles traductions d’extraits de naissance – dont le contenu ne change par définition jamais – ou de mariage pour l’obtention de cartes de séjour ? Un de mes correspondants me dit avoir l’impression que l’on se sert des expatriés comme jetons dans les négociations.
Troisième sujet de préoccupation : comment seront accueillies les demandes, de plus en plus nombreuses, d’acquisition de la nationalité française ? Nous sommes très souvent sollicités pour aider nos compatriotes à élaborer leur dossier, la procédure étant très complexe. Une procédure d’exception pourrait-elle accélérer le traitement des demandes ? La France, pays des droits de l’Homme, a ouvert les bras à des réfugiés syriens, afghans, ou érythréens, me dit un correspondant : pourrait-elle également accueillir les Britanniques qui se sentent apatrides après le référendum ?
La poursuite de la couverture santé, je l’ai dit, inquiète 84 % de mes compatriotes. La couverture sociale des Britanniques n’ayant pas cotisé en France entre dans le champ du règlement 883-2004 portant sur la coordination de la sécurité sociale. Ce régime sera-t-il maintenu lorsque le Royaume-Uni ne fera plus partie de l’Union européenne ? Si ces personnes perdent leur couverture sociale sans pouvoir payer une assurance privée, ils seront contraints de retourner au Royaume-Uni, ce qui créerait un fardeau supplémentaire pour le pays. Un retour annuel de 100 000 Britanniques vivant dans un pays de l’Union européenne au Royaume-Uni alimenterait un flux supérieur à celui des migrants, contre lequel notre gouvernement voulait lutter, et poserait un problème social particulièrement lourd, ces personnes n’ayant pas d’argent.
Nous aurons l’occasion de reparler des pensions de retraite britanniques et de l’action possible du gouvernement britannique, de l’accord sur la double taxation et du droit de fonder et de faire fonctionner une entreprise.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur Fatome, le périmètre de votre direction se trouve au cœur des préoccupations des Britanniques que M. Chantrey vient d’évoquer et que doivent partager bon nombre de nos compatriotes installés de l’autre côté du Channel… Votre éclairage nous sera précieux.
M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale. La coordination en matière de politiques de sécurité sociale a pour but d’éviter les ruptures et les pertes de droits de protection sociale pour les citoyens européens en situation de mobilité. Elle repose sur l’égalité de traitement, qui interdit à un État de léser un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, sur des critères de législation de sécurité sociale applicable destinés à éviter des conflits de compétence et des vides juridiques, sur des mécanismes de reconnaissance des périodes d’affiliation dans les différents États membres afin d’assurer la prise en compte des périodes de travail pour le calcul de la retraite, sur le détachement des travailleurs enfin, qui permet d’organiser, dans des conditions un peu spécifiques, la mobilité des travailleurs dans le continent européen.
Les citoyens européens détenteurs de la carte européenne d’assurance maladie peuvent être pris en charge sans autorisation préalable dans un autre État membre pour les soins médicalement nécessaires, et, avec autorisation préalable, pour les soins programmés.
Pour le calcul de leur retraite, les citoyens européens peuvent cumuler les périodes travaillées dans différents pays membres de l’Union. Aujourd’hui, 9 000 retraités français sont installés au Royaume-Uni et ont perçu 22 millions d’euros des régimes français en 2014, alors que les 64 000 retraités britanniques vivant en France ont reçu 370 millions d’euros des régimes britanniques.
La législation de l’assurance chômage s’avère également assez favorable à la mobilité, puisqu’il suffit d’avoir travaillé un jour dans un pays pour être indemnisé par son État, qui reconnaît les périodes d’assurance antérieures dans un autre pays. Une personne ayant travaillé plusieurs années au Royaume-Uni et s’installant en France pour prendre un emploi serait indemnisée par Pôle emploi à la perte de celui-ci et ne perdrait pas le bénéfice des salaires perçus au Royaume-Uni.
Le détachement permet le maintien du droit à la sécurité sociale d’origine des travailleurs envoyés dans un autre État membre, même si le droit du travail de l’État d’accueil s’applique. La France a ainsi détaché 12 000 travailleurs au Royaume-Uni, alors qu’elle n’a accueilli que 6 100 salariés britanniques.
Que pourrait-il se passer après le Brexit ? En l’absence de mécanismes de coordination, les trimestres cotisés par les Français au Royaume-Uni ne pourraient plus être cumulés, ce qui conduirait de fait à des retraites décotées ; cela étant, le Brexit n’aura pas d’impact sur les retraites déjà liquidées, quelle que soit la teneur des accords à venir. Les cotisations chômage seraient également perdues en cas de mobilité.
En 2014, les soins payés par le National health service (NHS) pour des citoyens britanniques résidant en France représentent un montant de 80 millions d’euros pour 70 000 bénéficiaires, la charge pour l’assurance maladie des citoyens français vivant au Royaume-Uni n’atteignant que 6 millions d’euros – cette inégalité s’explique par la dissymétrie des populations accueillies de part et d’autre de la Manche. Sans dispositions spécifiques pour l’assurance maladie dans les accords réglant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce serait la fin de ce système : rappelons que dans la plupart des accords bilatéraux de sécurité sociale, il n’y a pas de clause de coordination en matière d’assurance maladie ; les personnes sont donc couvertes par l’assurance maladie, selon les cas, soit de l’État d’activité, soit de l’État de résidence, ou par une assurance privée comme la caisse des Français de l’étranger.
L’accès aux prestations sociales non contributives comme le revenu de solidarité active (RSA) est ouvert aux citoyens communautaires sous condition de résidence de trois mois. Sans adaptation des règles, ce délai passerait à cinq ans de séjour régulier et préalable comme pour les citoyens non communautaires.
Voilà, rapidement posés, quels pourraient être les impacts dans l’hypothèse, peu vraisemblable, où aucun accord ne serait passé. On peut évoquer trois formes possibles de coordination avec nos amis britanniques, déjà évoquées.
Le Royaume-Uni, une fois sorti de l’Union européenne, pourrait être considéré, en matière de droit social, comme l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, membres de l’espace économique européen (EEE), et, dans une moindre mesure, comme la Suisse qui a conservé des règles spécifiques. Ces pays appliquent l’acquis communautaire, et les règlements de coordination couvrent les citoyens de ce pays. Cette solution offrirait une assez large continuité pour les Britanniques, à ceci près que le Royaume-Uni ne pourrait plus peser sur la définition de ces politiques.
L’Union européenne pourrait, autre solution, signer un accord spécifique avec le Royaume-Uni dont le champ dépasserait probablement la protection sociale et dont le contenu dépendrait des négociations.
En l’absence d’arrangement spécifique, les pays de l’Union européenne pourraient négocier séparément des conventions bilatérales de sécurité sociale avec le Royaume-Uni. La France en a déjà signé une trentaine, d’abord avec les pays du Maghreb et d’Afrique noire dans les années 1970 et 1980, puis avec des pays d’Asie et d’Amérique latine. Ces documents organisent souvent, notamment en matière de retraite, des mécanismes de totalisation et d’articulation des systèmes, destinés à favoriser les mobilités et les investissements croisés. Cette possibilité existe, mais elle ravalerait le Royaume-Uni au rang de partenaire bilatéral classique dans ses relations avec la France.
M. Denis Despréaux, chef de la mission « Europe et international pour la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur » au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le Royaume-Uni est un acteur mondial majeur dans les domaines de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, cette influence étant évidemment encore plus forte à l’échelle de l’Union européenne. Toute distance prise par ce pays dans les dispositifs communs est perçue défavorablement par les acteurs de ces secteurs. La France réalise 26 % de ses publications en commun avec les États-Unis, 17,8 % avec l’Allemagne et 17,7 % avec le Royaume-Uni. Un fait est à remarquer, l’indice d’affinité des recherches britanniques par rapport aux nôtres : 0,99, le meilleur que nous ayons avec n’importe quel autre pays de la planète.
Toute la question est de savoir si cet épisode sera soft ou hard… Si la sortie du Royaume-Uni est douce, il ne se passera pas grand-chose pour nous, mais si la séparation est dure, la question de la circulation des personnes deviendra centrale à nos yeux. La Commission européenne s’est déjà exprimée à ce sujet, et plusieurs pays ont d’ores et déjà soutenu cette position d’avant-négociation.
La période de la négociation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne durera au moins deux ans – encore est-il peu probable qu’elle aboutira dans ce délai – et sera suivie d’une transition destinée à mettre en œuvre le nouveau statut. Au cours de ces longs mois, les bases juridiques, pour l’essentiel européennes, sur lesquelles repose l’ensemble de la coopération universitaire et de recherche avec le Royaume-Uni auront un statut incertain, ce qui pourrait se révéler catastrophique.
Les personnes travaillant à la Commission européenne dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche se retrouvent déjà dans une grande incertitude, qui risque de durer deux ans et demi puisque l’on parle d’une activation de l’article 50 en mars prochain. Le droit de l’Union est en tout cas clair sur le fait qu’il faut posséder la nationalité d’un État membre pour être fonctionnaire à la Commission européenne. On peut se demander si une exception pourrait être apportée à cette règle. Les fonctionnaires britanniques, notamment les cadres dirigeants, se retrouvent d’ores et déjà face à un problème de légitimité ; ils rencontrent des difficultés à prendre une position ferme vis-à-vis d’autres partenaires dans l’élaboration de règlements dont l’application aura lieu après le Brexit. Ils se font du reste de moins en moins présents dans les réunions à un niveau très élevé : j’ai assisté au conseil de compétitivité où le ministre britannique ne s’est pas rendu. Les Britanniques, très efficaces dans les jeux d’influence, représentaient un associé important pour nous – même si nous ne sommes pas toujours en accord avec eux, comme sur le dossier du Golden access. Reste que nous nous appuyons beaucoup sur les Britanniques et les Allemands, notamment sur la question, assez complexe, de l’excellence. Il faut savoir que les Britanniques, les Allemands et les Français font de l’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur le pilier de la coopération européenne, alors qu’un bloc de treize pays, souvent membres récents de l’Union, souhaiterait renforcer les facteurs de cohésion. Une forte pression s’exerce pour rééquilibrer le financement entre les anciens et les nouveaux membres.
Le retrait britannique ne devrait pas avoir de grandes conséquences sur l’espace européen d’enseignement supérieur (EEES), car le processus de Bologne est suivi au Conseil de l’Europe, qui regroupe 48 pays et dans lequel la Commission européenne n’est qu’un acteur parmi d’autres.
Il n’en sera pas de même pour Erasmus. La France représente la troisième destination des étudiants britanniques inscrits au programme Erasmus et le Royaume-Uni occupe le même rang pour les étudiants français. La question de la circulation des personnes sera déterminante, mais, comme pour l’EEES, des pays non-membres de l’Union européenne adhèrent à Erasmus en payant une cotisation. Il n’est pas certain que l’enseignement supérieur britannique se montre très favorable à Erasmus : il est tenu de pratiquer des prix très modérés pour les étudiants étrangers de ce programme, à la différence des autres étudiants étrangers qui acquittent des droits de scolarité très élevés ; les établissements britanniques perdent donc de l’argent avec Erasmus. Les universités britanniques n’ont rien à envier à leurs homologues européennes en termes d’attractivité aujourd’hui, mais la situation pourrait évoluer si les étudiants et les enseignants européens rencontraient davantage de difficultés pour se rendre au Royaume-Uni.
La recherche britannique est très alimentée par les financements européens vis-à-vis desquels elle se trouve fortement bénéficiaire avec 135 % de retour par rapport à la France, par exemple ; elle est d’autant plus attachée aux financements communautaires que le financement national de la recherche au Royaume-Uni s’avère relativement faible et bien inférieur au nôtre. La question est posée de la pérennité des accords, d’autant qu’ils sont régis par le droit belge, une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union européenne ; les Britanniques affirment avoir d’ores et déjà été évincés de certains consortiums par mesure de précaution. Cette question s’étend à la circulation des personnes, des citoyens britanniques pouvant hésiter à rejoindre un projet européen à l’étranger s’ils en sont exclus dans trois ans. Dans ce domaine, la France et le Gouvernement britannique envoient des messages très positifs : le ministère de la recherche britannique a ainsi déclaré qu’il couvrirait les dépenses et qu’il permettrait aux chercheurs de circuler ; néanmoins, l’incertitude demeure.
La soutenabilité des infrastructures communes représente une question très lourde : dans la plupart des accords, les Européens ont mis en place des consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), possédant un statut ad hoc de droit belge. Il en existe 95, dont 47 sont en liaison avec les Britanniques, certains d’entre eux étant situés entièrement ou partiellement au Royaume-Uni. La question est posée du statut juridique et de la soutenabilité de ces consortiums, puisque ces projets représentent souvent des milliards d’euros. Chaque ERIC possède un mode de pilotage et un calendrier propres, puisqu’il s’agit d’entités juridiques autonomes : d’où un risque de saucissonner la négociation, au risque d’effets assez désastreux pour tout le monde.
Le projet énergétique ITER n’est pas régi par le droit de l’Union, mais par celui de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) ; néanmoins Euratom étant placé sous la compétence des instances de l’Union européenne, le maintien de la présence britannique reste en suspens. Il faut éviter un retrait britannique d’ITER : nous ne sommes pas très inquiets à ce sujet, mais l’incertitude est renforcée par l’inachèvement, à l’heure actuelle, des négociations sur le projet.
Enfin, les Britanniques sont très impliqués dans l’Agence spatiale européenne (ESA), dont le programme n’est pas régi par le droit de l’Union européenne ; en outre, le Royaume-Uni abrite de nombreuses installations dédiées à la recherche spatiale, si bien que nous ne nourrissons pas d’inquiétudes majeures dans ce domaine.
M. Félix Géradon, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale-Bruxelles. Je suis très honoré d’avoir été invité à participer à cette table ronde pour évoquer le cas des fonctionnaires européens de nationalité britannique – ce qui reste un bien petit problème à l’échelle du Brexit.
L’Union syndicale est le principal syndicat des fonctionnaires européens ou internationaux en Europe ; nous avons également des membres au sein du Conseil de l’Europe ou dans des organisations non européennes en Europe.
Le cadre juridique en vigueur est assez différent de ceux dont on a l’habitude. Les fonctionnaires et agents de l’Union européenne sont au service de l’Union, ils lui doivent leur loyauté. Ils ne peuvent accepter ni instruction ni distinction honorifique, décoration, faveur, don ou quelque rémunération que ce soit de la part de leur gouvernement ou de quelque autre source extérieure. Nous avons donc affaire à des fonctionnaires de l’Union et non, pour le sujet qui nous occupe, à des fonctionnaires britanniques qui travailleraient par hasard pour l’Union européenne.
Le statut des fonctionnaires prévoit l’interdiction de toute discrimination. Déjà le traité sur l’Union européenne interdit la discrimination fondée sur la nationalité. Il y a toutefois une exception : au moment de leur recrutement, les fonctionnaires doivent avoir la nationalité d’un État membre, à moins de bénéficier d’une dérogation – nous avons eu en effet quelques fonctionnaires norvégiens, suisses ou américains. Mais une fois le recrutement effectué, l’obligation d’être citoyen d’un État membre ne s’applique plus ; reste que les institutions peuvent licencier, donc démettre d’office les fonctionnaires qui n’ont plus la nationalité d’un État membre. Si les institutions ne font pas usage de cette faculté, le fonctionnaire garde son statut et son poste. Il en va différemment pour les agents temporaires et les agents contractuels dont le contrat se termine lorsqu’ils n’ont plus la nationalité d’un État membre, sauf dérogation accordée par les institutions – la logique est donc ici inverse.
J’ajoute que si les fonctionnaires sont démis d’office, aucune couverture sociale n’est prévue pour eux, aucune indemnité de chômage, aucun préavis, et ils ne bénéficient plus de couverture sociale – l’assurance maladie est un régime à part qui ne fait pas partie de la coordination des régimes européens d’assurance maladie. En revanche, pour les agents temporaires, des indemnités sont prévues.
Les pensions sont également régies par notre statut qui prévoit expressément qu’elles sont à charge du budget européen mais que les États membres en garantissent collectivement le paiement.
Jusqu’au moment du Brexit, soit, théoriquement, deux ans après l’activation de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, les fonctionnaires européens de nationalité britannique ne devraient subir aucune discrimination en matière de promotion, d’affectation ou de recrutement. Après le Brexit, même s’il est possible, théoriquement, de tous les licencier, on peut supposer que des Britanniques resteront fonctionnaires de l’Union européenne et dès lors ceux-ci ne pourront être l’objet de discrimination. Ce principe de non-discrimination doit toutefois, de mon point de vue, être appliqué en tenant compte du risque de conflit d’intérêts. On peut dès lors supposer que, pour des postes dont le titulaire doit définir la politique de l’Union, négocier avec des États tiers – et le Royaume-Uni en fera partie –, il pourrait y avoir conflit d’intérêts. Il est dès lors fort possible que certains postes, les plus sensibles, soient d’un accès très difficile pour les fonctionnaires de nationalité britannique qui demeureraient en poste après le Brexit. Ils garderaient bien sûr la possibilité de tenter de faire valoir, devant la Cour de justice de l’Union européenne, qu’ils ont été victimes de discrimination.
En ce qui concerne les pensions des fonctionnaires européens de nationalité britannique qui sont déjà à la retraite et celles, futures, des fonctionnaires aujourd’hui en activité, elles seront toujours payées par l’Union européenne. Néanmoins, le statut prévoyant que les États membres sont solidairement responsables du paiement des retraites, on pourrait très bien imaginer que, au cours des négociations, on demande aux Britanniques de supporter une partie du coût des retraites actuelles et futures des fonctionnaires européens en général. Il ne s’agirait pas de leur demander de payer les retraites des fonctionnaires de nationalité britannique, mais leur quote-part des droits à la retraite acquis pendant que le Royaume-Uni faisait partie de l’Union européenne.
Le montant peut s’en révéler élevé ; on considère que la dette de l’Union européenne envers les fonctionnaires pour payer leur retraite est de 50 à 60 milliards d’euros. C’est énorme mais il faut bien comprendre comment fonctionne ce régime. Il s’agit d’un fonds virtuel. Contrairement à un régime de répartition, pay as you go, dans lequel les contributions financent au même moment les prestations, les actifs finançant les pensionnés, ici, les actifs contribuent pour bénéficier, au moment où ils prennent leur retraite, de l’argent que, mutuellement, ils auront versé au fonds. Ce fonds a existé à l’époque de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) – les fonctionnaires payaient leur contribution et les États la part patronale selon une répartition un tiers-deux tiers. Au moment de la fusion des exécutifs des trois communautés (CECA, Communauté économique européenne et Euratom), les États membres ont considéré qu’il était plus intéressant pour eux, plutôt que de payer la totalité des salaires à laquelle s’ajoutaient 20 % versés au fonds de retraite, de ne payer que 90 % des salaires et de considérer que les 10 % que les fonctionnaires devaient payer au fonds de retraite et que les 20 % que ces mêmes États versaient au fonds, étaient mis de côté afin de garantir le paiement des pensions. C’est pourquoi le statut prévoit cette garantie solidaire des États membres. C’est un peu comme si ces derniers avaient émis des bons du Trésor – c’est d’ailleurs en général aux bons du Trésor qu’on compare les taux d’intérêt utilisés pour le calcul des cotisations retraites. Chaque année, une évaluation actuarielle permet de déterminer le taux de contribution nécessaire pour assurer les prestations de retraite prévues par notre statut. C’est pourquoi les droits à la retraite de tous les retraités, ajoutés à ceux des fonctionnaires en activité sont évalués à 50 ou 60 milliards d’euros – chiffre du reste tout à fait hypothétique parce que calculé selon des règles comptables suivant lesquelles on doit prendre en considération le taux d’intérêt au 31 décembre de l’année précédente ; or ce dernier était très bas et non représentatif de l’évolution des cinquante prochaines années, en tout cas nous l’espérons.
Il faut savoir que le statut des fonctionnaires européens provient d’un règlement du Conseil européen soumis à la procédure législative ordinaire – initiative de la Commission, adoption par le Conseil et par le Parlement : il relève donc du droit secondaire, au-dessus duquel on trouve les traités – traité de Rome, traité de Maastricht, traité de Lisbonne… mais aussi les traités d’adhésion – et donc au-dessus duquel on trouvera, sans doute, le traité qui sera conclu avec le Royaume-Uni à la suite des négociations prévues par l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Ce droit primaire, qui est supérieur, peut prévoir d’autres dispositions et j’imagine mal, par exemple que l’une d’entre elles ne concerne pas la couverture sociale des fonctionnaires de nationalité britannique éventuellement démis d’office.
J’ai dit qu’il resterait probablement des fonctionnaires britanniques au sein des institutions européennes après le Brexit : ce sera en partie pour des raisons linguistiques. Il est en effet plus que probable, malheureusement, que l’anglais restera la lingua franca des institutions de l’Union européenne : même si les Britanniques ne sont plus là, la grande majorité des nouveaux États membres n’utilisent quasiment que l’anglais ; aussi, j’imagine mal tous ces États se mettre rapidement à parler français ou une autre langue qui deviendrait notre lingua franca. Nous aurons donc probablement besoin de traducteurs-interprètes britanniques.
Les modifications du statut des fonctionnaires par le biais du traité qui serait conclu à la fin des négociations devraient bien sûr respecter les principes généraux du droit, notamment celui de non-discrimination et, plus largement, ceux contenus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il devrait être par exemple exclu, à mon avis, qu’on décide que les pensions des anciens fonctionnaires britanniques soient payées par le Royaume-Uni, transférées au régime britannique, car il y aurait discrimination entre les fonctionnaires britanniques et les autres. De même, on ne devrait pas non plus pouvoir démettre d’office ou licencier les fonctionnaires qui ont la nationalité britannique et une autre nationalité, ce qui serait tout à fait contraire, de mon point de vue, j’y insiste, aux principes généraux du droit applicables au sein de l’Union européenne.
La seule question qui se pose encore est de savoir s’il y aura un accord, un tel traité à la suite des négociations. Plusieurs options sont envisageables. La première est l’absence de Brexit – ce qui est très peu probable mais on ne peut pas totalement exclure que les Britanniques reviennent sur leur décision. Puis nous avons le soft Brexit, le hard Brexit mais aussi le « extra-hard » Brexit.
Or vu les positions respectives du gouvernement britannique, des autres États membres et des institutions européennes, il est fort possible que les négociations calent rapidement – nécessitant une révision desdites positions – et qu’elles prennent plus de temps que les deux années imparties par l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Il faut dès lors que les Vingt-Huit soient unanimement d’accord pour prolonger ce délai. Dans la mesure où les conflits, au cours de ces négociations, seront assez durs, chacun faisant pression en sens contraire, les uns jouant les prolongations, les autres désirant aller vite, il n’est pas du tout exclu qu’au bout de deux ans aucun accord ne soit conclu, les traités ne s’appliquant dès lors plus au Royaume-Uni. La situation serait chaotique. Resterait à espérer que le Royaume-Uni accepte de respecter ses engagements non seulement vis-à-vis des fonctionnaires mais aussi ceux concernant la recherche, les fonds européens, la Banque centrale européenne… Car les Britanniques ne seront plus obligés par la Cour de justice de l’Union européenne de les respecter. Reste que s’ils ne les respectaient pas, leur crédibilité s’en trouverait atteinte sur la scène internationale dans la perspective de la conclusion d’autres accords avec d’autres États. Cette option n’est toutefois pas à exclure, j’y insiste.
M. le président Claude Bartolone. Je dois vous dire, aux uns et aux autres, qu’au lieu de nous rassurer, vous augmentez notre perplexité et nos doutes…
M. Jacques Myard. Je suis assez étonné de votre volonté de complexifier, de compliquer les affaires plutôt que de les appréhender avec une certaine sérénité. Aucun des problèmes que vous avez soulevés ne trouve de solution en droit international public – aucun. Je suis étonné, à cet égard, madame Benlolo Carabot, que vous ayez omis le droit d’établissement quand vous avez évoqué les quatre libertés ; or, à ce titre, je vous rappelle que nous recevons sur le territoire français un certain nombre d’étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et qui séjournent chez nous aux termes de conventions bilatérales. Nous pourrons toujours, sur le plan bilatéral, régler les problèmes franco-britanniques, indépendamment de la situation de l’Union européenne. Je suis, sur ce point, formel.
En matière de sécurité sociale, nous avons conclu des accords avec de nombreux États étrangers. Ils sont plus ou moins bien appliqués, je vous l’accorde – le Parlement aborde d’ailleurs très souvent la question.
Quant à la recherche, je suis intimement convaincu que nous trouverons les solutions adéquates. Vous l’avez très bien dit : nous sommes liés en la matière avec les Britanniques et je ne vois pas comment nous parviendrions à couper les ponts : ce serait complètement ubuesque. Nous trouverons donc, ici encore, des solutions bilatérales. On a évoqué le retour des fonds européens à hauteur de 135 % pour les Britanniques. Très bien, mais je rappelle que le Royaume-Uni est le troisième contributeur au budget de l’Union européenne ; il retrouvera donc directement des fonds nationaux. Aussi, rien de ce que vous nous avez exposé n’est rédhibitoire.
Pour ce qui est du délai de deux ans prévu par l’article 50, l’Union européenne nous a très souvent habitués à arrêter l’horloge… De cette manière nous pourrons trouver un accord pour essayer de continuer les négociations sur un certain nombre de points.
Les problèmes que vous soulevez existent bel et bien, mais il me semble que nous n’éprouverons aucune difficulté à trouver des solutions sur le plan bilatéral. Il ne faut donc pas se mettre martel en tête. J’ajoute que nous, Français, avons intérêt à trouver un accord avec les Britanniques. Nous sommes en effet trop liés sur le plan sociologique – notre ami Christopher Chantrey nous l’a bien montré – et sur le plan commercial – je vous rappelle que notre solde commercial avec le Royaume-Uni est positif. Nous n’allons tout de même pas nous tirer des balles dans le pied à longueur de temps au nom de dogmes aujourd’hui largement remis en cause par certains États, à l’occasion du Brexit ; sans compter la kyrielle de crises que connaît l’Europe et à cause de laquelle il va bien falloir un jour ou l’autre remettre les pendules à l’heure. Donc, j’y insiste, on peut trouver des solutions bilatérales sans trop de difficulté, à condition bien sûr de ne pas trop faire monter les enchères en matière de principes – comme le disait Clemenceau, il faut s’appuyer sur les principes jusqu’à ce qu’ils cassent ; eh bien, c’est la position politique que je défendrai bec et ongles parce que, à un moment donné, trop c’est trop, et il faudra bien sortir des dogmes pour trouver des solutions pratiques.
M. Pierre Lequiller. Je ne tiendrai pas le même langage que mon collègue Myard, comme vous pouvez l’imaginer. Il est europragmatique…
M. Jacques Myard. Absolument !
M. Pierre Lequiller.… alors qu’il me dit eurobéat. Vous avez donc ici réuni deux points de vue complètement opposés.
M. Jacques Myard. Ce qui ne nous empêche pas d’être amis !
M. Pierre Lequiller. Tout à fait, et même voisins. J’ai trouvé très intéressants vos exposés et, pour ma part, j’y ai découvert, comme le président Bartolone, des problèmes que je n’avais pas imaginés jusqu’à présent. Sans doute seront-ils résolus, mais je me demande s’ils le seront dans les deux ans impartis par l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Et là, je ne suis pas d’accord avec Jacques Myard : s’ils ne sont pas résolus dans les deux ans, nous serons confrontés à un problème majeur parce qu’il est impensable que les Britanniques participent aux élections européennes et à la nomination de commissaires européens. La prolongation des négociations signifierait qu’ils bénéficieraient encore de ce privilège après avoir voté le Brexit. Or je m’interroge sur la possibilité de régler les nombreux problèmes que vous nous avez exposés en seulement deux ans.
Monsieur Chantrey, vous avez déclaré, si j’ai bien compris, que les Britanniques installés à l’étranger n’avaient pas pu participer aux élections.
M. Christopher Chantrey. Les Britanniques établis à l’étranger depuis plus de quinze ans n’ont pas pu voter à l’occasion du référendum malgré la promesse électorale de 2015 du parti conservateur d’abroger la loi qui les en empêchait.
M. Pierre Lequiller. Combien d’électeurs sont-ils concernés ?
M. Christopher Chantrey. Sur les 5,6 millions de Britanniques installés à l’étranger, environ 2 millions seraient concernés – il s’agit d’une estimation.
M. Pierre Lequiller. C’est une erreur de plus de David Cameron alors ?
M. le président Claude Bartolone. Je vous rappelle à votre devoir de réserve, monsieur Lequiller. (Sourires.)
M. Pierre Lequiller. Je suis aussi de nationalité britannique…
M. Christopher Chantrey. J’aurais préféré que M. Cameron programme ce projet de loi dès l’élection de mai 2015, car il savait déjà qu’il organiserait le référendum. Nous avons essayé d’amender la loi instituant le référendum, mais nous avons échoué.
M. Pierre Lequiller. J’ai une autre question concernant le mode de décision du Royaume-Uni : pour intégrer la CEE, il avait organisé un référendum et la Chambre des communes avait ensuite voté…
M. Christopher Chantrey. En fait, une loi a été votée en 1972 au terme de laquelle le Royaume-Uni intégrerait la CEE le 1er janvier 1973, et un référendum a été organisé en 1975 sur le maintien du Royaume-Uni au sein de la CEE, le « oui » l’emportant avec quelque 60 % des voix.
M. Pierre Lequiller. Il me semblait à l’inverse que pour entrer au sein de la CEE, le Royaume-Uni avait organisé un référendum suivi d’un vote à la Chambre des communes… Se pose en tout cas un vrai problème : même si, à la limite, cela ne nous regarde pas, on peut trouver assez extraordinaire que la Chambre des communes ne se prononce pas sur une question aussi difficile que celle soulevée par l’article 50 du traité sur l’Union européenne.
M. Jacques Myard. Mme May a dit non.
M. Pierre Lequiller. Elle a dit non mais cela, je le répète, pose un vrai problème.
M. Jacques Myard. Nous ne sommes pas là pour régler les problèmes britanniques ; nous avons déjà bien assez des nôtres…
M. Christopher Chantrey. La loi qui a instauré le référendum est muette sur les conséquences d’un vote négatif en termes d’actions à entreprendre de la part du pouvoir exécutif. Cela étant, la souveraineté parlementaire, dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, j’entends bien la souveraineté du parlement britannique, est un pilier de nos institutions.
M. Pierre Lequiller. Cela paraît surréaliste.
Madame Benlolo Carabot, vous avez suggéré que nous pourrions nous inspirer du système norvégien ; je souhaite que vous développiez ce point.
Vous êtes passés rapidement sur la question du taux de change. Il se trouve que j’ai une maison en Espagne et les Britanniques qui sont installés là-bas pâtissent durement de l’évolution du taux de change.
M. Jacques Myard. C’est autre chose.
M. Pierre Lequiller. C’est autre chose, mais la livre s’est dépréciée de 18 % par rapport à l’euro.
M. Jacques Myard. C’est très bon pour les exportations britanniques !
M. Pierre Lequiller. Soit, mais pas pour les Britanniques qui vivent à l’étranger – M. Myard ne veut pas voir les problèmes…
J’en viens à la question des retraites. Si j’ai bien compris, la retraite des Britanniques installés sur le continent risquerait d’être décotée.
Il me semble que M. Junker a fait une déclaration dès après le Brexit pour garantir que les fonctionnaires européens de nationalité britannique ne seraient pas « éjectés ». Il est vrai que l’argument que vous avez fait valoir, monsieur Géradon, sur le conflit d’intérêts est très important.
Pour finir, j’aimerais savoir combien de Français suivent un cursus dans le cadre du projet Erasmus au Royaume-Uni. D’après ce que j’ai compris, les universités britanniques sont peu intéressées par ce dispositif qui permet aux étudiants de payer des frais d’inscription inférieurs à ceux des étudiants extracommunautaires. Là aussi, je souhaite que vous nous en disiez plus.
M. le président Claude Bartolone. Malgré la différence de notre approche avec celle de Jacques Myard, nous devons convenir qu’il y aura bien un futur. En attendant, le doute qui prévaut en ce moment n’est bon ni pour les individus ni pour les entreprises, ni non plus pour l’économie en général ni pour la recherche.
M. Chantrey l’a plus que sous-entendu : M. Cameron a proposé ce référendum en pensant qu’il n’aurait jamais lieu, imaginant que le petit parti libéral n’en voudrait pas. Je suis très surpris, lorsque je rencontre mon homologue, par cette espèce de peur, y compris chez certains parlementaires qui se posent la question de savoir s’ils doivent, en tant que tels, se prononcer et donc respecter ou non le vote de leurs concitoyens.
M. Jacques Myard. Bien sûr !
M. le président Claude Bartolone. Un certain nombre de questions touchant aux principes vont donc être posées.
En tout cas, en ce qui concerne ce temps de doute, vous pouvez imaginer, de chaque côté du Channel, ce que peut représenter l’interrogation des citoyens européens.
Madame Benlolo Carabot, les résidents depuis plus de cinq ans peuvent-ils être protégés par un autre texte ? La convention européenne des droits de l’homme, par exemple, peut-elle servir de jurisprudence, peut-elle « border » les décisions prises par les responsables britanniques ?
Ensuite, quelles seraient les conséquences du Brexit sur les contentieux en cours auprès de l’ensemble des juridictions européennes ?
Par ailleurs, avez-vous une idée, monsieur Chantrey, du nombre de Britanniques élus au sein de nos conseils municipaux ?
M. Christopher Chantrey. On en compte un peu plus de 800 un peu partout en France, en majorité dans les petites communes.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur Fatome, prenons l’hypothèse d’un Brexit dur. Nous avons certes passé des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays – et sur ce point Jacques Myard a raison – mais, en ce qui concerne les personnes qui ont travaillé pour partie au Royaume-Uni et pour partie en France, quel est le système qui pourrait leur permettre de « reconstituer » leur carrière ?
Monsieur Despréaux, je reviens sur la béatitude de Jacques Myard pour ce qui est de la recherche. Il est évident que certains programmes engagés avec nos amis britanniques ne vont pas s’arrêter du jour au lendemain. La communauté scientifique y réfléchit-elle néanmoins ?
Encore une fois, ce qui me préoccupe, c’est la période de doute – et c’est aussi le cas des acteurs de l’ensemble des secteurs qui font la richesse de la coopération européenne et de la coopération franco-britannique. Je raconte toujours cette anecdote : lors de la réunion du G7 des présidents des parlements, les Japonais nous ont indiqué avoir prévu un investissement pour l’Europe au Royaume-Uni ; or ils se posent aujourd’hui la question de savoir vers quelle partie orienter cet investissement : le Royaume-Uni ou l’Union européenne ?
Mme Myriam Benlolo Carabot. Je n’ai jamais dit, monsieur Myard, que les problèmes auxquels nous allons être confrontés seraient insolubles.
M. Jacques Myard. Nous sommes donc d’accord.
Mme Myriam Benlolo Carabot. La situation est par contre hautement problématique et c’est sans doute là-dessus que nous divergeons.
Il est un point sur lequel je suis, certes, parfaitement d’accord avec vous : puisque le droit de l’Union européenne ne trouvera plus à s’appliquer au Royaume-Uni, nous nous tournerons nécessairement – et du reste nous le faisons dès à présent – vers le droit international qui nous offre des outils plus que flexibles. Les négociateurs vont opter pour des solutions de droit international général et c’est bien pourquoi il n’y a rien d’insoluble puisque ce droit est suffisamment souple, j’y insiste, pour nous permettre d’englober toutes les situations.
M. Jacques Myard. C’est le principe de la volonté des États.
Mme Myriam Benlolo Carabot. Soit, mais, jusqu’à preuve du contraire, la France, qui va négocier ces accords bilatéraux, reste, elle, membre de l’Union européenne. Dès lors, elle n’est pas liée que par le droit international : elle est aussi liée par le droit de l’Union européenne. C’est une réalité juridique et politique. Partant de là, la France ne fait pas ce qu’elle veut quand elle signe un accord bilatéral.
M. Jacques Myard. En effet.
Mme Myriam Benlolo Carabot. Elle peut tout à fait signer un accord bilatéral – et elle en a conclu beaucoup avec des États tiers à l’Union européenne –, mais elle doit tenir compte de ses obligations au titre du droit de l’Union et ces obligations sont contrôlées et par la Commission et par la Cour de justice de l’Union qui, à de maintes reprises, a empêché les États membres de faire ce qu’ils voulaient en matière de relations avec des États tiers.
M. Jacques Myard. Ce fut le cas avec l’EPR.
Mme Myriam Benlolo Carabot. Ce fut le cas avec l’EPR, mais pas seulement.
Je suis donc d’accord avec vous sur le fait que nous pouvons signer un accord – mais sous le contrôle très strict des institutions de l’Union européenne qui nous empêcheront de faire n’importe quoi.
M. le président Claude Bartolone. Ainsi, le Royaume-Uni a tenté de renégocier immédiatement un accord avec l’Australie et chacun s’est très vite rendu compte que le premier était encore membre de l’Union européenne et que dès lors, il ne pouvait négocier n’importe quoi.
Mme Myriam Benlolo Carabot. Bien sûr. Ce que je viens de dire concerne le Royaume-Uni tant qu’il sera membre de l’Union européenne, pendant cette période d’incertitude, de doute, et concernera quoi qu’il en soit tous les États membre dans leurs relations futures avec le Royaume-Uni. On pourrait mentionner de très nombreux exemples comme les cas où les compétences de l’Union européenne à l’extérieur n’étaient pas clairement affirmées, et au sujet desquels la Cour de justice de l’Union européenne a adopté une position très ferme et a encadré le pouvoir des États membres de signer des accords bilatéraux. Je serai donc nettement moins optimiste que vous, monsieur Myard, sur le fait qu’il n’y aurait pas de problème, que tout va se régler et que tout est magnifique.
J’en viens au modèle norvégien. Il repose sur l’Espace économique européen (EEE) et l’Association européenne de libre-échange (AELE). Tous les États membres de l’Union européenne sont également membres de l’EEE par le biais d’un accord qui les lie à trois autres États tiers qui sont la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. La Norvège, en tant qu’État extérieur à l’Union, ne prend part à aucune décision dans le cadre de celle-ci, mais elle contribue à son budget et a accès au marché intérieur européen. S’appliquent par conséquent aux Norvégiens installés dans les pays membres et aux citoyens de l’Union installés en Norvège, toutes les libertés de circulation : de personnes, de services, de capitaux et de marchandises.
M. Pierre Lequiller. Les Britanniques ne peuvent pas accepter un tel modèle !
Mme Myriam Benlolo Carabot. Je crois en effet pouvoir affirmer que l’on ne s’oriente pas du tout vers cette solution qui pourtant, quelques jours avant le référendum, quand on s’interrogeait sur les possibles conséquences d’un Brexit, avait été envisagée. Le Royaume-Uni cherche autre chose ; il ne voit aucun intérêt à contribuer au budget de l’Union, à être soumis au contrôle de la Cour de justice de l’AELE.
M. Pierre Lequiller. Sans oublier la libre circulation.
Mme Myriam Benlolo Carabot. Qu’il réfute également, en effet. Tout cela ne me semble pas très bon, politiquement, pour le Royaume-Uni.
M. Jacques Myard. Il faut faire preuve d’imagination…
M. Christopher Chantrey. Je suis tout à fait d’accord avec le fait que la solution à la norvégienne n’a aucune chance – l’adopter reviendrait à ne pas tenir compte du résultat du résultat du référendum. J’espère que les tribunaux, jusqu’à la cour suprême du Royaume-Uni, vont estimer nécessaire le vote de lois et que toutes échoueront parce que les solutions qu’elles proposeront ne seront pas, politiquement, acceptables. Nous n’allons pas trouver la solution qui réponde en tous points aux aspirations des gens qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Et, après ces échecs, des élections législatives anticipées devraient être organisées qui seraient une sorte de second round du référendum. C’est en tout cas ce que j’espère.
Mme Myriam Benlolo Carabot. Il y a aussi le modèle suisse. Pendant la campagne référendaire, j’ai beaucoup entendu les Britanniques l’évoquer comme solution au cas où le modèle norvégien ne serait pas retenu. La Suisse n’est pas formellement membre de l’EEE mais a négocié une série d’accords bilatéraux avec l’Union européenne – plus de 150. C’est ainsi qu’elle a choisi de ne pas signer d’accord dans le domaine de la libre circulation des personnes.
Pour le coup, une telle configuration serait très difficile à négocier pour le Royaume-Uni, ne serait-ce que parce que le modèle suisse est en ce moment même fortement remis en cause par l’Union européenne elle-même. En effet, à la suite de ces accords bilatéraux, l’Union européenne comme la Suisse se sont montrées très insatisfaites de cette situation. Depuis 2010-2011, un grand traité est en négociation pour regrouper ceux de ces accords qui respectent les principes de l’Union européenne. En outre, la réintroduction de quotas d’étrangers communautaires a été adoptée par référendum dans un des cantons suisses. Or, un an et demi plus tard, le blocage des négociations entre l’Union européenne et la Suisse, pour la mise en œuvre du résultat du référendum, est total car l’Union a des exigences en matière de non-discrimination que la Suisse doit respecter dans la mesure où, même si elle n’applique pas expressément le principe de libre circulation des personnes sur son territoire, elle est liée par d’autres engagements européens. Aussi la Suisse se retrouve-t-elle dans l’impossibilité d’appliquer le résultat de ce référendum si elle ne se soumet pas à certains critères de l’Union européenne. Il s’agissait par cet exemple de vous montrer que, alors que j’évoque ici un État tiers à l’Union européenne, celui-ci est malgré tout enserré dans une problématique juridique et politique très complexe et contrainte par rapport à l’Union.
M. Thomas Fatome. Si la période transitoire prévue par l’article 50 du traité de l’Union européenne est source d’interrogations, il est clair que toutes les règles en vigueur régissant la coordination des systèmes de sécurité sociale vont continuer de fonctionner. Aussi si, malheureusement, des messages discordants circulent, ils ne sont pas nécessairement fondés. Les mécanismes de prise en charge, j’y insiste, de totalisation des retraites, de remboursement d’assurance maladie, etc., continueront à fonctionner tant que le Royaume-Uni sera membre à part entière de l’Union européenne.
Ensuite, rien ne changera concernant les pensions des personnes qui ont liquidé leur retraite aujourd’hui. Si aucun accord n’est trouvé qui permette une reconnaissance mutuelle et une totalisation, alors chaque assuré devra consulter son régime français et son régime britannique pour tâcher de savoir dans quelles conditions la période travaillée pourrait ouvrir des droits. Ce qui est vraisemblable, au regard des règles, c’est qu’il y aura une décote – or tout l’intérêt de la totalisation est précisément de prendre en considération la totalité de la carrière. Si une convention bilatérale ou un accord appliquait bien cette logique, elle serait de nature à assurer la continuité de la mécanique de totalisation. Quelqu’un qui aurait cotisé avant la mise en œuvre des nouvelles règles bénéficierait de la totalisation à peu près dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Enfin, nous n’avons fait qu’évoquer un point pourtant central dans la discussion : la position des Britanniques sur l’application chez eux de la libre circulation des travailleurs. On recherche une solution pragmatique, et on loue souvent le pragmatisme britannique, mais on ne la trouvera que si les règles du jeu s’établissent sur cette thématique. On perçoit en tout cas, en tant qu’observateur, que ce sujet est de nature à présenter une difficulté de la part de nos amis britanniques.
M. le président Claude Bartolone. Il ne pourra pas y avoir de discussion si l’ensemble des libertés n’est pas appréhendé dans le même temps ; faute de quoi ce sera la fin de l’Union européenne.
M. Jacques Myard. Ce sera le cas.
M. le président Claude Bartolone. Certains pays d’Europe centrale, sinon, vont vouloir négocier à leur tour sur ce point.
M. Jacques Myard. Je vous ferai remarquer, monsieur le président, que l’une des personnalités européennes à avoir remis en cause la libre circulation des personnes est un ancien président de la Commission européenne, M. Prodi lui-même, qui, lorsqu’il était Président du Conseil italien a été confronté à la question des Roms – problème majeur en Italie.
Ensuite, qu’on le veuille ou non, le Conseil européen du mois de février a remis en cause la liberté de circulation et notamment du fait des problèmes liés à la sécurité sociale. On voit donc bien qu’intellectuellement on admet l’idée d’un accommodement des principes des quatre libertés – j’en suis intimement convaincu.
Je suis de la même manière convaincu que la jurisprudence issue de l’arrêt « Accord européen sur les transports routiers (AETR) », selon laquelle la compétence interne emporte la compétence externe sera remise en cause.
Dès lors, ou nous nous montrons pragmatiques afin d’obtenir un dispositif qui fonctionne, ou nous continuons dans l’idéologie et le dogmatisme et nous allons dans le mur.
M. le président Claude Bartolone. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’idéologie et de dogmatisme : le jour où il n’y aura plus la liberté de circulation, ce ne sera plus la même Union européenne.
M. Jacques Myard. Eh bien, ce sera autre chose.
M. le président Claude Bartolone. On parle souvent des Roms, des immigrés, mais je vous rappelle, monsieur Myard, que les Français et les Polonais ont été au cœur de la campagne référendaire britannique. Déjà là nous voyons se dessiner un tout autre projet européen. Je connais vos doutes sur l’Europe…
M. Jacques Myard. Non ! Sur la construction européenne présente, pas sur l’Europe !
M. le président Claude Bartolone. Voyez, monsieur Chantrey, quels peuvent être nos débats au sein du Parlement français. J’imagine, si la justice devait décider, au Royaume-Uni, qu’un texte de loi serait nécessaire, ce que seront les débats chez nos amis britanniques…
M. Denis Despréaux. Je reviens rapidement sur la Suisse pour noter que le délai de deux ans ne fige pas nécessairement la situation. En effet, dès lors que ce pays a commencé à limiter la liberté de circulation des personnes, en matière de recherche, l’accès au programme h 2020 a été limité ; du coup, la Suisse se heurte à de gros blocages pour bénéficier des financements européens. De la même manière, si les Britanniques votaient une loi limitant la liberté de circulation des personnes, la situation s’en trouverait modifiée.
J’ai surtout parlé de la recherche publique ; mais pour ce qui est de l’innovation, nous avons de très nombreux signaux qui nous indiquent que dans le secteur privé, les entreprises innovantes hésitent à s’implanter ou à maintenir leurs implantations sur le marché britannique car l’intérêt d’appartenir à l’Union européenne est tout de même d’avoir accès au marché européen.
M. Jacques Myard. C’est le problème du passeport européen.
M. Denis Despréaux. Nous avons ainsi plusieurs exemples d’entreprises japonaises, notamment pharmaceutiques, qui sont en train de réviser leur politique : ils n’ont plus tellement envie de s’installer au Royaume-Uni.
Pour ce qui concerne le programme Erasmus, le Royaume-Uni a envoyé, en 2013, 15 610 étudiants en mobilité dont 4 176 en France. La France est en troisième position, sachant que les Britanniques préfèrent les zones anglophones. Nous sommes nettement en tête des zones non anglophones, largement devant les Allemands. Nous avons même gagné des parts de marché, si je puis dire, car, depuis trois ans, la part d’étudiants britanniques a augmenté de 30 % chez nous depuis dix ans alors qu’elle chute de 12 % en Allemagne. Le Royaume-Uni constitue la première destination d’étudiants français – au nombre de 6 800, soit plus que les étudiants espagnols ou allemands –, ainsi que pour la formation et l’enseignement professionnel.
M. Pierre Lequiller. Et donc, d’après ce que vous nous avez expliqué, cela va devenir beaucoup plus difficile pour eux.
M. Denis Despréaux. En effet. Le budget du programme Erasmus + est de 1,68 milliard d’euros. Le volet Erasmus cofinance les études. Sans cela, l’étudiant devra payer les frais d’inscription et c’en sera fini des coûts modérés : jusqu’à présent, un étudiant ressortissant d’un État membre, même hors Erasmus, bénéficie, dans l’État membre dans lequel il s’installe, d’avantages assez considérables, alors que l’étudiant provenant d’un pays tiers à l’Union européenne paye le plein tarif.
M. Jacques Myard. Combien d’étudiants français, au total, bénéficient du programme Erasmus ?
M. Denis Despréaux. Je n’ai pas le chiffre précis, d’autant que les séjours en question sont d’une durée variable.
M. Pierre Lequiller. J’ignore qui interroger, mais nous sommes en train, au sein de la commission des finances, d’examiner la manière dont nous pourrions attirer les entreprises installées au Royaume-Uni et en particulier celles du secteur financier. Nous allons favoriser le statut d’impatrié. Se posent dès lors des problèmes de fiscalité, de droit du travail… À la suite de la perte du passeport financier par les Britanniques – et il serait totalement illogique qu’ils le gardent – peut-on espérer le retour ou l’arrivée d’entreprises japonaises, pour reprendre l’exemple que vous avez évoqué ?
M. le président Claude Bartolone. Ce sera l’objet d’une prochaine table ronde portant sur l’impact du Brexit sur les activités bancaires, financières et sur les investissements.
M. Denis Despréaux. Je souhaite ajouter un mot à propos des accords bilatéraux. D’un point de vue politique, nous sommes confrontés à un gros dilemme : nous avons construit l’espace européen de la recherche et de l’innovation et nous sommes en train de construire l’espace européen de l’enseignement supérieur parce que nous considérions qu’il s’agissait d’une véritable plus-value à l’échelle mondiale, pour peser dans le domaine de la recherche, face à la croissance rapide de la Chine ou à l’expansion importante des États-Unis. On peut certes faire du bilatéral, mais l’essentiel de la relation partenariale repose sur des financements apportés par l’ensemble des États membres à travers l’Union européenne. La question est donc de savoir, dans l’hypothèse où l’on construit quelque chose avec deux ou trois pays européens – avec le Royaume-Uni et éventuellement l’Allemagne, par exemple –, si l’on ne risque pas de du même coup de déconstruire l’espace européen de la recherche, ce qui nous laisserait dans une situation moins favorable d’un point de vue collectif.
M. Jacques Myard. Pour avoir rédigé un rapport avec une collègue socialiste, pour le compte de la commission des affaires européennes, je puis vous dire que les financements européens dont vous parlez représentent à peine 5 % des financements de la recherche en Europe. Il y a donc lieu de relativiser ce que vous venez de dire.
Je suis en revanche d’accord avec vous sur le fait que l’espace européen de la recherche permet de créer des liens, mais ces liens, on peut toujours les garder d’une manière ou d’une autre – je vous le dis comme je le pense.
M. le président Claude Bartolone. Répondez-lui donc, ne le laissez pas avoir le dernier mot !
M. Denis Despréaux. Le chiffre de 5 % est exact, mais il représente tout de même 95 % des financements partenariaux : or c’est avec ces derniers que l’on crée des relations. Le reste demeure sur notre territoire.
M. le président Claude Bartolone. Certes, il y a d’un côté les moyens financiers, mais, de l’autre, il y a aussi cette collaboration entre différentes équipes de recherche « appâtées » par cette amorce financière. Or si on la perd, on perdra beaucoup en matière de synergie de recherche.
M. Jacques Myard. On ne la perdra pas !
M. Pierre Lequiller. Vous faites preuve d’une patience extraordinaire, monsieur le président ! Vous savez, voilà des années que je siège aux côtés de M. Myard et nous ne parvenons pas à le convaincre de quoi que ce soit. (Sourires.)
M. Jacques Myard. M. Lequiller, lui, s’améliore : il commence à devenir eurosceptique…
M. le président Claude Bartolone. Monsieur Garadon, si M. Myard y consent, vous avez le mot de la fin.
M. Félix Garadon. Au lendemain du référendum, en effet, le président de la Commission européenne, M. Junker, et le président du Parlement européen, M. Schulz, ont rassuré les fonctionnaires européens de nationalité britannique en soulignant qu’ils avaient toujours été loyaux et qu’ils travailleraient avec les présidents des autres institutions afin qu’ils continuent à apporter leur savoir-faire. Le président du Conseil européen, M. Tusk, pour sa part, n’a pas fait le même type de déclaration car il est plus lié par les États membres, il est moins indépendant que les deux premiers. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est contributeur net, pour 12 %, au budget européen. J’ignore quelle sera la réaction de votre commission des finances quand on lui dira qu’il suffira d’augmenter de 12 % votre contribution au budget européen pour qu’il n’y ait plus aucun problème…
Il est probable que, même si les dépenses administratives ne représentent que 6 % du budget européen, dont la moitié pour les rémunérations, les États membres voudront réduire les effectifs. Et quel est le meilleur moyen de procéder, en cas de Brexit, sinon en licenciant les fonctionnaires de nationalité britannique ? Nous luttons pour que ce ne soit pas le cas, mais nous n’entendons pas être aveugles non plus : le risque est réel.
Vous nous avez interrogés par ailleurs sur ce qu’il adviendra des litiges en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne. La cour n’a en fait aucun moyen de faire appliquer ses décisions. Ses arrêts sont appliqués par les États membres parce que c’est dans l’ordre normal des choses, mais il n’y a pas d’exécution forcée possible. Pour ce qui est des arrêts qui seront pris après le Brexit ou dont les effets devraient se produire après le Brexit, de la même manière que pour ses autres engagements, le Royaume-Uni se sentira-t-il moralement obligé de les respecter ? Telle est la question.
En ce qui concerne les différents modèles, norvégien, suisse et autres, d’après Mme May, les Britanniques veulent limiter l’immigration et garder l’accès au marché intérieur. D’après les dirigeants européens, ces deux exigences sont incompatibles. L’accès au marché intérieur comprend les quatre libertés dont la liberté de circulation des personnes. Et si j’entends bien ce qui s’est dit ici, pour un État membre comme la France – et c’est valable pour les autres également –, il est plus intéressant de garder la liberté de circulation et d’éviter que les Britanniques aient accès au marché intérieur, cela afin d’attirer les entreprises étrangères dans nos pays afin qu’elles y investissent plutôt qu’au Royaume-Uni. Les positions de négociation sont donc tout à fait opposées.
J’assistais cette semaine à une conférence, à Bruxelles, dont l’un des participants, André Sapir, membre du groupe Bruegel, un think tank européen, établissait la typologie des différentes issues possibles au Brexit. Nous avions d’abord le no Brexit, puis le soft Brexit qui pourrait aboutir au modèle suisse ou au modèle norvégien qui tous deux prévoient la libre circulation des personnes, en dépit de certains accommodements pour la Suisse. Ensuite venait l’idée d’un partenariat continental, modèle quelque peu hybride prévoyant une circulation des personnes limitée mais l’accès au marché intérieur. Puis étaient envisagées les unions douanières telles celle que nous avons établie avec la Turquie ou alors les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Un participant à la conférence, un ancien eurodéputé britannique, a plaidé pour un accord du même type que celui que nous avons contracté avec l’Ukraine, c’est-à-dire un accord de libre-échange complet et approfondi (deep and comprehensive) qui ne prévoit pas la libre circulation. C’est peut-être également une idée à creuser.
M. Pierre Lequiller. Un tel accord ne va pas très loin.
Mme Myriam Benlolo Carabot. Je reviens sur les contentieux en cours devant les juridictions européennes. Il est tout à fait exact qu’il n’est pas prévu, pour les États membres, d’exécution forcée d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Si la France exécute ces arrêts, c’est parce qu’elle se sent liée, juridiquement et politiquement, par son appartenance à l’Union. Dès lors que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne, il reste tout de même lié par des principes de droit international qui sont des principes de sécurité juridique énoncés dans la Convention de Vienne. Dès lors qu’un traité s’éteint, le Royaume-Uni sera tenu, en vertu des principes généraux du droit, d’assumer les conséquences de contentieux noués. La question est celle de la date critique : il faut savoir à quel moment le contentieux s’est noué afin de savoir si le Royaume-Uni peut être tenu pour responsable ou pas de l’exécution d’un arrêt.
Enfin, pour répondre à votre question sur le fait de savoir si les résidents de plus de cinq ans pourraient invoquer d’autres normes juridiques, la réponse est oui. La Convention européenne des droits de l’homme peut bien sûr l’être puisque son article 8 protège le droit à la vie privée et familiale. Et, dès lors qu’on a noué une vie familiale ou une vie privée intense – notion interprétée très souplement par la Cour –, cet article peut être invoqué afin d’éviter que le pire ne se produise.
M. le président Claude Bartolone. Je vous remercie tous de nous avoir consacré de votre temps. Vous ne nous avez pas apporté de solution clé en main mais on voit bien, à travers vos interventions, l’épreuve que les Européens vont vivre au cours des négociations à venir. Ce qui m’inquiète beaucoup, nous l’évoquerons lors de la prochaine table ronde, c’est le développement du chacun pour soi, le but étant, en ordre dispersé, de savoir comment être plus attractif que le voisin – y compris au sein de la zone euro.
Séance du jeudi 3 novembre 2016
La mission d’information organise une table ronde, ouverte à la presse, sur les effets du Brexit sur les activités bancaires et financières, les monnaies et les investissements avec la participation de M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, Mme Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor, M. Gérard Rameix, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), M. Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace
M. le président Claude Bartolone. Madame, messieurs, bienvenue devant la mission d’information, qui s’intéresse ce matin aux effets du Brexit sur les activités bancaires et financières, les monnaies et les investissements. Nous rencontrerons aussi bientôt Mario Draghi.
Les milieux d’affaires londoniens ont clairement pris position, lors de la campagne référendaire, en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, et pour cause : Londres est la première place financière au monde et les services financiers représentent aujourd’hui 7,4 % du PIB et 4 % de l’emploi britanniques.
C’est le Royaume-Uni qui subira les conséquences les plus lourdes du choix fait par les électeurs, la chute de la livre n’en étant sans doute qu’un premier effet. Néanmoins, l’Union européenne et en particulier la zone euro, seront affectées également par l’incertitude engendrée par le retrait britannique, puis par le retrait lui-même. A contrario, la reconfiguration des marchés financiers européens créera des opportunités.
Quelles seront les conséquences du Brexit sur le secteur financier et les investissements, particulièrement s’il devait s’agir d’un hard Brexit ?
Alors que certaines banques européennes – je pense à la Deutsche Bank et à plusieurs banques italiennes – suscitent déjà des inquiétudes, que la croissance demeure trop faible et que la Banque centrale européenne a déjà utilisé des outils non conventionnels pour soutenir l’activité, comment la zone euro résistera-t-elle à ce choc ?
S’agissant des taux d’intérêt et du financement de l’économie de notre pays, quelles sont les perspectives qui se dessinent ?
Les institutions financières de la City vont-elles automatiquement perdre leur passeport européen ? La place de Londres pourra-t-elle continuer d’effectuer une grande partie des opérations financières, et notamment des opérations de compensation en euros ? Comment les services financiers auront-ils accès au marché unique ?
Quelle pourrait être l’ampleur des transferts d’activités financières et d’investissements vers le continent européen ? Certaines entreprises pourraient-elles décider de relocaliser leurs activités et leurs investissements aux États-Unis ou en Asie ?
Certaines mesures ont déjà été annoncées, mais comment la France s’organise-t-elle pour accueillir les établissements, les investisseurs et les activités jusqu’ici installés à Londres ? Quels types d’activités et d’investissements souhaitons-nous attirer ? Quelles sont nos forces et nos faiblesses par rapport aux autres places, notamment Francfort, Amsterdam et Dublin ? Quelles mesures sont prises dans ces pays ?
Voilà quelques-unes des questions qui se posent.
M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Merci d’avoir pris l’initiative de cette mission d’information sur un sujet à la fois essentiel, complexe et qui suscite de grandes incertitudes.
Le Brexit reste évidemment une mauvaise nouvelle, et d’abord pour l’économie britannique.
Les conséquences du référendum britannique sont toutefois jusqu’à présent moins sensibles que nous ne l’avions redouté. Pour la zone euro, les prévisions de l’Eurosystème, actualisées au mois de septembre, sont à peine modifiées par rapport à celles du mois de juin : 1,7 % de croissance pour la zone euro en 2016, 1,6 % en 2017 et 2018. Au Royaume-Uni, il y a eu un freinage au troisième trimestre, où la croissance est passée à 0,5 % contre 0,7 % au deuxième trimestre, mais ce freinage a été moindre qu’attendu. Nous ne disposons pas encore des prévisions actualisées pour 2017, qui pourraient marquer une division par deux de la croissance telle qu’elle était prévue avant le Brexit.
Déduire de l’absence de choc dur initial – due en partie à l’action coordonnée des banques centrales – l’absence de tout choc futur lié aux incertitudes économiques pesant notamment sur les investissements serait néanmoins une erreur.
Les négociations – tant leur calendrier que leur contenu – seront donc essentielles. La seule quasi-certitude dont nous disposons, c’est qu’il existe un rapport de un à quatre ou cinq entre l’effet économique du Brexit en zone euro et son effet sur l’économie britannique – ne serait-ce que parce que le Royaume-Uni est menacé de perdre 450 millions de clients, alors que les Vingt-Sept en perdent une soixantaine.
Si le hard Brexit devait l’emporter, trois points appelleraient particulièrement notre attention.
Le premier impératif des Vingt-Sept devra, à mon sens, être l’unité pour l’intégrité : l’unité des Vingt-Sept, en particulier l’unité franco-allemande, pour l’intégrité du marché unique. En matière financière, cela implique de ne pas reculer par rapport à tous les progrès accomplis depuis 2008 en matière de régulation et de supervision financières, ni par rapport aux avancées prévues. Si le Royaume-Uni choisissait de ne plus appliquer celles-ci, la City n’aurait plus de passeport européen et ne pourrait prétendre à un régime d’équivalence.
Ensuite, dans un tel scénario, les accords dits « pays tiers », c’est-à-dire conclus avec des pays extérieurs à l’espace économique européen, deviendraient une référence intéressante, en particulier parce qu’ils comprennent certaines reconnaissances d’équivalences. Toutefois, ces accords constituent aujourd’hui un ensemble très hétérogène, lacunaire, et trop peu piloté par la Commission européenne : suivre ces accords de plus près doit être l’une de nos priorités. Il faut aussi noter qu’aucun de ces accords ne concerne aujourd’hui un partenaire essentiel et proche de l’Union européenne, à l’exception de la Suisse – pour laquelle ces accords sont intégrés à un ensemble beaucoup plus large, qui inclut notamment la libre circulation des travailleurs. Aucun de ces accords « pays tiers » n’a par ailleurs vocation à favoriser des délocalisations hors de l’Union. Enfin, si ces accords sont importants pour l’activité de marché, ils le sont beaucoup moins pour les activités de banque et d’assurance : dans le cas des banques, par exemple, un agrément national demeure nécessaire pour les succursales venant de pays tiers ; celles-ci n’ont pas de passeport européen.
Je voudrais enfin souligner que, si la voie du hard Brexit se confirmait, il serait très complexe de négocier parallèlement la sortie du Royaume-Uni de l’Union, dans le cadre de l’article 50 du traité de l’Union européenne, et les accords commerciaux qui prendront la suite : ce sont deux discussions bien différentes. La tentation de recourir à des mesures transitoires va grandir ; mais celles-ci ne peuvent que très difficilement se concevoir et s’écrire sans connaître la cible finale.
Notre intérêt commun est que tout se déroule bien, et cela peut aider la négociation. Nous devrons veiller à ce que le secteur financier, secteur-clé pour la zone euro, ne subisse pas les répercussions néfastes de négociations dans d’autres secteurs importants et sensibles : l’unité de la négociation est essentielle ; un tronçonnage secteur par secteur serait contraire aux intérêts de l’Union.
J’achève mon propos en insistant sur deux responsabilités cruciales de la Banque de France et de l’Eurosystème.
Il y a tout d’abord la stabilité financière, avec notamment les chambres de compensation et de paiement (CCP) en euros. Le principe est clair : il est difficile d’imaginer que le clearing se fasse hors de la supervision de la zone euro ou du marché unique. Une adaptation juridique, mais aussi pratique, sera donc nécessaire. Il est trop tôt pour en préciser les contours. Quoi qu’il en soit, l’argument parfois entendu selon lequel New York serait la seule alternative à Londres si la compensation devait devenir plus difficile au Royaume-Uni n’est guère robuste.
Il y a ensuite la solidité des institutions financières françaises et des infrastructures de la place de Paris. La concurrence entre places européennes s’effectuera sans doute par segments d’activité. Si l’on brosse à très gros traits le paysage actuel, on peut estimer que Londres est environ dix fois plus gros que Paris en dérivés de taux ou en instruments de change ; si l’on regarde les fonds – monétaires ou non monétaires –, Luxembourg et Dublin se sont beaucoup développés ; quant à Paris et Francfort, leurs positions sont comparables.
L’équipe de France – pouvoirs publics, Paris Europlace… – a jusqu’à présent su jouer collectif. Il importe que nous restions cohérents dans les mois qui viennent ; la taxe sur les transactions financières (TTF) est un sujet particulièrement sensible, sur lequel il serait difficile d’imaginer un comportement isolé de Paris.
Il importe surtout que chacun se prépare à un futur incertain, mais ouvert.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité de supervision et d’agrément que je préside, a mis en place une procédure rapide pour les établissements qui souhaiteraient se réinstaller à Paris, depuis Londres ou depuis une autre place européenne. Le Premier ministre a confié à mon prédécesseur Christian Noyer une mission de contacts individuels avec les principaux établissements internationaux concernés.
Il me paraît également important que les banques et les assureurs de la zone euro commencent à dessiner une stratégie qui s’appliquerait à un hard Brexit.
Dans ce schéma, la zone euro a un atout formidable : sa capacité d’épargne ; l’épargne excédentaire y représente en effet en rythme annuel plus de 350 milliards d’euros. La matière première du secteur financier est donc très largement produite en zone euro. Nous devons donc bien jouer l’échelon régional ; nous devrons ensuite bien jouer l’avantage français au sein de la zone euro, c’est-à-dire la présence d’acteurs importants – banques, compagnies d’assurances, industrie des fonds. C’est ainsi que nous pourrons transformer ce qui demeure une mauvaise nouvelle en opportunité.
Mme Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor. Nous ne considérons pas non plus le Brexit comme une bonne nouvelle, car il risque d’affaiblir le projet européen et d’avoir des effets mécaniques sur les bénéfices que nous tirons du marché unique, par un amoindrissement des échanges à l’intérieur de celui-ci comme avec nos partenaires extérieurs.
Le Royaume-Uni, c’est une évidence, est un acteur essentiel des marchés financiers européens : en matière d’assurance et de réassurance, il détient 22 % des parts de marché de l’Union européenne ; il détient également 26 % des prêts bancaires et 35 % des financements interbancaires au niveau européen. Le Royaume-Uni est le premier marché européen de gestion de portefeuilles en termes de montants investis, et il est absolument prédominant en matière de marchés de dérivés échangés de gré à gré (over the counter ou OTC), avec 99 % du marché. Il réalise 38 % des opérations de Sale and Repurchase Agreement ou pension livrée (REPO).
Le Brexit aura donc nécessairement un effet structurant dans l’organisation des services financiers en Europe. Mais nous n’avons d’autre choix que de tenir compte du vote du peuple britannique : il nous faut donc rechercher la meilleure solution pour la France et l’Union européenne.
La Première ministre britannique a indiqué, vous le savez, que la notification interviendrait d’ici au mois de mars 2017 ; d’ici là, aucune négociation n’est engagée, mais les différents gouvernements mènent leurs réflexions propres, et des discussions à vingt-sept vont commencer d’ici à la fin de l’année.
Parmi les sujets à traiter, il y a d’abord l’accord de retrait du Royaume-Uni, sur le fondement de l’article 50 : il doit intervenir dans un délai de deux ans, sauf si les Vingt-Sept étaient unanimes pour prolonger cette période. Il visera principalement à organiser les modalités du divorce, et abordera donc les questions du budget européen et des dettes du Royaume-Uni vis-à-vis de ce budget, du traitement du personnel britannique au sein des institutions européennes, de la répartition des contingents commerciaux dans les accords passés avec des pays tiers qui en comprennent. Ce sont donc des considérations très pratiques. Les questions sectorielles – le sort, par exemple, de l’Autorité bancaire européenne, dont le siège est actuellement à Londres – devraient occuper une partie très marginale de cet accord.
Il faut également se préoccuper des négociations de l’accord qui organisera les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Le champ des possibles est ici très vaste ; quelle que soit la forme juridique qui sera retenue, les conséquences pour le secteur financier seront importantes. J’y reviendrai.
À plus court terme, nous devons réfléchir à la façon dont nous allons gérer la période qui s’ouvre : comment préserver, pendant ces deux années, la capacité de l’Union européenne à avancer collectivement et à répondre aux défis qui lui sont lancés ?
En particulier, le Royaume-Uni demeure, pendant cette période, membre à part entière de l’Union européenne ; mais il peut se trouver, dans certaines circonstances, en position de conflit d’intérêts, puisqu’il discute de réglementations qu’il n’appliquera pas forcément, ou qu’il appliquera en étant doté d’un autre statut. Les Vingt-Sept doivent donc s’imposer des règles de comportement propres à maintenir leur cohésion, et s’efforcer de défendre les intérêts de l’Union européenne.
Durant cette période transitoire, des questions d’adaptation du droit européen en vigueur peuvent également se poser : seuils, révision des régimes d’équivalence en faveur des pays tiers… La portée de ces réglementations sera en effet largement modifiée si le Royaume-Uni devient un pays tiers : on ne peut pas comparer un petit pays de l’autre côté de l’Atlantique et un grand pays au cœur de l’Europe.
Au niveau national, nous devrons enfin nous pencher sur l’organisation et l’attractivité de la place de Paris, afin de faciliter d’éventuelles réimplantations. Le Gouvernement se mobilise, avec Paris Europlace et les autorités de supervision, pour présenter les atouts français et faciliter l’accueil de nouvelles institutions – ce qui implique des considérations très pragmatiques, sur la présence d’écoles par exemple.
J’en viens aux enjeux d’un hard Brexit pour les acteurs financiers européens. Deux principes du marché intérieur sont aujourd’hui essentiels à l’organisation des marchés financiers.
Le premier, c’est le principe de libre installation : les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les établissements de monnaie électronique et les établissements d’assurance d’un autre pays membre peuvent venir s’installer librement en France ou dans tout autre État membre de l’Union, en ouvrant une succursale. Ainsi, notre pays compte aujourd’hui 75 assureurs, 21 établissements de crédit et 46 entreprises d’investissement britanniques, qui exercent dans notre pays grâce à des succursales.
Le second principe, c’est la liberté de prestation de services : toute entité soumise à agrément peut assurer la prestation de services dans tout autre État membre depuis son pays d’origine sans ouvrir d’établissement dans le pays concerné. Aujourd’hui, 87 entités londoniennes, dont 40 % sont détenues par une maison mère britannique, exercent dans ce cadre des activités bancaires en France depuis la capitale britannique. C’est aussi le cas de 218 assureurs, et un grand nombre d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) opèrent sur cette base. À l’inverse, les quatre grandes banques françaises disposent de 70 autorisations de fournir des services financiers et 340 OPCVM sont commercialisés au Royaume-Uni sur la base de ce principe.
La fin du dispositif de passeport, et la fin des principes de liberté d’établissement comme de prestation de services, auraient donc des effets extrêmement forts.
Elles ne signifient pas pour autant la fin de l’accès au marché européen depuis le Royaume-Uni. Dans le cadre actuel, il est toujours possible – quoique plus contraignant – pour un groupe bancaire ou d’assurances d’un pays tiers de s’installer dans un pays en y créant une filiale. De la même façon, il existe dans certains secteurs un régime national de succursale de pays tiers ; c’est notamment le cas pour les établissements de crédit, qui doivent disposer d’un agrément, et dont la capacité d’agir est limitée aux pays où cet agrément a été accordé. Mais un tel régime n’a jamais été expérimenté pour un pays de l’importance du Royaume-Uni. Enfin, la question du bénéfice des régimes d’équivalence se pose : la législation britannique est aujourd’hui, naturellement, équivalente à celle de l’Union européenne, et certains textes prévoient déjà des régimes d’équivalence, mais surtout dans le domaine des marchés ; ils ne couvrent ni les activités de crédit ni celles d’assurance.
La fin de l’accès au marché intérieur aurait donc pour les Britanniques des effets radicaux. Parallèlement, il est crucial pour l’Union européenne de préserver l’intégrité et la logique de fonctionnement du marché intérieur.
Les autorités britanniques ont d’ores et déjà indiqué vouloir suspendre la liberté de circulation des personnes ; ils souhaitent également se retirer de l’aire de compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). De telles conditions nous paraissent tout à fait incompatibles avec un accès plein et direct au marché intérieur, dont les principes fondamentaux sont les quatre libertés – circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux –, mais aussi un ordre juridique intégré où un droit commun s’applique de façon égale sur tout le territoire, sous la supervision de la CJUE.
Il faudra donc trouver des modalités de coopération. Il nous semble en tout cas essentiel de veiller à éviter tout dumping réglementaire, mais aussi tout dumping en matière de supervision qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la stabilité financière de l’Europe. Dans la perspective des futures relations bilatérales, nous devrons également identifier, secteur par secteur, nos intérêts offensifs et défensifs. Nous travaillons très étroitement avec la place de Paris pour parvenir à une position commune avant l’ouverture effective des négociations.
Dans le cadre de ces discussions, nous aurons à parvenir à un équilibre entre les différents intérêts économiques de notre pays : d’un côté, il faut essayer d’attirer en France de nouvelles activités, mais il faut aussi préserver un bon financement de l’économie, ce qui suppose de réfléchir à certains services offerts aujourd’hui par le Royaume-Uni.
Dans ce contexte, la France et sa place financière disposent d’atouts importants, qu’il faudra mettre en valeur : nous sommes le deuxième acteur du secteur de l’assurance, derrière le Royaume-Uni ; nous disposons de banques de taille internationale ; la place de Paris représente 20 % de la gestion européenne d’actifs. Enfin, la qualité de nos infrastructures est reconnue.
M. Gérard Rameix, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Je prends la parole en tant que président de l’AMF, régulateur de marché chargé de garantir que les infrastructures de marché fonctionnent bien, que les sociétés cotées dont les instruments financiers sont échangés délivrent une bonne information et que la gestion d’actifs, très importante en France, se fait selon les règles et donne satisfaction aux consommateurs. Je m’exprime également comme membre de l’ESMA (European Securities and Markets Authority), l’association européenne des régulateurs.
Si le champ de la régulation est très limité au regard des enjeux du Brexit, qui concernent l’ensemble de l’économie et des services, les conséquences du retrait britannique de l’Union n’y sont pas moins considérables, comme l’ont dit les précédents intervenants.
C’est d’abord le régulateur le plus puissant qui sort de l’Union européenne, donc de l’ESMA : notre homologue britannique emploie quelque 3 300 personnes quand nous n’avons que 475 agents – le même ordre de grandeur que les régulateurs italien et allemand même si ces derniers sont un peu mieux dotés que nous. La position dominante que le gouverneur de la Banque de France et la directrice du Trésor vous ont décrite à propos de l’activité se retrouve évidemment dans les moyens du régulateur.
Un autre chiffre : 55 % de la négociation d’actions européennes a lieu à Londres, soit sur le London Stock Exchange, soit sur des plateformes d’échange qui résultent de la directive MIF 1 (première directive sur les marchés d’instruments financiers) et qui ont toutes été installées au Royaume-Uni. L’effet volume est donc absolument considérable.
Ensuite, à moins d’un accord général, tout l’édifice fondé sur le passeport et sur le libre exercice de l’activité s’écroulera, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’article 50, comme Odile Renaud-Basso vient de l’expliquer. Les effets directs et indirects du Brexit dans ce domaine sont très nombreux et très divers : en voici quelques exemples, faute de temps pour les énoncer tous.
Aujourd’hui, un OPCVM de l’Union européenne, régulé par les directives, ne peut pas investir plus de 30 % dans un OPCVM extérieur à l’Union. Or les Britanniques seront hors de l’Union.
De même, un acteur financier régulé dans le cadre de l’Union européenne ne peut sans encourir de lourdes pénalités prudentielles faire compenser ses opérations par une chambre de compensation qui n’est pas enregistrée dans l’Union européenne. Vu l’importance des CCP britanniques, cela risque de poser un gros problème.
Les prospectus d’opérations financières, les introductions en Bourse, les augmentations de capital, les offres publiques visées dans l’un des Vingt-Sept n’auront plus de valeur au Royaume-Uni, et réciproquement, si aucune solution n’est trouvée.
En outre, les directives et les règlements établis depuis 2008 et 2009 pour tirer toutes les conséquences de la crise des subprimes, et qui composent l’impressionnant édifice que l’on a coutume d’appeler le « paquet Barnier », se réfèrent à des marchés financiers incluant la place de Londres. Les réadapter en moins de deux ans à un univers à vingt-sept et non plus à vingt-huit représente une tâche gigantesque, d’autant qu’il ne s’agit pas d’en retirer un vingt-huitième, mais beaucoup plus, en raison notamment de l’existence de seuils techniques.
Par ailleurs, l’AMF consacre un quart de ses moyens à ses activités dites répressives, c’est-à-dire d’enquête et de contrôle, pour lesquelles nous utilisons massivement des systèmes d’échanges de données qui font l’objet d’une coordination dans le cadre de l’ESMA, ce qui nous permet d’accéder aux données de marché quotidiennes, par exemple aux titres de marché français échangés sur les plateformes britanniques. Si aucune disposition ne l’empêche, nous perdrons cet accès dès lors que l’Union européenne ne comprendra plus le Royaume-Uni : il nous faudra passer par les MMoU (Multilateral Memoranda of Understanding) internationaux, ce qui sera plus long. Il deviendra alors bien plus difficile de réprimer les manipulations de cours, la diffusion de fausses informations, et surtout les abus de marché et les délits d’initiés.
Un travail technique rapide et efficace va donc être nécessaire. À cet égard, les orateurs précédents ont donné quelques pistes.
En réponse à certaines de vos questions, monsieur le président, et si je peux me risquer à exprimer une opinion personnelle, je ne vois pas le Brexit comme un choc systémique pour la zone euro comparable de près ou de loin à ceux que nous avons subis en 2008-2009 ou en 2011. Je n’y vois même pas une véritable menace pour le financement de l’économie. En revanche, si rien n’est fait ou si la situation n’est pas gérée convenablement, le risque est élevé d’une moindre efficacité du système financier européen, donc d’une hausse des coûts tant pour les émetteurs que pour les investisseurs. Mais il est toujours difficile de faire des prévisions.
Dans le champ qui nous occupe, les priorités sont les suivantes.
La première a été évoquée par le gouverneur : il s’agit de clarifier la position du Royaume-Uni jusqu’au Brexit proprement dit. En droit, évidemment, le pays conserve toute sa place au sein de l’ESMA et reste tenu par toutes les règles européennes, dont nos collègues britanniques nous ont d’ailleurs indiqué qu’ils les feraient respecter jusqu’au Brexit. Or la position du Royaume-Uni au sein de l’ESMA lui permet d’y apporter une contribution précieuse – compte tenu de la technicité des matières et de ses moyens et capacités – à la définition des règles, souvent de niveau 2 ou 3, qui sont essentielles pour les marchés, dans le champ de toutes les directives. Ainsi, pendant un peu plus de deux ans – si le calendrier annoncé par Mme May est respecté –, en droit, la FCA (Financial Conduct Authority), notre homologue britannique, va participer à la formulation de règles qui ne vaudront bientôt plus pour elle ou qui s’appliqueront à elle dans des conditions encore inconnues. La situation est donc très ambiguë, et nos collègues britanniques, sans leur prêter d’intentions machiavéliques, pourraient être en conflit d’intérêts sur tel ou tel point, par exemple la position de pays tiers.
Si ce régime de pays tiers est aussi important, c’est parce qu’un scénario de hard Brexit ferait du Royaume-Uni un pays tiers vis-à-vis de l’Union européenne. Dans cette hypothèse, seules les dispositions de chaque directive relatives aux pays tiers nous donnent une idée de ce qui va se passer. Or, cela a été dit, les régimes de pays tiers n’ont absolument pas été conçus pour une telle situation.
D’abord, ils sont hétérogènes, comme l’a dit le gouverneur : il faut chercher dans chacun des sept ou huit textes concernés pour savoir s’il y a ou non un régime de pays tiers. En outre, ils n’ont pas du tout été imaginés pour un acteur de la taille du Royaume-Uni, moins encore pour un pays qui a dès le départ une réglementation équivalente à celle de l’Union – et, ici, elle est identique ! Ils ont par ailleurs un énorme défaut : ces accords d’équivalence, assez flous, conçus dans des conditions très imparfaites, ne prévoient absolument pas de suivi. On considère qu’un pays a une réglementation équivalente à celle de l’Union, ce qui ne veut pas dire qu’elle est identique, mais que, selon une approche outcome-based, elle aboutit globalement au même résultat, à la même sécurité : c’est suffisant lorsque les échanges sont marginaux, mais, avec un acteur dominant, cela comporte des risques considérables – d’autant que, si la réglementation britannique est au départ identique à celle de l’Union, nul ne connaît son évolution future.
Aujourd’hui, la FCA semble privilégier la continuité. N’oublions pas un aspect rarement souligné : l’édifice financier, le « paquet Barnier », bien qu’il porte le nom d’un Français, a été conçu à 95 % avec l’accord des Britanniques qui, concrètement, ont très souvent tenu la plume au sein de l’ESMA. Il n’y a guère que les fameux bonus qu’ils aient critiqués, les jugeant trop sévères, parce que les Américains n’avaient pas le même système. Mais cette situation pourrait ne pas perdurer.
Je partage donc entièrement l’avis de mes collègues : si l’on doit vraiment utiliser le régime de pays tiers, ce qui n’est pas encore certain, alors il serait rationnel de le repenser et de l’harmoniser.
Sans entrer dans le détail de chacune des réglementations de pays tiers, en gros, c’est ici la Commission qui a la main. Elle peut demander dans certains cas son avis à l’ESMA dans le champ des marchés financiers, mais elle n’est pas obligée de le suivre, et elle peut s’adapter. C’est un point sur lequel il faut être très vigilant : il serait éminemment paradoxal que nous vivions un hard Brexit, avec toutes ses conséquences économiques que je juge dommageables pour les deux parties, mais que, dans le secteur financier, l’un des grands atouts de l’économie britannique, l’on maintienne une sorte de statu quo par une interprétation habile des dispositions d’ouverture prévues pour des échanges marginaux.
Enfin, le régime de pays tiers ignore pratiquement la réciprocité. On peut introduire celle-ci si la Commission le souhaite, mais ce n’est pas prévu.
La troisième orientation consiste à mettre à plat la question délicate de la compensation hors Union européenne d’instruments financiers et de contrats libellés en euros. La BCE avait entrepris cette démarche, mais a buté sur des obstacles juridiques ; elle avait voulu imposer l’enregistrement en zone euro des chambres de compensation dont l’exposition de crédit atteignait une certaine taille. L’idée était que l’accès à la liquidité ne pose pas de problème dans des situations difficiles.
La question se repose dès lors que les chambres de compensation, dans l’hypothèse d’un hard Brexit, ne se trouvent plus dans une zone à laquelle s’appliquent les règles européennes. La solution à ce sérieux problème devra s’articuler aux négociations très complexes qui ont eu lieu entre la Commission et la partie américaine, principalement la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), sur la reconnaissance de l’équivalence en Union européenne de l’action des chambres de compensation américaines régulées par la CFTC, homologue de l’AMF dans le secteur des dérivés – lequel est principalement concerné.
Enfin, il faut absolument accroître l’attrait de la place de Paris aux yeux des acteurs, français ou non, qui sont aujourd’hui installés à Londres et qui souhaiteraient s’implanter en zone euro. De notre point de vue, la régulation est un atout pour une place ; on le mesure surtout depuis la crise, à laquelle les pays dotés d’une bonne régulation ont mieux résisté que les autres. Elle doit être efficace, protectrice, tout en restant ouverte à l’innovation. Nous avons donc accru nos efforts dans les domaines suivants.
En matière de gestion d’actifs, en coopération avec l’Association française de la gestion financière (AFG), nous avons lancé le programme FROG (French [Routes & Opportunities] Garden), destiné à aplanir les dernières spécificités qui pouvaient encore affecter l’interprétation des réglementations et rendre le système français difficile à comprendre pour un intervenant de culture anglo-saxonne. Sans toucher à la protection des consommateurs, nous avons par exemple revu les dispositions relatives à la délégation en matière de gestion d’actifs. Lorsque l’on parle de volumes échangés et de parts de marché dans ce domaine, il convient de distinguer la société de gestion et le gérant. Ainsi, les Luxembourgeois détiennent une part de marché très importante du point de vue de la domiciliation des sociétés de gestion, mais, très souvent, les gérants sont ailleurs, à Londres ou à Paris. Nous pouvons donc introduire davantage de souplesse à cet égard, et c’est ce que nous avons essayé de faire.
En partenariat avec la Banque de France et l’ACPR, nous avons créé le forum FinTech pour accompagner les entreprises du secteur, nouvelles ou implantées à l’étranger, en leur apportant une expertise particulière. Au sein de l’AMF, une équipe d’environ vingt-cinq personnes y travaille, en liaison étroite avec les spécialistes équivalents de l’ACPR et de la Banque de France.
Nous avons également lancé un programme spécifique appelé AGILITY pour accueillir les gérants londoniens, auxquels nous proposons de délivrer en deux semaines un avis de pré-autorisation, en nous appuyant sur le travail accompli par notre collègue britannique, pour qu’ils puissent entamer leurs démarches et faire assez rapidement agréer leurs sociétés de gestion chez nous.
Enfin, nous participons avec Europlace et les associations professionnelles à des démarches de communication visant différentes places, en accompagnement de l’action de Christian Noyer.
En conclusion, je reviendrai à l’un des points de départ de l’exposé du gouverneur : l’un des enjeux les plus importants est de sauvegarder l’acquis que représente la régulation. Nous avons construit un marché unique financier et une régulation adaptée ; celle-ci n’est pas parfaite, le travail a été très long, très technique et n’est pas achevé, mais il a été considérable et il faut en préserver les résultats. Nous devons conserver notre dynamique malgré l’absence des Britanniques, la perte de leur contribution technique au sein de l’ESMA et le fait qu’ils puissent, en fonction de la stratégie qu’ils adopteront, modifier légèrement leur positionnement. Cela supposera de la part des régulateurs allemand, italien et français, en compensation, une participation encore plus active aux travaux de l’ESMA.
M. Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace. Beaucoup ayant déjà été dit, je serai bref. J’insisterai d’abord sur l’enjeu que représente le développement d’une place financière forte en France. J’expliquerai ensuite en quoi le Brexit – que nous n’avons pas voulu et auquel nous nous sommes opposés, y compris en achetant des encarts publicitaires dans la presse britannique pour exprimer le point de vue des entreprises françaises en faveur du Bremain –, peut représenter une opportunité historique pour la place de Paris. Enfin, j’évoquerai nos atouts, les conditions à mettre en œuvre et les priorités d’action.
Sur le premier point, je commencerai par rappeler quelques chiffres.
La place financière française apporte chaque année 300 milliards d’euros de financement à l’économie et aux entreprises, y compris aux PME, dont 180 milliards de crédits bancaires, 50 milliards de financement en actions – c’est d’ailleurs encore trop peu – et 10 milliards de capital-investissement, par le biais des fonds d’investissement pour les jeunes entreprises de croissance.
L’industrie financière française, avec l’ensemble de ses composantes, ce sont 1,2 million d’emplois en France, 4,5 % de l’emploi national, 6 % de l’emploi en région Île-de-France ; il s’agit de l’une des grandes industries créatrices d’emploi dans notre pays, même si elle n’a pas encore la surface de la place financière de Londres.
Enfin, le secteur représente un enjeu majeur pour la souveraineté économique française. À l’heure où les investisseurs étrangers représentent 40 à 50 % de la capitalisation en actions de la place de Paris, si nous voulons garder le contrôle de nos centres de décision au cours des années à venir – et l’on sait combien il est menacé –, il est essentiel de développer l’épargne en France et de l’orienter vers l’investissement dans nos entreprises.
La place de Paris est également très mobilisée pour accompagner le développement de l’économie durable et la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons lancé hier un plan d’action dans ce domaine, qui succède aux engagements que nous avions pris lors de la COP21. Gérard Mestrallet et moi-même serons demain à Casablanca pour le deuxième Climate Finance Day international, que Paris Europlace organise en partenariat avec la place financière de Casablanca, pour ouvrir la COP22 et témoigner des engagements que contracte l’industrie financière internationale, à un rythme de plus en plus soutenu.
J’en viens à l’opportunité que le Brexit peut représenter.
Dès l’annonce du référendum, la place de Paris s’est mobilisée, nommant très rapidement Christian Noyer président de la commission Paris Europlace, afin, quelle que soit l’issue du vote, de réfléchir à ses conséquences et aux paramètres à mettre en œuvre, d’une part, et de faire valoir les atouts de la place de Paris, d’autre part.
Nous avons adressé aux pouvoirs publics nos recommandations sur les conditions de la négociation ; je ne reviens pas sur ce point qui a déjà été abordé. Concrètement, les entreprises que nous représentons ont été attentives à trois aspects.
Premièrement, même si le processus de sortie est complexe, personne n’a intérêt à une négociation longue ; nous avons donc insisté dès l’origine sur la nécessité de faire au plus vite, les incertitudes représentant un frein considérable pour les acteurs économiques et pour l’économie française et européenne.
Deuxièmement, en ce qui concerne le contenu de l’accord, il faut être ferme sur les objectifs : la fin du passeport pour les services financiers, compte tenu de la nouvelle situation dans laquelle se trouvera le Royaume-Uni une fois sorti de l’Union européenne ; la reprise du contrôle de la monnaie européenne, enjeu tout aussi important et stratégique à l’heure où 40 % des transactions en euros sont effectuées sur la place de Londres, ce qui était déjà étrange dans la mesure où le Royaume-Uni était en dehors de la zone euro, et devient absurde dès lors qu’il quitte l’Union.
Troisièmement, c’est maintenant que les entreprises internationales, à Londres, à Tokyo, à Pékin et à New York, mènent leurs diligences afin d’analyser les performances comparées des différentes places financières européennes et d’arrêter leur plan B. Il y a encore quelques semaines, nous étions à Londres dans le business as usual : nos interlocuteurs préconisaient d’attendre de voir ce qui allait se passer, estimant qu’il n’était finalement pas certain qu’il arrive quoi que ce soit. Mais, depuis que Mme Theresa May a annoncé que l’article 50 serait activé en mars 2017, toutes les entreprises sont au travail. C’est donc le moment d’agir et de faire valoir nos atouts si nous voulons conserver une place financière en France.
Ces atouts, sur lesquels vous nous avez interrogés, ont été cités ; je n’y reviens pas en détail. Mais ils sont réels, y compris par comparaison avec Francfort. Si, eu égard aux chiffres, les deux places sont à peu près équivalentes, il faut aussi prendre en considération la nature de la place financière. Francfort est une ville de banques ; Paris est une place d’entreprises, de grandes entreprises françaises et internationales qui occupent les premiers rangs mondiaux, bien plus qu’à Francfort et même qu’à Londres. Dès lors, pour les banques, Paris est la place de leurs clients alors que Francfort est celle de leurs concurrents. En outre, ces entreprises sont très actives sur les marchés financiers : leur financement est désormais assuré à 40 % par le marché et à 60 % par les banques, contre respectivement 20 % et 80 % à Francfort.
À ces atouts s’ajoutent la présence d’infrastructures de marché très compétitives, notamment la plateforme Euronext et le pôle de gestion d’actifs, qui représente 20 % de la gestion européenne – le double de l’Allemagne, avec 3 600 milliards d’euros d’actifs gérés, contre 1 300 à Francfort ; une main-d’œuvre hautement qualifiée ; le développement des FinTech, qui s’accélère ; la régulation, déjà mentionnée.
Ce sont autant d’aspects auxquels nos interlocuteurs sont sensibles lorsque nous les leur présentons, comme nous avons commencé à le faire.
En revanche – je m’excuse d’y revenir, mais c’est mon devoir –, notre principal handicap, perçu par tous les acteurs internationaux, est évidemment l’environnement réglementaire et fiscal, le coût du travail, la rigidité des lois sociales et l’instabilité réglementaire permanente qui règne dans notre pays.
J’en parlais ce matin encore avec Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, à l’occasion de l’ouverture du guichet unique, important facteur d’attractivité, par le Premier ministre, accompagné d’Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse – un acte d’union sacrée pour marquer les avancées de la place de Paris. Nous saluons les mesures que le Premier ministre a annoncées au mois de juillet et rappelées ce matin : l’amélioration du régime des cadres impatriés, l’engagement à une baisse progressive de l’impôt sur les sociétés pour revenir à la moyenne européenne, l’ouverture de lycées internationaux, essentielle pour accueillir les familles des cadres qui viendront ou reviendront en France, enfin l’ouverture du guichet unique qui s’est matérialisée aujourd’hui. Ces signaux sont importants et bienvenus pour réduire la portée de notre handicap. Mais, au même moment, l’Assemblée nationale dresse de nouveaux obstacles en adoptant différents amendements.
D’abord, sur l’attribution gratuite d’actions (AGA), vecteur essentiel de l’épargne salariale, notamment dans les PME. Les PME françaises de croissance qui avaient réuni leurs assemblées générales pour présenter à leur personnel un nouveau dispositif de participation proposé par les pouvoirs publics et favorable à la croissance de leur société, et qui ont fait voter les mesures correspondantes, sont aujourd’hui confrontées à l’éventualité de la suppression de ce dispositif, lourde de conséquences pour la motivation des salariés et l’organisation de l’entreprise.
Viennent ensuite le relèvement de 50 % du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF), adopté sans même attendre l’issue des discussions européennes sur le sujet, et l’instauration d’une taxe sur les opérations intraday. Celles-ci n’ont pourtant rien à voir avec le trading à haute fréquence, que nous avons déjà supprimé de la place de Paris pour exaucer votre souhait de réduire la part de la finance spéculative de court terme : ce sont des opérations d’achat et de vente journalières sans lesquelles un marché ne peut exister et qui en constituent la condition de liquidité.
Le vote de ces amendements constitue un signal totalement contre-productif qui risque de réduire à néant l’action collective que nous sommes en train de mener avec les pouvoirs publics et la ville de Paris. Ils nous sont déjà opposés par nos interlocuteurs, nos concurrents immédiats que sont Francfort, Amsterdam, Luxembourg et Dublin les mettent en avant.
Il nous paraît donc essentiel que lors des prochaines étapes du débat sur le projet de loi de finances, vous vous mobilisiez pour rejeter les amendements en question et que la réforme des cadres impatriés soit confirmée. À défaut, ce retour sur les annonces faites par les pouvoirs publics donnera le pire signal possible de la part de la France.
Pour l’étape suivante, nous allons remettre, dans le cadre de la campagne présidentielle, un livre blanc sur les quatre réformes qui nous paraissent indispensables en matière d’attractivité.
Premièrement, il faut aller au-delà de la trajectoire actuelle de baisse de l’impôt sur les sociétés pour rejoindre effectivement la moyenne européenne ; le taux de 28 % visé en 2020 est encore supérieur de cinq points. Deuxièmement, il faut éteindre progressivement la taxe sur les salaires, qui est une taxe sur l’emploi. Troisièmement, il convient de remettre la fiscalité de l’épargne à l’endroit pour privilégier l’épargne de long terme, qui accompagne le financement des entreprises et de l’économie. Enfin, une fois ces réformes accomplies, il faudra faire de la stabilité et de la lisibilité de la norme fiscale réglementaire un principe cardinal pour notre pays. Je crois savoir qu’Anne Hidalgo a annoncé ce matin son souhait à cet égard, ainsi que son vœu de voir la mesure sur les cadres impatriés maintenue, et même élargie.
Je profite enfin de la présence de François Villeroy de Galhau et d’Élisabeth Guigou pour affirmer nos autres priorités, qui concernent l’accélération de la construction européenne avec les pays motivés autour de ce projet. Nous avons deux priorités immédiates : l’accélération de la mise en place du plan Juncker pour le financement des investissements d’infrastructures et de projets en Europe – la place de Paris contribue à remettre des projets – et surtout l’accélération de la capital market union, ou union de financement et d’investissement en Europe, qui est la condition pour la compétitivité de l’Europe dans le monde de demain.
M. le président Claude Bartolone. Merci pour cette intervention, d’analyse autant que de lobbying. La parole est à Mme Élisabeth Guigou.
Mme Élisabeth Guigou. Il y a une chose réconfortante dans vos propos : si le Brexit est une mauvaise nouvelle, c’est surtout une mauvaise nouvelle pour les Britanniques. Ils sont les responsables de cette décision, que nous regrettons profondément, et il ne tient qu’à nous que les conséquences n’en soient pas trop dommageables, nous pouvons même en faire une opportunité. C’est un élément à considérer dans notre attitude à l’égard de l’Union européenne.
À entendre les analyses développées par le gouverneur de la Banque de France et la directrice du Trésor, l’essentiel va dépendre de la façon dont nous abordons la négociation. Rien n’est plus dommageable que l’incertitude, pour l’économie, pour le secteur financier, mais aussi pour l’ensemble des vingt-sept pays de l’Union européenne. Malgré les positions très nettes de la Première ministre britannique sur la date et la façon dont les Britanniques vont entrer dans la négociation, tout reste soumis à de nombreuses incertitudes.
Ceux au Royaume-Uni qui souhaitaient rester dans l’Union espèrent un revirement, et nous ne savons pas comment les choses peuvent évoluer au sein du gouvernement britannique et du Parlement. La grande majorité du Parlement était opposée au Brexit, et c’est bien à lui qu’il reviendra d’approuver l’accord de divorce – si toutefois il se conclut avant mars 2019, ce qui est évidemment très souhaitable puisque les élections européennes auront lieu deux mois plus tard.
Donc, malgré toute l’amitié et la compassion que nous pouvons avoir pour nos amis britanniques qui souhaitaient rester dans l’Union européenne, je pense qu’il faut que nous entrions dans cette négociation avec beaucoup de fermeté. Cela évitera les pollutions nées des conséquences indirectes de négociations d’accords avec des pays tiers.
Les discussions sur les conditions du divorce doivent être limitées aux quelques points que Mme Renaud-Basso a évoqués, sans nous perdre dans toute sorte de sujets variés. Une fois entrés dans ces discussions, il y a un vrai risque que les Britanniques prennent conscience de l’absurdité folle de cette décision et modifient leur position. On ne peut pas se laisser ballotter ; peut-être qu’un jour, le Royaume-Uni, constatant les effets négatifs du Brexit pour lui-même, choisira de revenir. Mais tout dépend de l’attitude que nous adopterons, et de notre capacité à rester unis, sur le plan politique et sur le plan technique.
J’ai une question fondamentale : de votre point de vue, comment pouvons-nous le mieux défendre les intérêts de la France, défensifs et offensifs, et amener les autres Européens à nous rejoindre ? Quelles concessions devrons-nous faire à l’unité des Vingt-Sept ?
J’ai la conviction que nous ne sortirons convenablement de cette situation qu’en entrant dans les négociations de façon très ferme, sans commencer à intérioriser la dislocation du marché unique, comme certains l’ont fait dans des articles que je continue à ne pas comprendre. Par ailleurs, nous devons avoir le souci de défendre nos intérêts franco-français, mais aussi d’être ouverts aux intérêts des vingt-six autres États, et ce ne sera pas la chose la plus facile à faire.
C’est à l’initiative d’une majorité de parlementaires de la commission des affaires étrangères – que j’ai l’honneur de présider – que les amendements sur la taxe sur les transactions financières ont été adoptés. Mon opinion est qu’il faut revenir sur l’intraday, qui défavorise trop les intérêts français. Quant au niveau de la taxe sur les transactions financières, c’est un enjeu de financement de l’aide au développement. Peut-être peut-on trouver une autre solution, mais je ne suis pas sûre de me faire la porte-parole de la majorité de la commission des affaires étrangères en le disant. C’est une question importante, nous devons tenir compte d’intérêts beaucoup plus généraux : aider des pays qui nous sont proches et défendre des intérêts de sécurité et de maîtrise de l’immigration.
M. Pierre Lellouche. Je ne vais pas me livrer à un exercice de guérilla avec Mme Guigou, coutumier au sein de notre commission. Autant je suis convaincu que nous avons un problème de ciblage de l’aide au développement, autant la façon de faire n’est pas la bonne.
Deux aspects ressortent de vos interventions ce matin.
Tout d’abord, il y a un problème d’équipe de France en ce qui concerne la place de Paris. En tant qu’élu parisien, je pense que nous pouvons gagner à condition d’être cohérents. On ne peut pas tenir un discours très incitatif pour attirer vers Paris, tout en décidant de mesures fiscales allant dans l’autre sens au gré de nos débats internes à l’Assemblée nationale. J’en appelle à la raison, et j’espère qu’au cours de l’examen budgétaire, nous pourrons compenser les erreurs qui ont été commises par certains, en cohérence avec les vœux de la maire de Paris, la présidente de région, le Premier ministre. Nous voulons tous la même chose, mais nous sommes très gaulois, et très incohérents.
Le volet européen est au moins aussi important pour la façon de gérer les opérations. Je suis très inquiet du précédent suisse, un pays en Europe qui sait parfaitement jouer avec les institutions européennes, et qui a multiplié toutes sortes d’accords. Quand j’étais secrétaire d’État chargé des affaires européennes, j’ai été épaté par la capacité de ce petit pays à se jouer des règles européennes et à faire du cherry picking, pays par pays, en fonction de ses intérêts. Ils sont donc les mieux lotis, puisqu’ils ont tous les avantages sans les inconvénients. Les Britanniques sont des négociateurs roués et parfaitement capables d’exploiter toutes les divisions internes. Ils le font déjà au sein de l’OTAN et dans beaucoup d’autres domaines.
Je suis donc complètement d’accord avec Élisabeth Guigou sur ce point : tout va dépendre de la façon dont nous abordons cette négociation. Maintenant que nous avons une date, la pire des choses serait d’entrer dans la négociation sur les conditions de sortie du Royaume-Uni avec les Britanniques au sein des institutions.
Comment négocier la sortie de quelqu’un qui est à la table des négociations, et qui va continuer à produire les règles de droit pendant la période intérimaire ? Surtout que c’est la Commission européenne qui va négocier, sur laquelle nous n’avons aucun contrôle – voyez l’exemple des négociations commerciales. Si nous restons dans ce schéma, et faute d’une volonté politique très forte de la France, de l’Allemagne, et de quelques autres pour refuser de jouer ce jeu, nous sommes fous.
Il s’agit d’une décision souveraine du peuple britannique de sortir de l’Union. Nous avons une date. Il ne faut pas que le juridisme de l’article 50 nous amène à négocier les conditions du divorce avec l’autre partie autour de la table. Même en droit de la famille, cela ne se fait pas, sauf en cas de consentement mutuel, si tout est acté à l’avance devant le notaire. Là, nous allons discuter de la séparation alors que les négociateurs britanniques vont jouer de toutes les tensions internes au sein des Vingt-Sept ; pensez à la Pologne, à l’Allemagne, c’est infini ! Si nous procédons ainsi, nous sommes cuits, dans le domaine financier mais aussi s’agissant du commerce, des droits sociaux, de la libre circulation. Et au final, le risque est qu’ils ne s’en sortent pas si mal que cela. Même si théoriquement, ils perdent l’accès au marché, il ne faut pas sous-estimer la capacité d’adaptation du système britannique.
Tout cela n’est pas entre vos mains, ce sont des décisions politiques qui se prennent au plus haut niveau, et je souhaite qu’à l’occasion de l’élection présidentielle, les candidats de droite comme de gauche le disent. On ne peut entrer dans cette négociation dans les conditions actuelles, c’est de la folie.
J’en viens à l’utilisation de l’euro. Dans le cadre d’un rapport rédigé avec Karine Berger sur l’extraterritorialité des lois américaines, nous avons étudié l’histoire de l’euro et du dollar. À notre totale consternation, nous nous sommes aperçus que ces dix ou quinze dernières années, la part de l’euro dans les échanges mondiaux avait diminué. Sachant que la moitié des transactions se font à Londres – alors que Londres n’est pas dans l’euro – et que la part de l’euro baisse, ma question aux techniciens que vous êtes est la suivante : comment profiter de la sortie de l’Angleterre pour redonner à l’euro un rôle de monnaie d’échange ? Si l’euro ne joue pas ce rôle de monnaie d’échange, nous allons continuer à subir les normes édictées par les Américains – et demain par les Chinois – et nous serons totalement marginalisés.
Voilà les trois questions que je me pose. Celle de l’équipe de France est une question de bon sens, mais je perds parfois espoir. La deuxième question est très difficile, et si nous laissons les choses filer, les Anglais vont profiter de ce délai de deux ans pour nous éplucher et profiter des divisions internes. La troisième est celle de notre stratégie pour que l’euro devienne une monnaie de réserve, ce qui était son objectif initial.
M. Gilles Savary. Je remercie les intervenants pour les propos extrêmement clairs qu’ils ont tenus sur un sujet très compliqué.
J’aimerais connaître l’état d’esprit de leurs collègues européens. Quand nous sommes seuls au monde, il est facile de donner des coups de menton, mais c’est toujours plus compliqué dans les cénacles européens. Nous avons tendance à considérer ici que la voix de la France est universelle et s’impose d’emblée, mais ce n’est pas toujours évident, je pense que vous le mesurez, les uns comme les autres.
Vous nous avez parlé du Brexit hard, mais pas du Brexit « mou ». Il pourrait être dans les esprits, car perdre la place de Londres peut entraîner des conséquences considérables pour l’Europe, en particulier si la redistribution des dépouilles ne se fait pas à l’intérieur de l’Union, mais dans d’autres places, asiatiques ou américaines. Nous considérons que c’est un jeu à somme nulle ; que ce que Londres perd, Paris ou Francfort le récupéreront. La question se pose-t-elle bien en ces termes, ne courrons-nous pas le risque de perdre un atout considérable dans un univers très mondialisé ?
Par conséquent, de façon sous-jacente, au-delà de la fermeté martiale que nous réclamons tous, existe-t-il des stratégies qui pourraient déboucher sur un Brexit « mou » dans le domaine financier, un Brexit sélectif, avec des accords d’équivalence ad hoc ? Les rapports de force, très différents des rapports de force habituels, pourraient-ils nous amener à un quasi statu quo ?
Quel est votre sentiment sur l’état d’esprit de nos grands partenaires : Allemagne, Luxembourg ? Quelle est la tentation dominante ? Est-ce de casser Londres le plus rapidement possible, et de rentrer dans une compétition européenne impitoyable qui pourrait se traduire par un arbitrage en faveur de Singapour, Hong Kong ou New York, ou par la victoire de Londres ? Ou bien l’hypothèse d’un Brexit « mou » dans le domaine financier est-elle présente dans les esprits ?
M. Pierre Lequiller. Ma première question concerne le passeport financier européen. Le principe de la suppression du passeport financier à Londres est-il acquis ? Et dans ce cas, quand ? Il est important que les choses se fassent rapidement pour éviter les périodes d’incertitude. Cette suppression du passeport européen se fera-t-elle dans toutes les hypothèses, en cas de Brexit « mou » comme de Brexit « hard » ? Je considère que c’est une condition sine qua non.
J’ai bien noté vos souhaits concernant la taxe sur les transactions financières, la baisse de la fiscalité et la réforme du droit du travail, j’y souscris pleinement. Compte tenu de ces éléments, positifs et négatifs, sur la place de Paris, j’aimerais savoir ce qui se passe pour les banques et les compagnies d’assurance, françaises ou étrangères, actuellement installées à Londres. Des intentions se sont-elles manifestées depuis l’annonce ?
Enfin, je rejoins Mme Guigou et M. Lellouche, il faut vraiment de la fermeté, car rien ne serait pire que le statu quo, qui donnerait une image catastrophique de l’Europe. Cela voudrait dire qu’il est possible de faire n’importe quoi, et qu’il n’y a pas de solidarité européenne. De cette fermeté dépend l’avenir de la zone euro, et la meilleure réponse au Brexit est son renforcement : la nomination d’un président de la zone euro et l’instauration de politiques nouvelles. Ce Brexit offre l’opportunité d’une réponse de la zone euro : il a beaucoup été question des Vingt-Sept, mais pas des Dix-Neuf.
M. le président Claude Bartolone. Nous vivons les événements en direct : j’apprends à l’instant que la Haute Cour de justice de Londres estime que le Parlement a son mot à dire. Elle a jugé dans un arrêt rendu ce jeudi que le Parlement britannique doit voter sur le lancement du Brexit. Le Gouvernement britannique a immédiatement annoncé son intention de faire appel, cet appel sera examiné entre le 5 et le 8 décembre prochains.
M. Éric Elkouby. Même si Londres ne fait pas partie de la zone euro, pour protéger le secteur financier européen, ne faut-il pas aller encore plus avant dans l’idée d’instituer un gouvernement de la zone euro, avancée par le chef de l’État en 2015 ? Ce pourrait être un paratonnerre et un initiateur, dans le cadre du Brexit mais aussi dans l’éventualité du départ d’autres pays. Il est important que le secteur financier européen trouve une certaine stabilité, ou en tout cas un apaisement.
M. Joël Giraud. Permettez-moi de revenir sur l’opération séduction menée, sous l’égide de Paris Europlace, par l’industrie financière française, le Gouvernement, la région Île-de-France, la ville de Paris et la métropole du Grand Paris, dans le but d’attirer les grands PDG de banques qui souhaitent délocaliser leurs activités.
Nous venons de voter de manière consensuelle la modification de la durée des avantages fiscaux des impatriés, et sous la forme d’une exonération de taxe pour les employeurs avec un effet rétroactif au 6 juillet. Ce dispositif a un double avantage, il n’a pas d’équivalent en Allemagne, et le Royaume-Uni est en train de revoir à la baisse les avantages de son propre système fiscal.
Associé à la baisse programmée de l’impôt sur les sociétés en France, qui vient également d’être votée dans un certain consensus, cette opération séduction me semble avoir de quoi convaincre. D’autant que le régulateur français jouit d’une bonne réputation, vous l’avez tous rappelé, et que nos compétences en matière financière sont assez renommées.
J’entends bien, Monsieur de Bresson, que vous puissiez vous offusquer que le Parlement vote à son initiative des mesures de rendement. Je rappelle que si la mini taxe sur les transactions financières de la place de Paris a été augmentée à 0,3 %, celle qui est en vigueur à la City demeure de 0,5 %.
Quant à l’élargissement de l’assiette aux transactions intraday de la TTF locale, il n’a pas dû faire peur à grand monde dans la mesure où le ministre de l’économie et des finances a précisé que cette mesure ne serait pas opérationnelle, et qu’elle n’aurait donc pas d’effet en 2017.
Je me demande si le Brexit n’offre pas une occasion d’assainir les pratiques des marchés, le Royaume-Uni ne pouvant aller porter plainte contre la procédure de coopération renforcée européenne, pour mettre en œuvre une TTF digne de ce nom, pourquoi pas sous la houlette de la France. Elle permettrait de dégager des montants honnêtes au service du développement de pays en difficulté, dans un contexte de terrorisme international que nous subissons et qui me semble plus déstabilisant que la légère augmentation du taux de la TTF.
Compte tenu de ces enjeux qui dépassent l’économie et les finances – ce sont des enjeux de civilisation – j’aimerais connaître vos positions sur les possibilités de réforme financière offertes par le Brexit.
M. le président Claude Bartolone. Permettez-moi quelques remarques supplémentaires. Quel est votre avis sur l’affirmation du Chancelier de l’Échiquier britannique selon laquelle il n’est pas réaliste de croire que les chambres de compensation quitteront Londres, au risque de perdre les bénéfices qu’elles recueillent en termes d’économies d’échelle du fait de la concentration des infrastructures de marché et des acteurs financiers ?
Entre les différents qualificatifs de Brexit « dur » ou de Brexit « mou », nous voyons apparaître l’hypothèse que le Royaume-Uni joue la carte d’un dumping réglementaire et fiscal. Quel est votre avis ?
Monsieur de Bresson, je fais partie de ces élus de la région Île-de-France qui sont quelquefois très surpris de voir que nous sommes capables de nous mobiliser pour arracher l’implantation d’Euro Disney, mais que nous n’avons pas la même réponse collective pour attirer les cadres britanniques. Il s’agit tout de même de 300 000 cadres, soit l’équivalent de la ville de Bordeaux. Quoi que l’on pense des besoins de régulation de la finance internationale, on ne peut pas passer à côté de cela. Nous savons que nos débats ont parfois des répercussions qui dépassent la réalité des faits. Je me souviens du débat sur l’imposition à 75 % : un certain nombre de décideurs à l’étranger nous ont jugés en allant bien au-delà de la réalité de cette mesure.
M. Pierre Lellouche. « Mon ennemi, c’est la finance ! »
M. le président Claude Bartolone. Déréguler, pourquoi pas ? Mais la régulation est nécessaire au sein de la zone euro, pour ne plus être dans la situation que nous connaissons. Je regarde de très près un certain nombre de mesures arrêtées aujourd’hui par le Portugal, qui essaie de développer son attractivité, pas uniquement pour les capitaux financiers, mais aussi pour les retraités aux revenus moyens.
Il y a besoin de régulation, mais la France ne peut pas y répondre toute seule. On ne peut pas être en situation d’inégalité par rapport à d’autres pays qui vont se faire concurrence pour obtenir un certain nombre de réinstallations de banques ou d’assurances.
Ils ont voulu dérouler le tapis rouge, il me paraît indispensable d’avoir la capacité de dérouler le tapis bleu-blanc-rouge. Il faut une cohérence entre les annonces faites par le Premier ministre et l’Assemblée nationale. On ne peut pas prétendre que cette question sera sans conséquences sur l’activité de nos PME. La présence de centres de décisions financiers et d’entreprises, y compris d’entreprises en démarrage, est extrêmement importante, et il faudra y être attentif.
M. François Villeroy de Galhau. Je vais me concentrer sur trois questions : notre position dans la négociation, le renforcement de l’euro et de la zone euro, et celle du passeport européen selon les scénarios de Brexit « dur » ou « mou » – je ne sais d’ailleurs pas s’il convient de traduire soft Brexit par « Brexit mou » ou « Brexit doux » !
S’agissant de notre position dans la négociation, je voudrais préciser la formule que j’ai employée dans mon propos liminaire : la clé, c’est l’unité pour l’intégrité. Chacun de ces termes emporte deux conséquences.
Deux intégrités sont absolument essentielles dans la négociation. Tout d’abord, l’intégrité du marché unique financier lui-même. Sur ce point, les vingt-sept membres de l’Union européenne ont une position forte, et je pense que c’est l’élément essentiel en réponse à M. Giraud : nous avons construit un marché unique fortement régulé. Nous pouvons encore le renforcer, mais il est hors de question de reculer sur ce point. C’est la première intégrité.
La deuxième intégrité, c’est celle du marché unique entre les différents secteurs. Nous parlons aujourd’hui des services financiers, mais il y a aussi l’agriculture, l’industrie et les services. Cette deuxième intégrité est extrêmement importante. Il ne faudra pas accorder de concessions secteur par secteur ; il est probable que les négociateurs britanniques soient tentés de saucissonner le sujet, mais il sera au contraire très important de maintenir cette deuxième intégrité et l’équilibre d’ensemble du marché unique.
Sur l’unité, M. Savary soulevait la question de l’unité européenne, qui est la première des deux unités. À ce stade, tel que je sens les choses autour de la table du Conseil des gouverneurs, je crois qu’elle est forte. Bien sûr, elle devra résister au déroulement des négociations, mais il y a un intérêt économique, presque patrimonial, à préserver la valeur du marché unique que nous avons construit ensemble. Il y a aussi un intérêt politique à ce que les règles du jeu soient respectées.
La deuxième unité, c’est celle de l’équipe de France. Je ne reviendrai pas sur la TTF, je comprends le débat au sein du Parlement, qui est évidemment souverain en la matière. Le seul point que nous pouvons souligner est qu’aux yeux des observateurs étrangers, plus encore que le niveau des normes fiscales ou réglementaires, c’est leur instabilité qui peut nous pénaliser. Nous devons veiller à une certaine stabilité de nos règles.
Dans l’unité de l’équipe de France, j’ai insisté sur l’engagement de l’industrie financière. Beaucoup d’établissements attendent de voir comment les règles du jeu vont évoluer, mais je crois important qu’ils se préparent à une stratégie alternative en cas de Brexit « dur », comme Mme May semble en donner le signal.
Comme le préconise le rapport de M. Lellouche et de Mme Berger, je souhaite que la part de l’euro se renforce. Après sa naissance, l’euro comme actif international a connu une montée rapide – et positive – avant d’atteindre un palier, puis de redescendre en pente douce au cours de la dernière décennie, non seulement en raison de la crise de la zone euro mais aussi de la montée des devises émergentes, et parce que l’incertitude profite toujours au dollar.
Si nous voulons relancer la consolidation de la zone euro, nous devons en premier lieu poser la question de la localisation des chambres de compensation. Le Chancelier de l’Échiquier britannique estime qu’elles ne pourraient pas déménager ; qui, à sa place, dirait autre chose ? Cela étant, compte tenu des pouvoirs de supervision et de régulation dont nous disposons sur les établissements financiers de la zone euro, nous avons les moyens d’orienter fortement les transactions vers des chambres de compensation qui présentent toutes les garanties nécessaires de sécurité – car, au fond, l’enjeu est bien celui de la stabilité financière. Le fait que les transactions soient compensées via un organisme qui échappe totalement à notre supervision présenterait à l’évidence un risque accru dont il faudrait tirer les conséquences prudentielles. Des adaptations juridiques seront naturellement nécessaires, mais nul ne saurait prétendre que cette question, venant de la zone euro, est illégitime.
Quant à l’idée selon laquelle nous risquerions ainsi de susciter le transfert de la compensation de Londres à New York ou Singapour, elle ne me semble guère robuste : la question prudentielle se poserait exactement dans les mêmes termes, puisque la compensation échapperait également à notre supervision, et nous en tirerions les mêmes conséquences s’agissant du ratio de capital appliqué aux établissements.
Le renforcement de la zone euro doit aller au-delà. M. Elkouby a tracé plusieurs pistes en ce sens ; j’ai, quant à moi, eu l’occasion, avec plusieurs de mes homologues de la zone euro, en particulier Jens Weidmann, président de la Bundesbank, de formuler des propositions dans le champ de l’union économique. Souvenons-nous des débats sur le traité de Maastricht : il s’agissait de fonder une union économique et monétaire. Nous avons fait l’union monétaire, qui est un succès ; nous ne sommes qu’en chemin – c’est un euphémisme – vers l’union économique. Or, il est indispensable d’avancer en ce sens, y compris pour la croissance économique et l’emploi dans la zone euro. La politique monétaire est très active et le restera autant qu’il le faut, mais elle ne peut pas tout faire.
Le renforcement de l’union économique passe par deux étapes. La première consiste à élargir et renforcer l’union des marchés de capitaux – je préfère parler d’union de financement et d’investissement. Cet objectif déjà en vue inclut le plan Juncker sur l’investissement public et des mesures relatives à l’union bancaire. La zone euro dispose d’un formidable atout : son excédent d’épargne sur l’investissement, qui s’élève à 350 milliards d’euros par an. Mobilisons davantage cette épargne au profit des infrastructures publiques, de l’investissement productif et des fonds propres des entreprises européennes. Voilà en quoi consiste l’union de financement et d’investissement.
La deuxième étape pourrait nécessiter une modification des traités : elle consiste en effet à renforcer les institutions de l’union économique – en nommant par exemple un ministre des finances de la zone euro qui serait chargé non pas de décider d’un impôt européen – qui viendra plus tard – mais d’animer une stratégie collective visant à mettre en cohérence les politiques nationales de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et de tous les autres pays de la zone euro pour stimuler la croissance et l’emploi. Précisons que la zone euro en tant que telle – y compris ses banques et sa politique monétaire – n’est ni menacée, ni même affectée par le Brexit, même si celui-ci l’invite à se renforcer.
Un dernier mot sur la question du passeport européen et le débat sur un Brexit « dur » ou « doux ». De deux choses l’une : soit le Royaume-Uni entend demeurer au cœur du marché unique en appliquant toutes ses règles – y compris la liberté de circulation des travailleurs – et, quoique sorti de l’Union, reste membre de l’Espace économique européen, en vertu d’un accord semblable à celui qui s’applique à la Norvège. Il ne semble pas que cette voie soit choisie. Deuxième option : le Brexit « dur » – ces adjectifs ne venant pas de nous, mais d’outre-Manche – et, en conséquence, l’abandon du passeport européen. Dans ce cas, l’accord de séparation engloberait le marché unique et ouvrirait la voie à un régime de pays tiers, ce qui n’empêchera pas de continuer à appliquer certaines règles, moyennant des contreparties.
Dans cette hypothèse, le risque de dumping réglementaire sera limité par le fait que le Royaume-Uni n’aura plus accès au marché unique, les règles qu’il édictera ne s’appliquant que sur son propre marché, beaucoup plus limité.
Mme Odile Renaud-Basso. Depuis le référendum britannique et les déclarations subséquentes de Mme May, je suis frappée par l’unité et la solidité des positions des Vingt-Sept, qui doivent désormais gérer les conséquences sur les intérêts de l’Union d’une décision qu’ils n’ont pas prise. Sans doute la négociation fera-t-elle apparaître des divergences sur les intérêts financiers ou sectoriels de tel ou tel État mais, à ce stade, l’unité est forte : chacun s’est engagé d’une part à ne pas entamer de discussions bilatérales avant l’activation de l’article 50, ce qui inscrit la négociation dans un cadre assez strict, et d’autre part à préserver l’intégrité du marché intérieur en refusant toute approche à la carte, ou pick and choose. La liberté de circulation des personnes, par exemple, constitue un enjeu majeur pour certains pays de l’Est, qui n’accepteront sans doute pas qu’elle soit abandonnée si la liberté de circulation des capitaux, elle, est maintenue. De même, les Vingt-Sept s’accordent sur l’importance de préserver l’intégrité de l’ordre juridique européen et du rôle de ses institutions, par exemple la Cour de justice. Si aucune décision formelle n’est encore prise concernant le passeport financier, la cohérence des positions européennes est très forte même si, encore une fois, des arbitrages seront nécessaires entre pays – et à l’intérieur de chacun d’entre eux – au fil de la négociation.
J’en viens à la période intermédiaire : l’exclusion ex ante, en quelque sorte, étant juridiquement impossible, le Royaume-Uni demeurera membre de l’Union jusqu’à sa sortie, avec les droits – participation aux débats – et les devoirs – paiement de la contribution budgétaire – que cela lui confère. En revanche, les Vingt-Sept pourraient adopter un code de conduite régissant leurs relations avec le Royaume-Uni au cours de cette période. Admettons par exemple que le représentant britannique adopte dans un débat sur le régime des pays tiers une position qui, à l’évidence, sert à anticiper la situation future de son pays : les Vingt-Sept devraient alors veiller à ce que la décision prise in fine ne soit pas influencée par ce point de vue, qui procède d’un conflit d’intérêts.
M. Pierre Lellouche. Vous excluez donc toute espèce de modification du mécanisme de sortie de l’Union qui, certes, figure dans les traités mais qui n’a jamais été conçu dans l’hypothèse qu’il aurait à être appliqué ? Il est impensable de préparer une séparation pendant deux ans en laissant l’intéressé s’asseoir à table comme si de rien n’était ! Il me semble essentiel que les Vingt-Sept déterminent entre eux si c’est cette voie qu’ils souhaitent suivre ; dans ce cas, nous n’arriverons à rien. De surcroît, nous serons pris en otage par les convulsions politiques et judiciaires qui se produiront au Royaume-Uni et le processus finira par traîner en longueur – ce qui est dans l’intérêt des Britanniques, mais qui nous mettra en difficulté.
Mme Odile Renaud-Basso. Il va de soi que le Royaume-Uni ne participera à aucune des discussions des Vingt-Sept portant sur le divorce et les relations futures. En revanche, il continuera, en tant que membre de l’Union, de prendre part à la gestion de ses affaires courantes, en quelque sorte, et c’est dans ce domaine qu’il faudra définir un code de conduite. Précisons un point particulier : la compétence commerciale est communautaire, or le Royaume-Uni a annoncé qu’il entamerait des négociations commerciales avec des pays tiers – les États-Unis et le Canada, par exemple – pour son propre compte. La Commission a clairement identifié le problème juridique qui en résulte, le Royaume-Uni ne pouvant évidemment pas participer tout à la fois aux négociations qu’il conduit à titre bilatéral et aux négociations commerciales de l’Europe.
Entre Brexit « dur » et Brexit « mou », le premier est le plus vraisemblable : les lignes rouges fixées par les Britanniques ne leur permettront pas de demeurer dans le marché intérieur. La marge de négociation reste considérable, cependant : puisque le modèle de l’Espace économique européen n’est pas envisageable pour les Britanniques, c’est sans doute celui de l’accord de libre-échange qui s’imposera. La négociation sur les relations futures avec le Royaume-Uni, devenu pays tiers, portera donc sur chaque secteur, sachant qu’il existera des possibilités de reconnaissance mutuelle, même s’il faudra les encadrer. Pour nous, la priorité est d’éviter qu’un acteur économique non membre de l’Union – et beaucoup plus puissant que la Suisse, en l’occurrence – puisse accéder facilement à nos marchés sans que ses entreprises, financières ou non, soient soumises aux mêmes règles que les entreprises européennes. Pour se prémunir contre l’émergence d’un tel centre offshore – qui, de surcroît, poserait un réel problème de souveraineté –, il est indispensable de préserver nos acquis juridiques.
Il faut poursuivre l’intégration économique de la zone euro, une nécessité que le Brexit n’atténue aucunement, même s’il change quelque peu la donne en termes politiques, car la priorité consiste désormais à préserver l’unité des Vingt-Sept plutôt qu’à soulever des sujets qui pourraient susciter la division entre les membres de la zone euro et les autres pays de l’Union. Quoi qu’il en soit, la volonté de renforcer l’union économique autour de la zone euro est partagée, et la Commission européenne présentera prochainement des propositions en la matière.
S’agissant des intentions des banques et du secteur financier, les décisions devraient être prises rapidement : les acteurs économiques n’attendront pas de connaître précisément la nature des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni dans la mesure où il est déjà clair que le passeport et l’accès direct au marché intérieur seront remis en cause.
D’autre part, la perception de la place de Paris évolue : les perspectives qu’elle offre en vue d’éventuelles relocalisations suscitent un intérêt réel. À ce stade, la stratégie des établissements consiste plutôt à diversifier l’implantation de leurs activités en tirant parti des avantages comparatifs de chacune des places financières de l’Union en fonction de leurs intérêts. De ce point de vue, les décisions annoncées, qui sont perçues comme un signal très favorable d’ouverture et d’attractivité de la place de Paris, illustrent la forte cohérence de la stratégie globale de la France.
M. Gérard Rameix. Telle une poupée russe, le Brexit invite à penser en cascade des problèmes imbriqués les uns dans les autres, mais il est difficile de prévoir dans quel ordre ils se présenteront. Le passeport financier, par exemple, disparaîtra le jour de la sortie du Royaume-Uni, c’est-à-dire au plus tard en mars 2019 si l’article 50 est invoqué en mars prochain – à moins qu’un accord n’ait été trouvé pour qu’il soit maintenu. Si le Royaume-Uni accepte de respecter toutes les règles concernant la sphère financière, y compris celles qui évolueront, il pourrait alors obtenir de conserver peu ou prou les droits dont il jouit aujourd’hui. En revanche, il serait problématique qu’il accepte un accord dans le domaine financier tout en refusant des concessions politiques sur la liberté d’installation et de circulation. Autrement dit, il faut d’abord établir si le Brexit – dans l’hypothèse où il serait « doux » – donne lieu à un accord de libre-échange et si les dispositions convenues dans la sphère financière s’accompagnent de contreparties suffisantes. En cas de Brexit « dur », la négociation sera compartimentée entre secteurs. Dans la sphère financière, je ne doute pas que les Britanniques tenteront de s’adapter à la situation. S’ils proposent de respecter toutes les règles en la matière, un arbitrage politique sera nécessaire.
M. Pierre Lellouche. Ils seront plus en difficulté que nous…
Mme Élisabeth Guigou. Quoi qu’il arrive, il faudra leur résister !
M. Gérard Rameix. Si nous refusons une telle proposition, ils entreprendront alors de négocier des accords spécifiques, qu’ils soient bilatéraux ou sectoriels ; il faudra dans ce cas faire preuve de toute la rigueur nécessaire pour éviter que le diable ne se loge dans les détails. De mon point de vue, il faut donc éclaircir ce sujet au mieux.
Il est inévitable que certaines activités financières aujourd’hui exercées à Londres soient transférées sur le continent, même si leur volume n’est pas considérable. Les différentes places européennes étant en concurrence, nous devons faire valoir nos atouts. Nous faisons tout notre possible pour promouvoir l’attractivité de la place de Paris ; mieux vaut toutefois adopter des positions claires sans les nuancer dans la foulée – même pour de bonnes raisons – par d’autres déclarations, car l’efficacité dans les négociations s’en ressent.
Enfin, nos infrastructures de marché jouent un rôle important. Nous n’avons pas encore abordé la question du rapprochement des bourses de Londres et de Francfort. Les enjeux sont pourtant colossaux, tant en termes de risques systémiques dus à la concentration excessive des opérations dans une seule et même structure, qu’en raison du paradoxe selon lequel, à l’issue du Brexit, l’un des principaux centres de décision financiers européens serait localisé hors de l’Union européenne.
À mon sens, aucune autorité de régulation financière en Europe n’a le souhait de « casser » la place de Londres ; au contraire, la continuité de la régulation et des affaires sont prioritaires pour éviter tout accident. Dans toutes les hypothèses, la place de Londres conservera un rôle majeur. En revanche, il est important d’évaluer les activités qu’elle gardera et selon quelles modalités. Le risque de dumping est une question très complexe : les Britanniques seront partagés entre la volonté de conserver certaines règles, car il est utile de réguler la finance en certaines circonstances, et celle de procéder à des assouplissements en réponse, par exemple, à la demande de partenaires américains souhaitant s’installer à Londres, pour lesquels ils ont les yeux de Chimène. Il faudra donc établir avec la plus grande clarté si le passeport – ou son équivalent – est maintenu, et dans quelle mesure l’application des règles en vigueur dans les Vingt-Sept demeure contraignante.
Encore une fois, la question du Brexit est complexe parce qu’elle se décline en innombrables sous-questions. Or, les Britanniques sont les techniciens les plus habiles en la matière. Nous devrons donc nous doter des moyens suffisants pour analyser précisément les implications de chaque choix.
M. Arnaud de Bresson. Serait-elle capable de « casser » la place de Londres que la place de Paris n’en aurait aucunement l’intention, car cette place est un atout concurrentiel pour l’Europe – nous avions d’ailleurs pris clairement parti en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’Union. Au fond, la question ne se pose pas en ces termes, et ce pour au moins deux raisons concrètes. Tout d’abord, les banques et institutions internationales, notamment américaines, concentrent 80 % de leurs activités de financement en Europe à Londres et ne veulent plus courir un tel risque, a fortiori dans la perspective du Brexit. La question a d’ailleurs été soulevée auprès de leurs autorités de régulation nationale. Plutôt que de quitter définitivement Londres, les banques et sociétés de gestion internationales vont chercher à rééquilibrer une partie de leurs activités vers l’Union européenne, ne serait-ce que pour gérer ces risques. L’enjeu – important – pour nous consiste donc à tenter de reprendre une partie des activités en euros actuellement traitées à Londres. Même ainsi, la City continuera d’exister, vu l’écart qui la sépare des autres places financières européennes.
J’entends d’autre part demander pourquoi Paris Europlace se bat pour doter la France d’une place financière européenne, ce rôle pouvant être confié à Londres puisque la ville de Paris a plutôt fait le choix de développer les start-ups. Comment peut-on imaginer développer des PME de croissance et de haute technologie en France sans disposer des instruments financiers nécessaires à leur accompagnement ? Il n’y aura pas de start-ups en France sans place financière capable de leur apporter les instruments indispensables que sont le capital-investissement et la bourse des PME. En clair, l’idée de consolider une place financière en Europe continentale, notamment en France – l’une des principales économies de l’Europe – est réaliste et nous permettra, sans « casser » la place de Londres car ce n’est pas notre intention, de jouer un rôle croissant dans les différents secteurs liés à l’euro.
Nous n’avons adopté aucune religion hostile à la taxe sur les transactions financières, monsieur Giraud. En revanche, nous partageons précisément votre souhait que le Brexit soit l’occasion d’assainir davantage les marchés financiers européens en les rendant plus responsables. En effet, nous avons là une possibilité de développer une place financière européenne qui ne réponde pas aux mêmes standards que la place de Londres. Nous avons créé Paris Europlace il y a vingt ans selon un modèle économique consistant à placer les entreprises au premier rang, plutôt qu’à recréer un club de banquiers londoniens. C’est pourquoi depuis l’origine, Paris Europlace est présidée par un président d’entreprise, les entreprises représentant 70 % de nos membres, outre les banques et les investisseurs ; de plus, elle accorde une grande importance au dialogue des professionnels avec les autorités de régulation. Avant la crise financière, ce modèle était jugé franchouillard et irréaliste ; je prétends qu’il s’impose aujourd’hui comme le modèle d’après la crise. Depuis 2008, nous avons ainsi signé une quinzaine d’accords de coopération avec des places émergentes – Shanghai, Pékin, Moscou et Dubai ou encore Casablanca, Alger et Tunis, qui choisissent désormais notre modèle car elles l’estiment plus proche de la réalité du financement de l’économie et plus adapté à une bonne régulation des marchés.
La seule religion que nous nous sommes faite concernant la taxe sur les transactions financières est celle de M. Bartolone : la France ne saurait adopter seule cette mesure, à moins de provoquer la disparition de cette place financière que vous souhaitez plus responsable, monsieur le député. La Suède, qui avait instauré cette taxe, a dû l’abandonner au bout de deux ans car toute l’activité financière avait disparu. L’Italie, quant à elle, a créé une taxe sur les activités dérivées qui s’est traduite par le transfert de 60 % de ce secteur vers Londres, précisément. En prenant seuls cette mesure, vous provoqueriez le départ vers Londres de ce qui reste de la place financière de Paris au lieu d’y attirer et développer une finance européenne responsable.
Les banques et les sociétés d’assurance à Londres, monsieur Lequiller, ont non seulement exprimé leur souhait mais aussi entrepris concrètement de rééquilibrer leurs activités au profit de l’Europe continentale, compte tenu des risques liés à une surconcentration sur la place de Londres et au Brexit. Nous les rencontrons, et nous avons lancé une réflexion sur les six filières industrielles concernées – banque de financement, gestion d’actifs, capital-risque, entreprises industrielles, start-ups et technologie financière, infrastructures de marché – pour déterminer plus précisément nos objectifs en matière de relocalisation des activités. En effet, les banques et sociétés de gestion concernées ont d’ores et déjà commencé à recueillir les données relatives à la performance comparée des places financières concurrentes que sont Paris, Francfort, Amsterdam, Luxembourg et Dublin. La place de Paris a l’avantage de représenter une économie de rang mondial s’appuyant sur de grandes entreprises, ce qui n’est le cas ni de Luxembourg ni de Dublin – où, de surcroît, les capacités immobilières sont arrivées à saturation. De plus, Paris est le siège de grandes entreprises internationales et de marchés très actifs ; c’est un centre financier mondial, alors que Francfort est une place régionale largement tournée vers les banques – dont la situation n’est guère florissante.
Nous avons donc une véritable chance à saisir, à condition de réaliser une union sacrée. Le Premier ministre, la maire de Paris, la présidente de la région Île-de-France, le président de la métropole et le président de Paris Europlace, monsieur Mestrallet, sont heureusement autour de la table pour que nous progressions sur ce sujet, dont je ne comprends pas qu’il soit absent des débats sur le projet de loi de finances.
Séance du jeudi 24 novembre 2016
La mission d’information organise une table ronde, ouverte à la presse, sur l’incidence du Brexit sur les entreprises, avec la participation de M. Michel Guilbaud, directeur général du MEDEF, M. David Hubert Delisle, directeur-adjoint d’Invest de Business France, Mme Thaima Samman, avocate aux barreaux de Paris et de Bruxelles et experte en matière de politiques et de régulations financières, M. Philippe Coq, secrétaire général des affaires publiques d’Airbus Group, M. Pierre Todorov, secrétaire général du groupe EDF et membre du comité exécutif du groupe et M. Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
M. le président Claude Bartolone. Après avoir examiné, lors de notre dernière réunion, l’impact du Brexit sur les activités bancaires et financières, nous tenons ce matin une table ronde, ouverte à la presse, sur son incidence sur les entreprises.
Je souhaite la bienvenue à M. Michel Guilbaud, directeur général du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), M. David Hubert Delisle, directeur-adjoint d’Invest de Business France, Mme Thaima Samman, avocate aux barreaux de Paris et de Bruxelles et experte en matière de politiques et de régulations financières, M. Philippe Coq, secrétaire général des affaires publiques d’Airbus Group, M. Pierre Todorov, secrétaire général du groupe Électricité de France (EDF) et membre du comité exécutif du groupe et à M. Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Je rappelle quelques chiffres illustrant l’importance de nos échanges économiques avec le Royaume-Uni : ce pays est notre cinquième client, notre huitième fournisseur et il représente notre premier excédent commercial pour les biens avec 12,2 milliards d’euros en 2015. La même année, plus de 30 000 entreprises françaises ont exporté vers le Royaume-Uni où l’on dénombre plus de 4 440 filiales de groupes français.
Ma première question portera sur le contexte créé par le résultat du référendum britannique et par l’incertitude qui continue de régner sur les intentions du gouvernement britannique – nous sommes quelques-uns à avoir rencontré plusieurs de ses responsables il y a quinze jours ; or nous sommes revenus en nous posant encore plus de questions que lorsque nous sommes partis.
Comment ce climat d’incertitude et l’évolution des taux de change affectent-ils d’ores et déjà l’activité ou le projet d’investissement des entreprises ou des secteurs que vous représentez ? À plus long terme, quelles seront les conséquences du Brexit pour les entreprises, et en particulier s’il devait s’agir d’un Brexit dur qui verrait le Royaume-Uni sortir du Marché unique sans qu’un accord commercial ait été signé ? Quels sont, selon vous, les points sur lesquels les négociateurs devront se montrer particulièrement attentifs et qui devraient faire l’objet de mesures transitoires ?
Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire au cours de laquelle vous pourrez aborder les questions que je viens d’évoquer mais aussi les problématiques propres aux entreprises ou aux secteurs que vous représentez. Les députés vous interrogeront ensuite.
M. Michel Guilbaud, directeur général du Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Je vous remercie pour cette invitation ; un dialogue soutenu entre le monde économique et les pouvoirs publics apparaît en effet de plus en plus nécessaire sur le sujet qui nous occupe et, du reste, le bref échange que les invités ont pu avoir entre eux avant que ne commence cette table ronde a montré que le maître mot de nos réflexions est l’incertitude – la note que j’ai sous les yeux ne s’intitule-t-elle pas « Brouillard et inquiétude » ?
Je me rendrai cet après-midi même à Bratislava pour le conseil des présidents de Business Europe, qui regroupe les partenaires patronaux de l’ensemble des pays de l’Union européenne. Nous y discuterons du Brexit et du futur de l’Europe, deux sujets miroirs. Le contexte du Brexit exige que nous consolidions le socle européen, celui du marché intérieur et celui de la zone euro.
Vous avez souligné, monsieur le président, la grande importance de nos relations économiques avec le Royaume-Uni, qu’il s’agisse de l’excédent commercial ou de l’implantation des entreprises ; les liens financiers entre nos deux pays sont également considérables, sans oublier les liens humains puisque de 300 000 à 400 000 Français résident outre-Manche. Or comme le premier ministre, Theresa May, n’est pas en mesure de prendre un quelconque engagement sur la situation des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne installés au Royaume-Uni, nos entreprises s’interrogent sur ce dernier point.
Le MEDEF travaille depuis de nombreux mois sur le Brexit et nous avons d’ailleurs été très sollicités, avant même le référendum, par la très influente Confederation of British Industry (CBI), la confédération de l’industrie britannique, qui souhaitait que les entreprises européennes affirment leur volonté que le Royaume-Uni reste au sein de l’Union européenne. Nous nous sommes ainsi souvent déplacés à Londres pour rencontrer non seulement des représentants du monde de l’entreprise mais aussi des représentants politiques.
Le Brexit a été un très grand choc et l’on ne sait rien des termes essentiels de négociation de sortie de l’Union européenne ni des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Le Brexit a produit des effets immédiats sur les entreprises. La baisse du cours de la livre a affecté plusieurs secteurs. Des décisions d’investissement ont pu être suspendues ou renégociées. Une étude récente indique que 65 milliards d’euros ont ainsi été annulés ou reportés. En même temps, ces informations restent assez imprécises. En outre, nous avons une sensation d’anesthésie puisque nous n’avons pas vécu la catastrophe annoncée. Reste que nos collègues britanniques le disent eux-mêmes : « Winter is coming », l’hiver vient, parce que l’extrême complexité de la négociation, le temps qu’elle va prendre, l’ampleur des sujets à aborder – tous à double tranchant en termes d’intérêts économiques – entretiennent une incertitude très forte au détriment des échanges – l’incertitude étant en soi un élément négatif.
L’ensemble des fédérations professionnelles composant le MEDEF essaient d’identifier leurs intérêts stratégiques en matière d’implantations et d’échanges, de même qu’elles réfléchissent aux réglementations communautaires qui vont être en cause dans les négociations.
Le sentiment général est ambivalent : d’un côté – et c’est ce qui prédomine –, on ne souhaite pas compromettre et encore moins briser les liens très forts avec l’économie britannique ; de l’autre, on entend défendre vigoureusement les intérêts français et défendre un level playing field (règles du jeu équitables) pour éviter le dumping et pas seulement sur le plan fiscal.
Je reviens rapidement sur les effets immédiats. La baisse de la livre a été très fortement ressentie par le secteur du tourisme, notamment parce que la France est une terre d’accueil de touristes britanniques dont l’afflux s’est amoindri. D’autres secteurs ont également été touchés comme ceux de l’acier, des tuiles et briques, du textile, de l’automobile : dès qu’on vend sur les marchés britanniques, se produit un effet valeur.
Ensuite, l’absence de visibilité affecte toutes les décisions dans l’ensemble des secteurs. Pour ce qui est des implantations françaises au Royaume-Uni, les secteurs de l’énergie, des transports publics, de l’équipement automobile, des services financiers, des travaux publics, à l’industrie des déchets… craignent l’effet récessif de l’économie britannique. Le chancelier de l’échiquier a annoncé hier encore que la croissance pour 2017 devrait se révéler un peu meilleure qu’au lendemain du référendum, mais on en reste à une prévision de 1,4 % contre 2,2 % avant le Brexit. On pourrait se dire, en comparaison avec d’autres pays, qu’une croissance de 1,4 %, ce n’est pas si négatif, mais il s’agit clairement d’un ralentissement qui aura un effet direct sur l’économie britannique et un effet induit sur l’Europe.
À moyen terme, au plan commercial, les incertitudes sont majeures sur le régime d’échanges avec l’Union européenne. Certains interlocuteurs sont surpris quand on évoque les droits de douane ; or si le Royaume-Uni quitte l’Union européenne, la question se posera bien de savoir quels droits de douane seront appliqués à nos secteurs exportateurs comme le textile, la chimie, la plasturgie, l’acier. Je n’oublie pas non plus l’incertitude des secteurs qui, comme l’automobile ou l’aéronautique, ont intégré une part de production au Royaume-Uni dans leur chaîne de valeur. Et, au-delà des seuls droits de douane, il faudra compter avec des procédures douanières lourdes.
L’ensemble des secteurs met en outre en avant un fort risque compétitif du fait que nous n’avons pas de bonnes conditions de réciprocité dans le cadre de la négociation à venir, amenée à être très longue et touchant à tous les domaines de l’Union européenne, qu’il s’agisse, quel que soit le secteur considéré, de réglementations en matière environnementale ou de reconnaissance mutuelle, notamment. Dans chaque secteur il peut y avoir des micro-gains de compétitivité d’ordre réglementaire mais qui, accumulés, impliqueront l’absence, avec le Royaume-Uni, d’un level playing field acceptable.
Les entreprises françaises qui opèrent au Royaume-Uni craignent la remise en cause de la libre circulation des personnes. Plus largement, au MEDEF et au sein de Business Europe, nous voulons préserver les quatre libertés sur lesquelles repose le marché intérieur – car l’Union européenne n’est pas une simple union douanière. Nous avons besoin, dans les différents pays d’implantation, d’une bonne circulation des compétences au sein de nos entreprises. Il y a d’ailleurs une incertitude particulière en Irlande et en Écosse à cet égard.
Le secteur financier, quant à lui, pose des problèmes très spécifiques, je ne m’y attarde pas d’autant que vous avez déjà organisé une audition sur le sujet.
Contrairement à une idée reçue, le Royaume-Uni est souvent un allié pour nos entreprises vis-à-vis du reste du monde, qu’il s’agisse de la défense de l’industrie, de l’énergie, des quotas carbone, des instruments de défense commerciale… Les Britanniques, qui ont la réputation d’être très libre-échangistes, sont en fait très défenseurs des intérêts européens. Aussi craignons-nous la perte de ce partenaire majeur dans les négociations, l’économie européenne pesant lourd dans un certain nombre de dossiers.
Nous entendons répondre à cette situation notamment en renforçant l’attractivité de la France – de ce point de vue, nous attendons une cohérence totale des mesures qui vont être prises, je pense à l’annonce concernant le régime des impatriés, mais aussi à des décisions législatives qui, elles, nous paraissent contraires à cet objectif d’attractivité, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 en cours de discussion. Je pense également aux dispositions sur le devoir de vigilance ou l’information pays par pays qui figurent dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispositions qui, si elles ne sont pas discutées au niveau européen, vont pénaliser les entreprises françaises.
Ensuite, de notre point de vue, la négociation qui va s’engager avec le Royaume-Uni doit reposer sur des règles très claires de réciprocité. Il faut éviter d’aboutir à un accord d’association plus généreux qu’auparavant en matière d’opt-in et d’opt-out, ce qui serait tout de même paradoxal. L’équivalence des normes pour l’accès à un marché doit en effet être la règle. Si le Royaume-Uni ne veut pas s’astreindre aux réglementations communautaires, nous aurons beau avoir négocié, à un moment donné, des équivalences, si la réglementation britannique évolue, il faudra assurer le suivi des règles d’équivalence. Aussi pensons-nous que cette négociation présuppose un code de bonnes pratiques afin d’éviter, par exemple, que les Britanniques ne se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts, les réglementations adoptées au cours d’une négociation qui aurait lieu avant le Brexit étant destinées à ne plus s’appliquer au Royaume-Uni après le Brexit. La définition des méthodes de négociation sera donc cruciale.
M. David Hubert Delisle, directeur-adjoint d’Invest de Business France. J’interviendrai davantage, pour ma part, sur l’attractivité et l’investissement étranger en France. Pour Business France, opérateur dans le domaine du développement international des entreprises en France, le Brexit constitue un moment important en termes tactiques et stratégiques, encore que nous ne savons pas quelle sera la portée du phénomène. On peut néanmoins procéder par analogie avec des événements comme la création de l’euro, l’entrée de la Chine au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il y a quinze ans, l’apparition des technologies de l’information, il y a une dizaine d’années… Or chacun de ces événements macro-économiques a globalement permis, au cours de cette période, le doublement des investissements étrangers en France : on est ainsi passé de quelque 500 à 1 000 investissements. Inversement, l’arrivée de nouveaux pays au sein de l’Union européenne, ces dernières années, n’a pas encore créé de mouvement d’investissement vers la France, notamment de la part des ex-pays de l’Est. Il faut se rappeler que, trente ans après l’adhésion de l’Espagne à la Communauté économique européenne (CEE), en 1986, on ne compte que cinquante investissements espagnols en France. Ces mouvements de sortie ou d’entrée doivent donc être appréciés avec le temps. Reste qu’ils génèrent des investissements parce que la modification d’un environnement économique a un impact sur la stratégie des entreprises qui doivent toujours avoir des projets si elles ne veulent pas mourir. Or ces projets ont un impact positif sur l’attractivité de la France et donc sur le nombre d’investissements que l’on est capable d’attirer.
Or il ne s’agit pas ici des pays de l’Est ni de l’Espagne mais du Royaume-Uni, premier récepteur d’investissements étrangers en Europe, avant l’Allemagne et la France, et important émetteur d’investissements vers la France : entre soixante-quinze et une centaine chaque année. On compte quelque 2 300 filiales d’entreprises britanniques sur notre sol – soit près de 250 000 salariés – qui exportent 18 % de leur chiffre d’affaires. Le Brexit, puisqu’il touche le leader des investissements étrangers en Europe et l’un des principaux investisseurs en France, crée une situation à laquelle il va falloir que nous nous adaptions.
Pour ce qui concerne Business France, nous devons nous organiser pour l’accueil de tous les projets. Il faudra d’abord tenir compte d’un décalage réglementaire créé par les négociations à venir, qui concernera presque tous les secteurs et qui aura forcément un impact, j’y insiste, sur la stratégie des entreprises ou plutôt sur les opérations des entreprises ; parfois, il sera même question d’autorisations comme pour ce qui concerne le passeport européen dans les activités financières. Ensuite, il faudra anticiper les différentiels de croissance ou les différentiels de change. À Londres, nous disposons d’un bureau pour aller à la rencontre des entreprises, certaines souhaitant être rassurées, d’autres informées, d’autres encore voulant rééquilibrer leurs opérations sur le continent ou au Royaume-Uni. Nous devons donc faire un effort de proximité important vis-à-vis des entreprises britanniques. Et, au-delà de ces dernières, puisque le Royaume-Uni est le premier pays d’accueil des investissements étrangers en Europe, nous devons être plus proches des entreprises de toutes nationalités et notamment des entreprises américaines qui disposent au Royaume-Uni de 900 milliards de dollars d’actifs. Ces actifs sont localisés au Royaume-Uni pour servir à l’ensemble de l’Union européenne.
Ainsi, en tâchant d’être le plus proches des entreprises internationales – britanniques et américaines, donc, mais aussi japonaises, indiennes et chinoises – nous travaillons sur l’opportunité grâce à laquelle ces investissements pourraient être désormais dirigés de manière plus massive vers le continent, vers l’Union des Vingt-Sept.
Business France participe par ailleurs à l’initiative Choose Paris Region, rassemblement de moyens d’acteurs franciliens – conseil régional, métropole du Grand Paris, Ville de Paris, chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France et, donc, Business France – destiné à créer une équipe de collaborateurs dédiés à l’accueil et à l’accompagnement d’investissements liés au Brexit. Cette équipe est en place depuis le 1er septembre et dispose déjà d’un portefeuille d’activités.
Pour bénéficier des effets positifs de ces investissements étrangers, nous devons appréhender l’attractivité de la France – sur laquelle il convient bien évidemment de toujours travailler – de manière relative : c’est le différentiel d’attractivité que les entreprises prennent en compte et non l’attractivité en soi d’un pays. Or l’attractivité de la France par rapport à celle de ses concurrents dépendra, d’une part, du décalage induit par les négociations post-Brexit, mais aussi de la réaction britannique, le Royaume-Uni tâchant d’ores et déjà de renforcer son attractivité. Il y a en outre fort à parier que le patriotisme des entreprises britannique sera important.
Nous anticipons donc, à travers les décalages réglementaires et le renforcement de l’attractivité de part et d’autre, une modification du jeu. Si, je le répète, nous ne connaissons pas la portée du Brexit, nous nous sommes organisés, en matière de prospection, pour être plus près des investisseurs étrangers et pour mieux accueillir, sur l’ensemble du territoire, les investissements post-Brexit – objet de la création, pour l’Île-de-France, du guichet unique.
Mme Thaima Samman, avocate aux barreaux de Paris et de Bruxelles et experte en matière de politiques et de régulations financières. Je reviendrai sur l’attractivité, l’un des éléments clés pour les années à venir, mais également sur le fait que nous ne savons pas où nous allons « atterrir » une fois les négociations sur le Brexit achevées. Qui a une idée claire de ce que sera le monde dans dix ans et des étapes successives que nous allons franchir ? Les deux champions mondiaux du commerce international, les États-Unis et le Royaume-Uni, viennent de « se casser la figure dans l’escalier », or le monde est organisé autour de leur manière de faire, de leur culture et de leur leadership.
M. Pierre Lellouche. Qu’est-ce qui vous permet de dire que les États-Unis se sont « cassé la figure dans l’escalier » ?
Mme Thaima Samman. Ils viennent tout de même d’élire un président qui considère que le commerce international n’est plus un sujet.
M. Pierre Lellouche. Et alors ?
Mme Thaima Samman. Et les États-Unis viennent de « se casser la figure »…
M. Jacques Myard. Attendez donc que M. Trump ait pris ses fonctions !
M. le président Claude Bartolone. Vous aurez la possibilité de réagir après les interventions, mes chers collègues.
Mme Thaima Samman. Sans doute est-ce une caractéristique de la période : on reste incapable de se projeter.
Laissons les États-Unis de côté puisqu’ils ne sont pas le sujet ici, et revenons-en au Brexit. Quelle que soit la manière dont on l’envisage, nous allons vivre trois périodes.
Nous en sommes à la première où rien n’a démarré. Nous avons en effet l’impression que rien ne s’est passé depuis le vote du mois de juin ; pourtant, nous savons que quelque chose va arriver puisque l’on ne voit pas comment le Royaume-Uni ne pourrait pas faire son Brexit, surtout depuis les mots de Theresa May, prononcés en octobre dernier : « Brexit means Brexit » (« Brexit signifie Brexit »).
Entre-temps, le groupe Nissan a été rassuré par le gouvernement britannique sur le fait qu’il pourrait bénéficier de l’union douanière qui ne serait donc pas remise en cause. C’était la meilleure blague entendue depuis longtemps puisque personne n’est capable de dire ce qu’il adviendra de l’union douanière après le Brexit, les discussions n’ayant pas même commencé.
Tout ce que l’on sait, après la déclaration de Theresa May que je viens de rappeler, c’est que la City a perdu la bataille de l’atténuation du Brexit. Pour l’anecdote : le matin même du référendum, nous avons passé notre journée en call (conférence téléphonique) avec des interlocuteurs outre-Manche et d’autres outre-Atlantique, les premiers nous expliquant que le passeport pour le monde de la finance n’était pas remis en cause et que rien ne serait changé. Leur obsession était d’expliquer, comme on l’a fait avec Nissan, que l’union douanière ne serait pas modifiée. Or rien n’est moins certain et l’industrie leader du Royaume-Uni ne sait pas où elle va « atterrir », j’y insiste, dans les mois qui viennent.
On a par ailleurs vu le Royaume-Uni tenter d’engager des négociations commerciales avec le reste du monde afin d’arriver à la table des négociations, au moment où sera appliqué l’article 50 du traité sur l’Union européenne, en ayant déjà conclu des accords avec les grands partenaires de l’Union européenne. Or il semblerait que le Japon lui ait dit non, que les États-Unis, avant l’élection de Donald Trump, lui aient dit non et que même les pays du Commonwealth n’aient pas voulu remettre en cause leurs relations avec l’Union européenne et aient donc également dit non.
Quels sont les scénarios possibles ? Le plus probable, avant le discours de Theresa May en octobre, était que le Royaume-Uni intègre l’Espace économique européen (EEE) et qu’en effet rien ne change vraiment sinon au désavantage des Britanniques puisqu’ils n’auraient plus été en mesure de négocier les textes tout en ayant plus ou moins accès au Marché unique européen. Il semble que cette hypothèse ne soit plus envisageable.
Restent dès lors deux scénarios : celui selon lequel les accords seraient négociés de façon large ; celui selon lequel ils seraient négociés secteur par secteur pour que le Royaume-Uni ait accès au marché unique. Or ce dernier a été institué pour servir l’intérêt de l’ensemble des économies et des entreprises de l’Union européenne – premier acteur commercial du monde où 62 % des échanges sont intracommunautaires. Chaque pays tirant avantage du Marché unique dans ses rapports avec les pays tiers, si le Royaume-Uni n’y a plus accès, ce sera forcément pour lui une source de faiblesse. Que la quatrième ou cinquième puissance économique du monde se transforme en Off-Shore, comme il semblerait qu’elle ait l’intention de le faire, serait d’autant plus compliqué qu’elle risque d’être défiée par une autre grande puissance, les États-Unis, qui essaient d’adopter le même modèle.
La deuxième période sera celle des négociations.
La troisième, celle qui suivra les négociations.
Pendant les négociations, il sera primordial pour les pays de l’Union européenne de parler d’une seule voix et de ne pas chercher à négocier individuellement avec le Royaume-Uni. Ce sera en effet le plus grand point faible de l’Union européenne car tout le monde y perdrait : le Royaume-Uni, c’est certain, mais aussi l’ensemble des autres pays parce qu’ils auront cherché à négocier, je le répète, individuellement. On perçoit d’ailleurs déjà la concurrence à la baisse de l’imposition à laquelle les pays sont en train de se livrer.
M. le président Claude Bartolone. Avec le Brexit, Airbus Group pourrait se trouver comme un avion sans ailes, puisque, au-delà de la référence musicale, les ailes des avions sont fabriquées au pays de Galles, qui, à la surprise générale, a voté majoritairement en faveur du leave, en dépit des aides dont il bénéficie de la part de l’Union européenne.
M. Philippe Coq, secrétaire général des affaires publiques d’Airbus Group. Je m’inscris dans la continuité de ce qui vient d’être dit sur la grande incertitude qui règne. Nous ne savons pas ce que sera le Brexit. Or ce que détestent le plus les entreprises, c’est évidemment l’incertitude et le manque de visibilité.
Airbus est un acteur construit et intimement intégré sur quatre pays : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne. Depuis ces pays, nous exportons près de 80 % de nos produits. Il a fallu plus de cinquante années d’effort pour parvenir à ce qui est considéré par tout le monde, je crois, comme un succès industriel.
Le protocole d’accord lançant la phase de définition du projet d’Airbus européen, signé à Lancaster house, date du 9 mai 1967. Cela fait bien longtemps. Le logo d’Airbus que vous connaissez tous représente avec ses trois arcs la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, et pas autre chose.
Le groupe, qui réalise un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros, compte 137 000 employés, dont 90 % dans les quatre pays que j’ai cités, et 15 000 au Royaume-Uni répartis sur une quinzaine de sites majeurs.
Nous fabriquons au Royaume-Uni les ailes de tous nos avions ; l’activité de recherche et développement pour les avions y est également installée, avec l’appui réaffirmé du gouvernement britannique au travers d’un plan technologique de soutien à l’aéronautique, représentant un milliard d’euros sur sept ans.
Le Royaume-Uni compte aussi de grands sous-traitants : Rolls Royce est le motoriste de l’A380 et de l’A350. Airbus fournit 50 % de la flotte d’hélicoptères britannique. Le groupe est le premier acteur dans le domaine spatial et le deuxième fournisseur de la Royal Air Force, au travers de programmes variés : l’A400M, le ravitailleur, l’Eurofighter auquel la France ne participe pas. Enfin, Airbus est présent dans la cybersécurité et actionnaire du missilier MBDA dans lequel l’axe franco-britannique est essentiel.
Notre activité repose sur des accords intergouvernementaux. Même la production d’avions commerciaux fait l’objet d’un traité, et de réunions périodiques des ministres et des administrations pour coordonner leur soutien et leur action. Il en va de même pour l’Agence spatiale européenne et la défense qui est par essence un domaine intergouvernemental. Le Royaume-Uni, ce sont aussi des clients majeurs : British Airways, Virgin Atlantic, sans parler d’Easy Jet qui possède une flotte unique de 233 appareils Airbus.
Voilà pour l’importance systémique du Royaume-Uni pour la maison Airbus.
Je souligne plusieurs points de vigilance dans l’incertitude actuelle.
D’une façon générale, l’aviation a toujours été marquée par l’ouverture au travers des traités open skies ou des free trade agreements. Nos matériels et les pièces de nos avions circulent entre les différents pays. Toute rigidité, toute édification de barrières douanières freinant ou renchérissant la circulation de nos matériels auraient des impacts négatifs sur l’activité.
La fluidité de la circulation de nos personnels, qui est une composante de la nécessaire flexibilité, est importante. Je prends des exemples récents : quand nous avons connu des problèmes sur l’A380 dans les années 2000, nous avons fait venir massivement des employés allemands pour terminer les avions à Toulouse ; nous avons envoyé des personnels à Séville pour aller plus vite sur l’A400M. Nous sommes intimement intégrés sur ces quatre pays.
En matière de défense, le Royaume-Uni demeurera un acteur majeur et un allié incontournable. Il n’appartient pas à l’industrie de se prononcer sur ce sujet, mais la coopération devrait se poursuivre de manière naturelle.
L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est une pièce maîtresse de la réussite aéronautique européenne. Elle offre un cadre légal commun à tous ses membres pour faciliter les processus de certification des aéronefs commerciaux. Les États-Unis disposent d’une autorité équivalente, la Federal aviation administration (FAA). C’est l’une des grandes forces de l’aéronautique européenne que d’avoir constitué cette agence unique pour la certification des appareils commerciaux. Il faudra trouver des modalités d’association du Royaume-Uni pour l’avenir. Un statut de membre associé existe déjà pour certains pays : la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
Le Royaume-Uni – fait souvent peu connu – est un contributeur majeur de l’activité spatiale en Europe, tant de l’Agence spatiale européenne (ESA) que des programmes de l’Union européenne – Galileo et Copernicus. Le centre de sécurité de Galileo est basé à Saint-Germain-en-Laye et à Swanwick dans le Hampshire ; même si les satellites Galileo ont été fournis par l’entreprise OHB, la moitié d’entre eux sont réalisés au Royaume-Uni par notre filiale SSTL.
Que deviendront les participations britanniques dans les programmes européens comme le programme de financement de la recherche et de l’innovation Horizon 2020 ? Je ne le sais pas.
Enfin, nous sommes particulièrement attentifs à l’évolution du contexte économique et financier, en particulier à l’éventualité d’une dépréciation durable de la livre sterling et à ses effets potentiels en matière d’inflation et de relèvement des taux d’intérêt, autant de conséquences qui risquent d’affecter notre financement et celui de nos grands clients. La dépréciation de la livre sterling crée d’ores et déjà un problème immédiat pour le financement de l’ESA puisque les Britanniques paient leur contribution en livre. C’est un sujet pour la prochaine réunion ministérielle du mois de décembre.
Nous alertons les pouvoirs publics des deux côtés de La Manche sur les conséquences négatives des décisions qui pourraient être prises dans le cadre du Brexit. Nous continuerons à travailler avec les autorités dans une logique « gagnant, gagnant ». Encore une fois, nous ne sommes qu’au début d’un processus qui est totalement incertain.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur Todorov, le Brexit doit susciter un certain nombre d’interrogations compte tenu du projet Hinkley Point.
M. Pierre Todorov, secrétaire général du groupe EDF, et membre du comité exécutif du groupe. Avant de vous faire part des quelques points de vigilance ou d’attention d’EDF par rapport au Brexit, je vous livre deux éléments de contexte.
À travers sa filiale EDF energy, EDF produit aujourd’hui 20 % de l’électricité consommée au Royaume-Uni – 100 % de l’électricité d’origine nucléaire. Elle compte cinq millions de clients et un peu moins de quinze mille collaborateurs.
Le projet d’Hinkley Point C (HPC) vise à construire puis exploiter à l’horizon 2025 deux réacteurs de type EPR, avec d’autres développements possibles de réacteurs EPR ou de réacteurs de moyenne puissance. C’est un enjeu très important pour nous.
Deuxième élément de contexte, le secteur de l’énergie et de la production d’électricité est très dépendant de la régulation du marché, ce que l’on appelle le market design, et des politiques énergétiques qui se décident au niveau national mais aussi européen.
C’est à la lumière de ces deux éléments que je souhaite vous faire part de nos réflexions autour de quatre points.
Premier point, le Royaume-Uni occupe une place tout à fait particulière et importante en Europe en matière de politique énergétique. Parmi les États membres, il est sans doute celui qui défend les positions les plus explicites – il les a d’ailleurs mises en œuvre de façon méthodique – sur la décarbonation compétitive, qui repose sur deux piliers : production d’électricité d’origine nucléaire et production d’origine renouvelable. Comme vous le savez, nous partageons cette vision : EDF se veut le champion de la décarbonation compétitive et de tout ce qui peut favoriser, dans le cadre de la régulation, notamment par le prix plancher du carbone, le développement de la production d’électricité décarbonée. Il est extrêmement important de préserver les équilibres politiques actuels dans les discussions à Bruxelles. De façon pragmatique, quelles que soient les modalités de sortie du Royaume-Uni, nous pensons qu’il faut trouver des moyens alternatifs pour que celui-ci reste membre du système de quotas d’émission – les emission trading scheme (ETS) – et qu’il puisse, d’une façon différente, continuer à participer à la définition des règles sur le marché du carbone.
Concernant la coopération en matière nucléaire, se pose la question du maintien du Royaume-Uni dans le traité Euratom. Si ce dernier devait le quitter – à ce stade, selon notre analyse, il n’est pas évident que le retrait de l’Union européenne entraîne nécessairement et automatiquement le retrait d’Euratom –, il nous semble important que le Royaume-Uni reste dans le jeu, notamment face à d’autres États européens qui ne partagent pas vraiment – c’est un euphémisme – la vision qu’a la France de l’importance du secteur du nucléaire. Il faut trouver des modalités pratiques pour que la coopération en matière nucléaire – recherche et développement, normes, gestion des déchets – puisse se poursuivre.
Autre sujet de préoccupation, les interconnexions. Les interconnexions entre le Royaume-Uni et la plaque continentale jouent un rôle très important dans la sécurité d’approvisionnement, pour le Royaume-Uni – cela représente 5 % environ de sa consommation – mais aussi pour nous qui sommes souvent exportateurs nets. Il y a un intérêt mutuel à ce que les interconnexions continuent à bien fonctionner, et se développent.
Il est nécessaire de maintenir un cadre juridique adapté qui puisse, d’une part, favoriser le maintien des transactions d’électricité entre la plaque continentale et le Royaume-Uni, et d’autre part, permettre que les nouveaux projets d’interconnexion – des décisions d’investissement pour deux projets très avancés doivent être prises à court terme – puissent se développer, sans être entravés par la sortie du Royaume-Uni, et continuer à bénéficier, selon des modalités à inventer, de fonds européens au titre des projets d’intérêt commun.
Dernier point, je rejoins des préoccupations plus générales, au premier rang desquelles la circulation des personnes, puisque EDF exerce une activité domestique au Royaume-Uni. Dans notre projet Hinkley Point C, la question de l’accès aux compétences et aux ressources qualifiées en matière d’ingénierie, et des collaborateurs venant du reste de l’Europe sera un enjeu majeur. Il est important que nos projets ne soient pas entravés sur le plan opérationnel par d’éventuelles barrières à la circulation.
Ma conclusion porte deux messages : d’abord, il importe, même dans un nouveau cadre institutionnel, de pouvoir maintenir une forme d’arrimage du Royaume-Uni au reste des pays européens sur les questions de politique énergétique et d’investissement. Notre deuxième préoccupation, commune à tous ceux qui sont autour de la table, concerne la visibilité : nos réflexions s’inscrivent dans un contexte marqué par une grande incertitude sur les modalités concrètes du Brexit.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur Carré, nous allons évoquer la libre circulation des bateaux. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que s’il devait y avoir rupture des négociations et fermeture de l’accès des bateaux de pêche français aux eaux britanniques, c’est 75 % de l’apport en poisson frais qui pourrait être menacé.
M. Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Je vous remercie de permettre aux pêcheurs d’exprimer leurs craintes.
Les pêcheurs sont toujours taxés de paranoïa, mais, avant le Brexit, nous avions mis en garde le Gouvernement car nous étions à peu près persuadés que le Brexit serait voté. Nous nous appuyions sur les discours de nos collègues anglais qui revendiquaient, en reprenant une formule thatchérienne : « we want our fishes back ». Les pêcheurs britanniques considèrent que depuis leur entrée dans l’Union européenne et la mise en place de la politique commune de la pêche en 1983, les pêcheurs des États membres leur volent leur poisson, ce qui est vrai d’une certaine manière. Comme vous le disiez, les pêcheurs français – des Hauts de France et de la Normandie –, sont tributaires à 75 % en temps d’activité des zones britanniques. Quant aux pêcheurs bretons, ils sont dépendants à 50 % puisqu’ils vont pêcher en mer Celtique et en ouest-Écosse.
Il est clair que le Brexit est un véritable séisme. Pour le pêcheur français, le Brexit est à la fois un enjeu territorial et un enjeu économique.
L’enjeu territorial, c’est l’accès aux zones britanniques. Une carte, qui est fausse mais qui circule au Royaume-Uni, montre l’étendue de la zone économique britannique lorsque le pays sera sorti de l’Union européenne. Je vous rappelle que les îles anglo-normandes ne font pas véritablement partie de la politique commune de la pêche. Mais les Anglais sont assez pragmatiques et réactifs : leur logique consiste à inclure dans leur zone économique les îles anglo-normandes alors que les traités internationaux reconnaissent l’existence d’un couloir. Cette carte laisse penser que les Anglais vont être très durs dans la négociation.
Nous ne sommes toujours pas parvenus à un accord sur la limite territoriale entre la France et les îles anglo-normandes, il ne faut pas l’oublier. Le différend, qui dure depuis quelques siècles, continue d’opposer les pêcheurs du Cotentin et ceux de Jersey et Guernesey.
Pour les Britanniques, la logique du Brexit voudrait que les pêcheurs français, mais aussi hollandais, belges, allemands, et espagnols sortent de leur zone économique, et qu’eux seuls puissent y pêcher.
Si les Britanniques se soustraient au droit européen, l’État français devra leur rappeler l’existence d’un droit international qui s’impose à eux – la convention de Montego Bay de 1982 –, en vertu duquel ils auront à respecter ce qu’on appelle les droits historiques. Ce n’est pas acquis. Les Britanniques, qui sont de grands pragmatiques, ont commencé à dire qu’ils reconnaissaient les droits historiques, mais ceux des pêcheurs qui exerçaient en 1973, avant l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun. Autant vous dire que les pêcheurs qui naviguent encore et qui pêchaient déjà en 1973 ne sont plus très nombreux. C’est leur manière de contourner le droit international.
Autre sujet, avec la politique commune de la pêche, tous les États membres ont décidé de mettre en commun leurs eaux et les ressources halieutiques. Un partage a ensuite été établi. À l’époque – l’Espagne n’était pas encore membre –, la France, parce qu’elle possédait plus de 10 000 navires, a obtenu une grosse part du gâteau qu’elle a conservée. Lorsqu’on renégocie les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas chaque année en décembre, la part de la France est toujours calculée sur 10 000 navires. Or, aujourd’hui, le nombre de navires en métropole s’élève à 4 500. Autant vous dire que les Anglais ne vont pas accepter qu’on recalcule les droits sur 10 000 navires que la France n’a plus. Bien entendu, nos amis espagnols et hollandais ont tout intérêt à ce que la clé de répartition soit revue.
La France a deux choses à craindre – c’est le « double effet Kiss Cool » – : être pénalisée par la sortie de l’Union du Royaume-Uni ; être soumise à une nouvelle règle de partage des quotas entre les États membres.
Le second enjeu est économique. Le taux de dépendance des chefs d’entreprise est compris entre 50 et 75 %. Dans la politique commune de la pêche, des règles de présence s’appliquent : un pêcheur qui pêchait dans les eaux anglaises et qui y détenait des droits historiques ne peut pas, s’il en est chassé, aller pêcher ailleurs – de la même manière qu’un chauffeur de taxi à Paris ne peut pas exercer librement à Marseille, Lille ou Bordeaux. Cela signifie donc un arrêt d’activité pour un certain nombre d’entreprises si elles ne peuvent plus accéder aux eaux britanniques.
Autre sujet de préoccupation, le marché européen des produits de la mer est le premier marché mondial. Les Britanniques pêchent énormément mais ne consomment pas. Ils exportent 85 % de leur production vers l’Union européenne. Ils nous ont fait le coup de la dévaluation en 1992 et 1993 et ce fut l’une des crises majeures de la pêche française – souvenez-vous de l’attaque de Rungis et de l’épisode du Parlement de Bretagne. À l’époque, le poisson anglais arrivant à Rungis était moins cher que le poisson français débarqué sous les criées de Boulogne-sur-Mer, Lorient ou Le Guilvinec. Nous craignons la même chose. Même si on leur impose un tarif douanier – disons 30 % –, ce ne sera pas suffisant car leur politique sociale est pour le moins étonnante : ils embauchent actuellement des Syriens et des Libyens qui sont payés 500 dollars par mois pour travailler sur leur navire quand les salaires en France sont de 4 500 euros par mois en moyenne. Si la dévaluation vient s’ajouter à cette inégalité économique, en l’absence de règles précises, nous risquons de subir une déferlante de produits britanniques à bas prix – n’oublions pas que la France importe à 85 % ; la crevette et le saumon mis à part, les pêcheurs français répondent à 50 % de la demande des consommateurs français. Nous risquons de surcroît de faire les frais de la guerre fratricide que se livrent les acteurs de la grande distribution. Nous sommes très inquiets sur ce point.
En conclusion, lorsque les traités d’adhésion des différents États membres ont été négociés, le sujet de la pêche a toujours été traité en dernier parce qu’il est le plus complexe. Nous ne voudrions pas d’un Brexit à la découpe dans lequel la pêche française serait la variable d’ajustement d’accords dans d’autres secteurs. J’aime beaucoup nos amis agriculteurs, mais on sait très bien qu’ils exportent énormément vers le Royaume-Uni. Nous ne voudrions pas d’une discussion de marchand de tapis autour des importations et des exportations.
Une boutade pour finir : les Anglais sont de fins négociateurs ; ils sont redoutables. Il ne faut pas oublier que lors de la seconde guerre mondiale, ils ont réussi à faire croire aux Allemands qu’ils débarqueraient à Dunkerque. Il faut les attendre là où nous ne les attendons pas actuellement. Un exemple : nous avons connu un problème avec la coquille Saint-Jacques il y a un mois : nous avions conclu un accord avec eux aux termes duquel les bateaux de quinze mètres étaient autorisés à pêcher seulement à partir du 1er novembre. Ils ont transformé tous leurs bateaux pour qu’ils mesurent 14,99 mètres et ils ont commencé à pêcher un mois avant.
Nous sommes un peu paranoïaques, mais nous sommes très attentifs aux négociations qui auront lieu pour la défense des intérêts de la pêche française.
Mme Élisabeth Guigou. Monsieur Todorov, s’agissant d’Euratom, que vous disent vos interlocuteurs britanniques ? Avez-vous le sentiment qu’ils ont, comme nous, intérêt à ce que nos accords perdurent ? Il est évident à mon sens que nous devrons rechercher dans la négociation tous les accords bilatéraux qui paraîtront utiles.
Monsieur Todorov, Monsieur Coq, tous nos interlocuteurs à Londres nous ont assuré que les restrictions à la liberté de circulation entreraient bel et bien en vigueur. Bien sûr, on peut penser qu’il y a là une part « d’intox », dans l’idée de nous amener à assouplir notre position. Mais on nous a répété que Mme May ne céderait pas sur ce point. Quelles seront pour vous les conséquences de ces décisions ? Comment avez-vous prévu de vous adapter ? En particulier, le projet de nouveau réacteur d’Hinkley Point C ne risque-t-il pas d’être retardé et de coûter plus cher ?
M. Pierre Lellouche. Merci de ces exposés intéressants. Monsieur Todorov, Euratom ne fait pas, il me semble, partie des traités européens : c’est donc un cas un peu à part.
Les difficultés sectorielles que vous avez soulevées sont très sérieuses, et elles le deviendront d’autant plus que l’on laissera traîner les choses. C’est pourquoi mon message aujourd’hui est politique.
Un peuple, c’est son droit, décide de quitter l’Union européenne ; mais son gouvernement traîne les pieds. La sortie du Royaume-Uni n’a toujours pas été notifiée. Les Britanniques utilisent cette période transitoire pour diviser la partie adverse, déjà traversée de multiples contradictions : eux se préparent ; nous discutons. Et, peu à peu, nous nous trouverons dans un écheveau parfaitement inextricable, le risque étant qu’au lieu d’un Brexit, l’Union européenne accepte une sorte d’opting-out géant. Ce que les Britanniques voudraient, c’est avoir à la fois le beurre et l’argent du beurre.
Il faut absolument casser cette mécanique infernale. Peu à peu, les problèmes décrits ce matin ne pourront plus être réglés : ils ne feront que croître, et le capharnaüm sera de plus en plus ingérable.
Nous devons donc agir. À l’échelle nationale, nous devons nous mettre en ordre de marche afin d’attirer de nouveaux investissements, notamment américains ; pour cela, il faut éviter de voter des textes comme ceux qui viennent de l’être à l’Assemblée nationale, et qui sont exactement contraires aux projets que nous mettons en place depuis le mois de septembre. À l’échelle européenne, nous devons reprendre l’initiative et fixer aux Britanniques une date butoir. Faute de cela, nous risquons, je le redis, de nous engluer dans des batailles fratricides.
Monsieur le président, le rôle de notre mission peut être de tirer le signal d’alarme. Les Britanniques sont maîtres du calendrier ; la situation britannique paraît aujourd’hui difficile, mais si nous tardons à agir, le rapport de force s’inversera. Nous risquons de perdre sur tous les tableaux.
Les Européens doivent reprendre en main leur destin. Ne laissons pas s’installer une situation peu ou prou comparable à celle de l’Europe vis-à-vis de la Turquie, dans laquelle cette dernière exerce un chantage ouvert, notamment en ce qui concerne les migrants, et mène une politique du fait accompli.
Pour ne pas rentrer dans un tel engrenage, la France doit se réveiller, adapter sa législation pour accroître son attractivité, et prendre une initiative forte en Europe.
M. le président Claude Bartolone. Vous avez raison, il faut avant tout éviter que nos contradictions internes ne viennent miner la négociation. Je me réjouis de la position prise, ce mardi, par M. Guy Verhofstadt, référent du Brexit pour le Parlement européen, selon qui les négociations ne devront pas durer plus de quinze mois et devront être achevées avant les prochaines élections européennes.
M. Pierre Lellouche. Monsieur le président, permettez-moi d’insister : votre rôle est essentiel. Nous devons nous coordonner avec les autres parlements nationaux. Certes, les élections françaises approchent, et le moment n’est pas formidable pour prendre de grandes initiatives politiques. Mais nous devons profiter du consensus qui se dessine au sein de cette mission d’information. Faisons bouger les exécutifs ! C’est vraiment l’intérêt national.
M. Jacques Myard. Je ne sous-estime pas la force de négociation de nos amis britanniques : chaque fois que j’ai négocié en ayant le soutien des Britanniques, je me demandais quand ils allaient me lâcher – ce qui finissait inévitablement par survenir.
Mais, ce matin, j’ai eu le sentiment d’entendre le chœur des lamentations. Nous rencontrons des difficultés ; mais le Brexit ne change ni la géographie ni les relations naturelles et légitimes. Marx établissait une distinction entre les superstructures – les problèmes que vous avez décrits – et les infrastructures : notre intérêt à tous est de trouver un accord. Bien sûr, comme le dit Pierre Lellouche, il faut sortir au plus vite du flou artistique et entamer les négociations.
Monsieur Guilbaud, vous parlez de compétitivité. Le Royaume-Uni n’a jamais appartenu à la zone euro. Or la monnaie est un élément essentiel en matière de compétitivité, et l’euro est un carcan qui étrangle nos exportations. Nul besoin de s’étonner de nos difficultés ! J’aimerais un peu plus de cohérence dans les prises de position du MEDEF.
Monsieur Delisle, la France est exportatrice nette, en stock, des investissements et de l’épargne et du capital, parce que nous nous autoflagellons avec notre fiscalité mirifique – sans parler de la fermeture des voies sur berge qui rend la circulation dans Paris chaotique tous les matins ! Tout est dans tout, c’est aussi simple que cela ! Notre attractivité dépend essentiellement de notre capacité à remettre de l’ordre dans nos propres affaires.
Madame Samann, je suis juriste moi-même, et je peux vous le dire : il faut écouter les juristes jusqu’à dix heures, et à dix heures et une minute, « les passer par la fenêtre ». Ne sombrons pas dans un juridisme excessif ; passons outre, et nous trouverons des solutions.
Monsieur Coq, j’ai négocié l’entrée des Britanniques dans Airbus. Ce n’est pas un accord international, mais un mémorandum d’entente, c’est-à-dire un texte politique. Il n’est pas passé au Parlement. Ils avaient signé un traité pour le Concorde, et quand Mme Thatcher a voulu le dénoncer, le Foreign Office a craint que le Royaume-Uni ne soit condamné par un tribunal arbitral à payer de lourdes indemnités. Depuis, les British ne signent plus de traités, mais seulement des mémorandums d’entente ! Le meilleur exemple, c’est sans doute l’Acte final de la conférence d’Helsinki.
Quoi qu’il en soit, tout cela n’entre pas dans le système communautaire. Il n’y a aucun souci à se faire : c’est business as usual ! Ne nous prenons pas la tête sur des points qui ne sont pas essentiels.
Monsieur Todorov, s’agissant de l’électricité, il en ira sans doute de même : nous continuerons, j’en suis persuadé, d’échanger de l’électricité.
Monsieur Carré, je reconnais que les pêcheurs font face à de vraies difficultés. Rappelons tout de même que la reine d’Angleterre est duchesse de Normandie, donc vassale du roi de France : faisons appel au droit féodal !
M. Pierre Lequiller. Vraiment ?
M. Jacques Myard. Je mets un peu d’humour dans notre débat, monsieur l’intégriste européen !
Plus sérieusement, les Britanniques font toujours partie de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). S’ils font du dumping comme vous le décrivez – car employer des Syriens en les payant 500 dollars quand nous payons 4 500 euros, c’est scandaleux –, nous pouvons porter plainte devant l’OMC.
Enfin, il y aurait, me dit-on, un projet de loi britannique en cours de discussion sur le statut des personnes. Nous arriverons sur ce point à une réciprocité : les Britanniques veulent un statut pour leurs ressortissants installés en Europe. Nul ne veut la guerre.
M. Pierre Lequiller. Je vais tenir, cela n’étonnera personne, des propos un peu différents.
Madame Samman, sur de nombreux points, je ne suis pas d’accord avec vous. Mme Theresa May n’est pas Présidente de la République française ! Elle est Premier ministre d’un Gouvernement très divisé, qu’elle a du mal à diriger, et qui est responsable devant un Parlement très gêné. Les positions britanniques peuvent évoluer. Le ministre chargé du Brexit nous l’a dit : les Britanniques eux-mêmes ne savent pas exactement où ils vont. Il y a 350 textes à renégocier. Ne parlons donc pas des positions de Mme May comme si elles étaient claires et immuables.
S’agissant du passeport financier européen, j’espère bien que les Britanniques vont le perdre !
En ce qui concerne Nissan, il n’y a pas eu d’accord public, mais un entretien en tête-à-tête entre Mme May et M. Ghosn. Nous ne savons pas ce qui s’y est dit.
Monsieur Delisle, vous avez raison : en tant que conseiller régional d’Île-de-France que je suis aussi, j’estime également que ce que nous avons fait – notamment le guichet unique – est très bien. Mais le problème de fond, c’est que notre fiscalité et notre code du travail minent notre attractivité : j’espère que notre prochain gouvernement saura mener les réformes qui s’imposent.
Monsieur Coq, ce qui est terrible en effet pour les acteurs économiques, c’est l’incertitude, et surtout l’incertitude qui se prolonge. C’est pourquoi je me demande, monsieur le président Bartolone, si nous ne pourrions pas inciter l’Europe à anticiper la mise en œuvre de l’article 50. Nous allons perdre beaucoup de temps, car les Britanniques ont dit qu’ils notifieraient leur volonté de quitter l’Union au mois de mars, mais rien n’est encore fait. Pendant ce temps, nous attendons, alors que nous devrions travailler d’arrache-pied.
Monsieur Todorov, est-il possible de travailler avec les Britanniques hors du cadre d’Euratom ?
M. Christophe Caresche. Nous avons entendu ce matin deux approches contradictoires. La première consiste à plaider pour un renforcement de l’attractivité de notre pays, afin de profiter de futures délocalisations et de reports d’investissements, et donc pour une position ferme dans la négociation. La seconde met l’accent sur les conséquences inquiétantes d’un Brexit dur pour certains secteurs de l’économie, en soulignant que le Royaume-Uni représente le plus important excédent bilatéral de notre commerce extérieur.
Il faut chercher à articuler ces deux points de vue.
Selon vous, comment perçoit-on au Royaume-Uni la position française, plutôt ferme, notamment par rapport à celle de l’Allemagne – qui commence toutefois à évoluer, comme l’ont montré les récents propos de Wolfgang Schäuble ? À Londres, certains de nos interlocuteurs ont qualifié de « punitive » la position française.
M. Michel Guilbaud. Nous ne sommes ni trop positifs, ni trop négatifs, monsieur Myard. Nous souhaitons préserver nos liens économiques avec le Royaume-Uni ; nous souhaitons aussi protéger nos propres intérêts et ne pas être les dindons de la farce. Et la complexité du problème est bien réelle : toutes les réglementations sont remises en cause. Il y aura bien des diables cachés dans bien des détails.
Nous insistons donc sur le processus de la négociation. Nous avons toujours demandé que ces négociations commencent au plus vite. Nous demandons également que la Commission européenne et les négociateurs nous permettent de connaître à l’avance l’agenda, chapitre par chapitre, et les priorités. Les États membres et les parlements doivent être consultés au fur et à mesure : il serait périlleux d’accorder un blanc-seing aux négociateurs.
S’agissant de la compétitivité, je comprends le propos de M. Myard sur la monnaie. Mais l’attractivité et la compétitivité doivent être évaluées de façon globale. Bien sûr, une dévaluation a des effets à court terme, mais elle renchérit également les importations ; l’économie britannique en souffrira. En revanche, la zone euro est une zone de stabilité. Nous en connaissons les faiblesses structurelles, révélées par la crise.
M. Jacques Myard. Et ce n’est pas fini !
M. Michel Guilbaud. Nous demandons une convergence beaucoup plus forte, et une véritable gouvernance de la zone euro. Mais le temps des dévaluations compétitives qui a précédé l’euro est heureusement fini : ponctuellement, cela pouvait être intéressant, mais cela ne nous a pas permis de tirer notre épingle du jeu.
Nous raisonnons donc globalement. À l’échelle européenne, l’accès au marché intérieur est essentiel – une entreprise implantée au Royaume-Uni aura sans doute moins facilement accès à ce grand marché qu’une entreprise implantée sur le territoire de l’Union européenne. S’agissant de la compétitivité, nous devons travailler sur le financement, sur l’énergie, sur la convergence fiscale… Cela a été dit.
À l’échelle française, les acteurs français ou étrangers qui cherchent à s’implanter en Europe jugent sévèrement la rigidité de notre droit du travail, ainsi que l’insécurité juridique qu’il provoque, bien plus que notre fiscalité. C’est vraiment le premier message, même pour des emplois qualifiés. Ils redoutent également l’instabilité chronique de notre réglementation. La lourdeur des charges fiscales et sociales – les plus élevées de l’OCDE – vient en troisième. Hors même le cas particulier du Brexit, des réformes sont évidemment nécessaires pour reconstruire notre attractivité. Enfin, il faut mentionner la question de la sécurité des personnes, en raison du contexte international sur lequel je ne reviens pas. Nous devons plus que jamais travailler sur ces problèmes spécifiquement français.
Monsieur Caresche, s’agissant de la perception de la position française, il y a peut-être une question de style : nous avons été vus comme un peu plus matamores que d’autres. Mais la position allemande, je n’en doute pas, sera très dure : les enjeux financiers et réglementaires pour l’Union européenne leur tiennent énormément à cœur. Sans opposer les grands États que sont la France et l’Allemagne à d’autres plus petits, on peut supposer que d’autres États membres, notamment en Europe centrale, seront plus sensibles à des arguments bilatéraux, et moins attachés à la nécessité de consolider le marché intérieur et de conserver le sens du projet européen.
M. le président Claude Bartolone. La position des États d’Europe centrale peut aussi évoluer, notamment du fait des inquiétudes vis-à-vis de l’Alliance atlantique. Le moins que l’on puisse dire est que nous vivons une période intéressante !
M. David Hubert Delisle. Je reviendrai très rapidement sur la notion d’attractivité, en relevant d’abord que les trois pays leaders en Europe pour l’attraction des investissements étrangers sont, sans surprise, les trois plus grandes économies : le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Les écarts entre elles sont assez resserrés, puisque le Royaume-Uni accueille entre 1 400 et 1 500 projets par an, l’Allemagne entre 1 200 et 1 250 et la France entre 1 000 et 1 100.
S’il s’agissait seulement de la fiscalité et du droit du travail, tels qu’ils sont perçus de l’étranger et tels que les entreprises étrangères ont pu en faire l’expérience, nous ne connaîtrions pas les scores que je viens d’évoquer. Cela montre bien que les décisions des entreprises ne reposent pas que sur ces critères.
Nos atouts reconnus sont ceux du marché, des talents que l’on peut embaucher en France et de la productivité des collaborateurs, des infrastructures qui peuvent servir de base pour exporter non seulement en Europe, mais aussi vers la zone africaine et le Moyen-Orient, l’empreinte carbone, le coût de l’énergie, le coût de l’immobilier, la qualité de l’administration et l’e-administration. Voilà l’ensemble des facteurs qui permettent à une entreprise de prendre une décision.
Bien entendu, les sources d’information d’une entreprise étrangère ne sont pas forcément puisées dans une expérience vécue. Ce qu’une entreprise étrangère non encore implantée en France peut lire dans le Financial Times au sujet de notre pays n’est pas à son avantage, mais nous devons passer de la perception à l’explication de la réalité vécue par les entreprises.
Tous les jours, des mesures sont prises pour améliorer notre attractivité sur le long terme. Car une entreprise développe ses plans d’investissements et leur évaluation de rentabilité sur un horizon de cinq à dix ans.
Bien entendu, l’instabilité ou l’incertitude de notre droit social constituent certes des handicaps. Mais elles peuvent être levées par un travail sur l’attractivité. Nous avons pour rôle de montrer les vrais chiffres, en nous appuyant sur les bilans annuels de l’attractivité en Europe. Ils placent la France à son rang, très proche du Royaume-Uni et de l’Allemagne.
Il faut relever que la France est leader sur au moins deux secteurs en Europe. C’est d’abord le cas en matière d’investissements productifs. Ainsi le baromètre EY nous place en tête en la matière depuis plusieurs années. Tout cela peut sembler… confusing. Mais cela est dû à la base très large d’investissements industriels qu’offre notre pays, alors que le Royaume-Uni a une vocation plus spécifiquement pétrolière et financière et que l’Allemagne s’appuie davantage sur des capitaux locaux.
Il en va de même en matière de recherche et développement, grâce au crédit d’impôt recherche (CIR), mesure que l’on nous envie. Rien n’est cependant jamais gagné de manière pérenne en ce domaine.
La France investit aussi beaucoup à l’étranger. Il existe ainsi plus de 30 000 investisseurs français à l’étranger ; plus de 22 000 investisseurs étrangers sont inversement présents en France. Tout cela n’est pas un jeu à somme nulle, puisque plus de deux millions et demi de salariés en France travaillent dans une entreprise contrôlée par des investisseurs étrangers. Nous pourrions aussi évoquer la part des investisseurs étrangers dans les entreprises cotées en bourse à Paris.
La France s’affirme ainsi comme un pays ouvert, dont l’attractivité est reconnue. Au-delà de notre rang naturel si l’on considère la taille du produit intérieur brut (PIB), nous sommes bien placés dans les classements internationaux, eu égard à des atouts structurels que nous devons continuer à cultiver, notamment les infrastructures, leur accessibilité, et leurs coûts d’utilisation, et à des atouts en termes de productivité des talents – par exemple l’école française de mathématiques, pour la recherche et développement.
Pour conclure, plus que le coût du travail, le droit social et l’instabilité fiscale sont perçus à l’étranger comme des éléments négatifs pour l’attractivité française. Mais les décisions des entreprises se prennent sur une base beaucoup plus large que ces critères, et sur une durée beaucoup plus longue. Cela explique nos scores plus que tout à fait honorables en matière d’implantations étrangères. Je rappelle que la France accueille plus de 1 000 projets d’investissements étrangers par an, soit plus de treize par semaine.
Mme Thaima Samman. Il ne me semble pas que nous soyons tous tellement en désaccord. Et l’idée de me faire jeter par la fenêtre à dix heures me fait moyennement plaisir…
Plus sérieusement, s’agissant des procédures et des règles institutionnelles, le Royaume-Uni a la capacité de déclencher l’article 50, ce qui donne le top départ des négociations. Mais, ensuite, il perd le pouvoir, puisque l’on rentre dans les discussions, qui doivent être impérativement terminées dans les vingt-quatre mois. S’il n’y a pas d’accord à l’issue de cette période, le Royaume-Uni sort automatiquement de l’Union européenne, n’est plus partie à aucun des traités européens et perd son accès au marché unique.
M. Pierre Lequiller. C’est à voir. Entre les textes et la pratique, l’on observe parfois un écart.
M. le président Claude Bartolone. Non, c’est l’application des textes.
Mme Thaima Samman. En tout cas, le déclenchement de la procédure fait peser une épée de Damoclès au-dessus des Britanniques. Ces négociations seront conduites en effet par la Commission européenne et par le Conseil, mais le Parlement européen disposera d’un droit de veto sur leur résultat. Or c’est la plus pro-européenne des institutions. En cas d’exercice de ce droit de veto, la négociation se poursuivra secteur par secteur, comme cela se fait avec le Canada et les États-Unis. Avec ces pays, les traités prennent des années à être négociés, car les problématiques des différents secteurs s’entremêlent. Ces négociations séparées sont en effet dans un rapport de dépendance réciproque pour leur conclusion. Même avec le Canada, l’on peine à finaliser l’accord.
Néanmoins, les Britanniques ont intérêt à déclencher l’article 50, s’ils veulent en finir avant les prochaines élections. En outre, ce peuple de commerçants s’accommode mal de l’incertitude. Mme Theresa May se retrouve ainsi coincée. Elle fait ce qu’elle peut. Mais, n’ayant pas été élue pour être Premier ministre, elle ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite.
Dans son discours d’octobre, elle a pris une position ferme sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Mais elle est contrainte par le droit, puisque la haute cour de justice anglaise lui a imposé de repasser par le parlement. Elle se heurte à des blocages de tous côtés. Puisque les règles constitutionnelles anglaises le permettent, il ne faut pas exclure qu’elle convoque des élections à tout moment, ce qui réglerait la question en trois semaines, grâce à un nouveau mandat plus clair.
Dans aucun des pays d’Europe, les dirigeants politiques n’ont de position homogène sur le Brexit. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel et son ministre des finances Wolfgang Schäuble divergent. Des contradictions existent entre les intérêts des différents secteurs de l’économie, de même que des divergences se font jour entre Länder, selon que l’on y redoute plus la concurrence britannique, ou la perte des débouchés vers le Royaume-Uni.
De fait, la France est revenue en première ligne des puissances qui comptent dans les négociations européennes et mondiales. Sa position est devenue tout à coup extrêmement importante. Car ce ne sont plus trois, mais deux pays qui exercent désormais une forte influence à l’intérieur de l’Union européenne. Avec le départ du Royaume-Uni, la quote-part française dans la négociation va automatiquement remonter. La position française influera donc beaucoup sur la suite des discussions.
J’ai perçu beaucoup de rumeurs, d’incompréhension, et je voudrais dissiper quelques malentendus. Non, la nomination de Michel Barnier comme négociateur de la Commission n’est pas une agression envers le Royaume-Uni. Il a d’abord été choisi parce qu’il est populaire au sein du Parlement européen, qui détient un droit de veto sur l’issue de la négociation et joue ainsi un rôle important ; les deux autres négociateurs désignés par les deux autres institutions sont d’ailleurs eux aussi de fins connaisseurs du Parlement européen. Ensuite, Michel Barnier n’est pas si impopulaire auprès de la City ; lorsqu’il a fallu prendre des mesures à la suite de la crise financière de 2008, il n’est pas forcément allé contre les intérêts de cette dernière. Il serait faux de dire qu’il n’a pas su s’y gagner le respect. Même s’il sait être assez ferme, sa désignation n’est donc pas une provocation à l’endroit du Royaume-Uni.
Par ailleurs, je n’ai pas dit tout à l’heure que le passeport financier européen serait donné aux Britanniques, ni que Nissan aurait accès à l’union douanière. Mais les bruits les plus contradictoires circulent. Il est au contraire peu probable aujourd’hui, contrairement à ce que l’on pouvait penser il y a trois semaines encore, que la City conserve le passeport financier. Si les Britanniques veulent le garder, ils devront céder sur la question de la libre circulation. Or il s’agit précisément de l’un des éléments à la racine du vote populaire au référendum. Point dur des négociations, la question devient ainsi plus politique que strictement économique. Je n’ai certainement pas dit que Nissan aurait accès à l’union douanière. Personne n’en sait rien.
En revanche, j’ai été frappée par le nombre de lettres d’information, de communications et de notes qui ont véhiculé l’idée que le maintien de Nissan en Grande-Bretagne apportait la preuve que le Royaume-Uni resterait dans l’union douanière. Ce n’est pas exact. À l’heure où les négociations n’ont même pas encore commencé, personne ne saurait rien dire de tel. L’accord avec Nissan porte certainement sur autre chose que sur ce point.
Nous ne nous plaçons pas devant le mur des lamentations. Voyons au contraire dans le Brexit une opportunité sur l’attractivité plutôt qu’une menace. Confrontés, dans mon activité professionnelle, à des entreprises étrangères qui s’interrogent sur le Brexit, je me rends compte que la France est clairement envisagée comme l’un des marchés offrant une alternative au Royaume-Uni. Ce dernier s’était construit depuis vingt ans comme la place avancée des entreprises du monde entier pour pénétrer le Marché unique, dans tous les secteurs et pour toutes les tailles d’entreprise.
Ainsi, dans mon secteur, qui est aussi celui des start-up du numérique, les entreprises installaient d’abord un bureau au Royaume-Uni, avant de traverser la Manche et de pénétrer le marché européen sous passeport britannique, comme structures anglaises. Le Royaume-Uni a également fondé sa richesse là-dessus. Mais s’ils n’ont plus accès au Marché unique, l’édifice s’effondre. Il y aura donc une répartition différente des entreprises étrangères.
Comme alternative, l’Irlande a l’avantage de la langue, du monde numérique, d’une imposition basse. Ils sont au moins aussi bons que les Anglais dans les négociations commerciales. En s’y installant, les entreprises qui quittent Londres restent ainsi dans leur zone de confort. Mais la petite taille du pays fait qu’il ne pourra pas accueillir tout le monde. Quant à l’Allemagne, elle est tellement l’endroit naturel où l’on a envie d’aller, qu’elle ne fait pas campagne. Son organisation en Länder ne serait d’ailleurs peut-être pas la plus favorable pour cela. L’appréciation varie certes selon les secteurs. L’industrie financière regarde vers Francfort. Mais, entre Francfort et Paris, les cadres supérieurs considèrent qu’il est plus fun d’habiter dans la seconde. C’est quand même mieux de vivre à Paris, ou dans d’autres métropoles françaises, elles aussi attractives. S’ajoute l’avantage des infrastructures et du niveau d’éducation. C’est très clair.
Cela étant, la France est incompréhensible dans le monde anglo-saxon, qui s’est construit au cours des vingt ou trente dernières années. S’agissant du droit du travail, mon cabinet a pourtant expliqué à maintes reprises qu’un licenciement coûte moins cher en France qu’en Allemagne, qu’il peut se négocier… Les entreprises étrangères craignent en effet de ne pouvoir embaucher facilement, puisqu’il serait si difficile ensuite de licencier. Chiffres à l’appui, nous montrons que c’est pourtant assez simple, que cela se négocie et que cela revient moins cher qu’en Allemagne.
La manière dont nous nous adressons au monde ne correspond pas aux codes anglo-saxons qui y prévalent aujourd’hui. Hors la question de la compétitivité des coûts, si voulons nous rendre plus attractifs, il faut d’abord que nous devenions plus compréhensibles.
M. Philippe Coq. L’on ne se lamente pas du tout non plus. Nous ne nourrissons pas de craintes, mais définissons seulement quelques points de vigilance, parce que nous voudrions anticiper autant que faire se peut.
Je vous remercie, monsieur Myard, pour votre mise au point juridique. Pour être précis, il s’agissait en 1967 d’un protocole d’accord.
M. Jacques Myard. Il faut parler non d’un protocole d’accord, mais d’un mémorandum d’entente. La doctrine a été arrêtée à la direction des affaires juridiques du Quai d’Orsay.
M. Philippe Coq. La position du Royaume-Uni ne fut, en effet, pas tout à fait linéaire, dans les années qui ont suivi, avant que nous n’arrivions à la position stabilisée que nous connaissons aujourd’hui depuis quelques décennies.
Madame Guigou, je crois que, comme industriels, nous nous adapterons par la force des choses au cadre nouveau, quel qu’il soit, car nous n’avons pas le choix. Mais nous ne savons pas encore sur quelle base prévoir. Au Royaume-Uni, nous nous efforçons d’expliquer les enjeux qui sont les nôtres, dans l’espoir qu’ils seront pris en compte, mais sans nous élever au-dessus de notre condition d’industriels et tout en étant bien conscients de ce que nous ne représentons qu’un secteur dans un débat beaucoup plus large.
Au vu des négociations précédentes, il est clair, monsieur Caresche, que le Royaume-Uni va se préparer sérieusement, définir des buts de guerre et les poursuivre selon un plan de marche qui ne sera jamais une ligne droite. Il conduira une analyse tactique des points faibles de toutes les parties, y compris des siens. Nous nous préparons donc à des moments intéressants.
M. Pierre Todorov. S’agissant de l’analyse ou de l’interprétation de la position du Royaume-Uni relativement au marché de l’énergie et à sa régulation, il nous est bien sûr difficile de parler à sa place. Des contacts avec les Britanniques, nous avons retiré l’impression d’une forme d’incertitude sur les sujets techniques et pratiques. En ce qui concerne Euratom, à notre connaissance, leur religion n’est pas faite, leur analyse n’a pas été poussée à fond. La question de savoir s’ils peuvent ou doivent quitter Euratom reste donc une question ouverte.
Plus généralement, s’agissant du maintien de leur participation aux discussions sur la politique énergétique, nous observons là aussi des signaux contradictoires. Un député britannique du Parlement européen, M. Duncan, rapporteur sur les échanges de quotas d’émission, a envoyé au gouvernement britannique le message selon lequel il serait bon que la question de l’énergie et du climat ne fasse pas partie des négociations sur le Brexit.
En sens inverse, comme le permet le cadre institutionnel, le gouvernement britannique a souvent été précurseur. Ainsi, il a pris des mesures nationales et unilatérales sur le prix du carbone et sur le marché de capacités. Il n’est donc pas impossible que le Royaume-Uni veuille ou ait intérêt à développer sa politique énergétique de manière plus indépendante.
En ce qui concerne l’impact sur notre projet de long terme de Hinkley Point C, sa construction doit de toute manière durer dix ans, avant que ne commence la période d’exploitation, longue de soixante ans. Nous nous plaçons donc dans un temps qui est très long. À ce stade, il n’y aucune raison de remettre en cause ni l’estimation des coûts ni celle des délais. Certes, nous restons vigilants sur les éventuelles futures barrières, tarifaires ou non – c’est-à-dire pouvant aussi impacter la circulation des personnes. Mais, à ce stade, ni l’équation économique ni le calendrier du projet ne sont remis en cause.
Dans le cas d’une sortie du Royaume-Uni d’Euratom, il existe des mécanismes alternatifs. Des accords bilatéraux ont ainsi déjà été passés avec des pays tiers. Après la catastrophe de Fukushima, la Suisse a ainsi participé, sur la base d’une déclaration volontaire, à des discussions avec Euratom, et même davantage, dans le cadre d’un accord spécifique de coopération bilatéral.
M. Hubert Carré. Si l’on négocie mal le Brexit, nous allons pleurer. Nous pouvons ainsi nous placer devant le mur des lamentations, sans tomber pourtant dans les jérémiades.
S’agissant de la pêche, nous ne voulons pas d’un Brexit à la découpe. Nos présidents et vice-présidents l’ont dit au Président de la République au cours d’un entretien avec lui il y a un mois et demi. Le message avait été bien perçu.
Mais nous nous inquiétons, car nous n’avons pas le sentiment que l’administration française se mette en ordre de marche pour anticiper ce que seront ces négociations qui vont, à mon sens, être difficiles.
Il ne faut pourtant pas attendre que messieurs les Anglais tirent les premiers en déclenchant l’article 50. Je partage le sentiment déjà exprimé sur le risque de négociations bilatérales entre certains États membres et le Royaume-Uni sur la pêche. Selon certains échos, les Espagnols et les Néerlandais chercheraient à obtenir des conditions similaires à l’accord passé entre l’Union européenne et la Norvège. Dans la politique commune de la pêche, les négociations avec des États tiers sont pourtant de la compétence exclusive de la Commission européenne. Cela pose donc problème.
Signant le déclin de la pêche au Royaume-Uni, la guerre de la morue avec l’Islande a laissé outre-Manche des traces de ressentiment très importantes, car les Britanniques perdirent cette négociation internationale. Après cette expérience, il est certain qu’ils ne lâcheront pas en ce qui concerne la pêche.
M. Michel Guilbaud. Puis-je faire une dernière observation ?
M. le président Claude Bartolone. Le MEDEF aura donc le dernier mot dans cette table ronde. Vous pourrez le rapporter à M. Gattaz !
M. Michel Guilbaud. Ce n’était certes pas mon intention. Compte tenu de l’importance du sujet, nous avons demandé au Gouvernement de mettre en place un haut comité de concertation entre le monde économique et les pouvoirs publics sur le suivi de ce dossier. Il s’agit en effet d’avoir une vision partagée et de conduire une action commune en faveur de l’attractivité de la France, non seulement pour les services financiers, mais pour l’ensemble des secteurs économiques.
Je voulais le redire, car, si le sujet suscite un vrai intérêt, il y a en même temps d’autres actualités. Nous savons que l’administration se met en ordre de bataille. Mais il ne faudrait pas qu’elle le fasse en vase clos, ce serait dommage.
M. le président Claude Bartolone. Vous avez raison. Dans le même temps, il faut qu’il y ait non seulement une position française, mais une position européenne.
Je partage tout à fait l’opinion de M. Carré sur l’inopportunité d’un Brexit à la découpe. Je ne voudrais pas que l’axe franco-allemand se trouve affaibli, ni que les pays d’Europe centrale puissent nourrir certaines dérives. Certains d’entre eux seraient prêts à penser qu’il ne serait pas plus mal que l’Europe s’occupe moins des réfugiés.
À Londres, à l’occasion de notre déplacement, nous n’avons pas non plus trouvé de position claire et affirmée, hormis quelques généralités. Certes, à la City, l’on a agité la perspective de se tourner vers New York ou Hong Kong. Mais il m’a semblé que cela visait plutôt à nous intimider.
S’agissant de la libre circulation, le peuple se serait exprimé : c’était invoqué comme argument pour ne pas céder sur cette exigence. Avec toute la sympathie que je porte au ministre chargé du Brexit, je dois dire que nous ne sommes pas sortis de notre entretien avec beaucoup de précisions sur ce qui serait leur base de négociations. Ils sont aujourd’hui beaucoup plus préoccupés par le nombre de fonctionnaires extrêmement important qu’ils ont à embaucher et à former, mais aussi à coordonner.
Le seul point sur lequel j’ai ressenti qu’existe une position commune, notamment au cours de notre rencontre avec mon homologue, c’est le fait que les parlementaires ne bloqueront pas la procédure, même s’ils soutenaient à 75 % le maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne. En dehors de cette certitude, il y a beaucoup d’approximation.
Quant à nous, nous allons tout faire pour que notre rapport soit adopté à l’unanimité. Nous voulons déterminer le point de vue de l’Assemblée nationale. Il faut définir le point de vue de la France, et celui-ci doit être compatible avec celui de nos amis allemands. De Londres, je reviens en effet avec le sentiment qu’on y aimerait que le couple franco-allemand se défasse sur la question du Brexit. Aux Allemands, les Britanniques diront que la position française est extrêmement dure… Quand ils nous rencontreront, ils trouveront ensuite un autre bouc émissaire pour essayer de distendre la position européenne. Ils ont compris en effet que, plus la position européenne sera unie et solide, plus ils auront de difficultés.
J’ai été très intéressé par vos interventions et par vos réponses. Elles montrent qu’il convient d’éviter la caricature du pays, et d’avoir une idée précise de ce que doivent être la voix et l’action de la France pour affronter cette période de grande incertitude.
Je vous remercie d’être venus jusqu’à nous.
Séance du jeudi 15 décembre 2016
La mission d’information organise une table ronde, ouverte à la presse, sur l’avenir de l’Union européenne après le « Brexit », rassemblant : M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, M. Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, M. Marcel Grignard, président de Confrontations Europe et Mme Anne Macey, déléguée générale et M. Yves Bertoncini, directeur de l’Institut Jacques Delors
M. le président Claude Bartolone. Madame, messieurs, nous sommes heureux d’accueillir ce matin plusieurs représentants des cercles français de réflexion sur l’Europe. Nos travaux et nos déplacements nous ont déjà montré combien nous devions être attentifs aux négociations qui vont s’enclencher. La Grande-Bretagne, de son côté, commence à s’organiser : la Chambre des Communes a voté l’obligation pour le Gouvernement d’indiquer ses intentions en échange de l’autorisation d’activer l’article 50 du traité ; la décision de la Cour suprême, qui doit décider de la procédure qui sera utilisée, est attendue pour début janvier.
Les Vingt-Sept doivent s’entendre pour négocier. Et l’avertissement que représente pour l’Union européenne le vote britannique doit être entendu : c’est la première fois qu’un pays s’estime mieux protégé en sortant de l’Union européenne.
M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Merci, M. le président, de nous recevoir ce matin. Plusieurs de vos interlocuteurs précédents ont travaillé ou publié à la Fondation Robert Schuman, et nous lançons à la fin de cette semaine un laboratoire de recherche consacré au Brexit ; nous avons fait réaliser dans cinq pays européens un sondage, qui sera publié par la presse, sur le sentiment des Européens vis-à-vis du Brexit : je vous en remets les résultats en avant-première.
Vous savez que le Brexit n’est pas encore fait ; ce sera un processus de négociation long et complexe. Nous souhaitons que la négociation se déroule dans la sérénité, sans esprit de revanche ou de punition, mais dans le respect des règles européennes. Les Vingt-Sept doivent donc être très unis, et ne pas devancer les demandes britanniques en se montrant prêts à y répondre ; ces demandes ne sont d’ailleurs pas toutes connues, et parfois contradictoires. Le pire serait que le continent se divise, et fasse l’objet d’une négociation « curiacée » : ce serait en réalité préjudiciable à tous.
On tentera vraisemblablement d’aboutir à un accord de retrait. Mais, quoi qu’il en soit, avec ou sans le Royaume-Uni, avec ou sans accord, l’Union européenne – nous en sommes convaincus – continuera d’exister, comme elle existait avant l’adhésion britannique.
Cela ne veut pas dire que l’Union ne doit pas changer. Nous ne pensons pas qu’il faille « refonder » l’Europe, comme on l’entend trop souvent, mais qu’il faut l’adapter, en considérant qu’elle a réussi une première partie de son projet initial, et l’a même dépassé. Il est nécessaire aujourd’hui de lui fixer de nouveaux objectifs pour répondre à de nouveaux défis. À mon sens, les fondations de la maison Europe demeurent solides ; ce sont ses murs et ses façades qui demandent à être rénovés.
Il y a aujourd’hui de nouvelles tendances, de nouveaux défis, des surprises stratégiques qui résultent de bouleversements technologiques et géopolitiques : l’Europe doit apporter des réponses à ces évolutions. Cinq sujets me paraissent essentiels pour les démocraties et plus particulièrement pour les politiques européennes.
Il faut d’abord mentionner les libertés économiques, le rôle de l’État, le libre-échange, le commerce international.
Je pense également au rôle des institutions européennes dans ce cadre : doivent-elles par exemple négocier seules des accords de libre-échange ou des accords commerciaux ?
Le troisième de ces sujets, c’est la liberté de circulation, et le défi migratoire, qui est là pour durer.
Le quatrième de ces sujets, c’est la convergence et la gouvernance économiques de l’euro, qui posent des problèmes de souveraineté et de contrôle démocratique.
Enfin, le terrorisme et les guerres que nous menons au Levant constituent pour l’Europe une surprise stratégique : le cinquième sujet, c’est donc la sécurité et la défense.
Désormais, on peut dire que la politique d’élargissement est stoppée. On peut dire que la politique de concurrence est de plus en plus critiquée. On peut s’interroger sur la nécessité de la repenser – beaucoup appellent notamment de leurs vœux une refonte de la politique industrielle européenne. J’irai enfin jusqu’à dire qu’il faut modifier le logiciel des institutions communes. M. Jean-Claude Juncker le dit lui-même : nous avons trop réglementé ; le droit est indispensable au fonctionnement des institutions européennes, mais il ne doit pas constituer une fin en soi. Le mantra de « l’union sans cesse plus étroite » ne suffit pas : l’utilité même de l’intégration doit désormais être prouvée.
Sur tous ces points, la pratique de la Commission Juncker a déjà changé ; elle a même pris des libertés avec les traités.
Mais nous regrettons l’absence de parole forte des États membres sur ces interrogations partagées partout en Europe. La différence entre politiques communautaires et politiques intergouvernementales n’est pas la bonne grille d’approche pour fixer de nouveaux objectifs à l’Union : les avancées sont toujours venues de la volonté des États membres.
À l’avenir, l’intégration se fera, je crois, par l’exemple. Les États membres doivent exercer pleinement leurs compétences propres : l’immigration, par exemple, n’est pas une compétence des institutions communes.
En matière d’union économique, nous pourrions aussi attendre des initiatives – notamment franco-allemandes : je pense par exemple à un plan de rapprochement de nos fiscalités, en commençant par l’impôt sur les sociétés, puis en élargissant peu à peu à des problèmes aussi complexes que la parafiscalité, notamment sociale. Pour un rapprochement sur dix ans, chacun devrait faire chaque année un vingtième du chemin vers l’autre. Nous changerions ainsi la façon dont les investisseurs internationaux voient une union économique franco-allemande, puis européenne.
S’agissant des mouvements migratoires, les États les plus concernés pourraient également prendre des initiatives communes pour harmoniser les conditions d’octroi de l’asile et de gestion des migrations – délai, procédure, aides financières…
Nous pourrions également organiser la défense de l’Europe, au lieu de passer notre temps à nous interroger sur l’organisation de la défense européenne. Nous avons ainsi proposé un traité à trois rassemblant l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Il aurait pour objet de rassurer nos amis britanniques, mais aussi certains États membres sur notre engagement dans l’OTAN. Il autoriserait aussi les États de l’Union à construire une défense européenne qui rencontre les grandes difficultés que nous connaissons. Ce traité pourrait fixer des objectifs que le ministre de la défense M. Jean-Yves Le Drian a récemment rappelés – 2 % du PIB consacrés à la défense –, mais aussi organiser une coopération entre nos trois pays. Nos armées collaborent d’ailleurs déjà.
Ce projet pourrait permettre de débloquer l’idée d’une défense européenne, qui, aujourd’hui, piétine, malgré une initiative franco-allemande due à M. Le Drian et à son homologue allemande Mme Ursula von der Leyen. Au sein de l’Union européenne, les questions de défense sont un atout pour la France : c’est un domaine où nous sommes très crédibles, car nous sommes les seuls à disposer d’une armée complète, engagée en ce moment même sur plusieurs fronts.
Il me semble donc essentiel de fixer à l’Union européenne de nouveaux objectifs, et des objectifs précis. Au risque de vous surprendre, je rejoins sur ce point M. Hubert Védrine, qui a souhaité l’organisation d’une deuxième Conférence de Messine – je n’irai peut-être pas jusque-là, mais il faut à mon sens que les États membres disent clairement ce qu’ils attendent de l’Union européenne, profitant du fait que M. Jean-Claude Juncker a compris que l’Europe doit être plus politique.
Plus que des États malades de l’Europe, je crois que l’Europe est aujourd’hui malade de ses États. Ceux-ci doivent être plus actifs, plus impliqués. De grands débats vont se dérouler l’an prochain en France puis en Allemagne : ce sera, je l’espère, l’occasion pour nos États de s’engager plus avant dans la construction européenne et son avenir.
M. Claude Bartolone. M. Pisani-Ferry, j’espère vous entendre sur le texte que vous avez commis cet été, et qui a provoqué un certain émoi en suggérant de séparer la libre circulation des personnes des trois autres libertés. C’était là une proposition bien pro-britannique !
M. Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie. Je ne manquerai pas de revenir, M. le président, sur ce texte « infâme », que j’ai signé à titre personnel. (Sourires.)
Je commencerai néanmoins par dire quelques mots plus généraux. La crise européenne ne se résume pas au Brexit. Aujourd’hui, nous avons collectivement le sentiment que nous ne sommes pas capables d’aller de l’avant, que nous ne voulons pas reculer, et que nous ne voulons pas demeurer dans la situation inconfortable où nous nous trouvons. Le sentiment général est que le moment n’est pas bon pour élargir encore l’Union européenne ; d’un autre côté, en dépit de toutes les difficultés que nous connaissons, personne n’a voulu sortir de l’euro. Donc il n’y a ni avancées franches ni reculs prononcés ; mais le statu quo ne satisfait personne.
Il est donc nécessaire de rouvrir la discussion, de façon libre, c’est-à-dire en se permettant de réexaminer certains éléments du contrat, de proposer d’aller de l’avant dans certains domaines, mais aussi de renationaliser d’autres politiques. Il faut en tout cas réfléchir en oubliant l’approche traditionnelle selon laquelle toute discussion a pour objet de franchir une nouvelle étape vers l’intégration – ce qui peut être nécessaire dans certains domaines, mais pas dans tous.
Dans le contexte général de la mondialisation et de la montée des populismes, il me semble qu’il existe aujourd’hui un doute sur le contrat fondamental qui stipule qu’en matière économique et sociale, l’Union s’occupe de l’efficacité et les États membres de la redistribution et du partage des revenus. C’est évident en matière commerciale : l’Union soutient et promeut la libéralisation, tandis que les États membres se préoccupent des conséquences de ces politiques. Cela veut dire que ce sont les États qui doivent gérer les « perdants de la mondialisation », tandis que l’Union est relativement absente de ces débats. Elle est inexistante dans les débats sur les inégalités, quand elle n’apparaît pas comme indifférente aux conséquences de ses propres politiques, voire comme entravant des politiques nationales destinées à corriger les effets de ces politiques.
C’est un problème grave d’économie politique : cette répartition des rôles a très bien fonctionné pendant longtemps, parce qu’elle préservait l’indépendance des États en matière de politique sociale tout en laissant à l’Union européenne le soin de soutenir le développement économique. Aujourd’hui, cela ne marche plus, et les États membres se retournent contre une Union qui, je le redis, est absente des débats sur la montée des inégalités. Cela nous ramène au Brexit et à l’interprétation du vote britannique.
À mon sens, la sortie britannique peut aussi nous permettre de rouvrir certains sujets qui étaient jusque-là bloqués.
Je pense par exemple au budget européen, qui ne correspond pas aujourd’hui à ce que nous pourrions espérer, tant en ce qui concerne ses priorités que ses niveaux d’action. On peut se demander si l’échelle régionale est la plus judicieuse. N’aurions-nous pas besoin de politiques beaucoup plus fines, plus temporaires aussi, destinées par exemple à absorber des chocs et à revitaliser des régions, mais aussi de politiques d’investissement dans le capital humain plus que dans le développement régional ? Aucun bilan exhaustif n’a été dressé, mais la crise de l’euro a montré, je crois, que ces politiques régionales n’ont pas vraiment contribué à une meilleure résilience économique des pays qui en ont bénéficié.
De même, les Britanniques étaient, pour des raisons doctrinales, les principaux opposants à l’ouverture d’une discussion sur la question fiscale : nous pourrions rouvrir ce débat.
J’en viens maintenant au texte que vous avez mentionné, M. le président, et que j’ai rédigé avec d’autres, tous agissant à titre personnel. Notre idée était que le Brexit nous faisait courir des risques substantiels, et que son coût économique direct pourrait être important – et cela d’autant plus que l’on s’achemine vers un divorce pur et simple. Il existe aussi un risque d’affaiblissement de l’Europe, dans un contexte particulièrement instable et dangereux ; un risque d’accélération de notre disparition collective de la scène mondiale, alors que s’affirment des puissances nouvelles ; un risque, enfin, d’accentuation de la concurrence budgétaire et fiscale sur le continent européen.
Mais le Brexit offre aussi, à notre sens, des opportunités, et notamment celle de réfléchir à la façon dont l’Union européenne organise les relations avec son voisinage, dans un nouveau contexte où les perspectives d’élargissement sont quasi inexistantes, où il nous faut pourtant trouver une solution, s’il en est encore temps, à la question turque, et plus largement où il est nécessaire de proposer des solutions à d’autres pays qui n’ont pas vocation à rentrer dans l’Union, mais qui entretiennent et entretiendront néanmoins des relations étroites avec elle.
Notre idée était donc de faire du Brexit l’occasion d’une réflexion sur une nouvelle organisation de l’espace européen, qui comprendrait un cercle très intégré autour de l’Union – cercle qui se rapprocherait fortement, à terme, de la zone euro – et un cercle plus large, dont les liens avec l’Union seraient différents, qui serait organisé autour de l’Union et plus multilatéral qu’aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons proposé ce « partenariat continental », destiné à associer à l’Union des pays qui n’en sont pas membres – le Royaume-Uni et les pays de l’espace économique européen, mais aussi demain l’Ukraine ou la Turquie, voire d’autres pays du pourtour méditerranéen. Ces pays seraient étroitement associés à la décision, de façon plus partenariale que ne sont les relations que nous avons aujourd’hui avec la Norvège par exemple. Ce partenariat serait construit sur une base strictement intergouvernementale – la sortie britannique constituant bien un refus de participer à l’Union et à sa gouvernance.
Je précise ici que ce texte est aujourd’hui largement caduc, compte tenu de l’orientation prise de part et d’autre.
Nous avions souligné trois problèmes à résoudre.
Le premier est celui du marché intérieur et des quatre libertés. Nous défendons dans ce texte l’idée que la liberté de circulation des personnes est fondamentale pour les pays membres de l’Union européenne : c’est un élément de citoyenneté économique. La possibilité pour un citoyen de l’Union d’aller chercher du travail ailleurs, sans demander la permission à personne, est essentielle, surtout aux yeux des jeunes, qui en font d’ailleurs largement usage.
En revanche, elle n’est pas indispensable au fonctionnement d’un marché intégré des biens et des services : celui-ci a besoin d’un degré élevé de mobilité, mais ce n’est pas la même chose que la liberté d’installation. L’idée que l’on ne puisse pas dissocier intégration économique et liberté de mouvement des travailleurs passe difficilement le test de l’analyse froide. C’est pourquoi nous avions proposé cet arrangement, qui aurait naturellement concerné uniquement des pays non membres de l’Union. Nous n’avons jamais pensé à remettre en cause la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union ! Les négociations avec l’Ukraine vont d’ailleurs dans le sens que nous indiquions : accès au marché intérieur, mais pas de liberté de circulation des personnes.
La deuxième question est celle des formes de l’association à la décision. Dans un partenariat continental, les pays non membres de l’Union ne pourraient évidemment pas détenir de droit de vote : l’Union doit préserver ses procédures propres de décision. En revanche, elle peut mettre en place des procédures de consultation étendues, permettant, au fur et à mesure de l’élaboration d’un texte, de recueillir des remarques et des propositions d’amendements des pays partenaires. Nous proposions donc un conseil du partenariat, où s’ouvrirait un dialogue sur les initiatives législatives.
La troisième question est celle de l’application des règles. Il est évident que l’on ne peut avoir accès au marché intérieur si l’on n’applique pas ses règles et si l’on ne se soumet pas à sa discipline. La politique de la concurrence, certaines normes sociales et de protection du consommateur sont essentielles ; leur respect doit faire l’objet d’une vérification, dont les mécanismes sont nécessairement supranationaux.
Voilà les propositions que nous avions faites. Il ne s’agissait pas pour nous de proposer un agenda du divorce, dont les négociations seront très dures et très complexes. Ce que nous voulions, c’est fixer un objectif à terme, suggérer une solution durable à la question des relations entre le Royaume-Uni et les Vingt-Sept. Nous espérions ainsi minimiser le coût pour les uns et les autres d’une séparation trop abrupte, mais aussi informer les conditions de la négociation du divorce, sans que les préoccupations tactiques la dominent à l’excès.
L’orientation que prend la discussion, de part et d’autre, n’est pas celle-là : les Britanniques sont intransigeants et les Vingt-Sept sont unanimes sur le fait que les quatre libertés sont inséparables. Reste que nous devons bien nous interroger sur les conséquences de ce divorce.
M. Marcel Grignard, président de Confrontations Europe. Les quatre organisations réunies ce matin ont beaucoup de points communs, mais aussi quelques différences : c’est ce qui fera la richesse de notre débat.
Je partirai d’un paradoxe : la plupart des défis auxquels nos pays sont confrontés devraient nous conduire à renforcer l’intégration européenne, mais partout en Europe, le repli national est à l’ordre du jour.
Le Brexit n’illustre pas une crise britannique, mais européenne, et au-delà une crise des pays occidentaux. Nous faisons face à une menace d’explosion ou de délitement de l’Union européenne : il faut y prendre garde.
Cette crise est d’abord économique et sociale – je ne reviens pas sur la faible croissance que connaît notre continent ni sur la croissance des inégalités. Elle résulte aussi d’une inquiétude de nos concitoyens face à des défis nouveaux en matière de sécurité, de changement climatique, de numérique ; ces inquiétudes poussent nos concitoyens au repli. La crise est enfin une crise démocratique : la méfiance croît vis-à-vis des institutions. Les Européens ont, plus largement, le sentiment d’être dépossédés de leur avenir.
C’est la nature de cette crise qui nous pousse à dire que l’Union européenne doit dire où elle veut aller dans les années qui viennent : c’est un passage obligé pour animer la négociation avec les Britanniques. Nous parlons, nous, de « se réinventer », de « se refonder » : les défis auxquels l’Union est confrontée ne sont pas sur la trajectoire tracée par les cinquante années de construction européenne. La profondeur du désarroi des Européens oblige à consentir un effort important.
On parle beaucoup de la distance qui sépare l’idée européenne, ou l’Union européenne, des peuples. Notre organisation travaille avec les acteurs économiques et sociaux des différents pays européens : eux aussi ressentent cette distance. Je ne prendrai qu’un seul exemple : celui du climat. La réussite de la COP21 nous amène à attendre de l’Union européenne une politique très forte en la matière. Or nous sommes absolument en panne, sur la question du prix du carbone comme sur l’établissement d’une stratégie – les États communiquent leurs stratégies, mais celles-ci entrent en contradiction les unes avec les autres. Nous sommes tout autant en panne sur le plan industriel : champions de l’installation d’équipements utilisant les énergies renouvelables, nous sommes pourtant incapables de construire des filières de production industrielle dans ce domaine. Cela montre la profondeur de la rénovation nécessaire.
Le Brexit sera hard : cela apparaît comme une évidence. Les Vingt-Sept doivent donc tenir bon sur les fondamentaux tels qu’ils existent aujourd’hui ; toute autre démarche serait suicidaire. Mais ce sera très difficile dans des délais très brefs. Il est un point sur lequel nous sommes particulièrement vigilants : un accord intérimaire qui déterminerait un calendrier en vue d’une série de négociations échelonnées dans le temps risquerait d’aboutir à une addition de concessions dans lesquelles les Vingt-Sept perdraient leurs objectifs stratégiques et d’intérêt commun au profit d’intérêts nationaux divers et fluctuants. Voilà pourquoi ils vont devoir dire très clairement ce qu’ils veulent faire ensemble demain.
Comment la chose est-elle perçue, nous demandez-vous, dans d’autres pays de l’Union européenne, particulièrement en Europe centrale ? Cette question est vitale, car l’une des faiblesses de la construction européenne est une grande difficulté à entendre et à comprendre les différences politiques, socio-économiques et culturelles entre nos pays, d’où une certaine tendance, au niveau des institutions européennes, à confondre union et uniformité. Pour notre part, nous sommes convaincus que le respect des différences n’est pas contraire à la solidarité ni à la communauté de destin, mais qu’ils doivent être intimement liés. Les dirigeants polonais et hongrois, notamment, trouvent dans le Brexit une confirmation de leur diagnostic sur le besoin d’une réforme profonde de l’Union européenne. Schématiquement, ils se posent en défenseurs de la souveraineté et de l’identité nationales et s’inquiètent d’une intégration plus poussée, en particulier au sein de l’union économique et monétaire ; ils veulent davantage d’intergouvernemental. Toutefois, les citoyens de ces pays, et probablement une partie de leurs dirigeants, restent attachés à l’idée et à l’Union européennes. Il n’y aura donc sans doute pas de tentative réelle de sortie de l’Union.
En revanche, il existe des inquiétudes, notamment concernant les fonds structurels. La sortie des Britanniques va obliger l’Union européenne à retrouver 10 milliards d’euros pour compenser les recettes manquantes et, si les mesures d’accompagnement, particulièrement les fonds structurels, venaient à diminuer, cela poserait dans ces pays des problèmes de croissance, mais également de gros problèmes d’adaptation au moment où des efforts considérables doivent être consentis.
Nous ne croyons absolument pas que la future dynamique européenne reposera sur un renforcement de l’intergouvernemental, contrairement à ce que disent par exemple les Polonais. En revanche, le besoin de réinventer et de réarticuler les relations entre l’union économique et monétaire et les États membres est évident. C’est, de notre point de vue, l’un des aspects d’une réinvention de l’Europe susceptible de réconcilier les citoyens avec le projet européen. À cet égard, nous ne croyons guère que quelque sommet de chefs d’État que ce soit permette de refonder l’Europe, une Europe qui prendrait en compte les attentes de ses citoyens. Cela ne veut pas dire que nous n’en attendons pas beaucoup des gouvernements ; au contraire. Mais, dans ce domaine, nous sommes assez sceptiques.
Nous ne croyons guère plus au référendum. Les trois consultations référendaires qui se sont déroulées en Europe cette année – au Royaume-Uni, en Hongrie, en Italie – mêlaient chacune, à des degrés divers, de vraies questions et des enjeux de politique partisane. Il est absolument nécessaire, et même vital en démocratie, de consulter les citoyens, mais il faut se méfier de l’instrumentalisation de cet outil et, surtout, ne pas oublier qu’il ne saurait combler le manque d’espaces de délibération, qui seuls permettent de dépasser l’opposition des intérêts dans chacun de nos pays et entre les pays européens. C’est d’autant plus vrai dans un monde dont la complexité est croissante et où les compromis sont de plus en plus difficiles à trouver.
Tout cela conduira certainement, si l’on avance dans le processus de refondation, à modifier les institutions, mais ce changement ne pourra intervenir qu’en conclusion de ce processus : il ne saurait être une clé d’entrée, compte tenu de la nature de la crise que nous connaissons.
Mme Anne Macey, déléguée générale de Confrontations Europe. C’est la question de l’avenir de l’Union qui nous est posée, et du risque de son délitement. Le problème de fond est le suivant : malgré la défiance qui s’est installée, qu’acceptons-nous de partager entre Européens, entre peuples européens, au sein de la zone euro et de l’Union européenne, et dans quel dessein ? C’est ce qu’il importe de se demander au lieu de commencer par des institutions et des traités, ne serait-ce que parce qu’ils ne peuvent pas nous être imposés d’en haut, mais supposent que l’on rapproche au préalable les peuples et les nations.
J’aborderai d’abord la consolidation de l’union économique et monétaire – le premier cercle – et ce que le Brexit y change. Mais cette consolidation n’est pas possible sans celle de l’Union européenne. Les Britanniques pourraient être inclus dans un troisième cercle. Enfin, j’évoquerai le besoin d’union politique.
Sur le premier point, le principal défi auquel nous sommes aujourd’hui confrontés résulte des déséquilibres des balances des paiements courants et des divergences de trajectoire de compétitivité industrielle, qui menacent l’intégrité de l’Union et plus encore celle de l’union monétaire. Le départ des Britanniques change la donne, puisqu’ils n’auront plus leur mot à dire sur cette consolidation. Mais, à l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus, notamment franco-allemand, sur les grandes réformes qui ont été esquissées et dont nous avons besoin, en particulier s’agissant de la conciliation entre la solidarité et la mutualisation des investissements, d’une part, et d’autre part les indispensables réformes de structure nationales qui ne sont pas nécessairement mises en œuvre. La Commission prépare un livre blanc sur le sujet pour le printemps ; l’enjeu est précisément de parvenir à un accord entre États membres – ce qui impose à chacun un travail sur soi.
Cette consolidation, je l’ai dit, n’est pas envisageable sans une consolidation de l’Union européenne. À ce propos, il convient de noter un certain tropisme français qui nous incite à nous concentrer sur la zone euro alors que des questions absolument essentielles – la stratégie de compétitivité industrielle, l’union pour l’investissement ou union des marchés de capitaux, la sécurité intérieure et extérieure, les migrations, le climat, la politique extérieure – se décideront plutôt au niveau de l’Union européenne. Celle-ci ne doit pas être réduite à un grand marché, contrairement à ce que les Français ont tendance à faire, mais intégrer aussi des dimensions de politique publique européenne. Par ailleurs, en nous repliant sur la zone euro, nous échouerions à atteindre la masse critique requise et nous renoncerions à l’idéal fondateur d’union de tous les Européens.
Cette union doit donc tenter de devenir une union pour l’investissement. Nous souffrons en Europe d’une carence majeure d’investissements – en capital humain, dans l’innovation industrielle, transfrontières. Or ces investissements se traduisent en production et en emplois sur tout le territoire européen, et non dans la seule zone euro, et permettent de gagner en compétitivité, donc de parer au risque de divergences qui pourraient faire exploser l’Union.
Enfin, nous avons besoin d’union politique, à un moment où les peuples doutent de l’Union – non qu’ils la remettent entièrement en cause, mais parce qu’ils s’interrogent sur la direction qu’elle prend et la manière dont elle se construit depuis le début. Ils ont le sentiment que les politiques européennes sont imposées d’en haut, ce qui n’est plus admissible pour la plupart d’entre eux, notamment pour le peuple français.
Nous aurions besoin d’un traité de refondation de l’Union, mais toutes les conditions n’en sont pas pour l’heure réunies : il faudrait s’accorder sur beaucoup alors que nous ne sommes prêts à nous accorder que sur très peu, comme le disait M. Philippe Herzog, président fondateur de Confrontations Europe. L’enjeu est donc de parvenir à s’accorder sur des domaines d’intérêt stratégique commun dans lesquels il serait possible de développer des coopérations renforcées : par exemple, la sécurité collective, l’investissement dans le capital humain et l’innovation – un domaine où l’Union est aujourd’hui beaucoup trop faible –, le climat et le développement durable ou encore la réindustrialisation.
Dans ce cadre, quelle est actuellement la place du Royaume-Uni en Europe ? Les Britanniques ont décidé de sortir de l’Union, donc du deuxième cercle ; il convient d’en prendre acte. Ils restent cependant un partenaire essentiel, dont il faut par conséquent prévoir la place au sein d’un troisième cercle. Confrontations Europe propose un statut d’État associé qui pourrait être étendu à d’autres, mais qui serait ad hoc – à rebours du one size fits all – et prendrait la forme d’une sorte de contrat négocié avec le Royaume-Uni.
L’union politique a besoin de réformes de fond, pour une véritable autorité politique qui assume entièrement ses responsabilités, dans le dessein non pas d’imposer quoi que ce soit d’en haut, mais de rapprocher les perspectives dans les domaines d’intérêt stratégique, par l’intermédiaire de quelques ministres. Peut-être faudrait-il également aller vers la synchronisation des élections nationales et des élections européennes, et resserrer de plusieurs crans la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux – à cet égard, la balle est dans votre camp.
M. Yves Bertoncini, directeur de l’Institut Jacques Delors. Je commencerai par un constat sur le vote du 23 juin dernier : il s’agit d’un choix démocratique dont il faut évidemment tenir compte. L’Union européenne n’est pas une prison ; le vote britannique a le mérite de nous le rappeler. C’est une différence notable avec l’Union soviétique à laquelle on lui reproche souvent de ressembler. Les Britanniques ont fait ce choix que, pour ma part, je regrette, mais dont nous devons prendre acte.
Pour l’Institut Jacques Delors, il s’agit d’un cas d’espèce. Les Britanniques étaient depuis le début à moitié dans l’Union, à moitié dehors, suffisamment peu convaincus de la nécessité d’appartenir à la Communauté économique européenne pour organiser un référendum d’appartenance deux ans après l’adhésion, ce qui était assez original et signalait bien un malaise. Ce cas d’espèce s’intègre certes dans un contexte international, dans une tectonique des plaques qui concerne l’ensemble des pays européens et, de manière générale, occidentaux, dont les États-Unis ; mais, lorsqu’il s’agit de discuter de la sortie ou non, de l’appartenance ou non à l’Union européenne, c’est bien un cas d’espèce.
Il ne faut pas confondre l’europhobie majoritairement exprimée par les Britanniques, et qu’incarnaient si bien leurs tabloïds, avec les euroscepticismes. Ceux-ci existent sur notre continent depuis des années, y compris parce que l’Union européenne a agi, même si elle l’a fait trop peu et trop tard, face à la crise de la zone euro. Son action a suscité un euroscepticisme anti-austérité qui est l’exact pendant de l’euroscepticisme antisolidarité. Les Allemands, les Slovaques, les Finlandais n’ont pas aimé être solidaires. Les Grecs, les Irlandais, les Portugais n’ont pas aimé les conditions dans lesquelles cette solidarité a été accordée. On pourrait dire la même chose à propos de la crise migratoire.
En bref, nous assistons aujourd’hui en Europe à une crise de copropriétaires. Les Britanniques déménagent, les autres vont rester. Dire cela, ce n’est pas minimiser ce genre de crise, qui peut être terrible : on ne se parle plus, on ne veut plus payer les charges communes, etc. Mais il importe de bien caractériser la situation.
Dans ce contexte, que faire ? M. Jacques Delors évoque souvent à propos de la construction européenne les pompiers, les maçons et les architectes : ce sont ces trois corps de métier qui vont devoir se mettre en mouvement – disons-le tout de suite, nous manquons un peu d’architectes.
Les pompiers, d’abord, doivent non pas éteindre l’incendie parce qu’il risquerait de se propager selon la théorie des dominos, mais organiser un divorce. Les Britanniques ont voté : ils vont partir ; comment ? Je dirais qu’ils ont tiré les premiers, mais que la balle est toujours dans leur camp : il ne faut pas les devancer ; c’est d’ailleurs sans doute la manière dont il tentait de le faire qui m’a le plus choqué dans l’article cosigné par M. Jean Pisani-Ferry.
Les Britanniques ont d’autant plus de mal à savoir ce qu’ils veulent que le « non » à l’Europe était divers : il se composait d’un « non » souverainiste, qu’incarnait bien M. Boris Johnson ; d’un « non » anti-libre circulation, anti-immigration, représenté par M. Farage ; enfin – ne l’oublions pas –, de celui de M. Murdoch, très libéral, qui veut sortir de l’Europe pour retrouver des marges de manœuvre dans les relations commerciales, en particulier avec les pays émergents. Qu’ils se mettent d’accord ! Rendons à Shakespeare ce qui est à Shakespeare.
De notre côté à nous, Européens, le menu est varié : statut à la norvégienne, à la suisse, à la canadienne, à la turque – à eux de choisir. Mais ils voudront évidemment commander à la carte ; et ils auront, je crois, un statut à la britannique. Ils l’avaient déjà en étant membres de l’Union ; ils le rechercheront lorsqu’ils ne le seront plus. Peut-être aurons-nous d’ailleurs intérêt à leur concéder deux ou trois aménagements pour qu’ils se sentent à l’aise, car ils devront rester notre partenaire stratégique. Cela dit, je le répète, laissons-les exprimer leurs désirs et lancer eux-mêmes la procédure.
Venons-en aux maçons et concentrons notre attention sur l’Union européenne à vingt-sept, à l’heure où un Conseil européen se réunit dans ce format. Que peuvent faire les Européens à vingt-sept, sinon s’efforcer de ne pas se désunir dans la gestion du divorce avec les Britanniques ? Ils doivent évidemment se concentrer sur plusieurs projets communs, qui ont été assez bien identifiés à Bratislava. On peut également citer l’union de l’énergie, que nous promouvons au sein de l’Institut Jacques Delors depuis de nombreuses années ; l’approfondissement de l’union économique et monétaire, à propos duquel nous avons aussi produit des documents en franco-allemand ; le soin à apporter à la conduite des politiques commerciales européennes, laquelle doit être plus transparente.
À Bratislava, plusieurs éléments se dégagent, à commencer par les enjeux de migration et de frontières, identifiés comme essentiels par les Vingt-Sept et qui renvoient à ce que souhaitent les opinions publiques. Nous devons avancer dans cette direction, et c’est ce que vont faire, je l’espère, les chefs d’État et de gouvernement aujourd’hui et demain. Un corps européen de garde-frontières va se mettre en place ; c’est une avancée fédérale qu’il faut consolider. Mieux vaut contrôler ensemble nos frontières européennes plutôt que rétablir ponctuellement des contrôles à nos frontières nationales, même si cette démarche est tout à fait autorisée. Harmonisons aussi le droit d’asile. Tout cela dessine un chemin.
Un autre chemin est celui de la sécurité collective, dans un contexte favorable du fait de la sortie du Royaume-Uni, d’une part, et de la victoire de M. Donald Trump, d’autre part. Il s’agit d’abord de la sécurité intérieure. Nos compatriotes, français et européens, se sont fait tuer par des terroristes au cours des mois précédents ; cela arrivera peut-être à d’autres : la menace demeure. Face à cette menace, il faut renforcer la coopération judiciaire, policière et l’échange de renseignements. Ce n’est pas facile, mais nous en avons grand besoin.
Il s’agit ensuite, naturellement, de la sécurité extérieure. Le pilier européen de la défense atlantique doit être consolidé. Tout nous y pousse désormais. L’Europe de la défense a été lancée à une époque où nous n’avions pas besoin de nous défendre et où il n’y avait pas d’Europe : cela ne facilitait pas la tâche. Aujourd’hui, au contraire, les menaces sont partout autour de nous – la Russie, l’État islamique, le chaos en Syrie, la Libye, le Sahel – et peut-être y aura-t-il une véritable Europe de la défense dès lors que l’oncle Trump pourrait ne pas nous aider autant qu’il le faudrait et que le Royaume-Uni, qui doit rester un acteur important, ne sera plus membre de l’Union européenne.
Il s’agit, enfin, de l’investissement et de la priorité accordée à la croissance et à la jeunesse. La capacité financière du plan Juncker a été tout récemment accrue ; il faut s’en féliciter. Le programme Erasmus Pro va être expérimenté, comme nous l’avions proposé ; nous nous en réjouissons.
Mais, une fois que les maçons auront défini leur feuille de route, une fois qu’ils auront, aujourd’hui et demain, progressé à ce sujet, si nous ne disons pas où nous allons, nous ne susciterons que l’enthousiasme modéré des peuples – même s’ils sont divisés quant à la destination de l’entreprise européenne. M. Jean-Dominique Giuliani a eu raison de souligner que ce qui a été fait jusqu’à présent est un succès. Il faut maintenant aller plus loin, peut-être sur un mode différencié : si tout le monde n’est pas prêt à avancer, faisons-le à quelques-uns ! Quoi qu’il en soit, il faut situer toutes ces réalisations dans une perspective d’ensemble. À l’heure où nous sommes amputés d’un membre, il est d’autant plus essentiel de nous demander pourquoi nous restons ensemble.
Premier élément de cette vision d’ensemble : il faut redonner un sens à l’Union européenne comme espace d’opportunités et surtout, en temps de crise, comme réponse aux menaces, à condition de se donner le temps et l’énergie politique de nommer celles-ci – sans quoi c’est l’Union elle-même qui peut apparaître comme une menace. Aux menaces sécuritaires déjà mentionnées s’ajoute d’abord le changement climatique, qui fournit un bon exemple de la capacité de mobilisation européenne : une fois la menace identifiée, les Européens, unis dans leur diversité, ont entraîné le monde vers la signature de l’accord de Paris sous l’impulsion de la France. Ensuite, la finance folle : que font les Européens pour lutter contre elle ? Quant à la montée en puissance de la Chine, c’est aussi une menace supplémentaire, et non pas seulement une opportunité.
Deuxièmement, au moment où les Britanniques s’apprêtent à nous quitter, nous devons essayer de montrer ce qui nous unit dans notre diversité. Nous représenterons bientôt 6 % de la population mondiale. Nous sommes évidemment différents les uns des autres, mais de la même façon qu’un Aquitain est différent d’un Nordiste ! Il faut regarder le monde pour se sentir plus européens. Nous sommes unis par un modèle qui tente de concilier efficacité économique, cohésion sociale et protection de l’environnement ; un modèle dont on verra comment, avec M. Donald Trump, l’Amérique va s’éloigner encore davantage : car c’est un modèle européen, et non pas seulement occidental. On le mesure aussi au regard de la Chine. Nous sommes européens parce que nous avons en partage la démocratie, l’État de droit, le respect des minorités, l’égalité entre les hommes et les femmes. Nous devons en être fiers, souligner que cela nous unit. Nous sommes européens parce que nous avons appris à privilégier le règlement pacifique des différends ; nous n’envoyons pas des soldats sans uniforme se faire tuer en Ukraine : nous ne sommes pas les Russes ! Il faut affirmer plus clairement notre identité et notre vision européennes.
Dans une crise de copropriétaires, ceux-ci peuvent continuer d’avoir intérêt à rester ensemble – comme cela arrive dans les divorces, pour les enfants. Si les copropriétaires de la maison européenne se donnaient la peine de regarder ce qui se passe sous leurs fenêtres – tout brûle autour de nous ! – et un peu plus loin, peut-être ressentiraient-ils davantage la nécessité de mettre en œuvre des projets collectifs, mais aussi le sens de leur appartenance à l’Union européenne. C’est important, même si cela paraît purement conceptuel : là est aussi le défi que nous ont lancé les Britanniques en nous annonçant leur départ.
M. le président Claude Bartolone. Nous en venons aux questions des membres de la mission d’information.
M. Gilles Savary. Merci à tous les intervenants pour leurs exposés, tous très intéressants par-delà les différences d’analyse.
Je ne partage pas la thèse selon laquelle le Brexit serait une exception accidentelle. Certes, il existe historiquement une spécificité britannique qui distingue le grand large du continent, mais j’observe que la construction européenne a une image très dégradée, ou du moins qu’elle suscite une très forte interrogation, dans pratiquement tous les milieux. Cette interrogation est motivée par la crise identitaire, qui renvoie à l’impuissance européenne présumée à contenir les flux migratoires et à défendre notre territoire, et par la crise sociale, qui renvoie à une autre forme d’impuissance face à la mondialisation, l’Europe étant même considérée comme le porte-avions de la mondialisation et du déclassement. Ces deux éléments, très dangereux, conduisent l’Europe à marcher sur un fil.
Je suis tout à fait d’accord pour dire que de nouvelles urgences se sont fait jour, auxquelles nous devrions pouvoir répondre : la sécurité, les frontières, l’asile, etc. Dans ces domaines, l’Europe agit, et assez vite. Nous devons reprendre cette démarche pragmatique s’agissant de nouvelles politiques.
Mais il nous faut être clairs quant à l’articulation entre la nation et l’Union. Nous – nous-mêmes, Français – ne cessons d’entretenir l’équivoque. Quand un problème nous gêne, c’est la faute de l’Europe. On suggère ainsi que l’Europe est une nation. Mais on ne peut pas dire « l’Europe a décidé » : l’Europe, c’est nous ! Tout le monde dans ce pays est capable de comprendre, si on le lui explique, que l’Europe est plutôt une communauté de communes ou un syndicat de communes qu’une nation qui décide et qui nous impose ses décisions.
Il est urgent de reprendre le contact avec l’opinion. Nous avons fait une construction politique par la voie juridique, et non par la voie démocratique. Or on ne peut plus contourner la voie démocratique quand on est débordé par les réseaux sociaux où circulent toutes sortes de rumeurs.
D’où ma question, quelque peu paradoxale : sachant que nous sommes paralysés lorsqu’il s’agit de réformer les traités, à moins de satisfaire la revendication référendaire qui ferait tout disjoncter, ici comme au Royaume-Uni, la reconquête de l’Union ne passe-t-elle pas par celle des opinions publiques nationales ? N’est-ce pas dans l’espace public national qu’il faut résoudre le problème ?
Je pourrais poser la même question aux politiques, et je crains le pire dans les semaines à venir. Nous vivons une panne terrible : le seul espace public acceptable pour la population est l’espace public national. Or, dans cet espace, on ne l’informe pas de ce que fait l’Europe, dont on a au contraire tendance à parler de manière uniquement péjorative.
Les évolutions actuelles en matière de protection des frontières sont rapides ; il ne s’agit pas seulement de Frontex, mais aussi du fameux document d’autorisation d’entrée en Europe, sur le modèle de l’autorisation américaine – bref, d’éléments très concrets. Qui le sait en France ? Qui, dans notre pays, a conscience du fait que, grâce à l’Europe, nous avons évité le pire dans la crise des dettes souveraines, même si cela a été très pénible ?
Dans cette matière, ce n’est pas seulement Bruxelles qui est interpellée, mais nous-mêmes, directement. C’est un problème de transparence et de pédagogie : il faut expliquer ce qu’est l’Europe, ses forces comme ses faiblesses. La fuite en avant dans de nouveaux projets européens et de nouveaux traités est impossible. Soyons donc au moins clairs avec nos opinions publiques. Qu’en pensez-vous ?
Mme Élisabeth Guigou. Je vous remercie à mon tour de ce que vous avez dit, qui nous aide beaucoup à réfléchir ; c’est très intéressant et plus que jamais nécessaire.
Je partage l’analyse selon laquelle le Brexit ne fait que révéler une crise profonde. Tout dépend de la façon dont nous allons y répondre. Cessons donc de nous interroger : nous prendrons acte de la décision britannique, même si nous la déplorons ; mais c’est d’abord de nous que dépend l’évolution de la situation, de nous qui restons au sein de l’Union européenne.
Je ne m’attarderai pas sur l’article de M. Jean Pisani-Ferry, auquel j’avais d’ailleurs immédiatement réagi lors d’un dîner à l’ambassade du Royaume-Uni où nous étions l’un et l’autre conviés, en faisant valoir que l’on n’entre pas dans une négociation en abandonnant le principe de l’unité du marché intérieur ; mais M. Jean Pisani-Ferry en prend maintenant acte, et nous sommes passés à autre chose.
Je crois moi aussi essentiel de réfléchir à la future architecture européenne, et d’écarter l’éventualité d’un partenariat unique qui s’appliquerait au Royaume-Uni comme à la Turquie : une approche différenciée sera nécessaire. Je partage le point de vue selon lequel il vaut mieux réfléchir à une forme d’accord d’association renforcée, en prêtant attention à ce que veut le Royaume-Uni ; j’espère que le pays fera les concessions nécessaires pour être le plus proche possible de l’Union européenne.
En vue de notre rapport, il importe de bien situer le principal problème auquel l’Union européenne est aujourd’hui confrontée, à savoir l’éloignement des peuples. Sur ce point, je suis d’accord avec ce que vient de dire M. Gilles Savary. Cela va nous obliger à nous demander comment remédier aux défauts de l’Union européenne, à recentrer nos objectifs – comme vous l’avez tous dit – sur des priorités compréhensibles par les peuples, et non sur des réglementations que personne ne comprend et qui, souvent, insupportent, à juste titre. Enfin, il faudra adapter nos moyens. Sur tous ces sujets, vous avez formulé des propositions intéressantes.
Le big bang institutionnel… on s’y est essayé en 2005. À l’évidence, ce ne peut être que l’aboutissement d’une réflexion démocratique sur les projets que l’on veut poursuivre avec les peuples – et il est faux de prétendre que l’on puisse du passé faire table rase. Quelles sont donc les réussites, même imparfaites, de la construction européenne ? L’espace Schengen, l’euro, Erasmus. Ce sont trois desseins précis, mais pour la réalisation desquels les moyens, notamment institutionnels, ont par la suite été quelque peu comptés.
Notre entreprise collective doit être de définir mieux encore ce qui nous unit et de mieux répondre aux peurs des peuples, à la hantise du déclin économique et social – nous ne pouvons faire l’impasse sur le chômage des jeunes ! Il nous faut aussi réussir à régler la crise suscitée par les migrations et assurer la sécurité collective. Il est heureux que le Conseil européen se consacre aujourd’hui même – enfin ! – à ces questions ; il serait bon de reprendre la proposition tendant à la tenue de ce Conseil ad hoc au moins une fois par an. Et puis, parce que les peurs des peuples européens ne tiennent plus seulement aux difficultés internes à l’Union, mais aussi à l’évolution du monde, il faut déterminer les composantes extérieures de toutes les politiques européennes sans exception. Nous devons enfin réfléchir à une nouvelle architecture institutionnelle pour une Europe « unie dans la diversité », comme le veut sa devise.
Dans un contexte d’extrême gravité, puisque le risque de dislocation et de désintégration de l’Union européenne est réel, vous, qui, à quelques nuances près, partagez la même envie que l’Union européenne s’en sorte, ne pourriez-vous définir ensemble ce qui nous unit tous ?
M. Jacques Myard. Vous entendre vous interroger, madame, messieurs, est pour moi un plaisir sans mélange. Enfin ! Vous, que beaucoup considéraient comme des « euro-béats » convaincus, commencez à questionner la faillite d’une construction européenne qui ne peut aller de l’avant sur sa lancée actuelle.
Pour commencer, deux axiomes s’imposent. Le premier est que, si le Royaume-Uni est sorti d’une organisation internationale qui a pour nom « Union européenne », il n’est pas sorti de l’Europe ; les lois de la géographie valent pour le Royaume-Uni comme pour le reste de l’Europe. Le second est que, comme l’a rappelé M. Gilles Savary, la démocratie s’exerce au niveau de la cité et de la nation, lieux de cohésion culturelle que ne sont ni un continent ni l’Organisation des Nations unies.
Ensuite, comment en est-on arrivé là ? Le projet d’Union européenne est né dans les années 1950, à juste titre, pour éviter une nouvelle guerre franco-allemande. La tentative de Gustav Stresemann et la Société des Nations ayant échoué, il fallait trouver autre chose. On y a réussi, non par un traité et des règles, mais grâce à une révolution culturelle, l’Allemagne ayant compris qu’elle devait vivre en harmonie avec ses voisins. Mais, parce que l’on pensait en fonction de ce qu’était le monde d’alors, celui des blocs, le projet a été de constituer un bloc européen entre le bloc américain et le bloc soviétique, et l’on a poursuivi sur cette voie, celle d’une Union européenne unique au point d’en devenir intégriste. Cet intégrisme, sous sa forme la plus achevée, l’euro, est en train de tuer l’Europe, car une monnaie commune à des économies divergentes, sans budget fédéral, est vouée à l’échec – et l’euro échouera. Un jour qu’il était reçu dans cette salle, j’ai eu l’occasion de dire à M. Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, qu’il avait bien du courage d’être à la tête du Titanic, lui rappelant la longue liste des cinquante monnaies uniques mortes depuis un siècle. On a rêvé un monde qui n’existe pas ; il faut abandonner ce logiciel intégriste et en appliquer un autre.
Au moment de l’élargissement de l’Union, M. Valéry Giscard d’Estaing, grand Européen qui, initialement, ne le voulait pas, m’avait dit : « Maintenant, il faut faire autre chose. » Seulement, cela n’a pas eu lieu. S’en est suivi le traité de Maastricht, contre lequel j’ai voté, et l’on a abouti à une « Europe-kibboutz » : tout le monde dort dans la même chambre et tout le monde veut tout faire. Cela ne peut pas fonctionner. D’une part, il faut repenser l’Union, qui doit maigrir en appliquant à la lettre le principe de subsidiarité pour ne traiter que de l’essentiel. D’autre part, les valeurs européennes ne sont plus seulement en Europe, elles sont partagées par beaucoup d’autres États dans le monde. Parlant du fonctionnement de l’Alliance atlantique, M. Donald Rumsfeld avait déclaré : « C’est la mission qui définit la coalition et non la coalition qui définit la mission. » De fait, en fonction du problème traité au niveau planétaire, des Européens peuvent être sur la même ligne, ou être en désaccord entre eux. Parce que nous sommes désormais à l’ère des puissances relatives dans un village planétaire, une réorganisation s’impose.
Dans un monde transnational, il faut des lois uniformes, comme les conférences de La Haye ont permis, bien avant la Commission européenne, qu’il en existe depuis le début du XIXe siècle. Des normes sont nécessaires, mais elles dépassent le cadre européen. Nous devons, bien sûr, garder un marché commun, et je sais gré à M. Giuliani d’avoir parlé de politique industrielle pour tempérer la concurrence. Songez qu’elle n’est mentionnée qu’à l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union, en un seul article ramassé, alors que le traité contient dix articles relatifs à la concurrence ! Cela ne peut pas fonctionner. Enfin, il convient de tout régler à la carte, au niveau inter-gouvernemental. Dans un tel cadre institutionnel, qui ne serait plus celui d’une Union intégriste, mais d’une Union plus ouverte et plus souple, le Royaume-Uni comme la Turquie peuvent trouver leur place.
M. Philip Cordery. Chacun convient qu’il faut redonner du sens à la construction européenne et analyser ce qui n’a pas fonctionné. Actuellement, on s’occupe plus de rafistoler et de réagir aux événements que de concevoir des projets politiques, alors qu’il faudrait en mener à bien de nombreux : l’union de l’énergie a été mentionnée, de même que la politique industrielle – c’est à peu près mon seul point d’accord avec M. Jacques Myard…
M. Jacques Myard. Vous me rejoindrez sur le reste aussi !
M. Philip Cordery. Les pistes d’action sont donc connues. C’est sur l’architecture de l’Union que je m’interroge. À mon sens, l’une de ses faiblesses tient au trop grand nombre de dérogations et d’exceptions consenties ; elles ont rendu la construction européenne incompréhensible. Je suis un farouche partisan de l’intégration différenciée, mais elle doit être organisée en deux cercles cohérents, trois au plus. C’est pourquoi je juge intéressante la proposition de M. Pisani-Ferry, même si elle est venue trop tôt : elle reprend l’idée chère à François Mitterrand d’une confédération autour d’un noyau d’États fédérés, avec la perspective d’organiser un cercle extérieur au nôtre.
Une autre Europe pourrait être ainsi construite, composée de la zone euro, d’une Union européenne conçue comme un sas vers une union économique et monétaire véritablement intégrée, d’un cercle plus lâche de pays avec lesquels des accords commerciaux clairs pourraient être conclus. Ce cercle irait-il jusqu’à inclure la Turquie ? En tout cas, cette architecture serait plus claire et mieux compréhensible par les citoyens.
La nécessaire fermeté des Vingt-Sept à l’égard du Royaume-Uni doit persister : sinon, les populistes en tireront argument pour avancer que le choix du peuple n’est pas respecté ; mais, au Royaume-Uni, les partisans du maintien dans l’Union pensent encore que l’on pourra revenir sur cette décision. La fermeté est-elle unanimement partagée en Europe ? Elle me semble avoir quelques failles dans certains pays, où l’on attend les élections à venir en France et en Allemagne pour assouplir la position. Ce serait très dangereux pour notre crédibilité.
M. Yves Bertoncini. Pour M. Jacques Delors, l’Union européenne est une fédération d’États-nations. Cette union dans la diversité ne peut être forte qu’autant que ses États membres le sont. Or, beaucoup sont affaiblis, dont la France, car les Français, peu convaincus par la manière dont leur pays est gouverné depuis une dizaine d’années, sont devenus « franco-sceptiques ». Aussi longtemps que cet état d’esprit prévaudra, la France et l’Union européenne auront un problème.
Je suis en désaccord avec vous, M. Savary, et je maintiens que le Royaume-Uni est une exception, car si dans d’autres pays existent différentes formes d’euroscepticisme, l’europhobie n’y est pas le sentiment majoritaire. L’exception britannique tient au rapport au monde qu’entretient ce pays : c’est bien à la City de Londres – et aux États-Unis – qu’a été organisée la dérégulation financière folle, non en Pologne ; ce ne sont pas les Portugais qui ont inventé les prêts hypothécaires à risque – les subprimes. De même, l’ouverture à la mondialisation sans protection sociale élaborée n’est ni l’œuvre de la Suède ni celle du Danemark. M. Jean Pisani-Ferry a raison de souligner que l’Union ouvre ses frontières puis laisse les États membres assumer la protection sociale. Il se trouve que les Britanniques l’assument mal, et le fait est que cela entraîne plus de dégâts au Royaume-Uni et aux États-Unis qu’en Suède ou au Danemark.
Les peuples de la zone euro sont attachés à leur monnaie. Le peuple français a adopté l’union monétaire et il y est attaché, tous les sondages le montrent. Face à la menace de la finance folle, il existe une protection : l’union monétaire. Imaginons quel serait le poids du franc dans la mondialisation financière… Mais on n’entend guère le discours décrivant l’union bancaire pour ce qu’elle est : une manière de répondre à la finance folle qui a contraint des générations d’Irlandais et d’Espagnols à rembourser les folies commises par leurs banques qui, à l’époque, étaient contrôlées au seul niveau national et qui seront beaucoup mieux contrôlées au niveau européen. La mesure s’impose donc dans la manière de caractériser la crise, et il faut dire haut et fort ce que peut faire l’Union quand on lui en donne les moyens.
Oui, Mme Guigou, comme Washington l’est pour les Américains, les institutions bruxelloises seront toujours loin des peuples européens, en particulier parce que, en raison du principe de subsidiarité, elles n’ont pas tous les pouvoirs. Agriculteurs et pêcheurs savent que se définissent là les politiques qui les concernent, mais, pour les autres, Bruxelles est loin parce que les institutions européennes n’ont pas autant de compétences et de pouvoirs qu’on le dit. En revanche, la prolifération des normes en comitologie est bien trop ressentie. M. Jean-Claude Juncker essaye de contrôler ce flux normatif, puisque plus de directives et de règlements sont adoptés chaque année par la Commission que par le Parlement ou le Conseil. Le problème n’est pas seulement celui du déficit démocratique, il est politique : il n’y a aucun marketing politique, aucun service après-vente politique, et lorsqu’une controverse se déclenche, on se déballonne ! Voyez ce qu’il en a été avec Mme Ségolène Royal… Finissons-en avec l’excès de normes comitologiques : il en faut, mais a minima. On donnera ainsi moins l’occasion à M. Boris Johnson et à tant d’autres de railler une normalisation utile sur les plans technique, économique et sanitaire, mais politiquement désastreuse.
Enfin, je rappelle que l’Union européenne est née au son de l’hymne à la peur : nous avions peur de nous entre-tuer à nouveau, mais aussi peur de Staline. Certes, M. Myard, l’époque n’est plus celle de Staline et de Truman, mais c’est celle de M. Poutine et de M. Trump. Cette conjoncture crée les conditions pour que les Européens se prennent davantage en main. Elle incite à l’inquiétude, mais aussi à la résolution.
M. Maurice Grignard. Passer d’une construction juridique à une construction plus démocratique, selon les termes de M. Gilles Savary, me paraît bien résumer les enjeux, et la question n’est pas étrangère à la nécessité de revivifier la démocratie représentative dans notre propre pays. Mieux mettre en évidence dans les débats nationaux la plus-value qu’apporte la dimension européenne aux solutions nationales oblige à mieux appréhender la dimension extérieure des problèmes nationaux dont on traite. D’autre part, chaque État membre doit mieux mesurer les effets, positifs et négatifs, de ses décisions pour ses voisins. Cela participe de la reconsolidation de l’union économique et monétaire.
Nous avons tous insisté sur la nécessité de redonner des perspectives aux politiques économiques et industrielles européennes, mais peu a été dit de la nécessité de repenser dans le même temps les politiques commerciales extérieures. Nous venons de connaître les épisodes relatifs à l’accord économique et commercial global avec le Canada, d’une part, au partenariat transatlantique de commerce et d’investissement avec les États-Unis, d’autre part. Dans un monde dérégulé, où les politiques multilatérales sont en panne, l’Union européenne doit définir et appliquer une politique commerciale véritable – ou alors, c’est la fermeture. Étant donné les défis majeurs qu’il nous faut affronter et le bousculement provoqué par les nouvelles technologies, des accords de plus en plus larges sont nécessaires, qui doivent de plus en plus intégrer les États.
Confrontations Europe, la Fondation Robert Schuman, l’Institut Jacques Delors, le Mouvement européen et EuropaNova travaillent déjà ensemble. France Stratégie n’est pas encore dans le cercle que nous avons constitué et peut-être faudrait-il l’y associer, mais, depuis un an, tous ces groupes de travail se rencontrent une fois par trimestre pour définir comment mieux valoriser ce qui rassemble les États membres et comment mieux traiter les enjeux européens.
Nous sommes très favorables à l’idée d’une Union européenne constituée en trois cercles et nous insistons sur la nécessaire articulation entre l’Union européenne et une union économique et monétaire qui doit être consolidée. Détricoter l’euro serait extrêmement douloureux et très coûteux, mais il faut construire une trajectoire pour les pays membres de l’Union non membres de la zone euro. On ne peut refaire ce qui a eu lieu lors des élargissements – exiger des nouveaux entrants qu’ils absorbent l’acquis communautaire en oubliant quelque peu le nécessaire accompagnement de pays aux cultures différentes.
La fermeté à l’égard du Royaume-Uni ne fait pas débat pour l’instant, mais elle est extraordinairement fragile. Si les Vingt-Sept ne consolident pas leurs relations en cette période douloureuse, l’Union peut voler en éclats – et le résultat des élections à venir peut rebattre toutes les cartes.
M. Jean Pisani-Ferry. Le sujet fondamental est celui qu’a évoqué Mme Guigou en invitant à prendre en considération les composantes extérieures de toute politique européenne. Toute réflexion sur l’Union européenne doit s’inscrire dans son temps. Le monde dans lequel la question de l’utilité de l’Union européenne se posait était celui des années 2000, celui de la globalisation multilatérale régulée par l’ordre américain ; à l’époque, Gordon Brown l’avait théorisé en déclarant explicitement que l’échelle régionale n’avait plus de sens et qu’il fallait raisonner à l’échelle globale.
Mais le monde actuel n’est plus du tout celui-là : c’est un monde d’affirmation et de puissances, dans lequel l’échelon régional est essentiel. Au nombre de ce que peut offrir l’Union européenne et de ce que peuvent être ses atouts, il y a bien sûr son marché et sa régulation, mais aussi la capacité d’émettre une monnaie internationale, ce qu’aucun de nos pays n’est en mesure de faire individuellement. Renoncer à cela, simplement du point de vue externe, serait un choix très lourd puisque c’est un des éléments qui nous permettent d’exister dans un monde dans lequel, économiquement, nous pèserons de moins en moins. La capacité d’émettre une monnaie internationale n’est pas à la portée de tous les pays, les Chinois le savent d’expérience.
Faut-il faire le gros dos en se disant que l’appétit manque pour une intégration supplémentaire, ou faut-il être ambitieux ? Faire le gros dos n’est pas une stratégie, car la situation est insatisfaisante : l’Union ne crée pas assez de prospérité, n’a pas de capacité suffisante de création d’emplois et de sécurité pour que l’on puisse se contenter de la défendre telle qu’elle est. Il faut reconnaître ses faiblesses et être ambitieux. Cela signifie se projeter dans le futur sans se focaliser exclusivement sur ce qui nous oppose les uns aux autres.
Je prendrai pour exemple la discussion avec l’Allemagne sur l’avenir de l’euro. La France et l’Allemagne ont des sujets de contentieux hérités de la crise récente – la compétitivité relative ou la relation créanciers-débiteurs, par exemple. Mais une question bien plus large se pose : vers quoi voulons-nous tendre pour les dix ou vingt ans à venir, et selon quels principes ? Si nous restons bloqués sur les sujets immédiats, c’est l’impasse. Cela exige que nous, Français, disions beaucoup plus clairement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Nous avons une certaine difficulté à le faire, car il est assez facile de passer des compromis internes qui ne sont ni toujours très clairs ni toujours très sensés. Pour des raisons de politique interne compréhensibles, on peut assez facilement se mettre d’accord sur des positions qui, ensuite, ne nous portent pas très loin dans le dialogue avec nos partenaires européens. Nous devons dire beaucoup plus clairement ce que nous voulons nous-mêmes.
La proposition de partenariat continental est-elle une mauvaise idée ou vient-elle trop tôt ? Choisir d’attendre et de laisser l’initiative au Royaume-Uni a pour inconvénient que, pendant que les Britanniques se préparent, on s’abstient de réfléchir. Sans doute sont-ils en proie à un certain désarroi sur la manière d’aborder la négociation, mais le moment viendra où elle commencera. Mieux vaut, pour les Vingt-Sept, s’être mis d’accord sur le futur vers lequel ils veulent aller que d’être uniquement guidés par une considération tactique – ne pas bouger, alors que les Britanniques seront mobiles. Le danger est que le Royaume-Uni, adoptant la stratégie des Horaces et des Curiaces, ne détricote certains compromis en privilégiant des négociations sectorielles. Pour éviter cela, mieux vaut que les Vingt-Sept, plutôt que de se fixer simplement un compromis défensif, aient une idée de l’aboutissement qu’ils souhaitent.
M. Jean-Dominique Giuliani. J’ai essayé de théoriser l’intégration par l’exemple, car je pense que l’Europe souffre d’abord d’une indifférence des États membres. L’Assemblée nationale devrait se pencher davantage sur cette question, car les sujets qui préoccupent nos concitoyens et qui interpellent l’Europe – migrations, défense, sécurité – mettent en jeu des compétences partagées ou nationales qui n’appartiennent pas aux institutions communes. Or les États membres ne les exercent pas correctement. Rien n’interdit au gouvernement français de proposer une initiative à nos voisins italiens ou allemands pour rapprocher les conditions d’octroi de l’asile, ou, en matière de sécurité, pour organiser une vraie défense de l’Europe, au lieu de se polariser sur la défense européenne.
Nous confondons les objectifs et les moyens. Chaque fois que des avancées ont été faites en Europe, c’est à la suite d’initiatives des États membres – souvent la France et l’Allemagne – qui ont ensuite permis de donner aux institutions communes des règles pour gérer les problèmes en commun.
C’est la vraie question de la bureaucratie. En 1963, Robert Schuman disait : « L’intégration européenne doit, d’une façon générale, éviter les erreurs de nos démocraties nationales, surtout les excès de la bureaucratie et de la technocratie. » Nous y sommes, par défaut des gouvernements nationaux. Je pourrais citer une dizaine d’exemples, notamment en matière environnementale, de cas dans lesquels une réglementation est réclamée à Bruxelles par le ministère français de l’environnement, se gère dans des comités obscurs, et donne ensuite l’impression que l’Europe n’est que la contrainte. Si nous voulons ouvrir cette brèche, il faut que les politiques européennes des États membres soient plus offensives et plus assumées. Qu’elles se déploient sur le mode intergouvernemental ne me choque pas dès lors que par la suite, l’exemple aidant, se développe l’idée de les consolider à vingt-sept. Il n’est pas nécessaire de commencer à vingt-sept : à deux ou à trois, c’est suffisant. Il y a urgence en matière de défense, et l’immigration est la mère de toutes les batailles contre le populisme.
En matière de gouvernance économique, je suis d’accord avec M. Jean Pisani-Ferry. Dire que l’Europe doit s’occuper de l’essentiel, c’est laisser entendre que les États ne doivent s’occuper que de l’accessoire. Il faut que chacun exerce ses compétences, et donc que les États membres exercent les leurs, ce qu’ils ne font pas depuis plus de vingt ans sur les questions européennes. Si, en matière économique, en matière de défense, d’immigration ou de bureaucratie, les États membres avaient des politiques européennes plus actives, nous ne nous en porterions que mieux, et cela tiendrait lieu de pédagogie naturelle à l’intention de nos citoyens.
Je rappelle aussi à M. Myard que la célèbre conférence d’Ernest Renan Qu’est-ce qu’une nation ? se termine ainsi : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. » Nous n’y sommes pas encore, même si nous souhaitons un jour y parvenir.
M. le président Claude Bartolone. Merci à chacun d’entre vous. Nous attendons vos contributions écrites, si vous souhaitez approfondir vos réponses aux questions qui ont été posées. Nous souhaitons que ce rapport sur le Brexit soit utile et permette aux Vingt-Sept de résister et de partager un point de vue commun, mais c’est aussi pour les Européens un bon moyen de s’interroger sur la suite.
La mission d’information auditionne ensuite M. Frédéric Baab, membre national d’Eurojust pour la France.
M. le président Claude Bartolone. M. Baab, nous souhaitons aborder avec vous la question d’apparence plus technique, mais en réalité hautement politique, des conséquences de la sortie du Royaume-Uni sur la coopération judiciaire européenne, notamment en matière pénale. Nous aurons également, au mois de janvier, l’occasion d’auditionner le ministre de l’intérieur sur la coopération policière. Ces deux auditions sont très importantes. La fin de la règle de l’unanimité s’est accompagnée de la création d’un régime dérogatoire consistant en un droit de retrait ou de participation. En pratique, le retrait du Royaume-Uni mettra fin à de nombreuses coopérations qu’il avait choisies. Merci de nous faire part de vos réflexions sur ces différents points.
M. Frédéric Baab, membre national d’Eurojust pour la France. Merci de m’avoir invité à participer aux consultations que vous conduisez aujourd’hui sur le Brexit et ses conséquences probables, non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi plus largement pour l’Union européenne, et en particulier – puisque c’est le sujet qui nous intéresse aujourd’hui – dans le domaine de la coopération judiciaire pénale. Après les attentats terroristes commis en France et en Belgique, et au vu de la menace de plus en plus forte que représente l’organisation terroriste Daech sur le territoire européen, ces sujets sont extrêmement importants. Il faut avoir des idées claires avant d’entrer réellement dans les négociations qui vont s’ouvrir avec le Royaume-Uni. J’ai entendu hier que le ministre britannique chargé du Brexit, M. David Davis, n’excluait pas la possibilité d’un accord de transition avant que le Royaume-Uni ne quitte définitivement l’Union européenne, ce qui veut dire que les solutions pourront être très différentes au sein des cinquante-sept volets qui ont été ouverts par le Royaume-Uni, en particulier en fonction des impératifs de sécurité.
Permettez-moi de présenter Eurojust en quelques mots, avant d’aborder spécifiquement la question du Brexit. Il s’agit d’une agence intergouvernementale, et elle le restera. Le parquet européen sera très différent, puisqu’il s’agira d’une véritable institution judiciaire intégrée. Eurojust conservera son modèle intergouvernemental, avec vingt-huit bureaux nationaux qui représentent chacun leur pays, et un fonctionnement qui reste dans la logique intergouvernementale.
Si une autorité judiciaire française veut faire exécuter une commission rogatoire internationale en Allemagne, elle ne saisit pas directement le bureau national allemand, mais le bureau national français, qui va ensuite transmettre immédiatement cette commission rogatoire internationale au bureau allemand, qui la transmettra à son tour aux autorités judiciaires allemandes compétentes. On peut trouver cette procédure terriblement bureaucratique et d’une grande lourdeur, mais c’est exactement le contraire. Dans l’espace judiciaire européen qui s’est établi à la suite du Conseil européen de Tampere en 1999, nous constatons souvent que le principe de communication directe entre les autorités judiciaires d’émission et celles d’exécution – sur lequel il repose en théorie – ne peut pas être mis en œuvre, car les gens ne se comprennent pas. Il faut des intermédiaires spécialisés pour permettre à la coopération judiciaire de porter ses fruits. En 1993, les premiers magistrats de liaison ont été créés entre la France et l’Italie. Ce fut une étape extrêmement importante dans la construction de l’espace judiciaire européen. Le réseau judiciaire européen a ensuite vu le jour, puis l’agence Eurojust, en 2002.
Aujourd’hui, Eurojust a une activité opérationnelle très importante. Nous avons ouvert 2 214 dossiers l’année dernière. Le bureau français, à lui seul, en a ouvert 140, et il a été requis dans 241 dossiers. Autrement dit, notre activité portait l’année dernière sur 381 dossiers.
Non seulement le volume de coopération a augmenté, mais nous avons aussi été requis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, dans lequel Eurojust n’était pas présent jusqu’alors. Cela s’explique très simplement : il y a dix ans, l’essentiel des dossiers en matière de terrorisme appelait une coopération principalement bilatérale. C’était l’époque, par exemple, de la lutte contre l’organisation basque ETA. L’essentiel de la coopération dans ce genre de dossiers se faisait entre la France et l’Espagne, dans un cadre bilatéral. Pour mettre en œuvre la coopération, il fallait des liens directs avec les magistrats de l’Audience nationale, ou s’appuyer sur des magistrats de liaison qui servaient de supports opérationnels à la coopération judiciaire.
Al-Qaida et surtout Daech représentent des menaces multilatérales concernant potentiellement n’importe quel pays européen, qu’il constitue une cible d’attentats ou une base arrière abritant des cellules dormantes susceptibles d’être activées à tout moment. Nous voyons ces phénomènes à l’œuvre dans certains des dossiers dont nous sommes saisis. Nous devons donc coopérer de manière efficace avec des pays qui ne sont pas nécessairement des partenaires habituels de la France en matière pénale. Dans le cas des attentats du 13 novembre 2015 en France, le bureau français d’Eurojust, saisi par les juges d’instruction antiterroristes, a coopéré avec l’Autriche et la Grèce. Ce sont deux pays amis, mais pas des partenaires avec lesquels nous coopérions beaucoup dans les affaires de terrorisme. Néanmoins, c’est dans un camp de réfugiés en Autriche qu’ont été interpellés deux des candidats kamikazes pour les attentats du 13 novembre, et nous avions besoin d’obtenir des informations de la Grèce à propos du flux de migrants qui est entré dans l’Union européenne lors de la période qui nous intéressait.
Pour apporter un support de coopération efficace et utile aux autorités judiciaires françaises, Eurojust est la seule agence qui permette une coopération multilatérale. Cette coopération se fait de deux manières. Nous organisons tout d’abord des réunions de coordination qui permettent de rassembler tous les acteurs judiciaires des pays concernés par un même dossier, avec un service d’interprétariat afin que chacun puisse s’exprimer dans sa langue maternelle et échanger directement des informations avec les partenaires étrangers. Ces réunions permettent de définir des stratégies d’enquêtes communes, qui concernent non seulement la direction des enquêtes, mais aussi celle des poursuites, puisque la décision ultime dans un dossier complexe, multilatéral, qui concerne plusieurs États membres, est de déterminer devant quelle juridiction l’affaire sera jugée, et s’il est opportun de réunir l’ensemble du dossier devant une même juridiction de jugement.
De plus, nous avons de plus en plus souvent recours, dans tous types de dossiers, notamment dans les affaires de terrorisme, à des équipes communes d’enquête. Ce fut le cas, par exemple, dans le dossier du 13 novembre et dans le dossier Reda Kriket.
Telle est la place qu’occupe aujourd’hui Eurojust dans le dispositif de coopération judiciaire en Europe : une agence multilatérale fonctionnant sur un modèle intergouvernemental qui fait sa force, car il permet un contact direct avec des correspondants nationaux au sein de l’agence. Elle n’a aucun pouvoir, et nous en sommes très heureux, car cela nous permet d’avoir une relation extrêmement simple avec les autorités judiciaires françaises : il ne peut pas y avoir de rivalité ou de concurrence. Nous ne nous trouvons jamais dans une situation où il n’y aurait qu’un siège pour deux : quand on exerce des poursuites, il ne peut y avoir qu’une seule autorité compétente, en l’occurrence les autorités judiciaires françaises. C’est peut-être ce qui explique qu’elles n’aient plus aucune réticence à nous saisir dans les dossiers les plus sensibles.
En ce qui concerne le Brexit et ses conséquences sur la coopération judiciaire pénale en Europe, je propose d’aborder quatre sujets : les agences européennes (Europol et Eurojust) ; les instruments de reconnaissance mutuelle ; l’interconnexion électronique des casiers judiciaires et le parquet européen, sujet d’actualité puisque les négociations ont échoué lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 8 décembre dernier.
Je souhaite vous parler des deux agences européennes, car Europol me semble aujourd’hui un élément de coopération extrêmement important. Dès que le Royaume-Uni sortira de l’espace judiciaire européen unique, il quittera également les agences européennes. Il est difficile d’imaginer une marge de négociation sur cette question de principe. Mais cela ne signifie pas que les Britanniques cesseront de collaborer avec Eurojust. Aujourd’hui, nous avons déjà passé un certain nombre d’accords de coopération avec des pays tiers : la Suisse, les États-Unis et la Norvège. Ces accords ont permis à ces trois pays de créer un poste de procureur de liaison rattaché à Eurojust. Nous avons donc un point de contact direct au sein d’Eurojust avec ces trois pays.
Ces procureurs de liaison ont à peu près les mêmes capacités d’action que les membres nationaux : ils peuvent ouvrir un dossier, organiser des réunions de coordination et les présider, et participer à une équipe commune d’enquête. La Suisse ayant ratifié le deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire de 1959, le procureur de liaison suisse ne se distingue presque pas, sur le plan opérationnel, d’un membre national. La seule différence avec les membres nationaux est que les procureurs de liaison ne participent pas aux réunions du Collège d’Eurojust, c’est-à-dire à la gouvernance de l’organisation. Dans une agence intergouvernementale qui n’exerce aucun pouvoir propre, ces réunions ne portent que sur des éléments de fonctionnement quotidien de l’agence. Aucune décision d’importance susceptible d’engager l’avenir d’Eurojust ne peut être prise au sein du collège. Finalement, c’est presque une chance pour ce procureur de liaison de ne pas participer aux réunions du Collège, qui ne sont pas toujours extrêmement passionnantes…
Sur le plan opérationnel, j’imagine que les Britanniques feront le choix de créer un poste de procureur de liaison. Nous n’avons aucune raison de nous y opposer, cela fait partie des relations normales que nous pouvons établir avec des pays tiers. Les Britanniques, aujourd’hui très impliqués dans le fonctionnement d’Eurojust, feront en sorte de nommer un procureur de liaison doté d’adjoints et d’un secrétariat, ce qui leur permettra d’avoir exactement la même capacité opérationnelle qu’actuellement.
Il en ira de même pour Europol, qui peut également passer des accords de coopération opérationnels et stratégiques avec des pays tiers. J’imagine que le Royaume-Uni demandera à bénéficier de ce statut. Il est d’autant plus important pour nous de conserver une coopération étroite avec les Britanniques qu’ils sont particulièrement actifs et compétents sur le terrain du renseignement. Il faut établir avec eux des collaborations très fortes et très étroites, qui permettent de continuer à travailler ensemble, d’autant qu’aujourd’hui Europol et Eurojust sont très étroitement associés dans tous les champs de la criminalité organisée, également en matière de terrorisme, ce qui n’était pas le cas auparavant. Europol est un énorme bureau d’analyse criminelle. En matière de crime organisé, il traite 25 millions de renseignements – que l’on appelle « entités structurées » – et 3 millions en matière de terrorisme.
Ce bureau d’analyse criminelle recoupe en permanence toutes les informations qu’il reçoit des services de police et de renseignement des États membres, mais aussi des pays tiers avec lesquels Europol a un accord de coopération opérationnelle.
Europol a ouvert vingt-sept ou vingt-huit fichiers d’analyse criminelle – que l’on appelle des « points focaux » – consacrés chacun à une thématique particulière : les transactions financières suspectes, la surveillance des sites internet terroristes, et cinq fichiers particuliers en matière de terrorisme. Parmi ces derniers, les deux plus importants sont aujourd’hui les fichiers « Hydra », consacrés au terrorisme islamiste en général ; et le fichier « Travellers », consacré aux combattants terroristes étrangers.
Jusqu’en 2015, il n’existait pas d’accord d’association entre Eurojust et Europol en matière de terrorisme, faute de confiance. Après les attentats de janvier et novembre 2015, l’urgence opérationnelle et la pression politique qui s’est exercée ont été telles que nous avons signé en quelques mois des accords d’association avec Europol sur les deux fichiers que je viens de citer. J’ai été désigné par le Collège « point de contact » de ces fichiers, ce qui me permet de participer à toutes les réunions opérationnelles s’y rapportant et d’entretenir des relations très étroites avec les analystes d’Europol qui travaillent sur ces sujets.
Le Royaume-Uni est pour nous un partenaire extrêmement important dans le champ de la sécurité, et nous devons continuer à coopérer selon les modalités déjà prévues pour les pays tiers.
J’en viens aux instruments de reconnaissance mutuelle. Ce principe s’est imposé à partir du Conseil européen de Tampere, en octobre 1999, qui en avait fait la pierre angulaire de la coopération judiciaire en Europe. Après cette grande déclaration politique, il s’est ensuite passé ce qui arrive parfois au sein de l’Union européenne : pas grand-chose. Il a fallu les attentats du 11 septembre 2001 pour que l’Union commence sérieusement à mettre en œuvre le programme de Tampere dans le domaine de la coopération judiciaire. La pression politique très forte que les États-Unis ont exercée sur les États européens a eu pour résultat l’adoption de la décision concernant Eurojust le 28 février 2002. Le projet était déjà en cours, fortement soutenu par la France, mais les négociations avançaient très difficilement, notamment du fait de l’opposition de l’Allemagne. Autre résultat de cette pression des États-Unis, l’adoption quelques mois plus tard du mandat d’arrêt européen. Dans le champ de l’extradition, c’est une révolution copernicienne : nous avons changé de monde.
Que signifie le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice ? Que la demande n’est plus une demande, mais une décision. Par exemple, si un juge d’instruction français décerne un mandat d’arrêt européen contre un ressortissant allemand qui réside en Allemagne, il ne s’agit plus d’une demande aimable formulée par le juge d’instruction français aux Allemands, mais d’une décision prise par l’autorité judiciaire française et qui sera exécutée en Allemagne presque comme s’il s’agissait d’un mandat d’arrêt allemand. Il existe un principe d’assimilation de la décision étrangère à la décision nationale. Les motifs de refus sont extrêmement limités, et leur mise en œuvre est très encadrée.
L’obligation pour les États membres d’extrader leurs ressortissants nationaux constitue également un progrès considérable, puisque, vous le savez, le principe est que la France n’extrade pas les siens.
Le mandat d’arrêt européen repose sur cette logique et marque une étape très importante dans la création de l’espace judiciaire européen, auquel elle donne tout son sens. Des instruments ont été créés pour toutes les décisions que peut prendre un procureur ou un juge d’instruction et qui sont susceptibles d’être appliquées en dehors du territoire français. Le principe de reconnaissance mutuelle a été décliné dans toutes les matières possibles, de la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires à celle des décisions de gel des avoirs et des preuves – outil important dans le traitement des dossiers de faux ordres de virement, forme d’escroquerie qui s’est développée depuis quelques années et cause des préjudices considérables aux entreprises. Dans ce domaine, la première mesure à prendre ne consiste pas à arrêter les gens, mais à geler l’argent, à essayer de récupérer ce qui peut l’être par le biais d’une mesure qui sera exécutée immédiatement par les autorités judiciaires du pays concerné. Le gel – mesure provisoire – est suivi de la confiscation – à moins que l’on ne restitue ses biens à leur propriétaire.
Toujours dans le cadre de la reconnaissance mutuelle, le contrôle judiciaire, décerné par un juge français, peut aussi être exécuté à l’étranger. Enfin, dernier instrument en date, la décision d’enquête européenne va couvrir l’ensemble de la coopération judiciaire pénale et remplacer définitivement les commissions rogatoires internationales.
Dès lors que le Royaume-Uni sort de l’espace judiciaire européen, il ne peut plus utiliser les instruments de reconnaissance mutuelle. Malgré toute l’empathie que je peux avoir, à titre personnel, pour les Britanniques, je n’imagine pas comment, dans ces conditions, nous pourrions conserver le Royaume-Uni à bord. La reconnaissance mutuelle nécessite un niveau de confiance qui ne peut exister qu’au sein de cet espace, puisque les autorités judiciaires doivent exécuter quasiment les yeux fermés la décision qu’elles reçoivent : un mandat d’arrêt européen comporte un résumé très succinct des raisons pour lesquelles le juge étranger l’a décerné, et il n’y a pas de contrôle d’opportunité possible.
Par ailleurs, des missions d’évaluation mutuelles sont régulièrement réalisées par des magistrats et des fonctionnaires de la Commission européenne qui vont mesurer dans chaque État membre la manière dont les instruments en question ont été transposés en droit interne et sont appliqués par les autorités judiciaires. Ces mesures de contrôle inhérentes à la reconnaissance mutuelle ne pourraient plus être appliquées à un pays qui ne sera plus membre de l’Union européenne, mais qui sera désormais un pays tiers.
La seule solution pour le Royaume-Uni est d’en revenir aux anciens instruments de coopération judiciaire, non pas ceux de l’Union européenne, donc, mais ceux du Conseil de l’Europe – notamment la convention d’extradition de 1957. Nous aurons même des difficultés à faire bénéficier le Royaume-Uni des conventions de l’Union européenne de 1995 et 1996 adoptées par la suite et visant à mettre en place une procédure simplifiée en matière d’extradition. J’imagine que les juristes du secrétariat général du Conseil et ceux des États membres trouveront des solutions plus élégantes et mettront en place des procédures plus rapides et simplifiées avec le Royaume-Uni.
Vous allez considérer qu’on en revient à l’âge de pierre dans nos relations avec le Royaume-Uni ; d’une certaine manière, c’est vrai. Aussi est-ce sans doute à ce pays de faire un effort supplémentaire pour faciliter la coopération avec les États de l’Union européenne et pour ne pas en revenir aux situations que nous avons connues avec un dossier comme celui de Rachid Ramda.
Mme Élisabeth Guigou. Il a fallu dix ans pour l’extrader !
M. Frédéric Baab. Il a en effet fallu dix ans – 1995-2005 – pour obtenir l’extradition de quelqu’un qui était clairement et directement impliqué dans les attentats de 1995 à Paris et en particulier dans l’attentat perpétré dans le RER Saint-Michel, qui avait causé la mort de huit personnes.
Troisième point, l’interconnexion des casiers judiciaires, grande avancée, est issue d’un projet franco-allemand. À l’époque, j’étais magistrat de liaison à Berlin et j’avais reçu mandat – avec obligation non de moyens, mais de résultats – de signer dans les délais les plus brefs un accord avec l’Allemagne permettant un échange électronique rapide et simplifié d’informations entre les casiers judiciaires français et allemands. Nous avions même pensé, initialement, à réaliser un casier judiciaire unique, idée quelque peu déraisonnable qui n’a pas passé le cap de la première réunion de travail entre les experts français et allemands.
Nous disposons d’un système informatisé baptisé ECRIS (European Criminal Records Information System – Système européen d’information sur les casiers judiciaires) qui permet l’interconnexion électronique des casiers judiciaires au niveau européen. Il a été adopté en 2009 et est entré en vigueur en 2011. Grâce à ce système, il est possible d’envoyer un avis de condamnation au casier judiciaire de l’État dont la personne concernée est ressortissante. La convention européenne d’entraide judiciaire de 1959 le permettait déjà : en théorie, à l’époque, les États membres devaient envoyer au pays signataire de la convention tous les avis de condamnation concernant ses ressortissants. Par exemple, si un Allemand est condamné en France, le casier français doit envoyer l’avis de condamnation au casier judiciaire allemand qui va l’enregistrer. La France a tiré toutes les conséquences juridiques possibles de ces échanges d’informations puisque, aujourd’hui, une condamnation prononcée à l’étranger contre un ressortissant français peut servir de premier terme de récidive.
Prenons l’exemple d’un ressortissant espagnol interpellé en France : l’interconnexion électronique permet de connaître ses antécédents judiciaires dans un délai de dix à vingt jours, ce qui est très bref comparé aux délais antérieurs – et même, en réalité, il n’y avait aucun échange entre les casiers judiciaires des différents pays. Le système, j’y insiste, s’appuie sur un principe de nationalité : toutes les condamnations prononcées en Europe contre des ressortissants européens sont centralisées auprès du casier judiciaire du pays de la personne concernée, seul casier qui puisse être interrogé, ce qui évite d’avoir à consulter vingt-sept autres casiers judiciaires. Là encore, on peut imaginer que le Royaume-Uni devra sortir de ce dispositif propre à l’Union européenne. Or le volume d’informations judiciaires échangées entre la France et le Royaume-Uni est très important.
J’en viens au quatrième et dernier point, le parquet européen. Il s’agit là, sans doute, de la question la plus facile à résoudre, puisque vingt-cinq pays ont participé au projet initial, soit les Vingt-Huit à l’exception, précisément, du Royaume-Uni, mais aussi du Danemark et de l’Irlande. Cela étant, d’autres pays resteront peut-être en dehors du projet de parquet intégré. Celui-ci détiendra à ce titre toutes les prérogatives de l’action publique, ce qui implique un transfert de souveraineté des États membres vers l’échelon européen : c’est le parquet européen qui devrait donc conduire les enquêtes et exercer les poursuites en s’appuyant sur des points de contact dans les États membres – des procureurs européens délégués – qui travailleront pour le compte et au nom du parquet européen, mais qui resteront intégrés dans la hiérarchie judiciaire des États membres. J’ignore de quelle manière le dispositif sera transposé dans le droit français, mais on peut imaginer qu’il y aura un point de contact par juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) ou bien un point de contact centralisé auprès du parquet national financier, puisque la compétence du parquet européen est limitée à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – limitation du reste importante : j’ai cru comprendre que, pour la seule fraude à la TVA, le seuil de compétence se situait à 10 millions d’euros de préjudice…
Il faudra en tout cas créer un système assurant la connexion opérationnelle entre l’échelon européen et l’échelon national, sachant qu’il n’y a pas de juridiction européenne correspondant à ce parquet européen et que les dossiers seront jugés devant les juridictions nationales avec un représentant du ministère public représentant le parquet européen.
Le 8 décembre dernier, les négociations ont échoué. Plusieurs pays se sont montrés réticents vis-à-vis de ce projet. La Suède a clairement affirmé ne pas vouloir y participer, un peu à l’instar d’autres États, même s’ils ont formulé leur avis de façon plus diplomatique : la Pologne, la Hongrie et, plus inquiétant, les Pays-Bas ; quant à l’Italie, son refus tient à des raisons inverses, le ministre italien considérant que le parquet européen n’allait pas assez loin dans l’intégration. En l’absence d’unanimité, ce projet sera adopté dans le cadre de ce qu’on appelle une coopération renforcée, qui nécessite la participation d’au moins neuf États membres, parmi lesquels la France et l’Allemagne.
Reste, je le répète, que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne n’aura aucune conséquence sur ce processus puisque, dès l’origine, ce pays n’a pas souhaité en faire partie.
Mme Élisabeth Guigou. Je remercie M. Baab pour son intervention sur un sujet énorme, évidemment méconnu – et sur lequel nous-mêmes avons besoin d’actualiser nos connaissances. Vous vous êtes montré très pédagogue en tout cas.
Nous avons eu raison d’en rester à la coopération intergouvernementale. Lorsque j’ai participé au Conseil européen de Tampere, avec le Premier ministre finlandais dont le pays venait d’adhérer à l’Union européenne, nous avons immédiatement posé le principe selon lequel il ne saurait être question que la Finlande intègre le système communautaire sur ces questions.
Nous avons raison, j’y insiste, de continuer dans cette voie, car il ne peut y avoir de justice européenne supranationale sous quelque forme que ce soit s’il n’existe pas un système politique fédéral. La question est en effet de savoir, comme toujours, qui contrôle les contrôleurs. Et avancer de manière pragmatique ne nous a pas empêchés de beaucoup progresser : le principe de reconnaissance mutuelle, proclamé à Tampere, et que nous avons constamment développé par la suite, a tout de même abouti au mandat d’arrêt européen. Sur ce dernier point, vous l’avez rappelé, il a fallu dix ans pour extrader Rachid Ramda vers la France – je garde un souvenir précis de mes conversations avec mon homologue de l’époque –, alors que, grâce au mandat d’arrêt européen, Salah Abdeslam a été remis aux autorités françaises au bout de quatre ou cinq semaines seulement.
Pour ce qui est du parquet européen, il faudra que le rapport de la mission d’information le définisse clairement – or vous l’avez très bien fait, M. Baab. Je me souviens de débats constants avec les Britanniques sur la question de savoir s’ils allaient adopter ce dispositif, de débats féroces entre Britanniques eux-mêmes, très allants quant à la coopération judiciaire et policière en matière de lutte contre la criminalité organisée et de lutte contre le terrorisme, et donc inquiets pour certains à l’idée de devoir abandonner les instruments dont il est ici question. J’ai en mémoire le cas, abondamment commenté dans les journaux d’outre-Manche, d’un moniteur britannique de colonie de vacances, qui avait, je crois, agressé sexuellement une petite fille et s’était réfugié en France, les Britanniques nous demandant naturellement son extradition.
Dès lors qu’on considère qu’ils ne peuvent formellement rester au sein des agences européennes, il s’agit de savoir quels dispositifs mettre en place avec eux, de façon pragmatique et bilatérale, si jamais ils manifestent la volonté, que nous avons intérêt à encourager, de continuer à coopérer dans le cadre de mandats d’arrêt européens ou dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle. Il en va d’ailleurs un peu de même dans le domaine de la défense. Personne n’aurait rien à y perdre. Je rappelle que nous avons créé Eurojust – c’est en tout cas la proposition que j’avais faite à l’époque – pour donner un pendant judiciaire à Europol qui existait déjà. Or il ne faudrait pas que la sortie des Britanniques de l’Union européenne crée un appel d’air, le Royaume-Uni devenant le refuge de tous ceux que nous souhaitons traduire devant nos tribunaux.
M. Jacques Myard. Je vous ai écouté avec grand intérêt, M. Baab, et je n’ai pas tout à fait compris certaines de vos positions.
Une fois n’est pas coutume, je suis tout à fait d’accord avec Mme Élisabeth Guigou pour considérer que la justice relève de la souveraineté nationale. Je constate qu’aux États-Unis d’Amérique la justice est tout à fait distincte d’un État fédéré à l’autre, ce qui n’empêche pas l’ensemble de constituer un pays. Aussi le parquet européen tel que vous l’avez décrit ne me paraît-il pas viable. Je préférerais une somme de parquets nationaux qui engageraient des poursuites dès lors qu’on constaterait d’un commun accord, par exemple, une escroquerie aux finances de l’Union européenne. On ne peut donc guère imaginer le parquet européen que comme « flottant », dépourvu qu’il serait d’instructions de la part des responsables politiques.
En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle, le mandat européen est très certainement une avancée aussi forte que nécessaire, j’en suis bien d’accord. Vous avez néanmoins pu constater que plusieurs cours d’appel françaises ont refusé d’exécuter un mandat européen précisément par manque de confiance. Or, dans le contexte des négociations transatlantiques que nous avons menées avec les Américains, l’arbitrage que ceux-ci ont proposé provenait de leur absence totale de confiance dans les juges de certains États de l’Europe de l’Est. Tout réside en effet dans la confiance réciproque des systèmes judiciaires. La souplesse des relations intergouvernementales n’en apparaît que mieux : aussi faut-il la conserver.
J’en viens plus précisément à notre sujet : la confiance existe bel et bien avec les Britanniques. Pourquoi, dès lors, voulez-vous les priver de l’interconnexion électronique des casiers judiciaires ? Il y va de notre intérêt de n’en rien faire et l’opinion publique risque de se révolter s’ils n’ont plus accès à ce dispositif.
Depuis l’affaire Calas, les Français sont attachés à la justice plus encore qu’à la liberté. La notion de justice est consubstantielle à notre conception de ce qu’on appelle le « vouloir-vivre-ensemble ». Je ne vois donc pas pourquoi nous expulserions les Britanniques d’un système qui peut fonctionner dès lors que nous y avons tous avantage, et qui garantit l’efficacité de la sanction prononcée contre les malfrats.
M. Frédéric Baab. Quand vous estimez, Mme la présidente Guigou, que le parquet européen et, en général, tout élément de justice supranationale est difficilement concevable dans une Europe qui n’est pas fédérale, sachez que c’est également ma conviction. Je vous ai proposé la présentation standard du parquet européen qui est peu ou prou celle du gouvernement français. Du coup, M. Myard, sur ce point, je suis également en plein accord avec vous : ce qui fait la force et l’efficacité du système Eurojust, c’est précisément qu’il s’appuie sur un modèle intergouvernemental.
Je suis en outre d’accord avec vous sur la nécessité de conserver une relation étroite avec le Royaume-Uni, mais pas dans n’importe quel domaine. Le bureau français d’Eurojust a deux priorités : la lutte contre le terrorisme – nous sommes saisis de tous les grands dossiers d’action publique en la matière – et la lutte contre le trafic de migrants. Nous avons, à l’initiative de la procureure générale de Douai, créé un groupe de travail opérationnel associant les quatre pays de la mer du Nord, ainsi dénommés pour donner au groupe une certaine visibilité politique, à savoir la France, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, pays directement concernés par la situation non seulement de Calais, mais encore de Dunkerque, de Grande-Synthe… Président du tribunal de grande instance de Dunkerque dans une vie antérieure, je connais bien la région.
Dès lors que les contrôles sont de plus en plus serrés à Calais, les migrants en situation irrégulière sont présents sur toute la façade maritime, mais aussi dans l’arrière-pays de tous les États européens à proximité. Les quatre pays du groupe ont travaillé avec les magistrats de liaison britanniques, dont celui spécialement désigné pour travailler à Lille sur les dossiers de trafics de migrants. Nous avons évidemment intégré ces magistrats britanniques dans notre groupe de liaison et je considère qu’il est indispensable de maintenir cette coopération régionale avec eux pour coordonner nos enquêtes. En sortant de l’Union européenne, les Britanniques vont-ils perdre leurs magistrats de liaison ? Non, puisque leur existence repose sur un accord bilatéral. Nous pourrons donc maintenir la coopération que nous avons mise en place dans un cadre explicitement intergouvernemental.
Cependant, pour ce qui est de la reconnaissance mutuelle, le pays qui a le plus durement attaqué ceux de la partie la plus orientale de l’Europe auxquels vous avez fait allusion, M. Myard, à commencer par la Pologne, est le Royaume-Uni. Plusieurs mandats d’arrêt polonais ont été critiqués, à mon avis à juste titre, par les États membres qui considéraient qu’ils avaient été décernés pour des faits des plus mineurs, pour des queues de cerise. Reste que ces mandats d’arrêt peuvent concerner des ressortissants français, britanniques ou allemands, et pas seulement des Polonais qui auraient commis des infractions en Pologne. Le Royaume-Uni, par sa dureté, a affaibli le dispositif en lui portant de véritables coups de boutoir et en adoptant une deuxième loi de transposition beaucoup plus protectrice des intérêts britanniques. Or – et c’est un point de désaccord avec vous –, nous devons conserver contre vents et marées ce principe de reconnaissance mutuelle et cette idée qu’il doit s’appuyer sur une confiance mutuelle élevée entre les autorités judiciaires des États membres, même si, parfois, en effet, nous éprouvons des difficultés à exécuter des mandats d’arrêt qui nous paraissent disproportionnés par rapport…
M. Jacques Myard. Quid de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ?
M. Frédéric Baab. Vous avez raison et, d’ailleurs, nous en discutons. Nous voyons précisément que le système est en train, petit à petit, de se défaire, parce qu’il est de plus en plus critiqué par certains pays et par certaines autorités judiciaires qui exercent un contrôle de plus en plus étroit sur les mandats d’arrêt européens étrangers qui lui sont adressés. Si nous entrons dans cette logique, c’est la fin du mandat d’arrêt européen.
Mme Élisabeth Guigou. Évidemment ! Je ne comprends pas comment nous pouvons imaginer nous désarmer ainsi alors que nous avons accompli des progrès gigantesques, grâce à cet instrument juridique, qui concerne toutes les formes de criminalité. Et ce n’est pas parce que certains pays européens abusent de cet outil qu’il faut le rejeter tout entier.
M. le président Claude Bartolone. On ne peut pas, d’un côté, regretter une protection insuffisante et, de l’autre, contribuer à l’affaiblir.
M. Jacques Myard. J’ai mentionné l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, qui a refusé d’exécuter un mandat d’arrêt européen. En l’occurrence, il ne s’agit donc pas des Britanniques. Il va bien falloir réviser le mandat européen afin qu’il ne soit plus délivré, comme vous l’avez dit vous-même, M. Baab, pour des queues de cerise.
M. Frédéric Baab. D’abord, la décision de la cour d’appel de Montpellier reste très isolée. Ensuite, nous nous sommes toujours opposés, et avec la plus grande force, à la volonté du Royaume-Uni de réviser le dispositif. Si, en effet, vous introduisez un contrôle de proportionnalité au moment de son exécution, vous tuez le mandat européen ; nous en reviendrions alors au système antérieur avec, pour seul progrès, que la procédure serait entièrement judiciarisée et que la décision finale ne serait plus une décision de gouvernement. Pour le reste, nous affaiblirions cet instrument qui a produit des résultats remarquables.
Je souhaite dire un dernier mot sur les échanges d’informations concernant les condamnations – le système ECRIS. Je vous ai dit, position que l’on peut logiquement adopter dans un premier temps, que, si l’on sort de l’Union européenne, on sort en même temps du système d’interconnexion des casiers judiciaires. Ma conviction, en tant que praticien de l’entraide, confronté aux mécanismes de grande criminalité organisée et de terrorisme, est que nous devons évidemment trouver des solutions techniques permettant au Royaume-Uni de rester dans le système. Je suis tout à fait d’accord avec vous : il faut conserver cet échange d’informations avec les Britanniques, échange qui suivra peu ou prou le même modèle que celui qui prévaudra dans leurs relations avec Europol, dès lors qu’ils auront passé avec cette agence un contrat de coopération opérationnel et stratégique. Il faut conserver la fluidité des échanges d’informations.
M. le président Claude Bartolone. Nous vous remercions, M. Baab, et nous recevrons volontiers une éventuelle contribution écrite de votre part.
Séance du jeudi 19 janvier 2017
La mission d’information procède à l’audition, non ouverte à la presse, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense
M. le président Claude Bartolone. Nous allons maintenant nous intéresser aux conséquences du Brexit sur le contexte stratégique européen.
Évidemment, en toile de fond, nous avons tous en tête l’arrivée d’un nouveau président à la Maison Blanche. L’évolution de la politique étrangère américaine sera, me semble-t-il, déterminante pour les Britanniques, qui ont toujours vu la politique européenne, notamment celle de défense, comme servant de simple auxiliaire à l’OTAN.
La sortie du Royaume-Uni aura d’abord un impact sur la stratégie militaire britannique. Cet impact est difficile à évaluer, car il dépendra des effets économiques du Brexit outre-Manche : une situation économique dégradée aurait des conséquences sur les choix budgétaires britanniques, donc sur les choix militaires. N’oublions pas non plus que l’arsenal nucléaire britannique, déjà sous le feu des critiques d’une partie des travaillistes et de l’opinion publique, se situe en Écosse.
Dans ce contexte très particulier, quelles seront selon vous, monsieur le ministre, les conséquences du départ du Royaume-Uni sur la politique de sécurité et de défense commune ? Les Britanniques s’opposaient à une intégration renforcée en matière de défense, notamment à la mise en place d’un quartier général européen. Mais le Royaume-Uni, qui a posé, avec la France, la première pierre de l’Europe de la défense lors du sommet de Saint-Malo, en 1998, est aussi le seul autre État membre qui ait à la fois la volonté et la capacité de s’engager militairement pour l’Union sur des théâtres extérieurs. Après sa sortie, sur quels alliés pourrons-nous compter pour construire l’Europe de la défense ?
Avec le Brexit, l’Allemagne devient notre partenaire naturel dans ce domaine. En septembre, vous avez d’ailleurs remis, avec votre homologue allemande, des propositions à la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères : vous plaidiez notamment pour l’instauration d’une « coopération structurée permanente » permettant aux États membres qui le souhaiteraient d’aller de l’avant. Mais l’Allemagne se donnera-t-elle les moyens de prendre plus de responsabilités dans la défense de l’Europe ?
Je vous laisse la parole, monsieur le ministre, avant que nous n’en venions aux questions. Vous semblez véritablement maîtriser ce dossier de la conduite à suivre pendant les négociations et en vue de préparer la sortie.
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. Pour le ministère de la défense, et d’une manière générale pour notre pays, la relation de défense franco-britannique est fondamentale à deux titres : comme élément de notre stratégie de défense et de sécurité d’abord, comme terreau de partenariats majeurs pour notre industrie de défense ensuite. J’ai eu l’occasion de m’exprimer à plusieurs reprises sur le sujet depuis le vote des Britanniques ; je l’affirme à nouveau ici : ma première priorité est de préserver une relation de défense franco-britannique féconde et stable. Les différents volets de la coopération qui nous lie sont irremplaçables. Vous l’avez dit, monsieur le président, la France et le Royaume-Uni restent à ce jour les seules puissances militaires européennes disposant d’une capacité de dissuasion nucléaire et des moyens nécessaires pour engager leurs forces armées dans des opérations de haute intensité, à des distances stratégiques, et en assumer le commandement.
Dans son discours de mardi dernier, Theresa May a clairement souhaité que la relation spéciale entre nos deux pays dans le domaine de la défense soit maintenue et reste positive.
Il convient de prendre le temps d’identifier les enjeux stratégiques auxquels nous sommes confrontés, au même titre que les Britanniques, sachant que nos intérêts sont globalement convergents. C’est d’autant plus nécessaire que Washington, notre partenaire et allié commun, pourrait éventuellement être susceptible d’infléchir, brutalement ou non, sa politique étrangère et de sécurité.
Pour toutes ces raisons, la France entend continuer à renforcer sa coopération bilatérale avec Londres en matière de défense, sur le plan tant opérationnel que capacitaire.
Le socle de notre relation est une coopération bilatérale forte. Celle-ci est d’abord fondée sur les traités de Lancaster House, lesquels comportent un volet conventionnel et un volet nucléaire.
En ce qui concerne le volet conventionnel, nous avons appliqué et nous appliquons les accords ; en particulier, nous mettons en œuvre le concept de force expéditionnaire conjointe interarmées (Combined Joint Expeditionary Force, CJEF). J’ai ainsi assisté en avril dernier à l’exercice Griffin Strike, qui a mobilisé 5 000 militaires français et britanniques. Nos états-majors travaillent en ce moment, sans s’être interrompus, sur des scénarios variés d’intensité et de complexités croissantes, en vue de développer cette force opérationnelle sur l’ensemble du spectre des opérations envisageables.
Très concrètement, nous engageons en 2017 – j’y reviendrai – un sous-groupement tactique de 300 hommes en Estonie, dans le cadre de l’OTAN, au sein d’une brigade commandée par les Britanniques.
Le partenariat entre le commandement des opérations spéciales (COS) et son équivalent britannique, le Directorate of Special Forces (DSF), bénéficie d’une dynamique renouvelée en raison du défi commun que constitue la lutte contre Daech en Libye et au Levant et, en soutien au Nigeria et aux pays concernés, contre Boko Haram et les milices islamistes au Sahel.
Sur le plan capacitaire, la coopération de défense franco-britannique a été confortée par la revue stratégique de défense conduite par Londres en 2015. Elle doit encore lancer des projets essentiels pour le maintien et le développement de la base industrielle et des capacités militaires européennes, qu’il s’agisse des missiles – missile antinavire léger, futur missile antinavire post-Exocet, futur missile de croisière successeur du SCALP (système de croisière conventionnel autonome à longue portée) ou du Storm Shadow –, du système de combat aérien futur (FCAS) ou de la guerre des mines. Il importe à nos yeux que l’ensemble des engagements programmatiques souscrits par Londres fin 2015 ne soient pas remis en question afin que cette coopération capacitaire essentielle puisse se poursuivre.
Je tiens à souligner que, depuis le vote du 23 juin et jusqu’à ces derniers jours, les autorités britanniques ont montré une ferme volonté de renforcer notre coopération bilatérale de défense pour l’ancrer dans la durée. J’ai rencontré mon collègue Michael Fallon à quatre reprises depuis l’été ; chaque fois a été mise en avant la nécessité de poursuivre cette dynamique politique.
Les accords de Lancaster House comprennent un autre traité, par nature plus discret, couvrant le domaine nucléaire : le traité Teutatès. Il s’agit d’un acte de confiance réciproque fondamental, puisque cette collaboration a pour finalité de garantir à chacun des deux pays la fiabilité et la pérennité des armes – des têtes nucléaires – qui sont au cœur de la dissuasion, et ce sans réaliser d’essai, conformément aux engagements internationaux pris par la France et le Royaume-Uni. Dans ce domaine aussi, notre coopération se poursuit sans discontinuer.
Ce traité organise le partage d’installations expérimentales radiographiques et hydrodynamiques. Il se traduit déjà par la construction et l’exploitation commune de l’installation radiographique et hydrodynamique Épure, dans le centre du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) situé à Valduc. Le traité prévoit en outre la création d’une installation destinée à des développements technologiques communs – en particulier les machines radiographiques du futur – dans le centre d’Aldermaston, au Royaume-Uni. Le premier axe de l’installation radiographique Épure est opérationnel et l’équipe intégrée franco-britannique travaille désormais à la mise en place de deux axes supplémentaires.
Ces accords sont essentiels et je ne vois pas comment ils pourraient s’interrompre. Les accords qui organisent notre relation bilatérale de défense ne sont donc en rien affectés par la décision de sortie de l’Union européenne, du point de vue du ministère français de la défense comme de celui de M. Fallon, me semble-t-il, conforté par le discours de Mme May.
Nous avons également une analyse très proche des menaces qui pèsent sur notre sécurité et des moyens de dissuasion, de prévention et de combat. Nos appréciations des risques que représentent le terrorisme d’inspiration djihadiste, la montée en puissance militaire de la Russie, le comportement de la Chine en mer de Chine du Sud, ou encore de la nécessité de prévenir et d’entraver la prolifération nucléaire sont similaires et font l’objet de coopérations constantes en matière politique et de renseignement. Il en va de même du choix de doter nos forces armées de capacités de dissuasion, d’intervention extérieure et de protection du territoire national. Le Royaume-Uni a étudié de près l’opération Sentinelle et nous avons beaucoup travaillé ensemble sur cette question il y a peu. Cette convergence continuera, je l’espère, de s’exprimer en Europe, comme aux Nations unies où nous agissons de concert comme membres permanents du Conseil de sécurité.
Nous travaillons également ensemble dans le domaine du contre-terrorisme. Le renseignement est pour nous une première ligne de défense. Nous y œuvrons conjointement, très souvent dans un cadre bilatéral, ou sous divers formats internationaux d’échange. Cette coopération se caractérise par un partage de renseignements extrêmement fréquent, sur un rythme quasi-quotidien, voire en temps réel. Elle se traduit également par l’organisation d’opérations communes pour obtenir des renseignements et, éventuellement, entraver des projets. Je songe par exemple à la cellule de coordination et de liaison que nous avons créée à N’Djamena pour suivre ensemble ce qui se passe autour du lac Tchad et aider les troupes de la Force multinationale mixte africaine à riposter à l’action de Boko Haram ou du groupe de M. Barnawi. Il existe d’autres exemples, en Libye et ailleurs, de cette collaboration sérieuse, efficace et qui s’opère en toute confiance.
Nous veillons aussi ensemble à la sécurité de nos espaces maritimes et aériens. Nous sommes voisins ; nos espaces de souveraineté se jouxtent. Il existe en la matière, concernant la police du ciel, des accords techniques bilatéraux entre les deux ministères de la défense. Nous coopérons aussi dans le domaine de la sécurité et de la sûreté en Manche. Nous avons en particulier signé il y a très peu de temps un accord permettant l’embarquement de gardes armés étatiques sur les navires à passagers dans les eaux territoriales.
Tout cela doit durer ; c’est notre intérêt. Je n’ai pas entendu depuis le mois de juin la moindre inflexion à ce sujet dans le discours de mon collègue Michael Fallon.
Restent bien sûr quelques questions concernant l’avenir, auxquelles je n’ai pas encore de réponse.
D’abord, la question financière et le poids futur du budget de la défense. La France et le Royaume-Uni sont les deux seules nations européennes à fournir un effort de défense à la hauteur de leurs ambitions stratégiques : légèrement au-dessus de 2 % du PIB pour les Britanniques ; 1,81 % pour nous. Ces données chiffrées peuvent faire l’objet de débats d’experts, mais, globalement, Français et Britanniques ont des formats d’armées très comparables et des capacités d’intervention équivalentes.
Je l’ai dit, le Royaume-Uni a réaffirmé son ambition dans le cadre de la Revue stratégique de défense et de sécurité de 2015, après plusieurs années marquées par des interventions difficiles en Irak et en Afghanistan. La question de l’impact financier du Brexit et de la capacité des finances britanniques à maintenir l’effort de défense prévu se pose. Ce n’est pas à moi d’y répondre aujourd’hui mais une chose est certaine : le tempérament de nos partenaires en matière de défense n’est plus à démontrer et la France, qui a par ailleurs entrepris d’accroître son effort de défense, s’appuie fermement dans ce domaine sur sa coopération avec le Royaume-Uni.
Le deuxième point concerne l’Europe de la défense. C’est bien sûr dans ce domaine que les conséquences du Brexit sont les plus apparentes ; elles doivent être maîtrisées. Le Brexit crée une rupture fondamentale au sein du projet européen en matière de politique de défense commune : il sépare de fait l’Union européenne de l’une des principales puissances de l’Europe et, dans le même temps, paradoxalement, d’un pays qui participait peu au projet européen dans ce domaine et le soutenait moins encore.
Dans l’immédiat, Londres affirme vouloir demeurer entièrement associée aux décisions prises dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dans la mesure où elle restera un membre de plein droit pendant toute la durée des négociations. Pour la suite, le Royaume-Uni nous dit, à ce stade, souhaiter garder un lien fort avec les Européens et réaffirme que ses forces armées « sont une part cruciale de la défense collective de l’Europe », selon les termes employés par Theresa May le 17 janvier. Nous devons travailler à construire ce lien, qui sera nécessairement particulier.
En matière de politique spatiale, la place du Royaume-Uni dans le programme Galileo devra vraisemblablement être considérée sous le jour de sa nouvelle relation de partenariat avec l’Union européenne : du statut de membre à part entière, pleinement intégré au système, le pays passerait en ce cas à celui d’État tiers. Cela posera la question de l’accès au signal sécurisé PRS de Galileo, qui est soumis à négociation s’agissant des États tiers : tout le système devra alors être repensé.
J’en viens à l’action préparatoire à la recherche de défense. Vous savez qu’il a été décidé de consacrer au niveau européen une ligne budgétaire spécifique à ce secteur, pour un effort de recherche et d’innovation dans le seul domaine de la défense. L’instauration d’une période préparatoire de 2017 à 2019 a été actée. Si le montant qui lui est alloué n’est pas très élevé – 90 millions d’euros –, il s’agit d’un acte politique important, car porteur d’une nouvelle logique qui devrait nous permettre de développer à l’horizon 2021-2027 un programme cette fois significatif de recherche et d’innovation en matière de défense, doté de quelque 3 milliards d’euros. Or l’action préparatoire va devoir être rediscutée avec les Britanniques, à la fois acteurs majeurs de l’effort européen actuel de défense et généralement enclins à freiner les actions entreprises, tout en se montrant demandeurs de certaines technologies qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre de l’action préparatoire. Je songe en particulier à l’hélicoptère dronisé, qui pourrait faire l’objet d’une coopération utile.
S’agissant de l’Europe de la défense, nous avons pris en septembre dernier, au moment du sommet informel de Bratislava, une initiative conjointe avec l’Allemagne. Nous avons ensuite été rejoints par l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la République tchèque ; l’initiative a été validée par les ministres des affaires étrangères et de la défense, puis a amené aux décisions du Conseil européen de décembre. Le Royaume-Uni ne s’y est pas opposé ; c’est important. Si on l’entend déclarer qu’il veut rester partie prenante de la décision dans les deux ans qui viennent, il faudra sans doute régir ensuite par un accord particulier sa participation à certaines actions pouvant être entreprises dans le cadre de la PSDC.
Quelques mots des industries de défense, qui représentent un aspect essentiel de notre relation. Nous avons engagé en coopération plusieurs programmes majeurs qui, a priori, devraient continuer de se développer.
Je pense d’abord au drone de combat futur (FCAS), pour lequel nous prévoyons de disposer de deux démonstrateurs opérationnels à l’horizon 2025. Un avenant à l’arrangement bilatéral, signé en décembre 2016, permet d’étendre la phase actuelle et d’ouvrir la voie au lancement de la deuxième partie du projet. C’est important, car il s’agit du drone de combat de nouvelle génération : je ne parle pas du drone d’observation. C’est donc, d’une certaine manière, l’aviation de combat du futur que nous commençons d’élaborer ensemble.
Je pense aussi, dans le domaine industriel, à la vitalité du projet One complex weapons qui consiste en un renforcement de l’intégration de MBDA autour de la France et du Royaume-Uni. L’accord intergouvernemental dans le domaine des missiles, entré en vigueur en octobre dernier, est une étape historique car il vient concrétiser le principe d’interdépendance entre nos deux pays dans un domaine capacitaire et technologique de souveraineté. Ainsi, les programmes sont amenés à se poursuivre, qu’il s’agisse du futur missile de croisière ou du futur missile antinavire qui succèderont au Scalp et à l’Exocet.
Dans le même ordre d’idées, nous avons une coopération très importante autour de Thales : Thales UK, Thales France et le groupe Thales dans son ensemble sont ainsi en partenariat pour l’élaboration du projet de guerre des mines. Des accords ont été signés et devraient permettre une coopération extrêmement utile.
J’en reviens aux propositions formulées pour relancer l’Europe de la défense. J’ai été frappé par le fait que le Royaume-Uni, alors que ces propositions étaient postérieures au vote du 23 juin dernier, n’a pas fait obstacle à la validation de l’ensemble de la feuille de route que nous avions initiée avec l’Allemagne. Il est vrai que nous avions pris les précautions nécessaires sur les points de vigilance britanniques – notamment la complémentarité entre l’action de l’Union européenne et celle de l’OTAN. Cela étant, ce souci est partagé par l’ensemble des membres de l’Union, et en particulier par l’Allemagne. Nous avons également entériné le refus d’une duplication inutile avec la création d’une armée européenne – suite à la formule provocatrice lancée par Michael Fallon. Finalement, les Britanniques ont fait preuve, au cours du trimestre, d’une certaine flexibilité, ce qui nous a permis d’adopter l’ensemble des dispositions que nous avions prévues pour renforcer l’Europe de la défense. Ils ne se sont pas opposés, en particulier, à l’établissement, au sein de l’Union européenne, d’une capacité opérationnelle permanente de planification et de conduite dans le domaine stratégique. Ils ne se sont pas opposés non plus à la mise en œuvre du principe de financement de la défense européenne, que ce soit dans le domaine de la recherche ou qu’il s’agisse de la révision des mécanismes permettant le financement des actions de défense de l’Union européenne par le dispositif Athena.
Je terminerai mon propos en mentionnant deux programmes de coopération en cours.
Il s’agit, d’une part, de notre engagement commun en Estonie en 2017 : dans le cadre du Plan d’action pour la réactivité décidée lors du sommet de l’OTAN à Varsovie, validé lors de la réunion des ministres de la défense en juin dernier, nous allons participer au dispositif de présence avancée rehaussée en Estonie. Cette présence dissuasive vise à prévenir toute incursion russe sur le flanc est de l’Alliance. C’est un point de vigilance majeur que nous partageons avec les Britanniques. Nous mettrons en œuvre cette décision dès le mois d’avril en mobilisant 300 hommes, soixante-dix véhicules blindés et des chars lourds. Le même dispositif sera ensuite déployé en Lituanie avec nos alliés allemands.
D’autre part, dans le cadre de nos actions récentes, nous avons beaucoup coopéré face à la Russie puisque nous avons été conduits à mener des actions de « dissuasion » à l’égard d’appareils stratégiques russes ayant longé et frôlé l’espace aérien français. Dans le même objectif, nous faisons preuve de vigilance à l’égard de la menace sous-marine russe qui mérite une attention particulière en ce moment – surtout dans l’Atlantique Nord où nous menons des actions spécifiques avec les Britanniques, les Américains et les Norvégiens. Le regain de déploiement sous-marin russe étant relativement récent, il importe que nous puissions nous coordonner à cet égard.
Bref, nous coopérons très étroitement sur des secteurs extrêmement sensibles et la France considère que cette relation bilatérale est essentielle à notre propre sécurité. Cela ne nous empêche pas d’avoir des initiatives de défense au niveau européen. Je constate que jusqu’à présent, le paquet qui a été proposé a été approuvé par le Royaume-Uni. S’agissant des engagements financiers de ce pays, ceux-ci ont pu varier dans le temps, le Royaume-Uni ayant à un moment donné fait des coupes sombres dans sa participation budgétaire, mais son effort budgétaire est maintenant en phase de remontée. Il importe que celle-ci se poursuive. Il faut également que nous inscrivions notre coopération dans les industries de défense dans la durée. Je crois, pour en avoir parlé à de nombreuses reprises avec mon homologue d’outre-Manche, que c’est une volonté partagée.
Mme Élisabeth Guigou. Quels programmes voudriez-vous privilégier à la fois pour l’action préparatoire et pour le programme 2020-2027 ? Si des programmes importants de recherche sont financés par l’Union européenne, cela signera une évolution remarquable.
D’autre part, il faut, naturellement, non seulement poursuivre mais amplifier notre coopération bilatérale avec le Royaume-Uni. Vous avez souligné que c’était souhaité des deux côtés – ce qui me paraît excellent – et que nous partagions de surcroît les mêmes analyses des grands enjeux stratégiques mondiaux. Avez-vous le sentiment à ce stade, compte tenu de la distance que semble vouloir prendre le nouveau président des États-Unis par rapport à l’OTAN, que le Royaume-Uni sera plus ouvert sur les questions de projections extérieures communes de l’Union européenne au sens large ? Si tant est qu’une analyse soit possible à ce stade – les intentions de M. Trump étant encore assez floues –, pensez-vous que le Royaume-Uni acceptera, comme il l’a fait jusqu’à présent, que l’Europe de la défense continue à avancer ?
Ce que vous venez de nous dire concernant les industries de défense MBDA et Thales est très rassurant car sans véritable industrie de défense européenne, nous n’aurons jamais de défense commune.
M. Pierre Lellouche. Je retiens de ce que vous venez de dire que dans le domaine de la défense, l’intensité des relations bilatérales avec les Britanniques n’a pas été affectée par le Brexit.
Depuis le référendum britannique, il y a eu l’élection de M. Trump et son commentaire sur l’OTAN qu’il juge « obsolète ». Il ne s’agit donc plus seulement de reprocher aux Européens de ne pas financer suffisamment l’Alliance – vieille rengaine, d’ailleurs assez fondée, de nos alliés américains. Cette déclaration change en effet la donne de la défense européenne et notamment du socle de sécurité de l’Allemagne, de la Pologne et des États baltes. Qu’en pensent nos partenaires britanniques ?
Par ailleurs, vous avez indiqué que les deux principaux budgets de défense européens étaient ceux de la France et du Royaume-Uni – je souhaiterais que ce soit vraiment le cas du côté français mais c’est un autre débat. Il faut cependant noter une évolution outre-Rhin puisque le budget allemand de la défense est sur le point de dépasser le nôtre. Y a-t-il oui ou non moyen – du fait du Brexit et grâce, si j’ose dire, à M. Trump – de bâtir une défense commune en élargissant le champ des accords de Lancaster House à l’Allemagne dans le domaine des forces de projection, dans celui du renseignement et en matière d’organisation des forces et de complémentarité ?
M. Gilles Savary. Votre exposé, monsieur le ministre, est très éclairant et rassurant même s’il n’est pas évident de savoir quelle sera la marche à suivre dans les années qui viennent. Il est rassurant, au vu de l’histoire de nos deux pays et de leurs capacités militaires, de constater la très forte coopération franco-britannique sur des sujets essentiels. Cela suffira-t-il notamment vis-à-vis des opinions publiques, dans un monde aujourd’hui totalement déstabilisé tant au Sud qu’à l’Est et, sur le plan politique, aux États-Unis.
Comment articuler les trois chantiers : préserver ce lien bilatéral très fort, poursuivre nos efforts pour essayer d’embarquer tous les Européens dans une Europe de la défense et, enfin, l’OTAN ? La construction de l’Europe de la défense n’est pas neutre en termes d’attachement des opinions publiques à l’Europe car si le Brexit est un succès pour le Royaume-Uni, il nous faudra offrir d’autres perspectives. C’est pourquoi je souhaite que l’on réoriente les priorités de la construction européenne vers les questions de défense qui, contrairement aux questions économiques, peuvent faire l’adhésion des peuples.
Par ailleurs, le Brexit devrait conduire à la réintroduction de barrières commerciales et douanières. Vous parliez tout à l’heure des liens très étroits entre les industries de défense britanniques et françaises. Que va-t-il se passer ? Quelle sera la position de la France en ce domaine ? Demanderez-vous une exception au rétablissement des barrières douanières dans le domaine des industries de défense ?
M. Pierre Lellouche. La défense ne relève pas du marché intérieur.
M. Gilles Savary. C’est vrai mais je me demande si cela ne risque pas d’affecter certains fournisseurs. Peut-on considérer que le Brexit n’aura aucune incidence sur les échanges en matière d’industries de défense ?
M. Pierre Lequiller. Monsieur le ministre, vous nous avez complètement rassurés : la dynamique de la coopération franco-britannique, loin d’être remise en cause, se poursuivra comme précédemment. La continuité va l’emporter en dépit du Brexit, ce qui est évidemment très positif.
Je voudrais néanmoins évoquer, comme l’ont fait Pierre Lellouche et Gilles Savary, le changement d’approche que l’on peut pressentir de la part des États-Unis d’Amérique. Sous la présidence de Barak Obama, déjà, l’engagement des Américains n’était pas très fort. À présent, nous avons carrément le sentiment que les États-Unis vont se replier sur eux-mêmes, y compris, probablement, en matière de défense. M’étant rendu en Allemagne à plusieurs reprises récemment, j’ai entendu Mme Merkel dire devant le Congrès de la CDU qu’elle voulait porter l’effort de défense de l’Allemagne à 2 % du PIB. Cela va-t-il être fait à court terme ou bien par étapes ?
D’autre part, l’Allemagne acceptera-t-elle aussi de faire évoluer le type d’interventions qu’elle effectue sur le terrain, et qui se bornait jusqu’ici à de la formation. Au vu des déclarations de la chancelière et de Mme Von der Leyen, l’Allemagne est-elle en train de changer de cap sur ce sujet ?
Enfin, dès lors que l’Allemagne entrerait dans le jeu, peut-on espérer que l’Espagne, l’Italie et la Pologne se joignent au mouvement ? L’Europe de la défense veut certes se construire à vingt-sept mais cela ne marchera jamais dans un tel cadre. La coopération structurée est-elle néanmoins en marche ou pas ?
M. Jacques Myard. Je voudrais tout d’abord nous féliciter de l’excellence de la coopération intergouvernementale, monsieur le ministre. On voit bien que la méthode communautaire n’est pas la panacée et qu’il faut parfois revenir aux bonnes vieilles techniques…
Le Brexit aura sans doute un impact en matière de coopération en armement du fait de la récente directive qui rend obligatoire la passation d’appels d’offres …
M. le ministre. Elle ne l’impose pas dans tous les domaines.
M. Jacques Myard. Certes – et heureusement – mais elle va déjà trop loin, de mon point de vue. Il aurait fallu exonérer la défense de toutes les règles européennes un peu trop contraignantes.
Vous rappeliez à propos de Galileo – projet que j’ai appelé de mes vœux parce que c’est une bonne coopération – que l’accès au signal sécurisé PRS était soumis à négociation pour les États tiers mais les Américains l’ont déjà, n’est-ce pas ? Je crois savoir qu’ils avaient fait pour cela des pieds et des mains, disant que ce serait un casus belli si les Européens se dotaient de Galileo. Je ne vois donc pas pourquoi, en ce domaine, on mettrait les Britanniques au ban de l’empire.
Enfin, nous avons entendu dire que l’armée britannique avait le moral dans les chaussettes, pour parler familièrement. Il est donc nécessaire de la réconforter, tous Français que nous soyons.
M. le président Claude Bartolone. Vous avez raison, monsieur le ministre, de dire que pour le moment, le Brexit n’a pas d’impact sur les questions de défense. Il suffit de constater l’attitude qui a été celle du gouvernement britannique, que ce soit après la déclaration de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou après le Conseil européen de décembre dernier qui a envoyé un signal fort. Mais je reste préoccupé par une question qui a été soulevée par les différents intervenants et qui me taraude encore davantage depuis que j’ai entendu Michel Barnier : dans quels dossiers le Royaume-Uni peut-il avoir un moyen de chantage sur l’Union européenne. ? Je pense pour ma part que le dossier de la défense paraît le plus structuré à cet égard.
M. le ministre. Je ne crois pas.
M. le président Claude Bartolone. Je vous dis cela après avoir constaté le dialogue singulier qui a commencé à s’installer entre M. Trump et Mme May, et après les critiques qui ont été portées sur le fonctionnement de l’OTAN. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure mais avons-nous un plan B si le Royaume-Uni était tenté de faire du chantage sur ce dossier ? Compte tenu notamment de l’écart sur le chèque de sortie, je ne vois pas comment on pourra faire dans la dentelle. Un tel scénario pourrait donc exister : l’avez-vous prévu ?
M. Pierre Lellouche. Je prolonge les propos du président Bartolone : pour disposer d’un levier ou d’un moyen de chantage, les Britanniques ont besoin de conclure très rapidement un accord de libre-échange avec les États-Unis. Telle est la carte que détiennent les Américains. N’y a-t-il pas là un élément de nature à compromettre nos relations de défense avec les Britanniques, actuellement satisfaisantes ?
M. le ministre. Je vais répondre à vos questions en vous donnant mon sentiment personnel, en particulier lorsqu’il s’agit d’anticiper.
Dans mon propos liminaire, j’ai essayé de décrire la très grande étroitesse de nos relations de défense avec le Royaume-Uni.
C’est le cas dans le domaine nucléaire : nous avons des outils communs de vérification de la pérennité et de l’efficacité de nos têtes nucléaires, même si chacun dispose de sa propre « maison » sur le site de Valduc. Certes, les lanceurs sont fournis par les États-Unis. Par ailleurs, les sous-marins nucléaires britanniques sont basés en Écosse. Cela peut soulever d’autres problèmes, que je n’aborderai pas maintenant.
C’est également le cas dans le domaine opérationnel : nous avons une force de projection commune que j’ai vue fonctionner avec succès lors de plusieurs exercices. Conformément à ce qui est prévu dans le traité, nous organisons un exercice par an et par armée ou interarmées. L’année dernière, il s’est agi d’un exercice global : une opération fictive à laquelle ont participé nos deux marines, nos deux aviations et nos deux armées de terre. Nous sommes en train d’élaborer le concept opératoire.
C’est enfin le cas dans le domaine capacitaire : nous avons mis nos industries de production de missiles en commun. C’est une activité de très haut niveau, pourvoyeuse d’emploi : MBDA et Thales UK comptent respectivement 3 000 et 6 000 salariés au Royaume-Uni.
Je ne vois donc pas quel intérêt le Royaume-Uni aurait à infléchir ces relations en quoi que ce soit. Je n’ai jamais entendu mon collègue Michael Fallon faire la moindre déclaration en ce sens. Ce n’est pas notre intérêt, mais ce n’est pas non plus celui des Britanniques. Je pense donc que ces relations vont se poursuivre.
J’en viens aux déclarations de M. Trump.
D’abord, le Royaume-Uni est profondément attaché à l’OTAN, de même que l’ensemble des pays européens, en particulier l’Allemagne, car elle serait fragilisée sans la protection de l’OTAN : elle aurait des difficultés en matière de couverture sécuritaire.
Ensuite, j’attends de disposer de déclarations officielles du Gouvernement américain. Car le futur secrétaire à la défense, le général James Mattis, insiste au contraire sur la nécessité de maintenir l’action de l’OTAN, tout en établissant sans doute un meilleur équilibre transatlantique, ce qui est une demande américaine ancienne, ainsi que l’a rappelé M. Lellouche. Sur le fond, le général Mattis annonce des objectifs qui sont globalement ceux qui ont été fixés collectivement lors du sommet de l’OTAN à Varsovie. Et le sénateur John McCain, avec qui je me suis entretenu récemment sur ces questions, ne dit pas autre chose.
Nous sommes donc dans une phase intermédiaire, où il y a des déclarations contradictoires. Il est trop tôt pour tirer des conclusions ; pour le dire rapidement, je ne vais pas anticiper sur la base de tweets ! Il faut attendre une clarification des positions des uns et des autres. De ce point de vue, j’attends avec grand intérêt la réunion des ministres de la défense de l’OTAN à Bruxelles dans une quinzaine de jours, à laquelle participera le général Mattis.
Je ne pense pas qu’il y ait lieu d’imaginer une stratégie alternative, d’autant qu’un certain nombre de pays européens, qui étaient à un moment donné très pro-américains, parfois exagérément, au point de rompre leurs engagements – je pense à la Pologne –, sont désormais très inquiets et très attentifs à ce qui va se passer. Pour notre part, nous sommes au rendez-vous. Je n’ai pas eu le moindre signe de remise en cause de l’opération à laquelle nous allons participer en Estonie sous commandement britannique.
Monsieur Myard, à un moment donné, mon collègue britannique m’a effectivement fait savoir que son armée était « fatiguée » – c’est le terme qu’il a employé – en raison de la succession des interventions en Afghanistan et en Irak. C’est en tout cas la raison qu’il donnait pour expliquer la faiblesse de l’engagement britannique dans les opérations menées à l’initiative de l’Union européenne, notamment EUTM Mali, EUTM Somalie et EUTM RCA, pour citer les trois opérations majeures de l’Union en Afrique. Cela n’empêche pas les Britanniques de participer désormais au dispositif de présence avancée rehaussée en Estonie ou aux opérations contre Daech au Levant, avec une posture à peu près identique à la nôtre tant en termes d’effectifs que de capacités, puisqu’ils ont engagé des avions de combat Tornado et Typhoon. D’une manière générale, le moral des forces britanniques semble s’être amélioré en 2016 par rapport à 2014 et 2015. Il a notamment été conforté, en 2015, par la Strategic Defense and Security Review (SDSR), équivalent de notre Livre blanc et de notre loi de programmation.
Monsieur Lequiller, je constate trois inflexions majeures dans l’attitude de l’Allemagne, depuis un an et demi, voire depuis les premiers attentats commis en France en 2015 – l’Allemagne avait alors répondu à l’appel au soutien que nous avions lancé. Ces inflexions sont donc antérieures au Brexit, même si celui-ci a pu les conforter ensuite.
Première inflexion : une volonté affichée d’augmenter le budget de défense et une augmentation réelle de celui-ci, qui est toutefois encore loin d’atteindre 2 % du PIB.
Deuxième inflexion, frappante de mon point de vue : une réactivité et un engagement beaucoup plus fort sur de nombreux théâtres, que l’on n’aurait pas pu imaginer ne serait-ce qu’il y a deux ans. Ma collègue Mme Ursula von der Leyen donne une forte impulsion en la matière, avec le soutien, manifestement, de la chancelière Mme Merkel. Cela se traduit par une série de grandes nouveautés. Dans quelques semaines, l’Allemagne va déployer des hélicoptères dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Elle est également présente dans les combats contre Daech : la frégate allemande Augsburg a été en permanence aux côtés du porte-avions Charles-de-Gaulle, dans toutes ses missions ; certes, l’Allemagne n’a pas engagé d’avions de combat, mais elle participe à l’observation, à la surveillance et à la formation. À Erbil, où je me suis rendu récemment, il y a des formateurs allemands auprès des peshmergas.
M. Pierre Lellouche. Et les Allemands livrent plus d’armes que nous.
M. le ministre. Il faut en effet ajouter les livraisons d’armes.
Troisième inflexion : un intérêt récent mais marqué pour l’Afrique. Mme Merkel s’est rendue en Afrique, ce qui était, là aussi, une grande nouveauté. Nous allons agir ensemble : j’effectuerai dans quelques jours une mission conjointe en Afrique avec ma collègue allemande ; nous allons essayer de créer un partenariat important, avec à la fois un soutien aux armées africaines en reconstruction et – hors de notre champ de compétences – un volet relatif au développement.
Il y a donc une évolution significative de la volonté de l’Allemagne en matière de défense.
En complément, la France et l’Allemagne ont pris l’initiative, en septembre 2016 – donc, après le Brexit –, d’établir une feuille de route sur l’Europe de la défense. Nous avons pris toutes les précautions pour qu’elle soit acceptable par les Britanniques. Ainsi, pour être inclusifs, nous n’avons pas, à ce stade, retenu l’hypothèse d’une coopération structurelle permanente.
Cette feuille de route concerne trois domaines. Elle a, premièrement, une dimension opérationnelle, l’objectif étant d’améliorer la réactivité, avec notamment un renforcement de l’Eurocorps et de son emploi, des capacités d’organisation et de planification communes, une identification beaucoup plus active des Groupements tactiques de l’Union européenne (GTUE), afin que certains d’entre eux soient préidentifiés et plus aisément disponibles pour une intervention.
Elle a, deuxièmement, une dimension capacitaire, avec le renforcement de la recherche, évoqué tout à l’heure par Mme Guigou. À ce stade, l’action préparatoire ne concerne que l’hélicoptère dronisé. Ce programme sera mis en œuvre sur l’initiative d’Airbus. Les programmes futurs restent à établir, peut-être dans le cadre de l’Agence européenne de défense. En tout cas, il paraît acquis qu’il y aura, entre 2021 et 2027, une ligne budgétaire européenne consacrée aux industries de défense, tout à fait en amont, qui va nous permettre de consolider notre base industrielle en Europe, dès lors que les Etats le décideront. Les Britanniques seront peut-être intéressés à participer à ces programmes. Dans ce cas, il faudra établir un lien avec eux le moment venu. J’ignore encore si un accord spécifique sera nécessaire. De même, il faudra sans doute un accord spécifique sur Galileo, et peut-être un accord spécifique sur les industries de défense, MBDA et Thales étant les deux plus importantes, Airbus étant concernée dans une moindre mesure.
La feuille de route a, troisièmement, une dimension financière, avec la révision du mécanisme Athena, la création d’un fonds européen de soutien aux industries de défense, initiative de M. Juncker que nous avons soutenue, et la mise en œuvre d’un processus de soutien intitulé CBSD en anglais ou RCSD en français – renforcement des capacités en faveur de la sécurité et du développement –, qui permettra aux forces armées africaines de s’équiper en matériel non létal, chaque État conservant la liberté d’acquérir les armes de son choix. Nous constatons en effet qu’il ne suffit pas de former ces forces, il faut aussi les équiper.
Cette feuille de route a été validée par les Britanniques, sachant que nous avions fait en sorte qu’elle ne contienne pas d’élément bloquant pour eux. Mon collègue Michael Fallon m’avait d’ailleurs dit : « Tu vas être surpris, nous allons voter pour ! » Cela illustre notre volonté de créer un partenariat avec les Britanniques, de favoriser leur présence dans les actions que peut mener l’Union européenne en matière de défense.
M. Pierre Lellouche. Quel est le statut de cette feuille de route ? Si les Britanniques y adhèrent, il est important de le savoir.
M. le ministre. Elle a été validée par le Conseil européen du 15 décembre 2016.
M. Pierre Lellouche. Ne vous êtes-vous pas compliqué la tâche ? Dans la mesure où il s’agit d’un instrument européen, la question de la coordination entre ce système et le Royaume-Uni va se poser. Ne valait-il pas mieux une feuille de route bilatérale franco-allemande à laquelle nous aurions associé ensuite les Britanniques ? N’y a-t-il pas encore moyen de procéder de la sorte ?
M. le ministre. Le Royaume-Uni va rester partie prenante des travaux sur l’Europe de la défense pendant au moins deux ans. Nous n’allons pas arrêter ces travaux. Les Britanniques ont voté pour cette feuille de route, qui comprend d’ailleurs des éléments auxquels ils s’étaient opposés jusqu’alors.
M. Pierre Lellouche. Votre idée est donc de poursuivre ce travail après le Brexit sous une autre forme ?
M. le ministre. Bien sûr. Si les Britanniques le souhaitent, nous pouvons mettre en place en place un dispositif spécifique permettant leur participation à la PSDC. J’ai l’impression qu’ils y sont ouverts, ainsi que le laisse penser le point 11 du discours prononcé ce mardi 17 janvier par Mme Theresa May.
Pour ce qui est des déclarations de M. Trump, je le répète : l’ensemble des pays européens est très attaché à l’OTAN, en particulier l’Allemagne.
S’agissant de l’impact du Brexit sur les industries de défense, monsieur Savary, deux entreprises majeures peuvent être concernées : MBDA et Thales. Thales UK est avant tout présente sur le marché britannique, mais elle coopère avec Thales SA, située en France, sur un programme commun : la conception des drones sous-marins antimines, qui remplaceront en temps utile les chasseurs de mines.
L’une des conséquences sera la non-application aux entreprises britanniques des directives européennes imposant des appels d’offres. Cependant, à mon avis, les entreprises que j’ai citées ne sont pas concernées. Il peut aussi y avoir une conséquence pour les transferts de technologies de pointe, que les directives facilitent entre États membres de l’Union européenne. Il faudra peut-être prévoir un dispositif spécifique en la matière.
Quant à l’éventuel dumping qui a été annoncé, il sera inopérant en l’espèce, puisqu’il s’agit de programmes communs, notamment pour la production des missiles qui succéderont aux Exocet et aux SCALP, armes majeures de la guerre de demain.
S’agissant de Galileo, le financement étant communautaire, il faudra sans doute trouver un dispositif spécifique pour associer les Britanniques, d’autant plus qu’il y a un volet sécuritaire.
M. Jacques Myard. Les États-Unis ont eux aussi accès au signal sécurisé PRS de Galileo.
M. le ministre. Oui, en tant qu’État tiers, de même que la Norvège. Il faudra un dispositif spécifique du même type pour le Royaume-Uni.
M. le président Claude Bartolone. Merci, monsieur le ministre. On voit que les choses n’en sont qu’à leur début sur le dossier de la défense. Nous espérons que tout se déroulera dans les meilleures conditions possibles.
Séance du jeudi 26 janvier 2017
La mission d’information procède à l’audition, non ouverte à la presse, de Lord Llewellyn, ambassadeur de Grande-Bretagne en France
M. le président Claude Bartolone. Notre mission d’information arrive au terme de ses auditions, et nous avons la chance d’accueillir Lord Llewellyn, ambassadeur du Royaume-Uni en France.
Monsieur l’ambassadeur, nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir vous entendre que, en tant que directeur de cabinet du Premier ministre David Cameron, vous vous êtes trouvé aux premières loges de cet « accident » que constitue le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Aujourd’hui en poste dans notre pays, vous aurez à gérer les conséquences de cette sortie sur les relations franco-britanniques et allez pouvoir nous éclairer sur les différentes étapes qu’il faudra franchir, sachant que la Cour suprême du Royaume-Uni vient d’annoncer que le Parlement britannique devra être consulté sur l’activation du Brexit, alors même que la Première ministre s’était d’ores et déjà efforcée de désamorcer les oppositions par ses annonces sur la manière dont le Parlement serait associé aux négociations.
Dans ce contexte, nous sommes impatients de connaître le sentiment que vous inspirent vos relations actuelles avec les responsables politiques français. Nous attendons également de vous que vous nous éclairiez sur le « timing » britannique jusqu’à l’activation de l’article 50.
Enfin, pouvez-vous nous livrer votre interprétation du discours de Theresa May, notamment pour ce qui concerne la façon dont elle envisage la sortie du marché unique et les nouvelles relations que pourraient établir les Britanniques avec leurs partenaires européens ?
Lord Llewellyn, ambassadeur du Royaume-Uni en France. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je suis très heureux d’être ici ce matin pour témoigner devant vous.
C’est un grand honneur et un privilège d’être en poste à Paris, dans un moment très important pour les relations entre nos deux pays. La France a toujours joué un rôle majeur dans ma vie professionnelle et personnelle.
Ma carrière, ces trente dernières années, a été axée sur les affaires étrangères, ce qui m’a amené à rencontrer déjà plusieurs d’entre vous. Avant d’être directeur de cabinet de David Cameron à Downing Street pendant six ans, j’ai passé treize ans à l’étranger : cinq ans à Hong-Kong, auprès de notre dernier gouverneur, Chris Patten, puis trois ans à Bruxelles, au sein de son cabinet ; cinq ans enfin à Sarajevo, au sein de la mission chargée de la reconstruction de la Bosnie.
Il se trouve que, par une incroyable coïncidence, le premier Français que j’ai rencontré lors de mon arrivée à Calais, il y a environ deux mois, pour prendre mes fonctions d’ambassadeur en France, était un policier de la police de l’air et des frontières avec lequel j’avais travaillé il y a onze ans à Sarajevo : cela m’a rappelé à quel point la France et le Royaume-Uni travaillent ensemble partout dans le monde pour défendre nos valeurs et nos intérêts communs.
Dès ma prise de fonctions, j’ai pu mesurer le caractère fort et unique de la relation qui unit nos deux pays. J’ai assisté à la cérémonie marquant le centenaire de la fin de la bataille de la Somme au cours de laquelle de nombreux soldats britanniques et français ont combattu côte à côte : parmi eux, mon arrière-grand-oncle, soldat britannique, mais également l’arrière-grand-père de ma femme, soldat français. J’ai également participé à l’émouvante commémoration du premier anniversaire de l’attentat du Bataclan ; ces cérémonies m’ont rappelé à quel point nos deux pays ont toujours su s’entraider dans les moments difficiles et comment ils continuent à le faire.
Ma mission en tant qu’ambassadeur comporte plusieurs priorités, au premier rang desquelles la relation entre la France et le Royaume-Uni. Cela signifie que, tout en faisant le maximum pour que les nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne soient un succès pour tous, je veux surtout œuvrer à l’approfondissement de notre relation bilatérale, dans de nombreux domaines.
J’en viens à présent à la position du Royaume-Uni et à notre feuille de route concernant le Brexit. Avant d’entrer dans les discussions techniques, je tiens à dire que je suis conscient de l’émotion suscitée par le résultat du referendum, ici comme ailleurs.
La Première ministre Theresa May a prononcé la semaine dernière un discours majeur sur notre sortie de l’Union européenne, présentant notre plan pour le Brexit, notre vision du futur partenariat stratégique entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
Les principaux points développés par la Première ministre sont les suivants.
Nous quittons l’Union européenne mais nous ne quittons pas l’Europe. Nous resterons des partenaires fiables, volontaires et des amis proches de nos voisins, comme la France, avec lesquels nous partageons tant de valeurs et d’intérêts communs.
Je sais que les raisons du vote des Britanniques n’ont pas toujours été très bien comprises ; ce choix peut s’expliquer par la volonté de mes concitoyens de voir les décisions qui concernent leur vie prises par des élus qu’ils ont choisis et dont ils se sentent proches. Leur vote en faveur du Brexit reflète tout particulièrement l’attachement de notre pays à sa démocratie parlementaire et au rôle de notre Parlement, à Westminster.
Nous avons entendu la position des leaders de l’Union européenne sur la question de l’indivisibilité des quatre libertés relatives au marché unique. C’est pourquoi notre proposition est celle d’un accord de libre-échange audacieux et ambitieux, qui supprime autant que possible les freins au commerce des biens et des services. Nous voulons donner aux entreprises européennes et britanniques un maximum de liberté pour commercer ensemble et opérer sur leurs marchés respectifs.
Notre priorité, comme vous le savez, est de parvenir à un accord dès que possible, afin de garantir les droits des citoyens, qu’il s’agisse des Britanniques vivant dans les États membres de l’Union européenne ou des citoyens des États membres vivant au Royaume-Uni.
Nous voulons que la transition entre notre statut actuel d’État membre de l’Union et le nouveau partenariat que nous souhaitons voir naître soit aussi nette et fluide que possible, dans notre intérêt commun. Dans cette perspective, nous souhaitons qu’un accord sur ce futur partenariat soit signé dans les deux ans prévus par l’article 50.
Je veux insister sur les ambitions du nouveau partenariat que nous proposons : destiné à se substituer à la relation institutionnelle à laquelle nous renonçons, il doit être constructif, bénéfique pour les deux parties, et englober bien plus que les seules questions économiques. Nous souhaitons que notre coopération continue dans d’autres secteurs clefs, notamment la défense, la sécurité ou la recherche.
Je souligne que nous ne voulons pas déstabiliser le marché unique ni l’Union européenne. Au contraire, nous voulons que l’Union européenne soit une réussite et que ses États membres, qui sont nos alliés, nos voisins, nos amis, soient prospères.
Nous voulons aussi que les relations entre le Royaume-Uni et la France restent étroites. Pourquoi ? Pas seulement parce que nous sommes des amis, des voisins et des alliés, mais parce que nos deux pays, de taille similaire, partagent un héritage, des valeurs et des objectifs communs et qu’ils font face aux mêmes défis mondiaux. Si nous avons eu nos rivalités et nos différends – pour dire les choses en termes diplomatiques –, notre relation se fonde sur un profond respect mutuel ; il est donc clair que notre partenariat devra continuer à s’approfondir dans de multiples domaines.
En matière de défense tout d’abord : j’étais à Downing Street lors de la signature des accords de coopération de Lancaster House – qui sont l’un des accords dont je suis le plus fier. Depuis, notre coopération – qui se déploie sur de nombreux théâtres d’opérations extérieures comme au Mali, en Irak ou en Syrie – n’a cessé de se renforcer, à tel point qu’aujourd’hui un pilote britannique pilote un avion militaire français et inversement. En tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies enfin, nos deux pays ont également une responsabilité particulière sur la scène internationale.
En matière de sécurité, j’ai pu, lors de mes années passées à Downing Street, mesurer l’étendue de notre coopération en matière de sécurité, notamment dans le cadre de la menace terroriste, mais également en amont, dans la lutte contre la radicalisation. Nous vivons dans un monde dangereux ; loin de réduire notre coopération, nous devons au contraire la renforcer dans ce domaine.
La recherche, les sciences et les technologies sont l’un des autres domaines dans lesquels se déploie notre coopération ; j’ai pu en voir de mes propres yeux de nombreux exemples. Ainsi, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, j’ai visité la semaine dernière l’institut Laue-Langevin à Grenoble, un centre de recherche sur les neutrons qui réunit les Français, les Britanniques et les Allemands, et constitue un bel exemple de cette coopération scientifique.
Enfin, notre coopération dans le domaine énergétique est également essentielle : il n’est qu’à voir la signature de l’accord pour la construction d’un EPR par EDF à Hinkley Point, qui engage le Royaume-Uni pour plus de soixante ans, autrement dit vraiment sur le long terme.
Plus globalement, je lancerai très prochainement, avec ma collègue Sylvie Bermann, l’ambassadrice de France à Londres, un programme d’échanges de haut niveau, intitulé Young Leaders et visant à encourager les relations directes entre jeunes professionnels issus de divers États des deux côtés de la Manche.
Je suis donc très optimiste sur l’avenir de nos relations. Nous avons hâte de poursuivre un travail constructif ensemble, alors que nous entrons dans une période cruciale pour le futur de nos deux pays et de l’Europe.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur l’ambassadeur, Hilary Benn vient d’exiger, dans une déclaration récente, que le Gouvernement présente au Parlement avant la mi-février un rapport sur son plan de négociations, sous la forme d’un Livre Blanc. La presse parlait quant à elle d’un texte court, sur lequel il ne serait guère possible de multiplier les amendements. Quelle est votre position sur cette question ? Faisons par ailleurs un peu de politique-fiction : quelles seraient les conséquences d’un vote négatif dans l’une des deux chambres ?
D’autre part, commence-t-on à avoir une idée du sort des citoyens britanniques résidant sur le continent et des citoyens européens qui se trouvent au Royaume-Uni ? On s’interroge notamment sur le fait de savoir si la question du statut de ces citoyens s’est ouverte à la date du référendum ou si elle dépendra du moment où l’article 50 se trouvera activé. Il s’agit d’une question pratique, mais qui va rapidement se trouver à l’ordre du jour.
Mme Élisabeth Guigou. Monsieur l’ambassadeur, nous nous réjouissons d’avoir de nouveau en poste à Paris un amoureux de la France ; vous perpétuez en cela une heureuse tradition.
Il n’y a naturellement aucune raison que nos relations bilatérales souffrent du choix qu’a fait le peuple britannique de sortir de l’Union européenne. Nous devons certainement même les renforcer dans les domaines que vous avez cités, notamment la défense.
J’aimerais néanmoins insister sur ce qui se passe à Calais et savoir comment vous envisagez sur ce point précis notre coopération future. En effet, les migrants recommencent à venir à Calais, malgré les efforts considérables que nous avons faits pour répartir harmonieusement sur notre territoire ceux d’entre eux que nous étions parvenus à persuader de demander l’asile en France. Il reste en particulier des centaines de mineurs isolés qui attendent de passer au Royaume-Uni. Un certain nombre ont déjà été accueillis outre-Manche mais, de notre point de vue, cela reste très insuffisant.
Quelle est par ailleurs votre appréciation de ce que votre Gouvernement jugera absolument prioritaire dans la période des deux ans qui va suivre l’invocation de l’article 50 ? Quels sont les sujets que vous estimez devoir être réglés pendant cette période, avant que débutent les négociations commerciales, qui seront évidemment beaucoup plus longues ?
M. Jacques Myard. Excellence – selon le protocole du ministère des affaires étrangères, on donne du « monsieur l’ambassadeur » à un ambassadeur français mais de l’ » Excellence » à un ambassadeur étranger –, Mme May, comme vous-même, l’a laissé entendre : on ne refait pas la géographie. M. de Talleyrand l’avait déjà expliqué en 1815, alors qu’il renouait avec Londres au sortir d’une guerre franco-britannique qui avait duré depuis plus de trente ans : « Je fais la politique étrangère de ma géographie. » Je me félicite de ces permanences dans la conduite de ce que la Cour permanente de justice internationale (CPJI) appelle les « nations les plus civilisées ».
Cela étant, si je suis convaincu, dans la mesure où notre solde commercial avec le Royaume-Uni est positif et que les Français n’ont donc par conséquent aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied, que nous nous dirigeons vers un accord de libre-échange, j’aimerais votre opinion sur le fait que, compte tenu de la législation européenne, la City risque selon toute vraisemblance de perdre le bénéfice du passeport européen.
Qu’on le veuille ou non, le Brexit est la preuve de la crise que traverse l’Union européenne et le signal qu’il est grand temps de la refonder sur de nouvelles bases. Quel est selon vous le grief principal qu’ont exprimé vos concitoyens par leur vote ? On a beaucoup évoqué les questions d’immigration – notamment polonaise – mais cela ne masque-t-il pas un reproche plus fondamental, sur lequel nous devrions tous nous interroger, et qui touche à la perte de souveraineté des parlements nationaux ?
M. Pierre Lellouche. Monsieur l’ambassadeur, nous nous connaissons depuis vingt-cinq ans. Nous nous sommes rencontrés une première fois à Hong Kong, où j’accompagnais Jacques Chirac, venu observer comment vous accompagniez la sortie – déjà ! – de Hong Kong du giron britannique, puis nous nous sommes revus à Sarajevo. Je suis donc très heureux de vous accueillir aujourd’hui, malgré mes regrets que l’ambiance ne soit pas franchement à la gaieté et que nous entrions dans une période complexe qui doit avoir le moins de conséquences négatives pour nos deux pays.
La dernière fois que les Anglais ont quitté le continent, si l’on excepte l’épisode de la poche de Dunkerque, c’était il y a cinq cent quarante-deux ans, lorsque fut signé le traité de Picquigny, aux termes duquel, Louis XI, sans doute le roi le plus intelligent qu’ait eu la France, paya à Édouard IV d’Angleterre une somme de 75 000 écus, assortie d’une rente annuelle, pour que les Anglais veuillent bien rentrer chez eux et nous ficher la paix… Or les négociations qui s’annoncent ne sont pas sans évoquer le traité de Picquiny, toute la question étant de savoir qui va payer.
Et c’est là que ça se complique. Plusieurs problèmes urgents se profilent devant nous ; nous devons donc éviter que cette affaire ne traîne trop car, même si Mme May affirme ne pas vouloir déstabiliser l’Europe, le seul fait que les négociations s’étirent en longueur, sur deux ans voire plus, sera extrêmement délétère pour ce qui reste de l’unité européenne. Je pense en particulier à tout ce qui touche à la désindustrialisation et à la délocalisation dont souffrent nos territoires – le cas de l’usine Whirlpool d’Amiens qui va être délocalisée en Pologne est à ce titre emblématique. Nos débats à cet égard sont assez voisins des vôtres…
Je souhaite donc que tout se passe le plus rapidement possible. Mme May a indiqué qu’elle voulait un divorce : eh bien, divorçons ! La première question dans un divorce concerne les enfants, en l’occurrence les citoyens. De mémoire, 1,2 million de Britanniques qui vivent sur le continent, dont de nombreux pensionnés qui vivent en France. Quelles sont vos intentions à leur égard ? Pourriez-vous par ailleurs nous dire ce qu’il en est des rumeurs de montée à Londres de manifestations de xénophobie à l’égard des citoyens européens, y compris français ? Que compte faire votre Gouvernement ?
J’aimerais également en savoir plus sur votre stratégie. En quoi consiste exactement l’accord de libre-échange que vous souhaitez ? Vous avez parlé d’un partenariat fort et ambitieux : quels domaines concernera-t-il ? Envisagez-vous un divorce à la norvégienne ? à la suisse ?
Enfin, l’unité du Royaume-Uni est-elle mise en danger par le Brexit et qu’implique-t-il dans votre organisation interne ?
M. le président Claude Bartolone. Quelles devraient être les conséquences de la décision de la Cour suprême qui a rejeté la demande de l’Écosse concernant la consultation des parlements régionaux ?
Lord Llewellyn. Monsieur le président, la Première ministre a en effet annoncé hier que le Gouvernement publierait un Livre Blanc. Un projet de loi sera également présenté et débattu au Parlement, conformément à la décision de la Cour suprême.
Nous ne nous projetons pas dans l’hypothèse d’un vote négatif sur l’activation de l’article 50. La Chambre des communes a déjà voté avant Noël une résolution proposée par l’opposition, et le principe de l’activation de l’article 50 a été approuvé par 448 voix contre 75, c’est-à-dire avec une majorité de 373 voix, ce qui est assez confortable.
En ce qui concerne l’accord que nous voulons négocier, la Première ministre a déclaré dans son discours de la semaine dernière qu’à la fin du processus, l’accord serait soumis au vote du Parlement. Le Gouvernement entend quoi qu’il en soit négocier un accord qui convienne non seulement au Royaume-Uni, mais également à nos partenaires.
Quant à la question des ressortissants européens au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques en France et dans les autres États membres, la Première ministre a été très claire. Elle a répété hier devant la Chambre des communes, lors des Prime Minister’s Questions ce sur quoi elle avait déjà insisté dans son discours de la semaine dernière, à savoir que nous voulons être en mesure de garantir les droits des ressortissants britanniques vivant dans les autres États membres comme des ressortissants européens vivant au Royaume-Uni. Nous aurions voulu trouver un accord sur ce point dès avant Noël, tout comme plusieurs autres États membres, mais pas tous. Cela reste néanmoins pour nous une priorité et une question que nous souhaitons résoudre le plus rapidement possible dans les négociations.
M. Pierre Lellouche. Avant de vous laisser répondre sur le sort de nos concitoyens expatriés des deux côtés de la Manche, je voudrais revenir sur ce que vous venez de répondre à la question du président Bartolone. Vous avez indiqué qu’il y aurait un vote du parlement britannique non seulement avant la mise en œuvre de l’article 50 du traité de Lisbonne mais également à l’issue de l’accord négocié avec l’Union européenne. Il s’agit donc au fond d’une forme de ratification de cet accord. Mais de mémoire, correct me if I’m wrong, l’article 50 ne prévoit pas que l’accord revienne devant les parlements nationaux du côté européen si un État sort de l’Union. Il y aura un traité, un accord international entre le Royaume-Uni, devenu pays tiers, et l’Union ; mais si votre parlement doit le ratifier, on ne peut écarter l’hypothèse qu’il n’en veuille pas… Cela entraînerait une nouvelle période de négociations qui risque de durer, ce que, pour ma part, je ne le souhaite pas. Mais cela veut dire aussi que les parlements nationaux du continent devront eux aussi être consultés. On imagine mal que les parlementaires britanniques décident de se prononcer sur l’accord et que nous regardions le texte sans pouvoir le faire ; il y aura naturellement des demandes en ce sens. Cela ouvre des perspectives politiques un peu compliquées. Ai-je tort sur ce point, monsieur le président ?
M. le président Claude Bartolone. Dans sa décision, la Cour suprême indique qu’un certain nombre de lois ayant des conséquences sur la vie des Britanniques ont été transférées à l’Union européenne. Par conséquent, dès lors que l’on met fin à l’application des textes transférés, il faut passer devant le Parlement. Cela revient à dire que la Première ministre doit expliquer dans le cadre du Livre Blanc les différents points sur lesquels elle veut revenir.
Lord Llewellyn. La décision de la Cour suprême n’a rien à voir avec ce qu’a annoncé la Première ministre dans son discours de la semaine dernière concernant un vote à la fin du processus, car cette question n’avait pas été posée à la Cour. Cette décision de soumettre l’accord final au Parlement de Westminster appartient à la Première ministre. Ce que feront les autres États membres ne nous regarde pas, et vous comprendrez donc que je ne me prononce pas à ce sujet. La Première ministre a clarifié, à l’attention de notre parlement, le fait que le gouvernement britannique lui soumettrait l’accord final. C’est une décision purement nationale.
M. le président Claude Bartolone. En fin de processus ?
Lord Llewellyn. Oui. La semaine dernière, la Première ministre a dit exactement : « Au sujet du parlement, je voudrais fournir une autre certitude : je puis confirmer aujourd’hui que le Gouvernement soumettra l’accord final négocié entre le Royaume-Uni et l’Union européenne à un vote dans les deux chambres du Parlement avant que cet accord n’entre en vigueur ».
M. Pierre Lellouche. C’est un point capital. Je n’ai pas le sentiment qu’on ait ouvert ce débat en France ni qu’on ait interrogé M. Barnier la semaine dernière à ce sujet. D’abord, il y a une incertitude quant à la ratification par le parlement britannique et ensuite, si ce dernier s’arroge ce droit, les parlements des pays continentaux – et moi le premier, si je suis encore élu à ce moment-là – voudront regarder ce qu’il y a dans cet accord.
M. le président Claude Bartolone. Je précise, pour la bonne compréhension de notre discussion, que lorsque nous avons reçu M. Barnier la semaine dernière, il a bien indiqué que dans les six mois précédant l’échéance, devrait intervenir l’approbation ou non du Parlement européen, de la Chambre des communes et de la Chambre des lords. Autrement dit, nous devrons obtenir un accord sur le Brexit lui-même en octobre 2018.
M. Pierre Lellouche. Il a parlé du Parlement européen, pas des parlements nationaux.
M. le président Claude Bartolone. Pour les parlements nationaux, c’est le système constitutionnel propre à chaque État membre qui s’appliquera.
M. Pierre Lellouche. Il me semble que c’est votre devoir, monsieur le président, que de faire figurer le Parlement français dans la liste énumérée par M. Barnier. Il m’avait échappé que tout cela reviendrait devant le Parlement britannique. Or, ce n’est pas une question légère.
Mme Élisabeth Guigou. Pour ma part, j’ai toujours compris que l’accord final reviendrait devant le Parlement britannique. D’ailleurs, M. Corbyn n’a cessé de dire qu’il bataillerait très ferme sur l’accord final. Cela n’aura que des conséquences internes et ne préjuge en rien de ce que feront le Gouvernement et le Parlement français : il reviendra au Président de la République et aux présidents de nos deux assemblées de décider si nous organisons un débat et dans quelles conditions. Ce n’est pas une obligation pour nous. Supposons que le Parlement britannique, au bout des deux ans, décide de ne pas approuver l’accord finalement conclu par le gouvernement de Mme May – si, toutefois, elle est toujours en place car il pourrait bien y avoir des élections entre-temps ; cela regardera le Gouvernement britannique. Mais pour nous, l’absence d’accord signifiera une sortie sèche du Royaume-Uni au bout des deux ans. C’est cela que nous a expliqué Michel Barnier l’autre jour.
M. Jacques Myard. Je comprends bien que sur le plan strictement juridique, ce soit une affaire entre l’Union européenne, organisation internationale, et un État membre qui va devenir un État tiers. Je suis en cela le raisonnement du conseiller juridique qui nous l’avait expliqué. Les parlements nationaux n’ont pas vraiment à se prononcer sur ce processus, ce qui, politiquement, pose quand même problème dans la mesure où, rappelons-le, l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté européenne avait fait l’objet en France d’un référendum. En revanche, il est possible que l’accord qui sera conclu sur le fondement de l’article 50 du traité de Lisbonne puisse toucher à certaines matières qui ne sont pas strictement communautaires. C’est par ce biais que cet accord devra revenir devant les parlements nationaux. Car on voit très bien qu’il y aura des zones grises.
M. Pierre Lellouche. Cet accord de sortie aura évidemment des conséquences sur les finances publiques françaises, ne serait-ce que parce que le financement britannique sera moindre. Un certain nombre de textes législatifs seront également affectés, de la régulation financière au droit des étrangers. Bref, on ne peut donc pas considérer que ce soit une affaire strictement européenne ou que, si un problème survenait, l’alternative se résume à une rupture nette et définitive sans aucune possibilité d’arrangement avec un pays qui est notre allié, notre partenaire au Conseil de sécurité des Nations unies et notre voisin immédiat. C’est dans ce jeu où tout le monde se tient par la barbichette que la négociation va se faire ; et c’est là qu’il peut y avoir des problèmes.
Mme Élisabeth Guigou. Je n’ai jamais dit qu’il ne devrait pas y avoir un débat, sinon un vote, sous quelque forme que ce soit, au Parlement français sur les conséquences du Brexit, dans les domaines de compétence qui nous regardent ; je suis d’accord avec Jacques Myard sur ce point. Il n’empêche que si le Parlement britannique rejette l’accord qui a été négocié, on ne peut envisager rien d’autre qu’une sortie sèche du Royaume-Uni de l’Union européenne ; je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Ce sera le dilemme qui leur sera posé, mais cela regarde le Gouvernement britannique, de même que la question de savoir si nous devons nous prononcer ou pas sur les conséquences de l’accord nous regarde, nous. C’est un débat interne au Parlement français.
M. le président Claude Bartolone. Il me semble que les choses sont claires entre nous ; Michel Barnier nous a bien expliqué la manière dont le processus allait se dérouler en application de l’article 50. Pour le reste, notre Constitution n’oblige pas le Parlement à examiner cet accord, mais quelle que soit l’organisation de la future majorité au sein de l’Assemblée nationale, il faudra certainement consulter le Parlement selon des modalités que j’ignore, ne serait-ce que pour qu’il examine les différentes conséquences de cet accord.
M. Pierre Lellouche. Si un traité est conclu, je ne vois pas comment il pourrait échapper à la ratification du Parlement.
M. Jacques Myard. Si l’accord a des conséquences financières, l’article 53 de la Constitution s’appliquera.
M. le président Claude Bartolone. Il est évident qu’à un moment donné, un débat sera organisé au sein du Parlement. Mais le point qui me paraît le plus important pour le moment est celui qu’a soulevé Élisabeth Guigou : si, au bout de la négociation, une des deux parties n’est pas d’accord avec le compromis proposé, ce sera une sortie sèche. Nous l’avons senti à plusieurs reprises, notamment lorsque nous étions à Bruxelles, sur la question du ticket de sortie financier.
M. Pierre Lellouche. Ce qui nous renvoie à Louis XI… (Sourires)
Lord Llewellyn. Madame Guigou, je suis entièrement d’accord avec ce que vous avez dit sur nos relations bilatérales.
Au sujet de Calais, je constate que la coopération entre nos deux pays reste extrêmement importante. Nous pensons que les principes de base des accords du Touquet restent aussi valables aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a près de quatorze ans lorsqu’ils ont été signés. Notre Border Force (force frontalière) travaille en étroite collaboration avec ses collègues français. Nous travaillons main dans la main, en amont, pour détruire les filières de passeurs en mer Méditerranée et affronter ensemble ces enjeux dans les pays de transit et dans les pays sources. Je veux saluer la manière dont les autorités françaises ont géré la situation difficile à Calais et surtout le démantèlement de la « jungle ». Nous avons essayé d’appuyer vos efforts : nous avons mobilisé de nombreux fonctionnaires britanniques pour aider leurs collègues français pendant le démantèlement et dans la période qui a suivi, des agents du Home office ont procédé à des entretiens dans les centres d’accueil et d’orientation partout en France. À ce jour, le Royaume-Uni a recueilli plus de 750 mineurs isolés ayant des liens familiaux avérés sur notre sol. Nous avons aussi débloqué un financement assez important, de 63 millions de livres pour l’année financière 2015/16, et nous avons débloqué 36 millions de livres supplémentaires, soit environ 40 millions d’euros, en octobre, suite au démantèlement de la jungle. Nous allons continuer ce travail commun car la sécurité de cette frontière maritime reste capitale pour nos deux pays. Je ne dis pas du tout que la situation est réglée, mais on me dit que les flux commerciaux du port de Calais ont augmenté de 10 % depuis le démantèlement de la jungle, ce qui est un bon signe. Je salue aussi le fait que les autorités françaises aient affecté des forces de sécurité dans cette zone pour éviter que des migrants y reviennent.
Quant à ce qui va se passer pendant les deux années de la négociation, nous voulons régler, pendant cette période, la question de notre sortie mais aussi celle de notre futur partenariat. Il me semble important de le faire simultanément et, comme l’a dit M. Lellouche, nous ne voulons pas tarder.
On entend souvent dire, monsieur Myard, que la décision du peuple britannique a été motivée par des considérations liées à l’immigration. Mais comme l’a expliqué la Première ministre la semaine dernière, l’enjeu du référendum était plutôt le contrôle de cette immigration, c’est-à-dire le droit, pour le Gouvernement britannique, de dire qui peut venir ou pas au Royaume-Uni. Cette question renvoie plus largement à notre histoire particulière, à notre attachement à notre démocratie parlementaire, assez ancienne ; s’y ajoutait le désir d’une certaine flexibilité. Comme vous le savez, le débat préalable au référendum fut très vif. Tous les arguments ont été avancés de chaque côté et je pense qu’en fin de compte, le peuple britannique a pris sa décision les yeux grands ouverts. Il sait que le chemin sera parfois incertain, mais il a jugé que le plus important, pour l’avenir de son pays, était de restaurer la primauté de sa démocratie parlementaire.
Je me souviens très bien, monsieur Lellouche, de votre visite à Hong Kong. Nous commémorerons d’ailleurs le 30 juin prochain le vingtième anniversaire de la rétrocession de ce territoire à la Chine.
Je pense avoir déjà répondu à votre question concernant les 1,2 million de citoyens britanniques expatriés dans les autres États membres et les 3,2 millions de citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni. C’est une question importante que nous voulons régler en priorité dans la négociation. Cela étant, même si nous mettons en place un système de contrôle des entrées et sorties, nous resterons un pays ouvert sur le monde et ouvert à nos amis : c’est dans le caractère des Britanniques, dans notre culture, et cela ne changera pas.
En ce qui concerne l’avenir du Royaume-Uni et l’unité des quatre nations qui le composent, la Cour suprême s’est prononcée sur le rôle du parlement écossais, de l’assemblée du Pays de Galles et de celle d’Irlande du Nord et a conclu que c’est au Gouvernement britannique de décider de déclencher l’article 50 du traité de Lisbonne. C’est donc en tant que Royaume-Uni que nous allons négocier et sortir de l’Union européenne. Cela dit, la Première Ministre a répété à plusieurs reprises que les gouvernements d’Ecosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord pourront contribuer au processus de planification de notre sortie de l’Union Européenne.
Mme Élisabeth Guigou. Dites-vous bien avoir accepté environ 750 mineurs ?
Lord Llewellyn. Oui.
Mme Élisabeth Guigou. Je suis, comme vous, persuadée que notre intérêt conjoint est de continuer à appliquer le mieux possible les accords du Touquet et de renforcer notre coopération, faute de quoi nous ne ferons qu’aggraver le problème. Certains, en France, demandent qu’on repousse la frontière de Calais à Douvres, mais je continue à penser que ce serait une folie : nous nous retrouverions à Calais avec un afflux encore plus important de gens qui veulent passer à Douvres et de surcroît, nous ne gérerions pas la situation conjointement comme nous le faisons actuellement. Cela étant, ne sous-estimez pas les pressions politiques qui vont se faire sentir en France à ce sujet. Un collègue du Pas-de-Calais me disait hier que l’on commençait à voir revenir des migrants à Calais. Nous ne sommes donc déjà plus dans la situation dans laquelle nous nous trouvions il y a un mois et les tensions vont recommencer. Par conséquent, si l’on veut maintenir les accords du Touquet, il va falloir adapter le dispositif en permanence pour montrer ici, en France, qu’il y a une vraie coopération entre la France et le Royaume-Uni et que nous partageons vraiment le fardeau.
M. Jacques Myard. Pour prolonger la question d’Élisabeth Guigou, qu’on le veuille ou non, malheureusement, il y a des entrées permanentes de migrants sur le continent européen dans son ensemble. Je voudrais, Excellence, connaître votre position sur la Libye qui est sans doute une des sources d’alimentation de Calais et qui me semble présenter un paradoxe. Je comprends parfaitement qu’il faille sauver des gens qui vont se noyer, mais on a affaire à des mafias qui poussent de pauvres gens sur des barcasses juste en dehors des eaux territoriales libyennes puis qui téléphonent aux Européens pour leur demander de les récupérer. Peut-être faudrait-il carrément imposer à la Libye de renvoyer ces gens-là d’où ils viennent, sans quoi c’est le tonneau des Danaïdes, un mouvement perpétuel. Et nous ne sommes qu’au début des flux migratoires.
M. Pierre Lellouche. Je viens de publier un livre dans lequel je donne des chiffres extrêmement précis sur ce qui va se passer en termes de flux migratoires – notamment en provenance d’Afrique du Nord, mais surtout du Sahel. Nous n’en sommes qu’au début. Il est bien évident que si la politique de contrôle des frontières de l’Union européenne se résume à du sauvetage en mer – ce qui a été le cas des opérations menées depuis l’arrivée au pouvoir de Matteo Renzi –, les trafiquants en profiteront pour faire fructifier leurs affaires puisqu’il leur suffit de téléphoner aux navires de l’OTAN et de l’Union européenne pour qu’ils viennent repêcher les migrants et les conduire ensuite en Italie d’où ils rentrent en France tous les jours. Demandez à Jean-Claude Guibal, collègue de la Commission des affaires étrangères, combien de migrants arrivent chaque jour à Menton. Ces gens se retrouvent ensuite à Paris, dans le quartier Stalingrad, puis à Calais. C’est sans issue. Je suis d’accord avec Mme Guigou lorsqu’elle dit que ce serait folie de revenir sur les accords du Touquet et d’ouvrir grand la frontière française car la situation deviendrait absolument ingérable – d’abord pour la France, ensuite pour le Royaume-Uni. La seule solution serait que l’Union européenne et l’Alliance atlantique changent de stratégie s’agissant de cette politique de contrôle des frontières maritimes. Tant qu’on en reste à du sauvetage en mer et qu’on ne reconduit pas les migrants sur les côtes libyennes, il n’y a aucune raison que cela s’arrête, au contraire : les parties rivales en Libye vont continuer à profiter du trafic. Mettre fin à ce dernier suppose que nos gouvernements prennent des actes peu populaires, certes pas très jolis à voir à la télévision ; mais si nous ne le faisons pas, nous en paierons le prix à Stalingrad, à Paris où les centres d’accueil sont totalement saturés et débordés, à Calais et dans d’autres villes de France. On ne peut pas continuer à nier la réalité et à essayer de vider des campements en distribuant à tout va le statut de demandeur d’asile à des gens qui, pour l’essentiel, sont des réfugiés économiques. Il est inadmissible de voir à quel point toutes les procédures sont détournées. Cela ne fait qu’aggraver les choses. Nous nous livrons vraiment à un jeu d’apprenti sorcier, tout cela à cause des images de télévision, des qui associations hurlent à la mort et de la peur de passer pour des méchants. Mais ceux qui deviennent méchants, ensuite, ce sont ceux qui en vivent les conséquences à Stalingrad et à Calais.
Lord Llewellyn. Madame Guigou, je suis entièrement d’accord avec vous sur le fait que nous devons continuer à travailler ensemble à Calais. J’aurais dû préciser que la convention de Dublin nous oblige à accueillir sur notre territoire les mineurs isolés ayant des liens avérés avec notre pays et que cela restera évidemment le cas. Lorsqu’on se rend à Calais, on s’aperçoit à quel point nous y avons conjointement renforcé les équipements de sécurité. Nous continuerons à vous aider à sécuriser la zone portuaire et les abords du tunnel de la Manche, mais nous voulons à tout prix éviter un appel d’air à Calais – qui risquerait de se produire si les gens pensaient que cette frontière était soudain ouverte.
La Libye est évidemment un défi majeur. Nous devons continuer à travailler ensemble en tant que communauté internationale, aux Nations unies et avec nos partenaires européens pour essayer de renforcer le fragile gouvernement en place. Il faut faire en sorte que la Libye dispose des moyens de contrôler son propre littoral, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui. Nous devons aussi continuer à travailler ensemble pour détruire ces filières de passeurs, améliorer nos capacités de renseignements et renforcer les frontières extérieures de l’Union. Le Royaume-Uni contribue à cet effort en Italie et en Grèce. C’est un exemple des défis auxquels nous allons continuer à faire face ensemble quand le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne car nous resterons un pays engagé en Europe.
M. le président Claude Bartolone. Nous vous remercions, monsieur l’ambassadeur. Nous aurons l’occasion de revenir sur la question de Calais en entendant Bruno Le Roux, jeudi 2 février à 14 heures 30.
La commission procède ensuite à l’audition, non ouverte à la presse, de M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur le ministre des affaires étrangères et du développement international, soyez le bienvenu. Nous arrivons au terme de notre cycle d’auditions. Pour la dernière, qui aura lieu le jeudi 2 février, nous recevrons Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur. Juste avant vous, nous avons reçu l’ambassadeur de Grande-Bretagne…
M. Pierre Lellouche. Du Royaume-Uni !
M. Jacques Myard. Ou désuni !
M. le président Claude Bartolone. Nous avons donc reçu l’ambassadeur du Royaume-Uni. Nous avons eu l’occasion d’aller à Londres, à Bruxelles, à Berlin ; nous avons rencontré nombre de ceux qui prendront part au processus de décision, que ce soit à la Commission européenne, au Parlement européen ou au Royaume-Uni. Il nous a semblé indispensable de vous recevoir pour prendre un peu de champ et nous replacer dans une perspective politique : la définition de la politique étrangère et européenne de la France et la défense de ses intérêts.
M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international. Je veux d’abord saluer l’initiative de l’Assemblée nationale : cette mission très utile est peut-être appelée à durer, sous la forme que les députés voudront donner à leurs travaux, car il y a évidemment une suite au vote des Britanniques. Le 23 juin dernier, ceux-ci ont pris la décision de quitter l’Union européenne. Comme j’ai eu l’occasion de le dire devant votre commission des affaires étrangères, nous regrettons cette décision mais c’est un choix démocratique que la France respecte.
Les États-membres de l’Union européenne se retrouvent devant une situation totalement inédite : nous n’avions même pas imaginé que la question pût se poser un jour. C’est ce qui a conduit les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-Sept, en marge du Conseil européen du 29 juin, à affirmer clairement les principes qui devront présider aux négociations. Dans son article 50, le Traité européen fixe heureusement un cadre juridique clair en cas de retrait d’un État membre. Il ne saurait y avoir de négociation bilatérale ou sectorielle en dehors de ce cadre.
Une fois appliqué l’article 50, il faudra envisager une relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, fondée sur un équilibre entre les droits et les obligations des deux parties. En particulier, si le Royaume-Uni veut continuer à participer au marché unique, il devra accepter les quatre libertés qui y sont attachées, y compris la liberté de circulation des travailleurs et de leur famille. À ce stade, les Vingt-Sept ont fait preuve d’unité et de cohésion, ce qui est extrêmement important.
L’Union européenne s’organise. En marge du Conseil du 15 décembre, les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-Sept ont défini les modalités des négociations, afin de garantir l’efficience et la transparence de ces dernières. Cela permettra à chaque institution de jouer pleinement son rôle, afin que l’Union européenne soit prête dès que le Royaume-Uni aura notifié formellement son intention de se retirer. Le Conseil européen adoptera les orientations qui fixeront les principes de la négociation de l’Union européenne. Puis la Commission présentera des recommandations pour le Conseil de l’Union européenne qui devra adopter les directives de négociation.
La Commission négociera au nom de l’Union européenne. Cela paraissait logique ; encore fallait-il que ce fût décidé. Cette désignation correspond à l’esprit du Traité et elle offre la garantie d’aboutir à une position claire. La Commission dispose de l’expertise technique et des moyens nécessaires à l’examen de ce dossier compliqué. Elle doit évidemment agir sous le contrôle politique du Conseil.
Jean-Claude Juncker a désigné notre compatriote Michel Barnier à la tête de l’équipe de négociateurs. Nous connaissons très bien Michel Barnier, qui a beaucoup de qualités et qui est apprécié en France et en Europe où il a été commissaire à la politique régionale, puis commissaire au marché intérieur et aux services. Son expérience est très riche et très utile. Sa désignation a donc été acceptée par les Vingt-Sept. Michel Barnier a commencé son travail de cartographie des enjeux et il a mené beaucoup de consultations, se rendant dans chacun des États membres, de façon très méthodique et rigoureuse.
Plusieurs dispositions spécifiques ont été prévues pour assurer la nécessaire transparence. Elles concernent les rapports entre les institutions et avec les États membres. L’équipe des négociateurs de la Commission va intégrer un représentant du Secrétariat général du Conseil, en la personne sans doute de Didier Seeuws que vous avez rencontré à Bruxelles. La Commission devra rendre systématiquement compte des négociations au Conseil européen et au Conseil de l’Union européenne. Tout au long du processus, le Conseil pourra actualiser les orientations et adapter les directives de négociation. Au sein du Conseil, le suivi sera assuré par un groupe de travail ad hoc, disposant d’une présidence permanente, composée des représentants des États membres et du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne. C’est le Conseil des affaires générales, composé essentiellement des ministres des affaires européennes des membres de l’Union européenne, qui sera chargé de suivre cette négociation.
Voilà pour ce qui est de la méthode. Je n’oublie pas le Parlement européen qui sera tenu régulièrement et étroitement informé tout au long des négociations. Le président du Parlement européen pourra exprimer les positions de cette institution lors de sa prise de parole, en ouverture des réunions du Conseil européen. Le Parlement européen est donc étroitement associé et il s’est organisé pour ce faire : le président Guy Verhofstadt s’en est d’ailleurs exprimé récemment.
Ce dispositif sur mesure, prévu dans le cadre de l’article 50, diffère de celui qui est habituellement mis en place pour la négociation d’accords commerciaux par l’Union européenne. Il permettra d’établir une relation de confiance entre les institutions et entre les États membres, à charge pour chacun d’eux de rendre compte à son parlement national. Pour ce qui est de la France, l’Assemblée nationale et le Sénat souhaiteront sans doute être informés en temps réel, ce qui serait une bonne chose.
Cette articulation est une garantie dans ce cas précis où les négociations se déroulent au nom de l’Union européenne. Cette étape était indispensable au bon déroulement d’un processus qui va être très compliqué.
En France, nous avons renforcé notre organisation pour effectuer ce suivi. Depuis l’été dernier, le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) conduit un important travail de cartographie des intérêts français en vue des négociations tant sur le retrait que dans la perspective des relations futures avec le Royaume-Uni. Au sein du ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI), nous avons constitué un groupe de travail spécifique, piloté par Philippe Setton, directeur de l’Union européenne. Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, vous a déjà donné force précisions à ce sujet lorsque vous l’avez auditionné. Je ne vais donc pas développer davantage, à moins que vous le souhaitiez.
Nous avons la chance d’avoir l’expertise permanente du SGAE, placé sous l’autorité du Premier ministre, dans un dossier où le travail interministériel est constant. Il y a énormément de travail à faire sur les plans technique et juridique, dossier par dossier. Tous les pays ne disposent pas d’un outil précieux tel que celui-là, que nous avons d’ailleurs renforcé.
Qu’attendons-nous du Royaume-Uni ? Nous attendons la notification officielle. Lors de son discours du 17 janvier, la Première ministre Mme May a confirmé qu’elle transmettrait cette décision d’ici à la fin du mois de mars et elle a apporté quelques clarifications sur les objectifs du Royaume-Uni. Si le cap annoncé est maintenu durant toutes les négociations, le Royaume-Uni devra renoncer à son accès actuel au marché intérieur. Nous avons été clairs, et il était nécessaire de l’être : si le Royaume-Uni refuse la libre circulation des personnes et l’intervention de Cour de Justice de l’Union européenne, il n’a pas d’autre choix que de renoncer au marché intérieur.
Les Vingt-Sept ont intérêt sur ce sujet à réaffirmer leur cohésion et leur unité. Ils ont exprimé leur position sans agressivité, sur la base des principes qui fondent l’Union européenne, et ils devront examiner avec la plus grande attention certains points qui restent à éclaircir, je pense notamment à la participation au marché unique. La Première ministre nous a fait part de sa volonté de sortir du marché unique mais elle a également déclaré que le futur accord de libre-échange, souhaité par le Royaume-Uni, « pourrait reprendre des éléments des dispositions actuelles du marché unique dans certains domaines comme, par exemple, les exportations d’automobiles ou de camions ou bien la liberté de fournir des services financiers au-delà des frontières nationales. »
Autre point à éclaircir : l’union douanière que le Royaume-Uni souhaite quitter mais en signant un nouvel accord douanier et sans rétablir de frontière entre l’Eire et l’Irlande du Nord, ce qui n’est pas une mince affaire. Michel Barnier vous a cité l’exemple du mouton néo-zélandais qui peut arriver dans le marché unique en passant par l’Irlande. Pour en avoir parlé avec mon homologue Charles Flanagan, je sais que la situation suscite des inquiétudes en Irlande. Les deux voisins ont d’ailleurs commencé à discuter.
En résumé, il subsiste des zones d’ombre et les Vingt-Sept devront se montrer vigilants et afficher fermement leurs principes : le marché unique repose sur quatre libertés qui ne sont pas négociables ; il n’est pas possible de faire des arrangements sectoriels, d’avoir un pied dedans et un pied dehors, de pratiquer le cherry picking.
L’accord de retrait et l’accord relatif aux relations futures devront être traités en deux temps. Cela n’interdit pas de réfléchir à ce que pourrait être le cadre des relations futures, mais il faut d’abord négocier le retrait. Certes, l’accord de retrait doit être négocié en tenant compte des relations futures ; c’est ce qu’indique l’article 50. Mais il n’est pas possible de négocier avec une partie qui serait à la fois un État membre et un État tiers… Il n’y a là aucune manifestation d’agressivité à l’égard du Royaume-Uni ; c’est une question de cohérence, de logique juridique. Une négociation simultanée serait source de confusion et affaiblirait la position de l’Union européenne.
Plusieurs points majeurs devront être réglés dans l’accord de retrait. Il y aura des incidences sur le budget ou encore sur les droits des citoyens ; il est difficilement envisageable d’ouvrir des négociations concrètes sur l’avenir sans avoir résolu au préalable ces questions difficiles. On peut le voir comme un divorce ou comme le départ d’un membre d’une copropriété. Il faut tenir compte des contraintes, des engagements financiers. Combien le Royaume-Uni devra-t-il à l’Union européenne ? Il y aura sans doute des résistances à payer, peut-être une volonté de ne rien régler du tout, ce qui compliquerait davantage encore la suite des événements. Dans un deuxième temps, le départ du Royaume-Uni va se traduire par un manque à gagner très important pour l’Union européenne. Comment fera-t-on avec moins de moyens ?
Il ne s’agit pas de punir la Grande-Bretagne parce que le peuple britannique a pris cette décision. Nous ne sommes pas dans cet état d’esprit. Nous devons décrire la situation sans arrière-pensée et avec rigueur si nous voulons défendre nos intérêts et préserver la construction européenne. Le fait que nous soyons fermes ne veut pas dire que nous sommes agressifs. Il n’est pas agréable de nous entendre menacer de dumping fiscal si nous n’accédons pas d’emblée à certaines demandes. Il faut recommander que ce genre de préalable ne soit pas répété parce que les négociations ne peuvent pas débuter de cette manière.
Il faut d’ailleurs évaluer cette menace de dumping. Lors d’une récente réunion de la Commission des affaires étrangères, un député m’a dit que la France devrait se mettre aussi à baisser l’impôt sur les sociétés pour faire face au dumping fiscal britannique. Mais faisons attention : pour commencer, nous n’en sommes pas là. Ensuite, je pense que le Royaume-Uni a besoin de faire fonctionner son État et ses services publics ; je ne suis pas sûr qu’une baisse des impôts ne poserait pas d’énormes problèmes de politique intérieure. Sans vouloir renvoyer à nos débats franco-français, je constate que des questionnements semblables ont déjà lieu en Grande-Bretagne. Pendant la campagne précédant le référendum, certains – et non des moindres – prétendaient que l’argent qui ne serait pas versé au budget de l’Union européenne serait consacré au système de santé public, le National Health Service. Il n’en est plus question. Imaginons qu’il y ait encore moins de recettes dans les caisses britanniques…
Theresa May a aussi évoqué la question d’une phase transitoire. Sur ce point également, soyons clairs. Nous ne pouvons préjuger aujourd’hui du contenu de l’accord de retrait et de l’accord sur les relations futures. Il est donc prématuré de commencer à parler d’une période de transition. Il faut d’abord réussir l’accord de sortie, puis préciser la nature des futures relations. Plus nous serons rigoureux dans l’application de nos règles et de nos principes, plus nous pourrons discuter franchement avec nos partenaires.
La décision du peuple britannique s’explique d’abord par des raisons internes au Royaume-Uni qui a toujours entretenu une relation particulière avec l’Union européenne, décidant notamment de ne pas participer à nombre de politiques communes. Le peuple britannique entend dire du mal de Bruxelles depuis de nombreuses années. Pour autant, sa décision doit également être vue, plus largement, comme un révélateur de l’érosion de la confiance des peuples dans le projet européen. L’Union européenne a connu de nombreux défis au cours des dernières années ; elle a affronté ce que Jean-Claude Juncker a appelé avec beaucoup de finesse des polycrises – économiques, financières, migratoires, sécuritaires. Les citoyens européens ont de plus en plus de mal à percevoir les réponses apportées par l’Union européenne à ces crises, de sommet en sommet, quelle que soit leur pertinence.
Peut-on en déduire que les peuples européens veulent moins d’Europe ? La question est posée et pas seulement en France. Certaines forces politiques veulent changer fondamentalement les choses. Est-ce le désir des peuples européens ? Je n’en suis pas certain mais je pense qu’il ne faut pas rester inerte. Pour éviter cette fuite en avant que d’aucuns préconisent, les citoyens attendent que l’Europe réponde vraiment à leurs préoccupations quotidiennes.
Lors de mes nombreux déplacements, je rencontre les dirigeants des autres pays membres de l’Union européenne. En Pologne, j’ai discuté avec les dirigeants des divers partis politiques, dont M. Jaroslaw Kaczynski, le président du parti au pouvoir, qui était d’ailleurs étonné que j’aie demandé à le voir. Nous avons eu des échanges très intéressants pendant une heure. Il m’a dit qu’il était européen, qu’il n’avait rien à voir avec M. Trump, Mme Le Pen, M. Farage ou avec « Alternative für Deutschland (AfD) ». « Je suis un patriote polonais et je trouve que l’Europe fonctionne mal », m’a-t-il expliqué. Et de préconiser une remise à plat, une conférence, pour restituer diverses compétences aux États nations avant d’élaborer un nouveau traité… Telle est la position des dirigeants polonais actuels, qui est aussi défendue par d’autres forces politiques en Europe. Certains vont d’ailleurs encore plus loin, parlent de sortir de l’euro, etc.
À entendre de tels propos, on aurait pu craindre un effet de contagion après le référendum britannique. Même si certains ont demandé l’organisation d’un référendum dans leur pays également, le contenu des enquêtes d’opinion se révèle finalement assez rassurant : les sondés manifestent plutôt leur envie de rester dans l’Union européenne et de ne pas prendre le risque de s’engager dans une voie plus qu’incertaine dont les conséquences pourraient être dramatiques. En même temps, il faut que les citoyens européens voient les choses bouger. Leurs attentes légitimes ont été en partie prises en compte lors du sommet de Bratislava en septembre dernier et avec la déclaration adoptée à cette occasion. Répondre aux attentes des citoyens européens est également la voie à suivre pour les célébrations du soixantième anniversaire du traité de Rome, car il ne s’agit pas de se contenter d’en faire une commémoration.
Il faut que l’Europe protège vraiment ses citoyens, ce qui passe en particulier par une maîtrise de ses frontières extérieures, par une autonomie stratégique en matière de défense, par le renforcement de nos instruments de protection dans le domaine du commerce. L’Europe doit aussi investir réellement dans l’avenir et redevenir un espace de progrès, d’espérance, de croissance, d’emploi. Il s’agit aussi de résorber les différences structurelles qui existent entre les États et qui minent la confiance, et de dégager de nouveaux moyens pour les investissements dans la transition énergétique, l’économie numérique, la recherche.
Il est nécessaire aussi de s’attacher à réduire le dumping, fiscal ou social, qui existe dans certains pays. L’harmonisation doit se faire dans le sens du progrès. En avançant dans cette direction, nous pouvons créer un nouveau climat, provoquer le débat et redonner des perspectives d’espoir. Nous devons nous montrer offensifs et entraînants. Telle est ma conviction. C’est aussi celle du Président de la République qui va rencontrer la chancelière allemande à Berlin demain midi. L’avenir de notre pays passe non pas par moins d’Europe mais par une Europe plus efficace et qui s’assume.
Cette décision du peuple britannique a créé beaucoup d’inquiétude chez nous, mais aussi dans le monde entier. Je reviens d’Inde où l’on m’en a parlé, comme partout. La même question revient : vous n’allez tout de même pas commettre l’erreur d’abandonner l’Europe ? C’est l’organisation qui est perçue comme la plus originale et la plus efficace à l’échelle mondiale, même si elle est souvent critiquée – parfois à juste titre – en interne. À l’heure où le monde semble de plus en plus incertain en raison de la position de la Russie sur toute une série de questions, de l’élection de Donald Trump aux États-Unis, de la volonté de la Chine de jouer son rôle de puissance mondiale, nous ne devons pas commettre cette erreur si nous voulons défendre les intérêts français et ceux de nos partenaires. Ce sont aussi ces arguments que nous devons faire valoir à nos concitoyens, au-delà des clivages politiques qui peuvent exister. La défense de l’Europe peut faire l’objet d’un large consensus pour peu que nous nous montrions exigeants, que nous fassions un peu moins de technique et plus de politique. Peut-être pourrons-nous alors repartir vers un horizon plus positif.
M. le président Claude Bartolone. Je rebondis sur votre conclusion, monsieur le ministre, qui souligne la nécessité de politique mais aussi de psychologie diplomatique.
Jusqu’à présent, le bloc des Vingt-Sept résiste en dépit du jeu auquel s’essaie le Royaume-Uni pour nous faire passer pour les méchants – tantôt nous, tantôt nos amis allemands. Ce petit jeu souligne une nouvelle fois l’importance du couple franco-allemand et le rôle qu’il sera appelé à jouer.
Mais les choses ne sont pas figées. On commence à entrevoir des évolutions : la Conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient en est un exemple : nos amis britanniques n’ont pas soutenu, c’est le moins qu’on puisse dire, l’initiative française. Avez-vous le sentiment que sur certains dossiers – le Proche-Orient mais aussi la transition énergétique, par exemple –, la Première ministre May cherche à se montrer plus conciliante avec les États-Unis de Donald Trump dans l’espoir d’un rapprochement ?
Nos auditions nous ont permis d’appréhender les dimensions juridiques, techniques et réglementaires de cette affaire, mais il ne faut pas sous-estimer la partie réellement diplomatique des négociations qui s’engagent.
Mme Élisabeth Guigou. Quelques jours après le discours de Mme May, les hauts fonctionnaires britanniques ont éprouvé le besoin de réunir les ambassadeurs des Etats membres de l’Union européenne pour apporter des clarifications. Comment interprétez-vous cette démarche pour le moins bizarre ?
Il est vrai que si le discours de la Première ministre était très clair sur un point – la sortie du marché unique pour se soustraire à la Cour de Justice de l’Union européenne et à la liberté de circulation des personnes –, pour le reste, tout était très flou ; il laissait à penser que les Britanniques voulaient le beurre et l’argent du beurre, le cherry picking, etc.
Leur démarche peut être motivée par la volonté de dissiper l’impression négative laissée par le discours, mais elle peut aussi être comprise comme la volonté de déceler des failles et de mettre à l’épreuve l’unité européenne ; heureusement celle-ci ne s’est pas démentie depuis le Conseil européen de Bratislava. Elle peut être la première tentative d’une diplomatie hors pair – pas meilleure mais au moins aussi bonne que la nôtre – pour essayer de jouer de toutes les ambiguïtés que vous avez soulignées.
L’ambassadeur britannique, M. Llewellyn, – c’est une des seules indications qu’il nous a données – a indiqué que le gouvernement britannique essaierait de négocier à la fois le divorce et le futur accord. Avez-vous une idée plus précise de la stratégie de Michel Barnier, qui ne nous a pas trop répondu sur ce point lorsque nous l’avons auditionné, pour éviter que les négociations durent indéfiniment et qu’elles ne laissent de côté des sujets incontournables ? Je vous fais part de cette inquiétude. D’autant que, dans leur volonté de négocier des accords de libre-échange – avec les États-Unis, mais pas seulement –, les Britanniques ont déjà bien avancé, et avec l’aide de Donald Trump. Ils disent vouloir mener des discussions. La Commission européenne les a toutefois avertis que tant qu’ils étaient membres de l’Union européenne, ils ne pouvaient pas engager de négociation ; mais il ne leur est pas interdit d’avoir des discussions…
Il est important que le négociateur européen et les États membres tiennent bon. Il faut veiller à ne pas mélanger indûment les différentes étapes de la discussion et à ne pas faire durer celle-ci indéfiniment sans quoi l’agenda européen et l’état d’esprit des peuples, que vous avez très bien décrit, s’en trouveraient très affectés.
M. Pierre Lellouche. Monsieur le ministre, je retiens de votre exposé très intéressant les principes défendus par la France dans la négociation, qui semblent empreints de bon sens. Nous ne vous chercherons pas querelle sur les objectifs que vous avez définis.
J’ai compris que la négociation devrait aboutir au terme d’un délai de deux ans à deux accords – un accord de retrait et un accord de libre-échange pour organiser les relations avec l’État tiers que deviendra le Royaume-Uni. D’ici là, la négociation est confiée à Michel Barnier, sous le contrôle le plus étroit possible du Conseil, le Parlement européen étant informé.
Je souhaiterais savoir à ce stade quel mandat la France a donné à Michel Barnier et à la Commission. Que veut-on le voir défendre au nom de la France ?
Quand et comment comptez-vous informer le Parlement sur le contenu du mandat donné par la France à la Commission ? Cette information me paraît indispensable pour éviter les mauvaises surprises après celle que nous avons connue avec le TAFTA à cause d’un mandat préparé de façon pour le moins elliptique…
Le mandat donné par la France doit être clair et le Parlement français doit être dans la boucle dès le début. Il ne s’agit pas de nourrir une opposition entre droite et gauche sur un sujet d’intérêt national.
Enfin, j’aimerais connaître la position du Gouvernement sur la ratification par le Parlement français des deux accords auxquels donnera lieu la mise en œuvre de l’article 50.
M. Jacques Myard. Je vais reprendre en partie ce qui vient d’être dit, car nous nous posons tous les mêmes questions.
Vous avez mentionné à juste titre le travail de cartographie des intérêts français que réalise le SGAE. Il faut le rappeler, la France a des intérêts spécifiques dans la relation avec le Royaume-Uni, qui ne sont peut-être pas ceux de ses partenaires européens. Je me félicite de ce travail de réflexion qui ne s’en tient pas à la seule doxa européenne.
Il faut regarder les choses telles qu’elles sont : le Brexit illustre les relations ambiguës qu’entretient le Royaume-Uni avec l’Union européenne, mais aussi la crise intrinsèque de l’Union européenne. Autrement dit, ce n’est pas une « divine surprise » pour reprendre un mot par trop galvaudé.
Quelles sont vos vues sur cette Union européenne qui doit se réformer sous peine de risquer l’implosion à force de contradictions ?
Il y a quelques années, le président Valéry Giscard d’Estaing disait ici même qu’il faudrait procéder différemment en matière d’élargissement ; il n’en a rien été. L’Europe a conservé son logiciel intégrateur, inadapté à une union à vingt-huit.
Quelle est votre position sur le rôle du Parlement français ? M. Jean-Claude Piris nous a expliqué qu’il s’agissait d’une affaire entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. J’en prends acte. Mais je rappelle que l’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne a fait l’objet d’un référendum – pour ce qui me concerne, j’avais voté non… Cela m’est souvent arrivé, je vous l’accorde.
M. le président Claude Bartolone. J’allais le dire : ce n’est pas une surprise !
M. Jacques Myard. Je vous l’accorde. Toujours est-il qu’à l’époque déjà, il y avait une ambiguïté dans l’adhésion du Royaume-Uni.
Pour quelles raisons selon vous le Royaume-Uni nous a lâchés lors de la Conférence de Paris – je ne vous reproche pas d’avoir tenté de faire bouger les lignes ; j’ai du mal à en comprendre la raison, si ce n’est celle d’avoir été vexé de ne pas avoir été à l’origine de cette initiative…
M. le ministre. Vous évoquez les conséquences politiques du Brexit. Le changement de pied entre le vote de la résolution condamnant la colonisation israélienne le 23 décembre et la décision de ne venir qu’en simple observateur à la Conférence de Paris le 15 janvier en est une. J’ai entendu des explications très embarrassées de Boris Johnson avec qui je me suis entretenu à plusieurs reprises pour le convaincre de venir à la Conférence.
Rappelons que le Royaume-Uni, avec lequel les convergences étaient nombreuses jusqu’à présent, a participé à la rédaction de la résolution à New York qui correspond à sa position constante sur le Proche-Orient. Ce changement subit a suscité des interrogations très fortes dans le monde arabe ainsi qu’à la table du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne L’explication se trouve dans la volonté britannique d’aller au bout du Brexit, de s’inscrire dans un partenariat renouvelé avec les États-Unis et d’engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange avec ce pays.
Doit-on s’attendre à d’autres conséquences politiques ? C’est possible, mais nous le verrons au fur et à mesure. À ce jour, nous ignorons la position de la nouvelle administration américaine et du nouveau président sur bien des sujets : la lutte contre le terrorisme, les relations avec la Russie, l’accord sur le nucléaire iranien, le dossier syrien ou encore la conception des échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Rien ne dit qu’à un moment donné, les positions britanniques traditionnelles ne seront pas mises en difficulté. Pour l’heure, je ne suis pas en mesure de répondre.
Cette tactique britannique est-elle motivée par des considérations de politique intérieure ? C’est possible. Le gouvernement peut ainsi faire valoir, pour justifier la sortie de l’Union européenne, qu’il dispose d’une alternative, que le partenariat avec les États-Unis est une bien meilleure solution et que d’autres accords de libre-échange seront signés avec des pays tels que l’Inde, je m’y suis rendu récemment ; ce ne sera pas aussi facile que Mme May le dit. La Cour suprême du Royaume-Uni a considéré que le Gouvernement devait recueillir l’avis du Parlement avant de notifier sa décision d’enclencher la procédure prévue par l’article 50. Le projet de loi demandant au Parlement l’autorisation de recourir à l’article 50 doit être déposé à la Chambre des Communes aujourd’hui. Ce ne sera pas simple pour autant car de nombreux parlementaires espéraient saisir l’occasion de ce projet de loi pour mener un débat sur le fond, ce que justement la Première ministre veut éviter, mais elle a annoncé un livre blanc qui fera sans doute l’objet d’un débat distinct du vote.
Vous avez raison de souligner nos relations bilatérales avec le Royaume-Uni, que nous entendons préserver : l’accord du Touquet – dont nous ne souhaitons pas la remise en cause car elle serait lourde de conséquences –, ou encore le traité de Lancaster House relatif à la coopération en matière de défense que les Britanniques n’envisagent pas non plus, semble-t-il, de remettre en cause. Il reste donc des sujets sur lesquels nous pouvons encore nous retrouver : la sécurité, la défense, la lutte contre le terrorisme. C’est possible et en tout cas souhaitable. Mais dans le domaine de la politique étrangère et de la diplomatie, on voit le doute et la confusion s’installer. Dans ce domaine, le Brexit donne à la France des responsabilités particulières, mais aussi une capacité d’action non négligeable, puisqu’elle sera le seul pays de l’Union européenne, également membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.
La France n’a pas à donner un mandat de négociation : c’est au Conseil européen et au Conseil qu’il appartient d’en donner un à la Commission. Évidemment, nous veillerons à ce que, dans la définition de ce mandat, nos intérêts soient totalement préservés. Je pense notamment à nos intérêts économiques : le Royaume-Uni est pour nous un grand partenaire, notre cinquième marché à l’export – il représente 8 % de nos exportations, avec un excédent de 12,2 milliards d’euros en 2015. Mais ce n’est pas parce que nous avons des intérêts à défendre – le travail du SGAE peut nous aider à préciser le contenu du mandat que nous souhaitons – que nous allons déroger au principe de la solidarité européenne et nous mettre à négocier dans le dos des autres pays. Il ne faut surtout pas entrer dans le jeu de la négociation sectorielle.
S’agissant de l’information du Parlement, le Gouvernement est en permanence à sa disposition – de cette mission ou des commissions compétentes. Nous souhaitons que l’exécutif vienne rendre compte en temps réel des négociations. Nous le devons aux parlementaires français.
Pour ce qui est du vote, le traité prévoit que la négociation ne peut pas durer plus de deux ans. L’accord fixant les modalités du retrait est conclu par le Conseil à la majorité qualifiée ; la France peut toujours s’y opposer. Le Gouvernement britannique peut également rejeter l’accord, au risque toutefois de voir tomber le couperet : à l’issue des deux années de négociation, la sortie de l’Union est automatique et les relations économiques avec le Royaume-Uni ramenées au droit commun de l’OMC ; je ne suis pas sûr que ce soit l’intérêt des Britanniques. La ratification par les parlements nationaux de l’accord de retrait n’est pas prévue par l’article 50. Il ne s’agit pas d’un accord mixte. En revanche, chaque parlement national sera amené à ratifier, comme pour tout traité de libre-échange avec un pays tiers, l’accord qui fixera le cadre des relations futures avec le Royaume-Uni.
M. Pierre Lellouche. La Commission européenne négocie, mais elle est nourrie par les positions nationales. Dès lors la nôtre aura été arrêtée – il ne s’agit pas de définir seulement des principes mais de dire ce que nous voulons –, elle méritera de faire l’objet d’un débat devant notre assemblée, y compris dans l’hémicycle. Car ce n’est pas rien.
S’agissant de la ratification, vous estimez qu’un accord aux termes duquel le Royaume-Uni quitte l’Union européenne, qui emporte des conséquences législatives et financières pour la France, ne peut pas être soumis au Parlement. J’ai pris note de votre position. J’espère qu’elle n’est pas définitive.
M. le ministre. Ce n’est pas ma position : c’est le droit, en l’occurrence l’article 50.
M. Pierre Lellouche. Le droit s’interprète.
M. le président Claude Bartolone. Nous sommes tenus par des textes sacrés. L’article 50 du Traité en est un, mais la Constitution aussi ; or la Constitution, sur cette question, n’oblige pas le Gouvernement à saisir le Parlement.
M. Pierre Lellouche. Rien n’oblige le Gouvernement, j’en conviens. Mais nous savons depuis ce matin que le Parlement britannique sera saisi de l’accord pour le ratifier. Pourquoi la République française n’en ferait pas autant ?
M. le ministre. Je prends note de vos propos. Quant à l’idée d’en débattre, pourquoi pas dans l’hémicycle, de ce que sera le mandat européen pour que le Parlement français soit éclairé, je n’y vois que des avantages. La transparence que j’ai évoquée pour la négociation s’applique à nous-mêmes.
Du côté britannique, le Parlement sera aussi saisi de deux autres projets de loi qui se rapportent au Brexit, le premier visant à annuler l’adhésion de 1972, le second tendant à reprendre dans le droit britannique l’intégralité de l’acquis communautaire. Cette volonté d’intégrer toutes les normes du marché intérieur peut paraître surprenante, mais elle s’explique par deux raisons : d’une part, les Britanniques ne tiennent pas à être en situation de rupture brutale dans la période de sortie qui suivra l’activation de l’article 50 ; d’autre part, ils seront ainsi en mesure de modifier unilatéralement les normes en retrouvant leur totale souveraineté sur la réglementation européenne. Ils vont jusqu’au bout de la logique. Reste que les règles communes sont nombreuses : pour mémoire, la réglementation européenne n’occupe pas moins de 17 000 pages…
M. Jacques Myard. C’est bien ce qu’on lui reproche.
M. le ministre. Il n’y a pas lieu de faire un tel reproche.
M. Jacques Myard. C’est trop lourd !
M. le ministre. On ne peut développer un marché unique sans normes qui s’appliquent à tous.
M. Jacques Myard. Les normes sont trop nombreuses.
M. le président Claude Bartolone. C’est un débat que nous pourrions avoir en franco-français… Certains de nos textes pèsent lourd dans les rayonnages !
M. le ministre. En tout cas, il va s’écouler un certain temps avant que le Royaume-Uni parvienne à négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. L’alternative à l’appartenance à l’Union européenne n’est pas une voie aussi simple que certains le font miroiter, y compris du point de vue des intérêts britanniques. Les Britanniques ont pris un risque énorme en décidant de sortir de l’Union. Je le dis à Jacques Myard qui était enthousiaste après le vote du peuple britannique.
M. Jacques Myard. Je considère que c’est un signe avant-coureur.
M. le président Claude Bartolone. Jacques Myard défend un point de vue singulier sur la construction européenne…
M. Jacques Myard. Je suis pour la coopération européenne, mais contre l’intégrisme !
M. le ministre. Pour des raisons de politique intérieure, voire de politique interne à un parti, les Britanniques ont pris un risque énorme. Je ne conseille pas de les imiter. Mais c’est un autre débat que nous aurons l’occasion de tenir dans les mois qui viennent.
M. le président Claude Bartolone. En réponse à M. Lellouche, le Parlement britannique doit évidemment s’exprimer puisque l’accord concerne les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne : c’est parfaitement normal. Nous ne sommes pas dans la même situation. Néanmoins, je vois mal comment le Parlement français pourrait échapper à un débat, dans le cadre d’une résolution ou d’une déclaration ; mais nous n’en sommes pas encore là.
M. le ministre. Pierre Lellouche s’est interrogé sur la stratégie de Michel Barnier. Les choses sont très claires : d’abord l’article 50, ensuite seulement la négociation du nouveau cadre des relations entre l’Union et le Royaume-Uni. Si transition il doit y avoir, ce ne sera qu’après. Il n’est pas question d’en traiter avant.
M. le président Claude Bartolone. Monsieur le ministre, nous vous remercions.
Séance du jeudi 2 février 2017
La mission d’information procède à l’audition, non ouverte à la presse, de M. Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur
M. le président Claude Bartolone. Nous clôturons avec vous, monsieur le ministre de l’intérieur, notre cycle d’auditions sur le Brexit.
Au terme de ces auditions, si des incertitudes subsistent dans de nombreux domaines, nous savons en revanche qu’il est de notre devoir de veiller à ce que les négociations avec le Royaume-Uni ne se fassent pas au détriment des citoyens. Cela passe notamment par la garantie de leur sécurité, alors que des menaces graves pèsent sur notre continent.
Nous avons évoqué, il y a deux semaines, lors de l’audition de Jean-Yves Le Drian, l’impact du Brexit en matière de défense ; mais le Royaume-Uni est également un partenaire privilégié de l’Union européenne et de la France dans le maintien de notre sécurité intérieure.
La coopération policière est l’un des exemples les plus éclatants de l’attitude ambiguë – qu’on peut résumer par la formule : « Un pied dedans, un pied dehors » – du Royaume-Uni vis-à-vis de la construction européenne. Quel sera selon vous l’impact de sa sortie sur la dynamique globale de la coopération policière européenne, notamment en matière de renseignement ?
Malgré la dérogation dont ils disposent dans ce domaine, les Britanniques occupent aujourd’hui une place parfois importante au sein des instruments auxquels ils ont décidé de participer – je pense notamment à Europol, le Royaume-Uni étant le deuxième contributeur de la base de données de l’agence.
Il nous importe donc d’analyser les conséquences précises du Brexit sur les différents pans de cette coopération. Une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union, dans quelle mesure pourra-t-il être associé à ces instruments européens ? De quel statut pourrait-il bénéficier grâce à un accord avec Europol ? Pourrait-il participer au système d’information Schengen, au PNR (Passenger Name Record) européen ou aux mécanismes du traité de Prüm de coopération policière transfrontalière ?
Par ricochet, la sortie du Royaume-Uni de ces instruments pourrait également affecter notre coopération bilatérale. Quel bilan faites-vous de cette dernière et comment envisagez-vous son évolution, notamment en matière de lutte contre le terrorisme ?
Les questions d’immigration et la situation de Calais ont été évoquées à de multiples reprises au moment du référendum britannique. Quelles pourraient être les conséquences du Brexit sur la gestion de la frontière franco-britannique, et sur notre coopération en matière de lutte contre l’immigration illégale ? Comment évoluent les discussions avec le gouvernement britannique sur ce sujet ? Enfin, qu’en sera-t-il des accords du Touquet ?
M. Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur. Je vous remercie, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, de m’avoir invité. Je suis en train de vivre deux journées particulières puisque j’étais hier dans l’hémicycle pour représenter le Gouvernement à l’occasion de la discussion de deux propositions de loi dont je suis le premier signataire, et que je clos aujourd’hui avec vous le cycle des auditions sur les conséquences du Brexit, cycle que j’avais inauguré parmi vous il y a plusieurs mois. Je suis heureux de partager ce moment avec vous tant le sujet dont nous allons traiter est important. Je serai exhaustif afin d’apporter à vos questions des réponses très précises qui pourront nourrir votre rapport.
Je me dois au préalable de vous préciser les limites inhérentes à l’exercice : vous le savez, nous attendons le déclenchement des négociations par l’activation par le Royaume Uni de l’article 50 du traité de l’Union européenne. À la suite de l’arrêt de la Cour suprême britannique, le gouvernement de Theresa May a déposé au parlement un projet de loi par lequel il demande l’autorisation d’activer l’article 50. Les débats à la Chambre des communes ont débuté le 31 janvier et abouti à un premier vote permettant l’application du dispositif. L’objectif affiché est celui d’un calendrier resserré permettant une activation début mars, avant le Conseil européen des 8 et 9 mars.
Nous n’en sommes donc encore qu’aux prémices et même si la Première ministre Theresa May a annoncé les grandes lignes de son action dans son discours du 17 janvier, la position de négociation britannique n’est pas encore « sur la table » – nous devons par conséquent nous montrer particulièrement prudents. C’est au vu de ces éléments que l’Union européenne devra à son tour se positionner pour entamer la négociation de l’accord de retrait. Si la décision de retrait revêt un caractère unilatéral, l’accord est en revanche conclu par le Conseil au nom de l’Union, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Les traités européens cesseront d’être applicables à l’égard du Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur de cet accord. À défaut d’un accord, et sauf décision conjointe d’étendre la période de négociation, le retrait deviendra effectif automatiquement deux ans après la notification. Pour l’heure, je vais rester très factuel concernant les effets, étant entendu qu’aucun des éléments que je vais évoquer ne relève d’une quelconque négociation – qui serait prématurée étant donné la manière dont les Britanniques envisagent le Brexit.
Pour ce qui concerne plus précisément le ministère de l’intérieur, le retrait du Royaume-Uni aura des conséquences touchant essentiellement à la libre circulation des personnes et à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, qui comprend quatre domaines : le contrôle aux frontières, l’asile et l’immigration ; la coopération judiciaire en matière civile ; la coopération judiciaire en matière pénale ; enfin la coopération policière. Elles concernent également le code électoral et la sécurité civile.
Il faut rappeler que les politiques européennes relatives à la circulation des personnes et à la coopération judiciaire et policière en matière pénale sont fortement marquées par le régime spécifique accordé au Royaume-Uni, qui a choisi de participer – « opt in » – à certaines dispositions, y compris à l’acquis Schengen – Europol, Eurojust, équipes communes d’enquête, mandat d’arrêt européen, Système d’information Schengen II... – mais notifié des « opt out », notamment dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Tout d’abord, pour ce qui est de la circulation, du séjour et de l’asile et, en premier lieu, de l’acquis Schengen, le Royaume-Uni applique les dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire, à la lutte contre la drogue et à certains aspects de la lutte contre l’immigration illégale. Il n’est pas concerné par le reste de l’acquis Schengen, notamment par l’absence de contrôles aux frontières intérieures. Il ne relève pas du code communautaire des visas et ne participe pas au système d’information sur les visas (VIS).
En second lieu, concernant le Système d’information Schengen (SIS II), le Royaume-Uni a accès au SIS, à l’exception des données relatives aux étrangers signalés aux fins de non-admission dans la zone Schengen. Dès lors qu’il ne sera plus membre de l’Union européenne et qu’il ne sera pas dans l’espace Schengen, la déconnexion du SIS ralentira les possibilités de détection, au Royaume-Uni sur signalements européens, ou dans l’Union européenne sur signalements britanniques. L’adhésion de pays tiers n’est pas prévue, et les données traitées par le SIS ne sont pas transférables à des pays tiers. Le Royaume-Uni contribue peu à l’alimentation du système – il se situe au septième rang –, mais il le consulte régulièrement – se hissant ici à la quatrième place.
Troisièmement, le Royaume-Uni n’est pas membre de Frontex, mais il est prévu que l’agence facilite la coopération opérationnelle entre ce dernier et les États membres. De fait, les Britanniques ont participé à une quinzaine d’opérations depuis 2015. L’association de pays tiers est possible au regard de la politique de l’Union en matière de relations extérieures.
Ensuite, pour ce qui est de la circulation et du séjour, la question du contrôle de l’immigration, point dur du discours de Mme May, constituera un thème important de la négociation. Le Royaume-Uni a fait le choix de ne pas appliquer les directives sur le séjour, l’éloignement et la réadmission. La seule directive applicable, car sans dérogation possible, concerne la circulation et le séjour des citoyens communautaires et de leur famille. En cas d’impossibilité de trouver un compromis dans le temps imparti – deux ans –, le droit commun s’appliquera – avec obligation de visas et de titres de séjour. Cette question est à apprécier dans le cadre plus vaste de la négociation d’ensemble entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le principe fondamental posé dès le départ par l’Union européenne est le caractère indivisible des quatre libertés.
Enfin, en matière d’asile, le Royaume-Uni a opté pour l’application de la convention de Dublin sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile et du règlement Eurodac. Il ne sera donc plus contraint par les règles de cette convention sur la réadmission des demandeurs d’asile. L’accès à Eurodac est ouvert aux quatre États de l’Association européenne de libre-échange, car ils sont associés au système de Dublin. Il est toutefois peu probable que le Royaume-Uni adhère à cette association.
Autre grand domaine, la coopération policière se caractérise par le fait que, si les outils communautaires sont des outils de référence, l’accès à l’information et aux échanges de données est souvent ouvert aux États tiers ; par ailleurs, de nombreux autres textes –conventions multilatérales et accords bilatéraux – régissent les coopérations en la matière.
Pour ce qui est des échanges d’informations, le droit de l’Union européenne prévoit que les transferts de données à destination d’un pays tiers sont en principe soumis à une décision de la Commission, attestant que cet État offre des garanties suffisantes sur la protection des données à caractère personnel. En l’absence de décision d’adéquation, il appartiendra aux États membres d’évaluer, avant tout transfert, si l’État tiers offre de telles garanties. Le règlement de cette question est donc un préalable.
Membre depuis l’origine d’Europol, le Royaume-Uni avait choisi de ne pas participer au nouveau règlement applicable au 1er mai 2017. En novembre 2016, le Gouvernement a toutefois lancé un processus interne en vue d’une participation au nouveau règlement, volonté concrétisée par une notification adressée au Conseil fin décembre 2016. Si l’accès est réservé aux États membres, la coopération – opérationnelle, technique, stratégique – avec les États tiers est possible, la liste étant arrêtée par le Conseil.
Le cadre Prüm, lui, régit l’échange de données ADN, empreintes digitales et immatriculation des véhicules. Il prévoit également la transmission d’informations aux fins de prévention des infractions pénales, dont le terrorisme, et du maintien de l’ordre lors de manifestations majeures à dimension transfrontalière. Le Royaume-Uni a déposé une demande de participation en mai 2016. Le système permet des accords spécifiques avec des États tiers.
Le PNR européen, dont l’échéance de transposition est mai 2018, cessera de s’appliquer au Royaume-Uni. La directive laisse toutefois la possibilité de transférer des données à des autorités de pays tiers, au cas par cas et pour des besoins opérationnels.
J’ajoute que les échanges d’informations resteront naturellement possibles dans le cadre d’Interpol.
Troisième domaine, en matière de coopération judiciaire, la grande majorité des instruments repose sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, inhérent à l’Union européenne.
En ce qui concerne l’extradition et le mandat d’arrêt européen, ce dernier est l’outil le plus emblématique et le plus efficace de coopération en matière pénale. Le Royaume-Uni étant signataire d’une convention d’extradition du Conseil de l’Europe, le Brexit conduira donc au retour de cette procédure, ancienne forme de coopération, longue et lourde administrativement, qui permet à une partie de refuser l’extradition de ses ressortissants.
En outre, la souplesse des équipes communes d’enquête – investigations conjointes et coordination des poursuites – sera remise en cause. Toutefois, Europol et Eurojust pourraient en théorie continuer à subventionner des équipes communes franco-britanniques.
Pour ce qui est d’Eurojust, précisément, la coordination assurée en matière d’échanges d’informations, de définition de stratégies communes et d’opérations, notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, prendra fin, mais pourra être en partie palliée par la nomination de magistrats de liaison britanniques au sein d’Eurojust. Ce dispositif prévoit par ailleurs des accords de coopération avec des États tiers.
Il en va de même avec l’interconnexion des casiers judiciaires : le système ECRIS (European Criminal Records Information System) n’est en effet pas ouvert à la participation d’États tiers.
Enfin, le quatrième domaine couvre la sécurité intérieure. Les activités de renseignement échappent au domaine de compétence de l’Union et ne seront donc pas touchées par le Brexit. La sécurité nationale reste de la responsabilité de chaque État membre.
En matière de coopération bilatérale, aucune modification n’est à anticiper sur ce point. S’agissant de la coopération multilatérale, la seule enceinte multilatérale de coopération et d’échanges opérationnels est le Groupe antiterroriste (GAT), groupe informel qui réunit les chefs des services de sécurité de l’ensemble des États membres. L’Union européenne en tant que telle n’y participe pas. Le Royaume-Uni peut en rester membre après le Brexit, au même titre que d’autres États tiers.
J’en viens à quelques domaines spécifiques.
Le mécanisme européen dans le domaine de la protection civile vise à renforcer la coopération et la coordination, mais les États gardent l’ensemble de leurs compétences dans ce domaine. Le Royaume-Uni pourrait, en tant qu’État tiers, demander à s’y maintenir.
Pour ce qui concerne la circulation et la sécurité routières, en particulier les infractions routières, le Royaume-Uni est actuellement inclus dans le dispositif européen permettant de poursuivre les contrevenants d’un État membre qui commettent des infractions dans un autre État. Il devait transposer la directive au plus tard en mai 2017. Le Brexit entraînera une sortie de ce dispositif, posant problème au regard des volumes concernés – 150 000 flashs de véhicules britanniques par an en France. Dans le même ordre d’idées, devenant État tiers, le Royaume Uni perdra le bénéfice de la reconnaissance mutuelle du permis de conduire et se verra appliquer le droit commun des échanges.
Autre domaine, les électeurs et élus britanniques : le traité de Maastricht accorde aux ressortissants d’un État de l’Union européenne le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes dans l’État membre où ils résident. Les électeurs britanniques, au nombre d’environ 41 000, ne rempliront plus les conditions d’inscription et d’éligibilité. En revanche, le critère d’éligibilité s’appréciant à la date de l’élection et le droit actuel n’autorisant pas à les démettre pour perte de la qualité de ressortissant européen, les citoyens britanniques devraient, si le traité de retrait ne prévoit rien, conserver leur mandat jusqu’à son terme.
J’ajoute à tout cela qu’en dehors des mécanismes européens, le Royaume-Uni est membre de plusieurs conventions internationales, qui peuvent, après le Brexit, lui offrir des cadres de coopération avec l’Union européenne : conventions de l’Organisation des Nations unies (ONU) contre le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics illicites de stupéfiants, la traite des êtres humains ; conventions du Conseil de l’Europe, notamment en matière d’entraide judiciaire et pénale.
Il reste naturellement les instruments bilatéraux grâce auxquels nous continuerons d’être liés au Royaume-Uni : traité du Touquet, accord de Sangatte, autres accords de coopération à la frontière – avec notamment le centre conjoint d’information et de coordination de Calais, qui a contribué au démantèlement de 15 filières d’immigration illégale depuis début 2016 –, protocole de 1989 relatif à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue et l’immigration clandestine.
Le Brexit aura donc des conséquences mais il ne signifie pas la fin de nos coopérations, en raison de la possibilité offerte par plusieurs mécanismes européens de maintenir des liens avec les pays tiers, si de part et d’autre il y en avait la volonté, mais aussi en raison des coopérations permises par d’autres instruments internationaux, enfin en raison, je l’ai évoqué, de nos accords bilatéraux.
Mme Élisabeth Guigou. Merci beaucoup, monsieur ministre, pour la précision de vos propos : elle nous sera précieuse.
En matière de coopération judiciaire, on a fait au Royaume-Uni un statut ad hoc, si bien que, dans leur cas, on peut vraiment parler d’Europe à la carte.
Ce sont surtout les Britanniques qui vont pâtir de leur renoncement au mandat d’arrêt européen – débat qui fait rage, outre-Manche, depuis de nombreuses années. Sauf erreur de ma part, ils nous en envoient davantage que nous ne leur en envoyons. Disposons-nous de données exactes en la matière ? Je me souviens avoir entamé les discussions avec mon homologue Jack Straw pour obtenir l’extradition de Rachid Ramda et qu’il a fallu dix ans pour aboutir alors que nous n’avons eu besoin d’attendre que cinq ou six semaines l’extradition de Salah Abdeslam – progrès considérable obtenu grâce au fait que nous n’avons plus eu à suivre une procédure juridique très complexe, très lourde et très lente. Le Royaume-Uni va-t-il renoncer définitivement au mandat d’arrêt européen ? Un accord bilatéral ou un accord avec l’Union européenne est-il possible pour maintenir ce mandat pour peu que les Britanniques le demandent – car il n’est pas exclu qu’ils y aient intérêt ?
Plus généralement, pouvez-vous nous indiquer les domaines dans lesquels le Brexit aura nécessairement un impact ? On ne pourra en effet pas systématiquement éviter des conséquences négatives en passant avec eux des accords bilatéraux ou des accords ad hoc…
Enfin, les accords du Touquet sont très contestés en France par une partie des responsables politiques. À quelles conditions croyez-vous possible de résister à la pression qui va s’accroître à mesure que nous allons nous approcher des élections, afin que soit déplacée la frontière depuis Calais jusqu’à Douvres ? Je considère pour ma part, et c’est la position du Gouvernement – donc la vôtre –, que ce serait une folie puisque ce déplacement ne ferait qu’attirer davantage de migrants à Calais. Qu’avons-nous d’ores et déjà obtenu des Britanniques ? L’ambassadeur du Royaume-Uni en France nous a indiqué que son pays avait accepté d’envoyer 750 mineurs isolés outre-Manche mais on sait qu’ils sont beaucoup plus nombreux. En outre, les Britanniques ont déjà participé massivement aux investissements destinés à protéger la zone de transit et ses abords ; que devons-nous leur demander de plus pour que les accords du Touquet « tiennent », si j’ose dire ?
M. Jacques Myard. On peut envisager des coopérations bilatérales dans de nombreux domaines et notre intérêt est d’aller en ce sens.
Certes le mandat d’arrêt européen relève d’une coopération très particulière mais, là encore, je ne vois pas pourquoi l’Union européenne et le Royaume-Uni ne pourraient pas avoir des échanges et pourquoi on ne pourrait pas prévoir l’extension de ce dispositif à un pays tiers : il est de l’intérêt de tous nos concitoyens que la justice passe.
Vous n’avez pas évoqué, monsieur le ministre, le statut des Britanniques chez nous. Les mettons-nous à la mer, leur donnons-nous un statut particulier – je doute fort qu’on leur refuse un permis de séjour ? Et, parallèlement, quid des Français de l’autre côté de la Manche ?
M. Christophe Premat. Merci, monsieur le ministre, de vous être livré à un tour d’horizon aussi complet, d’autant que la situation est assez compliquée. Vous avez rappelé que la Chambre des communes avait émis un premier vote favorable à la poursuite de l’examen du projet de loi sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. En outre, Theresa May a présenté le 17 janvier dernier ses douze priorités. Les éléments solides que vous nous apportez nous sont donc utiles dans un contexte évolutif.
À travers mes contacts avec notre ambassade, en particulier avec l’attaché de défense, il me semble que les coopérations bilatérales en matière de défense et de sécurité intérieure sont anciennes et paraissent résister. Peut-être ces coopérations nécessitent-elles, ici ou là, des ajustements, mais, sans anticiper le Brexit, nous avions développé à travers elles une relation assez forte avec le Royaume-Uni ; c’est pourquoi je ne suis pas vraiment inquiet à leur sujet.
Je m’interroge davantage quant aux conséquences du Brexit pour les Français vivant au Royaume-Uni. Or, si l’on s’en tient aux données du National Health Service (NHS), différentes des statistiques consulaires, on peut évaluer cette population à 300 000 voire 400 000 individus. Depuis plus de huit mois, dans mes permanences, je constate une plus forte inquiétude qu’auparavant – le consulat général de France à Londres m’indiquait que les demandes de naturalisation française, pour le seul mois de juillet, avait crû de 130 %, la nationalité française donnant accès à la citoyenneté européenne. J’ajoute que le cas de la France n’est pas isolé : la pression consulaire est très forte également en Irlande du Nord. Il faut prendre en compte cette inquiétude et il nous faudra peut-être anticiper un mouvement d’impatriation. À cet effet, notre collègue sénatrice Helen Conway-Mouret a remis en juillet 2015 un rapport proposant de simplifier les possibilités de retour en France. Je connais le cas de gens établis depuis vingt ou trente ans et qui ne comprennent plus tellement le pays où ils vivent. Ils doivent désormais remplir le formulaire P 185 de résident permanent, formulaire considérablement complexifié quelques mois avant le vote du 23 juin, au point qu’il compte quatre-vingt-cinq pages à remplir – d’où certaines crispations.
Sans doute, par ailleurs, y a-t-il eu des échanges avec Philip Hamond sur les transferts des fonds de pension, des capitaux – vous avez évoqué la liberté de circulation. La loi n’est pas la même selon l’organisme de gestion des fonds de pension concerné, certes, mais on peut observer des phénomènes de décaissement – or le rapatriement de capitaux est taxé. Avez-vous anticipé ce phénomène, même s’il déborde votre périmètre de compétences ? J’ai eu l’occasion d’en discuter avec des députés britanniques, travaillistes en l’occurrence, et ils apprécient la clarté de la position du Gouvernement français.
Mme Valérie Fourneyron. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre présentation détaillée qui nous permet de mieux appréhender les conséquences du Brexit sur la libre circulation et sur nos coopérations avec les Britanniques. Vous avez par ailleurs rappelé le calendrier de Theresa May, qui semble lié, dans l’opinion publique, avec l’élection de M. Trump aux États-Unis.
Ma première question, qui rejoint l’une de celles posées par la présidente Élisabeth Guigou, a trait à la situation à Calais et au traité du Touquet : où en sommes-nous – je pense en particulier aux mineurs ?
Certes il existe des coopérations bilatérales qui permettront de poursuivre un certain nombre de politiques mais, selon vous, quelles sont les conséquences les plus risquées du Brexit pour la France en matière de sécurité intérieure, qu’il s’agisse de dispositifs déjà en vigueur ou bien de dispositifs à venir comme le PNR, prévu pour 2018 ? Au-delà des 150 000 automobilistes « flashés » que vous avez mentionnés, sur quels points le Brexit est-il susceptible de présenter un danger pour la sécurité intérieure ?
M. le président Claude Bartolone. Quand on rencontre nos compatriotes à Londres, une de leurs réflexions est qu’il nous faut attendre que les Anglais tirent les premiers, à savoir qu’ils déclenchent l’article 50 du traité sur l’Union européenne. On sent néanmoins d’ores et déjà chez eux une préoccupation : à partir de quelle date entrerait en vigueur leur nouveau statut, le jour du référendum ou bien celui de l’activation de l’article 50 ?
M. le ministre. Il entrera en vigueur à la date effective du retrait, soit à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait, soit à défaut d’accord deux ans après l’activation de l’article 50.
Vous comprendrez qu’au moment présent, sur certains sujets, je n’irai pas plus loin que je n’ai été.
La France n’a aucune peur, Madame Fourneyron, de la décision prise par le Royaume-Uni. Si je dois nourrir des craintes, c’est pour le Royaume-Uni lui-même, parce que tout ne va pas pouvoir être réglé par des accords avec des pays tiers. Pour notre part, nous avons l’Europe dans le cadre de laquelle nous allons pouvoir parfaire les dispositifs que j’ai mentionnés. Même si le domaine de la sécurité ne sera pas le plus affecté par le Brexit, on comprend bien que deux pays comme les nôtres, étant donné leur proximité géographique, malgré la Manche, ont un intérêt commun à assurer leur sécurité. Certaines démarches seront certes un peu plus lourdes qu’auparavant mais certainement pas de nature, j’y insiste, à nous faire peur. Je suppose que c’est davantage mon homologue britannique que moi qui doit se poser des questions sur les conséquences du Brexit. La France est mieux protégée que si elle était seule.
En ce qui concerne Calais, je vous confirme, Madame Guigou, que ma position est bien celle que vous m’avez attribuée. Pour l’heure, ma responsabilité est de faire en sorte que les Britanniques respectent leurs engagements. Or, leur réalisation n’est pas toujours complète, notamment en ce qui concerne les mineurs : qui ont le sentiment que les critères fixés par le Parlement ne sont pas toujours respectés – comme ceux de parentalité et de vulnérabilité – par ceux chez qui ils souhaitent se rendre. Des recours ont été intentés. Le dialogue est donc très fréquent avec mon homologue britannique.
En outre, ma préoccupation est que ne se reforment pas des campements sauvages dans la zone de Calais. Là encore, je suis en liaison permanente avec nos amis britanniques afin qu’ils y veillent avec nous. Comme ce fut le cas à l’occasion de l’évacuation du campement, il s’agit de conjuguer le respect de l’ordre public et celui d’une grande humanité en prenant en considération chaque cas individuel aux fins d’une meilleure orientation.
J’en viens au mandat d’arrêt européen : la décision de l’Union ne peut pas s’appliquer aux États tiers. Il faudrait donc engager une négociation pour élaborer une nouvelle convention. Je vous fournirai avant la publication de votre rapport les chiffres dont je ne dispose pas en ce moment même.
Pour ce qui est des résidents britanniques en France, je l’ai dit, nous en reviendrons au droit commun applicable au séjour des ressortissants extracommunautaires. C’est le principe de réciprocité qui prévaudra. Les Britanniques installés en France devraient donc pouvoir bénéficier d’une carte de résident permanent mais on ne pourra pas leur donner un statut plus protecteur que celui accordé aux ressortissants des autres États tiers.
Je vous remercie pour votre invitation, monsieur le président, et je me tiens bien entendu à votre entière disposition, en fonction de ce qui pourra se passer dans les prochains mois, même si les travaux parlementaires seront suspendus.
M. le président Claude Bartolone. Nous vous remercions à notre tour, monsieur le ministre, pour les précisions que vous nous avez apportées.
Mes chers collègues, nous devrions nous retrouver le 15 février pour discuter du rapport.
1 () La situation du Royaume-Uni au regard de ces politiques est présentée dans la deuxième partie du présent rapport afin de déterminer précisément l’impact d’une sortie de ce pays sur ces politiques.
2 () in Variété, la Crise de l’esprit, 1919, première lettre et deuxième lettre.
3 () Audition du 29 septembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
4 () Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
5 () Le Praesidium était composé du Président de la Convention, Valéry Giscard d’Estaing, des vice-présidents et de neuf membres issus de la Convention, au nombre desquels figurait Michel Barnier en tant que représentant de la Commission européenne.
6 () Commentaire du Praesidium de la convention sur l’avenir de l’Europe à propos du projet d’article I-59 du traité instituant la Constitution.
7 () Rencontrée par la mission lors de son déplacement à Bruxelles du 12 janvier 2017.
8 () Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie.
9 () Audition du 15 décembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
10 () Catherine Guillard, L’accord relatif au Brexit, Revue de l’Union européenne n° 602, octobre-novembre 2016, page 537.
11 () Conférence de presse du 6 décembre 2016.
12 () Jean-Claude Piris, Article 50 is not for ever and the UK could change its mind, Financial Times, 1er septembre 2016.
13 () Déplacement à Bruxelles du 12 janvier 2017.
14 () Paragraphe 26 de l’arrêt de la Cour suprême du 24 janvier 2017 : « In these proceedings, it is common ground that notice under article 50(2) (which we shall call “Notice”) cannot be given in qualified or conditional terms and that, once given, it cannot be withdrawn. »
15 () Point 7 de la résolution du Parlement européen du 28 juin 2016 sur la décision de quitter l’Union européenne à la suite du résultat du référendum au Royaume-Uni.
16 () Audition du 21 septembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
17 () Audition du 26 janvier 2017, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
18 () Souvent désignée par l’expression « cliff edge » (effet falaise) dans les débats sur le Brexit au Royaume-Uni.
19 () Audition du 21 septembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
20 () R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant), 24 janvier 2017.
21 () The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union, 2 février 2017.
22 () Audition du 21 septembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
23 () Le paragraphe 4 de l’article 15 du traité sur l’Union européenne dispose que « le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement ».
24 () Rencontré par la mission lors de son déplacement à Bruxelles du 12 janvier 2017.
25 () Discours du 17 janvier 2017.
26 () Déplacement à Bruxelles du 12 janvier 2017.
27 () En application de l’article 82 du Règlement du Parlement européen, si un État membre décide de se retirer de l’Union, la question est renvoyée à la commission des affaires constitutionnelles, dans les mêmes conditions que pour une demande d’adhésion. C’est cette commission qui préparera la résolution soumise au vote en séance plénière.
28 () Jean-Claude Piris, Brexit ou Britin : fait-il vraiment plus froid dehors ? Question d’Europe n° 369, Fondation Robert Schuman, 26 octobre 2015.
29 () Aux termes du second alinéa de l’article 49 du traité sur l’Union européenne, « les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ».
30 () Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.
31 () Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet.
32 () Déplacement à Bruxelles du 12 janvier 2017.
33 () Aux termes de l’article 14 du traité sur l’Union européenne, « le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union ».
34 () Audition du 21 septembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
35 () Le 3 de l’article 4 du traité sur l’Union européenne dispose que « en vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
« Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.
« Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. »
36 () Dans le Livre Blanc publié le 2 février 2017, le Gouvernement britannique précise que le Royaume-Uni quittera la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) en même temps que l’Union européenne. Lors de la table ronde du 24 novembre 2016, M. Pierre Todorov, secrétaire général du groupe EDF, avait fait part de ses interrogations à ce sujet et souligné la nécessité de trouver des modalités pour que la coopération en matière nucléaire puisse se poursuivre.
37 () Isabelle Bosse-Platière, Catherine Flaesch-Mougin, Carole Billet, Christine Delcourt, Anne Hamonic, Alan Hervé et Cécile Rapoport, Brexit et action extérieure de l’Union européenne, Revue trimestrielle de droit européen, 2016, page 759.
38 () Les contingents tarifaires permettent, pendant la période de validité de la mesure et pour un volume de marchandises limité, l’abandon total ou partiel des droits qui devraient être normalement payés sur les marchandises importées.
39 () Jörg Haas et Eulalia Rubio, Brexit et budget de l’Union européenne : menace ou opportunité ?, Jacques Delors Institut, Policy paper n° 183, 16 janvier 2017.
40 () Outre son président, Mario Monti, ce groupe comprend trois membres nommés par le Parlement européen, trois membres nommés par le Conseil et trois membres nommés par la Commission européenne.
41 () Future financing of the EU, Final report and recommendations of the High Level Group on Own Resources, décembre 2016, page 13.
42 () Le solde net comptable est calculé par différence entre la contribution d’un État membre au budget de l’Union européenne au titre de l’ensemble des ressources propres, y compris les ressources propres traditionnelles, et le montant des dépenses européennes effectuées dans cet État membre, y compris les dépenses administratives.
43 () Elle employait 890 personnes au 31 décembre 2015 (source : rapport annuel de l’agence).
44 () Le nombre de salariés de l’agence était de 156 au 31 décembre 2015 (source : rapport annuel de l’agence).
45 () Règlement n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
46 () Déplacement à Bruxelles du 12 janvier 2017.
47 () En réponse à une demande du Premier ministre britannique de novembre 2015, le Conseil européen des 18 et 19 février 2016 est parvenu à un accord renforçant le statut particulier du Royaume-Uni au sein de l’Union sur quatre points : compétitivité ; gouvernance économique ; souveraineté ; prestations sociales et libre circulation. Cet arrangement était censé servir d’argument à David Cameron pour défendre le maintien dans l’Union lors de la campagne référendaire. Les conclusions du Conseil européen précisent clairement que « si l’issue du référendum au Royaume-Uni devait être la sortie du pays de l’Union européenne, l’ensemble des dispositions [concernant ce nouvel arrangement] cesseront d’exister ».
48 () Department for exiting the EU.
49 () Déplacement à Bruxelles du 12 janvier 2017.
50 () Composée du Président du Parlement européen et des présidents des groupes politiques.
51 () Déclaration à l’issue de la réunion informelle à vingt sept du 29 juin 2016.
52 () Résolution du Parlement européen du 28 juin 2016 sur la décision de quitter l’Union européenne à la suite du résultat du référendum au Royaume-Uni.
53 () L’article 83 du statut des fonctionnaires européens dispose que « le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge du budget de l’Union. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses. »
54 () Article 7 de l’accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet.
55 () Audition du 21 septembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
56 () Discours de M. Martin Schulz, président du Parlement européen, au Conseil européen du 15 décembre 2016.
57 () Source : audition de David Davis devant la commission de la Chambre des Communes chargée de suivre le Brexit, le 14 décembre 2016.
58 () Joseph Owen et Robyn Munro, Whitehall’s preparation for the UK’s exit from the EU, Institute for Government, Briefing paper, décembre 2016, page 22.
59 () Il a été remplacé par Tim Barrow, ancien ambassadeur à Moscou et qui a déjà été en poste à Bruxelles à deux reprises.
60 () Kevin Morrell, Brexit: how a single word became the most powerful rhetorical device in a generation, The conversation, 12 octobre 2016, http://theconversation.com/brexit-how-a-single-word-became-the-most-powerful-rhetorical-device-in-a-generation-66871.
61 () « a smooth and orderly Brexit »
62 () Le nombre de parlementaires britanniques qui auraient voté en faveur du maintien dans l’Union européenne est estimé aux trois-quarts.
63 () Audition du 24 novembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
64 () Source : Eurostat.
65 () Audition du 24 novembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
66 () Source : In brief: UK-EU economic relations, Chambre des Communes, 13 juin 2016. Il convient de noter que cette part a toutefois diminué au cours des dernières années: elle était de 60% en 2004. Si cette baisse est particulièrement marquée au Royaume-Uni, la part des exportations intra-européennes dans le total des exportations a également diminué d’environ 10 points pour l’Espagne, 8 points pour l’Italie et 7 points pour la France et l’Allemagne, et reflète avant tout une évolution générale de l’environnement économique européen.
67 () Source : Geographical breakdown of the current account, The Pink Book 2016.
68 () Rapport d’Open Europe : What if…? The Consequences, challenges & opportunities facing Britain outside, mars 2016.
69 () Audition du 3 novembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
70 () Source : OCDE, https://www.oecd.org/eco/The-Economic-consequences-of-Brexit-27-april-2016.pdf.
71 () Source : Open Europe, How the UK’s financial services sector can continue thriving after Brexit, http://openeurope.org.uk/intelligence/britain-and-the-eu/how-the-uks-financial-services-sector-can-continue-thriving-after-brexit/.
72 () TheCityUK Member briefing, Brexit and the industry, septembre 2016.
73 () Source : Livre Blanc du 2 février 2017.
74 () Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/422174.
75 () Audition du 3 novembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
76 () Source : Olivier Wyman pour TheCityUK.
77 () Arrêt dans l’affaire T-496/11 Royaume-Uni / Banque centrale européenne.
78 () Audition du 3 novembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
79 () Audition du 3 novembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
80 () R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant), 24 janvier 2017.
81 () Seuls 89 députés ont voté contre cet amendement sur l’activation de l’article 50 et 461 députés ont voté pour. Parmi ceux qui ont voté contre figurent 51 SNP, 23 travaillistes, 5 Lib Dem, 3 SDLP, 3 Plaid Cymru et 1 seul conservateur, Kenneth Clarke.
82 () http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/05/exclusive-peers-will-not-sabotage-brexit-lord-speaker-tells/
83 () Parmi ses membres, 9 députés ont fait campagne en faveur du « leave », dont pratiquement tous les députés tories (comme Michael Gove, John Whittingdale, Andrea Jenkyns, Peter Lilley, Karl McCartney, Dominic Raab). Parmi les pro-européens figurent l’ancien ministre fantôme travailliste pour l’Europe Pat McFadden, Emma Reynolds, et le Libéral Democrate Alister Carmichael.
84 () Respectivement règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui remplace le règlement n°1408/71 du Conseil, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et règlement (CE) n°987/2009 du 16 septembre 2009 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.
85 () D’après les chiffres transmis par Christopher Chantrey, président de l’association British community committee of France.
86 () Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.
87 () Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – COM(2016)128, modifiée.
88 () https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20160628-british-participation-erasmus-plus_en
89 () http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/test-news.aspx
90 () http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/images/infograph/2016-erasmus-destination.jpg
91 () http://www.telegraph.co.uk/education/2016/05/24/what-would-brexit-mean-for-universities-and-eu-students/
92 () http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/images/infograph/2016-erasmus-radialgraph.jpg
93 () http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-faqs.aspx
94 () http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/donnees-statistiques-horizon-2020.html
95 () http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/158/158.pdf, p.6
96 () House of Commons Library, Brexit : impact across policy areas, 26 août 2016, p. 143
97 () http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Pages/brexit-faqs.aspx
98 () https://www.timeshighereducation.com/blog/european-commissioner-carlos-moedas-reassures-uk-researchers-post-brexit
99 () https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum et https://www.gov.uk/government/news/chancellor-philip-hammond-guarantees-eu-funding-beyond-date-uk-leaves-the-eu: « As a result, British businesses and universities will have certainty over future funding and should continue to bid for competitive EU funds while the UK remains a member of the EU. That is why I am confirming that structural and investment funds projects signed before the Autumn Statement [23 novembre 2016] and Horizon research funding granted before we leave the EU will be guaranteed by the Treasury after we leave. »
100 () Voir notamment https://www.theguardian.com/education/2016/jul/12/uk-scientists-dropped-from-eu-projects-because-of-post-brexit-funding-fears
101 () Les analyses suivantes sont développées notamment dans le rapport « L’Union vacille – les choix de l’Europe et de la Finlande après le Brexit » d’ EVA, think tank du patronat finlandais EK, sous dir. Vesa Vihriälä, économiste et directeur du Centre de recherches ETLA, et de Taneli Lahti, directeur Europe du patronat finlandais EK, novembre 2016
102 () Le traité de Lisbonne a remanié en profondeur cette procédure. Désormais, on distingue les actes délégués des actes d’exécution. Les premiers découlent d’une autorisation explicite dans les textes législatifs adoptés par le Parlement et le Conseil tandis que les seconds sont déclenchés en conformité avec le principe de subsidiarité, si l’application uniforme d’un texte législatif ne peut être laissée à l’appréciation seule de chaque État membre.
103 () Pour mémoire, le Protocole n°15 prévoit que le Royaume-Uni n’est pas tenu d’adopter l’euro et qu’il conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire, conformément à son droit national. Le Pacte de stabilité et de croissance (article 126 du TFUE) ne s’applique que partiellement puisqu’aucune mise en demeure (article 126-9) ou sanction (article 126-11) ne peut lui être imposée en cas de déficit excessif. La Banque d’Angleterre ne participe pas pleinement au Système européen des Banques centrales (article 127 du TFUE, paragraphes 1 à 5) et à la politique monétaire de l’Union européenne (article 130 à 133 du TFUE). Elle n’est pas membre du Conseil des gouverneurs de la BCE (article 283 du TFUE) et n’est pas liée par l’objectif de maintien de la stabilité des prix (article 282-2 du TFUE). La Banque centrale ne peut émettre d’avis sur la réglementation britannique entrant dans son champ de compétence (article 282-5 du TFUE). Le Royaume-Uni participe néanmoins au Conseil qui confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurance (article 127-6). Le Royaume-Uni n’est pas concerné par la question de la coordination et de la représentation des positions européennes au sein des institutions et conférences financières internationales (article 138 du TFUE) ou de la fixation d’un taux de change entre l’euro et des pays tiers (article 219 du TFUE).
104 () En France, arrêts de la Cour de cassation Société des cafés Jacques Vabre en 1975 et du Conseil d’État Alitalia et Nicolo en 1989, arrêt Madame Perreux de 2009 qui énonce que le juge national est le juge de droit commun de l’application des directives de l’Union européenne, mettant expressément fin à la jurisprudence Cohn-Bendit de 1978.
105 () Sous le contrôle et la responsabilité de la Commission, ajoutons que des agences d’exécution peuvent être chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes de l’Union européenne (Règlement 58/2003 et règlement 1653/2004.
106 () L’exemple typique est celui des cessions de filiales du Crédit Lyonnais à la suite de son sauvetage par l’État français.
107 () Un exemple à suivre concernera l’amende record de 13 milliards d’euros infligée à Apple au titre des aides d’État abusives obtenues de la part de l’Irlande, qui a fait appel de cette décision.
108 () « Les traités ont institué un nouvel ordre juridique dont les sujets sont non seulement les États, mais également leurs ressortissants », principe absolument novateur.
109 () Il existe a contrario des requêtes en annulation qui visent à garantir le respect de la procédure notamment par la Commission européenne.
110 () http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201604/rapport_annuel_2015_activite_judiciaire_fr.pdf
111 () La première procédure concerne le comportement de Google relatif au système d’exploitation et aux applications Android, pour laquelle elle a conclu en avril 2016 à l’abus de position dominante au moyen de restrictions aux fabricants d’appareils Android et aux opérateurs de réseaux mobiles. La seconde procédure concerne des pratiques supposées anti-concurrentielles et qui porte sur d’autres aspects du comportement de Google dans l’EEE, tels que le traitement favorable qu’elle réserve à ses autres services de recherche spécialisée dans ses propres résultats de recherche générale et les préoccupations de la Commission concernant la copie de contenus web concurrents (connue sous le nom de « scraping » ou « moissonnage »), l’exclusivité en matière publicitaire et des restrictions injustifiées imposées aux annonceurs.
112 () Philippe Léglise Costa, secrétaire général des Affaires européennes, lors de son audition devant la mission en date du 21 septembre 2016.
113 () Audition de Mme Odile Renaud-Basso dans le cadre d’une table-ronde organisée par la mission le 3 novembre 2016 sur l’impact du « Brexit » sur les activités bancaires et financières, les monnaies et les investissements.
114 () Audition de M. Philippe Léglise-Costa par la mission au cours de sa réunion du 21 septembre 2016.
115 () Un plan de mise œuvre sur la sécurité et la défense entérinant un niveau d’ambition renouvelé pour l’Union européenne fondé sur la protection, la projection et l’assistance et proposant des actions concrètes pour renforcer les outils à disposition : lancement notamment d’un semestre européen de la défense visant à développer des programmes capacitaires communs, des ajustements aux structures militaires de gestion de crise y compris pour renforcer les synergies civilo-militaires (l’Union européenne a actuellement cinq missions militaires déployées en mer Méditerranée, dans le golfe d’Aden, au Mali, en Centrafrique et en Somalie) ainsi qu’une refonte des outils de réaction rapide ;
un plan d’action européen de la défense présenté par la Commission visant à maximiser les dépenses et la coopération en matière de défense, notamment au travers d’un fonds européen de la défense comprenant un volet de recherche collaborative sur les technologies de défense innovantes et stratégiques (budget estimatif de 500 millions d’euros par an) et un volet capacité pour le financement en commun ;
un plan de mise en œuvre de la déclaration UE-OTAN du 8 juillet 2016 basé sur 42 mesures concrètes, notamment sur la cyber sécurité, les capacités militaires ou la recherche, constituant l’avancée la plus significative dans la coopération entre les deux organisations depuis les accords de Berlin+ de 2003.
116 () Dominique Moïsi, in Repenser l’Europe, Politique étrangère, Automne 2016, page 86.
117 () Jean-Claude Piris, Brexit ou Britin : fait-il vraiment plus froid dehors ?, Question d’Europe n° 369, Fondation Robert Schuman, 26 octobre 2015.
118 () https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/354
119 () Audition du 20 octobre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
120 () Migration Observatory, What Would UK Immigration Policy Look Like After Brexit ?, juin 2016.
121 () Brexit: acquired rights, 10th report of session 2016-17, commission des affaires européennes de la Chambre des Lords.
122 () Audition du 20 octobre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
123 () Jean-Claude Piris, Brexit ou Britin : fait-il vraiment plus froid dehors ?; Question d’Europe n° 369, Fondation Robert Schuman, 26 octobre 2015.
124 () Arrêt de la Cour du 10 novembre 1992. - Exportur SA contre LOR SA et Confiserie du Tech SA
125 () Audition du 20 octobre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
126 () Audition du 20 octobre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
127 () http://openeurope.org.uk/intelligence/britain-and-the-eu/as-the-uk-searches-for-a-post-brexit-plan-is-the-eea-a-viable-option/ .
La Norvège contribue au budget de l’Union européenne à hauteur de 447 millions d’euros pour la période 2014-2020 au titre de sa participation à certains programmes européens (Horizon 2020, Erasmus +, Galileo et Copernic) – à laquelle s’ajoutent des contributions annuelles de 6 millions d’euros pour la coopération entre le pays et l’Union européenne en matière de justice et d’affaires intérieures et de 25 millions d’euros dans le cadre du programme de coopération territoriale européenne. Elle contribue également à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’EEE à hauteur de 388 millions d’euros par an en 2014-202 (source : rapport fait au nom de la commission des finances du Sénat sur les conséquences économiques et budgétaires d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne par M. Albéric de Montgolfier).
128 () Source: étude indépendante commandée par le Gouvernement norvégien en 2012 http://www.eu-norway.org/Global/SiteFolders/webeu/NOU2012_2_Chapter_1.pdf.
129 () Accords dits « bilatéraux I » sur la libre circulation des personnes, la suppression des obstacles techniques au commerce (dit accord de reconnaissance mutuelle, sur l’examen de la conformité des produits), les marchés publics, l’agriculture, les transports terrestres, le transport aérien et la recherche.
130 () Accords bilatéraux II, qui concerne d’autres secteurs économiques (industrie des denrées alimentaires, tourisme notamment) et élargit la coopération entre la Suisse et l’Union européenne à d’autres domaines importants dépassant le seul cadre économique, tels que la sécurité, l’asile, l’environnement ou la culture.
131 () Discours au World Trade Symposium de Londres sur l’état du commerce mondial: https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra126_e.htm.
132 () Une Autorité de surveillance (aux pouvoirs inspirés de ceux de la Commission en matière de surveillance) et une Cour de Justice spécifiques existent pour l’application des règles de l’EEE. Cette Cour de Justice, où siègent trois juges nommés par chacun des États de l’AELE membre de l’EEE, coopère étroitement avec la Cour de Justice de l’Union.
133 () Liste complète de pays ayant signés un accord opérationnel avec Europol : l’Albanie, l’Australie, le Canada, la Colombie, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Lichtenstein, la Moldavie, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Suisse, les États-Unis.
134 () Audition du 2 février 2017, dont le compte-rendu est annexé au présent rapport.
135 () Audition du 26 janvier 2017, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
136 () Audition du 15 décembre 2016, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
137 () “Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014".
138 () Source : Livre Blanc du 2 février 2017. Par ailleurs, depuis 2004, date à laquelle la procédure du mandat d’arrêt européen est entrée en vigueur entre le Royaume-Uni et la France, 212 mandats ont été échangés entre nos deux États dont 122 à l’initiative de la France et 90 à l’initiative du Royaume-Uni.
139 () La Norvège et l’Islande ont négocié un tel accord entre 2001 et 2014, accord qui n’est toujours pas entré en vigueur.
140 () Source: Leaving the European Union: UK Armed Forces and Diplomatic Service, Chambre des Lords, 2 décembre 2016.
141 () Rapport d’information n° 1582 de Mme Elisabeth Guigou sur l’Europe de la défense.
142 () Audition du 19 janvier 2017, dont le compte rendu est annexé au présent rapport.
143 () – Membres présents lors de la réunion du 15 février 2017 : M. Claude Bartolone, M. Christophe Caresche, M. Philip Cordery, M. Éric Elkouby, M. Daniel Fasquelle, Mme Valérie Fourneyron, M. Joël Giraud, Mme Élisabeth Guigou, Mme Marietta Karamanli, M. Pierre Lellouche, M. Pierre Lequiller, M. Jacques Myard, M. Christophe Premat, M. Gilles Savary, M. Michel Vauzelle.
– Membre excusée lors de la réunion du 15 février 2017 : Mme Nicole Ameline.
144 NSP : ne se prononce pas
145 () Témoignages recueillis par le député Christophe Premat
© Assemblée nationale
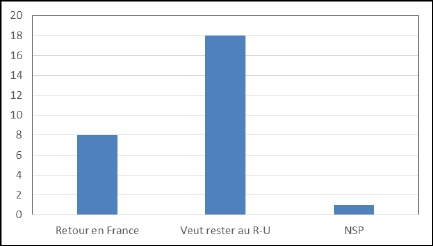 144
144