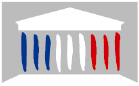
N° 3389
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
EnregistréàlaPrésidencedel’Assembléenationalele 13 janvier 2016.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI pour une République numérique,
PAR M. Emeric BRÉHIER,
Député.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 3318.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. DES DISPOSITIONS INDISPENSABLES À LA RECHERCHE ET À LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 7
A. LE LIBRE ACCÈS AUX PRODUITS DE LA RECHERCHE ENCOURAGÉ 7
1. Le fonctionnement actuel du marché de l’édition scientifique, frein à la circulation des savoirs 7
2. Le droit d’auteur des chercheurs : un droit détourné au profit des éditeurs 9
3. Voie verte, voie dorée, archive ouverte, open access institutionnel : quelles alternatives au modèle du lecteur-payeur ? 12
4. Permettre la diffusion des résultats de la recherche scientifique après un délai d’exploitation exclusive : une transition nécessaire 16
a. Un nouveau droit pour les chercheurs qui profitera à l’ensemble de la communauté scientifique 16
b. Un choix cohérent au plan européen 18
c. Le statut des données de la recherche 19
d. La nécessité de créer un cadre favorable à l’exploration automatisée de textes et de données 23
B. UNE MEILLEURE UTILISATION DES DONNÉES AUX FINS DE RECHERCHE 27
1. Le caractère signifiant du NIR, obstacle aux activités de recherche 27
2. La solution équilibrée proposée par l’article 18 du projet de loi 29
II. ACCOMPAGNER LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE EN MATIÈRE CULTURELLE EN RESPONSABILISANT LES PLATEFORMES 31
A. UN STATUT D’HÉBERGEUR INADAPTÉ À L’ACTIVITÉ RÉELLE DES PLATEFORMES 31
B. LA LUTTE CONTRE LE PIRATAGE, VÉRITABLE TONNEAU DES DANAÏDES 32
C. ACCROÎTRE LA RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES DANS LE RESPECT DU DROIT EUROPÉEN 35
D. FAIRE PARTICIPER LES PLATEFORMES AU FINANCEMENT DE LA CRÉATION : LA NÉCESSITÉ D’UNE ÉVOLUTION DU CADRE EUROPÉEN 37
III. FACILITER L’ORGANISATION DE COMPÉTITIONS DE JEUX VIDÉO POUR ASSURER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE DANS CE DOMAINE 39
A. LES COMPÉTITIONS DE JEUX VIDÉO, UN SECTEUR ÉCONOMIQUE EN PLEINE EXPANSION 39
B. UN CADRE JURIDIQUE INADAPTÉ À L’ORGANISATION DE COMPÉTITIONS 41
C. LA NÉCESSITÉ DE CRÉER UN STATUT POUR LES COMPÉTITIONS DE JEUX VIDÉO ET LEURS PARTICIPANTS 43
EXAMEN EN COMMISSION 47
Article 17 (art. L. 533-4 [nouveau] du code de la recherche) : Accès au travaux de recherche financés sur fonds publics 57
Après l’article 17 59
Article 18 (art. 22, 25 et 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Procédure d’accès à certaines données publiques à des fins statistiques par l’intermédiaire du numéro d’inscription au répertoire (NIR) 61
Article additionnel après l’article 18 (art. L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle) : Exception de panorama 61
Après l’article 18 64
Article additionnel après l’article 18 : Protection du domaine commun informationnel 64
Article additionnel après l’article 18 : Création d’un domaine commun volontaire 68
Article 22 (art. L. 111-5-1 du code de la consommation) : Principe de loyauté des plateformes en ligne vis-à-vis des consommateurs 68
Article 23 (art. L. 111-5-2 [nouveau] du code de la consommation) : Autorégulation des principaux opérateurs de plateformes en ligne 69
Article 42 : Compétitions de jeux vidéo 69
ANNEXE LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS 73
Le présent projet de loi, qui porte des ambitions fortes dans de nombreux domaines, reflète le caractère transversal de la révolution numérique, qui touche chacun des champs de compétence de la Commission. La Commission s’est donc légitimement saisie de plusieurs dispositions de ce projet de loi.
Il s’agit tout d’abord des articles 17 et 18, visant à favoriser la circulation des savoirs en renforçant les droits des chercheurs et en donnant un statut aux données de la recherche, et à faciliter la conduite de projets de recherche complexes recourant à des données à caractère personnel.
La Commission s’est également saisie de l’article 42, relatif aux compétitions de jeux vidéo, qui entre naturellement dans son champ de compétence, eu égard au caractère créatif de ces œuvres protégées au titre du droit d’auteur et à la proximité que de telles compétitions entretiennent avec le monde sportif.
Enfin, plusieurs dispositions du présent projet de loi ont des conséquences importantes sur le monde culturel et conduisent à s’interroger à nouveau sur certains enjeux de la culture à l’ère numérique. C’est notamment le cas des articles 22 et 23, qui ont trait à l’activité des plateformes en ligne. Or, les plus importantes d’entre elles, gérées par les GAFA – Google, Amazon, Facebook, Apple – ont acquis un poids considérable dans le secteur culturel. Ces nouveaux acteurs dominants bouleversent les schémas traditionnels, soulevant jour après jour de nouvelles interrogations, particulièrement en matière de droit d’auteur.
Le projet de loi sur lequel la Commission est appelée à se prononcer est le résultat d’une procédure innovante de consultation de la société civile, qui a eu lieu à un stade suffisamment précoce pour que des conclusions intéressantes puissent en être tirées. Notamment, l’introduction de l’article 42 précité qui autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances, n’aurait a priori pas vu le jour sans l’apport des internautes. De la même façon, des modifications substantielles ont été introduites au texte de l’article 17, afin de prendre en compte les remarques formulées par la communauté scientifique elle-même. Enfin, cette consultation a fait apparaître la nécessité qu’une réflexion plus approfondie s’engage ou se poursuive sur certains sujets, tels que celui des biens communs informationnels.
Si on ne peut donc que se féliciter de cette novation démocratique, on ne peut parallèlement que regretter le temps imposé au Parlement pour l’examen de ce texte présenté en Conseil des ministres le 9 décembre 2015 et soumis à notre Commission le 12 janvier 2016. Cette précipitation a conduit l’ensemble des rapporteurs à procéder à de très nombreuses auditions sans disposer de la version définitive du projet de loi.
L’édition scientifique, qui assure la mise à disposition des résultats de la recherche auprès de la communauté des chercheurs et assure la qualité de la production scientifique par le biais d’un examen par les pairs, est indispensable à la diffusion du savoir et au progrès de la recherche, publique comme privée. Si la valeur ajoutée de l’édition scientifique est indéniable, il apparaît pourtant qu’une réflexion doit être menée sur le caractère économiquement justifié des coûts induits.
En effet, le fonctionnement du marché mondial de l’édition scientifique, contrôlé par une poignée d’éditeurs, fait aujourd’hui l’objet de critiques nourries. Sa structure oligopolistique conduit à ce que quelques entreprises seulement
– l’Anglo-Néerlandais RELX Groupe (anciennement Reed Elsevier), les Allemands Springer et Macmillan/Nature, les Américains Wiley et Thomson Reuters – dominent un marché estimé, en 2014, à 21,8 milliards d’euros (1). Ainsi, d’après les données recueillies par la direction de l’information scientifique et technique du CNRS (2), en 2014, ces quatre éditeurs possédaient 40 % du marché des revues scientifiques en valeur et publiaient 50,1 % des revues les plus prestigieuses. Leurs catalogues de revues sont sans commune mesure avec ceux des autres éditeurs : tandis qu’ils ont en moyenne 1 500 revues à leur actif, les autres éditeurs proposent, en moyenne, un peu plus de deux revues.
La concentration des éditeurs scientifiques à but lucratif intervenue au cours des quinze dernières années a conduit à une élévation continue des tarifs d’abonnement exigés des organismes de recherches et des universités, bien supérieure à l’inflation ou aux évolutions du coût de la main d’œuvre, de l’ordre de 7 % par an en moyenne depuis dix ans (3). De fait, « la présence de fonds d’investissement dans le secteur s’associe à des exigences accrues de rentabilité, de surcroît de non-réinvestissements des marges et à une certaine instabilité de l’offre » (4). Ainsi, ces grands groupes financiers, dont certains sont d’ailleurs cotés en bourse, parviennent à dégager des marges opérationnelles élevées, de l’ordre de 30 % (5).
Plusieurs éléments tendent à expliquer les prix élevés pratiqués par les grands éditeurs scientifiques, comparativement aux autres. D’une part, la place prise par les publications, notamment dans les revues à fort facteur d’impact (6), dans l’évaluation des chercheurs tend à donner une importance considérable à l’activité de publication et confère donc aux grands éditeurs, qui possèdent la plupart de ces revues, un certain pouvoir tant sur les chercheurs dont ils peuvent ainsi capter les meilleures publications, que sur la communauté scientifique, qui a besoin d’accéder à un certain nombre de revues spécifiques. Ainsi, « les taux de marge élevés déjà évoqués sont caractéristiques d’activités où la concurrence ne se fait pas sur les prix des services rendus. Cela s’explique par le phénomène d’insubstituabilité des revues l’une à l’autre, qui fait de l’édition scientifique un secteur économique à "concurrence imparfaite" : dans une discipline ou une sous-discipline donnée, une revue de qualité n’est jamais substituable à une autre » (7). Ainsi, le marché de l’édition scientifique des revues à fort facteur d’impact est inélastique au plan économique : même si les tarifs des abonnements augmentent, la communauté scientifique n’a d’autre choix que de continuer à s’abonner aux publications auxquelles elle a besoin d’accéder.
S’il est indéniable que l’édition scientifique est indispensable à la diffusion des connaissances, il apparaît toutefois que les tarifs imposés sont révélateurs de la structure insuffisamment concurrentielle de ce marché. En effet, comme le souligne avec justesse l’Académie des Sciences dans un récent rapport, « nous sommes actuellement dans une situation absurde où les chercheurs conçoivent et réalisent les travaux de laboratoire, écrivent les articles, les expertisent et finissent par acheter les articles de leurs collègues en donnant aux éditeurs des sommes très élevées à l’origine de profits considérables » (8). En ce qui concerne la recherche publique, l’État finance donc les éditeurs scientifiques à trois titres : il rémunère les chercheurs à l’origine de la publication et ceux qui participent à l’examen par les pairs – celui-ci étant généralement bénévole –, et paie à nouveau pour accéder à ces publications…
Le coût d’accès à la connaissance scientifique apparaît aujourd’hui particulièrement élevé : le CNRS consacre ainsi 24 millions d’euros par an à l’achat de ressources documentaires, tandis que ce montant est estimé, pour l’ensemble des organismes de recherche et des universités français, à plus de 100 millions d’euros par an. Les grands éditeurs scientifiques sont par ailleurs parvenus à imposer un système d’abonnement à des bouquets de revue, et non plus à des revues en particulier ; ces « big deals » se révèlent plus coûteux pour les structures publiques, sans pour autant leur être utiles, celles-ci étant généralement intéressées par un faible nombre de revues au sein des bouquets proposés.
Les éditeurs ont également tiré profit de la révolution numérique : ainsi, si une bibliothèque choisit, pour des raisons d’économies, de ne s’abonner qu’aux versions numériques des revues, « elle se prive alors de toute possibilité d’archivage : le jour où elle interrompra cet abonnement, elle perdra l’accès aux publications futures mais aussi passées. Dans ce nouvel univers numérique, on n’acquiert donc plus un exemplaire d’une revue mais un droit d’accès temporaire à un espace contrôlé par l’éditeur (…) il faut reconnaître que c’est le droit d’auteur qui donne aux éditeurs le moyen d’imposer ces nouvelles pratiques » (9).
La relation des chercheurs aux éditeurs est en effet particulièrement asymétrique. Tandis que les premiers ont besoin de publier dans des revues à comité de lecture pour faire valider leurs travaux par leurs pairs, acquérir une certaine visibilité, percevoir des financements et voir leur carrière avancer, les seconds bénéficient d’un marché captif, dans lequel les chercheurs ne disposent pas d’une réelle alternative eu égard au nombre réduit de revues à fort facteur d’impact existant dans chaque discipline.
Ainsi, le déséquilibre qui structure la relation des chercheurs aux maisons d’éditions des revues les plus prestigieuses conduit le plus souvent le chercheur à accepter de céder à l’éditeur des droits exclusifs, empêchant, dans les contrats les plus léonins, toute mise à disposition du public. Dans la plupart des cas, aucune autre possibilité contractuelle n’est laissée au chercheur : s’il refuse les conditions proposées par l’éditeur, celui-ci ne publie pas son article, même s’il a été validé par les pairs.
Par ailleurs, comme l’indique l’INSERM dans sa contribution écrite, « cette cession concerne non seulement l’article sous sa forme publiée mais également l’ensemble des "manuscrits auteur" qu’il a rédigés, depuis le premier manuscrit soumis à publication jusqu’à la dernière version, le manuscrit accepté pour publication. » (10) Ainsi, certains contrats vont même jusqu’à empêcher la mise en accès libre des versions préparatoires à une publication scientifique (cf. schéma ci-après).
ÉTAPES DE LA PUBLICATION D’UN ÉCRIT SCIENTIFIQUE
DANS UNE REVUE À COMITÉ DE LECTURE
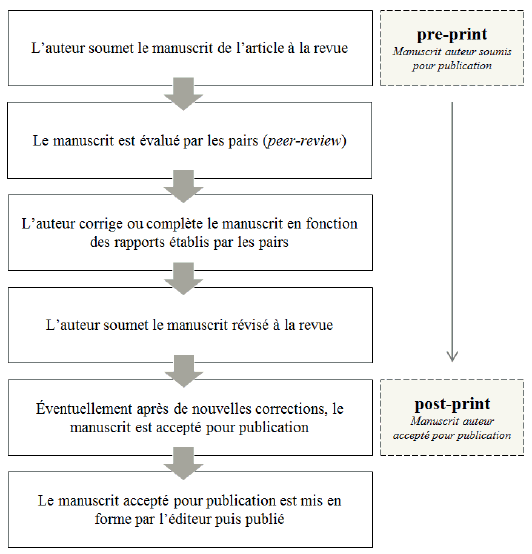
Ce transfert de propriété intellectuelle peut conduire, dans le modèle commercial décrit précédemment, à une nouvelle dépense publique. En effet, comme l’ont indiqué au rapporteur M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, et M. Denis Jérôme, membre de l’Académie des sciences, de telles cessions de droits d’auteur peuvent conduire les chercheurs à devoir racheter les droits en question pour réutiliser et exploiter les fruits de leur propre recherche, qu’il s’agisse de graphiques, de cartes ou de tableaux de données, etc.
La communauté scientifique, pour répondre aux conséquences dommageables de cette position de faiblesse, a été à l’initiative, à partir des années 1990, d’un important mouvement en faveur du libre accès aux publications, défini comme la « mise à disposition gratuite sur l’Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s’en servir de données pour un logiciel, ou s’en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l’accès et l’utilisation d’Internet » (11).
En effet, le libre accès aux publications scientifiques, quelle que soit la forme qu’il prend (cf. infra), est indispensable au progrès permanent de la recherche. En évitant les doublons et en mettant au jour les impasses, il assure une plus grande continuité aux recherches et accélère la survenue de résultats significatifs. Mais il est également fondamental pour le développement économique des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de moyens suffisants pour assurer leur documentation, mais dont l’accès à certaines publications peut stimuler l’innovation et, partant, la croissance. C’est également le cas des pays en voie de développement, dont les laboratoires sont dans l’incapacité de souscrire des abonnements coûteux, mais produisent de la connaissance et tireraient profit d’un accès plus libre aux publications d’autres communautés de chercheurs.
La plupart des grands organismes publics de recherche étrangers ont aujourd’hui développé des politiques institutionnelles en faveur du libre accès. En France, l’Agence nationale de la recherche (ANR) demande depuis 2007 « que, dans le respect des règles relatives à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et propriété industrielle), et des règles de confidentialité inhérentes à des recherches, toutes les publications consécutives aux projets financés par elle soient d’ores et déjà intégrées par les chercheurs au système d’archives ouvertes HAL avec lequel elle collaborera » (12).
Par ailleurs, depuis 2010, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) a mis en place une obligation de dépôt des publications, mais également de la littérature grise – rapport, compte rendu, etc. – produites par ses chercheurs, au sein de l’archive institutionnelle Archimer. C’est également le cas de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) qui, depuis 2013, impose le dépôt des publications de ses chercheurs au sein de l’archive HAL-INRIA. D’autres organismes de recherche, comme le CNRS et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), ont choisi la voie de l’incitation pour assurer le libre accès aux publications de leurs chercheurs.
Toutefois, ces politiques institutionnelles se heurtent le plus souvent aux clauses prévues par les contrats que les chercheurs signent avec les éditeurs les plus importants, même si, dans certaines disciplines, comme l’informatique et les mathématiques, les pratiques culturelles des chercheurs les conduisent à rendre leurs travaux accessibles à tous en dépit d’une cession exclusive des droits à l’éditeur.
Les grands éditeurs ont progressivement adapté leurs modèles commerciaux pour répondre à ces revendications. Certains permettent ainsi la mise en accès libre passé un certain délai et d’autres proposent aux chercheurs, moyennant le paiement de frais de publication (author processing charges, APC), de rendre leur article immédiatement accessible à la communauté scientifique. Toutefois, ce système, connu sous le nom de « voie dorée » ou « libre accès or » (open access gold, cf. infra), ne se substitue nullement, dans la plupart des cas (13), au système classique du « lecteur-payeur » : les organismes de recherche sont donc amenés à payer l’accès aux publications deux fois, au titre des APC puis au titre des abonnements.
3. Voie verte, voie dorée, archive ouverte, open access institutionnel : quelles alternatives au modèle du lecteur-payeur ?
Si le libre accès aux publications scientifiques fait l’objet d’un consensus, ses modalités concrètes sont cependant débattues. En effet, plusieurs modèles peuvent être explorés, chacun présentant avantages et inconvénients.
Les archives ouvertes sont apparues dans les années 1990, afin d’accueillir les versions de travail des publications ou « pre-print » (14) et de susciter, par le biais de cette mise à disposition, des réactions de la part de la communauté scientifique avant la publication de l’article au sein d’une revue à comité de lecture. C’est notamment le cas de l’archive ouverte Arxiv dans le domaine de la physique, qui a été fondée en 1991 par un laboratoire américain, et qui a, par la suite, été étendue à l’astrophysique, aux mathématiques, à l’informatique et à la biologie quantitative.
En France, le CNRS a mis en place, à partir des années 2000, une archive institutionnelle, Hyper Article en Ligne (HAL), pour accueillir les publications de ses chercheurs. Désormais accessible aux établissements d’enseignement supérieur et aux organismes de recherche, HAL assure la conservation de la mémoire de la recherche. Mais cette archive ouverte permet également la diffusion des articles publiés vers des archives ouvertes thématiques et internationales, comme Arxiv, PubMed pour les sciences du vivant ou encore Research Papers in economics (Repec) pour les sciences économiques, ce qui confère une certaine visibilité aux publications des chercheurs français. Toutefois, la part des écrits scientifiques publiés dans HAL est encore relativement faible du fait des contraintes posées par les éditeurs.
Les archives ouvertes ne disposant pas de processus d’évaluation par les pairs, elles ne sauraient se substituer à une publication dans une revue à comité de lecture. Aussi le modèle connu sous le nom de « voie verte » ou open access green, qui repose sur l’archivage des articles par le chercheur lui-même, ne saurait répondre à lui seul aux enjeux de l’information scientifique et technique et de la prise en compte des publications dans l’évolution de la carrière des chercheurs. Elle ne constitue donc qu’une voie complémentaire au système actuel de publication (cf. schéma infra). Le développement d’épi-revues pourrait toutefois remettre ce constat en cause.
Les épi-revues, de l’archive ouverte à la revue à comité de lecture
Un nouveau modèle d’open access tend à voir le jour à travers les épi-journaux ou épi-revues qui regroupent, à partir d’une archive ouverte, les articles ayant fait l’objet d’un processus d’évaluation par les pairs conduisant à une labellisation distincte de celle fournie par les revues à comité de lecture. En France, le projet Épisciences conduit par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) du CNRS a précisément pour objet d’organiser un processus d’évaluation par les pairs autonome des éditeurs scientifiques.
Une plateforme en ligne, Episciences.org, assure l’hébergement des épi-revues en accès libre. Celles-ci sont constituées d’articles issus d’archives ouvertes qui ont été soumis avec succès à un processus éditorial qui comprend la soumission des articles, la gestion des relectures par les pairs puis la publication. Dans chaque discipline, des épi-comités composés d’experts ont pour rôle de stimuler la création de nouveaux comités de rédaction et de vérifier la qualité du contenu des épi-revues. De tels projets, qui ne sont financés ni par le lecteur, ni par le payeur, nécessitent néanmoins que des moyens soient affectés à leur fonctionnement.
Un autre modèle, intitulé « voie dorée » ou open access gold, est également défendu par certains. Il repose intégralement sur le principe de l’« auteur-payeur » présenté précédemment : les auteurs s’acquittent d’APC et les articles publiés sont immédiatement accessibles, sans frais, à l’ensemble de la communauté scientifique nationale et internationale. En renversant le principe du « lecteur-payeur », ce système fait reposer les coûts de publication sur les chercheurs qui publient et leurs organismes de recherche.
C’est la seconde voie vers le libre accès identifiée par l’Initiative de Budapest pour l’accès ouvert (Budapest open access initiative, BOAI) adoptée par les tenants de l’accès ouvert en 2002 : « En second lieu, les savants ont besoin des moyens pour lancer une nouvelle génération de revues alternatives engagées dans le libre accès et pour aider les revues existantes qui choisissent d’opérer la transition vers l’accès libre. Puisque les articles de revues devraient être diffusés aussi largement que possible, ces nouveaux périodiques n’invoqueront plus le droit d’auteur pour restreindre l’accès et l’utilisation du matériel qu’ils publient. Puisque le prix constitue un obstacle à l’accès, ces nouvelles revues ne factureront pas l’abonnement ou l’accès, et se tourneront vers d’autres méthodes pour couvrir leurs frais. Il existe, pour cette fin, de nombreuses sources de financement alternatives, parmi lesquelles les institutions et les gouvernements qui financent la recherche, les universités et laboratoires qui emploient les chercheurs, les dotations allouées par discipline ou par institution, les amis de la cause du libre accès, les profits générés par la vente d’enrichissements apportés aux textes de base, les fonds libérés par la transformation ou la disparition des périodiques facturant un abonnement traditionnel ou un prix d’accès, voire les contributions des chercheurs eux-mêmes. » (15)
Toutefois, tel qu’elle est aujourd’hui utilisée par les éditeurs commerciaux, cette seconde voie ne résout pas le problème des coûts excessifs pratiqués par ces derniers pour permettre le libre accès immédiat à l’article publié. En effet, les tarifs des APC, fixés unilatéralement par les éditeurs, sont, là encore, relativement éloignés de la réalité économique, et peuvent varier de 1 000 à 7 000 euros par article selon le prestige de la revue, le coût de l’expertise par les pairs ou encore celui de la mise en forme des articles. Peu d’organismes de recherche publics seraient aujourd’hui en mesure de financer, par ce biais, le libre accès aux publications de leurs chercheurs. Par exemple, pour le CNRS, cela équivaudrait à une dépense annuelle deux fois supérieure à son budget d’abonnement actuel (16).
Des revues fonctionnant uniquement selon ce modèle ont d’ores et déjà vu le jour. Toutefois, certaines d’entre elles, qualifiées de « prédatrices », offrent des délais de publication en libre accès extrêmement rapides, sans qu’un comité de relecture soit réellement constitué pour s’assurer de la qualité de la recherche en question. Ainsi, le système « auteur-payeur » fait peser d’importants risques sur la qualité éditoriale des revues, car l’éditeur est financièrement incité à accepter la publication d’un grand nombre d’articles.
SCHÉMA RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS CIRCUITS DE PUBLICATION SCIENTIFIQUE
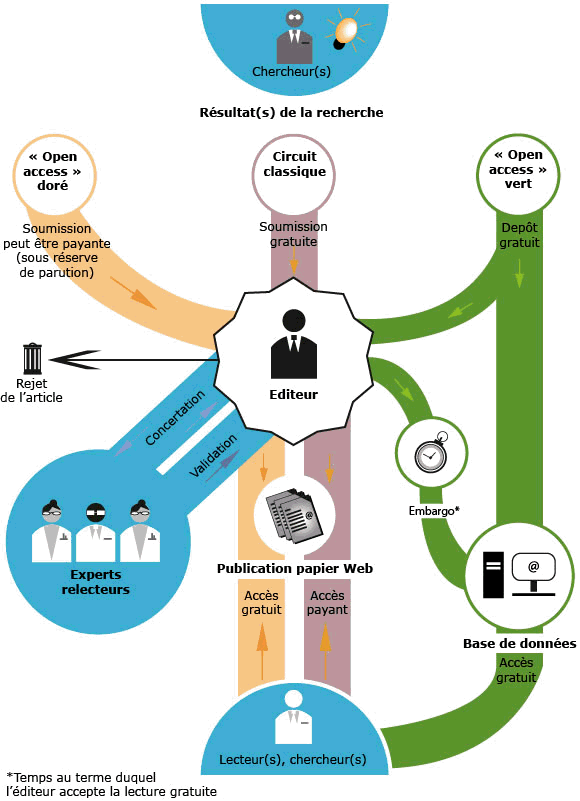
Source : Site internet de l’Open access week de l’Université d’Évry.
Pour répondre aux limites présentées par le modèle doré, l’Académie des Sciences a proposé, dans un récent rapport, d’adopter à terme un modèle de « libre accès institutionnel », reposant sur une négociation centralisée avec les grands éditeurs scientifiques. Ce modèle repose sur la conclusion d’un « contrat unique pluriannuel d’abonnement (…) négocié entre les pouvoirs publics et chaque éditeur, définissant les revues concernées, organisant la mise en accès libre immédiate sur le site de l’éditeur de tous les articles de ces revues dont l’un des auteurs appartient à l’organisme ayant conclu un abonnement négocié, en contrepartie d’un paiement forfaitaire affecté d’un coefficient de réévaluation garantissant une stabilité de revenus pour l’éditeur. L’article ainsi publié devra également être versé immédiatement par l’éditeur en archive ouverte sous sa forme éditée » (17).
Ce modèle, déjà partiellement mis en œuvre aux Pays-Bas (18) et en Allemagne (19), présente plusieurs atouts. La négociation centralisée, au niveau de la France voire de l’Union européenne, placerait les organismes de recherche dans une situation plus favorable face aux grands éditeurs, ce qui pourrait conduire à moyen terme à une réévaluation des coûts de l’information scientifique et technique, tout en assurant, à court terme, la stabilité du marché de l’édition scientifique en France. La répartition de la contribution de chaque organisme de recherche bénéficiant du contrat pourrait également tenir compte des capacités financières de chacun d’entre eux et ne limiterait pas, contrairement à la voie dorée, les publications issues de petits laboratoires. Enfin, le libre accès aux publications serait assuré tant par les archives ouvertes, avant et après la publication, que par les revues, qui continueraient d’organiser l’évaluation par les pairs.
4. Permettre la diffusion des résultats de la recherche scientifique après un délai d’exploitation exclusive : une transition nécessaire
L’article 17 du présent projet de loi constitue, dans ce contexte, un aménagement bienvenu de la situation actuelle. Il prévoit en effet de permettre aux chercheurs conduisant des activités financées au moins pour moitié par des fonds publics – issus de dotations de l’État, des collectivités, des établissements publics, de l’ANR ou encore de l’Union européenne – de mettre à disposition du public la version finale de leur article (post-print (20)), et ce même en cas de cession exclusive de leurs droits d’auteur à un éditeur. Cette mise à disposition est possible dès que l’éditeur met lui-même l’article en accès libre, ou, à défaut, après un certain délai à compter de la publication. Ainsi, au bout de six mois pour les sciences, la technique et la médecine (STM) et au bout de douze mois pour les sciences humaines et sociales (SHS), le chercheur pourra déposer son article dans une archive ouverte ou le rendre accessible par tout autre moyen. C’est donc une exclusivité seulement temporaire que le chercheur pourra concéder à l’éditeur, ce nouveau droit permettant ainsi de corriger l’asymétrie qui structure aujourd’hui les relations entre chercheurs et grands éditeurs.
En confiant un nouveau droit aux chercheurs, cet article permet ainsi d’encourager le développement de la voie verte, tout en maintenant, à moyen terme, les ressources financières des éditeurs. En effet, les délais prévus assurent aux éditeurs un temps suffisant pour tirer profit de la publication de l’article dans l’une de leurs revues. En effet, notamment dans les domaines des STM, la communauté scientifique a généralement besoin d’accéder immédiatement aux fruits de la recherche et continuera donc de financer l’achat documentaire. En revanche, dans le domaine des SHS, la durée de vie d’un article est généralement plus longue et nécessite qu’un délai d’exploitation de douze mois soit prévu pour assurer des bénéfices suffisants aux éditeurs de ces disciplines, plus atomisés que l’édition scientifique et technique. Le rapporteur s’interroge néanmoins sur l’opportunité qu’au-delà de ces délais légaux, une réflexion soit menée pour prendre en compte les spécificités de certaines disciplines ou familles de disciplines, à l’issue de laquelle, si cela s’avérait nécessaire, un texte de nature réglementaire pourrait fixer ces délais dans une limite de six mois pour les STM et de douze mois pour les SHS.
Au-delà des spécificités de chaque discipline, il importe de tenir compte de la structure du marché éditorial. En effet, si les STM sont dominées par de grands groupes étrangers, sur lesquels le dispositif n’aura que peu d’impact, il en va autrement des SHS dont l’édition est assurée, en France, par des petits éditeurs, publics et privés, qui seraient mis en difficulté, au plan économique, si la totalité de leurs publications était effectivement mise en accès libre immédiat. C’est pour leur permettre d’effectuer la transition vers le libre accès que l’étude d’impact annexée au présent projet de loi prévoit la mise en œuvre d’un plan d’aide aux éditeurs français voire francophones de revues scientifiques dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ce plan comprendra deux volets : une aide à la publication en accès libre et une aide à la traduction en langue anglaise, afin d’assurer une plus grande visibilité internationale aux publications en langue française, respectivement dotés, dès 2016, de 0,5 et 0,2 million d’euros. Le rapporteur estime que la plus grande attention devra être apportée à ce plan si l’on veut que cette transition numérique s’effectue au bénéfice de la recherche et de l’ensemble des acteurs.
Ce choix est conforme aux recommandations de l’Union européenne. En effet, le 17 juillet 2012, la Commission européenne, considérant que le libre accès améliore « les conditions dans lesquelles s’effectuent les activités de recherche en réduisant la duplication des efforts et en limitant autant que possible le temps passé à rechercher des informations et à y accéder » (21), a notamment recommandé que les États veillent « à ce que les publications issues de la recherche financée par des fonds publics soient librement accessibles dans les meilleurs délais, de préférence immédiatement et, dans tous les cas, au plus tard six mois après leur date de publication, et au plus tard douze mois pour les publications dans les domaines des sciences sociales et humaines » (22). Elle a également invité les organismes de financement de la recherche publique comme les universités et les laboratoires à élaborer des politiques institutionnelles permettant le libre accès et la diffusion des publications scientifiques. L’article 17 du présent projet de loi permettra d’encourager tant les chercheurs que les agences de financement, les universités et les organismes de recherche à poursuivre des politiques institutionnelles plus ambitieuses dans ce domaine, en levant en partie la contrainte liée à la cession des droits.
D’autres pays ont adopté des dispositions législatives similaires à celle proposée par le Gouvernement à l’article 17 du présent projet de loi. Ainsi, en 2013, l’Allemagne a introduit le droit, pour les chercheurs, de rendre librement accessibles les versions finales des contributions nées d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des ressources publiques et publiées au sein d’un périodique paraissant au moins deux fois par an, après un délai de 12 mois suivant la première publication. En Italie, la loi du 7 octobre 2013 relative à la valorisation de la culture prévoit que les chercheurs dont les recherches sont financées au moins pour moitié par des fonds publics doivent publier leurs travaux, soit dans des revues en libre accès, soit dans des archives institutionnelles ou thématiques, après un délai maximal de 18 mois pour les STM et de 24 mois pour les SHS suivant la publication.
Les États-Unis mènent également une politique active en faveur du libre accès. Ainsi, depuis l’adoption du Consolidated Appropriations Act du 17 janvier 2014, les agences ou bureaux fédéraux ayant plus de 100 millions de dollars de dépenses de recherche et développement doivent développer une politique de libre accès afin de rendre accessible, en ligne et gratuitement, les versions finales ou publiées des articles au plus tard 12 mois après la publication officielle. Par ailleurs, l’adoption du Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR) présenté en mars 2015 au Congrès prévoit une disposition similaire, obligeant les agences précitées à s’assurer que les articles résultant de leur recherche soient librement accessibles la version finale ou publiée de leur manuscrit au plus tard six mois après la publication dans une revue à comité de lecture.
Au-delà de ces dispositions, qui encouragent le développement de la voie verte, il convient de mener une réflexion plus générale sur le droit d’auteur dans le domaine de la recherche. Les évolutions en cours de la philosophie du droit d’auteur ont notamment conduit à l’apparition des licences dites « creative commons », proposées à titre gratuit par une organisation éponyme à but non lucratif fondée en 2001 par un professeur de l’École de droit de Stanford. Afin d’accompagner les pratiques de création à l’ère numérique et de faire évoluer le droit d’auteur, six licences types sont proposées :
– la licence « BY » assure une diffusion maximale des œuvres, puisque le « titulaire des droits autorise toute exploitation de l’œuvre, y compris à des fins commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, dont la distribution est également autorisée sans restriction, à condition de l’attribuer à son l’auteur en citant son nom » (23) ;
– la licence « BY ND » permet l’exploitation de l’œuvre, y compris à des fins commerciales, mais pas de créations dérivées ;
– la licence « BY NC ND » permet l’exploitation de l’œuvre à des fins autres que commerciales, mais pas de créations dérivées ;
– la licence « BY NC » permet l’exploitation de l’œuvre et la création d’œuvres dérivées sans fin commerciale ;
– la licence « BY NC SA » permet au titulaire des droits d’autoriser « l’exploitation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale » ;
– la licence « BY SA » permet l’exploitation de l’œuvre et la création d’œuvres dérivées à des fins commerciales à condition d’une distribution sous une licence identique à celle de l’œuvre originale.
Ainsi, certaines militent actuellement en faveur du recours à des licences de cette nature pour assurer la publicité des écrits scientifiques et permettre leur réutilisation par l’ensemble de la communauté scientifique.
• Le libre accès aux données de la recherche, corollaire du libre accès aux publications
Parce que la recherche se nourrit de la recherche, il est indispensable que les données issues de la recherche, lorsqu’elles ont été rendues publiques dans le cadre d’une revue ou au sein d’une archive ouverte, puissent être librement réutilisées, sans obstacle ni frais, par l’ensemble de la communauté scientifique, a fortiori par le chercheur à l’origine desdites données (cf. supra).
En effet, les données qui sous-tendent une activité de recherche – qu’il s’agisse d’« un cliché de coléoptère prélevé à Madagascar, [d’]un spectrohéliogramme produit à Meudon, des informations sur les gènes d’une moisissure, [des] relevés météorologiques d’un vaisseau ayant traversé l’Atlantique au XVIIIe siècle ou [de] l’enregistrement d’un dialecte rare » (24) –, sont souvent coûteuses à réunir. Et, lorsqu’elles sont financées par des fonds publics, leur réutilisation par d’autres acteurs, publics et privés, revêt un intérêt majeur.
Les revendications relatives à l’accès libre aux publications scientifiques sont en réalité indissociables des demandes de diffusion des données de la recherche, notamment à des fins de réutilisation. D’ailleurs, dès 2007 (25), le Conseil européen de la recherche, financeur majeur de la recherche européenne, a, d’une part, exigé que les écrits scientifiques soient versés, dans les six mois suivant leur publication, dans des archives ouvertes, et, d’autre part, indiqué qu’il était essentiel que les données primaires soient versées dans des bases de données immédiatement après la publication de la recherche pour laquelle elles ont été utilisées, et au plus tard six mois après ladite publication.
La Commission européenne s’est également saisie de ce sujet et a souligné, dans sa communication du 17 juillet 2012 précitée, que « le libre accès aux données de la recherche scientifique améliore la qualité des données, réduit le besoin de duplication des efforts de recherche, accélère le progrès scientifique et contribue à la lutte contre la fraude scientifique ». Elle a ainsi recommandé aux États membres de définir des politiques claires en matière de libre accès aux données de la recherche, notamment en veillant à ce que « les données de la recherche financée par des fonds publics deviennent accessibles, utilisables et réutilisables par le public au moyen d’infrastructures électroniques ».
• L’impact du droit d’accès aux documents administratifs sur les organismes de recherche
Le mouvement de libre accès aux données publiques (open data), s’appliquant aux organismes de recherche publics comme à toute autre administration, est a priori profitable à la circulation des données de la recherche. Le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, adopté par le Sénat le 17 décembre dernier, doit d’ores et déjà conduire à une évolution notable. En effet, alors que les établissements d’enseignement et de recherche pouvaient jusqu’à présent fixer eux-mêmes les conditions dans lesquelles leurs informations publiques étaient réutilisables (26), cette dérogation a été supprimée par le projet de loi précité.
Pour autant, cela ne signifie nullement que l’ensemble des documents des organismes de recherche puissent être communiqués et réutilisés librement. En premier lieu, les documents inachevés ne constituent pas des documents communicables au sens de la loi. Aussi les travaux de recherche, et les données associées, ne sauraient faire l’objet d’une communication en l’absence de document finalisé.
En outre, les données dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial ne peuvent être communiquées qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Or, lorsque des recherches sont susceptibles de conduire à la délivrance d’un brevet ou d’un autre titre de propriété intellectuelle, l’intéressé est l’organisme de recherche lui-même, rendant de facto le document non communicable au public (27).
En second lieu, seules les informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 (28) sont susceptibles de réutilisation ; or, les informations contenues dans des documents sur lesquels un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, de même que les documents dont la communication au public ne constitue pas un droit, sauf s’ils ont été rendus publics, ne sont pas des informations publiques au sens de la loi et, partant, ne sauraient être réutilisées. Le chercheur pouvant être considéré comme un tiers vis-à-vis de son administration, les documents qu’il produit et qui sont couverts par un droit de propriété intellectuelle – comme ses écrits scientifiques et ses bases de données –, ne peuvent donc être librement réutilisés. Il en va de même des documents qui ne sont pas communicables au public en raison d’un secret industriel et commercial.
Si, l’article 4 du présent projet de loi met en œuvre, à la charge des administrations, une obligation de diffusion des documents administratifs communiqués au titre du droit à communication fixé par la loi du 17 juillet 1978 (29),des bases de données et des données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental, cette obligation s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : les documents dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial n’y seront pas soumis. Cette disposition amènera peut-être les organismes de recherche à diffuser plus largement les données en leur possession, mais dans une mesure qui ne peut être à ce jour clairement déterminée. En tout état de cause, l’existence de droits de propriété intellectuelle détenus par les chercheurs sur certains documents administratifs fera obstacle à la réutilisation des données contenues dans les documents diffusés, nonobstant leur caractère public (cf. supra).
Ces dispositions, applicables à « l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission » (30), ne prennent donc pas en compte les spécificités du secteur de la recherche. Dès lors, il serait opportun d’encourager l’ensemble des acteurs – financeurs publics, organismes de recherche, chercheurs – à créer les conditions d’une plus grande ouverture des données de la recherche, nonobstant les dispositions générales applicables aux administrations. L’article L. 112-1 du code de la recherche, qui dispose que la recherche publique a notamment pour objectif « l’organisation de l’accès libre aux données scientifiques », pourrait ainsi trouver une traduction concrète.
• La nécessité de donner un statut aux données de la recherche pour s’assurer de leur accessibilité effective
Par ailleurs, il convient également de répondre aux pratiques récentes de certains éditeurs, qui demandent de plus en plus fréquemment aux chercheurs de leur céder leurs données de recherche à l’occasion d’une publication. En effet, comme l’indique le comité d’éthique du CNRS, « dans des disciplines comme la biologie et la médecine, (…) les éditeurs exigent des chercheurs qu’ils fournissent leur jeu de données pour vérifier la reproductibilité de l’expérience ou du processus faisant l’objet de la publication, afin de contrôler les résultats à publier en les confrontant aux données et de détecter des fraudes ou des erreurs éventuelles pouvant entraîner la rétractation. Une fois accumulées, ces données, si elles ne sont pas dans des bases publiques (…), mais restent exclusivement entre les mains des éditeurs, risquent de constituer pour les éditeurs un "marché de données" fermé et autonome par rapport aux publications, alors qu’elles n’étaient demandées que pour contrôler les résultats. » (31) Pour se prémunir de toute velléité d’appropriation, il convient de préciser dans la loi le statut de ces données.
Le II de l’article L. 533-4 que l’article 17 du projet de loi tend à introduire dans le code de la recherche pour répondre à cette nécessité assure la libre réutilisation des données issues de la recherche qui auraient été rendues publiques. Il dispose ainsi que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics sont librement réutilisables dès lors qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, sauf à ce qu’elles soient protégées par un droit ou une réglementation spécifique. Ce dispositif complète ainsi utilement les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques des administrations, limitée en présence de droits de propriété intellectuelle sur les documents administratifs (cf. supra).
Par ailleurs, le III de l’article L. 533-4 vise à permettre la réutilisation la plus large possible des données contenues dans des écrits scientifiques issus de la recherche publique, en empêchant les éditeurs de limiter la réutilisation des données « rendues publiques dans le cadre de sa publication ». Si, en théorie, les données ne sont pas protégées par le droit d’auteur – celles-ci étant, comme les idées, de libre parcours –, il convient de prévenir toute clause contractuelle ou tout dispositif technique qui aurait pour effet de gêner leur réutilisation.
En réalité, l’un des principaux enjeux du libre accès aux publications scientifiques et de la réutilisation des données réside aujourd’hui dans l’exploration automatisée de textes et de données.
• L’exploration de textes et de données : une nouvelle dimension de la recherche
La fouille de données ou data mining consiste à appliquer à des bases de données des méthodes d’extraction permettant de créer de l’information. Née dans les années 1990, cette technique a notamment été utilisée dans le domaine du marketing, pour étudier les habitudes de consommation des clients et conduire des politiques de ciblage, ou encore dans le domaine de la banque, pour identifier les clients à risque. La fouille de textes ou text mining, apparue plus récemment, en est une déclinaison. Ces techniques de production d’informations sont largement utilisées par la recherche, qu’il s’agisse de la génomique, de l’astrophysique, des mathématiques ou des sciences humaines et sociales, qui tirent ainsi profit de l’accumulation de la littérature scientifique.
D’aucuns pourraient considérer l’exploration de textes et de données comme la simple mécanisation du travail de lecture, de recherche d’informations et de mise en cohérence des données jusqu’alors opérée manuellement dans le cadre de travaux de recherche. Dès lors, le droit d’auteur ne saurait être mobilisé à l’encontre de ces pratiques, qui constitueraient une extension du « droit de lire ». Pour le collectif Savoirscom1, « il convient de démystifier la pratique du content-mining. Il s’agit avant tout d’une technologie intellectuelle (…) : un outil permettant de faciliter ou d’automatiser certaines opérations mentales. (…) Si le content-mining marque un changement d’échelle, il ne fonde pas une activité nouvelle. Extraire et synthétiser des informations préexistantes constituent le labeur quotidien du chercheur depuis que la recherche scientifique existe. » (32) Le droit d’extraire des données ne se heurte pas, aujourd’hui, au droit d’auteur lorsqu’il est opéré par le truchement d’un stylo et d’un papier, dans la mesure où les idées sont de libre parcours.
Toutefois, en pratique, ces opérations de fouilles de textes et de données, qui concernent une somme colossale d’articles, nécessitent que des copies temporaires des documents explorés soient réalisées afin de mettre en œuvre les algorithmes nécessaires. Du fait de cette reproduction, certains estiment que le droit d’auteur trouve à s’appliquer. C’est notamment le cas des grands éditeurs scientifiques. Ainsi, certains d’entre eux les encadrent par le biais des contrats qu’ils passent avec les organismes de recherche, notamment en imposant aux chercheurs de recourir à leur interface de programmation (API) pour réaliser ces explorations.
Or, ces API limitent généralement les requêtes des chercheurs, notamment pour assurer le bon fonctionnement de la base de l’éditeur. Ainsi, si l’on prend l’exemple d’Elsevier, « les requêtes à l’API sont elles-mêmes plafonnées à 10 000 articles par semaine. Pour un projet ambitieux, c’est peu. En réutilisant ce système pour analyser 3 millions d’articles, Text2Genome y aurait passé près de 300 semaines, soit 6 ans. Et en plus, il lui aurait fallu découper son corpus en rondelle, sans avoir la possibilité de faire une requête unique à l’ensemble du corpus » (33). En outre, les chercheurs ont généralement besoin de consulter les bases de plusieurs éditeurs pour mener à bien leurs projets, ce qui suppose de réaliser plusieurs démarches distinctes pour interroger chacune des bases concernées. Aussi, ce système de licences ne semble pas adapté aux projets de recherche de grande ampleur.
Qui plus est, le recours obligatoire à l’API de l’éditeur permet à ce dernier d’enregistrer le sens des requêtes effectuées par les chercheurs. Ainsi, « les éditeurs n’auront pas seulement des informations sur les projets réalisés, mais sur ceux en train de se faire » (34). C’est notamment, semble-t-il, l’intention que certains prêtent à Springer, qui demande au chercheur de remplir un formulaire détaillé pour accéder à son outil d’exploration de contenus. Or, les informations recueillies par ce biais peuvent à nouveau être sources de profit pour les éditeurs qui les vendraient, par exemple, à des sociétés privées.
• Une possibilité désormais offerte aux chercheurs dans d’autres pays
Certains pays ont d’ores et déjà réagi, au plan juridique, aux velléités des grands éditeurs de limiter l’exploration de textes et de données à leur profit. Notamment, les États-Unis ont, à travers plusieurs décisions judiciaires, reconnu la légalité des explorations automatisées de textes et de données. Notamment, la pratique développée par Google Books, qui consiste à proposer au public tout ou partie d’œuvres couvertes par le droit d’auteur, notamment à des fins d’exploration de textes et de données, a été assimilée à un usage raisonnable (fair use) non-contraire à la loi (35) eu égard à la promotion de la recherche permise par cette initiative. En permettant une nouvelle utilisation de ces ouvrages par l’exploration de contenus, la Cour a jugé que Google Books ne remplaçait pas les œuvres protégées, mais leur donnait une dimension « transformative » établissant leur usage raisonnable. Elle a également considéré que les copies numériques délivrées par Google Books aux bibliothèques partenaires relevaient également de l’usage raisonnable permis par la loi, dans la mesure où cela leur permet de créer leurs propres bases de données, de préserver les livres les plus anciens ou encore de les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap.
Plusieurs pays européens ont également entrepris de légaliser ces pratiques. C’est notamment le cas de la Grande-Bretagne, qui a adopté en 2014 une disposition permettant l’exploration de contenus à des fins de recherche à but non commercial (36). Ainsi, les chercheurs sont autorisés à copier des œuvres protégées auxquelles ils ont légalement accès dès lors que cette copie est réalisée dans le cadre exclusif d’une recherche à but non commercial et que la copie s’accompagne, autant que possible, de crédits suffisants. Tout transfert de la copie ou toute utilisation commerciale de cette dernière, s’ils n’ont pas été autorisés par le titulaire des droits, sont contraires à la loi. Un projet similaire est également à l’étude en Irlande.
• Une possible évolution du droit européen sur ce point
Au plan européen, une réforme de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est actuellement en cours et pourrait conduire à l’adoption d’une exception au droit d’auteur allant dans ce sens. En effet, à l’heure actuelle, la directive n’autorise les États à prévoir de telles exceptions que dans des cas limités. C’est le cas en matière de recherche et d’enseignement, uniquement « lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi » (37). Cette formulation n’autorise a priori pas la mise en œuvre, par les États membres, d’une exception au droit d’auteur visant les explorations de contenus opérées par les chercheurs.
La commission des affaires juridiques du Parlement européen a récemment eu à examiner le rapport de Mme Julia Reda sur la mise en œuvre de la directive de 2001, qui met notamment l’accent sur la nécessité d’autoriser les explorations automatisées de contenus, dès lors qu’un droit de lire a été acquis (38). Cependant, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen a quant à elle invité la Commission européenne à tenir compte des différentes options disponibles, en particulier des modèles de licence déjà développés dans certains États membres. À la suite du rapport présenté par Mme Julia Reda, le Parlement européen a adopté, le 9 juillet 2015, une résolution soulignant « qu’il est impératif d’évaluer avec soin la mise à disposition des techniques analytiques automatisées des textes et des données (par exemple la "fouille de textes et de données") à des fins de recherche, étant entendu que la permission de lire l’œuvre doit avoir été acquise » (39).
Enfin, la commission européenne, dans une communication du 9 décembre 2015 intitulée Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur, a indiqué qu’elle analysait les options envisageables afin de « permettre aux organismes de recherche d’intérêt public d’appliquer les techniques [d’explorations de textes et de données] aux contenus auxquels ils ont légalement accès, avec une sécurité juridique totale, à des fins de recherche scientifique ».
• La nécessité d’instaurer une exception au droit d’auteur pour libérer la recherche à l’ère numérique
La France a, en l’absence d’une exception au droit d’auteur en matière de fouilles de textes et de données, initié un projet visant à permettre l’accès des chercheurs aux collections rétrospectives de la littérature scientifique, notamment en vue d’opérer des fouilles de textes et de données. L’initiative d’excellence de l’information scientifique et technique (ISTEX), financée à hauteur de 60 millions d’euros sur trois ans, repose ainsi sur l’acquisition massive d’archives scientifiques par le biais de licences concédées par les éditeurs. Une plateforme spécifique, actuellement testée par certains établissements, hébergera l’ensemble des revues couvertes par les licences.
Par ailleurs, l’accord pluriannuel conclu entre le consortium Couperin et l’éditeur Elsevier en 2014 permet, au plan juridique, aux universités et organismes couverts par cet accord, de télécharger les articles auxquels ils ont accès, notamment pour réaliser une exploration de textes et de données, celle-ci pouvant recourir à l’API de l’éditeur.
Le caractère encore limité des possibilités offertes par ces licences tend à léser la communauté scientifique française par rapport à celles de ses homologues étrangères qui bénéficient déjà de cette faculté. Dès lors que l’exploration de fouilles de textes et de données est d’ores et déjà entrée dans les mœurs des organismes de recherche comme des éditeurs, il serait opportun de favoriser autant que possible la passation d’accords de ce type avec d’autres grands éditeurs, avant d’introduire cette possibilité en droit français si le droit de l’Union européenne devait emprunter cette voie. En tout état de cause, si une telle disposition était introduite en droit français, elle serait encadrée et reposerait, en particulier, sur la licéité de l’acquisition du contenu faisant l’objet de l’exploration. En outre, un tiers de confiance pourrait intervenir pour s’assurer que la copie réalisée à des fins d’exploration ne fait pas l’objet d’utilisation abusive.
Toutes les personnes nées en France sont inscrites au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) et se voient attribuer un numéro d’inscription au répertoire (NIR), qui est en particulier utilisé par les administrations médico-sociales. Ce numéro, qui figure sur la carte vitale, est conçu de telle façon qu’il délivre des informations à caractère personnel sur les individus : le sexe, le mois et l’année de naissance et le lieu de naissance constituent en effet les premiers chiffres qui composent le NIR.
Le caractère signifiant du NIR a conduit à ce que son utilisation soit particulièrement encadrée. En effet, l’extension de son usage à d’autres sphères fait craindre un rapprochement plus aisé des données personnelles des individus. Comme l’indique la CNIL, « ce numéro, parce qu’il est plus facile à reconstituer à partir des éléments d’état civil, parce qu’il rend plus aisées les possibilités de rapprochements de fichier et facilite la recherche et le tri des informations dans les fichiers, reste associé au risque d’une interconnexion généralisée ou d’une utilisation détournée des fichiers » (40).
Ainsi, les traitements de données à caractère personnel qui utilisent le NIR ou requièrent la consultation du RNIPP sont soumis à un régime particulier d’autorisation faisant intervenir la CNIL (41) et ne permettant l’utilisation du NIR que dans un nombre limité de cas prévus par la loi ou le règlement. C’est notamment le cas des traitements mis en œuvre par :
– les organismes de sécurité sociale, les mutuelles, les établissements qui dispensent à des assurés des prestations prises en charge par l’assurance maladie, les collectivités qui servent des prestations d’aide sociale (42) ;
– les employeurs publics ou privés, dans le cadre de leurs fichiers de paie ou de gestion du personnel, pour les opérations de déclaration, de calcul de cotisations ou de versements aux organismes de sécurité sociale (43) ;
– les administrations fiscales pour leurs traitements des données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes (44) ;
– le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour faciliter la recherche des actes d’état civil (45) ;
– l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans le cadre de son fichier relatif à la surveillance de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants (46).
Initialement cantonnée à la sphère médico-sociale, l’utilisation du NIR s’est donc répandue à d’autres administrations et personnes privées. C’est d’ailleurs pour répondre à cette évolution que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) préconisait déjà, en 1983, que les administrations se dotent de leurs propres numéros d’identification (47). Toutefois, l’extension du NIR est porteuse d’opportunités pour le monde de la recherche, eu égard aux nouveaux appariements de données qu’il rend possible.
Si l’utilisation du NIR par les organismes de recherche est possible, elle fait toutefois l’objet d’un encadrement législatif relativement contraignant, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer le rapprochement de données. En effet, en application du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, « les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques » doivent être autorisés par un décret en Conseil d’État pris après avis publié et motivé de la CNIL.
Dans les faits, il est difficile, pour les organismes de recherche, d’obtenir de leur ministre de tutelle une telle initiative. Au cours des vingt dernières années, seule l’INSEE a obtenu, en 2002, l’autorisation d’utiliser le RNIPP dans le cadre de l’enquête sur la santé et la consommation médicale (48) et d’études sur la mortalité (49). Aussi, afin de faciliter l’utilisation du NIR dans le cadre d’activités de recherche, l’article 18 du présent projet de loi soumet de tels projets à une procédure d’autorisation ne nécessitant pas de décret en Conseil d’État, sans pour autant faire une quelconque concession en matière de protection des données personnelles.
L’article 18 du projet de loi prévoit la mise en œuvre de deux procédures distinctes. La première soumet l’utilisation du NIR par le service statistique public à la déclaration auprès de la CNIL prévue à l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi, l’INSEE, ainsi que les services statistiques ministériels, pourront, dans le cadre défini par un décret en Conseil d’État, utiliser ce numéro pour l’ensemble des statistiques publiques.
Toutefois, un garde-fou est posé par l’article 18 : une opération cryptographique doit rendre le NIR non signifiant. Cela signifie, de façon concrète, que le service de l’INSEE en charge de la gestion du RNIPP – qui ne fait pas de statistique – établira tous les dix ans une clé à laquelle il aura seul accès et assurant le chiffrement du NIR en un code ne dévoilant aucune information personnelle. Il n’aura toutefois pas accès aux informations personnelles liées au NIR qui existent dans les fichiers administratifs (50). Le service statistique public aura, quant à lui, uniquement accès au code statistique non signifiant (CSNS), qui lui permettra d’apparier les données sans recourir au NIR.
Les organismes de recherche font l’objet d’une procédure distincte, puisqu’ils devront obtenir l’autorisation de la CNIL prévue à l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978, pour chaque projet de recherche utilisant le NIR. Là encore, le NIR doit faire l’objet, pour chaque projet de recherche, d’une opération de chiffrement permettant la création d’un code de recherche dédié non signifiant (CRDNS).
Un deuxième garde-fou est ici prévu : le responsable du traitement doit être distinct de celui qui délivre le CRDNS et de celui qui opère, le cas échéant, l’appariement des données à partir de ce dernier. Ainsi, le responsable du traitement et la personne qui réalise, le cas échéant, un appariement, n’ont jamais connaissance des variables identifiantes – nom, date et lieu de naissance ou NIR –, tandis que celui qui réalise le chiffrement n’accède qu’à celles-ci, sans connaissance des informations personnelles qui y sont associées (51).
Il convient également de noter que ces dispositions ne seraient pas applicables dans les cas où des données sensibles, relatives à l’origine, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle, les opinions politiques ou religieuses, ou encore le passé judiciaire des personnes, seraient en jeu. Au final, il apparaît que les précautions multiples prévues par l’article 18 justifient un allégement des procédures qui pèsent aujourd’hui sur la statistique et la recherche publiques. La mise en œuvre de ces dispositions devrait assurer la conduite de projets de recherche de première importance, notamment en matière d’évaluation des politiques publiques, en même temps qu’elle permettra de limiter la conduite d’enquêtes coûteuses rendues nécessaires par l’impossibilité d’apparier certaines données.
Le droit d’auteur est confronté, depuis l’entrée dans l’ère numérique, à une démultiplication des actes de contrefaçon. Si l’échange de fichiers ou peer-to-peer fait d’ores et déjà l’objet d’un arsenal préventif et répressif poussé, la législation n’a pas encore su intégrer les potentialités offertes par les sites dont les contenus sont générés par les utilisateurs eux-mêmes. Ainsi, des plateformes comme YouTube ou Dailymotion, initialement créées pour permettre le partage de contenus numériques privés, ou des moteurs de recherche comme Google, se sont progressivement mués en diffuseurs de contenus illicitement acquis.
Or, le droit de l’Union européenne n’a prévu, pour les prestataires « d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » (52), qu’un régime de responsabilité allégée. En effet, la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information (53), édictée pour accélérer le développement du commerce électronique en Europe, a été élaborée dans les années 1990, à une époque où les plateformes dont le fonctionnement permet aujourd’hui un piratage de grande ampleur des œuvres protégées n’existaient pas encore.
La Cour de justice de l’Union européenne a été amenée, face à l’apparition de nouveaux acteurs du stockage de données, à préciser la définition fournie par la directive. En 2010, à propos du service de référencement payant de Google, elle indique que le régime de responsabilité allégée dont bénéficient les hébergeurs s’applique « au prestataire d’un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées » (54). Ainsi, la société détenant un site internet de vente en ligne mettant à disposition des vendeurs des services d’optimisation et de promotion, qui suppose qu’elle prenne un rôle actif dans les données stockées, ne pourrait bénéficier du régime des hébergeurs pour cette activité, comme cela a par exemple été jugé pour l’entreprise eBay (55).
Des plateformes comme YouTube, Dailymotion ou Google sont ainsi considérées, au regard du droit européen, comme des hébergeurs pour leurs activités non éditorialisées. En application de l’article 14 de la directive précitée, ces hébergeurs ne doivent pas être considérés comme responsables des informations stockées, dès lors qu’ils n’ont pas connaissance du caractère illicite des activités ou des informations stockées ou qu’ils agissent promptement pour retirer ces informations ou en bloquer l’accès dès que cela est le cas.
Par ailleurs, l’article 15 de la directive précitée précise que les États membres ne doivent pas imposer aux hébergeurs une « obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». En effet, la protection de la propriété intellectuelle doit être mise en balance avec d’autres droits fondamentaux tels que la liberté de communiquer, la protection de la vie privée des destinataires de ces services et la liberté d’entreprendre des acteurs d’internet.
La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser la portée de cette interdiction. Dans un arrêt opposant la SABAM, société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, à la société Netlog, fournisseur d’un réseau social, la Cour a rappelé que l’interdiction s’étendait « notamment aux mesures nationales qui obligeraient un prestataire intermédiaire, tel qu’un prestataire de services d’hébergement, à procéder à une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle » (56). Ainsi, un juge national ne saurait enjoindre à un hébergeur de mettre en œuvre un système de filtrage généralisé visant l’ensemble du catalogue de la SABAM, s’appliquant indistinctement à tous les utilisateurs, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps.
Pour autant, la directive n’interdit pas aux États membres de permettre à une juridiction ou une autorité administrative « d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation » et « d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible » (57). La directive autorise également les États membres à instaurer, à la charge des hébergeurs, une obligation d’information sur les activités illicites alléguées des utilisateurs et de communication de leur identité (58).
La transposition de la directive précitée a été mise en œuvre, en France, par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Son article 6 prévoit ainsi, conformément à la directive, que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
La réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen de la loi précitée conduit à minorer encore la responsabilité des hébergeurs : ce n’est que si le contenu notifié est manifestement illicite ou que son retrait a été ordonné par un juge que la responsabilité de l’hébergeur peut être engagée en cas de non-retrait de l’information dénoncée comme illicite (59). Ainsi, les allégations d’atteintes à la propriété intellectuelle, en particulier au droit d’auteur, doivent être soutenues par la justification des droits en question pour que leur caractère manifestement illicite soit acquis.
Reprenant les termes de la directive, le 7 du I de l’article 6 de la loi précitée prohibe toute obligation de surveillance générale. L’interdiction de faire peser sur les hébergeurs une obligation de surveillance généralisée connaît toutefois plusieurs exceptions. Notamment, en matière d’apologie de crimes contre l’humanité, de provocation et d’apologie d’actes terroristes, d’incitation à la haine et à la violence et de pédopornographie, les hébergeurs ont l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement à l’usage des destinataires du service, d’informer les autorités des activités illicites de ces derniers et de rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Par ailleurs, il convient de noter que cette interdiction s’exerce « sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire ».
L’article 6 de la loi précitée prévoit également que la connaissance du fait litigieux, qui peut éventuellement fonder la responsabilité des hébergeurs, est acquise par le biais d’une notification comportant obligatoirement les éléments suivants : la date de la notification ; l’identité de la personne physique ou morale exerçant la notification ; l’identité du destinataire ; la « description des faits litigieux et leur localisation précise » ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, les dispositions légales afférentes et la justification des faits ; la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur du contenu demandant l’interruption de l’activité litigieuse ou la justification de ce qu’il n’a pas pu être contacté.
Ce cadre juridique soulève un problème de taille pour les titulaires du droit d’auteur et leurs ayants droit. La notification devant notamment indiquer la localisation précise du contenu illicite – soit l’adresse URL d’une vidéo par exemple –, elle ne permet de viser qu’un acte illicite à la fois. Même lorsqu’un contenu illicite est ainsi signalé à un hébergeur, celui-ci n’est nullement dans l’obligation de retirer tous les contenus identiques stockés par son entremise, ni de prévenir la réapparition de tels contenus à une autre localisation. La tâche est donc colossale pour les titulaires du droit d’auteur, dont certains confient cette tâche d’identification à des sociétés spécialisées.
Face à l’incapacité du dispositif à prévenir la réapparition perpétuelle des contenus illicites, certains juges ont eu une interprétation extensive de la loi. Notamment, dans un jugement du 19 octobre 2007 (60), le tribunal de grande instance de Paris a considéré que Google, informé du caractère illicite de la diffusion du documentaire intitulé « Tranquility Bay » après une première notification, devait mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter une nouvelle diffusion. Notamment, le juge a écarté l’argument selon lequel chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification, au motif que « si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ». De la même façon, en 2010, le tribunal de grande instance de Créteil, considérant que YouTube, bien que bénéficiant du statut d’hébergeur, était dans l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour prévenir la diffusion de contenus ayant déjà fait l’objet de notifications, a ordonné à la plateforme d’installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l’Institut national de l’audiovisuel (61).
Ce passage d’un système de notification et de retrait – notice and take down – à un système de notification et de non-réapparition – ou notice and stay down – a toutefois connu un coup d’arrêt en 2012. La Cour de cassation s’est en effet prononcée sur le bien-fondé de cette interprétation et a considéré comme contraire à la loi la décision de la cour d’appel aboutissant à soumettre les sociétés Google et Aufeminin.com, « au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps ». Ainsi, il n’est pas possible d’engager la responsabilité d’une plateforme du fait de la connaissance qu’elle aurait tiré du caractère illicite d’un contenu ayant fait l’objet d’une première notification, car cela reviendrait à lui imposer, pour prévenir toute réapparition, une obligation générale de surveillance.
La voie judiciaire n’ayant pas l’efficacité escomptée par les titulaires de droits de propriété intellectuelle, la voie de la coopération est de plus en plus privilégiée par ces derniers pour prévenir l’apparition de contenus contrefaisants. En effet, les plateformes les plus importantes, comme YouTube ou Dailymotion, disposent aujourd’hui des capacités techniques de contrôler la licéité des contenus déposés par les utilisateurs. Elles peuvent ainsi réaliser des empreintes numériques à partir des contenus notifiés ou remis par les ayants droit, qui sont ensuite utilisées pour passer au crible les contenus mis en ligne.
Le programme Content ID mis en place par YouTube permet ainsi aux titulaires de droits d’auteur qui y sont éligibles de bloquer eux-mêmes la vidéo litigieuse, d’en monétiser le contenu par le biais de publicités ou d’obtenir des statistiques sur son visionnage. La plateforme Dailymotion recourt quant à elle aux technologies développées par Audible Magic et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) pour protéger des contenus spécifiquement identifiés dans des bases de données.
Par ailleurs, des accords ont vu le jour entre certains acteurs culturels et les principales plateformes : l’INA a ainsi signé des accords avec YouTube et Dailymotion prévoyant la mise à disposition de plusieurs dizaines de milliers d’archives vidéo, en échanges d’un partage des revenus publicitaires, tandis que ces mêmes plateformes ont conclu des accords avec de nombreuses sociétés d’auteur françaises, qui fournissent un accès licite à leur catalogue en échange d’une monétisation. La coopération semble devoir être encouragée, dès lors qu’elle assure une juste rémunération aux acteurs culturels. Mais elle n’est pas accessible à tous, certains acteurs n’ayant pas un poids économique suffisant pour parvenir à des accords équitables.
Les articles 22 et 23 du projet de loi, qui imposent aux plateformes certaines obligations vis-à-vis des consommateurs, pourraient ainsi constituer le support d’une politique visant à favoriser la passation d’accords entre les plateformes et les ayants droit ou les sociétés d’auteur. En effet, les opérateurs de plateforme en ligne seraient soumis, en application de l’article 22 du présent projet de loi, à l’obligation de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur « les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet d’accéder ». Les opérateurs de plateforme en ligne devraient notamment faire apparaître « clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération par lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens et services proposés ».
Dès lors, les plateformes de vidéos et musiques en ligne seraient dans l’obligation de signaler au consommateur les contenus faisant l’objet d’un contrat avec les ayants droit ou les sociétés d’auteur, ce qui permettrait à ce dernier de s’assurer que le contenu visionné est licite. Il est en effet loisible de considérer que dès lors que de tels accords existent, le consommateur est en droit d’être informé du caractère licite du contenu auquel il a accès. Ainsi, sans obliger les plateformes à surveiller l’ensemble des contenus mis en ligne par les utilisateurs, une telle disposition permettrait aux consommateurs d’identifier, par défaut, les contenus dont la licéité n’est pas nécessairement acquise.
L’article 23 du présent projet de loi tend à soumettre les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité est particulièrement importante à des obligations supplémentaires. Notamment, ces derniers devraient élaborer et diffuser auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de loyauté, de clarté et de transparence, définir des indicateurs permettant de mesurer le respect de ces obligations et en rendre périodiquement publics les résultats. Le rapporteur estime que l’autorégulation ainsi encouragée pourrait également concerner la lutte contre les contenus illicites.
Au-delà, certaines personnes entendues par le rapporteur militent en faveur d’une notification à effet prolongée, visant ainsi à prévenir la réapparition de tous les contenus futurs illicitement mis en ligne pendant un certain délai. Dans un rapport remis en février 2014 à la ministre de la culture et de la communication sur les outils opérationnels de prévention et de lutte contre la contrefaçon en ligne, Mme Mireille Imbert-Quaretta, présidente de la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), propose la mise en œuvre d’une injonction de retrait prolongé prononcée par l’autorité administrative. Pour respecter la directive européenne sur le commerce électronique, le dispositif envisagé est particulièrement encadré :
– l’autorité n’aurait pas la faculté de se saisir elle-même : seuls les titulaires de droits sur les œuvres, leurs ayants droit ou les organismes de défense professionnelle pourraient enclencher cette procédure ;
– l’injonction ne concernerait que le contenu des sites internet, non pas les liens hypertextes renvoyant vers des contenus contrefaisants ;
– l’injonction concernerait un contenu précisément identifié et déjà notifié à l’hébergeur ;
– son application serait limitée dans le temps et sa durée, de six mois maximum, serait fixée par l’autorité administrative dans le respect du principe de proportionnalité ;
– l’injonction répondrait à une procédure contradictoire ;
– les mesures demandées par l’autorité administrative dans le cadre de cette injonction seraient fixées en tenant compte des capacités matérielles, organisationnelles et financières de l’hébergeur et ne seraient pas assorties de sanction ; l’injonction « impliquerait seulement que soient mises en œuvre les diligences raisonnables qui devraient permettre, eu égard à l’état de l’art des techniques, d’assurer un retrait prolongé de l’atteinte » (62) ;
– enfin, l’injonction ne vaudrait que pour l’avenir, les plateformes n’ayant pas à vérifier les contenus déjà en ligne.
Il est possible qu’un tel dispositif, fondé sur la proportionnalité entre, d’une part, la protection du droit d’auteur et, d’autre part, la protection de droits fondamentaux tels que la liberté d’entreprendre, respecte les termes de la directive de 2000 sur le commerce électronique ainsi que les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, l’autorité administrative n’ordonnerait pas aux hébergeurs de surveiller l’ensemble des contenus qu’ils stockent, mais de mettre en œuvre tous les moyens raisonnablement à leur disposition pour prévenir la réapparition de contenus ayant déjà fait l’objet d’une notification. Dès lors que de telles mesures ne seraient, pour les plateformes considérées, ni complexes, ni coûteuses, elles ne sauraient porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
Au final, la frontière est mince entre des dispositions qui respecteraient le droit européen et celles qui seraient contraires à la directive de 2000 sur le commerce électronique. Même si les marges de manœuvre sont aujourd’hui étroites, il importe de les exploiter autant que possible pour mieux encadrer les pratiques dommageables des plateformes dans l’attente d’une évolution du droit européen.
D. FAIRE PARTICIPER LES PLATEFORMES AU FINANCEMENT DE LA CRÉATION : LA NÉCESSITÉ D’UNE ÉVOLUTION DU CADRE EUROPÉEN
Au-delà de l’ambivalence de certaines plateformes en matière de lutte contre le piratage, le principal enjeu réside aujourd’hui dans la participation de ces dernières au financement de la création. En effet, outre le fait qu’il est difficile, si ce n’est impossible, de taxer les plateformes localisées à l’étranger à la hauteur des bénéfices dégagés à partir du territoire français, celles-ci ne sont pas non plus assujetties aux dispositions qui assurent leur participation au financement de la création et à la diversité culturelle, en particulier dans le domaine audiovisuel.
Ainsi, alors même que certaines plateformes ont développé une réelle politique éditoriale au travers de chaînes, elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, n’étant pas établies en France et n’étant pas considérées comme des éditeurs de services de télévision. De la même façon, des services de vidéos à la demande comme ceux proposés par la société Netflix, localisée aux Pays-Bas pour ses activités européennes, ne sont pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande en matière de contribution au développement d’œuvres cinématographiques européennes et en langue française et de quotas d’œuvres du même type.
Ainsi, en parallèle des inflexions souhaitées par certains États membres de l’Union européenne en matière de fiscalité – dont certaines ont abouti à la création de nouveaux impôts, comme en Grande-Bretagne, visant spécifiquement les bénéfices rapatriés par des sociétés comme Google ou Amazon –, une réflexion est actuellement conduite au niveau européen en ce qui concerne les obligations auxquelles les éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels doivent être assujettis. La Commission européenne a ainsi engagé, dès 2013, une consultation sur la directive de 2010 relative aux services de médias audiovisuels (63). Dans le cadre de cette réflexion, certains plaident notamment pour que les règles relatives au financement de la création et à la promotion de la diversité culturelle deviennent applicables aux opérateurs du net qui tirent profit du marché européen dans ce domaine et qui échappent à la directive précitée en raison de leur statut d’hébergeur ou qui bénéficient, pour son application, du principe du pays d’origine.
Ce principe, qui permet à un opérateur de s’installer dans un seul pays européen pour distribuer ses services, conduit à ce que seules les règles dudit pays lui soient applicables. Or, certains opérateurs choisissent délibérément de s’implanter dans des États membres de l’Union européenne dont les règles, notamment fiscales, sont allégées. Si les chaînes françaises, les sociétés d’auteurs et le Gouvernement sont favorables à une évolution dans ce domaine, les résultats de la consultation, qui s’est achevée récemment, sont plutôt en faveur du maintien du principe du pays d’origine.
III. FACILITER L’ORGANISATION DE COMPÉTITIONS DE JEUX VIDÉO POUR ASSURER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE DANS CE DOMAINE
Si la création de jeux vidéo constitue, depuis plusieurs décennies, un marché porteur, bénéficiant à ce titre d’un crédit d’impôt (64), les compétitions de jeux vidéo n’ont revêtu que récemment un enjeu économique réel. Le développement d’internet a conduit, à partir des années 1990, à la multiplication des jeux vidéo en réseau (65) et à l’apparition de compétitions internationales. Dès 1997, la Cyberathlete Professional League (CPL) est constituée pour accueillir des tournois de jeux vidéo, puis, en 2001, la première Coupe du monde de jeux vidéo, la World Cyber Game, est organisée à Séoul.
Depuis cette date, de nombreuses compétitions internationales ont vu le jour, telles que l’Electronic Sports World Cup, organisée par la société française Oxent depuis 2003 et réunissant des joueurs de toutes nationalités autour de jeux de sport, de jeux de combat ou encore de jeux de course. Certaines compétitions sont organisées autour d’un type de jeux en particulier, comme l’Evolution Championship Series (EVO), qui se tient aux États-Unis depuis les années 2000 autour de jeux de combat. Certains éditeurs de jeux vidéo organisent même leur propre compétition : c’est notamment le cas de l’éditeur américain Riot Games qui a mis en place, à partir de 2011, la Coupe du monde du jeu League of Legends.
Ces compétitions ont acquis une envergure, tant financière que médiatique, sans précédent. Si la première compétition organisée par la CPL était dotée d’un prix d’une valeur de 4 000 dollars, les sommes en jeu sont aujourd’hui d’une tout autre ampleur. En 2014, les joueurs ayant participé à la Coupe du monde du jeu League of Legends ont été récompensés à hauteur de deux millions de dollars, dont un million de dollars pour le vainqueur. En 2015, la Coupe du monde du jeu Dota 2 a ainsi distribué 18 millions de dollars de récompenses, dont 6,6 millions de dollars pour la première place. Outre les nombreuses équipes de joueurs qui sont mobilisées, tout au long de l’année, par les sélections et les tournois, ces événements attirent également un nombre de plus en plus important de spectateurs, qui assistent en direct à la compétition retransmise sur écran géant, et plus encore de téléspectateurs. Ainsi, la finale de l’édition de la Coupe du monde du jeu League of Legends a ainsi réuni 40 000 spectateurs et 27 millions de téléspectateurs en 2014.
Les plus grandes entreprises du monde numérique ont d’ailleurs investi le marché des compétitions de jeux vidéo multi-joueurs, comme Amazon, qui a racheté la plateforme Twitch pour 970 millions de dollars en 2014, ou YouTube et Dailymotion, qui ont créé leurs propres plateformes de diffusion en direct et à la demande de jeux vidéo et d’émissions apparentées. Les médias traditionnels sont également présents, notamment en Corée du Sud, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où des chaînes diffusent les retransmissions des compétitions à la télévision. La coupe du monde du jeu FIFA 16 a également été retransmise très récemment sur la chaîne française L’Équipe 21.
Les jeux vidéo sur lesquels reposent ces compétitions, qui ont amené certains joueurs à se professionnaliser, tendent aujourd’hui à se distinguer de la masse des jeux vidéo en ligne, qui ne comportent pas tous de caractère compétitif suffisant pour conduire à l’organisation de ce type d’événements. Ainsi, la notion de « sport électronique » ou e-sport est de plus en plus utilisée pour décrire ces jeux multi-joueurs qui opposent des équipes quasi-professionnelles autour d’un but précis à atteindre, qu’il s’agisse d’éliminer ses concurrents ou d’atteindre le premier la ligne d’arrivée, et qui laissent peu de place au hasard. Dans un sport électronique, c’est l’habileté du joueur, physique ou intellectuelle, qui préside au succès. Ainsi, les compétitions de jeux de carte en ligne ne font pas partie des sports électroniques. Au-delà, des considérations plus pragmatiques conduisent à limiter cette qualification aux jeux susceptibles d’être suivis par un spectateur virtuel, qui doit pouvoir apprécier instantanément les actions des joueurs, ainsi qu’à ceux dans lesquels les interactions entre joueurs ont une place centrale.
Les différents types de jeux vidéo relevant du sport électronique
Les compétitions de sport électronique font aujourd’hui intervenir différents types de jeux vidéo, parmi lesquels on peut distinguer :
– les jeux de course ;
– les jeux de combat ;
– les jeux de sport virtuel ;
– les FPS (first-person shooter), des jeux de tir fondés sur une vision subjective, les déplacements et les actions du joueur étant vus par les yeux du protagoniste, par opposition aux jeux où le joueur voit le protagoniste en action depuis un point de vue extérieur (third-person shooter) ;
– les jeux de stratégie : ces jeux, qui se jouent en temps réel ou tour à tour, reposent moins sur l’adresse du joueur que sur la mise en œuvre d’une tactique, généralement dans le cadre de la conquête d’un territoire ;
– les MOBA (multiplayer online battle arena) associent jeu de stratégie en temps réel et jeu de rôle ; les équipes s’affrontent ainsi sur une carte ou un champ de bataille par le biais des personnages contrôlés par les joueurs.
La revendication de « sport électronique », comme du statut de cyberathlète ou d’e-sportif, font toutefois l’objet de critiques, certains considérant comme illégitime le rapprochement entre le jeu vidéo et le sport. Pourtant, force est de constater que ces compétitions se rapprochent, à de nombreux égards, des compétitions sportives. Les tournois de jeux vidéo ont en particulier en commun avec le sport professionnel un aspect compétitif indéniable, dérivé d’une activité initialement ludique. Sur la base d’un jeu, des équipes ou des individus spécifiquement entraînés à cette fin s’affrontent pour déterminer un vainqueur. Par ailleurs, ces compétitions requièrent des qualités physiques, intellectuelles et psychiques – endurance, précision, réflexe, stratégie, etc. – proches de celles que le sport professionnel nécessite.
Au-delà, le modèle économique des compétitions de sport électronique s’inspire de celui du sport professionnel, eu égard notamment à l’importance des sponsors et des revenus générés, lors de la retransmission sur internet ou à la télévision, par la publicité. Certes, le caractère physique de l’activité est moins prégnant dans le sport électronique que dans des disciplines olympiques. Au final, le sport électronique n’est pas tant une déclinaison électronique du sport, qu’un jeu électronique qui emprunterait certaines caractéristiques de l’univers sportif.
Bien qu’aucun contentieux n’ait été signalé par les personnes entendues par le rapporteur, le cadre juridique actuel n’est pas favorable au développement de telles compétitions sur le territoire national. En effet, un risque juridique non négligeable pèse aujourd’hui sur les organisateurs de compétitions de jeux vidéo, celles-ci pouvant être assimilées des loteries, interdites par les articles L. 322-1 à L. 322-7 du code de la sécurité intérieure. Cette insécurité juridique détourne, semble-t-il, certains organisateurs étrangers du territoire français, qui lui préfèrent des pays comme la Corée et les États-Unis (66), où l’organisation des compétitions de sport électroniques est facilitée par un cadre juridique plus approprié.
En France, l’article L. 322-2 du code précité dispose ainsi que « toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants » constituent, au regard de la loi, une loterie prohibée. L’interdiction, en application de l’article L. 322-2-1, concerne également « les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur ». Ainsi, même si le hasard tient une part infime dans la loterie par rapport à l’adresse du joueur, celle-ci est prohibée dès lors que le jeu est payant et qu’il fait naître l’espérance d’un gain chez le joueur. Cette précision, introduite en 2014, visait à intégrer explicitement les jeux d’adresse ou skill games au cadre juridique applicable aux loteries.
Dès lors, les compétitions de jeux vidéo, telles qu’elles sont aujourd’hui organisées, sont susceptibles de remplir les quatre critères retenus par l’article L. 322-2 du code précité pour qualifier une loterie prohibée. Dépassant largement le cadre privé, les compétitions de jeux vidéo sont généralement accessibles à tous, même si elles peuvent exiger des épreuves de qualifications préalables pour les plus importantes d’entre elles. En outre, elles offrent généralement une récompense aux vainqueurs, qu’il s’agisse de lots ou de sommes d’argent, et exigent souvent des participants une contribution monétaire.
Par ailleurs, si les éditeurs de jeux vidéo à succès s’efforcent de réduire la part aléatoire de leurs jeux, pour récompenser l’habileté du joueur et ainsi rendre les compétitions plus attractives, le critère relatif au hasard est entendu de façon relativement large par la jurisprudence et doit donc être apprécié au cas par cas en fonction des règles de chaque jeu et de la part des variables insusceptibles d’être maîtrisées par le joueur. En tout état de cause, rares sont les sports électroniques qui ne comportent pas une part, même minime, d’aléa. Les jeux de football virtuel, par exemple, comportent généralement des algorithmes rendant plus ou moins aléatoire le succès d’un tir.
Dès lors, une application stricte des articles L. 322-1 à L. 322-7 du code de la sécurité intérieure pourrait conduire à interdire l’organisation de compétitions de jeux vidéo requérant une contribution financière des joueurs et à punir les organisateurs de telles compétitions des peines prévues par l’article L. 324-6 du même code (67). Au final, il est difficile pour les organisateurs d’apprécier si leur compétition entre effectivement dans le cadre d’une loterie prohibée ou si elle est au contraire légale.
Par ailleurs, les compétitions de jeux vidéo en ligne n’entrent pas dans le cadre des jeux en ligne autorisés en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, qui n’autorise que les paris sportifs et hippiques et les jeux de cercle, définis à l’article 14 comme les « jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains ». N’entrent aujourd’hui dans cette catégorie que les jeux de poker (68).
Pour permettre aux compétitions de sport électronique de se développer en toute légalité sur le territoire français, l’article 42 du présent projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les « mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir, par dérogation aux interdictions fixées par les articles L. 322-1 à L. 322-2-1 de ce code, le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo, tels que définis à l’article 220 terdecies II du code général des impôts ». Au titre de cet article, le jeu vidéo est défini comme « tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non ».
En s’appuyant sur cette définition, il est prévu de légaliser les compétitions de jeux vidéo, tout en les encadrant « afin d’éviter toute dérégulation des jeux de cercle électroniques et de prévenir tout risque en termes de santé publique et de lutte contre la fraude et le blanchiment », comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi. Par ailleurs, eu égard à l’âge de certains participants mineurs, des dispositifs spécifiques doivent être prévus pour assurer leur protection, notamment lorsque la compétition porte sur un jeu violent.
Pour autant, il convient également d’entamer une réflexion sur les autres problèmes juridiques soulevés par le développement des compétitions de jeux vidéo. En premier lieu, une clarification du régime fiscal auquel doivent répondre les prix remportés par les gagnants est nécessaire. De ce point de vue, les compétitions de jeux vidéo se rapprochent des compétitions de poker, qui ont suscité les mêmes interrogations. En effet, étant considérés comme des jeux de hasard, les gains issus des jeux de cercle ne doivent pas, a priori, faire l’objet d’une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu. Toutefois, depuis 2011, la doctrine fiscale a évolué sur ce point et les gains retirés par un joueur de poker professionnel doivent faire l’objet d’une imposition (69). Il en est de même si l’on considère, cette fois, les compétitions de jeux vidéo comme un sport. En l’occurrence, les sportifs professionnels qui exercent de façon indépendante, comme les boxeurs ou les coureurs cyclistes, répondent au même régime fiscal en matière d’impôt sur le revenu : celui des bénéfices non commerciaux. En tout état de cause, que l’on considère les jeux vidéo comme des jeux de hasard ou comme des sports, les gains dégagés par les joueurs ne sauraient échapper à l’impôt, dès lors que ceux-ci exercent cette activité à titre professionnel.
En deuxième lieu, les personnes entendues par le rapporteur ont souligné la nécessité de clarifier le statut des commandes informatiques effectuées par les joueurs dans le cadre de ces compétitions, et des images ainsi produites, au regard de la propriété littéraire et artistique. En effet, lorsque les images générées par les joueurs font l’objet d’une exploitation commerciale, par exemple dans le cadre d’une diffusion en flux sur une plateforme, il est loisible de considérer que les joueurs devraient bénéficier d’une rémunération ou, à tout le moins, d’une forme de reconnaissance au titre de la propriété littéraire et artistique. Sur ce point, le législateur pourrait s’inspirer des droits voisins reconnus aux artistes-interprètes : de la même façon que l’artiste-interprète bénéficie d’un droit voisin du droit d’auteur sur l’œuvre qu’il a interprétée, le joueur de jeu vidéo exécute l’œuvre d’un autre pour créer une œuvre qui lui est propre.
Une telle évolution suppose toutefois de parvenir à définir avec précision les œuvres de l’esprit susceptibles de générer un tel droit. En effet, si l’on considère que les jeux vidéo constituent à la fois des logiciels et des œuvres de nature audiovisuelle, il faut aussi faire face à l’extrême diversité des types de jeux vidéo qui existent aujourd’hui, et plus encore demain, et qui font intervenir de façon différenciée l’aspect logiciel ou l’aspect audiovisuel. Or, si des droits voisins pourraient trouver à s’appliquer dans des jeux d’aventure, extrêmement scénarisés, qui laissent une place importante à la créativité et à l’expression de la personnalité du joueur dans les actions effectuées, il n’en va pas de même de jeux de carte, par exemple. Aussi une réflexion avec les principaux acteurs du jeu vidéo doit-elle être conduite préalablement à toute évolution dans ce domaine.
Enfin, certains acteurs associatifs souhaiteraient voir le sport électronique reconnu par l’État, notamment par le biais d’un agrément du ministre chargé des sports. Le ministère des sports s’est toujours refusé, jusqu’alors, à assimiler les compétitions de jeux vidéo à des compétitions sportives, bien qu’elles disposent de caractéristiques proches (cf. supra). S’appuyant sur la définition de l’activité sportive retenue par le Conseil d’État,
– une activité tendant à la recherche de la performance physique –, l’État a donc constamment dénié le statut de fédération sportive agréée aux quelques fédérations qui existent aujourd’hui dans le domaine des compétitions de jeux vidéo, empêchant ainsi le mouvement de s’organiser et de bénéficier du cadre protecteur offert par le code du sport.
Si l’on peut comprendre les réserves émises par le ministère des sports à accueillir, en son sein, de telles fédérations, le rapporteur estime toutefois souhaitable qu’une réflexion soit amorcée sur ce point, eu égard aux bénéfices que le mouvement du sport électronique pourrait tirer, en matière d’encadrement, d’une telle reconnaissance par l’État. Il apparaît notamment indispensable, si les compétitions physiques de sport électronique devaient être rendues légales, que l’autorité administrative soit en mesure de fixer un cadre clair à l’organisation de ces compétitions, notamment eu égard aux enjeux que représentent l’intégrité des compétitions, la lutte contre le blanchiment, la protection des mineurs, la lutte contre les addictions ou encore le dopage.
La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation examine pour avis, sur le rapport de M. Emeric Bréhier, les articles 17, 18, 22, 23 et 42 du projet de loi pour une République numérique (n° 3318), lors de sa séance du mardi 12 janvier 2016.
M. le président Patrick Bloche. La commission des affaires culturelles s’est saisie pour avis des articles 17, 18, 22, 23 et 42 du projet de loi pour une République numérique, puisqu’ils comportent des dispositions qui relèvent, à divers titres, de ses compétences. Les articles 17 et 18 visent à favoriser la circulation des savoirs scientifiques en renforçant les droits des chercheurs et en donnant un statut aux données de la recherche. Les articles 22 et 23, qui traitent de l’activité des plateformes en ligne, concernent bien évidemment le monde culturel : ces nouveaux opérateurs sont porteurs de nombreux enjeux pour la diffusion des créations et des biens culturels à l’ère numérique. Enfin, l’article 42, relatif aux compétitions de jeux vidéo, relève du champ de compétence de notre commission en raison du caractère créatif de ces œuvres protégées au titre du droit d’auteur et de la proximité que de telles compétitions entretiennent avec les compétitions sportives.
Je salue tout particulièrement le travail de notre rapporteur pour avis Emeric Bréhier. Dans des délais extrêmement réduits, il a procédé à de nombreuses auditions, seul ou avec le rapporteur au fond de la commission des lois, Luc Belot. À peine plus d’un mois s’est écoulé depuis l’adoption du projet de loi en conseil des ministres, qui incluait la période des fêtes d’années. Je vous remercie d’autant plus, monsieur le rapporteur pour avis, de nous proposer quelques amendements visant à améliorer le texte sur les points qui nous intéressent directement.
Ce projet de loi, examiné dès demain par la commission des lois, qui a prévu d’y consacrer trois séances, le sera ensuite en séance publique à partir du mardi 19 janvier. Ce matin, la Conférence des présidents a souhaité repousser le terme du délai de dépôt des amendements du vendredi 15 janvier au samedi 16 janvier à treize heures.
M. Emeric Bréhier, rapporteur pour avis. À l’évidence, le numérique a bouleversé le secteur culturel et sportif, de même qu’il a bouleversé notre économie et l’exercice des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Comme l’a expliqué le Président Bloche, plusieurs articles du projet de loi concernent directement les compétences de notre commission : les articles 17 et 18 ont trait à l’édition scientifique et à la recherche ; les articles 22 et 23 portent sur les plateformes numériques ; l’article 42 est relatif aux compétitions de jeux vidéo.
L’article 17 a fait couler beaucoup d’encre – parfois virtuelle – au cours de la consultation citoyenne organisée autour du projet de loi. Nos concitoyens ont d’ailleurs eu beaucoup plus de temps que nous pour examiner le texte. Si cette consultation s’est, à l’évidence, révélée très utile, on peut regretter que si peu de temps ait été alloué au travail parlementaire. Ces délais contraints ne nous ont toutefois pas empêchés d’entendre de nombreux représentants de l’édition scientifique et de la recherche. Tous s’accordent à dire que l’article 17 présente une avancée majeure pour la connaissance scientifique. Évitons donc les faux procès : les éditeurs eux-mêmes sont acquis à l’idée qu’il convient de permettre aux chercheurs, nonobstant la cession de leurs droits à l’éditeur, de mettre à disposition du public leurs écrits scientifiques afin qu’ils puissent être lus par tous. Deux limites doivent cependant préserver l’activité d’édition scientifique : d’une part, la forme de l’écrit mis à disposition du public ne peut être celle qui a été retravaillée et publiée par l’éditeur ; d’autre part, sauf si l’éditeur y consent, la mise à disposition ne peut être effectuée avant un certain délai, pour lui laisser la possibilité d’en tirer un profit commercial.
C’est sur ce dernier point que le débat a achoppé, les éditeurs considérant qu’un délai de six mois pour les sciences, la technique et la médecine, et de douze mois pour les sciences humaines et sociales est trop court pour leur permettre de générer suffisamment de bénéfices sur l’écrit publié. À l’inverse, certains chercheurs souhaiteraient aller plus loin, et permettre que l’écrit soit mis à la disposition du public dès la publication de l’article dans une revue. En somme, le dispositif prévu par le projet de loi satisfait tout le monde dans son principe, mais personne dans ses modalités ; c’est, je crois, la preuve qu’un équilibre a été atteint !
Malgré ce débat très vif, le dispositif est porteur de nombreux progrès pour la recherche, notamment la recherche française. Celle-ci sera beaucoup plus visible par la communauté internationale des chercheurs, y compris ceux issus des pays en développement, et du monde économique. Il permet aussi d’envisager une mutation plus profonde du système mondial de l’édition scientifique : un libre accès immédiat aux articles scientifiques publiés dans les revues à comité de lecture. Ce dispositif prend le chemin de ce qu’on appelle la « voie verte », tout en incitant les acteurs de l’édition à trouver le moyen de passer rapidement à la « voie dorée » ou, en tout cas, à un modèle de négociation où les universités et les organismes de recherche paient une seule fois pour accéder aux fonds des éditeurs, pour publier en accès immédiat et pour exploiter ledit fonds par le biais de l’exploration de textes et de données (ou TDM, pour text and data mining) ou encore « droit de fouille ». C’est donc une évolution particulièrement importante que dessine cet article.
L’article 18 a soulevé moins de remarques lors des auditions que Luc Belot et moi-même avons menées, mais il est tout aussi utile aux organismes de recherche dont certaines activités peuvent nécessiter l’appariement de données distinctes par le biais du numéro d’identification qui figure sur nos cartes Vitale. Le dispositif actuel est en effet trop complexe du point de vue administratif pour être mis en œuvre, puisqu’il suppose que soit pris un décret en Conseil d’État, ce qui n’est pas à la portée de tous les organismes de recherche. Dans le dispositif proposé, du reste très protecteur des données personnelles, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pourra réaliser ces appariements après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), tandis que les organismes de recherche devront obtenir son autorisation pour chaque projet de recherche.
Les articles 22 et 23 du projet de loi sont porteurs d’évolutions très intéressantes au regard de l’enjeu juridique et économique que représente l’activité des grandes plateformes telles Google, Facebook ou YouTube. Ces acteurs bénéficient aujourd’hui, en Europe, d’une responsabilité allégée qui les place dans la même situation juridique que les hébergeurs des années 2000. Or ces plateformes sont aujourd’hui bien plus que de simples hébergeurs de contenus mis en ligne par des tiers. Facebook tend à devenir une plateforme vidéo, et YouTube une chaîne de télévision, lorsque Google diversifie massivement ses activités. Désormais, ce sont des acteurs à part entière de l’activité, notamment culturelle. Leur résonance est mondiale, le nombre de leurs utilisateurs connaît une croissance exponentielle, et leur usage est quasi inévitable. Leur niveau de responsabilité doit donc, à l’évidence, être rendu aussi conforme à la réalité de leur pouvoir économique que le permet le cadre européen actuel. Il est temps, me semble-t-il, de commencer à dessiner le statut qui sera le leur demain. Je vous proposerai d’ailleurs un amendement qui va un peu plus loin que le texte actuel en matière de contenus illicites.
Enfin, la consultation citoyenne a fait naître un nouvel article, relatif aux compétitions de jeux vidéo, parfois dites de sport électronique. Celles-ci se développent dans le monde entier, et leur poids économique est de plus en plus important. Malheureusement, il est très difficile de les organiser en France de façon parfaitement légale, puisqu’elles risquent d’être assimilées à des loteries, prohibées. Elles remplissent en effet les quatre critères qui définissent les loteries : l’offre publique, l’espérance d’un gain, la part, même infime, de hasard et le sacrifice financier exigé des joueurs. Ces compétitions ne sont pourtant pas, à mon sens, des jeux d’argent et se rapprochent parfois du sport lui-même, la recherche de la performance étant au cœur d’un certain nombre de ces jeux. L’article 42 du projet de loi a donc pour objet d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre leur organisation en toute légalité sur le territoire français. Je ne suis pas, pour ma part, opposé au principe du recours aux ordonnances – c’est souvent un moyen très utile d’avancer rapidement sur des sujets techniques. Toutefois, le Parlement me paraît en l’occurrence à même de trouver une solution satisfaisante dans le délai imparti. C’est pourquoi je vous proposerai un amendement, que je suis prêt à sous-amender pour tenir compte de remarques qu’ont formulées certains collègues et qui vont dans le sens de ce que nous avons élaboré avec Luc Belot, rapporteur de la commission des lois.
M. Michel Pouzol. Au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, je me félicite que les travaux de notre commission commencent, cette année, par l’examen du projet de loi pour une République numérique défendu par Axelle Lemaire. Pour la première fois depuis le début du quinquennat, un texte émanant de l’exécutif a en effet été en partie coconstruit avec les internautes. C’est là le symbole du souci de transparence affiché par le Gouvernement, mais aussi le témoignage d’une grande volonté de concertation. Au total, ce sont 21 330 contributeurs qui ont déposé plus de 8 500 arguments, amendements et propositions d’articles sur le site republique-numerique.fr. Cette réussite a déjà poussé le Gouvernement à enrichir son texte et j’espère que nous allons faire de même aujourd’hui avec l’esprit de consensus et l’intelligence collective qui caractérisent notre commission.
Ce texte offre à notre pays, à nos entreprises et à nos concitoyens une réelle occasion de développement, de croissance et de partage. L’objectif du Gouvernement est double : donner une longueur d’avance à la France dans le domaine du numérique, en favorisant l’ouverture des données et des connaissances, et s’appuyer sur les individus pour renforcer leur pouvoir d’agir et leurs droits dans le monde numérique.
La Commission a donc choisi de s’intéresser principalement à trois sujets : l’accès aux publications et données de la recherche scientifique publique ; l’amélioration de la transparence et les bonnes pratiques des plateformes en ligne ; le développement et l’encadrement des compétitions de jeu vidéo, qui, si elles ne sont pas sportives au sens strict du terme, ne le sont pas moins au sens philosophique.
Le monde académique produit un nombre considérable d’informations sous la forme de publications scientifiques et de données de toute nature. L’accès à ces informations constitue un enjeu à la fois scientifique, social et économique. Si le web a été créé, c’est notamment, rappelons-le, parce que les universités américaines voulaient communiquer entre elles et échanger beaucoup plus facilement leurs informations, leurs travaux et leurs recherches, et c’est là le cœur même du monde numérique. Le partage des connaissances constitue un outil indispensable à la réalisation de cette émancipation. D’autre part, comment concevoir de bâtir une société innovante sans fournir à l’économie et aux PME des opportunités nouvelles, qui fassent espérer des créations d’emplois ? Or, malgré les possibilités ouvertes par la diffusion numérique, l’accès à ces informations n’est pas toujours aisé. En effet, chaque année la quantité de données provenant de la recherche croît de 30 % et la quasi-totalité des données produites au cours des vingt dernières années ont été détruites, faute d’une réelle politique de sauvegarde.
Tout en se conformant aux recommandations de la Commission européenne relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur préservation, l’article 17 vise à favoriser la libre diffusion des résultats de la recherche publique. C’est d’une logique implacable : les données issues de la recherche, financée majoritairement sur des fonds publics, doivent être librement réutilisables, sans pour autant déroger aux principes du droit d’auteur, auquel notre commission est très attachée.
Le projet de loi s’attarde ensuite sur la réglementation des plateformes en ligne. Je tiens à souligner combien il importe de s’attaquer au sujet si épineux de la protection des données personnelles. Les dispositions de l’article 22 viennent donc renforcer, dans le code de la consommation, les obligations de ces plateformes à l’égard de leurs consommateurs, notamment en matière d’information et de circulation des données. Elles devront désormais faire apparaître clairement l’existence d’une relation contractuelle avec les personnes référencées. Le renforcement des principes de transparence et de loyauté de ces plateformes est fondamental. Je souhaite que nous puissions y travailler collectivement, en commission et à l’occasion de la séance publique.
L’article 42 porte sur un sujet assez spécifique, mais qui tient particulièrement à cœur à notre rapporteur : la réglementation des compétitions de jeu vidéo, ou e-sport. Ces compétitions diffusées à la télévision et sur internet sont en plein essor et rassemblent des milliers, voire des centaines de milliers de fans. Nées dans les années 90 aux États-Unis et en France, elles se multiplient partout dans le monde et le marché se développe considérablement. Amazon, plateforme qui ne compte pas le mécénat dans ses habitudes, l’a bien compris : au mois d’août 2014, le géant américain a racheté la société Twitch, plateforme qui diffuse les matchs en direct, pour la bagatelle de un milliard de dollars, soit 910 millions d’euros ; c’est dire le potentiel de ce marché. L’objectif est donc d’établir des règles afin d’organiser ces compétitions, en évitant toute dérégulation des jeux de cercles électroniques et en prévenant tout risque en termes de santé publique, mais aussi de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, puisque des sommes importantes circulent à l’occasion de ces compétitions.
Le travail de nos collègues, particulièrement celui d’Emeric Bréhier, permettra, j’en suis certain, de régler quelques questions que nous avons volontairement laissées de côté lors de l’examen du projet de loi relatif à la liberté de création, ce véhicule législatif étant plus adapté. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen votera ce texte de façon unanime et enthousiaste.
Mme Virginie Duby-Muller. Nous entamons enfin aujourd’hui l’examen du projet de loi pour une République numérique, annoncé depuis plus de trois ans. Le groupe Les Républicains estime qu’il y a urgence : le numérique est au cœur de notre société. Citoyens, entreprises, administrations, tous sont désormais connectés et les améliorations permises par le numérique n’ont plus à être vantées. Le numérique représente une véritable ouverture sur le monde, une innovation permanente et d’innombrables créations d’emplois. Ce texte doit aussi être fondateur d’un nouveau socle législatif pour le numérique afin d’adapter notre République à cette révolution.
Pourtant, monsieur le rapporteur pour avis, c’est, malgré son titre prometteur, un projet de loi bancal qui nous est présenté aujourd’hui. Certaines mesures vont certes dans le bon sens, notamment le renforcement des droits des consommateurs, la portabilité d’un fournisseur à un autre, le droit à l’oubli pour les mineurs, la possibilité de décider du sort de ses données après son décès et le chapitre relatif à l’économie du savoir, qui favorise la libre circulation des résultats de la recherche publique en encourageant l’accès aux résultats scientifiques et leur partage. Pourtant, il faut noter l’absence du text and data mining, droit de lire de l’ère numérique, demandé par de nombreux chercheurs et qui représente un potentiel de retombées économiques pour la France, alors même que la Commission européenne s’est fixé l’objectif de réfléchir à une directive européenne d’ici à six mois.
Cet exemple illustre parfaitement les difficultés présentées par le projet de loi. De nombreux enjeux clés sont éludés ou traités de manière incohérente au regard de la réglementation européenne, et le texte n’est finalement pas à la hauteur des enjeux. Il n’a d’ambition que dans son titre. Dans un avis très critique, où il déplore également l’insuffisance d’une étude d’impact qui n’évalue pas l’incidence de plusieurs dispositions, le Conseil d’État a d’ailleurs proposé de le renommer « projet de loi sur les droits des citoyens dans la société numérique ». Mais vous avez précisément déposé, monsieur le rapporteur pour avis, un amendement AC19 qui prévoit que les mesures prévues à l’article 17 fassent l’objet d’une étude d’impact. En découvrant cet avis du Conseil d’État, vous avez aussi décidé de supprimer ou d’édulcorer un certain nombre de propositions. Des mesures sont donc en décalage, sinon en contradiction, avec les directives et règlements européens. Des décisions franco-françaises et franco-centrées sur le numérique nuiraient pourtant à nos entreprises et feraient fuir les investisseurs. C’est pourquoi mon collègue Patrick Hetzel a déposé des amendements de suppression des articles 22 et 23. Aujourd’hui, c’est, au minimum, à l’échelle européenne que doit s’engager une réflexion sur de nouvelles obligations, aussi pertinentes puissent-elles être. Anticiper les résultats de travaux en cours serait simplement contre-productif.
J’appelle aussi votre attention, monsieur le rapporteur, sur les dangers de votre amendement AC21 rectifié à l’article 42. Définissant le jeu vidéo comme « un support physique ou en ligne, s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées », votre amendement nous expose à un bouleversement du système des jeux en ligne. Rien n’empêchera un opérateur de jeux d’argent de scénariser du casino en ligne, du poker en ligne, du loto en ligne, en les faisant sortir de la régulation, puisque c’est l’objet du III de votre amendement. Par ailleurs, les professionnels du secteur comprennent mal le choix du ministre de la jeunesse comme autorité habilitée à délivrer l’agrément. Pourquoi pas, plutôt, le ministère de l’intérieur ou du budget, pour la partie physique, et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ? Il s’agit en effet de disposer des moyens et des compétences pour assurer la fiabilité et la transparence des compétitions, prévenir les activités frauduleuses ou criminelles et les atteintes à la santé publique, en l’espèce l’addiction et le jeu pathologique. Nous vous alertons sur ce point et nous agirons en séance publique. Si votre amendement est adopté, nous serons vigilants, le cas échéant, en amendant.
Ce texte ne signe pas le « grand soir » du numérique. Nous avons besoin d’un texte global qui appréhende les multiples enjeux du numérique : le secteur est diversifié et affecte tous les pans de notre société. À la place, on nous soumet une kyrielle de textes et un patchwork de mesures. Après le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public de Clotilde Valter et avant le projet de loi Macron II sur les nouvelles opportunités économiques, nous avons désormais ce texte, et cet empilement de mesures. Ainsi, l’article 22 introduit un nouvel article dans le code de la consommation, après celui créé par la loi Hamon.
Le calendrier d’examen du texte étant très serré, les auditions ont été menées de manière précipitée, alors même que la version définitive du projet de loi n’était pas disponible. Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur la stratégie numérique du Gouvernement. Espérons que les débats permettront d’étoffer et de renforcer le texte : c’est indispensable pour consolider notre République numérique.
Mme Gilda Hobert. Le présent projet de loi, qui apporte des réponses juridiques dans un domaine en constante mutation, est un bel exemple de création participative. Dans votre projet d’avis, monsieur Bréhier, vous mettez justement l’accent à la fois sur la protection des données et des droits et sur la promotion de la liberté d’accès. Vous pointez la difficulté de leur mise en pratique au travers de l’étude de l’article 17. Le monde académique subit en effet, à certains égards, la révolution numérique – je dis « subit », car, devant un marché de l’édition scientifique qui était estimé en 2014 à 21,8 milliards d’euros, et à côté d’éditeurs au poids plus qu’important, il fallait agir, mais vous écrivez que les éditeurs semblent plutôt favorables à une évolution, ce dont on ne peut que se réjouir.
Le projet de loi vise précisément à trouver un équilibre. Votre projet d’avis est éclairant sur ce qui pourra à terme protéger les chercheurs et permettre une meilleure diffusion du savoir académique. Il est en effet bien étrange de voir un chercheur payer à la fois pour que son article soit édité et pour le consulter, et sans disposer d’aucun moyen de pression. L’universitaire doit publier, c’est l’objectif de son travail : il recherche donc les éditeurs les plus prisés, lesquels se trouvent de facto dans une situation très favorable et voient leurs marges de manœuvre s’accroître. Quant au libre accès total, on en voit les limites : aucune évaluation par les pairs et aucune forme de rentabilité de l’article. Cela ne semble souhaitable pour aucune des parties. Je souscris donc aux propositions faites, en particulier sur le modèle de libre accès institutionnel, qui permet d’accorder une place plus importante aux pouvoirs publics, garants de la bonne utilisation des ressources académiques.
L’article 17, qui prévoit la gratuité des articles financés principalement sur fonds publics, me paraît tout à fait opportun. Le délai de six mois pour les sciences, la technique et la médecine, et de douze mois pour les sciences humaines et sociales peut répondre à une logique de retour sur investissement. Cette différence de délai ne risque-t-elle pas, cependant, de les mettre parfois en concurrence ?
En ce qui concerne les plateformes en ligne, les GAFA (Google-Apple-Facebook-Amazon) occupent une place centrale. Il ne faudrait pas que leur monopole asphyxie d’autres forces vives, moins puissantes et moins bien armées, mais indispensables à la diversité et à la liberté qui est l’apanage du numérique. Ainsi, la loi sera le garant de l’équité et remédiera en particulier aux faiblesses juridiques dont ils se saisissent trop souvent. Point positif, on constate que nos entreprises audiovisuelles commencent à tirer parti de la révolution numérique. Je pense particulièrement à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) qui a notamment signé des accords avec YouTube et Dailymotion, mais il s’agit là d’une instance reconnue et solide. Comment, selon vous, pourrait-on soutenir, dans leur passage au numérique, celles qui sont plus nouvelles, plus fragiles ?
Quant à l’article 42, il prévoit d’adapter le cadre juridique afin de faciliter l’organisation des compétitions de jeux vidéo, tout en les encadrant. Certes, le jeu vidéo est, à l’image du numérique, en pleine expansion, et génère des profits exponentiels : de véritables compétitions émergent. Aussi cet article semblait-il s’imposer, mais, en dépit du caractère de compétition de jeux dont les participants sont de tous âges, cette activité ne me paraît pas pouvoir être assimilée à un sport, et le terme e-sport ne me paraît pas non plus très adapté. On ne peut mettre sur le même plan un athlète qui allie la recherche de la performance technique et physique à un mental solide, qui repousse sans cesse ses limites, et des joueurs qui, au-delà de réels atouts de stratégie, de technicité, de vélocité, ne répondent pas aux mêmes exigences.
Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste se prononcera en faveur de ce texte.
M. Jean-Pierre Allossery. La mesure la plus soutenue dans les consultations qui ont accompagné la construction du projet de loi est l’organisation de compétitions de jeux vidéo. Vous le signalez dans votre projet d’avis, monsieur Bréhier, ces compétitions ont acquis une envergure financière et médiatique sans précédent. Cependant, inadapté à leur organisation, le cadre juridique en vigueur est loin d’être favorable à leur développement sur le territoire national. Aussi l’article 42 a-t-il pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo pour en permettre l’organisation. Il me semble cependant important d’attendre les conclusions de la mission parlementaire qui travaille sur un cadre juridique précis pour ce type d’activité : elles doivent être publiées au mois de mars.
Dans le même esprit, je suis également réservé sur l’amendement substituant à l’habilitation à légiférer par ordonnance un régime d’agrément délivré par le ministre chargé de la jeunesse. Non seulement ce type d’activité ne concerne pas que les jeunes, mais il y aurait là un symbole regrettable, alors même que ce ministère mène des actions de fond pour lutter contre les addictions au jeu vidéo. Enfin, en fonction de quels critères précis le ministère pourrait-il délivrer l’agrément, alors que les conclusions de la mission parlementaire n’ont pas été rendues ? Je comprends votre amendement, monsieur le rapporteur pour avis, mais soyons patients et vigilants jusqu’au mois de mars prochain, et permettons au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin de définir le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo.
M. Christian Paul. Je me réjouis, comme Michel Pouzol, que le début de cette année nous permette d’examiner ce texte : c’est un agenda parlementaire optimiste et positif, à condition que nous sachions, bien sûr, enrichir ce texte avant de l’adopter. Vous l’avez tous dit avant moi, chers collègues : la révolution numérique, c’est l’occasion de progrès considérables. Un certain nombre sont inscrits dans ce texte, et je ne parlerai, ici, que des dispositions dont notre commission s’est saisie.
Je relève deux progrès très importants : l’ouverture, dans de meilleures conditions, de l’accès aux travaux scientifiques et l’inscription dans notre droit d’un principe de régulation qui a émergé au cours des deux ou trois dernières années, celui de la loyauté des plateformes. S’il a émergé, c’est bien parce qu’il y avait des interrogations très fortes sur les moteurs de recherche, notamment Google, et sur les pratiques d’autres grandes plateformes, telles que Facebook ou Twitter. On note là des progrès considérables. Mesurons la portée historique du texte : c’est, n’en doutons pas, la grande loi numérique de la législature. L’histoire ne repassera pas les plats de sitôt. N’évitons donc pas les sujets importants, ne nous arrêtons pas aux premiers obstacles.
Attachée aux libertés numériques et, plus généralement, à l’accès libre à la culture, attachée également à la protection des auteurs, notre commission doit porter son attention sur trois sujets, non simplement en amendant le texte, mais en lui apportant une substance nouvelle. Le premier, essentiel, c’est la possibilité de reconnaître en droit positif les biens communs informationnels. Manquer à cet impératif serait extrêmement dommageable au texte et aux parlementaires de la majorité comme de l’opposition. C’est un sujet sur lequel nous pouvons peut-être converger, au prix d’un travail collectif que la brièveté des délais ne nous a pas permis d’avoir jusqu’à présent.
Le deuxième sujet concerne l’exploration des données à des fins scientifiques, ou data mining. C’est un domaine où il faudrait aussi prendre position.
Le troisième sujet se situe à la rencontre de la propriété intellectuelle et des libertés : c’est l’exception de panorama, que nous connaissons bien, avec Patrick Bloche, puisque l’Assemblée en débattait déjà il y a une dizaine d’années. J’espère que les esprits ont mûri et que nous pourrons marquer des points à l’occasion de ce débat.
Ce texte comporte de très bonnes choses, qu’il nous faut approfondir et enrichir, et d’autres pour lesquelles l’imagination et la capacité d’action du Parlement sont fortement requises.
M. le rapporteur pour avis. J’entends les remarques et je ne doute pas que nous saurons trouver un chemin commun. Il n’est cependant pas interdit au Parlement de proposer des éléments allant parfois plus loin que le texte du Gouvernement. Celui-ci nous indiquera dans l’hémicycle s’il est d’accord ou non avec les amendements que nous pourrions adopter ce soir ou qui pourraient être proposés dans l’hémicycle, mais, à ce stade, aucun représentant de l’exécutif ne participe à nos travaux et nous ne sommes pas ici pour porter un jugement sur la stratégie numérique du Gouvernement, mais pour amender son texte. Mon rôle n’est pas de défendre la stratégie du numérique qu’il a mise en place. Nous sommes ici pour faire la loi, et donc pour porter un jugement sur l’ensemble des articles dont notre commission s’est saisie.
Si je suis très heureux de savoir qu’une mission, enfin, a été confiée par le Gouvernement à certains de nos collègues, dont un membre de notre commission, à propos de l’organisation des compétitions de jeux vidéo, nous ne sommes pas obligés d’en attendre les conclusions pour proposer des solutions. Ayons même la faiblesse de penser que les propositions issues de nos travaux pourraient amener cette mission parlementaire à envisager certaines pistes. Nous aurions alors vraiment fait œuvre utile.
Article 17
(art. L. 533-4 [nouveau] du code de la recherche)
Accès au travaux de recherche financés sur fonds publics
La Commission a apporté cinq modifications à l’article 17 :
– la première précise que la mise à disposition des écrits scientifiques doit se faire dans un format ouvert ;
– la deuxième dispose que le droit offert aux chercheurs concerne toutes les versions successives de leur manuscrit, jusqu’à la version finale acceptée pour publication ;
– la troisième a pour objet de permettre au ministre chargé de la recherche de fixer, par arrêté, des délais inférieurs à six mois pour les STM et douze mois pour les SHS, pour certaines disciplines ou familles de disciplines ;
– la quatrième précise la portée de l’interdiction d’exploitation commerciale prévue à l’alinéa 3 ;
– enfin, le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport évaluant les effets de l’article 17 sur l’édition scientifique, la diffusion de la science et la visibilité de la recherche française.
*
La Commission examine l’amendement AC6 de Mme Isabelle Attard.
Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à garantir que les publications nées d’une recherche financée principalement sur fonds publics rendues gratuitement accessibles le seront en format ouvert afin qu’elles soient réellement accessibles à tous. Le format ouvert se comprend au sens de l’article 4 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision rédactionnelle AC22 du rapporteur pour avis.
Elle en vient ensuite à l’amendement AC7 de Mme Isabelle Attard
Mme Michèle Bonneton. Il s’agit de supprimer la distinction faite entre, d’une part, les sciences, la technique et la médecine, et, d’autre part, les sciences humaines et sociales, pour que le délai de six mois s’applique dans tous les cas. Faire la distinction pourrait d’ailleurs être très difficile dans le cas de recherches pluridisciplinaires auxquelles s’appliquent des délais différents, et cela pourrait mettre ces disciplines en concurrence.
M. le rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement, pour des raisons assez simples. Le marché des revues des STM (sciences, technique, médecine) et celui des SHS (sciences humaines et sociales) sont extrêmement différents. Celui des STM est assez concentré, entre quelques grandes sociétés, le second est très éparpillé et rassemble des structures de petite ou moyenne taille. Il est donc nécessaire de prévoir des délais distincts pour ces deux grandes catégories ; c’était le cas dans la version du texte qui précédait la consultation citoyenne, qui prévoyait des délais de douze et vingt-quatre mois – mais je suis favorable à des délais plus courts. Maintenons donc deux délais distincts.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AC17 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il est apparu, au cours des auditions, que des durées inférieures aux délais inscrits dans le texte pouvaient être prévues pour certaines disciplines, à l’intérieur de ces deux grandes catégories que sont les STM et les SHS, et ce en raison de leur culture propre ou de l’avancée plus rapide des pratiques d’accès ouvert. Je pense, par exemple, à l’informatique. Aussi, il m’a semblé opportun de permettre au ministre chargé de la recherche de fixer des délais inférieurs pour certaines disciplines ou familles de disciplines. Les délais fixés par la loi seraient alors des délais par défaut pour les disciplines qui ne seraient pas couvertes par cet arrêté. L’amendement vise donc à permettre un peu de souplesse.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en arrive à l’amendement AC18 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. La formulation actuelle de l’alinéa 3, qui interdit l’exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial, me paraît être une source importante de contentieux. Par ailleurs, il ne faudrait pas que certains acteurs puissent tirer profit de cette restriction aux activités d’édition pour exploiter commercialement l’article 17 du projet de loi, quand les éditeurs ne pourraient pas, eux, le faire. Pour éviter cette distorsion, je propose donc de viser toutes les activités commerciales, quelle que soit leur nature. C’est bien le but recherché par cet alinéa : que personne ne puisse exploiter les écrits mis à disposition du public par les chercheurs. L’amendement élargit donc la portée de l’alinéa.
La Commission adopte l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement AC19 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement prend en compte les inquiétudes d’un certain nombre de représentants de l’édition en demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de trois ans, un rapport évaluant les conséquences – négatives ou positives – des dispositions de ce texte sur le milieu de l’édition. Ce rapport permettra également de déterminer s’il convient de renforcer le plan de soutien dont le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche discute actuellement avec les éditeurs dans leur grande diversité.
M. Benoist Apparu. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais la doctrine de cette commission n’est-elle pas de ne pas demander de rapports ?
M. le président Patrick Bloche. Je plaide coupable : nous en demandons régulièrement. C’est la commission des Lois qui n’en réclame jamais, mais nous ne sommes pas la commission des lois. Il s’agirait en l’occurrence d’un rapport très classique, comme on en rédige un très grand nombre chaque année.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 modifié.
La Commission examine les amendements identiques AC11 rectifié de Mme Isabelle Attard et AC16 rectifié de M. Christian Paul.
Mme Isabelle Attard. L’amendement AC11 rectifié porte sur le data mining, la fouille automatique de données, qui permet de découvrir des résultats inaccessibles par une méthode manuelle. Cette technique permet par exemple de trouver les occurrences d’un mot dans un corpus, mais elle n’est pas réservée à la linguistique.
Un chercheur doit pouvoir y recourir. Or les contrats des maisons d’édition limitent aujourd’hui la possibilité d’effectuer de telles recherches. Interdisons cette déviance et autorisons systématiquement la fouille automatique pour les besoins de la recherche publique, évidemment à l’exclusion de toute finalité commerciale. Quand on parle d’efficacité et de numérique, les éditeurs ne doivent pas imposer leurs règles et empêcher cette recherche automatique.
M. Christian Paul. Je souscris tout à fait aux propos que vient de tenir Mme Attard. Aujourd’hui, les travaux de la recherche publique – mais cela vaut aussi pour la recherche privée – sont amenés à traiter des masses de données considérables, au moyen d’algorithmes. Avec cette notion de data mining dont on parle depuis quelques années, il s’agit de pouvoir faire de l’exploration de données, de textes, à des fins scientifiques. Si, depuis 2001, quelques exceptions à la règle de l’interdiction de l’exploration de données, pour des raisons qui tiennent à la propriété intellectuelle, ont été mises en place, elles n’en sont pas moins très limitées, relevant du droit de citation ou de l’utilisation très éphémère de ces données. Nous sommes nombreux à souhaiter qu’un pas supplémentaire soit franchi avec cet amendement qui vise à permettre des copies ou des reproductions numériques à partir d’une source licite, ou bien des copies ou reproductions numériques des bases réalisées dans cette finalité d’exploration des données. D’autres pays européens ont pris une avance considérable, de même que les États-Unis. Aujourd’hui, la frilosité de notre droit empêche notre recherche publique de disposer des mêmes armes que dans d’autres pays.
M. le rapporteur pour avis. Je suis plutôt favorable à ce que j’appellerai le droit de fouille, qui relève du travail habituel de l’universitaire et du chercheur. Toutefois, j’émettrai un avis défavorable à ces amendements identiques, contraires au droit européen. La directive concernée ne prévoit en effet qu’un nombre limité d’exceptions, parmi lesquelles ne figure pas celle que vous envisagez. Évidemment, Mme Attard a raison : en France, le droit de fouille est relativement limité, en nombre d’occurrences, par les contrats passés avec les éditeurs. C’est moins le cas dans le dernier contrat passé par un grand éditeur avec un autre pays européen, les Pays-Bas, il y a quelques semaines.
Cela dit, le droit européen pourrait évoluer à brève échéance, la Commission européenne ayant récemment indiqué qu’elle cherchait précisément un moyen d’inclure cette exception dans le cadre de la révision de la directive « Droit d’auteur ». Il me paraît donc plus raisonnable d’attendre avant d’adopter un dispositif en France ; sinon, nous risquons de devoir le modifier très prochainement. Aussi suis-je défavorable à ces amendements.
Mme Isabelle Attard. Appelons un chat un chat et donnons les noms des maisons d’édition dont les pratiques ne sont pas forcément normales. Les Pays-Bas ont cassé leur contrat avec Elsevier, à qui la France a donné 172 millions d’euros en cinq ans, ce qui crée un rapport de force complètement différent. Cette maison d’édition a dû mettre de l’eau dans son vin, modifiant ses contrats et sa façon de traiter les scientifiques, quels qu’ils soient. Je comprends la préoccupation exprimée par M. le rapporteur pour avis : il ne s’agit pas de prendre des dispositions contraires au droit européen, mais nous pouvons être en avance. En tout cas, la recherche ne saurait être entravée par la volonté de quelques maisons d’édition d’avoir la main sur les contenus scientifiques. Ce n’est pas acceptable.
L’amendement AC11 rectifié est retiré.
M. Christian Paul. Comment ne pas suivre l’exemple d’Isabelle Attard ? Je suis cependant un peu moins prompt à retirer cet amendement, que nous redéposerons peut-être en vue de la séance plénière, dans une rédaction plus compatible avec le droit européen. Ce ne serait pas la première fois que notre pays inspire la législation européenne. Ainsi, au début de l’année 2014, sur une question fiscale, nous avons pris des positions très courageuses, dont j’espère qu’elles inspireront très vite la législation européenne. En l’occurrence, il s’agit non de fiscalité, mais de propriété intellectuelle, et la question est importante non seulement pour les ayants droit, mais aussi pour ceux qui ont besoin de recourir à ces techniques d’exploration de données. Je veux bien qu’on prolonge la réflexion quelques jours, mais que ce soit avec le souci de faire progresser notre droit à l’occasion de l’examen du texte dans l’hémicycle.
L’amendement AC16 rectifié est retiré.
Article 18
(art. 22, 25 et 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)
Procédure d’accès à certaines données publiques à des fins statistiques par l’intermédiaire du numéro d’inscription au répertoire (NIR)
La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.
Article additionnel après l’article 18
(art. L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle)
Exception de panorama
La Commission a adopté, contre l’avis du rapporteur, deux amendements identiques introduisant une nouvelle exception au droit d’auteur relative à la reproduction et à la représentation des œuvres architecturales et des sculptures placées en permanence dans des extérieurs publics.
*
La Commission examine les amendements identiques AC10 rectifié de Mme isabelle Attard et AC15 de M. Christian Paul
Mme Isabelle Attard. On discute de la liberté de panorama dans toute l’Union européenne. Des touristes qui se prennent en photo devant le viaduc de Millau, par exemple, ne peuvent pas publier leurs photos de vacances en raison d’un droit d’auteur sur le viaduc de Millau, mais ce n’est pas le seul ouvrage dans ce cas.
Il s’agit d’accorder une exception au droit d’auteur en vertu de laquelle il serait permis de reproduire et de diffuser l’image d’œuvres protégées se trouvant dans l’espace public, notamment les œuvres d’architecture et de sculpture. C’est là l’une des exceptions optionnelles prévues par la directive européenne 2001/29/CE relative au droit d’auteur. Nombre de nos voisins européens ont fait le choix d’appliquer cette exception, et l’opinion publique est unanime : prendre des photos dans l’espace public devrait être une liberté pleine et entière. Celui qui choisit de construire un bâtiment dans l’espace public ne devrait pas pouvoir privatiser la vue de tous au nom du droit d’auteur. La liberté de panorama aurait en outre des retombées économiques pour le tourisme en France, et pour les artistes eux-mêmes à travers l’obtention de nouvelles commandes. La reproduction photographique des œuvres en milliers ou en millions d’exemplaires représente effectivement une publicité considérable dont personne ne se plaint, à part, peut-être, quelques-uns.
M. Christian Paul. À l’Assemblée nationale, nous débattons de la question depuis une dizaine d’années. Prenons donc une décision d’intérêt général et adoptons ces amendements identiques. Il ne s’agit pas de choisir l’intérêt des photographes contre celui des architectes. Nous voulons trouver une solution équilibrée, qui permette de ne pas privatiser l’espace public. Aujourd’hui, c’est vrai, des créations architecturales, artistiques, ne devraient pas pouvoir être totalement privatisées quand il s’agit de les reproduire. Cette liberté de panorama est aussi une exception prévue par la directive de 2001. La rédaction des amendements identiques précédents doit peut-être être améliorée, mais, ici, l’exception est prévue, même si la France n’y a pas consenti. Franchissons donc ce pas. Seule une minorité de pays européens ne l’a pas fait. Ce serait vraiment un progrès d’intérêt général que de reconnaître la liberté de panorama à l’occasion de l’examen de ce texte.
M. le rapporteur pour avis. Je n’ai connaissance d’aucun procès qui aurait été intenté à un touriste ayant publié ses photos de vacances sur un réseau social. Cela dit, la situation particulière des œuvres architecturales et des sculptures dans l’espace public ne justifie pas, à mes yeux, que l’on cesse de rémunérer les artistes et les architectes pour leurs œuvres. Car il s’agirait bien de permettre à certains acteurs, notamment sur internet, et pas simplement des vacanciers, de reproduire sans autorisation et de tirer profit sans frais de toutes les œuvres qu’ils souhaitent. Vous prétendez que cette exception favoriserait la diffusion des œuvres : j’avoue mon scepticisme. Un certain nombre de ces plateformes, notamment YouTube et Dailymotion, ont passé des accords avec les sociétés d’auteurs pour assurer la juste rémunération des artistes. Je ne vois pas pourquoi d’autres acteurs – Wikipedia, si Mme Attard veut appeler un chat un chat – ne pourraient pas faire de même. Par ailleurs, rien n’empêche le titulaire du droit d’auteur de permettre la reproduction de son œuvre à titre gratuit. Certains grands architectes le font, précisément pour faire connaître leur travail. J’aurais donc tendance à vouloir laisser aux artistes la liberté de choisir la façon dont leurs œuvres pourraient être au mieux médiatisées. Quant à l’argument selon lequel une telle exception permettrait l’accès à la culture, il oublie que ces œuvres, qui se situent précisément dans l’espace public, sont librement accessibles à tous.
De surcroît, il n’y a pas, en matière d’architecture et de sculpture, d’industrie forte pour soutenir les artistes. En particulier, la rémunération des plasticiens est constituée d’une myriade de petits revenus liés au droit d’auteur qu’il importe absolument de préserver. La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) répartit ainsi 27 millions d’euros chaque année, pour les œuvres d’environ 10 000 artistes, dont 69 % de plasticiens. Les sommes en jeu ne sont donc pas négligeables pour ces artistes. Aussi, prévoir une telle exception sans compensation pour les auteurs me semble particulièrement préjudiciable.
Enfin, monsieur Paul, la France ne présente pas de singularités qu’en cette matière, et ce n’est pas si choquant.
Mme Isabelle Attard. Les propos du rapporteur pour avis ne sont pas tout à fait exacts. C’est bien le droit d’auteur qui a récemment été invoqué pour faire retirer une photo de la petite sirène de Copenhague d’un réseau social.
Ensuite, on parle du droit d’auteur pour les plasticiens et les architectes, mais cela représente bien peu par rapport à l’avantage de nouvelles commandes suscitées par une popularité grandissante et une présence partout sur les réseaux sociaux et sur le net. Il faudrait pouvoir disposer d’éléments tangibles avant de s’opposer à ce genre de diffusion et d’entraver la mise à disposition sur un réseau social.
En outre, Wikipedia n’utilise que des images libres de droits, pour que les contenus ainsi diffusés puissent être librement réutilisés. Wikipedia ne gagne pas d’argent sur les photos des œuvres d’architectes.
Quant à la liberté laissée aux artistes de mettre à disposition leurs œuvres dans le domaine public, elle n’existe pas ! La législation française ne prévoit pas la possibilité de mettre de manière volontaire ces œuvres dans le domaine public, et c’est précisément l’objet d’autres amendements.
M. Christian Paul. Nous prolongerons évidemment ce débat dans l’hémicycle, mais je souscris à ce qui vient d’être dit à propos de Wikipedia. On n’imagine pas Wikipedia négocier avec la tour Eiffel ou avec le Centre Pompidou la reproduction de ces édifices. C’est tout à fait contradictoire avec l’idée d’apport volontaire de textes et d’images sur Wikipedia.
Ensuite, je ne plaide pas pour porter atteinte aux ayants droit, mais pour trouver une solution d’intérêt général. Le droit en vigueur est un frein à certaines activités, notamment la diffusion des œuvres, la photographie urbaine. Dans certains cas, retrouver les ayants droit est d’ailleurs extrêmement difficile. Il s’agit d’un droit profondément archaïque. Trouvons une solution. Je suis à la disposition du rapporteur pour parvenir à une formulation acceptable par tous, mais je souhaite vraiment que nous, membres de la commission des affaires culturelles, ne renoncions pas sur ce point à la première difficulté rencontrée.
M. le rapporteur pour avis. Chers collègues, mes explications ne vous convainquent pas, mais je ne suis pas convaincu par les vôtres. Je suis à votre disposition pour essayer de trouver une solution, mais, en l’état, je reste défavorable à vos amendements.
La Commission adopte les amendements.
La Commission en vient à l’amendement AC12 de Mme Isabelle Attard.
Mme Isabelle Attard. L’objectif est d’étendre au livre numérique le mécanisme de rémunération des livres imprimés. Aujourd’hui, des bibliothèques négocient avec les éditeurs, paient un certain prix pour avoir la possibilité de mettre à disposition, pour des prêts, des livres imprimés. En revanche, ce n’est absolument pas le cas pour les livres numériques. Les bibliothèques sont obligées de traiter avec un éditeur à la fois et n’ont accès qu’à une partie de l’offre : 14 % de l’offre commerciale disponible pour le grand public. Ainsi, 86 % de la production éditoriale numérique leur sont totalement inaccessibles, et toute évolution de ce chiffre dans les prochaines années reste soumise à la volonté des éditeurs. Cet amendement permettrait de résoudre ce problème en mettant sur le même plan les livres imprimés et les livres numériques et en fixant un mécanisme de rémunération, décidé par nous-mêmes. Il permettrait aussi de simplifier les procédures, de simplifier les prêts et finalement d’assurer l’avenir de la lecture.
M. le rapporteur pour avis. Je remercie Mme Attard, dont l’amendement aborde une question importante. Sur le fond, j’y suis assez favorable. Toutefois, il présente certains problèmes de rédaction. Le III, notamment, ajoute à un article portant sur la répartition de la rémunération des dispositions relatives aux modalités de mise à disposition des livres numériques et à la rémunération elle-même, prévue par un autre article du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, j’avoue mal comprendre, à ce stade, si vous souhaitez appliquer le système actuel de rémunération en deux parties au prêt de livres numériques – l’une basée sur le nombre d’utilisateurs, l’autre sur le prix public des livres achetés par les bibliothèques – ou si le décret prévu au III de votre amendement a vocation à trouver une autre forme de rémunération, en lien avec la précision que vous apportez à l’article L. 133-1.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement. Nous pourrons y retravailler ensemble ou avec la commission des lois, pour parvenir à une rédaction qui puisse passer le cap de la séance publique.
Mme Isabelle Attard. Souhaiteriez-vous sous-amender l’amendement ?
M. le rapporteur pour avis. Les modifications seraient trop importantes.
L’amendement est retiré.
Article additionnel après l’article 18
Protection du domaine commun informationnel
La Commission a adopté, contre l’avis du rapporteur, un amendement créant la notion de domaine commun informationnel – réunissant les éléments insusceptibles d’être protégés au titre de la propriété intellectuelle, comme les informations, les idées ou les découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, et les éléments ne faisant plus l’objet d’une telle protection – et prohibant l’usage exclusif et la restriction de l’usage commun à tous des éléments constitutifs du domaine commun informationnel.
*
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC8 et AC9 de Mme Isabelle Attard et AC 13 de M. Christian Paul.
Mme Isabelle Attard. Voilà des mois, sinon des années, que je reviens sur ce sujet au sein de notre commission : le domaine public. La première version du projet de loi parlait de « domaine commun informationnel », formule bien plus appropriée. Aussi, l’amendement AC8 propose de reprendre la première version du projet de loi. Il s’agit en effet de définir le domaine public de manière positive. Aujourd’hui, nous n’en avons qu’une définition en creux : lorsqu’il ne reste rien d’autre, il reste le domaine public. Il s’agit de définir un droit positif de certaines données, telles des œuvres d’art, qui constituent un patrimoine commun de l’humanité, régulièrement rendues inaccessibles par un usage abusif du droit, notamment celui des marques ou celui des bases de données. Soixante-dix ans après la mort de l’auteur, une œuvre est dans le domaine public. Or des ayants droit déposent des marques de façon à faire durer la poule aux œufs d’or. L’auteur a pourtant pu vivre de ses droits, comme ses enfants, ses neveux, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses cousins, et nous ne remettons pas cela en question – nous ne touchons pas au délai de soixante-dix ans.
Les ayants droit d’Arthur Conan Doyle ont par exemple créé une marque Sherlock Holmes et peuvent empêcher la sortie d’un film ou d’une pièce de théâtre, ou en retirer des recettes substantielles. Ce droit des marques permet d’attaquer le domaine public, domaine commun informationnel, tout simplement parce que celui-ci n’a pas de définition dans notre droit. De même, le département de la Dordogne a réclamé un droit d’auteur sur les reproductions de la grotte de Lascaux, 17 000 ans après la mort de ses créateurs, et la Bibliothèque nationale de France (BNF) impose des licences d’utilisation commerciales pour des œuvres qui remontent à plusieurs siècles. Des cinéastes qui publient sur YouTube voient leur compte supprimé à la suite de plaintes fallacieuses de grands studios, alors qu’il s’agit de leur principale source de revenus.
Dans le même ordre d’idées, nous assistons au développement du copyfraud. Des établissements culturels publics ou privés font payer des droits pour l’accès à des œuvres qui appartiennent à ce domaine commun informationnel. C’est un abus caractérisé, alors que nous sommes plus de soixante-dix ans après la mort du créateur, mais cette pratique est courante. Tout doit être fait pour défendre ce domaine commun informationnel.
Nous proposons également de donner aux artistes la liberté de faire ce qu’ils veulent, de disposer de leurs créations et de les mettre dans le patrimoine commun de l’humanité dès aujourd’hui, sans attendre soixante-dix ans après leur mort. Aujourd’hui, ils sont obligés de passer par des solutions contractuelles de type Creative Commons. Cela devrait être beaucoup plus aisément accessible à tous.
M. Christian Paul. Outre mon amendement AC13, j’évoquerai par anticipation l’amendement AC14, car les deux visent à la reconnaissance en droit positif des communs informationnels. Mes propositions ne contrarient en aucun cas les droits d’auteur et ne constituent en aucun cas une privation de droits exclusifs légitimement acquis. Nous refusons tous que le droit d’auteur soit bricolé, quand bien même il doit être adapté à la révolution numérique. Ces amendements permettraient cependant de régler séparément la question.
Ce que nous entendons voir figurer dans le domaine commun informationnel, ce sont des informations, des faits, des idées qui sont inappropriables ; ils n’entrent donc pas en conflit avec le respect d’autres droits. Ce sont également des œuvres tombées dans le domaine public, ou des informations administratives rendues publiques dans le cadre des lois en vigueur, notamment la loi de 1978 créant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Il s’agit bien de protéger l’accès de tous et d’éviter les restrictions.
L’amendement AC14 est un amendement protecteur de la volonté des auteurs. De nombreux auteurs, à travers le monde, font le choix de publier leurs œuvres dans le cadre de licences ouvertes. Ces licences sont en anglais, car c’est souvent dans les pays anglo-saxons que cela a été expérimenté, mais je me souviens cependant que, ici même, il y a sept ou huit ans avaient été accueillis pour la première fois les défenseurs français des Creative Commons et que c’est à l’Assemblée nationale qu’ont été lancées les licences Creative Commons.
Il est temps de reconnaître aux auteurs, aux détenteurs de droits de création, la capacité de leur donner un statut de bien commun pour tous les usages ou, s’ils le souhaitent, pour certains usages seulement. La secrétaire d’État avait eu raison de se battre pour que cette loi comporte la reconnaissance des communs informationnels. Ce serait une avancée considérable en droit français si nous parvenions à nous mettre d’accord pour adopter ce texte. Et ce n’est pas à la secrétaire d’État qu’il faut reprocher que l’article 8 initial, que je propose de rebâtir, ait disparu. Ce serait vraiment à l’honneur du Parlement que notre commission inscrive les biens communs informationnels dans cette loi.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement AC8 de Mme Attard, le plus large, prévoit diverses sanctions et me paraît imparfaitement rédigé. La définition des infractions et la proportionnalité des peines pourraient soulever beaucoup de problèmes.
Il est vrai que la question est débattue par le Parlement, et ailleurs, depuis plusieurs années. Des avancées ont été réalisées, en quelque sorte en contournant les textes, avec les licences Creative Commons, qui ont donné aux artistes la possibilité de céder tout ou partie de leurs droits, y compris patrimoniaux. Il n’est donc pas interdit, dès lors qu’il y a un contrat entre deux personnes, dont l’artiste, de céder une grande partie de ses droits, y compris leur utilisation commerciale. Les Creative Commons se sont assez largement développées dans notre pays ces cinq dernières années, et encore plus ailleurs, par exemple outre-Manche.
Cela dit, les amendements proposés ne résolvent pas tous les problèmes. D’ailleurs, si l’article 8 du pré-projet de loi offrait une certaine reconnaissance au domaine commun informationnel, le Gouvernement a décidé de le retirer : certaines questions juridiques n’avaient pu être résolues avant l’adoption du texte en conseil des ministres. Donnons-nous donc encore un peu de temps pour aboutir à une rédaction qui puisse à la fois faire droit à ce souci de reconnaissance et prendre en compte certaines craintes, interrogations, remarques.
Je demande donc le retrait de ces amendements, en m’engageant à travailler à la question au cours des prochains jours. Évidemment, vous serez libres, chers collègues, de les redéposer d’ici à la séance publique.
M. Christian Paul. Nous devons, en la matière, nous montrer ambitieux. Le rapporteur pour avis ne le conteste d’ailleurs pas. Notre responsabilité de parlementaires est de ne pas laisser passer cette occasion historique. Si la grande loi numérique de la législature contourne la question des biens communs informationnels, nous serons à côté de l’époque – et à côté de la plaque !
Je ne suis pas dogmatique et suis disponible pour que nous travaillions ensemble, y compris avec des collègues d’autres groupes, car je sais qu’on peut améliorer la rédaction de ces amendements, mais si notre commission marquait, par son vote de ce soir, son intention ferme de reconnaître les biens communs informationnels, ce serait un signal important qui nous permettrait de discuter ensuite avec le Gouvernement dans de meilleures conditions que si nous donnions nous-mêmes l’impression d’en rabattre trop fortement.
Mme Isabelle Attard. N’oublions pas que ce projet de loi a fait l’objet d’une élaboration innovante, avec la consultation des internautes. L’article 8, sur les propositions de domaine commun informationnel, a obtenu un vote favorable à 80 %, et celles concernant la lutte contre le copyfraud ont recueilli 98 % d’avis favorables. Ce sont là aussi des arguments. À quoi bon lancer une consultation si c’est pour ne pas tenir compte de l’avis des personnes consultées ?
Au cours de l’examen en commission du projet de loi sur la liberté de la création, Fleur Pellerin avait repoussé les amendements sur le domaine commun informationnel, en indiquant que cela figurerait dans la loi numérique. Axelle Lemaire a vaillamment défendu le domaine commun informationnel. Ce serait également à l’honneur du Parlement de ne pas céder à tel lobby qui prend peur alors que nous ne touchons pas au droit d’auteur, à tel autre qui utilise le droit des marques ou le copyfraud – qui constitue une atteinte aux biens communs de l’humanité. Continuellement, quel que soit le sujet, les tribunaux sont soumis à ce genre d’attaques, parce que nous n’avons pas défini positivement le domaine public. Je suis prête à discuter, mais non à retirer ces amendements. Ayons, comme la secrétaire d’État, le courage de défendre ces biens communs, soutenons-la. Le rôle de notre commission est de ne pas céder à quelque pression que ce soit, de réfléchir pour l’intérêt général. Adoptons au moins l’un des amendements en discussion, que ce soit mon amendement de repli ou un amendement de Christian Paul, pour envoyer un message de soutien à la secrétaire d’État.
M. le rapporteur pour avis. Je confirme que je suis défavorable à tous ces amendements. Je suis prêt à travailler la question, mais donnons-nous le temps de le faire.
Par ailleurs, je rappelle qu’un projet de loi présenté par le Gouvernement est un texte collégial. Ne saucissonnons pas la responsabilité gouvernementale entre les différents ministres !
M. Marcel Rogemont. Je souscris aux arguments de Christian Paul.
La Commission rejette successivement les amendements AC8 et AC9.
Puis elle adopte l’amendement AC13.
Article additionnel après l’article 18
Création d’un domaine commun volontaire
La commission a adopté, contre l’avis du rapporteur, un amendement visant à permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d’autoriser l’usage commun de l’objet auquel lesdits droits sont attachés, par le biais d’une manifestation de volonté expresse, non équivoque et publique.
*
Contre l’avis du rapporteur pour avis, la Commission adopte ensuite l’amendement AC14 de M. Christian Paul.
Article 22
(art. L. 111-5-1 du code de la consommation)
Principe de loyauté des plateformes en ligne vis-à-vis des consommateurs
La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.
Article 23
(art. L. 111-5-2 [nouveau] du code de la consommation)
Autorégulation des principaux opérateurs de plateformes en ligne
La Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement visant à renforcer l’auto-régulation des grandes plateformes en matière de contenus illicites. Les plateformes visées à l’article 23 devraient ainsi désigner une personne physique pour les représenter en France et établir des bonnes pratiques visant à lutter contre les contenus illicites, notamment par la mise en œuvre de techniques d’empreintes numériques. Elles seraient également tenues d’évaluer les effets de leur politique en matière de contenus illicites en définissant des indicateurs permettant d’apprécier le respect des lois et règlements relatifs aux contenus qu’elles mettent à disposition du public du fait de leur activité.
*
La Commission se saisit de l’amendement AC20 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il me semble aujourd’hui nécessaire de renforcer les obligations, quasi inexistantes, qui pèsent sur les grandes plateformes, en particulier en matière de contenus illicites. L’article 23 du projet de loi fournit un support adéquat, en leur imposant une forme d’autorégulation, qui existe aujourd’hui, mais mérite d’être largement renforcée. Je vous propose donc de soumettre ces plateformes à plusieurs obligations nouvelles : désigner un représentant légal en France pour assurer un meilleur dialogue avec les autorités ; mettre en œuvre des bonnes pratiques en matière de lutte contre les contenus illicites ; évaluer leur propre action à partir d’indicateurs spécifiques. Nous aboutirions ainsi à une plus grande transparence dans le domaine de la lutte contre les contenus illicites. Un certain nombre de plateformes mettent déjà en œuvre de tels dispositifs, mais pourraient le faire plus encore compte tenu de leur capacité économique et de leur diffusion.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 23 modifié.
Article 42
Compétitions de jeux vidéo
La Commission examine l’amendement AC21 rectifié du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit ici de proposer une piste permettant au Gouvernement d’avancer plus vite que ne le prévoit le texte de loi. J’ai bien entendu les remarques de certains collègues sur la caractérisation du sport électronique et j’ai modifié mon amendement en conséquence. La législation sur les loteries est efficace et nous protège de nombre de tentatives malhonnêtes. Elle encadre aussi utilement les jeux d’argent en ligne comme le poker. Il serait risqué de tenter d’introduire dans la loi une exception générale à la prohibition des loteries pour le sport électronique, car certains jeux d’argent qui n’en sont pas pourraient être tentés d’en prendre les apparences pour bénéficier d’un statut légal…
C’est pourquoi il m’a semblé opportun de créer un dispositif qui réponde spécifiquement au besoin exprimé et qui participe également aux objectifs visés par la législation sur les loteries, à savoir : l’intégrité de la compétition, la santé publique, la protection des mineurs, la lutte contre le blanchiment. En délivrant un agrément aux organisateurs qui sont capables d’assurer le respect de ces principes, et seulement pour certaines compétitions identifiées par un arrêté, il me semble que l’on répond au problème sans encourir de risques trop importants. Par ailleurs, les objectifs visés par le texte proposé, et l’ordonnance prévue, seraient atteints.
M. Pascal Deguilhem. L’intention du rapporteur pour avis est excellente. Il s’agit de répondre aux exigences posées tout en évitant le recours, qui n’est jamais plaisant, aux ordonnances. Le législateur est dans son rôle lorsqu’il propose des dispositions qui encadrent juridiquement les compétitions de jeux vidéo. Je note l’évolution du rapporteur, qui voudrait éviter de les caractériser en tant que sport électronique, mais le risque est de revenir à la catégorie des jeux, sur laquelle le ministère de la jeunesse n’est pas forcément compétent.
La caractérisation en termes de sport ne me paraît pas adéquate – il n’est en aucune façon question de performances physiques. De plus, l’organisation du sport se caractérise par des fédérations, à tous les niveaux, et des règles acceptées et comprises par tout le monde et dans toutes les compétitions, dans le monde entier. Avec le jeu vidéo, il me semble que nous sommes trop loin de l’activité sportive.
Par ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports agrée dans son domaine de compétence, grâce à son expertise et à des moyens appropriés. La question des moyens peut toujours être réglée si on le souhaite, mais je ne crois pas que le ministère de la jeunesse puisse apprécier, notamment, les listes de logiciels. Cela me semble un peu loin de ses compétences, et peu conforme à son discours. Si l’intention est bonne, le véhicule choisi l’est moins. Je ne suis pas donc pas favorable à l’amendement dans sa rédaction actuelle.
M. Michel Ménard. Je partage le point de vue de Jean-Pierre Allossery et de Pascal Deguilhem. Je comprends bien l’intention du rapporteur, mais l’amendement définit le jeu vidéo comme « un support physique ou en ligne, s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées ». Il me semble que rien n’empêchera un opérateur de jeux d’argent de scénariser du casino ou du loto en ligne, et ainsi de les affranchir de la régulation des jeux en ligne, comme cela est prévu dans la troisième partie de l’amendement. De plus, l’amendement prévoit un agrément délivré par le ministère de la jeunesse, qui n’a pas les compétences pour lutter contre la fraude et le blanchiment. L’agrément et le contrôle devraient plutôt relever du ministère du budget et du ministère de l’intérieur, et, par ailleurs, de l’ARJEL, pour la partie en ligne. Il me semble qu’il serait préférable de ne pas inscrire de dispositions dans la loi tant que les premiers résultats de la mission dont nous avons parlé tout à l’heure ne sont pas rendus. Pour ces raisons, il me paraîtrait plus raisonnable que l’amendement soit retiré. À défaut, je voterai contre.
Mme Virginie Duby-Muller. Je partage les remarques de mes collègues sur les problèmes que pose cet amendement. Un jeu vidéo avec argent est, par définition, un jeu d’argent : il serait donc plus pertinent que cet agrément soit délivré par les autorités compétentes, ministère du budget, ministère de l’intérieur et, pour la partie en ligne, ARJEL. Sa délivrance par le ministère de la jeunesse témoigne d’une conception trop restrictive et pose des problèmes de moyens et de compétences. En l’état, votre amendement ne nous paraît pas pertinent.
M. le rapporteur pour avis. Je vais retirer l’amendement, mais il me semble, chers collègues, que vous commettez une erreur fondamentale. Croire que les compétitions de jeux vidéo relèvent uniquement de la législation applicable aux loteries ou au poker en ligne et de la régulation de l’ARJEL est une erreur, qui ne prend pas en compte l’évolution culturelle dont vous vous réclamiez tout à l’heure. Cet amendement entendait ouvrir des pistes, pour le Gouvernement et pour la mission à laquelle Michel Ménard a fait référence. Nous passons à côté de notre rôle, qui est aussi, comme on dit, de « cranter » les sujets pour qu’ils puissent être abordés dans l’hémicycle. J’entends les remarques sur la compétence du ministère chargé de la jeunesse, mais si nous n’avions pas cette discussion, nous n’aurions pas non plus cette mission, attendue depuis quatre mois.
Je retire l’amendement, en me fiant à votre sagesse, mais l’agrément qui aurait pu être délivré aurait pris en compte les remarques faites lors de l’audition de l’ARJEL, sur l’intégrité, la fiabilité et la transparence des compétitions, la protection des mineurs, la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, des atteintes à la santé publique. Il s’agissait par ailleurs de s’appuyer sur des dispositifs mis en place, notamment par l’industrie du jeu vidéo, et validés par les autorités ministérielles, relatifs notamment à l’âge minimal des joueurs. Enfin, nombre de collectivités locales – y compris Paris – organisent de grandes compétitions de jeux vidéo et rencontrent de plus en plus de difficultés, alors même que notre pays est un des meilleurs producteurs de jeux vidéo, à tel point que nous avons décidé il y a un an et demi d’élargir le crédit d’impôt à cette industrie pour relocaliser une partie de la production. Je comprends vos interrogations, mais nous risquons de perdre quelques mois de plus.
M. Pascal Deguilhem. Je suis d’accord pour « cranter » : encore faut-il savoir sur quelle base !
L’amendement AC21 rectifié est retiré.
La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 42 sans modification.
Elle émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
*
* *
En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation émet un avis favorable à l’adoption des articles 17, 18, 22, 23 et 42 du projet de loi pour une République numérique (n° 3318).
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS
(par ordre chronologique)
Ø Agence française pour le jeu vidéo (AFJV) – M. Emmanuel Forsans, directeur général
Ø Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports – Direction des sports – Mme Claudie Sagnac, cheffe de service, et M. Gérald Contrepois, chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses
Ø Académie des sciences – M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel, et M. Denis Jérome, membre
Ø Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – M. Renaud Fabre, directeur de l’information scientifique et technique, et M. Nicolas Castoldi, délégué général à la valorisation, conseiller juridique du président
Ø Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) – M. Antoine Petit, président du conseil d’administration
Ø Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – M. Alain Colas, conservateur en chef des bibliothèques, chef du département de l’information scientifique et du réseau documentaire
Ø Fédération française des jeux vidéo en réseau – M. Patrick Tisserant, président
Ø Table ronde réunissant :
– Oxent – M. Matthieu Dallon, directeur général
– Bang Bang Management – M. Geoffrey Baldet, président
Ø Syndicat national de l’édition (SNE) – Mme Christine de Mazières, déléguée générale, M. François Gèze, groupe Editis et président du groupe des éditeurs universitaires, M. Jean-Marc Bocabeille, directeur éditorial revues, et M. Emmanuel Leclerc, directeur département livres
Ø Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) – M. Pascal Rogard, directeur général, et M. Guillaume Prieur, directeur des relations institutionnelles et européennes
Ø Table ronde réunissant :
– Syndicat national d’édition phonographique (SNEP) – M. Alexandre Lasch, directeur juridique
– Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) – Mme Karine Colin, directrice juridique
– Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) – Mme Laurence Marcos, directeur juridique
Ø Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) – MM. Didier Pelaprat et Michel Pohl, direction de l’information scientifique et de la communication
Ø Syndicat des distributeurs indépendants (SDI) – M. Etienne Ollagnier, président, et M. Christian Oddos, représentant permanent
Ø Table ronde réunissant :
– Association des producteurs de cinéma (APC) – M. Frédéric Goldsmith, délégué général
– Union des producteurs de films (UPF) – Mme Marie-Paule Biosse Duplan, déléguée générale
Ø Creative commons France – Mme Danièle Bourcier, directrice émérite de recherche au CNRS, membre du comité d’éthique
Ø Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l’accès aux publications numériques (COUPERIN) – M. Jean-Pierre Finance, président, et M. Grégory Colcanap, coordonnateur consortium et bureau professionnel
Ø Table ronde réunissant :
– École des hautes études en sciences sociales (EHESS) – M. Pierre-Cyrille Hautcœur, président
– Institut des sciences humaines et sociales du CNRS – M. Patrice Bourdelais, directeur
– Cairn.info – M. Marc Minon, directeur
Ø Capital Games – M. Fabien Delpiano, président
Ø Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) – Mme Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale, et M. Thierry Maillard, directeur juridique
Ø Me Jean Martin, avocat, membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CLSPA)
Ø Table ronde réunissant :
– Direction du Budget – M. Nicolas Hengy, chef de bureau des recettes, M. Paulin Richard de Latour, adjoint au chef de bureau des recettes, M. Grégoire Halliez, chargé de mission du bureau des recettes
– Direction générale des entreprises – Mme Angélique Girard, cheffe du bureau de l’audiovisuel et du multimédia, et M. Fabien Terraillot, chef du bureau du logiciel
Ø Institut Pasteur – M. Michaël Pressigout, directeur des systèmes d’information
Ø Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) – M. Baptiste Heynemann, chef du service de l’innovation et des industries techniques
Ø Centre national du Livre (CNL) – M. Vincent Monadé, président
Ø RELX Group – M. Jean-Frank Cavanagh, directeur des relations extérieures, et M. Nicolas Boudot, associé chez TILDER
Le rapporteur a également participé aux auditions conduites par M. Luc Belot, rapporteur au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
© Assemblée nationale