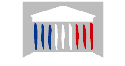______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 3968)
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence,
PAR M. Pascal POPELIN,
Député
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. L’ÉTAT D’URGENCE, UN CADRE DE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DES POUVOIRS PUBLICS 6
A. UNE MENACE AUX FORMES RENOUVELÉES 6
B. UN RÉEXAMEN RÉGULIER DE L’OPPORTUNITÉ DE L’ÉTAT D’URGENCE 8
II. UNE PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE AU-DELÀ DU 26 JUILLET POUR RENFORCER L’ACTION OPÉRATIONNELLE DES FORCES DE SÉCURITÉ 8
A. LES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES SERONT À NOUVEAU POSSIBLES 8
B. UN DISPOSITIF EST MIS EN PLACE POUR LA SAISIE DES DONNÉES ET DES MATÉRIELS INFORMATIQUES 9
C. D’AUTRES MESURES POURRONT ÊTRE MOBILISÉES 10
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS 13
AUDITION DE M. BERNARD CAZENEUVE, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 15
EXAMEN DES ARTICLES 35
Article 1er : Prorogation de l’état d’urgence 35
Article 2 (art. 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence) : Régime des perquisitions administratives 42
Après l’article 2 58
TABLEAU COMPARATIF 75
Une fois de plus, notre pays est durement éprouvé par le terrorisme. Après les attentats de Charlie Hebdo, de Saint-Denis et de Paris ou de Magnanville, un nouveau crime odieux a ensanglanté, à Nice, la fête nationale, emportant à ce jour quatre-vingt-quatre vies et faisant plusieurs centaines de blessés.
Face à cette menace que chacun apprend à considérer, hélas, comme durable, la détermination du Gouvernement et de la majorité parlementaire demeure inébranlable. La mobilisation des forces de l’ordre, des services de renseignement et de nos armées est totale depuis dix-huit mois. Des progrès considérables ont été accomplis qui ont permis de déjouer dix attentats (1) depuis juillet 2015. Les leçons des événements tragiques de la semaine dernière seront tirées et les mesures de protection des populations adaptées en conséquence.
Dans ces circonstances tragiques, à quoi sert-il de proroger à nouveau l’état d’urgence ? Le soir des attentats du 13 novembre, le Président de la République avait décrété celui-ci sur l’ensemble du territoire national. Par une loi du 20 novembre 2015 (2), le Parlement a autorisé, une première fois, sa prolongation pour trois mois et également renforcé le cadre juridique de l’état d’urgence. Cette légalité d’exception a été, ensuite, prorogée pour trois mois supplémentaires par la loi du 19 février 2016 (3), puis pour deux mois par la loi du 20 mai 2016 (4). Elle n’a toutefois pas suffi, à elle seule, à prévenir la survenue de nouveaux attentats.
La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence n’a pas été conçue comme un instrument de lutte contre le terrorisme. Elle permet à l’autorité administrative de disposer, face à l’urgence, de prérogatives accrues pour défendre l’ordre public. Si certaines de ces mesures ont un intérêt moindre – ou ont progressivement perdu celui-ci – pour prévenir la menace terroriste, d’autres complètent utilement les dispositions de droit commun. En outre, elles répondent à des conditions désormais précisément définies par les jurisprudences constitutionnelle et administrative.
Nul ne comprendrait, à l’heure de l’épreuve, que nous nous privions de ces ressources. Notre responsabilité est de mobiliser tous les ressorts de notre législation, dans les limites de l’État de droit, afin de permettre aux moyens opérationnels de se déployer.
Le présent projet de loi « prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » traduit cette résolution : il prolonge pour trois mois l’état d’urgence, prévoit expressément la faculté pour les préfets d’ordonner les perquisitions administratives prévues à l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 et tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 en rendant de nouveau possible la saisie de données informatiques à l’occasion de celles-ci.
L’examen du présent projet de loi impose, d’une part, de vérifier que les conditions de l’état d’urgence sont toujours réunies et, d’autre part, de fixer la durée de la prorogation.
Avec cinq attaques, dont trois ont occasionné plusieurs dizaines de victimes, auxquelles il faut ajouter au moins dix tentatives déjouées depuis dix-huit mois, la France demeure l’une des cibles privilégiées de la nébuleuse terroriste. « Nous avons tout eu » a résumé, il y a quelques semaines, devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, le coordonnateur national du renseignement, M. Didier Le Bret : « des actes d’ampleur, préparés, planifiés, coordonnés – les deux attaques de janvier et novembre ; des actes isolés, perpétrés par des acteurs revenant de théâtres de guerre en Syrie ou par d’autres qui, sans jamais quitter le territoire national, ont pu agir à l’instigation d’un contact sur place ; enfin, des individus relevant de la fameuse catégorie des " loups solitaires " qui, autoradicalisés, ont pris leur décision sur un fondement strictement personnel, mais le plus souvent à partir d’Internet » (5).
Les attaques préparées, planifiées et coordonnées du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, mais aussi du 13 mars 2016 sur la plage de Grand Bassam, en Côte d’Ivoire, et du 22 mars 2016 à Bruxelles, sont le fait des organisations terroristes Daech et AQMI. Celles-ci réagissent ainsi, entre autres, à l’engagement de l’armée française sur le théâtre syro-irakien et au Sahel. En particulier, Daech peut s’appuyer sur plusieurs centaines de ressortissants français ayant rejoint ses rangs, mais également sur plusieurs milliers d’autres combattants francophones, tous susceptibles d’être projetés sur le territoire français.
Parallèlement à cette planification, Daech tente de susciter, par mimétisme avec les attentats les plus spectaculaires, des passages à l’acte de la part d’individus isolés et pouvant présenter des profils très variés. En septembre 2014, dans une vidéo de propagande, elle avait appelé les musulmans à commettre individuellement des attentats partout dans le monde.
L’attentat perpétré à Nice le 14 juillet s’inscrit, selon les premiers éléments de l’enquête judiciaire rendus publics (6), dans cette logique. Il convient, cependant, de ne pas méconnaître deux spécificités : d’une part, son mode de commission n’a impliqué ni arme lourde, ni explosif et, d’autre part, son auteur n’était pas connu des services de police pour son adhésion à l’idéologie islamiste. Cet « attentat d’un type nouveau », selon les mots du ministre de l’Intérieur (7), ne peut que conduire à redouter un risque de récidive sur le sol national.
Au regard de ce risque, la condition de « péril imminent », posée par l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 pour la mise en œuvre de l’état d’urgence, paraît donc satisfaite. Le Conseil d’État l’a confirmé en plusieurs occasions :
– lorsqu’il a statué en référé, le 27 janvier 2016, sur la décision implicite des pouvoirs publics de ne pas mettre fin à l’état d’urgence de manière anticipée (8) ;
– lorsqu’il a été consulté, le 2 février, sur l’avant-projet de loi de deuxième prorogation (9) et, le 28 avril, sur celui de troisième prorogation (10) ;
– et, à nouveau, à l’occasion de son avis rendu sur le présent projet de loi (11), où il a considéré que cette nouvelle prorogation de l’état d’urgence était justifiée « eu égard à la nature de l’attentat commis à Nice ».
Votre rapporteur fait sienne l’analyse de la haute juridiction administrative.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 avril 1955, la loi de prorogation de l’état d’urgence détermine la « durée définitive » de celui-ci. Le présent projet de loi propose de prolonger de trois mois supplémentaires la durée de l’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 et prorogé à trois reprises, alors que celui-ci devait expirer le 25 juillet 2016 à minuit.
Aucune disposition ne limite la durée pendant laquelle l’état d’urgence est prorogé : trois mois pour les deux premières prorogations en novembre 2015 et en février 2016, mais deux mois pour la dernière en mai 2016.
Prolongé pour trois mois par le présent projet de loi, l’état d’urgence expirerait donc à la fin du mois d’octobre. Comme pour les prorogations précédentes, le Gouvernement aura la possibilité d’y mettre fin à tout moment par décret en conseil des ministres. S’il souhaitait, à l’inverse, prolonger l’état d’urgence au-delà de cette date, le Gouvernement devrait à nouveau solliciter l’autorisation parlementaire.
II. UNE PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE AU-DELÀ DU 26 JUILLET POUR RENFORCER L’ACTION OPÉRATIONNELLE DES FORCES DE SÉCURITÉ
Le présent projet ne se borne pas à une prolongation de l’état d’urgence ; il se distingue des deux précédentes lois de prorogation, en élargissant le champ des mesures autorisées et en toilettant le dispositif de la loi du 3 avril 1955.
Au moment de la déclaration de l’état d’urgence le 14 novembre dernier, le Président de la République et le Gouvernement avaient fait le choix de permettre aux autorités administratives compétentes, c’est-à-dire au ministre de l’Intérieur ou aux préfets, d’ordonner des perquisitions administratives.
Le I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit, en effet, que celles-ci doivent être autorisées par une disposition expresse du décret instituant l’état d’urgence ou de la loi de prorogation. Est ainsi fondée une distinction entre l’état d’urgence « simple » et l’état d’urgence « aggravé », qui permet la mise en œuvre de mesures plus attentatoires aux libertés publiques.
Cette mesure a été massivement utilisée, en particulier au cours des premières semaines de l’état d’urgence ; entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016, 3 594 perquisitions administratives ont été ordonnées sur le fondement de l’état d’urgence, en pratique exclusivement par les préfets. Elles ont alimenté un contentieux significatif, qui a récemment conduit le Conseil d’État à préciser leur régime et les conditions d’indemnisation applicables (12).
La loi du 20 mai 2016 n’a pas reconduit cette autorisation. Deux raisons principales avaient alors convaincu le législateur. D’une part, les perquisitions administratives ne présentaient plus le même intérêt opérationnel qu’au début de l’état d’urgence dès lors que, comme le précisait l’exposé des motifs du projet de loi correspondant, « la plupart des lieux identifiés avait déjà fait l’objet des investigations nécessaires » et qu’il restait possible de recourir aux perquisitions judiciaires, dont les modalités ont été adaptées par la loi du 3 juin 2016 sur la procédure pénale (13). D’autre part, l’efficacité de cette mesure avait été largement amoindrie par la décision du Conseil constitutionnel précitée n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 censurant la faculté de copier des supports informatiques lors des perquisitions administratives ordonnées sur le fondement de l’état d’urgence.
Le présent projet de loi propose de rétablir l’autorisation d’ordonner des perquisitions administratives, en créant des garanties pour encadrer la copie des données informatiques, désormais assimilée à une saisie, conformément à la jurisprudence constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 18 janvier 2016, par le Conseil d’État, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Ligue des droits de l’homme sur la conformité à la Constitution du régime de la perquisition administrative prévu par l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 et notamment de la possibilité, dans ce cadre, de copier des données stockées dans un système informatique auquel ces perquisitions donnent accès.
Par sa décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a validé trois aspects de la perquisition administrative :
– le principe même d’une perquisition administrative telle qu’elle est définie dans la loi du 3 avril 1955 (décision de perquisition en précisant le lieu et le moment ; information du procureur de la République ; présence d’un officier de police judiciaire ; présence de l’occupant ou de deux témoins ; compte rendu délivré au procureur de la République) ;
– sa réalisation en dehors de la direction et du contrôle de l’autorité judiciaire, le Conseil considérant que ces perquisitions « n’affectent pas la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution » dont les magistrats de l’ordre judiciaire sont les gardiens ; le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé l’autonomie de la législation sur l’état d’urgence et le rôle du juge administratif dans la protection des libertés ;
– le régime contentieux de la perquisition administrative. Le Conseil, tout en notant que les voies de recours prévues à l’encontre d’une perquisition ne peuvent être mises en œuvre qu’a posteriori, a souligné qu’elles permettaient à l’intéressé d’engager la responsabilité de l’État et autorisaient un contrôle « dans des conditions appropriées au regard des circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence ».
Le Conseil a, en revanche, jugé contraires à la Constitution une partie des dispositions du paragraphe I de l’article 11, privant de fondement juridique les copies de données informatiques, introduites par la loi du 20 novembre 2015. Il a estimé que « le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée ».
Le commentaire de cette décision, publié aux Cahiers du Conseil constitutionnel, pointe ainsi la faiblesse des garanties entourant cette faculté :
– la possibilité de copier toutes les données auxquelles l’autorité administrative peut accéder, y compris des éléments sans lien avec la menace que représenterait l’intéressé ;
– la possibilité de copier les données des amis ou des parents de la personne regardée comme une menace ;
– ou encore, l’absence de précision sur le sort de ces données.
L’article 2 du présent projet de loi entend remédier à cette censure, en proposant un régime de saisie administrative des données et des matériels informatiques.
Durant les trois mois supplémentaires pendant lesquels l’état d’urgence serait prolongé, outre les perquisitions administratives, dix mesures dérogatoires, individuelles ou de portée générale, prévues par la loi du 3 avril 1955, seraient encore applicables dans un contexte marqué par la permanence de la menace terroriste au niveau le plus élevé :
– l’interdiction de la circulation des personnes ou des véhicules (1° de l’article 5 de la loi) ;
SYNTHÈSE DES MESURES ADMINISTRATIVES PRISES EN APPLICATION DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955
ENTRE LE 14 NOVEMBRE 2015 ET LE 18 JUILLET 2016
PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES
Mesure |
Article de la loi du 3 avril 1955 |
Nombre de mesures ordonnées entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016 |
Armes découvertes |
Infractions constatées |
Interpellations |
Gardes à vue |
Nombre de recours | ||
Contentieux de l’annulation |
Contentieux indemnitaire | ||||||||
Perquisition à domicile de jour et de nuit |
Article 11 |
3 594 |
757 |
557 |
420 |
364 |
70 |
22 | |
ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
Du 14 novembre 2015 au 25 février 2016 |
Du 26 février au 25 mai 2016 |
Depuis le 26 mai 2016 | ||||||||
Mesure |
Article de la loi du 3 avril 1955 |
Nombre de mesures ordonnées |
Nombre de référés liberté (dont annulations) |
Nombre de référés suspension (dont annulations) |
Nombre de mesures ordonnées |
Nombre de référés liberté (dont annulations) |
Nombre de recours pour excès de pouvoir (dont annulations) |
Nombre de mesures ordonnées |
Nombre de référés liberté (dont annulations) |
Nombre de recours pour excès de pouvoir (dont annulations) |
Assignation à résidence |
Article 6 |
400 |
179 (12) |
0 |
72 |
20 (3) |
14 (0) |
82 |
11 (0) |
0 |
AUTRES MESURES DE L’ÉTAT D’URGENCE
Mesure |
Article de la loi du 3 avril 1955 |
Nombre de mesures ordonnées depuis le 14 novembre 2015 |
Nombre d’infractions à ces mesures ayant donné lieu à des poursuites |
Nombre de recours |
Interdiction de séjour |
Article 5 |
540 |
nd |
25 (13 suspensions prononcées) |
Fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion |
Article 8 |
4 |
nd |
0 |
Dissolution d’associations ou de groupements |
Article 6-1 |
0 |
||
Interruption de sites Internet |
Article 11 |
0 |
Source : ministère de l’Intérieur.
nd : données consolidées non disponibles.
– l’institution de zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé (2° de l’article 5) ;
– l’interdiction de séjour (3° de l’article 5), parfois qualifiée d’« interdiction de paraître » ;
– l’assignation à résidence, complétée le cas échéant par une assignation à domicile à temps partiel, pouvant comporter jusqu’à trois pointages au commissariat ou à la brigade de gendarmerie et une interdiction d’entrer en relation, et qui peut être aménagée sous la forme d’un placement sous surveillance électronique (article 6) ;
– la dissolution d’associations ou de groupements (article 6-1) ;
– la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion (premier alinéa de l’article 8) ;
– l’interdiction de manifestation (second alinéa de l’article 8) ;
– la remise des armes des catégories A à C et de celles de catégorie D soumises à enregistrement (article 9) ;
– la réquisition de personnes ou de biens (article 10) ;
– le blocage de sites Internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie (II de l’article 11).
S’il faut saluer le fait qu’une étude d’impact soit jointe au projet de loi (14), celle-ci ne dit rien des mesures auxquelles le Gouvernement envisage de recourir plus particulièrement. L’exposé des motifs qui accompagne le présent projet de loi se borne à souligner l’« utilité accrue » des perquisitions administratives.
Déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le matin du 19 juillet 2016, le présent projet de loi a été examiné par votre commission des Lois, l’après-midi même, dans la perspective d’un examen en séance publique à 21 heures 30. Ce calendrier particulièrement resserré était justifié par la perspective de l’extinction de l’état d’urgence, à défaut de prorogation expresse, à compter du 25 juillet à minuit.
Votre rapporteur rappelle, à cet égard, que les délais minimaux de six et quatre semaines, prévus par l’article 42 de la Constitution entre le dépôt d’un projet de loi et le début de son examen puis au stade de sa transmission à la seconde assemblée saisie, ne sont pas applicables à un « projet relatif aux états de crise ».
L’article premier du projet de loi prévoit que l’état d’urgence, déclaré par les décrets du 14 novembre et du 18 novembre 2015 et prorogé à trois reprises par les lois du 20 novembre 2015, du 19 février 2016 et du 20 mai 2016, est prorogé pour trois mois supplémentaires, sur le territoire métropolitain et sur celui des collectivités d’outre-mer mentionnées par le décret du 18 novembre 2015, jusqu’à la fin du mois d’octobre. Il prévoit expressément que les préfets pourront, à nouveau, ordonner des perquisitions domiciliaires administratives, de jour comme de nuit.
L’article 2 complète le régime juridique des perquisitions administratives posé par le I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. Afin de remédier à la censure prononcée par la décision précitée n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel, il précise, en particulier, les conditions dans lesquelles il sera possible de procéder à la saisie des équipements informatiques découverts sur les lieux de la perquisition, et à l’exploitation ultérieure des données qu’ils contiennent. Cet article prévoit également la possibilité de perquisitionner successivement plusieurs lieux, en autorisant une régularisation a posteriori de l’ordre de perquisition.
Suivant l’avis du rapporteur, votre commission des Lois a décidé d’adopter les dispositions du texte qui lui était soumis compte tenu des modifications suivantes :
– elle a porté de trois à six mois la durée de prorogation de l’état d’urgence ;
– elle a réduit de quarante-huit à vingt-quatre heures le délai dont dispose le juge des référés du tribunal administratif pour autoriser l’exploitation des données et des matériels informatiques ayant fait l’objet d’une saisie administrative, dans le cadre d’une perquisition ordonnée sur le fondement de l’état d’urgence ;
– elle a prévu que ce même juge soit saisi dès la fin de la perquisition administrative pour autoriser l’exploitation de ces données et matériels informatiques ;
– elle a ajouté un dispositif de retenue administrative des personnes présentes dans les lieux faisant l’objet d’une perquisition ordonnée sur le fondement de l’état d’urgence.
*
* *
AUDITION DE M. BERNARD CAZENEUVE, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE
Lors de sa réunion du mardi 19 juillet 2016, la commission des Lois procède à l’audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (n° 3968).
M. le président Dominique Raimbourg. Nous allons examiner le projet de loi prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Ce texte a été déposé ce matin sur le bureau de l’Assemblée.
Je vous rappelle que l’état d’urgence a été déclaré par décret le 14 novembre 2015, qu’il a été prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015 par la loi du 20 novembre 2015, et qu’il l’a été de nouveau par les lois du 19 février et du 20 mai 2016.
Nous débattrons de ce projet de loi en séance publique dès ce soir à partir de vingt et une heure trente. Le Sénat s’en saisira demain, et je vous informe d’ores et déjà que, s’il ne vote pas le texte dans les mêmes termes, une commission mixte paritaire pourrait être convoquée demain soir à vingt et une heure trente. En cas d’échec de cette dernière, la commission des lois pourrait se réunir jeudi en fin de matinée, les journées de jeudi et, éventuellement, de vendredi devant alors nous permettre d’aller au terme de la navette.
Je remercie le ministre de l’Intérieur pour sa présence.
Il nous appartient de désigner un rapporteur. J’ai reçu la candidature de M. Pascal Popelin. En l’absence d’objection, il en est ainsi décidé.
Je vais donner la parole au ministre, puis au rapporteur et ensuite à un orateur par groupe avant que nous n’entamions la discussion générale.
J’appelle votre attention sur le fait qu’il est prévu, je le répète, que nous examinions le texte en séance publique à vingt et une heure trente, et je vous informe qu’une centaine d’amendements ont été déposés ; or, si la commission n’a pas terminé ses travaux à temps, c’est le texte du Gouvernement qui servira de base à la discussion en séance publique.
Je vous invite par conséquent à faire preuve de modération dans la durée de vos interventions. Je propose que les orateurs des groupes disposent chacun de cinq minutes de temps de parole, et que chaque orateur, ensuite, ne dépasse pas deux minutes dans la discussion générale.
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur. Nous allons examiner un texte prorogeant pour une quatrième fois l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Le sujet qui nous réunit et les circonstances dans lesquelles nous sommes amenés à débattre exigeaient que nous procédions à l’examen du texte suivant la procédure accélérée. Je tiens cependant, à titre préalable, à vous remercier, monsieur le président, ainsi que l’ensemble des membres de cette commission, pour avoir fait en sorte que ce débat puisse se tenir si rapidement dans le cadre de la présente session extraordinaire.
L’examen de ce texte s’inscrit dans le contexte de l’attentat perpétré jeudi dernier, le jour de la fête nationale, à Nice. À ce jour, cet attentat a entraîné la mort de quatre-vingt-quatre personnes dont dix enfants et adolescents. Trois cent trente personnes ont par ailleurs été blessées, souvent très grièvement, dix-neuf d’entre elles étant d’ailleurs toujours entre la vie et la mort.
Au moment où nous abordons l’examen du présent projet de loi, toutes nos pensées vont bien entendu vers les victimes, leurs familles, leurs proches, mais aussi vers les habitants de la ville de Nice, endeuillés par cet acte d’une barbarie inédite. Mais le deuil et le recueillement vont, bien sûr, de pair avec notre volonté commune de tirer toutes les leçons de ce lâche attentat et de nous donner les moyens de protéger les Français face à une menace terroriste d’une intensité sans précédent.
Le texte que le Gouvernement soumet à votre examen a pour objet de prolonger et de consolider le régime d’état d’urgence que le Président de la République a initialement décrété dans la nuit du 13 novembre 2015 à la suite des attentats de Paris et de Saint-Denis. Ce régime, vous l’avez prorogé et modernisé en adoptant la loi du 20 novembre 2015. Vous l’avez prolongé à nouveau à deux reprises en février dernier pour une période de trois mois puis au mois de mai pour une période de deux mois. Le 26 juillet prochain, cette dernière prorogation prendra donc fin.
Si notre pays se trouve ainsi, depuis huit mois, placé sous le régime de l’état d’urgence, il est utile de rappeler que les mesures qui le permettent ont fait l’objet d’une application différenciée dans le temps.
Tout d’abord, l’essentiel des 3 594 perquisitions administratives effectuées par les forces de l’ordre se sont déroulées dans les jours qui ont immédiatement suivi les attentats de novembre 2015. Il s’agissait d’éviter tout risque de réplique, de prendre les individus suspectés de visées terroristes par surprise et de déstabiliser les filières existantes. Parallèlement, l’administration a pris 350 mesures d’assignation à résidence qui lui ont permis de procéder aux contrôles nécessaires à l’égard de personnes suspectes, de ruiner certains doutes et d’entraver l’action et les déplacements de certains individus susceptibles de constituer une menace pour l’ordre et la sécurité publics.
Pendant une deuxième phase de l’application de l’état d’urgence, des mesures de perquisition administrative ont continué d’être prises, mais de façon beaucoup plus ciblée. Comme cela a été justement relevé dans le rapport de la commission d’enquête, récemment remis par votre collègue Sébastien Pietrasanta, ces perquisitions administratives ont joué un rôle-clé en matière de renseignement. Les conclusions du rapport rejoignent d’ailleurs les échanges que nous avons eus avec Dominique Raimbourg et le sénateur Michel Mercier, tous deux responsables du suivi de l’état d’urgence, l’un à l’Assemblée, l’autre au Sénat. Il convient, à cet égard, de souligner que plus de 80 % des personnes assignées à résidence et plus de 50 % des individus dont le domicile a été perquisitionné, figuraient déjà au fichier de traitement des signalements de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Ces données montrent bien que les personnes prioritairement ciblées ne l’ont pas été de façon arbitraire, mais parce qu’elles entretenaient des liens avec l’islamisme radical.
Enfin, vous vous en souvenez, le Gouvernement a demandé une troisième prorogation de l’état d’urgence, en mai dernier, avec le souci d’assurer dans les meilleures conditions possibles la sécurité de l’Euro 2016 et du tour de France, et de disposer des outils nécessaires à cette fin. Ainsi, 438 mesures d’interdiction de paraître ont été prises pendant l’Euro 2016 et ses préparatifs – à savoir depuis le 1er mai –, et 44 personnes ont été interpellées pour association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise terroriste.
En revanche, le Gouvernement n’avait pas demandé au Parlement, en mai dernier, de pouvoir procéder à des perquisitions administratives, principalement parce que l’intérêt pratique de ces mesures avait été considérablement réduit par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, comme la commission d’enquête à laquelle je viens de faire allusion l’a justement relevé dans son rapport, « la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016, déclarant contraire à la Constitution la possibilité de copier des données informatiques découvertes pendant les perquisitions administratives, a privé ces dernières d’une part non négligeable de leur plus-value opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme. En effet, par-delà la riposte initiale que l’état d’urgence a permis d’organiser dans les milieux délinquants ou radicalisés, votre rapporteur [a] estim[é] que son apport essentiel, sur le moyen terme, aurait pu consister en un enrichissement de la connaissance des réseaux terroristes ou de leurs réseaux de soutien […] précisément grâce à l’exploitation des données numériques captées ».
Afin de tirer les conséquences de cette jurisprudence, le Gouvernement vous propose donc une nouvelle rédaction de la mesure relative aux perquisitions administratives. L’article 2 du texte prévoit ainsi la possibilité de saisir et d’exploiter des données contenues dans tout système informatique ou dans tout équipement terminal présent sur le lieu de la perquisition. Afin d’assurer le nécessaire équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée, il est toutefois prévu que le juge puisse être saisi et qu’il statue dans un délai de quarante-huit heures pour autoriser ou non l’exploitation et, le cas échéant, la conservation des données renseignant sur la menace que constitue le comportement de l’individu concerné. En cas de refus du juge des référés, les données copiées seront détruites et les supports saisis restitués à leur propriétaire.
Quant aux mesures d’assignation à résidence, elles ont fait l’objet d’un renouvellement lors de chaque prorogation de l’état d’urgence. Ces renouvellements sont décidés lorsqu’ils correspondent à des objectifs opérationnels et qu’ils ne présentent pas de fragilités juridiques, compte tenu des exigences accrues du juge administratif et de la jurisprudence du juge constitutionnel. En effet, comme le montrent certaines annulations ou suspensions prononcées, heureusement très rares, il est apparu qu’il n’était pas toujours aisé de prouver devant le juge la réalité des éléments justifiant une mesure d’assignation à résidence, d’abord en raison de la nécessité de protéger des sources humaines ou des méthodes opérationnelles de renseignement, ensuite en raison de l’impossibilité d’utiliser des informations issues de données copiées lors d’une perquisition administrative, cela depuis la décision du Conseil constitutionnel que j’ai évoquée.
Je rappelle néanmoins qu’à ce jour 79 individus sont toujours assignés à résidence. Depuis le 26 mai dernier, 27 nouvelles assignations à résidence ont en outre été prononcées. Aussi, contrairement à certaines assertions, le Gouvernement n’a-t-il jamais renoncé à prendre de telles mesures permises par l’état d’urgence, dès lors que la gravité de la menace le justifiait.
Je vous invite à réécouter l’intervention traditionnelle du Président de la République à l’occasion du 14 juillet. En effet, il s’est borné à rappeler que l’état d’urgence n’avait pas vocation, dans la République, à être permanent, mais qu’il devait demeurer un régime d’exception, encadré par le droit et justifié par une menace de haute intensité. Il a en outre souligné que nous avions adapté notre législation de droit commun, notamment avec la loi du 3 juin 2016, afin de renforcer nos moyens de lutter contre la menace terroriste et que la « sortie » éventuelle de l’état d’urgence s’en trouvait facilitée. Ces constats ne sont en rien contradictoires avec la décision que nous avons prise de prolonger l’état d’urgence dans les conditions que j’ai décrites, afin de tenir compte de la situation nouvelle créée par l’attentat de Nice.
À chaque fois que cela sera nécessaire, le Gouvernement demandera donc au Parlement, comme il le fait ici, l’autorisation de déclencher ou de proroger l’état d’urgence. Mais nous devons également savoir vivre en dehors de ce cadre juridique exceptionnel et disposer des moyens juridiques adéquats pour assurer la sécurité des Français.
Plus généralement, je souhaite encore rappeler que l’état d’urgence ne constitue pas, à l’évidence, l’unique réponse que nous devions apporter à la menace terroriste qui pèse sur notre pays. La lutte contre le terrorisme requiert en effet une stratégie globale, faisant appel à un ensemble cohérent de moyens, reposant simultanément sur la détection, la prévention et la répression.
Il n’est pas nécessaire que je revienne sur l’ensemble des moyens mobilisés par l’État au cours des dix-huit derniers mois. Je rappellerai seulement, sur le plan européen, la mise en place du Passenger Name Record (PNR), l’adoption de la directive sur les armes, la modification de l’article 7-2 du code frontières Schengen et l’interconnexion des fichiers de sécurité. Quant aux efforts que nous avons faits concernant les moyens des services, ils ont été recensés par le rapport de M. Pietrasanta.
Je me tiens prêt à répondre à vos questions.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Nous avons tous été bouleversés par l’attentat immonde qui a ensanglanté notre fête nationale, vendredi dernier, à Nice. Une nouvelle fois, notre pays a été frappé par l’obscurantisme, la régression et la barbarie, comme l’ont été dernièrement la Belgique, les États-Unis et, probablement, hier encore, l’Allemagne. Nous partageons la peine incommensurable des familles des victimes et nous comprenons la détresse des Niçois.
Des polémiques – inédites, en de telles circonstances – ont été lancées par certains élus ; notre commission ne me semble pas le lieu pour les alimenter. Je me contenterai de dire que semer le doute parmi nos concitoyens sur la réalité de l’action menée par l’État pour lutter contre le terrorisme, ne pas dire et assumer la vérité en face, ne procurera aucun bénéfice politique à ceux qui cèdent à la facilité de tels comportements. Plus grave encore, nous offrons ainsi à nos agresseurs le germe de la désunion qu’ils ont pour projet d’installer dans notre nation.
Pour ma part, je me bornerai à dire à tous ceux qui agissent chaque jour pour assurer notre protection, parfois au péril de leur vie – policiers, gendarmes, services de renseignement –, notre soutien, notre reconnaissance et notre admiration.
Chacun des membres de notre commission est au fait de la réalité de l’état d’urgence, puisque c’est le quatrième texte relatif à ce sujet que nous examinons en moins d’un an et que nous sommes particulièrement impliqués dans le suivi de sa mise en œuvre et son contrôle. Le texte qui nous est soumis est bref ; il comporte deux articles.
À l’article 1er, il est proposé que l’état d’urgence déclaré par les décrets des 14 et 18 novembre 2015 et prorogé à trois reprises par les lois du 20 novembre 2015, du 19 février 2016 et du 20 mai 2016 soit prorogé pour trois mois supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’à la fin du mois d’octobre. Je vous proposerai de porter cette prorogation à six mois, soit jusqu’à la troisième semaine du mois de janvier.
Cet article autorise également expressément les préfets à ordonner des perquisitions domiciliaires administratives, de jour comme de nuit. Nous avions renoncé à cette disposition en mai dernier, en raison notamment de la perte de substance de cette disposition consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 censurant la possibilité de saisie des équipements informatiques.
L’article 2 tend à répondre aux objections du juge constitutionnel en précisant en particulier, comme ce dernier y invitait le législateur, les conditions dans lesquelles il sera possible de procéder à la saisie des équipements informatiques découverts sur les lieux de la perquisition et à l’exploitation ultérieure des données qu’ils contiennent.
Je vous proposerai, là encore, quelques amendements visant à améliorer la rédaction de cet article.
Cet article prévoit en outre opportunément la possibilité de perquisitionner successivement plusieurs lieux, en autorisant une régularisation a posteriori de l’ordre de perquisition.
Je sais qu’existe la tentation de vouloir introduire dans ce texte d’autres dispositions relevant, non pas de l’état d’urgence, mais du droit commun. Sur le fond, certaines d’entre elles présentent un intérêt opérationnel et ne sauraient être écartées d’un revers de la main ; d’autres ne produisent aucun effet de droit et relèvent plutôt d’une volonté d’affichage ; d’autres encore soulèvent des difficultés constitutionnelles ou conventionnelles. Sur la forme, en tout cas, toutes relèvent, je le crains, de ce que nous appelons des cavaliers législatifs. Elles pourraient donc, à ce titre, être censurées par le Conseil constitutionnel, d’autant plus que ces dispositions durables seraient insérées dans un texte relatif à une légalité d’exception, forcément temporaire. À ce stade de notre discussion, je ne vous proposerai donc pas de les retenir. Toutefois, si la majorité sénatoriale souhaite prendre ce risque juridique, certains de ces amendements pourront être examinés sur le fond dans le cadre de la commission mixte paritaire à laquelle, en tout état de cause, nos collègues sénateurs semblent tenir.
M. Yves Goasdoué. En préambule, je veux rappeler la peine qu’ont ressentie tous les Français en apprenant le drame absolu qui s’est déroulé à Nice jeudi dernier. Bien entendu, la représentation nationale assure de sa compassion et de son soutien les familles et les amis des victimes ainsi que ceux qui luttent encore contre la mort et qui souffrent. Nous leur devons la vérité : le risque zéro n’existe pas. Nous leur devons également la sécurité maximale, mais nous ne pouvons pas pour autant renoncer aux principes de la République. Nous leur devons enfin la dignité ; il ne s’agit pas d’être unanimes, mais de faire preuve de hauteur de vues et de formuler des critiques empreintes d’honnêteté intellectuelle plutôt que de considérations politiques.
Qu’est-ce que l’état d’urgence ? Je veux rappeler qu’il permet de réglementer l’activité des personnes dans des zones de protection, de maintenir chez elles des personnes dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public, de dissoudre dans certaines conditions des associations ou des groupements de fait, de réaliser pour des motifs sérieux, en tout lieu et à toute heure, des perquisitions administratives. J’ajoute qu’il sera désormais possible de saisir les matériels informatiques découverts lors de ces perquisitions et d’exploiter ultérieurement les données informatiques qu’ils contiennent, dans des conditions conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Cependant, nous plaçons au cœur de notre lutte contre le terrorisme le respect de l’État de droit et des principes fondamentaux de la République. Permettez-moi de rappeler à ceux qui en douteraient que le Conseil d’État lui-même a estimé que, face à l’ampleur de la menace, la poursuite de l’état d’urgence était nécessaire, adaptée, proportionnée et, par suite, justifiée. Il n’y a donc pas de violation de l’État de droit, non plus que des libertés individuelles. Bien entendu, le Conseil d’État rappelle que l’état d’urgence ne saurait être permanent ; il précise même que, pour en sortir, il convient d’adapter nos règles de droit commun.
Dans ce domaine, nous avons beaucoup œuvré, non seulement pour adapter notre arsenal répressif mais aussi pour qu’il puisse être appliqué. En effet, nous avons créé, en 2015, l’interdiction de sortie ou d’entrée sur le territoire français pour les personnes dangereuses et nous avons permis, le 3 juin dernier, en matière de lutte contre la criminalité organisée, l’utilisation de moyens spéciaux tels que la sonorisation de lieux privés, l’usage d’IMSI-catchers ou le recours élargi aux perquisitions judiciaires de nuit. Mais cette politique, nous nous sommes donné les moyens de la mettre en œuvre en augmentant notamment les effectifs des forces de police et de gendarmerie.
Un état d’urgence nécessaire compte tenu de la menace et respectant l’État de droit ; une adaptation de l’arsenal juridique antiterroriste de droit commun, dont la mise en œuvre est rendue possible par une mobilisation sans pareille des moyens techniques, financiers et humains, le tout au service de la sécurité des Français : voilà ce que votera le groupe socialiste, écologiste et républicain !
M. Éric Ciotti. Si nous participons à cette réunion exceptionnelle, c’est parce que notre pays a subi, jeudi soir, jour de notre fête nationale, un nouvel attentat qui prolonge la longue série tragique que notre pays connaît depuis le 7 janvier 2015. Nous abordons donc ce débat avec gravité, conscients du devoir qui nous incombe de mieux protéger nos concitoyens. De fait, nous sommes réunis aujourd’hui – et nous devons pouvoir, me semble-t-il, partager ce constat – parce que certains dispositifs ont échoué et que d’autres n’ont pas fonctionné. Loin de moi, qui ai vécu cette nuit tragique dont les images resteront à jamais gravées dans ma mémoire, l’idée de faire un procès à quiconque mais, depuis le 7 janvier 2015, nous avons perdu quasiment toutes les batailles de cette guerre que vous et le Premier ministre avez légitimement évoquée, monsieur le ministre de l’Intérieur. Or, cette guerre, nous avons le devoir de la gagner.
Vous nous proposez aujourd’hui de proroger l’état d’urgence, comme je l’avais réclamé lors de l’examen des trois projets de loi précédents. Je n’aurai pas la cruauté de rappeler que, le 14 juillet dernier, à treize heures, le Président de la République avait annoncé dans son intervention télévisée qu’il ne demanderait pas cette prorogation au Parlement. Force est donc de reconnaître que nous sommes là parce qu’un événement tragique s’est produit. Nous vous l’avons souvent reproché, nous sommes face à un manque d’anticipation, alors que nous avons un devoir de vigilance.
Le triptyque qui fait se succéder d’abord l’émotion, ensuite la réaction, la communication, enfin la banalisation à mesure que le temps nous éloigne de la tragédie, n’est plus opportun.
Voici les principes qui nous guideront lors de l’examen des amendements.
Nous voulons que la prorogation de l’état d’urgence, dont nous souhaitons qu’elle soit prononcée pour une durée d’un an, soit efficace et utile. Nous aborderons ce projet de loi avec responsabilité, comme nous en avons le devoir, comme nous l’avons toujours fait. Il s’agit, monsieur le ministre, du dixième texte de lutte contre le terrorisme que nous examinons au cours de cette législature ; pour ma part, avec l’immense majorité de mes collègues du groupe Les Républicains, j’ai voté tous les textes précédents, quelquefois alors même que votre propre majorité y était hostile. Nous avons pris nos responsabilités ; nous avons été au rendez-vous de l’unité nationale. Mais, pour nous, l’unité nationale ne signifiera jamais l’inefficacité nationale.
Nous devons changer de cadre, car la guerre nécessite des moyens particuliers. Il nous faut réarmer notre pays, du point de vue juridique – en renonçant à certaines contraintes qui entravent notre capacité de protection –, budgétaire, matériel, humain et moral.
Nous souhaitons aller plus loin que ce que vous proposez à l’article premier, pour rendre l’état d’urgence plus utile, notamment grâce à des dispositions qui accroîtront l’efficacité de nos forces de l’ordre. Je veux leur rendre hommage, témoigner du courage exemplaire des policiers qui, à Nice comme sur tout le territoire national, ont fait preuve du sens du devoir qui les anime. Si la sécurité publique, si la police nationale n’était pas intervenue à Nice, il aurait pu y avoir plusieurs centaines de morts supplémentaires. Je tiens à exprimer à ces agents ma plus profonde reconnaissance. Nous avons aussi le devoir de protéger ceux qui nous protègent.
Tel est l’état d’esprit de notre groupe au seuil de ce débat d’une extrême gravité.
M. Alain Tourret. Je m’exprimerai au nom du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste.
La France est au bord de la crise de nerfs. Le Président de la République a revendiqué le 14 juillet le statut de protecteur des Français. Or proposer la suppression de l’état d’urgence quelques heures avant le massacre de Nice était, au mieux, une erreur de tempo.
Aux victimes, je veux rendre ici un hommage appuyé. Mais après l’attentat de Charlie Hebdo, qui a réuni toute la France et des dizaines de chefs d’État, après celui du Bataclan et les premières fêlures de l’unanimité citoyenne et politique, on a vu à Nice l’éclatement du consensus républicain, en direct, à la télévision. MM. Christian Estrosi et Alain Juppé, puis M. Nicolas Sarkozy ont tiré au canon sur le rassemblement des Français proposé par le chef de l’État et l’ont fait exploser. Ils soutiennent que les Français veulent des résultats.
Ils n’ont pas tort : les Français veulent autre chose que des chambres mortuaires, des bougies, des fleurs. Ils veulent être assurés qu’ils pourront se rendre sans risque, en famille, à telle ou telle manifestation, tel ou tel rassemblement. Mais, aujourd’hui, la France a peur. Elle a peur d’elle-même. Elle a peur de la communauté musulmane : pour la première fois, on entend de manière répétée des phrases de rupture, du genre « tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans ». Le risque d’explosion sociale est grand ; il ne fait que grandir.
Faut-il donc se limiter à approuver un projet de loi qui prolonge l’état d’urgence ? Ne doit-on pas étudier le bien-fondé des amendements de l’opposition, quel qu’en soit le risque constitutionnel ? Le Gouvernement propose de prolonger l’état d’urgence pour une durée de trois mois, sans référence à d’éventuelles manifestations sportives, culturelles ou autres. Trois mois, cela paraît un minimum ; notre rapporteur a parlé de six mois : pourquoi pas ?
Quant aux autres mesures – le sort des fichés S, leur éventuelle expulsion, leur éventuel internement ; les centres de déradicalisation ; l’isolement des terroristes condamnés ; l’urgence d’un vrai service de renseignement pénitentiaire ; l’imbroglio de la double peine ; la création d’une agence nationale du renseignement ; la fermeture des mosquées radicales ; le renforcement des forces de sécurité –, chacune mérite une réflexion sérieuse. Certaines sont contraires aux principes mêmes de la République. D’autres sont parfaitement recevables. Plusieurs ont d’ailleurs été introduites sur le conseil du ministre de l’Intérieur.
De même, comme l’a fort justement dit M. Éric Ciotti, on ne peut parler d’état de guerre sans envisager sa conséquence même : la mobilisation des Français, qui passe par la création d’un service obligatoire pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, hommes et femmes. Il s’agirait d’un véritable service rendu à la nation, d’un service à la fois armé et civique qui redonnerait du sens aux idées d’unité nationale, de patriotisme, et soulagerait nos forces armées.
Il ne convient plus d’attendre : il faut étancher la soif de sécurité des Français, faute de quoi le consensus social et politique explosera pour de bon. Et il faut le faire en respectant les fondements mêmes de la République. Prenons garde, mes chers collègues : si nous n’assurons pas la protection des Français, ces derniers se réuniront en dehors même du rassemblement républicain pour l’exiger. La France, disais-je, est à bout de nerfs : nous devons, ensemble et avec le chef de l’État, agir en profondeur pour rassurer les Français et assurer la paix publique.
M. Jean-Christophe Lagarde. La France vient à nouveau de subir un traumatisme qui bouleverse les Français, suscitant leur émotion mais aussi leur colère.
Afin que l’on ne se méprenne pas sur le sens de mes propos, je tiens à rappeler que, depuis trois ans – je songe particulièrement au début de l’intervention française, justifiée, au Mali –, le groupe de l’Union des démocrates et indépendants a soutenu toutes nos interventions extérieures et tous les textes qui, à l’intérieur, visaient à lutter contre les terroristes.
En ce qui concerne l’état d’urgence, nous avons estimé, lorsque le chef de l’État l’a décrété, puis lorsqu’il a demandé sa prolongation après les attentats du 13 novembre, qu’il était utile pour – n’ayons pas peur des mots – « donner un coup de pied dans la fourmilière », comme vient en substance de le rappeler le ministre de l’Intérieur.
Avec les quelque 3 200 perquisitions administratives conduites dans un premier temps, puis celles – à peine 250 – qui ont été menées après la prorogation, on a vu que la mesure avait produit les résultats voulus et qu’elle n’était plus nécessaire. C’est la raison pour laquelle, lors de la troisième prolongation de l’état d’urgence, le Gouvernement n’a pas souhaité se donner le droit de poursuivre les perquisitions administratives – un droit exceptionnel, exorbitant, qui nous avait semblé requis dans le cadre de la menace terroriste. Aujourd’hui, il nous demande à nouveau de l’y autoriser ; il demande, près de neuf mois après la première, une nouvelle prolongation de l’état d’urgence.
Quant aux assignations à résidence, nous avons dit, dès le mois de novembre, qu’il faudrait s’interroger sur ce qu’il adviendrait des assignés après la levée de l’état d’urgence – laquelle arrivera bien un jour – et mettre à profit le temps qui nous séparait de l’été pour adapter notre arsenal législatif à la menace et à la guerre que nous devons livrer à cette nouvelle barbarie, à ce terrorisme inédit. Or, pour les 79 assignés à résidence restants, le problème reste entier dans l’hypothèse d’une levée de l’état d’urgence, car notre législation n’a pas été modifiée. Nous avions proposé que, dans le cadre strict de la lutte contre le terrorisme, lorsque des individus semblent présenter un danger suffisant pour que, au titre de l’état d’urgence, on les assigne à résidence, il soit possible de continuer de les surveiller activement en dehors de l’état d’urgence, au besoin par le port d’un bracelet électronique et la limitation de leur capacité de communication, notamment électronique.
Mais voici ce que l’on nous propose à la suite d’un traumatisme, d’un drame, sous le coup de l’émotion que nous inspire à tous le sort des victimes, de leur famille, ainsi que l’héroïsme de nos forces de l’ordre – je songe en particulier aux policiers que l’on a vu à la télévision arrêter le fou au volant de son camion. Avant même l’enquête, dès le soir du drame, le chef de l’État annonce qu’il va demander la prorogation de l’état d’urgence. Je m’interroge sur l’utilité et la nécessité de cette mesure.
Au mois de novembre, c’est un groupe organisé, structuré, venu pour partie de France, pour partie de l’étranger, qui a commis un attentat programmé. Mais aujourd’hui ? J’ai fort peu goûté – pour ne pas dire que j’ai partagé le dégoût qu’elles ont inspiré à nos concitoyens – les polémiques nées au cours du week-end, de part et d’autre.
Mme Pascale Crozon. Non ! Pas de part et d’autre !
M. Jean-Christophe Lagarde. Alors que les morts étaient encore chauds, alors que l’on ne savait rien de l’enquête jusqu’à la conférence de presse de M. François Molins, chacun, qu’il appartienne à la majorité ou à l’opposition, y est allé de sa conclusion. Personnellement, je me refuse à toute conclusion. J’observe simplement que celui qui est à l’origine de cette demande de prolongation de l’état d’urgence – puisque, la veille encore, le Président de la République en annonçait la fin pour le 26 juillet –, celui qui est à l’origine du drame de Nice ne présente a priori aucun signe de connexion avec des réseaux de radicalisation. C’est ce que semble indiquer l’enquête judiciaire, confirmée sur ce point par les éléments recueillis par le ministère de l’Intérieur.
L’état d’urgence pouvait-il donc empêcher ce drame ? L’a-t-il pu ? Non !
M. Éric Ciotti. On n’en sait rien ! On ne connaît pas les résultats de l’enquête !
M. Jean-Christophe Lagarde. Laissez-moi terminer, je vous prie. La réponse est non à ce jour, au moment où l’on nous demande de prolonger l’état d’urgence – certains pour trois mois, d’autres pour un an. Cette demande est-elle la bonne réaction à la situation – à l’attentat de Nice comme à la guerre qui nous est faite et dont je ne suis pas sûr qu’elle lui soit liée ? Peut-on, malgré la revendication, rattacher à Daech quelqu’un dont la sexualité, telle que la révèle l’enquête, ne paraît pas tout à fait conforme à l’image du chevalier djihadiste que Daech veut vendre à nos jeunes Occidentaux, un consommateur d’alcool, de porc ? Je suis d’ailleurs prêt à parier que l’organisation n’aurait jamais revendiqué l’attentat si elle avait connu ces informations auparavant. D’après les éléments d’enquête qui nous parviennent petit à petit, on est plutôt tenté de comparer le drame à celui de la Germanwings, dû à un homme instable, souffrant de troubles psychologiques, qui, plutôt que de mourir seul, veut faire parler de lui au moment de sa mort. Peut-être le djihadisme a-t-il ici servi de prétexte ; encore l’homme n’a-t-il rien revendiqué lui-même. Quoi qu’il en soit, est-ce par l’état d’urgence que l’on doit réagir à cela ?
À moins que vous ne disposiez, monsieur le ministre, d’informations établissant clairement que des réseaux islamistes organisés ont programmé cet attentat – mais on nous parle d’un homme seul, sans soutien logistique –, auquel cas il faut nous les donner, pour éclairer le vote de la représentation nationale. Sinon, l’état d’urgence ne me paraît ni nécessaire ni efficace, seulement symbolique.
Assurément, les symboles comptent. Mais ne va-t-on pas user le symbole quand, dans six mois ou dans trois mois, se reposera la question de la levée de l’état d’urgence ? Dans trois mois, peu avant l’anniversaire du 13 novembre, comment lever l’état d’urgence ? Et comment le lever dans six mois, soit quatre mois avant l’élection présidentielle, lorsque la campagne battra son plein ? Comment lever l’état d’urgence, telle est la question que plusieurs d’entre nous ont posée dès le début.
Je le répète, monsieur le ministre : nous avons soutenu l’état d’urgence, car il était nécessaire. Mais, aujourd’hui, sa nécessité nous laisse pour le moins dubitatifs. En revanche, il importe, comme l’a dit M. Alain Tourret, de faire comprendre aux Français – cela dépend en grande partie de l’exécutif, mais aussi de la majorité comme de l’opposition – que le risque zéro n’existe pas lorsque l’on est en guerre, que l’on ne peut pas vivre en temps de guerre comme en temps de paix. En temps de guerre, on a besoin de mobiliser la population, on doit accepter certaines contraintes.
Permettez-moi de vous faire part d’une anecdote. Ce que je vais raconter n’est pas seulement de votre fait, monsieur le ministre, mais s’explique également par le manque de mobilisation des Français, auxquels nous ne faisons pas suffisamment comprendre la guerre que nous livrons là-bas et qu’on nous livre ici. Il y a eu dans le Thalys un attentat qui a fort heureusement échoué, grâce à l’intervention de quatre héros américains. Désormais, le Thalys fait donc l’objet d’une surveillance particulière pour éviter que l’on n’y embarque avec une arme : on n’y monte pas sans passer par des portiques de sécurité ; il faut donc arriver un peu plus tôt, faire la queue, etc. On est d’ailleurs fondé à se demander pourquoi, dans la même gare – la gare du Nord –, on peut prendre le TGV pour Lille sans être soumis aux mêmes mesures de précaution. Mais, surtout, j’ai constaté, en prenant le Thalys au moment du sommet européen, que 40 % des voyageurs passaient à côté des portiques sans que personne leur dise rien !
Je n’en fais grief ni au Gouvernement – ce serait ridicule –, ni au personnel qui était présent, ni même aux usagers qui, excédés, finissaient par passer. Je veux simplement montrer par là qu’en temps de guerre, on doit se placer, si je puis dire, en situation de guerre. Il faut mobiliser la population, lui en expliquer les raisons ainsi que les précautions que nous sommes amenés à prendre, et ce au-delà du temps de l’émotion, du deuil, des quelques jours qui suivent un attentat.
Nous avons aussi besoin de les mobiliser dans la défense nationale. Je suis toujours frappé par ces Français qui, au lendemain de l’attentat, vont donner leur sang ou demander à prendre des cours de secourisme – bref, qui veulent participer à l’unité nationale dont on parle tant. Et en matière politique, je préfère d’ailleurs parler de cohésion nationale que d’union nationale, la première permettant d’avoir des objectifs communs sans interdire le débat comme la seconde. Ces Français sont prêts à participer. Nous avions proposé, il y a un an et demi, la constitution d’une garde nationale – ce qui n’est pas la même chose que la réserve citoyenne. Mais ceux qui ont voulu participer à cette réserve au sein de l’éducation nationale, ceux qui ont voulu le faire au sein de l’armée ou des forces de police, ont-ils reçu une réponse ? Je vous le dirai pour ce qui concerne l’éducation nationale – tout aussi nécessaire que les forces de police pour pouvoir résister à cette guerre avant tout idéologique : l’idéologie nihiliste qui nous agresse doit aussi être combattue par les idées, l’éducation et la culture. Quand on est volontaire pour l’éducation nationale, dans la réserve citoyenne – soi-disant constituée, annoncée et affichée –, on ne reçoit pas de réponse de l’État – pas du Gouvernement : de l’État. « Non, nous n’avons pas mis notre pays en guerre », s’entend-on dire, alors que nous sommes bel et bien en guerre.
Ce que je demande, ce n’est donc pas la prolongation de l’état d’urgence, mais la mobilisation de l’exécutif, de la majorité, de l’opposition et de l’ensemble de nos institutions pour que nous mettions notre pays en guerre, faute de quoi la division éclatera, la guerre civile – qui est l’objectif de nos ennemis – finira par l’emporter et la France perdra. Et nous n’avons ni le droit ni les moyens, normalement, de perdre un tel combat.
M. Jean-Frédéric Poisson. Le 23 janvier dernier, ici-même, avec le président Jean-Jacques Urvoas, nous faisions le premier rapport sur le contrôle de la mise en œuvre de l’état d’urgence – rapport dont nous avait chargé notre commission au début du mois de décembre. Nous étions d’accord à la fois sur les constats et sur le fait que l’efficacité de l’état d’urgence déclinait – dès cette période. Monsieur le ministre, vous avez rappelé tout à l’heure que l’immense majorité des actes pris sous ce régime l’avaient été au tout début de la mise en place de ce dispositif. C’est ce que nous n’avons cessé de constater depuis que la commission des Lois procède à ce contrôle. À la suite de ces constats puis des différents comptes rendus qui ont été présentés devant nous, j’ai voté contre la prolongation de l’état d’urgence en février comme en mai. Et, de la même façon, je voterai contre la prolongation qui est demandée aujourd’hui par le Gouvernement – pour trois motifs.
Premièrement, l’état d’urgence, dans le dispositif qui nous est proposé, ne peut pas constituer une réponse adaptée à la nouvelle forme d’attentats qui, avec toute l’atrocité qu’on connaît, a frappé la ville de Nice la semaine dernière. En effet, je rendrai demain au président de l’Assemblée nationale, avec M. Kader Arif, le rapport de la commission d’enquête sur les moyens de Daech, qui nous a demandé quelques mois de travail. Nous voyons bien évoluer – j’ai peine à le dire devant le ministre de l’Intérieur – le terrorisme qui nous attaque. L’état d’urgence est justifié quand il faut affaiblir des réseaux, quand on connaît les lieux à perquisitionner – ou qu’ils sont sous surveillance – et quand les gens sont repérés. L’état d’urgence est impuissant devant les nouvelles menaces isolées qui nous frappent et qui ont fait tant de victimes la semaine dernière.
Deuxièmement, il y a une contradiction, bien que vous l’ayez niée, monsieur le ministre. Soit les dispositions de la nouvelle loi pénale adoptée par le Parlement au printemps dernier nous permettent de nous passer de l’état d’urgence, soit elles ne nous le permettent pas. Si le chef de l’État déclare qu’il met fin à l’état d’urgence ou qu’il ne le prolongera pas parce que nous disposons de tout l’arsenal législatif nécessaire, croyons-le, et faisons en sorte que le Parlement ne soit pas sollicité sur le sujet.
Troisièmement, il me semble que les Français attendent autre chose que de simples dispositions législatives, depuis plusieurs mois maintenant. Cela a été rappelé par MM. Alain Tourret et Jean-Christophe Lagarde, notamment. Nous attendons des mesures de fermeté contre l’islamisme radical, des mesures dans les prisons, dans les fausses écoles coraniques et dans les mosquées clandestines. Nous attendons l’expulsion des personnes qui propagent des messages de haine. Rien de tout cela ne vient. Cette nouvelle forme de propagande qui passe largement par les réseaux sociaux fait certainement de la communication notre premier adversaire. L’état d’urgence n’y changera rien non plus.
En conséquence, pour ces motifs comme pour d’autres que j’aurai l’occasion de préciser en séance publique ce soir, je ne voterai pas – pas plus que les deux fois précédentes – la prolongation de l’état d’urgence.
M. Patrick Mennucci. Chacun comprend le niveau d’inquiétude du pays. Notre commission doit se hisser à la hauteur de l’angoisse qui étreint le cœur de nos compatriotes. Je soutiens sans réserve la proposition du Gouvernement de prolonger l’état d’urgence, en autorisant à nouveau les perquisitions administratives ainsi que la saisie de données informatiques.
Mais nous sommes là aussi pour éclairer le pays sur les moyens susceptibles d’améliorer notre capacité opérationnelle de recherche et de mise hors d’état de nuire des terroristes – que ces derniers soient organisés par un centre décisionnel ou qu’ils agissent de façon individuelle comme le tueur de Nice. Nous avons déposé des amendements qui devraient permettre d’éclairer le pays sur les solutions possibles.
Depuis la nuit du 14 au 15 juillet, nous assistons à un concours Lépine d’affirmations martiales, plus péremptoires les unes que les autres, comme si ceux qui les prononçaient avaient la solution pour régler cette situation. C’est pourquoi il me paraîtrait normal que certains de nos collègues ici présents s’expliquent sur des positions qui ont été prises. Un candidat à la présidence de la République nous dit que, s’il avait été à la place du Gouvernement, les choses se seraient passées différemment : je n’ai toujours pas compris s’il a la solution ou non, mais s’il l’a effectivement, il me semble nécessaire aujourd’hui qu’il la mette sur la table dans l’intérêt du pays. Tel autre candidat à la présidence de la République, qui a supprimé, lorsqu’il occupait déjà cette fonction, 12 469 postes de policiers et gendarmes ainsi que 1 000 postes de douaniers, et liquidé les renseignements généraux et la police de proximité, nous explique aujourd’hui que lui sait comment faire ! Je ne parlerai pas du premier adjoint au maire de Nice pour ne pas gêner notre collègue Éric Ciotti... Je ne partage pas tout ce qu’a dit ce dernier, mais je l’ai entendu défendre des positions plus réfléchies que celles qu’on a entendues sur la Promenade des Anglais ces derniers temps dans la bouche du premier adjoint précité. Il me paraît quand même nécessaire de dire que l’état d’urgence est indispensable. Mais oui, M. Jean-Christophe Lagarde a raison : nous devons aussi mobiliser la société.
Il me paraît essentiel de réexpliquer à nos concitoyens ce qu’est Daech : ce n’est pas une structure de l’islam radical. Daech est une secte millénariste qui pousse un certain nombre d’individus à des dérives. M. Jean-Christophe Lagarde commet une erreur : ce n’est pas parce que le terroriste a été un alcoolique, un fêtard ou que sais-je encore que son acte ne peut pas être revendiqué par Daech. C’est justement parce qu’il a été cela que Daech lui promet la capacité de se réformer. Il ne faut pas se tromper sur ce point.
Enfin, nous devrions essayer de regarder l’exemple de ce qui s’est passé en Algérie pendant la période noire. Je ne compare évidemment pas notre situation à celle d’un pays qui a subi 200 000 morts, mais rappelons-nous la façon dont la société algérienne a su isoler le Groupe islamique armé (GIA) et le terrorisme. Tout n’est pas comparable, car nous ne partageons pas la même culture, mais nous devrions aussi appeler nos concitoyens à faire en sorte que la lutte contre Daech soit la lutte de chacun d’entre nous et pas seulement celle du Gouvernement et de l’État.
M. Jacques Bompard. Quatre-vingt-quatre personnes assassinées à Nice. Un couple de policiers froidement tué. Aujourd’hui, une mère et ses trois enfants poignardés. Hier, en Allemagne, une attaque à la hache dans un train. À côté de Perpignan, un attentat déjoué contre un gradé militaire. Tout cela s’est déroulé au cours de la dernière semaine. Et je ne reviens pas volontairement sur toutes les attaques qui ont endeuillé notre pays. Je reviendrai en revanche sur une information révélée par la commission d’enquête de notre assemblée, mais occultée par les médias. Au Bataclan, certaines victimes ont été éviscérées …
M. Sébastien Pietrasanta. C’est faux !
M. Jacques Bompard. … ont subi des « sourires kabyles » et des émasculations.
Cette barbarie a un nom et une source. Elle est systématiquement commise par les mêmes profils, en lien avec des réseaux islamistes notoires. Dans le même temps, les services de l’État font tout pour tenter de rassurer la population. Mais ce que nous devrions plutôt chercher à faire, c’est lutter contre la sidération de nos concitoyens – une sidération qui est un danger pour la nation. Quand les Français ne s’aiment pas, quand les Français n’ont pas le droit de dire ce qui se passe, alors la crise est là et ne peut que s’amplifier. J’ai donc proposé une série d’amendements pour renforcer l’état d’urgence. Mais soyons clairs : l’immigration massive, l’islamisation exacerbée, le soutien de l’État à l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), le non-contrôle des financements étrangers : voilà ce qui doit changer. L’attitude de la France en Syrie, notre relation avec les djihadistes qui y agissent et notre comportement général au Proche-Orient doivent faire l’objet d’un débat national et d’une œuvre de transparence. Je rappelle que le gouvernement syrien affirme que nous avons refusé ses informations pour lutter contre le terrorisme. Si tel est le cas, la responsabilité du Gouvernement est engagée, au moins devant l’Histoire.
Pour conclure, vous nous dites que nous sommes en guerre. Comment peut-on mettre en adéquation la guerre et le respect de l’état de droit ? Vous nous dites que l’argument massif pour lutter contre le terrorisme est l’assignation à résidence. Or, cette dernière n’empêche pas le terroriste potentiel de continuer ses actions ni de devenir un terroriste efficace. Enfin, comment peut-on trouver des solutions si l’on refuse de faire une analyse objective complète, en dehors de l’idéologie totalitaire dominante ? Certaines réactions à mon discours illustrent bien que cette idéologie nous empêche de réfléchir.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Devant les horribles événements de Nice qui nous ont tous meurtris, je vois mal comment nous pourrions ne pas voter la prolongation de l’état d’urgence, dans la mesure où elle est demandée par des autorités qui ont su à la fois garder leur sang-froid et répondre aux différents impératifs de sécurité auxquels nous sommes confrontés. Sans doute l’état d’urgence ne sert-il pas à grand-chose, mais quand bien même il ne servirait qu’à la marge – je pense aux assignations et aux perquisitions –, nous ne pouvons pas le refuser au Gouvernement qui en a exposé rationnellement les besoins.
Prolonger l’état d’urgence, c’est pour nous, parlementaires, l’occasion d’envoyer un signal à nos concitoyens. Les symboles, la rhétorique ont d’autant plus de poids dans la période que nous vivons.
Si l’état d’urgence, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, n’est pas la réponse unique – pas même la principale, ajouterai-je –, la question essentielle est celle des moyens. Elle a été évoquée par plusieurs de nos collègues dont les interventions, à l’exception d’une, la dernière, étaient d’une tenue digne de notre commission. Je ne reviendrai pas sur la création de nouveaux postes. Je ne reviendrai pas non plus sur la très fâcheuse suppression par M. Nicolas Sarkozy de la police de proximité, qui nous a fait perdre dix ans dans le fonctionnement des services de renseignement, dix ans aussi dans l’encadrement intelligent de certaines populations dont l’intégration peut poser problème même si elles ne sont pas les seules dans ce cas. La même remarque vaut pour le renseignement territorial dont les moyens ont été ponctionnés, non par volonté philosophique cette fois-ci, mais pour être affectés à la direction générale de la sécurité intérieure.
Au-delà de l’état d’urgence, nous devons faire preuve de sang-froid et réfléchir à ce qui va naître demain : des grands projets collectifs dont notre nation tout entière rassemblée a besoin. M. Lagarde a évoqué tout à l’heure la constitution d’une garde nationale ; pour ma part, j’ai lancé un appel au Président de la République afin de recréer un service national obligatoire, à la mesure des enjeux du XXIe siècle. Fondé sur l’apprentissage des armes mais aussi sur la protection civile et l’humanitaire, il permettrait de former les jeunes gens qui recherchent des règles comme ceux qui n’en recherchent pas, et que l’on trouve dans tous les milieux – mais c’est une autre question.
Je terminerai en vous précisant que j’approuve la proposition du rapporteur de porter la prolongation de l’état d’urgence de trois mois à six mois. Ce délai a un sens : il nous mène jusqu’aux fêtes de fin d’année.
J’ai deux questions, monsieur le ministre.
D’une part, j’aimerais savoir à quoi correspond la perquisition dans un autre lieu qui remplirait les conditions fixées au premier alinéa. Avez-vous décidé de cette mesure en vous fondant sur des expériences vécues ?
D’autre part, je m’étonne que l’on passe par le juge des référés du tribunal administratif pour autoriser ou non l’exploitation des documents informatiques qui pourraient être saisis afin de prendre en compte la jurisprudence restrictive que le Conseil constitutionnel a établie en février dernier. Dieu sait que je ne suis pas de ceux qui pensent que le juge judiciaire a le monopole de la défense libertés publiques, mais il m’aurait semblé plus pertinent de passer plutôt par lui. Le Conseil d’Etat a estimé que ce dispositif était bon et je ne serai pas plus royaliste que le roi. Je m’interroge seulement sur les raisons de ce choix.
M. le président Dominique Raimbourg. Je constate qu’aucun des orateurs inscrits n’a respecté les règles relatives au temps de parole et quatre orateurs doivent encore s’exprimer – M. Valax, Mme Capdevielle, M. Morel-à-l’Huissier et M. Goujon. Il est ici de mon devoir de vous rappeler que des contraintes s’imposent à nous : nous pouvons difficilement achever nos travaux après vingt heures, car il serait alors matériellement impossible d’intégrer les amendements que nous avons adoptés dans le texte soumis à discussion en séance publique à vingt et une heures trente.
Si vous n’y voyez pas d’objection, chers collègues, je vais donc directement donner la parole à M. le ministre pour répondre aux orateurs qui se sont déjà exprimés, et laisser lors de la discussion des amendements plus de temps à ceux qui n’ont pu le faire.
M. le ministre. Je tiens à remercier les différents orateurs pour leur contribution au débat et pour leur volonté d’améliorer le projet de loi du Gouvernement.
Je m’attacherai d’abord à ce qui a motivé la décision du Président de la République de prolonger l’état d’urgence. Nous avons toujours affirmé que l’état d’urgence n’est pas un état de convenance politique, et qu’il ne s’impose pas dès lors que les conditions de droit qui président à sa mise en œuvre ne sont plus réunies. Or le tragique événement de Nice a placé notre pays dans la situation de péril imminent qui justifie l’état d’urgence. Compte tenu des risques de réplique et du fait qu’il peut être nécessaire de mettre en œuvre des décisions de police administrative pour contrer certaines tentatives, nous avons considéré qu’il était indispensable de proposer une prolongation.
Jean-Frédéric Poisson, Alain Tourret et Jean-Christophe Lagarde ont mis en avant des arguments selon lesquels l’état d’urgence ne se justifiait pas puisqu’il n’avait pu éviter l’événement de Nice. Un tel raisonnement n’est pas tenable. Nous sommes confrontés à une menace protéiforme qui recouvre de multiples cas : des individus s’étant radicalisés depuis longtemps et qui passent tout d’un coup à l’acte alors même qu’ils sont sous contrôle judiciaire – je vous renvoie à l’affaire de Magnanville ; des commandos disposant de faux documents et de moyens de communication cryptés, et arrivant dans notre pays pour le frapper le lendemain – c’est le cas des attentats du 13 novembre ; des individus dont les services de renseignements n’ont jamais entendu parler qui passent à l’acte après une radicalisation extrêmement rapide – c’est le cas de Nice.
L’état d’urgence ne saurait répondre à toutes ces situations. Toutefois, si sa prolongation permettait le démantèlement ne serait-ce que d’un seul réseau grâce à une perquisition administrative, elle se justifierait compte tenu de la complexité de la lutte anti-terroriste. Grâce aux perquisitions, nous avons déjà déjoué des attentats dans le centre de la France et à Montpellier. Nous disposons d’informations relatives à la porosité entre milieux délinquants et milieux terroristes. Forts de ces éléments, nous sommes en mesure de cerner le comportement atypique d’individus qui ne sont pas identifiés comme appartenant à la mouvance radicale, mais qui pourraient être tentés de passer à l’acte.
Le dispositif de l’état d’urgence n’est pas l’alpha et l’oméga de la lutte anti-terroriste. Nous devons traiter d’autres sujets : le rehaussement des moyens ; l’augmentation des crédits de fonctionnement ; l’articulation des services de renseignements entre eux ; la montée en puissance du renseignement territorial ; le développement des forces d’intervention spécialisées sur le territoire national ; le rééquipement des brigades anti-criminalité (BAC) de la police nationale et des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale (PSIG) ; l’articulation entre primo-arrivants, primo-intervenants et forces spécialisées ; l’articulation entre l’opération Sentinelle et les forces de police et de gendarmerie ; enfin, au niveau européen, l’interconnexion des fichiers et la mise en œuvre du contrôle aux frontières tel qu’il doit résulter de la modification de l’article 7-2 du code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen ».
La lutte anti-terroriste – le rapport de Sébastien Pietrasanta le montre bien – recouvre l’ensemble de ces outils que nous faisons monter en puissance afin de disposer d’une palette globale.
L’état d’urgence n’empêche pas les attentats, l’état d’urgence ne permet pas d’atteindre tous nos objectifs, mais ne pas accepter sa prolongation nous priverait d’un outil nécessaire dans la lutte anti-terroriste.
Jean-Frédéric Poisson, fidèle au raisonnement qu’il avait déjà tenu lorsqu’il s’était agi de prolonger une premier fois l’état d’urgence, souhaiterait davantage de mesures d’expulsion et de fermetures de mosquée, points abondamment évoqués par l’opposition ces derniers jours. Sachez que, dans le cadre de l’état d’urgence, nous avons procédé à la fermeture de dix lieux de culte radicalisés. Des instructions ont été données aux services de renseignement territorial et de renseignement intérieur. De ce point de vue, l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) fournit un outil extrêmement utile : il élabore la liste des lieux de culte où la pensée salafiste et la radicalisation religieuse se développent et il rassemble les éléments pour pouvoir en droit procéder à leur fermeture. Nous sommes déterminés à poursuivre notre action en ce sens, dans le respect du droit. De la même manière, nous avons procédé à l’expulsion de quatre-vingts prêcheurs de haine qui appelaient au terrorisme au cours des derniers mois. Avec le concours de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), nous instruisons tous les dossiers qui peuvent l’être dans la volonté de répondre à toutes les situations dans les délais les plus brefs.
M. Mennucci et Mme Bechtel ont avancé des propositions avec lesquels je suis en parfait accord.
La compétence du juge administratif pour autoriser l’exploitation des données informatiques, madame Bechtel, découle directement de la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 selon laquelle les perquisitions administratives ne peuvent que relever de la police administrative et donc du juge administratif.
Quant à la perquisition « par ricochet », mise en œuvre dans l’hypothèse où des éléments découverts pendant une perquisition révèlent l’existence d’un autre lieu fréquenté par la personne visée – pensons aux garages, aux lieux de stockage –, elle permet un assouplissement de la procédure : l’autorisation pourra désormais être donnée oralement ou par SMS afin que la deuxième perquisition puisse se faire dans la continuité immédiate de la première. Nous répondons à une demande très forte des forces de sécurité intérieure qui souhaitent éviter que le délai entre deux perquisitions ne soit mis à profit pour évacuer des éléments utiles aux enquêtes en cours.
M. le président Dominique Raimbourg. Merci, monsieur le ministre, d’avoir participé à cette discussion générale.
Après le départ du ministre de l’Intérieur, la Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.
Article 1er
Prorogation de l’état d’urgence
Cet article prolonge, pour trois mois supplémentaires, l’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 et déjà prorogé à trois reprises le 26 novembre 2015, le 26 février 2016 et le 26 mai 2016.
I. L’ÉTAT DU DROIT
La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (15) prévoit que l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire, soit en cas de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », soit en cas d’« événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».
Elle permet de déclarer l’état d’urgence par décret en Conseil des ministres depuis les modifications introduites par l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960. Conformément à son article 3, la prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par une loi. Cette loi fixe la durée définitive de son application.
Dès la déclaration de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur et les préfets se voient dotés de pouvoirs de police étendus, c’est-à-dire qu’ils peuvent décider de mesures qui seraient déclarées illégales en temps ordinaires. Onze mesures, individuelles ou de portée générale, sont énumérées par la loi du 3 avril 1955 modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (16).
Dans le contexte des attentats meurtriers du 13 novembre 2015, le Président de la République a déclaré l’état d’urgence sur le territoire métropolitain à compter du 14 novembre, à zéro heure, par le décret n° 2015-1475 du même jour. Un second décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015, pris dans des formes analogues, a étendu le périmètre de l’état d’urgence aux cinq départements d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Cet état d’urgence a été prorogé :
– jusqu’au 25 février 2016, à minuit, par la loi du 20 novembre 2015 qui a également procédé à l’actualisation du régime des mesures de la loi du 3 avril 1955 (17) ;
– jusqu’au 25 mai 2016, à minuit (18), par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
– et jusqu’au 25 juillet prochain, à minuit (19), par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016.
Reprenant les dispositions du décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, ces deux premiers textes avaient rendu expressément applicables certaines mesures de « l’état d’urgence aggravé » (20), en l’espèce les perquisitions administratives prévues au I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955.
La loi du 20 mai 2016, en revanche, ne comportait pas de mention expresse. Cette rédaction aboutissait à suspendre toute nouvelle perquisition administrative à compter du 26 mai 2016 à zéro heure. La faculté de recourir aux perquisitions judiciaires, dans les conditions de droit commun, n’avait évidemment pas été remise en cause.
II. LE DROIT PROPOSÉ
Le présent article reprend la formulation désormais classique, en trois points, fixant l’étendue de la prorogation – périmètre géographique et durée –, les mesures autorisées et les modalités de cessation anticipée.
Les alinéas 1 à 3 (I) prorogent « l’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 (…) et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 (…) et prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (…), puis par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 (…), puis par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ». Comme votre rapporteur l’avait déjà souligné au mois de mai (21), rien ne s’oppose à des prorogations successives de l’état d’urgence, sans qu’il soit besoin d’un nouveau décret présidentiel. Le Conseil d’État l’avait rappelé dans son avis, rendu public, sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation : « si les conditions de fond de l’état d’urgence sont toujours remplies, une nouvelle prorogation par la loi sera possible. Il reviendra au Parlement d’en décider au cas par cas. »
L’alinéa 1 prévoit que la prorogation de l’état d’urgence prenne effet dès l’entrée en vigueur de la loi, alors que les précédentes lois de prorogation retenaient un point de départ fixe. Dans son avis du 18 juillet 2016, rendu public, le Conseil d’État a estimé justifiée l’entrée en vigueur immédiate de ces mesures qui incluent les perquisitions administratives, sans attendre le 26 juillet 2016
La durée de prorogation proposée – trois mois, soit jusqu’à la fin du mois d’octobre – est la même que celle des deux premières lois de prorogation, mais la loi du 20 mai 2016 avait retenu deux mois. Elle reste inférieure à celles de précédentes applications de l’état d’urgence, en 1955 ou en 1961.
L’alinéa 4 (II) mentionne expressément le I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 afin de permettre aux préfets d’ordonner des perquisitions administratives en tous lieux, de jour comme de nuit. Ces perquisitions seront à nouveau possibles dès l’entrée en vigueur de la loi, et le régime applicable tiendra compte des modifications introduites.
Enfin, l’alinéa 5 (III) poursuit la pratique inaugurée par la loi de prorogation du 18 novembre 2005 (22) et autorise l’exécutif à mettre fin à l’état d’urgence, de manière anticipée, par décret en Conseil des ministres à condition d’en rendre compte au Parlement.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre rapporteur rappelle la persistance de la menace terroriste illustrée tragiquement par l’attentat du 14 juillet à Nice. Il souligne les risques spécifiques liés à ce nouveau type d’attentat, n’impliquant pas d’armement sophistiqué et reposant, selon les premiers éléments de l’enquête judiciaire, sur une radicalisation très rapide de son auteur.
Le Conseil d’État a estimé que la situation présente caractérise un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » au sens de l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, compte tenu de l’attentat perpétré à Nice dans un contexte marqué par plusieurs tentatives d’attentats et une menace terroriste intense.
Les mesures autorisées par cette quatrième prorogation doivent permettre de recourir à des moyens adaptés, fondés en particulier sur les articles 6 et 11 de la loi du 3 avril 1955 permettant l’assignation à résidence de certains individus dangereux et des perquisitions administratives destinées à opérer des « levées de doutes ».
Votre Rapporteur rappelle également que l’entrée en vigueur des décrets d’application de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale doit permettre de doter les autorités administrative et judiciaire d’outils juridiques renforcés pour prévenir et réprimer le terrorisme, en s’appuyant davantage sur le droit commun que sur la légalité d’exception.
*
* *
La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL38 de M. Éric Ciotti, CL8 de M. Guillaume Larrivé, CL20 de M. Jacques Bompard, des amendements identiques CL65 du rapporteur, CL9 de M. Guillaume Larrivé, CL39 de M. Éric Straumann, CL42 de M. Éric Ciotti et CL92 de M. Christian Jacob, ainsi que de l’amendement CL40 de M. Jean-Christophe Lagarde.
M. Georges Fenech. Le ministre, à juste titre, a mis en avant l’excellence du rapport de Sébastien Pietrasanta.
Il a encore souligné que l’état d’urgence n’empêchera pas les attentats mais qu’il ne fallait pas se priver de cet outil. L’une des parties du rapport de la commission d’enquête est précisément intitulée : « L’état d’urgence, un apport à la lutte anti-terroriste utile mais limité ». Alors que toutes les auditions se sont tenues pendant l’état d’urgence, force est de constater qu’aucun des spécialistes de la lutte contre le terrorisme n’a évoqué les mesures prises dans ce cadre comme jouant un rôle particulier.
Le rapporteur nous a fait part de cette anecdote rapportée par M. Patrick Mairesse, directeur départemental de la sécurité publique dans l’Isère : « Dès le deuxième jour suivant l’instauration de l’état d’urgence, il est arrivé que nous soyons accueillis d’un : “ Enfin ! Je vous attendais…” C’est pour certains une question de standing ! Nous avons d’ailleurs trouvé chez un individu radicalisé un ordinateur dont l’entier contenu avait été vidé… à l’exception, dans l’historique, d’une recherche sur l’état d’urgence ! Et ce dès le dimanche soir ! »
Le nombre de six procédures relevant totalement ou partiellement d’une perquisition administrative et ayant eu un intérêt quelconque dans le domaine qui nous intéresse est à rapprocher de celui des 96 procédures ouvertes depuis le 14 novembre 2015 par la section antiterroriste sur une base exclusivement judiciaire, ce qui montre bien l’efficacité de celle-ci dans la lutte contre le terrorisme.
Si je n’ai évidemment rien contre l’idée que nous nous dotions d’un nouvel outil, j’ai été heureux d’entendre le ministre reconnaître que celui-ci avait ses limites, que nous avions déjà relevées dans notre rapport. Pour ma part, j’aurais préféré que nous mettions davantage de moyens dans l’institution judiciaire, le parquet antiterroriste, les juges antiterroristes, les juges d’application des peines en matière d’antiterrorisme – à l’heure actuelle, il n’y en a qu’un pour toute la France. Malheureusement, ce qui nous est proposé relève de l’affichage et marque la limite de l’action du Gouvernement dans la lutte contre le terrorisme.
M. Jean-Christophe Lagarde. J’ai fait part de mes doutes sur la mesure consistant à proroger l’état d’urgence, et j’entends la réponse du ministre sur ce point, en particulier l’argument selon lequel la prorogation se justifie à partir du moment où ne serait-ce qu’une perquisition administrative effectuée dans ce cadre se révèle fructueuse. Cela dit, personne ne peut dire de combien de temps l’état d’urgence doit être prolongé, car personne ne sait quand la guerre qui a commencé va s’arrêter : la question du délai est donc également celle de la méthode.
Au fond, peu importe ce qui sera proposé par le rapporteur et adopté par notre assemblée : si la méthode consistant à effectuer des perquisitions administratives est utile, ne serait-ce qu’une seule fois, ce n’est pas dans le cadre de l’état d’urgence justifié par la lutte antiterroriste que ce dispositif doit s’inscrire, mais dans le droit commun, afin que nous ne soyons pas obligés de nous demander sans cesse s’il faut proroger l’état d’urgence, au cas où il pourrait être utile.
Sans revenir sur ce que j’ai dit précédemment au sujet du symbole et de la nécessaire mobilisation nationale, j’insiste sur le fait que le choix d’un délai pose le problème de la méthode : ce qu’il pourrait être utile d’intégrer à notre droit pour lutter contre les terroristes qui nous font la guerre ne doit pas être rattaché exclusivement à l’état d’urgence, car cela nous oblige à maintenir un état d’urgence symbolique, presque artificiel.
M. Éric Ciotti. Je ne partage en rien l’argumentaire que vient de développer M. Lagarde, ni ce qu’il avait dit plus tôt. Il préjuge des résultats de l’enquête en cours en partant du principe que, sur les cinq personnes se trouvant en garde à vue à la sous-direction anti-terroriste (SDAT), aucune ne fait partie d’un réseau, aucune n’était surveillée ou n’aurait pu être détectée – or, seule l’enquête permettra de le dire.
Pour moi, la menace durera plusieurs années. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure, avait affirmé, au cours d’une audition en 2015, que la France était désormais sur « un long chemin tragique ». Entendu à nouveau il y a quelques semaines, il a précisé que la France était devenue la première cible au monde pour Daech : cela montre bien toute l’incongruité des propos tenus par le Président de la République le 14 juillet dernier, et le caractère irresponsable de la décision de l’exécutif de baisser la garde.
Plutôt que de limiter notre capacité d’agir à une période de trois mois, régulièrement renouvelée, donnons-nous les moyens d’agir sur le long terme. Si un nouvel attentat est commis en janvier, allons-nous légiférer à nouveau ? J’estime que nous devons prendre nos responsabilités en faisant en sorte de rendre pérennes les mesures de police administrative de l’état d’urgence, mais une telle décision implique de modifier notre Constitution, notamment pour y inclure des rétentions administratives de vingt-quatre heures. Pour cela, nous devons sortir de l’angélisme et d’un cadre juridique qui nous empêche de nous défendre – car nous sommes en guerre et pour faire la guerre, il faut des armes adaptées. Certes, c’est un autre débat, mais notre pays ne pourra en faire l’économie s’il entend combattre efficacement le terrorisme.
La durée de trois mois qui nous est aujourd’hui proposée par le Gouvernement ne me paraît pas du tout adaptée. Compte tenu de la triste expérience du 14 juillet, le Président de la République n’osera plus sortir de l’état d’urgence : plutôt que de renouveler ce dispositif tous les trois mois, assumons nos responsabilités en l’instaurant dès maintenant pour une durée d’un an.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL38.
M. Guillaume Larrivé. Je tiens à m’exprimer sur l’amendement CL8 en dépit du fait que la majorité semble considérer que tout est joué d’avance, car nous n’avons pas l’intention de faire de la figuration. Pour nous, l’état d’urgence a un sens sur le fond, mais également en termes de durée.
Si nous proposons d’allonger significativement la durée de l’état d’urgence, c’est aussi parce que la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence prévoit qu’il prend fin au moment de la démission du Gouvernement – ce qui implique qu’il tomberait en mai 2017 en cas de changement de gouvernement. Nous considérons qu’entre-temps, il est nécessaire de faire en sorte de ne perdre aucun des instruments juridiques que l’état d’urgence confère aux autorités. Gardons-nous de voter, par facilité, un délai très court qui nous amènerait inévitablement à nous poser la question d’une prolongation dans quelques semaines.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL8.
M. Jacques Bompard. Je considère, moi aussi, qu’il convient d’allonger de manière significative la durée de l’état d’urgence, pour deux raisons.
Premièrement, le terrorisme est le résultat, au moins partiel, d’un échec de l’intégration, sur lequel nous devons nous interroger. L’un des membres de la majorité, apparemment mieux renseigné que moi, a fait état de mes racines italiennes – si j’ai cette origine, j’en suis fier. Il fut un temps où il n’était nul besoin de mettre en œuvre une politique d’intégration : la France intégrait naturellement, tout simplement parce que les personnes qui arrivaient dans notre pays – qu’elles soient italiennes, polonaises, espagnoles ou portugaises – étaient heureuses de venir y travailler et de s’y intégrer : leur démarche était imprégnée d’un amour de l’identité et du patrimoine français. Il en va tout autrement aujourd’hui, où les gens issus de l’immigration ont souvent honte de la nationalité française, même quand ils la prennent. Face à ce phénomène, la France a une attitude coupable, qui se concrétise dans la politique de discrimination positive et ne peut que confirmer, aux yeux des populations concernées, qu’elle doit payer pour une faute commise autrefois. À mon sens, les conséquences d’une telle attitude ne peuvent être que dramatiques.
Deuxièmement, tout le monde s’accorde pour dire que la France est en guerre. C’est effectivement le cas, et j’ajouterai que cette guerre me fait penser à une autre, à savoir la guerre d’Algérie, que nous avons gagnée – ce dont nous ne serions peut-être plus capables dans le contexte de décomposition actuel. Il est essentiel que l’État se donne les moyens de mener une vraie guerre, s’il veut avoir une chance de la gagner – car faire la guerre est toujours terrible, mais ce l’est encore plus de la perdre.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL20.
M. le rapporteur. L’amendement CL65 vise à substituer, à la durée de trois mois proposée par le Gouvernement, une durée de six mois pour l’état d’urgence. Ceci permettra d’éviter de débattre de la même question dans trois mois, tout en préservant le principe selon lequel le Parlement est régulièrement amené à se prononcer à ce sujet. Par rapport à la proposition du Gouvernement et à celles qui viennent d’être faites par nos collègues, mon amendement me semble constituer une position d’équilibre et de sagesse.
M. Guillaume Larrivé. Nous voterons en faveur de cette proposition – le groupe Les Républicains a d’ailleurs présenté un amendement de repli identique –, mais j’insiste sur le fait que le débat sur l’état d’urgence ne saurait se résumer à une question de délai.
Les amendements identiques CL65, CL9, CL39, CL42 et CL92 sont adoptés. En conséquence, l’amendement 40 tombe. La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL25 de M. Jacques Bompard.
M. Jacques Bompard. L’état d’urgence montre bien que notre pays est en danger. Dans la mesure où c’est le Parlement qui vote l’état d’urgence, il me paraît logique et cohérent que ce soit lui qui y mette fin, et non que cette décision soit prise par décret en conseil des ministres, comme le prévoit l’alinéa 5 de l’article 1er. Tel est l’objet de mon amendement.
M. le rapporteur. Avis défavorable : le Parlement fixe une durée maximale, à laquelle le Gouvernement peut mettre fin par anticipation à tout moment, s’il l’estime justifié.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1ermodifié.
Article 2
(art. 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence)
Régime des perquisitions administratives
Le présent article modifie les dispositions de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relatives aux perquisitions administratives pouvant être ordonnées sur le fondement de l’état d’urgence : d’une part, il ouvre un droit de suite permettant de procéder à la perquisition d’un second lieu après une première opération et, d’autre part, il remédie à la censure constitutionnelle de la procédure de copie des données informatiques à l’occasion d’une telle perquisition.
I. L’ÉTAT DU DROIT
Dans le cadre de « l’état d’urgence aggravé », le I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit la possibilité pour le ministre de l’Intérieur, sur l’ensemble des zones où est appliqué l’état d’urgence, ou pour un préfet, sur tout ou partie de son département sous réserve que l’état d’urgence s’y applique, d’ordonner des perquisitions, de jour comme de nuit.
S’il existe, à côté des perquisitions strictement judiciaires, d’autres types de perquisitions – les perquisitions fiscales prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les visites domiciliaires douanières à l’article 64 du code des douanes mais également certaines procédures diligentées par l’Autorité des marchés financiers, par l’inspection du travail ou les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) – pouvant être demandées par l’autorité administrative, cette mesure d’exception a la particularité de ne pas requérir une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.
Au regard de la mise en cause de l’inviolabilité du domicile, les jurisprudences du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l’Homme (23) et de la Cour de justice de l’Union européenne (24) convergent pour encadrer les perquisitions ou visites domiciliaires de la manière suivante :
– si, lorsque le contrôle d’un juge est prévu, il constitue une garantie forte, son caractère préalable n’est pas requis ;
– d’autres garanties procédurales peuvent permettre de contrebalancer l’absence d’un contrôle préalable ;
– le contrôle du caractère suffisant de ces garanties est toutefois renforcé en l’absence d’un contrôle préalable ;
– cette appréciation s’opère au regard des pouvoirs dont dispose l’autorité qui procède aux perquisitions et du but poursuivi ;
– en toute hypothèse, les personnes visées doivent bénéficier de voies de recours appropriées.
À la lumière de ces principes, et dans le souci d’écarter tout risque d’inconstitutionnalité pour cause d’incompétence négative du législateur, l’article 4 de la loi du 20 novembre 2015 (25) a complété le régime juridique de ces perquisitions administratives ordonnées sur le fondement de l’état d’urgence, qui remontait à 1955, et a soumis celles-ci au contrôle du juge administratif.
Le premier alinéa du I de l’article 11 précise désormais que ces perquisitions ne peuvent être effectuées que « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », selon une expression identique à celle introduite à l’article 6 pour les assignations à résidence. Les modifications ont aussi eu pour but d’élargir à tous les types de lieux comme les foyers d’hébergement, les commerces ou les annexes à l’habitation, et pas seulement aux domiciles, la faculté d’ordonner des perquisitions, tout en excluant les locaux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, magistrats ou journalistes.
Reprenant le cadre de deux circulaires prises respectivement par le ministre de l’Intérieur (26) et le ministre de la Justice (27), le deuxième alinéa de ce I a imposé que la décision administrative précise le lieu et le moment de la perquisition et que le procureur de la République territorialement compétent en soit informé sans délai. La perquisition ne peut, de surcroît, être conduite qu’en présence d’un officier de police judiciaire ; elle doit se dérouler en présence de l’occupant ou, à défaut, du représentant de son choix ou de deux témoins comme cela est prévu, par exemple, par l’article 57 du code de procédure pénale. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis du 6 juillet 2016, les ordres de perquisition doivent être remis aux occupants du local visé et suffisamment motivés, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ils constituent des décisions administratives individuelles défavorables.
S’inscrivant dans le strict cadre de la police administrative, le troisième alinéa de ce I n’ouvre la faculté d’opérer des saisies à l’occasion d’une perquisition administrative qu’au seul officier de police judiciaire agissant en flagrance. Faute de prévoir des saisies administratives comme le Conseil d’État l’y avait pourtant encouragé (28), le Gouvernement a retenu dans la loi du 20 novembre 2015 la possibilité d’accéder, « par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial » et de procéder à la copie de ces données, sur le modèle des dispositions prévues à l’article 57-1 du code de procédure pénale applicables aux perquisitions judiciaires en flagrance ou en enquête préliminaire.
Alors qu’une seule perquisition administrative avait eu lieu en 2005 pendant toute la durée de l’état d’urgence, cette mesure a été largement utilisée depuis le 14 novembre 2015 : selon les données recueillies par la commission des Lois, dans le cadre du contrôle de l’état d’urgence qu’elle a mis en place, 3 594 perquisitions avaient été ordonnées, exclusivement par les préfets, au 25 mai 2016, dont près de la moitié au cours des douze premiers jours de l’état d’urgence.
Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a néanmoins déclaré contraires à la Constitution, dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 11, dans la rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015. Ce faisant, il a privé de base légale la copie de données informatiques, interdisant à la fois la captation à l’occasion de nouvelles perquisitions et l’exploitation des données déjà collectées qui ont dû être détruites.
Comme cela a été rappelé plus haut, l’impossibilité de procéder à des copies de données lors de nouvelles perquisitions administratives, parce qu’elle limitait l’intérêt opérationnel de cette mesure, a contribué à la décision du législateur de ne plus autoriser ces perquisitions à compter de la troisième loi de prorogation de l’état d’urgence.
II. LE DROIT PROPOSÉ
Le cadre juridique des perquisitions administratives ordonnées sur le fondement de l’état d’urgence fait l’objet d’aménagements portant sur deux points distincts.
A. LA POSSIBILITÉ DE PERQUISITIONS SUCCESSIVES
Les alinéas 2 et 3 du présent article créent, sous la forme d’un nouvel alinéa au I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, un « droit de suite » permettant aux policiers et gendarmes, lors d’une perquisition administrative ordonnée sur le fondement de l’état d’urgence, de se transporter dans un second lieu dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est également fréquenté par des personnes dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public.
Lors des auditions conduites par votre commission des Lois dans le cadre du contrôle parlementaire de l’état d’urgence (29), plusieurs responsables opérationnels avaient effectivement souligné l’intérêt à pouvoir utiliser les éléments trouvés chez un individu afin de « rebondir » sur une nouvelle adresse. Votre rapporteur souligne toutefois que le régime actuel n’interdisait pas d’enchaîner ainsi deux perquisitions administratives, sous réserve que l’autorité préfectorale délivre immédiatement un nouvel ordre de perquisition. Le souci d’une meilleure réactivité conduit ici à écarter l’obligation de motivation préalable de l’ordre de perquisition par une disposition législative expresse permettant de « régularis[er] en la forme dans les meilleurs délais ».
Au demeurant, des dispositions analogues figuraient à l’article 2 de l’avant-projet de loi d’application de l’article 36-1 de la Constitution, rendu public le 3 février 2016, que l’article 1er du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation visait à modifier.
B. LA CRÉATION D’UN RÉGIME DE SAISIE ADMINISTRATIVE DES DONNÉES ET MATÉRIELS INFORMATIQUES
Les alinéas 2 à 3, puis 6 à 12 remplacent les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel au mois de février par une procédure détaillée permettant, dans le cadre d’une perquisition administrative, la saisie des données et matériels informatiques découverts, sur autorisation a posteriori du juge administratif, assortie de garanties renforcées pour la personne concernée.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait assimilé à une saisie les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 permettant à l’autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d’accéder au cours de la perquisition (considérant n° 14).
Il avait relevé que « ni cette saisie ni l’exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l’occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s’y oppose et alors même qu’aucune infraction n’est constatée ; qu’au demeurant peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition » et estimé que « ce faisant, le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée ».
En conséquence, l’alinéa 7 détermine les modalités d’une saisie administrative des données et matériels informatiques. Cette procédure, sans équivalent dans notre droit, est applicable à la fois aux « données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal » et aux supports matériels de ces données, c’est-à-dire aux téléphones, tablettes, ordinateurs, périphériques de stockage, mais aussi à d’autres équipements comme des manettes de jeux vidéo dès lors que celles-ci permettent d’échanger des messages. Sont ainsi concernés tous les équipements trouvés sur les lieux de la perquisition, qu’ils appartiennent à la personne expressément visée par celle-ci ou à d’autres individus hébergés sur place ou simplement présents au même moment.
Le champ des données dont l’autorité administrative peut demander la saisie est limité, afin d’exclure « les éléments dépourvus de tout lien avec la menace » que représenterait la personne visée par la perquisition ; il s’agit ainsi d’éviter l’accès par les services de police à des « éléments intimes », dont le Conseil constitutionnel avait pointé les risques au regard du respect de la vie privé, alors même que la personne qui occupe les locaux n’a commis aucune infraction.
Deux modes de saisie sont prévus : d’une part, la simple copie des données et, d’autre part, lorsque celle-ci ne peut être réalisée sans allonger « le temps de la perquisition », la confiscation des matériels. Dans les deux cas, la saisie réalisée donne lieu à établissement d’un procès-verbal spécifique, conformément aux alinéas 2 et 3. Le contrôle parlementaire de l’état d’urgence avait effectivement mis en évidence la durée excessive de certaines perquisitions administratives causée par les délais nécessaires pour copier parfois plusieurs téraoctets de données. Il ne faudrait pas, cependant, que la rédaction puisse aboutir à une saisie systématique de l’ensemble des matériels, difficilement conciliable avec le droit de propriété et la liberté d’expression.
À rebours des procédures applicables aux perquisitions judiciaires ou aux autres formes de perquisitions administratives, qui font l’objet d’une autorisation préalable d’un magistrat dès lors qu’elles visent des lieux d’habitation, hors le cas particulier de la flagrance, le présent projet de loi exclut de soumettre les perquisitions administratives ordonnées dans le cadre exceptionnel de l’état d’urgence à un contrôle juridictionnel – judiciaire ou administratif – préalable dans la mesure où ni la jurisprudence constitutionnelle, ni celle de la Cour européenne des droits de l’homme ne l’exigent. Dès lors, l’alinéa 9 retient une solution inédite consistant à soumettre les saisies de données et de matériels informatiques, conduites en police administrative, au contrôle a posteriori du juge administratif tandis que les autres opérations de saisie, consécutives à la découverte d’une infraction, sont réalisées par un officier de police judiciaire qui en informe sans délai le procureur de la République.
Ce rôle est confié au juge des référés du tribunal administratif du lieu de la perquisition, solution préférable à la création d’un juge dédié, sur le modèle du juge de la liberté et de la détention judiciaire, et assurant une disponibilité permanente. Celui-ci ne statue pas sur la saisie elle-même, puisque celle-ci est déjà intervenue, mais il autorise ou non l’exploitation et la conservation des données et des matériels informatiques saisis. Il doit décider « au vu des éléments révélés par la perquisition », c’est-à-dire des procès-verbaux rédigés par les policiers et les gendarmes ayant réalisé la perquisition, et, s’il l’estime utile, des données et matériels saisis.
Le juge des référés est obligatoirement saisi par l’autorité administrative ayant ordonné la perquisition, en pratique le préfet, sans que la rédaction proposée ne précise le moment de cette saisine. Il statue dans un délai de quarante-huit heures. Votre rapporteur estime ce délai relativement long par comparaison avec les garanties dont le législateur a par exemple entouré la loi du 28 mars 2014 pour la mise en œuvre de dispositifs de géolocalisation (30). Comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi, dans l’intervalle, « l’autorité administrative ne peut exploiter les données concernées sans avoir obtenu l’autorisation préalable du juge des référés du tribunal administratif ».
La décision du juge administratif est rendue au terme d’une procédure contradictoire et d’une audience publique, puisque l’alinéa 12 du présent article renvoie « aux formes prévues par le livre V du code de la justice administrative », et plus particulièrement à son article L. 522-1. L’occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données dispose, pour défendre ses droits, de la faculté de faire appel devant le juge des référés du Conseil d’État de la décision rendue par le juge des référés du tribunal administratif, alors que cette possibilité n’existe pas pour les perquisitions judiciaires applicables à la criminalité organisée (article 706-92 du code de procédure pénale). Cet appel est suspensif, c’est-à-dire que l’exploitation des données sera interrompue, ce qui constitue là encore une garantie supplémentaire car tel n’est pas le cas de celui formé en matière de perquisitions administratives demandées par l’administration fiscale (II de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales).
L’alinéa 8 encadre le processus de copie des données ou de saisie des matériels informatiques. Il impose la présence de l’officier de police judiciaire, afin de garantir la régularité de la saisie en cas de découverte ultérieure d’infractions susceptibles de poursuites pénales. Un procès-verbal de saisie est dressé ; une copie est remise à l’occupant ou, à défaut, à son représentant ou à deux témoins, selon des modalités analogues à celles prévues à l’article 57 du code de procédure pénale.
Enfin, l’alinéa 10 précise les conditions de conservation des données et matériels. Celles-ci sont distinctes des règles applicables en matière de procédure pénale, c’est-à-dire des dispositions de l’article 55 du code de procédure pénale concernant notamment le placement sous scellés, qui demeurent applicables si une infraction est constatée.
La durée de conservation des données et des matériels informatiques est limitée au « temps strictement nécessaire à leur exploitation » : les matériels seront restitués au bout de quinze jours au maximum, le cas échéant après qu’une copie des données ait été réalisée, tandis que les données seront détruites après trois mois. L’alinéa 12 prévoit cependant la possibilité de saisir le juge des référés pour obtenir la prorogation de l’un et l’autre de ces délais pour la même durée en cas de difficultés techniques pour procéder à l’exploitation, dans les mêmes formes que celles prévues à l’alinéa 9. La rédaction proposée ne limite pas le nombre de prorogations qui peuvent être sollicitées.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre rapporteur souligne le souci du Gouvernement d’élaborer un dispositif comportant des garanties procédurales pour contrebalancer l’absence de contrôle préalable par le juge, afin d’assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés de l’occupant du lieu perquisitionné ou du propriétaire des données.
Il semblait effectivement nécessaire d’envisager une réécriture de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 sur les perquisitions administratives, en particulier après la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016. Toutefois, d’autres imperfections du régime des perquisitions administratives fixé par l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 auraient pu faire l’objet d’aménagements bienvenus, dans le cadre de la réécriture opérée par le projet de loi. Tel est le cas, par exemple, du maintien dans les lieux, éventuellement par la contrainte, de toute personne visée par une perquisition administrative.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL23 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. L’article 2 vient utilement rétablir le régime des perquisitions administratives, qui avait été très imprudemment supprimé par le Parlement lors de la précédente prolongation de l’état d’urgence. Nous allons présenter plusieurs amendements visant à répondre aux difficultés techniques que pose le rétablissement de ces perquisitions. Ainsi, la personne qui occupe le lieu faisant l’objet de la perquisition n’est pas tenue de rester pendant que celle-ci est effectuée : l’amendement CL23 a donc pour objet de prévoir que, « lorsque l’occupant ou son représentant est présent au début de la perquisition, il est tenu de ne pas quitter le lieu faisant l’objet de la perquisition, jusqu’à la fin de cette dernière ».
M. le rapporteur. Nonobstant ce que nous avions décidé à l’occasion de la dernière prorogation, je suis d’accord avec Guillaume Larrivé sur la nécessité de la présence de l’occupant lors de la perquisition. Cela dit, la rédaction de mon amendement CL66, que nous examinerons ultérieurement, me paraît plus adaptée. Je suggère donc à notre collègue de retirer son amendement, et émettrai à défaut un avis défavorable.
M. Alain Chrétien. L’article 2 vise à autoriser la saisie des matériels informatiques. Le 18 novembre 2015, cinq jours après les attentats perpétrés à Paris, j’avais demandé une telle mesure, mais je n’avais recueilli que dédain et mépris dans cette commission. « Cela ne constitue pas une demande des services », m’avait on rétorqué. J’ai persévéré et déposé une proposition de loi le 26 janvier 2016, mais l’on m’a opposé une même fin de non-recevoir, au prétexte d’inconstitutionnalité. Cet argument était certes juste (Exclamations parmi les députés du groupe Socialiste, écologiste et républicain), mais le Gouvernement n’a apporté aucune réponse au problème.
Nous sommes le 19 juillet 2016, et la rédaction qui nous est soumise aujourd’hui a sûrement été élaborée avant le 14 juillet dernier. Le Gouvernement a donc disposé de huit mois pour nous répondre et de six pour chercher une solution à la question constitutionnelle, mais il a fallu attendre le drame de Nice pour obtenir la saisie des matériels informatiques. Je n’émets là aucun jugement, mais rappelle implacablement les faits et le bilan du Gouvernement en la matière.
M. le rapporteur. Je ne souhaite pas engager de polémique, mais nous avons débattu d’un projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, qui prévoyait d’inscrire l’état d’urgence dans la Constitution. Plusieurs députés de votre groupe, monsieur Chrétien, avaient alors affirmé que cela ne servirait à rien, alors que cette inscription aurait permis de régler le problème.
M. Guillaume Larrivé. Je maintiens mon amendement.
M. Patrick Mennucci. Monsieur le rapporteur, quelle est la teneur de votre amendement ?
M. le rapporteur. Les objectifs poursuivis par mon amendement sont les mêmes que ceux de l’amendement de M. Larrivé, mais l’écriture juridique s’avère plus solide.
La Commission rejette l’amendement CL23.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL44 de M. Éric Straumann.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL1 du rapporteur.
Elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL26 de M. Jacques Bompard.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL85 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Dans les périodes extraordinaires, il importe de veiller à la forme, afin de garantir l’État de droit ; je m’avoue ainsi surpris de la rédaction de l’alinéa 5 de l’article 2, qui dispose que : « Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu remplit les conditions fixées au premier alinéa, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. »
L’expression « par tout moyen » me semble très contestable, car elle confond l’autorisation et sa transmission, celle-ci apportant la preuve de celle-là. Il y a lieu de modifier la rédaction sans changer la règle posée par cet alinéa. On peut aujourd’hui transmettre l’autorisation par mail et par SMS, moyens simples qui ne nuisent pas à la continuité des opérations de perquisition. Il convient donc de supprimer les mots « par tout moyen ».
M. le rapporteur. Monsieur Robiliard, je vous propose de retirer votre amendement, afin d’en étudier l’objet d’ici la séance, car vos arguments suscitent un doute dans mon esprit.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL31 de M. Jacques Bompard.
M. Jacques Bompard. Cet amendement vise à lancer un débat pour trouver une solution au problème posé par la décision n°2016-536 du 19 février 2016, dans laquelle le Conseil constitutionnel, répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), avait estimé que le législateur n’avait pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. Il a, par suite, jugé contraires à la Constitution les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. Nous sommes en guerre contre des terroristes qui ne respectent aucune loi, et nous nous laissons entraver par les lois « républicaines » qui, si elles s’avèrent belles et bonnes pour ceux qui les respectent, pèsent comme un fardeau pour lutter contre ceux qui les méprisent. Tant que l’on ne réglera pas cette question, on s’interdira de combattre efficacement le terrorisme.
M. le rapporteur. Monsieur Bompard, je vous invite à relire l’intégralité de l’article 2 et vous constaterez que l’objet de votre amendement est satisfait. Je vous demande donc de le retirer.
L’amendement est retiré.
Puis la Commission aborde l’amendement CL96 de M. Christian Jacob.
M. le rapporteur. Mon amendement CL70 poursuit le même objectif, et je suggère à ses auteurs de s’y rallier, pour des raisons rédactionnelles.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL21 de M. Jacques Bompard.
M. Jacques Bompard. L’alinéa 7 de l’article 2 a le défaut de ne pas rendre automatiques les saisies d’éléments, notamment informatiques, révélés par la perquisition et relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. Mon amendement vise à les rendre automatiques compte tenu des risques qu’une absence de saisie peut entraîner ; face à la menace terroriste, il est primordial que les services de l’État disposent du maximum d’informations, même si elles paraissent inutiles au moment de la perquisition. Personne ne peut affirmer qu’elles ne s’avéreront pas profitables, chaque détail pouvant compter dans les enquêtes.
M. le rapporteur. L’enfer est pavé de bonnes intentions, mon cher collègue ! Si une saisie informatique apparaît utile, le policier y procédera lors de la perquisition ; en revanche, si chaque perquisition donne lieu à la saisie de nombreux éléments sans intérêt, on engorgera les services qui devront les analyser. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement CL24 de M. Jacques Bompard.
M. Jacques Bompard. La présence d’un officier de police judiciaire (OPJ) est toujours souhaitable, mais les menaces pesant sur notre pays exigent des réactions rapides. Je propose donc qu’un OPJ assiste à la copie des données ou à la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux, « sauf si l’extrême urgence réclame une action plus rapide ».
M. le rapporteur. S’il n’y a pas d’OPJ, les infractions pénales ne pourront pas être poursuivies. Nous ne devons donc pas adopter cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL86 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. L’OPJ est placé sous le contrôle du procureur général. Formé à la rédaction des procès-verbaux, sa déontologie et ses compétences techniques sont de nature à garantir la protection des citoyens et à assurer la sécurité juridique des actes effectués. Son procès-verbal restera un acte de police administrative et non judiciaire.
Par ailleurs, le texte ne prévoit pas le placement sous scellés, alors qu’il constitue une garantie d’impossibilité de substitution des pièces saisies ; il serait prudent de l’instaurer, afin de nous prémunir de tout risque de contestation.
M. le rapporteur. Nous sommes extrêmement attentifs à entourer les dispositions que nous prenons de toutes les garanties du droit, mais nous ne souhaitons pas ajouter des contraintes juridiquement dispensables qui complexifieraient les procédures. Il n’est pas nécessaire qu’un OPJ dresse le procès-verbal d’une perquisition administrative, si bien que j’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement.
M. Denys Robiliard. L’OPJ est déjà présent dans la procédure, donc mon amendement ne la complexifie pas !
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CL49 de M. Éric Straumann.
M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, le procès-verbal de saisie constituant l’une des pièces éclairant la décision du juge des référés relative à l’autorisation de l’exploitation des données et des matériels informatiques. Un délai de trente jours pour élaborer un procès-verbal réglera peut-être quelques problèmes administratifs, mais ne contribuera guère à fluidifier la procédure.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite les amendements CL16 et CL17 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Le procès-verbal de perquisition a vocation à être transmis au juge et à la personne faisant l’objet de la perquisition. Le Gouvernement proposant que ce procès-verbal indique le motif de la perquisition, mes deux amendements proposent d’opérer un choix : soit le procès-verbal ne mentionne pas les motifs de la perquisition et il peut être transmis à l’individu concerné, soit il les explicite et il ne doit pas être transmis à la personne perquisitionnée. Il convient en effet de ne pas informer un terroriste potentiel de son inscription dans un fichier ou des soupçons pesant sur ses relations. Il faut choisir : l’amendement CL16 traduit la première solution, le CL17 la seconde.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La personne perquisitionnée est de toute façon informée des motifs de la perquisition au moment où elle reçoit l’ordre de perquisition. C’est l’indication de ces motifs qui, le cas échéant, permet un recours contre l’acte administratif.
La Commission rejette successivement les deux amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CL87 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. La mention du chef de service me semble compliquer la procédure, et je me demande d’ailleurs si toutes les perquisitions administratives conduites dans le cadre des états d’urgence antérieurs l’ont été en sa présence. Cela étant, je retire l’amendement, car il était cohérent avec l’amendement CL86 et je ne peux le maintenir en l’état : si ce n’est pas l’officier de police judiciaire qui dresse le procès-verbal, cela n’a guère de sens de lui demander de conserver le scellé associé.
M. le rapporteur. À toujours prévoir l’intervention de l’OPJ, on risque de judiciariser les perquisitions administratives, même si tel n’est pas votre état d’esprit. Nous pouvons revoir les choses d’ici à la séance, mais cela ne signifie pas que mon avis sera favorable.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL68 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le texte du Gouvernement ne précise pas à partir de quel moment le juge est saisi pour autoriser l’exploitation des données administratives. Comme je souhaite que la procédure soit la plus fluide possible, je propose une saisine dès la fin de la perquisition.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement l’amendement CL69 visant à corriger une erreur matérielle, l’amendement de clarification rédactionnelle CL70 et l’amendement rédactionnel CL2 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL67 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement propose un dispositif tenant compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et en particulier de sa décision du 19 février 2016 prévoyant qu’une saisie de matériel informatique requiert l’avis du juge des référés. Il est prévu que cet avis soit rendu sous quarante-huit heures, ce qui me paraît excessivement long, et je propose donc vingt-quatre heures. Le Gouvernement estime que c’est là faire peser une contrainte excessive sur les juridictions administratives, qui pourrait porter atteinte aux droits de la défense, mais je maintiens l’amendement. Le délai de vingt-quatre heures est celui que nous avons retenu en matière de géolocalisation.
La Commission adopte cet amendement.
En conséquence, l’amendement CL18 de M. Guillaume Larrivé tombe.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL3 et CL4 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CL52 de M. Éric Straumann.
M. Éric Straumann. Le délai de quinze jours me paraît insuffisant pour la restitution du matériel. Dans le cas d’une opération d’envergure, il faut laisser le temps aux services de traiter tout le matériel, et un mois me semble plus raisonnable.
M. le rapporteur. Il est prévu que le juge puisse autoriser une prolongation ou prorogation ; systématiser un délai d’un mois poserait un problème par rapport à la liberté de communication, mais le juge pourra l’autoriser aussi souvent que nécessaire.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL5 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL19 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Je propose que les données saisies soient conservées un an, au lieu des trois mois proposés par le Gouvernement.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Systématiser douze mois me semble excessif, mais votre préoccupation est satisfaite par le fait que le juge peut autoriser les prorogations nécessaires.
M. Guillaume Larrivé. Nous sommes en état d’urgence, et nous créons un luxe procédural hallucinant. Nous savons que les progrès du chiffrement sont considérables et que le traitement de ces données prendra du temps. Or, vous multipliez les procédures : saisine du juge des référés, débats contradictoires… Ce seront autant de nids à contentieux. Nous pourrions, sans méconnaître aucun principe ni aucune convention internationale, accepter que les données soient conservées un an après le feu vert du juge des référés, soit le temps de les exploiter de manière propre et carrée.
M. Pierre Lellouche. Le 13 juillet au matin, M. Urvoas, garde des sceaux, déclarait à M. Bourdin que nous avions tout l’arsenal judiciaire nécessaire et que l’on pouvait mettre fin à l’état d’urgence le 26 juillet. Le 14 juillet, à midi, le Président de la République reprenait quasiment les mêmes termes, affirmant que la loi du 3 juin 2016 nous offrait l’arsenal judiciaire nécessaire et que nous n’avions par conséquent plus besoin de l’état d’urgence. Puis survient l’horreur de l’attentat de Nice – 90 morts et 300 blessés, c’est du même niveau de violence qu’un attentat de Daech bien réussi en Irak ou en Syrie – et le Président de la République annonce la prorogation de l’état d’urgence pour trois mois, que nous venons de porter à six mois.
Ce texte comporte la possibilité de procéder à des perquisitions et de saisir du matériel informatique, ce qu’à la suite d’une décision – prise en temps de paix – du Conseil constitutionnel on ne pouvait plus faire. L’exposé des motifs parle d’un changement de stratégie de Daech justifiant ce texte, mais il n’y a eu aucun changement de stratégie : Daech déroule sa stratégie et continuera de commettre des attentats.
Il nous faut des moyens de défense. Qu’apporte ce texte à notre défense face au terrorisme ? Rien, ou seulement la saisie de matériel informatique, mais vous encadrez celle-ci de manière ubuesque : un officier de police judiciaire dans la pièce, l’autorisation du juge des référés, conditions de saisie, conditions de conservation des données… Faites-vous la guerre ou faites-vous de la procédure ? Est-ce une guerre de professeurs de droit et d’avocats, ou une guerre contre des terroristes ? Je suis avocat et je ne comprends rien à ce que vous faites. Ou bien ce texte est nécessaire ou bien il ne l’est pas. Il ne l’était pas la semaine dernière, il le devient aujourd’hui. Sa seule innovation, c’est cette usine à gaz autour de la saisie des données informatiques. De surcroît, vous n’avez pas de chances, car les terroristes communiquent sur des darknets ou avec WhatsApp et autres systèmes qui leur permettent d’être cryptés. Mais, à supposer que vous saisissiez des données, saisissez-les et faites le travail !
Cela fait un an et demi que cela dure. Avec mes collègues, nous vous avons dit, sur chacun de vos dix textes, que nous ne pouvions continuer à faire la guerre avec les mains liées dans le dos, avec une mentalité de temps de paix. Je le dis avec mon cœur car je suis inquiet pour notre pays. Ce texte est incompréhensible, tant dans ses objectifs que dans son contenu. Si vous souhaitez répondre aux attentats, donnez-vous les moyens de lutter contre les terroristes et arrêtez de faire du juridisme ou vous allez perdre tout le monde, y compris notre peuple. Je vous mets en garde.
M. le président Dominique Raimbourg. La majorité de la commission des Lois du Sénat avait aussi réclamé la fin de l’état d’urgence le 13 juillet.
M. Pierre Lellouche. Moi aussi, car cela ne sert à rien !
M. Jean-Luc Warsmann. Je soutiens l’amendement de Guillaume Larrivé, car je ne vois pas d’atteinte aux droits de la défense dans le fait que les données informatiques saisies soient conservées un an plutôt que trois mois. Un an n’est pas trop long, compte tenu des progrès du cryptage. Votons au moins cet amendement-là. Je vous laisse imaginer, si, demain, une procédure est annulée pour des raisons procédurales, si un juge écarte des preuves d’un dossier car telle ou telle formalité n’a pas été respectée, ce que sera la colère de la population. Faisons très attention à rendre les mesures que nous prenons efficaces et pragmatiques.
M. le rapporteur. Dans la pratique, la prorogation de la conservation des données est possible par simple décision du juge, à la demande des préfets.
J’entends ce discours qui permet, par de faciles effets de tribune, d’obtenir des applaudissements. (Exclamations parmi les députés du groupe Les Républicains.) J’ai souffert jusqu’au bout le long monologue de M. Lellouche : j’ai le droit d’y répondre.
Dire que l’on ne va pas s’embarrasser de considérations juridiques parce qu’on fait la guerre…
M. Pierre Lellouche. Les attaques personnelles ne sont pas convenables, surtout quand elles déforment les propos d’un collègue.
M. le rapporteur. Si l’un des termes que j’ai employés vous a blessé, je le retire. Celui que vous voulez. (Sourires.)
Quand on ne s’embarrasse pas de considérations juridiques, le résultat est celui que nous avons connu lors du premier vote sur l’état d’urgence, à savoir une censure du Conseil constitutionnel, qui a considéré que nous n’avions pas été suffisamment précis. Je souhaite comme vous que les données informatiques puissent être saisies au cours d’une perquisition administrative. C’est pourquoi je pense que le Gouvernement a bien fait, après avis du Conseil d’État, de rétablir ces dispositions, ce qui n’a pas été simple. Il aurait été bien plus simple en effet – vous disiez aussi que cela ne servirait à rien – d’inscrire l’état d’urgence dans la Constitution. La rédaction que vous critiquez vise tout simplement à permettre la saisie de matériel informatique en évitant une nouvelle censure du Conseil constitutionnel.
M. Georges Fenech. La brièveté des délais – de détention provisoire, par exemple – sert toujours à encadrer les procédures pour protéger les libertés individuelles. En quoi la conservation de matériels informatiques porte-t-elle atteinte aux libertés individuelles ? Pourquoi leur conservation pendant trois mois serait-elle plus protectrice que pendant douze mois ?
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Parce qu’il s’agit de données personnelles !
M. Georges Fenech. Certes, mais dès lors qu’elles sont exploitées, elles peuvent tout aussi bien l’être pendant trois ou douze mois sans qu’il soit porté atteinte aux libertés de manière disproportionnée. Tâchez donc de nous convaincre sur le fond ; en l’état, vous n’apportez pas d’argument juridique.
M. Guillaume Larrivé. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons lu la décision du Conseil constitutionnel ; à titre personnel, je la regrette, car je considère, comme M. Lellouche, que chacune des institutions de la République, y compris le Conseil constitutionnel, devrait réfléchir à la portée de ses décisions dans un contexte juridique qui n’est pas celui du droit commun. Quoi qu’il en soit, cette décision existe et nous devons en tirer les conséquences.
Je l’ai lue avec attention. Elle a deux effets : d’une part, la restriction du champ des données saisies et, d’autre part, un régime procédural impliquant l’intervention d’une autorité juridictionnelle. Autrement dit, monsieur le rapporteur, elle n’interdit en aucun cas de fixer le délai de conservation des données à douze mois. Je maintiens donc cet amendement de bon sens qui, je le répète, est conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 19 février dernier. Il me semble qu’il faut l’adopter non pas par principe ou en raison de considérations politiques, mais pour des raisons pratiques : cessons de surcharger les services de police en leur imposant un luxe de contraintes procédurales tel que nous créons des nids à contentieux qui fragiliseront les procédures.
M. le rapporteur. En effet, la décision du Conseil constitutionnel n’interdit pas ce délai, mais elle impose de donner des garanties. Nous allons donc vérifier dans quelle mesure il est possible de modifier le délai de conservation – même si ce ne sera peut-être pas douze mois.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL6 et CL7 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL66 du rapporteur.
M. le rapporteur. Pour répondre à une préoccupation partagée par plusieurs groupes politiques, cet amendement vise à créer les conditions permettant de retenir une personne visée sur les lieux d’une perquisition pendant la durée de celle-ci. Nous nous alignons pour ce faire sur le délai de retenue de quatre heures prévu dans la loi renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite sur l’amendement CL89 de M. Julien Dive.
M. Pierre Morel-à-l’Huissier. Cet amendement vise à systématiser la suspension des moyens de communication en ligne pour les personnes utilisant les nouvelles technologies à des fins d’organisation ou d’apologie d’actes terroristes. Je rappelle que la population française est à 80 % favorable à des mesures de contrôle supplémentaires, voire à des mesures pouvant porter atteinte à certaines libertés individuelles. Autrement dit, cet amendement correspond à une forte attente de la société.
M. le rapporteur. Je partage votre préoccupation, mais votre amendement n’est pas recevable pour des raisons techniques. Les décisions de suspension de sites internet ont beaucoup plus souvent été prises au titre de dispositions de droit commun qu’à celui des dispositions de l’état d’urgence. Il existe déjà des outils satisfaisants de blocage des sites lorsqu’il est nécessaire et possible de le faire – étant entendu que les sites bloqués en France peuvent être reconstruits ailleurs.
M. Guillaume Larrivé. Pour la bonne information de l’Assemblée nationale, il serait utile que le Gouvernement nous indique combien de sites et de contenus internet ont été bloqués en vertu des dispositions de droit commun inscrites dans la loi de lutte contre le terrorisme de 2014.
M. le rapporteur. Nous interrogerons le Gouvernement sur ce point. Je peux néanmoins vous indiquer que, des deux outils, celui du droit commun et celui de l’état d’urgence, c’est le premier qui est privilégié pour des raisons opérationnelles. Sur le fond, je suis d’accord avec les auteurs de l’amendement, mais j’en suggère le retrait pour des raisons pratiques.
M. Pierre Morel-à-l’Huissier. Soit, mais je le déposerai de nouveau en séance afin que le débat puisse avoir lieu.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 2 modifié.
La séance est suspendue de dix-neuf heures à dix-neuf heures dix.
M. le président Dominique Raimbourg. Je vous propose, chers collègues, de concentrer vos interventions sur les amendements qui émanent des groupes et de passer plus vite sur les amendements individuels, de sorte que nous puissions établir en temps utile le texte qui sera examiné en séance publique ce soir même.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL32 de M. Pierre Morel-à-l’Huissier, CL60 et CL61 de M. Éric Ciotti.
Elle examine ensuite les amendements identiques CL53 de M. Éric Ciotti et CL101 de M. Christian Jacob.
M. Guillaume Larrivé. Ces amendements visent à étendre le champ d’application des mesures administratives d’expulsion prononcées à l’encontre des étrangers dont la présence sur le sol français constitue une menace grave pour l’ordre public.
M. le rapporteur. Avis défavorable ; je répondrai sur le fond lors de la séance publique.
La Commission rejette les amendements.
Elle rejette également, suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements identiques CL56 de M. Éric Ciotti et CL102 rectifié de M. Christian Jacob.
Puis elle examine les amendements identiques CL51 de M. Éric Ciotti et CL97 de M. Christian Jacob.
M. Guillaume Larrivé. La loi antiterroriste de 2012, en faveur de laquelle nous avions voté, prévoyait – c’était une avancée – que les actes terroristes commis sur le théâtre irako-syrien et, plus généralement, à l’étranger, pouvaient faire l’objet de poursuites en France dès lors qu’ils étaient le fait de Français ou d’étrangers résidant en France. Nous proposons par ces amendements d’aller plus loin en prévoyant que tout séjour d’un ressortissant français sur un théâtre d’opérations djihadistes puisse être pénalisé.
M. Pierre Lellouche. La situation, en effet, est problématique. Ces amendements visent à prévoir l’emprisonnement immédiat des personnes revenant du djihad. Nous savons que plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Français ou de francophones vont revenir en France après avoir participé à des conflits djihadistes à l’étranger.
En l’espèce, c’est le titre IV du code pénal qui devrait s’appliquer, car il s’agit là de traîtres qui servent dans une armée étrangère contre la France. Quoi qu’il en soit, la présente proposition a le mérite de judiciariser immédiatement les faits, alors qu’en l’état actuel des choses le juge doit d’abord démontrer que l’intéressé s’est livré à des actes de guerre dans telle ou telle région et avec telle ou telle katiba – ce qui est très difficile.
Je partage naturellement la préoccupation de M. Larrivé, mais force est de constater que nous ne sommes pas au point dans ce domaine, et l’état d’urgence n’y fera rien. Il faut prendre une mesure essentielle qui ne figure dans aucune des dix lois de lutte contre le terrorisme que cette Assemblée à adoptées depuis quatre ans. Le problème est pourtant devant nous !
M. le rapporteur. Je partage pleinement l’objectif de cet amendement, et il me semble que nous y avons répondu. Tout d’abord, les personnes revenant des territoires en guerre peuvent être judiciarisées sur-le-champ – c’est le cas d’environ 60 % d’entre elles. D’autre part, je rappelle que nous avons adopté, dans la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, une mesure de contrôle administratif des personnes revenues de l’étranger que les éléments disponibles ne suffisent pas à judiciariser d’emblée. Puisque nous acceptons – ce à quoi le Sénat nous conduira certainement – le principe de l’adoption d’articles additionnels ne concernant pas strictement de l’état d’urgence, il me semble préférable, plutôt que d’approuver l’amendement, d’améliorer cette mesure, en particulier sur les durées prévues – si je m’avance à ce point, c’est que des échanges avec les sénateurs ont déjà eu lieu. En clair, le Gouvernement et la majorité partagent votre objectif, mais le mode opératoire que vous proposez ne semble pas être le meilleur. Sans doute trouverons-nous en commission mixte paritaire la solution qui permettra d’améliorer le dispositif existant.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il faudra également se référer au code civil, en particulier à son article 27-3. Le soldat franco-israélien récemment sorti des geôles israéliennes aurait pu tout aussi bien tomber sous le coup de cette disposition nouvelle, bien que cela ne soit pas le but recherché, indépendamment du jugement que l’on peut porter sur un comportement comme le sien.
M. Pierre Lellouche. Je m’en tiens au titre IV du code pénal, relatif aux combattants des armées en guerre contre la France. Le cas de Gilad Shalit ne serait pas concerné.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CL57 de M. Éric Ciotti et CL103 de M. Christian Jacob.
M. Guillaume Larrivé. Cet amendement, très important, du groupe Les Républicains n’est en rien un « cavalier législatif », puisqu’il s’agit tout simplement de donner un réel contenu à l’état d’urgence. Nous proposons que les mesures d’aménagement et de réduction de peines concernant des détenus condamnés pour des crimes ou des délits terroristes ne soient pas appliquées pendant la durée de l’état d’urgence.
M. Pierre Lellouche. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales interdit l’expulsion de ces détenus ; j’avais déposé une résolution sur ce point. Il faudrait exciper de l’état d’urgence pour obtenir les réserves nécessaires auprès de la cour.
Mme Sandrine Mazetier. Ces amendements sont bel et bien des « cavaliers » au sens constitutionnel du terme. Ni dans cet amendement ni dans les précédents, d’ailleurs, il n’est fait mention d’un quelconque lien avec l’état d’urgence.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL71 de M. Éric Ciotti.
M. le rapporteur. En l’état actuel de la discussion, je suis défavorable à cet amendement, mais peut-être les débats que nous conduirons avec le Sénat dans le cadre de la navette permettront-ils de faire droit aux préoccupations qui s’y expriment. Une réflexion est en cours.
M. Éric Ciotti. Il s’agit de porter à quinze ans le quantum maximal des peines correctionnelles, comme le préconisent certains magistrats dont le procureur François Molins, ainsi qu’il l’avait déclaré devant la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes que j’ai présidée l’an dernier. Cela permettrait une répression plus forte, sans avoir à passer par les cours d’assises.
M. Jean-Luc Warsmann. Je m’inscris en faux contre l’idée que l’Assemblée nationale devrait s’interdire de prendre position en laissant l’initiative de ce genre de dispositions aux sénateurs dans le cadre de la navette. Pourquoi la commission des Lois de l’Assemblée nationale devrait-elle s’interdire d’apporter des ajouts au texte ? C’est une question de principe.
M. Sébastien Pietrasanta. Dans le cadre de la commission d’enquête présidée par Georges Fenech, nous avons constaté que l’on est déjà passé à la criminalisation des agissements concernés. L’actuelle politique pénale du parquet répond à la demande qui s’exprime dans l’amendement et va même au-delà, puisque le quantum maximal des peines prévues s’élève à vingt ans pour ces crimes.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CL46 de M. Éric Ciotti et CL98 de M. Christian Jacob.
M. Éric Ciotti. Cet amendement prévoit que les autorités de police et de gendarmerie peuvent contrôler l’identité des personnes se trouvant sur le territoire national, en l’affirmant comme un droit général en toutes circonstances et sans plus l’enfermer dans le cadre de l’exécution des réquisitions du parquet.
M. le rapporteur. Une décision du Conseil constitutionnel affirme que la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires est incompatible avec le principe de la liberté individuelle. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CL47 de M. Éric Ciotti et CL99 de M. Christian Jacob, les amendements identiques CL48 et CL100 de M. Christian Jacob, et l’amendement CL15 de M. Guillaume Larrivé.
M. Philippe Gosselin. Je déplore que l’on demande à l’opposition de s’autocensurer en ne défendant pas ses amendements !
M. le président Dominique Raimbourg. Je vous rappelle que, si la Commission ne mène pas à bien l’examen du projet de loi, nous délibérerons en séance publique sur le texte tel qu’il a été déposé par le Gouvernement. Par ailleurs, si l’ensemble des amendements portant articles additionnels font l’objet d’un avis défavorable du rapporteur, des discussions sont en cours qui pourraient permettre de faire évoluer les choses. En l’état actuel de la discussion, son avis reste cependant défavorable.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Je n’ai jamais assisté à une réunion de commission où l’on ne vote même pas !
M. le président Dominique Raimbourg. Mais si, on vote !
Mme Marie-Jo Zimmermann. Lorsque notre collègue Jean-Luc Warsmann présidait notre commission, il arrivait que nous allions rapidement, mais nous votions toujours.
M. le président Dominique Raimbourg. Si vous le souhaitez, nous pouvons voter de façon plus formelle sur chaque amendement.
M. Éric Ciotti. J’en viens à la présentation de mon amendement. Dans le contexte actuel, nous voyons qu’un véhicule peut être une arme par destination. Il importe donc d’en permettre la fouille. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous nous interdisions, par naïveté, d’adapter les outils trop faibles dont nous disposons.
M. le rapporteur. Il faudrait trouver une façon de rédiger le dispositif pour la durée de l’état d’urgence. Mais si les dispositions que nous adoptons ne sont conformes ni à la Constitution ni au droit international, cela ne sera d’aucun effet pour le temps ordinaire.
M. Jean-Luc Warsmann. Je préférerais que nous ayons une autre approche, consistant à envisager en priorité ce qui est nécessaire dans la situation actuelle, sans rien nous interdire. Pour ma part, cela ne me gêne pas que nous prenions prenne le risque de l’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel prendra ses responsabilités, et nous prendrons ensuite les nôtres. Faciliter les contrôles d’identité et les fouilles de véhicules : voilà des outils nécessaires aux forces de l’ordre. Le cas échéant, nous en tirerons les conséquences en nous faisant constituants.
M. le rapporteur. Je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent imaginent qu’il n’est pas possible aujourd’hui de fouiller des véhicules : non seulement des dispositions existent, mais nous les avons renforcées, y compris dans la loi du 3 juin 2016. Nous pouvons regarder si l’on peut encore améliorer notre dispositif dans le cas spécifique de l’état d’urgence ; mais, dans le cadre du droit commun, des garanties sont nécessaires – garanties que vous proposez de supprimer.
M. Pierre Lellouche. Nous essayons, monsieur le rapporteur, de voter la prorogation de l’état d’urgence. Il y a urgence, il y a eu des attentats, il y en aura d’autres. Et vous nous dites que, dans une loi qui proroge l’état d’urgence, vous refusez d’inclure une mesure aussi élémentaire que l’ouverture des coffres des véhicules ?
Je demande solennellement le vote de cette disposition.
M. le rapporteur. Votre amendement ne concerne pas seulement l’état d’urgence : il modifie le droit commun. Je viens précisément de dire que nous pourrions imaginer nous affranchir de certaines règles du droit commun dans la période de l’état d’urgence, et je vous propose d’y travailler. Hors de l’état d’urgence, je pense néanmoins qu’il faut en demeurer au droit commun, que nous avons déjà largement modifié dans la récente loi visant à lutter contre le terrorisme.
M. Sébastien Denaja. La majorité est très ouverte sur ces sujets, mais dans les limites dessinées par le rapporteur à l’instant : nous souhaitons, en vue de la séance publique de ce soir, essayer d’aboutir à un consensus, mais dans le strict respect de l’état de droit d’une part, et en précisant bien d’autre part que cette loi concerne la période tout à fait exceptionnelle de l’état d’urgence.
Un vote défavorable en commission ne présage pas forcément un vote défavorable en séance publique ce soir.
M. le rapporteur. Ou demain en commission mixte paritaire.
M. Sébastien Denaja. Ne donnons pas à nos concitoyens l’impression que nous ne pouvons pas avancer ensemble. Je ne peux pas laisser dire non plus que, si l’on avait pu fouiller le fameux camion de Nice, les choses se seraient passées différemment.
M. Éric Ciotti. M. Lellouche parlait de l’incompréhension de nos concitoyens. La menace est forte, et nous nous devons d’être logiques.
Le Conseil constitutionnel a été saisi quatre fois sur l’article 60 du code des douanes, et il l’a validé : le débat juridique est donc loin d’être aussi clair que vous le pensez, monsieur le rapporteur.
J’ai pour ma part déposé un amendement visant précisément à élargir l’objet de cette loi : à mon sens, la gravité de la situation nécessite que nous prenions des mesures de portée générale, qui aillent au-delà de l’état d’urgence.
Je préparerai pour la séance un amendement de repli intégrant cette disposition pour le seul état d’urgence. Mais, désormais, il me semble devoir s’appliquer de façon permanente.
Monsieur Denaja, je n’ai jamais dit que la fouille du camion aurait évité l’attentat ; mais nous risquons de voir de plus en plus souvent des véhicules utilisés comme arme. Ce qui s’est passé à Nice – et le ministre de l’Intérieur, avec qui je m’en suis entretenu, partage cette crainte – risque de faire des émules. Nous devons adapter nos outils à ces nouvelles menaces, sans naïveté. Sinon, nous aurons toujours les mêmes conséquences et les mêmes drames.
M. le président Dominique Raimbourg. En attendant cet amendement de repli, retirez-vous celui-ci ?
M. Éric Ciotti. Non.
M. le rapporteur. Je précise que je préparerai moi aussi sans doute un amendement sur ce sujet en vue de la séance publique.
La Commission rejette successivement les amendements identiques CL46 et CL98, les amendements identiques CL47 et CL99, les amendements identiques CL48 et CL100, puis l’amendement CL15.
Puis elle se saisit de l’amendement CL72 de M. Éric Ciotti.
M. Éric Ciotti. Il s’agit à nouveau d’appliquer le principe de précaution pour protéger la société des personnes qui demeurent très dangereuses à leur sortie de prison. Le garde des sceaux soulignait récemment qu’il y avait aujourd’hui en prison 1 500 personnes radicalisées, qu’elles soient condamnées ou en détention provisoire.
Cet amendement vise donc à étendre aux personnes condamnées pour faits de terrorisme le mécanisme de rétention de sûreté que nous avons créé pour les criminels sexuels. Des évaluations psychologiques sont nécessaires.
M. Georges Fenech. Je soutiens fortement cet amendement. Nous avons aujourd’hui des équipes pluridisciplinaires à même d’analyser, de façon scientifique, inspirée de méthodes canadiennes, l’état de dangerosité d’un individu. Il n’y a aucune raison de ne pas étendre cette procédure à des terroristes condamnés comme tels.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL74, CL78, CL76 et CL75 de M. Éric Ciotti, les amendements identiques CL12 rectifié de M. Guillaume Larrivé et CL95 de M. Christian Jacob, ainsi que l’amendement CL13 de M. Guillaume Larrivé.
M. Éric Ciotti. L’amendement CL74 vise à supprimer, en matière de terrorisme, toute automaticité de réduction de peine.
M. Georges Fenech. C’est, je le rappelle, une proposition qui figure dans le rapport rédigé par Sébastien Pietrasanta à l’issue de la commission d’enquête sur le terrorisme. Ce rapport a été voté à l’unanimité de notre commission, moins deux abstentions.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le rapporteur, il me semble opportun de rappeler qu’une commission d’enquête vote pour autoriser la publication du rapport, mais que ce vote ne vaut absolument pas adhésion de ses membres à l’ensemble des propositions qui y sont formulées.
M. le rapporteur. En effet. Cela dit, nous aurons sans doute plus de facilité à nous accorder sur cet amendement-ci que sur le précédent.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL74.
M. Éric Ciotti. L’amendement CL78 tend à interdire les permissions de sortie aux individus condamnés pour des faits de terrorisme ou présentant des signes de radicalisation religieuse.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL78, CL76 et CL75.
M. Éric Ciotti. Monsieur le président, je veux souligner à quel point le rejet de ces amendements nous semble grave. Nous le dirons en séance : malgré le contexte actuel, la majorité souhaite favoriser la sortie de prison des personnes radicalisées ! Vous vous opposez à tous nos amendements, qui ne visent qu’à protéger la société !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Que voilà un bel exemple d’honnêteté intellectuelle !
M. Éric Ciotti. C’est une clarification ! D’ailleurs, nous demanderons des scrutins publics en séance, et vous devrez prendre vos responsabilités devant les Français !
M. Pierre Morel-à-l’Huissier. Vous êtes des Bisounours ! Vous n’avez toujours rien compris !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C’est lamentable ! Absolument lamentable !
M. le président Dominique Raimbourg. Mes chers collègues, s’il vous plaît ! Des évolutions sont possibles, cela a été indiqué. (Exclamations sur tous les bancs.)
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ils ne sont pas là pour ça ! Nous, nous sommes là pour faire la loi, mais ils ne sont là que pour faire leur cinéma !
M. Éric Ciotti. Nous sommes là pour protéger les Français !
M. Georges Fenech. Monsieur Le Bouillonnec, ces propos sont injurieux ! Retirez-les !
M. Éric Ciotti. Je suis l’élu de la circonscription où des dizaines de personnes ont été tuées la semaine dernière, et vous osez me dire des choses pareilles ! Retirez vos propos !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je ne retirerai rien du tout !
M. Éric Ciotti. Dans ces conditions, je quitte la séance !
La séance est suspendue de dix-neuf heures quarante à dix-neuf heures quarante-cinq.
M. le président Dominique Raimbourg. Après ces discussions un peu vives, et le départ d’une partie de nos collègues, nous reprenons nos débats.
M. Philippe Gosselin. L’amendement CL95 vise à interdire aux détenus condamnés pour des actes terroristes toute réduction et tout aménagement de peine.
M. le rapporteur. Je commence par préciser à nouveau, à l’intention de tous ceux qui regardent nos débats et qui ne maîtrisent pas forcément les subtilités des usages parlementaires, que j’ai indiqué une position de principe.
La majorité considère que ces amendements, sans préjuger du fond, n’ont pas leur place dans un texte visant à proroger l’état d’urgence, qui est un état d’exception prévu pour une durée donnée. Ces amendements proposent au contraire de modifier le droit commun.
Si nos collègues sénateurs souhaitent, eux, prendre la responsabilité d’introduire de telles dispositions dans ce projet de loi, nous quitterons l’argument de la forme pour passer aux arguments de fond. C’est alors en commission mixte paritaire que nous émettrons, point par point, des avis favorables ou défavorables.
L’amendement CL95 fait partie de ceux dont nous pourrons débattre.
Je vois bien l’incident créé, et le temps qu’il a libéré pour que nos collègues puissent aller faire de la communication et prétendre que nous refusons de protéger les Français. Ce n’est évidemment pas la réalité ; la réalité, c’est que nous voulons travailler dans la rigueur juridique, afin que cette loi ne soit pas une simple proclamation d’intention, mais un texte efficace et bien fait.
M. Philippe Gosselin. Monsieur le rapporteur, il y a un problème de fond derrière votre forme. Je suis parlementaire, membre de l’Assemblée nationale comme chacun d’entre nous. Dans le système bicaméral de la Vème République, chaque chambre a pleine capacité de s’exprimer. Un dialogue singulier peut se dérouler dans le cadre d’une commission mixte paritaire, mais je ne peux pas comprendre que l’on souhaite laisser le Sénat décider.
Nous avons la capacité pleine et entière, si nous le voulons, d’introduire un certain nombre de dispositions qui ne correspondent pas forcément aux souhaits du Gouvernement, mais qui ne sont pas contraires à la Constitution ni au Règlement de l’Assemblée nationale. Osons un peu ! Cette autolimitation est une forme d’amputation de nos propres pouvoirs que je trouve, je le dis comme je le pense, assez minable.
M. Guillaume Larrivé. J’appelle l’attention du président, du rapporteur, et de mes collègues de la commission des Lois sur quelques éléments de technique juridique. Nous proposons le contraire d’un cavalier législatif. Cet amendement CL95 ne crée pas un article « en l’air » qui viendrait compléter l’état du droit en dehors de l’état d’urgence.
Au contraire, nous créons un nouvel article au sein de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Et c’est pour l’application de cette loi que nous pensons nécessaire de prévoir un régime d’application des peines différent du droit commun. Nous sommes bien dans le cadre de l’état d’urgence, ce n’est en rien un cavalier législatif.
Au mois de novembre dernier, le Gouvernement avait accepté cette méthode. Lorsque pour l’application de l’état d’urgence, nous avons introduit dans la loi de 1955 un article additionnel sur les modalités de dissolution des associations troublant l’ordre public, nous avons procédé exactement avec la même technique.
Il ne s’agit pas d’un cavalier législatif, de dispositions sans rapport avec l’état d’urgence. Nous soutenons que l’état d’urgence doit être substantiel et non virtuel, et donc prévoir un certain nombre de dispositions dérogatoires au droit commun.
M. Patrick Mennucci. Je suis très gêné, et je trouve que ce débat n’est pas convenable. Il n’est pas possible de dire qu’ici, nous parlons de la forme, et qu’il reviendra au Sénat de débattre du fond.
Si, ce soir, en séance publique, nous continuons sur cette voie, je prendrai mes responsabilités lorsque les amendements me conviendront. Je ne vois pas pourquoi moi, député du groupe Socialiste, écologiste et républicain et mes camarades et collègues de l’Assemblée nationale, nous devrions laisser la majorité de droite du Sénat décider.
Je ne comprends pas cette stratégie. Notre collègue Sébastien Pietrasanta a rédigé un rapport, dont un amendement reprend l’une des préconisations ; pourquoi nous demande-t-on de ne pas le voter et de laisser le Sénat prendre cette responsabilité ?
Sur la question des fouilles de véhicules et de remise de peines pour les terroristes, si les amendements sont présentés en séance publique, je les voterai.
M. Philippe Doucet. J’abonde dans le sens de M. Patrick Mennucci, et une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec M. Philippe Gosselin. Je ne me soucie pas de ce que fera la droite sénatoriale. Comme nous, ils prendront leurs responsabilités devant les Français. S’ils ne veulent pas d’accord en commission mixte paritaire et que nous devons revenir vendredi, ce sera leur affaire. Je ne veux pas que nous nous mettions sous pression et que, contrairement à l’esprit et à la lettre des institutions de la Vème République, nous nous retrouvions à négocier avec nos collègues sénateurs, comme c’est trop souvent le cas.
Ce soir, nous avons un problème de ligne politique, notamment au sein de la majorité parlementaire. Nous devons assumer nos responsabilités et décider de ce que nous voulons faire. Ensuite, la droite parlementaire, qui a la majorité au Sénat, prendra ses responsabilités. Pour notre part, nous devons prendre les nôtres ici, car nous parlons devant les Français.
Sur le fond des mesures proposées, nous n’allons pas laisser la droite sénatoriale donner le sentiment qu’elle préserve la sécurité des Français et lui laisser reprendre des propositions qui émanent d’un de nos collègues de groupe, M. Sébastien Pietrasanta.
Sur les deux sujets évoqués, qu’il s’agisse de la fouille des véhicules ou des remises de peine, nous sommes nombreux à penser qu’il faut évoluer afin d’adapter la riposte à la menace et à la guerre qui nous est menée. Tout le monde est conscient qu’une étape a été franchie, je souhaite que nous prenions nos responsabilités ce soir, la droite sénatoriale prendra les siennes.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Ce débat est surréaliste. Nous sommes députés, donc représentants du peuple. Je ne comprends pas très bien la méthode utilisée et les explications qui nous sont données. Vous nous dites que c’est le Sénat qui va légiférer, mais nous avons le devoir de répondre aux Français. Ce ne sont pas les seuls sénateurs qui doivent le faire.
Les Français qui nous regardent ce soir doivent être stupéfaits par ce débat.
M. Guillaume Larrivé. Pour l’information de tous, je rappelle que les députés et les sénateurs des groupes Les Républicains ont travaillé de concert, sous la présidence du président du parti Les Républicains, sur ces questions.
Tous les amendements présentés par le groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale sont donc conformes à la position collective du parti Les Républicains, et nous avons bien l’intention, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, de faire progresser le débat sur le fond. Je remercie nos collègues MM. Patrick Mennucci et Philippe Doucet d’avoir su dépasser les affinités partisanes pour considérer que le groupe Les Républicains propose des mesures d’intérêt général, opérationnelles et efficaces, sur ces questions concrètes.
M. Jean-Luc Warsmann. Je suis heureux de ressentir un changement d’état d’esprit de la part de nombreux collègues au sein de cette commission.
Je propose d’étudier très concrètement l’amendement CL95. Il consiste simplement à interdire, durant l’application de l’état d’urgence, que les détenus condamnés pour actes terroristes bénéficient de réductions de peine. Je demande à chacun de voter en fonction, non de l’identité des auteurs de l’amendement, mais du dispositif lui-même. Si vous voulez illustrer un changement de comportement dans la manière d’examiner ce texte, je vous appelle à voter cet amendement CL95.
M. le rapporteur. Je suis attentif aux débats de la Commission, et j’adapterai mes propositions en séance publique en fonction de ce qui vient d’être dit. Nous acceptons donc le principe de présenter des dispositions qui ne sont pas liées à l’état d’urgence.
Sur le fond, je suis favorable à ce que nous suspendions les réductions de peine pour les personnes faisant l’objet de condamnations terroristes, mais je pense que la rédaction de cet amendement pose une difficulté. J’ai fait une erreur tout à l’heure, et je vous prie de m’en excuser, mais le rythme auquel nous avons dû examiner ces textes est à peu près le même que celui auquel vous avez dû les élaborer, les uns et les autres.
Vous proposez cette mesure spécifiquement pour la durée de l’état d’urgence. Or, par construction, ces réductions de peine vont poser des problèmes dans la durée. Nous pouvons en débattre de manière apaisée : si nous souhaitons exclure toute réduction de peine pour les personnes condamnées pour terrorisme, il faut le faire de manière globale, et pas simplement pendant la durée de l’état d’urgence. Qui serait concerné si nous procédions ainsi ? Ceux qui ont été condamnés pendant l’état d’urgence ? Ceux qui auraient pu bénéficier d’une réduction de peine pendant cette période ?
Que l’on soit pour ou contre cette mesure, elle doit s’appliquer – ou non – dans le cadre du droit commun, sans limitation de temps. Sinon, elle n’a pas de sens.
Mme Élisabeth Pochon. Je suis désolé, M. Jean-Luc Warsmann, je ne serai pas aussi consensuelle que lors de l’examen de notre proposition de loi commune. Je ne comprends pas cet amendement. Pour moi, il s’agit typiquement d’une mesure d’affichage. Pourquoi prévoir que, pendant l’état d’urgence, il n’y aura pas de réductions de peine ou de libérations conditionnelles ? Franchement, pouvez-vous imaginer que, pendant les six mois que va durer encore l’état d’urgence, des réductions de peines ou des libérations anticipées seront accordées à des personnes condamnées d’actes de terrorisme ?
C’est du pur affichage. Si nous débattons de ces mesures, il faut le faire dans le cadre du droit commun, mais ce texte ne le permet pas car il porte sur l’état d’urgence.
Je sais que vous serez contents de dire que la majorité n’a pas voté cette disposition, mais la majorité en a assez d’être manipulée et d’entendre dire que les méchants, les irresponsables, ceux qui ne s’intéressent pas au bien-être des gens, sont de notre côté, alors que vous seriez les seuls à accepter de prendre des mesures. C’est, je le répète, de l’affichage.
Mme Sophie Dion. Il faut que l’atmosphère de ces débats change. La France a peur, les Français ont peur, dans chaque ville, dans chaque village. Dans ma circonscription de Haute-Savoie, à Passy, une famille a été décimée, tout le territoire est touché.
Nous devons donner des signes, et je pense que cet amendement tendant à supprimer les réductions de peine pour les personnes condamnées pour des actes de cette nature enverrait un signal fort aux Français.
L’état d’urgence est une chose, mais, le ministre de l’Intérieur l’a dit, ce n’est pas une mesure suffisante. Le débat n’oppose plus la droite et la gauche, la majorité et l’opposition : ces mots n’ont plus de sens. (Exclamations parmi les députés du groupe Socialiste, écologiste et républicain.)
Nous devons envoyer des signaux forts. Cet amendement répond à un souci de bon sens et d’équité, et surtout, à la volonté des Français.
M. le président Dominique Raimbourg. Le rapporteur s’est dit prêt à rédiger des amendements élargissant le cadre des fouilles et des contrôles d’identité dans le cadre de l’état d’urgence. Mais l’objection formulée par Mme Élisabeth Pochon est très solide. La suspension des aménagements de peine jusqu’au 22 janvier 2017 n’a pas de sens. Si l’on décide de telles mesures, elles doivent être permanentes et ne pas s’arrêter au 22 janvier.
Je vous propose donc de passer au vote sur cet amendement, afin que nous puissions avancer dans l’examen de ce texte et rediscuter de tout cela en séance.
M. Guillaume Larrivé. En tant que rédacteur de chacune des lignes de cet amendement, je serais heureux que le rapporteur accepte de le lire intégralement. Sa dernière phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence. »
Je rappelle à mes collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain, qui semblent regretter aujourd’hui que ce dispositif n’ait pas été voté sous une forme pérenne, que, depuis l’automne 2014, le groupe Les Républicains propose de manière extrêmement régulière de l’adopter. Cela fait donc deux ans et demi que la majorité socialiste refuse que les détenus condamnés pour crime ou délit terroriste ne fassent plus l’objet de mesures d’aménagement ou de réduction de peine. Depuis deux ans et demi, vous assumez le fait que des détenus condamnés pour crime ou délit terroristes font l’objet de libérations anticipées, de réductions automatiques de peine, d’aménagements de peine.
À l’époque où M. Jean-Jacques Urvoas présidait notre commission, j’avais montré dans un rapport, que, entre 2012 et 2014, cinquante-six détenus condamnés pour des faits de terrorisme avaient bénéficié de libérations conditionnelles. Voilà la vérité ! Nous posons ces questions depuis trois ans ; nous aimerions beaucoup qu’elles puissent enfin être tranchées ce soir à l’Assemblée nationale.
M. le président Dominique Raimbourg. Elles ne seront pas tranchées de façon définitive. Nous avions adopté des positions qui s’appuyaient sur le fait que la suppression des crédits de réduction de peine rendait les prisons totalement ingouvernables et en faisait des poudrières. Nous n’étions pas motivés par une soudaine envie de voir sortir des terroristes de prison, mais par l’intérêt du pays. C’était un problème de gestion de la population carcérale.
La Commission rejette les amendements identiques CL12 rectifié et CL95.
M. Guillaume Larrivé. L’amendement CL13 est un amendement de repli qui ne concerne que les crédits de réduction de peine automatique. Il correspond à l’une des propositions du rapport présenté au début du mois par M. Sébastien Pietrasanta au nom de la commission d’enquête présidée par M. Georges Fenech.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie des amendements identiques CL10 de M. Guillaume Larrivé et CL93 de M. Christian Jacob.
M. Guillaume Larrivé. Monsieur le président, vous nous aviez indiqué que cette séance serait levée à vingt heures. Il est vingt heures huit. Allons-nous poursuivre nos travaux ?
M. le président Dominique Raimbourg. Dix amendements doivent encore être examinés : nous pouvons donc en terminer. Je n’avais pas affirmé que nous lèverions la séance à vingt heures ; j’avais simplement indiqué que ce serait opportun.
M. Jean-Luc Warsmann. Pour être encore plus précis, monsieur le président, il ne nous reste que sept amendements à appeler, car certains collègues sont absents ! (Sourires.)
M. Guillaume Larrivé. L’amendement CL10 vise à compléter le droit positif par une mesure de police administrative donnant au ministre de l’Intérieur la faculté de placer en centre de rétention un certain nombre d’individus qui constituent, par leur comportement, une menace pour la sécurité nationale. Nous soutenons que cet amendement est conforme, dans son principe, aux règles du droit constitutionnel. Il relève d’une logique de police administrative, et les décisions ministérielles prises pourraient bien évidemment faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif – nous prévoyons la possibilité de saisine en premier et dernier ressort du Conseil d’État.
Parce que nous avons également bien compris que ce que l’on pourrait considérer comme l’Habeas corpus prévu par l’article 66 de la Constitution doit s’appliquer, nous avons prévu l’intervention ex post d’un juge des libertés et de la détention spécialisé, qui interviendrait au-delà d’un certain délai après la décision de placement par le ministre de l’Intérieur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.
Elle en vient aux amendements identiques CL11 de M. Guillaume Larrivé et CL94 de M. Christian Jacob.
M. Guillaume Larrivé. Nous évoquons assez vainement depuis plusieurs mois la question des modalités de fermeture des lieux de culte où l’on prêche la haine islamiste, et de dissolution des associations ou groupements de fait responsables de ces lieux.
Sont aujourd’hui en vigueur des dispositions législatives héritées du décret-loi de 1938, relatif aux ligues, désormais insérées dans le code de la sécurité intérieure, et le dispositif particulier inséré dans la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, créé par la loi du 26 novembre 2015. Ce dispositif particulier n’a pas été appliqué, comme l’ont montré les travaux des missions d’évaluation présentés devant notre Commission. Il faut donc sur le métier remettre l’ouvrage.
L’amendement prévoit que l’autorité pouvant procéder à une fermeture de lieu ou à une dissolution pourra être l’autorité préfectorale, et un régime contentieux plus efficient est mis en place.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL14 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Nous voulons poser la question de l’expulsion des ressortissants étrangers présentant une menace pour la sécurité nationale. Nous souhaitons que, par dérogation aux conditions de fond et de procédure prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un dispositif d’expulsion accélérée soit prévu dans la loi pour la durée de l’état d’urgence. La mesure d’expulsion prise par le ministre de l’Intérieur pourrait être assortie d’une interdiction administrative définitive du territoire.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL76 de M. Éric Ciotti.
M. Guillaume Larrivé. Il faut faciliter très largement, dans les établissements pénitentiaires, la fouille des personnes condamnées ou prévenues dans des affaires de terrorisme. La loi du 3 juin 2016 a constitué une avancée modeste. Les personnels de l’administration pénitentiaire, qui méritent tout notre respect, ne doivent pas se voir opposer des conditions procédurales restrictives et complexes.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle en vient enfin à l’amendement CL91 de M. Philippe Gosselin.
M. Philippe Gosselin. Il s’agit de donner une base légale plus solide à l’arrêté pris le 9 juin dernier par le Garde des sceaux afin de mettre en place, sous certaines conditions, la vidéosurveillance dans des cellules. La mesure a été jugée conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), mais elle a fait l’objet d’une certaine publicité après la saisine, la semaine dernière, du tribunal administratif de Versailles.
Le Garde des sceaux s’est montré favorable à cette idée.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le jugement du tribunal de Versailles a conforté l’arrêté.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
M. Guillaume Larrivé. Je précise, pour le compte rendu, que le groupe Les Républicains s’est abstenu sur le texte tel qu’il est modifié par la Commission. Nous regrettons vivement que, dans une logique partisane qui n’est pas à la hauteur des enjeux, la majorité s’obstine à refuser de manière systématique tous les amendements présentés par les députés de mon groupe.
Mme Pascale Crozon, M. Jean-Yves Le Bouillonnec et Mme Élisabeth Pochon. Arrêtez de donner des leçons !
M. le président Dominique Raimbourg. Nous l’avons déjà dit : des avancées sont possibles !
M. Jean-Luc Warsmann. Monsieur le président, je me permets d’appeler l’attention sur les arguments de M. Philippe Gosselin concernant l’arrêté du 9 juin. Le risque semble exister que les bases législatives puissent faire défaut, et nous aurions intérêt à sécuriser le dispositif.
M. Philippe Gosselin. Je suggère que nous mettions à profit le délai qui nous sépare de la séance publique pour approfondir cette importante question.
M. le président Dominique Raimbourg. La suggestion est bonne mais le délai est bref.
*
* *
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 3968) prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
___
1 () Se reporter au rapport de M. Sébastien Pietrasanta fait au nom de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 (Assemblée nationale, XIVème législature, n° 3922).
2 () Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
3 () Loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
4 () Loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
5 () Audition du 18 mai 2016 devant la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
6 () Selon les éléments rendus publics par le procureur de la République de Paris François Molins lors de la conférence de presse des 15 et 18 juillet 2016.
7 () Lors de sa déclaration à la presse à l’issue du Conseil de sécurité convoqué le 15 juillet au matin à l’Élysée.
8 () Conseil d’État, Ord., 27 janvier 2016, Ligue des droits de l’homme et autres, requête n° 396.220. Le recours dont le Conseil d’État avait été saisi était postérieur à la prorogation de l’état d’urgence par la loi du 20 novembre 2015 ; celle-ci faisait donc obstacle à ce que le juge ordonne la suspension totale ou partielle de l’état d’urgence.
9 () Conseil d’État, Avis, 2 février 2016, n° 391.124.
10 () Conseil d’État, Avis, 28 avril 2016, n° 391.519.
11 () Conseil d’État, Avis, 18 juillet 2016, n° 391.834.
12 () Conseil d’État, Avis, 6 juillet 2016, n° 398.234 et 399.135.
13 () Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
14 () Le présent projet de loi est dispensé, en application de l’article 11 de la loi organique du 15 avril 2009, de l’obligation d’être accompagné d’une étude d’impact.
15 () Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
16 () Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
17 () Voir le rapport n° 3237 de M. Jean-Jacques Urvoas (Assemblée nationale, XIVème législature). http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3237.asp
18 () Voir le rapport n° 3495 de M. Pascal Popelin (Assemblée nationale, XIVème législature). http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3495.asp
19 () Voir le rapport n° 3753 de M. Pascal Popelin (Assemblée nationale, XIVème législature). http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3753.asp.
20 () Selon la formule de Roland Drago dans « L’état d’urgence et les libertés publiques », in : Revue du droit public, 1955, p. 680.
21 () Voir le rapport n° 3753, op. cit.
22 () Loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
23 () Notamment, s’agissant d’inspections en matière de concurrence, la décision CEDH, 2 octobre 2014, req. n° 97/11, Delta Pekarny, n° 87, 91 et 92.
24 () Récemment, la décision CJUE, 18 juin 2015, C-583/13 P, Deutsche Bahn AG, n°22.
25 () Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
26 () Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets, du 14 novembre 2015, n° INTK1500247J.
27 () Circulaire de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux procureurs, du 14 novembre 2015, « Attentats terroristes. État d’urgence ».
28 () Conseil d’État, avis du 17 novembre 2015 sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, n° 390.786.
29 () Voir le rapport n° 3784 de MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson (Assemblée nationale, XIVème législature). http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3784.asp.
30 () Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation.