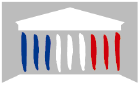N° 4223
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire,
Par M. Philippe VIGIER,
Député.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 4119.
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. UNE RÉPARTITION TERRITORIALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ TOUJOURS PLUS INÉGALE 17
A. L’HÉTÉROGÉNÉITÉ CROISSANTE DE LA RÉPARTITION DES MÉDECINS SUR LE TERRITOIRE 17
1. Évolution des effectifs régionaux et départementaux de médecins généralistes, spécialistes et chirurgicaux depuis 2007 18
2. Évolution de la densité médicale depuis 2007 20
3. Les critères d’accessibilité géographique font apparaître de véritables déserts médicaux 24
B. LE VIEILLISSEMENT GALOPANT DE LA POPULATION DES MÉDECINS 28
II. DES DISPOSITIFS CORRECTIFS NOMBREUX MAIS TOUJOURS INSUFFISANTS 34
A. L’ÉCHEC DES MESURES DE RÉGULATION MISES EN œUVRE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES MÉDECINS 35
B. L’INEFFICACITÉ DES COÛTEUX DISPOSITIFS PUBLICS D’INCITATION À L’INSTALLATION DANS DES ZONES SOUS-DOTÉES 39
1. Les dispositifs financés par l’État 42
2. Les dispositifs financés par les collectivités territoriales 44
3. Les dispositifs financés par la Sécurité sociale 46
a. L’avenant n° 20 48
b. Le contrat d’engagement de service public 49
c. La dérogation au parcours de soins 50
d. Le conventionnement sélectif 50
III. LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE RAPIDEMENT DES MESURES FORTES POUR ENRAYER LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE 53
A. UNE GESTION RÉGIONALISÉE DE LA FORMATION DES MÉDECINS 54
1. Mieux prendre en compte les besoins de santé de chaque territoire dans la fixation et la répartition du numerus clausus 55
2. Organiser des épreuves classantes au niveau régional 55
B. UN PASSAGE OBLIGÉ EN ZONES SOUS DOTÉES AU COURS DES ÉTUDES MÉDICALES 56
C. UNE OBLIGATION D’INSTALLATION EN ZONE SOUS-DOTÉE PENDANT TROIS ANS À L’ISSUE DU CURSUS 56
D. UN RÉGIME D’AUTORISATION D’INSTALLATION GÉRÉ PAR LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ 59
E. UNE MOBILISATION NÉCESSAIRE DE TOUS LES OUTILS DISPONIBLES POUR LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE 60
1. Allonger la durée d’activité des médecins en encourageant le cumul emploi-retraites 60
2. Encourager le développement de la télémédecine 61
3. Évaluer les mesures proposées 62
TRAVAUX DE LA COMMISSION 63
EXAMEN DES ARTICLES 89
Article 1er(Art. L. 631-1 du code de l’éducation) : Fixation du numerus clausus des études médicales 89
Article 2 (Art. L. 632-5 du code de l’éducation) : Stage pratique dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins 91
Article 3 (Art. L. 632-2 et L. 632-6 du code de l’éducation) : Création d’un internat régional 95
Article 4 (Art. L. 1434-4 du code de la santé publique) : Abaissement des charges sociales pour les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de la retraite dans les zones sous-dotées 101
Article 5 (Art. L. 632-2 du code de l’éducation ; art. L. 162-12-23 du code de la sécurité sociale) : Extension du statut de médecin collaborateur libéral aux internes de médecine générale 103
Article 6 (Art. L. 4131-6 [nouveau] du code de la santé publique) : Obligation d’installation des nouveaux médecins dans les zones sous dotées 106
Article 7 (Art. L. 4131-6-2 [nouveau] et L. 4131-7 du code de la santé publique) : Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession de médecin 110
Article 8 (Art. L. 4141-5-2 [nouveau] et L. 4141-6 du code de la santé publique) : Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste 115
Article 9 (Art. L. 4151-6-1 [nouveau] et L. 4151-10 du code de la santé publique) : Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession de sage-femme 117
Article 10 (Art. L. 4311-11-1 [nouveau] et L. 4311-29 du code de la santé publique) : Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession d’infirmier 119
Article 11 (Art. L. 4321-11-1 [nouveau] et L. 4321-22 du code de la santé publique) : Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute 121
Article 12 (Art. L. 6316-1 du code de la santé publique) : Développement de la télémédecine 123
Article 13 (Art. L. 1432-2 du code de la santé publique) : Compétences du directeur général de l’agence régionale de la santé (ARS) 127
Article 14 : Évaluation du dispositif de régulation de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire 128
Article 15 : Gage financier 130
Il y a quelques semaines encore, la question de l’égalité de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire a nourri les débats de l’Assemblée nationale à l’occasion du vote, par la commission des Affaires sociales, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2017, d’un amendement de notre collègue Annie Le Houerou (1) qui proposait un dispositif de conventionnement sélectif des médecins libéraux dans les zones « sur-dotées », c’est-à-dire dans celles où existe un fort excédent en matière d’offre de soins.
Dans un communiqué publié le 19 octobre dernier, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a aussitôt condamné une initiative « prise sans concertation avec les acteurs concernés, au premier rang desquels les médecins et les étudiants en médecine » et « regretté le choix d’une fausse solution, qui ne répond en rien aux problèmes de désertification dans les territoires et porte atteinte à la liberté d’installation des médecins, socle essentiel et fondamental de l’exercice de la médecine », rappelant que « les mesures coercitives à l’installation des médecins se sont révélées inefficaces dans les pays qui les ont expérimentées et ont eu un effet dissuasif sur les vocations » (2).
Si les mesures coercitives adoptées ailleurs ont pu s’avérer inefficaces aux yeux du CNOM, il n’en demeure pas moins que les mesures incitatives adoptées ici sont tout autant insuffisantes. Le CNOM en a lui-même convenu dans le Livre Blanc « Pour l’avenir de la santé » qu’il a publié en janvier dernier. Il constate que « la présence des médecins sur le territoire est très inégalement répartie », que « les incitations conventionnelles mises en place par l’assurance maladie obligatoire n’ont pas été suffisantes pour faire réellement bouger les lignes » et que « pour Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, “ Paris intra-muros va aussi devenir un désert pour les généralistes de secteur 1, car les charges sont devenues trop importantes ” » (3).
Le risque de prolifération des « déserts médicaux » est d’autant plus paradoxal que le nombre total de médecins n’a jamais été aussi élevé en France (285 840 au 1er janvier dernier). Malgré ces effectifs pléthoriques, on assiste ces dernières années à la formation de zones sous-médicalisées dans lesquelles les patients éprouvent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais satisfaisantes. Elles correspondent souvent à des espaces ruraux, mais aussi à certaines villes moyennes ou à des zones périurbaines. La multiplication de ces « déserts médicaux » pose un problème majeur d’égalité des territoires, car l’accès à la santé fait partie des services indispensables qui conditionnent l’attractivité d’un territoire. Les carences de la présence médicale génèrent des situations inacceptables. Dans un pays qui attache tant d’importance à la solidarité, cela pose en outre un problème d’égalité entre les citoyens, car le principe de protection de la santé est garanti à tous par le préambule de la Constitution de 1946.
Autre paradoxe : la situation s’aggrave alors que, depuis plus d’une décennie, malgré les nombreuses préconisations et propositions formulées par des parlementaires d’horizons politiques variés, les gouvernements successifs ont préféré multiplier les dispositifs d’incitation financière plutôt que de prendre les mesures fortes qui s’imposent.
Déjà sous la XIIIe législature, les deux assemblées avaient mené des missions d’information sur l’offre de soins. En 2007, l’ancien sénateur Jean-Marc Juilhard, avait évoqué la possibilité de recourir à un conventionnement sélectif dans les zones surmédicalisées (4).
Un an plus tard, l’ancien député Marc Bernier, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’offre de soins sur l’ensemble du territoire présidée par notre collègue Christian Paul (5), faisait le constat que le régime de liberté d’installation dont jouissent certaines professions de santé nuit à l’équilibre de leur répartition géographique. Il déplorait que les formations médicales et paramédicales ne soient pas organisées et le numerus clausus modulé en fonction des besoins de santé. Il relevait que les mesures incitatives prises jusqu’à présent pour réguler la démographie médicale n’avaient pas suffi à éviter l’aggravation des inégalités d’accès aux soins, regrettant la complexité de ces mesures, l’instabilité et le peu de pertinence des zonages afférents ainsi que les risques d’effets d’aubaine induits par les incitations mises en place.
Cette mission d’information avait alors formulé de nombreuses propositions, dont la majorité sont malheureusement restées lettres mortes, cette année encore. C’est notamment le cas de la proposition n° 7 aux termes de laquelle il était recommandé, « sans remettre en cause le principe de la liberté d’installation des médecins libéraux, [de] mettre des freins à l’installation de professionnels de santé dans les zones déjà sur-dotées en offre de soins, dans un premier temps par des mesures “désincitatives” comme, par exemple, une modulation de la prise en charge de leurs cotisations sociales par l’assurance maladie ».
Le groupe socialiste, dans la contribution qu’il avait jointe au rapport de M. Marc Bernier, affirmait alors que « la liberté d’installation n’est plus un tabou » précisant notamment que « les incitations financières [devaient] être évaluées, encadrées pour éviter la concurrence des territoires et mieux ciblées (accorder des bourses d’études cofinancées par l’Assurance maladie assorties de l’engagement d’exercer cinq ans en zones sous-denses, ou bien demander leur remboursement…) » et que « devant l’insuffisante efficacité des seules incitations financières, […] il est devenu nécessaire de se préparer à freiner les installations dans les zones excédentaires ».
Près de dix ans plus tard, l’initiative en ce sens prise par notre collègue Annie Le Houerou et approuvée par la commission des Affaires sociales s’est heurtée à l’opposition du Gouvernement… de la même façon que plusieurs propositions de loi déposées sous la précédente législature en vue d’encadrer plus rigoureusement l’installation des médecins et, plus largement, des professionnels de santé, voire des services publics, sur le territoire, n’ont pas recueilli l’assentiment des gouvernements d’alors.
Ces propositions émanaient aussi bien de l’opposition que de la majorité. En effet, en février 2011, M. Jean-Marc Ayrault cosigna avec Mme Marisol Touraine, désormais ministre des Affaires sociales et de la Santé, une proposition de loi pour l’instauration d’un bouclier rural au service des territoires d’avenir (6), dont l’exposé des motifs insistait sur la nécessité de « revoir sans tabou le dogme de la liberté d’installation des praticiens médicaux » et appelait la représentation nationale à prendre ses responsabilités à l’égard des populations dépourvues d’accès aux soins. Ce texte fut rejeté par l’Assemblée nationale… comme la proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire, que le rapporteur et plus d’une cinquantaine de ses collègues de la majorité de l’époque cosignèrent et déposèrent en novembre 2011 (7).
Sous la XIVe législature, les initiatives parlementaires se sont multipliées sans connaître davantage de succès. Rejetée en janvier 2012 par l’ancienne majorité, la proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire que le rapporteur et plusieurs de ses collègues du groupe Union des démocrates et indépendants (UDI) déposèrent à nouveau (8) fut également rejetée par la nouvelle majorité, en novembre 2012.
Pourtant, cette même majorité aurait pu se sentir liée par le « Projet socialiste pour 2012 », dans lequel il était indiqué : « nous demanderons aux jeunes médecins libéraux d’exercer en début de carrière dans les zones qui manquent de praticiens ».
Même si le Président de la République, M. François Hollande, alors candidat à la primaire socialiste, s’était déjà quelque peu démarqué du programme officiel de son parti, en se déclarant le 5 octobre 2010 opposé à la coercition, il n’en avait pas moins affirmé qu’il était prêt à « interdire certaines installations » dans les zones trop pourvues en médecins (9).
Mieux encore : dans le vingtième de ses « 60 engagements pour la France », le Président de la République avait promis de « sécuriser l’accès aux soins de tous les Français » (10). Constatant lui aussi que « dans certaines zones rurales, dans certains quartiers défavorisés, il est devenu très difficile et parfois même impossible d’avoir recours à certains spécialistes dans une durée raisonnable, de trouver un généraliste, voire même d’accéder en temps utile à des structures de soins » (11), il avait appelé à une « mobilisation générale pour lutter contre ces déserts médicaux », dans son discours de clôture du congrès de la Mutualité française le 22 octobre 2012.
Malgré toutes ces annonces, le changement annoncé n’a pas eu lieu… et le constat est toujours le même. Le rapport d’information présenté en 2013 par le sénateur Hervé Maurey (12) le montre bien : les difficultés d’accès aux soins primaires (13) concernent un pourcentage croissant de la population ; le nombre de territoires sous-médicalisés est appelé à se multiplier sous l’effet conjugué, d’une part, de la baisse des effectifs de médecins et de la diminution du temps médical disponible résultant des aspirations nouvelles des jeunes médecins en termes de conditions de vie et, d’autre part, de l’augmentation des besoins de santé liés au vieillissement de la population et au développement des pathologies chroniques ; trop peu est fait dans le cadre du cursus d’études médicales et de la régulation de la profession pour inciter les médecins à s’installer dans des zones abandonnées de tous… Bref, les barrières territoriales à l’accès aux soins sont toujours plus hautes.
La représentation nationale n’a que trop tardé : il est grand temps de prendre rapidement des mesures fortes pour enrayer la désertification médicale tout en respectant les aspirations des jeunes médecins et en s’appuyant sur elles.
Lors de la discussion générale du PLFSS pour 2017, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, a indiqué que le Gouvernement souhaitait « amplifier la dynamique d’incitation », notamment en proposant des mesures destinées à financer « l’aide à l’installation de 50 000 euros négociée dans le cadre de la convention médicale [et] accordée aux médecins qui s’installeront dans des territoires sous-dotés, en contrepartie d’une maîtrise tarifaire – c’est-à-dire l’absence de dépassements d’honoraires ou avec des dépassements maîtrisés – et d’une participation à la permanence des soins ambulatoires » (14).
Mais on aura beau mettre en place toutes les mesures incitatives possibles et imaginables : elles resteront insuffisantes si la profession souffre d’un déficit d’attractivité toujours plus grand.
Pour inciter les jeunes médecins à s’installer dans des zones sous-dotées, qu’elles soient rurales ou urbaines, il faut être à l’écoute de leurs demandes : c’est parce que leurs souhaits d’exercice ne sont pas satisfaits dans certains territoires qu’ils hésitent à s’y installer.
La régulation de l’installation des professionnels de santé, et des médecins au premier chef, doit s’inscrire dans le cadre des études médicales, mais aussi être conçue comme un prolongement de ce cursus.
C’est la position défendue par le groupe UDI qui, constant dans les combats qu’il mène, a tenu à ce que soit à nouveau débattue, en cette fin de XIVe législature, sa proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire déjà présentée, sans succès, au début de l’actuelle législature.
Le texte qui vous est soumis aujourd’hui reprend en grande partie les mesures pragmatiques et de bon sens qui figuraient dans les propositions de loi n° 3914 et n° 284 examinées par l’Assemblée nationale en 2012.
Il ne s’agit pas de mesures révolutionnaires. Elles reprennent pour la plupart d’entre elles des préconisations figurant dans les rapports précités et ne sont aucunement conçues comme un affront pour les médecins.
L’article 1er propose de renforcer les critères de démographie médicale dans la détermination du numerus clausus en veillant à ce qu’ils prennent en compte les besoins de santé de la population sur l’ensemble du territoire.
Le rapporteur note que cette mesure rejoint les aspirations des médecins puisque, dans le Livre Blanc qu’il a publié en janvier dernier, le CNOM recommande lui-même de créer un numerus clausus régionalisé en fonction des capacités de formation des universités et des besoins des territoires (15).
L’article 2 prévoit de généraliser, lors de la troisième année d’internat, les stages dans les zones déficitaires en offre de soins, au sein de structures collectives, conformément au vœu émis par la ministre des Affaires sociales et de la Santé à l’été 2012 (16).
En effet, à une époque où les études de médecine se sont allongées et où la plupart des étudiants en médecine passent désormais par l’internat, il faut que les futurs médecins sortent des murs des centres hospitaliers universitaires (CHU) pour apprendre l’exercice de la médecine dans des structures de soins publiques et privées très diverses (cabinets médicaux, dispensaires, services hospitaliers publics non universitaires ou privés).
Cette mesure va dans le sens des préconisations formulées par le CNOM dans son Livre Blanc de janvier dernier, qui invitent à renforcer la professionnalisation des études en créant notamment un nouveau « parcours post-DES (17) de territoire » pour inciter à l’exercice volontaire dans les territoires sous-médicalisés.
L’article 3 prévoit également une régionalisation de l’internat avec l’organisation d’épreuves classantes, non pas au niveau national, mais au niveau régional afin de fidéliser les internes dans leur région de formation mais aussi de mieux adapter les cursus de formation aux souhaits des internes en médecine.
En effet, dans le Livre Blanc précité, le CNOM recommande lui-même de régionaliser la formation initiale des médecins et de remplacer les épreuves classantes nationales (ECN) par des épreuves classantes interrégionales (Ecir).
Le système actuel de répartition des étudiants en médecine entre les différentes spécialités ne permet pas de maîtriser l’effectif des généralistes formés. Il repose sur des épreuves classantes nationales (ECN) qui se sont substituées au concours de « l’internat », et sur l’attribution à chaque candidat d’un rang de classement au niveau national, chacun choisissant à son tour selon cet ordre une affectation, c’est-à-dire un lieu de formation et une spécialité.
Ce système est tout aussi contraignant que l’ancien. La prétendue liberté que visait l’instauration d’un classement national plutôt que régional est illusoire, car les choix des lieux de formation et des spécialités restent largement encadrés.
En outre, la spécialité de médecine générale est quasiment la seule à ne pas pourvoir la totalité de ses postes. Ce phénomène est constant, et se reproduit chaque année dans des proportions proches de 20 %.
Cela résulte du choix fait par certains étudiants de ne pas valider leur dernier semestre de deuxième cycle afin de tenter d’obtenir un meilleur classement aux épreuves nationales de l’année suivante, dans l’espoir de pouvoir choisir une autre spécialité jugée plus « prestigieuse » que celle qui leur est proposée parmi les postes restants, le plus souvent lorsque celle-ci est la médecine générale. Les deux seules autres spécialités à ne pas faire le plein des postes ouverts sont la santé publique et la médecine du travail.
Afin de limiter les possibilités de redoublement volontaire des étudiants reçus aux épreuves classantes nationales et de réduire l’écart entre le nombre de postes ouverts et le nombre de postes pourvus, le décret n° 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales n’autorise à redoubler qu’une seule fois et a surtout limité le total des redoublements à 3 % des effectifs des candidats.
Par ailleurs, le choix exercé par l’étudiant, en fonction de son rang de classement, détermine non seulement sa spécialité, mais en même temps la région où il effectuera son troisième cycle. Or, on observe une propension des médecins à s’installer dans la région où ils ont fait leurs études, dans une proportion de 80 %. Ce phénomène renforce la nécessité d’adapter aux besoins la répartition régionale des étudiants en médecine.
Il paraît donc nécessaire de régionaliser les épreuves classantes, en ouvrant dans chaque région un quota de postes en adéquation avec les particularités de la région en termes de démographie médicale.
Le rapporteur tient à souligner qu’il ne s’agit nullement de scléroser la profession mais bien plutôt d’offrir aux jeunes médecins de nouvelles possibilités.
C’est d’ailleurs tout l’esprit de l’article 5 qui ouvre la possibilité aux internes de médecine générale qui n’ont pas terminé leur thèse de pratiquer la médecine en qualité de collaborateur, ce qui leur assurerait une rémunération. Cet article propose ainsi d’inscrire dans la loi l’annonce faite par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, qui, le 25 octobre dernier, dans la discussion générale du PLFSS pour 2017, a annoncé promulguer « très prochainement une circulaire d’interprétation, qui permettra à l’ordre [des médecins] d’autoriser des médecins n’ayant pas encore présenté leur thèse de venir en appui de médecins installés dans des zones sous-denses ».
L’article 6 prévoit qu’à partir de 2020, les médecins libéraux seront tenus d’exercer pendant trois ans dans un territoire où l’offre de soins de premiers recours n’est pas satisfaite. Cette obligation d’installation doit être conçue comme un prolongement des études médicales : il ne s’agit pas d’ajouter une nouvelle contrainte aux contraintes existantes.
Il s’agit d’une mesure limitée dans la durée, qui est justifiée par l’impératif de répondre aux besoins de santé de la population, mais qui pourrait être temporaire, dans la mesure où l’article 14 de la proposition de loi prévoit également la mise en place d’un comité d’évaluation appelé à faire des propositions.
Les articles 7 à 11 suggèrent de mettre en place une procédure d’autorisation de création, de transfert et de regroupement de cabinets afin d’œuvrer en faveur d’une meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire. Ces autorisations, qui seraient octroyées par le directeur général de l’agence régionale de santé, reposeraient sur la définition d’une densité maximale de praticiens. Les médecins s’installant dans des zones sur-denses ne pourraient plus être conventionnés par l’assurance maladie.
À cet égard, le rapporteur ne partage pas les propos du Président de la République selon lequel « la coercition, l’obligation ne créerait que des conflits sans fin » (18).
Le rapporteur rappelle d’ailleurs qu’outre la profession des pharmaciens d’officine (depuis 1943), celle des biologistes médicaux fait, depuis 2010, l’objet d’une régulation de son installation. L’article L. 6222-2 du code de la santé publique prévoit en effet que le directeur général de l’ARS « peut s’opposer à l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un site d’un laboratoire de biologie médicale, lorsqu’elle aurait pour effet de porter, [sur la zone infrarégionale définie par l’ARS] l’offre d’examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu’ils sont définis par le schéma régional de santé ».
L’Assemblée nationale ne peut plus fermer les yeux sur les conséquences inacceptables, en termes d’égalité d’accès à la santé qu’a la multiplication de déserts médicaux, pour le moins paradoxale dans un pays comme la France qui dispose d’un nombre globalement suffisant de médecins et consacre une fraction considérable de sa richesse aux dépenses de santé.
Les mesures mises en place par les gouvernements successifs étant insuffisantes, pour ne pas dire inefficaces, la gravité de la situation et les sombres perspectives d’évolution commandent qu’au-delà des clivages partisans, seul l’intérêt général soit pris en compte.
Le rapporteur invite donc l’ensemble de ses collègues, à commencer par ceux qui sont élus de circonscriptions situées dans des zones sous-médicalisées, qu’elles soient rurales ou urbaines, comme ceux qui sont solidaires, ceux de la majorité qui ont soutenu, par le passé, des propositions similaires, comme ceux de l’opposition, conscients de la gravité du problème auquel nous sommes confrontés, à prendre leurs responsabilités et à voter la présente proposition de loi.
D’après l’édition 2016 de l’Atlas de la démographie médicale en France réalisé par Mme Gwénaëlle Le Breton-Lerouvillois, géographe de la santé, sous la direction du Dr Jean-François Rault, président de la section « Santé publique et démographie médicale » du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), 285 840 médecins étaient inscrits au tableau de l’ordre au 1er janvier dernier. Parmi eux, 215 583 étaient en activité totale et 70 257 étaient retraités (dont 15 878 en cumul emploi-retraite).
Ce même document explique que « la France continue de présenter d’importantes disparités territoriales. Ainsi les territoires de la façade Atlantique, Rhône-Alpes et les territoires transfrontaliers (Nord, Est) voient leurs effectifs augmenter quand d’autres territoires allient densité faible et manque d’attractivité tels que le Centre, la Bourgogne qui sont de plus en plus en souffrance [… et] il existe des territoires en souffrance y compris dans les départements et régions bien dotés, à l’instar de la Bretagne intérieure (Argoat) » (19).
Les inégalités territoriales en matière de répartition des professionnels de santé – et donc d’accès aux soins – continuent de s’accentuer (A) tandis que l’évolution démographique de ces professionnels est de plus en plus défavorable (B).
Les rapports se suivent et le constat est toujours le même : la pénurie de professionnels de santé dans certaines zones du territoire national ne cesse de s’aggraver.
Pourtant, la démographie médicale est historiquement abondante au niveau national. En 2010, la France se classait au 14e rang des trente-quatre pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de densité médicale moyenne.
Le problème n’est donc pas celui du nombre des médecins ou des autres professionnels de santé, mais celui de leur répartition sur le territoire. Les inégalités de répartition géographique des médecins entre régions sont importantes, même si elles tendent à se réduire. En revanche, les écarts de densité sont beaucoup plus sensibles au niveau départemental.
1. Évolution des effectifs régionaux et départementaux de médecins généralistes, spécialistes et chirurgicaux depuis 2007
D’après l’Atlas de la démographie médicale en France publié cette année par le CNOM, sur la période 2007-2016, la région Île-de-France enregistre la plus forte baisse des effectifs (– 7 %) tandis que la région Pays-de-la-Loire comptabilise la plus forte hausse des médecins inscrits en activité régulière (+ 7 %).
Au 1er janvier 2016, le tableau de l’ordre recensait 88 886 spécialistes en médecine générale exerçant en activité régulière (tous modes d’exercice confondus), contre 97 012 en 2007, soit une baisse de près de 10 000 généralistes en activité en moins de 10 ans.
Sur la période 2007-2016, la ventilation de la variation des effectifs de médecins généralistes à l’échelle des régions mettait en évidence de fortes disparités territoriales : ainsi la région Île-de-France a enregistré la plus forte diminution (– 18,7 %). La région Centre occupe le deuxième rang des régions qui recensent une baisse significative du nombre de médecins généralistes (– 13,1 %). Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) occupe à quasi-égalité avec le Nord-Pas-de-Calais/Picardie la troisième place des régions affectées par une forte diminution du nombre de médecins généralistes en activité régulière.
APPROCHE RÉGIONALE DE LA VARIATION
DES EFFECTIFS DES MÉDECINS EN ACTIVITÉ RÉGULIÈRE SUR LA PÉRIODE 2007-2016
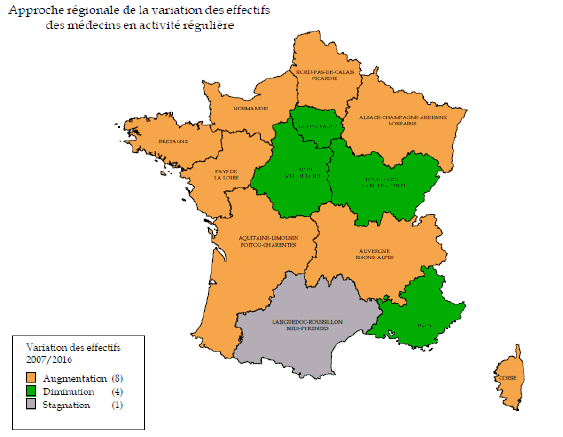
Source : CNOM, Atlas de la démographie médicale en France 2016, p. 24.
À l’échelle départementale, les écarts de variations sur la période 2007-2016 sont nettement plus importants. 55 départements enregistrent une baisse plus ou moins importante des effectifs de médecins inscrits à l’ordre en activité régulière.
Certains départements connaissent des baisses très significatives, comme l’Yonne (– 17 %), la Niève et l’Indre (– 16 %), le Cher (– 15 %), la Haute-Marne, la Creuse et le Gers (– 14 %) ou encore les Yvelines, l’Ariège et l’Aveyron (- 12 %).
À l’opposé, 37 départements comptabilisent une hausse importante des effectifs des médecins inscrits au tableau de l’ordre en activité régulière, parmi lesquels la Loire-Atlantique (+ 13 %), la Haute-Savoie (+ 12 %), le Doubs, le Maine, la Loire et la Savoie (+ 9 %), l’Ille-et-Vilaine et le Calvados (+ 8 %) ou encore le Rhône (+ 7 %).
VARIATIONS DES EFFECTIFS DES MÉDECINS EN ACTIVITÉ RÉGULIÈRE
À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE SUR LA PÉRIODE 2007-2016
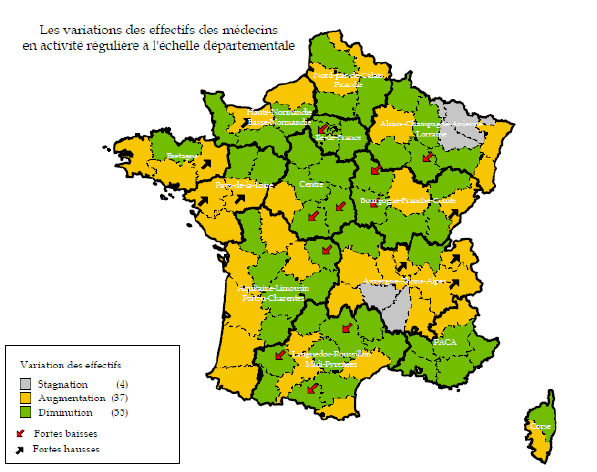
Source : CNOM, Atlas de la démographie médicale en France 2016, p. 25.
Pour ce qui concerne les médecins généralistes, les départements de la Ville de Paris et de la Nièvre sont ceux qui ont connu la plus forte baisse du nombre de ces médecins en activité régulière sur la période 2007-2016 (– 25 %), devant les départements de l’Yonne et des Yvelines (– 21 %). Cela montre que la désertification médicale n’est pas exclusivement rurale, mais qu’elle concerne aussi des espaces urbains de plus ou moins grandes échelles.
Pour ce qui est des médecins spécialistes, parmi les 25 départements qui enregistrent une baisse des effectifs, les départements du Cher, de la Haute-Marne et de la Meuse comptabilisent la plus forte baisse (– 13 %). En revanche, les départements de la Haute-Savoie et de la Somme connaissent la plus forte hausse des effectifs des médecins spécialistes en activité régulière sur la période 2007-2016 (respectivement + 24 % et + 23 %).
Quant aux médecins spécialistes chirurgicaux, c’est dans le département de la Loire-Atlantique que leurs effectifs ont le plus crû sur la période 2007-2016 (+ 41 %). Les départements du Calvados, du Doubs, de la Somme, du Maine-et-Loire et du Bas-Rhin ont connu pour leur part une augmentation de 3 % de leurs effectifs. À l’opposé, les départements du Gers, de l’Yonne et de l’Ariège enregistrent une diminution du nombre de spécialistes chirurgicaux en activité régulière (de l’ordre de 20 %).
Au 1er janvier 2016, la densité médicale métropolitaine était de 284,4 médecins pour 100 000 habitants. La région Centre était celle qui connaissait la plus faible densité avec 232,7 médecins pour 100 000 habitants tandis que la région PACA enregistrait la plus forte densité avec 350 médecins pour 100 000 habitants – conséquence d’une longue période marquée par un fort héliotropisme. Les régions Centre, Basse-Normandie/Haute-Normandie et Pays-de-la-Loire se situent dans le quart des densités les plus faibles tandis que les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Île-de-France et PACA se regroupent dans le quart des densités les plus fortes.
Pour ce qui est de l’évolution de la densité médicale depuis 2007, on constate que, toutes spécialités et tous modes d’exercice confondus, 86 départements enregistrent une baisse de la densité médicale sur cette période. Le département du Gers comptabilise la plus forte baisse nationale (– 20,2 %), suivi par le département de l’Yonne (– 19,8 %) et par l’Ariège (– 18,8 %).
En revanche, dix départements enregistrent une hausse de la densité médicale sur la même période. La Loire-Atlantique connaît la plus forte augmentation de la densité médicale (+ 44 %), devant le Calvados (+ 33 %) et le Doubs (+ 3 %).
VARIATIONS DE LA DENSITÉ DES MÉDECINS EN ACTIVITÉ RÉGULIÈRE À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE SUR LA PÉRIODE 2007-2016
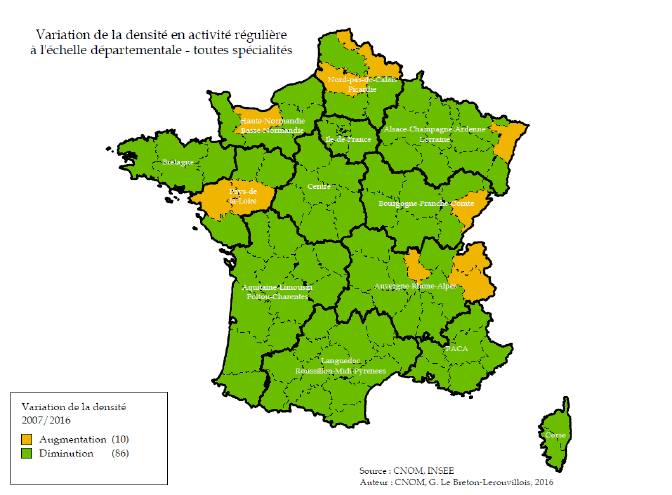
Source : CNOM, Atlas de la démographie médicale en France 2016, p. 61.
• Pour ce qui est de la médecine générale, la densité médicale était, au 1er janvier 2016, de 132,1 médecins pour 100 000 habitants. La région Centre recensait la plus faible densité avec 107,5 médecins généralistes pour 100 000 habitants tandis que la région PACA présentait la plus forte densité avec 152,6 médecins pour 100 000 habitants.
Les régions Centre, Basse-Normandie/Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Franche-Comté/Bourgogne se situent dans le quart des densités les plus faibles en médecine générale tandis que les régions Poitou-Charentes/Limousin/Aquitaine, Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées, Corse et PACA font partie du quart des densités les plus fortes.
La répartition des médecins généralistes est donc à la fois urbaine et littorale. Leur densité est particulièrement importante sur le littoral atlantique, dans le quart Sud-Ouest du pays, le long de la côte méditerranéenne et dans les Alpes. Dans la moitié Nord de la France, elle est faible partout, sauf dans les départements les plus urbanisés. L’essentiel des départements du grand bassin parisien connaît des densités très faibles, à l’exception, bien sûr, de Paris et de la première couronne. Plus on va vers le Sud, plus les densités s’élèvent.
VARIATIONS DE LA DENSITÉ DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES EN ACTIVITÉ RÉGULIÈRE À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE SUR LA PÉRIODE 2007-2016
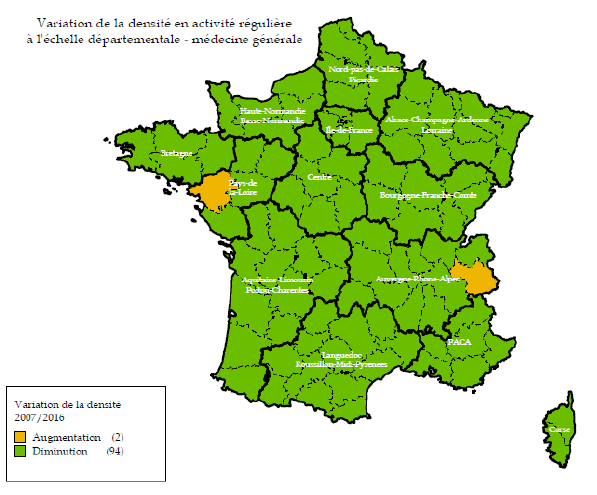 Source : CNOM, Atlas de la démographie médicale en France 2016, p. 63.
Source : CNOM, Atlas de la démographie médicale en France 2016, p. 63.
Sur la période 2007-2016, la quasi-totalité des départements a connu une baisse plus ou moins significative de la variation de la densité des médecins généralistes en activité régulière. Seuls les départements de la Loire-Atlantique et de la Savoie ont enregistré une hausse (de + 0,6 % et + 0,3 % respectivement).
• Pour ce qui concerne les médecins spécialistes, au 1er janvier dernier, leur densité était de 118 médecins pour 100 000 habitants. La région Centre recense la plus faible densité avec 96,7 médecins spécialistes pour 100 000 habitants tandis que la région Île-de-France enregistre la plus forte densité avec 172,9 médecins pour 100 000 habitants.
Les régions Centre, Corse, Pays-de-la-Loire et Basse-Normandie/Haute-Normandie se situent dans le quart des densités de médecins spécialistes les plus faibles tandis que les régions Auvergne/Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées, PACA et Île-de-France se regroupent dans le quart des densités les plus fortes.
À l’exception des départements incluant des villes universitaires dans la moitié Nord et dans le centre du pays, les départements de fortes densités sont donc ceux du littoral atlantique et surtout du Midi, de Bordeaux à Nice. À l’inverse, des régions entières de la moitié Nord sont marquées par de faibles densités : la Champagne-Ardenne, la Haute Normandie, la Picardie. Plus encore que pour les généralistes, la concentration urbaine est la règle et tout particulièrement dans les plus grandes villes, capitales régionales siège de facultés de médecine. Au Nord, à part les Yvelines, tous les départements de fortes densités en spécialistes libéraux sont dotés de centres hospitaliers universitaires (CHU). Ce n’est pas le cas dans la moitié Sud du pays, où l’on compte aussi des départements denses bien que dépourvus de CHU.
Sur la période 2007-2016, 46 départements ont connu une hausse plus ou moins significative de la densité des médecins spécialistes en activité régulière. Le département de la Somme recense la plus forte augmentation de la variation de sa densité de médecins spécialistes (+ 19 % sur la période considérée). Les départements du Cantal et du Nord ont eux aussi enregistré une hausse notoire (+ 15 %) tandis que la Haute-Savoie a enregistré une variation de la densité médicale de + 12 %.
En revanche, 51 départements recensent une diminution plus ou moins importante. Le département de l’Ariège compte la plus forte baisse (- 16 %). Le département du Cher se place au deuxième rang des fortes diminutions (- 15 %), devant les départements de la Meuse et de la Haute-Marne qui se placent en troisième position des baisses significatives (- 14 %).
VARIATIONS DE LA DENSITÉ DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN ACTIVITÉ RÉGULIÈRE À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE SUR LA PÉRIODE 2007-2016
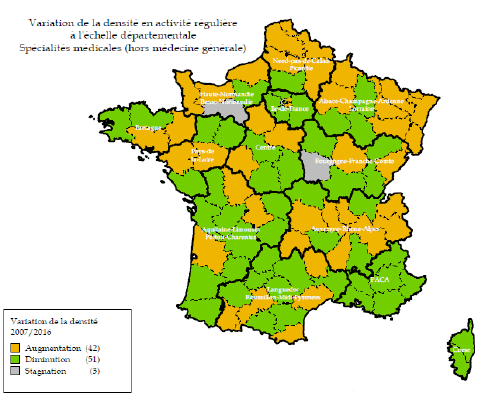
Source : CNOM, Atlas de la démographie médicale en France 2016, p. 65.
Enfin, pour ce qui est des spécialités chirurgicales, leur densité, au 1er janvier dernier, était de 34 chirurgiens pour 100 000 habitants. La région Centre enregistre la plus faible densité avec 28,6 médecins spécialistes chirurgicaux pour 100 000 habitants tandis que la région PACA enregistre la plus forte densité avec 46,2 chirurgiens pour 100 000 habitants.
En matière de densité des médecins chirurgicaux, les régions Centre, Franche-Comté/Bourgogne, Basse-Normandie/Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais/Picardie se situent dans le quart des densités les plus faibles tandis que les régions Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées, Île-de-France et PACA figurent dans le quart des densités les plus fortes.
La répartition territoriale des autres professions de santé fait apparaître le même tropisme vers le Sud, les littoraux et les grandes villes. Les écarts de densités entre départements sont également plus marqués pour ces professions que pour les médecins généralistes.
Au niveau infra-départemental, il apparaît que même un département bien pourvu en professionnels de santé par rapport à la moyenne nationale peut comporter des zones sous-denses, au niveau de bassins de vie, à savoir les plus petits territoires au sein desquels les populations ont accès à la fois à l’emploi et aux équipements de la vie courante. Ainsi, les Alpes-Maritimes, qui est l’un des départements les mieux dotés en quasiment toutes les professions de santé, voient celles-ci géographiquement concentrées sur les quinze kilomètres de la bande littorale, l’arrière-pays constituant un véritable désert médical.
Il y a donc des déserts médicaux dans quasiment tous les départements.
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite « HPST ») a introduit la notion d’accessibilité géographique dans la définition même des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS).
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Affaires sociales et de la santé a consacré en juin 2011 une étude aux distances et temps d’accès aux soins en France métropolitaine. Celle-ci a fait apparaître que 95 % de la population ont accès en moins de quinze minutes à des soins de proximité, fournis par les médecins généralistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes libéraux – ce qui laisse tout de même de côté les 5 % restants, soit plus de trois millions d’habitants.
En ce qui concerne les seuls médecins généralistes, une proportion de 84 % de la population dispose d’au moins l’un d’entre eux dans sa commune de résidence. Moins de 1 % de la population, vivant dans 4 % des communes françaises (soit environ 600 000 personnes), se trouvait à plus de quinze minutes de trajet d’un médecin généraliste en 2007. Les communes concernées se trouvent essentiellement dans des zones rurales ou montagneuses et à faibles densités de population, qui cumulent d'ailleurs l'éloignement aux autres équipements et services.
La même étude a révélé que la plupart des médecins spécialistes libéraux et les équipements médicaux les plus courants (scanners, etc.) sont accessibles en moyenne en moins de vingt minutes de trajet. Et 95 % de la population peut accéder aux soins hospitaliers courants en moins de quarante-cinq minutes, les trois quarts en moins de vingt-cinq minutes.
La DREES a affiné ces résultats en développant, en collaboration avec l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), un indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) permettant de dresser un état des lieux de l’accessibilité à l’offre libérale de soins de ville en chirurgiens-dentistes et en médecins généralistes, pour les quatre spécialités en accès direct (ophtalmologie, gynécologie, pédiatrie et psychiatrie) ainsi que pour quatre autres professions de santé (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et pharmaciens). Cet indicateur permet de synthétiser au niveau communal l’adéquation entre l’offre de soins locale (c’est-à-dire celle de la commune ainsi que celles des communes environnantes) et la demande de soins en tenant compte des besoins plus élevés pour les plus âgés.
Cet indicateur a permis de mettre en évidence que, si la répartition des médecins généralistes sur le territoire est relativement diffuse, les autres professionnels de santé de premier recours sont en revanche très concentrés dans les grands pôles urbains.
Ces fortes disparités territoriales ressortent également du « Portrait des professionnels de santé » que la DREES a publié en février 2016.
D’après cette étude, les médecins généralistes constituent la profession de santé de premier recours la mieux répartie sur le territoire. En 2013, 84 % de la population résidaient dans une commune où exerce un médecin généraliste et la quasi-totalité de la population pouvait accéder à un médecin généraliste en moins de 15 minutes. Les 10 % des habitants des communes les mieux dotées avaient une accessibilité trois fois plus forte que les 10 % des habitants des communes les moins bien dotées. Ces disparités sont comparables à celles observées pour les pharmacies.
Les disparités d’accessibilité aux médecins généralistes sont davantage liées au type d’espace (commune urbaine ou rurale, située au centre d’un pôle ou en périphérie) qu’à la région et c’est dans les communes des pôles urbains que l’accessibilité est la plus forte : on y compte en moyenne 80 équivalents temps plein (ETP) de médecins généralistes pour 100 000 habitants, quelle que soit la taille du pôle – à l’exception notable de l’unité urbaine de Paris qui présente une accessibilité particulièrement faible (55 ETP de médecins généralistes pour 100 000 habitants).
Dans les espaces ruraux, les communes isolées de l’influence des pôles sont en moyenne mieux loties que les communes rurales des couronnes des pôles (65 ETP de médecins généralistes pour 100 000 habitants contre 49 ETP pour 100 000 habitants). Toutefois, cette accessibilité relativement bonne en moyenne est nuancée par l’existence de fortes disparités, d’autant plus importantes que l’on s’éloigne des grands pôles.
Moins nombreux, les médecins spécialistes en accès direct sont également répartis de façon plus hétérogène sur le territoire. Ils sont essentiellement concentrés dans les grands pôles urbains, qui seuls bénéficient d’une accessibilité supérieure à la moyenne nationale. L’accessibilité est ensuite d’autant plus faible que l’on s’éloigne des pôles et que les pôles sont de moindre importance. Les communes isolées hors influence des pôles sont donc les moins bien desservies, avec une accessibilité d’1 ETP de chaque spécialité pour 100 000 habitants.
La répartition des professionnels de santé est en outre plus hétérogène pour les professions les moins nombreuses : concernant l’accès aux chirurgiens-dentistes, aux gynécologues ou aux ophtalmologues, un rapport de six à huit sépare les 10 % des habitants les mieux lotis des 10 % des habitants les moins bien lotis. Ce rapport est même de quatorze pour les pédiatres et de dix-neuf pour les psychiatres.
La situation de l’unité urbaine de Paris est particulière, puisqu’elle se caractérise à la fois par une accessibilité aux médecins généralistes très faible par rapport aux autres grands pôles et par une accessibilité aux spécialistes d’accès direct particulièrement élevée.
À l’exception de Paris, les grands pôles urbains cumulent bonne accessibilité et part relativement élevée des professionnels de secteur 1 (20). Les professionnels conventionnés de secteur 2 sont beaucoup plus concentrés dans les pôles que les professionnels de secteur 1. L’unité urbaine de Paris en est l’exemple le plus prégnant : l’accessibilité aux gynécologues y est par exemple la plus élevée, mais seul un cinquième de cette accessibilité est lié à des professionnels de secteur 1. Le constat est similaire pour les autres spécialités. C’est essentiellement l’offre de secteur 2 qui assure à l’unité urbaine de Paris une bonne accessibilité aux soins spécialisés en accès direct.
L’absence de barrière territoriale peut donc cacher des barrières financières. Dans certaines zones qui ne sont pas à proprement parler sous-médicalisées, le secteur 2 est en effet très majoritaire, voire exclusif pour certaines spécialités. Les personnes qui ne peuvent pas payer de dépassements, ou qui ne disposent pas d’assurance complémentaire santé, peuvent alors se retrouver dans un désert médical relatif, en dépit d’une abondance apparente de praticiens Des zones bien dotées en médecins se trouvent ainsi englobées dans des déserts médicaux au regard de l’accessibilité financière des soins.
Les grands pôles urbains autres que Paris profitent en revanche d’une situation particulièrement favorable, avec des niveaux d’accessibilité aux spécialistes similaires à ceux du pôle parisien tout en affichant des parts relativement importantes de soins facturés aux tarifs conventionnels.
Quant aux espaces ruraux, ils cumulent les déficits : la DREES a en effet montré que les difficultés d’accessibilité sont pour une large part cumulatives : les zones peu dotées en médecins généralistes sont également peu dotées en spécialistes en accès direct. Selon la spécialité, 60 % à 80 % de la population dont l’accessibilité aux médecins généralistes est faible ont également une faible accessibilité aux spécialistes en accès direct.
7 % de la population française cumule une accessibilité faible aux médecins généralistes et à au moins deux spécialistes en accès direct. Cette partie de la population réside quasi exclusivement (à plus de 90 %) hors des pôles : 46 % de ces personnes résident dans des communes rurales des périphéries des grands pôles, 27 % dans les couronnes des petits et moyens pôles, et 18 % dans les communes isolées hors de l’influence des pôles.
Enfin, 4 % de la population cumule une accessibilité faible aux généralistes et aux quatre spécialistes en accès direct. De la même manière qu’entre médecins généralistes et spécialistes en accès direct, certaines substitutions dans la prise en charge des soins sont envisageables entre médecins généralistes et infirmiers. La présence d’infirmiers pourrait donc, dans certains cas, atténuer la faible accessibilité aux médecins généralistes. Cette substitution est toutefois rarement possible, dans la mesure où, ici aussi, les territoires cumulent les faibles niveaux d’accessibilité : parmi les personnes ayant une faible accessibilité aux médecins généralistes, les deux tiers ont également une faible accessibilité aux infirmiers. Le constat est cependant légèrement différent concernant la répartition des gynécologues et des sages-femmes libérales : en effet, 56 % des personnes ayant une faible accessibilité aux gynécologues ont une accessibilité moyenne ou élevée aux sages-femmes.
Les analyses conduites tant par le CNOM que par la DREES confirment l’aggravation des inégalités territoriales en matière de répartition des médecins et donc d’accès aux soins – inégalités que l’évolution de la démographique médicale ne peut que contribuer à accentuer.
D’après l’édition 2016 de l’Atlas de la démographie médicale en France publié par le CNOM, entre 1979 et 2016, le nombre de médecins est passé de 118 842 à 285 840, soit une augmentation de 140,5 %. La part des médecins actifs a enregistré une hausse de 92,4 % alors que celle des médecins retraités a bondi de 940 % sur cette période.
EFFECTIFS DES MÉDECINS ACTIFS ET RETRAITÉS DE 2006 À 2016
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |
Actifs |
212 972 |
213 995 |
215 028 |
216 017 |
216 450 |
216 145 |
216 142 |
215 865 |
215 531 |
215 539 |
215 583 |
Retraités |
37 433 |
38 751 |
40 070 |
42 136 |
44 928 |
48 321 |
51 930 |
56 105 |
60 823 |
65 548 |
70 257 |
Total |
250 405 |
252 746 |
255 098 |
258 153 |
261 378 |
264 466 |
268 072 |
271 970 |
276 354 |
281 087 |
285 840 |
Source : CNOM, Atlas de la démographie médicale en France 2016, p. 15.
Si, sur la période 2007-2016, le nombre de médecins en activité régulière est resté stable (reculant seulement de 0,4 %), le nombre de médecins retraités a en revanche connu une forte augmentation (de 87,7 %).
Au 1er janvier dernier, les médecins en activité régulière étaient âgés en moyenne de 51,3 ans. Les médecins âgés de 60 ans et plus représentaient 27,1 % des effectifs alors que les médecins âgés de moins de 40 ans ne représentaient que 18,6 % des effectifs.
Le vieillissement de la population médicale est particulièrement marqué en matière de médecine générale. Alors que les spécialités médicales et chirurgicales voient, dans l’ensemble, leurs effectifs augmenter (avec quelques exceptions toutefois), les effectifs de médecins généralistes sont les premiers touchés par le nombre important de départs en retraite. Ils connaissent une chute inexorable, et ce, de manière préoccupante puisque cette chute devrait se poursuivre jusqu’en 2025 et pourrait se traduire par la perte d’un médecin généraliste sur quatre sur la période 2007-2025. Les quelque 88 886 médecins généralistes en activité régulière au 1er janvier dernier étaient âgés, en moyenne, de 52 ans. 27,3 % étaient âgés de 60 ans et plus, tandis que les moins de 40 ans ne représentaient que 16 % des effectifs.
C’est d’autant plus préoccupant que, comme l’a souligné en 2013 le sénateur Hervé Maurey, « les départements les moins bien dotés en médecins sont aussi parfois ceux où la moyenne d’âge de ceux-ci est la plus élevée. Cette diminution du nombre des médecins, indépendamment des inégalités dans leur répartition géographique, explique la perception aujourd’hui généralisée d’un creusement des déserts médicaux. Alors que les générations nombreuses de médecins des années soixante et soixante-dix sont parties à la conquête de nouveaux territoires, les médecins prenant aujourd’hui leur retraite ne trouvent plus que difficilement des successeurs » (21).
Le maillage du territoire par les médecins généralistes est pourtant crucial pour garantir l’accès aux soins de nos concitoyens : leur rôle de pivot dans l’organisation des parcours de soins et de référent dans l’offre de soins de premier recours en font des acteurs de premier plan de l’organisation du système de santé.
La DREES s’est efforcée d’étudier l’impact que l’évolution de la démographie médicale pourrait avoir, à horizon de cinq ans, sur les inégalités territoriales en matière d’implantation des médecins.
Pour ce faire, elle a défini des zones de vigilance qui doivent donc faire l’objet d’une attention particulière à divers titres, comme l’accessibilité aux médecins de secteur 1 ou le cumul d’accessibilité faible à plusieurs professions de santé. Pour caractériser les zones qui pourraient nécessiter une vigilance accrue dans les prochaines années, la DRESS a retenu le critère de l’âge des médecins auxquels la population a accès. En effet, de nombreux départs à la retraite sont à prévoir dans les prochaines années et ce mouvement est susceptible de modifier la répartition géographique des médecins généralistes libéraux, en touchant certains territoires plus que d’autres. Il est donc important d’identifier les territoires dans lesquels l’offre de soins est en plus ou moins grande partie assurée par des médecins âgés dont le départ à la retraite est prévisible dans quelques années, et pourrait ne pas être compensé par des installations de jeunes médecins.
Les zones de vigilance identifiées par la DREES sont celles où l’accessibilité est inférieure à 50 % de la densité nationale. Ainsi, la densité médicale moyenne étant, pour les médecins généralistes, de 69 ETP pour 100 000 habitants en 2013, le seuil de vigilance s’établit pour cette profession à 35 ETP pour 100 000 habitants.
En raisonnant comme si aucun nouveau médecin généraliste n’allait s’installer en France pendant cinq ans, la DREES a étudié les zones qui seraient les moins bien dotées à cet horizon. Ce sont celles sur lesquelles il convient de porter une vigilance particulière pour favoriser l’installation de jeunes médecins.
Ainsi, pour ce qui concerne la médecine générale, l’accessibilité moyenne des communes faiblement dotées en médecins généralistes était de 22 ETP pour 100 000 habitants, contre 74 ETP pour 100 000 habitants pour les autres communes.
Ces communes sont essentiellement situées hors des pôles urbains : 85 % de la population se trouvant sous le seuil de vigilance résident dans les périphéries rurales des grands pôles urbains, dans les périphéries des petits et moyens pôles ou dans une commune située hors de l’influence des pôles urbains, alors que ces espaces rassemblent 24 % de la population totale. C’est ainsi un tiers de la population de chacun de ces espaces qui se trouve sous ce seuil (respectivement 32 %, 34 % et 28 %). Par ailleurs, en Bourgogne et en Corse, plus d’une personne sur cinq se trouve sous le seuil de vigilance (respectivement 23 % et 22 % de la population).
L’âge moyen de départ à la retraite des médecins généralistes libéraux étant de 65,5 ans en 2013, la DREES a estimé que les communes se trouvant sous le seuil de vigilance à horizon de cinq ans ont accès, en moyenne, à 22 ETP de médecins de moins de 60 ans pour 100 000 habitants, contre 61 ETP pour 100 000 habitants pour les autres communes.
Cette potentielle perte d’accessibilité touche, pour moitié, des personnes résidant dans les espaces situés à la périphérie des pôles ou hors de leur influence, soit des espaces relativement peu dotés aujourd’hui : au total, dans ces territoires, c’est environ une personne sur deux qui réside dans une commune située sous le seuil de vigilance à 5 ans (respectivement 51 % de la population dans les couronnes rurales des grands pôles, 55 % dans les communes des couronnes des petits et moyens pôles et 45 % dans les communes isolées hors influence des pôles).
Cinq régions de France métropolitaine (Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne et Picardie) sont particulièrement susceptibles d’être touchées par les départs à la retraite, avec environ un tiers de la population régionale sous le seuil de vigilance à horizon de cinq ans. Si leurs situations sont très hétérogènes, tous les départements d’outre-mer (DOM), hormis La Réunion, ont en commun une part élevée de la population située en zone de vigilance actuelle ou à venir.
Bien que très peu concernée aujourd’hui, l’Île-de-France est susceptible de connaître une forte augmentation de ses difficultés d’accessibilité : en cas de non-compensation des départs en retraite, c’est ainsi un Francilien sur quatre qui se retrouverait sous le seuil de vigilance dans cinq ans.
À l’opposé, les régions Nord-Pas-de-Calais et PACA ne sont que très peu touchées par les départs à la retraite, la part de population sous le seuil de vigilance passant de 2 % et 3 % respectivement actuellement, à 6 % et 7 % à horizon de cinq ans.
ZONES DE VIGILANCE ACTUELLES ET ZONES DE VIGILANCE À HORIZON DE CINQ ANS
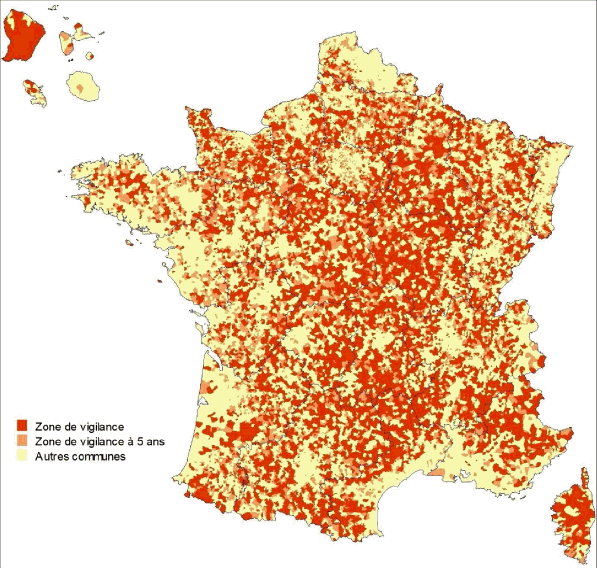
Champ : médecins généralistes libéraux (hors médecins à exercice particulier), France entière, hors Mayotte.
Source : DREES, SNIIR-AM 2013, CNAM-TS, Population municipale 2011, INSEE, Fonds de carte IGN.
N-B : les zones de vigilance correspondent aux communes situées sous le seuil de vigilance actuel. Les zones de vigilance à cinq ans correspondent aux communes situées au-delà du seuil de vigilance actuel, mais sous le seuil de vigilance à cinq ans.
Au vieillissement de la profession médicale s’ajoutent sa féminisation (22), et, plus globalement, l’évolution des aspirations des jeunes médecins en termes de conditions de vie et de travail, qui sont allées de pair avec une augmentation des temps partiels et une diminution du temps médical, alors que la demande de soins de la population tend à augmenter.
D’après le sénateur Hervé Maurey, « les femmes devraient représenter 50 % du total des médecins dès 2020, et 53,9 % à l’horizon 2030. Mais, s’il est vrai qu’une femme médecin consacrera davantage de temps qu’un homme à ses enfants et à sa famille à certaines périodes de sa carrière, l’aspiration à un meilleur équilibre de vie est aujourd’hui très également partagée par ses pairs masculins. L’aspiration à davantage d’équilibre est plus une question de génération, que de sexe » (23).
Le rapporteur estime que, plus encore que la féminisation de la profession – qui est positive –, c’est le changement de mode de vie des jeunes médecins et l’accroissement de leurs charges administratives qui contribuent à expliquer la diminution du temps médical. Tout comme les autres professionnels libéraux, les jeunes médecins aspirent à mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
Une étude sur les emplois du temps des médecins généralistes publiée par la DREES en mars 2012 a montré, sur la base d’une enquête réalisée en 2011 auprès d’un échantillon représentatif, que 78 % des médecins généralistes déclarent travailler plus de 50 heures par semaine, la durée hebdomadaire moyenne étant de 57 heures, avec un écart de quatre heures entre les zones rurales (60 heures) et les zones urbaines (56 heures).
Les médecins généralistes déclarent consacrer en moyenne quatre heures aux tâches de gestion, secrétariat et comptabilité, en dehors des consultations et visites, soit 7 % de leur temps de travail hebdomadaire moyen. En outre, un médecin sur sept (14 %) déclare effectuer lui-même l’entretien des sols des locaux – une charge non négligeable puisque environ 80 minutes par semaine y sont alors consacrées.
Les aspirations des nouvelles générations expliquent aussi leur préférence marquée pour le salariat. En effet, la part de l’exercice libéral décroît : aujourd’hui, seul un médecin sur dix s’installe en libéral à l’issue de ses études. Toutefois, une étude de cohorte citée par le CNOM montre que, s’il est vrai que, lors de leur première inscription à l’ordre, seuls 10,8 % des jeunes diplômés font le choix d’exercer à titre libéral, ce taux remonte sensiblement après quelques années. Ainsi, 33,3 % des inscrits de 2008 exercent en libéral en 2016 (24).
Aspiration à meilleur équilibre de vie, féminisation croissante, développement du salariat… tout cela conduit le temps d’exercice médical effectivement disponible à se réduire, d’autant que la charge des tâches administratives va en s’accroissant et que la lassitude des médecins face aux contraintes du métier contribue au raccourcissement de la durée des carrières.
Or, si le temps d’exercice médical se réduit, le temps d’attente des patients tend, lui, à s’allonger. D’après le sénateur Hervé Maurey, « selon les données de l’assurance maladie, alors que le délai d’attente pour consulter un médecin généraliste n’est en moyenne que de 4 jours, il est de 103 jours pour un ophtalmologiste, 51 jours pour un gynécologue et de 38 jours pour un dermatologue » (25).
Selon une enquête réalisée par l’Institut français d’opinion publique (IFOP) en octobre 2011 pour le cabinet de conseil en assurance-santé Jalma, 58 % des Français interrogés déclarent avoir déjà renoncé à des soins en raison de la difficulté d’obtenir un rendez-vous chez un médecin spécialiste.
Ces chiffres sont extrêmement préoccupants, car les délais d’attente peuvent priver les patients des soins dont ils ont besoin, ou retarder ceux-ci, au risque de mettre gravement en danger la santé des personnes concernées.
Une étude sur la « fracture sanitaire » rendue publique en juin 2016 par l’UFC-Que choisir, qui a analysé l’offre exhaustive de soins de ville pour quatre spécialités (généralistes, pédiatres, ophtalmologistes et gynécologues), a montré qu’entre 2012 et 2016, l’accès géographique aux médecins généralistes (à moins de 30 minutes du domicile) s’est dégradé pour plus du quart de la population. L’accès aux médecins spécialistes a diminué pour 38 % des Français en ce qui concerne les ophtalmologistes, 40 % pour les pédiatres et même 59 % de la population pour l’accès aux gynécologues (26).
Selon les spécialités, ce sont entre 14,6 millions (pour les généralistes) et 21,1 millions (pour les pédiatres) d’usagers qui vivent dans un territoire où l’offre de soins libérale est notoirement insuffisante. Mais à ces déserts médicaux « des champs », il faut ajouter les déserts médicaux « des villes », qui eux sont financiers. D’après l’UFC-Que choisir, lorsque l’on cherche à se soigner sans dépassement d’honoraires, c’est plus de 8 Français sur 10 qui n’ont pas suffisamment d’ophtalmologistes ou de gynécologues autour de chez eux.
Ces évolutions générales ne peuvent que susciter une inquiétude d’autant plus forte et légitime que les spécialistes en économie de la santé estiment que la demande de soins est appelée à poursuivre sa hausse de long terme sous l’effet du vieillissement de la population. En effet, la situation épidémiologique de notre pays se caractérise par un développement croissant des poly-pathologies liées à l’âge ainsi que des pathologies chroniques (diabète, cancer, etc.), nécessitant un suivi et une prise en charge au long cours des patients organisée autour des médecins traitants.
Par ailleurs, les soins de santé sont des services « supérieurs » dont le niveau de consommation s’accroît plus que proportionnellement au niveau de revenu. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dans l’ensemble des pays développés, la dépense totale de santé a, jusqu’à la fin des années 1980, connu un rythme de croissance plus rapide que celui de la richesse nationale, et a donc mécaniquement tendu à représenter une part toujours plus importante du produit intérieur brut (PIB). D’après le sénateur Hervé Maurey, « en 1970, la France consacrait 5,6 % de sa richesse à la dépense totale de santé. En 2011, cette part était passée à 12 %. La France se situe ainsi dans le groupe de tête des pays de l’OCDE, derrière les États-Unis (17,6 % du PIB), à égalité avec l’Allemagne et les Pays-Bas, mais nettement devant le Royaume-Uni (7,5 % du PIB) » (27).
Face à ces besoins de soins croissants de la population, la démographie médicale est sur une pente nettement déclinante pour la décennie à venir, en raison principalement des effets décalés dans le temps des décisions de resserrement du numerus clausus (28)jusque dans les années quatre-vingt-dix – effets que les multiples dispositifs correctifs mis en œuvre sont toujours impuissants à contrer.
Le constat de l’existence de déserts médicaux n’est pas nouveau, et des dispositifs ont été mis en place pour y remédier par presque tous les gouvernements successifs depuis le début des années quatre-vingt-dix.
Pourtant, comme l’UFC-Que choisir l’a montré dans son étude sur l’accès aux soins publiée en juin dernier, la fracture sanitaire s’aggrave et les mesures financières censées inciter « les médecins à s’installer dans les zones sous-dotées prouvent ici leur criante inefficacité » (29).
Le principe de liberté d’installation des médecins n’y est pas pour rien. Ce principe est posé par l’article L.162-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que « dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin ».
Consacrée par la loi, la liberté d’installation des médecins est néanmoins qualifiée par le code de la sécurité sociale de « principe déontologique fondamental ». Les contours en sont effectivement précisés par le code de déontologie médicale, prévu par l’article L. 4127-1 du code de la santé publique, et qui fait l’objet des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 dudit code. Les limites apportées par le code de déontologie médicale au principe de liberté d’installation sont établies dans le but de préserver la qualité des soins susceptibles d’être dispensés dans les différents lieux où se propose d’exercer le médecin, d’éviter un détournement de clientèle par le médecin ayant effectué un remplacement et de protéger les intérêts du premier médecin installé dans un immeuble en évitant toute confusion dans l’esprit des patients.
Les trois limites au principe de liberté d’installation des médecins
1° Le lieu habituel d’exercice du médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l’ordre dont il relève ; l’exercice de la médecine sur un ou plusieurs autres lieux doit faire l’objet d’une autorisation par le conseil départemental (art. R. 4127-85 du code de la santé publique).
2° Un médecin qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. À défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du conseil départemental de l’ordre (art. R. 4127-86 du code de la santé publique).
3° Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande (art. R. 4127-90 du code de la santé publique).
Sous ces réserves, le médecin souhaitant exercer à titre libéral s’inscrit auprès de l’ordre départemental des médecins dans le département où il a décidé de s’installer. Le conseil départemental de l’ordre s’assure qu’il remplit les conditions légales de diplôme et de nationalité. L’inscription au tableau n’est pas conditionnée par le nombre de médecins déjà inscrits, la spécialisation du médecin demandeur ou la localisation choisie au sein du département. En vertu de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique, l’inscription a pour effet de rendre licite l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.
L’installation des médecins demeure donc faiblement régulée… et force est aujourd’hui de constater que les mesures mises en œuvre tant dans le cadre de la formation des médecins (A) qu’à l’issue de celle-ci, sous forme d’incitations financières à l’installation dans des zones sous-dotées (B), ont échoué.
Les effectifs de la plupart des professions de santé font aujourd’hui l’objet de quotas d’entrée en formation. Les étudiants en médecine ont été les premiers concernés par le numerus clausus instauré par une loi de 1971.
L’article L. 631-1 du code de l’éducation prévoit en effet qu’à l’issue de la première année des études de santé commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme (PACES), le nombre des étudiants admis dans chacune de ces filières est déterminé par un arrêté des ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de la Santé.
Celui-ci a été fixé initialement à 8 500 étudiants admis en deuxième année, alors que les dernières promotions avant son instauration étaient deux fois plus nombreuses.
Puis il a été progressivement réduit à partir de la fin des années 1970, en raison des craintes relatives à une possible « pléthore médicale ». Inspiré par le souci de maîtriser les dépenses de santé en exerçant une contrainte sur l’offre de soins, le numerus clausus des médecins a atteint son plancher en 1993, au niveau de 3 500, avant de remonter progressivement, puis de manière plus nette depuis 2002 (30) . Il a été fixé à 7 646 pour 2016, soit une augmentation de 149 places par rapport à 2015 – année où, dans le cadre du « Pacte territoire santé » mis en place par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, le numerus clausus a été augmenté de 131 places dans dix régions en manque de médecins, à savoir les Antilles-Guyane, l’Auvergne, la Basse-Normandie, la Bourgogne, le Centre-Val-de-Loire, la Haute-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Réunion et la région Rhône-Alpes.
S’il est vrai que l’article L. 631-1 du code de l’éducation prévoit que le numerus clausus « tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés », il n’en demeure pas moins que, de l’aveu même du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), ce dispositif « a fait la preuve de son inefficacité » (31) :
– d’abord parce qu’il ne régule en rien la démographie médicale (en raison d’une déconnexion entre la première année des études de santé commune – PACES – et la réalité des besoins démographiques) ;
– ensuite parce qu’il est largement contourné (d’après le CNOM, 25 % des médecins inscrits à l’ordre entre 2009 et 2014 ne sont pas titulaires du diplôme français, beaucoup d’étudiants entamant en outre leurs études hors de France) ;
– enfin parce qu’il est insuffisamment adapté aux besoins, entraînant ainsi une alternance de périodes « fastes » et de périodes « creuses ».
Le Livre Blanc du CNOM publié en janvier dernier fait état d’un « important gâchis humain (80 % d’échecs au concours 2015) », que ne fait que renforcer une absence de passerelles vers des formations de niveau licence.
Par ailleurs, en dépit de l’augmentation du nombre de postes ouverts aux épreuves en médecine générale, on observe un nombre croissant de postes non affectés à l’issue des épreuves.
Dans son Livre Blanc, le CNOM souligne la nécessité de réformer le système et formule des propositions pour développer une formation initiale plus proche du terrain – et le plus tôt possible dans le cursus des études de médecine – afin de renforcer l’attractivité d’une spécialité et de territoires en souffrance.
Le CNOM a ainsi proposé de fixer le numerus clausus en fonction des capacités de formation des universités et des besoins des territoires. Il s’agirait de créer un numerus clausus régionalisé, en fonction des besoins des territoires par spécialité, des capacités de formation des établissements universitaires et des possibilités d’organisation de stages durant la scolarité sur les territoires.
Le CNOM préconise également de mettre en place un socle commun à toutes les professions de santé en première année. La formation à l’exercice de certaines professions de santé n’a en effet pas lieu à l’Université (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs en radiologie…). Cette absence de filières universitaires spécifiques réduit le nombre de débouchés et de passerelles précoces. Le CNOM estime donc nécessaire de commencer par créer des filières universitaires pour les professions réglementées, d’organiser un socle commun pour toutes les professions de santé lors de la première année d’études, en définissant de nouveaux prérequis scientifiques, médicaux et juridiques pour le concours de fin de première année, d’organiser des stages interprofessionnels dès la deuxième année, pour mieux connaître les autres professions de santé et d’inscrire les filières universitaires des professions de santé dans des facultés de sciences médicales et regrouper ces facultés au niveau régional.
Le CNOM a par ailleurs appelé à accorder aux étudiants en médecine des équivalences vers d’autres filières universitaires sur le principe du système « Licence, Maîtrise, Doctorat » (LMD) en créant des passerelles précoces avant le concours de fin de première année, vers d’autres voies (sciences, droit, physique…) sur la base d’accords interuniversitaires.
En cas d’échec au concours de première année, des passerelles vers une deuxième année d’une autre filière « LMD » seraient ouvertes, en tenant compte de la note obtenue.
Des passerelles devraient en outre être créées à un stade plus tardif des études de médecine, si les étudiants manifestent leur volonté de rejoindre une autre profession de santé.
Dans ce même Livre Blanc, le CNOM suggère de régionaliser la formation initiale des médecins et de renforcer la professionnalisation du deuxième cycle à l’internat. En effet, ce deuxième cycle pâtit d’un manque de professionnalisation en dehors de l’hôpital. L’enseignement théorique prend une part de plus en plus importante dans les emplois du temps. La fin du deuxième cycle est marquée par les épreuves classantes nationales (ECN), qui ont remplacé depuis 2004 le concours de l’internat. En fonction de leur classement, les étudiants choisissent leur centre hospitalier universitaire d’affectation, leur filière de spécialité et les services où ils effectueront leurs stages de six mois.
Ce système pose aujourd’hui un certain nombre de problèmes :
– il impose d’abord une année de préparation consacrée quasi-exclusivement aux révisions, sans projet de formation, ce qui ne donne pas de vision exhaustive de la discipline ;
– ensuite, l’examen classe, sans note éliminatoire, un choix géographique et de spécialité qui se fait souvent par défaut, avec peu de possibilités de changement d’orientation ;
– enfin, la mobilité des étudiants n’a aucun impact sur la densité médicale dans les territoires.
Le CNOM propose donc de remplacer les épreuves classantes nationales (ECN) par des épreuves classantes interrégionales (Ecir). Pour former les médecins dont les territoires ont besoin, plutôt que les internes dont ont besoin les centres hospitaliers, le CNOM suggère qu’en fin de deuxième cycle, les étudiants passent une épreuve classante organisée sur cinq grandes interrégions : Île-de-France, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est. Les places disponibles seraient définies pour chaque grande interrégion et pour chaque spécialité, en fonction des besoins démographiques régionaux.
De nouvelles règles seraient mises en place : possibilité de concourir sur plusieurs interrégions (avec un maximum de 3 concours par année) sur deux années ; instauration d’une note éliminatoire avec possibilité de redoublement ; garantie de l’équité au niveau national sur les concours interrégionaux.
Parallèlement, le CNOM estime nécessaire de renforcer la professionnalisation des études. Après la première année d’acquisition des sciences médicales fondamentales, le cursus devrait permettre aux étudiants de mieux connaître l’organisation du système de santé et les divers modes d’exercices médicaux, moyennant :
– au cours du deuxième cycle, un enseignement théorique des pathologies, complété par plusieurs stages hospitaliers, dans les territoires et dans des services et cabinets agréés ;
– au cours du troisième cycle, quatre ou cinq années d’internat selon la filière du diplôme d’études spécialisées (DES) choisi au sein de toutes les structures de soins publiques et privées (cabinets médicaux, dispensaires, services hospitaliers publics non universitaires ou privés), avec le développement effectif de stages ambulatoires pour toutes les spécialités. Un stage de fin de cursus obligatoire serait organisé dans les centres hospitaliers de territoire.
Cette professionnalisation s’effectuerait sous forme de liens conventionnels et/ou contractuels, sous le contrôle du directeur général de l’ARS, des doyens, des conseils régionaux de l’ordre des médecins, des unions régionales des professionnels de santé (URPS) et des commissions médicales d’établissements.
En outre, un nouveau « parcours post-DES de territoire » serait créé pour inciter à l’exercice volontaire dans les territoires sous-médicalisés. D’une durée de trois ans, ce nouveau parcours serait proposé aux nouveaux diplômés, dans leur spécialité et dans une zone en tension de la grande « inter-région » dans laquelle ils auraient obtenu leur diplôme. En contrepartie d’un exercice de trois ans dans la zone définie, ces médecins bénéficieraient de compensations : avantages sociaux, progression de carrière plus rapide, avantages conventionnels (accès automatique au secteur 2), etc.
Le rapporteur se réjouit que bon nombre des préconisations du CNOM aillent dans le sens du texte qu’il défend depuis déjà plusieurs années. Il n’est cependant pas certain qu’un nouveau « parcours post-DES de territoire » reposant sur la « vieille » logique d’incitation financière suffise à convaincre les jeunes médecins fraîchement diplômés de s’installer dans des zones sous-dotées.
En effet, avant de choisir un lieu d’exercice, les médecins analysent leur charge de travail future, c’est-à-dire la patientèle, les contraintes liées à l’organisation de la permanence des soins, la proximité d’autres professionnels de santé et d’un plateau technique, mais aussi la qualité de vie en général.
Or ce choix est rarement individuel. Il s’agit le plus souvent d’une décision de couple, qui dépend des possibilités d’activité professionnelle pour le conjoint et de scolarisation pour les enfants.
Toutes ces considérations n’incitent pas à l’installation dans les zones déjà fragilisées au regard de la densité médicale, si grandes les incitations financières soient-elles.
B. L’INEFFICACITÉ DES COÛTEUX DISPOSITIFS PUBLICS D’INCITATION À L’INSTALLATION DANS DES ZONES SOUS-DOTÉES
Les nombreuses tentatives des gouvernements successifs pour instaurer des mécanismes de régulation susceptibles d’influer directement sur l’installation des médecins se sont, pour l’heure, toutes soldées par des échecs, qu’il s’agisse de dispositifs mis en place par l’État, par les collectivités territoriales ou par l’assurance-maladie.
Quant aux mesures structurelles de planification régionale de l’offre de soins et de permanence des soins, elles n’ont eu, à ce jour, qu’un impact limité.
Si utiles et efficaces que soient les maisons et pôles de santé pluriprofessionnels, ces structures de soins présentent des fragilités et des limites.
Ce modèle possible de réorganisation de la médecine de premier recours, jusqu’à présent majoritairement exercée de manière individualiste avait déjà été expérimenté dès les années 1980 dans les centres de santé salariés et dans quelques maisons de santé libérales, mais n’était alors pas parvenu à s’imposer.
Il revient aujourd’hui sur le devant de la scène comme une réponse à la désertification médicale, et les expériences se multiplient, promues par des professionnels de santé et des élus.
Certes, les médecins libéraux montrent depuis longtemps une préférence pour l’exercice regroupé, désormais devenu le mode d’exercice majoritaire. Mais, alors que le mode d’exercice regroupé le plus classique était celui du cabinet de groupe, les maisons ou pôles de santé pluriprofessionnels apparaissent comme une forme nouvelle de regroupement.
Une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) est en effet le regroupement dans des locaux communs de plusieurs médecins généralistes et infirmiers exerçant à temps plein, et d’autres professionnels de santé exerçant à temps plein ou partiel : médecins spécialistes, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, podologues, diététiciens, psychologues, orthophonistes, psychologues, etc.
Un pôle de santé pluriprofessionnel (PSP) est un réseau fonctionnel de praticiens libéraux, dépourvu de locaux communs. Il peut associer des professionnels isolés, mais aussi déjà regroupés en maisons ou centres de santé. Certaines MSP ou certains PSP peuvent être adossés à un hôpital de proximité, une clinique privée ou un établissement médico-social.
La simple juxtaposition de cabinets de groupe libéraux ne forme pas une MSP ou un PSP. Ces structures, en rompant avec l’isolement, permettent d’améliorer les conditions d’exercice et le cadre de travail des professionnels de santé. L’équipement y est supérieur à la moyenne, les pratiques coopératives développées, les conditions de travail plus souples, avec notamment des périodes de congés plus longues à activité égale. Pour les patients, elles offrent une plus grande accessibilité horaire, sans accroître le temps de travail individuel des professionnels de santé.
On assiste aujourd’hui à une véritable floraison d’initiatives qui bénéficient des financements du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (Fiqcs) ainsi que, le plus souvent, des collectivités territoriales concernées. D’après la ministre des Affaires sociales et de la Santé, « il y avait 150 maisons de santé pluriprofessionnelles en 2012, il y en aura 1 200 en 2017 ; c’est un mode d’exercice qui est plébiscité par les jeunes professionnels » (32).
Toutefois, comme l’a signalé le sénateur Hervé Maurey dès 2013, « le risque est grand pour les collectivités territoriales qui réalisent l’investissement dans les murs avant d’être certaines de l’engagement des professionnels de santé, de voir celui-ci ne jamais se concrétiser. Ainsi, les cas ne sont pas rares de communes ou de communautés de communes qui ont financé, dans l’espoir d’accueillir une MSP, des bâtiments qui sont demeurés vides par la suite, ce qui constitue un intolérable gâchis d’argent public ». En outre, « les MSP et PSP contribuent d’une certaine manière à accélérer le processus de concentration géographique des professionnels de santé. Ces structures peuvent aider à maintenir la présence de ceux-ci dans les zones en voie de fragilisation, mais ne peuvent pas répondre aux besoins des zones déjà désertées » (33).
Les modifications apportées à l’organisation de l’offre de soins par
la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
La loi n° 2016-41 a modifié l’organisation de l’offre de soins en tentant de renforcer sa territorialisation.
Création des communautés professionnelles territoriales de santé
La loi permet à l’ensemble des professionnels l’opportunité de constituer des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) réunissant les maisons de santé, les professionnels de santé de premier et second recours, les acteurs sociaux et médico-sociaux.
L’ambition de ces communautés professionnelles territoriales de santé, qui est d’assurer une meilleure coordination de leur action respective, de structurer des parcours de santé et de réaliser les objectifs du projet régional de santé.
Afin de préciser les actions mises en œuvre à ces fins, les professionnels procéderont à la rédaction d’un projet de santé qui sera transmis pour validation à l’ARS.
Création d’un contrat territorial de santé en complément du contrat local de santé
La mise en œuvre des projets régionaux de santé (PRS) peut faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus par l’ARS, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. Ces CLS participent à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé et concernent les territoires particulièrement vulnérables. Ils peuvent associer d’autres acteurs que les collectivités territoriales : caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM), caisses d’allocations familiales (CAF), associations, mutuelles, etc..., pour créer une dynamique de santé locale, cohérente et coordonnée, en réponse à des besoins clairement identifiés à partir d’un diagnostic local partagé.
Sur la base d’un diagnostic territorial de santé, les équipes de soins et les CPTS peuvent désormais en lien avec l’ARS se doter d’un contrat territorial de santé. L’article L. 1434-23 du code de la santé publique prévoit que « pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux […] et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé [qui définissent] l’action assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation. À cet effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d’intervention régional ».
Développement des centres de santé universitaires
Afin de renforcer l’attractivité médicale des territoires, la loi de modernisation du système de santé a encouragé le développement de centres de santé universitaires qui, aux termes de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, sont des centres de santé, ayant signé une convention tripartite avec l’ARS dont ils dépendent et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins primaires.
Les médecins peuvent bénéficier des dispositifs d’exonération d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés au titre d’une installation dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et dans les zones de revitalisation rurales (ZRR), prévues par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. L’exonération est totale pendant les cinq premières années, puis dégressive durant neuf ans.
La loi du 23 février 2005 précitée a également prévu une exonération d’impôt sur le revenu au titre de la participation à la permanence des soins, à hauteur de soixante jours de permanence par an, pour les médecins installés dans une zone déficitaire en offre de soins, telle que définie dans le schéma régional de santé.
Ces exonérations fiscales se doublent, en ZRU comme en ZRR, d’une exonération de charges sociales financée par l’État au titre de l’embauche d’un salarié par un cabinet médical. Elles s’accompagnent, en ZRR seulement, d’une possibilité d’exonération de taxe professionnelle.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (34) a par ailleurs créé un dispositif qui offre aux « praticiens territoriaux de médecine générale » (PTMG) qui exercent en zones sous-dotées une garantie de revenu différentielle pendant deux ans au maximum.
Destiné à de jeunes diplômés qui viendraient soutenir et prendre le relais des professionnels qui partent à la retraite, le dispositif prévoit la conclusion, entre les ARS et de jeunes médecins généralistes non-installés ou installés depuis moins d’un an, de contrats d’un an renouvelables une fois, sur la base desquels ces derniers percevront une rémunération complémentaire aux revenus tirés de l’activité de soins qu’ils devront exercer, en qualité de « praticien territorial de médecine générale », dans des zones définies par l’ARS et caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.
Sous réserve que le « PTMG » réalise 165 consultations par mois et qu’il pratique les tarifs du secteur 1 de la Sécurité sociale, il se voit garantir un complément de rémunération calculé par la différence entre un revenu mensuel brut garanti de 6 900 euros brut/mois et le montant des honoraires qu’il a perçus (actes et majorations associées) compte tenu de son activité réelle. Le revenu mensuel minimal garanti s’élève ainsi à 3 640 euros nets. Pour le calcul du complément de rémunération, ne sont inclus ni les revenus perçus au titre des aides conventionnelles ni les revenus issus de la permanence des soins organisée (honoraires et rémunérations forfaitaires au titre des astreintes et de la régulation).
En plus de ce complément de rémunération, le PTMG bénéficie d’un dispositif avantageux en matière de protection sociale (maladie, maternité). Sous réserve d’être PTMG depuis au moins trois mois et d’avoir réalisé au moins 495 consultations durant le trimestre précédent, il est indemnisé en cas de maladie – pour tout arrêt de travail supérieur à 7 jours – et en cas de maternité durant toute la durée du congé. En cas de maladie, l’indemnisation correspond à la moitié du complément de rémunération maximal, soit 1 820 euros brut par mois. Elle est versée pendant 3 mois maximum par arrêt maladie. En cas de congé de maternité, l’indemnisation correspond au complément de rémunération maximal, soit 3 640 euros brut par mois.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (35) a complété ce dispositif en créant un dispositif qui offre une protection sociale améliorée aux « praticiens territoriaux de médecine ambulatoire » (PTMA) souhaitant s’installer et exercer dans des zones sous-dotées.
Tout médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, en secteur 1 ou 2, peut, depuis le 1er janvier 2015, signer avec l’ARS un contrat d’une durée de trois ans renouvelable une fois, aux termes duquel il bénéficie d’un complément de rémunération (jusqu’à 3 105 euros brut par mois en cas de congé maternité et jusqu’à 1 118 euros brut par mois en cas de congé paternité) s’il s’installe une activité médicale libérale dans une zone définie par l’ARS comme sous-dotée, s’il respecte les tarifs du secteur 1 ou modère ses dépassements d’honoraires en cas d’exercice en secteur 2 et se fait remplacer en cas de congé maternité ou paternité.
À ces conditions s’ajoute, comme pour les contrats de « PTMG », le respect d’engagements individualisés pouvant porter sur les modalités d’exercice, des actions d’amélioration des pratiques, de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, ainsi que des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins et la permanence des soins ambulatoires.
L’engagement n° 3 du « pacte territoire santé n° 1 » présenté en décembre 2012 par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, fixait un objectif de 200 PTMG dès 2013. D’après le site Internet du ministère des Affaires sociales et de la Santé, on en comptait 180 en décembre 2013 (36).
L’engagement n° 2 du « pacte territoire santé n° 2 » lancé en novembre 2015 par la même Marisol Touraine a revu cet objectif à la hausse, visant 1 000 installations de PTMG et de PTMA d’ici l’an prochain. D’après le site Internet du ministère des Affaires sociales et de la Santé, on ne comptait toutefois que 480 PTMG en octobre 2015.
Le 25 octobre dernier, lors de la discussion générale du PLFSS pour 2017, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, a indiqué que « 650 jeunes médecins ont d’ores et déjà signé un contrat de praticien territorial de médecine générale » (37).
On peut néanmoins douter de l’efficacité de ces dispositifs, tant du point de vue du nombre de médecins mobilisés que de la pérennité de telles dispositions qui tiennent plus de la rustine ou du replâtrage que d’une rénovation complète du dispositif d’installation des médecins sur le territoire.
Si les dispositifs de « PTMG » et de « PTMA » peuvent rassurer les plus timorés, ils ne seront certainement pas décisifs : ils paraissent même bien dérisoires au regard de la fracture sanitaire à laquelle le pays est confronté.
La loi du 23 février 2005 a autorisé les collectivités territoriales dans les zones déficitaires à attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales, ainsi que des aides visant à favoriser l’installation ou le maintien des médecins (article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales).
Ces aides peuvent consister dans :
– la prise en charge, en tout ou en partie, des frais d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité de soins ;
– la mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;
– la mise à disposition d’un logement ;
– le versement d’une prime d’installation ;
– le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d’une prime d’exercice forfaitaire.
En contrepartie de ces aides, leurs bénéficiaires doivent s’engager à rester en exercice effectif (libéral ou salarié) dans la zone sous-dotée pendant au moins trois ans, en secteur 1. Leurs engagements sont prévus par une convention tripartite passée entre la collectivité territoriale, l’assurance-maladie et le professionnel de santé.
Les régions ont ainsi pu mettre en place des contrats régionaux d’exercice sanitaire afin de maintenir l’activité médicale et paramédicale dans les territoires classés en zone déficitaire, ou dans les zones identifiées comme fragilisées au titre de la démographie médicale et/ou paramédicale suivant les données des ARS.
Co-signataires de ces contrats, les communes d’implantation accompagnent les praticiens de premier recours bénéficiaires (médecins généralistes ou spécialistes, sages-femmes, infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes) dans leurs démarches d’installation et dans l’exercice de leur activité.
Les dépenses éligibles aux aides sont les travaux d’installation et d’équipement pour les professionnels de santé qui s’installent sur la zone et les travaux et équipements de sécurisation des locaux pour les professionnels déjà installés. Si les professionnels de santé sont salariés dans une structure médicale ou médico-sociale, les dépenses sur lesquelles porte la subvention doivent incomber aux professionnels concernés, et non à la structure.
La loi du 23 février 2005 précitée a également permis aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale qui effectuent leurs stages en zones déficitaires.
Enfin, une « indemnité d’étude et de projet professionnel » peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s’il s’engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans une zone déficitaire. Ce dispositif a préfiguré le contrat d’engagement de service public (CESP) instauré au niveau national.
La loi du 23 février 2005 a également prévu la possibilité :
– pour les communes d’exonérer de cotisation professionnelle, pendant deux à cinq ans, les médecins libéraux qui s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située en ZRR (articles 1464 D et 1465 A du code général des impôts) ;
– pour les collectivités territoriales ou leurs groupements de réaliser ou de subventionner la réalisation d’équipements sanitaires pour le maintien de services de santé en zones de montagne.
Dans son rapport sur la Sécurité sociale de septembre 2011, la Cour des comptes a signalé que ces mesures présentaient un risque de redondance et de concurrence entre territoires, en l’absence de coordination nationale, pour attirer de jeunes internes ou des médecins.
La Cour des comptes a déploré que ces mesures ne fassent pas l’objet d’un recensement des aides effectivement accordées, ni d’une évaluation.
Dans son rapport sur la présence médicale sur l’ensemble du territoire, le sénateur Hervé Maurey a indiqué que, « pour tenter d’évaluer le coût de ces dispositifs, [il] s’est adressé directement aux vingt-six ARS pour leur demander des éléments d’évaluation. Les réponses qu’il a pu obtenir confirment le foisonnement des aides accordées par les collectivités territoriales, notamment pour le soutien aux maisons de santé pluriprofessionnelles, et la difficulté d'une évaluation précise. Dans leur très grande majorité, les ARS ont en effet répondu qu’elles n’étaient pas en mesure de communiquer d’éléments chiffrés » (38).
Outre ces difficultés d’évaluation, le rapporteur tient à souligner que, d’après des informations qui lui ont été transmises, un certain nombre de jeunes professionnels de santé ayant bénéficié d’aides de la part des collectivités territoriales, notamment au titre de l’indemnité d’étude et de projet professionnel, préfèrent « racheter » leur liberté d’installation en les remboursant plutôt que de s’installer dans des zones déficitaires.
Établissements publics de l’État à caractère administratif créés par la loi « HPST » du 21 juillet 2009, les agences régionales de santé (ARS) sont chargées, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional des objectifs de la politique nationale de santé et des principes de l’action sociale et médico-sociale.
En application de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique, les ARS définissent un projet régional de santé qui, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, fixe leurs objectifs pluriannuels dans leurs domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
Conformément à l’article L. 1434-2 du même code, ce projet régional de santé (PRS) est constitué :
– d’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;
– d’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;
– et d’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels.
Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l’organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
En vertu de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, le schéma régional de santé indique, dans le respect de la liberté d’installation, les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours et des soins de second recours (39) – étant précisé que les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.
À un niveau encore plus fin que le bassin de vie, les ARS sont donc chargées de déterminer les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé. Pour ce faire, le directeur général de l’ARS détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés :
– les zones sous-dotées caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ;
– les zones sur-dotées dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions avec l’assurance maladie ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement.
Ce zonage conditionne donc le bénéfice de certains dispositifs d’aide financés par l’assurance maladie et destinés à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé.
L’avenant n° 20 à la convention médicale avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de 2005, approuvé par arrêté du 23 mars 2007, a institué une majoration de 20 % des honoraires des médecins généralistes libéraux exerçant en groupe dans les zones déficitaires identifiées par les anciens schémas régionaux d’organisation des soins (SROS), désormais baptisés schémas régionaux de santé.
Selon la Cour des Comptes, cette mesure a eu un effet d’aubaine. D’un coût élevé de 20 millions d’euros pour 773 bénéficiaires en 2010, elle ne s’est traduite que par un apport net de l’ordre de 50 médecins dans les zones déficitaires depuis 2007. En outre, la majoration de 20 % a représenté en moyenne 27 000 euros par médecin concerné et a même dépassé 100 000 euros pour l’un d’entre eux, ce qui a conduit la Cour à s’interroger sur la réalité de l’activité correspondante et sur l’absence de plafonnement de l’aide.
Dans le cadre de la nouvelle convention médicale, entrée en vigueur le 26 septembre 2011, le dispositif d’incitation de l’avenant n° 20 a été redéfini, avec la mise en place de « l’option démographie », complétée par une nouvelle « option santé solidarité territoriale » pour les médecins libéraux exerçant sur une commune en zone sous-dotée, ou souhaitant y assurer des consultations.
L’option « démographie » élargit le périmètre du dispositif de 2007 à tous les médecins libéraux, généralistes ou spécialistes, de secteur 1 ou de secteur 2 adhérant à l’option de coordination, ou de secteur 2 pratiquant les tarifs opposables dans la zone. Elle concerne les médecins exerçant leur activité en groupe ou en pôle de santé et réalisant au moins deux tiers de leur activité auprès de patients résidant dans une zone sous-dotée. Le médecin adhérent s’engage à s’installer ou rester installé dans la zone ou à proximité immédiate (5 kilomètres en zone rurale, 2 kilomètres en zone urbaine) pour une durée de trois ans. En contrepartie, il bénéficie d’une aide forfaitaire à l’investissement de 5 000 euros par an pour les médecins exerçant en groupe et de 2 500 euros par an pour les médecins membres d’un pôle de santé, ainsi que d’une aide à l’activité de 10 % des honoraires annuels dans la limite de 20 000 euros par an, pour les médecins exerçant en groupe, et de 5 % des honoraires annuels dans la limite de 10 000 euros par an, pour les médecins membres d’un pôle de santé. Selon la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 1 732 médecins ont obtenu cette aide en 2013 mais seuls 10 % des bénéficiaires étaient nouvellement installés.
L’option « santé solidarité territoriale » vise à favoriser une solidarité entre médecins face à la difficulté des praticiens exerçant en zone déficitaire pour se faire remplacer. Elle est ouverte à tous les médecins libéraux, généralistes ou spécialistes, de secteur 1 ou de secteur 2 adhérant à l’option de coordination, ou de secteur 2 pratiquant les tarifs opposables dans la zone. Le médecin adhérent s’engage à exercer au minimum 28 jours par an dans la zone déficitaire sous forme de vacations. En contrepartie, il bénéficie d’une aide à l’activité de 20 % des honoraires annuels, dans la limite de 20 000 euros par an, ainsi que d’une prise en charge des frais de déplacement. Cette mesure n’a pas rencontré le succès escompté : d’après la CNAMTS, seuls 22 médecins ont demandé à en bénéficier en 2013.
Comme l’a justement fait remarquer le sénateur Hervé Maurey, « une incitation financière supplémentaire n’est pas déterminante dans le choix d’un médecin de s’installer en zone sous-dotée, puisque son activité y sera déjà spontanément supérieure à celle d’un confrère en zone sur-dotée » (40).
L’installation des jeunes médecins en zone rurale a été encouragée par l’intermédiaire des contrats d’engagement de service public (CESP) qui permettent à un étudiant de bénéficier d’une bourse en contrepartie de son engagement à s’installer dans une zone sous-dotée.
Créés par la loi « HPST » du 21 juillet 2009, sur le modèle d’initiatives déjà prises par certaines collectivités territoriales, ces contrats proposent une allocation de 1 200 euros par mois aux étudiants en médecine, à partir de la deuxième année ou plus tardivement, en contrepartie de leur engagement d’exercer dans des zones sous-dotées identifiées par les ARS, avec une priorité aux ZRR et aux ZUS, pendant une durée équivalente à la durée de versement de l’allocation et qui ne peut être inférieure à deux ans. Ce dispositif, financé par des crédits issus du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) de l’assurance maladie, est piloté au niveau national.
Fin 2015, plus de 1 300 étudiants ou internes en médecine avaient conclu un CESP. L’engagement n° 2 du « pacte territoire santé n° 1 » présenté en décembre 2012 par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, fixait un objectif de 1 500 CESP d’ici 2017 – objectif que l’engagement n° 2 du « pacte territoire santé n° 2 » a légèrement revu à la hausse en visant 1 700 CESP d’ici l’an prochain.
Dans son intervention lors de la discussion générale du PLFSS pour 2017, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, a indiqué que « 1 800 étudiants en médecine se sont engagés dans un contrat d’engagement de service public ; concrètement, ce sont 1 800 jeunes médecins qui vont prochainement s’installer dans des territoires sous-dotés, après avoir reçu des bourses pendant leurs études » (41).
Malgré sa montée en charge, le dispositif semble encore trop peu connu par le public visé. Plus fondamentalement, il souffre de la réticence des étudiants en médecine à s’engager pour l’avenir dans un contexte d’incertitude. Avant d’avoir passé les épreuves classantes nationales, ils ne savent pas encore quelle sera leur spécialité, ni quel sera leur lieu de formation en troisième cycle. De même, les zones sous-dotées dans lesquelles ils devront obligatoirement exercer ne sont pas exactement connues au moment où ils contractent, car celles définies aujourd’hui ne seront pas forcément les mêmes que demain. L’origine sociale des étudiants en médecine, de plus en plus issus de milieux favorisés et urbains, explique également en grande partie le succès relatif du dispositif.
Selon le sénateur Hervé Maurey, « le CESP semble surtout conçu comme une aubaine pour certains étudiants qui ont déjà, pour des raisons personnelles, un lien d’attache avec un territoire bien précis » (42).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu une dérogation au parcours de soins en faveur des médecins nouvellement installés en exercice libéral, ou nouvellement installés dans les zones déficitaires délimitées par l’agence régionale de santé.
Pendant cinq années, les consultations des médecins en question sont exonérées des pénalités qui s’appliquent normalement aux patients qui ne respectent pas le parcours de soins, soit qu’ils n’ont pas de médecin traitant, soit qu’ils consultent sans prescription de sa part.
Ce dispositif, à la charge de l’assurance maladie, ne constitue pas à proprement parler une aide financière directe aux médecins concernés, mais une manière indirecte d’augmenter leur patientèle. Il semble, en pratique, encore très méconnu.
L’assurance maladie finance au profit de certaines autres professions de santé, dans le cadre de dispositifs de conventionnement sélectif, des aides à l’installation dans les zones sous-dotées : depuis 2008 pour les infirmiers, depuis 2011 pour les masseurs-kinésithérapeutes et depuis 2012 pour les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les orthophonistes.
En effet, certaines professions de santé qui bénéficiaient jusqu’à présent d’une liberté totale d’installation sont désormais soumises au principe d’une régulation conçue de façon à concilier le principe de la liberté d’installation avec la préservation d’un égal accès aux soins pour les patients.
L’accord conventionnel signé en septembre 2008 par l’assurance maladie avec l’ensemble des syndicats d’infirmiers libéraux, entré en vigueur en avril 2009, est articulé autour de trois axes :
– un zonage du territoire adapté aux besoins des patients : dans chaque région, cinq catégories de zones sont distinguées : « très sous-dotée », « sous-dotée », « à densité intermédiaire », « très-dotée » et « sur-dotée » ;
– un dispositif d’aide à l’installation et au maintien d’infirmiers libéraux dans les zones « très sous-dotées » : aide à l’équipement et prise en charge par l’assurance maladie des cotisations d’allocations familiales ;
– une régulation des conventionnements dans les zones « sur-dotées » : toute nouvelle demande de conventionnement est conditionnée au départ d’un infirmier de la zone.
Expérimenté d’abord sur une durée de trois ans, ce dispositif a répondu aux objectifs visés. D’après le sénateur Hervé Maurey, « on a pu observer une progression de 33,5 % des infirmiers libéraux dans les zones « très sous-dotées » (354 infirmiers supplémentaires) entre 2008 et 2011, et une diminution de 3 % des effectifs dans les zones « sur-dotées » (283 infirmiers de moins), alors que ces zones avaient encore enregistré une progression des effectifs de 8,5 % sur la période 2006-2008. Au total, 25 départements dont la densité était inférieure à 100 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants ont connu une amélioration de leur densité » (43).
L’expérimentation parvenue à son terme, le dispositif a été pérennisé et renforcé par l'avenant n° 3, signé en septembre 2011, qui prévoit un doublement du nombre des zones « très sous-dotées » et « sur-dotées », ainsi qu’une actualisation du zonage sur la base des données récentes.
Les organisations représentatives des infirmiers qui ont signé ces accords conventionnels s’en déclarent très satisfaites. Ce bilan positif a encouragé l’extension du mécanisme d’aide à l’installation dans les zones sous-dotées à d’autres professions de santé : les masseurs-kinésithérapeutes (avenant n° 3 à la convention nationale signé en novembre 2011), les sages-femmes (avenant n° 1 signé en janvier 2012), les chirurgiens-dentistes (avenant n° 2 signé en avril 2012) et les orthophonistes (avenant n° 13 signé en mai 2012 et avenant n° 15 signé en mai 2016). Pour chacune de ces professions, un accord adapté à ses spécificités a mis en place un dispositif de régulation semblable à celui des infirmiers libéraux :
– un zonage adapté aux besoins des patients (par exemple, besoins de sages-femmes là où se trouvent les populations de femmes jeunes) ;
– une incitation à l’installation et au maintien en libéral dans les zones « sous-dotées » et « très sous-dotées » : aide à l’équipement du cabinet et prise en charge des cotisations d’allocations familiales en contrepartie d’un engagement d’exercice dans la zone pendant une durée minimale ;
Une régulation de l’activité dans les zones « sur-dotées » a été prévue pour les sages-femmes exerçant à titre libéral (44).
Il convient de noter que ces mesures conventionnelles ne peuvent être adoptées par les parties que sur la base d’une habilitation expresse du législateur : saisi de l’arrêté par lequel les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale approuvent une convention ou un avenant, le Conseil d’État juge de façon constante que les stipulations conventionnelles qui instituent une limitation du nombre de professionnels susceptibles d’être conventionnés dans certaines zones touchent aux principes fondamentaux de la sécurité sociale et sont donc du domaine de la loi.
Si la régulation démographique basée sur le conventionnement sélectif est une mesure intéressante pour améliorer la répartition territoriale des professionnels de santé, il n’en demeure pas moins qu’elle souffre de deux défauts importants : outre qu’elle ne s’applique pas aux médecins, elle risque d’accentuer les inégalités (financières) dans l’accès aux soins.
En effet, dans une zone sous-médicalisée, la patientèle, « captive » faute d’offre suffisante, aura tendance, si elle en a les moyens financiers, à s’adresser au médecin le plus proche, même s’il n’est pas conventionné.
Comme l’a justement fait remarquer la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, lors de la discussion générale du PLFSS pour 2017, le 25 octobre dernier, « il faut être clair : le conventionnement sélectif, ce n’est pas imposer à un médecin d’aller s’installer là où il ne le veut pas ; c’est dire à un médecin qui va s’installer dans des zones surdenses qu’il ne peut pas le faire, à moins d’être déconventionné. “ Déconventionné ” est un mot un peu chic pour dire que les malades qui iront voir ledit médecin ne seront pas remboursés par la sécurité sociale » (45).
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait prévu dans son article 33 d’inclure dans le champ des négociations conventionnelles l’adaptation des règles de conventionnement des médecins en fonction des besoins de santé sur le territoire. Cette option a néanmoins été en définitive abandonnée, à la suite d’une importante grève des internes à l’automne 2007.
L’absence persistante de régulation de l’installation des médecins contraste aujourd’hui avec les mesures prises en partenariat avec l’assurance maladie par d’autres professions de santé pour corriger les inégalités de répartition observées sur le territoire en limitant les installations dans les zones identifiées comme sur-dotées et en aidant à l’installation dans les zones sous-dotées.
À plusieurs reprises, dans ses rapports sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale, la Cour des comptes s’en est émue. Dans son rapport de septembre 2011, la Cour a indiqué que les données de la démographie médicale conduisent à « ne plus exclure l’hypothèse de mesures plus contraignantes, qui pourraient aller jusqu’au conventionnement sélectif, à l’instar du dispositif infirmier » (46).
Dans son rapport de septembre 2014, la Cour des comptes a recommandé d’étendre le conventionnement sélectif des professionnels de santé dans les zones géographiques en surdensité, alors limité aux seuls infirmiers, à l’ensemble des professionnels de santé.
Constatant que sa recommandation n’avait été qu’imparfaitement mise en œuvre par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la Cour a indiqué, dans son rapport de septembre 2016, que « dans le domaine des politiques conventionnelles, les progrès n’ont cependant encore à ce stade qu’une portée partielle. S’agissant des médecins, les pouvoirs publics s’en tiennent ainsi à ce jour à des mesures incitatives à l’installation dans les zones en sous-densité » (47).
Ainsi, seuls les médecins n’ont pour l’heure accepté aucune mesure contraignante de régulation démographique et leur liberté d’installation est restée quasi-totale. Faut-il pour autant que le législateur se résigne à cet état de fait ?
Comme l’a très justement écrit le sénateur Hervé Maurey en 2013, « l’augmentation de la désertification médicale témoigne de l’inefficacité des politiques et des actions mises en place depuis deux décennies. L’évolution prévisible de ce phénomène est un véritable défi pour le système de santé français et pour nos territoires. Pour le relever, il faut désormais faire montre de volonté, de persévérance et de courage pour agir sans tabou ni a priori dans le seul souci de l’intérêt général » (48).
Dès 2007, le sénateur Jean-Marc Juilhard notait que « la possibilité de recourir à des mécanismes plus coercitifs s’installe progressivement dans le débat » (49).
La même année, dans un rapport intitulé « Comment corriger l’inégalité de l’offre de soins en médecine générale sur le territoire national ? » (50), l’Académie nationale de médecine a recommandé, en l’absence d’évolution favorable de la démographie médicale, « l’application, comme ultime recours, de mesures contraignantes, avec l’obligation d’exercer dans des zones prioritaires pour les médecins qui y seraient affectés, pour une période de trois à cinq ans ».
La même année encore, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), s’est prononcé à deux reprises sur la nécessité de garantir une répartition plus harmonieuse de l’offre médicale sur le territoire, le cas échéant par des « mesures de régulation plus directives ».
Près de dix ans plus tard, l’échec d’une régulation de l’installation des médecins, que ce soit par le biais de mesures conventionnelles ou législatives contraste aujourd’hui fortement avec les exemples émanant de pays étrangers qui, confrontés aux mêmes difficultés en matière de démographie médicale, ont clairement fait le choix de restreindre la liberté d’installation. La Cour des comptes, dans son rapport sur la Sécurité sociale de septembre 2011, cite notamment l’Allemagne, l’Autriche, le Québec, le Royaume-Uni et la Suisse.
La présente proposition de loi reprend une grande partie des propositions émises afin de mieux équilibrer la répartition des professionnels de santé sur le territoire. Elle repose sur une conviction simple : la nécessité d’apporter une réponse au plus près des besoins et d’orienter les outils de la politique de santé « en fonction » de ces besoins, le cas échéant en mettant en place des instruments de régulation ad-hoc, ni plus ni moins coercitifs que ceux qui existent déjà pour d’autres professions.
Le constat est aujourd’hui presque unanime : les études de médecine sont quasi-exclusivement tournées vers le milieu hospitalier et ne permettent pas, sauf exception, aux étudiants de découvrir la pratique de la médecine de premier recours, ancrée dans des territoires.
La présente proposition de loi entend y remédier par un certain nombre de mesures qui ne sont pas exclusives de celles que le sénateur Hervé Maurey a pu préconiser en 2013, parmi lesquelles la modification des critères de sélection pour l’accès aux études de santé ou la diversification de l’enseignement dispensé aux étudiants afin d’introduire ou de renforcer les cours de gestion, de communication, de psychologie, d’éthique, d’économie de la santé (51).
1. Mieux prendre en compte les besoins de santé de chaque territoire dans la fixation et la répartition du numerus clausus
Depuis quelques années, les pouvoirs publics essayent tant bien que mal d’affecter dans les territoires sous-dotés les places supplémentaires offertes par le relèvement du numerus clausus. Ces tentatives sont loin de donner satisfaction.
Afin d’améliorer l’adéquation entre les capacités de formation des professions de santé et les besoins de santé des territoires, l’article 1erde la proposition de loi renforce le caractère obligatoire de la prise en compte des besoins de santé dans la fixation du numerus clausus et réaffirme, avec force contraignante, la nécessité que sa fixation et sa répartition contribuent pleinement à la résorption des inégalités en matière d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
L’action sur le numerus clausus est complétée, à l’article 3, par une disposition qui substitue aux épreuves classantes nationales, qui ont montré leurs limites, des épreuves classantes régionales ouvertes uniquement aux étudiants ayant validé leur deuxième cycle d’études médicales dans la même région.
Cette mesure vise à stabiliser les étudiants dans la région dans laquelle ils auront effectué l’ensemble de leurs études médicales de manière à faire obstacle à la propension de beaucoup de jeunes médecins à quitter la région dans laquelle ils ont effectué leur internat, qui limite aujourd’hui fortement la gestion territoriale des flux de formation.
Ces dispositions seront néanmoins assorties de dérogations permettant aux étudiants de se présenter aux épreuves classantes dans deux autres régions et de changer de région en cours d’internat, notamment si cela est nécessaire dans le cadre de leur spécialisation.
Ce faisant l’article 3 concrétise la préconisation formulée en 2013 par le sénateur Hervé Maurey, dans son rapport sur la présence médicale sur l’ensemble du territoire, qui appelait à organiser au niveau régional les épreuves classantes au niveau régional en fonction des besoins de chaque région (52).
Il faut noter que la régionalisation des épreuves classantes ne pourra aboutir à une meilleure adéquation des flux de formation des médecins aux besoins locaux que si les capacités d’accueil des facultés de médecine sont parallèlement rééquilibrées, pour être adaptées aux besoins des territoires. Actuellement, les facultés de médecine parisiennes apparaissent nettement surdimensionnées par rapport aux besoins de la région Île-de-France.
L’article 2 de la proposition de loi instaure, au cours de la troisième année du troisième cycle des études médicales, une obligation d’effectuer un stage pratique d’au moins douze mois dans une maison de santé pluridisciplinaire ou un établissement de santé implanté dans une zone qui enregistre un déficit en matière d’offre de soins.
Il s’agit de permettre aux jeunes internes de découvrir la problématique de l’exercice médical en zone sous-dotée afin de les inciter, le cas échéant, à choisir une zone d’installation qu’ils ont appris à connaître au cours de leurs études.
Ce stage aurait vocation à se substituer à la troisième année du troisième cycle (la dernière pour les futurs médecins généralistes) et n’aurait, en aucune manière, pour effet de rallonger la durée des études médicales.
Cette mesure fait écho à la préconisation faite en 2013 par le sénateur Hervé Maurey de mettre en place une année professionnalisante pour les étudiants en médecine générale dans les zones fragilisées (53).
Une dernière année professionnalisante, effectuée sur le terrain, peut en effet apporter au futur professionnel la formation complémentaire qui lui permettra d’être parfaitement autonome et efficient dès la fin de son cursus. Cette année contribuerait à revaloriser cette filière par rapport aux autres spécialités.
Les gouvernements successifs ont, jusqu’à présent, refusé d’aller au-delà de mesures purement incitatives à l’égard des médecins. Pourtant, la mise en place de mesures plus volontaristes pour réduire les inégalités de densité médicale, qu'il s’agisse de dispositifs de régulation ou de contrainte à l’installation, est de plus en plus considérée comme nécessaire.
Dès 2008, le rapport d’information produit par notre ancien collègue Marc Bernier, après avoir constaté que l’idée d’un encadrement de la liberté d’installation des médecins progressait, laissait ouverte la possibilité de recourir à des mesures contraignantes : un conventionnement sélectif consistant à limiter le nombre de nouveaux conventionnements accordés aux médecins s’installant dans les zones sur-dotées, voire l’institution de règles géo-démographiques d’installation des cabinets médicaux, maisons médicales et centres de santé, à l’image de ce qui existe pour les pharmacies (54).
En février 2011, la proposition de loi pour l'instauration d'un bouclier rural déposée par Jean-Marc Ayrault, alors président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, et cosignée par Mme Marisol Touraine, désormais ministre des Affaires sociales et de la Santé, proposait de subordonner à une autorisation des agences régionales de santé (ARS) l’installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé dans les zones sur-dotées déterminées par les anciens schémas régionaux de l’organisation des soins (SROS), désormais connus sous le nom de « schémas régionaux de santé ».
Notre collègue Germinal Peiro, dans le rapport sur cette proposition de loi qu’il a présenté au nom de la commission du développement durable, appelait à « ne pas craindre les conséquences pratiquement apocalyptiques que ne manquent pas de prédire [les] représentants [des médecins] » (55), soulignant que de nombreux pans du système de santé fonctionnaient déjà correctement dans un cadre d’installations réglementées.
En mai 2012, dans le sillage des travaux conduits depuis 2005 par le professeur Yvon Berland, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), à la suite de son séminaire annuel sur le thème de l’accès aux soins, a lui-même remis en cause le principe de la liberté totale d’installation, se déclarant favorable à la mise en place de contraintes pour tenter d’enrayer la désertification médicale.
Constatant l’échec des aides incitatives pour pallier l’inégale répartition régionale des médecins, le CNOM a préconisé la mise en œuvre d’« une régulation des conditions du premier exercice dans une période quinquennale éventuellement révisable » organisée au niveau régional, en partenariat avec les universités et les ARS.
Soutenant le principe d’une répartition régionale des postes ouverts à l’examen classant national déterminée en fonction des besoins de santé de la population avec une nécessaire adaptation des moyens de formation donnés à l’Université, le CNOM a également alors recommandé qu’à l’obtention de sa qualification ou à l’issue de son post-internat, chaque jeune médecin soit désormais tenu d’exercer pendant une période de cinq ans dans sa région de formation de troisième cycle. Obéiraient aux mêmes règles l’exercice des médecins qui, une fois leur diplôme obtenu, choisiraient de faire des remplacements, et celui des médecins à diplôme étranger ayant obtenu l’autorisation d’exercer.
Dans cette optique, la détermination des lieux d’exercice, quelles qu’en soient leurs modalités, à l’intérieur de la région, se ferait sous la conduite de l’ARS en fonction des besoins identifiés par unités territoriales, et en liaison étroite avec le conseil régional de l’ordre des médecins.
Lors des travaux du groupe de travail du Sénat sur la présence médicale sur l’ensemble du territoire, le représentant de l’association des maires ruraux de France s'est prononcé en faveur d’une obligation de primo-installation de quelques années en zone sous médicalisée, après évaluation des dispositifs incitatifs existants. De même, la fédération des villes moyennes a prôné des conventionnements différenciés en fonction de la densité médicale des différents territoires. D’après le sénateur Hervé Maurey, « un grand nombre d’acteurs du secteur de la santé ont jugé nécessaire la mise en place de mesures de régulation, si ce n’est de coercition » (56).
Notre collègue a lui aussi recommandé d’instaurer une obligation de service pour les médecins spécialistes en début de carrière dans les zones particulièrement sous dotées ainsi qu’une obligation d’exercer pendant deux ans à la fin de leurs études, à temps plein ou partiel, dans les hôpitaux des chefs-lieux de départements où le manque de spécialistes est reconnu par les ARS.
Malheureusement, les déclarations du Président de la République, M. François Hollande, à l’encontre de toute mesure « coercitive » pour pallier l’inégale répartition des médecins sur le territoire national, semblent avoir plongé le Gouvernement dans l’impasse et limité la marge de manœuvre de ce dernier pour lutter contre les déserts médicaux à la construction d’un cadre attractif pour les professionnels de santé.
Il est incompréhensible que l’actuelle majorité, qui fustigeait jadis l’inaction de la précédente, répugne aujourd’hui à prendre des mesures fortes pour répondre aux besoins qui se font jour sur nos territoires. Si elle dresse le constat de l’inefficacité des incitations mises en place pour favoriser l’installation des médecins dans les zones déficitaires en offre de soins, elle se refuse toujours à en tirer les conclusions qui s’imposent.
Or les mesures qui s’imposent sont celles prévues par l’article 6 de la présente proposition de loi, qui dispose que tout médecin désireux d’exercer ses fonctions à titre libéral doit, à l’issue de sa formation, s’installer pour une durée minimale de trois ans dans une zone géographique dans laquelle le niveau de l’offre de soins de premier recours est insuffisant pour répondre aux besoins de la population.
Cette mesure permettra, en premier lieu, d’apporter, pendant les trois ans où l’obligation s’impose, une réponse concrète à la problématique des « déserts médicaux » et devrait en outre favoriser, à l’issue de cette période, l’installation des médecins dans la zone sous-dotée dans la mesure où on constate que la mobilité professionnelle postérieure à la première installation est faible.
S’il est vrai qu’une telle mesure amoindrit, mais de façon limitée dans le temps, le caractère absolu du principe de la liberté d’installation des médecins, elle opère néanmoins, au nom de l’intérêt général, une conciliation entre les principes fondamentaux de l’exercice traditionnel de la médecine libérale française et le principe constitutionnel selon lequel « la Nation […] garantit à tous, […] la protection de la santé ».
La liberté d’installation n’existant pas pour les pharmaciens d’officine, dont le régime d’installation est étroitement encadré en fonction de la population de la commune concernée par les articles L. 5125-3 à L. 5125-16 du code de la santé publique, il semble qu’aucun principe constitutionnel ne s’oppose a priori à ce qu’un encadrement fondé sur des critères géographiques puisse être apporté par la loi au régime d’installation des médecins libéraux.
La présente proposition de loi concrétise la proposition faite en 2013 par le sénateur Hervé Maurey d’étendre aux médecins le principe du conventionnement sélectif en fonction des zones d’installation qui s’applique déjà aux principales autres professions de santé.
Afin de remédier à l’hétérogénéité de l’offre de soins médicaux sur le territoire national, l’article 7 vise en effet à mettre en place un dispositif d’autorisation d’installation pour l’exercice de la profession de médecin. Le directeur général de l’ARS serait ainsi appelé à se prononcer, sur la base de critères de densité médicale.
Cette disposition prévoit également la possibilité pour le directeur général de l’agence de fixer des distances minimales entre cabinets, comme il le fait déjà pour les pharmacies d’officine.
Enfin, en cas de non-respect de ces dispositions, le médecin sera déconventionné par l’assurance maladie. Ainsi, il ne lui serait plus possible d’être conventionné dans les zones sur-dotées définies par les ARS, sauf cas de reprise d’activité, tandis que des dispositifs incitatifs continueraient d’être proposés dans les zones sous-dotées.
L’article 6 ne remet pas en cause le caractère libéral de la médecine puisqu’il sera toujours loisible au médecin concerné de s’installer dans ladite zone : il devrait néanmoins alors assumer seul la création d’une patientèle non-solvabilisée par l’assurance maladie. Loin de remettre en cause l’exercice libéral de la médecine, cette mesure de régulation des installations se borne donc à ajuster l’effort financier de la collectivité aux besoins des Français.
Les articles 8 (chirurgiens-dentistes), 9 (sages-femmes), 10 (infirmiers libéraux) et 11 (masseurs-kinésithérapeutes) reprennent ce même dispositif pour l’appliquer à différents professionnels de santé. L’article 13 tire les conséquences de ces nouveaux régimes d’autorisation et acte l’élargissement des compétences du directeur général de l’agence régionale de santé.
E. UNE MOBILISATION NÉCESSAIRE DE TOUS LES OUTILS DISPONIBLES POUR LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Les projections de la démographie médicale font ressortir un infléchissement dans les prochaines années, jusqu’en 2020, avant que le nombre des médecins en exercice retrouve progressivement en 2030 son niveau d’aujourd’hui.
Face à cette perspective, une solution palliative consiste à favoriser l’allongement de la durée d’activité des médecins, afin de limiter l’ampleur de ce creux démographique.
Le mécanisme d’incitation à la cessation d’activité (MICA) qui a été mis en œuvre à partir de 1988, afin d’inciter les médecins libéraux à cesser de manière anticipée leur activité à partir de 57 ans, obéissait à une logique exactement inverse. Il consistait en une allocation de remplacement de revenu qui était versée au médecin par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour le compte de l’assurance maladie jusqu’à l’âge de la retraite, soit 65 ans. Le MICA a été supprimé en 2003, après avoir bénéficié en moyenne à 3 600 médecins chaque année, soit un quart des effectifs potentiellement concernés.
L’année même de la suppression du MICA, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a autorisé les médecins libéraux à cumuler leur retraite avec une activité libérale, à condition que le revenu net tiré de cette activité soit inférieur au plafond de la sécurité sociale. Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé ce plafonnement.
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir en quoi ces médecins « retraités-actifs » peuvent contribuer à lutter contre la désertification médicale. En effet, s'ils contribuent au maintien de l'offre de soins, rien ne garantit que leur répartition géographique réponde aux besoins les plus pressants. Au contraire, les données du CNOM montrent que ces médecins « retraités-actifs » sont, pour près d’un tiers, concentrés en Île-de-France.
Actuellement, le médecin retraité qui poursuit ou reprend une activité est tenu de cotiser aux régimes de base et complémentaire d’assurance vieillesse, sans que ces cotisations génèrent des points supplémentaires, l’article 4 de la présente proposition de loi propose donc d’inciter les médecins retraités toujours actifs à aller exercer en zones sous-dotées en les faisant bénéficier à ce titre d’un allègement de leurs charges sociales, dans le cadre d’une contractualisation avec l’ARS.
Cette disposition étant susceptible d’entraîner une perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, elle est gagée à l’article 15 de la proposition de loi.
L’article 12 vise à inciter l’ensemble des professionnels de santé, qu’ils exercent en cabinets, en établissements de santé ou sous forme regroupée, à favoriser le développement de la télémédecine, qui constitue également une réponse pertinente aux déserts médicaux.
La télémédecine peut constituer une solution partielle à la raréfaction des praticiens libéraux dans certains territoires, et répondre au souci des médecins généralistes isolés de pouvoir s’appuyer en tant que de besoin sur l’expertise de médecins spécialistes.
Alors qu’il n’y a plus de véritables entraves technologiques, le développement de la télémédecine se heurte aux mêmes obstacles qui freinent de manière générale l’informatisation du système de santé : émiettement des prestataires de services, absence d’interopérabilité des divers logiciels, retard dans la mise en œuvre du dossier médical personnel, cloisonnement des systèmes d’informations ville/hôpital.
Le développement de la télémédecine se heurte également, de manière plus spécifique, à des obstacles juridiques et financiers.
L’engagement n° 7 du « pacte territoire santé n° 1 » de décembre 2012 proposait seulement de concrétiser la mise en place de la télémédecine par une expérimentation sur la filière dermatologie.
L’engagement n° 9 du « pacte territoire santé n° 2 » de novembre 2015 propose de favoriser l’accès à la télémédecine pour les patients chroniques et pour les soins urgents.
Le rapporteur estime que l’heure est venue de déployer la télémédecine à grande échelle, tout en ayant conscience que l’une des limites intrinsèques au développement de la télésanté réside dans la nécessité de disposer d’une couverture en haut débit satisfaisante – ce qui n’est pas encore le cas sur l’ensemble du territoire – et que les zones blanches correspondent le plus souvent aux zones de désertification médicale.
Alors que la conclusion unanime des travaux menés sur les dispositifs aujourd’hui mis en œuvre pour pallier l’inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire fait état à la fois d’une absence de recensement des initiatives et d’un manque criant d’évaluation de leur efficacité, le rapporteur ne veut pas que les présentes mesures tombent in fine dans un même travers. C’est pourquoi il propose, à l’article 14, la création d’un comité d’évaluation chargé de suivre la mise en œuvre des dispositions de la loi et de proposer, le cas échéant, des modifications. Un rapport devra être remis au Parlement dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du texte.
La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de M. Philippe Vigier, la proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire, lors de sa séance du mercredi 16 novembre 2016.
Mme la présidente Catherine Lemorton. La proposition de loi de M. Philippe Vigier visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire sera débattue, dans le cadre de la niche du groupe Union des démocrates et indépendants, le jeudi 24 novembre.
Monsieur Vigier, je vous félicite pour votre constance, puisque vous aviez déjà présenté cette proposition de loi sous l’ancienne législature, puis dès le début de la nouvelle législature en 2012. Son objet fait débat dans tous les groupes, tout comme le conventionnement sélectif pour les médecins. Je souligne que, malgré la mise en place d’un nombre important de dispositifs d’incitation pour les médecins et l’accumulation des aides, certains territoires n’ont toujours pas de médecin. Et la disparition d’un médecin entraîne celle de toutes les professions travaillant sur prescription médicale, certains territoires se retrouvent donc sans aucun professionnel de santé.
Je pense, moi aussi, que l’incitation aura des limites. Notre pays ne pourra pas continuer à accorder des aides d’un tel niveau, sauf à créer des distorsions entre professionnels de santé – les autres sont beaucoup moins aidés. Les demandes, légitimes, des médecins de pouvoir vivre dans des territoires pourvus de services publics, de bonnes écoles, et où leur compagne ou compagnon de vie pourra exercer un emploi, sont aussi celles des autres professionnels de santé.
M. Philippe Vigier, rapporteur. Madame la présidente, je vous remercie d’avoir rappelé ma constance sur le sujet. Comme tout parlementaire, je suis là, non pas pour inscrire mon nom sur une proposition de loi, mais pour essayer de régler les problèmes. Celui que je me propose de traiter est assez majeur pour s’être invité dans le PLFSS, pour 2017, à la faveur d’un amendement de Mme Annie Le Houerou, tendant à conditionner le conventionnement dans les zones « surdotées ». Le Conseil national de l’Ordre des médecins avait regretté cet amendement, adopté par la Commission puis rejeté par le Gouvernement. Pourtant, dans un Livre blanc « Pour l’avenir de la santé », publié en janvier dernier, il constatait que « la présence des médecins sur le territoire est très inégalement répartie » et que « les incitations conventionnelles mises en place par l’assurance maladie obligatoire n’ont pas été suffisantes pour réellement faire bouger les lignes ».
Paradoxalement, malgré la mise en place du numerus clausus en 1971, le nombre de médecins n’a jamais été aussi élevé en France. Toutefois, il faut le rapporter au nombre d’heures de médecine travaillées. Du fait de la nouvelle organisation de la vie, de la féminisation de la profession, les jeunes médecins ont de nouvelles aspirations et ne souhaitent plus travailler 60 à 90 heures par semaine, ce que l’on comprend.
L’Atlas de la démographie médicale en France fait apparaître des zones avec de grandes disparités et des zones de surdensité. Les territoires de la façade Atlantique connaissent généralement une densité importante. Rhône-Alpes également, mais sur une petite partie seulement ; l’Auvergne, en dehors des alentours de Clermont-Ferrand, est un désert médical. La région Centre, dont je suis issu, la Bourgogne, la Picardie souffrent d’une sous-densité médicale.
On peut vraiment parler de « fracture sanitaire ». À cet égard, l’UFC-Que Choisir a réalisé en juin 2016 une étude très intéressante sur l’accès aux soins sur la période 2012-2016. Il en ressort que l’accès aux médecins spécialistes, aux ophtalmologistes et aux gynécologues a diminué respectivement pour 38 %, 40 % et 59 % des Français. Force est bien d’admettre que nous sommes face à un problème majeur de fracture territoriale, lequel induit également un problème d’égalité entre les citoyens. Or le principe de protection de la santé est garanti à tous par le préambule de la Constitution de 1946.
Les barrières territoriales à l’accès aux soins sont toujours plus hautes, et les mesures financières et dispositifs d’incitation financés par l’État ne se sont pas montrés très efficaces. De l’exonération d’impôt sur le revenu au titre d’une installation dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou de revitalisation rurale (ZRR), ou au titre de la participation à la permanence des soins, à l’exonération de taxe professionnelle en ZRR, en passant par la garantie de revenu assurée aux praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) et la protection sociale améliorée aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire (PTMA), ces dispositifs sont pourtant très nombreux.
De leur côté, les collectivités territoriales ne sont pas restées sans rien faire : bourses, indemnités kilométriques, financement de logements, aides aux jeunes internes en fin de cursus, « kit installation » gratuit dans les communes de moins de 2 000 habitants. Si ces dispositifs ont apporté un début de réponse ici ou là, la fracture n’en a pas pour autant été réduite globalement. On voit même des jeunes médecins dont les études ont été financées par les collectivités territoriales en échange d’une installation dans les zones sous-dotées, préférer rembourser cette aide pour se soustraire à l’engagement qu’ils avaient signé – ils sont 42 % dans ma région.
La sécurité sociale aussi y est allée de ses dispositifs : majoration, depuis 2005, de 20 % des honoraires des médecins généralistes libéraux exerçant en groupe dans les zones déficitaires ; option démographie, en 2011, assortie d’incitations financières complémentaires ; plus récemment, contrats d’engagement de service public proposant une bourse en contrepartie de l’engagement d’installation en zone sous-dotée. Or, en liant ainsi une installation à une incitation financière, c’est à ceux qui ont le moins d’argent que l’on impose d’aller dans ces zones ! Selon que vous serez puissant ou misérable…
Des régulations, il y en a eu pour les chirurgiens-dentistes, les orthophonistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières, sans qu’on invoque la sacro-sainte liberté d’installation. Pourquoi n’est-elle pas non plus mise en avant alors que, depuis 2010, un directeur d’ARS peut s’opposer à l’installation d’un biologiste dans un territoire où la concentration de professionnels est supérieure à 25 % de l’offre ? Pourquoi pas non plus pour les pharmaciens ?
Je veux remercier publiquement Mme la ministre Marisol Touraine de s’être montrée sensible à un problème que je lui avais soumis concernant les jeunes médecins qui, n’ayant pas présenté leur thèse, ne peuvent pas s’installer – ils ne le font, en général, que dans les deux ans qui suivent la fin de leur cursus. Leur permettre d’être associés dans des maisons de santé pluridisciplinaires pourrait être une vraie réponse, à la fois pour eux et pour la réussite d’un projet médical, puisque les professionnels de santé peuvent travailler, dans ces maisons, ensemble et en réseau, grâce au développement de la télémédecine.
Nombre de parlementaires se sont impliqués sur ce sujet. Dès 2007, le sénateur Jean-Marc Juilhard alertait ses collègues. En 2008, le député Marc Bernier, rapporteur de la mission d’information sur l’offre de soins présidée par notre collègue Christian Paul, affirmait que « la liberté d’installation des médecins n’est plus un tabou » et que l’insuffisante efficacité des seules incitations financières, rendait nécessaire « de se préparer à freiner les installations dans les zones excédentaires ». En 2011, Jean-Marc Ayrault déposait une proposition de loi, cosignée par Marisol Touraine, dont l’exposé des motifs insistait sur la nécessité de « revoir sans tabou le dogme de la liberté d’installation des praticiens médicaux ».
Moi-même, en janvier 2012, j’avais déposé une PPL qui a été battue par la majorité même à laquelle j’appartenais. En novembre 2012, je remettais l’ouvrage sur le métier en nourrissant quelque espoir : dans le vingtième de ses « 60 engagements pour la France », le candidat François Hollande ne promettait-il pas de « sécuriser l’accès aux soins de tous les Français » ? Le projet socialiste n’indiquait-il pas : « nous demanderons aux jeunes médecins libéraux d’exercer en début de carrière dans les zones qui manquent de praticiens » ?
En 2013, Hervé Maurey, sénateur de Normandie, expliquait dans un très bon rapport que le refus des médecins de s’installer comme autrefois tenaient à plusieurs facteurs : vieillissement de la population médicale, diminution du temps médical disponible, évolution des conditions de vie, accroissement des charges administratives des médecins, préférence marquée des nouvelles générations pour le salariat – que l’on peut comprendre –, augmentation des besoins de santé liés au vieillissement de la population. De fait, actuellement, neuf jeunes médecins sur dix font le choix du public ou du parapublic. Il faut avoir le courage d’admettre que la perte d’attractivité du secteur libéral est patente. Dès lors, quid de l’exercice libéral dans les cinq, dix, quinze ans à venir ? Quid de l’équilibre entre public et privé ? La seule médecine publique ne pourra pas prendre le relais.
À un moment ou à un autre, la régulation devra s’organiser. Il faut écouter les jeunes médecins – je les ai rencontrés hier et je les reverrai début janvier. Une demande récurrente des représentants syndicaux est la poursuite de la formation. Après leur internat, les médecins ne veulent pas se sentir lâchés dans la nature : ils souhaitent que les premières années de leur vie professionnelle soient le prolongement de leur formation. On peut le comprendre si l’on considère que l’âge moyen d’installation d’un médecin en médecine générale est de trente-huit ans, ce qui représente vingt années d’études après le bac !
Le texte qui vous est soumis aujourd’hui reprend une grande part de mes propositions de 2012. À l’époque, j’avais été heureux de constater que nous avions pu faire avancer le numérique, compte tenu des perspectives de développement de la télémédecine.
L’article 1er propose de renforcer les critères de démographie médicale dans la détermination du numerus clausus. En 1971, 8 500 jeunes passaient en deuxième année de médecine ; ce chiffre est tombé à 3 500 au début des années 1990, il est environ de 7 600 aujourd’hui. Or les besoins de santé liés au vieillissement de la population et au développement des pathologies chroniques, conjugués à la diminution du temps de travail et à la féminisation de la profession, ont abouti à une diminution des heures disponibles. C’est pourquoi je propose, non seulement d’augmenter le numerus clausus, mais de revenir à l’internat régional qui permet des fluidités entre régions. Le jeune n’est pas fixé pour toute sa formation dans une région, il peut passer plusieurs concours d’internat dans plusieurs régions, d’où une vraie notion de choix. Actuellement, le concours national d’internat classant est un faux choix et une fausse liberté : un jeune classé 2 500e du concours national n’obtiendra pas nécessairement la ville et la spécialité souhaitées. La vraie liberté, c’est de suivre sa formation là où on le désire.
L’article 3 prévoit la régionalisation de l’internat. Elle existait avant les années 2000 : peut-on dire qu’elle fonctionnait mal ? Le numerus clausus serait adapté aux régions par l’adéquation de l’outil de formation aux besoins. Certaines régions ne disposent pas de structures de formation suffisantes pour accueillir davantage d’internes. En augmentant simplement le numerus clausus sans cette adaptation, on risquerait d’avoir des postes d’internes de médecine générale non pourvus dans certaines régions – dans la région Centre-Val-de-Loire, par exemple, quarante postes d’internes de médecine générale n’ont pas été pourvus.
L’article 5 vise à permettre aux internes en médecine générale qui n’ont pas terminé leur thèse de pratiquer la médecine en qualité de collaborateur. Marisol Touraine semble vouloir aller dans ce sens, et je l’en remercie encore.
L’article 6 prévoit qu’à partir de 2020, les médecins souhaitant exercer à titre libéral à l’issue de leur formation seront tenus de s’installer pour une durée minimale de trois ans dans une zone déficitaire en offre de soins. Or, des zones sous-dotées, il y en a partout : en région Centre-Val-de-Loire, en dehors de Tours, tout est sous-doté ; dans le 20e arrondissement de Paris, le même problème se pose pour d’autres raisons ; pareil en Auvergne, excepté la tête d’épingle de Clermont-Ferrand ; du côté de Toulouse, Mme la présidente peut le dire mieux que moi, il existe des déserts médicaux à seulement quinze kilomètres alentours. Je pose une question : faire un quart d’heure de voiture pour se rendre à son travail situé à quinze kilomètres d’une métropole comme Toulouse, est-ce un obstacle majeur à une bonne qualité de vie, à l’accès aux structures éducatives pour la famille, au travail du conjoint ? Dans mon département, beaucoup de nos compatriotes passent quatre heures par jour en transport pour aller travailler en région Île-de-France. Le moment est venu, je pense, de s’interroger sur la notion de bassin de vie.
En conclusion, je fonde beaucoup d’espoir dans la télémédecine, mais elle ne résoudra pas tout. On pourra imaginer toutes les méthodes modernes de diagnostic, elles ne remplaceront jamais le contact direct, la relation singulière entre un médecin et son patient.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Comme nous avons déjà subi, vous, monsieur le rapporteur, moi-même et d’autres collègues, des insultes de la part d’une poignée de médecins sur les réseaux sociaux, attendons-nous à en recevoir de nouvelles incessamment. Une telle frénésie dépasse l’entendement ! Nous, parlementaires, de la majorité comme de l’opposition, avons obtenu la légitimité de nos concitoyens : notre devoir est de permettre l’accès pour tous aux droits, et la santé est un droit ! Faut-il rappeler que les citoyens solvabilisent leur système de soins en payant des cotisations sociales, la CSG, des cotisations à une complémentaire santé, voire un reste à charge ? Ils sont payeurs : nous leur devons ce droit à la santé.
Je crains fort, monsieur le rapporteur, que votre proposition de loi n’aboutisse pas aujourd’hui. Mais un jour ou l’autre, j’en suis persuadée, nos concitoyens dans les territoires réclameront leur droit à accéder un médecin de façon raisonnable, en kilomètres et en temps. Le jour où la population fera entendre fortement sa voix, les politiques et les syndicats de médecins seront dépassés.
M. Gérard Sebaoun. J’ai longtemps partagé cette conviction de la nécessité de recourir à la coercition, mais, au fil des années, la pratique et les idées défendues par les plus jeunes m’ont fait revenir sur cette idée.
À mon tour, monsieur le rapporteur, je salue votre ténacité et votre fidélité à vos idées. Nous devons cependant avoir à l’esprit cette donnée incontournable que la santé s’appréhende sur le temps long et que de nombreux paramètres y participent : le nombre de médecins – à former ou en installation –, notre démographie bien portante mais aussi vieillissante, l’aménagement du territoire, l’attractivité des pôles urbains, le bouleversement des parcours professionnels au cours de la vie active, celle du médecin mais aussi celle de son conjoint ou de sa conjointe.
On ne peut pas se contenter de compter le nombre de professionnels pour le mettre en adéquation avec le nombre d’habitants. Cela requiert des études prospectives extrêmement compliquées. Par exemple, dans les endroits où le vieillissement de la population est très important, il faudra un nombre considérable de professionnels de santé pour les entourer ; dans d’autres endroits, où le territoire est plus large mais l’accessibilité plus facile et la population plus jeune, il faudra moins de professionnels de santé pour rendre un service à peu près équivalent.
Il faut de neuf à douze ans pour former un médecin, qui exercera le plus souvent en médecine libérale – et non en médecine salariée – après sept ou huit ans de remplacements multiples. La médecine dans notre pays s’est construite en deux pôles : l’un salarié, hospitalier ; l’autre de médecine libérale, que personne ici n’envisage de détruire. Ce qu’il faut considérer, c’est la courbe du numerus clausus qui, de 9 000 étudiants lors de sa création au début des années 1970, a connu une décroissance régulière dès les années 1980 et un creux considérable, à 3 500, dans les années 1990. Aujourd’hui, nous payons la tragique erreur de prospective des décideurs de l’époque.
À cela s’est ajoutée, dans les années 2000, l’incitation financière pour les médecins à prendre une retraite anticipée, le fameux MICA, qui reposait sur l’idée que la diminution de l’offre diminuerait la consommation. Mais l’effet mécanique attendu ne s’est pas produit, et l’on s’est privé de médecins qui ont décroché leur plaque à cinquante-sept ans.
Monsieur le rapporteur, je mettrai, en face de vos propositions, trois constats.
Premier constat : nous ne réformerons pas le cursus long des études médicales et l’installation des futurs médecins sans une concertation approfondie avec les intéressés. Tous ceux que j’ai pu rencontrer me l’ont dit clairement.
Vous parliez des professions qui ont accepté des contraintes conventionnellement. Cette méthode a été tentée avec les médecins en 2007, mais une grève dure des internes a conduit à renoncer à cette notion de convention, trop liée à celle de coercition. C’est le deuxième constat : nous ne construirons pas un système viable et solide sur la pratique des plus jeunes dans des endroits où ils ne veulent pas aller. Les y envoyer par la coercition, pourrait en conduire certains à se détourner de l’art médical.
Troisième constat : dans les pays où elle a été mise en place, la coercition n’a pas très bien marché.
Que reste-t-il : l’incitation ? Vous avez rappelé les dispositifs mis en place par les différents gouvernements. Nous en connaissons les limites, mais je crois que c’est la seule voie. Je ne crois plus à la coercition.
Chacun d’entre nous connaît la réalité de son territoire, mais les chiffres doivent être regardés au niveau infraterritorial. Les chiffres régionaux ou départementaux ne veulent pas toujours dire grand-chose. La région qui va connaître la plus grande décroissance de médecins généralistes entre 2017 et 2025 est l’Île-de-France, perte de – 22 % de médecins actifs, contre 10 % à 15 % pour les autres régions. La région Centre, la vôtre, monsieur le rapporteur, est en deuxième position. Ces chiffres sont issus d’une réalité construite par d’autres. Quant à nous, nous sommes collectivement responsables de ce qui se passera demain.
Malgré toute la considération que j’ai pour vous, monsieur le rapporteur, je ne crois pas que vos propositions soient de nature à résoudre à court terme les problèmes des jeunes médecins. Ces derniers sont des partenaires actifs, ils ont mis des propositions sur la table. Quel Gouvernement sera susceptible de les entendre ? Nous le verrons bien.
M. Jean-Pierre Door. Cher Philippe Vigier, je retrouve bien là votre fidélité et votre ténacité. Vous vous associez à votre collègue sénateur de l’UDI, Hervé Maurey, qui a également rédigé un rapport sur l’accès aux soins dans les territoires. Chacun reconnaît que ce sujet est particulièrement sensible, mais je veux vous expliquer pourquoi toute proposition de limiter la liberté d’installation rencontrera toujours l’opposition d’une majorité.
D’abord, ici même, la ministre a confirmé fortement son refus de revenir sur le socle de la médecine libérale, lors de l’examen de la loi de modernisation de notre système de santé d’abord, puis du PLFSS pour 2017 il y a quelques jours. Tous les syndicats des jeunes médecins – ISNI, ISNAR-IMG, REAGJIR, SNJMG –, mais aussi l’Association nationale des étudiants en médecine, que vous avez reçue hier, ainsi que le Conseil national de l’Ordre des médecins et les syndicats de médecins seniors sont pour le maintien de la liberté d’installation. Tous les candidats à la primaire de la droite et du centre ont soutenu la liberté d’installation, soit dans leurs écrits, soit dans les congrès annuels des médecins libéraux et des étudiants auxquels ils ont participé. Notre groupe Les Républicains, dans sa large majorité, ne cesse de réaffirmer qu’une politique de santé publique doit se faire avec les professionnels de santé, et non contre eux. Nous avons toujours soutenu la préservation de la liberté d’installation, tout en proposant des mesures incitatives pour l’installation durable dans des zones en souffrance.
Si nous sommes d’accord sur la gravité du déséquilibre démographique, nous ne validons absolument pas la solution que vous proposez. Elle serait immédiatement contreproductive compte tenu de la réalité constatée : les médecins ne s’installent pas avant trente-cinq ans ; ils sont moins de 9 % à se diriger vers la médecine ambulatoire libérale, ce qui représente moins de 300 personnes par an sur tout le territoire, soit trois à quatre par département ; à trente-cinq ans en moyenne, les jeunes médecins n’iront pas où ils ne veulent pas aller. Certains pays européens tels l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique, ont tenté ce que vous proposez ; le Québec, souvent mis en avant en matière médicale, aussi. Tous ont échoué. Dès lors que le déconventionnement se présentera comme l’alternative, beaucoup choisiront le secteur 3.
Le numerus clausus avait atteint un niveau très bas dans les années 1990-1995, ramené aux alentours de 3 500 par tous les gouvernements, de gauche comme de droite. Nous en payons les effets négatifs aujourd’hui. En outre, la médecine générale n’est plus du tout « sexy » depuis quelques années, en raison du poids des contraintes administratives, de la déconsidération de la profession, des obstacles multiples dans les territoires où les services publics ont disparu, de la faiblesse des tarifs depuis 2010-2011 – 23 euros, c’est moins que le prix du coiffeur de certaines personnalités politiques ! Tout cela a conduit des milliers d’étudiants à choisir une autre voie. Plus de 10 000 médecins exercent en mode d’exercice particulier (MEP), d’autres travaillent comme salariés dans l’industrie.
Il y a quelques mois, le groupe Les Républicains avait déposé une proposition de loi dont le contenu avait l’assentiment des étudiants en médecine, comme du Conseil national de l’Ordre des médecins. Elle prévoyait la déshopitalisation des études de médecine, pour que les jeunes aillent étudier hors de l’hôpital ; des épreuves classantes régionalisées ; un stage en médecine ambulatoire d’un an minimum ; le soutien aux retraités qui souhaiteraient reprendre une activité, éventuellement dans les territoires, mais sans les contraintes financières de l’assurance maladie ; le maintien des maisons de santé pluridisciplinaires, qui sont plus de 800 ; les contrats d’engagement de service public. Toutes ces mesures étaient incitatives, mais la proposition n’a pas été adoptée, ni au stade de la commission ni dans l’hémicycle. Peut-être l’avez-vous néanmoins approuvée, monsieur le rapporteur ?
Je note que vous n’avez pas abordé le tiers payant généralisé, qui est dénoncé par tous les professionnels de santé et qu’il faudrait absolument abolir.
Même si nous sommes en phase avec certains articles de votre proposition de loi, et avec le constat sous-jacent, nous n’acceptons pas cependant les solutions retenues, en particulier les contraintes qui restreignent la liberté d’installation. Pareille mesure n’a jamais facilité l’accès aux études médicales générales et libérales. Pour ce faire, il faut redonner une image attractive à la médecine générale ambulatoire. Ce n’est pas la contrainte, mais l’incitation qui peut être efficace.
Vous avez entendu hier les étudiants en médecine, qui ont déclaré être tout à fait favorables à un débat avec les élus locaux, régionaux et nationaux, pour que nous puissions éventuellement engager avec eux des mesures incitatives. Mettons les étudiants avec nous, non contre nous.
Monsieur le rapporteur, vous aurez compris que je voterai contre cette proposition de loi.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous dites que tous les professionnels de santé sont contre le tiers payant. Parlez-en aux radiologues, aux biologistes et aux pharmaciens d’officine ! Il est faux de dire que tous les professionnels de santé sont contre.
M. Francis Vercamer. Au nom du groupe UDI, je soutiendrai cette proposition de loi, non seulement parce qu’elle sera examinée en séance publique grâce à l’ordre du jour réservé à notre groupe, mais parce que j’ai moi-même alerté, en diverses occasions, le Gouvernement et mes collègues sur le problème de l’accès aux soins et sur les déserts médicaux qui s’amplifient dans nos territoires. Comme l’accès à l’emploi et d’autres obligations régaliennes de l’État, l’accès aux soins se trouve en difficulté. Il y a des mesures structurelles à prendre, car les solutions mises en œuvre à ce jour se sont révélées largement insuffisantes.
Une étude d’UFC-Que choisir a montré que 5 % de la population en 2016, soit près de 3 millions de nos concitoyens, vivent dans des déserts médicaux. Même le Conseil national de l’Ordre a dressé un constat qui doit nous alerter, puisque il n’y a pas un département de France qui n’ait de difficulté à remplacer un médecin de campagne. Madame la présidente, je pense, comme vous, que ce sujet de société doit transcender les barrières partisanes.
Le Gouvernement a pris plusieurs mesures incitatives. Elles ont certes le mérite d’exister, mais elles ont vu leurs limites. Dévoilé en 2012, le Pacte territoire-santé incluait un stage obligatoire en médecine générale pour les étudiants et des contrats d’engagement de service public en contrepartie de leur installation en zone fragile. À l’époque, déjà, le groupe UDI avait alerté sur son insuffisance au regard de la fracture médicale grandissante dans notre pays. Cette proposition de loi va dans le sens d’une transformation de l’accès aux soins et de notre société.
Un autre problème de la désertification médicale est que les professionnels paramédicaux et pharmaceutiques sont tenus de s’installer dans des territoires où manquent pourtant des médecins, qui sont prescripteurs pour ces mêmes professionnels de santé. L’équilibre économique de ces professionnels, pris dans une situation d’entonnoir, risque d’en pâtir. Il importe donc de parvenir à une bonne répartition de l’ensemble des professions de santé sur le territoire. En ce sens, la proposition de Philippe Vigier est équilibrée, même s’il faudra travailler en parallèle sur la revalorisation de la profession médicale et sur son environnement, notamment parce que cette profession se féminise, ce qui modifie les conditions d’exercice. En tout cas, il faut prendre des mesures pour que la tendance à la désertification médicale s’inverse.
Nous entendons, nous aussi, les professionnels de médecine ; il faut convenir qu’ils ne vont pas dans notre sens. L’on ne fait pas le bien des gens malgré eux, mais au contraire avec eux. Aussi devons-nous continuer la discussion. Ce texte constitue la première étape d’un débat plus large sur l’avenir de notre système de santé.
Le groupe UDI considère qu’en s’attelant aux problèmes de structure et d’organisation des études, cette proposition de loi favorisera la mobilité des professionnels et permettra de lutter efficacement contre la désertification médicale. C’est pourquoi nous voterons pour cette proposition de loi.
Mme Dominique Orliac. J’ai lu avec attention les quinze articles de cette proposition de loi qui tente d’apporter une réponse à la désertification médicale. Très vite, il apparaît qu’elle passe par des éléments de coercition, ce qui va à l’encontre de ce que nous pensons au groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP). Pour cette raison, vous pouvez déjà considérer, cher collègue Philippe Vigier, que notre groupe ne sera pas favorable à votre proposition de loi.
De notre point de vue, la coercition, aujourd’hui, est dépassée. Nous parlons de la désertification médicale depuis des années. On a pu voir, lors de l’examen de la loi relative à la santé puis du projet de loi de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), que la ministre de la santé a bien compris que de telles mesures ne permettraient pas d’avancer sur ce sujet extrêmement complexe. Cela nous semble un combat d’arrière-garde.
Dans l’exposé des motifs de votre proposition de loi, vous arguez qu’aucune mesure d’ampleur n’a été prise pour lutter contre la désertification médicale. Je ne vais pas les reprendre une à une, mais beaucoup de mesures incitatives ont été décidées. Certes, il faut parfaire leur organisation, mais elles existent. Au passage, je salue l’action, dans nos territoires, des collectivités locales. Les mairies, les communautés de communes et les conseils départementaux mettent en œuvre une incitation à l’installation, en faisant la promotion de nos territoires et de la qualité de vie que nous y avons. Leur action doit être entendue comme un complément aux instruments que nous envisageons.
L’on parle de manière parfois un peu vague de désertification médicale. Où s’observe-t-elle vraiment ? Il y a aussi bien des zones urbaines qui sont concernées. Dans mon département rural, le Lot, il n’y a jamais eu autant de médecins généralistes, grâce à une politique d’incitation et de promotion de notre département. Beaucoup de maîtres de stage accueillent des internes en stage pendant six mois. Vous proposez d’étendre cette période à un an. Pourquoi pas ? Il y faut du temps, mais cela porte ses fruits. Constatant cela, comme Gérard Sebaoun, j’ai évolué sur le sujet.
Nous avons loupé le coche il y a trente ans, n’ayant pas anticipé que le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques, mais aussi les progrès techniques et de la médication aussi rendraient plus souvent nécessaire de faire appel à un médecin aujourd’hui qu’alors. Il y avait une formation double, soit par l’internat, soit par les certificats d’études spécialisées (CES). Quand, sous la pression de l’Union européenne, l’on a supprimé les CES, l’on n’a pas augmenté pour autant les postes d’internes. Il aurait fallu, pour cela, que les doyens soient d’accord pour accepter de les former en plus grand nombre. La baisse du nombre de médecins formés est donc une responsabilité collective. Le numerus clausus a toutefois augmenté sensiblement ces dernières années. Il importera d’évaluer quels en seront les effets sur les installations.
Certains articles nous paraissent mériter que l’on s’y arrête, mais l’esprit général de la proposition de loi ne satisfait pas notre groupe. Les médecins suivent une formation longue, de neuf années s’ils sont généralistes, de treize ans si s’y ajoutent l’internat et le clinicat, comme c’est le cas pour les oncologues. Les étudiants en médecine ont rencontré au cours de cette période beaucoup de personnes qui ont influé sur leur cursus : patients, médecins, professeurs... Ils ont formé à leur contact un projet de vie. Au bout de ce parcours, nous ne pouvons pas les obliger à s’installer là où ils ne veulent pas aller. N’oublions pas qu’il s’agit d’un exercice libéral. Même en milieu rural, une patientèle met du temps à se constituer ; un patient ne donne pas immédiatement sa confiance à un médecin libéral, même dans des zones réputées être des déserts médicaux.
Bien des mesures incitatives pourraient être mises en place, par exemple pour soutenir les médecins généralistes qui acceptent d’être maîtres de stage. Je n’ai pas le temps de les énumérer toutes.
Je rappelle, pour finir, que les syndicats et les associations représentatives des étudiants en médecine, les internes de toutes les spécialités, les chefs de clinique ambulatoires et hospitaliers, les remplaçants et les jeunes installés avaient unanimement dénoncé l’amendement de Mme Annie Le Houerou, qui prévoyait un conventionnement sélectif. Ils avaient déposé un préavis de grève. Or cette proposition de loi est encore plus coercitive. Je me demande quelle serait leur réaction si elle venait à être votée.
Pour toutes ces raisons, notre groupe ne soutiendra pas la proposition de loi.
Mme Jacqueline Fraysse. La situation est de plus en plus difficile, le constat est partagé par tous. À vrai dire, il crève les yeux. Nous voyons le résultat de choix politiques catastrophiques. Malgré les alertes que nous avons lancées et les statistiques bien connues sur l’âge moyen des médecins en exercice, ces mêmes choix politiques ont continué, pour aboutir à la situation actuelle. Voyons les choses avec lucidité.
Je ne crois pas qu’il y ait lieu d’opposer les différentes régions. À Nanterre et à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, où je suis élue, il y a aussi une désertification médicale dans certains quartiers. J’entends beaucoup parler de la liberté d’installation et de la médecine libérale. Mais, dans certains quartiers difficiles et dans certaines conditions, l’installation de jeunes médecins ne serait pas la meilleure réponse. Un exercice plus collectif de la profession, dans des centres de santé ou des maisons médicales, serait peut-être plus adapté.
Il n’y a pas de recette unique, mais plutôt un faisceau de raisons qui expliquent la situation actuelle et qui justifient un faisceau de solutions. Les efforts déjà consentis ont fourni des résultats. Je regrette qu’il n’en soit pas fait davantage d’évaluation, de sorte que nous disposions d’arguments sérieux en faveur de l’une ou l’autre solution. En tout état de cause, il faut former davantage de médecins. Notre collègue Gérard Sebaoun a raison de souligner que c’est long. Les dispositions que nous prenons maintenant ne porteront leurs fruits que beaucoup plus tard, de même que nous payons aujourd’hui les mesures négatives prises dans le passé.
Je pense qu’il faut conserver les hôpitaux de proximité. Les médecins libéraux en ont impérativement besoin, de leurs plateaux techniques et des compétences qui peuvent venir en appui à leur pratique. Certaines régions sont désertifiées parce que l’on a trop fermé de lieux de santé de proximité. Nous devons prendre aussi des mesures pour aider les étudiants.
L’Ordre national des médecins a réalisé un travail remarquable, formulant des propositions. Les cinq premiers articles du texte que nous examinons contiennent ainsi des dispositions recommandées par l’Ordre, qui me semblent positives : prise en compte de l’offre territoriale de soins pour déterminer le numerus clausus ; stage de douze mois dans un cabinet après les trois premières années d’études ; internat plutôt régional que national, pour que des postes soient ouverts dans les régions qui en ont le plus besoin. Logiquement, en effet, les étudiants en médecine s’installent majoritairement là où ils ont fait leurs études, car c’est là qu’ils se sont faits des amis, qu’ils se sont formés et qu’ils ont constitué leurs réseaux de relations. Je suis favorable à l’idée d’un internat interrégional, qui permette d’ouvrir plus ou moins de postes selon les régions. Cela répond à l’obligation qui pèse sur nous de faire que tous nos concitoyens puissent être soignés. L’idée que les internes non thésés puissent exercer en tant que collaborateurs me paraît bonne. J’ai de même soutenu le statut de praticien territorial remplaçant promu par la ministre de la santé Mme Marisol Touraine.
S’agissant de la coercition, il faut que nous ayons du courage. Au moment de sauter, certains d’entre nous éprouvent quelques réticences… Ce type de mesures n’est certes agréable pour personne. En tant que législateurs, nous avons cependant la responsabilité de prendre des mesures et de veiller à ce que tout le monde soit soigné sur le territoire. Demander à de jeunes médecins de s’installer là où ils veulent, sauf dans les zones où il y a déjà trop de médecins, ne me paraît pas porter atteinte à la liberté d’installation. L’amendement de notre collègue Annie Le Houerou proposait un déconventionnement comme sanction. Est-ce vraiment une bonne idée ? J’assume, en tout cas, l’idée que les jeunes médecins ne choisissent leur lieu d’installation qu’hors des zones excédentaires.
Parce qu’elle paye leurs études et qu’elle finance la sécurité sociale, la puissance publique est légitime à prendre des dispositions à leur endroit.
M. Denis Jacquat. À l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a quelques jours, nous avons déjà eu l’occasion de peser le pour et le contre de ces mesures contre la désertification médicale.
La coercition ne marche pas. Elle peut seulement conduire à la diminution du nombre d’étudiants souhaitant se diriger vers la médecine. Au sein des étudiants en médecine eux-mêmes, de moins en moins choisissent l’orientation de la médecine générale. Notre collègue Jean-Pierre Door a fait état des propositions que notre groupe avait formulées pour remédier à ces problèmes. Elles furent refusées. Je regrette ce temps perdu.
Nous sommes attachés à la liberté d’installation. Contre la désertification médicale, des médecins ont déjà mis en place des maisons pluridisciplinaires de santé. Elles marchent bien, sans coûter un centime aux collectivités.
M. Philippe Noguès. Je partage avec beaucoup de nos concitoyens le constat sur le phénomène de la désertification médicale auquel veut remédier notre collègue Philippe Vigier. Comme il l’écrit dans l’exposé des motifs, la question de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire n’a pas été réglée par la loi de modernisation de notre système de santé. Les inégalités territoriales tendent même à s’amplifier. Les incitations financières proposées n’ont pas suffi. Le refus systématique de créer un cadre réglementé pour l’installation n’a finalement jamais permis de l’expérimenter. Cette proposition de loi a au moins le mérite de s’attaquer à l’angoisse qui s’installe souvent dans nos secteurs ruraux et périurbains, comme dans les quartiers défavorisés, en proposant une approche différente.
Des articles de la proposition de loi, je ne reprendrai que deux exemples emblématiques. L’article 2 prévoit qu’au cours de la troisième année d’internat, tout étudiant en médecine doit exercer un stage pour une durée minimale de douze mois au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire ou d’un établissement hospitalier dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. Ils iront constater la situation sur le terrain et je trouve que c’est une bonne idée.
L’article 6 prévoit, quant à lui, qu’à partir de 2020, tout médecin doit, à l’issue de sa formation, et pour une durée minimale de trois ans, s’installer dans un secteur géographique souffrant d’un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d’accès aux soins. Je connais bien des secteurs ruraux où ils seront accueillis à bras ouverts.
Je suis un peu plus dubitatif sur l’article 4 et sur le renforcement du dispositif de cumul emploi-retraite, qui est aujourd’hui sans effet sur la répartition territoriale des médecins. Au contraire, il bénéficie prioritairement aux médecins installés en zone surdotée. Le renforcer dans les zones défavorisées, grâce à un abaissement des cotisations sociales, ne m’apparaît pas comme une bonne idée. Les médecins à la retraite qui habitent dans ces territoires seraient-ils simplement motivés par des gains supplémentaires ? Je n’en suis pas si sûr. J’espère même, pour la morale et pour l’éthique, ne pas me tromper.
Néanmoins, cette proposition de loi, envisagée dans sa globalité, me semble de nature à faire bouger les lignes. Je ne doute pas, d’ailleurs, qu’elle sera particulièrement attaquée par des lobbies en tout genre. Sans doute est-ce la raison pour laquelle j’ai une furieuse envie de la voter.
Mme Isabelle Le Callennec. Tous les ans, nous reprenons le débat sur le sujet de l’installation des médecins. Nous en avons eu encore récemment l’occasion lorsque nous avons examiné l’amendement de notre collègue Annie Le Houerou, élue des Côtes-d’Armor. Certes, nous devons entendre les médecins et les étudiants en médecine, mais nous devons écouter aussi les citoyens et les élus locaux. Ils s’inquiètent de la désertification. Elle est réelle.
Notre responsabilité est de lutter contre les inégalités, de plus en plus criantes, de l’accès aux soins. Jusqu’à présent, les gouvernements, de droite comme de gauche, ont fait le pari de l’incitation. Des progrès ont été observés avec la création de maisons de santé pluriprofessionnelles, l’augmentation du numerus clausus, les contrats d’engagement de service public, le soutien aux remplacements et l’engagement des élus locaux. Pourtant, force est de constater que cela ne suffit pas, y compris dans les départements dotés de grandes universités. Ainsi, à Rennes, les étudiants en médecine ont bien du mal à s’installer ou même à simplement exercer loin de l’agglomération, ne serait-ce qu’à trente minutes. Ils pourraient, à tout le moins, habiter dans la ville où ils ont fait leurs études, mais accepter d’aller exercer à trente minutes, si les conditions le permettent.
Indubitablement, les stages obligatoires au cours de l’internat sont une vraie piste, à condition qu’ils soient d’une durée significative. La déshospitalisation des études de médecine est aussi une piste à explorer. Ce qui fait débat, c’est l’obligation prévue, à partir de 2020, pour tout médecin de s’installer, à l’issue de sa formation, et pour une durée minimum de trois ans, en zone sous-dotée, sous peine de pénalités financières. J’ai trois questions à ce sujet.
Monsieur le rapporteur, que répondez-vous à ceux qui militent pour que ces discussions aient lieu non au niveau national, mais au niveau régional, puisque les lignes bougent ? Vous êtes-vous interrogé sur les critères de définition des zones tendues et sous-tendues ? Les élus locaux pourraient contribuer à les déterminer. Quelle forme prendraient les pénalités financières prévues, en cas de non-respect des obligations nouvelles ? Notre collègue Annie Le Houerou proposait le déconventionnement.
M. Michel Liebgott. Je complèterai l’intervention de notre collègue Gérard Sebaoun, par deux ou trois remarques tirées de mon expérience locale.
Je pense qu’il faut des outils de régulation. Ne voyons-nous pas des pôles médicaux se constituer autour des pharmacies ? Ces pôles médicaux sont, en général, faciles à mettre en place, puisque quatre ou cinq médecins généralistes peuvent trouver un intérêt à être à côté d’une pharmacie, en mutualisant leur secrétariat. J’en connais des exemples en zone urbaine sensible. Cela s’est fait grâce à des exonérations de charges sociales. Les moyens de régulation existent donc et ils peuvent être efficaces.
Originaire d’une région minière, je sais que la sécurité sociale minière a longtemps joué ce rôle. Ne négligeons pas les possibilités de renforcer la démographie de l’ensemble de la profession médicale.
Enfin, je connais l’exemple d’un patient qui cherchait, sur indication de son cardiologue, à obtenir un rendez-vous pour un scanner en Lorraine. Il n’était pas possible de trouver un horaire de rendez-vous avant un mois dans la région. À Paris, au deuxième coup de téléphone, un rendez-vous était possible pour le lendemain à 13 heures 30. Mais l’acte coûtait 350 euros et n’était remboursé qu’à hauteur de 70 euros. Je suis étonné que l’on puisse donner autant d’autorisations d’exploitation, alors que certains outils sont manifestement sous-employés. Parfois, l’on solliciterait presque les gens pour venir passer des examens.
M. Arnaud Viala. Nous avons eu cette discussion lors du débat sur le PLFSS pour 2017. J’avais alors voté l’amendement présenté par Mme Annie Le Houerou et, ne m’alignant pas sur la position présentée comme étant celle de mon groupe politique, je voterai la proposition de loi de M. Philippe Vigier.
Après que tant de mesures incitatives sont restées sans effet, il est légitime de débattre de l’instauration de mesures plus coercitives. Il en irait autrement si l’on n’avait rien fait avant de chercher à contraindre. Mais qu’autant d’argent public national et local soit dépensé pour créer des maisons médicales qui restent vides faute que des médecins s’y installent est à la fois désastreux et insupportable. Qui plus est, la démographie de nombreuses régions est mise en péril par l’absence de personnel de santé, qui ruine les initiatives prises par les acteurs publics et privés alors même que les territoires ruraux ont un attrait réel. Il est donc impératif de traiter ce problème. Mais, pour le traiter au mieux, il faut aussi, par voie réglementaire, revoir les zonages. Pour l’instant, s’y trouvent amalgamées des zones à fortes densité médicale et des zones périphériques à très faible densité, si bien que des problèmes apparaissent souvent à l’intérieur des zones ainsi définies. J’ai en ce moment des discussions très serrées à ce sujet avec l’agence régionale de santé (ARS) dont dépend ma circonscription et avec la Caisse primaire d’assurance maladie. La révision des zonages devant avoir lieu en 2017, il faut revoir la manière dont ils sont dessinés et permettre aux élus de donner leur point de vue sur leur définition.
Je voterai cette proposition à laquelle je souscris sans réserve.
M. Denys Robiliard. Je suis, comme notre rapporteur, député du Centre-Val de Loire, la région où la densité médicale est la plus faible, dans un département où la population augmente légèrement alors que le nombre de médecins diminue – et je ne parle pas des départements du Cher et de l’Indre, ce dernier accusant une baisse de la densité médicale de l’ordre de 15 %. Étant donné la pyramide des âges, les problèmes sont devant nous, car nombreux sont les médecins qui vont prendre leur retraite dans les années à venir. Autant dire qu’une proposition de ce type attire mon attention et m’incite à la réflexion.
La formation des médecins étant financée par les deniers publics, la demande de soins étant solvabilisée par des mécanismes de solidarité – la sécurité sociale principalement, et la mutualisation opérée par les complémentaires santé –, nous ne pouvons récuser le principe d’une liberté d’installation encadrée ; il faut en tenir compte dans la définition des modes d’installation. On constate aussi que, pour ce qui est de l’installation des médecins, le libéralisme ne fonctionne pas : il est avéré que la liberté totale d’installation a abouti à une mauvaise répartition spatiale.
Si l’on peut discuter sur le principe, la thérapeutique préconisée interroge au regard de son efficacité. À ce sujet, j’ai été attentif aux propos de MM. Door et Sebaoun. Il se pose un problème de méthode : le sujet doit être débattu, mais une loi en cette matière ne devrait être élaborée qu’après qu’une véritable négociation a été conduite et si elle a échoué. Cette négociation n’a pas eu lieu, ce qui est suffisant pour, malheureusement, ne pas adopter le texte en l’état. À cela s’ajoute que le périmètre retenu est trop étroit, le problème affectant à la fois la médecine libérale et l’hôpital.
Mme Bérengère Poletti. Le marronnier refleurit donc, comme depuis vingt, sinon trente ans, et le sujet est grave. La désertification médicale, c’est tout autre chose que de devoir faire une heure de route pour aller consulter un médecin : c’est ne trouver qu’à très grand mal un médecin à consulter et, quand un rendez-vous a finalement pu être pris, parfois plusieurs jours plus tard, se trouver face à un médecin surmené par douze sinon quinze heures de travail quotidien et au bord du burnout. Telle est la réalité, et tel est le problème auquel nous devrons absolument apporter une solution. Lors de la discussion du PLFSS pour 2017, les opposants au dispositif de régulation de l’installation proposé par Mme Annie Le Houerou ont avancé des mesures de toutes sortes : il a été question de stages, de formation, d’ouverture du numerus clausus, de postes d’internat, de maisons médicales, de télémédecine… On trouve tout cela dans la présente proposition de loi, que je soutiendrai, car, même si elle est imparfaite, elle a le mérite de proposer un éventail de solutions sur lesquelles on peut enfin discuter, notamment avec ceux qui étaient opposés à l’amendement Le Houerou.
La féminisation de la profession est très souvent présentée comme l’une des causes de la désertification médicale. C’est une des données à prendre en considération, mais le problème est bien plus large. Il tient à ce que les comportements se modifient ; que les médecins, hommes ou femmes, veulent une vie familiale de qualité ; qu’ils refusent d’être corvéables à merci et de travailler douze ou quatorze heures par jour ; que les épouses ne sont plus des petites mains zélées et que les médecins doivent avoir un secrétariat. Ces données-là n’ont pas été intégrées dans les schémas imaginés pour permettre aux médecins de s’installer dans les zones rurales. Cela ne signifie pas que rien n’aurait été fait ; des évolutions ont eu lieu depuis quinze ans concernant le numerus clausus, les stages des médecins, les postes d’internat, les maisons médicales et la télémédecine. Les gouvernements de gauche et de droite ont agi, mais il manque précisément le dispositif proposé par Mme Le Houerou. Il est inacceptable de continuer à laisser des médecins s’installer là où l’on sait qu’il y en a déjà trop.
M. Gérard Bapt. Je partage le constat dressé par le rapporteur et confirmé par mon collègue Gérard Sebaoun : alors que la Haute-Garonne est l’un des départements où la densité de médecins généralistes rapportée à la population est la meilleure, dans ma propre circonscription, qui part du centre de Toulouse pour aller jusqu’au Tarn, de plus en plus nombreuses sont les communes qui se trouvent sans médecin quand le généraliste en exercice prend sa retraite. De plus, on ne dit pas assez combien il est difficile pour les petits établissements de santé de recruter et de garder des médecins salariés ; dans certaines spécialités, le problème vaut même pour les CHU.
Le principe de réalité s’impose donc et il s’imposerait de la même manière pour les mesures contraignantes proposées aujourd’hui que pour les mesures incitatives – en admettant que l’on puisse en cueillir les fruits avant dix ans, étant donné la pyramide des âges des médecins qui exercent actuellement. De plus, il est gênant que cette proposition nous soit soumise en fin de législature et que l’on soutienne en même temps certains candidats aux primaires des groupes politiques qui se prononcent en faveur de la liberté d’installation.
Par ailleurs, au motif qu’ils n’ont pas passé leur thèse dans les délais requis, on est en train de démettre de leur fonction de soignants des médecins étrangers venus de pays extérieurs à l’Union européenne et qui travaillent sous la responsabilité de médecins français depuis des années. Ils sont plusieurs dizaines dans ce cas en France. Autant dire qu’il y a encore des mesures à prendre, mais je pense que la question relève du débat préalable à l’élection présidentielle.
Mme la présidente Catherine Lemorton. M. Vigier ne présente pas cette proposition aujourd’hui pour la première fois : il l’a déjà fait en 2011 et en 2012. On ne saurait dire que c’est une nouveauté !
M. Bernard Perrut. Le droit à la protection et à la santé est un principe constitutionnel et son exercice exige que l’on puisse accéder aux soins en tous lieux. Mais il faut aussi réaffirmer qu’une politique de santé publique ne se fait pas contre les professionnels de santé mais avec eux. La liberté d’installation est essentielle. Pour autant, il faut favoriser l’installation durable des médecins dans les zones en souffrance, en milieu rural comme en milieu urbain, car certains quartiers souffrent également d’être des déserts médicaux. La situation est grave et la précédente majorité avait défini une politique de lutte contre la désertification médicale qui s’est traduite par l’élargissement du numerus clausus, la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les contrats d’engagement de service public, les maisons de santé pluridisciplinaires. Parce qu’il faut aller plus loin, notre groupe a proposé la déshospitalisation des études médicales, l’effectivité des stages en ambulatoire pendant les études de médecine, la définition d’une formation initiale plus proche du terrain et permettant de renforcer l’attractivité d’une spécialité et des territoires en souffrance. Où en sont, d’ailleurs, les centres de santé universitaires prévus dans la loi Touraine ?
Obliger à l’installation dans les zones désertifiées, n’est-ce pas risquer de provoquer la fuite des internes vers d’autres modes d’exercice qui ne permettront pas d’assurer une présence médicale proche ? Le problème doit être envisagé dans le cadre de la politique générale d’aménagement du territoire ; or comment obliger de jeunes médecins à s’installer là où il n’y a ni services, ni écoles, ni activités ? Il faut avant tout privilégier l’engagement volontaire des professionnels de santé grâce à des aides et à un plan ambitieux de maisons de santé permettant qu’ils se regroupent. Au moment où se créent les groupements hospitaliers de territoire, ne devrions-nous pas aborder la question à l’échelle de chaque territoire et donc aller plus loin dans la territorialisation des activités d’urgence et des rôles respectifs ? Au cours de la discussion des crédits de la mission Santé du projet de loi de finances pour 2017, j’ai d’ailleurs interrogé la ministre sur la réorganisation territoriale de la prise en charge des urgences et dit la nécessité d’associer aux décisions les élus locaux, qui connaissent parfaitement la situation de leurs territoires respectifs.
Mme Michèle Delaunay. Cette proposition nous conduit à poursuivre la discussion que nous avons eue sur l’amendement de Mme Le Houerou. Je suis toujours choquée que l’on traite en un seul bloc les spécialités et la médecine générale alors que, selon que l’on parle des unes ou de l’autre, les zones sous-tendues ou sur-tendues ne relèvent ni de la même définition ni des mêmes palliations.
La proposition apparaît alors qu’une convention avec les médecins vient d’être signée il y a quelques semaines. Je trouve de mauvaise pratique de vouloir modifier des règles contractuelles à peine fixées.
Il est nécessaire de prendre en considération la manière dont les jeunes médecins – que, comme M. Philippe Vigier, j’ai reçus longuement au moment de la discussion du PLFSS et sans lesquels nous ne ferons rien – souhaitent exercer la profession. Je reprendrai donc mot pour mot ce qu’a dit Mme Poletti, pour aboutir à d’autres conclusions. Prenons en considération les desiderata des jeunes futurs médecins, qui pour beaucoup sont des femmes
– lesquelles, en effet, ne sont plus seulement les petites mains de leurs grandioses époux. Nous ne pouvons introduire une dose de répartition territoriale « facilitée » des installations qu’en nous donnant les moyens de satisfaire les demandes de pratique des jeunes médecins. Comme M. Perrut, je pense qu’une coercition imposée brutalement et trop rapidement conduira de nombreux professionnels à fuir l’exercice libéral.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je rappelle que la médecine générale est désormais une spécialité.
M. Jean-Louis Costes. Nous partageons tous l’idée qu’il est de notre responsabilité de parlementaires de satisfaire l’accès aux soins de premier niveau, besoin essentiel. La situation actuelle est intenable, et il y a pire : au fil des décennies, nous avons laissé s’instaurer une rupture de l’égalité de traitement des citoyens en matière de santé. Les gouvernements successifs ont multiplié les dispositifs incitatifs ; le dernier étant une prime d’installation de 50 000 euros, nous avons atteint la limite de ce que peuvent supporter les deniers publics. Nous devons donc absolument définir un système de régulation comme il en a été institué, en liaison avec les ordres professionnels, pour les infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes et les sages-femmes, sans que le principe de la liberté d’installation ait été brandi devant nous comme un chiffon rouge pour interdire toute négociation et toute mesure de régulation. Les médecins qui exercent dans les territoires frappés par la désertification médicale nous implorent de trouver des solutions, car, submergés de demandes, ils ne peuvent plus accepter de nouveaux patients et sont confrontés à des comportements agressifs. Il résulte de cette situation une autre conséquence tout aussi préjudiciable pour la santé : l’engorgement des services des urgences des hôpitaux, qui ne peuvent plus se consacrer à leur mission première.
Pour toutes ces raisons, je voterai d’autant plus volontiers en faveur de cette proposition de loi que j’avais déposé un amendement à la teneur semblable lors de la discussion du PLFSS pour 2017.
M. Fernand Siré. Pour avoir exercé pendant quatre décennies comme médecin généraliste en milieu rural, j’observe que certains parlent de médecine pendant que d’autres la pratiquent. Le système ne marche plus depuis quarante ans, depuis que l’on a considéré qu’il fallait faire des économies au détriment des professions médicales. Au départ, le médecin exerçait sans infirmières, kinésithérapeutes ni auxiliaires de vie. Maintenant qu’il est entouré d’un pool de professionnels divers, un excès d’offre est proposé au malade, qui en abuse parfois.
Il faut modifier radicalement le système au lieu de le rapiécer. Au lieu de rationaliser, on a rationné : on a resserré le numerus clausus et incité des générations de médecins à cesser leur activité à cinquante-cinq ans pour restreindre l’offre, en pensant que cela ferait baisser la demande de soins ! Il faut instituer un système centralisé autour du malade, avec un dossier personnalisé partagé avec l’ensemble des professionnels de santé, et réorganiser les métiers, la rémunération et l’intérêt qu’auront les professionnels de santé à aider le patient.
Je suis contre l’idée d’un droit à la santé. Maintenant, on a droit à tout ! En matière de santé, il convient d’abord de moins fumer et de moins boire. Il faudra développer la médecine préventive et modifier la médecine curative, car on ne peut demander à un médecin qui a reçu une formation hyper-performante d’exercer en un lieu isolé avec pour tous instruments un stéthoscope et un tensiomètre. Le système est à bout de souffle. Imaginez que, dans mon département, un service de pompiers volontaires a été condamné à verser 2 millions d’euros pour n’avoir pas donné « toutes les chances de réanimation » à un malade pendant son transport vers l’hôpital !
Nous – l’État – sommes tous responsables de cette situation. Il faut maintenant procéder à une réorganisation totale de notre dispositif de soins en l’articulant autour du patient, en médecine préventive comme en médecine curative, et en rassemblant tous les professionnels concernés, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers et les associations de maintien à domicile et d’information sur la prévention en matière de santé.
M. Bernard Accoyer. La question qui nous occupe, d’une extrême gravité, a de nombreuses causes, déjà exposées. Étant donné la désertification des zones rurales et la disparition des activités, pourquoi seuls resteraient les médecins ? Le mal, aigu, résulte de quarante-cinq ans d’un numerus clausus décidé pour des raisons principalement économiques. L’effectif des médecins généralistes diminue depuis vingt-cinq ans ; surtout, près de 90 % des étudiants sont évincés à la fin de la première année commune aux études de santé (PACES), si bien qu’un quart des médecins inscrits aux conseils départementaux de l’Ordre ont été formés dans les universités étrangères. L’échec des décisions prises au cours des dernières décennies est donc patent.
Pour autant, la solution avancée aux articles 7 à 9 de la proposition de loi – un conventionnement sélectif – n’est pas la bonne. Je suis opposé à une disposition qui aurait un effet paradoxal et contre-productif, dissuadant les vocations et les installations, à commencer par les installations dans les zones sous-denses. Il faut augmenter le numerus clausus par région. Pourquoi ne pas créer un internat régional destiné à la médecine générale ? Cela remettrait en cause certains choix contestables. Une proposition a été faite qui pourrait être mise en œuvre tout de suite avec un effet relativement rapide : augmenter de quelques centaines de places le nombre d’admissions à l’issue de la PACES, places conditionnées par l’exercice pendant quelques années en zones sous-denses. Ainsi les choses seraient claires dès le départ pour les étudiants. Un contrat serait signé, comprenant, si nécessaire, des avantages tarifaires. Concomitamment, des maisons médicales pluridisciplinaires et des cabinets secondaires seraient installés, et la télémédecine développée. C’est seulement dans cette direction, qui implique le volontariat, que l’on pourra trouver la solution.
M. Rémi Delatte. Nous nous accordons sur le diagnostic, celui d’inégalités aux conséquences parfois dramatiques dans l’accès aux soins. Le texte qui nous est soumis formule des propositions dynamiques et incitatives intéressantes, qu’il s’agisse de formation, de stages, d’un numerus clausus éventuellement adapté en fonction des situation, de mesures fiscales ou d’organisation de maisons de santé. En revanche, les propositions figurant aux articles 6 à 11 et qui tendent à l’installation obligatoire, pendant les trois premières années d’exercice, dans des territoires sous-dotés ne correspondent pas à notre culture. On n’y parviendra pas sans l’assentiment des médecins, et l’on sait l’opposition de la profession à la coercition. Outre que nous sommes tous attachés au principe de la libre installation, comment s’organisera le turn-over des jeunes médecins ? Cette mobilité artificielle risque de créer de nouveaux déséquilibres, avec une surdotation des campagnes en jeunes médecins au détriment des villes, où, dans certains secteurs, les difficultés sont aussi fortes.
M. le rapporteur. Je remercie tous les intervenants, dont le grand nombre dit la passion que suscite le sujet. Je n’escomptais pas, en présentant ce texte, qu’il serait adopté en bloc, mais prétendre qu’il faudrait tout prendre ou ne rien prendre, c’est refuser le débat. J’appelle donc chacun à la réflexion, et à prendre ses responsabilités.
Monsieur Sebaoun, vous considérez que la coercition ne fonctionne pas, mais ne faudrait-il pas changer de vocable ? L’internat national classant est bel et bien une forme de coercition, puisque la ville où l’on ira n’est pas celle que l’on a déterminée au préalable : elle est fonction de la place obtenue au terme du concours. Personne ne peut le nier. De plus, quand, dans le cadre de l’internat, les jeunes médecins sont envoyés six mois en formation à 180 kilomètres de chez eux, ils n’ont pas le choix, et ils ne disent rien. « Coercition » est donc un terme trop fort et nous devons, tous, prendre garde aux mots dont nous usons.
Vous avez jugé intéressantes certaines des mesures proposées. Vous avez noté qu’en proposant qu’à partir de 2020 tout médecin soit tenu, à l’issue de sa formation et pour trois ans au moins, de s’installer dans une région où la densité de médecin est insuffisante, je laisse à la réforme un peu de temps pour se faire. Vous avez bien voulu reconnaître que c’est avec la profession, et non contre elle, que je propose de conduire cette réforme. J’ai eu plusieurs échanges avec les internes, et je les reverrai parce que c’est avec eux qu’il faut faire évoluer le système en vigueur. Vous avez enfin souligné qu’à l’issue de leur formation initiale, les jeunes médecins font des remplacements pendant sept à huit ans ; ce sont autant d’années de nomadisme, mais personne ne dit mot de la manière dont s’organise leur famille pendant qu’ils exercent à 200 ou à 500 kilomètres. Pourtant, cela provoque des difficultés. Tout cela doit aussi être évoqué ! Pourquoi ce qui serait une contrainte quand on est installé en un lieu ne le serait pas pendant ces années de remplacements nomades ?
M. Door a exprimé sa position avec constance. Je lui rappelle qu’en 2012, le Conseil national de l’ordre des médecins a préconisé la mise en œuvre « d’une régulation des conditions de premier exercice dans une période quinquennale éventuellement révisable, organisée au niveau régional, en partenariat avec les universités et les ARS ».
M. Jean-Pierre Door. Cela a duré une semaine !
M. le rapporteur. Dans son Livre blanc pour l’avenir de la santé, le CNOM recommande aussi de créer un numerus clausus régionalisé. Il a été fait référence au CNOM, et certains de ceux qui siègent ici ont eu des responsabilités ordinales importantes dans les départements ; je ne doute pas qu’ils suivront à la lettre les préconisations du CNOM, qui disait aussi qu’il serait bon de créer un « parcours post-DES de territoire » pour inciter à « l’exercice volontaire dans les territoires sous-médicalisés » – c’est ce que je propose. J’ai été frappé que les jeunes médecins ne s’installent qu’après huit à dix ans ; ma proposition rejoint donc leur souhait, puisqu’elle leur permet de s’installer tout en poursuivant leur formation grâce à la télémédecine. Enfin, j’ai entendu M. Door parler de liberté, mais je ne me souviens pas l’avoir entendu s’exprimer avec autant de force quand, en 2010, la liberté d’installation des biologistes a été mise par terre ; pourtant, la liberté ne se segmente pas.
Je remercie M. Vercamer pour ses propos, ceux que tient l’élu d’un département où la sous-densité médicale est particulièrement marquée. Pour m’avoir soutenu d’emblée, il sait parfaitement que mon objectif est que nous avancions collectivement, par étapes, puisque la somme de petites mesures nous permettra d’arriver à nos fins.
Mme Orliac a également insisté sur la coercition, notion sur laquelle je me suis déjà expliqué. J’insiste sur le fait que l’absence de barrières territoriales peut cacher des barrières financières. Seul M. Accoyer a eu le courage de rappeler que 25 % des installations nouvelles sont le fait de médecins formés à l’étranger. J’avais demandé, lors du débat sur le PLFSS, que les conseils de l’ordre valident les diplômes des médecins étrangers travaillant en France ; je me suis heurté à un refus. Il est anormal que les conseils de l’ordre soient d’une exigence totale pour les médecins exerçant en médecine libérale et ne fassent pas preuve de la même exigence pour les médecins hospitaliers. Ils sont plus de 30 000, de l’aveu même du président du CNOM, pour lesquels l’intégralité des diplômes n’a pu être validée comme assurant une parfaite efficience des soins. Il y a là une formidable hypocrisie qu’il faut soit assumer collectivement, soit dénoncer – je préfère la dénoncer.
Enfin, si l’on vous en croit, madame Orliac, il suffirait de faire la promotion de son territoire pour attirer des médecins ; cela me paraît quelque peu réducteur. À constater que la désertification médicale commence à 15 kilomètres de Toulouse, ville considérée, avec Bordeaux, comme celle où l’on a le plus envie de s’installer, on déduit qu’il ne suffit pas d’être l’ambassadeur de son territoire, ce que nous sommes tous. Beaucoup de collectivités ont mis sur la table des moyens considérables, et cela s’est soldé par des échecs. Mais j’ai constaté que vous étiez favorable à trois de mes propositions.
Je vous remercie, madame Fraysse, pour les mots que vous avez eus. C’est au législateur de prendre ses responsabilités, et ce n’est pas facile, mais l’approche que vous proposez me convient. Formé par les hôpitaux publics, je suis partisan d’un équilibre entre médecine libérale et médecine publique – d’ailleurs, vous-même avez salué le rôle de la médecine libérale. Vos propos, empreints d’une modération que je salue, montrent qu’il nous appartient d’avancer sur cette difficile question.
Denis Jacquat est revenu sur la notion de coercition, mais, comme l’a rappelé Mme la présidente, la médecine générale est également une spécialité. D’ailleurs, savez-vous que les jeunes internes souhaitent que la durée de formation des généralistes passe à dix ans ? Auparavant, un généraliste était formé en sept ans ; maintenant, c’est en neuf ans. Je comprends que les jeunes veuillent quatre ans d’internat de médecine générale. Cette volonté d’être mieux formés et de mieux prendre en charge leurs patients est tout à leur honneur – je pense moi-même que la formation doit être continue et s’inscrire dans le temps –, mais si la formation dure plus longtemps, alors l’installation aussi prendra encore plus de temps, et la fracture ne fera que s’aggraver.
Monsieur Noguès, globalement, nous sommes d’accord sur nombre des dispositions que je propose. Vous avez été choqué par le dispositif de cumul emploi-retraite ; vous voyez que je ne considère pas qu’une idée est bonne ou mauvaise selon qu’elle émane d’une travée ou d’une autre de l’hémicycle de l’Assemblée nationale. À Châteaudun, trois médecins ont soixante-neuf ans. Comment faire s’ils arrêtent d’exercer ? Je le dis avec gravité. Samedi dernier, dans un cabinet, nous avons frôlé la bagarre quand quatre personnes sont arrivées et qu’il n’y avait pas de médecin. Les gens veulent être pris en charge ! Je veux bien entendre tous les arguments, mais, à un moment, il faut regarder la situation en face, et ne pas faire dire à un mot le contraire de ce qu’il veut dire. Qu’on ne parle donc pas de vraie liberté d’installation avec l’examen national classant !
Isabelle Le Callennec me demandait comment réguler dans les zones sous-dotées et qui définit ces zones. Ce sont les agences régionales de santé qui le font. Dans ma région, auparavant, nous avions des statistiques de 2011 ou 2012, mais cela s’est un peu amélioré. Il faut travailler avec les élus locaux, parce qu’ils ont une vision de leur territoire. Pour ma part, je sais parfaitement quand les médecins qui exercent sur le territoire que je représente prendront leur retraite. La compilation et le traitement des statistiques à l’échelle d’une région, et d’autant plus maintenant qu’elles sont très grandes, entraîne du retard à l’allumage. Que l’on implique les élus, cela me va très bien. Quant à la sanction prévue pour les médecins qui s’installent dans les zones surdotées, elle n’est pas financière ; ils n’ont plus de conventionnement, ce qui reprend l’amendement Le Houerou.
M. Liebgott a également eu des propos courageux. À la suite d’un petit accident à l’Assemblée qui m’a valu un tendon déchiré, j’ai vu ce qu’il en coûtait d’être hors nomenclature. Quand on parle d’égalité devant les soins, cela me fait sourire l’espace d’un instant. J’ai également pu mesurer quelles complications pouvaient entraîner les délais d’attente pour un examen d’imagerie par résonance magnétique ou pour des échographies quand on n’a pas accès à des professionnels.
Merci, monsieur Viala, pour votre contribution. Beaucoup d’argent public – de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales – a été mis sur la table, via de nombreux dispositifs incitatifs. Vous l’avez dit, comme Isabelle Le Callennec, les élus ont leur mot à dire ; c’est important. Nous sommes, d’une certaine manière, le réceptacle des difficultés rencontrées tant par les professionnels de santé que par la population. D’ailleurs, que disent nos concitoyens ? « Que font-ils ? Ont-ils conscience de ce drame qui s’aggrave ? » Et nous nous étonnons de poussées d’extrémisme et de populisme dans nos territoires aussi bien ruraux qu’urbains ! Jean-Pierre Door parlait de la primaire, mais je ne m’inscris pas dans cette perspective, ce n’est pas mon sujet. J’ai rappelé les engagements pris par François Hollande en 2012, dont nous savons ce qu’ils sont devenus. Je ne me place pas du tout sur un terrain politique, j’ai simplement rappelé, au détour d’une phrase, quelles propositions de loi les ministres actuels avaient signé, quels engagements avaient été pris. Nous devons tous faire œuvre de modestie – c’est Roselyne Bachelot qui a contribué à égratigner la liberté d’installation, nous l’avons vu avec les biologistes.
Monsieur Robiliard, c’est vous qui êtes allé le plus loin dans le sens d’un encadrement de l’installation. Vous avez insisté sur le manque de médecins dans nos hôpitaux publics. C’est une vraie difficulté, car nous sommes confrontés à de véritables mercenaires. Il y a 900 millions d’euros de dettes dans les hôpitaux ! Êtes-vous allés voir, chers collègues, dans les comptes d’exploitation des hôpitaux, combien coûtent ces mercenaires, qui décident de leur lieu d’exercice ? Cet été, l’hôpital de Bourges a failli fermer ses urgences, mais des situations analogues se rencontrent en de nombreux autres endroits.
Bérengère Poletti a bien fait de rappeler le rôle des femmes en médecine. Il faut accepter les évolutions. En 1981, quand nous étions internes, nous nous battions pour que les congés de maternité des internes soient indemnisés, car ils ne l’étaient pas.
Gérard Bapt, certes, le constat est partagé, mais la présidente a très bien répondu à cette critique adressée à ce qui serait une proposition de loi d’opportunité : en l’occurrence, c’est la troisième fois que je la présente.
Bernard Perrut a insisté sur les qualités qu’il trouvait à un internat régional, aux stages de douze mois, au fait que l’on sorte les internes des centres hospitalo-universitaires, ce à quoi la conférence des doyens est favorable. Il a aussi beaucoup parlé d’aménagement du territoire, mais cette proposition de loi y participe. Il est bien beau de parler d’aménagement du territoire, mais quels actes suivent les belles déclarations en faveur d’un rééquilibrage entre villes et campagnes ?
Merci à vous aussi, Madame Delaunay, qui connaissez merveilleusement ce domaine. J’entends bien votre propos, selon lequel il ne faut pas changer la donne sitôt une convention signée, mais vous m’accorderez que nous avons mis en place beaucoup de dispositifs. Il serait bon que nous disposions d’un bilan – je reprends là une idée exprimée par Mme Fraysse. J’ai, pour ma part, travaillé avec un excellent administrateur du service de la culture et des questions sociales ; il nous faut encore compiler des données, mais il serait bon que nous les examinions sans tabou. J’ai parlé des internes qui remboursent les aides qu’ils ont reçues pendant leur formation ; c’est un phénomène récurrent et qui semble s’aggraver. Il apparaît que l’incitation financière ne suffit pas et qu’il faut inventer quelque chose.
Merci aussi à Jean-Louis Costes, dans le propos de qui j’ai reconnu un élu rural engagé au service de son territoire en proie à de véritables difficultés. Jean-Louis Costes a souligné que des aides financières importantes ont été apportées, sans que cela se révèle toujours efficace. Il a dit que la situation était « intenable ». C’est un propos responsable, dont je le remercie.
M. Siré a évoqué la nécessité d’une réorganisation complète des systèmes de soins. Nous serons d’accord sur ce point. En l’occurrence, la réponse doit être structurelle, mais il est compliqué de réformer de fond en comble. Il est déjà compliqué de rassembler sur une proposition de loi telle que celle-ci !
Bernard Accoyer est le seul à l’avoir dit : 25 % des médecins qui exercent actuellement en France ont été formés à l’étranger. Des villes se font démarcher par des cabinets divers et variés, qui leur offrent de trouver un médecin contre 20 000 euros. Et quel est le résultat ? Sur les cinquante et un médecins que compte ma circonscription, sept sont étrangers. Je ne veux être désagréable avec personne, mais qualité de prescription et efficacité thérapeutique ne sont pas forcément au rendez-vous. Soyons fiers de la formation délivrée en France !
Enfin, merci à Rémi Delatte pour sa contribution. Je ne peux cependant pas le suivre dans son refus de réguler l’installation.
Un dernier mot avant l’examen des articles : je ne l’ai pas dit au début, sciemment, mais il y a un vrai problème de reconnaissance du rôle majeur que jouent les professionnels de santé, quels qu’ils soient. La meilleure preuve en est le tarif de la consultation, dont je ne sais depuis combien de temps il est fixé à 23 euros. Cette règle est contournée, vous le savez très bien ; des statistiques parfaitement pertinentes sont sorties récemment : cela coûte en fait 42 euros. Quant à la consultation à l’hôpital, qui, du coup, a augmenté, en raison du moindre nombre de médecins en villes, elle coûte 400 euros. Les finances publiques sont ainsi grevées parce que nous n’avons pas su organiser une médecine de qualité. Il y a, nous le savons très bien, des conventionnements spécifiques pour les généralistes qui reçoivent des enfants, des personnes âgées, mais il fallait avoir le courage de revaloriser la consultation. Nous devons tous balayer devant notre porte. Favorisons la reconnaissance, la revalorisation des carrières et faisons en sorte que notre très belle médecine, très menacée, suscite l’enthousiasme. Ce château de cartes, naguère exemplaire, s’écroulera-t-il ? Ou ferons-nous œuvre de courage et de détermination ?
Article 1er
(Art. L. 631-1 du code de l’éducation)
Fixation du numerus clausus des études médicales
Le présent article a pour objet de mieux prendre en compte les besoins de santé de chaque territoire dans la fixation du nombre et la répartition des étudiants admis à l’issue de la première année des études de santé.
● La modulation du numerus clausus limitant les effectifs d’étudiants en deuxième année d’études médicales, instituée pour la première fois pour l’année universitaire 1971-1972, constitue le principal levier d’action des pouvoirs publics sur l’offre de soins en France.
À défaut d’une évaluation fiable des besoins de santé tenant pleinement compte des perspectives démographiques et des besoins territoriaux, les pouvoirs publics ont longtemps échoué à gérer le numerus clausus de façon optimale. S’agissant des médecins, de 8 588 étudiants en 1972, son niveau a continûment décru pour atteindre son minimum en 1992-1993 au moment même où commençaient de se manifester la pénurie de praticiens et les fortes inégalités de leurs implantations sur le territoire, en particulier au détriment des zones rurales. Ce n’est toutefois qu’à partir de 2001, où il ne dépassait pas 4 100, qu’il s’est fortement redressé pour atteindre 7 400 en 2009 puis 7 646 en 2016.
Initialement déterminé en fonction des seules capacités hospitalières, le numerus clausus doit être fixé, depuis 1984 (57), pour chacune des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques où il est appliqué, au regard des besoins, notamment géographiques. L’article L. 631-1 du code de l’éducation dispose ainsi que le nombre d’étudiants autorisés à poursuivre des études dans chacune de ces filières à l’issue de la première année des études de santé est déterminé chaque année par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé en « tenant compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés ».
Ces objectifs ont exercé une réelle portée sur l’équilibre géographique des places disponibles, émancipant les affectations de la seule observation du nombre de bacheliers des académies et des aptitudes des universités à accueillir immédiatement les étudiants, qui privilégiaient les zones les mieux dotées. En témoigne par exemple l’observation des principales augmentations fixées en 2016 (+ 15 % à l’université de La Réunion, + 10 % à celles des Antilles-Guyane, de Clermont-Ferrand, de Grenoble ou de Limoges et + 9 % à Tours). Toutefois le poids des capacités de formation préexistantes demeure toujours très puissant tandis que l’évaluation et surtout la prévision des besoins de santé de la population dans chaque territoire apparaissent lacunaires.
● Pour franchir une nouvelle étape garantissant une meilleure adéquation entre les capacités de formation des professions de santé et les besoins de santé des territoires, l’alinéa 2 du présent article propose que le numerus clausus ne se borne non plus à « tenir compte » des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, mais soit « arrêté en fonction » de ces mêmes critères. Cette disposition renforce le caractère obligatoire de la prise en compte des besoins de santé dans la fixation du numerus clausus et réaffirme, avec force contraignante, la nécessité que sa fixation et sa répartition contribuent pleinement à la résorption des inégalités en matière d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
En parallèle, le même article L. 631-1 du code de l’éducation offre aux universités la faculté de répartir le nombre d’étudiants admis entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d’organisation et d’amélioration de la pédagogie. La seule contrainte aujourd’hui prévue par la loi est qu’un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre « de façon à garantir l’égalité des chances des candidats ».
Compte tenu du net accroissement du périmètre des universités dans le cadre des regroupements encouragés par la puissance publique, il est nécessaire que cette répartition n’aboutisse pas à délaisser des zones géographiques déjà dépourvues de couverture médicale satisfaisante. C’est pourquoi l’alinéa 3 du présent article vise à ce que l’arrêté déterminant ces critères de répartition prenne aussi en compte l’objectif d’un « accès aux soins équitable sur l’ensemble du territoire ». Les éléments relatifs à la formation ne peuvent en effet constituer à eux seuls des critères pertinents de répartition sans prendre en compte la nécessité d’apporter une réponse concrète aux inégalités territoriales d’accès aux soins.
*
La commission se saisit de l’amendement AS1 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain a souhaité déposer des amendements de suppression à chaque article de la proposition de loi de M. Vigier.
En l’occurrence, chacun a bien compris l’intérêt d’un relèvement progressif du numerus clausus au profit des zones sous-denses, mais ce relèvement est déjà à l’œuvre. Nous avons rappelé les chiffres : d’environ 9 000 étudiants autorisés à poursuivre leurs études de médecine en deuxième année en 1971, nous sommes descendus à 3 500 en 1990, puis nous sommes à peu près revenus à l’étiage initial. La réalité, c’est que, selon les études de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), nous ne retrouverons qu’à l’horizon 2030 l’équilibre auquel nous aspirons, en termes de présence des médecins sur nos territoires.
Le numerus clausus a été instauré pour limiter, encadrer le nombre de professionnels formés. La limite est la capacité de formation. Vous ne pouvez pas augmenter demain matin, de manière exponentielle, le nombre de places en deuxième année de médecine sans vous préoccuper de l’aval. Comment former ces jeunes admis qui en prennent pour dix ans ? Il faut que les filières en aient la capacité. Nous partageons votre volonté d’un relèvement ciblé, nous y sommes déjà. Nous ne pouvons aller plus loin sans nous poser la question de la formation, de la capacité de nos CHU à former l’ensemble des étudiants du premier cycle des études médicales.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement de suppression.
Vous parlez de 2030, monsieur Sebaoun, mais il y a urgence et, en médecine, le mot « urgence » veut dire quelque chose ! En 2025, dans de nombreux territoires, le nombre de généralistes aura diminué de 25 % ! Je ne peux cautionner cette aggravation.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 1er est supprimé.
*
* *
Article 2
(Art. L. 632-5 du code de l’éducation)
Stage pratique dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins
Le présent article a pour objet d’instaurer au cours de la troisième année du troisième cycle des études médicales des futurs généralistes une obligation d’effectuer un stage pratique d’au moins douze mois dans une maison de santé pluridisciplinaire ou dans un pôle ou un établissement de santé situés dans une zone qui enregistre un déficit en matière d’offre de soins.
1. Une organisation des stages dans les études de médecine aujourd’hui insatisfaisante à deux égards
D’abord, les étudiants ont trop peu de contact de terrain avec la spécialité de médecine générale en médecine ambulatoire alors même qu’un étudiant sur deux environ est appelé à exercer cette activité.
Après deux années de premiers cycles consacrées à l’enseignement des matières théoriques fondamentales, le deuxième cycle de quatre années, en alternance, est concentré sur l’activité hospitalière, avec 36 mois de stage, organisés, dans la plupart des cas, en douze stages de trois mois, en tant qu’étudiant hospitalier (ancien « externe »). Un arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales a toutefois opportunément institué un stage d’initiation de huit semaines à la médecine générale au sein d’un cabinet, ouvert à tous les étudiants au cours de ce cycle.
Après avoir validé leur deuxième cycle des études médicales, tous les étudiants se présentent aux épreuves classantes nationales (ECN) pour obtenir leur affectation en qualité d’interne dans une des disciplines existantes. Au cours de ce troisième cycle de trois à cinq ans selon les spécialités qui constitue « l’internat », les futurs généralistes en formation de la spécialité de médecine générale n’ont qu’un semestre obligatoire dans le cadre de la médecine ambulatoire auprès d’un médecin généraliste agréé « maître de stage », contre deux stages de deux semestres dans des services hospitaliers dans un service d’adultes et dans un service d’urgence et un stage dans un service de pédiatrie ou de gynécologie.
En fin de troisième cycle, pour leur dernière année d’internat, les étudiants peuvent également effectuer un stage facultatif en situation de responsabilité professionnelle dans un cabinet de médecine générale : le stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé (SASPAS). À défaut, cette année est effectuée en établissement hospitalier (stage « libre ») ou dans une structure médicale agréée par le responsable du département universitaire de médecine générale. Or, là encore, la proportion d’internes en médecine générale choisissant un stage en responsabilité dans un cabinet ne dépasse pas le tiers des effectifs.
De surcroît, ces stages, trop rares, négligent dans les faits l’exercice médical dans les zones de faible densité médicale, se concentrant dans les centres hospitaliers universitaires et, lors des expériences de médecine ambulatoire, dans les principales villes étudiantes.
Ces deux traits caractéristiques – peu de contact avec la médecine ambulatoire et peu de présence dans de vastes zones du territoire dans lesquelles le besoin en médecins est criant – ne fournissent aucun encouragement à ce que les futurs médecins choisissent des lieux d’implantation qu’ils n’ont pas appris à connaître au cours de leurs études. Le fait d’avoir vécu précédemment en milieu rural, et plus particulièrement d’y avoir réalisé un stage, est l’un des facteurs les plus déterminants pour attirer des professionnels dans les zones rurales isolées.
On remarquera aussi que le développement des stages en zones rurales achoppe souvent sur la question des distances de transport ou sur celle du logement. De nombreuses collectivités territoriales proposent certes des allocations de transport ou de logement aux étudiants en médecine désireux de faire un stage sur leur territoire et de plus en plus de maisons de santé pluridisciplinaire (MSP) s’équipent en logements pour l’accueil des stagiaires, mais le rapporteur estime que ces initiatives mériteraient d’être plus systématiquement encouragées, par exemple en conditionnant la labellisation et le financement des MSP à la présence de logements d’accueil dans les zones mal datées en soins.
2. L’instauration d’un stage obligatoire en zone sous-dotée
Le présent article vise à compléter l’article L. 632-5 du code de l’éducation, qui décrit le contenu du troisième cycle des études médicales, afin d’imposer au cours de la troisième année de ce dernier cycle la réalisation d’un stage pratique obligatoire d’au moins douze mois dans une zone enregistrant un déficit en matière d’offre de soins.
Les structures susceptibles d’accueillir les stagiaires intégreraient utilement les maisons de santé pluridisciplinaires, définies à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, qui regroupent des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens, assurant des activités de soins sans hébergement de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pouvant participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Elles regroupent ainsi sous un même toit plusieurs professionnels de santé pour éviter un exercice isolé et constituent donc une solution très adaptée au manque d’attractivité des zones les plus fragiles où elles se concentrent. Elles correspondent en outre à une modalité d’exercice particulièrement prisée des jeunes médecins généralistes qui déclarent de plus en plus ne pas souhaiter l’exercice isolé, notamment par rejet de l’isolement intellectuel ou par volonté de partager un plateau administratif.
De même, seraient concernés les pôles de santé qui regroupent, aux termes de l’article L. 6323-4 du code de la santé publique, des professionnels de santé mais également, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale, qui peuvent chacun maintenir une activité individuelle mais coordonnée.
Enfin, compte-tenu du nombre encore modeste de maisons et pôles de santé installés dans les zones déficitaires en offre de soins, il apparaît nécessaire d’étendre le champ des organismes habilités à accueillir les stagiaires à l’ensemble des établissements de santé présents dans ces zones.
Le présent article propose de retenir à ce titre les zones « définies en application de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique ». Ce renvoi à l’article définissant le projet régional de santé peut se justifier compte tenu de l’inclusion dans ce projet de schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) qui déterminaient traditionnellement « les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé » dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cependant, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ayant modifié ces dispositions en confiant, dans un souci de meilleure adéquation aux besoins et de plus grande précision dans le zonage, au directeur général de l’agence régionale de santé, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés, la détermination des « zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins », la référence à l’article L. 1434-4, issu de la loi précitée, semble désormais plus pertinente.
*
La commission examine l’amendement AS2 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Vous proposez notamment, monsieur le rapporteur, que l’ensemble des étudiants en médecine effectuent un stage dans des maisons médicalisées ou, entre autres, dans des services hospitaliers de proximité, mais la réforme du troisième cycle, qui entrera en application dès la prochaine rentrée, prévoit déjà, pour l’internat de médecine générale, qu’au moins la moitié des stages sera effectuée en ambulatoire. Voilà qui répond à votre souhait.
Aujourd’hui, il n’y a pas assez de maîtres de stage en zones sous-denses. Les praticiens ont la tête sous l’eau, alors qu’il faudrait des maîtres de stage aguerris, formés, capables de recevoir ces jeunes internes. Les praticiens ne cessent de courir pour essayer de pallier les difficultés engendrées par le manque de médecins sur leur territoire – ce sera vraiment un fil rouge de mes interventions. Il faut construire avec des professionnels convaincus de ce qu’on leur propose et chaque fois se préoccuper de l’accueil de ces étudiants. Il faut des conditions pédagogiques adéquates. On ne peut pas simplement les envoyer en zones sous-denses, ce n’est pas ainsi que l’on forme des gens aguerris et capables de rester sur ces territoires.
M. le rapporteur. Naturellement, je m’oppose à cet amendement de suppression. Si ce que je demande est fait dans le cadre de la nouvelle réforme, pourquoi, cher collègue, ne pas adopter mon dispositif tout de suite ?
M. Gérard Sebaoun. La réforme est déjà faite !
M. le rapporteur. J’y vois seulement une volonté d’obstruction. Il est un peu dommage qu’on ne puisse demander à ces étudiants de sortir de leurs murs pendant un an en raison d’un nombre insuffisant de maîtres de stage, mais pourquoi donc ce nombre est-il insuffisant ? Il faut voir comme il est difficile de devenir maître de stage, et le problème va encore s’aggraver. Nombreuses seraient les formations que le numérique permettraient de suivre à distance. Quand on se trouve à 110 kilomètres de la faculté de médecine, à vingt heures, après avoir vu cinquante malades dans la journée, on ne repart pas à Tours, parce que le lendemain matin il faudra être au travail à sept heures et demie ! Il faut permettre une formation à distance.
Est-ce que des généralistes établis depuis vingt ou trente ans seraient capables de dispenser des formations ? J’ai la faiblesse de penser qu’ils ont quand même, après dix ans d’études, et dix, quinze ou vingt ans d’expérience, quelques qualités pour le faire. L’intérêt, surtout, c’est que ces jeunes internes découvriront une autre vision de la médecine – en exercice libéral ou non, en médecine générale ou dans d’autres spécialités.
Six mois, c’est trop court pour commencer à inscrire son parcours dans telle ou telle spécialité, à tel ou tel endroit. Au bout d’un an, la greffe prend. Il y a quarante ans, que faisaient les externes en médecine ? Ils étaient déjà envoyés dans les centres hospitaliers, dans les petites villes, c’est ainsi que la greffe prenait, et ils revenaient une fois qu’ils avaient leur diplôme. Les étudiants, les internes sont demandeurs. Je regrette que nous ne puissions pas aller au bout.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 2 est supprimé, et l’amendement AS16 tombe.
Mme la présidente Catherine Lemorton. En parlant des stages, nous pourrions aussi un jour nous pencher sur les auxiliaires médicaux. Nous sommes tous sollicités par les orthophonistes, les sages-femmes, absolument pas rémunérés pendant leurs études – on veille à ne surtout pas leur donner de stage de plus deux mois, cela contraindrait l’organisme d’accueil à les rémunérer. Ces jeunes vont au fin fond du monde rural, très loin de leur ville universitaire, pour trouver, très difficilement des stages. Les orthophonistes viennent de se manifester, via un syndicat étudiant, mais la situation est la même pour tous les jeunes auxiliaires médicaux. Nous les avons d’ailleurs un peu oubliés, même si Chaynesse Khirouni, rapporteure de la proposition de loi sur le développement et l’encadrement des stages et l’amélioration du statut des stagiaires en a parlé. Ce problème du financement des stages paramédicaux subsiste, d’autant que ce sont des stages absolument obligatoires, qui conditionnent l’obtention du diplôme.
*
* *
Article 3
(Art. L. 632-2 et L. 632-6 du code de l’éducation)
Création d’un internat régional
Le présent article a pour objet de substituer un internat régional aux actuelles épreuves classantes nationales qui permettent aux étudiants qui ont validé leur deuxième cycle d’études médicales d’obtenir leur affectation en qualité d’interne.
1. Le dispositif actuel de classement national
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales, les étudiants en médecine doivent à l’issue du deuxième cycle se soumettre à des épreuves classantes nationales (ECN) qui conditionnent le passage en troisième cycle des études de médecine (TCEM) qui permet de se spécialiser.
En fonction de leur rang de classement aux épreuves et après validation de leur dernière année de deuxième cycle, les étudiants choisissent un poste d’interne en faisant un choix relatif à une spécialité ainsi qu’à une subdivision géographique, le lieu de formation, dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la Santé et de l’Enseignement supérieur. Depuis 2004, la médecine générale est mise sur le même plan que les autres spécialités, auparavant séparées entre résidanat et internat. On remarquera que les vingt-huit subdivisions territoriales existantes correspondent à une ou plusieurs unités de formation et de recherche composantes d’une université, certaines régions, telles la Bretagne, les Pays de la Loire, Provence–Alpes–Côte d’Azur et l’Auvergne-Rhône-Alpes comptant plusieurs subdivisions.
La répartition des internes fait l’objet d’une programmation pluriannuelle définie à l’article 43 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires précitée. Sur le fondement des propositions émises par l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS), un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine en effet, pour une période de cinq ans, le nombre d’internes à former par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
Ce mécanisme de régulation est insatisfaisant car il permet le maintien d’un nombre important de postes non affectés en médecine générale plus particulièrement dans certaines régions déjà sous-dotées en offre médicale.
En premier lieu, en effet, si le nombre de postes ouverts aux épreuves correspond aujourd’hui au nombre de candidats, tous les postes ne sont pas pourvus car certains étudiants préfèrent repasser plusieurs fois les épreuves s’ils ne sont pas satisfaits de leur classement. Il est vrai que le décret n° 2011-954 du 10 août 2011 a atténué ce phénomène en prévoyant que les validations du deuxième cycle sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des ECN, empêchant les étudiants insatisfaits de leur classement d’invalider les stages de la dernière année du deuxième cycle après les ECN pour redoubler et repasser les épreuves l’année suivante. Mais le décret a maintenu la possibilité, à titre dérogatoire et à la discrétion d’une commission, de repasser les ECN l’année suivante avec le statut d’auditeur, dans la limite de 8 % du nombre d’étudiants en 6e année inscrits dans la même unité de formation et de recherche et aux ECN ayant validé le deuxième cycle.
Ainsi au total, si le nombre de candidats classés mais non affectés est passé de 10 % en 2011 à 4 % en 2014, cette proportion se maintient à 6 % en médecine générale alors qu’elle est nulle dans l’immense majorité des autres spécialités. De surcroît on observe une « déperdition » des étudiants au cours du cursus que reflète l’existence d’un écart durable entre les postes ouverts à l’internat en médecine générale et le nombre de titulaires d’un DES de médecine générale recensés dans les données du tableau de l’Ordre des médecins trois ans plus tard. Ce différentiel pénalise tout particulièrement les régions les moins bien dotées en offre de soins
En second lieu, on observe une très nette propension des médecins à s’installer dans la région où ils ont fait leurs études, dans une proportion de 80 %, d’autant plus forte d’ailleurs qu’ils y effectuent l’intégralité de leur parcours. Dès lors, l’intérêt est évident de mieux s’assurer que les futurs médecins libéraux soient formés là où les besoins d’implantation sont les plus manifestes, en adaptant plus étroitement aux besoins la répartition régionale des étudiants en médecine.
2. Le dispositif proposé d’internat régional
Face à ce constat, le présent article vise à modifier le code de l’éducation afin de remplacer les actuelles épreuves classantes nationales par des épreuves classantes régionales aptes à pallier le phénomène de fuites en direction des régions les mieux dotées observé aujourd’hui. Cela permettrait de mieux sédentariser les internes dans leur région de formation et, ainsi, de mieux garantir que l’implantation des médecins généralistes visée au travers du numerus clausus puis de la répartition des postes en médecine générale dans le troisième cycle bénéficie réellement aux territoires confrontés à des besoins médicaux.
● À cet effet, le I du présent article modifie l’article L. 632-2 du code de l’éducation relatif au troisième cycle des études médicales en précisant que le troisième cycle des études médicales sera désormais ouvert, dans chaque région, à tous les étudiants ayant validé leur deuxième cycle dans la même région. Le 1° (alinéas 3 et 4) prévoit ainsi que les épreuves classantes ne seront donc plus organisées au niveau national mais au niveau régional et l’accès au troisième cycle sera réservé, dans chaque région, aux étudiants ayant validé leur deuxième cycle dans ladite région. Par coordination, le 5° (alinéa 9) remplace la mention au quatrième alinéa de l’article des « épreuves classantes nationales » par celle d’« épreuves classantes régionales ».
Ce dispositif cohérent serait assorti de deux dérogations évitant de porter une atteinte excessive à la liberté des étudiants en médecine en particulier au regard de leurs impératifs d’ordre privé ou familial ou de leurs projets professionnels qui peuvent porter sur domaines de compétence pointus pour lesquelles toutes les régions n’offriront pas nécessairement des postes. Le 3° (alinéa 7) autorise donc les étudiants à se présenter aux épreuves classantes régionales de deux régions, en plus de celle dans laquelle ils ont validé leur deuxième cycle. Le 4° permet au pouvoir réglementaire de prévoir, par arrêté, « les conditions dans lesquelles les étudiants admis en troisième cycle peuvent être autorisés à l’effectuer dans une région dans laquelle ils n’ont pas passé l’épreuve classante régionale ».
Le 2° modifie en conséquence le dispositif relatif à la programmation pluriannuelle des prévisions d’ouverture de postes afin de tirer les conséquences de la suppression des épreuves classantes nationales organisées sur le fondement de subdivisions territoriales qui ne correspondent pas toujours aux régions actuelles. La programmation quinquennale précitée devra donc fixer désormais par région le nombre d’internes à former par spécialité (alinéa 5). Par coordination, le 6° (alinéa 10) supprime l’obligation de déterminer par décret les contours des subdivisions territoriales qui n’existeraient plus.
En parallèle, le II du présent article modifie l’article L. 632-6 du code de l’éducation afin de régionaliser la procédure dans le cadre de laquelle les futurs médecins généralistes choisissent les zones où ils vont exercer lorsqu’ils ont signé un contrat d’engagement de service public.
On rappellera que ce contrat créé par la loi du 21 juillet 2009 précitée est destiné à fidéliser de jeunes médecins dans des spécialités et des lieux d’exercice fragiles où l’accès aux soins est menacé. Réservé aux étudiants en médecine, de la deuxième année des études médicales à la dernière année du troisième cycle des études médicales, il leur permet de bénéficier d’une allocation brute mensuelle de 1 200 euros jusqu’à la fin de leurs études en contrepartie d’un engagement à exercer leurs fonctions, à l’issue de leur formation, dans des zones où l’offre médicale est insuffisante. La durée de leur engagement est égale à celle de versement de l’allocation, avec un minimum de deux ans.
Alors qu’aujourd’hui le quatrième alinéa de l’article L. 632-6 prévoit que les internes ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent au cours de leur dernière année d’études leur futur lieu d’exercice sur une liste de lieux situés dans des zones où le schéma régional d’organisation des soins (SROS) indique que l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de l’accès aux soins menacée, il serait désormais clairement prévu que choix du lieu d’exercice ne pourra s’effectuer que parmi les zones sous dotées situées dans la région où les médecins ont été formés.
*
La commission en vient à l’amendement AS3 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Le rapporteur souhaite revenir, somme toute, à une forme d’internat régional, comme certains d’entre nous l’ont connu, avec la possibilité de se porter candidat dans plusieurs villes où se trouve une faculté de médecine. Je n’ai pas le sentiment que la fin de cet internat régional ait produit les effets qu’il a décrits.
Par ailleurs, il a dit que l’examen national classant était très inégalitaire. Mais, monsieur le rapporteur, à moins de vouloir supprimer tout ce qui ressemble à un concours, entre le premier, le vingtième, le trois-millième et le six-millième reçu, il y aura toujours une distinction : c’est le drame des concours !
C’était une grande idée issue de Mai 68 que celle de supprimer les concours, mais nous en sommes progressivement revenus. Aujourd’hui, une forme de sélection bien conduite est légitime. Je ne sais si la sélection est bien conduite en médecine, peut-être serions-nous d’accord pour contester ce fait, mais revenir à un internat régional, plutôt que de réfléchir à ce que sont nos territoires, au plus près du terrain, au niveau infrarégional, ne me paraît pas la bonne solution ; je crois que c’est M. Viala qui l’a dit le mieux. Au dernier examen national classant, ce sont 86 postes qui étaient proposés en médecine générale ; c’est extrêmement peu. Là encore, nous sommes confrontés à la réalité des formations et de leurs capacités.
Le principe de l’internat régional, c’était qu’un certain nombre d’internes pouvaient être accueillis dans les services des CHU. Aujourd’hui, avec l’examen national classant, un certain nombre d’étudiants sont supposés trouver la possibilité d’exercer en fonction de leur rang de classement, même si cela ne correspond pas forcément à leur premier choix. Je ne suis pas certain que nous y gagnerions en adoptant cet article.
M. le rapporteur. Sur ce point, nous ne sommes pas du tout du même avis, cher collègue. L’avantage d’un internat régional, c’est qu’il permet d’être au plus près des territoires – vous m’avez servi l’argument sur un plateau. Dans une région, quelles sont les besoins de l’année « n+1 », « n+2 », « n+3 » ?
Ensuite, 80 % des étudiants qui se forment dans une région s’y installent : c’est un fait. À partir de là, plus vous favorisez une réponse territoriale aux besoins territoriaux, plus vous encouragez, de façon assez simple et non autoritaire, l’installation dans la région – et je vous rappelle que je laisse ouverte la possibilité de dérogations. Cela correspond d’ailleurs aux préconisations du Conseil national de l’ordre.
Quant à l’examen national classant, pardonnez-moi, cher collègue, mais ce que vous dites n’est pas juste. Si vous voulez faire de la neurochirurgie et que vous n’êtes pas dans les 600 ou les 900 premiers, vous n’allez pas où vous voulez ! Certains étudiants, on l’a vu à Tours, préfèrent même redoubler et repasser le concours. S’ils peuvent passer le concours dans trois ou quatre régions, au moins pourront-ils vraiment choisir.
Mme Bérengère Poletti. Je soutiens complètement le rapporteur sur la question de la proximité et de l’internat régional.
Je regrette que le traitement réservé à ce texte par la majorité, qui demande la suppression pure et simple de tous les articles les uns après les autres. Il en est pourtant, parmi ceux qui votent en faveur de ces amendements de suppression, qui ont récemment voté l’amendement de Mme Le Houerou dont nous parlions.
Avançons ensemble, chers collègues, sans balayer d’un revers de main les dispositions proposées.
M. Gérard Sebaoun. Vous êtes trop au fait de ce sujet, monsieur le rapporteur, pour dire ce que vous avez dit sur l’internat régional. Il offrait effectivement la possibilité de se présenter dans trois régions, mais que se passait-il alors ? Êtes-vous certain que les gens du CHU de Saint-Étienne ou de Tours se présentaient à Saint-Étienne ou à Tours et y restaient ? Ce n’est pas mon souvenir. Il y avait des internats qui étaient « nobles », notamment celui de Paris, avec beaucoup de candidats. Les Parisiens y étaient les plus fréquemment admis, parce que les mieux préparés. L’étudiant parisien allait aussi se confronter aux concours d’Angers ou de Strasbourg, mais, par défaut, lorsqu’il n’était pas nommé à Paris du premier coup, il retentait sa chance l’année suivante. Après son troisième essai, il allait éventuellement à Strasbourg, voire s’y installait, mais si vous devenez urologue à Strasbourg, vous pouvez parfaitement vous installer à Châlons-en-Champagne ou à Marseille. Les étudiants en médecine sont attachés, pour des raisons familiales, personnelles, à la ville où ils sont formés, pas à celle où ils font leur internat ; les deux ne vont pas de pair, monsieur le rapporteur. Et ils veulent avoir le choix.
J’ai beaucoup évolué sur ce sujet, mais je ne suis pas du tout certain – je vous le dis très tranquillement, sans arrière-pensée, au-delà de la position de mon groupe, que je défends – que revenir à l’internat régional répondrait à votre souhait de voir plus de médecins s’installer dans nos zones sous-denses.
M. le rapporteur. Prenons le cas de quelqu’un qui grandit à Saint-Étienne. Il entame son cursus à Saint-Étienne. Très bien. Nous en conviendrons, 80 % de ceux qui faisaient leurs études secondaires et leur cursus de médecine à Saint-Étienne y restaient. Imaginez qu’en sixième année, à la suite de l’examen national classant, ils partent à Clermont-Ferrand, à Besançon, ailleurs. Est-ce là une liberté absolue ? Non. Ceux qui se formaient dans une région et voulaient y rester pouvaient le faire ; avec l’examen national classant, ils sont bien plus nombreux à être déracinés.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 3 est supprimé.
*
* *
Article 4
(Art. L. 1434-4 du code de la santé publique)
Abaissement des charges sociales pour les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de la retraite dans les zones sous-dotées
Le présent article a pour objet de prévoir un allègement des charges sociales pesant sur les médecins qui exercent au-delà de l’âge légal de départ en retraite dans les déserts médicaux.
Il modifie à cet effet l’article L. 1434-4 du code de la santé publique qui confie au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) le soin de déterminer par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés :
1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ;
2° Les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions conclues avec les organismes d’assurance maladie (et plus précisément l’Union nationale des caisses d’assurance maladie) ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement.
Le dernier alinéa de l’article L. 1434-4 précité prévoit que, dans ces zones sous-dotées et surdotées, sont mises en œuvre les diverses mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, et qui sont prévues par les codes de la santé publique, des impôts, de l’éducation ainsi que par le code général des collectivités territoriales ou encore par les conventions passées entre les professions de santé et les organismes d’assurance maladie.
Il s’agit de compléter cet alinéa par une phrase précisant que, dans les zones sous-dotées, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leurs charges sociales.
Alors que depuis la fin des années 1980, les médecins étaient incités à prendre une retraite anticipée via le mécanisme d’incitation à la cessation d’activité (MICA) qui visait à réduire l’offre de soins ambulatoires et à contribuer à maîtriser les dépenses d’assurance-maladie, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a au contraire encouragé les praticiens libéraux en âge légal de faire valoir leurs droits à cumuler leur retraite avec la poursuite d’une activité médicale. Si, initialement, le revenu net tiré de cette activité devait être inférieur au plafond de la Sécurité sociale, sous peine de voir le versement de la pension de retraite suspendu, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a libéralisé le dispositif en supprimant le plafond de ressources.
En 2015, sur 65 548 médecins retraités, 14 665 praticiens (tous modes d’exercice confondus) avaient choisi de poursuivre une activité professionnelle après avoir fait valoir leurs droits à la retraite. Ce sont donc un peu plus de 20 % des médecins retraités qui avaient choisi de poursuivre une activité tout en percevant leur pension. Parmi les 14 665 praticiens séduits par le cumul emploi retraite, les deux tiers (9 992 exactement) étaient des médecins libéraux (58).
Mais alors que le dispositif visait à pallier la baisse programmée de la démographie médicale, ces médecins exercent majoritairement dans des zones plutôt bien pourvues en offre de soins, notamment en Île-de-France (3 029) et dans la région de Marseille (1 331).
Afin de renouer avec l’objectif initial du dispositif de cumul emploi-retraite, qui était de lutter contre la désertification médicale, le présent article tend à l’orienter dans un sens plus favorable à une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire en l’assortissant d’une incitation, sous forme d’une diminution de cotisations sociales, lorsque ces médecins exercent leur activité dans les zones qui en ont le plus besoin.
Cet article, susceptible d’entraîner une perte de recettes pour les régimes sociaux, doit faire l’objet d’une compensation. L’article 15 de la présente proposition de loi prévoit à cet effet un mécanisme de compensation pour l’ensemble des créations de charges et des pertes de recettes susceptibles de résulter de son adoption, pour l’État comme pour les organismes de sécurité sociale.
*
La commission étudie l’amendement AS4 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Aujourd’hui, le nombre de médecins qui continuent à cumuler emploi et retraite augmente très significativement – je crois que nous en sommes à peu près à 15 000, c’est considérable. Au nom de quoi quelqu’un qui, dans les conditions actuelles, cumule emploi et retraite serait-il demain exonéré de cotisations sociales ou bénéficierait d’allégements ? C’est un vieux débat, que nous avons déjà eu. Je ne peux pas cautionner cet article.
M. le rapporteur. Ils sont près de 16 000 effectivement, et la Cour des comptes porte un jugement sévère sur cette situation, qui coûte de l’argent. Mais je pourrai aussi évoquer ce qu’elle dit sur la régulation de l’installation !
Au moins, une mesure courageuse avait été prise sous le quinquennat précédent, défendue par Xavier Bertrand. Heureusement que nous avons des médecins de soixante-dix ans qui continuent d’exercer ! Heureusement qu’il y en a quatre sur le territoire que je représente ! Et je vous rappelle que les ministres successifs, tant de gauche que de droite, les ont encouragés à cumuler. Remercions-les tous les jours de continuer à pratiquer la médecine. Sinon, nous ne ferions qu’aggraver la situation.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 4 est supprimé.
*
* *
Article 5
(Art. L. 632-2 du code de l’éducation ; art. L. 162-12-23 du code de la sécurité sociale)
Extension du statut de médecin collaborateur libéral aux internes de médecine générale
Le présent article a pour objet de permettre aux internes en médecine générale d’exercer en tant que médecin collaborateur avant qu’ils aient soutenu la thèse concluant leurs études.
L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis aux médecins de s’attacher le concours d’un médecin collaborateur libéral ou salarié.
Dans ce cadre, précisé par l’article R. 4127-87 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié, chacun des deux acteurs exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l’interdiction du compérage. Le médecin collaborateur libéral exerce auprès du médecin avec lequel il collabore. Ce n’est ni un remplaçant ni un associé, même si les plages d’activités de chacun ne sont pas entièrement superposables. Il exerce à titre libéral, sous son entière responsabilité, et doit souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Il relève à titre personnel de la convention médicale prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Il dispose en cohérence d’ordonnances et de feuilles de soins pré-identifiées à son nom.
Ce dispositif s’adresse de façon préférentielle, mais non exclusive, aux jeunes professionnels, afin qu’ils acquièrent une expérience pratique avant de s’installer. À cet effet, la qualité de médecin collaborateur est mentionnée sur sa plaque professionnelle. Le collaborateur est encadré et bénéficie donc d’un soutien, d’un accompagnement et, au besoin, d’une formation pratique de la part du médecin auquel il est rattaché. Via le lien de subordination qui encadre la relation du médecin salarié et du médecin employeur pour tout ce qui relève de l’organisation du travail et de la gestion du cabinet, le collaborateur salarié intervient pour le compte et au nom de son employeur.
Ce dispositif, qui gagnerait sans doute à être simplifié, permet aux médecins installés de se faire seconder de la manière la plus aisée possible. À ce titre, elle constitue une solution intéressante, et immédiatement mobilisable, à la pénurie liée à la démographie médicale, en permettant le maintien dans certains secteurs de médecins qui, sans l’aide et l’assistance de leur collaborateur, n’auraient d’autre choix que de se désengager.
Cependant, elle est limitée aux seuls internes ayant obtenu leur thèse, alors même que leurs confrères qui n’ont pas encore franchi cette étape finale des études ont étudié et pratiqué dans les mêmes conditions et disposent d’un socle de connaissances identique.
On remarquera à cet égard que, pour faire face à la pénurie de médecins du travail, l’article 36 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a emprunté une voie originale en complétant l’article L. 4623-1 du code du travail afin de permettre aux médecins non encore spécialistes en médecine du travail mais engagés dans une formation en vue de l’obtention de cette qualification auprès de l’ordre des médecins, d’exercer, sous l’autorité d’un médecin du travail d’un service de santé au travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail sous le statut de collaborateur médecin.
Dans une logique comparable, le présent article propose d’autoriser les internes de médecine générale à être collaborateur même en l’absence de thèse. Cette solution serait bien entendu limitée aux internes « en fin de cursus ». Elle serait en outre encadrée par la signature d’un contrat avec les agences régionales de santé prévoyant notamment des engagements individualisés relatifs au nombre de patients différents reçus en consultations, au respect des tarifs conventionnels et aux actions destinées à favoriser la continuité des soins. Les agences devraient ainsi fixer des objectifs en matière d’organisation des soins et pleinement solliciter la participation des collaborateurs aux missions de dépistage et de prévention, en évaluant la qualité de leur participation et, le cas échéant, en l’assortissant des légitimes contreparties financières.
*
La commission en vient à l’amendement AS5 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il s’agirait, par cet article, de permettre à des médecins qui n’ont pas encore soutenu leur thèse d’exercer, mais nous reconnaissons déjà la notion de remplaçant. Et, grâce aux dispositions du PLFSS pour 2017, un contrat de praticien territorial de remplacement pourra être proposé – vous vous en êtes félicité, monsieur le rapporteur. C’est effectivement une bonne initiative. En somme, ce que vous avez imaginé va être mis en œuvre avec le praticien remplaçant.
Il me semble néanmoins que ces praticiens en appui des médecins sont toujours des praticiens en formation tant qu’ils n’ont pas leur diplôme. Avant la fin de son internat, il faut en effet avoir soutenu sa thèse.
Je ne vois pas quel progrès cet article permettrait par rapport aux dispositions proposées par Mme la ministre dans le cadre du PLFSS.
M. le rapporteur. Je vois bien, cher collègue, que l’objectivité s’arrête lorsqu’un élu de l’opposition prend une initiative heureuse. Si la ministre en est là, c’est qu’à plusieurs reprises je l’ai rencontrée, que j’ai rencontré le président de la conférence des doyens, que j’ai rencontré les responsables des agences régionales de santé et que nous avons essayé, ensemble, de trouver une solution. J’ai d’ailleurs publiquement remercié la ministre de son écoute, et elle a évoqué la question dans son discours dans le cadre de la discussion générale du PLFSS pour l’année 2017.
Pourquoi donc ne pas donner force de loi à la proposition que je fais, plutôt que de nous en tenir à une circulaire ? Ce serait donner force de loi à quelque chose qui est aussi demandé par les internes : ils ne peuvent pas s’installer avant d’avoir soutenu leur thèse. Franchement, c’est un obstacle totalement artificiel. La thèse a son importance, mais je ne suis pas persuadé qu’elle fasse de vous un meilleur médecin du jour au lendemain ! Si vous rejetez ma proposition, cela signifie tout simplement que vous considérez que le Parlement n’a pas son mot à dire, même lorsqu’il ne fait que prendre de l’avance sur le Gouvernement et l’inciter à agir. Nous sommes certes coutumiers du fait, puisqu’hier après-midi nous avons débattu dans l’hémicycle sur un décret déjà signé par le Président de la République et le Premier ministre – le décret créant le fichier dit « TES », pour « titre électronique sécurisé » –, mais faisons œuvre collective ! Revalorisons le problème, et si vous voulez mettre votre nom à côté du mien, cher Gérard Sebaoun, signons le texte ensemble ! Mon problème est que cela marche.
Je connais trois jeunes médecins dans ce cas. Nous avons mis ce dispositif en place, nous les avons installés tous les trois dans des maisons de santé pluridisciplinaires en réseau avec d’autres et nous avons partiellement réduit la désertification médicale sur un bout de territoire. Je suis persuadé que cette expérience peut être transposée ailleurs. Il est important que cela passe par le Parlement car cette question traverse tous les groupes, toutes les sensibilités, depuis des années.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 5 est supprimé.
*
* *
Article 6
(Art. L. 4131-6 [nouveau] du code de la santé publique)
Obligation d’installation des nouveaux médecins dans les zones sous dotées
Le présent article prévoit qu’à partir de 2020, tous les médecins désireux d’exercer à titre libéral à l’issue de leur formation seront tenus de s’installer pour une durée minimale de trois ans dans une zone déficitaire en offre de soins.
À cet effet, il insère un nouvel article L. 4131-6-1 dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique – chapitre qui définit les conditions d’exercice des médecins.
Le premier alinéa de ce nouvel article L. 4131-6-1 instaure tout d’abord un système de déclaration d’intention d’activité par les jeunes médecins diplômés : ceux-ci disposeraient d’un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme de docteur en médecine pour déclarer à l’agence régionale de santé (ARS) de la région dans laquelle ils désirent s’installer leur intention d’exercer leurs fonctions à titre libéral – qu’il s’agisse d’un exercice exclusivement libéral ou d’un exercice mixte, c’est-à-dire à la fois libéral et salarié ou à la fois libéral et hospitalier.
À compter de 2020, et au sein de cette région, ils auraient l’obligation de s’installer, dans un premier temps, dans un territoire où le schéma régional de santé du projet régional de santé a identifié que les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours n’étaient pas satisfaits.
Cette notion de soins de premier recours est définie à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, qui dispose que « l’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé conformément au schéma régional de santé […]. Ces soins comprennent :
1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
3° L’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;
4° L’éducation pour la santé.
Les professionnels de santé, dont les médecins traitants […], ainsi que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux. »
L’obligation d’installation en zone déficitaire ne vaudrait toutefois que pour une durée minimale de trois ans : aussi l’« entorse » au principe de la liberté d’installation du médecin mentionnée à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale (59) n’est-elle que temporaire. Il s’agit de rechercher une conciliation entre les principes fondamentaux de l’exercice traditionnel de la médecine libérale, au nombre desquels compte la liberté d’installation, et le principe constitutionnel selon lequel « la Nation […] garantit à tous, […] la protection de la santé ».
Le rapporteur rappelle que plusieurs autres principes déontologiques fondamentaux de la profession de médecin, également mentionnés à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, ont déjà connu certains tempéraments. Ainsi, la liberté de choix du médecin par le patient a été encadrée par le dispositif du médecin traitant, la liberté de prescription du médecin n’a pas empêché les caisses d’assurance maladie de mener des actions de maîtrise médicalisée des dépenses de médicament tandis que le paiement direct des honoraires par le malade a été aménagé avec le recours au tiers-payant.
Par ailleurs, l’instauration d’une obligation temporaire d’installation dans une zone géographique dans laquelle le niveau de l’offre de soins médicaux est particulièrement faible peut également s’analyser comme la contrepartie de l’effort financier important réalisé par l’État pour former les médecins, une très faible partie étant à la charge de l’étudiant. En 2007, l’Académie nationale de médecine a ainsi fait remarquer que « la formation de chaque étudiant en médecine représente pour la société une charge financière importante (plus de 200 000 euros). À l’exemple de ce qui existe pour certaines des plus grandes écoles, il ne serait donc pas anormal que chaque jeune médecin doive consacrer quelques années de son début d’activité au service de la nation » (60).
Enfin, le choix de la date de 2020 pour la mise en œuvre de l’obligation d’installation s’explique par le souci de ne pas modifier les règles en vigueur pour les actuels étudiants en médecine, afin de ne pas introduire rétrospectivement un biais susceptible d’influer sur leur choix d’études et de carrière.
Le deuxième alinéa du nouvel article L. 4131-6-1 prévoit que cette obligation d’installation s’impose également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131-1-1 du même code.
Outre le diplôme français d’État de docteur en médecine, l’article L. 4131-1 précité vise les titres de formation permettant aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’exercer la profession de médecin en France.
Quant à l’article L. 4131-1-1 précité, il vise les autorisations individuelles d’exercer la profession de médecin qui peuvent être délivrées aux ressortissants de ces mêmes États en dépit du fait qu’ils ne répondent pas aux conditions prévues à l’article L. 4131-1.
Un décret en Conseil d’État précisera dans quelles conditions l’obligation d’installation s’appliquera à ces ressortissants, de manière à ce que le dispositif soit compatible avec le principe de libre installation des médecins au sein de l’Union européenne.
Afin d’assurer l’effectivité du dispositif, le dernier alinéa du nouvel article L. 4131-6-1 prévoit l’instauration d’une sanction en cas de non-respect de l’obligation d’installation. Cette sanction prendra la forme d’une pénalité financière acquittée par le médecin concerné. Le montant de celle-ci sera fixé par voie réglementaire et devra être suffisamment dissuasif pour garantir la mise en œuvre de l’obligation d’installation.
Le rapporteur tient à souligner que cette obligation d’installation ne présente pas seulement un intérêt ponctuel pour les trois années où elle s’impose, mais qu’elle peut être de nature à favoriser une installation pérenne de ces médecins dans les zones sous-dotées, car il est souvent constaté que la mobilité professionnelle postérieure à la première installation est faible.
*
La commission examine l’amendement AS6 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Je ne reviendrai pas, pour parler de cet article, sur l’atteinte à la liberté d’installation. Je souhaite que chacun comprenne qu’un interne, après de nombreuses années de formation, souvent comme salarié à l’hôpital, a indéniablement rendu service à la société, sachant ce qu’est sa charge de travail. Le Gouvernement a pris des mesures pour encadrer cette charge de travail, et je crois que les internes lui en sont reconnaissants. Les internes sont la cheville ouvrière de l’hôpital. Ils sont faiblement rémunérés, malgré les nombreuses gardes auxquelles ils sont astreints. Et vous voudriez qu’à la suite de ce long cursus, de cette implication jour et nuit, ils donnent en plus, de façon coercitive, trois années supplémentaires ? Ils sont vent debout contre cette mesure.
Mme Dominique Orliac. Comment pouvez-vous imaginer qu’un jeune médecin soit motivé à s’installer pendant trois ans dans une zone sous-dense, après le cursus qui vient d’être évoqué ? On parle beaucoup du burn-out des médecins ; si nous les démotivons dès le départ, ce ne pourra que s’avérer néfaste.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je rappelle que les internes sont rémunérés. En première année d’internat, ils perçoivent 16 605 euros de salaire brut annuel, en deuxième année 18 383 euros, ensuite 25 500 euros. Il ne faut pas laisser croire aux gens qui nous écoutent que l’État ne les rémunère pas ! Je ne connais aucun profil, à ce niveau d’études, qui soit autant rémunéré dans les facultés. En outre, les autres professionnels de santé, qui font aussi fonctionner les hôpitaux, sages-femmes en quatrième ou cinquième année, orthophonistes en quatrième ou cinquième année, rendent des services et ne sont pas rémunérés.
M. Gérard Sebaoun. Et c’est dommage ! Vous opposez les médecins aux autres, pas moi.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le système de santé fonctionne grâce à tous les professionnels de santé.
Mme Dominique Orliac. Il ne faut pas opposer les médecins aux autres professionnels. L’hôpital peut être heureux de disposer de personnes aussi motivées et qualifiées. Les internes sont en formation et apprennent, bien sûr, mais ils sont aussi la cheville ouvrière de l’hôpital, avec les autres professionnels de santé.
M. le rapporteur. Nul ne peut dire que les internes ne sont pas la cheville ouvrière des hôpitaux ; ils l’ont été, le sont et le seront. Mme la présidente a raison de rappeler qu’ils sont rémunérés, même s’ils ne le sont pas très bien, pour ce qu’ils font. À « Normale Sup », les étudiants sont payés près de 20 000 euros par an pendant quatre ans et doivent ensuite travailler dix années dans le secteur public. Le système est le même à Polytechnique. Une infirmière formée dans un CHU gratuitement doit de trois à cinq ans à l’État, en fonction des conventions passées.
Les zones sous-dotées, entendons-nous bien, c’est partout ! Sauf les pointes d’épingle que nous avons évoquées. Le choix est donc en réalité très large. En outre, les internes y gagneront très bien leur vie, une clientèle abondante leur est assurée. De même, une étude a été publiée sur le loyer des locaux dans les maisons de santé pluridisciplinaires : vous verrez qu’un jour les artisans et d’autres nous demanderont les mêmes facilités que pour les médecins aujourd’hui. Ce sont les collectivités qui payent les maisons de santé pluridisciplinaires.
Je peux comprendre que les internes trouvent que cela représente une contrainte, et je ne suis pas arc-bouté sur cette solution, mais la puissance publique finance déjà, à raison de 1 500 euros par mois, pendant trois ans, les études de certains internes en contrepartie d’une installation en zone sous-dotée ; cela existe à l’heure actuelle. Or vous ne dites rien là-dessus. Je vous parle d’égalité des chances : il y a des gens qui ne peuvent pas payer pour de telles études. Vous pratiquez une discrimination entre les uns et les autres.
Du reste, la mesure ne s’appliquerait qu’en 2020, ce qui nous laisserait du temps afin de voir s’il n’y a pas des dispositifs plus incitatifs permettant de conclure un véritable pacte avec les médecins.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Des indemnités sont également versées aux internes : une majoration de 1 004,61 euros pour ceux qui ne sont ni logés ni nourris, de 334,32 euros pour ceux qui sont nourris mais non logés, de 670,29 euros pour ceux qui logés mais non nourris – majorations qui s’ajoutent à la rémunération que j’ai indiquée. Ce sont des gens qui rendent des services, certes, mais qui sont toujours en formation.
Mme Dominique Orliac. Quand les étudiants s’inscrivent en première année de médecine, ils connaissent la règle. On ne peut pas décider un changement aussi fondamental en cours d’exercice. La règle doit être connue dès le départ.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 6 est supprimé.
*
* *
Article 7
(Art. L. 4131-6-2 [nouveau] et L. 4131-7 du code de la santé publique)
Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession de médecin
Le présent article a pour objet de remédier à l’hétérogénéité de l’offre de soins médicaux sur le territoire national en instaurant un dispositif d’autorisation d’installation pour l’exercice de la profession de médecin s’inspirant des mesures de régulation applicables aux officines de pharmacies dont la création, le transfert ou le regroupement sont réglementés depuis 1943 et soumis à autorisation en fonction d’un critère de densité de population et dont l’implantation peut faire l’objet de restrictions. Ce système de réglementation a permis au cours des dernières décennies de développer un maillage étroit de l’ensemble du territoire en officines de pharmacie.
Conditions d’ouverture d’une pharmacie
• Création, transfert ou regroupement
En application des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique, tout transfert, regroupement ou création de pharmacies est soumis à la délivrance d’une licence par l’agence régionale de santé (ARS).
L’ouverture d’une nouvelle pharmacie dépend du nombre d’habitants recensés dans la commune où elle va être située.
L’ouverture d’une pharmacie, par transfert ou création, est possible dans les communes qui comptent plus de 2 500 habitants (ou 3 500 en Guyane, en Moselle et en Alsace).
Ensuite, l’ouverture ou le transfert de nouvelles pharmacies sont autorisés par tranche de 4 500 habitants. Ainsi, une seconde pharmacie peut être implantée dans une commune qui compte plus de 7 000 habitants.
L’implantation d’une pharmacie dans une commune de moins de 2 500 habitants n’est pas autorisée sauf si la commune a précédemment disposé d’une pharmacie qui desservait plus de 2 500 habitants.
Le transfert d’une pharmacie dans une autre commune est possible seulement si la commune d’origine compte moins de 2 500 habitants, s’il n’y a qu’une seule pharmacie, ou un nombre d’habitants inférieur à 4 500 par pharmacie supplémentaire.
Si la condition de population est remplie pendant au moins deux ans et si aucun transfert ou regroupement de pharmacies n’a été autorisé pendant cette période, la création d’une nouvelle pharmacie peut être autorisée dans une commune dépourvue de pharmacie, dans les zones franches urbaines (ZFU), dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
À la demande de leurs titulaires, plusieurs pharmacies peuvent être regroupées en un lieu unique, que ce soit à l’emplacement de l’une d’elles ou un nouveau lieu situé dans la commune de l’une d’elles. En cas de regroupement dans un nouveau lieu, la nouvelle pharmacie ne peut ouvrir qu’après fermeture des pharmacies regroupées. Les licences libérées sont prises en compte dans la commune d’implantation pour vérifier la condition de population.
• Lieu d’implantation
Les pharmacies doivent être implantées dans un lieu en accès libre permanent permettant d’assurer un service de garde ou d’urgence.
La licence fixe l’emplacement de la pharmacie et l’ARS peut imposer :
– une distance minimale par rapport à la pharmacie la plus proche,
– le secteur de la commune où la pharmacie doit être située.
La pharmacie dont le transfert, le regroupement ou la création a été autorisé doit ouvrir au public dans l’année suivant la notification de l’arrêté de licence.
Afin d’encadrer l’installation des médecins, le I du présent article propose d’introduire dans le chapitre du code de la santé publique relatif à leurs conditions d’exercice un article L. 4131-6-2 [nouveau].
Le I de ce nouvel article L. 4131-6-2 pose le principe selon lequel les créations, transferts ou regroupements de cabinets de médecins conventionnés par l’assurance maladie seront désormais subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’ARS après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l’Ordre de médecins. Les conditions de délivrance de cette autorisation seront déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 4131-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article.
La délivrance ou non de l’autorisation se fera en fonction de l’appréciation de critères régionaux de démographie médicale : il est en effet précisé que les créations ou transferts de cabinets entraînant le dépassement, dans la région concernée, d’une densité maximale de médecins ne pourront pas être autorisés. Les critères de définition de cette densité maximale seront déterminés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 4131-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article. Il reviendra donc au pouvoir réglementaire de veiller à ce que ces critères permettent de prendre en compte les réalités locales : l’objectif n’est pas de déboucher sur une densité unique pour l’ensemble du territoire, mais de tenir compte des conditions réelles d’accès aux soins de premier recours.
Le II du nouvel article L. 4131-6-2 précise que, dans le cadre d’un transfert ou d’un regroupement interrégional de cabinets, l’autorisation susmentionnée est délivrée conjointement par les directeurs généraux des ARS territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État des départements concernés et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins.
Le III du nouvel article L. 4131-6-2 propose de donner au directeur général de l’ARS la possibilité, lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets médicaux, d’imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche. Il s’agit par là de faciliter l’accès aux soins qui, dans certaines zones, ne saurait être garanti par le seul critère de densité médicale.
Le IV du nouvel article L. 4131-6-2 octroie au directeur général de l’ARS le pouvoir de prononcer le « déconventionnement » d’un médecin, en cas de création, transfert ou de regroupement de cabinet non autorisé.
Enfin, sur le modèle du dispositif applicable aux officines de pharmacie, le V du nouvel article L. 4131-6-2 propose d’instaurer une obligation d’exploitation effective du cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé par le directeur général de l’ARS, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. Là encore, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le déconventionnement du médecin concerné. Les situations de force majeure justifiant la non-application de l’obligation d’exploitation seront précisées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 4131-7, dans sa rédaction issue du présent article.
Le II du présent article tire les conséquences du dispositif prévu par le nouvel article L. 4131-6-2 du code de la santé publique en complétant l’article L. 4131-7 du même code qui, en l’état du droit, renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer certaines modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’exercice de la profession de médecins prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Sont ainsi insérés au sein de l’article L. 4131-7 cinq nouveaux alinéas permettant de fixer par décret en Conseil d’État :
– les conditions de délivrance de l’autorisation de création, de transfert ou de regroupement des cabinets médicaux ;
– les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, de transfert ou de regroupement des cabinets médicaux ;
– les modalités de contrôle du respect des obligations prévues au nouvel article L. 4131-6-2 – et notamment les cas de force majeure justifiant la non-application de l’obligation d’exploitation effective d’un an à compter de la notification de l’autorisation de création, de transfert ou de regroupement ;
– les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux ;
– les critères de définition de la densité maximale de médecins dont dépend l’octroi des autorisations de création, de transfert ou de regroupement des cabinets médicaux.
*
La commission examine l’amendement AS7 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il existe une vraie différence entre les professions qui ont conventionné et donc accepté une régulation, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et les médecins.
Je prends un exemple pour m’inscrire en faux contre l’amendement de Mme Le Houerou. Paris manque cruellement de médecins généralistes et regorge de spécialistes, dont les trois quarts exercent en secteur deux. Le fait d’empêcher, demain, un urologue de s’installer à Paris ne l’empêchera pas de se déconventionner, ce qui aura pour conséquence la présence d’un urologue supplémentaire à Paris, déconventionné, avec, pour le patient, des honoraires à payer en totalité, sauf à avoir souscrit une mutuelle qui les couvrirait. C’est entrer dans un cycle infernal. En soumettant le conventionnement à une autorisation administrative de l’agence régionale de santé (ARS) pour l’ensemble des professions de santé, je ne crois pas que vous répondiez au problème central de la désertification médicale. Là encore, les jeunes professionnels, médecins mais aussi infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes notamment, n’y sont pas favorables.
M. le rapporteur. J’ai cité tout à l’heure les écrits du Président de la République, je n’y reviens pas. Il faut une bonne régulation. Chez moi, je ne me pose même plus la question de savoir si les spécialistes sont conventionnés ou déconventionnés : il n’y a plus de spécialistes. Il faut attendre neuf mois pour obtenir un rendez-vous chez le dermatologue, un an pour un rendez-vous chez l’ophtalmologue… Des patients se rendent à Paris et vous imaginez le coût que cela représente.
En Normandie, des écoles d’infirmières ont été ouvertes à tout-va, et on est aujourd’hui obligé de fermer les écoles car 40 % des infirmières formées se retrouvent au chômage, faute de régulation.
S’il est permis de poser sa plaque de médecin selon son désir, ce n’est pas le cas des centres d’imagerie par résonance magnétique (IRM), que l’on ne trouve pas dans toutes les villes. Pourquoi cette approche à géométrie variable ? Ce n’est pas normal. Certains actes de gastroentérologie ne peuvent être réalisés dans un cabinet et doivent être pratiqués en milieu hospitalier, il faut donc que des anesthésistes soient disponibles. Tous ces exemples montrent qu’une régulation est nécessaire pour éviter la désorganisation.
M. Gérard Sebaoun. Je n’ai pas dit que je ne souhaitais pas de régulation. Dans le cadre conventionnel, des accords ont été conclus avec toutes les professions sauf les médecins. Si nous voulons changer cela, je suis convaincu que cela doit passer non par la loi, mais par la convention, comme pour toutes les autres professions de santé. La régulation ne s’applique pas aux médecins aujourd’hui car nous n’avons pas encore trouvé le mode de fonctionnement qui permette qu’elle soit acceptée par toutes les parties.
Mme Jacqueline Fraysse. Comme je l’ai dit, j’estime que la régulation est légitime et qu’elle est de notre responsabilité ; je n’y reviens pas. Je partage les remarques du rapporteur sur la liberté d’installation. Attention, toutefois, à l’excès de pouvoir laissé aux ARS ; j’ai connu dans ma circonscription des expériences extrêmement préoccupantes. Je regrette que le groupe socialiste repousse l’ensemble des articles de cette proposition de loi, qui auraient mérité une attitude plus nuancée et plus constructive. Ce rejet en bloc me déçoit.
Mme Chaynesse Khirouni. Cette proposition de loi et l’amendement de Mme Le Houerou confirment que les dispositions incitatives à l’installation des médecins sur le territoire n’ont répondu que partiellement au problème de la désertification médicale. Je comprends l’impatience des malades, des élus, des médecins confrontés dans leurs territoires à l’absence de réponse efficace. Même les maisons de santé connaissent leurs limites. Des médecins, travaillant près de cent heures par semaine, sont au bord du burn-out et ne trouvent personne pour les remplacer. Ils se retrouvent piégés car, par conscience professionnelle, engagement, militantisme, ils absorbent la demande, prennent en charge les malades au-delà de leurs limites, et leur vie personnelle et familiale s’en trouve mise à mal.
Je suis sensible à trois arguments. S’il est nécessaire de négocier un accord-cadre avec les médecins, je considère qu’ils ne peuvent plus poser comme postulat de base la non-régulation. Je pense en outre qu’il faut intégrer la problématique des zones sous-tendues à l’offre globale de soins et ne pas la limiter aux médecins généralistes. Enfin, je suis sensible à l’argument de Mme Fraysse sur la nécessité d’évaluer les dispositifs existants.
Si aucune réponse efficace n’est apportée pour répondre à la problématique des zones sous-tendues, c’est au législateur de prendre ses responsabilités, même si nous n’avons pas de certitudes en la matière mais seulement la conviction qu’il y a urgence.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 7 est supprimé.
La présidente Catherine Lemorton observe que les articles 8 à 11 proposent de décliner par professions le même dispositif que celui qui vient d’être supprimé.
*
* *
Article 8
(Art. L. 4141-5-2 [nouveau] et L. 4141-6 du code de la santé publique)
Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession
de chirurgien-dentiste
Le présent article a pour objet d’encadrer l’installation des chirurgiens-dentistes par un dispositif semblable à celui prévu par l’article 7 de la présente proposition de loi pour la création, le transfert ou le regroupement de cabinets médecins.
L’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes […] sont définis par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions ». Ce texte ajoute que ces conventions déterminent : « 8° les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ».
Sur le fondement de cette habilitation législative, l’avenant n° 2 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue en mai 2006 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et, d’autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire, a mis en place un dispositif d’incitation au conventionnement dans les zones « très sous-dotées », afin de contribuer au rééquilibrage de l’offre de soins en chirurgiens-dentistes libéraux.
Au travers du « contrat incitatif chirurgien-dentiste », les chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés bénéficient, depuis le 1er février 2013, d’une aide financière et d’une prise en charge de la totalité de leurs cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.
En effet, en cas de nouvelle installation en exercice libéral dans une zone « très sous-dotée », le « contrat incitatif chirurgien-dentiste » permet à un chirurgien-dentiste libéral de percevoir une aide forfaitaire, pour 5 ans, et de bénéficier pendant 3 ans d’une prise en charge de ses cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.
S’agissant des chirurgiens-dentistes libéraux qui, en 2013, étaient déjà installés dans une zone « très sous-dotée », le « contrat incitatif chirurgien-dentiste » leur permet de bénéficier d’une prise en charge de leurs cotisations sociales dues au titre des allocations familiales pendant 3 ans.
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a développé, en collaboration avec l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), un indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) permettant de dresser un état des lieux de l’accessibilité à l’offre libérale de soins de ville en chirurgiens-dentistes et en médecins généralistes, pour les quatre spécialités en accès direct (ophtalmologie, gynécologie, pédiatrie et psychiatrie) ainsi que pour quatre autres professions de santé (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et pharmaciens). Cet indicateur permet de synthétiser au niveau communal l’adéquation entre l’offre de soins locale (c’est-à-dire celle de la commune ainsi que celles des communes environnantes) et la demande de soins en tenant compte des besoins plus élevés pour les plus âgés.
Il ressort du « Portrait des professionnels de santé » que la DREES a publié en février dernier, que l’accessibilité aux chirurgiens-dentistes est un peu plus faible que l’accessibilité aux médecins généralistes, et que leur répartition est assez proche : ils sont concentrés dans les pôles de toutes tailles – à l’exception de l’unité urbaine de Paris, relativement peu dotée – et les communes isolées de l’influence des pôles sont mieux desservies que les couronnes rurales des pôles (61).
Si, au niveau national (hors Mayotte), le nombre d’équivalents temps plein (ETP) de chirurgiens-dentistes est de 48 pour 100 000 habitants, on constate une forte disparité entre :
– d’une part, un ensemble relativement bien doté comprenant les communes des grands pôles et les communes urbaines de leurs couronnes où le nombre d’ETP de chirurgiens-dentistes est respectivement de 61 et de 46 pour 100 000 habitants (ce nombre n’étant que de 49 pour 100 000 habitants dans l’unité urbaine de Paris) ainsi que les communes des moyens et petits pôles (où le nombre d’ETP est de 56 pour 100 000 habitants) ;
– d’autre part, un ensemble sous-doté formé des communes rurales des couronnes des grands pôles et des communes des couronnes des moyens et petits pôles (22 ETP pour 100 000 habitants) ainsi que des communes isolées hors de l’influence des pôles (28 ETP pour 100 000 habitants) (62).
Ce constat milite en faveur d’une régulation territoriale plus directive.
Le I du présent article vise en conséquence à insérer au sein du code de la santé publique un nouvel article L. 4141-5-2 qui reprend à l’identique, pour les chirurgiens-dentistes, le dispositif d’autorisation de création, de transfert et de regroupement de cabinets prévu pour les médecins à l’article 7 de la présente proposition de loi.
Le II du présent article modifie quant à lui la rédaction de l’article L. 4141-6 du même code afin de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application de ces dispositions, sur le modèle du II l’article 7 de la présente proposition de loi.
*
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement AS8 de M. Gérard Sebaoun.
En conséquence, l’article 8 est supprimé.
*
* *
Article 9
(Art. L. 4151-6-1 [nouveau] et L. 4151-10 du code de la santé publique)
Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession de sage-femme
Le présent article prévoit pour les sages-femmes le même dispositif d’autorisation d’installation que pour les médecins et les chirurgiens-dentistes (cf. supra le commentaire de l’article 7).
Un dispositif conventionnel de régulation de l’installation des sages-femmes exerçant en libéral a été mis en place, sur le fondement du 8° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.
Approuvé par arrêté du 12 mars 2012, l’avenant n° 1 à la convention nationale des sages-femmes conclue en octobre 2007 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et, d’autre part, l’Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises et l’Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, comprend six articles visant notamment à rééquilibrer l’offre de soins en sages-femmes libérales sur le territoire et à mettre en place une évaluation et un suivi de la profession des sages-femmes par un observatoire conventionnel national.
Quatre zones de population sont définies par l’accord : les zones « surdotées » et trois zones déficitaires en offre de soins maïeutiques :
– les zones « sans sage-femme » (à l’exception des zones ayant moins de 350 naissances domiciliées par an) ;
– les zones « très sous-dotées » ;
– et les zones « sous-dotées ».
Depuis le 15 septembre 2012, l’installation dans ces zones déficitaires est conditionnée. Dans les zones « sans sages-femmes », « très sous-dotées » et « sous-dotées » en sages-femmes libérales, des mesures destinées à favoriser l’installation et le maintien sont proposées à travers la création d’un « contrat incitatif sage-femme ». À adhésion individuelle, ce contrat permet à la sage-femme libérale conventionnée de percevoir une aide forfaitaire à l’équipement et de bénéficier d’une prise en charge de la totalité de ses cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.
Dans les zones « sur-dotées » en sages-femmes libérales, l’accès au conventionnement ne peut intervenir que si une sage-femme libérale conventionnée cesse définitivement son activité dans la zone ou la réduit d’au moins 50 % par rapport à son activité des deux années précédentes.
Toutefois, ce dispositif d’incitation et de régulation n’a que partiellement atteint ses objectifs : d’après le « Portrait des professionnels de santé » (63) que la DREES a publié en février dernier, les sages-femmes libérales sont d’autant plus accessibles que l’on se trouve proche d’un pôle et que le pôle est de taille importante (à l’exception toutefois de l’unité urbaine de Paris).
Si, au niveau national (hors Mayotte), le nombre d’équivalents temps plein (ETP) de sages-femmes est de 6 pour 100 000 habitants, on constate une certaine hétérogénéité entre :
– d’une part, un ensemble relativement bien doté comprenant les communes des grands pôles et les communes urbaines de leurs couronnes où le nombre d’ETP de sages-femmes est respectivement de 7 et de 5 pour 100 000 habitants (ce nombre n’étant que de 4 pour 100 000 habitants dans l’unité urbaine de Paris) ainsi que les communes des moyens et petits pôles (où le nombre d’ETP est de 5 pour 100 000 habitants) ;
– d’autre part, un ensemble sous-doté formé des communes rurales des couronnes des grands pôles et des communes des couronnes des moyens et petits pôles (4 ETP pour 100 000 habitants) ainsi que des communes isolées hors de l’influence des pôles (3 ETP pour 100 000 habitants) (64).
Sur la base de ces constats, le présent article vise à instaurer un dispositif d’autorisation d’installation des cabinets de maïeutique.
Le I du présent article introduit dans le code de la santé publique un nouvel article L. 4151-6-1 qui reprend pour les sages-femmes, le dispositif d’autorisation d’installation proposé à l’article 7 de la présente proposition de loi pour les médecins.
Quant au II du présent article, il modifie la rédaction de l’article L. 4151-10 afin qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de ce dispositif pour la profession de sage-femme.
*
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement AS9 de M. Gérard Sebaoun.
En conséquence, l’article 9 est supprimé.
*
* *
Article 10
(Art. L. 4311-11-1 [nouveau] et L. 4311-29 du code de la santé publique)
Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession d’infirmier
Le présent article transpose aux infirmiers libéraux le même dispositif d’autorisation d’installation que pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes (cf. supra le commentaire de l’article 7).
D’après le « Portrait des professionnels de santé » (65) que la DREES a publié en février dernier, les infirmiers libéraux sont très concentrés dans les grands pôles urbains : l’accessibilité y atteint 121 ETP pour 100 000 habitants, à l’exception de l’unité urbaine de Paris où l’on dénombre 53 ETP pour 100 000 habitants.
Les communes urbaines des couronnes de ces pôles ainsi que les communes des pôles de moindre taille ont également une accessibilité supérieure à la moyenne nationale de 100 ETP pour 100 000 habitants : celle-ci est respectivement de 112 et 110 ETP pour 100 000 habitants.
En revanche, les communes rurales des couronnes des grands pôles et les communes des couronnes des petits et moyens pôles sont nettement sous-dotées, avec respectivement 76 et 75 ETP pour 100 000 habitants.
Toutefois, la situation des communes isolées hors de l’influence des pôles est plus favorable : on y compte en moyenne 91 ETP pour 100 000 habitants. Mais il faut noter que les disparités au sein de cette catégorie sont très importantes. Les infirmiers sont en outre très concentrés dans certaines zones localisées, comme les littoraux breton et méditerranéen ou la Gironde.
La répartition géographique des infirmiers se caractérise donc par de grandes disparités démographiques en dépit de la mise en œuvre depuis 2008 d’un outil conventionnel de régulation.
En effet, sur le fondement du 3° de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux conclue avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie le 4 septembre 2008 a défini un dispositif de régulation de la démographie infirmière libérale. Ainsi depuis 2009, dans une zone sur-dotée, l’installation d’un nouvel infirmier exerçant à titre libéral n’est possible que si un infirmier cesse son activité définitivement dans la zone considérée.
L’avenant n° 3 à cette convention signé le 28 septembre 2011 a pérennisé ce dispositif et a introduit des cas permettant de déroger à ce conventionnement sélectif comme une situation médicale grave du conjoint, d’un enfant, ou d’un ascendant direct ou la mutation du conjoint dans le cadre de son travail.
Cet avenant, en créant un « contrat incitatif infirmier », vise à favoriser l’installation et le maintien des infirmiers libéraux conventionnés dans des zones très sous-dotées. En cas d’installation en exercice libéral dans une telle zone, le contrat permet aux infirmiers de percevoir une aide forfaitaire annuelle et de bénéficier d’une prise en charge de leurs cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.
L’assurance maladie s’engage notamment, à verser, au cours du premier trimestre de l’année suivant l’adhésion au contrat, une aide à l’équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule...) d’un montant maximum de 3 000 euros par an, pendant 3 ans.
En contrepartie, les infirmiers libéraux s’engagent à exercer les deux tiers de leur activité libérale conventionnelle dans la zone très sous-dotée, à respecter un taux de télétransmission d’au moins 80 % de leur activité, à réaliser les injections vaccinales contre la grippe dans le cadre des campagnes de l’assurance maladie et à assurer le suivi de leurs patients atteints de pathologies chroniques, notamment le suivi des patients insulino-dépendants.
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a indiqué, en juin 2014, que depuis 2012 le nombre d’infirmiers libéraux s’était accru de 198 dans les zones sous-dotées et avait baissé de 295 dans les zones sur-dotées.
Le rapporteur estime que, face aux disparités persistantes en termes de densité dans la profession infirmière, il faut aller plus loin et soumettre l’installation des infirmiers libéraux à une autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).
À cette fin, le I du présent article insère, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 4311-11-1 qui reprend, pour les infirmiers, le dispositif d’autorisation d’installation proposé pour les médecins à l’article 7 de la présente proposition de loi.
Quant au II du présent article, il modifie l’article L. 4311-29 du même code, afin de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les mesures d’application du dispositif.
*
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement AS10 de M. Gérard Sebaoun.
En conséquence, l’article 10 est supprimé.
*
* *
Article 11
(Art. L. 4321-11-1 [nouveau] et L. 4321-22 du code de la santé publique)
Autorisation d’installation pour l’exercice de la profession
de masseur-kinésithérapeute
Le présent article transpose aux masseurs-kinésithérapeutes le dispositif d’autorisation d’installation proposé pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers libéraux (cf. supra le commentaire de l’article 7).
La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue en avril 2007 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et, d’autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et l’Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, a fait l’objet d’un avenant n° 3, conclu le 30 novembre 2011, qui prévoit des mesures structurantes pour la profession, dans un objectif d’amélioration de l’accès aux soins de masso-kinésithérapie et d’efficience de la prise en charge.
Cet avenant a introduit des mesures en faveur d’un rééquilibrage de l’offre de soins des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones qualifiées de « très sous-dotées », de « sous-dotées » et de « sur-dotées ».
Dans les zones « très sous dotées » et « sous-dotées », déficitaires en offre de masso-kinésithérapie, un « contrat incitatif masseur-kinésithérapeute » destiné à favoriser l’installation et le maintien est proposé. Depuis le 15 juillet 2012, ce contrat individuel permet au masseur-kinésithérapeute installé dans l’une de ces zones de percevoir une aide forfaitaire annuelle à l’équipement et de bénéficier d’une prise en charge de la totalité de ses cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.
Dans les zones « surdotées », l’avenant n° 3 prévoyait que l’accès au conventionnement d’un masseur-kinésithérapeute ne pouvait intervenir que si un autre masseur-kinésithérapeute cessait son activité libérale dans la zone considérée. Toutefois, ces dispositions ont été annulées le 17 mars 2014 par le Conseil d’État qui a estimé que seule la loi pouvait autoriser un conventionnement sélectif et que, faute de fondement légal, les partenaires conventionnels n’avaient pas la compétence pour édicter un tel conventionnement (66).
Dans les zones qualifiées de « sur-dotées », les masseurs-kinésithérapeutes peuvent donc être conventionnés sans autre formalité particulière que celles prévues dans les autres zones du territoire.
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a cependant comblé la lacune juridique pointée par le Conseil d’État et complété le 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale.
Il n’en demeure pas moins que, d’après le « Portrait des professionnels de santé » que la DREES a publié en février dernier, les masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont, comme les médecins généralistes, très concentrés dans les grands pôles (98 ETP pour 100 000 habitants), à l’exception de l’unité urbaine de Paris (76 ETP pour 100 000 habitants).
Les autres espaces urbains (petits et moyens pôles, communes urbaines des couronnes des grands pôles) bénéficient d’une accessibilité de l’ordre de la moyenne nationale (environ 78 ETP pour 100 000 habitants).
En revanche, les communes rurales des couronnes des grands pôles et les communes isolées des pôles urbains sont peu dotées (respectivement 42 et 47 ETP pour 100 000 habitants). Quant aux communes des couronnes des petits et moyens pôles, elles sont les moins bien dotées, avec 37 ETP pour 100 000 habitants.
Le moins que l’on puisse dire est qu’il y a donc une marge de progrès en matière d’homogénéisation de la répartition géographique des masseurs-kinésithérapeutes.
C’est la raison pour laquelle le I du présent article introduit dans le code de la santé publique, au sein d’un nouvel article L. 4321-11-1, un dispositif identique à celui prévu pour les médecins à l’article 7 de la présente proposition de loi, de manière à encadrer l’installation en libéral des masseurs-kinésithérapeutes.
Pour sa part, le II du présent article modifie l’article L. 4321-22 du même code, qui, en l’état du droit, renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer certaines modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il s’agit de prévoir que ce décret devra en outre déterminer les modalités d’application du dispositif de régulation de l’installation des masseurs-kinésithérapeutes (conditions de délivrance de l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé, modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, modalités du contrôle des obligations, notamment d’exploitation d’effective, critères de définition de la densité maximale au regard de laquelle les créations et transferts de cabinets sont, ou non, autorisés).
*
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement AS11 de M. Gérard Sebaoun.
En conséquence, l’article 11 est supprimé.
*
* *
Article 12
(Art. L. 6316-1 du code de la santé publique)
Développement de la télémédecine
Le présent article vise à encourager le développement de la télémédecine.
Dans cette perspective, il complète l’article L. 6316-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et qui définit la télémédecine comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication [et qui] met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient ».
L’article L. 6316-1 précité ajoute que la télémédecine permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.
La télémédecine est en effet constituée par quatre types d’activités :
– la télé-consultation, qui est un acte médical à distance. Le patient dialogue avec le médecin par le biais d'un système de visioconférence ;
– la télé-expertise, qui est un échange entre deux ou plusieurs professionnels de santé arrêtant ensemble un diagnostic ou une thérapeutique sur la base de données biologiques, radiologiques ou cliniques échangées sur un dossier médical partagé par voie électronique ;
– la télé-surveillance, qui consiste en la transmission et l’interprétation par un médecin d’un indicateur clinique ou biologique recueilli par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
– la télé-assistance, lorsqu’un médecin assiste à distance l’un de ses confrères en train de réaliser l’acte médical ou chirurgical.
Enfin, l’article L. 6316-1 précité prévoit que la définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique.
Le présent article propose de compléter ce texte par un alinéa indiquant que les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé et les pôles de santé s’engagent à développer la télémédecine.
Le rapporteur estime en effet nécessaire d’encourager la télémédecine qui constitue un outil intéressant pour contribuer à réduire au maximum les inégalités d’accès aux soins, notamment pour les personnes habitant dans des territoires isolés (zones rurales, montagneuses, insulaires…).
La télémédecine apporte en outre une réponse organisationnelle et technique aux défis auxquels notre système de santé est aujourd’hui confronté (augmentation du nombre de maladies chroniques et des poly-pathologies liées au vieillissement de la population, inégale répartition des professionnels sur le territoire national, impératif de maîtrise des dépenses de santé).
Une stratégie nationale de déploiement de la télémédecine a été mise en œuvre dès la publication du décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. Ce projet est piloté par la direction générale de l’offre de soins (DGOS). Un comité de pilotage national a été mis en place afin de mieux coordonner les initiatives des nombreux acteurs intervenant sur le sujet. Ce comité est animé par la DGOS avec l’appui d’autres partenaires institutionnels tels que la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS), la Direction de la Sécurité sociale (DSS), la CNAM-TS, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), la Haute autorité de santé (HAS), la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR), la Direction générale des entreprises (DGE) et les représentants des usagers.
Le comité de pilotage national a identifié, en mars 2011, cinq chantiers prioritaires pour faciliter le déploiement de la télémédecine en France. Ces domaines d’application visent tous à améliorer l’accès aux soins et leur qualité, de même que la qualité de vie des malades ou la réponse à un problème de santé publique : permanence des soins en imagerie médicale, prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC), santé des personnes détenues, prise en charge d’une maladie chronique (insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque, diabète…), soins en structure médico-sociale ou en hospitalisation à domicile (HAD).
Un certain nombre d’outils participant de la mise en œuvre du plan national de déploiement de la télémédecine ont par ailleurs été progressivement mis à la disposition des acteurs.
Un guide d’aide à l’élaboration des programmes régionaux de télémédecine, élaboré par la DGOS, a été publié le 1er décembre 2012. L’objectif de ce guide est de fournir une aide méthodologique aux agences régionales de santé (ARS) dans l’élaboration de leur programme régional de télémédecine, qui doit constituer l’un des éléments de leur projet régional de santé (PRS).
Ont également été élaborés un guide méthodologique pour l’élaboration des contrats et des conventions en télémédecine ainsi qu’un document relatif à la responsabilité des acteurs impliqués dans la réalisation d’un acte de télémédecine.
Enfin, des recommandations ont été formulées pour le déploiement technique d’un projet de télémédecine.
De son côté, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a publié en février dernier un rapport intitulé « Télémédecine et autres prestations médicales électroniques » dans lequel il indique qu’au terme d’une consultation qu’il a conduite, 70 % des médecins interrogés jugent nécessaire d’intégrer le numérique dans l’organisation des soins sur les territoires.
Le CNOM recommande dans ce même rapport :
– de simplifier la réglementation de la télémédecine résultant du décret du 19 octobre 2010, pour qu’elle soit intégrée concrètement dans les parcours de soins des patients et les pratiques quotidiennes des médecins ;
– d’instaurer une régulation des offres numériques en santé, dans le respect de principes éthiques et déontologiques dans le champ sanitaire (67).
Le présent article propose donc de créer un engagement des différentes structures de santé (établissements, cabinets médicaux, maisons de santé et pôles de santé) au développement de la télémédecine.
*
La commission examine l’amendement AS12 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il s’agit d’un article visant à développer la télémédecine. Nous avons déjà progressé sur cette question avec les deux derniers PLFSS. En particulier, des expérimentations couronnées de succès ont été étendues dans le dernier texte. Les acteurs du champ sont réticents à une extension brutale et non contrôlée. En l’occurrence, l’article n’est qu’incitatif et n’apporte rien à l’existant. C’est pourquoi nous demandons sa suppression.
M. le rapporteur. Vous souhaitez supprimer même cet article ! La télémédecine est une avancée formidable et la représentation nationale s’honorerait de montrer qu’elle a son développement à cœur. On ne peut pas parler d’aménagement du territoire, de fibre optique, de résorption de la fracture numérique sans considérer en même temps que le numérique doit être au service de l’amélioration de la prise en charge des patients. On voit que le travail collaboratif, scandé sur les estrades, trouve ses limites dans la pratique, dès qu’il s’agit d’une proposition de loi.
M. Gérard Sebaoun. La télémédecine est en effet un outil très utile, mais voilà ce que vous écrivez : « Les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé et les pôles de santé s’engagent à développer en France la mise en place de la télémédecine telle que définie par le présent article. » Est-ce que cela change quoi que ce soit ? Les expériences de télémédecine, à l’initiative de professionnels, se développent et doivent être encadrées. La télémédecine ne remplace pas le contact avec le médecin ou le professionnel de santé. Je partage le vœu exprimé par l’article, mais il n’apporte rien.
Mme Dominique Orliac. Je pense que la télémédecine permettra de réelles avancées dans la prise en charge des patients, ne serait-ce que par l’échange d’images et de radiologies. Le contenu des métiers est aussi quelque chose qu’il faudrait prendre en compte. Dans le dernier PLFSS, nous avons par exemple permis aux pharmaciens de vacciner.
M. Gérard Bapt. Au sein du groupe d’étude « Santé numérique », nous avons beaucoup travaillé pour essayer d’accélérer le développement de la télémédecine : téléconsultation, téléexpertise, mais aussi téléobservance. Notamment dans les zones qui manquent de spécialistes, il est capital de la développer au plus vite. La télémédecine se passe déjà bien entre établissements de santé. La difficulté est entre cabinets médicaux libéraux car il se pose des problèmes de responsabilité, de partage d’honoraires, de sécurité des échanges par des messageries sécurisées qui n’existent pas encore. Quant à cet article, pure expression d’un vœu, c’est du verbiage législatif et il n’a pas sa place dans un texte de loi.
M. le rapporteur. J’appartiens au département de France qui a la plus faible densité médicale : une centaine de médecins généralistes pour 100 000 habitants. Nous avons donc pris conscience du sujet il y a longtemps. Nous avons engagé 140 millions d’euros sur le numérique, avec un objectif de 80 % de la population couverte par la fibre optique à domicile à la fin de 2016. Nous l’avons fait car nous connaissions l’impuissance du législateur, et c’était le seul moyen d’éviter que la fracture médicale s’aggrave au fil du temps.
L’ARS donne 50 000 euros aux maisons de santé pluridisciplinaires qui acceptent de se mettre en réseau avec d’autres. Je viens d’en mettre quatre en réseau. « Fibrer » une maison de santé coûte 200 000 euros, pour vingt professionnels. C’est très cher. Nous allons aussi établir une liaison avec le CHU de Tours : les images de neurologie pourront passer de l’IRM au généraliste et être transférées à Tours. C’est une avancée considérable. Il n’y a pas de médecins, laissez-nous au moins l’imagerie !
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 12 est supprimé.
*
* *
Article 13
(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)
Compétences du directeur général de l’agence régionale de la santé (ARS)
Le présent article vise à compléter l’article L. 1432-2 du code de la santé publique – qui définit les missions du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) – afin d’y insérer la mention des compétences nouvelles dévolues au directeur général de l’ARS, en application de la présente proposition de loi, en matière d’autorisation d’installation des professions visées aux articles 7 (médecins), 8 (chirurgiens-dentistes), 9 (sages-femmes), 10 (infirmiers libéraux) et 11 (masseurs-kinésithérapeutes).
En l’état du droit, le neuvième alinéa de l’article L. 1432-2 précité prévoit que le directeur général de l’ARS délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, à savoir celles concernant les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, à la création, à la conversion et au regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et à l’installation des équipements matériels lourds. En application de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, le directeur général de l’ARS délivre également une licence pour toute création d’une nouvelle officine de pharmacie, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines.
Il s’agirait de modifier la rédaction de ce neuvième alinéa de l’article L. 1432-2 pour prévoir qu’il reviendra également au directeur général de l’ARS de délivrer les autorisations d’installation mentionnées aux articles L. 4131-6-2 pour les médecins, L. 4141-5-2 pour les chirurgiens-dentistes, L. 4151-6-1 pour les sages-femmes, L. 4311-11-1 pour les infirmiers et L. 4321-11-1 pour les masseurs-kinésithérapeutes.
*
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement AS13 de M. Gérard Sebaoun.
En conséquence, l’article 13 est supprimé.
*
* *
Article 14
Évaluation du dispositif de régulation de l’accès aux soins
sur l’ensemble du territoire
Le présent article prévoit la mise en œuvre d’une évaluation des dispositions contenues dans la présente proposition de loi assortie, le cas échéant, de propositions d’adaptations.
En avril 2005, le rapport de la commission « démographie médicale » présenté par le professeur Yvon Berland, président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, soulignait à juste titre que les mesures de régulation visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire « ne garantissent pas l’efficacité escomptée a priori. Il serait particulièrement dangereux de s’en contenter sans évaluer leur performance. Il est donc essentiel de prévoir une évaluation régulière de leur diffusion, de leur application, de leur efficience » (68).
En conséquence, il proposait qu’une commission rassemblant tous les acteurs de l’offre de soins puisse se réunir pour établir au bout de quelques années un bilan de la situation démographique et des conséquences des mesures prises pour une meilleure répartition de l’offre de soins et proposer les mesures nécessaires à la correction des déséquilibres éventuels (69).
C’est l’objectif du I du présent article qui renvoie à un comité ad-hoc le soin de mener à bien l’évaluation des mesures contenues dans la présente proposition de loi. Ce comité rassemblerait les divers acteurs concernés par les problématiques d’accès aux soins, en l’occurrence :
– des députés et des sénateurs ;
– des représentants des collectivités territoriales ;
– des représentants des administrations compétentes de l’État ;
– des représentants des ordres des professions de santé concernées.
Ce comité aura la charge d’établir, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, un rapport destiné à la fois au Gouvernement et au Parlement évaluant la mise en œuvre de ses dispositions et proposant « les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires ».
Le II du présent article prévoit que les règles d’organisation et de fonctionnement du comité sont déterminées par décret en Conseil d’État.
*
La commission examine l’amendement AS14 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Cet article prévoit une évaluation de l’application de la loi en moins de deux ans, et j’imagine mal que ce soit possible. Comme Mme Fraysse, je pense que nous devrions évaluer les incitations existantes, dont nous n’avons pas une vision très claire.
M. le rapporteur. Francis Vercamer rappelle fréquemment, et à juste titre, son attachement à l’évaluation des politiques publiques. Quand on fait quelque chose de bien, il est bon de le savoir, tout autant que lorsqu’on s’est trompé.
Vous prétendez qu’il est impossible d’évaluer en moins de deux ans la mise en œuvre de la présente proposition de loi. Ne dites pas à un grand groupe industriel que vous avez besoin de deux ou trois ans pour réaliser l’audit d’une de ses entreprises pour savoir ce qu’il faut faire !
Par ailleurs, nous avons beaucoup de moyens d’investigation à notre disposition, beaucoup d’observatoires divers et variés, et beaucoup de structures qui fonctionnent et qui pourraient collecter utilement les éléments afin de procéder à une évaluation à partir d’éléments complémentaires. Il faut accepter l’évaluation de cette proposition de loi qui, je le répète, ne représente qu’un pas pour réduire cette fracture, car n’oubliez pas, mes chers collègues, que ce sujet nous revient en boomerang partout sur le territoire, et que c’est notre responsabilité de législateur qui est engagée.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 14 est supprimé.
*
* *
Le présent article prévoit un gage pour les éventuelles dépenses supplémentaires entraînées par la proposition de loi : outre que l’article 40 de la Constitution n’autorise pas les gages de charges, celui-ci s’avère inutile car la présente proposition de loi n’entraîne aucune dépense supplémentaire au-delà de simples charges de gestion.
En revanche, il convient de conserver un gage pour les pertes de recettes susceptibles de résulter, tant pour l’État que pour les organismes de sécurité sociale, des dispositions de la présente proposition de loi, et notamment de son article 4 qui prévoit un allègement des charges sociales au bénéfice des médecins qui exercent au-delà de l’âge légal de départ en retraite dans les déserts médicaux.
*
Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement AS15 de M. Gérard Sebaoun.
En conséquence, l’article 15 est supprimé.
*
* *
Mme la présidente Catherine Lemorton. L’ensemble des articles de la proposition de loi ayant été supprimés, il n’y a pas lieu de mettre celle-ci aux voix.
En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.
1 () Amendement n° 154. Adopté par la commission des Affaires sociales, cet amendement proposait de prévoir que, dans des zones sur-dotées définies par les agences régionales de santé (ARS), en concertation avec les syndicats médicaux, un nouveau médecin libéral ne pourrait s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesserait son activité.
Cet amendement a été rejeté en séance publique, au profit de l’adoption d’un amendement gouvernemental visant à inciter les jeunes médecins remplaçants à découvrir l’exercice libéral en zones sous-denses, afin d’améliorer la période de transition entre la fin des études médicales et l’installation.
Issu de cet amendement, l’article 43 bis du PLFSS pour 2017 donne donc compétence aux ARS pour coordonner, directement ou indirectement, les périodes de remplacement effectuées dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. En contrepartie d’un engagement à un niveau minimal d’activité dans les zones sous-denses, le médecin remplaçant bénéficierait du statut de praticien territorial médical de remplacement (PTMR). Il s’agit par là de favoriser la constitution d’équipes de médecins libéraux remplaçants qui viendront soutenir les médecins libéraux installés en zone sous-dense.
Le 25 octobre dernier, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Marisol Touraine, a expliqué, dans la discussion générale du PLFSS pour 2017, qu’il s’agissait de répondre à « une attente forte, exprimée par les jeunes professionnels eux-mêmes, à plusieurs reprises, depuis quelque temps : l’installation dans un territoire où l’on ne peut être remplacé, expliquent-ils, est une contrainte lourde car aucun d’entre eux n’assume de laisser ses patients sans recours lorsqu’il part en vacances ou tombe lui-même malade pendant longtemps ».
2 () Ce communiqué est consultable au lien suivant : https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1909
3 () Ce Livre Blanc est consultable au lien suivant :
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_livreblanc/2016-01/index.htm
4 () « Offre de soins : comment réduire la fracture territoriale ? », rapport d’information n° 14 (session ordinaire 2007-2008) présenté par le sénateur Jean-Marc Juilhard.
5 () Rapport d’information n° 1132 (XIIIe législature), présenté par le député Marc Bernier.
6 () Proposition de loi n° 3158 (XIIIe législature).
7 () Proposition de loi n° 3914 (XIIIe législature).
8 () Proposition de loi n° 284 (XIVe législature).
9 () Le Quotidien du Médecin du 16 décembre 2011, La lutte contre les déserts, thème de campagne.
10 () F. Hollande, « Le changement, c’est maintenant. Mes 60 engagements pour la France », 2012.
11 () Discours du Président de la République, 22 octobre 2012.
12 () Rapport d’information n° 335 (session ordinaire 2012-2013), présenté par le sénateur Hervé Maurey en conclusion des travaux du groupe de travail sur la présence médicale sur l’ensemble du territoire.
13 () En 1978, dans sa déclaration d’Alma-Ata, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini les « soins de santé primaires » comme « des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et une technologie pratiques, scientifiquement viables et socialement acceptables, rendus universellement accessibles aux individus et aux familles dans la communauté par leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à chaque stade de leur développement dans un esprit d’autoresponsabilité et d’autodétermination ».
14 () Le compte-rendu intégral de la première séance du 25 octobre 2016 est consultable au lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170024.asp#P878509
15 () CNOM, Livre Blanc « Pour l’avenir de la santé », janvier 2016, pp. 50 et s.
16 () Dans son discours prononcé lors de la « Fête de la rose » de Frangy-en-Bresse à l’été 2012, Mme Marisol Touraine a annoncé que « les études de médecine devront imposer des stages dans les déserts médicaux ».
17 () Diplôme d’études spécialisées.
18 () Discours du Président de la République, 22 octobre 2012.
19 () CNOM, Atlas de la démographie médicale en France, 2016, p. 4.
20 () La convention médicale entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie définit les honoraires pratiqués par les médecins libéraux et le niveau de remboursement qui est ensuite appliqué par la Sécurité sociale. Les tarifs pratiqués par les médecins et le montant qui sert de base de remboursement aux organismes d’assurance maladie varient en fonction de la discipline du médecin (généraliste ou spécialiste) et de son secteur d’activité (secteur 1 ou secteur 2). Lorsque le médecin a adhéré à une convention, il doit pratiquer les tarifs définis par l’organisme d’assurance-maladie. Il peut être classé par la Sécurité sociale dans l’un des deux secteurs : secteur 1 ou secteur 2.
Le secteur 1 regroupe les médecins qui appliquent le tarif conventionnel, c’est-à-dire le tarif fixé par la Sécurité sociale.
Le secteur 2, ou secteur conventionné à honoraires libres, regroupe les médecins qui sont autorisés à appliquer des honoraires libres (souvent d’anciens chefs de cliniques) et qui donc peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires « avec tact et mesure ». Ces dépassements ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. C’est alors la complémentaire santé qui, selon les garanties des contrats, pourra prendre en charge le dépassement.
Certains médecins peuvent également exercer sans convention médicale, dans le secteur 3. Dans ce cas, le médecin peut fixer librement ses honoraires et la Sécurité sociale ne rembourse l’assuré que sur la base d’un tarif d’autorité qui varie entre 0,49 euro et 0,61 euro.
21 () Rapport d’information n° 335 (session ordinaire 2012-2013), p. 25.
22 () D’après l’édition 2016 de l’Atlas de la démographie médicale en France publié par le CNOM, les médecins généralistes étaient, au 1er janvier dernier, à 54 % des hommes et à 46 % des femmes.
23 () Rapport d’information n° 335 (session ordinaire 2012-2013), p. 26.
24 () CNOM, Atlas de la démographie médicale en France, 2016, p. 4.
25 () Rapport précité, p. 19.
26 () Cette enquête est consultable au lien suivant : https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-acces-aux-soins-en-france-la-fracture-s-aggrave-n21799/
27 () Rapport précité, p. 22.
28 () Le numerus clausus dans l’admission aux études médicales françaises permet de fixer directement par arrêté ministériel le nombre d’étudiants pouvant être admis en deuxième année de médecine, d’odontologie, de pharmacie et de sages-femmes. De ce fait, il ne s’agit plus de passer un examen mais de réussir un concours pour accéder à un nombre restreint de places à pourvoir.
29 () Voir le lien suivant : https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-acces-aux-soins-en-france-la-fracture-s-aggrave-n21799/
30 () Depuis sa mise en place, le numerus clausus pour les pharmaciens et les quotas pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les sages-femmes ont connu une évolution parallèle à celui des médecins.
31 () CNOM, Livre Blanc « Pour l’avenir de la santé », janvier 2016, pp. 50 et s.
32 () Intervention dans la discussion générale du PLFSS pour 2017, première séance du mardi 25 octobre 2016.
33 () Rapport précité, p. 32.
34 () Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
35 () Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
36 () Voir le lien suivant : http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/pts/les-10-engagements-du-pacte-territoire-sante-2/article/engagement-2-faciliter-l-installation-des-jeunes-medecins-dans-les-territoires
37 () Le compte-rendu intégral de la première séance du 25 octobre 2016 est consultable au lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170024.asp#P878509
38 () Rapport d’information n° 335 précité, p. 39.
39 () L’article L. 1411-11 du code de la santé publique dispose que « l’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé conformément au schéma régional de santé […]. Ces soins comprennent :
1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;
3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;
4° L'éducation pour la santé. »
L’article L. 1411-12 du même code ajoute que les soins de deuxième recours correspondent à ceux qui ne sont pas par l’offre de premier recours.
40 () Rapport précité, p. 36.
41 () Le compte-rendu intégral de la première séance du 25 octobre 2016 est consultable au lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170024.asp#P878509
42 () Rapport précité, p. 38.
43 () Rapport précité, p. 34.
44 () Faute de fondement légal, le dispositif de régulation de l’installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones sur-dotées a été censuré par le Conseil d’État dans un arrêt du 17 mars 2014 (requête n° 357594).
45 () Le compte-rendu intégral de la première séance du 25 octobre 2016 est consultable au lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170024.asp#P878509
46 () Rapport sur la Sécurité sociale, septembre 2011, p. 170.
47 () Rapport de la Cour des comptes sur les lois de financement de la Sécurité sociale, septembre 2016, p. 584.
48 () Rapport précité, p. 46.
49 () Rapport d’information n° 14 (session ordinaire 2007-2008) présenté par le sénateur Jean-Marc Juilhard, p. 32.
50 () Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 2007, 191, n° 3, 641-652, séance du 27 mars 2007.
51 () Rapport précité, pp. 46 et s.
52 () Rapport précité, p. 52.
53 () Rapport précité, p. 53.
54 () Rapport d’information n° 1132 (XIIIe législature), présenté par le député Marc Bernier.
55 () Rapport n° 3245 (XIIIe législature), présenté, au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, sur la proposition de loi pour l’instauration d’un bouclier rural au service des territoires d’avenir, p. 32.
56 () Rapport précité, p. 64.
57 () Article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur.
58 () H. de Saint Roman, « Près de 15 000 médecins retraités actifs dont 10 000 libéraux ! Le phénomène du cumul emploi-retraite », Le Quotidien du médecin, 29 juin 2015.
59 () Cet article dispose que « dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin ».
60 () Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 2007, 191, n° 3, 641-652, séance du 27 mars 2007.
61 () DREES, Portrait des professionnels de santé, février 2016, p. 39.
62 () Ibidem, p. 42.
63 () Cf supra le commentaire de l’article 8.
64 () DREES, Portrait des professionnels de santé, février 2016, p. 42.
65 () Cf supra le commentaire de l’article 8.
66 () Conseil d’État, 17 mars 2014, requête n° 357594.
67 () CNOM, « Télémédecine et autres prestations médicales électroniques », février 2016, p. 4.
68 () Rapport de la commission Démographie médicale, présenté par le Professeur Yvon Berland, avril 2005, p. 57.
69 () Ibidem, p. 58.