![]()
N° 3611
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (N° 3596), relatif à l’interdiction de la peine de mort,
PAR M. Philippe HOUILLON,
Député.
——
A. LA PEINE DE MORT BANNIE PROGRESSIVEMENT DES LÉGISLATIONS NATIONALES 8
1. Le mouvement des Nations vers l’abolition de la peine de mort 8
a) Une majorité d’États abolitionnistes 8
b) Un obstacle emblématique : le maintien de la peine capitale aux États-Unis 10
2. Le cas français 14
B. LA PEINE DE MORT EN RECUL DANS L’ORDRE INTERNATIONAL 21
1. Les instruments européens 22
2. Les instruments universels 30
a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 30
b) Le deuxième protocole facultatif de 1989 visant à abolir la peine de mort 33
II. — LA CONSTITUTION À LA CONFLUENCE DE LA VOLONTÉ NATIONALE ET DE L’ORDRE INTERNATIONAL ABOLITIONNISTES 36
A. LA QUESTION DE LA COMPATIBILITÉ DE LA CONSTITUTION AVEC LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX D’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 36
1. La compatibilité des protocoles additionnels à la Convention européenne des droits de l’homme 37
2. L’incompatibilité du deuxième protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 41
B. LA CONSOLIDATION DU CHOIX ABOLITIONNISTE 45
1. Le dispositif proposé 45
2. L’examen en commission 50
TABLEAU COMPARATIF 55
ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE 57
ANNEXE II : LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE 75
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 81
La peine de mort est « peu répressive sous les divers rapports de la brièveté de sa durée, de la funeste philosophie des coupables, de la trempe des âmes des criminels pour lesquels elle est réservée », estime Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur dans le premier débat parlementaire sur l’abolition en 1791 (1) ; elle est le « signe spécial et éternel de la barbarie », déplore Victor Hugo en 1848 (2). En 1957, Albert Camus l’apparentera à « une mesure définitive, irréparable, qui fait injustice à l’homme tout entier puisqu’elle ne fait pas sa part à la misère de la condition commune » (3).
Dans notre pays, la peine capitale, qui porte dans son étymologie même la réalité du corps vivant du condamné coupé en deux, a été abolie dans toutes ses modalités et pour tous les crimes depuis plus de vingt-cinq ans ((4).
Après un quart de siècle, les débats se sont apaisés. Sans méconnaître le poids des pays qui pratiquent encore la peine de mort, il convient de souligner que le nombre d’États abolitionnistes est devenu majoritaire dans le monde. Les instruments internationaux qui fondent l’abolition sont devenus plus nombreux et plus exigeants, que l’on songe seulement au protocole n° 13 du 3 mai 2002 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite « Convention européenne des droits de l’homme », et relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Le temps est venu d’inscrire l’interdiction de toute peine capitale dans notre norme suprême, la Constitution du 4 octobre 1958.
Ce projet répond à une triple exigence morale, politique et juridique.
La première exigence est morale. Personne ne soutient plus que la peine de mort aurait une valeur morale. À l’inverse, son abolition, par l’hommage insigne qu’elle rend au droit à la vie, porte au plus haut point le refus d’une justice qui utiliserait les mêmes armes que ceux qu’elle condamne. Utiliser la peine de mort contre ceux qui tuent, c’est, pour une démocratie, faire siennes les valeurs de ces derniers. Comme l’a écrit Arthur Koestler, l’un des artisans de son abolition en Angleterre, « la peine de mort n’est pas seulement un problème de statistiques ou de moyens, mais de morale, et de sentiments. (…) L’échafaud n’est pas seulement une machine de mort, c’est aussi le plus vieux et le plus obscène symbole de cette tendance propre à l’espèce humaine, qui la conduit à vouloir sa propre destruction morale. » (5) À ce titre, l’abolition mérite d’être élevée au rang des valeurs constitutionnelles. Elle est de celles qui doivent transcender les clivages, surmonter les divisions, abolir les frontières entre ceux qui constituent la Nation et composent la société politique. Elle est une affaire de conscience nationale.
La deuxième exigence est politique. Sur le plan international, l’inscription de l’interdiction de toute peine capitale dans notre Constitution, par son caractère quasi irréversible (6), rapproche la France de toutes les Nations qui ont opté, à titre individuel et collectif, pour le rejet de l’exécution. De ce point de vue, le continent européen – à l’exception d’un seul pays (7) – est libéré du sang versé au nom de la justice d’État. Au plan national, l’inscription de l’abolition dans la Constitution rejette dans les oubliettes de l’histoire toute utilisation de la peine de mort à des fins – dont on sait combien elle est illusoire – de politique criminelle.
La France n’a pas besoin du simulacre de la peine capitale pour réprimer les crimes les plus odieux. Notre démocratie est suffisamment forte pour résister et sanctionner les actes les plus barbares et pour ne plus risquer, notamment, de transformer tout terroriste en martyr de sa cause perdue. Il faut mentionner, à l’appui de ce choix, les lignes directrices en matière de lutte contre le terrorisme, définies par le Groupe multidisciplinaire du Conseil de l’Europe sur l’action internationale contre le terrorisme, créé après les événements du 11 septembre 2001, lignes directrices qui furent adoptées par le comité des ministres du Conseil le 11 juillet 2002 et qui prévoient que l’extradition de toute personne accusée d’actes de terrorisme doit être refusée si elle encourt la peine de mort, à moins que l’État requis n’obtienne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera soit pas prononcée, soit pas exécutée. La politique efficace de lutte contre le terrorisme menée ces dernières années est là pour prouver que la peine capitale, même dans ce cas extrême, doit être refusée.
En tout état de cause, s’il a permis de sortir de la chaîne ininterrompue des vengeances privées, l’antique talion ne saurait, en aucun cas, être l’étalon de la justice dans une démocratie moderne.
La troisième exigence, enfin, est juridique. Pour participer pleinement au concert des Nations abolitionnistes, la France se doit de ratifier les instruments internationaux qui bannissent le recours à la peine de mort. C’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (8), la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (9) et, plus nettement encore, le protocole n° 6 à ladite Convention concernant l’abolition de la peine de mort du 28 avril 1983 (10).
Mais ces instruments comprenaient des réserves que ne contiennent pas les deux textes les plus récents signés en la matière : le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort et adopté à New York, le 15 décembre 1989, et le protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances et ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002. Si ce dernier ne pose pas de difficulté au regard de notre Constitution, en revanche, le premier nécessiterait, pour être ratifié, la modification de celle-ci (11).
C’est pourquoi, en réponse à ces impératives exigences, il est proposé, dans le présent projet de loi constitutionnelle, d’inscrire l’interdiction sans réserve de la peine de mort dans un nouvel article 66-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui disposera que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ».
Dans son allocution prononcée lors de la présentation des vœux au Conseil constitutionnel, le 3 janvier 2006, le Président de la République avait relevé, en évoquant le deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, que le Conseil constitutionnel avait « estimé que sa ratification exigerait une révision de la Constitution ». Il a « décidé d’engager ce processus. Une telle révision, en inscrivant solennellement dans notre Constitution que la peine de mort est abolie en toutes circonstances, consacrera l’engagement de la France. Elle témoignera avec force de notre attachement aux valeurs de la dignité humaine. »
Déjà, devant la Commission des droits de l’homme des Nations unies (12), à Genève, le 30 mars 2001, il constatait que « sur la peine de mort aussi, nous devons progresser. Plus de cent pays l’ont abolie, rejoints chaque année par trois ou quatre nouveaux États, à mesure que s’enracine la conviction qu’en aucun cas la mort ne peut constituer un acte de justice. En outre nulle justice n’est infaillible et chaque exécution peut tuer un innocent. Et que dire des exécutions de mineurs ou de personnes souffrant de déficience mentale ? » Il en a alors appelé « à l’abolition universelle de la peine de mort, dont la première étape serait un moratoire général ».
En renonçant sans condition à la peine capitale, la France cessera définitivement de la laisser au « vent de l’éventuel », pour reprendre l’expression d’André Breton, au gré des propositions d’affichage favorables à son retour et faites en méconnaissance des engagements internationaux de la France passés et à venir. La nature de l’abolition exclut tout marchandage, toute réserve.
Le refus d’une justice qui exécute constitue assurément un principe universel, à l’image des droits de l’homme. C’est la reconnaissance du premier d’entre eux, le droit à la vie.
En 1948, lors de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dix-neuf États étaient abolitionnistes. En 1981, la France était le trente-sixième État à abolir la peine de mort (13). Elle était alors le seul pays d’Europe occidentale à conserver une telle sanction dans son droit pénal.
Aujourd’hui, selon les données recensées par Amnesty International, plus de la moitié des États membres des Nations unies ont aboli la peine de mort en droit ou en fait, soit au total cent vingt-cinq membres, dont quatre-vingt-six États pour tous les crimes, dix États pour tous les crimes à l’exception des crimes exceptionnels, en particulier de ceux commis en temps de guerre, tandis que vingt-neuf États n’ont pratiqué aucune exécution depuis au moins dix ans. À l’inverse, soixante-sept États maintiennent et appliquent aujourd’hui ou ont pratiqué récemment la peine de mort (14).
Depuis 1976, ce sont soixante-quatorze États qui ont aboli la peine capitale, soit pour les crimes de droit commun, soit pour tous les crimes. En Europe, le Portugal le fit à la sortie de la dictature en 1976, suivi par le Danemark en 1978, le Luxembourg et la Norvège en 1979, la France en 1981, les Pays-Bas en 1982, Chypre en 1983, la République démocratique allemande (RDA) en 1987, la Roumanie et la Slovénie en 1989.
LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE | |||
Situation des pays |
États membres |
Pays non membres |
Total |
Total des pays abolitionnistes |
125 |
3 |
128 |
— Pays abolitionnistes pour tous les crimes |
86 |
2 |
88 |
— Pays abolitionnistes pour les crimes ordinaires |
10 |
1 |
11 |
— Pays abolitionnistes de fait |
29 |
0 |
29 |
Pays non abolitionnistes |
67 |
2 |
69 |
Total |
192 |
5 |
197 |
(1) Nioué, Saint-Siège, Îles Cook, Autorité palestinienne, Taïwan. | |||
Source : d’après Amnesty International et Organisation des Nations unies. | |||
Depuis 1990, ce sont plus de quarante pays et territoires qui ont rejoint le camp des abolitionnistes pour l’ensemble des crimes, dont la Côte-d’Ivoire, le Liberia, le Canada, le Mexique et le Paraguay, ou encore le Turkménistan et la Turquie. En Europe, l’abolition totale est acquise en 1990 en Andorre, en Croatie, en Hongrie, en Irlande et en Tchécoslovaquie. En 1992, c’est le tour de la Suisse, en 1994 de l’Italie, en 1995 de l’Espagne et en 1996 de la Belgique. Suivront la Pologne en 1997, la Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie et le Royaume-Uni en 1998, l’Ukraine en 1999, l’Albanie en 2000, la Bosnie-Herzégovine en 2001, Chypre et l’ex-Yougoslavie en 2002, la Grèce et la Turquie en 2004. Les Philippines, en juin 2006, sont le dernier État du monde à avoir, à ce jour, renoncé à la peine capitale (15).
Ainsi, à l’issue de ce processus, l’Europe est aujourd’hui, un continent libéré de la peine de mort, en droit ou en fait (16), à l’exception notable de la Biélorussie. L’histoire de l’abolition commence en Toscane, où le Grand-Duc Léopold décide, en 1786, de bannir de ses terres tortures et peine capitale. D’autres pays suivront cette voie. En Europe, la République de Saint-Marin abolit la peine de mort pour tous les crimes en 1865, après l’avoir abolie pour les crimes de droit commun en 1848 et n’avoir procédé à aucune exécution depuis 1468. La marche réelle du continent vers l’abolition a été entamée avant la seconde guerre mondiale et s’est accélérée une fois la déflagration passée.
Avant la guerre, réserve faite du Portugal, qui, sous l’empire d’un courant humanitaire d’inspiration française, avait été, en 1867, le premier grand pays européen à avoir aboli la peine de mort, seuls les pays du nord de l’Europe l’avaient, en fait ou en droit, supprimée. Immédiatement après la guerre, d’autres pays rejoignirent le camp des abolitionnistes de la peine de mort pour les crimes de droit commun, à l’exemple de l’Italie, de la République fédérale d’Allemagne, de l’Autriche ou de la Finlande. La renaissance des institutions démocratiques, en même temps que la liquidation par la défaite des tensions internationales extrêmes qu’ils avaient subies, coïncidait ainsi avec l’abolition. La Grande-Bretagne, par l’Homicide Act de 1957, a réduit considérablement la liste des crimes capitaux avant de supprimer complètement la peine capitale en 1965 pour tous les crimes de droit commun et de l’abolir définitivement pour tous les crimes non militaires en 1969.
En Afrique, vingt-deux États connaissent encore la peine de mort. En revanche, l’Afrique du Sud a marqué la fin de l’apartheid par l’interruption, en 1991, de toute exécution, puis par l’abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun en 1995 et pour tous les crimes en 1997. Le Sénégal l’a suivie en 2004, le Liberia en 2005.
En Asie, ce sont encore trente États qui exécutent, dont le Japon, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et les deux Corée, mais aussi la plupart des pays du Moyen-Orient jusqu’en Afghanistan. La Chine, sans qu’aucune donnée officielle ne soit disponible sur cette question, exécute sans doute plus d’un millier de condamnés à mort par an, ce qui la place en tête des pays pratiquant la peine de mort.
En Amérique, le Venezuela abolit la peine de mort dès 1863 pour tous les crimes. C’est le premier pays dans le monde à l’avoir fait. Il sera suivi par le Costa Rica en 1877, l’Équateur en 1906, l’Uruguay en 1907 et la Colombie en 1910. Plus récemment, le Canada, s’il avait aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun en 1976 après un moratoire ouvert en 1962, ne le fit pour l’ensemble des crimes qu’en 1998. Mais, aujourd’hui, ce sont encore quatorze États américains qui pratiquent la peine de mort, dont Cuba, une dizaine d’autres États des Caraïbes et, bien sûr, les États-Unis, dont le comportement à l’égard de la peine capitale marque, sans aucun doute, un signal pour nombre de pays.
La question de la peine de mort aux États-Unis constitue ainsi un enjeu majeur pour la cause abolitionniste et offre un alibi facile à tous ceux qui refusent de s’y rallier. Comment la plus ancienne et la plus puissante des démocraties modernes accepterait-elle une loi qui serait injuste ?
La situation y est paradoxale. Les États-Unis restent aujourd’hui, sans doute avec le Japon (17), le plus important régime démocratique à recourir à la peine capitale. Mais c’est aussi aux États-Unis que l’on rencontre les premières législations intégralement abolitionnistes. Le fondateur du New York Tribune, Horace Greeley, et la Société américaine pour l’abolition de la peine capitale, créée en 1845, lancèrent la première campagne dans les années 1840. La peine capitale est l’affaire des États. La Constitution fédérale leur laisse la maîtrise de la législation pénale. En 1846, le territoire du Michigan abolit la peine de mort, sous réserve des cas de trahison, pour lui substituer la prison à vie. Le Rhode Island est le premier à adopter, en 1852, l’abolition sans restriction, suivi dès 1853 par le Wisconsin. Aujourd’hui, douze États fédérés (18) sur cinquante seulement sont abolitionnistes en droit.
Sur cette base historique, les aléas de la conjoncture criminelle vont inciter les différents États à avoir un usage divers de la peine de mort. Elle sera parfois supprimée, puis rétablie, au moins pour certains crimes, ce qui nous enseigne qu’en la matière, rien n’est définitif. Par exemple, l’Iowa la supprimera en 1872 avant d’y recourir de nouveau à partir de 1878. Les mêmes fluctuations peuvent être observées au Colorado, au Kansas ou dans le Maine. De la même façon que le remplacement de tous les supplices par la seule guillotine a été considéré en France, à partir de 1791, comme un progrès de l’humanité, le remplacement de la pendaison par l’électrocution, adoptée à partir de 1880 à la suite d’une campagne organisée par l’entreprise General Electric, puis la diffusion, à partir de 1982, de l’injection de poisons, ont, pendant longtemps, suffi à répondre du caractère humain du châtiment.
En 1972, la Cour suprême déclara contraire à la Constitution la peine de mort, parce qu’elle constituait un châtiment inutile et dégradant dans les conditions où elle était prononcée et exécutée. À cette date, la pratique de la peine capitale était tombée quasiment en désuétude. Mais la hausse de la criminalité et une nouvelle rhétorique concentrée sur le thème de l’ordre conduisirent à des changements législatifs. La Cour suprême infléchit alors sa jurisprudence.
Condamnations et exécutions reprirent à partir de 1977. En 1988, le Congrès des États-Unis réinstaurait la peine de mort au niveau fédéral. Entre janvier 1977 et décembre 2006, dans l’ensemble des États-Unis, ce sont 1 057 personnes qui ont été exécutées, dont 888 par injection létale, 153 par électrocution et 11 dans une chambre à gaz. Les chiffres ont augmenté à partir de la fin des années 1990 : 23 exécutions en 1990, 14 en 1991, 31 en 1992, 38 en 1993, 31 en 1994, 56 en 1995, 45 en 1996, 74 en 1997, 68 en 1998, 98 en 1999, année d’un triste record, 85 en 2000, 66 en 2001, 71 en 2002, 65 en 2003, 59 en 2004, 60 en 2005 et encore 53 en 2006.
Sur la même période, le Texas a exécuté 379 personnes, la Virginie 98, l’Oklahoma 83, le Missouri et le Montana 66, la Floride 63. Tous pratiquement sont des États du Sud ou des États où le souvenir de la justice des pionniers n’est pas si lointain. Au niveau fédéral, 3 exécutions sont intervenues depuis 1988.
Cette recrudescence des exécutions ne doit cependant pas masquer certaines évolutions. L’erreur judiciaire mine le système de l’intérieur. On pourrait rappeler et transposer les propos de l’ancien premier président de la Cour de cassation française, Maurice Aydalot, qui affirmait qu’il « ne (peut) plus supporter cette loterie sanglante qui est l’exercice de la justice quand elle prononce la mort ». Selon une étude complète menée par des chercheurs de l’Université de Columbia sur les condamnations à mort prononcées en première instance entre 1977 et 1995, une très large majorité, plus des deux tiers, a été acquise au terme d’un procès irrégulier qui pouvait être sanctionné en appel, si un tel appel était formé (19).
Dans ce contexte, les juridictions fédérales et les cours suprêmes des États contrôlent de manière de plus en plus attentive les condamnations à mort prononcées par les juridictions de première instance. La Cour suprême des États-Unis elle-même s’attache à réduire progressivement le domaine de la peine de mort, notamment sur le fondement des traitements dégradants prohibés par le huitième amendement à la Constitution (20). Elle a ainsi interdit l’application de la peine de mort aux déments et aux débiles mentaux (21), de même qu’elle a refusé l’exécution des condamnés mineurs lors de l’accomplissement du crime (22).
Selon la même logique, les garanties procédurales ont été renforcées au profit de l’accusé. En 2002, la Cour suprême a réaffirmé que, lorsqu’un jury populaire est appelé à choisir entre condamnation à mort et prison à vie, il doit recevoir toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour le condamné de bénéficier éventuellement d’une liberté conditionnelle (23). En outre, seuls désormais les jurés, et non plus le juge qui dirige les débats, ont compétence pour prononcer la peine de mort après avoir rendu un premier verdict de culpabilité (24). La défense des accusés sans ressources est mieux assurée par des avocats commis d’office plus expérimentés (25).
Dans ce contexte, l’influence des erreurs judiciaires sur les responsables de chaque État n’est pas non plus négligeable. L’autorité qui décide en dernier ressort de l’exécution reste le gouverneur, qui dispose du droit de grâce et l’on sait, depuis Montesquieu, que les titulaires du droit de grâce « ont tant à gagner par la clémence, elle est suivie de tant d’amour, ils en tirent tant de gloire, que c’est presque toujours un bonheur pour eux d’avoir l’occasion de l’exercer » (26), mais aussi, selon les mouvements de l’opinion et l’actualité criminelle, de ne pas l’exercer.
Montesquieu releva aussi que porter le glaive et en user permet de faire respecter son autorité à bon compte. Mais, par exemple, en janvier 2003, le gouverneur de l’Illinois, après avoir fait libérer quatre condamnés à mort dont l’innocence avait été établie, décida une mesure de grâce collective sans précédent, commuant cent soixante-sept condamnations à mort en peines de prison à vie. Sur cette même base, la Caroline du Nord et le New Jersey décidèrent des moratoires.
Cependant, la structure fédérale multiplie les débats. Il y a autant de luttes à mener qu’il y a d’États. Au fur et à mesure que l’abolition de la peine de mort se diffuse en Europe et dans le monde, s’accroît la tension entre la sphère strictement pénale, réservée à la souveraineté nationale (27), et la scène internationale des droits de l’homme.
Ainsi, pendant que des voix s’élèvent régulièrement dans les enceintes internationales pour dénoncer, exécution après exécution, la pratique de certains États des États-Unis (28), le chef adjoint de la mission des États-Unis auprès du Conseil permanent de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne, réaffirmant le caractère national de cette question, pouvait déclarer, le 23 janvier 2003 : « Nous prenons note de la déclaration de l’Union européenne concernant la peine de mort aux États-Unis (…) (mais soutenons) que, dans une société démocratique, le système de la justice pénale, y compris les peines infligées pour les crimes les plus graves, devrait tenir compte de la volonté du peuple librement exprimée et être mis en œuvre comme il convient. Aux États-Unis, la décision d’avoir recours à la peine de mort est une décision qui appartient aux gouvernements élus démocratiquement au niveau fédéral et au niveau de chaque État. »
Cependant, un ancien secrétaire d’État américain à la démocratie et aux droits de l’homme pouvait, à l’inverse, estimer que la peine de mort était devenue le talon d’Achille de l’Amérique dans quasiment toutes les instances multilatérales traitant des droits de l’homme (29). Comme le souligne William A. Schabas, « étant donné le progrès énorme et rapide du développement des normes internationales touchant la peine capitale depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l’acceptation générale de l’abolition et sa transformation en une norme coutumière de droit international, peut-être même une norme de jus cogens, peuvent être envisagées dans un avenir pas trop éloigné » (30).
L’exemple français montre que, si le débat sur l’abolition est installé sur la scène politique dès la mise en place des institutions démocratiques, il peut rester indécis pendant très longtemps avant d’être tranché de manière définitive.
Il n’est pas nécessaire de refaire dans le détail l’histoire de la peine de mort en France pour constater que notre pays, sensibilisé très tôt, dès avant la Révolution, à cette question, ne s’en défit qu’avec difficulté et au prix de nombreux soubresauts, à tel point qu’au moment où il s’en libéra, il restait le seul pays d’Europe occidentale à conserver un tel châtiment dans ses codes et lois.
Sous l’Ancien Régime, la peine de mort s’appliquait selon des modes différenciés, en fonction du rang du condamné, tandis que le niveau de souffrance précédant la mort était lié à la nature du crime. La décapitation était réservée aux nobles, la pendaison aux voleurs, le bûcher aux hérétiques, l’écartèlement aux régicides.
Sous l’influence des écrits de Cesare Beccaria (31), qui considère que la peine de mort est illégitime dans son principe bien qu’elle puisse être utile dans certains cas, la question de l’exécution capitale devient un objet de débat. Dès le début de la Révolution, elle entre sur la scène politique.
Le premier acte a lieu en mai 1791, lorsque l’Assemblée nationale constituante est saisie d’un projet de loi visant à l’abolir, débat au cours duquel s’illustra, notamment, le rapporteur, Le Pelletier de Saint-Fargeau, mais aussi Robespierre qui, alors, assimilait peine capitale et « meurtre juridique », exécution judiciaire et « lâche assassinat ». Le rapporteur plaide pour l’abolition, au nom de l’inefficacité de la peine de mort. Prugnon, favorable au maintien de la peine capitale, estime celle-ci nécessaire pour deux motifs, l’exemplarité et l’inefficacité du cachot, tandis que Robespierre prêche l’abolition en voulant prouver que la peine de mort est essentiellement injuste ; qu’elle n’est pas la plus « réprimante » des peines et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévient ; la peine de mort de surcroît n’est pas nécessaire, et la meilleure preuve en est que certains peuples l’ont supprimée sans en éprouver de désagrément.
L’éloquence des « abolitionnistes » n’emporta pas la conviction de l’Assemblée qui se borna à rationaliser la peine capitale en réduisant le nombre de crimes punis de mort de cent quinze à trente-deux et en instaurant une mort égale pour tous par décapitation. En effet, si l’abolition n’est pas votée, en revanche, la loi du 6 octobre 1791 uniformise le mode d’exécution : « tout condamné à mort aura la tête tranchée ». À l’exception du peloton d’exécution réservée aux militaires pour les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions, la guillotine, adoptée par l’Assemblée législative, le 20 mars 1792 et qui sera utilisée pour la première fois à l’encontre d’un voleur de grand chemin, Nicolas-Jacques Pelletier, le 25 avril suivant, constituera dorénavant et jusqu’en 1981 l’instrument de la mort légale.
Cette uniformisation sera pendant longtemps perçue comme le signe d’une « humanisation » de la peine capitale. Auparavant, « quand l’énormité du forfait a exigé la vie du coupable, on ne pouvait, sans entrer dans la carrière des tortures, continuer l’échelle de gradation entre les faits et les peines » (32). Ainsi, au début du XIXe siècle, la peine de mort « réduite à la simple privation de la vie » apparaissait, par rapport aux mutilations et autres supplices pratiqués par la justice d’Ancien Régime, comme étant devenue effectivement un châtiment humain.
Plus tard, le décret du 25 novembre 1870, pris à l’initiative d’Isaac Crémieux alors ministre de la justice, conservera la guillotine, mais la fera descendre de son piédestal en supprimant l’échafaud. Victor Hugo écrivait : « L’échafaud, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. (…) L’échafaud n’est pas une charpente, l’échafaud n’est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d’être qui a je ne sais quelle sombre initiative ; on dirait que cette charpente voit, que cette machine entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l’âme, l’échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu’il fait. L’échafaud est le complice du bourreau ; il dévore ; il mange de la chair, il boit du sang. » (33) Le même décret uniformisera la charge de bourreau, cette fonction n’étant plus réservée qu’à un exécuteur en chef, assisté de cinq collaborateurs (34).
La guillotine survit néanmoins. Victor Hugo poursuit : « On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu’on n’a pas vu de ses yeux une guillotine ; mais si l’on en rencontre une, la secousse est violente, il faut se décider et prendre parti pour ou contre (…). La guillotine est la consécration de la loi ; elle se nomme vindicte ; elle n’est pas neutre, et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l’aperçoit frisonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d’interrogation. » (35)
Après celle de 1791, une deuxième tentative d’abolition sera engagée sous la Convention. Dans sa dernière séance, celle-ci est saisie d’un projet de décret portant à la fois amnistie et abolition immédiate de la peine de mort. Les défenseurs du régime refusent l’une et l’autre. Tout au plus accorde-t-on à Marie-Joseph Chénier, dont le frère André avait été guillotiné le 7 thermidor, que la peine capitale serait abolie « le jour de la signature de la paix générale », selon les termes du décret du 4 brumaire an IV (26 octobre 1795). La paix se faisant attendre, la peine de mort, sera rétablie, le 12 février 1810, inscrite dans le code pénal par Napoléon et étendue dans une large mesure, venant sanctionner aussi bien l’assassinat, le meurtre, que la désertion, l’incendie volontaire ou encore le faux monnayage.
La Révolution de 1830 voit renaître la controverse. De nombreuses propositions de loi abolitionnistes sont déposées, notamment par Victor Destutt de Tracy le 17 août 1830, suivie du vote par la Chambre des députés d’une Adresse au Roi demandant l’abolition. La modification du code pénal réalisée par la loi du 28 avril 1832 prévoit une abolition partielle grâce à la suppression de neuf cas passibles de la peine capitale et à la généralisation des circonstances atténuantes, réforme dont l’importance s’avéra fondamentale. De nouveaux débats ont lieu en 1838, marqués par les interventions de Lamartine, qui, le 17 mars 1848, plaide devant la Chambre des députés en faveur de l’abolition, en particulier dans le domaine politique (36) ; il affirme que la peine de mort est devenue nuisible dans une société évoluée : « L’abolition systématique de la peine de mort dans nos lois serait une intimidation et un exemple plus puissant contre le crime que des gouttes de sang répandues de temps en temps, si stérilement, vous en convenez vous-même, devant le peuple, comme pour lui en conserver le goût.
« Il y a une sanction matérielle, brutale, inflictive, sanglante, que vous appelez la loi du talion, qui punit l’homme dans sa chair, qui frappe parce qu’on a frappé, qui jette un cadavre sur un autre cadavre, qui lave le sang dans le sang. Cette sanction aboutit à la peine de mort ; que dis-je ? elle ne s’arrête pas là ; elle va jusqu’à ces supplices, jusqu’à ces tortures, jusqu’à ces morts multipliées par les mutilations qui font mourir cent fois le coupable ou le condamné, et qu’il faudrait regretter et rétablir si vous vouliez aller loyalement aux conséquences de vos principes d’intimidation par la mort. » (37)
La naissance de la Deuxième République fera de nouveau résonner les voix abolitionnistes. Le 15 septembre 1848, Victor Hugo soutient que « partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine ; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. » La Constitution du 4 novembre 1848, dans son article 5, se contentera d’abolir la peine de mort en matière politique. D’autres propositions abolitionnistes furent rejetées par l’Assemblée : celle de Savatier-Laroche en 1849 et celles de Schoelcher et Raspail en 1851. À la fin du Second Empire, Jules Simon, député républicain, dépose une proposition de loi en faveur de l’abolition. Il sera rejoint dans son combat, au début de la Troisième République, par Victor Schoelcher et quelques autres députés.
Le début du XXe siècle verra une nouvelle tentative, portée par Aristide Briand et soutenue par Jean Jaurès. Un premier feu est lancé lorsque la commission du budget de la Chambre des Députés supprime les crédits du bourreau dans le budget pour 1906. Un essai plus significatif sera tenté en 1908. Le 3 juillet, Aristide Briand, devenu garde des Sceaux, défend un projet de loi d’abolition de la peine de mort déposé en novembre 1906 par son prédécesseur, Edmond Guyot-Dessaigne. Mais, le 8 décembre 1908, le projet est rejeté par 330 voix contre et 201 voix pour. Entre-temps, se saisissant d’un fait divers particulièrement horrible dont l’auteur fut condamné et gracié par le Président de la République, Armand Fallières, partisan de l’abolition de la peine de mort (38), un journal, Le Petit Parisien, avait fait appel aux lecteurs, recueillant les signatures d’un million de personnes qui ont écrit pour dire « vive la guillotine ! ».
La dernière exécution publique, celle d’Eugène Weidmann, aura lieu, le 16 juin 1939, à Versailles. Suite à l’agitation qu’entraîna ce funeste spectacle, transformé en véritable kermesse, le 24 juin 1939, le Président du Conseil, Édouard Daladier, promulguera un décret-loi abolissant les exécutions capitales publiques.
Le 11 mars 1963, l’exécution du colonel Jean-Marie Bastien-Thiry, jugé responsable de l’attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle par la cour militaire de justice, fera de lui le dernier condamné à mort à être fusillé. Le 10 septembre 1977, Hamida Djandoubi, condamné à mort pour assassinat après tortures et viol, sera guillotiné. Il est le dernier condamné à avoir été exécuté en France.
Les affaires « Buffet et Bontems » (39), en 1972, puis l’affaire « Patrick Henry » en 1977 (40) replacent la question de la peine de mort au cœur du débat politique.
b) L’abolition
Au milieu des années 1970, le débat s’est ainsi cristallisé : d’un côté, l’inutilité de la peine de mort est établie et son application tend à disparaître, de l’autre, le législateur français ne se résout pas à l’abolir. De manière apparemment paradoxale, il enrichissait la liste des nouveaux cas de peine de mort et ce d’autant plus que le châtiment était moins pratiqué. L’exécution était quasiment tombée en désuétude. Il y avait cinquante exécutions annuelles sous la Restauration, vingt sous le Second Empire, dix sous la Troisième République, cinq sous la Quatrième République, une tous les deux ans dans les années précédant l’abolition.
Les exemples étrangers ont montré qu’au fur et à mesure où une société atteint un certain équilibre et échappe aux tensions extrêmes, la conscience collective se libère progressivement du carcan du mythe de l’utilité de la peine de mort.
Un tournant décisif fut pris lorsqu’en 1977, le comité d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance, créé par le Président Giscard d’Estaing, installé le 20 avril 1976 et présidé par Alain Peyrefitte, qui devint entre-temps garde des Sceaux le 30 mars 1977, recommanda l’abolition de la peine de mort. Ainsi, dans sa recommandation 103, il était proposé « l’abolition de la peine de mort et – dans le cas où le législateur prendrait une telle décision qui appartient à lui seul – son remplacement par une peine dite de sûreté (…). Pendant une longue durée (à fixer par le législateur) à compter de son prononcé, cette peine ne serait susceptible d’aucune modification, ni administrative, ni juridictionnelle. Le principe de l’abolition de la peine de mort a été adopté par le Comité à la suite d’un vote à bulletin secret, acquis par six voix contre trois et deux abstentions. » (41)
À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 1979, en octobre 1978, un groupe d’étude de l’Assemblée nationale, conduit par M. Pierre Bas, député de Paris, tenta, comme en 1905, de supprimer les crédits pour la rémunération du bourreau et le fonctionnement de la guillotine, soit un total de 185 000 francs. Les crédits de la justice firent l’objet d’un vote bloqué ; ni l’amendement de M. Bas, ni un amendement identique déposé par le Groupe Socialiste, ne furent retenus. Un schéma similaire se reproduisit au Sénat.
Puis, la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur le rapport de M. Philippe Séguin, adopta, le 15 juin 1979, une proposition de loi abolissant la peine de mort, mais celle-ci ne fut pas inscrite à l’ordre du jour.
En revanche, le 26 juin 1979, un débat sans vote était organisé à l’Assemblée nationale. Quatre mois plus tard, le 16 octobre 1979, c’est au Sénat qu’était engagé un « débat de réflexion et d’orientation » sur une déclaration du Gouvernement relative à l’échelle des peines criminelles. À cette occasion, le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, proposa que les deux cents crimes environ qui, alors, étaient passibles de la peine de mort soient répartis en trois catégories : dans une première, entreraient les crimes pour lesquels la peine de mort n’est plus ni requise ni prononcée, et pour lesquels elle serait désormais abolie ; dans une deuxième catégorie, se trouveraient certains crimes qui étaient encore effectivement punis de mort, comme l’assassinat ou l’empoisonnement et pour lesquels le Parlement pourrait se voir proposer de suspendre la peine de mort pour une durée probatoire de cinq ans ; la troisième catégorie regrouperait les crimes abominables, comme les meurtres d’enfants pris en otage ou les meurtres accompagnés de sévices et de tortures, ainsi que les crimes perpétrés par un prisonnier déjà condamné à la détention perpétuelle, autant de crimes qui seraient sanctionnés par la peine de mort, qui serait maintenue pour une durée de cinq ans. En contrepartie de la suspension de la peine de mort, aurait pu être adopté un allongement du délai de prescription de l’action publique.
Le 16 novembre 1979, lors de l’examen du budget de la justice pour 1980, des amendements supprimant les crédits du bourreau furent à nouveau déposés, émanant non seulement de M. Pierre Bas et du Groupe Socialiste, comme l’année précédente, mais également de M. Séguin ainsi que du Groupe Communiste. Au cours de ce débat, le garde des Sceaux annonça que, à la lumière des débats d’orientation, « le Gouvernement se prépare à déposer d’ici à la fin de la présente session un projet de loi sur la révision de l’échelle des peines ». À l’issue de ce débat, les amendements abolitionnistes furent repoussés par 272 voix contre 215.
Après une nouvelle tentative avortée pour abolir la peine de mort à l’occasion de l’examen de la loi « sécurité et liberté », la question de la suppression des crédits revint lors des débats sur les crédits de la justice pour 1981. Trois amendements tendant à la suppression des crédits relatifs aux exécutions capitales furent déposés, l’un par M. Pierre Bas, l’autre par le Groupe socialiste et le troisième par le Groupe Communiste. Seul M. Bas maintint son amendement, qui fut rejeté par 252 voix contre 203.
Lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 1981, François Mitterrand, le 16 mars 1981, se déclare favorable à l’abolition de la peine de mort, tandis que M. Jacques Chirac annonce, le 24 mars de la même année, qu’il voterait contre la peine de mort (42).
Le 25 mai 1981, le nouveau Président de la République gracie Philippe Maurice, qui sera le dernier condamné à mort gracié en France avant l’abolition. Le 18 juin 1981, le Parlement européen, réuni à Strasbourg, adopte plusieurs résolutions en faveur de l’abolition. Le 9 juillet, M. Robert Badinter, nouveau garde des Sceaux, annonce qu’il va proposer l’abolition de la peine de mort. Le 26 août de la même année, le Conseil des ministres approuve le projet de loi abolissant la peine de mort. Le 18 septembre, le projet de loi est adopté à l’Assemblée nationale par 369 voix pour et 116 contre. Le 30 septembre, le Sénat l’adopte avec 161 voix pour et 126 contre. Le 9 octobre, la loi est promulguée. La référence à la peine de mort est alors remplacée, dans tous les textes en vigueur, par une référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité, selon la nature du crime concerné. Les six condamnés à mort détenus à cette date dans les prisons françaises furent graciés et leur peine commuée en réclusion à perpétuité.
Depuis lors, hors les périodes de grandes tensions, liées par exemple à la survenance d’attentats ou de crimes sexuels contre des mineurs, le thème de la peine de mort a été progressivement réduit au sein du débat politique et public, même si l’on constate que, de 1981 à aujourd’hui, une trentaine propositions de loi visant à rétablir la peine de mort pour certains crimes ont été déposées au Parlement. Elles visent en particulier à sanctionner les auteurs d’actes de terrorisme et de crimes contre des enfants ou contre des agents de la force publique et des magistrats. L’adoption du présent projet de loi constitutionnelle rendra toute proposition de loi rétablissant la peine de mort irrecevable.
L’inutilité de la peine de la mort, comme le montre à l’envi l’exemple des États-Unis, a été largement admise. Elle n’est pas dissuasive et sa pratique est soumise aux hésitations d’un système judiciaire particulièrement inégalitaire, voire à des erreurs judiciaires patentes.
L’abolition est désormais bien acceptée, comme le montre l’évolution de l’opinion publique sur la question. S’il convient de prendre toutes les précautions d’usage pour interpréter les sondages relatifs à des questions aussi « éruptives » que la peine de mort, qui ne peut être considérée que dans son abstraction par les personnes auxquelles l’on pose la question de son rétablissement, il faut bien constater que, selon une enquête réalisée en novembre 2003, seulement 40 % des Français étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour rétablir la peine de mort. Ils étaient plus de 58 % à y être plutôt opposés ou tout à fait opposés (43).
C’est en 1985 que les « partisans » de la peine de mort ont été les plus nombreux, avec un taux de 65 %, soit une légère augmentation par rapport à l’année de l’abolition où ils étaient 62 %. En 1999, les courbes se sont croisées pour la première fois. À cette date, les opinions favorables à la peine de mort atteignaient 46 % des personnes interrogées, tandis que les opinions défavorables approchaient pour la première fois la barre symbolique des 50 % avec 48 % d’opinions défavorables. En septembre 2001, 49 % des Français se déclaraient opposés au rétablissement de la peine de mort tandis que 44 % y étaient favorables.
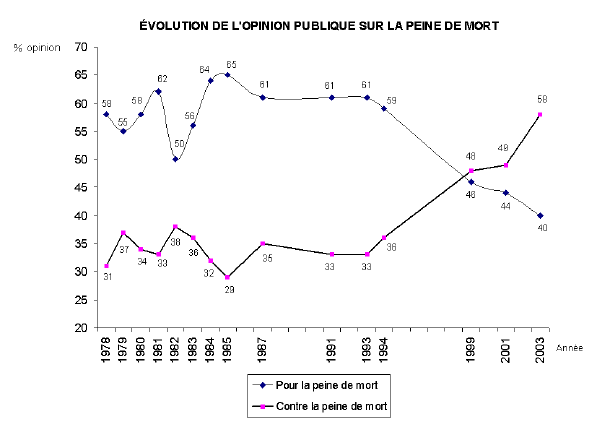
La vision d’Alain Peyrefitte, alors garde des Sceaux, qui affirmait, en 1979, que « le public s’accoutumerait à l’idée qu’il faudra vivre sans la peine de mort et trouver ailleurs la sécurité » (44) s’est réalisée. Cette évolution doit convaincre tous ceux qui, disciples de Montesquieu, considéraient, pour fonder leur refus de l’abolition, que rien ne devait être fait dans les lois que les esprits et les cœurs ne fussent disposés à accepter.
En raison de la persistance d’un nombre non négligeable d’États non abolitionnistes, le droit international général n’exige pas expressément l’abolition de la peine de mort. Mais, la position adoptée publiquement par les gouvernements, par le biais de traités et d’autres instruments, est que l’abolition de la peine de mort, si elle n’est pas immédiatement exigée, n’en reste pas moins un but ultime dans le domaine des droits de l’homme. Certains traités engagent les États parties à emprunter la voie de l’abolition.
Ainsi, depuis plus de vingt-cinq ans, les traités, protocoles et déclarations se multiplient pour dessiner un chemin vers l’abolition universelle de la peine de mort. Dans ce mouvement, le Conseil de l’Europe se distingue par son dynamisme et sa volonté de faire de notre continent une terre sans exécution capitale.
Un mouvement identique s’est fait jour sur les autres continents et au niveau international, en particulier sous la bannière des Nations unies. Dans cette évolution, il convient également de mentionner la victoire constituée par l’adoption du traité de Rome de 1998 portant statut de la Cour pénale internationale. Celle-ci doit juger les auteurs des pires crimes mais son statut ne prévoit comme peine ultime que la détention à perpétuité (45), de la même façon que le prévoyaient les textes relatifs au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, créé par la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 février 1993 (46), et au Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 (47).
La victoire de 1945 a consacré le triomphe des droits de l’homme comme le système de valeurs sur lequel se fondent les démocraties. Suivant de quelques années la déclaration universelle de 1948 des Nations unies, la Convention européenne des droits de l’homme revêt à cet égard une importance particulière. Elle exprime cette exigence que l’Europe, où furent conçus les droits de l’homme, demeure leur foyer privilégié.
En instituant pour la première fois un système de protection supranationale de ces droits, sanctionné par la Cour européenne des droits de l’homme, la Convention a fait passer les droits de l’homme de l’ordre éthique à l’ordre juridique.
Parmi ces droits, figure le droit à la vie. Le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention stipule que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ». Mais, il réserve aussi le cas de l’« exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Ainsi, cette convention, socle des valeurs européennes, tolérait néanmoins, à l’origine, la peine de mort comme un « mal nécessaire ».
Dans son article 15, elle réserve les cas d’urgence. De la même façon que Cesare Beccaria, dans son Traité des délits et des peines, estimait que « la mort d’un citoyen ne peut être jugée utile que pour deux motifs : d’abord si, quoique privé de sa liberté, il a encore des relations et un pouvoir tels qu’il soit une menace pour la sécurité de la Nation, et si son existence peut provoquer une révolution dangereuse pour la forme du gouvernement établi », en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la Nation, un État partie à la Convention peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par celle-ci, mais dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
Par exemple, dans ces circonstances, l’article 16 de la Constitution française du 4 octobre 1958 pourrait, en droit, trouver à s’appliquer et permettre de rétablir la peine de mort par-delà l’abolition fondée sur la loi « ordinaire » du 9 octobre 1981 précitée. La Convention impose seulement à celui qui exerce ce droit de dérogation de tenir le secrétaire général du Conseil de l’Europe informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. L’État qui déroge doit également l’informer de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Ces dérogations ne sauraient cependant porter atteinte au droit à la vie proclamé dans l’article 2 de la Convention – l’article 15 l’exclut expressément. En revanche, dans les cas visés par ce dernier article, dès lors que la peine de mort est décidée « en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi », elle ne serait pas interdite.
Parallèlement, si elle a eu à connaître de la portée de l’exception ouverte au droit à la vie par l’article 2 de la Convention de manière relativement tardive, la Cour européenne des droits de l’homme a élaboré une jurisprudence protégeant ce droit de plus en plus stricte. En matière de peine capitale, sa jurisprudence a été construite principalement à l’occasion des risques encourus par des individus menacés d’éloignement vers des États tiers. Elle n’a pourtant jamais pris position ouvertement au cœur du débat abolitionniste.
Mais, à l’occasion de deux arrêts récents, rendus respectivement le 12 mars 2003 et le 12 mai 2005 (48), la Cour semble avoir rompu avec cette prudence. Quittant le champ des limites qu’elle s’était fixées, celui des exceptions au droit à la vie, la Cour a établi une relation entre le prononcé de la peine capitale et l’interdiction des traitements inhumains et dégradants stipulée par l’article 3 de ladite convention. Par ce biais, elle a élargi la protection des individus à l’encontre de la peine capitale.
Elle avait déjà fait un pas dans ce sens dans son arrêt Soering c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1989. Nonobstant les garanties procédurales dont le requérant bénéficierait aux États-Unis, sans soutenir que la peine de mort en elle-même violait l’article 3 de la Convention et compte tenu, d’une part, de la très longue période à passer dans le « couloir de la mort » qui ne manquerait pas d’être marquée par une angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale et, d’autre part, de la situation personnelle du requérant, en particulier son âge et son état mental au moment des faits, la Cour a conclu que son extradition vers les États-Unis l’exposerait à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 de la Convention.
Les évolutions de la Cour européenne sont récentes et encore mal assurées, tandis que la tolérance pour la peine de mort contenue dans la Convention de 1950 ne pouvait qu’être temporaire. C’est pourquoi les États membres du Conseil de l’Europe décidèrent d’aller plus loin en négociant des protocoles additionnels, qui deviendront le protocole n° 6 et le protocole n° 13.
— Le protocole n° 6 concernant l’abolition de la peine de mort
Le protocole n° 6 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort a été ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983. Il est entré en vigueur le 1er mars 1985 et, pour la France, le 17 février 1986. Quarante-cinq États l’ont ratifié à ce jour, un seul parmi les membres du Conseil de l’Europe, la Russie, l’a signé sans le ratifier (49). Ce protocole a été le premier instrument juridiquement contraignant en Europe, et dans le monde, prévoyant l’abolition de la peine capitale en temps de paix, et n’autorisant ni dérogation en cas d’urgence, ni réserves.
Lors de la trois cent trente-septième réunion des délégués des ministres, le 25 septembre 1981, le comité des ministres a donné mandat au comité directeur pour les droits de l’homme de « préparer un projet de protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme visant l’abolition de la peine de mort en temps de paix ». Cette décision est le résultat d’une longue évolution tendant à l’abolition de la peine de mort au sein des États membres du Conseil de l’Europe. En effet, dès sa création, en 1957, le comité européen pour les problèmes criminels avait inscrit à son programme de travail « le problème de la peine de mort dans les États européens ».
Pour sa part, l’Assemblée parlementaire s’était saisie à plusieurs reprises de cette question. En 1979, sa commission des Questions juridiques avait désigné comme rapporteur M. Carl Gunnar Lidbom, un député social-démocrate suédois (50). C’est sur son rapport que l’Assemblée a adopté, lors de sa trente-deuxième session, le 22 avril 1980, deux textes fondateurs. Le premier, la résolution 727, a « fait appel aux Parlements de ceux des États membres du Conseil de l’Europe qui maintiennent la peine de mort pour des crimes commis en temps de paix, pour la supprimer de leurs systèmes pénaux ». Le second, la recommandation 891, demandait au comité des ministres de « modifier l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dans le sens de la résolution 727 ».
Dans le même temps, les ministres européens de la justice se sont attachés à examiner plus attentivement cette question à l’initiative du ministre autrichien de la justice d’alors, M. Broda. Ainsi, lors de la conférence de Copenhague des 21 et 22 juin 1978, ils recommandèrent au comité des ministres de « transmettre les questions concernant la peine de mort aux instances compétentes du Conseil de l’Europe aux fins d’examen dans le cadre de son programme de travail ». Lors de la conférence de Luxembourg des 20 et 21 mai 1980, après avoir considéré que « l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne reflète pas exactement la situation actuelle en ce qui concerne la peine de mort en Europe », ils ont conseillé au comité des ministres « d’étudier la possibilité d’élaborer de nouvelles normes européennes appropriées concernant l’abolition de la peine de mort ». En dernier lieu, lors de la réunion informelle de Montreux du 10 septembre 1981, la conférence « a exprimé son grand intérêt pour tout projet législatif national visant à l’abolition de la peine de mort ainsi que pour les efforts entrepris dans ce sens sur le plan international, notamment au sein du Conseil de l’Europe ».
Préparé par le comité directeur pour les droits de l’homme, le projet de protocole additionnel a été transmis au comité des ministres qui a définitivement adopté le texte lors de la réunion des délégués des ministres le 10 décembre 1982 et l’a ouvert à la signature des États membres le 28 avril 1983.
L’article 1er, qui doit être lu en regard de l’article 2, proclame le principe de l’abolition de la peine de mort. En conséquence, l’État qui souhaite ratifier le protocole doit supprimer une telle peine de sa législation.
L’article 2 précise le champ d’application du protocole en limitant au temps de paix l’obligation de l’abolition de la peine de mort. Ainsi, un État peut devenir partie au protocole même si sa législation, actuelle ou future, prévoit la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Dans cette hypothèse, la peine de mort ne pourra être appliquée que dans les cas prévus par cette législation.
Alors que, comme on l’a vu, l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme autorise les États membres, « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la Nation », à prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention, l’article 3 du protocole n° 6, plus restrictif, stipule qu’aucune dérogation audit protocole n’est admise en vertu de l’article 15. De plus, par exception à l’article 64 de la Convention – devenu depuis lors article 57 –, les États ne peuvent pas faire de réserve au protocole. En revanche, son article 5 autorise des réserves d’application territoriale, conformément au modèle de clauses finales adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe en février 1980.
L’article 6 du protocole n° 6, tout comme l’article 5 du premier protocole additionnel et l’article 6, paragraphe 1, du protocole n° 4, a pour but de préciser les relations entre le protocole et la Convention, en stipulant que toutes les dispositions de cette dernière s’appliqueront à ses articles 1er à 5, ce qui permet d’inclure le système de garantie instauré par la Convention mère. En précisant le caractère « additionnel » du protocole, l’article 6 n’a pas pour effet de supprimer l’article 2 de la Convention. Ainsi, demeurent toujours pleinement valables la première phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de cet article en vertu desquels « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
En outre, la deuxième phrase du paragraphe 1 qui, rappelons-le, prévoit que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi », reste applicable pour les États qui maintiennent la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, en particulier en ce qu’elle exige que la sentence capitale soit prononcée par un tribunal.
Le succès de ce protocole a qualifié l’ensemble du continent européen pour la cause abolitionniste, seules les dispositions à caractère exceptionnel demeurant. Ainsi, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a instauré une pratique selon laquelle elle demande aux États qui souhaitent devenir membres du Conseil qu’ils s’engagent à appliquer un moratoire immédiat sur les exécutions, à supprimer la peine capitale de leur législation nationale et à signer et ratifier le protocole n° 6. Plus largement, en 1994, dans sa résolution 1044 (1994) du 4 octobre relative à l’abolition de la peine capitale, l’Assemblée a pris l’initiative d’inviter tous les États membres qui ne l’avaient pas encore fait à signer et à ratifier sans délai le protocole n° 6. Cette résolution fait de l’adhésion au protocole n° 6 « une condition pour l’accession au Conseil de l’Europe », préparée par un moratoire sur l’exécution de la peine capitale observé à ce jour dans l’ensemble des États membres.
Dans le sillage de ces initiatives et dans l’attente d’un nouveau protocole plus strict, l’Union européenne, le 29 juin 1998, a adopté des Orientations pour une politique à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, qui précisent que « ce châtiment n’a pas sa place dans le système pénal des sociétés démocratiques » et que « l’abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l’homme ».
Il faut rappeler, enfin, que le 7 décembre 2000, à l’occasion du sommet de Nice, le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne ont proclamé solennellement, dans l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que « toute personne a droit à la vie » et que « nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté » (51). Le 12 juin 1997, le Parlement européen avait estimé que l’abolition de la peine de mort doit être envisagée lors de toute négociation d’accords de coopération et de partenariat.
— Le protocole n° 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances
Depuis l’adoption du protocole additionnel n° 6, le droit à la vie, « attribut inaliénable de la personne humaine » et « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international », a été unanimement reconnu par des normes juridiques contraignantes universelles et régionales. Il s’agissait, dès lors, de s’intéresser à l’hypothèse, réservée en 1985, de l’interdiction de la peine capitale en temps de guerre. Le cinquantième anniversaire de la Convention européenne, à Rome, en novembre 2000, fournit l’occasion d’enclencher le processus qui allait conduire à « faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances » et donc de faire disparaître la peine capitale « en temps de guerre et de danger imminent de guerre ».
Il s’agissait donc d’interdire la peine de mort en toutes circonstances, ce qui est, au seul niveau national, le résultat de la loi du 9 octobre 1981 précitée. C’est l’objet du protocole n° 13 ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002 et dont l’intitulé est explicite en ce sens. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2003, son article 7 prévoyant, dans son paragraphe 1, que son entrée en vigueur a lieu le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par lui. Trente-sept États l’ont déjà ratifié. Sept, dont la France, l’ont signé sans le ratifier (52).
L’objectif fondamental de l’abolition de la peine de mort a été affirmé lors du second sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, en octobre 1997. Tous ont appelé « à l’abolition universelle de la peine de mort et (ont) insist(é) sur le maintien, entre-temps, des moratoires existants sur les exécutions en Europe ». Le comité des ministres a, pour sa part, indiqué qu’il « partage la forte conviction de l’Assemblée parlementaire contre le recours à la peine de mort et sa ferme volonté de faire tout son possible afin de faire en sorte que les exécutions capitales cessent d’avoir lieu ».
La question spécifique de l’abolition de la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre restait posée. Elle avait été soulevée, la première fois, par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Dans sa recommandation 1246 (1994) du 4 octobre 1994, cette dernière a souhaité que le comité des ministres élabore un nouveau protocole additionnel à la Convention, abolissant la peine de mort en toutes circonstances. Alors que le comité directeur pour les droits de l’homme était très largement favorable à l’élaboration d’un tel protocole additionnel, le comité des ministres considéra alors que la priorité politique était d’obtenir et maintenir un moratoire sur les exécutions.
Une étape décisive a été franchie à l’occasion de la conférence ministérielle européenne sur les droits de l’homme réunie à Rome, les 3 et 4 novembre 2000, pour fêter le cinquantième anniversaire de la Convention européenne. Dans sa résolution II, la conférence a demandé aux quelques États membres qui n’avaient pas encore procédé à l’abolition de la peine de mort ni à la ratification du protocole n° 6 de ratifier ce protocole dans les plus brefs délais et, dans l’intervalle, de respecter strictement les moratoires concernant les exécutions. Dans la même résolution, elle a invité le comité des ministres « à examiner la faisabilité d’un nouveau protocole additionnel à la Convention excluant la possibilité de maintenir la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ».
À l’initiative de la Suède, une proposition pour un protocole additionnel à la Convention fut présentée dans ce sens lors de la sept cent trente-troisième réunion des délégués des ministres du 7 décembre 2000. Lors de leur sept cent trente-sixième réunion des 10 et 11 janvier 2001, les délégués des ministres ont donné mandat au comité directeur pour les droits de l’homme « d’étudier la proposition suédoise de nouveau protocole à la Convention (…) et de soumettre son avis sur la faisabilité d’un nouveau protocole sur la question ». Ce dernier élabora un premier projet en 2001 et le transmit au comité des ministres le 8 novembre 2001. Ce dernier a adopté le texte du protocole le 21 février 2002 lors de la sept cent quatre-vingt-quatrième réunion des délégués des ministres. Ce texte a été ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002.
À l’instar du protocole n° 6, le protocole n° 13, on le rappelle, abolit la peine de mort et écarte l’application de l’article 15 de la Convention, qui permet des dérogations aux droits consacrés par la Convention en cas d’urgence. Tout comme son « aîné », il fait obstacle à la formulation de réserves sur le fondement de l’article 57 de la Convention. Tout juste autorise-t-il des « réserves territoriales » d’application, en vertu desquelles « tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent protocole ». Ainsi, l’« intangibilité » du droit à la vie est susceptible de varier en fonction des différentes portions du territoire d’un État signataire (53).
Le protocole de Vilnius marque assurément le franchissement d’un seuil supérieur dans la volonté abolitionniste des États membres du Conseil de l’Europe. Il ne reprend pas, là est l’avancée majeure qu’il propose, la possibilité offerte à un État de « prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». Par son biais, le droit à la vie, reconnu par l’article 2 de la Convention, devient un véritable droit intangible.
En tant que protocole additionnel, il n’a pas, en revanche, pour résultat de supprimer – pour les parties au protocole – l’article 2 de la Convention. En effet, la première phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 2 demeurent toujours, même pour ces États, pleinement valables. Il est évident que la deuxième phrase du paragraphe 1 n’est plus applicable pour les États parties à ce protocole. Dans la mesure où ces derniers ont également ratifié le protocole n° 6 à la Convention, ils ne pourront plus recourir à la possibilité prévue à l’article 2 du protocole n° 6. Conformément à l’article 32 de la Convention, toute question concernant les relations précises entre les protocoles eux-mêmes et entre le protocole n° 13 et la Convention relève de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La peine de mort ne peut être qu’abolie, dans toutes ses dimensions, ou maintenue. Tout autre choix, à l’époque contemporaine, se révélerait contradictoire. En effet, soit on croyait aux vertus dissuasives de la peine de mort, alors il fallait demander qu’on la conserve, soit on n’y croyait pas, et il ne servait à rien de la conserver pour certains cas.
Outre l’existence d’un autre instrument à portée régionale, le protocole à la Convention américaine des droits de l’homme, adopté en 1990 par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (54), qui interdit le recours à la peine de mort en temps de paix, la communauté internationale s’est dotée, avec le Pacte international de 1966 et le deuxième protocole facultatif de 1989 qui l’accompagne, de deux outils à portée réellement universelle et visant à abolir la peine de mort.
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 reste muette sur la question de la peine de mort, bien que celle-ci ait été abordée dans le cadre du débat sur le droit à la vie. Plusieurs propositions ont préconisé de proclamer l’abolition de la peine de mort, au moins en temps de paix, tandis que d’autres souhaitaient son maintien sans réserve comme une exception explicite au droit à la vie. Il fut alors décidé de laisser une simple mention du droit à la vie. Ce choix a été dicté non seulement par la volonté de tenir compte de la diversité des opinions, mais aussi par la décision de laisser le soin d’établir des dispositions détaillées sur l’étendue des droits dans le cadre de la convention qui est devenue le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ce pacte a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976. Il a été ratifié par cent soixante des cent quatre-vingt-douze États membres de l’Organisation des Nations unies (55).
Dans son article 6, il affirme le caractère inhérent du droit à la vie, qui doit être protégé par la loi et qui interdit d’en priver arbitrairement qui que ce soit.
En revanche, il autorise dans certains cas la peine capitale. Il prévoit ainsi que « dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis ». Cette exception ne doit cependant être en contradiction ni avec les autres dispositions du Pacte (56), ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (57). La peine capitale ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Le Pacte permet également à tout condamné à mort de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
Cependant, il interdit qu’une sentence de mort puisse être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et puisse être exécutée contre des femmes enceintes. Il convient de relever, à cet égard, que les États-Unis « se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu’une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l’imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ».
Par ailleurs, l’article 7 dudit pacte interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui impose sans nul doute de pratiquer l’exécution capitale dans certaines conditions.
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies (58), sis à Genève, a eu l’occasion de présenter des observations sur le contenu du Pacte et en particulier sur son article 6 (59). Il a notamment estimé que le droit à la vie, qui ne saurait être interprété dans un sens restrictif, constituait un « droit suprême pour lequel aucune dérogation n’est autorisée, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la Nation ».
Dès lors, il convient d’écarter l’article 4 du Pacte qui stipule que « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la Nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties (…) peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le (…) Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale ». Ainsi, selon l’interprétation du Comité des droits de l’homme, la peine capitale ne saurait être prononcée dans les cas visés à l’article 4, car l’exception au droit à la vie excéderait alors les limites imposées par le Pacte.
De manière plus générale, le Comité fait une lecture abolitionniste de l’article 6. Il relève ainsi qu’aux termes de ce dernier, les « États parties ne sont pas tenus d’abolir totalement la peine capitale » mais qu’« ils doivent en limiter l’application et, en particulier, l’abolir pour tout ce qui n’entre pas dans la catégorie des " crimes les plus graves " ». Il en conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie. Il ajoute que l’expression « les crimes les plus graves » doit être interprétée d’une manière restrictive, « comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle ».
Par ailleurs, il ne fait pas de doute que, lorsque la peine capitale est prononcée, elle n’est autorisée par le Pacte que si elle l’a été sur le fondement d’un procès équitable. Si l’article 6 du Pacte ne mentionne pas directement la règle du « procès équitable », l’interdiction d’une peine prononcée « arbitrairement » couvre cette hypothèse. De plus, rien ne permet d’écarter – hors les cas où un danger public exceptionnel menace la vie de la Nation – les dispositions de l’article 14 du Pacte qui énoncent les garanties préalables et postérieures à tout procès. En conséquence, il existe une obligation implicite de ne pas exécuter les condamnés n’ayant pas bénéficié d’un procès équitable, afin de garantir le caractère non arbitraire de la privation de la vie.
Dans ce sens, dans sa résolution 2393 (XXIII) du 26 novembre 1968, l’Assemblée générale avait invité les gouvernements membres à, notamment, « assurer l’application des procédures légales les plus scrupuleuses et les plus grandes garanties possibles à toute personne accusée d’un crime passible de la peine capitale ». De manière plus explicite encore, dans sa résolution 35/172 du 15 décembre 1980, elle priait les États « de respecter, en tant que critère minimal, le contenu des dispositions des articles 6, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, le cas échéant, de modifier leur législation et leur pratique judiciaire de manière à assurer l’application des procédures légales les plus scrupuleuses et les plus grandes garanties possibles à toute personne accusée d’un crime passible de la peine capitale ».
À son initiative, le Conseil économique et social des Nations unies (Ecosoc) a adopté, dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984 approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 39/118 du 14 décembre 1984, des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, dont la cinquième réaffirme la nécessité d’assurer un procès équitable dans les affaires de crimes passibles de la peine capitale, « y compris le droit de bénéficier d’une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure » (60).
Le 4 novembre 1980, la France, en devenant État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’est engagée à ne plus appliquer la peine de mort aux personnes de moins de dix-huit ans au moment du délit et aux femmes enceintes. La ratification, intervenue le 29 janvier 1981, a été publiée au Journal officiel le 1er février 1981.
Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort a été adopté par la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 44/128 du 15 décembre 1989. L’Assemblée a adopté le texte avec cinquante-neuf voix pour, vingt-six contre et quarante-huit abstentions. Si les voix favorables représentaient plus du double des voix contre, elles ne constituaient qu’une minorité parmi les membres présents et les votants. De nombreux États non abolitionnistes ont clairement déploré cette initiative.
Le Pacte a été ratifié à ce jour par soixante États, dont tous les États de l’Union européenne, à l’exception de la Pologne qui l’a seulement signé et de la France qui ne l’a ni signé, ni ratifié. C’est le premier traité abolitionniste universel, entré en vigueur le 11 juillet 1991, après acceptation de son dixième instrument de ratification.
Moment essentiel puisqu’il vise à l’abolition mondiale de la peine de mort, il été adopté à l’initiative de l’Allemagne, où l’abolition de la peine de mort est constitutionnelle.
Le principe abolitionniste a déjà été admis par l’Organisation des Nations unies. Par exemple, dans sa résolution 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971, réaffirmée dans sa résolution 32/61 du 8 décembre 1977, l’Assemblée générale a estimé qu’« afin de garantir pleinement le droit à la vie, énoncé à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’objectif principal à atteindre est de restreindre progressivement le nombre de crimes passibles de la peine capitale, afin de rendre souhaitable son abolition dans tous les pays ».
La communauté internationale a, par ailleurs, renforcé la limitation du nombre des cas où la peine de mort pouvait être prononcée ou exécutée, en réaffirmant l’interdiction contenue dans l’article 6 du Pacte de 1966 concernant les mineurs ou encore les femmes enceintes, les jeunes mères et les personnes âgées.
Par exemple, la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, a contribué à encadrer l’usage de la peine de mort au niveau international. Son article 37 interdit l’usage de la peine de mort à l’égard des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Le Comité des droits de l’enfant est chargé de suivre sa mise en œuvre. Les Garanties précitées de l’Ecosoc du 25 mai 1984 prévoient que « les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment où elles commettent un crime ne seront pas condamnées à mort ». Le cinquième paragraphe de l’article 6 du Pacte de 1966 interdit d’exécuter une sentence de mort contre des femmes enceintes. La Convention américaine sur les droits de l’homme du 22 novembre 1969, dans le paragraphe 5 de son article 4, stipule que « la peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans ; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes ».
Mais, le nouveau protocole au Pacte de 1966, épilogue d’une discussion longue de dix ans, va plus loin, est plus large et marque une évolution décisive.
Dans son article 1er, paragraphe 1, il est stipulé qu’aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie à ce protocole ne sera exécutée et le paragraphe 1 de son article 2 prévoit qu’il n’y sera admis aucune réserve, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre. Les États peuvent ainsi prévoir la peine de mort « en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre ». Cette faculté n’a été utilisée que par un nombre restreint d’États, cinq au total, à savoir, l’Azerbaïdjan, Chypre, l’Espagne, la Grèce et Malte. Trois d’entre eux, Chypre, l’Espagne et Malte, ont par la suite retiré leurs réserves. À l’exception initialement de l’une d’entre elles (61), les réserves se sont contentées de reproduire le libellé du paragraphe 1 de l’article 2.
En comparaison de l’évolution « européenne », le deuxième protocole onusien est, dans sa substance, plus proche du protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme que du protocole n° 13. En effet, sur le fond, cette possibilité de mettre en œuvre la peine de mort est similaire à celle qui est prévue par le protocole n° 6, si ce n’est que l’exception est plus restrictive que celle envisagée dans ce texte, le protocole n° 6 à la Convention européenne mentionnant aussi « le danger imminent de guerre ». En revanche, contrairement à ce dernier, le deuxième protocole exige qu’une réserve expresse soit émise lors de la ratification ou de l’adhésion. Il ne s’agit pas d’une exception « automatique » comme dans le protocole n° 6.
Les dérogations à l’interdiction de la peine de mort, telles qu’elles pourraient être instituées en application de l’article 4 du Pacte de 1966 en cas de « danger public exceptionnel » menaçant « l’existence de la Nation », sont, en revanche, proscrites par le deuxième protocole additionnel. Sur ce point, le deuxième protocole se rapproche des protocoles nos 6 et 13 qui écartent l’application de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans la logique du deuxième protocole facultatif, la Commission des droits de l’homme des Nations unies, dans sa résolution E/CN 4/1997/L. 20 du 3 avril 1997, a reconnu que la peine de mort est une question qui concerne les droits de l’homme et non plus la seule politique criminelle des États.
LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET EUROPÉENS | ||||
Traité |
Principe |
Réserve |
Dénonciation |
Position de la France |
Convention européenne des droits de l’homme (1950) |
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement |
Exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi Réserve territoriale |
5 ans après ratification et délai de six mois (article 58) |
Ratification le 3 mai 1974 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) |
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine Ce droit doit être protégé par la loi Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. |
Une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les autres dispositions du Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent |
Pas de clause de dénonciation |
Adhésion le 4 novembre 1980 |
Protocole n° 6 à Convention européenne (1983) |
La peine de mort est abolie Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté |
Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation Réserve territoriale possible |
Selon les clauses de l’article 58 de la Convention européenne |
Ratification le 17 février 1986 |
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international (1989) |
Aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie au protocole ne sera exécutée Chaque partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction |
Application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre, à condition qu’il existe une législation au moment de la ratification ou de l’adhésion |
Pas de clause de dénonciation |
Ni signé ni ratifié |
Protocole n° 13 à la Convention européenne (2002) |
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. |
Aucune réserve autre que territoriale |
Selon les clauses de l’article 58 de la Convention européenne |
Signature le 3 mai 2002 |
La seule chose qui mérite la peine capitale doit être… la peine de mort. Le message de Beccaria résonne désormais par-delà les frontières : « si je prouve que cette peine n’est ni utile ni nécessaire, j’aurais fait triompher la cause de l’humanité ». L’inscrire dans notre norme suprême constituerait le moyen à la fois de l’affirmer comme valeur fondamentale et intangible de notre société et de souscrire aux engagements internationaux les plus incontestables en faveur d’une abolition de cette peine en toutes circonstances.
II. — LA CONSTITUTION À LA CONFLUENCE DE LA VOLONTÉ NATIONALE ET DE L’ORDRE INTERNATIONAL ABOLITIONNISTES
Lorsque la Nation est menacée dans son existence même, la question de la réglementation du droit de vie et de mort de l’État sur ses citoyens – c’est bien de cela qu’il s’agit lorsqu’on évoque la peine de mort – appartient sans conteste au domaine inhérent à la souveraineté, telle que définie par la Constitution. Y renoncer définitivement en signant tous les traités internationaux relatifs à l’abolition de la peine de mort, c’est accepter une limitation de cette souveraineté. Ce renoncement, au nom du droit à la vie, doit donc, pour être légitime, s’inscrire dans le texte constitutionnel. C’est aussi l’occasion, pour reprendre la formule d’Albert Camus, de « proclamer, dans les principes et dans les institutions, que la personne humaine est au-dessus de l’État » (62).
En l’état du droit, dans l’ordre interne et par une loi « ordinaire », la France a aboli la peine de mort en toutes circonstances. Dans l’ordre international, sur le fondement du protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ratifié par la France en 1986, la peine de mort ne peut y être rétablie, sauf en cas de guerre ou de danger imminent de guerre.
Ratifier le protocole n° 13 à la convention précitée interdira de la rétablir en toutes circonstances. Ratifier le deuxième protocole additionnel au Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies permettrait de signer un instrument international qui vise l’abolition universelle de la peine de mort. Pour respecter la hiérarchie des normes, ces ratifications ne peuvent se faire que si elles sont compatibles avec notre Constitution.
A. LA QUESTION DE LA COMPATIBILITÉ DE LA CONSTITUTION AVEC LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX D’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Sur le fondement de l’article 54 de la Constitution, le Président de la République a saisi, à deux reprises, le Conseil constitutionnel pour lui demander de vérifier la compatibilité avec la Constitution d’engagements internationaux relatifs à l’abolition de la peine de mort.
La première fois, ce fut en 1985 sur le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (63), et la seconde fois, vingt ans après, en 2005, à la fois sur le protocole n° 13 à la même Convention et sur le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (64).
Le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité du protocole n° 6 et celle du protocole n° 13. En revanche, il a estimé que le deuxième protocole facultatif portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale définies par la Constitution, dès lors que cet engagement régit des situations dans lesquelles se trouve en cause l’existence même de la Nation et que sa ratification serait irrévocable. Serait ainsi franchi un seuil de basculement dans l’« interdit constitutionnel », mouvement constitutif d’une atteinte qualifiée à la souveraineté nationale, que seule une révision de la Constitution pourrait surmonter.
En 1985, saisi par le Président de la République, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, signé par la France le 28 avril 1983.
Il a considéré que cet engagement international n’est pas incompatible avec le « devoir pour l’État d’assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la Nation et la garantie des droits et libertés des citoyens ». De ce considérant, il est possible de déduire que le Conseil a examiné la compatibilité du protocole n° 6 avec l’article 16 de la Constitution, qui permet au Président de la République, « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu », de prendre les mesures exigées par ces circonstances.
Comme on l’a vu, l’article 2 du protocole n° 6 permet à un État de prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Il est possible d’imaginer qu’une telle situation pourrait être couverte par l’article 16. Mais les circonstances visées par ce dernier vont sans doute bien au-delà des seuls cas de guerre et même de danger imminent de guerre.
La question pouvait donc se poser de savoir si le champ de la réserve de l’article 2 ne limitait pas en droit, outre mesure, celui de l’article 16 et empêcherait ainsi le Président de rétablir la peine de mort, hors les cas avérés ou imminents de guerre, ce qui serait en contradiction avec la Constitution.
Il faut relever, à ce titre, que le protocole exclut toute dérogation sur le fondement de l’article 15 de la Convention qui réserve les cas d’urgence, mais seulement en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la Nation et dont le champ est très proche de celui de l’article 16 de la Constitution.
Dans une réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 3 mai 1974, la France avait d’ailleurs rappelé « que les circonstances énumérées par l’article 16 de la Constitution pour sa mise en œuvre doivent être comprises comme correspondant à l’objet de l’article 15 de la Convention et, d’autre part, que pour l’interprétation et l’application de l’article 16 de la Constitution de la République, les termes dans la stricte mesure où la situation l’exige ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre les mesures exigées par les circonstances » (65). La compatibilité entre le protocole et cette dernière ne peut donc être fondée sur l’article 15 de la Convention.
Sans se prononcer explicitement sur cette question de compatibilité entre le protocole et l’article 16, il résulterait néanmoins de sa décision que « le Conseil n’a pas (…) estimé que le recours à la peine de mort constituait un moyen nécessaire au Président de la République pour rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics dans le cadre de l’article 16 de la Constitution » (66). Cette argumentation sera reprise à l’appui de la décision du 13 octobre 2005. Une interprétation contraire aurait semblé audacieuse et les dispositions de l’article 16 ne permettaient pas de l’énoncer sans prêter à ce texte des virtualités qu’il ne recèle pas à sa seule lecture. En toute hypothèse, nul principe ou disposition constitutionnel ne paraît requérir qu’il soit fait application de la peine de mort, même dans des circonstances limitées.
En tout état de cause, le Conseil a écarté tout risque d’incompatibilité en relevant la possibilité de dénoncer les dispositions du protocole n° 6, dans les conditions fixées par l’article 65 de la Convention – devenu, par l’effet du protocole n° 11, l’article 58 (67). L’article 6 du protocole de 1983 prévoit, en effet, que ses articles 1er à 5 sont des articles additionnels à la Convention et que toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence, y compris celles relatives à la dénonciation. On sait qu’en droit international public, la question de la dénonciation possible d’un traité, ou plus exactement, s’agissant d’un traité multilatéral, du retrait d’un État, est considérée comme majeure. Et cette faculté est toujours liée au respect de la souveraineté des États (68).
Le Conseil constitutionnel a conclu qu’en conséquence, le protocole ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté nationale et qu’il ne contient aucune clause contraire à la Constitution, de telle manière que la possibilité de dénonciation « couvre », en l’espèce, tout risque d’incompatibilité.
Rétrospectivement, il est possible, bien sûr, de s’interroger in concreto sur la capacité de dénoncer ledit protocole. En effet, il peut paraître difficile d’admettre que les conditions de dénonciation du protocole – qui imposent des délais minimaux – soient compatibles avec l’extrême urgence que requiert la mise en œuvre de l’article 16.
L’article 58 de la Convention détermine les conditions dans lesquelles celle-ci peut être dénoncée. Cette dénonciation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention et moyennant un préavis de six mois. Elle ne peut avoir pour effet de délier l’État intéressé pour les actes accomplis antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit son effet. Cesse d’être partie à la Convention tout État qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe. En effet, depuis l’élargissement des années 1990 et suivantes, un lien indissoluble entre l’adhésion à la Convention et l’appartenance au Conseil de l’Europe a été formellement imposé et se trouve désormais opposable, comme on l’a vu, à tous les États membres de cette organisation. Ainsi, un État qui se retirerait de la Convention ne pourrait plus être membre du Conseil.
La Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. La France l’ayant ratifié le 3 mai 1974, la possibilité de dénonciation est ouverte depuis 1979. La question se pose de savoir si le protocole doit être considéré de manière solidaire ou bien séparée de la Convention.
Dans le premier cas – les protocoles additionnels sont généralement considérés comme faisant partie intégrante de la Convention (69) –, le protocole pouvait être dénoncé six mois après sa ratification par notre pays, soit six mois après le 17 février 1986. Dans le second cas – une partie de la doctrine, minoritaire, est ainsi favorable à la possibilité d’une dénonciation séparée des protocoles additionnels (70) –, le protocole n° 6 ne pouvait être dénoncé qu’à partir de février 1991, le délai de six mois s’imposant de surcroît.
Dans tous les cas et sans qu’il soit réellement possible de trancher sur la validité de l’un d’entre eux, au-delà même des considérations politiques qui empêcheraient la France de s’engager sur la voie de tels retraits – de la Convention et du protocole solidairement ou du seul protocole –, les possibilités matérielles de dénonciation semblent ainsi difficilement compatibles avec le rétablissement, pour un temps limité, de la peine de mort dans le cadre de l’article 16 de notre Constitution.
Néanmoins, considérant que la seule possibilité de dénonciation suffisait, le Conseil constitutionnel, par sa décision du 22 mai 1985, a ouvert la voie à la ratification du protocole n° 6.
Dans des conditions proches de celles qui ont présidé à sa saisine sur le protocole n° 6, le Conseil constitutionnel, saisi en 2005 du protocole n° 13, a également relevé que celui-ci ne contient pas de clauses contraires à la Constitution, qu’il ne met pas en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis et qu’il ne porte pas atteinte aux « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Parmi celles-ci se trouve explicitement rangée « l’adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent » (71) à la souveraineté nationale (72).
Cette dernière peut être définie comme le « caractère suprême d’une puissance pleinement indépendante » (73) et permet que son détenteur puisse défaire ce qu’il a fait. Elle s’oppose donc à toute irrévocabilité définitive.
Pour ce qui concerne le protocole n° 13, la situation est aussi simple que pour le protocole n° 6. Son article 5 règle la question des rapports entre le protocole et la Convention européenne des droits de l’homme. Les articles 1er à 4 du protocole sont ainsi qualifiés d’« articles additionnels à la Convention ». En conséquence, « toutes les dispositions de la Convention s’appliquent », y compris son article 58 relatif à la dénonciation de ses stipulations.
Alors qu’en 1985, le Conseil s’était attaché à relever la possibilité pour l’État de prévoir la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre pour parvenir au même résultat, en 2005, la seule évocation de la possible dénonciation suffit à fonder la compatibilité du protocole avec la Constitution.
Il reste que les possibilités matérielles de dénonciation, qui sont les mêmes que celles du protocole n° 6, appellent les mêmes remarques. Le délai de six mois imposé serait, dans les faits, difficilement conciliable avec l’urgence qu’appellerait le rétablissement temporaire de la peine de mort sur le fondement de l’article 16 de la Constitution lorsque l’existence de la Nation elle-même se trouverait gravement menacée.
De plus, une fois ratifiée par tous les États membres du Conseil de l’Europe, l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances aurait vocation à acquérir une valeur coutumière, comme dans le cas du protocole n° 6 (74). En pareille hypothèse, la dénonciation du protocole n° 13 demeurerait formellement toujours possible. Mais son effet serait limité. L’État recourant à la dénonciation continuerait à être lié en substance par le principe d’abolition, en application du droit international non écrit ; il ne serait plus, en revanche, assujetti au contrôle européen portant sur le respect de l’abolition de la peine de mort en qualité de règle conventionnelle.
C’est pourquoi, dans toutes les hypothèses, que la possibilité de dénonciation couvre ou non l’incompatibilité avec la Constitution, il est de bonne politique d’inscrire dans notre Constitution le renoncement définitif à la peine de mort, y compris pour permettre la ratification du protocole n° 13.
2. L’incompatibilité du deuxième protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Saisi en 2005, en même temps que du protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Conseil constitutionnel a relevé que, si celui-ci ne contenait pas de clauses directement contraires à la Constitution ni ne mettait en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis, il portait atteinte aux « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».
En effet, « si l’abolition intégrale de la peine de mort est, en période normale, sans incidence sur les conditions d’exercice de la souveraineté nationale, il n’en est pas de même de l’engagement irrévocable de ne jamais la réintroduire, même dans des cas exceptionnellement graves et dans des circonstances dramatiques pour la Nation » (75).
En 1998, le ministre des affaires étrangères, en réponse à une question écrite, relevait déjà que « la ratification du protocole n° 2 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’est jusqu’à présent heurtée à des difficultés d’ordre juridique, tenant en particulier à l’absence de clause de dénonciation ou de retrait et aux exceptions à l’interdiction du recours à la peine de mort plus strictes que celles contenues dans le protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l’homme » (76).
Pour examiner la compatibilité entre le deuxième protocole et la Constitution, le Conseil s’est attaché à mesurer les possibilités de dénoncer les stipulations du protocole, dont l’application serait susceptible d’être incompatible avec la possibilité constitutionnelle pour la France de rétablir la peine de mort même « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la Nation ».
Il faut observer, de nouveau, que l’hypothèse de « temps de guerre » prévue par le deuxième protocole ne correspond pas rigoureusement à celle qui résulterait de la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution si, à cette occasion, la peine de mort était rétablie en France. En effet, la rédaction de l’article 16 ne vise pas exclusivement le cas de guerre ; ainsi, s’il est admis que l’article 16 autorise le Président de la République à prévoir, par un acte de nature législative pris en application de cet article, la répression de certains crimes par la peine de mort, une telle mesure, hors du temps de guerre strict – on se souviendra que le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme prévoit aussi le cas de « danger imminent de guerre » –, cette mesure entrerait en conflit avec le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Si, comme on l’a vu, le deuxième protocole facultatif est plus restreint, dans son champ, que le protocole n° 13, il ne comporte, en revanche, aucune clause de dénonciation ni directe, ni indirecte – c’est-à-dire par un renvoi au Pacte de 1966. En tout état de cause, pas plus que le protocole, le Pacte ne contient une telle clause de dénonciation.
Comme l’indique le commentaire aux Cahiers (77), le Conseil constitutionnel s’est référé à l’article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 qui, si elle n’a pas été ratifiée par la France (78), peut être considérée, pour certaines de ses stipulations, comme faisant partie de la coutume internationale dès lors qu’elle en constitue une codification, qui s’impose à la France dans l’ordre international en application du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Or, l’article 56 prévoit que dans le silence des stipulations conventionnelles, il n’est que deux cas dans lesquels un État peut dénoncer un traité. La dénonciation est admise, d’une part, s’il est établi « qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait » ou, d’autre part, si « le droit de dénonciation ou de retrait » peut « être déduit de la nature du traité ».
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, compétent pour adresser aux États « toutes observations générales qu’il jugerait appropriées » aux termes du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte de 1966, s’est prononcé sur la question de la dénonciation du Pacte de 1966 et du deuxième protocole dans son observation générale n° 26 du 8 décembre 1997 (79).
Selon le Comité, le silence concernant la dénonciation résulte de la volonté des parties et il doit être compris comme interdisant une telle possibilité. En effet, si les États parties ont introduit une clause de dénonciation pour le premier protocole additionnel au Pacte, dans son article 12, adopté le même jour que celui-ci, ils ne l’ont fait ni pour le Pacte lui-même ni pour le deuxième protocole additionnel.
S’agissant de la nature du traité, certains auteurs estiment qu’elle ne diffère guère des deux autres conventions internationales relatives à l’abolition de la peine de mort, à savoir le protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l’homme et le protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme du 6 août 1990. Ils en déduisent que la présence de clauses de dénonciation dans ces engagements peut être transposée au deuxième protocole facultatif (80).
Pour d’autres, en revanche, l’absence de clause de dénonciation est la marque d’une volonté explicite (81). De la même façon, le Comité des droits de l’homme ne retient aucune possibilité de dénonciation, ainsi qu’on l’a déjà souligné. Il n’est pas difficile de reconnaître, avec lui, qu’il est dans la nature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 au même titre que dans celle de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 de s’inscrire dans un temps illimité. Il n’a pas été signé pour être soumis aux soubresauts de la conjoncture. Le Comité en conclut que « le droit international n’autorise pas un État qui a ratifié le Pacte (...) à le dénoncer ou à s’en retirer ».
Si les constatations faites par le Comité et a fortiori ses observations n’ont pas de force contraignante, comme l’a relevé le Conseil d’État (82), ses interventions ne sauraient être ignorées dans l’interprétation du Pacte et de ses protocoles et en constituent sans nul doute la source la plus autorisée.
En outre, l’impossible dénonciation du Pacte est confirmée par la pratique. Cette doctrine a pu être forgée à l’occasion de la tentative de retrait en 1997 de la Corée du Nord. Confrontée à une forte pression diplomatique, la Corée du Nord finit par renoncer à maintenir sa décision de retrait du Pacte et, dès 2000, elle se soumit à nouveau au contrôle du Comité des droits de l’homme des Nations unies (83). En tant que dépositaire du Pacte, le Secrétaire général des Nations unies adressa au gouvernement nord-coréen, fin septembre 1997, un aide-mémoire dans lequel il estimait qu’en l’absence de clause de dénonciation dans le Pacte, le retrait unilatéral d’une partie contractante était soumis au consentement de toutes les parties contractantes.
L’impossibilité de dénonciation, même pour des motifs d’intérêt général supérieur et en raison de circonstances exceptionnelles, est attestée par la lettre même du protocole, dont l’article 6, paragraphe 2, exclut toute dérogation fondée sur l’article 4 du Pacte, y compris « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la Nation » visé par l’article 4, paragraphe 1, du texte.
Il paraît, par ailleurs, difficile de fonder une dénonciation sur l’article 54 de la Convention de Vienne précitée qui stipule qu’un traité peut être éteint, « à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants ». Si souveraineté il doit y avoir, elle consiste pour l’État à se dégager « seul », c’est-à-dire de manière unilatérale, de ses obligations conventionnelles.
Enfin, une dernière considération mérite examen : l’exercice de la souveraineté suppose assurément de pouvoir renoncer à tout moment à ce qu’on a accepté. Dans ces conditions, ce qui a été ratifié pourrait être dénoncé. Mais, ce qui est valable dans l’ordre interne ne l’est pas forcément dans l’ordre international. Et la règle « pacta sunt servanda » en vertu de laquelle les « conventions doivent être respectées » a acquis un caractère constitutionnel indéniable (84). C’est ce qui résulte sans équivoque de la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 sur le Traité de Maastricht et de la décision du 22 janvier 1999 sur le statut de la Cour pénale internationale (85). En conséquence, il paraît difficile d’admettre un droit illimité, hors de tout fondement conventionnel solide, à dénoncer les traités.
En toutes hypothèses, il serait possible d’imaginer que la France, pour préserver la possibilité de rétablir la peine de mort dans un « cas où un danger exceptionnel menacerait l’existence de la Nation » et donc conserver sa souveraineté sans tache, puisse émettre, au moment de ratifier le deuxième protocole, une réserve. Il faut se rappeler que l’article 2, paragraphe 1, du protocole autorise une telle réserve dès lors que celle-ci est formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoit l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.
Outre que l’adoption d’une telle réserve impliquerait que la France rétablisse dans sa législation la peine de mort pour les crimes visés avant toute ratification – hypothèse qui relève, en l’état de la question, de l’imagination la moins retenue –, elle serait incompatible avec la ratification du protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette ouverture juridique à la ratification du deuxième protocole dans l’état de notre droit constitutionnel devant être refermée, il convient d’admettre l’impossibilité de ratifier aujourd’hui cette convention. C’est pourquoi la ratification du deuxième protocole facultatif de 1989 exige une révision de la Constitution.
Il est proposé d’inscrire le principe de l’irrévocabilité de l’abolition de la peine de mort dans la Constitution.
La peine de mort est le signe du despotisme. La loi du talion, qui consiste à traiter un coupable de la même manière qu’il a traité les autres (86), inscrite en droit positif dans la loi des Douze Tables, en est l’illustration. Pour Montesquieu, « les États despotiques, qui aiment les lois simples, usent beaucoup de la loi du talion » (87). Nombreux sont ceux qui, parmi nos voisins européens, ont d’ores et déjà introduit l’abolition définitive de la peine de mort dans leurs normes constitutionnelles. La France doit s’inscrire dans ce mouvement.
Plusieurs pays européens ont choisi d’inscrire explicitement l’interdiction de la peine de mort dans leur texte constitutionnel, réalisant la prophétie d’Ihering selon laquelle « l’histoire de la peine est celle d’une constante abolition ».
La République Fédérale d’Allemagne a aboli la peine de mort dès 1949. La Loi fondamentale du 23 mai 1949 dispose, dans son article 102, que « la peine de mort est abolie ». Selon le même modèle, la Loi constitutionnelle fédérale de la République d’Autriche, datant du 1er octobre 1920 et amendée en ce sens en 1968, affirme, dans son article 85, que « la peine de mort est abolie ».
La Constitution de la Finlande, consolidée dans sa version actuelle le 11 juin 1999, dans son article 7, dispose que « chacun a droit à la vie ainsi qu’à la liberté, à l’inviolabilité et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine. » Le pays a aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires en 1949 et en toutes circonstances en 1972.
La Suède a aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires en 1921 et pour tous les crimes en 1972. Elle l’a inscrit, en 1976, dans la Constitution du 28 février 1974. L’article 4 proclame qu’« aucune condamnation à la peine capitale ne peut être prononcée ».
Le Portugal, dès sa sortie de la dictature, proclame dans l’article 24 de la Constitution du 2 avril 1976 que « la vie humaine est inviolable » et que « la peine de mort n’existe en aucun cas ».
La Constitution de la République d’Islande du 23 mai 1944 et amendée en 1995 prévoit, dans son article 69, que « la peine de mort ne peut jamais être prescrite par la loi ».
La Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983, dans son article 114, affirme que « la condamnation à mort ne peut être infligée ». Les Pays-Bas ont aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires depuis 1870 et en toutes circonstances depuis 1982.
La Croatie a aboli la peine de mort pour tous les crimes en 1990. La Constitution de décembre 1990 prévoit ainsi, dans son article 21 que « tout être humain a droit à la vie. En République de Croatie, la peine de mort n’existe pas ». Par ailleurs, l’article 17 affirme que les dispositions constitutionnelles qui touchent au droit à la vie sont exclues de celles que le Parlement peut suspendre en temps de guerre ou en cas de péril grave pour le pays.
La Roumanie a aboli la peine de mort en 1989. La Constitution du 8 décembre 1991 prévoit, dans son article 22, paragraphe 3, que « la peine de mort est interdite ».
La Slovénie, devenue indépendante en 1991, a aboli la peine de mort pour tous les crimes en 1989, alors qu’elle était encore membre de la République Fédérale Socialiste de Yougoslavie. La Constitution du 23 décembre 1991 dispose, dans son article 17, que « la vie humaine est inviolable. En Slovénie, la peine de mort n’existe pas. »
La République tchécoslovaque libérée déclare, dès 1990, son abolitionnisme dans sa Constitution. Les deux États qui en sont issus ont conservé cette option. Ainsi, la Constitution de la Slovaquie, adoptée le 1er septembre 1992, dispose, dans son article 15, que « la peine capitale n’est pas permise ». La Constitution de la République tchèque du 16 décembre 1992, dans son article 3, affirme que la Charte des droits et libertés fondamentaux, qui avait été adoptée par l’Assemblée fédérale de la République fédérative tchèque et slovaque, le 9 janvier 1991, est partie intégrante de son ordre constitutionnel. Celle-ci, dans son article 6, proclame que « la peine de mort est inadmissible ».
La Constitution du Luxembourg, entrée en vigueur le 17 octobre 1868, amendée le 29 avril 1999, précise, dans son article 18, que « la peine de mort ne peut pas être introduite ». Le pays avait aboli celle-ci en 1979.
L’Irlande a aboli la peine de mort en 1990. Depuis le référendum de 2001, la Constitution du 1er juillet 1937 a été amendée pour interdire la peine de mort. L’article 15, paragraphe 5, tel que modifié par le vingt et unième amendement promulgué le 27 mars 2002, proclame désormais que « le Parlement ne peut adopter de loi prévoyant l’application de la peine de mort ».
L’Italie, dans sa Constitution du 27 décembre 1947, a aboli, à l’article 27, la peine de mort pour les seuls crimes ordinaires : « La peine de mort n’est pas admise, sauf dans les cas prévus par les lois militaires en temps de guerre ». Par ailleurs, la peine de mort a été abolie du code militaire grâce à la loi ordinaire d’octobre 1994. Un projet de loi constitutionnelle est actuellement en examen au Parlement italien pour abolir la peine de mort en toutes circonstances dans la Constitution par suppression de l’exception des cas prévus par les lois militaires en temps de guerre. Il a été adopté, en première lecture, par la Chambre des Députés, le 10 octobre 2006.
Par ailleurs, plusieurs cours constitutionnelles européennes ont été amenées à interpréter la loi fondamentale de leur pays dans le sens de l’abolition de la peine de mort. Par exemple, dès le 24 octobre 1990, la Cour constitutionnelle hongroise a estimé que la peine de mort violait le « droit inhérent à la vie et à la dignité humaine » défini par l’article 54 de la nouvelle Constitution du pays. Par cette décision, la peine capitale a été abolie pour tous les crimes en Hongrie.
Selon le même processus, le 9 décembre 1998, la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a déclaré que la peine de mort pour meurtre, telle que prévue par le code pénal, n’était pas conforme aux dispositions de la Constitution affirmant que le droit à la vie est protégé par la loi et interdisant la torture, les blessures, la dégradation, les mauvais traitements et l’établissement de semblables châtiments.
De la même façon, le 29 décembre 1999, la Cour constitutionnelle d’Ukraine a relevé que la peine de mort n’était pas compatible avec les articles de la Constitution affirmant le droit à la vie et interdisant la torture et les traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants violant la dignité personnelle. Elle a noté qu’à la différence du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Constitution de l’Ukraine ne prévoit pas explicitement la peine de mort comme exception au droit à la vie. Il faut rappeler qu’auparavant le pays avait été menacé d’expulsion du Conseil de l’Europe parce qu’il continuait à pratiquer clandestinement des exécutions. Depuis, l’Ukraine a ratifié le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (88).
Au-delà même du continent européen, plusieurs grands pays ont intégré l’abolition de la peine de mort dans leurs normes constitutionnelles, à l’exemple du Mexique qui a récemment révisé, le 9 décembre 2005, l’article 22 de sa Constitution pour proclamer cette abolition en toutes circonstances (89).
La loi n’a pas seulement une fonction technique et répressive mais aussi une fonction expressive, en ce sens qu’elle exprime ce que la conscience collective juge convenable. Cette fonction est assurée a fortiori par la norme constitutionnelle.
Proposée dans le présent projet de loi, l’inscription dans notre Constitution, dans un nouvel article 66-1, du principe selon lequel « nul ne peut être condamné à la peine de mort », participera de ce mouvement. Il fera ainsi suite à la protection de la liberté individuelle garantie par l’article 66, aux termes duquel « nul ne peut être arbitrairement détenu » et « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
Autorisée, c’est-à-dire « couverte », par le nouvel article 66-1, l’impossibilité de dénoncer le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort pourra être dépassée et le présent projet de loi constitutionnelle ouvrira à la France le verrou de la ratification et lui permettra de participer à cet instrument d’abolition universelle de la peine de mort. Les questions qui pouvaient demeurer quant à la compatibilité de l’abolition en toutes circonstances qui résulterait de la ratification du protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme avec l’article 16 de la Constitution trouveront également leur solution, sans contestation possible, dans l’adoption du présent projet de loi constitutionnelle. Ainsi, l’utilisation de l’article 16 de la Constitution – le pouvoir constituant doit être bien clair sur ce problème – ne pourra, en aucun cas, servir à rétablir la peine de mort, même de manière temporaire.
Le ralliement progressif de tous les États européens à l’abolition de la peine de mort, en toutes circonstances, au-delà même du protocole n° 13 à la Convention européenne des droits l’homme, tendra à faire de celle-ci une véritable norme coutumière régionale (90), ce qui rendra toute dénonciation ultérieure impossible, la coutume s’imposant alors. La France doit participer de ce mouvement.
Si l’irrévocabilité de l’abolition de la peine capitale pourrait résulter de la ratification du deuxième protocole facultatif de 1989 et surtout du protocole n° 13 de 2002, ratification permise et facilitée par le présent projet de loi constitutionnelle, elle ne saurait, en droit, résulter de son inscription dans la Constitution, mais directement de la règle « pacta sunt servanda », elle-même déjà inscrite dans notre Constitution (91).
En effet, si elle exige des règles de procédure particulières et une conjoncture politique elle-même particulière, la révision constitutionnelle reste, en théorie, toujours possible. Cette « malléabilité » permanente de la Constitution résulte très directement du caractère souverain du pouvoir constituant, en vertu duquel il peut défaire ce qu’il a fait, y compris revenir demain sur ce qu’il a proclamé irréversible hier. En toute hypothèse, le principe de souveraineté reste garanti par le présent projet de loi constitutionnelle et sa violation ne saurait, par conséquent, être invoquée à son encontre.
Ainsi, pour reprendre la formule du doyen Vedel, la souveraineté restera « à l’intérieur du territoire un pouvoir qui n’a point d’égaux, mais seulement des subordonnés ; à l’extérieur un pouvoir qui ne peut être lié que de son propre consentement » (92). Selon une formule proche, « le pouvoir souverain n’est pas en effet celui qui n’obéit à aucune règle, c’est celui qui ne se peut voir imposer de règles en dehors de son consentement » (93).
Le Conseil constitutionnel a validé l’hypothèse d’un pouvoir constituant souverain, susceptible d’adopter des dispositions qui pouvaient déroger explicitement ou implicitement à des normes constitutionnelles existantes.
Dans sa décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Traité sur l’Union européenne, dite « Maastricht II », il a ainsi estimé que « sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles “ la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ”, le pouvoir constituant est souverain », « qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée » et « qu’ainsi rien ne s’oppose à ce qu’il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle ; que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu’implicite ».
En 1862, Victor Hugo, alors en exil, exclu de la France du Second Empire, écrit au pasteur Bost, à Genève, deux lettres où il appelle les auteurs de la nouvelle Constitution helvétique à proclamer l’abolition : « une Constitution qui, au XIXe siècle, contient une quantité quelconque de peine de mort n’est pas digne d’une République » (94). Au XXIe siècle, c’est une Constitution qui ne contiendrait pas l’interdiction de la peine de mort en toutes circonstances qui ne saurait être complètement digne d’une République.
À ceux qui estiment que cette inscription dans la Constitution est inutile, car le caractère irréversible de l’abolition serait manifeste, il faut rappeler les mots d’Arthur Koestler assimilant à une superstition la croyance dans l’efficacité de la peine de mort : « comme toutes les superstitions, elle participe de la nature du diable-dans-la-boîte : vous aurez beau refermer le couvercle, à coups de faits et de statistiques, le diable bondira pourtant de nouveau hors de sa boîte, parce que le ressort qui le pousse est le pouvoir inconscient et irrationnel des croyances traditionnelles » (95).
La révision constitutionnelle accompagnée de la ratification des protocoles n° 2 se rapportant au Pacte de 1966 et n° 13 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme consolidera le choix abolitionniste fait par le législateur national en 1981 et rangera au magasin de l’histoire la peine de mort, toujours synonyme de « défaite de l’humanité », de « réaction, et non dissuasion », d’« expression légalisée de l’instinct de mort », et constituant « partout et toujours le signe de la barbarie totalitaire », comme l’a écrit M. Robert Badinter en 2006 (96).
La Commission a examiné le présent projet de loi constitutionnelle au cours de sa réunion du mercredi 24 janvier 2007.
Après l’exposé du rapporteur, M. André Vallini a indiqué que le Groupe Socialiste apporterait un soutien résolu, total et enthousiaste à une initiative du Président de la République qui, au terme de son second mandat, n’est pas sans rappeler la manière dont François Mitterrand avait inauguré sa présidence, en 1981, par un geste symboliquement fort.
Le rapporteur s’est réjoui des propos de M. André Vallini et du soutien sans condition apporté par le Groupe Socialiste.
Puis la Commission est passée à l’examen de l’article unique du projet de loi constitutionnelle.
La Commission a été saisie de deux amendements de M. Richard Dell’Agnola, visant à prévoir une réserve à l’abolition de la peine de mort lorsque l’existence même de la Nation est menacée, pour le premier, et pour les auteurs de crimes de caractère militaire d’une gravité extrême et commis en temps de guerre, pour le second.
Leur auteur a fait valoir que le projet de loi constitutionnelle ne se contente pas de transposer l’abolition législative de la peine de mort, votée en 1981, en ce qu’il comporte des conséquences juridiques plus contraignantes pour la France.
Il a rappelé que, jusqu’à présent, la France n’a pas ratifié le protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit une abolition absolue, et que le deuxième protocole des Nations unies, dit de « New York », qui comporte quant à lui une réserve sur la peine de mort en temps de guerre, n’a pu en tout état de cause être ratifié parce que le Conseil constitutionnel l’a jugé contraire au principe constitutionnel de souveraineté. Il a souligné que les amendements qu’il présente ont pour objectif d’inscrire dans la Constitution les dérogations prévues par le protocole de New York, de manière à éviter, par exemple, qu’on puisse se trouver conduit à rencontrer dans la rue un criminel de guerre, tel Hitler, au terme de sa peine de prison, quelle que soit l’horreur des crimes dont il se serait rendu coupable à l’encontre de la société civile.
Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’adoption de ces deux amendements, pour des raisons juridiques et politiques.
Il a tout d’abord rappelé que si le deuxième protocole de New York prévoit effectivement une exception à l’abolition de la peine de mort pour les crimes particulièrement odieux en cas de guerre, cette exception ne peut entrer en vigueur qu’à la condition qu’une loi spécifique l’ait prévu antérieurement à la ratification du protocole.
Il a, en outre, ajouté qu’en adoptant les amendements proposés, le Parlement placerait la France dans l’impossibilité de ratifier le protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui abolit la peine de mort en toutes circonstances et a, ainsi, une portée plus générale. Or, alors que le Conseil constitutionnel a mis en évidence les atteintes que porte le protocole de New York à la souveraineté nationale, il n’a trouvé rien à « redire » à la compatibilité du protocole n° 13 avec la Constitution, car celui-ci, par renvoi de la Convention européenne, contient une clause de retrait.
Du point de vue pratique enfin, revenir à l’application de la peine de mort, après la ratification du protocole n° 13, nécessiterait, sans doute, de dénoncer la Convention elle-même.
Le rapporteur a ensuite souligné que le projet de loi constitutionnelle manifestait la volonté du pouvoir exécutif d’abolir la peine de mort d’une manière universelle. Il a rappelé que trente-sept États membres du Conseil de l’Europe ont ratifié le protocole n° 13, et que seulement sept, parmi lesquels figure la France, ne l’ont pas fait à ce jour. De surcroît, ceux qui n’ont pas procédé à cette ratification ont, pour certains, entamé un processus constitutionnel destiné à la permettre, à l’instar de l’Italie qui s’apprête à supprimer une réserve inscrite depuis 1947 dans sa loi fondamentale.
Par ailleurs, à l’exception de la France et de la Pologne, tous les pays de l’Union européenne ont ratifié le protocole de New York. En outre, seuls l’Azerbaïdjan et la Grèce ont maintenu des réserves. Par voie de conséquence, la France, pays des droits de l’homme, se trouve très en retard dans le processus de ratification de ces textes internationaux. Toute la question est de savoir si notre pays souhaite résolument abolir la peine de mort ou se distinguer par une réserve.
Le rapporteur s’est prononcé pour la première solution, considérant que le débat soulevé par les amendements en discussion n’avait qu’une portée théorique. En effet, les crimes les plus graves en période de guerre sont ceux qualifiés de crimes contre l’humanité, pour lesquels la Cour pénale internationale n’applique pas la peine de mort. Il n’est pas sûr, au demeurant, que la réserve proposée soit dissuasive pour des dictateurs, tel Hitler, dont l’histoire a démontré la détermination jusque dans leur issue fatale.
M. Xavier de Roux a observé que la convention de Genève, qui définit les crimes les plus graves, parmi lesquels le génocide, ne prévoit pas la peine de mort pour les sanctionner. Il a indiqué que les conventions internationales ayant institué le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie puis la Cour pénale internationale excluaient également la peine de mort contre les crimes les plus odieux, ce qui montre le cheminement accompli par la communauté internationale depuis les procès de Nuremberg et Tokyo, sans que cela ne l’empêche de juger efficacement des criminels qui ont commis des actes innommables.
M. Patrick Delnatte a estimé que les amendements soumis à l’examen de la Commission avaient pour conséquence de revenir insidieusement sur le principe de l’abolition de la peine de mort, tranché à la fois par le législateur et par les Français. Il s’est montré opposé au rétablissement indirect de cette peine, par le biais d’exceptions, en estimant que la barbarie ne saurait répondre à la barbarie et que la République disposait d’ores et déjà de réponses juridiques suffisantes contre les crimes les plus odieux.
M. Jérôme Lambert s’est déclaré ému de participer à cette ultime phase du débat sur l’abolition de la peine de mort en France, peine qu’il a qualifiée de sacrificielle et barbare. Il a estimé que la France doit être humaniste et faire respecter ses lois autrement que par la terreur qu’est supposée inspirer la peine de mort. L’expérience montre que cette dernière n’a jamais été dissuasive et qu’elle doit être abolie en toutes circonstances, ce qui ne saurait empêcher les États de se prémunir par un arsenal répressif à l’encontre des criminels en tous genres.
M. Jérôme Lambert s’est ensuite interrogé sur la pertinence d’une exception à l’abolition de la peine de mort en temps de guerre, estimant que les crimes commis en temps de paix, lorsqu’ils sont le fait du terrorisme de masse, peuvent être tout aussi odieux qu’en temps de guerre. Il en a conclu qu’il ne convenait pas de faire de différence et il a souligné la profonde évolution de la société sur le sujet depuis 1981.
M. Richard Dell’Agnola a précisé que son premier amendement visait justement à prévoir une exception pour les auteurs d’attentats terroristes mettant en cause l’existence de la Nation. Il a ensuite souligné que le deuxième protocole de New York distingue les crimes de guerre des crimes contre l’humanité, les premiers consistant en l’emploi d’armes interdites à l’encontre des civils.
Souhaitant dissiper tout malentendu et éviter les caricatures, il a indiqué qu’il ne pouvait être excipé de la réserve admise par le deuxième protocole de New York qu’avec l’accord de la communauté internationale. Sans nier que la peine de mort ne dissuade pas un apprenti dictateur de devenir tyran, il a observé que la peine d’emprisonnement à perpétuité n’existe actuellement pas en Europe, sa traduction pratique étant un enfermement pendant trente ans.
Il a ensuite relevé que le Conseil constitutionnel n’avait pas soulevé la nécessité d’une révision constitutionnelle pour ratifier le protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que le débat pouvait rester ouvert sur le projet de loi constitutionnelle.
Il a enfin estimé qu’en épargnant automatiquement la vie de ceux qui sont coupables de massacres, on n’accordait pas nécessairement beaucoup de valeur à la dignité humaine.
M. Christian Decocq a estimé que le débat sur ce projet de loi constitutionnelle constituait en soi un moment historique. Citant Condorcet, qui disait « Mes électeurs m’ont choisi pour mes idées, pas pour les leurs », il a souhaité exprimer son sentiment profond sur la question en adhérant aux propos du rapporteur. Il lui est apparu important de ne pas affaiblir la position de la France et s’est prononcé pour l’adoption tel quel de l’article unique du projet de loi constitutionnelle. Se rappelant que, dans les facultés de droit, avant 1981, la rédaction de l’article de l’ancien code pénal disposant que « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » était citée comme un exemple de concision juridique, il a considéré qu’une fois la loi constitutionnelle adoptée, les facultés pourront se référer au nouvel article 66-1, tout aussi concis et beaucoup plus beau dans sa substance.
M. Gérard Menuel a précisé qu’il avait vécu très directement le débat sur la peine de mort puisque, élu de Troyes, il connaissait bien les parents du petit Philippe Bertrand. Il a indiqué que la position du rapporteur confirmait sa conviction.
Le rapporteur a rappelé les propos tenus par M. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, le 17 septembre 1981 à l’Assemblée nationale : « Il se trouve que la France aura été en dépit de tant d’efforts courageux, l’un des derniers pays, presque le dernier – et je baisse la voix pour le dire – en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort ». Il a déduit de ces paroles la nécessité de ne pas nuire une fois de plus à l’image de la France, par l’adoption de réserves qui ne présentent aucun intérêt pratique et constitueraient un retour en arrière.
Il a fait valoir que l’abolition correspondait à un mouvement de fond affectant de nombreux pays européens et le monde entier, ce que notre pays ne peut ignorer. Il a ajouté qu’une phrase inscrite dans notre Constitution n’arrêterait certainement pas les terroristes, la véritable solution à ce fléau résidant dans le développement du renseignement.
Il a enfin fait observer que des criminels reconnus coupables de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale avaient peu de chance de bénéficier d’une libération anticipée, dès lors que les statuts de la Cour prévoient explicitement une peine à perpétuité en cas de crimes d’une extrême gravité et lorsque la situation du condamné le justifie.
M. Richard Dell’Agnola a affirmé que la peine à perpétuité n’existe pas. Il a ensuite regretté que l’on refuse de condamner un criminel de guerre à mort, alors que l’on admet intellectuellement la guerre et les morts de civils qu’elle cause.
M. Xavier de Roux a précisé que la Cour pénale internationale prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération anticipée, de sorte que l’affirmation de l’inexistence de la perpétuité est erronée.
La Commission a alors rejeté les deux amendements.
Elle a ensuite adopté l’article unique du projet de loi constitutionnelle sans modification.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter sans modification le projet de loi constitutionnelle (n° 3596), relatif à l’interdiction de la peine de mort.
___
Texte du projet de loi constitutionnelle ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Article unique |
Article unique |
Il est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
« Art. 66-1. — Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » |
ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE
Pages
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 58
Art. 2, 15, 57 et 58.
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort 59
Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances 62
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 65
Art. 6 et 14.
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort 67
Décision du Conseil constitutionnel n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005 71
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Art. 2. — Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Art. 15. — Dérogation en cas d’état d’urgence
1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la Nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le secrétaire général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Art. 57. — Réserves
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
Art. 58. — Dénonciation
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe.
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l’article 56.
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort,
tel qu’amendé par le Protocole n° 11
Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance générale en faveur de l’abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. — Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Art. 2. — Peine de mort en temps de guerre
Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au secrétaire général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Art. 3. — Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
Art. 4. — Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent protocole en vertu de l’article 57 de la Convention.
Art. 5. — Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Art. 6. — Relations avec la Convention
Les États Parties considèrent les articles 1er à 5 du présent protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
Art. 7. — Signature et ratification
Le présent protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Art. 8. — Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le protocole conformément aux dispositions de l’article 7.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 9. — Fonctions du dépositaire
Le secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à ses articles 5 et 8 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.
ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE | |||
États |
Signature |
Ratification |
Entrée en vigueur |
Albanie |
4 avril 2000 |
21 septembre 2000 |
1er octobre 2000 |
Allemagne |
28 avril 1983 |
5 juillet 1989 |
1er août 1989 |
Andorre |
22 janvier 1996 |
22 janvier 1996 |
1er février 1996 |
Arménie |
25 janvier 2001 |
29 septembre 2003 |
1er octobre 2003 |
Autriche |
28 avril 1983 |
5 janvier 1984 |
1er mars 1985 |
Azerbaïdjan |
25 janvier 2001 |
15 avril 2002 |
1er mai 2002 |
Belgique |
28 avril 1983 |
10 décembre 1998 |
1er janvier 1999 |
Bosnie-Herzégovine |
24 avril 2002 |
12 juillet 2002 |
1er août 2002 |
Bulgarie |
7 mai 1999 |
29 septembre 1999 |
1er octobre 1999 |
Chypre |
7 mai 1999 |
19 janvier 2000 |
1er février 2000 |
Croatie |
6 novembre 1996 |
5 novembre 1997 |
1er décembre 1997 |
Danemark |
28 avril 1983 |
1 décembre 1983 |
1er mars 1985 |
Espagne |
28 avril 1983 |
14 janvier 1985 |
1er mars 1985 |
Estonie |
14 mai 1993 |
17 avril 1998 |
1er mai 1998 |
Finlande |
5 mai 1989 |
10 mai 1990 |
1er juin 1990 |
France |
28 avril 1983 |
17 février 1986 |
1er mars 1986 |
Géorgie |
17 juin 1999 |
13 avril 2000 |
1er mai 2000 |
Grèce |
2 mai 1983 |
8 septembre 1998 |
1er octobre 1998 |
Hongrie |
6 novembre 1990 |
5 novembre 1992 |
1er décembre 1992 |
Irlande |
24 juin 1994 |
24 juin 1994 |
1er juillet 1994 |
Islande |
24 avril 1985 |
22 mai 1987 |
1er juin 1987 |
Italie |
21 octobre 1983 |
29 décembre 1988 |
1er janvier 1989 |
Lettonie |
26 juin 1998 |
7 mai 1999 |
1er juin 1999 |
Liechtenstein |
15 novembre 1990 |
15 novembre 1990 |
1er décembre 1990 |
Lituanie |
18 janvier 1999 |
8 juillet 1999 |
1er août 1999 |
Luxembourg |
28 avril 1983 |
19 février 1985 |
1er mars 1985 |
Macédoine |
14 juin 1996 |
10 avril 1997 |
1er mai 1997 |
Malte |
26 mars 1991 |
26 mars 1991 |
1er avril 1991 |
Moldavie |
2 mai 1996 |
12 septembre 1997 |
1er octobre 1997 |
Monaco |
5 octobre 2004 |
30 novembre 2005 |
1er décembre 2005 |
Norvège |
28 avril 1983 |
25 octobre 1988 |
1er novembre 1988 |
Pays-Bas |
28 avril 1983 |
25 avril 1986 |
1er mai 1986 |
Pologne |
18 novembre 1999 |
30 octobre 2000 |
1er novembre 2000 |
Portugal |
28 avril 1983 |
2 octobre 1986 |
1er novembre 1986 |
République tchèque |
21 février 1991 |
18 mars 1992 |
1er janvier 1993 |
Roumanie |
15 décembre 1993 |
20 juin 1994 |
1er juillet 1994 |
Royaume-Uni |
27 janvier 1999 |
20 mai 1999 |
1er juin 1999 |
Russie |
16 avril 1997 |
— |
— |
Saint-Marin |
1 mars 1989 |
22 mars 1989 |
1er avril 1989 |
Serbie |
3 avril 2003 |
3 mars 2004 |
1er avril 2004 |
Slovaquie |
21 février 1991 |
18 mars 1992 |
1er janvier 1993 |
Slovénie |
14 mai 1993 |
28 juin 1994 |
1er juillet 1994 |
Suède |
28 avril 1983 |
9 février 1984 |
1er mars 1985 |
Suisse |
28 avril 1983 |
13 octobre 1987 |
1er novembre 1987 |
Turquie |
15 janvier 2003 |
12 novembre 2003 |
1er décembre 2003 |
Ukraine |
5 mai 1997 |
4 avril 2000 |
1er mai 2000 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications : |
1 |
Nombre total de ratifications/adhésions : |
45 |
Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort
en toutes circonstances
Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. — Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Art. 2. — Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
Art. 3. — Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent protocole au titre de l’article 57 de la Convention.
Art. 4. — Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Art. 5. — Relations avec la Convention
Les États Parties considèrent les articles 1er à 4 du présent protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
Art. 6. — Signature et ratification
Le présent protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Art. 7. — Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent protocole conformément aux dispositions de son article 6.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 8. — Fonctions du dépositaire
Le secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l’Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à ses articles 4 et 7 ;
d) tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.
ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE | |||
États |
Signature |
Ratification |
Entrée en vigueur |
Albanie |
26 mai 2003 |
— |
— |
Allemagne |
3 mai 2002 |
11 octobre 2004 |
1er février 2005 |
Andorre |
3 mai 2002 |
26 mars 2003 |
1er juillet 2003 |
Arménie |
19 mai 2006 |
||
Autriche |
3 mai 2002 |
12 janvier 2004 |
1er mai 2004 |
Azerbaïdjan |
— |
— |
— |
Belgique |
3 mai 2002 |
23 juin 2003 |
1er octobre 2003 |
Bosnie-Herzégovine |
3 mai 2002 |
29 juillet 2003 |
1er novembre 2003 |
Bulgarie |
21 novembre 2002 |
13 février 2003 |
1er juillet 2003 |
Chypre |
3 mai 2002 |
12 mars 2003 |
1er juillet 2003 |
Croatie |
3 juillet 2002 |
3 février 2003 |
1er juillet 2003 |
Danemark |
3 mai 2002 |
28 novembre 2002 |
1er juillet 2003 |
Espagne |
3 mai 2002 |
— |
— |
Estonie |
3 mai 2002 |
25 février 2004 |
1er juin 2004 |
Finlande |
3 mai 2002 |
29 novembre 2004 |
1er mars 2005 |
France |
3 mai 2002 |
— |
— |
Géorgie |
3 mai 2002 |
22 mai 2003 |
1er septembre 2003 |
Grèce |
3 mai 2002 |
1 février 2005 |
1er juin 2005 |
Hongrie |
3 mai 2002 |
16 juillet 2003 |
1er novembre 2003 |
Irlande |
3 mai 2002 |
3 mai 2002 |
1er juillet 2003 |
Islande |
3 mai 2002 |
10 novembre 2004 |
1er mars 2005 |
Italie |
3 mai 2002 |
— |
— |
Lettonie |
3 mai 2002 |
— |
— |
Liechtenstein |
3 mai 2002 |
5 décembre 2002 |
1er juillet 2003 |
Lituanie |
3 mai 2002 |
29 janvier 2004 |
1er mai 2004 |
Luxembourg |
3 mai 2002 |
21 mars 2006 |
1er juillet 2006 |
Macédoine |
3 mai 2002 |
13 juillet 2004 |
1er novembre 2004 |
Malte |
3 mai 2002 |
3 mai 2002 |
1er juillet 2003 |
Moldavie |
3 mai 2002 |
18 octobre 2006 |
1er février 2007 |
Monaco |
5 octobre 2004 |
30 novembre 2005 |
1ermars 2006 |
Norvège |
3 mai 2002 |
16 août 2005 |
1er décembre 2005 |
Pays-Bas |
3 mai 2002 |
10 février 2006 |
1er juin 2006 |
Pologne |
3 mai 2002 |
— |
— |
Portugal |
3 mai 2002 |
3 octobre 2003 |
1er février 2004 |
République tchèque |
3 mai 2002 |
2 juillet 2004 |
1er novembre 2004 |
Roumanie |
3 mai 2002 |
7 avril 2003 |
1er août 2003 |
Royaume-Uni |
3 mai 2002 |
10 octobre 2003 |
1er février 2004 |
Russie |
— |
— |
— |
Saint-Marin |
3 mai 2002 |
25 avril 2003 |
1er août 2003 |
Serbie |
3 avril 2003 |
3 mars 2004 |
1er juillet 2004 |
Slovaquie |
24 juillet 2002 |
18 août 2005 |
1er décembre 2005 |
Slovénie |
3 mai 2002 |
4 décembre 2003 |
1er avril 2004 |
Suède |
3 mai 2002 |
22 avril 2003 |
1er août 2003 |
Suisse |
3 mai 2002 |
3 mai 2002 |
1er juillet 2003 |
Turquie |
9 janvier 2004 |
20 février 2006 |
1er juin 2006 |
Ukraine |
3 mai 2002 |
11 mars 2003 |
1er juillet 2003 |
Nombre total de signatures non suivies de ratifications : |
7 |
Nombre total de ratifications/adhésions : |
37 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Art. 6. — 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un État partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
Art. 14. — 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;
c) À être jugée sans retard excessif ;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
f) À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
Les États parties au présent protocole,
Convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l’homme,
Rappelant l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,
Notant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent protocole, l’engagement international d’abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. — 1. Aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie au présent protocole ne sera exécutée.
2. Chaque État partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Art. 2. — 1. Il ne sera admis aucune réserve au présent protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.
2. L’État partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre.
3. L’État partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies la proclamation ou la levée de l’état de guerre sur son territoire.
Art. 3. — Les États parties au présent protocole feront état, dans les rapports qu’ils présentent au Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 40 du Pacte, des mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet au présent protocole.
Art. 4. — En ce qui concerne les États parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations s’étend aux dispositions du présent protocole, à moins que l’État partie en cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.
Art. 5. — En ce qui concerne les États parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s’étend aux dispositions du présent protocole, à moins que l’État partie en cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.
Art. 6. — 1. Les dispositions du présent protocole s’appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.
2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l’article 2 du présent protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l’article 1er du présent protocole ne peut faire l’objet d’aucune des dérogations visées à l’article 4 du Pacte.
Art. 7. — 1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé le Pacte.
2. Le présent protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
3 Le présent protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies informera tous les États qui ont signé le présent protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 8. — 1. Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 9. — Les dispositions du présent protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.
Art. 10. — Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies informera tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte :
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l’article 2 du présent protocole ;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent protocole ;
c) Des signatures apposées au présent protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 7 du présent protocole ;
d) De la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément à l’article 8 de celui-ci.
Art. 11. — 1. Le présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies transmettra une copie certifiée conforme du présent protocole à tous les États visés à l’article 48 du Pacte.
Entrée en vigueur : |
11 juillet 1991, conformément au paragraphe 1 de l’article 8. |
Enregistrement : |
11 juillet 1991, N° 14668. |
État : |
Signataires : 35 ; Parties : 60. |
Texte : |
Nations unies, Recueil des Traités, vol. 1642, p. 414. |
Participant |
Signature |
Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
Afrique du Sud |
— |
28 août 2002 (a) |
Allemagne |
13 février 1990 |
18 août 1992 |
Andorre |
5 août 2002 |
22 septembre 2006 |
Argentine |
20 décembre 2006 |
— |
Australie |
— |
2 octobre 1990 (a) |
Autriche |
8 avril 1991 |
2 mars 1993 |
Azerbaïdjan |
— |
22 janvier 1999 (a) |
Belgique |
12 juillet 1990 |
8 décembre 1998 |
Bosnie-Herzégovine |
7 septembre 2000 |
16 mars 2001 |
Bulgarie |
11 mars 1999 |
10 août 1999 |
Canada |
— |
25 novembre 2005 (a) |
Cap-Vert |
— |
19 mai 2000 (a) |
Chili |
15 novembre 2001 |
— |
Chypre |
— |
10 septembre 1999 (a) |
Colombie |
— |
5 août 1997 (a) |
Costa Rica |
14 février 1990 |
5 juin 1998 |
Croatie |
— |
12 octobre 1995 (a) |
Danemark |
13 février 1990 |
24 février 1994 |
Djibouti |
— |
5 novembre 2002 (a) |
Équateur |
— |
23 février 1993 (a) |
Espagne |
23 février 1990 |
11 avril 1991 |
Estonie |
— |
30 janvier 2004 (a) |
Finlande |
13 février 1990 |
4 avril 1991 |
Géorgie |
— |
22 mars 1999 (a) |
Grèce |
— |
5 mai 1997 (a) |
Guinée-Bissau |
12 septembre 2000 |
|
Honduras |
10 mai 1990 |
|
Hongrie |
— |
24 février 1994 (a) |
Irlande |
— |
18 juin 1993 (a) |
Islande |
30 janvier 1991 |
2 avril 1991 |
Italie |
13 février 1990 |
14 février 1995 |
Liberia |
— |
16 septembre 2005 (a) |
Liechtenstein |
— |
10 décembre 1998 (a) |
Lituanie |
8 septembre 2000 |
27 mars 2002 |
Luxembourg |
13 février 1990 |
12 février 1992 |
Macédoine |
— |
26 janvier 1995 (a) |
Malte |
— |
29 décembre 1994 (a) |
Moldavie |
— |
20 septembre 2006 (a) |
Monaco |
— |
28 mars 2000 (a) |
Monténégro |
— |
23 octobre 2006 (d) |
Mozambique |
— |
21 juillet 1993 (a) |
Namibie |
— |
28 novembre 1994 (a) |
Népal |
— |
4 mars 1998 (a) |
Nicaragua |
21 février 1990 |
|
Norvège |
13 février 1990 |
5 septembre 1991 |
Nouvelle-Zélande |
22 février 1990 |
22 février 1990 |
Panama |
— |
21 janvier 1993 (a) |
Paraguay |
— |
18 août 2003 (a) |
Pays-Bas |
9 août 1990 |
26 mars 1991 |
Philippines |
20 septembre 2006 |
|
Pologne |
21 mars 2000 |
|
Portugal |
13 février 1990 |
17 octobre 1990 |
République tchèque |
— |
15 juin 2004 (a) |
Roumanie |
15 mars 1990 |
27 février 1991 |
Royaume-Uni |
31 mars 1999 |
10 décembre 1999 |
Saint-Marin |
26 septembre 2003 |
17 août 2004 |
Sao Tomé-et-Principe |
6 septembre 2000 |
|
Serbie |
— |
6 septembre 2001 (a) |
Seychelles |
— |
15 décembre 1994 (a) |
Slovaquie |
22 septembre 1998 |
22 juin 1999 |
Slovénie |
14 septembre 1993 |
10 mars 1994 |
Suède |
13 février 1990 |
11 mai 1990 |
Suisse |
— |
16 juin 1994 (a) |
Timor oriental |
— |
18 septembre 2003 (a) |
Turkménistan |
— |
11 janvier 2000 (a) |
Turquie |
6 avril 2004 |
2 mars 2006 |
Uruguay |
13 février 1990 |
21 janvier 1993 |
Venezuela |
7 juin 1990 |
22 février 1993 |
Décision du Conseil constitutionnel n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2005, par le Président de la République, en application de l’article 54 de la Constitution, de la question de savoir si doivent être précédées d’une révision de la Constitution les autorisations de ratifier :
— le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989,
— le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté à Vilnius le 3 mai 2002 ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales abolit la peine de mort en toutes circonstances ;
2. Considérant que le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule qu’« aucune personne... ne sera exécutée » et oblige tout État partie à abolir la peine de mort ; qu’il ne permet de déroger à cette règle que pour les crimes de caractère militaire, d’une gravité extrême et commis en temps de guerre ; qu’en outre, cette faculté doit être fondée sur une législation en vigueur à la date de la ratification et avoir fait l’objet d’une réserve formulée lors de celle-ci ;
3. Considérant qu’au cas où un engagement international contient une clause contraire à la Constitution, met en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de le ratifier appelle une révision constitutionnelle ;
4. Considérant que les deux protocoles soumis à l’examen du Conseil constitutionnel ne contiennent aucune clause contraire à la Constitution et ne mettent pas en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ; que la question posée est donc celle de savoir s’ils portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ;
5. Considérant que porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale l’adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à celle-ci ;
6. Considérant que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il exclut toute dérogation ou réserve, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l’article 58 de cette Convention ; que, dès lors, il ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ;
7. Considérant, en revanche, que ne peut être dénoncé le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que cet engagement lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l’existence de la Nation ; qu’il porte dès lors atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale,
D É C I D E :
Article 1er. — Le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances n’est pas contraire à la Constitution.
Article 2. — L’autorisation de ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 3. — La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
ANNEXE II : LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE
ÉTATS ABOLITIONNISTES POUR TOUS LES CRIMES
Pays |
Abolition pour |
Abolition pour |
Dernière exécution |
Afrique du sud |
1997 |
1995 |
1991 |
Allemagne |
1987 |
|
|
Andorre |
1990 |
|
1943 |
Angola |
1992 |
|
|
Arménie |
2003 |
|
|
Australie |
1985 |
1984 |
1967 |
Autriche |
1968 |
1950 |
1950 |
Azerbaïdjan |
1998 |
|
1993 |
Belgique |
1996 |
|
1950 |
Bhoutan |
2004 |
|
1964 |
Bosnie-Herzégovine |
2001 |
1997 |
|
Bulgarie |
1998 |
|
1989 |
Cambodge |
1989 |
|
|
Canada |
1998 |
1976 |
1962 |
Cap-Vert |
1981 |
|
1835 |
Chypre |
2002 |
1983 |
1962 |
Colombie |
1910 |
|
1909 |
Costa Rica |
1877 |
|
|
Côte-d’Ivoire |
2000 |
|
|
Croatie |
1991 |
|
|
Danemark |
1978 |
1933 |
1950 |
Djibouti |
1995 |
|
1977 |
Équateur |
1906 |
|
|
Espagne |
1995 |
1978 |
1975 |
Estonie |
1998 |
|
1991 |
Finlande |
1972 |
1949 |
1944 |
France |
1981 |
|
1977 |
Géorgie |
1997 |
|
1994 |
Grèce |
2004 |
1993 |
1972 |
Guinée-Bissau |
1993 |
|
1986 |
Haïti |
1987 |
|
1972 |
Honduras |
1956 |
|
1940 |
Hongrie |
1990 |
|
1988 |
Îles Marshall |
|
|
1986 |
Îles Salomon |
|
1966 |
1966 |
Irlande |
1990 |
|
1954 |
Islande |
1928 |
|
1830 |
Italie |
1994 |
1947 |
1947 |
Kiribati |
|
|
1979 |
Liberia |
2005 |
|
|
Liechtenstein |
1987 |
|
1785 |
Lituanie |
1998 |
|
1995 |
Luxembourg |
1979 |
|
1949 |
Macédoine |
1991 |
|
|
Malte |
2000 |
1971 |
1943 |
Maurice |
1995 |
|
1987 |
Mexique |
2005 |
|
1937 |
Micronésie (États fédérés de) |
|
|
1986 |
Moldavie |
1995 |
|
|
Monaco |
1962 |
|
1847 |
Monténégro |
2002 |
|
|
Mozambique |
1990 |
|
1986 |
Namibie |
1990 |
|
1988 |
Népal |
1997 |
1990 |
1979 |
Nicaragua |
1979 |
|
1930 |
Nioué |
2004 |
|
|
Norvège |
1979 |
1905 |
1948 |
Nouvelle-Zélande |
1989 |
1961 |
1957 |
Palau |
|
|
|
Panama |
|
|
1903 |
Paraguay |
1992 |
|
1928 |
Pays-Bas |
1982 |
1870 |
1952 |
Philippines |
2006 |
|
1999 |
Pologne |
1997 |
|
1988 |
Portugal |
1976 |
1867 |
1849 |
République Dominicaine |
1966 |
|
|
République Tchèque |
1990 |
|
|
Roumanie |
1989 |
|
1989 |
Royaume-Uni |
1998 |
1973 |
1964 |
Saint-Marin |
1865 |
1848 |
1468 |
Saint-Siège |
1969 |
|
|
Samoa |
2004 |
|
|
Sao Tomé-et-Principe |
1990 |
|
1975 |
Sénégal |
2004 |
|
1967 |
Serbie |
2002 |
|
1992 |
Seychelles |
1993 |
|
1976 |
Slovaquie |
1990 |
|
|
Slovénie |
1989 |
|
|
Suède |
1972 |
1921 |
1910 |
Suisse |
1992 |
1942 |
1944 |
Timor oriental |
1999 |
|
|
Turquie |
2004 |
2002 |
1984 |
Turkménistan |
1999 |
|
|
Tuvalu |
|
|
1976 |
Ukraine |
1999 |
|
|
Uruguay |
1907 |
|
|
Vanuatu |
|
|
1980 |
Venezuela |
1863 |
||
Source : secrétariat général des Nations unies et Amnesty International. | |||
ÉTATS ET PAYS ABOLITIONNISTES POUR LES SEULS CRIMES DE DROIT COMMUN
Pays |
Date d’abolition pour les crimes de droit commun |
Date de la dernière exécution |
Albanie |
2000 |
|
Argentine |
1984 |
|
Bolivie (1) |
1997 |
|
Brésil |
1979 |
1855 |
Chili |
2001 |
1985 |
Fidji |
1979 |
1964 |
Îles Cook |
|
|
Israël |
1954 |
1962 |
Lettonie |
1999 |
1996 |
Pérou |
1979 |
1979 |
Salvador |
1983 |
1973 |
(1) Le secrétariat général des Nations unies considère, au contraire d’Amnesty International, que la Bolivie a aboli la peine de mort pour tous les crimes. | ||
Source : secrétariat général des Nations unies et Amnesty International. | ||
ÉTATS ABOLITIONNISTES DE FAIT
Pays |
Date de la dernière exécution |
Algérie |
1993 |
Bénin |
1987 |
Brunei |
1957 |
Burkina Faso |
1988 |
Congo (République du) |
1982 |
Gabon |
|
Gambie |
1981 |
Ghana |
1993 |
Grenade |
1978 |
Kenya |
1987 |
Kirghizstan |
1998 |
Madagascar |
1958 |
Malawi |
1992 |
Maldives |
1952 |
Mali |
1980 |
Maroc |
1993 |
Mauritanie |
1987 |
Myanmar (Birmanie) |
1993 |
Nauru |
1968 |
Niger |
1976 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
1950 |
République centrafricaine |
1981 |
Russie |
1996 |
Sri Lanka |
1976 |
Suriname |
1982 |
Swaziland |
1983 |
Togo |
1978 |
Tonga |
1982 |
Tunisie |
1991 |
Source : Amnesty International. | |
ÉTATS ET PAYS NON ABOLITIONNISTES
Kazakhstan | |
Antigua-et-Barbuda |
Koweït |
Arabie Saoudite |
Laos |
Autorité palestinienne |
Lesotho |
Bahamas |
Liban |
Bahreïn |
Libye |
Bangladesh |
Malaisie |
Barbade |
Mongolie |
Belize |
Nigeria |
Biélorussie (Belarus) |
Oman |
Botswana |
Ouganda |
Burundi |
Ouzbékistan |
Cameroun |
Pakistan |
Chine |
Qatar |
Comores |
République démocratique du Congo |
Corée du Nord |
Rwanda |
Corée du Sud |
Sainte-Lucie |
Cuba |
Saint-Christophe-et-Niévès |
Dominique |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Égypte |
Sierra Leone |
Émirats arabes unis |
Singapour |
Érythrée |
Somalie |
États-Unis |
Soudan |
Éthiopie |
Syrie |
Guatemala |
Tadjikistan |
Guinée |
Taïwan |
Guinée équatoriale |
Tanzanie |
Guyana |
Tchad |
Inde |
Thaïlande |
Indonésie |
Trinité-et-Tobago |
Irak |
Viêt-Nam |
Iran |
Yémen |
Jamaïque |
Zambie |
Japon |
Zimbabwe |
Jordanie |
|
Source : Amnesty International. |
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article unique
Amendements présentés par M. Richard Dell’Agnola :
• Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. 66-1. — Nul ne peut-être condamné à la peine de mort, à l’exception des auteurs de crimes de caractère militaire, d’une gravité extrême et commis en temps de guerre. »
• Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. 66-1. — Nul ne peut-être condamné à la peine de mort, sauf lorsque l’existence même de la Nation est menacée. »
© Assemblée nationale