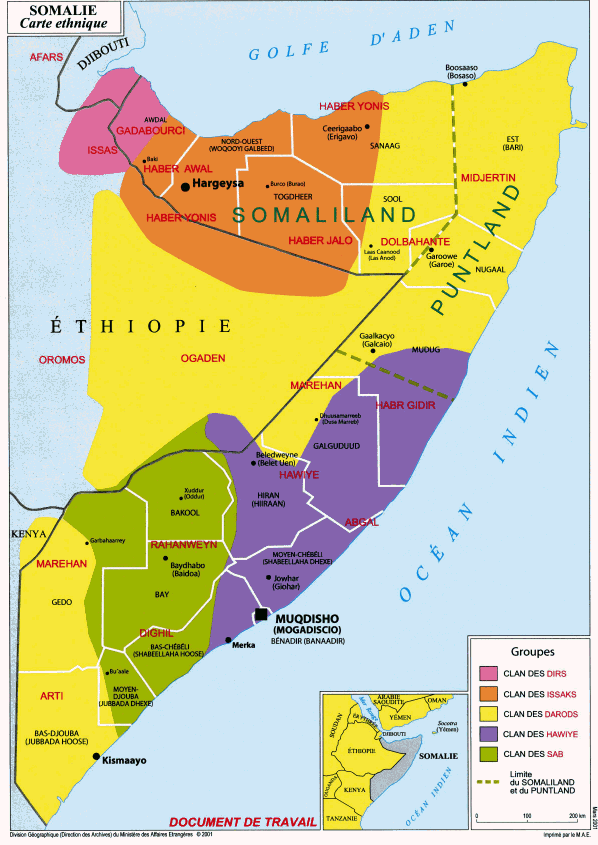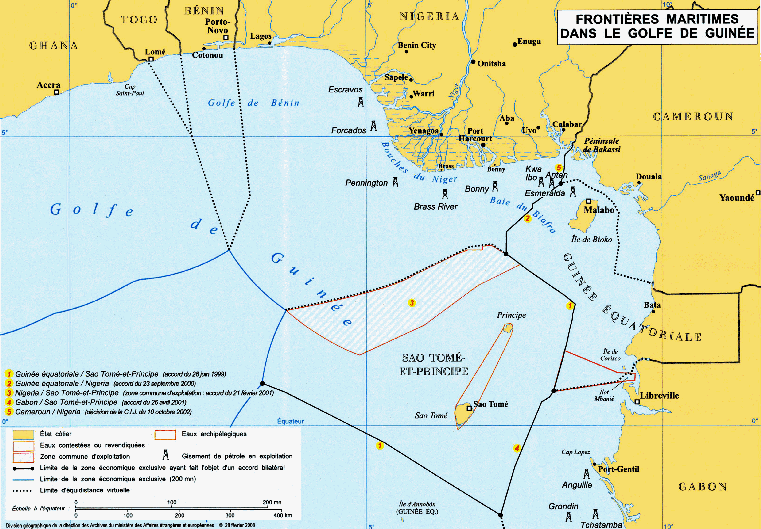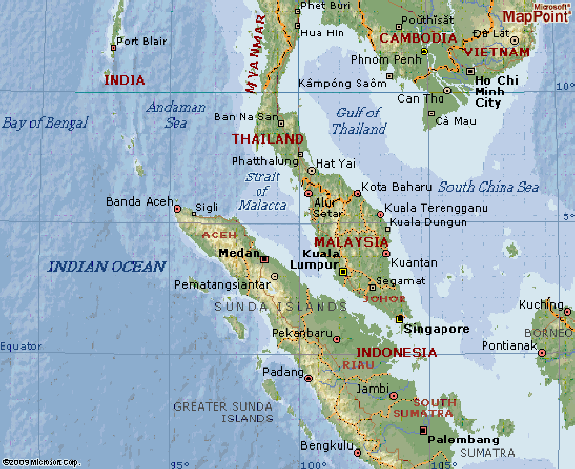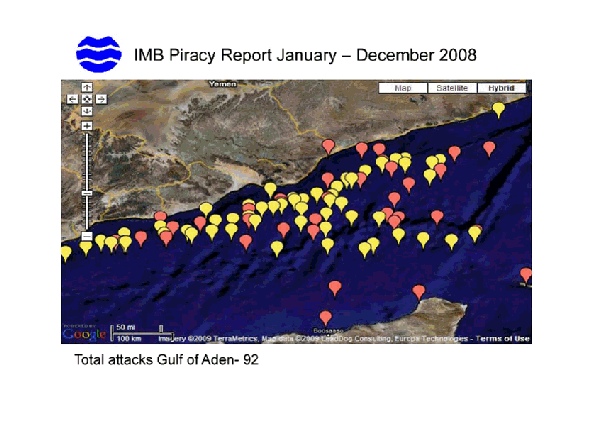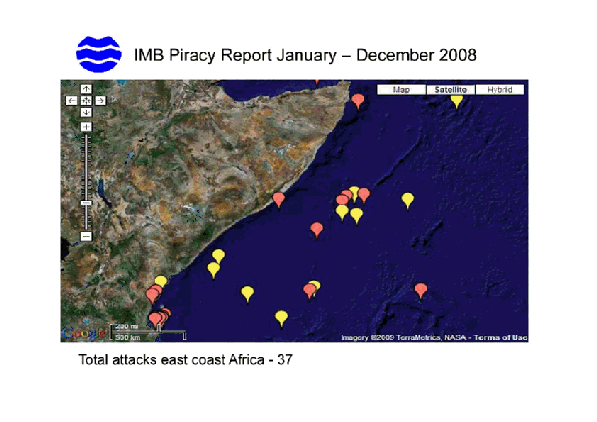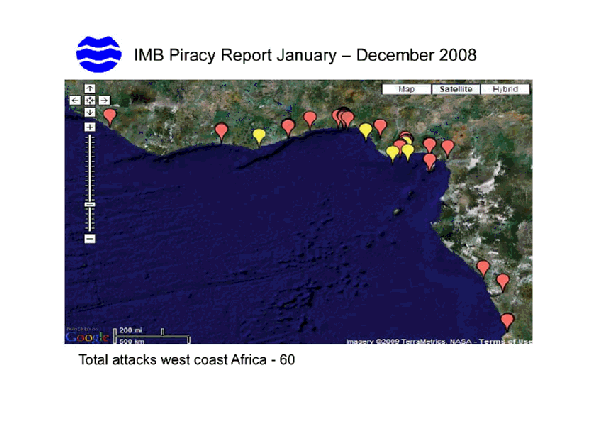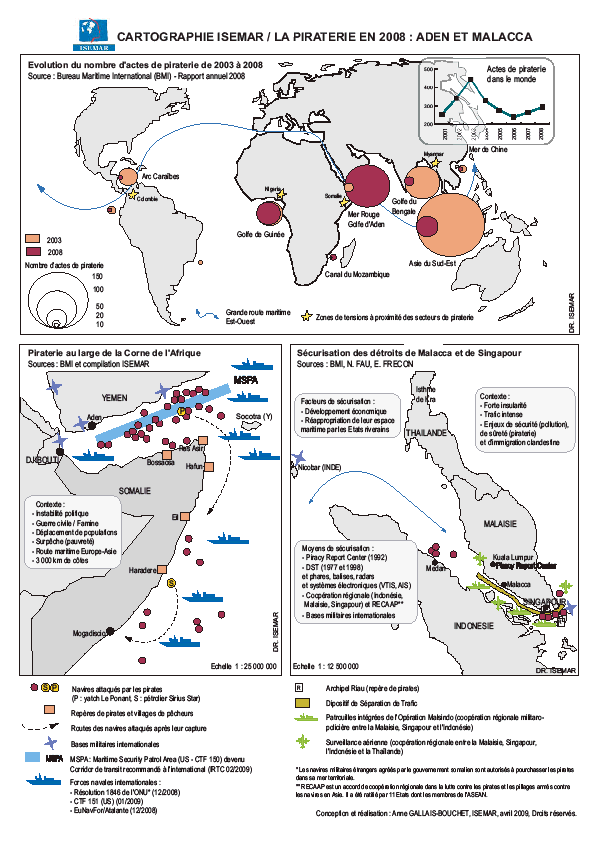N° 1670
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2009.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
sur la piraterie maritime
ET PRÉSENTÉ PAR
M. Christian MÉNARD,
Député.
——
S O M M A I R E
_____
Pages
INTRODUCTION 7
I. — LA PIRATERIE AU XXIE SIÈCLE : CE N’EST PAS DU CINÉMA ! 9
A. UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE 9
B. DES CAUSES DIVERSES 11
C. UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE 12
D. UNE RÉALITÉ MULTIPLE 14
1. Les principales zones à risque 14
a) Le golfe d’Aden 14
b) Le golfe de Guinée 16
c) Le détroit de Malacca 16
2. Modus operandi 17
3. Ce qu’est la piraterie… et ce qu’elle n’est pas 20
E. DES CONSÉQUENCES INDÉNIABLES 24
1. Un impact économique et financier variable 24
2. Un effet pour le moment limité sur le trafic maritime 26
II. — UN OBJET JURIDIQUE BIEN IDENTIFIÉ 29
A. EN DROIT INTERNATIONAL 29
1. Un cadre d’exception : le chapitre VII de la charte des Nations Unies 29
2. Le cadre de droit commun : la convention de Montego Bay 30
3. Un cadre subsidiaire : la convention de Rome 33
4. Le rôle de l’OMI 33
B. EN DROIT FRANÇAIS 36
1. Les incriminations utilisables 36
2. Le tribunal compétent 37
3. Les procédures applicables 37
III. — LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE : UNE RÉPLIQUE NÉCESSAIRE MAIS
INSUFFISANTE 41
A. UNE PRISE DE CONSCIENCE PROGRESSIVE 41
1. Le rôle moteur de la France 41
a) Une organisation ad hoc 41
b) Des compétences spécifiques 44
c) Un effort en matière d’information et de renseignement 46
d) Des initiatives précoces 47
2. L’implication du Conseil de sécurité des Nations Unies 49
3. L’intervention de l’Union européenne 51
B. LE GOLFE D’ADEN, THÉÂTRE D’UNE MOBILISATION GÉNÉRALE 54
1. Enduring Freedom et les CTF 150 et 151 54
2. La volonté d’implication de l’OTAN 55
3. L’afflux de forces navales sous pavillons nationaux 56
C. DIFFICULTÉS ET LIMITES 57
1. Une zone d’intervention mouvante et très étendue 57
2. De fortes interrogations juridiques 58
3. La concurrence opérationnelle : intérêts et limites 61
4. Quelle efficacité à long terme ? 63
IV. — POUR UNE RÉPONSE DURABLE : UN NOUVEAU PARTAGE DES
RESPONSABILITÉS 65
A. UNE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE SOLIDAIRE MAIS VIGILANTE 65
1. En Somalie 65
2. Plus généralement 73
B. DES PUISSANCES RÉGIONALES PROACTIVES 78
1. L’exemple du détroit de Malacca 78
2. Dans le golfe d’Aden et l’ouest de l’océan Indien 79
CONCLUSION 89
RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 91
EXAMEN EN COMMISSION 93
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 97
ANNEXES 103
I : CARTE DE LA SOMALIE 103
II : CARTE DU GOLFE DE GUINÉE 104
III : CARTE DU DÉTROIT DE MALACCA 105
IV : BMI : ATTAQUES 2008 DANS LE GOLFE D’ADEN 106
V : BMI : ATTAQUES 2008 – CÔTE EST DE L’AFRIQUE 107
VI : BMI : ATTAQUES 2008 DANS LE GOLFE DE GUINÉE 108
VII : ISEMAR : SYNTHÈSE SUR LA PIRATERIE EN 2008 109
VIII : CHARTE DES NATIONS UNIES – CHAPITRE VII 110
IX : CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DITE DE
MONTEGO BAY 113
X : LOI N°94-589 DU 15 JUILLET 1994 RELATIVE AUX MODALITÉS DE L'EXERCICE
PAR L'ÉTAT DE SES POUVOIRS DE POLICE EN MER 116
XI : CODE DE LA DÉFENSE (ARTICLES L. 1521-1 À L. 1521-10 : EXERCICE PAR
L'ÉTAT DE SES POUVOIRS DE POLICE EN MER) 123
Le 4 avril 2008, un grand voilier de croisière est bien malgré lui à l’honneur des journaux de 20 heures : transitant par le golfe d’Aden pour rejoindre sa zone d’activité de printemps, il a été abordé par un groupe de pirates qui a pris l’équipage en otage et réclame une rançon qui se chiffre en millions de dollars. Libéré quelques jours plus tard par une opération remarquable des forces françaises (commandos marine et GIGN), le Ponant révèle aux Occidentaux les menaces qui pèsent sur la liberté des mers dans cette région du globe, connue pour sa misère et son insécurité.
Depuis lors, la piraterie n’a plus quitté la une des médias et chaque semaine apporte son lot de nouvelles attaques. L’opinion publique s’émeut de l’audace des ces hors-la-loi, partagée entre l’étonnement de voir resurgir des pratiques qu’elle croyait réservées aux fictions sur grand écran et le scandale de constater que quelques « Gueux des mers » (1) peuvent tenir en échec les marines les plus sophistiquées du monde…
Pourtant, la piraterie n’est pas une nouveauté, y compris à l’époque contemporaine. Au début des années 2000, elle sévissait en mer de Chine et dans le détroit de Malacca, sans pour autant attirer l’attention des opinions occidentales. Aujourd’hui même, alors que tous les projecteurs sont braqués sur le golfe d’Aden et les côtes somaliennes, une piraterie bien plus dangereuse et violente touche les installations pétrolières du golfe de Guinée et des eaux nigérianes.
Grâce à une prise de conscience précoce des enjeux et des risques, la France a joué et joue toujours un rôle de premier plan dans la lutte contre la piraterie. De l’escorte des navires du programme alimentaire mondial (PAM), le long des côtes somaliennes, jusqu’à l’engagement de la première opération navale de l’Union européenne, notre pays a fortement contribué à la mobilisation de la communauté internationale sur ce sujet.
Au-delà de ses conséquences les plus directes, la piraterie a mis en évidence l’importance des enjeux de sûreté maritime, aux frontières de la défense et de la sécurité. Alors que plus de 90 % du commerce mondial transite aujourd’hui par la mer et que celle-ci constitue une formidable réserve de ressources, l’économie mondiale est désormais étroitement liée à la maîtrise du milieu marin et sous-marin. Il y a là un enjeu stratégique essentiel, souvent mal connu en France, puissance maritime qui s’ignore.
Au sein de cette problématique, la piraterie est l’exemple parfait de la menace asymétrique : elle provient de formations réduites, dotées de moyens légers et peu classiques et vise de gros bateaux, civils mais aussi parfois militaires. Conduite dans le golfe d’Aden avec des moyens dérisoires et un certain degré d’amateurisme, elle a eu un impact médiatique extraordinaire et généré une spectaculaire mobilisation de la communauté internationale, dans un relatif consensus.
La première réaction aux attaques de pirates a nécessairement été de nature militaire et navale, afin d’endiguer le péril et de protéger le plus directement possible les intérêts nationaux menacés. Pourtant, chacun s’accorde à dire que la piraterie n’est que le symptôme d’un mal beaucoup plus profond : la solution durable au problème est essentiellement politique et réside à terre, là où l’autorité des États riverains est défaillante et où la misère pousse les plus démunis à tenter d’attaquer la caravane qui croise à quelques milles (2) de leurs côtes…
*
Consciente de l’importance du phénomène de la piraterie et de ses enjeux en matière de sécurité mondiale et de sûreté maritime, la commission de la défense et des forces armées a décidé, le 28 mai 2008, de créer une mission d’information sur le sujet.
Au cours de dix mois d’auditions et de déplacements, le rapporteur s’est attaché à préciser les caractéristiques, les enjeux et les conséquences de ce phénomène et à étudier les capacités de réponses de la France, de l’Europe et de la communauté internationale, afin de proposer les orientations qui lui semblent les mieux à même d’apporter une réponse durable à cette résurgence d’une pratique millénaire.
*
Le rapporteur adresse ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qu’il a rencontrées, en audition et lors de ses déplacements, pour toutes les informations et observations qu’elles ont bien voulu lui communiquer.
I. — LA PIRATERIE AU XXIE SIÈCLE : CE N’EST PAS DU CINÉMA !
La piraterie est un phénomène très ancien, qui connaît une évolution sinusoïdale selon la capacité des États riverains à contrôler l’activité de la population sur ses côtes, et notamment des mouvements rebelles ou dissidents. L’importance des actes de brigandage est donc fortement liée à l’impuissance des États et de leurs marines. Les techniques d’attaque ont cependant évolué : auparavant, les pirates partaient de la côte et attaquaient les bateaux les plus proches. Aujourd’hui, ils s’avancent très loin en mer et piratent parfois un premier bâtiment pour parvenir à leur cible, car ils ne disposent pas en propre de bateaux suffisamment puissants pour affronter la haute mer.
L’activité maritime est clairement menacée par ces attaques, qui posent en outre un problème d’assurance pour la circulation dans les zones les plus dangereuses. Le principe séculaire de la liberté des mers se trouve à nouveau menacé, dans une époque où la mondialisation rend plus que jamais essentiel le trafic maritime.
Globalement, le nombre des attaques est en baisse mais les golfes d’Aden et de Guinée constituent deux zones « dures » où la violence des attaques augmente, ainsi que la durée de détournement et la professionnalisation des pirates. Au-delà des chiffres publiés par l’OMI et le BMI, qui peuvent varier selon la définition juridique retenue, la tendance est donc clairement à l’aggravation du phénomène.
Si l’on s’éloigne un tant soit peu des clichés hollywoodiens, les pirates, aujourd’hui, ne font plus rêver !
« La piraterie, tout comme le meurtre, est une des branches de l’activité humaine dont on trouve le plus tôt des traces dans l’histoire. Les références que l’on y voit coïncident avec les premières allusions aux voyages et au commerce. On peut admettre que très peu de temps après que les hommes eurent commencé à transporter des marchandises d’un lieu à un autre, il se révéla nombre d’hommes entreprenants qui trouvèrent profit à intercepter ces produits au cours de leur trajet. Le commerce suit l’implantation du pavillon ; et le pillage, que ce soit sur terre ou sur mer, suit le commerce. » (3).
De fait, la piraterie semble aussi ancienne que la navigation. Elle est apparue environ 5 000 ans avant J.-C. en Arabie (certaines cartes du golfe Persique font d’ailleurs mention d’une « côte des Pirates »).
Les mythes et légendes de l’antiquité, mais aussi les chroniques et écrits historiques, mentionnent régulièrement la présence de pirates dans le bassin méditerranéen. Les premières attaques datées remontent au VIIe siècle av. J.-C., en Méditerranée et sur la mer Égée. Sans compas pour se repérer, les navires marchands étaient alors contraints de longer les côtes, ce qui en faisait des proies faciles. Le commerce égyptien, crétois, phénicien, grec et romain est ainsi régulièrement détourné mais également les navires de passagers. Ainsi, en 78 av. J.-C., le jeune Jules César, banni de Rome par l’empereur Sylla, est capturé par des pirates en mer Égée. Il sera libéré après 38 jours de détention contre le versement d’une rançon de 50 talents d’or (somme énorme pour l’époque), avant de se retourner vers ses ravisseurs et de les exterminer !
À la fin de l’empire romain, la piraterie connaît un ralentissement parallèle à celui du commerce en Méditerranée. Avec les croisades, l’activité reprend et, à la Renaissance, les marchands génois, vénitiens, espagnols subissent régulièrement l’abordage des Barbaresques d’Afrique du nord. Un de leur chef, Barberousse, deviendra même roi d’Alger au XVIe siècle.
Avec la découverte des Amériques et le développement de nouvelles voies maritimes entre l’Europe et le Nouveau Monde, l’Atlantique va devenir, à partir du XVIe siècle, un nouveau foyer d’activité prospère pour les pirates, essentiellement français et anglais. Parallèlement, les conflits européens trouvent une traduction sur mer avec l’invention de la « guerre de course ».
« La course était une guerre navale menée par les armateurs privés et leur armement maritime, au nom et pour le compte de leur roi. Elle consistait à attaquer et, si possible, à s’emparer de la cargaison des navires marchands battant pavillon d’une puissance ennemie déclarée pour détruire son commerce maritime et ses approvisionnements, tout en enrichissant la puissance qui effectuait la prise. Pour qu’une guerre de course fût licite, elle devait être fondée sur des " lettres de marque " royales et respecter l’objectif fixé par elles. Elles autorisaient en effet son porteur à s’attaquer exclusivement aux navires d’un pavillon ennemi […]. C’est ainsi que le corsaire était différencié du pirate. Il était, en quelque sorte, un auxiliaire de la marine officielle. » (4). La guerre de course connaîtra un âge d’or au XVIIIe siècle et ne sera abolie qu’au milieu du XIXe siècle.
Durant plusieurs siècles, la seule réponse que les États pouvaient alors opposer aux corsaires et aux pirates (aux méthodes tout à fait ressemblantes…) était la formation de convois de navires marchands escortés par des vaisseaux de guerre. Au début du XIXe siècle, Thomas Jefferson, président de la jeune nation américaine, tente, sans succès, de monter une intervention collective des puissances européennes pour faire cesser les attaques barbaresques en Méditerranée. Cette incapacité des puissances du vieux continent à s’entendre pour lutter contre une menace commune conduira les États-Unis à effectuer en 1821 leur première intervention au Proche-Orient : « …les trois premiers bâtiments de guerre de l’US Navy qui venait d’être créée […] traversèrent l’Atlantique, bombardèrent Tripoli et firent cesser la piraterie barbaresque. Du fait de la détermination de Jefferson, les États-Unis prenaient la décision d’intervenir hors de leur zone d’influence pour régler un problème que les puissances européennes avaient été incapables de traiter. » (5).
Le 16 avril 1856, les nations européennes s’accordent enfin pour proclamer, dans la Déclaration de Paris, la fin de la guerre de course. Celle-ci ne signifiant cependant pas la fin de la piraterie, les États-Unis (ainsi que le Mexique et l’Espagne) ayant refusé de s’associer formellement à cet engagement international, de peur que la fin de la guerre de course ne permette pas à une nation dépourvue d’une marine puissante d’assurer sa défense en mer.
Ainsi, même si l’US Navy est depuis longtemps devenue la première force navale du monde, le Congrès des États-Unis dispose toujours aujourd’hui de la possibilité, selon la constitution américaine, « d’accorder des lettres de marque et de représailles, et d’établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer […] ».
Face à la résurgence actuelle de la piraterie, l’histoire enseigne que plusieurs réponses sont possible : les convois escortés, l’opération militaire, isolée ou collective, l’action diplomatique ou encore la guerre de course…
De façon assez schématique, trois conditions sont nécessaires pour permettre le développement de la piraterie :
– un positionnement géographique propice (golfe, détroit, côtes désertiques ou découpées, mangroves, archipel) sur un point maritime de passage de richesses ;
– une instabilité politique ou une autorité publique défaillante (État faible ou corrompu) ;
– une population pauvre habituée à aller en mer (typiquement : des pêcheurs).
Un ensemble de facteurs plus conjoncturels permettent ensuite de comprendre comment une tradition préexistante peut être réactivée. Parmi ces facteurs, on peut noter que, depuis la fin de la guerre froide, la présence navale soviétique, et en conséquence américaine, sur les mers du globe ont fortement diminué, alors même qu’une richesse croissante circulait sur les océans, la mondialisation ayant entraîné une explosion du trafic maritime. D’autres facteurs liés à la modernisation du commerce par mer, comme le développement des porte-containers et la réduction du nombre des membres d’équipages, s’ils permettent de réaliser des économies, renforcent également la vulnérabilité des bateaux et de leurs cargaisons. Enfin, la chute de l’empire soviétique et la multiplication des conflits régionaux dans les années 90 ont entraîné la prolifération d’armes à bon marché dont le commerce prospère est aussi un des visages de la globalisation.
Le Bureau maritime international (BMI – IMB en anglais) est une division spécialisée de la Chambre de commerce internationale (ICC) créée en 1981 pour participer à la lutte contre tous les types de crimes et délits maritimes. En 1992, en réaction à la hausse alarmante des actes de piraterie sur les mers du globe, le BMI a créé à Kuala Lumpur, en Malaisie, un centre de suivi de la piraterie (Piracy Reporting Center) chargé de recenser les actes de piraterie et les attaques à main armée déclarés par les navires de commerce, d’alerter les autorités publiques sur ces attaques et d’assister les autorités locales dans leur lutte contre la piraterie, d’aider les armateurs et les équipages victimes d’attaques et de publier des informations sur la piraterie dans le monde.
Le nombre réel d’attaques est cependant difficile à évaluer car il existe tout à la fois des fausses alertes (par des cargos simplement effrayés par des manifestations « musclées » de pêcheurs dont ils dérangent les filets) et des actes non signalés (par des navires régulièrement piratés pour des rançons peu élevées ou utilisés comme « bateaux mères » par des pirates cherchant à atteindre leur cible). En outre, le BMI ne fait pas de distinction entre les attaques perpétrées en haute mer et celles intervenant dans les eaux territoriales, alors que ces dernières, d’un point de vue juridique, ne constituent pas des attaques de piraterie mais des actes de brigandage, assimilables la plupart du temps à des attaques à main armée.
Les statistiques et les cartes publiées par l’IMB (6) constituent néanmoins une référence précieuse pour la connaissance du phénomène de la piraterie et de son évolution dans le temps et dans l’espace. Le tableau ci-après reprend les principaux chiffres relevés par le BMI depuis 2003, ce qui permet de dresser un constat nuancé de l’évolution quantitative de la piraterie. En effet, si le nombre global des attaques a baissé entre 2003 et 2007, une nette remontée peut être observée depuis cette date, en raison d’un fort accroissement des attaques en Somalie et dans le golfe d’Aden mais également au large du Nigeria.
– Bilan des actes de piraterie perpétrés dans le monde – | ||||||
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
Total des attaques |
445 |
329 |
276 |
239 |
263 |
293 |
dont : |
||||||
- Indonésie |
121 |
94 |
79 |
50 |
43 |
28 |
- détroit de Malacca |
28 |
38 |
12 |
11 |
7 |
2 |
- Nigeria |
39 |
28 |
16 |
12 |
42 |
40 |
- golfe d’Aden |
18 |
8 |
10 |
10 |
13 |
92 |
- Somalie |
3 |
2 |
35 |
10 |
31 |
19 |
Source : BMI – Rapport sur la piraterie maritime - 2008 | ||||||
Ainsi en 2008, selon le rapport du BMI publié en janvier 2009, 293 navires ont subi des attaques et 49 navires ont été capturés. 889 marins ont été pris en otage, 11 ont été tués et 21 sont portés disparus ou présumés morts. L’essentiel de ce bilan s’est réalisé au large de la Somalie (cf. annexes IV et V) : 111 attaques (+ 200 %), avec 42 vaisseaux capturés et 815 marins retenus en otage. Toujours selon le rapport, 13 navires, avec 242 marins, étaient toujours aux mains des pirates début 2009.
Deuxième zone la plus touchée, les eaux nigérianes, avec 40 attaques, 5 bateaux capturés et 29 marins enlevés (cf. annexe VI). En revanche, autour de l’Indonésie, la situation continue à s’améliorer puisque seules 28 attaques ont été relevées en 2008 contre 121 en 2003. Le détroit de Malacca, considéré comme la zone la plus dangereuse par le Lloyd’s de Londres il y a encore quelques années, n’a connu que deux attaques en 2008 contre 7 en 2007.
Le premier trimestre 2009 semble marqué par une forte hausse des actes de piraterie (102 incidents, soit 20 % de plus qu’au dernier trimestre 2008), l’essentiel de cet accroissement provenant d’une accélération des attaques dans le golfe d’Aden et le long des côtes est de la Somalie. 61 attaques ont ainsi été relevées durant ce premier trimestre 2009 contre seulement six à la même période en 2008. 41 incidents ont été signalés dans le seul golfe d’Aden et cinq bateaux ont été capturés.
Le « taux de réussite » des pirates est cependant en baisse depuis le début de l’année puisqu’il est passé de un sur trois (un navire capturé pour trois navires attaqués) au dernier trimestre 2008 à un sur six en janvier 2009, un sur huit en février et un sur treize en mars, preuve que la présence navale dans la zone a un effet certain.
1. Les principales zones à risque
Oubliée de l’Occident pendant de nombreuses années, la piraterie n’a jamais totalement disparu de ses zones d’implantation traditionnelles, souvent dépourvues de perspectives économiques et d’un pouvoir politique fort. Dans les années 90, le phénomène touchait essentiellement l’Asie du Sud-Est ; la zone la plus dangereuse se trouvait dans le détroit de Malacca (carte en annexe III), point de passage stratégique pour 90 000 navires par an, et en mer de Chine.
Depuis quelques années, les zones à risque se sont déplacées : il s’agit désormais de la corne de l’Afrique, et singulièrement des côtes somaliennes et du golfe d’Aden (carte en annexe I), mais également du golfe de Guinée (carte en annexe II), des côtes du Brésil et de l’Équateur. En Asie du Sud-Est, ce sont désormais les eaux territoriales indonésiennes qui sont les plus touchées.
Les trois conditions évoquées précédemment sont réunies en Somalie.
Le pays, désertique, borde un golfe et un détroit traversés par une route maritime très fréquentée. Le trafic du détroit de Bab el Mandeb est essentiellement un trafic de transit (entre l’Asie et l’Europe) qui représente chaque jour en moyenne 45 navires et 3,5 millions de barils de pétrole. Environ 27 navires français (ou de navires gérés et/ou armés par une société française) y passent chaque mois.
La Somalie est un des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu par tête de 226 dollars. Pour ses 8 millions d’habitants, à 70 % analphabètes, l’espérance de vie ne dépasse pas 46 ans et un enfant sur cinq meurt avant d’avoir cinq ans.
La Somalie connaît une unité linguistique et religieuse remarquable mais se caractérise, sur le plan politique, par une division extrême de sa population entre une multitude de clans et sous-clans.
L’absence d’État est endémique dans cette zone de l’Afrique. La guerre civile dure depuis 1992. Le pays est actuellement divisé entre le Somaliland, le Puntland et le sud du pays, en situation insurrectionnelle, aux mains des milices armées du Shabab et de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie (ARS). Le gouvernement fédéral transitoire de Somalie, mis en place sous l’égide de l’ONU depuis 2004, ne contrôle en réalité qu’une partie de la capitale, Mogadiscio.
Depuis janvier 2007, une mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) est présente sur le territoire somalien pour tenter d’appuyer le dialogue entre le gouvernement fédéral transitoire et les rebelles et d’assurer la protection des institutions de transition et leurs infrastructures. Initialement déployée pour six mois, cette mission a vu son mandat prorogé jusqu’à aujourd’hui. Attaquée dès les premiers jours par les rebelles, la mission de paix de l’Union africaine manque cruellement de moyens (7) et reste désormais repliée sur quelques positions stratégiques à Mogadiscio (aéroport, zone portuaire).
En janvier 2009, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, islamiste modéré, a été élu président de ce gouvernement fédéral transitoire. Il a fait part, dès son arrivée au pouvoir, de son intention de juguler l’insurrection, de restaurer la sécurité dans le pays et de lutter contre la piraterie. S’il parvient à imposer sa légitimité, une charte constitutionnelle sera préparée afin d’être approuvée par référendum mais les observateurs s’accordent à considérer que, dans le meilleur des cas, il faudra au moins cinq ans pour restaurer une structure étatique capable de faire respecter la loi et l’ordre.
Les interrogations sont nombreuses sur les chances de succès d’une telle solution institutionnelle car, dans le pays, la culture de gouvernement n’existe pas, pas plus que la notion d’État de droit et de droits de l’homme. Pourtant, la poursuite du processus de paix (processus de Djibouti) est la seule solution pour parvenir à construire un État capable de faire régner l’ordre et de restaurer un contexte de sécurité propice au développement du pays.
À l’heure actuelle, la Somalie est dépourvu d’État et donc d’une autorité légitime pour faire régner l’ordre public. Il n’y a plus d’impôt ni de politiques publiques. Le pays est, de fait, en faillite, même s’il conserve un certain nombre de ressources qui, dans un autre contexte, pourraient lui permettre de vivre : bétail (ovins, chameaux), agriculture, retours financiers de la diaspora.
Dans ce contexte, la piraterie est un « business » comme un autre, plutôt plus rentable. Elle offre un emploi et une rémunération à des gens qui n’ont rien et n’espèrent plus rien. Depuis 2006 (période durant laquelle le pouvoir était exercé par des tribunaux islamistes dans le sud du pays, jusqu’à l’arrivée des troupes éthiopiennes), les attaques s’étaient déplacées vers le Puntland. Depuis la fin de l’année 2008, avec le renforcement de la présence militaire dans la zone, on observe un double mouvement géographique, d’une part de l’est des côtes somaliennes vers le golfe d’Aden, plus intéressant au regard du transit, et d’autre part vers le sud du pays, jusqu’à la mer des Seychelles. Les attaques ont également lieu de plus en plus loin des côtes, jusqu’à 500 nautiques (900 kilomètres).
La piraterie est un phénomène installé au Nigeria depuis 2003-2004 et il s’agit certainement aujourd’hui de la zone la plus dangereuse.
Le golfe, bordé de mangroves avec des eaux intérieures difficilement pénétrables, est une région stratégique, qui détient la 7e réserve mondiale de pétrole et la 9e réserve mondiale de gaz, et procure aux États-Unis 15 % de leurs importations pétrolières. Le trafic maritime n’est pas aussi intense que dans les détroits de Malacca ou de Bab el Mandeb, mais une importante activité industrielle (exploitation pétrolière), nécessitant des approvisionnements réguliers et prévisibles (bateaux « supplie »), y est installée. Les plates-formes sont implantées jusqu’à 20 nautiques de la côte : elles peuvent donc être dans les eaux territoriales ou en haute mer. La zone de Port Harcourt, à l’embouchure de la rivière Bonny, est la plus touchée car la ville est un centre majeur pour le ravitaillement, l’équipement et les mouvements de personnels entre les plates-formes et la terre.
Sur le plan politique, le contexte est également très différent de la Somalie : il existe deux États clairement constitués (le Nigeria et le Cameroun), même si l’autorité de l’État nigérian est inexistante dans certaines zones, manque de moyens d’action navale et souffre d’une corruption importante dans le pays. L’insécurité est extrême et les enlèvements sont une pratique courante : personne n’est à l’abri, ni les étrangers, ni les ressortissants nationaux. Lorsqu’elles se déplacent en mer, ces pratiques sont requalifiées en piraterie mais l’activité reste la même et, en réalité, les attaques se déroulent rarement en haute mer (plutôt dans les eaux intérieures et territoriales), ce qui limite fortement les possibilités d’interventions internationales.
Le pays retire des revenus très importants des activités pétrolières mais leur répartition est contestée par les populations du delta du Niger (l’ethnie Ijaw notamment), qui estiment être spoliées, alors que ce sont elles qui subissent les nuisances générées par les activités d’exploitation (pollution de l’eau et de l’air). Ceci explique que l’industrie pétrolière soit la cible de nombreux groupes plus ou moins politisés.
Les motivations du principal d’entre eux, le MEND (Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger), sont tout à la fois matérielles (prédations) et politiques. La violence des assauts et des prises d’otages s’aggrave et les revendications sont de plus en plus radicales. Les attaques commencent à déborder le Nigeria pour s’étendre au Cameroun et à la Guinée Équatoriale.
Historiquement, la mer de Chine en général et le détroit de Malacca en particulier ont toujours été des zones menacées par la piraterie. Géographiquement, ce détroit, situé entre l’Indonésie et la Malaisie, est un passage stratégique du commerce international : 30 % du commerce mondial y transite, soit 50 000 navires par an et près de 10 millions de barils de pétrole brut par jour.
Le détroit de Malacca est un couloir maritime dépourvu d’eaux internationales. Il constitue la route naturelle entre l’Asie et l’Europe et une voie d’échange commercial vitale pour Singapour et les États d’Extrême-Orient. Mais il est également le lieu d’une confrontation directe d’une cité-État totalement occidentalisée (Singapour) et de pays où subsistent de fortes inégalités sociales en même temps qu’une véritable tradition de piraterie (Malaisie, Indonésie).
La densité du trafic est intense et toute surveillance très difficile, car il est impossible de distinguer les bateaux de pêcheurs de ceux des pirates… ou des policiers.
Après une phase de laisser-faire, sous la menace d’une intervention occidentale, la mobilisation et la coopération des États côtiers, avec une forte implication de Singapour, a permis d’endiguer le phénomène. La Malaisie, l’Indonésie et Singapour disposaient de moyens très différents mais avaient tous la volonté d’agir pour éviter une intervention des États-Unis ou d’autres puissances occidentales. Depuis le mois d’octobre 2006, le détroit de Malacca n’est plus classé « route maritime dangereuse » par le Lloyd’s Register (site de référence en matière de données statistiques maritimes).
Depuis le retour de la piraterie dans l’actualité occidentale, beaucoup a été dit et écrit sur ces « nouveaux flibustiers », sans toujours résister à la tentation du sensationnel et de l’exagération. Ce qui semble confirmer que, dans l’opinion publique, la piraterie continue, malgré sa triviale réalité, à générer fantasmes et romance… Si l’on s’en tient aux sources les plus fiables, une connaissance « raisonnable » des procédés utilisés dans le golfe d’Aden est néanmoins possible. Ceux-ci différent assez largement des pratiques utilisées dans le détroit de Malacca et des attaques se déroulant actuellement dans le golfe de Guinée.
• Dans le détroit de Malacca, les pirates sont organisés en gangs (il y en avait sept à huit dans chaque île au plus fort de leur activité, il y a cinq ans), eux-mêmes placés sous l’autorité de petits parrains locaux. Mais il y a aussi des pirates « free lance » qui sont recrutés pour une opération spécifique par un commanditaire. Les attaques sont perpétrées avec des navires rapides (go fast) et visent principalement les liquidités présentes à bord. Les pirates sont essentiellement équipés d’armes blanches et ne font pas de prises d’otages.
• Dans le golfe de Guinée, la spécificité des activités visées (exploitation pétrolière) explique la vulnérabilité particulière des « cibles » (plateforme, bateaux de ravitaillement, dits « supplie »). Au départ, il s’agissait plutôt d’opérations à terre (détournement d’oléoducs, prises d’otages) mais, depuis 2005, les attaques se sont déplacées vers la mer, de plus en plus loin des côtes et sur une zone élargie. Les attaques sont en recrudescence depuis fin 2007, avec des moyens et une volonté d’action en hausse. Bien armés, bien organisés, bien entraînés, les pirates, et notamment ceux issus des troupes du MEND, sont capables de mener des raids à plus de 100 nautiques des côtes.
Les attaques ont lieu de nuit, à l’aide de speed boats, avec des armes légères ; les cibles sont des navires isolés ou en attente d’opération. La plupart du temps, les bâtiments sont pillés et les équipages ramenés à terre et cachés dans la mangrove. La violence est grande et les risques encourus par les otages sont très élevés (on dénombre une quarantaine de morts en 2008, nigérians pour les trois quarts). La rançon demandée dépend de l’importance des personnes enlevées. Il s’agit clairement de grand banditisme, très bien organisé.
• Pour en revenir au golfe d’Aden et aux côtes somaliennes, la façon de procéder des pirates est aujourd’hui relativement bien connue, même si ceux-ci font preuve d’une forte capacité d’adaptation voire d’une grande imagination pour dissimuler la réalité de leur activité (comme par exemple en utilisant un bateau d’immigrants clandestins pour partir à l’assaut de leur proie). Les techniques et les équipements évoluent également très vite, grâce notamment à l’argent des rançons qui permet d’acquérir des armes et des matériels de télécommunication plus sophistiqués.
De façon générale, il semblerait que les attaques soient conduites avec un boutre qui remorque deux petits bateaux équipés d’un moteur hors-bord rapide. Ces « bateaux mères » ne sont donc pas des bâtiments imposants, mais ils permettent de disposer de l’allonge et de la capacité à durer en mer nécessaires pour conduire des attaques de plus en plus loin des côtes. L’équipement reste assez rudimentaire et les armes (mitraillettes, lance-roquettes) sont souvent anciennes et mal entretenues.
Le petit groupe de pirates se laisse dériver dans le rail et attaque quand une opportunité se présente. Au-delà d’une heure de résistance, ils abandonnent et vont tenter leur chance sur un autre bâtiment. Il n’y a pas de choix préalable des cibles ni, comme on l’a entendu dire, de réseau organisé d’informateurs dans les ports. Si cela était le cas, un groupe de pirates n’aurait sûrement pas attaqué un pétrolier ravitailleur de la flotte Atalante en mars 2009… Cette méthode peut cependant évoluer avec la présence renforcée de forces navales.
Le choix des bateaux dépend essentiellement de deux caractéristiques : la hauteur sur l’eau et la vitesse. Plus un bateau est bas et lent, plus il est facile à attaquer. Par contre, la taille n’est pas un handicap car plus un bâtiment est grand, plus il est difficile à surveiller pour l’équipage. Ainsi, les porte-containers constituent une cible facile car, du château, l’équipage n’a pas la possibilité de contrôler visuellement tous les accès au bâtiment. Les thoniers sont également des bâtiments très vulnérables car ils sont bas sur l’eau, disposent d’une rampe arrière et sont incapables de se dégager lorsque le filet est déployé.
Les acteurs de la piraterie dans le golfe d’Aden
De sources concordantes, il est possible de distinguer, de façon assez schématique, trois types d’acteurs dans les attaques de piraterie :
ð Les investisseurs commanditaires sont ceux qui disposent de suffisamment d’argent pour organiser l’attaque. Il s’agit le plus souvent d’investisseurs occasionnels résidant en Somalie. 10 000 à 20 000 dollars sont nécessaires pour préparer une campagne en mer, ce qui permet de louer le bateau (qui peut aussi bien servir à la pêche et à différents trafics qu’à la piraterie) et les armes. Le commanditaire confie l’opération à un chef de bande et veille à ce qu’un représentant de son sous-clan fasse partie de l’équipe.
ð Les pirates proprement dits sont de « pauvres bougres », souvent drogués par le qat, qui ne savent parfois ni lire ni écrire et n’ont pas de compétences maritimes ou linguistiques particulières (ils ne savent même pas reconnaître un pavillon). Certains d’entre eux sont pêcheurs mais un grand nombre vient de l’intérieur du pays, ce qui explique que de nombreux pirates ne sachent pas nager… Ce ne sont ni des combattants, ni des miliciens, ni des bandits professionnels : l’existence de camps d’entraînement paramilitaires est un mythe et l’amateurisme reste très largement la règle. Certains viennent avec une arme ou même un bateau, ce qui leur vaut une part de butin supplémentaire. Il s’agit pour eux d’une activité opportuniste, destinée à gagner de l’argent pour pouvoir, la plupart du temps, aider leur famille à quitter le pays.
ð Les acteurs secondaires sont ceux qui vivent véritablement de la piraterie :
– les interprètes (souvent des anciens de l’éducation nationale) sont chargés des relations avec les otages et des négociations avec les armateurs ; ils sont parfois attachés à un investisseur particulier ;
– les commerçants fournissent les matériels nécessaires à l’attaque mais aussi les repas pour nourrir les pirates et les otages ;
– les forces de sécurité gardent les otages et préservent l’ordre à terre, près du mouillage.
Une fois un bateau capturé, le commanditaire indique au chef des pirates où aller mouiller ; le traducteur monte alors à bord pour conduire la négociation. La durée moyenne de rétention est d’une soixantaine de jours. L’ambiance à bord est plus ou moins tendue mais il n’y a jamais eu de morts, sauf peut-être une fois. Les pirates savent très bien que s’ils commencent à éliminer des otages, la situation va changer de dimension et qu’ils risquent d’avoir contre eux la population et les autorités religieuses.
Ainsi, on sait que les pirates appliquent une sorte de code d’honneur : les rôles sont clairement répartis et le chef des pirates note toutes les dépenses engagées. La pratique du crédit est courante et les dettes sont respectées. Lors du versement de la rançon, chacun récupère son dû. Il existe même un système d’amendes pour faire respecter l’organisation de la vie sociale à bord des bateaux.
Les pirates établissent des camps temporaires à proximité des zones de mouillage des bateaux piratés. Ils ne sont pas forcément installés dans les villages, ce qui peut laisser penser qu’ils ne sont pas toujours acceptés par la population, tout particulièrement si le contexte clanique n’est pas favorable.
Après l’attaque, une des difficultés est d’entretenir et de nourrir les otages. D’où la création d’une mini-économie alimentée par le montant croissant des rançons. La piraterie est créatrice d’emplois : les populations des côtes font venir leurs parents et leurs amis du centre du pays pour les aider dans les activités d’attaque puis de gardiennage (des bateaux et des otages).
La rançon est généralement versée en liquide, comptée à bord puis répartie entre les différents ayants droit et tous les participants à l’opération. Le partage de la rançon se pratique un peu comme pour la pêche : 50 % pour la « main d’œuvre », c’est-à-dire les hommes qui ont mené l’action (ce qui peut représenter jusqu’à 80 personnes), 30 % pour le commanditaire, 15 % pour l’interprète, les commerçants et plus globalement les intermédiaires et 5 % réservés pour les familles des pirates morts. L’essentiel de l’argent est dépensé sur place, notamment pour envoyer la famille à l’étranger. Il semble néanmoins qu’il existe quelques filières pour financer des constructions immobilières à l’étranger.
3. Ce qu’est la piraterie… et ce qu’elle n’est pas
La piraterie est essentiellement une activité crapuleuse et opportuniste de bandes locales, un « business » facile et lucratif en zone de grande pauvreté et de non-droit.
Au Nigeria, les causes de la piraterie sont tristement banales : précarité, chômage, corruption, prévarication, népotisme… Celle-ci n’est en fait qu’une branche de l’activité d’entités politico-criminelles qui pratiquent principalement le captage clandestin et illicite de pétrole (oil bunkering) ainsi que les prises d’otages (notamment d’expatriés) avec demandes de rançon. Malgré leur habillage politique et la réalité des problèmes et nuisances supportés par les populations du delta, ces enlèvements relèvent bien d’activités criminelles de gangs à tendance mafieuse et sont encouragés par la corruption régnante et la collusion entre les milieux criminels et les autorités publiques et militaires.
Dans le détroit de Malacca, outre une tradition séculaire bien installée dans la région, ce sont également le chômage et la pauvreté qui sont à l’origine de la piraterie. Cela a commencé par des vols à main armée afin de s’approprier les effets du bord et les liquidités. Les vols de bateaux maquillés et revendus sont demeurés exceptionnels. La piraterie est une activité opportuniste et temporaire, de nature crapuleuse, comme celle des trafiquants. Elle relève du phénomène de gang et de la petite criminalité et est dépourvue de lien avec le terrorisme. Il s’agit de simples bandits, même si certaines grandes puissances occidentales auraient souhaité pouvoir rattacher leurs activités au terrorisme afin de les combattre plus directement.
En Somalie, la piraterie est, comme toute la société, profondément marquée par la structure clanique du pays. Les clans les plus actifs en la matière sont les Darod (au nord) et les Bahawein (au sud). La confrontation entre clans et sous-clans s’exprime également dans les activités de piraterie : un certain équilibre est recherché à bord des bateaux mais les accrochages sont fréquents.
Le rapport présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies par le Secrétaire général le 16 mars 2009 donne des informations précises sur les zones d’implantation des pirates. Il précise notamment : « Les principales milices de pirates seraient issues des populations de pêcheurs établies sur les côtes somaliennes, en particulier au nord-est et au centre, et leur organisation transposerait les structures sociales des clans somaliens. Il y a deux grands réseaux de piraterie en Somalie : l’un au Puntland et l’autre dans la région de Mudug, dans le Sud. Selon certaines informations, le principal groupe de pirates au Puntland serait basé dans le district d’Eyl, tandis que des groupes plus petits opéreraient à partir de Boosaaso, Qandala, Caluula, Bargaal et Garacad. […] Il est désormais largement admis que certains de ces groupes rivalisent avec les autorités somaliennes en ce qui concerne les moyens militaires et les sources de financement. » (8).
L’identification des groupes est complexe car ils se fondent dans une population elle-même organisée selon la logique tribale et se confondent avec les groupes de pêcheurs (en pratique, il s’agit souvent des mêmes personnes).
À l’origine de la piraterie, il y a très vraisemblablement la volonté de ces populations de défendre leurs zones de pêche contre les bateaux occidentaux et asiatiques qui ne respectaient pas les eaux territoriales et la zone économique exclusive - ZEE (même si celle-ci n’a jamais été déclarée dans les conditions requises). Puis, au début des années 2000, les bateaux asiatiques se sont armés et la lutte est devenue trop dangereuse, ce qui a incité les pêcheurs somaliens à se retourner vers des embarcations plus vulnérables. C’est à cette période que le gouvernement somalien a eu recours à une société de sécurité britannique pour former des gardes-côtes et, théoriquement, contrôler les droits de pêches. En réalité, il s’agissait plutôt de les accaparer et de mettre en place un trafic profitable. Lorsque la société britannique n’a plus été payée, elle s’est retirée et les pseudo gardes-côtes qu’elle avait formés se sont transformés en pirates. Au tournant des années 2000, la piraterie, encouragée par l’absence totale d’autorité publique et l’insécurité que connaît la région, est ainsi devenue une activité en elle-même, de mieux en mieux organisée et de plus en plus rentable.
Il y a encore un an, la piraterie en Somalie était une activité essentiellement opportuniste, exercée par des pirates amateurs et des investisseurs occasionnels. Avec le succès et l’afflux d’argent, elle se rapproche très rapidement d’une activité mafieuse, structurée par les clans et les sous-clans. Il ne s’agit pas encore de crime organisé car il n’y a ni parrains ni gros commanditaires, mais les quelques « professionnels » de la piraterie implantés localement profitent pleinement de l’absence totale d’État de droit et de moyens de faire respecter l’ordre public. Une véritable logique commerciale s’est développée puisque les pirates sont financés par des investisseurs, eux-mêmes représentés par des intermédiaires qui négocient les rançons en leurs noms.
L’afflux massif de l’argent des rançons dans l’économie locale a également un impact économique indéniable et, au-delà, transforme les structures sociales car les « nouveaux riches » de la piraterie font concurrence aux autorités plus traditionnelles, les anciens et les structures claniques et religieuses.
Pour les populations, cependant, les pirates sont bien plus des « Robins des Bois », courageux et admirés, que des dangereux criminels.
D’un point de vue occidental, le problème de la piraterie est crucial compte tenu de l’importance des routes commerciales et de la sauvegarde du principe de liberté des mers mais le regard des Somaliens, des Indonésiens ou des Malaisiens est différent. Cette pratique, héritée d’une vraie tradition, est bien acceptée et, pour les communautés côtières, constitue une source importante de revenus.
En outre, la population somalienne adhère sincèrement à la thématique de la défense des intérêts nationaux (tout particulièrement des zones de pêche qui constituent souvent l’unique moyen de survie) et refuse de se voir imposer des règles dans lesquelles elle ne se reconnaît pas. La plupart estime que la communauté internationale ne se manifeste que parce que ses intérêts sont menacés, alors qu’elle s’est désintéressée de la Somalie depuis le début des années 90.
Enfin, la piraterie n’est pas uniquement la résultante d’une situation de grande pauvreté. Elle exprime aussi un désir de réussite et de sortie par le haut. Les pirates ne veulent pas seulement être un peu moins pauvres : ils veulent devenir riches, soit pour quitter le pays et aller vivre ailleurs (pour les Somaliens), soit pour rattraper le niveau de vie occidental triomphant à quelques encablures, de l’autre côté du détroit (pour les Indonésiens).
La situation est différente au Nigeria, où les pirates, même s’ils cherchent à légitimer leurs méfaits par les revendications économiques et politiques des habitants du delta du Niger, sont beaucoup plus craints par la population. En effet, ils n’hésitent pas à racketter les pêcheurs et les prises d’otages s’effectuent sans distinction en mer et à terre et concernent tout le monde, étrangers et Nigérians.
La motivation de la piraterie est en tout cas clairement lucrative ; elle n’a pas de dimension politique majeure (même au Nigeria où le rattachement au MEND est plus une façade et un prétexte qu’une réalité) et encore moins d’objectif terroriste.
Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a aucune preuve d’un lien organique entre des actes de piraterie et des réseaux terroristes, notamment islamistes. La piraterie est d’ailleurs clairement condamnée par la Charia et la période durant laquelle les tribunaux islamiques ont exercé le pouvoir en Somalie a été particulièrement difficile pour les pirates (dont certains ont été exécutés).
On ne peut pas exclure que les réseaux terroristes utilisent les voies de circulation empruntées par les pirates ou leur mode d’action, mais les objectifs sont fondamentalement différents. Qu’il s’agisse de groupes de petits voyous ou de factions plus organisées, les pirates ont pour but l’enrichissement frauduleux et pas l’instauration de la terreur. Ils ont d’ailleurs tout intérêt à éviter une telle assimilation car ils y perdraient à coup sûr leur impunité.
En Somalie, il peut néanmoins y avoir des connexions complexes et indirectes en raison de liens familiaux ou claniques. Sil n’y a pas de soutien idéologique, il peut donc y avoir une aide occasionnelle à titre amical. En outre, dans les milieux d’affaires, il est préférable d’être en bons termes avec les détenteurs du pouvoir et, dans le sud de la Somalie, le pouvoir est entre les mains des islamistes. Il est donc possible que certains subsides soient versés pour préparer le terrain et se protéger.
Il en est de même dans la zone du détroit de Malacca : les pirates se mélangent aux trafiquants, voire aux terroristes (Abou Saiaf notamment), mais il n’y a pas de collaboration avérée (ce qui n’exclut pas des croisements d’intérêt et l’utilisation de mêmes réseaux). Ici aussi, les pirates ont besoin de discrétion pour faire prospérer leurs activités : ils savent très bien qu’un acte terroriste provoquerait une réplique tellement forte que leur « business » serait interrompu.
Néanmoins, dès lors que la piraterie génère un afflux de ressources important, elle devient une source de financement qui pourrait finir par intéresser les mouvements terroristes. La vigilance reste donc de rigueur et il convient notamment d’être attentif à une possible récupération politique de la présence de pirates somaliens dans les prisons françaises ainsi qu’aux conséquences que cela pourrait avoir sur les Français retenus en otage.
E. DES CONSÉQUENCES INDÉNIABLES
1. Un impact économique et financier variable
• Dans le golfe d’Aden, 2008 a été une grande année pour la piraterie puisque les attaques ont rapporté plus de 30 millions de dollars de rançon. C’est beaucoup si l’on se rapporte budget du Puntland, qui s’élève à 15 millions de dollars, mais c’est très peu en regard du trafic maritime dans la zone du golfe d’Aden, puisqu’en moyenne deux millions de tonnes de marchandises, dont 3,5 millions de barils de pétrole (9), transitent chaque jour par le canal de Suez…
En outre, d’un point de vue strictement quantitatif, malgré le retentissement médiatique majeur des attaques, il faut reconnaître que le nombre de bateaux touchés représente une part infime des navires transitant par le golfe d’Aden. En effet, en 2008, 120 navires ont été attaqués par les pirates sur les quelque 16 000 bâtiments qui ont franchi le détroit de Bab el Mandeb.
L’impact économique et financier est donc globalement très limité, même si on y ajoute le coût lié à l’immobilisation des bâtiments et des cargaisons. En revanche, l’effet est plus marqué sur les activités de pêche.
Orthongel regroupe les principaux armateurs thoniers français, soit une flottille de 22 senneurs (bateaux de pêche au thon), dont 17 dans l’océan Indien, au large des côtes de Somalie et cinq dans le golfe de Guinée. Ils emploient 400 marins français et 800 marins africains, embauchés en application des accords de pêche.
Durant les dix dernières années, la zone d’activité des thoniers s’est déplacée sous la pression des attaques de pirates. Jusqu’en 2000, les armateurs thoniers disposaient d’autorisations de pêche dans la ZEE somalienne, accordées par une « autorité somalienne » difficile à identifier… Depuis 2006, le gouvernement français interdit la pêche à moins de 200 milles des côtes somaliennes et le commandement des forces navales françaises dans l’océan Indien la déconseille à moins de 300 milles. Mais, en septembre 2008, deux tentatives d’attaque, dont une sur le Drennec qui battait pavillon français, ont eu lieu bien au-delà de la ZEE somalienne, entre 420 et 450 milles des côtes.
Désormais, les thoniers français s’interdisent de pénétrer dans la zone des 500 nautiques des côtes somaliennes, ce qui constitue, par bateau, une diminution de 500 à 700 tonnes des prises annuelles, soit plus d’un tiers des captures réalisées durant la saison de pêche dans la zone au large de la ZEE somalienne. Cette restriction de la zone de pêche est d’autant plus pénalisante que les eaux somaliennes sont particulièrement riches, ce qui explique que l’ouest de l’océan Indien représente les trois quarts de la pêche thonière française.
Outre les français, ce sont essentiellement des bateaux espagnols, thaïlandais et japonais qui pèchent dans la zone. Seuls des bateaux asiatiques, de type palangriers, s’aventurent encore aujourd’hui dans le ZEE somalienne. Les armateurs français commencent à s’interroger sur l’intérêt de maintenir des bateaux dans la région et un premier mouvement de repli sur la zone atlantique a pu être observé chez les Espagnols. Or, il faut absolument préserver un équilibre entre les deux zones de pêche thonière existantes car, sinon, l’overfishing risque d’appauvrir durablement la ressource. Pour les armateurs thoniers, il est donc urgent de pouvoir retourner travailler dans la zone située entre 200 et 500 milles.
La piraterie a également des conséquences importantes sur le coût des assurances maritimes. Selon le rapport mensuel de novembre 2008 du Bussiness Monitor International, le montant des primes d’assurance pour les navires transitant par le golfe d’Aden a été multiplié par dix et la zone est désormais classée en zone de guerre.
Il est cependant difficile de disposer d’une évaluation générale de la hausse du coût des assurances pour le transit par le golfe d’Aden car il existe plusieurs marchés avec leur propre appréciation du risque. En outre, les éventuelles surprimes applicables ne font pas l’objet de publication officielle pour des raisons de concurrence, les taux des surprimes étant fonction, outre l’appréciation du risque proprement dite, de la situation particulière de chaque armateur. On peut cependant relever, pour les assurances « Corps » (10), des surprimes dites « risque de guerre » pour la zone du golfe d’Aden d’une valeur située entre 0,020 % et 0,075 % de la valeur du navire.
Pour les polices françaises, les attaques de piraterie entrent dans le cadre du risque normal ; en revanche, pour les polices britanniques, elles sont assimilées à un risque de guerre. Depuis quelques mois, la Lloyd’s de Londres, première bourse mondiale d’assurance, s’est donc adaptée en proposant des polices spéciales pour le risque de piraterie qui comprennent le remboursement de la rançon, le paiement des frais légaux ou l’acheminement de l’argent aux ravisseurs. Mais ces polices ne semblent s’appliquer qu’au-delà de la zone des 500 milles et les armateurs doivent par ailleurs se protéger contre le manque à gagner dû à l’immobilisation de leur navire.
• Dans le golfe de Guinée en revanche, les attaques des « pirates » ont un effet négatif indéniable sur les activités pétrolières puisqu’elles ont entraîné une baisse de 25 % de la production nationale. Les pertes économiques du Nigeria sont évaluées à 64 millions de dollars par jour et certains grands groupes pétroliers occidentaux (comme Shell) ont décidé de se désengager de la région.
2. Un effet pour le moment limité sur le trafic maritime
La route maritime Asie/Moyen Orient – Europe est l’une des routes les plus fréquentées au monde et une voie stratégique pour l’approvisionnement de l’Europe. Cette route traverse quatre détroits internationaux : Malacca, Bab el Mandeb (à l’embouchure du golfe d’Aden), Gibraltar et le pas de Calais (Dover Strait). Les détroits internationaux, qui sont par définition des eaux resserrées, concentrent la majeure partie du trafic et donc des risques maritimes. Ils constituent un point stratégique qui est en général surveillé et contrôlé par les États riverains. Ils sont de plus propices aux échanges entre pays riverains et génèrent par ce fait une forte activité locale.
Dans ce contexte, le détroit de Bab el Mandeb et le golfe d’Aden sont aujourd’hui les maillons faibles de l’approvisionnement de l’Europe. En effet, les États riverains ne sont pas en mesure d’assurer la sécurité et la faible activité maritime locale ne crée pas de poumon économique susceptible de générer une richesse locale.
Pour le moment rares sont les armateurs à faire le choix d’un déroutage par le sud de l’Afrique. En effet, le passage par Bab el Mandeb plutôt que par le cap de Bonne Espérance permet un gain de temps de 14 jours sur un voyage entre le golfe Persique et l’Europe et une économie en carburant de 800 000 dollars pour un VLCC (Very Large Crude Carrier) et de 2,7 millions de dollars pour un porte-containers. Au total, la société V-Navy évalue à plus d’un million de dollars le surcoût du passage par le cap de Bonne Espérance pour un VLCC, en comptant l’économie de 500 000 dollars de la redevance de passage par le canal de Suez.
Au regard du montant moyen des rançons demandées (entre un et deux millions de dollars), d’un strict point de vue financier, le risque mérite encore d’être pris. Néanmoins, dans un contexte de crise économique et de baisse des prix du carburant, qui rend les jours supplémentaires en mer moins pénalisants, le choix du contournement pourrait bien finir par s’imposer, ne serait-ce que pour répondre à la pression des équipages.
D’ores et déjà, plusieurs compagnies maritimes – comme la compagnie norvégienne Odfjell, qui possède une flotte de 90 pétroliers, ou le groupe danois AP Moller Maersk, plus gros propriétaire de navires en Europe – ont annoncé avoir suspendu ou envisagé de suspendre la route de Suez au profit du cap de Bonne Espérance pour tout ou partie de leur flotte.
Une telle évolution aurait nécessairement des conséquences pour le canal de Suez, qui représente pour l’Égypte un atout stratégique majeur et une source vitale de revenus, en constante progression depuis les années 2000. Même si une baisse de recettes du canal ne mettrait pas à elle seule en péril les équilibres financiers du pays, on peut comprendre les inquiétudes de l’Égypte face à la montée de la piraterie dans le golfe d’Aden dans une période où le ralentissement de l’activité économique a d’ores et déjà généré une baisse importante du trafic (- 25 % entre février 2008 et février 2009) et donc des ressources tirées du canal de Suez.
Depuis l’antiquité, la piraterie a fait peser une menace constante sur la liberté des mers, elles-mêmes considérées comme des espaces de non-droit soumises, au pire, à la loi du plus fort et, au mieux, à des règles coutumières.
Il n’en est plus ainsi aujourd’hui et le droit international de mer s’applique y compris dans les eaux internationales, même si le principe de liberté demeure dominant. À ce titre, la piraterie est traitée de façon spécifique, comme un péril particulier qui engage la responsabilité de tous les États. Le droit français quant à lui considérait jusqu’il y a peu de temps la piraterie comme une infraction obsolète. Sous la pression de l’actualité, doter notre pays d’un cadre juridique adapté à cette nouvelle menace et à cette nouvelle mission de sauvegarde maritime est devenu une nécessité dont le Parlement devra prochainement se saisir.
II. — UN OBJET JURIDIQUE BIEN IDENTIFIÉ
La piraterie a été définie en 1958 par la convention de Genève sur la haute mer, dans l’esprit du droit coutumier, comme tout acte illicite de violence, de détention, ou de dépréciation commis à titre privé et pour des buts personnels contre un navire privé, son équipage ou ses passagers.
Elle fait aujourd’hui l’objet d’une définition resserrée et d’un traitement juridique détaillé en droit international de la mer. En effet, la lutte contre la piraterie constitue une exception au principe général de la liberté de la haute mer et engage la responsabilité de l’ensemble des États membres des Nations Unies.
1. Un cadre d’exception : le chapitre VII de la charte des Nations Unies
Ce chapitre porte sur les actions du Conseil de sécurité en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression : il s’agit d’un dispositif d’urgence en cas de péril grave pour la communauté internationale (cf. annexe VIII).
L’article 39 de la charte dispose que, face à une telle situation, le Conseil de sécurité peut émettre des recommandations et engager des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces mesures ne sont pas nécessairement militaires et peuvent par exemple prendre la forme d’embargos aériens, de contrôle de certaines importations ou exportations ou de boycotts divers (article 41). Lorsqu’elles recourent à l’emploi de moyens militaires (article 42), elles peuvent prendre la forme d’opérations menées dans le cadre du droit des conflits armés.
Dans ce cas, aucun contrôle juridictionnel sur l’action n’est requis. Les personnes éventuellement détenues par les forces armées sont des prisonniers de guerre et le régime de leur détention est fixé dans le cadre du droit des conflits armés. La détention de prisonniers n’est pas organisée par rapport à une quelconque finalité judiciaire (il n’y a pas de jugement des prisonniers de guerre).
Même si la piraterie porte atteinte à la liberté des mers ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens traversant les zones à risque, il semble difficile de considérer qu’elle menace directement et globalement la paix et la sécurité internationales. La réponse à la piraterie ne semble donc pas relever du cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies et du droit des conflits armés, d’autant que ces pratiques illicites sont spécifiquement visées par le droit commun de la mer.
2. Le cadre de droit commun : la convention de Montego Bay
La convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), signée en 1982 à Montego Bay, est la seule convention internationale qui traite de la piraterie (art. 100 à 108 et art. 110 – cf. annexe IX).
En application de cette convention, le droit commun de la piraterie est un droit de temps de paix. La lutte contre la piraterie s’inscrit clairement, pour les États signataires, dans le cadre juridique de la police en mer (« law enforcement ») et ne relève pas d’une guerre. Selon cette conception, la piraterie constitue une infraction pénale qui doit, en tant que telle, être sanctionnée par voie judiciaire.
• Une définition précise mais restrictive de la piraterie
L’article 101 de la Convention de Montego Bay fixe quatre conditions cumulatives pour caractériser l’acte de piraterie :
– l’acte doit être commis en haute mer, c’est-à-dire au minimum au-delà de la limite des 12 milles (environ 20 km des côtes) des eaux territoriales ;
– l’acte doit être commis avec « violence » : le fait de monter à bord par la force et sans y être invité correspond par exemple à cette définition ;
– le bateau « pirate » doit être un bâtiment civil ;
– l’attaque doit être effectuée à des fins privées (vol, demande de rançon…).
Cette définition exclut donc clairement les actes de terrorisme.
La convention de Montego Bay ne réserve cependant pas la qualification de piraterie aux seuls auteurs d’attaques avérées. Si tel était le cas, le texte condamnerait l’action des États à rester lettre morte puisqu’il faudrait en toute logique attendre que l’attaque ait eu lieu et avoir la certitude qu’elle a été commise à des fins privées avant d’engager des poursuites pénales contre les auteurs. Au contraire, la convention établit un système de répression des actes de piraterie commis mais également en cours ou en préparation.
Ainsi, l’article 103 fonde la définition du navire pirate sur un critère d’intentionnalité : « Sont considérés comme navires [...] pirates les navires [...] dont les personnes qui les contrôlent entendent effectivement se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101. ».
En outre, l’article 101 indique que les actes constituant la piraterie comprennent :
– « tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire lorsque son auteur a connaissance des faits dont il découle que ce navire [...] est un navire pirate » (il n’est pas spécifié que « participer à l’utilisation » implique de naviguer à bord) ;
– l’incitation à commettre un acte de piraterie ;
– et l’acte commis dans l’intention de faciliter les actes de piraterie (sans qu’il soit spécifié si cet acte doit avoir produit son effet).
Il en résulte que l’incitation, la planification et le soutien, effectués de la terre ou de la mer (« bateau mère » par exemple), d’actes de piraterie passés, présents et même futurs est sanctionnable comme acte de piraterie au même titre que l’attaque pirate effectivement réalisée, pourvu que ces actions aient été volontairement conduites et en connaissance de cause.
• La lutte contre la piraterie est une prérogative de puissance publique
L’article 105 de la convention UNCLOS confère à tout État le pouvoir d’appréhender « en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État » les auteurs d’actes de piraterie (comme précisé ci-dessus) et de les traduire devant ses tribunaux. Il institue donc pour la répression de la piraterie une capacité de juridiction universelle. Il ne s’agit cependant pour cet État que d’une option, l’État de nationalité des pirates ou l’État du pavillon conservant toujours la possibilité d’exercer leur juridiction pénale.
L’« État qui a opéré la saisie » dispose également de la même option pour déterminer les mesures à prendre en ce qui concerne le navire et les biens saisis.
L’article 105 ne lie donc pas automatiquement juridiction sur le navire et les biens saisis, d’une part, et juridiction pénale sur les auteurs d’actes de piraterie, d’autre part, pas plus qu’il n’impose à l’État capteur d’exercer sa juridiction dans l’un ou l’autre cas. Ce dernier peut déterminer dans quelles limites il entend exercer une quelconque juridiction en matière de piraterie, soit en s’attribuant la juridiction sur les pirates appréhendés, le navire et les biens saisis, soit en restreignant sa juridiction à des cas plus limités, par exemple lorsque le navire piraté ou les victimes sont de sa nationalité, ou bien lorsque les déprédations commises portent atteinte à des personnes physiques ou morales de sa nationalité.
Conformément à l’article 100 de la convention, qui fixe aux États une obligation de coopération en matière de répression de la piraterie, une autre norme visant spécifiquement la répression de la piraterie (11) peut permettre de régler la question de la juridiction. Par ailleurs, les accords de coopération judiciaire ou d’extradition peuvent donner à un État non « capteur », qui aurait établi sa compétence pénale en la matière, la possibilité de juger un pirate capturé sur le territoire ou dans les eaux territoriales d’un autre État.
Au total, la convention de Montego Bay permet donc de réprimer en haute mer l’intention de commettre un acte de piraterie ainsi que la participation directe ou indirecte à des actes de piraterie commis ou à commettre.
• Cette réglementation pose néanmoins différents problèmes
Les dispositions de la convention UNCLOS sont tout d’abord très générales et n’entrent pas dans le détail opérationnel. Ainsi, l’article 100 incite à la coopération entre États mais ne dit pas comment procéder.
En outre, la définition de la piraterie – et donc le dispositif prévu pour sa répression – ne s’applique qu’aux attaques en haute mer. Dans les eaux territoriales, les attaques de pirates sont considérées comme des actes de brigandage et c’est le droit de l’État côtier qui prévaut. Les pirates connaissent bien l’avantage de cette distinction et savent comment faire évoluer leurs bateaux pour pouvoir perpétrer leurs attaques en toute impunité. Car, malheureusement, l’État de droit est un luxe de pays riches… Face à la piraterie, les nations occidentales se retrouvent donc bien souvent en situation de « défense juridique asymétrique » !
La seule possibilité d’intervention de la communauté internationale réside alors dans la signature de conventions avec les autorités politiques des États concernés (ou l’adoption de résolutions par le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme cela a été fait pour la Somalie) mais l’instrument juridique n’est pas toujours suffisant et doit être soutenu par les autorités politiques.
Enfin, la convention de Montego Bay dispose que la répression de la piraterie relève de la responsabilité des États. Cependant, si l’État capteur choisit de ne pas exercer ce droit de répression par voie judiciaire, la convention ne précise pas s’il doit rechercher une solution judiciaire dans un autre État ou s’il lui est loisible d’exercer d’autres modes de répression (extra-judiciaires). Ce silence permet à certains États d’envisager de mener des actions de lutte contre la piraterie dans le cadre des dispositions du chapitre VII de la charte de l’ONU et sous droit des conflits armés (cf. ci-après).
Au total cependant, la convention UNCLOS, qui instaure un traitement de la piraterie dérogatoire au principe de liberté de la haute mer, constitue un équilibre satisfaisant. Pour ce qui est des attaques dans les eaux territoriales, la protection de la souveraineté a été privilégiée et de nombreux pays seraient totalement opposés à une quelconque modification de la convention en la matière. La France elle-même ne semble pas souhaiter une remise en cause de ce texte.
L’obtention d’un droit de poursuite dans des eaux territoriales doit donc plutôt passer par la voie bilatérale. Mieux vaut traiter les situations au cas par cas, comme cela a été fait pour la Somalie avec les résolutions 1816 et suivantes.
3. Un cadre subsidiaire : la convention de Rome
La difficulté de répondre aux exigences de la procédure pénale dans des opérations navales, et plus encore lors de libération d’otages en milieu maritime, a conduit certains États (dont les États-Unis) à envisager d’agir contre la piraterie avec des moyens purement militaires, sans contrôle du juge national et en évitant d’avoir à pratiquer – en conséquence – l’incarcération de pirates en milieu militaire (en particulier à bord de navires).
Afin de légitimer cette approche du problème, ces États invoquent le régime juridique du terrorisme, basé sur des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies aux formulations très générales.
Cependant, ces résolutions n’ayant pas un caractère permanent, ces États militent également pour la reconnaissance de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (SUA), conclue à Rome le 10 mars 1988 (et de ses protocoles additionnels de 2005), qui traite du terrorisme et de la lutte contre la prolifération, comme source du droit international en matière de lutte contre la piraterie. Cette convention ne fait pas de distinction entre les responsables d’actes de violence contre la sécurité de la navigation et permet donc de traiter les pirates comme des terroristes.
Une raison pratique explique cette pression américaine en faveur de cette convention SUA : la notion d’action de l’État en mer n’existant pas aux Etats-Unis, la marine américaine n’est pas habilitée à mener des opérations au profit de la justice. L’application de la convention de Rome permet d’écarter la finalité judiciaire caractéristique de la convention de Montego Bay. Mais il y a également une raison plus politique : l’amalgame entre pirates et terroristes qu’autorise la convention SUA permet d’intervenir également à terre et d’utiliser des sociétés privées.
Cette approche, qui laisse à l’État intervenant une souplesse maximale dans l’action en se désintéressant du traitement pénal de la piraterie, est néanmoins juridiquement erronée car elle est incompatible avec le respect de la convention de Montego Bay et amalgame deux régimes juridiques distincts.
La France estime pour sa part que la convention de Rome (dont on peut noter que les protocoles additionnels de 2005 ont à ce stade été relativement peu ratifiés) offre une base juridique complémentaire mais ne peut être considérée comme l’outil principal de la lutte contre la piraterie, comme voudraient le faire croire les États-Unis.
• Encourager les coopérations régionales
L’Organisation maritime internationale (OMI), organisme spécialisé des Nations Unies, se préoccupe de la piraterie depuis 25 ans, le problème ayant été soulevé pour la première fois par la Suède en 1985. Le sujet est depuis cette date régulièrement à l’ordre du jour du comité de sûreté maritime.
Dans les années 90, l’OMI a concentré ses efforts sur l’Asie du Sud-Est et tout particulièrement le détroit de Malacca et a multiplié les contacts et les réunions avec les différents responsables régionaux pour tenter d’endiguer le phénomène. Elle a incité les États côtiers à prendre les choses en main et à s’organiser pour lutter conjointement contre les attaques. Le Japon a notamment beaucoup œuvré pour l’adoption d’un accord régional.
L’accord RECAAP, signé par le Japon, Singapour, la Malaisie, la Indonésie, l’Inde, la Corée et la Chine, est entré en vigueur en 2005. Il constitue un cadre général de coordination et de coopération mais ne comporte pas de dispositions détaillées sur les modalités d’engagement ni sur le droit de poursuite inversé, qui donne la possibilité à un État de poursuivre les pirates dans les eaux territoriales d’un État voisin. Cet accord a été complété par des accords mutuels ou bilatéraux de coopération (cf. infra, IV. B.).
Après les succès rencontrés dans le détroit de Malacca, l’OMI a reporté ses efforts vers la corne de l’Afrique et le Nigeria. À l’exception du Yémen et du Kenya, les capacités militaires de lutte y sont quasi inexistantes et l’embargo sur les livraisons d’armes applicable en Somalie rend toute acquisition de moyens impossible.
En ce qui concerne la Somalie, l’OMI a adressé une résolution en novembre 2005 au Secrétaire général des Nations Unies pour lui demander de persuader la Somalie d’autoriser l’entrée de navires de guerre dans ses eaux territoriales, solution finalement adoptée en 2008 avec la résolution 1816. Elle a ensuite organisé deux conférences régionales (en octobre 2008 au Yémen et fin janvier 2009 à Djibouti) afin d’organiser la mise en place, sur le modèle de RECAAP, d’un système régional de coopération pour la lutte contre la piraterie autour de la corne de l’Afrique et le long de la côte Est (cf. infra, IV. B.).
La mission de l’OMI n’est pas simple car elle doit parvenir à faire comprendre aux États riverains l’intérêt de mécanismes de coopération régionale, y compris pour leur développement économique (qui ne pourra qu’être favorisé par une restauration de la sécurité dans leurs eaux territoriales), tout en ménageant leur susceptibilité. Il est effectivement difficile pour un État de reconnaître qu’il n’a pas les moyens d’assurer la sécurité sur son territoire et de renoncer à une partie de sa souveraineté.
• Le code ISPS
Le code international sur la sûreté des navires (ISPS), adopté à l’OMI le 12 décembre 2002 à la suite des événements du 11 septembre 2001, définit des règles et conseils pratiques pour réduire l’exposition des navires aux risques terroristes. Les dispositions du code ont été intégrées par amendement à la convention SOLAS (Safety of life at sea - sauvegarde de la vie humaine en mer, régulièrement révisée par l’OMI depuis 1960) mais tous les pays n’ont pas ratifié ces modifications, comme la Libye par exemple. La mise en œuvre du code est à la charge des armateurs et des autorités portuaires.
Ces mesures se traduisent principalement par la mise en place de contrôles des circulations des équipages et des bâtiments, un meilleur repérage des bateaux et le développement de moyens de communication et de procédures de détresse permettant d’envoyer à l’armateur et aux CROSS (Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) des messages préformatés précisant la position du navire, sa vitesse et le type de menace.
Sur ce dernier point, le système d’identification automatique à distance (AIS) des bâtiments, seul en usage jusqu’en 2008, était fortement critiqué car il utilise la communication par VHF qui n’est pas sécurisée et peut donc permettre aux pirates de localiser les bateaux. Pour répondre à cet inconvénient, un nouveau système d’identification utilisant la communication par satellite a récemment été mis en place. À compter du 1er janvier 2009, les navires cargos de plus de 300 tonnes, les navires à passagers et les plates-formes mobiles de forage en mer doivent être équipés d’un dispositif LRIT (Long Range Identification & Tracking) programmé pour transmettre automatiquement, toutes les six heures, l’identité du navire et sa position. Le message est destiné à l’État du pavillon, l’État du port de destination du navire et les États côtiers, dans une zone allant jusqu’à 1 000 milles marins de leurs côtes.
Le code ISPS a indéniablement permis de réduire les actes de vol, le nombre de passagers clandestins et de mieux prémunir les équipages et les navires contre les actes de piraterie. En revanche, ses dispositions peuvent entraîner un conflit entre la sûreté et la sécurité : ainsi, si l’on ferme tous les accès pour éviter les intrusions et les vols, cela peut poser problème en cas d’évacuation incendie. En outre, les exigences du code ISPS sont très contraignantes pour les équipages, qui sont à la fois très sollicités et très encadrés dans leurs déplacements (dans certains ports, la descente à terre était devenue impossible).
Enfin, les modalités d’application du code ISPS restent très variables d’un pays à l’autre, notamment pour la sécurisation des ports, car celle-ci implique des installations qui peuvent se révéler très coûteuses.
• Les recommandations aux armateurs
En complément du dispositif général du code ISPS, l’OMI a également rédigé des recommandations spécifiques destinées aux personnels navigants et aux armateurs afin de les aider dans leur réactions face aux attaques de pirates (12). Ces recommandations rejoignent celles qu’ont pu diffuser le Bureau maritime international ou encore le «comité de guerre » de la Lloyd’s market association de Londres.
Un « décalogue de sûreté » récapitule les principales mesures à adopter : surveiller le navire et la cargaison, éclairer le navire et sa coque, établir un moyen de communication pour obtenir une aide extérieure, contrôler l’accès à la cargaison et aux locaux d’habitation, tenir les hublots fermés, ne pas laisser d’objets de valeur en évidence, laisser levées les passerelles d’accès, placer les gardiens contractuels sous la surveillance de l’officier de quart, signaler aux forces de l’ordre tout incident de vol qualifié, de vol simple ou de tentative de voies de fait.
Enfin, en cas d’attaque, il est recommandé de :
– ne pas hésiter à sonner l’alarme générale du navire en cas de menace d’agression ;
– essayer de garder un éclairage qui soit toujours aveuglant pour les attaquants, au cas où des personnes étrangères au navire tenteraient de grimper par le bordé ;
– donner l’alarme aux navires qui se trouvent dans les parages et au système de veille permanente des autorités à terre ;
– sonner l’alarme à coups de sirène intermittents et utiliser des signaux d’alarme visuels au moyen de projecteurs et de fusées de signalisation ;
– s’il y a lieu, afin de protéger les personnes qui sont à bord, essayer de repousser les assaillants au moyen de projecteurs puissants qui les aveugleront ou de jets d’eau ou de fusées de signalisation dirigés vers les zones d’abordage ;
– ne pas tenter d’action héroïque.
Ces recommandations sont actuellement en cours d’actualisation afin de mieux les adapter aux modes d’action des pirates et à la spécificité des attaques en haute mer.
Pour juger une personne, trois éléments sont nécessaires : une incrimination, un tribunal compétent et une procédure pénale.
1. Les incriminations utilisables
L’incrimination spécifique de piraterie figurait dans une loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime qui a été abrogée par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Ce texte, qui se référait à l’autorité royale et aux « lettres de marque ou de commissions régulières », était cependant totalement obsolète et non conforme aux dispositions du droit international de la mer applicables en matière de piraterie.
Il existe cependant plusieurs infractions de droit commun utilisables et a priori suffisantes pour incriminer la piraterie. Il s’agit notamment de l’infraction d’association de malfaiteurs, qui permet d’interpeller les personnes avant même la commission du crime, dès lors que l’on détient la preuve d’actes préparatoires (ce qui correspond au contenu de la convention de Montego Bay).
La convention de Montego Bay prévoit une compétence universelle pour juger les auteurs d’actes de piraterie mais une telle possibilité n’existe pas en droit français, qui exige toujours la présence d’un lien de nationalité. En matière de piraterie, l’auteur, les personnes ou le bateau attaqués doivent être français. La convention de Rome y ajoute une compétence pour les criminels appréhendés en France.
Une telle compétence universelle entraînerait très certainement un engorgement des juridictions (en raison du nombre mais aussi de la lourdeur des procédures, de nature criminelle). La Belgique, qui s’est reconnu une compétence universelle en matière de génocide, doit aujourd’hui faire face à un afflux considérable de plaintes. Sans créer de juridiction universelle, il pourrait être envisagé d’étendre le lien de nationalité à l’interpellation par la marine française mais une telle solution risquerait de créer un conflit de droit avec les autres États judiciairement compétents (État de nationalité de l’auteur de l’infraction ou des victimes, État du pavillon du navire attaqué).
La solution reste donc, en l’absence de lien de nationalité, de transférer les personnes interpellées vers leur État national via une procédure proche de l’extradition – ce qui peut poser des problèmes en regard de l’obligation de garantir le respect des droits de l’homme et des droits judiciaires fondamentaux – ou bien de passer un accord avec un État riverain pour obtenir qu’il juge les pirates en respectant ces principes fondamentaux – c’est l’option choisie par l’Union européenne, qui a passé un accord de ce type avec le Kenya.
La Convention de Montego Bay est muette à ce sujet.
En France, le seul dispositif existant est celui de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer, qui définit un cadre légal permettant l’intervention en haute mer pour réprimer le trafic illicite de stupéfiants ainsi que pour lutter contre l’immigration illicite (cf. annexe X).
Cette loi, partiellement intégrée dans le code de la défense en ce qui concerne les mesures de contrôle et de coercition possibles à rencontre de navires étrangers (13), prévoit que la marine française peut intervenir à bord et dérouter le navire en infraction sous réserve de l’accord de l’État du pavillon et après obtention de sa renonciation à exercer sa compétence judiciaire. Concernant l’aspect judiciaire, la loi instaure au profit des officiers de police judiciaire (OPJ), mais également au profit d’autres autorités spécialement habilitées compte tenu du défaut d’OPJ en haute mer (14), un cadre procédural dérogatoire aux règles habituelles du code de procédure pénale.
Si la loi de 1994 constitue une base juridique éprouvée qui fait précisément défaut en matière de lutte contre la piraterie, elle présente cependant une faiblesse car elle ne définit pas la procédure applicable entre l’interpellation et l’arrivée en France, à l’exception d’une obligation d’information du procureur.
Il y a là une fragilité juridique qui a été relevée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt Medvediev rendu le 10 juillet 2008 dans le cadre d’une procédure engagée en juin 2002 (interception en océan Atlantique du navire Winner se livrant à un trafic de stupéfiants (15)). La CEDH estime en effet que l’information du procureur de la République est une garantie insuffisante car elle ne reconnaît pas à ce magistrat l’indépendance à l’égard de l’exécutif nécessaire pour pouvoir être qualifié de « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La France a demandé un nouvel examen de cet arrêt mais il convient de modifier la loi de 1994 afin d’encadrer juridiquement le transfèrement et d’assurer son contrôle par une autorité judiciaire indépendante – au sens où l’entend la CEDH. Ce magistrat pourrait être le juge des libertés et de la détention (JLD), qui est un magistrat du siège : il lui reviendrait de veiller aux conditions matérielles de rétention (vie à bord) de la personne interpellée durant son transfèrement.
Cela restera une procédure difficile à mettre en œuvre car il faut y intégrer les variables liées au temps et à l’éloignement mais elle semble néanmoins plus envisageable que le respect des dispositions habituelles du code de procédure pénale et notamment des conditions de déroulement d’une garde à vue (à savoir information du procureur de la République, notification des droits, examen par un médecin, assistance de l’avocat, recours à un interprète...), qui risquerait de fragiliser l’ensemble de la procédure.
Afin de disposer d’un outil juridique complet et efficient pour l’action de l’État en mer, la loi du 15 juillet 1994 doit donc être complétée afin :
– d’être étendue à la piraterie, ce qui implique de définir les incriminations applicables en référence aux articles existants du code pénal (association de malfaiteurs, complicité, violences contre les personnes et les biens...) ainsi que les mesures à prendre à l’encontre des navires pirates et de leurs équipages et de préciser la compétence des juridictions françaises ;
– et de prévoir l’intervention du JLD pour le contrôle des conditions matérielles de transfèrement des personnes interpellées.
Il serait également souhaitable d’exclure la nécessité d’obtenir, en préalable à toute intervention, la renonciation de l’État du pavillon, car il s’agit d’une disposition très lourde à mettre en œuvre et qui ralentit considérablement les opérations.
Un texte est en préparation depuis plusieurs mois au Secrétariat général à la mer. Son inscription à l’ordre du jour des assemblées devrait constituer une priorité car l’adoption d’un tel support juridique comblerait les lacunes actuelles préjudiciables à la défense des ressortissants (membres d’équipage, passagers) comme des intérêts français (navires de commerce de compagnies nationales, approvisionnement énergétique), sans pour autant nécessiter des modifications plus complexes du code pénal ou du code de procédure pénale.
III. — LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE : UNE RÉPLIQUE NÉCESSAIRE MAIS INSUFFISANTE
Depuis l’Antiquité, l’opération navale est une réponse traditionnelle à la piraterie. Différents types d’intervention sont envisageables et peuvent être articulés :
– actions de prévention (présence dissuasive, démonstration de force, surveillance navale et aérienne, instauration d’un rail de passage, partage du renseignement) ;
– arraisonnement de bâtiments suspects avec confiscation ou destruction des matériels et des armes, voire arrestation des pirates présumés ;
– présence de militaires à bord des navires les plus vulnérables ;
– escortes de bâtiments, individuelles ou en convoi ;
– reprise de vive force des navires retenus en otage.
Aujourd’hui, les interventions se concentrent dans le golfe d’Aden. Dans le golfe de Guinée, le fait que l’essentiel des attaques se produise dans les eaux territoriales limite fortement les possibilités d’intervention des marines étrangères et il y a peu de chances que le Nigeria accepte l’instauration d’un droit de poursuite dans ses eaux territoriales comme l’a fait le gouvernement fédéral transitoire de Somalie. La seule perspective réside donc dans la conclusion d’accords bilatéraux de coopération et de formation militaires afin d’organiser un partage des responsabilités (cf. supra, IV. A.).
A. UNE PRISE DE CONSCIENCE PROGRESSIVE
1. Le rôle moteur de la France
• Le concept de sauvegarde maritime
La mission de sauvegarde maritime mobilise aujourd’hui près de 2 000 marins et 70 bâtiments et représente près d’un tiers des heures de mer de la marine nationale. Cette mission a tout à la fois vocation à faire face aux menaces susceptibles de venir de la mer (terrorisme, narcotrafic, piraterie, transport illicite de migrants…) et à assurer la défense des droits souverains en mer ainsi que la maîtrise des risques liés à l’activité maritime (accidents de mer, pollution…). Elle relève donc simultanément de la défense nationale et de l’action de l’État en mer et, en cela, s’inscrit pleinement dans la logique du continuum sécurité-défense défendue par le Livre blanc publié en juin 2008.
Le système français de sauvegarde maritime a le mérite de regrouper sous l’autorité unique du préfet maritime et la supervision du secrétariat général à la mer tous les moyens disponibles pour exercer l’action de l’État en mer (marine nationale mais aussi gendarmerie maritime, douanes, sécurité civile, affaires maritimes, etc.).
Chaque acteur est utilisé selon ses moyens et ses capacités, la marine possédant un savoir-faire inégalé dès lors qu’il s’agit d’intervenir en haute mer. La polyvalence des équipages et des équipements a depuis longtemps fait la preuve de son efficacité et permet la réalisation des missions assurées dans d’autres pays par les compagnies de gardes-côtes, sans l’inconvénient du cloisonnement et de la redondance et avec tout le bénéfice d’une double expérience.
L’outil existant fonctionne très bien. La gestion interministérielle des questions maritimes est une vraie force qu’il faut à tout prix préserver. C’est notamment elle qui a permis à la France de jouer un rôle moteur dans le montage de l’opération européenne Atalante, à la frontière de l’opération militaire et de la police des mers. Au moment où les États-Unis sont en train de redécouvrir le concept de national fleet, il serait donc absurde, comme d’aucuns le suggèrent, d’instaurer une séparation administrative entre armée de mer et marine nationale.
• Le plan Pirate-Mer
Conçu dans les années 80, le plan de réaction Pirate-Mer est un outil d’organisation décisionnelle et opérationnelle applicable en cas d’attaque terroriste maritime. S’il n’a pas été conçu à l’origine pour les actes de piraterie, il est suffisamment flexible pour pourvoir être utilisé dans ce contexte. Sa mise en œuvre entraîne une série de procédures qui permettent d’organiser rapidement et efficacement l’action des pouvoirs publics et d’afficher une posture claire en matière de communication publique. Il ne concerne pas le niveau tactique et opérationnel, qui relève des armées.
Le plan Pirate-Mer est un plan national. La conduite opérationnelle de l’action gouvernementale incombe au Premier ministre et peut être déléguée à un ministre (par exemple le ministre de la défense). Une cellule interministérielle est désignée pour piloter la crise : elle réunit les responsables politiques et des autorités civiles et militaires.
Bien que mis en œuvre pour la première fois lors de l’opération « Thalathine » de reprise de vive force du voilier Le Ponant, le plan Pirate-Mer est bien rôdé car, depuis vingt ans, les unités qualifiées participent à des exercices (16) associant tous les acteurs intervenant dans le dossier, de la décision d’engagement jusqu’aux opérations de secours et de police judiciaire. Le dispositif de réponse à la crise s’affine continuellement et les scénarios tiennent compte de l’évolution des menaces.
En matière de piraterie maritime, le plan Pirate-Mer prévoit l’intervention conjointe du GIGN et de la marine. Le premier se concentre sur l’aspect contre-terroriste de l’action et la seconde prend essentiellement en compte la dimension maritime de la problématique. Le GIGN et le commando Hubert (un des six commandos marine) sont les seules unités à disposer de plongeurs qualifiés pour mener un assaut subaquatique : cette capacité rare doit être utilisée à plein. Les synergies ainsi développées depuis de nombreuses années ont contribué au succès de la reprise de vive force du Ponant.
L’expérience de cette opération a montré que la présence des commandants du GIGN et d’ALFUSCO est, au moins dans un premier temps, indispensable aux côtés des décideurs politiques. Leur expertise est cruciale dans les premiers instants de la crise, qui sont généralement décisifs. Les liens étroits entre l’autorité politique et le commandant de l’opération demeurent la clé du succès dans la gestion d’une telle opération. Par ailleurs, certaines tâches qui relèvent du niveau politique (comme la communication) sont nécessairement liées à la gestion de la crise. Une concertation entre les acteurs politiques et les responsables opérationnels permet donc de coordonner l’ensemble des actions.
• Une présence permanente dans les zones sensibles
– Les forces navales françaises de la zone maritime de l’océan Indien comprennent un noyau dur de bâtiments stationnés en permanence sur zone. Elles disposent également de moyens de renfort qui sont détachés depuis la métropole pour des durées de deux à six mois. Viennent s’ajouter à ces déploiements réguliers des moyens occasionnels. En cas de crise ou lors d’exercices majeurs, des moyens plus importants peuvent être déployés : groupe aéronaval, groupe amphibie, chasseurs de mines...
L’amiral commandant les forces maritimes françaises de l’océan Indien (« ALINDIEN »), représentant personnel du chef d’état-major des armées, assure le commandement de la zone maritime de l’océan Indien et joue un rôle d’ambassadeur « militaire » et itinérant pour les actions de coopération. Son état-major interarmées est embarqué à bord d’un bâtiment de commandement et de soutien déployé en permanence en océan Indien. Depuis l’été 2002, la Marne a pris la relève du Var comme bâtiment amiral. Cette permanence dans la zone facilite la connaissance du théâtre et le dialogue vis-à-vis des pays riverains avec qui la France entretient des relations.
La base française de Djibouti constitue également un point d’appui précieux pour toutes les opérations qui doivent être menées dans l’ouest de l’océan Indien.
– Pour le golfe de Guinée, le prépositionnement de l’armée de terre (et de ses hélicoptères) au Gabon et au Sénégal ainsi que la présence permanente d’un avion de patrouille maritime à Dakar (en vertu d’un accord de coopération avec le Sénégal) constituent des points d’appui importants dans la zone et une réserve d’hommes et de matériels. De son côté, la marine dispose à Dakar d’une véritable base navale qui permet d’utiliser les moyens des bâtiments de façon simple et efficace (équipement, réparation, transport des armes et des munitions) et un bâtiment est en permanence présent sur zone dans le cadre de la mission Corymbe.
Les forces navales sont placées sous le commandant opérationnel de CECLANT, l’amiral commandant la zone Atlantique, basé à Brest.
b) Des compétences spécifiques
• Les forces spéciales
Les commandos marine appartenant à la force des fusiliers marins et des commandos (FORFUSCO) interviennent pour des opérations spéciales, dans le cadre des missions générales aéromaritimes et de l’action de l’État en mer, dont le contre-terrorisme maritime, la police des pêches et la lutte contre le narcotrafic. Il existe six commandos dotés de spécialités distinctes. La FORFUSCO fonctionne comme un réservoir de forces et doit préserver un équilibre entre les différentes missions dont elle est chargée et le maintien de ses capacités opérationnelles. Elle est utilisée par deux grands « employeurs » :
– le Premier ministre, par l’intermédiaire des préfets maritimes, pour tout ce qui concerne l’action de l’État en mer (soit 40 % de l’activité). Il s’agit d’opérations de plus en plus sensibles et complexes, notamment en matière de lutte contre le narcotrafic et de contre-terrorisme maritime, qui s’exercent toujours dans un cadre juridique très contraint ;
– le chef d’état-major des armées pour toutes les opérations maritimes, qu’elles soient menées sous l’autorité du commandement des opérations spéciales (soit 40 à 50 % de l’activité totale) ou du centre de planification et de conduite des opérations.
Les hommes constituent la principale richesse des commandos marine. Ils sont le fruit d’une sélection rigoureuse et reçoivent une formation permanente, constamment enrichie par le retour d’expérience. Les commandos allient leur culture de marin et celle des forces spéciales et conjuguent autonomie, initiative, esprit d’équipe et fortes facultés d’adaptation.
L’intervention du commandement des opérations spéciales (COS) se fait dans le cadre du plan Pirate-Mer. En ce qui concerne la piraterie, les hommes du COS remplissent deux types de missions : ils recueillent des renseignements opérationnels pour disposer d’une bonne capacité d’intervention et mènent des opérations ponctuelles d’intervention ou de libération (du type Ponant). Le COS n’intervient que pour des opérations militaires : il n’est pas concerné par les opérations d’escorte. Le COS travaille également en symbiose avec le GIGN, qui dispose d’une grande expérience en matière de prise d’otages, dans les avions notamment. Par contre, les opérations à terre relèvent des actions commando classiques et constituent le cœur de métier des forces spéciales.
• L’atout complémentaire de la gendarmerie
Force armée exerçant des missions de police sur l’ensemble du territoire national mais également à l’étranger, la gendarmerie est capable d’intervenir aux côtés des autres armées, et notamment de la marine, dans la lutte contre la piraterie, qu’il s’agisse de l’intervention du GIGN dans le cas d’une reprise de vive force ou de l’engagement d’enquêteurs à bord des bâtiments de la marine.
Le GIGN est une unité spécialisée dans la gestion des crises relevant du terrorisme ou du grand banditisme. Il possède une cellule de négociation hautement qualifiée et des capacités d’intervention lourdes. Il est ainsi en mesure d’apporter une réponse globale, allant de la résolution d’une crise en souplesse jusqu’à une action en force, si la situation l’exigeait. Son champ de compétences s’étend, en priorité, sur tout le territoire national mais l’unité peut également intervenir hors de France, dans un cadre interarmées, lorsque des intérêts français sont en jeu.
En dehors des situations d’urgence requérant l’intervention du GIGN et des forces spéciales, et notamment dans le cas d’opérations planifiées de lutte contre la piraterie comme l’opération Atalante, la présence de gendarmes enquêteurs pourrait être particulièrement utile à bord des navires engagés ou auprès du commandant de l’opération sur zone. Ce type de concours est notamment employé en matière de police des pêches. Cette coopération ponctuelle permettrait de disposer en amont de l’ensemble des prérogatives de l’officier de police judiciaire et notamment d’éviter toute rupture entre les phases opérationnelles pures et les phases judiciaires, en garantissant les meilleures conditions de transition.
Concernant l’enquête judiciaire, la multiplication des opérations, et donc des procédures liées à la répression des agissements des pirates, va immanquablement entraîner un durcissement de la défense. Celle-ci cherchera à relever des faiblesses dans les constatations, les conditions de rétention et le degré de responsabilité et de participation réelle de chaque personne mise en cause (condition indispensable à une condamnation pénale). Dans un tel contexte de « judiciarisation », il pourra difficilement être demandé aux autorités habilitées temporairement à constater des infractions, par ailleurs en charge de l’aspect tactique de l’opération, de satisfaire à toutes les exigences d’une enquête complexe relative à des atteintes graves aux personnes.
Les armées françaises disposant de militaires officiers de police judiciaire en la personne des gendarmes, il semblerait judicieux d’utiliser pleinement les compétences des unités de recherches de la gendarmerie maritime, unités à compétence judiciaire nationale qui se caractérisent par leur spécialisation dans les affaires liées au milieu maritime ainsi que par leur habitude à travailler en lien étroit avec la marine nationale.
c) Un effort en matière d’information et de renseignement
• Le travail de fond des services de renseignement
Les missions complémentaires de la direction du renseignement militaire (DRM) et la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) permettent aux autorités françaises et aux forces armées de disposer d’un grand nombre d’informations leur permettant de mieux appréhender et combattre le phénomène de la piraterie. La DRM produit plutôt du renseignement image et électromagnétique (écoutes) et collabore avec les bateaux et les alliés présents sur zone pour réunir des informations. La DGSE rassemble quant à elle des renseignements sur la situation à terre afin de mieux connaître le contexte général des activités de piraterie ainsi que l’environnement des pirates et des commanditaires.
• L’apport du Centre de renseignement de la marine (CR-MAR)
Le CR-MAR a été créé à Brest en 2005 afin de coordonner la production du renseignement d’intérêt maritime dans le cadre de la sauvegarde maritime et de faciliter la circulation de ces informations entre la marine, la DRM et les autres acteurs du renseignement.
Sous la double autorité de l’état-major de la marine et de la DRM, il assure le suivi de la situation maritime des bâtiments civils et militaires à partir des remontées des systèmes AIS et LRIT (cf. supra, II. A.) par lequel les bâtiments civils précisent leur position quatre fois par jour, la constitution de dossiers de renseignements image, la recherche ouverte de renseignements sur Internet, la tenue à jour d’une documentation thématique et géographique et des écoutes dans la gamme VHF.
Sa base de données TETRIS (17) permet ainsi le suivi des cinématiques (reconstitution historique des routes maritimes suivies) sur 18 mois de 90 % des quelque 190 000 bateaux marchands naviguant sur les mers du globe, accompagné, dans 60 % des cas, d’un dossier photographique. Couplée aux outils de surveillance satellite, elle permet une information en temps réel sur les mouvements des bâtiments et, par croisement d’informations, le repérage des navires suspects (trajectoire atypique, absence de remontées LRIT, repérages antérieurs).
• Le contrôle naval volontaire (CNV)
Le CNV est un protocole de coopération et d’échange d’informations entre la marine nationale et les armateurs français destiné à assurer la sécurité des navires et des marins français. Prévu pour les temps de guerre par l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, il a été étendu à la protection des navires de la marine de commerce en temps de paix par l’instruction ministérielle du 27 juin 2001.
Le CNV a pour but d’accroître la sécurité des navires dans les zones où elle pourrait être compromise et d’assurer le maintien des flux d’échanges nécessaires à l’économie nationale. Ce dispositif est actif dans le nord-ouest et dans l’est de l’océan Indien et dans le golfe Persique ainsi que, depuis juillet 2008, dans le golfe de Guinée.
Tous les armateurs français susceptibles de naviguer dans les zones couvertes sont parties prenantes au CNV. D’un côté, ils bénéficient d’informations relatives à la situation nautique et militaire dans leur zone de navigation ainsi que de directives pour les routes à suivre et le comportement à adopter. D’un autre côté, ils signalent leur itinéraire et leur position, permettant ainsi une intervention très rapide en cas de difficultés. Le lien direct établi entre marine marchande et marine nationale permet une alerte rapide et documentée.
Si le CNV est un dispositif français, la marine nationale peut faire appel aux moyens des marines alliées pour accroître son niveau d’information, ce qui renforce et l’intérêt et la rapidité des interventions. D’autres États envisagent d’ailleurs de s’inspirer du CNV français pour assurer la sécurité de leurs navires et de leurs ressortissants.
• Depuis septembre 2007, la France travaille sur le sujet de la piraterie en cherchant à rassembler toutes les compétences disponibles dans les différents domaines concernés (politique, diplomatique et militaire notamment) afin de définir la menace et d’élaborer un cadre juridique et opérationnel. Cela a conféré à notre pays une véritable avance par rapports à nos partenaires et aux organisations internationales, pour lesquels ce sujet est encore assez nouveau.
L’opération Alcyon d’escorte des navires du programme alimentaire mondial (PAM) transportant l’aide humanitaire vers la Somalie, décidée par l’ONU en décembre 2007 sur proposition du Président de la République française, a constitué une première expérience très spécifique (escorte individualisée d’un cargo par un bateau de guerre et équipe de protection militaire embarquée), à la légitimité incontestable.
Jusqu’en novembre 2007, il existait seulement un système officieux d’échange d’informations entre l’OMI, l’OTAN et le PAM. Face à la multiplication des attaques contre les navires affrétés par le PAM, certains États membres (dont la France) ont alors décidé de fournir des escortes pour protéger ces navires. Ce dispositif a été confirmé par les résolutions 1814 (du 15 mai 2008) et 1816 (du 2 juin 2008) du Conseil de sécurité.
De novembre 2007 à décembre 2008, 47 voyages ont ainsi été protégés (tour à tour par les marines française, danoise, néerlandaise et canadienne), ce qui représente environ 252 000 tonnes d’aide humanitaire. Aucun navire affrété par le PAM n’a subi d’attaque sur cette période. Depuis le début de l’année 2009, la sécurité des livraisons du PAM à la Somalie est assurée dans le cadre de l’opération Atalante ; fin février, 10 convois avaient déjà été escortés.
La Chine et l’Inde ont fait savoir que leurs forces navales pouvaient également assurer des escortes en cas de nécessité. Il semble important que l’opération Alcyon n’apparaisse par comme une affaire exclusivement occidentale et que des marines du monde entier contribuent à cet effort de solidarité humanitaire.
• Au printemps 2008, l’attaque et la prise en otage du voilier de croisière le Ponant et de ses 30 membres d’équipage a brusquement révélé à l’opinion publique internationale l’implication active de la France dans les problèmes de piraterie ainsi que la menace que constituait celle-ci pour les États occidentaux et la liberté des mer.
L’attaque du Ponant a eu lieu le 4 avril, à mi-chemin du Yémen et de la Somalie. Le bateau était en transit et n’accueillait pas de passagers. ALINDIEN a été alerté par le capitaine avant même l’arrivée à bord des pirates. Dans l’heure qui a suivi, le bâtiment était déjà sous surveillance et n’a jamais été perdu de vue. Plusieurs bâtiments de la marine française ont été requis pour l’opération de libération, conduite conjointement par les commandos marine et le GIGN dans le cadre du plan Pirate-Mer.
La reprise de vive force a été ordonnée le 11 avril par le Président de la République et a permis la libération de tous les otages ainsi que l’arrestation de six pirates et la récupération d’une partie de la rançon. Le droit de poursuivre les pirates dans les eaux territoriales somaliennes puis à terre avait été accordé au préalable par le président somalien Abdhullahi Yusuf Ahmed.
Les clés du succès ont résidé, d’une part, dans la préparation et les compétences des commandos et du GIGN et, d’autre part, dans l’organisation de l’opération. Celle-ci a clairement bénéficié de l’existence de la base de Djibouti, mais également de la mise en place rapide d’une chaîne de commandement courte et interactive (avec un pôle à Paris et un commandement tactique sur zone), de groupes des planification efficaces et d’une bonne coopération interalliée (avec les américains notamment).
Les échanges entre le Quai d’Orsay, le ministère de la défense et le gouvernement provisoire de Somalie ont grandement facilité le déroulement des opérations. Le dispositif interministériel a très bien fonctionné, les décisions du Président de la République étant prises sur proposition conjointe des affaires étrangères et de la défense. Il faut également souligner le rôle central joué par le centre de crise du Quai d’Orsay (notamment pour les relations avec les familles) ainsi que par la DGSE, qui possède une grande expertise du contexte somalien.
Cette première opération a cependant révélé les principales difficultés rencontrées depuis dans la lutte contre les attaques de pirates : complexité de la mise en place rapide d’un commandement tactique à grande distance, manque d’allonge des moyens (l’attaque a eu lieu loin de la France mais également loin de Djibouti) et grande rapidité des événements (qui ne laisse pas le temps d’acheminer sur place l’ensemble des hommes et moyens nécessaires).
La crise du Ponant a constitué l’événement déclencheur de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1816, sur l’initiative de la France et des États-Unis.
2. L’implication du Conseil de sécurité des Nations Unies
Depuis mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté pas moins de quatre résolutions sur la question de la lutte contre la piraterie au large de la Somalie et dans le golfe d’Aden (1816, 1831, 1846 et 1851), qui témoignent d’une prise de conscience croissante des enjeux et des dangers du phénomène. Tous ces textes ont pour objectif d’alerter la communauté internationale sur la gravité de la situation et de permettre aux États qui le souhaitent de se substituer, sous certaines conditions, à l’autorité défaillante de la Somalie pour restaurer la sécurité dans ses eaux territoriales.
• La résolution 1816 adoptée le 2 juin 2008 autorise, pour une période de six mois, les États coopérant avec le gouvernement de transition somalien à entrer dans les eaux territoriales du pays afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer. Ces États sont également autorisés à « utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière conforme au droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée ». Le gouvernement fédéral de transition somalien transmettra au Secrétaire général des Nations unies la liste des États souhaitant coopérer avec lui dans la lutte contre la piraterie.
Le texte souligne le respect du Conseil de sécurité pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Somalie et invite les États à coopérer entre eux et avec l’OMI pour combattre la piraterie au large de la Somalie. Il préconise également la mise en œuvre d’une assistance technique visant à renforcer les capacités des États côtiers en matière de sécurité maritime.
De façon un peu ambiguë sur le plan juridique, le Conseil de sécurité précise qu’il agit en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies mais la résolution dispose expressément que sa mise en œuvre doit intervenir dans le cadre de la convention de Montego Bay, c’est-à-dire avec une finalité judiciaire.
Afin de tranquilliser de nombreux États membres inquiets d’une éventuelle atteinte au principe de souveraineté dans les eaux territoriales, la résolution affirme que « l’autorisation donnée ne s’applique qu’à la situation en Somalie » et souligne expressément qu’elle ne constitue pas un précédent et ne doit pas être considérée comme établissant un droit international coutumier. Cela signifie que les eaux territoriales des autres États côtiers doivent être respectées et que les règles habituelles du droit de la mer (interdiction des poursuites notamment) continuent à s’appliquer.
• La résolution 1831, adoptée le 7 octobre 2008 à l’initiative de la France, alors présidente de l’Union européenne, répond à un double objectif : alerter la communauté internationale sur l’intensification des attaques de pirates au large des côtes somaliennes et dans le golfe d’Aden et inciter les États dont les navires de guerre ou les aéronefs militaires opèrent au large des côtes somaliennes à utiliser « tous les moyens nécessaires » et conformes à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer « pour réprimer les actes de piraterie » et sécuriser la zone. Les efforts entrepris dans le cadre des résolutions 1814 (escorte des navires du PAM) et 1816 doivent être poursuivis et renforcés.
En se plaçant une nouvelle fois dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité légitime clairement le recours à des moyens militaires pour combattre la piraterie et confère ainsi une base légale incontestable à l’envoi de forces navales dans la zone (notamment dans le cadre d’une opération européenne). Le texte renouvelle néanmoins les précautions prises par la résolution 1816 pour rappeler que les dispositions de la résolution « s’appliquent à la seule situation en Somalie » et « n’affectent pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États membres du droit international », et plus spécifiquement de la convention de Montego Bay.
• La résolution 1846, adoptée le 2 décembre 2008, a pour premier objet de prolonger de 12 mois la résolution 1816, permettant ainsi, notamment, la mise en œuvre de l’opération Atalante. Le texte renouvelle l’appel du Conseil de sécurité à l’action militaire des États dans la zone ainsi que les demandes d’assistance technique aux navires de commerce et aux États côtiers pour le renforcement de leurs capacités en matière de sécurité maritime.
Deux novations témoignent de la prise de conscience de l’importance accordée à la dimension juridique et judiciaire du traitement de la piraterie : l’appel à une coopération juridique entre États afin de se donner les moyens de poursuivre et de juger les auteurs d’actes de piraterie et le rappel des termes de la convention de Rome qui exige de traiter comme une infraction les actes de piraterie. Ces mentions sont cohérentes avec le fait que les dispositions de la résolution doivent être mises en œuvre dans le cadre de la convention de Montego Bay (et donc avec une finalité judiciaire).
Dans une perspective de traitement à plus long terme de la piraterie, la résolution demande au Secrétaire général des Nations Unies de présenter sous trois mois un rapport « sur les moyens de garantir durablement la sécurité de la navigation internationale au large des côtes somaliennes ». Ce rapport a été remis au Conseil de sécurité le 16 mars 2009.
• Enfin, le Conseil de sécurité a adopté le 16 décembre 2008, à la demande des États-Unis, une résolution 1851 qui ouvre, durant la période d’application de la résolution 1846, la possibilité d’interventions terrestres sur le territoire somalien après accord préalable du gouvernement fédéral transitoire (18). Le texte encourage également les États et les organisations régionales qui luttent contre la piraterie dans la zone à mettre en place « un mécanisme de coopération internationale pour servir de point de contact commun » et à « créer dans la région un centre chargé de coordonner les informations ayant trait à la piraterie et aux vols à main armée au large des côtes somaliennes ».
3. L’intervention de l’Union européenne
Dans le cadre de sa présidence de l’Union depuis le 1er juillet 2008, la France s’est employée à mettre en place un dispositif spécifiquement européen d’application de la résolution 1816.
• La cellule de coordination renforcée pour la lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden baptisée NAVCO a été mise en place par le Conseil des affaires générales et des relations extérieures (CAGRE) le 15 septembre 2008, en application de la résolution 1816 du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin d’assurer une liaison entre les demandes de protection des navires civils se trouvant dans le golfe d’Aden ou au large des côtes somaliennes et les autorités disposant de bâtiments susceptibles de fournir une telle protection (soit les États membres et les États tiers souhaitant intervenir dans la lutte contre la piraterie, mais également l’état major américain de la TF150 basée à Bahreïn, voire l’OTAN).
La cellule NAVCO a été sollicitée par le PAM, l’AMISOM (qui envoie régulièrement de l’équipement pour ses effectifs sur le terrain) et diverses associations d’armateurs de commerce et de pêche. Située dans les locaux de l’état-major de l’Union européenne, elle ne disposait pas de pouvoirs de contrôle des navires et les modalités de protection devaient être négociées directement entre les parties intéressées.
Cette initiative a permis de soutenir les actions de surveillance et de protection menées par certains États membres au large des côtes somaliennes (la France et l’Espagne ont déployé dans la région respectivement un navire et un avion de surveillance maritime) et de préparer le lancement de l’opération Atalante, en préfigurant un outil de coordination des moyens opérationnels.
• L’opération ATALANTE
Le 8 décembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé de lancer une opération militaire afin de contribuer à la dissuasion et à la répression des actes de piraterie et de vol à main armée au large de côtes de Somalie. Cette opération, dénommée EU NAVFOR Somalie – opération Atalante, est la première opération navale de l’Union européenne et s’inscrit dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Elle s’appuie sur les résolutions 1814, 1816, 1838 et 1846 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
L’opération a pour mandat de :
– fournir une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d’éléments armés de l’opération, en particulier lorsqu’ils naviguent dans les eaux territoriales de la Somalie (19) ;
– protéger les navires marchands naviguant dans les zones où elle est déployée ;
– surveiller les zones au large des côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales, présentant des risques pour les activités maritimes, en particulier le trafic maritime ;
– prendre les mesures nécessaires, y compris l’usage de la force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de piraterie ou aux vols à main armée qui pourraient être commis dans les zones où elle est présente.
Le commandement de l’opération est assuré par le Royaume-Uni au quartier général de Northwood. Un état-major de forces embarqué sera commandé de façon tournante pour quatre mois par la Grèce, l’Espagne et les Pays-Bas. Sa base logistique se situera à Djibouti et il sera en relation avec l’état-major américain de la TF150 à Bahreïn.
Le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération sous la responsabilité du Conseil.
Les coûts communs (estimés à environ 8,3 millions d’euros) sont destinés à financer le quartier général de Northwood, l’antenne logistique de Djibouti et l’état-major de forces embarqué. Au-delà, le financement est assuré par le mécanisme Athéna (chaque État membre contribuant selon son engagement). Comme toujours pour les opérations PESD, ce sont les États membres qui s’engagent qui payent : il n’y a pas solidarité financière.
En même temps que l’opération militaire Atalante, l’Union européenne a mis en place un Centre de sécurité maritime pour la Corne de l’Afrique (MSC-HOA) qui succède en quelque sorte à la cellule NAVCO. L’objectif, comme le décrit la décision du Conseil, est d’assister les marins présents dans le golfe d’Aden et au large de la Somalie et de la Corne de l’Afrique, en leur donnant une image aussi précise que possible des risques existant dans les eaux traversées, comme prévu par les résolutions du Conseil de sécurité.
Le Centre, pourvu de militaires et de personnels de la marine marchande de plusieurs pays, travaille en étroite coordination avec les forces militaires opérant dans la région (notamment celles d’Atalante) et fournit soutien et protection aux marins. Afin de connaître les destinations des navires marchands transitant dans la région, le MSC-HOA recommande aux propriétaires ou capitaines de navires d’enregistrer, via un site web sécurisé (www.mschoa.eu), les positions de leurs navires. Ils peuvent également recevoir par ce biais des alertes ainsi que des informations et conseils propres à réduire le risque d’attaques de pirates.
Aucun des 1 500 navires dont les déplacements sont surveillés grâce à ce service n’a encore été victime d’actes de piraterie dans la région.
Le MSC-HOA est placé sous l’autorité du commandant de l’opération Atalante. Cette création est tout à fait originale dans le cadre des missions européennes de défense : c’est en effet la première fois qu’une opération militaire met, de façon aussi transparente, un service particulier d’information et de renseignement à la disposition des principaux acteurs économiques concernés.
L’opération Atalante s’est vu fixer une durée de 12 mois, correspondant à la période d’application de la résolution 1846 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En parallèle, les actions déjà mises en œuvre, c’est-à-dire le contrôle naval volontaire pour la France et la diffusion d’informations aux armateurs par le BMI, sont poursuivies.
• Quatre mois après son lancement, cette opération de lutte contre la piraterie peut être regardée comme un vrai succès de la PESD. Le total accord entre le Royaume-Uni et la France sur cette question doit notamment être souligné. Dans la zone, seule Atalante a pour mission d’assurer l’application des résolutions du Conseil de sécurité ; les autres marines sont essentiellement présentes pour répondre à des intérêts nationaux ou pour s’assurer un positionnement stratégique dans cette région du monde particulièrement sensible.
Depuis son démarrage, la force européenne a sécurisé la totalité des convois du PAM (soit 76 000 tonnes d’aide humanitaire) et des ravitaillements de l’AMISOM ainsi que les deux tiers du transit commercial dans le golfe d’Aden.
Début février, à l’initiative d’Atalante, et en accord avec l’OMI, le Bureau des opérations maritimes du Royaume-Uni et l’Office de liaison maritime américain, un couloir maritime a été mis en place dans le golfe d’Aden sous le nom d’IRTC (International Recommended Transit Corridor) dans lequel patrouillent les navires de la force européenne, de la TF151 et de différents pays tiers. Il permet de faire transiter les navires loin des côtes yéménites et de s’éloigner des zones habituelles de pêche, évitant ainsi de nombreuses fausses alertes.
Des accords bilatéraux ont été conclus avec plusieurs pays de la région afin de pouvoir conduire la lutte contre la piraterie avec un maximum d’efficacité : accord avec la Somalie pour l’accès à ses eaux territoriales en novembre 2008 ; accords analogues avec Djibouti et le Kenya en décembre 2008 ; accord avec l’Éthiopie en novembre 2008 autorisant les appareils de l’opération Atalante à survoler son territoire.
Par ailleurs, l’Union européenne a conclu un accord avec le Kenya afin de pouvoir traduire devant la justice de ce pays les pirates appréhendés par la force Atalante. Un accord comparable devrait prochainement être signé avec la Tanzanie (cf. infra, III. C.).
Si la génération de forces est difficile, comme pour toute opération PESD, la mobilisation est bien réelle et, sur l’année 2009, tous les États membres disposant d’une marine participeront à l’opération. Les relèves se passent bien et les contributions annoncées sont disponibles selon le calendrier prévu.
Début avril, le dispositif d’Atalante comprenait, pour les moyens maritimes, la frégate grecque Psara (qui fait fonction de navire amiral) et son hélicoptère, la frégate française le Floréal, une corvette italienne, une frégate allemande équipée de deux hélicoptères et de commandos susceptibles de prendre place dans les navires marchands sensibles ainsi qu’une frégate espagnole. Les moyens aériens se composaient d’un avion de surveillance P3-Orion espagnol, basé à Djibouti, et, si besoin, d’un Atlantique II français, ainsi que des hélicoptères embarqués à bord des frégates. Au total, Atalante mobilise un effectif de 1 200 personnes.
Enfin, la Suisse et la Norvège devraient apporter leur contribution à la force Atalante d’ici à l’été 2009.
B. LE GOLFE D’ADEN, THÉÂTRE D’UNE MOBILISATION GÉNÉRALE
1. Enduring Freedom et les CTF 150 et 151
La Combined Task Force 150 (CTF 150) est une force navale constituée par une coalition multinationale, opérationnelle depuis novembre 2002. Elle est coordonnée par la Cinquième flotte américaine et intègre une partie de ses navires.
Cette force opérationnelle a été créée afin de surveiller, d’inspecter et d’arrêter les entités suspectées de terrorisme. Elle assure des opérations dans le nord de la mer d’Arabie et dans l’océan Indien en soutien à l’opération Enduring Freedom dans le cadre informel de la guerre contre le terrorisme. Ses activités sont qualifiées d’opérations de sécurité maritime.
Plusieurs pays ont participé à la CTF 150. En avril 2009, elle comprend des navires mis à disposition par la France, les États-Unis, le Pakistan, le Canada, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Le commandement de la Task Force est assuré par les différentes marines militaires à tour de rôle, pour environ quatre à six mois. La flotte se compose généralement de 14 à 15 navires.
La CTF 150 a participé, fin 2008 et début 2009, à la sécurisation du golfe d’Aden et à la lutte contre la piraterie. Elle a ensuite passé le relais à la CTF 151, mise en place début janvier par le quartier général américain à Bahrein pour mener des opérations de contre-piraterie. Le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport précité sur la lutte cotre la piraterie, précise que « contrairement aux autres forces qui composent les Forces maritimes combinées, le CTF-151 a une mission bien précise qui ne connaît pas de limites géographiques et est conçue comme une structure internationale spécialisée combinant forces militaires, partage de l’information et patrouilles coordonnées. » (20).
Pour le moment, la CTF 151 comprend essentiellement des navires américains et britanniques ainsi qu’une frégate danoise et une frégate turque. Cette force semble constituer le prélude à différents réaménagements des forces américaines dans les opérations extérieures. On peut donc se demander si la piraterie est l’objectif principal de cette nouvelle formation ou si la présence et le contrôle de cette zone stratégique ne sont pas aussi essentiels.
2. La volonté d’implication de l’OTAN
L’OTAN a commencé à se préoccuper de la question de la piraterie dans le golfe d’Aden à l’été 2008, pour partie en réaction à la mobilisation européenne sur le sujet.
Lors du sommet de Budapest en octobre 2008, les Alliés ont choisi d’organiser au large de la Somalie une opération de circonstance baptisée Allied Provider. Profitant du déploiement de son deuxième groupe maritime permanent (la SNMG2) à compter du 25 octobre 2008, ils ont décidé de revoir la mission originelle de cette force (essentiellement destinée à de la diplomatie navale) et de la dédier provisoirement à la protection des navires du PAM contre d’éventuels actes de piraterie. Le mandat de cette force, limité dans le temps, s’est achevé le 12 décembre 2008.
Depuis le début du mois de mars, le déploiement de la SNMG1 (21), qui devait initialement se rendre en Australie via l’Asie, a de nouveau été utilisé pour contribuer à la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes dans le cadre d’une nouvelle opération baptisée « Allied Protector ». Fin avril, la force se trouvait toujours dans le golfe d’Aden et les visites initialement prévues à Singapour et en Australie étaient annulées afin qu’elle puisse poursuivre son action dans le golfe d’Aden jusqu’à la fin du mois de juin.
La présence sur zone de la SNMG1 constitue une contribution fort utile à une période où les attaques s’intensifient. Pour autant, l’action de l’OTAN souffre d’un manque patent de couverture juridique pour ses opérations. Le mandat du groupe naval ne lui permet pas de détenir les pirates une fois qu’ils ont été arraisonnés ni d’intervenir après qu’un navire a été attaqué et la force ne dispose pas d’un accord de transfert judiciaire des prisonniers vers un pays tiers comme cela a été négocié par l’Union européenne. Cette impasse judiciaire s’est récemment traduite par la libération de neuf pirates somaliens appréhendés par la marine néerlandaise dans le cadre de l’opération de l’OTAN, les Pays-Bas ne souhaitant pas juger sur leur territoire des pirates qui n’avaient pas directement mis en cause des intérêts nationaux.
L’Alliance poursuit à l’heure actuelle sa réflexion sur une action à plus long terme contre la piraterie. Les États-Unis sont favorables à une implication de l’OTAN dans ce domaine car ils souhaitent mettre en avant la politique maritime de l’Alliance et valoriser ses capacités navales. Face au succès de l’intervention européenne et à la multiplication des acteurs sur ce sujet, le positionnement n’est cependant pas aisé à définir et un consensus politique est manifestement difficile à trouver.
La lutte contre la piraterie doit être considérée comme une priorité qui nécessite la mobilisation du plus grand nombre possible de moyens sur zone. Une opération de l’OTAN, conduite en bonne coopération avec les autres pays et organisations impliqués dans la lutte contre la piraterie (et tout particulièrement l’Union européenne) ne pourrait donc que contribuer positivement à l’effort international.
3. L’afflux de forces navales sous pavillons nationaux
Depuis le début de l’année 2009, plusieurs États ont décidé de déployer des forces sous pavillon national dans le golfe d’Aden et au large de la Somalie afin d’assurer la protection des navires transitant dans la zone ou d’escorter uniquement les bâtiments représentant un intérêt économique national. Les trois États les plus présents sont à l’heure actuelle la Russie, le Chine et le Japon.
Quatre navires de la flotte russe du Pacifique sont actuellement présents dans le golfe d’Aden. Il s’agit du deuxième groupe de navires russes chargé de participer à l’opération internationale de lutte contre les pirates somaliens. Cette présence témoigne d’une triple volonté, aux fondements politiques et militaires : participer à l’action internationale contre la piraterie, protéger les marins ou bateaux russes et être présent dans la zone stratégique qu’est l’océan Indien. La coopération avec la force Atalante se déroule de façon satisfaisante, les Russes étant notamment très demandeurs d’informations et de retours d’expérience.
Le déploiement opérationnel de trois bâtiments de guerre chinois dans le golfe d’Aden a constitué une grande première pour la Chine, qui n’avait pas envoyé d’opération navale loin de ses côtes depuis des siècles. La décision chinoise est symbolique tout à la fois sur les plans diplomatique (la Chine veut conforter son statut et son image d’État responsable au sein de la communauté internationale), stratégique (l’extension de la zone d’influence chinoise vers l’océan Indien se dessine depuis déjà quelque temps) et militaire (la marine chinoise veut faire la preuve de sa capacité à remplir, si nécessaire, des missions de combat en haute mer). Jusqu’à une période récente, la Chine refusait toute insertion de sa force navale dans un dispositif de coordination mais semble désormais s’intéresser à la possibilité d’une coordination des interventions, voire à une répartition des zones d’action.
Le Japon tient quant à lui à marquer son engagement dans l’opération internationale de lutte anti-piraterie au large de la Somalie puisque, après avoir envoyé deux destroyers dotés chacun de deux hélicoptères et d’environ 200 hommes d’équipage, les forces d’autodéfense vont s’adjoindre deux avions de patrouille maritime qui devraient être à pied d’œuvre d’ici au mois de mai. L’objectif de la mission est cependant clairement défini de façon nationale puisqu’il s’agit d’escorter les navires marchands qui ont un lien avec le Japon. Les forces japonaises sont pour le moment engagées sous couvert de dispositions de la police maritime des forces d’autodéfense, qui permettent d’agir face à la menace de pirates mais imposent de strictes limites d’action. Une loi est en préparation pour autoriser les marins japonais à ouvrir le feu sur des bateaux pirates qui, après un coup de semonce, continuent d’attaquer les bateaux civils mais elle ne permettra pas le droit de poursuite et limitera l’usage des armes à certaines circonstances comme la légitime défense et les évacuations d’urgence. Cette loi prévoit des peines pour les actes de piraterie, allant d’un emprisonnement pour trois ans jusqu’à la peine de mort.
L’Inde, l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Indonésie, la Malaisie ont également (ou ont eu) des bâtiments présents dans la zone. De leur côté, l’Égypte et l’Ukraine ont indiqué vouloir envoyer des navires de guerre dans le golfe d’Aden, sans concrétisation jusqu’à présent.
1. Une zone d’intervention mouvante et très étendue
L’étendue de leur zone d’action et leur extrême mobilité constituent les principaux atouts des pirates. Ceux-ci n’hésitent pas à s’aventurer de plus en plus loin des côtes et à déplacer leur zone d’action, comme le montre la multiplication des attaques dans la ZEE des Seychelles depuis le printemps 2009.
Pour les marines occidentales, la zone à surveiller est immense : deux millions de km², soit quatre fois la France, et 3 100 kilomètres de côtes. Maintenir en permanence une surveillance aérienne et maritime de la zone et une capacité d’intervention en temps réel est un défi quasiment impossible à relever, d’autant que de nombreux bateaux sont trop petits pour pouvoir être repérés et que les pirates sont désormais équipés de radars performants.
Pour surveiller et intervenir dans un espace aussi étendu, il faut des moyens importants et notamment des frégates capables d’embarquer un hélicoptère et une drome lourde. Les moyens aériens (hélicoptères, avions de patrouille maritime) sont des outils clés pour ce type d’opération et font aujourd’hui défaut aux forces françaises et européennes.
Outre l’étendue, l’éloignement est également un élément de contrainte : les forces stationnées à Djibouti doivent parcourir 2 000 kilomètres pour arriver sur zone. Au-delà d’une certaine distance, les contraintes en kérosène des hélicoptères et des avions ne permettrent pas de réaliser la mission. Il est donc absolument nécessaire que les bâtiments supports aient la capacité d’emporter un certain nombre de vecteurs (hélicoptères et embarcations). À défaut, le commandement se trouverait amputé d’une partie de ses moyens d’action.
Avec la recrudescence des attaques au printemps 2009 et leur déplacement vers le sud, l’opération Atalante est confrontée à la nécessité de reconsidérer sa zone d’intervention afin de l’étendre vers la zone des Seychelles.
Dans un premier temps, une présence temporaire d’un avion Falcon et de la frégate amirale a été décidée afin de faire acte de présence et de rassurer les flottilles de pêcheurs, particulièrement menacées dans la région. Mais couvrir une telle zone – située entre les Seychelles, la côte sud de la Somalie et le Kenya – autrement plus conséquente que celle du golfe d’Aden, demeure difficile compte tenu des capacités limitées de la force Atalante. La question du renforcement des moyens consacrés par les États membres à l’opération EUNAVFOR va donc nécessairement se poser.
2. De fortes interrogations juridiques
Pour combattre la piraterie dans le cadre d’un État de droit et conformément à la convention de Montego Bay, la seule « réponse militaire » ne peut suffire. En effet, si l’objectif premier de mettre fin à une séquestration en cours et de faire cesser les agissements délictueux constitue une priorité indiscutable, cette première phase conduit nécessairement à une seconde qui se joue sur le terrain judiciaire et ne s’achève que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. Il ne faut donc surtout pas oublier que les opérations menées contre la piraterie utilisent des moyens militaires mais sont des opérations de police qui auront des conséquences judiciaires.
Or, sur cet aspect juridique et judiciaire de la lutte internationale contre la piraterie, les interrogations demeurent nombreuses.
• Problèmes posés par la Convention de Montego Bay
La nécessité de recourir aux droits nationaux pour juger les auteurs ou complices d’actes de piraterie en haute mer rend l’efficacité de la répression tributaire de l’adaptation des droits nationaux au cadre international. Or les dispositions de la convention relatives à la piraterie n’ont été pleinement incorporées dans aucun pays européen, pas plus qu’aux Etats-Unis, et les pays disposant d’une juridiction universelle en la matière sont très rares.
En outre, la convention entraîne la nécessité de distinguer, dans l’engagement des moyens militaires, la phase purement militaire (dissuasion) et la phase au cours de laquelle les moyens militaires interviennent dans le cadre du service public de la justice, c’est-à-dire toutes les actions susceptibles de mener à l’appréhension d’un pirate et toutes les phases de la procédure judiciaire : arrestation, rétention, transfèrement, défèrement, mise en examen, mise en détention, etc. Or, cette distinction n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre à bord de bâtiments militaires et dans l’urgence opérationnelle.
• Suites judiciaires à donner aux interpellations de pirates
En Europe, seuls quatre pays de l’Union (Finlande, Suède, Allemagne, Pays–Bas) ont la capacité juridique de poursuivre des pirates sans aucun lien de nationalité et la mise en œuvre de cette possibilité revêt une dimension d’opportunité politique qui demeure prépondérante. En outre, la convention de Montego Bay ne crée aucune obligation en matière judiciaire : les États qui arrêtent des pirates ou arraisonnent un bâtiment ont toujours le choix de la juridiction.
Pour permettre néanmoins un aboutissement judiciaire des opérations militaires comme le prévoit la convention, le choix a été fait de conclure des accords avec les États régionaux susceptibles d’accueillir et de juger les pirates arrêtés par la force Atalante, dans le respect des principes fondamentaux en matière de droits de l’Homme et de droits de la défense, ce qui exclut notamment le recours la peine de mort. C’est pour cette raison que des États comme le Yémen ou Djibouti ont été écartés. Le transfert vers la Somalie n’était pas non plus envisageable, le pays n’étant pas en mesure d’assurer une quelconque prise en charge judiciaire.
Au début de l’opération Atalante, la France a choisi de transférer un certain nombre de prisonniers au Puntland mais l’Union européenne s’y est refusée en considérant que les garanties en matière de droits de l’Homme n’étaient pas suffisantes et que le Puntland n’était pas reconnu par la communauté internationale.
En mars 2009, l’Union européenne a conclu un accord avec le Kenya permettant de traduire devant la justice de ce pays certains des pirates arrêtés par la force Atalante et de fixer les conditions et modalités de transfert des suspects. Ce document fixe suffisamment de garanties pour que la peine de mort ne soit pas appliquée et que les suspects ne soient pas soumis à des traitements dégradants ou inhumains (tels que l’interdit la convention des Nations Unies de 1984). L’accord donne en outre aux représentants d’Atalante un pouvoir de vérification et de contrôle sur le sort du prisonnier que peu de responsables d’opérations militaires ont normalement dans un système juridictionnel classique. En contrepartie, l’Union s’est engagée à assister le Kenya dans le renforcement de ses capacités judiciaires et carcérales.
L’Union européenne pourrait passer, dans les prochaines semaines, un accord du même type avec la Tanzanie afin que le système judiciaire kenyan ne se retrouve pas totalement saturé.
On peut estimer que ces accords mettent en œuvre un véritable partage des responsabilités dans la lutte contre la piraterie : les marines occidentales apportent les capacités militaires et les États de la zone, dépourvus de moyens maritimes, apportent une solution pénale.
• Des difficultés de juger des pirates en France…
La France a fait le choix de traduire devant ses tribunaux les pirates ayant directement porté atteinte à des ressortissants français. Quinze pirates, arrêtés lors des opérations de libération du Ponant, du Carré d’as et, tout récemment, du Tanit, sont ainsi actuellement retenus sur le territoire français.
Outre les problèmes juridiques évoqués précédemment et les interrogations sur la légalité de leur arrestation et des conditions de leur transfèrement, la poursuite de pirates (somaliens ou d’autres nationalités) devant une juridiction française comportent plusieurs inconvénients :
– elle est très contraignante pour la marine car elle l’oblige à quitter le théâtre pour ramener les prisonniers en territoire français (ce qui prend beaucoup de temps et coûte beaucoup d’argent) ;
– elle nécessite de nombreux éléments de preuves (notamment pour démontrer l’intention de commettre une attaque ou la participation indirecte à une attaque) qui ne sont pas toujours disponibles et pour lesquels les marins ne sont pas toujours bien formés ;
– elle comporte un gros risque d’échec et donc de libération, in fine, des pirates arrêtés.
L’expérience acquise en matière de lutte contre le narcotrafic montre que ce type d’activités mobilise beaucoup de gens, d’énergie et d’argent et nécessite une véritable expertise juridique que les commandants de bâtiment et les militaires ne sont pas toujours en mesure de mettre en œuvre.
Enfin, la présence de prisonniers somaliens sur le territoire français peut se révéler dangereuse pour les bâtiments français transitant dans la zone ou pour les ressortissants retenus en otage.
3. La concurrence opérationnelle : intérêts et limites
La mobilisation internationale pour lutter contre la piraterie se traduit par une multiplication des initiatives qui permettent à chaque État ou organisation de préserver sa visibilité, de valoriser son approche du problème et de composer avec ses propres contraintes légales, sans nécessairement chercher à optimiser l’emploi des moyens disponibles.
Compte tenu de l’importance de l’enjeu et de l’étendue de la zone d’intervention, la multiplication des forces navales en présence dans la zone est un avantage sur le plan quantitatif. Elle pose néanmoins différents problèmes qui risquent, s’ils ne sont pas résolus, de limiter fortement l’efficacité opérationnelle.
Les Européens participent, à des degrés divers, à au moins trois opérations similaires, voire concurrentes (Atalante, OTAN, CTF 151, sans compter la CTF 150 et les présences nationales – française et américaine à Djibouti, notamment). Toutes ces opérations ont le même objectif, rassemblent plus ou moins les mêmes intervenants (à tour de rôle) et se déroulent de façon concomitante.
Le premier risque porte donc sur la génération de forces, les capacités des États intervenant dans la zone n’étant pas extensibles à l’infini. Comment se fera l’arbitrage entre l’opération européenne, l’OTAN et Enduring Freedom ? À la longue, tensions et pressions ne sont pas à écarter.
En outre, les forces en présence, multinationales ou nationales, ne sont pas toutes mues par les mêmes objectifs et ne mettent pas en œuvre les mêmes règles d’engagement. Une telle présence militaire – parfois motivée par des objectifs stratégiques purement nationaux – risque d’entretenir un confusion dommageable avec les autres enjeux de sécurité de la région (et tout particulièrement la lutte contre le terrorisme maritime) qui ne servirait en rien la lutte contre la piraterie et la restauration de la liberté des mers.
Une coordination minimale entre toutes les marines présentes dans la zone semble donc nécessaire pour éviter une concurrence contre-productive, même si elle est difficile à mettre en œuvre tant les cadres d’action diffèrent.
Trois approches sont a priori possibles, suivant un besoin de coordination croissant : un partage dans le temps, un partage par zone, un partage par tâche. L’approche séquentielle est la plus simple à mettre en œuvre mais n’est pas vraiment intéressante car elle se heurte au problème de la mobilisation, à un instant t, de capacités suffisantes. Par contre, un partage des zones d’intervention et des types de tâches est envisageable dès lors qu’il existe une vraie volonté de travailler ensemble et de croiser régulièrement les expériences.
Dans le cadre d’Atalante, chaque coopération bilatérale avec un État tiers est proposée par le chef d’opération, étudiée par le comité militaire et approuvée au niveau du Conseil. Ainsi, un cadre de coopération a été mis en place en janvier 2009 avec la Chine, la Russie et l’Arabie Saoudite, qui a été étendu en février 2009 à sept pays supplémentaires (Égypte, Inde, Japon, Malaisie, Oman, Ukraine et Yémen). Parmi les principaux éléments de ces accords figurent l’échange d’informations à partir des repérages effectués, l’association à l’escorte de certains bateaux présentant un intérêt national, l’échange d’officiers de liaison pour organiser une action commune ainsi que le retour d’expérience sur le modus operandi des pirates et les opérations réalisées. De plus, des contacts réguliers ont lieu en mer au niveau tactique entre commandants de forces avec la Russie, le Japon et la Chine.
Au-delà, des coopérations plus poussées peuvent se développer, sans forcément être formalisées, entre les États ou les forces internationales ayant déjà l’habitude de travailler ensemble dans le cadre d’opérations extérieures. Ainsi, une réunion entre Atalante et la coalition maritime dont dépend la CTF 151 a eu lieu à Dubaï le 25 mars 2009, des officiers de liaison ont été mis en place entre les deux opérations et les échanges opératoires sont fréquents. Une coordination avec l’OTAN s’est également engagée avec l’échange d’informations tactiques. Cette coopération est facilitée par la proximité des deux états-majors d’opération, tous les deux situés à Northwood.
Dans le prolongement des dispositions de la résolution 1851 adoptée le 16 décembre par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis ont organisé à New York, le 14 janvier 2009, une première réunion du « groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes ». 23 États (22) et cinq organisations internationales (23) y ont participé.
Ce groupe de contact a constitué quatre groupes de travail dans les domaines suivants : activités relatives à la coordination militaire et opérationnelle et à la mise en commun de l’information et la création d’un centre régional de coordination, aspects judiciaires de la piraterie (notamment la mise en détention et la poursuite en justice des personnes appréhendées pour des actes de piraterie ou des vols à main armée en mer), renforcement de la sensibilisation des armateurs et des équipages des navires marchands et le renforcement d’autres capacités, et intensification des initiatives diplomatiques et des activités d’information concernant tous les aspects de la piraterie. Les groupes de travail, qui se sont réunis en février et en mars, ont rendu compte de leurs activités à l’occasion de la deuxième réunion du groupe de contact qui s’est tenue le 17 mars 2009 au Caire.
La constitution de ce groupe de contact a donné un signal politique fort sur la volonté de la communauté internationale de se mobiliser pour combattre le « fléau » de la piraterie mais, pour constituer une véritable plus-value, ce groupe devra transcender les nombreuses contradictions d’objectifs, d’ambitions et d’intérêts de ses différents membres.
4. Quelle efficacité à long terme ?
Comme le montrent les chiffres publiés par le BMI, la mobilisation de la communauté internationale a indéniablement eu un effet, tout à la fois dissuasif et répressif, sur les attaques de bâtiments dans le golfe d’Aden. Les succès sont réels et compliquent l’activité des pirates mais ils risquent aussi de déplacer les zones d’intervention ou d’orienter les pirates vers d’autres activités illégales.
Selon le blog bien informé du journaliste Nicolas Gros-Verheyde sur l’Europe de la défense (24), « depuis le début des opérations internationales de lutte contre la piraterie, près de 202 personnes ont été arrêtées par les navires de guerre croisant dans le golfe d’Aden et au large de la Somalie et du Kenya, dont certaines en flagrant délit (attaque) ou sur de fortes suspicions (visite à bord et découverte d’armes de guerre). Sur ce nombre, 159 ont été traduites en justice, le plus souvent des pays riverains (Yémen, Puntland-Somalie, Kenya) - sauf 21 personnes rapatriées en France, Pays-Bas et aux USA » .
La présence des forces navales a également eu pour effet de faire réduire le taux de succès des pirates (de un sur trois en décembre 2008 à un sur treize en mars 2009 selon le BMI) et de faire baisser la moyenne du nombre de bateaux retenus en otages.
Mais la réussite reste fragile, comme en témoignent la reprise des attaques au début du mois d’avril (cinq bateaux pris en moins d’une semaine) et le déplacement des attaques vers le sud, entre les Seychelles et le Kenya.
Il convient cependant de noter que 70 à 80 % des bateaux pris par les pirates depuis janvier n’avaient pas suivi les consignes de sécurité et de comportement recommandés par Atalante pour le transit dans la zone à risque ou n’avaient pas, tout simplement, signalé leur position et leur passage.
Pour autant, tous les intervenants militaires s’accordent à considérer que les opérations navales ne pourront, à elles seules, apporter une solution durable au problème de la piraterie, certains allant même jusqu’à considérer, de façon assez cocasse dans ce contexte de piraterie, qu’il s’agit simplement « d’un cautère sur une jambe de bois » !
Endiguer la piraterie est possible, comme en témoigne l’amélioration considérable de la situation dans le détroit de Malacca, mais, pour cela, l’action navale ne suffit pas. En outre, comme tout phénomène délinquant, la piraterie a tendance à se déplacer si un contexte favorable – ou moins défavorable – existe ailleurs. Une intervention purement répressive ne peut donc avoir, dans le temps, qu’une efficacité limitée.
L’action navale contre la piraterie dans le golfe d’Aden est donc la condition nécessaire mais non suffisante à la résolution du problème de la piraterie.
La présence de forces navales occidentales dans la zone sera vraisemblablement encore nécessaire pendant plusieurs années, les États de la région et l’Union africaine ne disposant pas des capacités nécessaires pour prendre le relais. Ainsi, il semble d’ores et déjà acquis que l’opération Atalante sera reconduite au-delà du 14 décembre 2009, le Royaume-Uni ayant fait savoir qu’il était prêt à continuer d’accueillir l’état-major de la force à Northwood.
Au-delà, il convient de profiter du relatif répit procuré par la présence militaire pour attaquer le mal à la racine et mobiliser toutes les énergies disponibles afin de mettre en place des mécanismes à plus long terme, susceptibles de faciliter la stabilisation politique de la Somalie et de permettre aux États côtiers concernés de mieux exploiter leurs richesses économiques et de mieux répartir les revenus dans la population.
« À long terme, la question des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes ne sera résolue que par une approche intégrée permettant de mettre un terme au conflit et de s’attaquer à l’absence de gouvernance et de moyens de subsistance pour ceux qui vivent en Somalie. » (25).
IV. — POUR UNE RÉPONSE DURABLE : UN NOUVEAU PARTAGE DES RESPONSABILITÉS
Parmi les trois facteurs favorables au développement de la piraterie évoqués en début de rapport, il ne semble pas possible d’agir sur le premier : dans un contexte commercial totalement mondialisé, les routes maritimes resteront ce qu’elles sont. Une action sur la pauvreté de la population et une restauration de ses moyens de subsistance, notamment grâce à la pêche, peuvent être envisageables mais demeurent conditionnées par une effort majeur sur le troisième terme de l’équation : la restauration d’un État de droit et d’une autorité publique capable de faire régner l’ordre.
Avec plus de coopération, plus de vigilance et plus de responsabilité, de véritables progrès sont possibles.
A. UNE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE SOLIDAIRE MAIS VIGILANTE
Afin de jouer tout son rôle dans la lutte contre la piraterie, la communauté internationale doit mettre en œuvre une approche globale du problème articulant les actions civiles et militaires, à court et à long termes.
ð Adapter les modalités d’intervention militaire afin de rendre les attaques plus risquées et plus coûteuses pour les pirates
Le tout premier enjeu sera une nouvelle fois celui de la génération de force puisqu’il s’agit de pouvoir maintenir une présence navale et aérienne suffisamment dense et durable pour parvenir à maintenir une pression importante sur les pirates. Cependant, compte tenu du climat local, une simple démonstration de force des puissances étrangères ne résoudra rien et il est également vain de vouloir s’attaquer aux pirates eux-mêmes car ils sont bien trop nombreux (le « bassin d’emploi » est de plusieurs dizaines de milliers de personnes).
Pour agir plus sûrement contre la piraterie, il est préférable de chercher à accroître le coût des attaques. Pour le moment, le rapport coût/avantage est encore intéressant pour les pirates, et notamment pour les commanditaires mais, avec l’installation durable d’une présence navale dans le golfe d’Aden (ainsi, on peut le souhaiter, qu’une plus grande vigilance des États de la région, voire des autorités au pouvoir en Somalie ainsi qu’au Puntland et au Somaliland), l’augmentation du risque pourrait peu à peu dissuader les moins professionnels.
Outre le fait de systématiquement jeter à la mer toutes les armes saisies sur les bateaux de pirates arraisonnés, même si les preuves de culpabilité ne sont pas suffisantes pour arrêter les suspects, des actions de type policier, ciblées et à terre – comme par exemple répertorier les bateaux suspects et prévenir qu’ils sont interdits de mer, sous peine de destruction – pourraient certainement avoir une plus grande efficacité dissuasive.
La résolution 1851 du Conseil de sécurité des Nations Unies a ouvert la possibilité d’interventions de ce type sur le sol somalien mais celles-ci requièrent un savoir-faire différent des opérations navales et devraient vraisemblablement être réalisées dans un cadre national car elles ne sont pas prévues par le mandat de la force européenne.
ð Renforcer la présence navale et aérienne afin de mieux couvrir les zones à risque
Face aux nouvelles attaques de pirates menées dans l’océan Indien entre la côte sud de la Somalie, le Kenya et les Seychelles, Atalante doit faire évoluer son dispositif afin de protéger les navires marchands circulant dans cette zone (et notamment les bateaux de croisière) mais également les pêcheurs qui, suite à l’interdiction de pénétrer dans les 500 nautiques des côtes somaliennes, ont été contraints de concentrer leurs activités au large des Seychelles. Cette évolution ne doit cependant pas être mise en œuvre au détriment des opérations en cours dans le golfe d’Aden, qui sont efficaces et ne doivent pas être fragilisées.
Compte tenu de l’étendue des espaces à surveiller, les patrouilles aériennes sont ici mieux adaptées qu’une présence navale. En effet, il n’est pas envisageable d’accompagner les bateaux de pêche ou d’organiser des convois ; l’objectif est avant tout d’« éclairer » la zone par des passages aériens réguliers afin d’indiquer aux armements thoniers les zones de pêche sécurisées.
L’idéal serait de baser un avion aux Seychelles car Djibouti est beaucoup trop loin (4 heures de vol) pour permettre une surveillance efficace. Les Seychelles semblent prêtes à accepter une telle présence militaire puisque les revenus de la pêche thonière représentent 50 % de leur PIB, l’autre moitié étant assurée par le tourisme, et notamment les croisières, qui peuvent également être menacées par les attaques de pirates.
Début mai, deux avions (un P3 Orion espagnol positionné à Mombasa au Kenya et un Falcon 50 français) et deux navires (un bâtiment espagnol et un patrouilleur français sous pavillon national) ont effectivement été envoyés dans la zone proche des Seychelles. À cela, il convient d’ajouter les différents navires croisant dans la zone en provenance ou à destination du Kenya pour assurer le ravitaillement de la force Atalante, l’accompagnement des bateaux du PAM ou la livraison de pirates prisonniers, qui peuvent donc intervenir assez vite. Plusieurs bateaux français basés à Djibouti ou à la Réunion transitent également dans ces eaux.
Cette mobilisation de capacités supplémentaires (uniquement franco-espagnole, ce qui confirme que la menace pèse essentiellement sur les intérêts de pêche), devrait être complétée, sur le plan juridique et diplomatique, par un accord avec les Seychelles portant tout à la fois sur le positionnement de troupes et le traitement judiciaire des pirates (comme cela existe déjà avec le Kenya).
ð Utiliser des drones pour renforcer les moyens de surveillance
La force Atalante devrait sérieusement envisager l’utilisation de drones, à l’image des forces américaines qui, selon le blog Bruxelles2, en ont fait un véritable outil de la lutte anti-pirates (l’USS Mahan, qui patrouille dans la zone, est le premier destroyer anti-missiles à déployer un système de drones pleinement intégré dans les systèmes de combat du navire) (26). La marine américaine assure que ces images peuvent être partagées avec les autres forces présentes dans la zone mais il serait cependant utile que la force européenne soit dotée de tels équipements, qui apportent un véritable atout opérationnel.
En effet, les drones sont souples et très réactifs, capables de voler de jour comme de nuit dans une posture ouverte ou déguisée et de changer de zone d’exploitation et de mission en plein vol. Leur capacité à fournir des images de haute qualité en temps réel accélère la prise de décision et donne un avantage tactique significatif pour arrêter la piraterie en haute mer.
ð Accroître l’aide au développement de la Somalie en combinant soutien à la restauration de l’État de droit et aides directes et conditionnelles à la population
L’aide mondiale à la Somalie s’élève à environ 200 millions d’euros par an, ce qui n’est pas considérable d’autant qu’il s’agit, pour moitié, d’aide alimentaire. Par ailleurs, l’AMISOM coûte également 200 millions d’euros, essentiellement pris en charge par les Américains.
Sur les 200 millions d’euros d’aide internationale à la Somalie, l’Union européenne contribue à hauteur de 75 millions d’euros par an environ, dont 40 millions d’euros d’assistance humanitaire (programme ECHO de la Commission) et 35 millions d’euros d’aide au développement à travers différents programmes, principalement financés par le Fonds européen de développement (FED). Au total, le programme de soutien spécial de l’Union à la Somalie arrêté pour les années 2008-2013 s’élève à 215,4 millions d’euros ; les trois actions les plus importantes concernent l’enseignement (30 millions d’euros), le soutien au gouvernement fédéral provisoire (30 millions d’euros) et le soutien au développement économique (25 millions d’euros). L’Union a également versé 15 millions d’euros pour le soutien à l’AMISOM en 2008.
Si le processus de paix dit « processus de Djibouti » aboutit, l’argent consacré au maintien de la paix pourra être recyclé pour financer la constitution d’une administration et de forces de sécurité responsables et solides mais, en tout état de cause, l’effort financier de la communauté internationale en direction de la Somalie devra être accru pour permettre à ce pays de sortir de l’impasse politique et économique dans laquelle il se trouve.
L’aide au développement est incontestablement difficile à mener en Somalie car les notions d’intérêt général et de bien public ne font pas partie de la culture des sphères dirigeantes, dominées par la logique de clan. En outre, l’absence d’État entraîne une insécurité croissante et la disparition des responsables d’organismes humanitaires est monnaie courante. Il n’y a plus d’ONG sur place et plus d’interlocuteurs valables. C’est pourquoi l’argent versé n’est que trop rarement distribué et réparti de façon équitable.
Pour autant, la Somalie ne saurait se passer de l’aide internationale. Le gouvernement fédéral transitoire doit être activement soutenu dans ses efforts pour restaurer l’État de droit et la sécurité. Pour que la piraterie cesse d’être une option profitable pour la jeunesse somalienne, il convient de relancer le développement économique du pays, et il n’y aura pas de développement économique sans restauration de l’ordre intérieur et de la sécurité.
• La conférence des donateurs organisée à Bruxelles les 22 et 23 avril 2009 par les Nations Unies, l’Union africaine et l’Union européenne, conformément à la résolution 1863 (2009) du Conseil de sécurité, avait pour objectif de mobiliser les contributions en faveur de la consolidation de la sécurité sur le territoire somalien. Elle semble avoir atteint ses objectifs puisque la communauté internationale s’est engagée à mobiliser 165 millions d’euros (213 millions de dollars) pour favoriser la stabilisation interne de la Somalie et financer la poursuite de la mission de maintien de la paix de l’Union africaine (l’AMISOM), ainsi que les forces de police et de sécurité (maintien de l’ordre militaire) somaliennes.
La piraterie n’était pas en tant que telle à l’ordre du jour de cette conférence mais, la sécurité en mer et à terre étant profondément liées, toute amélioration des capacités de la Somalie à faire régner l’ordre et l’État de droit constituera un atout dans la lutte anti-piraterie. Le représentant du gouvernement d’unité nationale a d’ailleurs fait part de son intention de lutter contre la piraterie sur terre et sur mer et de constituer une force de gardes-côtes, en coordination avec les administrations régionales et locales.
Plus de la moitié de la somme promise provient de l’Union européenne. 72 millions d’euros vont être débloqués au titre du budget communautaire, dont 60 millions consacrés à l’AMISOM et 12 millions pour les forces de police (soit le budget d’une année de formation et de salaires pour les 10 000 policiers somaliens). La plupart des États membres de l’Union européenne ont également annoncé des contributions, ajoutant environ une quinzaine de millions d’euros à cette somme.
La France a pour sa part choisi la voie de la coopération franco-arabe en s’engageant à former 500 militaires somaliens dans sa base de Djibouti. Le financement et les salaires seront assurés par la Ligue arabe qui fournira pour ce faire 18 millions de dollars pendant six mois.
• Dans l’attente d’un rétablissement de l’autorité publique en Somalie, il pourrait également être utile, malgré les réticences longtemps affichées par la communauté internationale, d’engager une collaboration avec le Somaliland et le Puntland, qui conservent une certaine structure administrative et semblent vouloir faire des efforts pour apparaître comme des autorités responsables et dignes de confiance.
Même le Secrétaire général des Nations Unies le recommande : « Les États membres peuvent également envisager d’accroître leur appui à l’action menée au titre du dispositif de consolidation de la paix et d’intervention des Nations Unies en faveur des régions relativement stables de " Somaliland " et du " Puntland ". » (27) […] « Les autorités du " Puntland " se sont montrées véritablement disposées à lutter contre la piraterie au large de leurs côtes. J’encourage les États membres à soutenir les efforts que continuent de déployer l’Organisation des Nations Unies et ses partenaires en vue d’améliorer la gouvernance locale et de formuler des propositions viables de consolidation de la paix dans les régions relativement stables du " Puntland " et du " Somaliland ". » (28).
• Enfin, pour redonner plus rapidement des moyens de subsistance aux populations et leurs permettre ainsi de pouvoir renoncer à la piraterie, une distribution directe des aides à la population (y compris sous forme de matériels de pêche) pourrait également être envisagée, ce qui permettrait d’éviter, le plus possible, les « ponctions » intermédiaires.
Il ne faut cependant pas être naïf : si l’on ne veut pas alimenter, indirectement, la poursuite des activités illégales, il conviendrait de réserver les soutiens aux zones côtières où il n’y a pas de piraterie et d’expliquer clairement et fermement qu’il n’y aura pas d’aide pour les personnes malhonnêtes.
ð Mieux articuler l’aide européenne au développement de la Somalie avec les priorités de la politique étrangère et de sécurité commune et progresser vers une politique d’aide plus conditionnelle et des actions plus directes
À la différence de l’opération EUFOR engagée par l’Union européenne au Tchad et en RCA, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif d’accompagnement civil, à terre, des effort militaires déployés par l’Union européenne en mer au large des côtes somaliennes dans le cadre de l’opération Atalante. Les stratégies d’aide européennes au développement par pays sont organisées par la Commission sur des périodes de cinq ans et articulent les différents outils que sont le FED, l’aide humanitaire et l’instrument de stabilité (destiné à la gestion des crises et donc utilisable à tout moment). Pour ce qui concerne la Somalie, la Commission semble avoir du mal à percevoir l’urgence de la situation et l’utilisation de l’instrument de stabilité n’est pas prévue avant la fin 2009.
Or, certains États membres ont décidé de contribuer à l’opération Atalante parce qu’elle avait la volonté de s’insérer dans une approche globale du problème de la piraterie, en agissant sur les causes du phénomène et en mettant en œuvre une coopération entre le 1er et le 2e piliers de l’Union. En ce sens, l’opération Atalante n’est pas qu’une opération navale : elle représente un véritable enjeu pour la politique étrangère et de sécurité commune.
Pour le moment, cette approche globale n’existe pas, ce qui risque de décrédibiliser l’opération navale et de lui retirer sa raison d’être par rapport à l’intervention de forces plus puissantes comme la TF 151 (qui dispose d’une meilleure capacité de renseignement, d’une plus grande puissance militaire et d’une capacité plus importante d’échange avec les pays tiers). Pour confirmer sa plus-value et sa spécificité, l’Union doit montrer, à travers Atalante, qu’elle est capable de répondre pleinement à une ambition globale en coordonnant ses différentes actions.
Des actions de soutien aux capacités régionales tant en matière de lutte contre la piraterie et de sécurité maritime que dans les domaines judiciaire et pénitentiaire doivent être engagées rapidement afin de pouvoir être prises en compte à l’échéance du mandat actuel d’Atalante, en confirmation de l’approche globale défendue par l’opération.
Par ailleurs, en matière d’aide au développement, la commission est très réticente face à la prise de risque, notamment financier. Elle préfère accorder des fonds à des organismes identifiés comme sûrs (sous bannière des Nations Unies par exemple) et ne pas s’impliquer dans la mise en œuvre de l’aide pour éviter tout risque comptable, même si cela se solde par un enlisement des actions. En outre, en application du principe de l’ownership, elle se refuse à donner des consignes aux pays bénéficiaires pour l’utilisation des fonds.
Tout cela doit changer car cette optique constitue un frein considérable à la gestion globale des crises prônée par le deuxième pilier. L’aide européenne doit évoluer vers une politique plus conditionnelle et des actions plus directes. Elle ne doit plus se contenter de donner des conseils et de distribuer des moyens mais mettre en place des partenariats dynamiques dans lesquels elle est partie prenante.
ð Contribuer à la consolidation des capacités juridiques et judiciaires des États côtiers
L’Union européenne et les États-Unis ont fait le choix de transférer les pirates appréhendés dans les cadre des opérations navales dans le golfe d’Aden à des États de la région (principalement le Kenya mais également, à moyen terme, les Seychelles et la Tanzanie). Mais une telle « délégation » de leur compétence judiciaire ne peut se faire sans un accompagnement de ces États dans la consolidation de leurs capacités tant juridique que judiciaire à juger les pirates arrêtés.
Il s’agit donc, d’une part, de les aider, si cela n’est pas déjà fait, à transposer dans leur législation nationale les dispositions de la convention de Montego Bay relatives à la lutte contre la piraterie et, d’autre part, de les soutenir dans la constitution de moyens judiciaires et pénitentiaires adaptés et suffisants. À moyen terme, des États comme Djibouti, voire la Somalie, devront aussi disposer de telles capacités et doivent donc également bénéficier de l’aide internationale dans ces domaines.
La division des affaires maritimes et du droit de la mer du bureau des affaires juridiques de l’ONU a d’ores et déjà pour mandat d’aider les États à appliquer, de façon uniforme et cohérente, les dispositions de la convention UNCLOS. De son côté, l’OMI dresse actuellement un inventaire des lois des États sur la question et prépare une assistance technique pour les États qui souhaiteraient élaborer ou mettre à jour leur législation nationale contre la piraterie.
Peu d’initiatives concrètes ont jusqu’à présent été prises sur le plan matériel, à l’exception du programme « État de droit et sécurité » du PNUD en Somalie (doté de 14 millions d’euros, dont 9 financés par le Fonds européen de développement), destiné au renforcement des capacités des secteurs judiciaires et pénitentiaires du pays. Ce plan prévoit notamment la construction d’une nouvelle prison de 250 places à Gardo, au Puntland. La construction de cet équipement a cependant pris du retard et le bâtiment devrait être livré au printemps 2009.
L’Allemagne a de son côté proposé de mettre à l’étude la création d’un fonds fiduciaire international qui pourrait accueillir des contributions publiques et privées et soutenir des initiatives destinées à accompagner les États de la région dans leur lutte contre la piraterie, tout particulièrement dans les domaines judiciaire et pénitentiaire.
En ce qui concerne le Kenya, il est urgent que la Commission européenne lui apporte une assistance technique (via l’instrument de stabilité) dans les domaines judiciaire et pénitentiaire car, face à l’ampleur de la tâche, les autorités de ce pays deviennent de plus en plus réticentes à accepter le transfert de pirates capturés par le force Atalante. Dans l’attente, des interventions bilatérales pourraient être engagées, en liaison, par exemple, avec l’office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
ð Aider la Somalie à recouvrer sa souveraineté maritime et à exploiter ses ressources halieutiques
Le développement de la pêche occidentale dans la zone, avec des licences plus ou moins légales, a sûrement eu un impact sur la pêche locale en ponctionnant la ressource halieutique.
Les bateaux de pêche européens sont extrêmement contrôlés, que ce soit pour leurs parcours ou pour leurs prises. Ils ont ainsi l’obligation de signaler leur position toutes les deux heures au centre national de surveillance des pêches (en France, le CROSS Ethel) via le système VMS – vessel monitoring system – et ces informations peuvent être transmises sur demande à l’Union européenne et aux États ayant accordé des droits de pêche. Les débarquements sont par ailleurs systématiquement analysés. Il s’agit donc d’une activité totalement transparente.
La pêche illégale existe néanmoins encore aujourd’hui, que ce soit dans l’océan Indien ou l’Atlantique, notamment dans le golfe de Guinée, au profit d’intérêts asiatiques, voire occidentaux, dissimulés sous des pavillons fantaisistes. Elle constitue une double menace, tant sur la préservation de la ressource que pour l’équilibre des marchés.
Le rapport établi en janvier 2008 par la Banque mondiale pour l’évaluation du programme de reconstruction et de développement de la Somalie (29) estime que le montant annuel de la pêche illégale dans les eaux somaliennes s’élève à 95 millions de dollars (et à 25 % des prises potentielles). Ce même rapport précise que les eaux somaliennes ont été régulièrement pillées depuis 15 ans par 500 à 1 000 bateaux dépourvus, dans leur grande majorité, de licence ou de droit de pêche. L’exportation de langoustes a notamment beaucoup souffert de cette prédation, la destruction des stocks et des récifs par les bateaux étrangers pratiquant la pêche illégale ne permettant pas aux pêcheurs locaux de vivre de leur activité. Les navires étrangers ont également détruit beaucoup de filets et de matériels de pêche.
Ce même rapport considère que le patrimoine halieutique somalien représente 500 millions de dollars et que les droits de pêche pourraient rapporter jusqu’à 100 millions de dollars par an. Il souligne l’urgence de contrôler et de licencier les bateaux (nationaux et étrangers) pêchant dans les eaux somaliennes et recommande de renforcer les activités de pêche locale par la création d’un corps de gardes-côtes ainsi que par la mise en place d’un cadre légal et d’un dispositif de licence commerciale. De tels efforts ne pourraient qu’encourager les investissements privés dans les installations côtières destinées à la filière pêche.
Les instruments de coopération de l’Union européenne devraient très certainement être utilisés pour accompagner la mise en place d’un système de gardes-côtes et d’une administration susceptible de délivrer des licences de pêche et de percevoir les redevances.
Il pourrait également être intéressant de favoriser les échanges entre le gouvernement somalien et les compagnies de pêche internationales afin de parvenir à une exploitation efficace et équilibrée du patrimoine halieutique somalien ainsi qu’au développement de l’industrie de pêche du pays.
Enfin, il conviendrait d’encourager la Somalie à rejoindre, le moment venu, la commission thonière de l’océan Indien, organisation régionale chargée de gérer les ressources de cette espèce dans la zone.
D’aucuns estiment cependant que le pillage des eaux et la pollution systématique de la zone depuis plusieurs années ont fortement réduit l’importance de la ressource halieutique. Un des interlocuteurs du rapporteur sur ce sujet estime même que « dans la poubelle qu’est devenue la Somalie », on trouve des déchets toxiques, du trafic d’armes et de la pêche illégale, mais aussi « pas mal d’intérêts européens »…
ð Améliorer le partage de l’information et la coopération entre les forces navales présentes dans les zones à risque
• Dans le golfe d’Aden
Le « Groupe de contact » créé à la suite de la résolution 1851 (2008) du Conseil de sécurité avait pour objectif majeur d’améliorer la coordination militaires des forces navales présentes dans la zone et de favoriser l’échange d’informations. Bien que l’administration américaine semble désormais moins enthousiaste à l’idée de favoriser la création d’un centre régional de coordination de la lutte contre la piraterie dont elle n’aurait pas le plein contrôle, cette idée mérite d’être défendue dès lors qu’il s’agit d’un dispositif qui ne dupliquera pas ce qui existe déjà et n’interfèrera pas avec les commandements opérationnels des forces.
Un tel centre présenterait l’avantage d’optimiser l’emploi des moyens disponibles, de capitaliser et de diffuser les retours d’expérience et de progresser vers une plus grande harmonisation des procédures. Il s’agirait nécessairement d’une structure souple et légère (une sorte de club d’échange entre officiers de liaison), sans lien hiérarchique avec les différentes opérations militaires, qui doivent demeurer autonomes.
Différentes options sont possibles mais il serait souhaitable de ne pas exclure les États régionaux (notamment ceux riverains du golfe d’Aden) de ce dispositif et donc de s’assurer de sa compatibilité avec les décisions prises lors de la réunion OMI de Djibouti en janvier 2009 (cf. infra B. 2.).
À la suite de la libération d’un cargo battant pavillon américain, les déclarations de la secrétaire d’État Hillary Clinton le 15 avril 2009 semblent marquer la volonté de la nouvelle administration américaine de s’investir sur le dossier de la piraterie. Si cette prise de conscience constitue une bonne nouvelle, il est cependant regrettable que cette implication ne prenne que très peu en compte les opérations en cours et tout ce qui a déjà été réalisé sur le dossier, au profit d’une montée en puissance de la CTF 151 et de l’état-major américain à Bahreïn.
Pionnière dans le domaine de la lutte contre la piraterie, l’Union européenne doit être particulièrement vigilante pour préserver sa légitimité, son autonomie et sa visibilité sur ce dossier, pour lequel elle possède une expérience incontestable tant en matière opérationnelle que pour la coordination ou encore l’action diplomatique et judicaire. L’enjeu est important pour la politique européenne de sécurité et de défense et le rôle de l’Union sur la scène internationale.
• Dans le golfe de Guinée
Les principaux pays impliqués dans l’industrie pétrolière cherchent à sécuriser la zone pour dissuader les attaques mais, dès lors que celles-ci interviennent la plupart du temps dans les eaux territoriales, les possibilités d’intervention sont très limitées.
En outre, l’obtention de renseignements est très difficile car le Nigeria dispose d’un appareil d’État centralisé, relativement fort et très vigilant sur ses prérogatives de souveraineté. La coopération entre États est donc privilégiée.
Pour faire face à la multiplication des attaques en mer et aux menaces sur les intérêts français, la France a décidé la mise en place d’un contrôle naval volontaire du même type que celui existant dans l’océan Indien et assure, de façon occasionnelle, la présence d’équipes de protection sur des bâtiments de l’État en mission dans la zone (comme par exemple, au printemps 2008, sur le Pourquoi Pas, bâtiment de l’IFREMER en mission prospective pour TOTAL).
De façon générale, les moyens disponibles sur zone sont néanmoins insuffisants pour assurer une véritable sécurisation. Pour être efficace, il faudrait disposer, en permanence, d’un centre de commandement, d’un bâtiment porte-hélicoptère et d’une capacité à délivrer très rapidement (en moins d’une heure) une équipe d’intervention (de type commando) sur la zone. Pourtant, seule la logique de dissuasion est envisageable : afficher une présence ostensible, avec des bateaux et des forces disposant de tous les moyens d’agir constitue très certainement la meilleure façon de faire. En cela, le golfe de Guinée est désavantagé par rapport au golfe d’Aden, qui bénéficie de la présence de la TF 150 dans l’océan Indien.
Les États-Unis sont néanmoins de plus en plus présents dans la zone et ont clairement engagé une politique de sécurisation de leurs approvisionnements stratégiques ; la création de l’AFRICOM n’est pas étrangère à cet enjeu. Les Britanniques, qui ont sur place les mêmes intérêts industriels que la France, ne sont par contre présents que de façon épisodique, sans logique d’ensemble. Enfin, les Chinois réalisent actuellement de gros investissements dans la zone et sont en train de prendre pied économiquement.
La logique de coopération doit donc être privilégiée mais l’importance des enjeux économiques et industriels rend celle-ci particulièrement difficile à réaliser.
ð Renforcer la coopération bilatérale avec les États côtiers en matière de sauvegarde maritime
• « Dans sa résolution 1816 (2008), le Conseil de sécurité a demandé aux États et aux organisations intéressées, y compris l’OMI, de fournir à la Somalie et aux États côtiers voisins, à leur demande, une assistance technique visant à renforcer la capacité de ces États d’assurer la sécurité côtière et maritime, y compris la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins. » (30).
Le développement de capacités régionales de sauvegarde maritime est un élément central de la stratégie de lutte contre la piraterie et, plus largement, de restauration de la sécurité maritime dans cette région de l’océan Indien. Or, pour le moment, les moyens dont disposent les États de la région dans ce domaine sont soit limités (au Yémen et à Djibouti) soit embryonnaires (au Somaliland, au Puntland et au Kenya).
Il convient donc d’accroître la coopération internationale en faveur du développement de compagnies de gardes-côtes, sous la forme de formations et de financement des équipements et des infrastructures, mais aussi de mettre en place des mécanismes voire des structures de coopération entre les forces existantes.
Une démarche en plusieurs temps pourrait être envisageable pour la formation des personnels de sécurité des États côtiers (Yémen, Kenya, Djibouti, Nigeria, Cameroun, voire Somalie) aux missions de sûreté maritime.
Dans un premier temps, il pourrait être envisagé d’accueillir sur les bâtiments des forces navales occidentales des détachements de douaniers ou de militaires afin de les sensibiliser et de les former à la fonction de garde-côte. C’est notamment ce que la France a proposé récemment à Djibouti. Dans un second temps, le relais pourrait être passé à un ou plusieurs États côtiers (Djibouti, Yémen, Kenya, Nigeria, Cameroun), tout en leur assurant un soutien financier pour leur équipement, et notamment l’achat et l’entretien de bâtiments adaptés, comme ceux récemment présentés par DCNS ou proposés à l’Union européenne par la société V-Navy. Enfin, dans un troisième temps, les pays concernés pourraient poursuivre cette activité régalienne en pleine autonomie.
Ce même processus devrait pouvoir s’appliquer à la Somalie dès lors qu’elle commencera à reconstruire des structures étatiques et administratives. Il nécessite néanmoins un préalable incontournable : une volonté de coopération réelle et sincère de l’État riverain…
L’instrument de stabilité de l’Union européenne doit être mobilisé afin d’apporter rapidement à plusieurs États de la région (Yémen, Djibouti, Kenya) un financement pour des actions de formation, voire de matériels d’équipement (moyens de communication, radars), dans le domaine de la surveillance côtière.
De très nombreuses coopérations bilatérales, principalement anglo-saxonnes et françaises, existent depuis quelques années avec le Yémen dans le domaine des gardes-côtes et de la sauvegarde maritime. La coopération française est structurelle (formations, dons d’équipements, participation à l’aménagement d’une base de gardes-côtes) mais également opérationnelle, avec l’organisation d’exercices avec la marine française depuis avril 2008. La France participe aussi à la mise en place d’un dispositif de sécurité maritime dans le détroit de Bab el Mandeb à travers un accord tripartite signé avec le Yémen et Djibouti.
Le Kenya est également prêt à contribuer à une action en mer et à la lutte contre la piraterie mais a pour cela besoin d’une aide rapide pour remettre à niveau ses capacités navales. Ce pays a demandé un audit technique à la marine française pour évaluer la valeur opérationnelle des bâtiments existants et préconiser des améliorations réalisables rapidement. Le Kenya a également manifesté son intérêt pour les frégates « Gowind » de DCNS.
• Dans le golfe de Guinée, on peut noter la recherche d’une coopération régionale, voire internationale, pour sécuriser la zone et, sur le plan militaire, des efforts indéniables de la marine nigériane. Le Nigeria semble plus ouvert à la coopération en matière de sécurité, comme en témoigne la signature d’un accord de coopération stratégique avec la France lors de la visite du Président de la République dans ce pays en juin 2008, qui comprendrait notamment, pour ce qui concerne la marine, la fourniture d’équipements de détection et de transmission et des prestations de formation.
Il existe également une coopération avec le Cameroun depuis déjà plusieurs années ; le pays a notamment demandé à la France de réaliser un audit sur la capacité de la marine à remplir des missions de gardes-côtes.
ð Mieux contrôler la circulation des flux financiers générés par la piraterie
Pour lutter contre la piraterie, il est certainement plus efficace d’agir sur les financeurs que sur les pirates proprement dits, qui sont beaucoup trop nombreux et quasiment impossibles à repérer en amont des attaques. Les hommes d’affaires somaliens disposant de suffisamment de fonds pour financer des « campagnes » en mer ne sont pas très nombreux. Il serait donc intéressant de parvenir à arrêter deux ou trois commanditaires afin de faire clairement comprendre qu’il s’agit là d’affaires dangereuses.
Comme l’a récemment suggéré la nouvelle secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, il serait également utile d’étudier la possibilité de placer un certain nombre de commanditaires sous le régime de sanctions prévu par la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies, même s’il est avéré que les pirates utilisent fort peu, jusqu’à présent, les moyens financiers internationaux.
Pour suivre les flux financiers issus de la piraterie – particulièrement difficiles à isoler puisque les rançons sont presque toujours versées en liquide –, il faut cependant être en mesure d’identifier les commanditaires et les comptables, de dresser la carte des réseaux de financement, de comprendre le système bancaire somalien (formel et informel) ainsi que ses liens avec les pays voisins et d’obtenir l’accord des États de résidence pour effectuer des poursuites.
Seul un renforcement de la coopération des services de renseignement financiers et militaires occidentaux permettra un véritable progrès dans ce domaine. Encore plus peut-être qu’en matière d’opération militaire, l’efficacité est ici conditionnée par la mise en commun des compétences et l’échange d’informations.
ð Clarifier la réglementation internationale en matière de pavillon
Dans le monde maritime actuel, l’armateur est libre de choisir le pavillon sous lequel sont placés ses bateaux. L’État du pavillon fixe les obligations des armateurs et des affréteurs (comme, par exemple, les dispositifs de sûreté à bord ou la nationalité de l’équipage) et, en contrepartie, s’engage à assurer la sécurité du bâtiment lorsqu’il navigue. Un armateur peut donc faire le choix de pavillonner ses navires dans un État apte à le protéger contre la menace de piraterie – ce qui a évidemment un coût – ou de pavillonner dans un autre État, moins onéreux à l’immatriculation mais incapable d’exercer une quelconque prérogative souveraine en haute mer et d’assumer ses responsabilités à l’égard des navires battant son pavillon.
Cette possibilité entraîne en pratique une grande complexité pour déterminer les intérêts nationaux en jeu. Ainsi, un navire sous pavillon français n’est pas nécessairement opéré par des intérêts français et un navire sous pavillon étranger peut appartenir à des intérêts français (actionnariat, cargaison). La plupart du temps, il y a une grande différence entre l’État du pavillon et la nationalité des intérêts financiers en œuvre (propriété des bateaux et des cargaisons), ce qui entraîne une dilution néfaste des responsabilités (comme dans l’affaire de l’Erika).
Comme certaines grandes pollutions maritimes, la crise de la piraterie est révélatrice de la complexité voire de l’opacité des règles et des modes de fonctionnement du commerce maritime international.
Dans une optique libérale, certains États considèrent que les pratiques actuelles ne doivent pas être affectées par la montée de la piraterie, que les armateurs ou assureurs doivent faire leur affaire de ce nouveau risque et qu’en cas d’intervention des États, celle-ci doit bénéficier indistinctement à tout pavillon. D’autres États, plus responsables, sont prêts à assumer leurs responsabilités et à lutter contre les attaques, mais ils réclament légitimement une meilleure lisibilité du monde maritime afin d’identifier les bénéficiaires réels des protections dispensées et de mieux responsabiliser les armateurs, les affréteurs et les États spécialisés dans le pavillon « low coast ».
B. DES PUISSANCES RÉGIONALES PROACTIVES
1. L’exemple du détroit de Malacca
La situation dans le détroit de Malacca est régulièrement citée comme un exemple vertueux dont l’expérience doit être mise à profit pour transformer la situation dans le golfe d’Aden et, plus largement, dans l’ouest de l’océan Indien. Les pays riverains, c’est-à-dire la Malaisie, l’Indonésie et Singapour, ont en effet fait le choix – sous la pression « amicale » du Japon mais aussi dans la crainte de voir intervenir des puissances occidentales – d’organiser un échange d’informations et une coopération opérationnelle afin de venir à bout de la piraterie menaçant la sécurité et donc la prospérité du trafic dans le détroit.
L’accord ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on combating Piracy and armed robbery against ships in Asia) procède d’une initiative japonaise. Finalisé en novembre 2004 à Tokyo et entré en vigueur en septembre 2006, cet accord de coopération réunit 16 pays d’Asie. Il vise à faciliter la circulation de l’information et la mise en place de coopérations entre les États contractants. Un centre de partage de l’information (ReCAAP Information Sharing Center – ISC), basé à Singapour, est chargé d’organiser la collecte, l’échange et la diffusion d’informations vers les autorités publiques, les armateurs et l’industrie navale.
L’opération MALSINDO (Malaisie – Singapour – Indonésie), lancée en 2004, a permis d’organiser des patrouilles coordonnées (en mer et dans les airs - opération dénommée Eyes in the sky –) entre les trois pays pour surveiller en permanence le détroit. Les marines, les gardes-côtes et/ou les gendarmeries maritimes des trois pays agissent de façon coordonnée grâce à une communication et un échange d’informations permanents mais chacun reste dans ses eaux territoriales. En cas d’attaque, les poursuites sont coordonnées, chaque autorité nationale prenant le relais dès l’entrée sur son territoire.
Ces patrouilles coordonnées ont permis de réduire très fortement le nombre des attaques. Les opérations de surveillance et de dissuasion ont été complétées par des actions à terre et notamment par un effort du gouvernement indonésien pour restaurer l’autorité publique dans des zones de non-droit. L’important développement économique qu’ont connu la Malaisie et l’Indonésie ces dernières années a également contribué à la résorption du phénomène. Enfin, on peut estimer que le passage du tsunami a également eu pour effet de détruire, pendant un temps au moins, les bateaux des pirates et l’arrivée massive de subsides internationaux a permis d’améliorer provisoirement la situation matérielle des populations.
Singapour a également joué un rôle moteur dans cette sécurisation ; la cité-État travaille actuellement à renforcer sa capacité globale de gestion des crises et ouvrira un centre régional dédié en 2010. Ce dispositif n’est pas spécifique à la piraterie mais prend bien évidemment en compte le phénomène.
Le détroit de Malacca est pour le moment sécurisé mais l’activité pirate n’a pas été éradiquée et l’accalmie peut n’être que temporaire. Le nombre de gangs spécialisés dans la piraterie a certes diminué mais des attaques sont toujours perpétrées dans les zones proches des extrémités du détroit. Il n’est pas certain qu’avec la crise économique la piraterie ne redevienne pas une activité tentante, tout particulièrement pour les laissés-pour-compte de la croissance… La vigilance ne doit donc pas être relâchée.
2. Dans le golfe d’Aden et l’ouest de l’océan Indien
La conférence internationale sur la piraterie au large de la Somalie, réunie à Nairobi le 11 décembre 2008 sous la coprésidence du gouvernement kényan et du représentant spécial pour la Somalie du Secrétaire général des Nations Unies, a marqué pour la première fois la volonté des acteurs régionaux de coopérer les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations internationales afin de lutter contre la piraterie en mer et de trouver des solutions aux causes du problème.
Le communiqué final de la conférence souligne que le renforcement et l’élargissement des institutions fédérales de transition et l’amélioration rapide de la sécurité sur terre sont indispensables pour réduire la piraterie au large de la Somalie. Les représentants du gouvernement fédéral de transition de Somalie, de l’ARS et des régions du Puntland et du Somaliland se sont notamment dits prêts à créer prochainement un groupe de travail chargé d’examiner la façon dont la Somalie pourrait coopérer avec la communauté internationale afin de mettre un terme à la piraterie et aux vols à main armée en mer.
ð Soutenir la mise en œuvre politique, technique et matérielle de l’accord régional de coopération adopté à Djibouti le 29 janvier 2009
L’Organisation maritime internationale a organisé à Djibouti, du 26 au 29 janvier 2009, une réunion de haut niveau à l’occasion de laquelle 17 pays de la région ont adopté par consensus un « code de conduite » concernant la répression des actes de piraterie et des vols à main armée commis contre des navires dans la partie ouest de l’océan Indien et dans le golfe d’Aden. Il s’agit du premier accord signé entre pays arabes et africains pour lutter contre la piraterie dans cette zone.
Cette initiative montre que les États de la région sont déterminés à se mobiliser et à travailler ensemble pour résoudre les problèmes de sécurité maritime. Il faut cependant souligner qu’il s’agit d’un texte non contraignant, qui laisse aux États signataires un délai de deux ans pour adapter leur législation et leurs procédures au contenu du code de conduite.
Le code de conduite, formellement signé par neuf États (31), est immédiatement entré en vigueur. Dans le cadre du droit international de la mer défini par la convention de Montego Bay, ce texte prévoit des mécanismes de coopération et de coordination des actions anti-pirates, y compris la possibilité de conduire des opérations communes. Les États signataires se sont notamment mis d’accord sur la mise en place :
– de trois centres régionaux d’information sur la piraterie (sur le modèle du centre ReCAAP à Singapour) : les deux premiers seront rattachés au centre régional de coordination des opérations de sauvetage en mer de Mombasa (Kenya) et au centre sous-régional de coordination de Dar es Salaam (Tanzanie) tandis que le troisième sera mis en place à Sana’a (Yémen). Ces centres seront chargés de recueillir et de transmettre des informations et des alertes sur la piraterie dans la zone mais seront dépourvus de compétences opérationnelles ;
– d’un centre de formation et d’entraînement pour les acteurs de la sécurité en mer (gardes-côtes) des pays de la région, dont l’implantation à Djibouti est recommandée.
La mise en œuvre de ce code de conduite sera complexe, notamment parce qu’il a peu de substance juridique et opérationnelle, mais une véritable volonté de progresser semble exister. Cet accord représente un bon outil diplomatique qui doit être articulé avec les travaux du groupe de contact et les dispositifs de coordination d’ores et déjà mis en œuvre par les forces navales en présence (Atalante notamment).
La création des centres d’information et de formation pourrait notamment constituer un levier important pour faire émerger une stratégie régionale durable de lutte contre la piraterie. Elle nécessitera cependant beaucoup de temps et de moyens (salaires, achat puis entretien des bateaux, infrastructures) et les États côtiers auront besoin de la solidarité internationale pour mener à bien leurs projets.
À ce sujet, le programme « Routes maritimes critiques », lancé par l’Union européenne en 2008 dans le cadre de l’instrument de stabilité, doit être mobilisé le plus rapidement possible pour apporter son appui à la mise en place du centre d’information de Sana’a et du centre de formation de Djibouti. Ce programme est doté de 14 à 18 millions d’euros pour la période 2009-2011, dont 3,5 millions d’euros mobilisables en 2009 pour le golfe d’Aden.
Par ailleurs, toujours sous les auspices de l’OMI, il existe un projet d’accord de coopération entre les États côtiers du golfe de Guinée mais rien ne pourra se mettre en place tant que le Nigeria ne jouera pas le jeu.
C. DES ARMATEURS PLUS IMPLIQUÉS
L’intervention de la force publique est aujourd’hui privilégiée par les armateurs : elle est effectivement pertinente compte tenu de son effet dissuasif mais n’est pas envisageable à long terme et sur grande échelle. La menace en mer a évolué : les navires de commerce doivent s’adapter pour être moins vulnérables et plus vigilants.
ð Respecter les consignes de sécurité et de comportement pour la navigation dans les zones à risque
Le bilan des premiers mois de l’année 2009 le démontre : la très grande majorité des attaques réussies dans le golfe d’Aden concerne des bateaux, du voilier de plaisance au porte-containers, qui n’avaient pas respecté les directives de sécurité diffusées par les autorités militaires. Le Centre de sécurité mis en place par l’opération Atalante (MSC-HOA) mais également les commandements tactiques des forces présentes sur zone s’attachent à donner de façon régulière et précise des informations et consignes afin de sécuriser au mieux la traversée du Golfe. Encore faut-il que les bâtiments signalent leur position et prennent en compte ces recommandations…
Il est de la responsabilité des armateurs, commandants et équipages, mais également des États du pavillon, de faire tout leur possible pour respecter ces consignes de comportement et de sécurité et jouer pleinement le jeu de la transparence. Sans cette collaboration, les forces navales, aussi nombreuses soient-elles, ne suffiront jamais à sécuriser la navigation dans ces zones difficiles.
ð Renforcer les capacités de défense passive des navires et améliorer la formation des équipages
Il existe un certain nombre de moyens simples, réalistes, peu coûteux et non violents pour améliorer la capacité de défense des navires :
– capacité de détection et de surveillance (caméras infrarouges panoramiques, radars portatifs) ;
– capacité de dissuasion (projecteur à magnésium, canons à eau, canons acoustiques dits LRAD) ;
– protection physique du bateau (barrières, fermeture des accès, blindages, relèvement des francs bords) ;
– formation des équipages (comportement face au risque, manœuvres d’évitement).
En cas d’attaque, l’équipage peut également constituer une « citadelle » en verrouillant le château et la passerelle pour interdire tout contact avec l’extérieur : cela fait partie des règles ISPS. Cette manœuvre permet de garder le contrôle du bateau et d’attendre les secours mais elle n’est envisageable que si l’équipage est entraîné, adhère à la démarche et surtout est prévenu avant l’attaque pour avoir le temps de se mettre à l’abri.
Pour les traversées dans les zones à risque, la présence à bord d’un spécialiste de la sécurité, capable de prendre les bonnes décisions en temps et heure afin de rendre l’abordage le plus difficile possible, pourrait également se révéler utile.
Les entreprises spécialisées dans le naval de défense, comme DCNS, et celles qui disposent d’une bon savoir-faire en matière d’intelligence embarquée
– comme Thales, BAE systems, Saab, Finmecanica –sont susceptibles de proposer des équipements en matière de sécurité maritime. C’est un domaine exemplaire pour le rapprochement, tout au moins au niveau industriel, des secteurs de la défense et de la sécurité car de nombreuses technologies de surveillance et de défense utilisées par les navires militaires sont transposables sur des bâtiments civils. Néanmoins, le marché n’est pas encore bien identifié et demeure, pour le moment, dans une logique de l’offre.
Une réponse adaptée au besoin : le système de veille optique automatique
Sea on Line est une société spécialisée dans les équipements de sécurité des navires. En cherchant à utiliser au mieux les possibilités technologiques actuelles (notamment en matière d’infrarouges), elle a développé un outil de détection optique automatique en mer, désormais au stade de la commercialisation. Cette technologie 100 % française ne connaît pas de concurrent, même aux États-Unis.
Il s’agit d’implanter sur les navires des caméras infrarouges connectées à un logiciel de détection et d’alerte automatiques, qui ne nécessite pas de personnel supplémentaire. Différentes configurations et implantations des caméras sont possibles selon les types de bâtiments. Ainsi, pour les porte-containers, des caméras sont disposées tout autour du bateau, ce qui permet d’obtenir une vision à 360 degrés sans angle mort. Cela permet de soulager l’officier de quart qui, de toute façon, n’est pas physiquement en mesure d’assurer une surveillance complète puisque l’arrière du bateau n’est pas visible de la passerelle.
La veille optique permet de détecter ce que ne voient pas les radars (embarcations petites et proches). Dans la configuration proposée aux armateurs, les caméras ont une portée de 4 000 à 5 000 mètres, ce qui correspond à la zone non couverte par les radars pour de petites embarcations. L’utilité pour lutter contre les pirates est évidente puisque ceux-ci attaquent de préférence dans les zones de mauvaise détection (arrière du bâtiment), avec de petites embarcations (non repérables par les radars) et la nuit (mauvaise visibilité).
Dans ses recommandations pour lutter contre les attaques, le BMI souligne l’importance, pour l’équipage, de pouvoir être alerté à l’avance : c’est ce que permet le système de détection automatique, qui repère les éléments proches, analyse le vecteur en fonction de critères préétablis et alerte l’équipage si nécessaire, tout cela en temps réel. Il n’est pas étonnant que les assureurs et les courtiers soutiennent cette démarche !
Le coût d’un système pour l’équipement d’un porte-containers est aujourd’hui de 140 000 euros pour 12 caméras infrarouges et le système électronique de détection. Pour des navires neufs, le coût marginal est limité ; il est bien sûr plus lourd pour des bateaux déjà existants. Pour un bateau de pêche, le prix est beaucoup moins élevé, autour de 10 000 euros, l’équipement étant également très utile pour éviter les collisions.
Un exemple intéressant : la stratégie de sécurité du groupe Total
Total dispose de plus d’une centaine d’installations portuaires, flottantes ou à terre, réparties dans ses différentes zones d’activité (golfe de Guinée, Venezuela, Bolivie, Yémen). La stratégie de sécurité du groupe combine intelligemment les mesures de défense passive et les dispositifs d’accompagnement, dans une logique de collaboration avec les États et les marines nationales. Le groupe se refuse à recourir aux sociétés militaires privées, par principe et par crainte d’une escalade de la violence.
L’analyse des risques et des menaces est considérée comme un élément central de l’élaboration du plan de sûreté. Celui-ci doit prévoir des solutions pour pallier tous les types de menaces : collision volontaire, intrusion, piraterie, attaque aérienne ou sous-marine. Ainsi, pour prévenir les intrusions à bord et les attaques de pirates, le plan de sûreté prévoit une veille humaine et un radar à bord des remorqueurs et de la plateforme ainsi que la mise en place d’obstacles (grilles) pour empêcher les accès au bâtiment. En cas d’attaque, l’équipage doit se regrouper dans une pièce de sécurité (safe room) le temps que les secours arrivent.
Dans le golfe de Guinée, la société s’est organisée pour assurer l’escorte des bâtiments de transport et la sécurisation des installations en mer. Elle a loué des bateaux civils (de type supplie) sur lesquels embarquent des marins nigérians équipés d’un armement de protection. Ces marins (qui touchent un défraiement) sont encadrés par un coordinateur de sécurité, lui-même ancien marin nigérian salarié par Total. Il s’agit d’un dispositif totalement officiel qui fonctionne relativement bien. Total est la seule compagnie à procéder ainsi pour le moment ; les autres sociétés pétrolières s’en remettent à une force constituée par le Nigeria pour lutter contre la piraterie (baptisée JTF – joint task force), jugée peu fiable. Les FPSO (unités flottantes de production, stockage et enlèvement) sont de leur côté équipées de porte-voix très puissants (jusqu’à 1 000 mètres) pour dissuader les pêcheurs d’approcher trop près.
Dans le golfe d’Aden, Total collabore avec la marine française dans le cadre du contrôle naval volontaire ; les bateaux utilisés ne battent pas forcément pavillon français mais, dès lors que la cargaison est française, le contrôle d’Alindien s’applique afin d’assurer la « défense des intérêts français ». L’embarquement de marins français durant les escortes ne pose pas de problème de principe. Au Yémen, où Total prépare l’installation d’une exploitation de gaz qui nécessitera des chargements réguliers, la société cherche à développer les stratégies de sécurité les moins agressives possible afin de ne pas s’aliéner la population. Le pays possède une marine et des gardes-côtes mais, si cela n’est pas suffisant, Total envisage l’installation de barrières flottantes autour du méthanier au moment des chargements (du type de celles utilisées pour protéger la rade de l’Île-Longue).
ð Organiser la contribution des armateurs à la sécurisation des espaces maritimes
Les armateurs ont tout intérêt à la restauration de la sécurité dans le golfe d’Aden, le contournement de l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance générant des surcoûts difficilement supportables à long terme. Il n’est donc pas absurde d’imaginer qu’ils participent financièrement à cette sécurisation. Les richesses qui transitent par la zone sont considérables : à titre indicatif, la perception d’un euro par tonne de marchandise passant par le canal de Suez rapporterait 2 millions d’euros par jour…
Le rapporteur ne propose pas de mettre en place une taxe automatique sur le trafic dans le canal de Suez, mais plutôt de sensibiliser les armateurs et affréteurs aux enjeux de sécurité maritime dans la zone afin qu’ils organisent, entre eux, un mécanisme de contribution volontaire. La création d’un fonds fiduciaire international proposée par l’Allemagne relève de la même logique.
La gestion des fonds recueillis pourrait être confiée à une banque de développement à gouvernance publique/privée, qui pourrait ensuite répartir la ressource entre la Méditerranée et le golfe d’Aden, pour divers projets de sécurisation. Le soutien à la création de gardes-côtes dans les États riverains pourrait bien entendu figurer parmi ces projets.
De tels investissements constitueraient sans aucun doute un levier de développement très important et un moyen d’attirer de nouveaux investisseurs. En outre, cela pourrait créer un nouveau marché pour les technologies et matériels de sûreté et de sécurité tout à fait intéressant pour les industriels européens.
Si les armateurs ont le sentiment que les moyens mis en place peuvent contribuer à une meilleure sécurité maritime, ils ne devraient pas refuser de réfléchir à un tel mécanisme de solidarité. C’est pourquoi il est fort regrettable que l’Union européenne ait refusé la proposition française d’associer les armateurs au financement de l’opération Atalante. Ceux-ci semblaient prêts à participer non pas à l’opération militaire proprement dite mais plutôt à des opérations contribuant à la restauration de la sécurité maritime dans la zone. L’idée de les associer à des projets destinés à renforcer la sécurité maritime est donc tout à fait valable.
D. QUEL RÔLE POUR LES SOCIÉTÉS MILITAIRES PRIVÉES ?
Le principe de la liberté de navigation est la clé du développement de l’économie mondiale et doit être garanti par des acteurs fiables, responsables et à la légitimité incontestable.
Si cette tâche est laissée à des sociétés militaires privées (SMP) dont la seule légitimité relève d’un contrat, on risque d’assister à une surenchère d’armement et de violence. En outre, le niveau d’encadrement des activités de ces sociétés est tellement variable d’un pays à un autre que l’on ne peut pas écarter le risque d’une intervention et d’un usage de la force non justifiés.
Nombreux sont ceux qui craignent que les océans se transforment ainsi en Far West et qui, en conséquence, refusent de « privatiser » la sécurité en mer. L’OMI et le BMI, les armateurs, les représentants des capitaines de marine marchande et des équipages, les principaux responsables de l’armée française, tous sont fermement opposés à l’intervention des SMP, et tout particulièrement à la présence des gardes armés privés à bord des bâtiments. Celle-ci pourrait certes avoir un effet dissuasif, mais risquerait surtout d’entraîner une escalade de la violence. Chacun s’accorde à estimer que les pirates sont de mieux en mieux entraînés et équipés et que ce n’est pas le métier des marins de s’opposer à ce genre d’attaque. En outre, la présence d’armes à bord est source de problèmes avec les douanes et les autorités portuaires.
D’un point de vue strictement juridique, les moyens étatiques sont plus efficaces que des moyens privés car même si, en situation de flagrance, les conditions d’emploi de la force par des agents de l’État (militaires principalement) sont les mêmes que pour une SMP – c’est-à-dire la légitime défense –, les forces publiques disposent néanmoins de nombreux atouts tels que :
– le droit de visiter un bâtiment en haute mer sans accord de l’État du pavillon ;
– la possibilité d’employer des navires de guerre, des moyens de transmissions, des réseaux d’échanges d’information nationaux ou interalliés ;
– le recours au soutien diplomatique (droit d’agir en eaux étrangères en vertu de la résolution 1816 du Conseil de sécurité ou d’accords ponctuels, actions en coordination avec les autres marines impliquées dans la zone) ;
– la possibilité d’agir en reprise de vive force pour libérer des otages ;
– l’engagement de la responsabilité de l’État à l’égard des pirates.
Surtout, les moyens étatiques ont pour eux la légitimité de leur intervention en application du droit international. Le crime de piraterie n’est pas seulement un problème de protection d’intérêts particuliers, c’est aussi et peut-être surtout un problème de protection d’intérêts publics (liberté et sécurité du trafic maritime, protection du pavillon et des intérêts qui y sont attachés, protection des ressortissants nationaux).
En conséquence, dans le débat sur l’opportunité d’employer des SMP, il convient de retenir que celles-ci ne peuvent agir qu’avec l’accord de l’État du pavillon (permis de détenir des armes, conditions d’emploi de moyens de coercition) et n’ont pas qualité pour dialoguer avec d’autres États que celui du pavillon pour traiter des aspects diplomatiques liés à certains types de répression de la piraterie (reprise de vive force par exemple). En outre, elles ne peuvent pas, en principe, agir au-delà de la légitime défense et n’ont pas la possibilité d’appréhender des personnes (sauf dispositions ad hoc dans les législations nationales).
Néanmoins, au-delà des positions de principe, tout ce rapport démontre que la lutte contre la piraterie pose indéniablement la question des moyens que les États sont prêts à y consacrer et de l’impossibilité pour les marines nationales d’assurer la protection de tous les navires transitant dans les zones à risque.
Par principe, les armateurs préfèrent bien sûr une solution intégralement publique – et, en conséquence, gratuite. Néanmoins, face à la dangerosité de certaines zones, ils pourraient être tentés de recourir à des agences de protection privée.
Différents types d’interventions sont alors envisageables, de l’organisation d’escortes (intéressantes pour des porte-containers ou des bateaux de croisière mais inadaptées pour la pêche) à la présence d’un conseiller sécurité à bord des bâtiments, mais aussi l’embarquement de gardes armés (32).
ð Adopter un cadre juridique national pour les activités de sociétés militaires privées
Dans tous les cas, si l’on envisage de faire jouer aux sociétés privées de sécurité un rôle de complément ou de variable d’ajustement, la France doit définir un cadre juridique pour ce type d’activités, avec un agrément soumettant la société candidate à des critères exigeants de compétence, d’expérience acquise, de transparence et de contrôle. Cet agrément pourrait comprendre une autorisation de détention d’armes restreinte à certaines catégories, assortie d’une limitation du droit d’usage à la légitime défense – critère applicable aux militaires en mission de protection. Pourquoi ne pas effectuer une expérimentation pendant un an avant d’adopter une réglementation définitive ?
La nécessité d’un cadre juridique recouvre également un enjeu économique car si les sociétés de sécurité françaises ne sont pas en mesure d’intervenir, le marché sera monopolisé par des intervenants anglo-saxons et israéliens, aux méthodes parfois discutables.
Les sociétés privées ne sont pas capables – et ne doivent pas être mises en situation – de tout faire. Elles peuvent éventuellement être pertinentes pour répondre à un besoin de formation, voire de sûreté ponctuel et temporaire, mais le travail de fond (renseignement, prévention, surveillance, sanction) ne peut que relever de la responsabilité des États et ne saurait en aucun cas être privatisé.
Parvenir à la conclusion inverse signerait l’échec de toutes les autres possibilités de lutte contre la piraterie qui viennent d’être énoncées. Cela reviendrait, en somme, à adopter la solution retenue durant les siècles passés et à ressusciter les corsaires et la guerre de course.
Cette voie semble d’ores et déjà avoir été ouverte par les États-Unis puisque le Congrès a adopté, en 2007, une loi autorisant le Département d’État à délivrer des lettres de marque (September-11 marque and repraisal Act). Une société militaire privée spécialisée dans les opérations maritimes, Pistris Incorporated, a ainsi été chargée par l’administration Bush de réprimer les actes de violence dans l’océan Indien (33). L’objectif visé est le terrorisme maritime et non la piraterie mais le pas d’une privatisation de la sécurité maritime a néanmoins été franchi, en contradiction avec les principes du droit maritime international.
Raison de plus pour s’attacher à privilégier, le plus rapidement possible, les pistes de solutions évoquées dans le présent rapport.
La résolution du problème de la piraterie sera une conséquence de la stabilisation intérieure de la Somalie, qui passe nécessairement par la restauration de la gouvernance et de l’autorité publique, la mise en place de structures administratives et le rétablissement de la souveraineté maritime. Dès aujourd’hui, deux axes d’action doivent être privilégiés : la coordination des forces navales intervenant dans la zone et le développement des capacités des États de la région à assurer, par eux-mêmes, la sécurité maritime dans la zone.
Au-delà de la situation au large de la Somalie, la piraterie s’insère dans la problématique globale de la sécurisation des espaces maritimes mondiaux. Cet objectif, qui englobe à la fois la sûreté et la sécurité maritimes, ne pourra pas être atteint par les seuls efforts des États développés : les États riverains et les intérêts privés (armateurs, commanditaires) doivent également s’y associer et les ressources du commerce maritime doivent être mises à contribution pour restaurer la sécurité des zones de navigation.
Pour atteindre l’objectif, trois capacités doivent être activées grâce à une coopération à tous les niveaux, selon les alliances et les zones régionales :
– une capacité de surveillance, par la fédération des vecteurs nationaux disponibles ;
– une capacité d’analyse, par la mise en commun et l’échange d’informations ;
– une capacité d’intervention adaptée et durable, comme l’illustre bien l’opération Atalante.
Chacun, selon ses moyens économiques et financiers, ses capacités militaires et de sécurité, ses outils juridiques et technologiques, doit contribuer à cet effort mondial de coopération et de régulation, afin de préserver la liberté des mers et de valoriser au mieux ce trésor commun que sont les espaces maritimes.
1. Adapter les modalités d’intervention militaire afin de rendre les attaques plus risquées et plus coûteuses pour les pirates.
2. Renforcer la présence navale et aérienne afin de mieux couvrir les zones à risque.
3. Utiliser des drones pour renforcer les moyens de surveillance.
4. Accroître l’aide au développement de la Somalie en combinant soutien à la restauration de l’État de droit et aides directes et conditionnelles à la population.
5. Mieux articuler l’aide européenne au développement de la Somalie avec les priorités de la politique étrangère et de sécurité commune et progresser vers une politique d’aide plus conditionnelle et des actions plus directes.
6. Contribuer à la consolidation des capacités juridiques et judiciaires des États côtiers.
7. Aider la Somalie à recouvrer sa souveraineté maritime et à exploiter ses ressources halieutiques.
8. Améliorer le partage de l’information et la coopération entre les forces navales présentes dans les zones à risque.
9. Renforcer la coopération bilatérale avec les États côtiers en matière de sauvegarde maritime.
10. Mieux contrôler la circulation des flux financiers générés par la piraterie.
11. Clarifier la réglementation internationale en matière de pavillon.
12. Soutenir la mise en œuvre politique, technique et matérielle de l’accord régional de coopération adopté à Djibouti le 29 janvier 2009.
13. Respecter les consignes de sécurité et de comportement pour la navigation dans les zones à risque.
14. Renforcer les capacités de défense passive des navires et améliorer la formation des équipages.
15. Organiser la contribution des armateurs à la sécurisation des espaces maritimes.
16. Adopter un cadre juridique national pour les activités de sociétés militaires privées.
La commission de la défense nationale et des forces armées a examiné le présent rapport d’information au cours de sa réunion du mercredi 13 mai 2009.
Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.
M. Philippe Vitel. Bravo pour ce rapport. Nos accords de défense doivent être renégociés avec Djibouti notamment : comportent-ils des dispositions permettant de lutter contre la piraterie ? Par ailleurs, quel est le statut du Puntland ? Quelles relations entretient-il avec la France et l’Union européenne ?
Les SMP connaissent une évolution rapide. La société de transport MSC a par exemple sécurisé ses voyages en recourant à leurs services. Quelles relations et quels moyens d’interopérabilité peut-on envisager entre les forces militaires et ces sociétés privées ?
M. Marc Joulaud. Quelles sont juridiquement les possibilités d’intervention en haute mer, notamment au regard des conventions internationales en vigueur ? Une réflexion est-elle menée pour adapter le droit afin d’éviter de libérer les pirates ?
Je voudrais également savoir si les attaques ont eu des conséquences sur le montant des primes d’assurance dont les armateurs doivent s’acquitter.
M. François Cornut-Gentille. Merci pour cet intéressant rapport. On lit dans la presse que le phénomène de la piraterie tend à exploser : est-ce vrai ? Sa médiatisation en France a-t-elle eu un impact local ?
De quels moyens de pression disposons-nous sur la Somalie ? En matière de coopération juridique, les solutions ont-elles été identifiées et, si oui, y a-t-il des groupes d’experts internationaux pour les mettre en œuvre ou les compléter ?
Enfin, l’idée d’une contribution financière des armateurs, par exemple sur la base du tonnage de marchandises transitant par le golfe d’Aden, fait-elle son chemin ou vous est-elle personnelle et reste-t-elle à promouvoir ?
M. Christian Ménard. Je n’ai pas d’information sur le contenu de nos accords de défense avec Djibouti mais je sais que la France a signé un accord avec le Yémen et Djibouti pour la mise en place d’un dispositif de sécurité maritime dans le détroit de Bab el Mandeb.
La situation du Puntland est un peu ambiguë : il dispose d’une semi-autonomie au sein de la Somalie sans être officiellement reconnu par la communauté internationale. En même temps, plusieurs États, dont la France, entretiennent des relations officieuses avec lui et le secrétaire général des Nations Unies encourage les coopérations avec ce territoire pour lutter contre la piraterie.
Les SMP sont en effet amenées à se développer : il est donc nécessaire de leur donner un cadre juridique. A cet égard, je rappelle que Total, au Nigeria, a réglé la question en affrétant des vaisseaux d’escorte armés par des militaires nigérians « défrayés » pour l’occasion, eux-mêmes encadrés par un ancien militaire nigérian, salarié par l’entreprise.
En réponse à Marc Joulaud, je précise que la convention de Montego Bay de 1982 est le seul texte de droit international visant spécifiquement les actes de piraterie qui, par définition, se produisent uniquement en haute mer. Mais peu nombreux sont les pays ayant totalement transposé ces dispositions dans leurs législations. Quant aux États-Unis, dont la marine n’est pas compétente pour mener des actions de police en mer, ils préfèrent s’appuyer sur la convention de Rome de 1988, qui concerne principalement la lutte contre le terrorisme maritime.
En France, la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer, qui concerne la lutte contre le narcotrafic et l’immigration illégale, devrait être étendue à la piraterie : le secrétariat général à la mer prépare d’ailleurs un texte en ce sens. Cette loi comporte cependant une fragilité, mise en évidence par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt de juillet 2008 sur l’affaire du Winner, un bateau arraisonné dans l’Atlantique qui se livrait au trafic de drogue. En effet, les dispositions prévues pour encadrer la détention des personnes à bord des bâtiments de la marine jusqu’à leur remise à la justice française sont considérées comme insuffisantes. La présence d’un gendarme maritime, qui dispose de la qualification d’officier de police judiciaire, à bord de chaque bateau de commandement ou frégate pourrait être, sur ce point, une solution intéressante. C’est l’option qui a été retenue dans le cas du navire Osiris, qui assure en Antarctique la surveillance des zones de pêche.
En ce qui concerne le nombre des attaques, celles-ci étaient en régression début 2009 : alors que, selon les données du Bureau maritime international, à la fin du dernier trimestre 2008, une attaque sur trois avait réussi, ce pourcentage est tombé fin mars 2009 à une sur treize. Cela dit, il faut relativiser ces chiffres : d’une part, parce qu’ils ne sont pas complets ; d’autre part, en raison du mauvais temps dans le golfe d’Aden qui a compliqué la tâche des pirates. En avril, les attaques ont d’ailleurs repris de plus belle, plus au sud.
En Somalie, les principaux moyens de pression sont les différentes forces navales présentes sur zone, principalement Atalante, la Task force 151 et l’OTAN. Je ne crois pas, contrairement à certains, que l’OTAN doive prendre la suite d’Atalante : l’Union européenne doit rester présente sur place. Mais il existe également à terre des dispositifs, humanitaires ou plus politiques, de soutien au processus de paix en Somalie.
L’idée d’une contribution volontaire des armateurs, sous la forme, par exemple, d’une « taxation à la tonne », m’a été inspirée par une société de conseil. Je crois cette solution réalisable mais elle doit être étudiée avec les armateurs, qui seront amenés à en apprécier les avantages et les inconvénients.
Mme Marguerite Lamour. Comme l’a montré le démantèlement des navires de guerre, les actions fondées sur le seul volontariat risquent d’être insuffisantes.
M. le président Guy Teissier. Une contribution d’un euro par tonne risque de finir par coûter cher, pour les tankers par exemple. Les armateurs pourraient préférer le contournement de l’Afrique…
M. Franck Gilard. Quelle est la durée prévue pour l’opération Atalante et celle-ci pourrait-elle être prolongée ? Par ailleurs, au sujet des SMP, je recommande le livre Blackwater de Jeremy Scahill, qui montre très bien le développement – hors de toute juridiction – d’armées privées en Irak. Il s’agit là d’un phénomène inquiétant et sous-estimé.
M. Jean-Claude Viollet. En tant que membre de la nouvelle mission d’information sur les drones, je me réjouis que le rapporteur ait évoqué cet équipement, qui constitue en effet un moyen inégalé de surveillance, discret, à moindre coût, et donc un excellent outil de prévention.
M. Christophe Guilloteau. La piraterie, qui est un phénomène ancien, est en pleine évolution. Elle touche une zone de plus en plus étendue, qui va des Maldives à la Somalie. Les moyens de surveillance mobilisés par la France et l’Union européenne sont-ils à cet égard suffisants ?
M. Christian Ménard. La mission Atalante arrive à échéance fin décembre 2008. Elle devrait être reconduite pour un an.
Le développement de SMP du type Blackwater est effectivement très inquiétant. Il faut savoir que les États-Unis ont délivré des lettres de marque à des entreprises de cette nature, leur permettant d’agir légalement. Il parait difficile d’éviter une réflexion sur ce sujet et si l’on doit y recourir, il conviendrait d’encadrer très strictement leurs activités.
M. le président Guy Teissier. Le développement de ces entreprises est une tendance anglo-saxonne. Nous avons une autre doctrine de l’usage du recours à la force. La question du développement des SMP s’est posée lors de la précédente législature ; je n’ai pas jugé opportun, à ce moment-là, d’aller plus loin sur ce sujet. Si l’embarquement de vigiles dans certaines situations très particulières ne peut pas être exclu, celui-ci doit alors être extrêmement encadré. La défense nationale, comme celle des personnes et des biens, relève du pouvoir régalien ; les confier à des sociétés privées constitue une perte de substance importance. Des vigiles ont certes remplacé les gendarmes dans des missions de contrôle des accès de certains sites liés à la défense mais la République ne peut se défaire de son domaine régalien ni déléguer à la société civile l’usage de la violence légale.
M. Christian Ménard. Je suis d’accord avec Jean-Claude Viollet : les drones sont un atout majeur pour renforcer nos capacités de surveillance et de renseignement en matière de piraterie maritime ; nous devons faire notre maximum pour qu’ils puissent être utilisés.
La zone à surveiller est effectivement immense : 3 100 kilomètres de côtes et un espace maritime qui représente entre 4 et 6 fois la France. Selon certains de mes interlocuteurs, une flotte de 45 vaisseaux serait nécessaire pour véritablement sécuriser le seul golfe d’Aden. Actuellement, 5 à 7 navires sont déployés dans le cadre d’Atalante et à peu près autant dans le dispositif OTAN. On est loin du compte. Il faut donc trouver des solutions politiques pour rétablir la situation à terre.
M. le président Guy Teissier. Qu’est devenu le navire ukrainien Faina, pris en otage alors qu’il transportait des armes, des munitions et 33 chars ?
M. Christian Ménard. La question du sort de la cargaison n’a pas été simple à résoudre. Les islamistes ont un temps envisagé de la récupérer avant, finalement, de condamner cette attaque, comme ils le font pour tous les actes de piraterie. Le bateau a été libéré après quatre mois contre une rançon d’environ 3 millions de dollars et a rejoint, comme prévu, le port de Mombasa au Kenya.
M. Franck Gilard. Les pirates ont apparemment pris toutes les armes qu’ils pouvaient emporter.
La commission a décidé, en application de l’article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
– Amiral Édouard GUILLAUD, chef d’état major particulier
DÉFENSE
• État major des armées
– Général de corps d’armée Benoît PUGA, sous-chef d’état-major Opérations, et capitaine de vaisseau Hubert de BREMOND d’ARS, adjoint mer du Centre de conduite et de planification des opérations (CPCO)
– Contre-amiral Pierre MARTINEZ, commandant des opérations spéciales (COS)
– Contre-amiral Arnaud de TARLÉ, chargé de la coordination des actions « piraterie » à l’état-major des armées, détaché au cabinet du ministre
• Marine
– Amiral Pierre-François FORISSIER, chef d’état major de la marine
– Vice-amiral d’escadre Xavier ROLIN, CECLANT
– Contre-amiral Xavier MAGNE, sous-chef d’état-major Opérations (ALOPS)
– Contre-amiral Marin GILLIER, commandant de la force des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO)
– Capitaine de frégate Stéphane CHANFREAU, commandant du Centre de renseignement de la marine
– Commissaire en chef François LAURENT, chef du bureau « droit de la mer » à la direction centrale du commissariat de la marine
– Capitaine de vaisseau Jean HAUSSERMAN, conseiller à la représentation militaire permanente de la France auprès de l’Union européenne
– Capitaine de vaisseau Dominique de LORGERIL, commandant de la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic
• Gendarmerie
– Général Denis FAVIER, commandant du GIGN
– Lieutenant-colonel Hervé BASSET, chef de la section des formations et moyens nautiques à la direction générale de la gendarmerie nationale
• Services de renseignement
– Général Benoît PUGA, directeur du renseignement militaire
– M. Érard CORBIN de MANGOUX, directeur général de la sécurité extérieure
GOUVERNEMENT
• Secrétariat général de la défense nationale (SGDN)
– M. François LUCAS, préfet, directeur de la protection et de la sécurité de l’État
– Général de brigade Olivier TRAMOND, sous-directeur prospective et planification de sécurité
• Secrétariat général de la mer
– M. Xavier de LA GORCE, secrétaire général
– Contre-amiral Jean-Pierre LABONNE, secrétaire général adjoint
– Colonel Guillaume GRIMAUX, chargé de mission sur la piraterie
• Affaires étrangères
– Mme Chantal POIRET, ambassadeur chargée de coordonner l’action de la France dans la lutte internationale contre la piraterie maritime
– Mme Alice GUITTON, conseiller au cabinet du ministre pour les questions de piraterie
– M. Jean-Hugues SIMON-MICHEL, directeur adjoint des affaires stratégiques, de la sécurité et du désarmement
– Mme Hélène LE GAL, sous-directrice Afrique centrale et orientale
– M. Fabien PENONE, sous-directeur des affaires politiques à la direction des Nations Unies
– Mme Christine FAGES, sous-directrice Afrique occidentale
– M. Samer MELKI, rédacteur « politique extérieure et de sécurité commune » pour l’Afrique
– Capitaine de vaisseau Christophe PIPOLO, conseiller pour les affaires militaires et de sécurité au Centre d’analyse et de prévision
• Justice (direction des affaires criminelles et des grâces)
– Mme Delphine DEWAILLY, sous-directrice de la justice pénale spécialisée
– M. Elie-Victor RENARD, magistrat au bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment
MARINE MARCHANDE
• Armateurs de France
– M. Patrick RONDEAU, responsable affaires techniques et sûreté
– M. Pierre Gaël JEANGENE, chargé des relations institutionnelles
– M. Jacques PAUL (Genavir)
– M. Jean CAROTENUTO (Bourbon)
– M. Pierre ALDEBERT (Brostrom)
– MM. Édouard BERLET et Pierre de SAQUI de SANNES (CMA-CGM)
– MM. Jean-François LE GALL, Jacques LOISEAU et Christian LOUDES, représentants de l’association des capitaines de marine marchande (AFCAN)
– M. Pierre-Alain CARRÉ, directeur de l’armement thonier CMB
– M. Yvan RIVAT, président d’Orthongel
– MM. Jean-Paul GUYADER, Armand QUENTEL et Luc LE GUIRRIEC, membres du comité local des pêches de Concarneau
INDUSTRIES NAVALES ET DE DÉFENSE
– M. Bernard PLANCHAIS, directeur général délégué de DCNS
– MM. Arnoult GAUTHIER, président de V-NAVY, Claude LANOISELEE, directeur général, et Xavier GENIN, directeur de la branche sûreté maritime
– Amiral Alain COLDEFY, conseiller défense du Président exécutif d’EADS, MM. Bruno MASNOU, directeur des grands comptes France pour la division défense et sécurité du groupe, Philippe BOTTRIE, Eurocopter, et Mmes Françoise AXES, Spot Image et Annick PERRIMOND du BREUIL, directeur des relations institutionnelles France
– M. Philippe WAQUET, PDG de Sea on Line
AUTRES
– M. Rahim HUSSIN, responsable de la politique de sécurité maritime au sein du Conseil national de la sécurité auprès du Premier ministre de Malaisie
– MM. Vincent CLOUZEAU, responsable du département stratégies maritimes au cabinet de conseil Dupont Partners, et Benoît CHAUCHEPRAT, en charge des stratégies européennes
– MM. Philippe GELINET, chargé de la sûreté pour le groupe Total, et François TRIBOT LASPIERRE, directeur des relations institutionnelles
– M. Roland MARCHAL, chargé de recherche au et au CERI (Centre d’études et de recherches internationales – Sciences Po – CNRS)
– M. Éric FRECON, chercheur à l’Institut des études stratégiques et de défense de Singapour
– M. Guillaume LOONIS-QUELEN, juriste spécialisé en droit de la mer
– MM. Pierre MARZIALI, président de SECOPEX et Julien DUVAL, responsable du département sécurité maritime
– MM. Gilles SACAZE, Président de Gallice Security, et Gilles MARÉCHAL, directeur général international
DÉPLACEMENT À LONDRES
• Organisation maritime internationale (OMI)
– M. Koji SEKIMIZU, directeur de la sûreté maritime
– M. Nicolaos CHARALAMBOUS, directeur délégué
– Capitaine Hartmut HESSE, directeur délégué pour l’opérationnel
– Mme Rosaly BALKIN, directrice juridique
• Bureau maritime international (BMI)
– M. Michael HOWLETT, directeur adjoint du Commercial crime service
En présence de M. André-Yves LEGROUX, représentant permanent de la France auprès de l’OMI, et du capitaine de vaisseau Jean-Nicolas GAUTHIER, attaché naval de l’ambassade de France.
DÉPLACEMENT À BRUXELLES
– Général d'armée Henri BENTÉGEAT, président du Comité militaire de l'Union européenne
– Mme Claude-France ARNOULD, directrice de la DG E pour les questions de Défense au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
– M. Marc ABENSOUR, représentant permanent adjoint de la France au Conseil de l'OTAN et Capitaine de vaisseau Yvan GOALOU, en charge de la piraterie maritime à la représentation militaire française à l'OTAN
– M. Giorgio BALZARRO, chef du bureau Somalie – DG DEV de la Commission européenne
– Général de corps aérien Patrick de ROUSIERS, représentant militaire de la France auprès du Comité militaire de l'Union européenne, et Colonel Cyrille CLAVER, conseiller
|
Source : Ministère des affaires étrangères. |
ANNEXE II : CARTE DU GOLFE DE GUINÉE |
|
Source : Ministère des affaires étrangères. |
ANNEXE III : CARTE DU DÉTROIT DE MALACCA |
|
Source : encyclopédie en ligne Encarta (encarta.msn.com). |
ANNEXE IV : BMI : ATTAQUES 2008 DANS LE GOLFE D’ADEN |
|
|
Source : Bureau maritime international (BMI) rapport annuel 2008. |
|
|
Source : Bureau maritime international (BMI) rapport annuel 2008. |
|
|
Source : Bureau maritime international (BMI) rapport annuel 2008. |
|
Source : Institut supérieur d’économie maritime - www.isemar.asso.fr |
ANNEXE VIII : CHARTE DES NATIONS UNIES – CHAPITRE VII
Action en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix et d'acte d'agression
Article 39 : Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40 : Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41 : Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42 : Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43 : Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44 : Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45 : Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46 : Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.
Article 47 : Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48 : Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49 : Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50 : Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51 : Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
______________
ANNEXE IX : CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DITE DE MONTEGO BAY
(10 décembre 1982)
Articles relatifs à la piraterie
Article 100 - Obligation de coopérer à la répression de la piraterie
Tous les États coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État.
Article 101 - Définition de la piraterie
On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État ;
b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate ;
c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.
Article 102 - Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'État ou d'un aéronef d'État dont l'équipage s'est mutiné
Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d'État ou un aéronef d'État dont l'équipage mutiné s'est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.
Article 103 - Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables.
Article 104 - Conservation ou perte de la nationalité d'un navire ou d'un aéronef pirate
Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'État qui l'a conférée.
Article 105 - Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate
Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.
Article 106 - Responsabilité en cas de saisie arbitraire
Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'État qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'État dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.
Article 107 - Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.
[…]
Article 110 - Droit de visite
1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire :
a) se livre à la piraterie ;
[…]
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect.
4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.
5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public.
______________
ANNEXE X : LOI N°94-589 DU 15 JUILLET 1994 RELATIVE AUX MODALITÉS DE L'EXERCICE PAR L'ÉTAT DE SES POUVOIRS DE POLICE EN MER
(texte en vigueur)
Titre I : dispositions générales : codifié dans le code de la défense, articles L. 1521-1 à 1521-10 (cf. annexe XI)
Titre II : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes
Article 12 – La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s'appliquent, outre aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense :
- aux navires battant pavillon d'un État qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention ;
- aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.
Article 13 – Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.
Chapitre Ier : Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'État du pavillon
Article 14 – I. - A l'occasion de la visite du navire, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.
Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.
II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.
Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'État du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.
III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'État du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.
Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
Article 15 – Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'État du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.
L'assentiment mentionné à l'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.
Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement des ces infractions.
Article 16 – Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commandants des bâtiments de l'État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :
I. - Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.
II. - Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.
Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.
Article 17 – En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.
Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.
En matière criminelle, les dispositions de l'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables.
Titre III : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l'immigration illicite par mer
Article 18 – Les infractions visées au présent titre sont celles qui, commises en mer, sont définies aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au I de l'article 28 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l'article 28 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
Article 19 – La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions visées à l'article 18 sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s'appliquent, outre aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense :
- aux navires battant pavillon d'un État qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention ;
- aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.
Article 20 – Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 se commettent à bord de l'un des navires visés à l'article 19 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, qui en avisent le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.
Chapitre Ier : Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'État du pavillon
Article 21 – I. - A l'occasion de la visite du navire, le commandant peut faire procéder à la saisie des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions visées à l'article 18.
Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.
II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.
Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.
III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.
Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
Article 22 – Les auteurs ou complices d'infractions visées à l'article 18 et commises en haute mer à bord des navires visés à l'article 19 peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.
L'assentiment mentionné à l'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 sont commises sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.
Article 23 – Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commandants des bâtiments de l'État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions visées à l'article 18 et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :
1° Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. La copie en est remise à la personne intéressée ; à défaut, la procédure n'est pas pour autant entachée de nullité ;
2° Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions visées à l'article 18 ou qui paraissent servir à les commettre.
Cette autorisation est transmise par tout moyen.
Les produits, documents ou objets saisis sont placés immédiatement sous scellés.
Les perquisitions et saisies peuvent, lorsque l'autorisation du procureur de la République le mentionne, être effectuées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.
Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions visées à l'article 18, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
Article 24 – En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.
Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 25 – La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
______________
ANNEXE XI : CODE DE LA DÉFENSE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer
Section 1 : Police en mer.
Article L. 1521-1 : Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux États par le droit international ;
2° Aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'État étrangers utilisés à des fins non commerciales ;
3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un État étranger, en accord avec celui-ci.
Article L. 1521-2 : Les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
Ils sont notamment habilités à exercer et à faire exercer au nom de l'État du pavillon ou de l'État côtier les mesures de contrôle et de coercition fixées en accord avec cet État.
Article L. 1521-3 : Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
Article L. 1521-4 : Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
Article L. 1521-5 : Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés. Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :
1° Soit en application du droit international ;
2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;
3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;
4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.
Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.
Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
Article L. 1521-6 : Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
Article L. 1521-7 : Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.
Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'État.
Article L. 1521-8 : Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'État du pavillon par la voie diplomatique.
Section 2 : Sanctions pénales
Article L. 1521-9 : Est puni de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'État sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
Article L. 1521-10 : Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.
______________
1 () Nom donné aux corsaires hollandais qui attaquaient les navires espagnols et portugais au XVIe siècle.
2 () Un mille marin, ou « nautique », correspond à 1,85 kilomètre.
3 () Philippe Gosse, Histoire de la piraterie (Payot, 1952), p. 13.
4 () « Le retour de la lettre de course », Jean-Paul Pancracio, in Bulletin d’études de la marine, n° 43, septembre 2008.
5 () Les cahiers du cercle Jefferson, n° 1, avril 2008.
7 () Sur les 8 000 personnes prévues, seuls 1 500 soldats ougandais avaient été déployés le 18 juillet 2007, lors de la première prorogation de 6 mois. En janvier 2008, 440 soldats burundais ont rejoint les 1 600 soldats ougandais en place.
8 () Rapport S/2009/146 du Secrétaire général des Nations Unies, soumis au Conseil de sécurité en application de la résolution 1846 (2008) ; 16 mars 2009, § 5.
9 () Soit, à un cours « raisonnable » de 50 dollars le baril, 175 millions de dollars par jour…
10 () Un bâtiment est couvert par deux assurances : un police traditionnelle pour le corps du bateau (coque) et la cargaison et un contrat de responsabilité civile pour l’équipage et les autres types de risques (pollutions par exemple). Cette seconde assurance est prise en charge par une mutuelle des armateurs dite P&I (protecting et indemnity club).
11 () Comme par exemple une résolution du Conseil de sécurité, un accord bilatéral ou multilatéral ou éventuellement un accord régional dans le cadre de l’OMI s’il couvre l’aspect de la juridiction pénale.
12 () Cf. notamment la circulaire n° 623 révisée du 29 mai 2002 adoptée par le Comité de la sécurité maritime sur les principes directeurs destinés aux propriétaires, aux exploitants, aux capitaines et aux équipages de navires concernant la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à main armée à l’encontre des navires ; consultable sur http://www.imo.org.
13 () Articles L. 1521-1 à L. 1521-10 du code de la défense, cf. annexe XI.
14 () Peuvent être ainsi habilités, dans des conditions fixés par décret en Conseil d’État, les commandants des bâtiments de l’État et les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments.
15 () La CEDH a estimé qu’il y avait violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, eu égard notamment aux conditions de rétention des personnes soupçonnées (défaut d’encadrement, de défense et de contrôle de l’autorité judiciaire), et a condamné la France sur ce fondement. Le ministère des Affaires étrangères et européennes a fait appel de cette condamnation le 10 octobre 2008.
16 () Un entraînement annuel est organisé dans ce cadre, alternativement en Méditerranée (ESTEREL) et en Atlantique (ARMOR).
17 () Thésaurisation et traitement du renseignement issu de la situation.
18 () Paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies : « […] pour une période de douze mois à compter de l’adoption de la résolution 1846 (2008), les États et les organisations régionales qui coopèrent à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et concernant lesquels le Gouvernement fédéral de transition aura donné notification au Secrétaire général sont autorisés à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en Somalie aux fins de réprimer ces actes de piraterie et vols à main armée en mer, conformément à la demande du Gouvernement fédéral de transition, étant toutefois entendu que toutes les mesures prises en application du présent paragraphe devront être conformes aux normes applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme ; ».
19 () La question de la présence d’équipes de protection embarquées (EPE) à bord des bateaux les plus vulnérables ne fait pas l’unanimité parmi les États membres : la France estime qu’il s’agit d’un préalable à toute escorte d’un bâtiment alors que d’autres pays sont moins systématiques. Cet embarquement doit nécessairement être couvert par un accord avec l’État du pavillon afin de définir le statut juridique des EPE.
20 () Rapport S/2009/146 du Secrétaire général des Nations Unies : op. cit., § 30.
21 () Composée de sept bâtiments, dont un bâtiment de commandement portugais, cinq frégates (américaine, espagnole, néerlandaise, canadienne et allemande) et un pétrolier ravitailleur allemand.
22 () Australie, Chine, Danemark, Djibouti, Égypte, France, Allemagne, Grèce, Inde, Italie, Japon, Kenya, Corée du Sud, Pays-Bas, Oman, Russie, Arabie Saoudite, Somalie, Espagne, Turquie, Émirats arabes Unis, Royaume-Uni, États-Unis et Yémen.
23 () Union africaine, Union européenne, OTAN, Secrétariat général des Nations Unies et OMI.
24 () http://bruxelles2.over-blog.com
25 () Rapport S/2009/146 du Secrétaire général des Nations Unies ; op. cit., § 59.
26 () « De l’utilité des drones dans la lutte anti-pirates », 1er mars 2009, http://bruxelles2.over-blog.com
27 () Rapport S/2009/146 du Secrétaire général des Nations unies ; op. cit., § 48.
28 () Ibid., § 62.
29 () Consultable sur http://www.somali-jna.org/downloads/ACF7C9C.pdf.
30 () Rapport S/2009/146 du Secrétaire général des Nations Unies ; op. cit., § 49.
31 () Djibouti, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maldives, Seychelles, Somalie, Tanzanie et Yémen.
32 () Cette dernière option n’est cependant pas sans risque, même si en principe les fautes commises par les agents de sûreté privés engagent leur responsabilité personnelle et celle de leur employeur. La responsabilité de l’armateur pourrait néanmoins être recherchée et, le cas échéant, le juge pourrait s’attacher à vérifier qui, de l’employeur ou de l’armateur, avait autorité effective sur l’agent. Une responsabilité cumulative de l’employeur et de l’armateur pourrait même être retenue.
33 () « La société Pistris est ainsi habilitée à armer deux bâtiments de 65 m. de long qui seront reliés aux satellites militaires d’observation. Ils seront dotés chacun d’un hélicoptère armé, d’embarcations annexes ultra-rapides capables d’atteindre la vitesse de 50 nœuds et embarqueront un équipage de 50 hommes dont des commandos. La société Pistris possède son propre camp d’entraînement militaire, notamment aux opérations commando, dans le Massachusetts, près de Boston. », in « Le retour de la guerre de course », Bulletin d’études de la marine, op. cit.
© Assemblée nationale