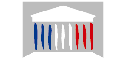
N° 3514
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 février 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (1), SUR
les violences faites aux femmes,
PAR
Mme Pascale CROZON
Députée
——
(1) La composition de la délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de : Mme Catherine Coutelle, présidente ; Mme Conchita Lacuey, Mme Monique Orphé, M. Christophe Sirugue, Mme Marie-Jo Zimmermann, vice-président.e.s ; Mme Édith Gueugneau ; Mme Cécile Untermaier, secrétaires ; Mme Laurence Arribagé ; Mme Marie-Noëlle Battistel ; Mme Huguette Bello ; Mme Brigitte Bourguignon ; Mme Marie-George Buffet ; Mme Pascale Crozon ; M. Sébastien Denaja ; Mme Sophie Dessus ; Mme Marianne Dubois ; Mme Virginie Duby-Muller ; Mme Martine Faure ; M. Guy Geoffroy ; Mme Claude Greff ; Mme Françoise Guégot ; Mme Chaynesse Khirouni ; Mme Sonia Lagarde ; Mme Geneviève Levy ; Mme Véronique Massonneau ; Mme Sandrine Mazetier ; M. Jacques Moignard ; Mme Dominique Nachury ; Mme Maud Olivier ; Mme Bérengère Poletti ; Mme Josette Pons ; Mme Catherine Quéré ; Mme Barbara Romagnan ; M. Gwendal Rouillard ; Mme Maina Sage ; Mme Sylvie Tolmont ; M. Philippe Vitel.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : AVANCÉES ET VOIES D’AMÉLIORATION 9
1. Une priorité politique forte avec des avancées majeures depuis 2010 10
a. Sur le plan législatif, avec en particulier la loi du 9 juillet 2010 et la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 10
b. Le lancement de plusieurs plans gouvernementaux de lutte contre les violences faites aux femmes 12
c. La mise en œuvre des différentes mesures engagées de 2012 à 2015 : un bilan globalement satisfaisant 14
2. Des interrogations sur la nécessité d’adapter certaines dispositions pénales pour mieux prendre la spécificité des violences de genre 16
a. Sur le terme de « féminicide » et les meurtres commis à raison du sexe 16
b. Sur la question de la légitime défense concernant les victimes de violences conjugales 20
c. Les recommandations de la Délégation 28
3. Des mesures nécessaires pour consolider les avancées en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, avec une priorité : accompagner et protéger les victimes 32
a. Développer la formation des professionnel.le.s et améliorer les connaissances pour pouvoir mieux agir 33
b. Encourager l’utilisation de l’ordonnance de protection 38
c. Le renforcement de la coordination des acteurs, par le déploiement de politiques de juridiction volontaristes, et l’exclusion de la médiation familiale en cas de violences 40
d. Les autres recommandations de la Délégation 43
CONCLUSION 47
LISTE DES RECOMMANDATIONS ADOPTÉES 49
TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 51
ANNEXES 107
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA DÉLÉGATION ET PAR LA RAPPORTEURE 109
ANNEXE 2 : PRINCIPALES DONNÉES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES 111
ANNEXE 3 : 2012-2015, UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 123
MESDAMES, MESSIEURS,
Le 3 décembre 2015, la Cour d’assises de Blois confirmait la condamnation de Jacqueline Sauvage à dix ans de réclusion criminelle, pour avoir tué son mari, après avoir subi des violences pendant plusieurs décennies, ainsi que ses enfants. Ce jugement a suscité une forte émotion collective, de nombreuses voix s’élevant pour dénoncer ce qu’elles considéraient comme une incompréhensible injustice. Votre rapporteure salue à cet égard la décision prise par le Président de la République, le 31 janvier 2016, d’accorder une remise de peine gracieuse, en tenant compte d’une situation humaine exceptionnelle.
Mais au-delà, cette affaire tragique a remis au jour la réalité des violences faites aux femmes qui interviennent dans le déni, le silence et l’impunité – et dans ces affaires tragiques, bien souvent, « tout le monde savait » – en privant les victimes de droits aussi élémentaires que la sécurité, l’intégrité physique et la dignité, en affectant leur santé et en entravant la liberté des femmes. Un scandale à bas bruit sur lequel la République avait trop longtemps fermé les yeux.
Et pourtant les chiffres sont là, accablants. En France, une femme meurt encore tous les 2,7 jours victime de son conjoint, soit 134 femmes en 2014, et près de 1 260 femmes assassinées depuis 2006 (1). Près d’un meurtre sur cinq résulte de violences au sein de couples (2) et environ 223 000 femmes de 18 à 75 ans subissent des violences physiques et sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire, selon une moyenne établie par l’Insee pour les années 2010 à 2015. Par ailleurs, si les femmes sont les premières touchées par les violences conjugales, elles ne sont pas les seules victimes : en 2014, 25 hommes et 35 enfants sont morts dans le cadre de violences au sein du couple, 110 enfants sont devenus orphelins de mère et/ou de père, et plus de 140 000 mineur.e.s vivent dans une famille où une femme est victime de violences, entraînant de profonds traumatismes pour ces enfants témoins.
Le phénomène est de mieux en mieux connu depuis 2000, avec les résultats d’une grande enquête sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), qui sera prochainement actualisée. Et depuis, de nombreuses autres enquêtes montrent, au-delà des violences au sein des couples, la diversité des violences faites aux femmes, comme leur coût humain, social et économique pour la société. Elles sont de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, dans l’espace privé ou public, et peuvent concerner les femmes de tous les âges et de tous les milieux sociaux.
Qu’elles qu’en soient la forme, ces violences de genre s’inscrivent dans un système de domination et contribuent à renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Loin d’être des « faits divers », les violences de genre constituent donc une question politique centrale.
Dans ce contexte, et pour faire suite aux mobilisations féministes et aux nombreuses interpellations consécutives à la condamnation de Madame Sauvage, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, conformément aux missions qui lui ont été confiées par la loi du 12 juillet 1999, a souhaité faire le point sur la mise en œuvre de mesures prises par les pouvoirs publics depuis la loi du 9 juillet 2010. Votre rapporteure a par ailleurs jugé nécessaire d’approfondir la réflexion sur les questions que cette affaire a soulevées dans le débat public.
Peut-on entendre qu’une femme ait pu tuer pour ne pas mourir ? Peut-on modifier le régime de la légitime défense sans courir le risque de légitimer la vengeance et de rendre la sphère familiale plus dangereuse encore ? Faut-il reconnaitre en droit le « féminicide » ou au moins développer l’usage de ce terme pour rendre plus visibles les violences de genre ? Peut-on envisager d’instituer des circonstances aggravantes lorsque des meurtres sont commis à raison du sexe ? Est-il cohérent de modifier la loi sans d’abord chercher à évaluer et, le cas échéant, améliorer la mise en œuvre des textes existants ? Et s’il est important d’apporter une réponse pénale juste et adaptée dans les cas les plus tragiques, lorsque des meurtres sont commis suite à des violences de genre, la priorité n’est-elle pas, en amont, d’assurer la protection et l’accompagnement des victimes de violences et veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures susceptibles de prévenir ce type de drames ?
Telles sont quelques-unes des questions qui ont traversé les travaux de la Délégation, dans le cadre d’une série d’auditions organisées du 12 janvier au 10 février 2016, avec des avocat.e.s, juristes, magistrats et représentant.e.s d’associations, du ministère de la justice, de la MIPROF et du CESE, et dont votre rapporteure tient à saluer la très grande qualité des interventions.
Au terme de ces travaux, le présent rapport, examiné par la Délégation le 17 février 2016, comporte :
– les comptes rendus des auditions de la Délégation (seconde section du présent rapport) ;
– la liste des personnes entendues (annexe 1) et deux annexes thématiques sur les principales données en matière de violences faites aux femmes, s’agissant notamment des violences au sein des couples (annexe 2), et le bilan détaillé des différentes mesures mises en œuvre sous cette législature (annexe 3 « 2012-2015 : un changement d’échelle dans la lutte contre les violences faites aux femmes ») ;
– une série d’orientations et de recommandations (première section) visant à consolider les avancées intervenues et à renforcer l’efficacité de la politique de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales.
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : AVANCÉES ET VOIES D’AMÉLIORATION
Si de nombreuses avancées sont intervenues depuis 2010 en matière de prévention et de lutte contre les violences envers les femmes (1), des interrogations sont apparues récemment sur la nécessité d’adapter le droit pénal pour mieux prendre en compte la spécificité des violences de genre (2). En outre, les actions volontaristes engagées par les pouvoirs publics doivent être poursuivies et complétées, notamment pour mieux accompagner et protéger les victimes (3).
Violences conjugales, violences sexuelles : les chiffres clés
Violences au sein du couple
En 2014, 118 femmes et 25 hommes ont été tué.e.s par leur conjoint ou ex-conjoint. On compte également 16 femmes et 6 hommes tué.e.s par leur partenaire non-officiel. Une femme décède tous les 2,7 jours victime de son conjoint.
En moyenne, chaque année, on estime que 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales dans ses formes les plus graves (violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint).
Parmi elles, 14 % ont déposé plainte. Les victimes estiment à 68 % que ces violences ont eu des répercussions plutôt ou très importantes sur leur santé psychologique et, à 54 %, qu’elles ont entraîné des perturbations dans leur vie quotidienne.
35 mineur.e.s ont été tué.e.s dans le cadre de violences au sein du couple. 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré être victime de violences physiques et/ou sexuelles de la part de son conjoint ou ex-conjoint. 42 % de ces enfants ont moins de 6 ans.
Sur un an, de novembre 2014 à octobre 2015, 82 635 faits de violences commis par conjoint ou ex-conjoint ont été recensés par les forces de sécurité en France métropolitaine. Dans 88 % des cas, la victime est une femme (72 873 faits). En 2014, 15 982 hommes et 561 femmes ont été condamné.e.s pour des crimes ou des délits sur leur conjoint ou ex-conjoint.
Violences sexuelles
En moyenne, chaque année, on estime que 84 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Dans 90 % des cas, la victime connait son agresseur. 10 % des victimes déclarent avoir déposé plainte. Les victimes estiment à 76 % que ces violences ont eu des répercussions plutôt ou très importantes sur leur santé psychologique et, à 61 %, qu’elles ont entraîné des perturbations dans leur vie quotidienne. Sur un an (novembre 2014-octobre 2015), 31 825 faits de violences sexuelles ont été recensés par les forces de sécurité en France métropolitaine, et dans 85 % des cas, la victime est une femme (majeure ou mineure). Les viols représentent 38 % des faits de violences sexuelles constatés par les forces de sécurité. En 2014, 765 hommes et 6 femmes ont été condamné.s.s pour viol sur des personnes de plus de 15 ans.
Pour plus de précisions sur les principales données relatives aux violences de genre et violences au sein des couples, voir l’annexe détaillée n° 2 du présent rapport.
Source : MIPROF, novembre 2015
1. Une priorité politique forte avec des avancées majeures depuis 2010
a. Sur le plan législatif, avec en particulier la loi du 9 juillet 2010 et la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
Issue d’une proposition de loi adoptée à l’unanimité, et nourrie par un important travail mené au sein d’une mission d’information de l’Assemblée nationale, présidée par Mme Danielle Bousquet et dont le rapporteur était M. Guy Geoffroy (3), la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et à leurs incidences sur les enfants a prévu, comme mesure centrale, la création de l’ordonnance de protection. Rendue par le juge aux affaires familiales (JAF), celle-ci vise à fournir un cadre d’ensemble aux femmes victimes de violences et à stabiliser leur situation juridique. La liste des mesures que peut prendre le JAF sur le fondement de l’article 515-11 du code civil est particulièrement complète (cf. infra).
Outre la création de l’ordonnance de protection, la loi du 9 juillet 2010 a introduit de nouvelles dispositions pénales transcrivant la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de violences. Désormais, « les violences (….) sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques (4) ». Par ailleurs, les associations ayant fait valoir que la médiation pénale ne saurait trouver sa place dans les situations de violences conjugales, l’article 30 de la loi de 2010 a introduit dans le code de procédure pénale une présomption de non-consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection. Cette loi a aussi modifié le délit de dénonciation calomnieuse afin de ne pas rendre automatique la condamnation des personnes qui portent plainte pour violences conjugales quand elles ne parviennent pas à prouver la réalité des violences dont elles sont victimes et que les auteurs sont relaxés au bénéfice du doute.
Des avancées majeures sont par ailleurs intervenues sous la présente législature, à travers tout d’abord l’adoption de plusieurs mesures législatives.
Ainsi, à la suite de l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel, la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a rétabli ce délit en élargissant son champ, afin de prendre en compte l’ensemble des manifestations possibles de ce délit (5). Votre rapporteure souligne à cet égard la nécessité de procéder prochainement à une évaluation de la mise en œuvre de cette loi, près de quatre ans après sa promulgation.
En outre, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France apporte au droit en vigueur des modifications afin notamment de le rendre conforme à la directive européenne du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains, et pour permettre la ratification, intervenue en juillet 2014, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, dite convention d’Istanbul.
Ainsi, le texte crée une infraction spécifique de mariage forcé à l’étranger et incrimine la tentative d’interruption illégale de grossesse sans le consentement de la personne, l’incitation à subir une mutilation sexuelle ainsi que le fait de contraindre ou de forcer une personne à avoir des relations sexuelles avec un tiers. Sur le plan procédural, il prévoit l’information de la victime en cas d’évasion de l’auteur des faits et permet l’indemnisation des victimes étrangères en situation irrégulière sur le territoire national.
Surtout, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, conçue comme un plan d’action transversal mobilisant l’ensemble des ministères et des politiques publiques, comportait 27 articles visant à protéger les femmes contre les violences. Ce texte prévoyait notamment : l’allongement de la durée des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de protection, en visant aussi la réduction des délais de délivrance de l’ordonnance de protection ; la restriction de la médiation pénale aux seuls cas où la victime en fait expressément la demande ; l’éviction du conjoint violent du domicile ; la généralisation du dispositif d’alerte avec le téléphone grand danger, expérimenté avec succès à Bobigny et à Strasbourg ; l’harmonisation des définitions des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple ; la prise en compte des violences faites aux femmes en situation de handicap.
La loi prévoyait également de responsabiliser les auteurs de violences au moyen de stages, pour prévenir la récidive, et de former l’ensemble des professionnel.le.s impliqué.e.s dans les violences, la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la traite des êtres humains (MIPROF, cf. infra) devant définir le cahier des charges d’un plan de formation transversal et interministériel sur les violences faites aux femmes.
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile, dont la Délégation s’est saisie, a permis d’améliorer la protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences. Cette loi a ainsi posé le principe selon lequel les aspects liés au genre doivent être pris en considération dans l’interprétation des cinq motifs de persécution de la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Les rapports d’activité de l’Office français de protection des réfugié.e.s et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) devront par ailleurs inclure des données sexuées et des développements sur les actions de formations des agent.e.s à l’égalité.
Cette loi a par ailleurs prévu : la mise en place d’actions de prévention en direction des parents et/ou tuteurs légaux des mineures protégées contre les risques médicaux et judiciaires des mutilations sexuelles et de l’excision ; la possibilité de la présence lors de l’entretien à l’OFPRA d’un.e représentant.e d’une association de défense des droits des femmes ou de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Ont également été introduites des dispositions relatives au huis clos à la CNDA lorsque la requête repose sur des faits de viol, de torture et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles ou de traite des êtres humains. Enfin, ce texte permet la conduite de l’entretien à l’OFPRA par un.e agent.e en présence d’un.e interprète de même sexe, si le/la demandeur.se en fait la demande et si cette demande apparaît fondée.
Votre rapporteure souligne à cet égard la nécessité de veiller à la formation des agent.e.s, notamment de l’OFPRA, en vue d’améliorer la protection des demandeuses d’asile victimes de violences.
Votre rapporteure se félicite enfin de l’adoption par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le 3 février 2016, de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, suite aux travaux importants menés par la Délégation aux droits des femmes, au début de cette législature, sous l’impulsion de Mme Maud Olivier, de la présidente Mme Catherine Coutelle et de M. Guy Geoffroy.
b. Le lancement de plusieurs plans gouvernementaux de lutte contre les violences faites aux femmes
Depuis 2005, quatre plans interministériels de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ont été élaborés. Le quatrième plan interministériel contre les violences faites aux femmes pour 2014-2016, en cours de mise en œuvre, s’articule autour de trois axes.
Dans le cadre du premier volet – organiser l’action politique autour d’un principe partagé : aucune violence déclarée ne doit demeurer sans réponse –, plusieurs mesures sont prévues : la création d’une plateforme téléphonique d’écoute et d’orientation, le doublement du nombre d’intervenant.e.s sociaux.ales en commissariats et en brigades de gendarmerie, la garantie de l’accès à un hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences (avec un objectif 1 650 solutions d’hébergement d’urgence nouvelles d’ici 2017) et la mise en œuvre d’un pilotage départemental de l’ensemble des réponses apportées.
Par ailleurs, il est prévu que toute victime ayant recours à une main courante ou à un procès-verbal de renseignement judiciaire, si elle a expressément refusé de porter plainte, soit désormais systématiquement informée sur les conséquences de son refus, sur ses droits, sur les procédures à engager pour les faire valoir et sur l’aide dont elle peut bénéficier. Il lui est alors proposé d’être mise en relation avec une structure d’accompagnement partenaire (intervenant.e social.e, psychologue, permanence d’association). Ce dispositif s’appuie sur des conventions signées au niveau départemental (voir aussi le bilan du « protocole plainte », avec environ 80 protocoles locaux conclus fin 2015, dans l’annexe n° 3 du présent rapport).
Dans le cadre du second volet du plan visant à protéger efficacement les victimes, sont mentionnés le renforcement de l’ordonnance de protection, la généralisation du téléphone grand danger, le soutien à l’accueil de jour ainsi qu’à la création d’espaces de rencontre parents-enfants et à l’accompagnement protégé, et le développement des stages de responsabilisation des auteurs, pour prévenir la récidive.
Enfin, différentes mesures sont prévues dans le cadre du dernier volet visant à mobiliser l’ensemble de la société, à travers notamment l’amélioration des connaissances, les actions d’information et de sensibilisation du grand public, la prévention des comportements sexistes et des violences en milieu scolaire et universitaire et dans le sport, la lutte contre les mariages forcés et les mutilations sexuelles la prévention du harcèlement sexuel et des violences au travail, la conduite d’actions spécifiques dans les outre-mer, etc (6). Une attention particulière est ainsi portée à la prévention des violences dans ce quatrième plan interministériel.
Il convient par ailleurs de rappeler que le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 a institué une Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). La Délégation a entendu Ernestine Ronai (7), coordinatrice « violences faites aux femmes » au sein de la MIPROF, dont le rôle essentiel (8) est aujourd’hui unanimement reconnu.
Parallèlement, le plan d’action national contre la traite des êtres humains, présenté en Conseil des ministres le 14 mai 2014, pose pour la première fois les fondements d’une politique publique transversale de lutte contre ce fléau sous toutes ses formes : proxénétisme, réduction en esclavage, servitude domestique, soumission à du travail ou à des services forcés, trafics d’organes, mendicité forcée, contrainte à commettre des délits. Ce plan comprend 23 mesures portant sur l’identification et l’accompagnement des victimes, le démantèlement des réseaux et la mise en œuvre d’une politique publique à part entière, tant au niveau national que local.
En outre, un plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun a été présenté en juillet 2015 et suivi par une campagne nationale lancée en novembre dernier (9).
On constate, au vu de ces différents plans, une approche de plus en plus précise du phénomène des violences et la volonté de l’appréhender de manière globale. La nécessité d’une réponse globale dans ce domaine a d’ailleurs été soulignée récemment, lors d’une réunion de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en janvier 2016, à laquelle votre rapporteure a participé, concernant les attaques récentes contre des femmes dans des villes européennes.
Attaques récentes contre des femmes dans des villes européennes :
nécessité d’une réponse globale
« Les attaques récentes contre des femmes dans plusieurs villes européennes ont choqué l’opinion publique et déclenché des débats sur les questions de migration et les politiques d’intégration. Elles ont également mis en lumière les violences sexuelles, le sexisme et l’inégalité de genre dont nous faisons l’expérience dans nos sociétés.
La violence à l’égard des femmes est l’une des violations les plus systématiques des droits humains et est ancrée dans une inégalité profonde entre les femmes et les hommes. Elle ne peut pas être considérée comme étant un problème culturel avec une femme sur trois victime de violences en Europe. La violence ne doit jamais rester impunie et les auteurs de toutes les formes de violence à l’égard des femmes doivent être poursuivis en justice.
Les médias ont une responsabilité importante pour couvrir de manière objective les faits, sans stigmatisation. Rendre compte de crimes de manière partielle, tardive ou malhonnête peut alimenter les théories conspirationnistes et attiser la haine à l’égard d’une partie de la population. Cela peut également contribuer à la défiance envers les autorités et les médias.
Ces attaques contre des femmes appellent une réponse globale comprenant une enquête officielle sur les faits et les réactions ainsi que des actions spécifiques pour protéger les femmes contre la violence. Celles-ci comprennent la ratification et la pleine mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). »
Source : rapport de M. Jonas Gunnarson (Suède, groupe socialiste) au nom de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination (13961), Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (26 janvier 2016)
c. La mise en œuvre des différentes mesures engagées de 2012 à 2015 : un bilan globalement satisfaisant
Les premières réalisations du quatrième plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ont été présentées en mai 2014 par la ministre des Droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui a annoncé, à cette occasion, le doublement des moyens consacrés spécifiquement aux violences faites aux femmes, soit 66 millions d’euros d’ici 2016.
Les campagnes d’information et de sensibilisation commencent à porter leurs fruits : les appels mensuels au 39 19, numéro vert gratuit et accessible 7 jours sur 7, sont passés de 4 000 à 7 000 en 6 mois. Le dispositif du téléphone portable d’urgence pour les femmes en très grand danger, initialement déployé dans dix départements, a été généralisé à l’été 2014.
LE LANCEMENT DE PLUSIEURS CAMPAGNES D’INFORMATION SUR LES VIOLENCES

L’annexe thématique n° 3 du présent rapport (« 2012-2015, un changement d’échelle dans la lutte contre les violences faites aux femmes ») présente un bilan détaillé des mesures engagées sous cette législature en vue de : favoriser la dénonciation des violences et améliorer la prises en charge des victimes ; les protéger dans l’urgence et dans la durée ; agir dans tous les domaines et sur tous les territoires ; apporter des réponses spécifiques à certaines formes de violences ; rendre visible leur ampleur et mobiliser l’ensemble de la société.
Mise en œuvre des mesures engagées depuis 2012 en matière de lutte contre les violences et d’accompagnement des victimes: quelques éléments de bilan chiffrés
– 50 780 appels traités au 3919 en 2014.
– 81 départements couverts par un protocole local de plainte.
– 400 téléphones grand danger déployés en 2015 et 100 de plus le seront en 2016.
– 1 147 hébergements pour les femmes victimes de violences créés depuis 2012.
– 300 accueils de proximité implantés sur tout le territoire pour accompagner les victimes et préparer la séparation.
– 541 intervenant.e.s sociaux.ales dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie pour mieux accompagner les victimes depuis 2014.
– 1 546 auteurs de violence ont suivi des stages de responsabilisation en 2014.
Source : ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes (novembre 2015)
Ce bilan apparaît globalement satisfaisant quant à la mise en œuvre des mesures annoncées. Il n’en reste pas moins nécessaire de maintenir une vigilance constante et de consolider ces avancées majeures, tant en matière de prévention des comportements sexistes que d’accompagnement de femmes durablement meurtries ou encore de traitement des agresseurs.
Votre rapporteure souligne à cet égard l’importance de responsabiliser les agresseurs et déresponsabiliser les victimes, comme l’a justement fait observer Luc Frémiot, substitut général à la cour d’appel de Douai exerçant les fonctions de procureur général.
2. Des interrogations sur la nécessité d’adapter certaines dispositions pénales pour mieux prendre la spécificité des violences de genre
a. Sur le terme de « féminicide » et les meurtres commis à raison du sexe
● Féminicide : définition et usages
En première acception, le féminicide peut désigner le meurtre d’une femme. Il s’agit ici de ne pas ignorer le sexe de la victime. C’est ce premier sens qui est retenu au tribunal de Bobigny selon Ernestine Ronai, coordinatrice sur les violences à la MIPROF, qui a évoqué l’emploi de ce mot dans la pratique. En effet, en Seine-Saint-Denis a été mis en place un « protocole féminicide », qui désigne le dispositif expérimental prévu pour la prise en charge des enfants mineurs orphelins lorsque l’un des parents (généralement l’homme) tue l’autre parent (la femme) au sein du couple.
En seconde acception, le féminicide peut désigner le fait de tuer une femme parce qu’elle est une femme ; il s’agit alors d’un meurtre individuel ou collectif à raison du sexe. Des associations féministes françaises se sont mobilisées pour l’utilisation de ce terme dans les débats relatifs aux violences faites aux femmes.
Bien connu dans d’autres pays et utilisé dans la littérature internationale, le terme gagne peu à peu du terrain en France.
Des siècles après l’inscription dans le vocabulaire du droit de l’infanticide et du parricide, le mot a été ajouté le 16 septembre 2014 au vocabulaire du droit et des sciences humaines par la Commission générale de terminologie et de néologie qui retient la définition suivante : homicide d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant en raison de son sexe. En préconisant l’emploi de l’expression, la Commission s’inscrit dans la continuité avec le vocabulaire des organisations internationales ou européennes, qui utilisent le terme anglais de femicide pour désigner les meurtres individuels ou collectifs à caractère sexiste. L’intérêt de l’avis est d’officialiser l’usage du terme féminicide, même si les avis de la commission n’ont pas de valeur contraignante pour l’ensemble des locuteurs français. Cette reconnaissance terminologique n’a pas pour effet bien entendu de modifier le droit pénal français.
Si le terme apparaît au XIXème siècle selon le Petit Robert, c’est au début des années 1990 qu’il devient un objet d’étude et de recherche, notamment grâce à deux femmes, Jill Radford et Diane Russell, qui publient un livre intitulé Femicide : the politics of woman killing. Ce terme est construit sur une contraction de female et homicide. Depuis 2005, les travaux du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne dans leur traduction française emploient le mot, de même que les traductions françaises des travaux de l’ONU.
Selon Diane Roman, professeure de droit public, en refusant de reconnaitre la spécificité de certains homicides sexistes et en prétendant que le vocable « d’homicide » parce qu’il serait universel, permet de désigner aussi bien les meurtres de femmes que ceux d’hommes, on contribue à invisibiliser certains rapports de sexe et une construction sociale fondée sur le genre qui est largement défavorable aux femmes. C’est pourquoi l’usage du terme « féminicide » pourrait être encouragé dans le vocabulaire courant.
En effet, comme l’avait souligné avec force Simone de Beauvoir, à propos de l’introduction du mot sexisme dans le dictionnaire Petit Robert en 1978, « Nommer, c’est dévoiler. Et dévoiler, c’est déjà agir ».
Recommandation : encourager l’usage du terme de « féminicide » dans le vocabulaire courant et administratif.
Pour donner un exemple typique de féminicide, on cite généralement la tuerie de l’école polytechnique de Montréal en décembre 1989, le tueur ayant annoncé aux étudiantes qu’« il combat le féminisme » et « hait les féministes » en ouvrant le feu sur elles.
Un autre exemple malheureusement connu est celui du Mexique à Ciudad Juarez à l’origine d’un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 2009. Alors que les nombreux enlèvements, viols et meurtres de femmes étaient traités avec indifférence par les autorités policières et judiciaires, qui ne voyaient dans ces assassinats que des violences d’ordre privé ou domestique, une enquête internationale a été diligentée par le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes. Celui-ci a publié un rapport en 2005 dans lequel il soulignait que les meurtres commis s’inscrivent dans une culture d’impunité qui facilite et encourage de graves violations des droits de l’Homme (10). Saisie à son tour, la Cour interaméricaine déplorait l’incurie des autorités mexicaines, relevant que cette « indifférence » des autorités « reproduit la violence qu’elle prétend attaquer ». Elle a reconnu l’État mexicain responsable de n’avoir pas fait le nécessaire pour protéger trois jeunes femmes décédées.
Sept pays d’Amérique latine ont adopté des dispositions concernant la reconnaissance du crime de féminicide. La première à entrer en vigueur est celle de Costa Rica en mai 2007, suivie par celle du Guatemala (mai 2008) du Chili (décembre 2010), du Pérou (décembre 2011) et d’El Salvador (janvier 2012). Au Mexique et au Nicaragua, les lois sont entrées en vigueur en juin 2012. Selon l’une des associations entendues par la Délégation (11), dans la plupart des législations où le terme « féminicide » est retenu, notamment au Chili, au Pérou, en Espagne et en Italie, il s’agit de souligner la demande d’aggravation des peines en cas de meurtre d’une femme par son conjoint. Pour un certain nombre d’autres pays, notamment l’Argentine, le Guatemala et le Mexique, il s’agit de prévoir une circonstance aggravante en cas de crime commis à raison de l’identité de la victime – donc de l’identité de genre.
En Europe, le mouvement est plus timide mais pas inexistant. L’Italie a adopté en 2013 plusieurs lois renforçant les sanctions contre les violences conjugales, le président du Conseil de l’époque, Enrico Letta ayant alors parlé de dispositions visant à lutter contre le féminicide.
Mais le contexte latino-américain est différent du contexte français, où les assassinats de femmes, bien que liés à des discriminations, s’exercent surtout dans la sphère domestique, comme le font remarquer certain.e.s chercheur.se.s, notamment Jules Falquet, maîtresse de conférence en sociologie à l’université de Jussieu-Paris Diderot, qui évoque à propos de l’Amérique latine, une « logique de guerre particulièrement complexe ».
● Au vu de ces évolutions, est-il opportun aujourd’hui de modifier le code pénal français et d’y introduire le féminicide ou prévoir des circonstances aggravantes pour les meurtres commis « à raison du sexe » ?
Ainsi que le rappelait Diane Roman lors de son audition (12), en France, les diffamations ou injures à caractère sexiste sont sanctionnées pénalement mais il n’existe pas de reconnaissance spécifique des meurtres sexistes, au même titre que pour les meurtres homophobes ou racistes par exemple. Ainsi, le code pénal reconnaît à l’article 221-4 des circonstances aggravantes (13) pour les meurtres commis « à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (6°), ou « à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle » de la victime (7°). Dans cette hypothèse, la peine maximale de trente ans de réclusion criminelle, prévue en matière de meurtre, est aggravée et portée à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais il n’y a pas pour l’instant de circonstances aggravantes pour les meurtres commis à raison du sexe.
Cependant, un certain nombre de dispositions législatives visent, expressément ou implicitement, les meurtres dont les femmes sont spécifiquement victimes. C’est le cas par exemple lorsqu’il est fait mention d’une circonstance aggravante lorsque la « vulnérabilité » d’une personne due à un « état de grossesse » est « apparente ou connue de son auteur » (3° de l’article 221-4 du code pénal) : ici il ne peut s’agir que de femmes. D’autres dispositions, sans nommer les femmes, ont été introduites les concernant : comme l’a rappelé le magistrat Luc Frémiot, une circonstance aggravante est ainsi prévue lorsque le meurtre est commis « par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » (9° de l’article 221-4 du code pénal). Implicitement, cela désigne les violences conjugales commises à l’encontre des femmes.
Il convient de noter que l’article 182-80 du code pénal modifié par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 prévoit que « la circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Ces dispositions sont applicables « dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ».
Faut-il alors aller plus loin ? Pour sanctionner les crimes sexistes, il pourrait être envisagé de modifier le 7° de l’article 221-4 en le rédigeant de la manière suivante : « À raison du sexe, de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ». Mais il convient de noter que, comme l’a fait remarquer l’AVFT lors de son audition (14), l’introduction d’un crime commis à raison du sexe dans le code pénal ferait peser sur les parties civiles une exigence probatoire accrue. Selon Mme Béatrice Bossard, magistrate et sous-directrice de la justice pénale générale à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, il serait difficile de caractériser en quoi il s’agit d’un meurtre aggravé en raison du sexe.
Votre rappporteure soutient que l’introduction d’une circonstance aggravante pour un meurtre commis à raison du sexe ne saurait méconnaître le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, dès lors qu’elle ne viserait que l’identité de la victime mais la motivation sexiste de l’auteur des faits. Toutefois, malgré l’intérêt légistique d’unifier dans notre code pénal les circonstances aggravantes sur la base des motifs de discrimination établis par l’article 225-1, cette évolution ne lui apparaît ni adaptée ni opportune en matière de violences conjugales et intrafamiliales, pour lesquelles les circonstances aggravantes en vigueur apparaissent plus protectrices.
Recommandation : réaliser une étude de droit comparé sur les meurtres et violences commis à raison du sexe et les dispositions normatives adoptées dans certains pays en matière de féminicide.
b. Sur la question de la légitime défense concernant les victimes de violences conjugales
La condamnation de Jacqueline Sauvage à dix ans d’emprisonnement par deux cours d’assises, pour avoir tué son mari de trois coups de fusils dans le dos après avoir été victime de violences pendant plusieurs années, a suscité une vive émotion et une mobilisation collective pour demander sa grâce, avec notamment une pétition en ligne ayant recueilli plus de 435 000 signatures.
En application de l’article 17 de la Constitution, le Président de la République a décidé, le 31 janvier 2016, d’accorder à Mme Sauvage une remise gracieuse de sa peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois ainsi que de l’ensemble de la période de sûreté qu’il lui reste à accomplir. À travers cette grâce, lui permettant de présenter immédiatement une demande de libération conditionnelle, le président de la République a voulu, face à une situation humaine exceptionnelle, rendre possible dans les meilleurs délais le retour de Mme Sauvage auprès de sa famille, dans le respect de l’autorité judiciaire (15).
Mais au-delà, cette affaire a été le révélateur de la situation des femmes victimes de violences en France, et notamment de la difficulté à porter plainte. Ce jugement a conduit à reposer dans le débat public la question des moyens de lutte contre les violences au sein des couples et de la protection des femmes victimes, mais aussi celle de l’adaptation éventuelle du droit pénal, concernant plus particulièrement le régime de la légitime défense.
La Délégation aux droits des femmes a souhaité approfondir la réflexion sur ces questions complexes, sans a priori mais avec le recul et la distance nécessaires pour apprécier l’opportunité de modifier la loi, au-delà de l’émotion compréhensible suscitée par cette affaire. Compte tenu de la séparation des pouvoirs et de l’autorité de la chose jugée, votre rapporteure souligne que la présente contribution n’a pas pour objet de « refaire le procès », en procédant à la réécriture a posteriori d’une affaire judicaire complexe, a fortiori en n’ayant qu’une vision très parcellaire du dossier d’instruction. Il s’agit en revanche d’examiner attentivement l’état actuel du droit et des pratiques, en France et dans certains autres pays, en vue d’apprécier l’opportunité de procéder à une réécriture de certaines dispositions pénales et, le cas échéant, selon quelles modalités, mais aussi de les mettre en regard de leurs inconvénients et risques de dérives éventuels.
En outre, et c’est l’objet de la troisième section du présent rapport, au-delà de la réponse pénale apportée dans les quelques cas où une victime de violences en vient à tuer son conjoint, il est fondamental, en amont et plus généralement, de chercher à identifier les difficultés le cas échéant rencontrées, sinon les dysfonctionnements, non seulement dans le cadre de la procédure judiciaire mais aussi concernant l’accueil, la prise en charge et la protection des victimes de violences intrafamiliales. Autrement dit, de veiller à la bonne mise en œuvre, et si nécessaire d’adapter, toutes les mesures susceptibles de concourir à éviter de tels drames humains, alors que plus de 220 000 femmes sont aujourd’hui victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles, et qu’une femme décède encore tous les 2,7 jours en France sous les coups de son conjoint.
● L’état actuel du droit en matière de légitime défense
Le principe de la légitime défense est posé par l’article 122-5 du code pénal, dont les dispositions sont reproduites dans l’encadré ci-après. Elle figure parmi les causes d’irresponsabilité pénale, au même titre que l’abolition du discernement, la contrainte, l’erreur de droit, l’autorisation de la loi et l’état de nécessité (16). La notion de légitime défense figure également à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (17).
Légitime défense : les dispositions actuellement prévues par le code pénal
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
Source : article 122-5 du code pénal
Les effets de la légitime défense : irresponsabilité civile et pénale
La légitime défense peut être reconnue dans les différentes phases de la procédure pénale, par les juridictions d’instruction comme motif de non-lieu, ainsi que par les juges du fond comme motif de relaxe ou d’acquittement.
Ainsi, l’auteur.e d’un homicide volontaire n’est pas coupable et ne peut être condamné.e, malgré la preuve de la matérialité des faits, s’il existe en sa faveur l’une des causes d’irresponsabilité énumérés aux articles 122-1 à 122-7 du code pénal, dont la légitime défense. Autrement dit, conformément aux articles 349-1 et 361-1 du code de procédure pénale (18), lorsque la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question leur demandant si l’accusé.e bénéficie, pour le fait qu’il/elle a commis, d’une cause d’irresponsabilité pénale prévue par le code pénal, l’accusé.e doit être déclaré.e non coupable de ce fait (19) .
Il n’y a donc pas de régime d’irresponsabilité partielle liée à la légitime défense, mais une forme de « tout ou rien ». C’est aussi pourquoi une stratégie de défense, uniquement fondée sur l’invocation de la légitime défense, n’est pas exempte de risques, a fortiori si les faits matériels contredisent les critères définis par l’article 122-5, parmi lesquels la concomitance de l’agression et de la riposte.
Il convient enfin de rappeler que les circonstances atténuantes ont été supprimées avec la réforme du nouveau code pénal en 1994 (voir aussi infra, concernant « l’excuse de provocation », antérieurement applicable). Par ailleurs, si en France, l’état de légitime défense emporte nécessairement l’irresponsabilité pénale de l’accusé.e, et donc son acquittement, il existe en Suisse par exemple un régime d’atténuation de la responsabilité en cas de disproportion entre l’agression et les moyens de défense (cf. encadré infra), ce qui peut s’apparenter à une forme d’irresponsabilité partielle.
Les conditions de la légitime défense relatives à l’agression et à la riposte
Plusieurs conditions, précisément définies par la loi, doivent être réunies pour que la légitime défense soit reconnue, et donc l’impunité pénale accordée :
– l’existence d’une agression réelle et injustifiée envers soi-même ou autrui : cette condition légale se comprend parfaitement et vise notamment à exclure un acte de rébellion ; l’usage de la force contre une personne peut en effet être justifié, par exemple un policier qui arrête un malfaiteur qui se débat et utilise la force nécessaire pour le maîtriser – ce dernier ne pouvant naturellement invoquer la légitime défense s’il a frappé ce policier en réaction ;
– l’absence de disproportion entre la gravité de l’agression et les moyens de défense employés : la proportionnalité de la riposte est ainsi une condition déterminante de l’admission de la légitime défense ; autrement dit, on ne pas se défendre n’importe comment et par exemple tirer avec une arme à feu après une simple gifle ; cette condition légale se comprend bien intellectuellement, en ce qu’elle vise à éviter les abus et risques de dérapages, mais peut poser des difficultés d’application dans certains cas (cf. infra) ;
– la concomitance de l’agression et de la riposte : le premier alinéa de l’article 122-5 du code pénal prévoit ainsi que l’agression et la riposte doivent intervenir « dans le même temps », et le deuxième alinéa comporte la même nécessité de l’actualité de l’agression (« pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit »). Cette dernière condition est particulièrement importante pour ne pas que des actes qui relèvent en fait d’une vengeance privée soient commis en toute impunité : autrement dit, la légitime défense ne peut être reconnue à une personne qui s’en prendrait à son agresseur plusieurs jours plus tard.
La présomption de légitime défense
L’article 122-6 du code pénal prévoit une présomption de légitime défense dans deux cas particuliers. Ainsi, est présumée avoir agi en état de légitime défense la personne qui accomplit l’acte « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ou « pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. ».
Il s’agit toutefois d’une présomption simple, et non irréfragable. En effet, la thèse de la présomption irréfragable avait autrefois été défendue par certains auteurs et admise par la Cour de Cassation dans deux arrêts anciens, en 1844 et 1871. Dans ces deux cas, il s’agissait de maris qui avaient tué leurs amants de leurs femmes au moment où ceux-ci s’introduisaient la nuit par escalade dans la maison conjugale. En l’espèce, les circonstances établissaient les motifs de l’escalade de leurs victimes et les accusés savaient qu’ils ne couraient aucun danger pour leur sécurité personnelle. En réalité, le mari n’avait pas voulu défendre ni sa sécurité personnelle, ni même l’inviolabilité de son domicile, mais punir l’adultère et se venger (20).
Cependant, dans deux procès ultérieurs, la présomption se vit attribuer par les juridictions d’instruction saisies le caractère de présomption simple : en effet, ces juridictions refusèrent de prononcer un non-lieu pour légitime défense et renvoyèrent devant la cour d’assises où les poursuites devaient toutefois aboutir à des acquittements (dans ces deux affaires, il s’agissait de parents qui avaient fait tuer des jeunes gens s’introduisant par escalade dans leur propriété, la nuit, pour venir y rencontrer leur fille, étant établi que les parents connaissaient parfaitement les intentions de leurs victimes et savaient n’avoir rien à craindre pour leur sécurité personnelle, ni pour leurs biens). Il fallut finalement attendre 1959 pour que la Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour de Bourges (21), pose clairement le principe que la présomption de légitime défense est toujours susceptible d’être renversée par la preuve contraire (22).
Au-delà de la portée juridique de la présomption de légitime défense, ce bref rappel historique et jurisprudentiel est aussi important pour appréhender les risques de dérives et d’abus liés au principe même de légitime défense.
● Des dispositions pénales inadaptées à la spécificité des violences conjugales ?
Ce que l’on désigne parfois par le terme de « syndrome de la femme battue » fait référence à un ensemble de signes cliniques qui traduisent un état post-traumatique résultant de la violence subie sur une longue période, entraînant perte d’estime de soi, un sentiment d’isolement et d’impuissance, la peur et l’altération des capacités de jugement.
Une psychiatre a par exemple proposé la définition suivante (23): « un tableau persistant qui s’intensifie avec l’accélération des gestes de violence causés par le conjoint abuseur. La femme victime d’abus se sent isolée et impuissante. Elle croit que son conjoint est tout-puissant et elle s’y soumet passivement. Ses perceptions sont restreintes, toutes ses énergies se concentrent sur des stratégies de survie à court terme. Elle est constamment en alerte face aux comportements de son conjoint et à ses moindres changements d’humeur. Dans un tel contexte, la femme en vient à développer une impuissance apprise qui ne lui permet plus de trouver des solutions pour sortir de la situation d’abus, comme par exemple en se réfugiant dans un centre pour femmes en difficulté, en laissant derrière elle le conjoint abuseur. Lorsque ces femmes en viennent à craindre pour leur vie, la seule solution envisageable devient alors de se défendre contre le conjoint avant que celui-ci les supprime. Il ne s’agit pas d’un choix délibéré ni d’un geste prémédité, la capacité de ces femmes de trouver des solutions plus adaptées étant nettement altérée par le perpétuel contexte de violence dans lequel elles ont vécu. »
Dès lors, le droit pénal, concernant notamment – mais pas uniquement – la légitime défense permet-il de prendre en compte, dans la mesure du possible, l’état psychologique de la victime, le phénomène d’emprise et ses répercussions, sa perception du danger, l’antériorité des violences et de menaces graves, concernant en particulier l’interprétation des critères d’actualité et de proportionnalité de la menace ? Votre rapporteure souligne à cet égard l’importance d’expliquer les mécanismes d’emprise et de violences intrafamiliales, notamment dans le cadre de la procédure judiciaire et de la formation des magistrat.e.s (cf. infra).
En outre, selon Mme Catherine Le Magueresse, juriste et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), a indiqué que « 41 % des femmes tuées par leur conjoint avaient déposé plainte, ce qui montre qu’une procédure pénale ne protège pas de la mort (24). ». Selon elle, « le droit actuel ne prend pas en compte la spécificité des violences conjugales : la légitime défense a été conçue par et pour des hommes, pour protéger leur propriété, dans le cadre d’une rixe à la sortie d’un bar… La jurisprudence n’évoque que ces cas. (…) En effet, en ne tenant pas compte de la situation spécifique des femmes victimes de violences conjugales, le code pénal français exclut les femmes violentées du droit à la légitime défense et ainsi du droit à un procès équitable. »
Il serait d’ailleurs intéressant d’objectiver ce constat par la production d’une étude détaillée sur le nombre et l’identité des personnes (femmes et hommes) ayant été reconnues en état de légitime défense, et en le comparant également à l’ensemble de celles et ceux l’ayant sollicité (cf. infra). Il convient par ailleurs de rappeler que l’état de légitime défense a déjà été reconnu dans le cas d’une victime de violence, Alexandra Lange, qui avait tué d’un coup de couteau son époux qui la battait en mars 2012 et a été acquittée du meurtre de son mari par la cour d’assises de Douai. Encore faut-il souligner qu’en l’espèce, les circonstances étaient assez différentes de celle de l’affaire Sauvage, puisque le coup avait porté au moment où son époux tentait de l’étrangler, avec ainsi un acte de défense concomitant à l’agression.
Quant à certaines propositions de réforme actuellement évoquées, Mme Le Magueresse a estimé qu’ « avec la présomption de légitime défense, on joue sur le régime de la preuve, mais sans toucher à la définition même de la légitime défense, or il est fondamental de définir la légitime défense », et par ailleurs qu’ « avec la légitime défense différée, les choses ne sont pas claires » – et de fait, cette notion apparait pour le moins confuse, sinon comme une contradiction dans les termes (peut-on parler de « défense » alors que le danger immédiat est par définition écarté, puisque la riposte intervient ultérieurement ?). Elle a dès lors suggéré une troisième piste : celle de la redéfinition de la légitime défense au regard des critères posés en droit canadien.
En 1990, la Cour suprême du Canada avait été conduite à se prononcer sur l’état de légitime défense invoqué par une femme victime de violences, Mme Lavallée, ayant tiré sur son conjoint (25). La juge Bertha Wilson avait notamment soutenu que « le jury n’a pas à porter de jugement sur le fait qu’une femme battue accusée ait poursuivi sa relation, et il a encore moins le droit de conclure qu’en agissant ainsi elle a perdu son droit de légitime défense (26) ». Le témoignage d'un expert a été admis à juste titre afin d'aider le jury à déterminer si l'appelante avait des motifs raisonnables pour appréhender la mort ou quelque lésion corporelle grave et croyait pour des motifs raisonnables n'avoir d'autre recours que celui de tirer.
Une réforme est intervenue en 2012, comme l’a indiqué Mme Le Magueresse, et « des facteurs à prendre en compte pour apprécier si la personne alléguant la légitime défense a agi de façon raisonnable, ont été intégrés à l’article 34 du Code criminel canadien. Les jurés doivent ainsi tenir compte notamment de : "la taille, l'âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause ; la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace ; la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force". Le législateur français pourrait s’inspirer des critères canadiens pour redéfinir la légitime défense, de telle sorte qu’elle ne soit pas discriminante pour les femmes victimes de violences conjugales ».
Ces dispositions ne concernent donc pas spécifiquement les femmes victimes de violences, mais s’appliquent à l’ensemble du droit de la légitime défense, et s’inscrivent dans un régime pénal et, plus globalement, un environnement juridique sensiblement différent.
Légitime défense : les dispositions prévues par le code criminel au Canada
« Art. 34 – (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne ;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger –ou de défendre ou de protéger une autre personne– contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace ;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel ;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident ;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause ;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace ;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause ;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force ;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. »
Antérieurement à la réforme intervenue en 2012, l’article 34 prévoyait que « (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à repousser la violence par la violence, si, en faisant usage de violence, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves et si la violence n’est pas poussée au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre de se défendre. (2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque, est justifié a) s’il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein, et b) s’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. »
Source : article 34 du code criminel canadien
Mme Diane Roman, professeure de droit public à l’université François Rabelais de Tours, a déclaré souscrire à la proposition de Mme Catherine Le Magueresse « sur les critères de la légitime défense permettant d’encadrer l’appréciation des magistrats », mais « si la question de la légitime défense s’avérait être un sujet trop sensible politiquement, [a proposé] une solution de repli sur la base de l’article 122-2 du code pénal » relatif à la contrainte.
La « contrainte » : une autre cause d’irresponsabilité pénale (122-2 du code pénal)
Aux termes de l’article 122-2 du code pénal, « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». La contrainte est caractérisée par l’impuissance à résister à une pression ou la création de cette même volonté par une action tierce. La contrainte réside donc, soit dans la perte totale de la liberté de commettre ou ne pas commettre l’action envisagée, soit dans l’absence de spontanéité de l’acte. Le nouveau code pénal ne traite plus au même article des troubles psychiques (article 122-1 du code pénal pénal (27) relatif à l’abotion du discernenement) et de la contrainte (122-2), ce qui autorise à reconnaître une qualification différente. On peut distinguer plusieurs types de contraintes : contrainte physique externe (due à une force de la nature, au fait d’un animal, d’un tiers ou à celui de la puissance publique qui exerce sur la personne une pression telle que celle-ci n’a plus l’exercice normal de son activité), voire interne (par exemple si l’impossibilité de faire quelque chose est la conséquence d’une maladie), et la contrainte morale, qui résulte d’un dérèglement des factultés de vouloir causé par une crainte, une menace ou une sugestion qui peuvent naitre d’évènements divers.
En ce sens, Mme Roman a fait valoir que « la contrainte intègre théoriquement la situation psychique de l’auteur de l’acte criminel. Par conséquent, les violences subies par la victime – asservissement, processus d’aliénation constant, humiliations répétées – pourraient être considérées comme constitutives d’une contrainte. Pour l’heure, la jurisprudence n’a pas retenu la contrainte comme cause d’irresponsabilité pénale en matière de violences, mais cela pourrait l’être en restant dans le cadre actuel du code pénal (28). »
Il reste que, comme la légitime défense, la reconnaissance de l’état de contrainte emporte l’irresponsabilité pénale, et non une atténuation de la responsabilité d’une personne, et soulève aussi plusieurs interrogations, liés au caractère subjectif de cette cause d’irresponsabilité pénale, et à la nature de la « contrainte » dans ce type de cas, ce qui peut aussi sembler réfuter la possibilité d’un libre-arbitre. La réflexion sur ce point mérite donc d’être approfondie.
c. Les recommandations de la Délégation
Au cours des travaux de la Délégation, plusieurs réserves ont été exprimées sur l’opportunité ainsi que sur les risques que présenterait une modification du régime de la légitime défense.
Certaines personnes entendues ont tout d’abord estimé qu’en l’état actuel du droit, un verdict bien plus clément aurait pu être rendu dans le cas de l’affaire Sauvage (29). Par ailleurs, il est d’ailleurs à noter que, dans une affaire récente présentant certaines similarités, une autre femme jugée pour l’assassinat de son mari, a été condamnée finalement pour des faits de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et condamnée à cinq ans de prison avec sursis (30) – et en l’espèce, les dispositions du code pénal relatives à la légitime défense n’avaient d’ailleurs pas été invoquées pour la défense de l’accusée.
En outre, assouplir les dispositions actuelles du code pénal, concernant en particulier le critère de concomitance entre l’agression et la riposte, dans le cas d’une légitime défense « différée », ne conduirait-il pas, nolens volens, à accorder une forme de « permis de tuer », et même un « permis d’assassiner », s’agissant d’un acte commis avec préméditation, de façon « préventive » ou dans le cadre d’une vengeance privée ? Dans un État de droit, peut-on promouvoir l’auto-défense et reconnaître le principe même de se faire justice soi-même ? Et peut-on espérer prévenir tout risque de dérive en confiant cette lourde responsabilité à des expert.e.s ?
Par ailleurs, ne risque-t-on pas ce faisant d’envoyer un signal redoutable à toutes les femmes victimes de violences, celui d’une forme de démission collective en matière de lutte contre les violences conjugales ? Dans ce sens, M. Luc Frémiot (31) a ainsi évoqué « le droit de tuer parce que l’institution démissionne, parce que les pouvoirs politiques et institutionnels vous font passer ce message : "Débrouillez-vous toutes seules, vous, qui êtes sous emprise, vous, dont les psychiatres diront que votre discernement est altéré, femmes de l’ombre, dont la société ne reconnaît pas le visage, faites ce que vous avez à faire, car nous sommes incapables de vous défendre" ».
Enfin et surtout, ce débat, qui se concentre sur un article du code pénal, n’est-t-il pas d’une certaine manière l’arbre qui cache la forêt, au sens où il conduit à occulter le problème central : celui de l’accompagnement et de la protection des victimes ? Dans ce sens, il ressort du témoignage édifiant donné par Mme Le Magueresse, qui a assisté à l’ensemble du second procès en assises de Mme Sauvage, qu’il y a eu aussi une série d’occasions manquées (32), et donc une forme de responsabilité collective. Pour votre rapporteure, la priorité doit être de tout en mettre en œuvre pour prévenir ce type de drames humains et d’assurer une prise en charge rapide et adaptée des femmes victimes de violences.
Et c’est aussi pourquoi plusieurs mesures récentes sont particulièrement importantes, telles que la désignation d’un.e référent.e violence dans les services d’urgences, à la demande de la ministre Marisol Touraine, le développement de la formation des professionnel.le.s, notamment des magistrat.e.s, mais aussi des gendarmes et policier.e.s, et profesionnel.le.s de santé, sous l’impulsion de la MIPROF, le développement des protocoles plainte et l’organisation de campagnes d’information sur les violences, pour mieux faire connaître les dispositifs existants d’aide aux victimes (cf. infra, dans la troisième section du présent rapport).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, votre rapporteure estime donc qu’il serait inopportun d’introduire une « légitime défense différée », qui pourrait ouvrir la voie à une légitimation de la vengeance et du meurtre avec préméditation, le statut de victime ne pouvant ouvrir un droit à se faire justice soi-même.
En revanche, et pour tirer tous les enseignements des affaires judicaires récentes, et au vu des différents éléments recueillis dans le cadre des présents travaux, votre rapporteure formule les recommandations suivantes :
Ø d’une part, poursuivre les actions volontaristes engagées et prendre les mesures nécessaires pour consolider les avancées majeures intervenues en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, avec une priorité : accompagner et protéger les victimes (cf. les recommandations n° 5 à 14, dans la troisième sous-section du présent rapport) ;
Ø d’autre part, procéder dans les meilleurs délais à une étude approfondie sur l’état du droit et de la jurisprudence en matière de légitime défense : cette étude, qui pourrait faire l’objet d’un rapport remis au Parlement préparé par les services du ministère de la justice, viserait :
– d’une part, à fournir une analyse chiffrée et sexuée sur le nombre de cas dans lesquels la légitime défense a été reconnue, et comparativement aux cas dans lesquels elle avait été invoquée, pour déterminer notamment dans quelle mesure il est exact que les hommes sont aujourd’hui les principaux concernés ;
– d’autre part, à procéder à une revue de jurisprudence détaillée sur l’interprétation jurisprudentielle donnée aux critères légaux de proportionnalité entre l’agression et la riposte, de concomitance, et enfin de la prise en compte de la perception par la personne de la situation et de la gravité de la menace. Par exemple, dans un arrêt récent de la Cour de Cassation (33), il était fait référence aux considérants d’une cour d’appel estimant que « la nécessité de la légitime défense doit être appréciée au regard de la situation qui pouvait se présenter à l’esprit de l’auteur de la réplique au moment de l’action, compte tenu à la fois de ce qu’il en connaissait et de ce qu’il en pouvait imaginer, le cas échéant sous le coup d’une émotion violente de nature à obscurcir son jugement ». Cette étude pourrait d’ailleurs inclure des éléments de droit comparé.
Ø Enfin, et à la lumière notamment des éléments recueillis dans le cadre du rapport précité, il conviendrait d’approfondir la réflexion sur une possible adaptation du droit, concernant en particulier le critère de proportionnalité et la question d’une forme d’atténuation de la responsabilité.
– Sur le critère de proportionnalité, il peut y avoir des difficultés liées à l’état de panique intense suscitée par une agression et la difficulté de répondre par un acte strictement proportionnel, par exemple dans le cas d’une jeune femme qui se saisirait d’une arme blanche suite à des coups violents portés par un homme, auxquels elle ne serait pas en mesure autrement de répondre physiquement. Autrement dit, faut-il imposer en toute circonstance que l’acte de défense soit strictement proportionnel à l’attaque ?
Un avocat a proposé à cet égard de modifier le droit sur ce point, dans une tribune (34) portant sur la légitime défense et le critère de proportionnalité, qui n’évoquait d’ailleurs pas la question des victimes de violences, en introduisant par exemple des dispositions suivantes : « n’est pas pénalement responsable, en cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle-même, celui ou celle qui se sera défendu sous l’effet d’une panique ou d’un stress qui ont modifié ou pu modifier sa perception de la réalité à la condition que cet état soit directement imputable à la menace suscitée par l’agression (35) ». Cette tribune évoquait d’ailleurs à cet égard les dispositions prévues par l’article 16 du code pénal helvétique, dont les dispositions sont reproduites ci-après, notamment le cas notamment où la personne, en repoussant une attaque a excédé les limites de la légitime défense.
Une autre option pourrait être de maintenir inchangées les dispositions actuellement prévues par le premier alinéa de l’article 122-5 du code pénal, définissant précisément les conditions de la légitime défense (avec notamment les critères de proportionnalité et de concomitance), mais de le compléter par un alinéa concernant l’interprétation du principe de proportionnalité. En s’appuyant le cas échéant sur des principes dégagés par la jurisprudence (cf. étude évoquée supra), il s’agirait de préciser que pour l’appréciation de l’absence de disproportion entre l’agression et les moyens de défense employés, il est tenu compte de l’existence de violences antérieures répétées et de menaces d’une particulière gravité, voire de la perception du danger et que de ce que la personne pouvait raisonnablement appréhender.
Les dispositions prévues par le code pénal suisse en matière de légitime défense
Article 15 (légitime défense) : « Quiconque de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. »
Article 16 (défense excusable) : « 1 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. 2 Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable. »
– Sur les possibilités éventuelles d’atténuation de la responsabilité pour les victimes de violences conjugales. Il convient tout d’abord de rappeler que l’ancien code pénal français (en vigueur avant la révision de 1994) admettait dans certains cas des « excuses de provocation ». L’ancien article 416 du code pénal disposait ainsi que « le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes » (même si des dispositions plus restrictives (36) dans le cas de violences domestiques). L’exemple est cependant intéressant, dans la mesure où il montre que l’excuse de provocation a pu être admise dans d’autres contextes, avec donc une forme d’atténuation de la responsabilité.
Il s’agirait alors, à la lumière notamment d’exemples étrangers, d’explorer les options susceptibles de sortir d’une logique binaire, qui consiste à déclarer la personne totalement irresponsable ou non sur le plan pénal. Il reste que ce type de modification pourrait conduire à une modification assez profonde du système pénal actuel, avec des répercussions dont il convient de mesurer toute la portée –outre le fait que des dispositions étrangères ne sont pas nécessairement transposables en l’état, sans prendre en compte l’économie générale du droit interne.
On peut toutefois rappeler qu’en matière d’altération du discernement, l’article 122-1 du code pénal prévoit qu’ « une personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. » Faut-il dès lors approfondir la réflexion sur la possibilité d’introduire une forme de circonstance atténuante lorsque des violences et menaces répétées et d’une particulière gravité ont été commises à l’encontre d’une personne accusée d’un homicide ? Et, le cas échéant, à quelles conditions et quelles en seraient la portée ?
Enfin, il convient de rappeler que des circonstances aggravantes sont prévues (article 221-4 du code pénal précité) lorsqu’un meurtre a été commis sur un conjoint ou ex-conjoint, et que ces dispositions, qui entraînent une aggravation de la peine maximale encourue (de trente ans à la réclusion criminelle à perpétuité), s’appliquent dans tous les cas de figure – y compris donc en cas de plainte ou de condamnation pour violences conjugales par exemple. Faudrait-il également envisager une adaptation de ces dispositions ?
Recommandation : préciser le droit en vigueur pour mieux prendre en compte la notion d’emprise des victimes de violences, notamment des femmes victimes de violences conjugales pérennes :
– sans créer un régime de légitime défense différée, qui ouvrirait la porte à un « permis de tuer » en établissant une présomption d’irresponsabilité pénale ;
– en interrogeant la définition de la légitime défense pour que soit mieux appréciée l’absence de disproportion entre l’agression et les moyens de défense employés, compte tenu de l’existence de violences antérieures répétées, de menaces d’une particulière gravité et d’un danger de mort.
Pour étayer cette recommandation, la Délégation demande la remise, par la Chancellerie et dans les meilleurs délais, d’une étude approfondie, chiffrée et sexuée sur l’état de la jurisprudence en matière de légitime défense (nombre de cas concernant les femmes et les hommes, interprétation jurisprudentielle des critères légaux, éléments de droit comparé, etc…)
3. Des mesures nécessaires pour consolider les avancées en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, avec une priorité : accompagner et protéger les victimes
Pour que l’Assemblée nationale dispose de recommandations de la délégation aux droits des femmes avant l’examen du projet de loi relatif à la procédure pénale ou autres projets de réforme prévues en matière de justice, votre rapporteure a décidé de concentrer ses travaux sur les améliorations susceptibles d’être apportées en matière de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales, c’est-à-dire essentiellement les violences conjugales et les violences, directes ou indirectes à l’encontre des enfants.
En effet, votre rapporteure n’a pas l’intention de « rouvrir » la totalité des débats qui avaient précédé les deux précédentes lois de 2010 et 2014. Toutefois, pour répondre aux demandes multiples formulées lors des auditions, votre rapporteure a souhaité que la délégation aux droits des femmes évalue la mise en application de ces politiques publiques avant 2017.
a. Développer la formation des professionnel.le.s et améliorer les connaissances pour pouvoir mieux agir
● Développer la formation initiale et continue des professionne.le.s
La question de la formation des professionnel.le.s confronté.e.s aux violences conjugales est identifiée par l’ensemble des actrices et acteurs des droits des femmes comme un élément indispensable des politiques publiques en matière de lutte contre les violences. Cette question n’est pas nouvelle et depuis 2005, trois plans triennaux de lutte contre les violences faites aux femmes ont permis de mobiliser les services de l’État sur l’objectif de formation des professionnel.le.s concerné.e.s. Mais les actions mises en place sur le terrain sont apparues hétérogènes suivant les professions et les territoires.
C’est pourquoi le Comité interministériel aux droits des femmes du 30 novembre 2012 a confié à la MIPROF le soin de définir le cahier des charges d’un plan de formation transversal et interministériel sur les violences, afin d’assurer une meilleure formation des professionnel.le.s.
En outre, dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le Parlement a posé le principe de l’obligation de formation de l’ensemble des acteurs de la lutte contre les violences, satisfaisant ainsi une recommandation adoptée par la Délégation aux droits des femmes en juillet 2012 (37).
Ainsi, aux termes de l’article 51 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, modifiant l’article 21 de la loi précitée du 9 juillet 2010, « La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’État civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique ».
La loi ayant posé un principe fort, la MIPROF conformément à sa mission a conçu de nouveaux outils permettant à l’ensemble des acteurs de bénéficier d’un socle de références communes pour la prévention, la détection des violences faites aux femmes et leur protection. Quatre kits de formation ont ainsi été construits.
Les kits de formation conçus par la MIPROF
Les quatre kits se composent d’un court-métrage et d’un livret d’accompagnement.
– Le kit « Anna » explique les mécanismes des violences au sein du couple, le repérage, la prise en charge par le/la professionnel.le et le travail en réseau. Il met en scène un médecin et une patiente, victime de violences, et encourage la pratique du questionnement systématique.
– Le kit « Elisa » traite des conséquences des violences sexuelles et de l’impact du repérage systématique sur la femme victime. Cette pratique professionnelle améliore le diagnostic, la prise en charge et l’orientation par le/la professionnel.le. Il est destiné d’abord aux sages-femmes et aux professionnel.le.s de santé.
– Le kit « Tom et Léna » traite de l’impact des violences au sein du couple sur les enfants ainsi que du repérage et de la prise en charge de la mère et de l’enfant victimes. Il est destiné d’abord aux professionnel.le.s de l’enfance et de l’adolescence.
– Le kit « Protection sur ordonnance » traite des mécanismes des violences, du repérage et de l’évaluation du danger lié aux situations de violences au sein du couple pour mettre en place une prise en charge et une protection adaptées pour la mère et les enfants victimes ; il est conçu d’abord pour les avocat.e.s et les professionnel.le.s du droit.
Source : Mission interministérielle pour la protection des femmes pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF)
Ces outils ont permis la sensibilisation et/ou la formation de 200 000 personnes, selon les précisions apportées par Mme Ernestine Ronai, coordinatrice des violences faites aux femmes au sein de la MIPROF (38).
De plus, concernant la formation initiale des médecins, l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales a modifié et intégré les « violences sexuelles » dans les programmes des examens universitaires. Pour les sages-femmes, le diplôme d’État modifié par arrêté du 11 mars 2013 prévoit, dans ses objectifs, la prévention et le dépistage des violences faites aux femmes.
Pour les gardiens de la paix, une évaluation sur les violences intrafamiliales et l’accueil des victimes est intégrée pour le classement de fin de scolarité. La direction générale des étrangers du ministère de l’intérieur est intervenue dans la formation « prise de poste des chefs de bureau des étrangers en préfecture » pour sensibiliser les agents à la situation de vulnérabilité juridique et administrative des femmes immigrées lorsqu’elles subissent des violences intrafamiliales, et lorsqu’elles se retrouvent en rupture de droit de séjour, au moment de la séparation du couple. La formation sur les violences faites aux femmes fait par ailleurs partie des contenus prioritaires à intégrer dans la réforme des travailleurs et travailleuses sociaux.
La MIPROF s’attache particulièrement à la formation des formateurs et formatrices, dans le cadre de la formation initiale et continue, en partenariat avec les ministères concernés, les organismes professionnels et de formation. Un travail est entrepris pour les professionnel.le.s en lien avec les femmes en situation de handicap. Les représentant.e.s du ministère de la justice ont également apporté des éléments chiffrés pour ce qui concerne la formation des magistrat.e.s (39).
Ces éléments montrent qu’un effort significatif est fait dans ce domaine. Néanmoins, la formation continue des magistrat.e.s par exemple est facultative et se fait sur la base du volontariat. Il serait souhaitable que cette formation continue dans ce domaine devienne systématique, sinon obligatoire. Il apparaît également que lorsqu’une femme subit des violences conjugales, la première difficulté est de porter plainte et votre rapporteure souligne l’importance du premier accueil de la victime. Ceci suggère un effort accru pour former policier.e.s et gendarmes à la réception des plaintes des femmes victimes de violences, en respectant notamment la confidentialité de la déposition.
Cet effort de formation des professionnel.le.s doit être poursuivi sans relâche et amplifié pour toucher progressivement l’ensemble des professionnels concernés. À cette fin, et au-delà des données ponctuelles sur les participant.e.s à des sessions de formation une année considérée, il conviendrait de procéder au suivi annuel du nombre total de magistrat.e.s, policier.e.s et gendarmes ayant suivi une formation sur les violences, rapporté au nombre total de professionnel.le.s en exercice. Il s’agit de suivre les progrès constatés dans la durée, l’objectif étant naturellement qu’à terme cette proportion se rapproche de 100 %, ce qui suppose de veiller parallèlement aux moyens nécessaires. Ces données pourraient être publiées dans les feuilles de route ministérielles pour l’égalité des ministères de la justice et de l’intérieur, et assorties d’objectifs chiffrés intermédiaires précis pour les années à venir.
Recommandation : en matière de formation :
– poursuivre et amplifier l’effort de formation de tous les professionnel.le.s confronté.e.s à la problématique des violences faites aux femmes, s’agissant en particulier de la formation continue ;
– publier chaque année dans les feuilles de route ministérielles pour l’égalité, des statistiques détaillées sur la proportion de professionnel.le.s en exercice ayant suivi une formation sur les violences (en particulier les magistrat.e.s, policier.e.s et gendarmes) avec des objectifs chiffrés pour l’année à venir.
● Améliorer les connaissances pour pouvoir mieux agir contre les violences conjugales
Il serait tout d’abord souhaitable que le ministère de la justice dispose de davantage de statistiques sexuées. Les statistiques recueillies par le ministère concernant les violences au sein du couple, permettent de connaître, chaque année, le nombre de femmes et d’hommes condamné.e.s pour faits de violences sur leur conjoint ou ex-conjoint en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. En 2014, par exemple, 15 982 hommes et 561 femmes ont été condamnés en 2014 pour les crimes ou délits sur leur conjoint ou ex-conjoint en 2014, et 97 % de ces condamnations ont été prononcées contre des hommes. Cependant, ces statistiques, qui sont en fait tirées du casier judiciaire national ne permettent pas de disposer de données sur les victimes. C’est la même chose pour les viols et agressions sexuelles.
En tout état de cause, comme cela a été suggéré au cours des auditions de la Délégation, il serait intéressant de procéder à une étude comparée des peines prononcées à l’encontre des hommes et des femmes violent.e.s, en intégrant d’ailleurs également des analyses sur l’exécution des peines. Ceci permettrait d’objectiver, le cas échéant, les interrogations émises quant à l’existence d’une différence de traitement, en comparant par exemple la peine prononcée concernant un chanteur célèbre suite à des violences ayant entraîné la mort de de sa compagne, comparativement à celle prononcée dans l’affaire Jacqueline Sauvage.
Il conviendrait également d’approfondir la réflexion sur la possibilité de prendre en compte les suicides liés aux violences conjugales ainsi que les décès ultérieurs et consécutifs aux violences conjugales.
Recommandation : recenser les données sur les peines prononcées à l’encontre des hommes et des femmes auteur.e.s de violences et leur exécution.
La question de la correctionnalisation des crimes a par ailleurs été soulevée lors des travaux de la Délégation. À cet égard, le manque de de données est manifeste, puisque même le ministre de la justice et des libertés déclarait, en mai 2011, que « les cours d'assises ne jugent aujourd'hui que 2 200 crimes par an ; on ne sait si 80 % des crimes sont correctionnalisés, car nous n'avons pas de statistiques, mais la pratique est patente pour les viols (40) ».
En janvier 2016, une plateforme de revendications communes a été présentée par une douzaine de structures féministes, spécialisées sur les violences faites aux femmes – dont le Collectif national pour les droits des femmes (CNDF) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV), qui ont été entendus dans le cadre de cette mission d’information. La question de la correctionnalisation y est notamment soulevée, en appelant à son interdiction pour les infractions à caractère sexiste et/ou sexuel de nature criminelle (cf. encadré ci-après).
Une évaluation des pratiques actuelles serait en tout état de cause nécessaire. L’interdiction de correctionnaliser des infractions à caractère sexiste et/ou sexuel de nature criminelle devrait également être examinée dans ce cadre.
« Compétence des tribunaux et problème de la correctionnalisation » : la position d’un collectif d’associations féministes (janvier 2016)
« La loi du 10 mars 2004 a conditionné la possibilité de faire juger les crimes et crimes aggravés par un tribunal correctionnel à l’accord de la victime. En réalité, cet accord se déduit du fait que la partie civile ne fasse pas appel de l’ordonnance du juge d’instruction de renvoyer devant le tribunal correctionnel des faits de nature criminelle.
Le fait de correctionnaliser des infractions criminelles entre en contradiction grave avec les classifications du code pénal. Les viols, viols par conjoint, les mutilations sexuelles féminines sont des infractions criminelles qui doivent être jugées comme telles. La loi les ayant qualifié de crimes, leur sous-qualification en délit doit être invalidée.
Nous dénonçons l’abandon de la commission d’enquête relative aux conséquences de la correctionnalisation judiciaire, créée à l’Assemblée nationale le 22 juin 2011. Nous réclamons un principe d’interdiction de correctionnaliser des infractions à caractère sexiste et/ou sexuel de nature criminelle, une revendication que le mouvement féministe porte avec constance depuis de longue années. »
Source : « Mettre fin aux violences faites aux femmes : ce que nous voulons », brochure présentée le 23 janvier 2016 par un collectif d’associations (Amicale du Nid, Collectif féministe contre le viol, Collectif national pour les droits des femmes, Coordination lesbienne en France, Fédération nationale Solidarité femmes, Femmes pour le dire, femmes pour agir, Féminisme enjeux, Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles, Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, Mémoire traumatique et victimologie, Voix de femmes et Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées)
S’agissant, d’autre part, de la question de l’opportunité des poursuites et des classements sans suite, également évoqués au cours des travaux de la Délégation (41), il convient de rappeler que le procureur territorialement compétent peut décider s’il est opportun soit d’engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient, conformément à l’article 40-1 du code de procédure pénale (42).
Aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale, le procureur avise les plaignant.e.s et les victimes, si elles sont identifiées, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement, et « lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient ».
À cet égard, dans la brochure précitée sur les violences faites aux femmes, les douze associations féministes demandent « le respect de l’obligation faite au Procureur de la République de motiver tout classement sans suite en imposant une motivation détaillée et approfondie en fonction du cas d’espèce, afin d’éviter les motivations stéréotypées ». À cette fin, une circulaire d’orientation de politique pénale adressée aux procureurs de la République pourrait permettre d’insister sur ce point, voire l’article 40-2 du code de procédure pénale complété en ce sens.
Recommandation : créer les outils pour mieux identifier les phénomènes de correctionnalisation des crimes, s’agissant en particulier des viols, et veiller à ce que les décisions de classement de suite prononcées par les procureurs de la République fassent l’objet d’une motivation détaillée.
b. Encourager l’utilisation de l’ordonnance de protection
La loi du 9 juillet 2010 a adopté comme mesure centrale la création de l’ordonnance de protection. Celle-ci est rendue par le juge aux affaires familiales et vise à fournir un cadre d’ensemble aux femmes victimes de violences et à stabiliser leur situation juridique. L’ordonnance de protection est destinée à protéger les personnes victimes de violences dans le couple ainsi que leurs enfants dès lors « qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
La liste des mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-11 du code civil est particulièrement complète. Elles permettent notamment d’assurer : la sécurité physique des personnes (interdiction de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation, interdiction de détenir une arme, dissimulation de l’adresse de la requérante…) ; la sécurité juridique en qualité de parent isolé (autorité parentale et modalités de son exercice..) ; la mise à l’abri et la sécurité économique (principe d’attribution du logement de la requérante…).
La loi du 4 août 2014 avait pour objectif d’améliorer le dispositif de l’ordonnance de protection en réduisant les délais de délivrance en précisant dans le texte « dans les meilleurs délais » et en prolongeant la durée des mesures (portée de 4 à 6 mois). Une circulaire en date 7 août 2014 (43) du ministère de la Justice et d’application immédiate est venu préciser les dispositions relatives à l’ordonnance de protection.
Comme le faisait remarquer Ernestine Ronai lors de son audition, l’ordonnance de protection est un outil très complet mais encore insuffisamment utilisé parce qu’insuffisamment compris. Elle est destinée à permettre à une femme sous emprise, qui a très peur, de demander une protection avant la plainte. Or, encore trop souvent, les magistrat.e.s exigent une plainte comme élément de vraisemblance du danger.
À cet égard, il convient de noter que le protocole-cadre du 30 décembre 2013 relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales affirme le principe d’un dépôt de plainte suivi d’une enquête pénale lorsqu’une victime de violences au sein du couple se présente dans un service de police ou une unité de gendarmerie. Il rappelle le caractère très exceptionnel du recueil de déclarations sur main courante ou procès-verbal de renseignement judiciaire, qui devra être encadré de façon très stricte. Les parquets doivent donc veiller à ce que les services de police et unités de gendarmerie respectent les instructions définies au niveau local en application de ce protocole cadre. Ce point est expressément précisé dans la circulaire de politique pénale du 24 novembre 2014 (44) en matière de lutte contre les violences au sein du couple.
Sur le terrain, 2 481 décisions concernant une demande d’ordonnance de protection ont été prises en 2014 par un juge aux affaires familiales. Dans 1 991 affaires, le juge aux affaires familiales a statué sur le fond de la demande et 1 303 ont été acceptées totalement ou partiellement. Le nombre d’ordonnances de protection prononcées en 2014 a augmenté de 10 % par rapport à 2013 (45).
Il serait intéressant de disposer de statistiques plus fines par ressort de tribunal de grande instance (TGI) concernant le nombre d’ordonnances de protection demandées et prononcées ainsi que le délai de délivrance (moyen et maximal), afin de mieux apprécier les disparités sur le territoire, souvent évoquées lors des travaux de la Délégation aux droits des femmes.
RÉSULTAT DES DEMANDES D’ORDONNANCES DE PROTECTON DANS LE CADRE DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE EN 2014 ET EN 2013
2014 |
2013 | |
Total décisions Total hors jonction et interprétation |
2 481 2 462 |
2 182 2 161 |
Décisions statuant sur la demande * Acceptation – dont totale – dont partielle |
1 991 1 303 658 645 |
1 775 1 183 629 554 |
Champ : France métropolitaine, DOM, COM
* Les situations ou la décision ne statuent pas sur la demande regroupe les cas de désistement de la partie demanderesse et de radiation ou d’irrecevabilité de la demande.
Source : ministère de la justice (SDSE/DACS/PEJC, exploitation du répertoire général civil, 2014)
Votre rapporteure estime en effet que le délai moyen actuel de délivrance des ordonnances de protection, qui serait de 37 jours selon les informations recueillies auprès du ministère de la justice (46), est trop long pour un dispositif d’urgence. Une étude statistique devrait prochainement être menée sur l’éviction du conjoint violent et la pratique de l’ordonnance, selon le ministère de la justice.
Par ailleurs, une nouvelle circulaire ministérielle pourrait utilement orienter les magistrat.e.s (juges aux affaires familiales) pour une utilisation plus fréquente et judicieuse de l’ordonnance de protection, notamment pour l’appréciation de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués et l’exposition au danger.
Recommandation : améliorer l’application de l’ordonnance de protection, en raccourcissant ses délais de délivrance et en favorisant son usage en adressant une nouvelle circulaire ministérielle aux juges aux affaires familiales, et procéder à une étude quantitative et qualitative du recours à l’ordonnance de protection sur l’ensemble du territoire et par ressort de TGI.
c. Le renforcement de la coordination des acteurs, par le déploiement de politiques de juridiction volontaristes, et l’exclusion de la médiation familiale en cas de violences
Si le recours à la médiation pénale a été strictement encadré par la loi du 4 août 2014 en prévoyant qu’elle ne soit possible lorsque des violences ont été commises que « si la victime en fait expressément la demande » (article 41-1 du code de procédure pénale), il n’en est pas de même de la médiation familiale.
La médiation familiale est une voie de règlement des conflits qui peut être proposé par le juge civil (juge aux affaires familiales) dans les cas de ruptures, séparations et divorces avec l’accord des deux personnes. Il convient ici de rester vigilant car cette possibilité doit être rigoureusement exclue en cas de violences dans le couple alors que la victime est sous l’emprise de son agresseur. À cette fin, il convient de modifier l’article 373-2-10 du code civil afin de préciser que la possibilité pour le juge d’enjoindre un médiateur familial est exclue en cas de violences conjugales, en ajoutant « sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. »
À cet égard, la plateforme commune de revendications sur les violences faites aux femmes, présentée en janvier 2016 par douze associations féministes (dont le CNDF et le CFCV, entendus dans le cadre de la présente mission d’information), a souligné que, non plus que la médiation pénale (47), « la médiation familiale ne doit pas être utilisée pour persuader la victime de renouer les liens dans ces contextes de violences ».
Recommandation : exclure le recours à la médiation familiale en cas de violences conjugales.
Ce point conduit à aborder la question complexe, évoquée à plusieurs reprises lors des auditions menées par votre rapporteure, de l’articulation entre le civil et le pénal et de la communication entre les différents acteurs d’un dossier judiciaire ouvert pour violences conjugales ou intrafamiliales. Il est particulièrement crucial que le parquet, ait une relation institutionnelle avec le juge aux affaires familiales, le procureur recevant l’ensemble des signalements. Il est impératif de mettre en œuvre des politiques de juridiction dans ce domaine, avec un effort de communication entre les acteurs et un travail en réseau, de façon souple et réactive. Il doit y avoir des passerelles, et c’est en premier lieu au procureur qu’il appartient de veiller à l’existence de ces échanges d’information.
La lutte contre les violences physiques et psychologiques ou le harcèlement commis au sein du couple constitue en effet une priorité de politique pénale nationale, comme l’a souligné Mme Béatrice Bossard, et cette priorité doit se traduire au niveau local. Elle nécessite le renforcement d’une politique dynamique adoptée par les parquets, qui doivent veiller à utiliser l’ensemble des mesures leur permettant de traiter efficacement les procédures de violences conjugales, mais aussi de poursuivre le développement d’une politique partenariale locale et d’initier une politique de juridiction volontariste.
Les violences commises au sein du couple constituent en effet une part non négligeable des faits d’atteinte aux personnes (48). Le phénomène reste néanmoins difficile à appréhender dans la mesure où il se produit pour une grande partie dans la sphère privée et ne fait pas l’objet de dénonciations systématiques de la part des victimes ou des personnes qui en sont témoins. Les magistrats du parquet doivent en conséquence veiller à réserver à ces violences une attention particulière, comme le souligne la circulaire d’orientation de politique pénale du 25 novembre 2014 en matière de lutte contre les violences au sein des couples.
Développer une politique de juridiction afin d’améliorer le dialogue entre les acteurs judiciaires : les mesures prévues par la circualire pénale de novembre 2014
« Divers magistrats ou personnels locaux du ministère de la justice sont susceptibles de connaître des situations de violences conjugales dans le cadre de procédures dont les magistrats du parquet n’ont pas nécessairement connaissance (le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le juge de l’application des peines, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation). En outre, un danger éventuel encouru par une victime ou le risque de réitération de faits de violences dans un contexte conjugal ne sont pas toujours connus des acteurs judiciaires. Ainsi en est-il par exemple d’une mesure alternative aux poursuites décidée par un magistrat du parquet à la suite de violences commises dans un contexte conjugal qui n’aurait pas été portée à la connaissance du juge aux affaires familiales, lui-même saisi d’une procédure concernant le même couple, ou d’un juge des enfants saisi en assistance éducative.
Les décisions prises par chacun des magistrats ayant à connaître, sous des angles différents, de situations conflictuelles concernant les mêmes couples doivent pouvoir présenter entre elles une cohérence, garante d’une prise en charge judiciaire de qualité.
Il convient à cette fin de développer une véritable « politique de juridiction », associant l’ensemble des acteurs judiciaires, afin que chacun dispose en temps utile d’une information complète sur la situation de l’auteur de violences conjugales et celle de la victime, sur la configuration familiale et les éventuelles possibilités d’éviction. Il paraît par exemple souhaitable qu’un magistrat instructeur envisageant une mise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ait obtenu au préalable des éléments sur une procédure en assistance éducative éventuellement ouverte concernant la même famille afin d’adapter le contenu du contrôle judiciaire. Il lui appartiendra à l’inverse de tenir informé le juge des enfants des éventuelles mesures d’interdiction d’entrer en contact ou de paraître qu’il aura ordonnées.
La formalisation des circuits de communication de l’information entre les différents services, associant le cas échéant les intervenants sociaux au suivi de la situation, peut constituer un outil efficace et se matérialiser par exemple par la mise en place de soit-transmis type ou de fiches-navettes.
Il convient de souligner que les articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, créés par l’article 34 de la loi [du 4 août 2014], imposent à la juridiction de jugement de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsqu’elle condamne pour un crime ou délit d’atteinte volontaire à la vie, d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, de viol et agression sexuelle ou de harcèlement commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent. La mise en oeuvre de cette nouvelle disposition suppose que la juridiction soit éclairée de la manière la plus complète sur la situation familiale de la personne condamnée. »
Source : circulaire du 24 novembre 2014 d’orientation de politique pénale en matière de lutte contre les violences au sein du couple et relative au dispositif de téléassistance pour la protection des personnes en grave danger (CRIM/AP/2014/0130/C16)
En effet, la coordination des agents de l’État, favorisée par une clarification des circuits de signalement et de communication sous l’impulsion du procureur de la République, est de nature à accroître les garanties d’une réponse pénale adaptée et délivrée dans un délai raisonnable. L’association des acteurs locaux de la prévention (État, réseau associatif, etc.) à la mise en œuvre de la déclinaison locale des orientations de politique pénale favorise par ailleurs l’émergence d’une réponse sociale complétant efficacement la prise en charge judiciaire.
En tout état de cause, le développement d’une véritable « politique de juridiction », associant l’ensemble des acteurs judiciaires, est essentielle pour que chacun.e dispose en temps utile d’une information complète sur la situation de l’auteur de violences conjugales et de la victime et sur la configuration familiale.
En particulier, la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites par la loi du 4 août 2014, qui imposent à la juridiction de jugement de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsqu’elle condamne pour un crime ou délit d’atteinte volontaire à la vie, d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, de viol et agression sexuelle ou de harcèlement commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, suppose que la juridiction soit éclairée de la manière la plus complète sur la situation familiale de la personne condamnée. À cet égard, s’il n’existe pas encore de données chiffrées concernant l’application de cette mesure issue de la loi de 2014, la Délégation aux droits des femmes sera attentive à la publication ultérieure de précisions sur ce point, pour en tirer tous les enseignements utiles le cas échéant.
Recommandation : mettre en œuvre des politiques de juridictions volontaristes pour renforcer le dialogue entre les différents acteurs judiciaires, avec une clarification des circuits de signalement et de communication des faits de violence conjugales sous l’impulsion du procureur.
d. Les autres recommandations de la Délégation
Lors de l’audition de représentantes de l’association SOS Les Mamans, votre rapporteure a entendu des témoignages bouleversants sur les difficultés rencontrées dans le déroulement de procédures judiciaires. Plusieurs points ont été évoqués à cette occasion, concernant notamment l’accès aux unités médico-judiciaires (UMJ), suite à des violences sexuelles et conjugales, ainsi que les expert.e.s sollicité.e.s dans le cadre de l’instruction, conformément à l’article 156 du code de procédure pénale (49).
À cet égard, le rapport de la commission de réflexion sur l’expertise, publié en mars 2011, observait que « l’inexistence dans le système actuel de tout dispositif d’évaluation du contenu des opérations expertales rend moins efficiente la procédure de réinscription des experts », en soulignant que le juge ne dispose pas d’un outil lui permettant d’apprécier et d’évaluer la qualité des expertises. La commission préconisait dans le domaine pénal de généraliser la pratique des fiches d’évaluation des expertises, parfois mise en place mais peu répandue.
Ce rapport soulignait par ailleurs que l’éparpillement des modalités de sélection et de désignation des expert.e.s selon la nature des contentieux (civil, pénal, administratif) fragilise la fiabilité du choix de l’expert, ainsi que l’existence de carences en matière de formation (50). Y était également évoquée la question de la déontologie des expert.e.s, en dressant le constat suivant : « la dispersion des devoirs et obligations des experts dans diverses dispositions du code de procédure civile, de la loi du 29 juin 1971 et du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires rend peu lisible leur déontologie et n’assure pas la transparence nécessaire à l’égard du justiciable, notamment l’exigence de l’impartialité objective ».
Recommandation : renforcer les moyens des unités médico-judiciaires (UMJ) et faciliter l’accès pour les personnes victimes de violences en urgence.
Recommandation : améliorer la formation et l’évaluation des expert.e.s et examiner les possibilités de faciliter le recours à une seconde expertise dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Il convient par ailleurs de veiller à ce que :
– les mesure nécessaires soient prises quant à l’organisation matérielle des audiences (51) afin que les victimes soient protégées des menaces et intimidations (salles d’attentes distinctes, horaires d’arrivée et de départ décalés, position des parties face aux magistrats, etc.) ;
– la mise en œuvre effective de l’obligation faite aux policier.e.s ou aux gendarmes de prendre les plaintes pour violences, viols et agressions sexuelle, proxénétisme ou traite avec des consignes fermes afin d’éviter les refus de plainte, par une application stricte de l’article 15-3 du code procédure pénale (52) , comme l’a préconisé le collectif des associations féministes, dans ses revendications communes présentées en janvier 2016.
Enfin, au-delà des mesures susceptibles de faciliter les démarches et faire progresser les droits des victimes concernant outre l’ordonnance de protection, le dépôt de plainte ainsi que l’enquête et l’instruction, votre rapporteure rappelle que seules 14 % des femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles déclarent avoir porté plainte (53).
Il est donc essentiel de poursuivre, sans relâche, les efforts engagés en matière de prévention des violences, d’information et d’accompagnement des victimes, afin notamment de mieux faire connaître aux femmes victimes de violences les mesures de protection existantes, les structures d’accueil, etc., mais aussi libérer la parole. À cet égard, il est important que les campagnes d’information comportent des messages forts et montrent notamment les conséquences des violences sur les enfants.
Cela suppose également de rester vigilant quant aux moyens financiers alloués aux principaux acteurs et actrices dans ce domaine, en particulier le service central des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) et services déconcentrés, ainsi que les associations intervenant auprès des femmes victimes de violences.
Recommandation : poursuivre les efforts engagés en matière de prévention des violences et d’accompagnement des victimes :
– en organisant des campagnes régulières d’information sur les violences au sein des couples, en rappelant les mesures de protection existantes et les dispositifs d’accompagnement ;
– en veillant aux moyens des principaux acteurs, en particulier le service central des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) et services déconcentrés et les associations intervenant auprès des femmes victimes de violences.
Enfin, votre rapporteure formule la recommandation suivante.
Recommandation : évaluer les dispositions en matière de droit au séjour pour les femmes étrangères victimes de violences conjugales.
Les recommandations du présent rapport ne sauraient prétendre à l’exhaustivité. Les auditions menées par la Délégation aux Droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes ont révélé, bien au contraire, la nécessité de poursuivre nos réflexions sur la protection des victimes de violences conjugales et intrafamilales, et la prévention des situations d'emprise qu'elles subissent et qui peuvent les conduire à se « faire justice » elles-mêmes.
Votre rapporteure souhaite donc, à l’occasion de cette conclusion, partager les interrogations personnelles qu’ont suscitées ces auditions et qui lui paraissent nécessiter que la Délégation approfondisse ces travaux.
On ne peut qu’être frappé par le faible taux de plaintes – 14 % en cas de violences conjugales, 10 % en cas de viols – qui caractérisent les violences sexistes et s'expliquent principalement par la proximité et l'emprise que peut exercer l'auteur de ces violences sur sa victime. Dans bien des situations, comme cela semble avoir été le cas pour Jacqueline Sauvage, on ne peut ignorer que « la société savait » sans qu'elle ait pu, ou voulu, protéger ces victimes.
Ce constat conduit votre rapporteure à déplorer notre responsabilité collective face à l'escalade qui peut aboutir au meurtre de l'un ou l'autre des protagonistes, et l’interroge sur les règles applicables au signalement de ces situations. Cela pose en particulier la question du consentement de la victime à ce que des démarches soient engagées pour faire cesser la situation d’emprise.
En particulier, il semble nécessaire d'interroger les professionnels tenus au secret, tels que les médecins, de l'usage qu'ils font de l’article 226-14 du code pénal qui en délie « celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». Cette définition est-elle aujourd’hui appliquée, applicable et adaptée aux situations d'emprise et de violences conjugales qui constitueraient une incapacité psychique à consentir au signalement ?
De la même façon, il semble nécessaire d'interroger le consentement à la délivrance d'une ordonnance de protection prévu par l’article 515-10 du code civil qui précise que celle-ci « est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public » . Il paraît en effet contradictoire que le ministère public, dès lors qu'il aurait connaissance de faits susceptibles de le conduire à engager l’action publique, ne puisse demander la mise en œuvre de mesures de protections.
Consciente que des évolutions en la matière seraient susceptibles de répercussions plus larges sur l’équilibre de notre législation, votre rapporteure recommande qu'elles puissent faire l’objet d’examens approfondis dans le cadre des futurs travaux de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Enfin, votre rapporteure rappelle la nécessité de mener un travail d’évaluation sur la situation plus spécifique des femmes étrangères victimes de violence, que ces travaux n’ont pas permis d’aborder. La Délégation aux droits des femmes s’était d’ailleurs saisie de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile (54).
Le conditionnement du droit au séjour à la poursuite de la vie commune entretient pour ces femmes étrangères une situation particulière de danger et les conduit, plus encore que les nationales, à garder le silence sur les violences qu'elles subissent.
Cette situation a été identifiée par le législateur qui a prévu que « lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement » (article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile –CESEDA) et lié la compétence du préfet en cas de délivrance d'une ordonnance de protection. Il semble néanmoins que l'appréciation par l'autorité administrative d'une situation de violences conjugales, et la diversité d'interprétation sur le territoire, conduise encore un trop grand nombre de femmes à devoir faire face à une « double peine administrative » et justifie que la Délégation se saisisse de cette question.
LISTE DES RECOMMANDATIONS ADOPTÉES
1. – Encourager l’usage du terme de « féminicide » dans le vocabulaire courant et administratif.
2. – Réaliser une étude de droit comparé sur les meurtres et violences commis à raison du sexe et les dispositions normatives adoptées dans certains pays en matière de féminicide.
3. – Préciser le droit en vigueur pour mieux prendre en compte la notion d’emprise des victimes de violences, notamment des femmes victimes de violences conjugales pérennes :
– sans créer un régime de légitime défense différée, qui ouvrirait la porte à un « permis de tuer » en établissant une présomption d’irresponsabilité pénale ;
– en interrogeant la définition de la légitime défense pour que soit mieux appréciée l’absence de disproportion entre l’agression et les moyens de défense employés, compte tenu de l’existence de violences antérieures répétées, de menaces d’une particulière gravité et d’un danger de mort.
Pour étayer cette recommandation, la Délégation demande la remise, par la Chancellerie et dans les meilleurs délais, d’une étude approfondie, chiffrée et sexuée sur l’état de la jurisprudence en matière de légitime défense (nombre de cas concernant les femmes et les hommes, interprétation jurisprudentielle des critères légaux, éléments de droit comparé, etc…)
4. – Améliorer l’application de l’ordonnance de protection, en raccourcissant ses délais de délivrance, et en favorisant son usage en adressant une nouvelle circulaire ministérielle aux juges aux affaires familiales, et procéder à une étude quantitative et qualitative du recours à l’ordonnance de protection sur l’ensemble du territoire et par ressort de TGI.
5. – Exclure le recours à la médiation familiale en cas de violences conjugales.
6. – En matière de formation :
– poursuivre et amplifier l’effort de formation de tous les professionnel.le.s confronté.e.s à la problématique des violences faites aux femmes, s’agissant en particulier de la formation continue.
– publier chaque année dans les feuilles de route ministérielles pour l’égalité des statistiques détaillées sur la proportion de professionnel.le.s en exercice ayant suivi une formation sur les violences (en particulier les magistrat.e.s, policier.e.s et gendarmes) avec des objectifs chiffrés pour l’année à venir.
7. – Mettre en œuvre des politiques de juridictions volontaristes pour renforcer le dialogue entre les différents acteurs judiciaires, avec une clarification des circuits de signalement et de communication des faits de violence conjugales sous l’impulsion du procureur.
8. –Recenser les données sur les peines prononcées à l’encontre des hommes et des femmes auteur.e.s de violences et leur exécution.
9. – Créer les outils pour mieux identifier les phénomènes de correctionnalisation des crimes, s’agissant en particulier des viols, et veiller à ce que les décisions de classement de suite prononcées par les procureurs de la République fassent l’objet d’une motivation détaillée.
10. – Renforcer les moyens des unités médico-judiciaires (UMJ) et faciliter l’accès pour les personnes victimes de violences en urgence.
11. – Améliorer la formation et l’évaluation des expert.e.s et examiner les possibilités de faciliter le recours à une seconde expertise dans le cadre d’une procédure judiciaire.
12. – Poursuivre les efforts engagés en matière de prévention des violences et d’accompagnement des victimes :
– en organisant des campagnes régulières d’information sur les violences au sein des couples, en rappelant les mesures de protection existantes et les dispositifs d’accompagnement ;
– en veillant aux moyens des principaux acteurs, en particulier le service central des droits des femmes et de l’égalité, les services déconcentrés et les associations intervenant auprès des femmes victimes de violences.
13. – Évaluer les dispositions en matière de droit au séjour pour les femmes étrangères victimes de violences conjugales.
I. COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
– Audition de Mme Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), coprésidente de la commission « Violences de genre » du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), et responsable de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, de Mme Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la MIPROF, et Mme Pascale Vion, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et auteure du rapport Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses, vice-présidente de la Mutualité Française (mardi 12 janvier 2016) 52
– Audition de Mme Maryvonne Bin-Heng, présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), de Mme Dominique Guillien, vice-présidente, et de Mme Priscillia Fert, chargée de mission justice à la FNSF, de Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV), de Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), et de Mme Eléonore Stévenin-Morguet, membre du conseil d’administration de l’association Osez le féminisme (mardi 19 janvier 2016).. 65
– Audition de Mme Diane Roman, professeure de droit public à l’université François Rabelais de Tours, de Mme Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris, de M. Edouard Durand, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, secrétaire général de la première présidence, de Mme Catherine Le Magueresse, juriste et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), et de M Antoine Fabre, avocat spécialisé en droit pénal, sur les violences faites aux femmes (mardi 26 janvier 2016) 74
– Audition de Mme Béatrice Bossard, magistrate, sous-directrice de la justice pénale générale, de Mme Ombeline Mahuzier, cheffe du pôle de l’évaluation des politiques pénales, et de M. Francis Le Gunehec, magistrat, chef du bureau de la législation pénale générale, de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice (mardi 9 février 2016) 88
A. AUDITION DE RESPONSABLES DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LA PROTECTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES (MIPROF) ET DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES DU CESE
Lors de sa réunion du mardi 12 janvier 2016, sous la présidence de Mme Catherine Coutelle, la Délégation a procédé à l’audition, sur les violences faites aux femmes, de :
– Mme Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), coprésidente de la commission « Violences de genre » du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), et responsable de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, et de Mme Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la MIPROF ;
– Mme Pascale Vion, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et auteure du rapport « Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses », vice-présidente de la Mutualité Française.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Mes chers collègues, notre délégation a achevé, à la fin du mois de décembre dernier, son rapport Femmes et numérique ; à cette occasion, j’ai déposé des amendements au projet de loi pour une République numérique. Cette possibilité vous reste encore ouverte dans le cadre de l’article 88 du Règlement de l’Assemblée nationale, car le texte sera examiné demain par la commission des Lois et discuté en séance publique mardi 19 janvier. À cette occasion, la délégation ne manquera pas de faire entendre sa voix sur des sujets tels la cyberviolence, le cybersexisme et, plus largement, femmes et numérique.
J’ai souhaité entendre aujourd’hui Ernestine Ronai, accompagnée d’Élisabeth Moiron-Braud, puisque c’est sous la présente législature qu’ont été créés, par la volonté du Gouvernement, la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) ainsi que le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh). Le travail que nous menons avec le HCEfh et la MIPROF est très utile car, sans doublonner avec eux, nous reprenons certaines de vos recommandations afin de les transposer dans la loi. Nous entendrons également Pascale Vion, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du CESE.
Ernestine Ronai pourra dresser le bilan statistique des évolutions constatées dans le domaine des violences faites aux femmes, et nous dire si une amélioration est constatée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et suite au développement des campagnes d’information. Ces textes donnent-ils satisfaction ? Reste-t-il des aspects à améliorer ?
Dans ma circonscription de la Vienne, j’ai pris contact avec le commissariat de police, les centres d’accueil et d’hébergement d’urgence – centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) –, le procureur de la République – très mobilisé par le sujet, mais malheureusement frappé prochainement par les règles de mobilité – et l’unité médico-judiciaire (UMJ) en milieu hospitalier : tous ces services ont fait état d’une amélioration de la coordination et de l’action. Cependant, les UMJ sont menacées par le manque de moyens budgétaires, j’ai d’ailleurs écrit à ce sujet à Mmes les ministres de la justice et de la santé ; de fait, ces unités n’ont pas pour seul champ de compétence la médecine légale, elles savent aussi accueillir et interroger les femmes et enfants victimes de violence et constater les incapacités totales de travail (ITT).
Mme Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la MIPROF, coprésidente de la commission « Violences de genre » du HCEfh, et responsable de l’Observatoire des violences de Seine-Saint-Denis. Nous avons constitué un groupe de travail réunissant l’ensemble des organismes de statistique : l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l’Observatoire de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), l’Institut national d’études démographiques (INED) ainsi que les ministères de la justice et de l’intérieur afin d’améliorer la connaissance et d’harmoniser les données, conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 2013.
Les statistiques dont nous disposons montrent une certaine stabilité, notamment dans les enquêtes portant sur les déclarations de faits de violences réalisées par l’INSEE ; promulguée il y a un peu plus d’un an seulement, la loi ne produit probablement pas encore tous ses effets. En revanche, les campagnes d’information menées par le Gouvernement se traduisent par la multiplication des appels au numéro vert 3919 : leur nombre est passé de 24 596 en 2013 à 38 972 en 2014. L’élargissement de la plage horaire d’appel a, elle aussi, concouru à cette augmentation.
Un bémol doit être placé au sujet des statistiques du ministère de la justice, car elles ne concernent que les agresseurs et jamais les victimes ; le logiciel est ainsi conçu, reflétant peut-être la pensée du ministère, ce qui est cause d’une moindre connaissance statistique des victimes de violences. Le taux de femmes portant plainte en cas de violence dans le couple s’élève à 16 %, soit une légère augmentation. Dans les cas de viol, ce taux est de 10 % seulement, alors que le nombre des condamnations prononcées à ce titre est en diminution, ce qui peut être dû à leur requalification en agression sexuelle. L’enquête de l’INSEE « Cadre de vie et sécurité » (CVS) montre que, depuis 2013, le nombre des déclarations de viols oscille entre 83 000 et 86 000 selon les années et que 821 hommes et douze femmes ont été condamnés pour viol. Le rapport est donc de 1 %, la marge de progrès demeure importante, et j’imagine que c’est pour cela que vous avez demandé à la commission « violences de genre » du HCEfh d’améliorer la définition du viol : nous vous remettrons bientôt notre avis sur ce sujet, ainsi qu’à Mmes Marisol Touraine et Pascale Boistard.
La loi a considérablement amélioré le dispositif de l’ordonnance de protection (OP) en raccourcissant les délais, mais de grandes disparités sont constatées selon les départements. Pour la convocation au débat contradictoire, ce délai est de quinze jours si « monsieur » l’apprend par lettre recommandée ; en Seine-Saint-Denis, l’intéressé est convoqué systématiquement par huissier, et le délai est alors d’une semaine ; enfin la voie administrative est la plus rapide puisque la force publique se rend au domicile de l’individu, mais cette disposition est exceptionnelle. La question des délais demeure une préoccupation, même en Seine-Saint-Denis, du fait du manque de magistrats, qui sont, dans ce département, au nombre de neuf pour les affaires familiales sur un effectif théorique de treize, de sorte que le délai moyen est passé de quatorze à vingt et un jours.
La prolongation de l’ordonnance de protection à six mois reconductibles est une très bonne nouvelle, de même que l’information du procureur au cas où les violences mettraient en cause la sécurité des enfants. Au demeurant, nous savons que, dans ces situations, les enfants sont toujours en danger, puisqu’ils sont covictimes du fait que maman se fait insulter, même si papa retient ses coups devant eux ; et je ne parle pas des violences sexuelles. Il y a donc quelque chose à repenser en la matière.
L’ordonnance de protection vise à parer au danger auquel sont exposées les victimes. Dans ce domaine, la France a progressé : nous sommes passés de la puissance maritale à l’égalité entre partenaires ; le fait d’être mari, partenaire ou compagnon est devenu une circonstance aggravante en cas de meurtre, enfin, la protection par l’éloignement – l’éviction du logement – du conjoint violent constitue une garantie de sécurité. La loi du 4 août 2014 est révolutionnaire – le mot n’est pas trop fort – car elle permet de protéger la femme avant la commission de nouveaux faits de violence ; en tant que législateur, vous avez eu là un coup de génie. Nous n’en avons pas fini avec la question de la dangerosité, dont le paroxysme est la mort de la femme ou des enfants, nombreux à être victimes de la violence dans le couple : plus d’enfants que d’hommes sont tués dans ce contexte.
L’ordonnance de protection constitue donc un outil très complet, mais insuffisamment utilisé et encore mal compris. Lors de l’élaboration de la loi, vous avez compris qu’une femme qui est sous l’emprise de son bourreau, qui a peur de lui, a encore plus peur de porter plainte, car elle redoute les conséquences ; vous l’avez d’ailleurs dit dans votre communiqué de presse relatif au procès de Mme Sauvage.
L’ordonnance de protection permet de demander une protection avant la plainte, mais, trop souvent, les magistrats exigent un dépôt de plainte comme élément de vraisemblance du danger. Certes, le magistrat n’est pas Madame Soleil, et a besoin de preuves ; c’est pourquoi la MIPROF a travaillé avec les ordres des médecins et des sages-femmes à l’amélioration des certificats médicaux. Nous avons aussi fait en sorte que tout travailleur social ou toute personne habilitée rencontrant la femme victime de violences puisse établir une attestation permettant au juge de considérer, en l’absence de preuves proprement dites, qu’il existe – je cite la loi de 2010 – « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants, sont exposés ». Cette rédaction est excellente, mais on continue malheureusement d’exiger des preuves de la vraisemblance, ce qui est absurde : ce qui importe ce sont les éléments de la vraisemblance, ce qui est très différent.
Mme la présidente Catherine Coutelle. À plusieurs reprises, nous avons tenté d’améliorer le dispositif de l’ordonnance de protection, mais, à ma connaissance, aucun magistrat ne prend une telle mesure s’il n’y a pas dépôt de plainte. Toutefois, l’éventuel retrait de la plainte ne suspend pas l’action de la justice.
Mme Ernestine Ronai. C’est vrai en beaucoup d’endroits, pas en Seine-Saint-Denis ; un travail devrait être conduit avec la ministre de la justice afin que les magistrats soient mieux informés de ces dispositions, car la situation locale est curieuse.
Mme la présidente Catherine Coutelle. La loi de 2010 relève à la fois du droit civil et du droit pénal, ce qui fait que c’est le juge aux affaires familiales qui prononce l’ordonnance de protection et que, par conséquent, le système de la médiation n’est pas totalement abandonné.
Mme Ernestine Ronai. La loi prévoit que le procureur demande de manière systématique à la femme si elle souhaite demeurer dans son logement – c’est la procédure d’éviction – et peut également préciser les modalités de prise en charge des frais afférents au logement. Le fait que cette mesure, d’ordre civil, relève du procureur, dont le rôle est, par définition, pénal, explique qu’elle soit si peu appliquée ; il faudrait pourtant qu’elle le soit, car le départ du conjoint risque d’entraîner une baisse dramatique de revenu de la mère. Les magistrats doivent se pénétrer de cette logique de protection et mieux articuler, dans cette perspective, droit civil et droit pénal.
La loi du 4 août 2014 prévoit qu’il peut être recouru à la procédure de médiation à la demande de la dame, mais le texte est encore trop souvent compris dans le sens de la rédaction de 2010, qui mentionne simplement l’« accord » de cette dernière, ce qui vaut à la médiation de perdurer dans bien des départements alors qu’elle a disparu dans d’autres. Dans ce contexte, la protection de l’enfance demeure un sujet à part entière ; nous avons fait sortir la médiation par la porte, elle reviendra par la fenêtre avec la médiation familiale. Pas plus que la médiation pénale, la médiation familiale n’est adaptée aux cas de violences, à la différence des situations ordinaires de conflit. Qu’elle soit considérée sous l’angle civil ou l’angle pénal, la violence ne met pas les deux interlocuteurs sur un pied d’égalité, car il y a un dominant et un dominé : la médiation ne peut pas fonctionner dans ces conditions, et je me permets d’appeler l’attention du législateur sur ce point.
Vous avez décidé que le magistrat devait se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsque « monsieur » était condamné pour un délit ou un crime. L’application de cette mesure demeure imparfaite : même dans le pire des cas, lorsque « monsieur » a tué « madame », le retrait de l’autorité parentale n’est toujours pas systématique. Je suggère donc que la loi prévoie la suspension systématique lorsque l’un des deux parents a tué ou tenté de tuer l’autre, sauf circonstances particulières. Aujourd’hui, même si « monsieur » est en prison, il a encore le droit de décider si l’enfant peut pratiquer l’équitation, partir en colonie de vacances ou fréquenter le centre aéré : c’est aberrant !
Enfin, le dispositif du téléphone portable d’alerte pour femmes en grand danger (TGD) fonctionne, il fait la preuve de son efficacité.
Mme la présidente Catherine Coutelle. J’ai entendu dire, à l’occasion d’une présentation à la presse, que les magistrats opposaient des conditions drastiques à leur mise à disposition. Savez-vous si le fait que le conjoint violent ait été condamné est l’une de ces conditions ?
Mme Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la MIPROF. La loi mentionne la notion de danger « grave ». Au départ, au stade de l’expérimentation, nous avions obtenu la référence à un « grand danger », mais le Conseil d’État a imposé la rédaction actuelle. Or, comme on le constate dans le domaine de l’ordonnance de protection, la notion de gravité est difficile à apprécier pour un magistrat. Il est vrai qu’il n’y a pas de définition précise du danger « grave » et que tout dépend des politiques pénales mises en œuvre par les parquets, ce qui laisse place à une large diversité d’interprétations.
Mme Ernestine Ronai. Plus que la condamnation, ce qui importe est l’interdiction de contact entre « monsieur » et « madame », qui peut relever du droit pénal lorsque la victime a porté plainte, ou du droit civil par le truchement de l’ordonnance de protection. En Seine-Saint-Denis, un tiers des téléphones d’alerte sont accordés à l’occasion du prononcé d’une ordonnance de protection lorsque « monsieur » va sortir de prison alors qu’il est susceptible de récidives violentes. Il s’agit là d’une procédure de protection devant le danger maximum ; la faiblesse du nombre de téléphones accordés n’est pas préoccupante pour le moment, car la culture du danger et de son repérage s’acquiert petit à petit. Le parquetier, le juge aux affaires familiales, les juges d’application des peines, les services et les associations peuvent repérer le « grand dangereux ». En Seine-Saint-Denis, nous avons commencé avec vingt téléphones, nous en sommes à quarante aujourd’hui ; à Paris, ce nombre est passé de dix à vingt.
Toutes les femmes victimes de violences sont en danger, et plus je progresse dans mes travaux – je m’occupe depuis plus de treize ans de la Seine-Saint-Denis – plus je prends conscience de la question du danger et de la difficulté de son évaluation. On aurait tort de penser qu’une gifle, un coup asséné sous l’emprise de l’alcool sont des gestes sans gravité ; la connaissance de la situation de danger permet d’adopter une politique pénale adaptée et, dans le domaine du droit civil, la politique de protection est importante.
La MIPROF a reçu des ministres la mission de développer une culture commune dans le cadre de la formation de l’ensemble des professionnels au contact de femmes victimes de violences. Cinq kits de formation ont été conçus.
Le premier, « Anna », conçu au départ pour les médecins, est aujourd’hui utilisé par tous, et traite du mécanisme de la violence : emprise, repérage par le questionnement systématique, prise en charge et orientation. Le deuxième, « Élisa », plus particulièrement destiné aux sages-femmes, concerne l’impact des violences sexuelles sur les femmes, ainsi que, dans un deuxième temps, celui du questionnement systématique des victimes : « la question m’a été posée, il a été possible de parler des violences subies dans l’enfance, et du coup, dit la dame, ma vie a été changée ». Le kit « Tom et Léna », consacré aux violences exercées sur les enfants, est axé sur la prise de conscience du mal que la violence fait aux enfants et du secours que peuvent leur apporter professionnels qui aident la mère à se protéger. Le quatrième kit, « Protection sur ordonnance », qui s’adresse aux avocats et aux juristes, informe sur l’ordonnance de protection, sur l’évaluation du danger auquel sont exposées les victimes ainsi que sur leur accompagnement. Le dernier, « Harcèlement sexiste et sexuel », élaboré avec le concours du ministère de la défense, est destiné aux militaires du rang. Tous ces kits se composent d’un court-métrage et d’un livret destiné à l’ensemble des professionnels : gendarmes, magistrats, avocats, médecin, sages-femmes, etc.
Un groupe de travail a été installé, dont l’objet est la formation des professionnels au contact des femmes en situation de handicap : la situation est complexe, car il n’existe aujourd’hui aucune formation ni action de sensibilisation à la question du handicap dans ce contexte. Une enquête est en cours en Seine-Saint-Denis sur le viol et les agressions sexuelles : 10 % de femmes et d’hommes handicapés ont été victimes de viols, les hommes concernés ayant été violés par d’autres hommes.
Vous m’avez interrogée au sujet de l’appréciation que je porte sur l’action du Gouvernement et en particulier les priorités définies pour 2016 en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. La campagne contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports a été une grande réussite. Bien diffusée, elle a fait comprendre ce qu’est une agression Le cas de Mme Sauvage montre que les violences sexuelles conjugales constituent un psychotrauma extrême, aboutissant au meurtre : la gratuité des soins de psychologie ainsi que le développement des consultations post-psychotrauma constitueraient un progrès considérable. Cela a certes un coût, mais qui sera toujours inférieur aux 3,5 milliards d’euros que coûte l’inaction.
sexuelle : la main aux fesses, la main aux seins, l’homme qui se frotte… Elle a eu un retentissement certain sur les femmes elles-mêmes, leur permettant de prendre conscience des agressions dont elles peuvent être victimes.
Parmi les cinq priorités fixées pour 2016 figure aussi l’amélioration de la prise en charge des victimes par le système de santé. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a demandé aux agences régionales de santé (ARS) de prévoir la désignation d’un référent violence dans les services d’urgences ; nous allons préparer un kit d’information à l’intention des urgentistes ainsi que pour ces référents. Il s’agit d’une très bonne mesure et le procès de Jacqueline Sauvage a montré que si ces personnels avaient été formés, celle-ci aurait pu être aidée avant le drame.
Une autre piste d’amélioration concerne les UMJ, avec la question du recours en amont du dépôt de plainte, c’est-à-dire sans réquisition, particulièrement pour les violences sexuelles : « Je suis victime de viol, je suis à bout, je me rends aux urgences médico-judiciaires. » Tous les prélèvements sont réalisés et les preuves conservées ; pendant trois ans, la victime peut porter plainte. Cela constituerait une réelle amélioration de l’administration de la preuve en tant qu’élément de témoignage, car si l’on retrouve sur « madame » l’ADN de « monsieur », la réalité du rapport sexuel et l’identité du violeur seront indiscutables.
Il faut améliorer la prise en compte des conséquences de la violence sur les enfants, en généralisant la mesure d’accompagnement protégé, actuellement expérimentée en Seine-Saint-Denis, bientôt à Paris et, je l’espère, dans d’autres départements par la suite. La loi du 9 juillet 2010 prévoyait déjà cette mesure : une association, dite « tierce personne morale qualifiée », accompagne les enfants à partir du lieu de résidence de la mère vers le lieu de visite du père afin d’éviter que « monsieur » agresse à nouveau « madame ». Efficace, ce dispositif aide les juges aux affaires familiales à prendre en compte la violence ainsi que le fait que les enfants sont covictimes de celle-ci. Je souhaite que ce terme de « covictimes » prenne la place du mot « témoins », qui laisse entendre que les enfants seraient des spectateurs impassibles : si la maman est victime, les enfants le sont aussi. Il y a un agresseur, mais plusieurs victimes.
À l’occasion de décisions de divorce ou de séparation, il faut encourager les femmes victimes de violences conjugales à user de la possibilité de demander l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Ce droit est d’autant plus légitime lorsqu’il a été interdit à « monsieur » d’entrer en contact avec « madame » ; dans ce contexte, il est absurde qu’un père placé sous le coup de cette interdiction doive être consulté afin d’autoriser une colonie de vacances pour les enfants. Une évolution législative serait bienvenue sur ce point.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Mme Moiron-Braud souhaite peut-être ajouter des éléments à ce bilan, et Mme Vion, qui a rendu en novembre 2014, en qualité de rapporteure du CESE, le rapport Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses, pourra évoquer des sujets que nous n’aurions pas encore abordés.
Enfin, je voudrais que nous puissions débattre de la question du « féminicide ». Notre réflexion pourrait aussi porter sur un fait d’actualité que nous avons toutes vécu très douloureusement : le cas de Jacqueline Sauvage, qui, pour nous, relève moralement de la légitime défense, en pleine contradiction avec les dispositions légales en vigueur. Il nous revient d’agir afin de faire en sorte que, dans de telles situations, la victime ne soit pas deux fois victime.
Mme Élisabeth Moiron-Braud. Dans le droit fil de l’exposé d’Ernestine Ronai, j’apporterai quelques précisions, mais aussi, quelques bémols. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 – texte dont j’avais suivi l'élaboration, étant alors en poste au ministère de la justice – , on constate une nette amélioration en ce qui concerne le prononcé des ordonnances de protection.
Dans le cadre du Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV), j’avais rédigé un rapport relatif à la première mise en œuvre de l’ordonnance de protection. Vous l’avez rappelé, celle-ci a été très longue et laborieuse, car les juges civils – je le dis d’autant plus volontiers que je suis moi-même magistrate – peinent à appliquer des mesures coercitives portant atteinte à la liberté d’aller et venir, telle l’interdiction pour l’auteur des faits d’entrer en contact avec la victime.
Ainsi, après une période de doute, nous constatons que les choses vont beaucoup mieux puisque, en 2011, 1 662 ordonnances de protection ont été prononcées, et que, en 2014, ce chiffre s’est élevé à 2 589. Cela constitue un progrès, car l’étude que j’avais menée dans le cadre du CNAV montrait que les magistrats déclaraient n’être pas saisis ; or, en matière de procédure civile, cette saisine est indispensable puisque, dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’une des parties au moins doit agir. Cette absence de saisine procédait surtout d’un manque de formation, car le sujet n’était jamais abordé.
Une amélioration du taux de réponses pénales est aussi constatée : il est passé de 85 % en 2011 à plus de 87 % en 2014, ce qui signifie a contrario une baisse du nombre des classements sans suite, pratique trop longtemps courante.
En revanche, les alternatives aux poursuites et, singulièrement, la médiation, représentent encore 50 % de la réponse pénale ; par ailleurs, il est toujours régulièrement recouru à la composition pénale, qui est proche d’une peine.
La possibilité ouverte au juge de prononcer l’éviction, c’est-à-dire de décider que le domicile du couple reviendra à la femme, mais en se prononçant sur les charges y afférentes, est caractéristique des mesures ressortissant à la fois au droit civil et au droit pénal. Je me suis rapprochée du directeur des affaires criminelles et des grâces, car la MIPROF aurait souhaité qu’une circulaire du ministre de la justice soit adressée aux procureurs de la République et aux procureurs généraux des cours d’appel afin de les inciter à recourir à cette procédure, insuffisamment utilisée. La prochaine circulaire de procédure pénale annuelle comportera un chapitre important consacré aux victimes, nous espérons qu’il comprendra des éléments de pédagogie propres à encourager les procureurs à faire usage de ces procédures nouvelles.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Pascale Vion, dans votre rapport de 2014, vous avez été pionnière en insistant sur le sujet, à l’époque peu traité, des violences exercées dans l’espace public.
Mme Pascale Vion, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil économique, social et environnemental (CESE). La présentation du rapport présenté au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité du CESE a eu lieu au mois de novembre 2014 afin de la faire coïncider avec le 25 novembre, journée internationale de l’élimination de la violence contre les femmes. C’était la première fois que le CESE se saisissait de ce sujet, il importait de mettre en lumière l’ampleur du phénomène, autant en termes de typologie de violences qu’en termes quantitatifs. Nos sources statistiques proviennent de la MIPROF, un chiffre nous a cependant frappés puisque 83 %, à l’époque – 86 % aujourd’hui – des femmes violées connaissent leur agresseur ; l’image du violeur inconnu fait ainsi partie des idées reçues qu’il convient de dissiper.
Nous avons souhaité envisager les violences dans tous leurs aspects : les violences conjugales et les viols sont régulièrement évoqués ainsi que, dans une moindre mesure, la prostitution, mais pas les autres violences faites aux femmes. La connaissance du harcèlement dans l’espace public a progressé avec l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), réalisée en 2000 et qui était une première ; elle a aussi démontré la réalité du viol conjugal. Par ailleurs, une vidéo réalisée par une femme belge permettait d’entendre tous les propos déplacés susceptibles d’être adressés quotidiennement à une femme dans la banalité d’un jour ordinaire. Ces propos sont répétitifs et adressés, pour 20 % à 25 %, à de jeunes femmes, voire à des adolescentes ou préadolescentes ; ces situations de harcèlement dans les transports en commun perturbent durablement les plus jeunes d’entre elles. À cet égard, la campagne réalisée en France actuellement présente le plus grand intérêt.
L’évidence nous est apparue que les violences nous concernent tous, car chacun connaît une femme victime de violences, quand il ne s’agit pas de soi-même : une des clés du problème est la prise de conscience d’être ou d’avoir été placé dans une telle situation. La banalisation du sexisme concourt largement à cette méconnaissance ; même les femmes tendent à considérer qu’il s’agit là d’une fatalité ordinaire à laquelle elles sont confrontées depuis l’enfance, dès l’école.
En termes de typologie, les mutilations sexuelles féminines ne sont pas à négliger, bien que la France ait été précurseur : la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes réprime en effet ces pratiques. La polygamie, les mariages forcés, l’esclavage constituent autant de formes de violences inacceptables. Le plus grand silence règne au sujet de l’esclavage alors qu’il est bien plus répandu en France qu’on ne l’imagine, les chiffres publiés sont très en dessous de la réalité. Ce phénomène peut concerner tous les milieux sociaux, il ne se cantonne pas aux ambassades : les cas sont nombreux à La Courneuve, par exemple.
Nous avons encore étudié les violences exercées dans le cadre du travail. Il y a eu des avancées dans ce domaine sur le plan législatif, et avec la loi du 4 août 2014 concernant les violences. Les lois existent, mais la question qui demeure est celle de leur application, avec des carences dans la mise en œuvre de certaines dispositions. Nous avons par ailleurs souligné la nécessité de protéger les enfants et soulevé la question de l’ordonnance de protection.
Les travaux que nous avons menés au sujet du harcèlement à l’école nous ont conduits à nous pencher sur la cyberviolence, au sujet de laquelle nous avons interrogé M. Éric Debarbieux, délégué ministériel chargé de la prévention de la lutte contre les violences en milieu scolaire, qui a indiqué qu’à l’époque, 18 % des jeunes étaient victimes de cette forme de violence. La cyberviolence ne s’exerce pas par le seul biais des réseaux sociaux : le SMS constitue également un vecteur important. Elle concerne aussi les milieux professionnels et ne peut qu’être appelée à connaître une grande amplification. S’agissant des jeunes, l’information des parents constitue un enjeu majeur, car beaucoup d’entre eux ignorent que leurs enfants sont susceptibles de faire l’objet de cyberviolences.
Nous sommes parvenus à la conclusion qu’il est indispensable que l’ensemble de la société se saisisse du sujet, que les violences doivent êtres sorties de la sphère privée ou individuelle, qu’il s’agisse des violences dans la rue, des violences conjugales, exercées au travail ou dans la sphère familiale. Il faut mettre un terme à la banalisation ; nombre d’entre vous connaissent le discours adressé aux femmes dans les années soixante, érigeant en modèle l’image de la femme soumise et gentille, qui, même fatiguée par sa journée, devait malgré tout être « sexy » et disponible pour son mari et ses enfants. Pour beaucoup, ce schéma est toujours d’actualité : la question de la violence est celle de la domination du mâle sur la femelle qui remonte à la nuit des temps. Ces conceptions ont 250 000 ans d’âge et reposent en grande partie sur une angoisse masculine archaïque, puisque seule la femme dispose du pouvoir d’enfanter, tandis que l’homme ne peut jamais être sûr d’être le père. Ce doute relatif à la paternité a conduit à l’adoption de diverses stratégies de claustration de la femme.
Bien des progrès demeurent à réaliser dans le domaine de la protection infantile, un enfant voyant sa mère maltraitée est bien plus traumatisé que s’il est lui-même victime de violences. Que serait une société qui ne saurait pas protéger ses enfants ? C’est là une priorité : il s’agit de prévention, car on assiste à un phénomène de continuum, les femmes qui ont été victimes dans leur enfance ou leur adolescence reproduisent souvent ce schéma et, à l’âge adulte, sont victimes de violences dans leur couple. C’est pour cela que la prise en charge psychologique est primordiale, et, quel que soit le type de violence ou le type de victime, la stratégie de l’agresseur demeure la même, il s’agit d’instaurer une situation d’emprise et de domination.
Si besoin en était, cela démontre le rôle éminent du triptyque : sensibiliser, informer et former. Tout le monde doit être informé, particulièrement les professionnels, de ce que sont les violences et des comportements qu’elles induisent chez les femmes qui adoptent – phénomène observable partout dans le monde – des stratégies d’évitement : ne pas sortir au-delà d’une certaine heure, ne pas emprunter les transports en commun, etc.
Il faut rendre aux victimes leur place de victime. À cet égard, la formation des divers intervenants est capitale : cessons de penser que, lorsqu’une femme se plaint de violences, elle agit dans le seul but d’extorquer de l’argent à son mari ! Les affabulatrices sont très peu nombreuses : moins de 1 %.
La situation dans les territoires ultramarins est alarmante. Les violences y sont beaucoup plus graves qu’en métropole, et sont souvent exacerbées par l’insularité, la précarité économique et l’alcoolisme. Par ailleurs, tout est fait pour que les filles ne fréquentent pas longtemps l’école. Ces territoires ont manifesté le plus grand intérêt pour notre étude tant les manques y sont nombreux : la Guyane n’avait plus de délégué aux droits des femmes depuis des années, et ceux qui sont en poste ne disposent que de très faibles moyens. Le CESE va conduire une étude sur les violences faites aux femmes dans les territoires ultramarins, pour laquelle il espère obtenir une saisine gouvernementale ; il est actuellement en négociation avec le secrétariat d’État chargé des Droits des femmes et le ministère des Outre-mer à ce sujet. Cette étude sera menée conjointement par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité et la Délégation à l’outre-mer du CESE ; une des rapporteures pressenties est Sarah Mouhoussoune, originaire de Mayotte.
Mme Maina Sage. Les statistiques mettent en évidence la distance astronomique séparant l’outre-mer de la métropole, et ont permis d’alerter les territoires concernés, dont la Polynésie française dont je suis l’élue. Cependant, les données gagneraient à être affinées et les méthodes adaptées aux codes ultramarins.
On constate que l’habitude a été prise de renvoyer à la médiation avant le dépôt de la plainte, particulièrement à la médiation familiale ; or les résultats ne sont pas satisfaisants. Que préconisez-vous ?
L’année dernière, mon groupe avait déposé une proposition de loi tendant à allonger de dix ans le délai de prescription des agressions sexuelles – qui, à mes yeux, devraient même être imprescriptibles. J’aimerais connaître votre avis sur ce sujet.
Un trop grand nombre de victimes redoute de porter plainte : conduisez-vous une réflexion sur le rôle que devrait alors jouer l’entourage de la victime ? De fait, outre la pression exercée sur la victime par l’agresseur, j’ai pu constater que c’est souvent l’entourage lui-même qui dissuade cette dernière de passer à l’action en portant plainte.
Mme la présidente Catherine Coutelle. À l’occasion d’une mission qui nous a conduites à Mayotte, il nous a été donné de constater qu’il n’est pas d’usage de porter plainte contre sa famille. La notion de parenté étant très large dans cette région, les dépôts de plainte, même pour fait de viol, sont quasi inexistants.
Mme Monique Orphé. De façon très pertinente, Ernestine Ronai a souligné que les victimes de violences sont en danger, de façon potentielle toutefois, car le passage à l’acte n’est pas la règle. À La Réunion, nous vivons un nouveau drame puisqu’une jeune fille a été assassinée à Villeurbanne : cent coups de couteau et divers coups lui ont été assénés. L’assassin, son compagnon, l’avait déjà frappée six mois auparavant et, par la suite, avait présenté des excuses. Le couple s’était alors reformé. Ces jeunes gens avaient respectivement 23 et 24 ans au moment de la commission des faits. Je m’interroge sur l’information apportée aux populations : une campagne est en cours, mais qu’est-il fait à l’intention des jeunes qui n’ont que rarement conscience que la plainte doit être déposée dès le premier coup ? En l’occurrence, la jeune femme s’en était abstenue afin d’épargner ses parents. Je n’ai pas vu cette campagne d’information à La Réunion ; une fois de plus, je me vois contrainte à réclamer une égalité de traitement de tous les territoires.
Le traitement des auteurs de violences n’a pas été évoqué. La loi prévoit pourtant un stage de responsabilisation. Le jeune assassin, dans le cas que je viens de citer, pensait « corriger » légitimement sa compagne insoumise ; une consultation psychologique aurait probablement mis en évidence un certain déphasage chez l’intéressé.
Le chiffre de 2 500 ordonnances de protection prononcées sur l’ensemble du territoire paraît faible. Je m’interroge, en outre, au sujet de la répartition par départements, car il me semble que beaucoup de femmes sont en attente d’un jugement.
Le retrait total et systématique de l’autorité parentale serait, à mes yeux, une bonne chose : l’enfant a besoin d’être protégé, quitte à reconsidérer plus tard la question ; hélas, je n’ai pas eu gain de cause au moment du débat. Je persiste à penser que l’enfant doit bénéficier du statut de victime.
Au sujet de l’égalité entre les hommes et les femmes, il me semble que du chemin reste à parcourir, singulièrement dans le domaine des images sexistes véhiculées par la publicité : j’ai encore vu récemment des produits de consommation courante distingués par le rose et le bleu.
Enfin, nous souhaiterions que l’équivalent de l’enquête « Violences et rapports de genre » (VIRAGE) de l’INED puisse être conduit dans tous les territoires de la République. Je reconnais toutefois que cela a été engagé à La Réunion.
Mme Édith Gueugneau. Dans le cadre du plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016, nous avons créé un réseau « violences intrafamiliales » (VIF) dans ma commune, Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire ; le maillage territorial progresse malgré le manque persistant de moyens. Je souhaiterais demander à Ernestine Ronai quelle appréciation elle porte sur ces outils et quelle politique de développement national les pouvoirs publics comptent mener, particulièrement en termes budgétaires. Les besoins concernent surtout la mise à disposition de professionnels formés et en nombre suffisant.
Le harcèlement moral constitue à mes yeux une violence, en cas de séparation, il faudrait que les tribunaux disposent de moyens propres à accélérer les procédures, car les délais prolongés portent préjudice à la mère comme aux enfants. Le juge familial croule sous les dossiers et, si l’entourage de la femme n’est pas là pour la soutenir, elle se trouve obligée de retourner au domicile conjugal, et l’enfant est alors en grand danger. L’ordonnance de protection doit donc être appliquée rapidement.
Mme Maud Olivier. L’affaire de Jacqueline Sauvage prouve qu’il y a urgence à agir, vous semble-t-il nécessaire de modifier dans la loi la notion de légitime défense et, le cas échéant, de quelle façon ? Car il ne s’agit bien évidemment pas de donner un droit à tuer.
Par ailleurs, le sexisme, comme le féminicide, devrait être traité comme le racisme : on sait que c’est parce qu’elles sont des femmes qu’elles subissent de tels traitements, et la question excède le seul cadre familial, mais concerne l’ensemble de la société. Une action spécifique doit être conduite si l’on veut changer le regard porté par les hommes sur les femmes et mettre fin à la domination masculine.
La France doit être exemplaire à cet égard, car le monde entier nous regarde, je pense particulièrement à la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, qui doit être débattue en nouvelle lecture le 3 février à l’Assemblée nationale et le 18 février au Sénat. (Applaudissements.) L’actualité la plus récente – je pense particulièrement à ce que DAECH donne à voir – montre que, partout dans le monde, la femme est traitée comme une marchandise : la législation française doit donc montrer la voie.
Mme Ernestine Ronai. L’affaire Jacqueline Sauvage a démontré que les magistrats ignoraient les mécanismes de la violence et méconnaissaient le psychotrauma, de même qu’ils négligent les phénomènes d’emprise. Ma première proposition est de rendre obligatoire la formation de l’ensemble des magistrats sur les violences faites aux femmes : cela existe en formation initiale, mais pas en formation continue. Celle-ci doit devenir systématique au moins pour les juges aux affaires familiales, les juges des enfants, les juges correctionnels et les juges d’application des peines. Les outils existent : la MIPROF a publié des fiches « réflexes » à cet effet.
Les questions qui ont été posées à Mme Sauvage sont caractéristiques de cette situation : « pourquoi n’êtes-vous pas partie ? », « pourquoi n’avez-vous pas porté plainte ? » Jacqueline Sauvage avait fait une tentative de suicide – ce qui est caractéristique du psychotrauma – mais cela n’a pas été porté au dossier. La question de la formation des médecins est aussi posée, car l’intéressée s’était rendue au service des urgences à quatre reprises : un dispositif permettant de regrouper ces passages aurait permis de détecter une situation critique, ce qui est le minimum exigible.
Par ailleurs, une voisine avait déposé une plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite, ce qui conforte les propos de Monique Orphé au sujet des campagnes de sensibilisation. Une répression plus ferme encouragera les femmes aux prises avec la peur à engager des actions en justice. Tout le monde a dit que le mari de Jacqueline Sauvage était un monstre : la sœur l’a dit ; la fille, violée, a fugué, a été rattrapée par les gendarmes, a fait une déposition pour viol, le père est arrivé en criant – effrayant tout le monde, car la violence a pour effet de tétaniser – de sorte que la fille s’est rendue dans les toilettes de la gendarmerie pour y déchirer sa déposition et qu’il n’y a pas eu de suites. Les étapes de cette histoire ont été autant d’occasions manquées de secourir cette femme, et dans l’état du droit actuel, aux assises, Jacqueline Sauvage aurait pu être condamnée à un an de prison avec sursis et sortir libre.
Elle aurait même pu comparaître libre, car, en fin de compte, elle a tué le seul homme qu’elle aura jamais tué de sa vie, à savoir son tortionnaire. On constate que, la problématique de la légitime défense stricto sensu étant écartée, la justice, comme souvent, n’a pas fonctionné, et n’a fait, au contraire, qu’enfoncer cette femme.
En Seine-Saint-Denis, depuis 2008, le procureur Patrick Poiret et moi-même appelions féminicide l’assassinat d’une femme. Je milite pour que, dans le vocabulaire judiciaire, le terme féminicide soit utilisé pour le meurtre d’une femme, comme celui d’homicide lorsqu’il s’agit d’un homme.
Pour autant, je ne pense pas que le fait que la victime du meurtre soit une femme doive constituer une circonstance aggravante, car toute forme de violence, qu'elle soit fatale ou non, qu’elle porte sur une femme ou sur un homme, constitue un acte d’une égale gravité. Le féminicide a été considéré comme circonstance aggravante au Mexique, où près de 4 000 femmes ont trouvé la mort dans les maquiladoras. Je ne suis pas partisane d’aller jusque-là en France : nous avons déjà des hommes qui se juchent sur des grues pour faire entendre leur cause…
Je plaide la prudence en faveur de la présomption de légitime défense ou l’amélioration des conditions de la légitime défense, car le climat politique actuel me paraît peu propice.
Avec Élisabeth Moiron-Braud, nous avons consulté le blog de Catherine Le Magueresse, ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), et qui est une remarquable juriste ; je ne saurais trop vous recommander de l’entendre au sujet du droit international.
Mme la présidente Catherine Coutelle. On nous oppose que « féminicide » n’est pas le féminin d’« homicide » ; j’ai entendu que les juristes considèrent qu’il faudra prouver que la femme a été tuée parce que femme. De vrais massacres de femmes ont eu lieu en nombre en Amérique latine parce que celles-ci étaient femmes ; cela s’est aussi produit au Canada.
Mme Maud Olivier. Des femmes sont mortes dans les attentats récents, sans pour autant que cela constitue un féminicide. Il faut caractériser tous les actes de violence sexiste commis envers les femmes parce qu’elles sont des femmes ; ce ne sera pas bien difficile. La chose est plus aisée à établir lorsqu’il s’agit de meurtre de groupe, mais les situations décrites par nos collègues ultramarines mettent bien en évidence un traitement particulier réservé aux femmes, souvent considérées comme de la marchandise.
Mme Élisabeth Moiron-Braud. La caractérisation du féminicide constitue un écueil juridique, Maud Olivier a évoqué les violences sexistes, c’est un débat que nous avons souvent eu au ministère de la justice au sujet de l’article 225-1 du code pénal qui vise toutes les formes de discrimination. Si ces formes de discrimination devenaient elles-mêmes des circonstances aggravantes, cela éviterait la focalisation sur le féminicide ; il s’agirait alors d’établir une discrimination en fonction du sexe, ce qui est plus facile à prouver. Et il n’y aura pas d’hommes investissant les grues, comme le mentionnait Ernestine Ronai, puisqu’il s’agira autant d’un homme tué parce qu’homme, que d’une femme tuée parce que femme. Il me semble que cette possibilité a été étudiée dans le cadre de la future réforme du code pénal ; ce serait à vérifier.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Il nous faut trouver un véhicule législatif, l’expérience montre que le parcours d’une proposition de loi est long.
Mme Maud Olivier. Le projet de loi, en cours d’examen, relatif à la « Justice du XXIe siècle » pourrait faire l’objet d’amendements, ce qui serait plus efficace que le dépôt d’une nouvelle proposition de loi. Au regard des violences faites aux femmes, il me semble qu’il faudrait prévoir dans les textes des circonstances aggravantes en raison du sexe.
Mme Pascale Vion. L’Espagne a beaucoup progressé dans la question du féminicide, et ce terme figure dans la loi. Le cas de Mme Sauvage montre qu’il est important de trouver sur le plan législatif une solution permettant la prise en compte de la situation des femmes dans l’ensemble de leur parcours. Nous savons que les femmes qui tuent leur mari, conjoint ou ex-conjoint violent, le font au terme d’une trajectoire particulière et qu’il aurait dû être possible d’enrayer cette mécanique avant la commission du meurtre. Cela nous ramène à la nécessaire protection des intéressées ainsi qu’au statut de victime.
Concernant les auteurs de faits de violence, la sémantique est importante. Aussi les nommons-nous « agresseurs », car il s’agit de personnes qui agressent et non pas d’« auteurs » comme ceux d’œuvres littéraires. Les agresseurs doivent être effectivement poursuivis et sanctionnés, et pour cela nous devons encourager les femmes à porter plainte, ce qui met en jeu l’information de l’ensemble de la société, car aujourd’hui tout est occulté, ce qui dissuade les victimes d’agir. D’ailleurs, lorsqu’elles viennent porter plainte, elles sont mal reçues ; ces difficultés sont encore rencontrées après le dépôt de plainte, les juges aux affaires familiales ne prennent pas toujours de mesures d’éloignement du mari, même après plusieurs plaintes.
Aujourd’hui, les agresseurs peuvent être soignés et suivis ; nous savons par ailleurs que la plupart d’entre eux ont été victimes alors qu’ils étaient enfants ou ont vu leur mère subir des violences, ce qui prouve le rôle éminent de la protection de l’enfance.
Je vous concède que les campagnes médiatiques sont importantes, mais elles sont très insuffisantes en quantité. La question des violences doit être mise sur la place publique : il faut expliquer ce qu’elles sont et quelles sont leurs conséquences, considérables, en termes de santé publique. Ernestine Ronai évoquait à ce sujet un coût de 3,5 milliards d’euros, et encore ce chiffrage ne couvre-t-il que les violences conjugales, et pas l’ensemble des violences. Nous savons qu’il existe des diagnostics erronés de schizophrénie alors qu’il s’agit de mémoire traumatique.
L’éducation à l’égalité des sexes et contre le sexisme constitue l’une de nos préconisations ; il faut expliquer que la femme n’est pas l’inférieure de l’homme, que la petite fille n’est pas inférieure au garçon, que le droit des êtres humains vaut pour tous et que la violence n’est qu’une impasse.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Les programmes scolaires français prévoient trois séances par an et par élève consacrées à ces sujets depuis l’école primaire ; j’ai posé la question hier à des élèves venus m’interroger dans le cadre de travaux personnels encadrés (TPE) : ils ne savaient pas de quoi je parlais, et pourtant ils étaient en classe de première…
B. TABLE RONDE AVEC DES REPRÉSENTANTES D’ASSOCIATIONS FÉMINISTES
Lors de sa réunion du mardi 19 janvier 2016, sous la présidence de Mme Catherine Coutelle, la Délégation a procédé à l’audition de Mme Maryvonne Bin-Heng, présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), de Mme Dominique Guillien, vice-présidente, et de Mme Priscillia Fert, chargée de mission justice à la FNSF, de Mme Eléonore Stévenin-Morguet, membre du conseil d’administration de l’association Osez le féminisme, de Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV), et de Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), sur les violences faites aux femmes.
Mme la présidente Catherine Coutelle. À la lumière d’événements récents, en particulier l’affaire Jacqueline Sauvage, notre délégation souhaite aborder notamment la question de la légitime défense pour les femmes victimes de violences répétées de la part de leur conjoint. Une femme qui tue son conjoint parce qu’il l’a violentée pendant quarante-sept ans ne bénéficie pas de la légitime défense, alors qu’un policier qui tue une personne dans le dos obtient la clémence de la justice au nom de la légitime défense. Je rappelle qu’en droit français la légitime défense est fondée sur trois éléments : le fait que la personne ait été victime d’une atteinte injustifiée envers elle-même, l’usage de moyens de défense proportionnés, ainsi que la concomitance de l’attaque et de l’acte commandé par la nécessité de la légitime défense.
Nous nous interrogeons également sur le « féminicide », qui ne figure pas dans le code pénal français, contrairement à d’autres pays, en particulier d’Amérique latine. En la matière, nous n’envisageons pas de déposer une proposition de loi, dont le cheminement risquerait d’être trop long, mais plutôt d’amender un projet de loi en discussion.
Mesdames, êtes-vous favorable à l’introduction du féminicide dans le code pénal ? Avez-vous des propositions à nous faire pour modifier les conditions de la légitime défense ?
Nous aborderons ensuite d’autres points, si vous le souhaitez.
Mme Maryvonne Bin-Heng, présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF). Notre fédération regroupe 63 associations sur le tout le territoire, y compris en outre-mer. Nous gérons le service téléphonique national d’écoute 3919 « Violences Femmes Info », qui a traité 50 000 appels l’année dernière. Les associations font de l’accueil, de l’écoute, de l’accompagnement et de l’hébergement spécifiques. Nous insistons sur le terme « spécifiques », car nous aidons les femmes victimes de violences conjugales, mais plus généralement toutes les femmes victimes de violences parce qu’elles sont femmes.
Mme Dominique Guillien, vice-présidente de la FNSF. La FNSF ne se positionne pas en faveur d’une révision de la législation sur la légitime défense. En effet, une telle révision pourrait avoir un effet boomerang, autrement dit donner la possibilité à certaines personnes de justifier un crime en raison d’événements antérieurs. Par contre, s’agissant des violences faites aux femmes, notamment des violences conjugales et intrafamiliales, la question de la légitime défense se pose, car les tribunaux ne sont pas suffisamment avertis de la particularité du crime commis par une femme victime de violences conjugales pendant des années, comme Jacqueline Sauvage. Peut-être faudrait-il s’inspirer du modèle canadien qui, à la suite de la modification d’un article du code criminel en 2013, permet de prendre en compte la spécificité de la situation des femmes qui tuent leur conjoint violent. Il s’agit donc là d’une question de société, qui tient plus à la méconnaissance par les tribunaux de la spécificité des violences conjugales, qu’à la nécessité d’un article de loi qui miraculeusement résoudrait tout.
S’agissant du féminicide, la recherche réalisée par notre chargée de mission montre que, dans la plupart des législations où le terme « féminicide » est retenu, notamment au Chili, au Pérou, en Espagne et en Italie, il s’agit de souligner la demande d’aggravation des peines en cas de meurtre d’une femme par son conjoint. Pour un certain nombre d’autres pays, notamment l’Argentine, le Guatemala et le Mexique, il s’agit de prévoir une circonstance aggravante en cas de crime commis à raison de l’identité de la victime – donc de l’identité de genre. En France, les circonstances aggravantes sont prévues en cas d’infraction commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS), mais pas en cas de féminicide à proprement parler. Aussi, la FNSF se prononce-t-elle pour l’introduction du terme « féminicide » dans la loi, comme circonstance aggravante à raison du genre de la personne tuée. Cette circonstance aggravante spécifique pourrait ainsi être ajoutée à l’article 221-4 du code pénal en cas de meurtre à raison de l’identité de la victime.
Mme Éléonore Stévenin-Morguet, représentante de l’association Osez le féminisme. Osez le féminisme a mené deux campagnes, l’une contre le viol, intitulée « La honte doit changer de camp ! », et l’autre sur le féminicide. Sur cette deuxième question, nous constatons que les choses bougent peu, puisque le nombre de femmes mortes sous les coups de leur conjoint – 134 en 2014 – ne diminue guère par rapport aux années précédentes. De surcroît, pour 40 % de ces femmes décédées sous les coups de leur conjoint, la justice savait qu’elles étaient victimes de violences, puisqu’elles avaient déjà porté plainte ou déposé une main courante. Ces deux constats nous poussent à nous interroger sur la responsabilité de l’État, dont on a l’impression qu’il ne protège pas assez les femmes victimes de violences conjugales.
Par conséquent, s’agissant de la légitime défense, l’État est d’une certaine manière complice de l’assassinat des femmes par leur mari – ou des hommes par leur femme – à l’issue de plusieurs années de violences. Certes, la présomption de légitime défense – selon laquelle toutes les femmes victimes de violences conjugales seraient en situation de légitime défense – est une question assez compliquée. En revanche, comme la FNSF, nous sommes d’accord avec la notion d’antériorité de la menace, introduite par le législateur canadien. Cette antériorité de la menace parmi les facteurs de présomption de la légitime défense conduirait à prendre en compte durant le procès les violences conjugales subies par une femme pendant des années, comme c’est le cas pour Jacqueline Sauvage, victime de violences durant quarante-sept ans.
Sur le féminicide, notre campagne de 2014 se voulait spécifique, puisque le meurtre d’une femme à raison de son sexe est une spécificité : les 134 femmes qui meurent chaque année sous les coups de leur conjoint sont tuées parce qu’elles sont femmes. Au demeurant, la violence machiste dans le monde est la première cause de mortalité des femmes de seize à quarante-quatre ans : meurtres de filles à la naissance, crimes d’honneur, femmes tuées par leur conjoint ou par des inconnus dans la rue. Plusieurs pays proches de nous, dont l’Italie et l’Espagne, ont choisi de reconnaître le féminicide pour plusieurs raisons : c’est un meurtre spécifique, un crime ignoré ou banalisé, et qui peut être évité. Pour nous, le féminicide doit donc être reconnu dans la loi comme facteur aggravant, d’autant qu’il permettrait aussi de mettre en place des dispositifs spécifiques en termes de prévention.
J’ajoute qu’à la lumière d’affaires récentes, on a l’impression que le fait pour un homme de tuer sa femme est plus un facteur atténuant qu’aggravant – Bertrand Cantat a écopé d’une peine très faible, comparée à celle de Jacqueline Sauvage, condamnée à dix ans de prison, par exemple. C’est pourquoi nous préconisons une étude comparée des peines entre les hommes et les femmes.
Enfin, nous pensons que la formation des professionnels, au premier rang desquels les magistrats, doit être développée. En Espagne, par exemple, une loi contre les violences conjugales a permis la création de tribunaux spécialisés dans ces violences spécifiques.
Mme la présidente Catherine Coutelle. En France, la notion de tribunal spécialisé n’a pas été retenue par le législateur. Par contre, nous sommes tout à fait favorables à une formation spécifique des magistrats. D’ailleurs, la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) organise une formation auprès de l’École nationale de la magistrature (ENM) en direction des futurs magistrats.
Pour me rendre sur le terrain régulièrement, je peux vous dire que l’accueil des femmes victimes de violences conjugales s’est amélioré, que ce soit au niveau de la justice, de la police ou de la gendarmerie, ce que nous confirment les associations. On ne peut donc pas dire que l’État ne fait rien. Certes, on ne peut se satisfaire de la situation actuelle – le nombre de femmes tuées sous les coups de leur compagnon ne baisse pas –, mais la loi du 9 juillet 2010, renforcée par la loi du 4 août 2014, a constitué une très grande avancée, en particulier avec l’ordonnance de protection.
Mme Éléonore Stévenin-Morguet. Effectivement, ces progrès doivent être notés.
Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV). Je tiens avant tout à rappeler deux choses.
D’abord, la question de l’opportunité des poursuites pose problème dans les affaires que nous défendons. En effet, lorsque nous signalons des excisions dans le cadre de la protection maternelle et infantile (PMI), les affaires peuvent être classées sans suite. Ou lorsque des personnes portent plainte pour viol – et elles sont pourtant peu nombreuses à le faire –, les affaires sont classées pour un grand nombre d’entre elles, faute d’éléments de preuve suffisants ou parce que la victime n’est pas crédible, ou que sais-je encore.
Ensuite, les violences faites aux femmes sont très sous-évaluées. Si 134 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint l’année dernière, il faut savoir que sur les 32 hommes morts sous les coups de leur compagne chaque année, les trois quarts étaient violents avec celle-ci. En outre, le nombre de femmes tuées ne tient pas compte des celles qui sont mortes en réanimation quinze jours après leur agression, ni de celles qui se sont jetées du quatrième étage par désespoir.
J’en viens aux deux points de la législation.
Sur la légitime défense, le CFCV ne s’est pas prononcé, mais comparé au jugement très récent sur l’affaire de Bobigny, la peine infligée à Jacqueline Sauvage – dix ans de prison – est sidérante ! D’ailleurs, j’ai vu des maris condamnés seulement à deux ans de prison avec sursis pour avoir tué leur femme, et des pères condamnés à trois ans de prison avec sursis pour avoir violé leurs filles ! On peut donc parler d’une justice machiste, puisque les femmes paient toujours plus cher que les hommes en matière de violences conjugales. Néanmoins, les moyens de notre justice – dans un état de misère absolue à Bobigny ! –, expliquent la légèreté des peines pour violences faites aux femmes. Dans ce contexte, il est difficile de parler d’égalité de traitement et de justice de qualité.
Sur le féminicide, le CFCV persiste à dire que les violences faites aux femmes restent peu visibles. Aussi la reconnaissance du crime de féminicide donnerait-elle une visibilité à ce meurtre spécifiquement sexué.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Vous avez raison, une étude comparée entre les peines serait très utile – j’ai encore lu récemment qu’un mari très violent avait obtenu un sursis. D’une façon générale, les statistiques sexuées font défaut. En matière de cyberviolences, les femmes ne semblent pas identifiées dans les statistiques. En 2000, l’enquête ENVEFF (Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France) a montré qu’une femme mourait tous les trois jours sous les coups de son conjoint, ce qui a permis une prise de conscience dans notre pays des violences faites aux femmes. Près de quinze ans après, l’enquête VIRAGE (Violences et rapports de genre) entend actualiser la connaissance statistique des violences faites aux femmes et son champ d’investigation a été étendu à la population masculine.
Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Avant de s’interroger sur l’introduction du féminicide dans le code pénal, il serait intéressant de remettre à plat la question des circonstances aggravantes inscrites dans le code pénal à raison de l’identité ou de caractéristiques des personnes.
Il est en effet plus grave aujourd’hui de tuer un homme parce qu’il est homosexuel, juif, catholique ou musulman, que de tuer une femme parce qu’elle est une femme. Le législateur a profité de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, votée au bénéfice des femmes, pour aggraver le crime d’homicide volontaire à raison, non du sexe, mais de l’identité de genre. Ainsi, tuer une femme parce qu’elle est une femme n’est pas puni de la réclusion criminelle à perpétuité, contrairement aux crimes prévus à l’article 221-4 du code pénal : meurtre d’une personne à raison de son orientation sexuelle ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, notamment.
Les peines prévues pour d’autres crimes et d’autres délits sont alourdies en raison de ces circonstances aggravantes, à l’exception du sexe : le vol, la séquestration, les actes de torture et de barbarie.
Plus grave : tous les délits et crimes à caractère sexuel sont aggravés à raison de l’orientation et de l’identité sexuelle, de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Mais le viol et l'agression sexuelle ne sont pas aggravés à raison du sexe.
En clair, le législateur français nie le principe même du délit ou du crime sexiste, puisque les femmes, qui sont les premières concernées, ne bénéficient pas des circonstances aggravantes à raison du sexe. Notre association a développé cette analyse depuis 2004, après la présentation par M. Raffarin d’un projet de loi visant à aggraver les injures et les diffamations à raison de l’orientation sexuelle, et non à raison du sexe.
Douze ans plus tard, cette analyse des circonstances aggravantes du code pénal est toujours d’actualité.
Cette discussion est assez désagréable pour les féministes que nous sommes car le législateur nous met en position de revendiquer un alignement des droits des femmes sur ceux d’autres catégories de personnes, alors que les femmes sont les premières victimes des délits et des crimes sexuels. Les circonstances aggravantes constituent donc pour nous une question de politique majeure. Faut-il rajouter une circonstance aggravante à raison du sexe pour aligner les droits des femmes sur ceux d’autres catégories de personnes ? La question est encore ouverte pour l’AVFT. Ne faudrait-il pas plutôt supprimer toutes les circonstances aggravantes afin de mettre tout le monde sur un pied d’égalité ? Ce serait peut-être une solution raisonnable.
Sur le féminicide, nous nous interrogeons. En effet, créer ce crime spécifique ne réglera pas la question des circonstances aggravantes pour les infractions autres que le meurtre. En outre, introduire ce crime spécifique ne présente un intérêt juridique que si les peines sont aggravées. Par ailleurs, cela augmenterait le travail de la partie civile en termes de preuves : la condamnation d’un homme pour féminicide nécessiterait de prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction initiale, en plus du meurtre de la femme parce qu’elle est une femme. Cette question est donc, de notre point de vue, assez délicate.
Sur la légitime défense, on s’intéresse à cette question en cas de meurtre ou d’assassinat, mais il est intéressant de replacer ce débat de manière plus large. En effet, la question de la légitime défense se pose parfois dans les dossiers de notre association, qui défend les femmes victimes de violences à caractère sexuel dans le cadre du travail. Récemment, nous sommes intervenus aux côtés d’une femme qui avait jeté une bouteille de vin sur la tête de son chef cuisinier qui l’agressait sexuellement – il lui touchait les seins, tentait de l’embrasser de force. Tous deux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel : lui a été condamné pour agression sexuelle, elle pour violences volontaires. Ainsi, la question de la légitime défense ne se pose pas seulement en cas de meurtre.
Pour nous, compter sur l’évolution de la société et la prise en considération de la question des violences faites aux femmes par les magistrats, c’est encore renvoyer cette question aux calendes grecques. En définitive, on fait toujours payer aux femmes le fait de se défendre : la définition de la légitime défense, telle qu’elle est prévue dans le code pénal français, ne permet pas de les protéger contre des condamnations. Par conséquent, l’AVFT préconise une réforme de la définition de la légitime défense, en s’inspirant du modèle canadien, très clair et très opérationnel.
Mme Pascale Crozon. Lors de la discussion de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, nous avons prévu de faire une évaluation de l’application de la loi. Nous aurons donc l’occasion de vous rencontrer pour en discuter.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Que pensez-vous de l’application de la loi de 2010, améliorée en 2014, et plus particulièrement, de l’ordonnance de protection, du téléphone grand danger et de l’extension du dispositif 3919 ?
Quelles améliorations peuvent être envisagées pour faire reculer les violences faites spécifiquement aux femmes ?
Mme Dominique Guillien. La loi de 2010 sur les violences faites spécifiquement aux femmes était très attendue. Malheureusement, s’agissant de l’ordonnance de protection, nous observons une grande disparité dans son application par les tribunaux de grande instance. En effet, dans certains tribunaux de grande instance (TGI), les avocats en viennent à ne plus demander l’ordonnance de protection au motif que la procédure prendrait des mois et des mois. Dans d’autres, comme celui de Strasbourg où je travaille à SOS Femmes solidarité, nos avocates sont enclines à demander les ordonnances de protection, car celles-ci sont la plupart du temps octroyées, le suivi réalisé de façon correcte et l’écoute tout à fait favorable. Il nous paraît donc important qu’une évaluation soit réalisée par TGI sur le nombre d’ordonnances délivrées et les délais de délivrance par rapport au nombre d’ordonnances de protection demandées.
En ce qui concerne le téléphone grand danger, il est délicat de se prononcer. En effet, le nombre annoncé de téléphones grand danger – 400 déployés sur tout le territoire – peut sembler insuffisant. Par contre, le nombre de ces téléphones d’alerte qui nous a été octroyé à Strasbourg, où nous avons été précurseurs, comme en Seine-Saint-Denis, dans ce domaine grâce au procureur Patrick Poirret, est tout à fait suffisant. En outre, il ne faudrait pas que ce dispositif devienne une réponse à la non-délivrance des ordonnances de protection, comme nous le disent nos avocates.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Il faut une ordonnance de protection pour délivrer le téléphone grand danger.
Mme Dominique Guillien. Certes, mais il y a parfois une confusion : des téléphones grand danger sont demandés au motif que l’ordonnance de protection n’est pas délivrée.
Concernant l’évaluation du nombre de téléphones grand danger délivré par région, les comités de pilotage (Copil) en charge du dispositif de téléprotection seraient plus à même de vous donner des informations.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Le numéro d’écoute 3919 est-il utilisé partout ? J’ai l’impression que le numéro local est encore utilisé dans certains endroits.
Mme Maryvonne Bin-Heng. Celui-ci est encore utilisé, en raison des habitudes notamment. Par contre, l’utilisation du 3919 a considérablement progressé, les appels ayant doublé depuis quelques années. Nous avons mis en place un pré-accueil, pour orienter les victimes, certaines associations n’ayant pas de ligne directe pour répondre aux femmes victimes de violences. Je pense au GAMS (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants) et à l’AVFT. Nos collègues des associations avec lesquelles nous avons passé des conventions ont, en effet, accepté de former nos écoutantes, qui étaient formées aux violences conjugales, mais pas aux autres types de violences. Après cette première écoute au 3919, nos écoutantes indiquent donc aux femmes à qui elles peuvent s’adresser.
Vous le voyez, le 3919 est extrêmement utile, et je pense que les femmes sont plus nombreuses à nous appeler aujourd’hui parce qu’elles retiennent le numéro. Il faut rappeler l’intérêt des campagnes d’information, du gouvernement et de notre fédération. À chacune de nos campagnes, à chaque émission de télévision, les appels « Violences Femmes Info » explosent – cela peut aller jusqu’à 400 appels en une heure ! Ce service national d’écoute fonctionne tous les jours de l’année de 8 heures à 22 heures – mais pas 24 heures sur 24, faute de financement.
Mme Maud Olivier. Je m’étonne que vous soyez favorable à l’introduction du féminicide dans le code pénal, mais pas à l’évolution de la loi sur la légitime défense. En effet, dans la mesure où le code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par le conjoint – homme ou femme –, les femmes qui tuent leur conjoint violent sont lourdement condamnées.
Mme Édith Gueugneau. Il faut rappeler que 93 % des enfants résident au domicile où s’exercent les violences conjugales et que 21,5 % sont maltraités. Comment améliorer la protection de l’enfant en lien avec le 3919 ?
Mme Maryvonne Bin-Heng. Les écoutantes ont conscience de ce problème et un rapprochement est fait avec le 119, le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger. Néanmoins, nous ne pouvons pas amalgamer les deux problèmes, violences faites aux femmes et enfance maltraitée. L’enfant dont la mère est violentée est un enfant victime, mais nous ne pouvons pas dire que la mère ne le protège pas. Nos écoutantes sont très attentives et tentent de déceler si la mère est protectrice ou pas, et lorsqu’elles pressentent un souci, elles le disent à la femme et lui proposent d’appeler les services à même de l’aider. D’ailleurs, un certain nombre de femmes demandent de l’aide. Lors d’une première écoute, l’important est que la femme soit entendue et crue, pour qu’elle sache qu’elle peut être aidée par des associations de terrain, qui font un énorme travail en lien avec la protection de l’enfance. Ainsi, les choses avancent positivement.
Mme Dominique Guillien. Le 3919 n’est pas un numéro d’urgence – en cas d’urgence, il faut appeler la police ou la gendarmerie. Il s’agit d’un numéro national d’écoute des femmes en grande détresse, mais aussi des familles, des voisins et des personnes proches qui peuvent se retrouver démunis. Je le précise car l’urgence est souvent très mauvaise conseillère s’agissant des enfants – réagir trop rapidement peut amener à penser qu’il faut enlever les enfants aux parents. La situation des enfants est prise en compte localement, au niveau des associations vers lesquelles les femmes se tournent.
Pour nous, le féminicide étant une circonstance aggravante, il doit être reconnu comme un homicide aggravé à raison du genre de la victime. Cela ne remet pas forcément en question la loi sur la légitime défense.
Je précise que notre commission justice travaille actuellement sur ces questions.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Le président du TGI de Poitiers m’a indiqué que les statistiques sur les ordonnances de protection n’existent pas en raison de leur faible nombre. Nous pourrions interpeller à ce sujet les présidents de TGI au moment des audiences solennelles.
Mme Éléonore Stévenin-Morguet. Pour Osez le féminisme, l’ordonnance de protection et le téléphone grand danger sont des dispositifs très importants. On peut avoir l’impression qu’ils sont utilisés de manière inégale, si bien que des statistiques en la matière seraient effectivement très utiles.
L’arsenal juridique est désormais important. Plus que voter des lois supplémentaires, faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité affichée serait préférable. La lutte contre ce fléau a certes été grande cause nationale en 2010, mais on n’en a pas beaucoup entendu parler à l’époque.
Sur le cyberharcèlement, nous allons mener une campagne prochainement, à la faveur de l’examen au Parlement du projet de loi pour une République numérique.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Les textes ne suffiront pas : il faut des campagnes fortes.
Mme Éléonore Stévenin-Morguet. En plus d’un engagement politique fort, il faut communiquer davantage sur les violences faites aux femmes, ainsi que sur le revenge porn, le cyberviol, etc., mais aussi prévoir une prévention accrue auprès des jeunes.
Par ailleurs, les femmes victimes de violences subissent un traumatisme, qui pourrait être indemnisé, d’autant qu’une procédure contre un mari violent engendre d’importantes dépenses. Faut-il imaginer une aide juridictionnelle élargie à toutes les victimes de violences, sans condition de ressources ? C’est une question que nous nous posons.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Une des recommandations de mon rapport d’information sur le projet de loi pour une République numérique est de généraliser l’emploi de termes français pour mieux traduire la réalité des cyberviolences : « vengeance pornographique » pour revenge porn, « vidéo-lynchage » pour happy slapping, « harcèlement sexuel par textos » pour sexting.
Mme Éléonore Stévenin-Morguet. Ou « sextos », à la place de sexting. Dans le cadre de notre campagne, nous parlons de cyber viol, plutôt que de revenge porn.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Littéralement, revenge porn signifie vengeance pornographique : un ex-partenaire diffuse sur internet des photos intimes sans le consentement de la victime.
Mme Emmanuelle Piet. Les enfants sont également victimes des violences conjugales. Un homme violent est toxique avec sa femme, mais également toxique avec ses enfants – dans 30 % des cas, il a d’ailleurs tapé sur le ventre de sa compagne pendant la grossesse. Par conséquent, protéger la mère, c’est protéger les enfants. Les juges aux affaires familiales ne sont pas assez attentifs à ce problème. Pourquoi prononcer la garde alternée quand le père est violent ? Lorsque Madame emmène l’enfant au commissariat et que Monsieur la frappe devant les agents de police, ceux-ci ne peuvent rien faire en cas de garde alternée ! On ne mesure pas la dangerosité de ces situations !
En Seine-Saint-Denis, nous testons la mesure d’accompagnement protégé (MAP), qui est une mesure formidable. Elle n’empêche pas Monsieur de voir ses enfants, mais l’empêche de rencontrer Madame, et donc de faire pression sur elle, de continuer à la terroriser par l’intermédiaire des enfants !
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous sommes d’accord.
Le législateur a introduit une autre amélioration : le versement de la pension alimentaire sur un compte en banque. En revanche, nous devrons être vigilants sur la médiation, que les juges souhaitent développer, en raison notamment d’un manque de moyens.
Mme Emmanuelle Piet. En Seine-Saint-Denis, je constate que des pères peuvent empêcher que leurs enfants reçoivent des soins médicaux !
Cela fait trente-cinq ans que nous demandons des statistiques sexuées en matière de justice, sur les victimes comme sur les agresseurs, ce qui contribuerait à la visibilité des violences faites aux femmes.
Mme Marilyn Baldeck. Pour l’AVFT, le bilan de la loi du 4 août 2014 a été traumatique. En effet, une peine d’indemnisation plancher pour les victimes de discrimination, et donc de harcèlement sexuel, avait été votée – vous aviez déposé cet amendement, madame Coutelle –, mais elle a été abrogée par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la procédure législative. Nous tenons énormément à cette mesure, extrêmement importante en ces temps de loi Macron qui a eu plutôt tendance au plafond qu’au plancher en matière d’indemnisation des salariés ayant perdu leur travail… Il est donc très important que votre amendement soit déposé à nouveau dans le cadre d’un autre texte.
Le législateur devra également être attentif, dans le cadre du projet de loi sur la justice du XXIe siècle, à la question du recours collectif en matière de discriminations, duquel les associations de défense des droits des femmes ne devront pas être exclues.
Quant aux idées d’amélioration de la loi, ce n’est pas ce qui manque, je pense en particulier à la question de l’harmonisation des règles en matière de preuves. En effet, les textes actuels sont un réel embrouillamini, les règles de preuve en matière de discrimination n’étant pas identiques à celles en matière de harcèlement sexuel, à tel point que certains juristes tendent à penser que la France transgresse le principe d’équivalence. Comme vous le savez, sur un même sujet, en l’occurrence toutes les discriminations, les règles de preuves doivent être identiques ; or les règles de preuve en matière de harcèlement sexuel sont beaucoup moins favorables que celles tendant à prouver une discrimination à raison de l’orientation sexuelle ou du handicap.
C’est d’ailleurs la loi de modernisation sociale qui a rendu plus compliquée la preuve du harcèlement sexuel – les débats parlementaires de 2002 montrent une volonté consciente du législateur de rendre plus compliqué l’établissement de la preuve d’un harcèlement sexuel que celui d’autres types de discriminations. Les avocats de la défense viennent de s’en rendre compte, si bien que dans nos procédures, on commence à nous opposer cette différence en matière de règles de preuves. De notre point de vue, il s’agit là d’une violation du principe de non-régression du droit interne au regard du droit communautaire.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Les condamnations pour harcèlement sexuel sont très rares.
Mme Marilyne Baldeck. Les choses sont beaucoup plus simples en matière civile qu’en matière pénale. Mais cela pourrait l’être encore plus si les règles de preuves étaient identiques à celles d’autres contentieux.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Merci beaucoup, mesdames.
C. TABLE RONDE AVEC DES AVOCAT.E.S, MAGISTRAT ET JURISTES
Lors de sa réunion du mardi 26 janvier 2016, sous la présidence de Mme Catherine Coutelle, la Délégation a procédé à l’audition de Mme Diane Roman, professeure de droit public à l’université François Rabelais de Tours, de Mme Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris, de M. Edouard Durand, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, secrétaire général de la première présidence, de Mme Catherine Le Magueresse, juriste et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), et de M Antoine Fabre, avocat spécialisé en droit pénal, sur les violences faites aux femmes.
Mme la présidente Catherine Coutelle. À la lumière d’affaires récentes, la délégation réfléchit au féminicide, ainsi qu’aux conditions de la légitime défense.
Madame Roman, vous avez publié sur le site Dalloz un article intitulé « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément » : la reconnaissance du terme de " féminicide" », et dans La Revue des droits de l’Homme un article intitulé « Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu’une question de terminologie ! »
Madame Le Magueresse, vous avez écrit un texte sur l’affaire Jacqueline Sauvage, cette femme qui a connu un enfer de quarante-sept ans de violences conjugales et qui a tué son conjoint « pour ne pas mourir ». Dans ce texte, vous analysez les circonstances du meurtre au regard des critères de la légitime défense qui auraient pu être appliqués à Mme Sauvage.
Pouvez-vous, les uns et les autres, nous donner votre avis sur l’introduction du terme « féminicide » dans le code pénal ? Que pensez-vous des notions de présomption de légitime défense et de légitime défense différée concernant les victimes de violences conjugales ? Enfin, pouvez-vous nous présenter la législation canadienne en la matière ?
Mme Diane Roman, professeure de droit public à l’université François Rabelais de Tours. Le « féminicide » est le fait de tuer une femme parce qu’elle est une femme. Ce terme, employé à l’étranger, est peu utilisé en France. Néanmoins, la Commission générale de terminologie et de néologie a récemment préconisé son utilisation dans le champ des sciences sociales et humaines, et le Petit Robert lui a consacré une entrée dans son édition 2015.
En droit français, un certain nombre de délits font l’objet d’une incrimination spécifique lorsqu’ils sont perpétrés en raison de leur caractère sexiste – c’est le cas des diffamations et des injures à caractère sexiste –, mais aucune circonstance aggravante n’est prévue pour les meurtres commis à l’encontre des femmes parce qu’elles sont femmes, alors que les meurtres commis en raison de motifs homophobes ou racistes font l’objet de sanctions renforcées. Néanmoins, les meurtres commis sur des femmes peuvent faire l’objet de circonstances aggravantes dans certains cas : lorsque la victime était enceinte ou lorsque le meurtre a été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS).
Faut-il aller plus loin ? Sans forcément inscrire le terme « féminicide » dans le code pénal, il semble utile d’en retenir l’idée. En effet, les homicides commis par l’ex-concubin n’entrent pas dans le champ des circonstances aggravantes précitées. De même, dans l’hypothèse où des meurtres seraient motivés par la haine des femmes – comme les meurtres commis à l’école polytechnique de Montréal en 1989 et au Mexique dans les environs de Ciudad Juarez –, les dispositions actuelles du code pénal ne permettraient pas de les sanctionner spécifiquement.
En refusant de reconnaître la spécificité de certains homicides sexistes, et en inscrivant le caractère universel du terme « homicide » – dont la vocation est de couvrir l’ensemble des violences, à l’encontre des femmes comme des hommes –, le droit pénal français contribue, selon moi, à invisibiliser une construction sociale fondée sur le genre et largement défavorable aux femmes.
C’est la raison pour laquelle je suis, à titre personnel, favorable à une modification de l’article 221-4 du code pénal, qui prévoit les circonstances aggravantes du meurtre. Il s’agirait d’insérer à l’alinéa 7° de cet article les mots « à raison du sexe, » avant les mots « de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ». Cette modification constituerait un progrès considérable en matière de défense des femmes, notamment des femmes victimes de violences conjugales.
Mme Catherine Le Magueresse, juriste et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Il est important – symboliquement et juridiquement – de visibiliser le féminicide notamment par le jeu des circonstances aggravantes. Mais cette circonstance aggravante « à raison du sexe » devrait s’appliquer à toutes les formes de violence et à tous les modes de conjugalité, y compris aux violences commises par les ex-conjoints. À l’heure actuelle, il est très difficile de prouver devant les tribunaux que les violences ont été commises « en raison des relations » comme l’exige le code pénal pour caractériser la circonstance aggravante.
M. Édouard Durand, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, secrétaire général de la première présidence. La notion de « féminicide » est très importante. D’ailleurs, le « dispositif pour la prise en charge des enfants mineurs lors d’un féminicide ou d’un homicide au sein du couple » est en cours d’expérimentation à Bobigny.
Cela étant dit, je suis réservé à l’idée de faire du sexe de la victime une circonstance aggravante. En effet, dans la lutte contre les violences, c’est la dimension conjugale qui est déterminante. L’alinéa 9 de l’article 221-4 du code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Or la création d’une circonstance aggravante à raison du sexe, outre qu’elle pourrait créer des ambiguïtés pour les magistrats, les ferait passer à côté de la dimension conjugale. Il est très important que le droit pénal consacre une circonstance aggravante au caractère conjugal des violences – qu’il faut bien sûr étendre aux relations ayant existé, c’est-à-dire aux « ex ». La dimension conjugale doit être prioritaire, j’y insiste, car cette voie est cohérente sur le plan législatif comme sur le plan jurisprudentiel.
M. Antoine Fabre, avocat spécialisé en droit pénal. L’analyse d’Édouard Durand est tout à fait pertinente. Je suis moi-même opposé à l’introduction d’une circonstance aggravante « à raison du sexe », car les violences au sein du couple – hétérosexuel ou homosexuel – touchent aussi bien le conjoint que la conjointe. Même si le modèle hétérosexuel est dominant, le nombre d’agressions envers les hommes est en augmentation et celui des agressions commises contre des femmes est en diminution. Récemment à Paris, s’est tenu le procès d’une femme qui avait battu son compagnon pendant une longue période. C’est donc bien le lien relationnel qui est en cause, plutôt que la notion de sexe. Les deux affaires citées par Mme Roman, au Mexique et au Canada, justifient-elles de changer la loi ? Dans mon quotidien d’avocat, je n’ai jamais eu connaissance d’agressions de femmes parce qu’elles étaient femmes ; par contre, j’ai rencontré un grand nombre de femmes victimes d’agressions parce qu’elles vivaient avec un homme violent. Ainsi, la vraie problématique est : comment sauver la vie des femmes victimes de violences ?
Dans l’affaire Jacqueline Sauvage, le dossier a été, selon moi, présenté de manière un peu simple. Je rappelle qu’un certain nombre de magistrats professionnels, tant en première instance qu’en appel, ont jugé que cette femme devait être condamnée. Ce que j’ai entendu de l’audience, c’est que la présentation selon laquelle cette femme a été victime de violences pendant une durée aussi longue n’était pas aussi certaine et qu’un des enfants n’a pas témoigné dans le sens des violences exposées, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre le délibéré qui a été rendu.
Instaurer la présomption de légitime défense serait un aveu d’échec terrible au regard des lois qui ont été votées pour lutter contre les violences conjugales – je pense en particulier à l’éviction du conjoint violent du domicile. La justice fonctionne très bien lorsque les femmes déposent plainte – ce que n’a pas fait Mme Sauvage –, la condamnation étant quasi automatique lorsque la plainte est accompagnée d’un certificat médical attestant de violences, mêmes légères. Je le constate pratiquement toutes les semaines dans mon métier.
Aucune procédure n’a été diligentée par Mme Sauvage. Deux hypothèses. Soit elle n’a pas été victime, et c’est la raison pour laquelle elle ne l’aurait pas fait. Dans ce cas, pourquoi faudrait-il créer ce flou juridique ? Soit elle est victime. Alors comment se fait-il que, pendant quarante-sept ans, cette femme n’ait jamais rencontré un interlocuteur à même de l’aider à accomplir des démarches ? Comment se fait-il qu’elle soit restée dans l’isolement aussi longtemps, malgré l’existence de permanences gratuites proposées par les avocats, d’un numéro vert et de campagnes de presse sur les violences conjugales ?
Mme la présidente Catherine Coutelle. Mme Sauvage a fait trois tentatives de suicide. Il faut savoir que les femmes victimes de violences sont sous emprise et qu’elles ne parlent pas si les bonnes questions ne leur sont pas posées – notamment par les médecins et les policiers. Dans les commissariats, il existe des cellules d’accueil des femmes victimes de violences, mais tous les agents ne sont pas formés aux violences conjugales. Je connais le cas d’une femme qui avait réussi à s’échapper du domicile un week-end et à laquelle le policier a demandé de revenir porter plainte accompagnée de son conjoint !
M. Antoine Fabre. Ni le féminicide ni la présomption de légitime défense ne régleront le problème. On ne peut pas expliquer aux femmes sous emprise que la bonne solution est de tirer sur leur mari ! La présomption de légitime défense signifie que l’auteur est présumé avoir agi dans son bon droit. Dans le cas de Mme Sauvage, cela signifierait qu’elle n’a pas fait appel au dispositif en place, mais que la solution consistant à tirer dans le dos de son mari ne mérite pas de sanction judiciaire. Cela me semble excessif.
Mme Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris. J’interviens exclusivement dans des dossiers de femmes victimes de violences et auteures de meurtre sur conjoint violent. On vient généralement me voir comme deuxième, voire troisième avocat, lorsque l’avocat « classique » ne comprend pas le mécanisme de la violence conjugale. Je traite donc uniquement des cas qui dysfonctionnent.
Philosophiquement, idéologiquement, je suis favorable au féminicide. Malheureusement, cette notion n’entre pas dans la philosophie des magistrats ni du droit actuel, ce qui rend nécessaire une loi de genre, une loi-cadre sur le féminicide, qui définirait la notion de « violences conjugales ». En effet, si le code pénal prévoit les violences physiques ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou supérieure à dix jours, ainsi que les violences psychologiques, introduites par la loi de 2010 – notion que manient assez mal les professionnels de la justice –, il n’apporte pas une définition des violences conjugales. Si bien que nous, les avocates des femmes victimes, sommes systématiquement renvoyées vers la notion de « conflit de couple ».
Dans ce contexte, un délit de violences conjugales peut paraître intéressant, mais il impliquerait un renversement de la preuve. Aussi serait-il préférable d’insérer dans le code civil la définition des violences conjugales, telle qu’elle existe dans les textes internationaux, notamment la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la France.
Dans les dossiers de légitime défense avec meurtre – que je défends une fois par an environ –, les auteures ne sont jamais acquittées, elles sont généralement condamnées à une peine de cinq ans de prison dont trois avec sursis. À présent, l’affaire Jacqueline Sauvage ouvre le débat sur la présomption de légitime défense. Soit c’est un dossier particulier. Soit ça ne l’est pas, et alors le législateur pourrait utilement s’inspirer de la disposition canadienne sur la légitime défense féminine. En effet, la légitime défense en France fait l’objet de jugements réguliers devant les tribunaux correctionnels, car si Madame s’est défendue, elle et son conjoint sont cités à comparaître pour violences devant le tribunal correctionnel – elle a un œil au beurre noir et lui quelques griffures –, si bien que tous deux sont sanctionnés des mêmes peines ! Ce traitement correctionnel, par le « bas du panier », est particulièrement inquiétant, car à partir du moment où les condamnations sont équivalentes ou égales pour la femme et l’homme, nous ne pouvons pas dire au juge aux affaires familiales que c’est Monsieur qui est violent, ni demander un droit de visite en lieu neutre ou en présence d’un tiers, encore moins présenter l’exercice de l’autorité parentale comme instrument de domination.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Je connais le cas d’un couple où les deux ont été condamnés, le mari parce qu’il avait frappé sa femme, et la femme parce que le premier portait quelques traces de violences car elle s’était défendue.
Présomption de légitime défense ou légitime défense différée, madame Le Magueresse ?
Mme Catherine Le Magueresse. Ni l’une ni l’autre. J’ai commencé à travailler sur la question de la légitime défense, après avoir eu connaissance de la condamnation de Jacqueline Sauvage en première instance, condamnation extrêmement lourde par rapport à d’autres contentieux. J’ai suivi les trois jours de procès en appel à Blois, procès de haute tenue car toutes les personnes qui ont témoigné ont eu à cœur d’être précises et honnêtes dans la présentation des faits, y compris dans la reconnaissance de leur propre aveuglement.
Je rappelle que les faits se sont déroulés dans un petit village, où tout le monde était au courant des violences subies par Mme Sauvage : le maire savait, ainsi que les voisins, les gendarmes, le médecin, les pompiers. Tout le village savait. À l’audience, le maire a eu l’honnêteté intellectuelle de reconnaître qu’il avait connaissance des violences subies par Mme Sauvage, et l’un des assesseurs lui a même reproché d’avoir méconnu l’article 40 du code de procédure pénale selon lequel tout fonctionnaire ayant connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de crimes ou de délits est tenu d’en informer le Procureur de la République. Les voisins ont expliqué avoir été menacés de mort. Les gendarmes eux-mêmes étaient au courant, ce qu’a confirmé le maire. Les pompiers sont intervenus lors de l’une des trois tentatives de suicide de Mme Sauvage.
M. Marot, le mari de Mme Sauvage, a également fait vivre un enfer à ses enfants : deux des filles ont été violées, l’aînée a été victime d’agressions sexuelles, et le fils a été victime de maltraitances graves. Le village savait : un jour, alors qu’une des filles tardait à rentrer un soir, le père est allé la chercher en l’insultant, en la tirant très violemment devant ses camarades.
L’échec social et judiciaire est patent. Non seulement personne n’a déposé plainte concernant ces faits, mais les quatre plaintes pour menaces de mort déposées par la voisine dont le mari a été menacé de mort à de nombreuses reprises ont toutes été classées sans suite.
La plus jeune des filles, qui a été violée, a fait une fugue à dix-sept ans. Après avoir été retrouvée, elle a été placée en cellule ! Dans les locaux de la gendarmerie, elle a commencé à dénoncer le viol, mais en entendant son père arriver en hurlant, elle a eu très peur et a récupéré le formulaire de plainte pour le brûler dans les toilettes. Le gendarme n’a pas fait de signalement au parquet ni à l’aide sociale à l’enfance (ASE), mais il a informé le père que sa fille l’avait accusé de viol la mettant ainsi en danger.
Ces dysfonctionnements majeurs méritent, selon moi, un procès contre l’État : Mme Sauvage n’a pas été protégée pendant quarante-sept ans, alors qu’elle aurait dû être protégée.
Mme Sauvage s’est mariée à dix-sept ans, en 1965, année où les femmes ont obtenu le droit de travailler sans l’accord de leur mari. Les violences ont commencé tout de suite après le mariage. À l’époque, les violences au sein du couple étaient la norme – le premier refuge pour femmes victimes de violences conjugales a été ouvert en 1975. La famille de Mme Sauvage était opposée à ce mariage, car M. Marot sortait d’une maison de correction – « on t’avait bien dit de ne pas l’épouser », lui ont dit les membres de sa famille –, ce qui a contribué à l’isolement de cette femme.
Extrêmement isolée, Mme Sauvage a tenté de se protéger au travers de l’entreprise de transport qu’elle avait créée avec son mari : quand l’argent rentrait, M. Marot se calmait. Pendant ces quarante-sept ans, elle a utilisé toute son énergie pour faire en sorte que « ça aille bien », comme elle l’a dit au procès. Cette stratégie d’évitement est bien connue en matière de violences conjugales. Mme Sauvage subissait quotidiennement des violences psychologiques, sexuelles ou physiques.
Comment une condamnation à dix ans est-elle possible ? Je pense que Mme Sauvage n’a pas été aidée dans sa prise de parole par la présidente qui s’adressait à elle vertement – « Levez-vous, madame Sauvage ! » et qui lui coupait la parole. Une présidente qui osait dire « On n’est pas chez les Marot ici ! » parce que sa fille émue, s’exprimait de façon familière à la barre… À de nombreuses reprises durant l’audience, j’ai trouvé anormale que la présidente et l’avocat général – la figure de la justice – s’adressent aux témoins et à Mme Sauvage de cette façon. Quand on sait ce qu’a vécu cette femme et ce qu’il faut d’empathie pour permettre aux personnes de parler, on comprend que Mme Sauvage n’a certainement pas été invitée à parler de ce qui lui était arrivé. Heureusement, les témoins l’ont fait pour elle. Heureusement, le témoignage de ses filles, remarquables de courage, a permis de comprendre l’enfer qu’elle a vécu pendant quarante-sept ans.
L’avocat général a pensé que les jurés demanderaient une condamnation moins lourde. Dans ses réquisitions, il leur a expliqué qu’en la condamnant à dix ans, elle sortirait à telle date, qu’en cas de condamnation moindre, elle sortirait le soir même… Face un discours si peu clair, j’aurais eu du mal en tant que jurée à comprendre le message… Il aurait fallu que l’avocat général assume publiquement, soit que Mme Sauvage devait rester en prison, où elle avait déjà passé trois années, soit que Mme Sauvage devait sortir de prison le soir même, et alors il aurait dû requérir cinq ou six ans. Compte tenu des témoignages, de tout ce que cette femme a enduré – son fils s’est suicidé pratiquement au moment du meurtre –, j’ai sincèrement pensé qu’elle retrouverait ses enfants le soir même. Cela n’a pas été le cas. Tout le monde a été surpris de cette décision.
Mme Sauvage porte le viol de ses filles, dont elle se sent éminemment coupable. Après la fugue de sa fille, elle lui avait demandé « est-ce que c’est vrai ? » et celle-ci, voulant protéger sa mère « qui avait déjà son fardeau » a-t-elle dit au procès, avait répondu « non, maman, j’ai menti ». Elle avait interrogé ses autres filles, qui lui avaient répondu la même chose. Ses filles ne voulaient pas lui mettre sur le dos la responsabilité des agressions sexuelles. Mme Sauvage a dit au procès qu’elle n’aurait jamais imaginé que cet homme, en plus d’être violent, pouvait s’attaquer sexuellement à ses filles.
Cette affaire a ouvert le débat sur la légitime défense. Faut-il modifier les conditions de la légitime défense ? La France n’a pas traité cette question, contrairement à beaucoup d’autres pays – États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande – qui l’ont abordée spécifiquement sous l’angle des violences faites aux femmes et des violences conjugales. Il ne s’agit pas d’imaginer un permis de tuer. Il s’agit de penser la situation d’une femme qui se défend lorsqu’elle est victime de violences conjugales. C’est un réel problème de société : plus les filles seront éduquées au respect d’elles-mêmes, plus elles seront légitimes à se défendre – à opposer une riposte physique à une attaque injuste et illégale.
En droit, la légitime défense est définie par l’article 122-5, alinéa 1, du code pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »
Quelles sont les conditions relatives à l’agression ?
L’agression doit être injuste, d’abord. En matière de violences conjugales, l’agression est toujours injuste. Ce critère était rempli pour Mme Sauvage.
L’agression doit être réelle, ensuite. En clair, l’agression ne doit pas être imaginaire. Mme Sauvage vivait sous le risque réel d’être tuée – M. Marot la menaçait de mort quotidiennement. Ce critère était donc rempli.
Enfin, l’agression doit être actuelle – « dans le même temps » selon le code pénal. Mais les termes « dans le même temps » ne signifient pas forcément dans la seconde, dans la minute, dans la demi-heure. Jusqu’à présent, la jurisprudence a interprété ces termes comme un temps très court – cela renvoie au cas de Mme Lange qui tué son conjoint avec un couteau alors qu’il était en train de l’étrangler, et qui a donc été acquittée pour avoir rempli toutes les conditions de la légitime défense.
En raison de quarante-sept ans de violences, Mme Sauvage était détruite, elle n’avait plus aucune estime d’elle-même – c’est ce qu’on appelle le syndrome de la femme victime de violences. Tous les travaux ont montré qu’une personne ayant subi une violence grave est traumatisée – elle n’est plus une personne « raisonnable », terme utilisé par les Canadiens. Tous les repères de Mme Sauvage étaient donc déconstruits par toutes ces années de violences.
Je rappelle les faits qui ont précédé le meurtre. Alors que Mme Sauvage dormait, après avoir pris deux comprimés pour s’endormir, son mari est venu défoncer la porte de sa chambre, fermée à clé, en lui hurlant : « Va faire à manger ! ». Certes, terrorisée, Mme Sauvage a fini par lui ouvrir. Le constat de gendarmerie a bien confirmé que la porte avait été fracturée. Ensuite, M. Marot a traîné Mme Sauvage par les cheveux, lui a donné un coup de poing, ce qui lui a déchiré la lèvre, puis il est allé prendre son whisky sur la terrasse. À ce moment-là, la cocotte-minute a explosé – « ça a explosé dans ma tête », a dit Mme Sauvage au procès. Elle est alors partie chercher un fusil avec lequel elle a tiré trois coups sur son mari, assis de dos. Trois coups, ce qu’ont confirmé les voisins, car elle a tiré automatiquement – elle et son mari étaient un couple de chasseurs, elle savait tirer. À la question de savoir si elle aurait tiré si son mari avait été de face, elle a répondu par la négative – les travaux canadiens ont montré que les femmes qui tuent leur conjoint le font lorsqu’elles ne sont pas en danger d’être elles-mêmes victimes de violences. Mme Sauvage était convaincue de la dangerosité de cet homme. En effet, une des fois où elle avait tenté de quitter le domicile en voiture avec sa fille, M. Marot les avait poursuivies en voiture, puis avait mis en joue sa fille en hurlant : « Si tu ne rentres pas à la maison tout de suite, je tire ! ». Cette fois-là encore, Mme Sauvage était donc rentrée à la maison, et sa fille n’avait pas porté plainte de peur que cela ne se retourne contre sa mère, c’est-à-dire que sa mère soit tuée. Voilà pourquoi les enfants n’ont pas déposé plainte, comme elles l’ont expliqué à la barre.
Dans la situation spécifique de Mme Sauvage victime de violences durant quarante-sept ans, ce critère d’actualité était donc rempli. Des violences graves venaient de se produire, les menaces de mort étaient quotidiennes – elles avaient même été plus que verbales lorsque Monsieur avait mis en joue son enfant. Avec une interprétation jurisprudentielle plus éclairée sur les conséquences des violences conjugales sur les femmes victimes, ce critère d’actualité aurait pu être retenu lors du procès.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Les avocates n’ont pas plaidé l’actualité ?
Mme Catherine Le Magueresse. La légitime défense n’a pas été évoquée en première instance, ce que m’ont confirmé les journalistes sur place à l’époque. En appel, la légitime défense a été évoquée, mais je pense trop rapidement – cela n’a pas été suffisamment développé. Les plaidoiries sont intervenues très tard dans la journée – le procès a duré trois jours, mais quatre jours auraient été préférables pour une bonne organisation de la justice. Mme Sauvage était présente au procès de neuf heures du matin à neuf heures du soir, elle était sommée de répondre après trois heures de témoignages – « Qu’avez-vous à dire ? » –, mais elle n’était pas en mesure de répondre correctement dans un tel contexte. Je pense aussi que les jurés étaient saturés en raison du nombre d’informations à assimiler.
Maintenant, quelles sont les conditions relatives à la riposte ?
D’abord, la riposte doit être « nécessaire ». Pendant quarante-sept ans, toutes les stratégies que Mme Sauvage avait tenté de mettre en place pour dénoncer les faits avaient échoué, si bien qu’elle ne pensait pas que la justice était possible. Les plaintes de sa voisine avaient été classées sans suite, ce qui renforçait l’impunité du mari et la conviction de toute-puissance de celui-ci. Les menaces de M. Marot contre sa fille n’avaient pas fait l’objet d’un signalement à la justice. Mme Sauvage ne pouvait compter ni sur les voisins, ni sur le maire, ni sur la société de chasse dont le mari avait été exclu pour cause de violences, ni même sur les gendarmes ! Tout le monde était au courant, mais personne n’avait jamais rien fait ! Sur qui pouvait-elle compter ? Elle ne pensait pas que ses enfants, devenus adultes et partis de la maison, pouvaient la protéger. Ainsi, sa sécurité ne dépendait que d’elle-même, elle n’avait pas d’autres moyens que tirer sur son agresseur pour assurer sa protection. Le critère de nécessité était donc rempli.
Ensuite, la riposte doit être « proportionnée ». En l’occurrence, la question n’est pas de savoir si toutes ces violences méritaient mort d’homme. Mme Sauvage était convaincue d’être en danger de mort, autrement dit que M. Marot finirait un jour ou l’autre par mettre à exécution ses menaces de mort – il terminait ses phrases par « je vais te buter ! » Je rappelle qu’il s’agissait d’une famille de chasseurs et que plusieurs armes se trouvaient dans la maison, comme l’a confirmé le constat de police. En se plaçant, non du côté de la personne « raisonnable », mais du côté de Mme Sauvage, traumatisée par des années de violences, on comprend que le critère de proportionnalité était rempli.
Enfin, la riposte doit être « volontaire ». Je n’y insiste pas. Toutes les femmes savent qu’elles tuent.
En conclusion, le jury aurait pu prononcer un autre délibéré, mais encore eût-il fallu qu’il ait été éclairé par les conseils de la présidente et des assesseurs.
Mme Maud Olivier. Selon vous, le fait de se sentir en danger de mort pourrait constituer un critère de la légitime défense. Or beaucoup de femmes se sentent également en danger de mort lorsqu’elles subissent des violences psychologiques. Comment faire ?
Mme Catherine Le Magueresse. Le droit actuel ne prend pas en compte la spécificité des violences conjugales : la légitime défense a été conçue par et pour des hommes, pour protéger leur propriété, dans le cadre d’une rixe à la sortie d’un bar… La jurisprudence n’évoque que ces cas.
Le législateur français doit-il s’orienter vers la présomption de légitime défense, la légitime défense différée ou une autre piste ?
Avec la présomption de légitime défense, on joue sur le régime de la preuve, mais sans toucher à la définition même de la légitime défense. Or il est fondamental de définir la légitime défense.
Avec la légitime défense différée, les choses ne sont pas claires. Pour moi, la légitime défense s’inscrit totalement dans le processus des violences conjugales. Je rappelle que 41 % des femmes tuées par leur conjoint avaient déposé plainte, ce qui montre qu’une procédure pénale ne protège pas de la mort. En outre, parmi les femmes auteures d’homicide, à peu près la moitié avaient elles-mêmes été victimes de violences conjugales.
La troisième piste est celle du droit canadien. La première jurisprudence au Canada date de 1990, avec l’arrêt Lavallée. Mme Lavallée avait tué son conjoint à peu près dans les mêmes circonstances que Mme Sauvage : insultée par son mari lors d’une soirée, elle était montée se cacher dans sa chambre, puis son mari l’avait rejointe pour lui dire « Attends que les invités s’en aillent, tu auras de mes nouvelles ! ». Mme Lavallee avait alors tiré sur son mari qui était en train de quitter la chambre – il était donc de dos avec l’arme qu’il lui avait remise. Dans cette affaire, la juge à la Cour suprême Bertha Wilson a pris en compte la spécificité des violences conjugales. Par la suite, plusieurs arrêts ont confirmé cet arrêt.
Enfin, en 2012, des facteurs à prendre en compte pour apprécier si la personne alléguant la légitime défense a agi de façon raisonnable, ont été intégrés à l’article 34 du Code criminel canadien. Les jurés doivent ainsi tenir compte notamment de : « la taille, l'âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause ; la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace ; la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force ».
Le législateur français pourrait s’inspirer des critères canadiens pour redéfinir la légitime défense, de telle sorte qu’elle ne soit pas discriminante pour les femmes victimes de violences conjugales. En effet, en ne tenant pas compte de la situation spécifique des femmes victimes de violences conjugales, le code pénal français exclut les femmes violentées du droit à la légitime défense et ainsi du droit à un procès équitable.
M. Édouard Durand. Je souscris en tout point à l’exposé brillantissime de Mme Le Magueresse. La piste canadienne me semble très intéressante.
Sur le procès de Jacqueline Sauvage, je m’en tiens à mon devoir de réserve pour une raison simple : je suis magistrat à la Cour d’appel d’Orléans. Par contre, je peux dire que la synthèse réalisée par Mme Le Magueresse correspond aux données générales que nous connaissons, à savoir que, dans la majorité des cas d’homicide, la femme était déjà victime de violences conjugales et que, dans la majorité des cas de féminicide, la femme était également victime de violences conjugales antérieures.
Nous savons également que dans 40 % à 60 % des situations de violences conjugales, les enfants sont directement victimes de violences exercées contre eux par l’agresseur qui commet les violences conjugales. Par conséquent, les professionnels ne peuvent être pertinents dans les situations de violences conjugales s’ils n’en connaissent pas les mécanismes. Je suggère donc qu’une étude coordonnée des dossiers de mort dans le couple – homicides et féminicides – soit réalisée, travail auquel je suis tout à fait disposé à contribuer.
Mme la présidente Catherine Coutelle. J’entends votre demande, mais au niveau du ministère de la justice, il semble déjà très difficile de produire des statistiques sexuées sur les condamnations pour cyberharcèlement, par exemple.
M. Édouard Durand. Pour les homicides conjugaux, les proportions seraient différentes et les infractions qualifiées et codées de façon plus claire qu’une infraction comme le cyberharcèlement. Je souligne que le téléphone grand danger a été inventé parce que des professionnels sur un territoire ont voulu raisonner sur les situations de féminicide.
Autre remarque : il faut absolument prendre en compte les suicides et les tentatives de suicide. Ce qui vient d’être expliqué est limpide : c’était lui ou elle ; or le plus souvent, c’est elle, y compris par suicide ou tentative de suicide. Notre responsabilité est très grande en la matière, même dix ans après la séparation quand il y a des enfants.
M. Antoine Fabre. Je trouve dommage que vous n’ayez pas invité l’avocat du mari défunt de Mme Sauvage, car il aurait été intéressant de connaître sa position. La pensée univoque gêne l’avocat pénaliste que je suis. On nous présente M. Marot comme un violeur, mais il n’a pas été condamné pour viol. Peut-on entendre qu’une personne reste présumée innocente jusqu’à ce qu’elle ait été condamnée pour les faits qui lui sont reprochés ? À chaque fois que des affaires suscitent l’émotion, est-on obligé de considérer que la thèse d’une des parties est l’extrême vérité ?
Deuxième point : la présence de référents dans les commissariats et les gendarmeries pour écouter les femmes battues est indispensable. La priorité est celle-là, et non de raisonner philosophiquement sur des concepts. Ces femmes n’ont pas l’accueil qu’elles méritent. J’ajoute qu’il est très compliqué d’obtenir un téléphone grand danger, or c’est la rapidité de l’intervention qui peut sauver des vies.
Mme Maud Olivier. Quelle est cette société où les femmes devraient apprendre à se défendre ? Nous nous battons pour l’égalité femmes-hommes, nous voulons que les femmes aient la possibilité de se promener dans la rue sans être agressées sexuellement. Pour ma part, je n’ai jamais constaté de harcèlement sexuel sur des hommes. Les violences conjugales restent un fléau en France et je ne supporte pas l’idée que les femmes soient obligées de se défendre !
Mme Diane Roman. Je souscris tout à fait à l’analyse de Mme Catherine Le Magueresse sur l’affaire Jacqueline Sauvage. Je me permets d’ajouter que, au regard des défaillances et des manquements des services publics nationaux, tous les éléments sont réunis pour une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, dont la jurisprudence est très stricte sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui interdit les « traitements inhumains ou dégradants ». Les États sont tenus d’agir positivement pour protéger les victimes de violences conjugales, qui sont considérées par la cour européenne comme des violences constitutives d’une discrimination fondées sur le sexe. Dans une affaire jugée en 2009, la Cour européenne a condamné la passivité des autorités policières et judiciaires turques à protéger une femme victime de violence.
Je souscris également à la proposition de Mme Catherine Le Magueresse sur les critères de la légitime défense permettant d’encadrer l’appréciation des magistrats.
Cela étant dit, si la question de la légitime défense s’avérait être un sujet trop sensible politiquement, je propose une solution de repli sur la base de l’article 122-2 du code pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ». En effet, la contrainte intègre théoriquement la situation psychique de l’auteur de l’acte criminel. Par conséquent, les violences subies par la victime – asservissement, processus d’aliénation constant, humiliations répétées – pourraient être considérées comme constitutives d’une contrainte. Pour l’heure, la jurisprudence n’a pas retenu la contrainte comme cause d’irresponsabilité pénale en matière de violences, mais cela pourrait l’être en restant dans le cadre actuel du code pénal.
M. Antoine Fabre. Il s’agit d’une disposition sur l’abolition du discernement.
Mme Diane Roman. L’abolition du discernement est régie par l’article 122-1 du code pénal.
M. Antoine Fabre. Imaginer qu’une femme battue est dans un processus de contrainte me semble incroyable dans un procès ordinaire !
Mme Diane Roman. L’imagination est l’arme des juristes, disait Jean Giraudoux !
M. Antoine Fabre. Elle est aussi source d’erreur judiciaire !
Mme Isabelle Steyer. Comme le dit Catherine Le Magueresse, il est important d’évoluer vers une modification législative. Par contre, le législateur devra définir des critères de la légitime défense extrêmement clairs et facilement compréhensibles pour des personnes qui ne sont pas juristes, en l’occurrence des jurés de cour d’assises !
Dans des affaires au pénal comme celles-là, la victime est non seulement incapable d’expliquer le mécanisme psychologique, social, médical, judiciaire, qui s’est noué autour d’elle, mais elle est fragilisée par le maniement de la langue française de la part des pénalistes pour faire en sorte qu’elle se sente nulle – alors même que son système de pensée a été de se sentir nulle pendant toutes ces années de violences conjugales ! Dans ce contexte, nous, les avocates de ces femmes, devons être très présentes, occuper toute la place, et ne pas avoir peur d’aller au clash ! Mais il faut surtout que la loi nous aide à poser les piliers de ce rapport de force !
Mme la présidente Catherine Coutelle. Les jurés ne sont pas des spécialistes du droit. Le président du tribunal fait-il de la pédagogie ?
M. Édouard Durand. Pour avoir eu l’honneur d’être dans le secret des délibérés des Assises à plusieurs reprises, je peux vous dire que le président d’audience fait œuvre de pédagogie et que les jurés prennent parfois beaucoup de temps pour délibérer.
Mme Maud Olivier. On dit même que le président influence énormément les jurés…
M. Édouard Durand. C’est possible… Je ne sais pas.
La compréhension des mécanismes des violences conjugales est cruciale, non seulement pour les jurés, mais aussi pour les magistrats. D’ailleurs, des sessions de formation sont en cours pour les futurs magistrats, en plus de la formation continue pour les magistrats en place.
M. Antoine Fabre. Chère consœur, en défendant un grand nombre de femmes victimes de violences, je n’ai jamais échoué dans la reconnaissance de ces violences, y compris en cas de viol. Par contre, certaines de mes clientes, alors même qu’elles avaient alerté les services de police, se sentaient menacées et ont été agressées faute d’avoir été protégées. C’est tout le problème : comment protéger ces femmes, sachant que 40 % de celles qui sont tuées ont déjà porté plainte ?
Mme la présidente Catherine Coutelle. Les tribunaux se sont-ils emparés de l’ordonnance de protection ?
M. Antoine Fabre. Pas tellement.
Mme la présidente Catherine Coutelle. On me dit que les avocats ne souhaitent pas s’en emparer.
Qu’en est-il du téléphone grand danger ? Pouvez-vous nous donner des éléments sur la formation ?
M. Édouard Durand. S’agissant de l’ordonnance de protection, les délais pourraient être améliorés.
Je voudrais souligner le coup de génie du législateur qui a substitué la notion de « vraisemblance » à celle de « preuve » dans la loi. Ce faisant, il a prouvé sa parfaite compréhension des violences conjugales. Malheureusement, les professionnels disent : « nous devons apporter la preuve de la « vraisemblance » »… Je peux dire que les choses progressent malgré tout.
À Bobigny, les choses fonctionnent mieux qu’ailleurs grâce à la formation et au partenariat. Formation sur les mécanismes de la violence conjugale, sur la stratégie de l’agresseur, le psycho-traumatisme, l’emprise. Partenariat avec les huissiers de justice qui se sont engagés à signifier les assignations dans un délai très bref, avec les avocats, avec les structures associatives. La conjugaison de ces deux dimensions est fondamentale pour progresser dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
J’en viens à mes propositions.
Sur la médiation, d’abord. La médiation est un outil extrêmement utile dans les situations de conflit, mais elle est totalement inadaptée dans les situations de violences conjugales. Le législateur a fort heureusement restreint le recours à la médiation pénale, mais un jour ou l’autre – et le plus tôt possible – il devra faire la même chose pour la médiation familiale, encore plus inadaptée aux situations de violences conjugales que la médiation pénale. En effet, la médiation pénale s’exerce sur l’infraction commise et suppose la reconnaissance des faits par l’agresseur, alors que la médiation familiale est un mode de règlement des conflits entre les deux parents et ne suppose pas la reconnaissance des faits.
Sur la coparentalité, ensuite. Il est tragique pour une femme de rester sous l’emprise par la parentalité, après avoir été victime de violences conjugales et être parvenue à sortir de l’emprise de l’agresseur. Le législateur devrait y remédier, en limitant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. » Je pense que les violences conjugales constituent un motif légitime pour confier l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Sur ce dernier sujet, nous sommes d’accord, mais nous n’arrivons pas à nous faire entendre par le ministère de la justice. L’enjeu est pourtant de protéger l’enfant.
M. Édouard Durand. Je vous propose cette piste : on peut dire que, dans les violences conjugales, l’agresseur n’est pas un parent protecteur.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Dans un procès récent, un homme condamné pour violences graves envers sa femme ne s’est pas vu retirer l’autorité parentale au motif, dixit le magistrat, qu’il est « un mauvais mari, mais un bon père » !
M. Édouard Durand. D’où l’intérêt de la formation, mais aussi de l’intervention du législateur. Certes, la loi de 2014 a été peu mise en application sur le retrait de l’autorité parentale – car on touche là au cœur de nos représentations de la famille, à une conception patrimoniale de l’autorité parentale. L’autorité parentale est conçue moins comme un outil juridique pour protéger et éduquer l’enfant que comme un outil juridique permettant de reconnaître le parent comme parent. Or dans la vie quotidienne, l’exercice conjoint de l’autorité parentale dans les situations de violences conjugales est inconcevable. Jusqu’en 1987, l’autorité parentale était liée à la garde de l’enfant et les enfants de parents divorcés ont toujours su qu’ils avaient deux parents !
La suspension de l’autorité parentale est une piste intéressante dans les cas de féminicide ou de tentative de féminicide. Comme juge des enfants, j’ai vu un père condamné à la prison pour avoir tué sa femme et qui continuait à exercer l’autorité parentale, en refusant de donner l’autorisation à la justice d’envoyer l’enfant chez un pédopsychiatre, car il s’agissait du pédopsychiatre de la branche maternelle… Le système est donc totalement pervers. Une disposition du code civil permet au juge des enfants, par exemple, de déléguer ponctuellement au gardien – famille, tierce personne, service éducatif, aide sociale à l’enfance – la charge de certains actes.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Dans ma permanence, j’ai accueilli une femme dont le mari refusait de lui donner le passeport de son fils, alors que celui-ci devait partir en voyage scolaire à l’étranger !
M. Édouard Durand. Il faudrait que la mère demande au juge aux affaires familiales l’exercice exclusif de l’autorité parentale, puisque l’autorité parentale devient l’arme pour perpétuer l’emprise !
Dans une situation de féminicide ou de tentative de féminicide, l’auteur continue à exercer l’autorité parentale pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant la condamnation par la Cour d’assises. Je préconise donc une suspension provisoire de l’exercice de l’autorité parentale, car si des motifs justifient la détention provisoire, ils peuvent aussi justifier que ce soit le tiers désigné comme protecteur par la justice qui décidera si l’enfant doit aller voir un pédopsychiatre.
Je voudrais finir sur le problème des enfants victimes des violences conjugales. En effet, s’ils ne sont pas directement victimes de violences exercées contre eux, les enfants ne sont pas victimes au sens pénal. Je vois deux pistes. La première est de faire de la présence des enfants une circonstance aggravante de l’infraction de violences. Elle n’a pas ma préférence, car elle aurait l’inconvénient de signifier que les violences dans le couple commises en l’absence d’enfant ou en l’absence de l’enfant sont moins graves. La deuxième piste est le cumul d’infractions, par la création d’une infraction autonome selon laquelle les violences conjugales constituent une violence contre l’enfant. Le cumul idéal de qualifications est envisageable dans deux cas de figure : d’une part, la pluralité d’atteintes à des valeurs sociales différentes – violences dans le couple et maltraitance faite à l’enfant : nous savons que les violences conjugales sont l’une des plus graves maltraitances faites aux enfants – et, d’autre part, la pluralité de victimes. Ces deux conditions sont réunies dans les situations d’enfants victimes des violences conjugales.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Au législateur de trouver le bon véhicule législatif…
M. Antoine Fabre. Nous sommes tous d’accord sur un point : notre justice est relativement imparfaite. L’affaire Sauvage le montre. Il arrive que la justice se trompe.
Avec tout le respect que je vous dois, madame la présidente, il me semble qu’un mari violent peut être un bon père.
Mon cabinet est situé près de Trappes, et je sais qu’un très grand nombre de femmes en situation irrégulière ont porté plainte pour violences légères afin d’être régularisées, or les hommes concernés ont été relaxés dans un grand nombre de cas.
Dans un système judiciaire imparfait, où l’on peut être tenté d’instrumentaliser la justice, créer une disposition pour priver une personne présumée innocente de l’autorité parentale me semble dangereux. Vendredi, j’ai fait libérer un homme, après deux ans et demi de détention provisoire, accusé à tort de viol sur sa conjointe : dans quel état serait-il aujourd’hui si l’autorité parentale lui avait été retirée ?
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous n’avons pas l’impression d’en faire trop pour lutter contre les violences conjugales. Les enfants qui ont vu leur mère battue sont marqués à vie.
Mme Catherine Le Magueresse. J’ai été auditionnée par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) sur la modification de la définition juridique du viol et la notion d’agression sexuelle.
Il s’agirait d’introduire à l’article 222-22 du code pénal sur les agressions sexuelles une définition positive du consentement. Là encore, le code canadien est intéressant, en ayant introduit comme définition du consentement « l’accord volontaire donné à l’activité sexuelle ». Il serait préférable d’inscrire un consentement positif dans le code pénal, au lieu de continuer à penser l’absence de consentement de la victime en termes de « violence, contrainte, menace ou surprise » de l’agresseur, cette situation aboutissant à déposséder totalement les femmes de leur pouvoir de dire oui ou non. Autrement formulé, il y aurait viol ou agression sexuelle quand la femme ne dit pas « oui », pas seulement quand elle dit « non ».
Cette notion de consentement est primordiale. Pour m’être rendue dans différents lycées d’Île-de-France, les jeunes lycéens que j’ai interrogés étaient incapables de répondre à ma question « qu’est-ce que le consentement ? » et toutes les lycéennes d’une autre classe m’ont soutenu que « si l’on sourit à un garçon on doit coucher avec lui après, sinon on est une salope ».
Mme Diane Roman. La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), dont je suis membre, souhaiterait travailler sur la question des violences envers les femmes, aussi bien sur le féminicide que sur la légitime défense. Une saisine de votre délégation pourrait constituer une première étape intéressante.
Mme Isabelle Steyer. Les femmes qui sont déjà sous un système de protection ne sont pas suffisamment protégées. En effet, malgré le contrôle judiciaire, le sursis avec mise à l’épreuve ou encore l’ordonnance de protection, certains hommes passent à l’acte. Je pense que la responsabilité de l’État est engagée dans le cas de cette femme assassinée à Grande-Synthe, qui avait déposé plainte pour violences conjugales, son compagnon était sous contrôle judiciaire et devait être jugé un mois et demi plus tard, mais il l’a poursuivi en voiture et l’a tuée à coups de revolver, ainsi que le père et la mère de celle-ci, alors qu’elle venait d’appeler le 17. Dans cette affaire, le contrôle judiciaire ne s’est jamais exercé, alors que cette femme s’était présentée quatre fois dans des commissariats. La protection des femmes, lorsque le conjoint veut tuer, est un gros souci.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Certains tribunaux demandent peu de téléphones grand danger.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs.
D. AUDITION DE REPRÉSENTANT.E.S DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Lors de sa réunion du mardi 9 février 2016, sous la présidence de Mme Catherine Coutelle, la Délégation a procédé à l’audition de Mme Béatrice Bossard, magistrate, sous-directrice de la justice pénale générale, de Mme Ombeline Mahuzier, cheffe du pôle de l’évaluation des politiques pénales de la direction des affaires criminelles et des grâces, et de M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale, de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, sur les violences faites aux femmes.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Mes chers collègues, nous recevons aujourd’hui Mme Béatrice Bossard, sous-directrice de la justice pénale générale, accompagnée par Mme Ombeline Mahuzier, cheffe du pôle de l’évaluation des politiques pénales, et de M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale, de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.
Mesdames, monsieur, comme vous le savez, le récent procès de Jacqueline Sauvage a suscité un certain émoi dans notre pays. La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a longuement travaillé sur le sujet des violences faites aux femmes et pris part aux débats sur la première loi consacrée à cette question, loi qui a été adoptée en 2010 puis renforcée en 2014. Aujourd’hui, il s’agit, pour nous, non pas de préparer un nouveau texte, mais de nous interroger notamment sur les raisons pour lesquelles Jacqueline Sauvage n’a pas bénéficié d’un jugement plus clément. Certes, la légitime défense, telle qu’elle est définie dans le code pénal, doit répondre à des critères cumulatifs, critères qui n’étaient pas tous réunis dans le cas que j’évoque, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la stratégie de défense consistant à plaider l’acquittement. Quoi qu’il en soit, on a le sentiment qu’aucune main secourable ne lui a été tendue alors que différentes alertes avaient été lancées : tentative de suicide, signalements, fugue de ses filles, plainte de la voisine à l’encontre de son mari pour menaces de mort, classée sans suite par les gendarmes…
Peut-on modifier le code pénal pour prendre en compte de telles situations qui perdurent pendant des années et aboutissent à un acte dramatique, puisqu’il consiste d’une certaine manière à se faire justice soi-même en tuant un conjoint violent ? Il ne s’agit pas du tout pour nous, contrairement à ce que certains ont pu penser, de donner un permis de tuer, mais d’améliorer éventuellement les choses. Nous avons déjà entendu des magistrats, des avocats, des juristes, notamment Catherine Le Magueresse, qui a suivi l’ensemble du procès.
Par ailleurs, lors de l’audition des représentantes de l’association SOS les mamans, nous avons recueilli deux témoignages bouleversants de mères dont les enfants subissent des maltraitances reconnues et qui sont pourtant presque considérées comme coupables. Nous avons également connaissance du cas d’une mère qui n’est pas protégée alors que les violences sont avérées et que des plaintes ont été déposées auprès des gendarmes.
Mme Pascale Crozon, rapporteure d’information. La loi du 4 août 2014 prévoit la formation initiale et continue de l’ensemble des professionnels, notamment des magistrats, confrontés aux violences faites aux femmes. Qu’en est-il de cette formation aujourd’hui ?
Mme Béatrice Bossard, sous-directrice de la justice pénale générale à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La question des violences conjugales est, depuis dix ans, pour le ministère de la justice, une priorité de politique pénale. Un certain nombre de circulaires, de directives et de dépêches ont donc été diffusées auprès des procureurs de la République, qui sont mobilisés pour lutter contre ce fléau sur l’ensemble du territoire national, même si, bien entendu, tout n’est pas parfait.
Quel bilan pouvons-nous tirer de la loi du 4 août 2014 en ce qui concerne la formation des magistrats ? L’École nationale de la magistrature (ENM) mène une politique dynamique dans ce domaine, qu’il s’agisse de la formation initiale ou de la formation continue puisque les magistrats sont soumis à une obligation de formation tout au long de leur vie professionnelle. À ce titre, une palette de thèmes leur est proposée chaque année, parmi lesquels figure bien entendu celui des violences conjugales et des violences sexuelles.
Dans le cadre de la formation initiale, une session de deux demi-journées de conférences et de tables rondes a été organisée pour la promotion de 2015, en association avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). Ces thèmes sont également évoqués dans le cadre des enseignements fonctionnels, car on sait qu’en la matière, la coordination entre le parquet, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales est essentielle pour éviter la déperdition d’informations.
Mme la présidente Catherine Coutelle. À ce propos, il semble qu’une telle coordination fait figure d’exception : elle dépend de la bonne volonté des magistrats. Ainsi, il arrive qu’un juge aux affaires familiales (JAF) en charge d’une instance de divorce n’ait pas connaissance de l’existence d’une procédure pénale pour violences et propose une médiation entre époux. De même, on nous a dit que lorsqu’une plainte a été déposée contre un des deux parents et que le juge pour enfants auditionne les enfants mineurs, ce dernier ne communique pas forcément son dossier au juge aux affaires familiales. On ne peut que déplorer une telle étanchéité.
Mme Béatrice Bossard. De tels cas de figure peuvent en effet, hélas, se présenter. Toutefois, je rappelle qu’au sein du parquet, le substitut des mineurs, dont relève également le contentieux de la famille – ce qui traduit bien la volonté de développer une approche globale –, intervient à la fois dans le champ pénal et dans celui de l’assistance éducative. Il est donc l’interlocuteur privilégié et le partenaire de travail quotidien du juge des enfants. Ainsi, lorsqu’il a à connaître d’une situation de violences dans laquelle des enfants sont en danger, il transmet une copie de la procédure au juge des enfants pour éclairer celui-ci sur le suivi de la famille et les mesures à prendre. Cette transmission peut également se faire en cas d’instance de divorce. En tout état de cause, le lien entre le substitut des mineurs et le juge des enfants est bien présent dans les pratiques professionnelles.
Quant à la transmission d’informations entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, elle existe également. Mais – j’y reviendrai à propos de l’ordonnance de protection –, il convient sans doute d’élaborer une politique de juridiction afin de mettre en place ou d’améliorer les circuits de transmission des informations. Des progrès sont donc souhaités par le ministère dans ce domaine. Toutefois, dire que le cloisonnement est total serait une contrevérité. Un magistrat sait que les situations individuelles sont complexes, comprennent divers paramètres et que la réponse judiciaire, notamment pénale, doit, pour être efficace, tenir compte des différentes interventions de la justice.
N’oublions pas, au demeurant, que l’avocat est un acteur fondamental en la matière. S’il s’agit d’un avocat attitré, qui intervient à la fois au plan pénal et dans le champ des affaires familiales, la continuité de l’information est assurée. En revanche, il est vrai que, pour les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou de la commission d’office, une déperdition d’information est possible. En tout état de cause, le conseil joue un rôle clé : il pourra, par exemple, porter à la connaissance du juge aux affaires familiales la plainte que sa cliente a déposée par ailleurs. De fait, le substitut aux affaires familiales ou des mineurs ne connaît pas forcément l’existence d’une éventuelle instance de divorce, et la copie d’une procédure pénale ne peut pas être transmise dans le vide.
Quoi qu’il en soit, le ministère de la justice travaille à l’amélioration des circuits d’information entre les différents acteurs judiciaires : JAF, juge des enfants, parquet, en la personne du substitut des mineurs ou du substitut chargé du contentieux de la famille, sachant qu’il s’agit souvent du même magistrat.
J’en reviens à la question de la formation. Dans le cadre de ce que l’on appelle les séquences transversales, c’est-à-dire lorsque les auditeurs de justice sont sensibilisés à la question de la médecine légale, par exemple, la situation des victimes de violences ou des mineurs victimes de sévices est abordée.
En ce qui concerne la formation continue, une session principalement consacrée aux violences conjugales est renouvelée chaque année depuis 2008. Cette formation de trois jours est ouverte à un large public. Ainsi, en 2015, elle a été suivie par 62 magistrats, 8 juges de proximité, 4 gendarmes, 5 policiers, 7 personnels de l’administration pénitentiaire et 3 membres de l’éducation nationale. En 2016, a été créée une session de formation particulière, dirigée par Mme Ernestine Ronai, qui est consacrée aux violences sexuelles. Par ailleurs, l’ENM permettra, chaque année, à un magistrat de bénéficier de l’enseignement dispensé dans le cadre du diplôme universitaire sur les violences faites aux femmes que délivre, à partir de cette année, l’université Paris 8.
Enfin, il convient de mentionner la formation déconcentrée, qui se cumule avec l’obligation de formation continue suivie à Paris. En effet, dans chaque cour d’appel, un coordonnateur régional de la formation peut prendre l’initiative d’organiser des sessions de formation. Ainsi, en 2016, une formation spécifique est consacrée à la présentation du dispositif « téléphone grave danger », pour permettre à chaque magistrat de se familiariser avec ce dispositif.
Mme la rapporteure. Avez-vous une estimation du nombre de magistrats qui ont suivi des sessions de formation continue consacrées à ces questions ?
Mme Béatrice Bossard. La session organisée en 2015 a été suivie par 62 magistrats, et je rappelle qu’elle existe depuis 2008.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Ces magistrats sont-ils volontaires ?
Mme Béatrice Bossard. Oui. La formation est obligatoire, mais chaque magistrat formule chaque année quatre vœux, validés par ses supérieurs hiérarchiques qui s’assurent que ces vœux correspondent aux fonctions qu’il exerce.
Mme la rapporteure. Dans quelle mesure l’appareil statistique du ministère de la justice comporte-t-il des données sexuées ?
Mme Béatrice Bossard. Les statistiques du ministère de la justice étant issues du casier judiciaire national, elles ne comportent de données sexuées que pour les personnes condamnées.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Ne serait-il pas possible de disposer de telles données pour les victimes ? Nous souhaiterions connaître, par exemple, le nombre de plaintes qui ont été déposées pour cyber-violences, le nombre de femmes concernées et celui des condamnations. Or, nous ne parvenons pas à obtenir une réponse précise sur ces différents points.
Mme Ombeline Mahuzier, cheffe du pôle de l’évaluation des politiques pénales, à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La véritable question est celle de savoir s’il est pertinent de comparer ces éléments, qui sont très différents. Les données concernant les dépôts de plainte sont collectées par le ministère de l’intérieur ; or, le ministère de la justice n’a pas accès à ces bases de données. Quant à ses propres statistiques, elles sont construites à partir du casier judiciaire national ou du logiciel d’enregistrement des procédures, qui reflètent l’activité réelle des juridictions. Ses données concernent donc les affaires transmises au parquet, qu’elles soient ou non poursuivies. C’est ainsi que nous avons pu vous indiquer quels étaient le nombre d’affaires de violences conjugales et la structure de la réponse des parquets : classement sans suite et motif de ce classement, poursuite et voies de poursuite... Ces données sont non seulement complètes et précises mais également fiables. On peut en effet disposer d’un appareil statistique ; encore faut-il savoir comment les données sont construites afin de déterminer si elles ont un sens par rapport au contentieux que l’on cherche à évaluer.
S’agissant du lien que vous établissez entre le nombre de plaintes et le nombre de condamnations, il ne peut être fait ni au niveau statistique, ni au niveau juridique. En effet, non seulement une plainte n’aboutit pas forcément à une condamnation – même si, en matière de violences conjugales, toutes les affaires sont en principe élucidées, puisque l’auteur est connu –, mais elle n’entraînera pas non plus systématiquement des poursuites, en raison d’un manque de preuves par exemple.
En ce qui concerne le suivi statistique, c’est-à-dire l’évaluation du nombre des plaintes reçues par les services enquêteurs et celui des affaires transmises aux parquets – et non celui des condamnations –, le service statistique du ministère de la justice participe avec celui du ministère de l’intérieur à un groupe de travail destiné à étudier notamment la manière dont le contentieux des violences conjugales est identifié par les policiers. Le ministère de l’intérieur dispose en effet, contrairement à celui de la justice, d’un système de comptage purement statistique, qui repose sur le logiciel de rédaction des procédures et sur des index statistiques remplis par les policiers eux-mêmes au moment où ils enregistrent une plainte. Ce faisant, ils précisent un contexte, qui ne correspond pas forcément à une infraction, dès lors que l’appréciation n’est pas portée par un magistrat. Ce système de comptage n’est donc pas parfaitement fiable. En effet, il se peut que, lors du dépôt de plainte, le policier qualifie les faits de violences sans retenir la circonstance aggravante, qui n’est pas requise à ce stade de la procédure, mais en précisant tout de même dans l’index statistique qu’il s’agit de violences conjugales.
Les statistiques du ministère de la justice et celles du ministère de l’intérieur sont donc parfaitement compatibles, leurs ordres de grandeur sont comparables. En revanche, elles ne sont pas construites de la même façon, car les outils, les méthodes et les ressources sont différents.
Mme la rapporteure. Avez-vous des données concernant le nombre d’affaires dans lesquelles les femmes ont pu bénéficier, au cours de la période récente, de la légitime défense ?
Mme Béatrice Bossard. Hélas, nous ne pouvons pas non plus vous fournir de données dans ce domaine, dans la mesure où, lorsque la légitime défense, qui est une cause d’irresponsabilité pénale, est retenue, aucune condamnation n’est prononcée. Or, comme je vous l’ai indiqué, nous travaillons sur la base des statistiques issues du casier judiciaire national, donc des condamnations.
Mme Ombeline Mahuzier. Je me permets de revenir sur la question du décompte des victimes, à laquelle je n’ai pas répondu. Les éléments inscrits au casier judiciaire sont définis par la loi. Or, ni l’identité des victimes ni leur nombre ne figurent parmi ces éléments, non seulement parce qu’il ne recense que les personnes condamnées et leur peine, mais aussi parce qu’on peut être condamné sans que la victime soit identifiée. Quand bien même celle-ci ne serait pas connue ou refuserait de déclencher le processus pénal, la justice passerait outre l’absence de plainte. C’est une des raisons pour lesquelles le recensement du nombre des plaintes n’est pas forcément pertinent. L’étude du nombre des victimes de violences conjugales ou sexistes relève donc davantage des enquêtes de victimation.
Mme la rapporteure. La loi du 4 août 2014 prévoit que la juridiction de jugement puisse prononcer le retrait de l’autorité parentale en cas de meurtre du conjoint ou d’un enfant. Cette mesure a-t-elle été souvent prononcée ?
Mme Béatrice Bossard. Les statistiques du ministère de la justice ne pouvant être consolidées qu’une fois l’année écoulée et les condamnations inscrites au casier judiciaire, les données concernant l’année 2015 ne seront disponibles qu’à la fin de l’année 2016.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Quelle est la position du ministère de la justice sur, non pas le retrait – car c’est une décision grave –, mais la suspension de l’autorité parentale ? J’ai lu récemment un jugement dans lequel un homme violent a été condamné sans que l’autorité parentale ait été suspendue au motif que, s’il est un mauvais mari, il est un bon père. Les enfants sont pourtant les victimes directes ou collatérales des violences conjugales. Il nous est donc difficile de concevoir qu’un mauvais mari puisse être un bon père – cette distinction nous choque beaucoup. La Chancellerie recommande-t-elle d’aborder ce sujet dans le cadre de ses instructions concernant les violences conjugales ?
Mme Béatrice Bossard. Dans ce type de contentieux, la charge émotionnelle est très forte, et le rôle du magistrat est de dépasser l’affect et de se prononcer au regard des éléments objectifs qui lui sont soumis, non seulement pour caractériser l’infraction mais aussi pour motiver une mesure aussi importante que le retrait ou la suspension de l’autorité parentale. En l’absence de tels éléments débattus contradictoirement, il peut être délicat de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale. En tout état de cause, je n’ai pas relevé, dans la circulaire de 2014, d’indications du ministère sur ce point. J’ajoute que la suspension de l’autorité parentale ne peut pas être automatique, en raison du principe de l’individualisation de la sanction. Pour qu’elle soit prononcée, des éléments attestant de la dangerosité d’un parent doivent rendre inenvisageable l’exercice de son autorité parentale.
Mme la rapporteure. Lors de nos auditions, plusieurs personnes se sont étonnées que l’article 221-4 du code pénal, relatif aux circonstances aggravantes du meurtre, fasse référence aux conjoints mais pas aux ex-conjoints.
Mme Béatrice Bossard. On peut en effet penser, à la lecture de cet article, que la situation des ex-partenaires et des ex-conjoints n’est pas visée, mais il faut se référer à l’article 132-80 du code pénal, qui définit cette circonstance aggravante et dont le deuxième alinéa prévoit explicitement que celle-ci est constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire d’un Pacs.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Cela ne soulève-t-il pas le problème de la fabrication de la loi ?
M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Dans le cadre de mes fonctions, j’ai participé à l’élaboration de ces dispositions. Le code pénal comporte une partie générale, qui comprend elle-même les dispositions générales relatives aux circonstances aggravantes, qu’il s’agisse de la préméditation ou des violences à caractère raciste et homophobe, par exemple. C’est dans ce cadre que l’article 132-80 définit la circonstance aggravante de l’infraction commise par un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un Pacs, en précisant bien que cette circonstance aggravante est également reconnue lorsque l’infraction est commise par un ex-conjoint, un ex-concubin ou un ex-partenaire lié par un Pacs. Lorsque la loi a été adoptée, des circulaires ont été adressées aux juridictions. Pour les magistrats, il n’y a pas de doute que les dispositions générales du code pénal s’appliquent de façon générale. En tout état de cause, nous n’avons pas jugé utile de le repréciser pour chaque infraction ; du point de vue de la légistique, cela me paraît cohérent.
Je vous donne un autre exemple. L’ancien code pénal fixait des peines minimales et maximales ; le nouveau code pénal prévoit, quant à lui, une peine de dix ans de prison ou de quinze ans de réclusion criminelle, par exemple : il est précisé, dans la partie générale, qu’il s’agit de maxima et que l’on peut descendre aussi bas qu’on le veut. Le code pénal doit donc être lu en tenant compte de sa partie générale, qui définit également les principes de responsabilité, notamment les causes d’irresponsabilité pénale, telles que la légitime défense, par exemple. Ainsi, l’article relatif au meurtre ne précise pas que celui-ci n’existe pas en cas de légitime défense.
Cela ne me choque pas car, du point de vue de la légistique, il importe que le code soit cohérent et ne se répète pas. Certes, l’accessibilité de la loi pour un particulier est relative, car la question est, hélas, extrêmement complexe. Mais il n’apparaît pas pour autant opportun de modifier les articles concernés pour y préciser que la circonstance aggravante est également constituée lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin. Il s’agissait, du reste, d’un point fondamental lors de l’examen du projet de loi : je me souviens d’avoir plaidé pour que cette précision soit explicitement mentionnée dans le texte, ce qui n’était pas le cas à l’origine.
Mme la rapporteure. Que pensez-vous de la possibilité de modifier l’article 221-4 du code pénal relatif aux circonstances aggravantes du meurtre pour y faire référence aux meurtres commis « à raison du sexe » ? À votre connaissance, le terme de « féminicide » est-il utilisé dans le vocabulaire juridique et administratif pour désigner le meurtre de femme ?
Mme Béatrice Bossard. À ma connaissance, le terme de « féminicide » – dont je suppose qu’il est le pendant d’homicide – n’est pas usité dans le monde judiciaire. Au demeurant, le fait de donner la mort à autrui n’est pas qualifié d’homicide dans le code pénal ; celui-ci fait référence au meurtre, qui est une notion asexuée. Par conséquent, si la proposition de créer une infraction de féminicide procède de la volonté d’instaurer un parallèle avec l’homicide, elle ne nous paraît pas nécessaire, au regard des textes actuels. Dans le code pénal, le terme d’« homicide » est principalement utilisé à propos de l’homicide involontaire.
Sur le point de savoir si la création d’une nouvelle circonstance aggravante à raison du sexe présente un intérêt juridique, notre direction est réservée, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il existe d’ores et déjà un certain nombre de circonstances aggravantes qui sont de nature à répondre à ces situations factuelles. La première d’entre elles vient d’être évoquée, c’est celle qui est constituée lorsque le meurtre est commis par le conjoint ou l’ex-conjoint. La deuxième est celle qui s’applique au meurtre d’une personne motivé par le refus de celle-ci de contracter un mariage ou de conclure une union. La troisième est celle qui est prévue en cas de commission simultanée d’un viol et d’un meurtre. Il nous semble que ces trois circonstances aggravantes permettent de prendre en compte sinon toutes, du moins un grand nombre des situations de violences subies par les femmes.
Par ailleurs, il serait difficile de caractériser juridiquement en quoi le meurtre est aggravé à raison du sexe. De fait, l’objectif serait de protéger davantage les femmes battues par leur conjoint masculin, mais il ne serait pas forcément atteint car seraient également concernés les cas où une femme bat ou tue sa rivale, par exemple. La terminologie est trop large pour déterminer le type de situations concrètes auquel on se réfère.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous savons que la notion de féminicide est utilisée en Italie et, surtout, en Amérique latine et au Canada, où ont eu lieu des assassinats de masse visant des femmes parce qu’elles étaient femmes ; il s’agit bien de meurtres spécifiques. Je pense également – mais peut-être cette situation est-elle déjà couverte par une circonstance aggravante – aux meurtres liés au code d’honneur : un frère tue sa sœur parce qu’il considère qu’elle a sali l’honneur de la famille, par exemple. Selon nous, il s’agit d’un féminicide, dans la mesure où un garçon qui ferait la même chose ne risquerait pas d’être tué. Nous cherchons à savoir si cette notion serait opérante dans notre code pénal.
Mme Béatrice Bossard. Le cas que vous évoquez, même s’il relève du même esprit, échappe en effet à la circonstance aggravante liée au refus de contracter un mariage. Mais il est important que le choix des mots ne laisse pas trop de place à l’interprétation afin que chacun sache quel type de comportement est visé. Or, le terme de féminicide dépasse l’acte d’un homme tuant une femme, soit dans un contexte conjugal ou intrafamilial – il s’agirait alors d’un « féminicide intime » –, soit en raison de convictions antiféministes.
Mme la présidente Catherine Coutelle. On peut en effet penser aux meurtres des étudiantes de l’École polytechnique de Montréal, qui ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes. Il me semble qu’au cours de nos auditions, a été souligné le fait que figurent dans le code pénal, au titre des circonstances aggravantes, les infractions commises à raison de la race – alors que ce mot ne devrait plus être utilisé – ou de l’orientation sexuelle, et non celles commises à raison du sexe.
M. Francis Le Gunehec. C’est en effet le cas. Il existe une interrogation légitime, depuis quelques années, sur la présence du mot « race » dans notre législation. Une proposition de loi a été votée par l’Assemblée nationale, initialement pour le supprimer, puis, sur la suggestion de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour le remplacer par des expressions telles que « raisons racistes » ou « prétendue race », afin de réprimer le racisme sans pour autant donner le sentiment que l’on cautionne l’existence des races.
Pour revenir à la question du féminicide, je rappellerai un précédent qui doit nous amener à réfléchir ; je veux parler de celui qui concerne l’inceste. Un texte a en effet été adopté dont l’objet était d’inscrire l’inceste dans le code pénal, non pas pour sanctionner des faits qui ne l’étaient pas, mais pour qualifier les choses plus clairement. Or, la définition de l’inceste soulevait des difficultés telles que cette disposition a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel. Un nouveau texte sur la protection de l’enfance a depuis été voté, dont la partie relative à l’inceste – partie qui a d’ailleurs été adoptée conforme par le Sénat et l’Assemblée – ne pose plus, selon moi, de problèmes d’ordre constitutionnel. Il me paraît toutefois plus difficile, d’un point de vue juridique, d’aboutir à une définition du féminicide qui n’encourrait pas la censure du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, à chaque fois que l’on a rencontré des problèmes particuliers, par exemple celui des mariages forcés, on les a réglés en créant une circonstance aggravante. La question des crimes d’honneur peut se poser, mais il faut savoir exactement ce que l’on veut réprimer et la manière dont on veut le réprimer. La formule générale « à raison du sexe » n’est pas satisfaisante de ce point de vue. Prenons l’exemple du racisme : la circonstance aggravante est établie notamment lorsque des propos racistes ont accompagné des violences ou un meurtre. Si l’on suit la même logique, le meurtre commis par une femme qui tue sa rivale en proférant des insultes sexistes devrait être qualifié de sexiste. Or, cela n’a pas de sens. Le parallèle entre sexisme et racisme n’est donc pas opérant : on aboutirait à des situations absurdes, voire contre-productives.
Si une réforme doit intervenir, elle doit donc cibler de façon précise ce que l’on veut réprimer, étant observé que, dans le cas des crimes d’honneur, par exemple – qui sont a priori déjà aggravés par la préméditation et passibles, à ce titre, de la réclusion criminelle à perpétuité –, il n’y a aucune difficulté à ce que les cours d’assises prononcent le maximum des peines encourues. On peut donc prévoir une aggravation dans un souci pédagogique – ou d’affichage, diront certains –, mais elle n’est pas forcément indispensable d’un point de vue juridique. Sur ce point, la réflexion doit peut-être se poursuivre. En revanche, la circonstance aggravante de sexisme paraît complexe à mettre en œuvre, de même que la notion de féminicide, qui peut avoir une utilité en sociologie mais qu’il est délicat d’introduire dans la loi, dès lors que doivent être respectés le principe de légalité des peines ainsi que la sûreté et la prévisibilité de la loi.
Mme Béatrice Bossard. Certains observateurs peuvent estimer qu’un certain nombre de circonstances aggravantes manquent, mais n’oublions pas que les éléments factuels sont dans le débat judiciaire et que, dans le cadre du procès d’assises, le contexte dans lequel l’acte a été commis sera mis en évidence. Ces éléments seront pris en considération tant par le ministère public dans ses réquisitions que par la cour d’assises dans son verdict.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Dans le cas de Jacqueline Sauvage, on peut se poser la question…
Mme Béatrice Bossard. Sur la situation individuelle de Mme Sauvage, je ne me prononcerai pas. Mais, en tant que magistrat, je peux faire état des pratiques professionnelles. Or, les conditions du passage à l’acte sont exposées à la cour d’assises et aux jurés pour qu’ils puissent apprécier la gravité des actes commis et déterminer la peine qui sera requise et prononcée.
Mme la rapporteure. Quelles réflexions vous inspire la présomption de légitime défense ou la légitime défense différée, qui a été évoquée à l’occasion de l’affaire Jacqueline Sauvage ?
Mme Béatrice Bossard. Pour que la légitime défense soit retenue, l’action doit être simultanée et proportionnée à l’attaque subie. Si elle est différée, elle n’est plus simultanée. Or, je rappelle que cette définition de la légitime défense n’est pas nouvelle : elle est inscrite dans les concepts fondamentaux du droit pénal français. À ce stade, pour la direction des affaires criminelles et des grâces, aucune réforme de cette notion n’est envisagée – le législateur appréciera. En tout cas, il semble complexe d’introduire la notion de différé, d’autant que se poserait la question de la proportionnalité d’une riposte différée.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Dans le code criminel canadien, la notion de légitime défense est extrêmement détaillée. Ces précisions vous paraissent-elles utiles ou nécessaires ?
M. Francis Le Gunehec. La spécificité du droit canadien est liée à une décision de 1990 de la Cour suprême, qui a reconnu, dans l’arrêt « Lavallée », une sorte de légitime défense différée. Cette décision a fait l’objet de commentaires de la doctrine et de magistrats, notamment à propos de l’emprise qui était exercée sur la victime. On a notamment comparé sa situation à celle d’un otage régulièrement menacé de mort qui tuerait son ravisseur sans attendre que celui-ci tente effectivement de l’assassiner. Toujours est-il qu’une loi est intervenue suite à cette jurisprudence, non pas pour clarifier la notion de différé, mais pour fixer des critères de bon sens – qui, selon moi, relèvent de l’interprétation de la loi plutôt que de la loi elle-même – qui permettent d’apprécier la légitime défense.
Je précise que nous n’avons pas de statistiques sur l’application effective de cette jurisprudence de 1990. En revanche, dans une décision plus récente, qui date de 1998, la Cour suprême canadienne a validé l’hypothèse dans laquelle la femme avait été déclarée coupable mais très faiblement condamnée. Vous avez indiqué vous-même que vous ne réclamiez pas un permis de tuer. Or, la légitime défense, l’état de nécessité ou la contrainte sont des causes d’irresponsabilité pénale, qui entraînent l’acquittement de l’auteur des faits. D’un point de vue strictement juridique, la légitime défense est donc un permis de tuer. Dans l’affaire Sauvage, la question qui se posait était celle de savoir si elle devait être acquittée ou si elle devait être condamnée à une peine moins sévère. Vous avez dit vous-même que ses avocats avaient axé sa défense sur la demande d’acquittement au nom de la légitime défense, et non sur la reconnaissance de circonstances qui auraient justifié une peine moindre. Le choix de la défense n’est donc pas anodin, en l’espèce.
Il s’agit de savoir ce que souhaite le législateur dans un tel cas. Souhaite-t-il que la femme battue qui tue son mari soit considérée comme pénalement irresponsable – et alors il faut faire évoluer la notion de légitime défense, qui est vieille de deux siècles – ou souhaite-t-il qu’elle ne soit pas condamnée à une peine disproportionnée – et il faut envisager une autre solution ? J’ajoute que, dans l’affaire dont nous parlons, se posait la question de l’application de la circonstance aggravante liée au fait que Mme Sauvage avait tué son conjoint, alors même que cette circonstance aggravante a été créée pour protéger les femmes se trouvant dans sa situation.
Il me semble donc que la légitime défense ou d’autres causes d’irresponsabilité n’offrent pas une solution satisfaisante, que ce soit du point de vue juridique ou même du point de vue sociologique, car encourager ainsi une femme battue à se défendre seule en lui reconnaissant le droit de tuer son mari violent serait, pour l’État, un terrible aveu d’impuissance.
Mme la rapporteure. Disposez-vous d’éléments statistiques sur l’application de l’ordonnance de protection, qui semble disparate sur l’ensemble du territoire ?
Mme Béatrice Bossard. Cette question n’est pas suivie par la direction des affaires criminelles et des grâces mais par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, laquelle nous a transmis à ce sujet un certain nombre de données que je vais vous livrer mais que je ne serai pas forcément en mesure de commenter.
Le nombre des demandes d’ordonnance de protection a augmenté de 55 % entre 2011 et 2014. Il ressort d’une mission d’évaluation menée par l’inspection générale des services judiciaires (IGSJ) et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) que l’appropriation du dispositif par les magistrats connaît une réelle amélioration. Quant au taux de rejet des demandes, il s’établit entre 25 % et 27,9 % entre 2012 et 2014. Cette stabilité peut s’interpréter comme le résultat d’un positionnement pondéré et assez conforme à la mission du juge, qui doit évaluer s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables à la fois la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
Par ailleurs, la direction des affaires civiles et du Sceau nous indique qu’aucun service aux affaires familiales ne répond dans le délai de 72 heures qui avait été envisagé lors des débats parlementaires, puisque les décisions sont rendues dans un délai moyen de 37 jours. Un tel délai s’explique par les contraintes inhérentes à la procédure suivie, notamment la nécessité de convoquer les parties à l’audience pour respecter le principe du contradictoire. La convocation se fait en effet par lettre recommandée avec accusé de réception et par délivrance d’assignation.
Toutefois, un certain nombre de juridictions, soucieuses de réduire ces délais, ont développé de bonnes pratiques qui consistent, pour les tribunaux de grande instance, à se rapprocher des huissiers de justice pour faire en sorte que l’acte d’assignation soit signifié dans la journée. Une politique de juridiction est également mise en œuvre pour renforcer l’articulation entre les procédures pénales et les procédures civiles, afin de prendre en considération l’ensemble du champ des violences conjugales et intrafamiliales et tenter de développer une approche globale.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Je m’étonne tout de même que le délai dont nous avions prévu qu’il serait de 72 heures soit en définitive de 37 jours ! Je rappelle que l’ordonnance de protection est une mesure de très grande urgence dont l’objectif est de sauver la vie de femmes en grave danger. Par ailleurs, et je vais peut-être commettre ici un crime de lèse-justice, je ne vois pas en quoi le principe du contradictoire devrait être respecté en l’espèce. Qui est coupable ? Qui est victime ?
Mme Béatrice Bossard. Pour le savoir, un débat contradictoire est nécessaire.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Si une femme franchit le pas et demande une protection, c’est parce qu’elle estime que sa vie est en danger. Peut-être peut-on commencer par la lui accorder avant de déterminer si elle a raison ou tort. C’est ainsi que des femmes se font tuer ! Nous savions très bien, lors des débats parlementaires, que nous rencontrerions ce type de difficultés ; j’entends que le débat contradictoire est nécessaire, mais il me semble que tel n’est pas l’esprit de la loi.
Mme Béatrice Bossard. Le contradictoire est en effet un principe général du droit et une obligation conventionnelle contenue dans la Convention européenne des droits de l’homme.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Encore une fois, l’ordonnance de protection doit permettre de protéger des femmes en danger de mort. Or, aujourd’hui, certains avocats nous disent qu’ils ne la demandent plus, précisément pour protéger leurs clientes.
Mme Béatrice Bossard. Manifestement, le ministère de la justice ne se satisfaisait pas de ces délais. L’ensemble des mesures qui peuvent être prises dans les juridictions pour les réduire sont les bienvenues. C’est la raison pour laquelle certaines bonnes pratiques sont encouragées. Au demeurant, en cas de danger imminent, dès lors que des menaces ont été proférées, le pénal prend le relais. De fait, ces menaces, de même qu’un éventuel harcèlement, sont susceptibles de constituer une infraction, laquelle peut donner lieu à une enquête diligentée en flagrance. En tout état de cause, une situation de danger imminent fait l’objet d’une alerte telle que le procureur et le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie se contacteront pour que des dispositions soient prises, qu’il s’agisse de patrouilles autour du domicile ou de l’ouverture d’une enquête en flagrance, notamment pour caractériser les menaces rapportées par la victime. On ne détournera pas la tête : la protection des victimes est également au cœur de la mission du magistrat.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Le problème, c’est l’éviction du conjoint violent.
Mme Béatrice Bossard. L’éviction du conjoint violent est au cœur de la politique pénale menée par la Direction des affaires criminelles et des grâces. Cette mesure, initiée il y a plusieurs années, est désormais bien inscrite dans les pratiques des magistrats. Elle est une réalité dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites en cas de classement sans suite, dans le cadre du contrôle judiciaire prononcé dans l’attente du jugement ou, après l’audience, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Une autre mesure a été adoptée dans le cadre de la loi 2014, qui est plus délicate à appliquer par les parquets ; je veux parler de la possibilité pour le procureur de la République de se prononcer sur la prise en charge des frais relatifs à l’entretien du logement conjugal. Selon les éléments qui nous ont été communiqués par les différents parquets, cette mesure n’est pas véritablement mise en œuvre car les procureurs s’interrogent sur les modalités et la portée d’une telle décision ainsi que sur l’absence de recours.
Il s’agit néanmoins de remontées ponctuelles. La question des violences conjugales est une priorité de politique pénale, mais il est difficile pour la Direction des affaires criminelles et de grâces d’en connaître les contours. C’est pourquoi elle a proposé, et sa proposition a été acceptée, au conseil de la statistique et des études du ministère de la justice que cette question fasse l’objet d’une enquête nationale en 2016. Cette proposition, élaborée par Ombeline Mahuzier, qui pourra vous en dire plus à ce sujet, traduit notre volonté de comprendre et de disposer de données fiables qui nous permettront d’avancer. La question de l’éviction du conjoint fait d’ailleurs partie des thématiques prises en compte dans cette étude.
Mme Ombeline Mahuzier. Ce que l’on appelle la mesure d’éviction au sens strict est assez peu prononcée. Pour les praticiens du droit, elle s’entend en effet davantage au sens large et regroupe toutes les mesures juridiques qui permettent d’obliger le conjoint violent à rester à distance de la victime. Or, jusqu’à présent, seules les évictions au sens strict étaient comptabilisées, ce qui ne nous paraît pas pertinent. Il en est de même pour l’ordonnance de protection civile, qui est en effet assez peu utilisée au regard du volume d’affaires pénales traitées parce que les premières mesures prononcées par les parquets et les juges en cas de danger sont des mesures pénales, plus efficaces. Dès lors, comptabiliser uniquement les mesures civiles en omettant l’ensemble du dispositif pénal, qui sera pourtant préféré pour des raisons d’efficacité, c’est étudier le phénomène sous un angle réduit et faire l’impasse sur l’évaluation du dispositif pénal.
C’est pourquoi nous avons proposé que ces procédures fassent l’objet d’une étude qualitative et quantitative. Ainsi la sous-direction des études et de la statistique du ministère de la justice doit mener une étude quantitative sur l’éviction du conjoint violent ou l’ordonnance de protection, au sens large : cette étude portera sur tous les cas dans lesquels une mesure a été prise pour évincer le conjoint, par exemple dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Au plan qualitatif, une étude menée par l’université de Strasbourg en lien avec le ministère de la justice a permis un premier travail de défrichage sur le fonctionnement du dispositif civil. Nous allons donc utiliser cette base de recherche pour étendre l’étude à une appréciation qualitative de l’articulation du dispositif civil et du dispositif pénal.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Lorsqu’une mesure d’éviction a été prononcée, rien n'empêche le conjoint qui a été éloigné de revenir sans cesse. Comment fait-on appliquer concrètement cette mesure ?
Mme Béatrice Bossard. Le comportement que vous décrivez est constitutif d’un autre délit, le harcèlement.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Mais le harcèlement peut avoir été constaté : dans le cas auquel je pense, la femme a reçu un nombre important de SMS en l’espace d’un mois. Et son cas n’est pas unique…
Mme Béatrice Bossard. Je peux difficilement me prononcer sur la situation individuelle à laquelle vous faites référence, car je ne la connais pas. Mais je puis vous indiquer, pour connaître les pratiques professionnelles en ma qualité de magistrat, que le comportement du conjoint qui n’accepte pas une séparation, par exemple, et va suivre constamment son ex-conjoint, sans pour autant le menacer explicitement ni même prononcer une parole, est constitutif d’un harcèlement et que des condamnations sont prononcées de ce chef.
Je précise que le dépôt de plainte, qui n’est pas toujours facile, n’est pas exigé. En revanche, il faut que les faits soient portés à la connaissance des services d’enquête. Dès lors, s’ils sont susceptibles de constituer une infraction, le procureur de la République ou ses substituts en sont informés.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Ce n’est pas le dépôt de la plainte qui est difficile, c’est son enregistrement par les policiers ou les gendarmes. Que fait-on ?
Mme Béatrice Bossard. Sur ce point, le ministère de la justice a donné des instructions très claires. On trouvera toujours une exception : dans un tel cas, il faut écrire au procureur de la République, en donnant son identité et ses coordonnées, afin de révéler les faits. Les délais seront peut-être plus longs, mais cette lettre sera traitée par un substitut et une enquête sera ouverte. En tout état de cause, les directives de la Direction des affaires criminelles et des grâces, qui figurent dans une dépêche de 2013 sont très claires sur ce point : le principe est le recueil de la plainte ; si la personne ne souhaite pas déposer plainte et préfère une main courante, des protocoles ont été conclus pour définir dans quel cadre ces mains courantes doivent être portées à la connaissance du procureur de la République et de son équipe, afin que chaque situation de violences puisse recevoir une réponse, qu’elle soit sociale ou pénale.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Je souhaiterais vous soumettre un autre cas. Si une personne a été écartée du domicile conjugal pour violences au motif qu’elle fait l’objet d’un internement d’office, et qu’ensuite soumise à une obligation de soins, elle est accueillie dans un service de désintoxication dont elle s’échappe régulièrement afin de harceler son conjoint. Les services de gendarmerie ou le procureur doivent-ils être informés de ses permissions de sortie et peuvent-ils l’entendre à cette occasion ?
Mme Béatrice Bossard. Il m’est très difficile de vous répondre, car je ne connais pas la situation particulière que vous évoquez : il peut s’agir d’une hospitalisation d’office ou d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. Les permissions de sortie sont délivrées par l’autorité médicale. Pour que l’autorité judiciaire en soit informée, il faut que cette hospitalisation intervienne au titre d’une injonction de soins en exécution d’une peine. Quant à l’addiction, elle ne fait pas, a priori, obstacle à une audition. Si cette personne est convoquée dans le cadre d'une enquête pénale et que l’enquêteur ou le magistrat a des doutes sur ses capacités à disposer de ses facultés mentales, le procureur ordonnera un examen psychiatrique avant de l’entendre.
Mme la rapporteure. Un magistrat référent en matière de violences commises au sein du couple a-t-il été désigné dans toutes les juridictions ?
Mme Béatrice Bossard. Oui.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous vous posons cette question car, lors des débats préalables à l’adoption de la loi de 2010, l’hypothèse de la création d’une juridiction spéciale, réclamée par certaines associations, avait été évoquée, mais la majorité des députés n’y étaient pas favorables. Le magistrat référent peut-il être contacté ?
Mme Béatrice Bossard. Oui. Il est d’ailleurs souvent en relation avec la déléguée départementale aux droits des femmes.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous vous remercions d’avoir répondu à nos nombreuses questions. Je ne voudrais pas laisser croire que nous avons le sentiment que les choses n’avancent pas. J’ai suivi localement le circuit emprunté par les femmes victimes de violences et, partout, les associations d’aide aux victimes nous ont dit ressentir un changement depuis trois ans : la coordination des services s’est améliorée, la formation a progressé et l’on sait désormais poser aux femmes victimes de violences les questions qui les amèneront à se confier. Nous nous efforçons toujours d’améliorer la loi mais, sur le terrain, de manière générale, la prise en charge de ces femmes s’est améliorée
La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, a examiné le présent rapport, présenté par la rapporteure Mme Pascale Crozon, lors de sa réunion du mercredi 17 février 2016, sous la présidence de Mme Catherine Coutelle.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous examinons aujourd’hui un rapport important, par lequel nous avons souhaité tout d’abord faire le bilan de l’application de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, ainsi que de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Notre intention est d’améliorer un certain nombre de situations susceptibles de l’être dans le domaine des violences faites aux femmes, notamment la prise en compte de ces réalités par la société et par les divers professionnels – médecins, gendarmes, policiers, etc. – qu’une femme est susceptible d’appeler à l’aide, mais qui ne savent pas toujours entendre ces appels, car ceux-ci ne sont pas toujours explicites, incapables qu’elles sont parfois d’exprimer les violences terribles auxquelles elles sont soumises.
Après les travaux menés par la délégation sur le projet de loi pour une République numérique, notre rapporteure, Pascale Crozon, a entendu depuis la mi-janvier un certain nombre de magistrats, de juristes et d’associations sur les violences faites aux femmes. Si le rapport a été rédigé dans des délais à dessein restreints, je précise que, lorsque ce travail a commencé, nous avons été sollicitées par des associations, dont une association représentant des femmes en situation de handicap – qui font souvent l’objet d’un surcroît de violence – ainsi que l’association SOS les Mamans, qui a été auditionnée en février, de même que le Collectif national pour les droits des femmes. J’ai par ailleurs rencontré, de mon côté, une association qui reçoit des auteurs de violences – car il convient de les soigner aussi.
Pascale Crozon aurait souhaité approfondir les investigations relatives aux femmes immigrées victimes de violences, mais nous n’avons pas voulu reprendre l’intégralité des débats et des textes. Si j’ai lu dans la presse des contrevérités concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, la situation a bel et bien évolué, les textes sont appliqués, des politiques sont mises en œuvre, des associations nous indiquent disposer de davantage de moyens et d’outils réglementaires pour intervenir. La question, naturellement, demeure très vaste et il serait faux de prétendre que tout peut se régler en trois ou quatre ans.
Mme Pascale Crozon, rapporteure. Le rapport que je présente aujourd’hui s’inscrit dans un contexte particulier : celui de l’émotion soulevée par la condamnation de Jacqueline Sauvage par la cour d’assises de Blois. Devant cette situation qui nous a toutes et tous interpellés, la délégation a souhaité entendre des juristes et des acteurs de l’égalité entre les femmes et les hommes, afin de faire le point sur l’état de la législation relative à lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.
Notre ambition n’a pas été de refaire le procès, car nous respectons la chose jugée et ses attendus ; si nous ne pouvons que saluer la mesure d’humanité décidée par le Président de la République, nous ne nous sommes pas demandé si telle ou telle évolution de la loi aurait permis d’aboutir à un autre verdict.
Notre rapport a pour objet l’évaluation de la portée des mesures législatives adoptées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 – issue notamment des travaux de Guy Geoffroy et Danielle Bousquet —, renforcée par la loi du 4 août 2014, Najat Vallaud-Belkacem étant alors ministre des droits des femmes. Nous avons, d’autre part, étudié les principales propositions résultant du débat public sur l’aggravation des peines pour les crimes commis à raison du sexe et sur la réforme du régime de la légitime défense.
En ce qui concerne l’évaluation des actions mises en œuvre, la prise de conscience des pouvoirs publics doit être saluée : la lutte contre les violences faites aux femmes est devenue une priorité, et les campagnes régulièrement menées désormais – le rapport les évoque – contribuent à la libération de la parole des victimes.
Au titre des résultats concrets illustrant les progrès réalisés que le rapport mentionne, je relèverai certains éléments chiffrés.
Le nombre des appels reçus au numéro 3919 a plus que doublé, passant de 24 000 en 2013 à 50 000 en 2014, et l’augmentation se poursuit puisque 7 000 appels mensuels sont actuellement enregistrés.
Le recours au téléphone portable d’alerte pour femmes en grand danger s’est étendu : 400 sont utilisés aujourd’hui, et le nombre des « téléphones grand danger » est appelé à augmenter.
Le protocole local de plainte a été mis en œuvre dans 81 départements, et 300 points d’accueil de proximité ont été déployés.
L’hébergement des victimes de violence progresse : 1 147 places d’hébergement ont ainsi été créées depuis 2012.
En 2014, plus de 1 500 auteurs de violences ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de stages de responsabilisation.
Cependant, d’autres constats appellent à la vigilance : seulement 15 % des femmes victimes de violences conjugales portent plainte, et le délai moyen constaté avant la délivrance d’une ordonnance de protection demeure de trente-sept jours, alors qu’un rapport émanant du Conseil de l’Europe – à l’Assemblée parlementaire duquel je siège – préconise vingt-quatre heures, considérant qu’il s’agit d’une urgence. La marge de progrès est large, l’attente constituant un facteur de danger pour les femmes concernées.
Ces constats m’ont amenée à formuler un certain nombre de recommandations, dont l’édiction d’une nouvelle circulaire sur l’ordonnance de protection, afin de tirer les enseignements des inégalités d’application constatées selon les départements, ainsi que la mutualisation des meilleures pratiques. En ce qui regarde les moyens mis en œuvre, priorité doit être donnée à l’accueil et à l’accompagnement des victimes, ce qui implique la formation des intervenants, qu’il s’agisse d’améliorer la détection de ces situations et des phénomènes d’emprise, ou de mieux informer les victimes de leurs droits et de les accompagner dans leur démarche de dépôt de plainte. À cet effet, le rapport recommande que les feuilles de route ministérielles fixent des objectifs chiffrés du nombre de professionnels formés. Il est également préconisé de créer des outils de suivi de façon à mieux appréhender les phénomènes de déclassement ou de correctionnalisation par les procureurs.
L’un des axes majeurs de notre travail a porté sur l’encouragement à utiliser le terme de « féminicide » dans le vocabulaire courant et administratif, étant entendu qu’il ne s’agit pas dans mon esprit de caractériser ainsi tout meurtre commis sur une femme – qui peut être de nature crapuleuse ou terroriste –, mais le meurtre commis sur une femme à raison de son sexe. De fait, la question s’est posée de savoir si le « féminicide » devait constituer une circonstance aggravante, comme c’est aujourd’hui le cas pour les meurtres commis à raison de l’ethnie, la nation, la race, la religion, l’orientation ou l’identité sexuelle.
Ma position de départ était que, l’article 225-1 du code pénal reconnaissant aujourd’hui vingt-deux motifs de discrimination d’égale valeur en matière délictuelle, il serait logique de faire prévaloir le même principe en matière criminelle. Cependant, les auditions m’ont convaincue que cette approche n’est pas adaptée en cas de violences conjugales et intrafamiliales. Il est en effet plus difficile d’établir que le crime répond à une motivation sexiste de l’auteur des faits que de solliciter les circonstances aggravantes existantes, qui reposent sur des éléments objectifs lorsqu’ils visent le conjoint, le partenaire, l’ex-conjoint ou l’ex-partenaire. Ces dispositions sont au demeurant plus protectrices pour les femmes, qui constituent la grande majorité des victimes de ces violences. Aussi le rapport ne recommande-t-il pas une telle évolution.
Le délicat débat en cours sur la notion de légitime défense me conduit à souhaiter que nous n’instaurions pas sous le coup de l’émotion une « légitime défense différée », dont on mesure mal aujourd’hui la portée. Il ressort des auditions que la création d’un tel régime, établissant une présomption d’irresponsabilité pénale, ouvrirait la porte à un « permis de tuer » à la victime de violences conjugales. Il nous a cependant semblé qu’une éventuelle modification du droit devrait mieux prendre en considération la notion d’emprise, et mieux établir la proportionnalité entre l’agression et les moyens de défense employés, en retenant la notion de menaces et de violences antérieures d’une particulière gravité.
Nous souhaitons que cette recommandation puisse s’appuyer sur la remise par le ministère de la Justice, dans les meilleurs délais, d’une étude approfondie, chiffrée et différenciée en fonction des sexes, portant sur l’état de la jurisprudence en matière de légitime défense, et détaillant le nombre de cas concernant les femmes et les hommes, l’interprétation jurisprudentielle des critères légaux, les éléments de droit comparé, etc.
Je reconnais toutefois que la définition actuelle de la légitime défense est inadaptée aux situations de violences conjugales, car elle a été pensée par et pour des hommes, dont la principale préoccupation était la protection de leurs propriétés. Plutôt que de modifier cette notion, je propose d’introduire dans le droit celle d’emprise ; cela vaut pour le signalement de ces situations : doit-on pouvoir protéger, contre sa volonté — à l’instar de ce qui existe pour les mineurs —, une personne sous emprise ? Aujourd’hui, cela n’est pas clair et, en tout cas, ne suffit pas à justifier une ordonnance de protection.
Faut-il par ailleurs considérer cette emprise comme un facteur susceptible d’atténuer le discernement, ou d’excuser la disproportion entre la réponse et la menace ? C’est ce que fait la législation helvétique, qui s’abstrait de la logique binaire de la légitime défense, qui considère l’individu soit comme totalement irresponsable, soit totalement coupable avec des circonstances aggravantes, et qui aboutit – fût-ce de façon légitime – à ce que les peines prononcées paraissent incohérentes et parfois disproportionnées.
Le rapport recommande enfin que la délégation s’empare d’un sujet connexe que nous n’avons pu aborder, alors même qu’il est essentiel : celui de l’exposition spécifique des femmes étrangères aux violences conjugales et à la double peine administrative.
Mme Maud Olivier. Merci pour ce travail exécuté dans un délai très court.
Toutes les recommandations sont intéressantes, mais mon appréciation de la notion de légitime défense diverge de ce que préconise le rapport.
Je souhaiterais par ailleurs que l’ordre de ses préconisations soit revu, de façon à placer en tête la troisième, relative à la légitime défense, puis la septième, qui concerne l’ordonnance de protection, puis la huitième, qui a pour objet la médiation familiale, puis la quatrième, portant sur la formation, puis la neuvième, qui a trait aux politiques de juridiction volontaristes – le reste sans changement.
Mme la présidente Catherine Coutelle. L’ordre des recommandations n’implique pas une quelconque hiérarchisation : il se borne à reprendre celui de leur apparition au sein du rapport.
Mme Maud Olivier. Par ailleurs, la rédaction de la treizième proposition, relative aux femmes étrangères, me gêne, l’expression « exposition spécifique des femmes étrangères aux violences conjugales » pouvant donner à entendre que les conjoints étrangers sont nécessairement plus violents que les autres. Je suggère la rédaction suivante : « Évaluer les dispositions en matière de droit au séjour pour les femmes étrangères victimes de violences. » Nos travaux préparatoires à la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ont montré que la question primordiale était le droit au séjour.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Il est notoire que certaines femmes étrangères ont pour époux des Français qui les maltraitent, leur confisquent leurs papiers et les jettent à la rue.
Mme Maud Olivier. La rédaction de la troisième proposition, qui concerne la légitime défense, pourrait être améliorée. Je propose d’écrire ainsi le deuxième alinéa : « En redéfinissant la légitime défense pour que soit mieux appréciée l’éventuelle disproportion entre l’agression et les moyens de défense employés, compte tenu de l’existence de violences antérieures répétées et d’un danger de mort permanent. » S’il ne s’agit évidemment pas de délivrer un permis de tuer, il n’est pas non plus question d’établir un régime d’autodéfense différée : ce qui importe, c’est la prise en compte de l’antériorité des violences. C’est parce qu’elles se sentent en danger de mort que ces femmes peuvent être amenées à réagir violemment, et notre droit doit intégrer ce fait.
Mme la présidente Catherine Coutelle. La rédaction retenue est le fruit d’un long travail, sur lequel je ne souhaite pas que nous revenions, même si je comprends vos motivations. Votre proposition se réfère à la notion de légitime défense ; or, cette notion a pour effet d’écarter toute responsabilité. Or, dans le cas de Jacqueline Sauvage, par exemple, il y a bien homicide : cette personne a tué son mari en lui tirant dans le dos à un moment où il n’était pas directement menaçant – c’est du moins tout ce que nous avons pu comprendre par la presse. Il est donc difficile de légitimer cet acte en considérant que Mme Sauvage n’est pas coupable d’avoir tué son mari. S’il est malheureux que la notion de circonstance atténuante ait été supprimée du code pénal en 1994, je rappelle que les faits étaient passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, soit bien plus que la peine de dix ans qui a été effectivement prononcée – même si elle nous a paru injuste au regard de ce que la malheureuse avait vécu.
La délégation aux droits de femmes doit clairement affirmer qu’il n’y a pas lieu de créer un régime de légitime défense différée qui serait un permis de tuer ; le substitut Luc Frémiot nous l’a démontré. Nous pouvons aller dans votre sens en indiquant que nous interrogeons la définition et en suggérant un critère de proportionnalité ; de fait, nous ignorons si, au moment des faits, le mari de Mme Sauvage était particulièrement menaçant – elle reconnaît elle-même qu’il s’est agi d’une accumulation de violences dans la durée, qui a conduit à l’épilogue que l’on sait.
Nous demandons par ailleurs que le Gouvernement nous fournisse dans un délai raisonnable une étude sur le sujet, car nous ne disposons pas de la jurisprudence : nous ignorons combien de femmes ou d’hommes sont condamnés pour de telles affaires ; une vision d’ensemble nous fait défaut.
Mme la rapporteure. Cette question figure dans un chapitre du code pénal, qui traite des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité.
Mme Maud Olivier. Je m’interroge par ailleurs sur le terme « absence de disproportion » dans le troisième alinéa de la troisième proposition : à mes yeux, il ne peut exister qu’une éventuelle disproportion entre l’agression et les moyens de défense employés, qu’il convient de mieux apprécier dans des cas tels que celui de Jacqueline Sauvage.
Mme la rapporteure. Nous nous sommes fondées sur la rédaction actuelle du premier alinéa de l’article 122-5 du code pénal, aux termes duquel : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
Mme la présidente Catherine Coutelle. C’est la formulation que nous avons reprise : quand bien même sa lecture peut surprendre, nous nous y sommes conformées.
Mme Maud Olivier. L’expression « absence de disproportion » me semble peu claire : ne vaudrait-il pas mieux écrire « absence de proportion » ? La formulation « éventuelle disproportion » conserve cependant ma préférence.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous pouvons l’écrire entre guillemets afin de signifier que la rédaction est celle du code pénal.
Mme Maud Olivier. Il faut par ailleurs souligner que c’est le danger de mort qui conduit à des réactions d’une telle violence.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Nous pourrions recourir à l’expression : « menaces d’une particulière gravité pouvant entraîner la mort ». Le danger ne s’exprime pas toujours par des menaces de mort. Mme Lange, en 2009, était sous la menace d’un danger permanent qui l’a conduite à tuer son mari alors qu’il tentait de l’étrangler.
Mme Maud Olivier. Le terme « d’une particulière gravité » me paraît moins clair que l’expression « danger de mort ».
Mme la présidente Catherine Coutelle. La rédaction pourrait alors être la suivante : « l’existence de violences antérieures répétées, de menaces d’une particulière gravité et d’un danger de mort. »
Mme Maud Olivier. Je rappelle que 41 % des femmes concernées ont porté plainte. Le danger de mort était bien réel.
Mme la rapporteure. Je persiste à penser que nous devons maintenir au premier rang la proposition relative à l’usage du terme « féminicide », qui constitue l’un des deux axes de réflexion ayant présidé à la rédaction du rapport ainsi qu’au choix des personnes auditionnées. En 2014, la question avait d’ailleurs été évoquée dans le cadre d’un amendement et il avait été prévu de conduire une réflexion afin d’étudier comment cette notion pourrait être intégrée dans notre droit ; aujourd’hui, nous rencontrons toujours de grandes difficultés à faire accepter ce terme dans la langue française… Nous souhaitons donc que son utilisation soit encouragée dans le vocabulaire courant et administratif.
Il nous a été dit qu’il n’existait pas de réponse pour la légitime défense en France, mais que des solutions avaient été trouvées en Suisse et au Canada. La rédaction canadienne, très complexe, semble difficilement transposable en l’état dans notre droit ; c’est pourquoi une étude comparée des dispositions existant en matière de féminicide nous permettrait de mieux apprécier les conditions dans lesquelles ce terme pourrait être utilisé en France. Cette demande fait l’objet de notre deuxième proposition, et je préférerais donc qu’elle soit maintenue à cette place.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Dans ces conditions, la septième proposition, relative à l’ordonnance de protection, deviendrait la quatrième, et la huitième, qui concerne la médiation familiale, deviendrait la cinquième. La quatrième, qui a trait à la formation, viendrait à la sixième place, et la neuvième, qui préconise la mise en œuvre de politiques de juridictions volontaristes, à la septième place.
Par ailleurs, la formulation de la dernière proposition au sujet des femmes étrangères serait modifiée afin de lever tout risque d’ambiguïté.
Enfin, je souhaiterais que, dans la conclusion du rapport, les travaux menés par la Délégation aux droits des femmes soient mentionnés, puisque, lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile, Maud Olivier avait rendu un rapport au nom de notre délégation et que, depuis, les violences exercées sur les femmes étrangères sont mieux prises en compte pour l’attribution du droit d’asile.
Mme la rapporteure. J’ai rencontré des associations qui m’ont indiqué que des aménagements ont été apportés au bénéfice des demandeuses d’asile se trouvant dans le Calaisis, car elles sont singulièrement victimes de violences : elles seront ainsi mieux protégées à l’avenir.
Mme la présidente Catherine Coutelle. Je tiens à saluer le travail de grande qualité réalisé dans un laps de temps très restreint, et malgré un contexte passionnel et d’emballement médiatique. Il est bon que notre délégation ait pu prendre le temps de conduire une réflexion sereine et formulé des propositions après avoir entendu des points de vue très différents.
La Délégation adopte le rapport d’information ainsi que les recommandations présentées plus haut (55).
– ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA DÉLÉGATION ET PAR LA RAPPORTEURE 109
– ANNEXE 2 : PRINCIPALES DONNÉES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES 111
– ANNEXE 3 : 2012-2015, UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 123
ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA DÉLÉGATION ET PAR LA RAPPORTEURE
1. Personnes entendues par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (56)
● Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF)
– Mme Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la MIPROF, coprésidente de la commission « Violences de genre » du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), et responsable de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis.
– Mme Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la MIPROF, coprésidente de la commission « Violences de genre » du HCEfh.
(mardi 12 janvier 2016)
● Conseil économique, social et environnemental (CESE)
– Mme Pascale Vion, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et auteure du rapport « Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses » (CESE, novembre 2014), vice-présidente de la Mutualité Française.
(mardi 12 janvier 2016)
● Associations
– Mme Maryvonne Bin-Heng, présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF).
– Mme Dominique Guillien, vice-présidente de la FNSF.
– Mme Priscillia Fert, chargée de mission justice à la FNSF.
– Mme Eléonore Stévenin-Morguet, membre du conseil d’administration de l’association Osez le féminisme.
– Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV).
– Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT).
(mardi 19 janvier 2016)
● Avocat.e.s, magistrat et juristes
– Mme Diane Roman, professeure de droit public à l’université François Rabelais de Tours.
– Mme Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris.
– M. Edouard Durand, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, secrétaire général de la première présidence.
– Mme Catherine Le Magueresse, juriste et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT).
– M. Antoine Fabre, avocat spécialisé en droit pénal.
(mardi 26 janvier 2016)
● Ministère de la justice
– Mme Béatrice Bossard, magistrate, sous-directrice de la justice pénale générale à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice.
– Mme Ombeline Mahuzier, cheffe du pôle de l’évaluation des politiques pénales.
– M. Francis Le Gunehec, magistrat, chef du bureau de la législation pénale générale.
(mardi 9 février 2016)
2. Personnes entendues par la rapporteure
● Association SOS Les Mamans
– Mme Carole Lapanouse, présidente.
– Mme Lisa Novi, professeure à Nice.
– Mme Claire Lallemand, enseignante.
– Mme Charlotte Posse, avocate à Paris.
(mardi 9 février 2016)
● Collectif national pour les droits des femmes (CNDF)
– Mme Suzy Rojtman, porte-parole du CNDF.
– Mme Isabelle Thieuleux, avocate.
(mercredi 10 février 2016)
● Magistrat
– M. Luc Fremiot, substitut général exerçant les fonctions d’avocat général près les cours d’assises du Nord et du Pas-de-Calais.
(mercredi 10 février 2016)
ANNEXE 2 :
PRINCIPALES DONNÉES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES
A. LES ENQUÊTES GÉNÉRALES SUR LES VIOLENCES ENVEFF ET VIRAGE. 111
1. La grande enquête sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF, 2000).. 111
2. Le lancement d’une nouvelle enquête sur les violences de genre (VIRAGE, 2016) 113
B. LES VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES 114
1. Les violences physiques et sexuelles subies par les femmes au sein du couple : nombre de victimes et caractéristiques des agressions (2010-2015) 114
2. Les démarches entreprises par les victimes auprès des professionnel.le.s (2010-2015) 116
3. Les morts violentes au sein des couples en 2014 117
4. Les faits de violences par conjoint ou ex-conjoint constatées par les services de police et de gendarmerie de novembre 2014 à octobre 2015 118
5. Les condamnations pour violences au sein des couples en 2014 119
C. LES VIOLS, TENTATIVES DE VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES 120
1. Les viols et tentatives de viol : nombre de victimes, caractéristiques des agressions et démarches auprès des professionnel.le.s (CVS, INSEE-ONDRP, 2010-2015) 120
2. Les faits de violences sexuelles constatés par les services de politice et de gendarmerie de novembre 2014 à octobre 2015 121
3. Les condamnations pour viols et agressions sexuelles en 2014 122
A. LES ENQUÊTES GÉNÉRALES SUR LES VIOLENCES ENVEFF ET VIRAGE
Insultes, menaces, harcèlement sexuel, violences conjugales, viol, prostitution… Les violences de genre sont protéiformes et de nombreuses femmes en feront l’expérience au cours de leur vie. Pourtant, jusqu’au début des années 2000, seules les violences physiques étaient plus ou moins repérées et l’on parlait d’ailleurs essentiellement de « femmes battues ». L’enquête ENVEFF, lancée en 2000 (1), a permis de montrer l’ampleur du phénomène et de mettre au jour l’importance des violences conjugales et du viol conjugal, ainsi que leur présence dans tous les milieux sociaux, mais aussi l’existence de violences psychologiques et de violences commises dans l’espace public.
L’enquête VIRAGE (2), dont le déroulement se poursuit en 2016, permettra d’actualiser la connaissance des violences faites aux femmes.
Commandée par le secrétariat d’État aux Droits des femmes, l’enquête portait sur toutes les formes de violences dans l’espace public, au travail et au sein des couples. Réalisée par téléphone de mars à juillet 2000 auprès de 6 970 femmes âgées de 20 à 59 ans, elle constitue la base de référence de tout travail portant sur les violences subies par les femmes. Les chiffres qui en sont issus constituent encore aujourd’hui la référence dans le débat public sur les violences conjugales.
En distinguant bien la violence au sein du couple du conflit conjugal qui est, lui, interactif et met en présence deux sujets sur un plan d’égalité, ainsi que l’a souligné Édouard Durand lors de son audition par la Délégation, le constat de l’enquête était le suivant : la violence dont sont victimes les femmes au sein du couple est à la fois malheureusement fréquente et grave, puisque 10 % des femmes étaient victimes de violences selon cette enquête, et qu’une femme décédait tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint, compagnon ou « ex ». Ces deux statistiques témoignent d’une même réalité, celle d’une violence grave et ordinaire subie par les femmes.
PROPORTION DE FEMMES AYANT DÉCLARÉ AVOIR SUBI DES VIOLENCES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS SELON L’ÂGE EN 2000
(en pourcentage)
Type de violences |
20-24 ans |
25-34 ans |
35-44 ans |
45-59 ans |
Ensemble |
Dans l’espace public* |
(n=717) |
(n=1 934) |
(n=2 122) |
(n=2 197) |
(n=6 970) |
Insultes et menaces verbales |
24,9 |
15,2 |
11,7 |
8,6 |
13,2 |
Agressions physiques |
2,8 |
1,6 |
1,2 |
1,7 |
1,7 |
Être suivie |
12,4 |
5,8 |
4 |
2,8 |
5,2 |
Exhibitionnisme |
8,9 |
3,3 |
1,7 |
1,2 |
2,9 |
Avances et agressions sexuelles |
6,5 |
2,6 |
0,9 |
0,5 |
1,9 |
Indice global de harcèlement sexuel (1) |
21,9 |
9,9 |
5,9 |
3,9 |
8,3 |
Au travail** |
(n=335) |
(n=1 409) |
(n=1 596) |
(n=1 408) |
(n=4 748) |
Insultes et menaces verbales |
11,7 |
10,1 |
8,8 |
6,2 |
8,5 |
Pressions psychologiques |
20,2 |
18,6 |
15,2 |
15,7 |
16,7 |
– dont harcèlement moral (2) |
5,2 |
4,7 |
3,6 |
3,1 |
3,9 |
Destruction du travail, de l’outil de travail |
3,6 |
2,8 |
2,3 |
1,3 |
2,2 |
Agressions physiques |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
Harcèlement sexuel |
4,3 |
2,8 |
1,9 |
0,7 |
1,9 |
Violences conjugales*** |
(n=464) |
(n=1 707) |
(n=1 872) |
(n=1 865) |
(n=5 908) |
Insultes et menaces verbales |
6,1 |
4,1 |
4,3 |
3,9 |
4,3 |
Chantage affectif |
2,7 |
1,4 |
2,3 |
1,6 |
1,8 |
Pressions psychologiques |
51,2 |
40,1 |
35,4 |
32,6 |
37 |
– dont harcèlement moral |
12,1 |
8,3 |
7,5 |
6,5 |
7,7 |
Agressions physiques |
3,9 |
2,5 |
2,5 |
2,2 |
2,5 |
Viols et autres pratiques sexuelles imposées |
1,2 |
0,9 |
1 |
0,6 |
0,9 |
Indice global de violence |
15,3 |
11 |
10 |
8 |
10 |
(1) Avoir, au moins une fois, été suivie ou en présence d’un exhibitionniste, ou avoir subi des avances ou une agression sexuelle.
(2) Parmi les trois composantes de cet indice (brimades, critiques ou dénigrement, mise à l’écart), l’une au moins a une occurrence.
Champ : * ensemble des femmes de 20 à 59 ans ; ** femmes de 20 à 59 ans ayant exercé une activité professionnelle au cours des 12 mois précédant l’enquête ; *** femmes de 20 à 59 ans ayant eu une relation de couple au cours des 12 mois précédant l’enquête.
Source : enquête ENVEFF (2000)
En extrapolant les résultats de cette enquête à la population française, le nombre de femmes exposées à la violence de leur conjoint pouvait être estimé à environ 1,3 million. Certaines femmes subissent des violences cumulées, à la fois physiques, sexuelles et psychologiques.
L’enquête montre que tous les milieux sociaux sont concernés par le phénomène, même si la désaffiliation sociale, au sens de fragilisation des liens professionnels et familiaux, semble être un facteur aggravant. Les disparités entre régions et entre zones rurales et urbaines sont faibles. Cependant, l’accès au droit peut se révéler plus problématique dans les zones rurales.
Les circonstances du passage à l’acte ont également été explorées. Le premier facteur déterminant dans le déclenchement des violences est celui de la première grossesse. L’alcool est également un élément important du passage à l’acte. Les violences ne cessent pas avec la séparation du couple, au contraire, puisque les violences commises par les « ex » constituent un nombre non négligeable des faits commis à l’encontre des femmes.
L’ENVEFF cherchait aussi à identifier les formes de violences psychologiques par des questions portant sur des paroles ou des attitudes. Selon l’enquête, environ 8 % des femmes interrogées étaient en situation de harcèlement psychologique, alors que les agressions physiques concernaient 2,5 % d’entre elles et les agressions sexuelles au sein du couple 1 % environ. Les violences psychologiques s’accompagnent le plus souvent d’un phénomène d’emprise caractérisé par une inversion de la culpabilité et l’incapacité à se rendre compte de la gravité de la situation.
Le coût annuel des violences en France a été estimé à 2,5 milliards d’euros dans le cadre du projet européen Daphné 2006.
La mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, constituée en décembre 2008 au sein de l’Assemblée nationale, concluait, dans son rapport de juillet 2009, à la nécessité d’une nouvelle enquête ENVEFF, qui fut pionnière.
En 2011, la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe (57), a enjoint les États signataires à mesurer les violences liées aux rapports de genre et à mieux évaluer les conséquences sur les victimes.
À l’écoute de ce besoin de connaissances, une équipe de chercheur.se.s s’est constituée au sein de l’unité de recherche « Démographie, genre et sociétés » de l’Institut national des études démographiques (INED), afin de réaliser une nouvelle enquête plus de quinze ans après l’ENVEFF, avec le soutien financier des pouvoirs publics. Cette enquête est coordonnée par Mme Christelle Hamel, sociologue.
Intitulé « Violences et rapports de genre (VIRAGE) : contexte et conséquences des violences subies par les femmes et par les hommes », ce projet entend actualiser et approfondir la connaissance statistique des violences faites aux femmes et prévoit d’étendre son champ d’investigation à la population masculine. Elle concernera 35 000 personnes (17 500 femmes et 17 500 hommes) âgées de 20 à 69 ans.
L’enquête devra décrire la complexité du phénomène en considérant les contextes où la violence se produit – famille, travail, espace public – et les formes hétérogènes qu’elle prend – violence verbale, physique, sexuelle… Elle entend distinguer les violences subies selon la nature, la fréquence, le contexte et les conséquences des actes subis. La construction d’une typologie permettra de distinguer la situation des victimes selon la gravité des situations subies et notamment, d’établir dans quelle mesure les violences subies par les personnes des deux sexes se ressemblent ou au contraire se distinguent, de façon à adapter la prévention aux réalités vécues par chacun des deux sexes.
L’enquête entend aussi estimer le nombre de victimes de violences physiques et sexuelles au travail et étudier les liens entre harcèlement moral et harcèlement sexuel.
B. LES VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES
Sont présentés ci-dessous des extraits d’une étude publiée par la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la traite des êtres humains (MIPROF), en novembre 2015 (58), pour ce qui concerne les cinq points suivants.
1. Les violences physiques et sexuelles subies par les femmes au sein du couple : nombre de victimes et caractéristiques des agressions (2010-2015)
Les statistiques présentées sont des estimations calculées en cumulant les résultats de 6 années (2010 à 2015) de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » (CVS) – INSEE et ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales). L’enquête CVS est une enquête de victimation en population générale. Elle interroge un échantillon représentatif de la population française sur les violences subies. Les résultats doivent donc être vus comme des ordres de grandeur s’approchant de la réalité vécue par les femmes mais s’écartant légèrement des résultats qu’aurait donnée une interrogation exhaustive de la population. La notion d'intervalle de confiance permet de donner une idée de cet écart qui dépend de la taille de l’échantillon enquêté et de la prévalence du phénomène dans la population.
Les violences entre conjoints et ex-conjoints prennent des formes variées. Elles sont physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, administratives, économiques… Elles peuvent être exercées de manière isolée ou combinée. Les développements ci-après se concentrent sur les violences physiques et sexuelles et présentent une estimation du nombre de femmes victimes de ces violences sur un an.
● Chaque année, en moyenne, 223 000 femmes déclarent subir des violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint.
En moyenne, chaque année, 1 % des femmes de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, soit près de 223 000 femmes, déclarent être victimes de violences conjugales physiques et/ou sexuelles. Ces résultats s’appuient sur les déclarations des faits subis au cours de l’année civile précédant l’enquête. Ils ne tiennent pas compte des faits de violences verbales ou psychologiques (menaces, dénigrement, chantage affectif…) non enregistrés dans l’enquête CVS. L’auteur de ces violences conjugales est le conjoint, marié ou non, ou l’ex-conjoint au moment des faits. Cette estimation ne représente cependant qu’une partie de la réalité des violences conjugales en France, d’une part du fait de la limitation de champ de l’enquête, d’autre part du fait que certaines femmes ne souhaitent pas signaler ces faits dans l’enquête et ce, malgré le protocole mis en place pour préserver la confidentialité des données. Malgré les difficultés pour capter et chiffrer les violences conjugales, l’enquête permet cependant, grâce aux déclarations recueillies, de caractériser le phénomène et ses conséquences. La violence conjugale touche des femmes tous les âges.
● Répartition par forme de violences : davantage de violences physiques que sexuelles
Parmi ces victimes, deux sur dix ont déclaré des violences sexuelles, c’est-à-dire que leur conjoint ou leur ex-conjoint leur ont fait subir des attouchements ou un rapport sexuel non désiré en utilisant la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Plus de sept sur dix ont subi des violences physiques (gifles, coups). Enfin, une sur dix a subi à la fois des faits de violences sexuelles et d’autres faits de violences physiques.
EFFECTIFS ET TAUX MOYENS DE FEMMES ÂGÉES DE 18 À 75 ANS VICTIMES DE VIOLENCES PHYSIQUES ET/OU SEXUELLES DE LA PART DE LEUR CONJOINT OU EX-CONJOINT AU COURS DE L’ANNÉE PRÉCÉDANT L’ENQUÊTE
Nombre de femmes victimes sur un an |
En % de la population de référence totale |
Répartition par forme des violences | |
Victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part du conjoint ou ex-conjoint |
223 000 |
1,0 |
100 % |
… dont victimes de violences uniquement physiques … dont victimes de violences uniquement sexuelles … dont victimes de violences physiques ou sexuelles |
164 000 33 000 26 000 |
0,7 0,2 0,1 |
74 % 15 % 12 % |
Champ : femmes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en métropole. Intervalle de confiance : le nombre de femmes victimes de violences conjugales chaque année a 95 % de chance de se trouver compris entre 212 000 et 234 000.
Source : CVS 2010-2015-INSEE-ONDRP (MIPROF, novembre 2015)
● Dans 70 % des cas, les victimes ont subi des violences répétées
Les femmes qui sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles, déclarent souvent avoir subi plusieurs fois ce type de violences au cours des deux dernières années. Ainsi, sept sur dix déclarent avoir connu plusieurs épisodes de violences conjugales. Les faits de violences sexuelles sont plus souvent répétés que les faits de violences physiques.
FRÉQUENCES DES VIOLENCES SUBIES PAR LES FEMMES VICTIMES AU COURS DES DEUX ANNÉES PRÉCÉDANT L’ENQUÊTE
(en effectif et en pourcentage)
Ensemble |
Faits multiples |
Fait unique | ||
TOTAL |
223 000 100 % |
155 000 70 % |
68 000 30 % | |
– Violences physiques |
164 000 100 % |
103 000 63 % |
61 000 37 % | |
– Violences sexuelles |
33 000 100 % |
26 000 79 % |
7 000 21 % | |
– Violences physiques et sexuelles |
26 000 100 % |
26 000 100 % |
– |
Champ : femmes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en métropole.
Ce tableau présente la fréquence des violences au cours des deux années précédant l’enquête subies par les femmes ayant connu ce type de violence l’année précédant l’enquête.
Source : CVS 2010-2015-INSEE-ONDRP
Les chiffres présentés ne tenant pas compte des violences verbales et psychologiques, un fait unique ne signifie pas forcément que la victime n’a pas subi d’autres formes de violences.
● Des conséquences physiques et psychologiques
Six victimes de violences conjugales sur dix déclarent avoir subi des blessures physiques, qu’elles soient visibles ou non, et près de sept sur dix affirment que ces violences ont causé des dommages psychologiques plutôt ou très importants. Plus de la moitié des femmes ayant subi des violences conjugales ont déclaré que ces violences avaient entraîné des conséquences, des perturbations dans leur vie quotidienne, notamment dans leurs études ou leur travail.
BLESSURES ET CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES DES VIOLENCES PHYSIQUES ET/OU SEXUELLES COMMISES PAR LE CONJOINT OU L’EX-CONJOINT
Effectif |
Pourcentage | |
Nombre total de femmes victimes par an |
223 000 |
100 % |
– dont ayant des blessures physiques visibles et/ou non visibles |
134 000 |
60 % |
– dont ayant des dommages psychologiques plutôt ou très importants |
151 000 |
68 % |
– dont l’agression a entraîné des conséquences, des perturbations dans la vie quotidienne, notamment dans les études ou le travail |
121 000 |
54 % |
Champ : femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en métropole.
Lecture : sur les 216 femmes déclarant avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, 151 000 soit 68 % déclarent que ces violences leur ont causé des dommages psychologiques plutôt ou très importants.
Source : CVS 2010-2015 INSEE –ONDRP (MIPROF, novembre 2015)
2. Démarches entreprises par les victimes auprès des professionnel.le.s
Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » – INSEE – ONDRP – 2010-2015.
● 14 % des femmes victimes de violences conjugales physiques et/ou sexuelles déclarent avoir porté plainte.
On estime que parmi les victimes de violences conjugales, seule une femme sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie, 14 % ont déposé plainte et 8 % ont déposé une main-courante.
DÉMARCHES ENTREPRISES AUPRÈS DES FORCES DE SÉCURITÉ PAR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES PHYSIQUES ET/OU SEXUELLES DE LA PART DE LEUR CONJOINT OU EX-CONJOINT
Pourcentage de femmes * | |
S’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie |
25 % |
…. Et a déposé plainte |
14 % |
…..et a fait une déclaration de main courante |
8 % |
Champ : femmes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en métropole (*).
Source : CVS 2010-2015-INSEE-ONDRP
Les victimes se rendent moins souvent à la gendarmerie ou au commissariat lorsqu’elles vivent toujours avec leur conjoint : c’est le cas de deux femmes sur dix, contre cinq sur dix lorsqu’elles ne vivent plus avec l’auteur des faits.
● Les professionnel.le.s de santé, premier recours des femmes victimes de violences conjugales
Plus des deux-tiers des victimes habitent toujours avec leur conjoint. Parmi ces dernières, 23 % ont consulté un médecin, 19 % un psychiatre ou un psychologue et 19 % en ont parlé aux services sociaux. Certaines ont pu consulter plusieurs de ces services. Enfin, 10 % ont appelé un numéro vert et une sur dix a rencontré des membres d’une association d’aide aux victimes.
Un peu plus de la moitié des victimes n’ont fait aucune des démarches précitées.
DÉMARCHES ENTREPRISES PAR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES PHYSIQUES ET/OU SEXUELLES DE LA PART DE LEUR CONJOINT COHABITANT AU MOMENT DE L’ENQUÊTE
Parmi les 152 000 femmes victimes vivant avec l’auteur des faits au moment de l’enquête |
% |
A été vue par un médecin à la suite d’une agression |
23 |
A consulté un psychiatre, un psychologue |
19 |
A parlé de sa situation aux services sociaux |
19 |
S’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie |
17 |
A appelé un numéro vert, un service téléphonique d’aide aux victimes |
10 |
A rencontré des membres d’une association d’aide aux victimes |
9 |
N’a fait aucune des démarches citées ci-dessus |
54 |
Champ : femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en métropole.
Lorsque la victime a connu plusieurs faits de violences durant l’année précédant l’enquête, les résultats concernant les démarches entreprises portent sur la description d’un seul de ces évènements.
Source : CVS 2010-2015-INSEE-ONDRP
3. Les morts violentes au sein du couple en 2014
Source : étude nationale sur les morts violentes au sein de couple (année 2014), délégation aux victimes (DAV), ministère de l’intérieur.
Les femmes représentent 81 % des victimes d’homicides au sein de couples officiels et non-officiels.
En 2014, 118 femmes et 25 hommes sont décédé.e.s, victimes de leur partenaire ou ex-partenaire de vie officiel. On compte également 16 de ces homicides commis sur des femmes et 6 sur des hommes par leur partenaire dans un couple non-officiel. Au total, le nombre de femmes tuées s’élève donc à 134 et le nombre d’hommes à 31. Parmi les hommes tués, deux l’ont été au sein de couples homosexuels.
En moyenne, 1 femme décède tous les 2,7 jours. Pour les victimes hommes, cette fréquence s’élève à 1 tous les 11,7 jours, victime de sa/son (ex)-compagne/compagnon.
En 2014, 35 enfants ont été victimes des violences au sein du couple : 7 ont été tués en même temps que l’un de leurs parents et 28 dans le cadre de violences conjugales, notamment liées à un refus de la séparation sans que l’autre parent ne soit tué.
On compte également 12 homicides commis sur des « rivaux » réels ou fantasmés, ainsi que 11 victimes collatérales, hors enfants mineurs (enfants majeurs, beaux-parents, cousins, nouveaux compagnons, tiers).
Au total, on dénombre donc 223 homicides liés aux violences au sein du couple en 2014. Suite à ces faits, 60 auteur.e.s se sont suicidé.e.s, ce qui porte à 283 le nombre total de décès liés aux violences au sein du couple.
Les résultats des enquêtes des cinq dernières années ne permettent pas de conclure à une tendance à la baisse ou à la hausse de ces violences.
RÉCAPITULATIF DU NOMBRE D’HOMICIDES LIÉS AUX VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 2010 – 2014
20132014 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
Victimes femmes |
134 |
129 |
166 |
- |
157 |
– dont couples officiels (concubins, époux, pacsés) |
118 |
121 |
148 (3) |
122 (3) |
146 |
– dont couples non-officiels (petits-amis, amants, relations épisodiques…) |
16 |
9 |
18 |
- |
11 |
Victimes hommes |
31 |
30 (2) |
31 |
- |
33 |
– dont couples officiels (concubins, époux, pacsés) |
25 (1) |
25 |
26 |
24 |
28 |
– dont couples non-officiels (petits-amis, amants, relations épisodiques…) |
6 |
5 |
5 |
- |
5 (5) |
Victimes enfants |
35 |
33 |
25 |
24 |
12 |
– dont enfants tués en même temps que l’autre parent |
7 |
13 |
9 |
11 |
6 |
– dont enfants tués dans le cadre de violences conjugales sans que l’autre parent ne soit tué |
28 |
20 |
16 |
13 |
6 |
Victimes « collatérales » hors enfants mineurs |
11 |
8 |
11 |
6 |
4 |
Homicides de rivaux |
12 |
11 |
14 |
13 |
17 |
TOTAL VICTIMES D’HOMICIDES |
223 |
213 |
247 |
201 (4) |
223 |
Suicide des auteur.e.s |
60 |
65 |
67 |
69 |
60 |
TOTAL DÉCÈS |
283 |
278 |
314 |
270 |
283 |
(1) dont deux au sein d’un couple homosexuel
(2) dont quatre au sein d’un couple homosexuel
(3) dont un a sein d’un couple homosexuel
(4) les 12 homicides au sein de couple non officiels pour lesquels l’enquête ne donne pas le sexe de la victime ont été ajoutés
(5) Ces 5 homicides ont un lieu au sein de couples homosexuels
Source : étude nationale sur les morts violentes au sein de couple, année 2014, Délégation aux victimes (DAV), ministère de l’intérieur (MIPROF, novembre 2015)
4. Les faits de violences par conjoint ou ex-conjoint constatés par les services de police et de gendarmerie sur un an (novembre 2014 – octobre 2015)
Source : SSMSI - base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
Les nouveaux outils de recueil de données mis en place par la police et la gendarmerie nationales permettent de connaître pour la France métropolitaine le nombre des crimes et délits enregistrés pour des violences par conjoint ou ex-conjoint (plaintes, signalement, faits constatés suite à une intervention, etc.) par l’ensemble des forces de sécurité (police nationale, gendarmerie nationale, préfecture de police de Paris).
Au total, sur un an, 72 873 faits de violences commis contre des femmes par leur conjoint ou ex-conjoint ont été recensés par les forces de sécurité en France métropolitaine
Les données recueillies par les services de police et de gendarmerie permettent de connaître le nombre de victimes ayant déposé une plainte ou étant concernées dans une affaire ayant fait l’objet d’une enquête de police relative à des faits de violences entre conjoints. La conjugalité est ici envisagée au regard de la définition qui en est donnée dans le code pénal.
Sur un an, de novembre 2014 à octobre 2015, 82 635 faits de violences entre conjoint ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie. Dans 88 % des cas, la victime est une femme. Il s’agit dans 97 % des cas de coups et blessures volontaires. Ces statistiques ne prennent pas en compte les homicides. Les actes commis par le conjoint représentent 54 % de l’ensemble des faits de coups et blessures (hors vols avec violence) commis contre des femmes enregistrés par les services de sécurité en un an.
Il est possible que le taux de plainte varie selon la nature des violences commises. En effet, les violences physiques peuvent être davantage reportées que les violences verbales, sexuelles ou psychologiques qui sont plus difficilement identifiables par les victimes ou qui font l’objet d’un tabou social persistant.
FAITS DE VIOLENCES ENTRE CONJOINTS ENREGISTRÉS PAR LES FORCES DE SÉCURITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE DE NOVEMBRE 2014 ÀOCTOBRE 2015
Nombre de victimes |
Nombre de femmes victimes |
% de femmes parmi les victimes | |
Tentatives d’homicides |
90 |
75 |
83 % |
Coups et blessures volontaires |
80 393 |
70 663 |
88 % |
Viols conjugaux |
1 714 |
1 703 |
99 % |
Harcèlement sexuel et autres agression sexuelles |
438 |
432 |
99 % |
Total |
82 635 |
72 873 |
88 % |
Champ : victimes majeures et mineures, France métropolitaine, en date d’enregistrement.
Source : SSMI – base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie (ONVF, novembre 2015)
5. Les condamnations pour violences au sein du couple en 2014
Source : ministère de la justice – SDSE – exploitation du casier judiciaire national (données provisoire, 2014).
Les statistiques recueillies par le ministère de la justice permettent de connaître, chaque année, le nombre de personnes condamnées pour des faits de violences sur leur conjoint ou ex-conjoint en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer. Ces statistiques ne permettent pas de disposer de données sur les victimes.
Au total, 15 982 hommes et 561 femmes ont été condamné.e.s en 2014 pour des crimes ou des délits sur leur conjoint ou ex-conjoint en 2014. En 2014, 16 543 condamnations ont été prononcées pour des crimes ou des délits commis sur le conjoint ou l’ex-conjoint. 97 % de ces condamnations ont été prononcées contre des hommes.
Selon le code pénal, la qualité de conjoint ou d’ex-conjoint constitue une circonstance aggravante notamment pour : les atteintes volontaires à la vie ; les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (tortures, actes de barbarie, violences, menaces) ; les agressions sexuelles, dont les viols. L’ITT (incapacité totale de travail) est une notion pénale qui participe à la qualification des faits, à l’orientation de la procédure et à la détermination de la peine encourue. Elle correspond à la durée pendant laquelle la victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante. Les violences intra familiales sont des délits qu’elles aient ou non donné lieu à une ITT et quelle que soit la durée de l’ITT.
CONDAMNATIONS POUR CRIMES ET DÉLITS SUR CONJOINT ET CONCUBIN EN 2014
SELON LE SEXE DE L’AUTEUR (EFFECTIFS)
Hommes |
Femmes |
Total | |
CRIMES, dont : |
79 |
9 |
88 |
Homicides par conjoint et concubin |
32 |
3 |
35 |
Viols sur conjoint ou concubin |
38 |
- |
38 |
Autres crimes sur conjoint ou concubin |
9 |
6 |
15 |
DÉLITS, dont : |
15 903 |
552 |
16 455 |
Agressions sexuelles par conjoint ou concubin |
126 |
- |
126 |
Violences avec ITT > à 8 jours |
1 093 |
36 |
1 129 |
Violences avec ITT < à 8 jours |
8 855 |
265 |
9 120 |
Violences sans incapacité |
5 154 |
238 |
5 392 |
Menaces de mort |
464 |
9 |
473 |
Harcèlement et autres menaces |
211 |
4 |
215 |
TOTAL |
15 982 |
561 |
16 543 |
« Autres crimes » regroupe les violences et administrations de substances nuisibles ayant entrainé la mort ou une infirmité permanente, les tortures et actes de barbarie.
Source : ministère de la Justice – SDSE – exploitation du casier judiciaire national – données provisoires 2014
C. LES VIOLS, TENTATIVES DE VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES
1. Viols et tentatives de viol : nombre de victimes et caractéristiques des agressions
Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » (CVS) INSEE – ONDRP, 2010-2015.
● Chaque année, en moyenne, 84 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol.
En moyenne, chaque année, près de 0,2 % des personnes de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, soit environ 98 00 personnes, déclarent avoir été victimes d’un viol ou d’une tentative de viol. Les femmes sont plus souvent victimes de ce type de violences que les hommes. Environ 0,4 % des femmes de 18 à 75 ans, soit 84 000 environ, ont déclaré avoir été victimes de ces faits l’année précédant l’enquête, contre 0,1 % des hommes. Parmi ces femmes victimes, les trois quarts ont subi un viol, un rapport sexuel forcé.
● Dans 90 % des cas, les victimes de viols et de tentatives de viols connaissent leur agresseur.
Dans neuf cas sur dix, la victime connait l’auteur des faits, qui pour un peu plus de la moitié des femmes victimes est un membre du ménage au moment des faits. Dans 37 % des cas, l’auteur est le conjoint vivant avec la victime au moment des faits. Les agresseurs inconnus représentant seulement 10 % de l’ensemble des agresseurs.
Parmi les victimes de viols ou tentatives de viols au sein du ménage, quatre sur dix ont peur que cela se reproduise.
● Des conséquences physiques et psychologiques
Près de 50 % des victimes de viol, ou de tentative de viol déclarent avoir subi des blessures physiques, qu’elles soient visibles ou non, et 76 % des victimes affirment que cette agression a causé des dommages psychologiques plutôt ou très importants. 61 % des femmes ayant subi un viol ou une tentative de viol ont déclaré que cette agression avait entraîné des conséquences, des perturbations dans la vie quotidienne, notamment dans leurs études ou leur travail.
● Une victime sur dix de viol ou de tentative de viol porte plainte.
Parmi les femmes victimes de viols et de tentatives de viols, 21 % se sont rendues au commissariat, 10 % ont déposé plainte et 7 % une main courante.
Par ailleurs, trois victimes sur dix déclarent avoir consulté un psychiatre ou un psychologue à la suite de cet événement et un quart avoir consulté un médecin. Le recours aux numéros verts et aux associations est en revanche moins fréquent.
Enfin, plus de la moitié des femmes victimes de ce type de violences sexuelles n’ont effectué aucune de ces démarches
2. Les faits de violences sexuelles constatés par les services de police et de gendarmerie de novembre 2014 à octobre 2015
Source : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
Les nouveaux outils de recueil de données mis en place par la police et la gendarmerie nationales permettent de connaître, pour la France métropolitaine, le nombre de crimes et délits de violences sexuelles enregistrés par l’ensemble des forces de sécurité (police nationale, gendarmerie nationale, préfecture de police de Paris).
Au total, sur un an, 31 825 faits de violences sexuelles ont été recensés par les forces de sécurité en France métropolitaine. 85 % des victimes sont des femmes majeures ou mineures.
Les données recueillies par les services de police et de gendarmerie permettent de connaître le nombre de victimes ayant déposé une plainte ou concernées dans une affaire ayant fait l’objet d’une enquête de police relative à des faits de violences sexuelles. Sur un an, de novembre 2014 à octobre 2015, 31 825 faits de violences sexuelles ont été constatés en France métropolitaine par les forces de sécurité. Dans 85 % des cas, la victime est une femme, mineure ou majeure. Les faits de viols représentent 38 % de l’ensemble des violences sexuelles constatées par les forces de sécurité.
Pour de multiples raisons, certains viols peuvent être plus difficiles à dénoncer que d’autres. Il semble que ce soit notamment le cas de ceux commis par un conjoint. En effet, les viols conjugaux représentent 16 % de l’ensemble des faits de viols commis contre des femmes enregistrés par les forces de sécurité, ce qui est bien inférieur à la part des viols et tentatives de viols qu’ils représentent dans les enquêtes de victimation, à savoir 37 % selon l’enquête CVS (voir supra).
3. Les condamnations pour viols et agressions sexuelles en 2014
Source : ministère de la justice, SDSE, exploitation du casier judiciaire national (données provisoire, 2014).
Les statistiques recueillies par le ministère de la justice permettent de connaître, chaque année, le nombre de personnes condamnées pour des faits de violences sexuelles. Ces statistiques ne permettent pas de disposer de données sur les victimes (59).
En 2014, 5 539 hommes et 53 femmes ont été condamnés pour viols ou autres agressions sexuelles, quel que soit le lien entre la victime et l’agresseur. En 2014, 1 075 condamnations ont été prononcées pour des faits de viol et 4 517 pour des faits relevant d’une agression sexuelle autre qu’un viol, soit au total 5 592 condamnations. 99 % de ces peines ont été prononcées contre des hommes. Les condamnations pour viols représentent 19 % de l’ensemble des condamnations pour violences sexuelles
CONDAMNATIONS POUR VIOLS ET AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES PRONONCÉES EN 2014 SELON LE SEXE DE L’AUTEUR (EFFECTIFS)
Hommes |
Femmes |
Total | |
VIOLS, dont : |
1 069 |
6 |
1 075 |
– Viols sur personnes de plus de 15 ans |
765 |
6 |
771 |
– Viols sur mineur.e.s de 15 ans |
304 |
- |
304 |
AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES, dont : |
4 470 |
47 |
4 517 |
– agressions sur personnes de plus de 15 ans |
2 087 |
13 |
2 100 |
– agressions sur mineur.e.s de 15 ans |
2 383 |
84 |
2 417 |
TOTAL |
5 539 |
53 |
5 592 |
Source : ministère de la justice, SDSE, exploitation du casier judiciaire national (données provisoires 2014)
Selon le code pénal, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (article 222-23). Toute atteinte sexuelle, sans pénétration, commise avec violence, contrainte, menace ou surprise relève des « autres agressions sexuelles ».
Parmi d’autres circonstances aggravantes, le fait que la victime soit âgée de moins de 15 ans au moment des faits aggrave la peine encourue par l’agresseur.
En 2014, les condamnations pour des faits commis sur mineur de 15 ans représentent 28 % du total des condamnations pour viols (304 condamnations sur un total de 1075) et 54 % des condamnations pour une autre agression sexuelle (2 417 condamnations sur un total de 4 517).
ANNEXE 3 :
2012-2015, UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Sont présentées ci-après les principales mesures mises en œuvre depuis 2012 en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, selon un bilan récent présenté par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, en novembre 2015 (60).
*
L’action publique contre les violences est globale. Elle vise, d’abord, à mieux accompagner les victimes tout au long de leur parcours de sortie, en favorisant la dénonciation des violences, en améliorant la première prise en charge des femmes victimes et en améliorant leur protection, dans l’urgence comme dans la durée. L’action publique apporte également des réponses adaptées à certaines formes de violences ou aux lieux dans lesquels ces dernières sont commises. Enfin, l’action publique crée les conditions d’une mobilisation de l’ensemble de la société, via de grandes campagnes de sensibilisation, une meilleure connaissance statistique des violences et l’engagement des collectivités territoriales. Plusieurs actions ont ainsi été mises en œuvre afin de :
– favoriser la dénonciation des violences et améliorer la prise en charge des femmes victimes (1) ;
– protéger les femmes victimes, dans l’urgence comme dans la durée (2) ;
– agir dans tous les domaines, sur tous les territoires (3) ;
– apporter des réponses spécifiques à certaines formes de violences (4) ;
– rendre visible l’ampleur des violences et mobiliser l’ensemble de la société (5).
1. Favoriser la dénonciation des violences et améliorer la première prise en charge des femmes victimes
1.1. Le numéro national de référence : 3919
● Le dispositif : le 3919 « Violences Femmes info » est, depuis le 1er janvier 2014, le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences. Tout type de violence peut y être révélé : conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement, etc. Il propose une écoute téléphonique, d’information et d’orientation vers les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge. Il est accessible 7 jours sur 7, gratuit et garantit l’anonymat des personnes appelantes.
Le fonctionnement de ce numéro, géré par la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et soutenu par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, s’appuie sur un partenariat avec les principales associations nationales luttant contre les violences faites aux femmes.
● Sur le terrain : près de 50 780 appels ont été traités en 2014 par les écoutant.e.s du 3919.
1.2. Le soutien aux associations dans la durée
Les associations de prise en charge des femmes victimes de violences sont des actrices essentielles, permettant la mise en œuvre, sur le terrain, des mesures de prévention des violences et de protection des femmes (gestion d’accueils de proximité, de centres d’hébergement, etc.). Le Gouvernement a donc souhaité favoriser la pérennité de leurs actions, à travers la signature de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM). Douze associations nationales, généralistes ou spécialisées dans la prise en charge d’une forme de violences, en bénéficient désormais. Les CPOM qui s’achèvent en 2015 seront reconduites.
La collaboration entre les associations et le Gouvernement, et entre les associations elles-mêmes, a été renforcée grâce à l’accord de partenariat en faveur des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce partenariat permet d’assurer la coordination entre les associations, notamment en vue d’assurer une répartition efficace des appels au 3919. Ce partenariat évoluera en 2016 afin de permettre l’intégration de nouvelles associations nationales dans le pilotage du 3919.
1.3. Les accueils de jour et les lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation (LEAO)
● Les dispositifs : ces structures de proximité sont ouvertes sans rendez-vous durant la journée pour accueillir, informer et orienter les femmes victimes de violences. Ils permettent un accompagnement spécialisé et dans la durée des femmes victimes, en amont et en aval de la séparation.
● Sur le terrain : il existe plus de 300 accueils de jour et LEAO – 120 accueils de jour dans 99 départements (+ 16 accueils dans 5 départements en un an, + 50 accueils depuis 2012) et 206 LEAO dans 89 départements (+ 10 dans 10 départements en un an).
1.4. Le « protocole plainte » : organiser la réponse à la révélation des violences et réaffirmer le principe du dépôt de plainte
● Le dispositif : le « protocole plainte » organise la réponse apportée à toute femme qui révèle une situation de violences auprès de la police ou de la gendarmerie :
– sur le plan judiciaire : le protocole réaffirme que le dépôt d’une plainte est la règle et organise, dans le cas où la femme victime ne souhaite pas déposer de plainte, les conditions de recours aux mains courantes ou aux procès-verbaux de renseignement judiciaire ;
– sur le plan social : le protocole met en place un accompagnement et une prise en charge par un.e intervenant.e social.e, un.e psychologue ou une association.
Un modèle de convention locale a été mis à la disposition des parquets et des services de police et de gendarmerie par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur.
● Sur le terrain : depuis un an, le nombre de protocoles locaux a doublé. Il devait y en avoir 81 soient d’ici la fin de l’année 2015 sur l’ensemble du territoire.
1.5. Les intervenant.e.s sociaux en commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie
● Le dispositif : les intervenant.e.s sociaux en commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie assurent un accueil et une orientation des victimes nécessitant un accompagnement juridique, médico-psychologique ou social. La majorité des personnes accueillies subissent des violences intrafamiliales ; 80 % sont des femmes.
● Sur le terrain : 241 intervenant.e.s sociaux œuvrent désormais dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Ils n’étaient que 179 en 2013. L’objectif est d’atteindre 350 interventant.e.s en 2017.
1.6. Les référent.e.s « femmes victimes de violences »
● Le dispositif : le/la référent.e pour les femmes victimes de violences au sein du couple est l’interlocuteur unique et de proximité des femmes victimes de violences. Il a pour objectif de favoriser leur prise en charge globale et dans la durée. Le référent assure également une mission d’accompagnement des femmes disposant d’un « téléphone grand danger » (TGD).
● Sur le terrain : il existe aujourd’hui 74 postes de référent.e.s dans 52 départements (+ 14 postes dans 5 départements en un an). Près de la moitié des référent.e.s gère, ou se verra confier, la gestion de l’accompagnement des femmes bénéficiant d’un téléphone grand danger.
1.7. La formation des professionnel.le.s
La formation est essentielle pour améliorer le repérage, l’accompagnement et la protection des victimes, mais aussi pour faciliter la création d’une culture commune et de partenariats entre les professionnel.le.s. C’est pourquoi, par exemple, la prise en charge des victimes de violences sexuelles est intégrée, depuis 2013, à la formation initiale des étudiants de médecine.
Quatre kits de formation, composés de « fiches-réflexe » et de vidéos, ont été co-construits avec l’appui de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), à destination de l’ensemble des professionnel.le.s pouvant être au contact de femmes victimes de violences : gendarmes et policier.ère.s ; magistrat.e.s, avocat.e.s et professionnel.le.s du droit ; professionnel.le.s de santé ; travailleur.seuse.s sociaux.ales ; professionnel.le.s de l’enfance et de l’adolescence. Les 4 films « Anna », « Elisa », « Tom et Léna » et « Protection sur ordonnance » se composent d’un court-métrage et d’un livret d’accompagnement.
Ces outils ont permis la sensibilisation et/ou la formation de 200 000 personnes.
– Le kit « Anna » explique les mécanismes des violences au sein du couple, le repérage, la prise en charge par le/la professionnel.le et le travail en réseau. Il met en scène un médecin et une patiente, victime de violences, et encourage la pratique du questionnement systématique.
– Le kit « Elisa » traite des conséquences des violences sexuelles et de l’impact du repérage systématique sur la femme victime. Cette pratique professionnelle améliore le diagnostic, la prise en charge et l’orientation par le/la professionnel.le. Il est destiné d’abord aux sages-femmes et aux professionnel.le.s de santé.
– Le kit « Tom et Léna » traite de l’impact des violences au sein du couple sur les enfants ainsi que du repérage et de la prise en charge de la mère et de l’enfant victimes. Il est destiné d’abord aux professionnel.le.s de l’enfance et de l’adolescence.
– Le kit « Protection sur ordonnance » traite des mécanismes des violences, du repérage et de l’évaluation du danger lié aux situations de violences au sein du couple pour mettre en place une prise en charge et une protection adaptées pour la mère et les enfants victimes. Il est conçu d’abord pour les avocat.e.s et les professionnel.le.s du droit.
1. Protéger les femmes victimes, dans l’urgence comme dans la durée
2.1. Le « téléphone grand danger » : pour une intervention immédiate des forces de l’ordre
● Le dispositif : le « téléphone grand danger » (TGD) est un téléphone portable disposant d’une touche « raccourci » préprogrammée, permettant à une femme ayant été victime de violences conjugales ou de viol, de joindre, en cas de grand danger, un service de téléassistance, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et de permettre l’intervention immédiate des forces de l’ordre.
Ce dispositif a fait ses preuves lors des expérimentations menées dans le Bas-Rhin, en Seine-Saint-Denis, dans le Val d’Oise et à Paris. Généralisé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, il est aujourd’hui déployé sur l’ensemble du territoire.
● Sur le terrain : 400 téléphones devaient être déployés d’ici la fin du mois de novembre 2015 dans l’ensemble des 175 tribunaux de grande instance (+ 250 TGD en un peu plus d’un an). En 2016, 100 nouveaux téléphones seront déployés, portant à 500 le nombre total de TGD actifs.
2.2. L’ordonnance de protection
● Le dispositif : l’ordonnance de protection permet aux juges aux affaires familiales (JAF) de prendre des mesures de protection concernant, par exemple, l’attribution du domicile ou la limitation de l’exercice de l’autorité parentale. Pour accompagner la montée en puissance de cette nouvelle procédure, une présentation pédagogique à destination des avocat.e.s est désormais disponible. Toutes les écoles de formation des avocat.e.s dispenseront, à l’occasion de ce 25 novembre, une formation sur les violences faites aux femmes, et présenteront les nouveaux outils réalisés par la MIPROF (film pédagogique et livret d’accompagnement).
● Sur le terrain : en 2014, 1 303 ordonnances de protection ont été prononcées. Ce chiffre est en augmentation de 10 % par rapport à 2013. Pour en savoir plus : kit et film pédagogique « Protection sur ordonnance » à destination des avocat.e.s et des professionnel.le.s du droit, réalisés par la MIPROF ; plaquette de présentation de l’ordonnance de protection réalisée par le Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF) et disponible sur le site infofemmes.com.
2.3. L’hébergement et le logement pour une mise en sécurité
● Le dispositif : pouvoir disposer d’un hébergement ou d’un logement est fondamental pour améliorer la protection et l’accompagnement des femmes victimes de violences. Le 25 novembre 2012, le président de la République a souhaité que 1 650 places d’hébergement soient créées d’ici 2017 pour les femmes victimes de violences.
● Sur le terrain : 1 147 nouvelles places ont été créées depuis 2012, 70 % de l’objectif du plan d’ici à 2017 sont d’ores et déjà atteint.
En particulier, dans le Gard : création de 8 places en hébergement dédié, gérées par la Croix-Rouge. Dans le Var : création de 46 places en hébergement spécialisé depuis fin 2014 (dont 6 en cours de création). Dans les Alpes-Maritimes : création de 41 places en 2015 (5 en hébergement d’urgence spécialisé, 30 en lieu sécurisé, 6 d’autres types). Dans l’Eure : offre d’hébergement en hébergement d’urgence (30 places) et en hébergement d’insertion (20 places). En Loire-Atlantique : création de 9 places en hébergement d’urgence, gérées par Solidarités Femmes. Dans la Somme : création de 15 places en hébergement d’urgence dédié, depuis 2013. En Seine-et-Marne : création de 51 places depuis 2014, dont 42 gérées par Solidarité Femmes – Le Relais 77 (25 à Champagne-sur-Seine, 17 à Vert-St-Denis et Montereau), 9 par SOS Femmes à Meaux. Dans la Nièvre : création de 4 places en hébergement d’urgence, gérées par l’Association nivernaise Accueil et réinsertion (ANAR). En Indre-et-Loire : création de 20 places en hébergement d’urgence avec accueil spécifique au CHRS Albert Camus. En Haute-Garonne : création de 31 places en hébergement spécialisé depuis 2013, gérées par les associations Association Promotion Initiatives Autonomes des Femmes (APIAF), Olympe de Gouges et Du côté des femmes.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR » a précisé que le plan départemental évaluant les besoins en terme de logement doit prendre en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des violences ou menaces de violence. De plus, cette loi facilite le fait de donner en location des logements conventionnés, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, pour les personnes victimes de violences au sein du couple.
2.4. L’éviction du conjoint violent du domicile
● Le dispositif : la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit le principe de l’éviction du conjoint et du maintien de la victime dans le logement du couple lorsque celle-ci le souhaite. Pour assurer la mise en œuvre de ce dispositif, des conventions locales permettent la prise en charge des conjoints violents (accompagnement social, thérapeutique, hébergement, etc.).
● Sur le terrain : dans le département de la Seine-Saint-Denis, 60 % des femmes victimes ont eu recours à l’éviction du conjoint et ont fait le choix de rester dans leur logement.
2.5. Des espaces de rencontre et des mesures d’accompagnement protégé (MAP), pour un exercice de la parentalité sans nouvelle mise en danger des enfants ou du parent victime
Les femmes sont les premières touchées par les violences conjugales, mais ne sont pas les seules victimes. Les enfants témoins, en étant exposés à ces violences, les subissent également. En 2014, 35 enfants sont morts dans le cadre de violences au sein du couple et 110 d’entre eux sont devenus orphelins de mère et/ou de père. Plus de 140 000 enfants vivent dans une famille où une femme est victime de violences.
● Le dispositif : la loi du 4 août 2014 prévoit désormais que le juge, en cas de violences, se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Les espaces de rencontre sont des lieux permettant la continuité des relations entre l’enfant et son père. Ce dispositif permet également de préserver la sécurité du parent victime de violences. Il peut être complété de mesures d’accompagnement protégé, par exemple grâce à l’assistance d’un tiers accompagnateur (intervenant.e social.e, psychologue).
● Sur le terrain : près de 160 espaces de rencontre sont répertoriés à ce jour, sur l’ensemble du territoire. Des mesures d’accompagnement protégé (MAP) sont à l’expérimentation en Seine-Saint-Denis notamment : depuis octobre 2012, 40 MAP ont été prononcées et ont bénéficié à 64 enfants.
2.6. Des stages de responsabilisation des auteurs pour prévenir la récidive
● Le dispositif : ces stages de prévention de la récidive constituent une réponse pénale à part entière qui peut être ordonnée à titre principal ou complémentaire.
● Sur le terrain : 10 services pénitentiaires d’insertion et de probation ont été mobilisés à la fin de l’année 2014 pour expérimenter la mise en place de stages de responsabilisation d’une durée de 3 jours. De manière complémentaire, 84 dispositifs ont été dénombrés dans 58 départements, sous forme de stages, de groupes de parole, d’entretiens individuels, etc. Ils ont permis la prise en charge de 1 546 auteurs en 2014.
3. Agir dans tous les domaines, sur tous les territoires
3.1. Dans l’espace public
● Le dispositif : afin de lutter efficacement et dans la durée contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dont les femmes sont victimes dans les transports en commun, un Plan d’action, co-construit avec le ministère de l’Intérieur et le secrétariat d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a été lancé en juillet dernier. 12 engagements articulés autour de 3 axes guident cette action : prévenir, réagir et accompagner.
● Sur le terrain : la campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports a été lancée le 9 novembre dernier. Elle a été diffusée dans l’ensemble du territoire et se poursuit jusqu’au début de l’année 2016 grâce aux opérateurs de transport, mairies, agglomérations ou afficheurs partenaires.
Le Gouvernement a mobilisé les services de l’État. Les préfets ont été invités à mettre en œuvre des actions locales et partenariales destinées à mieux prévenir les situations de harcèlement dans les transports. Ces actions pourront passer par l’organisation de « marches participatives » d’usagères, dans la continuité de l’expérimentation menée dans 13 villes depuis le début de l’année.
3.2. Au travail
La lutte contre les violences sexistes au travail s’est accélérée :
● La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a codifié la notion d’agissement sexiste. Le code du travail prévoit désormais que nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cette mesure était une recommandation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) dans son rapport sur le sexisme au travail, publié le 6 mars 2015.
● Un guide de prévention des violences et harcèlement dans la fonction publique sera publié (sa parution était prévue avant la fin de l’année 2015).
● Ces mesures sont complémentaires de celles réalisées depuis 2012 :
– protocole d’accord du 8 mars 2013 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ;
– circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ;
– référentiel de formation à l’égalité professionnelle, publié en mars 2014 ;
– guide « Discriminations et harcèlements au travail » ;
– campagne « Stop harcèlement sexuel » (2012) ;
– loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
3.3. En milieu scolaire et universitaire
La lutte contre les violences sexistes prend la forme de différents dispositifs :
● Dans les établissements de l’Éducation nationale : des dispositifs d’éducation à la sexualité, éducation à l’égalité filles-garçons, de protection de l’enfance en danger sont déployés. La problématique est intégrée au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Dans le cadre du prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement » des prix supplémentaires seront remis pour des projets traitant du harcèlement sexiste et sexuel.
● Le HCEfh a été saisi afin d’identifier les facteurs facilitant la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité. Des premiers résultats sont attendus pour le premier semestre 2016.
● Dans les établissements agricoles : une enquête sur le climat scolaire intègre le sujet et le projet GAIA (Gérer l’accompagnement individuel des apprenant.es) a été lancé afin de lutter contre les discriminations et contre les stéréotypes de sexe. À ce jour, il a été mis en place par près de 10 % des établissements de l’enseignement agricole technique.
● À partir de 2016, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche devront se doter d’un dispositif de prévention et de traitement du harcèlement sexuel, dont il sera rendu compte au moment du dialogue contractuel et qui entrera dans l’évaluation de la politique globale de l’établissement. Ce dispositif comprendra l’institutionnalisation d’un protocole d’action et la création de cellules de veille et d’orientation. Un « vade-mecum sur la mise en place des dispositifs spécifiques de prévention et de traitement du harcèlement sexuel » sera diffusé. Une nouvelle circulaire sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel sera publiée.
● La convention signée le 25 novembre 2014 par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et le CNOUS prévoit la prise en charge des étudiant.e.s victimes de violences. Durant l’année 2014-2015, les assistant.e.s de service social des CROUS ont rencontré 3 415 étudiant.e.s (dont 3 194 femmes) ayant subi des violences, permettant un accompagnement et l’attribution de logements.
Pour en savoir plus : sur le site du ministère de l’Éducation nationale, un dossier sur les repères et ressources pour la prévention et le traitement des violences sexuelles de l’école au lycée ; le guide Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir ; site du réseau Canopé ; la campagne « Agir contre le harcèlement à l’école ».
3.4. Dans les médias et sur internet
Afin de lutter contre les violences sexistes dans les médias et internet, plusieurs dispositifs ont été créés ou renforcés.
Les médias doivent dorénavant diffuser des programmes dédiés à la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette démarche est pilotée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), dans le cadre défini par la délibération de son collège publiée le 6 janvier 2015. Un premier bilan est attendu début 2016.
La plateforme de signalement en ligne PHAROS de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), qui peut être saisie par toute personne, a vu son nombre de signalements augmenter.
3.5. Dans le sport
● Une campagne de sensibilisation contre les discriminations dans le sport intitulée « #Coup de Sifflet » a débuté le 17 mai 2015. Elle se décline en 4 volets : homophobie et transphobie, handicap, sexisme et racisme. Le volet sexisme sera diffusé en mars 2015.
● Les fédérations françaises de football et de basket-ball ont mis en place un observatoire des comportements contraires aux valeurs du sport, afin de mieux repérer les comportements sexistes. D’autres fédérations souhaitent s’y engager. Le ministère a élaboré un guide pour accompagner l’ensemble des fédérations dans cette démarche, et produira une synthèse à partir des données collectées.
● Une procédure spécifique de signalement concernant la sécurité et l’intégrité des pratiquant.e.s a été mise en place au 1er trimestre 2015.
Sur ce thème, voir aussi le guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et discriminations dans le sport, le guide de formation sur la prévention du sexisme dans le sport, le vademecum sur les procédures à conduire en cas de signalement de faits de violences sexuelles (guide à destination des services, des fédérations sportives et des établissements publics nationaux).
3.6. Dans les armées
La cellule Thémis, créée en 2014, permet de mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans les armées. Cette structure traite les cas de harcèlement, discrimination et violences, et veille à ce qu’ils soient sanctionnés de façon adaptée.
La MIPROF et la cellule Thémis ont réalisé un kit de prévention « Harcèlement et violences sexuels : comprendre et réagir » comprenant trois films d’animations à vocation pédagogique et un livret d’accompagnement. Ces kits seront présentés à tous les militaires du rang. Ils abordent les thèmes suivants : « Le harcèlement sexuel : tolérance zéro », « Les violences sexuelles : agissons ensemble », « Le consentement : c’est tous les deux ».
3.7. Dans les départements et territoires d’Outre-mer
Un appel à projets spécifique du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) a financé en 2014 des projets destinés à la prévention des violences faites aux femmes en Outre-mer dans trois champs d’intervention : la sensibilisation des jeunes en milieu scolaire et universitaire, la sensibilisation des jeunes en dehors du milieu scolaire et la formation des professionnel.e.s en contact avec les jeunes. Ces projets concernent l’ensemble des territoires et départements d’outre-mer.
Par ailleurs, l’Agence française pour le développement (AFD) mène actuellement une étude portant sur les enjeux entre le genre et l’Outre-mer. Des résultats sont attendus en décembre 2015.
3.8. À l’international
Contre les violences faites aux femmes et contre l’impunité de leurs auteurs, la France agit à l’extérieur, et en premier lieu, dans les instances internationales :
– à l’Assemblée générale des Nations unies, la France porte tous les deux ans avec les Pays-Bas une résolution sur l’élimination des violences envers les femmes (la prochaine en 2017) ;
– le Conseil de sécurité s’est saisi de la question des violences sexuelles dans les conflits, à l’initiative notamment de la France ;
– La France a joué un rôle moteur pour l’adoption des résolutions 1325 et suivantes dites « Femmes, paix et sécurité », qui protègent les femmes dans les conflits et demandent qu’elles soient pleinement associées au maintien de la paix et à la sortie de crise. La France a adopté son deuxième plan d’action (2015-2018) pour la mise en œuvre de ces résolutions.
Au niveau européen, après l’avoir activement promue, la France a ratifié le 4 juillet 2014 la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et milite désormais pour que davantage d’États puissent y adhérer.
La France mène par ailleurs de nombreuses actions au titre de ses activités humanitaires et d’aide au développement (éducation des filles, sensibilisation à l’égalité, droits sexuels et reproductifs, autonomisation et participation des femmes).
4. Apporter des réponses spécifiques à certaines formes de violences
4.1. Les violences sexuelles, le viol
● Chiffres clés : environ 146 000 femmes déclarent avoir été victimes de violences sexuelles. 84 000 femmes de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes d’au moins un viol ou une tentative de viol dans l’année précédente.
● Les dispositifs : contre ces violences, le gouvernement agit à différents niveaux – loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (61) ; extension du téléphone grand danger aux femmes victimes de viols ; plan présenté le 9 juillet 2015 contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun ; campagne lancée à l’occasion de ce 25 novembre qui, pour la première fois, nomme explicitement les agressions sexuelles et les viols, en rappelant que le 3919 peut être appelé pour toute forme de violence.
4.2. La prostitution
● Chiffres clés : afin de renforcer la lutte contre la prostitution et les réseaux qu’elle engendre, la France souhaite renforcer son cadre législatif. La proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et l’accompagnement des personnes prostituées poursuit son parcours parlementaire.
● Les dispositifs : en 2015, et avant même que la loi ne soit définitivement adoptée, le Gouvernement a doublé les crédits de la lutte contre la prostitution. Ces moyens renforcés permettront notamment de former l’ensemble des professionnel.le.s aux évolutions législatives, d’appuyer mieux encore les personnels des associations accompagnant les personnes prostituées, ou encore de mettre en place le parcours de sortie de la prostitution.
4.3. Les mariages forcés et l’excision
Chiffres clés : 53 000 femmes excisées vivent en France.
● Plusieurs lois sont venues renforcer la protection des filles et des femmes.
– La loi du 5 août 2013 considère comme une infraction le fait de tromper une personne pour lui faire quitter le territoire national en vue de contracter une union contre son gré à l’étranger. Elle punit plus sévèrement toute personne qui inciterait une mineure à subir une mutilation sexuelle, par des promesses, des avantages quelconques ou en usant contre elle de pressions.
– La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit que le consentement libre et volontaire prévu par le droit français prime sur les lois étrangères ayant une conception plus restrictive en matière de consentement. La loi allonge la durée de l’ordonnance de protection, qui peut être prononcée par un juge aux affaires familiales pour protéger une personne majeure menacée de mariage forcé.
– La loi sur la réforme du droit d’asile consolide les garanties de protection et d’accueil des mineures menacées de mutilations sexuelles.
● Concernant plus spécifiquement le mariage forcé :
– une adresse électronique (mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr) a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international en avril 2014 pour tout signalement ;
– une rubrique spécifique est consacrée aux mariages forcés sur le site gouvernemental stop-violences-femmes.gouv.fr ;
– les agents consulaires susceptibles d’accueillir à l’étranger les victimes de mariages forcés ont été formés ;
– des instructions à destination des chefs d’établissement ont été adressées avant l’été 2015 appelant à la plus grande vigilance de départs d’élèves pendant la période des congés scolaires.
● Concernant plus spécifiquement l’excision, un dépliant dédié à cette problématique a été diffusé.
4.4. Les femmes en situation de handicap
Afin de mieux connaître la réalité des violences faites aux femmes en situation de handicap et de mieux y répondre, un groupe de travail, piloté par la MIPROF, a été lancé cette année.
Les objectifs donnés à ce groupe de travail sont les suivants : dresser un état des lieux des violences faites aux femmes en situation de handicap pour identifier des besoins, initier des actions et mettre en place des mesures de prévention et de protection spécifiques.
Le travail se poursuivra en 2016, avec la formation des professionnel.le.s susceptibles d’être en contact avec des femmes en situation de handicap, par la création d’une fiche-réflexe pour les agent.e.s du numéro d’urgence 114, et enfin avec l’interprétation en langue des signes française (LSF) des films de formation créés par la MIPROF.
4.5. Les femmes étrangères
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile a permis d’améliorer la protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences :
– elle affirme le principe selon lequel les aspects liés au genre doivent être pris en considération dans l’interprétation des cinq motifs de persécution de la Convention de Genève relative au statut de réfugié ;
– elle intègre des données sexuées et des actions de formation des agents à l’égalité au sein des rapports d’activité de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
– elle met en place des actions de prévention en direction des parents et/ou tuteurs légaux des mineures protégées contre les risques médicaux et judiciaires des mutilations sexuelles et de l’excision ;
– elle permet la présence lors de l’entretien à l’OFPRA d’un.e représentant.e d’une association de défense des droits des femmes ou de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle ;
– elle instaure le huis clos à la CNDA lorsque la requête repose sur des faits de viol, de torture et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, ou de traite des êtres humains ;
– elle permet la conduite de l’entretien à l’OFPRA par un.e agent.e en présence d’un.e interprète de même sexe, si le demandeur en fait la demande et si cette demande apparaît fondée.
La loi relative au droit des étrangers, en cours d’examen au Parlement, devrait permettre d’autres avancées.
5. Rendre visible l’ampleur des violences et mobiliser l’ensemble de la société
5.1. Le développement de la connaissance sur les violences
Près de quinze ans après l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), l’enquête VIRAGE entend actualiser et approfondir la connaissance statistique des violences faites aux femmes. Confiée à l’Institut national d’études démographiques (INED), elle interrogera 26 500 personnes, âgées de 20 à 69 ans. Des premiers résultats sont attendus pour le 25 novembre 2016, et des résultats complets pour la fin de l’année 2018.
De manière complémentaire, des études sur des sujets très spécifiques sont menées. Après celle réalisée sur le coût des violences faites aux femmes, une étude sur l’impact des violences conjugales sur les enfants a été lancée récemment. Les résultats sont attendus pour l’année 2017.
5.2. Par la diffusion de la connaissance sur les violences
Créée en 2013 par le gouvernement, la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) mène les missions suivantes :
– le développement et l’animation de formations et d’initiatives locales ;
– le recueil, l’analyse et la restitution des données utiles.
Afin de valoriser les données existantes, la MIPROF publie la lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes. Elle a pour objectif d’apporter une connaissance partagée sur ces violences et de diffuser les bonnes pratiques. Chaque année quatre lettres d’information sont publiées.
5.3. Par le développement d’observatoires territoriaux
Les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes sont des structures de partenariat entre les collectivités territoriales, les services de l’État et l’ensemble des acteurs locaux intervenant auprès des femmes victimes de violences. Créés à l’initiative de collectivités territoriales, leur objectif général est d’améliorer les réponses apportées aux différents besoins des femmes victimes de violences sur le territoire.
Sur le terrain : 12 observatoires ont d’ores et déjà été créés. Un guide à destination des collectivités territoriales pour la création et l’animation d’un observatoire territorial des violences faites aux femmes sera publié en 2016.
5.4. Par la diffusion de campagnes d’information
– Lutte contre le harcèlement au travail (2012), « Harcèlement sexuel : Désormais la loi vous protège ».
– Lutte contre les mutilations sexuelles (2014).
– Lutte contre les violences conjugales (2014).
– Lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun (2015).
1 () Ministère de l’intérieur, délégation aux victimes (DAV), 2006-2014.
2 () Les morts violentes dans le couple représentent 18,74 % des homicides non crapuleux et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner constatés au plan national en 2014 (ministère de l’intérieur, étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, DAV, 2014).
3 () Mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, créée par la Conférence des présidents, rapport d’information n° 1799, publié le 7 juillet 2009.
4 () Article 222-14-3 du code pénal.
5 () La loi contre le harcèlement sexuel punit le fait d’imposer à une femme ou à un homme, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle, portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou créant une situation intimidante. Elle punit également tout acte assimilé à du chantage sexuel. Ce délit est passible de peines pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.
6 () Les mesures prévues dans le cadre de ce troisième volet du plan interministériel étaient les suivantes : mobiliser les agents du service public et les professionnels à travers un programme transversal de formation initiale et continue ; renouveler le plaidoyer pour agir : le programme de l’Observatoire national des violences faites aux femmes ; assurer le respect des droits des femmes dans le champ des médias et d’internet ; prévenir les comportements sexistes et les violences en milieu scolaire ; prévenir les comportements sexistes et les violences sexuelles dans le milieu universitaire ; Prévenir les comportements sexistes et les violences sexuelles dans le sport ; prévenir le harcèlement sexuel et des violences au travail ; prévenir et lutter contre les mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines ; informer et sensibiliser le grand public ; prévenir les stéréotypes sexistes et les violences faites aux jeunes femmes dans les DOM ; poursuivre la mobilisation internationale initiée par la Convention d’Istanbul.
7 () Voir le compte rendu de l’audition du 12 janvier 2016, en annexe au présent rapport.
8 () La MIPROF a notamment pour objet de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes.
9 () Voir également sur ce point la présentation du plan national et de la campagne d’information lancés en 2015 dans l’annexe n° 3 du présent rapport.
10 () Rapport du Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, CEDAW/C/2005/OP 8/MEXICO, publié en janvier 2005.
11 () Compte rendu de l’audition de la Délégation du mardi 19 janvier 2016, en annexe au présent rapport.
12 () Compte rendu de l’audition de la Délégation du mardi 26 janvier 2016.
13 () Une circonstance aggravante est une situation particulière dans laquelle une infraction est commise et qui confère à celle-ci un caractère de gravité accru entraînant de ce fait l’aggravation de la peine encourue.
14 () Compte rendu de l’audition du mardi 19 janvier 2016, en annexe du présent rapport.
15 () Communiqué de la Présidence de la République, en date du 31 janvier 2016, sur la grâce présidentielle accordée à Mme Jacqueline Sauvage.
16 () Sont réunis aux articles L. 122-1 les faits justificatifs (légitime défense, ordre de la loi) et les causes de non-imputabilité (troubles psychiques abolissant le discernement, contrainte), bien que les premiers suppriment le crime lui-même, tandis que les seconds n’opèrent qu’en faveur de la personne qui les réalisent. On distingue ainsi les causes objectives d’irresponsabilité pénales, qui peuvent s’entendre comme des faits justificatifs de la commission de l’infraction (dont la légitime défense), des causes subjectives d’irresponsabilité, autrement dit des causes de non-imputabilité de l’infraction à celui qui l’a commise : dans cette hypothèse, c’est l’élément moral de l’infraction qui sera neutralisé, de sorte que la responsabilité pénale de l’auteur ne pourra être retenue (contrainte ou erreur de droit).
17 () La CEDH précise ainsi que n’est pas infligée en violation du « droit à la vie » qu’elle consacre par ailleurs, la mort qui « résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire […] pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ».
18 () L’article 349-1 dispose ainsi que « Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) » – soit la légitime défense – « et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit : " 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ; " 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ? " (…). L’article 361-1 dispose par ailleurs que « Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable (…). »
19 () Aucune faute ne peut être imputée à la personne poursuivie dès lors qu’elle est considérée comme ayant agi en état de légitime défense : se trouve ainsi exclue toute condamnation à des dommages-intérêts qui serait fondée sur les articles 1382 du code civil (faute volontaire), 1383 (faute involontaire) ou 1884 (responsabilité du fait de la chose que l’on a sous sa garde). Ce principe s’impose aussi à la juridiction pénale : ainsi, les juridictions répressives, même la cour d’assises malgré les dispositions prévues par l’article 372 du code de procédure pénale, ne sauraient indemniser les parties civiles alors que la personne poursuivie a été reconnue avoir agi en légitime défense.
20 () E. Garçon, Code pénal annoté, 1959, in Jurisclasseur Droit pénal.
21 () Cour de Cassation, Crim., 19 février 1959, aff. Réminiac.
22 () Ainsi, selon la chambre criminelle de la Cour de Cassation (arrêt précité), « il s’agit là d’une présomption légale qui, loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire ; que le texte dont il s’agit ne saurait justifier des actes de violence lorsqu’il est démontré qu’ils ont été commis en dehors d’un cas de nécessité actuelle et en l’absence d’un danger grave et imminent dont le propriétaire ou les habitants aient pu se croire menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens ».
23 () Description proposée par Dr Renée Roy, extraite du procès de Mme Linda Côté en 1995, citée par Sylvie Frigon dans L’homicide conjugal au féminin, d’hier à aujourd’hui, Éditions du remue-ménage, 2003.
24 () Voir le compte rendu de la table ronde du mardi 26 janvier 2016, en annexe au présent rapport.
25 () Voir aussi en annexe au présent rapport la présentation de cette affaire par Mme Le Magueresse.
26 () « La femme battue comme moyen de défense : l’affaire Lavallée », Christopher Morris et Marilyn Pilon, Division du droit et du gouvernement, Direction de la recherche parlementaire du Parlement du Canada, rédigé le 11 mai 1990, révisé le 5 novembre 1992.
27 () Aux termes de cet article, « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsyhique ayant aboli son discernement ou el contrôle de ses actes. »
28 () Voir le compte rendu de la table ronde du mardi 26 janvier 2016.
29 () Voir le compte rendu des auditions en annexe au présent rapport.
30 () Cour d’assises de l’Isère, Bernadette Dimet, janvier 2016.
31 () Entendu par la rapporteure le mercredi 10 février 2016, propos extraits de sa tribune parue dans le journal Libération, « La société démissionne, n’instaurons pas un droit de tuer », 10 février 2016.
32 () Voir sur ce point le compte rendu de l’audition du mardi 26 janvier 2016 en annexe au présent rapport.
33 () Cour de Cassation, chambre criminelle, audience publique du 9 septembre 2015, n° de pourvoi 14-81308.
34 () « La légitime défense et l’exigence de proportionnalité : critique », tribune de M. Didier Reims, avocat, parue sur le site internet Village de la justice, communauté des métiers du droit, 28 octobre 2015.
35 () Ibidem.
36 () L’ancien code pénal prévoyait en effet que « Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu »
37 () Rapport d’information n° 89 de juillet 2012 sur le harcèlement sexuel, présenté par Mme Ségolène Neuville.
38 () Compte rendu de l’audition du 12 janvier 2016, en annexe au présent rapport.
39 () Compte tendu de l’audition du mardi 12 janvier 2016, en annexe du présent rapport.
40 () Compte rendu de l’audition du mardi 3 mai 2011 par la commission des Lois du Sénat de M. Michel Mercier, Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés.
41 () Notamment par Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV), lors de la table ronde organisée le mardi 19 janvier 2016 (compte rendu en annexe).
42 () Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, aux termes de l’article 40-1 du code de procédure pénale.
43 () Circulaire du 7 août 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, ministère de la justice.
44 () Circulaire du 24 novembre 2014 d’orientation de politique pénale Circulaire du 24 novembre 2014 d’orientation de politique pénale en matière de lutte contre les violences au sein du couple et relative au dispositif de téléassistance pour la protection des personnes en grave danger (CRIM/AP/ 2014/0130/C16).
45 () Le nombre d’ordonnances de protection prononcées aurait par ailleurs augmenté d’environ 55 % entre 2011 et 2014, selon les précisions apportées par Mme Béatrice Bossard, magistrate, sous-directrice de la justice pénale générale à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, lors de son audition par la Délégation, le mardi 9 février 2016, en annexe au présent rapport.
46 () Compte rendu de l’audition du mardi 9 février 2016, en annexe au présent rapport.
47 () Le collectif souligne aussi que « la loi du 4 août 2014 (article 33) ne permet le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales qu’à la demande expresse de la victime. Il est très peu vraisemblable qu’une victime de telles violences, qui a parfois mis des années à déposer plainte, fasse une demande de médiation pénale, sauf si elle a subi des pressions en ce sens », en réclamant « donc l’interdiction totale de la médiation pénale dans les affaires de violences dans le couple et de mariages forcés, comme le dit l’article 48 de la Convention d’Istanbul ».
48 () Ainsi, pour les juridictions dotées de Cassiopée (chaine applicative supportant le système d’information oriente procédure pénale et enfants), ce sont un peu plus 67 600 affaires qui ont été enregistrées en 2012 (dont 39 200 poursuivables), et presque 70 000 en 2013, dont 41 200 poursuivables), pour un taux de réponse pénale de 89 %. Les condamnations et mesures de composition pénale inscrites au casier judiciaire pour les années 2004 à 2013 ont parallèlement augmenté de plus de 96,9% passant de 9 129 condamnations à 17 972 (source : ministère de la justice, 2014).
49 () Aux termes de cet article, « Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise. »
50 () Selon le rapport précité, « la formation des experts est assurée de manière inégale et disparate sur l’ensemble du territoire national et ne permet pas de garantir, lors de leur inscription ou à l’occasion de leur réinscription sur les listes, leur compréhension du processus judiciaire et leur maîtrise des outils juridiques nécessaires à l’accomplissement de leur mission ».
51 () Mettre fin aux violences faites aux femmes : ce que nous voulons, brochure présentée le 23 janvier 2016 par un collectif d’associations (Amicale du Nid, Collectif féministe contre le viol, Collectif national pour les droits des femmes, Coordination lesbienne en France, Fédération nationale Solidarité femmes, Femmes pour le dire, femmes pour agir, Féminisme enjeux, Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles, Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, Mémoire traumatique et victimologie, Voix de femmes et Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées – Rajfire).
52 () Aux termes de l’article 15-3 du code de procédure pénale, « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »
53 () Source : MIPROF, novembre 2015.
54 () Rapport d’information n° 2379, présenté par Mme Maud Olivier, rapporteure de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le projet de loi (n° 2182) relatif à la réforme de l’asile novembre 2014.
55 () Liste des recommandations adoptées figurant page 49 du présent rapport d’information.
56 () Les comptes rendus de ces auditions figurent supra, dans la section du présent rapport relative aux travaux de la Délégation.
57 () Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011.
58 () « Violences faites aux femmes : les principales données » (en particulier, la section sur « les violences au sein des couples en France en 2014 »), lettre n° 8 de l’Observatoire national des violences faites aux femmes (ONVF), MIPROF, novembre 2015.
59 () Selon la MIPROF (lettre n° 8 précitée, publiée en novembre 2015).
60 () « Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes », dossier de presse du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, novembre 2015.
61 () La loi contre le harcèlement sexuel punit le fait d’imposer à une femme ou à un homme, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle, portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou créant une situation intimidante. Elle punit également tout acte assimilé à du chantage sexuel. Ce délit est passible de peines pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.
© Assemblée nationale