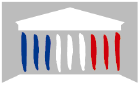______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2015.
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie,
PAR MM. Alain CLAEYS et Jean LEONETTI,
Députés.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 2512.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. LES SOINS PALLIATIFS : UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE 9
A. UN ACCÈS INSUFFISANT AUX SOINS PALLIATIFS 9
1. Une offre majoritairement proposée par le secteur public hospitalier 9
2. Une prise en charge insuffisante 10
B. UN ACCÈS INÉGALITAIRE AUX SOINS PALLIATIFS 11
1. Des disparités territoriales 11
2. Des disparités au sein du secteur sanitaire 11
3. Des disparités entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social 12
C. DE NETTES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES 13
II. UNE FORMATION DES PERSONNELS SOIGNANTS RENFORCÉE 14
TRAVAUX DE LA COMMISSION 21
Article 1er(art. L. 1110-5 du code de la santé publique) : Droit des malades et droit des patients en fin de vie 43
Article 2 (art. L. 1110-5 du code de la santé publique) : Refus de l’obstination déraisonnable 52
Article 3 (art. L.1110-5 du code de la santé publique) : Le traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès 61
Après l’article 3 85
Article 4 (art. L. 1110-5-3 du code de la santé publique) : Droit aux traitements antalgiques et sédatifs en cas de souffrance réfractaire 97
Article 4 bis (art. L. 1110-10-1 du code de la santé publique) : Présentation par les ARS d’un rapport annuel sur les soins palliatifs 103
Article 5 (art. L. 1111-4 du code de la santé publique) : Information des patients et droit au refus de traitement 104
Article 6 (art. L. 1111-10 du code de la santé publique) : Coordination avec l’article 5 Arrêt du traitement d’une personne en fin de vie 108
Article 7 (Intitulé de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique) : Droit des patients à refuser un traitement 109
Article 8 (art. L. 1111-11 du code de la santé publique) : Renforcement de la volonté du patient et opposabilité des directives anticipées 109
Article 9 (art. L. 1111-11-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Précision du statut du témoignage de la personne de confiance 120
Article 10 (art. L. 1111-12 du code de la santé publique) : Hiérarchie des modes d’expression de la volonté du patient 125
Article 11 (art. L. 1111-13 du code de la santé publique) : Article de coordination avec les articles 2, 5 et 10 Limitation ou arrêt des traitements pour une personne en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté 128
Après l’article 11 129
Lors de la campagne électorale pour l’élection présidentielle, M. François Hollande avait proposé que « toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».
C’est dans ce contexte, qu’une fois élu Président de la République, M. François Hollande a décidé d’engager une large concertation sur la question. En juin 2012, il a donc chargé le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) d’évaluer la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Le rapport (1) remis à cette occasion propose notamment un renforcement substantiel de la prise en compte de la volonté du malade et ouvre la voie à la sédation prolongée. À la suite de ce rapport, le CCNE a été saisi et, en juin 2013, a émis un avis (2) qui souligne notamment la nécessité de développer les soins palliatifs. Il a ensuite organisé une conférence de citoyens qui s’est déroulée durant quatre week-ends à l’automne 2013, et a impliqué un dialogue des citoyens avec une vingtaine d’intervenants de tous horizons, la moitié d’entre eux étant proposée par le CCNE, et les autres choisis par les citoyens eux-mêmes. L’avis et les recommandations de cette conférence ont été rendus publics lors d’une conférence de presse, à la fin de l’année 2013, puis mis en ligne (3).
Si, de tous ces travaux, s’est dégagé un consensus sur la nécessité d’améliorer la législation en vigueur notamment s’agissant de l’accès aux soins palliatifs et de la mise en œuvre des directives anticipées, les questions autour de l’aide à mourir et notamment de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté ont fait et continuent de faire débat.
Enfin, en juin 2014, le Premier ministre, a chargé les rapporteurs d’une mission auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé dans le cadre de l’article L.O. 144 du code électoral et les a invités à lui faire des propositions dans trois directions :
– le développement de la médecine palliative, y compris dès la formation initiale des professionnels de santé ;
– une meilleure organisation du recueil et de la prise en compte des directives anticipées en leur conférant un caractère contraignant ;
– la définition des conditions et des circonstances précises dans lesquelles l’apaisement des souffrances peut conduire à abréger la vie dans le respect de l’autonomie de la personne.
Après plusieurs mois d’auditions, et sur la base des rapports et des travaux précédents, dans le rapport (4) qu’ils ont remis au président de la République le 12 décembre 2014 les auteurs proposent un nouveau dispositif législatif, qu’ils ont déposé au mois de janvier 2015 sur le bureau de l’Assemblée nationale sous la forme de la proposition de loi qui fait l’objet du présent rapport.
Faisant siennes les conclusions du rapport qui lui étaient remis, le Président de la République soulignait que l’ « apaisement des souffrances » et le « respect des décisions des malades (…) sont deux grandes avancées qui permettront de faire franchir une étape importante dans les droits et les libertés dans notre pays. »
Afin de permettre à chacun de nos concitoyens d’être entendus et de bénéficier d’une fin de vie digne et apaisée, cette proposition de loi est en effet clairement destinée aux malades auxquels elle confère de nouveaux droits, s’inscrivant ainsi dans la lignée de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (5) et de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (6).
Les rapporteurs proposent deux principales évolutions aux textes antérieurs : l’accès à la sédation en phase terminale et le caractère contraignant des directives anticipées.
Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme pourra demander à bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’à son décès, pour accompagner, à sa demande, l’arrêt de son traitement, selon certaines conditions.
Le dispositif des directives anticipées est amélioré, à la fois en créant un modèle qui permettra de servir de cadre pour leur rédaction et en les rendant contraignantes pour le médecin. Leur durée de validité n’est plus limitée, tout en restant modifiables.
Consultation citoyenne sur la proposition de loi n° 2512 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
À l’initiative du Président Claude Bartolone, une consultation citoyenne a été ouverte du 2 au 16 février 2015 sur le site de l’Assemblée nationale au sujet de la proposition de loi n° 2512 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Cette consultation, qui a suscité 11 922 contributions, est intervenue avant le débat en commission des affaires sociales, les avis des internautes qui devaient préalablement s’enregistrer ont fait l’objet d’une modération a posteriori par le service de la communication qui s’en est tenu aux dispositions de la charte du site qui bannit les commentaires sans lien avec le texte visé ou contraires à la loi. Il faut souligner le faible nombre des contributions supprimées, en l’occurrence moins de 1 %.
L’intégralité des contributions est consultable sur le lien suivant : http://archives.assemblee-nationale.fr/14/consultations_citoyennes/export_consultations_fin_de_vie.pdf
Le secrétariat de la commission des affaires sociales a ensuite trié et analysé ces contributions quotidiennement afin de permettre une information régulière des rapporteurs.
De manière générale, ce sont avant tout les personnes insatisfaites de ce texte qui ont participé.
En majorité, les commentateurs regrettent que la loi n’aille pas « plus loin » en autorisant l’euthanasie active ou le suicide assisté, environ une moitié de cette majorité s’identifiant explicitement comme membre de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et une centaine d’internautes demandant de revenir à la proposition de loi n° 2435 de Mme Véronique Massonneau visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie.
À l’inverse, très nombreux également sont les internautes qui ont dénoncé une loi amenant au « permis de tuer » et autres « dérives euthanasiques », soutenant qu’il fallait plutôt réellement appliquer la loi Leonetti dans sa rédaction actuelle et notamment développer les soins palliatifs. Certains de ces commentateurs se revendiquaient de la Fondation Lejeune ou des Associations familiales catholiques. Il faut noter que dans les derniers jours d’ouverture de la consultation, la majorité des contributions étaient des copiés-collés de textes envoyés par diverses associations à leurs membres.
À côté de ces contributions exprimant un avis général sur le texte, d’autres ont été plus ciblées, concernant un article, une partie d’article voire un mot ou une expression. Les rapporteurs en ont reçu une analyse détaillée mais leur nombre et leur diversité empêchent de les développer davantage ici. Tout au plus peut-on signaler parmi les plus fréquentes :
– La décision du Conseil d’État de considérer que « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement », reprise à l’article 2 de la proposition de loi, est discutée et contestée (75 % des contributions sur cet article, soit environ 1 200) ;
– Un nombre significatif de critiques sur certains termes utilisés tels que « fin de vie digne et apaisée » (article premier), « prolonger inutilement » la vie (article 3), « délai raisonnable » (article 5), soulignant que ces termes non définis laissaient trop de place à la subjectivité et à l’interprétation.
La lecture du présent rapport, et notamment des débats en commission, permettra aux internautes de trouver une réponse à nombre de leurs interrogations.
La présentation complète de la proposition de loi par ses auteurs a fait l’objet du rapport remis au Président de la République au mois de décembre 2014 et cité ci-dessus, cependant il a semblé nécessaire, en particulier à la lumière des travaux de la commission des affaires sociales lors de ses deux réunions du mardi 17 février dernier, de compléter cette étude par un point plus spécifiquement consacré au développement des soins palliatifs, qui constituent le cadre nécessaire sans lequel le dispositif proposé ne saurait trouver son plein effet.
Introduit par la loi du 9 juin 1999 (7), l’article L. 1110-9 du code de la santé publique reconnaît le droit de toute personne malade, « dont l’état le requiert, à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». Les soins palliatifs sont définis comme « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage » (8).
Malgré la mise en œuvre de trois plans triennaux consacrés à développer les soins palliatifs, 80 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès.
Une circulaire de 2008 (9) organise les soins palliatifs au sein des structures hospitalières. L’offre est graduée et adaptée en fonction de la situation des patients.
On distingue ainsi :
– les services hospitaliers non dédiés qui prennent en charge des situations ne présentant pas de difficulté clinique, sociale ou éthique ;
– les lits identifiés de soins palliatifs (LISP) qui sont chargés d’assurer une prise en charge de proximité dans des services de soins confrontés à des fins de vie mais dont ce n’est pas l’activité exclusive ;
– les unités de soins palliatifs (USP) qui sont des unités spécialisées qui ont une activité spécifique et exclusive en soins palliatifs. Elles assurent une triple mission de soins, de formation et de recherche.
S’agissant des missions de soins, elles prennent en charge de façon temporaire ou permanente toute personne atteinte de maladie grave et évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale lorsque la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire ayant des compétences spécifiques.
L’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP), quant à elle, est une équipe multidisciplinaire et pluri professionnelle rattachée à un établissement de santé qui se déplace auprès du malade et du soignant à la demande des professionnels de l’établissement de santé. Elle est chargée de faciliter la mise en place de la démarche palliative et d’apporter un soutien technique et éthique aux équipes de soins et de diffuser les dispositions de la loi du 22 février 2005 précitée.
L’offre de soins palliatifs relève majoritairement du secteur public dans lequel se trouvent 62 % des unités de soins palliatifs et des lits identifiés de soins palliatifs.
Le secteur privé à but non lucratif constitue, de son côté, 26 % de l’offre des USP et 24 % des LISP.
Le secteur privé à but lucratif ne représente que 12 % des capacités en USP et 16 % des LISP.
Par ailleurs, le développement de l’offre est centré sur l’hôpital.
La Cour des comptes dans son rapport annuel (10) souligne qu’en 2013 sur 1,6 milliard d’euros de dépenses d’assurance maladie dans les établissements de santé consacrées aux prises en charge palliatives, 1,2 milliard d’euros étaient affectés à l’hospitalisation en court séjour, 127 millions d’euros aux équipes mobiles et 300 millions d’euros à l’hospitalisation à domicile.
Dans le cadre de son étude sur les soins palliatifs et la fin de vie à l’hôpital (11), l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) constatait, qu’en 2009, sur 238 150 patients hospitalisés dans des services de soins aigus, qui présentaient une pathologie dont la gravité et l’évolution prévisible auraient pu nécessiter des soins palliatifs, la moitié seulement, soit 119 000 patients, avaient pu bénéficier d’une telle prise en charge.
De même, la Cour des comptes, dans son rapport précité, relève le recours limité aux soins palliatifs pour des patients en fin de vie, tout en regrettant l’absence de données fiables et complètes sur cette prise en charge. Ainsi, à l’hôpital, en 2009, seul un tiers des 238 000 patients décédés lors d’une hospitalisation en court séjour, soit 78 000 patients, ont bénéficié de soins palliatifs.
Si l’accès aux soins palliatifs est loin d’être effectif, il est, de plus, inégalitaire selon les régions, les secteurs et disciplines des établissements hospitaliers et les structures sanitaires.
L’offre de soins palliatifs est hétérogène sur tout le territoire.
Selon le rapport établi par le Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement (12), 5 des 26 régions concentrent les deux tiers des USP (Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais).
On retrouve cette disparité dans le taux d’équipement en lits des unités de soins palliatifs. En 2011, la moyenne nationale est de 2,2 lits pour 100 000 habitants ; le Nord-Pas-de-Calais dispose d’un équipement de 5,45 lits pour 100 000 habitants tandis que les Pays-de-Loire affichent un taux de 0,36 lit pour 100 000 habitants, soit un écart de un à quinze.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève des disparités infrarégionales marquées. À titre d’exemple, elle cite la région de la Basse-Normandie où une inégalité existe entre le département de l’Orne qui n’est couvert par aucun réseau de soins palliatifs tandis que le Calvados en possède deux.
L’implantation des unités de soins palliatifs s’est faite majoritairement dans le secteur médical ou MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) et non en soins de suite ou SSR (soins de suite et de réadaptation). Ainsi, 73 % des lits identifiés en soins palliatifs sont situés dans des services de MCO (13).
De plus, au sein du secteur MCO, la proportion de séjours en soins palliatifs diffère selon le type de pathologie. Ainsi, 67 % des séjours de patients souffrant d’un cancer ont bénéficié de soins palliatifs contre 12 % de ceux souffrant d’une maladie cardiovasculaire ou d’une affection grave de l’appareil respiratoire (14).
Par ailleurs, la discontinuité entre soins curatifs et soins palliatifs est dommageable. Plus la démarche palliative est mise en œuvre en amont, plus la fin de vie de la personne malade se déroule dans de bonnes conditions.
Le point le plus crucial est la quasi-inexistence de soins palliatifs dans les établissements médico-sociaux et particulièrement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).
En effet, si la circulaire précitée de 2008 organisant les soins palliatifs ne prévoit pas de dispositif spécifique pour ces structures, une instruction en 2010 a fixé les conditions d’intervention des équipes mobiles dans ces établissements (15).
Néanmoins, comme le souligne la Cour des comptes, l’intervention de ces équipes mobiles au sein des EPHAD reste insuffisante.
Les rapporteurs sont particulièrement préoccupés par ce point et tiennent à alerter sur la situation dans les EHPAD où résident des personnes en fin de vie souffrant de lourdes pathologies.
Dans son rapport de 2013 consacré à la fin de vie des personnes âgées, l’ONFV relevait que 85 % des EHPAD ne disposaient pas d’infirmière de nuit, d’où une multiplication des hospitalisations en urgence.
Sur 17 705 patients décédés en 2012 aux urgences, 9 130 soit 52 % avaient entre 75 ans et 89 ans et 3 990 soit 22 % avaient 90 ans ou plus. 60 % de ces patients ont été hospitalisés pour une pathologie qui aurait nécessité des soins palliatifs (16).
Dans ce même rapport, une autre catégorie de la population, particulièrement vulnérable, apparaissait oubliée : les personnes handicapées en fin de vie. L’ONFV soulignait que dans un établissement sur deux, que ce soit une maison d’accueil spécialisée (MAS) ou un foyer d’accueil médicalisé (FAM), ni le médecin, ni l’infirmier n’avaient reçu de formation à l’accompagnement de la fin de vie. Cela se traduisait par une proportion de résidents ayant reçu des antalgiques puissants qui passait de 18 % dans les établissements où l’équipe soignante n’était pas formée aux soins palliatifs à 40 % lorsque ces derniers avaient reçu ce type de formation.
D’indéniables progrès ont été faits depuis la mise en place du premier plan de développement de soins palliatifs (17).
L’offre de soins s’est développée ; ainsi le nombre d’unités en soins palliatifs (USP) est passé de 90 en 2007 à 122 en 2012, soit une augmentation de 35 % et le nombre de lits de ces unités a augmenté, en progressant de 942 lits en 2007 à 1 301 en 2012, soit une hausse de 38 %. S’agissant du nombre de lits identifiés de soins palliatifs, il a varié de 3 060 lits en 2007 à 5 057 en 2011, soit une augmentation de 65 % (18). Enfin, le nombre d’équipes mobiles est passé de 337 en 2007 à 418 en 2011, en progression de 24 %.
Cependant, ces progrès ont privilégié les structures hospitalières.
Il est donc indispensable que cette proposition de loi s’accompagne d’un engagement de l’exécutif sur le développement de l’offre de soins palliatifs, particulièrement dans les structures médico-sociales.
Le Président de la République a annoncé le lancement d’un nouveau plan triennal de développement des soins palliatifs à compter de 2015, avec comme axe prioritaire la mise en place de ces soins à domicile. Les rapporteurs seront particulièrement vigilants à la mise en œuvre de ce nouveau plan.
S’agissant des EHPAD, la mise en place d’une infirmière de nuit pour 250 places à 300 places, comme le préconise l’ONFV, est nécessaire. D’autant plus qu’ainsi, lorsqu’un EHPAD dispose d’un tel poste, le taux d’hospitalisation aux urgences baisse de 37 %.
Donner aux équipes mobiles de soins palliatifs les moyens d’intervenir réellement dans les EHPAD et rendre obligatoire un module « accompagnement de la fin de vie » dans le diplôme de médecin coordonnateur d’EHPAD sont également des mesures qui permettraient de diffuser une démarche palliative dans ces institutions.
Dans ce même esprit, des stages entre les équipes mobiles et le personnel et les médecins des structures médico-sociales amélioreraient les conditions de fin de vie des personnes handicapées.
Enfin, il convient de mentionner que dans le cadre du projet de loi relatif à la santé, qui devrait être examiné prochainement à l’Assemblée nationale, un article (19) précise les différents modes de délivrance de soins, y compris les soins palliatifs, par les établissements de santé, qui pourraient se présenter sous forme ambulatoire ou à domicile, ce dernier terme couvrant tant le lieu de résidence que l’établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles.
Le rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France de décembre 2012 cité dans l’introduction de ce rapport soulignait que la prise en compte de la douleur était encore aléatoire. Il y était précisé que « si la médecine offre aujourd’hui des possibilités très sophistiquées de traitements contre la douleur, leur maniement concret laisse à désirer. Il y a peu de cours pratiques au profit d’abondants cours théoriques de pharmacologie sur les effets secondaires. En ce domaine comme dans beaucoup d’autres, les infirmières elles-mêmes sont de moins en moins aidées par des cadres de proximité responsables de la qualité et de la sécurité des soins qui préfèrent ou qui sont sommés d’accomplir des tâches administratives dénuées de toute attention réelle, directe à la personne malade. La loi ou la réglementation hospitalière aggravent la situation en empêchant des soignants infirmiers de prescrire de leur propre chef des médications antalgiques, en urgence, la nuit par exemple, sans une prescription médicale écrite, datée et signée, le plus souvent d’un interne de garde … [et que]… la souffrance psychique est peu prise en compte. »
Pourtant, la prise en compte et la lutte contre la souffrance dans sa dimension tant physique que morale, s’appuie sur des dispositions législatives d’ores et déjà très explicites du code de la santé publique consacrées au droit des personnes malades et que la proposition de loi vise à renforcer. Il convient de rappeler également ici que la lutte contre la souffrance, un devoir pour les personnels soignants, est au cœur des codes de déontologie inclus dans ce même code.
Ainsi, pour les médecins, l’article R. 4127-37 du code de la santé publique précise qu’en « toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie » et que « lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé (…) le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne (…) il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »
Les sages-femmes doivent « prodiguer leurs soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci » (article R. 4127-327). L’article R. 4311-2 dispose que les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs ont pour objet de « participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage » et l’article R. 4321-85 prévoit qu’en « toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement. »
Le rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France constatait également que dans une culture médicale essentiellement curative, alors que le médecin tend à devenir un technicien et le malade un usager, la médecine ne semble plus prêter l’attention nécessaire à la parole du patient.
Ce manque de communication, lorsqu’il porte sur des sujets aussi graves que les traitements et les soins assurés aux malades en fin de vie semble renforcé « par la faiblesse extrême de la formation des étudiants en médecine sur ce sujet et la quasi-absence de l’évaluation et de la formation continue des médecins durant leur exercice professionnel. S’agit-il de désintérêt ? Ou plutôt de manque de reconnaissance de l’institution universitaire et des organismes d’assurance maladie ? Toujours est-il que les disciplines étiquetées palliatives n’ont que peu ou pas de reconnaissance universitaire. Ceux qui choisissent cette voie s’écartent d’emblée des plus hautes reconnaissances et sont considérés par les praticiens de la médecine curative comme des “humanitaires” certes nécessaires mais dont le statut doit rester modeste. »
C’est à ces lacunes qui persistent, en matière de formation, qu’il convient de remédier.
La Société française d’accompagnement des soins palliatifs (SFAP) rappelle, dans ses différentes publications (20), que les lois du 9 juin 1999 et du 22 avril 2005 précitées qui visent à promouvoir les soins palliatifs et l’accompagnement supposent, pour leur réalisation, que l’accent soit mis sur ce qui les conditionne : la formation. L’amélioration de la prise en charge globale des personnes nécessite en effet la participation des équipes de soins et « une modification du savoir, savoir être et savoir-faire des différents soignants dans la prise en compte des symptômes, mais aussi dans l’écoute et l’accompagnement. » Ces changements impliquent à la fois une formation initiale et continue, toutes les deux renforcées.
Dans un article de décembre 2003, le docteur Véronique Blanchet remarquait qu’il pouvait sembler « paradoxal de créer un enseignement spécifique de la douleur et des soins palliatifs alors que cela fait partie intégrante de la médecine. » (21) La SFAP relève à cet égard, en effet, que « la science et la technique ont bien pris une place souvent prépondérante dans la relation soigné-soignant. À cela viennent s’ajouter les comportements de “consommation de soins” et le phénomène de judiciarisation. Dans ce cadre, si tant est qu’on évite les excès normatifs, la formation est un moyen de redonner du sens au soin en général et à la médecine, en particulier. Elle est un gage de réflexion sur la place de la personne malade dans notre société et nos responsabilités respectives. »
Le rapport la Commission de réflexion sur la fin de vie en France conclut donc parallèlement que « tant que la formation des professionnels de santé à la culture palliative restera marginale, il n’y a rigoureusement rien à espérer d’un changement des pratiques en France face aux situations de fin de vie. Si un nouveau regard, heurtant les conformismes et les traditions, n’est pas porté par les pouvoirs publics, il n’y a aucune possibilité que les institutions médicales elles-mêmes proposent de leur propre chef, des changements dont elles ne mesurent pas l’importance sociale pour les citoyens. »
Enfin, l’article L. 1112-4 du code de la santé publique, introduit par la loi du 9 juin 1999, précise que les « établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l’unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis », pour cela, « les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche. »
Certes, les trois cycles de formation initiale des médecins comportent des enseignements relatifs aux soins palliatifs et à l’éthique.
En 1er cycle, le traitement de la douleur, les soins palliatifs et l’éthique sont abordés à travers l’unité d’enseignement « santé, société, humanité », dès la première année commune aux études de santé. L’enseignement se prolongeant jusqu’au niveau de la licence, mais étant inclus dans un programme large, le temps consacré à ces questions est dès lors très variable.
En 2e cycle, le programme fixé par l’arrêté du 8 avril 2013, intègre, dans le tronc commun d’enseignements, une unité d’enseignement consacrée à « l’apprentissage de l’exercice médical et de la coopération interprofessionnelle » qui traite notamment de la relation médecin-malade dans le cadre du colloque singulier ou au sein d’une équipe, le cas échéant pluri-professionnelle, la communication avec le patient, les droits du patient et l’éthique médicale avec, en particulier, les principes éthiques à respecter lors des phases palliatives ou terminales d’une maladie. Le programme comprend également une unité d’enseignement « handicap – vieillissement – dépendance – douleur – soins palliatifs – accompagnement » qui comprend des enseignements sur les soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en phase palliative ou terminale d’une maladie grave, chronique ou létale et sur la connaissance des aspects spécifiques des soins palliatifs en pédiatrie et en réanimation.
L’intégration dans la formation pratique des dimensions palliatives, techniques, relationnelles, sociales et éthiques figure aussi, ce qui semble évident, dans l’unité d’enseignement « cancérologie-onco-hématologie ».
Les stages hospitaliers effectués pendant le 2e cycle doivent également permettre un meilleur échange avec d’autres professionnels de santé, la problématique des soins palliatifs étant, en principe, présente dans tous les services.
Le 3e cycle des études médicales comprend une formation à un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) « médecine de la douleur et médecine palliative » qui permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de la médecine palliative.
Les études d’infirmiers comportent aussi, depuis 2009, dans le cadre de l’alignement du diplôme d’État d’infirmier sur la licence, une formation aux questions d’éthique et aux soins palliatifs, à travers les unités d’enseignement « législation, éthique et déontologie » en première et deuxième années et « soins palliatifs et fin de vie » en troisième année. Les aides-soignants sont, quant à eux, formés depuis 1994 à l’approche spécifique des malades en fin de vie.
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a instauré une formation continue obligatoire pour les médecins : le développement professionnel continu (DPC) au chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
En matière de formation continue aux soins palliatifs, deux parcours universitaires sont proposés : les diplômes universitaires ou interuniversitaires de soins palliatifs (DUSP et DIUSP). Le premier, d’une durée d’un an, est également ouvert aux étudiants et aux professions paramédicales (sont en effet admis à s’inscrire, non seulement les docteurs en médecine et pharmacie mais les étudiants en médecine et en pharmacie, les étudiants en médecine de troisième cycle, les infirmières, les puéricultrices supérieures, les sages-femmes, les titulaires d’un diplôme d’État de kinésithérapie, les psychologues, les aides-soignantes, les travailleurs sociaux, les aumôniers et les accompagnants bénévoles), le second prolonge le cursus d’une année supplémentaire de formation clinique et critique.
Pourtant, dans son rapport public annuel de 2015 précité, la Cour des comptes souligne que « ces efforts ne se traduisent pas pour l’instant par une véritable évolution de la culture médicale qui reste marquée par la survalorisation des prises en charge techniques, au détriment des dimensions d’accompagnement et de prise en charge globale. De ce point de vue, la mise en place d’une filière universitaire de médecine palliative est considérée par de nombreux acteurs comme essentielle pour une véritable promotion de la démarche et pour le développement d’activités de recherche. »
C’est en effet une recommandation présentée dans l’avis citoyen sur la fin de vie (22) : « les soins palliatifs doivent être érigés en cause nationale avec l’objectif affiché d’un accès à tous (…) ces soins doivent être partie prenante dans la formation initiale comme continue de l’ensemble du corps médical, des médecins hospitaliers et généralistes aux étudiants en passant par l’équipe médicale et paramédicale. Ce processus de formation passe à nos yeux obligatoirement par un enseignement pratique, basé sur la transmission concrète par les médecins pratiquant des soins palliatifs de leurs expériences au contact des malades. Plus globalement, nous suggérons la possibilité d’un enseignement intégré du palliatif à toutes les spécialités médicales. Cette proposition est susceptible de réduire le clivage soins curatifs / soins palliatifs voire de faire bénéficier les patients de soins plus intégrés. »
Un certain nombre de contributions à la consultation citoyenne lancée sur le site de l’Assemblée nationale au mois de février 2015 ont également proposé l’obligation tant d’inclure dans la formation des étudiants en médecine que dans la formation continue des médecins et des soignants en exercice un enseignement sur le traitement de la douleur, et sur les lois du 9 juin 1999 et du 22 avril 2005.
Aussi les rapporteurs, dans le document de présentation de la proposition de loi précité appellent à « l’engagement d’un effort massif dans le développement de la formation initiale et continue des médecins car la formation des étudiants et des médecins aux soins palliatifs et à l’accompagnement est un levier essentiel de l’amélioration des pratiques en France face aux situations de fin de vie ». Ils soulignent également que l’effort de formation doit maintenant largement porter sur le 3e cycle des études médicales, afin d’associer la formation théorique avec un enseignement transversal et la formation pratique dans le cadre de l’exercice hospitalier, la réforme en cours de ce cycle des études médicales devant permettre tout à la fois : « la création d’un enseignement spécialisé de haut niveau (…) pour les médecins qui se destinent à un exercice exclusif en structure de soins palliatifs (…) et rendre obligatoire un séminaire de formation dans tous les diplômes d’études spécialisées (DES) particulièrement concernés par la fin de vie (cancérologie, gériatrie, neurologie, médecine générale, réanimation…). La formation pratique pourra ainsi passer par l’habilitation des unités de soins palliatifs comme lieu de stage validant pour les DES concernés. »
L’annonce faite par le Président de la République, lors de la remise de cette présentation, visant à intégrer aux formations sanitaires un enseignement obligatoire et commun, spécifiquement consacré à l’accompagnement des malades est également bienvenue et les rapporteurs s’en félicitent.
Il est en effet essentiel que « les soins palliatifs ne soient plus associés à un constat d’échec de la médecine » et deviennent une partie intégrante de la mission du médecin et des professionnels de santé, assurant ainsi un véritable continuum entre les approches préventives, curatives et palliatives de la pratique médicale.
La Commission des affaires sociales examine la présente proposition de loi au cours de ses séances du mardi 17 février 2015.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Depuis la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs, le sujet difficile et complexe qui nous réunit aujourd’hui a fait l’objet de nombreux débats et réflexions ; et, depuis 2012, plusieurs travaux ont jalonné la route qui nous a conduits au présent texte : on peut mentionner le rapport de la commission Sicard et les travaux du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), présidé par M. Ameisen – que nous avons auditionné –, sans oublier la proposition de loi de M. Jean Leonetti visant à renforcer les droits des patients en fin de vie, que nous avons examinée en juin 2013, et la proposition de loi de Mme Véronique Massonneau visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie, texte dont nous avons débattu il y a quelques semaines.
La proposition de loi qui nous est aujourd’hui soumise a fait l’objet, à l’initiative du Président Claude Bartolone, d’une consultation citoyenne sur le site de l’Assemblée. Cette consultation, lancée à titre expérimental, a obtenu un gros succès d’audience puisque, entre le 2 et le 16 février, pas moins de 11 922 contributions ont été déposées par les internautes. Je laisserai les rapporteurs nous donner leur sentiment sur le contenu de cette consultation, notamment sur la façon d’exploiter les contributions recueillies.
Enfin, comme à l’ordinaire, j’ai saisi mon homologue de la commission des finances des amendements dont la recevabilité financière me paraissait douteuse. Ont ainsi été déclarés irrecevables les amendements identiques AS1, AS9, AS55 et AS62, ainsi que les amendements AS113, AS119 et AS115.
M. Alain Claeys, corapporteur. En juin dernier, le Premier ministre nous a demandé un rapport sur la question des patients en fin de vie, question dont vous avez rappelé, madame la présidente, qu’elle a fait l’objet de nombreux travaux depuis l’élection du Président de la République. On peut évoquer, entre autres, le rapport commandé par ce dernier à M. Sicard, l’avis du Comité consultatif national d’éthique et le rapport publié par cette instance sur la base de débats publics et d’autres travaux. Enfin, sous la présente législature, votre commission a examiné deux propositions de loi sur le sujet.
Au seuil de nos travaux, l’établissement d’un nouveau rapport nous est rapidement apparu inutile : la question était plutôt celle d’une avancée législative qui pût s’appuyer sur les rapports précédents et réunir opposition et majorité. Je ne reviendrai pas, d’autre part, sur les nombreuses auditions que nous avons conduites ; elles témoignent de ce que la représentation nationale et l’exécutif ont à répondre à une question centrale, l’égalité de nos concitoyens face à la mort. Sur ce sujet, des inégalités subsistent entre les territoires et les hôpitaux, mais aussi entre les patients qui meurent à domicile ou en maison de retraite. Ce sont 51 % de patients qui, rappelons-le, décèdent au sein des services d’urgence.
Les soins palliatifs, qui sont de droit, sont très inégalement répartis sur le territoire. On n’en administre guère à domicile et dans les maisons de retraite et, lorsqu’ils font l’objet d’un service dédié au sein des hôpitaux, ils n’interviennent qu’en toute fin de vie ; qui plus est, ils n’ont que peu de lien avec les soins curatifs, sauf en cancérologie. De telles inégalités sont très vivement ressenties par nos concitoyens. Enfin, la fin de vie pose également l’enjeu central de la formation des médecins.
Il est donc indispensable que notre proposition de loi s’accompagne d’un engagement de l’exécutif sur le développement des soins palliatifs et sur la formation des médecins. Le Président de la République s’est déjà exprimé à ce sujet ; le ministère de la santé et le secrétariat d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche doivent aussi s’engager.
Nos concitoyens ont formulé deux vœux très clairs : celui d’être entendus ; celui d’avoir la possibilité d’une fin de vie apaisée et digne, qu’il s’agisse d’eux-mêmes ou de leurs proches. C’est à cette double interpellation que Jean Leonetti et moi avons tenté de répondre.
La fin de vie fait débat : faut-il laisser, voire faire mourir les patients concernés ? Notre texte ne tranchera pas cette question, dont nous devons débattre de façon calme et apaisée.
Nous ne partions pas de rien puisque la loi Kouchner de 2002 et la loi Leonetti de 2005, adoptée à l’unanimité, avaient déjà fixé un cadre. La nécessité d’un nouveau texte tient cependant à plusieurs raisons, à commencer par la méconnaissance de la loi Leonetti, laquelle, je le dis d’autant plus facilement que je l’avais votée, est également tournée vers les médecins davantage que vers les patients, auxquels notre texte entend donc conférer de nouveaux droits ; pour ce faire notre proposition de loi vise les directives anticipées, qui s’imposeront au médecin – moyennant certains garde-fous –, sans supprimer, bien entendu, le colloque singulier qui le lie aux patients et à leur entourage.
Nos concitoyens, je l’ai dit, veulent également être entendus : c’est l’enjeu de la sédation profonde continue, jusqu’au décès, administrée conjointement à l’abandon des traitements curatifs. Cette demande, formulée dans des conditions précisées à l’article 3, engage donc des actes médicaux ; elle pourra intervenir dans trois cas de figure, sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir.
Le Parlement, je crois, commettrait une faute en n’apportant pas de réponse aux inégalités que j’évoquais et aux aspirations de nos concitoyens.
Vous avez enfin évoqué, madame la présidente, la consultation citoyenne décidée par le président de l’Assemblée nationale. Une telle consultation ne me choque en rien, bien au contraire : il n’est pas question d’opposer démocratie représentative et démocratie participative, quelle que soit la forme qu’elle prenne, et, sur de tels sujets, un éclairage peut être utile au législateur. Cependant, comme je l’ai dit au président Bartolone, les contributions seront d’autant plus utiles qu’elles reposeront sur des avis éclairés. Chacun n’ayant pas le même niveau d’interprétation sur des sujets parfois complexes, un accompagnement me paraît nécessaire. Les services de la commission ont procédé au dépouillement des quelque 10 000 contributions sur le présent texte ; sans doute faudra-t-il réfléchir aux moyens de renforcer ce type de procédure.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Je partage bien entendu ce qui vient d’être dit. Alain Claeys et moi avons travaillé sur la base d’une lettre de cadrage du Premier ministre qui énumérait les trois thématiques évoquées : la sédation en phase terminale, l’opposabilité des directives anticipées et le développement des soins palliatifs.
La loi de 1999 a ouvert droit aux soins palliatifs ; celle de 2002 a rendu la parole du malade opposable s’agissant de l’arrêt des traitements ; celle de 2005, enfin, a condamné l’acharnement thérapeutique et imposé la non-souffrance et le non-abandon. Or ces trois lois ne sont pas appliquées – c’est d’ailleurs le premier constat de Didier Sicard dans son rapport. Autrement dit ce nouveau texte, pour être appliqué – et ce faisant échapper aux critiques ultérieures sur son contenu –, appelle des moyens. Le développement des soins palliatifs et la formation des médecins sont deux enjeux aussi essentiels, de ce point de vue, que le vote d’un nouveau dispositif législatif. On ne change pas les mœurs avec des lois ; en l’occurrence c’est notre culture médicale, focalisée sur la guérison bien plus que sur le soulagement des souffrances, qui doit profondément évoluer.
J’en viens aux deux mesures-phares de notre proposition de loi. La première a trait au caractère contraignant des directives anticipées : l’opposabilité, elle, poserait des problèmes juridiques, en particulier dans les situations d’urgence, où il peut être difficile d’avoir connaissance de ces directives : des soins de réanimation, dans le cas d’un suicide ou d’un accident sur la voie publique, par exemple, peuvent être nécessaires avant toute réflexion sur les souhaits éventuels du malade. L’une des faiblesses majeures de la loi de 2005 est l’absence de cadre pour la rédaction des directives anticipées, rédaction dont on peut constater la difficulté, surtout lorsque l’on est en bonne santé. Aussi proposons-nous de confier à la Haute autorité de santé (HAS) et au Conseil d’État le soin de donner un cadre à cette rédaction, conformément à la procédure suivie dans des pays qui, tels le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont des législations comparables à la nôtre. Avec ce support, la rédaction des directives anticipées sera claire pour chacun, ce qui facilitera notamment la tâche des médecins qui auront à les suivre.
Quant à la sédation en phase terminale, on a observé qu’elle est déjà possible ; elle l’est, c’est vrai, mais le médecin peut aussi ne pas l’administrer. Or 12 % des Français meurent dans des souffrances physiques intolérables, et près de 80 % des étouffements, par exemple, ne font l’objet, en fin de vie, d’aucun traitement de nature à les soulager. Comme l’a suggéré Alain Claeys, il faut donc passer d’un devoir des médecins à un droit qui est comme son miroir, le droit des malades. Il n’y a là rien qui doive choquer le corps médical, car il est évident qu’un patient à qui il ne reste que peu de temps à vivre doit être soulagé de ses douleurs ou, s’il est réfractaire au traitement, faire l’objet d’une sédation. Les médecins devraient administrer ces soins ; mais, si cette injonction à leur devoir ne suffit pas, la demande du patient doit être de droit.
La sédation revient à endormir profondément le patient ; M. Claeys et moi ne sommes pas favorables à la solution qui consiste à le réveiller périodiquement pour lui demander s’il continue de souffrir : la sédation, à notre sens, doit aller jusqu’au terme de la vie et être profonde, afin d’apaiser réellement la souffrance.
Quant au fait de savoir si la sédation contribue à accélérer la mort, cela nous paraît être un faux problème : d’une part, les sédatifs peuvent tout aussi bien allonger que raccourcir la vie, à supposer d’ailleurs qu’ils aient un effet. Puisque la sédation se prolonge jusqu’au décès, nul ne saura jamais ce qu’il en est sur ce point. D’autre part, ma conviction est que, au moment considéré, la qualité de la vie prime sur sa durée. Le devoir d’assistance trouve donc, avec la sédation profonde, son aboutissement le plus logique.
Sur la consultation citoyenne, je réserverai la primeur des analyses au président de l’Assemblée. Alain Claeys et moi, respectivement président et rapporteur d’une mission d’information sur la révision des lois bioéthiques, avions, dans ce cadre, lancé une telle consultation sur internet, d’ailleurs assortie de nombreuses auditions ouvertes au public. Cette opération avait permis de rassembler des panels de citoyens sur l’ensemble du territoire. Je rappelle aussi que c’est l’un de nos amendements à la loi sur la bioéthique de 2011 qui a rendu ce type de consultation obligatoire. On peut toutefois regretter que celle dont nous parlons arrive trop tard, et surtout qu’elle ne s’appuie sur aucun support, comme l’a noté Alain Claeys. Ce faisant elle a donné un écho à l’avis, non de l’ensemble de nos concitoyens, mais plutôt de ceux d’entre eux qui, organisés en associations, ont des convictions souvent tranchées sur ces sujets. Bref, une telle expérimentation avait déjà eu lieu, et dans de meilleures conditions puisque, d’une durée de six mois, elle s’était faite sur la base d’un support énumérant les différents courants de pensée sur le sujet : cela avait permis des échanges fructueux entre informations et contributions.
Le fait que la majorité et l’opposition se réunissent sur un texte comme celui-ci n’implique nulle trahison de part et d’autre : c’est au contraire le signe d’une convergence qui fait suite à des doutes fertiles et légitimes. Alain Claeys et moi n’avons négocié aucun compromis en acceptant telle ou telle disposition en échange d’une autre ; nous avons surmonté certaines oppositions, forts de la conviction que notre texte fait avancer la cause de l’accompagnement de la fin de vie et qu’il évitera des souffrances inutiles à certains de nos concitoyens.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Comme je l’avais indiqué lors de l’examen de la proposition de loi de Mme Véronique Massonneau, nul n’a raison ou tort sur de tels sujets, qui font appel à des convictions intimes, par définition toutes respectables. Je ne doute donc pas de la qualité d’un débat qui transcendera nos clivages habituels, dès lors qu’il sera question de l’attitude de chacun face à la mort, la sienne comme celle de ses proches. Aucun jugement ne sera donc porté sur les positions des uns et des autres.
Mme Michèle Delaunay. Je salue la démarche que consacre le présent texte, celle de la recherche d’un consensus politique tout au long de débats qui ont duré plusieurs mois. Ils font suite aux travaux du Comité consultatif national d’éthique, qui avait procédé à de nombreuses auditions sur l’ensemble du territoire, et au débat public qui s’était ouvert à la suite de procès très médiatisés. Je salue également le travail des deux rapporteurs, qui, avec la sérénité et le sens de la mesure qu’on leur connaît, ont su mener à bien leur tâche.
Notre consensus politique est en effet le fruit d’une démarche exceptionnelle, tout particulièrement sur des sujets de cette gravité, et il correspond aux attentes de la majorité des Français : de fait, en de telles matières, qui pourrait proclamer détenir la vérité ? Beaucoup de sondages en témoignent, qui interrogent nos concitoyens sur ce qu’ils préfèrent, entre une mort dans la souffrance et une mort plus rapide – quand la grande majorité d’entre eux préféreraient ne pas mourir du tout. (Sourires.) Bref, la plus grande prudence s’impose.
Cette proposition de loi est nécessaire, car on meurt encore de nos jours comme on mourait sous Louis XIV. Parce que l’on meurt plus tard, parfois après avoir échappé à des chocs très sévères, on peut mourir dans de grandes souffrances, telles que des artérites ou des étouffements.
Le texte qui nous est soumis ne présente que des avancées : nul, parmi nous ou parmi nos concitoyens, ne parle à son sujet de recul. Ces avancées contribueront à résorber les inégalités face à la mort : inégalités entre les territoires, on l’a rappelé, mais plus encore entre les âges, les plus défavorisés étant, paradoxalement, les patients les plus âgés.
La sédation prolongée est un droit nouveau, et la prise en compte de la volonté de la personne en tant que telle, plutôt que de sa famille ou de son entourage, me semble être une avancée majeure. Le texte comporte aussi des avancées considérables sur les soins palliatifs, qui sont un droit auquel tous les patients, nous le savons, n’ont pas accès.
Enfin, si je puis exprimer un avis de praticienne, les dispositions qui nous sont soumises me paraissent opératives, tant elles apportent des solutions concrètes tout en restreignant la possibilité de s’y soustraire. On parle toujours de la qualité de vie des malades, mais ce texte nous invite à considérer la qualité de la mort, que nous devons regarder comme une exigence au moins égale. Nous faisons un pas en avant en ce sens ; et si d’autres progrès ne sont pas à exclure dans le futur, ils dépendront d’abord de l’égal accès de chacun aux soins palliatifs, y compris au regard de leur qualité.
M. Jean-Louis Touraine. Madame la présidente, mes chers collègues, je voulais à mon tour féliciter Alain Claeys et Jean Leonetti, ainsi que tous les groupes de travail, ceux de la société civile comme ceux de l’Assemblée nationale. Nos rapporteurs ont effectué un travail méritoire d’analyse, de concertation et de recherche d’un consensus. Il nous permet à tous – les Français et nous-mêmes – d’être éclairés et il nourrit cette proposition de loi qui comporte des avancées substantielles et des droits additionnels pour nos concitoyens confrontés à la mort.
Il reste quelques situations qui peuvent paraître insuffisamment prises en compte, évoquées par Alain Claeys quand il analyse les différentes circonstances d’application du texte. Il existe aussi des risques de disparités d’application si les recommandations ne sont pas suffisamment claires. J’en tire deux conséquences : ce texte doit être enrichi par le travail parlementaire ; le résultat final devra lui-même être retouché à l’avenir pour s’adapter à l’évolution de la réflexion dans notre société. Personnellement, je propose deux amendements et j’en soutiens plusieurs autres.
Selon les données publiées en 2012 par l’Institut national d’études démographiques (INED), chaque année dans notre pays, entre 2 000 et 4 000 personnes terminent leur vie en ayant une aide active à mourir de la part des médecins. En outre, comme le rappelait Manuel Valls fin 2009, et comme l’indiquait une enquête publiée par Le Nouvel Observateur dès 2007, plus de 2 000 soignants ont reconnu avoir, en conscience, aidé médicalement des patients à mourir. Les juges sont désarçonnés par l’inadéquation entre les pratiques et la loi.
L’aide active à mourir est donc la question principale dont il nous faut débattre ici et dans l’hémicycle. Dans certaines circonstances d’exception, doit-elle être le choix du médecin, par exemple sous la forme d’une sédation médicalement décidée qui peut abréger la vie, comme le prévoit la proposition de loi ? Doit-elle être le choix du patient, après avis d’un collège de médecins, comme certains amendements le suggèrent ? L’esprit de la proposition de loi – donner plus de responsabilité aux patients qu’à la seule équipe médicale – milite pour ce deuxième choix.
En ce qui concerne mon groupe, je propose de ne pas en rester le coreprésentant avec Michèle Delaunay, afin de pouvoir m’exprimer avec une totale liberté sur les amendements qui sont signés par une grande partie des députés de mon groupe et soutenus par d’autres.
Mme Isabelle Le Callennec. Permettez-moi tout d’abord de rendre hommage à Jean Leonetti. Auteur de la loi éponyme adoptée à l’unanimité en 2005, il s’emploie sans relâche et avec passion à en expliquer les contours aux équipes médicales et aux familles.
Dix ans après la promulgation de cette loi, on s’accorde généralement à reconnaître qu’elle répond à une très grande majorité des situations de fin de vie. En revanche, tous les rapports insistent sur le fait qu’elle est mal connue et pas systématiquement appliquée, que les soins palliatifs auxquels les patients devraient pouvoir prétendre ne sont pas accessibles à tous, et qu’il y a lieu de s’interroger sur quelques rares situations que la loi ne couvre pas.
Cette question fondamentale de la fin de vie a fait l’objet d’une large concertation, souhaitée par le Président de la République « dans un esprit de rassemblement » : avis du Comité consultatif national d’éthique, rapport Sicard, et même consultation citoyenne qui aurait donné lieu à environ 12 000 contributions sur le site de l’Assemblée nationale en moins de quinze jours. Nous autres, commissaires aux affaires sociales, nous aimerions prendre connaissance de ces contributions qui sont censées alimenter nos travaux parlementaires.
Revenons à cette proposition de loi que vous qualifiez, chers collègues, d’opérative. Je veux saluer la contribution des deux rapporteurs : Jean Leonetti, du groupe UMP, et Alain Claeys, du groupe SRC. Leurs travaux nous éclairent sur l’état de la prise en charge de la fin de vie dans notre pays et proposent les moyens de l’améliorer via cette proposition de loi dont nous partageons pleinement l’esprit : le refus de l’acharnement thérapeutique et de l’obstination déraisonnable ; la non-souffrance de la personne mais l’interdiction de tuer qui est et doit rester absolue.
À l’instar de Robert Badinter, nous estimons que le droit à la vie est le premier des droits de l’homme et que personne ne peut disposer de la vie d’autrui. C’est la raison pour laquelle nous restons opposés à toute légalisation de l’euthanasie. Nous mettons aussi en garde contre la tentative d’aide active à mourir qui risque de recouvrir les mêmes réalités.
Au contraire, nous estimons que notre corpus juridique doit créer les conditions favorables à un accompagnement tout au bout de la vie. Il s’agit de nos semblables ; ils se trouvent dans une situation d’extrême fragilité et rien dans notre regard ne doit trahir l’idée qu’ils ne seraient plus dignes de vivre. Nous avons de nombreux témoignages d’équipes qui travaillent dans des unités de soins palliatifs. Si les demandes de recours à l’euthanasie existent, dans l’immense majorité des cas elles ne sont pas réitérées dès lors que les personnes sont soutenues et accompagnées, que leur souffrance est soulagée.
Nous devons donc parvenir à concilier le devoir des médecins et le droit des malades. Si la loi est mal appliquée par le monde médical, c’est par manque d’information et de formation. Le Président de la République a annoncé que la formation des jeunes médecins allait être renforcée dès la prochaine rentrée universitaire, ce dont nous nous réjouissons.
Si le recours aux soins palliatifs n’est pas systématique, c’est parce que notre pays ne compte pas suffisamment d’unités spécialisées. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes s’est intéressée aux personnes décédées à l’hôpital en 2009 : seulement un tiers de celles qui auraient pu recevoir des soins palliatifs en a effectivement bénéficié. La Cour constate néanmoins des progrès réels entre 2007 et 2012 : une augmentation de 35 % des unités spécialisées, de 65 % des lits identifiés et de 24 % des équipes mobiles. Pour les équipes qui y font un travail remarquable de soin, pour les bénévoles des associations qui s’engagent avec humanité dans l’accompagnement psychologique, la crainte est grande qu’une légalisation de l’euthanasie ne soit prétexte à relâcher les efforts.
Nos collègues Alain Claeys et Jean Leonetti nous proposent une voie d’amélioration de la loi sans en dévoyer l’esprit, notamment grâce à deux mesures emblématiques : une meilleure prise en compte des directives anticipées, contraignantes et non opposables ; un droit absolu à la prise en compte de la souffrance via la sédation profonde et continue jusqu’à la mort, quand le pronostic vital est engagé à court terme.
Dans sa très grande majorité, le groupe UMP estime qu’un point d’équilibre a été trouvé grâce à ce texte. Notre société a été bien malmenée par des réformes sociétales qui l’ont profondément divisée. Dans le contexte actuel, nos concitoyens attendent de nous, sur des sujets aussi sensibles, des propositions qui rassemblent.
M. Arnaud Richard. Je m’associe à nos collègues pour saluer la qualité du travail de Jean Leonetti et Alain Claeys.
La loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, adoptée à l’unanimité en 2005, constitue un point d’équilibre : elle permet de mieux respecter l’expression et la volonté des malades et de prendre en compte les souffrances de ceux qui sont en fin de vie, en faisant progresser les soins palliatifs ; elle autorise toute personne malade à refuser un traitement dont elle estime qu’il est devenu déraisonnable ; elle donne au médecin le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre des traitements qu’il estime inutiles, condamnant ainsi clairement l’acharnement thérapeutique.
Pour autant, des difficultés majeures subsistent : la douleur des patients n’est pas suffisamment prise en charge ; l’obstination déraisonnable demeure malheureusement une réalité dans notre pays ; l’accès aux soins palliatifs n’est pas toujours effectif ; la formation des médecins est encore largement insuffisante sur ce sujet.
Comment, dès lors, faire en sorte qu’il n’y ait ni souffrance ni abandon ni acharnement ? Si la loi de 2005 a permis d’éliminer des zones d’ombre, il en reste encore quelques-unes et deux questions majeures se posent. Doit-on et peut-on aller plus loin, dans certains cas exceptionnels où l’abstention thérapeutique ne suffit plus à soulager les patients qui souffrent de manière insupportable ? Doit-on et peut-on assumer un acte médical pour mettre fin à cette souffrance insupportable et irréversible ?
Ces deux questions en soulèvent de nombreuses autres. À partir de quel moment est-il possible de considérer que les traitements ne permettront pas d’éviter une issue fatale ? Comment juger du caractère insupportable de la douleur ? Comment s’assurer du consentement du patient ? Que faire dans les cas où ce consentement ne peut plus être obtenu ? Comment comprendre les directives anticipées alors même que le questionnement, face à la mort, évolue ? Comment être certains de ne pas emprisonner un malade dans une formulation ancienne de sa volonté ?
Tenter de répondre à une question si intime et personnelle exige d’adopter une attitude profondément humble. Face à l’extraordinaire complexité de la fin de vie et de l’idée même de légiférer sur ce sujet, il est nécessaire de prendre des précautions.
Je souhaite ici affirmer l’opposition de notre groupe à la légalisation de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté qui revient à consentir à la société, fût-elle représentée par le médecin, un droit sur l’existence de chacun, qui outrepasse largement le respect – pourtant souhaité par tous – de la personne.
Une évolution de la loi peut être envisagée pour éviter les souffrances, les abandons, l’acharnement, mais une rupture abrupte des digues érigées par la loi Leonetti risquerait d’entraîner des dérives qui, selon nous, seraient insupportables. Nos collègues Claeys et Leonetti, conscients du risque, tentent de préserver cet équilibre en proposant deux mesures phares : des directives anticipées qui s’imposeraient au médecin ; l’affirmation claire d’un droit à la sédation en phase avancée ou terminale. Cette proposition de loi permettrait à ceux qui sont proches de la mort, s’ils le demandent, de s’endormir plutôt que d’être confrontés à une souffrance intolérable, ou à ce qu’ils peuvent parfois vivre comme une déchéance. C’est une nuance infime et pourtant essentielle qui nous sépare de l’équilibre trouvé en 2005.
Mme Véronique Massonneau. Nous voilà réunis pour débattre du texte qui a servi à justifier, il y a trois semaines, le renvoi en commission de celui que je défendais ici même. Vous comprendrez, mes chers collègues, que je serai donc doublement attentive à ce que notre commission prenne le temps d’aborder consciencieusement les nombreuses questions de fond que soulève cet important sujet de la fin de vie.
Il s’agit bien d’ouvrir de nouveaux droits pour les patients. Vous conviendrez, et je m’adresse particulièrement à l’opposition, que les soins palliatifs – qui existent depuis 1999 – ne constituent pas un nouveau droit. S’il vous plaît, ne réduisons pas ce débat à une opposition simpliste et totalement erronée entre les soins palliatifs et le droit de choisir sa fin de vie y compris par l’euthanasie. Cette vision manichéenne est fausse et elle ne fait pas avancer le dialogue. Je regrette que certains amendements de l’opposition soutiennent cette posture clivante et stérile.
Chers collègues, je vous invite plutôt à déposer une proposition de loi concernant les soins palliatifs, et pas une proposition de résolution qui n’a pour but que de nier le choix du patient et défaire chacun de la liberté de disposer de son corps. Déposez une proposition de loi qui permette enfin que les soins palliatifs ne soient plus uniquement opposés à d’autres choix possibles de fin de vie de façon pavlovienne, mais qu’ils soient bien considérés à leur juste valeur. Les écologistes, qui ont déjà initié de telles propositions, seront alors prêts à soutenir la vôtre. Ce n’est pas le sujet du jour et vous comprendrez que les écologistes écarteront les amendements qui iraient dans ce sens.
Aujourd’hui, il s’agit d’ouvrir de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie, comme l’annonce l’intitulé de ce texte. Quels sont donc ces nouveaux droits ? Les directives anticipées, désormais opposables et mentionnées sur la carte Vitale, ont une valeur exécutive et non plus seulement consultative. Cette mesure figure dans la proposition de loi que j’ai défendue ici, et je ne peux que saluer cette avancée. En fait, il s’agit du seul réel nouveau droit proposé par ce texte, et qui ne concerne que les cas où la personne est inconsciente et a rédigé des directives anticipées.
Quant à la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’à la mort, elle existe déjà. Il en va de même pour l’arrêt de l’alimentation et de la nutrition artificielles du patient, ce que le Conseil d’État a requis dans le cas de Vincent Lambert. Pour cet homme dont la situation faisait polémique, en l’absence de directives anticipées, l’hydratation et l’alimentation artificielles auraient pu être suspendues depuis longtemps.
Des médecins utilisent déjà la sédation à visée ultime. En revanche, ce texte ne laissera plus le médecin libre de choisir d’y avoir recours ou non à la place de son patient. Il y sera contraint si le patient le demande et si sa situation le justifie. Monsieur Leonetti, vous avez évoqué des pratiques particulières qui perdurent, comme celle de réveiller son patient pour vérifier qu’il souhaite toujours poursuivre la sédation. Je ne reproche rien aux médecins ; je comprends très bien qu’ils puissent craindre d’être poursuivi en justice, d’autant que les interprétations possibles sont nombreuses compte tenu du caractère flou de la législation actuelle.
Il s’agit de sécuriser le médecin pour mieux garantir le choix du patient mais, chers collègues, peut-on dire sincèrement qu’il s’agit d’un nouveau droit ? Il s’agit plutôt d’une amélioration de l’écriture d’un texte qui a déjà dix ans, qui est toujours mal appliqué car ambigu. Je dirais même que c’est le service minimum. Comment pourrions-nous nous contenter de cela ? Les nombreux concitoyens qui m’ont parlé de leur cas personnel, souvent douloureux, attendent une véritable avancée. Je n’imagine pas me retrouver en face d’eux et leur dire dans les yeux qu’ils doivent se satisfaire de ce texte.
Croyez-vous sincèrement que cette proposition endiguera un phénomène dramatique : ces Français qui vont mourir à l’étranger, comme des clandestins, dans des pays où leur choix est réellement respecté ? Si nous, écologistes, ne pouvons pas nous opposer à ce texte, nous ne pouvons pas non plus l’approuver en l’état.
Nous attendons donc que notre commission le fasse évoluer afin qu’il corresponde concrètement aux attentes des Français, comme le candidat Hollande le leur a promis. De nombreux amendements très intéressants ont été déposés, ce dont je me réjouis. Votons en conscience et débattons avec un seul souci : le respect de l’ultime liberté de chacun.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Merci d’accueillir le passager clandestin que je suis, n’étant pas membre de votre commission.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous êtes le bienvenu.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Lors de la consultation citoyenne esquissée par la présidence de l’Assemblée nationale, il n’eût pas été anormal que les trois propositions de loi existantes – celle des rapporteurs, celle de Mme Massonneau et celle du groupe RRDP – fussent soumises aux citoyens sans que l’on privilégiât l’une d’elles. À ma connaissance, il s’agit bien d’une proposition de loi et non d’un projet de loi, même si le Gouvernement y semble d’autant moins hostile qu’il a peut-être contribué à l’inspirer ou à la valider. J’emploie des termes mesurés, à dessein.
Après 1 000 jours de consultations auprès d’instances ou de personnalités dont on savait à l’avance qu’elles étaient hostiles à l’aide active à mourir, nous voici donc saisis d’une proposition de loi. J’insisterai, moi aussi, sur les soins palliatifs puisque les radicaux de gauche sont à l’origine de la loi de 1999 sur le sujet. Reste à mettre tous les moyens financiers en face de cette avancée considérable.
Vous qui êtes médecin, Monsieur Leonetti, vous savez mieux que moi que, dans certains cas, les soins palliatifs ne soulagent plus le patient. Que faire ? Vous proposez la sédation profonde et continue. Sommes-nous sûrs que celle-ci ne s’accompagne pas d’une agonie lente, longue, et de souffrances provoquées par la faim, la soif, d’éventuelles phlébites, escarres ou infections ? Si tel est le cas, ce dispositif ne répond pas à l’objectif recherché : partir sans souffrir. Il ne faudrait pas que le patient souffre encore plus que s’il était décédé d’une mort naturelle.
Je mesure bien la différence qui existe entre la sédation dite profonde et continue et l’aide active à mourir, mais elle est extrêmement théorique. C’est une sédation profonde et continue jusqu’au décès, comme vous le dites. Dans Libération, M. Claeys parle d’une « aide à mourir » qui prend la place du « laisser mourir ». En réalité, l’objectif est le même, mais l’on peut penser qu’une aide active à mourir, dans des conditions qui ne soient pas celles que vous décrivez, sera moins douloureuse pour le patient qu’une sédation dite profonde et continue. Je pense que la sédation profonde et continue est plus confortable pour le médecin que pour le patient. Le médecin ne pourra être accusé d’avoir procédé à ce que le code pénal qualifie de meurtre, de meurtre aggravé ou d’empoisonnement ; il pourra dire qu’il s’est borné à soulager la souffrance sans apporter une aide active à mourir. En réalité, l’issue est la même et la dualité est largement fausse.
Cette proposition de loi aurait encore un plus grand mérite si elle était amendée de manière à donner le choix au patient entre votre solution et une autre qui serait l’aide active à mourir. Au fond, cela concerne le patient. J’entends parler de texte de consensus, de rassemblement. Nous ne sommes pas sur un point où la priorité des priorités serait de rechercher des équilibrages politiques ; nous sommes sur un point où il est indispensable d’agir pour le patient, pour qu’il ait une mort sans souffrance. Cela mérite une réflexion approfondie. Nul ne sait quelle est la bonne solution, car celle-ci dépend très largement de convictions personnelles.
Objectivement, en ce qui concerne les soins médicaux, je m’alarme d’un fait : l’article 3 de votre proposition de loi – qui est fondée sur l’arrêt des traitements – considère l’hydratation et la nutrition artificielles comme des traitements. Faute de définition légale ou réglementaire, on ne savait pas très bien jusqu’à présent si l’hydratation et la nutrition artificielles étaient ou non des traitements. Les qualifiant de traitements, vous rendez obligatoire leur arrêt. Je ne suis pas sûr que cela soit un progrès pour la qualité de la mort du patient, je pressens même plutôt le contraire. Comme notre but n’est pas de rendre le décès plus douloureux qu’il ne l’est actuellement, au contraire, je me pose des questions sur votre texte qui ne correspond pas à ce que souhaite notre groupe. Peut-être sommes-nous dans l’erreur ? En tout cas, je me suis permis d’exposer avec sincérité ce que je ressens à la lecture de ce document intéressant.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous en avons terminé avec les interventions des représentants des groupes politiques. Monsieur Touraine, je prends acte de votre demande de ne plus être responsable pour le groupe SRC, compte tenu d’amendements que vous serez amené à présenter et qui sont d’ailleurs soutenus par des parlementaires d’autres groupes.
M. Gérard Sebaoun. Nous abordons ce texte avec gravité et sérieux. Pour ma part, je veux écarter deux sujets : les sondages – dont nous devons nous méfier à ce stade – qui indiqueraient que les Français préfèrent telle ou telle fin de vie et qu’ils plébiscitent l’euthanasie ; les soins palliatifs qui ne sont pas le sujet de cette proposition de loi, même si on doit leur donner toute la place qu’ils méritent et qu’ils n’ont pas encore dans notre pays, comme l’ont souligné Alain Claeys et Véronique Massonneau.
Cette proposition de loi se veut un texte d’équilibre et je respecte le travail accompli. Avec d’autres, j’ai déposé des amendements qui visent à apporter des précisions car, dans un tel texte, tous les mots ont un sens. À l’alinéa 4 de l’article 8, on nous parle de directives « manifestement inappropriées », une formule qui illustre mon propos et nous invite à aller plus loin dans l’exercice de notre responsabilité de législateur. D’autres amendements porteront sur le fond du débat et iront au-delà du champ de nos deux rapporteurs : l’aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide médicalement assisté ou d’une euthanasie. Nous serons plusieurs à engager ce débat que réclament nos concitoyens, certains d’entre eux depuis plus de trente ans.
Les débats font rage depuis longtemps sur ces sujets, ici et au-delà de nos frontières. La loi adoptée récemment au Québec présente l’immense avantage d’embrasser totalement le triptyque des soins de fin de vie : les soins palliatifs ; la sédation palliative, dite continue dans la proposition de loi ; et l’aide médicale à mourir.
Dans un amendement portant article additionnel à l’article 3, je proposerai d’introduire dans ce texte l’exception d’euthanasie qui a été défendue à la fois par la conférence citoyenne et par la Comité consultatif national d’éthique dès 2001. Nous pouvons raisonner en conscience sur ce que pourrait être une exception d’euthanasie.
Notre attention va être portée sur des mots aussi nobles que « dignité » ou « conscience », qui ont fait l’objet de réflexions innombrables. Nous y reviendrons avec la conscience et la dignité que réclame une telle discussion.
M. Bernard Perrut. Nos concitoyens expriment de plus en plus souvent la volonté d’être maîtres de leur vie et de leur mort, et déplorent une mort de moins en moins humaine, de plus en plus distante, loin de chez soi, loin des siens, à l’hôpital le plus souvent.
La loi Leonetti du 22 avril 2005 interdit à juste raison toute obstination déraisonnable et respecte le double objectif de « non abandon » et de « non souffrance » qui est au cœur de la problématique de la demande de mort, et affirme que dans les moments les plus difficiles, la qualité de vie, je devrais dire la « qualité de mort », prime sur la durée de vie.
Nous attendions que les soins palliatifs se développent, mais le constat est déplorable puisque depuis 2012, il n’y a pas eu de nouveau plan et que 20 % seulement des personnes concernées peuvent y accéder. Combien d’unités de soins palliatifs ? Combien de lits identifiés en soins palliatifs ? Les chiffres sont ridiculement bas et les inégalités territoriales connues.
Les soins palliatifs sont particulièrement importants car non seulement ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance physique, mais ils prennent aussi en compte la souffrance psychologique, sociale, spirituelle et permettent de soutenir les familles et les proches.
Une nouvelle loi n’a de sens aujourd’hui que si nous développons les soins palliatifs, développons la formation des médecins et des soignants, aidons celles et ceux qui veulent accompagner leurs proches en fin de vie.
Le texte de 2005 mettait l’accent sur le devoir des médecins envers les malades, et cette proposition de loi donne aujourd’hui un nouveau droit aux malades. Les professionnels de santé en sont les garants. Mais le périmètre de ce droit demeure incertain. Comment définir les mots « dignité et apaisement » ? Peuvent-ils tout justifier ? Dans quelles conditions ?
Quant aux directives anticipées, elles permettront au malade de préciser sa volonté sur sa fin de vie, prévoyant le cas où il ne serait pas en mesure de s’exprimer. Ce n’est plus un souhait, mais désormais une volonté contraignante pour le médecin – on l’a dit à l’instant.
Vous créez un droit à la sédation profonde en phase terminale et continue jusqu’au décès, avec pour but de soulager le malade en situation de souffrance insupportable. On peut s’interroger sur l’article 3 de la proposition de loi qui indique que « la demande du patient… est de ne pas prolonger inutilement sa vie ». Comment définir le mot « inutilement » ? Comment juger si une vie est utile et jusqu’où ? L’utilité d’une vie est-elle un critère de dignité ?
Je terminerai sur un point important : j’attache beaucoup d’importance au statut du témoignage de la personne de confiance, où à défaut de la famille. Pour moi, la mort doit être un moment vécu et partagé avec ses proches, et pas un moment de solitude.
Gardons, chers collègues, la volonté de respecter l’équilibre trouvé, et n’allons pas vers une aide médicalisée active à mourir. Pensons aux dérives qui peuvent se produire en Belgique et aux Pays-Bas. Et n’oublions pas la définition du terme « euthanasie ». Celui-ci, qui vient du grec « euthanasia », signifie : bonne mort, douce et sans souffrance. C’est à la suite d’un glissement sémantique qu’il désigne maintenant l’action qui provoque la mort.
M. Michel Liebgott. C’est un beau débat que nous poursuivons aujourd’hui, après nos interventions successives dans le cadre de la proposition de loi de Mme Massonneau, déposée au nom du groupe écologiste. J’observe toutefois que l’euthanasie que l’on peut provoquer ou que l’on peut souhaiter pour soi-même, est une démarche avant tout individuelle alors que nous essayons de légiférer pour l’ensemble des populations qui se trouvent en situation de souffrance et qui subissent des injustices majeures pour des raisons territoriales, pour des raisons liées à leur catégorie socio-professionnelle, ou simplement parce qu’elles n’ont pas pu avoir accès à tel ou tel service de médecine spécialisée.
Nous devons avoir à cœur de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des meilleurs soins durant sa vie. Or ce n’est pas forcément le cas. En matière d’accès aux soins, il y a en effet de profondes injustices. Mais la « bonne mort » est aussi profondément injuste, puisque nous savons que la moitié seulement des médecins maîtrisent la loi Leonetti de 2005, que 20 % seulement des personnes qui pourraient bénéficier des soins palliatifs en bénéficient, et que les deux tiers des soins palliatifs sont concentrés dans cinq régions. C’est dire si le système actuel est injuste !
Certes, c’est un débat de société évoluée – d’ailleurs, aujourd’hui, on ne parle pas seulement d’espérance de vie, mais aussi d’espérance de vie « en bonne santé ». Mais je crois qu’avant d’envisager une nouvelle étape qui serait celle du suicide assisté – auquel je ne suis pas forcément opposé à titre personnel – il nous faut assurer la généralisation des soins palliatifs de la loi Leonetti et, je l’espère, demain, de la loi Claeys-Leonetti, que nous adopterons sans doute.
M. Rémi Delatte. La loi Leonetti s’est imposée comme socle fondamental de l’approche et de la prise en charge de la fin de vie. La condamnation de l’obstination déraisonnable, la procédure collégiale d’arrêt des traitements, la création des directives anticipées en sont les actes fondateurs qui devraient assurer à chaque personne de pouvoir bénéficier d’une mort apaisée.
Cela conduit à s’interroger sur le bien-fondé qu’il y aurait à revisiter la loi du 22 avril 2005. En effet, tout y est dit, même si son application se heurte à deux obstacles qu’il convient de corriger : d’abord sa diffusion est insuffisante dans les sphères professionnelles et dans le grand public ; ensuite, le recours aux soins palliatifs est trop restreint et mal réparti sur les territoires, faute de structures adaptées et en raison de l’insuffisance de formation des praticiens.
Certes, nous avons, comme parlementaires, la responsabilité de prendre en compte l’évolution sociétale d’une part, et la réalité d’une fin de vie qui change et qui s’allonge d’autre part. Cependant, nous avons aussi le devoir, sur un sujet aussi sensible, de rester rigoureux sur ce qui pourrait apparaître comme un progrès mais qui, rapidement, s’avérerait être les prémices d’un suicide médicalement assisté. Je pense à l’article 4, avec le traitement à visée sédative jusqu’au décès et à l’article 2, avec la reconnaissance, en tant que traitement, de la nutrition et de l’hydratation artificielles.
Il faut, j’ai envie de dire : « toute la loi Leonetti, rien que la loi Leonetti ». En effet, adossée aux dimensions de l’éthique médicale et de l’intime confiance qui anime la relation entre le patient et le soignant, le texte de 2005 garantit déjà à chacun les conditions d’une mort digne d’une société moderne.
M. Philip Cordery. Je tiens à mon tour à saluer le travail des deux auteurs et corapporteurs de cette proposition de loi qui crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, et permettra de répondre, dans une grande mesure, aux Français qui nous demandent d’agir pour apaiser la fin de vie.
Cette proposition répond à l’engagement présidentiel n° 21 de M. François Hollande de faire que « toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».
Cette proposition de loi inscrit pour la première fois dans la loi et le code de la santé publique le droit à mourir dans la dignité. Elle renforce le choix du patient de terminer sa vie comme il l’entend en rendant opposables les directives anticipées.
Elle reconnaît pour la première fois le traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès. J’avoue me poser les mêmes questions que M. Schwarzenberg. Mais discutons-en.
Cette proposition de loi permet des avancées importantes. Je pense néanmoins que nous pouvons aller plus loin. Tous les sondages confirment d’ailleurs qu’une grande majorité de Français souhaite que nous légiférions sur le fait que l’on puisse mettre fin à la vie de la manière la plus digne et la plus apaisée possible.
Ce texte vise les patients : il les place au centre des décisions pour leur fin de vie. C’est pourquoi je considère que le choix est la question centrale de cette proposition de loi, et qu’il mériterait d’être élargi pour que les patients – comme c’est le cas dans d’autres pays comme les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg ou le Québec – aient la possibilité de recourir à un dispositif d’aide médicalisée active à mourir s’ils le souhaitent, et pour que nous passions du « laisser mourir » au « faire mourir ». C’est notre rôle de législateur que de pouvoir en débattre et en décider ensemble.
M. Gilles Lurton. Tous, ici, nous sommes sensibilisés à cette question de la fin de vie. Tous ici, nous pouvons nous accorder pour offrir à chaque être humain une fin de vie apaisée et digne, comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur Alain Claeys.
Tous les personnels médicaux et les équipes de soins palliatifs que j’ai pu rencontrer s’accordent à dire que la loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie a permis d’évoluer, et à ce titre, je tiens à rendre un hommage appuyé à cette loi dans laquelle « tout est dit ».
Cette loi a parfaitement concilié l’absolue nécessité de soulager la souffrance et la dignité de la personne humaine. Or le texte qui nous est proposé aujourd’hui va beaucoup plus loin et appelle de ma part de nombreuses interrogations qui restent sans réponse actuellement.
Ma première interrogation porte sur l’article 2 et sur la rédaction de la phrase : « Lorsque les traitements n’ont d’autres effets que le maintien artificiel de la vie, […] ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. » Le texte de la loi de 2005 se contente d’indiquer que ces traitements « peuvent » être suspendus ou ne pas être entrepris, ce qui donne au médecin une certaine latitude d’user de sa connaissance médicale, et une certaine marge de manœuvre. Certes, l’actuelle proposition de loi précise que les traitements seront suspendus ou ne seront pas entrepris « sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient et selon la procédure collégiale ». Mais en l’absence de volonté du patient, comment réagira-t-on ?
Enfin, la dernière phrase de l’article 2 introduit une disposition radicale selon laquelle « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement ». L’interprétation de ces termes peut, de mon point de vue, être lourde de conséquences, notamment pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie et qui pourront ainsi décider d’arrêter d’être nourries et/ou hydratées.
L’article 3 fait également naître chez moi un certain nombre de questions. Que veut dire « traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance » ? Est-ce un endormissement comme je crois l’avoir compris dans les propos de notre corapporteur Jean Leonetti ? Est-ce un traitement ayant pour objectif de donner la mort ? L’ambiguïté de cet article fait envisager une possibilité d’euthanasie et ne laisse là non plus aucun espace d’interprétation pour le soignant.
J’avoue être très interrogatif sur ce que pourra engendrer cette proposition de loi qui repose principalement sur le motif que la loi de 2005 n’est pas appliquée. Si elle n’est pas appliquée, il faut la faire appliquer et ériger les soins palliatifs, auxquels tout être humain doit avoir droit, en principe fondamental.
M. Jean-Patrick Gille. Il s’agit d’améliorer et de poursuivre la loi Leonetti, et son application. Je voudrais moi aussi saluer le travail des rapporteurs – et particulièrement celui de mon collègue Jean Leonetti, car il m’est arrivé par le passé de porter quelques vives critiques – et leurs propositions. Celles qui portent sur la sédation profonde et sur les directives anticipées contraignantes font l’objet d’un consensus.
Certains veulent aller plus loin, créer un droit nouveau, la possibilité d’un suicide assisté ou d’une assistance médicale à mourir en fin de vie, qui ne s’imposerait bien évidemment à personne. Je comprends que certains s’y refusent – même si j’ai toujours du mal à admettre que l’on puisse refuser un droit aux autres. Mais je considère que notre devoir est sans doute, dans un premier temps, d’acter le consensus qui nous est proposé par les rapporteurs et d’en discuter, dans un deuxième temps, ici et surtout dans l’hémicycle avec l’ensemble des parlementaires. La question est assez simple à résumer : est-ce que l’on accorde à celui qui se sait condamné le choix de choisir sa mort et d’en choisir l’heure ? Vous avez bien compris que j’y étais favorable.
Peut-être ai-je mal saisi ce qu’a dit Arnaud Richard ? Je considère en tout cas que la légalisation de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté n’aboutit pas à consentir un droit exorbitant à la société. Elle crée au contraire un droit individuel, qui peut paraître extravagant à certains, ou légitime à d’autres. C’est aujourd’hui que la société dispose d’un droit exorbitant, dont elle délègue la responsabilité aux médecins.
M. Leonetti a fait le choix d’avancer étape par étape. Cette méthode, tout à fait respectable, a néanmoins ses limites, en raison même du sujet traité. Va-t-on ou non accorder ce droit individuel ? La question et inévitable et je pense que nous aurons ce débat dans l’hémicycle parce qu’il est attendu par nombre de nos concitoyens.
M. Dominique Dord. À mon tour de saluer le travail remarquable de nos deux rapporteurs, qui ont su faire preuve d’équilibre, de nuance et de sensibilité sur un sujet aussi difficile.
Personnellement, je ne me résous pas à l’idée qu’un jour notre droit puisse consacrer l’euthanasie sous une forme ou sous une autre. J’ai de la peine à comprendre que l’on puisse parler de « droit » en la matière. En tout cas, pour moi, ce qui est certain, c’est que cela ferait franchir à notre législation une nouvelle frontière.
Nos compatriotes et nos collègues qui sont ici porteurs de ces « droits nouveaux » peuvent légitimement considérer que la mort douloureuse de plusieurs dizaines milliers de nos compatriotes chaque année nourrit ce débat légitime sur l’euthanasie. Mais le débat d’aujourd’hui aurait-il lieu si la loi de 2005 était appliquée ? Si les soins palliatifs étaient généralisés, un tel débat perdrait de sa substance et, pour le coup, apparaîtrait vraiment dogmatique.
Mes chers collègues, j’ai envie de vous croire. Mais en quoi cette loi nouvelle permettra-t-elle la généralisation effective des soins palliatifs ? Sera-t-elle appliquée ? Ou s’agit-il de la dernière étape avant le prochain texte qui, lui, finira par légaliser l’euthanasie dans notre pays ? Faute de cette généralisation des soins palliatifs, je crains malheureusement que telle soit la pente sur laquelle nous sommes engagés.
Mme Sandrine Hurel. Madame la présidente, je voudrais à mon tour saluer l’excellent travail de nos deux corapporteurs.
Ce texte touche à une question intime et personnelle. Mais cette question nous est aussi posée très clairement par nos concitoyens qui souhaitent l’évolution du droit relatif à leur fin de vie, ou à celle de leurs proches.
Ce texte apporte des réponses et des avancées sociétales incontestables : la possibilité d’une sédation profonde ; des outils juridiques, parmi lesquels l’opposabilité des directives anticipées ; la désignation d’une personne de confiance. Je pourrais le voter en l’état, sans ambiguïté. Mais je crois qu’il doit être aussi une étape vers un dispositif plus ambitieux et peut-être plus ouvert sur la question de l’aide active à mourir. Voilà pourquoi j’ai proposé un certain nombre d’amendements.
Un amendement à l’article 3 sur le dispositif de la sédation profonde prévoit une clause de revoyure, pour ne pas fermer le débat et se ménager la possibilité de faire évoluer le dispositif par la suite, si l’opinion publique nous le demandait. D’autres amendements visent à sécuriser l’opposabilité des directives anticipées – au cas où un médecin qui n’y serait pas favorable déciderait de ne pas les appliquer.
J’ai également déposé un amendement prévoyant que la sédation profonde puisse avoir lieu à domicile, comme à l’hôpital. En effet, nos concitoyens réclament aussi de pouvoir mourir à domicile.
Mes chers collègues, je suis persuadée que le débat parlementaire permettra d’avancer positivement sur ce texte.
M. Élie Aboud. Je voudrais d’abord remercier les deux rapporteurs.
Depuis des années, règne entre le corps médical et le législateur un flou complet, à l’origine d’une situation malsaine. D’un côté, le corps médical dit qu’il n’est là que pour soigner et qu’au-delà, c’est au législateur et à l’exécutif de décider, ce qui est faux si on se réfère, justement, à la loi. Et de l’autre, le législateur lui transfère certaines responsabilités, qui sont sources d’angoisse.
Nos rapporteurs ont su ne pas céder à deux courants complètement opposés. Les tenants du premier souhaitent que l’on ne fasse rien parce qu’après tout, ces questions relèvent de la volonté de Dieu. Les tenants du second défendent avec vigueur le « laisser tout faire » et prônent la liberté absolue : il y a la liberté de vivre, et celle de mourir.
Nos rapporteurs ont abouti à un texte que je résumerai en une phrase : « tout faire sans laisser faire ». Les citoyens attendaient un tel texte. J’espère que, comme l’a dit brillamment notre collègue Dord, le corps médical appliquera enfin les lois existantes pour ne pas laisser ce débat de société, ce débat philosophique aux mains de certaines personnes qui ne maîtriseraient pas le sujet.
Mme Véronique Besse. Je voudrais revenir sur quelques points.
Premièrement, oui, nous devons remettre au cœur des débats le problème des soins palliatifs. La présente proposition de loi ne fait pas, à mon goût, suffisamment mention des soins palliatifs qui devraient être au cœur du droit à la fin de vie. Nous devons d’abord faire respecter la loi de 1999 qui garantit à tous les malades un accès aux soins palliatifs. Or aujourd’hui, je le rappelle, seulement 20 % des personnes concernées y ont accès.
Les soins palliatifs sont une bonne réponse au « mal mourir ». Il faut prendre acte de toutes les recommandations des rapports sur la fin de vie, notamment celui de la Cour des comptes, qui préconise le développement des soins palliatifs en France.
Deuxièmement, il faut mettre l’accent sur l’importance d’assurer la qualité de vie du patient. La notion de sauvegarde de la dignité existe dans le code de la santé publique où il est écrit que : « le médecin doit accompagner le mourant jusqu’au dernier moment, assurer par des soins appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage ». La dignité du mourant est respectée si la qualité de la vie du patient est correctement assurée par le médecin, en priorité grâce aux soins palliatifs.
Troisièmement, il faut supprimer l’idée que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. Il serait grave de confondre traitement et maintien en vie. La nutrition et l’hydratation artificielles n’ont pas pour objet de soigner mais de maintenir en vie. Celui qui ne peut pas se nourrir n’est pas forcément malade ni en fin de vie, il est simplement fragile. Si la nutrition et l’hydratation artificielles étaient considérées comme thérapeutiques, la loi pourrait alors autoriser leur arrêt, et pas seulement pour les personnes en fin de vie, mais tout au long du parcours de soins.
Enfin, la sédation profonde et continue modifie l’utilisation des traitements de son objectif principal. Elle permet d’éviter le ressenti de la douleur, mais aussi de la souffrance parce que c’est un processus d’endormissement.
L’article 3 de la loi pose problème car il fait disparaître le critère de l’intention. Il faut se demander quelle est l’intention de la sédation : accélérer la mort ou soulager les souffrances ?
Signalons, pour terminer, que le rapport Sicard précisait que : « L’administration de doses massives d’un sédatif ne peut pas s’appeler « à double effet ». Il s’agit que l’on veuille ou non d’une pratique euthanasique lente, surtout si elle est accompagnée de l’arrêt des traitements. »
M. Alain Claeys, corapporteur. J’interviendrai brièvement pour lever une ambiguïté. Véronique Massonneau et d’autres intervenants ont parlé des soins palliatifs tout en disant… que nous n’étions pas là pour parler d’une loi sur les soins palliatifs. Mais c’est un continuum, et on ne peut pas discuter de cette proposition de loi sans mettre en perspective le contexte.
Bien sûr, cette proposition de loi ne traite pas des soins palliatifs. Mais je crois que nous ferions collectivement une grave erreur en n’interpellant pas l’exécutif sur l’état actuel des soins palliatifs et de la formation. On ne peut pas opposer soins curatifs, soins palliatifs et fin de vie. C’est un continuum qui exige d’être extrêmement précis. Or dans l’ensemble des dispositifs qui existent dans notre pays, les soins palliatifs sont dispensés de façon inégale sur le territoire, notamment dans les maisons de retraite, à domicile, etc. Il faut qu’on le dise et que l’on obtienne un certain nombre de réponses.
Ensuite, à travers vos interventions, vous avez fait surgir, au-delà du débat sur l’aide active à mourir, toute une série de questions. Par exemple, M. Roger-Gérard Schwartzenberg a abordé l’idée introduite à l’article 2 – et non à l’article 3 – selon laquelle « la nutrition et l’hydratation artificielle constituent un traitement ». D’autres se sont interrogés sur l’adverbe « inutilement ». Mais toutes ces questions seront examinées à l’occasion des amendements qui devraient permettre d’améliorer notre propre texte.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Merci à tous les intervenants qui ont posé de bonnes questions. Les mots, dans ce texte, sont lourds, et ne pas admettre les réalités qu’ils recouvrent serait source de confusion. Nous devons avancer dans la clarté et bien exprimer ce que nous voulons avec ce texte.
Je remercie bien sûr Mme Delaunay et Mme Le Callennec qui ont exprimé le soutien de leur groupe à cette proposition de loi qui vise effectivement à rassembler.
Je voudrais rappeler à M. Touraine et à M. Sebaoun que c’est M. Sicard qui avait proposé l’exception d’euthanasie. J’ajoute que M. Sicard considère que depuis la loi de 2005, cette exception d’euthanasie n’a plus d’intérêt. On peut bien sûr en discuter, mais vous devez savoir qu’elle pose d’énormes problèmes dans une démocratie : qui la décide ? Ou c’est un droit ouvert, ou c’est un droit restreint. Mais restreindre un droit qui a vocation à être universel, c’est juridiquement très compliqué.
Monsieur Richard, ce texte n’ouvre pas la voie à l’euthanasie et au suicide assisté. C’est une évidence. Si tel avait été le cas, je n’aurais pas accepté la mission que m’a confiée le Premier ministre et je ne serais pas corapporteur. Il n’y a aucune ambiguïté sur ce point.
Monsieur Schwartzenberg, le Comité consultatif national d’éthique est hostile à l’aide active à mourir. On ne peut pas l’accuser d’être partisan d’autant que sa composition a été remaniée récemment. Je n’imagine pas que le Président de la République ait pu nommer des nouveaux membres sur la foi de leurs opinions en la matière.
Je tiens à vous dire amicalement que vous ne pouvez pas affirmer des choses fausses. Premièrement, en cas d’anesthésie générale, le patient n’a ni faim, ni soif. On peut dire qu’on meurt de déshydratation, même si cela ne correspond pas à la réalité. En revanche, dire qu’on meurt de souffrance, de faim et de soif sous une sédation profonde est un mensonge. Je l’entends de la part de l’Alliance Vita et de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité mais je m’étonne qu’un esprit aussi éclairé que le vôtre puisse le reprendre à son compte.
Deuxièmement, on peut débattre longtemps sur le point de savoir si l’hydratation et la nutrition artificielles sont un traitement. Selon moi, c’est le cas. Le Conseil d’État en a également jugé ainsi. Lorsqu’on met un tube dans l’estomac du patient, on lui demande son avis précisément parce qu’il s’agit d’un traitement.
Si la mort est un scandale, comme le pensait Vladimir Jankélévitch, ce texte a vocation à garantir l’absence totale de souffrance.
Pour abréger une vie au moyen d’une sédation profonde, il faut administrer au patient des doses d’Hypnovel dont la disproportion est évidente. La proposition de loi ne cherche pas à masquer l’euthanasie derrière la sédation profonde. Cette technique n’a pas d’autre but que d’empêcher toute douleur physique ou psychique.
Je suis d’accord avec Mme Hurel sur la nécessité de développer les procédures au domicile.
Madame Besse, les soins palliatifs ne sont pas oubliés. Le texte renvoie aux dispositions, déjà nombreuses, qui s’y rapportent. Nous ne sommes toutefois pas opposés à ce que le texte rappelle la nécessité de leur mise en œuvre, comme l’a soulignée la Cour des comptes dans son dernier rapport.
Beaucoup de bonnes questions ont été posées. Comme Mme la présidente, je considère qu’il n’y a pas ceux qui sont en avance et ceux qui sont en retard. Il n’y a pas d’un côté, les bons – Belges et Canadiens – et de l’autre, les mauvais – Français, Espagnols, Anglais ou Allemands. Chacun appréhende ces sujets avec sa culture. Les différences en la matière ne correspondent d’ailleurs pas à la traditionnelle séparation entre Nord et Sud. Les soins palliatifs sont nés en Angleterre ; l’euthanasie y est peu débattue car de très nombreux bénévoles accompagnent les personnes en fin de vie.
Ne cédons pas à la caricature ! Ces sujets méritent un débat dans lequel les mots sont posés sur des réalités. « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », disait Albert Camus.
La Commission en vient à l’examen des articles.
Article 1er
(art. L. 1110-5 du code de la santé publique)
Droit des malades et droit des patients en fin de vie
Cet article vise à rappeler deux droits principaux de la personne malade : celui d’être soignée dans les meilleures conditions et, si sa situation le rend nécessaire, celui de disposer d’un accompagnement attentif de sa fin de vie.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
La rédaction actuelle de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé complétée par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Il comprend l’ensemble des dispositifs que la proposition de loi suggère de réexaminer et de compléter en matière de droit des malades, d’obstination déraisonnable et de soulagement de la douleur.
Le droit de toute personne de recevoir « les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées » mais aussi « des soins visant à soulager sa douleur », défini en 2002, a été complété, en 2005, par deux dispositions déterminantes : la définition et l’interdiction de l’obstination déraisonnable, d’une part, et l’encadrement des traitements anti-douleur dispensés au malade en fin de vie, d’autre part.
Les difficultés rencontrées dans l’application de cet article et, plus largement, de la loi du 22 avril 2005, relevées dès les travaux de la mission d’évaluation de l’Assemblée nationale (23) en 2008, ont laissé penser qu’une nouvelle rédaction permettant de mieux distinguer les principes généraux des différentes situations rencontrées et des réponses proposées permettrait d’en rendre la réception meilleure par l’ensemble des acteurs concernés, les professionnels de santé mais aussi les patients et leurs proches. Elle permettrait parallèlement de rendre plus cohérent l’ensemble du dispositif en distinguant nettement les principes de leur application.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La proposition de loi présente donc une nouvelle architecture et complète les différentes dispositions qui figuraient dans l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, par l’introduction des nouveaux articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1110-5-3. Dès lors, l’article L. 1110-5 ne comporte plus que la définition des principes qui les fondent.
1. Le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés
La rédaction actuelle du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est complétée par l’ajout des « traitements » aux soins auxquels a droit tout malade. Les traitements sont en général des actes médicaux et les soins des actes paramédicaux, mais cette précision s’articule également avec l’article 5 de la proposition de loi, qui dispose que le refus ou l’arrêt des traitements que peut demander le patient ne s’oppose pas au maintien des soins qui les englobent, notamment palliatifs, nécessaires à son confort et à son accompagnement. Il convient donc de faire apparaître, dès cet article de principe le continuum curatif – palliatif qui doit guider la pratique médicale. Il a, en outre, été précisé à cet alinéa par la commission que le droit de tout malade de recevoir les soins et de bénéficier des thérapeutiques doit garantir également le meilleur apaisement possible de la souffrance.
2. Le droit à une fin de vie digne et apaisée
L’alinéa 2, nouveau, pose le principe du droit à une « fin de vie digne et apaisée ». La mise en œuvre de ce droit n’incombe pas seulement au médecin, mais à l’ensemble des professionnels de santé et par tous les moyens à leur disposition. L’article L. 1110-2 du code de la santé publique dispose que « la personne malade a droit au respect de sa dignité » et la double notion de dignité et d’apaisement figure également dans l’article L. 1110-10 du même code qui définit les soins palliatifs comme visant « à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
Le droit à une fin de vie digne, que l’on retrouvait jusqu’à présent, en contrepartie de la non-poursuite des actes de prévention, d’investigation ou de soins par une obstination déraisonnable et en introduction aux mesures prises pour soulager une souffrance réfractaire, par la mise en œuvre par les professionnels de santé de tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort, est ainsi posé en principe.
Lors de la consultation citoyenne, de nombreux internautes se sont interrogés sur le sens à donner à la notion de dignité. Aussi quelques éclaircissements apparaissent nécessaires.
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), dans son avis n° 121 de juillet 2013précité souligne que mourir dans la dignité est devenu une sorte d’évidence pour les partisans de l’euthanasie, alors que le même principe de dignité est également mobilisé par ses adversaires.
Ainsi, le CCNE relève que le terme de dignité connaît deux usages très différents : « Les partisans de la mort choisie se réfèrent à une conception subjective ou personnelle de la dignité, ici entendue comme un regard que l’individu se porte sur lui-même (…) Dans cette acception, le droit à mourir dans la dignité correspond à la prérogative qui serait celle de chacun de déterminer jusqu’où il juge acceptable que soient entamées son autonomie et sa qualité de vie. » Une autre conception revêt la dignité d’un « sens ontologique, elle est une qualité intrinsèque de la personne humaine : l’humanité elle-même est dignité, de sorte que celle-ci ne saurait dépendre de la condition physique ou psychologique d’un sujet. »
Le Comité, après avoir remarqué que ces deux conceptions de la dignité, bien qu’exprimant des significations très différentes du mot ne s’excluent pas a priori l’une de l’autre, souligne en effet que « c’est la lutte contre les situations objectives d’indignité qui doit mobiliser la société et les pouvoirs publics : non-accès aux soins palliatifs pour tous, isolement de certaines personnes à la fin de leur vie, mauvaises conditions de vie et défaut d’accompagnement des personnes malades et handicapées rendant impossible pour elles la fin de vie à domicile. La situation la plus indigne serait celle qui consisterait à considérer autrui comme indigne au motif qu’il est malade, différent, seul, non actif, coûteux… »
Le Comité souligne, dès lors, qu’il « existe donc une tension certaine entre la nécessité d’accorder sa place au sentiment personnel de dignité et le risque que cette dignité soit confondue avec la dignité inaltérable qu’il appartient aux proches et aux soignants de respecter chez les personnes en état de grande vulnérabilité en leur prodiguant soutien, réconfort et affection » et conclut ce point en précisant qu’il « est essentiel de ne pas perdre de vue que la dignité est aussi cette valeur inaltérable qui peut, sans l’abolir, entrer en confrontation avec la liberté individuelle. »
L’assurance d’une fin de vie apaisée repose, quant à elle, sur le droit pour le malade à une sédation profonde lorsque son pronostic vital est engagé et sur le droit de disposer de l’ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire, proposé aux nouveaux articles L. 1110-5-2 et L. 1110-5-3, accompagné notamment des soins palliatifs.
Ce nouvel alinéa inscrit ainsi dans l’article de tête des dispositions du code de la santé publique sur la fin de vie une double demande de la société que traduisent aussi bien les débats publics, en particulier ceux menés par la Commission de réflexion sur la fin de vie en France, que les réflexions du CCNE : le respect de la volonté des personnes quant à leur fin de vie, et de celle d’être accompagnées jusqu’à leur mort, avec la mise en exergue des deux concepts de dignité et d’apaisement.
*
La Commission examine l’amendement AS122 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement prévoit la prise en compte du meilleur apaisement possible des douleurs dans les traitements et les soins qui sont apportés au patient.
M. Alain Claeys, corapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve de substituer au terme de « douleurs » celui de « souffrance » qui figure déjà à l’alinéa 2 de l’article 4.
M. Élie Aboud. Cet amendement illustre le flou et le transfert de responsabilité vers le médecin que je dénonçais précédemment. J’en comprends l’esprit et j’y adhère. Mais, en tant que médecin, je pourrais, selon mes convictions, être amené à considérer que le meilleur apaisement réside dans la mort. La notion que vous introduisez avec cet amendement prête trop à interprétation.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’entends la remarque de M. Aboud mais cette notion vient compléter une phrase qui établit le cadre dans lequel celle-ci s’applique. Vos craintes sont infondées. Je remercie le rapporteur pour sa suggestion qui permet de prendre en compte la souffrance psychique qui est une réalité.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Je veux rassurer mon confrère. Le code de déontologie prescrit toutes les deux pages de tout mettre en œuvre pour apaiser la souffrance. Cela ne conduit pas pour autant à pratiquer l’euthanasie.
Que faisons-nous avec la sédation profonde jusqu’au décès, si ce n’est apaiser la souffrance, sans que cela ne relève de l’euthanasie ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je tiens à rappeler que dans cette commission, nous ne sommes rien d’autre que des élus de la nation. Nous ne débattons pas de médecin à médecin, mais entre collègues députés.
M. Gérard Sebaoun. J’attire votre attention sur l’alinéa visé. Celui-ci confère à toute personne le droit de recevoir tous les traitements. Or, les soins tendant à atténuer la douleur sont, que je sache, des traitements. Il ne m’apparaît donc pas nécessaire de préciser la notion de souffrance.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Tous les textes qui se rapportent à la fin de vie emploient deux termes qui sont peut-être ambigus : les traitements, d’une part, et les soins, d’autre part, ces derniers ayant une acception plus générale. En anglais, la distinction est plus claire entre cure et care. Cela ne me gêne pas d’introduire la précision souhaitée par Mme Le Dain car elle permet de viser la prise en charge globale du malade.
Mme la présidente Catherine Lemorton. La rectification de l’amendement est la suivante : les mots « des douleurs » sont remplacés par les mots : « de la souffrance » :
Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
La Commission est saisie de l’amendement AS123 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement tend à préciser que les actes médicaux sont conduits avec bienveillance.
M. Alain Claeys, corapporteur. Cette précision paraît inutile comme le reconnaît l’exposé sommaire de l’amendement en indiquant que « la bienveillance se développe de manière explicite au sein du corps médical ». Je vous suggère le retrait de votre amendement.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’accepte de le retirer. Je rappelle toutefois qu’il a fallu l’intervention du Président de la République pour que cette préoccupation soit prise en compte dans les études de médecine.
M. Élie Aboud. Peut-on imaginer des soins conduits avec malveillance ?
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AS121 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je retire l’amendement au bénéfice des observations précédentes du rapporteur.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS146 des rapporteurs.
M. Alain Claeys, corapporteur. Il s’agit de la rectification d’une erreur matérielle.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission examine l’amendement AS24 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Cet amendement a pour objet de remplacer le droit à une fin de vie digne et apaisée par le droit au respect de son choix de fin de vie. La notion de dignité, qui figure déjà dans le code de la santé publique, est trop subjective pour faire l’objet d’une définition universelle. Elle devrait reposer sur des critères précis. Je suis favorable au respect total du choix du patient. Tel est le sens de cet amendement.
M. Jean Leonetti, corapporteur. J’émets un avis défavorable sur cet amendement qui témoigne de la constance de Mme Massonneau. Il ouvre la voie à la mort donnée par le médecin à la demande du malade. Ce n’est pas l’objet de la proposition de loi. Je partage votre appréciation sur le flou qui caractérise la notion de dignité. Mais le respect du choix de fin de vie est également une notion suffisamment large pour inclure la demande de mort.
M. Philip Cordery. Je suggère à Mme Massonneau, à l’instar d’amendements à venir, d’ajouter au droit à la dignité du patient le respect de son choix de fin de vie plutôt que de l’y substituer.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AS116 de M. Philip Cordery.
M. Philip Cordery. Chaque personne a le droit à une fin de vie apaisée pour mourir dans la dignité. Alors que les patients sont au cœur de la proposition de loi, la liberté de choix de ces derniers pour leur fin de vie est un principe essentiel qui doit être inscrit dans la loi.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Je suis défavorable à cet amendement qui est sans ambiguïté. L’exposé sommaire fait référence à l’assistance médicalisée active à mourir. Or, la proposition de loi n’a pas pour objectif d’ouvrir la voie à une euthanasie active.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS147 des rapporteurs.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS11 de M. Gérard Sebaoun et AS68 de Mme Sandrine Hurel.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement affirme également le respect par les professionnels de santé du choix de fin de vie de la personne, mais je vous invite à considérer sa place dans le texte. L’amendement s’inscrit dans le droit fil des dispositions relatives aux droits des malades. La notion de dignité, aussi complexe soit-elle, doit être maintenue.
Les professionnels de santé ont pour mission d’être continûment aux côtés des patients en fin de vie. Ils veillent à utiliser l’ensemble des moyens à leur disposition, à commencer par les soins palliatifs. Au-delà, ils mettent en œuvre les nouveaux droits prévus dans la proposition de loi.
L’inscription de ce principe dans le troisième alinéa de l’article lui donne une signification différente de celle proposée dans les précédents amendements.
Mme Sandrine Hurel. L’amendement vise à consolider la notion de choix du patient quant aux conditions de sa fin de vie. Il prévoit que les actions des professionnels de santé doivent être cohérentes avec l’expression de la volonté du patient.
M. Jean Leonetti, corapporteur. J’exprime le même avis que sur les amendements précédents. L’objectif reste de laisser le libre choix total au malade, y compris d’une fin au moyen d’une euthanasie active. Le positionnement dans le texte n’y change rien : l’amendement aboutit aux mêmes résultats.
M. Gérard Sebaoun. Je m’inscris en faux contre l’argumentation du rapporteur. Le texte ne mentionne nulle part l’aide médicalisée à mourir. Le principe que défend cet amendement vaut pour les nouveaux droits donnés au patient. Le choix du malade intervient puisque vous lui proposez des directives anticipées ou la sédation profonde et continue. Il n’est pas question d’aide active à mourir. Vous extrapolez par rapport à ce que nous écrivons.
Mme Sandrine Hurel. L’idée est de renforcer le choix du patient à l’égard des outils proposés dans le texte.
M. Gérard Bapt. J’ai cosigné l’amendement AS68 car il se borne à demander que les décisions médicales prises pour assurer une fin de vie digne et apaisée soient cohérentes avec l’expression de la volonté du patient. Il ne faut pas y voir la volonté d’introduire une dimension supplémentaire.
M. Jean-Louis Touraine. Il s’agit de savoir si l’on respecte l’esprit de la loi, à savoir donner davantage de place au choix du patient, plutôt que de voir les décisions imposées par l’équipe soignante. Les patients ont le droit d’exprimer leur préférence sur les différentes possibilités qui leur sont offertes. Il ne faut pas voir de malice dans les formulations proposées qui ne font que rappeler l’esprit de la proposition de loi.
M. Alain Claeys, corapporteur. En l’absence de directives anticipées, les personnes n’ont-elles pas droit à une fin de vie digne et apaisée ?
Mme Michèle Delaunay. L’équivoque à laquelle prête cet amendement me fait retirer ma signature. Soit il est superfétatoire, soit il est équivoque. Son apport n’est pas suffisant pour justifier l’ambiguïté qu’il introduit.
M. Jean-Louis Touraine. Dans neuf cas sur dix, il n’y aura pas de directives anticipées. Il faut malgré tout que la personne, tant qu’elle est consciente, puisse exprimer sa préférence dans un cadre que nous pourrons définir. Le texte doit préciser que la volonté du patient l’emporte sur les décisions du personnel soignant.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Si le patient peut exprimer son avis, les directives anticipées n’ont pas d’intérêt.
Le texte ouvre deux droits nouveaux majeurs : le droit à une sédation profonde en phase terminale et le droit à des directives anticipées dont l’opposabilité est renforcée. De devoirs des médecins, ils deviennent des droits des malades. Soyons clairs, si on ouvre tous les droits à la demande du malade, nous devrons répondre à la demande de mort.
Si cet amendement entend défendre l’idée générale du respect du choix du patient, il n’a pas d’intérêt car cette question est abordée ultérieurement. S’il s’agit de donner une portée générale à ce principe, l’amendement dépasse les avancées proposées dans le texte.
M. Gérard Sebaoun. Plus je relis les alinéas 2 et 3, plus je suis convaincu que cet amendement a sa place. La volonté du patient n’apparaît nulle part dans l’article 1er alors qu’elle mérite d’y figurer, d’une manière ou d’une autre.
Mme Sandrine Hurel. Je peux entendre que cet amendement est superfétatoire mais notre volonté est d’insister sur le choix donné au patient. En revanche, il n’est pas équivoque. Vous avez reconnu à l’instant, monsieur Leonetti, que le patient doit s’exprimer s’il est en capacité de le faire. Je ne vois pas de malice dans cet amendement qui prévoit seulement que les moyens mis en œuvre doivent l’être en cohérence avec l’expression de la volonté du patient.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je crois comme mes collègues que l’article 1er doit faire référence au respect de la volonté du patient qui fonde le texte.
Si le patient ne souhaite pas recevoir la sédation profonde, que M. Leonetti a précédemment qualifiée très justement d’anesthésie, il faut qu’il puisse l’exprimer. Cette solution, qui semble présenter quelques inconvénients, ne doit pas lui être imposée.
M. Philip Cordery. Il y a une différence entre le droit à quelque chose et la liberté de choisir entre plusieurs possibilités. Il faut inscrire dans l’article 1er, qui garantit le droit à une fin de vie digne, le choix du patient quant aux moyens d’atteindre cet objectif.
M. Gérard Sebaoun. Je retire mon amendement au bénéfice de celui de Mme Hurel.
L’amendement AS11 est retiré.
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement AS68.
La Commission examine l’amendement AS25 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Je souhaiterais qu’il y ait un projet de loi sur l’aide active à mourir. Comment juger de la dignité d’un patient ? Je crois que c’est à lui seul qu’il revient de juger quelle est sa dignité ou son indignité. Cet amendement vise à le préciser dès l’article 1er.
M. Jean Leonetti, corapporteur. La notion de dignité est définie par des textes internationaux, textes relatifs aux droits de l’homme ou issus du Conseil européen, qui traitent du respect de la personne humaine. Ils définissent la dignité comme étant liée à notre humanité. L’expression « ma dignité » c’est l’estime de soi. Notre dignité ne peut être un élément d’appréciation. En revanche, quelle que soit notre situation ou notre souffrance, l’estime de soi procède de nous-mêmes. La dignité est liée à la personne humaine, et ne décline pas avec nos forces.
M. Élie Aboud. C’est faire une confusion que de dire que toute personne est seule juge de sa propre dignité et prétendre que cette même personne sera juge de sa fin de vie. Un patient en traitement psychiatrique, placé sous tutelle est digne à mes yeux mais est-il en état de juger ?
M. Gérard Bapt. M. Leonetti devrait préciser sa conception de la dignité humaine car la dignité d’un corps inconscient peut être jugée par son entourage. Un amendent déposé à l’article 3 traite de ce sujet. Vous semblez dire que seule une personne consciente est capable de porter un jugement sur sa propre dignité.
M. Gérard Sebaoun. La notion de dignité humaine relève bien de textes internationaux. M. Jean-Denis Bredin, en 2000, a dit du respect de soi que : « personne ne doit jamais être humilié, ni dans son esprit, ni dans son corps, ni dans sa vie, ni dans sa mort ». Un magistrat du Conseil supérieur de la justice de Belgique a considéré que : « De tous les droits de l’homme, c’est sans doute la dignité humaine, ce droit moderne, né des souffrances de l’humanité, fût-il incertain et même mouvant, qui donnera au juge les moyens de défendre ensemble la dignité et la liberté, sans doute inséparables, sinon confondues ».
M. Alain Claeys, corapporteur. Ces définitions donnent bien le double sens, personnel et universel, de la dignité.
Mme Michèle Delaunay. La notion de dignité humaine va au-delà de la mort même. Le cadavre aussi a droit au respect et, à ce stade, la notion échappe au soi.
M. Jean Leonetti, corapporteur. L’épisode fâcheux du lancer de nain illustre à l’envi ce débat entre liberté et dignité. Les personnes participant à ce « jeu » étaient consentantes. Le Conseil d’État a cependant interdit cette pratique en considérant, précisément, qu’elle portait atteinte à la dignité humaine et que la liberté de faire n’était pas garante de la dignité des intéressés. Dignité et liberté peuvent être confondues, mais aussi antagonisées et, dans ce cas, la jurisprudence du Conseil d’État montre bien que la dignité l’emporte sur la liberté.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 1ermodifié.
Article 2
(art. L. 1110-5 du code de la santé publique)
Refus de l’obstination déraisonnable
L’article deux tend à renforcer la force obligatoire du refus de l’obstination déraisonnable.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
1. Le refus de l’obstination déraisonnable
Communément dénommé acharnement thérapeutique, depuis la loi du 22 avril 2005, l’obstination déraisonnable est proscrite par le deuxième alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique (24). Le médecin a la possibilité de suspendre ou de ne pas entreprendre des actes qui « apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Cette phrase a fait l’objet de nombreuses contributions lors de la consultation citoyenne, s’interrogeant notamment sur le sens à donner aux mots « inutiles » et « disproportionnés ». S’agissant de droit positif, les développements qui suivent montrent l’interprétation qu’en ont donné le Conseil d’État et le Conseil national de l’ordre des médecins.
Cette interdiction de l’acharnement thérapeutique figure également à l’article 37 du code de déontologie médicale qui énonce que le médecin « doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique » (25).
Ainsi formulée, l’obstination déraisonnable est constituée par des actes :
– inutiles : les moyens mis en œuvre n’apporteront pas d’amélioration notable de l’état de santé (26) ;
– disproportionnés : les moyens mis en œuvre pourraient faire encourir des risques par rapport au bénéfice escompté (3) ;
– ayant comme unique effet de contribuer au maintien artificiel de la vie.
Selon le Conseil national de l’Ordre des médecins, le maintien artificiel de la vie pourrait s’entendre comme « la mise en œuvre de moyens et techniques nécessaires au maintien ou à la substitution de fonctions vitales essentielles, faute de quoi la vie s’interromprait inéluctablement à plus ou moins brève échéance ». (27) Le Conseil national de l’Ordre des médecins ajoute que l’article L. 1110-5 du code de la santé publique vise des situations dans lesquelles on constate une altération profonde et irréversible des fonctions cognitives et relationnelles des personnes malades.
2. Une démarche délicate
S’abstenir de toute obstination déraisonnable reste une démarche délicate pour le médecin. Ainsi, le Conseil national de l’Ordre des médecins, dans ses commentaires sur le code de déontologie médicale, souligne que « La question se pose avec acuité lorsque le praticien se prononce sur l’incurabilité. Deux possibilités d’erreur sont à évoquer. L’erreur par défaut : l’affection est curable et le médecin renonce trop tôt ; ou au contraire, l’erreur par excès : le médecin impose des investigations invasives, sans projet thérapeutique, et des soins douloureux, difficiles à supporter pour le patient, afin de prolonger sa vie de quelques jours. Le chemin est souvent étroit entre soigner, ce qui est la vocation du médecin et l’obstination déraisonnable qui peut le conduire à faire endurer à son patient des épreuves aussi inutiles que pénibles et souvent douloureuses ».
Sollicité par le Conseil d’État dans le cas Vincent Lambert, le Conseil national de l’Ordre des médecins (28) a estimé que les conditions d’une obstination déraisonnable pouvaient être constituées si trois critères cumulatifs étaient réunis :
– la personne malade se trouve dans une situation de maintien artificiel de sa seule vie somatique ;
– son état a été confirmé au fil du temps et selon les données actuelles de la science ;
– aucun signe clinique ou d’investigation ne permet d’espérer une évolution favorable.
Malgré les dispositions adoptées par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, l’obstination déraisonnable reste d’actualité comme l’ont relevé les rapporteurs (29).
La mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 précitée s’était interrogée sur l’effet de ces dispositions sur les pratiques médicales. Une étude comparative portant sur les données de l’activité des services de réanimation avait montré qu’entre 2002 et 2007, le nombre de limitations et d’arrêts des thérapeutiques actives en réanimation adulte n’avait connu qu’une évolution modeste passant de 53 % des patients décédés à 55,7 % des patients (30).
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La proposition de loi dissocie le refus de l’obstination déraisonnable des dispositions sur le droit aux soins les plus appropriés et, pour ce faire, introduit un nouvel article dans le code de santé publique (L. 1110-5-1).
1. Le refus de l’obstination déraisonnable est réaffirmé avec plus de force
Le Conseil d’État dans sa décision du 14 février 2014 (31) a qualifié de droit fondamental, « le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ».
Ainsi, dans la nouvelle rédaction de l’article L. 1110-5-1, le refus de l’obstination déraisonnable est reformulé afin que sa force obligatoire se manifeste clairement. Lorsque les actes de prévention, d’investigation ou les traitements apparaissent inutiles et disproportionnés, le médecin a l’obligation de ne pas les mettre en œuvre ou de ne pas les poursuivre.
2. L’interdiction de l’obstination déraisonnable devient impérative dans les situations de maintien artificiel de la vie
Le nouveau dispositif impose au médecin de suspendre ou de ne pas entreprendre de traitements lorsqu’ils visent au maintien artificiel de la vie, ce qui se traduit par la substitution du verbe être au présent au verbe pouvoir, de façon à utiliser une forme juridique plus catégorique : « lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, … ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris ». La rédaction antérieure prévoyait que lorsque les traitements apparaissent comme « n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ».
Les situations de personnes malades en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel sont visées par cette rédaction.
Deux conditions doivent être respectées :
– la prise en compte de la volonté du patient. S’agissant de personnes hors d’état de s’exprimer, leur volonté devra être recherchée par l’intermédiaire de directives anticipées, si elles existent, ou sur le fondement du témoignage de la personne de confiance ou à défaut par tout autre témoignage de la famille ou des proches. Cette procédure est prévue à l’article 10 de la présente proposition de loi ;
– le respect d’une procédure collégiale. L’article précise que cette procédure est définie par le code de déontologie médicale. Selon le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) (32), la procédure collégiale correspond à une procédure de consultation d’autres confrères et non à une délibération collective. Après avoir recueilli différents avis, le médecin prend, en effet, sa décision seul.
De plus, il est réaffirmé que l’arrêt des traitements lorsqu’ils concourent au maintien artificiel de la vie ne suppose pas l’arrêt des soins et notamment l’arrêt de l’accès aux soins palliatifs.
Par ailleurs, il est prévu à l’article 3 de la proposition de loi, commenté ci-dessous, que dans le cas de l’arrêt d’un traitement de maintien artificiel de la vie d’une personne malade hors d’état de s’exprimer, cette dernière recevra un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès, qualifiée plus communément de sédation profonde et continue.
3. Le champ de la notion de traitement est précisé
Le dernier alinéa de l’article 2 précise que « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement ». L’introduction de cette phrase, qui a suscité de nombreuses réactions lors de la consultation citoyenne, mérite quelques explications, afin que chacun puisse bien mesurer sa portée.
Le Conseil d’État a jugé dans sa décision du 24 juin 2014 (33) qu’une obstination déraisonnable pouvait exister, aux termes de la loi du 22 avril 2005 précitée, dans le cas d’un traitement n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Il a réaffirmé que la nutrition et l’hydratation artificielles constituaient des traitements (34), qu’elles peuvent faire partie des traitements considérés comme n’ayant d’autre objet que le maintien artificiel de la vie et qu’elles traduisaient alors une obstination déraisonnable.
Dans le cadre des auditions menées par les rapporteurs afin de préparer la présente proposition de loi, cet avis avait été partagé par le professeur Axel Kahn, président du Comité éthique et cancer (35), qui avait indiqué que la nutrition par sonde gastrique et l’hydratation par perfusion de personnes plongées dans un sommeil profond correspondaient à une forme de réanimation, assimilable à de l’acharnement thérapeutique.
S’agissant de la nature de la nutrition et de l’hydratation artificielles, le CCNE juge que la nutrition et l’hydratation artificielles nécessitent une prescription médicale et le recours à des techniques médicales et à ce titre constituent bien un traitement (36). Il précise que la prescription médicale est nécessaire pour instituer puis adapter les doses ou quantités utiles, la composition de la nutrition et la composition hydro-électrolytique de l’hydratation.
C’est pourquoi, le troisième alinéa proposé pour le nouvel article L. 1110-5-1 du code de la santé publique reprend expressément la formulation du Conseil d’État. Les rapporteurs ont ainsi souhaité clarifier la notion de traitement et rappeler que l’alimentation et l’hydratation artificielles pouvaient constituer un cas d’obstination déraisonnable.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS165 des rapporteurs.
M. Alain Claeys, corapporteur. Le médecin ne doit ni poursuivre, ni a fortiori, mettre en œuvre des actes qui lui apparaissent inutiles ou disproportionnés afin de respecter le refus de l’obstination déraisonnable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS166 des rapporteurs et AS214 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement vise à clarifier la formulation : « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable », en substituant au mot « par », le mot « avec » ; cela semble plus clair.
M. Alain Claeys, corapporteur. Votre amendement est satisfait par le nôtre.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je retire mon amendement au profit de celui des rapporteurs.
L’amendement AS214 est retiré.
L’amendement AS166 est adopté.
La Commission est saisie de l’amendement AS125 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit de préciser que les soins poursuivis de façon déraisonnable ou disproportionnée le sont dans l’attente de bénéfices escomptés, d’un certain mieux-être ou d’une amélioration au regard de la maladie et de la souffrance.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement, qui pourrait être de bon sens, est satisfait par la rédaction du deuxième alinéa de l’article 1er.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Aux termes des lois du 4 mars 2002 relatives aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, lorsqu’un malade est conscient, c’est lui qui détermine ce qui lui paraît disproportionné. Il peut refuser une amputation au péril de sa vie et il faudra alors se borner à lui dispenser des soins palliatifs. Votre rédaction restreint la notion d’acte disproportionné, elle obligerait à pratiquer l’amputation contre l’avis du patient. Elle risque d’affaiblir le libre arbitre de ce dernier au regard de ce qui utile ou inutile, proportionné ou disproportionné.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AS105 de Mme Sandrine Hurel.
Mme Sandrine Hurel. Cet amendement vise à renforcer la possibilité de choix du patient en ce qui concerne les conditions de sa fin de vie. Il doit pouvoir décider l’arrêt d’un traitement s’il juge celui-ci disproportionné.
M. Alain Claeys, corapporteur. L’amendement va au-delà du débat que nous avons eu sur l’article 1er. Il est satisfait par la loi du 4 mars 2002, dite Kouchner.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS75 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement vise à reprendre les termes exacts utilisés par le conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) lorsqu’il a été interrogé par le Conseil d’État sur la notion d’obstination déraisonnable. Le CNOM a considéré qu’il y avait obstination déraisonnable dès lors qu’un patient était dans une situation de « maintien artificiel sans vie relationnelle et sans espoir d’évolution favorable ».
M. Jean Leonetti, corapporteur. La loi du 22 avril 2005 considère que l’obstination déraisonnable, lorsqu’elle a pour seul but le maintien artificiel de la vie, concerne les patients privés de conscience et de vie relationnelle. La décision du Conseil d’État l’a confirmé – avec une subtilité lorsqu’il a précisé qu’il s’agissait d’un malade spécifique. Qu’on lise Descartes ou Pascal, une personne, même sans conscience, est toujours digne, elle demeure humaine. On peut néanmoins se poser la question de la pertinence du maintien de sa vie qui n’est plus que biologique. À mes yeux, deux critères sont liés : pour être, il faut avoir conscience d’exister et avoir une relation à l’autre. En revanche, si j’ai conscience de moi-même mais que je n’ai pas de relation à l’autre, je suis encore dans une vie qui n’est pas que végétative. Il vaudrait alors mieux mentionner une absence totale de conscience et une absence totale de relation à l’autre. Cela correspond à ce que nous avons voulu écrire dans la proposition de loi au sujet des corps artificiellement maintenus en vie sans espoir d’évolution favorable.
On m’a fait dire que je voulais tuer toutes les personnes handicapées. Il ne s’agit pas de personnes polyhandicapées ou qui ont perdu leurs facultés cognitives mais de gens qui n’ont plus de conscience ni de relation à l’autre en raison de lésions cérébrales majeures et irréversibles. À la lumière de la décision du Conseil d’État, nous pourrions chercher une rédaction précisant ce que nous entendons par : d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
Mme Martine Carillon-Couvreur. Je suis reconnaissante à M. Leonetti d’avoir abordé un sujet qui mérite en effet des précisions. La question est de savoir jusqu’où on peut aller et ce que nous considérons être la conscience de soi et la relation aux autres. J’entends que l’on vous a fait des reproches ; il est vrai que nous sommes souvent interrogés par des proches de personnes atteintes de polyhandicaps graves. Il faudrait que nous approfondissions notre réflexion en la matière.
M. Gérard Sebaoun. Je suis prêt à retirer cet amendement sous réserve d’une réécriture présentée en séance.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Le Conseil d’État dit que, dans ces conditions, on peut arrêter le maintien artificiel de la vie et, lorsque cela est possible, sur le fondement de directives anticipées ou de témoignages. Il considère que cela est une condition nécessaire mais pas suffisante. Pour ma part, je considère qu’aller au-delà et maintenir en vie une personne qui n’a pas conscience d’elle-même ni de relation à l’autre entre dans le cadre de l’obstination déraisonnable.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS126 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit d’un amendement visant à clarifier la rédaction.
Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS167 des rapporteurs.
M. Alain Claeys, corapporteur. Cet amendement vise à préciser par quels moyens la volonté du patient sera prise en compte.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS127 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Plutôt que de renvoyer la mention des soins palliatifs à un autre article, cet amendement tend à préciser que les soins destinés à assurer la qualité de vie du patient, visés au présent article, sont des soins palliatifs.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Ce sont bien des soins palliatifs qui sont visés, donc l’avis est favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite les amendements identiques AS2 de M. Dino Cinieri, AS97 de M. Dominique Tian et AS110 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Dino Cinieri. La nutrition et l’hydratation ne sont pas des traitements dans la mesure où ces apports sont aussi nécessaires au corps en bonne santé. Il faut donc les poursuivre jusqu’à la fin de la vie. L’hydratation ne maintient pas une personne en vie mais lui procure un bien-être que nous devons à toutes les personnes en fin de vie.
M. Dominique Tian. La nutrition et l’hydratation artificielles ne sont pas nécessairement utilisées pour des malades en fin de vie, elles n’ont pas pour objet de soigner mais de maintenir en vie. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme thérapeutiques.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. L’importance de la nutrition et de l’hydratation artificielles est considérable. Le fait de les considérer comme des traitements conduirait à les arrêter automatiquement. Or qui peut nous garantir que les patients ne connaîtront pas des conditions de décès très pénibles ? Il s’agira d’une anesthésie et pas d’une sédation ; la personne sera alors coupée de tout contact avec l’environnement extérieur. Dans ces conditions, l’utilité de prolonger cette période, qui peut durer de huit à dix jours, est nulle pour le patient et la famille. Je comprends donc mal l’intérêt de l’ensemble de ce dispositif.
Mme Michèle Delaunay. Le corps médical en général est enclin à penser que l’on n’a ni faim ni soif dans ces conditions. Il faut cependant reconnaître que le défaut d’hydratation entraîne une sécheresse des muqueuses et de l’inconfort. J’ai, moi aussi, du mal à considérer l’hydratation comme une simple thérapeutique.
M. Alain Claeys, corapporteur. Nous ne faisons que reprendre la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014. Je rappelle que nous n’en sommes pas encore à l’article 3, relatif à l’arrêt des traitements, mais à l’article 2 qui a pour objet l’obstination déraisonnable.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Nous ne sommes pas ici les porte-plume du Conseil d’État mais le législateur. C’est précisément parce qu’il y a des jurisprudences parfois bizarres qui ne concordent pas entre elles que le législateur doit trancher sans s’en remettre à des juridictions, aussi prestigieuses soient-elles. Je rappelle que, sur un sujet évoqué précédemment, la Cour européenne des droits de l’homme a contredit le Conseil d’État.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Le débat sur l’hydratation et la nutrition, en 2005, a abouti à un consensus pour reconnaître qu’il s’agissait d’un traitement. Une hydratation et une nutrition artificielles représentent une intervention sur le corps de l’autre. Cet acte consiste à ouvrir l’estomac pour y poser une sonde gastrique, c’est mettre une perfusion dans une veine. Selon la loi du 4 mars 2002, cela nécessite l’accord du patient. Il ne s’agit donc pas d’un soin simple mais d’une thérapeutique. La preuve en est que, passé un certain temps, on est conduit à remplacer la sonde gastrique par un tube placé dans l’estomac, c’est une gastrostomie, un geste chirurgical. Sauf à considérer que l’intervention chirurgicale n’est pas un traitement, il y a un problème. Aussi, placer quelqu’un sous respirateur constitue-t-il un traitement ? Vous allez répondre oui. Arrêter un respirateur dans certaines conditions est-il licite ? La réponse est oui lorsque, par exemple, il y a des lésions cérébrales irréversibles. Pourquoi serait-il moins naturel de faire circuler de l’air dans un poumon que d’ouvrir un estomac et y placer un tube pour faire passer des nutriments ?
Certes, la symbolique de l’hydratation et de l’alimentation peut ne pas être la même, cependant, je n’ai jamais entendu dire que l’arrêt d’un respirateur entraînait un étouffement désagréable du malade. M. Schwartzenberg a raison, nous sommes dans le cadre d’une anesthésie générale. Or, sous anesthésie générale, on ouvre des crânes ou des thorax, on coupe des jambes et jamais personne ne s’est réveillé en faisant état de sensations désagréables. Depuis la loi du 4 mars 2002, l’arrêt d’un traitement de survie, qui peut être interrompu ou ne pas être mis en œuvre, propose la mise en place d’une sonde gastrique qui peut être refusée par le patient. C’est bien qu’il s’agit d’un traitement. En revanche, le texte présenté aujourd’hui fait au médecin l’obligation – ce qui, auparavant, n’était qu’un devoir – de sédater profondément le malade afin d’éviter tout désagrément.
Lorsque l’on pratique une sédation, il est logique de ne pas appuyer à la fois sur le frein et l’accélérateur et de maintenir une vie de manière lente et excessive. On ne peut cependant pas dire qu’il y a une souffrance. En revanche, si on arrête l’hydratation d’une personne à qui on n’administre pas une sédation, Dominique Tian a raison, il s’agit d’un soin que le malade ne peut pas refuser. On ne peut pas dire qu’il ne s’agit pas d’un traitement. Cela le Conseil d’État ne l’a pas décidé : il a simplement constaté que, dans la loi du 22 avril 2005, cela est interprété comme un traitement. Il a alors fallu adapter la terminologie, faute de quoi, prendre un cachet d’aspirine relèverait du traitement alors que la pose d’une sonde gastrique relèverait du soin.
Dans la mesure où cela figure déjà dans la loi, nous aurions pu ne pas l’écrire dans le présent texte. Mais le retirer à ce stade risquerait de créer une confusion entre le soin et le traitement sur le plan juridique et judiciaire.
M. Gérard Sebaoun. Si l’on ne précise pas que l’alimentation et l’hydratation artificielles constituent un traitement, nous rencontrerons des difficultés à l’article suivant qui prévoit la sédation jusqu’au décès et l’arrêt de tout traitement.
M. Alain Claeys, corapporteur. Comme l’a dit M. Leonetti, il faut se reporter à l’article 3.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 3
(art. L.1110-5 du code de la santé publique)
Le traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès
L’article trois tend à créer un droit nouveau à la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour une personne malade dont le pronostic vital est engagé.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
1. La sédation en phase terminale pour détresse.
Les bonnes pratiques médicales recommandent l’usage de la sédation dans certaines situations.
Selon la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) (37), la sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles ou adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté.
La loi du 22 avril 2005 précitée a autorisé le praticien à utiliser des traitements antalgiques pour soulager la douleur d’une personne malade.
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur prévoit ainsi que : « Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » (38).
S’agissant des personnes malades hors d’état de s’exprimer, le troisième alinéa de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique (39) prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé « même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, (le médecin) met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne… ». Dans ses commentaires sur le code de déontologie médicale, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique : « il s’agit d’assurer, autant que faire se peut, à ce patient dont l’état cérébral trop altéré ne permet pas de mesurer la souffrance, une prise en charge comparable à celle d’un patient encore capable de communiquer ».
La mise en place de la sédation est décidée par le médecin. De plus, elle est réversible. Sa mise en œuvre est inégale. Les rapporteurs ont relevé qu’ « il existe incontestablement des lieux où elle est pratiquée, notamment dans certains services de soins palliatifs ou de services hospitaliers spécialisés dans les maladies graves. Mais cette pratique est loin d’être générale, ni homogène (40) ». Certaines pratiques sont d’ailleurs controversées, notamment celles qui consistent à ce que le malade soit réveillé afin qu’il réitère son choix d’être sédaté, au nom du respect de son autonomie.
2. Des questions autour de l’usage de la sédation
La question de l’usage de la sédation a donné lieu à de nombreuses réflexions.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (41) a envisagé la mise en place « d’une sédation adaptée, profonde, terminale », à condition que cette décision médicale relève d’un collège.
Cette sédation pourrait être mise en œuvre dans des circonstances particulières lorsqu’un malade atteint d’une affection pour laquelle les soins curatifs sont devenus inopérants et bénéficiant de soins palliatifs souffrirait de douleurs physiques ou psychiques résistant aux traitements antalgiques. Le malade devrait en faire la demande de façon libre et réitérée.
Lors de ses réflexions sur la fin de vie, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) (42) a analysé les conditions dans lesquelles la mise en place de la sédation pourrait s’appliquer. Il a étudié quatre situations cliniques :
– les personnes malades en phase terminale d’une affection grave et incurable, capables d’exprimer leur volonté. Dans ce cas, lorsqu’un patient présente un symptôme ou une souffrance réfractaire, le CCNE estime que la demande d’une sédation continue jusqu’à son décès devrait être satisfaite. Une délibération collective devrait juger de la forme de sédation à appliquer et de l’arrêt éventuel d’autres traitements ;
– les personnes malades en phase terminale incapables d’exprimer leur volonté. Le CCNE applique le même raisonnement. Les directives anticipées, si elles existent, et l’avis de la personne de confiance seraient recherchés ;
– les personnes malades atteintes d’une affection grave et incurable qui ne sont pas en phase terminale, qui sont inconscientes ou incapables d’exprimer leur avis et chez qui les traitements vitaux sont interrompus. Dans ce cas, si au terme d’une délibération collective, il est décidé d’arrêter les traitements afin d’éviter une obstination déraisonnable, le CCNE préconise une sédation jusqu’au décès qui permettrait d’éviter une éventuelle souffrance ;
– les personnes malades, atteintes d’une affection grave et incurable, mais qui ne sont pas en phase terminale et qui sont capables d’exprimer leur volonté. Dans ce cas, le CCNE suggère de recourir à une sédation transitoire. Si ces personnes demandent l’arrêt des traitements vitaux, la demande d’une sédation continue afin d’accompagner les conséquences de ces décisions pourrait être envisagée.
Le CCNE en conclut que le patient pourrait bénéficier d’un nouveau droit, celui d’obtenir une sédation continue jusqu’à son décès lorsqu’il est entré dans la phase terminale de sa maladie : « il s’agirait d’un droit nouveau qui viendrait s’ajouter au droit de refuser tout traitement et au droit de se voir prodiguer des soins palliatifs ».
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D’UN NOUVEAU DROIT POUR LE MALADE
Le nouvel article L. 1110-5-2 du code de la santé publique proposé par l’article 3 tend à créer un nouveau droit pour le malade, qui pourra demander à bénéficier « d’un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès associé à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie ».
L’article 3 clarifie la pratique existante de la sédation et modifie sa mise en œuvre sur deux points :
– elle serait de droit pour une personne malade dont le pronostic vital est engagé lorsque les conditions légales sont remplies ;
– elle serait désormais effectuée à la demande du patient lorsque celui-ci est capable de s’exprimer et elle serait alors irréversible.
1. Les caractéristiques de la sédation
La sédation envisagée présente plusieurs caractéristiques :
– elle est profonde pour garantir l’altération totale de la conscience ;
– elle est continue jusqu’au décès pour éviter de réveiller la personne malade afin qu’elle réitère son choix ;
– elle comprend une dimension antalgique afin d’épargner la douleur au malade.
2. La mise en œuvre
L’exercice de ce droit est conditionné par deux critères cumulatifs :
– la personne malade doit être atteinte d’une affection grave et incurable ;
– son pronostic vital doit être engagé à court terme.
En l’absence de définition médicale de la fin de vie, les rapporteurs ont choisi de retenir les termes de la lettre de mission du Premier ministre : « la phase terminale de la vie est celle où le pronostic vital est engagé à court terme (43) ».
Lors de la discussion en commission, la possibilité de bénéficier de cette sédation à domicile a été spécifiée, par l’adoption d’un amendement. Ce point avait d’ailleurs été soulevé par les internautes lors de la consultation citoyenne.
On distingue deux situations :
– l’alinéa 3 prévoit que la personne malade qui présente une souffrance réfractaire au traitement bénéficiera, à sa demande, d’un traitement à visée sédative et antalgique ;
– l’alinéa 4 fixe les conditions dans lesquelles la personne malade décide de demander l’arrêt de tout traitement selon les dispositions en vigueur de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, cette décision devant engager son pronostic vital à court terme. Dans ce cas, la personne malade bénéficiera d’un traitement à visée sédative et antalgique. « La situation visée ici est celle du patient qui décide de demander l’arrêt de tous les traitements qui le maintiennent en vie parce qu’il estime qu’ils prolongent inutilement sa vie, étant trop lourds ou ayant trop duré » (44).
Dans ses observations au Conseil d’État sur le cas Vincent Lambert, évoquées ci-dessus, le Conseil national de l’Ordre des médecins a jugé qu’une fois la décision prise d’interrompre les moyens artificiels qui maintenaient la seule vie somatique, il convenait, dans un souci humaniste de bienfaisance, de mettre en œuvre une sédation profonde afin de prévenir toute souffrance.
L’alinéa 5 du nouvel article L. 1110-5 prévoit ainsi l’usage de la sédation lorsqu’une décision d’arrêt de traitement de maintien artificiel en vie serait prise au titre du refus de l’obstination déraisonnable par le médecin pour un malade hors d’état d’exprimer sa volonté.
Les rapporteurs visent ici les situations des personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel.
La mise en œuvre de la sédation suit la procédure collégiale, qui permet de vérifier que les conditions légales sont bien remplies et la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient.
Cette sédation est obligatoirement associée à l’arrêt de tout traitement de maintien artificiel de la vie. Les rapporteurs justifient cette précision dans un souci de cohérence : « ne pas associer ces deux actes médicaux (sédation et arrêt des traitements) serait incohérent, les effets de l’un contrariant les effets de l’autre » (1).
L’arrêt des traitements concerne à la fois les traitements thérapeutiques comme les techniques invasives de réanimation, les traitements antibiotiques ou anticoagulants, mais aussi les traitements de survie comme la nutrition et l’hydratation artificielles, que l’article 2 de la présente proposition de loi qualifie expressément de traitements.
*
L’amendement AS30 de Mme Véronique Massonneau est retiré.
La Commission examine l’amendement AS28 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. L’adverbe « inutilement » me paraît inapproprié : comment juger de l’utilité d’une vie ?
M. Alain Claeys, corapporteur. Il s’agit de juger de l’utilité de la prolongation de la vie, non de l’utilité de la vie elle-même.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS76 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il s’agit de substituer à la notion de traitement antalgique celle d’analgésie, plus large et, partant, plus conforme à l’objectif poursuivi. Je ne fais que reprendre les recommandations du groupe de travail « sédation en fin de vie » de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP).
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la Commission adopte l’amendement.
La Commission aborde ensuite l’amendement AS34 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Monsieur Alain Claeys, vous affirmiez dans votre propos liminaire, cet après-midi, que nos concitoyens voulaient être entendus. Eh bien, entendons aussi, comme je le propose par cet amendement, ceux qui veulent choisir de bénéficier d’une euthanasie ou d’un suicide médicalement assisté.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
L’amendement AS33 de Mme Véronique Massonneau est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS169 des corapporteurs.
Elle en vient à l’amendement AS29 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Nous proposons de soumettre le recours à la sédation à l’existence d’une impasse thérapeutique et non au fait que le pronostic vital du malade soit engagé à court terme. Comme je le disais lors de l’examen de ma propre proposition de loi, je défie quiconque de mesurer le temps qui reste à vivre à un patient, et la notion d’impasse thérapeutique permettrait de répondre à certaines situations. Le cas de Vincent Lambert est éclairant à cet égard : aujourd’hui âgé de trente-huit ans, sa situation pourrait s’éterniser encore des mois, et pourtant il n’est pas considéré comme en fin de vie, l’usage de cette notion étant généralement réservé aux personnes âgées.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Il est vrai qu’il est difficile de déterminer combien de temps il reste à vivre à un patient, mais plus celui-ci approche de la mort, plus il est aisé d’identifier une phase de dégradation continue susceptible d’entraîner à court terme une défaillance viscérale. S’il est évidemment hasardeux de pronostiquer un décès un an à l’avance, il l’est moins d’affirmer que le pronostic vital d’un patient est engagé à une échéance de trois semaines.
Comment définir, en revanche, l’impasse thérapeutique ? Vincent Lambert ne se trouve pas dans une telle situation, puisqu’il est encore possible de lui administrer certains traitements. S’il s’agit de qualifier une situation dans laquelle la santé d’un patient ne s’améliore plus, l’adoption de votre amendement aurait pour effet que, dès lors qu’un patient se verrait administrer des soins palliatifs, il serait éligible à une sédation profonde. Ces termes, qui ne s’inscrivent pas dans une logique temporelle, me paraissent donc plus flous que ceux retenus dans notre proposition de loi.
M. Jean-Pierre Barbier. La notion d’impasse thérapeutique me paraît beaucoup trop large. D’abord, parce qu’une telle situation peut très bien n’être que temporaire. Ensuite, si cette expression vise les cas où il n’existe aucun traitement susceptible d’améliorer les conditions de vie du patient, il existe encore aujourd’hui, malheureusement, des maladies qui placent celui-ci en situation d’impasse thérapeutique sans mettre en jeu son pronostic vital à court terme. L’introduction d’une telle notion ouvrirait donc la porte à des dérives difficilement acceptables.
M. Jean-Louis Touraine. La notion d’impasse thérapeutique peut effectivement être comprise de différentes façons. Personnellement, je l’applique aux circonstances où aucun traitement, qu’il soit palliatif ou à visée curative, ne peut enrayer l’évolution néfaste d’une maladie.
Peut-être pourrions-nous, si nous n’attribuons pas tous la même acception à ces mots, choisir un terme plus précis, mais il me semble plus dommageable de maintenir la notion de pronostic vital engagé à court terme. J’ai vu tant d’erreurs de pronostic que j’ai demandé à tous mes collaborateurs de s’interdire de formuler quelque pronostic que ce soit sur l’espérance de vie des patients. Car les erreurs, qu’elles soient commises dans l’un ou l’autre sens, ne sont jamais pardonnées, ni par les patients ni par leurs familles. C’est, je crois, la sagesse même que de ne pas formuler de pronostic vital chiffré.
Mme Véronique Massonneau. Monsieur Leonetti, vous affirmez que la notion d’impasse thérapeutique est trop floue, mais celle de pronostic vital engagé l’est encore plus, sauf, en effet, en toute fin de vie, lorsque se manifestent des signes cliniques qui ne trompent pas.
Je veux bien, moi aussi, que l’on choisisse un autre terme, mais mon objectif est d’éviter de simplifier à l’excès l’encadrement par la loi du recours à la sédation. Et je tiens à préciser, monsieur Barbier, que ce ne serait pas là la seule et unique condition permettant ce recours, mais bien une condition en plus de celles qui figurent dans la proposition de loi. Je ne vois donc pas à quelles dérives vous faites allusion.
M. Alain Claeys, corapporteur. L’expression d’impasse thérapeutique figure dans plusieurs lois étrangères, dont la loi belge.
Mme Véronique Massonneau. C’est vrai.
M. Gérard Sebaoun. Il convient de relier ce débat aux précédents alinéas de cet article L. 1110-5-2 nouveau. L’une des seules définitions de l’impasse thérapeutique que j’aie trouvées figure dans un avis rendu en 1996 par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) à propos des nouveaux traitements du sida. Le CCNE y fait référence à une « situation qui survient chez un patient lorsque tous les traitements envisageables de sa maladie se sont révélés inefficaces ou présentent des effets secondaires intolérables ». Or, cette définition me semble bien correspondre à la logique du deuxième alinéa, qui vise les patients souffrant d’une maladie grave et incurable et dont la souffrance, extrême, demande une sédation définitive. Si je comprends la notion de pronostic vital engagé, celle de court terme soulève la question énoncée par Jean-Louis Touraine. La notion d’impasse thérapeutique me paraît répondre à une sollicitation plus large que celle de court terme.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Il est compliqué de dire en quoi consiste la fin de vie. Ne s’y trouve-t-on pas dès la naissance, dans la mesure où le compte à rebours a commencé ? On peut essayer, en revanche, de définir la phase avancée, au cours de laquelle une maladie a progressé sans avoir été arrêtée par un traitement. On peut ensuite considérer un patient comme étant en phase terminale dès lors que les traitements curatifs n’ont plus aucun effet d’amélioration sur son état. Puis survient un autre élément dans la phase terminale – que certains appellent la phase « toute terminale » – dans laquelle le patient, malgré le traitement qu’il subit, voit son état se dégrader. Enfin, il existe au bout de la vie la phase agonique : bien définie, elle correspond à une phase de défaillance polyviscérale telle que la mort est imminente. Entre la phase terminale, où il y a échappement thérapeutique et aggravation de l’état du malade, et la phase agonique, il est difficile de définir la phase au cours de laquelle on sait que le malade va mourir dans un bref délai sans pouvoir déterminer si ce délai est de quelques semaines, de quelques jours ou de quelques heures.
Monsieur Touraine, je me suis beaucoup trompé, moi aussi, dans mes pronostics. Mais si, lorsque le décès d’un malade est encore lointain, le fait de dire qu’il ne lui reste plus que deux ans à vivre relève du pari statistique, lorsqu’en revanche il entre dans une phase qui se compte en semaines, on peut certes se tromper d’une semaine, mais pas d’un an. Or, nous sommes en train de fixer les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Si l’on admet que la sédation n’est pas euthanasique mais qu’elle vise à soulager, elle ne peut s’appliquer que lorsque le patient est en phase terminale de la maladie, lorsque son pronostic vital est engagé à court terme. Nous avons d’ailleurs ici repris les termes de la lettre de mission du Premier ministre qui visait précisément cette notion. Je ne dis pas cela pour que nos collègues socialistes trouvent le terme plus pertinent (Sourires), mais nous n’avons finalement pas trouvé de meilleure expression pour désigner la phase dans laquelle le pronostic vital est engagé et qui ne correspond pas à la phase terminale. D’ailleurs, selon nombre de médecins que nous avons interrogés, la phase terminale peut durer plusieurs années : elle ne correspond donc nullement à la phase au cours de laquelle le pronostic vital est engagé à court terme.
Il est bon de définir le sens de cette expression, d’une part parce qu’elle constitue l’une des conditions auxquelles nous proposons de soumettre la mise en œuvre de la sédation, et d’autre part parce que, dans cette phase, le pronostic n’est guère loin de la réalité.
M. Jean-Louis Touraine. Si l’on maintient la référence au court terme, ne risque-t-on pas de laisser à la subjectivité de l’équipe médicale le soin d’en apprécier la portée ? Dans ce cas, certains médecins, peu enclins à recourir à la sédation profonde et continue, pourraient considérer qu’elle doit être réservée aux toutes dernières heures de la phase agonique du patient, tandis que d’autres pourraient l’envisager plusieurs semaines avant l’agonie.
À l’opposé, l’impasse thérapeutique est une notion médicalement définie : elle correspond au stade où plus aucun traitement n’agit positivement. Elle est donc moins ambiguë et plus précise que celle de court terme.
La Commission rejette l’amendement AS29.
Elle examine l’amendement AS19 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Je souhaite supprimer la notion de court terme qui me paraît vague, celle de pronostic vital engagé me convenant tout à fait. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai voté le précédent amendement.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Elle étudie ensuite l’amendement AS23 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Je propose, comme par l’amendement AS76 précédemment adopté, de substituer à la notion de traitement antalgique celle d’analgésie.
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS3 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Entre la mort dans d’atroces souffrances et l’euthanasie existe une voie médiane, que nous avions su trouver en 2005, et je trouve dommage que nous mettions en péril le fragile équilibre atteint grâce à la loi dite Leonetti. La désinformation considérable et le manque de formation des professionnels de santé à l’égard de la fin de vie sont inacceptables, dix ans après la promulgation de la loi.
La demande d’euthanasie régressant dès lors que les patients concernés sont bien pris en charge, développons les centres de soins palliatifs, accompagnons nos malades et entourons-les. L’urgence n’est pas à l’adoption d’une loi, mais à la formation des médecins, des infirmiers et des soignants. La carence de l’État dans le domaine des soins palliatifs, faute de moyens financiers, crée des inégalités territoriales. Mon amendement vise donc à supprimer le quatrième alinéa de cet article, qui est un pas de trop vers le suicide médicalement assisté.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Il me semble que vous faites une confusion. En fait, est visée au quatrième alinéa de cet article la situation particulière où le malade décide d’arrêter un traitement et engage ainsi son pronostic vital. Cela concerne concrètement les malades bénéficiant d’un traitement par respirateur artificiel et qui souhaitent y mettre fin, ce que la loi de 2002, complétée en 2005, permet à certaines conditions : le médecin doit leur expliquer le risque qu’ils encourent et faire appel à un autre médecin afin de dialoguer avec eux dans la collégialité. Enfin, la loi accorde un délai de réflexion supplémentaire à ces malades, ceux-ci pouvant avoir demandé l’arrêt de leur traitement de survie sous le coup d’une impulsion.
Ce que n’avaient prévu ni la loi de 2002 ni celle de 2005, ce sont les modalités de prise en charge des malades dont on arrête le traitement de survie. Nous avons tous en tête un cas, qui reste au fond de ma mémoire comme une souffrance indélébile : celui d’un jeune homme, fils de pompier, ayant été réanimé et qui n’a pas été pris en charge après l’arrêt de son traitement de survie. Ce jeune homme est mort au bout d’une semaine, au terme de convulsions, souffrant d’un encombrement pulmonaire.
En 2008, nous avons modifié non pas la loi mais le code de déontologie médicale afin de préciser que, lorsqu’un médecin met fin à un traitement de survie, soit à la demande du malade, soit parce qu’il considère ce traitement comme une obstination déraisonnable, il a l’obligation d’administrer à ce malade un traitement antalgique et sédatif, afin de lui éviter la moindre souffrance.
En d’autres termes, le malade dispose déjà du droit de faire cesser un traitement de survie, la loi de 2005 et la réforme du code de déontologie médicale de 2008 ayant parallèlement imposé au médecin le devoir d’administrer au malade une sédation profonde jusqu’à son décès.
Ce que nous proposons ici n’est que la reprise de cette procédure, de façon inversée dans le cadre de la sédation profonde : il s’agit de faire en sorte que, lorsqu’un malade fait arrêter son traitement, le corps médical, qui accepte à contrecœur la décision du malade, lui applique dans le même temps un traitement lui évitant toute souffrance potentielle.
M. Jean-Louis Touraine. Je suis, bien entendu, contre cet amendement qui aurait pour effet de supprimer l’une des quelques avancées de la proposition de loi. Si l’on veut épargner au patient une agonie douloureuse et pénible, et à son entourage et à l’équipe soignante d’en être les témoins, le médecin doit avoir la possibilité de prendre certaines décisions. Ce qui est proposé ici constitue à cet égard une première étape.
On peut déplorer que tous les cas possibles ne soient pas couverts, dans la mesure où certaines personnes souhaitent vivre une fin de vie sans être abrutis par la sédation, comme l’indiquait Manuel Valls lui-même. Il devrait effectivement y avoir d’autres choix offerts que celui de recourir à la sédation. Mais c’est un autre débat, et nous verrons plus tard si cet alinéa doit être complété ou non. En attendant, il doit être au moins maintenu, car il s’agit d’apaiser la souffrance des malades.
J’ajoute que ce type d’actes se pratique déjà, puisque l’on compte entre 2 000 et 4 000 cas par an en France. Or, il est inadmissible que les 2 000 médecins et infirmières ayant affirmé dans la presse qu’ils appliquaient cette sédation, tout comme ceux qui le font sans le dire, soient passibles de poursuites judiciaires alors qu’ils accomplissent un geste de compassion. Les juges ne s’y trompent d’ailleurs pas, qui ne condamnent généralement pas ces médecins et infirmières.
Pour toutes ces raisons, il serait regrettable et réactionnaire de vouloir supprimer cette petite avancée pleine d’humanité.
M. Jean Leonetti, corapporteur. J’entends bien l’argumentaire de M. Jean-Louis Touraine, mais il n’a trait ni à l’amendement ni au texte du présent article.
M. Alain Claeys, corapporteur. M. Jean-Louis Touraine anticipe le débat que nous aurons tout à l’heure…
M. Jean Leonetti, corapporteur. L’amendement de M. Dino Cinieri vise à éviter une dérive euthanasique. Or, c’est la loi de 2002, non cette proposition de loi, qui permet de mettre un terme aux traitements de survie. Nous ne faisons aujourd’hui qu’édicter l’obligation pour le médecin d’administrer, en pareil cas, une sédation afin d’empêcher la souffrance du patient, et ce, à la condition que l’arrêt d’un tel traitement engage le pronostic vital à court terme de ce dernier.
M. Gérard Sebaoun. Au lieu de proposer la suppression du quatrième alinéa de l’article, qui définit l’un des cas particuliers dans lesquels la sédation profonde et continue est possible, M. Dino Cinieri aurait dû viser directement son deuxième alinéa qui pose le principe général de la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Car c’est bien cela qui lui pose problème, et non les conditions de mise en œuvre de cette sédation.
L’amendement AS3 est retiré.
L’amendement AS20 de M. Gérard Sebaoun est également retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS98 de M. Dominique Tian.
M. Dominique Tian. Nous proposons qu’il faille que la situation clinique l’exige pour que la sédation profonde soit mise en œuvre lorsque la décision du patient, atteint d’une affection grave et incurable, d’arrêter un traitement, engage son pronostic vital à court terme.
M. Alain Claeys, corapporteur. Avis défavorable, car cela réduirait la portée de l’article.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Ce serait en outre une remise en cause des lois de 2002 et de 2005, car cela sous-entendrait que l’état clinique du malade, tel qu’apprécié par le médecin, prime sa décision d’arrêter son traitement.
L’amendement AS98 est retiré.
L’amendement AS31 de Mme Véronique Massonneau est également retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS36 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Certains patients souhaitant que leur sédation soit la plus courte possible, il conviendrait que la loi permette d’adapter sa durée à la demande du patient, afin de respecter la volonté de celui-ci. Je précise qu’il n’est nullement question ici d’euthanasie ni de suicide médicalement assisté.
M. Alain Claeys, corapporteur. Avis défavorable.
Dès lors que l’on administre à un malade un traitement à visée sédative et antalgique jusqu’à son décès et que l’on arrête tous les traitements visant à le maintenir en vie, on aide cette personne à avoir une fin de vie digne et apaisée. J’ai essuyé des critiques lorsque, dans les colonnes de Libération, j’ai utilisé pour désigner pareille procédure l’expression d’« aide à mourir ». J’en prends acte. Mais un tel geste médical, associé à l’arrêt de tout traitement, constitue selon moi une déclinaison de l’article 1er de la proposition de loi qui consacre le droit à une fin de vie digne et apaisée.
On ne saurait qualifier dans la loi la durée de cette sédation. Mais dès lors que l’on a l’assurance qu’il s’agit d’une sédation continue jusqu’au décès, il n’y a aucun risque que le patient se réveille. Je vous propose donc d’en rester au texte de la proposition de loi.
Il convient d’ailleurs de lier cette disposition à la notion d’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles, considérées comme « traitements » au sens du premier alinéa de l’article L. 1110-5-2.
Mme Véronique Massonneau. Je défends donc en même temps l’amendement AS80 qui précise justement que, parallèlement à la sédation, il doit être mis un terme à l’alimentation et à l’hydratation artificielles du patient, et que ce dernier doit être mis au courant des conséquences de tels actes.
En tout état de cause, le médecin sait très bien que, selon la dose de sédatif qu’il injectera au patient, sa sédation sera plus ou moins longue. Je ne suis certes pas médecin mais une personne de ma famille s’est vu administrer cette sédation à visée ultime. Or, lorsque l’on a demandé au médecin en cause d’augmenter les doses de sédatif, celui-ci a refusé au motif que le patient n’avait pas demandé la sédation jusqu’à la mort.
M. Alain Claeys, corapporteur. Je reviens à la construction de cet article. Nous sommes partis de la demande du patient qui veut éviter toute souffrance. Je ne suis pas médecin, mais nous avons recueilli les témoignages de personnes qui nous ont présenté le cas de parents très proches, et il ressort de ces témoignages que les pratiques médicales sont très différentes d’un endroit à l’autre. Nous avons donc voulu en clarifier très précisément le cadre.
Mme Michèle Delaunay. En prévoyant une sédation profonde, terminale et continue, l’article répond déjà à toutes les préoccupations. Aller plus loin serait entrer dans l’irréalité. La loi doit-elle détailler la recette de la sédation donnée aux patients ? Ce n’est nullement nécessaire, car la définition proposée est au contraire d’une clarté totale. Les modalités d’administration de la sédation doivent être laissées à l’appréciation du médecin. Elles ne seront certes pas les mêmes pour un homme de deux mètres de haut ou une patiente qui ne pèse que 35 kilogrammes.
Mme Véronique Massonneau. Ne caricaturons pas les débats !
M. Gérard Bapt. Le problème posé est réel. Un traitement sédatif profond et continu, administré à un patient agonisant, aboutit à la mort au bout de deux ou trois jours. La dignité du patient, même placé en sédation, doit être respectée ; il n’est pas encore mort. Quant à la souffrance psychique des personnes proches et de confiance, c’est une autre affaire. En tout état de cause, il y a une différence fondamentale entre la sédation apaisante et la sédation terminale.
M. Jean-Pierre Barbier. Le problème qui se pose à nous est celui du patient en fin de vie. Il ne se rend plus compte de rien, mais veut partir dans la dignité et sans souffrir. Quant aux familles, elles ne peuvent faire leur deuil que lorsque la mort arrive. Si nous essayons de traiter aussi la souffrance des familles, nous nous éloignons de l’esprit initial du texte, centré sur le patient.
M. Gérard Sebaoun. C’est en effet le patient qui se trouve à l’agonie. Mais ne caricaturons pas les choses : on peut entendre aussi que le patient ne veuille ni vivre ces derniers moments, ni les faire vivre à ses proches. Reste que la question de la temporalité mérite débat : quelques heures et quelques jours d’agonie, ce n’est pas la même chose.
Mme Michèle Delaunay. Pardonnez-moi, madame Véronique Massonneau, si la formulation que j’ai retenue a pu vous heurter. Je crois que la loi ne peut pas détailler expressément les modalités pratiques de la sédation. En tout cas, il est impossible d’engager avec un patient un dialogue où il lui serait demandé combien de temps il compte vivre encore : quinze minutes, davantage, que sais-je… Peut-être la formule la plus précise qui puisse être employée serait-elle « pas trop longtemps »…
M. Jean-Pierre Barbier. La situation deviendrait cependant inhumaine si le patient disait « vingt-quatre heures » et survivait en fait plus longtemps : faudrait-il alors le réveiller ? ! L’heure d’un décès ne peut être précisée à la minute près.
Mme Véronique Massonneau. Cet amendement, comme l’amendement AS80, m’a été suggéré par le professeur Olivier Lyon-Caen, conseiller du Président de la République (Sourires), qui m’a convaincu qu’il serait hypocrite de ne rien préciser. Monsieur Jean-Pierre Barbier, vous donnez l’exemple type de la situation à laquelle il ne faut pas arriver. Je défends le patient et non la famille, qui ne doit pas être décisionnaire. J’irai donc revoir le professeur Lyon-Caen…
M. Jean Leonetti, corapporteur. Je suis heureux que le professeur Lyon-Caen ait trouvé une députée comme porte-parole… Madame Véronique Massonneau, permettez-moi seulement de vous dire que vous ne sortez pas de l’impasse en prévoyant que la sédation « n’excède pas une certaine durée », ce qui ne veut pas forcément dire qu’elle soit courte. Plutôt que d’en exprimer néanmoins la volonté évanescente, donnons-nous les moyens de faire qu’elle puisse l’être vraiment.
Pourquoi un patient meurt-il ? En premier lieu, rappelons-le, parce que son pronostic vital est engagé. Depuis la loi de 2005, la sédation peut aussi entraîner la mort en allégeant ses souffrances, mais c’est un fort mauvais moyen, car il faut des doses énormes d’anesthésiant pour provoquer une chute de tension. Mieux vaut utiliser des antalgiques.
À ce stade du traitement, il s’agit avant tout de lâcher prise. Le patient ne veut pas « vivre le mourir », comme le dit mon collègue Alain Claeys, mais plutôt s’endormir. Or le code de déontologie impose de ne pas prolonger anormalement une agonie. La question ne se pose donc pas de savoir que faire du patient après trois mois si une sédation lui est administrée. Lâcher prise signifie en effet arrêter les traitements de survie, comme le permet la loi de 2002, puis le placer en sédation profonde, comme le prévoit depuis 2008 l’article 37, alinéa III, du code de déontologie médicale.
Récapitulons. Le patient meurt parce que sa mort est imminente, alors qu’il n’aurait pas droit à une sédation si son décès n’était envisageable que dans les cinq ans. Il meurt parce qu’il ne supporte plus les traitements de survie et se voit placé en sédation profonde et continue. Il meurt enfin parce que ces traitements ont cessé. Pardonnez ce rappel purement physiologique, mais un patient qui ne reçoit plus de traitement de survie et qui dort est un patient dont la mort survient à court terme. C’est une question de jours. En tout cas, un réveil n’est pas envisageable. Par ailleurs, le patient ne souffre plus.
Il en va différemment de la famille qui voit la mort du patient. Dans l’affaire Pierrat, la mort n’est survenue qu’au bout de dix jours, ce qui est un délai inacceptable. Ne légiférons donc pas sur la durée. En tout état de cause, « ne pas excéder une certaine durée » n’a pas de valeur normative. Il n’est pas opportun de légiférer sur la posologie et de graver dans la loi les indications du Vidal. Pour ma part, je trouve notre texte déjà trop tatillon, ne serait-ce que parce que d’autres produits médicamenteux peuvent arriver demain et bouleverser les pratiques actuelles.
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS4 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. L’alinéa 4 du nouvel article L. 1110-5-2 prévoit la sédation profonde et continue jusqu’au décès de personnes hors d’état d’exprimer leur volonté, mais qui ne sont pas en fin de vie. Je crois que nous glissons dangereusement vers une dérive euthanasique des personnes lourdement handicapées.
Je suis choqué lorsque j’entends certains – pas ici heureusement – parler d’eux comme de « légumes », car ces personnes ont droit au respect ! Nombreux sont les gens en bonne santé qui proclament ne vouloir à aucun prix vivre gravement malades ou handicapés, mais le jour où ils le deviennent, le discours change du tout au tout car, s’ils se sentent respectés et aimés, ils prennent conscience que leur vie, même dans ces conditions difficiles, est précieuse. C’est notre regard sur le handicap et la maladie que nous devons changer, plutôt que de chercher à faire disparaître les personnes qui en souffrent.
Je propose donc la suppression de cet alinéa.
M. Jean-Louis Touraine. Je voterai contre cet amendement, même si je comprends que cet alinéa puisse interpeller. D’une part, en effet, c’est l’équipe médicale qui, de fait, imposera au patient l’administration d’antalgiques ou de sédatifs à des doses susceptibles d’abréger sa vie alors qu’il n’en a pas exprimé la volonté. D’autre part, il y a aussi des patients qui, comme l’avait très bien expliqué Manuel Valls en tant que rapporteur de la précédente proposition de loi du groupe socialiste sur la fin de vie, ne peuvent s’exprimer mais ont conservé un certain niveau de conscience et ne veulent pas en être privés. Je reconnais donc que la rédaction actuelle puisse être embarrassante, mais je la soutiens néanmoins, car toute autre serait plus dangereuse encore.
M. Gérard Sebaoun. N’oublions pas que le dispositif renvoie explicitement à l’article précédent, qui encadre très strictement le refus ou l’arrêt des traitements n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie. Je partage donc l’avis de Jean-Louis Touraine : il ne faut pas y toucher.
M. Jean Leonetti, corapporteur. L’alinéa ne fait que reprendre la loi de 2005 et le code de déontologie, en son article 37, alinéa III, tel que modifié en 2008. Il ne s’agit pas d’une innovation, mais d’une reformulation.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS170 des corapporteurs.
Puis, suivant l’avis défavorable des corapporteurs, elle rejette l’amendement AS99 de M. Dominique Tian.
Elle examine ensuite l’amendement AS129 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. C’est un amendement rédactionnel, qui vise à éviter la répétition des mots « le médecin ».
M. Jean Leonetti, corapporteur. Nous ne pouvons avoir l’ambition d’égaler Chateaubriand… Au demeurant, la suppression que vous proposez ferait naître une ambiguïté, car le pronom personnel pourrait alors renvoyer à plusieurs antécédents possibles.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite les amendements AS77 et AS78 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il s’agit d’amendements de coordination avec les amendements AS76 et AS23 que nous avons adoptés tout à l’heure.
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la Commission adopte successivement ces amendements.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement AS172 des corapporteurs et l’amendement AS100 de M. Dominique Tian.
M. Alain Claeys, corapporteur. Il s’agit de mieux définir la finalité de la procédure collégiale.
M. Dominique Tian. Je propose pour ma part de préciser que la sédation est administrée « selon les recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé ».
La Commission adopte l’amendement AS172. En conséquence, l’amendement AS100 tombe.
La Commission en vient à l’amendement AS80 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. J’ai défendu cet amendement avec l’amendement AS36.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS70 de Mme Sandrine Hurel.
Mme Sandrine Hurel. Il s’agit de garantir à un patient souhaitant bénéficier d’une sédation profonde la possibilité de mourir à son domicile.
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement AS69 de Mme Sandrine Hurel.
Mme Sandrine Hurel. Je propose, par cet amendement, de consolider le caractère irréversible de la procédure décrite au présent article et de protéger le choix du patient contre d’ultimes tentatives de l’entraver, qu’elles proviennent de son entourage ou de l’équipe médicale.
M. Alain Claeys, corapporteur. Cette attente se trouve déjà satisfaite par l’emploi de l’adjectif « continue ».
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AS135 de Mme Sandrine Hurel.
Mme Sandrine Hurel. Cet amendement vise à éviter les situations d’agonie prolongée dans le cadre du traitement à visée sédative et antalgique associé à l’arrêt des traitements de maintien en vie.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements AS12 et AS13 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Je fais référence, dans l’exposé sommaire de ces amendements, à la clause de conscience, dont l’existence est rappelée par un texte qu’a adopté, le 8 février 2013, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) sur la fin de vie et l’« assistance à mourir ». Les guillemets font partie du texte en question, qui prévoit que « le médecin doit toujours pouvoir faire valoir sa clause de conscience » et que « celle-ci doit être indiquée au patient s’il remet des directives anticipées ou exprime des souhaits contraires aux opinions intimes personnelles du médecin ».
L’invocation de cette clause de conscience doit cependant, à mon sens, avoir une contrepartie, à savoir l’obligation pour le médecin de chercher d’autres praticiens aptes à le suppléer. Je sais que le CNOM n’est pas favorable à ces amendements, mais il faut éviter que le médecin puisse se délier de l’obligation de mettre en place la sédation profonde, sans obligation d’assurer néanmoins le continuum médical.
Je retire néanmoins le premier de ces deux amendements, qui vise également l’assistance médicalisée active de fin de vie, mais maintiens le second, qui vise uniquement la sédation profonde et continue.
L’amendement AS12 est retiré.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Une clause de conscience ne saurait être invoquée lorsque c’est son devoir que l’on accomplit. Comment des médecins pourraient-ils donc s’en délier ? Le texte que vous nous citez, monsieur Sebaoun, concerne l’aide à mourir, qui pose des problèmes tout différents. Le CNOM nous a confirmé par écrit qu’aucune clause de conscience n’est à invoquer si le texte reste en l’état.
Votre amendement ne ferait que compliquer les choses, car il laisse entendre qu’une euthanasie pourrait être pratiquée au travers d’un traitement sédatif. Avis défavorable.
M. Alain Claeys, corapporteur. Madame la présidente, notre Commission ne pourrait-elle entendre le CNOM ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Il me semble que cela fait plutôt partie du travail des rapporteurs, mais rien ne vous empêche de procéder à une telle audition et d’y admettre tous les membres de la Commission.
M. Alain Claeys, corapporteur. Très bien. C’est ce que nous allons par conséquent organiser, si M. Jean Leonetti en est d’accord.
M. Jean-Louis Touraine. Pour ma part, je soutiens l’amendement de M. Gérard Sebaoun. Dans la mesure où il est question d’administrer une sédation et des antalgiques à des doses importantes pouvant provoquer la mort, comme le dit l’article 4 – le fait que l’on appelle cela « euthanasie » ne change rien au problème – ou abréger la vie…
M. Jean Leonetti, corapporteur. Tout traitement soulageant la douleur peut avoir pour effet d’abréger la vie.
M. Jean-Louis Touraine. Certes, surtout aux doses utilisées dans les circonstances que nous évoquons.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Je ne peux vous laisser dire que ce texte est un texte relatif à l’euthanasie, monsieur Touraine.
M. Jean-Louis Touraine. Au sens étymologique, c’est pourtant le cas – du moins je l’espère.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Au sens étymologique, je vous le concède.
M. Jean-Louis Touraine. Je m’en félicite, monsieur le rapporteur, car nous avons tous le même objectif, à savoir lutter contre le mal-mourir, dramatique dans notre pays. Il est certain que, dans le contexte évoqué, les médecins adopteront des attitudes différentes en fonction de leurs convictions philosophiques. Certains, s’attachant à respecter la vie aussi longtemps que possible, ne mettront pas en œuvre des doses susceptibles d’abréger la vie, alors que d’autres, confrontés à des souffrances non contrôlées, auront recours à des doses pouvant avoir des conséquences létales. Il y aura donc des inégalités de traitement importantes, induites par des pratiques différant en fonction des équipes médicales. De ce fait, il me paraît important de faire en sorte que le médecin ne souhaitant pas, pour des raisons de conscience, mettre en œuvre un traitement suffisamment fort pour répondre à la demande du patient, puisse se retirer, comme le prévoit le code de déontologie. Ce que nous voulons faire figurer dans la loi, c’est son obligation de prévenir une autre équipe qui viendra faire droit à la demande du patient de bénéficier de la sédation profonde et terminale.
M. Jean-Pierre Barbier. Sur ces questions d’une grande importance, nous devons être très précis. L’amendement AS12, qui a été retiré, faisait état d’une « assistance médicalisée active entraînant le décès du patient », et aurait pu donner lieu à l’application de la clause de conscience. Ce n’est pas le cas de la « sédation profonde et continue associée à une analgésie jusqu’au décès du patient », qui n’a aucune visée euthanasique. Dans ces conditions, introduire une clause de conscience pour les médecins aurait pour conséquence de dénaturer le texte en laissant à penser que la sédation proposée a une visée euthanasique, ce qui n’est pas acceptable.
M. Jean-Louis Touraine. Ce n’est pas une visée, c’est un résultat !
M. Jean-Pierre Barbier. Quand il ne peut plus soigner, le médecin est là pour accompagner et soulager en administrant la sédation. Nous devons nous élever fortement contre cet amendement qui peut laisser penser que la sédation est une aide active à la mort.
M. Alain Fauré. Si le médecin a l’obligation de soulager la souffrance, chacun sait que cette obligation donne lieu à diverses appréciations dans sa mise en œuvre. Dès lors, il se peut qu’un médecin ne souhaite pas apporter son concours à la sédation profonde et continue – auquel cas il faudrait pouvoir faire intervenir un autre médecin. Cela dit, la clause de conscience à laquelle fait référence l’exposé sommaire n’a rien à voir avec cette problématique et entraîne un blocage inutile : il n’est pas question ici d’euthanasie, mais des moyens de soulager la souffrance.
M. Gérard Sebaoun. J’entends bien ce que veut dire M. Alain Fauré, mais la notion de clause de conscience est couramment utilisée pour décrire le rapport du médecin à l’acte qu’il souhaite ou ne souhaite pas accomplir. Comme vous l’avez remarqué, j’ai utilisé cette expression dans l’exposé sommaire, mais pas dans le texte de l’amendement lui-même. Les Canadiens vont plus loin, en faisant figurer cette expression dans la loi.
N’étant pas d’accord avec Jean Leonetti, je voudrais donner lecture de certains passages du texte adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins, intitulé « Fin de vie, “Assistance à mourir” », qui viennent contredire la position dont ses représentants ont fait état lorsqu’ils ont été auditionnés. Le texte commence ainsi : « En préambule, l’Ordre tient à rappeler les principes éthiques qui ont toujours été ceux des médecins depuis l’origine : ne pas donner délibérément la mort mais s’interdire toute obstination déraisonnable. » Il s’articule ensuite selon quatre axes : « 1. Il est indispensable de promouvoir la connaissance, l’accompagnement et l’application de la loi Leonetti » ; « 2. Quelles propositions pour des situations exceptionnelles non prises en compte dans l’état actuel de la loi, du droit et de la déontologie médicale ? » Ce paragraphe contient la proposition suivante : « Une sédation, adaptée, profonde et terminale délivrée dans le respect de la dignité pourrait être envisagée, par devoir d’humanité, par un collège dont il conviendrait de fixer la composition et les modalités de saisine. Ce collège fonderait son avis sur l’évaluation de la situation médicale du patient, sur le caractère réitéré et autonome de sa demande, sur l’absence de toute entrave à sa liberté dans l’expression de cette demande. » Il me semble que nous sommes là dans le droit fil de ce que vous proposez, monsieur Leonetti.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Non !
M. Gérard Sebaoun. Enfin, les troisième et quatrième axes sont les suivants : « 3. Les directives anticipées et la personne de confiance » ; « 4. Incidences déontologiques pour le médecin : le devoir d’accompagnement et la clause de conscience. Le médecin doit toujours pouvoir faire valoir la clause de conscience. Ce principe ne doit pas être remis en cause. Celle-ci doit être indiquée au patient s’il remet des directives anticipées ou exprime des souhaits contraires aux opinions intimes personnelles du médecin. Elle s’applique aussi aux situations évoquées plus haut dans ce texte. Pour autant, le médecin qui exprime au nom de sa propre liberté la clause de conscience doit le faire sans donner au patient, ou à son entourage, un sentiment d’abandon. Il doit l’accompagner et doit faire parvenir au médecin qui le prendrait parallèlement en charge toutes informations utiles. »
Nous ne faisons que transcrire dans le texte la possibilité dont doit légitimement disposer le médecin de se retirer si, pour des raisons personnelles et éthiques, il ne peut accompagner un patient en effectuant un certain geste, en l’occurrence celui consistant à administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Notre amendement vise simplement à clarifier les choses en posant la condition, pour le médecin ne souhaitant pas effectuer ce geste, de faire immédiatement appel à un autre praticien apte à le remplacer à cette fin. Il s’agit là d’une précision indispensable car les médecins du Conseil de l’Ordre n’ont pas répété, lorsque nous les avons entendus, ce qu’ils avaient pourtant écrit.
Mme Michèle Delaunay. Je veux dire à M. Jean-Pierre Barbier que la clause de conscience n’est pas du tout synonyme d’euthanasie. Par ailleurs, à ma connaissance, tout médecin est libre – mis à part le cadre de l’urgence – d’effectuer ou non tout acte thérapeutique, l’exemple le plus fréquemment cité en la matière étant celui de la vaccination – étant précisé que le médecin ne souhaitant pas la pratiquer a le devoir d’orienter le patient vers un confrère qui le suppléera.
J’avais proposé un amendement ne recourant pas à la notion de clause de conscience, et disant simplement que lorsqu’un médecin se trouvait dans l’incapacité de mettre en œuvre la sédation terminale, il devait alors contacter un confrère à cette fin, afin que l’expression de la volonté du patient ne se trouve en aucun cas contrariée. Il me paraît important d’éviter l’expression « clause de conscience », qui est inadaptée aux circonstances et risque d’induire le lecteur en erreur.
M. Alain Claeys, corapporteur. J’ai sous les yeux le texte de l’Ordre des médecins intitulé « Fin de vie, “Assistance à mourir” », et je pense qu’une clarification s’impose. C’est pourquoi je confirme que Jean Leonetti et moi-même estimons nécessaire de procéder à l’audition des représentants de l’Ordre – à laquelle pourront prendre part tous les membres de la commission le souhaitant – d’ici à l’examen du texte en séance publique.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Cette audition pourra avoir lieu, pourvu que vous l’organisiez en tant que rapporteurs, en dehors du cadre de notre Commission.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Le Conseil de l’Ordre, saisi de deux situations différentes, a bien distingué la sédation terminale de la sédation en phase terminale – la première expression étant liée à la finalité et la seconde à la temporalité, en l’occurrence la dernière période de la vie. Comme vous l’avez dit vous-même, monsieur Sebaoun, le texte dont vous avez lu des extraits s’intitule d’ailleurs « Assistance à mourir ».
M. Gérard Sebaoun. Oui, comme j’ai dit que cette expression était encadrée de guillemets.
M. Jean Leonetti, corapporteur. En tout état de cause, il y a bel et bien deux démarches distinctes, celle à laquelle vous faites référence posant le problème des médicaments ajoutés aux sédatifs afin d’accélérer la mort. Le texte du Conseil de l’Ordre visait, à une époque antérieure aux auditions, à prévenir le pouvoir exécutif que, dans le cas où il envisagerait la sédation terminale, il faudrait prévoir une clause de conscience. Cependant, je peux vous assurer qu’aujourd’hui, les médecins de l’Ordre considèrent que, dès lors qu’elle est pratiquée conformément aux recommandations de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, la sédation ne requiert pas de clause de conscience. J’admets qu’il peut subsister une ambiguïté et je partage donc le souhait d’Alain Claeys de disposer d’un rapport écrit du Conseil de l’Ordre – dont nous entendrons les représentants en dehors du cadre de la Commission, conformément à la volonté de Mme la présidente.
La clause de conscience est une clause très large, ayant vocation à s’appliquer pratiquement à tous les actes. Je dirai même qu’un médecin a le droit, s’il le souhaite, de ne pas soigner un patient, à condition que celui-ci puisse recevoir d’un autre médecin les soins qu’exige son état – c’est souvent le cas lorsqu’un médecin est amené à soigner des personnes de sa famille. Dès lors que la loi accorde un droit au patient, il n’est aucunement besoin de préciser les conditions permettant de faire respecter ce droit, et je dirai même que s’engager sur cette voie présenterait le danger de semer la confusion dans l’esprit des médecins.
M. Alain Fauré. Je veux dire à M. Jean Leonetti que la formulation de l’amendement ne fait en rien appel à la notion de clause de conscience : il n’est question que d’accompagner et de soulager le patient. Certes, l’exposé des motifs est maladroit et peut prêter à confusion, mais cela ne doit pas nous conduire à rejeter l’amendement lui-même. Cela dit, la proposition de M. Alain Claeys d’auditionner le Conseil de l’Ordre avant de prendre position sur cette question est sage, et je m’y rallie.
M. Gérard Sebaoun. Demander au Conseil de l’Ordre de formaliser un avis qui nous éclairera sur cette question très particulière de la clause de conscience – qui existera en tout état de cause – et l’entendre à nouveau, me semble être une bonne idée. En attendant que cela puisse se faire, je suis disposé à retirer mon amendement, que je redéposerai en séance.
M. Alain Claeys, corapporteur. Je suis tout à fait d’accord avec Jean Leonetti pour considérer qu’en adoptant l’amendement, nous permettrions que s’instaure une inégalité de traitement des patients, résultant de la mise en œuvre de pratiques différentes sur le territoire. Il est donc nécessaire que le Conseil de l’Ordre nous éclaire car, en l’état actuel, l’adoption de cet amendement présenterait un risque.
L’amendement AS13 est retiré.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS171 des corapporteurs.
Puis elle examine l’amendement AS32 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Je considère que cet amendement relatif à la clause de conscience est défendu – et pour ma part, je préfère le maintenir jusqu’à ce que l’avis du Conseil de l’Ordre nous soit communiqué.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS71 de Mme Sandrine Hurel.
Mme Sandrine Hurel. Il s’agit de permettre le réexamen des dispositions de l’article 3 par le Parlement cinq ans après la promulgation de la présente loi, afin que l’on puisse continuer à tenir compte d’éventuelles évolutions de la médecine et du débat citoyen qui va se poursuivre – c’est donc une clause de rendez-vous que je propose.
M. Alain Claeys, corapporteur. Nous sommes favorables au principe d’une évaluation de la loi mais, pour que la procédure soit moins lourde, nous souhaitons que le Gouvernement adresse un rapport d’évaluation au Parlement – à une fréquence restant à déterminer. Je suis donc défavorable à cet amendement en sa rédaction actuelle.
Mme Sandrine Hurel. Je suis disposée à rectifier mon amendement en ce sens.
M. Jean Leonetti, corapporteur. La question se pose, au sujet des grandes lois de société, de savoir s’il convient de les réviser à intervalle régulier, ou seulement lorsqu’une circonstance particulière – découverte médicale ou évolution de la pensée de nos concitoyens – l’exige. L’inconvénient de fixer un délai, c’est que l’on ne s’y tient généralement pas. Ainsi, alors qu’il a été décidé en 2011 que les lois de bioéthique seraient révisées tous les sept ans, il est évident que nous serions obligés d’y revenir dans un délai plus court si une avancée majeure dans le domaine des neurosciences le justifiait.
Pour ma part, je préférerais que soit effectué annuellement un état des lieux, plus exactement un état des pratiques, afin de voir si les nouveaux dispositifs de sédation ne donnent pas lieu à des gestes mal adaptés ou, au contraire, à une mise en œuvre trop timorée, avec des médecins ne jouant pas le jeu de la non-souffrance ; nous pourrions également vérifier quelle est la proportion de patients en fin de vie ayant rédigé des directives anticipées, et si ces directives posent problème aux médecins qui les reçoivent.
Prévoir à l’avance une révision régulière des lois de bioéthique pose un autre problème, celui de la pression exercée par les médias qui, dès le premier jour de la procédure de révision, s’interrogent sur les nouveautés qui vont être apportées au dispositif existant, alors même qu’en l’absence d’évolution des mentalités ou de la science médicale, il n’est pas forcément justifié de modifier ce dispositif – cela a été le cas lors de la dernière révision des dispositions relatives au don d’organes. En revanche, les expérimentations en cours au niveau européen au sujet des greffes d’organes vont peut-être aboutir à considérer qu’il est possible de procéder à des prélèvements d’organes chez des patients classés « Maastricht III », c’est-à-dire pour lesquels un arrêt cardiaque imminent est attendu – auquel cas une révision de la loi serait tout à fait justifiée.
Pour toutes ces raisons, je suis favorable à une révision en fonction des circonstances – qu’il s’agisse d’une évolution de la science ou des mentalités – plutôt qu’à une révision planifiée à intervalle régulier.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je rappelle qu’il entre dans les attributions de l’Assemblée de contrôler la loi, et qu’il n’est donc pas nécessaire de faire figurer ce principe dans le texte.
Mme Sandrine Hurel. Je voudrais demander à M. Jean Leonetti si une révision annuelle est de nature à permettre de rouvrir le débat.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Bien sûr.
M. Philip Cordery. En ce qui me concerne, j’estime que les deux propositions sont complémentaires plutôt que contradictoires. Si l’idée que le Gouvernement remette chaque année un rapport au Parlement est une très bonne chose – qu’il n’est effectivement pas nécessaire d’inscrire dans la loi, puisque nous sommes investis d’un pouvoir de contrôle –, ce que propose Mme Sandrine Hurel, consistant en un réexamen par le Parlement, est différent et tout aussi utile. Peut-être pourrions-nous préciser que ce réexamen se fera « au plus tard » cinq ans après la promulgation de la loi, ce qui laisse la possibilité de devancer ce délai si les circonstances le justifient – mais en tout état de cause, l’essentiel est bien que nous nous engagions à revoir le contenu de la loi dans les cinq ans qui viennent.
M. Gérard Bapt. À mon sens, le rapport annuel dont il est ici question compléterait celui qui est établi chaque année par l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) présidé par le professeur Régis Aubry.
L’idée d’instaurer une clause de revoyure tous les cinq ans peut paraître séduisante à première vue, mais je rappelle que, si la loi de santé publique votée en 2004 prévoyait une clause de rendez-vous au bout de cinq ans, nous n’avons prévu de réexaminer cette loi qu’en mars prochain au plus tôt, soit onze ans plus tard.
M. Jean-Pierre Barbier. Il me semble qu’en matière de bioéthique, la maxime selon laquelle il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante est particulièrement justifiée. Dès lors, je ne comprends pas pourquoi la loi dont nous débattons devrait forcément être revue dans cinq ans : nous la reverrons si nécessaire – et quand ce sera nécessaire – comme le veut notre mission en tant que législateur au sujet de toutes les lois, rien ne justifiant que ce texte fasse exception à notre pratique habituelle.
M. Alain Claeys, corapporteur. Si je considère que le principe de l’évaluation est indispensable sur une telle loi, force est de constater que le délai de cinq ans, retenu pour d’autres textes relatifs à la bioéthique, n’a jamais été respecté. De plus, je ne vois pas ce qui justifie que le texte soit remis en question dans son intégralité. En revanche, il me semble que l’évaluation que l’on pourrait demander à l’ONFV serait de nature à nous offrir une plus grande souplesse si des modifications législatives se révélaient nécessaires. Si, en matière de bioéthique, il n’est plus fait état du délai de cinq ans, c’est parce que l’Agence de biomédecine rend tous les ans un rapport extrêmement complet sur les avancées de la recherche et, d’une manière générale, sur l’ensemble des champs de la science sur lesquels portent ses compétences : le législateur peut, à tout moment, s’appuyer sur des éléments de ce rapport pour proposer des modifications du texte initial.
Mme Sandrine Hurel. À la lumière des explications de M. Alain Claeys, je retire l’amendement, que je retravaillerai pour le redéposer en vue de son examen en séance.
L’amendement AS71 est retiré.
La Commission adopte l’article 3 modifié.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS108 de M. Jean-Louis Touraine et AS117 de M. Philip Cordery.
M. Jean-Louis Touraine. L’amendement AS108 reprend, dans ses grandes lignes, la proposition n° 21 formulée par le Président de la République lors de la campagne présidentielle de 2012, qu’il précise en reprenant certains des termes de la proposition de loi défendue en novembre 2009 par Manuel Valls. Il s’agit de combler une lacune de notre dispositif légal, correspondant à des circonstances auxquelles la seule sédation terminale ne peut apporter une solution satisfaisante. Par ailleurs, cet amendement permettrait d’éviter certaines pratiques actuelles, consistant en des fins de vie organisées de façon illégale – donc dans des conditions nuisant à la sérénité – pour 2 000 à 4 000 personnes chaque année en France. De telles pratiques peuvent donner lieu soit à des fins de vie précipitées, soit à des refus de la part des équipes d’accompagner un malade implorant que l’on abrège ses souffrances – ce qui, dans les deux cas, plonge les patients concernés dans une situation de non-dit et de non-droit.
Notre proposition est tout à fait dans l’esprit de la proposition de loi d’Alain Claeys et Jean Leonetti, qui ont réaffirmé tout à l’heure que la volonté du patient primait celle de l’équipe médicale : nous proposons en effet que, dans certaines circonstances extrêmes, le patient puisse formuler la demande d’une aide médicalisée active mettant fin à sa vie dans la dignité, ladite demande étant soumise à un collège de trois praticiens avant qu’il y soit éventuellement fait droit. Cette proposition, destinée à s’appliquer de façon exceptionnelle, aura pour conséquence de mettre fin aux situations dans lesquelles l’équipe médicale peut être amenée à proposer au patient de lui administrer une sédation. En résumé, notre proposition présente plusieurs avantages : celui de restaurer la liberté de choix du patient, celui de recourir à l’expertise d’un collège de trois médecins, et celui de mettre fin à des pratiques souterraines, qui peuvent être excessives ou insuffisantes.
M. Philip Cordery. Dans le même esprit que l’amendement que vient de présenter M. Jean-Louis Touraine, l’amendement AS117 vise à élargir la palette de choix du patient en y faisant figurer l’assistance médicalisée active pour mourir dans la dignité, qui pourra être mise en œuvre soit par le patient lui-même, soit par un médecin. Nous considérons en effet que la sédation profonde n’a pas vocation à régler tous les cas, et que le choix du patient doit être complet : de quel droit refuserions-nous au patient atteint d’une maladie incurable de disposer du choix de pouvoir mettre fin à ses jours dans des conditions bien encadrées ?
L’une de nos préoccupations est d’éviter à ceux qui souhaitent recourir à l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté de devoir pour cela partir à l’étranger – une possibilité réservée à ceux qui disposent de moyens financiers suffisants, car les associations qui proposent de telles solutions, notamment en Suisse, réclament souvent des sommes d’argent importantes. Député des Français résidant au Benelux, je sais que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont, comme d’autres États, encadré cette pratique en posant l’exigence de la volonté du patient, de la possibilité de révocation ou du contrôle a posteriori – toutes conditions reprises dans l’amendement AS117 – et je tiens à préciser que les dispositions législatives en question sont régulièrement plébiscitées par les sondages. J’estime donc qu’il est temps que nous légiférions, nous aussi, pour encadrer la pratique de l’assistance médicalisée active pour mourir dans la dignité et offrir ainsi aux patients un choix libre et complet.
Mme Michèle Delaunay. Je rappelle, en tant que porte-parole du groupe SRC, que nous avions convenu de rester dans les limites du consensus. Or, si nous adoptions cet amendement, nous franchirions ces limites et nous détruirions de facto l’esprit du texte. Celui-ci comporte pourtant une avancée réelle, autour de laquelle une grande majorité de Français peuvent se rassembler. Je suggère donc que les auteurs de l’amendement déposent une proposition de loi distincte, comme l’a fait Mme Véronique Massonneau. Par ailleurs, dès lors que les actes évoqués par M. Jean-Louis Touraine ne font l’objet d’aucune déclaration, je me demande comment on peut les dénombrer.
M. Gérard Sebaoun. Nous sommes au cœur du débat, et nous devons aborder celui-ci avec sérénité. Michèle Delaunay a rappelé, dans le cadre de son mandat, et à titre personnel, que ce texte comportait des avancées, et nous ne le contestons pas. Mais puisque nous ne sommes pas seuls au monde, il nous faut bien examiner la manière dont d’autres pays démocratiques traitent cette question. Or, la Belgique a légalisé l’euthanasie sans réglementer le suicide médicalement assisté, tandis que les Pays-Bas et le Luxembourg ont légalisé et l’un et l’autre. Outre-Atlantique, trois États américains ont proposé de légaliser le suicide médicalement assisté. En 2011, 1 133 décès par euthanasie ont été déclarés en Belgique et 3 346 aux Pays-Bas, où l’on a dénombré également 196 décès par suicide assisté déclarés. Les patients concernés sont donc nombreux. C’est leur dignité et leur liberté de choix que nous voulons défendre. Nous pensons, quant à nous, qu’une personne dûment informée qui réitère, dans des conditions très encadrées, sa demande d’une aide médicale à mourir, quelle qu’en soit la forme, mérite d’être écoutée. Le débat existe au sein de la société. Depuis longtemps, de nombreuses personnes réfléchissent à cette question. Notre proposition va, certes, au-delà du texte que nous examinons, mais il est légitime que nous en débattions, d’autant plus qu’il est peu probable qu’une nouvelle proposition de loi soit déposée pour modifier celle-ci, si elle devait être adoptée.
M. Jean-Pierre Barbier. On peut s’interroger sur les termes utilisés par les auteurs de l’amendement. On parle de « phase avancée ou terminale d’une maladie incurable », mais combien de temps est-elle censée durer ? Par ailleurs, la personne qui apprend qu’elle est atteinte d’une maladie incurable et qu’elle n’a plus que quelques mois à vivre ne ressentira-t-elle pas « une souffrance psychique insupportable » ? Bien sûr que si. Dispose-t-elle alors de son libre arbitre et est-elle capable de prendre une décision « éclairée et réfléchie » ? Je ne le crois pas. Le devoir des soignants et des familles est d’accompagner ces patients pendant les quelques mois qu’il leur reste à vivre. Si ces derniers demandent que l’on abrège leur vie, c’est que la société et leur entourage ont échoué à les aider à passer ce moment si difficile. Dès lors que le suicide est assisté, le patient perd son libre arbitre, car il entre dans une logique qui le conduit forcément à quitter la société. C’est pourquoi je ne peux absolument pas soutenir cet amendement.
Mme Véronique Massonneau. Il est vrai que cet amendement correspond davantage à l’objet de la proposition de loi que nous avons examinée il y a trois semaines qu’à celui du texte que nous étudions aujourd’hui. Mais au moins abordons-nous le débat de fond, ce à quoi beaucoup d’entre vous s’étaient refusés il y a trois semaines, au motif que nous allions être saisis de la proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti. Certes, celle-ci comporte des avancées, mais elles ne sont pas suffisantes car, en refusant d’inclure l’euthanasie et le suicide médicalement assisté dans la loi, on conforte, et je le déplore, les inégalités actuelles : ceux qui connaissent les réseaux pourront se rendre en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg et ceux qui en ont les moyens pourront aller en Suisse ; les autres n’auront pas cette solution.
M. Alain Fauré. Nous abordons un débat crucial. Un socle a été défini sur la base duquel nous nous sommes engagés à travailler afin d’apaiser les tensions qui existent sur ce sujet. Faut-il offrir au patient en fin de vie la possibilité de choisir son départ ? Nous n’en sommes pas là. Le texte comporte de nombreuses avancées. Je suis de ceux qui jugent qu’elles ne sont pas suffisantes, mais, dès lors que nous avons accepté ce socle, nous ne pouvons pas adopter ces amendements.
M. Alain Claeys, corapporteur. Ces amendements sont plus que des amendements : il s’agit d’un choix extrêmement important. Je salue l’intervention de Philip Cordery, dont je connais les convictions ; je sais que, député des Français établis en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, il a pu examiner la situation qui prévaut dans ces pays. Cette question divise la société et, je dois le dire, ma famille politique.
Je souhaiterais corriger deux petites erreurs commises par Jean-Louis Touraine. Tout d’abord, on ne peut pas parler pour le Président de la République. Outre le texte qu’il a écrit sur le sujet pendant la campagne pour l’élection présidentielle, il a demandé au Premier ministre de confier une mission aux auteurs de cette proposition de loi. Or, ni l’euthanasie ni le suicide assisté ne figurent dans la lettre de mission que nous avons reçue. Bien entendu, on peut ne pas être d’accord : après tout, c’est au législateur de légiférer. Ensuite, on ne peut pas dire que la décision revient au médecin dans le cadre d’une sédation profonde et continue et au patient dans le cadre d’une euthanasie. L’amendement vise à étendre le choix du patient, je le reconnais, mais l’article 3 de la proposition de loi crée bien un droit nouveau pour celui-ci. Il faut que les choses soient claires sur ce point.
Véronique Massonneau a évoqué les inégalités ; c’est en effet une question centrale. S’il n’existait pas actuellement une inégalité devant la mort, nos concitoyens ne se prononceraient pas à 90 % pour la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté. C’est parce que la société n’est pas capable de leur offrir, à eux et à leurs proches, une fin de vie apaisée et digne qu’ils choisissent la solution la plus radicale. Je pense qu’il existe, dans la société, une fracture importante sur ce sujet. Devons-nous, en tant que parlementaires, assumer cette fracture ? Je ne le crois pas ; cela créerait des tensions extrêmement fortes. Il est vrai que cette proposition de loi ne réglera pas tous les problèmes – je pense en particulier aux maladies neurodégénératives –, mais elle apportera une solution dans plusieurs dizaines de cas. Et si un effort est fait en matière de formation et de soins palliatifs, les inégalités pourront être réduites.
Je crois que la véritable demande des malades est de pouvoir terminer leur vie de façon apaisée et digne, en étant accompagnés par leur famille. La femme de Vincent Humbert, que j’ai reçue longuement, m’a expliqué qu’elle souhaitait que cela puisse s’arrêter pour son mari, mais de façon apaisée. Par ailleurs, il est vrai également que la sédation profonde et continue soulève des problèmes importants, notamment celui de la « clause de conscience ».
Même si nous devions être battus sur ce point, soyez convaincus que je n’ai pas passé un accord politique avec Jean Leonetti. Nous nous sommes opposés, par le passé, lors de l’examen des lois bioéthique, et nous ne savions pas si, sur le sujet qui nous occupe ce soir, une convergence serait possible ; elle l’a été. Nous avons en effet tenté de trouver une voie, en tenant compte de la situation qu’on nous a décrite ainsi que du souhait de l’exécutif et, peut-être, des forces politiques républicaines d’aboutir à un texte qui rassemble.
Mme Michèle Delaunay. Je pourrais faire miens les propos d’Alain Claeys. Quant à moi, j’accepte difficilement que l’on nous invite à voter un amendement en arguant de la législation en vigueur dans d’autres pays. Nous légiférons pour les Français, en tenant compte du stade d’évolution de la société et en prenant garde de ne pas les jeter les uns contre les autres. Prenons l’exemple de la gestation pour autrui (GPA) ou celui du prix des cigarettes : ne devons-nous légiférer qu’en fonction de la situation qui prévaut dans d’autres pays, qui plus est minoritaires ? J’ajoute que la législation belge suscite des réserves, dans la mesure où les patients qui en « bénéficient » sont très âgés et probablement en déclin cognitif avancé.
Enfin, je précise, à l’attention de Gérard Sebaoun, qu’il ne m’a été confié aucun mandat. Si j’ai souhaité être porte-parole du groupe SRC sur ce texte, c’est parce qu’il traduit une convergence et comporte des avancées qui ne sont niées par personne.
M. Jean-Louis Touraine. Alain Claeys a évoqué la « véritable demande des malades ». Or, non seulement cette demande ne peut être univoque, dès lors que 4 000 à 5 000 patients sont concernés, mais il est inexact de dire qu’elle concernerait exclusivement l’amélioration de l’accès aux soins palliatifs. Du reste, les pays qui sont très en avance sur nous dans ce domaine sont également les premiers à avoir légiféré sur l’aide active à mourir. L’amélioration de l’accès aux soins palliatifs, que nous souhaitons tous, ne fera donc que renforcer la volonté de voir reconnaître à ceux qui le souhaitent le droit de recourir à une aide active à mourir.
Par ailleurs, Alain Claeys a raison d’indiquer que plusieurs situations ne sont pas prises en compte par le texte. À la dégénérescence cérébrale, qu’il a évoquée, on peut ajouter la réanimation néonatale et les agonies prolongées qui, chez des sujets relativement jeunes, peuvent être très longues et douloureuses. C’est précisément pour offrir une solution à ces patients – solution qu’ils peuvent bien entendu refuser – que nous proposons d’étendre la palette des choix qui leur sont offerts.
En tout état de cause, ce qui doit primer dans notre réflexion, c’est la lutte contre les inégalités. Les Français qui sont bien informés peuvent, soit se rendre à l’étranger, soit s’adresser à l’une des équipes médicales françaises, car il y en a, qui apportent ce soulagement dans une grande discrétion ; les autres n’ont pas cette possibilité. Cette injustice – qui existait également lorsque l’avortement était interdit en France – perdurera et risque même d’être aggravée si nous n’offrons pas un véritable choix aux personnes concernées.
Enfin, il ne s’agissait pas, pour moi, de faire parler le Président de la République, mais d’expliquer le choix des termes utilisés dans l’amendement. Les mots que nous avons choisis sont en effet ceux qui avaient été retenus, en 2012, par des personnes qui avaient réfléchi à la question.
M. Gérard Sebaoun. Lors du débat sur la fin de vie qui s’est tenu en séance publique en présence du Premier ministre, j’ai apprécié l’intervention de Bernard Roman, qui avait indiqué qu’il s’agissait de créer un nouveau droit – c’est pourquoi j’ai cité à de nombreuses reprises l’exemple canadien. Nous proposons en effet simplement d’ajouter un nouveau droit à la palette de choix actuelle, sans contester la principale disposition du texte.
Par ailleurs, j’ai été élu député sur la base du programme politique du Président de la République. Je souhaiterais donc rappeler sa proposition n° 21 : « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. » Cette phrase peut, hélas !, faire l’objet d’interprétations différentes. Selon moi, il s’agissait d’aller bien au-delà de la loi de 2005 et de ce qui nous est proposé aujourd’hui. Certes, le Président de la République est le seul à pouvoir nous dire ce qu’il en est exactement, mais nous sommes très nombreux à faire la même interprétation de sa proposition.
Enfin, lors de son audition, le professeur François Damas, du centre hospitalier universitaire de Liège, nous a dit que le patient ne choisissait pas entre la vie et la mort, mais qu’il choisissait sa fin de vie. Et il ajoutait que le médecin a un rôle pour que la mort soit humaine, mais que c’est le patient qui décide. Dans votre proposition de loi, il manque cet élément : la décision du patient. Or, il me semble qu’elle était au cœur de la proposition de François Hollande.
M. Philip Cordery. Jamais, monsieur Claeys, nous n’avons opposé la sédation profonde et l’assistance médicalisée à mourir – nous avons d’ailleurs voté l’article 3. Nous souhaitons simplement que ces deux choix soient offerts aux patients, et rien ne nous empêche de franchir ce pas supplémentaire. Par ailleurs, madame Delaunay, il n’est pas inutile de regarder ce qui se fait à l’étranger et de se nourrir de l’expérience des autres. En outre, dès lors que la liberté de circulation est reconnue au sein de l’Union européenne, des inégalités se créent, puisque la législation diffère d’un pays à l’autre. C’est un fait qu’il faut prendre en compte lorsque nous légiférons.
M. Jean-Patrick Gille. Je me félicite de la sérénité du débat malgré nos convictions aussi respectables que différentes. Nous serons tous d’accord pour souligner le sérieux du travail des corapporteurs et pour noter les avancées proposées en matière de sédation profonde et continue jusqu’au décès et de directives anticipées contraignantes. Et même si nous sortons ici quelque peu du cadre de la lettre de mission, nous abordons un sujet dont on ne peut pas dire qu’il ne fait pas partie, globalement, de la question traitée.
Je suis favorable à l’instauration d’une aide active à mourir par la personne elle-même ou par le médecin de son choix. Je suis cosignataire de ces deux amendements, mais je ne suis pas sûr que nous puissions, à une trentaine de présents, trancher la question – qui n’est pas une question de spécialistes. C’est pourquoi, même si nous devions être majoritaires ce soir, il me paraîtrait plus sage d’en débattre en séance avec l’ensemble de nos collègues.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Merci, une fois de plus, pour ce débat apaisé. J’ai lu ce qu’avait dit le candidat Hollande, mais également ce qu’il avait déclaré avant. Le candidat Hollande, dans un entretien, s’est prononcé contre l’euthanasie. Il ne me revient pas, de toute façon, d’interpréter la position du Président de la République en la matière. Reste que la sédation est une aide médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité lorsqu’on est en phase terminale et qu’on subit des souffrances insupportables. Sur ce point, la lettre de mission est claire : elle n’évoque ni le suicide médicalement assisté ni l’euthanasie. Et si cette terminologie avait été utilisée – ou du moins cette orientation proposée –, nous ne serions pas là ce soir Alain Claeys et moi.
Les amendements dont nous discutons ne consistent pas à modifier le texte ou à le préciser : ils invitent clairement au franchissement d’une ligne. Or je ne pourrais pas être le rapporteur d’un texte qui nous conduirait de nouveau à l’un de ces clivages – fussent-ils parfois artificiels – entre droite et gauche, comme nous avons pu déjà en vivre sur les sujets de société. Ce n’est l’intérêt ni du Parlement ni de nos concitoyens.
Enfin, je ne voudrais pas qu’on continue à penser que seuls trois pays, qui comptent moins de 30 millions d’habitants ensemble, seraient merveilleux, que tout y serait parfait, quand d’autres pays – comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la France – seraient en retard. Relisez donc le rapport Sicard, commandé par le Président de la République lui-même. Ce texte relève certaines dérives dans les pays montrés en exemple – je pense aux euthanasies clandestines là où l’on a légalisé l’euthanasie.
Chacun, ici, fait des efforts. Nous aurions très bien pu considérer que la loi de 2005 était parfaite, qu’il n’y avait rien à y changer, et qu’il suffisait de développer les soins palliatifs qui n’ont pas évolué depuis 2012. Or nous pensons que nous devons non seulement avancer sur la formation des médecins en matière de soins palliatifs mais encore passer le signal que la parole des malades est mieux entendue. C’est l’objet du présent consensus qui n’a rien de mou, mais au contraire révèle l’audace de chacun d’entre nous.
Je n’ai pas à prouver ma loyauté vis-à-vis de qui que ce soit, mais je me suis engagé sur ce que m’ont demandé le Président de la République et le Premier ministre. Je resterai donc loyal jusqu’au bout et veillerai à rester dans l’épure préalablement définie. J’ai bien compris que, malgré, encore une fois, des convictions divergentes, certains d’entre vous nous permettraient d’aborder le débat en séance publique sur un texte proche du texte initial et je les en remercie. Le Président de la République n’a pas la même couleur politique que la mienne, mais il est le chef de l’État et c’est vis-à-vis de lui qu’Alain Claeys et moi-même nous sommes engagés et nous entendons bien, j’y insiste, ne pas dépasser les limites fixées.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous sommes tous loyaux au sein de cette Commission. Certains le sont vis-à-vis d’une proposition faite au cours de la campagne présidentielle et les deux corapporteurs le sont vis-à-vis de la lettre de mission du Premier ministre.
Reste que le pouvoir législatif, c’est le pouvoir législatif, et que le pouvoir exécutif, c’est le pouvoir exécutif. C’est ce qu’on nomme la séparation des pouvoirs. Or la procédure législative suivie jusqu’à présent a été plus que particulière. Vous vous êtes conformés à la lettre de mission qui vous a été confiée, messieurs les corapporteurs, soit ; mais, et c’est la première fois au cours de l’examen d’une proposition de loi, vous n’avez pas convié les autres députés de la Commission aux auditions que vous avez organisées.
M. Alain Claeys, corapporteur. Si, ils l’ont été !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Mme Véronique Massonneau m’a rappelé que nous n’avons jamais été convoqués, et ce n’était pas à la Commission d’envoyer des invitations puisque les auditions ont été réalisées dans le cadre de la mission. Il est par conséquent normal que des amendements tels que ceux que nous sommes en train d’examiner aient été déposés puisque leurs cosignataires s’estiment, ce faisant, fidèles aux propositions d’avant 2012. On ne peut donc pas avancer que certains seraient loyaux et les autres non.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Ce n’est pas ce que j’ai dit, madame la présidente. Il n’y a pas d’un côté ceux qui disent la vérité et de l’autre ceux qui ne la disent pas.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je ne suis pas en train d’affirmer cela, monsieur Jean Leonetti, je m’efforce seulement d’expliquer pourquoi ces amendements ont été déposés. Quant à l’absence des députés aux auditions, elle était normale puisque le format choisi le voulait ; tout aussi normale, d’ailleurs, que la présentation de ces amendements, certains députés souhaitant faire valoir un autre choix.
Au reste, j’ai bien compris que la lettre de mission nous était imposée par l’exécutif.
M. Alain Claeys, corapporteur. Nous parvenons à un stade important du débat et devons éviter de nous faire des procès d’intention. Plusieurs méthodes étaient envisageables : une commission spéciale aurait pu être constituée, par exemple. Il se trouve que le Premier ministre nous a mandatés, M. Jean Leonetti et moi-même, et c’est dans ce cadre que nous avons travaillé.
Si l’on m’a bien écouté, j’ai estimé que nous étions en train d’examiner plus que de simples amendements – Jean Leonetti s’est exprimé dans le même sens. L’important débat que nous venons d’avoir devait bien se tenir ici. Je ne vois pas ce qui pourrait provoquer des crispations.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Il n’y en aura pas, monsieur le corapporteur : nous allons passer au vote.
M. Jean-Louis Touraine. J’ai une proposition à faire. Nos deux amendements ne formulant pas exactement dans les mêmes termes une proposition comparable, et compte tenu de la teneur de nos débats, il nous apparaît opportun, à M. Philip Cordery et moi-même, de retravailler notre idée afin, dans un souci de cohérence, de présenter un seul amendement en séance.
M. Philip Cordery. Nous allons en effet retirer nos amendements afin de retravailler notre proposition. Et je précise, à la suite des propos de M. Jean Leonetti, que c’est bien dans le cadre de cette proposition de loi que nous pouvons traiter de l’aide médicalisée à mourir et donc de l’euthanasie et du suicide assisté.
Les amendements AS108 et AS117 sont retirés.
La commission en vient à l’amendement AS53 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. L’amendement porte sur ce que la conférence des citoyens sur la fin de vie a appelé, reprenant les termes de 2001 du Comité consultatif national d’éthique, l’« exception d’euthanasie », c’est-à-dire une procédure très encadrée concernant le cas exprès où le patient, en conscience ou dans le cadre de directives anticipées, a demandé la sédation prolongée, continue, jusqu’au décès. Cette phase, l’agonie, que nous avons évoquée tout à l’heure assez longuement, on ne peut en déterminer la fin puisqu’elle est susceptible de durer de quelques heures à quelques jours.
Il s’agit, d’une manière ou d’une autre – et je reconnais qu’il est difficile d’écrire un amendement sur le sujet –, de permettre au patient d’exprimer son souhait de voir l’équipe médicale lui appliquer l’exception d’euthanasie aux conditions suivantes : que la sédation profonde et continue associée à l’analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie n’a pas provoqué son décès dans un délai raisonnable – formulation qui figure déjà dans la loi – ; et que l’équipe médicale en décide après avoir fait ce constat – et c’est la seule à pouvoir le faire, même si c’est contrevenir quelque peu à la volonté du patient mais un patient, je le rappelle, dûment informé. Tous les éléments ayant contribué à prendre cette décision sont en outre inscrits dans son dossier médical.
L’exception d’euthanasie – ainsi très encadrée – doit pouvoir être envisagée dans des cas d’agonie prolongée eu égard à la famille qui attend avec angoisse. En ces moments compliqués, difficiles, les demandes des familles sont variées et contradictoires. Aussi cette exception pourrait-elle être proposée pour interrompre une agonie trop longue, inacceptable à vivre, notamment pour l’entourage.
M. Dominique Tian. Cet amendement de repli ressemble furieusement aux amendements précédents.
M. Gérard Sebaoun. Absolument pas !
M. Dominique Tian. La rédaction du présent amendement est tout à fait effrayante et nous avons bien raison de nous méfier.
M. Gérard Sebaoun. « Effrayante » ?
M. Dominique Tian. Oui, effrayante : vous prévoyez d’euthanasier un individu si la sédation profonde n’a pas provoqué le décès « dans un délai raisonnable » ! J’y insiste : c’est effrayant et contraire à toutes mes convictions.
De plus, par là, vous relancez le débat, ce qui est malsain car la proposition de loi doit être consensuelle. Vous voulez rompre cette orientation souhaitée par le Président de la République et faire de ce texte un marqueur. Vous avez beau afficher votre volonté de différer le débat dans l’hémicycle afin que nous parvenions à un consensus, vous défendez ici un amendement de pseudo-repli à travers lequel vous affirmez clairement que vous êtes favorable à l’euthanasie. Eh bien, nous nous sommes contre.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le consensus signifie approbation du plus grand nombre et non pas unanimité, monsieur Tian.
M. Jean-Pierre Barbier. Je redoute le débat en séance publique, dont nous savons très bien qu’il sera bien moins apaisé qu’ici. Nous amènerons à nouveau la société vers une ligne de fracture, ce dont nous n’avons nul besoin, et vous en porterez la responsabilité.
L’objet du texte est d’améliorer le confort du patient et de lui permettre de terminer sa vie dans la dignité. Et, de nouveau, vous évoquez la souffrance des familles. Cette souffrance, que nous comprenons et connaissons bien, n’y a-t-il pas d’autres moyens de l’accompagner qu’en abrégeant la vie du patient ? Quelqu’un souffre, la famille souffre, et on fait disparaître le malade. Ne recherchez-vous pas sans cesse la facilité ?
M. Gérard Sebaoun. Nous parlons d’agonie et vous nous accusez de facilité ? Un peu de décence !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Les mots de M. Jean-Pierre Barbier ont dû dépasser sa pensée : on ne peut pas dire qu’on fait ainsi « disparaître » les gens.
M. Jean-Pierre Barbier. Je sais très bien ce que je dis. J’ai le sentiment que certains, ici, ont la conviction de détenir la vérité, et que nous les écoutons très poliment et avec beaucoup de respect, alors que leurs propos peuvent nous choquer.
M. Gérard Sebaoun. Eh bien, répondez-y !
M. Jean-Pierre Barbier. Il existe une autre manière d’accompagner les malades et les familles que celle que vous proposez et que je puis considérer à mon tour comme indécente.
M. Gérard Bapt. Le mot « euthanasie » ne s’entend pas de la même manière pour tous nos collègues ici présents. Le problème posé par M. Gérard Sebaoun n’en est pas moins réel. La différence entre lui et moi est qu’à mes yeux on pourrait parler d’euthanasie lorsque la sédation profonde et continue pourrait aboutir plus ou moins rapidement à la fin de l’agonie. À titre personnel, j’eusse donc préféré que les corapporteurs examinent avec plus d’attention l’amendement AS135 de Mme Hurel, que j’avais cosigné, et qui évoquait également ce « délai raisonnable » au bout duquel on peut penser que doit se terminer une agonie. Ce délai, selon nous, dépend de deux critères : la dignité du corps agonisant et la souffrance de la famille.
Chaque patient réagit différemment aux doses de benzodiazépine qu’on lui administre – et dont l’insuffisance respiratoire est l’un des possibles effets secondaires. Quelle différence y a-t-il entre une sédation terminale qui aboutit en quarante-huit heures et une sédation terminale qui aboutit en quatre ou cinq jours quand le patient a une bonne fonction cardio-respiratoire et une bonne fonction rénale ? Il ne s’agit pas ici d’euthanasie mais de la prise en compte de ce que certains d’entre nous avons pu vivre.
M. Dominique Tian. Il n’y a pas que vous !
M. Gérard Bapt. La dignité du patient agonisant n’est pas une idée que nous devons nous jeter à la figure, mais un concept des plus difficiles à définir.
M. Gérard Sebaoun. J’admets bien volontiers que MM. Jean-Pierre Barbier et Dominique Tian ne pensent pas comme moi, mais je n’accepte pas qu’on juge indécent ce que j’ai écrit après mûre réflexion. Cela signifie que vous n’avez pas lu l’exposé sommaire de l’amendement, que j’ai rédigé en m’appuyant sur des textes et non pas en fonction d’une soudaine lubie. Je considère que si, il y a près de quinze ans, le Comité consultatif national d’éthique a proposé, à un moment très particulier, une « exception d’euthanasie », ce n’est pas n’importe quoi, et je rappelle que le comité était alors présidé par Didier Sicard. Or Didier Sicard est toujours Didier Sicard : s’il n’a pas inscrit dans son rapport une proposition favorable au suicide médicalement assisté, c’est parce qu’il n’y avait pas consensus.
M. Alain Claeys et M. Jean Leonetti, corapporteurs. Non, ce n’est pas pour cette raison.
M. Gérard Sebaoun. Il a eu l’honnêteté de le reconnaître dans le rapport, ne vous en déplaise, monsieur Leonetti.
Je propose une mesure exceptionnelle, et certainement pas l’euthanasie pour tout le monde et tout de suite en place publique. Il faut, je le répète, avoir l’honnêteté de lire mon texte tel qu’il est rédigé. Cet amendement mérite d’être débattu. Je ne prétends pas détenir la vérité ; j’affirme seulement qu’il est des cas où, l’agonie se prolongeant, la question doit se poser. Et je reconnais la difficulté de définir un « délai raisonnable », la difficulté pour l’équipe médicale pratiquer l’euthanasie d’exception.
M. Bernard Perrut. Nous sommes au cœur d’un débat difficile – culturel, philosophique, religieux – qui commande le respect mutuel. N’oublions pas que l’objet de nos réflexions, c’est le malade en fin de vie. Si nous ne sommes pas d’accord entre nous, c’est notamment parce que vous allez beaucoup plus loin que le texte, marqué par l’équilibre, et qui prolonge la loi dite Leonetti sous l’impulsion, vous l’avez rappelé, du Président de la République et du Premier ministre, en reconnaissant au malade de véritables droits : une avancée significative d’un point de vue juridique. Partant de là, nous aurions pu nous réunir plutôt que nous diviser et par là diviser les Français, ce qui n’est pas souhaitable sur un tel sujet.
Il y a de quoi se montrer inquiet quand on observe ce qui se passe dans certains pays : je pense aux dérives de l’euthanasie en Belgique. En février 2014, ce pays est en effet devenu le seul au monde à autoriser l’euthanasie active sans limite d’âge, les mineurs étant donc concernés. Tous les rapports donnent un aperçu sérieux de dérives jugées inacceptables douze ans après l’entrée en vigueur de la loi sur l’euthanasie. L’euthanasie est en effet parfois pratiquée hors du cadre légal. Cette situation crée d’autres problèmes comme le développement du don d’organe chez les personnes engagées dans un processus d’euthanasie. Si l’intention est en soi louable, on peut imaginer les pressions et dérives qui peuvent résulter d’un tel cas de figure.
On peut dès lors s’interroger sur une telle évolution, voire s’y opposer. Notre vision des choses diffère. Nous devons faire en sorte que les soins palliatifs deviennent une véritable priorité en France et je ne comprends pas pourquoi, depuis tant d’années, nous ne les avons pas développés, pourquoi on ne traite pas mieux la douleur, pourquoi on n’accompagne pas mieux les malades. Cependant, vous débattez d’une autre question, celle du suicide médicalement assisté, de l’euthanasie – même si vous ne prononcez pas le mot.
M. Gérard Sebaoun. Vous ne m’avez décidément pas lu !
M. Bernard Perrut. Si, et derrière les mots que vous employez, c’est bien l’évolution que vous souhaitez. C’est pourquoi nous ne pouvons vous rejoindre sur ce terrain et pourquoi nous campons ferme sur le contenu d’un texte susceptible de réunir les Français.
Mme Michèle Delaunay. Il convient de revenir sur un point assez grave évoqué par Gérard Sebaoun : d’une part notre volonté de placer le seul malade – et non sa famille – en tête de nos préoccupations et, d’autre part, le caractère très douloureux voire insupportable d’une agonie prolongée. Cette dissociation est importante et l’impatience de la famille – le mot est cruel – doit toujours être adoucie autant que possible par des paroles et son avis ne pas être suivi à cause d’un éventuel changement d’opinion et de la très grande culpabilité qui pourrait en résulter.
La question de l’euthanasie est évoquée par 3 % des malades entrant dans une unité de soins palliatifs. Quand le malade est accompagné, qu’on est présent autour de lui, ce chiffre tombe à 0,3 %. Un bon accompagnement réduit la demande euthanasique et c’était dans cette optique que je souhaitais que nous assurions l’accompagnement pour tous et en particulier pour les personnes âgées.
Enfin, je vous l’assure, en quarante-cinq ans de vie hospitalière et médicale, aucun malade ne m’a jamais demandé d’euthanasie. À l’inverse, il n’y a guère de mois où une famille ne me l’a pas demandé. Je tiens à souligner cette dissociation.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement AS53.
Elle en vient à l’amendement AS111 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Stéphane Claireaux. Si les radicaux sont associés à la rédaction de l’amendement unique que nos collègues Jean-Louis Touraine et Philip Cordery envisagent de rédiger dans la perspective de l’examen du texte en séance publique, je retirerai celui-ci dont l’esprit est le même.
Mme la présidente Catherine Lemorton. MM. Touraine et Cordery semblent approuver l’idée d’associer M. Stéphane Claireaux à la rédaction de l’amendement unique.
L’amendement est retiré.
Article 4
(art. L. 1110-5-3 du code de la santé publique)
Droit aux traitements antalgiques et sédatifs en cas de souffrance réfractaire
Cet article tend à renforcer le droit du malade à recevoir des soins destinés à soulager sa souffrance, y compris, dans certains cas, au risque d’abréger sa vie.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
L’article L. 1110-5 en vigueur prévoit, dans son quatrième alinéa, que « toute personne a droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur » qui doit, « en toute circonstance », être prévenue et, dans son cinquième alinéa, que si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance « d’une personne en phase avancée ou terminale » qu’en lui appliquant un traitement pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit l’en informer ainsi que la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches.
Le médecin est donc autorisé à appliquer un traitement, même s’il peut avoir pour effet secondaire de risquer d’abréger la vie du patient, à condition qu’il constate qu’il ne peut pas le soulager autrement. L’objectif recherché est ainsi exclusivement de soulager le malade et non de provoquer sa mort volontairement. Les traitements à visées sédatives parfois nécessaires pour soulager une détresse importante en fin de vie doivent donc être dosés uniquement pour obtenir cet effet nécessaire de soulagement. Il convient de remarquer que ce recours aux traitements à visée antalgique et sédative aux doses suffisantes s’entendant « en toute circonstance » s’applique y compris si l’état cérébral du patient ne lui permet plus de l’évaluer directement.
Il s’agit de l’application du « principe du double effet » aux actes destinés à soulager la souffrance mais pouvant avoir pour conséquence d’abréger la durée de la fin de vie, en privilégiant donc l’intention, c’est-à-dire la recherche de l’effet bénéfique, sur son corollaire négatif.
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L’article 4 propose d’insérer un nouvel article L. 1110-5-3 dans le code de la santé publique tendant à renforcer le droit du malade à recevoir des soins destinés à soulager sa souffrance, en particulier lorsqu’elle présente un caractère réfractaire.
1. Le droit de recevoir des traitements et des soins soulageant la souffrance
L’alinéa 2 (premier alinéa du nouvel article L. 1110-5-3) réaffirme le droit de toute personne de recevoir des « traitements » et des « soins », visant à soulager sa souffrance. La double précision de « traitements » et de « soins », comme dans l’article L. 1110-5 dans sa rédaction d’article principiel de la présente proposition de loi, permet de couvrir le continuum des soins curatifs et palliatifs. Mais le terme de souffrance, plus large, puisqu’il englobe la douleur non seulement physique mais aussi morale, est substitué à celui de douleur.
Il y est également rappelé que la souffrance doit être, « en toute circonstance prévenue » et, dans cet ordre, « prise en compte, évaluée et traitée ». La rédaction en vigueur à l’article L. 1110-5 place l’évaluation avant la prise en compte, alors que reconnaître le droit de ne pas souffrir, comme le propose le Rapport de présentation de la proposition de loi, issu des conclusions de la mission confiée par le Premier ministre à ses deux auteurs (45), suppose logiquement que la prise en compte de la douleur du malade précède son évaluation par le professionnel de santé.
1. La réponse à la souffrance réfractaire
L’alinéa 3 (2e alinéa du nouvel article L. 1110-5-3) renforce le droit du malade à ce qu’il soit répondu à une souffrance réfractaire. Il est donc proposé afin, là aussi, que le droit de ne pas souffrir soit clairement reconnu, une rédaction prévoyant que « le médecin met en place l’ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie ». Il est ainsi fait obligation au médecin de traiter une souffrance réfractaire, même si ce traitement peut avoir pour effet d’abréger la vie du patient. Il convient de préciser qu’on définit comme réfractaire « tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé en dépit des efforts obstinés pour trouver un protocole thérapeutique adapté sans compromettre la conscience du patient. » (46)
La fin de l’alinéa est la reprise du dispositif antérieur, qui prévoit que le médecin doit informer le patient, la personne de confiance, la famille ou à défaut l’un des proches du malade sur le risque que le traitement abrège la vie. Le rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France (47) remarquait à cet égard que : « quelle que soit la situation, le consentement de la personne à ce double effet doit être recherché de façon explicite. Sauf si le malade, par sa demande d’endormissement et de ne plus souffrir, résout de lui-même l’ambivalence », sous réserve, cependant, de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui dispose que « la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. »
Cet impératif de soulager les souffrances a conduit les auteurs et rapporteurs de la présente proposition de loi à examiner plus particulièrement le cas des personnes pour lesquelles le pronostic vital est engagé, et à leur ouvrir le droit à une sédation profonde et continue prévue à l’article 3 de la proposition de loi.
*
La Commission examine l’amendement AS130 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le présent amendement prévoit de compléter l’alinéa 2 par les mots : « par l’équipe médicale ». Trop souvent le texte évoque les relations entre le médecin et le patient ; or l’importance des équipes médicales s’accroît : infirmières, kinésithérapeutes, soignants. La notion d’équipe médicale apparaît du reste explicitement dans le code de déontologie médicale.
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la commission adopte l’amendement.
La Commission examine l’amendement AS22 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. L’amendement AS22 vise notamment à préciser que le médecin indique au malade le « risque létal » liés aux traitements analgésique et sédatif permettant de répondre à la souffrance réfractaire. La rédaction actuelle du texte ne me paraît pas suffisamment claire.
M. Jean Leonetti, corapporteur. C’est le malade lui-même qui demande à bénéficier d’une sédation terminale parce qu’il se sait en fin de vie et qu’il est en proie à des souffrances réfractaires. Le risque létal lié à la sédation n’est qu’une partie de la vérité : la vérité, qu’il connaît fort bien, c’est qu’il va mourir.
M. Gérard Sebaoun. Le texte de la proposition de loi reprend une expression figurant dans la loi de 2005, à savoir que le médecin met en place ces traitements « même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie ».
Y faire figurer explicitement le mot « létal » me semble indispensable puisque le « risque létal » lié à ces traitements est avéré et que, de plus, ce mot est compris de chacun. L’expression qui figure dans la rédaction actuelle manque de précision.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Votre amendement n’est pas innocent. Loin de se contenter d’apporter une simple précision, il pourrait modifier, sinon l’orientation du texte, du moins son interprétation.
Il faut savoir que le traitement sédatif n’accélère pas nécessairement la mort – les médecins spécialisés dans les soins palliatifs ne se prononcent pas. Le texte prévoit que la sédation doit être mise en place « même si » le risque existe : il n’a pas, en revanche, à se prononcer sur l’effet létal de la sédation puisque celui-ci, je le répète, n’est pas démontré. De plus, le malade qui demande cette sédation est dans la phase terminale de sa vie.
Votre amendement vise simplement à inscrire que le traitement sédatif relève en partie d’une action létale.
M. Jean-Louis Touraine. Alors que le patient doit être obligatoirement prévenu des effets adverses de tout traitement – complications cardiaques ou pulmonaires, par exemple –, il ne serait pas prévenu quand le traitement présente un risque létal : j’ai du mal à le croire.
M. Jean-Pierre Barbier. Chercher à inscrire dans la loi le « risque létal » que comporte la mise en place de la sédation, c’est laisser entendre que ce traitement s’apparente à une euthanasie active, contrairement à l’objet du texte, qui ne vise pas à accélérer la mort mais à faire bénéficier le patient de traitements antalgiques et sédatifs.
Si ces traitements devaient avoir pour effet de provoquer la mort, nous ne voterions pas le texte.
M. Alain Claeys, corapporteur. Je tiens à rappeler la rédaction actuelle du texte : « le médecin met en place l’ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, mêmes s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-11-1, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
En tant que corapporteur, je défends la rédaction actuelle de la proposition de loi.
M. Gérard Sebaoun. Cet amendement ne vise pas à déformer le texte, mais à exprimer en termes plus clairs le « risque létal » lié à ce type de traitement.
M. Alain Claeys, corapporteur. La rédaction actuelle du texte est très claire : vous ne pouvez pas prétendre le contraire.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision AS154 des rapporteurs.
L’amendement AS37 de Mme Véronique Massonneau tombe.
La Commission examine ensuite les amendements identiques AS5 de M. Dino Cinieri, AS63 de M. Rémi Delatte et AS101 de M. Dominique Tian.
M. Dino Cinieri. Nous sommes tous d’accord : il est inadmissible, en 2015, que des personnes en fin de vie souffrent alors que les médecins des services de soins palliatifs nous assurent qu’ils disposent de tous les moyens pour combattre la douleur.
Le problème, c’est que nos concitoyens qui n’ont pas accès aux soins palliatifs sont trop nombreux. Notre pays doit apporter une autre réponse que la mort aux patients qui refusent légitimement de souffrir.
La loi Leonetti permet déjà la sédation en phase terminale, qui est réévaluée en permanence dans les unités de soins palliatifs entre le patient, sa famille et l’équipe médicale.
Je souhaite insérer le mot « secondaire » après le mot « effet », car il est important de bien préciser l’intention du texte : soulager la douleur, oui ! Tuer, non !
M. Rémi Delatte. Il convient de clarifier la finalité de la lutte contre la douleur, l’objectif poursuivi étant bien de soulager la souffrance et non d’abréger la vie, même si les traitements utilisés peuvent accélérer le décès.
C’est pourquoi il me paraît nécessaire de recourir au principe du double effet, qui présente un enjeu important pour les soignants.
M. Alain Claeys, corapporteur. La rédaction actuelle du texte, que j’ai lue en réponse à l’amendement AS22 de M. Sebaoun, est équilibrée et satisfait vos amendements.
Elle est le fruit d’une convergence entre M. Leonetti et moi-même.
M. Jean Leonetti, corapporteur. La loi de 2005 affirme de manière insatisfaisante le principe du double effet, puisqu’elle le fait apparaître via l’obligation d’inscrire dans le dossier médical l’éventualité que les traitements sédatifs accélèrent la mort.
C’est la raison pour laquelle le présent texte précise plus clairement que cette accélération possible de la mort n’est pas l’intention première. Nous avons choisi la rédaction suivante : « même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » après avoir procédé à des consultations juridiques de haut niveau.
J’ajoute que le mot « secondaire » présente en français de grandes difficultés en raison de sa polysémie : il peut signifier, non seulement : « qui vient en second dans le temps », mais aussi : « accessoire », dernier sens particulièrement mal venu s’agissant de la mort.
Les mots « même si » traduisant, au plan juridique, la non-intentionnalité première, nous n’avons pas conservé le mot « secondaire ».
Les amendements AS63 et AS101 sont retirés.
La Commission rejette l’amendement AS5.
Puis elle examine l’amendement AS38 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. L’amendement AS38 vise à conditionner l’usage d’un traitement qui pourrait abréger la vie du patient à l’accord préalable de ce dernier.
Dans le cas où le patient est conscient, le médecin doit l’informer des risques liés à la mise en place d’un traitement qui peut abréger la vie et s’enquérir de son accord, avant de le mettre en place.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision AS148 des corapporteurs.
Elle examine ensuite l’amendement AS112 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Stéphane Claireaux. L’amendement AS112 vise à instaurer une clause de conscience pour les médecins et les professionnels de santé.
J’ai déjà entendu les arguments de M. Claeys : je maintiens toutefois l’amendement.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
Article 4 bis
(art. L. 1110-10-1 du code de la santé publique)
Présentation par les ARS d’un rapport annuel sur les soins palliatifs
Il est proposé par cet article de compléter les dispositions législatives du code de la santé publique en matière de soins palliatifs, définies à l’article L. 1110-10 par l’introduction d’un article L. 1110-10-1 qui permette l’évaluation concrète de l’évolution des ressources régionales en la matière.
Il serait ainsi présenté par l’agence régionale de santé (ARS), annuellement, à la conférence régionale de santé, un rapport sur le nombre de lits de soins palliatifs en institutions sanitaires et médico-sociales mais aussi sur la prise en charge de ces soins, qu’elle soit accompagnée par les réseaux de santé définis à l’article L. 6321-1 du code de la santé publique « constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu’avec des représentants des usagers » et destinés à « favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires » ou qu’elle soit assurée à domicile.
La présentation de ce rapport par l’agence régionale de santé devrait ainsi contribuer à renforcer la politique poursuivie par la région pour développer les soins palliatifs, et donc à résorber les très grandes disparités rencontrées dans ce domaine.
*
La Commission examine l’amendement AS64 de M. Rémi Delatte.
M. Rémi Delatte. La loi du 22 avril 2005 prévoit que soit présenté tous les deux ans un bilan de la politique de développement des soins palliatifs. Or cette disposition n’a jamais été appliquée. La Cour des comptes souhaiterait la mise en place d’un recueil de données régulier et plus exhaustif.
Compte tenu de l’importance de la place des agences régionales de santé dans le développement des soins palliatifs, ce recueil doit être élaboré en régions et présenté annuellement aux conférences régionales de santé et de l’autonomie.
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la Commission adopte l’amendement portant article additionnel après l’article 4.
Article 5
(art. L. 1111-4 du code de la santé publique)
Information des patients et droit au refus de traitement
Cet article vise à préciser et à renforcer le droit, pour un patient dûment informé par le professionnel de santé, de refuser tout traitement.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur précise les modalités du consentement du patient aux décisions concernant sa santé. Le droit de la personne d’interrompre ou de refuser tout traitement comme la procédure de refus de traitement applicable à la personne consciente ou inconsciente qui n’est pas en fin de vie est, dans sa rédaction actuelle, principalement issu de la loi du 22 avril 2005.
Ce droit s’articule autour de deux alinéas fondamentaux de l’article, le premier qui dispose que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé » et le troisième qui indique qu’ « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
La procédure à suivre est distincte selon que la personne est consciente ou inconsciente, et suivant que le refus ou l’arrêt du traitement met sa vie en danger.
L’article traite enfin du cas particulier du consentement des mineurs ou des majeurs sous tutelle et de l’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique.
Le texte en vigueur prévoit donc que le droit de refuser les soins ne peut s’apprécier que parallèlement à l’obligation faite au médecin d’informer le malade des conséquences de ses choix.
Le droit à l’information des malades connaît une affirmation progressive mais continue relevée dans les travaux de la Commission de réflexion sur la fin de vie (48). Ce droit et son corollaire qu’est le consentement du patient, sont des points fondamentaux de la déontologie médicale, codifiés dans les articles R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-41 du code de la santé publique.
La charte de la personne hospitalisée rappelle pour sa part que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et le secret médical n’est pas opposable au patient. (…) Le médecin doit, au cours d’un entretien individuel, donner à la personne une information accessible, intelligible et loyale. Cette information doit être renouvelée si nécessaire. Le médecin répond avec tact et de façon adaptée aux questions qui lui sont posées. L’information porte sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés ainsi que sur leurs alternatives éventuelles. Dans le cas de la délivrance d’une information difficile à recevoir pour le patient, le médecin peut, dans la mesure du possible, proposer un soutien psychologique. »
L’avis du CCNE (49) souligne que « la question de l’information donnée au malade et à ses proches, à la fois sur la pertinence des traitements curatifs et sur les stratégies d’accompagnement palliatives, devient cruciale. Or il n’est pas facile de trouver le juste milieu entre devoir d’information pour que le malade puisse exprimer son avis et devoir de tact et mesure, de ne pas asséner des vérités difficiles à entendre. C’est pourtant là le cœur même du processus de choix libre et informé, qui est l’un des fondements de la démarche éthique médicale moderne. »
Cet équilibre difficile repose sur ce que le même avis du CCNE considère comme une appropriation inégale de la loi du 22 avril 2005 par les acteurs de la santé, « sans doute en raison de la modification profonde des pratiques médicales et des rapports entre les médecins et la personne malade que requiert sa pleine et entière mise en œuvre ».
Un renforcement du droit du patient dûment informé à prendre les décisions concernant sa santé est nécessaire.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Les modifications que tend à apporter la présente proposition de loi à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique portent sur deux points : la définition des droits des patients et la procédure suivie pour les mettre en œuvre.
1. Le droit de refuser tout traitement
À l’alinéa 2, l’ajout d’un deuxième alinéa à l’article L. 1111-4 disposant que : « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif » tend à ériger en principe le droit du patient de refuser tout traitement, rendant ainsi sa volonté prioritaire dans le rapport qu’il entretient avec son médecin, tout en reconnaissant à ce patient le droit de continuer à bénéficier d’un suivi médical par l’accès aux soins palliatifs.
2. Le respect de la décision du patient
À l’alinéa 4, en contrepartie de la volonté exprimée par la personne consciente et informée, il est précisé que le médecin aurait l’obligation de respecter ce choix tout en lui en rappelant la gravité, reprenant ainsi une partie du dispositif en vigueur. Mais si elle met la vie du patient en danger et après que celui-ci aura réitéré sa décision dans (et non plus après) un délai raisonnable, le médecin n’est plus tenu, contrairement au dispositif actuel, « de tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ». De même, alors qu’il est aujourd’hui prévu que, pour ce faire, « le médecin peut faire appel à un autre membre du corps médical », il est ici proposé qu’ « il peut être fait appel », sans autre précision, c’est-à-dire par le médecin, mais aussi par le patient, donc, à un autre membre du corps médical, afin d’équilibrer la prise de décision. Comme dans la rédaction actuelle de l’article L. 1111-4, il est précisé que le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en lui dispensant des soins palliatifs.
À l’alinéa 6, le dispositif actuel s’appliquant à une personne hors d’état d’exprimer sa volonté en matière de limitation ou d’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger serait modifié sur deux points. L’un est une précision et vise à remplacer « mettre sa vie en danger » par « entraîner son décès ». L’autre poursuit le même but de renforcement de la prise en compte de la volonté exprimée par le patient et place le respect de ses directives anticipées au même plan que celui de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. La consultation de la personne de confiance, de la famille ou des proches n’interviendraient dès lors qu’à défaut de directives.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS149 des corapporteurs.
L’amendement AS132 de Mme Anne-Yvonne Le Dain est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS150 des corapporteurs.
Puis elle examine l’amendement AS133 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’amendement AS133 vise à inscrire dans le texte la notion de droit de retrait pour un professionnel de santé face à la demande d’un patient à exercer son droit à mourir dans la dignité, l’institution publique devant mettre en œuvre rapidement les conditions permettant à chacun de faire prévaloir son droit. C’est déjà le cas pour les médecins qui refusent de pratiquer l’avortement.
M. Alain Claeys, corapporteur. Avis défavorable.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je retire l’amendement. J’en présenterai une nouvelle rédaction en séance publique.
L’amendement AS133 est retiré.
La Commission adopte l’amendement de précision AS151 des rapporteurs.
L’amendement AS140 de Mme Catherine Troallic est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS6 de M. Dino Cinieri et AS65 de M. Rémi Delatte.
M. Dino Cinieri. Toute personne confrontée à une situation de santé difficile – diagnostic grave, lourde dépendance, angoisse face à la mort – ou à des tentations suicidaires doit être soutenue, réconfortée et entourée par les soignants, ses proches ou des bénévoles, pour vivre le plus paisiblement possible la fin de sa vie.
Il ne saurait toutefois être question de céder à un état dépressif transitoire. C’est pourquoi il convient d’instaurer, entre l’abandon et l’euthanasie, un droit fondamental à une prise en charge globale de toutes les personnes âgées ou malades, dans le respect de la dignité de chacun.
M. Rémi Delatte. L’amendement AS65 vise à s’assurer que la personne qui exprime le désir de mourir n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement.
M. Jean Leonetti, corapporteur. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique prévoit déjà que le consentement du patient doit être libre et éclairé – c’est une rédaction consensuelle dans le milieu médical.
Les amendements sont donc satisfaits.
Il faut savoir que le médecin se trouvera toujours face à une personne en état de vulnérabilité puisqu’elle est en fin de vie. Cette précision risquerait d’avoir l’effet inverse à celui qui est recherché, la vulnérabilité servant trop souvent de prétexte pour refuser son autonomie à la personne – cet élément nous est rapporté par les différentes études sur le sujet. Or le malade vulnérable veut au contraire que sa parole soit écoutée. La parole du patient vulnérable ne doit pas être a priori remise en cause.
Les amendements AS6 et A65 sont retirés.
L’amendement AS138 de Mme Catherine Troallic est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AS131 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’amendement AS131 vise, comme à l’article précédent, à insérer le mot « palliatifs » après le mot « soins » pour une meilleure compréhension du texte.
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la Commission adopte l’amendement.
L’amendement AS103 de M. Dominique Tian est retiré.
Puis la Commission adopte successivement les amendements AS152, rectifiant une erreur matérielle, et AS153 de conséquence, des corapporteurs.
Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.
Article 6
(art. L. 1111-10 du code de la santé publique)
Coordination avec l’article 5
Arrêt du traitement d’une personne en fin de vie
Les dispositions de l’article L. 1111-10 du code de la santé publique donnent droit à une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin l’informant des conséquences de son choix. Dès lors, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en lui dispensant des soins palliatifs.
Les modifications apportées par l’article 5 à l’article L. 1111-4 visent à permettre à toute personne, y compris donc les personnes en fin de vie, d’arrêter tout traitement et de se voir dispenser par le médecin des soins palliatifs. Elles satisfont la situation particulière de la fin de vie, aussi les rapporteurs proposent-ils l’abrogation de l’article L. 1111-10.
*
La Commission adopte l’article 6 sans modification.
Article 7
(Intitulé de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er
de la première partie du code de la santé publique)
Droit des patients à refuser un traitement
La section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique en vigueur a pour intitulé : expression de la volonté des malades en fin de vie.
L’article 7 a pour objet de consacrer expressément le droit des patients à refuser un traitement en proposant de modifier le titre de la section. Le titre proposé est « expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie ».
En effet, plusieurs articles de la proposition de loi reconnaissent le droit du patient à refuser un traitement.
L’article 5 prévoit que « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir un traitement ». Dans ce cas, le suivi du malade demeure assuré par le médecin « notamment son accompagnement palliatif ».
L’article 8 prévoit que les directives anticipées puissent exprimer dorénavant « la volonté de la personne… en ce qui concerne les conditions du refus… des traitements et actes médicaux ».
Il est donc clair que la proposition de loi entend consacrer le droit du patient à refuser un traitement, qu’il mette sa vie en danger par ce refus ou pas. Il s’agit donc bien d’une situation distincte de celle des patients en fin de vie du fait de l’affection dont ils souffrent.
Dès lors, l’intitulé de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique doit être modifié en conséquence.
*
La Commission adopte l’article 7 sans modification.
Article 8
(art. L. 1111-11 du code de la santé publique)
Renforcement de la volonté du patient
et opposabilité des directives anticipées
Cet article vise à renforcer la volonté du patient et surtout à rendre les directives anticipées opposables au médecin lorsqu’elles respectent des formes qui sont précisées.
1. Le dispositif actuel : une simple indication de la volonté du patient
L’article L. 1111-11 du code de la santé publique, introduit par l’article 7 de la loi du 22 avril 2005 (50), prévoit que « toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté » qui sont révocables à tout moment par leur rédacteur.
La loi renvoie à un décret le soin de définir les « conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées » qui doivent cependant avoir été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne aux termes de l’article L. 1111-11 précité.
Le décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées pris en application de ces dispositions a ainsi introduit dans le code de la santé publique, les articles les articles R. 1111-17 et suivants précisant les conditions de forme, de validité et de conservation des directives anticipées.
– conditions de forme : aux termes de l’article R. 1111-17 du code de la santé publique : le document doit être écrit, daté et signé par son auteur dûment identifié par ses nom, prénom, date et lieu de naissance ; lorsque l’auteur, conscient, est dans l’impossibilité d’écrire lui-même, il peut demander à deux témoins d’attester que le document est l’expression de sa volonté libre et éclairée ; le dernier alinéa de cet article précise que « le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives (…) une attestation constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations appropriées » ;
– conditions de validité : l’article R. 1111-18 définit les conditions de validité. Les directives anticipées ne sont rédigées que pour une période de trois ans, renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document. Elles sont également modifiables à tout moment dans le respect des conditions prévues à l’article R. 1111-17. En cas de modification, court une nouvelle période de trois ans. Enfin, leur validité ne connaît plus de limite dès lors que la personne qui les a rédigées tombe dans un état d’inconscience ;
– conditions de conservation : aux termes de l’article R. 1111-19, les directives doivent être « aisément accessibles pour le médecin ». Pour permettre un accès facile, l’article précité dispose qu’elles sont conservées « dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical ». Elles peuvent toutefois être conservées chez le patient, confiées à la personne de confiance mentionnée aux articles L. 1111-6 et L. 1111-12 du code de la santé publique, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence doit être mentionnée dans le dossier médical. Enfin, il est précisé que toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l’existence de directives anticipées.
Enfin l’article R. 1111-20 instaure une obligation pour le médecin de s’enquérir de l’existence éventuelle de directives anticipées – lorsqu’elles ne sont pas déjà dans le dossier médical – auprès de la personne de confiance, de la famille ou des proches ou auprès du médecin traitant ou du médecin qui lui a adressé la personne malade.
Toutefois si ces directives indiquent « les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt des traitements », elles sont rédigées uniquement à titre indicatif et ne sont en aucun cas opposables aux médecins. En effet, l’article L. 1111-11 dispose que le médecin « en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement… concernant [la personne] » sans préciser d’ailleurs de quelle manière il le fait.
L’article L. 1111-13 est plus précis. Il confie au seul médecin le soin de « décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de [la] personne ». Celui-ci a l’obligation de respecter la procédure collégiale et seulement de consulter « la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille, ou à défaut, un [des] proches et le cas échéant, les directives anticipées ».
En définitive, les directives anticipées ne constituent pas le premier élément, loin s’en faut, à prendre en compte par l’équipe médicale à tel point que le Conseil de l’Europe estime qu’elles ont un « statut juridiquement faible (51) ».
2. Les directives anticipées : un droit mal connu et dont l’efficacité est peu probante
L’enquête sur la fin de vie en France réalisée en 2012 par l’Institut national des études démographiques (INED) avec l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) a montré que « les directives n’ont été rédigées que par un nombre infime de personnes en fin de vie (52) ».
Le rapport de MM. Claeys et Leonetti relatif à la fin de vie, remis récemment au Gouvernement et dont est issue la présente proposition de loi, fait état d’une récente étude du centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin concernant seulement les personnes âgées de plus de 75 ans sur leur intention quant aux directives anticipées.
Selon cette étude, 83 % des personnes interrogées ne voulaient pas se saisir de la question des directives anticipées.
42 % des personnes refusant de rédiger des directives estimaient que « c’était trop tôt, trop compliqué ou déjà confié aux proches » et 22 % car « ils refusaient d’anticiper ou de parler de ce sujet ». Ces résultats témoignent de la difficulté ontologique pour une personne de penser sa propre fin à tel point qu’elle préfère ne pas s’en occuper ou déléguer les décisions concernant cette fin à une tierce personne non directement concernée. Ces résultats ne peuvent être améliorés que grâce à un travail de formation du personnel soignant et de pédagogie auprès des patients. Des contributions recueillies dans le cadre de la contribution citoyenne réclament que les citoyens soient incités à rédiger de telles directives par leur médecin ou par une campagne publique d’information.
En revanche, 36 % des personnes n’ayant pas rédigé de directives les perçoivent comme « inutiles voire dangereuses ». Il est dommage d’avoir mis dans un même item les termes. En effet, « inutiles » renvoie à un manque d’effet de ces directives tandis que le mot « dangereuses » peut laisser à penser que les personnes considèrent qu’elles peuvent prendre des dispositions qui peuvent s’avérer in fine nuisibles à leur propre intérêt. Il convient en conséquence de rendre les directives anticipées plus directement applicables mais permettre tout de même au corps médical de les remettre en cause si elles s’avèrent manifestement inappropriées.
Cette position est, par ailleurs, une position d’équilibre entre les différentes contributions des internautes. En effet, une majorité de ceux qui se sont exprimés sur les directives anticipées ont souhaité qu’elles puissent s’imposer « absolument » au médecin mais une petite minorité a demandé que le médecin ait la possibilité de décider contre elles.
En revanche, selon l’étude de l’INED précitée, lorsque ces directives existent et qu’ils ont pu les consulter, les médecins déclarent qu’elles sont un élément important pour 72 % des décisions médicales relatives à la fin de vie sans que la notion d’« élément important » soit clairement explicitée.
La prise en compte des directives anticipées même lorsqu’elles existent n’est pas toujours possible du fait d’une accessibilité difficile du fait de l’absence d’un fichier les regroupant.
Les dispositions proposées dans la proposition de loi ont pour objet de répondre aux insuffisances du dispositif français actuel des directives anticipées afin de rendre aux sujets leur autonomie jusqu’à la fin de leur vie.
3. Le dispositif proposé : rendre les directives anticipées opposables sous certaines conditions
L’article 8 modifie l’article L. 1111-11 du code de la santé publique relatif aux directives anticipées.
a. Le renforcement de la portée des directives anticipées
L’alinéa 2 renforce la portée des directives anticipées en substituant le terme de « volonté » à celui de « souhait ». En effet, ces directives n’indiquent plus seulement des souhaits, qui renvoient à une demande ou à un vœu et qui peuvent être satisfaits ou pas mais « expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie ». L’expression d’une volonté et non plus seulement d’un souhait rend ainsi son autonomie à la personne qui l’énonce et renforce la portée des directives qui ne peuvent plus être ignorées, au nom de l’expertise du médecin, sans porter atteinte à la liberté individuelle du malade.
Pour exprimer sa volonté, la personne doit être non seulement majeure comme le prévoyait l’article L. 1111-11 du code de la santé publique en vigueur mais aussi « capable », précision ajoutée par le présent article. Cette disposition exclut par conséquent les mineurs non émancipés ainsi que les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de tutelle.
Enfin, l’alinéa 2 étend le champ des directives anticipées. Il prévoit en effet qu’elles peuvent exprimer une volonté de refuser un traitement ou un acte médical. Cette disposition est liée à l’article 5 de la présente proposition de loi qui dispose que : « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement ». Dans ce cas, « le professionnel de santé a l’obligation de respecter la volonté de la personne ». Toutefois, si l’arrêt du traitement est susceptible de mettre en danger la vie du patient et si ledit patient est incapable de « réitérer sa décision dans un délai raisonnable », la consultation des directives anticipées est placée en tête des éléments à consulter par le médecin, avant d’arrêter une décision, sur le même plan que le respect de la procédure collégiale, et prévaut sur la consultation de la personne de confiance ou de la famille.
b. La forme des directives anticipées
L’article L. 1111-11 en vigueur précise que les directives anticipées sont révocables à tout moment, l’alinéa 3 prévoit qu’elles sont « révisables et révocables à tout moment ». La révision des directives anticipées était déjà prévue par l’article R. 1111-18 : il n’est donc question ici que de lui donner une valeur législative.
Cependant, les directives anticipées n’ont plus de durée de validité de 3 ans et continuent donc d’être valables tant qu’elles n’ont pas été révoquées. Les internautes ont exprimé des avis très variés sur la durée de validité. Certains ont souhaité qu’elles soient valables « à vie » mais d’autres qu’elles aient une durée limitée car « on ne peut pas donner une valeur absolue à une directive écrite à un moment t de notre vie dans un bon état de santé ». La majorité a exprimé le souhait qu’elles soient aisément modifiables afin de tenir compte des évolutions de la personne ce que prévoit bien l’alinéa 3.
Par ailleurs, l’alinéa 3 prévoit un modèle pour la rédaction des directives anticipées. Celui-ci sera fixé par « un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé ». L’alinéa 3 dispose que le « modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle rédige de telles directives ».
En effet, le rapport Sicard (53) a souligné les « fluctuations de la volonté [des malades] entre abattement et réflexe de survie », et a proposé l’élaboration d’un deuxième document, en plus des directives anticipées existantes, à destination des personnes atteintes d’une maladie grave, qui serait beaucoup plus contraignant.
Dans la même logique, la présente disposition en prévoit une distinction entre les personnes se sachant atteinte d’une affection grave et les autres. Il ne s’agit pas là d’ouvrir la voie à la constitution de deux types de directives. En effet, si l’intention du législateur est bien de distinguer deux types de situation – le cas d’une personne sans affection grave connue qui serait victime d’un traumatisme et celui d’une personne atteinte d’une affectation dont l’évolution est plus ou moins prévisible –, il ne s’agit pas d’affaiblir l’opposabilité d’un des deux types de directives anticipées.
c. L’opposabilité des directives anticipées sous certaines conditions
L’alinéa 4 rend les directives anticipées opposables au médecin pour « toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement ». Les directives anticipées auront par conséquent une force juridique contraignante. Cependant, ce caractère contraignant doit être subordonné à la précision des directives et à leur adéquation avec la situation du moment. Doivent être envisagés l’état du mourant, le stade de l’agonie, les types de traitements refusés mais aussi l’évolution de l’affection.
Ainsi, l’alinéa 4 prévoit deux exceptions à l’opposabilité des directives anticipées :
– en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire au médecin pour procéder à « une évaluation complète de la situation ». Dans cette hypothèse, le médecin doit effectivement pouvoir se dégager des directives et s’écarter des cas envisagés par le patient lors de leur rédaction, notamment s’il est nécessaire de procéder à des investigations ;
– si les directives apparaissent « manifestement inappropriées », le médecin peut également s’en délier à condition de consulter un confrère et de motiver sa décision dans le dossier médical. En effet, une opposabilité absolue comporte le risque, outre de s’opposer au cadre légal si par exemple le patient demande à bénéficier d’une assistance médicale à mourir, mais aussi de déresponsabiliser le médecin qui n’aurait plus à évaluer la situation et à se demander ce qui est bon pour le patient. En revanche, le patient n’étant pas un expert de l’affection dont il souffre, la notion de « manifestement inappropriées » ne peut pas être invoquée pour vider l’opposabilité de tout effet. Le législateur a tout de même prévu une obligation de motivation afin de poser un verrou supplémentaire et mieux protéger la volonté du patient. Il ne s’interdit de faire encore évoluer le texte dans le sens d’une plus grande prise en compte de la volonté du patient.
d. La conservation des directives
L’alinéa 5 complète les dispositions en vigueur relative à la conservation et à l’accessibilité des directives anticipées.
Le mode de conservation des directives anticipées est jusqu’à présent encadré par l’article R. 1111-19 précité. Si celui-ci prévoit déjà qu’en principe les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical, il permet cependant que le patient puisse les garder chez lui ou les confier à la personne de confiance ou, à défaut, à la famille ou à un proche. Si cette liberté peut être conservée dans le cas de l’opposabilité des directives anticipées, il faut s’assurer que tout médecin amené à soigner le patient en ait connaissance. L’alinéa 5 prévoit donc que « leur accès est facilité par une mention inscrite sur la carte Vitale » qui signalera l’existence des directives anticipées. Cette mention permettra au médecin de les demander aux proches ou au médecin traitant. Sur ce dernier point, de nombreux internautes ont fait part de leur souhait que les directives anticipées soient mentionnées sur la carte Vitale ou puissent être déposées auprès d’associations.
Par ailleurs, afin de rédiger des directives anticipées appropriées, le patient doit être éclairé, le décret devra donc définir également « les conditions d’information des patients ».
*
La Commission examine l’amendement AS14 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il s’agit de préciser que les directives anticipées expriment la volonté de la personne relative non à sa fin de vie, mais à son choix de fin de vie.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
L’amendement AS15 de M. Gérard Sebaoun est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AS79 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il s’agit d’améliorer, en l’allégeant, la rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 2.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS155 des corapporteurs.
Elle examine ensuite l’amendement AS40 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Cet amendement vise à préciser le périmètre des directives anticipées en y ajoutant la mention possible de la mise en place d’une sédation, d’un suicide assisté ou d’une euthanasie.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
L’amendement AS39 de Mme Véronique Massonneau est retiré.
Puis la Commission examine l’amendement AS118 de M. Philip Cordery.
M. Gérard Sebaoun. L’amendement AS118 prévoyant « une assistance médicalisée active pour mourir », je le retire à ce stade de la discussion.
L’amendement AS118 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS156 des rapporteurs.
Elle examine ensuite l’amendement AS74 de Mme Michèle Delaunay.
Mme Michèle Delaunay. Il s’agit d’étendre à l’équipe médicale chargée du patient en fin de vie l’application du contenu de la directive anticipée.
Mme la présidente Catherine Lemorton. J’ai vérifié les définitions : l’équipe médicale ne comprend que les médecins et, éventuellement, les sages-femmes. Pour ouvrir le périmètre, il faut évoquer les équipes « soignantes ».
M. Alain Claeys, corapporteur. Dans le cas d’une équipe médicale, qui prend la décision ?
Mme Michèle Delaunay. Un des médecins de l’équipe.
Je retire l’amendement.
M. Gérard Sebaoun. Il me semble que l’équipe soignante, inversement, exclut les médecins.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Les auxiliaires de santé, notamment les diététiciens ou les infirmiers, ne figurent pas dans l’équipe médicale.
La rédaction définitive du texte devra avoir été dûment vérifiée.
L’amendement AS74 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS157 des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement AS102 de M. Dominique Tian.
M. Alain Claeys, corapporteur. La précision relative aux urgences doit être conservée pour permettre au médecin de pratiquer les actes nécessaires à une évaluation complète de la situation du patient.
Avis défavorable, donc.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS16 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. En cas de directives anticipées « manifestement inappropriées », le texte prévoit que « le médecin, pour se délier de l’obligation de les respecter, doit consulter au moins un confrère ».
L’amendement AS16 vise notamment à permettre à un médecin qui considérerait des directives anticipées comme inappropriées, de faire valoir la clause de conscience : dans ce cas il doit transmettre à un autre praticien toutes les informations utiles à la poursuite des soins dans le cadre des directives anticipées.
Cette clause, qui pourrait être assimilée à un refus de soins, ne s’applique pas en cas d’urgence vitale. Elle est encadrée par le code de déontologie médicale qui prévoit qu’un médecin qui fait valoir la clause de conscience doit en avertir clairement le patient et lui donner les moyens d’une prise en charge adaptée.
La rédaction actuelle me semble insuffisante : que signifie « consulter au moins un confrère » ? Prévoir de « demander immédiatement un avis collégial » est plus rassurant en cas de directives anticipées « manifestement inappropriées », lesquelles supposent que le patient n’avait pas mesuré toute leur portée.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Cet amendement vise à introduire une clause de conscience. Nous y sommes défavorables : les médecins doivent faire leur devoir.
M. Gérard Sebaoun. Le texte prévoit actuellement que le médecin « pour se délier de l’obligation, doit consulter au moins un confrère » : la rédaction me paraît légère.
Avec mon amendement, le médecin ne pourra pas se délier de l’avis collégial, sauf si, dans le temps imparti, il transmet le dossier à un autre praticien.
M. Jean Leonetti, corapporteur. L’amendement vise tout d’abord à prévoir une clause de conscience permettant au médecin de n’apporter son concours qu’à la réalisation des directives anticipées qu’il jugerait appropriées au regard de sa conviction intime. Cette disposition serait dangereuse car elle permettrait aux médecins de juger inappropriées toutes les directives anticipées.
Même les textes où les directives anticipées ont un caractère opposable prévoient le cas de directives inappropriées. Je pense que seules devront être prises en compte les directives entrant dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé et validé par un décret en Conseil d’État. Ce cadre, assurément restreint, aura l’avantage d’être précis et d’asseoir le caractère contraignant ou opposable de la directive. Un document qui engage la vie du patient ne saurait être rédigé sur un bout de papier. On m’en a ainsi montré un qui ne comportait que les mots : « Pas de tuyaux »… Une telle directive est manifestement inappropriée !
Je serais plutôt favorable à ce que l’on doive recueillir l’avis convergent de deux médecins. Le système ne doit pas permettre au médecin d’utiliser la clause de conscience pour se dégager de son obligation.
M. Gérard Sebaoun. Le médecin demandera certes un avis collégial, mais il y a lieu de définir la notion de collégialité. J’accepterais que l’on ôte la référence à la clause de conscience, puisque nous ne sommes pas d’accord. Mais, si l’on décide que les directives anticipées sont inappropriées, une lecture médicale collégiale semble utile.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Ne pourrait-on conserver la notion de collégialité telle que déjà définie dans le texte ?
M. Gérard Sebaoun. Je retire mon amendement au profit de celui que va défendre dans un instant Mme Massonneau.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS104 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Je propose que la personne de confiance participe à l’élaboration de l’avis collégial et que celui-ci s’impose et soit inscrit dans le dossier médical.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Je relève que votre amendement, tel qu’il est rédigé, introduit dans la collégialité, en principe constituée d’un double avis médical, la personne de confiance.
M. Alain Claeys, corapporteur. Il faut supprimer, selon moi, cette référence à la personne de confiance. Le texte se lirait ainsi : « Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin doit solliciter un avis collégial. La décision collégiale s’impose alors et est inscrite dans le dossier médical. ».
M. Jean Leonetti, corapporteur. C’est en effet la collégialité qui juge du caractère inapproprié de la directive anticipée.
M. Gérard Sebaoun. La temporalité est absente de la formule « doit solliciter », alors que c’est l’immédiateté qui contraint à l’action.
Mme Véronique Massonneau. Comme la personne est inconsciente, c’est la personne de confiance qui devient l’interlocutrice des médecins.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Dans la hiérarchie de la parole du malade, les directives anticipées priment l’avis de la personne de confiance, même s’il arrive souvent que celui-ci soit conforme à celles-là.
M. Alain Claeys, corapporteur. Si les directives anticipées s’avèrent inappropriées, la personne de confiance intervient-elle ?
M. Jean Leonetti, corapporteur. On recueille son avis, mais on ne doit pas lui donner le droit d’arrêter un traitement. Le texte renforce, comme en Belgique, le caractère contraignant des directives anticipées, mais pas celui de l’avis de la personne de confiance.
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la Commission adopte l’amendement tel que modifié.
En conséquence, les amendements AS134 de Mme Anne-Yvonne Le Dain, AS72 de Mme Sandrine Hurel et AS158 des corapporteurs tombent.
La Commission est saisie de l’amendement AS114 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Stéphane Claireaux. La durée de validité des directives anticipées doit figurer dans la loi elle-même et ne pas être renvoyée à un décret en Conseil d’État. Certes, les directives anticipées sont « révisables et révocables à tout moment » par l’intéressé, mais il ne serait pas opportun qu’elles demeurent valables sans condition de durée. Actuellement, elles doivent être renouvelées tous les trois ans, ce qui permet de s’assurer qu’elles correspondent toujours à la volonté exprimée auparavant par leur rédacteur. Il convient donc de maintenir le droit positif, issu de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et codifié à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
M. Jean-Pierre Barbier. Je regrette qu’aucun acte médical visant à aider les personnes à rédiger les directives anticipées ne soit reconnu. Imaginez-vous quelqu’un se trouvant en bonne santé s’asseoir à son bureau pour élaborer de telles directives ? Il importe que tout le monde puisse recevoir une aide pour écrire ces directives, mais je n’ai pas déposé d’amendement en ce sens à cause de l’article 40 de la Constitution.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Je ne sais pas s’il faut fixer une limite de validité aux directives anticipées ; la loi de 2005 en avait instauré une de trois ans, supposée correspondre à une longue phase terminale. On nous a dit que les troubles cognitifs pouvaient durer bien plus longtemps, et M. Alain Claeys et moi avons donc décidé de n’inscrire aucune durée. Si quelqu’un rédige ses directives à l’adolescence et tombe malade à quatre-vingts ans, on pourra évidemment faire valoir leur caractère inapproprié.
Mme Isabelle Le Callennec. Le Conseil d’État fixera bien une durée, non ?
M. Jean Leonetti, corapporteur. Oui, de trois ans, mais la loi ne la précisera plus, car elle n’est jamais pertinente. Le fait qu’elle soit révocable et modifiable à tout moment constitue la meilleure garantie pour que les directives traduisent bien la volonté du patient au moment où on les utilise.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS159 des corapporteurs.
Elle aborde ensuite l’amendement AS73 de Mme Sandrine Hurel.
Mme Sandrine Hurel. Cet amendement vise à informer les patients de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées.
Suivant l’avis favorable des corapporteurs, la Commission adopte l’amendement.
La Commission adopte l’article 8 modifié.
Article 9
(art. L. 1111-11-1 [nouveau] du code de la santé publique)
Précision du statut du témoignage de la personne de confiance
Cet article vise à préciser le statut du témoignage de la personne de confiance.
1. Le dispositif actuel
L’article L. 1111-6 du code de la santé publique, introduit par la loi du 22 avril 2005 précitée, prévoit que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ». La personne de confiance est désignée par écrit. Elle est révocable à tout moment.
Il est ainsi proposé au malade lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé de désigner une personne de confiance dans les conditions décrites précédemment pour toute la durée de l’hospitalisation sauf disposition contraire du malade.
Pour désigner une personne de confiance, la personne doit être non seulement majeure mais également capable. Cette disposition exclut par conséquent les mineurs non émancipés ainsi que les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de tutelle. Dans ce dernier cas, l’article précité prévoit que « le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci ». Pour les mineurs, la loi ne désigne pas de personne de confiance de droit.
Aux termes de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, la personne de confiance peut accompagner le malade dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider à exprimer sa volonté.
Enfin, l’article L. 1111-12 précise que, lorsqu’« une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable » est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’avis de la personne de confiance « prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées » dans l’ensemble des décisions prises par le médecin. La personne de confiance exprime bien là son avis sans qu’il soit spécifié s’il se contente de relayer l’avis du malade en fin de vie ou si elle exprime ses propres options.
La consultation de la personne de confiance est enfin prévue par l’article L. 1111-13 du code de la santé publique dans le cas où le médecin envisage de « limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie » administré à un patient dans le cas où celui-ci serait hors d’état d’exprimer sa volonté et en l’absence de directives anticipées. Cependant, l’avis de la personne de confiance ne prévaut pas sur celui des membres de la famille ou à défaut des proches et ne s’impose pas au médecin qui demeure soumis au respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale.
En définitive, la personne de confiance porte l’avis du malade hors d’état d’exprimer sa volonté sans qu’il existe une hiérarchie entre les différents avis sollicités par le médecin et sans qu’il ne s’impose au médecin.
2. Une possibilité très peu répandue
Si la loi dite Leonetti prescrit bien aux médecins de prendre en compte les éléments non médicaux que constituent l’avis de la personne de confiance ainsi que celui de la famille ou des proches, ceux-ci sont peu sollicités.
En effet, selon l’étude de l’INED précitée, la décision de limitation de traitement pour une personne inconsciente n’est discutée avec la personne de confiance que dans 8,12 % des cas. Ce chiffre monte à 48 % des cas pour la famille. La décision d’arrêter le traitement d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté est en revanche discutée avec la personne de confiance dans 13 % des cas et avec la famille dans 57 % des cas.
Il existe par ailleurs, une ambiguïté sur l’identité de la personne de confiance dans l’étude de l’INED. Est-elle assimilée à la famille ? En effet, le rapport Sicard de 2012 souligne que : « la personne de confiance [étant] volontiers assimilée à la famille ou à la « personne à prévenir », sa désignation est loin d’être toujours encouragée voire formalisée et même lorsqu’elle existe, sa consultation semble bien aléatoire ». L’absence de hiérarchie entre les avis des uns et autres ajoutant encore au flou.
En définitive, le rapport de MM. Claeys et Leonetti remis au Gouvernement pose la bonne question : « que se passe-t-il si les membres de la famille ont des avis divergents sur les traitements à dispenser ou à suspendre ? Que se passe-t-il si les médecins et les proches ont des vues différentes sur ce qui est préférable pour le patient ? »
Une information du public devra être organisée. Le personnel médical devra également être mieux formé afin qu’un espace de dialogue se constitue avec le patient soit directement soit indirectement à travers la personne qu’il aura désignée à cet effet.
Pour ce faire, il convient de préciser le statut du témoignage de la personne de confiance afin de sortir de l’ambiguïté.
3. Le dispositif proposé : préciser le témoignage de la personne de confiance
L’article 9 de la proposition de loi vise à introduire un article L. 1111-11-1 dans le code de la santé publique destiné à se substituer à l’article L. 1111-6 en vigueur afin de compléter et préciser le statut du témoignage de la personne de confiance.
À l’alinéa 1, il est inséré la mention suivante : « [la personne de confiance] témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ».
Deux changements majeurs sont ainsi apportés :
– la personne de confiance n’exprime plus un avis mais un témoignage. En ce sens, elle ne délivre plus sa propre appréciation de la situation et/ou ses propres choix quant à l’éventualité d’un arrêt ou d’une limitation d’un traitement mais témoigne seulement de la volonté du malade hors d’état de l’exprimer directement. La position exprimée par la personne de confiance est par conséquent réputée être celle du patient lui-même ;
– « [le] témoignage [de la personne de confiance] prévaut sur tout autre témoignage ». En effet, celui-ci n’est plus un avis parmi d’autres mais est la volonté du malade lui-même.
Pour pouvoir être mieux identifié, l’inscription de la personne de confiance sur la carte Vitale est parfois demandée par les internautes ayant participé à la consultation citoyenne.
Les autres dispositions restent inchangées.
En précisant le statut du témoignage de la personne de confiance, le législateur entend définir une hiérarchie plus claire entre les différents témoignages afin de distinguer celui de la personne de confiance et celui des autres membres de la famille dans le respect de la volonté du malade. En renforçant le statut de la personne de confiance, il entend ériger un interlocuteur privilégié sans pour autant opérer un transfert total de responsabilité en direction de la personne de confiance.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS160 des corapporteurs.
Elle étudie l’amendement AS107 de Mme Sandrine Hurel.
Mme Sandrine Hurel. Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité de désigner une personne de confiance suppléante. Si la première était absente, décédée ou refusait de s’exprimer, la seconde pourrait alors témoigner de la volonté du malade.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques AS18 de M. Gérard Sebaoun et AS42 de Mme Véronique Massonneau.
M. Gérard Sebaoun. Préciser que la personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant semble inutile, car la personne majeure peut librement désigner l’individu de son choix. En outre, si on connaît le médecin traitant, les limites des notions de parent et de proche s’avèrent beaucoup moins claires.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Si l’on ne précise pas l’identité de ceux pouvant être une personne de confiance, des associations pourront désigner a priori des individus qui ne connaîtront pas forcément le futur malade. Il est préférable que la personne fasse partie de l’environnement proche et affectif du patient.
La Commission rejette ces amendements.
Puis elle adopte l’amendement de coordination AS161 des corapporteurs.
Suivant ensuite l’avis défavorable des rapporteurs, elle rejette l’amendement AS43 de Mme Véronique Massonneau.
Puis elle en vient à l’amendement AS136 de M. Jean-Patrick Gille.
M. Jean-Patrick Gille. Le juge décidant de placer un majeur sous tutelle révoque en général toutes les procurations et les pouvoirs de représentation conférés par la personne concernée.
La révocation judiciaire de la personne de confiance par une disposition générale du jugement ou par une ordonnance spéciale place le majeur en tutelle dans la même situation que celle dans laquelle il n’aurait jamais désigné de personne de confiance.
Il devient dans ces conditions nécessaire d’inciter le juge à s’enquérir de l’existence d’une personne de confiance afin d’en empêcher la révocation systématique.
M. Alain Claeys, corapporteur. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car le Gouvernement en déposera un sur le même sujet pour la séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission aborde l’amendement AS137 de Mme Catherine Troallic.
Mme Sandrine Hurel. Il s’agit de veiller à ce que la décision du juge des tutelles soit prise après consultation de la famille, des proches et du médecin traitant.
M. Alain Claeys, corapporteur. L’amendement du Gouvernement que je viens d’annoncer ôtera également de sa justification au vôtre, chère collègue.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination AS162 des corapporteurs.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Article 10
(art. L. 1111-12 du code de la santé publique)
Hiérarchie des modes d’expression de la volonté du patient
Cet article vise à définir une hiérarchie des modes d’expression de la volonté du patient.
1. Le dispositif actuel
En l’état du droit, la hiérarchie des modes d’expression de la volonté du patient est définie à l’article L. 1111-12 du code de la santé publique.
La volonté du patient pour toutes les décisions ou tous les actes le concernant s’exprime directement. Cependant « lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable, quelle qu’en soit la cause » est « hors d’état d’exprimer sa volonté », celle-ci est prise en compte selon la hiérarchie suivante :
– les directives anticipées à condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience ;
– l’avis de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6 du code de la santé publique qui prévaut sur tout autre avis non médical « sauf cas urgent ou impossibilité » ;
– l’avis de la famille ou à défaut, d’un des proches du patient.
Cependant, comme cela a été rappelé ci-dessus, l’article L. 1111-13 prévoit que le médecin « [ne] peut décider d’arrêter ou de limiter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie » qu’après avoir consulté « la personne de confiance, la famille ou à défaut, un de ses proches et le cas échéant, les directives anticipées de la personne » sans établir de hiérarchie claire entre la personne de confiance, la famille et les directives anticipées.
Cette difficulté à établir clairement une hiérarchie dans les sources et les modes d’expression de la volonté du patient peut amener à des situations inextricables préjudiciables in fine au patient.
2. Le dispositif proposé : une hiérarchie plus claire
La proposition de loi prévoit l’abrogation de l’article L. 1111-13. Ne subsistera par conséquent dans le droit positif que l’article L. 1111-12 qui est précisé afin de ne plus laisser place à l’ambiguïté.
L’alinéa 2 prévoit en effet que lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable est hors d’état d’exprimer sa volonté, et en l’absence de directives anticipées, le médecin recueille le témoignage de la personne de confiance et seulement à défaut celui de la famille ou des proches. Il s’agit de témoignage même si un certain nombre de contributeurs au débat citoyen ont souhaité que ces témoignages soient respectés par le médecin, ce qui aurait eu comme résultat de transférer une responsabilité forte sur la famille ou la personne de confiance.
Les rapporteurs proposeront un amendement afin que cette hiérarchie des expressions de la volonté du patient soit bien respectée lorsque le médecin envisage de suspendre ou renonce à entreprendre un traitement qui n’aurait pour effet « que le seul maintien artificiel de la vie ».
Par ailleurs, l’alinéa 3 dispose que pour les mineurs, les titulaires de l’autorité parentale sont réputés être personnes de confiance.
L’expression des titulaires de l’autorité parentale, est plus qu’un simple témoignage comme l’est l’expression de la personne de confiance puisque le mineur est réputé ne pas être apte à exprimer sa volonté et qu’il ne peut donc pas exister de directives anticipées. Ainsi, à l’initiative des rapporteurs, cet alinéa a été supprimé par la commission des affaires sociales.
Par ailleurs, aux termes de l’article 372-2 du code civil, « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » Toutefois, pour les actes plus lourds et a fortiori ceux pouvant engager la vie du mineur, solliciter les deux avis est indispensable, excepté en cas d’urgence ou d’impossibilité.
Le désaccord éventuel entre les titulaires de l’autorité parentale n’emporte pas de conséquence puisque la responsabilité finale demeure celle du médecin qui n’a pour obligation pour les mineurs comme pour les personnes majeures que de recueillir les témoignages sans que ceux-ci ne le lient. En effet, aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, « dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale … risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur …, le médecin délivre les soins indispensables ».
*
La Commission adopte l’amendement de précision AS163 des corapporteurs.
Puis elle examine les amendements identiques AS21 de M. Gérard Sebaoun et AS44 de Mme Véronique Massonneau.
M. Gérard Sebaoun. La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 10 dispose qu’en l’absence de directives anticipées le médecin « recueille le témoignage de la personne de confiance et, à défaut de tout autre témoignage, de la famille ou des proches ». Je préférerais que le texte se contente de préciser « telle que définie précédemment » après « de confiance », puisque la personne de confiance est soit le médecin traitant, soit un proche, soit un parent. Comme tout témoignage, celui de la famille et des proches peut être sujet à caution.
Mme Véronique Massonneau. Je défends le même amendement, car la famille ou les proches peuvent avoir des motivations différentes de l’intérêt du patient. Si cet amendement n’était pas adopté, ce serait très grave.
M. Jean Leonetti, corapporteur. La loi de 2005 se contentait de prévoir que l’on prenne l’avis de la famille. Dans l’affaire Vincent Lambert, on a pris l’avis de chacun, alors qu’il importe avant tout de recueillir le témoignage de l’entourage du patient quant à la volonté de ce dernier. Le Conseil d’État a validé ce dispositif, car les proches de Vincent Lambert ont affirmé que celui-ci ne voulait pas de cette vie. Ce n’est pas l’avis des personnes que l’on demande, je le répète, c’est leur témoignage sur ce que le malade aurait souhaité.
Mme Véronique Massonneau. Comment allez-vous vérifier la véracité d’un témoignage ? Le législateur doit écrire des textes précis et éviter en l’espèce que des motivations économiques ou d’usure puissent s’exprimer. Le rôle de la famille dans le cas de Vincent Lambert a été catastrophique.
M. Jean-Louis Touraine. Monsieur Leonetti, votre opinion est louable mais naïve. Pour prélever des organes chez des sujets décédés afin de les transplanter, la loi de bioéthique prescrit de s’enquérir auprès de la famille de l’avis de la personne disparue. Or, l’Agence de la biomédecine affirme que le système ne fonctionne pas, la loi étant détournée par les coordonnateurs de transplantation qui demandent l’avis de la famille et non le témoignage de ce que le mort souhaitait. Dans ce cadre, les membres de la famille donnent bien souvent des avis divergents.
M. Alain Claeys, corapporteur. À défaut de directives anticipées et de personne de confiance, il faut bien rencontrer la famille et lui demander non son avis, mais ce qu’aurait été celui de la personne si elle avait été autonome.
M. Jean-Pierre Barbier. Sans directives anticipées, il est préférable que le médecin recueille plusieurs témoignages et non pas seulement celui de la personne de confiance, afin de procéder à des recoupements et d’obtenir une idée plus précise de la volonté du patient.
Mme Véronique Massonneau. J’ai peur que de nombreux patients ne remplissent plus les directives anticipées, en se disant que les proches et la famille pourront donner leur avis.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement de précision AS164 des corapporteurs.
Elle étudie l’amendement AS109 de M. Jean-Louis Touraine.
M. Jean-Louis Touraine. Les membres de la famille, consultés en cas d’absence de directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance, peuvent émettre des avis divergents sur la volonté du patient. Mon amendement propose de déployer alors une médiation indépendante des parties, impartiale et neutre.
Suivant l’avis défavorable des corapporteurs, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS168 des corapporteurs.
M. Jean Leonetti, corapporteur. Les parents jouissent d’un statut supérieur à celui de personne de confiance, puisqu’ils exercent la tutelle morale des enfants. Ils expriment donc la volonté du mineur et ne fournissent pas seulement un témoignage.
M. Gérard Sebaoun. Existe-t-il des cas dans lesquels l’avis du mineur possède une valeur juridique ?
M. Jean Leonetti, corapporteur. Le mineur peut toujours s’exprimer « en fonction de son âge et de son degré de maturité », selon la formule consacrée par le code civil, mais il n’a pas à désigner de personne de confiance puisqu’il se trouve sous la tutelle des titulaires de l’autorité parentale.
Mme Martine Pinville. Quelle est la situation des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ?
M. Jean Leonetti, corapporteur. C’est la tutelle qui joue le rôle de l’autorité parentale.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
Article 11
(art. L. 1111-13 du code de la santé publique)
Article de coordination avec les articles 2, 5 et 10
Limitation ou arrêt des traitements pour une personne en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté
L’article L. 1111-13 du code de la santé publique en vigueur prévoit un dispositif spécifique de limitation ou d’arrêt de traitement pour une personne en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté. Le médecin peut aujourd’hui décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
L’article L. 1111-4 du même code, de son côté, prévoit les mêmes dispositions sans distinguer si la personne est atteinte d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale.
Dans ces deux situations, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt des traitements sont encadrés. Si des directives anticipées ont été rédigées, elles doivent être prises en compte. La personne de confiance si elle existe, la famille ou à défaut un des proches du malade doit être consulté. Enfin, cette limitation ou arrêt des traitements requiert une procédure collégiale et doit fait l’objet d’un avis motivé qui figure dans le dossier du patient.
Les rapporteurs ont choisi de conserver des dispositions de portée générale qui pourront s’appliquer à toutes les situations. Le dispositif de l’article L. 1111-13 figure désormais aux articles 2, 5 et 10 de la présente proposition de loi et donc respectivement aux articles L.1110-5-1, L.1111-4 et L.1111-12 du code de la santé publique dont ils proposent une nouvelle rédaction, ce qui justifie l’abrogation de l’actuel article L. 1111-13.
*
La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement AS45 de Mme Véronique Massonneau.
L’amendement AS120 de M. Philip Cordery est retiré.
La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
* *
En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie |
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie | |
Code de la santé publique |
Article 1er |
Article 1er |
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
||
Art. L. 1110-5. – Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. |
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. |
« Toute personne … … sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard … … escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni du titre II du présent livre Ier. Amendements AS122 (rect) et AS146 |
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. |
||
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. |
||
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. |
||
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. |
« Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. » |
« Toute personne … … pour que ce droit soit respecté. » Amendement AS147 |
Article 2 |
Article 2 | |
Après l’article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient et selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. |
« Art. L. 1110-5-1. – … … doivent, ni être mis en œuvre, ni poursuivis, au titre du refus d’une obstination … … vie, alors et sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient conformément à l’article L. 1111-12 et selon la … … soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Amendements AS165, AS166, AS126, AS167 et AS127 | |
« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. ». |
||
Article 3 |
Article 3 | |
Après l’article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé : |
||
« Art. L.1110-5-2. – À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès associé à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie est mis en œuvre dans les cas suivants : |
« Art. L.1110-5-2. – … … vie, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie et à l’arrêt … … suivants : Amendement AS76 | |
« – lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ; |
« – lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable, et dont … … réfractaire à l’analgésie ; Amendements AS169 et AS23 | |
« – lorsque la décision du patient, atteint d’une affection grave et incurable, d’arrêter un traitement, engage son pronostic vital à court terme. |
||
« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable visée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique le traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès. |
« Lorsque … … et au titre du refus … … applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie. Amendements AS170 et AS77 | |
« Le traitement à visée sédative et antalgique prévu au présent article est mis en œuvre selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, qui permet de vérifier que les conditions d’application du présent article sont remplies. |
La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévus au présent article est mise en œuvre … … médicale, afin de vérifier … … remplies. Amendements AS78 et AS172 | |
« L’administration du traitement à visée sédative et antalgique décrite au présent article peut être effectuée, selon le choix du patient et après consultation du médecin, en milieu hospitalier ou au domicile du patient, par un membre de l’équipe médicale. Amendement AS70 | ||
« L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. ». |
« L’ensemble de la procédure suivie est … … patient. » Amendement AS171 | |
Article 4 |
Article 4 | |
Après l’article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1110-5-3. – Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. |
« Art. … … traitée par l’équipe médicale. Amendement AS130 | |
« Le médecin met en place l’ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-11-1, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » |
« Le … … réfractaire du malade en … … proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » Amendements AS154 et AS148 | |
Article 4 bis | ||
Après l’article L 1110-10 du même code, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 1110-10-1. – Chaque année, l’agence régionale de santé présente en séance plénière à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un rapport exhaustif et actualisé sur le nombre de places de soins palliatifs en institutions sanitaires et médico-sociales, sur la prise en charge des soins palliatifs accompagnée par les réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ou assurée à domicile par des professionnels libéraux ainsi que sur la politique poursuivie par la région pour développer les soins palliatifs. ». Amendement AS64 | ||
Article 5 |
Article 5 | |
Art. L. 1111-4. – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. |
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigé : |
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amendement AS149 |
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ; |
||
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigé : |
II. – Le deuxième alinéa … … rédigé : Amendement AS150 | |
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. |
« Le professionnel de santé a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Il peut être fait appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. » ; |
« Le médecin a l’obligation de … … soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » ; Amendements AS151 et AS131 |
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. |
||
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. |
III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 111-4 est supprimé. |
Alinéa supprimé Amendement AS152 |
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. |
IV. – Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-11-1, ou la famille ou les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. » |
|
V. - À la première phrase du V de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». Amendement AS153 | ||
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. |
||
L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. |
||
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. |
||
Article 6 |
Article 6 | |
Art. L. 1111-10. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. |
L’article L. 1111-10 est abrogé. |
(Sans modification) |
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. |
||
Article 7 |
Article 7 | |
Code de la santé publique Première partie Protection générale de la santé Livre Ier Protection des personnes en matière de santé Titre Ier Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre Ier Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté Section 2 Expression de la volonté des malades en fin de vie |
Dans le titre de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ». |
(Sans modification) |
Article 8 |
Article 8 | |
L’article L. 1111-11 est ainsi rédigé : |
||
Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. |
« Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions du refus, de la limitation ou l’arrêt des traitements et actes médicaux. |
« Toute … … ou de l’arrêt des traitements et des actes médicaux. Amendement AS155 |
« Elles sont révisables et révocables à tout moment. Elles sont rédigées selon un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle rédige de telles directives. |
« Elles … … modèle unique dont … … directives. Amendement AS156 | |
À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. |
« Elles s’imposent au médecin, pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin, pour se délier de l’obligation de les respecter, doit consulter au moins un confrère et motiver sa décision qui est inscrite dans le dossier médical. |
« Elles … … d’investigation, d’actes d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin doit solliciter un avis collégial. La décision collégiale s’impose alors et est inscrite dans le dossier médical. Amendements AS157 et AS104 (Rect) |
Un décret en Conseil d’État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. |
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’information des patients, de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Leur accès est facilité par une mention inscrite sur la carte vitale. » |
« Un … … patients, et les conditions de … … vitale. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées. » Amendements AS159 et AS73 |
Article 9 |
Article 9 | |
I. – Après l’article L. 1111-11, il est inséré un article L. 1111-11-1 ainsi rédigé : |
I. – L’article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé : amendement AS160 | |
« Art. L. 1111-11-1. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. |
« Art. L. 1111-6. – Toute … … Elle est révisable et révocable … … décisions. Amendements AS160 et AS161 | |
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. |
||
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. » ; |
||
Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. |
II. – L’article L. 1111-6 est abrogé. |
Alinéa supprimé Amendement AS162 |
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. |
||
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. |
||
Article 10 |
Article 10 | |
L’article L. 1111-12 est ainsi rédigé : |
||
Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. |
« Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées, il recueille le témoignage de la personne de confiance et à défaut de tout autre témoignage de la famille ou des proches. |
« Lorsqu’une … …anticipées, mentionnées à l’article L. 1111-11, il … …confiance ou à défaut … … proches. Amendements AS163 et AS164 |
« S’agissant des mineurs, les titulaires de l’autorité parentale sont réputés être personnes de confiance. » |
Alinéa supprimé Amendement AS168 | |
Article 11 |
Article 11 | |
Art. L. 1111-13. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. |
L’article L. 1111-13 est abrogé. |
(Sans modification) |
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. |
||
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS (54)
Ø Conseil national de l’ordre des médecins – Dr Patrick Bouet, président, et Dr Jean-Marie Faroudja, président de la section Éthique et déontologie
1 () Commission de réflexion sur la fin de vie en France, Penser solidairement la fin de vie, Rapport au président de la République, 18 décembre 2012.
2 () Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, avis n° 121, Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, 1er juillet 2013.
3 () Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, conférence de citoyens sur la fin de vie, avis citoyen, 14 décembre 2013.
4 () Rapport de présentation et texte de la proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, décembre 2014.
5 () Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
6 () Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
7 () Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.
8 () Article L. 1110-10 du code de la santé publique.
9 () Circulaire n° DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs.
10 () Cour des comptes, rapport public annuel 2015, Les soins palliatifs : une prise en charge toujours très incomplète, février 2015.
11 () Observatoire national de la fin de vie, Soins palliatifs et fin de vie à l’hôpital : une étude à partir des données existantes, 2013.
12 () Professeur Régis Aubry, Comité national de suivi du développement des soins palliatifs, État des lieux du développement des soins palliatifs en France, avril 2011.
13 () Bilan du programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012, juin 2013.
14 () Observatoire national de la fin de vie, Soins palliatifs et fin de vie à l’hôpital : une étude à partir des données existantes, 2013.
15 () Instruction DGOS/R 4/DGCS n° 2010-275 du 15 juillet 2010 relative aux modalités d’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
16 () Observatoire national de la fin de vie, Fin de vie des personnes âgées : sept parcours ordinaires pour mieux comprendre les enjeux de la fin de vie en France, 2013, Rapport 2013.
17 () Plan triennal de développement des soins palliatifs 1999-2001.
18 () Bilan du programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012, juin 2013.
19 () Article 26 du projet de loi relatif à la santé.
20 () En ligne sur le site Internet de la Société française d’accompagnement des soins palliatifs (SFAP).
21 () Paradoxes, écueils et enjeux de la formation, article du Dr Véronique Blanchet paru dans la revue Médecine Palliative n° 6, décembre 2003.
22 () Conférence de citoyens sur la fin de vie, avis citoyen, 14 décembre 2013.
23 () Rapport d’information n° 1287 du 28 novembre 2008 présenté par M. Jean Leonetti au nom de la Commission des affaires culturelles et sociales.
24 () Article premier de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie codifié à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.
25 () Codifié à l’article R. 4127-37 du code de la santé publique.
26 () Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Observations à l’attention du Conseil d’État, 5 mai 2014.
27 () Conseil national de l’Ordre des médecins, Observations en application de la demande avant dire droit de l’assemblée du contentieux du Conseil d’État du 14 février 2014, 24 juin 2014.
28 () Conseil national de l’Ordre des médecins, Observations en application de la demande avant dire droit de l’assemblée du contentieux du Conseil d’État du 14 février 2014, 24 juin 2014.
29 () MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, Rapport de présentation et texte de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, décembre 2014.
30 () Études de Limitation des arrêts et des thérapeutiques actives en réanimation adulte (LATAREA-1 et LATAREA-2).
31 () Conseil d’État, 14 février 2014, n° 375081, 375090, 375091.
32 () Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Observations à l’attention du Conseil d’État, 5 mai 2014.
33 () Conseil d’État, 24 juin 2014, n° 375081, 375090, 375091.
34 () Conseil d’État, 14 février 2014, n° 375081, 375090, 375091.
35 () Audition du 29 octobre 2014.
36 () Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Observations à l’attention du Conseil d’État, 5 mai 2014.
37 () Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), Sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes : recommandations chez l’adulte et spécificités au domicile et en gériatrie, 2009.
38 () Article 2 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie codifié à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.
39 () Article 37 du code de déontologie médicale.
40 () MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, Rapport de présentation et texte de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, décembre 2014.
41 () Ordre national des médecins, Fin de vie, assistance à mourir, 8 février 2013.
42 () Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, avis n° 121, Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, 1er juillet 2013.
43 () MM. Alain Claeys et Jean Léonetti, Rapport de présentation et texte de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, décembre 2014.
44 () MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, Rapport de présentation et texte de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, décembre 2014.
45 () Rapport de présentation et texte de la proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, décembre 2004, La documentation française.
46 () Cherny NI, Portenoy RK. Sedation in the management of refractory symptoms: guidelines for evaluation and treatment. J Palliat Care 1994.
47 () « Penser solidairement la fin de vie », rapport à François Hollande Président de la République Française, Commission de réflexion sur la fin de vie en France 18 décembre 2012.
48 () Inspection générale des affaires sociales, Fiches contributives à la mission de réflexion sur le fin de vie, décembre 2012.
49 () Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, avis n° 121 du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, 1er juillet 2013
50 () Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
51 () Rapport au Conseil de l’Europe élaboré sur la base de l’atelier exploratoire du Conseil de l’Europe sur les directives anticipées du 18-22 juin 2008 cité par le rapport de MM. Claeys et Leonetti relatif à la fin de vie, 2015.
52 () L’enquête a porté sur un échantillon de 14 999 décès de personnes âgées de 18 ans et plus représentatif des 47 872 décès survenus en France en décembre 2009.
53 () Commission de réflexion sur la fin de vie en France, Penser solidairement la fin de vie, Rapport au président de la République, 18 décembre 2012.
54 () Cf. liste des personnes auditionnées par la mission du rapport de présentation et texte de la proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, décembre 2014, annexe 1 page 31.