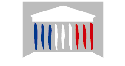
N° 2679
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 2570), DE M. PHILIPPE MEUNIER, visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité,
PAR M. Philippe MEUNIER
Député
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. LE CODE CIVIL, EN L’ÉTAT, NE PERMET DE PRIVER DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE QU’UNE FRACTION DES FRANÇAIS AYANT PERPÉTRÉ UN ACTE DE TERRORISME 10
A. LES RÈGLES APPLICABLES À LA PERTE, À LA DÉCHÉANCE ET AU RETRAIT DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 10
1. La perte de nationalité française 11
a. La perte de la nationalité française par déclaration 11
b. La perte de la nationalité française par jugement 11
c. La perte de la nationalité française par décret 12
2. La déchéance de la nationalité française 15
a. Un dispositif applicable seulement aux Français d’acquisition possédant une autre nationalité 15
b. Les cas de déchéance 15
c. Les délais applicables 16
d. La procédure 17
3. Le retrait de la nationalité française 17
B. UN ÉTAT DU DROIT TRÈS INSUFFISANT POUR FAIRE FACE AU TERRORISME 17
II. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI VISE À METTRE UN TERME À CETTE LACUNE ET À CETTE INÉGALITÉ DANS LE RESPECT DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES ET INTERNATIONALES 18
A. LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CAS DE PERTE DE NATIONALITÉ À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS PORTANT LES ARMES CONTRE LA FRANCE 18
B. LA CRÉATION D’UN CRIME D’INDIGNITÉ NATIONALE ASSORTI D’UNE PEINE DE DÉGRADATION NATIONALE 20
C. LA CONFORMITÉ AUX EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES ET INTERNATIONALES APPLICABLES 22
1. Les exigences constitutionnelles 22
a. La jurisprudence constitutionnelle relative à la déchéance de nationalité 23
b. La décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 relative à la perte de la nationalité française par acquisition d’une nationalité étrangère 24
c. La décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013 relative à l’imprescriptibilité de l’action du ministère public en négation de nationalité 25
d. Un dispositif pleinement conforme à la jurisprudence constitutionnelle 25
2. Les exigences européennes 26
3. Les exigences internationales 28
D. CETTE ÉVOLUTION DE NOTRE DROIT DE LA NATIONALITÉ LE RAPPROCHERAIT DE CELUI DES AUTRES DÉMOCRATIES OCCIDENTALES 29
1. La plupart des États membres de l’Union européenne peuvent priver de sa nationalité leur ressortissant s’étant mis au service d’un autre État 29
2. La plupart des État membres privent également de sa nationalité les citoyens ayant porté atteinte à leurs intérêts essentiels 29
3. Plusieurs pays ont récemment réformé leur législation relative à la perte de la nationalité dans le cadre de la lutte anti-terroriste 29
III. LES AMÉLIORATIONS ET COMPLÉMENTS PROPOSÉS PAR VOTRE RAPPORTEUR 31
A. L’EXTENSION ET LA CONSOLIDATION DU DISPOSITIF PROPOSÉ 32
1. L’extension du dispositif aux actes visant les pays alliés de la France et leurs ressortissants 32
2. La consolidation juridique du dispositif proposé 32
a. Un décret pris après avis conforme du Conseil d’État 32
b. Le renforcement des droits de la défense 32
c. La date d’effet de la perte de la nationalité 33
B. LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CAS DE PERTE DE LA NATIONALITÉ INCLUANT ÉGALEMENT LES FRANÇAIS MONO-NATIONAUX 33
IV. LE REJET DE LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION 34
Article 1er (art. 23-8-1 du code civil [nouveau]) : Perte de la nationalité française de tout individu ayant pris les armes contre les forces françaises ou un civil français 47
Après l’article premier 51
Article 2 (art. 411-5-1 et 411-5-2 du code pénal [nouveaux] : Création d’un crime d’indignité nationale et d’une peine complémentaire de dégradation nationale 52
Alors qu’un nombre croissant de Français sont impliqués dans des actes de terrorisme, la présente proposition de loi vise, d’une part, à permettre de priver de la nationalité française les terroristes qui, par leurs actes odieux de barbarie et en portant les armes contre la France et ses ressortissants, se sont eux-mêmes exclus de la communauté nationale et, d’autre part, à rétablir le crime d’indignité nationale à leur encontre.
Selon le dernier état des lieux dressé par le ministère de l’Intérieur, à la fin du mois de février 2015, 413 ressortissants français étaient engagés dans les zones de combat en Syrie dans les rangs de l’organisation terroriste Daech et 294 de nos compatriotes étaient en transit vers ces zones. Selon le Premier ministre, il y aurait aujourd’hui 3 000 Européens en Syrie et en Irak, et il devrait y en avoir sans doute 10 000 avant la fin de l’année 2015. Si ce triplement des effectifs concernait également les Français – ce dont rien ne permet de douter –, ce sont plus de 2 000 de nos compatriotes qui rejoindraient les rangs de Daech d’ici à la fin de cette année.
Ces milliers de Français radicalisés, devenus des ennemis de notre pays, disposent, du fait de leur nationalité française, d’un droit au séjour sur notre territoire ainsi que de celui de circuler librement dans toute l’Union européenne. Ils ne peuvent faire l’objet d’un éloignement de notre territoire, pas plus que d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire français. Ils bénéficient également d’une dispense de visa dans de nombreux autres pays tiers.
La menace constituée par ces individus est considérable. Elle exigerait qu’à leur retour, chacun d’entre eux fasse l’objet d’une surveillance permanente, 24 heures sur 24. Imagine-t-on les effectifs policiers qu’une surveillance continue – dont la parfaite fiabilité ne saurait en outre être garantie, un individu déterminé pouvant toujours échapper à la surveillance dont il fait l’objet – de milliers d’individus, pendant plusieurs années (de nombreux terroristes sont susceptibles de devenir « dormants » à leur retour et de ne passer à l’action que longtemps après celui-ci) mobiliserait, au détriment des autres missions de sécurité publique incombant aux forces de l’ordre ?
La seule mesure susceptible d’assurer la sécurité de nos concitoyens est de priver les individus concernés de la nationalité française, afin de pouvoir leur interdire notre territoire à leur retour ou de pouvoir les expulser, le cas échéant après avoir purgé une peine de prison. Le recours par le Gouvernement à la procédure de déchéance de la nationalité française pour actes de terrorisme démontre d’ailleurs qu’il considère, lui aussi, comme d’autres gouvernements avant lui, cette mesure utile (1).
Notre droit de la nationalité ne permet pas, en l’état, de priver de la nationalité française tout Français ayant perpétré des actes de terrorisme. En effet, en application des articles 25 et 25-1 du code civil, seuls les Français d’acquisition – et non les Français de naissance – possédant une autre nationalité peuvent être déchus de leur nationalité française. C’est une grave lacune, qui risque de nous handicaper lourdement dans la lutte contre le terrorisme. Il suffit, pour s’en convaincre, de se pencher sur le profil de certains des terroristes français ayant frappé notre pays et la Belgique au cours de la période récente :
– Mohamed Merah, l’auteur des attentats de Toulouse et de Montauban de mars 2012 ayant tué sept victimes, parmi lesquelles trois militaires et quatre civils, dont trois enfants de 3, 6 et 8 ans, était français de naissance ;
– Mehdi Nemmouche, l’auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles du 24 mai 2014 ayant fait quatre victimes, est français de naissance ;
– les auteurs de l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo qui ont tué douze personnes (parmi lesquelles huit membres de la rédaction du journal et deux policiers), les frères Kouachi, étaient français de naissance, de même qu’Amedy Coulibaly, l’auteur des attentats de Montrouge (au cours duquel une policière a été tuée et un agent de voirie grièvement blessé) et de la supérette casher de Vincennes de janvier 2015, qui a fait quatre morts.
Aucun d’entre eux n’aurait pu faire l’objet d’une procédure de la déchéance de nationalité française, les conditions requises n’étant pas remplies. Il est donc inexact d’affirmer, comme l’a fait le Gouvernement lors de l’examen en séance de la précédente proposition de loi déposée par le rapporteur et plusieurs de ses collègues sur ce sujet (2) ou en réponse une question du rapporteur (3), que le droit actuel est suffisant et qu’il permettrait de répondre à la menace que font courir ces terroristes.
Il est tout aussi inexact d’affirmer que la présente proposition de loi serait incompatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, telle qu’elle résulte des décisions n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 et n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015. Ces décisions ont, bien au contraire, validé le recours à la déchéance de nationalité à l’encontre des terroristes « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme » et la présente proposition de loi est conforme aux exigences posées par le Conseil :
– le recours à la perte de nationalité, qui concerne tous les Français, d’origine ou par acquisition, au lieu de la déchéance de nationalité, qui ne concerne que les Français d’acquisition, fait disparaître tout grief tiré d’une quelconque atteinte au principe d’égalité, puisque tous les Français seront concernés ;
– les principes de nécessité et de proportionnalité des peines sont pleinement respectés : on n’imagine en effet pas pour quel motif la déchéance de nationalité pour actes de terrorisme constituerait une sanction qui ne serait pas manifestement proportionnée, tandis que la perte de nationalité le serait, sauf à considérer qu’il existe deux catégories de Français, ce qui ne correspond pas à la jurisprudence constitutionnelle, pour laquelle tous les Français sont égaux, qu’ils aient acquis la nationalité française ou qu’elle leur ait été attribuée à la naissance.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le rapporteur et plusieurs de ses collègues ont décidé de déposer à nouveau la présente proposition de loi, dans une rédaction intégrant les modifications proposées par le rapporteur par voie d’amendements lors de l’examen de la précédente proposition de loi.
Cette nouvelle version de la proposition de loi vise par conséquent à créer un nouveau cas de perte de nationalité à l’encontre de tous les Français, d’acquisition ou d’origine, possédant une autre nationalité et menant ou se rendant complice d’opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français et à créer un crime d’indignité nationale, assortie d’une peine complémentaire de dégradation nationale, à l’encontre de tout Français auteur ou complice des mêmes faits. Ce crime d’indignité nationale s’inspire de celui mis en place à la fin de la Seconde guerre mondiale pour sanctionner les Français ayant collaboré avec l’ennemi.
Votre rapporteur déplore que la majorité, adoptant à nouveau une posture politicienne et caricaturant la présente proposition pour des raisons idéologiques, se soit à nouveau opposée, en commission, à cette mesure pourtant indispensable. Ce rejet démontre que les appels du président de la République et du Premier ministre à l’unité nationale et au dialogue avec l’opposition, au lendemain des attentats de janvier 2015, pour adopter les mesures nécessaires au renforcement de la lutte contre le terrorisme étaient de pure forme. L’unité nationale invoquée fonctionne à sens unique : elle implique, selon le Gouvernement, que l’opposition soutienne les réformes qu’il présente sans que lui-même ne soit tenu d’étudier avec honnêteté et sérieux les propositions de l’opposition.
Le code civil ne permet de priver de la nationalité française qu’une fraction des Français – les Français d’acquisition possédant une autre nationalité – ayant perpétré un acte de terrorisme (I). La proposition de loi vise à mettre un terme à cette lacune et à cette inégalité dans le respect des exigences constitutionnelles et internationales applicables (II).
I. LE CODE CIVIL, EN L’ÉTAT, NE PERMET DE PRIVER DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE QU’UNE FRACTION DES FRANÇAIS AYANT PERPÉTRÉ UN ACTE DE TERRORISME
Une personne peut être française en application de différentes règles prévues par le code civil. À cet égard, il convient de distinguer l’attribution de la nationalité ou la nationalité française d’origine, c’est-à-dire son octroi à l’intéressé dès sa naissance (4), de l’acquisition de la nationalité française, c’est-à-dire son octroi, sans rétroactivité, à un individu qui n’est pas né français (5).
Cette distinction a en effet des conséquences sur les modalités de perte, de retrait ou de déchéance de la nationalité française.
En l’état du droit, les règles applicables à la perte, à la déchéance et au retrait de la nationalité française ne permettent de priver un Français ayant perpétré des actes de terrorisme qu’à la double condition qu’il ait acquis la nationalité française (ce qui exclut les Français de naissance) et qu’il possède une autre nationalité. Ces limites rendent notre droit de la nationalité très insuffisant pour faire face au terrorisme.
En l’état du droit, le code civil prévoit trois éventualités dans lesquelles la nationalité peut se trouver soustraite : la perte, le retrait ou la déchéance de nationalité. Aucune de ces privations de la nationalité française ne produit d’effets collectifs, c’est-à-dire d’extension automatique au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé.
La perte de nationalité est régie par les articles 23 à 23-9 du code civil. Elle se distingue de la déchéance et du retrait de la nationalité française en ce qu’elle est susceptible de concerner tous les Français, qu’ils soient nés Français ou qu’ils aient acquis la nationalité française.
La perte de la nationalité française peut intervenir à la suite d’une déclaration de l’intéressé, d’un jugement ou d’un décret.
La perte de la nationalité française par déclaration concerne les situations suivantes :
– déclaration expresse de perte de la nationalité française à la suite de l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère par un Français majeur, à condition qu’il réside habituellement à l’étranger et qu’il soit en règle avec les obligations du code du service national s’il a moins de 35 ans (articles 23 à 23-2). Cette déclaration peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité étrangère et au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date de cette acquisition ;
– répudiation de la nationalité française par un enfant né à l’étranger dont un seul des parents est français (articles 18-1 et 23-3) ou par un enfant né en France dont un seul des parents est français (articles 19-4 et 23-3) ou par un enfant mineur devenu français de plein droit en raison de l’acquisition de la nationalité française par l’un de ses parents (article 22-3 et 23-3). Cette faculté de répudiation doit être exercée dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant ;
– répudiation de la nationalité française par un Français ayant acquis la nationalité étrangère de son conjoint, à condition que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger et que l’intéressé soit en règles avec les obligations du code du service national s’il a moins de 35 ans (articles 23-5).
La perte de la nationalité française par jugement concerne les personnes françaises d’origine par filiation qui n’ont point la possession d’état de Français et n’ont jamais eu leur résidence habituelle en France, à condition que leurs ascendants, dont ils tenaient la nationalité française, n’aient eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle (article 23-6). Cette disposition vise à éviter que l’attribution de la nationalité française par filiation puisse conduire à une transmission indéfinie de cette nationalité à des individus qui n’ont en réalité plus aucune attache avec la France.
La perte de la nationalité française par décret peut intervenir à la demande de l’intéressé ou sur l’initiative du Gouvernement. Elle concerne les trois situations suivantes :
– la demande de perte de nationalité d’un Français ayant une nationalité étrangère ;
– l’exercice actif d’une nationalité étrangère ;
– l’emploi ou le concours à une armée ou un service public étranger ou à une organisation internationale dont la France ne fait pas partie.
L’article 23-4 du code civil permet à un Français, même mineur, ayant une nationalité étrangère de demander au Gouvernement l’autorisation de perdre sa nationalité française. Entre 2005 et 2012, 389 demandes de libération des liens d’allégeance française ont été accordées sur ce fondement sur les 429 dossiers déposés en ce sens, soit un taux d’acceptation de 90,6 %. Les motifs de refus tiennent essentiellement à ce que le demandeur n’a pas durablement établi sa résidence à l’étranger ou qu’il entend, par sa demande de libération d’allégeance, échapper à ses obligations de Français, notamment en matière fiscale (6) ;
L’article 23-7 du code civil permet au Gouvernement de prononcer d’office, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, la perte de la nationalité française du Français qui « se comporte en fait comme le national d’un pays étranger, s’il a la nationalité de ce pays ».
Cette disposition est issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, qui a repris la règle posée à l’article 96 de l’ancien code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 45-2241 du 19 octobre 1945 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973. L’intéressé doit avoir la nationalité du pays concerné, ce qui exclut qu’il puisse devenir apatride.
La perte revêtant, dans cette hypothèse, un caractère semi-répressif, des garanties procédurales importantes sont prévues :
– l’intéressé doit avoir été entendu ou appelé à produire ses observations (article 27-3) ;
– le Gouvernement doit avoir notifié à l’intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée, les motifs de droit et de fait justifiant qu’il ait perdu la qualité de Français. À défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel. L’intéressé dispose alors d’un mois à compter de la notification ou de la publication de l’avis pour faire parvenir ses observations en défense (article 59 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française) ;
– le décret de perte de nationalité ne peut être pris que sur avis conforme du Conseil d’État.
Le Gouvernement, en réponse à une question écrite posée par l’un de nos collègues sénateurs (7), a indiqué que cette disposition n’a été utilisée que très rarement, à l’encontre de personnes ayant commis des faits précis, clairement contraire aux intérêts de la France. Selon le Gouvernement, ces faits témoignaient sans ambiguïté d’un défaut de loyauté de leur auteur à l’égard de notre pays, dans une période troublée, indépendamment de l’exercice normal, par l’intéressé, des droits et devoirs découlant de sa nationalité étrangère. L’ancien article 96 du code de la nationalité française a ainsi été appliqué dans les cas suivants :
– en 1958, à un Franco-norvégien ayant donné des conférences et publié des articles dirigés contre la France et sa politique ;
– en 1960 à un Franco-guinéen, qui, nommé, un mois après l’indépendance de la Guinée, trésorier payeur de la République de Guinée, militait dans des partis politiques guinéens et écrivait des articles extrêmement violents contre le Gouvernement français ;
– en 1970, à un Franco-allemand qui, résidant en Allemagne depuis la Libération, se comportait, dès avant 1939, comme un ressortissant allemand et manifestait ouvertement son hostilité à l’égard de la France.
iii. L’emploi ou le concours à une armée ou un service public étranger ou à une organisation internationale dont la France ne fait pas partie
L’article 23-8 du code civil prévoit que « perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement ».
Historiquement, cette disposition constitue la fusion de deux séries de règles (8). La première, dont on trouve trace dans l’article 17-2 du code civil de 1804, prévoyait la perte de plein droit de la nationalité française en cas d’acceptation non autorisée puis, à partir de la loi du 26 juin 1889, en cas de conservation malgré l’injonction contraire du Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger. La seconde, issue de la même loi du 26 juin 1889, prévoyait la perte de plein droit de la nationalité française en cas de prise de service militaire à l’étranger sans autorisation du Gouvernement français.
La notion d’emploi implique un service effectif, mais celle de concours est plus large et ne requiert qu’une coopération, qui doit en tout état de cause être volontaire. Les termes « une armée ou un service public étranger » semblent devoir s’interpréter comme l’armée régulière ou un service public d’un autre État (9). Le concours à une armée qui ne serait pas l’armée régulière d’un État ne paraît pas susceptible, dans la rédaction actuelle, d’entrer dans le champ du dispositif. La notion d’« organisation internationale dont la France ne fait pas partie » paraît pour sa part envoyer aux seules organisations intergouvernementales. Le concours apporté à une organisation terroriste ne semble donc malheureusement pas, en l’état du texte, couvert par l’article 23-8 du code civil.
À la différence des autres hypothèses de perte de la nationalité française, le code civil n’exige pas que l’intéressé ait une autre nationalité : il peut donc être rendu apatride, ce qui n’est – contrairement à une idée répandue – aucunement contraire à nos obligations internationales (voir infra).
Des garanties procédurales sont prévues au profit de la personne concernée :
– la perte de nationalité ne peut intervenir que si le Gouvernement a adressé à l’intéressé une injonction de cesser son activité. Une forme de « droit de repentir » lui est ainsi accordée. Le délai pour donner suite à cette injonction est fixé par celle-ci. Il ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, en application du deuxième alinéa de l’article 23-8 ;
– l’injonction doit préciser les motifs de droit et de fait qui la justifient et doit être notifiée en la forme administrative ou par lettre recommandée. À défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel (article 60 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française) ;
– l’intéressé doit avoir été entendu ou appelé à produire ses observations (article 27-3) ;
– la perte de la nationalité française prend la forme d’un décret en Conseil d’État. En cas d’avis défavorable du Conseil d’État, le décret de perte ne peut être qu’un décret en conseil des ministres, en application du troisième alinéa de l’article 23-8. Le décret, quelle qu’en soit la forme, doit être motivé (article 60 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993). Il peut naturellement faire l’objet d’un recours gracieux et d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
Selon les informations transmises à votre rapporteur, aucune procédure n’a jamais été mise en œuvre sur ce fondement depuis 1973.
Historiquement, la déchéance a pris sa physionomie actuelle au cours de la Première guerre mondiale avec les lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917. Elle a été maintenue par la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, qui prévoyait une procédure judiciaire. Celle-ci a été rendue administrative par un décret du 12 novembre 1938. Le code de la nationalité résultant de l’ordonnance du 19 octobre 1945 lui a conservé son caractère administratif, en définissant avec plus de précision les cas de déchéance et en encadrant son prononcé. La loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité a intégré les dispositions du code de la nationalité dans le code civil.
Les dernières modifications significatives de ces dispositions ont été opérées par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et par la loi n° 96-47 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
La déchéance de nationalité est aujourd’hui régie par les articles 25 et 25-1 du code civil.
À la différence de la perte de nationalité, la déchéance ne peut frapper que les Français d’acquisition, et non les Français d’origine. Elle vise à retirer la nationalité française aux Français qui ont acquis cette qualité par décret ou par déclaration en raison de leur indignité ou de leur manque de loyalisme. Toutes les causes d’acquisition sont concernées (naturalisation, déclaration, réintégration, mariage, naissance et résidence en France ou effet collectif).
La déchéance peut être prononcée par décret pris après avis conforme du Conseil d’État. Depuis un ajout opéré par la loi précitée du 16 mars 1998, elle ne peut être prononcée si elle a pour résultat de rendre l’intéressé apatride.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 25 du code civil permet de prononcer la déchéance de nationalité d’un individu dans quatre cas :
– « 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ». Les crimes et délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation sont les infractions prévues au titre Ier du livre IV du code pénal (articles 410-1 et suivants), qui comprend notamment la trahison, l’espionnage, le mouvement insurrectionnel ou les atteintes au secret de la défense nationale. Les crimes ou délits constituant un acte de terrorisme ont été ajoutés par la loi précitée du 22 juillet 1996. Ils sont définis par les articles 421-11 et suivants du code pénal. Depuis 1999, huit déchéances ont été prononcées pour ce dernier motif, à l’encontre d’individus condamnés pour acte de terrorisme (10) ;
– « 2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal », c’est-à-dire des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
– « 3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national » ;
– « 4° S’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ». On observera que, dans cette dernière hypothèse, aucune condamnation n’est exigée.
La loi précitée du 16 mars 1998 a supprimé un cinquième cas, celui de l’individu « condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement ».
L’article 25-1 du code civil précise les délais applicables.
La déchéance n’est encourue, en premier lieu, que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou, depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
La déchéance ne peut être prononcée, en deuxième lieu, que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
La combinaison de ces deux délais conduit à ce que la déchéance ne puisse être prononcée, au plus tard, vingt ans après l’acquisition de la nationalité.
Un délai spécial est prévu si les faits reprochés à l’intéressé sont ceux visés au 1° de l’article 25, c’est-à-dire en cas de condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme : les deux délais précédents sont portés à quinze ans. Cette exception a été ajoutée par la loi précitée du 22 juillet 1996.
La procédure de déchéance de nationalité est régie par l’article 61 du décret précité du 30 décembre 1993 :
– le ministre chargé des naturalisations doit notifier à l’intéressé les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de nationalité ;
– l’intéressé dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations ;
– à l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’État, que l’intéressé est déchu de la nationalité française.
Le retrait de la nationalité française est prévu par l’article 27-2 du code civil. Il peut intervenir si l’administration découvre a posteriori qu’un étranger ayant été naturalisé ou réintégré dans la nationalité française ne répondait pas aux conditions légales (exemples : absence de résidence en France, défaut d’assimilation, etc.) ou si la décision de naturalisation ou de réintégration a été obtenue par mensonge ou fraude (exemples : dissimulation d’un conjoint ou d’enfants résidant à l’étranger, dissimulation d’une union polygamique, production de documents falsifiés, etc.).
Le retrait ne peut être opéré que par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État. Le décret devant être rapporté peut l’être dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales et, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude.
Le nombre de « décrets rapportant » était de 22 en 2008, 31 en 2009, 42 en 2010, 35 en 2011 et 26 en 2012.
Il ressort de cette présentation de l’état du droit que ce dernier est très insuffisant pour faire face au terrorisme. En effet, seuls les Français d’acquisition possédant une autre nationalité peuvent faire l’objet d’une déchéance de la nationalité française, en application des articles 25 et 25-1 du code civil.
Comme cela a été rappelé en introduction du présent rapport, des terroristes tels que Mohamed Merah, Mehdi Nemmouche, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly n’auraient pas pu faire l’objet d’une telle mesure, les conditions légales n’étant pas remplies.
Cette lacune apparaît d’autant plus regrettable que notre droit permet déjà de priver des Français d’origine, même s’ils ne possèdent pas une autre nationalité, s’ils sont au service d’un autre État ou d’une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, en application de l’article 27-8 du code civil relatif à la perte de nationalité.
Il paraît difficilement compréhensible que l’on puisse priver un Français de naissance de sa nationalité française parce qu’il serait au service de l’État syrien, par exemple, et non parce qu’il combattrait dans les rangs d’une organisation terroriste. Une telle distinction ne paraît pas avoir de sens.
Il est indispensable, pour mettre fin à cette incohérence et assurer la sécurité de nos concitoyens, de créer un nouveau cas de perte de nationalité permettant de faire face à la situation nouvelle créée par l’embrigadement massif de Français dans les rangs d’organisations terroristes agissant en Syrie et en Irak.
II. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI VISE À METTRE UN TERME À CETTE LACUNE ET À CETTE INÉGALITÉ DANS LE RESPECT DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES ET INTERNATIONALES
La présente proposition de loi vise, en premier lieu, à créer un nouveau cas de perte de nationalité à l’encontre de tous les Français, d’acquisition ou d’origine, possédant une autre nationalité et engagé ou se rendant complice d’opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français (article premier). Cette perte de nationalité serait assortie d’une l’interdiction de se maintenir ou de revenir sur le territoire français.
Elle a pour objet, en second lieu, de créer un crime d’indignité nationale, assortie d’une peine complémentaire de dégradation nationale, à l’encontre de tout Français auteur ou complice des mêmes faits (article 2).
Ces deux dispositions sont pleinement conformes aux exigences constitutionnelles et internationales applicables et rapprocheraient notre droit de la nationalité de celui des autres démocraties occidentales.
A. LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CAS DE PERTE DE NATIONALITÉ À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS PORTANT LES ARMES CONTRE LA FRANCE
L’article premier de la proposition de loi crée un nouvel article 23-8-1 au sein de la section 1 du chapitre IV du titre Ierbis du livre Ier du code civil relative à la perte de la nationalité française.
Comme cela a été exposé précédemment, le recours à la perte de la nationalité française présente l’avantage considérable, par rapport à la déchéance de nationalité, d’inclure dans le dispositif les Français d’origine, sans se limiter aux seuls Français d’acquisition.
Le I de cet article prévoit que ce nouveau cas de perte de la nationalité française sera applicable à « tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français ».
Les 1° et 2° dudit I précisent que les faits motivant cette perte de nationalité peuvent s’être produits :
– soit sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;
– soit sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.
La perte de nationalité sera prononcée par décret en Conseil d’État. En cas d’avis défavorable du Conseil d’État, elle devra être prise par décret en conseil des ministres, comme cela est prévu par l’actuel article 23-8 du code civil pour un autre cas de perte de nationalité.
Comme toutes les autres mesures de déchéance (article 25 du code civil) ou de perte de la nationalité française (articles 23-7 et 23-8 du code civil) par décret, la compétence du Gouvernement ne serait pas liée. Le Gouvernement reste libre d’apprécier l’opportunité de prendre ou non un décret de perte de la nationalité française.
La mesure ne pourra avoir pour conséquence de rendre l’intéressé apatride, comme en matière de déchéance de nationalité.
Le II prévoit que, lorsque la perte de nationalité est devenue définitive, c’est-à-dire à compter de l’expiration du délai de recours contentieux ou de la date de la décision juridictionnelle définitive de rejet du recours, et que l’intéressé se trouve sur le territoire national, il faut l’objet d’une mesure d’expulsion vers le pays dont il a la nationalité dans les conditions prévues au titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit l’expulsion.
Le III prévoit que, lorsque la perte de nationalité est devenue définitive et que l’intéressé ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ces dispositions visent à garantir que l’intéressé, compte tenu de la menace grave à l’ordre public et à la sécurité intérieure qu’il représente, sera soit expulsé, soit interdit de territoire.
L’article 2 de la proposition de loi crée un crime d’indignité nationale assorti d’une peine complémentaire de dégradation nationale. Il complète à cette fin la section 2 du chapitre Ier du livre IV du code pénal relative aux « intelligences avec une puissance étrangère » par des nouveaux articles 411-5-1 et 411-5-2.
Ce dispositif s’inspire de celui mis en place au sortir de la Seconde guerre mondiale par le Général de Gaulle, avec l’ordonnance du 26 août 1944 instituant un crime nouveau – l’indignité nationale – puni d’une nouvelle peine – la dégradation nationale – pour sanctionner les Français ayant collaboré avec l’ennemi. Rétroactive, cette ordonnance visait les faits de collaboration perpétrés en France ou à l’étranger (notamment en Allemagne) entre le 16 juin 1940 et le 10 novembre 1945, date de libération totale de notre territoire. Cette infraction ne pouvait être commise que par des Français car il s’agissait de sanctionner un comportement profondément antinational : le citoyen français qui s’était rendu coupable d’hostilité à l’égard de la Patrie était déclaré indigne.
Les faits constitutifs du crime d’indignité nationale étaient définis de façon très large et pouvaient englober des comportements variés tels que les « atteintes à l’unité de la Nation », les « atteintes à la liberté des Français ou à l’égalité entre eux » mais également la propagande en faveur de l’ennemi, le commerce avec l’ennemi, l’appartenance à un organisme de collaboration ou encore l’aide morale ou matérielle apportée à un journal antinational. Finalement, seules les relations amicales voire sentimentales avec l’ennemi n’étaient pas sanctionnées en tant que telles, sauf à avoir été accompagnées d’autres actes eux-mêmes répréhensibles au titre de l’indignité nationale.
La répression du crime d’indignité nationale, à travers la création d’une nouvelle peine, la dégradation nationale, emportait la privation de tous les droits civiques, civils et politiques, certaines incapacités ainsi que certaines interdictions professionnelles. Elle pouvait en outre être assortie de deux peines complémentaires : la confiscation de biens et l’interdiction de résidence sur certaines zones du territoire. La gravité de la peine était caractérisée par son caractère perpétuel sauf amnistie, grâce ou réhabilitation. En l’occurrence, l’ordonnance du 26 août 1944 fut modifiée le 16 décembre 1944 puis abrogée par la loi d’amnistie du 5 janvier 1951.
Votre rapporteur estime qu’il convient aujourd’hui de s’inspirer de cet épisode législatif pour instaurer un nouveau crime d’indignité nationale dans notre code pénal, qui sanctionnerait les Français portant les armes, directement ou indirectement, contre nos militaires et nos forces de sécurité, au nom d’un État ou d’une organisation étrangère contre laquelle notre pays est en guerre.
Certains affirment que s’inspirer de cet héritage de la Libération serait anachronique. Votre rapporteur ne partage pas cet avis. Les principes qui ont inspiré les rédacteurs de l’ordonnance de 1944, à savoir « que la nation fasse le partage des bons et des mauvais citoyens » et que « tout Français qui s’est rendu coupable d’une activité antinationale caractérisée » est « un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs » sont plus que jamais valables et d’actualité.
Ce crime d’indignité nationale serait, à la différence de celui prévu en 1944, puni d’une peine de détention criminelle de trente ans, ce qui n’était pas envisageable à l’époque compte tenu du caractère nécessairement rétroactif du crime créé par l’ordonnance du 26 août 1944 (11).
À cet effet, le nouvel article 411-5-1 définit, en premier lieu, le crime d’indignité nationale. Celui-ci vise les mêmes faits que ceux mentionnés à l’article 23-8-1 créé par l’article premier de la proposition de loi, à savoir le fait, par un Français, de porter les armes ou de se rendre complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français, sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ou sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.
Compte tenu des faits constitutifs de l’infraction, qui correspondent à des actes de trahison accompagnés de violences contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, le crime d’indignité nationale serait puni de trente ans de détention criminelle, de 450 000 euros d’amende et d’une peine complémentaire de dégradation nationale dont le prononcé serait obligatoire.
Le quantum prévu serait donc équivalent à ceux encourus actuellement pour avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, tels que prévus par l’article 411-4 du code pénal.
La dégradation nationale serait une peine complémentaire obligatoirement prononcée par le juge, soit à titre définitif, soit par décision spécialement motivée, pour une durée de trente ans au plus.
Cette peine complémentaire emporterait un certain nombre d’interdictions, incapacité et déchéance de droit pour le condamné équivalentes à celles instaurées en 1944, à savoir :
1° la privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ;
2° la destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ;
3° l’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ;
4° l’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;
5° la destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ;
6° la destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline ;
7° l’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille ;
8° l’interdiction de séjour suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131‑31 du code pénal (défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction accompagnée de mesures de surveillance et d’assistance).
Le dispositif proposé est pleinement conforme aux exigences constitutionnelles, européennes et internationales applicables.
La déchéance de la nationalité française a fait l’objet de deux décisions du Conseil constitutionnel : la décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 (12) et, plus récemment, la décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 (13). Le Conseil constitutionnel a, dans ces deux décisions, validé le dispositif de déchéance de nationalité prévu par les articles 25 et 25-1 du code civil.
Par ailleurs, la perte de la nationalité française par acquisition d’une nationalité étrangère a été jugée conforme à la Constitution (sous réserve d’une disposition contraire à l’égalité entre les sexes) par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, de même que l’imprescriptibilité de l’action du ministère publique en négation de nationalité, dans une décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013.
En 1996, le Conseil a eu à se prononcer sur l’ajout, opéré par la loi précitée du 22 juillet 1996, du motif de déchéance tiré de la condamnation pour un crime ou un acte de terrorisme.
Les requérants contestaient, en premier lieu, la conformité de cette disposition au principe d’égalité devant la loi pénale, au motif que le fait que l’auteur de l’acte ait acquis la nationalité française par naturalisation ou que celle-ci lui ait été attribuée dès la naissance ne justifierait pas une différence de traitement au regard de la loi pénale.
Le Conseil a écarté ce grief en considérant qu’« au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation » et « que, toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité ».
Les requérants contestaient, en second lieu, la conformité de la disposition contestée au principe de nécessité des peines, en faisant valoir qu’elle serait assimilable à une sanction ni nécessaire ni utile à la protection de l’ordre public.
Le Conseil a également rejeté ce grief, jugeant qu’« eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, cette sanction a pu être prévue sans méconnaître les exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
En 2015, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S., déchu de sa nationalité française par un décret du 28 mai 2014 à la suite d’une condamnation en 2013 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, dont il a été saisi par le Conseil d’État.
La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l’article 25 du code civil et sur l’article 25-1 du code civil relatif aux délais.
Le Conseil a, à nouveau, rejeté le grief tiré de la violation du principe d’égalité. Il s’est référé à sa décision de 1996 et a précisé, s’agissant de l’allongement des délais à quinze ans opérés par la loi du 23 janvier 2006 pour les faits ayant conduit à une condamnation pour un crime ou un délit d’acte de terrorisme, que le délai prévu ne portait pas atteinte au principe d’égalité car il ne concernait que des faits d’une gravité toute particulière. Il a cependant précisé que ce délai ne saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité entre les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance.
Le Conseil a écarté le grief tiré de la violation des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, confirmant sa décision de 1996.
Il a également écarté le grief soulevé par une association intervenante relatif à la violation de la vie privée, qu’il a jugé inopérant au motif que la nationalité ne relève pas de la vie privée. Enfin, il a rejeté le grief tiré de l’atteinte aux situations légalement acquises, qu’il a jugé manquant en fait en l’absence de tout effet rétroactif.
b. La décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 relative à la perte de la nationalité française par acquisition d’une nationalité étrangère
Dans sa décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 (14), le Conseil constitutionnel a examiné la conformité aux droits et libertés, que la Constitution garantit, de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, relatif à la perte de la nationalité française par acquisition d’une nationalité étrangère.
Cette disposition, qui n’est plus en vigueur mais qui était applicable dans le cadre de l’affaire ayant suscité la question prioritaire de constitutionnalité adressée au Conseil constitutionnel, prévoyait que « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». Une distinction était cependant opérée, dans son application, selon le sexe de l’intéressé, car l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 précisait que : « Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français. Cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis une nationalité étrangère après l’âge de cinquante ans ».
La perte de la nationalité française pour acquisition d’une nationalité étrangère figure, depuis 1993, à l’article 23 du code civil, mais dans une rédaction très différente : la perte n’est plus automatique mais est subordonnée à une déclaration expresse de l’intéressé. Elle a par conséquent perdu le caractère automatique et de sanction qu’elle avait dans la rédaction soumise à l’examen du Conseil.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « de sexe masculin » étaient contraires au principe d’égalité entre les sexes et que, pour le surplus, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ».
Le Conseil a donc jugé qu’une disposition prévoyant la perte de la nationalité française d’un Français, y compris de naissance, à titre de sanction et, le cas échéant, contre sa volonté, était conforme à la Constitution. Il est erroné d’affirmer, comme l’a fait le Gouvernement lors de l’examen de la précédente proposition de loi de votre rapporteur le 4 décembre 2014 qu’une « déchéance prononcée à l’encontre d’une personne née française serait immanquablement jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel » (15).
c. La décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013 relative à l’imprescriptibilité de l’action du ministère public en négation de nationalité
Dans sa décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013 relative à l’imprescriptibilité de l’action du ministère public en négation de nationalité (16), le Conseil constitutionnel a examiné la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 29-3 du code civil relatif à l’action en contestation de nationalité.
Cette disposition permet au ministère public d’assigner toute personne – que la nationalité française lui ait été attribuée à la naissance ou qu’elle soit devenue française – devant les juridictions judiciaires afin de faire juger qu’elle n’a point la qualité de Français. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette action est imprescriptible.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette imprescriptibilité n’était contraire ni à la garantie des droits ni au principe d’égalité, aucun principe ni aucune règle constitutionnelle n’imposant que l’action en négation de nationalité soit soumise à une règle de prescription.
Le dispositif prévu à l’article premier de la proposition de loi est conforme aux exigences constitutionnelles résultant de ces décisions.
Le grief tiré de la violation du principe d’égalité est évidemment inopérant à son égard, puisque la perte de nationalité présente précisément l’avantage d’éviter toute différence de traitement entre les Français d’acquisition et d’origine. Il s’applique aux Français d’acquisition ou d’origine de manière indifférenciée et constitue, à cet égard, une mesure d’égalité. Avec ce nouveau dispositif, à la différence de la procédure de déchéance de nationalité, peu importe qu’un Français le soit de naissance et même, le cas échéant, depuis quinze générations ou plus, ou qu’il le soit devenu par naturalisation depuis trois ans : ce qui est pris en compte, c’est la gravité des actes de terrorisme perpétrés, et elle seule.
La seule différence de traitement entre Français opérée par l’article 23-8-1 se situe entre les Français mono-nationaux et les Français plurinationaux. Seuls ces derniers peuvent faire l’objet d’une perte de la nationalité en application du nouvel article 23-8-1. Cette distinction est objective et en rapport direct avec l’objet de la mesure concernée : la perte de la nationalité n’a pas les mêmes conséquences pour l’intéressé selon qu’elle le rend apatride ou non.
Votre rapporteur ne considère pas pour autant que rendre apatride un Français serait inconstitutionnel ou contraire au droit international (voir infra), mais il apparaît nécessaire, dans cette hypothèse, de prévoir un dispositif plus contraignant, fondé sur l’intervention d’une condamnation pénale préalable.
Le grief tiré de la violation des principes de nécessité et de proportionnalité des peines devrait également être écarté, pour les mêmes motifs que dans les décisions de 1996 et 2015, eu égard à la gravité toute particulière que revêtent les actes de terrorisme susceptibles d’entraîner la perte de nationalité.
Par ailleurs, il ressort de la décision du 9 janvier 2014 qu’il est constitutionnellement possible de priver un Français de naissance de sa nationalité française à titre de sanction. Ce qui est déterminant est que cette mesure soit proportionnée à la gravité des faits la motivant, ce qui est le cas en l’espèce.
Le dispositif est également compatible avec le droit européen, qu’il s’agisse du droit de l’Union européenne ou de celui du Conseil de l’Europe.
En application des traités européens qui la fondent, l’Union européenne ne dispose, en principe, d’aucune compétence en matière d’attribution ou de retrait de la nationalité, cette question relevant exclusivement de la compétence des États membres.
Toutefois, sur le plan jurisprudentiel, la Cour de justice de l’Union européenne, en réponse à une question préjudicielle qui lui avait été soumise par un tribunal allemand a indiqué dans un arrêt du 2 mars 2010 que si, effectivement, « le droit de l’Union, notamment l’article 17 CE, ne s’oppose pas à ce que l’État membre retire à un citoyen de l’Union européenne la nationalité de cet État membre acquise par naturalisation lorsque celle-ci a été obtenue de manière frauduleuse », c’est « à condition que cette décision de retrait respecte le principe de proportionnalité ». Elle a précisé qu’« il convient lors de l’examen d’une décision de retrait de la naturalisation, de tenir compte des conséquences éventuelles que cette décision emporte pour l’intéressé et, le cas échéant, pour les membres de sa famille, en ce qui concerne la perte des droits dont jouit tout citoyen de l’Union. Il importe à cet égard de vérifier, notamment, si cette perte est justifiée par rapport à la gravité de l’infraction commise par celui-ci, au temps écoulé entre la décision de naturalisation et la décision de retrait ainsi qu’à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer sa nationalité d’origine » (17).
L’article premier de la proposition de loi est compatible avec cette jurisprudence, car la perte de la nationalité encourue est justifiée par la gravité des faits la motivant, conformément au principe de proportionnalité.
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 ne garantit pas en tant que tel un droit à la nationalité.
La Cour européenne des droits de l’homme a cependant jugé, dans une affaire qui portait sur l’acquisition de la nationalité par filiation, Genovese c. Malte (18), que l’accès à la nationalité se situait dans le champ d’application de la protection accordée par la Convention, dans la mesure où il faisait partie de l’identité sociale d’une personne et donc de sa vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention. En l’espèce, le requérant, un ressortissant britannique dont le père était maltais, n’avait pu obtenir la nationalité maltaise parce qu’il était né hors des liens du mariage. La Cour a estimé qu’aune motif raisonnable ni objectif ne justifiait que le requérant soit traité différemment parce qu’il était né hors des liens du mariage et qu’il était victime de discrimination dans la jouissance de son droit au respect de la vie privée.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme interdit par conséquent que l’attribution de la nationalité soit opérée de manière discriminatoire. On peut supposer que cette exigence s’impose également en matière de retrait ou de perte de la nationalité française. Le dispositif retenu par la proposition de loi ne soulève aucune difficulté à cet égard, car il ne comporte aucune discrimination.
Le Conseil de l’Europe a par ailleurs élaboré la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, dont l’article 7 encadre strictement la perte de nationalité de plein droit ou à l’initiative d’un État partie. La France n’est cependant pas partie à cette convention, qu’elle a signée le 4 juillet 2000 mais qu’elle n’a pas ratifiée.
Au niveau international, la perte de la nationalité est encadrée par la convention sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée le 30 août 1961 dans le cadre des Nations unies. La France, si elle a signé cette convention le 31 mai 1962, ne l’a pas ratifiée. Elle n’est donc pas liée par cette dernière.
En outre, ladite convention n’interdit aucunement aux États parties de priver un individu de leur nationalité, y compris si cette privation doit le rendre apatride. Son article 8, paragraphe 3, en particulier, prévoit que :
« Un État contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité, s’il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs prévus à sa législation nationale à cette date et entrant dans les catégories suivantes :
a) Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l’État contractant ;
i. A, au mépris d’une interdiction expresse de cet État, apporté ou continué d’apporter son concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d’un autre État des émoluments, ou
ii. A eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ;
b) Si un individu a prêté serment d’allégeance, ou a fait une déclaration formelle d’allégeance à un autre État, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’État contractant. »
La France, lors de la signature de la convention, a effectué la déclaration prévue par cette disposition, aux termes de laquelle :
« Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française déclare qu’il se réserve d’user, lorsqu’il déposera l’instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l’article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition ».
Le dispositif prévu par l’article premier de la proposition de loi serait donc pleinement compatible avec la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, si la France envisageait un jour de la ratifier. En effet, quand bien même la convention aurait été ratifiée – ce qui encore une fois n’est pas le cas –, la France pourrait faire jouer l’article 8, paragraphe 3.
Il serait même possible d’aller plus loin que ne le fait l’article premier de la proposition de loi et de prévoir un dispositif privant de la nationalité française un Français ne possédant pas d’autre nationalité pour actes de terrorisme (voir infra).
D. CETTE ÉVOLUTION DE NOTRE DROIT DE LA NATIONALITÉ LE RAPPROCHERAIT DE CELUI DES AUTRES DÉMOCRATIES OCCIDENTALES
1. La plupart des États membres de l’Union européenne peuvent priver de sa nationalité leur ressortissant s’étant mis au service d’un autre État
La plupart des États européens prévoient dans leur législation qu’un citoyen qui s’est mis au service d’un autre État peut être privé de sa nationalité. Tel est le cas de l’Autriche, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Grèce, de l’Italie, de la Lettonie et de la Lituanie (19). Parmi ces pays, plusieurs (Autriche, Espagne, Estonie, Grèce, Italie, Lettonie et Lituanie) n’excluent pas que cette privation de la nationalité puisse conduire à l’apatridie.
2. La plupart des État membres privent également de sa nationalité les citoyens ayant porté atteinte à leurs intérêts essentiels
La plupart des États membres de l’Union européenne prévoient également de pouvoir priver de leur nationalité leurs ressortissants s’ils ont été déloyaux ou s’ils ont porté atteinte à leurs intérêts essentiels. C’est le cas en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Lituanie, à Malte, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Slovénie (20). Cette privation de nationalité peut entraîner l’apatridie dans plusieurs de ces États membres (Belgique, Estonie, Grèce, Irlande, Malte, Roumanie et Slovénie).
3. Plusieurs pays ont récemment réformé leur législation relative à la perte de la nationalité dans le cadre de la lutte anti-terroriste
Plusieurs États ont récemment réformé ou envisagent de réformer leur législation relative à la nationalité dans le cadre de la lutte anti-terroriste afin de pouvoir priver de leur nationalité leurs ressortissants qui se sont rendus coupables d’actes de terrorisme.
Seuls les exemples britannique et canadien seront exposés ici, car les réformes concernées sont entrées en vigueur, mais d’autres pays tels que l’Australie et la Belgique, par exemple, envisagent eux aussi de réviser leur législation.
Au Royaume-Uni, le British Nationality Act de 1981 a été réformé par l’Immigration Act de 2014. La réforme, entrée en vigueur le 28 juillet 2014, prévoit que le Home Secretary (le ministre de l’Intérieur) peut priver une personne de la nationalité britannique dans l’une des trois hypothèses alternatives suivantes :
– il est dans l’intérêt public de priver l’intéressé de la citoyenneté britannique et cela ne le rendrait pas apatride ;
– l’intéressé a acquis sa nationalité par la voie de la naturalisation, il est dans l’intérêt public de le priver sa nationalité parce qu’il s’est engagé dans des activités portant gravement atteinte aux intérêts essentiels du Royaume-Uni et le ministre de l’Intérieur a des motifs sérieux de penser que l’intéressé pourrait acquérir une autre nationalité ;
– l’intéressé a acquis sa nationalité par la voie de la naturalisation ou par déclaration et cette acquisition a été obtenue par fraude, mensonge ou dissimulation.
Dans les deuxième et troisième cas, une personne peut être privée de sa nationalité même si cela aurait pour résultat de la rendre apatride. La condition liée à l’intérêt public ainsi que celle relative à l’atteinte aux intérêts essentiels du Royaume-Uni inclut la privation de nationalité pour acte de terrorisme.
Le Royaume-Uni a par ailleurs récemment adopté le Counter-Terrorism and Security Act 2015. Cette loi prévoit la création d’« ordonnances d’exclusion temporaire » (Temporary exclusion orders). Ces actes ont pour effet d’interdire à un citoyen britannique de revenir sur le territoire britannique sauf si son retour a été autorisé au préalable par le Secretary of State ou si son retour est le résultat de son rapatriement par les autorités britanniques.
Ces actes peuvent être pris à l’encontre d’un citoyen britannique par le Secretary of State si l’intéressé remplit les conditions cumulatives suivantes :
– le Secretary of State a des motifs raisonnables de suspecter que l’intéressé a été impliqué dans des activités terroristes à l’étranger ;
– le Secretary of State a des motifs raisonnables de considérer qu’il est nécessaire, pour assurer la protection des personnes au Royaume-Uni d’un risque terroriste, d’imposer une ordonnance d’exclusion temporaire à l’intéressé ;
– le Secretary of State a des motifs raisonnables de considérer que l’intéressé n’est pas sur le territoire britannique ;
– l’intéressé a un droit de résidence au Royaume-Uni ;
– le Secretary of State a obtenu l’autorisation judiciaire de prendre cette ordonnance ou a des motifs raisonnables de considérer que l’urgence justifie que cette ordonnance soit prise sans avoir obtenu cette autorisation.
Une ordonnance temporaire d’exclusion du territoire britannique est valable deux ans, sauf si elle est abrogée avant la fin de ce délai.
L’intéressé doit, pour pouvoir revenir au Royaume-Uni, solliciter un permis de retour auprès du Secretary of State. Ce permis doit préciser à quelle date ou durant quelle période l’intéressé est autorisé à revenir, la manière selon laquelle il est autorisé à revenir et l’endroit où l’intéressé doit se rendre sur le territoire britannique. Le moyen de transport et, le cas échéant, le numéro du vol peuvent être indiqués.
Des obligations spécifiques peuvent être imposées à l’intéressé à son retour. Des sanctions pénales sont prévues si l’intéressé ne respecte pas ses obligations.
Au Canada, la loi renforçant la citoyenneté canadienne a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. Cette loi prévoit de nouveaux motifs pour révoquer la citoyenneté canadienne de personnes ayant la double citoyenneté et coupables de terrorisme, de haute trahison, de trahison ou d’espionnage ou si elles sont membres d’une force armée ou d’un groupe armé organisé engagé dans un conflit armé avec le Canada.
La procédure de révocation a également été simplifiée et accélérée. Auparavant, la procédure comportait trois étapes faisant intervenir trois acteurs différents : le ministre de la Citoyenneté et de l’immigration, la Cour fédérale et le gouverneur en conseil. Désormais, le gouverneur en conseil n’aura plus de rôle à jour et les décisions seront rendues, dans la majorité des cas de révocation, par le ministre de la Citoyenneté et de l’immigration ou son délégué.
Votre rapporteur a présenté plusieurs amendements visant, d’une part, à améliorer le dispositif proposé et, d’autre part, à le compléter afin de pouvoir faire perdre la nationalité française aux Français condamnés pour actes de terrorisme, même s’ils ne possèdent pas une autre nationalité.
Plusieurs des amendements présentés par votre rapporteur visaient à étendre le champ du dispositif proposé ainsi qu’à le consolider, afin de renforcer sa sécurité juridique.
Votre rapporteur a proposé de compléter l’article premier de la proposition de loi afin de pouvoir priver un Français de sa nationalité également s’il a pris part à des opérations armées contre les forces armées ou de sécurité françaises de nos alliés membres de l’Union européenne ou de l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ainsi que contre leurs ressortissants.
Cette extension s’inspirait de l’article 414-8 du code pénal, qui prévoit que les crimes de trahison et d’espionnage et le délit d’atteinte à la sécurité des forces armées sont également constitués lorsqu’ils ont été commis au préjudice des États membres de l’OTAN.
Votre rapporteur a également proposé que le décret de perte de la nationalité française pris en application du nouvel article 23-8-1 du code civil soit après avis conforme du Conseil d’État (comme le prévoit l’article 25 du code civil en matière de déchéance), et non plus par décret en Conseil d’État ou, en cas d’avis défavorable de ce dernier, par décret en conseil des ministres (comme le prévoit l’article 23-8 du code civil pour un autre cas de perte de nationalité).
Ce changement aurait accordé une garantie supplémentaire au profit de l’intéressé, supérieure à celle prévue pour le Français qui perd sa nationalité française en application de l’actuel article 23-8 du code civil, pour lequel le Gouvernement peut passer outre un avis défavorable du Conseil d’État.
Votre rapporteur a aussi déposé un amendement modifiant l’article 27-3 du code civil afin de renforcer les garanties procédurales accordées à l’intéressé. L’article 27-3 du code civil prévoit en effet que les décrets de perte de nationalité prévus par les articles 23-7 et 23-8 du même code ainsi que les décrets de déchéance de la nationalité française sont pris « l’intéressé entendu ou appelé à produire ses observations ». L’amendement visait à étendre cette garantie importante aux décrets de perte de la nationalité susceptibles d’être pris en application des nouveaux articles 23-8-1 et 23-8-2 (sur ce nouvel article, voir infra).
Il convient de préciser que l’article 59 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit, au sujet de la perte de nationalité régie par l’article 23-7 du code civil, que lorsque le domicile de l’intéressé est inconnu, un avis informatif est publié au Journal officiel et que l’intéressé dispose alors d’un délai d’un mois à dater de la publication dudit avis pour faire parvenir ses observations en défense. Une procédure identique pourrait être prévue pour les pertes de la nationalité française prévues par les nouveaux articles 23-8-1 et 23-8-2 du code civil.
Votre rapporteur a également déposé un amendement de coordination visant à modifier l’article 23-8-9 du code civil afin de préciser à quelle date la perte de nationalité prend effet. Cette date serait celle du décret, comme pour les autres cas de perte de nationalité intervenant par décret prévus par les actuels articles 23-4, 23-7 et 23-8 du même code.
B. LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CAS DE PERTE DE LA NATIONALITÉ INCLUANT ÉGALEMENT LES FRANÇAIS MONO-NATIONAUX
Votre rapporteur a proposé de créer, en complément du dispositif initialement proposé, un nouveau cas de perte de la nationalité française, applicable aux Français d’origine comme d’acquisition, qu’ils possèdent une autre nationalité ou non, dès lors qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.
Un nouvel article 23-8-2 aurait été inséré à cette fin au sein du code civil. Cette perte serait prononcée par un décret pris après avis conforme du Conseil d’État, comme en matière de déchéance de nationalité (article 25 du code civil).
Comme cela a été exposé précédemment, la privation de la nationalité française pour actes de terrorisme a été expressément validée par le Conseil constitutionnel à deux reprises, dans ses décisions n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 et n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme ».
Le fait que cette perte de nationalité puisse avoir pour conséquence de rendre l’intéressé apatride, s’il ne possède pas une autre nationalité, ne paraît pas soulever de difficulté particulière, tant au regard de la jurisprudence constitutionnel que du droit international.
La perte de nationalité prévue par l’article 23-8 du code civil (qui vise le Français apportant son concours à l’armée ou au service public d’un autre État ou à une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, malgré l’injonction du Gouvernement de cesser son activité) peut d’ailleurs déjà rendre un Français apatride.
En effet, comme cela a été exposé précédemment, le droit international n’interdit pas à la France de rendre l’un de ses ressortissants apatrides :
– la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée dans le cadre des Nations unies, a été signée par la France, le 31 mai 1962, mais n’a jamais été ratifiée. Elle ne lie donc la France ;
– même si la France décidait de ratifier un jour cette convention, celle-ci n’interdit pas aux États parties de priver un individu de sa nationalité, y compris si cette privation doit le rendre apatride, si cette privation est motivée par un manque de loyalisme envers l’État concerné ou s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiel de l’État concerné ou encore s’il a manifesté par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’État contractant (article 8, paragraphe 3). La France, lors de la signature de la convention, a effectué une déclaration par laquelle elle a indiqué qu’elle se réservait le droit d’user, en cas de ratification, de la faculté qui lui est ouverte par l’article 8, paragraphe 3.
Il ne fait pas de doute qu’un acte de terrorisme relève d’un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts de l’État concerné (21).
Selon votre rapporteur, le nouvel article 23-8-2 du code civil proposé aurait donc été parfaitement compatible avec le droit international et la jurisprudence constitutionnelle.
La Commission a adopté deux amendements de suppression des articles 1er et 2 de la proposition de loi, présentés par MM. Coronado et Molac et ne s’est pas ralliée aux propositions d’amélioration de votre rapporteur présentées ci-dessus.
Au cours de sa séance du mercredi 25 mars 2015, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Philippe Meunier, la proposition de loi qu’il a déposée visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité (n° 2570).
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’est engagée.
M. Alain Tourret. Monsieur le président, votre communication nous permettra de mieux réfléchir à une situation bien difficile.
Nous avons lutté dans notre histoire contre les nihilistes et les anarchistes, qui se rendaient responsables d’atteintes à l’ordre public aussi importantes que celles que commettent les djihadistes. Or il n’a pas été jugé utile, à l’époque, de transformer le code pénal. Une exception a été faite en 1944 : elle n’a pas été reprise lors de la guerre d’Algérie, notamment contre l’OAS, bien que cela eût été concevable.
En 1944, le crime d’indignité nationale vise plus les collaborateurs, dans le cadre de règlements de comptes politiques, que les auteurs de crimes. C’est en 1951 qu’on y a renoncé – il a notamment visé Sacha Guitry et Arletty.
Faut-il prévoir de nouvelles incriminations ? Des peines qui ont disparu pourraient également être réactivées : la déportation, les travaux forcés, les galères, la confiscation des biens, le bannissement ou l’ostracisme. Je rappelle qu’on a beaucoup hésité, s’agissant de l’ex-maréchal Pétain, entre le droit pénal général et le bannissement. Il a été condamné à mort. L’histoire de France compte des bannis célèbres : Villon, Charles X, Déroulède.
Je ne pense pas qu’il faille créer de nouvelles infractions : les moyens prévus, notamment dans le cadre de la future loi sur le renseignement, pour poursuivre ceux qui attaquent à l’heure actuelle la République, me semblent plus efficaces et consensuels.
Faut-il transformer des infractions spéciales en infractions générales ? Ce serait une erreur. Nous devons rester dans le cadre de la loi de 1881 et ne pas passer vers le droit pénal général. Je suis très inquiet de voir qu’on emprisonne de plus en plus pour délit d’opinion : c’est très perturbant. Certes, me direz-vous, Brasillach a été condamné à mort et exécuté pour délit d’opinion : François Mitterrand m’a dit un jour que cette condamnation avait été la pire faute politique jamais commise.
Quant à la perte des droits civils et civiques, elle est déjà prévue : son champ peut être étendu, comme peine principale ou comme peine complémentaire. C’est vers une telle solution qu’il convient à mes yeux de nous orienter si nous voulons être efficaces.
Créer une nouvelle incrimination d’indignité nationale ne servirait pas à grand-chose.
M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le président, comme vous l’avez souligné dans votre communication, dont j’ai apprécié le contenu, les sociétés ont toujours cherché à désigner et punir ceux qui s’excommunient, c’est-à-dire qui se retranchent de la communion nationale.
Les cités antiques étant plus petites, elles se trouvaient davantage fragilisées par les comportements erratiques ou déviants : c’est pourquoi les solutions alors proposées étaient radicales. On a ainsi proposé à Socrate de partir ou de boire la ciguë ; il a préféré le poison. Aristote, placé devant le même dilemme, a préféré partir, considérant que deux crimes de lèse-philosophie dans la même cité, c’était beaucoup ! Cette réflexion traverse donc les siècles.
Je n’ai rien à ajouter à votre présentation de l’application de l’ordonnance de 1944, ordonnance qui a « déçu », selon le mot de Mme Simonin au terme de ses travaux, la fragilité juridique du dispositif ayant donné les clés de son application aux tribunaux. Ceux-ci en ont fait ce qu’ils ont voulu, les lampistes ayant été, en fin de compte, plus condamnés que les organisateurs du crime visé par l’ordonnance. Cette injustice générale a fait l’objet d’un éditorial, cité par Mme Simonin, d’Albert Camus, éditorial écrit dès janvier 1945, c’est-à-dire quelques jours seulement après la mise en œuvre de l’ordonnance : l’écrivain s’y interrogeait sur les personnes visées par le dispositif. Les débordements observés ont fait dévier l’ordonnance de son objectif. C’est un point d’insatisfaction, dont il faut tirer la conséquence suivante : la solidité de la rédaction du texte adopté fera une grande part de son efficacité et donc de son succès.
Vous soulignez également que les circonstances ont changé et qu’il serait inopérant de plaquer sur la situation actuelle un contexte historique radicalement différent puisque datant de soixante-dix ans. Or la proposition de loi de M. Meunier ne plaque ni les concepts ni les circonstances de l’époque sur la situation actuelle. Simplement, notre société recherche, comme toutes les sociétés, le moyen de sanctionner les comportements erratiques et déviants qui, non seulement, excluent leurs auteurs de la communauté nationale mais, de plus, la combattent dans ses principes. Comme vous l’avez souligné vous-même, monsieur le président, les attentats de janvier sont une attaque contre les principes les plus fondamentaux de la République, que sont la liberté d’expression, la laïcité, l’autorité publique et l’égalité des croyances.
À mes yeux, le droit actuel ne suffit pas pour traiter de telles attaques, dont la gravité doit nous conduire, pour condamner leurs auteurs, à inventer des outils qui n’existent pas encore ou existent insuffisamment. C’est le point sur lequel je me distingue de M. Tourret.
Enfin, le caractère symbolique du dispositif doit-il être considéré comme une faiblesse ? Vous vous interrogez sur l’efficacité réelle de l’incrimination prévue. Je pense qu’une République, une cité ou une organisation politique quelconque gagne toujours à rappeler les conditions à remplir pour en faire partie, même si cela n’emporte pas de conséquences pratiques spectaculaires. De plus, la proposition de loi ne se contente pas du symbole pur : son adoption emporterait des conséquences.
S’agissant de la fin du XIXe siècle, nous avons tous à l’esprit la création des « Brigades du Tigre », visant à combattre les anarchistes. Nous devons nous montrer capables, lorsqu’il le faut, de décider d’écarter de la communauté nationale des personnes qui sont dans une opposition radicale à ce qu’elle représente. La solidité juridique de la proposition de loi repose sur la définition très claire de ceux qu’elle vise, à savoir tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français.
Le texte pose également de manière satisfaisante la question de l’apatridie. La France n’ayant pas ratifié la convention de 1961, celle-ci ne s’applique pas en droit français.
Assumons-nous le fait que les circonstances actuelles sont, sinon similaires, du moins comparables dans leur portée à d’autres circonstances tragiques de notre histoire ? La portée de ces crimes justifie-t-elle la création de nouvelles dispositions ? À ces deux questions, je réponds oui.
C’est la raison pour laquelle je soutiens la proposition de loi de M. Meunier.
Mme Cécile Untermaier. Monsieur le président, je tiens à vous féliciter de la qualité de votre communication, qui nous permet de jeter un regard éclairé sur le texte que nous examinons ce matin.
Si la proposition de loi pose une question importante, toutefois, elle envisage l’avenir à partir du passé. Serait-il efficace de construire la France de demain en réactivant l’indignité nationale, une peine infamante prévue par les résistants français à une époque radicalement différente de la nôtre ?
Je regrette que cette proposition ne puisse nous aider à répondre au défi mondial que constitue le terrorisme et plus généralement aux problèmes majeurs que nous rencontrons. Elle n’aura aucun effet ni dissuasif ni correctif sur des individus prêts à sacrifier leur vie pour des valeurs éloignées des nôtres. Non seulement elle n’aurait pas pu éviter les attentats du mois de janvier dernier, mais elle pourrait avoir l’effet inverse. En effet, l’assimilation qu’elle induit avec la libération du territoire au sortir de la Seconde Guerre mondiale pourrait laisser penser à nos concitoyens, de manière dangereuse ou fallacieuse, que, de nouveau, deux France s’opposent.
Le terrorisme est le fait d’individus qui ne représentent ni la France ni même une partie de celle-ci. Ils ne prétendent ni ne veulent du reste la représenter. Le droit pénal actuel offre des outils suffisants pour réprimer leurs actes. La vraie question qui se pose à nous, si nous voulons nous montrer efficaces, est celle de la prévention, dont ne fait pas partie l’arsenal pénal. Chacun le sait, quelle que soit sa dureté, une peine n’empêchera pas un terroriste de passer à l’action.
La future loi sur le renseignement répondra de manière adaptée aux aspects policiers et judiciaires de la question soulevée par la prévention, l’arsenal social et éducatif demeurant essentiel en la matière.
Je crains, comme le président de la Commission, que le dispositif prévu par le texte ne finisse par faire des djihadistes des martyrs, ce dont nous ne voulons à aucun prix. Ne laissons pas nos concitoyens penser que nous aurions trouvé une solution en ajoutant un outil inefficace à l’arsenal pénal existant.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cette proposition de loi, qui met à l’ordre du jour de notre Commission la question du crime d’indignité nationale et de la perte de la nationalité française, s’inscrit dans le cadre d’un calendrier actif en matière sécuritaire : je citerai pour mémoire la récente loi antiterroriste, le plan de lutte contre la radicalisation violente et l’examen prochain de la loi sur le renseignement.
Il importe donc de peser chacune de nos propositions non seulement à l’aune de la gravité de la situation mais également à celle de leur cohérence et de leur efficacité. Deux motifs non exhaustifs justifient à mes yeux le rejet du texte. Le premier est d’ordre juridique. Bien que retravaillée, cette proposition de loi ne présente toujours pas les garanties procédurales nécessaires et suffisantes. Le dispositif, par son manque d’équilibre entre le code civil et le code pénal, ne résistera pas au contentieux. Le second motif est le plus important : il vise l’efficacité du texte, qu’il s’agisse du retrait de la nationalité française ou du crime d’indignité nationale.
Ceux qui font le choix de porter atteinte, par des actes terroristes, aux valeurs républicaines et à la nation n’ont que faire de n’être plus membres de celle-ci. Leur action s’inscrit dans une quête d’une telle folie que la menace de perdre le lien qui les relie à leur pays d’origine ou d’accueil ne provoquera chez eux aucun questionnement sur le sens des actes meurtriers qu’ils prévoient d’exécuter. Enfin, notre connaissance de ceux qui prennent les armes est désormais assez fine pour savoir qu’il ne s’agit pas seulement de descendants d’immigrés ou de doubles nationaux, mais bien souvent d’adultes ou de jeunes sans lien récent avec l’immigration.
Le sujet est donc trop complexe pour être réduit à un public sommairement défini. À ces deux motifs, je pourrais en ajouter un troisième : la création des peines d’exception. Notre histoire comme celle des autres nations n’a pas encore fourni de preuve suffisante permettant de conclure à l’efficacité d’un recul de l’État de droit pour lutter contre la barbarie. La meilleure réponse est, comme l’a souligné le président de la Commission, de redonner force à l’idéal républicain et de réaffirmer la valeur de notre droit en punissant les auteurs des crimes visés par le texte avec les outils du droit pénal commun.
C’est pourquoi le groupe SRC votera contre la proposition de loi.
M. Pascal Popelin. Je vous remercie, monsieur le président, du travail complet que vous avez effectué sur un sujet aussi sensible et complexe.
Il était utile, pour alimenter notre réflexion et forger notre conviction, que nous disposions de références historiques et juridiques documentées.
Cela nous permettra en effet d’éviter deux écueils. Le premier eût été d’écarter d’un revers de main l’idée de réactiver dans notre droit le crime d’indignité nationale ou toute autre forme de peine de dégradation civique, dispositions qui ont accompagné, dans certaines circonstances, l’histoire de la République. Le second eût été de nous précipiter dans le vote d’une loi d’émotion, de réaction ou de circonstance, comme ce fut trop souvent le cas, sous le coup de la légitime indignation, suscitée au sein de la représentation nationale comme dans l’opinion publique, par les actes ignobles perpétrés sur notre territoire par des individus de nationalité française.
Votre travail, monsieur le président, a contribué à forger mon opinion, qui n’était pas arrêtée sur le sujet, même si j’avais déjà pointé des références historiques hasardeuses au cours de l’examen, en séance publique, le 4 décembre 2014, de la première version de cette proposition de loi.
Votre travail a conforté mon sentiment : les idées qui semblent frappées au coin du bon sens peuvent dissimuler des vices, qu’un regard attentif permet de déceler. Autrement dit : l’enfer peut être pavé de bonnes intentions.
Le principe qui vise à retrancher un concitoyen de la communauté nationale, c’est-à-dire à le priver de droits civiques ou à lui interdire l’accès à la fonction publique, avait un sens en 1944, lorsqu’il s’agissait de sanctionner des citoyens qui avaient collaboré avec l’occupant nazi et pour lesquels cette sanction avait incontestablement un impact, puisqu’il s’agissait souvent de notables revendiquant pleinement leur appartenance à la communauté nationale, aspirant même, parfois, à l’incarner. C’était une forme de sanction pour crime politique, que seules les circonstances exceptionnelles pouvaient rendre concevable et justifiable, par dérogation aux principes traditionnels du droit républicain, qui ne reconnaît pas le crime politique. Cette sanction trouvait sa justification, vous l’avez souligné, dans la volonté de mettre à l’écart de la reconstruction du pays et de la démocratie ceux qu’on jugeait indignes d’y participer.
Il n’y a là rien de comparable avec la menace à laquelle notre pays est aujourd’hui confronté. Qui peut en effet imaginer que l’obscurantisme qui embrouille l’esprit d’un terroriste avant, pendant et après son passage à l’acte, lui permettrait d’être impressionné par le risque d’encourir l’indignité nationale ? Au mieux, la perspective d’une telle sanction lui inspirera la même crainte qu’un pistolet à bouchon ; au pire – il serait peu sage d’écarter ce risque –, une telle peine pourrait devenir une sorte de « médaille du travail » du terroriste, dont chacun connaît le goût à figurer sur une liste de martyrs.
M. Urvoas a évoqué la manière dont la République a traité, à la fin du XIXe siècle, les anarchistes : elle leur a refusé le statut de martyrs judiciaires en faisant le choix de les traiter non pas hors de la République et hors de la nation mais comme des accusés de droit commun. Ceux qui nous ont précédés nous ont montré le chemin : les crimes commis aujourd’hui par les terroristes ne méritent pas d’être distingués par une peine particulière. Ils doivent être sanctionnés sans faiblesse pour ce qu’ils sont : des crimes de droit commun, qui exposent leurs auteurs à une large palette de sanctions sévères, lesquelles emportent, d’ailleurs, les mêmes conséquences que l’indignité nationale en matière de droits civiques ou d’accès aux emplois publics.
C’est pourquoi je ne voterai pas une proposition de loi recyclée par rapport à celle que nous avons déjà examinée en décembre 2014.
M. Jean-Frédéric Poisson. Retravaillée et non pas « recyclée », monsieur Popelin : ne soyez pas si méprisant envers le texte.
M. Pascal Popelin. Je n’ai aucune volonté d’être polémique ou méprisant. Je ne fais aucun procès d’intention à l’auteur du texte. Si vous le préférez, j’accepte le mot « retravaillée ». Je crois même me rappeler que c’est la troisième version sur laquelle nous nous penchons : nous en avons déjà refusé deux.
M. Gilbert Collard. J’ai le grand regret, monsieur le président, de vous dire que votre communication m’a passionné. J’en suis désolé. (Sourires.)
Je tiens toutefois à souligner mon désaccord, s’agissant de votre référence aux anarchistes : vous avez oublié les « lois scélérates » – c’est Léon Blum qui a inventé l’expression –, dont Ludovic Trarieux, alors président de la Ligue des droits de l’homme et radical-socialiste, fut à l’origine. Il est vrai toutefois que ces lois n’ont jamais dérogé au droit commun. C’est un trait essentiel pour juger l’histoire de la IIIe République.
Un membre de la commission des Lois connaît-il le texte d’abrogation de l’ordonnance de 1944 ? Je l’ai cherché ; je ne l’ai pas trouvé – l’amnistie de 1951 ne valant pas abrogation. C’est pourquoi je pose la question : ne débattons-nous pas d’une incrimination non abrogée et qui, donc, existerait toujours ?
Il est vrai, monsieur le président, que la notion d’indignité nationale paraît aujourd’hui bien anachronique, car nous renvoyant à une période historique radicalement différente de la nôtre. Toutefois, comme je crois aux symboles, je serai satisfait de savoir que l’homme qui tue un policier à terre n’a pas la même dignité nationale que sa victime. Pour cette seule raison, je serai satisfait du rétablissement du crime d’indignité nationale. Je le répète : l’homme qui abat un policier à terre ne doit pas avoir la même dignité nationale que sa victime.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’ai pas omis les « lois scélérates » : je les évoque dans ma communication écrite. L’expression constitue le titre d’un ouvrage, publié en 1899 et signé par trois auteurs : Francis de Pressensé, Émile Pouget, et « un juriste » qui était, en fait, Léon Blum.
S’agissant de l’ordonnance de 1944, sa rédaction même prévoyait son abrogation puisqu’elle précisait que l’infraction ne pouvait être constatée que six mois après la libération totale du territoire fixée au 8 mai 1945.
La loi d’amnistie de 1951 a amnistié 80 % des condamnés.
M. Patrick Mennucci. J’ai travaillé, au nom du groupe socialiste, sur la première proposition de loi de M. Meunier : le travail réalisé entre les deux textes est incontestable, les débats en commission puis dans l’hémicycle ayant conduit notre collègue à s’apercevoir qu’il s’était engagé dans une impasse juridique.
Le présent texte doit être contesté à la fois sur le plan juridique – votre communication y a contribué, monsieur le président – et sur son opportunité.
Le travail que je conduis avec Éric Ciotti dans le cadre de la commission d’enquête sur les filières djihadistes m’amène à deux considérations sur l’opportunité de cette proposition de loi.
S’agissant du retour des djihadistes, j’entends bien les arguments de M. Meunier. Mais peut-on laisser 400 à 500 individus animés d’une haine des principes républicains aller de la Syrie à la Libye, de la Libye à la Tunisie, voire au Maroc ou au sud de l’Algérie, et agir en tant que militants de l’anti-France à l’extérieur de nos frontières ? Non. Il faut leur permettre de revenir pour les traduire devant la justice et les juger pour les actes qu’ils ont commis. C’est parce que nous nous conformerons à l’État de droit que nous pourrons affirmer notre supériorité morale face à ces gens. Leur place est en prison, à Fresnes, aux Baumettes, à La Farlède, et pour longtemps. Notre commission d’enquête aura d’ailleurs des éléments à apporter sur la question des quartiers d’isolement.
Par ailleurs, votre proposition de loi tend à faire du terrorisme un crime politique, ce qu’il n’est pas à mon sens. On ne saurait accorder une médaille du travail aux djihadistes. Pensez-vous vraiment que les djihadistes français qui crucifient et lapident des femmes redoutent de perdre leur nationalité française ? Pensez-vous vraiment que les membres de Jund al Khalifa, Ansar al Charia, Ansar Dine ou du MUJAO, groupes satellites ou concurrents de DAECH, se soucient de cela ?
Votre proposition de loi est simplement destinée à rassurer l’opinion. Les actions de lutte contre le terrorisme, c’est le Gouvernement qui les mène : loi sur le renseignement, surveillance d’internet, collaboration entre les services de renseignement et les juges, renforcement du renseignement pénitentiaire, dont je tiens à souligner qu’il est beaucoup plus efficace que ce que nous entendons ici ou là.
Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, je ne voterai pas votre texte.
M. Hugues Fourage. Les dispositions de votre proposition de loi ont une connotation historique particulière, ce qui rend leur approche délicate. Par ailleurs, dans votre exposé des motifs, vous replacez ce texte dans le contexte des « attentats qui ont frappé la France à Noël et début janvier 2015 ». Il me paraît un peu dommage de lui donner cette tonalité teintée d’émotion. La question de l’indignité nationale n’est pas une simple question de circonstances.
De notre discussion, qui a d’une certaine manière un caractère transpartisan, je retiens deux dimensions principales : la force du symbole et l’efficacité.
Vous écrivez, monsieur le rapporteur, qu’« il serait proprement scandaleux que de tels individus jouissent des bienfaits et des droits attachés à la qualité de citoyen français, alors même qu’ils bafouent les devoirs les plus élémentaires que l’on doit à sa patrie et à la République. » Nous pouvons effectivement nous poser la question de la force symbolique de la loi dans notre République. Elle est fondamentale, beaucoup d’entre nous l’ont évoquée. Doit-on élaborer des lois en raison de leur force symbolique ? C’est tout l’enjeu de cette proposition de loi.
Un argument de Jean-Jacques Urvoas a particulièrement retenu mon attention : « En effet, si les actes commis par les terroristes impliquent bien un rejet de nos valeurs fondamentales et de nos institutions, ils ne constituent pas pour autant en eux-mêmes un courant d’idées contraires auquel se serait ralliée une partie de la population. Il n’y a en France ni guerre civile, ni programme idéologique de substitution d’une nouvelle conception de la Nation justifiant la protection de la conception actuelle par des techniques de disqualification. » Il m’a convaincu qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la force symbolique de la loi en adoptant cette proposition loi rétablissant l’indignité nationale.
J’en viens à l’efficacité de la loi. Je ne crois pas, mes chers collègues, qu’en votant une loi de cette nature, on puisse empêcher que des actes terroristes soient commis. De même, je n’ai jamais considéré que la peine de mort pouvait empêcher d’une quelconque manière que des meurtres soient commis. Robert Badinter, dans le discours qu’il a prononcé à l’Assemblée nationale pour défendre l’abolition de la peine de mort, a rappelé que, dans la foule rassemblée devant le palais de justice où se tenait le procès de deux meurtriers, l’un des manifestants qui criait « À mort ! » avait commis lui-même des crimes odieux.
Par ailleurs, il faut se demander si, en dehors des dispositions proposées, les actes visés resteraient impunis. Je constate qu’il existe déjà dans notre droit des moyens de les sanctionner de manière claire et précise. Par conséquent, les nouvelles dispositions portées par votre proposition de loi ne me semblent pas nécessaires.
Je ne la voterai donc pas.
M. Guillaume Larrivé. Je n’ai pas co-signé cette proposition de loi, afin de me laisser le temps de la réflexion, mais je la voterai pour une raison de fond, bien mise en avant dans le débat de qualité que nous avons.
Qu’est-ce qu’une nation ? Une communauté de citoyens qui se reconnaissent les uns les autres en tant que tels, dotés de droits et de devoirs mutuels et unis par un contrat social, comme l’a montré la philosophie politique. Lorsque l’un de nos compatriotes va jusqu’à porter les armes contre la France, il fait le choix de s’exclure de la communauté nationale. Je crois profondément que la République française est fondée à reconnaître par un acte positif que ce citoyen s’est exclu de la communauté nationale. C’est le cœur du débat qui nous rassemble ici.
Cela posé, il faut se demander si la peine d’indignité nationale est toujours adaptée aux réalités de notre époque. Je le crois plus que jamais. D’une part, elle renvoie à des principes qui ne dépendent pas de la conjoncture. D’autre part, elle s’inscrit dans un contexte de guerre, une guerre non-conventionnelle, une guerre asymétrique, mais une guerre dans laquelle certains de nos concitoyens ont fait le choix de se déclarer ennemis de la nation en ayant pour projet d’affaiblir voire de détruire la France par la terreur.
La proposition de loi a deux objets. Elle vise, premièrement, à étendre les cas de perte de la nationalité, mesure juridiquement fondée, que je voterai. Elle tend, deuxièmement, à instaurer une peine d’indignité nationale, que j’approuve également.
Je conclurai ce bref propos en m’adressant à ceux et celles qui ont invoqué l’État de droit. L’État de droit n’a pas s’excuser d’être fort. S’il est faible, il n’y a plus d’État et in fine plus de droit. Notre mission en tant que législateurs est de renforcer l’État de droit par divers moyens. Ce texte constitue une réponse à la menace terroriste. Il y en a d’autres, comme le projet de loi relatif au renseignement. Et vous le savez, les députés de l’UMP le voteront pour l’essentiel. Nous avons déjà démontré notre esprit de responsabilité lorsque nous avons voté la loi anti-terroriste de 2014, un esprit de responsabilité que les députés socialistes ont oublié en 2006 puisqu’aucun d’entre eux n’a voté la loi anti-terroriste présentée par Nicolas Sarkozy.
Nous sommes prêts à vous accompagner pour voter les mesures que vous proposez lorsqu’elles nous paraissent utiles mais estimons de notre devoir de les compléter quand cela nous semble nécessaire. C’est ce que se propose de faire ce texte plus que symbolique.
M. Guy Geoffroy. Je voudrais dire à M. le rapporteur toute la satisfaction qui est la mienne de compter parmi les premiers signataires de sa proposition de loi. Vous avez immédiatement compris sa portée, monsieur le président, et avez fait le choix d’introduire son examen par une communication, issue d’un travail très approfondi, d’une grande qualité, que je salue. Je regrette toutefois les conclusions trop hâtives que vous avez pu tirer de vos recherches.
Je vous invite à la modération, chers collègues de l’opposition. L’un de vous a posé la question de savoir si l’adoption de la proposition de loi initiale de Philippe Meunier aurait empêché les drames de début janvier. Je lui renvoie sa question : la loi anti-terroriste de novembre 2014 les a-t-elle évités ? Non. Méfions-nous de tels parallélismes, ils se retournent rapidement contre ceux qui les établissent.
Je confirme à M. Collard – mais M. le président Urvoas l’a déjà dit – que l’ordonnance du 26 août 1944 ne prévoyait l’application de la peine d’indignité nationale que pour une période limitée : elle s’est éteinte d’elle-même. Le fait qu’une loi d’amnistie ait été votée quelques années plus tard n’a rien d’incohérent. Elle est venue effacer ce qui avait été marqué par cette incrimination.
Pascal Popelin a posé une vraie question : les actes auxquels nous sommes confrontés relèvent-ils du crime ordinaire ? Si ce n’est pas le cas, y a-t-il lieu de marquer de manière différence la riposte de la nation ?
M. Pascal Popelin. Vous considérez qu’il s’agit de crimes politiques ?
M. Guy Geoffroy. Ne nous racontons pas d’histoires : le raisonnement politique de ceux qui commettent ces crimes est nul. Toutefois, leur objectif est bien de tuer la nation en portant atteinte à certaines de ses représentations très puissantes.
Ne vous fourvoyez pas, chers collègues : considérez plutôt cette proposition de loi comme un élément supplémentaire dans un ensemble que nous essayons de construire ensemble pour montrer que l’État de droit dans notre pays ne recule pas et pour rassembler notre peuple autour de valeurs fondamentales que nous voulons continuer de défendre après le 11 janvier. Le relâchement de notre vigilance aurait de graves conséquences. Il est bon d’envoyer des messages forts s’agissant des symboles qui fondent notre République.
En refusant cette proposition de loi, vous commettez l’erreur de ne pas répondre aux attentes que nos concitoyens ont à l’égard de la représentation nationale.
Cette proposition de loi, bien retravaillée, n’est pas un texte de circonstance. C’est un texte qui tient compte des circonstances, nuance qui ne me semble pas négligeable. C’est la raison pour laquelle je souhaite qu’il soit adopté.
Mme Élisabeth Pochon. Je me pose une question à laquelle je n’ai pas vraiment de réponses, peut-être pourrez-vous m’en fournir. Ce n’est pas la première fois que la nation est mise en péril par des actions terroristes. Nous avons déjà été confrontés aux terrorismes basque et corse, à Action directe, mais personne n’a alors invoqué la déchéance de nationalité. Pourquoi la met-on en avant aujourd’hui ?
Je suis d’accord avec vous, monsieur Geoffroy, pour dire que le message qu’une telle proposition envoie à la nation a son importance. Simplement, je ne l’envisage pas de la même manière que vous. Il me semble de nature à stigmatiser une partie de la population, en raison de son appartenance religieuse.
M. le rapporteur. Monsieur le président, je tiens à vous dire que j’ai apprécié votre communication : elle me renforce dans ma détermination à défendre cette proposition de loi.
« Dans l’esprit des juristes de la Résistance », soulignez-vous à la page 17, « l’instauration du crime d’indignité nationale devait donc répondre à une double finalité : juger les vaincus, accusés d’avoir déshonoré la République ; obtenir l’adhésion des populations libérées aux institutions mises en place par le GPRF, autrement dit à la restauration de la République à travers la diffusion d’une morale politique permettant de distinguer le "bon" citoyen du "mauvais". » J’approuve totalement ces principes. Vous affirmez encore – élément essentiel – que le contenu de cette proposition de loi est un choix juridiquement possible.
Rappelons que le président de la République et le Premier ministre ont manifesté la volonté que le pouvoir exécutif noue un dialogue constructif avec le pouvoir législatif, notamment avec les membres de l’opposition. À cette volonté, monsieur le président, nous répondons par cette proposition de loi. Semblable texte ne peut manquer de provoquer des divergences entre nous mais elles sont susceptibles d’être gommées par le dépôt d’amendements. Or les deux seuls amendements déposés par la majorité sont des amendements de suppression. Cela me paraît désolant au regard de ce que doit être l’union nationale.
Monsieur Tourret, j’ai beaucoup de respect pour vos analyses. Vous n’êtes pas d’accord avec l’introduction d’une peine d’indignité nationale, et c’est votre droit, d’autant que vous avez fait preuve d’honnêteté intellectuelle. Toutefois, je déplore qu’à l’instar de vos collègues de la majorité, vous n’ayez dit aucun mot de l’article 1er concernant la perte de nationalité. Les attentats du mois de janvier ont-ils changé votre positionnement politique ? C’est à vous de me le dire. Par ailleurs, M. Poisson a souligné que la peine d’indignité s’appliquait aux Français portant les armes. Un Sacha Guitry ne pourrait donc être inquiété.
Madame Untermaier, cette proposition de loi relève selon vous du passé. Je viens de rappeler que les principes sur lesquels elle repose sont toujours d’actualité. Vous avez insisté sur le rôle primordial que joue à vos yeux la prévention. Je laisse nos compatriotes réfléchir à vos propos. Ils jugeront par eux-mêmes si cela leur paraît suffisant pour régler le problème du terrorisme qui frappe sur notre territoire, en Europe et dans le monde entier.
Madame Chapdelaine, le problème n’est pas de savoir si les djihadistes veulent ou non rester français, mais s’ils doivent le rester. Les Français ne veulent plus partager leur territoire avec ces personnes : elles n’ont plus à faire partie de la communauté nationale car elles ont souillé la République en portant les armes contre elle.
Monsieur Popelin, nous ne réagissons pas en fonction de nos émotions. Cette proposition de loi, je le rappelle, a été débattue en 2014. Le groupe UMP n’a pas attendu les attentats de Noël et du mois de janvier pour la déposer. Si nous l’avons à nouveau défendue, c’est tout simplement que M. Hollande et M. Valls ont exprimé le souhait de travailler avec l’opposition. À vous d’en tirer les conséquences et d’assumer vos responsabilités politiques.
Aux interrogations de M. Collard sur la durée d’application de l’ordonnance, vous avez parfaitement répondu, monsieur le président. Je n’y reviendrai pas.
Les impasses juridiques qu’a évoquées M. Mennucci sont réelles, mais elles ont pu être contournées par des amendements, qui ont malheureusement été rejetés. Quant à la volonté d’empêcher le retour des djihadistes, elle n’est pas incompatible avec la possibilité qu’ils fassent l’objet de poursuites.
Monsieur Fourage, je ne remets pas en cause votre honnêteté intellectuelle. Votre raisonnement se tient.
Monsieur Larrivé, vous avez raison d’affirmer que, plus que jamais, il est important d’appeler à la nécessité de sauvegarder notre cohésion nationale dans ces moments extrêmement difficiles que nous traversons. Et, monsieur Geoffroy, vous avez aussi raison de souligner que les raccourcis hâtifs ne servent pas le débat. Cette proposition de loi n’a pas pour objet de donner dans la politique politicienne mais d’essayer de répondre à la main tendue par le président de la République et le Premier ministre au mois de janvier.
Enfin, madame Pochon, je ne peux nier que le terrorisme basque a été très sanglant. Mais il y a une différence majeure.
Mme Élisabeth Pochon. Huit cents morts !
M. le rapporteur. Les conséquences des actes terroristes que nous connaissons aujourd’hui en France et dans le monde ne sont pas de même nature.
La Commission en vient à l’examen des articles.
Article 1er
(art. 23-8-1 du code civil [nouveau])
Perte de la nationalité française de tout individu ayant pris les armes contre les forces françaises ou un civil français
Cet article vise, comme cela a été exposé précédemment, à créer un nouveau cas de perte de la nationalité française à l’encontre des Français ayant pris les armes contre la France et ses ressortissants. Il insère, à cette fin, un nouvel article 23-8-1 au sein de la section 1 du chapitre IV du titre Ierbis du livre Ier du code civil relative à la perte de la nationalité française.
Le I de cet article prévoit que ce nouveau cas de perte de la nationalité française sera applicable à « tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français ». Votre rapporteur avait déposé un amendement visant à étendre les faits visés aux opérations menées contre les alliés de la France, c’est-à-dire les États membres de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ainsi que contre leurs ressortissants.
Les 1° et 2° dudit I précisent que les faits motivant cette perte de nationalité peuvent s’être produits :
– soit sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;
– soit sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.
La perte de nationalité aurait été prononcée par décret en Conseil d’État. En cas d’avis défavorable du Conseil d’État, elle aurait dû être prise par décret en conseil des ministres, comme cela est prévu par l’actuel article 23-8 du code civil pour un autre cas de perte de nationalité. Votre rapporteur avait déposé un amendement visant à substituer à cette procédure un décret pris après avis conforme du Conseil d’État, comme en matière de déchéance de la nationalité.
La mesure ne pourrait avoir pour conséquence de rendre l’intéressé apatride, comme en matière de déchéance de nationalité. Votre rapporteur avait déposé un amendement spécifique sur ce point, visant à créer un cas distinct de perte de la nationalité, fondé sur une condamnation préalable pour acte de terrorisme, qui aurait fait l’objet d’un nouvel article 23-8-2 du code civil.
Le II prévoit que, lorsque la perte de nationalité est devenue définitive, c’est-à-dire à compter de l’expiration du délai de recours contentieux ou de la date de la décision juridictionnelle définitive de rejet du recours, et que l’intéressé se trouve sur le territoire national, il faut l’objet d’une mesure d’expulsion vers le pays dont il a la nationalité dans les conditions prévues au titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit l’expulsion.
Le III prévoit que, lorsque la perte de nationalité est devenue définitive et que l’intéressé ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Votre rapporteur avait déposé un amendement visant à préciser que l’intéressé pourrait également faire l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Contre l’avis de votre rapporteur, la Commission, adoptant un amendement de suppression de MM. Coronado et Molac, a supprimé le présent article.
*
* *
La Commission est tout d’abord saisie de l’amendement CL2 de M. Sergio Coronado, tendant à supprimer l’article.
M. Sergio Coronado. Je voudrais faire amende honorable. Dans l’article 1er de la présente proposition de loi, il est question de « perte » et non plus de « déchéance » de nationalité comme dans sa version antérieure. Cela dit, je ne suis pas certain que ce changement de terminologie implique une refonte totale de l’économie du texte, notamment du droit de la nationalité comme vous prétendiez le faire, j’y vois plutôt une astuce.
Je perçois, à l’œuvre dans cet article comme dans l’article 2 relatif à la peine de dégradation nationale, une volonté de produire des sujets de non-droit, ce que M. le président a bien souligné dans sa communication. Je ne suis pas sûr, en tout cas, que cela constitue un renforcement de notre État de droit.
Mon opposition à ce texte est une opposition de principe. Vous jouez avec des symboles constitutifs de notre nation sans apporter de solution efficace pour lutter contre le défi que constitue le terrorisme en France et dans le monde.
J’invite mes collègues à voter cet amendement de suppression de l’article 1er.
M. le rapporteur. Cet amendement de suppression révèle une profonde méconnaissance du sujet. Son exposé sommaire comporte de très nombreuses erreurs, qu’il convient de rectifier.
Il commence par indiquer que l’article 1er « vise à permettre la déchéance de nationalité de toute personne portant les armes contre les forces armées françaises et de police, ou leurs alliés ». Première ligne, première erreur : il s’agit non pas de déchéance mais de perte de la nationalité française. La différence est essentielle puisque, je le répète, la déchéance ne concerne que les Français d’acquisition, alors que la perte concerne aussi bien les Français de naissance que les Français d’acquisition. Notre article rétablit donc une égalité entre Français car, ce qui importe en la matière, je le répète, ce n’est pas de savoir si un Français est français depuis quinze générations ou depuis trois ans, mais la gravité des actes terroristes qu’il a commis, ce qui devrait rassurer Mme Pochon.
Le deuxième paragraphe explique que la loi prévoit déjà la possibilité de déchoir de leur nationalité française les personnes condamnées pour crime à au moins cinq années d’emprisonnement. C’est inexact : cette disposition, qui figurait au 5° de l’article 25 du code civil, a été supprimée par la loi du 16 mars 1998, il y a donc plus de dix-sept ans.
Troisième paragraphe, troisième erreur : « la proposition de loi ne couvrirait pas de cas nouveaux » et serait une mesure d’« affichage ». Pas du tout : elle permet de priver de la nationalité française les Français de naissance ayant perpétré des actes de terrorisme, ce que le droit actuel ne prévoit pas. Loin d’être une mesure d’affichage, elle comble une grave lacune de notre droit.
Quatrième paragraphe, quatrième erreur : la garantie temporelle prévue à l’article 25-1 du code civil serait abrogée. L’article premier n’abroge en rien l’article 25-1, cette garantie restera donc valable pour la déchéance de nationalité. Simplement, elle ne saurait s’appliquer en matière de perte puisque celle-ci concerne aussi les Français de naissance. Quant à l’absence d’avis conforme du Conseil d’État, cette critique, fondée, tombe, compte tenu de mon amendement CL12, que j’invite M. Coronado à adopter.
Au cinquième paragraphe, pas d’erreur, mais un constat que nous partageons entièrement et qui fonde, précisément, la proposition de loi et mon amendement CL6. Il faut en effet modifier notre droit pour priver de la nationalité les Français de naissance et les Français qui ne possèdent pas une autre nationalité. Ce qu’écrivent les auteurs de l’amendement devrait logiquement les conduire à voter la proposition de loi et mon amendement.
Sixième paragraphe, sixième erreur : cette nouvelle proposition de loi serait quasiment identique à celle débattue en décembre dernier. C’est inexact, elle est très différente de la précédente dans sa version initiale : elle ne vise plus la déchéance mais la perte de nationalité.
Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
M. Pascal Popelin. Nous sommes favorables à l’adoption de cet amendement de suppression de l’article ; nous avons peu évoqué le premier aspect de cette proposition de loi, relatif à la perte de nationalité, car nous nous étions largement exprimés lors de l’examen du précédent texte, la notion d’indignité n’ayant été intégrée que par voie d’amendement au moment de la séance.
M. Guy Geoffroy. Le groupe UMP ne votera pas cet amendement de suppression, car l’article 1er doit être maintenu et les autres amendements à cet article discutés.
Je suis frappé que, pour ce texte comme pour le précédent, les amendements de suppression ne soient pas présentés par des membres du groupe SRC, mais par des députés du groupe écologiste. Est-ce un oubli, ou s’agit-il de laisser les députés écologistes exécuter les basses œuvres ? Les députés socialistes pourraient ainsi proclamer leur accord avec le principe du texte tout en justifiant son rejet pour des raisons liées à ses modalités. Il est plus facile de voter un article de suppression que d’en présenter un soi-même !
M. Olivier Marleix. Le Premier ministre avait su trouver les mots pour toucher chaque député de la Nation lors de son discours du 13 janvier 2015, prononcé à la suite des attentats de Paris ; il avait notamment fait preuve d’ouverture en déclarant sa volonté de travailler avec l’opposition à des mesures législatives. En réalité, le Gouvernement ne déposera pas de texte conçu pour renforcer notre arsenal législatif, à cause de petites raisons tenant aux relations à l’intérieur de la majorité plurielle. Seules des dispositions sur le renseignement seront présentées, et nous verrons d’ailleurs si les voix de l’opposition ne sont pas indispensables à leur adoption. Nous assistons à un mouvement de fermeture qui prouve que le discours du Premier ministre n’était rien d’autre qu’un exercice de communication contenant des promesses qui n’auront aucun lendemain.
Si je comprends bien les propos de députés de la majorité, ce ne serait pas si grave d’être djihadiste et cela ne justifierait pas la perte de la nationalité française. Je suis sidéré par ce discours de banalisation qui se trouve en complet décalage avec les opinions et les votes de nos compatriotes. Ceux qui ont le plus besoin de voir la France affirmer son identité habitent dans les quartiers populaires ; les jeunes Français issus de l’immigration n’en peuvent plus de ce grand amalgame et de la perte des valeurs que vous portez, mes chers collègues de la majorité.
M. Guillaume Larrivé. Je regrette que le Gouvernement n’ait pas souhaité participer aux travaux de notre Commission aujourd’hui. Nous avons eu une discussion dense, éclairée, ce qui n’est pas courant, par une communication ad hoc de notre président, et centrée sur une proposition de loi qui a fait l’objet d’une correspondance entre le chef de l’opposition, M. Nicolas Sarkozy, président de l’UMP, et le Gouvernement. Nous évoluons dans un contexte particulier dans lequel l’ensemble de la communauté nationale devrait se rassembler, et l’absence de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui aurait très bien pu venir débattre avec nous d’une modification des codes civil et pénal, atteste le mépris porté par le Gouvernement à l’opposition sur cette question majeure. Tout cela est extrêmement regrettable !
M. le rapporteur. Monsieur Popelin, l’indignité nationale était intégrée à la proposition de loi précédente.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 1er est supprimé et les amendements CL3 rectifié, CL4 rectifié, CL12 et CL5 du rapporteur tombent.
La Commission examine l’amendement CL6 rectifié du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement insère un nouvel article 23-8-2 au sein du code civil, afin de prévoir un nouveau cas de perte de la nationalité française. Celui-ci concernerait les Français condamnés pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. La perte prendra la forme d’un décret pris après avis conforme du Conseil d’État, comme en matière de déchéance de nationalité.
La privation de la nationalité française pour actes de terrorisme a été expressément validée par le Conseil constitutionnel dans deux décisions du 16 juillet 1996 et du 23 janvier 2015. La perte de nationalité pourra avoir pour conséquence de rendre l’intéressé apatride, s’il ne possède pas une autre nationalité, comme le permet déjà l’article 23-8 du code civil pour le citoyen français qui apporte son concours à l’armée ou au service public d’un autre État ou à une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, malgré l’injonction du Gouvernement de cesser son activité. En effet, contrairement à une idée répandue, le droit international n’interdit pas à la France de rendre l’un de ses ressortissants apatrides ; ainsi, la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée dans le cadre des Nations unies, n’interdit aucunement aux États parties de priver un individu de sa nationalité, y compris si cette privation doit le rendre apatride, si cette privation est motivée par un manque de loyalisme envers l’État concerné ou s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État concerné ou encore s’il a manifesté par son comportement sa détermination à répudier son allégeance envers l’État contractant.
Le nouvel article 23-8-2 du code civil proposé est donc parfaitement compatible avec le droit international et la jurisprudence constitutionnelle.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette successivement les amendements CL7 rectifié et CL10 du rapporteur.
Article 2
(art. 411-5-1 et 411-5-2 du code pénal [nouveaux]
Création d’un crime d’indignité nationale et d’une peine complémentaire de dégradation nationale
Cet article vise, comme cela a été exposé précédemment, à créer un crime d’indignité nationale, assortie d’une peine complémentaire de dégradation nationale, à l’encontre de tout Français auteur ou complice des faits visés à l’article premier.
Il complète à cette fin la section 2 du chapitre Ier du livre IV du code pénal relative aux « intelligences avec une puissance étrangère » par les nouveaux articles 411-5-1 et 411-5-2.
Le nouvel article 411-5-1 définit, en premier lieu, le crime d’indignité nationale. Celui-ci vise les mêmes faits que ceux mentionnés à l’article 23-8-1 créé par l’article premier de la proposition de loi, à savoir le fait, par un Français, de porter les armes ou de se rendre complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français, sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ou sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.
Compte tenu des faits constitutifs de l’infraction, qui correspondent à des actes de trahison accompagnés de violences contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, le crime d’indignité nationale serait puni de trente ans de détention criminelle, de 450 000 euros d’amende et d’une peine complémentaire de dégradation nationale dont le prononcé serait obligatoire.
Le quantum prévu serait donc équivalent à ceux encourus actuellement pour avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, tels que prévus par l’article 411-4 du code pénal.
La dégradation nationale serait une peine complémentaire obligatoirement prononcée par le juge, soit à titre définitif, soit par décision spécialement motivée, pour une durée de trente ans au plus.
Cette peine complémentaire emporterait un certain nombre d’interdictions, incapacité et déchéance de droit pour le condamné équivalentes à celles instaurées en 1944, à savoir :
1° la privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ;
2° la destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ;
3° l’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ;
4° l’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;
5° la destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ;
6° la destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline ;
7° l’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille ;
8° l’interdiction de séjour suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131‑31 du code pénal (défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction accompagnée de mesures de surveillance et d’assistance).
Contre l’avis de votre rapporteur, la Commission, adoptant un amendement de suppression de MM. Coronado et Molac, a supprimé le présent article.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL1 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement tend à supprimer l’article 2.
M. le rapporteur. Je voudrais tout d’abord remercier les auteurs de cet amendement de suppression pour l’excellente suggestion qu’ils ont formulée à la fin de leur exposé sommaire, visant à compléter la liste des peines complémentaires prévues par l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Je l’ai reprise dans l’un de mes amendements, même s’il faut bien reconnaître que les terroristes, en pratique, sollicitent rarement l’autorisation de détenir ou de porter les armes dont ils font usage.
J’émets un avis défavorable à l’adoption de l’amendement.
Ses auteurs font valoir, en premier lieu, que les actes qui seraient réprimés par ce nouveau crime le sont déjà par d’autres infractions, ce qui porterait atteinte à la clarté de la loi et au principe de légalité des délits et des peines. Cette situation est bien connue du droit pénal, et réglée par les principes applicables au concours d’infractions. Lorsque plusieurs qualifications pénales peuvent être retenues pour un même fait, c’est la qualification pénale passible de la peine la plus élevée qui doit être retenue. C’est très courant et cela ne pose aucune difficulté au regard des principes constitutionnels auxquels doit satisfaire notre droit pénal.
Ils s’interrogent, en deuxième lieu, sur le fait que ce crime – il s’agirait d’un crime et non d’un délit comme ils l’écrivent – s’appliquerait aux seuls nationaux. La trahison, dans notre code pénal, ne concerne, par définition, que les Français. Un étranger peut être condamné pour espionnage, pas pour trahison : cela n’aurait guère de sens. Il en va de même pour l’indignité nationale.
En troisième lieu, les auteurs de l’amendement semblent considérer que le prononcé systématique d’une peine complémentaire serait contraire au principe d’individualisation des peines. C’est inexact : en application de la jurisprudence constitutionnelle, le principe d’individualisation des peines n’interdit pas les peines complémentaires obligatoires, qui, si elles sont imposées par la loi, doivent avoir été prononcées par l’autorité judiciaire pour être appliquées. La nature de la peine doit être directement liée à la nature de l’infraction et le juge doit pouvoir la moduler, ce qui est le cas dans cette proposition de loi.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 2 est ainsi supprimé, et l’amendement CL11 du rapporteur tombe.
En conséquence, l’ensemble de la proposition de loi est rejeté, et l’amendement CL8 du rapporteur portant sur le titre est sans objet.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cette proposition de loi sera examinée en séance publique le 2 avril prochain dans le cadre de l’ordre du jour réservé au groupe UMP.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi présentée par M. Philippe Meunier et plusieurs de ses collègues visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité (n° 2570).
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Conclusions de la Commission ___ |
Proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité |
Proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité | |
Article 1er |
Article 1er | |
« Après l’article 23-8 du code civil, il est inséré un article 23-8-1 ainsi rédigé : |
Rejeté | |
« Art. 23-8-1. – I. – Perd la nationalité française tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français : |
||
« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ; |
||
« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement. |
||
« L’individu est déclaré avoir perdu la nationalité par décret en Conseil d’État, sauf si cette mesure a pour effet de le rendre apatride. |
||
« Lorsque l’avis du Conseil d’État est défavorable, la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres. |
||
« II. – Lorsque la mesure mentionnée au I est devenue définitive et que l’intéressé se trouve sur le territoire national, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion vers le pays dont il a la nationalité dans les conditions prévues au titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. |
||
|
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Art. L. 214-1 à L. 214-7. – Cf. annexe |
« III. – Lorsque la mesure mentionnée au I est devenue définitive et que l’intéressé ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » |
|
Article 2 |
Article 2 | |
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal est complétée par deux articles 411-5-1 et 411-5-2 ainsi rédigés : |
Rejeté | |
« Art. 411-5-1. – Se rend coupable du crime d’indignité nationale tout Français portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français : |
||
« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ; |
||
« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement. |
||
« Le crime d’indignité nationale est puni de trente ans de détention criminelle, de 450 000 € d’amende et de la peine complémentaire de dégradation nationale dont le prononcé est obligatoire. |
||
« Pour la poursuite, l’instruction et le jugement du crime prévu au présent article, le titre 15 du livre IV du code de procédure pénale est applicable. |
||
« Art. 411-5-2. – La dégradation nationale emporte à titre définitif ou, par décision spécialement motivée de la juridiction, pour une durée de trente ans au plus : |
||
« 1° La privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ; |
||
« 2° La destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ; |
||
« 3° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ; |
||
« 4° L’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ; |
||
« 5° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ; |
||
« 6° La destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline » |
||
« 7° L’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille ; |
||
Code pénal Art. 131-31. – Cf. annexe |
« 8° L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues à l’article 131-31. » |
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Art. L. 214-1. – Tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille d’une telle personne peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Art. L. 214-2. – Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
Art. L. 214-3. – L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.
Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
Lorsque la décision a été prise en application de l’article L. 214-1 et que l’intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d’un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
Art. L. 214-4. – L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui s’apprête à entrer en France peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d’office à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3. L’article L. 513-2, le premier alinéa de l’article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire.
Art. L. 214-5. – L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire. L’étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d’un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
Art. L. 214-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-5, les motifs de l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
Art. L. 214-7. – Le second alinéa de l’article L. 214-4 n’est pas applicable à l’étranger mineur.
Code pénal
Art. 131-31. – La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
© Assemblée nationale