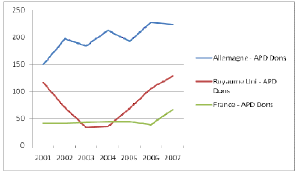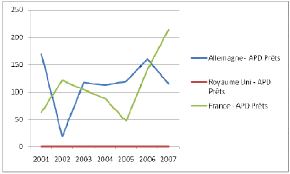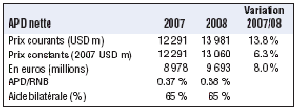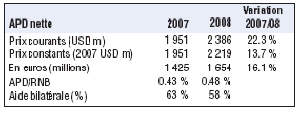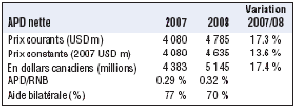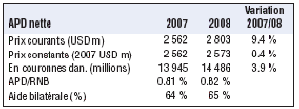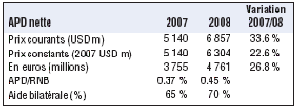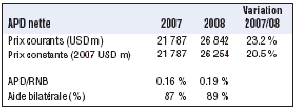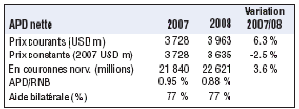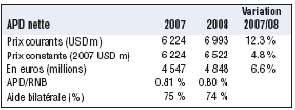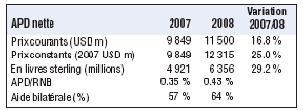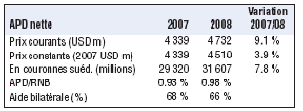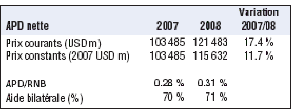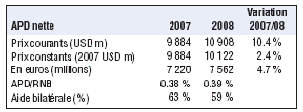______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 28 janvier 2009 (1),
sur « Aide au développement :
quel équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme ? »
Président
M. Jean-Paul BACQUET
Rapporteure
Mme Nicole AMELINE
Députés
__________________________________________________________________
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information « Aide au développement : quel équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme » est composée de : M. Jean-Paul Bacquet, président, Mme Nicole Ameline, rapporteure, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Jean-Louis Christ, Alain Cousin, Jean-Paul Dupré, Jean-Paul Lecoq, François Loncle, Jean-Luc Reitzer, Michel Terrot.
INTRODUCTION 7
I – L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT : UNE TRANSITION HISTORIQUE 9
A – L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT : LES CONSTANTES, D’HIER À AUJOURD’HUI 9
1) De la Guerre froide à la stabilité du monde, un fil conducteur : l'APD, politique d’intérêts nationaux et de sécurité 10
a) L’aide publique au développement, un instrument de politique étrangère 10
b) La dimension sécuritaire de l’APD 13
c) Le renforcement de l’approche sécuritaire après le 11 septembre 15
2) L'APD comme solidarité internationale 19
a) La solidarité du Nord envers le Sud, pilier de l’aide 19
b) L’opportunité des Objectifs du Millénaire pour le Développement 22
c) La base des engagements financiers des donateurs 25
d) Septembre 2010 : la réaffirmation de la solidarité internationale aux deux tiers du chemin 27
B – LES ENJEUX COLLECTIFS D’UN MONDE EN MUTATION 28
a) L’Afrique comme creuset des défis de l’avenir 30
b) Problématiques africaines et sécurité commune 31
a) Tenir les engagements 36
b) Besoins et modalités de financements du développement 38
C – PROBLÉMATIQUES D’UNE GOUVERNANCE MONDIALE DU DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE COLLECTIVE AUX ENJEUX DU XXIE SIÈCLE 40
1) Le paradigme contemporain de l’efficacité et ses incidences 42
a) Une thématique inévitable… 42
b) … et aujourd’hui universelle 45
2) Les nouveaux acteurs de l’aide au développement 49
a) La multiplicité des acteurs internationaux : état des lieux 50
b) Une réalité qui modèle la problématique du bilatéralisme et du multilatéralisme 52
3) Les nouveaux lieux de la gouvernance de l’aide 54
a) De G8 en G20 54
b) Le rôle et l’ambition de la France 57
D – POSER LES TERMES DU DÉBAT POUR DEMAIN 59
1) Les éléments de la discussion 60
a) De quelques avantages et inconvénients respectifs du bilatéralisme et du multilatéralisme 60
b) Un point de consensus : bilatéralisme et multilatéralisme sont complémentaires 63
c) Qu’en pensent les bénéficiaires ? 65
2) Prendre date pour demain 68
a) L’obsolescence de certaines préoccupations dans un monde changeant 68
b) Redonner la priorité au politique 70
II – REGARDS SUR LA POLITIQUE D’AIDE DE LA FRANCE 73
A – LA FRANCE, ACTEUR MAJEUR DE LA COMMUNAUTÉ DES BAILLEURS 73
1) Des financements considérables 73
a) La France, un des tout premiers contributeurs 73
b) Des effets d’affichage 75
2) Une aide mondiale 81
a) Une aide dispersée 82
b) Un souci louable de concentration géographique… 83
c) … qui tarde néanmoins à prendre effet 85
3) Une offre sectorielle étendue 88
a) La question des secteurs d’intervention 89
b) Un effort de concentration lent à se mettre en oeuvre 90
4) Un rôle moteur dans la communauté internationale 93
a) La promotion de nouvelles thématiques 93
b) Les financements innovants 94
B – DES INSTRUMENTS OBJECTIVEMENT DÉSÉQUILIBRÉS 96
1) Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 96
a) Une architecture qui gagnerait à être resserrée 96
b) La coordination sur le terrain 99
2) Le déséquilibre de nos instruments 100
a) L’AFD, banque du développement 100
b) L’incidence géographique des choix effectués 102
c) L’incidence sectorielle des choix effectués : le cas de l’eau et de l’assainissement 104
3) Le choix résolu du multilatéralisme 108
a) Multilatéralisme vs. bilatéralisme : l’état de la question 108
b) Un multilatéralisme dans lequel quelques privilégiés… 111
c) … Etouffent quelques parents pauvres 114
d) Des moyens bilatéraux aujourd’hui en état critique 116
C – L’INCIDENCE DES DÉSÉQUILIBRES SUR NOTRE APD 119
1) Existe-t-on vraiment dans le système multilatéral ? 120
a) Les effets d’un multilatéralisme insuffisant 120
b) Qu’en est-il de nos moyens d’influence au sein du multilatéralisme ? 122
2) Les conditions perdues d’un bilatéralisme influent 126
a) Les effets du manque de pilotage politique 126
b) Des déséquilibres au sein du bilatéralisme qui risquent de dénaturer notre aide 127
III – FAIRE DU DÉVELOPPEMENT UN ÉLÉMENT STRUCTURANT DE NOTRE POLITIQUE ÉTRANGÈRE 131
A – POUR UNE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT QUI SOIT UNE VÉRITABLE POLITIQUE 131
1) Pour une ambition mieux partagée 132
a) Définir une politique 132
b) Donner toute sa place au Parlement 134
c) Mieux coordonner la coopération décentralisée 139
d) Assurer une meilleure communication interne et externe 140
2) La réflexion stratégique de la France 143
a) Le Document cadre français de coopération au développement 143
b) La stratégie française pour la politique européenne de développement 146
B – RENFORCER LA COHÉRENCE DE NOS POLITIQUES 148
1) Mettre nos instruments de coopération en accord avec nos stratégies et objectifs 149
2) Améliorer la cohérence intrasectorielle : l’exemple de la santé 151
a) La structure de nos financements… 151
b) … traduit une cohérence surtout politique 153
C – LES INSTRUMENTS D’UNE AMBITION 155
1) Faire le deuil d’un certain bilatéralisme sans oublier de retrouver de nouvelles marges de manoeuvre 155
a) La voie étroite du rééquilibrage 155
b) Nos principaux partenaires nous montrent le chemin 159
2) Saisir l’opportunité européenne 162
a) La question du cadre européen de notre coopération au développement : une démarche essentielle 162
b) Savoir tirer profit d’une évolution favorable dans l’ensemble européen 165
c) Retrouver des marges de manœuvre sur nos financements européens 167
3) Les voies d’un multilatéralisme efficace 169
a) Mieux investir le multilatéralisme 169
b) Structurer une nouvelle articulation entre le bilatéral et le multilatéral 173
CONCLUSION 179
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LA MISSION D’INFORMATION 181
EXAMEN EN COMMISSION 185
ANNEXES 195
Liste des personnalités rencontrées 197
Mesdames, Messieurs,
La France est généreuse. Le fait qu’elle soit aujourd’hui le deuxième bailleur, en volume, d’aide publique au développement derrière les Etats-Unis, le prouve amplement. Cela mérite d’autant mieux d’être souligné que les temps sont durs. Mais « réduire nos déficits publics sur le dos des populations les plus pauvres du monde », pour reprendre la formule récente de David Cameron, serait de très mauvaise politique. En d’autres termes, diminuer les financements, certes considérables, que notre pays consacre chaque année à l’aide publique au développement serait, aux yeux de votre Rapporteure, une faute et une erreur.
Car le monde a changé. Il continue de changer, de plus en plus vite, et ce changement nous impose, qu’on le veuille ou non, de mesurer les effets de la mondialisation sur le continent le plus pauvre, à quelques dizaines de kilomètres de l’Europe. L’Afrique représentera demain un ensemble de plus d’un milliard et demi d’habitants. On ne peut pas ne pas tenir compte de ces réalités, de cette proximité, qui nous obligent tout à la fois à maintenir haut notre solidarité avec les pays africains et à nous engager résolument avec eux dans des relations renouvelées de partenariat.
Cette réalité est une donnée majeure et le contexte de crise que nous traversons aujourd’hui ne doit pas nous inciter à relâcher nos politiques de coopération au développement. Tout au contraire, devons-nous, ainsi que le Premier ministre britannique le soulignait, maintenir cet effort afin de continuer d’accompagner les pays pauvres sur la voie du développement et de la croissance. Il s’agit tout à la fois d’une question élémentaire de solidarité mais aussi de la prise en compte de notre propre intérêt national.
Néanmoins, chacun sent bien que la politique d’aide de notre pays souffre de certains déficits : de visibilité et d’influence, notamment, et chacun s’interroge sur son efficacité et sa cohérence. De fait, ces dernières années, la France semble avoir fait le choix d’instruments de coopération qui peuvent donner le sentiment d’un certain effacement : elle continue d’être active et présente, mais différemment, et sans que l’on sache vraiment si ses priorités géographiques et sectorielles sont respectées par les institutions auxquelles elles confient une grande part des moyens qu’elle y consacre.
C’est ce qui a motivé la constitution de cette Mission d’information de la commission des affaires étrangères sur l’équilibre à retrouver entre multilatéral et bilatéral, dès lors que qu’on y voit la cause première de cet effacement.
Consécutivement, il était nécessaire de se pencher sur l’architecture de notre politique pour identifier quels choix avaient pu être les plus déterminants pour conduire à cette situation d’autant moins satisfaisante que la crise budgétaire impose à toutes les politiques publiques des révisions difficiles.
Ces considérations de départ justifiaient en premier lieu, depuis une approche en partie historique, de débattre des avantages et inconvénients respectifs des divers instruments, et surtout d’analyser la nature des enjeux contemporains de l'APD qui en ont considérablement modelé l’architecture : les problématiques et l’environnement international de l’aide ont été bouleversés en quelques années et elle n’a pas échappé aux changements que connaît le monde actuel.
Sur cette toile de fond, il fallait analyser l’ensemble des aspects de notre politique avant de proposer une réflexion et des recommandations sur les perspectives d’avenir d’une politique qui doit résolument s’inscrire dans la mondialisation et sur les voies du rétablissement, articulées sur les questions fondamentales de l’efficacité et de la cohérence de notre politique de coopération, plus que d’aide, au développement, comme de sa visibilité et de son influence.
I – L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT : UNE TRANSITION HISTORIQUE
« Il est fondamental de donner une nouvelle impulsion à notre politique d’aide au développement. Celle-ci doit être plus efficace, plus lisible, plus stratégique. Elle doit rechercher et atteindre des résultats concrets et visibles. » (1)
On ne saurait aborder la question de l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme sans avoir une claire conscience de ce qu’est l’aide au développement, de ce que sont ses rôles et potentialités. Il est par conséquent important de revenir sur les caractéristiques fondamentales de cette politique publique qui repose traditionnellement sur deux piliers qui lui ont toujours été liés, et sans doute aujourd’hui plus que jamais.
Cette réalité influe directement sur la réponse que l’on entend donner à la question posée à la Mission d’information : On ne pourra définir un autre, ou un meilleur, équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme, instruments au service d’une politique, sans avoir préalablement une vision précise des objectifs de notre politique d’aide publique au développement (APD). Que celle-ci soit actuellement d’une très grande complexité n’aide assurément pas à trancher le débat, mais la lisibilité et l’efficacité de notre action que le Président de la République et le Premier ministre appelaient de leurs vœux en 2007 ne pourront se mesurer sans faire l’économie d’une réflexion sérieuse sur la finalité de ces mécaniques d’aide au développement.
Le fait que l'APD soit l’objet depuis maintenant une décennie d’une ample réflexion de la part de la communauté internationale quant à sa nature et à ses finalités, qu’elle ait vécu de profondes transformations sont des éléments essentiels à prendre en compte dans le cadre de ce travail.
A – L’aide publique au développement : les constantes, d’hier à aujourd’hui
Si l’aide publique au développement est la traduction de la solidarité que les pays riches manifestent aux pays du Sud, un retour en arrière permet de resituer les circonstances historiques particulières de l’invention de cette politique publique en Occident. Il en ressort que l’APD n’est pas que l’expression de cette seule solidarité, ni cette obligation morale face à une pauvreté insupportable. Elle est avant tout la manifestation de l’intérêt bien compris des pays riches.
1) De la Guerre froide à la stabilité du monde, un fil conducteur : l'APD, politique d’intérêts nationaux et de sécurité
L’aide publique au développement n’est pas exclusivement mue par des considérations d’ordre humaniste ou altruiste. La solidarité envers les plus pauvres, pour essentielle et centrale qu’elle soit dans les politiques d’aide, n’a en effet jamais constitué la préoccupation unique des pays donateurs, si tant est qu’elle ait même été la première. L’aide publique au développement a au contraire toujours concomitamment rempli une autre fonction, tout aussi importante pour les bailleurs, celle de contribuer, à sa mesure, à leur propre sécurité. Depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, cette dimension sécuritaire continue de marquer de son influence l’évolution des politiques.
a) L’aide publique au développement, un instrument de politique étrangère
Comme de nombreux auteurs l’ont souligné à maintes reprises, l’invention de l’aide au développement est inséparable de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la reconstruction de l’Europe et de la division du monde en deux blocs.
Le Plan Marshall est souvent considéré comme le moment fondateur des politiques d’aide au développement. S’il a permis le relèvement de l’Europe, et tout particulièrement de la France, deuxième bénéficiaire du Plan derrière le Royaume-Uni, il a aussi posé les bases concrètes du multilatéralisme en matière d’aide publique au développement, avec la création de l’Organisation européenne pour la coopération économique, ancêtre de l’OCDE, destinée à la gestion et la répartition des fonds alloués. Il a surtout coïncidé avec les débuts de la Guerre froide, et par conséquent avec la politique américaine d’endiguement du communisme et la nécessité pour les Etats-Unis de montrer la supériorité du modèle capitaliste et libéral. C’est le sens du discours d’Harvard de juin 1947 de George Marshall pour lequel cette politique d’aide « contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos » avait pour but la renaissance de l’économie permettant l’émergence de conditions politiques et sociales propres à des institutions libres. Le secrétaire d’Etat américain précisait qu’il était donc logique que les Etats-Unis fassent ce qu’ils pouvaient pour contribuer au retour à la prospérité économique dans le monde, sans laquelle il ne pouvait y avoir ni stabilité politique ni paix assurée.
En aidant l’Europe à se relever des dommages de la guerre, les Etats-Unis s’aidaient eux-mêmes, investissaient, et défendaient leurs intérêts politiques, économiques et stratégiques à long terme. Les questions de sécurité nationale vont d’ailleurs à se point dominer les débats américains que cette époque est aussi celle de la mise en balance de l’aide économique avec l’aide militaire.
C’est une démarche comparable qui animera la France et le Royaume-Uni quand ils mettront en place une aide au développement à l’aube des indépendances de leurs colonies respectives. On a ainsi pu faire remarquer la parfaite continuité administrative entre l’administration de la « France d’Outre-mer » et les services naissants de la coopération, les administrateurs de la FOM devenant du jour au lendemain assistants techniques des jeunes gouvernements africains indépendants. De même, au Royaume-Uni, le Département de la coopération technique fut-il tout autant composé dans ses débuts de fonctionnaires issus du Colonial Office (2).
Cette période est aussi celle de la signature entre la France et ses anciennes colonies de nombreux accords de coopération comportant chacun des volets permettant à la France de conserver une présence militaire. Comme le précise l’étude précitée, la coopération française « naît des indépendances africaines et se présente comme un cadre de substitution, imposé à ces territoires dès avant leur autonomisation formelle, permettant à la France de préserver plus longtemps ses intérêts et son autorité sur eux », le Premier ministre, Michel Debré, précisant au général de Gaulle qu’il s’agissait d’éviter à tout prix que « ces Etats soient indépendants, sans aucune obligation à notre égard. » (3).
Cet aspect de l’aide au développement comme instrument de politique étrangère est parfois même dominant chez certains des principaux bailleurs. C’est notamment le cas du Japon, qui a depuis la fin des années 1970 développé une conception en termes de « sécurité globale », qui structure sa politique étrangère, au-delà de ses seuls aspects militaires ou diplomatiques, en prenant en compte l’ensemble des différents facteurs économiques, sociaux ou environnementaux qui participent à la stabilité du monde. L'APD japonaise est définie « comme l’un des outils les plus adaptés à cette approche de " sécurité globale ", son rôle n’est pas remis en cause jusqu’aux années 1990. » (4). Si cette conception initiale a évolué au fil de l’adoption de « chartes de l'APD » successives, en 1992 puis en 2003, l’accent ayant progressivement été mis sur la dimension humaine du développement, il n’en reste pas moins que la « tendance majeure qui transparaît dans les réformes actuelles est une prise en compte croissante de l’intérêt national dans la politique d’APD. » (5).
Le fait que les budgets de l’aide diminuent drastiquement dès le début des années 1990, après la chute du Mur de Berlin traduit, s’il en était besoin, que pour la plupart des pays donateurs, l’APD est bien avant tout un instrument de politique étrangère plus que la mise en œuvre d’une solidarité « naturelle » envers les plus pauvres : il n’apparaît dès lors plus nécessaire d’intervenir, de continuer à aider financièrement les pays du Tiers-Monde, dans la mesure où ils ne risquent plus désormais de basculer dans l’autre camp, le communisme ayant été définitivement vaincu. A tout le moins, la géographie de l’aide en est-elle bouleversée, et la diminution des risques offre-t-elle alors l’opportunité d’une réaffectation des ressources (6).
A cet effet, le tableau ci-dessous montre clairement la diminution nette et constante, à partir du pic de 1990-1991, des contributions versées par les donateurs bilatéraux, et ce, quasiment jusqu’à la fin de la décennie. En quelques années, l'APD baissera de 0,32 % du PIB des pays du CAD, en 1992, à 0,21 % en 1997, son minimum historique. La tendance à la baisse commencera à s’inverser autour de 1997-1998 et l’effort bilatéral s’accentuera de nouveau nettement après 2001.
En d’autres termes, la justification idéologique de l’APD bilatérale ayant disparu avec le communisme, il n’est plus nécessaire de continuer à mener une politique de « containment », qui a largement fait ses preuves. L’utilité de l’aide bilatérale disparaît au cours des années 1990, et l’effort des pays donateurs diminue considérablement.
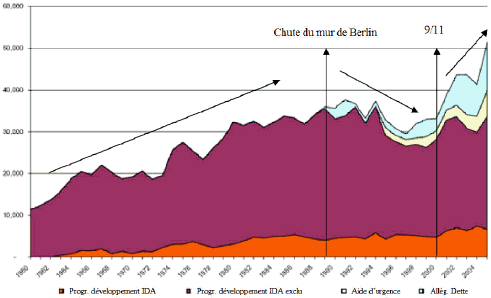
APD accordée aux pays admissibles à l’IDA par les membres de l’OCDE et les organisations internationales (1960 – 2005) (7)
Inversement, le graphique montre tout aussi clairement que l’aide multilatérale, moins soumise aux mêmes déterminants, reste en revanche étale sur toute cette période.
En ce qui concerne les bénéficiaires, les effets de ce tarissement de l’aide sont brutaux, comme en témoigne le deuxième diagramme, qui montre la chute drastique au cours des années 1990 de l'APD nette reçue par les pays d’Afrique subsaharienne qui, de 36 dollars par habitant au milieu des années 1980, en recevront moins de 20, en dollars constants, en 2001, dans un contexte d’ajustement structurel qui aurait évidemment mérité d’autres formes d’accompagnement. Au début des années 1990, l'APD totale aura ainsi baissé d’environ 1/5e en volume, mais de 50 % en ce qui concerne celle destinée aux PMA (8).
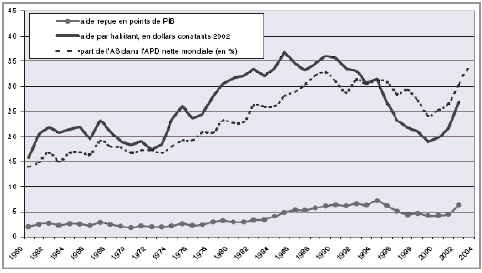
APD nette reçue par les pays d’Afrique subsaharienne (9)
L’aide au développement est donc initialement tout sauf un altruisme et une solidarité désintéressés. Bien plus un instrument de « realpolitik » comme on a pu le dire (10).
b) La dimension sécuritaire de l’APD
Ces préoccupations sécuritaires ne sont pas seulement celles des principaux donateurs du Nord. Elles se retrouvent aussi très clairement dans les réflexions de la communauté internationale. De sorte que le développement des pays pauvres est vu au sein des organisations internationales notamment comme une exigence non seulement morale, mais aussi comme contribuant fortement à la stabilité du monde et à son avenir pacifique.
En premier lieu, votre Rapporteure veut à cet égard mentionner la résolution 1710 de l’Assemblée générale, adoptée en décembre 1961, qui avait lancé la « Première Décennie des Nations Unies pour le développement » dont les considérants rappelaient déjà que « le développement économique et social des pays économiquement peu développés est non seulement d’une importance capitale pour ces pays, mais aussi essentiel pour la paix et la sécurité internationales (…) ». L’accent était mis sur les divers axes permettant la promotion d’un développement socioéconomique qui devait être pour l’essentiel autoentretenu. C’était également l’époque où l’aide apparaissait, déjà, moins importante que les efforts des pays sous-développés, lorsque l’Assemblée générale se déclarait « convaincue que le développement économique des pays doit être essentiellement fondé sur leurs propres efforts et sur l’exploitation de la totalité de leurs ressources productives » (11) et que l’essentiel devait tourner autour de la libéralisation des échanges, objet principal des négociations entre le Nord et le Sud.
Dix ans plus tard, cependant, la tonalité de la résolution 2626 de l’Assemblée générale sera quelque peu différente. Elle rappelait en 1970 les risques dont était porteur un monde déséquilibré en faisant remarquer que « le niveau de vie d’innombrables millions d’êtres humains qui vivent dans les régions en voie de développement du globe demeure lamentablement bas. (…) Tandis qu’une partie de l’humanité vit dans le confort et même dans le luxe, une autre partie, de loin plus nombreuse, végète dans une misère extrême. (…) Partout, la jeunesse est en effervescence (…) ». Œuvre de justice sociale internationale, le développement contribuera à la paix du monde. En lançant la « Deuxième Décennie pour le développement », la résolution 2626 tirait en fait un premier constat d’échec : malgré certains progrès, grâce à l’« effort majeur entrepris à l’échelle mondiale », le fossé qui sépare les riches des pauvres n’a cependant cessé de s’élargir et « cette situation déplorable a contribué à accroître la tension dans le monde. ». Réitérant les mêmes avertissements en ce qui concerne la sécurité internationale, ce texte mettait ainsi l’accent sur d’autres préoccupations, renforçant notamment, par rapport à la précédente résolution, les considérations sur l’aide, sur les transferts des pays de l’OCDE vers les pays en développement, abordant et détaillant des thèmes toujours d’actualité aujourd’hui.
Ces rappels illustrent et confirment le fait que, initialement, l’aide au développement est avant tout un outil contribuant à la stabilité du monde et répondant aux intérêts et à la sécurité des pays donateurs. La pauvreté est certes insupportable, il convient d’y remédier pour cela aussi, mais aussi parce qu’elle est facteur de déstabilisation.
L’actualité la plus récente montre que les réflexions actuelles en cours chez les principaux pays participant à l’effort d’aide sont aujourd’hui toujours fortement marquées de cette préoccupation. Les réformes qu’ils entreprennent de leur système d’aide au développement traduisent nettement cette orientation.
c) Le renforcement de l’approche sécuritaire après le 11 septembre
Le lien historiquement établi entre sécurité nationale, stabilité du monde et aide au développement n’a pas disparu. Il figure toujours au cœur des réformes des systèmes d’aide entreprises actuellement dans nombre de pays donateurs et trouve une traduction directe dans les appareils institutionnels et administratifs chargés de la coopération.
Ainsi, si l’évaluation que l’administration du président Barack Obama a entreprise de la politique étrangère des Etats-Unis n’était pas encore achevée lors du déplacement effectué par la Mission à Washington, l’inclusion de l’agence américaine de développement international, l'USAID, au sein du Conseil national de sécurité – National Security Council, NSC –, était en revanche déjà acquise, selon les informations qui avaient alors été communiquées à votre Mission (12). A cet égard, Pierre Vimont, ambassadeur de France aux Etats-Unis, faisait remarquer (13) la très forte réactivité américaine, capable sur ces thématiques, comme d’une manière générale, d’une « révolution » et d’une remise en question très rapide de ses orientations une fois effectué le bilan critique des actions menées, dès lors qu’elles s’avèrent ne plus coïncider avec les intérêts nationaux et les enjeux considérés comme prioritaires. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le président George W. Bush avait ainsi rapidement donné la priorité à l’Afrique, à la santé et à la lutte contre le sida. Le travail entrepris par l’administration Obama s’inscrit dans cette même logique : l’APD reste une priorité politique de la diplomatie des Etats-Unis dont elle est considérée comme partie intégrante. Elle doit donc aussi participer à la défense des intérêts américains dans le monde, en lien avec les politiques qui concourent à la sécurité nationale. La présidence Obama poursuit une réflexion entamée par l’administration antérieure, dans une perspective à la fois plus globale et non exclusivement militaire, le développement étant aujourd’hui présenté comme étant une véritable préoccupation et un engagement, profonds et personnels, tant du président que d’Hillary Clinton, secrétaire d’Etat.
Le défi, comme il a été indiqué à votre Mission, est désormais pour le NSC de réussir à mettre en concordance les différents impératifs et priorités respectives des services et administrations concernés qui n’ont pas eu jusqu’alors le loisir de collaborer. Quoiqu’il en soit, la politique de développement est désormais considérée comme un instrument d’intérêt national, l’aide devant conduire à augmenter les capacités des pays bénéficiaires, pour contribuer à leur stabilité dans un cadre globalisé et de façon plus équilibrée que sous l’administration Bush. La réflexion porte sur le rôle et la place de chacun dans cette nouvelle architecture, l’approche développementaliste au sein du gouvernement l’emportant aujourd’hui sur les aspects militaires (14).
Selon les termes d’un document de travail qui a « fuité » dans la revue Foreign Policy à l’époque du déplacement de votre Mission aux Etats-Unis, le principe est de redéfinir l'aide au développement comme un « impératif stratégique » pour les Etats-Unis. Dans un contexte d'aggravation des situations de fragilité dans certaines régions, accrues par des menaces transnationales, sur fond d'émergence de nouvelles puissances, d'intégration économique croissante et de fragmentation du pouvoir politique, l’aide au développement apparaît comme un élément essentiel à la préservation de la sécurité nationale (15).
Il n’est pas indifférent dans ce contexte de relever que David Cameron, nommé Premier ministre britannique le 11 mai dernier, a pris dès le lendemain la décision de créer lui aussi un Conseil national de sécurité, chargé de coordonner les réponses aux dangers auxquels le Royaume-Uni fait face, « fusionnant au plus haut niveau le travail des ministères des affaires étrangères, de la défense, de l’intérieur, de l’énergie et du développement international, (…) » (16). Présidé par le Premier ministre, le Conseil, dont la première réunion eut lieu le jour même, a pour membres permanents le vice Premier ministre, le Chancelier de l’Echiquier, les ministres des affaires étrangères et du Commonwealth, de l’intérieur, de la défense, du développement international, DFID, et de la sécurité.
Ces réformes confirment que l’aide est aussi considérée au Royaume-Uni comme « l’un des instruments de gestion des conflits, que ce soit de façon préventive ou synchrone, ou encore lors des périodes de reconstruction » et qu’« il est évident que l’un de ses mandats prioritaires sera à l’avenir de contribuer à la construction d’une architecture internationale de sécurité. » (17). Cela est d’autant plus important que, comme le font plus remarquer Jean-Michel Severino et Olivier Charnoz, ces dernières années, les crises afghane ou irakienne, ou encore la guerre civile de RDC, entre autres exemples, ont mobilisé des efforts extrêmement importants de la communauté internationale, cependant que depuis 1990 le tiers des pays africains connaissait une situation conflictuelle. Aujourd’hui, compte tenu de la mondialisation et de ses effets délétères sur les institutions étatiques plus faibles des pays en développement, les pôles de tension locale, les guerres civiles, sont considérés comme porteurs de risques plus importants, plus à même d’être diffusés et de « créer des " zones grises " incontrôlées, propices au terrorisme et au trafic de drogue. » (18). De sorte que les répercussions des crises locales pouvant affecter les pays développés, au même titre que les pressions migratoires, la croissance démographique ou les tensions ethniques, il apparaît finalement que, « née des enjeux de la guerre froide et de la décolonisation, l’aide au développement est devenue l’enfant adoptif de la mondialisation, dans la douleur mais aussi par espoir. L’APD est l’un des rares instruments d’envergure pour faire face aux défis d’enjeux mondiaux – qu’ils soient éthiques, sociaux, sécuritaires, économiques ou environnementaux. » (19). Votre Rapporteure y reviendra.
Dans notre pays, si la sauvegarde de l’intérêt national dans les anciennes colonies africaines a constitué dès l’origine une préoccupation centrale de la politique d’aide au développement, comme on l’a vu, la réflexion la plus récente n’a pas non plus été en reste, en témoignent certaines des réformes engagées ces dernières années.
La fusion des administrations du ministère de la coopération et du ministère des affaires étrangères en 1999 a évidemment répondu à cette logique selon laquelle la politique d’aide au développement est partie intégrante de la politique extérieure. Le propos est proche de celui que l’on trouve dans les modèles de réformes britannique ou américain qui ont opté pour une coordination plus poussée de leurs administrations sous l’égide d’un Conseil national de sécurité, ou encore du rapprochement qui se fait actuellement entre les ministères allemands des affaires étrangères et du développement (20). Quelle que soit la solution retenue, les propos se rejoignent.
Lors de son audition par votre Mission d’information (21), Alain Juppé avait ainsi fait remarquer que la commission du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, « La France et l’Europe dans le monde », qu’il avait coprésidé en 2008, s’était précisément interrogée sur le sens de l’aide au développement et sur son devenir, sur les raisons pour lesquelles la France devrait ou non continuer sur cette voie. Au-delà des raisons morales, l’ancien Premier ministre avait indiqué que la question de la sécurité du monde avait prévalu : dans la mesure où la pauvreté n’est évidemment pas un facteur contribuant à la stabilité, le maintien d’une aide aux pays en développement se confirme comme un impératif. Ce que traduisait ainsi le Livre blanc : « L’aide publique au développement est une composante à part entière de la politique étrangère de la France, qui doit contribuer à ses grands objectifs : favoriser une mondialisation équilibrée, renforcer la paix et la sécurité en luttant contre la pauvreté et le sous-développement, appuyer nos stratégies d’influence. Les objectifs d’aide doivent être clarifiés et pleinement assumés » (22).
De leur côté, les auteurs du Livre blanc « Défense et sécurité nationale » (23) menaient alors une réflexion parallèle dont il résultait que si l’Afrique était riche d’atouts nombreux, divers facteurs risquaient d’entraver pour une longue période son développement et de continuer à entretenir des foyers de tensions dont il importait de limiter les effets potentiels : « Les problèmes de l’Afrique ont des incidences directes sur nos intérêts : immigration clandestine, radicalisation religieuse en terrain musulman et développement de sectes fondamentalistes en terrain chrétien, implantation des groupes terroristes se réclamant d’Al-Qaida, apparition de nouvelles routes de la drogue, trafics d’armes illicites, réseaux de prolifération, blanchiment d’argent et risques sanitaires. » (24). La situation au Maghreb, notamment, était vue comme imposant une vigilance internationale, compte tenu du « risque de déstabilisation découlant des facteurs internes » (…) D’ici quinze ans, et au-delà, seul le développement économique, politique et social peut prémunir la région contre de tels risques. » (25). Dans ces conditions, concluaient les auteurs : « l’amélioration du système international passe par une meilleure corrélation entre l’aide au développement et les stratégies de sécurité internationale et nationale. L’aide au développement participe de la prévention. » (26).
Il n’est pas indifférent de faire remarquer que c’est aussi le sens de la stratégie européenne de sécurité adopté par le Conseil européen en décembre 2003. Les défis mondiaux et les principales menaces contre la sécurité de l'Union sont identifiés, qui permettent de clarifier les objectifs stratégiques pour y faire face, lesquels peuvent se résumer en un renforcement de la sécurité dans le voisinage de l'Union et dans la promotion d’un « multilatéralisme efficace ». La pauvreté, les épidémies, les répercussions des échecs économiques sur les problèmes politiques et les conflits violents, sont identifiées comme autant de facteurs à l’origine de la plupart des problèmes de sécurité des pays en développement, alors même que la sécurité est analysée comme une condition nécessaire du développement. L’Union européenne doit par conséquent faire face à ces menaces – terrorisme, conflits régionaux, déliquescence des Etats, crime organisé –, poursuivre ses objectifs stratégiques et mener notamment des politiques cohérentes, qui regroupent autant que faire se peut ses différents instruments et moyens : programmes d'aide, Fonds européen de développement, capacités militaires et civiles des Etats membres et autres, dans lesquelles les efforts diplomatiques, les politiques de développement, de commerce et d'environnement doivent tendre aux mêmes objectifs.
Aujourd’hui comme hier, un lien étroit unit donc aide publique au développement et sécurité. Que l’objet de la sécurité ait évolué avec le temps, basculant du communisme à des risques à la fois plus diffus et plus mondialisés, ne change rien à cette réalité première : « la motivation sécuritaire reste prédominante » (27), avant comme après le 11 septembre, et donne nécessairement à l'APD une forme d’ambivalence.
Ces réalités et leurs implications touchent au cœur de la réflexion de la Mission d’information sur l’équilibre à trouver entre action bilatérale et multilatérale.
2) L'APD comme solidarité internationale
La dimension sécuritaire de l’APD ne doit pour autant pas occulter le second aspect dont les effets concrets se mesurent sur les populations pauvres des pays en développement : La pauvreté est inacceptable et la solidarité envers les pays du Sud une exigence morale, un devoir des riches envers les pauvres.
a) La solidarité du Nord envers le Sud, pilier de l’aide
C’est la seconde préoccupation, qui fonde et légitime la coopération au développement, fréquemment conditionnée par cette obligation, et parfois même traduite dans certaines législations.
C’est notamment le cas en Espagne. La loi 23/1998 du 7 juillet 1998, de coopération internationale pour le développement, pose en effet comme principe que « la politique espagnole de coopération internationale pour le développement, inspirée par la Constitution, exprime la solidarité du peuple espagnol avec les pays en développement et, particulièrement, avec les peuples les plus défavorisés des autres nations (…)» (28). Cette politique est notamment fondée sur la reconnaissance de l’être humain dans ses dimensions individuelle et collective, la défense et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la paix, la démocratie, la non discrimination, la promotion d’un développement humain global, interdépendant, la promotion d’une croissance économique durable et soutenable, ou encore la redistribution équitable des richesses. La politique de coopération espagnole devra par conséquent déterminer des stratégies et des actions destinées à la promotion du développement durable humain, social et économique, pour « contribuer à l’éradication de la pauvreté dans le monde (…) ».
Indépendamment de la réflexion que le gouvernement britannique mène sur le lien entre APD et sécurité, l’approche solidaire des Britanniques est comparable et fortement orientée sur des objectifs sociaux. L’« International Development Act », du 26 février 2002 assigne en effet la contribution à la réduction de la pauvreté comme propos essentiel à l’assistance internationale au développement, entendue comme étant celle qui participe au développement durable hors des frontières du Royaume-Uni ou qui contribue à l’amélioration du bien-être des populations à l’étranger. Quelques temps avant l’adoption de cette loi, le titre du premier Livre blanc sur le développement international publié en novembre 1997, « Eliminating World Poverty : a Challenge for the 21st Century », résumait à lui seul l’approche du gouvernement britannique. La pauvreté y était présentée comme le plus grand défi auquel le monde devait faire face et Clare Short, alors ministre du développement au sein du gouvernement de Tony Blair, présentait en termes de devoir moral l’aide aux plus populations les pauvres de la planète (29). Dans la dernière version à ce jour du Livre blanc que le Department for International Development, DFID, a publié en juillet 2009 (30), la préface de Douglas Alexander, alors ministre du développement international, insistait encore à plusieurs reprises sur le fait que, même si le monde changeait, l’approche et les engagements du gouvernement du Royaume-Uni restaient centrés sur la lutte contre pauvreté, priorité indiscutable (31).
Cette approche se retrouve également chez d’autres bailleurs, parmi les principaux. En Belgique par exemple, où l’article 3 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale, précise simplement que « la coopération internationale belge a pour objectif prioritaire le développement humain durable, à réaliser par le biais de la lutte contre la pauvreté, sur la base du concept de partenariat et dans le respect des critères de pertinence pour le développement. » Cette coopération au développement est présentée comme s’inscrivant dans un cadre plus général, supérieur, en ce qu’elle doit contribuer « à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, en ce compris le principe de bonne gouvernance, ainsi qu'à l'objectif du respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec une attention particulière pour la lutte contre toute forme de discrimination pour des raisons sociales, ethniques, religieuses, philosophiques ou fondées sur le sexe. »
Une étude comparative entre plusieurs systèmes nationaux récemment publiée par Coordination Sud (32) confirme par ailleurs que les questions de solidarité et de lutte contre la pauvreté constituent, sans réelle surprise, le socle sur lequel se fondent nombre de politiques d’aide au développement.
Ainsi en est-il pour le Canada, qui révise tous les deux ans sa stratégie en matière de politique étrangère dont l’aide publique au développement est considérée comme partie intégrante, pour lequel la principale priorité est la lutte contre la pauvreté dans les pays où il intervient. L’objectif premier est de parvenir à un développement durable dans les pays les plus défavorisés, moyennant des progrès réalisés en matière de bien-être économique, de développement social, de viabilité environnementale et de gouvernance. Claude Lemieux, conseillère pour le développement à la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies à New York, a eu l’occasion de préciser à votre Mission d’information (33) que trois grandes priorités étaient désormais tracées : le développement économique durable, l’avenir des enfants et des jeunes et la sécurité alimentaire. En d’autres termes, les objectifs canadiens tendent à se resserrer sur ces thématiques particulières, tout en restant clairement circonscrits dans la tonalité globale de la lutte pour la réduction de la pauvreté. C’est également la priorité première du Danemark, dont les objectifs sont d’apporter des améliorations durables aux conditions de vie des populations les plus pauvres. La stratégie suédoise est sans doute plus holistique, qui aborde la question sous l’angle du partage des responsabilités. La lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sont les principaux objectifs de la politique suédoise de développement, orientée sur la réalisation des OMD. Les Pays-Bas ne s’en distinguent pas non plus, qui ont fait des Objectifs du Millénaire la ligne directrice de leur politique de développement, et mettent l’accent sur les Etats fragiles qui en sont les plus éloignés. On pourrait multiplier les exemples en ce sens.
Pour clore cet aspect, ajoutons que c’est enfin l’angle d’attaque de la coopération conduite par la Norvège : Lors de sa revue par les pairs, en 2005, le CAD de l’OCDE avait ainsi notamment indiqué que l’objectif central de la coopération norvégienne était de faire reculer la pauvreté, soulignant que les OMD servaient de fil conducteur, avec une importance particulière portée au huitième, relatif à l’instauration d’un partenariat mondial. Selon le ministère norvégien des affaires étrangères, cité par le document du CAD, « la Norvège se doit, en tant que pays riche, mais aussi par souci de morale, de soutenir les efforts déployés par les populations des pays en développement pour améliorer leur situation et leurs perspectives d’avenir. » (34).
Très logiquement, la réalisation des OMD sert de fil rouge aux décisions prises par la communauté internationale pour améliorer l’efficacité de l’aide au développement. Les différentes déclarations adoptées ces dernières années, depuis celle de Rome en 2003 sur l’harmonisation de l’aide, jusqu’au Programme d’action d’Accra, en 2008, abordent systématiquement la question sous l’angle du respects des engagements, de la lutte contre la pauvreté et de l’amélioration des conditions de vie des millions de personnes les plus vulnérables à travers le monde. Si l’accroissement des volumes est nécessaire et justifie la reprise des promesses, l’amélioration de l’efficacité de l’aide n’est pas considérée comme moins importante.
La Déclaration du Millénaire, qui a défini les OMD, apparaît naturellement comme un moment fondateur dans les démarches de la communauté internationale.
b) L’opportunité des Objectifs du Millénaire pour le Développement
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 septembre 2000, la Déclaration du Millénaire a réaffirmé avec force « la foi » des chefs d’Etat et de gouvernement dans l’ONU et sa Charte, « fondements indispensables d’un monde plus pacifique, plus prospère et plus juste. » (35).
D’une certaine manière, on peut soutenir que la Déclaration du Millénaire a surtout actualisé des textes que l’Organisation avait antérieurement adoptés, qui avaient lancé les deux premières Décennies pour le développement, en 1961 et en 1970, déjà évoqués. Les signataires déclarent notamment (36) : « (…) le principal défi que nous devons relever aujourd’hui est de faire en sorte que la mondialisation devienne une force positive pour l’humanité tout entière. (…) les pays en développement et les pays en transition doivent surmonter des difficultés particulières pour faire face à ce défi majeur. La mondialisation ne sera donc profitable à tous, de façon équitable, que si un effort important et soutenu est consenti pour bâtir un avenir commun fondé sur la condition que nous partageons en tant qu’êtres humains, dans toute sa diversité. Cet effort doit produire des politiques et des mesures, à l’échelon mondial, qui correspondent aux besoins des pays en développement et des pays en transition et sont formulées et appliquées avec leur participation effective. ». Il n’y a donc, fondamentalement, aucune différence majeure avec l’esprit de la résolution 2626, par exemple, par laquelle « au seuil des années 1970, les gouvernements s’engagent à servir les objectifs fondamentaux proclamés dans la Charte des Nations Unies il y a vingt-cinq ans : créer les conditions de stabilité et de bien-être et assurer un niveau de vie minimum compatible avec la dignité humaine, grâce au progrès et au développement dans l’ordre économique et social (…) ». La prise en compte de la mondialisation et de l’interdépendance est peut-être plus affirmée que précédemment, mais la communauté de destin de l’humanité était déjà soulignée 30 ans plus tôt, avant même que la globalisation ne fasse sentir ses effets.
De même, les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont-ils généralement considérés comme constituant autant d’engagements chiffrés et mesurables de la communauté internationale. On peut toutefois relever que ceux de la résolution 2626 se présentaient non comme une simple déclaration d’intention, mais comme devant déjà faire l’objet de mesures et d’évaluations, thèmes auxquels de longs développements étaient consacrés. Ainsi, c’est dans cette même résolution qu’apparaît pour la première fois une donnée aujourd’hui encore et plus que jamais objet de toutes les attentions : le taux de 0,7 % de leur RNB que les pays développés se doivent de consacrer à l’aide au développement : « Chaque pays économiquement avancé accroîtra progressivement son aide officielle au développement des pays en voie de développement et s’efforcera particulièrement d’atteindre, au milieu de la décennie au plus tard, un montant minimum en valeur nette de 0,7 % de son produit national brut au prix du marché. » (37).
Force est néanmoins de constater que, malgré ces apparentes similitudes, les OMD ont rencontré un succès et un écho internationaux qu’aucune résolution antérieure des Nations Unies n’avait sans doute jamais eus. Pourtant, les thématiques privilégiées par les OMD – la santé, l’éducation, la nutrition, l’habitat, l’intégration des femmes ou encore l’environnement –, de même que des questions telles que la générosité des donateurs, l’approche redistributive, le déliement de l’aide, la priorité à donner aux pays les moins avancés, PMA, la dette ou l’indispensable cohérence des politiques, étaient-elles déjà largement déclinées en 1970. La fortune des OMD aura sans doute été de coïncider avec la réduction progressive des crédits consacrés par les pays riches à l'APD, consécutive à la diminution des préoccupations géostratégiques du début des années 1990, alors même que les besoins de financements explosaient simultanément.
Tableau 1
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, Objectifs et cibles Objectif 1. Faire disparaître l’extrême pauvreté et la faim Cible 1 : réduire de moitié d’ici 2015 la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour Cible 2 : réduire de moitié, d’ici 2015, la proportion de la population souffrant de la faim Objectif 2. Garantir à tous une éducation primaire Cible 3 : d’ici 2015, donner à tous les enfants les moyens d’accomplir un cycle complet d’études primaires Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes Cible 4 : éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaires d’ici 2005 et à tous les niveaux d’ici 2015 Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants Cible 5 : réduite de 2/3 d’ici 2015 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle Cible 6 : réduire de 3/4 le taux de mortalité maternelle, d’ici 2015 Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies Cible 7 : enrayer la propagation du VIH-SIDA d’ici 2015 et commencer à inverser la tendance actuelle Cible 8 : enrayer la propagation du paludisme d’ici 2015 et inverser la tendance actuelle Objectif 7 : Assurer la durabilité des ressources environnementales Cible 9 : intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales Cible 10 : réduire de moitié le pourcentage de la population privée d’un accès régulier à l’eau potable, d’ici 2015 Cible 11 : parvenir d’ici 2020 à améliorer la vie d’au moins 100 M d’habitants de taudis Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement Cible 12 : instaurer un système financier plus ouvert intégrant bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté Cible 13 : subvenir aux besoins spécifiques des pays les moins avancés (allégement et annulation de la dette publique bilatérale, hausse du montant de l’APD) Cible 14 : subvenir aux besoins spécifiques des pays enclavés et des petits États insulaires en développement Cible 15 : engager une démarche globale pour régler le problème de la dette des pays en développement Cible 16 : création d’emplois productifs pour les jeunes Cible 17 : proposer des médicaments essentiels accessibles à tous Cible 18 : mettre à la disposition de tous les bienfaits des nouvelles technologies |
Les OMD auront ainsi eu pour effet de contribuer à remobiliser fortement la communauté internationale sur les thématiques « pures » de développement et de relégitimer les besoins de financement. Les objectifs définis en septembre 2000 se présentent comme un recentrage sur les considérations plus concrètement liées aux aspects sociaux et humains du développement, à la lutte contre la pauvreté. Les OMD ont pu à cette époque d’autant mieux occuper l’espace qu’il était en partie déserté et que les besoins étaient d’autant plus criants que les financements étaient alors en diminution. Aujourd’hui, ce sont ces objectifs du millénaire qui légitiment l’effort financier des pays développés.
c) La base des engagements financiers des donateurs
Logiquement, c’est fréquemment, si ce n’est essentiellement, sur ces bases, empreintes d’un devoir moral de solidarité que les politiques et surtout, les financements, en faveur de l’aide au développement sont fondés.
Cet engagement de la communauté internationale s’est parfois traduit par des réformes législatives nationales. Ainsi, une disposition législative belge de décembre 2002 amende-t-elle la loi sur la comptabilité de l'Etat et prévoit « une note de solidarité » par laquelle le gouvernement indique les mesures qu’il prend pour atteindre ce taux au plus tard en 2010 et « selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle » (38). De même, l’ancien Premier ministre britannique, Gordon Brown, avait-il exprimé, au second semestre 2009 devant la conférence du Parti travailliste, son intention de faire adopter une loi en ce sens, obligeant le gouvernement à augmenter l’aide au développement de manière à ce qu’elle atteigne le taux de 0,7 % du RNB au plus tard en 2013. Insérer cet objectif chiffré dans la législation britannique était aussi considéré comme un moyen d’inciter les principaux donateurs à accroître leurs propres efforts, tout en contribuant à assurer la prévisibilité de l’aide pour les bénéficiaires. Le gouvernement de coalition dirigé par David Cameron a repris cet engagement, confirmé par le discours de la Reine le 25 mai 2010 (39). Pour le nouveau Premier ministre britannique, l’engagement en faveur des dépenses d’aide au développement est clair et il n’est pas question de réduire les déficits publics, première priorité de son gouvernement, « sur le dos des populations les plus pauvres du monde », cependant que la Reine Elisabeth annonçait par exemple de manière simultanée une réduction de 25% des dépenses courantes du ministère de la défense.
Ces déclarations confirment, ce que faisait remarquer à votre Rapporteure Anthony Smith, directeur de l’Union européenne et des donateurs bilatéraux au sein du DFID (40), qu’entre conservateurs et travaillistes, il y a aujourd’hui communauté de vues en ce qui concerne la politique d’aide au développement, en soulignant que, avec la santé, l'APD était le seul budget en augmentation. L’issue législative envisagée par Gordon Brown n’est donc pas abandonnée. Elle sera mise en chantier une fois achevée la revue des politiques d’aide du DFID à laquelle le gouvernement de David Cameron procède actuellement. Pour les gouvernants britanniques, l’aide publique au développement se confirme tout à la fois comme une question de morale et d’intérêt national (41).
On sait par ailleurs que certains des pays financièrement les plus généreux ont d’ores et déjà atteint le taux de 0,7 % fixé par les Nations Unies. Cela est tout particulièrement vrai pour les pays scandinaves qui, selon le CAD de l’OCDE, sont même les seuls à dépasser aujourd’hui un taux d’aide publique au développement correspondant à 1 % de leur RNB : 1,06 % très précisément pour la Norvège, contre 0,88 % en 2008 ; 1,12 % pour la Suède (42), contre 0,98 % en 2008.
Si elles sont jusqu’à aujourd’hui peut-être moins emphatiquement affirmées qu’en Norvège ou en Espagne, ce sont néanmoins la solidarité et l’aide aux plus pauvres qui fondent aussi l’action et les financements de la France. Ce sont ces principes et la contribution de notre pays à prendre sa part au soulagement du fardeau qui sous-tendent l’engagement politique, indéfectiblement réitéré, malgré les difficultés évidentes qu’il y aura à le tenir, de consacrer 0,7 % de notre RNB aux dépenses d’APD (43). La France ne tient donc pas un discours différent de celui de l’ensemble des autres puissances occidentales. L’engagement des membres du G8 au sommet de Gleneagles en juin 2005 d’augmenter de 25 milliards de dollars par an l’aide à l’Afrique subsaharienne, pour faire mieux que la doubler d’ici à 2010 témoigne de cette communauté de vues. On y a souligné qu’une augmentation substantielle de l'APD était requise, en addition à d’autres ressources, pour permettre d’atteindre les OMD d’ici à 2015, ainsi que la conférence de Monterrey l’avait rappelé en 2002 (44).
A cet égard, entre autres exemples, le discours du Président de la République prononcé fin 2008 à la Conférence des Nations unies sur le financement du développement à Doha (45) était sans ambiguïté quant à la position de notre pays : « (…) de cette crise, nous avons débattu au sein de l'Union européenne. Alors que nous sommes tous face à des déficits croissants, face à l'augmentation du chômage, nous avons décidé de ne pas sacrifier les Objectifs du millénaire et d'être au rendez-vous des promesses qui vous ont été faites en matière d'aide publique au développement. Et ce n'est pas rien, la promesse de l'Europe car, d'ores et déjà, 60 % de l'aide publique au développement vient de l'Europe, 60 %, Monsieur le Secrétaire général ! C'est bien pour cela que j'ai voulu être là, pour affirmer cet engagement politique fondamental de l'Europe. Beaucoup de gens, à travers le monde, parlent de l'aide publique au développement. L'Europe paie pour 60 %. Cela représente 61 milliards de dollars pour 2007. Et l'Europe vient de décider d'ajouter un milliard d'euros en matière d'aide alimentaire pour faire face à la crise alimentaire sans précédent. L'Europe sera au rendez-vous du 0,7 % en 2015. C'est un choix politique majeur, c'est un choix politique unanime et je demande aux pays qui sont ici et qui ne participent pas au continent européen de considérer qu'avec les difficultés sociales, économiques, financières, politiques qui sont les nôtres, ce choix est un choix fondateur. »
d) Septembre 2010 : la réaffirmation de la solidarité internationale aux deux tiers du chemin
A la fin 2010, à cinq ans de l’échéance, la solidarité internationale envers les plus pauvres reste plus que jamais d’actualité et toujours au cœur des OMD. Le Sommet sur les objectifs du millénaire qui s’est tenu à New York des 20 et 21 septembre 2010 a vu les engagements de la communauté internationale réitérés avec plus de force encore. La Déclaration finale des chefs d’Etat et de gouvernement proclame solennellement – une fois de plus, pourrait-on dire –, qu’il leur « tient à cœur de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre les objectifs du Millénaire d’ici à 2015. ». Pour ce qui est de la France, le Président de la République y a notamment réaffirmé son plaidoyer en faveur du respect des engagements de la communauté internationale et notamment des pays riches : « La crise est sévère chez les pays riches, elle crée du déficit. Mais la crise a des conséquences bien pires pour les pays pauvres. Nous n'avons pas le droit de faire moins. Et la décision que nous prenons, nous souhaitons que l'ensemble des pays développés décident de faire davantage et naturellement de faire en priorité pour l'Afrique. » (46). Il a aussi notamment annoncé une augmentation de 20 % sur les trois prochaines années de la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La France apportera ainsi une somme totale de plus de 1,5 milliard de dollars au FMSTP sur cette période. Auparavant, quelques jours plus tôt, le Président de la République avait confirmé aux ONG, lors d’une réunion à l’Elysée, que l'APD serait la seule dépense publique qui ne diminuerait pas en 2011.
La crise économique et financière pesant fortement sur les finances publiques des Etats, le Secrétaire général des Nations Unies a rappelé pour sa part l’urgence d’instaurer des modes de financements innovants et a apporté son soutien aux initiatives en ce sens, notamment promues par la France, qui joue un rôle pionner en l’espèce, depuis la création de la taxe sur les billets d’avion et poursuit inlassablement son plaidoyer pour recourir à ces modes de financement.
B – Les enjeux collectifs d’un monde en mutation
A l’origine destinées à préserver les intérêts stratégiques des pays donateurs tout en témoignant d’une solidarité envers les Etats les plus pauvres, les politiques d’aide au développement poursuivent désormais aussi de nouveaux objectifs dans un contexte international bouleversé, marqué par une interdépendance croissante résultant de la mondialisation et la plus grande vulnérabilité des plus faibles face au changement climatique et à l’accès aux biens de première nécessité. Cette nouvelle donne touche très directement à la question de l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme.
Si les Biens publics mondiaux concernent tous les pays, ce sont de fait les pays en développement qui sont les plus immédiatement affectés par les effets du réchauffement climatique auquel participent aujourd’hui très fortement les pays émergents et qu’il importe donc d’associer à la recherche de solutions globales à gérer collectivement.
1) Globalisation et Biens Publics Mondiaux
Comme on en effet pu le faire très justement remarquer, « la fin de la guerre froide a profondément transformé les enjeux géopolitiques et de sécurité internationale. Ces derniers restent présents et continueront à représenter une importante motivation de l’aide publique au développement. Mais, contrairement à la seconde moitié du XXe siècle, ils ne sont plus le symptôme d’une fracture idéologique opposant des pays appartenant à des systèmes d’alliances ennemis. Ils ne sont plus autant identifiables aux intérêts de tel ou tel pays, mais ont pris la dimension globale d’un bien public mondial dont la " production " correspond aux intérêts du plus grand nombre. » (47).
Au-delà des questions de sécurité internationale, les intérêts des donateurs et des bénéficiaires de l’aide se recoupent désormais sur de nombreux aspects et sont aujourd’hui étroitement liés. Les éléments de la stabilité internationale sont aujourd’hui très divers et, pour mobilisateurs et consensuels qu’ils aient été, les seuls OMD apparaissent insuffisants. Ils doivent être prolongés par de nouvelles actions sous forme de régulations collectives.
Le réchauffement climatique, la lutte contre les grandes pandémies
– SRAS naguère, Sida ou grippe aviaire –, la stabilité financière internationale – la crise internationale de la fin des années 1990 à celle de 2008 –, ou encore la gestion durable des ressources limitées de la planète, la perte de biodiversité ou la sécurité alimentaire, pour n’en citer que quelques uns, sont des problèmes mondiaux qui concernent tous les Etats sans exception. Ces questions se sont rapidement et définitivement imposées et mobilisent désormais les gouvernements et les agences internationales de développement, tous les pays étant affectés de manière directe (changement climatique et recul de la biodiversité), ou médiate (émeutes de la faim de 2008).
A thématiques mondiales et interdépendantes, solutions nécessairement globales. On ne voit pas en effet comment ces défis considérables, par nature transfrontaliers, auxquels le monde fait face pourraient être traités autrement que par des prises de conscience collectives, et consécutivement, par des politiques publiques également collectives et globales, dans la définition et la mise en œuvre desquelles le multilatéralisme, quelque forme qu’il prenne, aura à jouer un rôle essentiel. L’ensemble de la communauté internationale doit être partie prenante de cet effort qui, dès lors que les pays en développement sont les premiers touchés, que les questions en jeu affectent les composantes de leur développement, intéresse prioritairement l'APD.
Si la référence commune au sein de la communauté internationale reste aujourd’hui encore essentiellement celle des OMD, les préoccupations qui ont émergé au cours des dernières années viennent s’ajouter à l’agenda de l’aide au développement qui, au rythme de la mondialisation, évolue notablement dans ses divers aspects et, consécutivement, dans la recherche de solutions.
Sur ce dernier point, la France est d’ailleurs parmi les pionniers, qui a pris une part déterminante dans la réflexion internationale sur les problématiques que les Biens Publics Mondiaux impliquent : approches ; financements ; cadres institutionnels.
2) L’Afrique, émergente ou explosive
L’Afrique est indiscutablement le continent par excellence sur lequel doivent se concentrer l’essentiel des efforts et des financements que la communauté internationale consacre au développement. Cette vérité d’évidence mérite toutefois d’être rappelée et il importe de ne pas se limiter aux seules apparences ou réalités les plus connues, sur fond de famines et de violences ethniques récurrentes auxquelles ces dernières décennies nous ont accoutumés.
Certes, l’Afrique est toujours, et pour longtemps encore, le continent le plus pauvre de la planète : la liste de l’OCDE des pays les moins avancés, PMA, compte 33 pays africains sur 49 soit également près des deux tiers des 54 Etats qui composent le continent noir. Si l’on complète cette liste par celle des douze pays « à faible revenu », également bénéficiaires de l’aide au développement, cinq autres pays africains sont concernés. Au total, seuls cinq pays d’Afrique apparaissent dans la liste des « pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche supérieure » : l’Afrique du sud, le Botswana, le Gabon, la Libye et Maurice.
Mais si l’Afrique représente le continent prioritaire pour les politiques d’aide au développement, c’est aussi parce que les défis qu’elle doit affronter prennent un relief particulier dans le contexte contemporain de la mondialisation.
a) L’Afrique comme creuset des défis de l’avenir
Comme le faisaient récemment remarquer Jean-Michel Severino et Olivier Ray (48), si l’Afrique est toujours un continent de misère et de violence, elle est aussi le creuset des défis les plus aigus. En termes démographiques, en premier lieu, les auteurs soulignent qu’elle est le théâtre de « l’aventure démographique la plus incroyable qu’ait jamais porté l’histoire de l’humanité » (49), étant passée de 100 millions d’habitants en 1900 à 700 millions en 2000, pour approcher aujourd’hui le milliard d’habitants et osciller entre 1,5 et 1,8 milliard en 2050. Cette explosion démographique – que n’ont pas connu, en ampleur, les géants comparables que sont la Chine ou l’Inde, qui n’ont multiplié leurs populations sur des périodes similaires « que » par 2,5 ou moins de 5 –, s’accompagne de bouleversements considérables aux conséquences incalculables.
La jeunesse de la population africaine, la plus jeune du globe, et l’explosion de l’urbanisation et des grandes cités, d’ores et déjà en cours, suffit à faire prendre la mesure des conséquences et des effets cumulatifs de cette croissance démographique en termes de besoins à satisfaire, aux plans alimentaire, éducatif, sanitaire ou environnemental ; en termes d’infrastructures et d’emplois, ne serait-ce que parce que « le sous-continent s’apprête à accueillir 27 millions de jeunes actifs de plus par an au début des années 2030. » (50). Autant de problèmes que les politiques de développement auront à relever. Le développement économique et social, mais aussi politique, de l’Afrique, sera étroitement marqué par la façon dont le continent et les pays qui le composent sauront y répondre, ce qui suppose qu’ils en aient les capacités nécessaires.
Mais l’Afrique est aussi le continent sur lequel d’ores et déjà les effets du réchauffement climatique se font le plus violemment sentir : « Bien que l'Afrique ne soit responsable que d'environ 3,8 % du total des émissions de gaz à effet de serre, les économies du continent sont au niveau mondial parmi les plus vulnérables aux conséquences néfastes des changements climatiques. » (51). En premier lieu sur les conditions de vie des agriculteurs et pasteurs africains, dont les terres et cheptels sont très directement affectés par la désertification et la raréfaction des ressources hydrauliques. Ces bouleversements ont une incidence particulière sur les modes de vie, les équilibres sociaux ancestraux internes, et peuvent devenir des sources de graves conflits : un récent rapport du Programme mondial des Nations Unies pour l’environnement soulignait ainsi que le conflit du Darfour pouvait être aussi considéré comme le premier conflit lié au réchauffement climatique, compte tenu de l’importance de la désertification que connaît la région depuis déjà plusieurs décennies.
Enfin, l’Afrique est aussi le continent où les taux de croissance économiques sont actuellement les plus forts, à tel point que Jean-Michel Severino et Olivier Ray estiment que le développement de l’Afrique subsaharienne est aujourd’hui devenu inévitable en précisant : « L’explosion démographique de l’Afrique, la densification de ses territoires, son urbanisation galopante modifient la nature de la croissance économique à sa portée : une croissance plus structurelle, plus endogène et donc bien plus solide que celle issue des seules exportations des matières premières » (52), avant de conclure qu’« il faudrait beaucoup de mauvaise volonté pour que l’Afrique subsaharienne ne connaisse pas au minimum 5 % de croissance économique par an. ». Ce qui a d’ores et déjà été le cas par le passé de la plupart des pays du continent : « En 2007, 25 pays ont atteint un taux réel de croissance du PIB de 5 % ou plus tandis que 14 autres enregistraient un taux de croissance compris entre 3 et 5 %. » (53). Dans l'ensemble, 39 pays ont progressé au taux de 3 % ou plus en 2007, année pendant laquelle le continent a progressé à un taux moyen de 5,8 %.
D’autres font néanmoins preuve d’un optimisme plus mesuré. Serge Michailof, notamment, qui soulignait au contraire devant la Mission que dans « de nombreux pays pauvres, le problème du développement vient d’une croissance démographique galopante et incontrôlable. Cf. à cet égard la situation des pays sahéliens, Niger, Burkina Faso, Mali, qui connaissent déjà une insécurité, une crise agricole, etc. Cette situation est source de tensions. De même, le problème de la Côte d’Ivoire est-il avant tout un problème démographique, le surpeuplement entraînant une course à la terre. » (54).
Ces divergences d’appréciation ne retirent rien au fait que l’Afrique concentre plus que toute autre région du globe un ensemble de risques qui font figurer ce continent en tête des priorités, des pays européens notamment.
b) Problématiques africaines et sécurité commune
En effet, comme le résumait Thierry Tanoh, vice-président de la Société financière internationale, du groupe de la Banque mondiale, devant votre Mission (55), « l’Europe a tout intérêt à ce que l’Afrique se développe. Si l’on veut réduire l’immigration vers l’Europe, une solution pour développer le continent africain doit être trouvée. L’immigration ne fait ni l’affaire de l’Afrique ni celle de l’Europe : vous avez l’immigration des pauvres, qui n’est pas une bonne chose pour l’Europe, mais aussi des élites, qui n’est pas une bonne chose pour l’Afrique. Il faut trouver un cadre pour une mobilité des personnes beaucoup plus rationnelle qu’aujourd’hui. »
La question des migrations n’est qu’une des nombreuses thématiques africaines dont les répercussions sont multiples et profondes, non seulement pour l’Afrique elle-même mais aussi pour les pays développés. Il en est évidemment de même des défis sanitaires, énergétiques ou encore climatiques, de l’Afrique. La réflexion que mènent en commun les Nations Unies et l'Union africaine depuis plusieurs années à ce sujet s’articule précisément en ces termes. Après un premier rapport publié en 2000 intitulé « L'Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le XXIe siècle ? », la Commission économique pour l'Afrique (CEA), la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), la Coalition mondiale pour l'Afrique et le Consortium pour la recherche économique en Afrique constataient que le continent avait progressé dans tous les domaines identifiés : enracinement de la démocratie ; diminution des conflits ; « volonté politique au niveau le plus élevé, de remettre le continent sur la voie d’un développement durable ». La Déclaration du Millénaire et le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), adopté par les chefs d'État et de gouvernement africains en 2002, ont ensuite ces dernières années opportunément servi de feuille de route à la croissance économique du continent. Son maintien, de même que la création d’emplois, les questions énergétiques, les changements climatiques, les progrès en matière de gouvernance, ou encore les réponses aux défis sanitaires et sociaux et à la marginalisation des populations pauvres, sont considérés comme autant de questions cruciales sur lesquelles asseoir la sécurité qui découle des progrès enregistrés.
S’il est vrai que, d’une part, « la façon dont l'Afrique s'attaque à certains de ces nouveaux défis du XXIe siècle déterminera son comportement au XXIe siècle » et, consécutivement, la qualité de la réponse apportée, le degré d’accompagnement de la part des pays du Nord ne sera pas moins déterminant. Plus que jamais sans doute, les préoccupations quant aux désordres potentiellement déstabilisateurs et dangereux qui surgissent notamment dans les Etats africains faillis ou fragiles – montée de l’islamisme au Sahel et risques terroristes inhérents –, et leurs répercussions internationales, imposent aux pays développés de dépasser la stricte compassion et de considérer, via l’aide, leur intérêt. Ce n’est pas un hasard si, voisinage géographique obligeant, de tous les bailleurs aujourd’hui, « les européens sont ceux qui accordent la plus forte priorité à l’Afrique subsaharienne. » (56). La solidarité occidentale se concentre sur l’Afrique non seulement pour son développement mais pour essayer de dessiner un futur commun. De nouvelles relations se nouent aussi, dans la mesure où, compte tenu de la nature des problèmes, ce n’est plus désormais d’aide qu’il s’agit à proprement parler. Comme le soulignait à ce sujet Serge Michailof dans son dernier ouvrage, « pays du Nord et pays du Sud ont en effet tous intérêt à gérer le problème du réchauffement climatique, à limiter la pollution atmosphérique, à gérer durablement les ressources en eau, à sauvegarder la biodiversité et les stocks pélagiques, à limiter la déforestation, à réduire les risques de pandémie, à éviter la poursuite de la transformation des océans en poubelle mondiale. Nous voyons bien qu’ici le terme d’aide est parfaitement désuet : en aidant les pays du Sud, le Nord tente en fait de cogérer avec le Sud certains biens publics mondiaux et donc s’aide lui-même. » (57). C’est « de partenariats entre pays également intéressés au succès des actions engagées » qu’il convient désormais de parler s’agissant de l'APD, pays donateurs et pays bénéficiaires étant aujourd’hui des « mutuellement concernés par la résolution des problèmes posés » (58), qu’ils soient ou non géographiquement localisés.
3) La question des pays émergents
Dans ce contexte international nouveau, la question des bénéficiaires de l’aide, notamment bilatérale, revient, d’autant plus lancinante que les moyens et contributions que les bailleurs peuvent y consacrer sont limités, comme le rappelait le Président de la République dans son intervention lors de la Conférence de Doha en 2008. Des interrogations surgissent quant à la sélection à opérer parmi les récipiendaires potentiels à privilégier.
Ainsi, question controversée entre toutes, celle de savoir s’il est légitime ou pertinent de mener des actions de coopération au développement au bénéfice d’un pays comme la Chine, par exemple, alimente les débats actuels. Récemment, Serge Michailof pouvait s’interroger au Sénat (59) sur la logique et la cohérence de l’aide française en soulignant que la Chine était aujourd’hui le 6e bénéficiaire de notre APD, alors même que les contraintes budgétaires actuelles imposent à la France de délaisser certains des terrains essentiels, dans des pays parmi les plus pauvres d’Afrique subsaharienne. Si cette appréciation est fondée sur le strict plan de la comptabilisation de notre APD, aux yeux de votre Rapporteure cet investissement de notre pays dans une forme de partenariat avec la Chine est extrêmement pertinent.
Aussi importe-t-il d’articuler cette question avec celle du rôle que les pays émergents peuvent et doivent jouer dans la mondialisation. Souvent très directement liée à la question de la gestion des biens publics mondiaux (BPM) ou celle du développement de l’Afrique subsaharienne, ce sujet intéresse aussi pour partie l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme.
Dans son rapport sur la mondialisation remis au Président de la République en 2007, l’ancien ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine, le rappelait opportunément : « Une régulation de la mondialisation est dans notre intérêt. (…) Nous devons inlassablement rechercher des alliés, organisation après organisation, d’abord en Europe puis ailleurs, pour constituer des majorités changeantes, domaine par domaine, y compris chez les émergents. C’est l’esprit même du multilatéralisme. » (60). Consécutivement, ajoutait-il, « pour augmenter nos chances d’atteindre nos objectifs de régulation dans les négociations multilatérales », convient-il de « rechercher méthodiquement les domaines où les émergents réalisent qu’ils ont aussi intérêt à la régulation. » (61).
Tout l’intérêt de l’aide au développement apportée aux pays émergents par les bailleurs, au premier rang desquels figure notamment l'AFD, que ce soit vis-à-vis de la Chine, du Mexique ou du Brésil, pour ne citer que ces trois pays, revient par conséquent à tenter de les arrimer à la réflexion et aux efforts des pays développés pour les inviter à prendre leur part dans la gouvernance de la mondialisation, sur des intérêts communs, et les amener aussi à respecter les règles du jeu auxquelles pour l’heure ils ne se conforment pas encore. Comme le faisait aussi remarquer Serge Michailof, « lorsque l’AFD soutient le programme sino-européen de coopération pour la capture et le stockage du carbone, elle n’aide pas la Chine mais participe à la recherche d’une solution à un problème global. Elle ne se situe plus du tout dans une logique altruiste de charité publique mais dans une logique de gestion durable d’intérêts communs. » (62).
En d’autres termes, autour de ces thématiques mais aussi des pratiques et négociations commerciales ou industrielles internationales actuelles, c’est toujours de mondialisation qu’il s’agit. L’interdépendance internationale impose la recherche d’une régulation qui rende la mondialisation à la fois acceptable pour tous et efficace. A cet égard, les difficultés des négociations internationales contemporaines traduisent les préoccupations des uns et des autres.
Qu’il se produise via des partenariats bilatéraux ou au sein des institutions internationales, cet arrimage des pays émergents à la gouvernance ne peut être dissocié de la réflexion sur l’équilibre entre les instruments de l’aide : les changements contemporains préfigurent de considérables bouleversements dans la gouvernance internationale. Ils ne seront évidemment pas sans effet sur le rôle et la place des institutions internationales chargées de l’aide au développement. Le rôle qu’un pays comme la France et que les uns et les autres pourront continuer à jouer, leur action bilatérale ou collective, dépendra fortement des orientations et de l’influence qu’ils auront pu prendre dès à présent dans les débats et au poids qu’ils auront eu dans la prise de décisions.
4) Les financements du développement
Quelque peu malmenée avec la baisse continue de l'APD au long des années 1990, la solidarité internationale a connu un certain regain au cours de la décennie qui s’achève et ce, dans tous les sens du terme : celle des uns envers les autres ; celle de tous envers tous.
La Déclaration du Millénaire et les OMD, principalement orientés sur des objectifs de réduction de la pauvreté, ont relancé la générosité du Nord envers les plus défavorisés que les conférences ultérieures, de Monterrey à Doha, se sont appliquées à conforter dans ses divers aspects. La mondialisation faisant prendre conscience de l’interdépendance et de la nécessité d’approches communes et globales, a contribué à la recherche de plus de cohérence et d’efficacité dans la fourniture de l’aide. C’est tout le sens de la Déclaration adoptée à Monterrey en 2002, aux termes de laquelle « les pays étant de plus en plus dépendants les uns des autres sur le plan économique, il y a lieu d’adopter une conception globale des problèmes nationaux, internationaux et systémiques interdépendants que pose le financement du développement » (63).
En complément, des objectifs chiffrés, pourtant initialement fixés de manière arbitraire, comme le taux de 0,7 %, sont devenus des normes à l’aune desquelles les acteurs de l’aide sont désormais jugés et sur lesquels ils sont sommés de s’aligner. Le dernier des défis de l'APD contemporaine est par conséquent celui des financements de l’aide, question rendue tout particulièrement aiguë dans une conjoncture économique et financière des plus délicates.
Il n’est pas non plus inutile de rappeler ici que les financements du Nord n’ont cependant jamais été considérés comme exclusifs ni même prioritaires, du moins dans la période contemporaine au cours de laquelle a mûri la réflexion sur la nécessité d’approches partenariales et coordonnées. En effet, si l’on reprend les principales déclarations adoptées ces dernières années, il apparaît en premier lieu que « la responsabilité principale d’assurer leur propre développement incombe aux pays en voie de développement eux-mêmes (…) » (64). Dans ce schéma, les pays riches interviennent en appui des pays en développement, car « si considérables que soient leurs propres efforts, ils ne suffiront pas à leur permettre d’atteindre les objectifs de développement voulus aussi rapidement qu’il le faut si les pays développés ne leur viennent pas en aide en mettant à leur disposition davantage de ressources financières et en adoptant à leur égard des politiques économiques et commerciales plus favorables. » (65).
Quoi qu’il en soit, ce sujet, tout autant que les précédents que votre Rapporteure a abordés, concerne directement la nature des instruments de l’aide et conditionne les choix futurs à définir en termes d’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme.
Le montant des déficits publics est aujourd’hui tel qu’il rend évidemment l’engagement des pays développés de consacrer 0,7 % de leur RNB à l'APD plus difficile à tenir que jamais. En ce qui concerne notre pays, avant même l’éclatement de la crise actuelle, la commission du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France s’était interrogée sur la pertinence de maintenir cet objectif, à la lumière de ce qu’il représente en termes d’efforts budgétaires : « Veut-on, en particulier, maintenir l’objectif de 0,7 % du revenu national brut (RNB) en 2015 sachant qu’il sera très difficile à atteindre pour des raisons tenant à la structure de notre aide, comme à la situation des finances publiques ? » (66). Pour que les termes du débat soient sans ambiguïté, le document précisait plus loin :
« Si la France veut :
- stabiliser son niveau d’APD exprimé en pourcentage du RNB (0,45 % en 2008), le budget d’aide français devrait augmenter d’un ordre de grandeur de 750 millions d’euros par an de 2009 à 2012 ;
- atteindre l’objectif de 0,7 % du RNB en 2012 (objectif souscrit à Monterrey en 2002), elle devra augmenter de 2 milliards d’euros par an ; de 1,5 milliard d’euros par an si elle se contente de l’atteindre en 2015, engagement pris par les pays membres de l’Union européenne en 2005. » (67).
Sur cette question cruciale, les positions des principaux donateurs diffèrent quelque peu. On a vu que certains, telle la Belgique, avaient inscrit l’objectif dans des dispositions législatives. C’est aussi la position du gouvernement de David Cameron, qui a repris l’idée de Gordon Brown d’une loi en ce sens, qu’il est prévu que le Parlement adopte à l’échéance de novembre 2011 pour sanctuariser – « enshrine » – le taux de 0,7 % d’ici à 2013 (68). Avant même cette issue législative, le programme de gouvernement britannique de coalition l’a réaffirmé : « le gouvernement croit que, même dans ces temps économiques difficiles, le Royaume-Uni a la responsabilité morale d’aider les peuples les plus pauvres du monde. Nous honorerons nos engagements (…) » (69).
Indépendamment de ces exceptions notables, ou des efforts remarquables de cinq pays, essentiellement scandinaves, Suède, Norvège et Danemark, ainsi que du Luxembourg et des Pays-Bas, qui sont aujourd’hui les seuls à avoir d’ores et déjà atteint et même dépassé cet effort, force est de constater que, d’une manière générale, il y a loin de la coupe aux lèvres. Il fut ainsi un temps, en 2005 lors du Sommet de Gleneagles, où notre pays s’était engagé à atteindre l’objectif de 0,7 % en 2012, avec une étape intermédiaire à 0,5 % en 2007. Aujourd’hui, comme le rappelle le Document cadre français de coopération au développement, récemment adopté par le CICID, avec un taux de 0,47 % de son RNB consacré en 2009 à l'APD, la France, malgré son retard sur ses promesses, se situe dans la moyenne des pays de l’Union européenne membres de l’OCDE, soit 0,44 %, et apparaît même « bien au-dessus de la moyenne de l’ensemble des membres du CAD (0,32 %) a fortiori des membres du G7 (0,28 %). » (70). On peut de même préciser qu’elle est nettement au-dessus des performances des Etats-Unis (0,20 %) ou du Japon (0,18 %). En 2009, l’aide publique au développement ne représentait d’ailleurs que 0,2 % du RNB mondial, et l’effort que consacrent les pays donateurs en pourcentage de leur RNB est aujourd’hui encore inférieur à ce qu’il était il y a cinquante ans (71).
Tombé à son étiage à la fin des années 1990, l’effort d’aide au développement a certes depuis repris son essor. Les engagements internationaux ont été réaffirmés avec plus de force encore, des conférences internationales, de Monterrey à Doha, ont tiré des conclusions jugées plus contraignantes. De G8 en Assemblée générale des Nations Unies, il n’est pas non plus de forum de haut niveau qui ne revienne sur la nécessité d’assurer le niveau et la pérennité des financements du développement. Le Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement de septembre 2010 plus que tout autre, qui a célébré le dixième anniversaire de la Déclaration du Millénaire et a confirmé les engagements antérieurs. Les uns et les autres acteurs, soit seuls soit au niveau régional, comme le fait régulièrement l’Union européenne, sont sur le front et ne cessent d’afficher leurs bonnes intentions et de réitérer leurs engagements.
Même si on a pu le considérer comme arbitraire et non fondé sur des éléments indiscutables, même si d’autres facteurs interviennent dans l’efficacité de l’aide et que privilégier cette seule donnée biaise quelque peu le débat, il est de fait que le taux de 0,7 % représente en premier lieu un engagement politique
– « majeur », pour reprendre les termes du Président de la République à Doha –, de la part de la communauté des bailleurs dans sa globalité et de chacun de ses membres, qui n’ont cessé de le répéter avec force depuis maintenant quarante ans sans jamais s’en approcher. Ne serait-ce que pour cette seule raison, il semble évidemment difficile, si ce n’est impossible, à remettre aujourd’hui en question.
La crise financière qui a éclaté en 2008 a toutefois singulièrement compliqué la donne : on voit mal aujourd’hui comment les circonstances actuelles pourraient permettre de dégager les marges nécessaires pour respecter cet engagement, que ce soit en 2013 ou en 2015, alors même que les déficits publics ont plus que doublé depuis 2008. A cet égard, il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler, comme le soulignaient naguère opportunément Jean-Michel Severino et Olivier Charnoz, que, au cours des années 1990, la pression des critères de Maastricht s’était ajoutée à la fin de la Guerre froide et à la chute de l’aide soviétique, pour contribuer à rendre des arbitrages budgétaires en défaveur de l'APD (72).
b) Besoins et modalités de financements du développement
Les tentatives de chiffrage de l'APD optimale effectuées ces dernières années ont conclu à la nécessité d’augmenter fortement le niveau des financements. La réflexion autour de la Déclaration du Millénaire a notamment contribué à la détermination d’une estimation moyenne de quelque cinquante à soixante-dix milliards de dollars supplémentaires par an pour garantir que les objectifs du Millénaire aient une chance d’être atteints dans les seuls pays pauvres. Ces ordres de grandeur sont aujourd’hui communément admis : malgré des méthodologies différentes, les institutions qui se sont attelées à cette tâche se rejoignent globalement : 10 à 15 milliards sont nécessaires pour l’éducation primaire ; 25 à 30 milliards pour les objectifs de santé ; 10 à 25 milliards pour l’accès à l’eau et à l’assainissement (73).
Quoi qu’il en soit, il est constant que les besoins de financement exigés par le développement sont énormes. Ils le sont d’autant plus que ces données ne portent pas sur tous les pays en voie de développement, et ne prennent pas en compte les autres composantes plus récentes de l'APD, touchant aux BPM ou au changement climatique, dont on sait l’importance croissante qu’ils prennent dans les problématiques liées tant à la mondialisation qu’au développement. A ce jour, comme l’a rappelé le sommet de New York de septembre 2010, les contributions internationales au développement restent dramatiquement insuffisantes et systématiquement en deçà des engagements : le G8 avait annoncé en 2005 à Gleneagles un doublement de l’aide apportée par ses membres à l’Afrique subsaharienne. Seize milliards de dollars font aujourd’hui défaut. L’OMS estime que 37 milliards de dollars manquent également au secteur de la santé, autant que pour traiter la malnutrition. Dix autres milliards de dollars seraient nécessaires pour le secteur de l’éducation et dix fois plus encore à l’horizon 2020 pour faire face au changement climatique (74).
Consécutivement, sauf à n’être finalement que des incantations sans efficacité, mais néanmoins répétées année après année de résolution en résolution, les questions tenant au financement public du développement doivent inévitablement trouver des solutions inventives et pérennes, dont on mesure l’importance sur le moyen terme. Non seulement parce que les besoins sont effectivement considérables, mais parce que le maintien de politiques publiques d’aide au développement dignes de ce nom, suppose un niveau de participation au financement qui soit suffisant et réponde effectivement aux attentes et un engagement politique des Etats et des institutions publiques.
Il ne s’agit pas ici d’entrer dans les controverses d’experts quant aux possibles effets pervers de l’aide au développement sur les économies intéressées, tenant notamment aux capacités d’absorption des flux financiers externes, aux considérations sur la gouvernance de l’aide, aux conditions de son efficacité. Il convient plutôt de remarquer que depuis quelques années, la concurrence est devenue vive entre modalités de financements du développement, ce qui ne peut que finir par fragiliser l’aide publique.
En effet, des modalités annexes et nombreuses de financement du développement, complémentaires de l'APD, sont apparues ces dernières années. Elles prennent aujourd’hui une part essentielle dans l’ensemble de l’aide au développement et, tendanciellement, relèguent à terme l'aide publique, au rythme où vont les choses, à n’occuper qu’une part résiduelle. Ainsi en est-il des investissements directs étrangers, de l’épargne domestique ou des transferts des migrants, pour ne pas mentionner les divers mécanismes de financements innovants institués ou envisagés au cours de la dernière décennie, tous désormais considérés comme déterminants. Pour ne prendre que la situation des transferts des migrants vers leurs pays d’origine, les flux concernés, avant l’éclatement de la crise financière, étaient d’ores et déjà estimés à deux ou trois fois, au niveau mondial, le montant global de l'APD. Selon les données de l’OCDE en effet, après qu’ils l’eurent dépassé pour la première fois en 2004, ces transferts représentaient, dès 2007, quelque 220 à 300 milliards de dollars par an contre un montant total d’aide publique au développement alors chiffré à un peu plus de 120 milliards. En d’autres termes, l'aide publique est d’ores et déjà loin de représenter la part la plus importante des financements consacrés au développement.
On est donc amené à s’interroger inéluctablement sur le poids, l’efficacité et l’influence réels d’une aide publique au développement dont certaines modalités – bilatérales, par exemple –, seraient exagérément réduites. Cet aspect est essentiel, il pose directement la question de l’influence qu’une politique d’aide peut réellement exercer et celle de la répartition des financements disponibles selon les instruments et les canaux.
Si les modalités de financements ont évolué, l’offre d’aide au développement s’est aussi considérablement étoffée ces dernières années : ce ne sont plus seulement, loin de là, les seuls bailleurs « historiques », les pays membres du CAD, qui interviennent. En parallèle, nombre de « nouveaux » pays, non membres de l’OCDE, en passe de réussir leur transition économique, mènent désormais leur propre politique d’aide, comme précédemment les bénéficiaires du Plan Marshall l’étaient aussi devenus. Les grands émergents, au premier rang desquels la Chine, interviennent notamment en Afrique, pour des montants de financements encore pour la plupart inconnus, mais d’ores et déjà considérables. Tarderont-ils longtemps à revendiquer la place qui leur correspond dans les débats et la gouvernance de l’aide ? S’y ajoutent aussi les financements privés multiples, des ONG nationales ou internationales, dont certaines disposent de budgets multimillionnaires. Depuis au moins Porto Alegre, elles participent aussi activement et impriment leur marque au débat international sur la mondialisation et mènent de nombreux partenariats avec les organisations de la société civile des pays du Sud. Comment ne pas mentionner enfin les fondations, encore plus puissantes, au premier rang desquelles la Bill and Melinda Gates Foundation, adossée aux fortunes de Bill Gates et de Warren Buffett, acteur aujourd’hui majeur de l’aide internationale, à l’action déterminante, notamment en matière de santé, capable de mobiliser chaque année des fonds comparables si ce n’est supérieurs à ceux que l’OMS peut engager.
Or, les modalités de la comptabilisation de l'APD « officielle », au sens du CAD, qui inclue les annulations de dettes et agrège des dépenses dont l’incidence sur le développement réel des pays est ténue, tels les frais d’écolage, ne sont pas faites pour conforter la légitimité des politiques publiques d’aide, à l’heure où une double concurrence fait rage, par d’autres modes de financements et d’autres acteurs. Financements privés de toutes sortes et financements innovants vont donc peser durablement sur la détermination des politiques publiques d’aide au développement. La recherche d’un équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme ne peut faire l’économie d’une réflexion sur cet aspect de la question.
C – Problématiques d’une gouvernance mondiale du développement, réponse collective aux enjeux du XXIe siècle
L’effort d’aide publique au développement a toujours été contesté. Cette politique publique particulière souffre par nature d’un déficit de légitimité, que la conjoncture n’aide sans doute pas à résorber. Certes, les citoyens des pays développés, et du nôtre en particulier, sont toujours prompts à répondre aux appels à l’aide humanitaire, comme ils l’ont encore témoigné au début de l’année lors du séisme en Haïti. Mais quel que soit le degré de générosité qu’ils sont spontanément prêts à manifester, cinquante ans plus tard, la Corrèze ne passe-t-elle pas aujourd’hui encore avant le Zambèze ? Comme le faisait précisément remarquer le Livre blanc sur la politique étrangère de la France, « alors que les pays développés ont pris des engagements sur le niveau quantitatif de leur aide qu’ils peinent à tenir, le besoin de relégitimer les politiques d’aide et de renforcer le consensus politique sur lequel elles sont fondées se fait sentir. » (75). Analyse que partageait, entre autres, François Bourguignon, qui, lors de son audition par votre Mission (76), établissait pour sa part une relation entre l’efficacité de l'APD – qu’il est au demeurant par nature difficile de prouver, comme on sait –, et sa visibilité et sa légitimité auprès des contribuables des pays développés.
Indépendamment de cela, la critique s’exprime aussi, et parfois vivement, dans les pays en développement eux-mêmes – cf. une certaine littérature publiée ces derniers mois, pour laquelle l’aide au développement serait non seulement inefficace mais aussi nuisible aux supposés bénéficiaires qui se trouveraient finalement bien mieux de n’être pas assistés (77). Ce questionnement n’est certes pas récent et les errements et travers de l'APD depuis ses origines n’ont rien fait pour asseoir sa légitimité : entre néocolonialisme, ajustements structurels, échecs avérés et diktats ultralibéraux, les biais ont été suffisamment nombreux pour prêter le flanc à la critique sans qu’il soit nécessaire de s’y arrêter ici. Proche de cette pensée, Matata Ponyo Mapon (78), ministre des finances de RDC, critiquait devant votre Mission le fait qu’au-delà des questions de financements, l'APD manquait cruellement de vision de long terme. A trop privilégier les règles de gestion et de bonne gouvernance, elle en oubliait l’essentiel : contribuer à la formation en nombre suffisant d’hommes et de femmes capables d’exercer les responsabilités permettant le développement endogène des pays bénéficiaires ; faute d’en être ainsi, l’aide ne pouvait qu’être versée à fonds perdus sans jamais réussir à briser le cercle vicieux. Quels que soient les milliards injectés dans un pays comme la RDC, l'APD ne saurait jamais produire que du sous-développement, concluait-il.
Ainsi prise entre deux feux, l’aide au développement a entrepris d’évoluer. La communauté internationale, bailleurs et bénéficiaires confondus, s’est mobilisée et sa réflexion a accouché d’un certain nombre de principes qu’elle essaie depuis de mettre en œuvre, avec difficulté, malgré le consensus général et les professions de foi. C’est autour d’eux que s’articule aujourd’hui la gouvernance contemporaine de l’aide publique au développement. Chacun d’entre eux intéresse aussi, et de manière très concrète, la question de l’équilibre entre bilatéralisme et multilatéralisme, aujourd’hui et pour demain.
1) Le paradigme contemporain de l’efficacité et ses incidences
A l’instar d’autres aspects précédemment abordés, comme la fixation de l’objectif de 0,7 %, ces questions ont été évoquées dans le passé, il y a même parfois fort longtemps. Ce n’est pas avec la Déclaration de Paris en 2005 que la communauté internationale a découvert les principes qui sous-tendent aujourd’hui la réflexion collective sur l’efficacité de l’aide. Déjà, la trame de la résolution 1710 (79) laissait poindre les notions de coordination et d’appropriation. Dix ans plus tard, la résolution 2626 parlait de stratégie globale de développement reposant sur l’action commune et concertée des pays en développement et des pays développés ; d’aide déliée ; d’harmonisation des conditionnalités de l’aide. On y parlait d’« esprit d’association et de coopération constructives », d’interdépendance des intérêts, de volonté politique et de la détermination collective d’atteindre les buts et objectifs. Tout cela était donc en gestation depuis longtemps. Il a néanmoins fallu attendre le tournant du siècle pour que la préoccupation de l’efficacité prenne le pas sur les autres considérations.
La question de l’efficacité de l’aide se pose aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité que les circonstances sont difficiles, qui obligent à des coupes drastiques dans les dépenses des Etats et, surtout, à procéder à des évaluations rigoureuses de l’impact des politiques publiques. Comme telle, l'APD a souffert des critiques qu’elle a endurées. La « fatigue de l’aide » s’est précisément alimentée de son inefficacité supposée, qui n’a pas été sans influence sur la diminution des montants au cours de la décennie 1990, comme on a pu en effet le faire remarquer : « Après une fin de XXe siècle financièrement désastreuse pour l'APD, où son " inefficacité " a été invoquée pour la tuer, les acteurs de l'aide ont compris le message. » (80).
Un effort de légitimation a par conséquent été d’autant plus nécessaire que la diminution des crédits consacrés à l'APD entraîne aussi un questionnement sur son utilité : de nouvelles modalités de financements apparaissent qui participent aussi au développement et vont jusqu’à dépasser en volumes cumulés une aide publique dont le rôle géopolitique et de réponse aux propres intérêts des bailleurs est parallèlement dénoncé. Consécutivement, indispensable naguère, cette aide devient suspecte. Comme le faisait remarquer à cet égard le Livre blanc déjà cité, « c’est au début des années 1990 que les flux financiers privés à destination des pays en développement ont dépassé ceux de l’APD. C’est également le cas aujourd’hui des transferts financiers des migrants vers leurs pays d’origine. Le rôle et l’efficacité de l’APD ont fait depuis l’objet de nombreuses interrogations » (81), les auteurs précisant plus loin que « l’objet prioritaire de transferts financiers devenus relativement moins importants est moins clair : la fonction de solidarité envers les pays les plus pauvres demeure, mais l’aide ne représente plus que un huitième des flux financiers à destination des pays en développement contre plus du tiers il y a vingt-cinq ans. » (82).
Le Consensus de Monterrey (Extraits)
(2002)
43. Les pays bénéficiaires et les pays donateurs, tout comme les institutions internationales, doivent s’efforcer de rendre l’APD plus efficace. Les institutions multilatérales et bilatérales spécialisées dans le financement et le développement doivent notamment intensifier leurs efforts pour :
• Harmoniser leurs procédures opérationnelles par rapport à la norme la plus élevée afin de réduire les coûts des transactions et assouplir les modalités de décaissement et d’acheminement de l’APD, en tenant compte des besoins et des objectifs nationaux de développement sous le contrôle du pays bénéficiaire ;
• Appuyer et encourager les initiatives récentes comme l’abandon de l’aide liée, notamment la mise en oeuvre de la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le déliement de l’aide fournie aux pays les moins avancés, que l’OCDE a approuvée en mai 2001. Des efforts supplémentaires doivent être consacrés à la question des restrictions contraignantes ;
• Améliorer la capacité d’absorption et la gestion financière des pays bénéficiaires afin de promouvoir l’utilisation des instruments les plus adaptés répondant aux besoins des pays en développement et à la nécessité d’une prévisibilité des ressources, notamment des mécanismes de soutien budgétaire, s’il y a lieu, le tout dans le cadre de consultations ;
• Utiliser les cadres de développement qui sont contrôlés et gérés par les pays en développement et qui comportent des stratégies de réduction de la pauvreté, y compris les documents stratégiques sur la lutte contre la pauvreté, pour une prestation d’aide sur demande ;
• Accroître la contribution des pays bénéficiaires à la conception de programmes d’assistance technique, y compris la passation de marchés, renforcer leur contrôle sur ces programmes et augmenter l’utilisation effective des ressources locales d’assistance technique ;
• Promouvoir l’utilisation de l’APD pour stimuler d’autres modes de financement pour le développement comme l’investissement étranger, les échanges commerciaux et les ressources nationales ;
• Renforcer la coopération triangulaire, comprenant les pays en transition, et la coopération Sud-Sud, comme moyens d’exécution ;
• Améliorer la focalisation de l’APD sur les démunis, la coordination de l’aide et la mesure des résultats.
Nous invitons les donateurs à faire le nécessaire pour appliquer ces mesures favorables à tous les pays en développement, notamment dans le contexte immédiat de la stratégie globale formulée dans le nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique et d’initiatives similaires dans d’autres régions, et au profit des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des pays en développement sans littoral. Nous nous félicitons des débats consacrés aux propositions de libéraliser le financement du développement, y compris en ayant davantage recours à des dons.
Consécutivement, comme le disaient Jean-Michel Severino et Olivier Ray, « la recherche et la mesure de " l'efficacité " sont devenues l'un des principaux moteurs de changement de l'aide ».
Après la première étape qu’a constituée la Déclaration de Monterrey en 2002, cinq engagements ont finalement été dégagés en 2005 sur lesquels la gestion de l’aide doit désormais reposer : Appropriation, Alignement, Harmonisation, Gestion axée sur les résultats et Responsabilité mutuelle sont désormais les maîtres mots du vade-mecum de l’aide publique au développement. La communauté internationale s’est alors engagée sur quelques axes majeurs aux termes desquels « les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de développement et assurent la coordination de l’action à l’appui du développement ». Pour leur part, « les donneurs font reposer l’ensemble de leur soutien sur les stratégies nationales de développement, les institutions et les procédures des pays partenaires. ». En parallèle, « les actions des donateurs sont mieux harmonisées et plus transparentes, et permettent une plus grande efficacité collective. ». La gestion orientée vers les résultats doit permettre de mieux « gérer les ressources et améliorer le processus de décision en vue d’obtenir des résultats. ». Enfin, « les donneurs et les pays partenaires sont responsables des résultats obtenus en matière de développement. » (83).
Depuis la Conférence de Rome en 2003 jusqu’à l’adoption du Programme d’Accra en 2008, la communauté internationale n’a cessé de consacrer ses efforts à la recherche des moyens d’une aide publique au développement plus efficace et plus efficiente. Il ne s’agit en effet pas seulement de tendre à l’efficacité de l’aide et de viser des résultats mesurables, il s’agit aussi d’une gestion plus soucieuse des coûts, notamment de transaction. A cet égard, la Déclaration de Rome sur l’harmonisation (84) était un premier pas concret, qui mettait nettement l’accent sur les procédures et pratiques opérationnelles des bailleurs dans leurs relations avec les pays bénéficiaires. Elle précisait notamment que le moment était venu de « simplifier et harmoniser nos conditionnalités et réduire les coûts qui y sont associés tout en améliorant la surveillance fiduciaire, la responsabilité à l’égard du public et les efforts visant à obtenir des résultats de développement concrets. ». Pour ce faire, des perspectives étaient tracées qui iront s’affinant, de réunion en réunion, jusqu’à Accra. Le Programme (85) qui y sera adopté lors du troisième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide au développement définira « trois défis majeurs pour accélérer les progrès dans le domaine de l’efficacité de l’aide » : l’appropriation par les pays bénéficiaires ; le montage de « partenariats plus efficaces et davantage ouverts à tous » ; l’obtention de résultats en matière de développement et la communication sur ceux-ci.
Il était inévitable que la thématique de l’efficacité de l’aide finisse par s’imposer. Le tournant du siècle était au volet social : avec l’adoption de la Déclaration du Millénaire, la lutte contre la pauvreté prenait définitivement le pas sur les autres aspects et composantes de l'APD, et la conjoncture économique et financière, de son côté, rendait parallèlement nécessaire la légitimation de l’aide. L’efficacité est donc devenue le pivot sur lequel les instruments de l’aide, tant bilatérale que multilatérale, se sont articulés. Le terrain restait néanmoins glissant : car sans même tomber dans la critique vive de Dambisa Moyo, comme cela a été maintes fois rappelé, « on ne sait toujours pas ce qui explique et détermine les processus de développement réussis » (86), et par conséquent, la part que peut y prendre l’APD. La thématique de l’efficacité de l’aide a par conséquent été abordée sous l’angle le plus consensuel, qui pouvait le moins prêter le flanc à la discussion : celui de la collaboration de tous les acteurs, aux efforts tendus dans un même but. Il n’y a ainsi désormais plus d’action de coopération qui ne soit fondée sur des critères de partenariats, de programmation par résultats, d’appropriation et d’utilisation des systèmes de gestion publique nationaux des bénéficiaires, ou qui, à tout le moins, y prétende dans la forme si les conditions de fond – en d’autres termes, le niveau de gouvernance du pays concerné –, ne le permettent pas. Ce paradigme s’est définitivement imposé à l’ensemble des acteurs de l’aide, qu’ils soient multilatéraux ou bilatéraux. Comme le faisait remarquer il y a quelques temps l’ambassadeur Pierre Jacquemot, « l’édifice proposé [par la Déclaration de Paris] est impressionnant par sa taille et son niveau de détail : 56 engagements à prendre par les donateurs et les bénéficiaires pour améliorer la qualité de l’aide et son impact sur le développement. (…) Désormais, la Déclaration sert de charte pour la majorité des donateurs comme des bénéficiaires. Au milieu de l’année 2007, plus d’une centaine de pays l’avaient formellement adoptée. » (87).
b) … et aujourd’hui universelle
Cette exigence d’efficacité, mais aussi d’efficience, est désormais au cœur, non seulement de la préoccupation des citoyens mais aussi des propres Etats, qu’ils soient donateurs ou bénéficiaires de l’aide. C’est tout le sens de l’exigence de transparence et de redevabilité des institutions internationales de développement, qui s’est également imposée au cours de cette période charnière. Leur crédibilité et leur réputation, un temps mises à mal, ont justifié une réorientation profonde de leur approche et de leur relation aux bénéficiaires.
Consécutivement, l’ensemble des acteurs, institutions internationales ou bailleurs bilatéraux, qui participent à la politique d’aide au développement ne peut aujourd’hui échapper au feu nourri de l’évaluation, dont Jean-Michel Severino et Olivier Ray estimaient récemment qu’elle devrait être revue et améliorée afin de devenir un véritable outil de mesure des actions de développement qui « permettrait de se concentrer sur le coeur de la question : l’impact de ces politiques. » (88). Les institutions qui reçoivent des contributions, obligatoires ou volontaires, de la part des Etats, ont ainsi mis en place des systèmes d’audits internes et externes de leurs programmes et pratiques et en publient les résultats dans un souci de transparence vis-à-vis de leurs tutelles, lesquelles les examinent avec la plus grande attention. Les Etats procèdent eux-mêmes à leurs propres évaluations des politiques que ces institutions mènent. La reconstitution régulière des fonds des banques régionales de développement est par exemple l’occasion à la fois d’évaluer leur action et d’essayer de peser, autant que faire se peut, sur leurs orientations stratégiques, sectorielles ou géographiques. C’est sur ces évaluations que repose in fine, le réengagement financier de Etats contributeurs. La France a par exemple procédé tout dernièrement à celles de l’action de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, quelques mois avant de renouveler son engagement au sein de leurs fonds concessionnels respectifs, le FAD pour l’une et l’IDA, pour la seconde.
Les Etats eux-mêmes sont depuis longtemps soumis au regard critique de leurs pairs et doivent conformer leur politique d’aide bilatérale aux directives du CAD de l’OCDE. Ici aussi, l’objectif est la recherche d’une meilleure efficacité de l’aide apportée. La politique d’aide de la France a ainsi été analysée en 2008 et, à la mi-septembre dernier, le CAD procédait à une revue à mi-parcours de la politique française, afin d’étudier la mise en œuvre des recommandations qui avaient alors été présentées. Les exemples pourraient être multipliés à l’envie : récemment, la Fondation Bill et Melinda Gates publiait ainsi un rapport sur l’efficacité des programmes de la Banque mondiale en matière de santé en Afrique subsaharienne.
Mieux, l’exigence d’efficacité conditionne désormais pour partie des aspects fondamentaux des politiques et des stratégies de l’aide servie par les bailleurs. Les programmes d’appui à la gouvernance sont ainsi devenus en quelques années une thématique incontournable, et l’une des priorités, par exemple, de l’aide française. Il ne s’agit pas ici d’en contester la pertinence – il est indiscutable qu’un Etat bien géré doit mieux contribuer au développement qu’un Etat failli –, mais de remarquer que, après la décennie des ajustements structurels où tous les acteurs de l’aide se souciaient peu, pour le moins, du renforcement des capacités des Etats, le balancier est aujourd’hui revenu en force. Au nom de l’efficacité de l’aide, de nouvelles thématiques se sont imposées qui n’existaient pas autrefois lorsqu’on se contentait de projets sociaux ou d’infrastructure. En d’autres termes, l’efficacité est venue conditionner pour partie l’allocation de l’aide et influencer le contenu des politiques des bailleurs. La gouvernance, démocratique ou non, fait désormais partie intégrante des portefeuilles des agences bilatérales ou multilatérales, et a un effet direct sur les autres composantes de l’aide, au nom du dogme de l’efficacité : sans un niveau de gouvernance minimal ou suffisant, pourquoi investir dans un pays donné, dans la mesure où les fonds versés seront perdus ? Ainsi, c’est tout à la fois l’allocation sectorielle mais aussi géographique, de l’aide qui est désormais affectée par la priorité accordée à la recherche de l’efficacité de l’aide qui devient vecteur de conditionnalité d’une APD contrainte par des conjonctures budgétaires difficiles.
De même en est-il très directement de la manière dont les politiques d’aide sont aujourd’hui conduites. De nouveaux instruments de gestion de l’aide sont apparus, qui traduisent le fait que l’aune, désormais et malgré les aléas concrets des partenariats entre bailleurs et bénéficiaires, est le degré de processus participatif. Il n’est pas d’institution de développement qui aujourd’hui n’ait institué de tels mécanismes dans sa relation avec les pays bénéficiaires, depuis le diagnostic des situations de départs jusqu’à l’évaluation de l’exécution des programmes en passant par leur définition. La France a ainsi les Documents Cadre de Partenariat, (DCP), qui sont désormais la base contractuelle de ses engagements avec les pays bénéficiaires de son aide. Les principaux bailleurs bilatéraux travaillent de même, tout comme les organisations internationales : la Banque mondiale a développé les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), qui définissent les objectifs à long terme pour un pays donné sur le plan macroéconomique, structurel et social. La Banque africaine de développement a ses propres Documents de Stratégie par Pays (DSP), qui prennent en compte les impératifs de performance et de résultats et sont alignés sur le plan de développement des pays bénéficiaires et leurs objectifs en matière de réduction de la pauvreté. Le cadre d’intervention du PNUD est le Document Programme de Pays, (DPP), élaboré par le gouvernement concerné à partir du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. La Commission européenne élabore pour sa part des Documents stratégiques par pays, déclinaisons de ses Documents Stratégiques régionaux, qui déterminent les principaux objectifs et les priorités sectorielles pour la coopération, d’où seront établi les cadres pertinents pour la définition et la préparation des programmes et des projets.
Quels que soient les dénominations et sigles, ces documents ont tous aujourd’hui la particularité de résulter, dans leur principe tout du moins, de processus consultatifs avec les différents acteurs : autorités des pays partenaires, société civile, secteur privé et autres partenaires au développement, la participation apparaissant comme garante de la meilleure exécution des projets.
Ce ne sont pas seulement les instruments stratégiques et de planification qui ont changé depuis quelques années. L’exigence d’efficacité a logiquement également touché la gestion de l’aide : l’aide budgétaire, globale ou sectorielle, est une modalité qui tire très directement son origine de la réflexion internationale sur l’efficacité. L’utilisation des systèmes nationaux de gestion publique est recommandée et fait partie des outils privilégiés dans une perspective d’appropriation, de réduction des coûts de transaction, et de meilleur pilotage national.
L’aide au développement a donc considérablement évolué ces dernières années depuis que la réflexion s’est engagée sur son efficacité. Cette évolution a porté à la fois sur les aspects stratégiques, sur les contenus, comme sur les questions touchant à la gestion. Il était inévitable que son impact porte également sur la problématique bilatéralisme – multilatéralisme.
La réflexion commune engagée sur ces thématiques, et la nécessité sur laquelle tout le monde s’accorde aujourd’hui de fournir une aide de meilleure qualité, ont débouché sur des décisions en faveur d’une coordination étroite entre bailleurs. Des processus collaboratifs se sont naturellement imposés qui se sont traduits par la définition d’un cadre de partage du travail sur la base des avantages comparés des uns et des autres. Consécutivement, dans la pratique, des compromis doivent être effectués sur la base de ces considérations, des engagements pris et, en ce qui concerne la politique d’aide d’un pays comme le nôtre, le positionnement du curseur sur l’axe bilatéral-multilatéral ne peut que s’en trouver affecté. Au sein de l’UE par exemple, l’adoption par les 27 en 2007 du Code de conduite (89) s’est naturellement inscrite dans cette logique et traduit une étape nouvelle. Le Code de conduite suppose en effet que des mécanismes de cofinancement soient mis en place entre pays européens, et que des délégations de ressources soient concédées. Il suppose par conséquent que des Etats membres confient à d’autres, mieux placés sur tel secteur ou dans tel pays bénéficiaire, le soin de gérer le portefeuille qu’ils auraient, sans cet accord, développé avec leurs propres ressources financières et humaines. Au risque, par conséquent, au nom de l’efficacité, de perdre en visibilité et en influence directe. Ce que faisait notamment remarquer François Bourguignon lors de son audition (90).
Il n’est pas indifférent de rappeler à ce stade que la démarche de la France s’inscrit résolument dans cette direction : avant même que le Code de conduite soit adopté, le « Plan d’action français pour le renforcement de l’efficacité de l’aide » avait été validé en décembre 2006 par la conférence d’orientation stratégique de programmation pour mettre en application les engagements que la France avait pris en adoptant la Déclaration de Paris l’année précédente. Cela étant, le Plan français allait même plus loin encore en axant l’effort sur le renforcement des capacités des pays bénéficiaires, et donc sur leur gouvernance, sur l’approfondissement des DCP comme instruments de planification et de pilotage de l’aide sur le terrain, et notamment en faveur de pratiques partenariales approfondies (91).
La logique de l’efficacité de l’aide, la logique d’accords entre partenaires tels que le Code de conduite européen, conduisent à relativiser, dans un monde globalisé tel que celui dans lequel nous évoluons aujourd’hui, la visibilité et l’influence attendues d’une politique bilatérale d’aide au développement. Inévitablement, la visibilité que la France peut retirer de son aide, l’influence qu’elle peut exercer grâce à cela, ne peuvent plus obéir aux mêmes critères. La visibilité et l’influence des Etats s’inscrivent aujourd’hui dans leur capacité à orienter les choix et les arbitrages financiers internationaux.
Pour de multiples raisons et facteurs, l’APD de demain aura sans doute peu à voir avec celle des années 1960 à 1980, dans ses objectifs comme dans ses modalités. La logique de l’efficacité impose aujourd’hui la recherche de la cohérence de l’aide et de la complémentarité entre les intervenants et leurs actions, que ce soit au niveau des contenus ou des géographies de l’aide. Une réflexion prospective sur un nouvel équilibre entre bilatéralisme et multilatéralisme ne peut pas ne pas tenir compte de cette nouvelle réalité. L’articulation entre ces deux pôles, non pas antagoniques mais plutôt complémentaires, est nécessairement affectée et conditionnée par les changements qu’induit la démarche collective à laquelle chacun participe. Les synergies auxquelles aspire l’ensemble de la communauté de l’aide obligent sans doute à penser autrement les concepts de visibilité et d’influence pour un pays comme le nôtre. A explorer d’autres voies pour les garantir.
2) Les nouveaux acteurs de l’aide au développement
Les développements antérieurs ont montré que l’émergence de thématiques nouvelles, directement liées à la mondialisation, imposait une forme de gestion collective en matière sanitaire, d’environnement ou de changement climatique. Comme on l’a vu, c’est notamment ici que, d’une certaine manière, réside la légitimité du multilatéralisme, dont on ne saurait évidemment se passer, de par les possibilités qu’il offre.
Néanmoins, pour poser les derniers jalons de la réflexion sur l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme, il importe de procéder à un état des lieux du multilatéralisme « contemporain », et de son évolution qui préfigure ce qu’il sera demain. Il ne servirait à rien, en effet, de répondre à la question qui a été posée à cette Mission et de repositionner le curseur sur le bilatéralisme pour simplement redonner un peu plus de visibilité et d’influence à l’APD de la France, comme on aurait pu le faire il y quinze ou vingt ans, sans prendre en compte la réalité de l’APD telle qu’elle est aujourd’hui, et sans tenter de définir ce que devra être la politique française de coopération au développement de demain qui aura inévitablement, comme c’est d’ores et déjà le cas, à articuler son action avec celle des autres intervenants, à bâtir de plus en plus de partenariats multiformes. A cet égard, pour clore cette analyse et donner à cette réflexion le caractère prospectif qui s’impose, il est indispensable d’examiner les thèmes des lieux de gouvernance de l’aide et des nouveaux acteurs, sans lesquels rien ne pourra demain se faire.
Comme Dov Zerah, directeur général de l’AFD, le faisait très justement remarquer à votre mission (92), dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les partenariats sont de mise et il convient adopter des stratégies de coopération et non d’affrontement. Cela est d’autant plus important que les acteurs sont aujourd’hui plus nombreux que jamais.
a) La multiplicité des acteurs internationaux : état des lieux
L’un des aspects qui, en effet, ont le plus frappé votre Mission, concernant la thématique et l’équilibre à trouver entre le bilatéralisme et le multilatéralisme, est celui de l’impressionnante prolifération des institutions internationales qui interviennent désormais à un titre ou à un autre. Aujourd’hui, quelque 263 organisations internationales sont en effet présentes sur le secteur de l'aide au développement. Selon une étude de l'AFD, leur nombre est passé de 15 en 1940 à 47 en 1960. Plus de 80 organismes étaient déjà éligibles à l'APD dans les années 1960 et 1970, comme le montre le graphique ci-dessous, particulièrement illustratif de cette réalité.
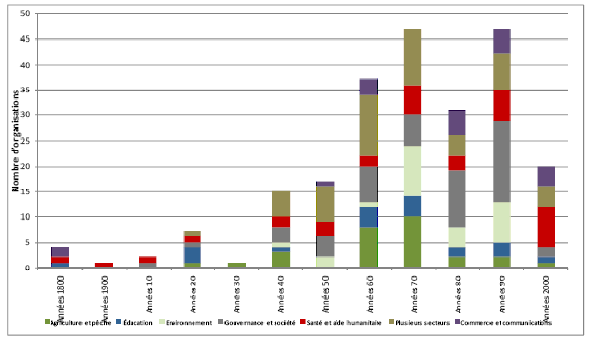 Création des organisations internationales, par décennie et secteur d’activité (93)
Création des organisations internationales, par décennie et secteur d’activité (93)
Si la prolifération s’est ralentie dans la décennie de 1980, puisque l’on constate qu’une trentaine, « seulement », de nouvelles organisations ont été admises à recevoir des apports d’aide publique au développement, les années 1990 ont en revanche vu apparaître 45 nouvelles institutions internationales éligibles, tandis que, uniquement « en 2006, une vingtaine d’organismes nouveaux ont été créés, notamment dans le secteur de la santé. » (94). Eckhard Deutscher et Sara Fyson soulignaient récemment (95) les effets négatifs de la complexité institutionnelle de l’aide au développement contemporaine et mentionnaient plus de 280 donateurs bilatéraux, 242 programmes multilatéraux, 24 banques de développement. Comme le remarquait de son côté Jean-Michel Severino lors de son audition par votre Mission, aujourd’hui, « le paysage est très complexe et les 120Mds $ de l’APD mondiale sont mis en œuvre par trois fois plus d’acteurs qu’il y a seulement dix ans. » (96). Si cette prolifération peut être porteuse d’innovation, ses conséquences sont souvent sur le terrain problématiques : elles se traduisent nécessairement par une dilution de l’aide, un éparpillement des moyens entre un nombre nettement supérieur d’intervenants, un besoin de mécanismes – et consécutivement, des coûts –, de coordination d’autant plus grand.
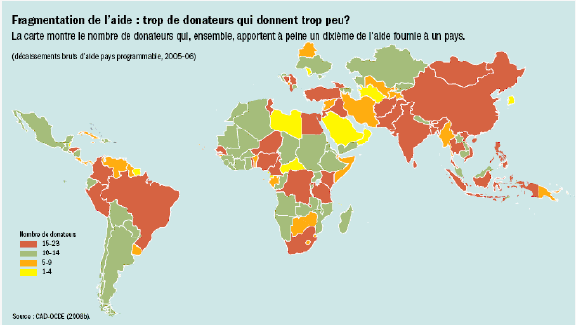
Source : « Finances et développement », septembre 2008, page 17
La communauté internationale est ainsi prise en flagrant délit de contradiction et d’impuissance dans la mise en œuvre de ses propres résolutions par rapport aux objectifs si haut affirmés de coordination et d’efficacité. Comme le disait Philippe Etienne (97), alors directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères et européennes, lutter contre la prolifération et la superposition des mandats des organisations internationales supposerait de pouvoir cartographier leurs domaines de compétences, exclusifs et concurrentiels, réussir à établir et faire appliquer une discipline, sans abandonner l’idée de regroupement ou de fusion. A cette réserve près que les organisations internationales disparaissent rarement, même en l’absence de performances.
Ce ne sont d’ailleurs pas seulement les organisations internationales publiques qui prolifèrent de manière incontrôlable dans le champ de l’aide internationale au développement. D’autres acteurs sont intervenus depuis une quinzaine d’années, qui revendiquent, grâce à leur puissance financière ou à l’autorité morale et à la légitimité qu’ils ont acquises, un rôle chaque jour plus déterminant.
b) Une réalité qui modèle la problématique du bilatéralisme et du multilatéralisme
L’état précis des lieux est sans doute aujourd’hui impossible à dresser. Déterminer combien de fondations et d’ONG interviennent de nos jours dans un des champs quelconques de l’APD relève de la pure gageure.
Dans un article récent, Jean-Michel Severino et Olivier Ray, relevaient qu’« une multitude d’organisations non gouvernementales de gauche, conservatrices, laïques, confessionnelles, petites, moyennes ou grandes, a poussé comme des champignons dans tous les pays industrialisés et a fini par représenter une part considérable des transferts financiers Nord-Sud. Les plus importantes d’entre elles (Oxfam, Save the Children, etc.) ont des budgets annuels de l’ordre de 700 à 800 millions de dollars, et sont devenues des acteurs incontournables de la solidarité internationale. Dans l’ensemble, on estime que les ONG ont contribué à hauteur de 14,6 milliards aux actions de solidarité internationale en 2006, contre 8,8 en 2002. Les fondations privées sont également devenues des acteurs majeurs de l’industrie de la solidarité. Avec un capital de près de 70 milliards de dollars, la Fondation Bill et Melinda Gates prévoit ainsi de décaisser près de 6 milliards de dollars au cours de deux prochaines années. Sa contribution à la recherche vaccinale a atteint 287 millions de dollars, soit un tiers des dépenses mondiales consacrées à la recherche et au développement du vaccin pour le VIH-SIDA. Elle se positionne donc comme un des acteurs clés en matière de politique de santé internationale et a acquis une influence considérable sur les organismes d’aide bilatérale et multilatérale. » (98).
Si les Etats du Nord et les organisations internationales n’ont plus le monopole de l’aide au développement, avec la concurrence des ONG et autres fondations, le paysage global s’est encore compliqué avec l’entrée en piste de certains pays bénéficiaires, avec une vigueur et des méthodes qui ne cessent, comme on le sait, d’inquiéter. La Chine, bien sûr, en premier lieu, mais demain l’Inde et le Brésil, sont en train de devenir des acteurs majeurs de l’aide au développement. Si le montant de leurs transferts financiers sont méconnus, dans la mesure où ils se refusent, malgré les sollicitations qui leur sont faites, de jouer le jeu de la coordination au sein du CAD, notamment, leur poids est d’ores et déjà considérable, et en augmentation. On estimait récemment que, selon les pays et régions, cet apport avait représenté en moyenne 12 % de l’APD fournie par les pays membres du CAD ces dernières années, et parfois jusqu’au tiers et même plus (99). D’une certaine manière, cela remet aussi en lumière, si besoin était, l’actualité de la thématique de l’APD comme politique d’influence et de visibilité, répondant aux intérêts des bailleurs autant, si ce n’est plus, qu’à ceux des bénéficiaires, cf. la présence de la Chine sur l’ensemble du continent africain.
Cela étant, ce n’est sans doute pas tant le nombre et la nature de cette prolifération qui importent, que leurs effets. Eckhard Deutscher et Sara Fyson mentionnaient que « le nombre croissant de fondations privées et la multiplicité des organisations non gouvernementales (ONG) ajoutent à cette complexité ». Pour innovants que ces acteurs puissent être, les auteurs soulignaient à juste titre qu’une telle augmentation du nombre des acteurs et des projets qui, ensemble, mettent en œuvre « les quelque 340 000 projets de développement qui existent de par le monde » (100),ne peut qu’être contreproductive, en termes d’efficacité : prévisibilité, coordination sont effectivement et nécessairement absentes lorsque, selon une étude de l’OCDE, un pays comme le Vietnam, véritable « success story » de l’aide, pouvait recevoir en un an, en 2005, 791 missions de donateurs, soit plus de deux par jour, week-ends et jours fériés compris (101), alors que les « orphelins de l’aide », telle la République centrafricaine, peinent à attirer l’attention des bailleurs sur leurs besoins criants.
Si l’ensemble des acteurs, récents venus sur le marché de l’aide ou bailleurs « historiques », a évidemment légitimité à intervenir et à participer au chantier du développement à la mesure de leurs moyens, il n’en reste pas moins que leur prolifération induit un coût exorbitant. Comme pouvait le relever Pierre Jacquemot (102), « la gestion de l’aide est devenue inextricable. Le bénéficiaire vit souvent le " cauchemar du planificateur ". Des pays comptent aujourd’hui plus de 40 donateurs pouvant financer plus de 500 projets. Le cas parmi les plus édifiants est celui de la Tanzanie qui, en 2002, a préparé 2000 rapports destinés aux bailleurs de fonds, reçu pas moins de 1000 délégations et qui comptait 600 projets de moins d’un million d’euros rien que dans le domaine de la santé. » D’autres études montrent que nombre d’autres pays bénéficiaires, tels le Cambodge, le Nicaragua ou le Bangladesh, n’ont malheureusement rien à lui envier et doivent faire face aux mêmes difficultés, avec la même faiblesse de ressources et de moyens propres.
Au-delà de ce premier point, essentiel, que souligne Pierre Jacquemot, sans doute cet état de fait traduit-il aussi plusieurs aspects fondamentaux touchant à la nature de l’aide contemporaine, telle qu’elle est aujourd’hui, après quelques années de profonds changements. On y voit en premier lieu non seulement les difficultés, malgré les bonnes volontés et résolutions indéfectiblement affichées, mais aussi, dans cet ordre d’idées, le coût politique de la coordination, compte tenu de ce qu’elle implique en termes de renoncements en matière de visibilité et d’influence. Surtout, aussi, le fait que, comme le soulignent également Jean-Michel Severino et Olivier Ray, l’émergence de nouveaux défis a été un formidable stimulateur de la créativité institutionnelle des gouvernements, relevant que l’ONU compte ainsi aujourd’hui plus de 70 organismes ou fonds spéciaux consacrés au développement (103). L’évolution du secteur de la santé, qui a dû faire face à de nouvelles pandémies, celle du secteur de l’environnement, avec le surgissement des problématiques liées au réchauffement climatique, ont ainsi constitué autant de raisons d’instituer des organismes divers et de fonds, tels que le GAVI ou le Fonds mondial, pour ne mentionner que ceux-ci, pour tenter d’y répondre collectivement.
En conséquence, comment ne pas suivre Jean-Michel Severino et Olivier Ray lorsqu’ils concluent de leur analyse que « nous sous-estimons probablement l’impact de ce changement radical sur nos politiques publiques vieilles d’un demi-siècle. L’explosion du nombre des acteurs du développement, tant publics que privés, aura un effet considérable sur la manière de gérer ces questions. Et cette tendance ne pourra pas être significativement infléchie : que l’on s’en réjouisse ou que l’on s’en désole, le génie ne retournera pas dans sa lampe. Les grands défis du développement de demain devront être résolus dans ce contexte nouveau et tumultueux. A l’époque de la mondialisation, la cohérence passera par des coalitions d’acteurs multiples, et les politiques publiques mondiales seront gérées au travers de ce que nous avons appelé " l’action hyper - collective ". » (104).
En conséquence, la réflexion sur l’équilibre entre bilatéralisme et multilatéralisme, autrement dit sur la gouvernance de l’aide publique au développement de demain, ne peut faire l’impasse sur la réalité d’ores et déjà actuelle de l’aide. La question de l’équilibre entre bilatéralisme et multilatéralisme ne peut aujourd’hui véritablement s’étudier que dans cette perspective.
3) Les nouveaux lieux de la gouvernance de l’aide
On ne saurait enfin traiter cette question sans prendre en compte l’émergence récente des nouveaux lieux de la gouvernance mondiale et tout particulièrement de celle de l’aide au développement, qui ont surgi à la marge des organisations, pourtant de plus en plus nombreuses, qui en étaient jusqu’alors seules chargées.
Ce n’est pas le lieu ici de discuter de la réforme du système des Nations Unies, indispensable comme chacun sait mais infiniment reportée. De souligner plutôt que l’émergence des enjeux globaux et la montée en puissance des grands pays du Sud, n’ont pas seulement d’ores et déjà imposé des changements importants dans la structure et les modalités de l’aide, ainsi qu’une forme de redéfinition de la solidarité internationale dans ses divers aspects. Ces changements portent sur la question des financements publics, considérables mais en l’état actuel néanmoins insuffisants, et supposent l’invention de modalités innovantes. Ils touchent aussi et surtout à la question de la gouvernance du système et sur ce point, les évolutions ne sont pas mineures ; elles contribuent à redessiner la ligne de partage de demain entre bilatéralisme et multilatéralisme. Il est d’autant plus justifié d’en parler ici que la France est à l’origine de ces forums, et notamment, de leur incursion sur les questions de développement, ce pourquoi ils n’étaient pas convoqués dans leurs débuts.
Si les institutions onusiennes, et particulièrement l'Assemblée générale annuelle, restent des points de passage obligé du débat international sur le développement, force est d’en constater la relative marginalisation. Comme si l’essentiel se passait désormais ailleurs qu’à New York, tout du moins en ce qui concerne l’initiative et la prise des décisions les plus importantes. Certes, le sommet des OMD, en septembre dernier, a constitué un temps fort. Retards dans les résultats à cinq ans de l’échéance et dixième anniversaire obligent, il a notamment réitéré une fois de plus l’engagement solennel de l’ensemble des Etats sur les objectifs chiffrés qu’ils sont incapables de respecter depuis quarante ans, quel que soit le caractère essentiel de ces résolutions.
Faute d’un Conseil de sécurité qui serait chargé du développement, ce sont finalement le G8 puis, plus récemment, le G20, qui se sont attelés à donner aux thématiques de développement un relief nouveau, au point que si l'Assemblée générale des Nations Unies maintient haut la flamme des OMD depuis 2000, c’est dans les réunions du G8 et du G20 que sont désormais débattues et prises les principales décisions, notamment celles qui semblent surtout tracer le chemin en matière de financement du développement, voire d’architecture du système.
La crise de 2008 n’a pas été étrangère à cela, bien sûr, qui a imposé une réactivité rapide, mais le pli était pris dès avant. Ainsi, lors du Sommet de Gleneagles de 2005, les principales puissances économiques avaient-elles renouvelé leurs engagements respectifs et pris date pour l’avenir. L’habitude a été prise que régulièrement d’autres aspects y soient traités, qui portent sur la définition des priorités internationales en matière de développement et la définition d’objectifs communs. C’est au sein du G8 qu’a ainsi été défini un partenariat spécifique avec les pays africains, en liaison avec le NEPAD, décliné en plans d’action détaillés et reposant sur des structures de dialogue propres. Au total, ces dernières années, le G8 aura accordé une attention particulière à tout un ensemble de questions touchant directement au développement socioéconomique du Sud, tant pour la gestion du développement que pour les conditions et l’environnement qui y concourent : efficacité de l’aide ; santé ; eau et assainissement ; sécurité alimentaire ; éducation ; gouvernance ; environnement et énergie ; paix et sécurité. L’inclusion récente de plusieurs pays émergents importants au sein du G20 lui donne désormais une nouvelle configuration lui permettant d’associer le Sud aux décisions des principales puissances économiques.
Le forum apparaît de plus en plus, comme une forme de directoire mondial de la gouvernance économique, au sein duquel les questions de développement prennent une place majeure. Il n’est que de voir la Déclaration finale « Reprise et renaissance », du dernier sommet du G8 qui s’est tenu en juin 2010 à Muskoka (105), pour comprendre que, par le suivi qui est effectué des décisions antérieurement prises, une instance de gouvernance mondiale est en passe d’émerger réellement, qui appelle à une forme de permanence, notamment sur les thématiques du développement : « nous avons reconnu lors du Sommet de 2008 à Hokkaido Toyako l’importance de montrer que le G8 entend rendre compte de la mise en oeuvre de ses engagements de façon transparente et cohérente. En 2009, au Sommet de L’Aquila, nous avons demandé à nos hauts fonctionnaires de préparer un rapport sur la réalisation de nos engagements concernant les objectifs liés au développement, en mettant l’accent sur les résultats. Nous accueillons favorablement le Compte rendu des activités - Actions et résultats du G8 : Évaluation des actions et des résultats à l’égard des engagements liés au développement et nous assurerons le suivi des recommandations qu’il contient. Ce document montre que d’importants progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines, mais aussi qu’il faut aller encore plus loin. Nous soulignons l’importance de présenter régulièrement des rapports sur le degré d’avancement de nos engagements et, à cet égard, mettrons l’accent en 2011 sur le compte rendu touchant la santé et la sécurité alimentaire. »
L’aide publique au développement occupe définitivement une place tout à fait cardinale dans les préoccupations du G8 qui, lors de ce sommet, lance de nouvelles actions : « L’Initiative de Muskoka », notamment, qui, moyennant des contributions financières accrues et de nouveaux partenariats avec les organisations internationales et les principales fondations internationales impliquées dans le secteur santé, ambitionne de renforcer considérablement l’effort en faveur des OMD 4 et 5, en matière de santé maternelle et infantile pour rattraper le retard pris dans leur réalisation. Le partenariat avec l’Afrique est aussi promu : « Les dirigeants du G8 ont (…) réaffirmé leur volonté commune de poursuivre la collaboration entre le G8 et ses partenaires africains, à l’appui des efforts menés par les Africains eux-mêmes pour rendre leur continent plus stable, plus démocratique et plus prospère, pour favoriser le développement économique et social, ainsi que pour promouvoir la primauté du droit. »
D’une manière plus générale, les membres du G8 réunis au Canada réaffirment une conception d’un développement « fondé sur la responsabilité mutuelle et sur un solide partenariat avec les pays en développement, surtout en Afrique » Leurs engagements s’articulent sur une « approche globale du développement, en recherchant des résultats durables (…) ». Efficacité de l’aide, essor social et économique, bonne gouvernance, ainsi que paix, sécurité et développement durable, notamment en ce qui concerne les Etats fragiles, sont les pivots de leur action.
Le futur équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme se joue ici et cela doit être d’autant mieux souligné dans le cadre de la réflexion de votre Mission, que la France est précisément de ceux qui n’ont eu de cesse, avec un succès certain, de voir le G8 se pencher sur les thématiques du développement.
b) Le rôle et l’ambition de la France
La France a en effet toujours joué un rôle d’impulsion au sein du G8, tout particulièrement sur les thématiques qui touchent aux questions de développement. Serge Michailof rappelait ainsi à votre Mission lors de son audition (106) que c’est elle qui avait eu l’initiative d’engager le dialogue sur l’aide à la gestion des biens publics mondiaux, afin d’inviter les grands pays émergents à s’engager sur ces nouvelles politiques publiques mondiales. C’est aussi au sein du G8 que la priorité donnée à l’Afrique subsaharienne a été donnée, avant que d’être reprise par les institutions financières internationales, répondant en cela parfaitement aux priorités géographiques de notre pays qui consacre l’essentiel de son aide bilatérale à ce continent.
Dans le même ordre d’idées, on sait aussi le rôle de la France en ce qui concerne la politique d’annulation de dettes des pays en développement, sujet sur lequel le G8 avait eu l’occasion, en 2005 à Gleneagles notamment, de prendre d’importantes décisions. C’est encore la France qui, au pic de la crise alimentaire de 2008, a été à l’initiative du Partenariat mondial pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, lancé au sommet de Rome et repris par le G8 de l’Aquila, puis le G20 de Pittsburgh (107).
Il n’est enfin que de voir aussi l’agenda de la prochaine présidence française du G20 pour confirmer que cette voie est désormais une des pistes essentielles que la France a choisies pour débattre collectivement des thématiques de développement. C’est le cas notamment de la question d’une taxation des transactions financières internationales que notre pays porte et défend avec l’Allemagne dans ce forum, sans trouver encore beaucoup d’écho, et s’opposant aux Etats-Unis, au Royaume Uni et au Canada.
Les propos les plus récents du Président de la République confirment que le G20 devrait devenir une instance de gouvernance mondiale dont le poids en matière de développement sera majeur. Les propos qu’il a tenus lors de la dernière Conférence des ambassadeurs, le 25 août dernier, suffisent à s’en convaincre : s’il intervenait encore naguère que ponctuellement sur ces thématiques, en réaction à des crises, comme en 2006, le G20 est désormais appelé à traiter résolument du développement : « Ne faut-il pas que le G20 ouvre son ordre du jour à des sujets nouveaux, tels le développement ? Ne devrait-on pas, par exemple, y adopter des règles de bonne conduite et de bonnes pratiques pour l’aide publique ? », s’interrogeait le président Sarkozy avant de poursuivre : « Je souhaite également que nous puissions débattre au G20 des financements innovants, et notamment d’une possible taxe sur les transactions financières dont a parlé Bernard Kouchner. Sans cette taxe, les pays développés ne seront pas au rendez-vous de l’aide au développement et des accords, cher Jean-Louis Borloo, que nous avons pris à Copenhague. C’est tellement évident. Avec qui et où trouverons-nous l’argent s’il n’y a pas de financements innovants, Tous les budgets sont en déficit. Ces financements sont indispensables pour être au rendez-vous des objectifs du millénaire. » Le Président de la République devait en faire un axe central de son discours lors du sommet des OMD à New York le 20 septembre suivant. Pour Nicolas Sarkozy, le G20 ne devrait cependant pas se limiter à ces seules thématiques, mais aborder également d’autres aspects, tels que le financement d’un accord sur le climat, la gouvernance mondiale, pour laquelle il prévoir que la France suggérera un débat plus large, portant sur le FMI ainsi que les institutions spécialisées du système des Nations Unies qui traitent de l’économie, de l’emploi et du commerce, sans omettre un partenariat avec l’Afrique, indispensable, « convaincu que le succès de l’Afrique, c’est une chance pour l’Europe et que l’échec de l’Afrique sera un drame pour l’Europe », les destins de l’une et de l’autre étant absolument liés.
Sur la question de la réforme des institutions financières internationales, il convient de remarquer que les sommets qui se sont tenus ces derniers mois ont d’ores et déjà pris d’importantes décisions. Cela a notamment été le cas à Pittsburgh, en septembre 2009, où la question des mandats, des missions et de la gouvernance du FMI et des banques régionales de développement a été abordée, sur laquelle le sommet de Séoul des 11 et 12 novembre dernier a tranché. Ainsi que le faisaient justement remarquer Jean-David Levitte, conseiller diplomatique et sherpa du Président de la République et Christian Masset, directeur général de la mondialisation du MAEE, lors de leurs auditions respectives par notre commission des affaires étrangères, le G8 et le G20 ont changé de stature : de la réaction à la crise, ils sont passés à la phase de construction.
Aux yeux de votre Rapporteure, les développements du Président de la République sur ces aspects sont essentiels quant à la réflexion de cette Mission : les principaux défis du développement seront demain majoritairement traités de manière collective. Et quoi que l’on puisse en penser, il semble qu’il soient appelés à l’être dans des instances telles que le G8 ou le G20 plutôt que dans celles du système institutionnel mondial existant, difficile sinon impossible, à réformer. Les uns avancent, les autres non, et des partenariats auront à être construits pour coordonner les approches, les stratégies, les solutions. Si l’on rappelle, de plus, que l’ambition du Président Sarkozy porte aussi sur des questions de régulations économiques et financières plus classiques, telle la régulation des marchés des matières premières et des matières premières agricoles, l’esquisse d’une cohérence des problématiques touchant au développement se dessine nettement et renforce l’impression que le G20 est en passe de devenir une instance majeure de la gestion des problématiques de développement, si ce n’est même la principale. Sans que les résultats soient pour l’heure loin d’être assurés : l’opposition de certains à la taxation des transactions financières n’est pas la seule à laquelle la présidence française devrait se heurter, comme le rappelait le Financial Times, relativisant les futurs succès que Nicolas Sarkozy pouvait espérer (108).
D – Poser les termes du débat pour demain
Comme on a pu le dire maintes fois, l’APD est une politique publique qui est devenue aujourd’hui d’une effroyable complexité, y compris pour les spécialistes, à la mesure de celle des problématiques en jeu et de leur enchevêtrement. Le maquis des mécanismes de financements modernes de l’aide, notamment, en rend la lecture pour le moins ardue. La technicisation croissante de l’APD au fil des dernières années est ainsi venue en contrepoint de l’exigence non moins croissante de transparence et de visibilité. Pierre-André Wiltzer, alors président du conseil d’administration de l’AFD, insistait sur cet aspect lors de son audition devant votre Mission (109), et sur la difficulté d’en avoir une vision claire. Ce que Serge Michailof, par exemple, faisait également remarquer lors d’une intervention au Sénat, soulignant : « la présentation des budgets de la coopération est d’une opacité exceptionnelle à tel point que les experts eux-mêmes ne s’y retrouvent pas (…) » (110), sentiment que tout parlementaire ne peut que partager, réalité insupportable dans une société dans laquelle la transparence des politiques publiques est une exigence démocratique.
A l’heure de se prononcer sur l’équilibre « idéal » entre multilatéralisme et bilatéralisme, sans doute est-il opportun de passer préalablement en revue les avantages et inconvénients comparés reconnus à l’un et à l’autre. La définition d’un équilibre entre les deux, n’en devrait être que facilitée, sachant aussi que le positionnement ultérieur du curseur sera une réponse pour partie politique, répondant à de simples questions : qu’entend faire la France de sa politique d’APD ? Avec qui et comment ?
1) Les éléments de la discussion
Au cours de ces derniers mois, votre Mission a entendu un très grand nombre d’experts et d’acteurs de l’aide au développement, tant en France que lors de ses déplacements à l’étranger. Pour différentes qu’elles soient selon l’endroit d’où ils parlent, leurs réponses ont l’intérêt de permettre de tracer une ligne de partage entre l’une et l’autre modalité, sur laquelle il y a un relatif consensus quant à leur complémentarité.
Cela étant, il n’est pas non plus inutile de reprendre quelques unes des préoccupations fréquemment exprimées, et qui ont notamment alimenté la réflexion de votre Mission.
a) De quelques avantages et inconvénients respectifs du bilatéralisme et du multilatéralisme
Si l’on se place sur un terrain essentiellement politique, celui de l’APD comme instrument diplomatique, indubitablement, le bilatéralisme dispose d’un avantage comparatif net sur lequel il n’est pas nécessaire de s’étendre très longtemps. Dans cette perspective, le multilatéral, de par les compromis qu’il requiert, tend à noyer l’effort individuel des bailleurs qui y perdent en marge de manœuvre, ainsi qu’en capacités de discrimination géographique et sectorielle. Ils y perdent aussi considérablement en visibilité, qui devient celle de l’institution multilatérale à laquelle ils contribuent, comme le constatait Hubert Védrine (111), ainsi qu’en capacité d’influence. Il n’est que de voir la façon dont, en juin 2010, lors de son déplacement en RDC, votre Mission s’est entendue reprocher par les directeurs généraux du ministère congolais de la santé en charge de la lutte contre le sida et le paludisme, le fait que la France n’intervienne pas suffisamment dans la lutte contre ces pandémies, pour prendre conscience de l’ampleur, dans certains cas, du problème.
Cette perception est communément ressentie, notamment par l’ensemble des interlocuteurs de votre Mission ; qu’ils y attachent ou non de l’importance, ils en conviennent. Avant même de placer la question sur le terrain du rapport entre bilatéralisme et multilatéralisme, Jean-Michel Severino considère cette préoccupation de visibilité d’une certaine manière inéluctable, eu égard aux particularité de l’APD, politique publique complexe par nature, marquée par « la déconnexion entre les contribuables et les bénéficiaires, l’éloignement territorial, qui induit des problèmes de lisibilité, de visibilité ; la multiplicité des acteurs, qui se traduit par un incroyable éclatement de la mise en œuvre de cette politique publique. » (112).
Parmi les idées qu’ont avancées les interlocuteurs de votre Mission, votre Rapporteure a notamment relevé que si le bilatéralisme est pour Eva Joly, présidente de la commission du développement du Parlement européen (113), plus réactif et rapide dans sa mise en œuvre que le multilatéralisme, comme outil diplomatique, il induit nécessairement une vision partielle, un évident morcellement de l’aide, et le fait qu’il y ait des pays « orphelins de l’aide », quand d’autres sont submergés de projets et de financements. A l’heure où efficacité, rationalisation et coordination de l'APD sont au menu des débats internationaux, on peut donc ainsi voir dans le multilatéralisme certains avantages, malgré ses politiques parfois doctrinaires, estimait-elle. La possibilité d’offrir une même opportunité à tout le monde est précisément l’une des raisons pour lesquelles le Canada, selon Claude Lemieux (114), conseillère pour le développement à la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, a toujours vu d’un bon œil le multilatéralisme, qu’il considère comme efficace. Il ne s’interdit cependant pas d’avoir une politique d’aide bilatérale avec certains pays, en nombre réduit, sans que l’histoire ou un passé colonial viennent influer sur ses choix. Cette histoire commune est justement l’une des raisons pour lesquelles, inversement, Pierre Ménat (115) ne trouve, en sa qualité d’ambassadeur, que des avantages à mener une politique bilatérale forte dans un pays comme la Tunisie : sauf à risquer de disparaître ou de voir les relations bilatérales se distendre et se diluer dans un ensemble indiscriminé, la visibilité doit être assurée.
On pourrait multiplier les exemples. En d’autres termes, le bilatéralisme permet une meilleure visibilité de l’effort de financement et de l’action qu’un pays fournit. On a vu que cette préoccupation était d’ailleurs partagée par l’ensemble des donateurs. N’en déplaise aux tenants de l’APD comme expression de la solidarité, ce ne peut être un trait à rejeter d’un revers de main. C’est tout au contraire une donnée majeure : l’APD est, et il ne saurait en être autrement, un outil diplomatique essentiel qu’il convient de revendiquer et de continuer à utiliser comme tel. D’autres que la France, soit dit en passant, sont sans doute moins frileux ou hésitants à afficher leur générosité. La France ne devrait pas avoir honte de revendiquer clairement son rôle, son action, et de montrer le niveau de son effort de financement.
Inversement, et logiquement, le principal reproche qui est adressé au multilatéralisme porte sur l’anonymat qu’il induit mécaniquement : dans son melting pot de contributions, la part de chacun, pour considérable qu’elle puisse être – cf. l’effort de la France au FED –, est diluée et perd tout relief. Ceci n’est pas le simple constat de parlementaires en déplacement rapide à l’étranger ; c’est aussi l’impuissance vécue des diplomates sur le terrain, jusqu’à être parfois presque ignorants des activités des organisations internationales peu communicatives malgré le niveau de contribution des Etats membres. Comme le résumait d’un mot Jacques Godfrain, ancien ministre de la coopération, ce que l’on peut reprocher au multilatéralisme, c’est la méconnaissance que l’on a de ce qui s’y fait (116), ce qui, soit au passage, relève aussi de notre propre responsabilité et d’une mauvaise connaissance de ces formes de financement.
Au-delà de ce premier aspect, le partage entre bilatéralisme et multilatéralisme doit naturellement tenir compte des capacités de chaque Etat et des moyens et ressources qu’il peut ou est prêt à consacrer à sa politique d’aide, en fonction de ses propres priorités.
La nature des projets à financer est une donnée essentielle à prendre en compte : l’ampleur des investissements à consacrer aux actions en matière de santé publique est par exemple telle que l’approche multilatérale est unanimement considérée comme la plus adaptée, qui permet d’allier les efforts épars vers des buts communs qui font facilement l’objet d’un consensus politique. La lutte contre les pandémies contemporaines appartient évidemment à ce registre. Dans cet ordre d’idées, les organisations internationales permettent, par les moyens qu’elles peuvent mobiliser, des effets de leviers irremplaçables, le fait que les institutions financières de Bretton Woods notamment, soient désormais des institutions véritablement mondiales, ajoutant à cet atout (117). Jean-Michel Severino développait cet aspect en considérant devant votre Mission que le multilatéralisme était très performant sur les aspects macroéconomiques, pour lesquels les problèmes de conditionnalité font qu’ils sont du ressort des grandes institutions financières et que le FMI ou la Banque mondiale sont ici irremplaçables. D’une manière générale, estimait-il, « le multilatéralisme est aussi mieux placé pour intervenir sur des questions à contenu plus capitalistique, telles les grandes infrastructures, les politiques de désenclavement », sur lesquelles « le bilatéral ne peut avoir de valeur ajoutée (…) tout comme sur les problèmes énergétiques où le bilatéralisme peut, au mieux, se rattacher, sans pouvoir prétendre à un vrai leadership. ».
Inversement, pour l’ancien directeur général de l’AFD, les avantages du bilatéralisme « se situent au niveau d’un ancrage territorial meilleur, d’une plus grande flexibilité et de mécanismes de gouvernance qui n’exigent pas la recherche de consensus larges. Il y a aussi une certaine capacité d’innovation, de même que des possibilités de choix supérieurs, en termes sectoriels ou géographiques. ». Il ajoutait dans son intervention que « le multilatéralisme, en revanche, a plus de mal à discriminer les territoires : les modes de répartition des aides y sont, au-delà de certains effets de mode, nécessairement plus impartiaux compte tenu de la multiplicité des contributeurs, laquelle implique le respect d’équilibres correspondant à l’expression des priorités, régionales ou sectorielles, de chacun des bailleurs. Sur ce point, en bilatéral, la marge de manœuvre est plus ample. Cet ensemble d’éléments joue sur les choix, et bilatéralisme et multilatéralisme ne fonctionnent pas sur les mêmes priorités. ». Enfin, concluait Jean-Michel Severino, sur un autre plan, le multilatéralisme apparaît « comme une instance de coordination, de recherche de la cohérence, qui est naturellement plus de son ressort que de celui de quelque acteur bilatéral que ce soit. C’est enfin un outil dont la neutralité permet parfois de faire passer certains messages qu’un acteur bilatéral pourrait moins facilement se permettre. ».
Bilatéralisme et multilatéralisme ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et consécutivement, leur pertinence dans le système international de l’aide. Ils sont aussi étroitement complémentaires.
b) Un point de consensus : bilatéralisme et multilatéralisme sont complémentaires
La complémentarité du bilatéralisme et du multilatéralisme est désormais unanimement perçue. De Jacques Godfrain, pour qui bilatéralisme et multilatéralisme ne vont pas l’un sans l’autre, à Robert Zoellick, président de la Banque mondiale (118) en passant par Eckhard Deutscher et Alain Juppé ou encore Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement (119), qui met en balance les avantages comparatifs de l’une et l’autre modalité, et Luis Alberto Moreno, Président de la banque interaméricaine de développement (120), qui insiste sur la complémentarité des actions de la France et de la BID en Amérique latine, aucun des interlocuteurs que votre Mission a interrogés ne remet désormais en question cette donnée pour plaider en faveur d’une rupture radicale et prôner un « tout-bilatéralisme » ou un « tout-multilatéralisme ». D’expérience, les ambassadeurs et diplomates en poste dans les pays que la Mission a visités inclinent également tous dans ce sens. De même en est-il des autorités des institutions multilatérales de développement : bilatéralisme et multilatéralisme se confortent l’un l’autre, bien plus qu’ils ne s’opposent ou se contredisent. Pour difficile que ce soit ou puisse apparaître, ils sont faits pour marcher main dans la main vers un objectif commun.
Cette complémentarité entre aide bilatérale et multilatérale ne vaut pas uniquement en terme d’efficacité, elle joue aussi dans le propre intérêt des donateurs et consécutivement, pour la visibilité et l’influence qu’un pays comme le nôtre peut avoir à travers sa politique d’aide au développement.
Lors de son audition devant votre Mission (121), Jean-Michel Severino, avait ainsi résumé la question : « Le sujet n’est (…) pas de choisir entre bilatéralisme et multilatéralisme, (…). Ce qui importe, c’est de rechercher les allocations optimales selon les sujets, les territoires, l’influence et l’action que l’on souhaite. Il faut par conséquent arriver à la bonne articulation entre les deux », ajoutant : « il s’agit de trouver les moyens d’agir en cohérence avec les acteurs multilatéraux, dans la mesure où bilatéralisme et multilatéralisme ont chacun des avantages comparatifs différents. ».
Cela étant, la possibilité de cette cohérence ne peut exister qu’en y mettant les moyens. A cet égard, et cela est également un point de vue partagé par l’ensemble des personnalités et experts que votre Mission a interrogés, comme le disait de nouveau l’ancien responsable de l'AFD, il est « essentiel de garder un appareil bilatéral pour pouvoir influer sur le multilatéralisme. L’amener à penser en nos termes passe par la participation à des cofinancements. ».
Il apparaît en effet que c’est grâce à de bons positionnements bilatéraux que la France pourra maintenir à la fois visibilité et influence, notamment au sein du multilatéralisme et il importe de savoir jouer de la complémentarité entre les deux modalités. Philippe Etienne (122) considérait ainsi que « l’aide bilatérale confère à la France une place visible dans le dialogue entre les autorités des pays partenaires et les institutions multilatérales. ». L’ancien directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères considérait par conséquent que « c’est en jouant sur la complémentarité entre les instruments et leurs avantages comparatifs qu’on peut espérer avoir le meilleur impact. C’est en ce sens que la problématique de l’équilibre entre le bilatéralisme et le multilatéralisme prend son sens, et il faut donc être en mesure d’effectuer des choix. ». Il importait par conséquent de maintenir des moyens bilatéraux en rapport avec nos engagements multilatéraux et Philippe Etienne explorait plusieurs pistes sur lesquelles on aura l’occasion de revenir.
En commentant les réflexions initiées par l’administration Obama en matière d’APD, Pierre Vimont (123), ambassadeur de France à Washington, synthétisait parfaitement le sujet en constatant que l’essentiel était de comprendre les stratégies de développement, de savoir influencer notre financement du multilatéralisme sans oublier le rayonnement de notre pays, qui ne peut évidemment se faire que grâce au bilatéral. Notre préoccupation quant au déséquilibre entre les deux modalités ne vient-elle pas de notre relative incapacité, ou supposée telle, à influer sur les institutions multilatérales ? Masood Ahmed, directeur du département Moyen Orient et Asie centrale du FMI, expliquait ainsi à votre Mission (124) que ces questions s’étaient également posées au DFID britannique, quelques années plus tôt, lorsqu’il y était haut fonctionnaire, en se montrant pour sa part désormais convaincu qu’il n’y avait pas concurrence entre les deux modalités, mais au contraire de plus en plus complémentarité. C’est logiquement en ce sens que plaident les responsables des institutions multilatérales : Rebeca Grynspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica, aujourd’hui administratrice associée du PNUD, insistait devant votre Mission (125) sur l’impératif de travailler ensemble, notamment sur les objectifs globaux, et sur la valeur irremplaçable d’un réseau mondial unique comme peut l’être celui des Nations Unies d’autant plus soucieux de la prise en compte des préoccupations de ses bailleurs qu’il est financé par des contributions volontaires.
c) Qu’en pensent les bénéficiaires ?
Cela étant, sans doute le point de vue des bénéficiaires de l’aide est-il aussi à prendre en compte. De la relation avec des organisations internationales proposant une approche technique ou avec des Etats aux préoccupations d’influence diplomatique, et partant, des conditionnalités de l’aide différentes, qu’en est-il de leur préférence ? Cette question n’est pas anodine, sachant que l’allocation géographique des aides bilatérales est prioritairement destinée aux anciennes colonies des bailleurs, pour ce qui est de nombre de pays européens, tout du moins.
Dans cet ordre d’idées, les rencontres qu’a faites votre Mission sont des plus éclairantes. Le président Abdou Diouf (126) soulignait ainsi que le manque d’empathie des institutions de Bretton Woods au cours des années 1970, qui ignoraient les conséquences sociales des ajustements qu’elles imposaient au gouvernement sénégalais, a pu être compensé par la composante politique dans l'APD de la France, due à une histoire commune qui a permis d’atténuer les effets d’une vision excessivement comptable. En d’autres termes, le bilatéralisme serait porteur d’une dimension politique et sociale que n’a pas le multilatéralisme, aspect essentiel aux yeux d’un dirigeant politique qui a dû contenir les émeutes en ayant le sentiment de n’avoir plus prise sur la détermination de la politique de son pays. Indépendamment de ces considérations, l’ancien Président de la République du Sénégal affirmait nettement sa préférence pour le bilatéralisme, pour des raisons tenant à fois de la gestion de l’aide et des perspectives collatérales : « l’aide bilatérale, soumise à la seule décision souveraine d’un gouvernement, est apparue plus réactive et plus souple que l’aide multilatérale : même si les montants diminuent fortement et ne sont plus à la hauteur des besoins identifiés, ils ont au moins l’avantage d’être mobilisables relativement rapidement, dans le cadre de procédures adaptables. Avec son formalisme, ses circuits longs et la dispersion des responsabilités, l’aide multilatérale s’avère, involontairement bien sûr, un terreau fertile pour la corruption, caractérisé par ses doubles emplois et une opacité pesante. Soumise à des contrôles exclusivement internes, cette aide apparaît également peu favorable à une appropriation démocratique. ».
Cela étant, dans un autre registre, les interlocuteurs vietnamiens de votre Mission (127), au ministère du plan et de l’investissement ainsi qu’au ministère des finances, se sont montrés dans l’ensemble plus pragmatiques, en tout cas, moins attachés au souvenir d’un passé partagé. Tout en se félicitant de l’excellence de la relation bilatérale entre nos deux pays, ils ont souligné que ce qui intéresse le Vietnam, c’est l’efficacité. D’une certaine manière, que l’aide soit bilatérale ou multilatérale importe peu, l’essentiel est qu’elle soit efficace et réponde aux attentes. En l’espèce, la France finance au Vietnam les priorités de développement définies par son gouvernement tout en restant dans le champ de ses propres priorités sectorielles – renforcement institutionnel, diminution de la pauvreté en milieu rural, infrastructures, tels le métro de Hanoï ou la signalétique ferroviaire, la formation médicale, et demain l’observation satellitaire ou l’aquaculture. Elle est un bailleur à la fois ancien et important et la relation est considérée comme positive. La France apparaît respectueuse du pays bénéficiaire, mène une action plus de partenariat que d’aide au sens classique, sur la base de procédures intéressantes. En d’autres termes, plus que l’aspect affectif ou quantitatif, ce qui importe est la qualité de l’aide fournie.
Le fait que le Vietnam soit un pays en transition est à l’évidence un élément déterminant dans la nature de la relation qui est entretenue au plan bilatéral. Toutes choses égales par ailleurs, votre Mission devait en effet retrouver une présentation identique, lors des entretiens qu’elle a eus avec les autorités tunisiennes (128). La coopération bilatérale avec la France, comme avec les autres pays européens, ceux du pourtour méditerranéen notamment, reste indispensable, compte tenu des liens ancestraux, des relations économiques et des intérêts communs, indiquait Saïda Chtioui, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères (129). En ce sens, si le multilatéralisme peut aller de pair avec le bilatéralisme, la préférence était marquée pour celui-ci, plus volontariste et moins uniforme. Mohamed Nouri Jouini, ministre du développement et de la coopération internationale (130), mettait aussi en avant le statut de pays à revenu intermédiaire en devenir de la Tunisie, insistait sur l’importance du maintien de la relation bilatérale, entendue comme partenariale, d’égale à égale. En Tunisie, la France est donc considérée comme un partenaire plus que comme un bailleur d’aide, et son action est perçue, dans ce cadre, comme bénéfique aux intérêts réciproques de l’une comme l’autre. Cet intérêt commun qui fonde la relation doit être avant tout entendu comme stratégique, politique, et analysé sur le long terme comme un jeu « gagnant-gagnant ». En ce sens, les difficultés conjoncturelles ne devraient pas amener la France à se recentrer sur ses préoccupations intérieures jusqu’à oublier un pays comme la Tunisie, au risque que les sirènes des grands émergents, voire même des Etats-Unis ou d’autres, ne viennent bientôt détourner son attention.
A cet égard, la situation est naturellement fort différente à tous points de vue dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui peine à sortir de la crise. L’immensité des besoins à satisfaire y est telle que les institutions multilatérales occupent la majeure partie du terrain. Consécutivement, il ne s’agit pas tant de tenter de rééquilibrer les deux modalités de l’aide, pour Matata Ponyo Mapon (131), que d’améliorer la coordination entre bailleurs, de rechercher des synergies qui, malheureusement, tardent à se mettre en place. Pour le ministre des finances congolais, l’essentiel est surtout de répartir les actions à financer entre les actions respectives du bilatéralisme et du multilatéralisme, en fonction des possibilités de chacun et des avantages comparatifs qu’ils présentent, citant classiquement les grosses infrastructures au multilatéralisme, le bilatéralisme pouvant s’insérer, s’il le souhaite, dans des niches spécifiques. L’ancien Premier ministre de Mobutu, Léon Kengo wa Dondo, aujourd’hui président du Sénat, a eu l’occasion de tenir à votre Mission des propos comparables. (132)
En d’autres termes, de quelque côté que l’on se place, tant du point de vue du bailleur que de celui du bénéficiaire, bilatéralisme et multilatéralisme ont l’un et l’autre leurs avantages et leurs inconvénients. Ni l’un ni l’autre ne doit être rejeté et l’on ne saurait non plus déterminer une fois pour toutes le positionnement du curseur en faveur de l’un ou l’autre : de nombreux facteurs interviennent qui peuvent avoir une incidence, tant depuis les origines que dans une perspective d’avenir. Bilatéralisme et multilatéralisme apparaissent à l’évidence comme étroitement complémentaires, voire comme se renforçant l’un l’autre.
Cela étant, ce rapport ne répondrait pas à son objectif s’il se limitait à une conclusion en quelque sorte statique. La question de l’équilibre entre bilatéralisme et multilatéralisme a certes à être tranchée en fonction de critères tenant à l’efficacité de l’aide : cette politique de solidarité doit évidemment remplir le rôle pour lequel elle est conduite et cet aspect est essentiel. La mesure de l’efficacité de l’un et l’autre instrument, et du coût respectif de chacun, figurent donc parmi les aspects premiers de cette réflexion. Cela étant, la recherche de l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme ne peut oublier que cette politique publique est aussi indiscutablement un instrument diplomatique essentiel pour l’influence qu’un pays comme le nôtre entend jouer sur la scène internationale. La mesure de cette efficacité-là de la politique de coopération au développement dépend aussi grandement, chacun le sait bien, du choix des instruments et des priorités données à l’un ou l’autre.
Mais surtout, on ne saurait fonder la réflexion sur ces seuls éléments. S’ils sont évidemment à prendre en compte, ils sont aujourd’hui clairement insuffisants. Comme on l’a montré, l’aide au développement a considérablement évolué ces dernières années. Dans ses objectifs comme dans ses modalités ; son environnement, ses acteurs, ont eux-mêmes profondément changé. En d’autres termes, il est tout autant essentiel de prendre la mesure de cette réalité nouvelle pour prendre date pour le futur : l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme ne peut définitivement demain être le même qu’hier.
a) L’obsolescence de certaines préoccupations dans un monde changeant
L’évolution de l'APD contemporaine, à laquelle la France a pris toute sa part, est une réalité fondamentale dont les incidences n’ont peut-être pas encore été perçues dans toute leur ampleur. Elles sont pourtant au cœur de notre problématique. Votre Rapporteure voudrait simplement se pencher sur quelques-uns de ses aspects, qui se situent au niveau des instruments de l’aide comme des tendances politiques profondes.
Parmi les préoccupations les plus vives en matière de politique d’aide au développement, celles de la visibilité et de l’influence sont au premier plan. Or, certaines des voies qu’a prises la communauté internationale ces dernières années pour contribuer à une meilleure efficacité de l’aide sont en totale contradiction avec ce souci. En premier lieu, l’aide budgétaire, globale ou sectorielle, est un instrument qui rend de fait invisible toute contribution des donateurs, bilatéraux comme multilatéraux. Comme l’analysait justement l’ambassadeur Pierre Jacquemot dans son étude sur le Ghana « pour le donateur, le danger de l’aide budgétaire, harmonisée et consolidée, est le risque fiduciaire associé au déliement et à la fongibilité de son apport. Il est " neutralisé ". Or son agence d’aide doit " rendre des comptes ". Dans une procédure d’harmonisation, davantage encore avec la cartellisation de l’offre d’aide, il lui est difficile d’identifier et de quantifier son propre apport et son impact final, à moins qu’elle décide de développer une attitude de " passager clandestin ", c’est-à-dire en cherchant à tirer davantage de profit de la coopération qu’elle ne met au pot, mais une telle attitude n’est jamais bien acceptée par les autres. » (133). En d’autres termes, l’un des instruments aujourd’hui considéré comme parmi les plus pertinents, et que la communauté des bailleurs s’est résolument engagée à développer, que ce soit au niveau mondial, avec l’adoption de documents comme la Déclaration de Paris, ou au niveau régional, avec l’adoption du Consensus européen pour le développement et du Code de conduite, est en train de faire perdre à l'APD l’un de ses intérêts premiers, du point de vue des donateurs, celui d’être un outil d’influence diplomatique.
Parallèlement, les nouvelles caractéristiques de l’aide au développement – appropriation, alignement ou harmonisation – telles qu’elles résultent des débats internationaux les plus récents sur cette question, en modèlent profondément l’architecture et sont intrinsèquement porteuses d’un nivellement des spécificités nationales contenues dans les aides bilatérales. Qu’on le veuille ou non, la singularité, l’identification et, par conséquent, la visibilité de l’aide d’un donateur sont appelées à s’atténuer. Ce n’est plus grâce à leur action particulière que demain les bailleurs bilatéraux pourront se prévaloir de leur solidarité. L’évolution des instruments de l’aide mène progressivement à la disparition de cette vitrine naguère si recherchée. Dans le même esprit, les financements innovants, sur lesquels la France est à la pointe de la réflexion, en assurant le pilotage du groupe de travail international, auront inévitablement une influence déterminante sur le rapport bilatéralisme/multilatéralisme. La réflexion a mis longtemps à prendre forme, puisque les concepts qui se sont aujourd’hui imposés ont surgi des débats engagés à la fin des années 1960.
Aujourd’hui considérées comme déterminantes par la communauté internationale, les notions de coordination, d’appropriation, de partenariat, d’évaluation, constituent le dogme de toute institution internationale, dont aucun acteur bilatéral ne peut non plus s’affranchir sous peine d’être rappelé à l’ordre par ses pairs. Elles étaient déjà décrites comme l’essence de ce que doit être une politique globale de développement dans l’intérêt bien compris du monde, certes pas encore aussi globalisé, mais dans lequel, néanmoins, bénéficiaires comme donateurs apparaissaient déjà comme interdépendants. C’est aujourd’hui dans ce cadre général qui a été définitivement tracé que la question de la détermination des instruments de l’aide doit évidemment être abordée.
Un regard prospectif sur les problématiques qui intéressent la Mission oblige par ailleurs à revenir, sur les implications de la mondialisation. Lors de son audition (134), Eckhard Deutscher considérait ainsi que le système d’APD bilatéral était d’une certaine manière le produit de l’Etat-nation du XXe siècle. Sans qu’il soit question de prétendre le rejeter aux oubliettes de l’histoire, force était de constater que, tendanciellement, la mondialisation avait pour effet d’entraîner à plus de multilatéralisme, à plus de relations d’interdépendances entre acteurs. Nécessairement, faire face aux défis du monde contemporain et plus encore du monde de demain, supposait davantage de coordination entre des acteurs infiniment plus nombreux qu’autrefois. Il attirait l’attention de votre Mission en soulignant que, si l’aide bilatérale avait été fort utile, le risque existait désormais qu’elle devienne contreproductive dans un environnement très différent de celui qui avait présidé à son émergence. La logique, selon le président du CAD, était que la tendance naturelle entraîne vers un multilatéralisme renforcé, dans lequel les acteurs étatiques continueraient certes à avoir leur place et à jouer un rôle, mais nécessairement différent : de coordination, de supervision, de contrôle politique, d’exigence de transparence, sur la base, toutes choses égales par ailleurs, du principe révolutionnaire « no taxation without representation ».
b) Redonner la priorité au politique
Chacun aura compris de l’ensemble des développements qui précèdent que la détermination d’un équilibre pour l’avenir entre bilatéralisme et multilatéralisme doit résulter, avant toute autre considération, des objectifs politiques qui sont assignés à l’aide. Cela est aujourd’hui d’autant plus vrai que les évolutions de l'APD en cours depuis une décennie maintenant, auxquelles notre pays participe résolument, ont imposé des réorientations profondes sur lesquelles on ne saurait envisager de revenir.
Née, comme on l’a relevé, d’une préoccupation sécuritaire des pays développés, l’aide au développement est toujours aujourd’hui liée à cette thématique fondatrice. Ayant profondément évolué, celle-ci inscrit désormais l’aide comme « projet global dans la mondialisation » (135) et c’est désormais la prise en compte d’intérêts partagés par tous qui structure en profondeur l’aide contemporaine et impose d’essayer de combiner ces contradictions intrinsèques pour trouver un juste milieu et qu’aucun des deux pôles qui fondent l'APD ne soit sacrifié. Ces aspects touchent directement à la responsabilité de chacun des acteurs de la mondialisation dans ce qui se joue aujourd’hui, notamment autour des enjeux climatiques et par conséquent, à la part que les uns et les autres auront à assumer dans un partenariat inévitable. Cette réalité des plus complexes oblige à en repenser profondément les instruments.
Le partage entre multilatéralisme et bilatéralisme ne peut être dissocié de cette ambivalence fondamentale de l'APD, du dilemme irréductible auquel cette politique publique est confrontée, à savoir la nécessité de prendre en compte l’intérêt des bénéficiaires de l’aide sans que ceux des donateurs en pâtissent.
Est-il fondamentalement illégitime que, aidant les pays en développement, fut-ce d’une manière renouvelée, via des partenariats aujourd’hui plus qu’une charité individuelle, les pays donateurs continuent d’y trouver aussi leur intérêt ? Sans doute pas, et d’autant moins aujourd’hui, que la mondialisation amplifie considérablement les interdépendances. Tout a priori initial, et pourrait-on dire, non réfléchi, en faveur du multilatéralisme ou du bilatéralisme ne pourrait par conséquent qu’être inopérant. L'APD comme politique publique, ainsi que votre Rapporteure l’a souligné, est aussi une politique, une diplomatie.
Dans cet ordre d’idées, Gérard Araud, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York, faisait remarquer à votre Mission (136) qu’en matière d’aide publique au développement comme dans d’autres secteurs, l’essentiel était clairement du ressort du politique et de la manière dont on entendait peser. L’Union européenne, par exemple, premier contributeur du système des Nations Unies et du PNUD, devrait pouvoir jouer un rôle central mais elle est jusqu’à aujourd’hui politiquement inexistante. Ce que Philippe Etienne, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles, formulait de son côté (137) en disant que l’Union européenne devrait réussir à exister comme force de conception. Apportant 40 % du budget des Nations Unies, L’Europe ne les pèse en rien, continuait Gérard Araud, et seuls la France et le Royaume-Uni en son sein ont une culture de puissance, dont les scandinaves, notamment, sont fort éloignés. Il faisait remarquer que la période actuelle, aussi marquée par une perte de leadership moral de l’Occident, depuis le déclenchement de la guerre d’Irak, combinée à des exigences considérées comme malvenues en matière d’aide publique au développement, aidaient les émergents à trouver leur place. Un nouvel équilibre du monde était en train de s’installer qui imposait définitivement de faire de la politique et non plus seulement de la charité, dans notre propre intérêt national. Il en était de même de l’intérêt, plus large, de l’Union européenne, en contribuant notamment à la stabilité et à la prospérité de l’Afrique. La recherche d’un équilibre entre nos instruments devait prendre en compte ces données.
Ce n’est en effet qu’une fois définis les buts que l’on entend poursuivre par notre aide au développement, qu’une stratégie aura consécutivement été décidée en ce sens, que les questions relatives au degré d’influence que l’on entend garder, à l’effort de solidarité que l’on est prêt à consentir ou à la nature des intérêts nationaux que l’on prétend par ce biais contribuer à protéger, auront été traitées, que celle des instruments, et donc, de la répartition de nos financements entre bilatéralisme et multilatéralisme, pourra utilement et pertinemment être abordée. Une autre approche serait sans doute vouée à l’échec, à tout le moins mal fondée.
Comme le soulignait Hubert Védrine à ce sujet devant votre Mission (138), il ne s’agit pas tant d’encenser l’un et de diaboliser l’autre, mais avant tout d’avoir une idée claire de ce que l’on veut, condition d’une véritable influence. Cela suppose « une pensée politique forte et continue », ajoutait l’ancien ministre des affaires étrangères, et d’avoir les moyens de cette vision. Un tel projet politique serait aussi la condition d’un bilatéralisme qui ne soit pas défensif, et permettrait éventuellement, de ne pas craindre de s’engager vers plus de multilatéralisme, si son efficacité supérieure était démontrée et si l’on était assuré de pouvoir y exercer un rôle déterminant. En d’autres termes, la complexité actuelle, et sans doute croissante du système ne doit pas forcément inquiéter. Elle est surtout le reflet d’une réalité contemporaine, où l’interdépendance des enjeux impose celle des instruments et partant, leur complémentarité.
Incidemment, on pourra estimer que c’est aussi sur ce terrain, selon votre rapporteure, que résidera la véritable ou la principale mesure de l’efficacité de notre politique d’aide : il y aura efficacité de notre aide si, et seulement si, il s’avère qu’elle répond effectivement aux objectifs qui lui auront été assignés, quels qu’ils soient, qu’ils répondent à la fois à nos intérêts nationaux, entendus au sens large, et à ceux de développement, des pays bénéficiaires, et que, dans un second temps, les instruments que l’on aura privilégiés pour ce faire auront correctement rempli leur rôle. C’est à cette seule aune que devrait être jugée la politique d’aide au développement.
C’est aussi cette efficacité qui, in fine, lui garantira sa légitimité. In fine, la première question, la plus importante, au cœur de ce débat sur les instruments idéaux de l’aide, sur le partage à définir entre bilatéralisme et multilatéralisme, reste avant tout celle des raisons pour lesquelles un pays comme le nôtre intervient sur ce secteur.
II – REGARDS SUR LA POLITIQUE D’AIDE DE LA FRANCE
Les financements que la France consacre à l’aide au développement en font un acteur incontournable de la communauté internationale. Nous n’avons certes toujours pas rempli notre promesse d’atteindre le niveau de financements de 0,7 % de notre RNB, mais on ne saurait pour autant nier que l’aide au développement est une préoccupation forte de notre pays qu’il traduit concrètement dans les faits. Votre Rapporteure souhaite détailler les points positifs de cette politique.
Il apparaît toutefois que l’aide de la France s’avère fortement déséquilibrée et que les différents instruments qu’elle met en œuvre manquent finalement d’efficacité. Les évolutions de la structure de notre aide et de ses modalités au cours des dernières années, ont conduit à rendre notre politique insatisfaisante, pour partie inefficace car ne répondant pas, ou insuffisamment, aux objectifs qu’on lui assigne. Souligner les contradictions les plus remarquables entre discours, annonces, effets d’affichage et réalités concrètes permettra de mieux tracer les perspectives du rééquilibrage nécessaire.
A – La France, acteur majeur de la communauté des bailleurs
C’est tout d’abord sur le montant des financements de la France qui montre l’importance de notre engagement en faveur du développement, même si ce n’est là que l’un des aspects qui caractérisent le rôle que notre pays joue et entend jouer sur la scène internationale en matière de développement.
1) Des financements considérables
a) La France, un des tout premiers contributeurs
Si l’on examine en premier lieu les grandes masses financières, les chiffres impressionnent : selon les données du CAD, en effet, « en 2008, les principaux donneurs en volume ont été les États-Unis, suivis de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France et du Japon. » (139). Le rapport annuel de l’OCDE précise en outre que l’APD nette de 14 pays de l’Union européenne membres du CAD a progressé en termes réels, dont celle de la France, de 2,4 %. En effet, pour la période considérée, 2008-2009, « en chiffres bruts (c’est-à-dire déduction non faite des remboursements de prêts), l'APD s’est élevée à 135.8 milliards USD en 2008, en hausse de 10.7 % en termes réels. Les donneurs les plus généreux, sur la base de leurs apports bruts, ont été les Etats-Unis (27.8 milliards USD), le Japon (17.5 milliards USD), l’Allemagne (16.0 milliards USD), la France (12.5 milliards USD) et le Royaume-Uni (12.0 milliards USD). » (140).
Mieux, si l’on étudie ensuite sur les dernières statistiques, récemment publiées sur le site de l’OCDE, la France se situait en 2009 non plus au quatrième rang, mais au deuxième en volume, derrière les Etats-Unis, comme en témoigne le tableau ci-dessous.
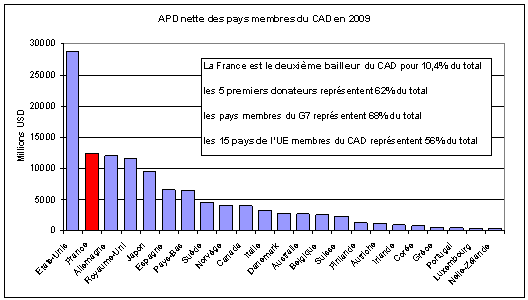
APD nette en volume des membres de l’OCDE, données 2009 en milliards de dollars (141)
L’augmentation constatée de l’aide de la France est encore plus forte en 2009, puisque l’OCDE la chiffre à + 16,9 %, par suite, comme l’année précédente, d’une progression des prêts bilatéraux et des contributions aux organisations multilatérales et européennes.
Ainsi que le faisait remarquer Jean-David Levitte, ambassadeur de France, conseiller diplomatique et sherpa du Président de la République, lors de son audition par votre Mission (142), notre pays n’a donc pas à rougir de son effort de solidarité qui est effectivement des plus conséquents.
Cela étant, comme votre Rapporteure a déjà eu l’occasion de le souligner, en pourcentage du RNB, la position de notre pays apparaît moins bonne, puisqu’il ne se situe plus que dans la moyenne des pays de l’Union européenne appartenant à l’OCDE. Comme le montre le tableau reproduit ci-dessous, ce ratio ne place en effet la France qu’au 11e rang des bailleurs internationaux.
A cet égard, comme l’indique l’OCDE, « selon les hypothèses du projet de loi de finances pour 2010, la France prévoit que le ratio APD/RNB en 2010 devrait se situer entre 0,44 % et 0,48 % (sur la base d’une hypothèse de RNB 2010 de 1 958 milliards d’euros), le montant réalisé dépendant des hypothèses d’annulations de dettes liées au calendrier d’atteinte des points d’achèvement par les pays éligibles à l’initiative PPTE. Sur la base de la prévision officielle de la France, le Secrétariat a estimé un ratio APD/RNB de 0,46 % en 2010 » (143).
Cette considération rappelle un aspect critiquable, et critiqué, de l’aide française à savoir la prise en compte de certaines dépenses dans la comptabilisation de notre effort et consécutivement, l’artifice statistique qui en résulte par rapport à l’aide que la France fournit réellement.
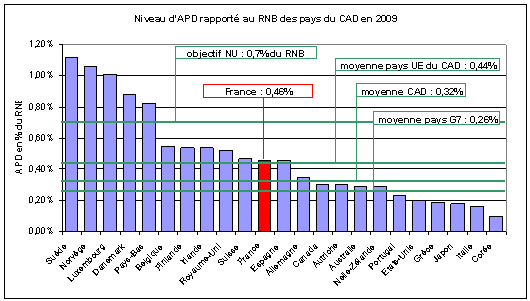
APD nette des membres de l’OCDE, données 2009 en % du RNB (144)
Malgré ses performances indéniables, certaines présentations statistiques et comptabilisations de notre APD montrent aussi une forme de présentation « optimisée » de notre effort. Un regard objectif appelle à plus de rigueur et à une présentation plus sincère.
Un certain nombre d’agrégats tendent en effet à surévaluer l’effort de la France en prenant en compte comme contributions déclarées au CAD au titre de l'APD, des crédits qui ne participent pas directement, voire nullement, au développement des pays qui en sont supposément bénéficiaires. La critique qui est faite à la France sur cet aspect est récurrente et mérite qu’on s’y attarde. Elle ne doit pas, pour autant, amener à conclure que la France ne tient pas son rang et il convient de rappeler avec force que notre pays est depuis toujours parmi les tout premiers contributeurs mondiaux de l’aide.
Cela étant souligné, le CAD a ainsi longtemps appelé la France à réduire la part des dépenses d’écolage – c'est-à-dire la comptabilisation ex-post du coût des étudiants dans l’enseignement supérieur provenant des pays en développement –, dans ses déclarations d’APD. En effet, la France a une appréciation très extensive des frais qu’elle engage à ce titre, bien au-delà des critères du CAD dont les directives aux bailleurs précisent que, à ce titre, « seul peut être comptabilisé le coût imputé aux étudiants issus de pays en développement venus poursuivre leurs études en France dans des domaines liés au développement puis retournant dans leur pays, à la condition que " la présence des étudiants reflète la mise en oeuvre par le pays d’accueil d’une politique délibérée de coopération pour le développement ". » (145). Or, comme le rappelait le CAD lors de sa revue de la politique française de 2008, la pratique de notre pays est de répertorier les dépenses « pour tous les étudiants provenant d’un pays en développement, qu’ils retournent ou non dans leur pays d’origine à la suite de leurs études et quelles que soient les disciplines étudiées, à l’encontre des directives du CAD sur ce sujet ». Il appelait donc la France à identifier « plus précisément les bénéficiaires, pour ne retenir dans la comptabilisation en APD que ceux qui répondent effectivement aux critères d’éligibilité. » (146). Comme le soulignait de son côté une étude de Coordination SUD, « l’importance de cet agrégat statistique dans l’APD française est d’autant plus problématique que très peu de pays comptabilisent l’écolage dans leur APD. Parmi eux, la France et l’Allemagne représentent à elles seules 90 % des dépenses d’écolage notifiées par les membres du CAD en 2004. » (147).
La France s’est pour partie rendue aux recommandations du CAD formulées lors de la dernière revue des pairs à laquelle elle a été soumise en 2008, comme en témoigne le tableau ci-dessous qui montre que la diminution a été conséquente. Les frais d’écolage qui représentaient 14 % de l’APD totale, hors allègements de dette en 2007, n’ont plus représenté que 9 % en 2008. Il n’en reste pas moins que la France en est restée à une interprétation extensive de ces dépenses qui va toujours bien au-delà des directives précitées. En effet, la France continue de prendre en compte dans sa déclaration le nombre d’étudiants étrangers originaires de pays éligibles à l'APD, qui s’élève à plus de 154 000, et retient ceux ayant une équivalence bac, soit plus de 115 000, selon les dernières statistiques fournies, sans tenir compte de la nature des études qu’il suivent dans notre pays. Cette question attire d’autant plus l’attention que les sommes en jeu sont conséquentes : quelque 666 millions d’euros ont été déclarés à ce titre en 2009, en hausse de 4,5 % sur l’année précédente. Si les critiques sont fondées sur le plan de la comptabilisation de nos dépenses d’APD, votre Rapporteure veut néanmoins rappeler qu’elle considère que notre politique d’accueil des étudiants étrangers, notamment chinois, est positive et participe de notre influence et de notre rayonnement culturel et ne doit pas être remise en question.
Selon les données budgétaires communiquées au Parlement dans le cadre de l’examen du PLF pour 2011 dont est extrait ce tableau, il apparaît que la tendance à prendre en compte ces dépenses s’est d’ores et déjà de nouveau inversée pour repartir à la hausse.
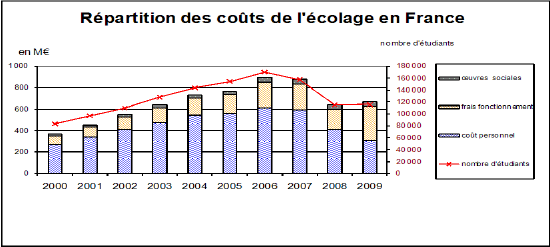 (148)
(148)
Dans le même ordre d’idées, la France inclut dans la comptabilisation de ses dépenses d’APD des frais que les autres donateurs ne prennent pas en considération. C’est notamment le cas des dépenses consacrées à l’accueil des réfugiés en France, qui sont loin de contribuer réellement au développement des pays dont ils sont originaires. Or, à l’instar de sa pratique en matière d’écolage, selon le CAD, « la France déclare la quasi-totalité de ces dépenses comme APD. Selon les règles du CAD, celles-ci devraient se limiter aux dépenses destinées à assurer le transfert de réfugiés, puis à leur entretien temporaire. » (149).
Ces frais représentent chaque année un pourcentage non négligeable de notre APD, comme en témoigne le tableau reproduit ci-après. Que ce taux soit aujourd’hui moindre par rapport à ce qu’il a pu être certaines années antérieures ne retire rien au fait que votre Rapporteure ne peut que reprendre les recommandations que notre collègue Henriette Martinez avait formulées dans un rapport budgétaire pour avis sans être pour autant entendue (150). Cela est d’autant plus important que cette prise en compte nuit également à la lisibilité de notre politique : comme le rappelait Serge Tomasi, directeur de l’économie globale et des stratégies de développement (151), c’est parce que l’on prend en compte les frais d’écolage que la Chine est aujourd’hui au deuxième rang des bénéficiaires de l’aide française,compte tenu de l’explosion du nombre des étudiants chinois intervenue ces dernières années.
A titre de comparaison, il est utile de rappeler que ni le Royaume-Uni ni le Luxembourg n’intègrent ces dépenses, ni d’ailleurs les frais d’écolage, dans le calcul de leur APD (152).
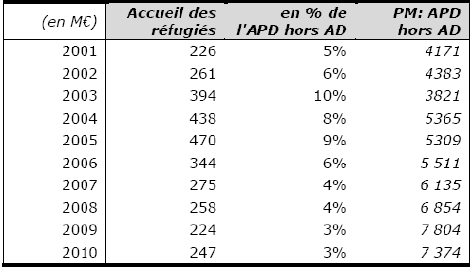 (153)
(153)
Ce thème appelle enfin une remarque sur la manière dont les allègements de dette sont intégrés dans nos dépenses d’APD. De façon générale, les annulations de dettes, pour une grande partie, négociées dans le cadre du Club de Paris, ont connu une très forte progression depuis 2002, en raison de la participation de la France à l’initiative Pays Pauvres Très Endettés, (PPTE). Ainsi, selon Coordination SUD, la chute de notre APD entre 2006 et 2007 puis la hausse qui a suivi en 2009, coïncident-elles avec la baisse puis la hausse des allègements de dettes, qui, cette dernière année, ne représentaient pas moins de 1,123 milliard d’euros, soit une hausse de 59 % par rapport à 2008.
Or, selon les directives du CAD de l’OCDE, « une annulation de dette est considérée comme une remise de dette entrant dans l'APD dès lors qu’elle est motivée par des considérations de développement, contrairement à un abandon unilatéral de créances pour seul motif comptable, qui n’a pas à être inclus dans les notifications au CAD. » (154). C’est précisément la raison pour laquelle, tenant compte de leur lien dans la plupart des cas ténu avec des finalités réelles de développement, l’économiste Daniel Cohen avait considéré dans le cadre d’une étude pour le compte de l’OCDE, qu’on ne devrait inclure que 10 % des annulations de dette dans notre déclaration d’APD.
Comme le faisaient remarquer Jean-Michel Severino et Olivier Ray (155), « il est assez maladroit de comptabiliser l’annulation de prêts qui, au moment où ils ont été octroyés, n’étaient pas considérés comme une APD. Ainsi par exemple, pendant sa guerre contre l’Iran, l’Irak a largement utilisé sa dette souveraine pour financer un armement sophistiqué fabriqué dans les pays industrialisés. Malgré cela, l’annulation de la dette de ce pays (riche en pétrole) est aujourd’hui comptabilisée en tant qu’aide publique au développement et vient gonfler les statistiques mondiales de l’aide. Les flux de l’APD en faveur de l’Irak atteignaient ainsi 6,5 milliards de dollars en 2006, dont la moitié correspondent à l’allègement de sa dette. ». La pratique actuelle de considérer un effacement comptable de créances impayables comme une dépense d’aide au développement induit un effet de gonflement des chiffres et nuit à la sincérité de notre APD. Le Livre blanc, résumant la structure de l’aide française, avait d’ailleurs souligné que « ensemble, les deux premières masses [l’aide bilatérale française et la contribution de la France à l’APD multilatérale et européenne] constituent l’aide " programmable " c’est-à-dire qui peut être affectée à des programmes déterminés, les annulations de dette venant simplement améliorer la situation financière des pays qui en bénéficient. » (156).
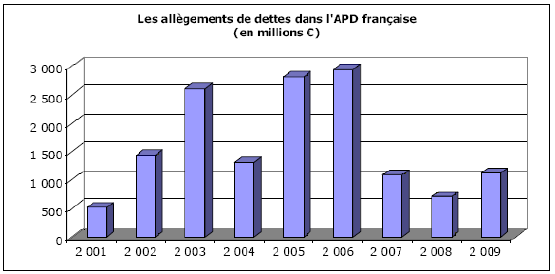 (157)
(157)
Enfin, il convient de rappeler sur ce chapitre que l’APD comptabilise aussi certaines dépenses allouées aux Territoires d’Outre mer, notamment à destination de Mayotte et de Wallis-et-Futuna. Mayotte est même le premier bénéficiaire de notre APD. En d’autres termes, certaines dépenses de solidarité nationale apparaissent intégrées à l’APD, produisant le même effet sur la sincérité de notre présentation et sur la réalité de notre effort.
Coordination SUD s’est livrée à une estimation de ce que représentent le total de ces artifices comptables et conclut que, en ne les prenant pas en considération, l’APD « réelle » de la France ne représente plus que 0,34 % (158) de son RNB en 2009. Nous serions donc considérablement plus éloignés de l’objectif de 0,7 % que nous ne le sommes aujourd’hui. S’il faut néanmoins se féliciter du fait que la part de l’APD « réelle » dans l’APD officielle est en progression passant de 60,7 % en 2002 contre 73,4 % en 2009, l’évolution prévisible à la baisse sur le moyen terme des annulations de dettes n’est pas sans inquiéter, comme en témoigne le tableau ci-dessous, que publiait le Livre blanc en 2008 :
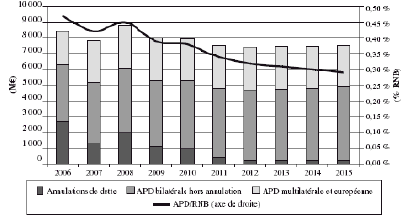 (159)
(159)
Evolution spontanée de l’effort d’APD à effort budgétaire constant
(Prévisions à horizon 2015)
Toutes ces considérations sont loin d’être anodines pour le propos de votre Mission car elles touchent à des aspects centraux de la problématique de l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme, ainsi qu’aux marges de manœuvre que se donne la France de par la structure même de ses financements de l’aide. En effet, comme le soulignait le CAD en 2008 : « L’aide pays programmable de la France représentait 29 % de son aide publique bilatérale en 2005, alors que la moyenne du CAD s’établissait à 46 %. Ceci résulte de la part très importante des dépenses budgétaires non programmables (écolages, coût des réfugiés), des dépenses non budgétaires (une part des annulations de dette), mais également, au sein de l’aide budgétaire programmable, du soutien élevé de la France à plusieurs fonds globaux et de la part incompressible de ses engagements multilatéraux (…). Cela diminue la marge de manoeuvre de la coopération bilatérale française. En augmentant le volume de son aide, la France devra veiller à choisir des instruments qui lui permettent de garder un volant d’action suffisant pour pouvoir assumer pleinement son rôle d’acteur de premier plan dans les pays et secteurs prioritaires. » (160).
La deuxième caractéristique de l’aide de la France est son universalité. Pour généreuse que cette ambition planétaire puisse paraître, elle n’en est pas moins facteur de dispersion finalement préjudiciable.
Que ce soit par ses actions et financements bilatéraux ou par ses contributions aux institutions européennes et multilatérales, notre pays intervient en effet sur une aire géographique extrêmement étendue : l’Afrique est certes son champ d’action privilégié – histoire, francophonie et OMD obligent –, mais les autres continents ne sont pas oubliés par notre politique de coopération. Le graphique ci-dessous, qui ne concerne que l’APD bilatérale, suffit à montrer l’étendue géographique de la coopération française qui intervient, certes à des degrés moindres, mais néanmoins de manière significative, eu égard aux sommes globalement engagées, au Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique latine, ainsi qu’en Europe.
Le diagramme ci-dessous montre que la priorité accordée à l’Afrique subsaharienne conduit à y diriger 49 % des financements bilatéraux de la France au titre de l’aide au développement, devant le Moyen-Orient et l’Afrique du nord. A titre de comparaison, votre Rapporteure relève que la concentration était inférieure en 2008, puisque l’Afrique subsaharienne ne recevait alors que 42 % des crédits, le Moyen-Orient et l’Afrique du nord en étant destinataires d’un quart. Ainsi, près des deux tiers des financements bilatéraux de la France se dirigent vers deux régions, les autres aires géographiques se répartissant le reliquat.
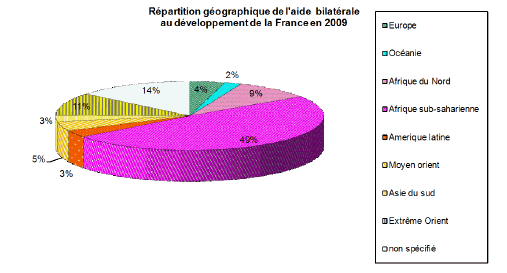 (161)
(161)
Le fait que la France contribue parallèlement à un nombre important d’institutions internationales, et notamment aux capital et fonds concessionnels des banques régionales de développement – Banque africaine de développement, Banque interaméricaine de développement, Banque asiatique de développement et BERD –, confirme le caractère planétaire de l’aide qu’apporte notre pays aux pays en développement.
Si une telle couverture géographique met en évidence les capacités et le rôle mondial d’une puissance comme la France, elle ne contribue toutefois pas à l’efficacité de son aide. Le risque est en effet grand de dispersion et de saupoudrage de financements, qui s’avèrent finalement de peu d’utilité car trop peu importants pour permettre le développement de projets d’envergure sur le terrain, ni pour espérer avoir de réels effets de leviers. Consécutivement, au-delà de la seule question de l’efficacité, l’image et la visibilité de la France, ne peuvent qu’en pâtir. C’est précisément la raison pour laquelle a été entrepris ces dernières années un effort de concentration géographique de l’aide qui n’est pas encore achevé.
b) Un souci louable de concentration géographique…
On retrouve cette préoccupation exprimée dans nombre de documents.
Selon une « Note du jeudi » (162) publié par la DGCID du MAEE en 2004, qui soulignait la priorité africaine de l’APD française, « en 2002, 72 % de l’APD bilatérale y était consacrée, dont 60 % pour l’Afrique sub-saharienne et 12 % pour l’Afrique du Nord. L’action française en Afrique s’inscrit dans le cadre des liens privilégiés qu’entretient la France avec de nombreux pays africains. Ainsi, au sein du continent africain, l’aide est concentrée dans les pays de la Zone franc et en Afrique du Nord. » Cette note précisait aussi que « parmi les vingt premiers pays bénéficiaires de l’aide française, quinze sont situés en Afrique (dont 4 en Afrique du Nord et 11 en Afrique sub-saharienne. ».
Le CICID de juillet 2004 annonçait lui aussi un recentrage géographique en précisant que « au sein de la Zone de Solidarité Prioritaire, la France souhaite maintenir la part prépondérante de l’Afrique (deux tiers environ de notre aide bilatérale) et augmenter la part consacrée aux PMA, en vue d’atteindre en 2012 l’objectif des Nations Unies de 0.15 % du PIB. Une stratégie d’intervention dans les pays émergents, fondée sur le renforcement de notre influence et la prise en compte des intérêts économiques et politiques de la France, sera élaborée d’ici à la fin 2004. Ce recentrage géographique, qui s’effectuera en cohérence avec les priorités de notre politique étrangère, sera accompagné d’une adaptation de nos méthodes de coopération en fonction de la capacité des Etats à gérer l’aide internationale. » (163).
L’année suivante, le CICID, réuni en mai 2005, annoncera que, « dix ans après la Déclaration de Barcelone, la France entend réaffirmer la priorité méditerranéenne de sa politique de coopération et de la politique de coopération de l’Union européenne. ». En complément, il rappellera de nouveau la priorité africaine de l’APD française : « L’Afrique restera la zone d’intervention prioritaire de la coopération française, avec environ deux tiers de notre aide bilatérale, aide qui sera orientée principalement vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Un effort particulier sera fait sur les pays les moins avancés (PMA) en vue d’atteindre un objectif de 0,15 pour cent du RNB en 2012. » (164).
Plus récemment, le CICID du 5 juin 2009 décidait à son tour « la concentration géographique de notre aide bilatérale, conformément aux recommandations du Conseil de modernisation des politiques publiques. La solidarité vis-à-vis de l’Afrique reste au coeur des priorités françaises, tant dans notre aide bilatérale que dans nos contributions aux institutions multilatérales. Ainsi l’Afrique subsaharienne se verra allouer 60 % des ressources budgétaires de l’aide. (…) Des partenariats différenciés seront mis en oeuvre suivant une nouvelle typologie de quatre catégories de pays. ». Dans cet ordre d’idées, une liste de 14 pays « composée essentiellement des pays pauvres d’Afrique subsaharienne francophone entretenant avec la France des liens privilégiés », a été établie (165), auxquels la France affectera de manière prioritaire ses moyens d’aide au développement. La deuxième catégorie est intégrée par les pays à revenu intermédiaire, essentiellement africains, entretenant des relations privilégiées avec la France. Les deux dernières catégories de pays bénéficiaires de l’aide sont les pays émergents à enjeux globaux et les pays en crise ou en sortie de crise. En cela le CICID a repris une préconisation du Livre blanc sur la France et l’Europe dans le monde qui l’avait prônée en 2008 dans les mêmes termes, suggérant notamment la substitution de partenariats différenciés selon cette même typologie de pays (166). Cette nouvelle architecture se substitue à la ZSP, composée de 55 pays, qui était jusqu’alors en vigueur depuis la fin des années 1990.
Enfin, le projet de loi de finances pour 2010 répétait que l’Afrique subsaharienne se verrait allouer 60 % des ressources budgétaires de l’aide bilatérale. Celui pour 2011 reprend les mêmes formulations. Logiquement, à son tour, le Document cadre reprend ces aspects, en précisant la proportion de financements consacrés à chacune de ces trois zones. Il consacre des développements assez longs sur la priorité africaine de la France et la façon de la mettre en œuvre de manière bilatérale et de la faire respecter via les financements européens ou multilatéraux auxquels la France participe.
c) … qui tarde néanmoins à prendre effet
Ces orientations sont dans leur principe tout à fait opportunes, mais pour autant leur mise en œuvre laisse perplexe, dans la mesure où le resserrement géographique de l’aide de la France ne se retrouve guère dans les faits qui semblent même contredire le discours et les annonces.
En effet, et sans pouvoir prendre encore en compte les changements, éventuellement importants, induits par les décisions du CICID de juin 2009, le tableau ci-dessous est instructif. Extrait des documents budgétaires présentés pour le PLF 2011, il classe la liste des principaux bénéficiaires de l’APD bilatérale française en 2009. Il en ressort que, loin d’être prioritairement orientée vers les pays africains et les pays les moins avancés, l’aide de la France, toutes modalités confondues, se dirige plus volontiers vers d’autres destinations et vers des pays qui ne sont pas, loin s’en faut, les plus pauvres. En premier lieu, on remarque que parmi les dix premiers bénéficiaires de l’APD, seul le Sénégal appartient à la liste des PMA. Dans le tableau présenté l’an dernier, le Burkina Faso apparaissait aussi, qui en a disparu. Tous les autres sont des pays à revenu intermédiaire, PRI, dont deux, la Turquie et le Liban, dans la tranche supérieure, ou à faible revenu, PFR, à savoir la Côte d’Ivoire et le Vietnam. Ensuite, seuls deux pays, contre trois en 2008, sur dix sont situés en Afrique subsaharienne. On peut à bon droit y voir une contradiction majeure par rapport au discours officiel et aux annonces. Surtout, ce tableau ne tient pas compte du fait que c’est Mayotte qui devrait en occuper la deuxième place derrière la Côte d’Ivoire, puisque ce TOM a reçu sur cet exercice au titre de l'APD, près de 320 millions d’euros.
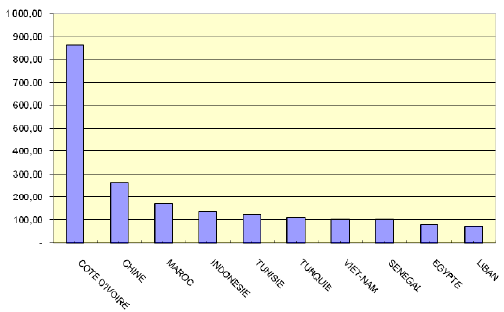
Les principaux pays bénéficiaires de l’APD officielle française en 2009 (167)
Comme le souligne le diagramme ci-après (168), la part de l’Afrique subsaharienne dans l'APD nette de la France est tendanciellement en forte baisse forte sur les dernières années, puisqu’elle est passée de 54 % en 2005 à 40,6 % en 2008.
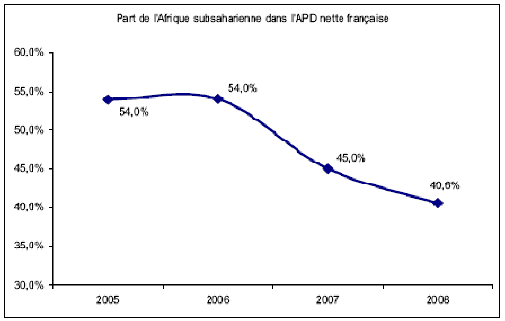
Si l’on examine désormais le tableau suivant proposé par le Document cadre (169) les conclusions sont les mêmes, qu’apportent les commentaires du Document eux-mêmes : « Les 20 premiers pays récipiendaires de l’APD bilatérale nette entre 2007 et 2009 ont bénéficié de 48 % de l’APD bilatérale nette française totale. Ce classement, qui comprend plusieurs émergents (dont la Chine) et seulement cinq pays de la liste des 14 pays prioritaires (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Madagascar et Guinée), s’explique par l’importance relative :
- des frais d’écolage (pour la Chine, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie);
- des prêts (en particulier pour l’Indonésie, le Liban, la Turquie, le Vietnam et la Chine);
- des restructurations de dette (pour la Côte d’Ivoire et pour le Congo). »
Principaux pays bénéficiaires de l’APD bilatérale nette française moyenne 2007 - 2009 (en millions d'euros, déclarée au CAD de l’OCDE) | |||||
1 |
Côte d’Ivoire |
309 |
11 |
Tunisie |
109 |
2 |
Irak |
260 |
12 |
Algérie |
96 |
3 |
Cameroun |
193 |
13 |
Mali |
89 |
4 |
Chine |
167 |
14 |
Burkina Faso |
79 |
5 |
Maroc |
148 |
15 |
Madagascar |
78 |
6 |
Turquie |
138 |
16 |
Egypte |
78 |
7 |
Sénégal |
120 |
17 |
Guinée |
50 |
8 |
Liban |
120 |
18 |
Zones adm. Palestiniennes |
50 |
9 |
Congo, rép. |
112 |
19 |
Indonésie |
48 |
10 |
Vietnam |
110 |
20 |
Brésil |
48 |
En d’autres termes, seuls cinq PMA figurent dans les vingt premiers bénéficiaires de notre APD bilatérale nette sur la période considérée, dont deux, la Côte d’Ivoire et le Congo, le sont pour bénéficier de remises de dettes.
Coordination SUD avait beau jeu, dans ces circonstances, de rappeler que, en 2001, devant la conférence de la CNUCED consacrée aux PMA, notre pays s’était engagé à consacrer 0,20 % de son RNB à cette catégorie de pays et de souligner qu’en fait, « sur la période 2002-2008, l’APD totale consacrée aux PMA (hors allègements de dettes) n’a jamais dépassé 0,05 %. Elle n’atteint que 0,04 % du RNB en 2008, avec 747 millions €. » Coordination SUD en déduisait donc logiquement de ces données que l’APD de la France « bénéficie peu à Afrique subsaharienne et aux PMA » (170). Christian Masset, directeur général de la mondialisation au MAEE, convenait pour sa part lors de son audition devant votre Mission, soulignant la réalité du désengagement bilatéral de la France vis-à-vis de l’Afrique depuis les années 2000, tout en mettant en avant la compensation via le multilatéral qui ne cesse d’augmenter. (171)
Ce sont précisément les mêmes conclusions qui ressortaient de la revue par les pairs effectuée par le CAD en 2008, qui remarquait que si la ZSP n’avait pas été modifiée depuis la dernière revue, et que l’aide de la France restait essentiellement ciblée sur l’Afrique, en revanche, la part allouée aux pays les moins avancés avait reculé depuis 2004. Le CAD soulignait que « la France souhaite concentrer davantage son aide, mais elle n’a pas une stratégie explicite pour cibler davantage l’aide programmable sur un petit nombre de pays selon des critères liés aux OMD et à l’impact potentiel de l’aide. » (172).
Ce n’est assurément pas des conclusions auxquelles votre Rapporteure se serait attendue, d’autant que l’effet de concentration géographique, lorsqu’il se produit est, selon l’OCDE, « essentiellement due à l’effet des volumes d’annulation de dette. » (173). Pour le CAD, en effet, si lors de la revue de 2008 « la concentration géographique semble augmenter, puisque la part de l’aide bilatérale allouée aux quinze premiers bénéficiaires de l’aide de la France est passée de 62 % en 2000-04 à 70 % en 2005-06, un niveau proche de la médiane du CAD de 73 % (…) hors opérations de remise de dette, les 15 premiers bénéficiaires ne représentaient en 2005-06 que 59 % de l’aide bilatérale allouable. ». Les conséquences de cet état de fait sont tout sauf anodines, puisque « la conjonction d’un volume d’aide bilatérale programmable relativement limité et dispersé sur un nombre important de pays, ajouté à l’arrivée de nouveaux donateurs, fait que la France n’occupe plus la position clé qui était la sienne dans de nombreux pays africains. ». L’OCDE concluait ce paragraphe en insistant : « Si le fait que la France ne soit plus un partenaire bilatéral quasi exclusif permet d’assainir la relation partenariale, il est important que la France garde les moyens nécessaires à une stratégie ambitieuse d’appui à la lutte contre la pauvreté dans ces pays, où elle bénéficie d’un avantage comparatif lié à une relation historique à multiples facettes, incluant un effort de coopération de long terme. ».
Votre Rapporteure voit dans cette réflexion un élément majeur qui intéresse très directement la problématique sur laquelle travaille votre Mission.
Cela étant, lors de son audition par votre Mission le 16 septembre dernier, en marge de la revue à mi-parcours de l’aide de la France que le CAD venait d’effectuer, Eckhard Deutscher indiquait que les résultats intervenus depuis lors lui semblaient extrêmement encourageants, notamment eu égard à la manière dont la France avait tenu compte des recommandations de 2008. Les aspects stratégiques lui semblaient en particulier avoir fait l’objet d’une attention remarquable de la part des autorités françaises. Il est à souhaiter qu’elles ne restent pas lettre morte ou que l’évolution des données dans le futur proche continue de montrer un discours et des résolutions qui ne correspondent que de loin à la réalité des faits.
3) Une offre sectorielle étendue
Qu’il s’agisse de ses secteurs d’intervention ou de son aire géographique, l’aide de la France peut être qualifiée d’étendue. Il serait par conséquent opportun, voire indispensable, que de façon parallèle le processus de concentration de l’aide de la France soit resserré sur un certain nombre de secteurs prioritaires sur lesquels notre pays bénéficie d’avantages comparatifs, eu égard à son expertise. Ce processus, engagé pour diminuer les dispersions et le manque d’efficacité, peine encore à trouver sa traduction dans les faits.
a) La question des secteurs d’intervention
« Les priorités sectorielles découlent pour partie de la situation des pays choisis au titre des priorités géographiques, pour partie des choix de notre politique au titre du traitement des problèmes globaux. Dans les pays du premier cercle, la défense du Français, le renforcement de l’État de droit, la gestion concertée des flux migratoires, le soutien à la croissance seront des priorités. La lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’eau et la santé devraient être privilégiés au titre du traitement des enjeux globaux. » (174). Le Livre blanc aurait pu opportunément ajouter que la définition des secteurs d’intervention de notre APD pouvait aussi reposer sur nos engagements internationaux en regard des OMD. Les priorités qu’il suggère paraissent un peu les oublier.
Au demeurant, cette répartition sectorielle n’est pas non plus tout à fait celle qui se dessine pour notre APD qui, précisément, montre un autre profil. En 2004, faisant le bilan de l'APD pour 2003, le MAEE rappelait (175) que « la France a défini six secteurs prioritaires d’intervention en matière d’APD : l’éducation ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ; les infrastructures en Afrique subsaharienne; l’eau et l’assainissement ; la santé et la lutte contre le Sida ; la protection de l’environnement. ». Le CAD de l’OCDE, dans sa revue de 2008, indiquait pour sa part que « le gouvernement a élaboré, d’une manière participative, des stratégies sectorielles pluriannuelles dans sept secteurs : l’éducation, la santé et la lutte contre le sida, l’eau et l’assainissement, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement et de la biodiversité, le développement des infrastructures en Afrique subsaharienne et le développement du secteur privé. Ces stratégies ont été validées en mai 2005. » (176). S’y ajoutaient des stratégies définies dans trois secteurs transversaux : la gouvernance, le développement durable et l’égalité homme/femme pour lesquels des documents d’orientation stratégique ont été adoptés en 2006, 2003 et 2007, respectivement.
Le CICID de juin 2009 a quelque peu resserré l’offre de notre pays sur les OMD. Cinq secteurs prioritaires ont alors été définis : l’éducation et la formation professionnelle ; la santé ; le développement durable et le climat ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ; le soutien à la croissance. En complément, en termes de stratégie transversale, le CICID indiquait aussi que « l’aide au développement française intègrera pleinement l’objectif de promotion de la gouvernance démocratique, de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme. Elle continuera de s’appuyer sur la recherche qui est une composante essentielle de l’aide au développement. ».
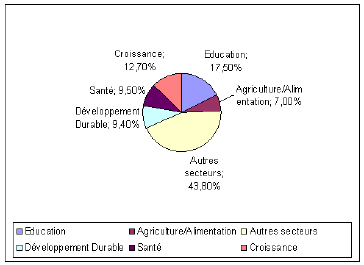
Répartition de l’aide française par secteur en 2008 (177)
Selon le Document cadre adopté à la mi-octobre 2010, ces cinq secteurs ont représenté un total de 56,2 % de l'APD totale nette de la France en 2008, tout types d’action confondus. L’éducation est le domaine d’action privilégié, qui emporte quelque 17,5 % du total, suivie du soutien à la croissance (12,7 %), de la santé et du développement durable, (9,5 % chacun), de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, qui reçoivent 7 % des financements nets. Force est donc de constater que près de 45 % du total de l'APD nette de notre pays se répartissent encore aujourd’hui sur un nombre non précisé « d’autres secteurs », hors priorités.
b) Un effort de concentration lent à se mettre en oeuvre
Selon la perception qu’en ont les principaux partenaires de notre pays au sein de l’OCDE, la répartition sectorielle de notre APD reste néanmoins exagérément étendue et mériterait un effort de concentration. La France en est consciente qui, dans le cadre des Documents cadre de partenariat qu’elle signe avec les bénéficiaires en développement, s’efforce de convenir de un à trois secteurs d’intervention dans chacun des pays. La réflexion qui est engagée au sein de l’Union européenne depuis quelques années, qui s’est notamment traduite par l’adoption du Code de conduite pourrait aider ce processus. C’était le sens de la recommandation du CAD en 2008, qui suggérait une approche plus stratégique, tenant compte du positionnement des autres donneurs. L’OCDE concluait en soulignant que certes, « la France tente également de concentrer son aide sur trois secteurs dans les pays partenaires. Toutefois, des facteurs tant historiques que politiques et administratifs font qu’en réalité l’aide française reste, au niveau des pays partenaires, très dispersée. Comme pour la répartition géographique de son aide, la France gagnerait à définir plus clairement sa vision actuelle des priorités sectorielles pour mieux les intégrer dans le processus de programmation » (178).
A cet égard, il semble à votre Rapporteure qu’il faille ici distinguer plusieurs niveaux de lecture et d’analyse. Deux, à tout le moins. Celui de la définition stratégique et celui de la réalité de terrain.
Au plan stratégique, les options choisies dans le Document cadre, qui reprennent celles décidées lors du CICID de juin 2009, semblent opportunes et de nature à répondre tout à la fois aux objectifs de réduction de la pauvreté sur lesquels la France s’est engagée, aux problématiques contemporaines liées à la globalisation, en matière de santé et d’environnement notamment, tout en prenant en compte nos propres intérêts. En cela, les dispositions prises par les principaux partenaires de notre pays n’en sont pas fondamentalement éloignées. Si chacun peut certes mettre l’accent sur tel aspect, il n’y a pas de différences considérables entre les stratégies sectorielles qui sont déclinées. Certains Etats importants de la communauté des bailleurs, et parmi les plus actifs, semblent même avoir une palette plus large que la nôtre, si l’on en croit une étude de Coordination SUD précédemment citée (179).
Cela étant, selon les renseignements qui ont été recueillis par votre Mission, la concentration sectorielle désirée est difficile à mettre en œuvre. En effet, malgré les orientations européennes tracées dans le Code de conduite, malgré notamment le cadre général de partage du travail qui a été institué, de nombreux éléments interviennent ou entrent en ligne de compte sur le terrain, qui en retardent la mise en œuvre. Les demandes des pays bénéficiaires peuvent ne pas se limiter toujours au « contrat » du DCP et inciter à élargir le cercle des priorités initialement défini ; le degré d’appropriation du DCP de la part des autorités du pays bénéficiaire semble d’ailleurs varier considérablement selon les pays et selon les conditions de son exécution.
Pour autant, la concentration sectorielle semble une nécessité d’autant plus impérieuse que les moyens financiers, en subvention notamment, sont à la baisse. Sans trop anticiper sur les développements ultérieurs, il est évident que les récentes restrictions budgétaires ont un impact considérable et fortement négatif. Autant que le déséquilibre entre le bilatéralisme et le multilatéralisme, le fait que dans un pays comme la République démocratique du Congo, dans lequel votre Mission s’est rendue, le volume de l’aide mise en œuvre sur le terrain situe notre pays au 15e rang des bailleurs avec un trop modeste 2 % de l’aide totale, rend cette aide bilatérale la France totalement invisible et partant inefficace : comment espérer que la voix de la France puisse désormais se faire entendre ? Comment espérer la moindre influence et que les autorités nationales daignent simplement prendre en compte ce qui ne peut que s’apparenter à une aumône par comparaison avec ce que font les autres bailleurs, venant de la part d’un pays comme le nôtre. Consécutivement, compte tenu aussi, du manque de prévisibilité de l’aide, il y a, ici et sans doute ailleurs, un relatif déphasage entre les réalités de terrain et la volonté des DCP de concentrer l’aide sur certains secteurs, quand bien même ont-ils été accordés.
Certains postes diplomatiques en sont réduits à chercher à la marge des « niches » d’intervention peu coûteuses, pour espérer donner à notre aide au développement quelques restes de visibilité. On ne saurait évidemment se satisfaire d’une telle situation : une réflexion est urgente sur les crédits à disposition des postes.
Tout autre est évidemment la situation au Vietnam ou en Tunisie, que votre Mission a également visités, et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, le fait que le degré de développement de ces pays leur permet de pouvoir bénéficier d’une palette d’instruments d’intervention beaucoup plus étendue, facilite les choses et notamment permet à notre pays, moyennant des prêts de l'AFD, de pouvoir continuer à répondre aux demandes du gouvernement, réel pilote de l’aide internationale. Comme le soulignaient Hervé Bolot ambassadeur de France au Vietnam et son équipe (180), la concentration sectorielle peut être effective dans un tel pays sans être contrainte par des considérations opérationnelles dues aux restrictions quant aux instruments disponibles. En Tunisie, la toile de fond et les enjeux sont différents, proximité géographique et partenariat méditerranéen obligent : la relation avec la France repose sur d’autres modalités qu’un DCP mais elle est réelle et concrète. Une véritable concentration de l’aide a été opérée, selon ce que Pierre Ménat, ambassadeur à Tunis, expliquait à votre Mission (181), sur des secteurs qui répondent aux priorités et intérêts des deux pays : l’AFD est le premier opérateur en Tunisie et malgré la baisse forte et récente de l’enveloppe budgétaire bilatérale, la visibilité de l’aide est une réalité, ne serait-ce qu’en terme de présence physique, dix cadres de l'AFD résidant par exemple à Tunis contre un seul de la Banque mondiale ou de la BEI. Cela étant, si la valeur ajoutée de la France reste reconnue, comme votre Rapporteure l’a souligné plus haut, les positions ne sont cependant pas définitivement assurées dans un contexte à tout point de vue fortement concurrentiel.
4) Un rôle moteur dans la communauté internationale
La France n’est pas seulement un acteur important de l’aide au développement par le montant des financements qu’elle y consacre, ni par l’étendue géographique de ses interventions ou la qualité de sa coopération. Notre pays est aussi à la pointe de la réflexion internationale sur un certain nombre des problématiques qui modèlent l’aide de demain et cherchent à en garantir la pérennité.
a) La promotion de nouvelles thématiques
Considérant, avec d’autres, que l’agenda décidé lors du Sommet du Millénaire n’était pas exhaustif et que, à se focaliser essentiellement sur des objectifs sociaux de réduction de pauvreté il risquait d’estomper d’autres problématiques majeures, la France a très tôt pris le parti d’investir le débat. La notion de Biens publics mondiaux (BPM), et la prise en compte qui désormais en est faite, doivent ainsi beaucoup à l’action que notre pays a su conduire.
Ainsi, il n’est pas inutile de rappeler ici – s’agissant dans le cadre de ce rapport, de traiter aussi d’influence et de visibilité –, que dès 2003, la France et la Suède ont copiloté un groupe de travail, confié à de hautes personnalités internationales, afin de clarifier la notion de BPM alors en gestation et de proposer des recommandations pour en assurer la fourniture et le financement, lesquels requièrent une action collective, sur des bases multilatérales, dans la mesure où ces biens, essentiels pour l’ensemble de la communauté internationale, ne peuvent être assumés de manière unilatérale.
Ces travaux et le rôle premier qu’a joué notre pays dans leur déroulement, sont essentiels dans la mesure où ils ont permis un accord sur une série de thèmes considérés comme prioritaires pour l’ensemble de la communauté internationale : la paix et la sécurité ; le commerce international ; la stabilité financière internationale ; la gestion durable des ressources naturelles ; la prévention et le contrôle des maladies transmissibles et la connaissance et la recherche.
Cette réflexion a des conséquences importantes sur l’équilibre entre le bilatéralisme et le multilatéralisme. Comme votre Rapporteure l’évoquait plus haut : dans la mesure où ces thématiques ne peuvent être abordées que de manière globales et collectives, que leur interdépendance est avérée, que des stratégies coopératives, voire des cadres institutionnels internationaux spécifiques, seront nécessaires pour assurer que les BPM seront fournis, notre propre réflexion ne peut qu’en être conditionnée.
Le champ des BPM ouvre mécaniquement un espace nouveau au multilatéralisme, en raison de la nature même des problèmes traités et des mécanismes de gestion et de financement collectifs mis en place pour y répondre. Comme le souligne fort justement le Document cadre, « dans ce monde d’interdépendances, le besoin d’une gouvernance collective et d’une approche plus globale du développement s’impose. » (182), et la politique de coopération au développement apparaît bien comme l’amorce de politiques publiques globales.
Les financements innovants sont également l’un des domaines sur lesquels la France, à la différence notable de certains autres bailleurs qui ne s’impliquent pas sur ce créneau, exerce depuis plusieurs années un véritable leadership. Consciente des impasses dans lesquelles se trouve le financement public traditionnel de l’aide au développement, forcément limité, et consécutivement, des risques de ne pas voir les besoins satisfaits comme ils le devraient ni les engagements respectés, eu égard à l’ampleur des besoins (183), elle développe sur ces questions une réflexion soutenue, et fait œuvre avec un certain nombre de partenaires, de propositions et d’initiatives, tant techniques que politiques.
Certaines ont d’ores et déjà eu l’heur de rencontrer un réel écho, d’être mises en application, en témoigne la création d’UNITAID, financée par la taxe sur les billets d’avion, directement inspirée des propositions du rapport Landau. La France est le premier pays à l’avoir instaurée le 1er juillet 2006, à la suite de la conférence internationale de Paris, avant qu’UNITAID ne soit ensuite officiellement lancée en septembre 2006 à New York, en présence du président de l’Union africaine, par les cinq pays fondateurs – Brésil, Chili, Royaume-Uni, Norvège et France. Depuis lors, de plus en plus de pays, certes essentiellement du Sud, se sont engagés dans cette voie et l’adoptent. Pour relativement modeste qu’elle soit encore, cette initiative a opéré un changement majeur dans la recherche de financements du développement, qui, parmi les autres instruments de l’aide, sont en train de vivre « une révolution spectaculaire », pour reprendre un propos de Jean-Michel Severino et Olivier Ray (184). On voit mal qu’ils ne s’imposent pas à court terme malgré les résistances, compte tenu des besoins.
L’initiative UNITAID est révélatrice du rôle que notre pays peut jouer. Sur cette thématique, la France continue sur sa lancée. Depuis la conférence de Paris sur les financements innovants qui s’est tenue en 2006, elle assure le secrétariat permanent du groupe de travail, aujourd’hui fort de soixante pays adhérents, d’une vingtaine d’organisations et institutions financières internationales et d’une trentaine d’ONG et coalitions d’organisations de la société civile internationale.
On sait également l’attachement du Président de la République à ces initiatives et l’impulsion qu’il souhaite donner aux financements innovants lors de sa présidence du G8 et du G20, comme il l’a souligné à New York. La récente Déclaration finale du sommet des OMD, le 22 septembre dernier, montre que, pour difficile que soit ce défi qui se heurte encore à de très vives oppositions, les esprits progressent néanmoins : pour la première fois, mention est faite dans une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies des travaux entrepris sur cette question, notamment ceux du groupe pilote. La contribution des mécanismes de financements innovants à la réalisation des OMD est reconnue et les Etats s’engagent par conséquent à « étudier la possibilité de recourir à des mécanismes de financement innovants et renforcer et développer au besoin les mécanismes existants ». Il s’agit que « ces mécanismes facultatifs soient efficaces et qu’ils aient pour but de mobiliser des flux stables et prévisibles de ressources qui viennent s’ajouter, et non se substituer, à ceux provenant des sources traditionnelles de financement et qui aillent aux pays en développement dans le respect de leurs priorités et sans leur imposer des charges excessives. »
Quoi qu’il en soit du devenir de ces propositions, que votre Mission encourage à soutenir, compte tenu de leurs énormes potentialités (185), cette thématique comme la précédente, suffit à montrer que notre pays dispose d’un capital mobilisateur important sur la scène internationale sur les questions essentielles de l’aide au développement et sur la manière dont la communauté internationale les aborde.
Cela étant, les développements précédents ont montré que par certains côtés, notre aide prêtait le flanc à la critique. Sur divers aspects en effet, l’impression persiste que la France est plus dans une politique d’affichage, essayant de faire pour partie illusion pour tenter de masquer ses faiblesses, que dans une recherche résolue de les surmonter, difficultés financières obligent sans doute. L’analyse détaillée des divers instruments qu’elle met en œuvre dans sa politique tend globalement à confirmer cette impression.
B – Des instruments objectivement déséquilibrés
Au risque de paraître fort critique, votre Rapporteure doit indiquer d’emblée que ce qui lui semble aujourd’hui essentiellement caractériser l’APD de la France est le déséquilibre fort entre les différents instruments qu’elle met en œuvre. Plus précisément, si la question du déséquilibre entre le bilatéralisme et le multilatéralisme a justifié la constitution de cette Mission d’information, force est de constater que d’autres que celui-ci existent, qui ont autant d’incidences sur la qualité de notre aide, sur ses orientations et son évolution, sur sa nature ainsi que sur les retombées, en termes de visibilité et d’influence, que notre pays peut en espérer. Cela est d’autant plus important à souligner que notre pays se démarque par nombre de côtés des options choisies par nos principaux partenaires.
C’est donc à la question de la cohérence entre le discours et les intentions affichées et les moyens mis en œuvre, qu’il convient de s’attaquer.
1) Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
a) Une architecture qui gagnerait à être resserrée
Lors de son audition par votre Mission (186), Pierre-André Wiltzer avait présenté plusieurs observations. Pour le président du conseil d’administration de l’AFD, l’APD française était marquée par certaines caractéristiques dont la moindre n’était pas l’éclatement institutionnel des structures qui en sont chargées. Dix ans après les réformes importantes intervenues au tournant des années 2000, il y voyait la cause de l’absence d’une véritable coordination et d’un réel pilotage de l’ensemble des moyens mis en œuvre par cette politique publique. Certes le CICID existe, mais il ne réunit pas l’ensemble des ministères concernés dont certains mènent pourtant de leur côté une politique d’aide conséquente, tel le ministère de l’agriculture. Il regrettait également l’extrême lourdeur des dispositifs institutionnels français, qu’il comparait plus à une négociation multilatérale résultant des réunions préalables d’experts ; de sorte que le CICID, qui, sous la présidence du Premier ministre, ne se réunit que rarement, n’était rien d’autre à ses yeux que la formalisation des arbitrages techniques et financiers entre administrations. En somme, concluait Pierre-André Wiltzer, la France manque cruellement d’une organisation institutionnelle qui permette le pilotage politique de l’aide, à la différence notable du Royaume-Uni, pour ne prendre que cet exemple. Cette lacune était d’autant plus dommageable à ses yeux que la connotation politique de l’APD est forte.
Alain Joyandet, alors secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la francophonie au MAEE ne s’exprimait pas différemment : lors de son audition par votre Mission (187), tout en soulignant les progrès qu’avait marqués le CICID du mois de juin 2009 en faveur d’une meilleure coordination des acteurs français, malgré les réformes antérieures, il convenait qu’il y avait un problème institutionnel certain et qu’il faudrait assurément aller encore plus loin en ce sens à l’avenir.
Le fait que deux ministères régaliens, les finances et les affaires étrangères, chacun animé de logiques différentes, chacun chargé de la gestion d’une partie de l’aide, exercent une cotutelle sur les institutions de l’aide rend des plus difficiles la définition d’une stratégie politique unique. Si l’on ajoute celle du ministère de l’immigration, dernier arrivé dans le tour de table, désormais chargé d’une partie des crédits de la mission APD et défendant avec une forte détermination ses propres priorités, on conçoit que la cohérence politique de notre aide ne soit pas chose aisée à réaliser et que la lisibilité de cette politique publique soit quelque peu floue (188). Cette pluralité de décideurs centraux ne peut qu’être source de tensions, compte tenu des différences de motivations, d’intérêts, de visions, d’approches, de relations avec les bénéficiaires. Compte tenu aussi des différences de culture institutionnelle et de pratiques.
Sur ce plan, la France se trouve dans une position tout à fait singulière qui, très probablement, nuit à l’efficacité de son aide, dans la mesure où, indépendamment de l’aspect stratégique, ce manque de coordination et, avant cela, la pluralité des institutions responsables, influent effectivement de manière très directe sur le choix des instruments de l’aide. La France est ainsi le seul pays dans lequel le ministère des finances, en concurrence avec le ministère des affaires étrangères, exerce un tel rôle dans la conduite de l’APD, à la différence d’autres montages institutionnels dans lesquels l’aide est exclusivement ou principalement canalisée par celui-ci.
C’est la situation qui prévaut en Suède où l’agence de coopération internationale, la SIDA, ne dépend que du ministère des affaires étrangères. C’est bien sûr aussi le cas du DFID au Royaume-Uni, comme le faisait remarquer le Conseil d’analyse économique (189), comparant les systèmes français et britannique : « la différence est frappante avec le Royaume-Uni où le DFID (Department for International Development) créé en 1997 comme un ministère à part entière dirigé par un secrétaire d’Etat au développement international, gère simultanément l’aide multilatérale et bilatérale. Alors qu’en 2004, l’AFD a mis en œuvre 9 % des engagements bruts de l’APD française, le DFID a géré 76 % de l’APD britannique. Alors même que la proportion de son PNB consacré par le Royaume-Uni à l’aide au développement est inférieure à celle de la France (0,36 % en 2004 contre 0,42 %), les ressources budgétaires dont dispose le DFID pour l’aide bilatérale sont cinq fois plus importantes que celles de l’AFD (…) La réforme du dispositif français de coopération internationale, décidée en 2004, est allée dans le bon sens, mais sans résoudre fondamentalement le problème de la dispersion des lieux de décision et de l’enchevêtrement des responsabilités. ». Or, ajoutait le conseil, « la dispersion des centres de décision s’accompagne d’une dispersion des objets de l’aide. ».
En Allemagne, où les institutions de l’aide se rapprochent sans doute plus des nôtres que celles de la Suède, le ministère pour la coopération économique et le développement, le BMZ, est certes un ministère à part entière, non dépendant mais néanmoins proche du MAE. Par ailleurs, si plusieurs ministères se répartissent les crédits d’APD, comme en France, la réflexion en cours à Berlin a pour but de rendre le dispositif plus cohérent et mieux articulé et devrait se traduire par un rapprochement entre le MAE et le BMZ. Les débats actuellement en cours pour un meilleur pilotage politique de l’aide ont aussi pour enjeu de renforcer l’autorité et la tutelle du ministère sur la GTZ à laquelle est reprochée une trop grande autonomie d’action. La banque allemande de développement, comparable à l’AFD, ne dépend cependant pas pour autant du ministère allemand des finances qui n’intervient pas dans la définition et la conduite de cette politique.
Cet état de fait est bien sûr porteur de conséquences fortes sur la nature de l’aide française qui est délivrée. Comme l’avait très pertinemment relevé le CAD lors de son examen de 2008, « certains instruments de l’aide sont gérés par des institutions spécifiques, ce qui fait que les arbitrages entre instruments de l’aide ont une incidence sur le volume des activités des institutions. Dans un contexte de contrainte de ressources, la logique institutionnelle risque de prendre le pas sur l’ajustement aux contextes nationaux, chaque acteur cherchant d’abord à sécuriser ses propres financements. Une telle logique peut influer sur les arbitrages entre prêts (relevant du MINEFE) et dons (relevant du MAEE), sur ceux concernant la coopération technique, partagée selon les domaines entre AFD et ministère, et sur ceux concernant l’aide budgétaire, qui relève du ministère des Finances. Le défi pour les instances de coordination et de programmation est donc de faire valoir la vision politique et l’intérêt du développement sur la logique institutionnelle. » (190). Le CAD ne manquait pas d’ajouter que cette logique peut d’autant plus prévaloir qu’étaient perceptibles des « affrontements non résolus entre différentes logiques, tenant notamment aux instruments prêts et dons qui sont affectés à des lignes budgétaires distinctes gérées par des ministères différents, et pour cette raison non fongibles. » (191).
Votre Rapporteure reviendra sur certains des aspects de cette question en étudiant plus loin l’AFD. A ce stade, on ne sache pas que le Document cadre revienne sur ces aspects de notre appareil institutionnel d’aide au développement.
b) La coordination sur le terrain
Ce n’est bien sûr pas qu’en termes de définition et de pilotage stratégiques que les effets du manque de coordination institutionnelle se font sentir. Les informations que votre Mission a recueillies sur le terrain lors des déplacements qu’elle a effectués sont à cet égard éclairantes et les analyses des diplomates en poste dans les pays que votre Mission a visités instructives. Comme en ce qui concerne d’autres aspects, les réalités varient selon les situations, mais les observations sur ce sujet confortent dans l’idée que si les choses ont tendance à plutôt bien se passer entre les acteurs français de l’aide dans les pays déjà en transition, où la coordination est bonne voire excellente, dans les PMA en revanche, le dialogue ne paraît pas être des plus fluides.
Au Vietnam, Hervé Bolot et l’équipe de l’ambassade (192) considéraient qu’il était difficile que la perception de la stratégie ne soit pas morcelée et que l’ambassadeur devait veiller à ne pas être court-circuité compte tenu des retards avec lesquels les informations parviennent sur le terrain. Indépendamment des questions budgétaires ou de procédures, les aspects stratégiques peuvent être largement ignorés. Il importe que l’ambassadeur puisse exercer un véritable leadership sur son équipe, recrée une interministérialité effective sur le terrain pour surmonter les éventuelles divergences et que la France parle d’une voix unie face à ses interlocuteurs. En d’autres termes, à la coordination interbailleurs, s’ajoute la coordination interne aux services français. Or, la lisibilité sur le terrain ne peut être que la résultante de ce qui se passe entre les administrations centrales. Le sentiment de Pierre Ménat, ambassadeur en Tunisie, était sensiblement différent, compte tenu du poids de l’AFD en Tunisie, premier opérateur international avec un encours de prêts de plus d’un milliard d’euros, et des enjeux particuliers que la proximité de ce pays avec le nôtre, dans tous les sens du terme, impose. En revanche, Pierre Jacquemot, ambassadeur à Kinshasa, faisait part de plus difficultés. L’éclatement des structures se répercute sur le terrain et conforte les tendances centrifuges facilitées par la diversité des cultures institutionnelles entre administrations, de telle manière que beaucoup, finalement, dépend de la capacité personnelle du chef de poste d’animation de ses équipes.
2) Le déséquilibre de nos instruments
Votre Rapporteure ne saurait véritablement clore ce survol des caractéristiques dominantes de l’aide au développement de la France sans faire mention de l’Agence française de développement et des moyens de notre aide.
Mieux que de longs développements, la carte ci-dessous illustre le fait que l’« opérateur pivot » de l'APD française est indéniablement devenu un acteur d’envergure mondiale. Comme le soulignait d’ailleurs Dov Zerah (193) devant votre mission, le terme de « Banque universelle de développement » pourrait lui convenir, dès lors que l’agence donne et prête aux PMA, aux PRI et aux pays émergents de tous les continents. Pour ne pas parler des DOM-TOM.
a) L’AFD, banque du développement
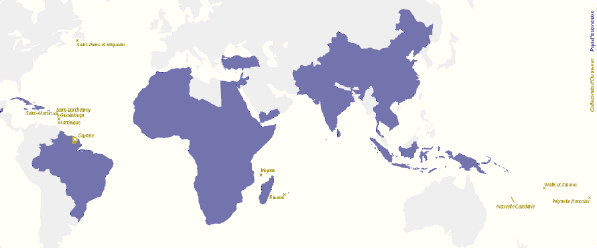 Les zones d’intervention de l’AFD (194)
Les zones d’intervention de l’AFD (194)
Deux aspects sont à souligner, pour mesurer l’ampleur des réformes qui ont été entreprises depuis quelques années qui marquent profondément non seulement la gestion de notre APD, mais aussi sa nature.
En premier lieu, l’AFD est désormais et définitivement l’instrument principal de l'APD française. En 2008, le Livre blanc appelait à « achever le transfert à l’AFD de la mise en oeuvre de la politique d’aide au développement », commencé avec « le transfert en 2004 à l’AFD de la mise en oeuvre des programmes d’aide au développement financés par le budget du MAEE dans des secteurs thématiques (agriculture et développement rural, santé, éducation de base, formation professionnelle, environnement, infrastructures et développement urbain) et la consolidation de la position de l’AFD comme l’instrument essentiel de mise en oeuvre de notre politique d’aide au développement. » (195). Ce que le CICID de juin 2009 a décidé en confiant à l'AFD « la plupart des moyens opérationnels » de l’aide. Cette réforme est d’une importance majeure, de part les conséquences qu’elle a eues jusques et y compris sur la nature même de l’aide délivrée.
Certes, pour reprendre la formulation du Livre blanc, cette évolution suit une « tendance lourde » de la réforme de l'Etat, à savoir la mise en œuvre de l’action publique par des opérateurs, après dissociation des responsabilités stratégiques, à la charge des administrations centrales, et des fonctions opérationnelles, confiées à des opérateurs. Il n’en reste pas moins que, s’agissant d’aide publique au développement, cette évolution est aussi porteuse de changements fondamentaux qui ne sont pas sans incidence sur la géographie de notre aide eu égard à la nature des instruments désormais privilégiés. En effet, le recours sans cesse accru aux prêts, comptabilisables en APD mais de moins en moins concessionnels, permet à l’AFD d’augmenter son volume d’activités à moindre coût pour l'Etat. Cette logique a, mécaniquement, pour effet de privilégier les pays à revenu intermédiaire et les pays émergents aux détriments des PMA et, d’une manière générale, de l’Afrique subsaharienne, qui ne peuvent avoir accès à des taux proches de ceux du marché. Consécutivement, entre les deux volets de l'APD contemporaine, celui tendant à traiter les thématiques de la mondialisation est en voie de prendre nettement le pas sur la solidarité et la lutte contre la pauvreté, soit sur les objectifs les plus directement centrés sur les OMD, pour lesquels les subventions sont des instruments mieux adaptés.
L’extension continuelle du mandat géographique de l’AFD s’inscrit dans cette logique. Alors même qu’il décidait la concentration géographique sur « 14 pays prioritaires », le CICID de juin 2009 élargissait le champ d’intervention de l’agence, « autorisée à étudier la possibilité d’interventions dans une dizaine de pays d’Amérique latine et d’Asie (Mexique, Colombie, Bangladesh, Malaisie, Philippines, Sri Lanka, Kazakhstan, Ouzbékistan et Mongolie). En cohérence avec les objectifs de concentration, ces nouvelles interventions autorisées au cas par cas s’insèreront dans un mandat spécifique visant à promouvoir une croissance verte et solidaire, et s’appuieront exclusivement sur des instruments non concessionnels, c’est-à-dire sans coût budgétaire pour l’Etat. » Dans le même esprit, Dov Zerah disait récemment à votre Mission souhaiter qu’il soit désormais permis à l’AFD d’intervenir aussi « dans d’autres pays, tels le Pérou, la Bolivie, l’Equateur ou encore en Asie mineure » afin de renforcer encore le poids et l’influence de l’agence, ce qui est apparu souhaitable à l’ensemble de la Mission.
Votre Rapporteure ne niera pas l’utilité de l’intervention de l’AFD dans ces nouveaux pays et soulignera, d’une manière générale, la pertinence de son action qui contribue excellemment à la visibilité de la France et participe au premier rang de sa politique d’influence sur les thématiques actuelles. Pour autant, objectivement, cette politique permet aussi à la France de continuer d’afficher une APD importante grâce aux effets de levier qu’autorisent ses prêts, alors même que les subventions qu’elle attribue aux pays les plus pauvres diminuent. Faute de disposer de marges de manœuvre suffisantes pour qu’elle puisse intervenir par d’autres instruments, les autorités de tutelle de l’agence, s’appuyant sur le cœur de métier de l’AFD depuis les origines de la Caisse centrale de coopération économique, l’incitent à amplifier son rôle de banque du développement, de telle manière que, depuis plusieurs années, selon l’OCDE, « contrairement à la pratique de la plupart des membres du CAD, la France tend à augmenter sensiblement la part et le volume des prêts concessionnels comptabilisés en APD. » (196). On peut considérer que cette logique n’est pas sans quelques effets pervers. Quoi qu’il en soit, le tableau ci-dessous, qui montre la répartition entre prêts et dons au niveau de l'APD mondiale, illustre suffisamment la singularité de la position française sans qu’il soit utile d’insister plus.
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
APD brute (bi + multi) |
60 231 |
60 133 |
58 891 |
65 864 |
80 158 |
92 584 |
118 506 |
117 572 |
117 080 |
136 696 |
Dons (bi + multi) |
49 379 |
50 976 |
50 955 |
57 607 |
70 676 |
82 886 |
108 776 |
108 186 |
106 804 |
123 721 |
dont allègements de dette |
2 277 |
2 045 |
2 501 |
4 538 |
8 317 |
7 134 |
24 999 |
18 600 |
9 624 |
11 067 |
Part des dons dans l'APD brute |
82% |
85% |
87% |
87% |
88% |
90% |
92% |
92% |
91% |
91% |
dont part des allègements de dette dans l'APD brute |
4% |
3% |
4% |
7% |
10% |
8% |
21% |
16% |
8% |
8% |
Prêts (bi +multi) |
10 852 |
9 158 |
7 936 |
8 257 |
9 482 |
9 698 |
9 730 |
9 386 |
10 276 |
12 975 |
Part des prêts dans l'APD brute |
18% |
15% |
13% |
13% |
12% |
10% |
8% |
8% |
9% |
9% |
Montants d'APD brute mondiale en millions de $ (197)
b) L’incidence géographique des choix effectués
Comme le faisait très justement remarquer le rapport du CAD sur l’APD française en 2008, « les prêts peuvent effectivement, par leur effet de levier, augmenter le volume des financements consacrés au développement – et donc optimiser l’utilisation de l’argent du contribuable français – tout en contribuant efficacement au développement ». Cela étant, ajoutait-il, « (…) compte tenu de la montée des prêts dans les pays émergents, l’AFD a diminué le niveau moyen de concessionnalité, allant jusqu’à générer 3 euros de prêt pour 1 euro de bonification. Les prêts sont ainsi un moyen pour l’AFD d’augmenter son volume d’activité et, dans une logique financière propre à tout établissement bancaire, de dégager des marges. ». Or, « la nécessité de ne pas contribuer au ré-endettement excessif des États limite pour les pays les plus pauvres le recours à ce type d’aide (au moins en termes de prêts souverains), et conduit à privilégier les pays à revenu intermédiaire (en Afrique, seuls l’Afrique du Sud, le Kenya et le Ghana étaient éligibles aux prêts en 2006). (…) L’objectif de lutte contre la pauvreté poursuivi dans les pays les plus pauvres de la ZSP est donc limité par les ressources disponibles sous forme de dons, alors que l’objectif de préservation des biens publics mondiaux poursuivi dans les pays émergents et à revenu intermédiaire peut recourir à l’instrument prêt, pour lequel les autorisations d’engagement sont très supérieures. Or il est essentiel que l’allocation géographique et sectorielle de l’aide soit déterminée sur la base d’une vision stratégique – et prenant en compte, au niveau de chaque pays, les besoins et les stratégies nationales – et non pas sur la base d’opportunités d’instrument. » (198).
De fait, le choix des instruments influe très directement sur les possibilités concrètes d’action. Ainsi, dans un pays comme la RDC, qui, lors de la visite de votre Mission, ne pouvait encore avoir accès aux prêts, n’ayant alors pas officiellement atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE permettant de mettre en place un contrat de C2D (199), les moyens d’intervention du poste de Kinshasa étaient des plus limités, comme votre Rapporteure l’a indiqué, ne représentant plus que 2 % de l’aide totale à ce pays. Consécutivement, les priorités définies par la France, la gouvernance – thématique essentielle, par exemple dans ce pays, peinent à y être mises en œuvre, faute de pouvoir jouer sur l’ensemble de la palette des instruments qui, naguère encore faisait la richesse de l’aide française. La réduction drastique de l’assistance technique ne permet pas non plus de pallier ces faiblesses de notre aide bilatérale qui, au final, laissent un boulevard dans lequel s’engouffrent les autres bailleurs. L’effet d’éviction de notre pays est par conséquent maximal, quel que soit par ailleurs le niveau de nos contributions multilatérales, quand bien même interviendraient-elles sur ces mêmes thématiques.
La situation est évidemment fort différente dans les deux autres pays visités par votre Mission, appartenant déjà à la catégorie des pays à revenu intermédiaire, la Tunisie, ou en passe de l’être à court terme, le Vietnam. A Hanoi, l’ensemble des instruments peut d’ores et déjà être mis en œuvre. Consécutivement, même si les crédits directement gérés par le poste sont en forte diminution sur les toutes dernières années, ayant perdu quelque 50 % entre 2007 et 2010, la marge de manœuvre et d’action reste suffisante et permet à la France de continuer à pouvoir intervenir, si besoin est, dans la plupart des secteurs prioritaires.
|
« La logique voudrait que de la destination géographique de l’aide, de son affectation sectorielle et de la nature et de la capacité de paiement des bénéficiaires (gouvernements, collectivités, entreprises, organisations de la société civile) découle le choix des instruments, dons ou prêts concessionnels. Or c’est l’inverse qui se passe. Depuis la décision de La Baule en 1990, l’Agence française de développement ne doit plus accorder aux États que des dons dans les pays à faibles revenus. Elle peut y faire des prêts au secteur privé, éventuellement au secteur marchand public ; mais les occasions d’investissements financièrement rentables sont rares et l’objet d’une forte concurrence entre bailleurs. Ses interventions dans les pays pauvres, notamment en Afrique au sud du Sahara, sont donc limitées par l’enveloppe de dons qui lui est affectée. Parallèlement elle dispose d’une enveloppe financière correspondant au coût budgétaire des prêts concessionnels inscrits en aide publique au développement (APD). Elle ne peut pas faire de transfert d’un poste à l’autre. Compte tenu des règles de calcul de l’APD définies par le CAD, qui inclut le montant total des prêts pourvu qu’ils comportent un élément de libéralité de 25 % au moins (pour un taux d’intérêt de référence égal à 10 %), le coût budgétaire des prêts (tout au moins si on considère les versements bruts) est inférieur à celui des dons ; la recherche d’un « effet de levier » (maximisation du volume de l’aide pour un coût budgétaire donné ou minimisation du coût budgétaire d’un objectif d’aide) conduit donc à privilégier l’enveloppe des prêts relativement à celle des dons. » (200). |
En Tunisie, en revanche, certains indices ne laissent pas de rendre perplexe, bien que les différents instruments puissent naturellement y être aussi engagés. Selon les informations qui ont été données à votre Mission lors de son déplacement, certaines difficultés semblent néanmoins poindre. En effet, la faible capitalisation de l’AFD, dont Dov Zerah aura également l’occasion de souligner les inconvénients lors de son audition, risque à court terme, à savoir dès la fin 2011, d’empêcher l’agence de continuer à prêter à l’Etat tunisien, en regard des règles prudentielles en vigueur. Par ailleurs, le fait que les autres bailleurs interviennent sur ce « marché de l’aide » très concurrentiel qu’est la Tunisie, à des conditions désormais plus concessionnelles que celles que proposent aujourd’hui l’AFD, confirme que rien ne peut être considéré comme définitivement acquis. Une réflexion sur la nature de nos divers instruments s’impose par conséquent, si ce n’est une remise à plat d’envergure.
c) L’incidence sectorielle des choix effectués : le cas de l’eau et de l’assainissement
Si l’on examine cette question sur un plan sectoriel et non plus géographique, les conclusions sont similaires. La « Coalition eau » (201) a par exemple récemment réalisé une analyse des montants renseignés au CAD par la France ces dernières années pour le secteur de l’eau. Dans le cadre du plan d’action adopté en 2003 lors du sommet du G8 d’Evian, pour répondre à l’OMD n° 7, visant à réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès à un approvisionnement en eau potable, le CICID a adopté en février 2005 une stratégie sectorielle au terme de laquelle notre pays s’engage notamment à doubler son APD bilatérale et multilatérale dans ce secteur pour y contribuer.
Il ressort finalement que l’augmentation significative de l’aide bilatérale de notre pays pour l’eau potable et l’assainissement, qui a porté notre pays au quatrième rang mondial des bailleurs sur ce secteur derrière le Japon, les Etats-Unis et l’Allemagne, s’explique par un accroissement massif des prêts bancaires, comme en témoigne le diagramme reproduit ci-après.
 (202)
(202)
Evolution des prêts et dons de l’aide bilatérale française en eau potable et de l’assainissement
entre 2001 et 2007, engagements en millions d’euros, (source CAD)
Consécutivement, ce sont majoritairement les pays à revenu intermédiaire, bien plus que les pays les plus pauvres qui, en 2007, bénéficiaient de l’essentiel de l’aide de notre pays, majoritairement sous forme de prêts. L’aide bilatérale aux PMA dans le secteur de l’eau augmente certes, mais également via l’octroi de prêts.
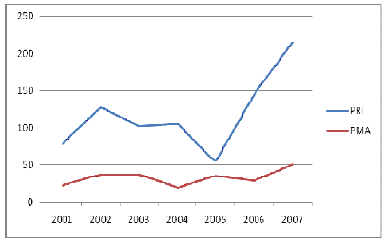 (203)
(203)
Evolution de l’aide bilatérale française en eau potable et assainissement allouée aux PMA et PRI,
entre 2001 et 2007, engagements en millions d’euros, (source CAD)
Sur ce plan, comme le font remarquer les auteurs de l’étude, « la France est très loin des pratiques de ses homologues européens, principaux contributeurs du secteur de l’eau potable et de l’assainissement. L’Allemagne, principal bailleur européen sur secteur de l’eau potable et de l’assainissement a alloué en moyenne sur la période 2001 - 2007, 66 % de son aide sous forme de dons, contre 29 % pour la France ; alors que le Royaume Uni a fait exclusivement appel aux dons. » (204).
|
|
Toutes choses égales, la situation est identique en ce qui concerne d’autres secteurs. C’est le cas notamment de l’agriculture dans lequel le rapport entre subventions et prêts dans notre aide bilatérale s’est également inversé au cours des dernières années. En conséquence de quoi, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’aide française à l’agriculture en vient tout d’abord à s’orienter majoritairement vers les PRI, qui peuvent répondent aux critères d’octroi des prêts de l’AFD, à la différence des PMA. Cette politique de prêts se traduit d’ailleurs parfois par une APD négative plus ou moins importante, certains pays, huit (205) ont été dans ce cas en 2009, étant amenés à rembourser plus qu’ils n’ont reçu. Les petits agriculteurs n’offrant pas de garanties suffisantes pour bénéficier de prêts, ce sont les projets d’infrastructure et de soutien à la production qui apparaissent priorisés, en contradiction avec les déclarations de l’Aquila et du sommet mondial de l’alimentation.
En d’autres termes, tout se passe comme si la France avait fait le choix de certains instruments d’aide lui permettant de continuer de pouvoir apparaître sur la scène internationale comme l’un des tout premiers bailleurs à moindre coût. Cette orientation n’est cependant pas sans conséquences concrètes sur la nature même de l’aide qu’elle peut désormais fournir, ni sur les bénéficiaires de celle-ci. Il ne s’agit pas ici pour votre Rapporteure de se prononcer résolument en faveur des dons de préférence aux prêts. L’un comme l’autre ont leur utilité et il est indispensable de pouvoir disposer des deux instruments pour la flexibilité de notre politique d’aide. Mais la logique financière qui conduit à privilégier les bénéficiaires en fonction du seul critère de leur solvabilité n’est assurément pas la plus heureuse.
Elle amène aussi, malheureusement la France à ne pas réussir à totalement respecter les stratégies qu’elle définit : la stratégie sectorielle sur l’eau adoptée en 2005 indiquait ainsi que l’aide française se concentrerait sur les populations défavorisées, notamment celles qui n’ont pas accès à l’eau et l’assainissement et interviendrait majoritairement en milieu rural et dans les quartiers défavorisés des petites et grandes villes, ce qui n’est pas tout à fait le cas, en témoigne le diagramme ci-dessous.
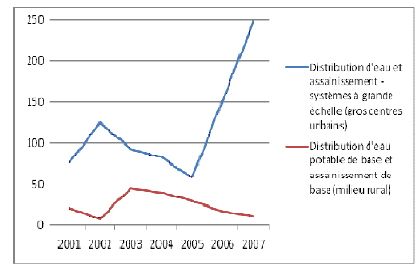
Comparatif entre l’aide engagée pour de gros centres urbains et pour le milieu rural,
entre 2001 et 2007 ; en millions d’euros, (ibid.)
Dans la mesure où la préoccupation qui a soutenu les travaux de votre Mission tourne autour de questions tenant non seulement à l’efficacité de notre aide au développement, mais aussi à des aspects plus immédiatement politiques telles que la visibilité et à l’influence que notre pays, via cette politique, peut espérer retirer, ces considérations sont essentielles. On voit en effet que ce n’est pas seulement, stricto sensu, l’articulation entre le bilatéralisme et le multilatéralisme qu’il importe de déterminer, mais que des aspects beaucoup plus larges, tenant à de multiples aspects de l’aide, impactent tout autant ces problématiques. Serge Tomasi, directeur de l’économie globale et des stratégies de développement estimait lors de son audition par votre Mission que c’est effectivement sur ce point que réside le véritable déséquilibre de nos instruments (206).
Le déséquilibre de notre aide ne concerne donc pas seulement, loin de là, le bilatéralisme et le multilatéralisme. Il est avant tout manifeste sur les instruments que nous avons peu à peu choisis et privilégiés, depuis des années, au fil de réformes successives aux effets convergents. Il est tel que la nature de notre APD en porte d’ores et déjà la marque.
3) Le choix résolu du multilatéralisme
La cause est entendue : le curseur a été porté trop loin sur l’échelle du multilatéralisme pour qu’on se satisfasse de cette situation et il convient de revenir à un meilleur équilibre, redonnant leur place aux moyens bilatéraux qui permettent de mieux respecter nos priorités et de garantir notre visibilité et notre influence sur les pays bénéficiaires. En ramenant les termes du débat à leur plus simple expression, les conclusions pourraient être aisément tirées. Cela étant, votre Rapporteure a présenté plus haut certains des éléments de la discussion en se plaçant sur un terrain plus particulièrement politique et a montré le consensus sur la complémentarité des deux plus que leur antagonisme. Il importe désormais de se pencher sur ce qu’il en est précisément.
a) Multilatéralisme vs. bilatéralisme : l’état de la question
Il ne s’agit pas pour votre Rapporteure de proposer ici la fixation de taux prédéterminés d’aide à consacrer au bilatéralisme et au multilatéralisme. Elle n’entend pas se situer ici sur le terrain du chiffrage précis, sur lequel de nombreux éléments sont connus (207), mais plutôt de continuer de proposer les éléments qui doivent soutenir la réflexion, gardant présente à l’esprit la complémentarité des deux plus que leur antagonisme. Comme le montre le diagramme ci-dessous, la part croissante de l’aide multilatérale dans la structure de l'APD française est une réalité indéniable.
Relativement stable, et même en baisse au long de la décennie 1990, l’aide multilatérale a entamé ensuite une progression nette et non interrompue depuis, qui a vu les financements versés passer d’un peu plus de 2 milliards de dollars à plus de 4 milliards, de 2000 à 2008.
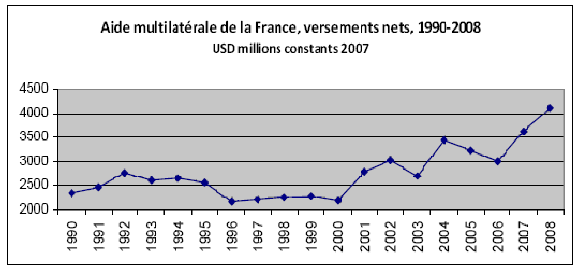
L’aide multilatérale de la France, 1990-2008 (208)
Une autre grille de lecture montre que la part du multilatéralisme a aussi nettement progressé dans la structure de notre aide. Selon l'AFD qui publie le tableau ci-dessous, elle a augmenté de plus de 10 %, « le rythme d’allocations des ressources à des organisations multilatérales, plus soutenu que le volume total de l’aide, a entraîné un accroissement de la part de l’aide multilatérale dans l’aide totale. » (209).
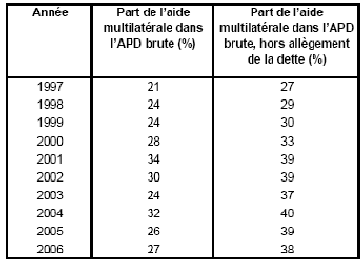
Part de l’aide multilatérale dans l'APD totale (210)
De manière inverse, et tout autant spectaculaire, l’aide bilatérale a connu sur la même période une rétractation importante. Le deuxième diagramme se suffit à lui-même pour illustrer cette réalité.
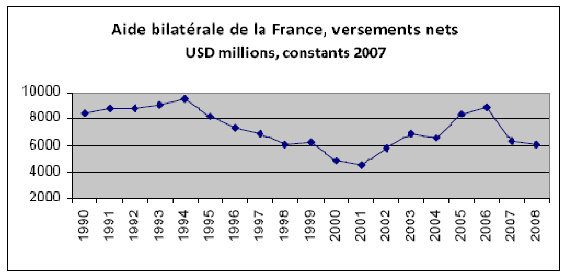
L’aide bilatérale de la France, 1990-2008 (211)
Votre Rapporteure rappellera enfin que, selon la nature de la dépense que l’on prend en compte, le rapport entre bilatéral et multilatéral peut s’inverser, comme Henriette Martinez l’avait noté dans son étude au Premier ministre.
De telle sorte que, la composition de l’APD de notre pays est aujourd’hui la suivante :
Les 8 927 M€ déclarés au CAD au titre de l’APD nette française en 2009 sont composés par : • 4 922,2 M€ d’APD bilatérale, soit 55 % de l’APD totale, • 2 082,6 M€ d’APD européenne (FED / UE), soit 23 % de l’APD totale • 1 921,8 M€ d’APD multilatérale (hors FED-UE), soit 22 % de l’APD totale Le poids relatif du canal bilatéral tend à s’amenuiser ces dernières années. L’APD totale programmable s’élève en 2008 à 5 232 M€. La part bilatérale de l’aide programmable totale ne représente que 42 %, soit 2 183 M€, contre 33 % pour le canal européen (1 731,5 M€) et 25 % pour le canal multilatéral (soit 1 317,5 M€). En ne tenant compte que des seuls dons programmables, le canal bilatéral ne représente en 2008 que 35 % du total, illustrant ainsi la faiblesse relative du canal bilatéral de l’APD française (212). |
Cette évolution a conduit à un effacement progressif de notre bilatéralisme, en tout cas à ce qu’une part de plus en plus importante de nos crédits d’APD soit consacrée au multilatéralisme.
Indépendamment de cet aspect, le fait que les organisations internationales se soient aussi imposées, autour de cette époque, comme les points de passage obligés des décisions les plus importantes qui engagent l’avenir de la communauté internationale, ne pouvait que favoriser cette inclination politique en faveur du multilatéralisme de la part de notre pays. D’une certaine manière, la montée en puissance du multilatéralisme était inscrite comme donnée essentielle de la politique extérieure de nombre de pays.
b) Un multilatéralisme dans lequel quelques privilégiés…
La structure de nos contributions multilatérales apparaît quelque peu atypique, et la totalité des interlocuteurs de la Mission, experts et diplomates, interrogés sur ce sujet sont tombés d’accord sur le fait que plusieurs contradictions coexistaient dans la structure de notre APD. De sorte que, à un bilatéralisme désormais insuffisant correspond aussi un multilatéralisme déséquilibré et ne répondant pas suffisamment à ce qu’on souhaite en obtenir.
A l’inverse des autres principaux pays de l’Union européenne notamment, la France se caractérise en effet par trois aspects : un niveau de contribution très élevé aux fonds verticaux ; des niveaux standard de contribution aux institutions financières ; des contributions aux organisations onusiennes désormais très faibles. Depuis maintenant quelques années, les contributions volontaires ont dépassé les contributions obligatoires substituant ainsi la gouvernance traditionnelle fondée sur les statuts à une gouvernance des bailleurs. Comme le faisait remarquer Sylvie Bermann, directrice des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’homme et de la francophonie au MAEE, la France verse aujourd’hui « moins de 1 % du total des fonds volontaires levés par le système, niveau très faible en comparaison de notre poids dans le revenu mondial (environ 4,5 %) et de notre quote-part aux budgets ordinaires de l’ONU et des institutions spécialisées (environ 6,1 %). » (213).
Le Fonds Européen pour le Développement (FED) est, de fait, une affaire essentiellement franco-allemande : la France en est aujourd’hui le deuxième contributeur, derrière notre voisin d’outre-Rhin. Ensemble, ces deux pays en assument à eux seuls plus de 40 % du coût et, si les apports importants du Royaume-Uni, de l’Italie et, dans une moindre mesure, de l’Espagne, sont remarquables, les 22 autres Etats membres apparaissent, à l’évidence, soit nettement moins concernés par le développement des pays bénéficiaires, soit désireux d’utiliser d’autres canaux.
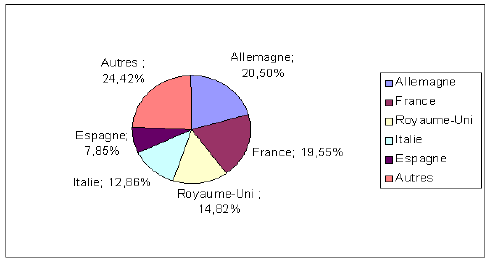
Répartition par pays contributeurs au 10e FED (214)
Après avoir longtemps assumé le quart de ce Fonds, 24,3 % exactement, la France a négocié la réduction de sa quote-part dans le cadre de la constitution du 10e FED, couvrant la période 2008-2013, et sa participation, imputée sur le budget du ministère des Affaires étrangères, intervient désormais à hauteur de 19,55 %. Sur une enveloppe globale de 22,7 milliards d’euros dont la quasi-totalité bénéficie aux pays ACP, la France apporte par conséquent plus de 4,4 milliards d’euros, l’Allemagne engageant de son côté plus de 4,6 milliards d’euros. Consécutivement, comme le rappelle le Document cadre, « les instruments européens sont les premiers bénéficiaires de l’aide française transitant par des voies multilatérales, devant les Fonds verticaux et les institutions financières internationales. ». Il s’agit en effet, avec les autres aides versées au système européen, de 21 % du total de notre APD comme le montre le diagramme ci-dessous (215), et de quelque 58 % de nos contributions multilatérales.
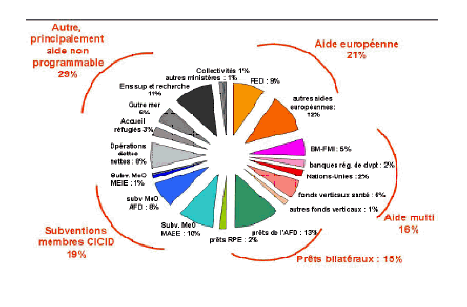
Nos contributions aux institutions financières internationales du système de Bretton Woods se situent à un niveau élevé et nous placent parmi les premiers bailleurs. Il en est ainsi de la Banque mondiale, dont la France est le cinquième contributeur, avec une cotisation totale de 547M€ en 2008, essentiellement destinée à la reconstitution de l’AID, guichet concessionnel de la banque. Selon les données communiquées à votre Mission, cela représente 12 % de notre aide multilatérale. Dans le même esprit, on peut encore relever que la France est le 3e contributeur au financement de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) et de la Facilité de lutte contre les chocs exogènes (FCE), fonds fiduciaires concessionnels du FMI, derrière le Japon et le Royaume-Uni (216).
De même en est-il auprès des principales banques régionales de développement, la Banque africaine de développement et la Banque asiatique de développement, auxquelles la France participe compte tenu de ses priorités géographiques. Ainsi en est-il de notre contribution au Fonds africain de développement, FAD, dont le montant de 363 M€, positionne notre pays au deuxième rang des financeurs. Notre contribution à la Banque asiatique, inférieure mais néanmoins conséquente avec 100 M€, porte la France au septième rang.
En ce qui concerne la Banque interaméricaine de développement, comme Marc-Olivier Strauss-Khan, administrateur de la France, l’expliquait à votre Mission (217), notre position est nécessairement plus modeste. L’Europe n’est entrée dans l’organisation que tardivement, en 1975, à la différence des institutions de Bretton Woods, et représente aujourd’hui 15 % du capital, face aux 30 % américains. Consécutivement, la France, détenant 1,89 % de ce capital est d’un poids plus modeste, inférieur à celui dont elle dispose à la BM ou à la BAfD. Notre participation au capital est de 80 millions sur les 4 milliards versés et nous participerons à hauteur de 37 millions à l’augmentation prévue de 1,37 milliard. Comme pour les autres banques régionales, ce sont les pays emprunteurs qui détiennent la majorité du capital, 50,01 %.
Dans cette catégorie d’organismes bien traités par la France, mention spéciale doit être également faite des Fonds verticaux, véritables priorités de l’aide multilatérale française. Sans doute pour partie parce qu’ils interviennent dans les champs de priorités sectorielles de notre pays. C’est en premier lieu le cas en qui concerne les Fonds dans le secteur de la santé, auxquels nous consacrons des budgets très importants, puisqu’en 2008 quelque 500 millions d’euros leur ont été destinés, dont 300 millions pour le seul Fonds mondial contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Michel Kazatchkine, directeur exécutif du FMSTP, rappelait devant votre Mission (218), le rôle essentiel de notre pays dans la création du Fonds en 2002 et depuis lors. Il soulignait que « en investissant dans le Fonds mondial, la France a montré sa détermination stratégique et politique dans la lutte contre ces maladies et pour l’accès au traitement dans les pays pauvres. ». Désormais, la contribution de notre pays sera augmentée de 20 % et portée 1,5 Md$ sur les trois prochaines années, soit quelque 360 M€ par an au taux actuel. Du fait de l’annonce parallèle des Etats-Unis d’une contribution de 4 Mds$ pour cette période, la plus importante contribution d'un Etat depuis la création du Fonds en 2002, la France restera le deuxième contributeur du FMSTP en volume et au premier rang des contributeurs, en pourcentage de son RNB consacré au FMSTP. De leurs côtés, le Japon, le Canada et la Norvège ont annoncé des apports respectifs de 800 millions, 520 millions et 225 millions de dollars.
En complément, la France contribue aussi de manière importante à d’autres organismes, tels que UNITAID, essentiellement financé grâce au produit de la taxe sur les billets d’avion, qui rapporte environ 120 à 150 millions, versés au FMSTP, ainsi qu’au GAVI pour un montant total de 39 millions d’euros en 2008, en cumulant notre contribution directe et notre financement via l’Iffim.
Dans le secteur de l’éducation, la France participe essentiellement à l’initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour tous « Fast Track » dont l’objectif est l’atteinte des OMD 2 et 3 relatifs à la scolarisation primaire universelle et à l’élimination des disparités de genre dans l’éducation. Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), principal fonds dans le secteur de l’environnement est aussi une initiative à laquelle la France a largement contribuée.
Au total, les Fonds thématiques et verticaux représentent la part la plus importante, après notre participation communautaire, de notre aide multilatérale avec 19 %.
c) … Etouffent quelques parents pauvres
Par comparaison, le système des Nations Unies, avec un petit 6 % de notre aide multilatérale en 2008, soit 274 M€, est assurément le parent pauvre de nos contributions multilatérales et notre participation ne cesse de s’y dégrader. Sylvie Bermann rappelait ainsi lors de son audition que la RGPP avait provoqué une diminution importante des contributions volontaires passant de 85 millions en 2008 à 55 millions en 2010, désormais fortement concentrés sur le PNUD, l’UNICEF, UNRWA et le HCR (219), qui en 2010, absorbent 85 % des contributions volontaires. La baisse générale a été de 19 % en 2009 et de 21 % sur 2010. La France n’est désormais plus qu’au 16e rang des donateurs globaux de l’OMS, par exemple, et d’une manière générale, elle navigue, selon les agences, entre le 14e et le 20e rang des contributeurs.
Qu’on en juge.
Alors même que la gouvernance est affichée comme un secteur de première priorité, en ce qui concerne le PNUD, financé par des contributions volontaires, la baisse est continuelle et rien ne semble devoir la ralentir : notre contribution était de 28,5 millions en 2008, de 26 millions en 2009 et de 18 millions en 2010. Pour leur part, la Norvège et les Pays-Bas apportent chacun 120 M$, les Etats-Unis (100 M$), le Royaume-Uni (95M$) et la Suède (90 M$).
De même, sommes-nous également au 17e rang des contributeurs du HCR, apportant modestement 14 M$ en 2010, soit moins 2 millions d’une année sur l’autre, quand la Suède et les Pays-Bas sont à 105 M$ et 85 M$ respectivement, pour ne pas mentionner les Etats-Unis (510 M$).
L’UNRWA, qui est la seule voie d’action internationale à Gaza pour assurer les services de base aux réfugiés (éducation, santé, aménagement des camps…), se voit gratifier d’un modeste 5 M$ de la part de la France, 15e contributeur, huit fois moins généreuse que le Royaume-Uni... Ce, alors même que depuis plusieurs années, compte tenu de l'augmentation de la population des réfugiés palestiniens, du coût croissant des programmes de soutien, l'agence connaît une crise financière structurelle, et que l’on a, surtout, une conscience aiguë des effets de la paupérisation et des conditions de vie dans les camps comme facteurs de radicalisation et d’implantation de mouvements extrémistes.
Dans un secteur qui touche au cœur des priorités de la France en matière de santé, à savoir la mise en place des programmes de santé reproductive, la planification des naissances, et d’une manière générale, l’ensemble des thématiques démographiques, nous ne contribuons que pour moins de deux millions de dollars (1,9 M$) au FNUAP, nous situant par là même encore une fois au 18e rang des financeurs, tandis que les Pays-Bas donnent 80 M$, la Suède 60 M$, la Norvège 50 M$ ou le Danemark 40 M$. Les Etats-Unis, dont on sait pourtant que l’administration républicaine du président Bush était extrêmement réticente à ces problématiques – cf. les conditionnalités posées aux programmes financés par le MCC, telles qu’elles résultent du Millenium Challenge Act de 2003 ou au PEPFAR dans ses débuts -, apportent néanmoins à ce Fonds 45 M$ par an…
Certes, on pourrait légitimement arguer de la nécessité d’une rationalisation des contributions en fonction de l’efficacité évaluée des agences. Mais comment expliquer dans ces conditions, le fait que, alors même que la France est membre de son conseil d’administration pour la période 2009 à 2011, sa contribution à l’UNICEF, unanimement reconnue comme l’agence clef en matière de protection de l’enfance, notamment dans le cadre des conflits armés, ait chuté de 14,3 millions en 2006 à 7 millions en 2010 ? La France n’est plus désormais que 17e contributeur de l’UNICEF, très loin derrière les Etats-Unis (300 M$) ou la Norvège, dont la contribution de 200 M$ à cette organisation est supérieure, à elle seule, au total de nos contributions volontaires ! De même en est-il des Pays-Bas (190 M$), le Royaume-Uni (180 M$) ou la Suède (170 M$).
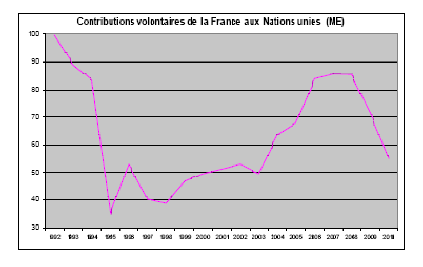
Votre Rapporteure pourrait continuer longtemps cette litanie. Qu’on lui permette simplement de s’interroger sur la cohérence d’une politique qui conduit notre pays à donner aujourd’hui des contributions au seul FMSTP pour un montant équivalent à ce qu’il attribue à l’ensemble du système des Nations Unies et aux banques régionales de développement réunis.
d) Des moyens bilatéraux aujourd’hui en état critique
Au cours de la XIe législature, auditionné par notre commission des affaires étrangères, Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie de 1997 à 2002, considérait que l’augmentation de notre multilatéralisme qui commençait alors à prendre forme était une bonne chose, à « condition que nous sachions peser mieux que nous ne le faisons dans les enceintes internationales. » (220). La coopération française restait cependant alors encore essentiellement bilatérale, mais si notre aide multilatérale ne représentait qu’un peu plus du quart de notre APD, elle était « destinée à monter en puissance » (221) : « L’aide bilatérale correspond aux trois quarts des crédits et constitue les moyens normaux de la coopération française, même si on a fait de l’action multilatérale notre priorité. » (222). Lorsque votre Mission l’a entendu, l’ancien ministre considérait aussi que les circonstances de cette époque charnière avaient joué dans ces choix déterminants : « Le basculement vers le multilatéralisme a aussi correspondu à la volonté d’une ouverture vers d'autres pays africains que nos seuls partenaires francophones classiques. Il y avait un a priori politique important qui est que la France soit ouverte à un partenariat avec toute l’Afrique et non un partenaire obligé et exclusif des seuls pays francophones. C’était la ligne du gouvernement Jospin, elle était en résonance avec les élites africaines qui voulaient aussi s'ouvrir au reste du monde. » (223).
Des voix s’élevaient déjà cependant, notamment au sein de la représentation nationale, pour s’alarmer du virage prononcé, auquel l’augmentation du budget de l'APD devait tout. L’invisibilité de notre apport était déjà considérée comme flagrante ; la question des stratégies à conduire vis-à-vis des organisations internationales était considérée comme une priorité, notamment sur le plan de la politique de ressources humaines, de l’aveu même du ministre. Si cette évolution n’est pas récente, la préoccupation des parlementaires ne l’est donc pas moins. Il n’est que de relire les comptes-rendus des débats de notre commission des affaires étrangères lors des législatures antérieures pour s’en rappeler. Le choix politique de la part du gouvernement, fut-il courageux et inspiré aux yeux de votre Rapporteure, a d’emblée rencontré le scepticisme de la représentation nationale.
Aujourd’hui, il y a unanimité pour considérer que nos moyens bilatéraux sont en état critique. La totalité des interlocuteurs, experts et diplomates, interrogés sur ce sujet par votre Mission sont tombés d’accord sur le fait que notre aide bilatérale est désormais insuffisante. Au long des développements précédents, cette question a déjà été abordée pour qu’il soit besoin d’y insister outre mesure. La situation de certains postes, tel celui de Kinshasa qu’elle a commentée plus haut, montre la difficulté dans laquelle se trouve aujourd’hui la politique en direction des pays les plus pauvres, reposant sur des subventions bilatérales, pour avoir vu ses crédits se réduire d’année en année.
Chacun se souvient aussi de l’émotion qui avait saisi la communauté des organisations de la société civile en 2008 à l’annonce de la suspension sine die par l’AFD de l’instruction de plus de 50 projets, soit l’ensemble des nouveaux projets prévus pour être financés sur dons, faute de moyens suffisants inscrits dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009. Ces projets devaient être engagés, certains dès 2008, pour un montant total de près de 470 millions d’euros (224) en Afrique subsaharienne ainsi que, marginalement, en Asie du Sud-est. Le secrétaire d’Etat avait alors dû intervenir et finalement annoncé qu’un certain nombre de dossiers réussiraient malgré tout à être sauvés (225). Cet état de fait a été d’autant plus dommageable que les projets dont il s’agissait concernaient en grande partie des secteurs liés à la réalisation des OMD, notamment les secteurs sociaux. Les ONG françaises ont alors eu beau jeu de souligner que le gouvernement, malgré ses affirmations, se retirait de facto en 2009 des secteurs sociaux sur le continent africain (226) et qu’il fallait y voir « les conséquences d’une politique menée sans vision stratégique ni cohérence d’ensemble. » (227).
Pour Coordination SUD, qui publie aussi le tableau reproduit ci-dessous, « une analyse de l’évolution de l’aide bilatérale, hors allègements de dettes et prêts octroyés par l’AFD, qui constituent les principaux volumes sur lesquels reposent l’augmentation de l’APD en 2009, montre une baisse de 4 % des crédits alloués à l’aide bilatérale en 2009. Crédits auxquels il convient de retirer les dépenses artificielles hors annulations de dettes (écolage, accueil des réfugiés, TOM). L’aide bilatérale de la France est en réalité en diminution de 7 % en 2009. Le respect des engagements multilatéraux s’est fait au détriment de l’engagement bilatéral de la France, au lieu de s’accompagner d’une hausse simultanée des crédits alloués au financement sur dons de projets bilatéraux. Ceci se traduit notamment par une baisse des crédits du programme " Solidarité avec les pays en développement " de la mission APD, géré par le MAEE. » (228).

Aide bilatérale de la France, évolution et variation 2009/2008
Tant Philippe Etienne que Jean-David Levitte reconnaissaient lors de leurs auditions respectives, que, déduction faite des contributions multilatérales, l’aide bilatérale était réduite à la portion congrue et désormais insuffisante. La revue des pairs de 2008 faisait une analyse sur ce point rigoureusement identique à celle de Coordination SUD en concluant que « la part de l’aide bilatérale programmable dans le total de l’aide française est relativement faible. L’aide pays programmable de la France représentait 29 % de son aide publique bilatérale en 2005, alors que la moyenne du CAD s’établissait à 46 %. (…) En 2008, les crédits de l’aide programmable inscrits dans la " mission APD " de la loi de finances ont certes augmenté de 524 millions d’euros par rapport à 2007, mais davantage sous l’effet de la reconstitution de plusieurs fonds multilatéraux pluriannuels que par anticipation d’une remontée importante du niveau des crédits de l’aide bilatérale en particulier. » (229). Christian Masset, directeur général de la mondialisation, considérait également qu’il était essentiel de retrouver la marge de manœuvre qui passe par l’aide bilatérale programmable (230).
Comme le disait récemment Serge Michailof, dix ans après le virage en faveur du multilatéralisme, « l’aide bilatérale française ne s’est toujours pas remise de ces choix, qui n’ont jamais été explicités ni discutés sur le plan politique. » (231).
C – L’incidence des déséquilibres sur notre APD
Aux termes des analyses qui précèdent, le bilan pourrait être considéré comme sévère. De fait, il doit l’être : un bilatéralisme insuffisant qui aujourd’hui ne permet plus d’exercer une politique de solidarité envers les pays les plus pauvres au moyen de subventions, et donc de remplir le rôle premier d’une politique d’aide digne de ce nom ; un multilatéralisme affaibli car déséquilibré, qui soutient mal la comparaison avec nos principaux partenaires ; des financements objectivement importants – encore une fois, la France est le deuxième contributeur en volume ! –, mais des effets d’affichage indéniables qui gonflent artificiellement les statistiques de ce que l’on consacre à l’aide publique au développement. Tels pourraient être, schématiquement synthétisés, les grands traits par desquels s’esquisserait le portrait de cette politique publique. Est-ce là véritablement ce que l’on est en droit d’attendre d’un pays comme le nôtre ? Peut-on longtemps continuer à se gargariser de chiffres et se payer de mots ?
A l’évidence, non, et si la problématique de l’équilibre à définir entre bilatéralisme et multilatéralisme qui a motivé la constitution de cette Mission d’information est effectivement pertinente, elle est loin d’être la seule sur laquelle il convienne de se pencher. Peut-être même n’est-elle pas la plus déterminante à résoudre pour redonner à notre APD lustre et efficacité.
Le constat est en tout cas suffisamment préoccupant pour que les effets de ces multiples déséquilibres convergents de notre APD soient soigneusement mesurés, afin de tenter d’en corriger certains travers porteurs de sérieuses difficultés pour notre image et notre politique étrangère.
1) Existe-t-on vraiment dans le système multilatéral ?
a) Les effets d’un multilatéralisme insuffisant
Alors même que nos contributions multilatérales n’ont cessé de croître, notre multilatéralisme onusien est désormais à un niveau non seulement minimal mais politiquement insuffisant : Alain Juppé faisait remarquer lors de son audition que le très faible niveau actuel de nos contributions à l’aide multilatérale, en comparaison de celles de nos principaux partenaires, avait retenu l’attention de la commission du Livre blanc, qui s’était interrogée sur le risque de perdre toute influence. Sur cet aspect, Jean-Michel Severino expliquait à votre Mission que l’on est désormais dans un système international où, si l’on entend avoir quelque influence, il est important de se situer entre le 4e et le 6e rang des contributeurs. Si c’est le cas en ce qui concerne les institutions de Bretton Woods, comme on l’a vu, ça ne l’est plus aujourd’hui pour le système onusien, si tant est, au demeurant, que ça l’ait jamais été : en 2001, selon le rapporteur spécial de la commission des finances pour les affaires étrangères, notre contribution au PNUD était déjà trois fois inférieure à ce qu’elle était en 1993 ; dans le même temps, nous étions déjà passés du 4e rang au 17e des contributeurs au HCR (232). Toutes organisations onusiennes confondues, la France était alors au 12e rang mondial, sans correspondance déjà avec son rang. Aujourd’hui, la situation est encore pire, votre Rapporteure l’a montré, même avec des institutions comme le PNUD, avec lequel nous avons un accord global de partenariat pluriannuel. Ne peut-on dans ces circonstances s’interroger sur la capacité d’influence et sur la crédibilité de la France au sein du conseil d’administration de l’UNICEF, avec les moyens que l’on y consacre ?
Pour reprendre les propos de Sylvie Bermann (233), ou encore ceux de Gérard Araud, ambassadeur, représentant permanent auprès des Nations Unies à New York (234), avec de tels financements aux Nations Unies, dont les fonds et les programmes n’ont d’autres ressources que les contributions volontaires, la France n’est plus à la hauteur de son implication dans le système, non plus que de son ambition et de son action de membre permanent du Conseil de sécurité. Par comparaison, il n’est pas indifférent de rappeler que les Etats-Unis, dont on ne cesse pourtant de critiquer le manque d’implication dans le multilatéralisme, fournissent au système des Nations Unies un effort 19 fois supérieur au nôtre en faveur des Nations Unies, le Royaume-Uni six fois, la Suède et les Pays-Bas cinq fois et l’Espagne trois fois.
Le sentiment que la France ne tient pas son rang au niveau international était partagé en 2008 par l’OCDE. Examinant l’aide humanitaire, par exemple, les pairs concluaient que « indépendamment des crédits supplémentaires et des incohérences de notification, les sommes globales allouées à l’action humanitaire demeurent modestes au regard de la position de la France dans la sphère humanitaire internationale. La proportion d’aide publique allouée à l’aide humanitaire en 2005-06 (1 % de l’aide bilatérale) est bien en deçà de la moyenne du CAD (8 %). De plus, en 2007, elle s’est classée au 17e rang de l’ensemble des pays (et au 13e rang des pays membres du CAD) pour ce qui est des contributions humanitaires globales notifiées au système de suivi financier de l’OCHA et était au 10e rang des contributeurs du Comité international de la Croix Rouge cette même année. Ces montants ne sont pas à la hauteur du rôle de la France au sein de la communauté humanitaire internationale. » (235). Cette situation est évidemment regrettable et il serait tout à fait opportun que notre pays puisse disposer de fonds d’intervention d’urgence, à l’instar de nos principaux partenaires.
Dans le même esprit, on peut enfin remarquer que la structure de nos contributions multilatérales diffère sensiblement de celle de nos principaux partenaires. Selon les renseignements qui ont été fournis à votre Mission, 19 % de notre aide multilatérale sont versés à des Fonds verticaux, contre en moyenne 10 % seulement pour l’ensemble des pays européens membres du CAD ; de même, nous ne consacrons finalement que 12 % de notre aide multilatérale à la Banque mondiale contre 20 % pour nos partenaires. Nous sommes de même quatrième contributeur aux banques régionales de développement, mais avec des contributions 2,5 fois inférieures à celles d’un pays comme le Japon. Nos maigres 6 % attribués au système onusien font décidément pâle figure face aux 13 % que les autres pays européens y consacrent en moyenne.
Il n’est pas question pour votre Rapporteure de nier que le recentrage de nos contributions multilatérales qu’a décidé la RGPP était indispensable. Le fait que l’essentiel de nos contributions volontaires soient concentrées sur cinq organisations, dans une recherche d’efficacité de notre aide, n’est pas non plus, a priori ou par principe, critiquable.
Cela étant, force est de s’interroger sur la logique qui préside à cette concentration, sur son pilotage, et de souligner qu’elle aurait évidemment dû être fondée sur des critères politiques, traduire un souci de cohérence de notre action et non reposer sur des simples considérations budgétaires.
Or, la seule logique qui semble ici dominer est la logique comptable qui réduit les contributions de manière indiscriminée. Où est la cohérence politique, ou simplement technique, en effet, dans le fait de diminuer ainsi nos contributions au PNUD dont, comme le rappelait entre autres à votre Mission Cécile Molinier, directrice du bureau du PNUD à Genève (236), le principal terrain d’intervention est, de loin, l’Afrique subsaharienne, première priorité géographique de la France. La perplexité est d’autant plus de mise que la gouvernance, priorité sectorielle s’il en est de notre APD, est également au cœur de l’action du PNUD, qui y consacre une grande part de ses efforts. En d’autres termes, cet exemple, comme d’autres qui ont été précédemment évoqués – UNRWA, UNICEF ou FNUAP –, montre que la réduction de nos contributions au multilatéralisme telle qu’elle est menée contrevient à la cohérence globale de notre action internationale en matière de développement. Ni le respect de nos priorités géographiques, ni celui de nos priorités sectorielles ne s’y retrouvent. Ne serait-ce que dans un souci de bonne gestion des ressources publiques et de recherche d’opportunes synergies, à l’heure où l’efficacité de l’aide et la coordination entre acteurs, se sont imposées, il est urgent de redonner à notre APD le pilotage politique qui lui fait défaut. Déjà en 2008, le Livre blanc avait appelé la France à « être plus cohérente avec son engagement en faveur de l’ONU et du multilatéralisme. » (237). Votre Rapporteure ne saurait mieux dire.
Année |
2008 | ||||||
Donneur Type d'aide |
Donneurs du CAD, Total |
France |
Allemagne |
Japon |
Royaume-Uni |
Etats-Unis | |
|
122 295,56 |
10 907,55 |
13 980,87 |
9 579,10 |
11 499,87 |
26 841,93 | |
I.B. APD Multilatéral |
|
35 291,85 |
4 446,39 |
4 918,18 |
2 755,86 |
4 133,04 |
2 982,47 |
I.B.1.1. ONU |
|
5 805,41 |
274,41 |
295,14 |
580,96 |
436,01 |
692,24 |
I.B.1.2. CE |
|
13 039,46 |
2 528,03 |
2 812,58 |
.. |
2 033,83 |
.. |
I.B.1.3. IDA |
|
8 150,30 |
538,77 |
1 135,79 |
1 168,10 |
1 014,01 |
848,08 |
I.B.1.4. BIRD, SFI, AMGI |
|
444,72 |
7,97 |
.. |
85,25 |
115,20 |
.. |
I.B.1.5. Banques régionales de développement |
|
3 217,80 |
243,96 |
270,06 |
580,63 |
314,69 |
241,19 |
I.B.1.6. Fonds pour l'environnement mondial (77%) |
|
549,11 |
48,68 |
80,37 |
78,12 |
60,79 |
111,34 |
Source : OECD.Stat |
|||||||
b) Qu’en est-il de nos moyens d’influence au sein du multilatéralisme ?
Si le déséquilibre de nos contributions au sein des systèmes multilatéraux nous était de quelque utilité, les choix qui ont été effectués pourraient se comprendre. La question se pose donc de savoir si le fait de « sur-cotiser » dans certains organismes procure à la France un quelconque avantage particulier, en termes de visibilité, d’influence, de prise en compte de ses priorités, géographiques ou sectorielles. De savoir si inversement, le fait de ne pas être à la hauteur de ce qu’on attend d’un pays comme le nôtre est ou non préjudiciable ou handicapant, sur ces mêmes critères. Les réponses à ces questions sont loin d’être satisfaisantes.
En premier lieu, Philippe Etienne (238) faisait remarquer que la France avait peu de personnels dans les sphères dirigeantes des organisations internationales et qu’il y avait là un effort permanent à faire pour les investir à tous les niveaux, de façon à pouvoir profiter à la fois de la force du multilatéralisme et renforcer notre visibilité. Il ajoutait toutefois que cette influence de la France sur les fonds et programmes multilatéraux supposait évidemment des moyens humains et financiers et une expertise organisée. Il convenait donc de mettre en place une politique de présence dans les organisations multilatérales en identifiant mieux les avantages et inconvénients des différentes options : jeunes experts, assistants techniques, cadres dirigeants, détachés. Cela étant, si l’analyse du directeur de cabinet du ministre est pertinente, elle se heurte aux réalités, qu’Alain Juppé soulignait de son côté (239) : nos financements au multilatéralisme sont d’ores et déjà trop faibles et l’on y joue peu de rôle précisément pour y être trop peu présents. Notre marge de manœuvre, comme l’avait constaté la commission du Livre blanc, était considérée comme nulle en 2008 et on ne pouvait raisonnablement davantage baisser notre part. Votre Rapporteure a montré ce qu’il en avait finalement été. Alors même que l’influence au sein d’un organisme international passe notamment par le fait de placer des cadres nationaux au sein des diverses instances, notre insuffisance de financement au système des Nations Unies nous interdit d’ores et déjà de prétendre à des postes de direction dans les agences onusiennes. A son tour, Sylvie Bermann a été sur cet aspect des plus claires lors de son audition devant votre Mission, même s’il n’est sans doute pas trop tard pour réagir.
En conséquence de quoi, nos moyens d’influence au sein des institutions multilatérales se trouvent essentiellement concentrés dans nos positions au sein des conseils d’administration. A cet égard, les administrateurs que votre Mission a entendus ont tous exprimé le sentiment que quelles que soient les difficultés et les insuffisantes budgétaires, le fait de siéger dans les instances dirigeantes des banques de développement était évidemment un atout majeur qui permettait de tenir un rôle effectif. Emmanuel Carrère, administrateur de la France à la Banque africaine de développement, expliquait ainsi (240) le fait que les parts de marché des entreprises françaises sur les opérations financées par la Banque étaient en augmentation sensible depuis quelques années, de telle sorte qu’elles sont aujourd’hui bien supérieures à la part de la France dans le capital de l’institution. Il soulignait d’autre part le très bon vecteur que représentait l’AFD en ce qui est des questions de visibilité, d’influence et d’efficacité. Dans le même sens, Ambroise Fayolle (241), administrateur pour la France de la Banque mondiale et du FMI, estimait que dans ces deux institutions de Bretton Woods, le fait que les grands pays actionnaires, dont la France, aient un siège permanent au conseil d’administration, alors que les autres se partagent une chaise, est un atout considérable pour l’influence que l’on entendait jouer. Malgré le fait que la France soit passée du quatrième au cinquième rang des actionnaires, à égalité avec le Royaume-Uni, après l’augmentation de capital intervenue au cours de l’été, qui a bénéficié à la Chine, sa position reste des plus enviables et doit être appréciée à sa juste mesure, dès lors que, compte tenu du rôle de cette instance, elle permet de participer à la définition des politiques de l’institution. L’administrateur français citait ainsi nombre d’exemples sur lesquels la France avait réussi à infléchir les positions du FMI ou de la BM. Ainsi en a-t-il été concernant les financements accordés au Mexique, à la Colombie ou à la Pologne pour les renforcer lors de la dernière crise. De même en était-il surtout vis-à-vis des pays pauvres, notamment pour tenter de faire évoluer les positions du Fonds sur des thématiques sociales. La France a ainsi été à la pointe au sein du conseil d’administration pour essayer de sanctuariser le social afin qu’il ne soit pas victime de la politique du Fonds, face à des pays comme les Etats-Unis ou même l’Allemagne, plus réticente. Bien que la position de la France à la Banque interaméricaine de développement soit plus modeste, Marc-Olivier Strauss-Khan, administrateur de la France, tenait des propos comparables (242) quant à l’influence de notre pays.
De leurs côtés, il n’est pas non plus inutile de souligner que les plus hautes autorités de ces institutions s’étonnaient de la préoccupation exprimée devant votre Mission. Luis Alberto Moreno (243), président de la BID, disait de quelle façon était valorisé le leadership de la France sur les principales thématiques sur lesquelles travaille l’institution et son ferme espoir que cela continue ; Robert Zoellick (244) mettait en relief la relation de la banque avec le groupe de l’AFD, seule agence européenne avec laquelle un accord de partenariat avait été conclu. Il mettait en avant le travail en commun effectué sur le terrain, ainsi que sur l’excellence de l’apport intellectuel des représentants de la France à la réflexion des instances dirigeantes de l’institution, et notamment au sein du conseil d’administration. De l’augmentation de la part de l’AID consacrée à Afrique subsaharienne, à l'UPM en passant par les questions climatiques, le président de la Banque mondiale ne voyait qu’une influence déterminante de la part de la France, grâce au dialogue permanent conduit au sein de ses instances. Axel van Trotsenburg (245) vice-président de la Banque mondiale, chargé des financements concessionnels et des partenariats mondiaux, soulignait de son côté le leadership indiscutable et le rôle de coordination de la France sur les questions touchant à l’Afrique subsaharienne francophone, mentionnant particulièrement la « très forte influence » de notre pays sur des dossiers comme le Tchad ou le Congo Brazzaville. Enfin, Geoffrey Lamb (246), directeur général de la Fondation Bill et Melinda Gates, considérait comme très positif le leadership de notre pays sur les thématiques santé au niveau mondial et mettait en avant son influence sur la prise en compte de l’Afrique subsaharienne, avant de mettre en garde contre une baisse éventuelle du multilatéralisme de la part de la France.
Votre Rapporteure et votre Mission se félicitent que les positions de la France et son rôle bénéficient de ces appréciations, même si certains témoignages qu’ils ont entendus avaient plutôt tendance à douter qu’il en soit vraiment ainsi, tel Serge Michailof dans son dernier ouvrage (247), ou encore Hubert Védrine pour qui « la Banque mondiale a une grande autonomie et nous n’y exerçons pas grande influence : sur la longue durée, on est incapable de dire sur quelle décision on a pu avoir une influence », soulignant « qu’on n’y exerce pas suffisamment notre pouvoir légitime, et que les organisations internationales acquièrent une autonomie propre. » (248). Quoi qu’il en soit des appréciations des uns et des autres, et de la réalité de ce leadership, et même si le recentrage de l’AID sur l’Afrique doit aussi, pour partie tout du moins, à une forme d’éviction « mécanique » de certains pays, votre Rapporteure souhaite souligner ici qu’il est essentiel que la France reste dans son rôle au sein des organisations internationales et qu’elle continue pour cela de se donner les moyens d’exercer toute l’influence dont elle est capable. Votre Rapporteure développera plus loin cette question.
Cela étant, force est de constater en tout cas que la sur-contribution de notre pays dans d’autres organismes ne semble pas permettre la visibilité et l’influence qu’on pourrait en attendre, même si, évidemment, là ne réside pas la motivation première de la contribution, s’agissant de solidarité envers des populations en souffrance. C’est notamment le cas du Fonds mondial sida, que la France a porté et auquel elle contribue dans les conditions que l’on sait. On pourrait espérer que ce niveau de contribution justifierait qu’une question aussi essentielle pour elle que le respect de la francophonie par l’institution soit prise en compte avec une particulière attention. Qu’il y ait une forme de « retour sur investissement » de la part du bénéficiaire immédiat de cette contribution, qui participerait ainsi de la visibilité, ne serait-ce que culturelle, de la part de son principal soutien. Votre Mission a constaté avec regret qu’il n’en était rigoureusement rien, puisque l’instruction des dossiers que soumettent les pays bénéficiaires pour le financement de leurs projets par le Fonds se fait en anglais, y compris dans les pays d’Afrique francophone, ce qui n’est pas sans leur poser de problèmes, entre autres financiers, ayant à engager des frais de traduction… Sur un autre niveau, mais significatif, on relève aussi que, siégeant au conseil d’administration du Fonds mondial, la France y partage sa chaise avec l’Espagne alors même que les Etats-Unis occupent seuls la leur, tout comme le Japon ou encore l’Italie, dont le niveau d’apport est évidemment loin d’être comparable au nôtre. Force est donc de constater que la France semble bien mal faire valoir sa contribution (249).
Encore une fois, il ne s’agit pas de critiquer la qualité du travail et les formidables résultats obtenus par le Fonds mondial qui doivent être salués, ainsi que sa gestion, selon les informations qui ont été communiquées à votre Mission. Simplement de souligner quelques incohérences flagrantes qui ne servent pas notre pays.
2) Les conditions perdues d’un bilatéralisme influent
a) Les effets du manque de pilotage politique
Tous ces aspects appellent évidemment un commentaire.
En effet, sauf à considérer que seule importe notre présence dans les institutions financières internationales, dont il n’est bien sûr pas question ici de nier l’importance pour le développement des pays pauvres, force est de constater les effets du déséquilibre de notre multilatéralisme.
On ne saurait considérer que notre aide multilatérale est actuellement pilotée de manière à nous donner le maximum d’efficacité, d’influence et de visibilité. A trop privilégier les institutions financières, quand bien même ce ne serait que relatif, comparativement aux autres bailleurs, nous nous privons de moyens d’actions politiques également indispensables dans d’autres forums dans lesquels nous n’avons aujourd’hui plus les moyens d’intervenir.
Ainsi que le souligne une note du MAEE rédigée à l’intention de votre Mission, « les contributions non affectées aux agences onusiennes ont servi de variable budgétaire d’ajustement au sein (…) du programme 209 qui héberge également les contributions françaises au Fonds européen de développement (FED) et au Fonds mondial sida, en forte progression sur la période. La composante multilatérale représente 70 % des crédits d’aide au développement du programme 209, dont seulement un peu plus de 3 % pour les agences onusiennes. Cette diminution s’est accompagnée d’un net recul de nos contributions bilatérales transitant par les organisations internationales (contributions dites « bi-multi ») gérées par la direction générale de la mondialisation. »
En cela, peut-on considérer que le poids du ministère des finances dans la gestion de notre politique d’aide, n’y est pour rien ? Est-ce vraiment un hasard si, entre les contributions multilatérales versées aux institutions financières, acquittées par Bercy, et celles versées au système des Nations Unies, à la charge du MAEE, ce sont celles-ci qui, d’année en année, diminuent, au point d’atteindre à l’indigence et de nous placer dans une situation aujourd’hui intenable vis-à-vis de nos partenaires ? Est-il admissible que la France ait aujourd’hui un poids financier dans les fonds et programmes des Nations Unies comparable à celui de la Grèce ou de la Turquie ? La répartition de nos financements aux institutions internationales serait-elle identique, le système des Nations Unies serait-il à ce point sacrifié si, à l’instar d’autres bailleurs, le ministère des finances n’intervenait pas dans la définition et la conduite de la politique d’aide au développement ? Il y a évidemment, dans ce qui se joue sur fond de RGPP, la traduction de la rivalité entre le Quai d’Orsay, d’un côté, conscient de la nécessité d’augmenter les contributions volontaires pour maintenir notre rang et notre influence, et Bercy d’autre part, désireux au contraire de les supprimer.
Prudemment, Philippe Etienne, directeur de cabinet du ministre, se demandait dans son audition (250) si le déséquilibre interne à notre multilatéralisme était effectué de manière consciente et partageait le sentiment selon lequel le fait qu’il y ait deux ministères à coordonner influait évidemment sur nos choix multilatéraux. Moins diplomate, Serge Michailof considère que « le bilan de telles décisions budgétaires, prises dans le contexte de l’habituelle guérilla entre Bercy et le Quai d’Orsay, est aujourd’hui consternant. » (251). Après d’autres, votre Rapporteure ne peut donc que s’interroger à son tour sur le fait de savoir qui, du ministère des finances ou des affaires étrangères, détermine et conduit la politique extérieure de la France.
A cela, et sur un plan plus strictement politique, le fait qu’un troisième ministère, celui de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, ait été intégré ces dernières années au pilotage de la mission APD, alors même que son apport financier à cette politique publique est des plus modestes, ne peut qu’ajouter à la confusion et desservir l’unité indispensable du pilotage politique.
b) Des déséquilibres au sein du bilatéralisme qui risquent de dénaturer notre aide
D’une certaine manière, compte tenu de la manière dont les choses ont évoluées et des réformes qui ont été entreprises, la visibilité sur le terrain de notre APD bilatérale repose aujourd’hui quasi exclusivement sur l’AFD. Il convient à cet égard de saluer l’efficacité de l’agence qui a su très intelligemment et en quelques années développer un portefeuille d’actions important, avec les moyens qui lui étaient donnés et acquérir une reconnaissance mondiale extrêmement forte, non seulement par ses actions sur le terrain, mais aussi les partenariats qu’elle a su monter ; comme Dov Zerah le disait aussi devant votre Mission, la politique de production intellectuelle que l’agence mène est également un formidable outil de visibilité et de renommée qui lui permet aujourd’hui d’être présente sur le terrain du débat d’idées qu’occupaient surtout jusqu’alors des institutions comme la Banque mondiale.
De très nombreux interlocuteurs que votre Mission a rencontrés ont souligné la très grande qualité du travail de l’opérateur français, le plaçant au tout premier rang de la communauté des bailleurs. On a dit plus haut le regard de la Banque mondiale, par exemple, sur l’agence. Donald Kabéruka (252), président de la Banque africaine de développement, lui porte la même considération, qui met en avant les collaborations entre les deux institutions, notamment sur les grandes thématiques qui détermineront très vite le futur, tant de l’Afrique que de l’Europe.
Sur le terrain, l’appréciation est également des plus favorables. Au Vietnam, par exemple, où les autorités voient la coopération française comme très positive et répondant parfaitement aux attentes du gouvernement, même si la lenteur de la mise en œuvre de ses projets pourrait être améliorée, défaut cependant vu comme commun à tous les opérateurs (253). Le président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale vietnamienne indiquait pour sa part (254) qu’il y avait d’ailleurs un potentiel important pour la France si elle élargissait le champ de son aide aux infrastructures, aux transports ou à l’aménagement du territoire, secteurs dans lesquels une concentration de l’aide française serait appréciée, eu égard aux avantages comparatifs que notre pays présente ici. De son côté, Nguyen Manh Hoa, directeur-général adjoint du ministère des finances (255) se félicitait du rôle de l'AFD sur les questions agricoles et de développement rural, ainsi qu’en matière bancaire et des progrès enregistrés sur la question de l’aide aux PME. L’intérêt du FSP articulé sur des projets en matière douanière et fiscale était souligné.
Ces commentaires sont fort positifs et votre Rapporteure s’en réjouit. Il importe néanmoins de souligner qu’ils confirment aussi le fait que notre APD, fonctionnant essentiellement désormais autour d’un opérateur principal si ce n’est quasiment unique et sur la base d’un seul de ses instruments, le prêt, est surtout adaptée à un certain type de bénéficiaires : les pays solvables. Le fait que l’aide bilatérale de la France au Vietnam ait doublé entre 2000 et 2006 ; qu’en 2009, les engagements de notre pays y étaient encore en augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente ; que notre pays soit le premier bailleur bilatéral européen et le deuxième mondial, avec plus de 280 M$, derrière le Japon, sont évidemment des facteurs très positifs qui ne peuvent que conforter la visibilité et l’influence de la France dans un futur pays émergent, mais on ne saurait oublier qu’ils doivent tout à la politique de prêts engagés par l’AFD. Si, comme on l’a souligné précédemment, la France intervient avec l’ensemble de ses instruments dans ce pays, il n’en reste pas moins que les moyens du SCAC de Hanoi ne cessent de diminuer, conduisant à un désengagement financier de certains secteurs désormais considérés comme moins prioritaires par rapport à la politique d’appui aux infrastructures et aux grands projets, tel que le métro de Hanoi.
Toutes choses égales par ailleurs, en Tunisie, les commentaires que votre Mission a entendus étaient tout aussi positifs sur l’action de l’AFD et s’inscrivaient d’autant plus dans cette même tonalité que le pays est dans la tranche des PRI, et qu’il affronte des problématiques différentes de celles de la seule réduction de la pauvreté en plaçant sa relation avec les bailleurs, et notamment avec la France, dans un cadre de partenariat dans l’intérêt réciproque de chacun. Une note sur les activités de l'AFD dans ce pays remise à votre Mission est tout à fait éclairante : « La Tunisie est, de tous les pays partenaires de l’AFD, le premier bénéficiaire de ses financements, avec près de 1,5 Md€ engagés en cumulé et une montée en puissance progressive des volumes annuels : le Groupe a engagé 180 M€ en 2008, dont 112,5 M€ de prêts souverains couplés à 2,5 M€ de subventions, 54 M€ de prêts et participations de PROPARCO et 11 M€ au titre du développement solidaire, associé à la gestion concertée des migrations. » (256). En d’autres termes, les subventions représentent 1,39 % des 180 M€ engagés par l’AFD en Tunisie.
Comme il a été évoqué, cette politique générale est selon elle porteuse d’un véritable risque de dénaturation de notre aide au développement, dont les bénéficiaires sont de plus en plus des pays à revenu intermédiaire ou des pays émergents, qui, seuls, peuvent bénéficier de prêts accordés à taux plus ou moins concessionnels. Les pays les plus pauvres, dans lesquels seul l’instrument subvention peut être employé sont donc de facto en passe d’être de plus en plus exclus de notre politique d’aide. Consécutivement, dans ceux-ci, notre visibilité et notre influence se réduisent tout aussi mécaniquement.
Le choix qui a été fait par la France de privilégier des instruments d’intervention comme le prêt, combiné à l’importance croissante accordée aux questions liées à la mondialisation conduit la France à oublier, en ce qui concerne sa politique bilatérale, la solidarité au profit des pays les plus nécessiteux et la lutte contre la pauvreté sur laquelle elle s’est engagée dans le cadre des OMD. A développer ainsi une aide publique au développement, elle risque d’en payer le prix fort, celui d’un effacement et d’une perte d’influence sur la scène internationale.
III – FAIRE DU DÉVELOPPEMENT UN ÉLÉMENT STRUCTURANT DE NOTRE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
« Cessons de nous interroger sur l’état de notre influence : elle est grande ; exerçons-la avec lucidité, réalisme et ambition. » (257)
L’aide publique au développement de la France doit donc aujourd’hui surmonter un paradoxe. Il ne s’agit pas tant d’opérer un simple rééquilibrage entre bilatéralisme et multilatéralisme que d’entamer une réflexion sur les modalités d’intervention que notre pays a choisies ces dernières années, lesquelles, malgré ses niveaux élevés de financements, ne réussissent pas à lui donner toute la visibilité et l’influence souhaitées. Dans le même temps, l’extrême enchevêtrement des divers aspects de l’aide au développement rend presque illusoire la détermination d’un nouvel équilibre entre bilatéralisme et multilatéralisme qui prétendrait tracer une ligne de partage claire et définitive entre eux.
Consécutivement, la dernière partie de ce rapport ne peut s’ouvrir que sur une forme de remise à plat de la politique d’aide qu’un pays comme le nôtre entend mener. A cet égard, la réflexion de votre Mission doit tenir compte de la publication d’un certain nombre de documents officiels très récents. Ensemble, à la suite des grands orientations définies par la RGPP et le CICID du 5 juin 2009, ils prétendent tracer la feuille de route d’un processus de réforme de notre politique d’aide sur lequel il est indispensable que la représentation nationale se prononce. Ce rapport ne peut raisonnablement proposer les recommandations qu’il estime pertinentes sans d’abord les présenter.
A – Pour une coopération au développement qui soit une véritable politique
Dans leur lettre de mission au ministre des affaires étrangères, le Président de la République et le Premier ministre avaient précisé : « vous nous proposerez une nouvelle politique de coopération et d’aide au développement fondée sur les principes essentiels suivants :
– éviter la dispersion de nos moyens et, au contraire, concentrer ceux-ci sur des priorités géographiques et sectorielles. Parmi celles-ci devront figurer naturellement l’Afrique, et, sur le plan sectoriel, la santé, l’éducation et la formation, le développement durable ;
– définir l’aide au développement en tenant compte du respect de la démocratie et de la règle de droit ainsi que de la lutte contre la corruption dans les pays partenaires, privilégier l’aide aux projets concrets, visibles sur le terrain, et directement utiles aux hommes et aux femmes qui habitent dans les territoires que nous aidons ;
– doter notre diplomatie des outils et des moyens qui lui font aujourd’hui défaut pour contribuer efficacement au traitement bilatéral ou multilatéral des sorties de crise ;
– contrôler l’utilisation des fonds et évaluer les résultats atteints. » (258).
1) Pour une ambition mieux partagée
Le Livre blanc publié en 2008 a conclu la réflexion lancée par le ministre des affaires étrangères et européennes et a traduit certaines des préoccupations qui lui avaient été exprimées. Comme on l’a vu précédemment, les décisions prises par le CICID de 2009 ont ensuite mis en application ces directives : la concentration géographique et sectorielle de notre aide, facilitée par la RGPP, en résulte directement, et les moyens de notre aide tendent à se resserrer. Nonobstant, votre Rapporteure voit surtout dans cette énumération avant tout une feuille de route, plus qu’une véritable ambition. Il lui semblerait nécessaire d’inclure d’autres aspects pour que notre politique soit à la fois à la hauteur de son ambition et plus efficace.
En premier lieu, affirmer le fait que l’aide au développement est avant tout une politique, et qu’elle doit par conséquent répondre à une stratégie, qui sera la garantie de son efficacité. Dans cet ordre d’idées, on doit au contraire relever quelques signes contraires. On aurait pu espérer, par exemple, que le secrétaire d’Etat à la coopération ait l’importance de son collègue britannique depuis 1997, qui, à la tête du DFID, a rang de ministre de plein exercice au même titre que le secrétaire au Foreign Office. On peut aussi regretter que nul CICID n’ait été convoqué depuis un an et demi, contrairement à ce que prévoit le décret de 1998, alors même que, de la réunion du G8 de Muskoka à la préparation de la présidence du G20, en passant par le sommet des OMD de New York, l’agenda du développement pouvait difficilement être plus dense pour justifier que l’organe chargé de la définition des orientations, objectifs et modalités de notre coopération soit saisi. Pour ne pas mentionner l’approbation récente des documents stratégiques fondamentaux pour notre aide, qui a aussi malencontreusement échappé au CICID. Les motifs étaient surabondants pour assurer la coordination politique de nos options. En d’autres termes, la qualité remarquable du travail sur le terrain des acteurs français de la coopération, qui doit être ici soulignée, doit être mieux accompagnée au plan politique.
Au plan intérieur, une meilleure conduite politique serait d’autant plus opportune que les acteurs de l’aide dans notre pays sont en France excessivement éclatés, Bercy, le Quai d’Orsay et le ministère de l’immigration, pour ne prendre que ceux qui pilotent la mission interministérielle APD, développant chacun des logiques concurrentes qui nuisent évidemment à la lisibilité et à l’efficacité de notre action. Le diagramme ci-après, extrait du Document cadre, le traduit amplement. (259)
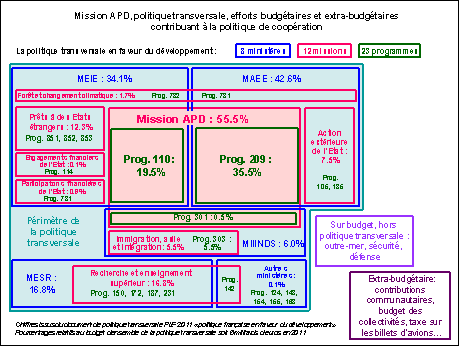
Au plan extérieur, surtout, cela paraît essentiel pour mettre plus nettement en évidence l’ambition de la France. Or, à l’heure actuelle, qui peut dire quelles sont les véritables priorités politiques de notre aide au développement ? Lutter contre la pauvreté ou contribuer aux Biens publics mondiaux, pour ne prendre que ces deux composantes ? Un dialogue politique de haut niveau est-il également ouvert avec nos partenaires africains pour connaître leurs attentes précises et nous donner les moyens d’y répondre ? Une conduite politique de notre aide doit donner force et efficacité à notre action, dans la mesure où le choix des instruments doit répondre à cette ambition et ne pas être le résultat des circonstances. Comme on a pu le faire remarquer (260), le basculement vers le multilatéralisme n’a jamais résulté d’un choix politique discuté et entériné.
Certes, dira-t-on, le niveau de financement de notre aide publique au développement au sein de la communauté internationale traduit clairement l’ambition forte des pouvoirs publics. Il n’est pas anodin pour un pays comme le nôtre, malgré les difficultés présentes, de continuer d’affirmer que la volonté d’atteindre l’objectif de 0,7 % du RNB ne faiblit pas, de vouloir exercer un rôle moteur dans la réflexion européenne et mondiale de la gouvernance du système ou sur les financements futurs de l’aide, et de revendiquer un rôle particulier au sein du système. Cela étant, aujourd’hui, ce leadership ne peut reposer sur les seuls financements. L’influence et la visibilité, tout comme l’efficacité de l’aide, sont fondées sur d’autres piliers. Il serait heureux que notre pays s’inspire des pratiques différentes de certains des plus importants bailleurs de fonds de l'APD mondiale.
Notre politique d’aide et de coopération au développement devrait affirmer qu’elle accorde la priorité à la lutte contre la pauvreté inscrite au fronton des OMD, tout en étant capable de répondre à d’autres objectifs de développement ; n’être plus seulement une affaire de spécialistes ou d’experts, mais bénéficier d’un soutien tant parlementaire que de la part de nos concitoyens, mieux informés ; être efficiente et disposer de budgets et d’instruments alloués pour contribuer effectivement à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés sur des priorités géographiques et sectorielles précisément définies ; répondre autant que faire se peut, au souhait légitime de visibilité que notre pays peut attendre en retour de son effort important et, enfin, participer, à sa mesure, à notre diplomatie.
Tels sont, rapidement esquissées, les caractéristiques qui pourraient être celles de la politique de coopération au développement de notre pays. A cette réserve près qu’il n’est pas inutile non plus de s’interroger sur le type de visibilité que l’on souhaite réellement retirer de notre action : celle, immédiate qui suit les annonces formulées lors des conférences internationales ; celle auprès des autorités politiques des pays partenaires, qui permet de prolonger l’action, ou enfin l’image que les populations bénéficiaires de l’aide eux-mêmes retirent de l’action de notre pays sur le terrain. Cette question n’est pas anodine et elle interpelle directement les pouvoirs publics et leurs stratégies, ainsi que le rapport entre bilatéralisme et multilatéralisme.
b) Donner toute sa place au Parlement
A l’heure actuelle, force est de constater que l’aide au développement de notre pays est assez éloignée de ces exigences. Le Parlement, en premier lieu, n’est malheureusement pas en France un lieu où se discute la politique d’aide au développement. A l’instar d’autres pans de notre politique étrangère, et à la différence de ce qui se passe chez nos principaux partenaires, aucun débat n’est jamais organisé sur l'APD, alors même que chacun en souligne l’importance et le rôle.
Les membres de votre Mission, unanimes, considèrent qu’il est plus que temps de donner au Parlement toute sa place en matière de coopération au développement. A ce jour, cette politique publique est sans doute l’une des rares sur laquelle, à aucun moment, la représentation n’a jamais à se prononcer.
Qui peut en effet se dire pleinement informé des objectifs et priorités de notre politique que le mémorandum de la France au CAD, présenté en 2008 en prévision de la revue des pairs, résumait ainsi : « les objectifs principaux de la politique française en faveur du développement visent à susciter la croissance, réduire la pauvreté et faciliter l’accès aux biens publics mondiaux, contribuant ainsi à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement à l’horizon 2015. Ces objectifs ont été déclinés en neuf secteurs sur lesquels la France concentre la plupart de ses moyens d’intervention : éducation, eau et assainissement, santé et lutte contre le sida, agriculture et sécurité alimentaire, développement des infrastructures en Afrique subsaharienne, protection de l’environnement et de la biodiversité, développement du secteur productif, gouvernance, enseignement supérieur et recherche (…). Enfin, la France doit pouvoir répondre aux situations de crise, quelle que soit leur nature (naturelle, militaire, politique, etc.) de la manière la plus efficace possible, en allouant rapidement des moyens humains et financiers adaptés aux besoins urgents des populations touchées (…). En dehors de la zone de solidarité prioritaire, la France accompagne les pays émergents dans leur transition en soutenant leur développement économique et humain. La coopération technique, culturelle, universitaire et scientifique y est la traduction de sa politique dédiée au renforcement de l’attractivité de son territoire. » (261). Ces stratégies, le niveau des financements à y consacrer, les instruments ou l’équilibre entre le multilatéralisme et le bilatéralisme ont-ils jamais fait l’objet d’un débat parlementaire ?
Pour l’essentiel, le regard parlementaire sur la politique d’aide au développement se limite au seul examen annuel des crédits de la mission « Aide publique au développement », laquelle ne comporte au demeurant que trois programmes sur les 23 qui, selon les documents budgétaires, concourent à la politique transversale, gérés par trois administrations, alors qu’au total une quinzaine sont concernées. Ainsi que notre collègue Henriette Martinez l’a souligné avec d’autres à plusieurs reprises ces dernières années dans ses avis budgétaires, cet état de fait affecte la lisibilité de la politique que notre pays conduit, dans un secteur au demeurant de plus en plus complexe. Mais en outre, cet unique moment où la représentation nationale pouvait se saisir de cette question, le vote du budget, a depuis ces dernières années considérablement perdu de son relief. Depuis que la procédure simplifiée d’examen du budget en commission élargie a été adoptée pour les crédits de l'APD, il n’y a, de facto, désormais plus d’espace de débat politique sur notre politique de coopération au développement. Cette procédure, qui limite l’examen de la politique à la stricte analyse de ses aspects comptables et financiers et implique qu’en séance publique un débat restreint est organisé auquel ne prennent part que le ministre, pour une brève intervention, ainsi qu’un orateur par groupe, pour une explication de vote de cinq minutes, est en ce sens, aux yeux de votre Rapporteure, des membres de votre Mission mais aussi d’autres députés, des plus regrettables.
Certes, dira-t-on, les choses changent : l’administration adresse désormais tous les ans un rapport au Parlement sur les activités de la Banque mondiale et l’intention a été réaffirmée d’améliorer encore l’information. Il en est de même de la consultation de la représentation nationale, qui a ainsi été invitée à se prononcer sur le projet de Document cadre ainsi que sur la stratégie vis-à-vis de la Banque mondiale récemment adoptée.
Si cela n’est pas niable, ces avancées restent encore très timides et subsiste un réel déficit démocratique. La stratégie pour la politique européenne, que votre Rapporteure présentera plus loin, n’a ainsi fait l’objet d’aucune communication au Parlement et il ne semble pas qu’il ait été envisagé que l’actualisation de la stratégie santé, dont l’approbation a été retardée au début de l’année 2011, fasse appel à la réflexion des élus. Qui, de même, peut dire qu’il a été invité à contribuer à la « stratégie française d’aide au commerce », dont on est heureux d’apprendre, au détour d’un paragraphe du Document cadre (262), qu’elle a été approuvée en 2009 ? Il aurait été opportun que la représentation nationale en soit au minimum avisée. Le Parlement reste toujours cruellement en manque d’informations précises et détaillées sur les orientations stratégiques de notre politique de coopération au développement. Dans un autre ordre d’idées, on peut également relever que les orientations données lors du dernier sommet franco-africain de Nice n’ont pas non plus fait l’objet d’une quelconque communication, alors même qu’une inflexion importante de notre politique y était prise en faveur du secteur privé. Sans contester ici la légitimité de ce choix, on peut estimer qu’il aurait pu au moins être présenté à la représentation nationale.
Dans l’intérêt même du gouvernement, il serait essentiel que le Parlement soit mieux informé et associé à la politique de coopération au développement et qu’il n’ait pas les moyens de la contrôler véritablement. L’ensemble des membres de la Mission d’information sont unanimes sur cette question. Il est urgent de s’inspirer des pratiques de nos pairs. Il est de l’intérêt même du gouvernement de rechercher auprès des représentants de la Nation l’assise et la légitimité d’une action mieux reconnue.
Les exemples étrangers sont nombreux en ce sens. Claude Lemieux, conseillère pour le développement à la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies à New York, avait ainsi indiqué à votre Mission (263) que la question de l’équilibre entre bilatéralisme et du multilatéralisme avait fait l’objet d’une discussion au Parlement fédéral, le gouvernement canadien, à son entrée en fonction, s’interrogeant sur le rôle que le pays devait jouer au sein des institutions multilatérales, et du système onusien notamment, sur lequel il avait quelques réserves. En 2007, le Sénat canadien avait de même procédé à une évaluation des activités de l’agence fédérale de coopération, l’ACDI, au terme de laquelle un bilan très négatif avait été dressé. C’est sur la base des critiques faites à la politique de l’agence, jugée inefficace, coûteuse et trop bureaucratique, qu’un recentrage sectoriel et géographique avait été décidé, de même qu’une évaluation des canaux de l’aide, notamment multilatéraux, après qu’une remise en cause de l’existence même de l’agence eut été envisagée par le Sénat. D’une manière générale, il apparaît que l’efficacité de l’ACDI reste un sujet de débats importants au Parlement canadien et ses choix stratégiques, notamment, sont au cœur des controverses, notamment quant au partage de ses actions entre pays d’Afrique francophone et anglophone, aspect sur lequel les parlementaires québécois semblent particulièrement attentifs.
En Norvège (264), le Livre blanc sur la politique internationale de développement est également soumis au Parlement, et constitue la base sur laquelle le gouvernement lui présente ensuite ses objectifs précis. Les orientations des principaux programmes d’aide sont débattues, de même que l’étendue géographique de la coopération norvégienne : c’est ainsi que le nombre de bénéficiaires a été réduit. Lorsque le Parlement n’a pas formellement à approuver d’orientations, ses membres sont néanmoins consultés, par exemple en ce qui concerne les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, CSLP, documents de partenariat négociés entre la Norvège et chacun des bénéficiaires de son aide.
Comment ne pas mentionner aussi l’exemple britannique ? Parmi les commissions permanentes de la Chambre des communes, la commission du développement international est non seulement chargée d’examiner les dépenses, l’administration et la politique du DFID et des organismes publics qui y sont liés, mais aussi de suivre les politiques et procédures des agences multilatérales et des ONG auxquelles le DFID apporte des contributions. La commission du développement international a été instituée en 1997, concomitamment à la création du DFID (265) et doté de moyens importants, notamment en personnel, sept administrateurs y étant actuellement affectés. Le fait qu’une loi sur le développement international (266) pose clairement les objectifs et modalités de la coopération au développement britannique a contribué à garantir l’effectivité du contrôle parlementaire. Consécutivement, les versions successives du Livre blanc, les stratégies géographiques et sectorielles du DFID, ou l’exécution de son budget ainsi que l’analyse de ses politiques, sont l’objet de contrôle précis et de nombreux et réguliers rapports. Enfin, la Chambre des Lords dispose d’un sous-comité des « affaires étrangères, de la défense et de la politique de développement » au sein de son comité des affaires européennes.
Votre Rapporteure plaide donc pour que l’étape du Document cadre soit rapidement dépassée et qu’une loi-cadre sur la politique de coopération au développement soit adoptée. Cette démarche est aussi partagée par nos collègues du Sénat qui l’ont évoquée dans un récent rapport d’information de la commission des affaires étrangères et de la défense. Il est à cet égard tout à fait symptomatique en effet que le Document cadre ne fasse à aucun moment mention du Parlement comme espace de débat des politiques de développement. |
Une volonté de transparence est cependant évoquée à diverses reprises au fil du Document cadre, mais elle s’adresse plus aux ONG et à la société civile qu’à la représentation nationale, qui apparaît surtout comme destinatrice d’une information gouvernementale spécifique : « A l’instar de la démarche mise en œuvre pour la préparation de ce document, les décideurs de la politique française de coopération entretiendront un dialogue régulier sur les priorités et les modalités de l’action de coopération internationale avec les représentants de la société civile et socioprofessionnels. Ils continueront à rendre compte au Parlement des résultats de l’action publique dans le cadre prévu par la LOLF, en intégrant les priorités définies par ce document cadre dans la programmation budgétaire, dans le document de politique transversale et dans les analyses de performance. Par ailleurs, un rapport sur les institutions financières internationales sera présenté tous les ans. En outre, les décideurs présenteront au Parlement, tous les deux ans, un rapport d’ensemble sur la mise en œuvre de la politique française de coopération au développement. Le premier rapport sera présenté en 2012. » (267).
Votre Rapporteure se félicite de la meilleure information qui sera désormais faite au Parlement, mais elle se doit de rappeler que, s’il est opportun que les représentants de la société civile et socioprofessionnels soient en contact avec les pouvoirs publics, c’est néanmoins prioritairement avec la représentation nationale que le « dialogue régulier sur les priorités et les modalités de l’action de coopération internationale » doit se faire.
Sans doute pourra-t-on objecter que l’accroissement du rôle du Parlement est l’affaire du Parlement lui-même qui doit prendre ses responsabilités. Néanmoins, chacun sait bien l’importance cruciale de l’environnement institutionnel : pour que le Parlement prenne toute sa place, il faut lui donner les moyens d’un contrôle réel. Avant cela, il faut aussi l’associer à la définition des stratégies, lui donner la possibilité de participer au dialogue entre toutes les parties prenantes, singulièrement dans un contexte de crise et de restructuration budgétaire.
Le Livre blanc avait rappelé en 2008, que « l’implication accrue du Parlement répond d’abord à un impératif démocratique. » (268). Au-delà du seul débat budgétaire, il avait appelé à un dialogue en matière de politique étrangère qui « participe de l’exigence d’expliquer à nos concitoyens, à travers leurs représentants, un monde complexe. Le Parlement doit être associé de manière plus étroite aux grandes décisions de politique étrangère ainsi qu’à leur mise en oeuvre. » (269). Partie prenante de la politique extérieure, l'APD doit être un des axes centraux de cette meilleure implication des députés et des sénateurs. Il est urgent de traduire cette volonté d’ouverture dans les faits.
c) Mieux coordonner la coopération décentralisée
Dans cet ordre d’idées, et bien que cela soit pour partie à la marge des préoccupations de cette réflexion, on ne peut omettre de mentionner l’importance de la coopération décentralisée que mène les collectivités territoriales de notre pays, qui financent leurs activités sur leurs fonds propres.
Des sommes considérables, et de plus en plus importantes, aujourd’hui estimées par le MAEE à quelque 75 M€ par an, sont engagées par les municipalités, les départements et régions de France. Or, il semble que la connaissance des priorités sectorielles et géographiques de cette coopération reste encore grandement parcellaire et que les collectivités territoriales continuent, pour l’essentiel, d’agir en matière d’aide au développement sans véritable concertation.
Certes, des efforts de coordination ont été entrepris, qui portent leurs fruits, grâce notamment au travail de la Commission nationale de la coopération décentralisée, CNCD, et qu’un meilleur dialogue se soit instauré avec l’Etat. Les politiques des collectivités territoriales sont aujourd’hui sans doute mieux connues, depuis l’instauration de la télédéclaration de leur APD.
Pour autant, un effort de synergie reste à faire pour mieux inscrire la coopération décentralisée, qui participe de notre effort bilatéral global d’aide au développement, dans un cadre politique plus coordonné, qui contribuera à atténuer la dispersion de notre aide et, consécutivement, à en améliorer l’impact et l’efficacité sur le terrain. La coopération décentralisée apporte une pierre utile qui doit être valorisée à sa juste mesure, d’autant que, au-delà des seules ressources qui y sont consacrées, elle est aussi un moyen appréciable de drainer des partenariats privés dont on ne saurait négliger l’importance.
d) Assurer une meilleure communication interne et externe
Il est tout autant essentiel que la politique de coopération au développement de notre pays soit aussi mieux connue et mieux présentée à nos concitoyens. L’insuffisance d’information est préjudiciable à la compréhension et au soutien d’une politique ; elle l’est d’autant plus que celle-ci a évolué de manière à n’être plus intelligible que des seuls spécialistes.
Cet aspect de la question est particulièrement crucial en matière d’APD, compte tenu des orientations qui sont données à notre politique. Votre Rapporteure a rappelé plus haut (270) que l’aide au développement avait longtemps été mue par des considérations qui n’avaient pas uniquement, ni même prioritairement, à voir avec les préoccupations de solidarité internationale. Globalement, la tendance est à l’heure actuelle au renforcement de cette orientation sécuritaire : la décision du Premier ministre britannique de créer un conseil national de sécurité dans lequel est représenté le DFID, celle du président Obama d’y inclure l'USAID, le montrent amplement.
Sans aller jusqu’à pousser les conséquences institutionnelles de sa réflexion à ce point, le Document cadre défend néanmoins des options proches, qui tendent à lier étroitement sécurité nationale et développement du Sud. La dimension purement solidaire, compassionnelle, n’est certes pas absente, comme on le verra, mais la lutte contre la pauvreté aurait néanmoins pu être placée plus nettement au tout premier rang des priorités, à l’instar de ce que l’on peut retrouver dans certaines législations, y compris au Royaume-Uni, où l’amélioration de la condition humaine est l’objectif fondamental.
Or, la comparaison internationale montre que c’est dans les pays où la politique d’aide au développement est la mieux connue qu’elle fait l’objet d’un plus grand consensus et d’un meilleur soutien de la part des citoyens. La situation budgétaire actuelle, qui impose les décisions douloureuses que l’on sait justifie qu’une politique qui ne bénéficie pas directement aux contribuables soit parfaitement explicitée. C’est la raison pour laquelle votre Rapporteure considère que la France devrait élever considérablement le niveau de sa communication sur l’aide au développement.
Jusqu’à récemment, le CAD constatait que la politique d’information gouvernementale était plus tournée vers la communication pour la visibilité des acteurs que vers la sensibilisation à la nécessité d’une politique de développement. Les moyens engagés sur ce poste restaient faibles également, par comparaison avec les pays voisins. Ainsi, le budget que les Pays-Bas consacraient en 2006 à l’information sur leur politique d’aide au développement était-il plus de six fois plus important à celui que la France engageait alors. La coopération belge consacrait le double. Quoiqu’il en soit, la France était en cela bien loin de la recommandation des conférences européennes pour la sensibilisation à la solidarité mondiale Nord-Sud de consacrer 3 % de l’aide à l’information. Le Consensus européen pour le développement avait aussi tracé un cadre pour l’éducation et la sensibilisation au développement qu’il était considéré comme opportun que la France mette à profit. Lors de son audition par votre Mission, Jean-Michel Severino estimait que cet aspect, délaissé chez nous, devrait être considéré comme une priorité, au même titre que la recherche et l’investissement dans le débat d’idées, compte tenu des effets secondaires que ces actions induisent, notamment quant à l’intérêt porté à l'APD dans la communauté nationale et à l’adhésion très forte suscitée dans la population comme le montrent les sondages. Il citait ainsi le cas de la Suède qui est l’un des très rares pays a avoir élevé son APD à 1 % de son RNB, grâce entre autres à une communication efficace du gouvernement qui contribué à rendre les opinions favorables, condition indispensable pour préserver les engagements internationaux et donc l’influence multilatérale. Dans une « Note du Jeudi » (271), la DGCID soulignait il y a quelques années le caractère remarquable de la politique du DFID en la matière qui « accorde à la communication une place de premier ordre. Tous les moyens sont convoqués pour promouvoir l'action du gouvernement en faveur des plus pauvres, en excipant de l'importance d'attiser la générosité nationale et internationale. L'impact de la récente parution du rapport de la Commission " Blair " pour l'Afrique, révèle l'efficacité de la stratégie de communication du Cabinet Office et du DFID. Celle-ci est d'autant plus percutante que les représentations britanniques bilatérales et multilatérales relaient systématiquement les positions défendues par le DFID, en s'appuyant le plus souvent sur des executive summaries et des non papers ad hoc. ».
Ces derniers temps, la politique de notre pays en la matière a justement commencé d’évoluer, sans doute encore trop modestement : en 2008, une campagne d’information et de sensibilisation aux thématiques de l’aide au développement et aux OMD, intitulée « Huit fois Oui ! » a été lancée par le secrétariat d’Etat et l’AFD. Un site Internet, une exposition itinérante, ont notamment servi de support. Le public concerné a surtout été celui des établissements scolaires et des collectivités locales, et selon le Document cadre, à ce jour, l’exposition a été proposée gratuitement à plus de 10 000 établissements scolaires – lycées, collèges et primaires –, de France métropolitaine et de l’étranger. Au total, plus d’un tiers des établissements l’ont commandée, ce qui témoigne d’un réel intérêt de la communauté pédagogique pour le sujet.
Selon le Document cadre, il est indispensable de mobiliser l’opinion publique « pour générer de nouvelles dynamiques favorables au développement. » Votre Rapporteure voit donc avec satisfaction la résolution annoncée selon laquelle « la France renforcera (…) la communication autour de la politique de coopération afin de sensibiliser les citoyens aux grands défis internationaux et de mieux rendre compte de la manière et de l’efficacité de sa politique de coopération. » C’est la condition non seulement d’une mobilisation de l’intérêt du public, d’une meilleure légitimation de notre politique de coopération au développement, en d’autres termes, un complément indispensable au renforcement du rôle du Parlement sur ce sujet.
Peut-être l’un des effets positifs en serait-il aussi une plus grande attractivité et un engagement des Français, qui aille au-delà de la seule générosité financière dont ils font preuve en cas de crise humanitaire : pour reprendre ici une réflexion que livrait Jacques Godfrain, président de France Volontaires, devant votre Mission (272), les Volontaires de progrès ne rassemblent en effet, en tout et pour tout, que 400 jeunes, qui soutiennent par conséquent difficilement la comparaison avec 20 000 volontaires du Peace Corps américain ou les quelque 18 000 à 20 000 volontaires allemands que mobilise la GTZ. Votre Rapporteure ne voit pas qu’il y ait des obstacles majeurs qui empêchent que notre pays réussisse à mobiliser ses jeunes en faveur du développement. Elle souhaite que cette question soit étudiée avec l’attention qu’elle mérite et que les moyens de renforcer le volontariat soient mis en œuvre.
Comme le disaient Jean-Michel Severino et Olivier Charnoz (273), dans un de leurs articles précités, « les questions du développement peuvent et devraient devenir politiques, au sens noble du terme. » Votre Rapporteure ne peut que partager ce sentiment et souhaiter qu’il en soit ainsi pour l’avenir de cette politique publique.
En complément de cette action de communication et de sensibilisation, il est tout aussi indispensable que le gouvernement fasse mieux connaître au plan extérieur, et tout particulièrement auprès des bénéficiaires et des populations elles-mêmes, l’action solidaire et l’engagement financier qui est le sien, que ce soit dans le cadre bilatéral ou via les organisations internationales auxquelles nous contribuons. La question du niveau de visibilité de notre aide auprès de nos partenaires du Sud doit être considérée comme un élément stratégique qui doit être partie prenante de notre politique de coopération au développement. A cet égard, il est indispensable que sur le terrain, les services des postes diplomatiques et de l'AFD définissent et mettent en œuvre des stratégies communes de communication. A l’heure actuelle, comme les membres de la Mission d’information ont pu le constater lors de leurs déplacements, la France ne met pas suffisamment en valeur ses réalisations. Il y a ici une forme de défaut d’appropriation de notre pays auquel il convient de remédier afin que l’on sache enfin rendre et visible et faire connaître ce que l’on fait en matière d’aide au développement. Il est essentiel que cette politique publique soit portée par une communication institutionnelle forte.
2) La réflexion stratégique de la France
Les recommandations de la revue des pairs en 2008 avaient invité la France à élaborer le cadre stratégique qui lui faisait défaut pour mieux clarifier les objectifs de sa politique d’aide, en assurer la cohérence et garantir la prévisibilité de ses engagements financiers. Notre pays devait ainsi réviser son approche stratégique de l’aide en tenant compte de sa valeur ajoutée dans le nouveau contexte international et de l’évolution de l’architecture de l’aide à laquelle il est partie prenante, ne serait-ce qu’au niveau européen dans le cadre de la division du travail instituée par le code de conduite. L’élaboration d’un plan d’action pour l’ensemble des stratégies sectorielles et transversales, conduisant à l’établissement de priorités reflétées dans la programmation budgétaire, de manière à pourvoir respecter ses engagements en termes de progression, était notamment considéré comme une des priorités sur lesquelles la France devait réfléchir. Selon l’analyse du CAD, c’est entre autres choses « l’absence d’une vision stratégique globale à moyen terme de l’aide multilatérale [qui] limite l’ampleur et l’impact des articulations avec le volet bilatéral de l’aide française et peut également conduire à une plus faible influence dans les organisations internationales. » (274).
Suivant ces conclusions, le CICID du 5 juin 2009 a lancé plusieurs chantiers qui, pour les principaux, sont d’ores et déjà achevés. Des documents importants ont été prévus, parmi lesquels, en premier lieu, un document cadre général, ainsi que d’autres : l’un vis-à-vis de la Banque mondiale ; une actualisation de la stratégie adoptée en 2007 pour le secteur santé, et un troisième relatif à la politique européenne de développement.
a) Le Document cadre français de coopération au développement
Le Document cadre de coopération au développement a été adopté le 15 octobre dernier. Il a pour ambition de définir les objectifs et la stratégie à moyen terme de la France et servir de référence unique pour guider les décisions et orienter les pratiques pour l’ensemble des acteurs de la coopération au développement, afin d’inscrire « la coopération française dans le processus de constitution progressive d’une politique européenne de développement reposant sur des objectifs communs » en veillant « à une meilleure articulation entre les canaux bilatéral, européen et multilatéral de notre aide (…) ».
Il faut tout d’abord souligner que ce Document vient à point nommé et saluer le remarquable travail qui a été accompli. Le Document cadre propose en premier lieu une lecture du monde contemporain et trace une perspective de long terme pour répondre aux enjeux que la mondialisation a introduits : la contribution à une croissance partagée et durable, principal moteur du développement ; la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, qui reprend les thématiques classiques de la solidarité, sur fond d’OMD encore loin d’être atteints, notamment dans les pays les plus pauvres d’Afrique subsaharienne ; la préservation des biens publics mondiaux est le troisième des enjeux que la mondialisation a imposés, dont l’universalité impose des approches innovantes dans les modes de financements et de gestion, qui annoncent l’émergence de politiques publiques globales ; la promotion de la stabilité et l’Etat de droit comme facteurs de développement, pour garantir la sécurité et faire face aux diverses catégories de risques qu’un pays comme le nôtre peut avoir à affronter (trafics, terrorisme, guerres civiles, etc.), est présenté comme le quatrième axe.
Le Document cadre aborde ensuite la question des outils de l’aide au développement de notre pays et distingue cinq volets : les financements, la mobilisation de tous types de ressources et l’amélioration de la cohérence des politiques de développement, pour faire face à l’ampleur des besoins à satisfaire ; le renforcement de la complémentarité entre actions bilatérales, européennes et multilatérales, tout aussi indispensable, dans une période de contrainte budgétaire, à l’heure où les acteurs de l’aide sont aussi de plus en plus nombreux. La gouvernance démocratique, la promotion des droits et des normes constituent le troisième volet sur lequel la France entend mettre en avant un soutien particulier. La composante culturelle de l’aide au développement fait l’objet d’un volet sur la production et l’échange des savoirs et des cultures, investissements essentiels et gages de pluralisme.
Dans une dernière partie intitulée « Des partenariats différenciés pour plus d’impact », le Document cadre reprend la géographie de l’aide française que le CICID avait définie en juin 2009, que votre Rapporteure a déjà mentionnés (275), et distingue quatre zones privilégiées : l’Afrique subsaharienne, avec laquelle nous devons avoir des relations de partenariat privilégié, axées sur le soutien à la croissance et à la réalisation des OMD ; le pourtour méditerranéen, dans les pays duquel nous devons travailler au soutien de la croissance créatrice d’emplois, à l’accompagnement des mutations sociales pour renforcer la cohésion et limiter tensions et conflits, ainsi qu’à la préservation de la Méditerranée. Trois groupes de pays sont identifiés : le Maghreb, le Proche-Orient et la Turquie et les Balkans avec lesquels cinq objectifs pratiques seront poursuivis : le développement harmonieux des territoires ; le développement humain et la coopération universitaire ; la modernisation du secteur productif ; la promotion du développement agricole et la gestion des ressources naturelles. Dans les pays de l’arc de crise, qui court de la Mauritanie à l’Asie centrale, il s’agit surtout pour la France de renforcer la stabilité par la prévention et les interventions coordonnées, thématique d’une particulière importance et qui, notamment, requiert une mobilisation coordonnée des volets civils et militaires en faveur des politiques de reconstruction. Vis-à-vis des pays émergents notre politique d’APD devra tendre à « coopérer pour la gestion des équilibres mondiaux », et faire face ensemble aux problématiques communes.
Le document insiste opportunément sur la nécessité de mettre cette politique en cohérence avec les autres documents de pilotage stratégiques de la coopération française : stratégies européenne et multilatérales, stratégies sectorielles, documents de partenariat, de cadrage budgétaires triennaux et documents préparés annuellement pour le projet de loi de finance.
A l’instar des commentaires que notre collègue Henriette Martinez a formulés dans son dernier avis budgétaire, votre Rapporteure regrette que l’élaboration du Document cadre n’ait pas constitué l’occasion d’une réflexion plus approfondie. S’il apporte d’utiles et intéressantes précisions aux décisions prises par le dernier CICID, on chercherait en vain l’articulation espérée entre les ambitions affichées et leurs traductions budgétaires ou financières. Le fait d’indiquer par exemple que « la France maintiendra ainsi une coopération bilatérale ambitieuse car celle-ci contribue à sa capacité de mieux comprendre ses partenaires par l’action partagée. Par la visibilité qu’elle lui procure, elle contribue à la fois à son image de marque auprès de ces pays et à l’appropriation de l’action de coopération par l’opinion publique française. » (276). est certes rassurant, mais ne révèle pas grand engagement. Alors même que chacun sait la question de l’équilibre entre les systèmes et financements bilatéraux et multilatéraux aujourd’hui cruciale, nulle allusion n’est faite, si ce n’est le rappel de leur complémentarité et de la valeur ajoutée de chacun. L’absence d’un quelconque lien, au demeurant, de cette réflexion stratégique avec les problématiques budgétaires, à l’heure où chacun s’interroge depuis plusieurs années sur la capacité de notre pays à respecter son engagement de consacrer 0,7 % de son RNB à l'APD, à l’heure aussi où plusieurs de nos voisins, malgré les mêmes difficultés, confirment résolument cet engagement en l’inscrivant dans la loi, est évidemment regrettable et laisse une impression d’occasion perdue.
N’aurait-il pas surtout été utile, à l’instar du Livre blanc par exemple, de définir de véritables orientations stratégiques à notre politique de coopération au développement en établissant l’ambition que la France entend donner à sa politique ? En d’autres termes, les précisions apportées par le Document cadre quant au ciblage géographique des moyens financiers bilatéraux (277) sont utiles mais elles ne touchent pas à l’essentiel. On peut tout autant regretter, pour ce qui concerne le cœur de la préoccupation de votre Mission d’information, que la réflexion du Document cadre sur le bilatéral et le multilatéral n’aille pas non plus au-delà du constat de leur complémentarité sans s’interroger de manière critique sur la question de leurs niveaux respectifs ni envisager que l’on puisse modifier la part de chacun dans l’architecture de notre aide.
Cela étant, c’est surtout le document stratégique vis-à-vis de la politique de coopération européenne qui retient l’attention.
b) La stratégie française pour la politique européenne de développement
Le deuxième document stratégique que l’administration vient d’élaborer porte sur notre contribution à la politique de développement de l’Union européenne. Comme le Document cadre, alors même que ces deux textes sont de la seule compétence du CICID (278) qui aurait évidemment dû les examiner et approuver, c’est finalement lors d’une simple réunion interministérielle le 15 octobre dernier à Matignon coordonnée par des collaborateurs du Premier ministre, qu’il a été adopté.
Votre Rapporteure regrette vivement que plus d’écho n’ait pas été donné à ce texte, tant lors de son élaboration, qui résulte d’un processus essentiellement interministériel, qu’en ce qui concerne son approbation : elle attache trop de prix à la construction européenne pour ne pas souligner toute l’importance d’un tel document qui inscrit résolument notre politique de coopération au développement dans le cadre qui doit être véritablement le sien, à un moment où l’entrée en application du Traité de Lisbonne ouvre de nouvelles et importantes opportunités.
Fort opportunément, l’analyse rappelle que « la France a fait le choix d’inscrire sa politique d’aide au développement dans un cadre européen et a toujours œuvré pour l’affirmation de cette compétence de l’Union. Le quart de son aide publique au développement transite par le canal européen et la Commission européenne met aujourd’hui en œuvre près de la moitié de ses dons programmables. » (279). L’ambition politique partagée par tous les Etats membres de faire de l’Union un acteur politique global sur la scène internationale justifie que la politique européenne de coopération au développement y participe : elle est en effet un instrument de projection de valeurs communes et d’influence dans le monde concurrentiel actuel.
La politique européenne de développement a déjà fait l’objet ces dernières années d’une réflexion poussée des Etats membres qui ont adopté plusieurs documents stratégiques, au premier rang desquels le consensus européen pour le développement, en 2005 et le code de conduite, en 2007, qui le met en œuvre. Pour autant, la réflexion sur la nature et les instruments de cette aide doit désormais aller plus loin, et prendre la mesure de la complexité du monde contemporain à laquelle elle doit s’adapter, en s’émancipant des fondements de l’histoire sur lesquels elle s’est bâtie. Il s’agit par conséquent, pour le document français, que l’Union européenne prenne aujourd’hui mieux en compte l’action des Etats membres en matière de coopération au développement, participe de façon plus active à la réflexion internationale sur l’élaboration de financements innovants et sache s’adapter aux enjeux de demain, autour des questions touchant à la régularisation de la mondialisation.
Le document assigne six objectifs à une politique européenne de coopération au développement rénovée. Votre Rapporteure souhaite les présenter ici, car ils lui semblent tracer, enfin, de remarquables perspectives, tant pour la coopération européenne que pour la nôtre.
Le premier entend faire de la politique de développement de l’Union européenne une composante à part entière de sa politique étrangère. Le dispositif institutionnel issu du Traité de Lisbonne permet en effet une unité de l’action extérieure de l’Union en mettant fin à la fragmentation des compétences qui prévalaient jusqu’à aujourd’hui. La politique de développement s’en trouve renforcée, et la mise en place du SEAE, Service européen d’action extérieure, apparaît comme l’opportunité du pilotage stratégique qui faisait jusqu’alors défaut et d’une meilleure coordination entre les politiques bilatérales de coopération des Etats membres et celle de la commission. Le document rappelle aussi l’attachement de la France à une approche équilibrée qui n’instrumentalise pas le développement et se félicite par conséquent que le Traité de Lisbonne ne subordonne pas la politique de développement à la politique extérieure de l’Union.
Sur cette base, fondamentale, le document stratégique propose que la politique européenne change de dimension. Le consensus européen pour le développement devrait à cet effet être actualisé pour mieux répondre aux enjeux contemporains et se décliner en stratégies plus détaillées. Surtout, il est temps que l’articulation entre les politiques des Etats membres et de la commission soit mieux assurée, sur la base d’une division du travail qui devrait être plus systématisée. Cela suppose que, de la programmation de l’aide aux modalités d’exécution et de financements, les avantages comparatifs des uns et des autres soient mieux identifiés pour éviter dispersion et concurrences inutiles.
Cela étant, la politique de coopération européenne au développement doit aussi s’adapter à la diversité croissante des pays partenaires et le document propose d’une certaine manière de transposer à la politique européenne le principe de différenciation géographique que la France a adopté en ce qui concerne les pays bénéficiaires, avec des effets comparables quant aux choix des modalités à mettre en œuvre, en terme d’instruments et de thématiques. La stratégie propose de renforcer la réponse de l’Union européenne, en mettant un accent particulier sur les thèmes de la sécurité alimentaire, du climat, des OMD ou de la gouvernance démocratique. Les thématiques liées à la sécurité ainsi qu’à l’intégration régionale devraient être privilégiées, compte tenu des avantages comparatifs de l’Union et de l’expérience acquise avec ses partenaires africains.
Surtout, un effort conséquent devrait être porté sur le renforcement de la cohérence des politiques publiques de l'Union, dont il faut rappeler qu’elle est le premier bailleur mondial d’aide au développement : politique commerciale et de développement n’ont pas toujours fait bon ménage ; politiques migratoires et de développement offrent désormais un terrain propice aux synergies ; politiques agricoles et de développement doivent évidemment être en harmonie pour contribuer à la sécurité alimentaire du Sud.
Selon votre Rapporteure, l’élaboration de ces documents est une étape déterminante et très positive qu’il convient de saluer comme elle le mérite. Elle considère qu’ils sont la base sans laquelle une véritable réorientation de notre politique d’aide au développement ne pourrait être conduite. Il importe désormais de prolonger l’effort et de les traduire dans les faits.
Il était essentiel de rédiger ces documents de stratégie dans la mesure où il est nécessaire d’avoir une claire vision de ce que l’on souhaite faire. Ces textes doivent être considérés comme la pierre angulaire sur laquelle doit s’articuler le débat, qu’elle appelle de ses vœux, sur la nature et les modalités de notre politique de coopération au développement, en termes de partenariats, de moyens, de communication, notamment, auquel devra participer la représentation nationale. Cette première étape était primordiale et devrait permettre désormais d’entreprendre une réflexion sur une meilleure adéquation de nos instruments aux objectifs assignés.
Loin d’être l’aboutissement d’un processus, il s’agit plutôt, selon votre Rapporteure, du point de départ de la réflexion et des réformes à entreprendre.
B – Renforcer la cohérence de nos politiques
L’incohérence des politiques concourrant au développement est probablement l’un des maux les plus dénoncés de la littérature sur l’aide. De multiples décisions ont été prises au plus haut niveau à ce sujet dans toutes les instances concernées, depuis plusieurs décennies. Dès les premières résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptées dans les années 1960 et 1970, la cohérence des politiques a été considérée comme essentielle à la réussite du développement et systématiquement reprise depuis lors par les diverses déclarations finales des sommets successifs. Après la Déclaration du millénaire qui y a fait référence, c’était le thème central de la Conférence de Rome sur l’harmonisation de l’aide en 2002, pour partie l’objet de celle de Monterrey qui avait souligné qu’il « fallait améliorer la compatibilité et la cohérence des politiques des pays donateurs afin d’accroître l’efficacité de l’aide publique au développement », ou encore de celle de Doha en 2008.
A la suite des travaux et recommandations de l’OCDE, la réflexion de l’Union européenne, surtout, est exemplaire en ce domaine, qui a conduit à l’adoption du Code de conduite et, en 2005, celle de la « Cohérence des politiques au service du développement », CPD, après que le Conseil européen eut confirmé l’engagement de l’Union européenne envers la réalisation des OMD. La cohérence des politiques en faveur du développement est considérée comme « un engagement politique clef dans le contexte des OMD ». Votre Rapporteure abordera l’état de cette question après avoir mis l’accent sur ce qu’il en est de nos propres politiques.
1) Mettre nos instruments de coopération en accord avec nos stratégies et objectifs
Les développements qui précèdent amènent à conclure sur un point qui devrait être prioritaire : s’il est important que notre pays réfléchisse comme il le fait à ses politiques d’aide, il est tout aussi impératif qu’il détermine également la nature de ses instruments de coopération. Il est essentiel de réussir à mettre en harmonie les priorités géographiques et sectorielles de notre coopération au développement avec les moyens dont on peut disposer et d’affiner nos stratégies en fonction de ceux-ci. Et non l’inverse, comme cela tend à être le cas. En ce sens, votre Rapporteure ne considère pas que les remarques formulées par le CAD en 2008 qu’elle rappelait plus haut (280) aient été réellement prises en compte.
En ce sens, le Document cadre peut apparaître comme une occasion manquée. En premier lieu, comme il a été précédemment indiqué, la question clef de la traduction budgétaire de notre engagement international d’atteindre un ratio de 0,7 % de notre RNB consacré à l'APD n’est à aucun moment abordée ce qui, compte tenu de ce qu’elle impliquerait, amène à conclure que le gouvernement, quoi qu’il en en dise, l’a, de facto, abandonné. Surtout, le rééquilibrage interne entre nos instruments financiers n’est pas non plus traité.
Ces lacunes sont graves aux yeux de votre Rapporteure : car sur un plan politique et d’image de notre pays, elles affectent durablement notre crédibilité internationale.
Certes, le Document cadre apporte une indication très importante quant à l’allocation géographique de notre APD, puisqu’il précise que « pour le triennum budgétaire 2011-2013, les cibles par partenariat différencié sont définies comme suit :
- Afrique subsaharienne : plus de 60 % de l’effort financier de l’Etat sur l’ensemble de la zone ; plus de 50 % des subventions sur les 14 pays pauvres prioritaires
- Méditerranée : 20 % de l’effort financier de l’Etat
- Pays en crise : 10 % des subventions (gestion des crises et post-crise, hors interventions relevant de la prévention)
- Pays émergents : au maximum 10 % de l’effort financier de l’Etat. » (281)
Ces précisions sont tout à fait bienvenues, dans la mesure où elles tendent à canaliser les ressources disponibles vers les priorités annoncées. Elles doivent être aussi mises en perspectives avec les autres indications données en parallèles. Celle selon laquelle « ces quatre partenariats différenciés fourniront une base d’arbitrage pour l’affectation des moyens bilatéraux consacrés par la France à sa politique de coopération au développement, ainsi que pour les positions de la France quant à l’orientation des instruments auxquels elle contribue aux niveaux européen et multilatéral. » (282). Celle, surtout, aux termes de laquelle « les quatorze pays pauvres prioritaires auront naturellement accès aux appuis destinés à soutenir le développement économique, notamment les infrastructures et le secteur privé. Toutefois, pour tenir compte des contraintes économiques et financières particulièrement élevées qui limitent leur possibilité de recourir aux marchés financiers, la France concentrera dans ces pays ses financements les plus concessionnels (subventions et prêts fortement bonifiés) destinés à promouvoir l’accès de leurs populations pauvres aux services essentiels et à améliorer le statut des femmes. (…). Au total, pour le triennum budgétaire 2011-2013, les 14 pays pauvres prioritaires recevront au moins 50 % des subventions bilatérales françaises ». (283)
Pour autant, peut-on regretter, ces orientations ne remettent en cause rien de ce qui fait aujourd’hui la faiblesse principale de l’aide de la France et sa singularité par rapport à ses principaux partenaires : le fait que la part des subventions dans son effort global d’aide est extrêmement réduite. A aucun moment, il n’est fait état d’une quelconque tentative de rééquilibrage de nos instruments en faveur des subventions, lesquelles demeurent trop faibles. Si l’on en croît les documents du PLF 2011, ce sont l’an prochain quelque 312 M€ qui seront consacrés aux dons projets du FSP, de l'AFD et des ONG, sans que l’on sache encore aujourd’hui quelle sera la répartition entre chacun de ces destinataires, les arbitrages n’ayant pas encore été rendus. Si cette enveloppe globale est légèrement en progression par rapport à l’an dernier, où 289 M€ avaient été prévus, ce dont il convient de se féliciter, il n’en reste pas moins que le déséquilibre est toujours flagrant avec les autres instruments. Un rapide calcul montre ainsi que les 14 pays pauvres prioritaires auront par conséquent à se partager 156M€, peut-être un peu plus, et que chacun recevra une aide projet moyenne d’un peu plus de 11M€.
Comme on l’a indiqué au long de ces pages, on ne peut dire que la France se donne réellement les moyens de sa politique. En l’état actuel, ils ne peuvent être considérés comme cohérents avec les objectifs assignés à notre politique d’aide au développement, et la structure de nos modalités de financements doit être revue en profondeur.
Au risque d’être vue comme sévère, votre Rapporteure conclura en disant qu’il importe désormais de ne plus se payer de mots : votre Mission a constaté lors de ses déplacements, notamment en Tunisie, que le fait que la France soit présente est perçu comme une excellente chose mais, que, en même temps, dans le monde globalisé et concurrentiel d’aujourd’hui, on ne nous attend plus. Nous sommes jugés sur pièce et sur acte. Il y a donc urgence, sauf à y perdre encore, en influence, en parts de marché, en image, à savoir être à la hauteur à laquelle on attend que la France soit.
2) Améliorer la cohérence intrasectorielle : l’exemple de la santé
Les considérations développées ci-dessus méritent d’être appréciées sous un angle particulier pour illustrer les effets des choix.
a) La structure de nos financements…
Le choix du secteur de la santé comme illustration semble particulièrement pertinent ici compte tenu de l’accent que le CICID de juin 2009 y a mis, en précisant que la question de l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme serait importante (284). Ce secteur est représentatif des problématiques qui intéressent votre Mission, voire de certaines incohérences qui marquent les politiques sectorielles que notre APD met en œuvre et par conséquent, de ses faiblesses, par comparaison avec celles que mettent en œuvre nos principaux partenaires, ainsi qu’on y a déjà fait allusion.
Il convient de souligner en premier lieu que c’est très récemment que la France a fortement augmenté ses contributions au secteur de la santé, marquant ainsi sa volonté politique de produire un effort comparable à celui de ses pairs. Ce qui n’était pas le cas auparavant puisque, au tournant du siècle, et même après, la France était en effet très en retard, de telle sorte que notre collègue Pierre Morange, dans son rapport au Premier ministre remis en juin 2005, pouvait écrire : « si les objectifs de la stratégie sectorielle de la DGCID/MAE, élaborée en 1999 en amont de la Déclaration du Millénaire, sont globalement en cohérence avec celle-ci, les résultats tels qu’ils sont présentés par le Groupe sectoriel santé au CICID en juillet 2004, ne reflètent pas l’engagement verbal de la France. La France consacre 4 % de son APD au secteur de la santé quand la moyenne des pays de l’OCDE y consacre 11 %. » (285).
Depuis lors, la situation a changé et la part de la santé dans notre APD totale a connu une progression considérable en très peu de temps : les données officielles divergent d’ailleurs à cet égard, puisque si le Document cadre indique que « Le secteur de l’éducation représentait 17 % de l’APD totale nette française, la santé 10 %, l’agriculture et la sécurité alimentaire 7 %, le développement durable 9 %, et le soutien à la croissance 13 % » (286), pour le PLF pour 2011, ce sont en fait 13,22 % de notre APD totale, hors annulation de dettes, qui y seront désormais consacrés, quand d’autres sources font état de 9,5 %.
Cette évolution s’est accompagnée, au contraire de ce qui était préconisé, d’une réduction drastique de nos moyens bilatéraux. Dans le même temps, en effet, « la réduction du nombre des assistants techniques sur la période 1990-2004 a contribué à cette perte considérable de savoirs et de savoir-faire en santé publique que Paris aurait pu exploiter au profit de la définition de politiques internationales. » (287). Bien différente, soulignait-il, est la politique suivie par les coopérations belge, allemande ou britannique, qui toutes, ont su développer des stratégies fortes vis-à-vis des organisations multilatérales, tant pour le bénéfice des pays récipiendaires que du leur propre. Votre Rapporteure souhaite à son tour mettre une nouvelle fois en garde contre ce désengagement vis-à-vis des institutions du système onusien qui nous est d’ores et déjà préjudiciable.
On sait que la situation sur cet ensemble de questions comme sur d’autres ne s’est depuis lors pas inversée, loin s’en faut. Elle se traduit par quelques incohérences. A titre d’illustration, la question de la part croissante faite aux prêts sur les subventions du FSP ou attribuées par l'AFD, est ici remarquable : la priorité affichée pour la santé est en effet très loin de se refléter dans les engagements de crédits de subvention sur les dernières années, comme en témoignent les données communiquées par le MAEE, dont il ressort que, au titre du FSP, la France ne consacrait ainsi qu’un très modeste 3,4 % du total de ses crédits de subventions en 2008, soit 3M€. Si ce pourcentage en faveur de la santé a augmenté en 2009, pour atteindre 5,86 %, ce n’est que parce que l’enveloppe globale du FSP a diminué, et le secteur n’a plus reçu que 2M€, prélude à sa disparition totale en 2010, aucun crédit de subvention n’ayant été versé au cours des six premiers mois de l’année. Votre Rapporteure ne peut que partager ce que Dov Zerah indiquait à ce sujet à votre Mission : « Pour les secteurs santé et éducation la limitation ressources doit conduire à la concentration des subventions sur ces deux secteurs, corrélativement à la concentration géographique. » (288). A l’évidence, nous en sommes cependant de plus en plus éloignés.
b) … traduit une cohérence surtout politique
Ces aspects rappelés, on peut encore s’interroger sur les choix et arbitrages que notre pays a effectués. Si nos financements dans le secteur de la santé sont essentiellement multilatéraux, ils sont aussi très fortement dirigés vers un bénéficiaire principal qui reçoit des crédits fort importants, le Fonds mondial de lutte contre le sida.
Comme le faisait à juste titre remarquer Christian Masset (289), le projet du Fonds mondial a été porté par la France. Le Président Jacques Chirac et le ministre Bernard Kouchner l’ont souhaité, afin de pouvoir délivrer des antiviraux dans les pays à faible revenu, dont les populations, auparavant, n’y avaient généralement pas accès : seuls 300 000 malades pouvaient en bénéficier en 2001. Il ne faut pas oublier ce point essentiel, et il serait évidemment mal interprété que notre pays paraisse s’en dégager aujourd’hui alors même que c’est le succès du Fonds qui a permis que plus de 3 millions de malades soient aujourd’hui soignés grâce à ces moyens thérapeutiques, dont 2,5 millions sont financés par le FMSTP, et cela doit être rappelé comme il se doit. Rétrospectivement, il se confirme ainsi qu’il était donc de bonne stratégie, au lancement des opérations, de porter un effort soutenu sur cette action, notamment vis-à-vis des Etats-Unis.
Néanmoins, s’interrogeait aussi le directeur général de la mondialisation, parmi d’autres des interlocuteurs de votre Mission, maintenir aujourd’hui ce deuxième rang mondial des financeurs est d’un coût très lourd et l’on peut se demander si un rééquilibrage de nos financements ne serait pas pertinent. Cette question se pose d’autant plus que les moyens sont aujourd’hui limités. Elle se pose aussi car d’autres pathologies, qui sont les premières causes de mortalité infantile, notamment la pneumonie et la diarrhée, responsables à elles deux de plus du tiers, 36 %, des décès des enfants de moins de cinq ans, appelleraient un effort particulier. Il n’est pas indifférent ici de rappeler que le sommet de New York de septembre dernier a souligné que, au rythme actuel des efforts internationaux, l’OMD 4, qui entend réduire des deux tiers entre 1990 et 2015 la mortalité des enfants de moins de cinq ans, serait difficile à atteindre compte tenu notamment de la situation prévalente dans les pays d’Afrique subsaharienne, où la mortalité due à ces maladies reste encore très élevée. Combinées à un certain nombre de pathologies néonatales, se sont au total près des deux tiers des cas de mortalité infantile qui sont dus à trois types de pathologies, loin devant le paludisme ou le VIH-sida (290).
Même si des engagements importants ont été pris à Muskoka l’été dernier, qui se traduisent pour la France par une contribution de 100 M€ par an sur les OMD 4 et 5 d’ici à 2015, d’autres choix que celui d’augmenter de 20 % notre contribution au Fonds mondial auraient sans doute pu être considérés comme plus opportuns dans une logique d’efficacité sectorielle et dans un souci de cohérence avec nos propres engagements internationaux, d’autant que pneumonies et diarrhées sont parmi les pathologies qui peuvent être efficacement traitées sur le terrain par les moyens mis en œuvre par la coopération bilatérale.
Cet exemple n’en est qu’un parmi d’autres contradictions qui au final, peuvent affecter notre crédibilité internationale. Certes, on ne saurait dire que la France n’est pas particulièrement consciente de la nécessité de cohérence en matière d’APD, tant au niveau de ses propres politiques que de celles qui sont conduites dans des cadres plus élargis. Le document de politique transversale qui accompagne le PLF souligne ainsi chaque année que « de nombreuses autres politiques publiques exercent des effets importants sur les pays en développement. L’efficacité de la politique française d’APD dépend donc en particulier de la cohérence entre ces différentes politiques (commerce, environnement, transport, énergie, recherche, sécurité, etc.) ». Il précise aussi que cette mise en cohérence des différentes politiques publiques en faveur du développement s’inscrit aussi dans le cadre européen auquel elle participe et souligne les travaux qui sont menés dans ce cadre, notamment en ce qui concerne le commerce auquel elle attache une importance particulière.
Il est aussi important de rappeler avant de conclure que l’attention des membres de votre Mission a été attirée, au gré de leurs déplacements, sur quelques aspects qui appelleraient à une réflexion. La question de nos politiques migratoire, notamment, ou d’accueil des étudiants, leur a ainsi ouvertement été présentée comme étant en contradiction avec le discours et, consécutivement, comme fragilisant nos positions. Il est opportun d’y remédier.
C – Les instruments d’une ambition
Le chemin de la réévaluation de notre politique de coopération au développement passe aussi plus spécifiquement par ses instruments. Estimant que c’est du débat sur les objectifs que devrait ressortir la détermination des modalités de l’aide, la Mission entend y contribuer en présentant ici quelques pistes de réflexion. L’analyse comparée des pratiques des principaux bailleurs en la matière apportera un éclairage utile.
1) Faire le deuil d’un certain bilatéralisme sans oublier de retrouver de nouvelles marges de manoeuvre
a) La voie étroite du rééquilibrage
Que l’on ne puisse probablement pas, le voudrait-on, revenir au bilatéralisme d’hier n’exonère pas d’un effort en faveur de financements plus équilibrés.
Qu’on s’en réjouisse ou qu’on s’en désole, le temps où notre politique d’aide au développement passait essentiellement par des canaux bilatéraux est révolu. Celui de l’assistance technique, notamment, qui assurait une bonne part de notre politique de coopération au développement, et permettait tout à la fois influence et visibilité, est terminé. Des quelque 23 000 assistants techniques encore en poste au début des années 1980, il ne reste aujourd'hui qu’un peu plus d’un millier, dont 220 volontaires internationaux. Ils constituaient autrefois les véritables structures des administrations nationales des pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, un grand nombre d’entre eux sont affectés dans des organisations internationales ou en Europe, et travaillent sur des enjeux qui ne sont plus strictement liés au développement de l’Afrique mais plus à la globalisation. On ne dira jamais assez combien cette présence dans les institutions internationales est essentielle et avec quelle attention elle doit être conduite.
On peut certes considérer, comme le faisait devant votre Mission Jacques Godfrain (291) que cette baisse « est une catastrophe », dans la mesure où il est désormais des régions africaines où il n’y en a plus, comme à Bobo-Dioulasso que l’ancien ministre de la coopération citait en exemple. Cela étant, un retour en arrière serait-il souhaité que l’on voit mal comment ce serait aujourd'hui envisageable, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires, RGPP oblige : nous n’avons plus les moyens de ce type de coopération-là. Surtout, la relation avec les pays en développement n’a-t-elle pas si considérablement évolué que cette coopération de substitution, qui, de l’avis de votre Rapporteure, a été opportunément supprimée, ne pourrait plus aujourd’hui être de mise dans le cadre des partenariats réels, désormais seuls acceptables, et acceptés, par les pays bénéficiaires. Reste, cela étant, que notre coopération technique bilatérale est de grande qualité et qu’il ne saurait être question d’y renoncer, tout au contraire. A cet égard, des instruments tels que l’ADETEF pourraient vraisemblablement être répliqués dans d’autres secteurs que financiers, qui permettraient de mobiliser sans doute plus aisément une expertise française, notamment en matière de coopération sanitaire ou éducative.
Cela étant, certaines des considérations que votre Rapporteure a analysées au long de son étude ont un impact fort sur le positionnement du curseur entre bilatéralisme et multilatéralisme qu’il n’est pas inutile de rappeler dans la perspective qui est la nôtre. Sur la voie du multilatéralisme prise par la France, plus que par d’autres pays dont l’effort global en faveur de l’aide est comparable, des « effets de cliquet » jouent fortement, qui laissent à penser que le retour en arrière vers un meilleur équilibre entre les deux modalités apparaît difficilement envisageable.
En effet, comme on l’a montré, les objectifs et les mécanismes d’attribution et de gestion de l’aide au développement qui prévalent aujourd’hui conduisent mécaniquement à plus de multilatéralisme.
En premier lieu, on ne rappellera jamais assez que l’architecture de l’aide a très profondément évolué. L’aide est aujourd’hui collective plus qu’individuelle. Elle est devenue plus complexe, inextricable même, ne serait-ce que parce que le nombre des acteurs a explosé. Ainsi que votre Rapporteure l’indiquait (292), ce sont désormais des centaines d’organisations internationales et régionales, de fondations privées, d’ONG, d’agences bilatérales de coopération, parfois au demeurant, de pays du Sud encore aujourd'hui récipiendaires d’aide internationale – cf. la Tunisie, dont les experts mettent en œuvre en Afrique subsaharienne des projets financés par l’AFD, dans le cadre de partenariats bilatéraux –, qui entendent jouer un rôle sur la scène de l’aide. De multiples intervenants de toute nature ont donc émergé ces dernières décennies, voire même ces toutes dernières années, avec lesquels, qu’on le veuille ou non, on doit nécessairement composer, et trouver un modus vivendi. Nul ne peut plus intervenir seul et ignorer le système multilatéral. Nul ne peut désormais intervenir sans tenir compte de l’environnement institutionnel et de l’offre parallèle à la sienne qui est désormais proposée, à des coûts parfois inférieurs, sur le marché fortement concurrentiel de l’aide internationale.
Principe de réalité oblige, il est aujourd'hui indispensable de rechercher des coopérations, des partenariats, des synergies et de s’inscrire dans une division du travail entre bailleurs, qui participe du multilatéralisme, complémentaire du bilatéralisme. En ce sens, les décisions prises par le CICID de juin 2009, les orientations prises par le Document cadre et le Document de stratégie européenne ne peuvent qu’être saluées.
L’architecture de l’aide est devenue plus complexe aussi avec l’évolution des thématiques qui intéressent le développement, lesquelles n’ont plus uniquement à voir avec les seuls aspects de la lutte contre la pauvreté et de la réduction des inégalités. Si ces aspects n’ont bien sûr pas disparu et continuent de constituer le socle sur lequel fonder la solidarité internationale, les enjeux contemporains ont pris une place désormais essentielle, comme il a également été rappelé. Liées à la globalisation, de nature transversale, elles supposent évidemment une gestion collective, associant les parties prenantes, institutions internationales, Etats et organisations de la société civile, qui contribue aussi à son niveau au renforcement du multilatéralisme. Il suffit de rappeler que les enjeux climatiques, actuels et futurs, touchent la réduction des émissions de carbone comme la gestion des forêts, l’industrialisation des pays du Sud et leur mode de croissance comme les phénomènes migratoires, la désertification ou la gestion des conflits, pour s’en convaincre. De même en est-il de la lutte contre les grandes pandémies modernes, VIH/sida en premier lieu.
En conséquence de quoi, la question des financements, à son tour, ne peut que s’inscrire dans cette même logique qui contribue au renforcement du multilatéralisme. Un pays seul, fut-il parmi les principaux bailleurs mondiaux comme le nôtre, ne peut plus en effet désormais, et depuis longtemps, agir seul. L’importance des besoins de financements est en effet aujourd'hui telle que, tout aussi mécaniquement, ce sont surtout des solutions multilatérales qui devront être trouvées pour y faire face. Votre Rapporteure a rappelé plus haut (293) les estimations les plus couramment admises concernant les seuls besoins exigés pour contenir le réchauffement climatique. C’est tout le sens de la réflexion internationale sur les financements innovants, à laquelle notre pays attache l’importance que l’on sait et sur laquelle il joue un rôle déterminant. Ici aussi, qu’on le veuille ou non, quelles qu’elles soient, les solutions innovantes de financements – actuelles taxe de solidarité sur les billets d’avion, IFFim, ou future taxe internationale sur les transactions financières et autres –, passeront inévitablement par plus de multilatéralisme.
Toutes choses égales, c’est précisément ce que les Etats, rejoints en cela par les organisations de la société civile et les institutions internationales, promeuvent aujourd'hui, et avec raison. Le fait que le G8 et le G20 se soient saisis de manière croissante ces dernières années, des thématiques touchant au développement, traduit le fait que leur gestion ne peut désormais s’inscrire que dans des contextes multilatéraux. A cet égard, la position de la France vis-à-vis du G8 et du G20 est sans ambiguïté : avant même les propositions formulées par le Président de la République quant à l’agenda de la présidence des deux groupes pour 2011 qui sont d’une importance majeure, il ne faut pas oublier que c’est sous l’impulsion de la France que le rôle du G20 a été redéfini à l’occasion de la crise financière. A cette occasion, notre pays a clairement confirmé son choix du multilatéralisme et comme le faisait remarquer Rémy Rioux, sous-directeur des affaires financières internationales et du développement à la Direction générale du Trésor lors de son audition devant votre Mission (294), cette option a permis d’obtenir des résultats conséquents, dont le moindre n’est pas la mobilisation de ressources importantes, y compris en faveur des pays pauvres. Ce sont des résultats qui n’ont pu être atteints que par le renforcement des institutions financières internationales auxquelles nous participons, au plan des ressources financières, des actions mises en œuvre, de la réforme de leur gouvernance, de la représentation des pays, et tout particulièrement de l’Afrique.
En conséquence il importe de ne pas se tromper et de ne pas tenter de mener un combat d’arrière-garde dans les problématiques qui intéressent la Mission d’information : il ne saurait s’agir de remettre le curseur loin en arrière en faveur d’un bilatéralisme daté, voire suranné, démarche qui serait vouée à l’échec certain.
Enfin, last but not least, on ne peut laisser hors de cette réflexion le fait que notre politique de coopération au développement s’inscrit résolument et à juste titre dans le processus de construction européenne. La France a œuvré dans le passé, et plus que tout autre sans doute, à l’émergence d’une politique européenne de coopération au développement qui est devenue aujourd'hui la plus importante du monde. Il serait pour le moins paradoxal que, par un réflexe frileux, pour des raisons tenant à un déficit d’image, à une difficulté à se faire entendre ou reconnaître la part qu’elle joue, la France choisisse aujourd'hui d’adopter une attitude en rupture avec ce qu’elle a de tout temps prôné.
Tout au contraire, le récent document de stratégie vis-à-vis de la politique européenne de coopération montre-t-il que notre pays entend tirer profit, non seulement pour lui-même mais pour la politique européenne de développement aussi, de toutes les opportunités offertes par le Traité de Lisbonne. Votre Rapporteure l’a montré et elle s’en félicite. Une certaine cohérence exige que le rééquilibrage entre nos efforts bilatéraux et multilatéraux en tienne le plus grand compte.
b) Nos principaux partenaires nous montrent le chemin
Cela étant dit, les aspects que votre Rapporteure vient de rappeler ne constituent pas non plus l’alpha et l’oméga de toute politique desquels il serait impossible de s’affranchir. Si elles la rendent plus difficile, l’évolution de l’environnement global de l’aide au développement et la mondialisation n’empêchent pas de continuer, si on le souhaite, de mener une politique bilatérale forte. L’ensemble des pays donateurs du CAD est là pour prouver en effet que cela reste possible et confirmer, par le fait même, que la situation particulière dans laquelle se trouve notre politique résulte avant tout de nos propres choix.
Il n’est pas inutile à cet égard de rappeler quelques chiffres. Sans revenir ici sur le débat qu’avait lancé notre collègue Henriette Martinez sur le positionnement exact du curseur entre multilatéralisme et bilatéralisme, fort différent selon que l’on parle d’APD brute, nette ou programmable, un simple regard sur les données statistiques du CAD montre que la France, parmi les principaux donateurs, est en effet de ceux qui ont l’effort en faveur du multilatéralisme le plus marqué. Des quelques pays qui figurent dans le tableau récapitulatif ci-dessous, construit sur la base du rapport 2010 du CAD, publié en avril dernier, il apparaît que la part de ses financements que la France consacre au bilatéral est en effet parmi les plus faibles, puisque, en 2008, seule la Belgique était à un taux légèrement inférieur à celui de la France. Tous les autres pays agissaient bien plus via des financements bilatéraux que multilatéraux.
Plus récemment, dans les conclusions qu’il tirait de sa revue à mi-parcours réalisée en septembre dernier, Eckhard Deutscher, président du CAD, estimait que la France avait raison de se considérer comme un important contributeur de l’aide européenne et multilatérale, dans la mesure où en 2009, 45 % de son APD nette était constituée par l’aide multilatérale, la moyenne du CAD n’étant que de 30 %.
Allemagne |
Belgique |
Canada |
Danemark |
Espagne |
Etats-Unis |
Norvège |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |
Suède |
Total membres du CAD |
France |
En d’autres termes, d’autres choix restent à l’évidence possibles, malgré les tendances lourdes et l’environnement contemporain que l’on a constatés, qui justifient que l’on explore toutes les pistes pour se rapprocher du niveau moyen de nos partenaires.
Parmi les voies qui nous permettraient de retrouver les marges qui nous font aujourd’hui défaut, la question du recentrage de nos contributions au système multilatéral est une piste fréquemment évoquée. On sait que cette orientation a été prise par la RGPP et que la concentration de nos contributions sur un petit nombre d’institutions internationales est désormais effective : si les contributions françaises éligibles à l’APD concernaient 68 organisations ou fonds spécialisés en 2009, elles se sont en fait très concentrées sur quelques acteurs, les six premiers instruments bénéficiaires recevant environ 91 % du total de l’aide multilatérale et les dix premiers, 94 % du total. La concentration recherchée a donc commencé de produire ses effets. Ce meilleur ciblage de nos contributions multilatérales doit aussi être accompagné d’une meilleure sélection de notre bilatéral. Dans le même esprit, sans doute des possibilités de mutualisation avec nos principaux partenaires sont-elles probablement envisageables, auxquelles il conviendrait aussi de réfléchir, soit en terme de représentation, soit de financements, qui ouvriraient la porte à d’utiles réductions de coûts.
Cela étant, votre Rapporteure, en accord avec l’ensemble des membres de la Mission d’information, ne saurait conclure ces développements sans inviter instamment le gouvernement à s’engager sur une réévaluation de notre APD bilatérale programmable.
Votre Rapporteure défendra plus loin la budgétisation du FED qui permettrait de diminuer considérablement l’enveloppe de notre contribution européenne, pour un montant qu’elle estime à 135M€. Pour opportune que soit la marge de manœuvre qui serait ainsi recouvrée, qui donnerait la possibilité, moyennant sanctuarisation des fonds concernés, d’augmenter nos moyens bilatéraux programmables, elle reste insuffisante. De son côté, le PLF pour 2011 confirme certes l’amélioration engagée sur ce plan par rapport aux deux années précédentes, puisque près de 312M€ ont été prévus, mais votre Rapporteure a montré plus haut (295) que cela ne permettra qu’un soutien fort modeste aux 14 pays pauvres prioritaires de notre coopération, qui bénéficieront de dons pour un montant moyen de 11M€.
Les membres de la Mission considèrent par conséquent qu’il importe, au vu de l’ensemble des éléments exposés au long de cette analyse, de s’engager sur une véritable réévaluation de nos subventions bilatérales programmables pour les porter à un niveau comparable à celui que nos principaux partenaires y consacrent.
Votre Mission est consciente que ce changement ne peut se faire sur le très court terme, compte notamment tenu des engagements pluriannuels déjà pris, mais préconise néanmoins que tout soit fait pour que, dans un délai de cinq ans, les financements de ce poste aient doublé.
Si, par rapport à la structure des financements de nos principaux partenaires, les moyens que la France consacrera alors aux subventions dans son effort global d’APD pourront toujours être considérés comme modestes, ils soutiendront néanmoins mieux la comparaison et permettront d’atténuer le déséquilibre et la faiblesse de notre aide, ce que chacun appelle de ses vœux.
2) Saisir l’opportunité européenne
Le récent document stratégique marque sans doute une première étape clef sur laquelle fonder la rénovation de notre politique. Cela semble d’autant plus opportun que l’horizon immédiat paraît ouvrir de nouvelles et intéressantes perspectives européennes qui pourraient contribuer à rompre avec les pratiques encore fréquentes.
a) La question du cadre européen de notre coopération au développement : une démarche essentielle
Le fait pour la France d’avoir une idée plus claire de ce qu’elle veut est indubitablement la condition de son influence, notamment sur Bruxelles. Ce point est une évidence pour Hubert Védrine (296), par exemple, qui insistait, on l’a vu, sur l’importance d’avoir une pensée politique forte et continue. Cela, d’autant plus que le rôle et le poids de la Commission européenne sont conséquents, eu égard à ses moyens financiers et au fait qu’elle se comporte souvent comme un 28e Etat membre. Les commissaires veillant tout autant aux intérêts de leurs pays qu’à celui de l’Union, loin de l’esprit et de la lettre des textes, la Commission n’étant pas toujours au-dessus des intérêts, la compétition avec les Etats membres ne poserait pas de problème, ajoutait-il, si l’on avait une vision précise de nos objectifs en matière d’Aide publique au développement, et les moyens pour réussir à les imposer. Faute de quoi, ou de réelle implication des Etats membres, la Commission domine avec la vision de ses services. Le sentiment que la Commission agisse ainsi est d’ailleurs vécu de cette manière en interne par certains de ses hauts responsables. Koos Richelle, directeur général d’EUROPAID (297), disait sans détour à votre Mission que « d’une certaine manière, on est le 28e Etat membre, avec une plus grande visibilité : on est présent dans 140 pays, les Etats membres ne le sont que dans un nombre plus petit, et ils laissent à la Commission le soin d’intervenir. Parfois la Commission est même le seul bailleur présent », poussée au demeurant en cela par le Parlement européen, qui oblige à être présent partout, par les ONG et les Etats membres eux-mêmes.
Stefano Manservisi (298), directeur général du développement et des relations avec les pays ACP à la Commission européenne, en revanche, se refusait à voir dans l’action de la Commission celle d’un 28e Etat membre et soulignait la forte spécificité de l’aide européenne, différente d’un multilatéralisme classique en ce qu’elle est fortement articulée sur les politiques bilatérales des Etats membres. Les stratégies décidées ces dernières années autour des notions de division du travail et de complémentarité sont donc des plus pertinentes et mériteraient d’être mieux mises en œuvre. Dans la logique européenne, selon Stefano Manservisi, le bilatéralisme, n’est pas résiduel et ne doit évidement pas disparaître. Mais il suppose aussi la définition d’une stratégie européenne qui soit cautionnée par les Etats membres et traduite dans leurs propres politiques. Cette approche, dans la logique du Code de conduite, devrait permettre à chacun de prendre sa part de la tâche sur le terrain en fonction de ses avantages comparatifs et d’espérer des retombées en termes de visibilité.
Si cette réflexion depuis le siège de la Commission européenne est intéressante, il faut bien admettre que pour le moment, elle relève d’une forme de modèle idéal qui n’a que peu à voir avec la réalité présente, telle que semblent la vivre les postes sur le terrain. Votre Mission a en effet reçu confirmation à plusieurs reprises lors de ses déplacements que les services déconcentrés de la Commission étaient parfois, si ce n’est souvent, assez peu désireux de partager ne serait-ce que l’information sur leurs programmes, là où les effets levier en lien avec les aides bilatérales seraient particulièrement opportuns.
Actuellement, dans la plupart des cas, les postes diplomatiques doivent avant tout compter sur eux-mêmes pour obtenir de l’information, auprès des niveaux européen comme des autres opérateurs multilatéraux, qui sont perçus comme fonctionnant sur un mode souvent plus opaque que transparent, et sans réelle coordination malgré les dires et les directives sur le partage du travail en application du Code de conduite.
Certes, la coordination, qui devrait incomber essentiellement aux pays bénéficiaires de l’aide aux termes de la Déclaration de Paris, est souvent fort limitée dans les pays les plus faibles, déficit de gouvernance et de capacités internes oblige. Elle l’est aussi compte tenu de l’intérêt qu’ils peuvent ainsi trouver à jouer de la concurrence entre donateurs sur le marché de l’aide. Dans la mesure où les bailleurs eux-mêmes n’y sont pas non plus indifférents, le simple échange d’informations a parfois même du mal à entrer dans les mœurs. Mais les perceptions des acteurs de terrain sont aussi fort variées. Ainsi, à Kinshasa, Dominique Struye de Swielande (299), ambassadeur de Belgique en RDC, regrettait ainsi l’insuffisance de coordination entre les services de la Commission et le noyau dur des coopérations bilatérales les plus importantes. La coopération belge étant incomparablement plus importante en RDC que le niveau d’intervention de la France, cette remarque confirme que ce n’est pas seulement la faiblesse de notre dispositif bilatéral qui peut jouer négativement, mais aussi la pratique des opérateurs multilatéraux, peu soucieux de communiquer, fut-ce avec les bailleurs étatiques les plus actifs. Pierre Jacquemot, ambassadeur de France à Kinshasa, et son équipe, exprimaient cependant un sentiment assez différent, voyant la coordination entre les Etats membres et la délégation européenne plutôt bien institutionnalisée, à la différence des relations avec les agences onusiennes, perçues comme plus fermées. Desmond Patrick Neil Wigan (300), ambassadeur du Royaume-Uni, partageait son avis et soulignait même que la relation entre la délégation de l’Union européenne et son ambassade n’était pas seulement constituée d’échanges d’informations, mais comprenait l’association à l’élaboration des programmes, ce qui était en revanche plus difficile à réaliser avec le reste de la communauté des bailleurs.
Au Vietnam, par exemple, pays dans lequel la Commission européenne n’est pas un acteur majeur parmi l’ensemble des bailleurs présents, votre Mission a appris qu’aucun projet n’avait jamais été développé en commun avec les services de la coopération française, ce qui n’empêche pas la délégation de la Commission de revendiquer un rôle de pilotage du dialogue interbailleurs (301). Le dialogue est fourni, néanmoins, au sein de la communauté des donateurs, sur des thématiques d’harmonisation et de coordination. Cela étant, comme le faisait remarquer l’ambassadeur Hervé Bolot, et cela est un aspect sans doute important sur lequel une réflexion serait bienvenue, les postes ne sont pas consultés sur les orientations stratégiques faites au niveau des sièges des organismes multilatéraux, alors même que les choix bilatéraux sont faits au niveau de l’ambassade. Ce n’est qu’au niveau « sous-stratégique » que le développement d’actions communes peut donc s’organiser et que la complémentarité peut effectivement jouer. Dans cette optique, la coordination, dans un pays comme le Vietnam, était alors considérée comme plutôt bonne.
Le sentiment de votre Mission est que la qualité et l’efficacité des actions d’aide au développement reposent aujourd’hui encore sur les individualités. Or, quelle que soit l’importance de cette dimension personnelle, l’un des moyens d’exister sur le terrain pour un pays comme le nôtre, passe par le renforcement d’une capacité d’action directe dans un cadre bilatéral qui garantisse une visibilité de nos interventions ce qui n’est à l’évidence pas la préoccupation des agences multilatérales.
b) Savoir tirer profit d’une évolution favorable dans l’ensemble européen
L’évolution institutionnelle de l’Union européenne intervenue avec l’adoption du Traité de Lisbonne, ouvre incontestablement des nouvelles perspectives qu’il faudra savoir exploiter et que votre rapporteure souhaite rappeler brièvement.
Le Traité de Lisbonne inscrit la politique de coopération au développement dans le cadre de la politique extérieure globale de l’Union européenne. Les principes de complémentarité et de renforcement mutuel entre les politiques de coopération de l’Union et celles des Etats membres sont également établis (302), de même que la recherche de l’efficacité entre les actions. Avec l’aide humanitaire, la coopération au développement est une compétence partagée entre les Etats membres. Rien ne les empêche bien sûr de mener leur propre politique, de même que l’Union européenne, qui mène en parallèle la sienne avec pour « objectif principal (…) la réduction et, à terme, l'éradication, de la pauvreté. » (303).
C’est sur ces nouvelles bases que, du côté européen les choses semblent d’ores et déjà pouvoir évoluer dans le bon sens. Votre Rapporteure veut mentionner ici deux initiatives récentes qui lui paraissent constituer les premières et remarquables opportunités pour la prise en compte de nos priorités et donner un nouvel élan à la coordination interbailleurs.
La commission européenne vient en effet d’annoncer (304) à son tour l’ouverture d’un chantier de réflexion sur sa politique d’aide au développement, qui se traduira par l’adoption d’un « Livre vert sur la politique de développement à l'appui de la croissance inclusive et du développement durable : amélioration de l'impact de la politique de développement de l'Union européenne ». A cet effet, la Commission souhaite engager un dialogue avec l'ensemble des parties intéressées sur la meilleure façon d'exploiter les nouvelles réalités, marquées par un environnement en constante évolution, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la situation politique et économique mondiale et les nouvelles relations avec les pays en développement fondées sur le partenariat.
Ce faisant, tenant compte du bilan mitigé tiré lors du sommet du millénaire, l'objectif de la Commission sera d'accélérer la réalisation des OMD et de réduire plus rapidement la pauvreté en s'assurant que l'aide qu'elle fournit fait la différence et soutient une croissance durable et inclusive dans les pays en développement. La commission souhaite que le Livre vert lance le débat sur différentes questions liées aux instruments d'aide de l'UE, mais aussi sur des thèmes tels quel la bonne gouvernance, le développement durable, la croissance économique et la croissance inclusive qui bénéficie aux plus pauvres, la sécurité alimentaire et l'agriculture. Le communiqué de presse de la commission rappelait que l'UE s'était fermement engagée en faveur de la réalisation de l'ensemble de ces objectifs d'ici à 2015 et avait, sur les dix dernières années et, plus particulièrement depuis l'adoption du consensus européen sur le développement en 2005, amélioré l'efficacité de ses politiques et de son aide à l'appui du développement.
Par ailleurs, à l’occasion du troisième sommet Afrique-UE, la commission européenne entreprend également l’actualisation de la stratégie commune UE-Afrique lancée en 2007, qui définit les orientations à long terme des mesures communes aux deux continents.
Plusieurs propositions ont été faites sur les moyens de renforcer la coopération avec l'Afrique, qui s'inscrivent dans la réflexion d'ensemble sur l'avenir de l'aide au développement. Elles portent notamment sur les défis mondiaux à relever ensemble : paix, sécurité, changement climatique, énergie, OMD, sécurité alimentaire et croissance inclusive et durable, en premier lieu. La commission européenne considère que la relation entre l’Union européenne et l’Afrique doit s’améliorer pour accroître la réactivité face aux défis les plus pressants et aux changements affectant sur le long terme l'équilibre des rapports de force au niveau mondial. Est particulièrement mis en avant le fait que le renforcement de l’alliance euro-africaine, notamment axée sur la protection des intérêts communs dans le cadre des négociations internationales, garantira un meilleur impact collectif et contribuera à la résolution des défis de la mondialisation. Une communication sera adoptée, intitulée : « Afrique-Europe 2020 : 1,5 milliard de citoyens, 80 pays, deux continents, un avenir commun - Communication de la Commission sur la consolidation des relations entre l'Union européenne et l'Afrique ».
Pour notre pays, qui vient de définir ses stratégies globales et européennes de développement, l’ouverture de ce chantier par la Commission est une occasion unique de faire confirmer par l’Union européenne les priorités qui sont les siennes.
Indépendamment de cet aspect, essentiel, et sans que l’on en sache encore plus sur l’organisation de cette consultation, votre Rapporteure ne peut que souhaite vivement que cette occasion soit saisie pour que la représentation nationale soit associée à la contribution de notre pays à la réflexion européenne.
c) Retrouver des marges de manœuvre sur nos financements européens
Au-delà de ce premier aspect, une réflexion nationale doit évidemment être engagée autour de la réforme du FED que chacun appelle de ses vœux depuis longtemps. La budgétisation du Fonds européen de développement est une question ancienne qui a eu l’occasion d’être débattue en de multiples instances et occasions. Toutes ou presque, se sont montrées favorables à cette issue, sans que pour autant une décision soit prise.
Sur un plan institutionnel, le Traité de Lisbonne change considérablement la donne dans la mesure où il lève certaines restrictions qui empêchaient cette évolution. En effet, les clauses qui excluaient le FED des règles des traités ne figurent plus dans le Traité de Lisbonne qui établit nettement que « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique. » (305).
A la différence de la situation antérieure, les prochains FED pourront désormais être incorporés au budget de l’Union sur décision du Conseil et sans qu’il soit nécessaire d’amender le Traité. Cela ne devrait pouvoir se faire que dans le cadre des négociations du prochain cadre financier pluriannuel qui s’étendra de 2014 jusqu’à la fin de la décennie. Cela étant, comme chacun le voit, c’est dès à présent qu’il convient de travailler à cette négociation essentielle pour notre pays, dont le résultat nous permettra de récupérer des marges de manœuvres conséquentes. En effet, l’unanimité des Etats membres est requise de même que l’approbation nécessaire du Parlement européen. Or, si la budgétisation du FED est une opportunité pour la France qui verra sa clef de financement se réduire encore, certains Etats membres devraient inversement voir leur contribution augmenter, par rapport à ce qu’ils acquittent actuellement à ce titre. La Commission est certes depuis longtemps favorable à ce rééquilibrage (306), de même que le Parlement, ainsi que certains pays, dont le nôtre, mais le résultat ne doit pas pour autant être considéré comme acquis. Cet aspect est d’autant plus important et requiert de notre part d’autant plus d’attention que l’on sait que la sensibilité de certains Etats membres, les nouveaux notamment, vis-à-vis des problématiques de développement ou de l’Afrique n’est pas la même que celle des pays traditionnellement engagés et actifs en la matière. Il est néanmoins essentiel pour nous redonner des marges de manœuvre et augmenter nos possibilités d’actions bilatérales, à destination de nos priorités géographiques et sectorielles et notre diplomatie se doit de réussir cette négociation.
En effet, très concrètement, en ce qui concerne notre contribution financière au FED, la situation est actuellement la suivante : à l’heure actuelle, selon la clef de répartition négociée lors de la constitution du 10e FED, la France participe à hauteur de 19,55 %. Elle a déjà obtenu une diminution importante par rapport aux 24,3 % antérieurs. De premier contributeur au FED, notre pays est ainsi passé au deuxième rang derrière l’Allemagne. Nous restons toutefois le premier Etat-membre « sur-contributeur », de 3,15 % par rapport à la clef du budget général, basée sur le RNB, qui est de 16,4 %. Compte tenu des sommes en jeu, et d’une contribution annuelle moyenne conséquente (307), le montant disponible annuel résultant de cette nouvelle répartition qui pourrait directement être destiné à notre coopération bilatérale serait de l’ordre de 135M€. Selon les documents budgétaires annexés au PLF 2011, il est en effet prévu que la France contribue en 2013 à hauteur de 840,6M€, sur la base de la clef actuelle de répartition (308). Dans l’hypothèse d’une clef de 16,4 %, à enveloppe globale constante, sa contribution au FED ne serait plus que de 705,2M€ annuels.
Dans la mesure où cette contribution est acquittée sur le programme 209 du MAEE, « solidarité à l’égard des pays en développement », qui gère aussi notre coopération bilatérale programmable, il n’y a aucun obstacle à ce que les crédits bilatéraux ne soient pas alimentés à due concurrence. C’est bien évidemment le souhait le plus vif de votre Rapporteure et de l’ensemble des membres de la Mission. Christian Masset, directeur général de la mondialisation du MAEE a eu l’occasion d’exprimer devant un eux un sentiment identique lors de son audition (309).
Ce faisant, il conviendra de veiller aussi que la priorité africaine du FED réformé soit maintenue et réaffirmée. La budgétisation du FED donne à la fois la possibilité d’obtenir une meilleure cohérence des politiques de développement de l’Union européenne et un meilleur contrôle politique par le Parlement européen ainsi qu’une meilleure légitimité, comme c’est déjà le cas vis-à-vis des autres programmes régionaux. Mais cette budgétisation comporte aussi le risque d’une certaine dilution des priorités marquées envers les pays ACP bénéficiaires depuis plusieurs décennies de cette politique. Certes, comme on l’a vu, la Commission entend réaffirmer sa politique de développement moyennant le Livre vert et l’actualisation de sa stratégie africaine. Ce sont d’excellentes prémices. Votre Rapporteure considère qu’il importera, cela étant, de réussir à sanctuariser l’Afrique et nos priorités sectorielles.
Même si son opinion ne sera sans doute pas partagée par tous, votre Rapporteure voit dans ce qui peut se dessiner dans un proche avenir au niveau européen, une véritable opportunité qu’il importe de ne pas laisser perdre : celle d’un jeu doublement gagnant qui permettra de renforcer l’Union européenne pour renforcer la France. Les réformes en cours et les réflexions, tant à notre niveau qu’à l’échelon européen, vont permettre la mise en place d’un instrument communautaire plus solide et sans doute plus efficace. Le fait que le Traité de Lisbonne donne à l’Union européenne une personnalité qu’elle n’avait pas jusqu’à présent devrait aussi lui permettre d’exercer une plus grande influence sur la scène internationale. Ces projets de réformes augmentent aussi les chances de succès d’une véritable mutualisation des efforts de la coopération au développement au sein de l’ensemble européen pour une meilleure efficience. Ils laissent aussi une place à la réappropriation par la France de la politique de coopération de l’Union européenne et lui ouvrent un espace pour mieux faire entendre sa voix et être reconnue à la hauteur de sa participation et de son ambition. Parmi d’autres aspects, la France pourrait opportunément essayer de prendre un leadership intellectuel dans le débat d’idées européen sur les thématiques de l’aide, comme elle le fait sur la question des financements innovants au niveau international, et contribuer fortement à porter l’Union européenne à un niveau qui devrait être à la hauteur de ses contributions à l'APD mondiale.
Enfin, votre Rapporteure ne peut clore ce développement sans inviter à la réflexion sur le devenir de la Banque européenne d’investissement. Elle voit en effet dans la BEI les potentialités d’une future banque européenne de développement qu’il conviendrait de mettre en place. Certes la BEI finance d’ores et déjà, depuis longtemps, des opérations d’investissements dans les pays ACP du FED, de même qu’en Amérique latine ou en Asie. Les thématiques de ses interventions sont néanmoins relativement restreintes et il pourrait être opportun d’étudier l’extension de son mandat à d’autres secteurs, qui permettraient probablement d’améliorer ou de compléter l’offre de financements de l’Union européenne, qui serait ainsi, grâce à cet instrument, plus large. Sans doute la position de l’Union européenne dans le concert de bailleurs s’en trouverait-elle encore renforcée.
3) Les voies d’un multilatéralisme efficace
a) Mieux investir le multilatéralisme
L’aide bilatérale peut conférer à la France une visibilité ciblée dans le dialogue entre les autorités des pays partenaires et les institutions multilatérales. Ainsi, Philippe Etienne (310) faisait remarquer que nous disposons malheureusement de ressources limitées, notamment si nous les comparons à ceux que nos partenaires, britanniques ou espagnols par exemple, sont capables de mobiliser pour appuyer la mise en œuvre de leurs contributions au multilatéralisme, quelle que soit la nature de ces ressources : fonds fiduciaires ; experts détachés ; études et recherche ou cofinancements. Il soulignait l’efficacité de la politique du Royaume-Uni, capable, grâce à l’importance de son enveloppe bilatérale, de mettre en jeu des masses considérables, de plusieurs dizaines de millions, pour peser de tout son poids. Ce que Jean-Michel Severino (311) confirmait de son côté en estimant que la faiblesse de notre dispositif bilatéral nous mettait en porte-à-faux et nous privait du poids significatif pour avoir une influence sur les orientations et décisions des organisations multilatérales auxquelles nous adhérons. Or, ce sont très nettement des crédits de ce type qui permettraient de renforcer l’influence française et d’assurer l’articulation entre le bilatéralisme et le multilatéralisme.
Que les données de la citation suivante, extraite d’une note du MAEE datent un peu ne change rien à leur pertinence. Ils résument excellemment l’impasse dans laquelle notre APD se trouve : « En matière d'aide au développement, le Royaume-Uni dispose de marges de manoeuvre supérieures à celles de la France car le pourcentage d'aide programmable dans leur APD est très supérieur au nôtre. En effet, du fait de l'importance des traitements de dette (1 842 M€), des écolages (640 M€) et des contributions obligatoires (710 M€), la part de l'aide programmable de l'APD française ne s'élève qu'à 36 % (répartie entre trois acteurs principaux). L'APD britannique au contraire abrite, au sein du budget d'un seul ministère, une part d'aide programmable supérieure à 60 %. Cela explique la capacité du gouvernement britannique à allouer de " l'argent frais " sur des projets ponctuels de cofinancement avec d'autres bailleurs, à intervenir dans nombre de fonds fiduciaires gérés par des bailleurs internationaux ou à pouvoir devenir en 2004 le premier contributeur en ratio à l'AID. » (312). Le tableau ci-dessous, proposé en appui de ces commentaires, est particulièrement parlant, aux termes duquel se confirme s’il en était encore besoin, que c’est bien la structure de notre aide et les instruments que la France a choisis, qui contribuent à l’affaiblissement de son influence et de sa visibilité.
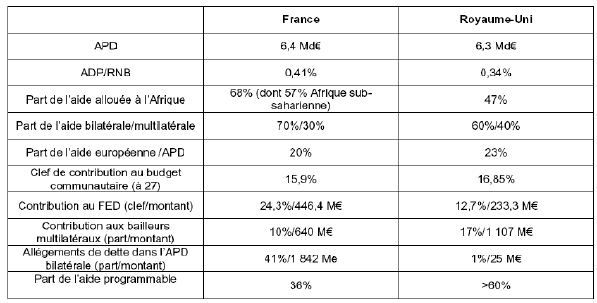
Comparaison de statistiques françaises et britanniques relatives à l'aide au développement
(Données CAD, 2003) (313)
La note du ministère pouvait conclure de ces constats, non sans une certaine admiration, que « l'efficacité du DFID en termes de concentration des instruments et d'influence dans les enceintes européennes et multilatérales, ainsi que les résultats de sa communication sur la politique d'aide et de la mobilisation des opérateurs britanniques publics ou privés sur les appels d'offre internationaux sont remarquables. Cette efficacité pourrait inspirer la réflexion du Département. »
De son côté, Jean-Michel Severino complétait son propos sur son expérience de vice-président de la région Asie à la Banque mondiale en rappelant que « sur 150 M$ de budget, 40 étaient consacrés à la recherche, auxquels s’en ajoutaient 75 M$, fournis par le Japon, destinés à la préparation des projets. La France est malheureusement très éloignée de tout cela, c’est une démarche qui lui est étrangère. Cela devrait pourtant être considéré comme une priorité, compte tenu aussi des effets secondaires que cela induit, notamment quant à l’intérêt porté à l'APD dans la communauté nationale et à l’adhésion très forte suscitée dans la population. (…) L’investissement en production intellectuelle de la part de pays comme la Suède ou la Grande Bretagne est tout à fait remarquable. Il représente 10 à 15 fois le nôtre, et chaque année un ou deux groupes de travail sont constitués qui réfléchissent aux grands sujets du moment. La Suède a par exemple fait financer une étude par le German Marshall Fund, qui a travaillé avec deux ans d’anticipation, pour influencer la future administration américaine, en y faisant valoir une série de recommandations inspirées des positions suédoises. En d’autres termes, on a ici la traduction d’une réflexion de fond possible grâce à une grande capacité d’anticipation et à des investissements non directement rentables en termes financiers mais très productifs au plan de la réflexion, qu’il faut oser faire. » (314).
Philippe Etienne (315) partageait ce sentiment en soulignant que la présence dans le débat d’idées et la définition des stratégies requerraient de valoriser la recherche-développement française, d’en orienter une partie vers les questions abordées par les multilatéraux, d’encourager le développement de compétences pour répondre aux appels d’offres internationaux en économie du développement. Il était aussi indispensable de mieux analyser et débattre de la production intellectuelle des organisations multilatérales qui joue un rôle structurant dans le débat. Dans un ordre d’idées connexe, votre Rapporteure souligne qu’il conviendrait de même de renforcer nos propres moyens d’évaluation des politiques conduites par les organisations internationales auxquelles nous contribuons.
Quelle que soit la façon d’aborder le problème, la nécessité surgit sans cesse d’avoir une vision claire des objectifs que l’on entend poursuivre via notre APD, et de se donner les moyens de l’influence. Si l’on recentre la réflexion sur un multilatéralisme spécifique, celui de l’UE, les impressions des nombreux interlocuteurs de votre Mission ne diffèrent pas fondamentalement.
Cette approche conduit votre Rapporteure à estimer qu’il serait logique que l’on sache tout d’abord exprimer de fortes exigences envers le système multilatéral pour mieux peser et optimiser notre apport, au mieux de nos intérêts et des stratégies et priorités que l’on défend. Des exigences que votre Rapporteure estime naturelles et légitimes et qui doivent être à la hauteur de notre engagement financier. Ne pourrait-on faire mieux que de partager notre chaise au conseil d’administration du Fonds mondial sida avec l’Espagne, alors même que notre apport est depuis toujours incomparablement plus élevé que ceux du Japon et de l’Italie qui occupent chacun un siège au conseil d’administration ? Ne serait-il pas souhaitable que les pays d’Afrique subsaharienne francophones puissent soumettre leurs dossiers de financement de projet autrement qu’en anglais ? Dans cet ordre d’idées, votre Rapporteure se félicite que le gouvernement ait repris, selon les informations qu’il a communiquées lors du récent débat budgétaire, la proposition de l’amendement que notre collègue Henriette Martinez avait formulé l’an dernier, d’affecter 5 % du montant de notre contribution au Fonds mondial sida aux ONG françaises travaillant sur le terrain sur ces pathologies, mais des améliorations peuvent à l’évidence être encore apportées à notre dispositif.
Cette exigence serait d’autant plus justifiée que l’investissement de notre pays ne serait pas seulement financier. Comme le faisait remarquer à juste titre Philippe Etienne (316), cela suppose en premier lieu de pouvoir assurer un suivi d’ensemble des contributions communautaires et multilatérales et des calendriers de négociation afin de mieux identifier les marges de manœuvre et les seuils critiques. En d’autres termes, cela suppose des moyens, en particulier humains. Serge Tomasi, directeur de l’économie globale et des stratégies de développement au MAEE tenait des propos identiques lors de son audition par votre Mission, quant à l’influence que permet le placement d’experts nationaux au sein des institutions multilatérales. (317)
Cette remarque amène votre Rapporteure à faire quelques propositions concernant l’articulation entre le bilatéralisme et le multilatéralisme.
b) Structurer une nouvelle articulation entre le bilatéral et le multilatéral
L’une des modalités considérées comme les plus pertinentes aujourd’hui porte sur les cofinancements associant agences bilatérales de coopération et institutions internationales, que nombre de pays bailleurs pratiquent. Non seulement, comme le disait plus haut Jean-Michel Severino, avoir du poids dans la bataille des idées est essentiel, et l’on a vu qu’il s’agissait là d’un domaine dans lequel les pays nordiques excellaient, mais le fait de ne pas opposer le bilatéralisme au multilatéralisme, d’essayer au contraire d’avoir des effets de leviers sur lui grâce à une participation dans les fonds fiduciaires, est primordial. Tous les experts que votre Mission a interrogés sur cette question partagent cet avis.
Comme le faisait remarquer François Bourguignon (318), les fonds fiduciaires se sont précisément multipliés ces dernières années pour répondre à cet objectif de visibilité que les bailleurs trouvaient trop diluée dans le multilatéralisme « classique ». Le directeur de l’Ecole économique de Paris citait à son tour le cas du DFID britannique qui, en quelques années, a réussi à accroître considérablement son audience sur le multilatéralisme non en réduisant ses contributions internationales pour les redéployer sur le bilatéralisme, - elles seraient plutôt en augmentation -, mais en jouant un jeu particulièrement coopératif avec les institutions multilatérales sur le terrain grâce au montage d’opérations conjointes, avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d’autres encore. Par comparaison, si la France apparaît comme un bailleur important, elle est loin d’avoir la même aura, jugeait-il, même si l’AFD a remarquablement réussi sur ce plan.
Il serait par conséquent hautement profitable aujourd'hui, et cohérent avec nos stratégies, de procéder à des redéploiements vers notre bilatéralisme depuis le FED réformé ou le FMSTP, notamment, comme l’appellent de ses vœux votre Rapporteure et les membres de la Mission. Cela permettrait le renforcement des moyens « bi-multi », à savoir les financements bilatéraux mis en oeuvre par des canaux multilatéraux et de pouvoir déterminer un ratio objectif entre aide multilatérale et aide bilatérale. Il faudrait aussi pour cela des moyens humains, permettant une expertise organisée, garantissant d’être présent à la fois en amont dans le débat d’idées, dans la conception des projets et en aval dans leur mise en œuvre. Philippe Etienne, notamment, lors de son audition, insistait sur ces aspects relevant du suivi de l’instruction des projets multilatéraux. L’articulation entre ambassades, ministères et représentations permanentes auprès des organisations internationales lui semblait essentielle pour aider à identifier les meilleurs moments pour influer sur la programmation multilatérale, mais on a vu ce qu’il en était, selon l’ambassadeur au Vietnam, Hervé Bolot. Le directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères estimait qu’il convenait par exemple de mettre en place une politique de présence dans les organisations multilatérales en sachant mieux identifier les avantages et inconvénients des différentes options : jeunes experts, assistants techniques, cadres dirigeants, détachés. D’une manière générale, le renforcement de l’expertise française pour répondre aux appels d’offres internationaux était aussi nécessaire. Une étude récente de l’AFD (319) sur cette question soulignait « un déficit de représentation de la France auprès des Institutions européennes. Les personnels en charge des politiques de développement à la Représentation permanente (RP) restent sans doute en nombre insuffisants - un poste de conseiller " développement ", distinct du portefeuille " Afrique " et rattaché en partie à la Cellule " entreprises et coopération " a été ouvert à la RP en 2005 – tout comme le nombre de détachés français au sein de la CE. Mais ce personnel ne reçoit pas l’appui qui serait nécessaire de la part de la centrale. Sur le terrain des opérations, on ne trouve pas de personnels chargés de suivre les allocations des fonds européens. ». L’étude avançait les moyens pour y remédier, via des ressources humaines auprès de la RP ou de la commission et ajoutait que, « en termes d’influence, le développement d’une meilleure politique de recherche, comme les Britanniques l’ont impulsé grâce à l’Overseas Development Institute (ODI), constituerait un facteur non négligeable d’influence de la France auprès des autorités européennes. » A cet égard, votre Rapporteure note que la réforme du système américain de coopération au développement lancée par le Président Obama tend, entre autres aspects, à reconstruire une capacité de recherche et d’élaboration de politiques de développement : un bureau spécifique devrait être prochainement créé au sein de l'USAID. Sur ce dernier aspect, selon votre Rapporteure, des bases remarquables existent en France, qui ne demandent peut-être qu’à être mieux mises à profit, ne serait-ce qu’autour de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, FERDI. Aux yeux de votre Rapporteure, il s’agit là d’un critère essentiel d’une véritable politique d’influence.
Selon votre Rapporteure, la France pourrait aussi s’inspirer de programmes en ce sens mis en œuvre par certains pays vis-à-vis de la Banque mondiale par exemple. Ainsi, « The Externally Funded Staffing Program » (320) (EFSP), est un programme conjoint mené par plusieurs pays européens (321), qui permet à la Banque mondiale de diversifier son recrutement et de renforcer ses capacités internes en recrutant, pour des contrats temporaires de cinq ans, des professionnels en milieu de carrière, originaires de ces pays, tant pour son siège que pour ses bureaux décentralisés. Il permet par conséquent aussi aux pays qui y participent et le financent intégralement, de pratiquer une politique d’insertion dans la Banque mondiale, fut-elle temporaire, en ayant au demeurant la possibilité d’exprimer des préférences pour que l’affectation de leurs recrues correspondent aux priorités sectorielles de leurs stratégies de développement. D’autres programmes de partenariats existent encore qui permettent selon des modalités comparables, certains mêmes étant purement bilatéraux, comme ceux que financent respectivement le Koweït et l’Arabie saoudite pour placer leurs nationaux dans des postes offerts par la Banque mondiale.
Il est remarquable que les analyses des acteurs institutionnels de l’aide française recoupent sur ce point les opinions des experts que votre Mission a consultés. Tant les études de l'AFD que celles de la Direction générale du Trésor concluent en effet dans le même sens : notre influence au sein du système multilatéral, si elle est réelle, n’est cependant pas à la hauteur de nos engagements financiers.
Dans sa « Contribution aux réflexions sur les synergies bilatérales - multilatérales » (322), l’AFD se penche plus particulièrement sur les politiques de la France en matière de changement climatique, d’éducation, de sécurité alimentaire et de santé. Il apparaît que dans ces différents domaines importants pour notre aide, les stratégies et leurs concrétisations sont déficientes. Ainsi, en matière de santé, est-il jugé que le décuplement de notre aide multilatérale dans ce secteur en sept ans n’a pas permis à la France de renforcer son influence et sa visibilité et que notre pays y tient insuffisamment son rang. Notre contribution multilatérale « est très déséquilibrée dans ses allocations, l’essentiel de l’effort multilatéral ayant porté sur les nouvelles initiatives (Fonds mondial, UNITAID, IFFIm), qui représentent 69 % des engagements multilatéraux totaux » (323) et notre expertise insuffisamment valorisée, cependant que l’aide bilatérale devrait être réévaluée : « Si les contributions multilatérales en santé ont été multipliées par près de 10 entre 2000 et 2007, les engagements bilatéraux n’ont été multipliés que par 1,5 sur la même période, et leur part dans l’aide totale en santé est passée de 69,6 % en 2000 à 26,5 % en 2007 ». Pourtant la totalité des rapports sur ces sujets ont systématiquement averti des risques que ces options faisaient courir, comme votre Rapporteure l’a aussi rappelé.
L'AFD considère qu’il en est de même dans le secteur de l’éducation, où notre stratégie multilatérale est « encore insuffisamment marquée » et où notre influence apparaît « menacée par des engagements non honorés » (324), le manque de subventions disponibles pesant par ailleurs sur la capacité d’intervention de l’agence en faveur des PMA. En ce qui concerne le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, si la France a montré ces dernières années en réaction à la crise de 2008 une force de propositions considérable, notamment au plan des mécanismes innovants de financements et de ses propres engagements, son influence est toutefois jugée encore insuffisante et fragile. Sur la thématique climatique, en revanche, l’AFD est aujourd’hui très bien positionnée parmi les principaux bailleurs de fonds et les avantages comparatifs de la France sont reconnus, en témoignent les partenariats souhaités et récemment conclus par des pays comme le Mexique ou l’Indonésie avec notre pays. De son côté, la Direction générale du Trésor, dans une note remise à votre Mission, plaide aussi sur la nécessité d’allouer des moyens bilatéraux pour orienter les contributions multilatérales, préférant d’ailleurs la mobilisation des enveloppes de dons bilatéraux pour financer des projets pilotes ou de l’assistance technique en appui aux contributions multilatérales au recours aux fonds fiduciaires. Elle recommande aussi de systématiser les stratégies françaises vis-à-vis des organisations internationales, articulées sur leurs volets actionnaire (Trésor ou DGM) et opérationnel de l'AFD. Il y a donc à l’évidence communauté de vues sur ces problématiques et il serait opportun, aux yeux de votre Rapporteure, que les traductions en termes de stratégies politiques soient faites.
Certes, depuis le début de la décennie, les choses évoluent quelque peu. Par exemple, des délégations de gestion de la Commission européenne se pratiquent désormais vers l'AFD. De nombreux co-financements ont aussi commencé de se mettre en place, comme en témoigne le diagramme reproduit ci-dessous (325), en particulier dans le cadre des facilités eau, énergie, infrastructures qui associent par exemple financements bilatéraux, FED et BEI, auxquels l'AFD participe. D’une manière générale, tant en nombre de projets qu’en volumes, c’est la Banque mondiale qui est aujourd’hui le premier partenaire de l’agence française, suivie de la BEI, de la Banque asiatique de développement, de la Banque africaine et de développement, puis de la JICA, agence de coopération japonaise, et de la Commission européenne.
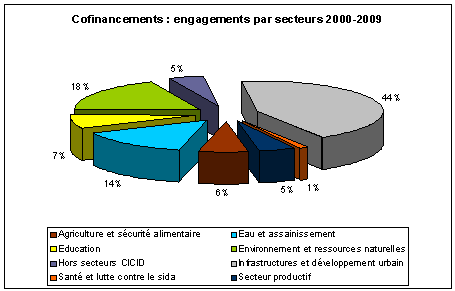
Cofinancements du groupe AFD
Cela étant, les choses ne semblent pas encore réellement stabilisées alors que cette orientation semble pourtant devoir être maintenue. En effet, en 2009, si le volume d’engagements de l’AFD dans les cofinancements représentait près de 750 M€, il restait cependant encore modeste par rapport au total des engagements de l’agence, tant en volume qu’en nombre de projets, 17 cette même année. Au total, le ratio moyen nombre de projets cofinancés / nombre de projets total sur la période 2000-2009 est de 20 %, après avoir été de 32 % en 2005, le nombre de projets cofinancés, qui a progressé jusqu’en 2007, ayant ensuite ralenti. Sur un autre plan, selon une note remise à votre Mission par le MAEE, la diminution des contributions aux agences onusiennes « s’est accompagnée d’un net recul de nos contributions bilatérales transitant par les organisations internationales (contributions dites « bi-multi ») gérées par la Direction générale de la mondialisation. »
Ainsi que votre Rapporteure l’a souligné plus haut, c’est la complémentarité et la cohérence des différents instruments qui est primordiale. La question principale n’est pas tant de rapatrier simplement des moyens multilatéraux vers le bilatéral, car il est essentiel de disposer du spectre étendu des outils existants, qui permet la flexibilité nécessaire à chaque situation et, consécutivement, garantit une meilleure efficacité par rapport aux besoins des populations bénéficiaires. Il faut donc en ce sens se donner les moyens d’agir en coordination avec les autres intervenants, de rechercher des synergies et des partenariats. Cela suppose aussi d’attacher une attention particulière à la cohérence de l’ensemble des politiques que l’on mène.
Le monde change et les politiques de coopération au développement avec lui. Elles l’accompagnent, en subissent les effets, aussi, dans les thématiques qu’elles sont aujourd’hui appelées à traiter comme dans la diversité de leurs modalités de plus en plus complexes, qu’elles doivent renouveler.
En identifiant quelques-unes des tendances lourdes qui semblent leur imprimer durablement leur marque, ce rapport a cherché à montrer que ces conditions ne constituent sans doute pas l’environnement le plus favorable pour qu’un pays comme le nôtre continue de tenir le rôle qu’il prétend jouer, de la manière dont il était accoutumé de le faire, sur une scène de plus en plus concurrentielle. D’une certaine manière, les circonstances imposent aujourd’hui de faire preuve de plus de sélectivité. Dans le choix des partenaires et des bénéficiaires, dans le choix des secteurs d’intervention. De faire preuve de plus d’inventivité aussi, pour que, malgré les difficultés rencontrées, l’effort soit soutenu pour répondre aux défis croissants.
Pour autant, que cet effort doive probablement passer aujourd’hui de plus en plus par des mécanismes collectifs ou multilatéraux, à quelque niveau qu’ils se situent, pour des raisons d’efficacité, de cohérence, de partenariats obligés, de transversalité des thématiques à traiter, ne devrait cependant pas être perçu comme la condamnation de la France à la perte de la visibilité de sa politique et de son influence, ni à ce que ses apports soient irrémédiablement dilués dans des ensembles indistincts sur lesquels elle n’aurait plus prise.
Tout au contraire, votre Rapporteure veut-elle insister en conclusion de son propos sur le fait que, compte tenu du niveau de son aide et de son implication dans les thématiques les plus prometteuses, la France a en fait sans doute plus d’atouts que bien d’autres pour figurer parmi les leaders incontestables de l'APD mondiale et pour être reconnue à sa juste valeur. A elle de savoir les identifier et mieux les utiliser. A elle, surtout, de reconnaître la dimension politique de la coopération au développement et de savoir enfin mettre en adéquation son discours, ses choix et ses instruments pour être plus cohérente, efficace, visible et influente.
A elle, par conséquent, de savoir enclencher une véritable dynamique en direction des nouveaux partenariats désormais indispensables, des stratégies et politiques européennes, et de savoir mener la réflexion qui s’impose pour la réconciliation du bilatéralisme et du multilatéralisme qu’elle pratique. Leur conjugaison est la clef de l’innovation sans laquelle les besoins de développement du Sud ne pourront être satisfaits.
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LA MISSION D’INFORMATION
I/ En ce qui concerne notre politique bilatérale
Améliorer notre dispositif
o Simplifier l’architecture institutionnelle du dispositif français de coopération au développement pour un meilleur pilotage politique, plus de cohérence et une clarification des responsabilités
o Fonder nos politiques de coopération au développement sur le principe de partenariat avec les bénéficiaires
o Faire procéder à une étude exhaustive de l’intégration et de la cohérence des différents instruments de l’aide au développement en regard des objectifs assignés à notre politique
o Rechercher l’optimisation de nos financements par une meilleure articulation des canaux bilatéraux et multilatéraux
o Réévaluer notre aide bilatérale programmable et s’engager vers son doublement d’ici à 2015
o Réévaluer les ressources humaines mobilisables pour la coopération au développement
o Etudier la possibilité de répliquer le modèle de l’ADETEF dans d’autres secteurs, notamment en santé et éducation
o Définir et mettre en œuvre une politique de volontariat au développement qui soit au niveau de celle de nos partenaires les plus actifs en la matière
Renforcer la cohérence et l’efficacité de nos politiques
o Mettre en cohérence nos mécanismes de financements avec nos priorités géographiques et sectorielles
o Veiller notamment à la prise en compte de l’Afrique subsaharienne comme première priorité de nos politiques globales mieux coordonnées
o Lancer une réflexion sur les structures de nos financements
o Mieux mettre en cohérence l’ensemble de nos politiques qui concourent au développement
o Réévaluer la pertinence des indicateurs d’évaluation et d’analyse de politiques de développement
Améliorer la sincérité et la lisibilité de nos financements au développement
o Budgétiser le taux de 0,7 % pour assurer le respect de nos engagements internationaux
o Respecter scrupuleusement les recommandations du CAD de l’OCDE dans la comptabilisation de nos financements du développement
o Adhérer à l’Initiative sur la transparence de l’aide internationale, IATI
o Améliorer de la présentation des documents budgétaires de la politique transversale de l'APD
o Annexer aux documents budgétaires soumis au Parlement les objectifs fixés aux opérateurs de l’aide et l’analyse des résultats enregistrés
o Mieux communiquer sur notre politique de coopération au développement aux plans national et international
Impliquer le Parlement
o Adopter une loi-cadre de la politique de coopération au développement de la France
o Organiser un débat annuel au Parlement sur la politique de coopération au développement de la France sur la base de rapports soumis par le gouvernement
o Associer le Parlement à l’adoption et à la révision des politiques sectorielles et des stratégies de notre coopération au développement
o Associer le Parlement aux travaux du CICID
Renforcer les synergies possibles avec la coopération décentralisée
o Evaluer les activités de coopération décentralisée des collectivités territoriales
o Améliorer la coordination de la coopération décentralisée pour une meilleure cohérence de notre bilatéralisme, aux plans géographique et sectoriel
II/ En ce qui concerne la politique européenne de développement
o Valoriser au profit de la France la démarche européenne en matière de coopération au développement en lien avec les Etats membres
o Peser de tout notre poids sur la politique européenne de coopération au développement
o Prendre toute notre part à la démarche stratégique de l’Union européenne et veiller au respect de nos priorités dans le cadre de l’élaboration du Livre vert
o Veiller à ce que la politique de développement soit intégrée de manière cohérente à la politique extérieure de l’Union
o Assurer un plaidoyer au niveau européen pour la cohérence des politiques européennes
o Veiller à l’articulation de notre coopération bilatérale avec les instruments européens
o Assurer la cohérence des financements européens avec nos priorités géographiques et sectorielles
o Engager les négociations européennes pour obtenir la budgétisation du FED
o Sanctuariser les montants correspondants à notre sur-contribution actuelle au profit de nos subventions bilatérales
III/ En ce qui concerne le système multilatéral
o Engager une réflexion sur l’interaction et l’optimisation des instruments bilatéraux et multilatéraux
o Mieux conditionner nos apports au système multilatéral et garantir la prise en compte de nos priorités géographiques et sectorielles
o Veiller notamment à ce que l’Afrique subsaharienne reste la première priorité des institutions internationales auxquelles nous contribuons
o Rééquilibrer la structure de nos financements multilatéraux
o Réévaluer nos contributions volontaires aux institutions du système onusien
o Mieux garantir le respect de la francophonie au sein des institutions internationales auxquelles nous contribuons
o Définir et appliquer une véritable politique de ressources humaines vis-à-vis des organisations internationales auxquelles la France contribue
o Mieux mettre en valeur au plan international la recherche et l’expertise françaises sur les thématiques du développement
o Continuer de soutenir la recherche sur les financements innovants et d’assurer le leadership international sur cette thématique
*****
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 22 décembre 2010.
Après les exposés de la rapporteure et du président, un débat a lieu.
M. le président Axel Poniatowski. J’aurai deux remarques. Sur la forme, j’imagine que le rapport écrit sera très explicite sur ce point mais pourriez-vous préciser quelle est la répartition chiffrée, au sein de l’aide publique au développement, entre les trois modalités que sont les annulations de dettes, les dons et les prêts ? Pour chacune de ces modalités, quelle part respective occupent le bilatéral et le multilatéral ?
Sur le fond, vous estimez que l’aide bilatérale française devrait être doublée. Mais si l’on veut bien rappeler que la France consacre déjà quelque 4 milliards d’euros à l’APD, qu’en valeur absolue elle est le deuxième contributeur au monde après les États-Unis, et qu’en valeur relative, en pourcentage du RNB, elle fait jeu égal avec le Royaume-Uni et laisse loin derrière les autres grands pays… n’est-ce pas un effort suffisant par les temps budgétaires qui courent ?
Enfin, sur le sujet majeur de l’articulation entre l’aide bilatérale et l’aide multilatérale, le rapport évoque-t-il la politique menée par les autres grands pays ?
Mme Nicole Ameline, rapporteure. Ce dont nous demandons l’augmentation sensible, c’est la partie de l’aide bilatérale constituée de dons, qui aujourd’hui représente 200 millions d’euros. Le rapport est très clair sur ce point. Ces sommes sont en effet très aisées à utiliser et la France pèche par la faiblesse des moyens ainsi mobilisés ; 500 millions d’euros seraient un bon niveau d’intervention.
En volume, il est vrai que nous sommes un contributeur très important, mais ces sommes comprennent tout aussi bien des annulations de dettes que des écolages, pour une part très substantielle du total ; or il n’est pas unanimement admis que ce type de dépenses relève de l’APD. Nos partenaires sont peut-être moins disants globalement, mais interviennent de façon plus efficace. Par exemple, à la contribution que verse la France au Fonds mondial de lutte contre le sida on peut opposer les contributions volontaires d’autres pays, plus visibles et plus valorisantes, au profit par exemple de l’Unicef. Par ailleurs, nos partenaires dégagent des marges de manœuvre plus importantes que nous en matière de dons bilatéraux, notamment à l’égard des plus pauvres des pays d’Afrique.
Par conséquent, je le répète, c’est davantage la structure de notre aide que les montants globaux qu’il s’agit d’améliorer.
M. Jean-Paul Bacquet, président. Nous constatons un réel manque de clarté et un déficit de gouvernance. Le montant de l’APD française, correspondant à un ratio de 0,44 % du RNB, ou de 0,48 % en programmation, inclut notamment des écolages, ce qui n’est pas le cas pour l’Allemagne et ce qui n’est admis par l’OCDE que dans certaines limites. Il inclut également l’aide aux réfugiés, là où l’OCDE recommande de ne pas l’inclure ; des dépenses au profit de Mayotte ou de Wallis-et-Futuna ; des annulations de dettes en omettant d’en retrancher ce qui ne contribue pas à financer des actions en faveur du développement – par exemple la vente d’armes à l’Irak à l’époque de son conflit avec l’Iran… De même, la programmation comprend-elle régulièrement des objectifs non tenus, comme la proportion de 46 %, puis de 60 %, d’aide destinée à l’Afrique subsaharienne. C’est pourquoi nous proposons de doubler l’aide programmable en direction de l’Afrique.
On doit se demander s’il y a « un pilote dans l’avion » quand on constate que 263 organisations internationales sont compétentes dans le domaine de l’APD, contre 15 seulement en 1940 et 80 en 1970… Les donateurs bilatéraux sont au nombre de 280, il existe 242 programmes d’aide et pas moins de 24 banques de développement. Pour la seule Tanzanie, nous avons constaté, dans le champ de l’APD, la production de 2 000 rapports, l’envoi de 1 000 délégations et l’existence de 600 projets en cours dans le domaine de la santé, tous d’un montant inférieur au million d’euros… comment s’étonner de ce que le suivi soit difficile ?
C’est avec raison que notre contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida est critiquée : la France est le deuxième contributeur, sa part va encore s’accroître et pourtant, lors du déplacement de la mission en République démocratique du Congo – pays concerné s’il en est par le virus –, nous avons rencontré le responsable des programmes de santé qui a vivement reproché à la France de ne pas intervenir dans ce domaine !
M. Jacques Myard. Le travail de la mission est intéressant et je voterai en faveur de sa publication mais face à un monde compliqué, ayons des idées simples. La liste des propositions est trop longue ; il faut dégager des axes stratégiques. Par ailleurs, comme l’a dit le président de notre commission, les comparaisons internationales font défaut. Et ce rapport ne souligne pas assez combien l’APD est un élément de la stratégie d’influence de la France.
Quant aux organisations internationales, elles sont devenues des « fromages ». Il faut dénoncer ce système qui s’auto-entretient.
Enfin, j’exprime mon désaccord total avec la proposition consistant à dépouiller la commission des Affaires étrangères de sa compétence en matière de suivi de l’APD ; à nous de faire notre travail, sans avoir peur des différends avec le ministère des Finances !
M. Jean-Michel Boucheron. Je salue ce travail considérable. Peut-on évaluer l’ensemble des aides non publiques au développement ? Je songe par exemple à ces firmes américaines qui distribuent des montants d’aide colossaux, dans les domaines caritatif, économique, sanitaire… L’aide privée est très importante et non désintéressée ; combien représente-elle pour la France ?
Un autre sujet important concerne les critères de l’aide : pourquoi telle aide, selon quelle stratégie – une stratégie fixée par qui ? En son temps, François Mitterrand avait instauré, dans son discours de La Baule, le critère de la démocratie et des droits de l’homme, sans pouvoir développer cette politique sur le long terme car il n’avait plus assez de temps devant lui. Aujourd’hui, qu’en est-il ? À cet égard, les graphiques qui nous ont été distribués à propos des régimes que nous aidons donnent à réfléchir.
M. Jean-Paul Dupré. En tant que membre de la mission, ayant participé à ses déplacements en République démocratique du Congo et en Tunisie, j’approuve le contenu de ce rapport. La France est un acteur important de l’aide au développement mais quid de son influence ? C’est un euphémisme de dire que la lisibilité de notre action bilatérale n’est pas excellente. Dans certains cas, les sommes ainsi versées le sont presque de façon mécanique, ce qui est à la limite de l’acceptable. Quel contraste avec la stratégie développée par la Chine, dont l’ambassadeur nous a dit tout de go que la « visibilité immédiate » de l’aide bilatérale était tout ce qui importait à son pays.
Le soutien à la francophonie est essentiel ; lors des auditions et des déplacements, la mission a entendu des reproches envers les manques de la France sur ce point.
Enfin, je voudrais soulever la question du train de vie des ONG dont les frais de fonctionnement sont parfois impressionnants.
M. François Loncle. Je salue le fait que, dans ce rapport, le débat entre le bi- et le multilatéral ait été abordé de manière positive, dépassant ce que l’opposition entre ces deux modes d’intervention aurait pu avoir de frontal. Je sais gré aux intervenants d’avoir souligné le point faible de la France : la nette dégradation des contributions volontaires aux organisations internationales. Au palmarès, nous sommes derrière la Belgique en ce domaine ! À propos du Fonds mondial de lutte contre le sida, je rappelle qu’il s’attaque aussi au paludisme et à la tuberculose. Il s’agit d’une institution efficace, dont la France devrait s’honorer d’être l’un des tout premiers contributeurs.
S’agissant des propositions formulées, je reconnais moi aussi qu’il faudrait les hiérarchiser et je me permets, un peu tard, d’en rajouter une à la liste : il est grand temps d’ouvrir un débat sur l’avenir du franc CFA avec les 15 pays concernés.
M. Dominique Souchet. Vous plaidez pour une meilleure articulation entre politique nationale et coopération décentralisée. Votre analyse repose t-elle sur le constat que la coopération décentralisée joue un rôle marginal ou significatif en matière d’aide au développement ? Ce point précis ne devrait- il pas faire l’objet d’une évaluation ? Par ailleurs, que pensez-vous de la proposition de la ministre des affaires étrangères et européennes de détacher des diplomates auprès des collectivités territoriales afin de professionnaliser leur action dans ce domaine notamment et de l’harmoniser avec la politique nationale ?
M. Hervé de Charette. Votre travail suscite de nombreuses réflexions et questions qui devraient donner lieu à débat plus fréquemment.
En premier lieu, il me semble que sur cette question le pouvoir est à prendre pour le Parlement. Il appartient à la Commission et non à une quelconque délégation de s’emparer du sujet et d’en traiter en profondeur les grands chapitres que vous avez dégagés. C’est un énorme travail à accomplir.
En second lieu, sur le niveau de l’APD, je considère que le chiffre de 0,7 % ne peut pas être traité comme une relique sacrée, cible de critiques permanentes. Dans la réalité, il se trouve que la France figure parmi les plus importants contributeurs. Il ne faut pas sans cesse battre notre coulpe mais s’honorer de la prééminence française ! En outre la politique d’aide au développement ne peut pas plus que d’autre être sanctuarisée et échapper au programme d’économies budgétaires auquel nous devrons nous astreindre dans les prochaines années. La demande de doublement de l’aide programmable ne peut aujourd’hui être soutenue dans un rapport parlementaire.
En troisième lieu, l’équilibre actuel entre multilatéral (45 %) et bilatéral (55 %) me paraît raisonnable. Nous devons maîtriser au minimum la moitié de l’aide que nous distribuons. Si nous devons préserver quelque chose, c’est l’aide au niveau européen. Nous devons être cohérents avec notre soutien à la construction européenne. S’il faut se battre pour rendre efficace une aide européenne très conséquente, cela ne signifie pas que nous devons nous livrer aux fonctionnaires européens.
En quatrième lieu, le choix de donner la priorité aux prêts sur les dons me paraît une bonne stratégie. Prêter, c’est responsabiliser. Nous devrions légitimer ce choix judicieux.
En dernier lieu, la coopération décentralisée doit bénéficier d’un large soutien pour permettre aux régions notamment de développer une véritable politique en matière d’aide au développement. En effet, la solidarité de proximité fonctionne.
M. Jean-Paul Lecoq. L’unanimité de la mission a été obtenue sur le constat – la situation, les incohérences, les outils, etc. – pas forcément sur les solutions.
Sur l’évaluation de l’aide, je crois que le travail reste à faire ; nos entretiens ont mis en avant l’absence de lisibilité, ce qui ne vaut pas nécessairement pour l’efficacité.
Je souhaite revenir sur l’importance de la notion de conditionnalité de l’aide. Alors que certains n’envisagent cette question que de manière affairiste comme un nécessaire retour sur investissement, on pourrait au contraire s’intéresser aux progrès en matière de droits de l’homme ou d’éducation, des critères pertinents, me semble t-il.
J’ai insisté sur l’aide décentralisée. Si ce n’était pas l’objet principal de la mission, nous ne pouvions éviter le sujet qui mobilise des sommes considérables et répond aux impératifs de lisibilité et visibilité. On évoque souvent l’aide directe apportée par les départements et régions mais il peut aussi s’agir d’aide indirecte, par exemple des subventions versées par des petites communes comme la mienne à des projets plus importants.
L’idée de créer à l’Assemblée une délégation à la coopération au développement avait pour but de témoigner de l’importance de cette question pour les parlementaires. Si vous considérez que la Commission est le niveau approprié pour traiter le sujet comme il le mérite, cela me convient.
Sur le niveau des subventions, il me semble que les effets de la crise devraient se faire sentir pour tout le monde, y compris le fonds mondial. Je préfère que ce sujet soit traité sur les bancs de l’Assemblée plutôt qu’à l’Elysée !
M. Michel Terrot. Les questions posées par le Président trouvent leurs réponses dans le rapport. On constate que l’aide multilatérale a augmenté dans des proportions élevées tandis que l’aide bilatérale a diminué de manière considérable alors même qu’elle est mieux identifiée sur le terrain. Le doublement de l’aide programmable d’ici 2015 ne représente qu’un effort de 200 millions d’euros à comparer aux 350 millions consacrés au Fonds mondial de lutte contre le sida… Seul un objectif chiffré peut permettre d’enrayer la spirale baissière de la seule part visible de l’influence de la France sur le terrain. On peut d’ailleurs mettre en rapport ces chiffres avec ceux de la Grande-Bretagne dont la politique est très visible et qui consacre 1 000 millions d’euros à l’aide bilatérale contre 250 millions aujourd’hui pour la France.
La mission est parvenue à dépasser l’opposition entre multilatéral et bilatéral d’une part en proposant de stopper la baisse de l’aide bilatérale et d’autre part en réfléchissant aux moyens de tirer notre épingle du jeu dans l’aide multilatérale. Sur ce point, les Britanniques et les Américains savent très bien utiliser les agences de l’ONU.
En conclusion, je me félicite de cet intéressant rapport qui présente un constat partagé remarquable. Parmi les propositions qui vont toutes dans le bon sens, je retiens la préconisation forte visant à inverser la vapeur sur l’aide bilatérale.
M. Loïc Bouvard. J’ai été très heureux de participer à cette mission passionnante. Je souhaiterais mettre l’accent sur plusieurs points qui m’ont frappé ou choqué :
D’abord, l’effet d’affichage qui voit la France gonfler ses chiffres en intégrant l’écolage et les remises de dettes. Il faut comparer les chiffres qui peuvent l’être : notre effort en faveur de l’APD se situerait ainsi plutôt autour de 0,34 % que de 0,47 %. La présentation incohérente du Gouvernement me gêne.
Ensuite, la politique des prêts : je suis favorable à la responsabilisation mais les pays de l’Afrique subsaharienne sont dans l’incapacité de rembourser des prêts. Cela rend notre politique en direction des pays pauvres inexistante. Seuls les dons peuvent leur apporter l’aide nécessaire et ceux-ci sont en forte baisse.
Les pays comme la Grande-Bretagne, qui nous est bien supérieure en matière de lisibilité et de visibilité de l’aide accepteront-ils de jouer le jeu d’une politique européenne plus reconnue ? La comparaison avec les Britanniques est intéressante car, au contraire de la France dont c’est l’une des faiblesses, ils parviennent très bien à tirer leur épingle du jeu en matière de représentation dans les instances internationales.
Enfin, je regrette l’absence de contrôle du Parlement. Les décisions sont prises par des fonctionnaires et nous échappent ce qui est anormal dans une démocratie comme la nôtre. Encore une fois l’influence des parlements britannique ou américain sur le rayonnement de leur pays est tout autre…Nous proposons de réorienter l’aide française mais serons-nous entendus par l’Exécutif ? Quel sera le suivi ? Il faut taper du poing sur la table !
M. le président Axel Poniatowski. Il est vrai que nous ne faisons pas de remise officielle de nos rapports à l’Exécutif. Nous sommes confrontés à l’éternel problème entre l’Exécutif et le Législatif. Sur ce sujet comme sur bien d’autres, nous aimerions contribuer plus à la décision.
M. Jean-Paul Bacquet, président de la mission. Le rapport cite le plan Marshall parmi les premiers éléments historiques de l’utilisation de l’aide au développement dans le cadre de la stratégie d’influence, à l’époque pour éviter le basculement de l’Europe occidentale dans le camp communiste. Le rapport évoque également les cas de la décolonisation et, plus récemment, des coopérations en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. En revanche, nous proposons une nouvelle logique de partenariat, dont la préfiguration nous a été donnée au Viêt-Nam. Avec un Etat fort, qui connaît ses priorités, l’aide au développement est beaucoup plus facile.
Le nombre d’intervenants en matière d’aide au développement est considérable, on en dénombre au moins 263. Le budget de la fondation Gates est égal à celui de l’OMS.
M. Nicole Ameline, rapporteure. Peut-être notre collègue Jean-Michel Boucheron souhaitait-il une évaluation au niveau international ?
M. Jean-Michel Boucheron. Si cette dernière existe…
M. Jean-Paul Bacquet, président de la mission. Nous n’avons pas de chiffres exacts dans ce domaine.
Huit critères président désormais à l’attribution de l’aide française. Lorsque l’on observe la liste des premiers bénéficiaires de notre APD, le respect du critère de la démocratie et des droits de l’homme n’apparaît toutefois pas clairement.
Concernant le problème de la visibilité, cela revient à aborder le débat relatif aux biens publics mondiaux. Dans certains pays, la France est accusée de ne rien faire alors que nous sommes le deuxième donateur mondial ! La Chine, elle, sait rendre visible l’aide qu’elle apporte, parfois en nature et en apparence gratuitement. Toutefois, elle masque le fait qu’elle se livre, en échange, à un véritable pillage des pays dans lesquels son aide est versée.
S’agissant des moyens disponibles, je pense que la grande difficulté de l’aide au développement est de la faire accepter par les populations des pays donateurs, qui continuent de privilégier la Corrèze au Zambèze.
M. François Loncle. Les esprits ont quand même évolué !
M. Jean-Paul Bacquet, président de la mission. Je ne le crois pas. La coopération décentralisée, par exemple, n’est reconduite que parce qu’elle n’est pas soumise au suffrage universel.
Cette coopération est d’ailleurs victime d’une grande incohérence entre les nombreuses actions menées. Je suis très favorable à la proposition de la ministre des affaires étrangères consistant à détacher des fonctionnaires d’Etat auprès des collectivités afin de rationaliser les moyens engagés et d’apporter une expertise.
De la même manière, je suis personnellement favorable au rattachement de la coopération au ministère des affaires étrangères, qui favoriserait également la cohérence de notre aide. Les chiffres révèlent ainsi que nos premiers bénéficiaires ne sont pas toujours ceux dont les besoins sont les plus importants.
Sur l’équilibre entre prêts et dons, il est fondé d’affirmer que les prêts responsabilisent, mais ils excluent dans le même temps les Etats qui ne peuvent pas rembourser, et qui sont précisément ceux qui ont le plus besoin d’aide ! Quand on voit la sphère d’influence que cela représente, on peut s’inquiéter.
Je voudrais enfin revenir sur la question du « retour » attendu de l’aide. Le temps n’est plus des aides versées pour financer les projets que nous définissons, en choisissant jusqu’aux intervenants destinés à mettre en œuvre ces projets. Les partenariats doivent être plus équilibrés, y compris en Afrique. Sur ce continent, dans les trente ans qui viennent, le nombre de jeunes actifs croîtra de 27 millions par an. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte cette situation dans le cadre du versement de notre aide au nom d’une charité chrétienne qui refuserait le retour.
Mme Nicole Ameline, rapporteure. Nous avons de nombreuses propositions car il faut une feuille de route très précise à l’orée de changements considérables et d’intenses réflexions quand à l’avenir de l’aide au développement dans le monde et en France.
En matière de conditionnalité, je voudrais évoquer la question de la gouvernance. Lors de la Déclaration de Paris, la France a rappelé son souci de l’Etat de droit, et nous devons développer notre expertise, envoyer des messages à certains pays en termes de gouvernance. Mais la conditionnalité n’est plus acceptée comme avant, car nous faisons face à des pays comme la Chine qui ne fixe aucune condition, et nous sommes sujets à des critiques nous accusant de néo-colonialisme. Cependant, la France doit continuer à souligner l’importance de l’Etat de droit.
Concernant l’évolution du Fonds mondial, je soulignerais que l’augmentation prévue de 1,5 milliard d’euros en trois ans est significative sur un budget global pour notre APD de 9 milliards.
Si la mission a proposé de créer une délégation parlementaire à l’aide au développement, c’est pour favoriser la prise de conscience. Nous pouvons tout à fait supprimer cette proposition dans le rapport final en considérant que notre commission pourrait s’en charger.
Nous proposons également un doublement de l’aide, mais seulement dans sa partie dons, ce qui représenterait seulement une hausse de 250 millions d’euros, dont la moitié pourrait être financée par le Fonds européen pour le développement.
Notre mission s’enorgueillit du rôle joué par la France en matière de développement, et nous n’avons pas l’impression de donner le sentiment contraire dans nos travaux. Nous souhaitons au contraire en être encore plus fiers, en tenant compte notamment de la légère hausse que connaît l’aide au développement au niveau mondial.
Je suis personnellement très favorable à l’aide au développement mise en place au niveau européen.
Sur le chiffre de 0,7 %, le Président de la République y a fait référence une nouvelle fois en 2008. Cet objectif permet de rappeler que l’aide au développement n’est pas versée dans le seul intérêt des pays bénéficiaires. A l’heure de la mondialisation, les problèmes les plus lointains peuvent nous concerner directement. Maintenir notre aide à un bon niveau relève de nos intérêts bien compris.
Puis la commission autorise la publication du rapport d’information.
Liste des personnalités rencontrées
(par ordre chronologique)
1) à Paris
– M. Jacques Godfrain, ancien ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, à la coopération (1995-1997) (17 mars 2009)
– M. Philippe Etienne, directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères et européennes (24 mars 2009)
– M. Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères (1997-2002) (31 mars 2009)
– M. Jean-Michel Severino, directeur général de l’Agence française de développement (31 mars 2009)
– M. Jean-David Levitte, conseiller diplomatique et Sherpa du président de la République, accompagné de M. Olivier Colom, conseiller technique à la cellule diplomatique chargé du G8, du G20, des Nations unies, des affaires multilatérales et globales et de la francophonie (7 avril 2009)
– Mme Cécile Molinier, directrice du bureau du PNUD à Genève (5 mai 2009)
– M. Alain Juppé, ancien Premier ministre (13 mai 2009)
– M. Benoît Coeuré, chef du service des affaires multilatérales et du développement à la direction générale du Trésor et de la politique économique, accompagné de MM. Julien Rencki, sous-directeur des affaires financières internationales et du développement, François Marion, chef du bureau aide au développement et institutions multilatérales de développement et Emile-Robert Perrin, conseiller du chef du service (26 mai 2009)
– M. Eckart Deutscher, président du Comité d’aide au développement (CAD) de l'OCDE, accompagné de M. Andrew Rogerson (2 juin 2009)
– M. Jean-François Trogrlic, directeur du bureau français du BIT (9 juin 2009)
– M. Jean-Louis Vielajus, président de Coordination Sud, accompagné de M. Florent Sebban, responsable des programmes APD et Europe, et de Mme Katia Herrgott, chargée de mission APD (1er juillet 2009)
– Mme Henriette Martinez, députée des Hautes-Alpes, chargée d’une mission temporaire sur l’aide multilatérale accordée par la France, auprès de M. Alain Joyandet, secrétaire d'Etat chargé de la coopération et de la francophonie (15 septembre 2009)
– M. Alain Joyandet, secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la francophonie (20 octobre 2009)
– M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la francophonie (OIF), ancien président de la République du Sénégal (21 octobre 2009)
– M. Pierre-André Wiltzer, président de l'AFD, ancien ministre de la coopération, (8 décembre 2009)
– M. Anthony Smith, directeur UE/donateurs bilatéraux du ministère britannique de développement, DFID, (15 février 2010)
– M. Thomas Barbat, consultant Nodalis Conseil, accompagné de M. Michel Courcelle (10 mars 2010)
– M. Charles Josselin, ancien ministre de la coopération, (1997-2002) (7 avril 2010)
– M. Serge Michailof, consultant, ancien directeur à la Banque mondiale, professeur à Sciences Po (11 mai 2010)
– M. Thierry Tanoh, vice-président (Afrique subsaharienne, Amérique latine, Caraïbes et Europe de l’Ouest) de l’IFC (International finance corporation, groupe de la Banque mondiale), accompagné de Mme Imoni Akpofure, déléguée générale pour l’Europe, M. Thomas Pellerin, chargé d’affaires et de M. Cyril Muller, représentant spécial pour l’Europe (12 mai 2010)
– M. Rémy Rioux, sous-directeur des affaires financières internationales et du développement à la direction générale du trésor (18 mai 2010)
– M. Michel Kazatchkine, directeur exécutif du Fonds mondial contre le Sida, accompagné de M. Ibra Ndoye, secrétaire exécutif du comité national de lutte contre le Sida au Sénégal, Mme Madeleine Leloup, conseiller principal au sein du bureau du directeur executif, Mme Michèle Barzach, présidente des amis du Fonds mondial-Europe, M. Antonio Manganella, chargé de mission AIDES, M. Patrick Bertrand, associé principal Avocats pour la santé dans le monde et de Mme Sylvie Chantereau (26 mai 2010)
– M. Christian Masset, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats, Ministère des affaires étrangères et européennes, MAEE, (1er juin 2010 et 23 novembre 2010)
– M. Serge Tomasi, directeur de l'économie globale et des stratégies de développement, MAEE, (1er juin 2010 et 23 novembre 2010)
– Mme Sylvie Bermann, directrice des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’Homme et de la francophonie, Ministère des affaires étrangères et européennes, accompagnée de M. Denis Quenelle, sous-direction des affaires budgétaires, (15 juin 2010)
– M. Mamadou Deme, président du Conseil de surveillance de la Facilité africaine de soutien juridique, accompagné de M. Tchétché N'Guessan, administrateur de la BAD, et M. Moktar Gaouad, responsable de la communication (25 juin 2010)
– Mme Violaine Messager, manager, relations avec les donateurs, relations extérieures, GAVI Alliance (29 juin 2010)
– Par visio-conférence entre Paris et Washington, M. Ambroise Fayolle, administrateur pour la France à la Banque mondiale et au FMI (7 juillet 2010)
– M. Dov Zerah, directeur général de l'Agence française de développement (14 septembre 2010)
– M. François Bourguignon, ancien économiste en chef et ancien vice-président de la Banque Mondiale, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et directeur de l'Ecole d'économie de Paris (Paris school of economics) (15 septembre 2010)
– M. Eckart Deutscher, président du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, accompagné de M. Lomoy, directeur de la coopération pour le développement (DCD) (16 septembre 2010)
2) à l’occasion du déplacement au Vietnam du Président, de Mme la Rapporteure et de M. Loïc Bouvard (du 6 au 9 octobre 2009)
– Son Exc. M. Hervé Bolot, ambassadeur de France au Vietnam
– M. Guillaume Rousson, premier conseiller à l’ambassade de France au Vietnam
– M. Michel Flesch, conseiller de coopération et d’action culturelle
– Mme Emmanuelle Boulestreau, conseillère-adjointe de coopération et d’action culturelle
– M. Ayumi Konishi, directeur régional, Banque asiatique de développement
– M. Willy Vanderberghe, conseiller politique, commission européenne
– M. Alain A. Barbu, manager portfolio and operations, Banque mondiale
– M. Yann Martres, directeur adjoint, AFD
– M. Nguyen Manh Hoa, directeur-général adjoint, ministère des finances du Vietnam
– M. Ho Quang Minh, directeur général, département des relations économiques extérieures, ministère du plan et de l’investissement
3) à l’occasion du déplacement à Bruxelles du Président, de Mme la Rapporteure, de MM. Loïc Bouvard et François Loncle (24 février 2010)
– Son Exc. M. Philippe Etienne, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne
– M. Irchad Razaaly, Conseiller pour la coopération au développement, Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne
– M. Koos Richelle, directeur général d'EuropeAid, Commission européenne
– M. Stefano Manservisi, directeur général du Développement et des relations avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Commission européenne
– M. Félix Fernandez-Shaw et Mme Teresa Barba Cornejo, Représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne
– Mme Eva Joly, présidente de la Commission du développement, Parlement européen
4) à l’occasion du déplacement en Tunisie du Président, de Mme la Rapporteure, de MM. Jean-Paul Dupré et Jean-Luc Reitzer (du 14 au 15 avril 2010)
– Son Exc. M. Pierre Ménat, ambassadeur de France en Tunisie
– M. Michel Tarran, ministre conseiller
– M. François Neuville, conseiller-adjoint de coopération et d’action culturelle
– M. Cyrille Bellier, directeur-adjoint, AFD
– M. Dirk Buda, adjoint du chef de délégation de la Commission européenne
– Mme Françoise Millecam, chef de Coopération, Commission européenne
– M. Ndiamé Diop, représentant de la Banque Mondiale en Tunisie
– M. Emmanuel Carrere, administrateur de la France à la Banque africaine de développement (BAD)
– M. Korsaga A. Frederic, administrateur, représentant le Bénin, le Burkina Faso, Cap Vert, les Comores, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad, Banque africaine de développement
– M. Jacob Kolster, directeur régional, Banque africaine de développement
– M. Youssouf Ouedraogo, conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement, ancien Premier ministre du Burkina Faso
– M. Isaac Lobe Ndoumbe, directeur régional, Banque africaine de développement
– Carlos Santiso, directeur du département gouvernance ; Banque africaine de développement
– M. Thierry de Longuemar, vice-président Finance, Banque africaine de développement
– M. Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de développement
– M. Mohamed Nouri Jouini, ministre du développement et de la coopération internationale
– Mme Saïda Chtioui, secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères
5) à l’occasion du déplacement à New-York et à Washington du Président et de Mme la Rapporteure (du 3 au 6 mai 2010)
à New-York
– Mme Rebeca Grynspan, administrateur associé du PNUD
– M. Hardin Lang, directeur de cabinet, Bureau du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour Haïti
– M. Sanjay G. Reddy, Professor of economics, Barnard College, Columbia University
– M. Claude Lemieux, conseiller développement, Mission permanente du Canada auprès des Nations unies
– Son Exc. M. Léo Mérorès, ambassadeur d’Haïti auprès des Nations unies
– M. Nicolas de Rivière, représentant permanent adjoint à la mission permanente de la France auprès des Nations unies
– Mme Afshan Khan, directrice du Bureau des alliances avec le secteur public et de la mobilisation des fonds publics, UNICEF
– Son Exc. M. Gérard Araud, ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente française près les Nations unies
à Washington
– Son Exc. M. Pierre Vimont, ambassadeur de France aux Etats-Unis
– M. François Rivasseau, ministre conseiller
– M. Romaric Roignan, deuxième conseiller
– M. Luis Alberto Moreno, président de la Banque Interaméricaine de Développement, BID
– M. Koldo Echebarría, directeur général, responsable du Bureau de la planification stratégique et de l’efficacité du développement, BID
– M. Marc-Olivier Strauss-Kahn, administrateur pour la France, Banque Interaméricaine de Développement
– M. Aymeric Ducrocq, administrateur suppléant auprès du FMI
– Mme Claire Waysand, directrice adjointe du département Europe du FMI
– M. Brice Quesnel, conseiller principal à la Banque mondiale
– Mme Aude de Amorim, conseillère principale à la Banque mondiale
– M. Dominique Desruelle, directeur adjoint du département de la stratégie et des politiques, FMI
– M. Axel Van Trotsenburg, vice-président des financements concessionnels et des partenariats, Banque mondiale
– M. Robert Zoellick, président du groupe Banque mondiale
– M. Ahmed Masood, directeur du département du Moyen Orient et de l’Asie Centrale, FMI
– M. Geoffrey Lamb, managing director, public policy, Fondation Bill et Melinda Gates
– M. Michael Deich, director, policy and government affairs, Fondation Bill et Melinda Gates
– Mme Kacy Button, policy and external relations officer, Fondation Bill et Melinda Gates
– M. Scott Morris, DAS for international development, finance and debt, Département du Trésor
– M. Lawrence Garber, expert-consultant, special advisor to the administrator (USAID)
– Mme Anna Borg, principal deputy assistant secretary, Département d’Etat
– M. Jay Branegan et Mme Connie Veillette, conseillers, commission des affaires étrangères, Sénat
– Mme Diana Ohlbaum, conseillère pour l’aide au développement du représentant Bermann, président de la commission des affaires étrangères, Chambre des Représentants
– M. Richard J. Kessler, staff director, Commission des affaires étrangères, Chambre des représentants
6) à l’occasion du déplacement en République démocratique du Congo du président, de Mme la rapporteure et de MM. Jean-Louis Christ, Jean-Paul Dupré et Michel Terrot, (du 8 au 12 juin 2010)
– Son Exc. M. Pierre Jacquemot, ambassadeur de France
– M. Philippe Righini, premier conseiller, ambassade de France
– M. David Sadoulet, conseiller-adjoint de coopération et d’action culturelle
– M. Philippe Lafosse, attaché de coopération, gouvernance
– Colonel Eric Hardy, attaché de défense, chef de la mission de coopération militaire et de défense
– M. Evariste Boshab, président de l’Assemblée nationale
– M. Jean-Claude Masangu, gouverneur de la banque centrale
– M. Henri Yav Mulang, conseiller économique à la présidence de la République
– M. Léon Kengo Wa Dondo, président du Sénat, ancien Premier ministre
– M. Raymond Tschibanda, ministre de la coopération internationale et régionale
– M. Olivier Kamitatu, ministre du plan
– M. Matata Ponyo Mapon, ministre des finances
– M. Léonard Mashako Mamba, Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
– Mme Jacqueline Bisimwa Murangaza, présidente de l’association des femmes chefs d’entreprises « ASSOFE »
– M. Stephen M. Haykin, directeur de USAID, agence américaine pour le développement international
– M. Richard Zink, ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne
– M. Vincent Dowd, ministre conseiller, délégation de l’Union européenne, RDC
– Son Exc. M. Wu Zexian, ambassadeur de Chine en RDC
– Mme Marie-Françoise Marie-Nelly, directeur régional, Banque mondiale
– Docteur Christian Tosi, conseiller santé régional, ambassade de France
– M. Francis Saudubray, conseiller principal, MONUC
– Mme Ros Cooper, chef de mission adjointe, coopération britannique DFID RDC, ambassade britannique à Kinshasa
– M. François Muamba Tshishimbi, président du groupe d’amitié RDC – France de l’Assemblée nationale
– Son Exc. M. Desmond Patrick Neil Wigan, ambassadeur du Royaume-Uni en RDC
– Son Exc. M. Dominique Struye de Swielande, ambassadeur de Belgique en RDC
*
Remerciements
Les membres de la Mission d’information souhaitent adresser leurs plus sincères remerciements à l’ensemble des personnalités et experts français et étrangers qu’ils ont rencontrés au long de leurs travaux.
Ils remercient aussi très chaleureusement les diplomates qui les ont assistés dans l’organisation de leurs différents déplacements au cours de cette mission et en ont permis le succès :
– Son Exc. M. Gérard Araud, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York
– Son Exc. M. Hervé Bolot, ambassadeur de France au Vietnam
– Son Exc. M. Philippe Etienne, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne
– Son Exc. M. Pierre Jacquemot, ambassadeur de France en République démocratique du Congo
– Son Exc. M. Pierre Ménat, ambassadeur de France en Tunisie
– Son Exc. M. Pierre Vimont, ambassadeur de France aux Etats-Unis.
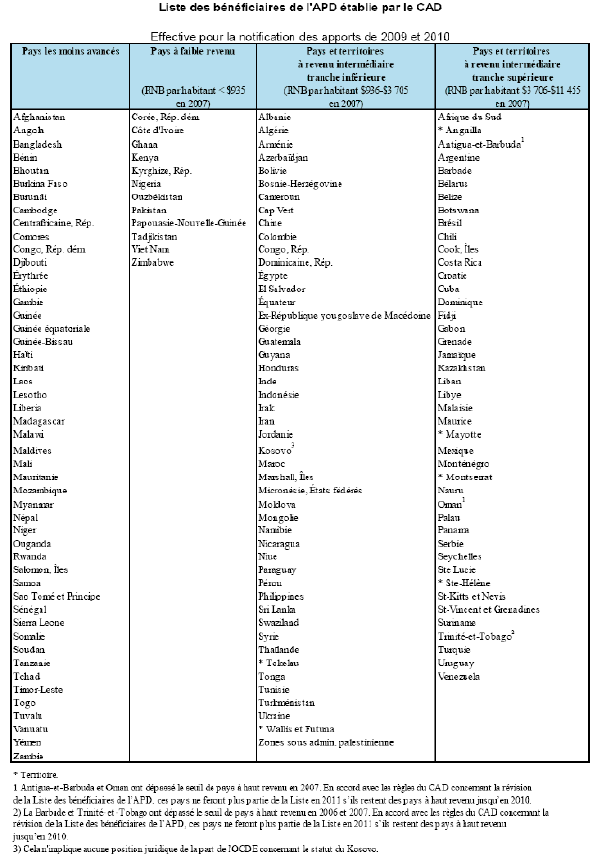
![]()
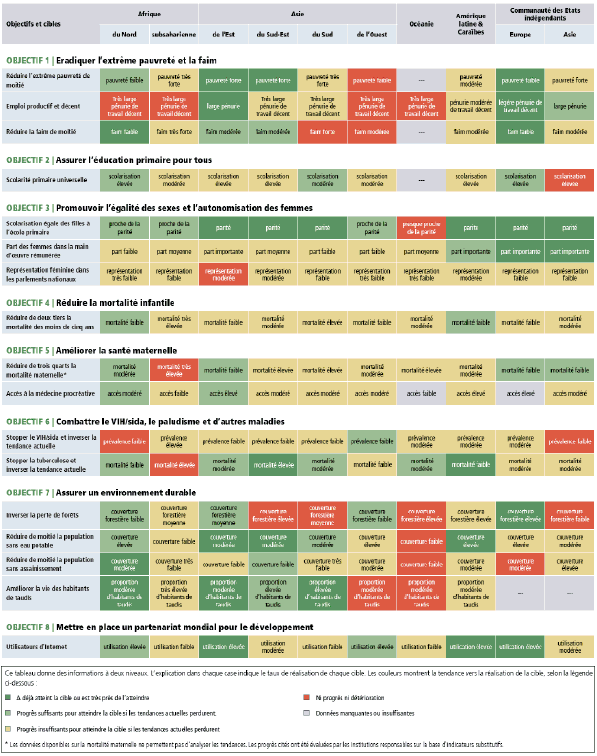
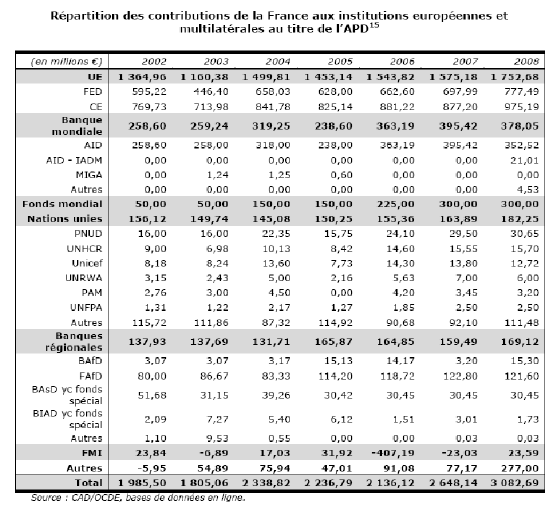
1 () « Lettre de mission de MM. Nicolas Sarkozy, Président de la République, et François Fillon, Premier ministre, adressée à M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes », 27 août 2007, in « La France et l’Europe dans le monde, Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, 2008-2020 », sous la présidence d’Alain Juppé et Louis Schweitzer, Annexe 1, page 181 ; La Documentation française, 2008.
2 () François Pacquement, « Le système d’aide au développement de la France et du Royaume-Uni : poins de repères sur cinquante ans d’évolutions depuis la décolonisation. » Revue internationale de politique de développement, n° 1, 2010, 24 pages.
3 () Julien Meimon, ibid., page 22. Citation extraite d’une lettre du 21 avril 1961 de Michel Debré au général De Gaulle ; Fonds Michel Debré, CHEVS 2 DE 30.
4 () Julien Kita, « L’Aide publique au développement japonaise et l’Afrique : vers un partenariat fructueux? », IFRI, septembre 2008, page 6.
5 () Ibid.
6 () Entretien avec le Professeur Sanjay G. Reddy, Professeur d’économie, Barnard College, Columbia University, New York, le 4 mai 2010.
7 () Jean-Michel Severino et Olivier Ray, « La fin de l’aide publique au développement : mort et renaissance d’une politique publique globale », Fondation pour les études et recherches sur le développement international, (FERDI), Document de travail, Série «Politiques de développement» / P1, Mai 2010. (Tableau extrait par les auteurs de : “AID Architecture: An overview of the Main Trends in Official Development Assistance Flows », IDA mai 2008).
8 () Antoine Seillan, « Annexe statistique », in « La France et l’aide publique au développement », op. cit., page 196.
9 () Jean-Michel Severino et Olivier Charnoz, « Les " mutations impromptues ", Etat des lieux de l’aide publique au développement », Afrique contemporaine, n° 213/2005-1, juin 2005, page 61.
10 () Serge Michailof, « Notre maison brûle au Sud, que peut faire l’aide au développement ? », Fayard/Commentaire, mars 2010.
11 () Assemblée générale, Résolution 1707, 19 décembre 1961, « Le commerce international, principal instrument du développement économique ».
12 () Entretien du 6 mai 2010, avec Lawrence Garber, Conseiller spécial de l’Administrateur de l’USAID, Washington.
13 () Entretien du 5 mai 2010, Washington.
14 () Entretien du 6 mai 2010 avec Richard J. Kessler, directeur, et Diana Ohlbaum, expert, Secrétariat de la Commission des affaires étrangères, Chambre des représentants, Washington.
15 () “The Obama Administration recognizes that the successful pursuit of development is essential to our prosperity, security and values. (…) Development is a strategic imperative for the United States. Our investments in development – and the policies we pursue that support development – can facilitate the stabilization of countries emerging from conflict, address the poverty that is a common denominator in the myriad challenges we face; foster increased global growth, and reinforce the universal values we aim to advance.” “A New Way Forward on Global Development”, disponible sur le site de la revue Foreign Policy (http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2010/05/03/white_house_proposed_taking_development_role_away_from_state).
16 () http://www.number10.gov.uk/news/latest-news/2010/05/establishment-of-a-national-security-council-49953: « The Council will coordinate responses to the dangers we face, integrating at the highest level the work of the foreign, defence, home, energy and international development departments, and all other arms of government contributing to national security.”
17 () Jean-Michel Severino et Olivier Charnoz, « Les mutations impromptues, état des lieux de l’aide publique au développement », Afrique contemporaine, n° 213, juin 2005-1), page 30.
18 () Jean-Michel Severino et Olivier Charnoz, ibid., page 31.
19 () Jean-Michel Severino et Olivier Charnoz, ibid., page 31.
20 () Sans que cela ait pour le moment débouché sur une évolution institutionnelle, le gouvernement issu des élections de septembre 2009 s’oriente vers une politique d’aide au développement moins autonome et davantage en phase avec les priorités économiques et sécuritaires de l’Allemagne, le ministre Dirk Niebel ayant notamment déclaré que la politique du développement devait être dirigée par les valeurs et les intérêts allemands, entre autres économiques.
21 () Audition de M. Alain Juppé, le 13 mai 2009.
22 () « La France et l’Europe dans le monde, Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, 2008-2020 », op. cit., page 85.
23 () « Défense et sécurité nationale, Le Livre Blanc », Odile Jacob/La Documentation française, juin 2008
24 () « Défense et sécurité nationale, Le Livre Blanc », ibid., encadré, page 46.
25 () « Défense et sécurité nationale, Le Livre Blanc », ibid., page 48.
26 () « Défense et sécurité nationale, Le Livre Blanc », ibid., page 67.
27 () Gilles Carbonnier, « L’aide publique au développement une fois de plus sous le feu des critiques », Revue internationale de politique de développement, n° 1, 2010, pages 143.
28 () Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Espagne, article 2, principes.
29 () “It is our duty to care about other people, in particular those less well off than ourselves. We have a moral duty to reach out to the poor and needy... The White Paper outlines the way we can make progress.” Préface de Clare Short au Livre blanc « Eliminating World Poverty : a Challenge for the 21st Century », citée in “The UK White Paper on International Development – and Beyond”, Overseas Development Institute, Briefing Paper, 1998 (2) May.
30 () Department for International Development, Eliminating World Poverty: Building our Common Future.
31 () “We have re-focused development on poverty and made it law that aid should be used only to tackle poverty, not for narrow self-interest and back-handed commercial deals.”
32 () Coordination SUD, « Etude comparative des stratégies de coopération au développement du Canada, du Danemark, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède », Auteur : Veronika Tywuschik, Février 2010.
33 () Entretien du 4 mai 2010, à New York.
34 () Source : MAE (2004), Fighting Poverty Together: A Comprehensive Development Policy, Rapport n° 35 (2003-04) au Storting., cité par « Examen par les pairs – Norvège – Comité d’aide au développement », encadré page 22.
35 () Résolution 55/2 adoptée par l’Assemblée générale, « Déclaration du Millénaire », 8 septembre 2008, I. Valeurs et principes, 1).
36 () « Déclaration du Millénaire », ibid., I. Valeurs et principes, 5).
37 () Stratégie internationale du développement pour le Deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement”, Résolution 2626, Assemblée générale, 24 octobre 1970, point # 43.
38 () Moniteur belge, 31.12.2002, page 58 780, chapitre 3, coopération au développement.
39 () « My Government is committed to spend nought point seven per cent of gross national income in development aid from 2013. »
40 () Entretien à Paris du 15 février 2010.
41 () « On aid spending our commitment is clear – we won’t balance the budget on the back of the world’s poorest people. Confirming our commitment on aid is both morally right and in our national interest. »
42 () Données OCDE, Aide publique au développement nette, en 2009. Disponible sur le site de l’OCDE : http://www.oecd.org/document/51/0,3343,fr_21571361_44315115_44995507_1_1_1_1,00.html
43 () « La France et l’Europe dans le monde », op. cit., pages 85 et 86.
44 () Communiqué final du Sommet de Gleneagles, points 25 et 27.
45 () Discours du Président de la République, Conférence des Nations unies sur le financement du développement, Doha, Qatar, 29 novembre 2008. (En gras : souligné par votre Rapporteure).
46 () Discours du Président de la République, Sommet sur les Objectifs du Millénaire, New York, 20 septembre 2010.
47 () « La France et l’aide publique au développement », op. cit., page 85.
48 () Jean-Michel Severino et Olivier Ray, « Le temps de l’Afrique », Ed. Odile Jacob, mars 2010, 345 pages.
49 () Ibid., page 17.
50 () Ibid., page 43.
51 () « Relever les défis en matière de développement de l’Afrique au XXIe siècle : Note conceptuelle », Nations Unies, Commission économique pour l’Afrique, E/ECA/COE/27/2, AU/CAMEF/EXP/2(III) ; 21 mars 2008, page 9.
52 () Ibid., page 110
53 () « Relever les défis en matière de développement de l’Afrique au XXIe siècle : Note conceptuelle », op. cit., page 3.
54 () Audition du 11 mai 2010.
55 () Audition du 12 mai 2010.
56 () Jean-Michel Severino et Olivier Charnoz, « Les mutations impromptues, op. cit., page 60.
57 () Serge Michailof, « Notre maison brûle au Sud, que peut faire l’aide au développement ? », op. cit., page 211.
58 () Ibid.
59 () Sénat, Table ronde organisée par la commission des affaires étrangères et de la défense, 12 mai 2010.
60 () « Rapport pour le Président de la République sur la France et la mondialisation », Hubert Védrine, Fayard, octobre 2007, page 24.
61 () Ibid., page 22.
62 () Serge Michailof, « Notre maison brûle au Sud », op. cit., page 211.
63 () Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Monterrey (Mexique), 18-22 mars 2002.
64 () Assemblée générale des Nations Unies, résolution 2626, op.cit., § 11. Plus loin, la même résolution affirme pareillement que « les pays en voie de développement doivent assumer, et assument, l’essentiel de la responsabilité du financement de leur développement. » (§ 41).
65 () Résolution 2626, ibid., § 11.
66 () « La France et l’Europe dans le monde, Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, 2008-2020 », op. cit., page 85.
67 () Ibid., page 86.
68 () DFID, “Draft Structural reform Plan”, 27 juillet 2010: “Action: Enshrine in law our commitment to spend 0.7% of national income on Official Development Assistance from 2013, End: Nov. 2011.”
69 () “The Government believes that even in these difficult economic times, the UK has a moral responsibility to help the poorest people in the world. We will honour our aid commitments, but at the same time will ensure much greater transparency and scrutiny of aid spending to deliver value for money for British taxpayers and to maximise the impact of our aid budget.” The Coalition: our programme for government, n° 18: International Development, page 22.
70 () Document Cadre Français de Coopération au Développement, 15 octobre 2010, page 64.
71 () “Keeping the promise, world economic and social survey 2010, mdg gap task force report 2010”; Jomo Kwame Sundaram, Assistant Secretary-General for Economic Development, UN-DESA, New York, 2 juillet 2010 ; http://www.un.org/esa/policy/wess/wess2010files/unga_briefing_wess_mdggap2010.pdf
72 () « Les mutations impromptues », op. cit., page 33.
73 () Ces estimations sont des fourchettes basses, ne serait-ce que parce que seuls les pays pauvres et hors géants démographiques ont été pris en compte.
74 () « Pauvreté : les promesses non tenues de l'aide internationale », Laurence Caramel, Le Monde, 12-13 septembre 2010, page 4.
75 () « La France et l’Europe dans le monde », op. cit., page 40.
76 () Audition du 15 septembre 2010.
77 () Voir par exemple « L’aide fatale, les ravages d’une aide inutile et de nouvelles solutions pour l’Afrique », Dambisa Moyo, JC. Lattès, septembre 2009.
78 () Entretien du 11 juin 2010, à Kinshasa.
79 () Résolution 1710 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Décennie des Nations Unies pour le développement », 19 décembre 1961.
80 () « Les " mutations impromptues " », op. cit., page 52.
81 () « La France et l’Europe dans le monde »,, op. cit., page 40.
82 () Ibid., page 41.
83 () « Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement », Paris, 28 février – 2 mars 2005.
84 () « Déclaration de Rome sur l’harmonisation », 25 février 2003. La conférence de Rome a réuni des ministres, responsables d’organismes d’aide et autres hauts fonctionnaires de 28 pays bénéficiaires de l’aide et plus de 40 institutions multilatérales et bilatérales de développement.
85 () Programme d’action d’Accra, Troisième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide au développement, 2-4 septembre 2008.
86 () Pierre Jacquet, « Les enjeux de l’aide publique au développement », Politique étrangère, 2006/4, page 947.
87 () Pierre Jacquemot, « Harmonisation et appropriation de l’aide. Commentaires autour de l’expérience du Ghana. », Afrique contemporaine, 2007/3-4, n° 223, page 164.
88 () Jean-Michel Severino et Olivier Ray, « La fin de l’aide publique au développement : mort et renaissance d’une politique publique globale. », op. cit., page 26.
89 () « Code de conduite sur la complémentarité et la division du travail en matière de politique de au développement ».
90 () Audition du 15 septembre 2010.
91 () Sur ces questions, DGCID, « les notes du jeudi », n° 72, 3 mai 2007, page 5.
92 () Audition du 14 septembre 2010.
93 () « Contributions de l’AFD aux réflexions sur les synergies bilatérales-multilatérales, Pour une approche intégrée des différents moyens de l’aide française » Dossier documentaire, septembre 2009, page 13.
94 () « Contributions de l’AFD aux réflexions (…) », op. cit., pages 12 et 13.
95 () Eckhard Deutscher et Sara Fyson, « Améliorer l’efficacité de l’aide », Finances et développement, septembre 2008, page 16
96 () Audition du 31 mars 2009.
97 () Audition du 24 mars 2009
98 () Jean-Michel Severino et Olivier Ray, « La fin de l’aide publique au développement : mort et renaissance d’une politique publique globale », op. cit., page 6 : « Les nouveaux acteurs du marché en croissance des politiques publiques mondiales. »
99 () Eckhard Deutscher et Sara Fyson, op. cit. page 17.
100 () Ibid., page 16.
101 () Eckhard Deutscher et Sara Fyson, ibid.
102 () Pierre Jacquemot, « Harmonisation et appropriation de l’aide. Commentaires autour de l’expérience du Ghana. », op. cit., page 162.
103 () Ibid., page 7.
104 () Ibid., page 8.
105 () Déclaration du G8 à Muskoka, « Reprise et renaissance », Muskoka (Canada) 25-26 juin 2010.
106 () Audition du 11 mai 2010.
107 () Voir « Le G8 et le développement », document de la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, MAEE, 2010.
108 () « Mr Sarkozy’s scope for spectacular success during the G20 presidency is limited, given opposition in other capitals to some of his most cherished plans, such as exchange rate reform or a proposed international tax on financial transactions. », Financial Times, 25 août 2010.
109 () Audition du 8 décembre 2009.
110 () « Compte rendu de la table ronde sur les orientations de la politique française en faveur du développement », Sénat, Commission des affaires étrangères et de la défense, 12 mai 2010, Rapport d’information n° 566.
111 () Audition du 31 mars 2009.
112 () Audition du 31 mars 2009.
113 () Audition du 24 février 2010, à Bruxelles.
114 () Audition du 4 mai 2010, à New York.
115 () Entretien du 14 avril 2010, à Tunis.
116 () Audition du 17 mars 2009.
117 () Cf. François Pacquement, « Essai de typologie des divers systèmes d’aide : clefs pour les institutions de l’aide au développement », in « La France et l’aide publique au développement », op. cit., pages 267 et suiv.
118 () Entretien du 5 mai 2010, à Washington.
119 () Entretien du 15 avril 2010, à Tunis.
120 () Entretien 5 mai 2010, à Washington.
121 () Audition du 31 mars 2009.
122 () Audition du 24 mars 2009.
123 () Entretien du 5 mai 2010, à Washington.
124 () Entretien du 5 mai 2010, à Washington.
125 () Entretien du 3 mai 2010, à New York.
126 () Audition du 21 octobre 2009, à Paris.
127 () Entretiens avec Ho Quang Minh, directeur général du département des relations économiques internationales et Bui van Ba, senior expert, ministère du plan et de l’investissement ; avec Nguyen Manh Hoa, directeur général-adjoint du ministère des finances. Déplacement effectué à Hanoï du 7 au 9 octobre 2009.
128 () Dans le cadre du déplacement effectué à Tunis les 14 et 15 avril 2010.
129 () Entretien du 14 avril 2010, à Tunis.
130 () Entretien du 15 avril 2010, à Tunis.
131 () Entretien du 11 juin 2010, à Kinshasa.
132 () Entretien du 10 juin 2010, à Kinshasa.
133 () « Harmonisation et appropriation de l’aide. Commentaires autour de l’expérience du Ghana. », op. cit., page 178.
134 () Audition du 2 juin 2009.
135 () « La France et l’aide publique au développement », op. cit., page 84 .
136 () Entretien du 4 mai 2010, à New York.
137 () Entretien du 24 février 2010, à Bruxelles.
138 () Audition du 31 mars 2009.
139 () « Coopération pour le développement, rapport 2010 », Rapport de Eckhard Deutscher, Président du Comité d'Aide au Développement, OCDE, page 111.
140 () Ibid. page 112.
141 () Source : OCDE, statistiques en ligne, http://www.oecd.org/dataoecd/17/9/44981892.pdf. Publié in : Document cadre, page 64.
142 () Audition du 7 avril 2009.
143 () Rapport 2010, op. cit., page 114. (En gras, souligné par votre Rapporteure).
144 () Source: OCDE, statistiques en ligne ; il est à noter que le Document cadre indique un taux de 0,47 % pour 2009 (Document cadre, page 65) et que les documents budgétaires ne sont pas précis sur cette question : le Document de politique transversale pour 2010 faisait état des estimations suivantes : 0,44 % en 2009 ; 0,44 % à 0,48 % en 2010 et 0,42 % en 2011 (DPT 2010, page 86) ; le DPT 2011 indique pour sa part que « l’effort français d’APD représenterait ainsi 0,50% du RNB en 2010 et 0,47% en 2011. » (DPT 2011, page 83).
145 () « L’APD française et la politique de coopération au développement : Etat des lieux, analyses et propositions, Coordination SUD, chapitre I : « Les faux semblants de l’APD de la France », page 36.
146 () OCDE, « Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement », op. cit., page 27.
147 () « Les faux semblants de l’APD de la France », op. cit., page 36.
148 () Note du ministère des finances à M. Henri Emmanuelli, rapporteur spécial et à Mme Henriette Martinez, rapporteure pour avis pour le budget de l'APD, octobre 2010.
149 () OCDE, « Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement », op. cit., page 27.
150 () Rapport n° 279, Avis au nom de la commission des affaires étrangères, budget de l’aide au développement, 17 octobre 2007, pages 35 et suiv.
151 () Audition du 1er juin 2010.
152 () Examen sur la notification au titre de l’APD des coûts dés réfugiés dans les pays donneurs, rapport préparé par M. Gérard Perroulaz et Mlle Vanessa Peat, Institut universitaire d’études de développement (Genève), CAD/OCDE, octobre 2000., cité in « Les faux semblants de l’APD de la France », page 35.
153 () Coordination SUD, Aide publique au développement française : bilan 2008-2009 », op. cit., page 9.
154 () Manuel pour la notification des réaménagements de dette au moyen du questionnaire du CAD ; annexe 1 : principes pour la notification des réaménagements de dettes, point n° 1, page 30.
155 () « La fin de l’aide publique au développement : mort et renaissance d’une politique publique globale », op. cit., page 20.
156 () « La France et l’Europe dans le monde », op. cit., pages 84-85.
157 () « Aide publique au développement française : Bilan 2008-2009 », op. cit., page 6.
158 () « Aide publique au développement française : Bilan 2008-2009 », op. cit., page 10.
159 () « La France et l’Europe dans le monde », op. cit. page 86.
160 () OCDE, « Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement », op. cit., page 28.
161 () Projet de loi de finances, DTP 2011, Annexes, Ventilation de l’effort d’APD, page 85.
162 () Note du jeudi, 8 juillet 2004, « Évolution récente de l'APD de la France et analyse par bénéficiaire et par secteur », page 11.
163 () Relevé de décision, CICID, 20 juillet 2004.
164 () Relevé de décisions, CICID du 18 mai 2005.
165 () Bénin, Burkina Faso, Comores, Ghana, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo.
166 () « La France et l’Europe dans le monde », op. cit. page 87.
167 () DTP 2011 – Aide Au Développement ; Annexes, Ventilation de l’effort d’APD ; en millions d’euros ; source : MEIE - DGTPE (septembre 2010), page 86.
168 () « Pour une mondialisation maîtrisée » Rapport d’information n °566, Christian Cambon et André Vantomme, Sénat, commission des affaires étrangères et de la défense, 17 juin 2010, page 55.
169 () Document cadre, annexe, page 67.
170 () « Aide publique au développement française : bilan 2008-2009 », op. cit., page 17.
171 () Audition du 1er juin 2010.
172 () « Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement, rapport du secrétariat », CAD/OCDE, 6 mai 2008, page 64.
173 () « Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement, rapport du secrétariat », ibid., page 30.
174 () « La France et l’Europe dans le monde », op. cit., page 87.
175 () « Évolution récente de l'APD de la France et analyse par bénéficiaire et par secteur », op. cit., page 12.
176 () « Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement, rapport du secrétariat », ibid., page 12.
177 () Source MAEE.
178 () Ibid., page 31.
179 () « Etude comparative des stratégies de coopération au développement du Canada, du Danemark, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède », op.cit.
180 () Entretiens des 7-9 octobre 2009, à Hanoï.
181 () Entretiens des 14 et 15 avril 2010, à Tunis.
182 () « Document cadre français de coopération au développement », op. cit., page 54.
183 () « En additionnant les fonds nécessaires pour réaliser les OMD d’ici 2015, l’objectif de 0,7 % du RNB pour l’aide publique au développement (APD) et les objectifs liés aux crises environnementales, le déficit de ressources est de l’ordre de 324 à 336 milliards de dollars par an entre 2012 et 2017 (156 milliards de dollars pour le changement climatique, 168 à 180 milliards de dollars pour l’APD). », « Mondialiser la solidarité : arguments en faveur des contributions financières, Rapport du groupe d’experts à la taskforce sur les transactions financières internationales pour le développement », juin 2010, page 11.
184 () « La fin de l’aide publique au développement : mort et renaissance d’une politique publique globale », op. cit., page 9.
185 () « Dans l’hypothèse d’un taux de 0,005 % [sur les transactions financières internationales], nous disposons d’un éventail très large d’estimations des recettes qui va de 70-80 milliards à 661 milliards de dollars, le chiffre probable se situant entre les deux. », in « Mondialiser la solidarité : arguments en faveur des contributions financières », op. cit., page 43.
186 () Audition du 8 décembre 2009.
187 () Audition du 20 octobre 2009.
188 () Il est prématuré de tirer des conclusions du transfert de la politique d’immigration vers le ministère de l’intérieur, intervenu en novembre. On notera cependant que c’est un troisième ministère régalien qui intervient désormais.
189 () « La France et l’aide publique au développement », op. cit., pages 29-30.
190 () « Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement, rapport du secrétariat », ibid., page 45.
191 () Ibid., page 39.
192 () Entretien du 7 octobre 2009, à Hanoi.
193 () Audition du 14 septembre 2010.
194 () Agence française de développement, plaquette de présentation, 2009.
195 () « La France et l’Europe dans le monde », op. cit., page 123.
196 () « Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement, rapport du secrétariat », ibid., page 26.
197 () Source MAEE.
198 () Ibid., page 26.
199 () Ce sera fait quelques jours plus tard : l’annulation de la dette congolaise, pour un montant de 12,3 milliards de dollars, a été annoncée le 1er juillet 2010. http://www.JeuneAfrique.com, 2 juillet 2010.
200 () Conseil d’analyse économique, « La France et l’aide publique au développement » page 31.
201 () Les ONG membres de la Coalition Eau sont : Acad, Action Contre la Faim, Adede, Avsf, CCFD, Crid, 4D, East, eau sans frontières, Eau Vive, Enda, Green Cross France, Gred, Gret, Helen Keller International, Hydraulique Sans Frontières, Ingénieurs Sans Frontières, Initiative Développement, Les Amis de la Terre, Réseau Foi et Justice Afrique Europe, Secours Catholique, Sherpa, Solidarité Eau Europe, Toilettes du Monde, Triangle Génération Humanitaire, WWF.
202 () Coalition eau, « Evolution de l'APD bilatérale française pour l’eau potable et l’assainissement, sur la période 2001-207 et perspectives à 2012 », mai 2010.
203 () Ibid.
204 () Ibid., page 41.
205 () Tunisie, Ile Maurice, Maroc, Kenya, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burundi et Angola.
206 () Audition du 1er juin 2010.
207 () Notamment « L’aide publique au développement française : analyse des contributions multilatérales, réflexions et propositions pour une plus grande efficacité » Rapport au Premier ministre, Henriette Martinez, 31 juillet 2009.
208 () Source : statistiques du CAD, in « Contributions de l’AFD aux réflexions sur les synergies bilatérales-multilatérales », septembre 2009.
209 () Ibid. Souligné par l'AFD.
210 () Ibid.
211 () Ibid.
212 () Source MAEE.
213 () Audition du 15 juin 2010.
214 () D’après données officielles, JO de l’Union européenne.
215 () Source MAEE.
216 () « Rapport présenté au Parlement sur les activités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, juillet 2008-juin 2009 », Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, DGTPE, page 46. La facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) est depuis 1999 l’instrument principal du Fonds pour fournir des prêts concessionnels. Elle soutient des programmes économiques destinés à faire face à des besoins prolongés de la balance des paiements favorisant la croissance économique et la réduction de la pauvreté.
217 () Entretien du 5 mai 2010, à Washington.
218 () Audition du 26 mai 2010.
219 () Audition du 15 juin 2010
220 () Commission des affaires étrangères, compte rendu n °7, jeudi 18 octobre 2001.
221 () Commission des affaires étrangères, compte rendu n °34, mardi 22 mai 2001.
222 () Commission des affaires étrangères, compte rendu n °5, mercredi 11 octobre 2000.
223 () Audition du 7 avril 2010.
224 () Pour 152 millions d’euros avant la fin de l’année 2008 et à hauteur de 316 millions sur 2009.
225 () Sur cette question, voir Coordination SUD, « L’aide publique au de : la France n’est pas à la hauteur », op. cit., page 12, ainsi que le débat budgétaire de l'APD pour 2009 : rapport pour avis n° 1201, Henriette Martinez, novembre 2008, page 71.
226 () « Aide publique au développement : la France n’est pas à la hauteur », op. cit., page 13.
227 () « Aide publique au développement française : bilan 2008-2009 », op. cit., page 12.
228 () « Aide publique au développement : la France n’est pas à la hauteur », op. cit., page 12.
229 () Op. cit., page 28.
230 () Audition du 1er juin 2010.
231 () « Notre maison brûle au sud », op. cit., page 177.
232 () Commission des affaires étrangères, compte rendu n °7, jeudi 18 octobre 2001.
233 () Audition du 15 juin 2010.
234 () Entretien du 4 mai 2010.
235 () Op. cit., page 75.
236 () Audition du 5 mai 2009.
237 () op. cit., page 72.
238 () Audition du 24 mars 2009.
239 () Audition du 13 mai 2009.
240 () Entretien du 15 avril 2010, à Tunis.
241 () Entretien du 7 juillet 2010, par visioconférence entre Washington et Paris
242 () Entretien du 5 mai 2010, à Washington.
243 () Entretien du 5 mai 2010, à Washington.
244 () Entretien du 5 mai 2010, à Washington.
245 () Entretien du 5 mai 2010, à Washington.
246 () Entretien du 6 mai 2010, à Washington.
247 () « Notre maison brûle au sud », op. cit., page 178 et suiv.
248 () Audition du 31 mars 2009.
249 () Selon le site web du FMSTP, de 2002 à 2010, la France, sans tenir compte de sa contribution parallèle à UNITAID, a versé directement au FMSTP plus de 2,2 Mds$, le Japon a apporté 1,3 Md$ et l’Italie environ 1 Md$. Source : http://www.theglobalfund.org/documents/pledges_contributions.xls
250 () Audition du 24 mars 2009.
251 () « Notre maison brûle au sud », op. cit., page 177.
252 () Entretien du 15 avril 2010, à Tunis.
253 () Entretien à Hanoi, le 8 octobre 2009.
254 () Entretien du 9 octobre 2009, à Hanoi.
255 () Entretien du 9 octobre 2009, à Hanoi.
256 () « L’agence française de développement en Tunisie », avril 2009, page 1.
257 () Hubert Védrine, « Le temps des chimères, 2003-2009 », Fayard, septembre 2009, page 292.
258 () « La France et l’Europe dans le monde », op. cit. page 181.
259 () Document cadre, page 62.
260 () Serge Michailof, « Notre maison brûle au Sud », op. cit., page 177.
261 () Mémorandum de la France sur ses politiques et programmes de coopération, page 12.
262 () Document cadre, page 25.
263 () Entretien du 4 mai 2010, à New York.
264 () Norvège 2008 ; Examen du CAD par les pairs.
265 () Auparavant, existait déjà, depuis 1967, un sous-comité de l’aide outre-mer, au sein du comité des affaires étrangères de la Chambre des communes.
266 () International Development Act, 2002.
267 () Document cadre de coopération au développement, page 58.
268 () Op. cit., page 152.
269 () Op. cit., page 153.
270 () Supra, Première partie : « De la guerre froide à la stabilité du monde, un fil conducteur : l'APD, politique d’intérêts nationaux et de sécurité ».
271 () « Les marges de manœuvre de l’aide publique au développement du Royaume-Uni », Les Notes du Jeudi, n° 33, 14 avril 2005, pages 4 et 5.
272 () Audition du 17 mars 2009.
273 () « Les mutations impromptues », op. cit., page 118
274 () Examen des politiques et programmes de la France, op. cit., page 33.
275 () Supra, pages 84 et suiv.
276 () Document cadre, page 28.
277 () Voir infra, pages 150 et suiv.
278 () « Le comité interministériel définit les orientations de la politique de coopération internationale et de l’aide publique au développement. A cette fin, le comité interministériel : 1o Détermine la zone de solidarité prioritaire, comprenant les pays vers lesquels sera concentrée l’aide au développement bilatérale ; 2o Fixe les orientations relatives aux objectifs et aux modalités de la politique de coopération internationale et d’aide au développement dans toutes ses composantes bilatérales et multilatérales ; 3o Veille à la cohérence des priorités géographiques et sectorielles des diverses composantes de la coopération, en particulier par l’établissement annuel des orientations d’une programmation globale ; 4o Assure une mission permanente de suivi et d’évaluation de la conformité aux objectifs fixés et aux moyens assignés des politiques et des instruments de la coopération internationale et de l’aide au développement. », décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, article 3.
279 () Stratégie française pour la politique européenne de développement, page 5.
280 () « Il est essentiel que l’allocation géographique et sectorielle de l’aide soit déterminée sur la base d’une vision stratégique - et prenant en compte, au niveau de chaque pays, les besoins et les stratégies nationales - et non pas sur la base d’opportunités d’instrument. » Supra, pages 102-103.
281 () Document cadre, op. cit., page 6.
282 () Ibid, page 6.
283 () Ibid., page 42.
284 () « La santé (engagements français à hauteur de 970 M € en 2008). La France est un contributeur majeur aux principales initiatives multilatérales et de financements innovants. Notre stratégie sur la santé sera réactualisée avant la fin de l’année 2009 et s’attachera à une meilleure articulation entre aide bilatérale et multilatérale. »
285 () Pierre Morange, « Evaluation de l’action de la France en faveur de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement dans le domaine de la Santé. Articulation et coordination des aides bilatérales et de la participation de la France aux programmes multilatéraux du secteur de la santé. », rapport au Premier ministre , page 13.
286 () Document cadre, op. cit., page 58.
287 () Pierre Morange, ibid., page 22.
288 () Audition du 14 septembre 2010.
289 () Audition du 1er juin 2010.
290 () Selon les statistiques épidémiologiques de l’OMS relatives aux principales causes de mortalité infantile paludisme et VIH-sida interviennent 12 % et 3 % respectivement des cas de mortalité infantile.
291 () Ibid.
292 () Supra, pages 50 et suiv.
293 () Supra page 94.
294 () Audition du 18 mai 2010.
295 () Supra, page 151.
296 () Audition du 31 mars 2009.
297 () Audition du 24 février 2010, à Bruxelles
298 () Audition du 24 février 2010, à Bruxelles
299 () Entretien du 10 juin 2010, à Kinshasa.
300 () Entretien du 9 juin 2010, à Kinshasa.
301 () Entretien avec Willy Vandenberghe, premier conseiller, délégation de la commission européenne au Vietnam, le 8 octobre 2009, à Hanoi.
302 () Traité de Lisbonne, article 188 D : «1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement. »
303 () Ibid.
304 () Communiqué de presse du 10 novembre 2010.
305 () Traité de Lisbonne, article 188 E.
306 () Cf. la communication de la commission au conseil et au Parlement européen : « vers une pleine intégration de la coopération avec les pays ACP dans le budget de l’UE », COM/2003/0590. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=590
307 () Le triennum budgétaire 2011-2013 prévoit ainsi au titre du FED entre 804M€ et 840M€ sur la période.
308 () Cette estimation se base sur le montant global de 4,3Mds€ à répartir en 2013 entre l’ensemble des Etats membres, le 10e FED étant d’un montant global de 22,7Mds€ ), en très forte hausse par rapport au 9e FED, de 13,5 Mds€ pour la période 2002-2007.
309 () Audition du 1er juin 2010.
310 () Audition du 24 février 2010, à Bruxelles.
311 () Audition du 31 mars 2009.
312 () « Les marges de manœuvre de l’aide publique au développement du Royaume-Uni », op. cit., page 4.
313 () Ibid., page 4.
314 () Ibid.
315 () Audition du 24 mars 2009.
316 () Audition du 24 mars 2009.
317 () Audition du 1er juin 2010.
318 () Audition du 15 septembre 2010.
319 () « Les collaborations entre l’AFD et la Commission Européenne, Vers une synergie des moyens bi et européens », septembre 2009.
320 () Informations en ligne sur le site de la Banque mondiale.
321 () L’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Italie, la Norvège et la Russie y contribuent.
322 () Op. cit., Dossier documentaire, septembre 2009.
323 () Ibid., page 27.
324 () Ibid., pages 30 et 31.
325 () Document AFD, communiqué à votre Mission.
© Assemblée nationale