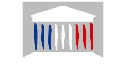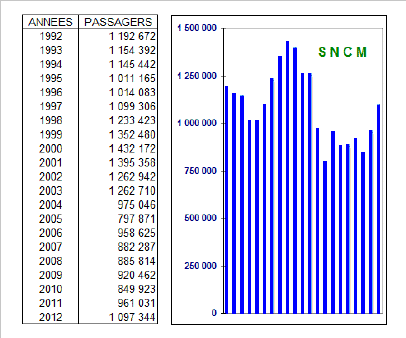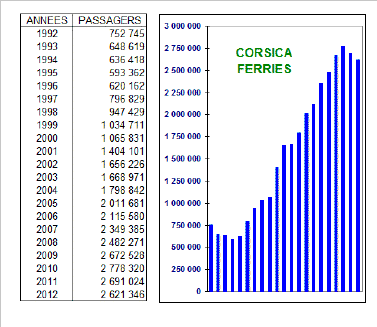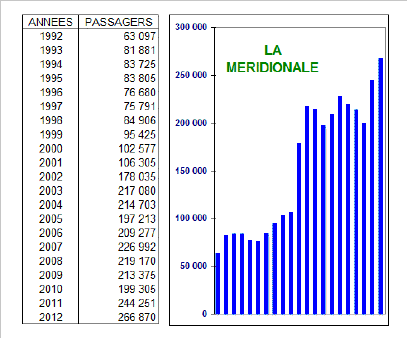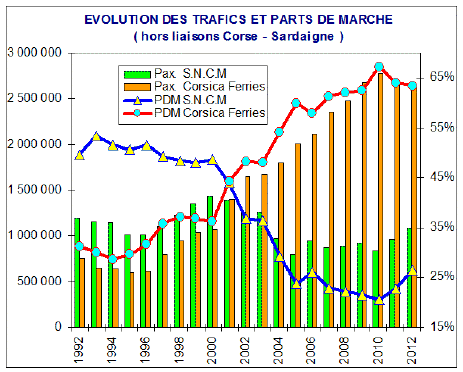______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2013
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur les conditions de la privatisation
de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM)
Président
M. Arnaud LEROY
Rapporteur
M. Paul GIACOBBI
Députés
——
La commission d’enquête sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) est composée de : M. Arnaud Leroy, président ; M. Paul Giacobbi, rapporteur ; MM. Avi Assouly, Henri Jibrayel, François-Michel Lambert et Camille de Rocca Serra, vice-présidents ; MM. Yann Capet, Jean-Philippe Mallé et Patrick Mennucci, secrétaires ; MM. Yves Albarello, Julien Aubert, Serge Bardy, Mme Valérie Boyer, MM. Gaby Charroux, Sébastien Denaja, Sauveur Gandolfi-Scheit, Christian Kert, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, Jean-Pierre Maggi, Laurent Marcangeli, François Pupponi, Boinali Said, Rudy Salles, Gilles Savary, Guy Teissier, Dominique Tian, Michel Vauzelle et Philippe Vitel.
AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT ARNAUD LEROY.
L’initiative d’examiner dans le cadre d’une commission d’enquête les conditions de la privatisation de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) revient au groupe RRDP.
D’aucuns ont pu s’interroger sur l’opportunité d’un tel retour d’intérêt concernant une opération engagée par l’État il y a plus de huit ans. Ayant présidé la commission d’enquête, j’estime que le travail accompli aboutit à la mise à jour de réelles difficultés et de certains errements qui peuvent valablement servir à améliorer les pratiques et perspectives de l’État-actionnaire.
En premier lieu, le recours à l’appel d’offres tel qu’initialement mis en œuvre s’est manifestement révélé inopérant. Bien que juridiquement fondée au regard du cadre législatif en vigueur, cette procédure a échoué s’agissant de trouver un véritable repreneur désireux d’ouvrir à la compagnie un projet lui assurant des perspectives économiques. Car, dans un premier temps, L’État s’est trouvé en définitive « piégé » face à seulement deux offres fermes qui émanaient l’une et l’autre de fonds financiers. Dans un premier temps, il a attribué 100 % du capital de la SNCM à Butler Capital Partners (BCP), le « mieux disant », dont l’offre portait sur la totalité du capital de la SNCM contre quelques millions d’euros.
La puissance des réactions syndicales, au-delà même de l’entreprise concernée, et la désapprobation des élus de tous les bords, en région PACA et en Corse, ont contraint le gouvernement de l’époque à susciter en toute urgence un « montage » qui consistait à faire appel à Veolia Transport en tant qu’opérateur industriel capable d’épauler BCP ; l’État conservant 25 % du capital.
En position de force, le fonds BCP conservait dans ce schéma une place de premier actionnaire avec 38 % des titres, jusqu’à ce qu’il puisse, deux années plus tard et au meilleur moment, faire racheter sa participation par Veolia Transport et réaliser une substantielle plus-value cinq fois supérieure à sa modeste sinon symbolique mise de fonds de quelque 13 millions d’euros payés à l’État ! Ce prix n’était aucunement en rapport avec le fonds de commerce et les valeurs d’actifs d’une entreprise publique, même régulièrement déficitaire.
Au moyen de cette privatisation « à deux tours », l’État a sans conteste cherché à se débarrasser d’une compagnie qu’il n’avait jamais su correctement gérer et d’ailleurs considérée de longue date comme socialement instable.
Cet objectif lui a fait perdre de vue tant la défense de ses intérêts patrimoniaux que les conditions de sauvegarde d’une mission de service public majoritairement assurée par la SNCM, une entreprise certes atypique, mais essentielle aux liaisons de passagers et au service du fret à destination de la Corse sur le fondement du principe de continuité territoriale.
La mécanique retenue pour l’évaluation de l’entreprise en témoigne. L’État a d’emblée privilégié « le prix négatif » au regard de son effort de recapitalisation afin d’apurer la situation financière de l’entreprise mais aussi des garanties qu’il a consenties au(x) repreneur(s) tant pour le financement d’un plan social et de régimes sociaux particuliers à la SNCM voire en matière fiscale. Une privatisation d’une telle nature n’est pas une opération ponctuelle qui se traduit par un encaissement pour solde de tous comptes dans les caisses de l’État. Elle engage lourdement les finances publiques. C’est pourquoi, il me paraît absolument nécessaire de mieux informer la Représentation nationale, non pas au-delà du terme d’une procédure de privatisation mais avant que l’État autorise le transfert de propriété.
Il ne s’agit pas pour autant d’interférer dans un processus dont l’encadrement juridique doit assurer une réelle confidentialité. Mais avant toute conclusion avec un ou plusieurs repreneurs, le Parlement et notamment certaines de ses commissions devraient être informés sur les voies et moyens caractérisant chaque opération. Il n’est pas normal que sur de tels sujets, l’information du Parlement se résume trop souvent à quelques articles de presse relatant un choix déjà effectué et assortis de quelques considérations sur les projets des repreneurs.
Plus généralement, le travail de la commission d’enquête nous amène à nous interroger sur la gestion par l’État des entreprises publiques ou des participations qu’il détient, notamment lorsqu’elles concernent des secteurs concurrentiels. Certes, à l’époque de la privatisation de la SNCM, l’Agence des participations de l’État (APE) avait à peine une année d’existence.
Mais il reste encore aujourd’hui pour cette Agence à mieux définir sinon une doctrine au moins une pratique dans l’approche des problèmes de gestion et de valorisation du patrimoine industriel et commercial qu’elle chapeaute. À titre personnel, je me félicite de la détermination du gouvernement qui, depuis deux ans, s’engage sur cette voie.
En effet, les membres de l’APE doivent pouvoir pleinement exercer, au nom de l’État, un rôle d’actionnaire présent et actif donc d’être ainsi à même de faire valoir un droit d’alerte face à toute situation périlleuse.
L’exemple de la SNCM mérite d’être médité. Peu de temps avant la privatisation, la compagnie avait fait l’objet d’une « aide au sauvetage » notifiée à ce titre, au début de l’année 2002, aux autorités européennes. Le bénéfice de cette aide n’avait été accordé par la Commission européenne qu’à la condition qu’elle prenne la forme d’un prêt de trésorerie de 22, 5 millions d’euros remboursable à court terme.
L’octroi de ce prêt supposait, pour la Commission, la mise œuvre de mesures de restructuration permettant à l’entreprise de restaurer significativement sa situation de trésorerie. À défaut, toute perspective de redressement était illusoire. Or, il n’en a rien été. Cet apport financier que l’État avait complété par une recapitalisation a été purement et simplement consommé en moins de deux exercices, sans que la tutelle n’intervienne pour rectifier la dérive. Cette carence dont la responsabilité incombe tout autant à la direction de la SNCM de l’époque qu’à son actionnaire étatique nous a été reprochée par les autorités européennes de la concurrence qui ont estimé que ces aides d’État représentaient, dès lors, l’ultime apport qu’elles pouvaient autoriser. À partir de cette situation et face à une nouvelle dégradation des comptes de la SNCM au terme de l’année 2004, la seule voie possible a paru être celle de la privatisation, une « solution » qui n’a pas été imposée par l’Europe mais qui résulte de l’impasse dans laquelle s’est placé le gouvernement en éludant toute rectification dans la gestion de l’entreprise.
Force est de constater qu’au long des décennies ayant précédé sa privatisation, l’État n’a jamais su, ou plus exactement voulu, définir et conduire un véritable projet industriel concernant la SNCM.
De façon récurrente, la compagnie a connu d’importantes crises de trésorerie, certes aggravées par la saisonnalité de son activité puisqu’elle transporte près de dix fois plus de passagers en haute saison (mois de juillet et août) qu’au cours des creux d’activité (mois de janvier et février). Mais est-il pour autant normal que cette entreprise soit condamnée à lancer des appels au secours à intervalles réguliers tout en « brûlant du cash » mois après mois ?
Sa privatisation, en 2006, n’a rien changé à cette situation désespérante. L’opération s’est soldée par un échec. La SNCM continue à vivre au jour le jour sans d’autres perspectives que l’urgence, en sollicitant, par exemple, des concours en compte courant de ses actionnaires principaux, voire une avance sur les subventions que lui accorde la Collectivité territoriale de Corse au titre de la délégation de service public (DSP).
La commission d’enquête n’a certes pas cherché à s’ériger en tribunal. Elle a toutefois porté toute son attention sur un processus complexe qui a impliqué de nombreux acteurs qu’elle a tenu à auditionner. À cet égard, je tiens à souligner le sérieux des membres de la commission et la qualité de leurs échanges. L’état d’esprit ayant présidé à ses travaux mérite d’être souligné, on le doit notamment à l’implication personnelle de son rapporteur, notre collègue Paul Giacobbi.
Au terme de plusieurs mois de travail, il me paraît néanmoins nécessaire d’apporter une conclusion optimiste quant à l’exercice par notre Assemblée d’une de ses missions naturelles de contrôle. La privatisation de la SNCM n’appartient pas à un lointain passé. Les conséquences de cette opération sont, à l’évidence, toujours sensibles. La gestion du « dossier de la SNCM » qu’il reste encore aujourd’hui à traiter doit être conduite par les pouvoirs publics en retenant notamment les leçons à tirer des observations de notre commission.
SOMMAIRE
___
Pages
AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT ARNAUD LEROY. 3
INTRODUCTION 3
PREMIÈRE PARTIE : UNE PRIVATISATION SOUS CONTRAINTE 3
I. UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS DÉGRADÉE 3
A. LA NÉCESSITÉ D’UN PLAN DE RESTRUCTURATION EN 2001 3
B. DE NOUVELLES DIFFICULTÉS A PARTIR DE 2004 3
II. UN ÉTAT LARGEMENT RESPONSABLE DES DIFFICULTÉS DE LA SNCM 3
III. DES RÈGLES EUROPÉENNES STRICTES INTERDISANT UNE NOUVELLE RECAPITALISATION 3
IV. DES REPRENEURS NATURELS RARES ET PEU INTÉRESSÉS 3
A. LE RAPPROCHEMENT ENTRE BUTLER CAPITAL PARTNERS (BCP) ET LA COMPAGNIE MÉRIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) FAIT LONG FEU 3
B. CORSICA FERRIES S’ABSTIENT DE TOUTE PROPOSITION 3
C. LA TENTATION DE LA LIQUIDATION 3
1. Les concurrents espèrent une liquidation 3
2. Le coût de la liquidation aurait été trop élevé 3
DEUXIÈME PARTIE : POURQUOI UNE PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES ET À QUELS PRIX ? 3
I. UN APPEL D’OFFRES INOPÉRANT 3
II. UNE PRIVATISATION « À DEUX TOURS » : UN MONTAGE EN URGENCE 3
III. LE « PRIX NÉGATIF » : UNE MÉCANIQUE DÉLIBÉRÉMENT RETENUE 3
IV. L’IMPORTANCE DES APPORTS ET GARANTIES CONSENTIS PAR L’ÉTAT. 3
V. LA CMN : UN « PARTENAIRE » PEU DISPOSÉ À LA COOPÉRATION. 3
TROISIÈME PARTIE : LA MISE EN ÉCHEC DE LA PROCÉDURE ET L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE SOLUTION 3
I. LA RÉVOLTE DE MARSEILLE 3
A. UN REJET SYNDICAL IMMÉDIAT ET D’UNE EXTRÊME VIOLENCE 3
B. LE REFUS DE LA PRISE DE CONTRÔLE PAR UN FONDS FINANCIER 3
C. UN CONTEXTE DE FORTES TENSIONS SOCIALES 3
D. UNE ATTENTION INSUFFISANTE DE L’ÉTAT AUX CONDITIONS LOCALES 3
E. LA SOLUTION DES ÉLUS 3
1. Une hostilité affirmée à la solution retenue 3
2. La suggestion de la reprise par Veolia 3
II. L’INTERVENTION DU PREMIER MINISTRE ET LA FORMATION D’UNE SOLUTION DE SORTIE DE CRISE 3
A. L’INTERVENTION DE L’ÉTAT 3
B. L’ACCORD DE BCP ET VEOLIA 3
C. L’ACCEPTATION FINALE DES SYNDICATS ET LA FIN DE LA GRÈVE 3
III. LE NOUVEAU DISPOSITIF DE PRIVATISATION 3
A. LA REMISE À FLOT DE LA SNCM PAR L’ÉTAT 3
B. LA RESTRUCTURATION DU CAPITAL ET LE NOUVEL ACTIONNARIAT 3
C. LES AUTRES ÉLÉMENTS DU DISPOSITIF 3
1. Les autres éléments financiers 3
2. Les clauses résolutoires 3
D. LA NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA SNCM 3
IV. LA PLUS-VALUE POUR BCP, LA SNCM POUR VEOLIA 3
A. UNE PRÉSENCE VIRTUELLE DE L’ÉTAT ? 3
1. La neutralisation de la participation de l’État au capital 3
2. L’exclusion de l’État de la gouvernance de la SNCM 3
B. L’ORGANISATION PROGRAMMÉE D’UNE SORTIE BÉNÉFICIAIRE POUR BCP 3
1. Les objectifs de BCP 3
2. Les dispositions du pacte d’actionnaires et de l’accord sur les modalités de calcul du prix de cession 3
3. La fixation du profit futur de BCP 3
C. UNE CESSION PAR L’ÉTAT AUX CONDITIONS DE VEOLIA 3
1. L’effort réellement consenti par l’État 3
2. Une solution juridiquement irréprochable 3
QUATRIÈME PARTIE : LA GESTION DE LA SNCM PRIVATISÉE 3
I. LA TENTATIVE AVORTÉE DE CONSTITUTION PAR VEOLIA D’UNE « GRANDE SNCM » 3
A. UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX 3
B. LA TENTATIVE DE PRISE DE CONTRÔLE DE LA CMN 3
C. L’ÉCHEC DE LA SOUMISSION DE LA SNCM SEULE À LA DSP 3
D. LE RETOUR À LA CONFIGURATION PRÉCÉDENTE 3
E. L’AFFAIRE DU PREMIER « JEAN NICOLI » : LES PREMIÈRES DIVERGENCES STRATÉGIQUES ENTRE VEOLIA ET BCP 3
II. LA SORTIE DE BUTLER CAPITAL PARTNERS DU CAPITAL DE LA SNCM. 3
1. Le remplacement du « Monte Cinto » 3
2. La clause d’adaptation de la convention de délégation de service public 3
C. POUR VEOLIA, UNE DÉCISION FORCÉE QUI TRADUIT L’INCOMPATIBILITÉ DES STRATÉGIES DES DEUX PARTENAIRES 3
1. Une décision forcée ? 3
2. La fixation du prix 3
III. UNE GESTION DIFFICILEMENT COMPRÉHENSIBLE 3
A. LA PRÉSENTATION OPTIMISTE DE MM. STÉPHANE RICHARD ET WALTER BUTLER 3
B. LA RÉALITÉ : UNE SNCM PAS REDRESSÉE DU TOUT 3
1. Un résultat d’exploitation constamment négatif 3
2. Une gestion déroutante des effectifs et des charges de personnel 3
C. POURQUOI UNE TELLE ÉVOLUTION ? 3
1. Veolia prise à contre-pied ? 3
2. Des concurrents déterminés et bien armés 3
3. Une absence de stratégie ? 3
IV. LE DÉVELOPPEMENT DE LOURDS CONTENTIEUX EUROPÉENS 3
A. L’INVALIDATION DE LA RECAPITALISATION 3
1. La validation du plan de recapitalisation et de privatisation par la Commission européenne 3
2. La remise en cause de ce plan par le Tribunal de l’Union européenne 3
3. La volte-face de la Commission 3
1. L’affaire du service complémentaire : l’obligation de rembourser l’autorité concédante malgré un service fait 3
2. La recapitalisation de la SNCM : une volte-face tardive aux conséquences difficiles à maîtriser 3
CONCLUSION 3
RAPPEL CHRONOLOGIQUE 3
EXAMEN DU RAPPORT 3
ANNEXES 3
CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES MEMBRES DU GROUPE UMP 3
CONTRIBUTION DE M. GABY CHARROUX AU NOM DU GROUPE GDR 3
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 3
a. Audition, à huis clos, de M. Claude Gressier, ancien directeur du transport maritime, des ports et du littoral au ministère chargé de l’équipement et des transports 3
b. Audition, à huis clos, de M. Gérard Couturier, président du directoire de la SNCM (2004-2011) 3
c. Audition, à huis clos, de M. Antoine Sindali, président de l’Office des transports de la Corse (2004-2010) 3
d. Audition, à huis clos, de M. Camille de Rocca Serra, président de l’Assemblée de Corse (2004-2010) 3
e. Audition, à huis clos, de M. Ange Santini, président du Conseil exécutif de Corse de 2004 à 2010 3
f. Audition, à huis clos, de M. François Goulard, secrétaire d’État aux transports et à la mer (2004-2005) 3
g. Audition, à huis clos, de M. Francis Lemor, président du groupe STEF 3
h. Audition, à huis clos, de M. Denis Samuel-Lajeunesse, directeur général de l’Agence des participations de l’État (2004-2006) et de M. Jean-Louis Girodolle, sous-directeur du transport à l’Agence des participations de l’État (2003-2006) 3
i. Audition, à huis clos, de M. Pierre Mattei, directeur général de Corsica Ferries France 3
j. Audition, à huis clos, de MM. Walter Butler, président de Butler Capital Partners (BCP), et Laurent Parquet, partner (BCP), accompagnés de M. Grégoire Lucas, conseil de BCP 3
k. Audition, à huis clos, de M. Christian Frémont, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône (mai 2003-mai 2007) 3
l. Audition, à huis clos, de M. Benoît Le Bret, chef de cabinet (mai 2004-à mai 2008) de M. Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne chargé des transports 3
m. Audition, à huis clos, de M. Maurice Perrin, délégué syndical CFE-CGC, secrétaire général CFE-CGC-« Sédentaires » de la SNCM à l’époque de sa privatisation 3
n. Audition, à huis clos, de M. Jean-Paul Israël, secrétaire général CGT-Marins de Marseille à l’époque de la privatisation de la SNCM 3
o. Audition, à huis clos, de M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF, auditionné en sa qualité d’ancien président-directeur général de Veolia Environnement 3
p. Audition, à huis clos, de M. Alain Mosconi, secrétaire général de la section maritime du syndicat des travailleurs corses, élu au comité d’entreprise de la SNCM à l’époque de sa privatisation 3
q. Audition, à huis clos, de M. Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange, auditionné en sa qualité d’ancien directeur général de Veolia Transport 3
r. Audition, à huis clos, de M. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, accompagné de MM. Alain Quinet, ancien directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, Jean-Marc Delion, ancien conseiller équipement et transports au cabinet du Premier ministre, et Luc Remont, ancien directeur adjoint de cabinet du ministre de l’économie et des finances. 3
Il n’était pas facile de mener une commission d’enquête sur les conditions de privatisation de la SNCM en 2006, alors même qu’en 2013, les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette compagnie maritime est à nouveau en grand péril.
L’inévitable télescopage de l’actualité avec l’enquête explique peut-être – avec la traditionnelle négligence des administrations – que les documents demandés à l’État soient parvenus en définitive le 8 novembre 2013, soit cinq mois après le début des travaux de la commission, quatre mois après avoir été sollicités, un mois avant la publication du rapport final et seulement au prix de nombreuses relances orales et écrites.
De surcroît, certains documents ne sont jamais parvenus in extenso. C’est le cas en particulier du rapport relatif au recouvrement de la taxe sur les transports, réalisé par l’Inspection générale des finances dont les données relatives au volet maritime auraient pu éclairer le débat sur les conditions réelles de concurrence.
Afin d’éviter toute confusion, la commission d’enquête s’en est tenue très strictement à la lettre de la résolution en ne faisant porter ses investigations que sur les conditions de la privatisation de 2006 et les conditions dans lesquelles, de ce fait, la SNCM a été gérée par la suite.
Les personnes auditionnées sont exclusivement celles qui étaient en fonction au moment des faits et non pas celles qui le sont actuellement. Les quelques rares personnes qui sont restées en fonction jusqu’à ce jour n’ont été interrogées que sur la période concernée par nos investigations.
La commission a également exclu tout a priori et s’est efforcée de s’abstraire de tout jugement prématuré et s’est fondée exclusivement sur les faits établis par les pièces ou les témoignages sur la foi du serment.
Enfin pour éviter de troubler ses travaux par la publicité des débats qui auraient inévitablement fait l’objet d’un certain retentissement dans la presse, compte tenu de l’actualité de la SNCM, la commission a préféré s’en tenir au huis clos pour toutes les auditions.
*
* *
Le lecteur pourra en consultant la chronologie de cette affaire complexe, disposer des repères et ainsi mieux comprendre l’enchaînement des faits et des causes.
La première partie de ce rapport rappelle les conditions initiales de la privatisation seule solution possible, compte tenu de l’interdiction faite par l’union européenne d’une nouvelle recapitalisation.
La deuxième partie s’interroge sur le choix opéré pour la procédure d’appel d’offres et sur l’appréciation de la valeur de l’entreprise.
La troisième partie décrit minutieusement les faits qui ont conduit à l’élaboration en cours de route d’une nouvelle solution et les conséquences financières que cela a pu avoir pour les différentes parties prenantes.
La quatrième partie décrit les mésaventures ultérieures de la SNCM pour expliquer sur la base des conditions de la privatisation, comment on a pu à nouveau en arriver là aujourd’hui.
La conclusion enfin, s’efforce sereinement de résumer les faits et de faire le compte – au sens propre comme au sens figuré – des erreurs ou des événements critiquables mais non juridiquement répréhensibles, des gains et des pertes de chacun en s’efforçant pour les premiers d’examiner s’ils ne pourraient pas tomber sous le coup de la loi.
La question principale à laquelle ce rapport tente d’apporter une réponse, est de savoir comment il a été possible que l’État dépense deux cents millions d’euros pour une privatisation, pour laquelle il abandonnait de surcroît, par anticipation plus de cent vingt millions de plus-values latentes qui ont été rapidement réalisées soit au profit d’une partie privée, soit en compensation de pertes d’exploitations de plus de dix millions d’euros par an, sans pour autant que ces efforts considérables – l’équivalent de près de cent cinquante mille euros par salarié – aient pu permettre de rétablir la situation.
PREMIÈRE PARTIE : UNE PRIVATISATION SOUS CONTRAINTE
La SNCM, une filiale de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF) – une société holding publique –, a été créée en 1976, à la suite de la prise de contrôle par l’État. La SNCM succédait ainsi à la Compagnie générale transméditerranéenne (CGMT), elle-même issue de la fusion des activités en Méditerranée de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie de navigation mixte. À l’origine la SNCM était détenue à hauteur de 75 % de son capital par la CGM (Compagnie générale maritime) et à 25 % par la SNCF dont la participation sera progressivement réduite à l’occasion d’augmentations de capital pour être ramenée à 6,98 % en 2003. Au cours de cette même année 1976, l’État a instauré le principe de continuité territoriale entre la Corse et le continent, selon lequel le coût des transports ne doit pas être supérieur à ce qu’il aurait été par chemin de fer.
La mise en œuvre ce principe s’est réalisée au moyen d’une convention cadre de service public pour la période 1976-2001, soit pour 25 ans. Celle-ci a confié à la SNCM l’exploitation du service public de transport de passagers et véhicules accompagnés entre le continent et la Corse ainsi que l’exploitation - pour la part lui incombant dans la répartition entre armements participants - du service public de transport des marchandises. Parallèlement, l’État a confié à la Compagnie méridionale de navigation (CMN) le complément du service public de transport des marchandises. Une subvention - dont le montant est à réviser tous les 5 ans - est la contrepartie des obligations de service public définies dans un cahier des charges.
Les lois du 30 juillet 1982 puis du 13 mai 1991 dite loi Joxe, ont conféré la responsabilité de la continuité territoriale à la Région qui deviendra la Collectivité territoriale de Corse (CTC) en lui transférant une pleine compétence pour l’organisation du service des transports maritimes et aériens entre la Corse et le continent ainsi que les ressources correspondantes. Depuis un premier appel d’offres en 2002, cette organisation est désormais mise en œuvre sous un régime de délégation de service public (DSP) par l’Office des transports de la Corse (OTC), un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de la CTC. Le dispositif de continuité territoriale repose à la fois sur le régime de subventions de la DSP mais également, depuis 2002, sur un système d’aide sociale offrant des réductions tarifaires à certaines catégories de passagers (résidents de Corse, handicapés, étudiants, personnes âgées etc.). Les passagers transportés par Corsica Ferries, compagnie non attributaire de la DSP, ont été également éligibles au bénéfice de cette compensation (1).
I. UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS DÉGRADÉE
A. LA NÉCESSITÉ D’UN PLAN DE RESTRUCTURATION EN 2001
Comme l’a fait remarquer à la commission d’enquête M. Claude Gressier, désigné, en février 2005, à titre d’expert par M. François Goulard, secrétaire d’État aux transports (2), chargé de superviser le processus de privatisation et notamment de prendre des contacts exploratoires avec les entreprises susceptibles d’apporter des fonds propres à la SNCM (3) , « Si la dotation initiale était substantielle, la SNCM a connu une situation financière plus difficile lorsque l’OTC lui a demandé d’être plus productive, parce qu’il entendait augmenter la desserte aérienne ». La rentabilité de la société a été affectée par la baisse progressive de la subvention :
• 458 MF valeur 1986 dans la convention 1986-1990 ;
• 480 MF valeur 1991 dans la convention 1991-1995 ;
• 515 MF valeur 1996 dans la convention 1996-2001 (4).
L’insuffisance de la compensation pour exercice des missions de service public pendant la période 1991-2001 a d’ailleurs été retenue par la commission européenne dans la justification de la recapitalisation de 2003. En outre, la SNCM était soumise à deux contraintes : disposer d’un cash-flow suffisant pour renouveler sa flotte et faire face à une activité saisonnière, qui rendait sa trésorerie négative entre décembre et février (périodes « creuses » de l’activité), lui imposant de recourir aux banques.
Alors que son trafic était satisfaisant jusqu’en 2000, la SNCM a vu ses parts de marché décroître, dès 2001, avec le développement de Corsica Ferries, une compagnie privée. Celle-ci avait mis en place, en 1996, une liaison entre Nice et la Corse avec un navire à grande vitesse sous pavillon français, et a proposé, en 1999, quand le cabotage s’est ouvert aux pays appartenant à l’Union européenne des allers et retours sous pavillon italien entre le continent et la Corse, ce qui revenait moins cher.
Ainsi que le souligne M. Pierre Mattei, directeur général de Corsica Ferries France, « nous avons pris acte de la dérogation en vertu de laquelle les entreprises existantes assurant le cabotage avec les îles se verraient accorder un délai pour se restructurer, ou se structurer, ou investir en fonction des échéances – 1999 pour les pavillons, 2001 pour l’échéance des concessions encours avec la Corse – nous nous sommes adaptés. Nous avons anticipé l’ouverture à la concurrence ».
Compte tenu de ces différents facteurs, les comptes se sont dégradés : le résultat net était de -26 M€ en 2001 et sa trésorerie déficitaire en fin d’année de 76 M€ (5).
L’État a donc décidé de procéder à une augmentation de capital afin que la SNCM reconstitue ses fonds propres, améliore sa trésorerie et mette en œuvre un plan de redressement et de productivité. En outre, une nouvelle délégation de service public devait être mise en place à partir de 2001 : « préparer l’appel d’offres supposait d’établir un plan de redressement de l’entreprise » a précisé M. Claude Gressier.
La notification en a été faite à la commission européenne, qui a donné son accord en juillet 2003 (6) pour un montant global de 76 M€. Une aide de 22 millions d’euros a été versée en 2002, suivie d’une recapitalisation. Sur la somme de 76 M€, une première tranche de 66M€ - incluant l’aide dite « de sauvetage » de 22 M€ - a été versée en 2003. Le solde de 10 M€ était conditionnel ; un peu plus de 3 seulement seraient accordés en 2005 – aide qui sera annulée en 2005 par le tribunal de l’Union européenne à cause d’une erreur de calcul sur les plus-values de cessions, comme l’a expliqué M. Benoît le Bret, chef de cabinet (7) de M. Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne, en charge des transports.
Après ces deux tranches d’augmentation de capital, 93,26 % des actions de la SNCM étaient possédées par la Compagnie générale maritime et financière (détenue à 100 % par l’État) et à 6,74 % par la SNCF. Parallèlement, un accord est intervenu entre le président de l’entreprise et la CGT, afin d’améliorer les conditions d’armement et d’augmenter la productivité.
L’approbation par la Commission européenne en juillet 2003 a été obtenue en contrepartie de la réalisation du plan d’affaires notifié par les autorités françaises, de cession d’actifs et de mesures d’encadrement de l’exploitation de la SNCM sur la desserte de la Corse jusqu’au 31 décembre 2006 :
• Le nombre de navires exploités est limité à 11 ; les éventuelles décisions de remplacement doivent être soumises à l’approbation de la Commission ;
• La SNCM ne peut pas proposer des prix plus bas que ceux de chacun de ses concurrents ;
• Le nombre annuel de rotations est limité (8).
B. DE NOUVELLES DIFFICULTÉS A PARTIR DE 2004
Le plan arrêté en 2001 prévoyait que l’équilibre serait retrouvé en 2004, ce qui n’a pas été le cas. L’entreprise n’a jamais réussi à atteindre les objectifs de ce plan, tel qu’il avait été négocié par l’ensemble des partenaires.
En 2003, le résultat général d’exploitation de la SNCM a enregistré un déficit de 12 M€ ; mais le bilan affichait un gain de 16 M€, car la société avait vendu des actifs non stratégiques (9).
Ce qui s’est passé entre 2001 et 2004 ressemble singulièrement à ce qui s’est passé à partir de 2006 : nouvel apport en capital, non réalisation du plan de redressement, récurrence des pertes d’exploitation, cessions d’actifs pour en équilibrer les comptes…
Les difficultés n’ont fait qu’empirer en 2004. Alors que, globalement, le trafic maritime entre le continent et la Corse était en baisse – diminution du nombre de passagers de 3,5 % en 2004 après avoir augmenté de 3,3 % en 2003 - Corsica Ferries a su développer son offre, ce qui a fait chuter le chiffre d’affaires de la SNCM vers la Corse de 20 % par rapport à 2003 (10) . Corsica Ferries a en effet ouvert une desserte au départ de Toulon, mis en service un nouveau navire Méga express, lui permettait d’augmenter son rythme de rotation et mené une politique tarifaire agressive (« véhicule à 1 € ») sur la ligne principale de Bastia. En 2004, Corsica Ferries devient le premier opérateur desservant la Corse, avec un million de passagers, ce qui représente 48 % des parts de marché, contre 43 % pour la SNCM.
D’autres facteurs peuvent expliquer les écarts avec le plan de restructuration. En 2004 et 2005, la SNCM a subi plus fortement la hausse des coûts de carburant que ses concurrents en raison d’une hausse des prix très marquée du gasoil, notamment utilisé pour les navires à grande vitesse (NGV) aujourd’hui abandonnés. Les coûts d’entretien des navires ont connu une très forte dérive à partir de 2004, du fait du vieillissement de certains navires mais aussi d’une sinistralité importante. La SNCM n’a pas été remboursée intégralement des charges patronales Assedic et allocations familiales (dites « non ENIM »), à l’instar de l’ensemble des compagnies maritimes françaises, alors que le plan présenté à la Commission européenne reposait sur l’hypothèse d’un remboursement intégral. Il s’en est suivi un manque à gagner pour la compagnie de 5,9 M€ pour la période 2002-2004.
En outre, trois grèves sont survenues la même année, deux du Syndicat des travailleurs corses (STC), l’une en février, l’autre en septembre, et la troisième lancée par des officiers, en juin. En fin d’année, le résultat net enregistrait un résultat net de -29 M€ ; la trésorerie était déficitaire de 76 M€. Les grèves de 2004 lui ont fait perdre 200 000 passagers, et 5 M€, comme l’a indiqué M. Christian Frémont, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-Rhône (11). Elles ont en outre eu des répercussions non négligeables sur l’image de la société.
Par conséquent, a souligné M. Jean-Louis Girodolle, sous-directeur (12) de l’Agence des participations de l’État (APE), « le chiffre d’affaires n’a pas suivi la trajectoire prévue, du fait essentiellement de la concurrence et d’un exercice 2004 difficile pour l’ensemble du tourisme en Corse. Surtout, les mesures d’adaptation n’ont pas été réalisées, en particulier le départ de 300 personnes inscrit dans le plan, pour faire passer l’effectif de 2 400 à 2 100 personnes ».
M. Christian Frémont a précisé à la commission qu’au contraire, en 2004, on comptait 1 644 navigants contre 1 599 en 2001. D’ailleurs, la compagnie rivale, Corsica Ferries exploitait le même nombre de bateaux avec la moitié moins de personnel. Pour avoir suivi les difficultés de Brittany Ferries lorsqu’il était préfet du Finistère, il avait pu constater que les dépenses de personnel y représentaient 26 % du budget, contre 56 % à la SNCM.
La structure même du compte de résultat était anormale : on a constaté pour 260 M€ de chiffre d’affaires (190 M€ + 70M€ de subvention) 100M€ de charges de personnel et presque 160 M€ d’achats et de charges externes, même avant l’envolée des prix du pétrole : l’exploitation ne produit aucune ressource. La capacité d’autofinancement était donc nulle ou négative, ce qui ne permettait pas de renouveler la flotte ; or 40M€ sont nécessaires.
En novembre 2004, les commissaires aux comptes ont lancé une procédure d’alerte auprès du tribunal de commerce auquel le président de l’entreprise a demandé de désigner un mandataire ad hoc pour essayer de convaincre les banques de maintenir leur concours, ce qu’elles refuseront à l’été 2005. Le 22 décembre 2004, le président de la SNCM, M. Bruno Vergobbi, est venu avertir le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur « d’une catastrophe imminente » parce que les deux banques qui le soutenaient, à savoir le Crédit agricole et la Deutsche Bank, lui avaient fait savoir qu’elles n’assureraient pas la fin du mois ».
Pour M. François Goulard, secrétaire d’État aux transports et à la mer (13) « les comptes étaient mauvais, la société perdait des parts de marché, la situation sociale était difficile-c’est une litote ».
La dégradation se poursuit en 2005, puisqu’à la fin de l’année, comme l’a indiqué M. Denis Samuel-Lajeunesse, ancien directeur général (14) de l’APE, la trésorerie était négative de 70 M€ et la dette représentait près de trois fois les fonds propres La part de marché de la SNCM sur la desserte Corse –continent est passée de plus de 80 % en 2000 à 34 % en 2005 : M. Jean-Louis Girodolle, sous-directeur à l’APE, a souligné devant la commission que « pour une entreprise souffrant de rigidités – une flotte abondante et pas toujours adaptée, des difficultés à engager des réformes internes - voir sa part de marché divisée par deux et demi en l’espace de 5 ans est un choc massif dont quasiment aucune entreprise ne pourrait se relever. C’est ce qui explique les 70 millions de découvert à la fin de 2005 et des dettes à hauteur de 220 millions face à des fonds propres de 60 millions ».
Le chiffre d’affaires s’est élevé à 183,3 M€, en diminution de 5,3 % par rapport à l’année précédente, et le résultat net à 29 M€.
La conclusion revient à M. Christian Frémont : « la crise qui a éclaté n’avait vraiment rien d’un coup de tonnerre dans un ciel serein ».
II. UN ÉTAT LARGEMENT RESPONSABLE DES DIFFICULTÉS DE LA SNCM
Comme l’a fait remarquer M. François Goulard, l’État choisit mal les dirigeants de ses entreprises publiques ; la décision se prend au plus haut de l’appareil d’État pour une grande entreprise, mais le Président de la République ou le Premier ministre ne peut pas y consacrer beaucoup de temps, contrairement à ce qui se produit dans le secteur privé, ou on y met beaucoup de soin. En outre, on choisit souvent un haut fonctionnaire, qui n’a pas toujours une expérience antérieure de l’entreprise : « l’État, en tout cas c’est mon point de vue, a la faiblesse de choisir souvent assez mal ses dirigeants ».
L’État, en outre, est vulnérable : il « est plus sensible qu’un autre actionnaire aux menaces de grève et de blocage de tous ordres. Il y a là une faiblesse structurelle par rapport à une entreprise comme la Méridionale, entreprise purement privée, dirigée par un homme qui est là depuis longtemps et qui connaît donc par cœur son entreprise ».
Ainsi que l’a estimé M. Camille de Rocca Serra devant la commission, l’État avait pour but essentiel la préservation des emplois : « tous les gouvernements ont suivi la même orientation, c’est-à-dire faire vivre la SNCM pour préserver les emplois –deux tiers sur le continent et un tiers sur l’île, y compris le personnel navigant corse. Je ne me priverai pas de dire et de répéter que l’État a été un mauvais actionnaire, de la SNCM comme d’autres entreprises. Elle n’a pas eu la chance, comme Air France, d’avoir de grands présidents ayant réussi à ouvrir le capital ».
L’État était d’autant plus prudent que les relations sociales étaient particulièrement difficiles, a souligné M. François Goulard : « parmi les difficultés de tous ordres, il me faut insister sur les relations sociales, extrêmement particulières. Pourtant, j’ai une assez longue expérience des relations sociales dans différents contextes. À l’époque, je voyais ce qui se passait à la SNCF et à la RATP, et cela n’avait rien de comparable avec la SNCM en proie à la surenchère permanente entre organisations syndicales et à des comportements que je n’ai jamais vus nulle part ». Afin d’expliquer son souhait de déposer une offre pour le rachat de la SNCM, M. Stéphane Richard explique, qu’en tant qu’entrepreneur, la Connex avait plus de chances de réussir que l’État, qui « ne pouvait être ni un bon actionnaire, ni un bon patron dans une société où les partenaires sociaux avaient toujours été à couteaux tirés».
M. Camille de Rocca Serra ajoute devant la commission qu’en 1999, la SNCM va déjà mal et que l’actionnaire, l’État « n’a d’autre but que d’assurer la paix sociale dont le prix exorbitant prive l’entreprise d’une stratégie d’avenir : il faut éviter le feu à Marseille, en Corse, et neutraliser l’activisme du syndicat dominant. Toujours dans une optique d’emploi, il a fallu acheter des bateaux à nos chantiers navals, où ils coûtent plus cher à construire ».
D’ailleurs, à ce moment, « le gouvernement fait le choix politique, critiquable comme tout choix de cette nature, mais compréhensible, de garantir la viabilité de la SNCM en lui garantissant la DSP à Marseille….la SNCM se voyait donc, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert, garantir sa position et, partant, l’emploi ».
L’État n’a pas pris à temps les mesures qui s’imposaient. M. Christian Frémont résume ainsi les différents griefs que l’on puisse adresser à l’État : les difficultés de la SNCM « s’étaient fortement aggravées avec l’apparition de Corsica Ferries et aucun gouvernement, de droite comme de gauche, n’avait jamais rien fait pour essayer d’y mettre de l’ordre. La valse des présidents était là pour le prouver : six en dix ans. Quelle entreprise résisterait à pareil traitement ? Il y avait eu des tentatives de restructuration sous les gouvernements Juppé et Jospin, mais elles avaient avorté ».
M. Francis Lemor, Président de la Compagnie méridionale de navigation (CMN) - ou La Méridionale - dans un document remis à la commission, est plus brutal : « l’État, piètre actionnaire par nature, a laissé la SNCM s’enfoncer depuis de nombreuses années dans une gestion approximative, accumulant les sureffectifs, les investissements inadaptés au trafic avec la Corse, l’emprise croissante de la CGT et du STC, l’ensemble permettant à un nouvel entrant – Corsica Ferries – de prendre plus de 50 % du marché en quelques années
Plus de six présidents, essentiellement des hauts fonctionnaires et non chefs d’entreprises, se sont succédé en 10 ans sans mettre en œuvre aucun plan de redressement de peur de déclencher des conflits sociaux bloquant la Corse, dossier toujours sensible sur le plan politique.
Les conflits sociaux n’ont pourtant pas manqué minant la crédibilité de la compagnie auprès de la clientèle et faisant le lit du développement foudroyant de Corsica Ferries ».
La Commission des participations et des transferts, saisie par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, se montre tout aussi sévère : « la Commission observe que la SNCM a été conduite à la situation critique qui s’est révélée pleinement durant l’été 2005 à la suite de longues années de gestion insatisfaisante de la société pendant lesquelles les décisions indispensables au redressement ont été inconsidérément retardées et les plans de restructuration qui avaient été tardivement arrêtés n’ont pas été eux-mêmes mis en œuvre, rendant vains les efforts financiers importants consentis par l’État. Le contexte social a joué un rôle primordial dans cette situation » (15).
III. DES RÈGLES EUROPÉENNES STRICTES INTERDISANT UNE NOUVELLE RECAPITALISATION
Lors du plan d’aide à la restructuration de 2002-2003, la Commission européenne avait autorisé le versement de 76 millions d’euros (66 millions d’euros fermes plus 10 millions conditionnels), dont un peu plus de 3 seulement seront accordés en 2005, aide qui sera annulée en 2005 par le tribunal de l’Union en raison d’une erreur de calcul sur les plus-values de cession.
Cette décision contraint la marge de manœuvre de la France et de la Commission car s’applique la règle du « one time, last time », soit « une fois pour toutes ». Aucune aide d’État ne peut être attribuée à une entreprise dans les 10 ans suivant l’octroi d’une première aide. Une aide d’État est une aide à la restructuration ou au sauvetage : elle ne doit financer ni la recherche, ni la sauvegarde de l’environnement, ni correspondre à une compensation de service public. Il s’agit de financements destinés à des entreprises en difficulté, et qui doivent être renflouées par la puissance publique. Les aides doivent garantir le retour à la viabilité et être autorisées par la Commission dans un cadre strict.
Comme l’a indiqué à la commission d’enquête M. Benoît le Bret, chef de cabinet de M. Jacques Barrot, alors vice-président de la Commission européenne en charge des transports, « en 2005, il s’agissait donc, d’une part de combler le vide juridique laissé par l’annulation du plan de 2003, en corrigeant les erreurs de calcul puisque le tribunal ne remettait pas en cause le principe d’une aide à la restructuration ; d’autre part de recevoir les nouvelles demandes de l’État français consécutives à l’évolution de la SNCM. Il allait de soi qu’une nouvelle aide à la restructuration était inenvisageable, de quelque façon que ce soit. Il fallait certes remplacer la décision de 2003 dans le contexte de 2005, mais toute nouvelle aide d’État aurait été incompatible avec les règles européennes. Il n’était donc pas question de recourir aux finances publiques avant 2012 ou 2013 pour faire un nouvel investissement ou éviter la liquidation, sinon sur la base d’une compensation de mission de service public ou du comportement d’investisseur avisé. Le cadre est donc celui d’un continuum juridique sous contrainte dans lequel une restructuration ne pouvait mobiliser une nouvelle fois les finances publiques en vertu d’une règle communautaire quasi intangible.
Pour qualifier d’avisé le comportement de l’État, c’est-à-dire pour qu’il n’accorde pas d’aide au sens des traités, les critères à remplir sont notamment l’injection concomitante d’argent public et d’argent privé, et l’analogie du comportement public et du comportement privé ».
Décision de la Commission du 9 juillet 2003
Concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM)
(370) La Commission rappelle à la France les éléments suivants:
— la période de restructuration s'achève pour la SNCM au 31 décembre 2006,
— en vertu des lignes directrices (134), toute aide individuelle destinée à favoriser l'investissement matériel qui est projetée, pendant la période de restructuration, en faveur de la SNCM ou de l'une de ses filiales dans le cadre d'un régime d'aides approuvé par la Commission devra être notifiée individuellement à la Commission,
— en vertu des lignes directrices, une seconde aide à la restructuration ne pourra normalement pas, sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles et non-imputables à l'entreprise, être envisagée pendant les dix années qui suivent la fin de la période de restructuration, c'est-à-dire dans le cas d'espèce, le 31 décembre 2006,
— tout nouveau projet de recapitalisation de la SNCM devra être notifié à la Commission avant la fin de la période de restructuration même si les autorités françaises estiment que ce nouveau projet vérifie le principe de l'investisseur privé en économie de marché.
Il s’agit donc d’une condition sine qua non, mais les traités n’imposent pas de privatiser ; M. Le Bret rappelle que, « lors de la rencontre de M. Jacques Barrot et de M. Thierry Breton, ministre de l’économie et des finances, il lui a été rappelé que « si la privatisation ne peut pas être imposée par l’Union, la présence d’investisseurs privés, leur poids dans l’opération, le caractère éventuellement temporaire de la présence de l’État au capital, joueront en faveur du dispositif. J’explique que, vu les antécédents de la société, plus il y aurait de privé, moins le projet serait suspect ».
IV. DES REPRENEURS NATURELS RARES ET PEU INTÉRESSÉS
Comme l’a souligné devant la commission M. François Goulard, il n’y avait pas pléthore de candidats. D’ailleurs, les compagnies qui se partageaient la desserte de la Corse avec la SNCM n’ont pas fait acte de candidature.
A. LE RAPPROCHEMENT ENTRE BUTLER CAPITAL PARTNERS (BCP) ET LA COMPAGNIE MÉRIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) FAIT LONG FEU
La Compagnie méridionale de navigation (CMN) - ou La Méridionale - fait partie depuis 1992 du groupe STEF, spécialiste européen de la logistique. Ce groupe deviendra son unique actionnaire en 2009. Il crée des emplois continûment depuis 20 ans, hors croissance externe : un emploi par jour, bon an, mal an, soit 300 chaque année, comme le souligne M. Francis Lemor, son dirigeant.
La Méridionale dessert la Corse depuis 1936, et depuis 1976 dans le cadre de la continuité territoriale instituée à la suite des événements d’Aléria. En 1988, elle fait son entrée sur le marché des passagers. Jusqu’à la fin de l’année 2013, elle exerce conjointement et de manière non solidaire avec la SNCM le deuxième contrat de délégation de service public, qui succédait à celui qui couvrait la période 2002-2006. Elle l’exercera encore pour la période 2014-2023 (16)
Elle opère en Corse à partir de trois ports, Ajaccio, Bastia et Propriano, avec une extension en Sardaigne (Porto Torres). Elle a transporté 273 000 passagers en 2012, 821 000 mètres linéaires de fret, pour un chiffre d’affaires de 108M€.
La CMN n’était pas intéressée par la reprise de la SNCM, bien qu’il arrive au groupe SETF qui contrôle la compagnie, même si ce n’est pas fréquent, de reprendre des entreprises en difficulté. Ainsi qu’il l’a déclaré à la commission, M. Francis Lemor aurait été informé de la future privatisation par M. François Goulard très en amont - en septembre 2004 -, puis il a eu des contacts avec son cabinet et celui du ministre de l’économie et des finances, et, enfin, avec celui du Premier ministre. Tous ses interlocuteurs souhaitaient manifestement son intervention.
M. Francis Lemor a fait valoir plusieurs arguments pour expliquer qu’il n’était pas candidat. La CMN n’a jamais possédé que des cargos mixtes (17) : « il y a dix ans déjà, et a fortiori il y a cinq ans, lors de la privatisation de la SNCM, il était clair que les car ferries n’avaient plus d’avenir : ils ont une vocation essentiellement touristique et ne conviennent pas pour le service public qui impose une fréquence de desserte […] qui, même s’ils ont été fortement subventionnés par la collectivité de Corse, ont été sous-utilisés et sont définitivement non rentables ».
Lorsqu’en février 2005, la CMN est approchée par HSBC, banque choisie par l’État comme conseil pour mener à bien la privatisation, M. Francis Lemor a répété qu’il ne pouvait pas intervenir dans une société exploitant des car-ferries.
Par ailleurs, il a souligné qu’il fallait « impérativement clarifier l’actionnariat de La Méridionale ». En effet la SNCM avait mis de l’argent dans la CMN, sans avoir d’influence en son sein : « par savoir-vivre, nous lui avons donné un ou deux postes d’administrateur, mais elle ne s’est jamais intéressée à la Méridionale, si ce n’est de façon négative… C’était moi qui avais fait entrer la SNCM à son capital parce que nous n’avions pas d’argent. Il y en avait alors un peu plus et c’était l’occasion de clarifier tout cela. Ensuite nous passerions un accord pour répondre à l’appel d’offres. J’avais donné ma parole et j’étais prêt à la confirmer par écrit. Troisième étage du schéma : après avoir obtenu – non sans mal – des administrateurs, nous prendrions une participation dans la SNCM privatisée à la condition expresse qu’elle soit inférieure à 10 %, que l’on intervienne jamais dans le management, et surtout que l’on y détache jamais personne. J’étais très réticent – et tous nos administrateurs aussi- à l’idée de mêler notre image à celle de la SNCM ».
Il a également mis l’accent sur la différence importante de culture entre les deux sociétés : « Au moment de la privatisation de la SNCM, j’ai dit à notre délégué syndical CGT d’aller faire un tour à Marseille, rencontrer ses camarades et de me dire ce qu’il en pensait. « Président, vous ferez ce que vous voudrez, m’a-t-il dit à son retour, avec l’accent, mais ceux-là, ils n’ont vraiment pas la culture et vous n’arriverez pas à les intégrer dans le groupe ». C’est exactement ce que je pensais. Pour changer l’état d’esprit d’une maison, on n’agit pas petitement, à la marge. On donne un schéma clair, précis, en n’occultant rien. La meilleure preuve de respect envers le personnel est de lui dire la vérité, toute la vérité. Ensuite, on décide. C’est ce qui aurait dû être fait et qui ne l’a pas été ».
S’agissant du personnel, il a ajouté : « le modèle de la SNCM a vécu. Il a même bien vécu à certaines périodes, mais avec de l’argent public »
Par ailleurs, la CMN avait évalué les actifs de la SNCM à 347 M€, mais ils étaient contrebalancés par des passifs tels que les pertes récurrentes : « le plan social ne couvrait qu’une partie du handicap de la société qui ressemblait au tonneau des Danaïdes, en premier lieu à cause des car-ferries, surtout tant que le printemps arabe n’avait pas eu lieu. Le passif était difficile à estimer et la prise de risque était importante ».
Étant donné qu’aucune de ses propositions n’a été acceptée, la CMN n’a pas retiré de dossier d’appel d’offres et n’a pas signé le contrat de confidentialité qui l’accompagnait : « nous n’avons donc pas été partie prenante au processus de privatisation. Néanmoins, nous avons été approchés à plusieurs reprises pour nous proposer des schémas divers et variés, dont aucun n’était susceptible de nous convenir, faute de crédibilité ».
Ultérieurement, alors que les opérations étaient déjà bien engagées, lors d’une réunion le 20 juillet 2005, Butler Capital Partners– fonds qui faisait partie des candidats « finit par accepter nos propositions. Verbalement. Comme je lui demandais de rédiger entre nous un petit protocole, il a refusé obstinément ».Des grèves dures ont éclaté ensuite : «entre-temps, Walter Butler avait oublié la parole qu’il m’avait donnée… dans le maritime, parole d’armateur vaut un écrit. J’avais oublié que je ne parlais pas à un armateur ».
M. Walter Butler apporte une autre lumière sur ce témoignage : « dans une de nos offres indicatives, la lettre d’intention du 17 juin (18) mentionnait notre bonne volonté, puisque l’État poussait à un rapprochement. STEF-TFE était un partenaire naturel de l’entreprise puisqu’elle détenait 39 % du capital de la SNCM et répondait à la DSP avec elle. J’ai vu à plusieurs reprises M. Francis Lemor. Il faut savoir qu’à l’époque, plusieurs acteurs jouaient en quelque sorte la mort de la SNCM, et sa liquidation. Nombreux étaient ceux qui espéraient qu’il n’y aurait aucune offre de reprise […] Souvenez-vous, à l’époque personne ne voulait y aller. Nous-mêmes, nous nous sommes interrogés sur l’opportunité d’investir. Et quand nous avons appris que Veolia était intéressé, nous nous sommes dit que nous n’avions aucune chance. L’État nous incitant à nous associer, il était logique que nous pensions à la Compagnie méridionale de navigation (CMN). Son dirigeant, M. Francis Lemor, ne s’est pas montré ouvert du tout. Je l’ai dit dans un échange de lettres peu aimables que nous avons eu par la suite ».
M. Jean-Louis Girodolle, sous-directeur à l’APE, fait écho à cette tentative de rapprochement entre MM. Lemor et Butler, tout en prenant acte de son échec : il a indiqué à la commission avoir assisté à une seule réunion entre M. Lemor et M. Butler « que j’ai fortement encouragé à ajouter une composante industrielle et d’armateur à son offre ; je crois que M. Lemor ne souhaitait pas apparaître en première ligne. Les relations entre STEF-TFE, la CMN et le corps social de la SNCM n’étaient pas toujours faciles, un certain nombre d’interrogations se posaient sur l’acceptabilité de la présence de STEF-TFE dans le consortium de reprise. Mais, in fine, c’est la décision de MM. Butler et Lemor de ne pas avoir fait affaire ensemble ».
B. CORSICA FERRIES S’ABSTIENT DE TOUTE PROPOSITION
Cependant, tout autres sont l’histoire et les caractéristiques de Corsica Ferries. En 1999, avec l’entrée en vigueur de l’ouverture du cabotage maritime aux États-membres de l’Union européenne, Corsica Ferries passe sous pavillon italien de deuxième rang. Selon M. Pierre Mattei, directeur général de Corsica Ferries France, « nous nous sommes adaptés. Nous avons anticipé l’ouverture à la concurrence ». Pour d’autres, elle « exerce une concurrence totalement déloyale », comme l’estime M. Walter Butler pour qui elle « contourne les engagements que nous avions souscrits s’agissant du pavillon français ».
Sa part de marché est substantielle, puisqu’elle correspond aux deux tiers des passagers et un tiers des marchandises.
L’entreprise a songé à être candidate à la reprise et ne l’a pas fait pour deux raisons : « d’une part, il était évident que ce qui serait demandé au(x) repreneur(s) serait essentiellement d’ordre social et du domaine de la restructuration, ce qui n’est pas notre spécialité ; d’autre part, il était non moins évident – et les faits l’ont démontré – que nous n’étions pas certainement le bon candidat.» a déclaré à la commission M. Pierre Mattei, ajoutant que « il n’a été un secret pour personne que nous n’avons pas la possibilité de répondre entièrement à la délégation de service public »
Il a d’ailleurs précisé n’avoir jamais été approché pour la reprise de la SNCM - même au cours du processus, lorsque les tensions étaient fortes à Marseille et en Corse – en tant qu’éventuel partenaire du groupe Butler, le candidat retenu.
C. LA TENTATION DE LA LIQUIDATION
1. Les concurrents espèrent une liquidation
« Il m’a semblé qu’il misait sur la liquidation », a fait remarquer M. Walter Butler à la commission à propos de M. Francis Lemor.
Il a souligné que, pour les syndicats, « la liquidation, c’était la fin de tout. Il était évident que Corsica Ferries allait jouer cette carte, mais Francis Lemor aussi. Après tout, il aurait pu alors racheter des bateaux à la casse, alors qu’ils avaient de la valeur. Je le dis crûment, le fait d’appartenir à la SNCM diminuait la valeur de la flotte. Nous avons été en contact un moment avec l’armement Dreyfus, mais le nombre de salariés le préoccupait. Sans avoir de preuve, je pense que la STEF avait des arrière-pensées. D’ailleurs, à la réunion où elle est venue, elle s’est demandée si la privatisation irait jusqu’au bout ».
Selon M. Stéphane Richard, ancien directeur général de Veolia Transport (19), M. Francis Lemor souhaitait la disparition de la SNCM : « M. Lemor de la CMN qui ne s’intéressait à la SNCM que pour la faire disparaître ». Il a même précisé : « La première fois que je l’ai vu, c’était à sa demande, dans son bureau, avant la date du 15 septembre. Il m’a tenu un discours assez « trash », m’expliquant que la SNCM ne devrait plus exister, qu’elle avait englouti des tombereaux d’argent public ; dénonçant la gabegie, les magouilles et les fraudes généralisées et concluant sa description apocalyptique en affirmant que la seule solution était la liquidation […] L’objectif était bien de me dissuader. Il estimait la faillite nécessaire … Avait-il l’idée de racheter ses actifs ? Probablement. Il m’a dit, « je suis formel, que la seule solution pour la SNCM, c’était qu’elle disparaisse ».
M. Pierre Mattei lui-même a indiqué : « Nous avons envisagé de reprendre certains actifs, mais nous avons abandonné cette option, puisqu’ils n’étaient pas à vendre ».
M. Dominique de Villepin a également évoqué devant la commission les tentations de démembrement qui se sont fait jour lors des difficultés de la SNCM, alors que le gouvernement de l’époque avait pour objectif la poursuite de son activité : il a rappelé « la pression des compagnies concurrentes, voire certaines tentations de démembrement de la SNCM » et évoqué, outre les objectifs des concurrents, ceux d’une organisation syndicale : « le Syndicat des travailleurs corses, qui milite depuis toujours pour le démembrement de la société afin de créer une compagnie spécifiquement corse ».
Les deux compagnies, qui auraient pu être des repreneurs naturels, ne guettaient en fait que le décès de la SNCM.
2. Le coût de la liquidation aurait été trop élevé
Selon M. Dominique de Villepin (20), l’option de la liquidation a été écartée : « à aucun moment nous n’avons envisagé une liquidation, ce qui aurait été un mauvais choix en termes d’ordre public, d’intérêt général au regard de la desserte de la Corse, et sur le plan social ». Il a également mis l’accent sur son coût : « la valorisation a été faite par l’APE, sous le contrôle de la Commission des participations et des transferts, sur la base d’expertises tierces qui, toutes, arrivaient à la conclusion que les coûts de liquidation excéderaient la valeur des actifs de plus de 200 millions d’euros ».
Le rapport de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF) réalisé en septembre 2005 avec l’appui de Ernst & Young, a estimé que le coût de la liquidation judiciaire de la SNCM serait compris entre 318,4 M€ et 125,8 M€, hors dommages collatéraux, et que le coût de la liquidation amiable serait compris entre 367,2 M€ et 150,7 M€, hors dommages collatéraux.
Une étude d’Oddo Corporate Finance et Paul Hastings du 29 mars 2006, a été réalisée dans le cadre d’un mandat confié par l’Agence des participations de l’État. Oddo Corporate Finance a souhaité s’adjoindre les services du cabinet Paul Hastings sur l’ensemble des aspects juridiques de la mission, afin de réaliser une contre-expertise de ce modèle. Elle a porté surtout sur l’hypothèse d’une liquidation judiciaire, estimant que le scénario amiable faisait intervenir « un grand nombre de paramètres subjectifs, aléatoires et difficilement quantifiables. Elle conclut que « la liquidation judiciaire de la SNCM aboutit à une fourchette de coûts comprise entre 126,2 M€ et 148,5M€ au 30 septembre 2005, hors coûts sociaux supplémentaires estimés entre 95,2 M€ et 123,5 M€ et hors autres coûts supplémentaires difficilement quantifiables et dont l’impact négatif pourrait se révéler substantiel ».
Parmi les actifs, elle rappelle que la SNCM exploite sept navires en propre et trois navires en crédit-bail, une flotte valorisée régulièrement par le courtier spécialisé BRS. L’étude des cabinets Oddo et Hastings rappelle effectivement cette valorisation régulière par ce courtier, dont la dernière étude, actualisée à juillet 2005, fait état d’évaluations conformes à la valeur vénale brute des navires présentée dans le rapport de la CGMF. Elle considère qu’une décote moyenne comprise entre 20 % et 35 % s’applique à la valeur vénale brute des navires, en raison de « l’impact de la spécificité des navires de la SNCM » – leur construction est adaptée aux dessertes assurées par la SNCM – et en raison de « l’impact financier négatif sur la valeur vénale d’une mise sur le marché de l’ensemble des navires SNCM », un risque d’engorgement du marché étant lié à sa capacité d’absorption limitée. La décote estimée par la CGMF correspondait à une fourchette de 10 à 50 %.
Mais des facteurs supplémentaires justifient la décote selon l’étude d’Oddo/Paul Hastings : « l’état des navires, sur lequel Bureau Veritas émet notamment un certain nombre de réserves dans ses derniers audits techniques, la mise en conformité avec les normes internationales de sécurité maritimes en vigueur … le risque de constater, en cas de conflit social lié à une liquidation de la SNCM, des détériorations significatives sur un ou plusieurs navires ».
Selon l’étude, « sur la base d’une valeur vénale brute estimée à 224M€, et compte tenu des remarques précédentes, la flotte en détention propre se trouve valorisée à 150,7 M€ après décote, commission de courtage et aléa judicaire. La valeur des immobilisations corporelles est ainsi portée à 161,9 M€ après intégration de la valeur de la cession des terrains et constructions ».
Après avoir tenu compte également des filiales et participations détenues par la SNCM (la CMN, la CGTH, Aliso, et SudCargos), à hauteur de 32,7 M€, des créances d’exploitation d’un montant de 10,2 M€, et d’une trésorerie affichant un déficit de 14,5 M€, elle conclut à une valeur des actifs du bilan social de 190,3 M€.
(en M€)
Immobilisations incorporelles |
0,0 |
Immobilisations corporelles |
161,9 |
Immobilisations financières |
32,7 |
Actif immobilisé |
194,6 |
Stocks |
0,0 |
Avances et acomptes |
0,0 |
Créances clients |
0,8 |
Autres créances |
9,4 |
Trésorerie nette |
-14,5 |
Actif circulant |
-4,3 |
Valeur des actifs |
190,3 |
Quant au passif, figurent, pour le passif dit « privilégié », notamment, le plan social conventionnel (coûts liés à la rupture du contrat de travail), les pertes intercalaires (hypothèse du versement des salaires sur un seul mois) et la mutuelle des retraités (usage selon lequel la SNCM prend en charge une partie des cotisations de mutuelle complémentaire) ; le passif « non privilégié » comporte la valeur des trois navires exploités en crédit-bail, le plan social extra-conventionnel, les pénalités de rupture des contrats.
S’agissant plus particulièrement des navires exploités en crédit-bail, l’étude considère que la décote de cession appliquée aux navires en détention propre est également justifiée dans ce cas ; en revanche, l’aléa judiciaire ne s’applique pas car les navires sont cédés par les banques créditrices des GIE et un coût financier de portage doit être pris en compte. Elle conclut que « la cession des navires en crédit-bail dégage un produit net de 144,8 M€ ; les économies d’impôt et les dettes bancaires s’élevant à 193,5 M€, il subsiste un solde de dettes bancaires à rembourser de 48,7 M€ ».
En conclusion, la liquidation judiciaire aboutit à une fourchette de coûts comprise entre 126,2 M€ et 148,5 M€, se décomposant ainsi :
(M€)
Borne basse |
Borne haute | ||
Valeur des actifs du bilan social |
190,3 |
||
Passif privilégié (21) |
-167.8 |
||
Valeur résiduelle du bilan liquidatif |
22,5 |
||
Passif non privilégié (22) |
-170,9 |
||
Coûts en cas de comblement de passif (23) |
126,2, |
-148,5 | |
Coûts sociaux supplémentaires (24) |
-95,2 |
-123,5 | |
Total des coûts quantifiés |
-221,4 |
-272,0 |
Une évaluation réalisée en mars 2006 produit des montants très semblables, excepté en ce qui concerne un élément nouveau lié à l’évolution du coût du plan de sauvegarde de l’emploi majorant les coûts de 150 M€, « ce qui démontre la très forte sensibilité des hypothèses au contexte social de la SNCM ».
Votre rapporteur est en complet désaccord avec cette étude qui a réduit de façon peu réaliste la valeur de la flotte de la SNCM.
En effet, comment croire à ces chiffres puisque les faits – comptables et incontestables s’agissant de valeurs constatées lors des cessions d’actifs – les ont totalement contredits moins de trois ans après ces évaluations ? Molière a très justement qualifié ce type d’évaluation : « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ».
Quid, en effet, des plus-values constatées ultérieurement sur les actifs de la SNCM puisqu’au total BCP réalisera une plus-value de 60 millions d’euros en revendant ses titres à Veolia ?
La participation de la SNCM dans la CMN sera cédée pour 45 millions d’euros et le siège social pour 15 millions d’euros.
Bien entendu, la différence réside pour l’essentiel dans le lien qui est fait entre la valeur des actifs et le « contexte social de la SNCM », ce qui est une appréciation très relative et très subjective. On peut simplement dire que ni la cession à BCP, ni la valeur des parts détenues dans la CMN, ni la valeur du siège social n’ont eu à pâtir de ce contexte social particulier…
***
Dès l’origine, cette opération de privatisation s’engage sous la contrainte du fait de la réglementation européenne et dans la précipitation car la compagnie est financièrement à bout de souffle. L’État est en grande partie responsable de la situation. En raison d’un écho médiatique et local très important et de la capacité supposée du blocage syndical, il a mal géré la SNCM et n’a pas fait ce à quoi il s’était engagé : il n’a même pas conduit les plans de redressement qui devaient être financés par les recapitalisations. Il a attendu passivement que les difficultés de trésorerie deviennent insurmontables ; la privatisation n’a même jamais été envisagée autrement que dans la précipitation.
Sans méconnaître les difficultés qu’a rencontrées le gouvernement dans le dossier de la SNCM et qu’ont rencontrées les gouvernements de tous bords, trois éléments critiques doivent néanmoins être indiqués.
Le premier est que lorsque l’on souhaite vendre quelque chose, on cherche plutôt à en souligner la valeur présente ou le potentiel plutôt qu’à le présenter comme un bien sans valeur voire dangereux pour la santé financière de l’acquéreur.
Les discours à cet égard des pouvoirs publics sont à tout le moins maladroits et parfois erronés. Ainsi lorsqu’il est indiqué par M. Goulard que la SNCM accumule les pertes en confondant la perte d’exploitation et les subventions versées au titre de la DSP.
Les subventions versées au titre de la DSP sont la compensation de sujétions de service public qui ont un coût réel et non pas une compensation de perte d’exploitation imputable à une mauvaise gestion. Au prorata des sujétions imposées dans les mêmes conditions, la CMN reçoit, sur les mêmes bases de calcul, les mêmes compensations de la DSP.
Par la suite, Corsica Ferries recevra 14 millions « d’aide sociale » par an, c’est-à-dire une compensation forfaitaire par passager sans aucune obligation autre que la pratique des réductions tarifaires pour certaines catégories de passagers (personnes handicapées, séniors, étudiants etc…), ce qui est le propre de tout transporteur du monde, et de faire une rotation par semaine… Personne ne dira pourtant que cette compagnie reçoit une « subvention » de 14 millions par an – l’équivalent de la perte récurrente moyenne de la SNCM – en compensation de ses pertes éventuelles.
En revanche, la comparaison avec la CMN est significative. Si l’on examine l’exploitation des cargo-mixtes de la CMN et ceux de la SNCM, on constatera que, par la taille et les caractéristiques, il s’agit de navires presque jumeaux, que leurs personnels sont embauchés sous le même régime et le même pavillon, que les dessertes sont identiques et que les compensations reçues au titre de la DSP sont équitablement réparties au regard du service imposé. Or, la CMN réalise, selon M. Lemor, une marge moyenne de 3 %, et la SNCM un déficit d’exploitation récurrent de l’ordre de 5 % ...
DEUXIÈME PARTIE : POURQUOI UNE PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES ET À QUELS PRIX ?
I. UN APPEL D’OFFRES INOPÉRANT
Au cours de leur audition, les deux hauts fonctionnaires en responsabilité de l’opération au sein de l’Agence des participations de l’État (APE), MM. Denis Samuel-Lajeunesse et Jean-Louis Girodolle, ont d’emblée mis l’accent sur le strict « juridisme » de la procédure :
« Conformément aux lois de privatisation de 1986 et 1993, on distingue les entreprises directement détenues par l’État (titre II) et les entreprises indirectement détenues par l’État (titre III), ce qui était le cas de la SNCM détenue via une holding, la CGMF. Le titre III ne pose aucune règle de procédure particulière : il prévoit simplement pour les entreprises d’une certaine taille un décret pris sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Néanmoins nous avons décidé de nous placer sous l’angle des règles plus contraignantes du titre II, lequel distingue deux catégories de cessions. D’abord, les cessions sur le marché, c'est-à-dire la mise en bourse, dont la SNCM ne relevait à l’évidence pas. Ensuite, les cessions dans le cadre d’un « appel à des acquéreurs hors marché », c'est-à-dire hors le marché financier. Dans ce cas la loi prévoit un appel d’offres, soit sur cahier des charges, soit sous le contrôle d’une personnalité qualifiée. C’est donc dans ce cadre-là que nous avons appliqué les règles de procédure et nous avons recommandé au ministre, qui l’a accepté, que la Commission des participations et des transferts exerce un contrôle plein et entier sur la conduite de l’opération, tant du point de vue de la procédure que du prix ». (Déclaration de M. Girodolle).
La procédure, conforme aux dispositions légales, n’était donc pas celle d’une offre publique de vente (OPV) mais celle de la vente de gré à gré après appel d’offres, un processus déjà choisi, dix années auparavant, pour privatiser la Compagnie générale maritime, (CGM), une autre compagnie importante qui était, elle aussi, détenue par l’État au travers de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF).
Toutefois, l’APE n’existait pas à cette époque, cette structure ayant été créée qu’en 2003 et véritablement mise en place dans l’année suivante. La privatisation de la SNCM est une des premières opérations de cession majoritaire voire globale dont le processus a été entièrement diligenté par l’APE (d’importantes cessions de participations mais minoritaires et dans le cadre d’OPV avaient cependant été précédemment réalisées avec le concours de l’APE : ouvertures du capital de France Telecom, d’Air France de GDF puis d’EDF).
Le respect d’une procédure est un fait. Mais il s’agit, en l’espèce, de s’interroger sur l’adaptation d’un cadre normatif au processus de cession d’une entreprise aussi particulière que peut l’être un opérateur maritime certes déficitaire mais chargé d’une mission de service public donnant lieu à des compensations financières. La procédure initiale, d’ailleurs conduite de Paris non sans un certain aveuglement, n’était-elle pas surdimensionnée au regard des perspectives de recettes nettes pour l’État actionnaire, au terme d’une opération qui ne réglera rien à moyen terme ?
Le précédent de la privatisation de la Compagnie générale maritime (CGM) aurait pu alerter les pouvoirs publics. L’État avait dû, à l’époque, supporter au total près de 2,8 milliards de francs en apports divers destinés à renflouer la CGM pour pouvoir la céder (au terme d’un appel d’offres qui aboutit aussi qu’à ne retenir au final deux candidatures) pour ... 20 millions de francs seulement à la Compagnie maritime d’affrètement (CMA) dirigée par M. Jacques Saadé qui constituera le groupe CMA-CGM. Cette opération avait donné lieu à de nombreuses critiques et dénonciations. Elle aura été une médiocre affaire pour l’État et un excellente opportunité pour le repreneur qui obtint ainsi un fonds de commerce et des actifs de valeur, lui offrant rapidement d’exceptionnelles perspectives de croissance grâce à une gestion dont l’entreprise CGM n’avait, il est vrai, jamais fait l’objet auparavant.
À dix années d’intervalle, des similitudes ont ainsi caractérisé les privatisations de deux compagnies maritimes, des filiales de la holding publique CGMF, certes sensiblement distinctes dans leurs positionnements commerciaux et leurs tailles respectives.
Mais la principale différence tient à la personnalité économique du repreneur : si certains errements ont effectivement marqué la privatisation de la CGM, l’acquéreur choisi par l’État était un spécialiste reconnu du transport maritime. Dans le cas de la SNCM, le « gagnant » de l’appel d’offres était un pur financier, le créateur d’un fonds dit de retournement d’entreprises en difficulté qui ne justifiait d’aucune expérience dans les activités maritimes. Il ne pouvait donc pas prétendre à une légitimité minimale vis-à-vis des autres acteurs d’un secteur aussi spécifique et, évidemment, des salariés dont il était appelé à devenir le patron.
En validant le choix de Butler Capital Partners (BCP), le gouvernement de Dominique de Villepin ne s’est d’ailleurs pas suffisamment interrogé sur les perspectives de stabilité pouvant résulter d’une telle décision pour la détention du capital de la SNCM. La nature de l’actionnariat appelé à contrôler la compagnie pouvait poser problème. En évoquant cette question, votre rapporteur ne s’interroge évidemment pas sur la nationalité de M. Walter Butler que d’aucuns, notamment dans certains milieux syndicaux marseillais, ont cru étrangère, ce qui d’ailleurs ne poserait pas de problème en soi.
M. Butler est, faut-il le rappeler, un ancien haut fonctionnaire français, d’ailleurs ancien élève de l’ENA puis membre d’un cabinet ministériel, avant de rejoindre le monde des affaires et d’intégrer, dans un premier temps, la banque Goldman Sachs à New York. Le fonds BCP qu’il a créé a son siège social à Paris.
Comme le démontrera la suite des événements et notamment le pacte d’actionnaires qu’il sera amené à conclure, M. Butler s’est engagé dans le dossier de la SNCM non seulement en tant que représentant du fonds BCP mais également pour le compte d’un fonds commun de placements à risques (FCPR) dénommé « France Private Equity III ». Les « Partners » de M. Butler comme les souscripteurs de ce FCPR, géré et contrôlé par lui, ne sont évidemment pas tous français. Il est probable que leurs exigences de rendement concernant un investissement soient beaucoup plus puissantes que l’affectio sociétatis susceptible de les impliquer à l’égard d’une compagnie maritime comme la SNCM.
II. UNE PRIVATISATION « À DEUX TOURS » : UN MONTAGE EN URGENCE
La privatisation de la SNCM n’a évidemment pas été conduite dans un cadre dénué de fondements juridiques. Il reste néanmoins possible de soulever la question sinon d’un certain simulacre procédural mais, un tout état de cause, de l’inadaptation des règles mises en œuvre s’agissant d’une entreprise aussi atypique. Au point de son développement, votre rapporteur tient cependant à souligner que les travaux de la commission d’enquête ne permettent en aucune façon de penser que M. Butler et les associés qu’il représente auraient été préalablement mis sur la piste d’une bonne affaire grâce à certains renseignements amicalement distillés.
M. Butler et ses collaborateurs ont respecté le cheminement procédural que les textes mis en œuvre leur imposaient. Les fonctionnaires en charge du dossier ont sans nul doute scrupuleusement veillé aux obligations imparties aux candidats. M. Samuel-Lajeunesse, ancien directeur général de l’APE, a tenu à préciser devant la commission d’enquête : « Une banque conseil, HSBC, a été sélectionnée par un comité présidé par M. Deguen, une personnalité qualifiée. M. Claude Gressier a été désigné pour suivre le processus et en attester la qualité à toutes les étapes ; la Commission des participations et des transferts a été sollicitée par le ministre et associée étroitement à l’ensemble du processus puisqu’elle nous a auditionnés cinq fois en quinze mois. Toutes ces opérations ont été réalisées sous le contrôle du ministre et de son cabinet, ainsi que du Premier ministre en collaboration étroite avec le ministère des transports ».
Le caractère inopérant de la procédure initialement choisie est néanmoins évident. Il a fallu procéder à un deuxième tour de la privatisation qui a abouti à un « montage » : le fonds BCP demeurant le principal actionnaire de la SNCM s’est trouvé associé à Veolia, en qualité de spécialiste des délégations de service public, à l’État, « sleeping partner » auto-désigné et à des salariés actionnaires en tant que caution sociale.
En effet, le choix de BCP comme unique repreneur était donc si peu judicieux et économiquement si peu crédible qu’il ne résista pas longtemps aux réactions, certes puissantes, qui se manifestèrent dès son annonce.
En effet, dans les jours suivants la proclamation de ce résultat, le Premier ministre a dû en toute urgence annoncer un maintien de l’État au capital de la SNCM (25 %). Il a également décidé de « réactiver » la recherche d’un autre actionnaire susceptible de présenter la qualité d’« opérateur industriel », en l’occurrence Veolia Transport. À charge pour cette entreprise de s’accorder avec le fonds BCP qui, après une reprise à 100 % du capital de la SNCM, se voyait ramener au rang d’associé, mais toujours premier actionnaire puisqu’il conservera 38 % du capital. M. Stéphane Richard, ancien directeur général de Veolia Transport a clairement précisé à la commission : « La grande préoccupation du ministre de l’économie et des finances de l’époque [M. Thierry Breton], c’était que la procédure engagée aille à son terme et soit incontestable. Il n’était donc pas question de délégitimer Butler ». Il reste à s’interroger sur une question : pourquoi le « perdant du premier tour », le fonds Caravelle n’a-t-il pas engagé un recours contre cette seconde phase de la privatisation intégralement négociée en coulisses, Son offre initiale était-elle simplement l’expression d’une candidature de témoignage ?
BCP se trouvait juridiquement et économiquement en position de force pour renégocier ses droits tant avec l’État qu’avec Veolia. Ce fait a été confirmé devant la commission d’enquête par M. Stéphane Richard, de même que par M. Henri Proglio qui a, lui aussi, souligné que dans la situation ainsi créée M. Butler était « incontournable » en ajoutant : « De fait, il [M. Butler].se trouvait dans une bien meilleure position pour valoriser sa plus-value latente que s’il avait été le seul propriétaire ».
III. LE « PRIX NÉGATIF » : UNE MÉCANIQUE DÉLIBÉRÉMENT RETENUE
L’autre point faible de la procédure qui déterminera d’ailleurs l’évolution du dossier aura porté sur l’évaluation des mises de fonds à acquitter par les repreneurs, tout particulièrement en considérant le prix payé puis la plus-value réalisée par le groupe Butler.
La commission d’enquête n’a pu disposer qu’une dizaine de jours avant la remise de son rapport des documents préparatoires au « chiffrage » officiel, en dépit de ses demandes exprimées quatre mois auparavant tant auprès du Premier ministre que du ministre de l’économie et des finances, et plusieurs fois réitérées. Ce retard qui pourrait s’interpréter comme une défiance vis-à-vis de la Représentation nationale, n’a pas empêché la commission d’enquête de se forger assez rapidement une opinion sur ces questions relatives à l’évaluation.
Cette rétention est d’autant moins compréhensible que la première des responsabilités à souligner dans le processus d’évaluation n’incombe pas aux services ou aux conseils (la banque et les avocats sélectionnés au titre de la procédure) mais au gouvernement de l’époque.
Dès la fin de l’année 2004, les ministres concernés ont en effet lourdement dramatisé la situation de la SNCM, par exemple, en additionnant les déficits d’exploitation et les subventions légalement compensatrices des missions de service public pour mieux faire ressortir un « bilan désastreux ». Tout vendeur commençant par dénigrer publiquement un bien qu’il doit céder se place, d’emblée, en très mauvaise position s’il envisage d’en obtenir le « bon » ou le « juste » prix » ! À la fin de l’exercice 2004, la situation financière de la SNCM était certes périlleuse en termes de trésorerie, mais son fonds de commerce et ses actifs (notamment ses bateaux et quelques participations) avaient une valeur positive.
De plus, il convient de rappeler que la SNCM ayant bénéficié d’un plan d’urgence de quelque 70 millions d’euros en 2002/2003, sa direction et sa tutelle ont lourdement failli en éludant toute mesure significative de redressement de la productivité en contrepartie de cet apport.
Cette carence aura pour effet de fragiliser durablement nos positions vis-à-vis des autorités européennes de la concurrence qui, aujourd’hui encore, comptabilisent ce premier apport au titre des ultimes aides d’État qu’elles avaient autorisées sous réserves de conditions qui n’ont pas été satisfaites. Dans un tel contexte, il n’est guère surprenant que l’appel à intérêt lancé auprès d’investisseurs considérés susceptibles de manifester leur volonté d’acquérir une partie du capital de la SNCM n’ait pas rencontré un réel succès. L’APE a précisé à la commission d’enquête que soixante-douze investisseurs potentiels (dont 38 étrangers) avaient ainsi été contactés par l’intermédiaire de la banque-conseil HSBC. Il s’agissait en majorité d’armateurs.
Cinq réponses ont été reçues. Toute réponse permettait de franchir une étape suivante du processus, bien entendu « non liante », et d’accéder sur la base d’un engagement de confidentialité à une data room, tenue par la banque-conseil, où étaient rassemblés les documents relatifs à la situation financière et commerciale de la SNCM. Il était évident que les grands armateurs n’allaient manifester aucun empressement pour participer à cette phase. Le secteur maritime est un monde assez restreint dans lequel tout se sait. Au regard du comportement et des déclarations de membres du gouvernement qui pourtant devaient parler au nom des intérêts de l’État-actionnaire, la situation de la SNCM était présentée comme fort mauvaise.
Les armateurs ayant généralement une bonne connaissance de la situation de leurs concurrents et de leurs partenaires en affaires (à cet égard, l’audition de M. Francis Lemor, le dirigeant de la CMN-La Méridionale, a été tout à fait révélatrice), ces professionnels ont donc préféré parier sur un pourrissement du dossier qui leur aurait ouvert d’autres perspectives, notamment le rachat « à la casse » de la compagnie voire de tout ou partie de ses bateaux dans le cadre d’une liquidation par le tribunal de commerce. Cette attitude demeure encore probablement la leur en considérant la situation actuelle de la SNCM.
En tout état de cause, l’idée de se débarrasser d’une entreprise considérée comme un fardeau économique et socialement instable avait gagné certains milieux administratifs et gouvernementaux, dès le début des années 2000. En témoignent les conditions dans lesquelles la décision de privatiser a été arrêtée et, pour l’évaluation de l’entreprise, la formule d’un prix qualifié de négatif délibérément retenue : « Nous avons donc cherché à démontrer que l’État se comportait en investisseurs avisé – c'est-à-dire qu’il prenait une décision rationnelle comme l’aurait fait un acteur économique privé – et que céder à un prix négatif était en définitive une solution moins coûteuse qu’une autre, laquelle consistait évidemment à laisser la SNCM aller dans le mur et procéder à sa liquidation » (audition de M. Denis Samuel-Lajeunesse, ancien directeur général de l’Agence des participations de l’État).
Au premier tour de la privatisation, les réponses définitives à l’appel d’offres, c'est-à-dire les deux propositions déposées au 15 septembre 2005, d’une part, par le fonds Butler Capital Partners (BCP) et, d’autre part, par le fonds Caravelle, portaient sur la totalité du capital :
BCP |
Caravelle | |
Recapitalisation de l’État |
||
Apurement du passé (pertes 2004 et 2005, risques du bilan et hors bilan) |
82 |
117 |
Préparation de l’avenir |
31 |
40 |
Total État. |
113 |
157 |
Apport du repreneur. |
35 |
20 |
Apport de fonds propres totaux. |
148 |
177 |
En millions € | ||
Plan « industriel ». |
Association avec STFE TFE (CMN- La Méridionale) Maintien de toutes les lignes de la desserte de Nice Renouvellement de la flotte |
Maintien de toutes les lignes Renouvellement de la flotte Maintien de la desserte de Nice |
M. Samuel-Lajeunesse a également déclaré à la commission d’enquête : « Des évaluations ont été réalisées par la banque-conseil et validées par la Commission des participations et des transferts. Elles tenaient compte des perspectives d’obtention de la Délégation de service publique (DSP), et c’est bien parce que celle-ci n’était pas encore acquise qu’une clause résolutoire a été prévue en contrepartie. À ma connaissance, il n’y a pas eu d’autre hypothèse que la privatisation : il nous semblait que le souhait était plutôt une privatisation à 100 %. Néanmoins, nous n’excluions rien, l’essentiel était de trouver des investisseurs. À titre personnel, j’ai toujours pensé que dans un tel cas, l’État, en restant au capital, se trouve en quelque sorte « prisonnier » et devient susceptible d’être soumis à de nouvelles pressions si les choses tournent mal ! ».
L’une et l’autre des propositions exigeaient de l’État un effort considérable au titre d’une nouvelle recapitalisation (qui s’ajoutait aux apports déjà consentis en 2002 / 2003) articulée avec une dotation dite « de préparation de l’avenir » (appellation pudique visant à désigner le financement d’un éventuel plan social d’accompagnement qui ne voulait pas dire son nom et non des investissements). Le total des moyens à engager par l’État pour conclure cette opération était manifestement très supérieur à l’apport de chacun des deux candidats souhaitant pourtant acquérir 100 % du capital de la SNCM, ce différentiel permet de qualifier de prix négatif le « net à payer » par le repreneur.
Par rapport à son compétiteur, le fonds Caravelle, M. Walter Butler et ses associés étaient effectivement « mieux disant ».
Son offre initialement acceptée par l’État permettait ainsi au fonds BCP de devenir le propriétaire de la totalité des actifs de la SNCM (avec une situation de bilan apurée) pour un montant qui aurait été de 35 millions €.
Pourtant, les ministres eux-mêmes et notamment le secrétaire d’État en charge des transports du gouvernement Raffarin, à l’initiative de la privatisation, n’ignoraient pas que la SNCM, certes dans une situation de trésorerie périlleuse, possédait des actifs de valeur : « Sans avoir de souvenirs précis – vous le comprendrez-, du côté des actifs il y avait, outre la DSP, la flotte » (audition de M. François Goulard). Sur ce point, nombreux sont les acteurs du monde maritime à considérer, dans une hypothèse très basse, que la valeur des dix bateaux de la compagnie s’établissait à plus de 150 millions € en 2005 au regard de leur état et des conditions financières de leur acquisition. Cette évaluation de 150 millions environ reste d’ailleurs inférieure à celle donnée par la SNCM elle-même s’agissant de la valeur de son « outil naval » retenue de façon conventionnelle au titre de la Délégation de service public (DSP).
IV. L’IMPORTANCE DES APPORTS ET GARANTIES CONSENTIS PAR L’ÉTAT.
Au second tour de la privatisation, lorsque l’État s’est trouvé contraint de garantir son maintien au capital de la SNCM et de rechercher un nouvel « entrant » pour épauler le fonds BCP, l’exigence commune au tandem « Veolia- Butler » portera sur un effort encore plus important de l’État afin d’apurer les pertes des exercices 2004 et 2005 et les risques au bilan et hors bilan.
Les négociations alors conduites avec ce nouveau partenariat aboutirent à une « rallonge » d’une trentaine de millions € portant la contribution financière de l’État à 142,5 millions €.
Cette contribution se traduira par une augmentation de capital intégralement libérée et souscrite par la CGMF, la holding publique contrôlant la compagnie, pour compensation des créances.
En complément, l’État s’est également engagé, par l’intermédiaire de la CGMF, à mettre à la disposition des nouveaux associés une avance en compte courant de 38,5 millions € à consacrer à un plan social de 400 départs en trois années, excluant tout licenciement « sec ».
Selon les termes du protocole d’accord conclu, le 16 mai 2006, entre la CGMF, Veolia Transport et Butler Capital Partners (BCP), ce montant « ... est destiné au financement de la fraction du coût des éventuels départs volontaires ou ruptures des contrats de travail (quelle qu’en soit la nature), dite de surgénérosité, qui viendrait en complément des sommes de toute nature devant être payées par l’employeur en application des dispositions légales et conventionnelles ». Au long des auditions ni les repreneurs ni les représentants syndicaux de la SNCM n’ont évoqué l’exécution de ce plan social. Votre rapporteur en conclut que les besoins prévisionnels correspondant à son financement ont été, dès l’origine, correctement dotés.
Au titre de son très contestable et tardif revirement de position, la Commission européenne qui avait pourtant initialement autorisé le plan de restructuration de la SNCM associé à sa privatisation, estime désormais, parmi d’autres griefs, que « l’avance en compte courant de 38,5 millions € au titre des mesures sociales couvrait des frais que la SNCM aurait dû supporter elle-même », c’est-à-dire que cette charge devait incomber aux repreneurs privés.
D’autres garanties sociales étaient également clairement précisées par l’État s’agissant de la cotisation patronale aux deux mutuelles de retraités (sédentaires et navigants) de la SNCM.
Par ailleurs, il a été possible à la commission d’enquête de consulter les procès-verbaux des conseils d’administration de Veolia Transport (et de sa maison-mère Veolia Environnement) tenus au cours des premiers mois de l’année 2006, une période au cours de la laquelle le groupe a négocié différents points conditionnant son entrée au capital de la SNCM. Votre rapporteur constate à cet égard qu’une entreprise privée se soumet de meilleure grâce aux demandes légalement fondées d’une commission d’enquête parlementaire que certains ministères et services !
Parmi les assurances obtenues de l’État, la SNCM a pu bénéficier de la réouverture d’un droit d’option à la taxe au tonnage (un régime forfaitaire plus favorable que celui de l’impôt sur les sociétés et largement adopté par les compagnies maritimes) qui permettait, nonobstant l’exercice de cette option, d’utiliser les déficits fiscaux accumulés (plus de 100 millions € au terme de l’exercice 2005) à l’occasion d’une réévaluation libre des actifs que Veolia estimait nécessaire avant la fin de l’année 2006. Cette opération permettait également de réduire d’éventuelles plus-values taxables réalisées dans le cadre du renouvellement de la flotte.
Veolia obtenait également au travers d’un projet de lettre de confort de la Direction générale des impôts (DGI) une garantie qui sécurisait la situation de la SNCM au titre du régime du « GIE fiscal » concernant tant le financement de ses bateaux exploités dans ce cadre de crédit-bail (le Danielle Casanova et le Pascal Paoli) que celui de bateaux que la compagnie pourrait acquérir. À l’automne 2006, Veolia Transport trouvera d’ailleurs un accord avec BCP et avec les banques participantes au financement et à la garantie des contrats concernant les deux bateaux précités. En l’espèce, le tandem « Veolia-Butler » n’a pas bénéficié d’un privilège mais d’une clarification indispensable : la privatisation pouvait impliquer les exigibilités bancaires et fiscales immédiates des deux « GIE fiscaux » en cours, donc se traduire par des charges incompatibles avec la situation de l’entreprise et la garantie de passif accordée dans le cadre de la privatisation. Ce type de négociation avec l’administration fiscale est d’ailleurs fréquent dans le secteur maritime s’agissant des conditions d’acquisition et d’exploitation de bateaux.
Au total, les apports et les garanties de l’État renforçaient encore un peu plus la mécanique du prix négatif délibérément considérée comme seule méthode de cession par les services en charge du dossier.
Face à un choix initial que l’État n’était plus en mesure de rectifier, il n’est pas étonnant que les seuls investisseurs ayant déposé une proposition ferme en réponse à l’appel d’offres de départ aient été les deux fonds français véritablement spécialisés dans le retournement d’entreprises en difficulté, les fonds Caravelle et BCP. La perspective d’obtenir pour quelques millions d’euros le contrôle d’une entreprise recapitalisée et offrant une garantie de passif leur ouvrait, à court terme, une possibilité de plus-value, assez peu sensible à l’élaboration d’un véritable projet d’entreprise. Les résultats du premier voire des deux exercices d’activité de la SNCM faisant suite à une telle remise en ordre devaient automatiquement être meilleurs. Il s’agissait d’un assainissement comptable, un couteux « coup de torchon » à la charge de l’État, mais non d’un réel redressement de l’entreprise. Dans ces conditions, la maitrise d’un simple business plan, non d’un projet industriel à plus long terme reposant sur des investissements, s’avérait adaptée à une stratégie qui, d’emblée, envisageait un désengagement rapide de la part du repreneur.
Telles étaient sans conteste les visées du groupe Butler, avec sa première offre sur la totalité du capital mais encore dans le cadre la seconde « mouture » de la privatisation organisant un partage du contrôle avec Veolia. Cette solution était même potentiellement moins risquée. En effet, Walter Butler a pu négocier des conditions de sortie du capital, au long d’une période de deux à sept ans après la privatisation. À cet égard, le pacte d’actionnaires qu’il a conclu avec Veolia Transport a conforté sa position au travers d’un mécanisme précisément décrit d’offres croisées d’achat et de vente des participations au capital.
Butler Capital Partners allait ainsi disposer de ce qu’il est convenu d’appeler un « PUT » vis-à-vis de Veolia. Il était libre de l’exercer à tout moment entre le 2 ème et 7 ème anniversaire du pacte.
En outre, Veolia et BCP s’interdisaient expressément au titre de ce pacte de transférer leurs titres aux sociétés CMN, Corsica Ferries, STEF-TFE « ... ainsi qu’aux affiliés de ces sociétés » (Article 3.1.3 du pacte).
A priori, le groupe Butler ne bénéficiait pas d’une garantie sur un prix de sortie minimum. La formule retenue était assise sur des éléments-clés : le chiffre d’affaires et l’EBITDA de la SNCM, après déduction de la dette financière. L’apurement comptable réalisé à la privatisation offrait cependant de réelles perspectives, du moins à court terme, si l’activité de la compagnie n’était pas trop socialement perturbée.
Les négociations entre le groupe Butler et Veolia ont sans doute été assez tendues au cours des mois de mars à mai 2006, notamment sur le multiple d’EBITDA à retenir au titre des variables à prendre en compte pour le calcul du prix de rachat de la participation de BCP. Il semble que M. Butler a fait preuve à ce sujet d’une solide capacité de résistance. Il n’a accepté qu’une faible réduction de ce multiple avec en conséquence des effets susceptibles de minorer le prix à payer par l’acquéreur (Veolia Transport) qui ne pouvaient intervenir de façon significative qu’à partir de 2009, sur la base du plan d’affaires prévisionnel. C’est dire s’il entendait bien sortir du capital avant cette date. Dans les faits, un redressement apparent de la SNCM interviendra effectivement avec, dans un premier temps, une reconquête relative de parts de marché, situation qui ne se confirmera pas. M. Stéphane Richard a d’ailleurs clairement exposé ce point : « à l’époque la SNCM ne marchait pas mal au niveau commercial et l’impact sur le résultat des reprises de provisions constituées à la privatisation se faisait sentir. D’ailleurs, Veolia Transport en a aussi profité en 2006 et 2007, même si ensuite la situation s’est de nouveau dégradée » (Audition du 13 novembre 2013).
La mise en forme par le pacte d’actionnaires d’une possibilité de désengagement après deux années de présence au capital de la SNCM ne pouvait être qu’inspirée puis mise en pratique par Butler Capital Partners (BCP).
Par sa culture d’opérateur industriel, le groupe Veolia devait d’ailleurs être à même de s’assurer au plus tôt un complet contrôle sur les activités opérationnelles de la SNCM.
Dès lors, sa position avec 28 % du capital ne pouvait être que provisoire face à un « partenaire » détenant 38 % des parts sociales et occupant la présidence du conseil de surveillance, une instance disposant d’un pouvoir d’autorisation sur les plans d’affaires et sur de nombreuses autres décisions comme, par exemple, les acquisitions, transferts ou aliénations de bateau pour un montant excédant 20 millions d’euros et qui n’auraient pas été prévus dans le plan d’affaires initial ou dans un plan d’affaires ultérieur. De plus, le conseil de surveillance coiffait deux comités spécialisés (le comité d’audit et des comptes et le comité stratégique) dont les présidences revenaient obligatoirement, selon les dispositions du pacte d’actionnaires, à un des représentants de BCP qui, en outre, devait détenir au moins la moitié des sièges de ces comités.
Le rachat, le plus tôt possible, de la participation du groupe Butler conditionnait la liberté de gestion de Veolia. Pour sa part, l’État n’a manifestement pas cherché sinon à maitriser mais au moins à peser tant soit peu sur les conditions dans lesquelles les membres du tandem « Veolia-Butler » entendaient organiser leur partenariat. Il aura ainsi été absent de l’élaboration du plan d’affaires initial de la SNCM privatisée dont les objectifs chiffrés de rentabilité sont annexés au pacte d’actionnaires entre Veolia et le groupe Butler. Ayant pourtant conservé 25 % des titres par l’intermédiaire de la CGMF, l’État s’est d’emblée comporté en simple « sleeping partner » peu désireux de conserver des droits économiques.
Au titre du protocole de cession qu’elle a signé avec les repreneurs, le 26 mai 2006, la CGMF n’a pris aucun engagement ferme concernant sa sortie du capital au nom de l’État qui estimait probablement que la durée de sa présence en tant qu’actionnaire restait subordonnée aux exigences de la Commission européenne.
Dans l’hypothèse où les autorités européennes lui auraient enjoint de céder sa participation, il était toutefois prévu que l’État dispose « ... si cela est possible techniquement » d’une promesse d’achat prioritaire de la part des autres actionnaires de la SNCM pour la reprise, à tout moment, de tout ou partie de ses titres à leur valeur nominale initiale augmentée de 10 % par an (dispositions inscrites au III.2.7 du protocole d’accord). À ce jour, cette promesse d’achat n’a pas été exercée par l’État. Un avenant au protocole d’accord initial du 16 mai 2006, a été conclu, le 4 avril 2011, entre les présidents de la CGMF (l’État) et de Veolia Transport (qui s’est substitué à la partie des droits que détenait BCP après le rachat de sa participation le 21 octobre 2008). Au titre de cet avenant signé par MM. Pierre Vieu (CGMF) et Jérôme Gallot (Veolia Transport), la promesse d’achat dont dispose la CGMF est prorogée « ... au plus tard, un an après l’entrée en vigueur de la convention de délégation de service public attribuée par la Collectivité territoriale de Corse et faisant suite à celle arrivant à échéance le 31 décembre 2013 ».
Quant à l’actionnariat salarié, son intérêt semble modestement perçu par les intéressés eux-mêmes. Il paraît également peu opérant quant à la gestion de l’entreprise, en dépit de la présence, depuis 2011, de deux représentants des salariés actionnaires au conseil de surveillance. Il ressort des auditions des représentants syndicaux que sa mise en place a été quelque peu tardive (à partir de 2009), et il fallut d’ailleurs que la direction de l’entreprise initie « une aide à l’achat » des actions par les salariés pour lancer le mouvement, selon les indications données à la commission par M. Gérard Couturier. À ce jour, cet actionnariat concernerait moins de 7 % du capital contre les 9 % prévus par le protocole de cession.
M. Maurice Perrin (CFE-CGC) a toutefois rappelé à la commission d’enquête que c’est notamment à la demande de son organisation que ce potentiel de participation a pu être fixé en 2006 car le gouvernement ne prévoyait, au titre de ses premières propositions, que 5 % du capital.
V. LA CMN : UN « PARTENAIRE » PEU DISPOSÉ À LA COOPÉRATION.
La Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) qui, depuis 2011, opère sous le seul nom de La Méridionale est le partenaire « historique » de la SNCM pour l’exécution des missions confiées par la Collectivité territoriale de Corse entre Marseille et les ports de Corse.
Selon les propos tenus devant la commission d’enquête par son dirigeant, M. Francis Lemor, cette exécution s’effectue de façon conjointe « ... mais non solidaire ». Une telle précision formulée avec insistance peut a priori surprendre de la part du responsable d’une compagnie qui, d’abord en 2001 puis encore en 2006, a répondu sous une forme groupée avec la SNCM à l’appel d’offres pour l’obtention de la Délégation de service public (DSP) sur la période 2007/2013 (non sans avoir préalablement tenté de s’associer pour cet objectif à Corsica Ferries). Cette formule du groupement « SNCM-La Méridionale » a d’ailleurs été une nouvelle fois mise en œuvre s’agissant de l’appel d’offres lancé en 2012 pour le renouvellement de la DSP arrivant à échéance au 31 janvier 2013. Le groupement « SNCM-La Méridionale » ayant remporté cet appel d’offres, on doit légitimement espérer que la coopération ou plus exactement le partage entre ces deux compagnies des liaisons ainsi concédées va se poursuivre au long des années 2014 / 2023, puisque la période couverte par la nouvelle délégation a été portée à 10 années.
À vrai dire la SNCM et La Méridionale restent deux délégataires distincts qui n’ont jamais été de véritables associés au sein d’un consortium, mais se limitent à participer à ce que les juristes nomment « un groupement momentané d’entreprises ». Chaque compagnie n’est ainsi responsable que pour les prestations qu’elle assure avec une relative liberté de définition de sa politique commerciale et d’exécution de façon sensiblement différenciée des prescriptions du cahier des charges qui s’impose à elle. Si la SNCM assure une part prééminente des liaisons et du trafic concédés, l’offre de la CMN au titre de la DSP introduit un facteur de concurrence non négligeable sur un marché ainsi caractérisé par des éléments comparatifs qui devraient d’ailleurs servir d’aiguillon à l’une et l’autre des compagnies.
Force est de constater que la défiance est solidement ancrée entre les deux « partenaires ».
Un tel contexte ne s’est jamais traduit à ce jour par une émulation positive. Chaque compagnie entretient un climat de critiques réciproques voire de dénigrements, la SNCM estimant, en outre, qu’en opérant sur une partie plus importante des liaisons, elle n’est pas en mesure de procéder à un même « écrémage » du marché que La Méridionale, toujours prompte à mettre en avant sa meilleure rentabilité.
La Méridionale demeure une compagnie de taille modeste. Elle ne transporte que moins du tiers des passagers transportés par la SNCM (même en incluant ses rotations avec la Sardaigne), une situation qui lui autorise sans doute une meilleure agilité de gestion. Il est à souligner que la qualité du service rendu par La Méridionale est fréquemment mentionnée par les usagers individuels et professionnels, la commission d’enquête ayant recueilli sur ce point nombre de témoignages favorables, notamment sur l’accueil, l’information ou encore les prestations à bord. S’agissant du fret, la situation est d’ailleurs assez peu déséquilibrée puisque La Méridionale détient plus du tiers du marché sur les destinations qu’elle dessert quand la SNCN n’y représente au mieux que 40 % au total.
Historiquement la CMN-La Méridionale était un armement familial, créé en 1931, exclusivement spécialisé dans le transport de marchandises et d’hydrocarbures entre le continent et la Corse. Elle n’a adjoint le transport de passagers à son activité qu’à partir de 1988 en répondant d’ailleurs à la sollicitation de la collectivité de Corse qui souhaitait ainsi « démonopoliser », au moins partiellement, le trafic passager à partir de Marseille. La reconversion en cargos mixtes des bateaux qu’elle exploitait jusqu’alors a été fort bien conduite et a donc rencontré le succès.
Les deux traits caractérisant la gestion de La Méridionale sont la maitrise des coûts d’armement (nombre de personnels embarqués par rotation) et la qualité d’une flotte ne souffrant pas de défauts de maintenance mais excluant les cars ferries considérés comme d’irrémédiables pôles de pertes. À ce jour, La Méridionale met en œuvre quatre navires rouliers-mixtes récents (le plus ancien ayant été livré en 1993) : Le Scandola, Le Kalliste, Le Girolata et Le Piana. Ce dernier bateau, mis en service le 26 décembre 2011, est le plus grand navire mixte sur la desserte de la Corse : il offre un haut niveau de services et de confort. Toutefois, l’acquisition du Piana, construit par les chantiers croates, a pesé sur les résultats de La Méridionale en 2012 (et probablement aussi en 2013).
L’état des relations entre La Méridionale et la SNCM illustre, certes, des différences généralement observées entre la filiale d’un groupe privé et une compagnie publique créée dans l’orbite étatique. Mais d’autres particularités s’expliquent par la personnalité et le savoir-faire professionnel du dirigeant de La Méridionale, M. Francis Lemor, un inspecteur des finances dont la carrière bifurqua vers le monde du transport maritime lorsqu’il est devenu, il y a trente ans, directeur financier de la Compagnie générale maritime (CGM), bien avant la privatisation de cette entreprise publique intervenue en 1996.
Quelques années avant cette privatisation, M. Lemor a en effet restructuré le capital de la Société Financière de l’Atlantique, une holding initialement détenue de façon majoritaire par la CGM (65 % du capital) regroupant la plupart de ses activités et participations non directement liées à son « cœur de métier », le transport maritime. Directeur général puis président de la Financière de l’Atlantique, M. Lemor a considérablement développé la principale filiale STEF, spécialisée dans l’entreposage et le transport frigorifiques, qui constituera un groupe privé avec une importante participation de son encadrement au capital, avant que la CGM, sa maison-mère, ne soit à son tour privatisée.
Depuis lors, M. Lemor dirige le groupe STEF. En 1992, les familles fondatrices Rousset-Rastit souhaitant se désengager de la CMN (La Méridionale), la compagnie a rejoint le groupe STEF par l’intermédiaire de la Financière de l’Atlantique « en incluant dans le schéma capitalistique de l’entreprise l’abondante trésorerie dont disposait alors la compagnie nationale SNCM » (source : document de présentation « La Méridionale–STEF » remis par M. Lemor à la commission d’enquête le jour de son audition). Cette dernière précision peut étonner. L’implication capitalistique de l’entreprise publique SNCM a, en effet, constitué un élément-clé de cette affaire qui aura de nombreuses conséquences. Au terme d’un montage complexe, la SNCM détenait 45 % du capital de la CMN et 45 % d’une société holding, la Compagnie Méridionale de Participations _ elle-même filiale à 55 % du groupe STEF via la société STIM d’Orbigny – et qui détenait 53 % de la CMN. Directement et indirectement, la SNCM possédait ainsi la majorité des droits économiques de la CMN dont le contrôle demeurait cependant assuré par le groupe STEF qui en était l’opérateur !
Cet étrange imbroglio ne disparaitra qu’en 2009, trois années après la privatisation de la SNCM, avec le rachat par STEF de l’intégralité de la participation de la SNCM dans la CMN-La Méridionale pour quelque 45 millions d’euros.
Plusieurs interlocuteurs de la commission d’enquête ont souligné que la majorité des droits économiques de la SNCM dans la CMN ne lui a jamais rien rapporté : la CMN, constamment bénéficiaire, ayant conservé l’intégralité des profits sans servir de dividendes à la compagnie publique. Certains estiment ainsi que le rachat de la participation intervenu en 2009 s’est effectué avec des fonds accumulés par l’ensemble STEF-CMN alors qu’ils auraient dû revenir, année après année, à la SNCM.
Depuis 1992, un pacte d’actionnaires liait d’ailleurs STEF-CMN, plus exactement la STIM d’Orbigny, et la SNCM, en tant qu’élément fondateur de leur collaboration.
Ce pacte sera unilatéralement dénoncé, en mars 2006, par M. Lemor qui ne verra reconnaître ce droit qu’au terme d’une procédure judiciaire, en appel puis en cassation. La dénonciation du pacte traduisait l’extrême tension des relations entre les deux compagnies « partenaires» à partir du lancement de l’opération de privatisation de la SNCM. La CMN a d’ailleurs tenté un renversement d’alliance en élaborant avec Corsica Ferries une offre alternative pour l’obtention de la DSP couvrant la période 2007/ 2013.
On aurait pu penser que la CMN adossée à un groupe puissant allait manifester un intérêt naturel pour reprendre la SNCM au terme de l’appel d’offres. Il n’en a rien été. Tout au plus, M. Lemor a, semble-t-il, consenti, « après avoir été approché à plusieurs reprises », selon ses propos devant la commission, à concevoir une sorte de partenariat technique avec le groupe Butler dont M. Lemor a souligné « qu’il ne connaissait rien au maritime ».
Il est exact que l’Agence des participations de l’État (APE) a milité, dès l’origine, en faveur d’un rapprochement entre le repreneur et un spécialiste du secteur dans le rôle d’« opérateur industriel ». Mais, dans les jours précédant la remise officielle des offres, M. Walter Butler n’aurait pas donné suite à cette proposition. M. Lemor a également tenu à préciser que l’implication de la CMN au capital d’une SNCM privatisée ne pouvait être que symbolique (en tout état de cause inférieure à 10 % de son capital) et, en outre, conditionnée à ce que la CMN n’intervienne jamais dans le management et n’y détache personne. Il a indiqué à la commission d’enquête avoir informé de cette position, dès le début de l’opération, la banque-conseil de l’État, non sans avoir également fait part, qu’à son sens, l’exploitation de car ferries comme le faisait la SNCM était économiquement injustifiée.
À l’évidence, l’expérience acquise par M. Lemor fait de lui un des meilleurs connaisseurs du transport maritime français.
Sa réticence à impliquer son entreprise dans la procédure de privatisation de la SNCM, exprimée dès le lancement de l’opération, a été analogue à celle de la quasi-totalité des armateurs dont l’intérêt pour les actifs de la SNCM n’était pas celle d’une reprise globale et en l’état de l’entreprise.
M. Lemor dont la légitimité professionnelle est certaine a eu une influence sans doute déterminante pour détourner du dossier d’autres entreprises éventuellement intéressées. Pour sa part, M. Maurice Perrin syndicaliste de la CFE-CGC a déclaré : « Du match qui s’est joué en amont entre les armateurs qui n’ont jamais donné suite, nous n’avons jamais rien su !».
En réalité, pour la CMN-La Méridionale comme pour Corsica Ferries, l’existence d’une SNCM affaiblie, en situation de crise récurrente et minée par les conflits sociaux, reste une opportunité pour développer leurs activités. Pendant longtemps, la présentation d’une « SNCM repoussoir » a judicieusement servi la valorisation des fonds de commerce de ces deux compagnies.
TROISIÈME PARTIE : LA MISE EN ÉCHEC DE LA PROCÉDURE ET L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE SOLUTION
Le 15 septembre 2005, le fonds Butler Capital Partners remporte l’appel d’offres. Il va maintenant falloir l’annoncer aux salariés de la SNCM, à Marseille et à la Corse.
A. UN REJET SYNDICAL IMMÉDIAT ET D’UNE EXTRÊME VIOLENCE
C’est M. Christian Frémont, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui sera chargé par le gouvernement de l’annonce : « Le 12 septembre, M. Perben, qui avait succédé à M. Goulard, m’a indiqué que les annonces qui suivraient seraient faites de Marseille, autrement dit que j’en étais chargé. Avant chacune d’entre elles, j’ai reçu des éléments de langage. Chaque réunion était donc préparée au niveau des ministères des transports et des finances. »
Le 19 septembre, le préfet reçoit, en deux réunions séparées, les organisations syndicales et les élus de la ville de Marseille, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du conseil général des Bouches-du-Rhône et de la Collectivité territoriale de Corse. Il indique qu’il n’y a que deux investisseurs, Butler Capital Partners et le fonds Caravelle, et que ceux-ci déposent chacun une offre de candidature pour une prise totale du capital de la SNCM.
Le résultat ne se fait pas attendre. M. Maurice Perrin, secrétaire général CFE-CGC « Sédentaires » de la SNCM à l’époque de sa privatisation, a relaté l’épisode à la Commission d’enquête : « Le 19 septembre, nous sommes reçus à la préfecture. Les marins n’ont pas attendu le délai de préavis de grève et tout s’arrête. En ce qui nous concerne, nous les rejoindrons cinq jours plus tard, après avoir déposé un préavis de grève en bonne et due forme. » M. Jean-Paul Israël, secrétaire général CGT-Marins de Marseille à l’époque de la privatisation, confirme : « Quand le préfet de région Frémont a annoncé la privatisation immédiate, exceptionnellement, nous avons arrêté l’ensemble de la flotte, sans préavis de grève puisqu’il n’y avait plus grand-chose à perdre. »
Le 26 septembre, de nouveau lors de deux réunions successives avec les élus et les organisations syndicales, le préfet précise le schéma de privatisation : le groupe Butler va effectivement acquérir 100 % de la SNCM ; le fonds verserait 35 millions pour racheter la SNCM, après que le gouvernement aurait versé 113 millions d’euros dans la compagnie pour la recapitaliser, et se soit engagé à prendre en charge un plan social portant sur environ 400 suppressions d’emplois (sur 2 400). Il rappelle aussi que la SNCM est sous la menace imminente d’un dépôt de bilan et d’une liquidation judiciaire. Le soir, la grève s’étend aux dockers du Port autonome de Marseille, initialement pour 24 heures en solidarité avec les marins, mais aussi contre l’intervention des forces de l’ordre sur le port et les menaces de privatisation du port autonome.
Ce mouvement massif de rejet s’effectue dans un climat d’extrême détermination, voire de violence. M. le préfet Christian Frémont en a donné un aperçu à la Commission d’enquête : « (Les grévistes) avaient pris possession du Méditerranée, tous syndicats confondus. Un autre jour (le lendemain, 27 septembre), ils ont pris le Pascal Paoli pour l’emmener en Corse. (…). Les grévistes ont aussi voulu empêcher le départ d’un navire de la CMN (le Kalliste), et cela a failli très mal tourner, parce qu’ils étaient dans de toutes petites embarcations autour de l’énorme bateau qui manœuvrait pour sortir du port. J’étais là et j’ai bien cru qu’il y allait avoir des hommes à la mer. Le capitaine avait reçu l’ordre d’appareiller quoi qu’il arrive… Finalement (…) en artiste qu’il était, il a réussi à se faufiler au milieu des embarcations (…).
« Dans le Finistère, j’avais dû faire face aux pêcheurs et aux agriculteurs, qui n’étaient pas des « tendres », mais jamais je n’avais vu une telle violence : juchés sur des pelleteuses, les grévistes ont poussé à la mer des voitures neuves entreposées sur le port et destinées à l’exportation ; une autre fois, du haut du pont du Méditerranée, ils ont jeté sur les CRS en contrebas d’énormes pièces de métal. ».
B. LE REFUS DE LA PRISE DE CONTRÔLE PAR UN FONDS FINANCIER
Pourquoi une telle violence ? D’abord, les syndicats ne croyaient pas à une privatisation, même partielle. Pour eux, l’État finirait toujours par payer. L’annonce de la privatisation imminente a été pour eux un véritable choc.
À propos de la première table ronde tenue à Marseille le 12 février 2005 par M. François Goulard, alors secrétaire d’État aux transports, M. Christian Frémont indique : « les syndicats protestaient, et ne cessaient de me répéter lors de nos contacts quasi quotidiens : « Tout ça, c’est du baratin. L’État a toujours payé, et il finira bien par le faire. » Le secrétaire d’État a expliqué clairement que Bruxelles interdisait tout nouvel apport de capital, dans les dix ans suivant la dernière recapitalisation. La situation paraissait donc bloquée, mais les syndicats, je pense, n’y ont jamais cru. Ils imaginaient, à l’époque en tout cas, qu’on « bluffait ».
À propos des événements de septembre 2005, le préfet Frémont rappelle : « Je garde un souvenir très précis de cette dernière semaine, quand j’ai expliqué aux syndicats que j’étais bien loin de les « baratiner », et que, si l’on ne faisait rien, l’entreprise serait liquidée à la fin de la semaine, ils ont reçu un véritable choc. Je me souviens de leur retour, après leur entrevue avec le président du tribunal de commerce : ils étaient complètement affolés. Et, en quelques minutes, ils ont décidé de consulter leurs mandants dès le lendemain. ».
Les modalités de la privatisation s’avéraient particulièrement traumatisantes. D’abord, ce n’était pas une privatisation partielle, mais une privatisation totale. Ensuite, la SNCM allait être confiée non pas à un opérateur industriel, à un partenaire connu tel que Connex, dont le nom circulait, mais à un fonds d’investissement ; les syndicalistes et les salariés de la SNCM pouvaient ainsi subodorer que l’objectif de ce fonds était non pas la reprise d’une exploitation mais bien la revente avec profit, sans doute en pièces détachées, de l’outil industriel, avec les nombreux licenciements qui l’accompagneraient. Après tout, ils savaient bien que le capital de l’entreprise, c’était ses navires.
Les syndicalistes entendus par la Commission d’enquête ont du reste eux-mêmes réitéré cette analyse.
Ainsi, M. Jean-Paul Israël (CGT) a indiqué lors de son audition: « le choix de Butler était simple, on le connaissait, pas besoin qu’il vienne nous l’expliquer … Il gardait quatre cargos qu’il donnait en gestion à la CMN, à M. Lemor, ce qui impliquait un plan social de très grande envergure ».
Quant à M. Alain Mosconi, secrétaire général de la section maritime du Syndicat des travailleurs corses (STC), élu au comité d’entreprise de la SNCM à l’époque de sa privatisation, il a expliqué que : « la nouvelle (de la privatisation) était d’autant plus inquiétante qu’il s’agissait d’un fonds de pension américain. Il ne pouvait passer aux yeux d’un syndicaliste pour la panacée. Dans le monde dans lequel nous sommes, les prédateurs se livrent à la curée d’entreprises dès qu’ils en ont l’occasion (…). Deux ans plus tard, il (Butler) n’était plus là. Et il est parti avec une plus-value monstrueuse. Qu’en aurait-il été s’il avait eu 100 % ? Le chèque aurait été plus gros ! Il aurait démantelé la compagnie sans aucun scrupule ».
Les recherches que les syndicalistes pouvaient faire sur les propos publics de M. Walter Butler leur donnaient de sérieux éléments pour conforter leurs interprétations. « Dans le livre que j’ai écrit, poursuit M. Mosconi, je cite M. Butler expliquer sa philosophie dans un article du journal Le Monde : « Moi, j’achète au prix du menu et je revends les plats à la carte ». (…) Nous, Le Monde, on le lit aussi. Alors, nous n’avons pas voulu être livrés en pâture à des prédateurs ».
Enfin, M. Maurice Perrin (CFE-CGC) a tenu les propos suivants : « On se battait pour que Butler sorte. (…). Il était là pour faire une opération financière. » Et, reprenant des termes employés par M. Walter Butler lui-même : « Le métier de Walter Butler c’était d’« acheter les plats au menu et de les vendre à la carte ! ».
Ces analyses étaient évidemment renforcées par les origines américaines prêtées à M. Walter Butler. Ainsi, a exposé M .Henri Proglio à la Commission : « Sur les barricades, M. Israël lance : « Be-te-leur, cet Américain, no pasarán ! Il déduit de son nom qu’il était américain. (…) Les syndicalistes marseillais voyaient donc derrière le nom de Butler la mainmise du grand capital américain sur les bateaux de la SNCM ».Il faut dire qu’un syndicaliste pouvait aussi, de bonne foi, ne pas attribuer spontanément une origine française tant au fonds Butler Capital Partners qu’à France Private Equity III, son partenaire…
En réalité, comme l’a dit M. Henri Proglio à la Commission d’enquête : « Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Les personnels avaient très bien compris qu’ils allaient être sacrifiés sur l’autel du profit financier immédiat. »
C. UN CONTEXTE DE FORTES TENSIONS SOCIALES
Le rejet de la privatisation se situe aussi dans un contexte local de grève généralisée, qui finit par mettre en cause la vie même de Marseille, voire l’alimentation en carburant du pays.
La privatisation de la SNCM apparaissait comme une grave mise en cause pour la CGT : « La CGT, expose M. Frémont, considérait que son pouvoir était en jeu, à la SNCM, dans le port de Fos, au terminal méthanier de Cavaou, ou dans la réparation navale : « C’est l’entreprise des syndicats, donc c’est nous qui prenons les décisions. » J’ai entendu cette phrase plusieurs fois, y compris devant des chefs d’entreprise éberlués. (…) En résumé, la CGT avait le pouvoir dans cette entreprise et elle ne voulait pas le perdre. »
Car l’industrie portuaire et navale était également en ébullition : « Dans le même temps, poursuit M. Christian Frémont, le port s’était mis en grève, d’abord vingt-quatre heures pour soutenir la SNCM, ensuite, pour protester contre le projet de réforme portuaire – cela a duré tout le mois de septembre –, entraînant le blocage du port de Fos, des raffineries et des dépôts pétroliers. (…) Le Gouvernement commençait à s’inquiéter sérieusement des risques de pénurie de carburant. Il y a eu dans la rade de Fos jusqu’à soixante pétroliers en attente de déchargement ».
De plus, d’autres décisions, publiques ou privées, suscitaient également des mouvements : « Parallèlement, poursuit M. Frémont, la Régie des transports marseillais s’est mise en grève elle aussi pour s’opposer à un projet de délégation de service public. Pendant six semaines, Marseille a vécu sans métro ni bus. Et il ne faudrait pas oublier la grave crise sociale qui a éclaté après la décision de Nestlé de fermer son usine de Saint-Menet. Le mois de septembre 2005 a été très rude du point de vue de l’ordre public, et très éprouvant pour les habitants ».
La situation n’était pas plus calme en Corse. L’hostilité à la privatisation des marins du STC, qui avaient entrepris dans le cadre de « l’occupation de notre outil de travail », pour reprendre les termes de M. Alain Mosconi devant la Commission d’enquête, de « ramener à son port d’attache » le Pascal Paoli, (qui sera finalement intercepté par le GIGN et des éléments du commando de marine Hubert à l’approche de Bastia) recoupait celle du mouvement nationaliste corse, favorable à une compagnie corse, et dont, du reste, le STC ne fait pas mystère d’être proche.
Ainsi, M. Camille de Rocca Serra, alors président de l’Assemblée de Corse, précise : « Une fois les décisions connues, la situation s’embrase et elle a failli très mal tourner en Corse. (…) Le 27 a lieu la prise du Pascal Paoli, le 28 je participe à l’émission au cours de laquelle j’ai un échange téléphonique avec celui qui venait de s’emparer du bateau et je l’enjoins d’arrêter les frais pour éviter de devoir qualifier le détournement d’acte de piraterie. J’ai d’ailleurs obtenu du Premier ministre qu’il en considère les auteurs comme des « Pieds Nickelés ». L’affaire a tout de même failli mettre le feu à la Corse puisque plusieurs milliers de personnes attendaient dans le port de Bastia le retour du navire. Les nationalistes n’auraient pas osé rêver pareil événement qui ravivait le souvenir d’Aléria ».
D. UNE ATTENTION INSUFFISANTE DE L’ÉTAT AUX CONDITIONS LOCALES
Si les syndicats ne croyaient pas à la privatisation, on peut aussi penser que l’État n’avait guère agi pour les en prévenir, et donc s’assurer de conditions minimales de réussite de l’opération, qui, en tout état de cause, représenterait une révolution pour la SNCM.
M. le préfet Christian Frémont a évoqué à plusieurs reprises ce qui peut apparaître comme une sorte de désinvolture, voire d’aveuglement de l’État : « Le 22 décembre 2004, donc, M. Vergobbi me prévient de la gravité de la situation. Paris réagit et une réunion ministérielle se tient le 10 janvier 2005, d’où il ne sort rien de précis. Il me semble que les autorités de la capitale sous-estimaient la dureté des relations sociales à Marseille. »
Lors de la table ronde tenue le 12 février 2005 à Marseille, « M. Goulard a annoncé qu’il confiait une mission à M. Claude Gressier, ingénieur général des Ponts et chaussées. Il l’a menée à Paris, et je n’ai pas eu de contacts avec lui pendant plusieurs mois. Les élus, comme les syndicats, se sont d’ailleurs plaint que le travail de préparation des appels d’offre ait été mené en solitaire. »
À une question du président Arnaud Leroy lui demandant comment il s’expliquait qu’il n’ait pas été sollicité davantage par l’Agence des participations de l’État (APE), M. Christian Frémont a répondu ainsi : « Je ne l’explique pas. M. Goulard a pris la décision de faire appel à M. Gressier, le 10 février, et je ne l’ai pas rencontré avant le mois de juin. J’avais l’impression, pas toujours agréable, que le dossier m’était tantôt confié, tantôt retiré soudainement… Il est parti, puis revenu plusieurs fois. Je m’en suis mêlé en décembre, en février un peu, en avril beaucoup, et j’ai récupéré le dossier le 9 septembre. Entre-temps, il y avait eu deux ou trois réunions interministérielles, mais jamais il n’a été question de l’appel d’offres. ».
Enfin, il expose que : « Le 15 septembre, le conseil d’administration de Veolia a décidé que sa filiale ne présenterait pas d’offre. Je n’en ai pas été averti officiellement ; je l’ai appris par la bande, et j’ai vérifié auprès du ministère. »
Les élus de Corse aussi ont fortement ressenti cette absence. À propos des événements de la fin septembre 2005, M. Camille de Rocca Serra a ainsi indiqué : « Il fallait tout faire pour apaiser la tension, due à une mauvaise concertation et une mauvaise information. Quant à la décision elle-même, elle était, sinon mauvaise, du moins totalement prématurée dans le contexte. »
Les organisations syndicales n’étaient pas en reste. Ainsi, M. Alain Mosconi a-t-il déclaré que : « Jusqu’au 27 septembre, c’est le fonds Butler qui tient la corde. Mais ce jour-là, à cause de la fameuse action du Pascal Paoli, l’État comprend qu’une privatisation totale n’est pas possible parce qu’elle n’avait pas été préparée ni même annoncée. »
Il n’est pas jusqu’à M. Walter Butler lui-même qui ne s’étonne de la gestion de la procédure et de sa décision par l’État : « L’État sentait la pression de Bruxelles, et j’ai l’impression qu’il a voulu passer en force. Devant les salariés, il parlait d’ouverture du capital et de l’arrivée de la Caisse des dépôts, ou d’une institution dans son genre. À la place, il leur a servi une privatisation à 100 %, un plan social, un fonds au nom anglo-saxon… Le délégué du personnel au CE m’a dit que c’était trop » ; et encore : « On a déposé une offre à 100 % et nous avions demandé à l’État s’il ne serait pas bon, avant de dévoiler notre offre, de l’expliquer en rencontrant les syndicats. Il a refusé. Mais le lendemain de l’annonce officielle, tout était dans la presse et la bataille syndicale était déjà lancée. »
1. Une hostilité affirmée à la solution retenue
Les élus, et tout particulièrement ceux de la Collectivité territoriale de Corse, étaient eux aussi tout à fait hostiles à la solution retenue, sur la base d’une analyse parfois assez proche de celle des syndicats. Ils sont venus le dire à la Commission d’enquête.
M. Ange Santini, alors président du Conseil exécutif de Corse, a ainsi exposé que : « Lorsque nous – présidence de l’Assemblée de Corse, présidence de l’exécutif de Corse et présidence de l’Office des transports de Corse – avons appris que nous allions vers une privatisation pure et simple, l’État se désengageant entièrement pour laisser le champ libre à Butler, nous sommes montés au créneau parce que, au-delà du 31 décembre 2006, la fiabilité du service public nous paraissait compromise : le nouveau maître à bord serait libre de découper la compagnie par morceaux et de vendre les bateaux. »
M. Camille de Rocca Serra indique qu’après l’annonce de l’attribution de la SNCM à BCP : « L’Exécutif corse et la majorité de l’Assemblée de Corse prend clairement position contre une privatisation totale même si nous pouvons comprendre l’ouverture du capital puisqu’on nous dit qu’il n’y a pas d’autre solution ». Notre collègue Camille de Rocca Serra avait débattu sur le plateau de la chaine LCI avec le repreneur Walter Butler. Avant cette émission, M de Rocca Serra avait appelé le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Pierre Mongin, pour lui dire qu’il n’accepterait pas la façon dont cette privatisation totale a été engagée, en insistant sur l’opposition des élus corses vis-à-vis de cette privatisation totale et en exigeant que l’État reste pour partie au capital et que les salariés eux-mêmes soient associés. Quelques jours plus tard, cette logique d’ouverture du capital qui avait été proposée au gouvernement prévalait : Walter Butler n’était plus le seul actionnaire et l’association de l’État et des salariés permettait ainsi de conserver une minorité de blocage à 33 %.
2. La suggestion de la reprise par Veolia
En réalité, depuis le début de l’année, les élus s’étaient fait progressivement leur idée d’une solution pour la SNCM. Le président de l’Office des transports de Corse, M. Antoine Sindali indique ainsi que : « Les élus, de Corse et de PACA, toutes tendances politiques confondues, étaient unanimes à ne pas vouloir d’un tête-à-tête avec un fonds d’investissement, à demander une minorité de blocage pour l’État et les salariés, et à réclamer l’opérateur industriel Connex. »
La Connex, filiale de Veolia, était en effet dans toutes les têtes en cas de privatisation de la SNCM. On savait à Marseille qu’elle était partie prenante dans la procédure d’appel d’offres. M. Jean-Louis Girodolle l’a rappelé à la Commission : « L’émotion est très forte car Connex s’était employée à faire connaître localement son intention de se porter candidat. Les représentants locaux, voire M. Stéphane Richard en personne, avaient pris des contacts avec les élus, les syndicats et les partenaires de la SNCM, pour s’assurer d’être bien vus. Le fait que Connex n’ait pas déposé d’offre a créé la surprise ».
Dans le contexte inédit de la victoire de BCP, l’appui des élus à un partage concret du capital entre BCP, un opérateur industriel, l’État restant au capital et les salariés, est vite acquis.
M. Ange Santini l’a rappelé devant la Commission d’enquête : « Indépendamment du choix de la privatisation qui nous échappait, nous avons fait savoir très rapidement pourquoi l’État devait rester au capital, les salariés y entrer – pour constituer une minorité de blocage, avec respectivement 25 % et 9 % du capital –, ainsi qu’un opérateur de transport, Veolia ou la Connex. La nouvelle répartition du capital nous paraissait de nature à garantir l’avenir. Et, quand l’État s’est acheminé vers cette solution, elle nous convenait parfaitement. »
Résumant la situation, M. Stéphane Richard, à l’époque directeur général de Connex, la division « Transport » du groupe Veolia, a exposé que : « Le personnel, mais aussi les élus locaux, notamment le maire de Marseille, considéraient que la reprise par un seul fonds financier, sans expérience du secteur, n’était pas la bonne solution et qu’il fallait faire appel à un partenaire industriel. Comme Veolia faisait partie du paysage et qu’elle était connue de toutes les collectivités, ils ont pensé à Connex et lui ont lancé un appel pour qu’elle revienne dans le jeu.»
II. L’INTERVENTION DU PREMIER MINISTRE ET LA FORMATION D’UNE SOLUTION DE SORTIE DE CRISE
Au bout du compte, le Gouvernement a dû s’emparer de nouveau de l’affaire. « Appelé à la rescousse par les élus marseillais, expose M. Dominique de Villepin, alors Premier Ministre, le Gouvernement se mobilise jour et nuit pour rechercher, sur les bases de l’offre dont il dispose, la solution la plus apaisante et la plus robuste possible pour le devenir de la SNCM. »
La situation n’était effectivement pas simple. Non seulement Marseille était paralysée et la Corse en ébullition, mais, comme l’a rappelé M. Jean-Louis Girodolle : « la procédure d’appel d’offre, fixée par les lois de privatisation, devait être respectée. Il fallait donc bien déclarer Butler gagnant. ». Par ailleurs : « Le Gouvernement ne pouvait pas arrêter la privatisation, l’entreprise n’avait plus d’argent. Et elle risquait la mise en cessation de paiement dès le lendemain, les commissaires aux comptes ayant suspendu leur décision parce que la procédure de privatisation était en cours. »
Le 28 septembre au soir, une réunion de crise est tenue à Matignon. Le lendemain, le Premier ministre Dominique de Villepin annonce un nouveau montage financier : l’État conservera 25 % du capital, Connex, filiale du groupe Veolia, y entrera à hauteur de 40 % et 5 % seront réservés aux salariés. Dans ces conditions, Butler Capital Partners n’entre plus au capital de la SNCM que pour 30 %. Dès le 30 septembre, M Thierry Breton, ministre de l’Économie et des Finances, est envoyé à Bruxelles rechercher l’aval de la Commission européenne sur le nouveau dispositif. M. Jacques Barrot, commissaire européen aux transports. Selon M. Benoît Le Bret : « Nous rappelons donc que nous n’exigeons pas la privatisation mais qu’une aide à la restructuration ayant déjà été accordée, le projet doit être conforme à celui d’un investisseur avisé, ou compenser des sujétions de service public, ou mobiliser des partenaires privés, ou encore procéder à une cession à un prix de marché. Je mentionne au cours de la réunion que, si la privatisation ne peut pas être imposée par l’Union, la présence d’investisseurs privés, leur poids dans l’opération, le caractère éventuellement temporaire de la présence de l’État au capital, joueront en faveur du dispositif. ». « La visite de M. Breton, poursuit M. Le Bret, s’inscrivait dans la chorégraphie politique obligée qui précède et prépare le traitement technique et rigoureusement juridique d’un dossier par la Commission. »
Pour monter un tel dispositif, encore fallait-il l’accord de BCP et de Veolia. M .Stéphane Richard a rappelé le caractère impératif de l’accord de Butler Capital Partners : « J’ai un souvenir précis de la conversation téléphonique que j’ai eue avec Henri Proglio et le directeur de cabinet du Premier ministre, Pierre Mongin, au cours de laquelle celui-ci nous a dit qu’il fallait trouver une solution et qu’elle passait nécessairement par un accord avec Butler. Comme il était impossible de le faire sortir du dossier, il fallait se rapprocher de lui pour trouver un arrangement (…).
Dans la foulée, il était minuit ou une heure du matin, nous avons engagé des discussions avec Butler (…). L’urgence et la pression étaient très fortes. Et nous en sommes arrivés à l’idée d’un partenariat aux termes duquel Connex serait l’opérateur industriel, tout en prenant une participation au capital, et Butler, le financier ; l’État restant au tour de table. La solution s’est esquissée dans les heures qui ont suivi la discussion avec le directeur de cabinet du Premier ministre. »
Cela dit, M. Walter Butler semble ne pas avoir été difficile à convaincre : « L’entreprise était en grève, un bateau venait d’être détourné – du jamais vu dans l’histoire maritime –, les salariés étaient très hostiles et les syndicats étaient « vent debout ». L’affaire ne s’annonçait pas sous les meilleurs auspices. J’avais le sentiment d’avoir un fusil braqué dans le dos, et un autre sur la poitrine. Dans ces circonstances, je me suis dit que mieux valait ne pas être seul. »
M. Henri Proglio a quant à lui exposé à la Commission d’enquête l’esprit qui l’avait animé : « Quand on est enraciné dans un territoire, on ne peut pas ignorer l’intérêt public. Indépendamment des considérations financières, il fallait ramener l’ordre et la vie économique dans les bassins d’emploi concernés. Voilà ce qui m’a guidé. ». Et aussi : « J’ai essayé que notre intervention ne soit pas désastreuse pour nos actionnaires, comptant que nos clients nous en seraient reconnaissants un jour. À défaut de profit financier, nous tirerions de l’affaire l’image d’une entreprise responsable. » On ne saurait mieux expliquer à quel point le maintien des positions de Veolia, dans la pluralité de ses métiers, c’est-à-dire leur développement au sein des marchés des collectivités de la région, a pesé dans la décision. En conséquence, expose M. Dominique de Villepin, « Le 2 octobre et, sur la base de l’offre de BCP, Veolia se met d’accord avec ce dernier pour participer à la reprise de la SNCM. BCP était prêt à céder une partie de sa participation à Veolia. Veolia, déjà présente à Marseille, avait participé à la procédure d’appel d’offres et avait manifesté un intérêt continu pour le dossier, même si elle n’avait pas in fine remis d’offre. Aux termes de ses accords avec BCP, Veolia devient l’opérateur industriel de la SNCM et entre au capital à hauteur de 28 % – contre 38 % pour BCP – ; l’État conserve une participation à hauteur de 25 %, le personnel entre au capital à hauteur de 9 %. »
C. L’ACCEPTATION FINALE DES SYNDICATS ET LA FIN DE LA GRÈVE
L’acceptation des syndicats fut plus difficile à obtenir. Les ministres doivent s’impliquer personnellement. Entre le 30 septembre et le 13 octobre, rappelle M. Dominique de Villepin, « Thierry Breton [ministre de l’Économie et des finances] et Dominique Perben [ministre des Transports] se rendent à quatre reprises à Marseille pour renouer les fils du dialogue et favoriser l’émergence d’une solution. »
La première rencontre de M. Dominique Perben à Marseille avec les syndicats, le 30 septembre, tourne du reste court après que la CGT ait quitté la salle. Dans l'après-midi, une trentaine de militants nationalistes et syndicalistes STC pénètrent de force dans l'Assemblée de Corse.
M. Christian Frémont, préfet de la région PACA a rappelé quant à lui : « J’ai tenu dix-sept réunions avec les syndicats entre le 19 septembre et le 13 octobre. Je les voyais donc quasiment tous les jours et cela durait toute la journée, voire parfois une partie de la nuit. »
La grève se poursuivant, le préfet de région invite MM. Walter Butler et Stéphane Richard à venir à Marseille pour rencontrer les syndicats à la préfecture. M. Stéphane Richard a relaté l’épisode à la Commission d’enquête : « Tout cela ressemblait quelque peu à un film … Nous sommes arrivés au milieu de manifestants, il a fallu passer par l’arrière sous la mitraille des photographes. On nous a parqués dans une salle de la préfecture, tandis que soixante syndicalistes, réunis dans une autre, ont refusé toute la journée de nous voir. La première fois, la rencontre n’a pas eu lieu. Mais elle a eu lieu ailleurs, dans un bistro ! Je ne me souviens plus avec quel syndicat. »
En réalité, au fil des jours, les négociations progressent. La CFE-CGC y tient un rôle central. Son responsable, M. Maurice Perrin, a notamment déclaré : « Dans la bataille, nous étions synchrones avec l’ensemble des élus dans les deux régions, c'est-à-dire en rester à une privatisation partielle. (…)
« Nous jouions un rôle très central dans le processus, car nous avions la confiance de nos collègues, y compris du STC auxquels nous ne nous sommes opposés qu’en fin de processus. »
« Avant ce vendredi 8 octobre au soir, donc, j’avais déjà rencontré Gérard Couturier, avant que Dominique Perben annonce le retour de Veolia. C’était le 29 septembre (…). Pour revenir dans le jeu, Veolia a souhaité rencontrer l’encadrement sédentaire et l’encadrement navigant.
« On a revu Gérard Couturier parallèlement aux négociations à la préfecture, pour qu’il nous explique les conditions du retour de Veolia, avec l’ensemble des élus CFE-CGC, à deux reprises, à Marseille.
« Dans la phase finale, parce qu’il y avait trop de monde à la préfecture, et que ça devenait trop compliqué, on a récupéré les clefs de l’Union régionale et le vendredi 8 octobre au soir, on a reçu Walter Butler, Stéphane Richard, Gérard Couturier et d’autres collaborateurs. (…) »
« Nous nous séparerons du STC à la fin car nous avons décidé d’appuyer la solution échafaudée au terme de trois ou quatre semaines de négociation au cours desquelles les ministres Thierry Breton et Dominique Perben sont venus à cinq reprises à Marseille : nous avions obtenu que l’État se maintienne avec 25 % du capital, et que les salariés obtiennent 9 % du capital, au lieu de 5 %. Nous avons préféré la solution réaménagée plutôt que de poursuivre l’aventure. »
L’audition de M. Jean-Paul Israël rend compte de l’évolution de la position de la CGT, organisation majoritaire à la SNCM à l’époque, et toute-puissante sur le port de Marseille : « À la fin, après la victoire de Butler, après les rencontres que nous avons eues avec les ministres Thierry Breton et Dominique Perben qui sont venus deux fois à Marseille, à la préfecture, nous n’avions plus d’autre choix que d’essayer de sauver les meubles et nous avons donc rencontré Veolia qui, à l’époque, s’appelait Connex. (…) Même si ce n’était pas ce que nous voulions, on a cru que Veolia avait un projet industriel. »
Au bout du compte, a exposé M. Maurice Perrin : « Seul le STC voulait tenir bon ». Il se ralliera pourtant in fine à la décision de la CGT, M. Alain Mosconi déclarant néanmoins que les 800 employés corses de la SNCM se considéraient comme trahis.
Le 13 octobre, un vote des salariés de la SNCM en assemblée générale décide la reprise du travail. « Le dépôt de bilan était prévu pour le 14. Le pire a donc été évité in extremis », rappelle M. Christian Frémont.
« À partir de là, indique M. Dominique de Villepin, les choses se mettent en place. De façon immédiate, le plan de reprise permet à l’État d’accorder à la SNCM une avance de trésorerie de 25 millions d’euros en octobre pour donner le temps à l’accord de se mettre en place. Le 3 mai 2006, 77 % du personnel se prononce par référendum en faveur du projet de reprise de Veolia au cours d’un référendum interne. Le 26 mai 2006, après avis de la Commission des participations et transferts, un décret autorise la vente de l’entreprise, cette décision ayant été par la suite confirmée par la Commission européenne ».
III. LE NOUVEAU DISPOSITIF DE PRIVATISATION
Le nouveau dispositif de privatisation, qui ne sera signé que le 16 mai 2006, après des négociations sans doute assez serrées, se traduit par trois documents.
Le premier est le Protocole d’accord conclu entre d’une part la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), possédée à 100 % par l’État et actionnaire de la totalité de la SNCM, et de l’autre Butler Capital Partners et Veolia Transport.
Le deuxième est un pacte d’actionnaires, le Pacte d’actionnaires de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, conclu entre BCP et Veolia Transport.
Le troisième document, s’inscrivant en complément du pacte d’actionnaires, est un Accord sur les modalités de calcul du prix de cession, également conclu entre Veolia Transport et BCP. Cet accord fixe en réalité le prix de cession à Veolia des actions de la SNCM détenues par BCP. Cet accord comporte essentiellement des formules de calcul de ce prix, légèrement différentes en fonction du chiffre d’affaires de la SNCM et selon que la sortie de BCP du capital se fera avant ou après la sortie de la CGMF. Le dernier alinéa de l’accord indique que « le pacte d’actionnaires et le présent « accord sur les modalités de calcul du prix de cession » font un tout qui doit s’interpréter globalement ».
Les trois documents sont datés du 16 mai 2006.
A. LA REMISE À FLOT DE LA SNCM PAR L’ÉTAT
Il ressort des trois documents précités les éléments suivants.
D’abord, alors que le capital de la SNCM était précédemment partagé entre la CGMF (pour 93,26 %) et la SNCF (6,74 %), la CGMF a racheté la part de la SNCF. Avant la privatisation, elle est donc propriétaire de 100 % du capital de la SNCM.
En application de l’article II du protocole, la CGMF injecte alors 142,5 millions d'euros au sein de la SNCM. Cette injection se fait sous la forme d’une souscription à une émission de 9 500 000 actions nouvelles de la SNCM, de 15 euros chacune.
À l'issue de cette augmentation de capital, le capital de la SNCM, jusqu’ici de 55 586 100 euros , est porté à 198 086 100 euros, divisé en 13 205 740 actions de 15 euros de nominal.
La quasi-intégralité de ces actions est alors annulée. Le capital de la SNCM est réduit à 37 005 euros, divisé en 2 467 actions de 15 euros de nominal.
Les 198 049 095 euros de capital correspondant aux actions annulées sont utilisés pour purger le report à nouveau négatif de la SNCM au 31 décembre 2005 (31,65 millions d'euros) ainsi que les pertes de l’exercice 2005 (28,82 millions d'euros), pour un total, donc, de 60,47 millions d'euros.
Le solde, soit 137,58 millions d'euros, est requalifié en « primes d’émission » et, selon l’article II.1 du protocole, affecté « à un compte de primes d’émission non distribuable et qui ne pourra recevoir d’autre affectation que l’imputation des pertes futures de la société » ; de fait, les comptes 2006 de la SNCM montrent l’existence de primes d’émission de 138,98 millions d'euros, correspondant à ces 137,58 millions d'euros accrus de primes préexistantes de 1,4 million d'euros.
La SNCM se trouve a priori prémunie par l’État contre plusieurs exercices déficitaires.
Par ailleurs, la CGMF met à la disposition de la SNCM une « avance en compte courant » de 38,5 millions d'euros. Selon le paragraphe III.2 du protocole, cette somme est « destinée au financement de la fraction du coût des éventuels départs volontaires ou ruptures de contrats de travail (quelle qu’en soit la nature), dite de « surgénérosité » qui viendrait en complément des sommes de toute nature devant être payées par l’employeur en application des sommes légales et conventionnelles ». Cette somme est alors placée sous un compte séquestre à cette intention. Bref, il s’agit d’assurer le financement d’un plan social qu’on peut considérer comme particulièrement généreux : rappelons que le plan social prévu porte au plus sur 400 départs. M. Stéphane Richard a du reste évoqué devant la Commission d’enquête « un pécule de plus de 100 000 euros » par salarié partant.
B. LA RESTRUCTURATION DU CAPITAL ET LE NOUVEL ACTIONNARIAT
C’est une SNCM remise à flot et équipée pour financer largement un plan social de 400 suppressions d’emplois qui est vendue.
La vente se fait ainsi.
● La CGMF cède aux consorts Veolia Transport et BCP (désignés par le protocole « les Partenaires ») 75 % des 37 005 euros constituant désormais le capital de la SNCM remise à flot.
Elle leur vend donc 1 850 actions de la SNCM, répartis entre les quatre septièmes pour BCP (1 057 actions pour 15 855 euros), et les trois septièmes pour Veolia Transport (793 actions pour 11 895 euros) (paragraphe III du protocole).
Pour ce prix les nouveaux actionnaires acquièrent également l’avance de 38,5 millions d'euros faite par la CGMF en vue du plan social, selon une répartition là aussi des quatre septièmes pour BCP (22 millions d'euros) et des trois septièmes pour Veolia Transport (16,5 millions d'euros). Il est cependant à noter qu’en cas d’excédent après la réalisation du plan, cet excédent devra être restitué à la CGMF.
La CGMF garde pour elle-même 617 actions, correspondant à 25 % du capital.
● Une augmentation de capital est alors organisée, en deux temps, pour 35 millions d'euros, ou plus exactement 35 000 010 euros.
1 750 000 actions sont émises au profit des partenaires BCP et Veolia Transport, pour 26,25 millions d'euros. L’augmentation de capital est répartie entre quatre septièmes pour BCP et trois septièmes pour Veolia Transport. Autrement dit, BCP souscrit à 1 million d’actions pour 15 millions d'euros, et Veolia Transport à 750 000 actions, pour 11,25 millions d'euros.
Par ailleurs, la CGMF souscrit à une augmentation de capital de 583 334 actions, pour un montant de 8 750 010 euros.
Les 9 % réservés aux salariés sont ensuite prélevés sur les 75 % attribués à BCP et à Veolia Transport. Le protocole prévoit que seront confiées à une institution financière agréée par la CGMF, aux fins de leur achat par les salariés avant le 31 décembre 2006, 210 222 actions, soit 120 127 actions par BCP et 90 095 actions par Veolia Transport.
À la suite de ces opérations, le capital de la SNCM s'élève donc à 35 037 015 euros, divisé en 2 335 801 actions de 15 euros de nominal, et est ainsi réparti :
Nombre d’actions |
% du capital | |
Butler Capital Partners |
880 930 |
37,71 % |
Veolia Transport |
660 698 |
28,29 % |
CGMF |
583 951 |
25 % |
Institution financière en lieu et place du FCPE |
210 222. |
9 % |
Total |
2 235 801 |
100 % |
Après soustraction du prix des actions réservées aux salariés, le montant payé par BCP est de 13 213 950 euros et celui payé par Veolia de 9 910 470 euros ; le montant des 9 % réservés aux salariés est de 3 153 330 euros et la part souscrite par la CGMF de 8 759 265 euros.
C. LES AUTRES ÉLÉMENTS DU DISPOSITIF
Plusieurs éléments doivent compléter cette analyse.
1. Les autres éléments financiers
● D’abord, BCP et Veolia doivent consentir à la SNCM un engagement d'avance en compte courant d'actionnaires d'un montant de 8 750 000 euros. Cet engagement est réparti selon la répartition habituelle des quatre septièmes et des trois septièmes, soit 5 millions d'euros pour BCP et 3,7 millions d'euros pour Veolia Transport.
Cette avance n’est cependant mise à la disposition de la SNCM qu’au fur et à mesure de ses besoins de trésorerie.
● Enfin la partie VII.5 du protocole met à la charge de la CGMF « une partie des dépenses patronales acquittées par la SNCM et relatives aux deux mutuelles des retraités de la SNCM » et ce « jusqu’à l’extinction des droits à mutuelle du dernier des retraités financés. »
Le calcul des charges ainsi mises à la charge de l’État est difficile. Il est néanmoins prévu une option, exerçable par « les Partenaires », autrement dits BCP et Veolia Transport, libérant intégralement de ces obligations la CGMF en contrepartie du versement d’une somme de 15,5 millions d'euros.
Le protocole inclut enfin au profit de BCP et de Veolia Transport deux conditions résolutoires de la vente.
La première porte sur la non acceptation du dossier par les autorités de l’Union européenne, et plus précisément la qualification d’aide d’État par la Commission « des sommes apportées par la CGMF à la SNCM au titre des opérations prévues par le présent protocole ou au titre des aides versées en application de la décision de la Commission du 9 juillet 2003 », ou la subordination de l’accord de la Commission « au remboursement des aides à la SNCM antérieurement déclarées compatibles avec le marché commun ou à toute autre condition ayant un impact substantiel sur les activités ou la valeur du Groupe SNCM ». Cette clause court pendant six ans à compter de l’entrée en vigueur du protocole.
La seconde porte sur la non attribution à la SNCM, à partir du 1er janvier 2007, de la nouvelle délégation de service public de la liaison Marseille-Corse ou d’une formulation de cette délégation selon des orientations autres que celles déjà « arrêtées par l’Assemblée territoriale de Corse et acceptées par les Partenaires ».
D. LA NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA SNCM
La restructuration de l’actionnariat s’accompagne d’une nouvelle gouvernance. D’abord, aux termes de l’article IV du protocole d’accord, la société prend la forme d’une société à conseil de surveillance et à directoire.
Le directoire est composé de deux membres, le président et le directeur général.
Il est révocable par le conseil de surveillance, dans les conditions courantes du code de commerce (article L. 225-68).
Sa mission est la gestion courante de la SNCM, selon les orientations fixées par le conseil de surveillance. Les articles IV.3.1 et IV.3.2 fixent les décisions, et tout particulièrement les décisions d’investissement ou de cession, pour lesquelles il a besoin d’une autorisation préalable du conseil de surveillance.
Le protocole définit aussi très précisément la composition du conseil de surveillance. Tant que l’actionnariat salarié n’est pas constitué, ce conseil comprend dix membres :
2 élus par les salariés ;
3 représentants de l’État ;
3 représentants de BCP ;
2 représentants de Veolia Transport.
Une fois l’actionnariat salarié constitué, il est composé de quatorze membres :
4 élus par les salariés ;
3 représentants de l’État ;
4 représentants de BCP ;
3 représentants de Veolia Transport.
Le protocole fixe aussi les conditions de nomination et de pouvoir du président du conseil de surveillance.
Le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage.
Jusqu’à la date où la délégation de service public sera attribuée à la SNCM par l’Office des transports de Corse, le président du conseil de surveillance sera choisi parmi les membres représentant l’État. Après cette date, le président du conseil de surveillance sera désigné parmi les membres représentant BCP.
Pour mémoire, la convention de délégation de service public a été signée le 7 juin 2007.
IV. LA PLUS-VALUE POUR BCP, LA SNCM POUR VEOLIA
Ainsi, la détermination des syndicats et des élus locaux aura eu raison de la procédure de privatisation à 100 %, et obtenu le maintien de l’État au capital – pour 25 % – et au sein du management de la SNCM, l’entrée des salariés au capital – pour 9 % – et au conseil d’administration, la réduction de BCP – à défaut de sa disparition souhaitée – à une participation minoritaire (38 %) et l’entrée, avec 28 % du capital, d’un opérateur industriel, en l’occurrence Veolia.
Par ailleurs, une minorité de blocage (34 %) est assurée en cas de convergence des intérêts des salariés et de l’État.
Il reste que, comme l’a dit M. Gérard Couturier à la Commission d’enquête « il y avait aussi beaucoup d’affichage dans cette répartition ».
A. UNE PRÉSENCE VIRTUELLE DE L’ÉTAT ?
Cet affichage concerne en premier lieu la présence de l’État au sein de la SNCM.
1. La neutralisation de la participation de l’État au capital
● D’abord, au sein de la SNCM privatisée, les parts de la CGMF font l’objet d’un statut particulier.
L’article III.2.7 du Protocole prévoit en effet que les actions de la SNCM détenues par la CGMF (autrement dit les 25 % détenus par l’État) auront pour valeur leur « valeur nominale initiale, libérée, déduction faite des montants éventuellement remboursés, augmentée de 10 % (dix pour cent) multipliée par le rapport J/365 » et diminuée du montant de tout dividende perçu.
Au cas où la CGMF voudrait vendre ces actions à un tiers, BCP et Veolia disposent d’un droit de préemption à ce prix.
Inversement, la CGMF dispose d’une promesse d’achat sur ses titres SNCM consentie par Veolia Transport et BCP. Ceux-ci au cas où elle souhaite les leur vendre, sont tenus de les lui racheter audit prix, selon une clé de répartition de répartition de 4/7è pour BCP et 3/7è pour Veolia Transport. Alors que cette clause était conclue pour six ans, soit jusqu’en mai 2012, son application a été prolongée, le 4 avril 2011, jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle DSP, autrement dit jusqu’en janvier 2015, au profit de la seule Veolia Transport.
Les actions de l’État sont ainsi transformées en sortes d’obligations, dont le taux de rendement, plutôt élevé, tend du reste à prouver la confiance qu’avaient les repreneurs, BCP et Veolia Transport, dans le redressement de la SNCM.
2. L’exclusion de l’État de la gouvernance de la SNCM
Apparemment forte au début, du fait du nombre de ses représentants et de la voix prépondérante du poste de président qui lui était réservé, la position de l’État au sein de la gouvernance sera vouée à un affaiblissement rapide jusqu’à un véritable effacement. Dès la signature de la DSP, la présidence du conseil de surveillance revient à BCP ; dès lors, en cas d’égalité entre d’une part les salariés et l’État et de l’autre BCP et Veolia – entre lesquels a été conclu un pacte d’actionnaires –, la voix prépondérante de la présidence exercée par le fonds BCP assure la majorité non plus à l’alliance entre l’État et les salariés mais au partenariat entre BCP et Veolia Transport. Le passage du nombre de représentants au conseil de 10 à 14 conforte encore la perte d’influence de l’État, qui ne représente plus alors qu’une voix sur cinq (pour une participation de 25 % au capital) au lieu d’une voix sur trois lors de l’entrée en vigueur du protocole.
Également signé le 16 mai 2006, le pacte d’actionnaires, qui est, aux termes de son article 14 « considéré comme confidentiel par les parties » – n’est donc pas censé être connu de la CGMF et des salariés – accroît la faiblesse de la position de l’État au sein de la gouvernance.
Son article 2 précise que « le conseil de surveillance devait être à l’origine, composé majoritairement de personnes désignées par BCP, y compris le conseil de surveillance », et rappelle que ce sont les discussions avec l’État qui ont conduit à ce que les conseils de surveillance successifs soient composés comme indiqué dans le protocole.
Il s’agit donc de remédier à cette situation.
À cette fin, l’article 2.3.2 stipule que, une fois BCP à la tête du conseil de surveillance « Veolia Transport se porte fort que les décisions ci-après ne pourront être prises par le directoire (…) sans l’accord d’une majorité des voix au Conseil de surveillance dont celle du Président :
« a) adoption de tout nouveau plan d’affaires ultérieur au plan d’affaires qui serait adopté le cas échéant (…)
« b) toute dépense non prévue dans les enveloppes financières mentionnée dans le plan opérationnel du Plan d’Affaires (…) correspondant à une acquisition, transfert ou aliénation de navires d’un montant supérieur à 40 millions d'euros ;
« c) toute dette financière d’un montant supérieur à 40 millions d'euros correspondant à l’achat de tout navire ou à tout autre investissement, et qui n’aurait pas été prévue dans le plan d’engagements financiers prévu dans le Plan d’Affaires (…) »
Autrement dit, toutes les décisions stratégiques ou d’investissement sont soumises à l’aval de BCP, alors même que la position de BCP serait minoritaire : il suffit de l’opposition du président du conseil de surveillance pour qu’une décision d’investissement ne soit pas prise. Le pacte étant confidentiel, on peut considérer que dans la pratique cette disposition signifie que, pour ces décisions, les représentants de Veolia s’alignent sur la position de BCP.
Inversement, « Veolia Transport serait en charge de la gestion opérationnelle de la société, les membres du directoire, y compris le président, étant désignés par le conseil de surveillance sur proposition de Veolia Transport. »
Commentant ce pacte d’actionnaires, M. Stéphane Richard a exposé que, même si « nous n’étions pas en position de force puisqu’il [Butler] avait été attributaire de l’appel d’offres », « les conditions du pacte que j’ai relu sont classiques concernant les relations au sein d’une société entre un financier d’un côté et un industriel de l’autre, notamment pour ce qui concerne la gouvernance, la répartition des pouvoirs, le rôle respectif du conseil de surveillance et du directoire. Le seul point particulier ayant d’ailleurs fait l’objet de discussions avait trait au rachat des parts de Butler ».
Plusieurs articles du pacte d’actionnaires traitent ensuite des obligations auxquelles les deux parties s’engagent, dans le cadre de leurs votes au conseil de surveillance, de façon à ce que ces dispositions soient respectées. Elles prévoient aussi les rares circonstances dans lesquelles BCP peut voter en faveur de la révocation d’un membre du directoire. BPC s’engage à ne voter la révocation d’un membre du directoire qu’en cas de non réalisation de l’objectif d’EBITDA annuel du plan d’affaires. On verra pourquoi ce point est essentiel pour BCP.
Sont joints en annexe au Pacte une définition de l’EBITDA, un plan d’affaires (orientations stratégiques), un plan d’exploitation opérationnel et surtout un plan d’investissements opérationnels très précis, indiquant année par année jusqu’en 2014 le montant des investissements à faire, en distinguant les investissements au titre des navires et les autres investissements et un plan d’investissements financiers). La gestion de la SNCM est donc pour un temps bel et bien partagée entre BCP et Veolia Transport.
En conclusion, dès l’entrée en vigueur du protocole, l’État n’a en réalité plus d’intérêts financiers dans la SNCM : il ne participera pas aux bénéfices que celle-ci attend de son retournement, ou que peut lui fournir l’abondante trésorerie constituée par ses 138,98 millions d'euros de « primes d’émission » ; en revanche, il peut vendre avec profit à tout moment les 8,76 millions d'euros qui constituent sa participation au capital.
De plus, dès l’entrée en vigueur de la DSP, la capacité d’action de l’État face aux partenaires signataires d’un pacte d’actionnaires que sont BCP et Veolia Transport est à peu près nulle.
Autrement dit, l’État n’est revenu dans la SNCM que pour n’y pas pouvoir agir avant d’en partir. Dans l’élaboration d’une telle posture, sans doute la volonté de pouvoir présenter, aux yeux de la Commission européenne, un dossier de privatisation indiscutable, a-t-elle eu une large part.
B. L’ORGANISATION PROGRAMMÉE D’UNE SORTIE BÉNÉFICIAIRE POUR BCP
De la même façon, la réduction de la part de BCP à 38 % du capital ne signifie pas plus la réduction de son pouvoir au sein de la SNCM que son échec à tirer profit de son acquisition. Vainqueur de l’appel d’offres, BCP s’est en effet trouvé dans une position lui permettant de peser de tout son poids dans la négociation qui s’ouvrait.
Le protocole d’accord le mentionne dès ses premiers paragraphes. « L’Offre de BCP consistait, après recapitalisation préalable de la SNCM par la CGMF, à acquérir l’intégralité des droits sociaux dans la société en contrepartie d’un apport total de 35 millions d'euros dont 25 millions d'euros en capital et le solde en apport en compte courant qui sera mis à la disposition de la SNCM au fur et à mesure de ses besoins de trésorerie.
« L’Offre de BCP a été retenue et acceptée par la CGMF et par l’État. Par suite, de très importants mouvements sociaux sont intervenus qui ont conduit BCP à aménager les conditions de reprise de la SNCM en s’associant avec Veolia Transport, acceptant que la CGMF conserve une participation de 25 % dans la Société, et permettant aux salariés de participer à la reprise de la Société, dans la limite de 9 % du capital de la Société. »
Dès lors, il aurait été curieux que BCP n’arrive pas à poursuivre au sein d’une SNCM au capital recomposé ce qu’il avait prévu de faire au sein de la SNCM achetée par lui.
Quels étaient ces objectifs ?
Tout d’abord, BCP est un fonds d’investissement. En tant que tel, il n’avait probablement pas l’intention de rester au capital de la SNCM au-delà d’une durée limitée. M. Walter Butler l’a indirectement reconnu devant la commission d’enquête lorsqu’il a évoqué les contentieux juridiques de 2006 entre Veolia et STEF-TFE, actionnaire de référence de la CMN donc partenaire de la SNCM dans le cadre de la DSP entre Marseille et la Corse : « quand Veolia est revenue, elle [STEF-TFE] l’a mal pris parce qu’une chose est de voir le fonds « France Private Equity III », géré par nous, rester au capital quelques années, configuration qui lui laissait des ouvertures, et une autre de voir s’implanter un groupe comme Veolia, qui employait 10 000 personnes dans la région. C’était en quelque sorte l’ennemi qui investissait la place ». « Rester quelques années ». Voilà bien un propos clair.
Ensuite, « L’État nous incitant à nous associer », selon M. Walter Butler, c’est vers la CMN que BCP se tourne pour trouver un partenaire industriel. Tant M. Walter Butler que M. Francis Lemor ont confirmé avoir eu des échanges sur un projet commun, même s’ils divergent sur le contenu et le degré d’approfondissement desdits échanges. Or, on connaît bien la position de CMN sur la flotte de la SNCM : M. Francis Lemor l’a rappelée devant la Commission d’enquête : « Nous avons été approchés par le banquier le 3 février à qui j’ai répété les conditions, en en ajoutant une de plus : nous ne pouvions pas intervenir dans une société exploitant des car ferries. (…) Déjà à l’époque, et sur un plan strictement économique, il n’y avait plus aucune raison pour que circulent des car ferries. Aucune de nos propositions n’a été acceptée et nous avons décidé de ne pas retirer de dossier d’appel d’offres ». Le rapprochement entre la CMN et BCP ne pouvait avoir comme point commun que la vente des car ferries, et donc, sauf projet d’extension des lignes de la SNCM vers le Maghreb, la réduction de la flotte aux quatre navires mixtes assurant la DSP avec les trois navires mixtes de la CMN, et la vente de tout ou partie des autres navires. Pour citer M. Henri Proglio : « En financier qu’il est, il [M. Walter Butler] voyait bien qu’il y avait 200 millions de plus-values latentes sur les bateaux. », Pour M. Walter Butler, du reste si l’affaire ne s’est pas faite, c’est sans doute parce que M. Lemor « misait plutôt sur la liquidation » de la SNCM.
En revanche, au cours de son audition par la Commission d’enquête, M. Walter Butler n’a pas cité Veolia Transport parmi les partenaires possibles de BCP. Il l’a même implicitement récusée : « j’hésitais à faire une offre car j’étais absolument persuadé que Veolia allait en faire une. On savait qu’elle avait eu des contacts précédemment et que, à conditions identiques, l’État choisirait l’industriel. Il nous poussait d’ailleurs à nous associer avec lui. » Ce que BCP n’a pas fait. Or, M. Stéphane Richard l’a exposé à la Commission d’enquête, et son action au sein de la SNCM le confirme, Veolia Transport souhaitait au contraire développer la SNCM.
Dans ces conditions, la plus-value potentielle représentée par la vente future des navires n’était pas accessible, puisque pour mener à bien sa stratégie Veolia avait besoin des bateaux ! M. Henri Proglio l’a clairement exposé à la Commission d’enquête : « Notre valorisation était très basse (…). Effectivement, nous n’avions pas intégré les plus-values parce que nous considérions qu’elles n’étaient pas accessibles. »
2. Les dispositions du pacte d’actionnaires et de l’accord sur les modalités de calcul du prix de cession
Par rapport à ces objectifs, quelle place est-elle faite à BCP dans la nouvelle SNCM par le pacte d’actionnaires et l’accord sur les modalités de calcul du prix de cession ?
● D’abord, le pacte d’actionnaires comporte une promesse d’achat par Veolia des titres de la SNCM détenus par BCP pendant cinq ans à partir du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du pacte d’actionnaire, autrement dit à partir du 16 mai 2008 jusqu’au 31 mai 2013. Le déclenchement de l’achat par Veolia est à l’initiative de BCP. C’est l’objet de l’article 3.5.1. du pacte.
« 3.5.1 Promesse d’achat
« a) Veolia Transport consent à titre irrévocable et définitif à BPC une promesse d’achat de tous les titres et de toutes les créances dont BPC sera propriétaire à la date de la promesse d’achat et s’interdit de rétracter la présente promesse d’achat.
« b) BPC accepte l’entier bénéfice de la promesse d’achat en tant que promesse sans prendre l’engagement de l’exercer.
« c) La promesse d’achat pourra être exercée à tout moment à compter du deuxième anniversaire de la signature du Pacte et jusqu’au septième anniversaire de la signature du pacte inclus.
« d) La promesse d’achat ne pourra être exercée qu’une seule fois et exclusivement pour la totalité des droits sous promesse, par notification adressée par BPC à Veolia Transport. (…) »
Certes, une disposition symétrique, instaurant une promesse de vente par BPC à Veolia Transport, sur demande de Veolia Transport, est également prévue ; mais son point de départ ne commence que « dans un délai de deux ans après à compter du jour suivant l’expiration de la période d’exercice de la promesse d’achat », autrement dit à partir du 16 mai 2015.
● À quel prix BCP peut-il faire racheter ses actions de la SNCM par Veolia ?
L’accord sur les modalités du prix de cession présente plusieurs formules de calcul de ce prix, en fonction des circonstances de la cession (sortie de l’État ou de Butler en premier) et du chiffre d’affaires de la SNCM.
Ainsi, la formule du prix de rachat de Veolia à BCP en cas de sortie de BCP avant l’État, et pour un chiffre d’affaires de la SNCM inférieur ou égal à 400 millions d’euros, dite P3 (c’est la formule qui a été appliquée ; il existait, pour d’autres configurations, des formules P1 et P2) est :
(0, 85 x CA x 0,4 + 7 x EBITDA x0,6) – DFN) x PB
Dans cette formule, DFN désigne la dette financière nette. PB désigne la participation totale détenue par BCP avant cession, « cette participation étant calculée en neutralisant les actions détenues par la CGMF » – ce qui montre, une fois de plus, le caractère de pur affichage du maintien d’une part de l’État à 25 %. Dans ces conditions, la participation de BCP est de « 50,29 ». De fait, 50,29 % est bien l’équivalent de 37,71 % (la part de BCP au sein de la SNCM) rapportés à 75 % (100 % du capital de la SNCM diminués des 25 % de l’État).
Dans tous les cas (P1, P2 ou P3), il est précisé que « si l’EBITDA ainsi calculé est négatif, il sera retenu dans la formule pour un montant égal à zéro ».
L’accord fournit en annexe plusieurs exemples chiffrés.
Dans l’exemple fourni pour le cas P3 (avec un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros environ), le prix de rachat de ses parts à BCP est, en cas d’EBITDA positif, de 113,8 millions d'euros, voire 122,8 millions d'euros en cas d’absence de dette financière nette, et en cas d’EBITDA négatif, de 40,5 millions d'euros.
Ne laissant rien au hasard, le pacte d’actionnaires fournit dans son annexe A la définition de l’EBITDA, en précisant que cette « définition s’applique exclusivement aux dispositions du présent pacte. »
Ladite définition est la suivante : « la notion d’EBITDA correspond au résultat courant tel que défini dans la comptabilité analytique après réintégration (i) des charges de capital d’exploitation et financier (incluant les loyers de crédit-bail de navires), (ii) des dotations aux amortissements des autres immobilisations corporelles et incorporelles et (iii) du résultat financier et après déduction des coûts de mise en conformité ».
● Enfin, il faut rappeler que le pacte d’actionnaires prévoit un contrôle par BCP sur les actes d’administration et de gestion de l’entreprise, donc sur les décisions stratégiques et d’investissement.
Autrement dit, l’accord de privatisation prévoit au profit de BCP une clause de sortie qu’il est libre d’actionner à sa guise après une présence de deux ans au sein de la SNCM, une formule de calcul de ce prix de sortie, et enfin des pouvoirs lui permettant de maîtriser, à travers, notamment, les décisions d’investissement et d’endettement, les paramètres de cette formule et donc le profit à attendre de la vente de ses actions SNCM, ledit profit étant évalué dès le départ à plusieurs dizaines de millions d’euros.
3. La fixation du profit futur de BCP
Comment Veolia, société multinationale séculaire et puissante, a-t-elle pu consentir une pareille clause à un modeste fonds d’investissement ?
M. Henri Proglio a bien résumé devant la Commission d’enquête les éléments de la négociation entre BCP et Veolia : « Concrètement, il a fallu une nuit de discussions non-stop avec le nouveau propriétaire. Je vous rappelle que l’État avait vendu et qu’il n’était plus qu’un spectateur dans l’histoire. Il donnait des coups de menton dans le vide.
« Butler avait, à mes yeux, la tâche facile. En financier qu’il est, il voyait bien qu’il y avait 200 millions de plus-values latentes sur les bateaux, et il lui suffisait de perdre la DSP pour être, en vertu de l’article L.122-12 du code du travail, débarrassé des marins qui auraient filé chez le nouvel opérateur. Il n’avait plus qu’à licencier le personnel du siège et à vendre les bateaux. Et c’en était fini de la SNCM. Le raisonnement est simple. Il s’accrochait donc à ses 200 millions de plus-values latentes qui aurait peut-être pu lui laisser, déduction faite des taxes et des indemnités de licenciement, entre 150 et 160 millions de cash. Grâce à un simple aller-retour.
« Devant un blocage total, je me suis dit qu’il fallait trouver une solution qui ne soit ni ruineuse pour l’entreprise que j’avais l’honneur de diriger, ni trop déresponsabilisante pour l’État, ni trop favorable à Butler qui, il faut le reconnaître, tenait le manche. Au bout d’une nuit de discussion, on est arrivé à 60 millions et on a conclu. Les juristes se sont ensuite chargés de rédiger le protocole. En substance, on lui reprenait sa participation pour 60 millions, mais il restait à bord pendant une période indéterminée, en tout cas au moins deux ou trois ans. (…) L’« équipage » était composé d’un pilote, Veolia, et d’un financier, Walter Butler, qui avait vocation à disparaître après avoir encaissé une plus-value. »
M. Stéphane Richard a tenu des propos du même ordre : « En somme, Butler a été malin et il a maximisé son investissement tandis que Veolia a payé le prix de sa décision de ne pas déposer d’offre le 15 septembre puisqu’elle a été fortement incitée à revenir, à cause de sa présence sur tout le territoire, et qu’elle a dû négocier avec un Walter Butler en position de force. »
Ainsi, les dispositions de l’accord sur les modalités de calcul du prix de cession déterminant les conditions de départ de BCP de la SNCM et le prix de cession de ses parts à Veolia sont en réalité l’habillage de la plus-value de 60 millions d’euros négociée par BCP (qui, toujours selon M. Henri Proglio « ne voulait pas céder à moins de 100 millions ») pour laisser les commandes de la SNCM à un opérateur industriel, au lieu d’extraire lui-même les plus-values qu’il y avait identifiées.
Cela dit, dans cette affaire, M. Henri Proglio ne prétend aucunement avoir réduit le gain que BCP aurait pu tirer de la SNCM ; il est parfaitement conscient que BCP a échangé quelque 150 millions d’euros de plus-values virtuelles, dont personne ne saura jamais quelle part aurait effectivement pu être réalisée, contre 60 millions d’euros de plus-values parfaitement réelles :
« L’expérience a prouvé qu’il n’était pas si simple de réaliser la plus-value puisqu’il [M. Walter Butler] aurait dû d’abord liquider l’entreprise. Pour aller chercher le diamant au fond de la mine, il fallait beaucoup de temps et d’efforts (…). L’incongruité vient du fait que nous avons été obligés de lui donner une partie significative des plus-values latentes potentielles alors que son profit aurait été bien moindre s’il était resté. Mais, pour l’obliger à rester, il fallait prendre en otage la ville et l’île, et ce n’est pas lui qui aurait payé la note. Bref, je devais lui faciliter l’accès à la plus-value, au-delà du raisonnable, pour la bonne raison qu’il était en position de force. »
C. UNE CESSION PAR L’ÉTAT AUX CONDITIONS DE VEOLIA
1. L’effort réellement consenti par l’État
Il a souvent été dit à la Commission d’enquête que la cession finale s’était faite aux conditions de la cession à BCP.
Pour le rapporteur, tel ne semble pas être le cas.
En effet, il ressort de l’analyse du protocole d’accord que le coût de la privatisation de la SNCM pour l’État a été le suivant :
– 142,5 millions d'euros au titre de la recapitalisation ;
– 38,5 millions d'euros au titre du plan social ;
– 8,75 millions d'euros au titre de la nouvelle souscription au capital ;
– 15,5 millions d'euros au titre du financement des mutuelles.
Le coût total pour l’État a donc été de 205,25 millions d'euros.
Ce que nous savons des propositions formulées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres fait apparaître que BCP demandait un apport de l’État de 113 millions d'euros, et Caravelle de 157 millions d'euros. Certes, ces chiffres sont à considérer comme des minima. Ils ne font apparaître aucune demande de financement au titre des plans sociaux. Or M. Jean-Louis Girodolle a indiqué à la Commission d’enquête que : « Enfin, l’État s’est engagé à financer le départ des 300 puis 400 salariés dans les conditions les plus généreuses, c’est-à-dire grâce à des mesures ASFNE dérogatoires, déjà accordées dans d’autres dossiers industriels difficiles. Au départ, je le répète, il n’était pas question de garantir quoi que ce soit. » Une fois les propositions déposées, la négociation continuait donc bon train.
Par ailleurs, les propositions de BCP et Caravelle demandaient elles aussi des clauses résolutoires, en cas de non acceptation de la transaction par l’Union européenne ou de non obtention de la DSP.
Il reste que la différence finale reste sensible. Comment en rendre compte ?
Lorsque, à la demande du Président Henri Proglio, M. Stéphane Richard informe, le 15 septembre 2005, le Conseil d’administration de Veolia Environnement de l’évolution du projet d’achat de la SNCM, il détaille ainsi l’effort à demander à l’État :
– 109 millions d'euros d’augmentation de capital ;
– 49 millions d'euros de prêt participatif ;
– 25 millions d'euros de complément de plan social ;
– 25 millions d'euros de compensation du handicap de compétitivité.
L’effort total ainsi demandé à l’État est donc de 208 millions d’euros.
Il ajoute que des conditions résolutoires seraient demandées à défaut de l’attribution à la SNCM de la nouvelle DSP « conforme à un cahier des charges prédéfini » ou de non acceptation du dossier par les autorités de Bruxelles. »
Enfin, s’il évoque une stratégie de retournement, avec un développement des lignes du Maghreb, et la vente de deux navires, il évoque aussi une diminution des effectifs de 700 salariés.
Pourquoi ce projet valorisait-il tellement moins la SNCM que les propositions des fonds Butler et Caravelle ? Le rapporteur a déjà cité M. Henri Proglio : « Notre valorisation était très basse (…). Effectivement, nous n’avions pas intégré les plus-values parce que nous considérions qu’elles n’étaient pas accessibles. »
Et malgré tout, toujours selon M. Henri Proglio : « Au final, nous étions à la limite de l’équilibre financier, avec un petit plus. Et mon conseil d’administration, même avec la prudence dont nous avions fait preuve, ne souhaitait pas prendre de risque pour une activité qui n’était pas suffisamment garantie par des flux récurrents. »
Dans ces conditions, on peut penser que M. Proglio a refusé à l’État de rentrer dans un schéma de valorisation inférieur à celui refusé par le Conseil d’administration de Veolia, contraignant ainsi l’État à un effort plus conséquent que celui que les fonds BCP et Caravelle lui demandaient, et au passage, faisant aussi apparaître que c’est bien sans doute dans l’esprit du démantèlement de la SNCM que ceux-ci avaient proposé une offre.
2. Une solution juridiquement irréprochable
En tout état de cause, que les montants demandés à l’État aient été supérieurs à ceux demandés par BCP ne pose guère de difficultés juridiques. La procédure était ouverte. M. Dominique de Villepin a rappelé que : « L’Agence des participations de l’État examine les offres sur la base de trois critères : un critère financier – quelle est l’offre la moins coûteuse pour l’État ? –, un critère social – l’emploi –, et un critère industriel – le projet ». M. Claude Gressier a exposé à la Commission que : « Le Gouvernement avait une marge d’appréciation et il n’était pas obligé d’adjuger au mieux disant. C’était un appel d’offres industriel : le but était de sauver la SNCM. (…) Même si Veolia avait été un peu plus cher, notre petit groupe de travail aurait sans doute recommandé au Gouvernement de retenir son offre. »
Raisonnant en termes de procédure européenne, M. Benoît Le Bret ne dit guère autre chose : « Par ailleurs, la notion de prix négatif n’a pas de sens. Avec la crise, la Commission est devenue beaucoup plus souple, et quand on ne trouve pour sauver une entreprise bancale qu’un seul investisseur privé, le prix qu’il propose est celui du marché. La théorie économique et la doctrine juridique n’ont pas de meilleure réponse à apporter. Sinon, le prix négatif n’est plus admis, et tout sauvetage d’une entreprise ayant reçu des fonds publics devient impossible. Car un repreneur mettra fatalement des conditions à une reprise. Je ne discute pas de la pertinence de celles qui ont été posées, je dis seulement qu’à la fin d’un processus transparent et non discriminatoire – et qui, en l’occurrence, n’a jamais été contesté – le bon prix est celui qu’est prêt à payer le dernier investisseur. »
M. Walter Butler a du reste souligné devant la Commission d’enquête que : « Contrairement à ce que j’ai pu lire ici ou là, l’opération a été validée par la Commission des participations et des transferts qui m’a entendu le 30 mars 2006, avec Veolia. »
Finalement, le seul obstacle à ce réaménagement aurait été M. Walter Butler lui-même, agissant au nom de ses mandants ; mais les termes mêmes du début du protocole d’accord montrent son parfait accord pour « aménager les conditions de reprise de la SNCM. »
Dans ces conditions, c’est à M. Dominique de Villepin que revient le dernier mot : « On ne peut pas refaire l’histoire, mais il est sûr que, si une proposition avait été faite par Veolia le 15 septembre 2005, aucun opérateur financier n’aurait fait de plus-value et Veolia n’aurait pas eu à la payer à Butler. Le processus de la privatisation s’imposait à nous. Et de rappeler : « Dans le système économique qui est le nôtre, tout agent a l’espoir de tirer un bénéfice d’autant plus élevé que le risque qu’il a pris est grand. Je rappelle que la plus-value de BCP a été faite au détriment de Veolia, pas de l’État ».
Ironiquement, on pourrait même dire que, en refusant de faire une offre globale puis en « réintervenant » à la demande de l’État, Veolia a acheté la SNCM dans les conditions qui lui convenaient ! M. Jean-Louis Girodolle a ainsi exposé à la Commission d’enquête que : « S’agissant de Connex, elle a, deux jours avant la clôture, évoqué l’idée de ne reprendre qu’une participation minoritaire. Nous lui avons dit de proposer ce qu’elle voulait mais en précisant que les règles communautaires empêchaient l’État d’aider une entreprise qui resterait publique. »
Ces propos sont corroborés par M. Gressier : « À ce moment-là, Veolia a proposé de se contenter d’une prise de participation minoritaire, quitte à monter à 100 % du capital après l’appel d’offres de 2007. »
Était-ce la frilosité du conseil d’administration de Veolia Environnement qui poussait Connex à proposer cette solution d’entrée progressive au capital de la SNCM ? Il faut bien reconnaître qu’au bout du compte, Connex, donc Veolia Transport, est bien entrée au capital de la SNCM, à titre minoritaire, aux côtés d’un partenaire privé – puisque l’État ne pouvait pas être majoritaire –, avant de ne monter à 66 % qu’en 2008, après l’obtention de la DSP ! En revanche, le partenaire financier, en l’occurrence BCP n’était-il peut-être pas celui vers lequel, dans un monde idéal, Veolia se serait tournée.
QUATRIÈME PARTIE : LA GESTION DE LA SNCM PRIVATISÉE
I. LA TENTATIVE AVORTÉE DE CONSTITUTION PAR VEOLIA D’UNE « GRANDE SNCM »
A. UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX
Le rapporteur l’a déjà indiqué, c’est dans une perspective de développement ambitieux que Veolia reprend la gestion de la SNCM. Le « Projet de relance de la nouvelle SNCM », communiqué à la Commission d’enquête par M. Alain Mosconi du Syndicat des travailleurs corses (STC), en porte témoignage :
UN PLAN AMBITIEUX ET PORTEUR D'AVENIR :
« Du redéploiement à la reconquête »
Préserver l'unicité de l'entreprise et assurer sa pérennité, en s'appuyant sur les compétences de chacun.
Stopper son retrait progressif, et reconquérir sa place en Corse, depuis Marseille, Nice et Toulon.
Gagner le renouvellement de la DSP, y compris dans la poursuite du partenariat avec la CMN.
Renforcer l'activité sur le Maghreb.
Chercher à ouvrir de nouvelles lignes en Méditerranée, afin de redevenir une compagnie incontournable.
Maintenir une flotte à 10 navires, armés au Pavillon Ier Registre.
Initier dès 2007 le renouvellement de 2 navires (I construction neuve, I bateau d'occasion)
Établir ensuite un rythme de renouvellement de la Flotte (I bateau tous les 2 ans et demi)
Faire de Veolia l'actionnaire majoritaire, en reprenant progressivement les parts des autres actionnaires (hors actionnariat salarié) à mesure de leur désengagement.
Organiser et développer l'actionnariat salarié.
Optimiser le Progrès Social, la valorisation des compétences, le dialogue entre les partenaires.
Prendre appui sur l'attachement du personnel à l'entreprise, pour devenir une compagnie reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses services.
Partager des valeurs communes à tous au service du Client.
Tel est le Projet proposé
Les éléments essentiels sont là : développer les activités de l’entreprise dans la desserte de la Corse, à partir de Marseille, mais aussi de Toulon et de Nice, renforcer sa position à destination du Maghreb, ouvrir même de nouvelles lignes en Méditerranée « afin de redevenir une compagnie incontournable », renouveler régulièrement la flotte, et enfin « faire de Veolia l’actionnaire majoritaire ».
Pour ce faire, conformément au pacte d’actionnaires, c’est Veolia qui nomme le directoire et fournit l’équipe de direction. « Un mot sur l’équipe, expose M. Stéphane Richard, chez Connex, le directeur régional en poste à Marseille, Gérard Couturier, était un ancien officier de marine, ce qui lui donnait un profil adapté aux particularités du dossier, lui permettant de rétablir le dialogue avec les partenaires sociaux, notamment avec Jean-Paul Israël de la CGT. Honnêtement, sans lui, je ne pense pas qu’on se serait lancé dans pareille aventure. Mais il était là, il y croyait et il s’est impliqué corps et âme. Il a donc fort logiquement pris la direction opérationnelle de la SNCM après le changement d’actionnaires. On lui a adjoint une autre personne venant également de Veolia et qui était son directeur général. Ils ont fonctionné en tandem au moins tant que j’ai été là. Une autre personne a joué un rôle important : le directeur des relations humaines de Veolia, Éric de Ficquelmont. En ce qui me concerne, je ne suis intervenu que très peu. Je siégeais bien sûr au conseil de surveillance, mais c’est l’équipe sur place épaulée de plusieurs personnes de l’état-major de Veolia qui a dirigé la société. »
On remarquera au passage que, dans cette phase, la direction de fait de la SNCM est bien aux mains de Veolia qui a délégué ses propres salariés dans la société et qui exerce un contrôle direct des relations humaines à travers le responsable du groupe.
Il reste que, pour mener cette politique, Veolia dispose de l’appui de BCP et du personnel. Comme l’indique M. Maurice Perrin (CFE-CGC) : « En somme, Veolia a pris en main l’application du plan approuvé par le personnel. » Et M. Walter Butler : « Nous avons bâti le business plan ensemble. Il se trouve qu’il a été respecté mais, sinon, on aurait pu changer le management, qui relevait de Veolia. »
B. LA TENTATIVE DE PRISE DE CONTRÔLE DE LA CMN
La constitution d’une SNCM puissante est d’abord marquée par la tentative de la SNCM de reprendre le contrôle de son ancienne filiale – de sa filiale, selon Veolia – la Compagnie méridionale de navigation.
Cette intention est clairement affirmée dans le « Projet de relance de la nouvelle SNCM » : « Pour ce qui est des rapports avec CMN, la poursuite de la collaboration actuelle sera prioritairement recherchée. Si toutefois, comme on peut le craindre, le Groupe STEF TFE continuait de faire obstacle à cette coopération, la SNCM, avec le soutien de Veolia, prendrait les dispositions pour répondre seule à la totalité de l'Appel d'Offres, et ferait valoir le droit, au titre d'une rupture entre les actionnaires pour reprendre le contrôle de sa filiale. »
Pour des raisons historiques qui dépassent le cadre de la présente Commission d’enquête – mais dont les auditions de MM. Francis Lemor, Walter Butler et Henri Proglio montrent qu’elles ne manquent pas d’intérêt – La SNCM et la CMN se trouvaient en effet l’une vis-à-vis de l’autre dans une situation plutôt originale.
En effet, la SNCM possédait 69 % des parts de la CMN. Cependant, cette participation était divisée en deux fractions. Près des deux tiers de ces parts étaient détenues en direct. La SNCM se trouvait ainsi actionnaire en direct de la CMN pour 45 %.
Les 24 % restants avaient été apportés, à travers une filiale à 100 % dénommée Compagnie générale de tourisme et d’hôtellerie (CGTH), à une société intermédiaire, la Compagnie méridionale de participations (CMP), laquelle détenait la quasi-totalité du reste du capital de la CMN, (53,1 %, les salariés de la CMN détenant les 1,9 % restants). Mais la CGTH ne détenait que 45 % de la CMP. Les 55 % restants étaient détenus à travers la société STIM d’Orbigny, par le groupe STEF.
Autrement dit, avec 69 % des parts directement et indirectement détenues, la SNCM n’avait aucune capacité de gestion de la CMN. Inversement, avec moins de 30 % du capital, c’est STEF qui, à travers la STIM d’Orbigny puis la CMP, en avait le contrôle. Comme M. Francis Lemor l’a exposé à la Commission d’enquête : « la SNCM a mis de l’argent » mais « elle n’a jamais eu d’influence au sein de La Méridionale. ». Par ailleurs, comme l’a rappelé M. Maurice Perrin : « Elle [la CMN] n’avait jamais versé de dividendes [à la SNCM] alors que la compagnie dégageait des résultats annuels entre 8 et 10 millions d’euros par an, pour un chiffre d’affaires d’une quarantaine de millions d’euros. »
Le rapporteur a déjà cité les propos de M. Walter Butler devant la Commission d’enquête : pour STEF, Veolia reprenant la SNCM, « c’était en quelque sorte l’ennemi qui investissait la place. » À vrai dire, STEF n’avait pas tort : « on a voulu reprendre le contrôle effectif de la CMN », a ajouté M. Walter Butler.
Inquiète de l’arrivée au capital de la SNCM d’un acteur privé puissant et qui ne cachait pas sa volonté d’expansion, STEF a rompu, en mars 2006, le pacte d’actionnaires qui, depuis 1992, unissait les deux compagnies. En conséquence de la rupture du pacte, la SNCM assigne, en août 2006, STEF devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la vente forcée des actions de STEF dans CMN-La Méridionale. Le 17 octobre 2006, ce tribunal, donne satisfaction à la SNCM et contraint STEF à céder sa participation dans La Méridionale à la SNCM, ce qui revenait de facto à donner le contrôle opérationnel de la CMN à la SNCM. De surcroît, le jugement rendu était immédiatement exécutoire, ce qui signifie que l'appel de la CMN n'était pas suspensif et que la SNCM pouvait en prendre le contrôle dès réception d'une lettre d'accord du Ministère des Finances. STEF obtient alors du ministère des finances qu’il ne donne pas cet accord, l’État se trouvant notamment juge et partie du fait des 25 % qu’il détenait dans la SNCM.
Le 17 octobre, alors que la SNCM avait déjà saisi le tribunal de commerce de Marseille afin de nommer des mandataires pour prendre effectivement le contrôle de la CMN, l'exécution provisoire de la sentence est suspendue par la Cour d'appel de Paris, dans l'attente du jugement sur le fond. Le 15 décembre, statuant en dernier ressort, cette même Cour d'appel de Paris infirme le jugement du tribunal de commerce et décide, contre les conclusions de l'avocate générale, que le pacte d'actionnaires de 1992 pouvait effectivement être résilié à tout moment à l'initiative de l'une des deux parties puisqu'il avait été conclu pour une durée indéterminée. En conséquence le groupe STEF n’était nullement contraint de céder tout ou partie de ses actions de la CMN à la SNCM. La Cour de Cassation a définitivement confirmé, le 6 novembre 2007, le jugement de la Cour d'appel. La CMN a donc finalement échappé à une prise de contrôle par la SNCM.
C. L’ÉCHEC DE LA SOUMISSION DE LA SNCM SEULE À LA DSP
Le parcours de la délégation de service public a été également assez compliqué.
Ayant sans doute, selon M. Francis Lemor, « considéré l’expropriation [de STEF de La Méridionale] comme un acquis » la SNCM a répondu à l’appel d’offres pour les lignes Marseille-Corse pour la période 2007-2013 sans la CMN, mais, selon M. Francis Lemor « en s’appropriant ses trois navires qui n’étaient pas nommés – en jargon maritime, on parle de navires « TBN » pour to be nominated – mais qui présentaient exactement les mêmes caractéristiques. De toute façon, il n’y en avait pas d’autres sur le marché. »
Inversement, la CMN s’était tournée vers Corsica Ferries pour présenter une offre commune de façon à faire échec à l’offre de la SNCM, voire à l’appel d’offres lui-même.
Au vu de des offres, présentées, l’Office des transports de la Corse a alors entamé des négociations avec la SNCM pour l’ensemble des cinq lignes et avec la société Corsica Ferries pour les seules lignes de Balagne et Porto-Vecchio.
Insatisfaites de cette décision, Corsica Ferries et la CMN ont saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bastia. Celui-ci, par une ordonnance du 23 octobre 2006, a suspendu la procédure de passation et enjoint à la Collectivité territoriale de Corse de procéder à un nouvel examen de l’offre présentée par le groupement composé de la CMN et de Corsica Ferries, mais sans faire droit à la demande de cette dernière tendant d’une part à réintégrer sa candidature individuelle pour les trois lignes de Bastia, Ajaccio et Propriano et de l’autre part à écarter la SNCM des négociations.
Saisi en cassation par Corsica Ferries, le Conseil d’État a d’abord estimé que l’OTC n’avait pu régulièrement engager des négociations avec la SNCM ; en effet, le cahier des charges de la délégation imposait de fournir une comptabilité détaillée ligne par ligne. Or, alors que celle-ci était indispensable pour comparer les différentes offres entre elles, elle ne figurait pas dans l’offre de la SNCM.
Il a ensuite jugé que l’offre de Corsica Ferries, présentée de manière alternative comme portant de façon indissociable sur deux des trois lignes desservant les ports d’Ajaccio, Bastia et Propriano ne comprenant pas, pour l’une des deux lignes, l’ensemble des services mentionnés par le cahier des charges, l’OTC avait donc le droit de ne pas ouvrir de négociations avec Corsica Ferries.
L’appel d’offres se trouvant ainsi quasi-intégralement vidé de son contenu, le Conseil d’État a donc jugé que, pour tirer les conséquences des irrégularités constatées au cours de la procédure, il revenait à la Collectivité territoriale de Corse, soit de reprendre intégralement la procédure, soit d’inviter les sociétés à produire de nouvelles offres, conformes aux prescriptions du règlement d’appel d’offres, en fixant une nouvelle date de remise.
En conséquence, l’appel d’offres a été déclaré infructueux par l'Assemblée de Corse en décembre 2006 et un autre a été lancé en janvier suivant, sur la base du même cahier des charges que celui prévu précédemment.
D. LE RETOUR À LA CONFIGURATION PRÉCÉDENTE
La fin de l’année 2006 marque ainsi un double échec de la stratégie de développement de la SNCM lancée par Veolia Transport. Non seulement la SNCM n’a pas repris le contrôle de CMN-La Méridionale, mais la justice a revêtu de l’autorité de la chose jugée l’indépendance de celle-ci par rapport à la SNCM.
De plus, la SNCM n’a pas réussi non plus à obtenir seule la délégation de service public de transport entre Marseille et la Corse. Dès lors qu’elle ne contrôlait pas la CMN, elle ne disposait du reste pas des bateaux nécessaires à ce service, et ne pouvait que très difficilement se les procurer ; non seulement, comme M. Francis Lemor l’a rappelé à la commission d’enquête, le marché des navires d’occasion est extrêmement étroit, mais les ports corses exigent des caractéristiques particulières : à l’exception d’Ajaccio et de Propriano, ils ne peuvent en effet accueillir par tous temps et sans l’aide d’un remorqueur des bateaux de plus de 180 m de long.
Il ne restait donc plus, dans l’intérêt bien compris de tous, qu’à revenir au statu quo ante, sous réserve bien sûr de l’indépendance consolidée de la CMN. À l'occasion de la reprise de la procédure d'appel d'offres, la SNCM et la CMN ont donc déposé une offre groupée, mais toujours « de manière conjointe et non solidaire » le 9 février 2007.
Compte tenu du cahier des charges, très proche de celui de la précédente convention, le contenu de cette offre ne proposait que peu de changements par rapport au service public en vigueur jusqu'alors.
Après plusieurs péripéties juridiques supplémentaires à l’initiative de Corsica Ferries, le Conseil d’État a validé la procédure le 4 juin 2007. La concession de service public maritime pour les lignes Marseille-Corse a pu alors être signée le 7 juin 2007 entre l'Assemblée de Corse et le groupement SNCM-CMN pour la période allant du 1er juillet 2007 à la fin 2013.
E. L’AFFAIRE DU PREMIER « JEAN NICOLI » : LES PREMIÈRES DIVERGENCES STRATÉGIQUES ENTRE VEOLIA ET BCP
En marge de l’opération de constitution d’une « grande SNCM », un épisode montre cependant que, dès le départ, les points de vue de BCP et de Veolia sur la gestion de la SNCM n’étaient pas les mêmes.
Le 20 octobre 2006 en effet, le conseil d’administration de Veolia Transport autorise l’achat à la compagnie grecque Attica, pour la somme de 112 millions d'euros, d’un navire mixte, appelé Superfast X, destiné à être mis « à la disposition de la SNCM ». Ce navire sera rebaptisé Jean Nicoli.
Pourquoi cet achat ? M. Francis Lemor l’a révélé à la commission d’enquête : « L’objectif poursuivi par Veolia, par Stéphane Richard plus précisément, c’était, faute d’avoir pu mettre la main sur les navires de La Méridionale, d’essayer de la contourner par des achats extérieurs. »
Les comptes sociaux pour 2007 de la SNCM confirment cette analyse : « Afin de maximiser ses chances de succès à l’appel d’offres lancé par la Collectivité territoriale de Corse (CTC) pour le service public maritime entre la Corse et Marseille, appel d’offres qui privilégiait les réponses globales, la SNCM avait demandé en juillet 2006 à ses actionnaires privés de l’aider à acquérir le navire Superfast rebaptisé Jean Nicoli de telle sorte que cette unité puisse être intégrée dans son offre faite à la CTC, le 4 août 2006. Veolia Transport s’est porté acquéreur de ce navire et un contrat d’affrètement coque nue a été signé le 5 février 2007 entre Veolia Transport et SNCM. »
Mais pourquoi cet achat par Veolia et non par la SNCM ? Cette fois, c’est M. Stéphane Richard qui fournit l’explication : « De mémoire, nous avons bien acheté un bateau d’occasion qui a été propriété de Veolia pour contourner Butler qui ne voulait pas investir alors que nous considérions qu’il fallait faire cette acquisition. Un tel montage était donc nécessaire pour surmonter ce blocage. »
Interrogé sur un épisode ultérieur, M. Gérard Couturier confirme cette déclaration : « Auparavant, nous avions déjà eu besoin d’un navire, mais comme nous n’avions pas obtenu l’autorisation de Butler, il nous avait fallu, dans la période compliquée de l’appel d’offre, nous livrer à une vraie gymnastique. Veolia avait dû acheter en direct un navire, que la SNCM avait affrété pendant un an. »
Autrement dit, cet épisode montre déjà une première divergence d’appréciation notoire entre les deux partenaires de la SNCM.
De fait, cette affaire n’aura pas été profitable pour la SNCM. Le Jean Nicoli, ex-Superfast X est devenu superflu une fois renoué le partenariat avec la CMN. En conséquence, toujours selon les Comptes sociaux de la SNCM pour l’exercice 2007 : « Suite aux conditions d’attribution de la DSP, SNCM a dénoncé le 8 juin (2007), avec un préavis de six mois, ce contrat d’affrètement. Le 11 décembre, un compromis de vente du Jean Nicoli a été signé entre Veolia Transport et Seafrance pour un transfert de propriété prévu en avril 2008. »
Selon des informations recueillies par le rapporteur, le Jean Nicoli ex-Superfast X aurait été loué à la SNCM par Veolia Transport pour 36 000 euros par jour, autrement dit pour un coût de 11 millions d'euros sur la période d’affrètement pendant l’année 2007.
Enfin, le Document de référence 2008 de Veolia Environnement indique que : « Le groupe a cédé le bateau Jean Nicoli utilisé par la SNCM dans le cadre de sa délégation de service public pour un montant de 105 millions d'euros au cours du premier semestre 2008. »
Bref, le navire a été revendu à perte, seule la location par la SNCM ayant sans doute permis à Veolia d’en tirer un bénéfice, de quelques millions d’euros, mais au détriment de la SNCM qui l’a d’autant moins utilisé que, long de plus de 200 mètres, il était peu adapté aux ports de Corse.
II. LA SORTIE DE BUTLER CAPITAL PARTNERS DU CAPITAL DE LA SNCM.
A. UNE SORTIE RAPIDE … À LA DEMANDE DE VEOLIA
On le sait, l’Accord sur les modalités de calcul du prix de cession prévoyait une promesse d’achat par Veolia des titres de la SNCM détenus par BCP pendant une période qui s’ouvrait le 16 mai 2008 et se terminait le 31 mai 2013.
Le rapporteur a trouvé dans l’un des documents qui lui ont été adressés le fait que la vente aurait été faite le 21 octobre 2008 : BCP n’aura ainsi pas attendu six mois pour faire activer la promesse d’achat par Veolia.
C’est que laisse entendre aussi M. Stéphane Richard : « Walter Butler a levé son option après mon départ. Il a réalisé rapidement une plus-value non négligeable parce qu’il a su le faire au bon moment, au terme de l’engagement de détention des titres, qui était de deux ans. »
En réalité, il semble curieusement que ce soit Veolia qui ait elle-même sollicité l’activation de ladite promesse, alors que rien ne l’y contraignait.
Au président Arnaud Leroy qui constatait : « Vous avez levé votre option très vite », M. Walter Butler a répondu : « Ce n’est pas moi qui l’ai actionnée. Le rachat s’est fait en gros sur la base de la formule qui était prévue, mais il n’y a pas eu de notification. L’horizon était dégagé, les prévisions favorables, Veolia voulait être maître à bord, et nous nous sommes mis d’accord. » Et encore « Veolia avait déclaré publiquement qu’elle avait vocation à devenir l’actionnaire majoritaire et elle a souhaité prendre le contrôle conformément à nos accords, pour consolider la SNCM dans ses comptes ».
B. DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES MOINS FAVORABLES
En réalité, il n’était pas besoin d’être grand clerc pour savoir que les conditions d’exploitation de la SNCM, quelles qu’elles aient été alors, avaient vocation à s’amoindrir dans un futur proche. Il suffisait de lire le texte de la convention de délégation de service public.
1. Le remplacement du « Monte Cinto »
Le A de l’annexe 2 de la convention dispose en effet : « Début 2009, la SNCM procède au remplacement numérique du « Monte Cinto », par un cargo mixte de construction récente et de caractéristiques commerciales accrues (capacités passagers et fret, vitesse d’exploitation) qui sera affecté à la ligne de Porto-Vecchio, « Monte d’Oro » assurant la desserte de la ligne de Balagne. « Monte Cinto » sera alors retiré de la flotte de continuité territoriale. »
Bref, la bonne exécution de la DSP supposait l’achat en 2009 d’un nouveau navire. Or, selon M. Gérard Couturier, « L’achat d’un navire augmentait l’endettement, ce qui pesait, selon les termes du pacte, sur le prix de cession des parts de Butler. C’est là, je pense, le point essentiel. »
BCP s’étant déjà opposé pour cette raison à l’achat en 2006 d’un navire supplémentaire en vue de soutenir l’expansion prévue de la SNCM, il n’y avait aucune raison qu’il remette en cause l’analyse qu’il avait faite deux ans plus tôt. « Au conseil de surveillance, expose M. Gérard Couturier, chacun connaissait les réticences de Butler à investir dans un nouveau navire, qui était pourtant nécessaire. »
Au passage, une clause comparable prévoyait le remplacement, mi-2011, du Scandola de la CMN « par un cargo mixte neuf de grande capacité qui sera affecté à la ligne de Bastia ». Or, on le sait, la construction du Piana, puisque tel fut le nom du nouveau navire, a pesé sur les comptes de la CMN.
2. La clause d’adaptation de la convention de délégation de service public
Par ailleurs, la convention de délégation de service public comportait un article 8, intitulé « Clause d’adaptation », ainsi rédigé : « Compte tenu de la durée de la convention, un point d’étape est prévu dans le courant de la troisième année pour analyser, en s’appuyant sur une procédure et une expertise contradictoire, l’équilibre financier de la Convention et arrêter, par concertation entre les parties, les mesures éventuelles de correction des services et d’ajustement des tarifs qui garantiront la maîtrise pour la Collectivité territoriale de Corse de son intervention financière, notamment par la diminution de la compensation, et devront préserver l’économie générale de la Convention. »
Autrement dit, la convention prévoyait une procédure de révision à la baisse des conditions de la DSP pendant l’année 2009-2010.
M. Antoine Sindali, alors président de l’Office des transports de la Corse, (OTC) s’est expliqué sur ce point : « Nous avons donc opté pour le maintien à l’identique du cahier des charges tout en introduisant, pour anticiper le risque de difficultés financières, la fameuse clause d’adaptation destinée à s’appliquer à la clause de sauvegarde au terme d’un délai de trois ans. Notre objectif était de maîtriser l’enveloppe financière que nous attribuions aux délégataires – le groupement SNCM-La Méridionale, avec deux gros tiers pour la première, et un petit tiers pour la seconde. »
Il s’agissait notamment de « remettre en cause une clause de sauvegarde de la convention en vertu de laquelle nous complétions, sans limite, la subvention que nous accordions aux compagnies délégataires en fonction des besoins, notamment des hausses du carburant » et de diminuer le service complémentaire : « nous avions souhaité une diminution de moitié du service complémentaire, nous sommes parvenus à une réduction de 25 % seulement. »
De fait, l’application de cette « clause de revoyure » n’a pas été une formalité : elle s’est traduite par une économie de plusieurs dizaines de millions d’euros par an – 30 ou 40 millions.
C. POUR VEOLIA, UNE DÉCISION FORCÉE QUI TRADUIT L’INCOMPATIBILITÉ DES STRATÉGIES DES DEUX PARTENAIRES
En fait, il semble bien que, conscient de ces perspectives, BCP ait en quelque sorte « forcé la main » à Veolia.
On l’a vu lors de l’analyse du pacte d’actionnaires, les investissements au-delà d’un certain montant supposaient l’accord de BCP. Il suffisait donc à M. Walter Butler de refuser l’investissement pour que celui-ci n’ait pas lieu.
Les conséquences du non-remplacement du navire étaient simples : « Le contrat de DSP avec la Corse nous obligeait à remplacer au moins un navire, inadapté en taille et en âge, avec une date limite, expose M. Gérard Couturier. Ne pas le faire, c’était nous exposer à perdre la DSP. Butler s’opposait au rachat de ce navire, et il en avait les moyens, aux termes des accords. Par conséquent, Veolia/Connex a décidé de lever l’option d’achat à ce moment-là pour faire sortir Butler. »
« La DSP était indispensable ! poursuit M. Gérard Couturier. La perdre, c’était signer l’arrêt de mort de la SNCM. D’où l’emballement dans cette affaire : Veolia envisageait très difficilement de devoir liquider la SNCM. »
L’affaire, selon M. Gérard Couturier, était imparable : « Le directoire aurait pu passer outre le choix de Butler, même s’il devait solliciter l’autorisation du conseil de surveillance au-delà de certains seuils. Mais, pour ce faire, il aurait fallu une trésorerie que la SNCM n’avait pas, ou au moins la garantie de ses actionnaires. Et là, on retombe sur l’obstacle. »
Bref, on retrouve de la part de BCP la même démarche que celle qu’il avait eu lors de la première négociation avec Veolia, et déjà rapportée par M. Henri Proglio : « Butler avait, à mes yeux, la tâche facile. En financier qu’il est, il voyait bien qu’il y avait 200 millions de plus-values latentes sur les bateaux, et il lui suffisait de perdre la DSP pour être, en vertu de l’article L. 122-12 du code du travail, débarrassé des marins qui auraient filé chez le nouvel opérateur. Il n’avait plus qu’à licencier le personnel du siège et à vendre les bateaux. Et c’en était fini de la SNCM. »
BCP était maître de la décision du conseil d’administration. Perdre la DSP entraînait la liquidation de la SNCM et donc la réalisation des plus-values latentes. Si l’on considère qu’elles étaient voisines de 200 millions d'euros, la part de BCP représentait 76 millions d'euros.
Au bout du compte, Veolia a racheté la part de BCP pour 73 millions d'euros. Le chiffre figure dans le Document de référence 2008 de Veolia environnement : « Veolia Transport a racheté en décembre 2008 (après l’obtention de l’accord des services européens de la concurrence) les parts dans la SNCM (37,71 %) détenues par BCP [Butler Capital Partners] pour un montant de 73 millions d'euros portant ainsi le pourcentage de participation du groupe dans la SNCM à 66 %. »
Selon M. Gérard Couturier, le départ de BCP fut extrêmement bien accueilli dans l’entreprise : « Lorsque la décision, prise entre actionnaires en dehors du conseil de surveillance – j’y insiste – a été présentée au conseil de surveillance et discutée, elle a été accueillie avec une grande satisfaction. Les salariés ne rêvaient que de voir disparaître Butler, et, je le dis égoïstement, le directoire a été soulagé de savoir qu’il aurait un navire et garderait la DSP. »
Et, conformément aux clauses de la convention de délégation de service public, Veolia a pu, pour remplacer le Monte Cinto, acheter en 2009 à la Minoan Lines, au prix de 75 millions d’euros environ, un navire d’occasion : le Pasiphae Palace, rebaptisé Jean Nicoli.
Une incertitude demeure : à partir du 16 mai 2008, BCP pouvait activer la promesse d’achat de Veolia. Or, au lieu de procéder ainsi, il a en quelque sorte forcé Veolia à lui demander le rachat desdites parts, alors que l’option de vente activable par Veolia n’était pas encore ouverte.
Le rapporteur n’a pas essayé de reconstituer à partir de la formule de l’accord sur les modalités de calcul du prix de cession ce qu’aurait dû être le prix de vente. Il reste qu’on peut se demander si, dès lors que c’est Veolia qui a demandé à BCP de lui vendre ses parts, le prix payé par Veolia n’a pas été supérieur à celui prévu par la formule.
M. Walter Butler a du reste déclaré à la Commission d’enquête : « Le rachat s’est fait en gros sur la base de la formule qui était prévue ». « En gros »….
M. Gérard Couturier a insisté sur le coût du rachat : « Connex a dû, à un moment, envisager le rachat de la part de Butler à un prix assez élevé, qui selon moi excédait très nettement la valeur de l’entreprise à ce moment-là (…) Il était devenu nécessaire de sortir Butler ». Certes, il précise aussi que ce prix « avait été convenu : il s’agissait de l’exécution du pacte. ». Mais il n’est même pas sûr que M. Couturier, président du directoire, ait eu connaissance de ce pacte. Il expose du reste que « Veolia-Connex a décidé de lever l’option d’achat à ce moment-là », alors que nous savons qu’elle n’était pas encore exerçable. Mais il ajoute : « Ce n’est pas la meilleure opération économique qu’ait réalisée Veolia, mais elle y a été poussée par la nécessité. »
Dans ces conditions, on peut se demander si le prix payé par Veolia à BCP est bien le résultat de la formule, ou le résultat d’une nouvelle négociation, dans les mêmes conditions qu’à l’automne 2005.
Dans la mesure où la Commission d’enquête porte sur les conditions de privatisation de la SNCM, et non sur les relations financières entre BCP et Veolia, le rapporteur arrêtera là ses commentaires.
En tout état de cause s’est concrétisé une fois de plus dans cette vente le fait que les intérêts de Veolia et de BCP dans la SNCM n’avaient jamais été compatibles. Au total, le contrôle de la SNCM par Veolia lui aura ainsi coûté, si l’on ajoute à ces 73 millions d'euros les 9,9 millions d'euros du protocole d’accord de mai 2006, la somme de 83 millions d'euros environ.
Ainsi se clôt un épisode à propos duquel on citera M. Dominique de Villepin : « On ne peut pas refaire l’histoire, mais il est sûr que, si une proposition avait été faite par Veolia le 15 septembre 2005, aucun opérateur financier n’aurait fait de plus-value et Veolia n’aurait pas eu à la payer à Butler. »
III. UNE GESTION DIFFICILEMENT COMPRÉHENSIBLE
A. LA PRÉSENTATION OPTIMISTE DE MM. STÉPHANE RICHARD ET WALTER BUTLER
Interrogés sur la gestion de la SNCM dans les premières années qui ont suivi sa privatisation, tant M. Walter Butler que M. Stéphane Richard se sont montrés plutôt satisfaits du parcours accompli.
M. Walter Butler notamment décrit une SNCM redressée, conquérante, à la gestion assainie et rationalisée : « Le plan déposé en annexe de notre offre finale visait à ramener le résultat d’environ – 30 millions à + 10 millions. Nous avons fait mieux grâce à un gain de chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros, par le biais notamment des restaurants, des ventes à bord, en reconquérant des passagers. L’impression que donnait la SNCM d’être en grève permanente faisait fuir les clients qui sont revenus quand la visibilité s’est améliorée. Les coûts de personnel ont été réduits de 15 millions d’euros, l’effectif étant passé de 2 400 à 2 000 personnes. Nous avons fait des économies de charges externes, de 16 millions à travers un plan de réduction des coûts. Malgré l’augmentation du fioul, des amortissements et des investissements à réaliser, on a respecté le plan d’investissement à la lettre ».
Sur la sortie de Butler Capital Partners (BCP) du capital, M. Stéphane Richard a précisé : « À l’époque, la SNCM ne marchait pas mal au niveau commercial, et l’impact sur le résultat des reprises de provisions constituées au moment de la privatisation se faisait sentir. D’ailleurs Veolia Transport en a aussi profité en 2006 et 2007, même si ensuite la situation s’est de nouveau dégradée. Bref, Butler a réalisé une plus-value dont je comprends que, quelques années après, elle puisse surprendre, mais il n’y avait pas de raison de s’en offusquer sur le moment. »
Enfin, selon M. Walter Butler : On est sorti parce que Veolia avait vocation à être l’opérateur dans la longue durée et que le repositionnement de l’entreprise était fait. À notre arrivée, le chiffre d’affaires était de 250 millions et de 307 millions à notre départ ; le résultat respectivement de – 25 millions et de + 15 millions. L’entreprise n’était plus la même, même si sa situation s’est détériorée depuis. »
L’examen des comptes de la SNCM ne permet pas de confirmer exactement ces propos.
B. LA RÉALITÉ : UNE SNCM PAS REDRESSÉE DU TOUT
En réalité, les comptes sociaux annuels de la SNCM le montrent, la situation de la SNCM ne s’est jamais améliorée, en tout cas jamais suffisamment pour qu’on puisse à un moment ou un autre considérer qu’elle était en voie de redressement. L’objet de la commission d’enquête portant sur la privatisation de la SNCM, le rapporteur s’est volontairement arrêté à l’année 2010, afin de ne pas interférer avec les débats actuellement en cours.
1. Un résultat d’exploitation constamment négatif
Certes, le chiffre d’affaires se redresse momentanément : de 183,3 millions d'euros (hors taxes) en 2005, il passe à 203,8 millions d'euros en 2006 (+ 11,2 %) et 222,2 en 2007 (+ 9,3 % et + 21,2 % par rapport à 2005) avant de se stabiliser, ou presque, en 2008, avec 219,2 millions d'euros.
Mais dès 2009, il redescend à 196,7 millions d'euros puis à 189,4 millions d'euros en 2010, 6,1 millions d'euros de plus qu’en 2005 et surtout 4,1 millions d'euros de moins qu’en 2004, année de très fortes pertes.
L’analyse du résultat après impôts et charges apparaît plus encourageante : négatif de 29,7 millions d'euros en 2004 et de 28,8 millions d'euros en 2005, ce résultat l’est certes encore de 22,1 millions d'euros en 2006 et de 27,8 millions d'euros en 2007. Mais on le voit ensuite se redresser : il est positif de 182 000 euros en 2008, puis de 17,7 millions d'euros en 2009. Le résultat négatif de 1,9 million d'euros en 2010 pourrait ainsi apparaître comme un léger faux pas, où la conséquence d’une situation d’exploitation défavorable.
Malheureusement, il n’en est rien. Le résultat d’exploitation aura été négatif pendant l’ensemble de la période ! Négatif de 39,5 millions d'euros en 2004 et de 33,5 millions d'euros en 2005, il l’est encore respectivement de 33,3 et de 31,6 millions d'euros en 2006 et 2007, les deux années pendant lesquelles le chiffre d’affaires se redresse. C’est en 2008 qu’est atteint le meilleur – si l’on peut dire – résultat de la période : une perte d’exploitation de seulement 2,8 millions d'euros, 1,3 % du chiffre d’affaires… Mais dès 2009, le creusement des pertes reprend : le résultat d’exploitation y est négatif de 8 millions d'euros, avant d’atteindre 16,4 millions d'euros en 2010.
En réalité, en trois ans de SNCM privatisée, c'est-à-dire de 2006 à 2008, les pertes d’exploitation auront représenté la moitié des 137,5 millions d'euros de « primes d’émission » versées par l’État comme solde de tout compte pour la couverture des pertes futures.
Le déficit d’exploitation de la SNCM n’aura donc été réduit – ou annulé, pour l’année 2008 – que par des produits financiers, essentiellement des produits financiers de participation et des intérêts – ceux procurés par le compte de primes d’émission, sans doute –, et par des produits exceptionnels, autrement dit des cessions d’actifs. Cela n’a pas échappé aux organisations syndicales.
Pour citer M. Maurice Perrin (CFE-CGC) : « c’est en cédant des actifs que la SNCM a pu rester, jusqu’à il y a peu, une société désendettée. ». À ce titre, on peut notamment noter l’impact sur les comptes de 2009 et 2010 de la vente à STEF des parts de la SNCM dans la CMN – qu’elles aient été détenues directement ou indirectement –, pour 45 millions d'euros environ, à l’automne 2009, opération qui dénoue tous les liens capitalistiques entre la SNCM et son ancienne filiale, et, il faut bien dire, consacre l’accès de celle-ci à une totale indépendance vis-à-vis de la SNCM. Le groupe STEF détient désormais 97,9 % du capital de la CMN, au côté des salariés qui détiennent 2,1 % des parts.
2. Une gestion déroutante des effectifs et des charges de personnel
Comment expliquer une telle évolution ? On peut certes évoquer la concurrence plus ou moins loyale de Corsica Ferries sous pavillon italien, les conséquences perverses de l’aide sociale au passager, ou même le poids syndical et les turbulences sociales dues au personnel.
Une raison en tout cas ne saurait être invoquée, celle du poids des charges d’investissement : pendant toute la période, un seul navire aura été renouvelé – c’était la condition pour garder la DSP –, et aucun construit.
On peut donc se demander si la SNCM a même été gérée. Le partenaire de la SNCM dans la DSP, la CMN, est aussi sous pavillon français premier registre ; or sa situation financière n’est en rien comparable à celle de la SNCM : la CMN fait même construire des bateaux !
La gestion du personnel fait partie des éléments les plus édifiants. Cette question avait attiré, dès son arrivée à Marseille, l’attention du préfet Christian Frémont : « J’avais suivi de près les péripéties de Brittany Ferries dans le Finistère, et je savais que les dépenses de personnel y représentaient 26 % du budget, contre 56 % à la SNCM ! Quant à sa grande rivale, Corsica Ferries, elle exploitait le même nombre de bateaux avec la moitié moins de personnel. »
Pour réduire les sureffectifs, le plan de redressement de la SNCM comportait un effort de l’État de 38,5 millions d'euros destinés au financement de 400 suppressions de postes. Or, il ressort des comptes sociaux de la SNCM que l’effectif de la compagnie, de 2 316 personnes en 2005, ne passa qu’à 2 258 en 2006, avant de remonter à 2 345 en 2007, puis de descendre à 2 204 en 2008. L’effectif des 2 000 salariés, objectif du plan social, n’est donc atteint qu’en 2009, plus de trois ans après la conclusion du protocole d’accord, et ce après que cet effectif ait remonté d’une centaine d’unités entre 2006 et 2007 !
L’analyse des charges de personnels est, dans ces conditions, tout aussi parlante. C’est le cumul de la masse salariale et des avantages sociaux qui représente, en 2004, les 56 % du chiffre d’affaires évoqués par M. le préfet Frémont. Ce cumul, qui se monte à 108,4 millions d'euros en 2004, descend à 104,6 en 2005. Ensuite, il ne fera que progresser : 106,8 millions d'euros en 2006, 112,1 millions d'euros en 2007 et même, sans doute du fait du versement de primes au départ, 149,3 millions d'euros en 2008. Il ne redescend qu’en 2009, avec 105,8 millions d'euros pour 2 007 salariés (572 de moins qu’en 2004). Sur la période, le ratio entre coûts de personnel et chiffre d’affaires, de 56 % en 2004, ne descendra jamais en dessous de 50 % (50,5 % en 2007). En 2010, il était du reste remonté à 52 %. Autrement dit, en termes de charges de personnel, le plan social, avec ses 38,5 millions d'euros, n’aura servi à rien !
SNCM : QUELQUES CHIFFRES CLÉS
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
Opérations et résultats de l’exercice |
|||||||||
Chiffre d’affaires hors taxes |
205 770 |
217 234 |
193 529 |
183 274 |
203 810 |
222 172 |
219 230 |
196 735 |
189 391 |
Résultat d’exploitation |
– 6 393 |
– 12 474 |
– 39 467 |
– 33 498 |
– 33 258 |
– 31 598 |
– 2 848 |
– 8 022 |
– 16 438 |
Résultat après impôt & charges calculées |
4 202 |
15 926 |
– 29 662 |
– 28 820 |
– 22 103 |
– 27 848 |
182 |
17 711 |
– 1 867 |
Montant des résultats distribués (précompte inclus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Personnel |
|||||||||
Effectif moyen employé pendant l’exercice (25) |
2 639 |
2 662 |
2 579 |
2 316 |
2 258 |
2 345 |
2 204 |
2 007 |
2 016 |
Montant de la masse salariale de l’exercice (en milliers d’euros) (26) |
83 537 |
89 722 |
87 682 |
78 858 |
84 565 |
92 721 |
121 370 |
86 645 |
81 609 |
Montant des sommes versées au titre d’avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales…) (en milliers d’euros) |
19 055 |
20 046 |
20 824 |
25 703 |
22 237 |
19 375 |
27 946 |
19 176 |
16 871 |
Source : Comptes sociaux annuels de la SNCM.
C. POURQUOI UNE TELLE ÉVOLUTION ?
1. Veolia prise à contre-pied ?
Cherchant à comprendre « pourquoi le plan de 2006 a échoué et la flotte n’a pas été renouvelée », M. Maurice Perrin en attribue la raison d’une part à une expérience insuffisante de Veolia en matière de transport maritime, mais aussi à la dureté, voire au caractère inéquitable de la concurrence : « Sur le fond, Veolia n’avait pas une grande expertise en matière de transport maritime. Elle avait l’habitude des délégations de service public, mais pas d’une concurrence aussi dure.
« Tout n’est pas imputable non plus à Veolia dans la mesure où la non-régulation de ce qui se passe entre Marseille et Toulon, entre Toulon et Nice, et entre Toulon, Marseille et Nice, est très préjudiciable. On a laissé les charges aux opérateurs historiques, La Méridionale comprise, et on observe que, après la SNCM, La Méridionale connaît aussi des difficultés, depuis qu’elle a acheté le Piana. »
« Veolia n’avait pas prévu ce niveau d’agressivité et, quand elle a constaté que le contrat devenait inapplicable et qu’il n’était plus rentable, la mission du sénateur Revet (sur la desserte maritime de la Corse) a été déclenchée. »
En fait, dans cette même optique, on peut se demander si Veolia n’a pas d’abord été victime d’erreurs d’analyse sur le marché (ou les marchés) de la desserte maritime de la Corse et sur le positionnement des acteurs autres que la SNCM, autrement dit Corsica Ferries et La Méridionale, voire sur le monde professionnel des transporteurs maritimes, qu’elle connaissait visiblement assez mal.
Relatant une rencontre avec M. Stéphane Richard pendant la procédure de l’appel d’offres, M. Francis Lemor indique que : « Je lui avais posé quelques questions pour savoir s’il connaissait le transport maritime, et il m’avait dit faire un peu de cabotage en Europe du Nord ! J’ai attiré son attention sur le fait que ce n’est pas la même chose de gérer des petits bateaux inter-îles. « Nous sommes des spécialistes de la DSP », m’a-t-il fait valoir. Je n’avais plus rien à ajouter. »
M. Stéphane Richard a lui aussi évoqué le thème de la DSP lors de son audition par la Commission d’enquête : « Le métier de Connex, c’était le transport public de passagers, avec à l’arrière-plan historique, les activités de ramassage scolaire dans le cadre de délégations de service public. (…)
« Avant mon arrivée (chez Veolia) […], déjà, le transport maritime de passagers constituait un des axes de développement. Avant la privatisation de la SNCM, j’avais notamment conclu une autre acquisition en Norvège qui assurait, par le biais d’une délégation de service public, les liaisons maritimes de passagers dans le comté de Finnmark. »
Et il semble bien que pour Veolia, le service d’été avait vocation à rester régi par des règles de délégation de service public. Parmi les raisons pour son équipe de croire au succès, M. Stéphane Richard indique en effet que : « les contacts que nous avions eus à l’époque avec les élus de la collectivité de Corse laissaient penser, malgré les critiques, qu’elle ne remettrait pas fondamentalement pas en cause l’équilibre entre Corsica Ferries et la SNCM. »
Et M. Jean-Paul Israël (CGT) d’ajouter : « Veolia est entrée en scène, avec (…) le maintien des car ferries pour le service public complémentaire qui est aujourd'hui remis en cause. »
Sur ce point, il faut ajouter aussi que la vente de la SNCM par l’État était soumise à une reconduction sans grandes modifications de la DSP alors en vigueur, c’est-à-dire incluant le service complémentaire d’été.
2. Des concurrents déterminés et bien armés
En fait Veolia est sans doute entrée dans un secteur dont les acteurs étaient plus déterminés et disposaient de plus de cartes qu’elle ne le croyait.
L’année 2006 a en effet été pour la SNCM dirigée par Veolia l’année d’un combat d’abord avec STEF pour, dans un premier temps, le contrôle de la CMN, puis, subsidiairement, l’obtention de la DSP sans l’appoint de la CMN. On l’a vu, elle a sous-estimé les atouts juridiques dont STEF disposait pour garder le contrôle de la CMN et sa détermination à la conserver – après tout, Veolia pouvait aussi penser que STEF, groupe de 14 500 salariés réalisant un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d'euros finirait par lui céder le contrôle de La Méridionale, société réalisant une centaine de millions d’euros de chiffre d’affaires avec moins de 450 salariés. Elle a aussi sous-estimé les difficultés à constituer à elle seule dans les délais impartis une flotte disposant des caractéristiques nécessaires pour desservir les ports de Corse.
De ce fait, la SNCM gérée par Veolia n’a pu, malgré les efforts considérables consentis, récupérer la totalité de la DSP pour le service de base.
Quant au service complémentaire, l’opposition qu’y manifestait Corsica Ferries s’exprimait très largement au-delà de la Collectivité territoriale de Corse.
M. Pierre Mattei, directeur général de Corsica Ferries France, a présenté à la commission d’enquête la stratégie de développement de sa compagnie : « Nous ne serions pas là aujourd'hui si, le 7 décembre 1992, il n’y avait pas eu un nouveau règlement européen régissant le cabotage maritime en Europe.
« Ce règlement du Conseil N°3577/92/CEE constitue le texte fondateur de notre stratégie (…) Il définit le service public comme ce qui est vital, et ce que ne ferait pas un opérateur privé qui ne serait mû que par son intérêt commercial et économique, sans contrepartie financière (...)
« Voilà pourquoi nous avons attaqué. Nous attaquons systématiquement toute décision de nature à donner des surcompensations à nos concurrents. (…)Et c’est toujours sur eux (les règlements européens) que nous nous fondons pour faire en sorte de ne pas être concurrencés par des compagnies qui, pour faire la même chose que nous, perçoivent des subventions que nous n’avons pas. »
Bref, venue dans la SNCM pour prendre à travers elle une délégation de service public pour l’ensemble de la desserte de la Corse, Veolia s’est rapidement retrouvée avec, pour le service de base, une délégation partagée sans espoir de croissance, et pour le reste, une situation de concurrence correspondant au plan stratégique de son concurrent et pour laquelle sa flotte comme son pavillon se trouvaient mal adaptés. Comme l’expose M. Francis Lemor : « Il y a dix ans déjà, et a fortiori il y a cinq ans, lors de la privatisation de la SNCM, il était clair que les car ferries n’avaient plus d’avenir : ils ont une vocation essentiellement touristique et ne conviennent donc pas pour le service public qui impose une fréquence de desserte ».
L’inaction déroutante de Veolia dans la gestion d’une société pourtant en difficulté a été constatée par tous.
Ainsi, M. Antoine Sindali, alors président de l’OTC, ne dit pas autre chose : « La diminution du service complémentaire, la réduction et le plafonnement des subventions versées dans le cadre de l’aide sociale et le plafonnement de la clause de sauvegarde en vertu de laquelle nous compensions les baisses de recettes étaient destinés à pousser l’opérateur industriel à avoir une politique d’entreprise, mais nous avons été déçus ».
Les responsables syndicaux eux-mêmes n’ont pas caché leur déception. « On a cru que Veolia avait un projet industriel, a exposé M. Jean-Paul Israël, À tort : la suite a montré que Veolia n’avait pas plus de projet industriel, ou à peine plus que Butler ».
Quant à M. Alain Mosconi (STC) après avoir noté que, dans le préambule du « Projet de relance de la nouvelle SNCM », Veolia s’engageait, entre autres, à « prendre toutes les dispositions utiles pour retrouver et maintenir une bonne santé économique », il fait observer que : « Sur ce point, ils ont fait strictement le contraire : aujourd'hui, la trésorerie est exsangue, la SNCM n’a plus de flotte, faute de l’avoir renouvelée. Le président de l’exécutif de l’Assemblée de Corse sait le nombre de procédures dont la SNCM fait l’objet et je ne vous cache pas que je suis des plus pessimistes quant à son devenir ».
Pour autant qu’on en sache, Veolia aurait rapidement envisagé de revendre la SNCM. Évoquant le retour de Veolia dans le dossier après le 15 septembre 2006, M. Walter Butler a déclaré à la commission d’enquête : « Ils sont donc revenus en exprimant le souhait de prendre le contrôle pour des raisons de consolidation. Ils avaient alors l’ambition de créer un pôle transports. Ensuite, Veolia a voulu vendre, n’y est pas arrivée. Il arrive aux grands groupes de changer de stratégie ».
Énumérant les points du projet de relance de la nouvelle SNCM, M. Alain Mosconi commente ainsi le point « faire de Veolia l’actionnaire majoritaire » par les propos suivants « alors que tout le monde a compris qu’il veut partir ».
Désormais aux mains d’un actionnaire privé, la SNCM se retrouve dans la même situation qu’en 2006 : cet actionnaire n’ayant ni pu développer la SNCM dans le cadre d’une délégation de service public, ni décider d’en adapter le format, ni même d’appliquer normalement le plan social a toutes les chances de connaître des difficultés au moins aussi grandes que l’État en 2006 pour la vendre.
Reste pour le rapporteur une dernière énigme. Que Veolia n’ait pris aucune décision stratégique envers la SNCM est un point. Mais l’État disposait (et dispose encore) de trois représentants au conseil d’administration. On sait que leur pouvoir d’action n’est guère étendu. Pourquoi n’ont-ils pas parlé ? La politique conduite a très clairement entraîné la lassitude, voire la désillusion du personnel. M. Alain Mosconi a fait remarquer que, prévu pour se monter à 9 % du capital, la part de l’actionnariat salarié n’est que de 7 %. M. Jean-Paul Israël (CGT) fait remarquer que : « L’ambiance d’une entreprise déteint sur le personnel. L’incertitude, ce n’est jamais très sain pour les salariés ».
Et M. Francis Lemor de conclure : « Vous me demandiez, monsieur le président, comment on en est arrivé là. Je pense qu’il n’y a pas eu grand-chose de fait depuis. Engager une opération comme la privatisation en laissant les choses en l’état, c’est une mauvaise façon et c’est faire fi de l’attente de tous les personnels sans exception, y compris des plus virulents qui s’attendaient aussi à ce que les choses changent vraiment pour retrouver de la rentabilité ».
IV. LE DÉVELOPPEMENT DE LOURDS CONTENTIEUX EUROPÉENS
En tout état de cause, la qualité de la gestion post-privatisation de la SNCM s’avère aujourd’hui un enjeu presque mineur au regard de la situation dans laquelle elle se trouve plongée par les contentieux engagés auprès des instances de l’Union européenne sur les conditions mêmes de sa privatisation et les termes de la délégation de service public à laquelle elle a soumissionné : en effet, la Commission européenne exige d’elle de rembourser aux autorités françaises deux fois 220 millions d'euros, soit plus du double de son chiffre d’affaires annuel.
A. L’INVALIDATION DE LA RECAPITALISATION
1. La validation du plan de recapitalisation et de privatisation par la Commission européenne
Le rapporteur a déjà souligné les difficultés techniques, au regard du droit européen, que l’État avait dû surmonter pour réussir à privatiser la SNCM.
Ayant déjà recapitalisé la SNCM en 2003, l’État ne pouvait la recapitaliser de nouveau en 2005 que pour la céder au privé. Et la recapitalisation avant cession devait relever d’une logique bien particulière, celle de « l’investisseur avisé ».
L’ancien chef de cabinet de M. Jacques Barrot, commissaire européen aux transports, M. Benoît Le Bret a exposé devant la commission d’enquête : « Pour qualifier d’« avisé » le comportement de l’État, c'est-à-dire pour qu’il n’accorde pas d’aide au sens des traités, les critères à remplir sont notamment l’injection concomitante d’argent public et d’argent privé, et l’analogie du comportement public et du comportement privé. La justification est sinon difficile. »
Afin de rendre le dossier aussi peu contestable que possible, M. Le Bret avait décidé aussi de ne pas se contenter des expertises diligentées par la France, et de demander une expertise du prix négatif au nom de la Commission : « Je demande un audit du prix négatif par un expert indépendant, selon une pratique usuelle mais pas obligatoire, afin d’éviter tout débat à ce sujet au sein du collège. Et il confirmera puisqu’à l’issue d’un processus transparent et non discriminatoire, plusieurs offres ont été présentées et que celle qui a été retenue était la moins coûteuse, ce qui constituait autant d’indices que le prix payé était un prix de marché. »
Dans ces conditions, M. Le Bret expose que, lors de la phase finale de préparation de la décision de la Commission : « les services [l’] informent que le prix négatif est validé, que la recapitalisation par la CGMF à hauteur de 8,75 millions pourrait passer en vertu du critère de l’investisseur avisé à cause de la présence de deux gros investisseurs privés – Veolia, qui a l’expérience des transports et Butler celle de la reprise d’entreprises en difficulté – et de la faiblesse du pourcentage du capital laissé à l’État ».
Par ailleurs, explique M. Le Bret, « Si un État se comporte en investisseur avisé, il doit choisir la solution la moins onéreuse pour les finances publiques. Or liquider une société est quasiment impossible pour un État, a fortiori au prix minimum. La décision est donc prise d’accepter – et à mon avis, cela ne prête pas à discussion – les 15 millions de provisions pour les retraites. Quant au surcoût du plan social, il paraît justifié dans le contexte corse, mais on peut toujours débattre du montant qui reste théorique tant que la liquidation n’a pas eu lieu. Compte tenu de mon expérience, j’ai tendance à penser qu’elle aurait coûté cher à l’État : la casse, la grève pénalisent tous les acteurs économiques. »
« Suivant la recommandation de mes services, poursuit-il, je pense plus prudent pour justifier le plan que l’État reconnaisse par écrit, compte tenu du contexte et des antécédents, le risque d’être appelé en comblement de passif, et le provisionne. La France n’est pas très enthousiaste, étant entendu que la Commission ne s’est pas assurée que les conditions étaient réunies. Mais, selon moi, cet argument est de nature à consolider les arguments. »
Au bout du compte, dans sa décision du 8 juillet 2008, la Commission a considéré que les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d’État.
Au passage, elle décide aussi que l’apport en capital de la CGMF à la SNCM, en 2002, pour un montant de 76 millions d’euros (53,48 millions au titre des obligations de service public et le solde de 22,52 millions d’euros au titre d'aides à la restructuration), était compatible avec le marché commun. En juillet 2003, en effet, la Commission avait approuvé la recapitalisation de la SNCM sur fonds publics sur la base d'un plan de restructuration notifié par la France. Le Tribunal de l'Union européenne avait annulé cette décision en juin 2005 parce que la Commission n'avait pas correctement vérifié que l'aide publique était limitée au minimum nécessaire.
2. La remise en cause de ce plan par le Tribunal de l’Union européenne
Saisi d’un recours par Corsica Ferries, le Tribunal de l'Union européenne a annulé cette décision par un arrêt du 11 septembre 2012. Il a estimé que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la recapitalisation de la SNCM en tant que mesure ne constituant pas une aide d’État.
Selon le Tribunal, afin de déterminer si la privatisation de la SNCM pour un prix de vente négatif de 158 millions d’euros comportait des éléments d’aide d’État, il incombait à la Commission d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de cette importance dans le cadre de la vente de cette entreprise ou aurait opté pour la liquidation de celle-ci.
Or, selon le Tribunal, la Commission est restée en défaut de définir les activités économiques de l’État français par rapport auxquelles il convenait d’apprécier la rationalité économique des mesures en cause. Deuxièmement, s’agissant de l’apport en capital de la CGMF pour un montant de 8,75 millions d’euros, concomitant avec l’apport des repreneurs privés, le Tribunal a considéré que la Commission n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments pertinents dans son appréciation du caractère comparable des conditions d’investissements.
Le Tribunal a également requalifié en aides d’État les mesures de financement (38,5 millions d’euros) du plan social : « la prise en compte de coûts allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnelles doit être considérée comme une aide d’État. ».
Enfin, selon le Tribunal, l’analyse par la Commission du solde de restructuration de 22,52 millions d’euros n’est pas valablement étayée dans la mesure où elle se fonde sur le fait que les mesures prévues par le plan de 2006 sont exemptes d’éléments d’aides d’État.
3. La volte-face de la Commission
Le 20 novembre 2012, la Commission européenne a publié un communiqué de presse aux termes duquel, à la suite du jugement du tribunal de première instance, elle a pris une nouvelle décision concernant la restructuration de la SNCM.
Le texte de la décision n’est pas encore publié aujourd’hui. Selon le communiqué de presse : « La version non confidentielle de la nouvelle décision sur la restructuration de la SNCM sera publiée dans le registre des aides d'État sous le numéro SA.16237 sur le site internet de la DG concurrence, une fois que tous les problèmes de confidentialité auront été résolus. »
Le rapporteur ne peut donc analyser cette décision qu’à travers ce communiqué de presse. Aux termes de celui-ci, on relève : « dans cette nouvelle décision, la Commission a conclu qu'il n'était pas établi qu'en choisissant l'option de la privatisation, l’État s'était comporté en investisseur avisé et avait choisi la solution la moins coûteuse pour les finances publiques. D'autre part, l'apport en capital supplémentaire de 8,75 millions d'euros a été réalisé dans des conditions qui n'étaient pas comparables à celles de l'apport des repreneurs privés. Enfin, l'avance en compte courant de 38,5 millions d'euros au titre des mesures sociales couvrait des frais que la SNCM aurait dû supporter elle-même. »
« Ces mesures ne correspondant pas à ce qu'aurait entrepris un investisseur avisé [...] elles ont conféré un avantage économique à la SNCM par rapport à ses concurrents qui devaient opérer sans ces subventions. Elles constituent dès lors des aides d’État. »
Par ailleurs, « La Commission a conclu que le plan de restructuration accompagnant ces aides ne permettait pas à la SNCM de rétablir sa viabilité à long terme sans recours à de nouvelles aides publiques. De plus, la contribution propre de la SNCM au coût de la restructuration demeurait très insuffisante. »
Enfin, « les mesures compensatoires proposées étaient largement insuffisantes pour remédier aux distorsions de concurrence créées par ces aides. Ces aides, d'un montant d'environ 220 millions d'euros, étaient donc incompatibles avec les règles de l'Union européenne et créaient un avantage indu sur le marché au bénéfice de la SNCM: elles doivent maintenant être recouvrées par la France. »
Pour autant qu’on puisse en juger à travers un simple communiqué de presse, la Commission remet donc en cause, en 2013, le choix par l’État de la procédure de « l’investisseur avisé », qu’elle avait pourtant validée en 2008.
Dans ces conditions, elle considère que l’ensemble des aides versées au titre du plan de restructuration sont des « aides d’État », qui, selon elle, sont facteurs de considérables distorsions de concurrence et d’un « avantage indu » au bénéficie de la SNCM : ainsi ces aides doivent être restituées à l’État. Il faut noter que parmi ces aides figurent celles destinées au plan social, et sans doute, celles destinées aux retraites.
Pour autant, malgré son caractère massif et considéré perturbateur pour la concurrence, « le plan de restructuration accompagnant ces aides ne permettait pas à la SNCM de rétablir sa viabilité à long terme sans recours à de nouvelles aides publiques ». Dans ces conditions, on peut penser, sauf meilleure information, que, après avoir considéré le 8 juillet 2008 que la SNCM pouvait être recapitalisée en vue de sa privatisation, et après avoir validé la procédure de privatisation, la Commission européenne considère, depuis le 20 novembre 2013, que l’entreprise aurait dû être liquidée !
B. L’INVALIDATION DU SERVICE COMPLÉMENTAIRE
Par ailleurs, les repreneurs de la SNCM avaient aussi suspendu cette reprise de la SNCM à l’obtention de la nouvelle délégation de service public (DSP) de la liaison Marseille-Corse, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2007 – elle est finalement entrée en vigueur au 1er juillet – dans une formulation selon des orientations déjà « arrêtées par l’Assemblée territoriale de Corse et acceptées par les Partenaires ».
Les conditions d’obtention de ladite délégation ont évidemment été contestées par Corsica Ferries. La DSP a alors été validée par le tribunal de Bastia par un jugement du 24 janvier 2008 ; ce jugement a ensuite été annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 7 novembre 2011 ; par un arrêt du 13 juillet 2012, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et a donc ainsi validé la DSP au regard du droit français.
Parallèlement, Corsica Ferries avait saisi la Commission européenne par courriers du 27 septembre, du 30 novembre et du 20 décembre 2007, d'une plainte « au sujet d'aides illégales et incompatibles » dont la SNCM et la CMN auraient bénéficié au tire de la convention de délégation de service public des liaisons maritimes entre la Corse et Marseille pour les années 2007 à 2013.
La Commission a rendu sa décision le 2 mai 2013.
Elle y considère d’abord que le service de base – assuré toute l’année par la SNCM et la CMN au moyen de sept navires mixtes – répondait à un véritable besoin de service public non assuré par le marché, conformément au règlement (3577/92) du conseil sur le cabotage maritime, et que les subventions perçues à ce titre par la SNCM et la CMN constituaient une compensation « nécessaire et proportionnée » pour la fourniture de ce service.
Elle a en revanche considéré que le service dit « complémentaire », assuré par la SNCM au bénéfice des passagers pendant les périodes de pointe «pouvait être pris en charge dans des conditions normales de marché », et ne pouvait donc être inclus dans le périmètre du service public.
En conséquence, la Commission européenne a déclaré « illégales et incompatibles avec le marché intérieur » les aides versées au titre du service complémentaire et décidé que l’État était tenu d’en obtenir un remboursement intégral, cette obligation devant être mise en œuvre dans un délai de quatre mois.
La Commission a fixé le montant de ces aides déclarées illégales à 220,2 millions d’euros. Cette décision a fait l’objet de la part de l’État d’un recours en référé ; ce référé ayant été rejeté par le président du tribunal de première instance de l’Union européenne le 29 août 2013, l’État s’est pourvu immédiatement en appel contre ce rejet. Dans le même temps, il a introduit une action au fond contre cette décision.
C. UNE INSÉCURITÉ JURIDIQUE PROBLÉMATIQUE
1. L’affaire du service complémentaire : l’obligation de rembourser l’autorité concédante malgré un service fait
L’affaire du service complémentaire pose une vraie question de sécurité juridique. Aujourd’hui, en effet, quatre juridictions se sont prononcées : tribunal administratif de Bastia, cour administrative d’appel de Marseille, Conseil d’État et enfin, Commission européenne, celle-ci agissant comme une juridiction de première instance en invalidant le service complémentaire. Ces quatre juridictions et ont rendu quatre avis différents. Même quand elles paraissent en accord sur un point, c’est pour des raisons différentes. Sur un plan strictement juridique, la question est plus que délicate. Comme un appel de la décision de la Commission a été interjeté, l’affaire va encore connaître de nouveaux développements.
Par ailleurs, il est certain que la légitimité de la définition d’un service complémentaire évolue dans le temps. Il n’y a pas toujours eu de concurrence pour les liaisons en haute saison touristique.
Or, M. Claude Gressier a tenu les propos suivants devant la Commission d’enquête : « j’ai rencontré la Commission avant l’appel d’offre lancé en 2001 pour la période 2002-2006. À aucun moment, celle-ci n’a envoyé le moindre signal pour nous indiquer que c’était la dernière fois. »
De fait, le président de l’Office des transports de la Corse d’alors, François Piazza-Alessandrini, disparu depuis, n’avait pas été saisi de la moindre alerte de la part de l’Union européenne, à l’époque, au sujet du service complémentaire.
Par ailleurs, si l’on peut comprendre que, du fait de son intensification, la concurrence suffit, l’été, à satisfaire les clients supplémentaires, et que la DSP devrait donc se limiter au service de base, la demande de remboursement à la France – en réalité, à la Collectivité territoriale de Corse, puisque c’est elle qui gère les subventions au titre de la continuité territoriale – peut apparaître étrange. Comme l’a exposé M. Claude Gressier : « je suis choqué par la demande de remboursement puisque le service a bel et bien été effectué. Je comprendrais que l’on intime aux parties de ne plus y revenir, mais le service a été rendu après un appel d’offre et des discussions financières normales avec l’Assemblée de Corse. Je souhaiterais que la Cour de justice de l’Union européenne ne laisse pas passer cette partie du jugement. »
Par ailleurs, à la demande de votre rapporteur – en sa qualité de président du Conseil exécutif de Corse – l’Assemblée de Corse avait décidé, bien en amont, qu’il n’y aurait plus de service complémentaire à compter du 1er janvier 2014. Il suffisait dès lors d’en prendre acte.
Enfin, alors même que les représentants de la Commission européenne disaient ne pas comprendre les raisons de la délégation de service public, jugeant suffisantes des obligations de service public (OSP), la décision récente de la Commission invalidant le service complémentaire valide le service de base assuré par les navires mixtes. Si la Collectivité territoriale de Corse a toutes les raisons de s’en réjouir, c’est là aussi une novation considérable qui met en lumière, a posteriori, l’ampleur de l’insécurité juridique dans laquelle les collectivités locales et les soumissionnaires sont contraints de travailler en matière de service public maritime.
2. La recapitalisation de la SNCM : une volte-face tardive aux conséquences difficiles à maîtriser
Le jugement du Tribunal de l’Union européenne sur la recapitalisation de la SNCM annule quant à lui une décision pourtant construite avec beaucoup de soin et de patience. Or, certains éléments peuvent en être trouvés contestables, pour des raisons de fond et de délai. « La décision initiale de 2002 – que celle de 2005, différée en 2008 à cause de la complexité du dossier, veillait à combler –, comprend indiscutablement une compensation de service public, mais aussi un delta qui est extrêmement difficile à apprécier, expose M. Benoît Le Bret. Il s’agit de mesurer à combien une aide à la restructuration compatible entre 2002 et 2005 se montait en 2008, et de l’actualiser en 2012. Juridiquement, c’est un exercice impossible. Le droit applicable est celui de l’époque, alors qu’il s’est passé beaucoup de choses depuis. (…) Le prix négatif a été validé par un expert. Qui est le tribunal pour se prétendre meilleur expert que celui qui a été désigné ? ». Mais c’est surtout la volte-face de la Commission européenne qui est difficilement compréhensible. Cette volte-face pourrait avoir commencé devant le tribunal lui-même. M. Benoît Le Bret le laisse assez nettement entendre : « Je comprends le tribunal parce que le travail de la Commission, y compris les plaidoiries, n’est pas irréprochable car elle a changé de position en cours de route. »
Autrement, dit, le dossier n’a peut-être pas été défendu devant le Tribunal par la Commission européenne comme il aurait dû l’être. Il est ensuite étonnant de voir la Commission reprendre à contrepied chacun des éléments de sa décision de 2008.
En outre, la Commission a décidé de revoir sa position alors que la France et la SNCM ont fait appel du jugement du Tribunal auprès de la Cour de justice de l’Union européenne. On aurait pu penser qu’une saine gestion du droit aurait dû laisser la Cour prononcer son jugement avant de reprendre la décision sur les bases énoncées par le Tribunal.
Ainsi, ayant répondu à l’invitation de la Commission d’enquête, le 13 novembre 2013, M. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, a présenté l’analyse suivante : « La situation est particulière puisque l’autorisation de la Commission a été annulée, ce qui a conduit l’État à porter l’affaire devant la Cour de justice européenne. Je suis confiant sachant que la procédure a été respectée et que l’État a pris des engagements conformes aux règles et à ses responsabilités sociales. La critique de Bruxelles ne me paraît pas fondée dans la durée. Nous avons de très solides arguments à faire valoir pour éviter d’être condamnés. Nous avions toutes les raisons d’agir comme nous l’avons fait. » Tant que la Cour n’a pas infirmé cette analyse, rien ne permet de dire qu’elle ne reste pas d’actualité.
En termes de stabilité juridique, l’affaire est d’autant plus problématique que les repreneurs de la SNCM avaient fait inscrire dans le protocole d’accord une clause résolutoire en cas de non acceptation du dossier par les autorités de l’Union européenne, et plus précisément de qualification d’aide d’État par la Commission « des sommes apportées par la CGMF à la SNCM au titre des opérations prévues par le présent protocole ou au titre des aides versées en application de la décision de la Commission du 9 juillet 2003 », ou de subordination de l’accord de la Commission « au remboursement des aides à la SNCM antérieurement déclarées compatibles avec le marché commun ou à toute autre condition ayant un impact substantiel sur les activités ou la valeur du Groupe SNCM ».
Cette clause courait pendant six ans à compter de l’entrée en vigueur du protocole, autrement dit jusqu’en mai 2012. Or, la décision du Tribunal a été rendue en septembre 2012. La nouvelle décision de la Commission date du 20 novembre 2013. Autrement dit, la sanction de la Commission vient frapper un accord ... dont les protagonistes avaient eux-mêmes convenu qu’il serait caduc en cas de refus du dossier par l’Union européenne, qui ne doit donc sa perpétuation qu’au retard pris par cette décision de refus et qui ne correspond plus à la situation actuelle, puisque l’un des repreneurs, BCP, est depuis sorti du capital !
L’élément le plus inquiétant pour la sécurité juridique en Europe est que ce qui s’est passé pour le dossier de la SNCM n’est pas un cas isolé.
M. Dominique de Villepin a rappelé à la commission d’enquête les conséquences de cette imprévisibilité et de cette instabilité : « Pour aller dans ce sens, de tels dysfonctionnements au niveau européen ne sont pas rares. On a vu plusieurs fois des procédures et des décisions qui avaient été approuvées être remises en cause par la suite, parfois dix à quinze ans plus tard ! Je pense à la réforme des retraites de France Télécom décidée en 1996 et invalidée l’an dernier. D’une manière générale, le problème devrait être traité sur un plan politique car une telle insécurité juridique peut être lourde de conséquences ». Votre rapporteur ne peut que faire sienne cette conclusion.
Depuis plus de dix ans, l’histoire de l’entreprise à travers ses avatars successifs, évoque irrépressiblement le mythe nietzschéen de « l’éternel retour ».
Après une période de difficultés à partir de 2002, une recapitalisation de 76 millions d’euros est accordée par l’État. Le plan de redressement n’est pas appliqué, et, dès 2003, le résultat d’exploitation affiche une perte de douze millions d’euros, compensée par la vente d’actifs. L’impasse dans laquelle était engagée l’entreprise fait l’objet d’une alerte qui n’est prise en compte par les pouvoirs publics qu’à la toute dernière extrémité, c’est-à-dire à proximité immédiate de la cessation de paiement.
En 2005 est lancée une nouvelle opération de sauvetage, par le biais de la privatisation, assortie en fait d’une recapitalisation massive qui a coûté à l’État la somme astronomique de deux cent cinq millions d’euros. Un plan de redressement comprenant une restructuration des effectifs est annoncé, mais non mis en œuvre réellement, ni sur le plan des effectifs, ni sur le plan du renouvellement de la flotte, ni sur le plan d’une stratégie de développement.
En réalité, après un semblant d’amélioration du résultat d’exploitation en 2008, ce dernier replonge dès 2009, tandis que la société compense les pertes par la vente de ses derniers actifs pour soixante millions d’euros environ.
À ce jour (décembre 2013), la SNCM est à nouveau au bord de la cessation de paiement, malgré le concours en trésorerie de ses actionnaires principaux qui dépasse les cent millions d’euros, soit un tiers de son chiffre d’affaires.
En une décennie, l’État aura dépensé plus de trois cents millions d’euros pour renflouer en capital ou en aides diverses la SNCM. Par l’intermédiaire de la filiale de la Caisse des dépôts, Transdev, il a été apporté plus de cinquante millions d’euros de trésorerie à la SNCM, apport qui ne fera vraisemblablement l’objet d’aucun remboursement.
Pour établir un bilan complet du coût pour l’État et la SNCM au cours de la décennie écoulée, il faut également considérer les valeurs abandonnées directement ou indirectement à des tiers :
– Soixante millions d’euros de plus-value réalisée par BCP pour la cession des parts en provenance de l’État recédées par la suite à Veolia ;
– Quarante-cinq millions d’euros de cession des parts de la SNCM dans la CMN ;
– Quinze millions d’euros de cession du siège social.
Sans parler de la cession à un prix critiquable des parts détenues par la SNCM, dans la société SudCargos, les pertes patrimoniales et financières totales de l’État sur la SNCM peuvent être estimées au moins à quatre cents millions d’euros, voire quatre cent cinquante !
Sur la même période, le seul bénéficiaire financier de cette affaire est la société Butler Capital Partners qui en a retiré une plus-value de soixante millions d’euros.
Cette situation choquante aurait pu sans aucun doute être évitée, mais elle résulte d’un enchaînement complexe de procédures inappropriées ou mal engagées, d’erreurs d’appréciation, sans qu’aucun élément recueilli au cours de l’enquête ne permette de fonder une action en justice, sans même qu’aucun doute sérieux ne puisse être soulevé en l’état, quant à une quelconque connivence qui aurait permis par avance d’obtenir pour l’intéressé ce profit considérable.
Le fait que cette plus-value, y compris dans l’évaluation approximative de son montant, était pratiquement inéluctable dès que l’accord a été scellé entre l’État, BCP et Veolia n’entraîne en aucune façon qu’au sein de l’État, à quelque niveau que ce soit, un ou plusieurs intervenants auraient agi pour permettre à BCP de bénéficier de cette plus-value.
Ceci étant dit, si rien ne peut être reproché dans cette affaire sur le plan pénal, si même aucune faute morale n’apparaît de la part des intervenants il est choquant et regrettable que l’on en soit arrivé dans cette affaire aussi calamiteuse sur le plan économique, aussi lourde de conséquences aujourd’hui au plan social, aussi ruineuse pour l’État, à procurer involontairement une plus-value aussi considérable à un partenaire privé, qui n’a en définitive guère pris de risque, n’a que très peu contribué au redressement de l’entreprise et n’est rentré que le temps nécessaire pour lui permettre une sortie profitable. La commission a constaté la mauvaise gestion de la SNCM par Veolia, son absence de vision, sa réticence à prendre les mesures propres au retour à l’équilibre.
La société Veolia n’a pas sur la période de privatisation et les exercices qui ont suivi, subi de pertes en raison de son implication dans cette affaire, les pertes d’exploitation ayant été compensées par des cessions d’actifs. Cependant la perte serait significative s’il s’avérait que les apports en trésorerie consentis par Veolia n’étaient pas remboursés.
Il n’entrait pas dans le champ de l’enquête de s’interroger sur ce qu’il adviendra du remboursement des subventions et aides requalifiées par l’Union européenne mais elles constituent un risque pour toutes les parties prenantes de cette affaire :
– L’État parce qu’il pourrait se voir reproché de n’avoir pas procédé au recouvrement des aides relatives à la recapitalisation (deux cent vingt millions d’euros), ce qui peut lui valoir des pénalités financières ;
– L’Office des Transports de la Corse pour n’avoir pas procédé au recouvrement des subventions versées au titre du service complémentaire (également deux cent vingt millions d’euros). Le code général des Collectivités Territoriales prévoit en effet que si l’État est condamné au niveau européen pour avoir manqué à l’obligation de faire rembourser une aide d’État indue, c’est à la collectivité territoriale qui a versé cette aide qu’il incombera de payer la pénalité ;
– Les actionnaires principaux - Veolia et Transdev - de la SNCM, qui lui apportent jusqu’à ce jour le moyen de poursuivre son activité par un concours considérable en trésorerie, et qui pourraient être recherchés en cas de défaillance.
Sur le plan financier, cette affaire a coûté plus de quatre cents millions d’euros à l’État, fait peser un risque considérable sur de grandes entreprises, sur l’État et sur la Collectivité territoriale de Corse, et a permis à un partenaire financier de se retirer en toute légalité avec une plus-value de soixante millions d’euros.
*
* *
Le simple fait que de manière récurrente les mêmes erreurs aient été commises entraînant des conséquences de plus en plus lourdes démontre suffisamment que l’absence de lucidité ou de courage, la dilution des responsabilités, le recours à des expédients et la faible résistance à la pression des évènements sont des défauts partagés par tous les intervenants sur l’ensemble de la période.
Nous en sommes aujourd’hui au même point qu’en 2001 ou qu’en 2006, s’agissant de la situation de la SNCM. Entre-temps des centaines de millions d’euros ont été dépensés sans autre bénéfice que de gagner du temps tandis que les remises en causes juridictionnelles au niveau européen représentent un risque financier à peu près équivalent à ce qui a été perdu ou décaissé par la sphère publique à ce jour.
Un risque à quatre cents millions, une dépense ou une perte de patrimoine équivalente représentent tout de même un gâchis épouvantable pour se retrouver, après des années de tergiversations dans la même situation.
DATE |
ÉVÉNEMENTS |
ACTEURS |
RÉACTIONS / CONSÉQUENCES |
1996 | |||
Corsica Ferries jusqu’alors confiné à des liaisons à partir de l’Italie met en place une liaison entre Nice et la Corse avec un bateau sous pavillon français |
|||
1999 | |||
Mise en œuvre du principe d’ouverture du cabotage maritime aux États-membres de l’U E ð Corsica Ferries passe sous le pavillon italien |
Mise en œuvre par Corsica Ferries de liaisons régulières (Bastia et Calvi) à partir de Nice. (navires à grande vitesse neufs NGV). | ||
2001 | |||
Compte tenu notamment de provisions pour restructuration, la SNCM a enregistré une perte de 40 millions d’euros |
|||
2002 | |||
La SNCM élabore un plan industriel visant à restructurer ses activités. Elle bénéficie pour cela d’une dotation en capital de 76 millions d'euros de la part de l’État : 66 millions d’€ fermes et 10 millions à titre conditionnel sur lesquels un peu plus des 3 millions d’€ seulement seront versés en 2004. (notification à la Commission européenne). M. Claude Gressier participe à l’élaboration du plan avec le Président Pierre Vieu de la CGMF, la holding publique contrôlant la SNCM. La SNCM fait également l’objet d’une « aide au sauvetage » notifiée à la Commission européenne de 22,5 millions €. | |||
2003 | |||
Aide à la restructuration : 66 millions €, approuvée par la Commission Européenne (rappelée par M. Gressier qui ajoute que cette aide incluait les 22 millions € déjà versés)- conditions : l'arrêt de toute acquisition de navires, voire la cession de certains. - – décision contestée par Corsica Ferries devant le Tribunal de 1re instance de l’Union européenne (TPUE) : jugement rendu en 2005. - – Corsica Ferries bénéficie pourtant de la nouvelle aide sociale attribuée par la Collectivité territoriale de Corse à de nombreuses catégories de passagers. - – Selon M. Gressier: un accord serait intervenu entre le président de la SNCM et la CGT, en vue d’améliorer les conditions d’armement donc d’augmenter la productivité ; si le résultat d’exploitation de la SNCM a enregistré un déficit en 2003; le bilan général affichait, en revanche, un gain de 16 millions, car la société avait vendu certains actifs non stratégiques. - Le bilan établi par l’État révélera toutefois que la SNCM aura « absorbé » en deux ans (2004 / 2005) la quasi-totalité de la recapitalisation, sans avoir engagé de façon significative les efforts de restructuration demandés : Des résultats de la SNCM très éloignés des objectifs déclarés : – Les constatations de l’État, en octobre 2005, mentionnaient un chiffre d’affaires pour l’exercice d’environ 260 millions € (dont 70 millions au titre de la subvention DSP), 100 millions de charges de personnels et environ 160 millions d’achats et de charges externes (avant même l’envolée du prix du carburant, c'est-à-dire un choc exogène frappant toutes les compagnies). – La productivité des marins était particulièrement soulignée : échec de l’accord « Navigants » de novembre 2003 dont les modalités avaient plus particulièrement permis d’obtenir l’acceptation par la Commission européenne du versement de la première tranche de 66 millions € du plan de sauvetage 2002/2003.Concernant les charges de personnels ; seuls les salariés sédentaires ont connu une diminution de leur effectif d’une centaine d’emplois alors que le nombre des navigants qui était, au terme de l’année 2001, de 1599 etp (équivalents temps plein) s’élevait à 1644 etp en septembre 2005 ! – L’estimation du coût global d’un navigant s’établissait alors à 50 000 € /an. En conclusion, l’État constatait une exploitation ne générant aucune ressource et donc aucune perspective d’autofinancement pour le renouvellement de la flotte qui exigerait au moins 40 millions € par exercice (800 millions de valeur brute de navires à renouveler sur environ 20 ans). | |||
2004 | |||
M. Gérard Couturier : (alors Délégué régional PACA de Veolia Environnement): « Courant 2004, l’Agence des participations de l’État (APE) a fait état de son souhait de privatiser la SNCM : elle a donc confié le dossier à la banque HSBC et choisi l’avocat Nicolas Baverez comme conseil. . « Je rapportais pour tout ce qui était de la délégation de la direction régionale à Henri Proglio, qui était président de Veolia, et pour la partie transport à Stéphane Richard, le patron de Connex » |
|||
Février 2004 |
Grèves paralysantes une semaine à l’initiative Syndicat des travailleurs corses (STC) : Problématique de la « corsisation » des emplois. |
Les Méga Express de la Corsica Ferries se substituent progressivement à ses NGV (ce nouveau type de bateaux confortera ses succès commerciaux) | |
Juin 2004 |
Grève des officiers. |
||
En fin d’année 2004, le résultat net enregistrera un déficit de 29,6 millions € ; la trésorerie étant quant à elle déficitaire de 76 millions d’euros. |
En 2004, la SNCM transporte 940 000 passagers (un trafic en recul de 26 % par rapport à l’année précédente). |
Avec plus d’un million de passagers transportés, Corsica Ferries devient, pour cette même année, le premier opérateur desservant la Corse à partir du continent avec une part de marché voisine de 48 % contre 43% pour la SNCM. | |
M. Bruno Vergobbi, président de la SNCM et M. Christian Frémont, préfet de la région Paca, préfet des Bouches-du-Rhône (mai 2003/mai 2007). |
La SNCM a connu six présidents au cours d’une période de dix années. | ||
Septembre 2004 |
Grèves lancées par le Syndicat des travailleurs corses (STC) : Perturbations durant trois semaines. M. Francis Lemor (CMN-La Méridionale): « J’ai été informé très en amont, dès septembre 2004. Monsieur François Goulard est le premier à m’avoir parlé de la privatisation ; puis, de manière plus détaillée, son cabinet et, à deux reprises, celui du ministère de l’économie ; enfin, celui du Premier ministre. Les échanges se sont déroulés jusqu’en décembre 2004 » |
M. Francis Lemor, président du groupe STEF-TFE qui contrôle la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN). |
|
Novembre 2004 |
M. Claude Gressier : les commissaires aux comptes lancent une procédure d’alerte auprès du tribunal de commerce Le président de l’entreprise a demandé au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc. |
||
Fin 2004 |
Dégradation de la situation financière fin 2004, l’entreprise est au bord de la cessation de paiement: - déficit pour 2004 est supérieur à 25 millions € (29,6 millions €) ; - chute du chiffre d’affaires de la SNCM vers la Corse de 20 % par rapport à 2003 ; - trésorerie déficitaire de la somme de 76 millions €, dès novembre 2004.(M. Gressier). M. Gérard Couturier : lui et d’autres dans ses équipes ont reçu instruction de rouvrir le dossier de la SNCM [dont les services de Veolia n’avaient pas jugé bon de poursuivre. l’étude. « N’étant pas pilote de l’opération, j’ai avant tout pris des contacts au niveau syndical, mais également au niveau des acteurs locaux concernés, principalement les acteurs insulaires ». |
Bien que significativement dégradée, la situation financière de la SNCM pouvait encore paraître acceptable avec un endettement net sur fonds propres de 77 % et un endettement net, y compris leasing, sur fonds propres de 202 %. Mais dans un contexte de crise de confiance et de grèves à répétition (mai 2005), les perspectives révélaient une accentuation des périls financiers, dès 2005, avec un endettement net sur fonds propres de près de 110 %, au terme du troisième trimestre de l’année, et un endettement net, y compris leasing, de 256 %. Graves difficultés financières de la SNCM confirmées par le préfet Christian Frémont au cours de son audition. le président Vergobbi l’avertit, le 22 décembre 2004, d’une « catastrophe imminente », les banques (Crédit agricole et Deutsche Bank) n’assureront pas la fin du mois ! | |
Décembre 2004 |
M. Francis Lemor : « En décembre 2004, la SNCM a connu de nouvelles difficultés de trésorerie et un mandataire ad hoc a été nommé. C’est à ce moment-là que j’ai été informé de la privatisation à venir. » [mais voir sa déclaration relative à septembre 2004]. | ||
Au cours de l’année 2005 | |||
10 janvier 2005 |
Réunion ministérielle à Paris, le 10 janvier 2005 : « ... d’où il ne sort rien de précis. Il semble que les autorités de la capitale sous-estimaient la dureté des relations sociales à Marseille ». » (audition du 9 octobre 2013 du préfet Christian Frémont). |
||
JANVIER 2005 | |||
26 janvier 2005 |
Annonce par François Goulard (secrétaire d’État aux transports) à l’Assemblée nationale que l’État recherche un « opérateur industriel » susceptible à la fois d’apporter des capitaux nécessaires pour garantir un avenir à la SNCM et d’améliorer sa gestion et ses performances commerciales ; une procédure d’appel d’offre sera lancée. Le ministre fait notamment référence aux conséquences très négatives pour la SNCM de la grève de septembre 2004. Réaction de totale incrédulité de la part des organisations syndicales : l’État a toujours répondu présent et il continuera à payer ! En raison des règles européennes de la concurrence, ni l’État, ni les collectivités publiques ne peuvent pourtant plus apporter de nouveaux fonds propres pendant les 10 années qui suivent une recapitalisation : principe dit du « One time, last Time ». |
M. François Goulard - Secrétaire d’État aux transports |
Les Echos du 27 Janvier : « En faisant du catastrophisme, l'actionnaire et le gouvernement font tout pour fragiliser la compagnie. C'est une action de sabotage qui ne peut que préparer un démantèlement et la vente par appartement », déclare Maurice Perrin, secrétaire général CFE-CGC. « Nous voulons une entité publique pour desservir la Corse avec une délégation de service public sur toutes les lignes entre l'île et le continent et nous invitons les organisations syndicales à refuser toute forme de privatisation », dénonce Alain Mosconi, secrétaire général du Syndicats des travailleurs corses (STC). |
Comité d'entreprise extraordinaire de la SNCM : annonce du lancement d'un plan de redressement par son président |
|||
M. Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, en visite à Marseille au siège de la SNCM. |
M. Bernard Thibault |
||
31 Janvier 2005 |
Le Premier Ministre décide du principe de de la privatisation. Un expert indépendant va être désigné (ingénieur général de Ponts et Chaussées) : une mission de préparation et de supervision de la procédure. |
||
FÉVRIER 2005 | |||
Février 2005 |
L’expert, M. Claude Gressier :« C’est dans ce contexte [faits du 26 janvier] que le Gouvernement m’a chargé en tant que personnalité indépendante non de chercher un investisseur – tâche qui incombait à l’Agence des participations de l’État (APE), aidée par une banque conseil –, mais de contrôler les conditions dans lesquelles se déroulerait la recherche d’un opérateur privé. Cette fonction était prévue par la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations pour la privatisation des entreprises de premier rang. Cela dit, la SNCM était alors une entreprise de deuxième rang, puisque sa maison mère était la Compagnie générale maritime et financière (CGMF)». ð recherche de partenaires privés susceptibles d’être intéressés par l’opération : réunion avec des responsables de l’APE et des représentants d’HSBC, la banque-conseil de l’État. « HSBC, choisie après mise en concurrence, avait engagé, au terme d’un appel d’offres, le cabinet d’avocats Gibson, Dunn & Crutcher, représenté par Nicolas Baverez ». M Denis Samuel-Lajeunesse concernant la SNCM : « ... une entreprise que nous avons tenté de sauver malgré elle » |
Concentration de la préparation du dossier à Paris : M. Claude Gressier, Président de la 4 éme section du Conseil général des Ponts et Chaussées. Agence des participations de l’État (APE) : M Denis Samuel-Lajeunesse, directeur général (mars 2003/septembre 2006, nommé officiellement en septembre 2004) et M. Jean-Louis Girodolle, sous-directeur chargé des transports (septembre 2004/décembre 2006). |
Lancement d’un appel à intérêt pour l’opération : 72 repreneurs potentiels contactés dont 38 étrangers (principalement des armateurs mais aussi quelques fonds financiers, tous français). Audition de M. Claude Gressier : « S’il le souhaitait, la banque lui adressait [au candidat intéressé] un accord de confidentialité, qui conditionnait lui-même l’envoi d’un mémorandum d’information sur la société. Celui-ci indiquait les engagements financiers que l’État était prêt à prendre, et demandait à chacun une offre non liante comprenant son évaluation de la société, la part de capital qu’il souhaitait acquérir et son projet industriel et social ». « 15 accords de confidentialité ont été signés. Autant de mémorandums ont été adressés. » Audition du 9 octobre 2013 du préfet, M. Christan Frémont : « ... M. Goulard a pris la décision de faire appel à M. Gressier le 10 février, et je ne l’ai pas rencontré avant le mois de juin. J’avais l’impression, pas toujours agréable, que le dossier m’était tantôt confié, tantôt retiré soudainement ... J’ai récupéré le dossier le 9 septembre [2005]. Entre-temps, il y a eu deux ou trois réunions interministérielles mais jamais il n’a été question de l’appel d’offres ». |
3 février 2005 |
M. Francis Lemor (Compagnie Méridionale de Navigation CMN-La Méridionale) : « Nous avons été approchés par le banquier [HSBC] le 3 février à qui j’ai répété les conditions [participation dans la SNCM privatisée devait être inférieure à 10 %, la CNM ne devait jamais intervenir dans le management, et surtout que l’on n’y détache jamais personne] en ajoutant une de plus : nous ne pouvions pas intervenir dans une société exploitant des car-ferries. Nous ne connaissions évidemment pas à l’époque la décision du tribunal concernant la notion de service public rendu, ou pas. Mais, déjà à l’époque, et sur un plan strictement économique, il n’y avait plus aucune raison pour que circulent des car-ferries. Aucune de nos propositions n’a été acceptée et nous avons décidé de ne pas retirer de dossier d’appel d’offres et n’avons pas signé le dossier de confidentialité qui allait avec. » Volonté de ne pas mêler l’image de la CMN-La Méridionale à celle de la SNCM clairement exprimée par M. Lemor et d’ailleurs, selon lui, partagée par ses administrateurs. Cette attitude de principe a été maintenue avec constance bien que : « Tous les interlocuteurs qui m’ont informé de la privatisation voulaient absolument nous voir intervenir » et « Nous n’avons donc pas été partie prenante au processus de privatisation. Néanmoins nous avons été approchés à plusieurs reprises pour nous proposer des schémas divers et variés dont aucun n’était susceptible de nous convenir, faute de crédibilité ». |
M. Francis Lemor. |
La CMN est le partenaire « historique » de la SNCM pour l’exécution « conjointe mais non solidaire » (précision formulée avec insistance par M. Lemor devant la commission d’enquête) de la délégation de service public vers la Corse (DSP). La CMN est, à l’origine, un armement familial, créé en 1931, pour acheminer entre le continent (Marseille) et la Corse du fret et des produits pétroliers. A la demande de l’Office des transports de la Corse (OTC), la CMN a complété son activité, à partir de 1988, avec des liaisons « passagers » par cargos mixtes. La CMN a intégré le groupe STEF en 1992, un des grands opérateurs du transport et de la logistique. Le groupe STEF est dirigé par M. Francis Lemor qui détient à titre personnel une partie de son capital. Bien que cotée en bourse, l’entreprise se caractérise par un important autocontrôle et une participation au capital de ses salariés(FCPE). Les transports maritimes ne représentent d’ailleurs qu’une infime partie des activités du groupe STEF (environ 4,5 % d’un chiffre d’affaires consolidé de 2,5 milliards € en 2012, en croissance régulière). Le groupe compte au total 14 500 salariés. La CMN opère désormais sous le seul nom La Méridionale qui, pour l’exercice 2011, a réalisé un chiffre d’affaires ayant franchi les 100 millions € (34 millions étant perçus au titre de la dotation de continuité territoriale). |
9 février 2005 |
Déclaration de François Goulard (La Tribune 10 février 2005) : "J'ai eu des appels d'armateurs intéressés par le dossier [vente de la SNCM]. C'est vital pour l'entreprise. En trésorerie on ne passe pas l'automne. Six mois est un délai normal pour conclure une opération comme celle-là." Communiqué de la CGT : dénonce la "position dogmatique de privatisation" de la SNCM prise par un gouvernement "fidèle à sa conception de casse des services publics", et demande une nouvelle fois une "table ronde" sur le dossier. |
François Goulard, Secrétaire d’État aux Transports. CFE-CGC. CGT. |
Réaction de la CFE-CGC, M. Maurice Perrin : "Nous ne voulons pas ajouter de la fragilité à la fragilité. Mais nous n'acceptons pas la privatisation de la SNCM et le refus du gouvernement d'accéder à la demande du personnel et des régions Paca et Corse de tenir une table ronde sur l'avenir de la compagnie." Préavis de grève |
12 février 2005 |
Table Ronde à Marseille entre le secrétaire d’État aux transports, les élus locaux et les partenaires. A l’issue: nomination officielle de M. Claude Gressier, ancien directeur des Ports au ministère de l'Equipement et des Transports et ancien administrateur de la SNCM, comme expert chargé de la recherche d'actionnaires privés. Sous l’égide du préfet de région, une structure de contact est instituée réunissant à un niveau technique, l’État, les collectivités concernées, la direction et les organisations syndicales. Cette structure mandate un groupe de travail auquel participera l’expert désigné par le comité d’entreprise. M. François. Goulard : « L'État veut rester au capital de manière très significative, mais il faudra passer par une phase d'évaluation de l'entreprise puis de négociations avec les investisseurs » (Les Echos, 18 février 2005) |
M. François Goulard. MM. Alain Mosconi, secrétaire national du STC, et Patrick Panzani, secrétaire du SAMMM. MM. Christian Frémont, préfet de région et Claude Gressier. |
Source AFP du 18 février 2005 : Le Syndicat des travailleurs corses (STC) et le Syndicat autonome des marins de la marine marchande (SAMMM) ont sévèrement critiqué les résultats de la table ronde, affirmant que "cette réunion n'a servi à rien" et que "la privatisation de la compagnie publique (était) déjà en marche". Réaffirmation de leurs propositions: inciter les régions PACA et Corse à entrer dans le capital de la SNCM, en grave difficulté financière. "Il suffirait pour cela de créer deux filiales, une en Corse et l'autre à Marseille, financées respectivement par la Collectivité territoriale de Corse et la région PACA", ont expliqué Alain Mosconi, secrétaire national du STC, et Patrick Panzani, secrétaire du SAMMM. SAMM et STC ne s'inscrivent plus dans le préavis de grève prévu à partir du 28 février, estimant qu'une telle action serait "préjudiciable" à l'entreprise. |
24 février 2005 |
1ére réunion sur l'avenir de la compagnie publique SNCM, à la préfecture de région à Marseille : création d’un groupe de travail issu de la structure de contact. Le mandat de ce groupe porte sur l’étude des solutions alternatives à l’entrée de partenaires privés tels que formulées par les syndicats. Principale proposition alternative (essentiellement exprimée par la CGT) : elle vise à restaurer les fonds propres et à renflouer financièrement la compagnie maritime publique (trésorerie) ; la holding qui chapeaute la SNCM, la CGMF, rachète une partie des actifs, permettant de renflouer les caisses et d'éponger le déficit. Mais il faut que la CGMF dispose des fonds nécessaires. Or pour cela, elle devrait soit contracter un prêt soit bénéficier d'une avance de l'État. Les experts doivent se renseigner auprès des autorités européennes pour savoir si une telle opération ne serait pas perçue comme une aide déguisée (forte probabilité). Le groupe de travail s’est réuni à huit reprises (sous différents formats) : les 7 et 31 mars, les 2, 11, 12, 17 et 27 mai et 29 juin. A cette dernière date un relevé de conclusions sera établi : les besoins de trésorerie pour la fin de l’année 2005 sont importants, au moins 70 millions €, voire plus au point bas d’activité en février 2006, tout en tenant compte d’environ 12 millions € de cessions à réaliser rapidement (hors vente immobilière du siège) mais en retenant la vente du NGV Asco et de la participation de 50% de la SNCM dans SudCargos. Ce montant dépasse de beaucoup les lignes de crédit à court terme jusqu’alors accordées par les banques qui refusent de s’engager sur une prolongation de leur soutien en l’absence de visibilité sur un véritable plan de restructuration. Le pool bancaire conditionne son attitude à la présentation des comptes en septembre, complétée par des mesures de redressement et des perspectives d’apports de partenaires privés. Les banques étant très vigilantes sur le risque de soutien abusif. |
Intersyndicale de la SNCM |
Le STC quitte la réunion refusant "la seule orientation de privatisation". (source : AFP le 24 février 2005) "Tant que nous resterons dans une logique de privatisation, nous ne participerons plus aux différents ateliers", a déclaré à l'AFP Alain Mosconi, secrétaire national du STC. |
28 février 2005 |
L’Intersyndicale de la SNCM renonce à son préavis de grève |
SudCargos est une compagnie desservant principalement le Maghreb : acquise par la CMA-CGM (rachat de la participation de 50 % de la SNCM). Cette opération réalisée dans l’urgence pour un montant voisin de 5 millions € n’a sans doute pas été conclue dans de bonnes conditions pour la SNCM. SudCargos qui ne possède pas de navires en propre mais les loue, était plutôt prospère avec 60 millions de chiffres d’affaires en 2005 et 170 salariés. |
Les autres cessions évoquées, notamment par les organisations syndicales, visaient des actifs dont le produit des cessions aurait été fait l’objet d’une remontée vers la maison mère, la holding CGMF. La vente des filiales outils (Aliso Voyages, SARA, Ferrytour ou encore MCM) ayant été écartée en raison de leur contribution directe à l’activité commerciale de la SNCM et, d’autre part, de l’impact faible voire négatif susceptible d’en résulter en matière de trésorerie. La réflexion s’est concentrée sur la cession de la participation de la SNCM au capital de la CMN : la SNCM y détenant directement et indirectement la majorité des droits économiques mais sans avoir jamais perçu de dividendes de la part de cette société bénéficiaire. La valorisation de cette participation est complexe. Les différentes méthodes évaluatives s’avèrent toutes plus ou moins contestables. L’État estime d’ailleurs que tout projet de « cession / relocalisation » des actifs de la CNM n’aurait de sens que dans la mesure où les intérêts stratégiques des deux compagnies seraient protégés (continuité des exploitations conjointes et sécurisation des appels d’offres à venir concernant la DSP). Toutefois, l’ouverture du capital de la SNCM pourrait, selon l’État, voir l’arrivée d’un tiers potentiellement mieux à même de faire valoir ses intérêts dans la CMN. Il apparaît d’ores et déjà que le groupe STEF ne conçoit pour lui-même que la possibilité du rachat global de la participation de la SNCM. Cette option générerait un fort risque d’« évasion » de la CNM donc sa recherche d’un autre partenaire pour exécuter la DSP (hypothèse sérieusement échafaudée par les dirigeants de STEF / CMN). |
MARS 2005 | |||
mars 2005 (?) |
Audition de M Camille de Rocca Serra: premier entretien informel, qui n’a pas fait l’objet de convocation écrite « François Goulard, alors ministre des transports, convie Ange Santini et moi-même pour nous avertir que Bruxelles n’acceptera pas une nouvelle recapitalisation et que la seule voie possible est la privatisation. Le terme me surprend car il signifie une cession totale que nous estimons inacceptable. […] Nous nous opposons donc à une privatisation pure et simple. À l’issue de cette réunion, aucune conclusion n’est arrêtée. Il s’agissait sans doute de tester notre réaction. François Goulard ayant quitté le ministère des transports le 31 mai 2005, la rencontre a forcément eu lieu avant » |
MM. Ange Santini, président du conseil exécutif de Corse (2004 / 2010) et François Goulard, secrétaire d’État aux transports. |
|
AVRIL 2005 | |||
17 jours de grève | |||
12 avril 2005 |
Date limite de dépôts des premières réponses (des offres purement indicatives). |
Cinq investisseurs potentiels répondent à cette consultation du premier tour. | |
15 avril 2005 |
M. Claude GRESSIER : « ... ouverture d’une phase d’approfondissement. Les groupes qui avaient répondu ont rencontré les dirigeants de la société et eu accès à une data room électronique. » |
M. Walter Butler a indiqué à la commission d’enquête que c’est à la date du 8 avril 2005 que son groupe a eu un premier contact avec la banque-conseil HSBC. | |
avril / mai 2005 |
M. François Goulard : « À mon époque, des contacts avaient été amorcés avec Veolia, en la personne de son président-directeur général, M. Proglio, que j’avais vu et qui m’avait dit d’emblée – après les premiers échanges entre mon cabinet et ses collaborateurs – que Veolia était susceptible d’entrer au capital et de devenir l’opérateur industriel de la SNCM. J’ai un souvenir assez précis. J’avais fait un déplacement en Chine avec le Premier ministre, en avril 2005, je crois, et il était accompagné de plusieurs chefs d’entreprise, dont M. Proglio. J’en avais profité pour les faire se rencontrer. Il y a eu un échange entre eux en ma présence et M. Proglio avait dit être prêt à « faire son devoir ». Je me souviens de ses mots, qui montraient que l’affaire ne serait pas facile » |
La CGT déclenche une grève de 15 jours (vacances de Pâques). « En général, les grèves ont lieu pendant les vacances ou au mois de février, à la saison des clémentines en Corse » (préfet Frémont). Motif de la grève : inscription de la SNCM au Registre international français (RIF), dont la perspective a été assez vite annulée, et la vente de la compagnie sous la forme d’une privatisation. | |
MAI 2005 | |||
17 mai 2005 |
Audition de M. Gressier : « Nous leur avons demandé de transmettre une offre liante pour le 1er juin » Deux candidats n’ont pas souhaité rencontrer les dirigeants de l’entreprise. La Comanav, qui ne tenait pas à faire une offre seule, a demandé qu’on fasse connaître aux autres candidats son désir de s’associer avec quelques autres, ce qui n’a pas retenu leur attention. A la date de remise des offres, le 17 juin 2005, il y avait trois candidats » |
La Comanav : Compagnie marocaine, leader sur son marché, qui assure des liaisons par ferries entre la France, l’Italie, le sud de l’Espagne et les ports de Tanger et de Nador. |
Le second « candidat » auquel M. Gressier fait allusion est Louis Dreyfus Armateurs. |
Fin mai/début juin 2005 |
M. Francis Lemor (CMN-La Méridionale): rencontre avec M. Stéphane Richard, directeur général de Connex (alors division « Transports » du groupe Veolia), « qui m’avait expliqué qu’il souhaitait absolument intervenir dans cette affaire. Je lui avais posé quelques questions pour savoir s’il connaissait le transport maritime, et il m’avait dit faire un peu de cabotage en Europe du Nord. J’ai attiré son attention sur le fait que ce n’est pas la même chose de gérer des petits bateaux inter-îles. « Nous sommes des spécialistes de la DSP », m’a-t-il fait valoir ... Je n’avais plus rien à ajouter ! ». |
||
JUIN 2005 | |||
17 juin 2005 |
Date de remise des premières offres. |
3 offres reçues selon M. Claude Gressier : le fonds Caravelle, le fonds Butler Capital Partners et Veolia (sa division Connex). Audition de M. Gressier : « Leurs offres avaient en commun de porter sur la totalité du capital, une prise de contrôle exclusive étant nécessaire, selon eux, pour assurer le redressement de l’entreprise. Largement indicatives, elles comportaient des incertitudes notamment sur le montant de la recapitalisation souhaitée – les demandes paraissaient déjà très élevées –, le contenu du plan social et celui du plan stratégique » | |
22 juin 2005 |
Audition de M. Francis Lemor : « J’ai rencontré M. Walter Butler pour la première fois, le 22 juin 2005. Il savait bien que sa capacité à gérer l’entreprise était voisine de zéro. Le fonds d’investissement n’avait pas de manager pour diriger une société en situation délicate, alors que la règle veut que l’on change les dirigeants en pareil cas. . Il cherchait donc à se rapprocher d’équipes valables» |
Dans la « meilleure » hypothèse, M. Lemor a affirmé devant la commission d’enquête avoir envisagé une participation de la CMN à hauteur de 10 % au maximum du capital de la SNCM « ... à la condition [...] que l’on intervienne jamais dans le management et surtout que l’on y détache jamais personne ». | |
JUILLET 2005 | |||
Du 17 juin |
Audition de M. Claude Gressier: « Il était convenu que les représentants de l’État – l’APE – rencontreraient chacun des candidats au sujet, premièrement, de la recapitalisation demandée à la CGMF qui devait être solidement étayée ; deuxièmement, de l’apport de fonds des investisseurs ; troisièmement, du projet industriel et social ; et, quatrièmement, les garanties et les clauses résolutoires. À l’issue des discussions, les candidats devaient faire de nouvelles offres pour le 28 juillet 2005 » M. Gérard Couturier (ne précise pas de dates): « Le dossier a avancé, géré principalement par des financiers – Veolia dispose d’équipes spécialisées dans la reprise d’entreprises, l’évaluation des risques, les projections de business plans. À partir de là, les discussions se sont engagées avec l’APE et HSBC » « Je crois me souvenir qu’au cours de ces discussions, nous avions envisagé une reprise progressive de la SNCM, pour un tiers dans un premier temps. Quelques écueils, il faut le dire, se présentaient à nous, tout particulièrement le renouvellement de la délégation de service public (DSP) avec l’Office des transports de la Corse (OTC), un an ou six mois après la date prévue de la privatisation. En effet, la desserte de l’île constitue l’épine dorsale de la SNCM puisque les deux tiers de son activité au moins sont liés à la Corse » « l’APE nous a fait savoir assez vite que l’État souhaitait plutôt une cession à 100 % de la société. Nous avons continué à travailler dans ce sens, en suivant les différentes étapes : une candidature, un appel d’intérêt, etc. » |
||
20 juillet 2005 (LEMOR/BUTLER) |
M. Francis Lemor : « réunion du 20 juillet 2005, au cours de laquelle Butler Capital, qui était très demandeur d’un accord de coopération technique avec nous – il ne connaissait rien au maritime –, finit par accepter nos propositions. Verbalement. Comme je lui demandais de rédiger entre nous un petit protocole, il a refusé obstinément ». |
Au cours de son audition, M. Jean-Louis Girodolle, ancien sous-directeur « Transports » à l’Agence des participations de l’État (APE) a précisé de mémoire (donc sans indiquer de date) qu’une seule réunion s’est tenue entre M. Butler et M. Lemor (CMN-La Méridionale), en tout cas en présence d’un représentant de l’APE. M. Camille de Rocca Serra regrettant pour sa part que cette réunion, ait sans doute été « insuffisamment préparée ». | |
28 juillet 2005 |
M. Claude Gressier : date limite pour déposer les nouvelles offres à la suite des rencontres entre l’APE et les candidats |
Offres restant à déposer par Butler Capital Partners, Connex (Veolia), et le fonds Caravelle ? | |
juillet / août 2005 |
M. Claude Gressier : « M. Breton et M. Perben ont publié un communiqué indiquant qu’ils souhaitaient que la concertation avec les organisations syndicales se poursuive dans le cadre de la structure de contact instituée auprès du préfet de la région PACA, Christian Frémont, et de son groupe de travail animé par Patrice Raulin, directeur général de la mer et des transports ». |
MM. Thierry. Breton, ministre de l’Economie et des Finances et Dominique Perben, ministre des Transports. M. Patrice Raulin. |
|
AOUT 2005 | |||
M. Claude Gressier : «Les offres reçues, encore conditionnelles, ont été analysées pendant le mois d’août, et fait l’objet de négociations supplémentaires pour clarification ». « À ce moment-là, Veolia a proposé de se contenter d’une prise de participation minoritaire, quitte à monter à 100 % du capital après l’appel d’offres de 2007 » |
Précision de M. Jean-Louis Girodolle, ancien sous-directeur « Transports » à l’APE : « ... .jamais nous avons posé comme exigence de départ une reprise à 100 % ». Pour sa part, M. Walter Butler a déclaré lors de son audition du 2 octobre 2013 « ... nous avons déposé une offre sur 100 % du capital. C’est ce qui était demandé ». | ||
SEPTEMBRE 2005 | |||
1er septembre 2005 |
M. Francis Lemor : « Henri Proglio, que j’ai rencontré le 1er septembre 2005, et à qui j’ai dit que nous serions bientôt confrères grâce à la Corse, m’a répondu : « Ça, jamais ! Je fais d’ailleurs voter à mon conseil d’administration, la semaine prochaine, une résolution m’interdisant de m’en mêler ». « C’est bien ce qu’il a fait. Veolia n’était pas candidat. Le conseil a dû se tenir le 8 septembre » |
||
Septembre 2005 |
M. Camille de Rocca Serra: réunion sous l’autorité de M. Pierre-Etienne Bisch (directeur de .cabinet de M. Perben) avec M. Pierre-René Lemas (préfet de Corse), Mme Marie-Hélène Debart qui suit les affaires de la Corse au ministère de l’intérieur, MM. Ange Santini, Antoine Sindali (OTC) et Rocca Serra. « Je ne sais plus ce qui s’est dit exactement mais j’en ai retiré l’impression que la messe était dite – ou presque. Pierre-Étienne Bisch a parlé de groupes financiers. Plusieurs noms de transporteurs installés à Marseille – Dreyfus, Grimaldi,… – ont été évoqués […] On nous annonce un appel d’offres impliquant plusieurs candidats, dont Butler et Caravelle. Il me semble qu’il y en avait d’autres» |
||
9 septembre 2005 |
M. Francis Lemor : « L’accord qui m’avait été donné [le 20 juillet] a été réitéré le 9 septembre, en présence de Walter Butler, de Claude Gressier, qui avait été mandaté pour suivre la privatisation, de l’Agence des participations de l’État (APE), de HSBC, et du président de la CGMF. Tout le monde était d’accord sur le schéma que j’avais proposé ». |
||
14 septembre 2005 |
M. Claude Gressier : dernière réunion dans les bureaux de la banque HSBC avec les 3 candidats avant le dépôt des offres définitives. « Et Stéphane Richard nous a dit à la fin que le pli nous parviendrait le lendemain en fin de matinée » |
||
15 septembre 2005 |
M. Claude Gressier : à 17 heures, à la remise des plis définitifs, pas d’offre de Veolia. « Nous n’avons rien reçu, sinon un coup de téléphone pour informer la banque que le conseil d’administration de Veolia avait refusé de faire une offre. Nous avons été pour le moins surpris, mais l’échéance était passée » M. Gérard Couturier : « Au bout du compte, une date ayant été prévue pour la remise définitive des offres de reprise, nous avons dû passer devant le conseil d’administration de Veolia, réuni le matin du jour où nous devions déposer le dossier. Et nous avons été très étonnés d’apprendre que le conseil d’administration refusait la proposition de reprise de la SNCM. Dans l’après-midi, nous avons donc informé l’APE et cette annonce a surpris beaucoup de monde » Sur les raisons du refus du conseil d’administration de Veolia Environnement : M. Gérard Couturier : « Ce n’est qu’une idée, mais le conseil d’administration a reculé devant les difficultés telles que nous les avions présentées. Peut-être avons-nous été maladroits, mais en tout cas nous nous étions efforcés d’être le plus objectifs possible. Il y avait des difficultés sociales à Marseille et en Corse. Par ailleurs, le donneur d’ordre insulaire ne pouvait pas s’engager durablement, ou tout au moins dans un premier temps, dans une DSP. La fragilité juridique de l’affaire était également un obstacle. Enfin, les difficultés concurrentielles avec Corsica Ferries ont également dû peser. » |
Hostilité ou prévention à l’égard du projet clairement exprimée au sein du conseil d’administration de Veolia Environnement tenu ce jour : MM. Daniel Bouton, Baudoin Prot, Philippe Kourilsky et Louis Schweitzer, administrateurs. Le président Proglio prend acte. |
|
19 septembre 2005 |
Réunion entre le préfet de la région PACA, M. Christian Frémont, et les syndicats : le préfet indique que deux investisseurs, Butler Capital Partners et le fonds Caravelle, déposent chacun une offre de candidature pour une prise totale du capital » de la SNCM. Le préfet de région tiendra dix-sept réunions avec les organisations syndicales entre le 19 septembre et le 13 octobre : « Je les voyais quasiment tous les jours et cela durait toute la journée, parfois une partie de la nuit ». |
M. Christian Frémont, Préfet de la région PACA. Les organisations syndicales |
Le préfet sera chargé de rappeler aux syndicats que les deux offres reçues portent sur une reprise à 100 % du capital de la SNCM. D’après les éléments de langage qui lui étaient transmis par les ministères concernés puis, en phase ultime, par Matignon, il lui incombait de faire état que ces options maximales n’ont pas été recherchées en quoi que ce soit par l’État mais qu’elles étaient effectivement la seule voie proposée par les repreneurs potentiels qui cependant s’engagent, sous certaines conditions, sur la survie de l’entreprise et son unité sur tous ses marchés. |
Réunion entre le préfet et les élus de la ville de Marseille, de la région PACA, du conseil général des Bouches-du-Rhône et de la collectivité territoriale de Corse. M. Antoine Sindali (OTC) : « Nous avons fait connaître notre souhait de voir l’État se maintenir dans le capital de la compagnie, et [il a été évoqué], d’une part, la possibilité d’y faire participer les salariés, pour constituer avec la puissance publique une minorité de blocage, et, d’autre part, l’introduction d’un opérateur industriel ». M. Camille de Rocca Serra : Réunion entre le préfet, « ... les élus de Corse, Ange Santini, président de l’exécutif, Tony Sindali, président de l’Office des transports et moi-même. Nous tenons une table ronde avant celle à laquelle les syndicats seront invités par le préfet Frémont. Nous retrouvons le préfet de Corse, M. Lemas ; le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin ; Mme Sylvie Andrieux qui représente Michel Vauzelle (c’est-à-dire la région PACA), ainsi que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini. Du côté des représentants de l’État, on compte le préfet délégué à la police, Bernard Squarcini ; Thierry Breton, ministre de l’économie, et Dominique Perben, ministre des transports, et leurs conseillers. La division Connex aussi est représentée en la personne de Stéphane Richard et il y a aussi Gérard Couturier» M. Camille de Rocca Serra précise « Henri Proglio m’avait dit qu’il répondrait présent en cas de besoin, mais pas à n’importe quelle condition ». |
Le Préfet et les élus. |
||
20 sept 2005 |
Les marins CGT, en grève contre le projet de privatisation, commencent à bloquer à Marseille les navires de la SNCM. |
||
26 sept 2005 |
Grève des marins de la SNCM. |
D’abord CGT puis STC. |
|
Précision sur le schéma donnée par le préfet : le groupe Butler va effectivement acquérir 100% de la compagnie ; le fonds verserait 35 millions pour racheter la SNCM, mais une fois que le gouvernement aurait versé 113 millions dans la compagnie pour la recapitaliser, et se soit engagé à prendre en charge un plan social portant sur environ 400 suppressions d’emplois (sur 2 400). La grève s’étend au Port Autonome de Marseille, initialement pour 24h (CGT), en solidarité avec les marins, mais aussi contre les menaces de privatisation qui pèsent sur le PAM lui-même Grève des dockers, le 26 au soir, en solidarité avec la SNCM et contre l’intervention des forces de l’ordre sur le port. |
Préfet de la région PACA : Monsieur Christian Frémont. |
||
Audition de M. Camille de Rocca Serra : Réunion d’urgence à Marseille. |
|||
27 sept – 28 sept 2005 |
Le gouvernement annonce une privatisation totale avant de faire marche arrière et d’indiquer que l’État restera actionnaire mais minoritaire (Le Monde, 29 septembre). |
Gouvernement. |
Des marins du Syndicats des travailleurs corses (STC) s’emparent sans violence du Pascal Paoli pour lui faire mettre le cap sur Bastia : interception du navire par des éléments d’un commando de marine et du GIGN, le matin du 28 septembre. A l’arrivée, des militants nationalistes auraient été prêts pour mener à bien l’exfiltration des « mutins ». |
Le soir même, M. Bernard Thibault (CGT) rencontre le Premier ministre Dominique de Villepin à Matignon (Le Parisien du 29 septembre). 27 Septembre. Audition de M. de Rocca Serra : à l’émission « Question d’actu » sur LCI avec Walter Butler et un journaliste du quotidien Les Echos : « J’ai donc demandé à Walter Butler que je ne connaissais pas, s’il accepterait que l’État reste au capital – il a répondu oui –, que les salariés participent au capital – il a répondu oui –, et si des transporteurs routiers de Corse le pourraient aussi, de façon à établir un équilibre entre les syndicats et les utilisateurs – il a encore répondu oui. M. Butler paraissait donc prêt à discuter. J’en ai donc déduit que les choses auraient pu se passer autrement » Avant l’émission : MM. Jean-Claude Gaudin et Camille de Rocca Serra prennent contact avec Pierre Mongin (directeur de cabinet de Dominique de Villepin), « Pierre Mongin me dit, en me demandant de garder le silence, que l’État restera au capital » |
Le Premier ministre, M. Dominique de Villepin et M. Pierre Mongin, son directeur de cabinet. |
||
28 sept 2005 |
M. Francis Lemor : « Matignon provoque une réunion le 28 au soir, dont j’apprendrai les conclusions vers deux heures du matin : recomposition du capital autour de Butler, Veolia, l’État et les salariés. Entre-temps, Walter Butler avait oublié la parole qu’il m’avait donnée… » |
||
29 sept 2005 |
Le Premier ministre annonce la configuration d’un nouveau plan de survie de la SNCM qui pourrait être : État : 25%, salariés : 5%, Butler : 40%, Connex (Veolia) : 30% Précisions du Ministre des Transports, M. Dominique Perben lors d’une réunion à la préfecture avec les syndicats : le projet suppose au préalable que l’État injecte 113 millions € dans la compagnie, pour aider à son redressement. Puis mouvement en deux temps : - le fonds Butler Capital Partners (BCP) prendrait d’abord 70 % du capital de la SNCM pour une valeur symbolique (l’entreprise ayant actuellement une valeur négative) tout en s’engageant à y injecter 35 millions d’euros - BCP « ferait le nécessaire » pour céder 30 % du capital à Connex, (Veolia Environnement). BCP et Connex ont pris l’engagement ferme qu’il n’y aurait aucun licenciement sec. (La Tribune du 30 septembre) Déclaration de M. Walter Butler au Monde du 29 septembre : «La présence de l’État ne doit pas contrebalancer ni aujourd’hui, ni surtout demain le projet de la SNCM ». Il souligne par ailleurs que « l’une des causes importantes de ses problèmes vient du fait que la SNCM est détenue par l’État ». « Je ne peux pas laisser dire que l’on brade la SNCM. Un expert indépendant a été désigné, une banque conseil a été nommée il y a six mois. Notre offre est deux fois supérieure à l’autre fonds –Caravelle-. Et les sommes que nous proposons -35 millions- sont entièrement destinées à l’entreprise. Sur les 113 millions d’euros injectés par l’État, 82 millions serviront à apurer le passé et 31 millions à accompagner notre projet. Il faut quand même savoir que l’entreprise a entre 150 millions et 200 millions d’euros de dettes. Sur les trois dernières années, elle a réalisé 100 millions d’euros de pertes. » « La SNCM peut être redressée car elle garde une part de marché significative sur le trafic entre la Corse et le continent, entre Marseille et le Maghreb » précise M. Butler. |
Le Premier ministre et le ministre chargé des Transports. MM. Walter Butler et Henri Proglio. |
Le Maire de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, la présence de l’État dans la nouvelle société serait « de nature à renforcer toutes les garanties pour le personnel et le développement de la société ». Le Maire de Bastia, M. Emile Zuccarelli trouve : « ... ahurissant que le gouvernement ait retenu le plan financier proposé par le groupe Butler », dans lequel «... l’État apporte 113 millions d’euros » tandis que « le fonds d’investissement n’investirait, lui, que 35 millions en échange de quoi il récupérerait un actif évalué à près de 500 millions en annonçant 400 suppressions d’emplois ». Audition de M. Walter Butler du 2 octobre 2013 : « Non, je n’ai pas eu de contact politique avant la remise de l’offre. Je ne sais pas comment Veolia a réussi à revenir. La presse a repris ses déclarations, à savoir qu’elle n’était pas en service commandé. La vérité doit être un peu plus nuancée. Le point central est que le conseil d’administration de Veolia ne voulait pas d’une participation majoritaire ». M. Butler a ajouté : « Je n’étais pas au courant de la réunion à Matignon. Le seul contact que j’ai eu, c’est avec Pierre Mongin, le directeur de cabinet du Premier ministre, qui, en quelques secondes, m’a demandé de trouver une solution. Mais c’était bien après le dépôt de l’offre ». Audition du 23 octobre 2013 de M. Henri Proglio, ancien président de Veolia Environnement : « Si Veolia avait été une entreprise financière, le groupe aurait probablement renoncé. Mais en tant qu’opérateur de services publics, responsable vis-à-vis des collectivités territoriales, à Marseille comme en Corse, j’ai eu la tentation de ne pas rester en dehors du dossier et d’apporter ne serait-ce qu’un début de réponse à une crise néfaste pour tout le monde. Quand on est enraciné dans un territoire, on ne peut pas ignorer l’intérêt public. Indépendamment des considérations financières, il fallait ramener l’ordre et la vie économique dans les bassins d’emploi concernés. Voilà ce qui m’a guidé ». |
30 sept 2005 |
Rencontre à Bruxelles entre M. Jacques Barrot, Commissaire européen en charge des transports et M Thierry. Breton, ministre de l’Economie et des Finances : Il faudrait que l’aide « soit la dernière » et qu’un « éventuel maintien résiduel de l’État au capital » soit « réduit donc limité dans le temps » Déclaration de M. Jacques Barrot au quotidien La Croix : prêt à négocier un feu vert de Bruxelles à un nouvel apport financier de Paris à la SNCM, à condition d’obtenir des garanties : « Nous pourrions autoriser le gouvernement à accorder une aide à la restructuration ». Au cours de son audition du 9 octobre 2013, M. Le Bret, ancien chef de cabinet de M. Barrot, a précisé : « ... le point de départ de l’affaire de la SNCM, vu de la Commission européenne, c’est non pas la privatisation de 2005/2006 mais le premier plan d’aide à la restructuration de 2002/2003 ». En dépit d’aléas et d’un certain vide juridique (le tribunal européen ayant annulé le plan de 2003 non dans son principe mais pour des erreurs de calculs incombant principalement aux services bruxellois), l’appréciation du dossier, d’un point de vue communautaire, ne pouvait s’effectuer que sur la base d’un continuum excluant toute nouvelle mobilisation exclusive des finances publiques, hors la règle du recours à un ou à des investisseurs avisés mais n’excluant toutefois pas une précise et stricte compensation des contraintes de service public qui leur seraient imposées. |
M. Benoît Le Bret, chef de cabinet du Commissaire européen. |
M. Benoit Le Bret : « Je me souviens, mais je ne sais plus du tout quand, de M. Thierry Breton, dépêché à Bruxelles toute affaires cessantes, après les mouvements sociaux mettant la pression sur l’État afin qu’il reste majoritaire, pour « pré-expliquer » le dossier et sentir le vent. Souvent les dirigeants français entreprennent ce genre de démarches pour avoir la confirmation qu’il y a des limites au droit économique et qu’on ne peut pas puiser sans cesse dans les finances publiques pour combler des trous sans fond. Le Premier ministre avait enjoint son ministre des finances de publier, après sa rencontre avec Jacques Barrot, un communiqué de presse fixant le cadre et bordant l’opération. Nous rappelons donc que nous n’exigeons pas la privatisation mais qu’une aide à la restructuration ayant déjà été accordée, le projet doit être conforme à celui d’un investisseur avisé ... Je mentionne au cours de la réunion que si la privatisation ne peut être imposée par l’Union, la présence d’investisseurs privés, leur poids dans l’opération, le caractère éventuellement temporaire de la présence de l’État au capital, joueront en faveur du dispositif ». « La visite de M. Breton est le seul contact politique entre la Commission et la France dont je me souviens ». |
OCTOBRE 2005 | |||
3 octobre 2005 |
Meeting de soutien politique aux grévistes : PS local, Verts, PCF. Réunion de concertation entre syndicats et les ministres : le Gouvernement annonce que l’État maintient une participation dans le capital à hauteur de 25 %. |
Les ministres Dominique. Perben (Transports) et Thierry Breton (Économie) |
|
5 octobre 2005 |
M. Thierry Breton propose d’augmenter la part des salariés dans le capital à 9%, mais affirme que l’État restera à « 25% maximum ». La CGT affirme que « le compte n’y est pas ». (source : AFP) |
||
6 octobre 2005 |
Réunion de concertation avec le ministre de l’économie et des finances – nouveau montage financier proposé : État : 25%, Connex : 28 %, Butler : 38 % et salariés : 9%. La présidence du directoire revenant à Connex |
Jean-Paul Israël (CGT) : « la porte n’est pas fermée, mais le compte n’y est pas ». | |
7 octobre 2005 |
Le patronat demande à ce que le Port soit débloqué. |
||
8 octobre 2005 |
Réunion au siège de la CGT entre MM. Thibault, Le Duigou (direction nationale de la CGT), Jean-Paul Israël (CGT-Marins) et les secrétaires des Unions départementales des Bouches-du-Rhône et de Corse venus y demander « une extension du conflit et en particulier dans les services publics » (M. Israël). Projet de protocole d’accord de sortie de crise entre la direction et les responsables de la CGT pour la reprise du travail |
CGT : MM. Thibault, Le Duigou, Israël et les secrétaires des Unions Départementales des Bouches-du-Rhône et de la Corse |
|
9 octobre 2005 |
Lettre de M. Bernard Thibault (CGT) au Premier ministre. |
Réponse donnée par le Premier ministre le 10 octobre : il promet l'absence de licenciements secs, le maintien de l'intégralité de la flotte (...) et l'unité de l'entreprise dans ses différentes activités. « La compensation pour non recours à la force publique lors des grèves a été payée selon une jurisprudence bien établie ». Source : éléments de langage transmis par fax au préfet de la région PACA, le 3 octobre 2005, par le ministère des transports. | |
10 octobre 2005 |
Echec de la réunion entre MM. Thierry Breton, Dominique Perben et les syndicats. Poursuite de la grève. Réunion du comité d’entreprise de la SNCM à la suite de laquelle Bruno Vergobbi déclare qu'"à défaut de reprise de l'exploitation avant la fin de semaine, la cessation de paiement serait inévitable". (source : AFP) |
Les ministres Dominique Perben et Thierry Breton, la CGT et M. Bruno Vergobbi, président de la SNCM. |
Le gouvernement menace ouvertement d’un dépôt de bilan si le travail n’a pas repris à la fin de la semaine. Le syndicat FO apparaît, aux côtés du syndicat des officiers CGT, pour appeler à la reprise Audition du préfet Christian Frémont : « Pendant le week end du 8 et 9 octobre, le président du tribunal de commerce m’a prévenu qu’il mettrait la société en dépôt de bilan à la fin de la semaine ... ». |
13 / 14 octobre 2005 |
La CGT de la SNCM incite à la reprise du travail. « Le dépôt de bilan était prévu pour le 14. Le pire a donc été évité in extremis. » (préfet Frémont) |
CGT : « ... avoir fait un pas en arrière », sans avoir mis « un genou à terre » (Les Echos du 17 octobre 2005) | |
15 octobre 2005 |
Manifestations |
||
17 octobre 2005 |
Entretien donné par M. Walter Butler au quotidien Les Echos : « Nous sommes engagés pour au moins cinq ans, période pendant laquelle nous ne percevrons pas de dividendes. ». Mais il reconnaît qu'il existe encore plusieurs « conditions suspensives » telles qu'un accord sur les conditions de travail - |
M. Walter Butler. |
Date de la reprise effective du travail. |
DÉCEMBRE 2005 | |||
27 décembre 2005 |
Les syndicats de la SNCM rencontrent le futur directeur opérationnel de la compagnie, M. Gérard Couturier de Veolia, pour prendre connaissance du plan industriel et financier. M. Gérard Couturier : « Nous voulons atteindre l'équilibre économique et être en position de pouvoir renouveler les navires à partir de 2009. Notre programme, qui s'appuie sur dix bateaux, l'unicité de l'entreprise et des commandes pour fin 2006-début 2007, comprend l'achat tous les deux ans et demi d'un bateau neuf et un d'occasion pour remplacer les plus anciens de la flotte. » « Nous souhaitons aboutir à un Pacte social avant fin février. S'il y a des adaptations en termes d'effectifs à venir, cela ne passera pas par un plan social. S'il y a des départs, ils se feront sur la base du volontariat ou des retraites anticipées avec des formules accompagnées... » (Le Parisien, 28 décembre) |
Les Organisations Syndicales, et M Gérard Couturier (Veolia). |
« Ce qui est fondamentalement intéressant dans leur approche est la définition d'un projet inscrit dans la durée, qui cible 2009 pour un retour à une pleine santé de la SNCM », déclare à l'AFP M. Maurice Perrin, secrétaire général de la CFE-CGC de la SNCM ( Le Monde du 28/12/2005 La CGT est favorable au projet de Veolia (Le Monde du 31 décembre). Au cours de son audition du 16 octobre 1013, M. Jean Paul Israël (CGT-Marins) déclare : « ... Veolia a été notre choix quand nous avons été mis dos au mur, quand le gouvernement a menacé de déposer le bilan. Nous avions même été contactés par le mandataire ad hoc. Je l’ai vu une seule fois. Nous n’avions plus le choix et notre responsabilité était de sauver ce qui était récupérable, qu’il s’agisse d’emplois ou du service public ». |
JANVIER 2006 | |||
Début 2006 |
M. Claude Gressier: l’architecture de la cession se dessine au début 2006. « Elle s’accompagnait d’une augmentation de capital de 158 millions, d’un complément de plan social de 38,5 millions, d’une aide à la restructuration de 22,4 millions et d’un apport en capital de la CGMF de 8,5 millions. Ces dispositions sont intervenues au moment où un accord était signé entre Pierre Vieu, Stéphane Richard et Walter Butler » (Soit 227,4 millions €). M. Francis Lemor : « En janvier 2006, nous avons appris aussi l’existence de la clause résolutoire qui permettait l’annulation de la privatisation en cas de non-obtention de la délégation de service public » |
Connex prend le nom de « Veolia Transport ». |
|
31 janvier 2006 |
Veolia Transport qui doit prendre 28 % de la SNCM souhaite que l’État injecte davantage d’argent dans le cadre du plan de privatisation |
Veolia Transport (appellation désormais substituée à celle de Connex) M. Thierry Breton |
M. Thierry Breton, ministre de l’Economie, avait indiqué en octobre que le plan de reprise de la SNCM prévoyait 113 millions d’euros de reprise de dettes ainsi que 7 millions de recapitalisation |
MARS 2006 | |||
15 mars 2006 |
STEF / CMN dénonce le pacte d'actionnaires liant, depuis 1992, ce groupe à la SNCM. |
||
17 mars 2006 |
Le tandem « BCP/Veolia Transport » a obtenu de l’État une rallonge. Les repreneurs ont demandé une « rallonge » de 70 millions € pour éponger les pertes 2005 supérieures aux prévisions L’Assemblée territoriale corse ne devrait pas changer en profondeur les conditions de la desserte maritime de l’île. |
L’État/BCP/Veolia |
Les repreneurs obtiennent une trentaine de millions € supplémentaires. « Selon nos informations, le texte définissant les nouvelles obligations de service public à compter du 1er janvier 2007, examiné le 23 mars par les élus, prévoit un dispositif très proche de celui instauré en 2002 pour 5 ans » Les Echos (17/06/2006) |
20 mars 2006 |
Veolia refuse de signer un pacte social avec les syndicats avant de connaître les termes de l’appel d’offres. |
Veolia |
M. Gérard Couturier (Veolia) dans un entretien à La Provence : « la baisse d’activité, si elle reste ce qu’elle est, rendra nécessaire la suppression de 150 à 200 postes » repris par La Tribune (20/06/2006) |
24 mars 2006 |
L’Assemblée de Corse adopte dans la nuit du vendredi au samedi le cahier des charges qui s’imposera de 2007 à 2012 aux candidats à la desserte maritime de Corse Le règlement particulier d’appel d’offres sur les lignes maritimes entre Marseille et la Corse ainsi que le cahier des charges élaborés par l’exécutif ont été adoptés à une majorité de 39 voix |
L’Assemblée de Corse |
Ce cahier des charges va dans le sens d’une reconduction d’une SNCM en voie de privatisation et de rassurer ses 2400 salariés. |
25 mars 2006 |
Lancement de l'appel d'offres pour la desserte de l'île. |
||
mars 2006 |
M. Gérard Couturier : « Notre engagement a été précédé d’une consultation favorable du personnel sur les principes d’organisation de cette entreprise : des réductions d’effectifs, l’absence de licenciements secs – garantie qui nous était demandée par l’État –, le maintien des salaires et la possibilité de conserver le pavillon français premier registre. En clair, c’était le jour et la nuit par rapport à notre concurrent en termes de conditions sociales, mais surtout de masse salariale » |
M. Walter Butler a précisé à la commission d’enquête avoir été auditionné avec Veolia Transport par la Commission des participations et des transferts (CPT), le 30 mars 2006. | |
AVRIL 2006 | |||
11 avril 2006 |
La SNCM doute des intentions de STEF-TFE dans la CMN. La SNCM s’apprête à relancer sa liaison vers la Corse à partir de Nice. |
SNCM et STEF-TFE. |
|
26 avril 2006 |
Bruxelles reçoit le projet de protocole d’accord avec les acquéreurs et le plan de restructuration de la SNCM dans le cadre de la demande d’autorisation prévue par les règles européennes sur le principe des aides aux entreprises en difficulté. Une recapitalisation d’un montant de 142,5 millions d’euros est prévue de la part de l’État. |
La Commission européenne. |
Urgence : pression des concurrents de la SNCM concernant le futur capital de la SNCM. è répartition : salariés : 9% ; État : 25% ; Veolia Transport : 28% ; Butler Capital Partners : 38% |
MAI 2006 | |||
2 mai 2006 |
Nouvelle avancée dans la privatisation de la SNCM, les actionnaires de l’armateur public ont approuvé l’entrée de Veolia Transport et de Butler Capital Partners au capital de la compagnie (prévue pour fin mai-début juin). Privatisation partielle de la SNCM suspendue au résultat de l’appel d’offres sur la desserte Marseille Corse (attendue d’ici automne). La DSP sera dotée d’une subvention de 90 MEUR |
Les actionnaires de la SNCM. Veolia Transport. |
Approbation de la recapitalisation de la société par l’État, via la GGMF, d’une somme de 142,5 millions € (reconstitution de son capital) Volonté affichée de Veolia Transport de reprendre les participations de ses partenaires au fur et à mesure de leur désengagement. Mise en place du plan social : 20 MEUR d’économie sur la masse salariale (réduction programmée de 400 postes à la fin 2008) è vote par les 2400 salariés à partir du vendredi 28 avril. Des réserves émises par la CGT. |
4 mai 2006 |
Le vote des salariés laisse le champ libre à la privatisation de la SNCM. Approbation majoritaire du « projet industriel » du groupe Veolia avec ses implications sociales. Le projet social a pour but de retrouver l’équilibre financier (déficit de l’exercice passé d’un montant de 30 millions €) et de restaurer des capacités permettant de renouveler la flotte. 400 suppressions de postes prévues par le plan social : négociation avec les instances de représentation du personnel une fois la privatisation effectuée. Conseils d’administration de Veolia Environnement des 28 mars et 11 mai 2006 : Avancées constatées mais poursuite des pourparlers avec Butler capital Partners sur les conditions de sa sortie du capital après au moins deux années mais également avec l’État. Préparation d’un protocole d’accord et d’un pacte d’actionnariat de mise en forme d’un accord avec le groupe Butler. Enfin, le conseil d’administration estime que l’économie générale de la prochaine DSP venant d’être arrêtée par l’Assemblée de Corse devrait permettre une exécution des missions de service public dans de meilleures conditions (durée portée de 5 à 6 ans). |
Les salariés de la SNCM. Le Conseil d’administration de Veolia Environnement (maison-mère de Veolia Transport). |
Consultation interne des salariés, le bilan est le suivant : sur 2336 inscrits è - 1197 OUI (77%) et 377 NON. Rejet formulé par le STC Initialement le projet du groupe Butler tablait sur quelque 700 suppressions de postes. Veolia obtient de l’État des réponses favorables à ses demandes. En premier lieu, la réouverture d’un droit d’option au régime fiscal de la taxe au tonnage (plus favorable que celui de l’impôt sur les sociétés) auquel la SNCM n’avait pas souscrit contrairement à la plupart des armateurs français et un traitement comptable des déficits accumulés jusqu’au 31 décembre 2006 dans le cadre d’une réévaluation libre des actifs (essentiellement les bateaux). En second lieu, le régime du « GIE fiscal » est sécurisé par la DGI dans le cadre d’un projet de lettre de confort adressé à l’entreprise pour la poursuite du financement des bateaux existants voire de futurs bateaux que la société pourrait acquérir. |
mai 2006 |
Signature, le 16 mai, du Protocole d’accord entre l’État (la CGMF) et les acquéreurs Butler Capital Partners et Veolia Transport : apport de 142,5 millions € de la CGMF (augmentation de capital) et mise à la disposition des repreneurs, en complément, d’une avance en compte courant de 38,5 millions € placée entre les mains d’un séquestre et destinée au financement du plan social. Cette somme dont la libération est prévue sur trois années (durée de l’« engagement social » des repreneurs) concerne les salariés non reclassés pour la fraction dite de « surgénérosité » (pages 9 du Protocole et annexe II.2) pour tout départ volontaire ou rupture du contrat de travail « quelle qu’en soit la nature ». Ce même jour, signature du Pacte d’actionnaires de la SNCM entre Butler Capital Partners (BCP) « agissant tant pour son compte que pour le compte du Fonds commun de placements à risques France Private Equity III »et Veolia Transport représenté par M. Stéphane Richard. La sortie du groupe Butler du capital de la SNCM est organisée par le jeu de promesses de vente et d’achat croisées (au-delà d’une période de conservation de sa participation de deux années) sur la base d’une formule de calcul de la valorisation de sa participation. En outre, il est prévu que Veolia Transport obtienne la majorité du capital dans l’hypothèse d’un désengagement de l’État (accord en ce sens avec BCP). L’État n’a pas d’engagement de sortie mais aurait fait savoir aux repreneurs qu’il demeurerait actionnaire « dans la limite des exigences de la Commission européenne » (!) Avis de la Commission des participations et des transferts rendu le 23 mai 2006 : concernant l’évaluation de la compagnie la Commission avalise la méthode « du prix négatif » après avoir pris connaissance des travaux sur ce point de la banque HSBC, des attestations des commissaires aux comptes (Ernst & Young) et des travaux complémentaires demandés à Oddo Corporate Finance et au cabinet juridique Paul Hastings sur les incidences financières d’une éventuelle liquidation de la SNCM. Dans ses attendus, la Commission souligne toutefois : « ... les longues années de gestion insatisfaisante de la société pendant lesquelles les décisions indispensables au redressement ont été inconsidérément retardées et les plans de restructurations qui avaient été tardivement arrêtés n’ont pas eux-mêmes été mis en œuvre, rendant vain les efforts financiers importants consentis par l’État. ». Publication du décret de privatisation N°2006-606 du 26 mai (JO du 28 mai 2006) suite à l’approbation du projet par l’assemblée générale des actionnaires de la SNCM. | ||
31 mai 2006 |
« Feu vert » de l’Union Européenne à la privatisation. Accord aux participations dans la SNCM du groupe Veolia et du fonds Butler Capital Partners. La Commission européenne estime que la privatisation « n’entrave pas de manière significative » la situation concurrentielle. | ||
31 mai 2006 |
Tenue d’un conseil d’administration de la SNCM avec pour ordre du jour la recapitalisation par l’État puis la répartition du capital. M. Gérard Couturier occupe la présidence du directoire et l’État la présidence du conseil de surveillance jusqu’en 2007, date à laquelle cette responsabilité incombera à un représentant de BCP. Le dernier défi de la nouvelle SNCM consistera à répondre à l’appel d’offres pour la desserte maritime de la Corse au départ de Marseille (officiellement lancé depuis le 27 mai dernier) | ||
JUIN 2006 | |||
6 juin 2006 |
M. Alain Mosconi (Syndicat des travailleurs corses) présent en fin de semaine dernière en Bretagne, à l'invitation du Syndicat des travailleurs bretons. Vendredi, il était accueilli au Guilvinec par Dominique Jolivet, un des responsables de la structure bretonne |
M. Alain Mosconi membre de l'exécutif du STC, secrétaire national du secteur maritime. |
« Nous nous apercevons que l'intérêt corse n'apparaît nulle part dans les débats. La Corse et la Sardaigne, qui sont séparées seulement de 13 km, ont de nombreuses similitudes culturelles or, il n'y a aucun échange économique, pas de ligne de service public régulière. L'État français nous impose des transports uniquement vers Marseille, alors que nous sommes aussi intéressés par Barcelone. Nous misons sur l'Europe des nations sans État. » Alain Mosconi (propos recueillis par Le Télégramme du 06 juin 2006). |
19 juin 2006 |
M. Gérard Couturier rencontre chacune des organisations syndicales pour leur présenter le plan de redressement, avec toutefois 400 suppressions d'emplois, et rédiger ensemble un protocole approuvé dans son principe par 77 % des salariés au début du mois de mai. |
Rappel : M. Couturier avait été nommé, en février 2004, Délégué régional de Veolia Environnement, en charge des transports mais aussi de la propreté et de l'énergie. Ancien officier de marine, il est l’« homme de Veolia » dans la région. |
M. Couturier fait référence à une entreprise ayant une « âme » et à des « salariés patriotes » Les Echos (19/06/2006). |
JUILLET 2006 | |||
3 juillet 2006 |
Accord conclu à Marseille entre les marins du Méditerranée et la SNCM, qui doit permettre le départ en soirée de ce ferry à destination de l'Algérie. Le conflit a bloqué le navire à quai toute la journée. Il portait sur la mise en place du plan social prévu dans le cadre de la privatisation de la compagnie, et concernait la suppression de trois postes. |
M. Jean-Paul Israël, secrétaire des marins CGT de la SNCM |
« Une solution a été trouvée » déclare Jean-Paul Israël dans Le Parisien (04/07/2006). |
27 juillet 2006 |
Le renflouement financier de la SNCM sera examiné de plus près par la Commission européenne, pour déterminer si l'injection massive d'argent public accompagnant la privatisation fausse le jeu de la concurrence Dans un délai minimum de six mois, la Commission européenne ne devrait pas remettre en cause la privatisation elle-même, mais pourrait imposer à la SNCM des contreparties en échange des aides d'État, alors évaluées à 181 millions d'euros. |
Commission européenne M. Jacques Barrot, vice-président de la Commission, chargé des Transports |
Dans un courrier, M. Jacques Barrot indique à l'avocat d'une des parties concernées que la Commission ouvrirait « prochainement une procédure d'enquête qui permettra à toutes les parties intéressées de faire valoir leur position » La Nouvelle République du Centre Ouest (27/07/2006). |
AOUT 2006 | |||
4 août 2006 |
La remise des offres à la Collectivité de Corse, pour l'attribution, fin octobre, de cette liaison encadrée dans une délégation de service public, a donné lieu à un renversement d'alliances. La Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), contrôlée par la société STEF-TFE, partenaire de la SNCM qui est aussi son actionnaire, se rapproche du concurrent de cette dernière, la Corsica Ferries qui devance la SNCM en parts de marché sur les liaisons entre le continent et la Corse et opère au départ de Toulon et de Nice M. Francis Lemor (CMN-La Méridionale) : « Le 4 août 2006, le jour même du dépôt de candidature à la DSP, la SNCM, actionnaire minoritaire de la CMN, nous a assignés devant le tribunal de commerce de Paris pour nous exproprier, c'est-à-dire pour obtenir la vente forcée des actions de STEF dans La Méridionale, en vertu d’un pacte très ancien que nous avions dénoncé six mois plus tôt, et qui n’avait donc plus cours ». |
La Compagnie méridionale de navigation (CMN) devenue La Méridionale, le « partenaire » de la SNCM. M. Francis Lemor qui, au cours de son audition, a particulièrement insisté devant la commission d’enquête sur la relation conjointe mais non solidaire de La Méridionale et de la SNCM pour l’exécution de la DSP. Robert de Lambilly, PDG de la CMN. |
La CMN va déposer « une offre groupée non solidaire avec Corsica Ferries sur trois lignes (Bastia, Ajaccio et Propriano) » et répondre seule pour d'autres lignes. « Nous répondons à l'agression de Veolia qui veut racheter la CMN, c'est notre indépendance qui est en jeu » affirme Robert de Lambilly. Le Monde (09/07/2006). « C'est une trahison majeure alors que nous pouvions nous entendre », estime Stéphane Richard, directeur général de Veolia Transport. Le Monde (09/07/2006) L’Express parle d’« une guerre fratricide, où tous les coups sont permis ». |
8 août 2006 |
La CMN se sépare de la SNCM et s'allie à Corsica Ferries. |
||
9 août 2006 |
La SNCM saisit le tribunal de commerce de Paris. |
||
11 août 2006 |
Clôture de l’appel d’offres. Résultats fin septembre. L'entreprise qui emportera cette délégation de service public recevra 90 millions d'euros pour la période 2007-2011. Pour remporter le précédent appel d'offres, qui couvrait la période 2002-2006, la SNCM s'était associée à la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN). Celle-ci a finalement décidé de coopérer avec Corsica Ferries. |
Si la desserte des lignes entre la Corse et Marseille lui échappe, la SNCM perdrait plus de la moitié de son chiffre d'affaires | |
SEPTEMBRE 2006 | |||
13 septembre 2006 |
La Commission européenne ouvre une enquête sur les aides accordées par l'État français à la SNCM lors de sa privatisation partielle fin 2005. Les investigations portent sur la compatibilité de la recapitalisation avec les règles de concurrence au sein de l'Union. (Le Monde du 15 septembre) |
||
14 septembre 2006 |
La CMN envoie une lettre au directeur général de la DGCCRF, M. Guillaume Cerutti, estimant que "l'ensemble de la procédure de mise en concurrence de la desserte maritime de la Corse paraît être entaché de très graves irrégularités au regard des dispositions (...) du Code de la concurrence". (source : AFP du 14 septembre). |
||
OCTOBRE 2006 | |||
3 octobre 2006 |
La CMN, désormais ouvertement concurrente de la SNCM pour la desserte maritime de la Corse, saisit la Commission européenne de "graves distorsions de concurrence" justifiant, selon elle, l'interruption immédiate de l'appel d'offres en cours pour la desserte de l'île à partir de Marseille. |
||
16 octobre 2006 |
Le Figaro du 16 octobre : « Veolia et Butler Capital ont la possibilité de rendre les clés à l'État si la SNCM n'obtient pas la reconduction de la délégation de service public (DSP) pour la desserte maritime de la Corse à partir de Marseille ». |
||
17 octobre 2006 |
Le tribunal de commerce de Paris donne raison à la SNCM dans le différend l'opposant à la Compagnie méridionale de navigation (CMN). M. Francis Lemor : « Le 17 octobre 2006, le tribunal, dont vous apprécierez l’exceptionnelle célérité, a donné satisfaction à la SNCM et contraint STEF à céder la totalité de sa participation dans La Méridionale à la SNCM. Ce jugement rocambolesque a évidemment été infirmé par les magistrats professionnels de la cour d’appel, puis définitivement par la Cour de cassation. ». L’arrêt définitif de la Cour de cassation sera rendu, dans cette affaire, le 6 novembre 2007 : le pacte d’actionnaire pouvait être dénoncé unilatéralement par STEF / CMN car conclu pour une durée indéterminée sans que ses clauses puissent contraindre la CMN à céder tout ou partie de sa participation dans la SNCM. |
M. Francis Lemor au cours de son audition du 18 septembre 2013 : « Une fois mise en échec la tentative grossière de mettre la main sur nos navires, j’ai décidé de répondre avec la SNCM à l’appel d’offres. Le message a eu du mal à passer tant à Marseille qu’à Paris. mais chacun a fini par comprendre l’enjeu. Nous avons donc établi un protocole avec la SNCM. En janvier 2006, nous avons appris aussi l’existence de la clause résolutoire qui permettait l’annulation, de la privatisation en cas de non-obtention de la DSP ». Le premier jugement (tribunal de commerce) était immédiatement exécutoire et Veolia avait demandé, en conséquence, la désignation d’un mandataire chargé de prendre possession des bateaux de la CMN- La Méridionale. | |
30 octobre 2006 |
Grève surprise des marins de la SNCM pendant les vacances scolaires (Les Echos du 2 novembre). |
||
NOVEMBRE 2006 | |||
14 novembre 2006 |
Corsica Ferries et la CMN présentent une offre groupée pour desservir la Corse. |
Corsica Ferries est, à l’origine, une société de taille modeste, créée à Bastia, pour commercialiser des voyages en bateaux. La première rotation assurée par Corsica Ferries entre Gênes et la Corse remonte au printemps 1968. Cette société contrôle la marque mais pas la flotte. Chaque navire relève d’une société particulière enregistrée à Gênes. Pour la France, l’exploitation de la flotte est contrôlée par la société Lota Maritime, créée en 1998, dont M. Pierre Mattei préside également le directoire. |
Audition 25 septembre 2013 de M. Pierre Mattei, directeur général de Corsica Ferries (France) : « Avec la CMN, nous avons des contacts très fréquents puisque nous sommes leurs manutentionnaires à Bastia, nous chargeons et déchargeons aussi pour la SNCM. Mais pas en vue de la privatisation. Nous avons seulement répondu ensemble à l’appel d’offres de 2006 puisque, à l’époque, les relations entre la CMN et la SNCM étaient rompues ». La société EGM qui dépend du groupe Lota gère notamment l’activité de transport de marchandises et de manutention à quai pour deux clients : La Méridionale et ... la SNCM. |
DÉCEMBRE 2006 | |||
13 décembre 2006 |
Publication par la Commission Européenne de sa décision prise en septembre d'ouvrir une enquête approfondie sur les aides à la restructuration en faveur de la SNCM. Elle précise que sa décision portera non seulement sur le plan de privatisation de 2006, dont la recapitalisation avant la cession aux repreneurs (Butler Capital Partners et Veolia Transport), mais aussi sur le précédent plan de sauvetage de la SNCM (2002 / 2003) de quelque 70 millions. (Les Echos du 15 décembre). |
||
15 décembre 2006 |
Le Conseil d’État annule l'appel d'offres piloté par la Collectivité territoriale de Corse (CTC) pour attribuer la délégation de service public (DSP) régissant la desserte continent / Corse entre 2007 et 2012 ; un marché doté de 95 millions d'euros de subventions annuelles. (source : AFP du 15 décembre) Le Conseil d'État précise qu'il revenait à la Collectivité territoriale de Corse "soit de reprendre intégralement la procédure d'appel d'offres, soit d'inviter les candidats -- CMN, Corsica Ferries et SNCM -- à produire de nouvelles offres". |
Le président de l'Office des transports de la Corse (OTC), M. Antoine Sindali, a déclaré qu'il envisageait une reprise intégrale de la procédure, "sur la base du règlement d'appel d'offres et du cahier des charges qui existent et qui, eux, n'ont pas été annulés". La SNCM indique qu'elle se portera à nouveau candidate | |
26 décembre 2006 |
Les élus corses repoussent de quatre mois l'appel d'offres pour la desserte maritime |
||
2008 | |||
Octobre / novembre 2008 |
Rachat par Veolia des parts du groupe Butler selon l’accord conclu entre eux. La volonté de rachat serait venue de Veolia : « Connex a dû, à un moment, envisager le rachat de la part de Butler à un prix assez élevé, qui selon moi excédait très nettement la valeur de l’entreprise à ce moment-là, mais qui avait été convenu : il s’agissait de l’exécution du pacte. Il était devenu nécessaire de sortir Butler. Le contrat de DSP avec la Corse nous obligeait à remplacer au moins un navire, inadapté en taille et en âge, avec une date limite. Ne pas le faire, c’était nous exposer à perdre la DSP. Butler s’opposait au rachat de ce navire, et il en avait les moyens, aux termes des accords. Par conséquent, Veolia-Connex a décidé de lever l’option d’achat [...] Ce n’est pas la meilleure opération économique qu’ait réalisée Veolia, mais elle y a été poussée par la nécessité » (audition de M. Gérard Couturier)). |
Sur la levée de l’option d’achat des parts de Butler Capital Partners : Audition de M. Walter Butler du 2 octobre 2013 : « Ce n’ai pas moi qui l’ai actionnée. Le rachat s’est fait en gros sur la base de la formule qui était prévue, mais il n’y a pas eu de notification. L’horizon était dégagé, les prévisions favorables. Veolia voulait être maitre à bord, et nous nous sommes mis d’accord ». | |
2009 | |||
Automne 2009 |
M. Francis Lemor : « pour des raisons de trésorerie, revente à la STEF par la SNCM de la totalité de ses parts dans La Méridionale ». Depuis le 1er décembre 2009, le capital de CMN-La Méridionale est détenu à 97,4 % par le groupe STEF et à 2,6 % par ses salariés. |
Produit de la cession : 45 millions € Avant cette opération, le capital de la CMN se partageait à 55 % entre le groupe STEF (au travers de sa filiale STIM d’Orbigny) et à 45 % pour la SNCM au travers d’une filiale qu’elle contrôlait à 100 %, la Compagnie générale de tourisme et d’hôtellerie (CGTM). | |
La commission d’enquête a examiné le présent rapport au cours de sa séance du 11 décembre 2013.
M. le président Arnaud Leroy. Chers collègues, nous allons aujourd'hui nous prononcer sur le rapport et ses annexes. La réunion de ce matin sera suivie d’une conférence de presse au cours de laquelle le président et le rapporteur présenteront le rapport. Je vous rappelle que les contributions des groupes, pour l’instant seule l’UMP en a déposé une, sont intégrées de droit au rapport mais, tout comme l’avant-propos du président de la commission d’enquête, il s’agit de textes tout à fait distincts.
Le délai pour la remise des contributions est fixé à demain, midi.
M. Dominique Tian. Je m’interroge. Sur quels documents devons-nous nous appuyer pour rédiger notre contribution ? La presse est là pour la remise du rapport, les représentants des groupes aussi, mais c’est demain que sera remis le rapport au Président Bartolone. Ce dérèglement du calendrier est tout de même un problème.
Dans sa contribution, le groupe UMP explique le malaise ressenti devant le mélange des genres, indépendamment des qualités de notre collègue Paul Giacobbi. L’actualité sociale est dramatique et la liquidation de la SNCM pourrait intervenir dans les jours qui viennent ; d’où notre gêne de voir la remise du rapport repoussée et des contributions arriver à la dernière minute. Rien de cela n’a été négocié et nous redoutons les conséquences. Nous ne mettons pas en cause M. Giacobbi, mais il a réclamé à Veolia le remboursement de sommes considérables ce qui aggraverait encore le déficit de la société. La situation est tout de même étrange : tout le monde réclame de l’argent à Veolia au moment où elle va décider, ou non, de déposer le bilan, au risque d’influencer le tribunal de commerce.
M. le président Arnaud Leroy. Dans la convocation à cette réunion adressée en date du 25 novembre, la limite de dépôt des contributions était bien fixée au jeudi 12 décembre douze heures.
En tout cas, la remise du rapport ne se fera pas dans l’indifférence générale. La presse nous appelle tous les jours pour obtenir des informations sur le rapport.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Le champ des investigations de la commission d’enquête portait sur les conditions de la privatisation, pas sur les événements actuels.
Ensuite, il y a des lois en France ! Il se trouve qu’un tribunal a condamné la SNCM à rembourser et que cette sentence est exécutoire. Dans ces conditions, le responsable de la collectivité concernée est obligé de recouvrer les sommes en cause, ce que je n’ai pas fait. Je suis dans une situation impossible, je vous laisse juges : si je recouvre comme la loi m’y oblige, je serais accusé de précipiter la faillite de la SNCM, mais si je ne recouvre pas, l’Union européenne va condamner la France – la procédure de manquement est ouverte – et ce sera à la collectivité de payer la pénalité. Voilà pourquoi, après avoir consulté des avocats, j’ai écrit de manière confidentielle à Veolia pour lui rappeler le risque d’extension de passif.
Accessoirement, ce n’est pas moi qui ai publié la lettre ! Je l’avais remise à l’État qui l’a transmise à Veolia qui, de façon fort inconvenante, l’a publiée. Par ailleurs, ma lettre ne changera rien à la décision du tribunal de prononcer l’extension de passif, tant est flagrante l’implication de Veolia dans la gestion : elle apporte à la SNCM 100 millions en compte courant depuis des années. Je n’ai jamais parlé à la presse, à l’exception d’un communiqué rappelant mes obligations légales découlant du code général des collectivités territoriales.
Pour le reste, le rapport témoigne d’un souci d’objectivité incontestable.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur Tian, je prends acte de votre contribution, mais sachez que la nomination du président et du rapporteur de notre commission a été validée en conférence des présidents où siège Christian Jacob.
M. Dominique Tian. L’UMP n’a jamais souhaité attiser la polémique et elle s’est tenue à cette ligne de conduite.
M. Yves Albarello. Camille de Rocca Serra, qui m’a demandé de le représenter, souhaiterait que soit précisé, à la page 48 du rapport qui nous a été soumis, que l’expression « Pieds Nickelés » qu’il a utilisée était seulement destinée à atténuer la gravité de l’acte que représentait la prise du Pascal Paoli. Assimilée à un acte de piraterie, elle aurait fait encourir à ses auteurs une peine de vingt ans d’emprisonnement, et risqué de détériorer encore une situation dramatique créée par une privatisation mal préparée et mal gérée.
M. le président Arnaud Leroy. Il me semble que la lecture du rapport explicite bien les intentions de M. de Rocca Serra.
M. Yves Albarello. Autre point plus important, Camille de Rocca Serra avait été invité à débattre avec le repreneur financier, M. Walter Butler au cours d’une émission de LCI. M. de Rocca Serra avait auparavant appelé le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Pierre Mongin, pour l’informer qu’il n’accepterait pas la privatisation totale. À aucun moment, les élus de la Corse n’y ont été favorables. Notre collègue Camille de Rocca Serra avait exigé que l’État reste dans le capital et que les salariés y entrent. Et, quelques jours plus tard, sous l’autorité de M. Frémont, le préfet de région, il avait logiquement, avec Ange Santini et Tony Sindali, proposé au Gouvernement une ouverture du capital pour que M. Walter Butler ne soit pas le seul actionnaire ; l’association de l’État et des salariés permettant de conserver une minorité de blocage à 33 %.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Ce point pourrait être effectivement précisé dans le rapport.
M. Yves Albarello. Et nous voudrions compléter notre contribution en ajoutant à la fin « et avaient souhaité que l’État reste actionnaire ».
M. le président Arnaud Leroy. Vous avez, pour le faire, jusqu’à demain midi.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Monsieur le président, dans l’avant-dernier paragraphe de la page 3 de votre avant-propos, vous ne parlez que de l’avance consentie par la Collectivité territoriale de Corse. Je propose de modifier ainsi la dernière phrase : « Sa privatisation, en 2006, n’a rien changé à cette situation désespérante. L’opération s’est soldée par un échec. La SNCM continue à vivre au jour le jour sans d’autres perspectives que l’urgence, en sollicitant, par exemple, des concours en compte courant de ses actionnaires principaux voire une avance sur les subventions que lui accorde la Collectivité territoriale de Corse… » Nous avons effectivement donné 10 millions là où les actionnaires principaux ont avancé près de 90 millions.
M. le président Arnaud Leroy. Remarque pertinente, mais mon avant-propos a été rédigé en fonction du périmètre de la commission d’enquête, et pas des derniers développements de l’affaire. Cela étant, je suis tout à fait prêt à accepter des modifications pour éviter de jeter de l’huile sur le feu.
M. Dominique Tian. Je trouve que le terme « pénalisé » utilisé à propos de l’État à la première ligne du dernier paragraphe de la page 102 du pré-rapport est exagéré.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Le mot est malheureux. Je rappelle le contexte. La Commission européenne a déclaré le service complémentaire illégal et, pour cette raison, enjoint la France à se faire rembourser les 220 millions d’euros. Constatant, au bout de plusieurs mois, que la République française, en l’occurrence la Collectivité territoriale, n’avait pas engagé la procédure de recouvrement, l’Union a ouvert une procédure pour manquement et l’État encourt de ce fait des pénalités.
M. Dominique Tian. J’avais pensé à « - L’État à qui peut être reproché de n’avoir pas procédé au recouvrement…
M. Paul Giacobbi, rapporteur. C’est plus simple, en effet, mais il faut sans doute compléter et améliorer ce paragraphe.
M. Avi Assouly. Les médias font état, depuis hier, de deux repreneurs possibles, à condition que Veolia se retire…
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Elle ne se fera pas prier. N’a-t-elle pas proposé la SNCM à la collectivité territoriale de Corse pour un euro ? Nous avons refusé, conscients du risque que représentait la garantie de passif. Une fois cette menace éliminée, la société a tout de même une certaine valeur, un fonds de commerce avec la DSP…
M. François Pupponi. Quel est le chiffre exact et comment s’explique-t-il ?
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Ce chiffre cumule des sommes identiques encourues dans le cadre de deux procédures distinctes. Dans un premier temps, la Commission européenne, en tant que juridiction de première instance de la concurrence, a déclaré le service complémentaire illégal et requalifié les dotations versées à ce titre en aide d’État, soit 220 millions. La somme n’a pas été mise en recouvrement, malgré le refus de sursis à exécution du tribunal. Par ailleurs, le tribunal de l’Union européenne a contredit la Commission à propos de la privatisation, qu’il a considérée comme illégale. En conséquence, la Commission a elle-même procédé à une évaluation des aides d’État consenties dans ce cadre. Il se trouve qu’elle est arrivée au même montant, 220 millions.
Les deux procédures font l’objet de recours. La première décision est exécutoire depuis le 2 mai et, d’après mes souvenirs, la partie française avait quatre mois pour se retourner. Elle n’a rien fait donc la procédure de manquement a été ouverte en septembre ou octobre.
M. Dominique Tian. Dans le contexte actuel – risque pour la Collectivité territoriale de Corse d’être mise en cause pour soutien abusif, contentieux en suspens avec l’Union européenne,… –, est-ce vraiment le moment de nous flageller ? C’est la gestion qui a été calamiteuse, pas la privatisation en elle-même. Tout le monde est impliqué, jusqu’à Veolia pour sa gestion. On s’éloigne du vrai sujet et je crains que nous nous tirions une balle dans le pied !
M. le président Arnaud Leroy. Le rapport est plutôt équilibré. Il met les choses en perspective sachant que la frontière entre les conditions de la privatisation et ses conséquences est très ténue. L’Europe a pesé sur les conditions de la privatisation, et de là découle une situation : celle d’une entreprise placée sous une épée de Damoclès lestée de plusieurs centaines de millions d’euros.
Nous avons évité la polémique mais une commission d’enquête doit identifier des faiblesses pour éviter à l’avenir les mêmes erreurs.
M. Gaby Charroux. Je trouve, au contraire, la conclusion trop « molle ». J’avais fondé beaucoup d’espoirs dans l’avant-propos du président, où il est écrit que la privatisation « s’est soldée par un échec » et que la gestion du dossier « doit être conduite par les pouvoirs publics », mais ces deux points ne se retrouvent pas clairement dans la conclusion.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Le président et moi avons fait extrêmement attention à limiter l’étendue de nos investigations, en particulier dans le choix des personnes auditionnées. Mais il est tout de même difficile de n’en tirer aucune conséquence. Les conditions de la privatisation ont été jugées illégales par un tribunal. Nous relevons une insécurité juridique constante : toutes les juridictions successives se désavouent les unes les autres. On ne peut ne pas se préoccuper de ce qui s’est passé ensuite.
Au bout du compte, la privatisation a coûté à l’État 205 millions, et il a été privé de 125 millions d’euros de plus-values faites par d’autres. Bref, on arrive à 400-450 millions.
Vous trouvez la conclusion tiède, mais elle reflète les débats. J’écris tout de même que « …le seul bénéficiaire financier de cette affaire est la société Butler Capital Partners qui en a retiré une plus-value de 60 millions d’euros. Cette situation choquante aurait pu sans aucun doute être évitée, mais elle résulte d’un enchaînement complexe de procédures inappropriées ou mal engagées, d’erreurs d’appréciation, sans qu’aucun élément recueilli au cours de l’enquête ne permette de fonder une action en justice, sans même qu’aucun doute sérieux ne puisse être soulevé en l’état, quant à une quelconque connivence qui aurait permis par avance d’obtenir pour l’intéressé ce profit considérable. Le fait que cette plus-value, y compris dans l’évaluation approximative de son montant, était pratiquement inéluctable, dès que l’accord a été scellé entre l’État, BCP et Veolia, n’entraîne en aucune façon qu’au sein de l’État, à quelque niveau que ce soit, un ou plusieurs intervenants auraient agi pour permettre à BCP de bénéficier de cette plus-value. » C’est ce qui ressort des débats, même si ce n’était pas ce que je pensais au départ. Je me suis seulement abstrait de toute idée préconçue.
Je poursuis : « Il serait vain et injuste de chercher à incriminer dans la sphère publique comme dans la sphère privée tel ou tel : le simple fait que de manière récurrente les mêmes erreurs aient été commises, entraînant des conséquences de plus en plus lourdes démontre suffisamment que l’absence de lucidité ou de courage, la dilution des responsabilités, le recours à des expédients et la faible résistance à la pression des événements sont des défauts partagés par tous les intervenants sur l’ensemble de la période. » On ne peut pas montrer du doigt qui que ce soit. Qui plus est, on n’a pas fait mieux depuis. Malheureusement.
En tant que commission d’enquête, avons-nous trouvé des faits qui fondent une incrimination ? Non. Avons-nous trouvé des erreurs à ne pas reproduire ? Certainement, mais rien qui permette de désigner les bons et les méchants.
M. François Pupponi. Effectivement, certains contentieux trouvent leur origine dans la privatisation, et les recours ultérieurs démontrent qu’elle a été mal faite. Cela ne veut pas dire qu’il y a matière à poursuites pénales. La conclusion peut sembler édulcorée, mais il faut penser à l’avenir. Des erreurs collectives ont été faites, par faiblesse et manque de courage, parce qu’on n’a pas voulu affronter tous les problèmes notamment sociaux. Le rapport doit être suffisamment net pour que les responsables d’aujourd’hui ne tombent pas dans les mêmes errements dans les mois qui viennent. Cette gabegie financière est proprement surréaliste. Comment perdre autant d’argent public et aboutir à un tel échec économique et industriel ?
M. Avi Assouly. Je suis d’accord avec François Pupponi. Toutefois, après avoir entendu le syndicaliste, je pense qu’il s’agissait de M. Mosconi, déclarer que Butler lui aurait proposé certains arrangements, nous aurions pu reconvoquer Walter Butler, pour mettre les points sur les i.
M. Gaby Charroux. Il aurait fallu écrire clairement que l’opération de privatisation s’était soldée par un échec, et réclamer que l’État soit désormais en première ligne. Inutile de polémiquer sur le passé.
M. Gilles Savary. Il me semble que les difficultés à venir avec l’Union européenne ne sont pas indépendantes du montage qui a été retenu et de l’exploitation passée de l’entreprise. Ce serait très malheureux de le taire surtout que nous avons un devoir d’information envers la population et les partenaires sociaux, ne serait-ce que pour qu’ils prennent conscience de la difficulté qu’il y aura à remonter la SNCM.
S’agissant du rapport, je trouve qu’il ressemble à un parapluie : le public entendra que la situation est vraiment calamiteuse, mais est-ce vraiment la faute à personne ? Il ne faut pas en rajouter dans la pondération. Il faut dire que la gestion a bien été calamiteuse, sans forcément mettre en cause nommément tel ou tel. Attention aux commentaires de la presse et de l’opinion publique. Mieux vaut ne pas faire de commission d’enquête si c’est pour trouver des choses monstrueuses et dire qu’elles ne le sont pas, pour conclure que l’État est incapable mais qu’il n’est pas responsable.
M. Yves Albarello. Sans l’incitation financière que constituait la DSP, qui aurait repris l’entreprise ? Elle aurait coulé et la continuité territoriale n’aurait plus été assurée. Il est là, le sujet. Aujourd'hui, Bruxelles nous condamne pour cette subvention, mais, sans elle, personne n’aurait répondu à l’appel d’offres. Quelle est la solution pour demain ? La disparition pure et simple de la SNCM et le licenciement de tout le personnel avant de repartir à zéro ?
M. François-Michel Lambert. La remarque de Gilles Savary est très pertinente. Nous allons devoir faire face à l’opinion publique, dont chacun ici sait qu’elle a une perception de plus en plus négative des politiques. Nous allons alimenter le populisme. Par son attitude, notre commission pourrait contribuer à redorer le blason des parlementaires en étant une force de proposition pour que cette débâcle ne se reproduise pas. Or c’est n’est pas exactement le sens de la conclusion. Je crains que les médias ne nous considèrent comme incapables de faire des propositions. Il ne manque plus qu’une phrase à la conclusion : la suite au prochain numéro,...
M. le président Arnaud Leroy. Je suis très attaché à la mission de contrôle du Parlement. Or plusieurs d’entre nous avaient détecté une anomalie, voire une faute dans la procédure choisie. Et l’issue de l’appel d’offres plaide en faveur de leur analyse : deux candidats seulement, deux fonds financiers d’investissement, alors qu’on cherchait un opérateur industriel ! Je vous propose de trouver un moyen, cellule de veille ou comité d’évaluation, pour que l’Assemblée nationale soit informée au long d’une procédure de privatisation, pour pouvoir apporter la contradiction. L’Agence des participations de l’État fonctionne comme une boîte noire, d’où sortirait la solution, sans que personne n’ait rien à dire.
Je ne suis pas d’accord avec la phrase de conclusion selon laquelle : « Il serait vain et injuste de chercher à incriminer dans la sphère publique comme dans la sphère publique tel ou tel », car la phrase déresponsabilise complètement les acteurs. Surtout, elle ne traduit pas nos impressions au cours des auditions.
Enfin, il faut insister sur le fait que l’État est resté actionnaire à hauteur de 25 %. Or il a été un très mauvais actionnaire ; on n’a jamais entendu le son de la voix des trois administrateurs. Au moins dans la conclusion.
M. Dominique Lefebvre. La conclusion mentionne le coût minimum pour l’État – plus de 400 millions – et l’absence d’indice laissant à penser que des poursuites pénales pourraient être engagées pour concussion ou prise illégale d’intérêt. Dès lors, nous sommes tenus à la présomption d’innocence. Peut-être faudrait-il maintenir le constat mais éviter effectivement la phrase « Il serait vain et injuste… » qui est malheureuse. Ensuite, il en découle une chaîne de responsabilités : l’État dans sa composante administrative et politique, la collectivité, les syndicats, les élus locaux sans qu’il soit possible de faire de classement. Une partie des réponses se trouve dans l’avant-propos. Peut-être pourrait-on les reprendre différemment. On ne peut pas déclarer que c’est la faute à pas de chance, même si la situation est compliquée. Il faut au moins faire des propositions pour éviter que les mêmes erreurs se reproduisent.
M. Yves Albarello. Comment expliquer que Corsica Ferries soit profitable, que la CMN soit également profitable, mais que la SNCM soit déficitaire depuis des années ? En 2005, il y avait le feu à Marseille et en Corse – un bateau avait été détourné – et il fallait à tout prix trouver une solution. Maintenant que vous êtes aux affaires, qu’allez-vous faire de la SNCM ?
M. le président Arnaud Leroy. La réponse à votre première question est dans le rapport : des charges salariales trop élevées, des plans qui ne sont jamais mis en œuvre. Vous avez été aux responsabilités, vous aussi, il y a un problème de gouvernance dans cette compagnie. L’État a été un actionnaire complètement défaillant, un losing partner ! Gilles Savary et moi qui nous occupons des transports savons pertinemment que nous aurons, dans les semaines qui viennent, à gérer l’avenir des compagnies de ferries en France. Le secteur est fragilisé.
Enfin, je rappelle qu’en vertu de l’article 145-8 de notre Règlement, le président d’une commission d’enquête, son rapporteur ou un groupe a un droit de suite, au terme d’un délai de six mois.
M. Gilles Savary. Je regrette que la conclusion n’explique pas assez clairement que les « solutions » au problème de la SNCM ont toujours été improvisées dans la panique, les considérations politiques et sociales l’ayant emporté sur la rationalité économique. C’est le grand non-dit de cette affaire. Il faut le mettre en exergue car il ne faut pas recommencer une énième fois. Ce constat exonère des responsabilités strictement individuelles.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Monsieur Albarello, le rapport ne se réduit pas à l’avant-propos et à la conclusion. À propos de la comparaison avec Corsica Ferries et la CMN, il y est écrit : « Par la suite, Corsica Ferries recevra 14 millions « d’aide sociale » par an, c'est-à-dire une compensation forfaitaire par passager sans aucune obligation autre que la pratique des réductions tarifaires pour certaines catégories de passagers, ce qui est le propre de tous les transporteurs du monde, et de faire une rotation par semaine… Personne ne dira pourtant que cette compagnie reçoit une subvention de 14 millions par an, l’équivalent de la perte récurrente moyenne de la SNCM – en compensation de ses pertes éventuelles. » La perte de Corsica Ferries hors cette subvention sans contrepartie est de 14 millions d’euros, la même que celle de la SNCM, soit dit en passant.
J’écris ensuite : « En revanche, la comparaison avec la CMN est significative […]. Or, la CMN réalise, selon M. Lemor, une marge moyenne de 3 % et la SNCM un déficit d’exploitation récurrent de l’ordre de 5 %. ». Tout est dit…
Idem dans la conclusion. Je vous cite la phrase qui semble m’être reprochée : « …le simple fait que de manière récurrente les mêmes erreurs aient été commises entraînant des conséquences de plus en plus lourdes démontre suffisamment que l’absence de lucidité ou de courage, la dilution des responsabilités, le recours à des expédients et la faible résistance à la pression des événements sont des défauts partagés par tous les intervenants sur l’ensemble de la période ». On ne peut pas dire les choses autrement.
Enfin, on ne peut pas me demander à la fois de me limiter au champ d’investigation de la commission d’enquête et de parler de ses conséquences et de l’avenir. Il faut s’en tenir à ce qui est dit même si l’on peut modifier ici ou là. Honnêtement, j’aurais été heureux de pouvoir incriminer et conclure sur la lourde responsabilité des uns ou des autres. Mais ce n’est pas ce que les auditions nous ont appris. Nous en avons été surpris, et même marris… J’aurais pu m’acharner sans trop de difficulté sur tel ou tel point. Nous aurions pu insister sur les conditions de location du Jean Nicoli I par Veolia, et qui ressemblent fort à de l’abus de biens sociaux. L’enjeu se compte tout de même en millions d’euros, mais le président du tribunal de commerce va prononcer une extension de passif de 200 millions d’euros, au moins. Cela suffira, non ? Le rapport retranscrit la qualité des débats de notre commission d’enquête. Si vous voulez pointer du doigt les uns et les autres, vous allez avoir du travail : les syndicats, le Gouvernement de l’époque, la mauvaise gestion. Il en est fait état dans le corps du rapport.
M. Dominique Tian. Le rapport ne met pas assez en cause la gestion de Veolia. Si ce groupe avait fait les efforts nécessaires, la société n’en serait pas là.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. C’est dans le corps du rapport.
M. Dominique Tian. Mais pas dans les conclusions. Veolia s’en tire bien à côté de l’Office des transports de Corse, de l’État. Veolia est peut-être venue à reculons, mais elle a fini par y aller. Alors, il faut en tirer les conclusions. L’UMP trouve que le rapport évoque insuffisamment les conséquences de la gestion de Veolia qui n’a pas procédé aux restructurations nécessaires. Après tout, Corsica Ferries et La Méridionale ne se portent pas si mal. Si vous flagellez les uns et les autres, n’oubliez pas Veolia qui n’a pas fait son travail.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Vous trouverez dans le rapport des mots extrêmement durs : « une gestion déroutante des effectifs et des charges de personnel », « L’inaction déroutante de Veolia dans la gestion d’une société pourtant en difficulté a été constatée par tous ». Comment dire plus ? Je suis peu suspect de défendre Veolia.
M. Dominique Lefebvre. On pourrait le rappeler dans la conclusion.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. On peut dire que la compagnie n’a pas été gérée pendant des années, je suis d’accord.
M. Dominique Tian. Entièrement d’accord. La restructuration n’a pas été faite. Il ne faut pas exonérer Veolia de ses responsabilités, d’autant que l’État n’était plus dans le coup, tout le monde le sait. Le drame aujourd'hui, c’est que Veolia n’a pas fait son travail. Dans les jours à venir, elle va se retirer en nous laissant une situation dramatique.
Le groupe UMP est en train de finir d’écrire ses conclusions et on ne peut pas déposer le rapport avant qu’il soit fini. Nous demandons donc une semaine de délai, car ce rapport en lui-même n’a rien d’urgent. En l’état, le vote me semble prématuré mais nous voterons contre la publication.
M. François Pupponi. Globalement, l’État est responsable de la situation de la SNCM. Quand il n’a plus pu assumer, il a « refilé la patate chaude » à Butler, puis à Veolia. Que, maintenant, elle se brûle les doigts, c’est une autre affaire. Le problème vient de loin, de la façon dont l’État a géré le problème pendant des années. Il ne faut pas exonérer trop vite les uns et les autres de leurs responsabilités.
Pour autant, il faut aller vite car la publication du rapport va intervenir à un moment crucial. Une grève est déjà annoncée pour le 1er janvier. Le rapport est équilibré : tout y est sans tomber dans la polémique.
M. le président Arnaud Leroy. Nous avons atteint la date limite et nous ne pouvons plus reculer.
M. Gaby Charroux. J’aurais aimé que soient pris en compte les deux points dont j’ai parlé. Sous réserve de cette modification, le groupe GDR votera le rapport.
M. Dominique Lefebvre. Sous réserve de certaines modifications dans la conclusion, ce rapport sera une contribution utile au débat qui va se poursuivre. La commission d’enquête portait sur les conditions de la privatisation, pas sur la situation présente, même celle-ci découle de celle-là. Les critiques sur la conclusion témoignent que les désaccords apparaissent au moment de hiérarchiser les responsabilités. L’équilibre me semble satisfaisant et le groupe socialiste votera pour.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Le groupe RRDP approuvera le rapport.
Si M. Tian le souhaite, je propose de compléter le paragraphe antépénultième de la page 102 du document qui vous est transmis consacré à Veolia. « La commission a constaté la mauvaise gestion de la SNCM par Veolia, son absence de vision, sa réticence à prendre des mesures propres au retour à l’équilibre. »
M. Dominique Tian. Parfait.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Je ne l’avais pas écrit de crainte d’être accusé de régler mes comptes avec Veolia qui a rendu ma lettre publique.
M. Dominique Tian. Je préfère que ce soit Veolia qui paie plutôt que l’État.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Je ne peux pas me faire à l’idée de devoir payer 100 millions de pénalités parce qu’on ne s’est pas fait rembourser.
La Commission a adopté le rapport présenté par M. Paul Giacobbi, le groupe UMP votant contre, ainsi que le principe de publication en annexe des auditions.
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Opérations et résultats |
|||||||||||
Chiffre d’affaires hors taxes. |
205 770 |
217 234 |
193 529 |
183 274 |
203 810 |
222 172 |
219 230 |
196 735 |
189 391 |
180 921 |
191 465 |
Résultat d’exploitation. |
– 6 393 |
– 12 474 |
– 39 467 |
– 33 498 |
– 33 258 |
– 31 598 |
– 2 848 |
– 8 022 |
– 16 438 |
– 21 816 |
– 27 296 |
Résultat après impôt & charges calculées. |
4 202 |
15 926 |
– 29 662 |
– 28 820 |
– 22 103 |
– 27 848 |
182 |
17 711 |
– 1 867 |
– 12 360 |
– 14 252 |
Montant des résultats distribués (précompte inclus). |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Personnel |
|||||||||||
Effectif moyen employé pendant l’exercice (1). |
2 639 |
2 662 |
2 579 |
2 316 |
2 258 |
2 345 |
2 204 |
2 007 |
2 016 |
1 996 |
2 068 |
Montant de la masse salariale de l’exercice (en milliers d’euros) (2). |
83 537 |
89 722 |
87 682 |
78 858 |
84 565 |
92 721 |
121 370 |
86 645 |
81 609 |
||
Montant des sommes versées au titre d’avantages sociaux en milliers € (sécurité sociale, œuvres sociales…). |
19 055 |
20 046 |
20 824 |
25 703 |
22 237 |
19 375 |
27 946 |
19 176 |
16 871 |
(1) Y compris le personnel détaché dans d’autres sociétés.
(2) Lignes FY du feuillet 2052-N de la déclaration fiscale.
Sources :
- 2002-2010 : Comptes sociaux annuels de la SNCM ;
- 2011 et 2012 : Comptes de résultat de la SNCM disponibles sur le site "Societe.com".
TRAFIC PASSAGERS PAR COMPAGNIE MARITIME
SNCM |
Corsica Ferries (C.F.)
|
12 liaisons assurées en 2012 : Ajaccio/Marseille ; Ajaccio/Nice ; Ajaccio/Porto Torres ; Ajaccio/Toulon ; Bastia/Marseille ; Bastia/Nice ; Bastia/Toulon ; L’Ile Rousse/Marseille ; L’Ile Rousse/Nice ; Porto-Vecchio/Marseille ; Propiano/Marseille ; Propiano/Porto Torres. |
11 liaisons assurées en 2012 : Ajaccio/Nice ; Ajaccio/Toulon ; Bastia/Livourne ; Bastia/Nice ; Bastia/Savone ; Bastia/Toulon ; Calvi/Nice ; Calvi/Savone ; Calvi/Toulon ; L’Ile Rousse/Nice ; L’Ile Rousse/Toulon. |
La Méridionale
|
|
6 liaisons assurées en 2012 : Ajaccio/Marseille ; Ajaccio/Porto Torres ; Bastia/Marseille ; Porto-Vecchio/Marseille ; Propiano/Marseille ; Propiano/Porto Torres. |
Pax. : Passagers. PDM : Part de marché. |
Source : Observatoire Régional des Transports de la Corse
Compagnies |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2013 |
SNCM |
958 625 |
882 287 |
885 814 |
920 462 |
849 923 |
961 031 |
1 097 344 |
971 185 |
1 165 422 |
C.F. |
2 115 580 |
2 349 385 |
2 482 271 |
2 672 528 |
2 778 320 |
2 691 024 |
2 621 346 |
2 416 754 |
2 900 105 |
CMN |
209 277 |
226 992 |
219 170 |
213 375 |
199 305 |
244 251 |
266 870 |
241 391 |
289 669 |
CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES
MEMBRES DU GROUPE UMP
1- Dès la 2e audition à huis clos de la commission, Dominique TIAN a tenu à soulever une incompatibilité dans la fonction du Rapporteur de la mission.
M. Paul GIACOBBI a en effet été nommé Rapporteur de la commission d’enquête sur les conditions de privatisation de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM).
M. Paul GIACOBBI est aussi Président de la Collectivité territoriale de Corse.
Dans un article paru dans La Provence, le 27 septembre 2012, il était indiqué que M. GIACCOBI venait d’entamer un « bras de fer » avec l’actionnaire Veolia Environnement. Dans un courrier adressé au Président M. Antoine FREROT, il faisait état de l’intention de la collectivité « de recouvrer auprès de la SNCM une somme d’un peu plus de 200 millions correspondant à la part de la contribution versée au titre du service complémentaire ».
Cette déclaration paraît étonnante au moment où la SNCM semble fragilisée par une décision de la Commission européenne lui ordonnant de rembourser des prestations effectuées l’été avec des car ferries jugées comme « des aides illégales ».
Même si la compagnie et l’État ont contesté cette décision dans ses motivations, même si l’État a introduit un recours en annulation, la demande de sursis à exécution de la décision a été rejetée.
Dominique TIAN craint donc que l’initiative de M. GIACOBBI en tant que Président de la Collectivité territoriale de Corse n’affaiblisse la position de la France dans ses négociations avec la Commission européenne.
2- L’ensemble des interlocuteurs auditionnés par la commission d’enquête (tout particulièrement Dominique de VILLEPIN en tant que Premier ministre et François GOULARD en tant que Secrétaire d’État aux transports) ont indiqué que le précédent gouvernement avait cherché des solutions pour éviter une mise en liquidation possible de la SNCM. La continuation d’activités de la SNCM leur paraissait une priorité absolue.
3- Une réunion a eu lieu à la Préfecture des Bouches du Rhône regroupant les élus marseillais et de Corse concernés par ce dossier. L’ensemble des élus présents s’étaient alors mobilisés pour sauver la SNCM dans un climat social alors très lourd. Les élus UMP, eux-mêmes, souhaitaient que l’État reste actionnaire de la SNCM.
4- Les élus UMP regrettent que Veolia n’ait pas pris pas les mesures de restructuration nécessaires pour assurer une bonne gestion de la SNCM.
CONTRIBUTION DE M. GABY CHARROUX
AU NOM DU GROUPE GDR
En prenant connaissance du projet de rapport émis par la commission d’enquête, j’ai le sentiment d’une distorsion entre des éléments essentiels contenus dans l’avant-propos du Président Arnaud Leroy et ce qui figure dans la conclusion.
En effet, page 5, il apparaît, je cite « Force est de constater qu’au long des décennies ayant précédé sa privatisation, l’État n’a jamais su, ou plus exactement voulu, définir et conduire un véritable projet industriel concernant la SNCM. »
Deux paragraphes plus bas, il est précisé « Sa privatisation, en 2006, n’a rien changé à cette situation désespérante. L’opération s’est soldée par un échec. La SNCM continue de vivre au jour le jour sans d’autres perspectives que l’urgence, en sollicitant, par exemple, des avances sur les subventions que lui accorde la Collectivité Territoriale de Corse au titre de la DSP. ».
Nous trouvons ensuite, en page 6 au dernier paragraphe : « la gestion du dossier de la S.N.C.M. qu’il reste encore aujourd’hui à traiter doit être conduite par les pouvoirs publics en retenant notamment les leçons à tirer des observations de notre commission. »
Au regard de ces éléments, la conclusion du rapport en lui-même paraît très « tiède ».
Sans aucune intention de polémiquer sur les responsabilités des différentes parties prenantes du dossier de privatisation, nous voulons souligner bien plus fortement que :
1/ Cette privatisation est un échec grave et que ce n’est pas seulement la question de l’incompétence de gestion qui est en cause mais la nature même d’une telle procédure.
2/ Que la gestion du dossier doit désormais et pour l’avenir être assuré par l’État, qui demeure un actionnaire majeur et doit être garant de la mise en œuvre du projet industriel, du maintien de l’emploi et de la continuité territoriale.
La prise en compte des remarques émises ci-dessus dans la conclusion conditionne l’avis favorable du groupe G.D.R. sur ce rapport.
Par ailleurs, il convient de souligner fortement que la question de l’ouverture du cabotage maritime aux pays membres de l’Union européenne permettant à Corsica ferries de passer en 1999 sous pavillon italien de deuxième rang a créé et crée toujours, comme le confirme les propos des syndicats et de Monsieur Walter Butler, (pages 24 et suivantes du rapport) une concurrence déloyale sur ce marché qui a fortement pénalisé l’activité de la SNCM.
a. Audition, à huis clos, de M. Claude Gressier, ancien directeur du transport maritime, des ports et du littoral au ministère chargé de l’équipement et des transports
(Séance du mercredi 10 juillet 2013)
M. le président Arnaud Leroy. C’est par vous, Monsieur Gressier, que la Commission d’enquête commence ses auditions. Polytechnicien, ingénieur général des Ponts et chaussées honoraire, vous avez effectué une longue carrière dans le domaine des transports. Vous avez été, entre autres, directeur des transports terrestres, puis directeur du transport maritime, des ports et du littoral au ministère chargé des transports. Vous avez été également directeur général adjoint de la SNCF, et président-directeur général du groupe SCETA, puis du groupe Geodis.
En février 2005, vous avez été désigné par M. François Goulard, secrétaire d’État aux transports, comme expert chargé de prendre contact avec toutes les entreprises privées susceptibles d’apporter des fonds propres à la SNCM. C’est à ce titre que vous entend la commission d’enquête.
Celle-ci s’intéresse à la manière dont vous avez conduit votre mandat. En quoi consistait-il ? Avez-vous été associé à sa rédaction ? Le spectre des propositions que vous pouviez faire à vos prospects était-il ouvert ou le Gouvernement privilégiait-il un type de solution ? Étiez-vous autorisé à proposer des garanties aux investisseurs éventuels, notamment pour le maintien de la délégation de service public (DSP) ? Deviez-vous proposer un cahier des charges aux repreneurs éventuels ? Le Gouvernement avait-il fixé un prix minimum indicatif ? Des offres ont-elles été écartées et, le cas échéant, pour quels motifs ? A-t-on privilégié des partenaires industriels ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Claude Gressier prête serment.
M. Claude Gressier, ancien directeur du transport maritime, des ports et du littoral au ministère chargé de l’équipement et des transports. Entre février 1998 et septembre 2001, j’ai été directeur du transport maritime, des ports et du littoral, fonction qui m’a amené à mieux connaître la SNCM. Créée en 1976, celle-ci a été dotée par l’État d’une convention de délégation de service public pour la période 1976-2001, soit vingt-cinq ans. Après 1991, les fonds ont été transférés à l’Office des transports de la Corse (OTC). Si la dotation initiale était substantielle, la SNCM a connu une situation financière plus difficile lorsque l’OTC lui a demandé d’être plus productive, parce qu’il entendait augmenter la desserte aérienne.
La SNCM était soumise à deux contraintes. Elle devait disposer d’un cash flow suffisant pour renouveler sa flotte. Elle exerçait une activité saisonnière, qui rendait sa trésorerie très positive fin août et très négative entre décembre et février. Si cette situation n’était pas un problème en soi, elle lui imposait de recourir aux banques et, partant, de leur inspirer confiance.
Si, jusqu’en 2000, le trafic était satisfaisant, la SNCM a vu ses parts de marché décroître dès 2001, avec le développement de Corsica Ferries. À partir de 1996, cette société avait mis en place une liaison entre Nice et la Corse avec un bateau sous pavillon français. En 1999, quand le cabotage s’est ouvert aux pays appartenant à l’Union européenne, elle a proposé des allers et retours entre la France continentale et la Corse sous pavillon italien, ce qui revenait moins cher. En 2001, compte tenu notamment de provisions pour restructuration, la SNCM a enregistré une perte de 40 millions d’euros. L’OTC allait procéder au premier appel d’offres. À cette époque, j’ai eu de nombreux échanges avec le président de l’OTC, François Piazza-Alessandrini, ainsi qu’à Bruxelles, pour examiner les contours de la future délégation de service public. L’Office souhaitait limiter celle-ci à Marseille et mettre en place pour Nice et Toulon une aide sociale maritime au passager transporté.
Préparer l’appel d’offres supposait d’établir un plan de redressement de l’entreprise, ce que j’ai fait avec le président de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), M. Pierre Vieu. Avec l’accord de la Commission européenne, une aide de 22 millions d’euros a été versée en 2002, suivie d’une recapitalisation. Sur une somme de 76 millions validée par la Commission, une première tranche de 66 millions – incluant les 22 millions – a été versée en 2003. Parallèlement, un accord est intervenu entre le président et la CGT, en vue d’améliorer les conditions d’armement et d’augmenter la productivité.
M. le président Arnaud Leroy. Votre interlocuteur à la Commission était M. Jacques Barrot ?
M. Claude Gressier. M. Jacques Barrot était commissaire européen aux transports. Je traitais avec la direction générale de l’énergie et des transports, et avec le responsable du maritime.
En 2003, le résultat d’exploitation de la SNCM a enregistré un déficit de 12 millions ; en revanche le bilan général affichait un gain de 16 millions, car la société avait vendu des actifs non stratégiques.
En 2004, la SNCM a été confrontée à plusieurs problèmes. Alors même que le trafic vers la Corse était en baisse, Corsica Ferries a développé son offre, ce qui a fait chuter le chiffre d’affaires de la SNCM vers la Corse de 20 % par rapport à 2003. Parallèlement, trois grèves sont intervenues en 2004, deux du Syndicat des travailleurs corses, l’une en février, l’autre en septembre, et une des officiers, en juin. En fin d’année, le résultat net enregistrait un déficit de 29 millions d’euros, la trésorerie étant, quant à elle, déficitaire de la somme considérable de 76 millions d’euros. En novembre 2004, les commissaires aux comptes ont lancé une procédure d’alerte auprès du tribunal de commerce. Le président de l’entreprise a demandé au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire.
Début 2005, le Gouvernement a décidé de chercher un partenaire extérieur afin de redresser la société. Une recapitalisation étant intervenue en 2003, les règles de concurrence communautaires interdisaient de renouveler l’opération à ce moment-là. La perspective d’un nouvel appel d’offres en 2007 imposait de trouver des financements pour développer la compagnie, renouveler sa flotte et augmenter sa productivité. C’est dans ce contexte que le Gouvernement m’a chargé en tant que « personnalité indépendante » non de chercher un investisseur – tâche qui incombait à l’Agence des participations de l’État (APE), aidée par une banque conseil –, mais de contrôler les conditions dans laquelle se déroulerait la recherche d’un opérateur privé. Cette fonction était prévue pour la privatisation des entreprises de premier rang par la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Cela dit, la SNCM était alors une entreprise de deuxième rang, puisque sa maison mère était la CGMF.
M. le président Arnaud Leroy. Vous avez été chargé de superviser la recherche des partenaires, qui a duré un mois. Pour nous éclairer sur votre charge de travail et votre capacité à surveiller l’opération, pouvez-vous nous dire combien de fois êtes-vous intervenu pendant cette période ?
M. Claude Gressier. Des réunions étaient organisées régulièrement avec des représentants de l’APE et de la banque conseil HSBC-CCF. Elles se tenaient dans les locaux de HSBC-CCF, aux Champs-Élysées. Cette banque, choisie après mise en concurrence, avait engagé, au terme d’un appel d’offres, le cabinet d’avocats Gibson, Dunn & Crutcher, représenté par Nicolas Baverez. Les protagonistes du dossier pouvaient aussi se réunir en dehors de ma présence.
La première étape consistait à dresser la liste des investisseurs potentiels français et étrangers. L’APE et la banque en avaient recensé soixante-dix, dont certains étaient des entreprises financières. J’ai d’abord cherché à savoir si la liste était complète. Puis je me suis demandé si la présence de fonds d’investissement, comme Butler Capital Partners, était opportune. M. Jean-Bernard Raoust, grand connaisseur du monde maritime et président du grand courtier maritime français Barry Rogliano Salles, que j’ai interrogé à ce sujet, m’a répondu qu’il valait mieux laisser les fonds dans cette liste, car il n’était pas sûr qu’un opérateur industriel souhaite apporter un financement à l’entreprise.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Quelle est alors la situation réelle de la SNCM ? La recapitalisation et la cession d’actifs non stratégiques, biens immobiliers ou filiales, lui permettent de dégager un résultat positif de 16 millions en 2003, mais, l’année suivante, elle enregistre des pertes qui justifient le déclenchement d’une procédure d’alerte. À quel moment l’État décide-t-il d’effectuer une nouvelle recapitalisation, puis de placer sous séquestre, aux fins de mise à disposition de la société, des fonds non consommés initialement destinés à un plan ambitieux de restructuration ?
M. Claude Gressier. Je sais seulement que l’État verse à la SNCM 66 millions d’euros en 2003. En 2004 et en 2005, peut-être lui apporte-t-il des fonds ou la CGMF des éléments de trésorerie.
M. le rapporteur. Comment est financé le plan social ?
M. Claude Gressier. Par l’augmentation de capital.
M. le rapporteur. À ma connaissance, lors de la cession, la SNCM avait fait l’objet d’une recapitalisation égale au montant de ses pertes et la somme apportée par l’État pour financer le plan social n’avait pas été totalement consommée. Lorsque vous cherchez des partenaires, ces décisions, qui modifient considérablement la valeur de la société, ont-elles déjà été prises ?
M. Claude Gressier. Après la recapitalisation de 2003, a eu lieu, début 2006, la cession. Elle s’accompagnait d’une augmentation de capital de 158 millions, d’un complément de plan social de 38,5 millions, d’une aide à la restructuration de 22,4 millions et d’un apport en capital de la CGMF de 8,5 millions. Ces dispositions sont intervenues au moment où un accord était signé entre MM. Pierre Vieu, Stéphane Richard et Walter Butler.
M. Henri Jibrayel. Comment la perte de 29 millions en 2004 et le déficit de trésorerie de 76 millions, ont-t-ils été comblés ?
M. Claude Gressier. Je pense que les banques ont accepté de combler le trou de trésorerie, car je ne me souviens pas qu’une recapitalisation soit intervenue à cette époque.
M. le rapporteur. Soyons précis sur ce point essentiel. On a cherché un partenaire, après quoi on lui a versé la bagatelle de 158 plus 38,5 plus 22,4 plus 8,5, soit 227,4 millions d’euros. Un esprit aussi naïf que le mien a tendance à penser qu’il fallait faire l’inverse : commencer par inscrire les conditions complètes dans l’offre, et ensuite rechercher des partenaires ; il était à craindre que les repreneurs ne se bousculent pas pour acquérir une entreprise qui avait perdu 29 millions en 2004 et dont la trésorerie était négative de 76 millions d’euros.
Or, ce n’est qu’une fois trouvé un repreneur improbable – qui n’avait aucune compétence dans le maritime ni dans les transports –, que l’État a mis ces 227,4 millions d’euros « sur le tapis ». J’ai la faiblesse de penser que si cet apport avait été inclus dans les conditions préalables à la recherche des partenaires, l’offre aurait peut-être suscité plus d’intérêt.
Au moment où l’on conclut avec les partenaires, la société n’a plus un sou de pertes. Elle est « in bonis ». De plus, non seulement la restructuration à laquelle elle doit procéder est financée par l’État à hauteur de 38,5 plus 22,4, soit 60,9 millions, mais cette somme est si élevée qu’elle n’a pas été entièrement consommée. Donc, la SNCM était alors « in bonis », sa seule dépense prévue – la restructuration – était couverte et sa flotte possédait une valeur nette. Ces éléments m’ont permis de dire à l’époque que, compte tenu du prix d’achat, l’acheteur ferait nécessairement, en vendant ses actions, une plus-value de plus de 50 millions. Dans les faits, cette plus-value est même montée à 58, voire 60 millions. Savez-vous pourquoi on a procédé aux choix des investisseurs avant de mettre 227,4 millions d’euros sur la table ? Tout le monde aurait fait l’inverse. Cet appel d’offres ou cette recherche de partenaires n’a de sens que si les conditions d’acquisition ont été présentées à tout le monde de manière égale.
M. Claude Gressier. J’ai été interrompu lorsque je présentais le déroulement de l’appel d’offres. Permettez-moi de poursuivre.
J’ai étudié la liste des partenaires possibles, établie par l’APE, qui comportait plus de soixante-dix noms. Puis nous avons envoyé à chacun une fiche destinée à éveiller l’intérêt de chacun. S’il le souhaitait, la banque lui adressait un accord de confidentialité, qui conditionnait lui-même l’envoi d’un mémorandum d’information sur la société. Celui-ci indiquait les engagements financiers que l’État était prêt à prendre, et demandait à chacun une offre non liante comprenant son évaluation de la société, la part de capital qu’il souhaitait acquérir et son projet industriel et social. La procédure était donc extrêmement ouverte. Je ne sais plus si le document comportait des chiffres, mais il mentionnait l’engagement que l’État était prêt à prendre. Pour être en conformité avec le droit communautaire de la concurrence, les candidats avaient intérêt à acquérir la majorité des parts.
M. le rapporteur. Peut-on retrouver ce document ?
M. Claude Gressier. Au terme de la procédure, j’ai rédigé un rapport auquel était annexé ce mémorandum d’information de soixante-quatre pages, annexes non comprises. Je n’ai pas retrouvé le rapport, mais je l’ai demandé au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ainsi qu’à l’APE, qui ne m’ont pas encore répondu.
M. le président Arnaud Leroy. Sur ces soixante-dix repreneurs potentiels, combien y avait-il de fonds ?
M. Claude Gressier. Pas plus de cinq ou six. On trouvait dans la liste, composée de manière très ouverte, des sociétés du Maghreb, comme la Compagnie marocaine de navigation (Comanav), ainsi que des armateurs français, comme Louis Dreyfus Armateurs, ou étrangers, comme P & O.
Quinze accords de confidentialité ont été signés. Autant de mémorandums ont été adressés. Les réponses non engageantes devaient parvenir à la banque avant le 5 avril 2005. Six groupes ont répondu à cette consultation du premier tour
À partir du 15 avril s’est ouverte une phase d’approfondissement. Les groupes qui avaient répondu ont rencontré les dirigeants de la société et eu accès à une data room électronique. Le 17 mai, nous leur avons demandé de transmettre une offre liante pour le 1er juin. Deux candidats n’ont pas souhaité rencontrer les dirigeants de l’entreprise. La Comanav, qui ne tenait pas à faire une offre seule, a demandé qu’on fasse connaître aux autres candidats son désir de s’associer, ce qui n’a pas retenu leur attention. À la date de remise des offres, le 17 juin 2005, il y avait trois candidats.
M. le rapporteur. Je suppose que leur nom figure dans votre rapport.
M. Claude Gressier. Bien sûr. En outre, ils sont connus par l’APE et par la banque. Pour ma part, je ne sais plus si Louis Dreyfus Armateurs avait fait une offre de premier tour. Francis Lemor, qui avait envisagé une offre commune avec Butler, avait finalement renoncé.
Donc, le 17 juin 2005, nous avions trois candidats : le fonds Caravelle, le fonds Butler et Connex – filiale de Veolia, qui deviendra en novembre Veolia Transport. Leurs offres avaient en commun de porter sur la totalité du capital, une prise de contrôle exclusif étant nécessaire, selon eux, pour assurer le redressement de l’entreprise. Largement indicatives, elles comportaient des incertitudes notamment sur le montant de la recapitalisation souhaitée – les demandes paraissaient déjà très élevées –, le contenu du plan social et celui du plan stratégique.
Il était convenu que les représentants de l’État – l’APE – rencontreraient chacun des candidats au sujet, premièrement, de la recapitalisation demandée à la CGMF, qui devait être solidement étayée, deuxièmement, de l’apport de fonds des investisseurs, troisièmement, du projet industriel et social et, quatrièmement, des garanties et des clauses résolutoires. À l’issue des discussions, les candidats devaient faire de nouvelles offres pour le 28 juillet 2005.
Parallèlement, M. Breton et M. Perben, les ministres, ont publié un communiqué indiquant qu’ils souhaitaient que la concertation avec les organisations syndicales se poursuive dans le cadre de la structure de contact instituée auprès du préfet de la région PACA, M. Christian Frémont, et de son groupe de travail animé par M. Patrice Raulin, directeur général de la mer et des transports.
Les offres reçues, encore conditionnelles, ont été analysées pendant le mois d’août, et fait l’objet de négociations supplémentaires pour clarification. À ce moment-là, Veolia a proposé de se contenter d’une prise de participation minoritaire, quitte à monter à 100 % du capital après l’appel d’offres de 2007. Nous ne nous attendions pas à un tel revirement et nous avons pensé qu’il s’agissait d’un ballon d’essai guidé par le souci d’obtenir un mécanisme de protection en prévision de l’appel d’offres et de la détermination du service de base et du service complémentaire.
M. le rapporteur. La chronologie est très importante. La société Connex, dont le directeur général était M. Stéphane Richard, semble intéressée, dans un premier temps, par une acquisition puis, dans un second temps, par une participation. En fait, elle semble surtout intéressée par un mécanisme qui lui permette de ne monter à titre majoritaire dans le capital qu’après avoir reçu la certitude de remporter l’appel d’offres lancé par l’Office des transports de la Corse. Il s’agissait d’une préfiguration de ce qui se fera plus tard sous forme de clause résolutoire.
M. Claude Gressier. C’est ce qui a été dit, mais cela n’a jamais été écrit. M. Stéphane Richard s’est contenté de ce ballon d’essai, sans poursuivre plus avant. Cela ne signifie pas forcément qu’il n’a pas poursuivi sur le terrain de la clause résolutoire. Mais en tout état de cause, une clause résolutoire ne relevait pas de la même démarche qu’une participation minoritaire, qui était problématique au regard du droit communautaire sachant qu’il fallait impérativement recapitaliser la société.
M. le président Arnaud Leroy. Qu’entendez-vous exactement par « mécanisme de protection » ?
M. Claude Gressier. Les candidats voulaient être assurés, d’une part, d’obtenir la recapitalisation par l’État avec l’aval de Bruxelles, ou, à défaut, une clause résolutoire ouvrant la voie à une renégociation au cas où Bruxelles n’accepterait pas, et d’autre part, de remporter l’appel d’offre de l’Office des transports de la Corse, dont dépendaient la valeur et l’avenir de la société. À titre personnel, la demande de clause résolutoire ne me paraît donc pas choquante.
M. le rapporteur. Effectivement, la desserte de la Corse constituant une grande partie de l’activité de la société, et en conditionnant grandement la valeur, il était logique que les candidats prennent des précautions, même si, en droit, cette clause résolutoire soulève des questions.
M. Dominique Tian. Ne serait-il pas préférable que M. Gressier s’exprime jusqu’au bout, plutôt que d’être interrompu sur des points de détail ?
M. le président Arnaud Leroy. Je vous rappelle que c’est à moi d’organiser les débats, Monsieur Tian.
M. Claude Gressier. Les trois candidats ont donc remis une nouvelle offre et on a fixé au jeudi 15 septembre 2005 à 17 heures la remise des plis définitifs. Le mercredi 14 septembre, je m’en souviens très bien, nous avons reçu une dernière fois, dans les bureaux d’HSBC, chacun des candidats. Et Stéphane Richard nous a dit que le pli nous parviendrait le lendemain en fin de matinée. Or nous n’avons rien reçu, sinon un coup de téléphone pour informer la banque que le conseil d’administration de Veolia avait refusé de faire une offre. Nous avons été pour le moins surpris, mais l’échéance était passée.
Nous avons rendu compte au Gouvernement des deux offres. Celle de Butler était nettement meilleure, en tout cas moins coûteuse.
Dans les jours qui ont suivi, deux réunions se sont tenues à Marseille, sous la présidence du préfet de région, M. Christian Frémont, l’une avec les organisations syndicales, l’autre avec les élus corses et marseillais, chacun réclamant le retour de Veolia. Après, les choses se sont passées à un autre niveau que le mien. In fine, l’État a conservé 25 % du capital – hypothèse qu’il n’avait jamais exclue –, participation qu’il devait porter jusqu’à remise à flot de la compagnie, les personnels conservaient 9 %, et les 66 % restants revenant aux investisseurs, respectivement 38 % pour Butler et 28 % pour Veolia. J’ignore comment on en est arrivé là puisque je n’ai pas participé aux discussions.
M. le rapporteur. Vous souvenez-vous de la différence entre le prix de l’offre présentée par Connex le 28 juillet et les conditions de son retour ?
M. Claude Gressier. D’après mes souvenirs, c’est Butler qui est l’investisseur désigné. Donc, les conditions, qu’il s’agisse des clauses résolutoires ou de la recapitalisation, sont celles de l’offre qu’il a faite. Y a-t-il eu des modifications ? Honnêtement, je ne le pense pas, même s’il faudrait vérifier. Je n’ai alors plus participé aux discussions qui se sont tenues à un autre niveau. En tout cas, le Premier ministre avait dit clairement que l’investisseur retenu était Butler. Veolia est revenu, en reprenant une partie de la participation de Butler. À ma connaissance, les conditions étaient celles de l’offre Butler.
M. le rapporteur. Il est important de savoir si les conditions d’entrée de Connex sont restées les mêmes que celles de son offre initiale.
M. Claude Gressier. Il faut bien distinguer l’offre de Connex et celle de Butler. S’agissant de Connex, nous ne connaissons que l’offre de juillet puisque celle de septembre n’a pas été remise. Sauf erreur de ma part, le montant de recapitalisation figurant dans l’accord signé en mai 2006 par MM. Vieu, Richard et Butler, est celui qui ressort de l’offre Butler.
M. le rapporteur. Il faudra vérifier les trois paramètres de l’offre, à savoir le prix des actions, le montant de la recapitalisation et la participation de l’État. Ont-ils varié entre l’offre initiale du 28 juillet 2005 et ce qui a été finalement négocié entre Butler et la Connex ?
M. Claude Gressier. Sauf erreur de ma part, les conditions finales étaient celles de l’offre de Butler. Cela dit, le Gouvernement avait une marge d’appréciation et il n’était pas obligé d’adjuger au mieux disant. C’était un appel d’offres industriel : le but était de sauver la SNCM. Pour moi, le renoncement de Veolia n’en était que plus surprenant. Même si Veolia avait été un peu plus cher, notre petit groupe de travail aurait sans doute recommandé au Gouvernement de retenir son offre. Certes, le directeur général de Veolia Transport ne représente pas le conseil d’administration, mais on peut penser qu’il devait, ou aurait dû, avoir des indications.
M. Dominique Tian. Avez-vous eu des échos de rencontres entre Veolia et les syndicats ? Par ailleurs, Veolia ne pouvait-il pas à l’époque s’inquiéter de l’attitude de Bruxelles ?
M. Claude Gressier. Il y a eu en effet des rencontres entre les investisseurs et les syndicats, mais nous en avons seulement entendu parler. En revanche, la Commission européenne, avec laquelle l’Agence des participations de l’État (APE) était en pourparlers, était tenue au courant et a approuvé l’ensemble du dispositif par une décision du 8 juillet 2008. Peut-être Veolia a-t-elle eu auparavant des échos différents, mais je n’en sais rien.
M. Dominique Tian. Pourtant, Bruxelles demande aujourd'hui au gestionnaire actuel le remboursement de sommes énormes. Que s’est-il passé ?
M. Claude Gressier. Je ne m’exprime ici qu’en tant que connaisseur du secteur des transports. Deux éléments peuvent expliquer ce changement : le service complémentaire et la privatisation.
Sur ce dernier point, après le feu vert de la Commission, il y a eu une plainte de Corsica Ferries et le tribunal de première instance a demandé à la Commission de revoir sa copie, surtout à cause, c’est ce qui ressort d’une lecture rapide des attendus, de conditions sociales trop favorables. Les 158 millions d’euros comprenaient des aides au départ plutôt généreuses. S’y ajoutaient les 38,5 millions de complément au plan social. Les juges ont estimé que c’était au repreneur de payer.
Le second élément concerne le service de base et le service complémentaire. En 2001, l’OTC a retiré Nice et Toulon de la DSP tout en maintenant au sein de celle-ci un service de base et un service complémentaire. Nous nous étions assurés du feu vert de la Commission. Il s’est passé la même chose lors de l’appel d’offres de 2007 mais Corsica Ferries a porté plainte et la Commission européenne a fait valoir que l’offre était désormais suffisante en période de pointe et qu’il ne fallait pas inclure de service complémentaire dans la DSP.
M. le rapporteur. Les conditions de la privatisation ont été approuvées par la Commission européenne. En première instance, le tribunal de l’Union européenne les a annulées, et la Commission va en tirer les conséquences financières en fixant le montant qui doit être remboursé à l’État, lequel a, sans doute, fait appel du jugement du tribunal.
S’agissant du service complémentaire, je rappelle qu’il n’est pas facile de savoir ce qu’est le droit. Dans un premier temps, après une plainte contre le service complémentaire, le tribunal administratif de Bastia valide la légalité de la délégation de service public. Dans un deuxième temps, la cour administrative d’appel dit le contraire. Le Conseil d’État, pour des raisons de fond, casse l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille. Pendant ce temps-là, la Commission européenne, saisie d’une plainte de Corsica Ferries, déclare le service complémentaire illégal.
M. le président Arnaud Leroy. Votre mandat s’arrête à la signature officielle par Butler. Le groupe de travail mis en place auprès du préfet M. Frémont était-il déjà actif ?
M. Claude Gressier. Je ne sais pas s’il s’était réuni avant juin avec le directeur général de la mer et des transports. En tout cas, M. Perben et M. Breton ont demandé qu’il y ait des réunions avec les organisations syndicales fin juin ou début juillet pour les informer, mais je n’y ai pas participé. Par ailleurs, après le 15 septembre, se sont tenues, sous la présidence de M. Frémont, les deux réunions dont j’ai parlé avec, d’une part, les syndicats, d’autre part, les élus. Il s’agissait non pas de réunions du groupe de travail, mais seulement de réunions d’information auxquelles l’APE et moi participions pour rendre compte des discussions avec les différents investisseurs.
M. Dominique Tian. Je rappelle seulement qu’en juillet 2005, la situation sociale est explosive. La CGT est à la pointe du mouvement avec les travailleurs corses. On craint que la desserte de la Corse ne soit interrompue de façon définitive car la société est quasiment en faillite, et les repreneurs ne se bousculent pas au portillon. Les réunions à la préfecture se succèdent sous la présidence de M. Frémont et tout le monde est extrêmement inquiet. La priorité est à la sauvegarde de la société.
M. le rapporteur. Il est important de rappeler le contexte. Certes, la Corse étant une île, la pression était très forte. Mais, dans la période très récente, la pression aussi était maximale puisque nous avons accueilli le Tour de France ; pourtant, nous n’avons cédé en rien. Malgré la menace de bloquer les ports, l’Assemblée de Corse, à l’unanimité, a accepté ma proposition de rejeter les offres de prix qui étaient faites. Mais la pression était peut-être encore plus forte à l’époque.
M. Dominique Tian. Oui, du fait d’une sorte de monopole.
M. le rapporteur. Nous devons comprendre pourquoi la Connex se retire puis revient. Est-ce pour des raisons objectives – les contacts avec les syndicats l’ont-elle échaudée ? Redoutait-elle les contentieux bruxellois ? Ou bien y a-t-il d’autres raisons ? Et alors lesquelles ? Il faut aussi vérifier les différences de conditions entre l’offre de la Connex et celles de son retour avec Butler.
M. Henri Jibrayel. On ne peut pas imputer les circonstances de la vente, même si elles ont été précipitées du fait du déficit, uniquement au personnel et à la CGT. La SNCM était soumise à la concurrence du fait de l’arrivée de Corsica Ferries qui a provoqué des déficits colossaux dès 2004.
Par ailleurs, je suis stupéfait que l’Union européenne réclame aujourd'hui 220 millions d’euros sans qu’il y ait eu à l’époque des garde-fous et je vous trouve – pardonnez-moi – assez flou sur les circonstances de la vente.
M. Claude Gressier. Vous parlez du service complémentaire ?
M. Henri Jibrayel. Oui.
M. Claude Gressier. Je suis peut-être flou mais, parallèlement à M. Piazza-Alessandrini, j’ai rencontré la Commission avant l’appel d’offre lancé en 2001 pour la période 2002-2006. À aucun moment, celle-ci n’a envoyé le moindre signal pour nous indiquer que c’était la dernière fois. Vous pouvez le demander à M. Piazza-Alessandrini.
M. le rapporteur. Malheureusement, il a disparu, mais il était très compétent et très prudent. S’il avait eu le moindre doute, il l’aurait dit. Il n’y avait pas d’alerte, en effet, au sujet du service complémentaire.
M. le président Arnaud Leroy. Je voudrais avoir votre opinion sur le changement de pied des instances européennes. Certes, c’est la décision d’un tribunal mais il est tout de même incroyable que la Commission ait donné son feu vert à un montage longuement élaboré en commun, avant de se rétracter et de nous condamner à verser non seulement 220 millions d’euros mais aussi 230 millions d’euros. Au final, l’enveloppe avoisine les 500 millions d’euros. Si la France et la compagnie sont condamnées à rembourser, on sera revenu au point de départ, et au même degré d’incertitude quant à l’avenir de la SNCM. Qu’est-ce qui justifie, à vos yeux, ce revirement ?
M. Claude Gressier. Il est difficile d’avoir une opinion. Excusez-moi de le dire ainsi, mais je me demande si la Commission, et peut-être aussi le tribunal de première instance, ne sont pas lassés du problème SNCM. Ils sont soumis à la pression constante de Corsica Ferries, qui n’en est pas à sa première plainte. Que l’État français soit successivement venu demander à la Commission l’autorisation de sauver les ports en 2002, de recapitaliser une première fois en 2003, puis avec un investisseur en 2005, n’est-ce pas beaucoup ? Ont-ils voulu marquer un coup d’arrêt ? Je me le demande.
Pour revenir au service complémentaire, je comprends que l’on puisse dire que la concurrence s’est intensifiée, que, l’été, elle suffit à satisfaire les clients supplémentaires, et que la DSP devrait se limiter au service de base. En revanche, je suis choqué par la demande de remboursement puisque le service a bel et bien été effectué. Je comprendrais que l’on intime aux parties de ne plus y revenir, mais le service a été rendu après un appel d’offre et des discussions financières normales avec l’Assemblée de Corse. Je souhaiterais que la Cour de justice de l’Union européenne ne laisse pas passer cette partie du jugement.
M. le rapporteur. Pour la bonne information de nos collègues, je souligne plusieurs points sur le service complémentaire.
Premièrement, quatre juridictions se sont prononcées, la Commission agissant comme une juridiction de première instance en invalidant le service complémentaire, et ont rendu quatre avis différents : tribunal administratif de Bastia, cour administrative d’appel de Marseille, Conseil d’État et Commission européenne. Même quand ils sont d’accord, c’est pour des raisons différentes. Sur un plan strictement juridique, la question est donc très délicate.
Deuxièmement, le Gouvernement est intervenu auprès de M. Joaquin Almunia en mai. La réponse a été négative. La Commission s’est prononcée à l’unanimité.
Le troisième point porte sur le service de base assuré par les navires mixtes. Alors même que les représentants de la Commission disaient ne pas comprendre les raisons de la délégation de service public, jugeant suffisantes des obligations de service public, la décision récente de la Commission qui invalide le service complémentaire valide le service de base. C’est une novation considérable.
De plus, le service complémentaire fait ressortir, au cours de la période récente, un taux de remplissage de 35 %. Enfin, en tout état de cause, et je rejoins M. Gressier, la décision de la Commission invalidant le service complémentaire et demandant le remboursement est d’autant plus surprenante que, effectivement, l’Assemblée de Corse avait, à ma demande, décidé bien en amont qu’il n’y aurait plus de service complémentaire à compter du 1er janvier 2014. Il suffisait dès lors d’en prendre acte.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur Gressier, il ne me reste plus qu’à vous remercier.
L’audition s’achève à douze heures quinze.
b. Audition, à huis clos, de M. Gérard Couturier, président du directoire de la SNCM (2004-2011)
(Séance du mercredi 17 juillet 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Mes chers collègues, nous recevons aujourd’hui M. Gérard Couturier, président du directoire de la Société nationale maritime Corse Méditerranée de 2006 à 2011.
Monsieur Couturier, vous avez d’abord été officier de la marine marchande. En 2000, vous êtes devenu directeur régional de Connex, filiale transport de Veolia, pour les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse. En 2004, vous êtes devenu délégué régional de Veolia Environnement, en charge des transports, de la propreté et de l’énergie. En 2006, vous avez été nommé président du directoire de la SNCM, désormais filiale de Veolia Transport et du fonds Butler Capital Partners (BCP). Vous êtes resté à ce poste jusqu’en 2011, année où vous êtes devenu président du conseil de surveillance de la SNCM, poste que vous occupez toujours aujourd’hui.
En 2005-2006, avez-vous participé, de près ou de loin, aux négociations ayant conduit à l’entrée de Connex, devenue Veolia Transport, dans le capital de la SNCM ? Que pouvez-vous nous dire sur les conditions de cette entrée ? Quel était l’intérêt pour Veolia de ne pas faire une offre seule, comme cela avait été envisagé initialement ainsi que nous l’avons appris la semaine dernière de la bouche de M. Gressier ? Pourquoi entrer au capital de la SNCM aux côtés du fonds Butler ?
En tant que président du directoire de la SNCM, à quelles difficultés majeures de gestion avez-vous dû faire face ?
Enfin, Veolia Transport a racheté fin 2008 pour la somme de 73 millions d’euros la part de Butler dans la SNCM, une part que ce fonds avait achetée 13 millions d’euros. Selon vous, les efforts de gestion qui ont été faits entre 2006 et 2008 peuvent-ils justifier une telle progression de la valorisation ? La valorisation de la part de Butler en 2008 était-elle conforme à la valeur de la SNCM ? Enfin, si tel est le cas, pourquoi Veolia a-t-elle renoncé à une excellente opération financière en ne présentant pas seule, dès 2005, une offre sur les 66 % du capital dont elle s’est retrouvée propriétaire en 2008 ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Gérard Couturier prête serment.
M. Gérard Couturier, président du directoire de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) de 2006 à 2011. J’ai bien sûr participé à cette opération de privatisation. Je vais vous présenter les choses telles que je les ai vécues.
Courant 2004, l’Agence des participations de l’État (APE) a fait état de son souhait de privatiser la SNCM : elle a donc confié le dossier à la banque HSBC et choisi Nicolas Baverez comme conseil. Le dossier a été adressé, je pense, à un grand nombre d’opérateurs ou de repreneurs possibles, dont Veolia, précisément sa branche transport, qui s’appelait Connex à l’époque. Je rapportais pour tout ce qui était de la délégation de la direction régionale à Henri Proglio, qui était président de Veolia, et pour la partie transport à Stéphane Richard, le patron de Connex.
Le dossier n’a pas été regardé uniquement par moi : j’étais le régional de l’étape dans cette affaire ! Rapidement, moi-même et les autres collègues en charge de donner un avis avons refermé le dossier en indiquant qu’il était un peu loin de nos activités et qu’il présentait beaucoup de difficultés.
Fin 2004, moi-même et d’autres dans nos équipes avons reçu instruction de rouvrir le dossier. N’étant pas pilote de l’opération, j’ai avant tout pris des contacts au niveau syndical, mais également au niveau des acteurs locaux concernés, principalement les acteurs insulaires.
Le dossier a avancé, géré principalement par des financiers : Veolia dispose d’équipes spécialisées dans la reprise d’entreprises, l’évaluation des risques, les projections de business plan. Puis les discussions se sont engagées avec l’APE et HSBC.
Je crois me souvenir qu’au cours de ces discussions, nous avions envisagé une reprise progressive de la SNCM, pour un tiers dans un premier temps. Quelques écueils se présentaient en effet à nous, tout particulièrement le renouvellement de la délégation de service public (DSP) avec l’Office des transports de la Corse (OTC), un an ou six mois après la date prévue de la privatisation. En effet, la desserte de l’île constitue l’épine dorsale de la SNCM puisque les deux tiers de son activité au moins sont liés à la Corse.
Au départ, l’idée – somme toute classique – était de conditionner à l’assurance de la reconduite de la DSP l’accroissement de notre participation au capital jusqu’à une prise de contrôle majoritaire. J’ai déjà repris des sociétés de transport, certes plus modestes et, lorsqu’il y avait une proximité de renouvellement de contrat qui portait sur une part majoritaire de l’activité, les dossiers comportaient en général des clauses soit résolutoires, soit conditionnées.
Au cours des discussions, l’APE nous a fait savoir assez vite que l’État souhaitait plutôt une cession à 100 % de la société. Nous avons continué à travailler dans ce sens, en suivant les différentes étapes : candidature, appel d’intérêt, etc. Au bout du compte, une date ayant été prévue pour la remise définitive des offres de reprise, nous avons dû passer devant le conseil d’administration de Veolia, réuni le matin du jour où nous devions déposer le dossier. Et nous avons été très étonnés d’apprendre que le conseil d’administration refusait la proposition de reprise de la SNCM. L’après-midi, nous avons donc informé l’APE que nous ne remettions pas d’offre.
Cette annonce a surpris beaucoup de monde. Il s’agissait tout de même d’une compétition – et non d’une vente de gré à gré – avec un règlement ; les trois candidats étaient Butler Capital Partners (BCP), Caravelle et nous-mêmes. Finalement, l’attribution – l’aurions-nous seulement gagnée ? – s’est faite au fonds Butler Capital Partners. Il s’en est suivi immédiatement une grève et des troubles graves à Marseille et en Corse.
Au bout de quinze jours ou trois semaines, certains, y compris des syndicalistes, se sont émus de l’enlisement de la situation. Ils ont rappelé que Connex avait étudié une proposition et entrepris de trouver une solution pour la faire entrer au capital. Je n’ai pas participé aux discussions de rapprochement entre Butler Capital Partners et Veolia, mais j’ai reçu instruction de me tenir disponible pour trouver des solutions de rapprochement et de les explorer avec les syndicats, avec lesquels j’avais établi des relations.
À l’époque, si le Syndicat des travailleurs corses (STC) avait une position plus radicale que la CGT, celle-ci avait une double revendication : que l’État reste présent au capital – Butler, desservi par son nom, était assimilé à un fonds américain –, aux côtés d’un opérateur national reconnu qui puisse progressivement prendre la maîtrise du capital jusqu’à faire disparaître Butler ; et que la présence des salariés au capital soit organisée. Tout cela a été négocié, et l’équilibre s’est établi tel que vous le connaissez : 38 % pour Butler Capital Partners, 28 % pour Connex, 25 % pour l’État, et 9 % pour les salariés. Ces deux derniers groupes de partenaires totalisant 34 % du capital, détenaient une minorité de blocage, pour autant que cela ait un sens dans une telle situation – il y avait aussi beaucoup d’affichage dans cette répartition. Voilà comment a été décidée cette opération.
Ensuite, après diverses interventions, y compris de ministres, le calme est revenu. Nous étions alors à l’automne 2005 et la privatisation n’a été réalisée qu’au mois de mai 2006. Se posait le problème de la continuité de l’activité. Elle était remise en cause par l’appel d’offre ; cependant le cahier des charges de la DSP respectait à peu près le format antérieur, si bien que, à condition de gagner, il induisait une certaine continuité de l’activité. Ainsi, Connex a pu signer avec BCP le contrat de cession de la SNCM, qui intégrait les recapitalisations antérieures.
Notre engagement a été précédé d’une consultation favorable du personnel sur les principes d’organisation de l’entreprise : des réductions d’effectifs, et le respect de quelques garanties qui nous étaient aussi demandées par l’État : l’absence de licenciements secs, le maintien des salaires et la conservation du pavillon français premier registre, qui nous imposait, en termes de conditions sociales, mais surtout de masse salariale, des obligations sans comparaison possible avec celles de notre concurrent.
La consultation ayant été positive, nous nous sommes engagés : à partir du mois de mai 2006, nous avons repris la société. Le modèle d’organisation était celui d’une société à conseil de surveillance et directoire. J’ai été nommé président du directoire et j’ai choisi un directeur général : j’avais en effet conservé parallèlement l’ensemble de mes activités Veolia dans la région. Dans cette première période, le conseil de surveillance était présidé par un représentant de l’État, Michel Pélissier. Il avait en effet été convenu que l’État conserverait la présidence du conseil de surveillance jusqu’à l’obtention espérée de la DSP. Ensuite, Walter Butler a pris la présidence du conseil de surveillance, conformément à un accord de gouvernance entre Connex et Butler Capital Partners. Le conseil de surveillance était alors composé, comme cela avait aussi été négocié, à parité de représentants de l’État et de salariés d’un côté, et de représentants de Connex et de BCP de l’autre. La montée au capital des salariés s’est opérée avec un peu de délai, car on s’est enlisé pendant des mois, voire des années, au sujet de protocoles de désignation ou d’élection des petits porteurs. Cette montée au capital pour arriver aux 9 % prévus a été très favorisée par une aide à l’achat des actions par les salariés, que nous avons négociée.
La cession comportait une clause résolutoire à double détente. La première portait sur l’obtention, dans un format de continuité en volume et en équilibre économique, de la DSP avec la Corse ; le troisième sur la non-remise en cause des recapitalisations antérieures de la SNCM – c’est-à-dire non seulement celles précédant immédiatement la privatisation, mais aussi toutes celles qui étaient intervenues auparavant, en 2002 et 2003 notamment, et qui étaient déjà contestées. Cette double clause était assortie d’une durée, négociée avec le conseil de l’État qui avait estimé que, pour couvrir le risque de contestation, trois ou quatre ans suffiraient. Fixé à cinq ans, le délai prenait fin début 2012. Or, dès 2010-2011, nous savions tous que les sommes seraient contestées – l’État ne le nie pas. Pour autant, lorsque j’ai demandé à plusieurs reprises la prolongation de la validité de cette clause, je n’ai pas obtenu gain de cause. Et malheureusement, les premières annonces indiquant que les sommes seraient contestées ont été faites environ deux mois après la fin de validité de cette clause résolutoire. Je considère que cette clause n’a pas été exécutée de bonne foi.
Les difficultés que nous avons rencontrées étaient d’ordre externe. Il y avait la reconduction de la DSP – une décision difficile à prendre, y compris au sein de la partie insulaire. Nous étions également confrontés à la concurrence : la présence de l’entreprise Corsica Ferries, notre principal concurrent, avait conduit à l’effondrement des parts de marché de la SNCM depuis le début des années 2000 – la courbe s’est inversée quelque temps après notre arrivée. Il y avait donc péril pour cette entreprise à l’époque. Une autre difficulté venait aussi de la différence de « standard social ». En outre, les navires détenus par la SNCM n’étaient pas totalement adaptés au service, et il convenait de les remplacer.
M. le président Arnaud Leroy. Vous nous avez expliqué la méthode choisie pour la vente et avez parlé d’un « règlement ». Lors de l’audition précédente, nous avons eu le sentiment que les personnes qui faisaient des offres étaient en capacité de négocier beaucoup. Un prix de vente avait-il été fixé, une valorisation effectuée ?
M. Gérard Couturier. Autant que je me souvienne, il y avait en effet une large possibilité d’initiatives ou de propositions. Aucun prix n’était établi puisqu’il s’agissait, en quelque sorte, d’un concours : la proposition la plus séduisante devait être retenue, selon des critères de coût, puisque l’opération était à prix négatif, mais aussi des critères sociaux, qui, me semble-t-il, comptaient beaucoup.
M. Paul Giacobbi, rapporteur . Ma première question porte sur la première offre préparée au sein de Connex, celle qui a fait l’objet du refus du conseil d’administration. Vous souvenez-vous des conditions exactes de cette offre ? Je précise que nous allons demander des pièces écrites, celles qui ont été présentées au conseil d’administration et le compte rendu de celui-ci.
M. Gérard Couturier. Cela relève plus de Veolia que de moi, mais, puisque nous nous sommes ensuite rapprochés de Butler Capital Partners –, nous sommes rentrés « dans les chaussons de Butler » – je crois me rappeler que les propositions faites par BCP tant sur le plan économique que sur le plan social, c’est-à-dire le nombre d’emplois supprimés sans licenciements secs, étaient très voisines des nôtres. Je ne peux pas vous dire qui était le mieux ou le moins disant, mais de mémoire elles étaient très similaires.
M. Yves Albarello. Quelles sont les raisons qui ont motivé le refus du conseil d’administration ?
M. Gérard Couturier. Je ne le sais pas, même si j’ai ma petite idée. Je n’ai pas défendu le dossier ce jour-là : je me trouvais à Marseille avec des représentants de la CGT quand j’ai reçu un appel téléphonique m’informant que nous ne déposions plus. Ça a mis de l’ambiance…
M. le rapporteur. Nous avons demandé que nous soit remis le document faisant état de la clause résolutoire. Le délai de cette clause était de cinq ans ; il s’est révélé insuffisant, mais honnêtement, on ne pouvait pas le prévoir et je retiens votre propos sur une exécution de mauvaise foi.
Cela étant dit, je crois me souvenir que Veolia a fait un recours juridictionnel lorsque la cour administrative d’appel a annulé la DSP. Vous en souvenez-vous ?
M. Gérard Couturier. La DSP a connu beaucoup de turbulences en 2006-2007. Elle n’a pas été totalement annulée par la cour d’appel à l’époque, elle a été suspendue partiellement et reprise à un certain point. En revanche, elle a été retoquée récemment pour un autre motif par la cour administrative d’appel de Marseille dont l’arrêt a été annulé par le Conseil d’État.
Oui, Veolia a demandé l’intervention du tribunal sur l’exécution de cette clause résolutoire. C’est une affaire pendante.
M. le rapporteur. Je pense que nous devrions nous faire communiquer la requête de Veolia.
M. Avi Assouly. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre « petite idée » concernant le refus du conseil d’administration de Veolia ?
M. Gérard Couturier. Ce n’est qu’une idée, mais, pour moi, le conseil d’administration a reculé devant les difficultés telles que nous les avions présentées. Peut-être avons-nous été maladroits, mais en tout cas nous nous étions efforcés d’être le plus objectifs possible. Il y avait des difficultés sociales à Marseille et en Corse. Par ailleurs, le donneur d’ordre insulaire ne pouvait alors pas s’engager durablement sur une DSP. La fragilité juridique de l’affaire était également un obstacle. Enfin, les difficultés concurrentielles avec Corsica Ferries ont également dû peser.
M. Gaby Charroux. Je repose la question du président : quelle était la valorisation – laquelle a pu être jugée inadaptée – lors de la vente de la société à cette époque ?
M. Gérard Couturier. L’actif net était négatif. Il appelait une recapitalisation pour rétablir l’équilibre.
Pour autant qu’on puisse liquider une telle entreprise – je souhaite bien du bonheur à celui qui le fera –, je ne pense pas que la valeur de l’actif de la SNCM, y compris de ses navires – à l’époque une centaine de millions – ait été suffisante pour désintéresser toutes les parties.
Quant à la vraie valorisation, celle liée aux perspectives du résultat, elle était extrêmement négative.
C’est ce qui a conduit à demander une recapitalisation avant la restructuration de l’entreprise.
Je ne peux donc vous indiquer de montant exact. C’était la somme nécessaire à la recapitalisation sous réserve d’exécuter notre plan d’affaires, c’est-à-dire procéder aux modifications de l’entreprise et reconquérir des parts de marché pour dégager un peu de recettes.
M. le président Arnaud Leroy. Reprenons la chronologie au moment où vous avez « reçu instruction », ce sont vos propos, de vous rapprocher de Butler.
M. Gérard Couturier. Le rapprochement ne s’est pas fait avec moi. Il y a eu un rapprochement, j’imagine sur demande ou suscité. Et l’affaire s’est conclue avec la répartition, à laquelle j’ai participé du fait des critères sociaux – présence de l’État et des salariés et minorité de blocage –, mais aussi avec l’idée de l’effacement progressif de Butler au profit de Veolia.
Le rachat des parts de Butler était en partie induit par l’organisation d’origine et par un accord entre actionnaires, c’est-à-dire entre Butler Capital Partners et Connex. Cet accord confidentiel prévoyait, si ma mémoire est bonne, une option de vente à l’initiative de Butler à prix convenu pendant les cinq premières années et, ensuite, une option d’achat également à prix convenu. Le prix résultait d’une formule figée établie dans un document qui doit pouvoir être retrouvé.
Connex a dû, à un moment, envisager le rachat de la part de Butler à un prix assez élevé, qui selon moi excédait très nettement la valeur de l’entreprise à ce moment-là, mais qui avait été convenu : il s’agissait de l’exécution du pacte. Il était devenu nécessaire de sortir Butler. Le contrat de DSP avec la Corse nous obligeait à remplacer au moins un navire, inadapté en taille et en âge, avec une date limite. Ne pas le faire, c’était nous exposer à perdre la DSP. Butler s’opposait au rachat de ce navire, et il en avait les moyens, aux termes des accords. Par conséquent, Veolia-Connex a décidé de lever l’option d’achat à ce moment-là pour faire sortir Butler. Ce n’est pas la meilleure opération économique qu’ait réalisée Veolia, mais elle y a été poussée par la nécessité.
M. le président Arnaud Leroy. L’accord confidentiel se découpe en deux temps : une option de vente au bénéfice de Butler pour les cinq premières années ; une option d’achat pour Veolia après cinq ans. Chronologiquement, nous sommes dans les cinq premières années : vous avez donc forcé Butler à la vente. Ou alors vous bénéficiiez vous-mêmes d’une option d’achat.
M. Gérard Couturier. Il faudrait regarder comment était rédigé exactement le pacte. Encore une fois, je n’ai pas mené cette discussion : elle l’a été entre les actionnaires Veolia et Butler, même si nous en étions informés. L’affaire s’est donc passée au niveau parisien. Cependant, la nécessité de trouver une solution était très locale : nous devions acheter un navire, ce que nous avons fait très rapidement par la suite.
M. le rapporteur. Nous demanderons que nous soit communiqué ce pacte entre Butler et Veolia.
Je voudrais revenir sur les raisons du retour de Connex dans « les chaussons de Butler », pour reprendre votre expression, et sur la conclusion de ce pacte, qui s’est révélé une mauvaise opération pour Veolia. À votre connaissance, qu’est-ce qui a poussé Veolia à revenir sur quelque chose qui avait été refusé au départ par le conseil d’administration, qui plus est, dans des conditions plus coûteuses ?
M. Gérard Couturier. Je n’ai pas connaissance des éléments qui ont motivé cette évolution à la fois du conseil d’administration et de la direction de l’époque.
M. le rapporteur. J’imagine que le conseil d’administration a tenu plusieurs délibérations.
M. Gérard Couturier. Vraisemblablement.
M. le rapporteur. Il nous faudra donc avoir le compte rendu de ces délibérations.
Avec Stéphane Richard, vous êtes venu me voir dans mon bureau de l’époque, rue Aristide-Briand, peu de temps avant cette cession des parts de Butler à Veolia, pour me tenir informé et me demander mon avis. Pouvez-vous corroborer ce souvenir ?
M. Gérard Couturier. Je suis bien venu avec Stéphane Richard, mais c’était bien avant la cession.
M. le rapporteur. C’était quelque temps avant que Connex reprenne les parts de Butler, me semble-t-il.
M. Gérard Couturier. Je ne suis pas sûr d’avoir été accompagné cette fois-là par Stéphane Richard, car il n’était déjà plus chez nous. Nous sommes venus plusieurs fois, puisque nous avions pris soin de prendre des contacts. Nous devions honorer nos engagements. Par conséquent, il nous fallait nécessairement sortir Butler pour avoir les mains libres et acheter un navire. De mémoire, tel devait être le sens de notre intervention.
M. Sébastien Denaja. Vous n’avez pas eu réellement connaissance des discussions entre actionnaires sur l’accord confidentiel Veolia-Butler, nous expliquez-vous, alors que vous étiez déjà président du conseil de surveillance de la SNCM. Est-il habituel que les actionnaires se passent de l’avis du président du conseil de surveillance dans une discussion de cette importance ? S’il s’agit d’une discussion d’actionnaires, devons-nous entendre que vous n’êtes qu’un salarié de l’entreprise et que vous n’êtes pas intéressé au capital, ni n’avez de stock-options dans le capital d’une entreprise dont vous pouvez espérer qu’elle sortira de l’ornière ?
M. Henri Jibrayel. Vous ne pouvez pas sans cesse tout rapporter à l’accord conclu à Paris et nous dire que vous n’êtes pas au courant, alors que vous étiez président du conseil de surveillance.
Vous avez évoqué deux raisons qui ont fait hésiter le conseil d’administration : la concurrence de Corsica Ferries et le climat social. À laquelle donnez-vous la priorité ?
M. Gérard Couturier. À l’époque, je n’étais pas président du conseil de surveillance, mais président du directoire.
M. Henri Jibrayel. C’est pareil…
M. Gérard Couturier. Non car en raison de mes expériences dans un passé récent, je sais que l’organisation des sociétés à conseil d’administration est très différente de celles à directoire et conseil de surveillance. Dans un conseil de surveillance, les discussions se déroulent entre actionnaires. Bien sûr, le président du conseil de surveillance est intéressé à l’affaire. À l’époque, je n’étais pas président du conseil de surveillance, j’étais président du directoire. Le montage avait été ainsi fait – et je pense à dessein.
Aujourd’hui, je suis président du conseil de surveillance. Je ne détiens pas de stock-options. J’ai un prêt d’une action pour opérer mon mandat, que j’exerce à titre bénévole, étant retraité depuis un an. Je n’ai donc pas d’activité salariée chez Veolia.
Très sincèrement, j’ignore quelle motivation a prévalu au refus initial du conseil d’administration. J’ai seulement formulé une interprétation.
M. Yves Albarello. Vous deviez sortir Butler pour pouvoir acquérir un nouveau navire, investissement qu’il refusait. Le coût du nouveau navire doit donc être incrémenté du différentiel entre l’investissement d’origine et le montant de sortie de Butler, qui fait apparaître un delta de 60 millions. Autrement dit, le navire vous a coûté 60 millions d’euros de plus !
M. Gérard Couturier. De mémoire, le navire par lui-même nous a coûté environ 80 millions d’euros. Auparavant, nous avions déjà eu besoin d’un navire, mais comme nous n’avions pas obtenu l’autorisation de Butler, il nous avait fallu, dans la période compliquée de l’appel d’offre, nous livrer à une vraie gymnastique. Veolia avait dû acheter en direct un navire, que la SNCM avait affrété pendant un an ; après quoi il avait été revendu en fin d’année, d’où la nécessité d’en racheter un nouveau. Vous le voyez : il nous fallait vraiment sortir de toutes ces péripéties.
M. le président Arnaud Leroy. Quand on additionne les parts de l’État, des salariés et de Veolia, on obtient la majorité. Comment Butler pouvait-il bloquer un choix stratégique ?
M. Gérard Couturier. Le pacte d’actionnaires lui permettait en effet de bloquer un investissement.
M. François Pupponi. Quel intérêt Butler avait-il à refuser un investissement sans lequel la SNCM aurait perdu la DSP, c'est-à-dire deux tiers de ses recettes ?
M. Gérard Couturier. L’achat d’un navire augmentait l’endettement, ce qui pesait, selon les termes du pacte, sur le prix de cession des parts de Butler. C’est là, je pense, le point essentiel.
M. Gilles Savary. Vu de l’extérieur, le choix est vraiment très irrationnel. Si j’ai bien compris, le groupe Veolia ne répond pas à l’offre, puis va chercher un porteur financier, et finalement demande à celui-ci de sortir parce que, en définitive, il s’intéresse à ce qui ne l’intéressait pas initialement. Moyennant quoi, il est obligé de désintéresser ledit porteur à grands frais et, en plus, d’acheter un bateau. Un tel comportement de la part d’un grand groupe défie la théorie économique sur la rationalité de l’entrepreneur.
Autant on peut comprendre que Butler et Veolia aient pu avoir un arrangement secret, autant il a dû vous être difficile de justifier un dispositif aussi particulier. Quelles ont été les réactions des différents partenaires, notamment au sein du directoire ?
M. Gérard Couturier. Encore une fois, ces décisions n’appartenaient pas au directoire ; elles se prenaient entre actionnaires, même pas au conseil de surveillance. Je ne me « défile » pas : le directoire n’a tout simplement pas à intervenir dans ces affaires.
M. Gilles Savary. Qui siégeait au conseil de surveillance et au directoire ? Qui savait quoi ?
M. Gérard Couturier. Le conseil de surveillance de la SNCM, au moment du rachat à Butler, était présidé par Walter Butler, selon les termes de l’accord. De mémoire, BCP avait trois représentants, Connex deux, l’État trois et les salariés deux. Je n’étais pas membre du conseil de surveillance, je siégeais en tant que président du directoire.
Quant au directoire, il était composé de deux personnes : votre serviteur et la personne que j’avais désignée comme directeur général. C’était le format minimum.
Bien sûr, les conséquences ont été traitées au conseil de surveillance puisque les administrateurs de Butler se sont retirés immédiatement et qu’ils ont été remplacés par les administrateurs de Veolia, qui a pris la présidence. Mais les discussions détaillées et intimes autour du pacte se sont passées en dehors du conseil de surveillance. D’ailleurs, ce n’est pas le lieu.
M. le président Arnaud Leroy. J’avoue être surpris aussi. Selon la presse, Butler se présente en investisseur qui s’installe dans la durée, mais il refuse de renouveler des actifs au risque de perdre la DSP. Étrange stratégie, même si elle n’est pas de votre fait !
De plus, il est difficile de comprendre que la décision soit prise en dehors du conseil de surveillance et que le directoire la subisse alors qu’il y va de l’activité de la société.
M. Avi Assouly. Revenons encore en arrière. Vous expliquez le recul de Veolia par les difficultés sociales. Cinq ans après, elles auraient disparu ? Ça a tout l’air d’un montage. Sinon, il n’y aurait pas eu de commission d’enquête. Vous êtes d’accord avec nous ?
M. Gérard Couturier. Il m’est difficile de vous répondre sur ce qui a motivé la création d’une commission d’enquête…
Encore une fois, je ne veux pas me défiler, mais je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement sans renoncer à la DSP. Les choses étaient contenues dans le pacte d’origine. Peut-être était-il maladroit, je n’en sais rien. Il reste que la décision prise entre les actionnaires n’a pas eu d’impact sur la gestion directe, la trésorerie et les comptes de la SNCM. Pour elle, la nécessité, c’était d’avoir un navire.
M. le président Arnaud Leroy. Voilà un investisseur qui déclare s’installer dans le long terme – au moins dix ans –, qui se positionne dans un secteur nouveau pour lui, et qui prend le risque d’affaiblir la société en menaçant de lui faire perdre sa DSP. Ce faisant, il l’affaiblit et la valorisation s’en ressent. Ne faut-il pas voir dans l’attitude de Butler un prétexte pour donner à sa sortie une allure d’obligation et justifier une plus-value de plusieurs dizaines de millions d’euros ?
M. Sébastien Denaja. Butler prend la décision de céder ses parts, mais quel est le déclencheur de ce pacte confidentiel ?
Vous nous avez dit avoir été convié, en tant que président du directoire, au conseil de surveillance qui officialise la cession. Êtes-vous resté muet ? Avez-vous été interrogé sur l’état précis de la société ? Personne n’a-t-il jugé utile de le faire ?
Selon vous, la décision n’a eu aucun impact sur la vie quotidienne de l’entreprise. Qu’en a-t-il été sur le plan social sachant que le simple renoncement de Veolia et le choix de Butler avaient suffi à déclencher une grève monstre. Les représentants des salariés n’ont-ils pas réagi ?
M. Gérard Couturier. Au conseil de surveillance, chacun connaissait les réticences de Butler à investir dans un nouveau navire, qui était pourtant nécessaire.
Lorsque la décision, prise entre actionnaires en dehors du conseil de surveillance, - j’y insiste - a été présentée au conseil de surveillance et discutée, elle a été accueillie avec une grande satisfaction. Les salariés ne rêvaient que de voir disparaître Butler, et, je le dis égoïstement, le directoire a été soulagé de savoir qu’il aurait un navire et garderait la DSP.
M. Dominique Lefebvre. Je relirai attentivement vos propos, monsieur le président du conseil de surveillance, parce que je m’interroge.
À l’origine, en 2004, dites-vous, le dossier est instruit par les personnes compétentes, qui décident de le refermer. Ultérieurement, votre hiérarchie vous demande de le rouvrir, mais le conseil d’administration de Veolia, réuni le jour même de l’échéance du dépôt des offres, décide de ne pas y aller. Finalement, l’entreprise y va « dans les chaussons de Butler » et, plus tard encore, elle reprend la part de Butler. Or j’ai cru comprendre que Connex n’étant pas présente dans le transport maritime, elle n’avait pas d’intérêt stratégique à investir. Vous avez fait référence au climat social, à la revendication de la CGT d’avoir un opérateur de référence. En tout état de cause, racheter les parts de Butler à ce prix ne pouvait pas être une bonne opération économique. Alors, l’initiative venait-elle du président de Connex, ou de celui du groupe Veolia ? Le groupe y a-t-il été incité ? Par qui ? Et, en l’absence de caractère stratégique et d’intérêt économique, Veolia aurait-il pu recevoir des contreparties indirectement, dans d’autres dossiers qui auraient été gérés à la même période ?
M. Gérard Couturier. Vous dites que cette opération de rachat a été calamiteuse. Il faut reconnaître que le prix était élevé. Mais la seule alternative était de perdre la DSP. L’impact pour Veolia aurait sans doute été pire. Je pense que c’est ainsi que s’est prise la décision.
Pour les compensations, je n’ai aucune connaissance de faits de cette nature.
M. le rapporteur. Vous nous avez expliqué les raisons du refus du conseil d’administration, telles que vous les imaginez. Elles paraissent logiques : une concurrence excessive de la part de Corsica Ferries, des conditions difficiles et un climat social à tout le moins tendu.
Par la suite, le groupe revient « dans les chaussons de Butler ». Ne sont-ce pas plutôt des brodequins de fer, ou un carcan ? Veolia passe avec Butler un accord incroyablement inégalitaire ! Avec 38 %, Butler est maître du jeu. Il est tout de même rare qu’une petite société dicte sa loi à un groupe comme Veolia ; je n’ai jamais vu, dans ma pratique de la vie des affaires, un petit imposer à un grand des clauses aussi léonines.
Enfin, vous indiquez que Butler vend à un prix trop élevé à Veolia, vous dites même que l’opération est « calamiteuse », et vous la liez au pacte entre les deux – un pacte proprement stupéfiant. Je ne comprends décidément pas le changement de pied du conseil d’administration de Veolia après sa rétractation.
M. François Pupponi. Butler dépose son offre à peu près un an avant le renouvellement de la DSP. Tout le monde sait donc déjà qu’il faudra racheter un bateau. Pourtant, il refuse ce rachat au risque de perdre la DSP. Moi aussi, je m’interroge devant quelqu’un qui investit dans une société et se tire une balle dans le pied en refusant un investissement, perdant ainsi sa seule source de revenus.
Quand intervient l’accord entre Butler et le groupe Veolia, on sait que l’investissement est indispensable au maintien de l’activité de la SNCM. Pourtant, on se lie les mains en acceptant qu’un actionnaire puisse refuser l’investissement. On aurait pu imaginer que l’accord ait également porté sur l’achat du navire.
M. Gérard Couturier. Je ne suis pas certain que le cahier des charges remis ait été aussi précis, et qu’on ait déjà su à cette date le type de navire qu’il fallait et sa taille. Il me semble que ces spécifications sont issues des négociations de la DSP.
M. François Pupponi. Il faut faire des recherches.
M. Gilles Savary. Admettons que le directoire n’ait pas été au courant et qu’il ait été soulagé en apprenant l’issue. Mais, à votre avis, les membres du conseil de surveillance ont-ils eu à se prononcer sur ce montage, c'est-à-dire sur le rachat pour 73 millions d’euros des parts de Butler ? J’essaie de savoir jusqu’à quel niveau le secret du pacte était conservé. Il y a bien quelqu’un qui a décidé d’engager l’argent de l’entreprise. Qui, du conseil de surveillance de la SNCM ou du conseil d’administration de Veolia, a dû statuer sur la mise en œuvre d’un pacte, somme toute, peu rationnel ? Il a bien fallu, devant une instance ou une autre, que Veolia justifie de ses engagements vis-à-vis de Butler.
Sans vouloir faire de tort à personne, la desserte maritime de la Corse n’est pas la DSP la plus alléchante de France. Pourtant, tout d’un coup, Veolia s’est mis à y tenir beaucoup … au point de payer 60 millions à un fonds d’investissement pour un enrichissement sans cause. En quelques années, l’analyse économique a changé du tout au tout.
Par ailleurs, qui a pu être informé en dehors des signataires du pacte ?
Enfin, quel est le niveau d’information et d’implication des salariés dans la gestion ?
M. Yves Albarello. Avant de débloquer 73 millions d’euros, le conseil d’administration de Veolia a dû être à nouveau convoqué et se déterminer en fonction d’un business plan. Pourrions-nous avoir communication de ce document ?
M. Gérard Couturier. Le conseil de surveillance de la SNCM a été informé de la cession des parts entre actionnaires, mais il n’y avait pas d’autorisation à lui demander pour des mouvements de titres. L’information a été faite quand l’affaire était conclue et les représentants des salariés, comme ceux de l’État apparemment, étaient plutôt soulagés.
Le conseil d’administration de Veolia Transport a évidemment lui aussi été informé, et sans doute plus encore. Même si je connais moins bien maintenant les niveaux de délégation des directions générales de Veolia Transport, je pense qu’il y a eu au moins débat, voire autorisation en conseil d’administration de Veolia Transport, et peut-être de Veolia. Je ne suis cependant pas certain de ce dernier point : pour engager environ 70 millions, je ne suis pas certain que les cascades de délégations fassent obligation de remonter au conseil d’administration de Veolia. On a dû en rester au niveau de Veolia Transport.
Les salariés sont informés, et même consultés, à l’occasion des réorganisations du capital d’une société. C’est ce que la loi prévoit non seulement à la SNCM, mais aussi chez Veolia.
La DSP était indispensable ! La perdre, c’était signer l’arrêt de mort de la SNCM. D’où l’emballement dans cette affaire : Veolia envisageait très difficilement de devoir liquider la SNCM.
M. Gilles Savary. Je ne comprends pas l’argument.
M. le président Arnaud Leroy. Voulez-vous dire que l’actionnaire principal, le président du conseil de surveillance, Butler, voulait la mort de la compagnie ?
M. Gérard Couturier. On ne peut pas dire ça, mais l’argument du pire pouvait être utilisé.
M. François-Michel Lambert. Comment décide-t-on de prendre des parts dans une entreprise comme la SNCM ? Sur quels arguments et quels chiffrages s’appuie-t-on ?
Comment, nous qui sommes nombreux à venir des Bouches-du-Rhône, pouvons-nous croire que Veolia Transport, avant d’investir dans un dossier éminemment politique, n’en ait pas référé au patron de Veolia, surtout en sachant qu’il entretient des liens très étroits avec les grands élus du département, ou leur entourage ?
M. le rapporteur. Vous justifiez cette cession – « calamiteuse », dites-vous – par l’existence d’un pacte entre Veolia Transport et Butler Capital Partners, qui aurait permis à ce dernier de bloquer un investissement. Mais Butler n’en avait absolument pas le droit et Veolia a tout de même des conseils juridiques pour le lui dire. Il est interdit au détenteur de 38 % des actions d’une entreprise, à moins d’en payer les conséquences sur le plan juridique, d’abuser de sa position au conseil d’administration et à l’assemblée générale pour bloquer des décisions conditionnant la survie de la société. Je vous renvoie à la jurisprudence sur l’abus de minorité. Plutôt que de racheter hors de prix ses parts à Butler, pourquoi Veolia ne lui a-t-il pas envoyé une lettre recommandée pour lui signifier qu’il n’avait pas le droit, nonobstant le pacte, de s’opposer à un investissement indispensable à la survie de la société, et le menacer de l’assigner en justice ?
M. Gérard Couturier. Je vous confirme que des business plans ont été établis et ajustés avec Butler, une fois prise la décision de s’engager.
Je n’ai jamais dit que la décision de s’associer à Butler pour acquérir la SNCM n’était pas remontée à Veolia. L’engagement d’origine a d’abord été retoqué, puis la décision finale prise, chez Veolia.
Pour ce qui est de la reprise des parts de Butler, il me semble – mais je n’en ai plus souvenance – que le niveau d’autorisation d’engagement était suffisamment élevé pour que la décision formelle ne remonte pas jusqu’au conseil d’administration de Veolia, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en ait pas discuté ni n’en ait été informé.
Quant au rachat des parts de Butler, le pacte prévoyait une autorisation conjointe, un accord unanime pour les investissements. Peut-être peut-on le contester, il y a suffisamment de juristes chez Veolia pour vérifier.
M. Gilles Savary. M. Giacobbi a relayé mon interrogation car je pensais aussi aux voies juridiques pour contrecarrer un actionnaire agissant à rebours des intérêts de l’entreprise, ce qui était le cas en l’espèce. De là à lui faire faire une plus-value de 60 millions d’euros…
Le cahier des charges de la DSP stipulait-il que le délégataire devait tout mettre en œuvre pour assurer correctement la mission qui lui était dévolue et procéder aux investissements nécessaires ? Auquel cas, Butler était en faute et sa position attaquable.
M. Sauveur Gandolfi-Scheit. La SNCM était en déficit depuis les années 2000, avant sa privatisation. Les conflits sociaux se succèdent, et la concurrence se réjouit. N’oublions pas les mauvais choix de navire – et ce n’est pas la première fois. Ce sont tout de même les acteurs économiques insulaires qui paient les conséquences et sont pris en otage. Dans ce contexte, quelle thérapeutique préconiseriez-vous ?
M. Gérard Couturier. Le cahier des charges précisait l’âge maximum des navires, leurs dimensions et leurs capacités. Identique pour tout le monde, au départ, il évolue au fur et à mesure des négociations de DSP, en toute transparence, et tous les candidats en bénéficient. Il se trouve qu’au cours de ces discussions, un âge limite a été redéfini. Les insulaires se rappelleront peut-être le Monte Cinto, de petite capacité, desservant Calvi et qu’il fallait remplacer parce qu’il avait plus de vingt-cinq ans.
Le directoire aurait pu passer outre le choix de Butler, même s’il devait solliciter l’autorisation du conseil de surveillance au-delà de certains seuils. Mais, pour ce faire, il aurait fallu une trésorerie que la SNCM n’avait pas, ou au moins la garantie de ses actionnaires. Et là, on retombe sur l’obstacle.
Quant au choix des navires, c’est plus facile d’en juger maintenant. Mes prédécesseurs à la tête de la SNCM avaient acheté des navires qui n’étaient pas tous adaptés – qu’il s’agisse de leur volume, de leur configuration, de leur vitesse, jusqu’aux équipages très coûteux qu’ils mobilisaient. Il convient de les remplacer par des navires plus polyvalents correspondant aux besoins du trafic. Les chroniques que j’ai trouvées en arrivant montrent tout de même que les décisions étaient les résultats de concertations impliquant beaucoup d’acteurs. Je ne cherche pas à excuser mes prédécesseurs mais le management de l’entreprise n’était pas seul. Tout le monde a mis son grain de sel pour sélectionner des moutons à cinq pattes.
M. le président Arnaud Leroy. Pourquoi Veolia n’a-t-il pas dissuadé Butler de présenter une offre ? Veolia n’était pas un champion du maritime, mais ajouter une corde à son arc pouvait faire sens. Veolia est beaucoup plus puissant que Butler, a la préférence de l’État et des syndicats, ce qui atténue les risques de difficultés sociales. Pourtant, Veolia se retire, laissant Butler seul en lice puisque l’autre fonds, Caravelle, n’avait pratiquement aucune chance. Stratégiquement, Veolia aurait pu aller chercher un allié et un complément d’apports chez Butler, dans le cadre d’un pacte d’actionnaires, et inverser le rapport de force. Il y a là une logique qui m’échappe.
M. Gérard Couturier. À ma connaissance, au stade de la « compétition » initiale, il n’y a pas eu de tentative d’alliance avec Butler ou de combinaisons, ou même de pressions pour l’écarter.
M. le président Arnaud Leroy. Quelque soixante-dix acteurs ont été approchés pour cette privatisation. Solliciter des fonds d’investissement – entre trois et cinq – avait suscité des questions, d’autant que l’État avait dit chercher un partenaire à connotation plus industrielle. Et, finalement, Butler l’a emporté. Il aurait été logique que Veolia cherche à s’en faire un allié et le ramène à sa juste proportion, celle d’un fonds d’investissement sans grand avenir dans le maritime face à un groupe puissant.
M. Gérard Couturier. Il faut interroger les acteurs eux-mêmes sur leurs motivations respectives et leurs intentions.
M. Yves Albarello. Parlons d’avenir avec le professionnel que vous êtes. Comment pérenniser la continuité territoriale de l’île tout en respectant les impératifs économiques, c'est-à-dire sans avoir à revenir très périodiquement sur le dossier ? D’un côté, Corsica Ferries est économiquement viable, et, de l’autre, la SNCM perd des parts de marché, de l’argent, sans que le service soit à la hauteur. Quel futur cette société peut-elle avoir, selon vous qui l’avez dirigée ?
M. le président Arnaud Leroy. C’est une très bonne question mais elle sort du champ de la commission d’enquête.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier, Monsieur Couturier. Je ne vous cache pas que nous aurons peut-être besoin de vous revoir, et de vous demander certains documents.
c. Audition, à huis clos, de M. Antoine Sindali, président de l’Office des transports de la Corse (2004-2010)
(Séance du mercredi 24 juillet 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons aujourd’hui M. Antoine Sindali, membre de l’Assemblée de Corse et maire de Corte. Mais ce n’est pas à ce titre que notre commission d’enquête souhaite l’entendre aujourd’hui. Monsieur Sindali, vous étiez membre du conseil exécutif de Corse et président de l’Office des transports de la Corse (OTC) lorsque le Gouvernement a décidé de privatiser la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) début 2005.
À cette époque, la SNCM était titulaire de la délégation de service public (DSP) pour la desserte maritime de la Corse et sa mise en liquidation aurait eu des répercussions considérables pour la vie de l’île. La DSP courant jusqu’en 2007, un nouvel appel d’offres devait être lancé pour la desserte de la Corse.
Comment, à la tête de l’OTC, avez-vous vécu la privatisation de la SNCM ?
Selon M. Gérard Couturier, que nous avons reçu la semaine dernière, la DSP était le principal élément de valorisation de la SNCM. La définition de la nouvelle DSP a-t-elle été affectée par les incertitudes liées à la privatisation ? La collectivité territoriale a-t-elle été l’objet de pressions pour que la DSP soit reconduite à l’identique – ou dans une version très similaire – ou que ses conditions fassent de la SNCM le meilleur candidat ?
Inversement, pourquoi avoir sorti de la DSP la desserte à partir de Toulon et de Nice, tout en instaurant sur ces lignes une « aide sociale au passager » ? Leur exclusion pure et simple du champ de l’action publique ou, au contraire, leur maintien au sein de la DSP n’aurait-il pas été plus rationnel ?
M. Antoine Sindali prête serment.
M. Antoine Sindali, président de l’Office des transports de la Corse (2004-2010). Établissement public industriel et commercial, l’Office des transports de la Corse est un outil de la collectivité territoriale. Il est présidé par un conseiller exécutif – cela a été mon cas entre 2004 et 2010. L’OTC a pour mission de gérer l’enveloppe de la dotation de continuité territoriale et de mener à bien le conventionnement lié à la desserte maritime de la Corse. En somme, il s’occupe de l’opération « desserte de la Corse » – pas des opérateurs. Lorsque nous avons établi la délégation de service public dans le secteur aérien, nous ne nous sommes pas préoccupés des évolutions du capital d’Air France. De même, pour la SNCM, nous nous sommes attachés seulement au service public de desserte maritime que nous voulions pour la Corse. Voilà pour le cadrage juridique.
D’un point de vue politique, il était difficile pour le président de l’OTC, comme pour l’ensemble des élus de l’Assemblée de Corse, de se désintéresser d’un dossier susceptible d’affecter la délégation de service public en cours, qui prenait fin en 2007. Le processus de privatisation a commencé, à l’initiative exclusive du Gouvernement, courant 2005 ; en tout cas, les élus de la Corse et de la région PACA en ont eu connaissance à la fin de l’été 2005. Sitôt connu, le projet a provoqué de graves tensions sociales, ce qui explique également que les élus du continent et de l’île ne soient pas restés insensibles. Nous avons pris le train en marche, en quelque sorte !
Ensuite, nous avons été associés à des réunions à la préfecture de région, à Marseille. Une première réunion s’est tenue en présence de Thierry Breton et Dominique Perben, respectivement ministre de l’économie et ministre des transports de l’époque, avec les syndicats et les responsables de la SNCM. Une seconde réunion a été organisée autour du préfet de région avec les élus de la ville de Marseille, de la région PACA, du conseil général des Bouches-du-Rhône et de la Collectivité territoriale de Corse, dont votre serviteur.
À l’époque, nous avons mal vécu d’apprendre que l’opérateur, titulaire de la délégation de service public jusqu’au 31 décembre 2007, allait tomber dans les mains d’un fonds d’investissement. Nous n’avons pas porté de jugement sur le choix politique de privatiser la SNCM – je le redis, l’opérateur en lui-même ne nous intéressait pas –, mais nous avons tout de même fait part de notre surprise car nous nous demandions quelles pouvaient être les perspectives de la SNCM, sans la présence, dans la gouvernance, d’un opérateur industriel.
Selon les rumeurs de l’époque, et l’information est devenue publique par la suite, la société Connex – compétente dans le domaine des transports et devenue ensuite Veolia Transport – avait été sur les rangs, mais elle semblait avoir été écartée au début du processus, laissant le fonds d’investissement seul en lice. Or nous n’avions jamais été consultés. C’est pourquoi les élus des deux bords de la Méditerranée, toutes tendances politiques confondues, ont souhaité la présence d’un opérateur industriel aux côtés duquel l’État resterait engagé. C’est lors de la réunion entre les élus de PACA, du conseil général, de la ville de Marseille et de la collectivité territoriale de Corse, dans le bureau du préfet de région, que nous avons fait connaître notre souhait de voir l’État se maintenir dans le capital de la compagnie, et qu’a été évoquée, d’une part, la possibilité d’y faire participer les salariés, pour constituer avec la puissance publique une minorité de blocage, et, d’autre part, l’introduction d’un opérateur industriel. Le Gouvernement a alors choisi la répartition que vous connaissez : 38 % pour le fonds d’investissement Butler Capital Partners (BCP), 28 % pour Connex, 25 % pour l’État et 9 % pour les salariés. Ainsi, avec le maintien de l’État et la présence d’un opérateur industriel dans la gouvernance de la compagnie, nous avions la garantie de pouvoir poursuivre la délégation de service public jusqu’au 31 décembre 2007.
Voilà comment nous avons vécu le projet de privatisation.
La DSP en cours n’a pas été affectée. En effet, à l’issue du conflit social, particulièrement dur et long au moment de la privatisation, le service public de continuité territoriale entre Marseille et les ports de Corse s’est poursuivi selon le cahier des charges défini en 2001 lors de l’attribution au groupement SNCM-La Méridionale de la délégation de service public pour cinq ans.
Monsieur le président, la sortie de Toulon et Nice de la DSP et l’aide sociale n’ont rien à voir avec la privatisation. Seules Marseille et Nice relevaient de la DSP ; Toulon n’en faisait pas partie et le service y était épisodique. En 2001 – je n’étais pas aux affaires à l’époque –, l’Assemblée de Corse avait décidé de limiter le périmètre de la DSP aux liaisons entre le port de Marseille et les ports de Corse, mais, pour maintenir une concurrence aussi loyale que possible entre les dessertes, il fallait assurer l’équilibre des autres liaisons au moyen de l’aide au passager transporté, aide validée par la Commission européenne.
Si l’aide sociale au passager transporté au départ de Nice se justifiait par l’importance de cette liaison, nous nous sommes rendu compte après coup – je l’ai vécu et l’ai déclaré publiquement – que, s’agissant de Toulon, nous nous étions tiré une balle dans le pied. En effet, d’un côté, nous subventionnions, dans le cadre de la DSP, les liaisons entre Marseille et les ports de Corse en garantissant les recettes par le versement d’une compensation en cas de baisse de trafic et, de l’autre, nous remboursions, selon une formule de calcul, les avances consenties par les sociétés aux passagers qui payaient moins cher ; en pratique nous reversions 65 % des bonifications accordées par les compagnies aux familles, jeunes, étudiants, personnes à mobilité réduite, personnes âgées. Il s’agissait d’une forme de subvention, calculée sur la base du nombre de passagers déclarés, qui pouvait être vérifié avec la chambre de commerce.
Parmi les compagnies qui bénéficiaient de l’aide sociale figurait donc la SNCM, au titre de ses liaisons entre Nice et la Corse et aussi à partir de Toulon, desserte qu’elle a ensuite abandonnée. Autant le cahier des charges de la DSP est rigoureux, autant le mécanisme de l’aide sociale en place pour Nice et Toulon est, malgré quelques contraintes de régularité, beaucoup plus souple.
La collectivité territoriale de Corse n’a subi aucune pression, d’aucune sorte, en tout cas votre serviteur, qui a été chargé d’instruire le dossier pour son compte. Sur un plan politique, nous avons décidé de maintenir pour la nouvelle DSP un cahier des charges pratiquement identique à celui de 2001. C’est celui que j’ai proposé au vote de l’Assemblée de Corse, qui l’a accepté pour la période 2007-2013. Sur la base des offres reçues, nous avons reconduit pratiquement à l’identique également, y compris en termes de subvention dans le cadre de la DSP, les conventions de délégation de service public à partir du 1er janvier 2007. En réalité, la DSP n’a débuté que le 1er juillet 2007 en raison d’un contentieux ouvert par le principal concurrent, Corsica Ferries : il a fallu que les tribunaux le purgent et ils ont donné raison à la collectivité territoriale de Corse pour l’attribution de la nouvelle DSP au groupement entre la SNCM et La Méridionale.
La nouvelle DSP a été affectée en partie par la privatisation – il s’agissait de défendre les intérêts de la collectivité territoriale. À l’époque, j’ai proposé à l’Assemblée territoriale de Corse d’introduire au bout de trois ans une clause d’adaptation, dite « clause de revoyure », qui n’existait pas dans le cahier des charges précédent, pour vérifier le fonctionnement de la DSP et maîtriser son impact financier, à savoir le montant des subventions accordées par la collectivité territoriale. Autrement dit, avec la nouvelle DSP, nous voulions donner du temps au nouvel opérateur industriel, mais également introduire cette clause d’adaptation, destinée à remettre en cause une clause de sauvegarde de la convention en vertu de laquelle nous complétions, sans limite, la subvention que nous accordions aux compagnies délégataires en fonction des besoins, notamment des hausses du carburant. Au bout de trois ans, c’est-à-dire fin 2009, nous avons mis au point cette clause de revoyure par laquelle nous entendions faire comprendre au nouvel opérateur la nécessité de s’adapter à l’évolution du marché et de diminuer le service complémentaire.
Je ne vous cache pas que cela a été difficile pour nous. Autant nous avons souhaité ne pas avoir affaire seulement à un fonds d’investissement – et les faits nous ont donné raison puisqu’il a vendu ses parts à Veolia –, autant nous avions confiance dans la Connex, qui bénéficiait d’une réputation internationale. Pourtant, nous n’avons pas eu de véritable retour. En effet, trois ans après, alors que nous souhaitions réduire de moitié au moins le service complémentaire subventionné, nous ne l’avons pas obtenu. Il est vrai que nous ne l’avions pas écrit, nous contentant simplement de la clause de revoyure. Alors que, au cours des discussions sur la DSP entre l’Office des transports de Corse et les responsables de la SNCM, notamment le président du directoire, issu de Connex, nous avions souhaité une diminution de moitié du service complémentaire, nous sommes parvenus à une réduction de 25 % seulement. Parallèlement, pour les raisons que j’ai expliquées tout à l’heure, j’ai proposé à l’Assemblée de Corse de diminuer significativement, puis de bloquer, le remboursement aux compagnies au titre de l’aide sociale, qui est ainsi passé de 20-21 millions à 16 millions. La diminution du service complémentaire, la réduction et le plafonnement des subventions versées dans le cadre de l’aide sociale et le plafonnement de la clause de sauvegarde en vertu de laquelle nous compensions les baisses de recettes étaient destinés à pousser l’opérateur industriel à avoir une politique d’entreprise, mais nous avons été déçus.
M. le président Arnaud Leroy. La perspective de la renégociation de la DSP en cours pourrait-elle expliquer la reprise des parts de BCP par Veolia en 2008 ? Selon vous, quelles sont les raisons de cette cession ?
M. Antoine Sindali. Je l’ignore complètement. C’était un jeu entre actionnaires. En tout cas, cela n’a pas eu d’impact sur la DSP.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Il faut rappeler que l’Office des transports de la Corse s’occupe des opérations de service public et non des opérateurs. Par ailleurs, l’objet de notre commission d’enquête porte uniquement sur les conditions de la privatisation – et non ce qui s’est passé depuis –, et sur la DSP dans la mesure où elle entrait en compte dans l’opération. À cet égard, nous avons obtenu un certain nombre d’explications claires.
Si j’ai bien compris, c’est au cours de la seconde réunion autour du préfet de région que les élus de la Corse ont demandé le maintien de l’État, la présence d’un opérationnel professionnel, mais aussi la participation des salariés au capital, de sorte qu’ils puissent détenir avec l’État une minorité de blocage.
Avez-vous eu vent d’un accord confidentiel sur le prix de rachat, signé entre Veolia et Butler Capital Partners ? Vous nous avez dit qu’il n’y avait pas eu de pression. Mais à votre sens, l’État s’est-il engagé à ce que la DSP reste telle quelle ?
M. Antoine Sindali. Il n’y a pas eu de pression directe. En choisissant de maintenir le cahier des charges à l’identique, à la clause de revoyure près, nous entendions laisser une chance au nouvel opérateur. Je rappelle que les conditions de mise en concurrence ont été validées par les tribunaux puisqu’il y a eu un contentieux.
Cela étant dit, et tout le monde le sait, le protocole de privatisation – qui ne s’imposait pas à nous – comportait une clause qui le remettait en cause si la nouvelle SNCM n’obtenait pas la nouvelle DSP. Mais il ne s’agissait pas là d’une pression. Nous avons fonctionné de la même manière qu’en 2001. Le cahier des charges était le même, les sommes allouées étaient sensiblement les mêmes. Simplement, la clause de revoyure au bout de trois ans – destinée à nous permettre de reprendre quelque peu la main – devait inciter l’opérateur industriel à mener une politique d’entreprise et de ne pas compter uniquement sur l’argent public.
Et nous avons été bien inspirés puisque, en 2008, est intervenu le gel de la dotation de continuité territoriale. Nous avons donc eu raison d’être prudents. Mais il est vrai que, au départ, aux termes de l’article 16 ou 17 du protocole de privatisation, celui-ci devenait caduc si la nouvelle SNCM n’obtenait pas la nouvelle DSP. La CMN- La Méridionale était également concernée.
M. le rapporteur. C’est somme toute logique de la part des opérateurs de la privatisation.
Je trouve frappant que la délégation de service public ait été réalisée dans des conditions identiques à celles de 2001. La clause de revoyure – ajoutée à la DSP et manifestement plus favorable à l’Office des transports de la Corse – n’est intervenue qu’après la privatisation. La limitation des subventions et la réduction du service complémentaire ont été obtenues par négociation de l’OTC après l’opération de privatisation, et même après le rachat des parts de Butler Capital Partners par Veolia. Au moment de la privatisation, l’opérateur pouvait se retirer s’il n’obtenait pas la même DSP.
M. François Pupponi. Vous avez indiqué que la DSP était quasiment la même, si ce n’est la clause de revoyure. D’après vos souvenirs, l’opérateur avait-il l’obligation de faire l’acquisition d’un nouveau navire pour respecter la nouvelle DSP ?
M. Antoine Sindali. Le cahier des charges de la DSP imposait un âge limite aux navires. L’un d’eux était concerné et il aurait fallu le remplacer de toute façon.
M. Henri Jibrayel. Depuis le début, on a l’impression que tout le monde s’est donné le mot pour dire que le retrait de Butler s’est décidé au niveau national. On évite d’en parler et vous aussi avez botté en touche … Vous étiez tout de même bien placé. On a l’impression qu’il y a quelque chose de secret derrière tout ça.
M. Antoine Sindali. Très honnêtement, je n’étais pas au courant de ce qui se passait entre les actionnaires. Le président du directoire de la SNCM, lui, relevait de l’un des actionnaires et était partenaire de l’autre. Exprimer mon sentiment déborderait du cadre juridique dans lequel je suis auditionné. Quand à mon opinion de simple citoyen, c’est celle de l’ancien président de l’Office des transports qui vous intéresse.
L’attitude de Butler explique que nous n’ayons pas voulu, en tant qu’hommes politiques, que le seul actionnaire soit un fonds d’investissement. La SNCM est tout de même l’opérateur historique : elle a une histoire et des liens avec la Corse, Marseille et la région PACA. Même s’il n’entrait dans notre rôle de nous opposer à la privatisation, nous savions très bien comment fonctionnent les fonds d’investissement : ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie.
M. Dominique Tian. La DSP était la condition sine qua non d’une reprise par quelque société que ce soit, et il est normal que Butler s’y soit intéressé. Simplement, elle était assortie d’obligations sociales dont vous avez parlé : la continuité territoriale, les tarifs sociaux... Qu’avez-vous obtenu de plus dans la clause de revoyure ? Convenez-vous que la privatisation a été moins favorable pour Veolia parce que vous avez alourdi les charges incombant au délégataire de service public après qu’elle a obtenu le marché ? Et pourquoi les avoir alourdies à ce moment-là ?
M. Antoine Sindali. À partir du moment où un opérateur industriel arrivait aux commandes de la SNCM, on pensait qu’il y aurait moins de « ronron » que dans une entreprise dont le seul patron était l’État, et qu’elle serait mieux gérée. Une fois que le Gouvernement avait fait le choix politique de privatiser, nous avons fait savoir sur un plan politique – juridiquement, nous n’étions pas concernés – que nous ne voulions pas d’un fonds d’investissement pour seul interlocuteur et qu’il fallait que l’État conserve une minorité de blocage. Le président Giacobbi l’a rappelé. Plutôt que d’y aller « à fonds perdus » – la DSP est subventionnée à hauteur de près de 100 millions d’euros par an –, nous avons décidé d’offrir une respiration économique à la nouvelle SNCM mais tout en considérant que l’argent public ne devait pas seulement assurer des traversées confortables à 25 % de taux de remplissage, même en dehors des périodes creuses, et en souhaitant, au bout de trois ans, vérifier les progrès réalisés par un opérateur industriel digne de confiance. Nous avons été un peu déçus, moi en tout cas, car je n’ai pas obtenu ce que j’avais mis en avant puisque j’avais proposé la fameuse clause de revoyure, et le blocage de la clause de sauvegarde destinée à compenser le manque de recettes induit par le manque de passagers, que l’Assemblée de Corse a fini par adopter. Je souhaitais qu’au bout de trois ans, tout soit mis à plat et bloqué. Parallèlement, nous avons aussi bloqué l’aide sociale. Et heureusement.
M. Yves Albarello. Le changement de statut de l’opérateur à l’issue de la privatisation ne s’est traduit ni par une amélioration, ni par une dégradation mais, selon vous toujours, le service public a été assuré et la transition s’est plutôt bien passée.
À partir du moment où la DSP a été attribuée, un inventaire a été fait, mentionnant la vétusté des navires, précisant leur limite d’âge ; l’opérateur était dans l’obligation de remettre la flotte à niveau. C’est ainsi qu’un nouveau navire a été acquis. Une autre société que Veolia se serait-elle vue imposer les mêmes conditions ?
M. Antoine Sindali. Je vous réponds par un oui catégorique. Une clause du cahier des charges imposait un âge limite aux navires, quel que soit l’opérateur.
S’agissant de la transition, nous avons choisi de maintenir un cahier des charges pratiquement identique. Nous n’avons pas voulu ajouter immédiatement de contrainte supplémentaire en réduisant le périmètre de la DSP, ce que mon successeur à l’Office des transports, sous l’autorité du président du conseil exécutif, est en train de faire pour éviter que des bateaux subventionnés ne circulent à vide comme s’ils fonctionnaient à plein. Nous avons préféré ne pas agir brutalement parce que la privatisation avait entraîné un plan social et des suppressions d’emploi à Marseille et en Corse. Nous avons donc opté pour le maintien à l’identique du cahier des charges tout en introduisant, pour anticiper le risque de difficultés financières, la fameuse clause d’adaptation destinée à s’appliquer à la clause de sauvegarde au terme d’un délai de trois ans. Notre objectif était de maîtriser l’enveloppe financière que nous attribuions aux délégataires – le groupement « SNCM-La Méridionale » avec deux gros tiers pour la première, et un petit tiers pour la seconde.
M. le président Arnaud Leroy. À l’époque, le président du conseil de surveillance de la SNCM était Walter Butler. L’avez-vous rencontré dans le cadre de vos fonctions à l’Office ? Comment avez-vous appris que Butler allait sortir du capital ?
M. Antoine Sindali. Ma réponse à votre première question sera cette fois un non catégorique. Je n’ai pas rencontré M. Butler, sinon une fois de façon informelle à son arrivée en Corse. Je l’ai croisé, je lui ai serré la main, mais nous n’avons pas parlé. Je n’ai pas eu de relations fonctionnelles avec lui. Les seules relations que j’ai eues dans le cadre de la mise en œuvre de la DSP, c’est avec le président du directoire, M. Gérard Couturier. Je n’ai donc pas été informé par qui que ce soit la vente des parts de M. Butler à Veolia, avant que la nouvelle ait été rendue publique.
M. Dominique Tian. Il n’y aurait rien eu de choquant à cette rencontre. Il me semble d’ailleurs qu’elle a eu lieu officiellement, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour une négociation entre les syndicats, le groupe Butler et les autres intéressés. Il était tout de même normal de se préoccuper de la situation sociale, qui était explosive. Il y avait à l’époque des mouvements de grève et le climat social était très tendu. Avez-vous rencontré d’autres personnes, puisqu’il y avait d’autres repreneurs possibles ?
M. le président Arnaud Leroy. J’aurais trouvé naturel que M. Sindali et M. Butler se rencontrent et, à vrai dire, l’inverse me paraît inquiétant. D’où ma question.
À propos du navire neuf dont il a été question la semaine dernière, si j’avais été président du conseil de surveillance, je serais allé expliquer à l’attributaire de la DSP pourquoi je ne pouvais pas acheter de nouveau navire. Il n’y a pas eu de rencontre et j’en tire les conclusions : pour moi, en tant qu’actionnaire, M. Butler a agi à la légère.
M. Antoine Sindali. À la première réunion à la préfecture des Bouches-du-Rhône, nous étions une quarantaine de personnes et, franchement, je ne sais plus si M. Butler était là. Cela fait huit ans… Admettons qu’il était présent. Nous étions autour de la table pour entendre le point de vue des syndicats, et des élus tant de l’île que du continent, sur le mécanisme de privatisation de la SNCM.
Ensuite, dans le cadre des discussions autour de la DSP, ou plus tard de l’exécution de la DSP, le seul interlocuteur de l’autorité délégante a été le président du directoire de la SNCM. J’ai fait le parallèle avec la desserte aérienne : notre interlocuteur chez Air France est le directeur, jamais le président du conseil de surveillance – même quand c’était Jean-Cyril Spinetta… Nous n’avons jamais discuté qu’avec le président du directoire, jamais avec un actionnaire, fût-il président du conseil de surveillance.
M. le rapporteur. C’est un point important. Il peut arriver de discuter avec un président de conseil de surveillance, mais, en l’espèce, cela ne s’est pas produit. Il est aussi établi que la négociation sur la transformation de la DSP s’est faite bien après la privatisation, donc indépendamment d’elle. Je rappelle que la clause de revoyure n’a pas été qu’une formalité puisqu’elle s’est traduite par une économie de plusieurs dizaines de millions d’euros par an – 30 ou 40 millions. La négociation s’est déroulée entre l’Office des transports et le président du directoire de la SNCM – et sans doute avec La Méridionale –, manifestement après la cession des parts de Butler qui s’est faite, comme c’est normal, sans consultation de l’autorité concédante, laquelle a appris la nouvelle par la presse.
M. Dominique Tian. Les conditions d’attribution vous ont-elles choqué ? Auriez-vous aimé plus de concurrence ? Avez-vous eu l’impression qu’on ne vous disait pas tout ? Ou, au contraire, avez-vous été soulagé qu’on trouve une solution pour la SNCM et la desserte ? Finalement, M. Butler, avec Veolia, n’était-il pas un sauveur ? Je me souviens qu’à l’époque, l’atmosphère était très tendue et qu’on ne savait pas où on allait. Les réunions à la préfecture se déroulaient dans un climat dramatique et les élus marseillais se sont plutôt réjoui qu’une solution voie le jour, avec à la clef la poursuite de la desserte et des emplois sauvés.
M. Antoine Sindali. Je ne sais pas quoi vous répondre. Je veux bien exprimer ma satisfaction d’avoir maintenu une bonne desserte de service public maritime entre Marseille et la Corse, mais c’est de la langue de bois. Je vous le dis honnêtement. Le choix et le départ de Butler se décidaient à un autre niveau. Nous, à l’OTC, nous occupions de l’opération, pas de l’opérateur. Dans ce cadre, au milieu des difficultés, notamment sociales, qui ont accompagné la privatisation, nous étions satisfaits de pouvoir reconduire quasiment à l’identique le cahier des charges, même si nous savions que les choses ne pourraient pas rester en l’état tout au long des six ans que durerait la nouvelle DSP – au lieu de cinq précédemment. La clause de revoyure avait pour objet de maîtriser au bout de trois ans la compensation financière.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur Tian, la commission d’enquête porte exclusivement sur la privatisation, pas sur l’exécution de la DSP même si je me réjouis que la continuité territoriale ait été assurée. Nous cherchons des éclaircissements sur les conditions de la privatisation.
De vos propos, monsieur Sindali, je retiens, d’une part, que vous n’avez pas du tout été informé durant la procédure de sélection des candidats – vous avez découvert que c’était le fonds Butler qui avait été choisi – ; d’autre part, que le renouvellement du bateau, décisif, semble-t-il dans la décision de Veolia de racheter les parts de Butler, figurait dans le cahier des charges et ne constituait une surprise pour personne.
M. Dominique Tian. On ne peut pas faire fi du climat social et de la situation financière qui participent des « conditions de la privatisation ». Je suis content que M. Sindali ait indiqué avoir ressenti du soulagement en apprenant que la desserte ne s’arrêtait pas avec la privatisation.
M. le président Arnaud Leroy. Cela figurera au compte rendu.
M. Antoine Sindali. Satisfait de voir assurée la continuité territoriale entre Marseille et la Corse,…
M. Dominique Tian. …en l’améliorant…
M. Antoine Sindali. Je ne comprends pas…
M. Dominique Tian. Vous avez indiqué qu’une gestion par le privé serait sans doute de meilleure qualité. Privatiser n’était pas synonyme de malheur, mais de gain de productivité et, en contrepartie, il était normal de prendre des garanties sur le plan social. En tout cas, la privatisation n’a pas été une catastrophe.
M. Antoine Sindali. Je ne porterai pas de jugement sachant que, pour nous, l’opération prime l’opérateur. Nous voulions un opérateur industriel, et pas un fonds d’investissement. Nous étions satisfaits qu’un opérateur historique, avec une nouvelle structure capitalistique, accepte le cahier des charges que nous maintenions dans un premier temps, en attendant de reprendre nos « billes financières », si vous me pardonnez l’expression. Franchement, ç’aurait été la même chose avec un autre opérateur, mais il n’y en avait pas – l’appel d’offres était pourtant lancé au niveau européen – et le concurrent Corsica Ferries n’a pas été retenu parce qu’il ne remplissait pas les conditions du cahier des charges. Même si l’un des navires avait atteint la limite d’âge et devait être remplacé, la nouvelle direction de la SNCM répondait avec les mêmes moyens que précédemment, pour les mêmes rotations, et en offrant les mêmes garanties. C’est la raison pour laquelle nous lui avons attribué la délégation de service public.
Ensuite, nous avons voulu prendre acte de la volonté de privatiser et de confier le service à un opérateur industriel et obtenir un retour en termes de maîtrise financière sachant que les crédits publics n’étaient pas illimités. Et nous avons bien fait d’anticiper puisqu’il y a eu des restrictions.
M. Avi Assouly. En somme, vous n’aviez pas le choix.
En sortant de chez le préfet des Bouches-du-Rhône, vous aviez le sentiment d’avoir conclu un bon accord ?
M. Antoine Sindali. La première réunion chez le préfet, c’était la grand-messe, une simple prise de contacts. C’est au cours d’une autre réunion avec lui, avec la représentante de la présidence de la région PACA, le président du conseil général, le maire de Marseille, le président de l’assemblée de Corse, le président du conseil exécutif, le ministre des transports, Dominique Perben, et votre serviteur que nous avons fait passer le message à l’État. Les élus, de Corse et de PACA, toutes tendances politiques confondues, étaient unanimes à ne pas vouloir d’un tête-à-tête avec un fonds d’investissement, à demander une minorité de blocage pour l’État et les salariés, et à réclamer l’opérateur industriel Connex. Le message est remonté jusqu’au Gouvernement puisque le montage s’est fait selon ce que voulaient les élus locaux des deux côtés de la mer.
M. le rapporteur. Nous nous interrogeons sur les conditions de la privatisation, et pas sur l’opportunité de privatiser ou non puisque l’Union européenne en faisait une obligation. Quant à la satisfaction éprouvée à l’époque, je rejoins M. Tian et M. Sindali, même si je parlerais plutôt de « soulagement » de voir le service public et l’emploi assurés, un soulagement ressenti y compris par ceux qui contestaient certaines conditions de la privatisation. M. Sindali a d’ailleurs souligné que tous les participants, quel que soit le bord auquel ils appartenaient, étaient à l’unisson.
Je rappelle que la clause de revoyure a été introduite après la privatisation et la cession des parts de Butler. Elle est donc éloignée du sujet qui nous préoccupe, même si elle a été extraordinairement bénéfique.
Je prends acte que Butler n’a jamais participé aux discussions avec le concédant et qu’il s’est opposé au renouvellement de la flotte dont l’obligation figurait au cahier des charges depuis le début.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur Sindali, je vous remercie.
d. Audition, à huis clos, de M. Camille de Rocca Serra, président de l’Assemblée de Corse (2004-2010)
(Séance du mercredi 11 septembre 2013)
M. Yves Albarello, président. Cher collègue et cher Camille, il n’est pas fréquent qu’une commission d’enquête auditionne l’un de ses membres, mais rien ne l’interdit cependant. Et les archives de l’Assemblée nationale conservent la trace de quelques précédents.
Alors, comment le président de l’Assemblée de Corse que vous étiez de 2004 à 2010 a-t-il vécu la privatisation ?
La mise en liquidation de la SNCM, titulaire de la délégation de service public (DSP) pour la desserte maritime de la Corse, aurait eu des répercussions considérables pour la vie de l’île. La délégation courant jusqu’en 2007, un nouveau contrat devait donc être négocié et un nouvel appel d’offres lancé, mettant en jeu la DSP qui constituait, selon M. Gérard Couturier, le principal élément de valorisation de la SNCM. Dans ce contexte, la définition de la nouvelle DSP a-t-elle été affectée par les incertitudes de la privatisation ? Pourquoi avoir reconduit la DSP à l’identique, ou presque, y compris donc le service public complémentaire ? La Collectivité territoriale a-t-elle été l’objet de pressions en ce sens ? En a-t-elle subies pour que la DSP soit définie dans des conditions qui fassent de la SNCM le meilleur candidat ?
M. Camille de Rocca Serra prête serment.
M. Camille de Rocca Serra. Une première précision à vous apporter, madame, messieurs les membres de la commission d’enquête, c’est que le président de l’Assemblée de Corse n’est pas en charge d’un exécutif. Ce n’est pas lui qui propose à l’Assemblée, ni qui est en relation permanente et directe avec les services de l’État et le Gouvernement, même s’il n’est pas interdit de l’associer à leurs travaux. En l’espèce, et aussi parce que j’étais parlementaire, j’ai participé au moins en partie à cette aventure qu’a été la privatisation, et qui s’est déroulée de mars à octobre 2005.
Comment en est-on arrivé là ? Lors du lancement d’un nouvel appel d’offres pour l’exploitation des lignes entre la Corse et Marseille – seul port, depuis l’origine, concerné par la DSP –, qui était du ressort de la collectivité et qui devait être préparé au moins un an avant l’échéance, on ne peut pas faire abstraction de la situation de la SNCM. Pour comprendre la raison du maintien de l’ensemble des obligations de service public, y compris donc le service complémentaire, il faut revenir en arrière. Il faut remonter à l’appel d’offres de 1999.
Comme nous ne sommes pas devant le tribunal de l’Union européenne, je peux m’exprimer sans détour. Tous les gouvernements ont suivi la même orientation, c'est-à-dire faire vivre la SNCM pour préserver les emplois – deux tiers sur le continent, et un tiers sur l’île, y compris le personnel navigant corse. Je ne me priverai pas de dire et de répéter que l’État a été un mauvais actionnaire, de la SNCM comme d’autres entreprises. Elle n’a pas eu la chance, comme Air France, d’avoir de grands présidents ayant réussi à ouvrir le capital.
En 1999, la SNCM va très mal, au point qu’il existe un risque de rupture avec son associé, la Compagnie méridionale de navigation (CMN-La Méridionale), à laquelle elle est liée par le biais de STEF-TFE. Sur le plan social, la situation se complique encore et l’actionnaire de la SNCM n’a d’autre but que d’assurer la paix sociale dont le prix exorbitant prive l’entreprise d’une stratégie d’avenir : il faut éviter le feu à Marseille, en Corse, et neutraliser l’activisme du syndicat dominant. Toujours dans une optique d’emploi, il a fallu acheter des bateaux à nos chantiers navals, où ils coûtent un peu plus cher à construire. Tout cela pousse la CMN, qui marche bien et assure avec des effectifs « normaux » la continuité territoriale en dégageant des bénéfices, et pour laquelle la SNCM est un poids mort, à imaginer un partenariat avec Corsica Ferries.
À ce moment-là, le Gouvernement fait le choix politique, critiquable comme tout choix de cette nature, mais compréhensible, de garantir la viabilité de la SNCM en lui garantissant la DSP à Marseille. Dans ce schéma qui peut passer pour une cote mal taillée, la SNCM a tout intérêt à défendre sa position à Marseille sans chercher à s’étendre à Toulon ou Nice, de façon que Corsica Ferries ne soit pas tentée de venir chasser sur ses terres et puisse se renforcer à Toulon où elle se verrait accorder l’aide sociale au passager. Ce mécanisme tend à devenir la règle au niveau européen, la DSP n’étant plus que l’exception là où la continuité territoriale ne peut être assurée que par l’exclusivité. Quoi qu’il en soit, la situation n’était pas tout à fait normale mais elle créait une sorte d’équilibre entre le port de Marseille et celui de Toulon, chacun dévolu à une entreprise différente. La SNCM se voyait donc, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert, garantir sa position et partant l’emploi. C’était ce à quoi œuvrait l’État actionnaire et il applaudissait quand nous ralliions une majorité à ce point de vue.
Malgré deux recapitalisations, la dégradation de la situation de la SNCM devient notoire. On peut toujours critiquer et reprocher à d’aucuns d’avoir exagéré les difficultés, mais force est de constater qu’elles sont constantes. La SNCM connaît d’ailleurs aujourd'hui une nouvelle rechute.
C’est vrai que nous avons garanti un volume financier constant grâce à la DSP parce que chaque navire correspond à quelques centaines d’emplois. Ce n’est pas la Corse qui a demandé la construction du Napoléon Bonaparte, un navire de croisière, ni la mise en service de car ferries. L’Assemblée de Corse avait voté en faveur du cargo mixte, le plus adapté à la desserte de la Corse, et choisi par la CMN, qui a toujours fait du bon travail.
Tous les gouvernements étaient sur la même ligne – même si je n’étais pas satisfait dans la mesure où Bruxelles a raison de considérer que le service complémentaire n’est pas du service public. Le service public consiste à mettre un bateau ou un avion là où personne n’en mettrait. La genèse de la continuité territoriale réside dans le choix d’acheminer le fret au prix du kilomètre SNCF. La SNCM a récupéré tout le volume parce qu’il fallait faire vivre l’entreprise qui n’arrivait pas à trouver sa place sur les autres segments du marché, comme le Maghreb. C’est pour cette raison que la Corse est devenue la chasse gardée, ou le marché captif, de la SNCM. Nous avons tous contribué à la situation et je ne me dégage pas de mes responsabilités. J’ai voté comme les autres et j’assume mon vote.
Un premier entretien informel, qui n’a pas fait l’objet de convocation écrite, est l’occasion de nous informer de la gravité de la situation. Je n’ai que des coupures de presse pour me rafraîchir la mémoire, mais je pense qu’il a eu lieu en mars. François Goulard, alors ministre des transports, convie Ange Santini et moi-même pour nous avertir que Bruxelles n’acceptera pas une nouvelle recapitalisation et que la seule voie possible est la privatisation. Le terme me surprend car il signifie une cession totale que nous estimons inacceptable. On comprend bien qu’il faille ouvrir le capital – Air France a montré la voie – et se plier à la règle de Bruxelles qui a le mérite d’être claire. Et si on ne la respecte pas, il faudra payer tôt ou tard, la France est bien placée pour le savoir. Nous nous opposons donc à une privatisation pure et simple. À l’issue de cette réunion, aucune conclusion n’est arrêtée. Il s’agissait sans doute de tester notre réaction. François Goulard ayant quitté le ministère des transports le 31 mai 2005, la rencontre a forcément eu lieu avant. La situation financière de la SNCM commence à intéresser la presse début 2005.
Deuxième temps fort, que j’ai du mal à dater – sans doute septembre 2005 puisque la réunion s’est tenue sous l’autorité de Pierre-Étienne Bisch, à l’époque directeur de cabinet du ministre des transports, Dominique Perben. Je crois me souvenir que c’est le préfet de Corse, Pierre-René Lemas, qui nous invite à l’accompagner à Paris. Sont présents, outre les personnes déjà citées, Marie-Hélène Debart, qui suit les affaires de la Corse au ministère de l’intérieur, Ange Santini et Tony Sindali, président de l’Office des transports de Corse et moi-même. Je ne sais plus ce qui s’est dit exactement mais j’en ai retiré l’impression que la messe était dite – ou presque. Pierre-Étienne Bisch a parlé de groupes financiers. Plusieurs noms de transporteurs installés à Marseille – Dreyfus, Grimaldi,… – ont été évoqués. J’en avais rencontré certains à l’occasion de dîners organisés par le directeur de la Caisse des dépôts, et ils avaient vivement démenti tout intérêt pour la SNCM. Pourtant, on nous annonce un appel d’offres impliquant plusieurs candidats, parmi lesquels les fonds Butler et Caravelle. Il me semble qu’il y en avait d’autres… Les événements s’accélèrent même si rien n’est encore définitif. À notre sortie, une caméra de télévision nous attendait, mais nous avons laissé le préfet répondre, préférant le silence car nous ne comprenions pas très bien ce qui se passait, ni cette précipitation. Au cours de cette phase, nous ne sommes pas impliqués directement, moi encore moins puisque je n’étais pas à l’exécutif. C’est l’État qui est à la manœuvre en tant qu’actionnaire. En tout cas, il ne nous demande pas notre avis. Il a pris sa décision et il a des informations que nous n’avons pas.
Une fois les décisions connues, la situation s’embrase et elle a failli très mal tourner en Corse. L’exécutif corse et la majorité de l’Assemblée de Corse prend clairement position contre une privatisation totale même si nous pouvons comprendre l’ouverture du capital puisqu’on nous dit qu’il n’y a pas d’autre solution.
Troisième temps : la réunion qui se tient à Marseille. Avant, je participe à une émission sur la chaine LCI, Questions d’actu – que la chaîne n’a plus dans ses archives – à laquelle participent Walter Butler, un journaliste des Échos, et moi. J’ai donc demandé à Walter Butler que je ne connaissais pas, s’il accepterait que l’État reste au capital – il a répondu oui –, que les salariés participent au capital – il a répondu oui –, et si des transporteurs routiers de Corse le pourraient aussi, de façon à établir un équilibre entre les syndicats et les utilisateurs – il a encore répondu oui. M. Butler paraissait donc prêt à discuter. J’en ai donc déduit que les choses auraient pu se passer autrement.
Comme le climat à Marseille était tendu, Jean-Claude Gaudin et moi avons pris l’attache du directeur de cabinet de Dominique de Villepin, Pierre Mongin, le matin de l’émission. Comme les élus locaux de la majorité n’étaient pas favorables à une privatisation totale, ce programme était donc l’occasion d’exercer une forme de pression sur Matignon en exprimant un désaccord total. Pierre Mongin me dit, en me demandant de garder le silence, que l’État restera au capital. Il s’agissait d’une solution préférable, sinon économiquement, du moins socialement et politiquement. Il faut bien comprendre que, jusque-là, aucun transporteur maritime n’était venu au secours de la SNCM. Le nom de Connex circulait, mais rien de plus. Entre neuf heures et midi, la décision est prise de calmer le jeu et d’appeler à discuter. Le lendemain de l’émission de LCI, j’étais à France Inter. Le 26, nous étions à Marseille, le 27 a lieu la prise du Pascal Paoli, le 28 je participe à l’émission au cours de laquelle j’ai un échange téléphonique avec celui qui venait de s’emparer du bateau et je l’enjoins d’arrêter les frais pour éviter de devoir qualifier le détournement d’acte de piraterie. J’ai d’ailleurs obtenu du Premier ministre qu’il en considère les auteurs comme des « Pieds Nickelés ». L’affaire a tout de même failli mettre le feu à la Corse puisque plusieurs milliers de personnes attendaient dans le port de Bastia le retour du navire. Les nationalistes n’auraient pas osé rêver pareil événement qui ravivait le souvenir d’Aléria. Il fallait tout faire pour apaiser la tension, due à une mauvaise concertation et une mauvaise information. Quant à la décision elle-même, elle était, sinon mauvaise, du moins totalement prématurée dans le contexte. Finalement, j’ai obtenu satisfaction, presque au forceps.
Nous voilà convoqués à Marseille pour une dernière réunion, avec les élus de Corse, Ange Santini, président de l’exécutif, Tony Sindali, président de l’Office des transports et moi-même. Nous tenons une table ronde avant celle à laquelle les syndicats seront invités par le préfet Frémont. Nous retrouvons le préfet Lemas ; le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin ; Sylvie Andrieux qui représente Michel Vauzelle, ainsi que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini. Du côté des représentants de l’État, on compte le préfet de police, Bernard Squarcini ; Thierry Breton, ministre de l’économie, et Dominique Perben, ministre des transports, et leurs conseillers. La Connex aussi est représentée en la personne de Stéphane Richard et il y a Gérard Couturier. Ils focalisent l’attention car tout le monde demande à ce qu’un transporteur entre dans le jeu. On ne pouvait pas accepter qu’une entreprise mal gérée par un actionnaire public tombe sous la coupe exclusive d’un financier. Finalement, nous sommes entendus, l’État et les salariés obtiennent une minorité de blocage et le nouvel actionnaire cède une partie de ses parts à la Connex, la seule entreprise de transport à s’être manifestée. Henri Proglio m’avait dit qu’il répondrait présent en cas de besoin, mais pas à n’importe quelle condition.
Je n’ai pas négocié, ce n’était pas mon rôle, mais l’Assemblée de Corse a voté le cahier des charges proposé par l’exécutif de la Collectivité territoriale. Le document prévoyait bien une compensation des éventuelles baisses de volume, calculé d’après le service de base et le service complémentaire. Malgré tout, l’enveloppe avait été réduite et nous laissions à l’entreprise un délai de deux ou trois ans pour s’adapter au marché, par le biais de la clause de revoyure. À l’époque, on lançait les « autoroutes de la mer » et l’entreprise ne pouvait pas être rentable en desservant seulement la Corse. À Marseille, nous avions obtenu que l’État reste actionnaire mais pas que les collectivités territoriales entrent au capital. Cette proposition avait essuyé un refus unanime. Dans le souci de maintenir la paix sociale, nous avons privilégié les départs volontaires, peut-être à tort puisque la question est de nouveau posée aujourd'hui comme celle de la viabilité de la SNCM qui continue à perdre des parts de marché et se limite désormais à son pré carré, le marché captif de la Corse.
Il va bien falloir trouver des solutions puisque Bruxelles a validé la sortie du service complémentaire. Contester sa décision ne ferait que gagner ou perdre un peu de temps. Une nouvelle concession, d’une durée de dix ans, vient d’être votée par l’Assemblée de Corse, et elle fera sûrement l’objet de contentieux de la part des concurrents de la SNCM. Elle ouvrira tout de même des perspectives, pourvu que la structure du capital soit solide.
M. Yves Albarello, président. Pourquoi avoir reconduit la DSP à l’identique tout en insérant une clause de revue ? Et maintenu dans la DSP le service complémentaire, qualifié par certains de « faux service public d’été » ? Pourquoi, au contraire, ne pas avoir proposé dès le départ une DSP assortie d’une diminution de moitié du service complémentaire ainsi que le plafonnement de la clause de sauvegarde ?
M. Camille de Rocca Serra. À titre personnel, j’étais pour la suppression du service complémentaire depuis longtemps. Mais sans le choix qui a été fait, aucun opérateur n’aurait accepté d’entrer au capital de la SNCM. Si elle avait été en bonne santé, tous les professionnels se seraient battus, notamment ceux qui renforcent leurs lignes sur le Maghreb. Sans les liens entre la SNCM et la CMN, la STEF-TFE aurait été intéressée. C’est d’ailleurs ce qu’a déclaré M. Lemor. La gestion de La Méridionale est performante. Pourquoi celle de la SNCM ne l’est-elle pas autant ?
Le service complémentaire existait déjà, suscitant l’opposition de Corsica Ferries qui est allé jusqu’au contentieux. J’étais pour assurer une continuité territoriale à partir de Marseille, et laisser ailleurs le champ libre à la concurrence, avec, éventuellement, une aide sociale au passager, mais on a reconduit la DSP vraisemblablement pour obtenir la présence d’un tiers au capital, aux côtés de Walter Butler. Je ne l’ai pas négociée, pas plus que je n’ai été associé à la négociation du cahier des charges, mon rôle consistant à animer le débat à l’Assemblée de Corse, et à y participer en donnant mes positions.
Le résultat était loin d’être parfait, mais le nécessaire, le souhaitable et le possible ne se confondent pas toujours.
M. Yves Albarello, président. Pour contraindre Veolia Transport à racheter ses parts au prix que l’on sait, Butler a-t-il bloqué le remplacement d’un navire qui était pourtant prévu dans la DSP ?
M. Camille de Rocca Serra. Je ne peux pas répondre car je n’ai pas l’information. Le rôle des élus de Corse se borne à garantir la desserte et, avec le Gouvernement ou l’Agence des participations de l’État, à établir le cahier des charges. La concertation pour la rédaction du cahier des charges, l’expertise juridique et les discussions avec Bruxelles impliquent le Gouvernement et l’exécutif de Corse. J’ai été associé seulement au volet politique, pas à « la cuisine », par la participation aux trois réunions que j’ai indiquées, jusqu’à la constitution du tour de table, réunissant Butler Capital Partners, la Connex, l’État et les salariés, et plus tard, au rachat des parts de Butler par Veolia Transport.
M. Yves Albarello. Il ne me reste plus qu’à vous remercier, cher collègue.
e. Audition, à huis clos, de M. Ange Santini, président du Conseil exécutif de Corse de 2004 à 2010
(Séance du mercredi 11 septembre 2013)
M. François Pupponi, président. Chers collègues, nous recevons maintenant M. Ange Santini, maire de Calvi, membre de l’Assemblée de Corse, et surtout, président du Conseil exécutif de Corse de 2004 à 2010.
En cette qualité, comment avez-vous vécu la privatisation de la SNCM ? À cette époque, en effet, elle était titulaire de la délégation de service public (DSP) pour la desserte maritime de la Corse et sa mise en liquidation aurait eu des répercussions considérables pour la vie de l’île. La délégation courant jusqu’en 2007, un nouveau contrat devait donc être négocié et un nouvel appel d’offres lancé, mettant en jeu la DSP qui constituait, selon M. Gérard Couturier, le principal élément de valorisation de la SNCM. Dans ce contexte, la définition de la nouvelle DSP a-t-elle été affectée par les incertitudes de la privatisation ? Pourquoi avoir reconduit la DSP à l’identique, ou presque, y compris donc le service public complémentaire ? La Collectivité territoriale a-t-elle été l’objet de pressions en ce sens ? En a-t-elle subies pour que la DSP soit définie dans des conditions qui fassent de la SNCM le meilleur candidat ?
M. Ange Santini prête serment.
M. Ange Santini. Monsieur le président, messieurs les parlementaires, après l’audition de mon collègue et ami Camille de Rocca Serra, mes propos risquent de vous paraître redondants puisque nous avions, tous deux, avec Tony Sindali, des responsabilités au sein de la collectivité territoriale de Corse de 2004 à 2010. Nous sommes arrivés au bon moment – ou au mauvais, c’est une question de point de vue.
Le contexte, vous le connaissez. Le plan de recapitalisation de la SNCM de 2003 n’empêche pas des résultats désastreux en 2004 – 30 millions de déficit annoncé, le double en examinant les comptes de plus près – alors qu’interdiction avait été faite à l’État de recapitaliser une nouvelle fois. L’opérateur historique depuis 1976 est en proie à des difficultés récurrentes : des grèves à répétition, s’accompagnant d’un désamour patent entre la SNCM et la Corse. Le blocage du port de Marseille pour des raisons étrangères à l’île, qui s’estime prise en otage, donne lieu à des comportements, qu’il faut sans doute respecter puisque le droit de grève est un droit constitutionnel, mais qui posent de réels problèmes. Tant et si bien que le monopole que subissait l’île s’est desserré et il est désormais possible d’accueillir d’autres compagnies. Au fil du temps, la Corse ne s’en est que mieux portée, le continent aussi parce que ce qui est vrai sur une rive l’est aussi sur l’autre.
La Collectivité de Corse est partagée, comme elle l’était hier et le sera sans doute demain, entre le fatalisme – « Il n’y a qu’à en finir, et à envoyer la SNCM par le fond une bonne fois pour toutes puisque ça fait quarante ans qu’on n’arrive pas à résoudre les problèmes » – quand on se laisse aller, et le sens des responsabilités. À l’époque, la société représentait 2 400 équivalents temps plein, et il y avait aussi une partie de la flotte.
Vous le savez, la Collectivité territoriale n’a pas de pouvoir, s’agissant de la privatisation de la SNCM, mais l’État lui a transféré l’enveloppe de la continuité territoriale, c'est à dire 187 millions d’euros, dont 90 % environ sont dévolus à la DSP maritime. La Collectivité, si elle s’en tenait strictement à ses compétences, aurait dû se préoccuper uniquement de l’opération, pas des opérateurs, mais elle est concernée dans la mesure où l’État l’est. Par les temps qui courent, les élus de tous les bords et de tous les niveaux cherchent à sauver l’essentiel.
J’ignore s’il y avait d’autres solutions à l’époque. En tout état de cause, la décision nous échappait complètement puisque la Collectivité s’est toujours refusé à mettre un centime d’euro au capital de la compagnie, et heureusement au vu des conséquences ! Avec le président de l’Assemblée de Corse et celui de l’Office des transports, nous sommes intervenus dans le conflit : nous ne pouvions pas rester sans rien faire alors que l’île était paralysée. Il nous fallait chercher à pallier la carence de la SNCM avec la CMN, Corsica Ferries ayant fait ce qu’elle pouvait pour que la Corse ne soit pas trop pénalisée.
Nous avons été invités deux ou trois fois à la préfecture de région par le préfet Frémont, pour trouver des solutions et obtenir le déblocage des ports. Lorsque nous – présidence de l’Assemblée de Corse, présidence de l’exécutif de Corse et présidence de l’Office des transports de Corse – avons appris que nous allions vers une privatisation pure et simple, l’État se désengageant entièrement pour laisser le champ libre à Butler, nous sommes montés au créneau parce que, au-delà du 31 décembre 2006, la fiabilité du service public nous paraissait compromise : le nouveau maître à bord serait libre de découper la compagnie par morceaux et de vendre les bateaux. Indépendamment du choix de la privatisation qui nous échappait, nous avons fait savoir très rapidement pourquoi l’État devait rester au capital, les salariés y entrer – pour constituer une minorité de blocage, avec respectivement 25 % et 9 % du capital –, ainsi qu’un opérateur de transport, Veolia ou la Connex. La nouvelle répartition du capital nous paraissait de nature à garantir l’avenir. Et, quand l’État s’est acheminé vers cette solution, elle nous convenait parfaitement.
L’enjeu pour nous, c’était des lignes de service public assurées par plusieurs compagnies car nous ne souhaitions pas remplacer un monopole par un autre, ce à quoi la Corse aurait été exposée avec la disparition de la SNCM, voire de la CMN.
S’agissant des questions qui m’ont été posées, il est évident que l’État, et les élus, ont toujours eu la volonté de sauver la SNCM et ses emplois. Cela nous a-t-il conduits à faire du cousu main pour la DSP ?
Nous avons fait en sorte que l’offre de la SNCM ne soit pas pénalisée sans que les autres opérateurs soient empêchés de soumissionner. Il fallait évidemment que les obligations découlant de la DSP soient calibrées pour que la flotte de la SNCM et de la CMN puisse les satisfaire. Sinon, à quoi bon le travail fait en amont par l’État ? En revanche, nous n’avions pas à nous préoccuper de savoir si d’autres compagnies comme Corsica Ferries pouvaient répondre au cahier des charges.
La DSP prenant fin à la fin décembre 2006, il fallait relancer un appel d’offres. Nous sommes allés à Bruxelles, avec Camille de Rocca Serra et le président de l’Office des transports, rencontrer le commissaire européen responsable du « paquet climat-énergie » et M. Jacques Barrot, en charge des transports, pour porter la durée de la DSP de cinq à six ans. Elle est maintenant de dix ans. La Commission a évolué parce qu’il faut bien stabiliser la desserte et rentabiliser les investissements demandés aux délégataires.
M. François Pupponi, président. Pourquoi avoir reconduit la délégation de service public à l’identique ?
Par ailleurs, il nous a été dit que la négociation entre Butler et Veolia avait achoppé à propos du remplacement d’un navire prévu dans le cahier des charges, mais que Butler refusait. Que savez-vous sur ce point ?
M. Ange Santini. Mettons-nous à la place des opérateurs, qu’ils soient privés ou publics. Comment engager la privatisation de la compagnie si demain, il n’y a plus de DSP ? Nous avons donc fait en sorte que les conditions soient adaptées à la compagnie, mais d’autres pouvaient soumissionner. En tout état de cause, il n’aurait pas été très cohérent que, d’un côté, l’État sauve la SNCM en la privatisant et que, de l’autre, la Collectivité verrouille l’appel d’offres de façon à écarter l’opérateur historique.
La pression sur les élus, elle est constante quand il y a 2 400 emplois à la clef et 400 suppressions d’emploi dans les tuyaux !
Quant au remplacement d’un bateau, je n’en ai pas entendu parler.
M. Avi Assouly. Fallait-il vraiment contribuer à creuser encore le déficit en obligeant à la compagnie à acheter un nouveau bateau ?
M. Ange Santini. Ce n’était pas obligatoire ! Les deux car ferries existaient et c’était simplement en prévision de la modernisation de la desserte de la Corse, avec des cargos mixtes. C’est d’ailleurs dans cette voie qu’on s’est engagé aujourd'hui, en augmentant un peu la capacité. Mais, sur le déficit de la SNCM, il y aurait beaucoup à dire, essentiellement en termes d’emploi. Le préserver a aussi un prix.
M. François Pupponi, président. M. Couturier nous a déclaré que la SNCM avait l’obligation de racheter un bateau et que, sinon, elle n’aurait pas obtenu ou conservé, la DSP.
M. Ange Santini. La Collectivité aurait fixé cette condition ? Je ne pense pas avoir de trou de mémoire et, pour ce qui nous concerne, nous n’avons jamais émis cette hypothèse puisqu’il fallait d’abord sécuriser la DSP avec l’existant. C’est une évidence. Qu’ensuite, nous ayons envisagé, à l’horizon de quelques années, une fois que la SNCM aurait vogué en eaux calmes, une modernisation de la flotte, pour améliorer le service rendu aux usagers, pourquoi pas ? Mais ce n’était sûrement pas une condition pour répondre à l’appel d’offres.
M. François Pupponi, président. Au moins, c’est clair.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier, monsieur Santini.
f. Audition, à huis clos, de M. François Goulard, secrétaire d’État aux transports et à la mer (2004-2005)
(Séance du mercredi 18 septembre 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons aujourd’hui M. François Goulard, qui fut secrétaire d’État aux transports et à la mer du 31 mars 2004 au 31 mai 2005, c’est-à-dire pendant toute la durée du troisième gouvernement Raffarin. Monsieur le ministre, vous étiez donc aux premières loges au début du processus de privatisation de la SNCM.
C’est au cours de l’année 2004 que se profilent les premières difficultés de la SNCM. Comment le dossier est-il suivi ? Quelles hypothèses sont alors étudiées par le Gouvernement quant au sort de la SNCM ?
Le 26 janvier 2005, vous avez déclaré à l’Assemblée nationale que le Gouvernement va « rechercher un opérateur industriel susceptible à la fois d’apporter les capitaux nécessaires pour garantir l’avenir de l’entreprise, et d’améliorer la gestion et la performance commerciale ». Quelle solution est-elle alors envisagée ? Un apport partiel de capital ou une privatisation totale ? Dans ce cas, selon quelle procédure la partition de la SNCM a-t-elle été envisagée ? Dans tous les cas, quels ont été les éléments de raisonnement du Gouvernement ?
M. François Goulard prête serment.
M. François Goulard, secrétaire d’État aux transports et à la mer. Vous avez, monsieur le président, rappelé très brièvement la genèse du dossier. Le souvenir que j’en ai, c’est que, dès 2004, nous savions que la SNCM allait mal, très peu de temps pourtant après un plan de sauvetage – de mémoire, il datait de 2003 –, supervisé par la Commission européenne. Il comportait des obligations de cession d’actifs et faisait interdiction à l’État d’intervenir à nouveau par des apports en fonds propres.
Or les comptes étaient mauvais ; la société perdait des parts de marché ; la situation sociale était difficile – c’est une litote – et le dirigeant était désemparé. Cela m’a frappé dès que j’ai pris connaissance du dossier : le président-directeur général paraissait plutôt perdu. Mon directeur de cabinet l’avait très fréquemment au téléphone et, si mes souvenirs sont bons, surtout pour tenter de lui remonter le moral, tant étaient sérieux les doutes dont il était la proie, quant à la possibilité de redresser l’entreprise.
Dans un tel contexte, il n’y avait pas d’autre solution que de rechercher des capitaux extérieurs. Vous savez qu’en matière de privatisation, c’est principalement le ministre de l’économie et des finances qui est à la manœuvre, mais, à l’époque, le choix entre la privatisation intégrale ou l’ouverture du capital, qui donnerait la direction à un opérateur industriel, n’était pas tranché. En tout cas, il fallait un professionnel des transports capable de redresser une entreprise dont la situation était si mauvaise qu’on ne voyait pas comment le faire en l’état.
Il n’y avait pas pléthore de candidats. Comme souvent, on recherchait plutôt une solution française, de préférence à un appel à des capitaux étrangers. On voulait aussi éviter les prédateurs. À mon époque, des contacts avaient été amorcés avec Veolia, en la personne de son président-directeur général, M. Henri Proglio, que j’avais vu et qui m’avait dit d’emblée – après les premiers échanges entre mon cabinet et ses collaborateurs – que Veolia était susceptible d’entrer au capital et de devenir l’opérateur industriel de la SNCM. J’ai un souvenir assez précis. J’avais fait un déplacement en Chine avec le Premier ministre, en avril 2005, je crois, et il était accompagné de plusieurs chefs d’entreprise, dont M. Proglio. J’en avais profité pour les faire se rencontrer. Il y a eu un échange entre eux en ma présence et M. Proglio avait dit être prêt à « faire son devoir ». Je me souviens de ses mots, qui montraient que l’affaire ne serait pas facile. Il y a peut-être d’autres considérations de la part de Veolia dans ce dossier. En tout cas, des contacts avaient été établis. On n’avait pas de valorisation de la SNCM pour chiffrer l’ouverture du capital correspondant à l’apport de fonds propres qui semblait indispensable. Autre difficulté : la nécessité de renouveler la flotte qui paraissait, au moins partiellement, inadaptée aux besoins de la desserte non seulement de la Corse, mais aussi de l’Afrique du Nord. En somme, il fallait de l’argent frais que, vis-à-vis de la Commission européenne, l’État ne pouvait pas fournir.
J’avais annoncé à l’Assemblée les intentions du Gouvernement et, pour ce faire, tenu à Marseille une réunion avec les élus locaux, des Bouches-du-Rhône et de Corse, et les syndicats. La forme n’étant donc pas encore entièrement précisée, la rencontre, que l’on annonçait houleuse, s’était bien déroulée, en tout cas, sans incident.
Pour ce qui me concerne, je ne suis pas allé plus loin dans ce dossier puisqu’il y a eu un changement de Gouvernement à la fin du mois de mai 2005. À partir du moment où j’ai changé de portefeuille, je n’ai eu d’autres informations que celles de la presse. Dans les mois qui ont suivi, je n’ai jamais été invité, par le Premier ministre par exemple, à me prononcer sur l’évolution des événements. Les seuls contacts sérieux, et d’ailleurs positifs, qui avaient eu lieu quand j’étais chargé des transports, c’était avec le PDG de Veolia.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Vos propos, Monsieur le ministre, correspondent aux autres témoignages que nous avons eus. La période où vous étiez responsable du secteur maritime n’est pas celle qui nous intéresse le plus dans la mesure où c’est plutôt après que se seraient produits des événements qui justifient l’existence de notre Commission d’enquête. Lorsque vous quittez vos fonctions, l’appel d’offres n’est pas encore en cours. Et, si vous avez ensuite entendu parler de l’affaire, vous n’exerciez plus de rôle dans la décision.
Au point de départ, M. Henri Proglio dit être intéressé, mais avez-vous le sentiment – on ne peut rien vous demander d’autre – qu’il l’était plutôt en tant qu’industriel, à cause de sa filiale, la Connex, et du plan stratégique de son entreprise, ou pour d’autres raisons, par civisme, ou parce qu’il aurait reçu, à un certain niveau de l’État, une invitation telle qu’il ne pouvait pas la refuser ? Selon votre réponse, on comprendrait mieux, ou moins bien, l’attitude de Veolia.
M. François Goulard. À ma connaissance, il n’y a pas eu « pression » de l’État, mais je ne suis pas forcément au courant de tout. En tout cas, je n’ai pas été informé d’une quelconque démarche à haut niveau, c'est-à-dire du Premier ministre ou du Président de la République, pour inviter M. Proglio à s’intéresser au dossier. Quand j’ai assisté à sa rencontre avec le Premier ministre, la manière dont elle s’est déroulée m’a laissé penser que le Premier ministre n’était pas impliqué. Il s’est montré intéressé d’apprendre qu’Henri Proglio pourrait s’engager et, s’il avait fait une première démarche auprès de lui, l’entretien ne se serait pas passé ainsi.
J’avais eu une première rencontre avec Monsieur Proglio et il se considérait bien placé, notamment pour gérer les sureffectifs de la SNCM, compte tenu de ses nombreuses filiales dans le Sud de la France. Il avait des capacités que d’autres n’avaient pas, pour reclasser le personnel. Je savais par ailleurs que le groupe s’intéressait à l’époque au transport maritime parce que, dans mon propre département, des filiales avaient été candidates à des délégations de service public (DSP). Il n’était donc pas aberrant, dans ce paysage d’ensemble, qu’il manifeste de l’intérêt, quelles qu’aient été les difficultés du dossier. Il faut ajouter qu’à l’époque, nous ne disposions d’aucun chiffre. Il s’agissait donc d’un intérêt de principe.
Je crois important de dire que, quand les privatisations, totales ou partielles, passent à la phase concrète, la gestion est prise en main par le ministère de l’économie et des finances. Mais on en n’était pas encore là, pas encore à discuter le pourcentage de participation et le montant, je l’aurais su.
M. le rapporteur. Après votre témoignage, il paraît clair que le Premier ministre de l’époque n’avait pas évoqué le dossier avec M. Proglio, ce qui tend à accréditer qu’il n’y avait pas eu de pression, à ce moment-là en tout cas. Mais il n’était pas encore question de prix. Par ailleurs, à ce stade, et dans le cadre de sa stratégie, sur laquelle elle est revenue depuis, Veolia avait de légitimes raisons à s’intéresser à la SNCM.
Je voudrais revenir sur la valorisation de la société. Elle était, certes depuis peu de temps, en très grande difficulté, conséquence sans doute des relations sociales et de l’émergence d’une concurrence ravageuse. Je rappelle à la Commission que ces deux dernières années, la tendance s’est inversée : la SNCM reconquiert des parts de marché en raison des prix élevés pratiqués par la concurrence, dont le service, quoi qu’on en ait dit, n’est pas toujours exceptionnel. Quand vous étiez en fonction, aviez-vous déjà réfléchi à la valorisation ? Monsieur Gérard Couturier nous a déclaré, quant à lui, qu’elle reposait avant tout sur la DSP.
M. François Goulard. Oui, nous y avions déjà réfléchi. Sans avoir un souvenir précis – vous le comprendrez –, du côté des actifs, il y avait, outre la DSP, la flotte.
Néanmoins, l’intérêt que Veolia portait à la SNCM était pour nous un soulagement car nous redoutions d’avoir du mal à trouver.
Parmi les difficultés de tous ordres, il me faut insister sur les relations sociales, extrêmement particulières. Pourtant, j’ai une assez longue expérience des relations sociales dans différents contextes. À l’époque, je voyais ce qui se passait à la SNCF et à la RATP, et cela n’avait rien de comparable avec la SNCM en proie à la surenchère permanente entre organisations syndicales et à des comportements que je n’ai jamais vus nulle part. D’ailleurs, la fragilité du PDG qui était, pour nous, source d’inquiétude venait de ce qu’il était très impressionné. Bruno Vergobbi, ingénieur des Ponts et Chaussées, avait été placé là par l’administration, suivant un processus assez classique, sans peut être avoir le background nécessaire pour diriger une entreprise aussi difficile, et il était littéralement perdu. Je n’ai jamais vu ailleurs un PDG d’entreprise publique en contact téléphonique quasi quotidien avec le cabinet du secrétaire d’État pour raconter ses malheurs. Il était personnellement atteint, surtout par le contexte social.
M. le rapporteur. Il faut dire que les cadres, y compris les dirigeants, étaient en butte à des menaces quasi physiques. Ce n’est pas la faiblesse de M. Vergobbi qui est en cause ; il y avait de quoi être désemparé.
M. le président Arnaud Leroy. Vous nous avez expliqué, monsieur le ministre, qu’un premier plan de sauvetage avait vu le jour en 2003, qui plaçait la France dans l’incapacité juridique de renflouer l’entreprise. M. Barrot était alors le Commissaire européen chargé des transports, mais aviez-vous d’autres interlocuteurs à Bruxelles, moins bienveillants, en particulier au sein de la Direction générale de la concurrence ?
M. François Goulard. Je me souviens d’avoir rencontré Jacques Barrot pour plusieurs dossiers. Il est probable que nous ayons parlé de la SNCM, mais je n’ai pas gardé de souvenir précis. Je n’ai plus aucun document auquel me référer, mais c’était une évidence que l’on ne pouvait pas refaire un plan de sauvetage aussi peu de temps après le premier. Nous avions d’autres dossiers dans le secteur des transports sur le bureau de la Commission européenne, notamment l’énième « plan fret » de la SNCF. Nous avions déjà beaucoup de mal à faire accepter un apport de 700 millions à ce titre. Les apports en capital de l’État aux entreprises publiques étaient donc un sujet sensible. En ce qui me concerne, je n’avais pas d’autre interlocuteur à la Commission que Jacques Barrot, mais les services du ministère devaient être en contact avec les directions générales. À mon niveau, il n’y a pas eu de négociations, de tentatives de passer outre les consignes européennes parce qu’il ne me, ne nous semblait pas jouable d’aller plaider un nouvel apport en capital à la SNCM, surtout qu’elle recevait déjà de la Collectivité territoriale au titre de la continuité territoriale et de la DSP. Le dossier paraissait difficile à plaider.
M. le président Arnaud Leroy. Avez-vous eu l’occasion de rencontrer Corsica Ferries venue se plaindre du traitement de faveur de la SNCM ? Avez-vous approché cette société ?
M. François Goulard. D’après mes souvenirs, je ne l’ai jamais rencontrée. Peut-être mon cabinet l’a-t-il fait, mais je n’en suis pas certain. En tout cas, jamais nous ne nous sommes dit qu’elle pourrait voler au secours de la SNCM. Il y avait eu des discussions, compliquées avec La Méridionale. Elle répondait avec la SNCM à l’appel d’offres et, d’après mes souvenirs, elle n’aurait pas vu d’un bon œil n’importe qui entrer au capital de la SNCM, parce qu’elle avait des accords particuliers avec elle. Je n’ai rencontré personne d’autre qu’Henri Proglio et le président de STEF TFE.
M. le président Arnaud Leroy. Pas la CGM, qui était en phase de redémarrage ?
M. François Goulard. Je voyais régulièrement son dirigeant M. Saadé, bien sûr, mais, à ma connaissance, la CGA-CGM n’opérait pas dans le transport de personnes. A priori, elle ne faisait pas du tout le même métier. Il y a peut-être eu des contacts avec elle, mais elle n’a jamais été présentée non plus comme une piste.
M. Yves Albarello. Que vous inspire, monsieur le ministre, la comparaison entre la Méridionale et la SNCM qui font pourtant le même métier ?
M. François Goulard. La Méridionale se portait bien, car elle appartient à un groupe qui a toujours été bien dirigé et qui a de très bons résultats. Un univers bien différent de la SNCM, même si les deux entreprises étaient alliées pour une part de leur activité.
La SNCM avait un passé. Il est banal de dire que le dirigeant, c’est important pour une entreprise. Or l’État choisit mal les dirigeants des entreprises publiques. La tâche est délicate et on se trompe souvent. En définitive, qui décide, dans l’appareil d’État ? Quand il s’agit d’une très grande entreprise, la décision se prend au plus haut sommet de l’État, mais le responsable, le Président de la République ou le Premier ministre, y consacre quelques dizaines de minutes. Il va entendre un candidat, à la rigueur deux, entre deux rendez-vous. Dans le secteur privé, on passe énormément de temps à choisir un dirigeant. En plus, même si c’est le moins cas aujourd'hui, on avait tendance à choisir les dirigeants d’entreprise publique parmi les hauts fonctionnaires. Je l’ai été moi-même, j’ai été aussi dirigeant d’entreprise… Un haut fonctionnaire peut apprendre un métier différent, mais s’il n’a pas une expérience antérieure de l’entreprise, il est très mal placé pour diriger, surtout quand l’entreprise est difficile. L’État, c’est en tout cas mon point de vue, a la faiblesse de choisir souvent assez mal ses dirigeants. Je ne mets pas en cause le dirigeant de la SNCM de l’époque, qui jouait une partie extrêmement difficile. En outre, l’État est plus sensible qu’un autre actionnaire aux menaces de grève et de blocage de tous ordres. Il y a là une faiblesse structurelle par rapport à une entreprise comme La Méridionale, entreprise purement privée, dirigée par un homme qui est là depuis longtemps, qui connaît donc par cœur son entreprise. Le contraste ne m’étonne pas tellement et à aucun moment je n’ai jeté la pierre à qui que ce soit dans cette affaire car les gens qui avaient été nommés avaient hérité de situations peu enviables.
M. Dominique Tian. Pour revenir au contexte social explosif de l’époque, pouvez-nous confirmer le soulagement à la fois du monde politique, syndical et économique quand on a su qu’on allait peut-être sauver la SNCM ? Le sentiment général, il faut se le rappeler, c’était la crainte de la voir disparaître purement et simplement car tout le monde savait qu’il n’y aurait pas beaucoup de repreneurs pour se précipiter à son chevet.
M. François Goulard. Vous avez raison, de notre côté, nous étions soulagés de voir une entreprise importante intéressée, surtout que, quand on est au Gouvernement, ce sont des dossiers très délicats et qu’il existe des risques de dérapage. Après analyse, une seule issue nous paraissait possible, mais la nouvelle n’était pas particulièrement agréable à annoncer. À vrai dire, quand j’ai fait le déplacement à Marseille, le climat était très tendu : le préfet était aux abois et il était très inquiet.
Pour l’anecdote, on m’avait fait passer par l’arrière de la préfecture, après m’avoir fait faire un circuit invraisemblable dans Marseille, pour ne pas attirer les regards. Et, pendant la réunion, au début, quelqu’un a apporté à M. Frémont un papier des RG, lui annonçant : « trente manifestants sur la place, autant dans les cafés aux alentours ». Cela l’a rassuré, car la tension était très forte. Le dossier était considéré comme non stratégique au niveau gouvernemental, mais porteur de risque pour ceux qui avaient à annoncer la nouvelle, jugée mauvaise par de nombreux acteurs, de l’ouverture du capital.
M. le rapporteur. L’intérêt de Veolia pouvait être réel compte tenu de l’exemple de La Méridionale qui, avec le même type de bateau et la même délégation de service public, gagnait de l’argent. Restructurer offrait des perspectives, au-delà de l’inquiétude que suscitait une situation sociale hors norme.
M. François Goulard. Sur le moment, j’ai pensé que Veolia voulait se développer dans le transport maritime et, comme ce groupe était très présent auprès des collectivités, le fait d’apparaître comme le sauveur de la SNCM était sans doute valorisant pour lui, et stratégique pour d’autres branches de ses activités. C’était une façon de devenir incontournable dans cette partie de la France.
M. Gaby Charroux. Comment expliquez-vous alors que l’affaire n’ait pas abouti ?
M. François Goulard. Il m’est d’autant plus difficile de vous répondre qu’à partir du moment où j’ai quitté le poste de secrétaire d’État aux transports et à la mer, je n’ai plus jamais été consulté sur le dossier. Il m’est arrivé de le regretter car je le connaissais. Même si c’est assez classique, quand on change de responsabilité, il ne faut surtout pas essayer d’interférer dans les affaires placées sous la responsabilité de quelqu’un d’autre. Mais, à aucun moment, alors même que j’étais assez proche du Premier ministre, je n’ai été consulté sur le devenir de la SNCM. Je n’ai aucune information ; je sais seulement que Dominique Perben qui était devenu le responsable en charge du dossier, n’était pas assisté d’un secrétaire d’État aux transports et à la mer. Comme son ministère était assez lourd, il n’a probablement pas pu dans les premières semaines et peut être même les premiers mois, suivre ce dossier comme je l’avais fait puisque ma charge était moindre. On peut le regretter parce que le dossier était brûlant, qu’il était amorcé, et je me demandais si le ministre, « qui avait d’autres chats à fouetter », aurait la disponibilité nécessaire pour le suivre. C’est une simple réflexion et je n’ai aucun élément d’appréciation puisque, par la suite, je n’ai fait que lire la presse.
M. le président Arnaud Leroy. À votre époque, l’idée était de s’appuyer sur un véritable industriel, et, au final, c’est un fonds qui remporte l’appel d’offres et, quand on regarde les noms qui figuraient sur la short list, les fonds sont nombreux, malgré tout. Comment expliquez-vous un tel glissement ?
M. François Goulard. Je vais faire la même réponse qu’à votre collègue. Je peux seulement ajouter qu’à mon époque, on n’a jamais évoqué de fonds, du moins au ministère des transports. Peut-être l’hypothèse avait-elle été envisagée au ministère des finances. En tout cas, il n’y a jamais eu de réunion de ministres sur le sujet. Ce n’est pas exceptionnel, car il y a beaucoup d’affaires qui se traitent par des arbitrages entre cabinets à Matignon, mais, en cas de désaccord, les ministres se rencontrent souvent. Dans le cas de la SNCM, il n’y en a pas eu. L’idée d’un fonds financier, je ne l’ai vue surgir que postérieurement à mon départ. En tout cas, ce n’avait pas été l’analyse du ministère des transports pour lequel un apporteur de capitaux n’était pas la solution. Il estimait qu’il fallait absolument quelqu’un qui gère autrement cette entreprise parce que sa gestion était un enjeu majeur. Nous recherchions un opérateur industriel, par opposition à un opérateur financier. En tout cas, je n’ai été au courant d’aucun contact avec aucun fonds, d’aucune sorte.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur le ministre, nous vous remercions de vous être rendu disponible, et des informations que vous nous avez données.
g. Audition, à huis clos, de M. Francis Lemor, président du groupe STEF
(Séance du mercredi 18 septembre 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons maintenant M. Francis Lemor qui, après en avoir été longtemps président-directeur général, est désormais président du groupe STEF, premier groupe français et européen de logistique et de transport de produits alimentaires frais et surgelés.
La Commission d’enquête a souhaité vous entendre parce que, depuis 1992, La Méridionale, ex-Compagnie méridionale de navigation (CMN), fait partie du groupe STEF. Spécialiste de longue date du transport maritime en Méditerranée, La Méridionale est la seule compagnie partenaire de la SNCM dans l’exécution de la délégation de service public (DSP) de transport maritime entre Marseille et la Corse, service auquel elle affecte trois de ses quatre navires.
À ce titre, plusieurs éléments intéressent la Commission d’enquête.
Associée à la SNCM dans l’exécution de la DSP, La Méridionale n’a, semble-t-il, jamais envisagé de se porter candidate seule pour l’attribution de celle-ci, non plus que de s’allier à un autre partenaire, malgré les difficultés récurrentes de la SNCM. Pouvez-vous nous exposer les raisons de cette politique ?
En dépit de cette alliance étroite, lors de la privatisation de la SNCM, ni La Méridionale, ni le groupe STEF n’ont déposé d’offre de reprise. Quels sont les motifs de cette abstention ?
Enfin, basée à Marseille, partenaire historique de la SNCM, tirant l’essentiel de ses revenus de l’exécution de la DSP, La Méridionale ne semble pas souffrir des mêmes difficultés que la SNCM. Pouvez-vous nous donner quelques pistes sur les raisons d’une situation aussi différente ?
M. Francis Lemor prête serment.
M. Francis Lemor, président du groupe STEF. Messieurs les députés, pour vous faire comprendre le contexte, je présenterai rapidement le groupe STEF et La Méridionale, avant de m’attarder davantage sur l’opération de privatisation lancée fin 2004 et réalisée en 2006 ; puis, parce que les événements sont liés, sur l’obtention d’une délégation de service public sur la Corse pour la SNCM et La Méridionale, partenaires in fine dans cette opération. La privatisation avait en effet prévu une clause résolutoire, la soumettant à l’obtention de la DSP. Même si j’ai fait un effort pour me souvenir de cet épisode, qui a tout de même duré deux ans et demi, il appartient pour moi au passé – près de huit ans – et le temps a fait son œuvre.
STEF, vous l’avez dit, monsieur le président, est le spécialiste européen de la logistique sous température dirigée – de – 25° à + 15°. Nous transportons les produits agroalimentaires, et avons donc grosso modo deux grandes catégories de clients : l’industrie agroalimentaire et la distribution. Nous desservons des clients prestigieux tels que l’économat des armées – de terre, de mer et de l’air –, la gendarmerie, les services de santé mais aussi l’Assemblée nationale, le ministère de l’agriculture, l’école Polytechnique, etc.
Nous développons constamment notre métier de base, et il arrive, même si ce n’est pas très souvent, que nous reprenions des entreprises en difficulté. Aujourd'hui, le secteur du transport souffre beaucoup et nous devrions, sous réserve de l’accord de l’Autorité de la concurrence, qui devrait être donné avant la fin de la semaine, reprendre Ebrex, une entreprise qui emploie environ 1 100 personnes et qui connaît, comme la SNCM, mais pour des raisons différentes, des difficultés récurrentes depuis quinze ou vingt ans. Depuis vingt ans, notre groupe crée des emplois continûment : hors croissance externe, un emploi par jour bon an, mal an, soit 300 emplois chaque année.
La Méridionale a intégré le groupe à la mi-1992. Elle appartenait à l’époque en majorité aux familles Rousset-Rastit, qui l’avaient fondée. Je parlerai indifféremment de Compagnie méridionale de navigation ou de La Méridionale. En 1992, donc, ils ont souhaité organiser sa transmission patrimoniale. Le fils Rousset était à l’époque directeur général de la Compagnie et son père, Jean, m’avait demandé de venir l’aider – au travers de la petite structure que je dirigeais, La Financière de l’Atlantique, appartenant au groupe de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF) – à organiser sa succession. Simultanément, la CGM, qui détenait une participation de 49 % dans la CMN, souhaitait s’en retirer pour préparer sa propre privatisation qui s’est réalisée deux ans plus tard. Nous avons donc repris cette participation et assurons le management de l’entreprise depuis 1992.
La Méridionale dessert la Corse depuis 1936, et depuis 1976, dans le cadre de la continuité territoriale, instituée à la suite des événements dramatiques d’Aléria. Vous en connaissez le principe : assimiler le bord à bord à son équivalent ferroviaire continental, c'est-à-dire, concrètement à un Paris-Rennes. Pour ce faire, une convention de vingt-cinq ans a été passée à l’époque entre l’État – le transfert à la collectivité territoriale de Corse s’est fait à la suite de la loi Joxe – et, d’une part, la SNCM et, d’autre part, La Méridionale. Depuis 2002 et l’obligation de passer par un appel d’offres européen, nous avons ce que l’on appelle des délégations de service public, dont l’attribution a été confiée à la collectivité territoriale de Corse, qui agit par l’intermédiaire de son bras séculier, l’Office des transports de la Corse. Nous terminons à la fin de l’année le deuxième contrat de délégation de service public – que nous exerçons conjointement et de manière non solidaire avec la SNCM. Il succédait à celui qui couvrait la période 2002-2006.
La Méridionale opère à partir de trois ports : Ajaccio, Bastia et Propriano, avec une extension sur Porto Torres en Sardaigne. Cet appendice est d’ailleurs en lien avec la DSP dans la mesure où, à l’origine, il s’agissait d’une demande expresse de l’exécutif de Corse.
Nous n’avons et n’avons jamais eu que des cargos mixtes. Il y a dix ans déjà, et a fortiori il y a cinq ans, lors de la privatisation de la SNCM, il était clair que les car ferries n’avaient plus d’avenir : ils ont une vocation essentiellement touristique et ne conviennent donc pas pour le service public qui impose une fréquence de desserte. C’est une façon de répondre à votre question sur les raisons de notre non-intervention dans le processus de privatisation.
J’ai été informé très en amont, dès septembre 2004. Monsieur François Goulard est le premier à m’avoir parlé de la privatisation ; puis, de manière plus détaillée, son cabinet et, à deux reprises, celui du ministère de l’économie ; enfin, celui du Premier ministre. Les échanges se sont déroulés jusqu’en décembre 2004.
Je connaissais un peu la SNCM puisque j’ai été pendant dix ans directeur financier de la CGM et, à ce titre, administrateur de la SNCM. Lorsqu’il s’est agi de recomposer le capital de La Méridionale, j’ai accepté de participer à l’opération, mais, dans la petite holding qui était la nôtre, la Financière de l’Atlantique, nous avions à l’époque fort peu d’argent. M’en plaignant auprès du président de la CGMF, et il m’a répondu que, comme je gérais la trésorerie abondante de la SNCM, je savais où me servir. Nous avons donc fait une opération à plusieurs étages si bien que la SNCM a mis de l’argent, mais qu’elle n’a jamais eu d’influence au sein de La Méridionale. Par savoir-vivre, nous lui avons donné un ou deux postes d’administrateur, mais elle ne s’est jamais intéressée à La Méridionale, si ce n’est de façon négative.
Tous les interlocuteurs qui m’ont informé de la privatisation voulaient absolument nous voir intervenir. J’ai tenu le même langage à tous, à savoir qu’il fallait impérativement clarifier l’actionnariat de La Méridionale. C’était moi qui avais fait entrer la SNCM à son capital parce que nous n’avions pas d’argent. Il y en avait alors un peu plus et c’était l’occasion de clarifier tout ça. Ensuite, nous passerions un accord pour répondre à l’appel d’offres. J’avais donné ma parole et j’étais prêt à la confirmer par écrit. Troisième étage du schéma : après avoir obtenu – non sans mal – des administrateurs, nous prendrions une participation dans la SNCM privatisée à la condition expresse qu’elle soit inférieure à 10 %, que l’on n’intervienne jamais dans le management, et surtout que l’on n’y détache jamais personne. J’étais très réticent – et tous nos administrateurs aussi – à l’idée de mêler notre image à celle de la SNCM.
Cela dit, le repreneur pressenti et, semble-t-il, considéré comme le plus apte était Butler, qui n’avait aucune légitimité et il souhaitait avoir une petite parenté industrielle dans les transports. Nous avions accepté sous réserve que les conditions soient remplies.
En décembre 2004, la SNCM a connu de nouvelles difficultés de trésorerie et un mandataire ad hoc a été nommé. C’est à ce moment-là que j’ai été informé de la privatisation à venir.
Début 2005, l’État se fait conseiller par la banque HSBC. Le 31 janvier, le Premier ministre décide la privatisation. Nous avons été approchés par le banquier le 3 février à qui j’ai répété les conditions, en en ajoutant une de plus : nous ne pouvions pas intervenir dans une société exploitant des car ferries. Nous ne connaissions évidemment pas à l’époque la décision du tribunal concernant la notion de service public rendu, ou pas. Mais, déjà à l’époque, et sur un plan strictement économique, il n’y avait plus aucune raison pour que circulent des car ferries. Aucune de nos propositions n’a été acceptée et nous avons décidé de ne pas retirer de dossier d’appel d’offres et n’avons pas signé le dossier de confidentialité qui allait avec.
Nous n’avons donc pas été partie prenante au processus de privatisation. Néanmoins, nous avons été approchés à plusieurs reprises pour nous proposer des schémas divers et variés, dont aucun n’était susceptible de nous convenir, faute de crédibilité.
Jusqu’à une réunion du 20 juillet 2005, au cours de laquelle Butler Capital, qui était très demandeur d’un accord de coopération technique avec nous – il ne connaissait rien au maritime –, finit par accepter nos propositions. Verbalement. Comme je lui demandais de rédiger entre nous un petit protocole, il a refusé obstinément. L’accord qui m’avait été donné a été réitéré le 9 septembre, en présence de Walter Butler, de Claude Gressier, qui avait été mandaté en qualité d’expert pour suivre la privatisation, de l’Agence des participations de l’État (APE), de la banque HSBC, et du président de la CGMF. Tout le monde était d’accord sur le schéma que j’avais proposé. Vous connaissez la suite. Matignon s’est saisi du dossier, des grèves dures ont éclaté à la SNCM, les ministres des finances et des transports se rendent à Marseille. Sans résultat. Matignon provoque une réunion le 28 au soir, dont j’apprendrai les conclusions vers deux heures du matin : recomposition du capital autour de Butler, Veolia, l’État et les salariés. Entre-temps, Walter Butler avait oublié la parole qu’il m’avait donnée… Dans le maritime, parole d’armateur vaut un écrit. J’avais oublié que je ne parlais pas à un armateur.
La SNCM a été privatisée le 31 mai 2006.
Tant que l’État était au capital de la SNCM par le truchement de la CGMF, nous avions des relations normales avec la SNCM. Nous avons toujours trouvé des accords dans l’intérêt des deux entreprises même si notre préoccupation a toujours été de nous prémunir contre l’agitation sociale qui existait chez nos partenaires. Que la représentation nationale le sache, ce faisant, nous avons aussi protégé nos personnels. Je le dis notamment à l’intention du président de l’exécutif de Corse, il nous est arrivé souvent, et encore récemment, d’organiser nous, direction générale de La Méridionale, les mouvements de soutien qui conviennent pour préserver nos personnels. C’est fâcheux, mais indispensable compte tenu des enjeux.
La privatisation, et plus encore la trahison de la parole donnée, ont complètement changé la donne. On s’en est très vite aperçu. La relation de confiance étant rompue, s’en est suivie une kyrielle de conflits entre les trois armateurs – Corsica Ferries, à l’origine de nombreux recours judiciaires, la SNCM et nous. En ce qui nous concerne, nous n’avons saisi qu’une fois l’Autorité de la concurrence.
Le premier plaideur fut la SNCM. Le 4 août 2006, le jour même du dépôt de candidature à la DSP, la SNCM, actionnaire minoritaire de la CMN, nous a assignés devant le tribunal de commerce de Paris pour nous exproprier, c'est-à-dire pour obtenir la vente forcée des actions de STEF dans La Méridionale, en vertu d’un pacte très ancien que nous avions dénoncé six mois plus tôt, et qui n’avait donc plus cours. Le 17 octobre 2006, ce tribunal, dont vous apprécierez en l’espèce l’exceptionnelle célérité, a donné satisfaction à la SNCM et contraint STEF à céder la totalité de sa participation dans La Méridionale à la SNCM. Ce jugement rocambolesque a évidemment été infirmé par les magistrats professionnels de la cour d’appel, puis définitivement par la Cour de cassation.
La période intermédiaire a été très difficile à vivre, mais, dans sa précipitation à rendre service au demandeur, le tribunal de commerce de Paris avait commis une erreur grave qui a empêché le transfert des actions. Les juges avaient statué ultra petita, le transfert de quelques pour-cent du capital donnant la majorité à la SNCM ne posait pas de problème en termes de concurrence, mais un transfert total de la participation devait faire l’objet d’une instruction préalable de l’Autorité de la concurrence, à l’époque la DGCCRF. Nous avons saisi immédiatement le ministre de l’économie, M. Breton, pour lui signaler dans une lettre fort détaillée que je vous laisserai, que, s’il passait outre, il engageait la responsabilité de l’État. Le jugement du tribunal de commerce de Paris était donc inexécutable.
Le parcours de la délégation de service public n’a pas été plus simple. La SNCM avait considéré l’expropriation comme un acquis ; elle a donc répondu à l’appel d’offres sans la CMN, mais en s’appropriant ses trois navires qui n’étaient pas nommés – en jargon maritime, on parle de navires « TBN » pour to be nominated – mais qui présentaient exactement les mêmes caractéristiques. De toute façon, il n’y en avait pas d’autres sur le marché. La CMN, informée très en amont, n’a eu d’autre choix, dans un premier temps, que de se tourner vers Corsica Ferries pour faire échec à cet appel d’offres. L’appel d’offres a été déclaré infructueux en décembre 2006 et un autre a été lancé en janvier suivant.
Contre l’avis de tous mes proches, y compris à La Méridionale où l’on ne comprenait pas bien mon attitude, j’ai renoncé à persévérer dans une voie qui menait à une impasse. Une fois mise en échec la tentative grossière de mettre la main sur nos navires, j’ai décidé de répondre avec la SNCM à l’appel d’offres. Le message a eu du mal à passer, tant à Paris qu’à Marseille, mais chacun a fini par comprendre l’enjeu. Nous avons donc établi un protocole avec la SNCM. En janvier 2006, nous avons appris aussi l’existence de la clause résolutoire qui permettait l’annulation de la privatisation en cas de non-obtention de la délégation de service public.
Il n’était pas question pour nous de nous opposer à la privatisation de la SNCM. Pour nous, ce n’était pas un sujet. Nous avions vécu avec l’État comme actionnaire unique, nous pouvions continuer avec une société privatisée.
Pour ne pas ajouter au désordre et pour permettre la desserte de la Corse, on a donc décidé unilatéralement – et la SNCM n’attendait que cela – de participer à l’appel d’offres de manière conjointe et non solidaire pour la période juillet 2007-décembre 2013. Nous l’avons emporté et la décision contestée par Corsica Ferries a été validée par le Conseil d’État.
L’épilogue a été, deux ans plus tard, en juin 2009, a été, pour des raisons de trésorerie, la revente à la STEF par la SNCM de la totalité de ses parts dans La Méridionale. Tout ça pour ça !
M. le président Arnaud Leroy. Je vous remercie pour la clarté, la précision et la richesse de votre exposé, Monsieur Lemor, dont je retiens que vous avez su très tôt que Butler était pressenti et qu’il vous a approché bien avant la clôture officielle de la privatisation. C’est important pour nous parce que le discours politique affiche la volonté de s’appuyer sur un opérateur industriel. Pourtant, très en amont, c’est un fonds qui tente de nouer des relations industrielles, reconnaissant par là sa faiblesse. Par ailleurs, vous n’avez mentionné que très brièvement Veolia qui nous est souvent présentée comme le partenaire essentiel, un temps privilégié, qui a tourné casaque du jour au lendemain, M. Richard prenant des engagements oraux auprès de M. Gressier, et un conseil d’administration extraordinaire décidant de ne pas donner suite.
Quelles ont été vos relations dans ce dossier ? Vous avez rencontré M. Goulard, secrétaire d’État aux transports à l’époque, le ministre d’État et le Premier ministre. A-t-on tenté de vous rapprocher de Veolia pour constituer un pôle industriel qui aurait eu du sens ?
M. Francis Lemor. Le contact avec M. Goulard a été très bref. Après m’avoir informé de la privatisation, il m’a dit que la CMN devait évidemment s’y intéresser. Peu de temps après, il a d’ailleurs annoncé à la représentation nationale qu’on allait privatiser la SNCM et que le groupe STEF TFE pourrait être candidat à la reprise. J’avais immédiatement appelé son cabinet pour lui faire savoir qu’il n’était pas autorisé à dire devant les parlementaires que STEF allait racheter la SNCM.
J’ai rencontré Walter Butler pour la première fois, le 22 juin 2005. Il savait bien que sa capacité à gérer l’entreprise était voisine de zéro. Le fonds d’investissement n’avait pas de manager pour diriger une société en situation délicate, alors que la règle veut que l’on change les dirigeants en pareil cas. Il cherchait donc à se rapprocher d’équipes valables. Trois semaines plus tôt, j’avais reçu Stéphane Richard qui m’avait expliqué qu’il souhaitait absolument intervenir dans cette affaire. Je lui avais posé quelques questions pour savoir s’il connaissait le transport maritime, et il m’avait dit faire un peu de cabotage en Europe du Nord ! J’ai attiré son attention sur le fait que ce n’est pas la même chose de gérer des petits bateaux inter-îles. « Nous sommes des spécialistes de la DSP », m’a-t-il fait valoir. Je n’avais plus rien à ajouter.
Walter Butler cherchait à constituer un tour de table industriel. Henri Proglio, que j’ai rencontré le 1er septembre 2005, et à qui j’ai dit que nous serions bientôt confrères grâce à la Corse, m’a répondu : « Ça, jamais ! Je fais d’ailleurs voter à mon conseil d’administration, la semaine prochaine, une résolution m’interdisant de m’en mêler ». C’est bien ce qu’il a fait. Veolia n’était pas candidat. Le conseil a dû se tenir le 8 septembre.
J’ai vu Butler à plusieurs reprises, je lui ai expliqué qu’il aurait intérêt à se rapprocher de professionnels, que je ne voulais pas apparaître parce que le schéma industriel ne me convenait pas mais qu’il avait un partenaire tout désigné en la personne de Stéphane Richard, qui avait envie d’y aller. Pourquoi pas une opération à trois, avec Veolia, dans laquelle nous resterions très minoritaires, voire en dehors ? Il m’a répondu : « Veolia, jamais ! ». Effectivement, Veolia n’a pas été candidat, mais il a été ramené dans la course dans la nuit du 28 au 29 septembre. C’est ce que j’ai vu et j’ai eu suffisamment de contacts avec les uns et les autres pour savoir ce qui s’est passé.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Non seulement votre exposé était remarquable, mais vous avez gardé des souvenirs très précis !
J’ai été surpris de la valorisation de la SNCM par l’État. Après le versement des aides d’État, la situation était, à mon sens, la suivante : des bateaux en bien meilleur état que maintenant, qui avaient une valeur non négligeable, une société redevenue in bonis grâce à une recapitalisation à hauteur des pertes cumulées, et un plan social « sur-provisionné » – l’État avait mis sous séquestre les sommes nécessaires et Stéphane Richard m’avait expliqué qu’elles ne seraient pas entièrement consommées. Pourtant, la valorisation a permis à M. Butler d’acheter les actions à un prix manifestement sous-évalué puisque, quelque temps après, quand il a cédé ses parts, il a fait une plus-value de l’ordre de 58 millions d’euros.
M. Francis Lemor. J’ai les chiffres exacts et je vous les laisserai.
Nous aussi, nous avions fait nos propres calculs, parce que nous communiquions avec Bruxelles à l’époque, et l’évaluation se comptait en centaines de millions d’euros. Nous avions évalué les actifs à 347 millions, mais ils étaient contrebalancés par des passifs tels que les pertes récurrentes. Le plan social ne couvrait qu’une partie du handicap de la société qui ressemblait au tonneau des Danaïdes, en premier lieu à cause des car-ferries, surtout tant que le printemps arabe n’avait pas eu lieu. Le passif était difficile à estimer et la prise de risque était importante.
Vous me demandiez comment on en est arrivé là. Je pense qu’il n’y a pas eu grand-chose de fait depuis. Engager une opération comme la privatisation en laissant les choses en l’état, c’est une mauvaise façon et c’est faire fi de l’attente de tous les personnels sans exception, y compris des plus virulents qui s’attendaient aussi à ce que les choses changent vraiment pour retrouver de la rentabilité. J’ai dit à Walter Butler et à Henri Proglio qui a été administrateur de notre société – j’avais plutôt tendance à éviter les contacts avec Stéphane Richard – qu’ils n’avaient rien fait. Walter Butler me renvoyait à Henri Proglio au motif qu’il ne manageait pas, et Henri Proglio n’était pas favorable à la reprise de la SNCM contre laquelle il a fait voter son conseil d’administration. Tout est dit. C’est un mauvais film qui a duré deux ans et demi, et qui a écourté beaucoup de mes nuits.
M. le président Arnaud Leroy. Il nous a été dit que le pacte d’actionnaires avait poussé Butler à la vente, parce qu’il bloquait l’achat d’un nouveau navire nécessaire à l’exécution de la DSP. Qu’en pense le spécialiste que vous êtes ?
M. Francis Lemor. Il n’y avait absolument pas nécessité d’acheter un navire pour répondre à l’appel d’offres. L’objectif poursuivi par Veolia, par Stéphane Richard plus précisément, c’était, faute d’avoir pu mettre la main sur les navires de La Méridionale, d’essayer de la contourner par des achats extérieurs. Mais le marché des navires d’occasion est tout à fait particulier. Il s’agit d’un marché mondial, très étroit, et les courtiers savent instantanément, en fonction des caractéristiques, combien d’unités dans le monde correspondent aux besoins. C’est parce que nous n’avions pas trouvé une occasion que nous avons construit le Piana pour desservir Bastia dont le port ne peut accueillir des bateaux de plus de 180 mètres de long et 30 mètres de large. La SNCM, dans son élan, a acheté un navire, le Jean Nicoli, mais elle s’est rendu compte, quand il est arrivé en Méditerranée, qu’il faisait 210 mètres. Il a été par la suite vendu à SeaFrance. Mais il n’y avait pas de nécessité d’acquérir un navire pour répondre à l’appel d’offres.
Quant à l’évolution de la flotte, ce n’est peut-être pas l’objet de la commission d’enquête.
M. Yves Albarello. Je commencerai par vous féliciter, vous qui êtes un véritable professionnel. Passager, à plusieurs reprises, de vos navires, j’ai toujours reçu un accueil sympathique, digne d’une relation client-fournisseur normale, contrairement à ce que j’ai connu chez votre principal concurrent où j’étais traité en simple utilisateur. Or les bons chefs font les bons ouvriers. Et j’ai plusieurs témoignages qui vont dans le même sens. La Méridionale est donc une société bien gérée.
Comment expliquer qu’il y ait d’un côté une société assurant la continuité territoriale depuis de nombreuses années et qui est profitable et, de l’autre, un « tonneau des Danaïdes » ?
Les 347 millions d’actifs ne sont-ils pas surévalués puisque les matériels ne sont pas adaptés à l’usage auquel ils sont destinés ?
M. Francis Lemor. Je n’oublie pas que je suis partenaire de la SNCM pour l’appel d’offres de la future DSP, dont j’espère qu’elle sera signée la semaine prochaine s’il n’y a pas de référé précontractuel.
La réponse est implicitement contenue dans votre question, monsieur le député. Il faut d’abord tenir compte du coût du matériel naval qui est terriblement sous-utilisé à la SNCM. Les quatre cargos mixtes de la SNCM sont, contrairement à ce qui se dit, parfaitement adaptés à la Corse et les changer obérerait définitivement l’avenir. L’un d’entre eux est d’ailleurs le sistership de notre Kalliste. Il y a toutefois une exception, le Monte d’Oro qui dessert la Balagne, et qui devra être remplacé dans trois ou quatre ans. Mais, à côté, il y a les car-ferries qui, même s’ils ont été fortement subventionnés par la collectivité de Corse, ont été sous-utilisés et sont définitivement non rentables. L’activité sur l’Afrique du Nord a quelque peu souffert, mais l’exploitation est rentabilisable. Elle l’était quand j’étais administrateur de la SNCM.
Et il y a tout le reste qui mérite d’être revu du grenier à la cave.
S’agissant des personnels, le modèle de la SNCM a vécu. Il a même bien vécu à certaines périodes, mais avec de l’argent public.
M. Yves Albarello. C’est rendre service que de le dire.
M. Francis Lemor. Une entreprise qui a des problèmes, elle les met sur la table et elle les règle et on avance. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis.
À La Méridionale, nous avons, par rapport à la convention collective, un régime plutôt généreux avec les personnels. Personne ne s’en plaint et je ne reviendrai pas sur les acquis jugés raisonnables. Aujourd'hui, les conditions d’armement de La Méridionale sont un peu le benchmark du marché. Si nous les transposons à la SNCM, les choses changent complètement.
Le groupe n’a pas toujours intégré des sociétés faciles, mais elles ont toujours fini par assimiler notre culture. Au moment de la privatisation de la SNCM, j’ai dit à notre délégué syndical CGT d’aller faire un tour à Marseille, rencontrer ses camarades et de me dire ce qu’il en pensait. « Président, vous ferez ce que vous voudrez, m’a-t-il dit à son retour, avec l’accent, mais ceux-là, ils n’ont vraiment pas la culture et vous n’arriverez pas à les intégrer dans le groupe ». C’était exactement ce que je pensais. Pour changer l’état d’esprit d’une maison, on n’agit pas petitement, à la marge. On donne un schéma clair, précis, en n’occultant rien. La meilleure preuve de respect envers le personnel est de lui dire la vérité, toute la vérité. Ensuite, on décide. C’est ce qui aurait dû être fait et ce qui ne l’a pas été.
Ajoutez à çà d’autres travers. Aujourd'hui, on ne respecte même plus les engagements écrits. Mais je ne veux pas en dire plus, parce que nous allons signer ensemble la semaine prochaine et je ne veux pas en rajouter.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Il a toujours été clair dans notre esprit qu’entre le modèle de Corsica Ferries et celui de la SNCM, il y en avait un autre, intermédiaire, dans lequel le personnel n’était pas malheureux et travaille bien, même s’il est moins nombreux.
Sur le fond, s’agissant du service complémentaire, vous soulignez l’incongruité économique de ce service, avec des bateaux dont le taux de remplissage ne dépasse pas 35 % ou 38 %. C’est la raison pour laquelle, bien avant la condamnation juridique, nous y avions renoncé.
Revenons à certaines de vos expressions. Vous aurez compris que nous n’avons jamais cru qu’Henri Proglio avait été désavoué par son conseil d’administration. En tout cas, je retiens sa formule, de « se faire interdire d’y aller ».
M. Francis Lemor. Il a voulu s’abriter derrière un paravent juridique. Nous nous sommes retrouvés au conseil d’administration d’HEC et nous nous sommes parlé. Il m’a dit en effet qu’il allait se faire interdire par son conseil d’y aller. Il n’avait aucune envie d’y aller, mais son adjoint, lui, en mourait d’envie.
M. le rapporteur. Vous avez dit ensuite qu’Henri Proglio avait été « ramené dans la course ». Comment a-t-on pu le faire changer d’avis et comment l’État l’a-t-il amené à lui faire « faire son devoir » ?
M. Francis Lemor. Même avec toute la force de persuasion de l’État, il n’a pas dû être facile de faire revenir le conseil d’administration sur sa décision, à moins d’avoir des arguments concrets. Veolia est un grand groupe qui couvre beaucoup de métiers, y compris dans l’énergie.
M. le rapporteur. Pour faire avaler la pilule, il a fallu autre chose que la simple pression.
M. Francis Lemor. Un mandataire social ne peut pas intervenir si la société qu’il représente n’a pas un intérêt à agir.
M. le président Arnaud Leroy. Nous vous remercions, Monsieur le président, de la précision et de la franchise de vos propos.
h. Audition, à huis clos, de M. Denis Samuel-Lajeunesse, directeur général de l’Agence des participations de l’État (2004-2006) et de M. Jean-Louis Girodolle, sous-directeur du transport à l’Agence des participations de l’État (2003-2006)
(Séance du mercredi 25 septembre 2013)
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd’hui M. Denis Samuel-Lajeunesse qui fut, entre 2003 et 2006, directeur général de l’Agence des participations de l’État (APE), et M. Jean-Louis Girodolle, sous-directeur du transport à cette même agence de septembre 2003 à septembre 2006.
Messieurs, dans ces fonctions qui étaient alors les vôtres, vous vous êtes trouvés en première ligne du processus de privatisation de la SNCM. À ce titre, les questions que nous avons à vous poser sont nombreuses.
D’abord, l’Agence des participations de l’État avait sûrement fait procéder à une évaluation de la valeur de la SNCM. Était-ce le cas et, si oui, quels en étaient les termes ? Cette évaluation incluait-elle la perspective d’obtention de la délégation de service public (DSP) ?
L’Agence devait-elle rechercher une privatisation totale de la SNCM ou plusieurs hypothèses étaient-elles ouvertes ?
Quelles garanties l’État offrait-il ? S’était-il assuré de la compatibilité des conditions de la vente avec les règles de l’Union européenne ?
Enfin, comment l’État a-t-il réagi lorsqu’il s’est aperçu que, parmi les candidats à la reprise, figuraient seulement deux fonds d’investissement et aucun armateur ? Je précise que M. Lemor, président de la STEF, nous a indiqué avoir envisagé de participer avec M. Butler, mais en seconde ligne, à la reprise de la SNCM, mais que ce dernier n’avait pas satisfait aux conditions posées.
M. Denis Samuel-Lajeunesse et M. Jean-Louis Girodolle prêtent serment.
M. Denis Samuel-Lajeunesse, directeur général de l’Agence des participations de l’État (2004-2006). L’Agence des participations de l’État (APE) a été créée à la suite du rapport d’un groupe de travail dirigé par M. Barbier de La Serre, remis au mois de mars 2003 au ministre de l’économie. L’objectif de l’APE a été d’assumer toutes les responsabilités d’un actionnaire vis-à-vis de l’ensemble des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, d’être l’interlocuteur unique des dirigeants des entreprises, de valider et suivre la mise en œuvre de la stratégie des entreprises, de rechercher la valorisation du patrimoine de l’État, de rendre des comptes aux ministres et d’informer le Parlement de la situation du secteur public et de chacune des entreprises concernées.
L’ensemble des entreprises publiques a gagné, en 2004, 7,6 milliards d’euros et, en 2006, 13,2 milliards, après avoir perdu plus de 10 milliards en 2002. En 2006, la dette nette de l’ensemble des entreprises publiques a représenté une fois et demie leurs fonds propres, contre huit fois en 2002. À la même période, le budget de l’État a encaissé plus de 45 milliards – dont 40 milliards au titre des privatisations, le solde en dividendes. En dépit de ces privatisations, le patrimoine coté de l’État, qui était inférieur à 10 milliards à la fin de l’année 2002, était supérieur à 180 milliards d’euros quand j’ai quitté mes fonctions !
L’objectif de l’APE était, à mes yeux, d’aider les entreprises publiques à grandir pour en faire des champions européens, voire mondiaux. Il s’agissait donc de passer d’entreprises jugées autrefois mineures sous tutelle de l’État à des entreprises majeures en dialogue constructif avec un État actionnaire de longue durée. Aussi notre mission consistait-elle à assurer le développement de toutes ces entreprises dans le cadre de la valorisation du patrimoine de l’État.
Nous avons participé au sauvetage d’Alstom, au rapprochement d’Air France avec KLM, à la fusion entre la Snecma et Sagem – qui a donné lieu à la création de Safran, une très belle entreprise aujourd’hui –, au rapprochement de Gaz de France et de Suez, à l’intégration d’Orange et de Wanadoo au sein de France Telecom ou encore à la transformation de GIAT en Nexter. Nous avons participé à la modernisation de nombreux établissements publics, devenus de vraies sociétés, en particulier EDF, Gaz de France, le Laboratoire du fractionnement et des biotechnologies, les Monnaies et médailles, Aéroports de Paris (ADP). Nous avons toujours eu le souci de mener ces opérations sous l’autorité du ministre, et de la façon la plus transparente possible, ce qui a impliqué plusieurs changements : l’établissement et la publication d’un rapport annuel de l’État-actionnaire, incluant des comptes consolidés de l’ensemble des entreprises publiques ; la création d’un site Internet de l’APE, retraçant la vie de l’Agence et celle des entreprises dont elle a en charge le suivi; et le maximum de transparence vis-à-vis du Parlement, puisque nous avons été auditionnés chaque année par la commission des finances de l’Assemblée nationale et celle du Sénat.
Nous avons tenté de sauver – je serais tenté de dire, malgré elle – la SNCM. Malgré nos efforts, ce fut un échec collectif – même après 2006, après un début d’espoir.
Avant la création de l’APE, une première tentative de redressement de l’entreprise était intervenue, avec un plan en 2002-2003 qui avait entraîné une première recapitalisation pour le compte de l’État par l’actionnaire CGMF, à hauteur de 70 millions d’euros. Ce premier plan de redressement a échoué puisque les résultats de 2004 et 2005 ont été négatifs d’environ 30 millions d’euros. À la fin de 2005, la trésorerie était négative de 70 millions d’euros, et la dette représentait près de trois fois les fonds propres.
Les règles européennes de concurrence ne nous donnaient pas d’autre choix que de privatiser l’entreprise, avec la possibilité de la recapitaliser une nouvelle fois au préalable. C’est ce que nous avons fait, en prenant toutes les précautions possibles sur les plans déontologique, juridique, légal et économique, en essayant de trouver les meilleurs actionnaires possibles. Une banque conseil, HSBC, a été sélectionnée par un comité présidé par M. Deguen ; une personnalité qualifiée. M. Claude Gressier, a été désignée pour suivre le processus et en attester la qualité à toutes les étapes ; la Commission des participations et des transferts a été sollicitée par le ministre et associée étroitement à l’ensemble du processus puisqu’elle nous a auditionnés cinq fois en quinze mois. Toutes ces opérations ont été réalisées sous le contrôle du ministre et de son cabinet, ainsi que du Premier ministre en collaboration étroite avec le ministère des transports.
Je précise que nous avons eu un dialogue régulier avec la Commission européenne, en l’informant en permanence, le plus souvent par l’intermédiaire des cabinets, de façon à donner le maximum de chance au dossier d’être approuvé, ce que nous avons obtenu en juillet 2008.
Le dossier de la SNCM a été adressé par HSBC à soixante-douze investisseurs potentiels : des fonds, mais aussi un grand nombre d’armateurs. Une quinzaine d’investisseurs ont demandé et reçu le document complet établi par la banque conseil, décrivant la situation et les perspectives de la SNCM. Cinq investisseurs sont entrés dans l’étape suivante, leur donnant accès à ce qu’on appelle la data room, où sont rassemblés tous les documents leur permettant d’étudier le dossier en détail. Tout cela s’est déroulé au printemps. Fin juillet, trois offres étaient sur la table : celles de Butler Capital Partners (BCP), de Caravelle et d’un opérateur de transport, Connex.
Malheureusement, en septembre, jour de remise des offres finales, Connex s’est vu interdire le matin même par le conseil d’administration de Veolia de remettre son offre. L’État s’est donc retrouvé avec deux offres sur la table, celles de Walter Butler et du fonds Caravelle. Et le choix du Gouvernement s’est porté sur Butler Capital Partners qui, sur le plan financier, présentait sinon la meilleure, du moins la moins mauvaise des offres.
Tout cela s’est déroulé dans un contexte de forte tension sociale, avec des épisodes presque tragiques. Pendant toute cette période, le Gouvernement a eu le souci d’informer en permanence les organisations syndicales, de nombreuses réunions se sont ainsi tenues en préfecture pour informer les salariés sur la situation de l’entreprise et de son actionnaire.
Compte tenu des réactions des organisations syndicales et des salariés, ainsi que de la bonne volonté de BCP, l’accord final s’est fait non sur une reprise à 100 %, mais, Connex ayant accepté de revenir, sur une répartition du capital entre BCP à 38 %, Connex à 28 %, l’État à 25 % via la CGMF, et les salariés à 9 %.
Cette procédure a été réalisée en étroite collaboration avec le tribunal de commerce. Après deux séries d’alerte des commissaires aux comptes, le président du tribunal de commerce a désigné un mandataire ad hoc, puis convoqué une nouvelle fois, fin août, le président de la SNCM. Celui-ci et le commissaire du Gouvernement lui ont indiqué qu’une solution était en train d’aboutir. Néanmoins, jusqu’au dernier moment, le Gouvernement et l’APE ignoraient si une solution pourrait déboucher. Jusqu’au dernier jour, la seule alternative était, à défaut d’arrêt des grèves, le dépôt de bilan, lequel a été évité grâce à cette solution associant BCP à un opérateur de transport, Connex.
Des évaluations ont été réalisées par la banque conseil et validées le moment venu par la commission des participations et des transferts. Elles tenaient compte de la perspective d’obtention de la DSP, et c’est bien parce que celle-ci n’était pas encore acquise qu’une clause résolutoire a été prévue en contrepartie.
À ma connaissance, il n’y a pas eu d’autre hypothèse que la privatisation : il nous semblait que le souhait était plutôt une privatisation à 100 %. Néanmoins, nous n’excluions rien, l’essentiel étant de trouver des investisseurs. À titre personnel, j’ai toujours pensé que, dans un tel cas, l’État, en restant au capital, se trouve en quelque sorte « prisonnier » et devient susceptible d’être soumis à de nouvelles pressions si les choses tournent mal.
Un certain nombre de garanties offertes par l’État étaient prévues. Notre souci principal était d’avoir un processus compatible avec les règles européennes.
Les nombreux armateurs sollicités n’ont pas souhaité donner suite. S’agissant des discussions entre STEF et Butler, j’ai suivi ce dossier d’un peu plus loin, mais Jean-Louis Girodolle pourra vous en dire davantage.
M. Jean-Louis Girodolle, sous-directeur du transport à l’Agence des participations de l’État (2003-2006). J’ai été nommé sous-directeur à l’APE en charge de l’ensemble des entreprises de transport et infrastructures en septembre 2003, fonctions que j’ai quittées en décembre 2006. J’ai suivi de très près le dossier SNCM et j’y ai consacré beaucoup de temps, en participant au processus de privatisation et à l’ensemble des discussions en préfecture de région, sous la présidence conjointe des préfets, MM. Frémont et Lemas, puis des deux ministres, MM. Breton et Perben. Ce dossier m’a d’ailleurs amené à vivre des épisodes uniques dans ma carrière administrative compte tenu de ma volonté de faire réussir le sauvetage de cette entreprise dont on connaît l’importance pour l’économie des deux collectivités. À l’époque, les quelques personnes travaillant sur ce dossier avaient conscience des enjeux économiques, politiques et sociaux et aucune n’a économisé son énergie ni son imagination pour y parvenir.
Malheureusement, la SNCM a toujours connu des difficultés depuis l’ouverture du marché à la concurrence. Sa part de marché sur la desserte Corse-continent est passée de plus de 80 % en 2000 à 34 % au moment des opérations dont nous parlons, en raison notamment de la très forte concurrence de Corsica Ferries. Pour une entreprise souffrant de rigidités – une flotte abondante et pas toujours adaptée, des difficultés à engager des réformes internes –, voir sa part de marché divisée par deux et demi en l’espace de cinq ans est un choc massif dont quasiment aucune entreprise ne se pourrait se relever. C’est ce qui explique les 70 millions de découvert à la fin de 2005 et des dettes à hauteur de 220 millions face à des fonds propres de 60 millions.
Durant toute la période où je l’ai suivie, cette entreprise n’a cessé de connaître des difficultés. Le plan industriel négocié en 2001 et accompagné d’une recapitalisation d’environ 70 millions n’a pu être mis en œuvre. En effet, le chiffre d’affaires n’a pas suivi la trajectoire prévue, du fait essentiellement de la concurrence et d’un exercice 2004 difficile pour l’ensemble du tourisme en Corse. Surtout, les mesures d’adaptation n’ont pas été réalisées, en particulier le départ de 300 personnes inscrit dans le plan, pour faire passer l’effectif de 2 400 à 2 100 personnes. Ainsi, une grande partie des espoirs du plan de 2001 n’a pas été tenue.
Il en est résulté que, sur la période 2002-2005, le résultat d’exploitation de l’entreprise a été négatif et n’a cessé de se creuser. Il n’a été sauvé en 2002 et 2003 que par des opérations exceptionnelles, comptables ou de cession d’actif. Mais le résultat courant a été négatif de 6 millions en 2002, de 13 millions en 2003, et de 33 millions en 2004 et en 2005. En dépit de la recapitalisation de 2002, l’entreprise n’a jamais réussi à atteindre les objectifs de son premier plan de sauvetage, tel qu’il avait été négocié par l’ensemble des partenaires.
En 2001-2002, l’entreprise avait donc bénéficié d’une première aide d’État à travers la recapitalisation d’environ 70 millions. Cette aide était assortie d’un certain nombre de contreparties, en particulier une politique de prix raisonnable et la vente de quelques actifs. Il se trouve que les lignes directrices de la Commission européenne interdisent d’accorder une nouvelle aide d’État dans un délai de dix ans. Par conséquent, il n’était pas possible d’aller plus loin dans cette voie ; il fallait trouver un autre cadre compatible avec les règles communautaires. Nous avons donc cherché à démontrer que l’État se comportait en « investisseur avisé » – c’est-à-dire qu’il prenait une décision rationnelle comme l’aurait fait un acteur économique privé – et que céder à prix négatif était en définitive une solution moins coûteuse qu’une autre, laquelle consistait évidemment à laisser la SNCM « aller dans le mur » et à procéder à sa liquidation.
Je vous rappelle qu’en décembre 2004, le tribunal de commerce a nommé un mandataire ad hoc pour essayer de convaincre les banques de maintenir leurs concours, ce qu’elles ont refusé à l’été 2005. Au terme de la longue grève de septembre-octobre, vers le 12 octobre, le président du tribunal de commerce a convoqué le président de l’entreprise et le secrétaire du comité d’entreprise (CE) pour leur indiquer que le dépôt de bilan aurait lieu le lendemain, compte tenu des 70 millions de découvert et du refus des banques de maintenir leur concours. Ne rien faire aurait donc signifié pour l’entreprise le dépôt de bilan et, probablement, la liquidation – la situation ne nous permettait même pas de respecter une période d’observation pour essayer de mettre en place un plan de cession. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi une opération autorisant l’État à accompagner un investisseur ; je reviendrai sur les conditions dans lesquelles celui-ci a été recherché. Du point de vue des règles communautaires, c’était le seul cadre dans lequel l’État pouvait remettre de l’argent pour contribuer à l’évolution de l’entreprise. Car notre objectif était d’éviter la disparition de la SNCM.
Conformément aux lois de privatisation de 1986 et 1993, on distingue les entreprises détenues directement par l’État (titre II) et les entreprises détenues indirectement par l’État (titre III), ce qui était le cas de la SNCM, détenue via une holding, la CGMF. Le titre III ne pose aucune règle de procédure particulière : il prévoit simplement pour les entreprises d’une certaine taille un décret pris sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Néanmoins, nous avons décidé de nous placer sous l’angle des règles plus contraignantes du titre II, lequel distingue deux catégories de cession. D’abord, les cessions sur le marché, c’est-à-dire la mise en bourse, dont la SNCM ne relevait à l’évidence pas. Ensuite, les cessions dans le cadre d’un « appel à des acquéreurs hors marché », c’est-à-dire hors du marché financier. Dans ce cas, la loi prévoit un appel d’offres, soit sur cahier des charges, soit sous le contrôle d’une personnalité qualifiée. C’est donc dans ce cadre-là que nous avons appliqué les règles de procédure et nous avons recommandé au ministre, qui l’a accepté, que la Commission des participations et des transferts exerce un contrôle plein et entier sur la conduite de l’opération, tant du point de vue la procédure que du prix.
La décision a été prise par une réunion de ministres en janvier 2005. Nous avons ensuite fait recruter par la CGMF une banque conseil, HSBC, qui connaissait le secteur maritime et avait précédemment travaillé pour l’État sur ce dossier. Nous avons lancé les opérations en mars, en contactant soixante-douze investisseurs. Une quinzaine a signé un accord de confidentialité pour recevoir le dossier. Au mois d’avril, cinq d’entre eux ont fait une première offre. Les étapes suivantes, mi-juin, fin juillet et septembre, ont concerné ceux qui restaient. La procédure s’est donc déroulée de façon tout à fait classique.
Conformément aux lois de privatisation, nous avons demandé à la banque HSBC de procéder à une évaluation indépendante de la société. Cette évaluation a été délicate car, compte tenu de la situation financière de l’entreprise et du caractère récurrent de ses pertes, il était très difficile de la comparer à d’autres entreprises du même secteur. Nous avons procédé à une évaluation selon deux méthodes.
D’abord, la banque a estimé la valeur des cash-flows, c’est-à-dire des flux futurs de revenus de la société. Ces flux étaient naturellement très négatifs pendant les premières années, sachant qu’il fallait financer les plans de restructuration et encaisser des pertes pendant quelques années encore, mais ils devaient remonter à la faveur des mesures de restructuration et de la politique commerciale mises en place par le futur repreneur. Ce profil était évidemment fondé sur la perspective de l’obtention de la DSP pour laquelle nous avions fait deux hypothèses : une reconduite à l’identique et, dans la mesure où la Collectivité de Corse et son Office des transports avaient évoqué à l’époque une fourchette et un niveau éventuellement plus bas que la DSP en cours, un niveau dégradé. Selon ces deux cas, les calculs de la banque HSBC aboutissaient à des évaluations négatives de la valeur de l’entreprise, qui se situaient autour, voire plus bas que le prix de cession finale. Ainsi, les calculs, tels qu’ils ont été soumis à la Commission des participations et des transferts, sont cohérents, voire plus négatifs que le prix qui a été payé.
Ensuite, nous avons retenu l’approche que j’évoquais tout à l’heure dans le cadre du comportement d’un investisseur avisé et nous nous avons chiffré ce que coûterait de mettre fin aux activités de la société. Nous avons demandé à la CGMF de faire ce calcul avec ses experts comptables et ses commissaires aux comptes. Nous avons sollicité une contre-expertise auprès de deux cabinets indépendants : le cabinet financier Oddo Corporate Finance et le cabinet d’avocats Paul Hastings, qui était représenté par Me Borde. Au final, le calcul de la CGMF comme celui des deux experts indépendants ont démontré que, compte tenu des responsabilités de l’État dans la gestion de la SNCM depuis très longtemps et de la générosité des plans sociaux qui avaient été accordés ou négociés au sein de l’entreprise, le coût d’une liquidation se situerait entre 200 et 400 millions.
La Commission des participations et des transferts, après avoir entendu l’APE et la banque conseil, a validé cette approche dans son avis rendu préalablement à l’autorisation donnée par le ministre à la privatisation. Elle a considéré, compte tenu des évaluations indépendantes qu’elle avait examinées, que le prix négatif était acceptable et correspondait au meilleur intérêt financier de l’État. Je ne suis pas certain que cet avis soit public, mais la Commission et l’APE en disposent dans leurs archives.
Nous n’avons jamais exigé une privatisation totale à 100 %. Nous avons engagé le processus sur la base de la recherche d’un investisseur et avons laissé les candidats libres d’exprimer leur souhait sur le quantum et la forme du capital qu’ils souhaitaient acquérir. Nous leur avons indiqué que nous préférions une augmentation de capital, car la société avait besoin, avant tout, d’argent frais. Il se trouve que les trois seuls candidats qui sont allés au bout ont exigé non seulement le contrôle, mais aussi une privatisation totale. Comme ils l’ont expliqué dans le cadre de nos réunions communes, ils souhaitaient une prise de contrôle à 100 %, considérant qu’il était indispensable à la réalisation de leur projet de s’éloigner le plus possible de tout cadre public. Au départ, aucun document de la HSBC ou de l’APE transmis aux candidats approchés ne posait cette condition, mais nous avons été confrontés à trois candidats qui présentaient cette exigence. Cela ne nous a pas surpris car, compte tenu des difficultés de l’entreprise, il était compréhensible que des investisseurs privés veuillent avoir les mains libres. Puis nous leur avons demandé s’ils acceptaient que l’État reste au capital ; ils nous ont répondu qu’ils l’accepteraient si l’État le souhaitait. Mais leur position de base, je le répète, était d’avoir le contrôle, c’est-à-dire plus de 50 % du capital, voire davantage, et si possible, 100 %.
Au départ, nous n’avons proposé aucune garantie, si ce n’est les garanties usuelles sur la propriété des actions et la réalité du passif. Ce sont les offres des candidats qui nous ont amenés à négocier certaines garanties. Ils souhaitaient que soient couverts les deux grands risques, l’éventuelle annulation de l’opération par les autorités européennes et la non-obtention de la DSP, ce qui a donné lieu aux conditions résolutoires. D’autres risques concernaient le non-remboursement de certaines charges, quelques litiges, etc. Mais ces risques ont donné lieu à des garanties dont chacune représentait quelques millions d’euros et, de mémoire, nous avons plafonné le tout à une dizaine de millions d’euros. Les candidats nous ont également demandé des garanties en cas de fermeture de la liaison avec Nice, ce que nous avons refusé, puis ils ont changé leur projet en cours de discussion en choisissant de maintenir la liaison avec Nice. Enfin, l’État s’est engagé à financer le départ des 300 puis 400 salariés dans les conditions les plus généreuses, c’est-à-dire grâce à des mesures ASFNE dérogatoires, déjà accordées dans d’autres dossiers industriels difficiles. Au départ, je le répète, il n’était pas question de garantir quoi que ce soit.
Ainsi, le prix et les garanties sont le reflet de la consultation très large du marché, auprès de soixante-douze investisseurs. Tous les armateurs d’Europe, tous les fonds possédant des actifs dans le transport maritime ont été consultés en France et en Europe – nous avons même consulté des entreprises du Maghreb partenaires de la SNCM. Il ne restait plus à la fin que trois candidats qui nous ont indiqué que, au regard du prix très négatif, ils souhaitaient le contrôle à 100 % et un certain nombre de garanties. En définitive, on peut considérer que le prix a été établi de manière transparente et qu’il reflète la vision des investisseurs sur la SNCM. Ces derniers ont été traités de la même manière : tous ont obtenu la même information ; tous ont participé avec nous au même nombre de réunions, sous le contrôle de M. Claude Gressier ; tous ont eu le même calendrier.
Nous nous sommes assuré que ce que nous faisions était compatible avec les règles de l’Union européenne. C’était même la contrainte première, puisque, si ce que nous allions faire pouvait être qualifié d’aide d’État, nous serions censurés par la Commission. Il a donc fallu trouver les moyens de faire passer les différentes catégories du prix négatif en dehors de ce cadre. D’abord, nous avons démontré à Bruxelles que l’État se comportait en « investisseur avisé », selon la terminologie communautaire, parce qu’un entrepreneur privé qui, pour se séparer d’une entreprise, a le choix entre faire un chèque ou la liquider pour plus cher choisira de faire un chèque. C’est une question de bon sens. Ensuite, nous avons prouvé que des éléments du prix négatif étaient justifiés par la correction de sous-compensations passées. Enfin, nous avons démontré que des éléments du prix correspondaient au financement des plans sociaux qui étaient considérés à l’époque par Bruxelles non comme des aides à l’entreprise, mais comme des aides à la personne.
Sur l’ensemble des composantes de l’argent que l’État était amené à mettre pour accompagner cette opération, nous nous étions assurés, avec l’aide de l’avocat Nicolas Baverez du cabinet Gibson Dunn, de maître Borde du cabinet Paul Hastings, et des experts du ministère des finances et de la Représentation permanente française à Bruxelles, que ce que nous faisions était acceptable du point de vue communautaire et conforme à la jurisprudence et à la doctrine à l’époque. À telle enseigne que la Commission européenne a rendu une décision favorable autorisant en tous points les opérations auxquelles nous avions procédé. Or comme vous le savez, une des grandes préoccupations des services de la Commission est d’être certains que ce qu’ils font ne sera pas censuré par leur service juridique ou le tribunal.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Cela a été pourtant le cas par la suite.
M. Jean-Louis Girodolle. En raison, je crois, d’un durcissement de la jurisprudence.
Enfin, aucun armateur n’a répondu. Louis Dreyfus Armateurs et la Comanav ont regardé le dossier, puis se sont retirés. M. Butler est arrivé sans M. Lemor ; en fin de processus, il nous a indiqué qu’il envisagerait de lui ouvrir son offre. J’ai personnellement assisté à une seule réunion entre M. Lemor et M. Butler que j’ai fortement encouragé à ajouter une composante industrielle et d’armateur à son offre ; je crois toutefois que M. Lemor ne souhaitait pas apparaître en première ligne. Les relations entre STEF-TFE, la CMN et le corps social de la SNCM n’étaient pas toujours faciles, un certain nombre d’interrogations se posaient sur l’acceptabilité de la présence de STEF-TFE dans le consortium de reprise. Mais in fine, c’est la décision de MM. Butler et Lemor de ne pas avoir fait affaire ensemble.
M. Camille de Rocca Serra. Vous partez du postulat que la situation était dramatique à cause de la concurrence. Pourtant, elle n’a pas empêché la SNCM de regagner dernièrement des parts de marché. La concurrence n’est pas responsable de tous les maux et, de toute façon, nous souhaitons qu’il y en ait de plus en plus.
Nous avons mis en garde les autorités politiques contre une privatisation totale. Nous étions convaincus que le climat social ne la permettrait pas, surtout en faveur d’un fonds d’investissement qui n’était pas opérateur de transport. Il se trouve que j’ai demandé publiquement à M. Butler s’il accepterait que l’État reste au capital. Il m’a répondu oui. Et quand je l’ai interrogé pour comprendre pourquoi on en était arrivé là, il m’a expliqué qu’on lui avait demandé de tout prendre. Ce rappel n’est pas inutile.
La DSP a été maintenue dans toutes ses composantes pour rendre la privatisation possible. Pourquoi l’État actionnaire a-t-il limité sa réflexion au marché de la Corse ? Pourquoi ne pas l’avoir étendue au bassin méditerranéen puisque Sud Cargos, qui marchait plutôt bien, avait déjà été cédée ? Et pourquoi n’avoir pas recherché avant une entente avec les partenaires de la SNCM avec lesquels elle avait des liens capitalistiques ? À partir du moment où des suppressions d’emploi étaient acquises, pour faire repartir l’exploitation sur des bases beaucoup plus saines, je ne comprends pas que rien n’ait été fait. La rencontre entre M. Walter Butler et M. Francis Lemor a sans doute été insuffisamment préparée. Ce qui me surprend, c’est non pas la privatisation totale – on peut comprendre qu’un nouvel actionnaire n’ait pas envie de s’embarrasser de l’État – mais la méconnaissance de la dimension sociale et politique. Lorsqu’il a fallu négocier le maintien de l’État, il était déjà trop tard. Je ne suis pas convaincu que le conseil d’administration de Veolia ait décidé tout seul de ne pas souscrire à l’opération. Le dossier présenté n’était-il pas de nature à dissuader les opérateurs de transport, Connex ne pouvant passer pour le meilleur spécialiste du transport maritime ? Si nous n’avions pas reconduit la DSP à l’identique, la survie de l’entreprise aurait été en jeu.
M. Jean-Louis Girodolle. Je connais bien la polémique et les interrogations autour du retrait de Connex alors qu’elle était si proche du but, et s’était employée à le faire savoir. Il faut purger le débat. Comme je vous l’ai dit, nous n’avons jamais posé comme exigence de départ une reprise à 100 %. Il s’agissait seulement de rechercher un partenaire prêt à investir. L’entreprise allait de plus en plus mal. Accusant pour chacun des exercices 2004 et 2005 une perte de 30 millions, elle avait consommé en deux ans et demi la totalité de la recapitalisation de 2002. Nous étions donc revenus au point de départ, avec un trou dans la trésorerie de 70 millions et des banques qui ne voulaient plus prêter. Il fallait impérativement injecter de l’argent. Et nous sommes partis à la recherche d’un investisseur. Aucun document ne fait état d’une exigence de reprise à 100 %, ni même d’une prise de contrôle. Les investisseurs demandaient, dans leurs offres écrites, la majorité et, même, au départ, 100 % du capital.
S’agissant de Connex, elle a, deux jours avant la clôture, évoqué l’idée de ne reprendre qu’une participation minoritaire. Nous lui avons dit de proposer ce qu’elle voulait mais en précisant que les règles communautaires empêchaient l’État d’aider une entreprise qui resterait publique. C’est le conseil d’administration de Veolia Environnement qui a pris la décision de ne faire aucune offre. Jamais il n’a été imposé, ni à Connex, ni à Veolia Environnement, ni à personne de ne pas faire d’offre, ni d’en faire une à 100 %.
Ce sont plutôt les repreneurs qui ne voulaient pas de la présence de l’État. Nous les avons même testés explicitement en leur demandant s’ils accepteraient que l’État reste au capital car nous savions que la question se poserait.
M. Arnaud Leroy remplace M. Paul Giacobbi à la présidence.
M. Denis Samuel-Lajeunesse. Je complète la réponse faite à M. de Rocca Serra en précisant que STEF-TFE faisait évidemment partie des soixante-douze investisseurs qui avaient été contactés, mais elle n’a pas donné suite. À ma connaissance, ce n’est que plus tard qu’elle a commencé à discuter avec Butler Capital Partners Il est bon, en effet, de rappeler que le marché du Maghreb, avant le printemps arabe, était en relative croissance et que la SNCM avait alors deux pieds, l’un en Corse, l’autre au Maghreb.
M. François Pupponi. Vous nous présentez une société qui n’avait que peu de valeur, y compris aux yeux des repreneurs qui ne se sont pas bousculés. Mais alors, pourquoi ce qui n’avait aucune valeur – ou presque – en a subitement acquis une au point que quelqu’un soit prêt à débourser 70 millions d’euros pour la racheter ? Comment se fait-il qu’un investisseur, qui connaissait le dossier puisqu’il avait postulé dans un premier temps avant de se rétracter, ait finalement accepté, au bout de quelques mois, de mettre sur la table 70 millions et 50 millions dans un nouveau bateau afin de garder la DSP ?
M. Jean-Louis Girodolle. Il faut distinguer deux choses.
D’abord, nous n’avons pas participé – à quel titre l’aurions-nous d’ailleurs fait ? – aux discussions entre Veolia et Butler sur les conditions de la reprise par le premier des parts du second. Il s’agit d’une négociation entre actionnaires privés. Nous avions seulement demandé que, si l’un d’eux voulait sortir, il revende à l’autre, l’idée étant qu’au cas où Butler se désengagerait, il cède, plutôt qu’à un tiers, à l’opérateur industriel que le Gouvernement avait souhaité qu’il s’adjoigne. Nous avions également demandé que les deux actionnaires restent, collectivement ou individuellement, pour une durée minimale, celle de la clause résolutoire qui était de six ans. L’objectif était d’assurer une stabilité de l’actionnariat, autour du noyau d’origine.
Ensuite, la SNCM était appelée à connaître un fort retournement. On partait de très bas, et le plan des repreneurs prévoyait, au bout de quelques années, un fort redressement. Après le plan social, une fois prises les mesures de productivité, mise en place une politique commerciale agressive qui aurait permis de reprendre des parts de marché, y compris au Maghreb, la SNCM devait retrouver une situation positive. De fait, comme toujours dans les plans de redressement, les toutes premières années ne se sont pas si mal passées. Au départ, la société était en grand péril…
M. Paul Giacobbi, rapporteur. La valeur de la société, mesurée par la différence entre le prix de cession et le prix d’achat, a tout de même augmenté en deux ans dans des proportions assez considérables. En deux ans, le miracle s’est produit !
M. François Pupponi. Est-ce qu’il est arrivé d’inclure, dans ce type de contrat, une clause permettant à l’État de récupérer, le cas échéant, une partie de la plus-value réalisée quelques mois après la cession, dès lors, bien sûr, mais c’était le cas, qu’il n’y avait pas eu de plan de redressement ?
M. Jean-Louis Girodolle. Je ne connais pas les comptes 2007 et 2008 de la SNCM. Pour juger du caractère exorbitant, ou pas, du prix payé par Veolia, il faut se situer au moment de la transaction, c'est-à-dire deux ans après la privatisation, en 2008. La formule avait été fixée en 2005, mais pas le prix. Quand vous achetez une entreprise, vous regardez la situation présente et ses perspectives sur deux ans. Il faudrait se reporter aux résultats de la SNCM en 2008 et à ses perspectives pour 2009, pour juger si le prix était le bon ou pas.
M. le président Arnaud Leroy. De quand la formule de calcul date-t-elle ? 2005 ?
M. Jean-Louis Girodolle. Butler et Veolia négocient entre eux en 2006, mais l’État n’y est pas partie.
M. le président Arnaud Leroy. Lors d’une audition précédente, il a été fait mention de tentatives, bien avant la décision de privatisation, de la part de Butler pour s’adjoindre un partenaire industriel, dès 2004. Cela voudrait dire que la décision de privatiser était déjà prise et que Butler, c’est du moins ce que j’ai compris du message qui nous a été adressé, savait que la SNCM était pour lui.
M. Jean-Louis Girodolle. Je vais être très net, pour l’APE et l’honneur de ceux qui ont travaillé sur ce dossier. C’est faux.
M. le rapporteur. C’est vrai. Nous avons des documents. Simplement, vous pouviez ne pas être au courant.
M. Jean-Louis Girodolle. Nous ne sommes pas au courant. Nous n’en avons jamais entendu parler, ni, d’ailleurs, reçu la moindre instruction qui aurait pu laisser entendre quoi que ce soit de ce genre.
La décision de lancer la recherche de capital a été prise en réunion de ministres, en janvier 2005. Que M. Butler, qui avait déjà, dans le passé, « reniflé » des actifs publics, en particulier la Société Française de Production (SFP), ait pu identifier, au sein du patrimoine de l’État, la SNCM comme candidat à une reprise, ce n’est pas impossible. De tout mon mandat de sous-directeur, M. Butler n’est jamais venu m’en parler. Et nous n’avons jamais été informés, ni n’avons reçu la moindre instruction allant dans le sens de ce que vous affirmez.
M. le rapporteur. Je crois que votre réponse à la question du président est exacte, mais ne reflète que partiellement la réalité. Que vous n’ayez pas été au courant me paraît cohérent.
J’avais indiqué dès le départ à l’Assemblée nationale que M. Butler ferait rapidement une plus-value de 50 millions. Je ne suis pas devin, mais le calcul était à ma portée. Je me suis un peu trompé car je suis toujours prudent, mais c’était « clair comme de l’eau de roche ». Il ne peut y avoir que trois raisons à cette plus-value. Premièrement, l’évaluation de départ était minorée, mais je crois qu’elle a été faite selon les normes et avec la prudence qui s’impose en pareil cas, car il y a eu beaucoup d’intervenants. Deuxièmement, il s’est passé entre-temps un miracle économique – révolution culturelle, restructuration solide, reconquête inattendue de parts de marché,… Or rien de comparable ne s’est produit. Troisièmement, ayant exclu les deux premières hypothèses, il reste qu’une fois payé le Plan social qui était calqué sur ce qui se faisait de mieux, la recapitalisation effectuée, la DSP obtenue dans des conditions généreuses, la valeur de l’entreprise – et on pouvait l’anticiper dès la première cession – était bien supérieure. Quel est votre sentiment ?
Autre bizarrerie. Connex se retire parce que, selon un témoignage, le président Proglio a indiqué qu’il n’irait pas et qu’il se ferait même interdire d’y aller par son conseil d’administration.
Encore une bizarrerie. L’écart de prix entre ce que Connex était prête à consentir au départ, et celui effectivement payé à Butler. Vous ne connaissez pas le prix initial de Connex puisqu’elle n’a pas déposé d’offre.
M. Jean-Louis Girodolle. Il faudrait consulter les offres intermédiaires.
M. le rapporteur. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu connaissance des offres que la division Connex était prête à faire quand elle s’est retirée.
M. Jean-Louis Girodolle. Non, par définition.
Je vous remercie de nous avoir donné acte du sérieux de notre travail et de l’objectivité irréprochable de notre évaluation.
Pour expliquer pourquoi Butler a fait une plus-value, j’en suis réduit à des conjectures. Je ne connais pas la formule de prix qu’il a négociée avec Veolia, ni les résultats de la SNCM dans les deux ou trois années qui ont suivi l’opération que nous avons conduite.
Pour vérifier si ce prix correspond à celui auquel se vendaient les actifs maritimes en 2008-2009, il faudrait les comptes de la SNCM pour l’exercice 2008 et ses prévisions pour 2009 ainsi que la formule de prix qui a été négociée. Il est indéniable qu’il y a eu un certain redressement entre 2006 et 2008. Comme toujours, dans les entreprises en retournement, on commence par le plus facile. Les premières années, Veolia a réussi une certaine transformation. Ce n’est qu’après trois ou quatre ans qu’elle a touché ses limites, en dépit de son savoir-faire managérial qui est grand. La SNCM a connu un redressement important entre 2005-2006 et 2008. Le prix payé à M. Butler valorise-t-il justement ou excessivement cette amélioration ? Je ne sais pas. Il faut vérifier auprès des acteurs du dossier.
M. Butler, le jour où le Gouvernement lui demande de faire entrer Veolia, est en position de force pour négocier. Quarante-huit heures après l’annonce de la reprise par Butler Capital Partners, le Premier ministre – nous n’avons pas pris part à la décision – demande à M. Butler d’accueillir un partenaire industriel, Connex. S’en suivent des discussions auxquelles nous n’avons pas participé, dont le cadre est fixé à Matignon. Puis le témoin passe entre les mains de MM. Butler, Richard et Proglio. Il est évident que le premier, resté seul en lice, était bien placé pour négocier auprès de Veolia des conditions de sortie favorables. Je porte là un regard extérieur, je ne justifie rien. Dans cette manche, Butler avait la main.
Quant au prix initial de Connex, je ne le connais pas. Je me souviens que, dans les phases préliminaires, Connex était assez proche de Butler, surtout après avoir accepté de réduire son plan social, passé de 700 personnes à 400. Le classement d’alors était Butler en tête, pas très loin Connex, et Caravelle assez loin derrière. Mais, pour ce qui est de la phase ultime, je ne connais pas leurs intentions puisque Connex n’a pas déposé d’offre.
M. le président Arnaud Leroy. Je trouve votre récit résolument optimiste. Ma vision est différente, je ne pense pas que Butler ait été en position de force pour négocier quoi que ce soit. Je n’ai toujours pas compris comment Henri Proglio, qui, selon les témoignages, était déterminé à ne pas y aller, a fait volte-face dans des conditions quasi rocambolesques, en une soirée.
Même si vous n’étiez pas partie prenante dans les dernières discussions, vous avez, malgré tout, encadré l’opération de privatisation de la SNCM. Vous étiez certainement au courant des revirements de M. Stéphane Richard, qui n’était pas soutenu par sa maison mère, mais qui a fini par avoir gain de cause, et devenir partenaire de Butler. Comment expliquer un tel cheminement ?
M. Jean-Louis Girodolle. Il nous est difficile de tout expliquer. Nous étions fonctionnaires et il y a des niveaux auxquels la discussion se tient sans nous. Entre le moment de l’annonce que l’offre de Butler est retenue et celui où le Gouvernement demande à Butler de modifier le tour de table, il se passe quarante-huit heures extrêmement agitées sur le plan social, politique à Marseille et en Corse. L’émotion est très forte car Connex s’était employée à faire connaître localement son intention de se porter candidat. Les représentants locaux, voire M. Stéphane Richard en personne, avaient pris des contacts avec les élus, les syndicats et les partenaires de la SNCM, pour s’assurer d’être bien vus. Le fait que Connex n’ait pas déposé d’offre – et la discussion avec M. de Rocca Serra l’a illustré – a créé la surprise. Chez nous aussi. Je ne vous cache pas que, quand Stéphane Richard m’a appelé en me disant qu’il sortait du conseil d’administration de Veolia et qu’il n’avait pas obtenu le droit de déposer une offre, j’étais stupéfait et contrarié de perdre un candidat extrêmement crédible. Pour nous, la nouvelle était très mauvaise.
Il me semble que le Gouvernement a cherché à gérer la situation. Plusieurs acteurs du dossier attendaient la Connex, mais la procédure d’appel d’offre, fixée par les lois de privatisation, devait être respectée. Il fallait donc bien déclarer Butler gagnant. Le Gouvernement ne pouvait pas arrêter la privatisation, l’entreprise n’avait plus d’argent. Et elle risquait la mise en cessation de paiement dès le lendemain, les commissaires aux comptes ayant suspendu leur décision parce que la procédure de privatisation était en cours. Le Gouvernement a agi en s’accommodant de ces contraintes. Les termes précis, les conversations qui ont eu lieu ces jours-là entre le Premier ministre, son cabinet, les représentants du groupe Veolia et M. Butler, j’en ignore tout. Nous avons été, pour notre part, informés via le ministre et son cabinet des décisions qui venaient d’être prises et que nous devions appliquer. Mais nous n’avons été associés ni à leur préparation ni à leur discussion.
M. le président Arnaud Leroy. Messieurs, nous vous remercions.
i. Audition, à huis clos, de M. Pierre Mattei, directeur général de Corsica Ferries France
(Séance du mercredi 25 septembre 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Mes chers collègues, nous recevons aujourd’hui M. Pierre Mattei, directeur général de Corsica Ferries.
Créée en 1968, la compagnie que vous dirigez, monsieur le directeur général, est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du transport maritime vers la Corse. Avec douze navires, c’est la mieux équipée des compagnies opérant sur cette destination, et elle est devenue en quelque sorte « un point de mire ». On lui reproche son pavillon italien, qui lui assure des coûts plus faibles que le pavillon français de la SNCM. Inversement, elle est à l’origine de plusieurs contentieux, pas toujours voués à l’échec, devant la justice française et les institutions européennes, autour de l’organisation du transport maritime vers la Corse.
En vous recevant, monsieur Mattei, la commission d’enquête souhaite obtenir plusieurs éclaircissements.
D’abord, pourquoi, en 2005, Corsica Ferries n’a-t-elle pas été candidate à la reprise, au moins partielle, de la SNCM ?
Ensuite, puisque Corsica Ferries n’avait pas considéré le dossier comme attractif, pourquoi avoir attaqué les conditions de privatisation de la compagnie devant la justice européenne ?
Enfin, pourquoi votre entreprise soumissionne-t-elle régulièrement aux DSP de transport maritime sur la Corse, tout en sachant pertinemment que ses offres ne correspondent pas aux conditions des cahiers des charges ?
M. Pierre Mattei prête serment.
M. Pierre Mattei, directeur général de Corsica Ferries France. Monsieur le président, nous avons songé à être candidat à la reprise et ne l’avons pas fait pour deux raisons : d’une part, il était évident que ce qui serait demandé au(x) repreneur(s) serait essentiellement d’ordre social et du domaine de la restructuration, ce qui n’est pas notre spécialité ; d’autre part, il était non moins évident – et les faits l’ont démontré – que nous n’étions certainement pas le bon candidat. Nous avons envisagé de reprendre certains actifs, mais nous avons abandonné cette option puisqu’ils n’étaient pas à vendre.
Vous m’avez interrogé aussi sur le contentieux de la privatisation. Il faut remonter plus loin pour comprendre. Nous ne serions pas là aujourd'hui si, le 7 décembre 1992, il n’y avait pas eu un nouveau règlement européen régissant le cabotage maritime en Europe.
Ce règlement du Conseil N°3577/92/CEE constitue le texte fondateur de notre stratégie et de ce qui aurait dû être celle de nos concurrents. Il l’a d’ailleurs été pour quasiment l’ensemble de tous les opérateurs européens, sauf la SNCM. Que dit ce règlement ? Il définit le service public comme ce qui est vital, et ce que ne ferait pas un opérateur privé qui ne serait mû que par son intérêt commercial et économique, sans contrepartie financière. Ensuite, les régions ou l’État, selon leur compétence, ont la possibilité d’attribuer des contrats de service public, de définir des obligations de service public en respectant la notion de service public et l’obligation de mise en concurrence au niveau européen.
Lorsque nous avons analysé ce texte, et pris acte de la dérogation en vertu de laquelle les entreprises existantes assurant le cabotage avec les îles se verraient accorder un délai pour se restructurer, ou se structurer, ou encore investir en fonction des échéances – 1999 pour les pavillons, 2001 pour l’échéance des concessions en cours avec la Corse –, nous nous sommes adaptés. Nous avons anticipé l’ouverture à la concurrence. Nous étions corses, installés dans l’île et nous nous sommes dit qu’il n’y avait pas de raison que nous ne prenions pas une place qui serait prise de toute façon. Nous avons basé notre stratégie, nos investissements sur ces échéances et nous avons progressivement pris des places que nous ne voulions pas voir prises par d’autres que nous.
Nous avions, en revanche, mal prévu sans doute le fait que l’État continuerait à vouloir subventionner de manière excédentaire, inutile, « surcompensatoire » la SNCM, tout simplement parce qu’elle refusait de faire ce qu’elle aurait dû faire, et qu’ont fait la CMN – la Compagnie méridionale de navigation – et Corsica Ferries, c'est-à-dire s’adapter aux nouvelles règles.
Et, aujourd'hui, nous ne serions pas là si, en 1992, les gouvernements et les dirigeants successifs de la SNCM – ne me demandez pas pourquoi, vous êtes mieux à même de répondre – n’ont pas procédé à l’adaptation nécessaire. En tout cas, cette non-adaptation, nous l’avons payée, nous contribuables français, en 2003, en 2007 – certains membres de la Commission ont fait état de pressions pour attribuer la délégation de service public à la SNCM –, et peut-être le président Giacobbi ne sera-t-il pas tout à fait d’accord avec moi, mais je considère quant à moi qu’on continuera, certes dans une moindre mesure, à payer à partir de demain avec la signature de la nouvelle DSP.
Voilà pourquoi nous avons attaqué. Nous attaquons systématiquement toute décision de nature à donner des surcompensations à nos concurrents. Non pas parce que nous réclamons notre part, mais parce que nous estimons que l’argent que l’État donne à nos concurrents ne va ni au service public, ni à la restructuration. Pour le dire simplement, nous nous battons pour que l’État économise l’argent du contribuable, comme le prévoient les règlements. Et c’est toujours sur eux que nous nous fondons pour faire en sorte de ne pas être concurrencés par des compagnies qui, pour faire la même chose que nous, perçoivent des subventions que nous n’avons pas.
Quant à votre troisième question, elle ne concerne pas la privatisation de la SNCM, qui est l’objet de votre commission d’enquête. La privatisation en tant que telle ne nous pose strictement aucun problème. Ce qui nous pose problème, c’est sa recapitalisation selon le schéma bien connu : on donne trop d’argent et l’argent est utilisé pour nous faire concurrence au lieu de servir à la restructuration. Les chiffres démontrent qu’elle n’a absolument pas été menée à bien à la SNCM. Votre Commission pourra se demander ce qui en a été fait.
En ce qui concerne notre réponse à l’appel d’offres, je ne peux pas souscrire à ce que vous avez affirmé, monsieur le président. Nos offres sont valables techniquement, et performantes économiquement. J’en veux pour preuve les délibérations de l’Assemblée de Corse et les rapports produits par le conseil exécutif de Corse qui n’indiquent nulle part que nous sommes rejetés pour des motifs techniques. Je soutiens même que nous avons été rejetés pour d’autres motifs, très probablement – nous aurons peut-être à en faire la preuve – le comportement anticoncurrentiel de nos concurrents, pour lequel ils ont déjà été sanctionnés lors de l’appel d’offres de 2007, à savoir un abus de position dominante dans la mesure où ils exigeaient l’exclusivité et ne voulaient pas partager avec leurs concurrents. Il n’a jamais été un secret pour personne que nous n’avons pas la possibilité de répondre entièrement à la délégation de service public. Nous ne prétendons pas à un monopole, mais nous ambitionnons d’apporter à la Corse, sur une partie des lignes, une économie substantielle et une amélioration qualitative. Et je vous remercie d’avoir dit que nous étions les mieux équipés. J’en suis d’accord et c’est la raison de notre part de marché aujourd'hui : deux tiers des passagers et près d’un tiers des marchandises.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Je suis sensible à une partie du discours de Pierre Mattei, plus nuancé sur l’autre.
En substance, le service public, c’est ce qui est vital et qui ne serait pas fait par un opérateur privé sans compensation financière. Aujourd'hui, la Commission européenne a déclaré, dans un même mouvement, que le service complémentaire ne répondait pas à ces critères, mais que le service de base, lui, y répondait. Il s’agit presque d’une novation.
Depuis 1992, l’adaptation des opérateurs était indispensable. Vous avez fait remarquer que la CMN y avait procédé et vous aussi, mais pas la SNCM. Or, aujourd'hui, dans les mêmes conditions, la CMN dégage une marge de 2 %, compte tenu, et c’est normal, de l’affaire du Piana. Ce n’est pas le Pérou, mais ce n’est pas si mal dans un métier difficile.
Les acquéreurs de la SNCM – Butler et Veolia – ont acheté à un certain prix, qui tenait compte du financement par l’État du plan social, que sa générosité plaçait tout en haut de la fourchette ; d’une recapitalisation qui effaçait les pertes passées, avec une DSP qui était très généreuse ; bref, dans des conditions telles qu’on ne comprend pas pourquoi M. Butler a pu faire une plus-value aussi extraordinaire en deux ans. Estimez-vous que la gestion de la SNCM a pu faire augmenter sa valeur au point de justifier une plus-value de 60 millions d’euros ?
M. le président Arnaud Leroy. On entend dire que la Connex, par la voix de son président, avait fait acte de candidature sérieuse en faisant valoir auprès des acteurs du dossier ses ambitions dans le domaine maritime, stratégie qu’elle a dû revoir après le refus de Veolia de la suivre dans un premier temps. Avez-vous été de nouveau approché, pour trouver un partenaire industriel au groupe Butler, pendant ces quelques jours cruciaux où les tensions étaient fortes tant en Corse qu’à Marseille ? Vous a-t-on retendu la main ?
M. Pierre Mattei. La question du président Giacobbi est vraiment cruciale. Je n’ai d’autre information que celle obtenue par les contentieux, la presse et sur place puisque je vis en Corse. J’ai vu de mes yeux l’intervention du GIGN devant mon bureau, mais je n’évolue pas dans les hautes sphères de l’administration, et nous n’avons pas participé au processus. Nous n’avons pas été approchés.
En fait, d’après ce que j’ai compris, le retour de Veolia s’est produit à la suite des graves incidents qui ont éclaté sur le port de Bastia. Ce soir-là, des salariés de Corsica Ferries ont été attaqués, frappés ; j’ai moi-même été suivi dans la rue quand je suis rentré chez moi. La tension était très forte, les pressions politiques aussi si bien que Veolia a été rappelée comme opérateur industriel. Voilà ce que j’ai lu ou vu.
En revanche, étant partie à des contentieux, nous avons découvert la fameuse clause suspensive d’abord, résolutoire ensuite. C’est elle qui détermine la réponse à la question sur la valeur de la SNCM. Veolia a exigé d’avoir le même cahier des charges, des articles de presse l’attestent, en date du 25 mars 2006, à la veille de la délibération de l’Assemblée de Corse. Le président Rocca Serra pourra me corriger, mais, à la veille de la délibération visant à supprimer seulement une partie du service complémentaire à Propriano, Veolia a prévenu que, si tel était le cas, elle n’entrerait pas au capital. M. Walter Butler a déclaré : « Si le cahier des charges n’est pas assez fourni, nous nous retirerons. La décision sera rapide. Dans le cas contraire, nous serons à la barre de la SNCM dès le début du mois de mai ». Je cite La Provence du 24 mars 2006. J’ai un autre article du 18 mars où M. Couturier dit à peu près la même chose. En somme, les investisseurs n’entreraient pas au capital de la SNCM tant que le cahier des charges ne serait pas comme ils voulaient.
Ensuite, lorsque nous avons demandé les documents dans le cadre du contentieux qui nous opposait à la SNCM devant l’Autorité de la concurrence, et à l’issue duquel elle a été condamnée pour abus de position dominante – la concurrence déloyale n’est pas où l’on croit – eh bien, a été versée au dossier la fameuse clause dite résolutoire selon laquelle Veolia et Butler rendraient la SNCM si la DSP ne lui était pas attribuée. Les deux repreneurs demandaient aussi l’argent – les 280 millions – et la validation du montage par la Commission européenne.
Nous en avons conclu très simplement que, au moment où l’opération se fait, il est évident que la SNCM doit être attributaire de la délégation de service public. Sinon, la cession ne se serait pas intervenue. La valorisation devait donc se fonder sur une entreprise attributaire de la DSP. À défaut, Veolia et Butler auraient repris leurs billes. Il est normal d’imaginer que, lorsque l’opération s’est faite, la SNCM était valorisée avec la DSP.
Deuxième observation, on n’a pas noté sur le marché, entre 2006 et 2008, des mouvements considérables dans le trafic, dans la rentabilité des opérateurs, dans les parts de marché, qui pourraient justifier une quelconque augmentation de valeur. Certains indices pourraient même faire pencher la balance dans l’autre sens.
Troisième observation, il y a concomitance entre la décision de la Commission européenne de valider la recapitalisation et, quelques jours après, le dénouement de l’opération dont parlait le président Giacobbi.
Je n’ai pas d’autres informations, mais, ayant une formation financière, je sais que, lorsqu’on achète une entreprise, on valorise en fonction de ce dont on est certain. En l’occurrence, il était certain que la DSP serait accordée. J’ajoute que, dans sa décision du 11 septembre 2012, le tribunal de l’Union européenne a reproché à la Commission de ne pas avoir pris en compte cette fameuse clause résolutoire dans le calcul du prix, en théorie négatif qu’a dû verser l’État français pour donner la SNCM à ses repreneurs.
M. François Pupponi. Vous démontrez donc qu’il fallait valoriser l’entreprise avec la DSP puisque, sans elle, l’accord ne tenait pas. Mais la clause résolutoire s’appliquait au moment où Butler a racheté la SNCM, ce qui signifie que l’évaluation de la SNCM tenait déjà compte, à ce moment-là, de la DSP.
M. Pierre Mattei. Absolument.
M. François Pupponi. Donc la plus-value de 60 millions d’euros n’est pas justifiée par la cause résolutoire ?
M. Pierre Mattei. Exactement. C’est pourquoi nous avons défendu devant le tribunal de l’Union européenne que cette valorisation initiale était beaucoup trop faible. Elle aurait dû intégrer la DSP. La preuve par l’absurde a été apportée par la plus-value réalisée à la sortie sans que, dans les deux ans qui ont suivi, soit intervenu un événement qui aurait justifié la différence de valorisation.
M. le rapporteur. C’est un point essentiel. En tant que professionnel du secteur, M. Mattei dit que, dans les deux ans qui ont suivi, aucun élément, sinon de nature négative, ne s’est produit dans les conditions d’exploitation qui puisse expliquer la plus-value. D’ailleurs, Corsica Ferries, qui est bien gérée, n’a rien connu de tel.
Par ailleurs, M. Mattei considère, c’est aussi mon point de vue, que l’entreprise, dans les conditions de la cession, qui remettaient tous les compteurs à zéro – il n’y avait plus ni dette, ni perte et la certitude d’une DSP qui devait rapporter normalement beaucoup d’argent –, a fait l’objet d’une sous-évaluation au départ. Et la plus-value a été réalisée ensuite sans qu’aucun élément du marché, ni changement de la culture de l’entreprise ne puisse la justifier.
M. le président Arnaud Leroy. Les années 2006-2008 ont vu la flambée des cours du bunker, qui a alourdi les charges des entreprises ; il n’y a pas eu d’emballement du trafic en Méditerranée, et la SNCM ne s’est pas lancée dans une politique agressive.
Au cours des auditions, certaines questions ont surgi à propos de la façon dont avait été organisé l’appel d’offres. J’ai compris que l’on demandait plutôt aux repreneurs combien ils étaient prêts à donner… Certes, une évaluation a été faite, pour respecter les formes, mais il semblerait que les candidats pressentis aient conservé une certaine liberté de manœuvre. Nous pourrons vérifier avec les documents de l’Agence des participations de l’État, mais avez-vous cette impression ?
Ensuite, la revente des parts de Butler à Veolia était-elle contractuelle ? D’aucuns nous ont expliqué qu’elle était liée à la stratégie et à l’achat d’un nouveau navire, que refusait Butler. Dès lors, Veolia a dû organiser la sortie de Butler pour prendre les rênes de la compagnie et éviter le pire. Qu’en pensez-vous ? Sur ce sujet, nous avons entendu « différents sons de cloche » : pour les uns, il n’y avait pas besoin d’un nouveau navire, pour d’autres si. Nous n’arrivons pas à comprendre pourquoi a été prise la décision de revente, sinon, si l’on suit votre raisonnement, parce que la SNCM était très sous-évaluée au départ. Mais, alors, pourquoi l’État n’a-t-il pas prévu de clause pour récupérer une partie de sa mise ?
M. Pierre Mattei. Les navires qui devaient être achetés étaient prévus en début de convention puisque, lors de l’appel d’offres, on doit nommer les navires. À l’occasion de la première délégation de service public, en 2006, le Conseil d’État s’était prononcé, à notre demande, et avait empêché que l’on puisse faire des cotations sur des navires inexistants. Les soumissionnaires devaient donc nommer les navires et préciser les investissements en navires neufs. Je n’ai pas noté de besoins particuliers ; j’ai simplement observé que les valorisations de navire étaient, dans le cadre de la DSP de 2007, très favorables à l’opérateur SNCM. Nous les avons dénoncées. Elles ont même augmenté de manière surprenante entre le mois de décembre 2006 – date à laquelle nous avons fait annuler le premier appel d’offres – et le mois de février 2007, sachant que la rémunération est essentiellement fondée sur la valeur des navires. En tout cas, elle est plafonnée par rapport à la comptabilité de ce capital. Il ne s’est rien passé de particulier sinon une très forte pression, probablement liée au chantage social permanent qu’exerce la SNCM et surtout à cette fameuse clause résolutoire. Mais je n’ai pas d’autres informations que celles données par la presse à propos du rachat des parts de Butler par Veolia.
M. François Pupponi. Le cahier des charges obligeait-il à exploiter tel ou tel type de bateau ? La SNCM avait-elle les bateaux ? Ou bien s’était-elle engagée à les avoir ? Nous avons compris, d’après ce qui a été dit, que la SNCM s’était engagée formellement à acheter le bateau correspondant. La DSP en portait-elle la trace ? En a-t-on parlé ?
M. Pierre Mattei. En tant que témoin extérieur – je n’ai évidemment pas participé aux discussions entre l’Office des transports et la SNCM –, j’observe que le cahier des charges repose non pas sur des navires mais sur des obligations de service public : sur telle ligne, vous devez transporter tel type de mètre linéaire de fret et tel type de passager à telle condition tarifaire. Le cahier des charges raisonne en termes d’objectifs, pas de moyens.
Ensuite, le Conseil d’État a jugé que les opérateurs devaient soumissionner sur la base d’une flotte existante parce qu’il fallait répondre immédiatement. Les retards successifs dus au contentieux ont fait que la DSP a été attribuée au mois de juin pour un début au mois de juillet. Le délai, en tout cas, était de l’ordre de quelques semaines.
M. François Pupponi. Y avait-il des conditions d’âge ?
M. Pierre Mattei. Oui, et ce qui est plaisant, c’est que les clauses évoluent en fonction de l’âge des navires de la SNCM : en 2001, le plafond était de vingt ans ; en 2007, de vingt-cinq et maintenant de trente ans… En règle générale, et ce sera le cas pour le prochain contrat, l’opérateur retenu présente un plan d’investissement. Mais, sincèrement, je ne vois pas le rapport avec la question posée par le président. On a trop tendance à confondre les objectifs et les moyens – la flotte. C’est à l’opérateur de trouver les seconds pour atteindre les premiers.
M. le président Arnaud Leroy. Selon vous, il n’y avait pas, dans le cahier des charges, un critère obligeant la SNCM à remplacer un de ses navires ?
M. Pierre Mattei. Je ne peux pas répondre sans avoir vérifié. Les faits remontent à cinq ans. Mais, grosso modo, comme aujourd'hui d’ailleurs, la flotte était globalement adaptée avec des prévisions d’investissement.
M. le président Arnaud Leroy. Avez-vous été, en tant qu’opérateur industriel, approché par Butler entre 2004 et 2006 ?
M. Pierre Mattei. Nous avons eu quelques contacts très informels, mais ils n’ont pas abouti.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Vous souvenez-vous des dates ? Plus près de 2004 ou de 2006 ?
M. Pierre Mattei. Je ne saurais vous dire.
M. le rapporteur. Pour être très clair, avez-vous été approché avant qu’ait été prise officiellement la décision de privatiser ?
M. Pierre Mattei. Je dirais après.
M. le rapporteur. Et avec la CMN ou la STEF, avez-vous eu des contacts à cette époque ?
M. Pierre Mattei. Avec la CMN, nous avons des contacts très fréquents puisque nous sommes leurs manutentionnaires à Bastia, nous chargeons et déchargeons aussi pour la SNCM. Mais pas en vue de participer à la privatisation. Nous avons seulement répondu ensemble à l’appel d’offres de 2006 puisque, à l’époque, les relations entre la CMN et la SNCM étaient rompues.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur Mattei, je vous remercie de vos explications.
j. Audition, à huis clos, de MM. Walter Butler, président de Butler Capital Partners (BCP), et Laurent Parquet, partner (BCP), accompagnés de M. Grégoire Lucas, conseil de BCP
(Séance du mercredi 2 octobre 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons, ce matin M. Walter Butler qui est le dirigeant et fondateur éponyme du fonds d’investissement Butler Capital Partners.
Vous avez d’abord acquis, Monsieur, une expérience au sein de l’Inspection générale des finances et d’un cabinet ministériel. Puis, au début des années 1990, après avoir passé quelque temps à la banque Goldman Sachs à New York, vous avez créé votre propre structure d'investissement en France.
Le fonds Butler Capital Partners s’est retrouvé le principal actionnaire (38 %) de la SNCM en 2006, à l’issue d’une opération de privatisation qui est l’objet même de notre commission d’enquête. Quelles sont donc les raisons qui vous ont amené à vous porter candidat à une entrée au capital d’une entreprise aussi spécifique : la SNCM opère dans le transport maritime, un secteur apparemment éloigné de la sphère de vos investissements de référence ?
Après l’audition de différentes personnalités qui ont été au cœur de cette privatisation, certaines interrogations subsistent quant à la stratégie de Butler Capital Partners.
Nous souhaitons, par exemple, en savoir plus sur la relation nouée avec le groupe Veolia, dont le président de l’époque, M Henri Proglio, s’est au départ montré plutôt opposé à l’entrée de son groupe dans le capital de la SNCM. Dès l’été 2005, quatre administrateurs de Veolia avaient d’ailleurs exprimé, au sein même du conseil d’administration, leur hostilité à l’opération : MM. Bouton, Kourilsky, Schweitzer et Prot.
Nos interrogations portent aussi sur l’évaluation de la SNCM dans le cadre de sa privatisation. En effet, la cession de votre participation à Veolia dans les deux années qui ont suivi son acquisition vous a permis de réaliser une plus-value de quelque 60 millions d’euros, soit près de cinq fois l’investissement de départ, la situation financière et commerciale de l’entreprise ne semblant pas justifier un tel gain, au moins dans de telles proportions..
M. Walter Butler prête serment.
M. le président Arnaud Leroy. Vous l’avez compris, votre vocation de marin nous intrigue. Quand et comment avez-vous été mis au courant de la privatisation de la SNCM, car les dates varient selon les interlocuteurs ? Dans le cadre de la stratégie de votre fonds d’investissement, avez-vous une activité de « renifleur » d’affaires ? Comment procédez-vous ?
M. Walter Butler, président de Butler Capital Partners. Notre activité de « renifleur », Monsieur le président, est en effet au cœur de notre métier.
Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les députés, il est d’usage de déclarer devant une commission d’enquête que l’on est content d’être entendu, alors qu’on ne l’est pas du tout. En ce qui me concerne, je suis sincère car votre convocation me donne l’occasion de faire toute la lumière même si des discussions bilatérales avec certains d’entre vous m’en ont maintes fois offert la possibilité. Une certaine presse a fait circuler des choses à la fois fausses et désobligeantes et, à force de répétitions, les erreurs deviennent souvent des vérités.
J’ai commencé comme haut fonctionnaire avant de créer mon entreprise, il y a un peu plus de vingt ans, une entreprise industrielle, qui gère notamment des fonds d’investissement, spécialisée dans les entreprises « en disruption ». Nous investissons en France et je suis français, même si mon nom ne l’indique pas. Je suis établi en France et j’y ai mes attaches. Nous investissons dans des entreprises françaises, avec l’appui des salariés, c’est un point essentiel. C’était le cas avec la SNCM.
Notre portefeuille passé et présent ressemble à un inventaire à la Prévert, puisque nous intervenons dans tous les secteurs. Avant « Butler le marin », il y a eu « Butler le transporteur ». Nous avons par exemple investi il y a une dizaine d’années, dans France Champignon avec l’appui des salariés et de la région des Pays de la Loire. Le cas est comparable à la SNCM puisque, à l’époque, il n’y avait personne pour aider l’entreprise à passer de la culture du champignon dans les champignonnières à un stade industriel. Les banques ne voulaient pas s’engager seules, mais elles nous ont suivis. La région a dû mettre le dixième de notre mise et les syndicats ont été d’accord pour cette transformation. Cinq ans plus tard, nous avons rapproché France Champignon du groupe Bonduelle qui est aujourd'hui le leader européen, mais qui n’avait pas voulu initialement se porter acquéreur. Nous avons aussi investi dans le groupe Flo et Hippopotamus qui représente plus de 6 000 personnes. Il y a dix-huit ans, nous avions investi dans une autre entreprise du transport pour laquelle le coefficient multiplicateur a été de 7, donc supérieur à celui de la SNCM. Mais il nous est arrivé également de tout perdre. Notre métier repose sur la prise de risques calculés.
Nous ne sommes pas un fonds strictement financier. On a été qualifié par les experts comptables de la CGT qui sont les experts du comité d’entreprise (CE) de la SNCM d’investisseur « industriel ». L’appui des salariés est un élément extrêmement important. L’avant-dernière entreprise que l’on a reprise est le groupe ANOVO qui emploie plus de 5 000 personnes, sur sept sites industriels en France – en Corrèze, à Montauban, à Montpellier, à Beauvais, à Angers – et notre offre a reçu l’appui de 85 % des salariés. Plus récemment, on a repris une entreprise basée dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes considérés comme l’entreprise de référence pour les situations difficiles en France et nous avons désormais vingt ans d’expérience. Ces situations ne manquent pas, on citera ainsi : Neo Sécurité, Heuliez, les volailles Doux, CPI, le leader européen de l’impression, et l’entreprise CMA-CGM dans laquelle nous avons failli investir il y a deux ans. Comme la SNCM, elle est basée à Marseille, comme elle, elle fait du transport maritime. Si nous avions pu investir, nous aurions sans doute récupéré huit à dix fois notre mise. C’est à ce type de retour que l’on peut s’attendre.
J’étais invité à l’Élysée, il y a moins de cinq jours, pour la remise du prix l’Audace créatrice, à ID Logistics et à son président Éric Hémar, que je connais pour avoir failli investir chez eux. Le Président de la République l’a félicité pour l’augmentation du cours de bourse de la société de 150 % en un an. Cela arrive, vous le voyez, et il nous est aussi arrivé, la presse s’en est fait l’écho, de tout perdre à deux reprises, et pour des montants importants. Tel est notre métier.
On investit dans les entreprises. C’est toute la différence avec les autres fonds qui distribuent des dividendes et rachètent avec des fonds empruntés alors que nous investissons toujours par le biais d’une augmentation de capital.
Pour en venir à la SNCM, nous avons été contactés par la banque mandatée par l’État, le Crédit commercial de France, devenu HSBC. Pour résumer, le 8 avril 2005. L’opération implique trois acteurs : l’État d’abord, nous ensuite, et enfin Veolia. Le processus a été à la fois ouvert, concurrentiel et non discriminatoire. Notre prix était en ligne avec le marché, et notre offre était la meilleure. Contrairement à ce que j’ai pu lire ici ou là, l’opération a été validée par la Commission des participations et des transferts qui m’a entendu le 30 mars 2006, avec Veolia. Certes, c’est un fonds d’investisseurs qui a été choisi, mais cela arrive assez souvent. Voyez France Champignon ou encore les activités de restauration, des opérations pour lesquelles nos partenaires privés étaient très contents de notre arrivée.
Quant à notre rôle, nous nous sommes partagé les tâches avec Veolia. Nous avons eu énormément de travail pendant toute la période, dans un contexte très difficile. Un navire a été « enlevé », nécessitant l’intervention du GIGN, nous avons reçu au bureau des menaces de mort, nous avons bénéficié d’une protection policière pendant plusieurs mois.
On est sorti parce que Veolia avait vocation à être l’opérateur dans la longue durée et que le repositionnement de l’entreprise était fait. À notre arrivée, le chiffre d’affaires était de 250 millions et de 307 millions à notre départ ; le résultat respectivement de – 25 millions et de + 15 millions. L’entreprise n’était plus la même, même si sa situation s’est détériorée depuis.
Nous avions conclu avec Veolia une clause de sortie, selon des paramètres classiques du marché. Veolia avait déclaré publiquement qu’elle avait vocation à devenir l’actionnaire majoritaire et elle a souhaité prendre le contrôle conformément à nos accords, pour consolider la SNCM dans ses comptes.
M. le président Arnaud Leroy. Entre-temps, la SNCM s’était vue attribuer la délégation de service public (DSP). Quelles mesures avez-vous prises en tant que président du conseil de surveillance ?
Il se dit des choses assez contradictoires sur les raisons de votre sortie du capital. En ce qui vous concerne, vous invoquez une clause contractuelle, c’est-à-dire le pacte d’actionnaires ; d’autres parlent de divergences stratégiques. Vous vous seriez opposé au rachat d’un navire, pourtant nécessaire à la survie et l’exécution de la DSP, ce qui aurait obligé Veolia à prendre les rênes. Il s’avère que nous n’avons pas trouvé trace de cet achat.
M. Walter Butler. Avant d’évoquer notre sortie, je parlerai de notre entrée qui a été entourée de rumeurs selon lesquelles « les jeux étaient faits », il aurait s’agit, selon certains, de copinage, etc. J’ai entendu dire par M. Gérard Couturier que Veolia avait envisagé un moment de prendre une participation minoritaire,… Ce n’était pas notre problème. L’État gérait le processus qu’il avait lui-même décidé, et que ni la Commission des participations et des transferts, ni la Commission européenne – qui n’a pas fait de cadeau à la France dans beaucoup de dossiers –, ni même le tribunal n’ont remis en cause. En mars 2006, devant le comité d’entreprise (CE), l’État a expliqué que soixante-douze investisseurs potentiels avaient été contactés, que vingt-trois d’entre eux avaient exprimé des marques d’intérêt, que quinze mémorandums d’information avaient été diffusés accompagnés d’engagements de confidentialité – le nôtre portait le numéro 16 – et que trois sociétés, Connex, le fonds Caravelle et nous-mêmes, avaient remis une offre sous condition le 17 juin 2005. Nous avons remis une offre plus détaillée, mais encore conditionnelle, le 28 juillet 2005. L’offre finale a été déposée le 15 septembre 2005.
À ce stade, nous avions deux regrets. Premièrement, ne pas avoir pu rencontrer les organisations syndicales. Peut-être aurions-nous pu alors éviter des incidents. Nous avions mis comme condition à notre offre l’accord des partenaires sociaux et du comité d’entreprise. Nous le faisons toujours et nous l’avions déjà fait à la Société française de production (SFP). On était associé à la Générale des eaux, la « grand-mère » de Veolia, et le vote négatif des salariés a mis un terme à l’opération. Trois ans après, quand l’entreprise a été privatisée, nous ne sommes pas revenus. Deuxièmement, qu’il n’y ait pas eu une concertation avec les élus régionaux, ou une meilleure information à leur intention. Compte tenu des particularités de l’entreprise, une telle démarche aurait été préférable, mais l’État avait la main.
Le plan déposé en annexe de notre offre finale visait à ramener le résultat d’environ – 30 millions à + 10 millions. Nous avons fait mieux grâce à un gain de chiffre d’affaires de l’ordre de 50 millions d’euros, par le biais notamment des restaurants, des ventes à bord, en reconquérant des passagers. L’impression que donnait la SNCM d’être en grève permanente faisait fuir les clients qui sont revenus quand la visibilité s’est améliorée. Les coûts de personnel ont été réduits de 15 millions d’euros, l’effectif étant passé de 2 400 à 2 000 personnes. Nous avons fait des économies de charges externes, de 16 millions à travers un plan de réduction des coûts. Malgré l’augmentation du fioul, des amortissements et des investissements à réaliser, on a respecté le plan d’investissement à la lettre.
Contrairement à ce que j’ai pu lire ici ou là, l’entreprise faisait de lourdes pertes. Le procès-verbal de l’assemblée générale de mai 2006 fait état d’un résultat négatif de 28 millions en 2005. Les syndicats avaient exercé leur droit d’alerte auprès du tribunal de commerce de Marseille qui avait désigné un mandataire ad hoc, dont le mandat a été prolongé six fois entre 2004 et 2006. La situation de l’entreprise était compliquée et nous nous y sommes intéressés parce que ses marchés étaient solides.
Nous avons accompli un important travail de relance commerciale, jalonné de réunions mensuelles de suivi, de reporting et de validation des plans d’action. Dans ce cadre, nous avons déployé le plan de développement du chiffre d’affaires, d’ouverture de lignes, le plan de réduction des coûts de la maintenance. Nous avons, avec la SNCM, suivi toutes les procédures contentieuses contre STEF-TFE, associée provisoirement à Corsica Ferries. De ma vie, je crois que je n’ai jamais passé autant de temps devant les tribunaux : nous avons été assignés auprès du tribunal de commerce de Marseille et de Paris, auprès des deux tribunaux administratifs de Corse, du tribunal administratif de Marseille,… Il y a eu appel, puis cassation. Nous avons été traduits devant les autorités de la concurrence, le Conseil d’État, à la Commission d’accès aux documents administratifs. Bref, nous avons été impliqués dans vingt-cinq contentieux… Notre collaborateur Cyrille Teinturier a passé un an et demi sur ces dossiers. Dans certains cas, nous avons tout fait nous-mêmes, notamment face au Conseil de la concurrence où Veolia n’était pas persona grata. Mais pour tout ce qui avait trait à la DSP, il est normal que Veolia, qui était l’opérateur industriel, soit allée négocier avec l’Office des transports de la Corse (OTC). Veolia a une emprise sur la région marseillaise, puis en Corse, que nous n’avons pas. Dans ce type de partenariat où les acteurs ont des spécialités différentes, la répartition des tâches doit être claire. Nous avons bâti le business plan ensemble. Il se trouve qu’il a été respecté mais, sinon, on aurait pu changer le management qui relevait de Veolia.
Je ne sais pas pourquoi, au final, Veolia n’a pas fait d’offre. La presse a dit qu’elle avait renoncé les tout derniers jours. D’après ce que je comprends, ses dirigeants avaient en tête une participation minoritaire et ils voulaient en quelque sorte imposer à l’État leur propre solution. Ils sont donc revenus en exprimant le souhait de prendre le contrôle pour des raisons de consolidation. Ils avaient alors l’ambition de créer un pôle transports. Ensuite, Veolia a voulu vendre, n’y est pas arrivée. Il arrive aux grands groupes de changer de stratégie.
M. le président Arnaud Leroy. Revenons-en au groupe Butler. Vous faites l’offre la moins coûteuse pour l’État. En quoi l’était-elle ? Vous vous présentez comme industriel, mais telle n’est pas l’image que vous avez auprès des personnes chargées de la privatisation et des élus. Vous êtes entré en contact avec la STEF. Du côté de Veolia, il semble que Stéphane Richard se montrait, lui, très allant alors que la société mère était beaucoup moins enthousiaste.
Comment analysez-vous le comportement de Veolia, vous qui étiez en relation avec eux ? Avez-vous envisagé de déposer une offre commune, avant la réunion de Matignon où, semble-t-il, Veolia est revenu dans le jeu ?
M. Walter Butler. Notre offre était la moins coûteuse car il s’agissait d’un mécanisme de reprise à prix négatif, qui a été longuement étudié par la Commission avant qu’elle le valide. Dans ce cas de figure, il faut solder le passé, c'est-à-dire les dettes, le coût du retour à l’équilibre et les mesures d’ordre social. Finalement, il y a eu deux offres fermes, et la nôtre l’a emporté sur celle du fonds Caravelle.
Notre offre se décomposait en plusieurs éléments. Tout d’abord, le coût du retour à l’équilibre équivalent à deux années de pertes d’exploitation, soit une cinquantaine de millions d’euros. C’est assez classique. Quand Arkema a vendu Kem One, il a fait ce type de calcul. Je précise que l’argent que l’État a remis est allé dans l’entreprise, et celui que nous avons touché au moment de la cession ne venait pas de la SNCM. On n’a pas touché un centime de dividende, de commission de quelque nature que ce soit. Même en tant que président du conseil de surveillance, je ne me suis pas fait payer les billets d’avion quand j’allais à Marseille. Nous avons refusé toute rémunération en tant qu’administrateurs. Les fonds sont venus de Veolia. Donc, tout l’argent est allé à la SNCM.
L’État devait financer les mesures d’ordre social, soit un peu moins de 40 millions d’euros. Des provisions devaient être constituées pour les mutuelles de retraite, à hauteur de 25 millions d’euros, et le système de mutuelle complémentaire, à hauteur de 8 millions d’euros. Des ajustements ont été faits en fonction des expertises et des audits, et des contre-expertises de l’État. Enfin, la Commission des participations et des transferts a validé, avant l’accord final de la Commission.
À propos de Veolia, je ne peux exprimer que des impressions. Veolia a la réputation d’être un groupe compliqué, et c’est la vérité. Veolia Transport allait de l’avant tandis que le conseil d’administration du groupe était plus dubitatif. On s’est posé la question tout l’été ; j’hésitais à faire une offre car j’étais absolument persuadé que Veolia allait en faire une. On savait qu’elle avait eu des contacts précédemment et que, à conditions identiques, l’État choisirait l’industriel. Il nous poussait d’ailleurs à nous associer avec lui.
L’histoire se répétait, celle de la SFP ou de Thomainfor, quand Pierre Bérégovoy était Premier ministre. Nous avons repris cette entreprise avec l’aide des salariés et de l’État. Elle comptait 600 salariés, contre 4 500 aujourd'hui. L’État nous poussait dans les bras de Thomson qui avait mis l’entreprise en faillite. Il avait gardé 20 % du capital pendant trois ans, alors que nous sommes restés dix-sept ans. Mais, pour l’État, il y a d’un côté les industriels, de l’autre les financiers. Nous nous considérons quant à nous comme des investisseurs industriels, parce que nous ne sommes pas un fonds comme les autres, le fonds Caravelle non plus d’ailleurs. Nous sommes deux en France à faire ce métier et on nous retrouve toujours dans ce type d’opération
Il nous arrive de nous associer à des tiers, mais nous sommes à même de faire tout seuls. C’est pourquoi nous avons déposé une offre sur 100 % du capital. C’est ce qui était demandé. Plus tard, l’État nous a demandé de rester à hauteur de 25 % du capital. On a toujours souhaité la présence des salariés au capital, comme dans toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons.
Face aux méandres de Veolia, j’en suis réduit comme vous aux interprétations, mais vous regardez l’histoire à la lumière de ce qui a suivi. Le redémarrage de la SNCM a été très bon, les chiffres le montrent, et Veolia a souhaité se renforcer. Elle a même cherché à faire des acquisitions en Europe du Nord. Au moment où elle a voulu nous racheter notre part dans la SNCM, la période était très faste, parce que tous les contentieux étaient terminés. Le montage avait été avalisé par la Commission européenne et la DSP attribuée, il n’y avait pas eu de grève pratiquement pendant trois ans, le chiffre d’affaires augmentait vite. Le ciel était très dégagé. Ensuite, les choses sont devenues plus difficiles. Je n’ai pas suivi le détail, mais ils ont voulu se dégager… C’est la logique des grands groupes, notamment de Veolia.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Le premier contact au sujet de cette affaire, avec la banque HSBC, remonte au 8 avril 2005. Avez-vous des contacts antérieurement, avec M. Lemor, à propos d’une possible alliance au cas où…
M. Walter Butler. Pour être précis, nous avons envoyé la lettre d’intention le 8 avril 2005. Le 13 mars, nous avions signé le Non-Disclosure Agreement, l’engagement de confidentialité, c'est-à-dire le jour où nous avons reçu le mémorandum N° 16.
Quant aux relations avec Francis Lemor, et la STEF, je vais revoir mes notes, mais je suis à peu près sûr de ne pas avoir eu de contacts avec lui sur ce sujet-là avant. Ils ont eu lieu plutôt un ou deux mois plus tard. Dans une de nos offres indicatives, la lettre d’intention du 17 juin mentionnait notre bonne volonté, puisque l’État poussait à un rapprochement. STEF-TFE était un partenaire naturel de l’entreprise puisqu’elle détenait 39 % du capital de la SNCM et répondait à la DSP avec elle.
J’ai vu à plusieurs reprises M. Francis Lemor. Il faut savoir qu’à l’époque, plusieurs acteurs jouaient en quelque sorte la mort de la SNCM, et sa liquidation. Nombreux étaient ceux qui espéraient qu’il n’y aurait aucune offre de reprise. On me reproche d’avoir gagné de l’argent. Au passage, ce n’est pas moi qui en ai gagné, mais les actionnaires à qui l’argent a été distribué quelques jours plus tard. Souvenez-vous, à l’époque, personne ne voulait y aller. Nous-mêmes, nous nous sommes interrogés sur l’opportunité d’investir. Et quand nous avons appris que Veolia était intéressé, nous nous sommes dit que nous n’avions aucune chance. L’État nous incitant à nous associer, il était logique que nous pensions à la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN). Son dirigeant, M. Francis Lemor, ne s’est pas montré ouvert du tout. Je l’ai dit dans les échanges de lettres peu aimables que nous avons eu par la suite, il m’a semblé qu’il misait plutôt sur la liquidation.
Elle aurait été prononcée aussitôt par le tribunal de commerce s’il n’y avait pas eu d’offre le 15 septembre 2005. Je me souviens des représentants de la CGT, au moment où l’accord a été signé, M. Israël, et un de ses collègues, M. Marty. Ils disaient que la liquidation, c’était la fin de tout. Il était évident que Corsica Ferries allait jouer cette carte, mais Francis Lemor aussi. Après tout, il aurait pu alors racheter des bateaux à la casse, alors qu’ils avaient de la valeur. Je le dis crûment, le fait d’appartenir à la SNCM diminuait la valeur de la flotte. Nous avons été en contact un moment avec l’armement Dreyfus, mais le nombre de salariés le préoccupait. Sans avoir de preuve, je pense que la STEF avait des arrière-pensées. D’ailleurs, à la réunion où elle est venue, elle s’est demandé si la privatisation irait au bout.
On cherchait alors à sortir des problèmes sociaux, et quand Veolia est revenue, il n’était plus question de STEF-TFE. Elle l’a mal pris parce qu’une chose est de voir le fonds France Private Equity III, géré par nous, rester au capital quelques années, configuration qui lui laissait des ouvertures, et une autre de voir s’implanter un groupe comme Veolia, qui employait 10 000 personnes dans la région. C’était en quelque sorte l’ennemi qui investissait la place. En réaction, la STEF s’est tournée vers Corsica Ferries : ils ont conclu un accord. Ont suivi tous les contentieux avec eux, et j’étais à ce moment-là en première ligne parce qu’on a voulu reprendre le contrôle effectif de la CMN, dont STEF-TFE ne détenait juridiquement que 39 %, mais sur laquelle elle exerçait le contrôle économique. Le montage était le fruit d’un accord passé sept ou huit ans auparavant dont M. Lemor disait qu’il était l’idée du fondateur de la CMN, alors sur son lit de mort. J’y vois plutôt une application de la doctrine du « ni ...ni ... » de M. Rocard, qui était Premier ministre. Nous avons dû engager un bras de fer devant les tribunaux parce qu’on ne pouvait pas laisser une entreprise dont nous – Veolia et BCP – détenions, par le truchement de la SNCM, 60 % des droits économiques, être contre nous dans l’appel d’offre de la DSP.
M. François Pupponi. Aviez-vous mis comme condition à votre offre d’obtenir la DSP ? Vous étiez-vous engagé à racheter un navire pour en remplacer un qui ne correspondait plus aux critères de la DSP ?
M. Walter Butler. Nous n’avions pas posé de condition concernant les navires. On a respecté le plan d’affaires. Un bateau a été acquis pour 112 millions d’euros, pour remplir la première DSP, et il a été revendu par la suite. Nous nous étions engagés à maintenir dix bateaux, ce qui correspondait à la flotte existante.
Comme nous n’étions pas « suicidaires », nous avons, de même que tous les candidats, demandé à bénéficier, à l’échéance qui tombait dix-huit mois plus tard, d’une DSP comparable. À défaut, ce n’étaient pas 400 personnes qu’il aurait fallu faire partir, mais 2 000 ; et on aurait eu besoin non pas de deux gardes du corps, mais de 200, et tout à l’avenant ! Aucun chef d’entreprise sérieux n’aurait agi autrement.
M. Camille de Rocca Serra. Le premier bateau venu renforcer la flotte a été acheté d’occasion en Norvège. Il a été redimensionné et livré deux ans après. Veolia, qui était alors notre interlocuteur, convenait que les bateaux étaient trop lents et de trop faible capacité.
Je m’interroge sur la chronologie, Monsieur Butler. Nous nous sommes rencontrés au moment au début du processus ; nous avons même fait une émission de télévision ensemble. Il était alors question d’une reprise à 100 % et vous étiez seul en lice. Vous n’aviez pas, alors, de contacts avec Veolia ?
M. Walter Butler. Tout dépend de ce que vous appelez contacts. Nous savions, c’était d’ailleurs dans les journaux, que Veolia était intéressée, mais qu’elle n’avait pas remis d’offre.
M. Camille de Rocca Serra. Je me souviens que vous aviez répondu oui aux quatre questions que je vous avais posées pour savoir si vous étiez d’accord pour que l’État reste dans le capital, pour qu’une entreprise du transport entre dans le capital, pour que les salariés soient aussi dans le tour de table. Vous acceptiez même les transporteurs locaux à vos côtés. Vous m’aviez dit alors qu’on vous avait demandé de prendre la totalité du capital. Indépendamment de vos contacts avec Veolia, l’accord final était le fruit d’un accord pour endiguer la crise sociale et politique. Ceux qui ont fait entrer Veolia par la suite sont les mêmes que ceux qui avaient imaginé une privatisation à 100 %. Les événements se sont enchaînés selon la théorie des dominos : les troubles sociaux et la prise d’un bateau ont entraîné une réaction politique à un problème économique. Vous aviez une liberté d’action totale au départ, et la clause résolutoire pour la DSP n’est apparue qu’après l’arrivée de Veolia.
M. Walter Butler. Détrompez-vous, le maintien de la DSP figurait dès le départ dans chacune des offres. Pour le reste, je suis d’accord.
S’il y avait des divergences chez Veolia, il y en avait aussi au sein de l’État, entre le Gouvernement et l’administration. Le Trésor souhaitait vendre l’entreprise dans sa totalité et, dans les documents, l’offre portait sur 100 %. Si l’État avait dit d’emblée qu’il souhaitait garder 25 ou 34 %, nous aurions ajusté notre offre en conséquence. L’État sentait la pression de Bruxelles, et j’ai l’impression qu’il a voulu passer en force. Devant les salariés, il parlait d’ouverture du capital et de l’arrivée de la Caisse des dépôts, ou d’une institution dans son genre. À la place, il leur a servi une privatisation à 100 %, un plan social, un fonds au nom anglo-saxon,… Le délégué du personnel au CE m’a dit que c’était trop. Croyant voir arriver l’« antéchrist », la CGT s’est alliée au Syndicat des travailleurs corses (STC) et ils ont mis le feu aux poudres. Alors, l’État a fait marche arrière. Son maintien à 25 % ou 34 % aux côtés d’un opérateur industriel, ou une cohabitation à trois, aurait pu être envisagé dès le départ.
N’étant plus actionnaire de la SNCM, je connais moins bien sa situation aujourd'hui, mais ses pertes sont assez faibles. Pourvu que la DSP soit convenablement calculée, car, bien sûr, l’entreprise en dépend, la SNCM est tout à fait à même d’être à l’équilibre. Le seul vrai risque, c’est la décision du tribunal, car le marché du fret et du transport de passagers sur lequel elle évolue est bon, comparé à celui de la SERNAM ou de Mory qui chute de 25 %.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Alors que vous aviez remporté l’appel d’offre, pourquoi avoir accepté d’intégrer Veolia dans le tour de table ? Vous l’a-t-on demandé ? Avez-vous pris l’initiative ? Y avez-vous été incité fortement ?
M. Walter Butler. Non. Mettez-vous à ma place à ce moment-là. On a déposé une offre à 100 % et nous avions demandé à l’État s’il ne serait pas bon, avant de dévoiler notre offre, de l’expliquer en rencontrant les syndicats. Il a refusé. Mais le lendemain de l’annonce officielle, tout était dans la presse et la bataille syndicale était déjà lancée. L’entreprise était en grève, un bateau venait d’être détourné – du jamais vu dans l’histoire maritime –, les salariés étaient très hostiles et les syndicats étaient « vent debout ». L’affaire ne s’annonçait pas sous les meilleurs auspices. J’avais le sentiment d’avoir un fusil braqué dans le dos, et un autre sur la poitrine. Dans ces circonstances, je me suis dit que mieux valait ne pas être seul. Veolia voulait revenir, même si elle n’avait pas remis d’offre, et elle se faisait plus insistante car elle trouvait que la SNCM était une belle entreprise. Elle aussi a sous-estimé les aspects sociaux. Au même moment, la Régie des transports de Marseille était en grève parce que le maire avait décidé d’employer trois personnes de Veolia au ramassage des ordures. La situation était tendue et nous nous sommes entendus, jugeant la configuration finale acceptable.
M. le président Arnaud Leroy. Pour nous, le tour de table final était le résultat d’une réunion à Matignon. Vous nous apprenez que, depuis la date limite de dépôt des offres, Veolia faisait du lobbying pour revenir dans le jeu, alors que d’autres auditions donnaient l’impression qu’on était allé la chercher par la manche, pour rassurer les syndicats et obtenir la paix sociale. Confirmez-vous donc les démarches de Veolia, qui ont reçu la caution du Gouvernement dans le contexte social que l’on connaissait ? N’avez-vous pas été sollicité, comme les autres, par les plus hautes autorités de l’État, le Premier ministre, les ministres responsables ou le préfet de région ? Il n’en demeure pas moins que cette affaire comporte un aspect politique. Pourriez-vous nous éclairer plus précisément sur vos relations personnelles avec MM. Stéphane Richard et Dominique de Villepin ?
M. Walter Butler. Non, je n’ai pas eu de contacts politiques avant la remise de l’offre. Je ne sais pas comment Veolia a réussi à revenir. La presse a repris ses déclarations, à savoir qu’elle n’était pas en service commandé. La vérité doit être un peu plus nuancée. Le point central, c’était que le conseil d’administration de Veolia ne voulait pas d’une participation majoritaire. Un des administrateurs dont vous avez cité le nom estimait même qu’il s’agissait d’un investissement pour fonds de retournement et avait donné mon nom. Cette position cadre avec leur stratégie de prise de participation minoritaire, dans un premier temps. Cette solution n’était pas en opposition avec la doctrine du conseil d’administration du groupe, ce qui la rendait plus confortable.
Je n’étais pas au courant de la réunion à Matignon. Le seul contact que j’ai eu, c’est avec Pierre Mongin, le directeur de cabinet du Premier ministre, qui, en quelques secondes, m’a demandé de trouver une solution. Mais c’était bien après le dépôt de l’offre.
Sur mes relations avec Dominique de Villepin, tout a été dit, et même n’importe quoi. Au moment de la privatisation de la SNCM, je n’étais plus en contact avec lui depuis sept, huit, dix ans, peut-être plus. Je l’ai connu parce qu’il a été reçu trois ans avant moi à l’ENA et qu’il m’a aidé à préparer le concours. Ce n’est pas un délit. Je l’ai beaucoup vu entre vingt et vingt-six ans, beaucoup moins ensuite. Après, il a fait la carrière que l’on connaît. Contrairement à certaines bêtises que j’ai lues dans la presse, ce n’est pas lui qui m’a nommé au Conseil d’analyse économique, il m’a plutôt « dénommé ». Et j’ai plutôt l’impression que c’est parce que nous nous connaissions que j’ai raté la Sogerma, filiale d’EADS, implantée à Mérignac. Nous nous étions positionnés, nous avions eu l’accord des salariés et il y a eu un blocage au niveau du Premier ministre. Sans doute pour éviter les rumeurs. Je ne l’ai pas revu depuis des années. Il ne m’a pas dédicacé tous les livres qu’il a écrits…
Quant à Stéphane Richard, il était directeur général de Veolia Transport, et il a géré le dossier dans l’intérêt de son entreprise.
M. le président Arnaud Leroy. Vous ne le connaissez pas mieux que ça ? Vous avez été en contact avec HSBC, qui a désigné comme expert un avocat qui est, selon moi, plus un essayiste qu’un spécialiste du droit. Vous avez parlé de Pierre Mongin, de Stéphane Richard dont les noms apparaissent dans d’autres dossiers. Nous sommes en droit de nous interroger.
Je vous suis dans votre analyse, selon laquelle Veolia cherchait à rester actionnaire minoritaire, mais je ne comprends pas que Veolia n’ait pas essayé de redimensionner la vente. Pourquoi n’a-t-elle pas déposé une offre, même à 35 %, quitte à demander à l’État de rester le temps de consolider un Pacte d’actionnaires ?
M. Walter Butler. Comme souvent dans les grands groupes, la stratégie de Veolia a fluctué selon les circonstances. L’État voulait privilégier une vente à 100 % et il a dû faire marche arrière ensuite. Mais je ne vois pas en quoi le fait de connaître Stéphane Richard aurait changé quoi que ce soit. Je connais François Pinault, et quand je lui ai repris une affaire, il a défendu son « bout de gras », et moi le mien. Ce sont les affaires. Les gens de Veolia, croyez-moi, ne sont pas des enfants de chœur ! Les négociations sont dures, comme toujours dans ce genre de situation. Les grands groupes arrivent assistés de conseils, de banques, d’avocats,… En plus, Veolia était impliquée aux côtés de Veolia Transport. La thèse qui voudrait que quelqu’un ait piloté l’affaire tout seul ne tient pas.
M. le président Arnaud Leroy. Vous comprenez que nous nous intéressions à une affaire qui risque tout de même de coûter 500 millions d’euros à l’État français.
M. Walter Butler. L’ardoise, je n’y peux rien. Nous avions posé, Veolia et nous, comme condition que la Commission européenne approuve le plan, ce qu’elle a fait. Ce n’est pas toujours le cas. Dans une autre affaire dans laquelle nous avons perdu beaucoup d’argent, le SERNAM, et qui portait sur 680 millions d’euros, elle a rendu un avis négatif. Deux mois avant encore, nous avions fait une offre pour reprendre l’entreprise Mory, où nous devions mettre 50 millions qui ont failli disparaître en moins de deux mois. J’aurais eu de sérieux problèmes avec mes actionnaires. Il fallait faire avec le système, qui va perdurer d’une manière ou d’une autre, à moins de liquider la SNCM.
Il y a aussi un vrai problème que personne n’aborde, qui est celui de Corsica Ferries. Une des raisons des difficultés de la SNCM, une parmi d’autres, réside dans la concurrence totalement déloyale exercée par Corsica Ferries, qui contourne les engagements que nous avions souscrits s’agissant du pavillon français. J’ai regardé, avant de venir, des documents transmis par Corsica Ferries à la Commission. Ses dirigeants semblent se considérer comme les gestionnaires des transports de la Corse, en expliquant qu’il n’y a pas besoin de la SNCM, ni de telle ou telle ligne. Je crois d’ailleurs qu’il y a eu des projets de commission d’enquête parlementaire. En tout cas, c’est un vrai sujet.
M. le président Arnaud Leroy. Je partage votre analyse. La Commission a validé le plan, mais elle a été sanctionnée par le tribunal. Quels ont été vos rapports avec la Commission ? Avez-vous été associé aux négociations autour de l’aide d’État ?
M. Walter Butler. On nous a demandé des informations techniques, mais c’est la chasse gardée de l’État.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Les modalités d’acquisition des actions de la SNCM par votre groupe sont particulières puisque BCP s’est porté acquéreur au nom de ses partenaires – vos associés – mais aussi des salariés du groupe BCP, et du fonds de commun de placement à risque France Private Equity III dont le groupe Butler assure la gestion. Est-ce un montage habituel ?
M. Walter Butler. Oui. Nous l’avons utilisé des dizaines de fois. En vertu du contrat qui nous lie à nos investisseurs, nous devons investir dans les mêmes termes et conditions.
M. le rapporteur. Et à la sortie, que s’est-il passé ?
M. Walter Butler. Quelques jours ou semaines après le règlement, on a distribué l’argent à nos investisseurs, des fonds de pension de France et du monde entier.
M. le rapporteur. Le Pacte d’actionnaires conclu avec Veolia comportait à la fois le calcul des conditions financières de la sortie du capital de la SNCM et l’obligation, après deux ans et pendant cinq ans, faite à Veolia de racheter les parts au prix convenu et à la date choisie par BCP, et des pouvoirs renforcés en faveur du président du conseil de surveillance sur les investissements puisque tout investissement en navire de plus de 40 millions d’euros doit recueillir son accord. Certaines personnes que nous avons interrogées jugent ce Pacte très défavorable à Veolia. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, les termes de l’accord ne vous poussaient-ils pas à optimiser les conditions de votre sortie en jouant sur les variables de la formule plutôt qu’à organiser la viabilité à long terme de la société ?
M. Walter Butler. Vous pouvez dire que le Pacte était très défavorable à Veolia, mais je ne crois pas à l’histoire du « petit Poucet », Walter Butler, qui imposerait sa loi à un groupe de 250 000 personnes. Si vous aviez vu l’armada d’avocats utilisés par Veolia, vous comprendriez qu’ils étaient en position de force : ils ont une direction juridique, nous n’en avons pas ; ils ont fait appel à au moins deux ou trois cabinets d’avocat…
Si erreur il y a eu de leur part, c’est de ne pas avoir anticipé une dégradation de la situation. Sinon, le Pacte était classique. Il répartissait les rôles respectifs de l’opérateur et du contrôleur de la gestion, d’où le passage à une structure avec directoire et conseil de surveillance. Il est normal que celui-ci donne son autorisation préalable pour les décisions au-delà d’un certain montant. On a strictement respecté le Pacte, le plan d’affaires et les investissements qu’il prévoyait, d’ailleurs remis à l’État dans le cadre de la privatisation.
Le Pacte comportait le droit de préemption de chacune des parties en cas de cession par l’autre, les dates de réunion, les autorisations préalables. Les termes en étaient très classiques, quoi qu’en pensent certains. Le conseil de surveillance était présidé par l’État jusqu’à l’obtention de la DSP, par nous ensuite, selon l’accord initial. Il était composé de représentants de BCP, de Veolia, de l’État et des salariés. Le directoire était présidé par Veolia pour autant que le budget soit respecté. Il n’y a rien à redire à cela. Ensuite, il n’est pas question de navire de plus de 40 millions d’euros, mais le président du conseil de surveillance devait autoriser « toute dépense non prévue dans les enveloppes financières mentionnées dans le plan d’investissements opérationnels du plan d’affaires », lequel avait prévu des renouvellements de navire. En revanche, il n’était pas possible de se lancer dans des activités nouvelles.
M. le président Arnaud Leroy. Vous avez déclaré à la presse que vous entriez à la SNCM pour y rester. Le document que nous avons consulté prévoyait une possibilité de sortir entre la deuxième et la septième année. Vous avez levé votre option très vite.
M. Walter Butler. Ce n’est pas moi qui l’ai actionnée. Le rachat s’est fait en gros sur la base de la formule qui était prévue, mais il n’y a pas eu de notification. L’horizon était dégagé, les prévisions favorables, Veolia voulait être maître à bord, et nous nous sommes mis d’accord.
M. Avi Assouly. Quelle a été l’attitude du préfet ? Au moment de la transaction, il semble bien qu’il ait joué un rôle important.
M. Walter Butler. Le premier contact que j’ai eu à propos de cette affaire avec le préfet Frémont, dont j’avais fait la connaissance auparavant, dans ses fonctions antérieures, a eu lieu après la remise de l’offre finale, après le 15 septembre. Je l’ai appelé, il a organisé une réunion quelques jours après, à Marseille. Je pourrais retrouver la date. Dans l’appareil d’État, ce n’était pas au préfet de s’occuper de cette affaire, mais, compte tenu de la personnalité et de la compétence de M. Frémont, il a été décidé de le désigner comme interlocuteur unique. Et c’était bien après la remise des offres.
M. Dominique Tian. Je voudrais rappeler le contexte. La réunion à la préfecture était présentée comme celle de « la dernière chance ». La CGT encerclait la préfecture, les élus étaient sur les charbons ardents, et tout le monde craignait la liquidation. En somme, vous êtes apparu comme le sauveur potentiel et vous avez été plutôt bien accueilli. Les négociations avec les syndicats ont été de bonne qualité.
M. Walter Butler. Vous avez raison, Monsieur le député. Je rappelle seulement que nous avons obtenu un vote positif de 82 % des salariés, dont j’avais fait une condition sine qua non. Je pourrais retrouver des articles de l’époque se demandant ce que Butler venait faire dans cette galère, et présentant notre venue comme un service rendu à l’État. Cette année, nous avons perdu de l’argent dans une affaire, ce qui nous a valu d’être traités d’incompétents. Si on pouvait éviter de nous traiter de voleurs quand nous en gagnons… Nous avons fait un vrai travail de fond, compliqué et sérieux, avec un partenaire difficile. Nous avons respecté nos engagements à la lettre. Le prix convenu était un prix de marché compte tenu de la situation de l’entreprise cette année-là. Nous avons des exemples comparables. Prenez CGA-CGM dont la valeur a été multipliée par dix en moins de deux ans, parce que le prix du fret avec la Chine a, à nouveau, évolué favorablement. Nous nous intéressons d’ailleurs à d’autres affaires dans les Bouches-du-Rhône.
On s’interroge sur le rôle des fonds d’investissement. Il est important, mais surtout, j’insiste sur nos différences avec les autres fonds. Caravelle et BCP investissent dans des entreprises en difficulté, c’était le cas de la SNCM, mais ce ne sont pas des opérations strictement financières. On intervient souvent parce que les groupes industriels ne le font pas, par exemple chez France Champignon ou chez Flo.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Quand vous entrez au capital de la SNCM, les difficultés sont derrière vous. La recapitalisation qui a eu lieu a effacé les pertes, le plan social est provisionné et vous avez l’assurance d’avoir la DSP qui permet d’équilibrer les comptes. Il est donc logique d’envisager, à l’horizon de deux ans, une plus-value, à moins d’une catastrophe.
M. Walter Butler. L’argent que nous avons perçu venait de Veolia, pas de la SNCM, et nous ne l’avons pas forcée à vendre. Il n’y a pas eu de ma part d’exercice de la clause contractuelle. Sans doute Veolia a-t-elle des regrets aujourd'hui, mais il nous est aussi arrivé de nous mordre les doigts. Quand le SERNAM a été privatisé, j’ai eu droit à un quart de page dans Le Canard enchaîné intitulé « L’ami de Villepin prend la route ». Je ne suis pas l’ami de Villepin et nous avons perdu tout l’argent que nous avions investi, qui se compte en dizaines de millions d’euros. Dans le cas de la SNCM, l’opération concernait deux groupes dans le cadre d’une opération avalisée dès le début, transparente et sans discrimination.
Le sujet, maintenant, c’est l’avenir de la SNCM. Je pense qu’elle en a un et qu’il dépend beaucoup des élus de l’exécutif corse. Il faut être inventif, et se demander si la flotte doit forcément être la propriété de l’opérateur. Il faut examiner le dossier avec des yeux neufs. Deux entreprises au moins doivent assurer le service public. La situation actuelle est le fruit d’une histoire que vous connaissez mieux que moi, mais la SNCM a de l’avenir parce qu’elle a des actifs, et qu’elle opère sur de bons marchés. Et l’État a eu raison de faire un recours contre la décision du tribunal européen.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur Butler, je vous remercie et je laisse la parole à M. Tian qui veut faire une déclaration.
M. Dominique Tian. Nous sommes plusieurs à ressentir un certain malaise. Le rapporteur, en tant que président de l’exécutif corse, a lui-même demandé 220 millions d’euros à la SNCM, ce qui pourrait signifier sa mort pure et simple. Je ne vous cache pas, même si ce n’est pas l’objet de la commission d’enquête, que mon groupe politique a du mal à comprendre. Que le président Giacobbi prétende que ça n’a aucun rapport nous paraît spécieux. Le groupe UMP s’inquiète de ce mélange des genres.
M. le président Arnaud Leroy. J’invite le groupe UMP à saisir, s’il le souhaite, la conférence des présidents et, le cas échéant, nous prendrons des décisions en conséquence.
M. le rapporteur. Pour rétablir un peu d’exactitude, je précise que j’ai écrit au groupe Veolia pour une raison très simple : parce que nous avons attribué une délégation de service public à une société dont chacun reconnaîtra qu’elle ne présente pas toutes les garanties d’équilibre financier et de pérennité. Or je n’avais pas le droit de le faire puisque, avant de déléguer, il faut s’assurer de la pérennité et de la viabilité du ou des délégataires. J’ai donc écrit de manière très confidentielle à la direction de Veolia, et ce n’est pas mon fait si la lettre a été reprise dans la presse.
Pour le cas où nous serions contraints, en vertu des articles du code général des collectivités territoriales, d’émettre un titre de recette, il va de soi que nous mettrions en cause Veolia, du fait de la confusion de patrimoine qui existe entre les deux sociétés, sans laquelle la SNCM serait défaillante depuis plusieurs années, et qui s’apparente à un soutien abusif ; et d’autre part, du fait de l’évidente direction de fait exercée par Veolia. Aucune réunion, aucune rencontre, aucune décision ne s’est prise entre l’autorité concédante et les candidats à la délégation sans sa présence, ou celle de son mandataire social ou des personnes désignées par lui. Par conséquent, quand la confusion de patrimoine, la direction de fait ou le soutien abusif sont établis par autant d’éléments, il va de soi qu’un créancier potentiel est amené à le signaler à la maison mère.
La lettre a été publiée, je ne sais pas par qui, et j’y ai répondu par un communiqué précisant que ; premièrement, cette lettre était envoyée sous le secret des affaires qui a donc été violé – j’envisage des poursuites judiciaires à ce titre, en particulier parce qu’il y a diffusion de fausse nouvelle de nature à créer un préjudice – ; deuxièmement, le code général des collectivités territoriales enjoint à une collectivité qui a accordé une aide à une entreprise « au cas où ladite aide aurait fait l’objet d’une injonction de remboursement de la part soit de la Commission de l’Union européenne, soit de la Cour de justice, à titre provisoire – c’est le cas depuis le 3 mai – ou définitif, d’émettre un titre. Si la collectivité ne le fait pas, le préfet, après mise en demeure, doit, dans un délai d’un mois, y procéder par tout moyen » ; troisièmement, pour le cas où il y aurait une procédure de manquement et où des pénalités seraient imposées à la République française, le code général des collectivités territoriales dispose que c’est la collectivité qui aurait dû recouvrer en temps utile les sommes en cause qui devra acquitter lesdites pénalités. Je vais donc transmettre deux pièces : la lettre envoyée à Veolia, désormais plus ou moins publique ; et le communiqué par lequel je réponds. Je ne peux pas être tenu pour responsable de publications dans la presse contre lesquelles je m’insurge et qui disent l’inverse de faits qui sont aisément démontrables.
Par ailleurs, cette commission d’enquête a été créée exclusivement pour examiner les événements antérieurs. Nous n’avons pas à interroger des personnes qui, actuellement, gèrent la SNCM.
Saisissez la conférence des présidents, mais je trouve cela extrêmement déplaisant. Et je commence à me fatiguer de l’influence d’un certain nombre de lobbies sur les affaires publiques.
M. le président Arnaud Leroy. Les choses sont claires. Merci, Messieurs.
k. Audition, à huis clos, de M. Christian Frémont, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône (mai 2003-mai 2007)
(Séance du mercredi 9 octobre 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons ce matin M. Christian Frémont. Au long d’une carrière préfectorale bien remplie, M. Frémont a notamment été préfet de la région PACA, préfet des Bouches-du-Rhône, de mai 2003 à mai 2007. Une longévité de cinq années dans un tel poste mérite d’être soulignée.
Monsieur le préfet, votre expérience est très utile à nos travaux. La privatisation de la SNCM est en effet intervenue quand vous étiez en fonction à Marseille. À ce titre, vous avez eu à connaître et à gérer différents conflits sociaux et de fortes périodes de tension directement liées à la situation de la compagnie maritime. Vous pourrez nous retracer l’enchaînement des événements replacés dans le contexte de l’époque et, surtout, apporter votre éclairage sur ce que nous avons pu apprendre au cours des auditions précédentes.
C’est vous qui avez annoncé aux salariés, en septembre 2005, la privatisation future de la SNCM et sa cession au fonds d’investissement de Walter Butler, l’actionnaire choisi par l’État. Vous avez également été confronté à des grèves dures et vous avez dû organiser, pour sortir de la crise sociale, des tables rondes avec les organisations syndicales et les élus. Bref, vous étiez en première ligne.
Par ailleurs, quelles ont été à l’époque vos relations, et comment vous êtes-vous partagé le travail, avec votre collègue de la région Corse, Pierre-René Lemas qui, lui aussi, avait à connaître des conséquences du « dossier » de la SNCM et qui est devenu depuis le Secrétaire général de l’Élysée ?
Enfin, nous n’oublions pas que vous avez occupé ultérieurement les importantes fonctions de conseiller puis de directeur de cabinet à la Présidence de la République. Dans ce cadre, avez-vous été impliqué, voire simplement consulté au regard de votre expérience, sur les suites de la privatisation de la SNCM ? À l’époque, notamment au moment de la présidence française, qu’avez-vous su des relations avec les autorités de Bruxelles ? Avez-vous suivi, ou été seulement informé, du rachat de la participation de Walter Butler par Veolia en 2008 ? Ou bien s’agissait-il d’une relation purement contractuelle entre deux partenaires privés ?
M. Christian Frémont prête serment.
M. Christian Frémont, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône (mai 2003-mai 2007). Monsieur le président, à l’Élysée, je ne me suis jamais occupé de la SNCM, pas plus en 2008 qu’ensuite. Je n’ai suivi le dossier que dans la presse. Ma participation à cette affaire s’échelonne entre décembre 2004 et octobre 2005, période pendant laquelle, oui, j’ai souvent été en première ligne.
Quand je suis arrivé, la situation de la SNCM n’était pas bonne. Les élus marseillais invoquaient la baisse du trafic, qui mettait le port en difficulté. Avant d’être nommé à Marseille, j’avais été préfet notamment du Finistère et du Pas-de-Calais, ce qui m’avait familiarisé avec les problèmes de Brittany Ferries et de SeaFrance. Sans être spécialiste du transport maritime, j’avais tout de même des éléments de comparaison.
J’avais géré les grèves de 2003 et 2004. Cette année-là, il y avait eu notamment une grève d’une semaine en février et de trois semaines en septembre. Il me fallait veiller à l’ordre public, en particulier aux passagers bloqués sur le port que nous devions nourrir et héberger. Les choses s’arrêtaient là. Or, le 22 décembre 2004, le président de la compagnie, M. Vergobbi, est venu m’avertir d’une « catastrophe imminente » parce que les deux banques qui le soutenaient, à savoir le Crédit agricole et la Deutsche Bank, lui avaient fait savoir qu’elles n’assureraient pas la fin du mois. J’ai été convoqué à Paris et le tribunal de commerce a nommé un mandataire ad hoc, pour passer l’échéance.
Comment en était-on arrivé là ? Les difficultés éprouvées par la SNCM étaient d’ordre à la fois commercial, financier et même moral. De 2003 à 2004, son chiffre d’affaires avait baissé de 26 %, et sa part dans le trafic était passée de 82 % en 1999 à 43 % en 2004. Les grèves de 2004 lui avaient fait perdre 200 000 passagers, et le déficit atteignait à la fin de l’année de 29,6 millions d’euros, juste après une recapitalisation par l’État sous la forme d’un versement de 66 millions, sur les 69 millions autorisés par Bruxelles. Les autorités européennes avaient donné le feu vert à cette opération à condition qu’elle s’accompagne d’une restructuration. Elle n’avait pas eu lieu, bien au contraire, puisque, en 2001, il y avait 1 599 navigants, et 1 644 en 2004.
J’avais suivi de près les péripéties de Brittany Ferries dans le Finistère, et je savais que les dépenses de personnel y représentaient 26 % du budget, contre 56 % à la SNCM ! Quant à sa grande rivale, Corsica Ferries, elle exploitait le même nombre de bateaux avec la moitié moins de personnel. Les banques, comme Bruxelles, réclamaient régulièrement une restructuration qui n’avait jamais été entreprise, par aucun Gouvernement. En outre, six présidents s’étaient succédé en dix ans à la tête de la compagnie, ce qui nuisait évidemment à la continuité de la politique suivie. Bref, la crise qui a éclaté n’avait vraiment rien d’un coup de tonnerre dans un ciel serein.
Le 22 décembre 2004, donc, M. Vergobbi me prévient de la gravité de la situation. Paris réagit et une réunion ministérielle se tient le 10 janvier 2005, d’où il ne sort rien de précis. Il me semble que les autorités de la capitale sous-estimaient la dureté des relations sociales à Marseille. Le 12 février, le secrétaire d’État aux transports, M. Goulard, est venu tenir une table ronde réunissant les organisations syndicales, les élus de PACA et de Corse, et les professionnels du port, dont j’ai conclu qu’il n’y avait pas d’autre solution que l’ouverture du capital de la compagnie – on parlait alors d’une participation minoritaire. Les élus avaient rappelé à l’État ses devoirs, mais, dans l’ensemble, ils n’étaient pas opposés à l’arrivée d’un actionnaire privé, à la condition toutefois qu’il soit minoritaire. Les élus corses, et ils l’ont répété tout au long de l’année 2005, étaient résolument opposés à la création d’une compagnie régionale corse que réclamait le Syndicat des travailleurs corses (STC). Les syndicats protestaient, et ne cessaient de me répéter lors de nos contacts quasi quotidiens : « Tout ça, c’est du baratin. L’État a toujours payé, et il finira bien par le faire. » Le secrétaire d’État a expliqué clairement que Bruxelles interdisait tout nouvel apport de capital, dans les dix ans suivant la dernière recapitalisation. La situation paraissait donc bloquée, mais les syndicats, je pense, n’y ont jamais cru. Ils imaginaient, à l’époque en tout cas, qu’on « bluffait ». M. Goulard a annoncé à cette occasion qu’il confiait une mission à M. Claude Gressier, ingénieur général des Ponts et chaussées. Il l’a menée à Paris, et je n’ai pas eu de contacts avec lui pendant plusieurs mois. Les élus, comme les syndicats, se sont d’ailleurs plaints que le travail de préparation des appels d’offre ait été mené en solitaire.
Deuxième étape : avril 2005, quand la CGT déclenche une grève de seize jours, pendant les vacances de Pâques. En général, les grèves ont lieu pendant les vacances ou au mois de février, à la saison des clémentines en Corse. Le motif est de protester contre l’inscription, plus tard annulée, de la SNCM au registre international français et, bien sûr, contre le projet de privatisation. Évidemment, ce mouvement social n’a rien arrangé. Le Gouvernement, pour en sortir, a créé un groupe de travail. Il s’est réuni à Paris à huit reprises, sans résultat. Je n’y ai pas participé mais j’ai reçu le compte rendu final le 19 septembre. En avril, le Gouvernement s’était engagé à étudier le projet des syndicats pour la SNCM qui reposait essentiellement sur la vente des actifs de la compagnie. Mais, en 2005, il répétait qu’il cherchait avant tout des partenaires privés. C’était l’objectif fixé à M. Gressier. Cela étant, les décisions de fond n’ont pas été prises à ce moment-là, le Gouvernement craignant de compromettre la saison d’été de la SNCM.
En mai 2005, nouvelle alerte quand le procureur de la République m’apprend que les banques n’assureraient la trésorerie que jusqu’au 30 juin, « agacées » qu’elles étaient par la reculade du Gouvernement, et qu’au-delà de l’échéance fixée, il ne serait pas question de prolonger leur soutien si Sudcargos et le navire à grande vitesse (NGV) Asco n’étaient pas vendus, la privatisation effectivement engagée et le plan social annoncé. La menace se précisait pour la fin juin 2005. Heureusement, elle n’a pas été suivie d’effets.
Fin juin, M. Vergobbi est venu me faire part des résultats de l’appel d’offre : trois entreprises avaient répondu – Connex, Butler, Caravelle –, toutes demandaient une participation majoritaire et le plan devait être bouclé pour la fin août. D’ici là, il allait céder Sudcargos et le NGV.
Le 28 juin s’est tenue à Paris une réunion interministérielle, au cours de laquelle le représentant du ministère des transports a rappelé qu’il serait impossible de payer les salaires de septembre si on n’avait pas trouvé un repreneur d’ici là et qu’à défaut, on courrait au dépôt de bilan. Il m’annonçait aussi que les offres seraient clarifiées à la fin juillet. À ma connaissance, il ne s’est rien passé ni fin juillet, ni fin août. Les affaires ont repris à la rentrée.
Le 9 septembre, j’ai été convoqué par le directeur de cabinet du ministre des transports, M. Bisch, qui m’a confirmé les offres et informé qu’une décision serait prise très rapidement.
Le 15 septembre, le conseil d’administration de Veolia a décidé que sa filiale ne présenterait pas d’offre. Je n’en ai pas été averti officiellement ; je l’ai appris par la bande, et j’ai vérifié auprès du ministère. Le 12 septembre, M. Perben, qui avait succédé à M. Goulard, m’a indiqué que les annonces qui suivraient seraient faites de Marseille, autrement dit que j’en étais chargé. Avant chacune d’entre elles, j’ai reçu des éléments de langage. Chaque réunion était donc préparée au niveau des ministères des transports et des finances. Le 19 septembre, j’ai indiqué qu’il n’y avait que deux repreneurs, et qu’ils avaient demandé à être majoritaires. Et le 26, que c’était finalement Butler qui avait été retenu. J’étais à Marseille mais je n’ai à aucun moment participé au processus de choix qui s’est déroulé à Paris. J’ai tenu dix-sept réunions avec les syndicats entre le 19 septembre et le 13 octobre. Je les voyais donc quasiment tous les jours et cela durait toute la journée, voire parfois une partie de la nuit.
Parallèlement, j’avais à gérer l’ordre public. Or les manifestations de la SNCM étaient quelquefois très violentes. Dans le Finistère, j’avais dû faire face aux pêcheurs et aux agriculteurs, qui n’étaient pas des « tendres », mais jamais je n’avais vu une telle violence : juchés sur des pelleteuses, les grévistes ont poussé à la mer des voitures neuves entreposées sur le port et destinées à l’exportation ; une autre fois, du haut du pont du Méditerranée, ils ont jeté sur les CRS en contrebas d’énormes pièces de métal. Dans le même temps, le port s’était mis en grève, d’abord vingt-quatre heures pour soutenir la SNCM, ensuite, pour protester contre le projet de réforme portuaire –cela a duré tout le mois de septembre –, entraînant le blocage du port de Fos, des raffineries et des dépôts pétroliers. Parallèlement, la Régie des transports marseillais s’est mise en grève elle aussi pour s’opposer à un projet de délégation de service public. Pendant six semaines, Marseille a vécu sans métro ni bus. Et il ne faudrait pas oublier la grave crise sociale qui a éclaté après la décision de Nestlé de fermer son usine de Saint-Menet. Le mois de septembre 2005 a été très rude du point de vue de l’ordre public, et très éprouvant pour les habitants. Le Gouvernement commençait à s’inquiéter sérieusement des risques de pénurie de carburant. Il y a eu dans la rade de Fos jusqu’à soixante pétroliers en attente de déchargement.
Après avoir annoncé que le groupe Butler aurait 100 % du capital, le Gouvernement a accepté de garder une participation de 25 %, mais ces annonces ont été faites à Paris, par le Premier ministre en personne. J’ai repris la main la dernière semaine. Pendant le week-end du 8 et 9 octobre, le président du tribunal de commerce m’a prévenu qu’il mettrait la société en dépôt de bilan à la fin de la semaine suivante si aucune décision n’était prise. J’ai expliqué la situation aux syndicats le mardi, le 11 octobre, et les ai invités à aller voir le président du tribunal de commerce. À leur retour, le mercredi, ils étaient affolés, admettant que, jusque-là, ils n’avaient jamais cru à la disparition de la SNCM. Il y avait 2 400 emplois à la clef. Pendant toute la période, mon seul objectif a été de maintenir l’emploi autant que possible et d’éviter la mise en liquidation, qui aurait été, pour Marseille, une catastrophe absolue. Le 12 octobre, la CGT m’a indiqué qu’elle consulterait ses adhérents le lendemain, et ils ont, à une écrasante majorité, décidé de reprendre le travail. Le dépôt de bilan était prévu pour le 14. Le pire a donc été évité in extremis.
M. le président Arnaud Leroy. À notre grande surprise, M. Butler nous a dit avoir été dans l’impossibilité de rencontrer les syndicats ; il a fait en quelque sorte une offre « à l’aveugle », sur la seule base de dossiers techniques, alors qu’il s’agissait d’un investissement important et que cette façon de procéder n’est pas dans ses habitudes. Confirmez-vous les faits ?
Dans le cadre de la privatisation qui s’est déroulée comme si la SNCM était détenue directement par l’État, afin de s’assurer de la plus grande sécurité juridique, M. Gressier avait la qualité de « personnalité indépendante ». Je suis étonné que vous n’ayez pas été sollicité davantage par l’Agence des participations de l’État (APE), ne serait-ce que pour vous demander votre avis, vous qui aviez occupé des postes qui vous avaient sensibilisé aux transports maritimes. Comment expliquez-vous cette attitude ?
M. Christian Frémont. Je ne l’explique pas. M. Goulard a pris la décision de faire appel à M. Gressier, le 10 février, et je ne l’ai pas rencontré avant le mois de juin. J’avais l’impression, pas toujours agréable, que le dossier m’était tantôt confié, tantôt retiré soudainement… Il est parti, puis revenu plusieurs fois. Je m’en suis mêlé en décembre, en février un peu, en avril beaucoup, et j’ai récupéré le dossier le 9 septembre. Entre-temps, il y avait eu deux ou trois réunions interministérielles, mais jamais il n’a été question de l’appel d’offres. M. Vergobbi m’avait prévenu fin juin des trois réponses, qui demandaient à avoir la majorité, ce que M. Bisch m’a confirmé au mois de septembre, mais je n’en ai jamais su davantage.
Quant aux contacts entre M. Butler et les syndicats, c’est très simple : les syndicats refusaient de le voir. Une fois faits à l’idée de l’ouverture du capital, ils se sont mis en tête – je pense qu’ils ont eu des contacts mais je n’en ai jamais eu la preuve – que la Connex emporterait le morceau. Or la Connex, à Marseille, on connaissait. Elle y avait des activités, tout le monde connaissait M. Stéphane Richard… De plus, ils misaient sur une participation minoritaire. Lorsqu’ils ont appris que Connex avait disparu du paysage, après la décision du conseil d’administration de Veolia, et qu’ils auraient en face d’eux Walter Butler, qu’ils appelaient « l’Américain », ils ont même refusé de le voir bien qu’il leur ait dit m’avoir connu en France, dans d’autres circonstances.
J’avais rencontré tous les protagonistes du dossier, votre rapporteur, mais aussi le Premier ministre à l’époque, le secrétaire d’État, Walter Butler, Stéphane Richard,… mais vingt ans plus tôt.
Jusqu’au dernier moment, les syndicats ont été persuadés que « l’État » finirait par trouver une solution, pour éviter que la majorité du capital de la SNCM ne tombe dans l’escarcelle d’une entreprise privée. Cela étant, plus le temps passait, plus il devenait difficile d’imaginer qu’un partenaire accepte de rester minoritaire. Il fallait du courage pour y aller. Je garde un souvenir très précis de cette dernière semaine, quand j’ai expliqué aux syndicats que j’étais bien loin de les « baratiner », et que, si l’on ne faisait rien, l’entreprise serait liquidée à la fin de la semaine, ils ont reçu un véritable choc. Je me souviens de leur retour, après leur entrevue avec le président du tribunal de commerce : ils étaient complètement affolés. Et, en quelques minutes, ils ont décidé de consulter leurs mandants dès le lendemain.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Pourquoi avoir décidé de faire les annonces depuis Marseille, ce qui revenait à se soumettre d’emblée à la pression des événements ? Pourquoi pas plutôt en Corse ?
Vous qui avez rencontré les syndicats à d’innombrables reprises, qu’est-ce qui les animaient au fond ? L’idéologie ? Un irréalisme profond ? Ou même, parfois l’intérêt personnel ?
Dans ce dossier qui vous a été confié, puis enlevé à plusieurs reprises, de qui receviez-vous vos instructions ? N’est-il pas étrange qu’un préfet comme vous ait reçu des éléments de langage ? Si vous en avez gardé certains, peut-être pourrez-vous nous les transmettre.
M. Christian Frémont. S’agissant de votre première question, je me la suis posée aussi. Je connaissais Dominique Perben depuis l’ENA, nous sommes de la même promotion. J’ai été en contact permanent avec Pierre-René Lemas que j’ai compté, lui aussi, parmi mes élèves. Il m’avait succédé au poste que j’occupais à l’École et je le connaissais très bien.
Cela dit, les syndicats corses, le STC en particulier, étaient à Marseille. Le STC jouait un jeu compliqué : il était tantôt aux côtés de la CGT, tantôt contre elle, mais toujours avec l’idée que tout irait beaucoup mieux en créant une compagnie corse, qui ne recruterait que des Corses, l’idée étant de se débarrasser de la CGT de Marseille. Le STC avait une idéologie claire, des liens existaient avec les autonomistes. Quant à la CGT, elle faisait la loi sur le port de Marseille depuis 1945. Je me souviens de la première fois où, pour faire face à une manifestation très dure, j’y ai envoyé la police. Aussitôt, une délégation est venue m’expliquer que la police n’entrait pas dans le port de Marseille. Il a fallu lui faire comprendre que la règle venait de changer. La CGT considérait que son pouvoir était en jeu, à la SNCM, dans le port de Fos, au terminal méthanier de Cavaou, ou dans la réparation navale : « C’est l’entreprise des syndicats, donc c’est nous qui prenons les décisions. » J’ai entendu cette phrase plusieurs fois, y compris devant des chefs d’entreprise éberlués. En outre, il y avait la certitude que le Gouvernement suivrait toujours et, jusque-là, c’était vrai.
Quant aux intérêts personnels, la presse, juste après la crise, a soulevé une affaire de trafic de marchandises sur les bateaux. Je n’ai lu que ce qu’elle a publié. J’ignore s’il y a eu des suites judiciaires. Quoi qu’il en soit, la polémique a fait rage pendant huit jours, et elle a rebondi récemment. Ces révélations n’ont pas contribué à assainir le climat.
En résumé, la CGT avait le pouvoir dans cette entreprise et elle ne voulait pas le perdre.
En ce qui concerne les éléments de langage, je n’étais pas mécontent de les recevoir, car je ne savais pas toujours ce qu’il fallait dire. Les instructions sont venues, dans un premier temps, du ministère des transports, dans un deuxième temps, du ministère des transports et du ministère des finances. M. Perben est venu une fois tout seul à Marseille, et a fait ensuite, avec M. Breton, trois visites en une semaine. Enfin, au stade ultime, c’était l’Hôtel Matignon qui transmettait, surtout après l’intervention du Premier ministre le 29 septembre, soit lui, soit son directeur de cabinet, M. Pierre Mongin, un de mes anciens élèves lui aussi.
M. le président Arnaud Leroy. Bruxelles avait enjoint la France de ne pas remettre d’argent dans les dix années suivant la recapitalisation de 2002-2003…
M. Christian Frémont. C’est M. Goulard qui me l’a dit le 10 février et le discours n’a pas varié sur ce point.
M. le président Arnaud Leroy. Avez-vous été tenu informé de ce qui se passait à Bruxelles ?
M. Christian Frémont. Non, pas du tout. Une fois le plan définitif arrêté, se concrétisant par l’entrée conjointe au capital de Butler et de Veolia, l’État et les salariés se partageant respectivement 25 % et 9 % des actions, M. Breton m’avait dit qu’il devrait aller défendre le dossier à Bruxelles et que ce n’était pas gagné. Je n’en ai pas su davantage et j’en ai déduit que le plan avait dû être accepté.
M. le président Arnaud Leroy. Vous l’auriez su très vite ! Sans l’accord de Bruxelles, il n’y aurait pas eu de repreneur.
M. Gaby Charroux. Je ne trouve pas anormal que les annonces aient été faites à Marseille. Au contraire, puisque c’était là qu’étaient réunis les acteurs de l’affaire. Ne trouvez-vous pas, monsieur le préfet ?
M. Christian Frémont. Le siège social était à Marseille, les grévistes aussi. Ils avaient pris possession du Méditerranée, tous syndicats confondus. Un autre jour, ils ont pris le Pascal Paoli pour l’emmener en Corse. Un grand souvenir, là aussi ! Le ministre de l’intérieur m’avait demandé comment j’avais pu laisser sortir le bateau du port. Une fois que l’équipage était à bord et décidé à lever l’ancre, il était difficile de l’en empêcher ! Une autre raison tenait au fait que le mouvement, comme presque toujours, était parti de Marseille. Les grévistes ont aussi voulu empêcher le départ d’un navire de la CMN, et cela a failli très mal tourner, parce qu’ils étaient dans de toutes petites embarcations autour de l’énorme bateau qui manœuvrait pour sortir du port. J’étais là et j’ai bien cru qu’il y allait avoir des hommes à la mer. Le capitaine avait reçu l’ordre d’appareiller quoi qu’il arrive… J’ai vécu des moments très difficiles. En dehors de l’escapade du Pascal Paoli, tout se passait à Marseille.
M. Dominique Tian. Ces réunions à Marseille me semblent la marque d’une décentralisation plutôt réussie, même s’il s’agissait surtout de gérer les problèmes. Pouvez-vous confirmer la crainte générale de voir la compagnie disparaître ?
M. Christian Frémont. C’était toute la question ! Lors de la première réunion à l’hôtel Matignon en janvier, deux hypothèses seulement avaient été étudiées : un nouvel apport d’argent frais de la part de l’État ou la liquidation pure et simple. Il n’avait pas été question de l’ouverture du capital, et on commençait à envisager l’idée que la compagnie pouvait disparaître. À chaque crise, en avril comme en juin, on a frôlé le précipice, mais le seul but vers lequel je tendais, c’était d’éviter d’y tomber. Tout le monde savait que des emplois seraient perdus. Au début, on parlait de 1 000, finalement, il y en a eu beaucoup moins. Nous avions tous en tête de sauver l’entreprise. À partir de la venue de François Goulard le 10 février, tout le monde – les élus comme les autorités de tutelle, et le président du tribunal de commerce qui a tout fait tout ce qu’il pouvait –, a travaillé pour essayer de sauver la société, même amputée d’une partie de son personnel. Mes relations avec la CGT n’ont pas toujours été très faciles, mais, si nous ne nous étions pas mis d’accord après la visite au tribunal de commerce sur le principe de la privatisation, la compagnie aurait été purement et simplement liquidée.
J’avais dit à la CGT, le dernier jour, que les relations avaient été dures, mais que nous avions fait en trois semaines ce qu’il aurait fallu faire depuis trente ans. Les difficultés avaient commencé pratiquement à la création de la compagnie. Elles s’étaient fortement aggravées avec l’apparition de Corsica Ferries et aucun gouvernement, de droite comme de gauche, n’avait jamais rien fait pour essayer de mettre de l’ordre. La valse des présidents était là pour le prouver : six en dix ans. Quelle entreprise résisterait à pareil traitement ? Il y avait eu des tentatives de restructuration sous les gouvernements Juppé et Jospin, mais elles avaient avorté.
M. le rapporteur. Avez-vous eu à l’époque des contacts avec la Compagnie méridionale de navigation, et avec Corsica Ferries ? Avez-vous entendu dire qu’elles pourraient déposer une offre conjointe de reprise ?
M. Christian Frémont. Je n’ai jamais eu le moindre contact avec la Corsica Ferries, et si les syndicats avaient appris que j’en avais, ils n’auraient sûrement pas apprécié. Avec la CMN, non plus, à une exception près : le fameux soir où le Kalliste essayait de sortir du port et où les marins de la SNCM cherchaient à l’en empêcher. J’ai appelé la maison mère, la STEF, pour que la direction demande au capitaine d’arrêter. Finalement, il n’en a rien fait et, en artiste qu’il était, il a réussi à se faufiler au milieu des embarcations.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Et avec les dirigeants de Veolia ? Vous deviez connaître aussi Stéphane Richard ?
M. Christian Frémont. Oui, il fait partie des 1 600 élèves que j’avais connus à l’ENA, comme le Président de la République.
M. le rapporteur. Même si vous n’avez pas eu de contacts directs, avez-vous entendu dire que M. Richard était très partisan d’une prise de participation, et M. Proglio, au contraire, très réticent envers ce projet ?
M. Christian Frémont. Je n’ai jamais rencontré M. Proglio avant de travailler à l’Élysée. Stéphane Richard, lui, avait des activités à Marseille. Il était venu me voir pour me dire qu’il était intéressé par la SNCM. Il avait aussi rencontré les syndicats. Jusqu’au bout ils ont été persuadés que la Connex l’emporterait. Je crois savoir que Stéphane Richard a été surpris et peiné de la décision du conseil d’administration de Veolia.
M. le président Arnaud Leroy. Je vous remercie des informations détaillées que vous nous avez données, et j’en retiens une, importante pour la suite de nos travaux, c’est l’implication du Premier ministre.
M. Christian Frémont. Il s’est impliqué quand il l’a décidé. C’était normal. Son directeur de cabinet avait préparé le terrain. Les réunions interministérielles se tenaient à Matignon, mais en dessous du niveau des directeurs de cabinet. Le Premier ministre est intervenu le 29 juin pour annoncer que la Connex revenait. Mais je ne sais rien de plus que ce que la lecture des journaux m’a appris. M. Mongin avait eu un contact important dans les heures qui ont précédé pour convaincre Veolia de revenir sur sa décision. Auparavant, le Premier ministre avait déjà fait deux ou trois déclarations publiques.
M. Dominique Tian. Le Premier ministre s’est intéressé à l’affaire parce que la France entière s’y intéressait. Sa position a d’ailleurs un peu évolué au fil des mois, notamment sur le pourcentage de la participation de l’État. En outre, le Premier ministre subissait la pression des élus locaux qui s’inquiétaient d’une possible disparition de la société. Je ne vois pas en quoi l’implication du Premier ministre constitue un fait nouveau.
M. le président Arnaud Leroy. Je n’ai parlé que de confirmation, monsieur Tian.
M. Christian Frémont. Le dossier a d’abord été traité par le ministère des transports ; puis, quand Bruxelles s’en est mêlé, il a été rejoint par le ministère des finances. Dans un troisième temps, l’affaire est devenue nationale – tous les quotidiens parlaient de la SNCM –, et le Premier ministre ne pouvait pas ne pas prendre position. C’est lui qui a annoncé le schéma final, alors que, jusque-là, c’était le ministère des transports qui m’avait fait annoncer les étapes successives.
Pour résumer, mon interlocuteur le plus ancien et le plus courant a été le ministre des transports. Le ministre des finances s’est ajouté. M. Thierry Breton est venu à trois reprises à Marseille. J’ai eu quelques contacts avec M. Mongin, mais seulement dans la phase finale. Le ministère de l’intérieur ne s’est jamais occupé de cette affaire.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur le préfet, je vous remercie. S’il le fallait, nous n’hésiterions pas à reprendre contact avec vous.
M. Christian Frémont. De toute ma vie de préfet, la SNCM est le dossier le plus compliqué que j’ai eu à gérer. J’en ai gardé des souvenirs précis et quelques documents. C’est pour cela que je n’ai pas eu de difficulté à reconstituer le scénario.
l. Audition, à huis clos, de M. Benoît Le Bret, chef de cabinet (mai 2004-à mai 2008) de M. Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne chargé des transports
(Séance du mercredi 9 octobre 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons à présent M. Benoît Le Bret, qui a occupé de 2004 à 2008 le poste de chef de cabinet de M. Jacques Barrot, alors vice-président de la Commission européenne en charge des transports.
Le chef de cabinet d’un Commissaire européen a une fonction très importante : tous les dossiers sensibles passent par lui. Il est en contact permanent avec les grandes directions et services, je pense en particulier au service juridique de la Commission et à la direction générale de la concurrence.
Monsieur Le Bret, vous avez d’abord acquis une solide expérience au sein des administrations budgétaires et financières françaises avant de rejoindre Bruxelles. Devenu sans nul doute un spécialiste des procédures et du droit européen, vous êtes aujourd'hui un des associés d’un prestigieux cabinet d’avocats spécialisé dans le droit des affaires.
Monsieur Le Bret, nous allons faire appel à votre mémoire. La privatisation de la SNCM nous préoccupe, notamment au vu de son impact final sur les finances publiques. Il s’agit d’une opération complexe dont la préparation et l’exécution ont été regardées de près par la Commission européenne pendant les années 2005 et 2006, et même au-delà.
Je crois utile que vous rappeliez, dans votre exposé introductif, les grandes étapes de l’examen du dossier par la Commission. Vous nous direz comment le collège des Commissaires a réagi à cette privatisation. La personnalité et la nationalité de Jacques Barrot ont-elles eu ou non un effet « facilitateur », au bon sens du terme bien entendu ? Enfin, quels sont les points qui ont plus particulièrement fait l’objet de discussions entre la Commission et le Gouvernement français de l’époque – il est important pour nous de comprendre le pourquoi du rejet par le tribunal d’un plan auparavant validé par les services et la Commission – ? Et à quels « allers et retours » ont-ils donné lieu entre vous-même ou vos services et la direction du Trésor, l’Agence des participations de l’État (APE), voire dans la phase ultime de l’opération, la commission des participations et des transferts ?
M. Benoît Le Bret prête serment.
M. Benoît Le Bret, chef de cabinet (mai 2004-mai 2008) du vice-président de la Commission européenne chargé des transports (M. Jacques Barrot). Monsieur le président, Messieurs les députés, je vais m’efforcer de vous répondre aussi complètement que ma mémoire me le permet dans la mesure où les événements commencent à dater.
Tout d’abord, le fonctionnement d’un cabinet avec ses services au sein de la Commission européenne est très différent ce qu’il est en France. Le chef de cabinet, qui est l’équivalent d’un directeur de cabinet ici, doit veiller à ce que les dossiers présentés par son Commissaire et préparés par les services soient avalisés par les vingt-sept autres Commissaires. Jouant le rôle de « courroie de transmission », il contrôle la qualité et la cohérence de la procédure suivie, mais il n’a pas le pouvoir d’intervenir au quotidien dans le travail des services, ou de leur donner des instructions, dans un sens comme dans un autre. Le cadre est donc beaucoup plus strict, ce que je trouve, avec le recul, plus sain. Le cabinet d’un Commissaire, c’est, équivalent « dir’cab » compris, sept conseillers. Ils ne sont pas là pour refaire ce qui a été fait, comme je l’ai vu faire dans les administrations nationales.
Ensuite, le point de départ de l’affaire SNCM, vu de la Commission européenne, c’est non pas la privatisation de 2005-2006, mais le premier plan d’aide à la restructuration de 2002-2003. La Commission avait alors autorisé le versement de 76 millions – 66 millions fermes, plus 10 millions conditionnels, dont un peu plus de 3 seulement seront accordés en 2005 –, aide qui sera annulée en 2005 par le tribunal de l’Union à cause d’une stupide erreur de calcul, commise par les services, avant notre arrivée, sur les plus-values de cession. Cette première décision contraint juridiquement la marge de manœuvre ultérieure, tant de la France que de la Commission, à raison de ce qu’on appelle à Bruxelles la règle du « one time, last time », et que l’on pourrait traduire par « une fois pour toutes ». Autrement dit, aucune aide d’État ne peut être consentie à une entreprise dans les dix ans qui suivent l’octroi d’une première aide. Une aide d’État correspond à une aide à la restructuration ou au sauvetage, c'est-à-dire qu’elle ne va ni à la recherche, ni à la sauvegarde de l’environnement, ni ne correspond à une compensation de service public. Il s’agit de financements destinés à des entreprises en difficulté, et qui doivent être renflouées par la puissance publique. Ils sont autorisés par la Commission dans un cadre strict, sous condition. Les aides doivent notamment compenser la concurrence et garantir le retour à la viabilité.
En 2005, il s’agissait donc, d’une part, de combler le vide juridique laissé par l’annulation du plan de 2003, en corrigeant les erreurs de calcul puisque le tribunal ne remettait pas en cause le principe d’une aide à la restructuration ; d’autre part, de recevoir les nouvelles demandes de l’État français consécutives à l’évolution de la SNCM. Il allait de soi qu’une nouvelle aide à la restructuration était inenvisageable, de quelque façon que ce soit. Il fallait certes remplacer la décision de 2003 dans le contexte de 2005, mais toute nouvelle aide d’État aurait été incompatible avec les règles européennes. Il n’était donc pas question de recourir aux finances publiques avant 2012 ou 2013 pour faire un nouvel investissement ou éviter la liquidation, sinon sur la base d’une compensation de mission de service public ou du comportement d’investisseur avisé. Le cadre est donc celui d’un continuum juridique sous contrainte dans lequel une restructuration ne pouvait mobiliser une nouvelle fois les finances publiques en vertu d’une règle communautaire quasi intangible.
Une troisième remarque concerne la cession de gré à gré opérée en 2005 par l’État français. La privatisation partielle a été menée à bien au terme d’un processus que la Commission a qualifié de « non discriminatoire et transparent », et ce point n’a pas été retenu par le tribunal parmi les motifs d’annulation du plan. Si la Commission avait été d’un avis différent, elle n’aurait pas validé la décision proposée par la direction générale des transports (direction générale de l’énergie et des transports – DG TREN) à l’époque. En cas de privatisation, les règles européennes sont très claires : si le processus n’est pas « transparent et non discriminatoire », il y a soupçon d’aide d’État à l’entreprise cédée, surtout quand il y a vente à prix négatif, mais aussi à l’acheteur. La Commission considère l’appel public à l’épargne comme préférable mais la mise en bourse n’est pas toujours possible. Ainsi, si l’État démontre qu’il a exécuté toutes les diligences nécessaires, la Commission, nonobstant la vente de gré à gré, estime que les critères de transparence et de non-discrimination sont remplis. En l’espèce, le principe est très bien rappelé dans la note n° 64 de la décision de la Commission : il y a bien eu une personnalité indépendante, une banque conseil comme c’est d’usage quand il n’y a pas un appel à l’épargne urbi et orbi ; il y a eu plusieurs offres, une commission de privatisation, etc. Tout cet aspect de la procédure a été scruté par les services de la Commission sans qu’ils y trouvent à redire.
Maintenant que le décor est planté, comment les choses se sont-elles déroulées ? Nous sommes sous le choc de l’arrêt du tribunal annulant le plan. Le chef de cabinet que j’étais à l’époque appelle les services de la Direction générale des transports. Elle traitait encore des aides aux transports qui bénéficient d’une base juridique spéciale dans les traités. J’avais encore réussi à les arracher aux griffes du Commissaire à la concurrence qui examine l’ensemble des aides d’État, mais la dernière fois, il a réussi son putsch et les a récupérées dans son giron. On m’explique l’erreur de calcul, le vide juridique et la nécessité de préparer une nouvelle décision pour la part annulée par le tribunal. Éclate alors la crise de 2005, qui pousse le Gouvernement, pour sauver la SNCM, à mobiliser les finances publiques, mais avec l’obligation cette fois d’intervenir en investisseur avisé. Pour qualifier d’« avisé » le comportement de l’État, c'est-à-dire pour qu’il n’accorde pas d’aide au sens des traités, les critères à remplir sont notamment l’injection concomitante d’argent public et d’argent privé, et l’analogie du comportement public et du comportement privé. La justification est sinon difficile.
Les traités n’imposent nullement de privatiser. Ils sont neutres quant à la nature du détenteur des moyens de production, mais la mobilisation conjointe et simultanée d’argent public et privé est une condition sine qua non pour obtenir le feu vert de la Commission, surtout quand l’entreprise a déjà bénéficié d’un plan d’aide à la restructuration purement public.
Dans la phase de recherche d’un repreneur, la Commission n’est pas impliquée. Elle n’intervient qu’une fois que l’État membre la sollicite pour lui soumettre un projet à des fins de sécurité juridique. La notification est obligatoire seulement en cas d’octroi d’aide ou de simple soupçon d’octroi d’aide.
La France n’avait pas le choix puisque nous devions prendre une décision après l’annulation du plan de 2003 et elle a été plutôt prudente en préparant son « paquet » avant de demander l’accord de la Commission. Je me souviens, mais je ne sais plus du tout quand, de M. Thierry Breton, dépêché à Bruxelles toutes affaires cessantes, après les mouvements sociaux mettant la pression sur l’État afin qu’il reste majoritaire, pour « pré-expliquer » le dossier et sentir le vent. Souvent, les dirigeants français entreprennent ce genre de démarches pour avoir confirmation qu’il y a des limites au droit économique et qu’on ne peut pas puiser sans cesse dans les finances publiques pour combler des trous sans fond. Le Premier ministre avait enjoint son ministre des finances de publier, après sa rencontre avec Jacques Barrot, un communiqué de presse fixant le cadre et bordant l’opération. Nous rappelons donc que nous n’exigeons pas la privatisation mais qu’une aide à la restructuration ayant déjà été accordée, le projet doit être conforme à celui d’un investisseur avisé, ou compenser des sujétions de service public, ou mobiliser des partenaires privés, ou encore procéder à une cession à un prix de marché. Je mentionne au cours de la réunion que, si la privatisation ne peut pas être imposée par l’Union, la présence d’investisseurs privés, leur poids dans l’opération, le caractère éventuellement temporaire de la présence de l’État au capital, joueront en faveur du dispositif. J’explique que, vu les antécédents de la société, plus il y aurait de privé, moins le projet serait suspect, surtout que nous traitions parallèlement le dossier de plusieurs compagnies aériennes nationales qui étaient mal en point. La visite de M. Breton est le seul contact politique entre la Commission et la France dont je me souviens. Elle s’inscrivait dans la chorégraphie politique obligée qui précède et prépare le traitement technique et rigoureusement juridique d’un dossier par la Commission.
Le fait d’avoir un commissaire de la nationalité de l’entreprise qu’il faut sauver est un atout tout autant qu’un handicap. Bien sûr, il est plus facile de se comprendre – un Français comprendra mieux qu’un ressortissant d’un pays sans façade maritime que la Corse est une île qui doit être desservie de façon continue, que l’enjeu est à la fois politique et économique. Mais cette proximité dessert aussi parce que, quand le Commissaire présente à ses homologues un dossier compliqué, défendu par l’État dont il est originaire, il est forcément suspect aux yeux des autres et ce soupçon risque de compliquer la validation par le collège des Commissaires, même si, au moment de leur intronisation, tous prêtent serment la main sur le traité, devant la Cour de justice, de servir en toute indépendance. Croyez-le ou pas, c’est ainsi qu’un Commissaire travaille. Sinon, de toute façon, son espérance de vie politique au sein du collège, et son influence, y compris le jour où il y aura des batailles nationales légitimes, sont anéanties. Après cette réunion avec Thierry Breton, le Commissaire n’interviendra plus jamais sur le dossier de la SNCM. C’est moi qui ferai l’interface avec les services.
Une fois qu’ils auront reçu la notification du dossier par la France, je donnerai deux consignes très claires.
Je demande un audit du prix négatif par un expert indépendant, selon une pratique usuelle mais pas obligatoire, afin d’éviter tout débat à ce sujet au sein du collège. Et il confirmera puisqu’à l’issue d’un processus transparent et non discriminatoire, plusieurs offres ont été présentées et que celle qui a été retenue était la moins coûteuse, ce qui constituait autant d’indices que le prix payé était un prix de marché. Je vous confirme que je n’ai jamais parlé à cet expert, qui a reçu son mandat des services, et à qui il a rendu son rapport. J’ai évidemment été soulagé de sa conclusion, sinon, le dossier se serait arrêté là : l’appel d’offre aurait été qualifié d’aide à la restructuration et la SNCM mise en liquidation, à moins d’une privatisation totale. C’est en couplant les deux qu’on était sorti de dossiers comme Olympic Airways ou la Sabena.
J’invite ensuite les services à traiter le dossier en toute indépendance, tout en expliquant son importance pour la France et pour la Corse, et la dimension d’intérêt général qu’il revêt. Je leur conseille aussi de l’étayer solidement car, connaissant la guerre que se font Corsica Ferries et la SNCM, nous étions sûrs qu’il y aurait des plaignants. L’équipe chargée des aides d’État comptait des Français et des Italiens, je demande que les Français ne soient pas les seuls à s’occuper du cas SNCM, malgré l’indépendance à laquelle les fonctionnaires sont tenus. Bref, il s’agissait de mener un travail professionnel avec une équipe pluriculturelle au-dessus de tout soupçon.
Pendant un certain temps, je n’entends plus parler du dossier, à l’exception d’une visite d’un lobbyiste. Je ne sais même plus pour qui il travaillait, et si c’était avant ou après la notification. Ce qu’il m’a raconté ne m’intéressait que fort peu : le conseil d’administration de Veolia avait refusé de faire une offre, si bien que Walter Butler s’était retrouvé seul et qu’il avait ensuite fallu négocier pour convaincre Veolia de revenir sur ses positions. En somme, il m’a décrit le dessous des cartes, qui ne me concernait pas au premier chef, mais dont l’État ne m’avait rien dit. J’ai tout de même retenu que ce récit accréditait la thèse que le coût d’une liquidation pour l’État aurait excédé l’application du droit social de base. Il n’était nul besoin d’être grand clerc pour le comprendre ; il suffisait de connaître un peu la couleur locale. Je suis enclin à croire que ces éléments ont été mal motivés dans la décision de la Commission, ou mal compris des juges de la cour de Luxembourg.
J’entends reparler du dossier en 2007 ou 2008, dans la phase finale de préparation de la décision de la Commission. Les services m’informent que le prix négatif est validé, que la recapitalisation par la CGMF à hauteur de 8,75 millions pourrait passer en vertu du critère de l’investisseur avisé à cause de la présence de deux gros investisseurs privés – Veolia, qui a l’expérience des transports et Butler celle de la reprise d’entreprises en difficulté – et de la faiblesse du pourcentage du capital laissé à l’État. Restait à justifier le gap, mais nous étions sereins pour le prix négatif, et même pour l’abondement de la CGMF même si le tribunal le critique. Le problème vient de ce qu’il remet en cause le calcul du gap, qui constituait la pierre d’achoppement.
Les services m’expliquent que si l’on s’en tient au coût de liquidation de base, le projet ne tient pas. Si un État se comporte en investisseur avisé, il doit choisir la solution la moins onéreuse pour les finances publiques. Or liquider une société est quasiment impossible pour un État, a fortiori au prix minimum. La décision est donc prise d’accepter – et à mon avis, cela ne prête pas à discussion – les 15 millions de provisions pour les retraites. Quant au surcoût du plan social, il paraît justifié dans le contexte corse, mais on peut toujours débattre du montant qui reste théorique tant que la liquidation n’a pas eu lieu. Compte tenu de mon expérience, j’ai tendance à penser qu’elle aurait coûté cher à l’État : la casse, la grève pénalisent tous les acteurs économiques. Certes, il faut faire en sorte de ne pas confondre l’État dans ses fonctions régaliennes – le maintien de l’ordre – et l’État qui chiffre le surcoût d’un plan social en termes exclusivement économiques. Lui seul sera validé par la Cour.
Suivant la recommandation de mes services, je pense plus prudent pour justifier le plan que l’État reconnaisse par écrit, compte tenu du contexte et des antécédents, le risque d’être appelé en comblement de passif, et le provisionne. La France n’est pas très enthousiaste, étant entendu que la Commission ne s’est pas assurée que les conditions étaient réunies. Mais, selon moi, cet argument est de nature à consolider les arguments. Pendant que les services rédigent, je n’en entends plus parler.
Entre-temps, Jacques Barrot assure l’intérim du commissaire à la justice, au printemps 2008. M. Barroso l’appelle un matin pour le nommer aux droits de l’homme, afin d’éviter la nomination d’un « berlusconien », l’idée étant de lui laisser la justice et de confier les transports à un Italien. Nous étions un peu inquiets des réactions, mais la France était ravie car l’immigration était l’une de ses priorités et l’Italie aussi à cause de l’importance pour elle de sauver Alitalia. Dès lors, Jacques Barrot et moi cessons de suivre le dossier jusqu’à ce qu’il soit présenté au Collège des commissaires, d’abord en juin 2008.
Je suis tenu de respecter le secret des délibérations du Collège et je demande à ce qu’il le soit aussi par la commission d’enquête.
La décision préparée par la DG TREN, est présentée telle quelle aux vingt-six autres cabinets par le cabinet du commissaire italien qui venait d’arriver [...
...] La décision sera ensuite transmise au collège des Commissaires qui l’adoptera sans débat en juillet 2008. Je n’en ai plus entendu parler de cette décision jusqu’à son annulation par le tribunal. La lecture de l’arrêt m’a appris que, même s’il l’égratigne, il ne conteste pas le prix négatif, qui représente tout de même le plus gros montant. Il faut donc faire attention aux chiffres qui circulent. Je n’en ai parlé à personne, mais, en juriste qui a passé dix ans à traiter des aides d’État au sein de la Commission et cinq ans en tant qu’avocat, je pense que rien ne dit que la décision de la Commission qui remplacera celle qui a été annulée considérera comme incompatible l’intégralité des sommes en discussion.
Certains arguments du tribunal aussi peuvent paraitre contestables. La décision initiale de 2002 – que celle de 2005, différée en 2008 à cause de la complexité du dossier, veillait à combler –, comprend indiscutablement une compensation de service public, mais aussi un delta qui est extrêmement difficile à apprécier. Il s’agit de mesurer à combien une aide à la restructuration compatible entre 2002 et 2005 se montait en 2008, et de l’actualiser en 2012. Juridiquement, c’est un exercice impossible. Le droit applicable est celui de l’époque, alors qu’il s’est passé beaucoup de choses depuis. Or seuls les faits ont raison. Il se trouve que la situation de la SNCM entre 2008 et 2011 s’est plutôt redressée : le chiffre d’affaires a augmenté, la dette diminué. Tout n’est pas noir. Le prix négatif a été validé par un expert. Qui est le tribunal pour se prétendre meilleur expert que celui qui a été désigné ?
La contribution de la CGMF peut sans doute être contestée partiellement en tant qu’aide d’État. Comme c’est une entreprise publique à 100 %, on peut très bien considérer qu’elle se comporte en investisseur avisé dans un certain contexte, et pas dans un autre.
Reste à savoir dans quelle proportion le surcoût d’une liquidation devait être supporté par l’État. Je comprends le tribunal parce que le travail de la Commission, y compris les plaidoiries, n’est pas irréprochable car elle a changé de position en cours de route. Cette décision a été préparée de la même façon que les autres mais on sent qu’il y a eu des débats internes et qu’il y en avait qui trouvaient qu’on était trop généreux avec la France.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Le dossier n’a pas été défendu comme il aurait dû l’être ?
M. Benoît Le Bret. Voilà. On trouve toujours un juriste tchèque, bulgare ou hongrois, à l’ADN libéral, pour mal le défendre devant un tribunal. On ne peut pas négliger le facteur humain.
M. le rapporteur. On sera fixé très prochainement puisque la Commission doit se prononcer sur le quantum à rembourser…
M. Benoît Le Bret. Il y a aussi l’appel interjeté par la France et les entreprises en cause. J’ose espérer qu’elles se défendront mieux qu’en première instance.
M. le président Arnaud Leroy. Les actions sont intentées par Corsica Ferries et la facilité avec laquelle cette compagnie a gain de cause ne laisse de m’intriguer. Vous nous avez expliqué la diversité des sensibilités au sein de la Commission, le changement de Commissaires. Dont acte. La compagnie Corsica Ferries bat pavillon italien, au deuxième registre. Elle attaque et elle réattaquera sûrement si la décision ne va pas dans son sens, et n’aboutit pas à couler définitivement la SNCM. Que pouvez-nous nous dire des relations entre la Corsica Ferries et la Commission ?
M. le rapporteur. J’ai vu des courriers émanant de Corsica Ferries repris mot à mot, fautes d’orthographe comprises, par le service des affaires maritimes de la DG TREN à trois jours d’intervalle. C’est singulier, tout de même.
M. Benoît Le Bret. Je ne sais quoi vous répondre. Évidemment, Corsica Ferries s’acharne et utilise tous les moyens à sa disposition pour arriver à ses fins. Évidemment, il doit lui arriver de trouver sur son chemin des connivences, des aides. Cela dit, chaque fois que j’ai essayé de regarder le dessous des cartes, je peux vous dire que des guéguerres intestines, on en trouvait même entre entreprises qui avaient obtenu en consortium la délégation de service public. Une fois, je me suis fait piéger par un journaliste qui m’a interrogé sur le dossier off the record. Comme je le fais toujours, j’ai exposé honnêtement les points forts et les points faibles. Or, ces derniers, je les ai retrouvés en intégralité dans une lettre qui m’a été adressée quelques jours après par la STEF. J’ai décroché mon téléphone pour appeler le journaliste, qui n’était autre que le patron du bureau de l’AFP à Bruxelles. Si quelqu’un a manqué à sa déontologie, dans cette affaire, c’est bien lui. J’ignore s’il connaissait quelqu’un à la STEF. En tout cas, j’ai interdit à quiconque de lui parler, j’ai contacté l’AFP et il a quitté Bruxelles, mais sans que je sache s’il y a un lien. Alors, des « guéguerres » entre Français, y compris entre Corses – Corsica Ferries ne s’est pas développée qu’avec des capitaux italiens –, j’en ai vu.
Je me suis fait avoir mais je n’en ai pas moins essayé de faire mon travail correctement. Le chef d’unité chargé du dossier des aides d’État à la DG TREN – c’est moi qui l’ai fait venir de la DG concurrence – est l’un des grands spécialistes des aides d’État à la Commission, l’un de ceux qui a le courage de ne pas être un ayatollah et de regarder la réalité sociale, qui se cache derrière la sécheresse des cas juridiques. Il se trouve qu’il est français. J’ai fait venir Jean-Louis Colson pour professionnaliser l’unité qui s’occupait des aides à la DG TREN et qui disait tantôt blanc, tantôt noir, ce qui nous affaiblissait face à la DG Concurrence. À telle enseigne qu’elle a fini par récupérer les aides transports. De toute façon, il ne suffit pas d’avoir des informations. Corsica Ferries a parfaitement pu en obtenir, mais elle a aussi convaincu le tribunal. Bien sûr, cela peut jouer, mais seulement à la marge.
À cette aune, vous pouvez tout aussi bien imaginer que Jacques Barrot, Jean-Louis Colson et moi avons tout manigancé pour rendre un avis favorable dans un dossier qui n’était pas défendable. Eh bien, non. Ce n’est pas comme ça que nous avons travaillé.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. À propos du prix négatif, sachez, monsieur Le Bret, que j’avais anticipé dès le début qu’il aboutirait à une plus-value de 50 millions d’euros. J’aimerais bien connaître l’expertise qui en a été faite parce que je ne comprends pas qu’un expert-comptable ait pu en arriver à une conclusion, contredite par les faits aussitôt après.
Étiez-vous au courant du protocole entre la CGMF et le repreneur en vertu duquel la privatisation serait annulée si la SNCM n’obtenait pas la délégation de service public dans des conditions équivalentes à ce qu’elles étaient, c'est-à-dire y compris le service complémentaire ?
M. Benoît Le Bret. Non. Ce n’est qu’après que nous avons entendu parler de la question de la DSP complémentaire dans le cadre plus global du renouvellement de la DSP. Je me souviens que la directrice de la DG TREN – une Belge, Mme Houtman – avec qui je faisais régulièrement le point sur les dossiers, m’a fait part de ses doutes. Mme Houtman est d’une loyauté et d’une droiture remarquables et je lui ai dit de regarder et de faire ce qu’elle pensait devoir faire. On a donc entendu parler de nouveau de la SNCM, via la DSP, mais pas sous l’angle du protocole dont je n’ai appris l’existence que plus tard encore, peut-être même après avoir quitté mes fonctions, mais je ne sais plus quand. De toute façon, s’agissant de la DSP complémentaire, il était évident que les services de la Commission devaient regarder. Et c’est ce qu’ils ont fait.
M. le rapporteur. Vous n’avez donc pas eu connaissance du protocole au moment où les services de la Commission examinaient la validité des conditions de privatisation. Par ailleurs, vous indiquez que, lorsqu’ils ont appris que le service complémentaire était inclus dans la DSP, ils ont éprouvé des doutes sur ce point particulier, ce qui est bien compréhensible.
M. Benoît Le Bret. Je n’ai pas entendu parler du protocole mais je ne sais pas si les services l’avaient. En tout cas, s’ils l’avaient eu, ils auraient dû m’en parler, et, surtout, ils n’auraient pas recommandé la décision qu’ils ont préconisée.
M. le rapporteur. Cela dit, ce n’est pas l’existence de ce protocole qui a remis en cause la validité des aides d’État. La question n’a pas été soulevée. L’eût-elle été, je pense qu’elle aurait créé des difficultés.
Par ailleurs, à cette époque, avez-vous été amené, vous ou quelqu’un d’autre, à exprimer à l’État français, voire à la collectivité territoriale de Corse, des réserves ou des doutes sur le service public complémentaire, qui a fait l’objet d’une décision récente ? Suscitait-il déjà une attention particulière ?
M. Benoît Le Bret. Je ne me rappelle plus quand, ni en quels termes. Je me souviens de la directrice qui chapeautait l’unité de M. Colson me disant que la nouvelle DSP faisait débat et suscitait des doutes. Mais je ne sais plus si c’était à cause du service public complémentaire. Elle y est revenue pour m’avertir qu’il faudrait peut-être ouvrir une procédure. Il s’agit en quelque sorte d’une enquête préliminaire pour dissiper ou étayer les doutes. J’avoue ne plus me souvenir si c’est le service public complémentaire en tant que tel qui était visé, ou l’ensemble de la DSP.
En ce qui concerne le prix négatif, il est extrêmement difficile à évaluer, sauf ex post. C’est la raison pour laquelle je demande toujours dès le début l’avis d’un expert indépendant. Ce n’est pas moi qui l’ai désigné. Il a été choisi par les services sur une liste. J’ignore s’il était bon, ou pas. Quoi qu’il en soit, mon rôle consistait à m’assurer de la qualité de la procédure. Or elle a été respectée.
Par ailleurs, la notion de prix négatif n’a pas de sens. Avec la crise, la Commission est devenue beaucoup plus souple, et quand on ne trouve pour sauver une entreprise bancale qu’un seul investisseur privé, le prix qu’il propose est celui du marché. La théorie économique et la doctrine juridique n’ont pas de meilleure réponse à apporter. Sinon, le prix négatif n’est plus admis, et tout sauvetage d’une entreprise ayant reçu des fonds publics devient impossible. Car un repreneur mettra fatalement des conditions à une reprise. Je ne discute pas de la pertinence de celles qui ont été posées, je dis seulement qu’à la fin d’un processus transparent et non discriminatoire – et qui, en l’occurrence, n’a jamais été contesté – le bon prix est celui qu’est prêt à payer le dernier investisseur.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. À un détail près, tout de même. Dans le cas d’espèce, l’entreprise qui a fait le meilleur prix s’est retirée, avant de revenir au prix, moins avantageux pour l’État, fixé par celle qui a emporté l’appel d’offre. Mais vous n’étiez sans doute pas au courant de ces allers retours. Je suis d’accord avec vous sur le principe du vrai prix, sinon que nous parlons d’une société qui n’a plus de dettes, qui a été recapitalisée à hauteur des pertes, qui a un marché garanti à un prix et à des conditions que le repreneur a lui-même fixés, dont le plan social, le plus avantageux qui ait été accordé en France, est intégralement provisionné, au point qu’il ne sera pas totalement réalisé. On peut en déduire que son actif net est substantiel et que, cédée à un prix négatif, l’entreprise dégagera une plus-value. Ce n’est pas la peine d’avoir un expert très pointu pour arriver à une telle conclusion et je ne comprends toujours pas comment un expert digne de ce nom a pu démontrer le contraire. Peut-être pourrait-on en obtenir communication de son rapport.
M. Benoît Le Bret. Je vous entends bien, mais mon rôle de dir’cab’ se limitait à demander la nomination d’un expert indépendant. Je ne pouvais que me rallier à ses conclusions.
Dans un premier temps, le conseil d’administration de Veolia a refusé de déposer une offre. Et toutes les personnes qui sont passées dans mon bureau pour parler du dossier, m’ont dit que Veolia avait été plus ou moins forcée de revenir. Le petit jeu consistait alors à deviner ce qu’elle avait bien pu avoir en échange. Je n’en sais rien.
M. le rapporteur. Avez-vous eu, à un moment ou à un autre, des contacts avec l’administration française au niveau du Gouvernement ou des cabinets ministériels ? Avez-vous eu un interlocuteur direct ou indirect ?
M. Benoît Le Bret. Non, c’est même étonnant pour un dossier aussi sensible. Cela tient aussi au fait qu’un membre du cabinet était chargé des questions de concurrence : Thomas Chenevier, un excellent juriste, tout ingénieur qu’il est. Dans la phase où le cabinet a été actif, c’est lui qui a expliqué aux Français le gap à combler par rapport au prix négatif, et la nécessité d’invoquer le risque d’appel en comblement de passif pour justifier la totalité des montants et rendre la position française plus solide. Comme il venait de l’APE, c’était lui qui avait le contact.
M. le rapporteur. Personne d’autre ?
M. Benoît Le Bret. Non, à part la visite de Thierry Breton et de son cabinet pour voir Jacques Barrot, réunion à laquelle j’avais d’ailleurs convié Michel Petite, du Service juridique de la Commission. Il n’y a eu à mon niveau aucune interférence et aucun contact politique.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur Le Bret, nous vous remercions.
m. Audition, à huis clos, de M. Maurice Perrin, délégué syndical CFE-CGC, secrétaire général CFE-CGC-« Sédentaires » de la SNCM à l’époque de sa privatisation
(Séance du mercredi 16 octobre 2013)
M. Avi Assouly, président. Nous recevons, ce matin, M. Maurice Perrin, qui était le secrétaire général du syndicat CFE-CGC-« Sédentaires » de la SNCM, à l’époque de sa privatisation.
Votre point de vue, Monsieur, intéresse la Commission au plus haut point car les syndicats ont eu un rôle particulièrement actif au cours d’une procédure qu’ils ont sans doute en grande partie subie mais au cours de laquelle leurs interventions ont été marquantes. Même si votre organisation n’a pas été aussi médiatisée que d’autres, nous souhaiterions connaître ses positions au long de l’évolution d’une affaire peu banale qui a occupé les années 2005 et 2006. La CFE-CGC qui représentait une partie des personnels sédentaires de la SNCM n’avait sans doute pas la tâche facile aux côtés de la CGT ou encore du Syndicat des travailleurs corses (STC), des organisations disposant de forces de réaction plus massives.
La chronologie de la privatisation traduit de nombreux soubresauts, y compris de la part des pouvoirs publics, entre la première déclaration officielle d’intention de céder le capital de la SNCM et le choix du repreneur, à savoir Butler Capital Partners, qui aboutira à la gestion de l'entreprise par le « tandem » Butler/Veolia ».
Nous n’oublions pas que les salariés possèdent 9 % du capital de la SNCM. Le pacte d’actionnaires liant Butler et Veolia prévoyait la présence au conseil de surveillance de deux représentants des salariés actionnaires et de deux autres représentants élus par les personnels. Ces dispositions ont-elles eu un sens ? Quelles conclusions tirez-vous de cette première « mouture » de la direction de la SNCM post-privatisation ?
M. Walter Butler, nous a dit, ici même, avoir regretté que la procédure l’ait privé de la possibilité d’exposer directement aux syndicats son projet durant toute la période précédant le dépôt officiel de son offre de reprise. Est-ce bien comme cela que les choses se sont passées ?
Plus généralement, l’information voire les concertations préalables à la privatisation avaient-elles un réel contenu ?
Quelles ont été vos relations avec le préfet Christian Frémont ? Nous l’avons auditionné la semaine passée. Sa mission était à l’évidence difficile. Les syndicats et, peut-être aussi, les élus locaux ont-ils été dépassés, voire dans une certaine mesure écartés en raison de la tournure des événements ? Chacun ne jouait-il pas sa partition de son côté comme il le pouvait et en adoptant des postures de principe, à défaut d’être dans le jeu ?
Voilà autant d’interrogations que nous essayons de lever au long de nos travaux ?
M. Maurice Perrin prête serment.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Comment les syndicats ont-ils réagi à l’annonce de la cession de la SNCM à Butler Capital Partners (BCP) ? Au moment de l’annonce de la privatisation, aviez-vous une solution que vous auriez souhaité faire prévaloir ?
M. Maurice Perrin, délégué syndical CFE-CGC, secrétaire général CFE-CGC-« Sédentaires » de la SNCM à l’époque de sa privatisation. Avant de vous répondre, Monsieur le rapporteur, je souhaiterais vous présenter en quoi notre discours était spécifique.
J’étais un acteur du dossier à l’époque et je le suis toujours, mais avec un autre mandat puisque je représente les actionnaires salariés au conseil de surveillance. J’ai été élu à ce titre en octobre 2011 et nous avons siégé pour la première fois en 2012. Des batailles sont en train de se livrer et je n’ai pas eu autant de temps que je l’aurais voulu pour préparer cette audition.
La privatisation de la SNCM est évoquée pour la première fois de façon assez idéologique autour de 1996 avec l’arrivée à la présidence de la SNCM de Philippe Galy. Il est le premier à avoir envisagé la partition de l’entreprise. À l’époque, on nous disait que les lignes du Maghreb n’étaient pas rentables … La question de la privatisation était sous-jacente dans la dernière convention quinquennale 1996-2001, et elle était récurrente. Mais, après la dissolution de l’Assemblée nationale, le projet de 1996-1997 a été abandonné. Puis, suite à appel d’offres, la compagnie a obtenu la délégation de service public, avec, à la clef, la séparation entre Marseille, d’un côté, Toulon et Nice de l’autre. La privatisation est intervenue dans un climat de guerre commerciale, de concurrence que je qualifierai de « non régulée », alors que se déroulaient des tractations, des négociations plus ou moins discrètes, plus ou moins publiques, avec les pouvoirs publics, avec les élus. En outre, Corsica Ferries faisait preuve d’un activisme judiciaire qui persiste encore contre les décisions de la Corse, celles de l’Europe, et contre les autres compagnies.
L’année 2004 avait été une « année horrible ». Les grèves pour la « corsisation » des emplois de nos collègues du STC, une semaine en février et trois semaines en septembre, s’étaient traduites par une baisse de 25 % du chiffre d’affaires. À ce moment-là, c’est le gouvernement Raffarin qui est aux commandes, et M. François Goulard est secrétaire d’État aux transports. Il lance le processus et nomme à la fin du mois de décembre – mais nous ne l’apprendrons qu’en janvier – un mandataire ad hoc pour résoudre les difficultés de trésorerie de la SNCM. On ne peut pas vraiment parler de gouffre financier à l’époque puisque la compagnie détenait environ 450 millions d’euros d’actif. En janvier 2005, on annonce publiquement que l’impasse de trésorerie atteindra quelque 60 millions d’euros en septembre. Alors, on s’insurge. Je suis alors délégué syndical CFE-CGC et délégué du personnel. Nous avons toujours donné une dimension médiatique à notre action, souvent en résonance, et même en cohérence avec les principaux élus régionaux de Corse et de PACA. J’observe d’ailleurs un certain parallélisme des formes entre ce qu’a fait M. Goulard et ce que fait Veolia aujourd'hui, même si ce n’est pas à l’ordre du jour de votre Commission.
La SNCM avait gagné la bataille des NGV à Nice : elle transportait 500 000 passagers sur 700 000. À la faveur des difficultés de 2004, et avant même la privatisation, on l’avait amenée à réduire sa flotte et à apporter sur un plateau quelque 500 000 passagers à Corsica Ferries. Pour moi, la privatisation de la SNCM intervient dans un double contexte : après la guerre commerciale, on abandonne des parts de marché à Corsica Ferries France tout en conservant notre partenariat avec la CMN, un concurrent quotidien pour la SNCM, laquelle a pourtant contribué à son développement au fil du temps, avec la délégation conjointe de service public et l’exploitation des cargos mixtes 500 passagers, et en lui faisant des concessions sur le tapis de la négociation.
Le syndicat nationaliste, le STC, après le lancement de la privatisation à l’Assemblée nationale par François Goulard, se rapproche de nous au comité d’entreprise où nous passons des nuits à négocier. Nos collègues nous indiquent qu’au plus haut niveau de l’État, la liquidation judiciaire a été envisagée. Sur cette base, l’essentiel de la bataille de 2005 sera commune. Nos syndicats ne divergeront qu’en fin de conflit. La CFE-CGC a joué un rôle central dans ces événements car je suis très bien intégré dans le tissu régional, en Corse comme en PACA. Nous ne sommes pas des partisans acharnés de la grève puisque nous nous sommes créés en réaction à « la grève de trop » de 1995. Mais, en 2005, nous avons fait les quatorze jours de grève. Nous nous séparerons du STC à la fin car nous avons décidé d’appuyer la solution échafaudée au terme de trois ou quatre semaines de négociation au cours desquelles les ministres Thierry Breton et Dominique Perben sont venus à cinq reprises à Marseille : nous avions obtenu que l’État se maintienne avec 25 % du capital, et que les salariés obtiennent 9 % du capital, au lieu de 5 %. Nous avons préféré la solution réaménagée plutôt que de poursuivre l’aventure. Seul le STC voulait tenir bon.
Le processus de privatisation, pour nous, c’est un tunnel. On ne savait pas à qui s’adresser. M. Francis Lemor, le patron de la STEF-TFE, disait ne pas être intéressé. Or on apprendra qu’il avait été approché par tous les armateurs qui ont étudié le dossier, de près ou de loin, ce qui suscitera de notre part des questions qui sont toujours sur le blog que la CFE-CGC de la SNCM a tenu de 2006 à 2009. Quel rôle a-t-il joué auprès de ces armateurs ? Dans les six mois qui ont précédé le conflit de septembre, STEF faisait savoir qu’il n’était intéressé que par l’activité cargos, et CMA-CGM que par les lignes. Je peux vous fournir l’extrait d’une interview de M. Lemor sur France 3 dans laquelle il déclare que La Méridionale et Corsica Ferries suffiraient pour remplir le marché.
À la fin de l’été 2005, nous savions que Connex faisait partie des candidats sérieux, mais le 15 septembre au soir – j’ai encore en tête le jour et l’heure –, coup de théâtre : le conseil d’administration de Veolia a retiré l’offre de Connex et le lendemain, le vendredi 16 septembre à 16 h 30, nous sommes trois élus CFE-CGC dans le bureau du président Vergobbi. Il nous explique que le gagnant est Butler Capital Partners, et que l’opérateur industriel pressenti STEF-TFE a vocation à prendre 10 % du capital, alors qu’au départ, on était sur une solution à 100 % Butler. Selon l’expression du président, et je témoigne sous serment, M. Lemor « s’est converti » à la cause des car-ferries. L’entretien ne dure pas longtemps. Le 19 septembre, nous sommes reçus à la préfecture. Les marins n’ont pas attendu le délai de préavis de grève et tout s’arrête. En ce qui nous concerne, nous les rejoindrons cinq jours plus tard, après avoir déposé un préavis de grève en bonne et due forme.
Effectivement, à ce stade, nous ne rencontrons pas Walter Butler. Certains de nos collègues de l’encadrement participaient aux data rooms, mais ils étaient tenus au secret professionnel. On n’accédera aux repreneurs potentiels qu’à l’issue des échanges en préfecture. On n’a jamais vu non plus les gens du fonds Caravelle, ni d’autres ... Du match qui s’est joué en amont, entre les armateurs qui n’ont pas donné suite, nous n’avons jamais rien su ! C’est la préfecture qui a organisé l’ensemble des réunions. Je n’ai pas eu beaucoup de relations avec le préfet. Je travaillais plutôt avec ses collaborateurs, notamment le secrétaire général aux affaires régionales, Jean-Paul Bonnetain. Il avait l’avantage d’arriver de Corse, et avait travaillé sur la loi Jospin. Il était donc très au fait du sujet. Je travaillais aussi avec Jean-François Monteil, le secrétaire général aux affaires corses, et qui était alors le collaborateur du préfet Pierre-René Lemas. Ils assistaient à toutes les réunions en préfecture.
On n’a rencontré les repreneurs qu’en fin de cycle. Pour être plus précis, on a rencontré M. Gérard Couturier une première fois, très tôt dans le conflit, à la fin septembre, quand Veolia est revenue. Le conflit sur le port de Marseille a poussé le Gouvernement à chercher des solutions. J’ai donc rencontré M. Gérard Couturier une première fois, dans un café, à la Castellane. Il nous dit à quelles conditions Veolia pourrait revenir. Nous en faisons l’annonce dans le journal La Tribune. Le jour même, il y avait encore une réunion en préfecture et j’enchaîne un nouveau café du matin avec le président de l’exécutif corse de l’époque M. Camille de Rocca Serra et avec M. Antoine Sindali.
Tout le premier semestre 2005 avait été jalonné de tables rondes en préfecture, et des groupes de travail qui en étaient issus s’étaient tenus au ministère. Sur le principe, la région Corse, la région PACA, le conseil général des Bouches-du-Rhône, et la ville de Marseille avaient été associés à la phase amont des tables rondes, avant que les groupes de travail continuent jusqu’au mois de juin.
Le conflit a provoqué une séparation. Le préfet Frémont a travaillé avec les élus, et nous sommes entrés dans le cycle des négociations qui ont abouti à la transformation de la solution à 100 % Butler, avec STEF-TFE pressentie comme opérateur industriel, à la recomposition du capital que vous connaissez.
Le préfet Frémont nous avait proposé de rencontrer les repreneurs en préfecture, mais ça devenait très compliqué, il y avait beaucoup trop de monde. On a donc passé le week-end des 9 et 10 octobre à l’Union régionale CFE-CGC. Le vendredi soir, nous avions rencontré ensemble MM. Walter Butler, Gérard Couturier, Stéphane Richard et certains de leurs collaborateurs. Ils nous ont présenté le projet auquel ils étaient arrivés : 28 % pour Veolia, l’opérateur industriel, qui assurerait le management et le directoire, composé de Gérard Couturier et Jean-Marie d’Aspe, avec lesquels j’ai travaillé à partir de 2008.
M. Avi Assouly, président. M. Butler a-t-il pu vous exposer son projet ?
M. Maurice Perrin. Nous jouions un rôle très central dans le processus, car nous avions la confiance de nos collègues, y compris du STC auxquels nous ne nous sommes opposés qu’en fin de processus. Le mandataire ad hoc expliquait, plus à la CGT qu’à nous d’ailleurs, qu’il allait appuyer sur le bouton rouge.
Avant ce vendredi 8 octobre au soir, donc, j’avais déjà rencontré Gérard Couturier, vers la fin septembre, avant que Dominique Perben annonce le retour de Veolia. C’était le 29 septembre, je revenais de Corse où j’avais planché devant la commission compétente pour informer de ce qui se passait à Marseille. Gérard Couturier tenait à rencontrer les syndicats d’encadrement. À l’époque, la CFE-CGC-« Navigants » n’existait pas. Il y avait un syndicat qui tenait le rôle de la CFE-CGC navigants, c’était le Syndicat professionnel des officiers de la marine marchande avec lesquels nous avions de bonnes synergies. Pour revenir dans le jeu, Veolia a souhaité rencontrer l’encadrement sédentaire et l’encadrement navigant.
On a revu Gérard Couturier parallèlement aux négociations à la préfecture, pour qu’il nous explique les conditions du retour de Veolia, avec l’ensemble des élus CFE-CGC, à deux reprises, à Marseille.
Dans la phase finale, parce qu’il y avait trop de monde à la préfecture, et que ça devenait trop compliqué, on a récupéré les clefs de l’Union régionale et le vendredi 8 octobre au soir, on a reçu Walter Butler, Stéphane Richard, Gérard Couturier et d’autres collaborateurs. En présence aussi, et c’est un clin d’œil pour le président Giacobbi, il y avait Dominique Giuntini, et le directeur financier de Connex à l’époque. Il a toujours des Corses quelque part … Devant nous, ils ont fait le point et, à cette occasion, M. Stéphane Richard, alors directeur général de Connex, nous a expliqué avoir été approché par la STEF-TFE et a rapporté devant l’ensemble des élus CFE-CGC présents la fameuse phrase « Laissez-nous cueillir le fruit que l’on fait mûrir depuis dix ans ». Francis Lemor s’en est ému quand les syndicats l’ont rencontré pour ramener la CMN au partenariat alors qu’elle avait répondu, au premier appel d’offre, en 2006, avec Corsica Ferries. La CMN était tout de même détenue à 69 % par la SNCM ! J’ai revu M. Lemor et entrepris, avec d’autres, de le convaincre de revenir au partenariat en janvier 2007. Il était un peu gêné par les propos que nous avions tenus sur notre blog mais il s’est bien gardé d’approfondir la question.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. À partir du moment où vous avez appris que le gagnant était Butler Capital Partners, avez-vous tenté de peser pour arriver à une autre solution, notamment celle qui a finalement prévalu ? Avez-vous eu, par exemple, des contacts avec Veolia, pour l’encourager à revenir ?
M. Maurice Perrin. Dans la bataille, nous étions synchrones avec l’ensemble des élus dans les deux régions, c'est-à-dire en rester à une privatisation partielle. Dans les tables rondes, d’avril à juin, M. Jean-Claude Gaudin ne disait pas autre chose. Pendant longtemps, on a bataillé sur la proposition d’un certain François Hollande qui préconisait à l’époque, comme d’ailleurs Mme. Ségolène Royal, et le Parti socialiste, l’intervention directe de la Caisse des dépôts. Nous avons milité pour une intervention conjointe de l’État, de la Caisse des dépôts et Veolia. On se battait pour que Butler sorte. Mais le Gouvernement n’a pas suivi. Mon collègue Jean-Paul Israël avait proposé un projet d’avenir, avec le renouvellement de la flotte tous les deux ans et demi et 400 départs. Je n’ai pas fini mon exposé et je vous l’enverrai par mail.
Finalement, la SNCM, dont on dit pis que pendre, n’a pas cessé de s’adapter depuis 2001. La flotte d’abord : elle avait gagné la bataille des NGV et elle a fait des cargos mixtes quand on le lui a demandé et diminué le nombre de ses cargos mixtes et le nombre de car-ferries quand on le lui a demandé. Finalement, elle les a maintenus. Surtout, elle a fait trois plans d’adaptation successifs. On est en train de parler d’un nouveau et on a un peu de mal. Ces plans ont même été approuvés par le personnel, et très majoritairement – à 70 % ou 80 %. Quant à savoir pourquoi ça n’a pas marché, c’est un autre débat. Ce n’est pas celui qui vous occupe.
M. le rapporteur. Quel est votre sentiment sur la gestion conjointe Veolia/Butler Capital Partners ? Nous constatons que la société, au moment où elle est privatisée, est à l’équilibre grâce à la recapitalisation à hauteur des pertes enregistrées précédemment, au plan social à la générosité inégalée au coût duquel elle a les moyens de faire face, à la délégation de service public dont elle a obtenu le maintien des conditions. Le protocole signé par les nouveaux partenaires contient une clause résolutoire au cas où la DSP ne serait pas obtenue aux conditions souhaitées. Au départ, les conditions n’apparaissent pas si mauvaises. Au point que, à peine deux ans plus tard, la valeur de la société semble avoir augmenté de façon importante puisqu’intervient une cession qui permet à BPC de réaliser une plus-value de l’ordre de 60 millions d’euros. Qu’avez-vous observé pendant deux ans ?
M. Maurice Perrin. On arrive à une solution dans la semaine du 11 au 15 octobre. Un directoire très resserré – deux membres – et le management reviennent à Veolia qui consolide la SNCM dans ses comptes. En clair, le prix négatif de la SNCM (– 158 millions d’euros) remonte chez Veolia. Butler fait ce qu’on a envie qu’il fasse puisqu’on est dans une structure à conseil de surveillance et à directoire. M. Walter Butler est président du conseil de surveillance, il vient quasiment tous les mois avec ses collaborateurs, d’après mes souvenirs, un certain Teinturier et un dénommé Parquet. Ils auscultent les comptes tous les mois ou tous les deux mois, pratiquant une sorte d’audit permanent. On n’a jamais eu accès au pacte d’actionnaires.
L’actionnariat salarié ne s’est constitué qu’à la fin de 2008. D’autres syndicats que nous voulaient d’abord laisser partir ceux qui devaient partir dans le cadre des plans sociaux, pour éviter les effets d’aubaine. Si bien que les premiers représentants des actionnaires salariés sont élus en 2009. Avant cette date, nous avions donc difficilement voix au chapitre. Dans ce contexte, on comprend indirectement, par des indiscrétions de nos dirigeants, qu’il y a, dans le pacte d’actionnaires une clause qui fait que Walter Butler a intérêt à sortir avant que l’on procède à l’acquisition prévue dans le contrat de service public avec la Corse, c'est-à-dire avant l’acquisition du Jean Nicoli en remplacement du Monte Cinto. Mais on n’a pas eu le détail du pacte. Le métier de Walter Butler c’était d’« acheter les plats au menu et de les vendre à la carte » ! Il était là pour faire une opération financière. Il s’en était donné les moyens juridiques, mais nous ne savions pas lesquels. En tout état de cause, il n’a eu aucune influence dans la gestion de l’entreprise. C’est Veolia qui a nommé le directoire de deux personnes, et l’équipe de direction. En somme, Veolia a pris en main l’application du plan approuvé par le personnel.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Donc, vous estimez que c’est Veolia qui a pris « en main » le management de la société. Le rôle de M. Butler a consisté à suivre les comptes de très près, mais sans participer directement à la gestion, ce qui est d’ailleurs logique pour un président de conseil de surveillance.
Êtes-vous au courant de la tentative, qui nous a été rapportée, du nouveau management de prendre le contrôle de la CMN ?
M. Maurice Perrin. Oui. Le pacte d’actionnaires était secret et peut-être certaines clauses faisaient-elles interdiction aux parties d’en parler, mais aux joutes qui nous opposaient à Corsica Ferries avant la privatisation, s’est ajoutée celle qui s’est jouée au tribunal de commerce de Paris entre la CMN et la SNCM. Veolia a essayé de faire jouer le pacte d’actionnaires de 1992 dans la mesure où il y avait tout de même eu un acte hostile de la part de STIM d’Orbigny-STEF qui a fait alliance avec Corsica Ferries. Selon ce pacte, la SNCM avait 69 % des intérêts économiques de la CMN, mais pas le contrôle. Après la décision du tribunal de commerce de Paris, les gens de STEF disaient qu’on n’en était qu’à la mi-temps et qu’ils n’avaient pas encore perdu le match. Et, effectivement, ils l’ont gagné en appel et en cassation.
M. le rapporteur. La SNCM n’aurait-elle pas dû plutôt revendre sa participation dans la CMN pour se procurer de l’argent frais ?
M. Maurice Perrin. Le harcèlement de Corsica Ferries avait déjà abouti à une décision de juillet 2003 de la Commission européenne qui reconnaissait comme stratégiques les parts de la SNCM dans Sudcargos et dans la Compagnie méridionale. La vente des parts de la CMN est intervenue beaucoup plus tard, un an après le départ de Butler. Elle n’avait jamais versé le moindre dividende alors que cette compagnie dégageait des résultats annuels entre 8 et 10 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires d’une quarantaine de millions d’euros. La transaction se montait à quelque quarante millions d’euros, assez loin des 69 % de 70 millions d’euros, somme à laquelle les directeurs financiers nous disaient valoriser la CMN. À l’époque, c’est en cédant des actifs que la SNCM a pu rester jusqu’à il y a peu, une société désendettée. À notre avis, mieux aurait valu les garder dans une optique plus stratégique.
M. Avi Assouly, président. M. Butler venait-il souvent ?
M. Maurice Perrin. Il ne se passait pas un trimestre sans qu’il vienne.
M. Avi Assouly, président. Quel a été son rôle dans la gestion ?
M. Maurice Perrin. Il n’était pas impliqué dans le management. Sans doute devait-il y avoir des tensions avec Veolia. Sans pouvoir le prouver puisque je ne connais pas le pacte d’actionnaires, il me semble qu’il a surtout jugé du moment opportun pour sortir.
M. Avi Assouly, président. Et après son départ, que s’est-il passé ?
M. Maurice Perrin. Ce sont les gens de Veolia Transport qui ont pris le relais, c'est-à-dire Cyrille du Peloux, Jérôme Gallot puis Jean-Marc Janaillac.
M. Avi Assouly, président. Et quel regard portez-vous sur leur gestion ?
M. Maurice Perrin. Je ne peux rien dire de précis, mais on peut se demander pourquoi le plan de 2006 a échoué et la flotte n’a pas été renouvelée. Sur le fond, Veolia n’avait pas une grande expertise en matière de transport maritime. Elle avait l’habitude des délégations de service public, mais pas d’une concurrence aussi dure. Tout n’est pas imputable non plus à Veolia dans la mesure où la non-régulation de ce qui se passe entre Marseille et Toulon, entre Toulon et Nice, et entre Toulon, Marseille et Nice, est très préjudiciable. On a laissé les charges aux opérateurs historiques, La Méridionale comprise, et on observe que, après la SNCM, La Méridionale connaît aussi des difficultés, depuis qu’elle a acheté le Piana. Veolia n’avait pas prévu ce niveau d’agressivité et, quand elle a constaté que le contrat devenait inapplicable et qu’il n’était plus rentable, la mission du sénateur Charles Revet a été déclenchée.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Qu’avez-vous pensé des conditions financières de la sortie du capital de la SNCM de Butler Capital Partners et de la plus-value qu’il a réalisée ?
M. Maurice Perrin. C’est un des aspects scandaleux du dossier. À part l’activité de deux ou trois membres du conseil de surveillance, Butler Capital Partners n’a contribué à aucune production de richesse pour l’entreprise. Déjà, on peinait à dégager l’autofinancement qui aurait été nécessaire pour renouveler la flotte. Le groupe Butler s’est dépêché de partir en se servant au passage, en vertu d’un pacte d’actionnariat qu’on ne connaissait pas. Il aurait été beaucoup plus utile de s’atteler aux vrais problèmes de la SNCM et de réagir quand, au bout de deux ou trois ans, on s’est rendu compte que les choses ne se passaient pas comme prévu. On a laissé le bateau continuer sur son aire de manœuvre.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Vous avez fait allusion à Sudcargos, une participation de la SNCM. Le prix de cession de cette entreprise à CMA-CGM a-t-il convenable ?
M. Maurice Perrin. De mémoire, il était de 3 ou 4 millions d’euros. C’était aussi une participation stratégique qui n’aurait pas dû être cédée dans ces conditions, de même qu’on n’aurait pas dû quitter Nice sur simple injonction, au nom d’une prétendue obligation européenne liée à la recapitalisation. Je l’ai écrit dans la note que j’ai rédigée en prévision de cette audition et que je vous enverrai. La SNCM avait vingt ans d’existence en 1996, quand commence l’entreprise de partition. Compte tenu de l’intensité de la guerre commerciale, il aurait fallu trouver d’autres solutions, y compris capitalistiques. La première recapitalisation autorisée à hauteur de 76 millions d’euros en contrepartie de cessions d’actif n’a été que de 66 millions d’euros et la décision de 2008 ne faisait que réécrire la décision de 2003. C’est une seule et même recapitalisation qui intervient au bout de près de trente ans. Et c’est le résultat d’une absence de régulation.
Je m’autoriserai un rapprochement avec ce que nous vivons aujourd'hui. Appliquées au fait insulaire, les règles du grand marché sont profondément inadaptées. Le Conseil économique et social européen, dans un avis du 25 avril 2002, le disait déjà. Henri Malosse, son nouveau président, insulaire d’origine, vient de dire que les décisions actuelles aboutissaient à tuer la concurrence au nom de la concurrence. L’exemple de la Sardaigne montre que la concurrence non régulée se traduit par un doublement des prix et un effondrement du trafic. Et comme il n’y a pas de miracle, les armateurs privés, en l’occurrence les napolitains qui se sont entendus avec Corsica Ferries, récupèrent les subventions publiques. Je sais que je suis hors sujet, mais l’exemple me parait éloquent.
M. Avi Assouly, président. Monsieur Perrin, nous vous remercions.
n. Audition, à huis clos, de M. Jean-Paul Israël, secrétaire général CGT-Marins de Marseille à l’époque de la privatisation de la SNCM
(Séance du mercredi 16 octobre 2013)
M. Avi Assouly, président de la Commission. Nous recevons, à présent, Monsieur Jean-Paul Israël, qui était le secrétaire général de la CGT-Marins de Marseille, à l’époque de la privatisation de la SNCM, et je le prie d’excuser notre président, retenu par des travaux dans une autre commission.
Votre organisation, Monsieur, a été au premier rang des luttes syndicales – et on se souvient de vous à la télévision – menées contre la privatisation conduite par le Gouvernement au long des années 2005 et 2006. Plusieurs de nos interlocuteurs ont souligné devant nous la prééminence, sinon la toute-puissance, de votre organisation sur le port de Marseille et au sein de la SNCM : la CGT y étant solidement représentée chez les marins, ce qui n’est pas forcément le cas dans tous les armements français.
La privatisation de la SNCM s’est traduite par une opération très particulière. Dans ce dossier, les pouvoirs publics de l’époque ont modifié, à plusieurs reprises, certaines de leurs orientations initiales.
L’information qui vous a été donnée, voire la concertation, s’il y a véritablement eu concertation préalable, ont le plus souvent suscité des incompréhensions et de vives manifestations syndicales. Vous allez nous éclairer sur l’évolution du front syndical au cours de la période et nous dire ce vous pensez, avec le recul, de certaines actions, notamment celles du Syndicat des travailleurs corses (STC).
Walter Butler a regretté devant nous que la procédure retenue ne l’ait pas autorisé à exposer directement aux syndicats son projet pendant toute la période ayant précédé le dépôt officiel de son offre de reprise ? Est-ce bien exact ? N’avez-vous pas été étonné que le Gouvernement arrête son choix sur Butler Capital Partners, alors que Veolia, avec une offre globale, aurait été un repreneur plus « naturel » ?
La CGT avait-elle eu des contacts, même informels, avec Veolia qui était présente dans la région de Marseille, même si c’était en dehors du transport maritime, alors que le groupe Butler était localement quasiment inconnu ?
Plus généralement, comment analysez-vous, aux confins de ce dossier, les rôles et ambitions des compagnies Corsica Ferries et Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) devenue La Méridionale ?
Quel était d’ailleurs le paysage syndical au sein de chacune des compagnies délégataires du service public, et quel est-il aujourd'hui, à votre connaissance ?
Le « partenariat historique » entre la CMN et la SNCM n’est-il pas étrange à certains égards ? Il nous a été dit, ici même, que La Méridionale partage avec la SNCM l’exécution de la DSP « de façon conjointe mais non solidaire » !
Enfin, avec 9 % du capital de la SNCM détenus par ses personnels, de quels leviers disposent les organisations syndicales ? Les représentants des salariés actionnaires au conseil de la SNCM ont-ils le moindre pouvoir, la plus petite influence ?
M. Jean-Paul Israël prête serment.
M. Jean-Paul Israël, secrétaire général CGT-Marins de Marseille
à l’époque de la privatisation de la SNCM. J’ai lu votre proposition de résolution mais elle ne raconte pas tout à fait la même histoire que celle que j’ai vécue ! L’offre de Connex n’avait pas été retenue parce qu’elle s’accompagnait d’un plan social beaucoup plus important. Et, parallèlement à celle de Butler, il y avait l’offre concurrente du fonds Caravelle. Butler qui était le moins-disant a remporté l’offre. Il disait à qui voulait l’entendre qu’il « achetait au menu et vendrait à la carte », alors on a compris qu’on n’avait pas affaire à quelqu’un qui voulait développer l’entreprise ou s’engager dans le service public. Et nous avons eu des appels du pied de la maison Veolia, même si elle n’était plus dans la course officielle, comme nous l’avait expliqué le « commis de l’État », M. Claude Gressier.
Le ministre des finances Thierry Breton et le Premier ministre Dominique de Villepin invectivaient contre le gouffre financier que représentait la SNCM. Ce n’était pas vraiment exact parce qu’ils mélangeaient l’enveloppe de la continuité territoriale, de 70 millions, et les difficultés financières passagères de la compagnie. Tous les ans, nous dénoncions l’amalgame et, tous les ans, ils continuaient. Dans l’entreprise, leur discours était relayé par le président, M. Vergobbi, qui, lui aussi, noircissait le tableau.
Quand le préfet de région Frémont a annoncé la privatisation immédiate, exceptionnellement, nous avons arrêté l’ensemble de la flotte, sans préavis de grève puisqu’il n’y avait plus grand-chose à perdre. La donne a un peu changé et le rapport de force a évolué ensuite puisque, même si ce n’était pas ce que nous voulions, on a cru que Veolia avait un projet industriel. À tort : la suite a montré que Veolia n’avait pas plus de projet industriel, ou à peine plus que Butler.
Les difficultés d’aujourd’hui sont aggravées du fait que Corsica Ferries bénéficie d’aides à caractère social, financées sur l’enveloppe de continuité territoriale. En plus, elles ont un caractère déclaratif et l’Office des transports de la Corse (OTC) ne contrôlait pas grand-chose. Normalement, il s’agit d’une aide au passager, mais c’est Corsica Ferries qui la percevait directement par dérogation obtenue auprès de l’Europe. Cette dérogation, Monsieur Giacobbi, c’était vos prédécesseurs qui étaient allés la chercher, c'est-à-dire les présidents Rocca Serra et Baggioni, et les dirigeants de l’OTC. Je n’ai plus tous les noms en tête. En conséquence, plus Corsica Ferries déclarait de passagers aidés, plus l’enveloppe pour la continuité territoriale diminuait et plus la SNCM était en difficulté. La première difficulté vient de là.
Pour 35 millions d’euros, Butler et Veolia sont devenus propriétaires d’un actif de 450 millions, auxquels s’ajoutaient l’enveloppe annuelle de continuité territoriale, la recapitalisation de 110 millions d’euros, et le plan social provisionné à 50 millions d’euros. Tout ça pour mettre des gens à la porte et amputer le service de continuité territoriale !
M. Avi Assouly, président. Avez-vous eu des relations, des échanges, même de façon informelle, avec Veolia ?
M. Jean-Paul Israël. Quand l’État nous a mis devant le fait accompli, en menaçant de déposer le bilan, il a bien fallu regarder comment pérenniser l’entreprise et préserver le plus grand nombre d’emplois. Alors, effectivement, nous avons eu des réunions en off, avec Veolia. Mais quand nous avons eu le dos au mur.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Quand exactement avez-vous eu des « appels du pied » de la maison Veolia ?
M. Jean-Paul Israël. À la fin, après la victoire de Butler, après les rencontres que nous avons eues avec les ministres Thierry Breton et Dominique Perben qui sont venus deux fois à Marseille, à la préfecture. Nous n’avions plus d’autre choix que d’essayer de sauver les meubles et nous avons donc rencontré Veolia qui, à l’époque, s’appelait Connex.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. La Connex n’était pas encore revenue dans le jeu ?
M. Jean-Paul Israël. Exactement.
M. le rapporteur. Qui avez-vous rencontré, précisément ?
M. Jean-Paul Israël. MM. Couturier et Richard. Au passage, le président Vergobbi, le préfet de région Frémont, le préfet de police Squarcini, le maire Gaudin, se vantaient à l’époque d’avoir sauvé l’entreprise. Et, pour cette même raison, Stéphane Richard et Gérard Couturier se sont vus décerner la légion d’honneur !
M. Avi Assouly, président. On dit que la CGT faisait la pluie et le beau temps à la SNCM, et vous avez une forte personnalité…
M. Jean-Paul Israël. J’en ai fait bénéficier les marins… C’était mon seul but. La CGT a toujours été le défenseur du service public de continuité territoriale, même si on n’a pas toujours été compris. Et aujourd'hui, au vu des résultats, on se dit qu’on n’avait pas tout à fait tort.
M. Yves Albarello. Pourriez-vous m’expliquer le mécanisme de l’enveloppe de continuité territoriale ? Dois-je comprendre qu’elle servait aussi à la Corsica Ferries ?
M. Jean-Paul Israël. La SNCM recevait entre 65 et 70 millions d’euros, mais l’enveloppe globale était destinée à la fois à l’aérien et au maritime. Comme elle était plafonnée, plus Corsica Ferries déclarait de passagers, plus elle touchait et moins il restait d’argent pour les autres.
La compagnie Corsica Ferries ne contribuait pas autant à la continuité territoriale puisqu’elle n’était pas concessionnaire de la DSP. L’enveloppe correspondait à une aide à caractère social aux résidents.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Je confirme qu’il y a une enveloppe globale de continuité territoriale, qui se monte actuellement à 187 millions par an que se partagent l’aérien et la navigation. Ce que celle-ci draine se divise en deux : une partie va aux deux compagnies concessionnaires, la CMN et la SNCM, qui recevaient bien 70 millions environ ; l’autre partie finançait l’aide sociale, et elle était versée à toutes les compagnies, dès lors qu’elles respectaient des obligations de service public sur certaines lignes. Cette aide était destinée in fine aux passagers puisqu’elle était accordée en contrepartie d’une baisse des tarifs consentis aux personnes âgées, handicapées, etc. En vertu d’un nouvel accord, qui échoit au 31 décembre, et au terme d’une analyse statistique, on ventilait l’aide entre les compagnies. Il s’agissait bien d’une aide au passager et certains observateurs y ont vu curieusement, mais à mon avis à juste titre, une distorsion de concurrence. Cette aide est sans lien avec la DSP, mais elle concourt à une obligation de service public. De mémoire, Corsica Ferries doit toucher autour de 14 millions d’euros par an, et la SNCM guère plus de 1 million.
M. Jean-Paul Israël. Vous conviendrez que plus Corsica Ferries transporte de passagers, moins il en reste dans l’enveloppe de continuité territoriale. Pourtant, sur le principe, le candidat titulaire de la DSP ne devrait pas subir une concurrence d’autant plus déloyale que la compagnie rivale navigue sous un registre bis, si bien que les charges sociales ne sont pas les mêmes, les garanties ne sont pas les mêmes, et ainsi de suite. C’est là que se situe la principale source des difficultés de la SNCM, même si, ensuite, on peut discuter de la gestion.
M. le rapporteur. Pour mémoire, ce système d’aide sociale est supprimé et il fait l’objet d’un rapport de l’Inspection générale des finances qui devrait nous être communiqué prochainement car nous l’avons demandé.
Pour souligner ce que vous venez de dire, confirmez-vous qu’à l’époque, le ministre des finances, dans l’appréciation qu’il faisait de la perte de la SNCM, ajoutait aux déficits comptables la dotation de continuité territoriale ?
M. Jean-Paul Israël. Absolument.
M. le rapporteur. Or cette dotation n’allait pas qu’à la SNCM, elle profitait aussi, dans des proportions importantes, à la CMN, et à Corsica Ferries. Dans leur discours, le ministre des finances et le Premier ministre amalgamaient les pertes de la SNCM et l’enveloppe de continuité territoriale. Or cette dotation compense une obligation de service public. La traiter d’office comme une perte pose problème.
Par ailleurs, vous avez dit que M. Vergobbi, le dernier dirigeant de la SNCM, compagnie nationale, noircissait le tableau. Qu’entendez-vous par là ?
M. Jean-Paul Israël. Il a été le fossoyeur. On s’en est aperçu dès son arrivée. En comité d’entreprise, on s’est évertué en vain à lui demander sa feuille de route. On voyait bien les orientations qu’il prenait, lui et avant lui, le président Vieu ; leurs orientations allaient dans le sens d’une privatisation rampante. Aucun effort n’était fait, il n’y avait aucune volonté de renouveler la flotte, d’améliorer la continuité territoriale et la desserte du Maghreb. La Corse représentait les trois quarts du chiffre d’affaires mais il y avait le reste.
Les chiffres, vous pourrez les vérifier dans les archives de l’Assemblée nationale où le Premier ministre les a annoncés. Le président disait, peu de temps avant, que la seule façon de sauver l’entreprise était de la privatiser.
La préfecture avait demandé à nous rencontrer au début de l’été. Aussitôt après la fin de la saison, fin septembre ou début octobre, le STC était en conflit et le préfet a annoncé la privatisation à 100 %, directement à la radio, sans nous consulter. Jusque-là, il n’en avait jamais été question : les discussions portaient sur un simple apport de capitaux privés.
M. Yves Albarello. À combien se montait la perte stricto sensu, juste avant la privatisation ? Et le chiffre d’affaires ?
M. Jean-Paul Israël. Je ne m’en souviens plus, je vous prie de m’en excuser. Il faudrait consulter les documents. Certes, la SNCM rencontrait des difficultés financières mais elles étaient liées à ce que je viens de dire. Les conflits n’arrangeaient pas la situation mais nous voulions à alerter l’opinion publique sur les risques qui menaçaient la continuité territoriale. Les présidents successifs de la SNCM avaient fait des mauvais choix, comme les NGV. De là à céder 100 % de l’entreprise pour 35 millions d’euros alors que l’actif en valait 450 – il y avait à l’époque deux bateaux neufs, ou presque, le Napoléon Bonaparte et le Pascal Paoli, le siège social,…
M. Yves Albarello. Si l’exploitation est systématiquement déficitaire, monsieur Israël, et si le chiffre d’affaires diminue, l’entreprise est un tonneau des Danaïdes. On ne peut pas recapitaliser sans arrêt.
M. Jean-Paul Israël. La mise en concurrence était de nature à faire perdre de l’argent, surtout quand elle est déloyale : l’armateur en face n’a pas les mêmes charges sociales, ni les mêmes obligations que la SNCM et La Méridionale qui devaient assurer la continuité du service public.
Les conflits sociaux n’ont rien arrangé, surtout que la CGT et le STC s’opposaient systématiquement. C’était problématique mais je ne pense pas que ce sont les syndicats qui ont causé la perte de l’entreprise.
M. Avi Assouly, président. Walter Butler nous a dit avoir essayé en vain de rencontrer les syndicats avant l’annonce pour exposer son projet. Confirmez-vous ? Et si oui, pourquoi ?
M. Jean-Paul Israël. Je le répète, Veolia a été notre choix quand nous avons été mis dos au mur, c'est-à-dire quand le Gouvernement a menacé de déposer le bilan. Nous avions même été contactés par le mandataire ad hoc. Je l’ai vu une seule fois. Nous n’avions plus le choix et notre responsabilité, c’était de sauver ce qui était récupérable, qu’il s’agisse des emplois ou du service public. Le choix de Butler était simple, on le connaissait, pas besoin qu’il vienne nous l’expliquer… Il gardait quatre cargos qu’il donnait en gestion à la CMN, à M. Lemor, ce qui impliquait un plan social de très grande envergure. Paradoxalement, la SNCM était l’actionnaire majoritaire de la CMN, mais elle ne décidait pas. Longtemps, La Méridionale n’a pas osé révéler le nom de ses actionnaires. La SNCM ne touchait pas de dividendes parce que M. Lemor avait le pouvoir de décision. Et quand la STEF a racheté ses parts à la SNCM, elle a pu le faire avec les dividendes qu’elle aurait dû lui verser. Un gros scandale financier ! Un de plus ! Et nous étions les seuls à l’époque à dénoncer la « magouille » politico-financière.
M. Avi Assouly, président. Qu’aurait fait Butler des autres navires ?
M. Jean-Paul Israël. Veolia est entrée en scène, avec son projet de développement sur le Maghreb et le maintien des car-ferries pour le service public complémentaire qui est aujourd'hui remis en cause. Le plan social était moins dur que celui prévu par Butler.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Selon vous, le plan Butler consistait à ne conserver que quatre cargos mixtes, et à les confier à la CMN ou à la STEF.
M. Jean-Paul Israël. C’est ce qu’il avait déclaré, mais pas à nous directement.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. L’abandon du service public complémentaire aurait fatalement conduit à un plus grand nombre de licenciements. Veolia, au contraire, conservait les trois branches de la SNCM : le service de base assuré par les cargos mixtes, le service complémentaire par les car-ferries et la desserte du Maghreb.
Vous avez cru, avez-vous dit, que Veolia avait un projet industriel, mais il n’en avait pas vraiment. Pouvez-vous nous en dire plus ?
M. Jean-Paul Israël. Le plan initial prévoyait un renouvellement de la flotte tous les deux ans, ce n’est pas ce qui a été fait. À deux reprises, Veolia a acheté un navire d’occasion, qu’elle a rebaptisé Jean Nicoli, mais qui ne correspondait pas forcément aux besoins de la ligne, en termes de confort des passagers et de service public. Elle a manqué à toutes ses obligations. On pourrait retrouver les engagements qu’elle a pris, comme celui de ne pas verser de dividendes pendant cinq ans pour financer le renouvellement de la flotte. Elle l’aurait fait, la compagnie aurait été en bonne place pour conserver la DSP. Mais les actionnaires de Veolia ont eu le dernier mot.
M. le rapporteur. La CMN exploite aujourd'hui trois navires mixtes qui battent pavillon français et, hormis les difficultés liées à l’acquisition du Piana, elle équilibre ses comptes et gagne de l’argent. Comment expliquez-vous la différence avec la SNCM ?
M. Jean-Paul Israël. La SNCM a équilibré ses comptes pendant très longtemps et elle a été mise en difficulté pour les raisons que vous connaissez. Le rachat de Veolia à Butler ne lui a pas permis de tenir ses engagements et de renouveler la flotte, d’où les difficultés financières actuelles. Comment est-il possible d’avoir racheté l’entreprise cinq fois le prix ? Il fut un temps aussi où la collectivité territoriale voulait les bateaux les plus beaux et les plus gros. Peut-être la flotte était-elle surdimensionnée au moins en période creuse, ce qui créait des difficultés à l’entreprise. En période de pointe, elle engrangeait des recettes supplémentaires qui allaient bien au-delà de l’enveloppe et amortissaient le coût de la continuité territoriale tout au long de l’année.
M. Yves Albarello. En tant que syndicat majoritaire au sein de la SNCM, vous est-il arrivé de porter un regard critique sur la qualité du service à bord ? Je vais régulièrement en Corse, et j’ai pris les deux compagnies comme client lambda. L’accueil n’est pas le même : à La Méridionale, on porte une attention particulière au client, pas à la SNCM où il n’est même pas possible de boire le café à table au restaurant – on vous envoie au bar – et où on vous refuse un morceau de pain. Votre rôle d’organisation syndicale consiste aussi à vous comparer à la concurrence. Avez-vous fait ce travail critique ?
M. Jean-Paul Israël. Bien sûr. Il est incompréhensible qu’on vous ait refusé un morceau de pain. Pour le café, même s’il y a manière et manière de le dire, il faut savoir si la salle à manger du restaurant était équipée d’une machine à café. Sinon, le personnel ne pouvait pas faire les allées et venues entre le bar et le restaurant, à moins d’être équipé de patins à roulettes. On attirait l’attention de la direction sur le problème, mais c’était une question de stratégie d’entreprise. La direction faisait la sourde oreille et ses choix n’étaient pas les bons. La qualité s’approchait de celle de La Méridionale sur les bateaux mixtes. Les car-ferries, eux, étaient un peu surdimensionnés. Moi qui suis cuisinier de mon métier, j’expliquais que la qualité hôtelière aurait dégagé des recettes. On n’a jamais obtenu un salon de thé où proposer des glaces ou un thé avec des pâtisseries. Nous avons toujours dit qu’en période estivale, le passager devait être en congé à partir du moment où il mettait le pied à bord. On aurait dû offrir des spécialités méditerranéennes, mais cela n’entrait pas dans la politique de la direction, plus axée sur les transports que sur le reste, jugé annexe.
M. Avi Assouly, président. J’ai la même expérience que mon collègue. Sans parler de la restauration, obtenir de simples renseignements est parfois compliqué sur les bateaux de la SNCM.
M. Jean-Paul Israël. Sept ans ont passé… L’ambiance d’une entreprise déteint sur le personnel. L’incertitude, ce n’est jamais très sain pour les salariés. Je conclurai sur la nécessité de protéger le pavillon national, monsieur le président de l’exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et de sortir la SNCM du gouffre. Un service public de qualité est conforme à l’intérêt général et la disparition de la SNCM ne contribuerait pas à l’améliorer.
M. Avi Assouly, président. Nous vous remercions de votre intervention, Monsieur Israël.
o. Audition, à huis clos, de M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF, auditionné en sa qualité d’ancien président-directeur général de Veolia Environnement
(Séance du mercredi 23 octobre 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons, ce matin, M. Henri Proglio qui a dirigé le groupe Veolia Environnement avant de le quitter en novembre 2009 pour la présidence d’EDF. Il a donc été en responsabilité au cours des années 2005 et 2006, quand la privatisation de la SNCM a été préparée puis décidée.
Nos auditions et les documents en possession de la commission révèlent les soubresauts, voire les hésitations de Veolia sur l’opportunité de se porter acquéreur de la SNCM. Il semble que M. Stéphane Richard qui, jusqu’en 2007, était à la tête de la division Connex – devenue par la suite Veolia Transport –, se soit montré d’emblée très favorable au dépôt d’une offre sur la SNCM. Il n’en allait pas de même au conseil d’administration de Veolia Environnement au sein duquel s’étaient clairement exprimées des réticences vis-à-vis de l’opération, et ce dès l’été 2005. Certains de nos interlocuteurs ont évoqué devant nous « les méandres» qui caractériseraient un grand groupe comme Veolia. D’autres nous ont dit, au contraire, que vous auriez personnellement donné l’assurance à Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre jusqu'à la fin mai 2005, que votre groupe « ferait son devoir » vis-à-vis de la SNCM. Le conseil d’administration de Veolia a interdit in extremis à sa division Connex de participer à l’opération. Mais peu de temps après, votre groupe revenait dans le jeu comme opérateur industriel aux côtés du repreneur M. Walter Butler qui occupera, jusqu’en 2008, la présidence du conseil de surveillance de la SNCM.
Tout cela est apparemment bien compliqué...
Vous comprendrez, Monsieur le président, que nous souhaitions y voir plus clair dans la stratégie de Veolia mais aussi comprendre le rôle des pouvoirs publics.
Quel intérêt Veolia avait-il à s’impliquer dans un secteur comme le transport maritime, qui, à l’époque, était rentable, mais qui ne s’inscrivait pas au nombre de ses spécialités ? D’autant que l’opération s’est rapidement révélée coûteuse : le rachat au groupe Butler de sa participation dans la SNCM s’est fait sur la base d’un pacte d’actionnaires, certes négocié entre les deux groupes, mais qui s’est révélé favorable au « revendeur », si l’on considère sa plus-value !
Ayant dirigé Veolia jusqu’à 2009, vous pourrez aussi nous dire quelles difficultés et quelles perspectives se présentaient à votre groupe dans sa gestion au quotidien de la SNCM. Quelles ont été les stratégies respectives de Connex, puis de Veolia Transport ?
M. Henri Proglio prête serment.
M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF, auditionné en sa qualité d’ancien président-directeur général de Veolia Environnement. Je rectifie tout de suite, car je ne suis pas un grand diplomate. Le Premier ministre n’était déjà plus Jean-Pierre Raffarin, mais Dominique de Villepin. Et de « méandres », il n’y en a pas. J’assume la décision qui a été prise de manière très transparente.
En 2005, Veolia n’est pour rien dans la décision de l’État de privatiser la SNCM. Nous sommes repérés comme repreneur possible dans la mesure où il s’agit d’exercer une mission de service public et où nous avons quelques activités maritimes, assez marginales, dans le droit-fil de nos activités de service public.
Le directeur de nos activités de transports est effectivement M. Stéphane Richard. Il est donc venu me présenter ce qu’il considérait comme une opportunité de renforcer notre présence géographique. Il n’est pas interdit de regarder et il analyse le dossier. Il souhaite, avec un enthousiasme spontané et sincère, que nous nous présentions. À cette époque, je suis en contact avec Thierry Breton, le ministre des finances du gouvernement Raffarin. Il cherche des gens sérieux parce qu’une privatisation est un acte qui n’a rien de symbolique et qu’il y va, en l’espèce, de la pérennité d’un service public. Il aimerait que Veolia soit présent. Deux forces se conjuguent, une décision technique et professionnelle, d’un côté ; la pression de l’État sur Veolia, premier opérateur de service public dans son domaine de l’autre. Je n’avais pas d’a priori et je lui dis que je verrais si l’investissement répond à nos critères. Voilà comment l’affaire s’amorce et Stéphane Richard, quand vous l’auditionnerez, vous le confirmera vraisemblablement.
La deuxième phase correspond à la séquence de l’appel d’offre. Connex prépare son offre jusqu’à la séance du conseil d’administration de Veolia au cours de laquelle cette éventualité est suggérée. Le conseil d’administration est composé essentiellement de financiers pour lesquels la garantie de flux physiques et une rentabilité assurée sont plus importantes que la dimension de service public stricto sensu. Rien de surprenant : chacun est dans son rôle. Veolia est une société cotée en bourse, et il n’est pas absurde que le conseil joue un rôle de censure financière. Les administrateurs montrent très peu d’enthousiasme et me disent que nous avons mieux à faire de notre argent. Ils ne souhaitent donc pas que nous fassions une proposition. J’en avise aussitôt le ministre, qui ne me cache pas son embarras. Il avait le dossier puisque nous avions travaillé en étroite coopération avec les ministères des finances et des transports. Il se plaint : « Vous n’êtes pas compétitifs ! » Je lui réplique : « Cela tombe bien, je ne vais pas remettre de pli ». Il suffisait finalement de faire acte de présence pour attirer les repreneurs potentiels. « Si j’ai servi de lapin, tant mieux ! » Le ministre m’a donc fait part d’un réel mécontentement, mais nous n’avons pas répondu. Nous n’étions donc pas présents au premier tour et Butler remporte l’appel d’offres. Il se retrouve propriétaire de la SNCM. Dont acte. Full point.
Quelques jours plus tard, je ne sais plus exactement quand, et de façon assez prévisible, Marseille commence à s’agiter. Et, selon la tradition, on s’y agite un peu plus fort qu’ailleurs. Tous les soirs, TF1 montre une ville à feu – au sens propre – et à sang. Marseille est à l’arrêt, plus rien ne fonctionne. Le système étatique, toutes tendances confondues, est en émoi devant l’image brouillonne, pour ne pas dire plus, que donne la France et l’impact non négligeable sur l’économie locale. Sur les barricades, M. Israël lance : « Be-te-leur, cet Américain, no pasarán ! » Il déduit de son nom qu’il était américain. Que voulez-vous ? Les syndicalistes marseillais n’ont pas le Who’s Who sous la main et eux ne savent pas qu’il est inspecteur des finances. C’est une autre culture. Ils voyaient donc derrière le nom de Butler la mainmise du grand capital américain sur les bateaux de la SNCM. Retour à la case départ ! Après m’être fait accuser de n’être pas assez volontaire, pas assez généreux, pas assez ceci, pas assez cela,… on me dit qu’il faut trouver une porte de sortie et qu’il n’y a pas trente-six personnes pour y arriver.
Si Veolia avait été une entreprise financière, le groupe aurait probablement renoncé. Mais en tant qu’opérateur de service public responsable vis-à-vis des collectivités territoriales, à Marseille comme en Corse, j’ai eu la tentation de ne pas rester en dehors du dossier et d’apporter ne serait-ce qu’un début de réponse à une crise néfaste pour tout le monde. Quand on est enraciné dans un territoire, on ne peut pas ignorer l’intérêt public. Indépendamment des considérations financières, il fallait ramener l’ordre et la vie économique dans les bassins d’emploi concernés. Voilà ce qui m’a guidé.
Concrètement, il a fallu une nuit de discussions non-stop avec le nouveau propriétaire. Je vous rappelle que l’État avait vendu et qu’il n’était plus qu’un spectateur dans l’histoire. Il donnait des coups de menton dans le vide. Dès lors que la privatisation avait eu lieu, il n’y avait plus que l’autorité concédante qui pouvait interrompre le contrat. Mais à quoi bon puisque les bateaux ne circulaient plus ? L’État était désarmé, les collectivités aussi. En somme, deux acteurs privés se sont retrouvés face à face pour discuter d’un sujet public. J’ai guidé la négociation mais sans y assister, pour rester en réserve. Butler avait, à mes yeux, la tâche facile. En financier qu’il est, il voyait bien qu’il y avait 200 millions de plus-values latentes sur les bateaux, et il lui suffisait de perdre la DSP pour être, en vertu de l’article L.122-12 du code du travail, débarrassé des marins qui auraient filé chez le nouvel opérateur. Il n’avait plus qu’à licencier le personnel du siège et à vendre les bateaux. Et c’en était fini de la SNCM. Le raisonnement est simple. Il s’accrochait donc à ses 200 millions de plus-values latentes qui aurait peut-être pu lui laisser, déduction faite des taxes et des indemnités de licenciement, entre 150 et 160 millions de cash. Grâce à un simple aller-retour.
Devant un blocage total, je me suis dit qu’il fallait trouver une solution qui ne soit ni ruineuse pour l’entreprise que j’avais l’honneur de diriger, ni trop déresponsabilisante pour l’État, ni trop favorable à Butler qui, il faut le reconnaître, tenait le manche. Au bout d’une nuit de discussion, on est arrivé à 60 millions et on a conclu. Les juristes se sont ensuite chargés de rédiger le protocole. En substance, on lui reprenait sa participation pour 60 millions, mais il restait à bord pendant une période indéterminée, en tout cas au moins deux ou trois ans. J’ai demandé à l’État de revenir parce que je considérais qu’il ne pouvait pas s’en sortir indemne après avoir mis le feu et qu’il devait être solidaire. En maugréant, il a accepté de reprendre 25 %. Enfin, j’ai souhaité que le personnel ne soit pas oublié parce qu’il faut pouvoir remobiliser les gens et les récompenser en cas de réussite. L’ « équipage » était composé d’un pilote, Veolia, et d’un financier, Walter Butler, qui avait vocation à disparaître après avoir encaissé une plus-value. Nous avons mobilisé une équipe de gens que je crois compétents pour diriger l’entreprise. J’ai désigné des personnes au sérieux et aux aptitudes irréprochables, qui ont laissé, je crois, une marque positive.
M. le président Arnaud Leroy. Certaines des informations que vous nous donnez sont contradictoires avec d’autres qui nous ont été apportées par ailleurs. Si je comprends bien, Veolia était à la manœuvre pour conclure le nouveau pacte d’actionnaires. Vous parlez d’une longue nuit de négociation avec Butler qui nous a déclaré avoir été tenu à l’écart de cette réunion qui s’est certainement déroulée à Matignon …
M. Henri Proglio. Non, dans les locaux de Veolia, avenue Kléber. Peut-être que M .Butler avait envoyé un avocat ou un représentant. Je n’étais pas présent.
M. le président Arnaud Leroy. Pourriez-vous nous fournir un compte rendu, pour avoir au moins la date, afin de reconstituer la chronologie par rapport à la réunion qui a eu lieu à Matignon ?
M. Henri Proglio. Ensuite, il y a eu une réunion, d’abord, au ministère des transports, à l’époque situé au boulevard Saint-Germain, puis une autre à Bercy, avec Thierry Breton.
Il y a sûrement des traces de cette réunion, comme de celles qui ont suivi au ministère des transports et à Bercy. C’était le jour de la réunion du deuxième conseil d’administration. Je me rappelle que, pour ne pas le faire attendre, j’ai quitté précipitamment Bercy. C’est ce jour-là que le conseil d’administration m’a autorisé à signer le pacte qui avait été négocié.
Cette affaire est malheureuse par ses conséquences, mais les circonstances étaient telles à l’époque que je croyais faire mon devoir de citoyen et d’opérateur de service public en trouvant une solution adaptée aux circonstances.
M. le président Arnaud Leroy. Vous connaissiez bien le contexte local, en particulier la dimension sociale du conflit. M. Richard avait déjà fait un tour de chauffe en allant expliquer qu’il allait déposer une offre et que, avec Veolia, le reclassement des personnels serait plus facile. Votre comportement d’opérateur responsable pouvait aussi être un atout dans l’attribution de l’appel d’offre.
M. Henri Proglio. Je vous arrête. L’appel d’offres représentait une opportunité. On l’a étudiée et nous avons monté un dossier qui s’est révélé moins favorable que celui de Butler. Il est probable qu’on n’aurait pas gagné à partir du moment où c’étaient des financiers qui discutaient avec des financiers. Encore une fois, Breton m’avait quelque peu bousculé à cause de ce qu’il considérait être un manque d’ambition et une excessive prudence dans nos hypothèses de travail. Toujours est-il que mon conseil d’administration n’a pas suivi. Je n’avais pas le choix. La deuxième fois, on y est allé sous la pression. En tout cas, pas avec la fleur au fusil. On s’attendait à des difficultés.
Il n’y a pas de zone d’ombre.
M. le président Arnaud Leroy. Pour nous, si ; il en reste, même si les informations que nous recevons au compte-gouttes lèvent le voile par endroits.
M. Camille de Rocca Serra. Vous et nous avons fini par nous rejoindre dans la mesure où la privatisation à 100 % et l’arrivée de Walter Butler étaient pour nous synonymes d’échec. Nous savions bien ce qui allait suivre, d’où la démarche politique que nous avons engagée. Les élus corses ont sollicité le Gouvernement pour qu’il trouve un opérateur, en l’espèce Veolia qui avait manifesté son intérêt. Sachant qu’aucun des opérateurs maritimes implantés à Marseille n’avait voulu venir, il n’y avait pas d’autre solution. La tension était forte et des troubles à l’ordre public éclataient à Marseille comme en Corse. Un bateau a même dérivé pendant vingt-quatre heures sans que l’on sache où il était ! Veolia connaissant les délégations de service public et, spécialiste de l’assainissement, il avait une culture spécifique. Nous aussi pensions que l’État devait rester au capital. La façon dont les choses se sont enchaînées me paraît assez claire aussi. Nous regrettions que Veolia n’ait pas soumissionné, et, dans la situation dans laquelle nous étions, la solution retenue présentait la plus grande sécurité possible, en particulier pour le personnel.
M. Dominique Tian. À un moment, la situation était quasi insurrectionnelle. Le préfet Christian Frémont l’a rappelé, M. François Goulard également. Le port était bloqué, des voitures jetées à l’eau, des pneus incendiés,… Le STC, et surtout la CGT, bloquaient tout. Veolia pouvait difficilement sauter de joie et il n’y a rien d’étonnant qu’il ait fallu deux conseils d’administration avant d’emporter une décision dans laquelle vous avez dû mettre tout votre poids personnel. Vous avez plutôt dû penser que vous étiez tombé dans un nid de guêpes.
M. Henri Proglio. Je connais l’emphase du Sud puisque j’en viens. La situation économique périlleuse des personnels expliquait leurs excès ; ils s’exprimaient en Méditerranéens. En apportant à la fois une meilleure visibilité et des perspectives de reclassement, comme pouvait le faire un opérateur professionnel plutôt qu’un financier strict, qui n’avait d’autre ambition que de céder les bateaux, les choses allaient rentrer dans l’ordre. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Les personnels avaient très bien compris qu’ils allaient être sacrifiés sur l’autel du profit financier immédiat. La solution imaginée offrait une sortie possible et, à la clé, le retour à une relative sérénité.
Concrètement, ce n’était pas facile car il fallait passer d’un système où on avait donné tous les pouvoirs à un financier à un autre où l’intérêt public reprendrait le dessus. Il était plus aisé de gérer des risques socio-politiques – il suffit d’apporter un peu de perspective et d’avenir – que de prendre les risques que nous avons dû prendre pour mettre au point la sortie de Butler. Ce qui me motivait, c’était surtout mon sens des responsabilités. Franchement, nous étions depuis cinquante ans l’opérateur des services d’eau et d’assainissement de Marseille ; bref, nous étions un acteur important du paysage, et nous aurions regardé les événements d’un œil indifférent ?! Il y aurait eu de quoi choquer nos clients qui nous faisaient confiance et envers qui nous nous étions engagés à fournir des services de première nécessité. Ne pas répondre présent quand ils avaient besoin de nous ne me paraissait pas acceptable, en termes de responsabilité professionnelle. Et la responsabilité, ça se teste en temps de crise.
J’ai essayé que notre intervention ne soit pas désastreuse pour nos actionnaires, comptant que nos clients nous en seraient reconnaissants un jour. À défaut de profit financier, nous tirerions de l’affaire l’image d’une entreprise responsable.
M. Yves Albarello. Au premier tour, ce sont vos financiers et votre conseil d’administration qui vous ont dissuadé d’y aller. Mais, au second tour, quels sont les arguments qui vous ont fait basculer ? Et ceux qui ont fait basculer votre conseil d’administration ?
M. Henri Proglio. Mes financiers n’ont pas le pouvoir ; ils donnent leur avis. Nous ne sommes pas une démocratie. Sinon, on ne sait pas à quoi ressemblerait l’entreprise !
Au conseil d’administration, j’ai simplement exposé la réalité. Le dossier financier ne l’a pas convaincu. J’étais moi-même hésitant et je ne me suis pas beaucoup impliqué pour faire changer les administrateurs d’avis. À l’inverse, au deuxième tour, il me paraissait légitime que Veolia ne soit pas absent et ne s’exonère pas de ses responsabilités à l’égard des collectivités territoriales qui nous faisaient confiance depuis plus de cinquante ans. On quittait le terrain exclusivement financier pour s’interroger : à quoi sert cette maison ? Quelle est sa vocation, sa mission ?
Ensuite, les financiers sont là pour minimiser les risques, et exposer les hypothèses en toute transparence. D’ailleurs, l’opération n’a pas été une ruine pour Veolia.
M. Michel Vauzelle. Il a fallu trouver une solution sérieuse à un problème sérieux. Nous nous souvenons de l’état dans lequel était Marseille et un comportement citoyen a été très apprécié. Votre amitié avec Alexandre Guérini et son frère, Jean-Noël, le président du conseil général, vous a-t-elle aidé dans votre approche des problèmes marseillais ?
M. Henri Proglio. Restons-en à l’essentiel. Qu’est-ce que serait venu faire Alexandre Guérini dans cette affaire ? Mes contacts avec la ville de Marseille remontent au temps de Gaston Defferre, et j’ai entretenu des relations avec M. Vigouroux puis avec M. Gaudin, sans aucune discontinuité. C’est M. Defferre qui a créé la Société des Eaux de Marseille, et décidé d’en faire une société mixte à 50-50 entre la Lyonnaise et la Générale des eaux. J’ai débuté en 1972 dans ce dernier groupe qui m’a envoyé en mission en tant que secrétaire du conseil des Eaux de Marseille. À l’époque, je prenais les notes. Voilà comment s’est fait mon apprentissage marseillais. J’ai hérité du sentiment de responsabilité que doit avoir un opérateur de service public vis-à-vis de ses clients, c'est-à-dire la ville de Marseille et l’agglomération marseillaise. Le conseil général n’avait rien à voir là-dedans. Ce n’était ni lui ni le département qui était en feu, c’était la ville. M. Gaudin pourra témoigner qu’il était le premier concerné, plus que le département. Même s’il m’arrive d’interroger les voisins quand j’arrive quelque part, je préfère, surtout en cas de crise, m’adresser directement aux intéressés, en l’occurrence Marseille, la Corse. Le département n’était en rien concerné.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Revenons à la valeur de la société. Butler était là pour faire des plus-values. Vous l’avez dit, c’est sa vocation. Peut-on reprocher à un épicier de vendre des épices ou à un charcutier de la charcuterie ? Vous indiquez qu’il y avait quelque chose comme 200 millions de plus-values latentes brutes. Autrement dit, si la SNCM n’obtenait pas la délégation de service public, elle reviendrait à quelqu’un d’autre qui, en vertu de l’article L.122-12 du code du travail, reprendrait les personnels. Par conséquent, il serait resté les bateaux et le siège qu’il aurait fallu liquider.
M. Henri Proglio. Avec une plus-value à la clé.
M. le rapporteur. Compte tenu des frais et autres, la plus-value nette escomptée tournait autour de 100 millions. Ce constat ne correspond pas exactement à la vision de M. Butler qui nous explique qu’il recherche certes la plus-value mais qu’il redresse aussi des entreprises…
Ce qui nous surprend, et je voudrais votre avis là-dessus, c’est pourquoi il n’y a pas eu au départ d’évaluation complète de la société qui mette en évidence sa valeur intrinsèque, même dans la pire des situations. Pourquoi l’État ne l’a-t-il pas faite ?
M. Henri Proglio. Je ne suis que témoin et j’en suis réduit à me poser des questions et à raisonner. L’expérience a prouvé qu’il n’était pas si simple de réaliser la plus-value puisqu’il aurait dû d’abord liquider l’entreprise. Pour aller chercher le diamant au fond de la mine, il fallait beaucoup de temps et d’effort.
Par la suite, la négociation s’est résumée à un rapport de force avec un financier qui avait pris le contrôle et qui se considérait comme incontournable. De fait, il se trouvait dans une bien meilleure position pour valoriser sa plus-value latente que s’il avait été le seul propriétaire.
L’incongruité vient du fait que nous avons été obligés de lui donner une partie significative des plus-values latentes potentielles alors que son profit aurait été bien moindre s’il était resté. Mais, pour l’obliger à rester, il fallait prendre en otage la ville et l’île, et ce n’est pas lui qui aurait payé la note. Bref, je devais lui faciliter l’accès à la plus-value, au-delà du raisonnable, pour la bonne raison qu’il était en position de force.
M. le rapporteur. Je partage entièrement votre point de vue. La plus-value était purement virtuelle compte tenu de tous les obstacles que Butler aurait trouvés sur sa route et dont on ignore comment il les aurait surmontés. On peut imaginer qu’à la fin, il se serait retrouvé avec moins de 60 millions d’euros. La négociation entre Butler et vous s’est arrêtée sur ce chiffre considérant qu’il fallait lui garantir une plus-value telle qu’il accepte de se retirer, c'est-à-dire supérieure à ce qu’il pensait pouvoir obtenir en restant, et avec moins d’ennuis. Il n’en demeure pas moins surprenant que l’État n’ait pas regardé les choses de plus près.
À un moment, Veolia prend les commandes et nomme des gens compétents. On l’oublie aujourd'hui, mais l’entreprise a connu quelques années de répit, et regagné des parts de marché. Pourtant, la flotte n’a pas été renouvelée alors que, dans le même temps, la CMN renouvelait la sienne. Pourquoi ? Puis, la SNCM finit par replonger dans les difficultés. Or, parallèlement, la CMN, avec trois navires mixtes, mais dans exactement les mêmes conditions de délégation de service public, gagne sa vie. Elle dégage 3 % de marge et, malgré l’acquisition d’un grand navire, reste globalement équilibrée. À quoi attribuez-vous cette divergence persistante, malgré les équipes que vous avez mises en place et les contrôles qui sont exercés ? J’admets que les difficultés surgissent plutôt après votre départ de Veolia… mais tout n’était pas forcément rose avant.
M. Henri Proglio. J’ai des explications à tout, mais il m’est difficile de porter un jugement sur une entreprise cotée. Je connais la CMN depuis très longtemps. Si un jour, vous deviez vous plonger sur la privatisation de la Compagnie générale maritime et « l’auto privatisation » de la CMN et de STEF-TFE … Il y aurait à dire, mais je préfère m’abstenir de tout commentaire. Fermons la parenthèse. J’aimerais éviter d’avoir à porter des jugements sur de tels sujets en tant que citoyen.
De même, il m’est difficile de porter un jugement sur Veolia après mon départ. Il reste que, quand on annonce la cession d’une activité, qu’on démobilise tout le monde, qu’on arrête d’investir pour obéir aux diktats des agences de notation et des comptables, il ne faut pas s’étonner du résultat. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas investi : pour faire plaisir aux marchés, aux financiers, aux deux agences de notation !… Quand vous annoncez que vous cédez des activités parce qu’elles ne rapportent pas assez, vous voyez votre cours monter. Vous vous étonnez ensuite que les gens soient démobilisés ! Les pauvres gens font les frais d’exigences court-termistes. Ils sont sacrifiés aux modes auxquelles il est bon de céder. Les événements qui s’en suivent n’ont vraiment rien de surprenant. Une entreprise, comme toute action humaine, implique de la détermination, de l’ambition, et de la persévérance. N’attendez pas de ceux qui éprouvent un sentiment de trahison et d’abandon qu’ils réagissent positivement.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Il est bon que vous le disiez.
M. Henri Proglio. Non, ça me vaut quelques inimitiés profondes.
M. le président Arnaud Leroy. Si je comprends bien, Veolia a pris ses responsabilités et réuni les gens autour de la table pour répartir les plus-values latentes. On s’est mis d’accord sur 60 millions, on a trouvé une formule de calcul.
M. Henri Proglio. À ceci près que le type en face de moi ne voulait pas céder à moins de 100 millions.
M. le président Arnaud Leroy. M. Butler, lui, nous a montré son profil de bâtisseur. Et nous avons relu des coupures de presse : « Je resterai dix ans, quinze ans »,… « Je léguerai à mes enfants si nécessaire. » Il a défendu sa profession de capital-risqueur. Vous avez vu un oiseau de proie fondre sur des plus-values potentielles, difficiles à extérioriser mais réelles, surtout que M. Butler était assuré de rentrer très vite à Paris. Veolia a-t-il eu à faire par ailleurs avec le groupe Butler ?
M. Henri Proglio. Je ne le connaissais pas avant, je ne l’ai plus vu après. Encore une fois, je ne porte pas de jugement sur M. Butler. C’est un financier, et il fait son métier. Autant vouloir empêcher un tigre de griffer. Seulement, il tenait une proie et il ne voulait pas la lâcher.
M. Dominique Tian. Vous êtes très dur avec Walter Butler, même si vous vous défendez de porter un jugement. Après tout, la proie en question, vous la lui aviez laissée… Il a fallu attendre le deuxième tour pour que vous convainquiez votre conseil d’administration en trouvant les mots : « le service public, la France, le pavillon, la Corse,… » Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps ?
M. Henri Proglio. Un, je n’ai pas attendu longtemps. Revoyez la chronologie.
Deux, je ne juge pas plus Walter Butler que d’autres. Il reste que, quand vous vendez un actif à un fonds d’investissement, à un financier donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il soit motivé par les opérations ! Son métier consiste à acheter soit des rentes, soit des actifs. Il n’y a aucun mystère là-dedans. Ce n’est pas moi qui ai choisi un financier à l’issue d’une procédure décidée par les pouvoirs publics. Si l’activité avait été pérenne, dégageant des profits récurrents, probablement M. Butler serait-il resté puisque, avec sa mise, il aurait acheté un flux actualisé de revenus.
Pourquoi ne m’y suis-je pas intéressé avant ? Je m’y suis intéressé, et Stéphane Richard plus encore. Mais, au risque de me répéter, notre valorisation était très basse, elle n’était pas compétitive. C’est en tout cas ce que m’a dit le ministère quand nous échangions avec lui. Effectivement, nous n’avions pas intégré les plus-values parce que nous considérions qu’elles n’étaient pas accessibles. Au final, nous étions à la limite de l’équilibre financier, avec un petit plus. Et mon conseil d’administration, même avec la prudence dont nous avions fait preuve, ne souhaitait pas prendre de risque pour une activité qui n’était pas suffisamment garantie par des flux récurrents. C’est lui qui a décidé et il n’avait pas été convaincu par l’exposé de Stéphane Richard. Ma responsabilité, c’est de diriger une entreprise, pas le pays. Voilà mon état d’esprit. La décision, c’est l’État qui l’a prise.
Ensuite, les choses en évolué et, en tant que patron d’une entreprise de services publics, j’ai dû, sous la pression des élus locaux et nationaux, me raviser parce qu’il fallait absolument trouver une solution. La situation ex post s’est révélée très différente de celle imaginée ex ante par les décideurs publics. Nous nous sommes adaptés, oui. Tout est clair. Il n’y a eu de ma part ni mépris, ni inconscience, ni manque de discernement. Parce que je me faisais une idée assez claire de la réalité, nous n’avons pas fait une offre très élevée, et mon conseil, à qui j’avais exposé les risques encourus, a préféré ne pas y aller. Ce n’est qu’ensuite, a posteriori, que je lui ai expliqué qu’il nous était difficile, compte tenu des circonstances, de faire comme si de rien n’était. Ne rien faire est souvent ce que l’on fait de mieux. En l’occurrence, je ne le pensais pas, s’agissant d’une entreprise qui, encore une fois, était depuis le milieu du XIXe siècle une entreprise de services aux collectivités. Notre réputation valait de prendre le risque. Il n’entrait dans ce choix aucune complaisance.
M. le président Arnaud Leroy. Nous avons au moins appris qu’il n’était pas dans vos plans de faire de la SNCM votre vaisseau amiral dans le transport maritime.
M. Dominique Tian. Finalement, combien l’aventure a-t-elle coûté à Veolia ?
M. Henri Proglio. Je peux vous répondre jusqu’à mon départ de Veolia. Aujourd'hui, je n’en sais rien.
Au départ, nous avons mis dans cette affaire notre quote-part des 60 millions, de mémoire autour de 40 % – avec le personnel, nous étions majoritaires –, soit l’équivalent de 20 millions. Et ils devaient nous rapporter quelque chose comme 1,5 million chaque année. C’était correct compte tenu de la contrepartie positive en termes de réputation. Nous n’avons rien payé d’autre puisque notre participation nous a coûté un euro symbolique : l’entreprise était en déconfiture totale. Et, en échange, nous nous engagions à ce que Butler ait ses 60 millions. Ces 60 millions, c’est le prix du rachat des parts de Butler par l’entreprise.
M. Avi Assouly. Comment avez-vous pu entraîner derrière vous tout votre conseil d’administration dans une affaire somme toute mauvaise ?
M. Henri Proglio. Ce n’est pas Veolia qui a payé les 60 millions, mais l’ensemble des repreneurs, c'est-à-dire Veolia, l’État et le personnel. Estimer à 60 millions la somme actualisée des flux générés par l’exploitation de la SNCM et de la valeur des actifs – bateaux et siège social – n’avait rien d’incongru. Je n’ai jamais dit que la SCNM était la meilleure opération que j’aurais pu espérer faire, je dis qu’elle était acceptable : il y avait 200 millions de plus-value latente sur les bateaux, plus quelques dizaines de millions sur le siège. Notre analyse n’était pas absurde si la boîte était bien gérée. D’ailleurs, elle l’a été pendant quelques années et, à ce moment-là, elle a dégagé des résultats qui justifiaient notre valorisation. Alors, non, je n’ai pas honte d’avoir été capable en assemblée générale d’expliquer pourquoi nous devions y aller.
M. Avi Assouly. Vous n’avez pas fait une bonne opération. Mais Butler si !
M. Henri Proglio. Encore une fois, ce n’est pas moi qui suis allé le chercher ! Mais c’est moi qui ai dû y aller alors quand Butler s’accrochait. Tant pis si c’était le bazar à Marseille, si tout le monde souffrait, il était déterminé à rester tant qu’il n’aurait pas ses plus-values. Vous pouvez me reprocher que Butler ait fait une bonne affaire, ce n’est pas mon problème !
M. Dominique Tian. Si l’État a choisi Butler, c’était parce que l’offre de Veolia n’était pas acceptable. Et si vous aviez proposé ce que vous avez fini par proposer, l’État aurait choisi l’opérateur industriel compétent. L’État n’a pas sciemment décidé de condamner cette société en la confiant à un prédateur.
M. Henri Proglio. Réécrire l’histoire est extrêmement facile. Je vous redis la même chose. Premièrement, nous n’étions pas compétitifs par rapport à Butler parce que j’ai refusé de spéculer sur la valeur des plus-values latentes. Il a dû proposer 15 ou 20 millions là où j’étais prêt à mettre entre 1 et 3 millions. Je n’étais donc pas compétitif, d’où les reproches du ministre des finances de l’époque qui voulait que je relève mon offre. De toute façon, la conclusion aurait été la même.
Je ne juge pas non plus M. Butler, je dis simplement qu’avant d’analyser les conséquences d’une décision, il faut se pencher sur les hypothèses de départ. On ne peut pas être surpris de ce qui s’est passé.
M. Gilles Savary. Vous avez raison, Butler est un financier et il s’est comporté comme tel. Mais tous les financiers ne font pas des plus-values météoriques ni n’ont un comportement aussi systématique de prédateurs. Les fonds de pension qui investissent peuvent s’adjoindre leurs services pour consolider les financements ou les plans de reprise, mais ce qu’on vient d’entendre est proprement affolant. Pourtant, vous ne semblez pas vous en formaliser. Vous nous expliquez, un, que ce n’est pas vous qui avez pris la décision, et, deux, que c’est normal de la part d’un financier. Non, heureusement.
M. Henri Proglio. Il y en a beaucoup comme ça. J’ai passé ma vie à faire des road shows auprès des financiers. Je les connais. Ils veulent 25 % de rendement sur le capital investi, ou alors la garantie de l’État. C’est un fait. Vous les avez déjà rencontrés ? Moi, j’y ai passé ma vie. Je ne parle pas des Français. Dans l’ouest des Etats-Unis, le type en jeans qui m’a reçu m’a dit : « Vous ne dégagez que 15 %. C’est minable ! Nous, en dessous de 25 %, on n’investit pas. » Là voilà, la réalité. Le court terme l’emporte sur le long terme. Le monde de la finance a envahi l’industrie, et même l’ensemble du système. Et nous sommes victimes de cet état de fait.
M. Yves Albarello. Il est important que vous nous disiez ça, à nous qui sommes parfois déconnectés de certaines réalités financières, du monde des entreprises. S’agissant de rentabilité, je m’intéresse beaucoup au CDG Express qui doit relier la capitale à son aéroport international. Le groupe Vinci était attributaire d’un partenariat public-privé (PPP), mais il n’a pas donné suite car, quand est arrivé le Grand Paris, il s’est trouvé en concurrence le Grand Paris Express. Pour assurer sa rentabilité, Vinci a demandé la garantie de l’État, qui a refusé. Moralité : dix ans après, on n’a toujours pas de liaison directe et il faut se battre pour monter un dossier.
M. le président Arnaud Leroy. Je me considère au fait de cette réalité financière et, en tant que rapporteur du projet de loi relatif à la création de la Banque publique d’investissement, j’ai fait le même constat que M. Proglio.
Je suis tout de même choqué du comportement de l’État. Sans vouloir « charger la mule », quand les négociations sur l’avenir de la SNCM ont commencé, la privatisation ne faisait même pas partie des options sur la table. On en était à une liquidation pure et simple. À la lumière de ce qui s’est dit, on peut se demander si, officieusement, Walter Butler n’allait pas en être chargé.
Les informations que vous nous avez fournies éclairent certains aspects du dossier. Monsieur Proglio, nous vous remercions. Il n’est pas impossible que nous reprenions contact avec vous, pour avoir des précisions.
M. Henri Proglio. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les députés, je suis parfois réactif, mais je préfère dire les choses comme elles sont. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais nous sommes dans un monde cynique de financiers, pas dans un univers de poètes et de « bisounours ». Inutile de dramatiser, mais il faut être lucide.
Je reste à votre disposition et je n’ai rien à vous refuser. Merci.
L’audition s’achève à midi dix.
p. Audition, à huis clos, de M. Alain Mosconi, secrétaire général de la section maritime du syndicat des travailleurs corses, élu au comité d’entreprise de la SNCM à l’époque de sa privatisation
(Séance du mercredi 23 octobre 2013)
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons, aujourd'hui, M. Alain Mosconi, un des dirigeants du Syndicat des travailleurs corses, le STC. Votre organisation syndicale a été créée en 1984.
C’est avec la privatisation de la SNCM, que le « STC-Marin » a connu une forte médiatisation. Chacun se rappelle la prise spectaculaire du bateau Pascal Paoli et l’intervention, au matin du 28 septembre 2005, du GIGN. Monsieur Mosconi, vous avez joué un grand rôle au long de ces événements. Récemment, vous avez d’ailleurs déclaré ne rien regretter de ce combat syndical. Vous y revenez dans votre livre Dans le Sillage de la lutte, qui sort en librairie au cours de ce mois d'octobre 2013.
La commission d’enquête a tout à fait conscience des enjeux concernant encore aujourd'hui l’activité de la SNCM. Elle va néanmoins faire appel à votre mémoire pour que vous nous donniez votre analyse sur des événements ayant profondément marqué la vie de la compagnie.
Les conditions de cette privatisation représentent, je reprends vos propos, « une véritable trahison de la part du Gouvernement de l’époque ». Quels ont été, selon vous, les points les plus contestables d’une opération que vous avez toujours combattue ? La privatisation s’accompagnait d’une recapitalisation par l’État de la SNCM, qui n’était d’ailleurs pas la première, et d’un plan social que certains ont qualifié devant nous, à tort ou à raison, de « généreux ».
Qu’avez-vous pensé de la gestion conjointe, au cours d’une première période, du tandem Butler-Veolia ? L’entreprise Veolia pouvait-elle d’ailleurs être considérée comme le véritable opérateur « industriel » qui aurait auparavant fait défaut à la SNCM ?
La gestion des deux repreneurs soutenus par l’État a-t-elle, un temps, porté ses fruits ? De la confortable plus-value réalisée par Butler Capital deux années seulement après la privatisation, on pourrait déduire qu’un redressement de la situation de la SNCM a été constaté. Est-ce bien le cas ? Ou bien, en rachetant les quelque 38 % du capital que détenait le groupe Butler, Veolia aurait-elle fait preuve d’un manque de lucidité ? Nous sommes très intéressés par vos réponses à ces questions qui intriguent au plus haut point.
Que pensez-vous, par ailleurs, de l’exécution conjointe, mais à l’évidence non solidaire, de la délégation de service public (DSP) entre la SNCM et la CMN, devenue La Méridionale. Le partage des rôles est-il équitable ? La poursuite d’un tel partenariat vous paraît-elle inéluctable ?
M. Alain Mosconi prête serment.
M. Alain Mosconi, Secrétaire général de la section maritime du Syndicat des travailleurs corses (STC), élu au comité d’entreprise de la SNCM à l’époque de sa privatisation. Bizarrement, la privatisation de la SNCM ressemble plus à du bricolage qu’à un projet sciemment pensé et conçu pour durer. De la fin de l’année 2004 jusqu’au début de l’année 2005, de comité d’entreprise en comité d’entreprise, la direction de la SNCM essaie de nous convaincre du bien-fondé d’une privatisation qu’elle ne présente à l’époque que comme partielle. Autant vous dire que nous ne l’avons pas crue. La philanthropie n’étant pas la règle en ce monde, on voyait mal un entrepreneur privé, qu’il soit industriel ou financier, se porter acquéreur d’une structure déficitaire sans avoir la mainmise sur la politique de l’entreprise. S’il en acceptait les difficultés, il devrait en contrepartie être le maître à bord. On nous vendait pourtant l’inverse jusqu’au 25 septembre 2005, quand le Gouvernement a annoncé, en dehors de toute concertation et en trahissant tous les accords de principe qui existaient entre les partenaires sociaux, la privatisation totale de la SNCM au profit d’un fonds de pension américain, en l’espèce Butler Capital Partners.
D’où l’action syndicale que nous avons menée, à savoir l’occupation de notre outil de travail. Comme il s’agissait d’un bateau, nous l’avons ramené à son port d’attache, Bastia. Et, il faut bien le reconnaître – et ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les médias –, c’est ce qui a fait bouger le Gouvernement. À preuve, la journée du 27 septembre : le Premier ministre et le ministre des transports, en voyage au Maghreb, déclarent le matin que la privatisation est « intangible ». M. Dominique Perben va même plus loin en affirmant que cette action violente menée par des syndicalistes va conforter la privatisation, avant un changement de pied dans le cours de l’après-midi. De retour à Paris, il fait savoir que l’État resterait au capital de la SNCM à hauteur de 25 %.
Je m’abstiens d’aborder le sujet sous l’angle idéologique. Vous imaginez bien qu’à la place qui est la mienne, je suis opposé à la privatisation parce que je considère que les entités publiques sont plus à même d’être au service du public que les entités privées. Mais ce n’est qu’un point de vue. Je ne m’attarderai pas sur le sujet et je m’en tiendrai aux aspects strictement techniques du dossier.
Il y a deux documents fondamentaux dans cette histoire.
Le premier date de 2005 ; il s’agit du projet de l’actionnaire industriel, Veolia, considéré par le Gouvernement comme la référence en la matière. Il retrace les engagements pris entre Veolia et le Gouvernement, qui déterminent le devenir de la SNCM. Tout le monde l’a compris et il y a ceux qui y croient, et les autres, très minoritaires, mais dont nous sommes, qui considèrent que, dès le départ, les dés sont pipés. Nous ne faisons pas confiance un seul instant à cette multinationale.
M. le président Arnaud Leroy. Pourriez-vous nous situer chronologiquement ?
M. Alain Mosconi. Avant le 27 septembre, la solution est 100 % Butler. Avec l’affaire du Pascal Paoli, nous donnons un coup de pied dans la fourmilière et le Gouvernement opère un changement de pied, pied auquel il passe une chaussure, puisqu’il revient dans le capital à hauteur de 25 %, mais en imposant Veolia comme opérateur industriel sous prétexte qu’il aurait l’habitude des transports. Effectivement, Veolia avait une branche « transports », mais qui, pour le maritime, transportait des passagers du port de Marseille ... au Frioul. Ce n’était pas le même métier que de desservir la Corse à partir de Marseille, Toulon et Nice. Veolia prend alors la direction de la SNCM et on peut même se demander ce que fait Butler, à part qu’on a compris, qu’il était proche du Gouvernement.
Il faut s’intéresser de près aux engagements pris par Veolia parce qu’ils conditionnent l’avenir la SNCM. Je vous laisserai ce document intitulé « Un plan ambitieux et porteur d’avenir » qui annonce la couleur : « Pour le redéploiement de la nouvelle SNCM ». J’énumère devant vous ses différents points : « La préservation de l’unicité […] et assurer la pérennité de la SNCM en s’appuyant sur les compétences de chacun », […] stopper son retrait progressif et reconquérir sa place en Corse depuis Marseille, Nice et Toulon, […], gagner la nouvelle DSP y compris dans la poursuite du partenariat avec la CMN, […], renforcer l’activité sur le Maghreb, chercher à ouvrir de nouvelles lignes en Méditerranée afin de redevenir une compagnie incontournable »,… et, j’appelle votre attention sur ce point, « maintenir une flotte à dix navires armés au pavillon français, premier registre, » – malheureusement, l’avenir radieux ne tiendra pas ses promesses –,… « initier dès 2007 le renouvellement de deux navires : une construction neuve – du travail pour les Chantiers navals de l’Atlantique – « et un bateau d’occasion – tout ça restera lettre morte –, « établir ensuite un rythme de renouvellement de la flotte : un bateau tous les deux ans et demi » – sans préciser le type de navire –, « faire de Veolia l’actionnaire majoritaire » – alors que tout le monde a compris qu’il veut partir – ; « organiser et développer l’actionnariat salarié » – il était de 9 % au départ, il est à 7 %, aujourd'hui, étrange conception du développement !
Dans cette énumération de dix points, il en était quatre que nous jugions sérieux : ceux qui concernaient le renouvellement de la flotte et le maintien du pavillon français premier registre. À cet égard, il faut savoir qu’aujourd'hui, deux des navires de la SNCM battent, l’un pavillon grec avec une cinquantaine de marins grecs à bord, l’autre pavillon italien. Belle réussite ! Les dix navires n’existent plus parce que Veolia a vendu des actifs, quand elle ne les coule pas, comme le Napoléon Bonaparte. Et elle n’a pas vendu que les actifs flottants, le siège social aussi a été cédé, pour 15 millions d’euros, semble-t-il – il en valait sans doute le double – pour en faire un casino. C’est sûrement beaucoup mieux… Je termine sur le renouvellement de la flotte. Messieurs, si un armateur n’a pas de navires neufs, ou au moins répondant aux critères obligatoires établis par Bruxelles en matière énergétique et environnementale, il se met hors-jeu. D’ailleurs, la flotte est d’ores et déjà obsolète.
Vous imaginez bien que ces engagements n’ont pas été pris sans contreparties alléchantes. Elles sont d’ailleurs précisées dans le second document, un courrier ministériel du mercredi 31 mai 2006 signé Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et Dominique Perben, ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer. Tous deux se félicitent de l’entrée effective des nouveaux actionnaires Butler Capital Partners et Veolia Transport dans le capital de la SNCM. Quelles sont les conditions qui leur sont faites ? « L’État, à travers la CGMF, participe à l’apurement des pertes et au redressement de la SNCM à travers une recapitalisation préalable de 142,5 millions d’euros. Parallèlement, une somme de 38,5 millions d’euros a été apportée à la SNCM et placée sur un compte séquestre afin d’accompagner, dans le respect des engagements pris à l’automne 2005 – que je viens de vous lire – le projet social qui sera mis en œuvre par les nouveaux actionnaires. » Vous avez tous bien compris que c’est l’État qui paie le plan social de la SNCM – Butler et Veolia se pourlèchent les babines !
Je reprends : « Après que les consultations requises des instances représentatives du personnel auront été menées, […] les nouveaux actionnaires et l’État, via la CGMF, investissent respectivement 35 millions d’euros et 8,5 millions d’euros sous forme de capital ou d’avance en compte courant. » Tous calculs faits, l’État a cédé une entreprise appartenant au patrimoine public, c'est-à-dire à nous tous, estimée à une somme comprise entre 500 millions d’euros – fourchette basse – et 700 millions – fourchette haute – à un fonds de pension contre 13 millions seulement. Et il repartira, vous l’avez dit, Monsieur le président, deux ans après, en encaissant une plus-value de 62 millions d’euros.
Lors de mon procès, j’ai parlé de « braquage du siècle » et de « Spaggiari sans les égouts ». Et le juge a concédé que ce n’étaient peut-être pas les bonnes personnes qui étaient sur le banc des accusés. Dans cette affaire, on a dilapidé les deniers publics, laissé à une multinationale et à un fonds de pension un outil inscrit au patrimoine public
Et pour quel résultat ? Car, dans les faits, c’est ce qui compte. Eh bien, aujourd'hui, la flotte de la SNCM n’a pas été renouvelée, aucun navire n’ayant été acheté et encore moins construit. Elle a ce fameux bateau affrété par des Grecs, où naviguent des Grecs – et des Français –, sous pavillon grec. Première entorse alors qu’il y avait eu compensation financière. Deuxième entorse : le non-renouvellement de la flotte. Troisième atteinte : en 2007, deux navires devaient être remplacés par un neuf et un d’occasion. En fin de compte, il y a une violation totale des engagements pris par la multinationale Veolia. C’est elle que je mets à l’index, parce que c’est elle qui s’est engagée noir sur blanc.
Dans le préambule du document que je vais vous remettre, ils s’engagent à « respecter les accords conclus avec l’État et les organisations syndicales à l’automne 2005, […] s’impliquer de manière durable dans l’entreprise et en assurer la direction, […] apporter une utilité économique et sociale à l’ensemble des partenaires – donneurs d’ordre, clients, collaborateurs – de l’entreprise, […] prendre toutes les dispositions utiles pour retrouver et maintenir une bonne santé économique ». Sur ce point, ils ont fait strictement le contraire : aujourd'hui, la trésorerie est exsangue, la SNCM n’a plus de flotte, faute de l’avoir renouvelée. Le président de l’exécutif de l’Assemblée de Corse sait le nombre de procédures dont la SNCM fait l’objet et je ne vous cache pas que je suis des plus pessimistes quant à son devenir.
M. le président Arnaud Leroy. Je partage votre inquiétude, mais je suis obligé de limiter nos travaux à ce que vous appelez le « braquage du siècle » et qui reflète un sentiment partagé par nombre des personnes ici présentes. Nous cherchons à comprendre comment les choses se sont passées. Butler a d’abord eu 100 % du capital. Ensuite, on a joué sur sa fibre « philanthropique » pour qu’il accepte de faire revenir Veolia ; puis, Veolia a racheté sa part résiduelle et dirigé l’entreprise de façon plus ou moins contestable. Je voudrais aussi vous entendre comme actionnaire puisque vous avez été associé au processus. Aux termes du pacte d’actionnaires, le personnel détient 9 % de la compagnie dans le nouveau tour de table. Ce qui m’intrigue, c’est de voir le groupe Butler gagner l’appel d’offres et de se retrouver trois jours après avec un tour de table complètement différent.
M. Alain Mosconi. Jusqu’au 27 septembre, c’est le fonds Butler qui tient la corde. Mais ce jour-là, à cause de la fameuse action du Pascal Paoli, l’État comprend qu’une privatisation totale n’est pas possible parce qu’elle n’avait pas été préparée ni même annoncée. Cette fois-ci, Butler devient actionnaire minoritaire, mais il ne quitte pas le jeu. Et je ne comprends pas pourquoi. Si je jouais sur les antagonismes, je dirais que c’était pour lui permettre, deux ans après, de sortir avec 62 millions. En tout cas, il n’y avait pas de raison industrielle, pas plus que financière, à son maintien.
L’État qui veut se désengager n’arrive finalement qu’à ficeler une privatisation partielle ; il doit donc trouver un opérateur industriel. Il travaille déjà avec Veolia depuis l’été 2005. Le Gouvernement envoie à Marseille quelqu’un du ministère pour discuter avec la CGT des marins, du port et de la SNCM pendant que Bernard Thibault en fait autant à Paris avec le Gouvernement. On pressent déjà que Veolia n’est pas loin, mais, dans un premier temps, elle ne sera pas retenue puisque Butler remporte « l’appel d’offres » – si c’est bien de ça qu’il s’agit ! On le dirait propulsé par le gouvernement de l’époque. Chacun y trouvera les raisons qu’il veut.
Je ne peux pas vous parler en tant qu’actionnaire parce que je ne le suis pas. Cet état n’étant pas obligatoire, les membres de la direction de notre bureau syndical ont refusé d’entrer au capital parce que nous ne pouvions pas, en conscience, dénoncer un mécanisme en s’accommodant de quelques actions. Nous avons voulu rester fidèles à notre ligne de conduite. Nous sommes donc restés en dehors. Vous avez raison, au départ, 9 % des actions étaient réservées aux salariés. Ils ne sont plus que 7 %, un autre manquement à l’engagement de Veolia. Et on ne sait pas où est passée la différence. Il est tout de même extraordinaire qu’on ne puisse pas connaître précisément l’actionnariat d’une entreprise qui a une délégation de service public.
On a donc maintenu artificiellement Walter Butler dans le cercle, sans qu’il ait le moindre rôle à jouer.
M. le président Arnaud Leroy. Il était tout de même président du conseil de surveillance.
M. Alain Mosconi. En tout cas, c’était mon employeur à l’époque. Mais il n’est jamais descendu sur le port de Marseille pour vérifier si l’eau était salée ! En tant que syndicaliste, je peux me permettre de dire qu’il avait beau présider une compagnie de navigation, il ne faisait pas la différence entre tribord et bâbord. Dans ces conditions, comment inspirer confiance aux usagers, surtout aux Corses, et à son personnel ?
M. Avi Assouly. Ainsi, vous avez toujours refusé de recevoir M. Butler.
M. Alain Mosconi. Il y a des procédés auxquels je me refuse dans ma vie d’homme public. Je ne vous cache pas que j’ai le plus grand mal à répondre à une invitation de mon employeur à le rencontrer au bar du coin… Il y a un lieu pour le dialogue social, c’est la table de négociation. On est venu me chercher à la sortie du stade de Furiani alors que je tenais ma fille par la main, pour me dire que Butler voulait me voir. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela ne correspond pas à mes pratiques. Je n’ai pas voulu rencontrer M. Butler en dehors du cadre prévu par la législation du travail – et un article du quotidien Le Monde en fait état – J’ai malgré tout vu un de ses avocats dans un lieu public, à l’aéroport de Bastia, où il y avait du monde autour de moi. J’ai l’ai donc rencontré. Il est venu me proposer..., me proposer certaines choses qui n’avaient rien à voir avec mon métier et mon éthique de syndicaliste.
M. Gilles Savary. Des gratifications personnelles ?
M. Alain Mosconi. Voilà.
M. le président Arnaud Leroy. Quand ?
M. Alain Mosconi. Je suis libéré de garde à vue, le 1er ou le 2 octobre. Ça devait être après la privatisation, à la fin du mois d’octobre, après l’annonce du bouclage de l’opération.
M. le président Arnaud Leroy. Qu’est-ce qui a déclenché l’agitation à Bastia et à Marseille ? La privatisation à 100 % ou l’arrivée d’un fonds d’investissement que vous analysez comme un prélude au démantèlement de la compagnie ?
M. Alain Mosconi. Les deux. D’abord, nous éprouvons un sentiment de trahison puisque jamais la discussion n’a porté sur une privatisation totale. Jamais, jusqu’à l’annonce du 25 septembre faite par le Gouvernement. La nouvelle était d’autant plus inquiétante qu’il s’agissait d’un fonds de pension américain. Il ne pouvait passer aux yeux d’un syndicaliste pour la panacée. Dans le monde dans lequel nous sommes, les prédateurs se livrent à la curée d’entreprises dès qu’ils en ont l’occasion. Nous avons eu raison, et l’expérience l’a montré, même si ça ne me fait pas plaisir de le dire, de refuser la privatisation à 100 %, puisque, deux ans plus tard, il n’était plus là. Et il est parti avec une plus-value monstrueuse. Qu’en aurait-il été s’il avait eu 100 % ? Le chèque aurait été plus gros ! Il aurait démantelé la compagnie sans aucun scrupule.
Dans le livre que j’ai écrit, je cite M. Butler expliquer sa philosophie dans un article du journal Le Monde : « Moi, j’achète au prix du menu et je revends les plats à la carte. ». Ce n’est pas le STC, ni Alain Mosconi qui lui prête ces propos, c’est lui-même qui le dit pour expliquer son métier. Nous, Le Monde, on le lit aussi. Alors, nous n’avons pas voulu être livrés en pâture à des prédateurs.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Vous n’avez pas rencontré Walter Butler ?
M. Alain Mosconi. Jamais.
M. le rapporteur. Avez-vous eu, avant ou après ce que mous appellerons « les événements du bateau », un contact quelconque avec Stéphane Richard ?
M. Alain Mosconi. Jamais.
M. le rapporteur. Et ensuite, quand Veolia est rentré dans le jeu ?
M. Alain Mosconi. Jamais à ce niveau, mais j’ai rencontré Gérard Couturier ou des gens comme ça. On s’est refusé à cette pratique.
M. le rapporteur. Et la direction de la CMN, voire les dirigeants de la STEF ?
M. Alain Mosconi. La STEF, jamais. Mais avec la CMN, bien entendu. Cela fait partie du cadre syndical.
M. le rapporteur. Qui est votre interlocuteur à la CMN ? M. Reverchon ?
M. Alain Mosconi. M. Reverchon pour les négociations, puis M. Varin, à l’époque, je crois qu’il était alors commandant d’armement
M. le rapporteur. Mais cela dans le cadre de vos fonctions, pas parce qu’ils auraient été intéressés par la SNCM ?
M. Alain Mosconi. C’est ça.
M. le rapporteur. S’agissant du siège social de la SNCM, vous estimez qu’il a été vendu à un prix assez bas. Que pouvez-vous nous en dire ?
M. Alain Mosconi. Il a été vendu pour en faire un casino. Les élus de PACA savent très bien qu’il était dans un quartier où les prix sont en train de monter, en pleine réhabilitation. Il est surprenant, sachant que la pierre au 61, boulevard des Dames prend de la valeur, qu’on se précipite pour vendre, surtout à un prix qui ne me semble pas être celui du marché.
Certes, nous étions par principe opposés à la vente, mais les 15 millions d’euros qu’elle a rapportés auraient pu renflouer la trésorerie de la SNCM. Je ne suis pas sûr qu’ils y soient restés. De la même manière, la participation de la SNCM dans la CMN a été vendue par Veolia pour 75 millions – un montant très voisin du prix de rachat de ses parts à Butler…
M. le rapporteur. C’est 45 millions.
M. Alain Mosconi. Cette somme non plus n’est pas allée dans les caisses de la SNCM.
M. le président Arnaud Leroy. Vous en êtes sûr ?
M. Alain Mosconi. Oui.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. C’est à vérifier, mais si l’on met bout à bout la vente du siège et celle, forcée il est vrai, des parts de la SNCM dans la CMN, nous arrivons à 60 millions d’euros. Il faudrait savoir comment ont été comptabilisées ces plus-values et comment le résultat a été affecté.
M. le président Arnaud Leroy. On l’a déjà dit, mais il est tout de même délirant que, en mettant 13 millions sur la table, on puisse obtenir immédiatement un renflouement par l’État qui nous vaut quelques ennuis avec Bruxelles, alors qu’on reçoit en dot le siège social de 15 millions et une participation de 45 millions dans une société qui se porte bien,…
M. Alain Mosconi. …plus la vente du Liamone, le NGV qui avait été affrété du côté de Tahiti. Un grand mystère là aussi. Les chiffres varient de 11 à 8, ou 7 millions. Il s’agit du NGV. On les interroge mais on n’arrive pas à savoir.
M. le rapporteur. Je ne suis pas sûr que la vente soit bouclée à ce jour.
M. Alain Mosconi. Vous avez raison.
M. le rapporteur. S’y ajoute la cession de SudCargos qui avait attiré mon attention à l’époque. J’avais estimé à tort ou à raison, au vu des bilans successifs sur trois ans et de la valorisation qu’on pouvait tirer de sociétés de ce type, que le prix était sous-évalué de moitié, soit quelques millions d’euros.
L’addition de ces actifs – siège, participation dans la CMN, SudCargos – avoisine 70 millions d’euros, auxquels il faut rajouter plus de la centaine de millions d’euros qu’a mis l’État. Le résultat final est tout à fait extravagant. D’où cette question récurrente : comment se fait-il qu’on n’ait pas disposé, au moment de la mise en vente, d’une évaluation solide ?
Par ailleurs, M. Butler fait état des menaces qu’il aurait reçues et qui auraient justifié pendant quelque temps une protection policière. À votre sens, a-t-il été menacé personnellement, autrement que dans un contexte général ? Par qui ?
M. le président Arnaud Leroy. Il a tout de même reçu des balles par courrier au siège de la société ! Sans doute peut-on trouver des explications comme l’ambiance locale, les difficultés du dialogue social, les décisions très douloureuses à prendre,… Toujours est-il que Butler y a trouvé prétexte pour partir. Or, à vous écouter, Monsieur Mosconi, on comprend que votre syndicat est soucieux de l’avenir de la compagnie.
M. Gilles Savary. Pourquoi ne pas avoir eu les mêmes réticences à rencontrer les avocats de M. Butler que M. Butler lui-même ?
Veolia a-t-il tenté le même type de démarches auprès de vous ?
Vous présentez Butler sous les traits d’un prédateur, mais, d’après vos déclarations, Veolia ne l’est-il pas au moins autant ? À votre avis, cette société avait-elle, dès le départ, la même stratégie que Butler ? Ou bien est-elle arrivée à cause des circonstances ? Et, dans ce dernier cas, comment expliquer son engagement dans une telle affaire ?
M. Alain Mosconi. Effectivement, je pense que le groupe Veolia est arrivé à cause d’autres enjeux. En tout cas, pas pour ses compétences dans le service public maritime. Veolia avait des intérêts dont il discutait avec le Gouvernement de l’époque, comme le traitement des déchets, la distribution de l’eau,… Ce sont plutôt ces sujets qui auraient pu faire l’objet d’un deal. Le Gouvernement était bien embêté ; il devait absolument trouver quelqu’un, il relance Veolia qui voudrait la garantie d’obtenir certains marchés.
M. Gilles Savary. À Marseille ?
M. Alain Mosconi. Entre autres.
Oui, vous avez parfaitement raison. Veolia est un prédateur, tout autant que Butler. Mais lui annonce la couleur. C’est lui-même, et pas moi, qui se définit comme prédateur, quand il présente son métier. Il reprend des entreprises en grande difficulté, il donne de faux espoirs à des salariés et, enfin, il cède. Je suis syndicaliste, je me définis comme un homme de gauche, alors oui, je trouve ça immoral. D’autres, ceux qui croient à la « main invisible » doivent penser autrement. Butler était-il pire que Veolia ? Certainement pas. Je pense même que Veolia a très largement fait la démonstration qu’elle n’était pas venue se tourner les pouces. Elle a fait son beurre, sans prendre de risque.
Quant à mon choix de rencontrer les avocats de Butler, et pas Butler lui-même, il tient à mon éthique de syndicaliste qui ne place pas sur un même pied un homme de loi et mon employeur. Pour moi, ce n’est pas la même chose. L’avocat a un message à faire passer dans le cadre d’une mission. J’aurais pu ne pas le rencontrer mais j’ai aussi été poussé par la curiosité de savoir ce qu’il y avait derrière la volonté de nous voir. Était-ce en vue de construire un avenir commun ou de me graisser la patte ? J’ai eu la réponse.
Pour ce qui est de mes principes, et ils valent pour Butler comme pour les autres, le tête-à-tête avec mes employeurs, ou le MEDEF, se passe dans un lieu public, dans un cadre défini préalablement. C’est ma conception du dialogue social, le reste étant du ressort de la vie privée. On aurait tendance à croire aujourd'hui, à tort, qu’une rencontre au café du coin ou dans l’arrière-salle d’un restaurant tiendrait lieu de dialogue social. Non, mais je suis à la disposition de la Représentation nationale parce que c’est le rendez-vous de la vérité et de la clarté.
En ce qui concerne Veolia, sa direction générale n’a jamais tenté une telle manœuvre. Je crois que ses dirigeants ont pensé, à juste titre d’ailleurs, que ce qui était valable pour Butler le serait pour eux. J’adresse néanmoins un message à celui qui passe pour le « Monsieur Veolia en Corse », un ancien fonctionnaire de police aux Renseignements généraux. Je lui fais savoir très clairement qu’il est hors de question de discuter de la privatisation en bilatéral avec Veolia. Si discussion il devait y avoir, elle se tiendrait sous l’égide du dialogue social en préfecture de Marseille, ou ailleurs, mais en présence des représentants des pouvoirs publics et dans un cadre public.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Entre 2006 et 2008, le Jean Nicoli a été loué par Veolia Transport à la SNCM pour 25 millions d’euros au total. Nous nous penchons sur ce contrat car il s’agit d’une somme considérable.
M. Alain Mosconi. Seuls ceux qui sont à l’origine de la démarche en connaissent la raison. En ce qui me concerne, je me demande encore quel en était l’intérêt.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur Mosconi, nous vous remercions et nous vous souhaitons un succès en librairie. Vous trouverez aussi des lecteurs parmi nous.
q. Audition, à huis clos, de M. Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange, auditionné en sa qualité d’ancien directeur général de Veolia Transport
M. le président Arnaud Leroy. Nous recevons ce matin, M. Stéphane Richard, non en sa qualité de Président d’Orange mais d’ancien directeur général de Connex, la division Transport du groupe Veolia, qui sera d’ailleurs rebaptisée Veolia Transport, dès 2006. Vous avez exercé vos importantes fonctions au sein de Veolia de 2003 à 2007, période au cœur de laquelle s’est inscrite la privatisation de la SNCM.
Nos auditions ont révélé votre forte détermination à participer à cette opération aussitôt que les pouvoirs publics en ont adopté le principe. Or, le conseil d’administration de Veolia Environnement, votre maison mère, ne vous a pas suivi en refusant de vous laisser déposer une offre, le 15 septembre 2005, le jour même de la limite du dépôt officiel des candidatures !
Mais, le « dossier SNCM » allait connaître des rebondissements, dont le principal a été le retour du groupe Veolia peu de temps après que le fonds Butler Capital Partners (BCP) a été proclamé repreneur à 100 % de la SNCM. Que pouvez-vous nous dire sur vos relations et sur vos discussions avec M. Walter Butler, le cas échéant avant, et après le 15 septembre 2005 ?
Ensuite, comment le « tandem » Veolia/Butler a-t-il fonctionné pendant la période de cogestion de l’entreprise, au moins jusqu’à votre départ du groupe Veolia en 2007 ? Qui a désigné l’équipe opérationnelle de la « nouvelle SNCM » et qui étaient les membres de cette direction post-privatisation ? Plus généralement, avez-vous eu alors des divergences, voire des conflits avec le groupe Butler sur la gestion de la SNCM ? Pour sa part, le président Henri Proglio a-t-il à un moment repris le dossier en main et vous a-t-il donné des directives précises ?
Par ailleurs, quelles ont été vos relations avec le partenaire de la SNCM, la CMN-La Méridionale ? Nous ne vous cacherons pas que son patron, M. Francis Lemor, a tenu à rappeler à la commission d’enquête que l’on avait cherché à le déposséder, « à lui voler ses bateaux » au travers de la procédure que Veolia avait engagée devant le tribunal de commerce de Paris. M. Lemor conserve de cet épisode plus que de l’amertume !
Enfin, comment a été élaboré le pacte d’actionnaires conclu entre Veolia et le groupe Butler, notamment les conditions financières prévues à sa sortie du capital ? S’agissant de la gestion de la SNCM privatisée, le groupe Veolia a-t-il acheté un bateau d’occasion pour le louer à la SNCM ? A-t-elle consenti un prêt à la SNCM ? Dans l’affirmative, pour quelle durée et à quelles conditions ?
M. Stéphane Richard prête serment.
M. Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange, auditionné en sa qualité d’ancien directeur général de Veolia Transport. Monsieur le président, Messieurs les députés, je vais puiser dans mes souvenirs puisque la privatisation de la SNCM commence à dater et que je ne suis pas resté inactif depuis que j’ai quitté la direction de Veolia Transport en mai 2007. Je m’efforcerai de vous répondre aussi précisément que possible mais il m’arrivera de ne pas pouvoir le faire.
Auparavant, deux mots de contexte.
Vous avez d’emblée souligné la détermination qui était la mienne dans ce dossier. Je rappelle que la Connex, qui était à l’époque la division Transports publics de Veolia Environnement, dont Henri Proglio m’avait demandé de prendre la direction en 2003, a connu sous ma direction un fort développement puisque son chiffre d’affaires a doublé entre 2003 et 2007. Le métier de Connex, c’était le transport public de passagers, avec à l’arrière-plan historique, les activités de ramassage scolaire dans le cadre de délégations de service public, puisque Connex était l’héritière de la CGEA. Avant mon arrivée, la société s’était diversifiée dans le ferroviaire, où elle avait pris des positions importantes en Allemagne et en Australie, mais également dans le maritime puisqu’elle était présente en Europe du Nord, et tout particulièrement en Norvège. Déjà, le transport maritime de passagers constituait un des axes de développement. Avant la privatisation de la SNCM, j’avais notamment conclu une autre acquisition en Norvège qui assurait par le biais d’une délégation de service public, les liaisons maritimes de passagers dans le comté de Finnmark. En somme, la SNCM s’inscrivait parfaitement dans la stratégie de Veolia Transport. Il n’y a donc rien d’anormal à ce que nous nous y soyons intéressés. Parallèlement, nous nous étions implantés sur la façade Ouest de la France. L’État nous avait d’ailleurs identifiés comme repreneur potentiel.
Après avoir été sollicités, nous avons étudié le dossier et, comme il arrive quand on consacre du temps à un sujet, nous avions envie d’aboutir car la SNCM nous fournissait l’opportunité de prendre pied sur le bassin méditerranéen. À ce stade, nous n’avons eu aucune relation avec le fonds Butler, qui était un candidat parmi d’autres. J’ignore s’ils étaient nombreux, en dehors de M. Lemor de la CMN qui ne s’intéressait à la SNCM que pour la faire disparaître. Pendant le processus d’appel d’offres, nous avons travaillé avec toute une équipe en vue de déposer une offre qui devait être validée par le conseil d’administration de Veolia Environnement. À l’époque, Veolia était dans une phase de développement et de nombreuses équipes en son sein faisaient le même travail, y compris dans d’autres branches.
Le 15 septembre 2005, je me rends au conseil d’administration devant qui, à la demande du président Proglio, je présente le dossier de la SNCM en exposant les atouts mais aussi les risques qui n’étaient pas négligeables. La discussion s’engage et, très vite, s’expriment des réserves, voire une franche hostilité de plusieurs membres du conseil à l’égard du projet. Deux phrases d’un administrateur sont restées gravées dans ma mémoire : « Nous n’avons pas à faire les poubelles de l’État. », ce qui relevait plutôt d’une position de principe et « Tu me remercieras, je t’ai évité de terminer au fond du port de Bastia. », m’a-t-il dit en me donnant une tape sur l’épaule au moment de quitter la salle. J’ajoute que d’autres administrateurs ont exprimé des réserves ou préventions.
Il a donc fallu renoncer à déposer une offre et j’ai dû l’annoncer à l’Agence des participations de l’État qui conduisait le processus, suscitant surprise et déception. Du coup, il ne restait plus que Butler à avoir remis une offre qui remplissait les conditions formelles.
M. le président Arnaud Leroy. Vous souvenez-vous à combien vous aviez valorisé la SNCM ? Et vouliez-vous 100 % du capital ?
M. Stéphane Richard. Oui, nous voulions 100 % en conformité avec le cahier des charges, mais je n’ai pas de souvenir précis des chiffres. Je sais que notre évaluation était conservatoire compte tenu des risques. La valeur de la SNCM était négative car, avant que la société quitte le giron public, l’État devait financer des dépenses certaines telles que la réduction des effectifs, avec une dotation dénommée, d’après mes souvenirs, de « surgénérosité » ! La proposition financière que nous avons élaborée devait être inférieure à celle de Butler car, en tant que professionnel du transport, nous aurions, compte tenu des perspectives, été amenés à demander plus à l’État. Je regrette de ne pas pouvoir être plus précis.
Une fois le fonds Butler déclaré attributaire, l’émotion éclate localement, chacun s’en souvient, attisée par l’image de « fonds de pension américain » que donnait à penser, bien à tort, le nom de Butler Capital Partners (BCP). Le personnel, mais aussi les élus locaux, notamment le maire de Marseille, considéraient que la reprise par un seul fonds financier, sans expérience du secteur, n’était pas la bonne solution et qu’il fallait faire appel à un partenaire industriel. Comme Veolia faisait partie du paysage et qu’elle était connue de toutes les collectivités, ils ont pensé à Connex. Ils lui ont lancé un appel pour qu’elle revienne dans le jeu. La grande préoccupation du ministre de l’économie et des finances de l’époque, je crois me souvenir, c’était que la procédure engagée aille à son terme et soit incontestable. Il n’était donc pas question de délégitimer Butler.
Nous aurions pu nous en laver les mains, mais, comme nous avions beaucoup travaillé le dossier, que nous avions établi des relations avec les acteurs locaux, que nous étions sollicités instamment par les élus locaux, nous n’avons pas complètement fermé la porte. J’ai un souvenir précis de la conversation téléphonique que j’ai eue avec Henri Proglio et le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Pierre Mongin, au cours de laquelle celui-ci nous a dit qu’il fallait trouver une solution et qu’elle passait nécessairement par un accord avec Butler. Comme il était impossible de le faire sortir du dossier, il fallait se rapprocher de lui pour trouver un arrangement.
Dans la foulée, il était minuit ou une heure du matin, nous avons engagé des discussions avec Butler. M. Walter Butler, je le connaissais un peu, nous sommes tous les deux inspecteurs des finances, mais je n’avais jamais été en relation d’affaires avec lui. L’urgence et la pression étaient très fortes. Et nous en sommes arrivés à l’idée d’un partenariat aux termes duquel Connex serait l’opérateur industriel, tout en prenant une participation au capital, et Butler, le financier ; l’État restant au tour de table. La solution s’est esquissée dans les heures qui ont suivi la discussion avec le directeur de cabinet du Premier ministre.
Ensuite, la grève se poursuivant, le préfet de région Christian Frémont nous a demandé à Walter Butler et moi-même de venir à Marseille pour rencontrer les syndicats à la préfecture. Tout cela ressemblait quelque peu à un film … Nous sommes arrivés au milieu de manifestants, il a fallu passer par l’arrière sous la mitraille des photographes. On nous a parqués dans une salle de la préfecture, tandis que soixante syndicalistes, réunis dans une autre, ont refusé toute la journée de nous voir. La première fois, la rencontre n’a pas eu lieu. Mais elle a eu lieu ailleurs, dans un bistro ! Je ne me souviens plus avec quel syndicat. À la SNCM, le nombre des syndicats était multiplié par deux car il y avait ceux des marins et ceux des officiers. Au total, il devait y en avoir douze ou quatorze organisations pour 2 500 personnes. En tout cas, avec cette affaire j’ai été à bonne école pour la suite de mes activités ! Parmi les syndicats qui comptaient, il y avait la CFE-CGC très implantée chez les officiers. Les relations étaient très cependant compliquées avec la CGT majoritaire, dirigée par M. Israël, et avec le Syndicat des travailleurs corses (STC) que nous avons rencontré – pas moi, personnellement – mais en Corse. Nous avons fini par élaborer une plate-forme consistant à soumettre le plan industriel à référendum. Résultat : le taux de participation a été de 80 % et le « oui » a recueilli 80 % des voix, entérinant la suppression de 400 ou 450 postes, et l’entrée au capital des salariés, via un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE).
Un mot sur l’équipe. Chez Connex, le directeur régional en poste à Marseille, Gérard Couturier, était un ancien officier de marine, ce qui lui donnait un profil adapté aux particularités du dossier, lui permettant de rétablir le dialogue avec les partenaires sociaux, notamment avec Jean-Paul Israël de la CGT. Honnêtement, sans lui, je ne pense pas qu’on se serait lancé dans pareille aventure. Mais il était là, il y croyait et il s’est impliqué corps et âme. Il a donc fort logiquement pris la direction opérationnelle de la SNCM après le changement d’actionnaires. On lui a adjoint une autre personne venant également de Veolia et qui était son directeur général. Ils ont fonctionné en tandem au moins tant que j’ai été là. Une autre personne a joué un rôle important : le directeur des relations humaines de Veolia, Éric de Ficquelmont. En ce qui me concerne, je ne suis intervenu que très peu. Je siégeais bien sûr au conseil de surveillance, mais c’est l’équipe sur place épaulée de plusieurs personnes de l’état-major de Veolia qui a dirigé la société.
On ne peut pas parler de « conflit » avec Butler, du moins quand j’étais chez Veolia. Que s’est-il passé ? La première phase a consisté à négocier le pacte d’actionnaires, et nous n’étions pas en position de force puisqu’il avait été attributaire de l’appel d’offres. Les conditions du pacte que j’ai relu sont classiques concernant les relations au sein d’une société entre un financier d’un côté et un industriel de l’autre, notamment pour ce qui concerne la gouvernance, la répartition des pouvoirs, le rôle respectif du conseil de surveillance et du directoire. Le seul point particulier ayant d’ailleurs fait l’objet de discussions avait trait au rachat des parts de Butler. L’existence d’un engagement de liquidité n’a rien d’anormal, il est systématiquement réclamé par des investisseurs purement financiers. Quand Orange est entrée au capital de Dailymotion, c’est la première chose que les fonds, dont le Fonds stratégique d’investissement (FSI) nous a demandée.
La valorisation des parts de Butler a effectivement fait l’objet d’une négociation. On est arrivé à une formule que j’ai à nouveau examinée. Cette formule ne me paraît pas anormale. Walter Butler a levé son option après mon départ. Il a réalisé rapidement une plus-value non négligeable parce qu’il a su le faire au bon moment, au terme de l’engagement de détention des titres, qui était de deux ans. À l’époque, la SNCM ne marchait pas mal au niveau commercial, et l’impact sur le résultat des reprises de provisions constituées au moment de la privatisation se faisait sentir. D’ailleurs Veolia Transport en a aussi profité en 2006 et 2007, même si ensuite la situation s’est de nouveau dégradée. Bref, Butler a réalisé une plus-value dont je comprends que, quelques années après, elle puisse surprendre, mais il n’y avait pas de raison de s’en offusquer sur le moment.
En somme, Butler a été malin et il a maximisé son investissement tandis que Veolia a payé le prix de sa décision de ne pas déposer d’offre le 15 septembre puisqu’elle a été fortement incitée à revenir, à cause de sa présence sur tout le territoire, et qu’elle a dû négocier avec un Walter Butler en position de force.
Henri Proglio n’a pas été très présent dans le dossier jusqu’au 15 septembre, mais il était d’accord avec ce qu’on faisait. Le jour du conseil d’administration, il m’a normalement laissé « aller au casse-pipe ». Il a très vite compris qu’il ne fallait pas insister. Ensuite, nous avons mené l’affaire tous les deux. Nous étions ensemble dans le bureau de Pierre Mongin. Je ne sais pas s’il a repris le dossier en main après mon départ ; je ne le crois pas. Le seul moment où il est intervenu, c’est dans la discussion avec les pouvoirs publics, après le 15 septembre, et quand il a fallu, une fois jetées les bases de l’accord, repasser devant le conseil d’administration. Je me souviens de notre convocation par M. Thierry Breton à Bercy, pour valider le dispositif de l’accord avec Butler, et du conseil d’administration qui s’est tenu dans la foulée et qui a approuvé l’opération. Ensuite, il s’est retiré et nous avons organisé le référendum. Gérard Couturier a pris les commandes avec son directeur général et Éric de Ficquelmont, qui siégeait au conseil de surveillance, a continué à les soutenir dans le domaine des relations sociales.
Venons-en à M. Francis Lemor, un autre inspecteur des finances. La première fois que je l’ai vu, c’était à sa demande, dans son bureau, avant la date du 15 septembre. Il m’a tenu un discours assez trash, m’expliquant que la SNCM ne devrait plus exister, qu’elle avait englouti des tombereaux d’argent public ; dénonçant la gabegie, les magouilles et les fraudes généralisées et concluant sa description apocalyptique en affirmant que la seule solution était la liquidation. Il restait tout de même le problème de la participation de la SNCM dans la CMN. Notre première rencontre s’est résumée à un monologue. Nous avions des points de vue différents, nous en sommes donc restés là. Il n’a pas été question, d’après mes souvenirs, de ce qui se passerait si Connex reprenait la SNCM.
Quant à lui « voler ses bateaux », je ne comprends pas à quoi il fait allusion. La participation de la SNCM dans la CMN a servi de levier dans la discussion entre la SNCM et La Méridionale, qui s’est terminée par une vente, chacun reprenant ses billes. L’histoire s’est terminée ce jour-là. C’est vrai que l’entreprise de M. Lemor a été pénalisée indirectement par la grève et le blocus qui ont suivi l’annonce de la privatisation. Pour lui, la SNCM était l’empêcheur de tourner en rond, dont le personnel bloquait ses bateaux et risquait de contaminer ses marins. Je n’ai en fait que très peu discuté avec lui.
Le pacte d’actionnaires est le fruit des négociations entre BCP et nous.
De mémoire, nous avons bien acheté un bateau d’occasion qui a été propriété de Veolia pour contourner Butler qui ne voulait pas investir alors que nous considérions qu’il fallait faire cette acquisition. Un tel montage était donc nécessaire pour surmonter ce blocage. Je ne peux vous assurer qu’un prêt à la SNCM a été consenti par Veolia.
M. Yves Albarello. Ainsi, M. Lemor vous a invité dans son bureau pour vous dire tout le mal qu’il pensait de la SNCM. Avec l’intention de vous dissuader d’investir dans la compagnie, pour mieux l’achever ?
M. Stéphane Richard. L’objectif était bien de me dissuader. Il estimait la faillite nécessaire… Avait-il l’idée de racheter ses actifs ? Probablement. Il m’a dit, je suis formel, que la seule solution pour la SNCM, c’était qu’elle disparaisse. Je ne me souviens pas qu’il m’ait proposé de nous partager les dépouilles.
M. Dominique Tian. Vous avez rappelé que tout le monde, de la région aux syndicats, à Marseille comme en Corse, suppliait Veolia de revenir pour empêcher la catastrophe. Vous vous êtes exécutés, contraints et forcés, pour des raisons tenant à la stratégie de l’entreprise. Quelques années après, quel jugement portez-vous sur cette opération ?
M. Gaby Charroux. En 2006 et 2007, la SNCM ne s’est pas trop mal portée et même Veolia en a profité. Pourquoi la situation s’est-elle retournée ?
M. Stéphane Richard. Une réponse honnête implique d’être nuancée. Pourquoi Gérard Couturier et moi-même, mais aussi l’équipe autour de nous, y croyions-nous ? Pour trois raisons.
Premièrement, l’État était dans une impasse totale – il ne pouvait plus mettre d’argent en raison des contraintes communautaires – ce qui pouvait créer des conditions économiques favorables pour un acquéreur privé. Comme quoi, « faire les poubelles de l’État » peut être intéressant financièrement. Peut-être avons-nous fait preuve de naïveté, mais nous pensions pouvoir réussir là où l’État avait échoué : il ne pouvait être ni un bon actionnaire, ni un bon patron dans une société où les partenaires sociaux avaient toujours été à couteaux tirés. Nous étions des entrepreneurs, nous avions un savoir-faire, 70 000 salariés…
Deuxièmement, la SNCM présentait certains aspects intéressants notamment le marché de l’Afrique du Nord, avant le Printemps arabe. Le trafic se développait et la SNCM desservait des lignes prometteuses. En dehors de la Corse, il y avait des perspectives de croissance et nous envisagions même d’ouvrir d’autres lignes, vers d’autres pays du bassin méditerranéen.
Troisièmement, les contacts que nous avions eus à l’époque avec les élus de la Collectivité de Corse laissaient penser, malgré les critiques, qu’elle ne remettrait pas fondamentalement pas en cause l’équilibre entre Corsica Ferries et la SNCM.
Après le 15 septembre 2005, on est passé à une autre phase. Je reconnais que les élus n’ont pas eu tellement de mal à me convaincre. C’est le conseil d’administration de Veolia Environnement qui a fait volte-face.
Pourquoi les choses se sont-elles dégradées ensuite ? Je ne m’aventurerai pas à expliquer ce qui s’est passé après mon départ.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Pendant que vous étiez là, les baisses d’effectifs prévues ont-elles eu lieu ? M. Henri Proglio nous a dit avoir mis les gens qu’il fallait, reconnaissant la forte implication de Veolia. Confirmez-vous qu’à votre départ, l’opération était satisfaisante ? Plusieurs actifs ont été vendus, parmi lesquels les parts dans la CMN pour 45 millions d’euros, le siège social pour 15 millions d’euros. Ces ventes ont-elles servi à éponger des pertes d’exploitation ou à augmenter les profits de Veolia ?
M. Stéphane Richard. Je me souviens que le plan approuvé par référendum prévoyait une réduction d’effectifs de l’ordre de 400 postes. Il a été mis en œuvre sans difficulté dans la mesure où les départs volontaires étaient assortis du versement d’un pécule de plus de 100 000 euros. Les plus-values tirées des ventes d’actifs ont sûrement gonflé les résultats, ou limité les pertes comptables. Elles ont surtout permis de récupérer de la trésorerie pour financer soit l’exploitation soit les investissements.
M. le rapporteur. Lorsque Veolia a racheté les parts de Butler Capital Partners, le capital avait-il été entièrement libéré ? Nous ne sommes pas sûrs d’avoir compris. Nous pensions que Veolia avait dû décaisser 73 millions d’euros, mais M. Proglio nous a expliqué que le rachat des parts de BCP lui était revenu beaucoup moins cher, de l’ordre de 20 à 25 millions d’euros. Combien l’opération a-t-elle réellement coûté à Veolia ? Qui a payé Butler ?
M. Stéphane Richard. Malheureusement, je n’ai pas les éléments précis pour vous répondre. Il est tout à fait possible que le capital n’ait pas été entièrement libéré au départ, ce qui se serait traduit par une mise de fonds inférieure au capital nominal et un financement en comptes courants par les deux actionnaires, dans des proportions différentes. Dans ce cas de figure, Veolia a pu racheter les parts de BCP sur la base d’une valeur faciale de 73 millions d’euros, mais avec une sortie de cash inférieure. Il y a peut-être eu une compensation de comptes courants, ou un autre mécanisme, qui aurait limité le flux de trésorerie.
M. le rapporteur. Il semblerait que le capital n’ait jamais été libéré.
M. Stéphane Richard. C’est techniquement tout à fait possible.
M. le président Arnaud Leroy. Nous vous remercions d’avoir précisé plusieurs points soulevés au cours des nombreuses auditions.
r. Audition, à huis clos, de M. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, accompagné de MM. Alain Quinet, ancien directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, Jean-Marc Delion, ancien conseiller équipement et transports au cabinet du Premier ministre, et Luc Remont, ancien directeur adjoint de cabinet du ministre de l’économie et des finances.
M. le président Arnaud Leroy. Nous accueillons M. Dominique de Villepin qui a été Premier ministre du 31 mars 2005 au 15 mai 2007, période au cours de laquelle la SNCM a été privatisée. Évidemment, la commission d’enquête a pleinement conscience monsieur le Premier ministre, que vous avez eu à connaître de nombreux autres sujets ou événements majeurs, voire des crises comme celle des banlieues en octobre 2005, et que la privatisation ne relevait pas de vos seuls collaborateurs directs, d’autant que le « dossier » avait été ouvert par votre prédécesseur, M. Jean-Pierre Raffarin. Vous en avez donc en partie « hérité » de ce dossier.
Pour autant, nous allons faire appel à vote mémoire car, et cela n’a rien d'anormal, certains arbitrages déterminants ont été rendus à Matignon.
Le grand public garde en mémoire la « prise » du bateau Pascal Paoli par des marins du Syndicat des travailleurs corses, le STC, et son arraisonnement le lendemain par le GIGN. Vous avez alors annoncé que l’État conserverait le quart du capital de la SNCM. Pourtant, la décision de privatisation initialement annoncée, au terme d’un appel d'offres, portait sur une attribution de 100 % du capital au bénéfice du fonds financier Butler Capital Partners (BCP). À elle seule cette première décision peut étonner.
En considérant vos orientations politiquement les plus affirmées, n’étiez-vous pas quelque peu inquiet, voire franchement hostile, à la perspective de confier l’avenir d’une compagnie comme la SNCM, en charge d’une mission de service public, à un fonds financier sans expérience dans le secteur maritime ? N’avez-vous pas été tenté à un moment de déclarer l’appel d’offre infructueux pour ne pas avaliser une telle solution ? Connaissiez-vous personnellement M. Butler et ses activités de repreneur d’entreprise ?
Au cours de cette période de forte tension, à Marseille comme en Corse, les organisations syndicales se sont directement adressées à vous. Tel a notamment été le cas de Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT. Avez-vous considéré qu’il fallait impérativement trouver un accord de sortie de crise avec les syndicats et, à cet égard, les rôles de M. Thibault et de la CGT ont-ils été importants ?
M. Dominique de Villepin prête serment.
M. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Monsieur le président, Messieurs les députés, je viens aujourd’hui, à votre demande, rappeler et préciser l’action de mon gouvernement en 2005 pour sauver la SNCM. Je sais ce que représente cette société, depuis quarante ans, pour la continuité territoriale, pour le service public, pour l’emploi. C’est pourquoi mon gouvernement s’est pleinement mobilisé pour redonner à la SNCM une assise à la fois financière, industrielle et sociale. Et je ne sollicite, Monsieur le président, aucune forme de clémence sur le jugement qui sera porté sur l’action de mon gouvernement parce que nous avons fait tout ce que nous pouvions et que nous avons, au bout du compte, sauvé la société. J’aborderai successivement trois questions. Quelle était la situation de la SNCM mi 2005, au moment de mon arrivée à Matignon ? Quelle a été notre action, durant notamment les mois de crise, de septembre et d’octobres 2005, où j’étais directement en responsabilité ? En quoi la solution élaborée à l’époque a-t-elle permis de répondre à la crise de la SNCM ?
Début 2005, six mois avant mon arrivée à Matignon, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait publiquement constaté la situation de crise et l’impasse où se trouvait la SNCM.
Une crise financière d’abord, malgré le plan de restructuration arrêté en décembre 2001, dont la mise en œuvre avait été acceptée par la Commission européenne en juillet 2003. La SNCM a enregistré des pertes d’exploitation répétées malgré le plan de restructuration et les réductions d’effectifs arrêtées alors : le résultat net a été négatif de 30 millions d’euros en 2004, soit plus de 10 % du chiffre d’affaires. Ces pertes ont dégradé la trésorerie de la société, alimentant un risque permanent de cessation de paiement. De fait cette situation a conduit, dès novembre 2004, à la nomination d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Marseille dans le cadre d’une procédure d’alerte.
Une crise sociale et managériale aussi. L’image de la société, minée par des conflits sociaux à répétition, était dégradée. Elle avait ainsi perdu 250 000 voyageurs en 2004. Le management de la société, désavoué, déstabilisé par les conflits, n’avait plus la crédibilité ni l’autorité nécessaires pour mener à bien le redressement de la société.
Les marges disponibles pour redresser cette situation étaient très contraintes et, sans ce constat, on ne peut pas comprendre que les choix que l’État a dû faire. La société était – elle l’est toujours – étroitement dépendante de l’Office des transports de la Corse (OTC). Placé, depuis le statut Joxe de 1991, sous la responsabilité de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC), cet Office versait 70 millions d’euros par an à la SNCM dans le cadre d’un contrat qui devait être réattribué après appel d’offres. Il n’y n’avait aucune garantie pour la SNCM sur le renouvellement de ce contrat, et il aurait été impossible de le réattribuer à la SNCM si elle avait basculé en procédure judiciaire. La Commission européenne, en donnant son accord au plan de restructuration de 2001, avait exigé que la recapitalisation de l’État de 70 millions d’euro soit pour solde de tout compte. L’État ne pouvait plus injecter d’argent frais et n’était en tout cas plus en situation d’aider seul la compagnie face à la menace de cessation de paiement. Ce constat ne serait pas complet si je ne rappelais enfin la pression des compagnies concurrentes, voire certaines tentations de démembrement de la SNCM.
En un mot, cette situation désespérée condamnait clairement tout espoir de maintenir la SNCM sous gestion publique.
C’est dans ce contexte que le 26 janvier 2005, le gouvernement Raffarin avait lancé un processus de recherche d’un partenaire privé pour adosser la compagnie et sortir de l’impasse où elle se trouvait.
Ce processus a été piloté de manière rigoureuse et transparente par l’Agence des participations de l’État (APE), qui est, au sein du ministère de l’économie et des finances, chargée de gérer les participations de l’État et de conduire les opérations d’ouverture de capital et de privatisation. Elle dispose au sein du ministère d’un statut spécifique et les opérations qu’elle conduit sont strictement encadrées. Dans le cas de la SNCM, l’APE a mis en place un processus de recherche de partenaires privés pour adosser la compagnie. Ce processus consiste à solliciter des investisseurs potentiels, à mettre à leur disposition des informations moyennant un accord de confidentialité et à organiser trois tours de consultation devant déboucher sur la remise d’offres fermes. Comme il est d’usage, l’APE s’est appuyée sur une banque conseil chargée de procéder à l’évaluation intrinsèque de la société et de veiller à la défense des intérêts patrimoniaux de l’État et de la société. Une personnalité indépendante – M. Claude Gressier, président de section au Conseil général des ponts et chaussées – a été nommée pour veiller à l’égalité de traitement entre les candidats et aux respects des intérêts de l’État et de l’entreprise. Enfin la Commission des participations et des transferts, une commission composée de personnalités indépendantes, a rendu un avis sur les conditions de la privatisation, pour vérifier que celle-ci est conforme aux intérêts patrimoniaux de l’État et de la société. Dans le cadre de cette procédure, 70 entreprises, essentiellement européennes, ont été consultées, 15 s’engageant dans un accord de confidentialité et 3 offres préliminaires et non engageantes ont été remises en juin 2005, celles de Veolia Transport et deux fonds d’investissement : Butler Capital Partners et Caravelle.
J’arrive maintenant à la période où je suis en responsabilité directe, ayant été appelé aux fonctions de Premier ministre le 31 mai 2005.
Lors de mon entrée en fonction, au début de la haute saison, la priorité immédiate est d’assurer la continuité de l’exploitation des navires de la SNCM. Toute perturbation serait dramatique pour l’économie corse, fortement liée au tourisme. Par ailleurs, l’été est de loin la période de l’année la plus rémunératrice pour l’entreprise. En septembre, la fin de la saison d’été signifie la fin des rentrées d’argent et la trésorerie se tend très rapidement. Il est clair que les menaces de mise en cessation de paiement deviennent imminentes.
Dans le même temps, le processus de recherche d’un partenaire privé entamé huit mois plus tôt par mon prédécesseur arrive à son terme. Je voudrais, pour éviter polémiques et débats inutiles, vous rappeler la chronologie précise des événements.
Le 15 septembre 2005, malgré les efforts déployés, malgré le grand nombre de sociétés approchées, seules deux offres finales sont remises. Ces deux offres émanent de fonds d’investissements : celles de Butler Capital Partners ou BCP et Caravelle. Aucun opérateur industriel n’a voulu remettre d’offre ferme. Veolia, je le précise, n’a pas in fine remis d’offre ferme. Je n’ai pas eu à me prononcer personnellement sur le choix du candidat retenu. Il ne m’appartenait en aucune pas d’interférer avec un processus d’appel d’offres lancé huit mois plus tôt, comportant des étapes formalisées, piloté par l’APE dans les conditions que j’ai rappelées, sous le contrôle d’une personnalité indépendante et de la Commission des participations et des transferts.
Une fois les offres finales déposées, nous n’avons plus alors le choix qu’entre ; soit mener jusqu’au bout le processus de privatisation sur la base de l’une des deux offres ; soit, compte tenu de la situation d’urgence absolue, de déposer le bilan, ce qui ne pouvait qu’aboutir à la liquidation de la société.
L’APE examine les offres sur la base de trois critères : un critère financier – quelle est l’offre la moins coûteuse pour l’État ? –, un critère social – l’emploi –, et un critère industriel – le projet. L’analyse faite par l’APE montre que l’offre de BCP est celle qui doit être retenue. BCP propose de reprendre la société pour 35 millions d’euros, après sa recapitalisation par l’État à hauteur de 113 millions d’euros. BCP est la seule société prête à s’engager sur un apport financier important à l’entreprise ; elle est aussi la « mieux-disante » sur le montant de recapitalisation attendu de l’État.
Le 27 septembre 2005, les ministres concernés, Thierry Breton pour les finances et Dominique Perben pour les transports, ont ainsi logiquement annoncé retenir l’offre de BCP. Cette décision était impérative pour au moins affermir une offre financière viable.
Je veux souligner ici que la procédure de recherche d’un partenaire privé et son aboutissement n’ont jamais été contestés.
S’ouvre alors une période de crise, semée d’embûches, où l’État doit garder le cap.
Le 20 septembre, alors que l’annonce de la reprise par BCP est imminente, les organisations syndicales de la SNCM déclenchent une grève de grande ampleur, accélérant l’épuisement financier de la société. À ce conflit s’ajoute, le 28 septembre, l’épisode du détournement du Pascal Paoli par des membres du Syndicat des travailleurs corses, qui milite depuis toujours pour le démembrement de la société afin de créer une compagnie spécifiquement corse. Je dois décider la reprise du navire par un abordage héliporté du commando Hubert et du GIGN, ce qui est fait efficacement et sans violence. Appelé à la rescousse par les élus marseillais, le Gouvernement se mobilise jour et nuit pour rechercher, sur les bases de l’offre dont il dispose, la solution la plus apaisante et la plus robuste possible pour le devenir de la SNCM. Il le fait avec l’implication personnelle de Thierry Breton et Dominique Perben qui se rendent à quatre reprises à Marseille pour renouer les fils du dialogue et favoriser l’émergence d’une solution.
Le 2 octobre et, sur la base de l’offre de BCP, Veolia se met d’accord avec ce dernier pour participer à la reprise de la SNCM. BCP était prêt à céder une partie de sa participation à Veolia. Veolia, déjà présent à Marseille, avait participé à la procédure d’appel d’offres et avait manifesté un intérêt continu pour le dossier, même si elle n’avait pas in fine remis d’offre. Aux termes de ses accords avec BCP, Veolia devient l’opérateur industriel de la SNCM et entre au capital à hauteur de 28 % – contre 38 % pour BCP – ; l’État conserve une participation à hauteur de 25 %, le personnel entre au capital à hauteur de 9 %.
Le 13 octobre, un vote des salariés de la SNCM en assemblée générale décide la reprise du travail. À partir de là les choses se mettent en place. De façon immédiate, le plan de reprise permet à l’État d’accorder à la SNCM une avance de trésorerie de 25 millions d’euros en octobre pour donner le temps à l’accord de se mettre en place. Le 3 mai 2006, 77 % du personnel se prononce par référendum en faveur du projet de reprise de Veolia au cours d’un référendum interne. Le 26 mai 2006, après avis de la Commission des participations et transferts, un décret autorise la vente de l’entreprise, cette décision ayant été par la suite confirmée par la Commission européenne.
De mi-septembre à mi-octobre, tensions, crises et négociations se sont succédé. Au bout de ce mois, mon gouvernement est parvenu à dégager une solution industrielle, financière et sociale pour la SNCM. Cette solution a recueilli l’accord de toutes les parties prenantes et a permis d’éviter le dépôt de bilan de l’entreprise. Elle était fondée sur l’offre financière de BCP, reconnue aux termes d’une procédure ouverte comme la mieux-disante, à laquelle se sont adjointes les compétences industrielles du groupe Veolia. L’État, dans cette phase finale de négociations, a décidé de conserver 25 % du capital et a pesé en faveur d’une participation des salariés au capital de l’entreprise à hauteur de 9 %.
C’était il y a huit ans. Que peut-on dire aujourd’hui de la solution élaborée à l’époque ? A-t-elle répondu au problème identifié à l’époque ? Je voudrai aborder ce point à partir de cinq grandes questions
Première question : est-ce que l’État a simplement voulu se débarrasser du problème de la SNCM avec la privatisation de 2005 ? L’État a construit une solution durable. Loin de se désengager, il s’est au contraire fortement impliqué au cours de l’année 2005 pour donner une nouvelle chance à une société que tout paraissait condamner, et préserver ainsi 2 000 emplois, à Marseille et en Corse. Il a réussi à trouver un accord avec l’ensemble des parties prenantes. La poursuite de la gestion de la SNCM sans adossement à un partenaire privé n’était plus possible car les efforts pour redresser la compagnie dans un cadre public avaient échoué. Car l’État était dans l’impossibilité de remettre de l’argent directement : il s’était engagé vis-à-vis de l’Europe de ne plus le faire dans le cadre du plan de 2001 et les concurrents de la SNCM guettaient le moindre faux pas.
L’État s’est engagé au plan politique et social, au travers notamment de tables rondes à Marseille avec les ministres des transports et de l’économie ; au plan industriel, par une action de longue haleine pour trouver de nouveaux investisseurs ; au plan financier, avec un effort important pour conforter la solution de reprise, et le maintien de l’État au capital à hauteur de 25 % aux côtés du nouvel opérateur industriel.
Deuxième question : l’État a-t-il bradé ses intérêts patrimoniaux ou ceux de l’entreprise ? L’APE a réalisé, comme il se doit, une évaluation complète de l’entreprise avec l’appui d’une banque-conseil. Ce travail a intégré tous les éléments de valorisation possibles. Ces travaux de valorisation ont été soumis à l’avis indépendant de la Commission des participations et des transferts. Celle-ci a émis un avis favorable, ce qui signifie que les intérêts patrimoniaux de l’État et de la société ont été préservés. Je rappelle que, dans le cadre de la procédure de recherche des investisseurs, ceux qui ont signé l’accord de confidentialité ont eu accès aux données détaillées sur l’exploitation de l’entreprise et la valorisation de ses actifs. S’il y avait eu des perspectives d’argent facile, comment expliquer que deux offres seulement aient été finalement déposées ?
Troisième question : l’État en a-t-il fait assez pour la SNCM en 2005 ? L’État a été au maximum de ce qu’il pouvait faire. L’effort financier arrêté à l’automne 2005 a résulté des conditions posées par la meilleure offre de reprise. Cette offre permettait de rétablir la trésorerie et de porter les fonds propres à un niveau nécessaire pour relancer la compagnie. L’apport financier de l’État comprend, outre la souscription au capital de 113 millions d’euros destinée à apurer les dettes, 38 millions d’euros pour financer le plan social. L’effort de l’État a permis, avec la contribution du partenaire privé, d’apporter plus de 180 millions d’euros à la compagnie, de reconstituer sa trésorerie et de poser les fondements d’un redémarrage. Il a accompagné comme actionnaire minoritaire l’opération de transfert en conservant 25 % du capital.
Pour l’État, apporter plus était impossible : nous serions allés au-delà de l’offre de reprise et nous serions entrés dans l’arbitraire. Le montant est objectif, il est explicable, il est justifié. C’est ce montant qui a été contesté en première instance au niveau européen comme allant au-delà d’un comportement normal d’investisseur. Je pense que l’État français a, devant la Cour de Justice Européenne où l’affaire a été portée, un dossier solide, justement parce qu’il a été rigoureux dans son action et dans ses décisions.
L’État, et je veux le rappeler ici solennellement, n’avait le choix qu’entre mettre en œuvre de la privatisation – permettant de sauver l’entreprise – et laisser l’entreprise aller à une liquidation imminente et inéluctable. Il a donc choisi d’appuyer un processus de privatisation volontaire, qui permettait la recapitalisation et l’assainissement de l’entreprise.
Quatrième question : l’État a-t-il interféré dans la négociation entre Veolia et BCP ? Non, l’accord entre Veolia et BCP s’est strictement déterminé entre eux deux. L’État n’y a pris aucune part. Il faut distinguer ici très clairement le principe et les modalités de la participation de Veolia.
Sur le principe, l’État a toujours été favorable à la participation d’un opérateur industriel tel que Veolia. Veolia, par sa connaissance du secteur du transport et son expérience dans le domaine des délégations de service public, était un investisseur industriel utile à la SNCM. Nous savions que Veolia avait regardé avec intérêt le dossier de la SNCM : elle avait remis une première offre non engageante en juin 2005 et ce n’est qu’in extremis qu’elle avait renoncé à déposer une offre en septembre 2005. Veolia avait un intérêt pour revenir dans le dossier à partir du moment où elle n’avait plus à être actionnaire unique : cela a débloqué la situation.
Sur les modalités, Veolia ne pouvait venir que dans le cadre de l’offre remise par BCP. En effet, à partir du moment où les offres fermes avaient été déposées par BCP et Caravelle, la procédure devait être strictement respectée ; il était impossible au plan juridique de la modifier en sollicitant une nouvelle offre. L’État n’avait accès qu’à l’offre de BCP, et il était lié par cette offre.
L’entrée de Veolia au tour de table s’est faite par accord direct avec BCP. L’État n’était pas partie à cet accord privé entre BCP et Veolia ; il n’a pas eu accès à ses termes. J’ajoute qu’aucune contrepartie n’a été accordée par l’État à Veolia.
Cinquième question : le plan de 2005 a-t-il échoué ?
Le plan de 2005 a redonné à la SNCM l’assise financière, la perspective industrielle et la paix sociale dont elle avait besoin pour rebondir. J’ai entendu des critiques sur ce plan. Je note d’emblée que, pendant huit ans, l’entreprise a assuré sa mission de service public et continué d’être un employeur important à Marseille et en Corse. Au-delà de l’action de l’État, l’avenir de la SNCM dépendait dans la durée de l’engagement de toutes ses parties prenantes : l’actionnaire, le management, les organisations syndicales, la région.
Il ne m’appartient pas de juger l’action de chacune de ces parties prenantes depuis huit ans. Je m’en tiendrai à deux constats. Concernant l’actionnariat privé de la SNCM, BCP est sorti du capital en novembre 2008, laissant à Veolia le rôle d’actionnaire majoritaire avec 66 % du capital. La SNCM reste dépendante de la délégation de service public au titre de la continuité territoriale entre la Corse et le continent, et donc de son autorité concédante, en raison de son modèle économique et de la dimension de son outil industriel.
Tout cela était vrai jusqu’en 1991 quand l’État portait la responsabilité de l’Office des transports. Cela est resté vrai après 1991, avec le statut Joxe, quand il a été décidé de transférer cette responsabilité à la Collectivité territoriale de Corse, et les dotations qui allaient avec. La SNCM, qui est l’opérateur de la continuité territoriale, a suivi ces évolutions en essayant de s’y adapter. Dans ce contexte, la privatisation de la SNCM avait pour objectif de donner à cette entreprise les moyens de cette adaptation et de créer les conditions d’une relation équilibrée avec la collectivité territoriale.
Au total, je reste convaincu que mon Gouvernement a agi dans le meilleur intérêt du service public, en offrant à la SNCM l’opportunité de retrouver un modèle soutenable. Aujourd’hui, la SNCM fait face au risque d’une nouvelle crise. Son avenir dépend de la pleine mobilisation de tous les acteurs publics et privés concernés par cette entreprise. Je souhaite que les pouvoirs publics contribuent à trouver une solution conforme à l’intérêt général, avec exigence et détermination.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, pour la qualité et la clarté de votre propos. Le temps a passé et notre commission a pu prendre du recul pour apprécier les choses avec sérénité. La privatisation était une obligation, nous en sommes conscients, et la commission d’enquête a pour objet d’examiner seulement ses conditions. Le rappel que vous avez fait du contexte de l’époque, de la pression subie par le Gouvernement corrobore nos investigations.
Quand vous étiez Premier ministre, l’exploitation de la SNCM évoluait plutôt favorablement et les problèmes n’ont resurgi que plus tard. Simplement, au moment de sa privatisation, la SNCM est à l’équilibre après son renflouement par l’État. Elle n’a plus de dettes, ni de pertes, son plan social est provisionné. Elle peut normalement, avec le renouvellement de la DSP, espérer dégager une marge de 3 %, comparable à celle de la CMN sur le service de base. La compagnie recèle des plus-values latentes importantes : BCP retire de la revente de ses parts un profit de 60 millions d’euros, avant la cession de la participation dans la CMN qui rapportera 45 millions d’euros et celle du siège 15 millions d’euros – je néglige les autres. Bref, on arrive à un total de 125 millions d’euros. D’où des interrogations légitimes. Pouvait-on trouver une parade ? Vraisemblablement, mais il est toujours facile de le dire a posteriori, sans se replacer dans les conditions de l’époque. Était-ce prévisible ? Oui, d’ailleurs, je l’avais prédit mais sans prendre en compte le risque pris par les différents protagonistes, et qui méritait rémunération. Des sanctions pénales peuvent-elles être envisagées ? Autant le dire franchement, à ce stade, nous n’avons rien trouvé de répréhensible. Vous êtes le dernier auditionné, mais le premier à connaître ces conclusions.
Pourtant, une opération menée dans le cadre de la loi a semé le trouble, mais elle a permis un redressement et certains ont encaissé des plus-values, ce qu’il aurait été préférable d’éviter. Ensuite, l’entreprise a rechuté. Qu’en pensez-vous huit ans après, monsieur le Premier ministre ?
M. Dominique de Villepin. Le scénario que j’ai décrit nous imposait un grand nombre de contraintes, juridiques notamment, qui nous privaient de marges de manœuvre. Le processus était lancé sous le contrôle de l’APE, et je n’ai eu à aucun moment à porter un jugement sur le choix qui a été fait. Dans une procédure donnée, chacun doit rester à sa place.
Dans le système économique qui est le nôtre, tout agent a l’espoir de tirer un bénéfice d’autant plus élevé que le risque qu’il a pris est grand. Je rappelle que la plus-value de BCP a été faite au détriment de Veolia, pas de l’État. Veolia, qui avait choisi in fine de ne pas faire d’offre, n’aurait pas été dans la même situation si elle avait choisi d’en faire une. C’est le calendrier qui explique la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Nous avions deux offres, nous avons choisi la meilleure. Ce n’est qu’ensuite que l’« attelage Butler-Veolia » a pu être constitué, dans l’intérêt même de la SNCM qui pouvait ainsi s’appuyer sur un pôle industriel fort et une capacité financière imposée par la privatisation qui était lancée. On ne peut pas refaire l’histoire, mais il est sûr que, si une proposition avait été faite par Veolia, à la date du 15 septembre 2005, aucun opérateur financier n’aurait fait de plus-value et Veolia n’aurait pas eu à la payer à Butler. Le processus de la privatisation s’imposait à nous.
Je précise à propos des plus-values latentes, de l’ordre de 200 millions d’euros, sur lesquelles on a beaucoup glosé, qu’à aucun moment nous n’avons envisagé une liquidation, ce qui aurait été un mauvais choix en termes d’ordre public, d’intérêt général au regard de la desserte de la Corse, et sur le plan social. En outre, la valorisation a été faite par l’APE, sous le contrôle de la Commission des participations et des transferts, sur la base d’expertises tierces qui, toutes, arrivaient à la conclusion que les coûts de liquidation excéderaient la valeur des actifs de plus de 200 millions d’euros. Le passif de la société était évalué à 150 millions d’euros, avant même de prendre en compte le coût vraisemblable du plan social au-delà des seules indemnités légales. Les chiffres qui sont lancés en l’air ne correspondent pas à la réalité au moment où les décideurs devaient se prononcer. On peut, maintenant, reconstituer une cagnotte mirobolante, mais, quand nous avons dû trancher, la perspective était moins alléchante.
M. Dominique Tian. Monsieur le Premier ministre, Yves Albarello et moi avons été surpris d’entendre notre président parler de « clémence » à votre égard alors qu’il faudrait plutôt vous remercier d’avoir sauvé la SNCM.
M. Dominique de Villepin. Cela fait bien longtemps que j’ai compris que la République était rarement bonne fille avec ceux qui la servaient.
M. Dominique Tian. Je me souviens des réunions à la préfecture au cours desquelles le Gouvernement essayait de trouver des solutions avec le soutien des élus corses et marseillais, et de tous ceux qui redoutaient la disparition de cette société nationale et, avec elle, de ses 2 000 emplois. Votre action mérite mieux que de la clémence. En effet, le contexte était très contraignant, à cause des règles communautaires, de la perte de 30 millions d’euros enregistrée en 2004, du climat social extrêmement tendu avec le ballet des ministres et les syndicats qui ne voulaient pas participer à l’effort de redressement… Le Gouvernement a-t-il fait œuvre utile et a-t-il sauvé la SNCM ? C’est en tout cas le sentiment des élus marseillais autour de Jean-Claude Gaudin. Et nous espérons qu’elle survivra malgré des nouvelles alarmantes.
M. Dominique de Villepin. Si l’on considère le caractère très contraignant de la procédure, le climat social, extrêmement tendu, le chemin était très étroit. Au bout du compte, il me semble que la solution était optimale pour toutes les parties : l’État, l’entreprise, les liaisons avec la Corse,… Le package laissait espérer un redressement de la SNCM. Et les choses se sont relativement bien passées dans les premières années. Aujourd'hui, à l’aune des difficultés, rester serein est moins aisé, mais le regard porté sur le passé ne doit pas en être altéré. Hier, la situation était désespérée et nous avons réussi, sous contrainte, à construire une solution de sortie de crise qui présentait des garanties.
L’État a décidé de revenir dans le jeu parce que sa présence facilitait la constitution d’une offre globale et équilibrée. Il n’a pas démissionné de ses responsabilités, et il est resté pour consolider le plan de l’entreprise.
En ce qui concerne mes contacts avec les différents partenaires syndicaux, Bernard Thibault ainsi que les autres représentants syndicaux ont été reçus à Matignon et, si ma mémoire est bonne, je me suis entretenu personnellement de la SNCM avec Bernard Thibault, au plus fort de la crise, dans un état d’esprit très positif qui a permis, malgré les tensions, d’établir un dialogue constructif.
Incidemment, j’ai connu Walter Butler à Sciences Po mais je n’ai pas eu de contact avec lui depuis.
M. le président Arnaud Leroy. Vous savez que cette affaire est pendante à Bruxelles. Je suis confiant sur son issue et sur la réduction de l’amende qui a été infligée. Nous avons été troublés de voir la décision de la Commission européenne remise en cause si longtemps après, de voir la Cour de justice « tacler » aussi durement la compagnie et la déstabiliser au point que son sort soit désormais suspendu au verdict de la justice européenne. Vous qui avez eu pour interlocuteurs Jacques Barrot, puis Neelie Kroes, quel est votre avis sur la question ?
M. Dominique de Villepin. La situation est particulière puisque l’autorisation de la Commission a été annulée, ce qui a conduit l’État à porter l’affaire devant la Cour de justice européenne. Je suis confiant sachant que la procédure a été respectée et que l’État a pris des engagements conformes aux règles et à ses responsabilités sociales. La critique de Bruxelles ne me paraît pas fondée dans la durée. Nous avons de très solides arguments à faire valoir pour éviter d’être condamnés. Nous avions toutes les raisons d’agir comme nous l’avons fait.
M. Paul Giacobbi, rapporteur. J’en profite pour rappeler qu’il y a deux contentieux distincts : d’une part, et de façon assez surprenante, la Commission européenne, agissant sur le recours d’un tiers en tant que juridiction de la concurrence, a jugé que le service complémentaire était une atteinte à la concurrence et sa décision est soumise à la justice de l’Union européenne qui devra se prononcer – elle a rejeté le sursis, mais sans préjuger du fond – ; d’autre part, les conditions de la privatisation acceptées par la Commission ont été déclarées illégales par le tribunal de première instance de l’Union européenne dont la décision fait l’objet d’un appel interjeté, entre autres, par le Gouvernement français. Le verdict tombera dans quelques jours. Si la décision n’est pas réformée, la Commission aura à se prononcer sur le quantum du remboursement infligé à la SNCM. Force est de constater que, dans cette affaire, autant de juridictions saisies, autant d’avis différents. La Commission européenne elle-même se contredit puisqu’elle avait accepté le service complémentaire au départ, avant de le rejeter. Le tribunal administratif de Bastia, la cour administrative d’appel, et le Conseil d’État se sont successivement désavoués … Le tribunal de l’Union européenne a encore un autre avis et je ne préjuge pas du résultat des appels dans ce cadre de juridiction. Toutes les positions peuvent se défendre et nous sommes dans un état d’insécurité juridique absolue.
M. Dominique de Villepin. Pour aller dans ce sens, de tels dysfonctionnements au niveau européen ne sont pas rares. On a vu plusieurs fois des procédures et des décisions qui avaient été approuvées être remises en cause par la suite, parfois dix à quinze ans plus tard ! Je pense à la réforme des retraites de France Télécom décidée en 1996 et invalidée l’an dernier. D’une manière générale, le problème devrait être traité sur un plan politique car une telle insécurité juridique peut être lourde de conséquences.
M. le président Arnaud Leroy. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. M. le rapporteur vous a livré son opinion personnelle au terme de notre cycle d’auditions.
1 () En réalité, Corsica Ferries reçoit l’essentiel de cette subvention (environ 14 millions d’euros par an sur un total de 16 millions) qui n’a, en pratique, aucune contrepartie en terme de sujétions si ce n’est d’accorder de réductions tarifaires à certaines catégories d’usagers (ce que tous les transporteurs du monde font sans subvention particulière) et le respect des obligations de service public réduites à une traversée par semaine et donc inférieures à ce que les compagnies ont adopté comme fréquence minimale. De surcroît, aucun contrôle réel n’est prodigué et un doute subsiste quant à la concordance du nombre de passagers déclarés au titre de la taxe sur les transports et celui qui est notifié au titre de la subvention dite d’aide sociale.
2 () Du 31 mars 2004 au 31 mai 2005
3 () et ancien directeur du transport maritime, des ports et du littoral au ministère chargé de l’équipement et des transports
4 () Rapport au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et à la commission de la participation et des transferts sur les conditions et le déroulement de l’opération d’ouverture du capital de la société nationale Corse Méditerranée
5 () id
6 () Décision 2004/166/CEE du 9 juillet 2003
7 () De mai 2004 à mai 2008.
8 () Rapport d’évaluation pour la Commission des participations et des transferts ; ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, direction générale du Trésor et de la politique économique, Agence des participations de l’État.
9 () M. Claude Gressier, audition du 10 juillet 2013.
10 () id
11 () De mai 2003 à mai 2007
12 () De 2003 à 2006
13 () Du 31 mars 2004 au 31 mai 2005
14 () De 2004 à 2006
15 () Avis n°2006-A-3 du 23 mai 2006
16 () La durée de la DSP vient de passer à 10 ans.
17 () La CMN a développé le concept de « navire mixte » qui consiste à utiliser la fréquence des dessertes fret journalières de ses navires pour proposer une offre incomparable en termes de fréquence par rapport à celle des ferries en basse saison : elle le fait alors en sous-traitance de la SNCM qui a un monopole passager. Actuellement, elle n’est plus un sous-traitant de la SNCM pour les passagers.
18 () 17 juin 2005
19 () De 2003 à 2007
20 () Premier ministre du 31 mai 2005 au 15 mai 2007.
21 () Plan social conventionnel, pertes intercalaires, mutuelle des retraités SNCM
22 () Flotte exploitée en crédit-bail, plan social extra-conventionnel, pénalités de rupture des contrats,
23 () Hypothèse d’un comblement de passif par l’État qualifié d’actionnaire dirigeant.
24 () Versement d’indemnités complémentaires de licenciement par l’État en tant que puissance publique garante de la paix sociale ; coût des prestations Assedic du personnel licencié
25 () Y compris le personnel détaché dans d’autres sociétés.
26 () Lignes FY du feuillet 2052-N de la déclaration fiscale.
© Assemblée nationale