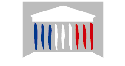
N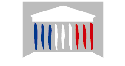
° 2436
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 décembre 2014
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
sur l’impact sociétal, social, économique et financier
de la réduction progressive du temps de travail
Président
M. Thierry BENOIT,
Rapporteure
Mme Barbara ROMAGNAN,
Députés
——
SOMMAIRE
___
Pages
AVANT-PROPOS DE M. THIERRY BENOIT, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 9
INTRODUCTION ET SYNTHÈSE 11
PREMIÈRE PARTIE – LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EST UNE TENDANCE DE LONG TERME DES ÉCONOMIES QUI SE DÉVELOPPENT 17
I. UNE TENDANCE HISTORIQUE DE LONG TERME OBSERVÉE DANS TOUS LES PAYS INDUSTRIALISÉS 17
A. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A JUSQU’À PRÉSENT ÉTÉ CONCÉDÉE ET NON PAS SPONTANÉE 17
1. Les Gouvernements libéraux du XIXe siècle ont concédé des réductions légales du temps de travail aux enfants puis aux femmes 17
2. Les salariés adultes ont du se coaliser pour obtenir de travailler moins de 10 heures par jour et de 60 heures par semaine 18
3. Les syndicats ouvriers sont parvenus à donner une audience mondiale à leurs revendications pour la réduction du temps de travail 21
B. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EST UNE TENDANCE MONDIALE DIVERSEMENT INSCRITE DANS LE DROIT 23
1. Le droit international limite les durées maximales de travail à des niveaux qui sont restés relativement élevés 23
2. Les normes internationales de temps de travail sont davantage respectées dans les pays industrialisés que dans les pays émergents 26
3. En deçà des maxima internationaux, trois obligations complémentaires sont utilisées pour baisser légalement le temps de travail des salariés 28
a. Le repos compensateur 29
b. Les congés payés 31
c. La tarification différenciée des heures de travail 32
4. Les législations nationales du travail s’affaiblissent tandis que l’individualisation des normes restaure l’autonomie du contrat 33
5. Des limites méthodologiques qui rendent plus difficiles les comparaisons internationales 36
a. Plusieurs définitions de la durée du travail rendent les comparaisons internationales peu pertinentes 36
b. Il faut surtout tenir compte de la part du temps partiel, très variable d’un pays à l’autre 39
II. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL S’EST EXERCÉE EN FRANCE PAR DES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES IRRÉGULIÈRES ET SANS DIMINUTION DES SALAIRES 41
A. APRÈS 1919 ET À L’EXCEPTION DE 1968, LE TEMPS DE TRAVAIL LÉGAL DES SALARIÉS A ÉTÉ RÉDUIT PAR DES MAJORITÉS DE GAUCHE 41
B. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PRESCRITE PAR LES LOIS AUBRY A ÉTÉ ASSORTIE D’AMÉNAGEMENTS ET DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES 45
1. Après la récession de 1993, des élus de tous bord tentent de favoriser l’emploi par la baisse du temps de travail 45
2. Une baisse générale est préparée par le Gouvernement de M. Lionel Jospin 47
3. Le passage à la norme des 1 600 heures annuelles se fait par deux lois successives 48
4. Les entreprises qui augmentaient l’emploi peu qualifié en réduisant le temps de travail payaient moins de cotisations 53
5. La réduction du temps de travail s’est appliquée inégalement mais les jours de repos supplémentaires dits de RTT sont « entrés dans les mœurs » 55
6. La mise en œuvre des 35 heures dans la fonction publique a fait l’objet d’accords spécifiques 60
C. LA POLITIQUE D’EMPLOI PAR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A ÉTÉ INTERROMPUE, ENTRE 2002 ET 2012, AU PROFIT D’UNE INCITATION AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES 64
D. CES POLITIQUES SE SONT INSCRITES DANS UN MOUVEMENT PLUS GÉNÉRAL DE TRANSFORMATIONS DU CADRE DE TRAVAIL ET DE VIE 65
E. DES DIFFICULTÉS D’ORDRE MÉTHODOLOGIQUE COMPLEXIFIENT L’ÉVALUATION DES EFFETS DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 68
1. La mesure de la durée du travail est une science imprécise 68
2. Certaines données disponibles sont incomplètes ou imprécises 69
DEUXIÈME PARTIE – DANS L’ÉVALUATION DES LOIS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DES FAITS SAILLANTS SE DÉGAGENT 71
A. LA PÉRIODE 1997-2002 EST CARACTÉRISÉE PAR DES CRÉATIONS MASSIVES D’EMPLOIS 71
1. Le nombre de chômeurs a beaucoup diminué entre 1999 et 2001 71
2. La pertinence d’une politique de RTT face au temps partiel 72
3. La croissance était élevée pendant la période de mise en œuvre de la législation sur le temps de travail. 73
4. Les créations d’emplois entre 1997 et 2001 ont atteint un niveau exceptionnel dans l’histoire économique française 74
5. La baisse du chômage est d’autant plus notable que la population active a augmenté sur la période 77
B. LES LOIS AUBRY ONT CONTRIBUÉ DE FAÇON IMPORTANTE AUX CRÉATIONS D’EMPLOI 79
1. Les premières prévisions des effets sur l’emploi des lois Aubry faisaient espérer la création de 700 000 postes 79
2. Une étude macro-économique extrapole la création de 320 000 emplois entre 1998 et 2001 80
3. Des études micro-économiques commandées par la DARES confirment la création de 350 000 emplois 82
4. Controverses sur les effets de la réduction du temps de travail : création d’emploi ou augmentation du coût du travail et pertes de compétitivité ? 85
5. Après les lois Aubry, les baisses de cotisations patronales sont devenues l’instrument principal de la politique de l’emploi 88
C. LES LOIS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SONT-ELLES RESPONSABLES DE LA PERTE DE COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE ? 89
1. Le diagnostic partagé par les organisations patronales et syndicales sur la compétitivité indique qu’il n’y a pas eu de dérive des coûts salariaux unitaires 90
2. La compétitivité coût s’est améliorée de 1997 à 2002 et ce n’est qu’à partir de 2004 que l’évolution s’inverse, notamment vis-à-vis de l’Allemagne 94
3. Les comptes des entreprises n’ont pas été dégradés par les 35 heures 96
4. Les 35 heures ont amélioré la productivité horaire industrielle 97
5. Mais les gains de productivité n’ont pu compenser la forte appréciation de l’euro à partir de 2002 98
6. Les industries européennes se sont adaptées à cette appréciation par des stratégies divergentes 100
7. L’industrie française a réduit l’offre intérieure et s’est redéployée à l’international 100
8. Les responsables d’entreprises entendus par la commission ne souhaitent pas remettre en cause les 35 heures 101
D. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A EU UN COÛT MODÉRÉ POUR LES FINANCES PUBLIQUES, COMPENSÉ PAR DES RECETTES SUPPLÉMENTAIRES ET DE MOINDRES DÉPENSES DE TRANSFERT 105
1. Les conséquences financières des lois Aubry ont été évaluées en 2004 105
2. Le coût budgétaire brut des allègements de cotisations des lois Aubry 106
a. Un scenario de coût «conventionnel », reposant sur deux périodes distinctes 108
b. Un scenario de coût « total », qui reprend simplement la chronique de coût des allègements généraux sur la période 2003-2014. 108
3. Quand on tient compte des effets induits, le coût net « ex-post » des Lois Aubry pour les finances publiques s’élève à 2,5 milliards 110
4. Un bilan macroéconomique détaillé des lois Aubry, réalisé avec les modèles de l’OFCE, conduit à des résultats voisins de ceux évoqués par le directeur du Budget 111
E. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC S’EST FAITE À EFFECTIFS CONSTANTS SAUF À L’HÔPITAL 113
1. Le temps de travail et les effectifs dans les fonctions publiques ont été peu modifiés en pratique 113
2. La réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale est mal connue 116
3. Le passage aux 35 heures dans la fonction publique hospitalière a été difficile et parfois mal vécu 117
4. L’impact budgétaire des 35 heures devait être réduit dans la fonction publique d’État 119
5. Les entreprises publiques pratiquaient déjà les 35 heures et se sont adaptées aux lois Aubry à un coût relativement limité 120
F. L’EFFET DYNAMIQUE DE LA MISE EN PLACE DES 35 HEURES SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 121
1. Les lois Auroux : le « point de bascule » dans les liens entre temps de travail et négociation collective 121
2. Les lois Aubry I et II : un « coup de fouet » en faveur du dialogue social 122
3. Les réticences actuelles à modifier les équilibres négociés 125
TROISIEME PARTIE - LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) EST ÉGALEMENT UN FACTEUR DE PROGRÈS SOCIAL 127
I. LA RTT A PERMIS UNE AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE EN DEHORS DU TRAVAIL 127
A. LA RTT A FAIT NAÎTRE UN SENTIMENT GÉNÉRAL D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE, SANS REMETTRE EN CAUSE LA VALEUR ACCORDÉE AU TRAVAIL 128
1. Les Français portent une appréciation globalement positive de l’incidence de la RTT sur la qualité de vie hors travail 128
2. La RTT est perçue comme un acquis social 131
3. La RTT n’a pas remis en cause l’attachement des salariés au travail 133
B. LA RTT N’A PAS TRANSFORMÉ LA STRUCTURE DE L’OCCUPATION DU TEMPS LIBRE, ELLE A SURTOUT CONTRIBUÉ À L’ÉPANOUIR 134
1. Un surcroît de temps libre partiellement mis à profit pour les loisirs 134
2. La structure de l’utilisation du temps libre a peu évolué avec la RTT 136
a. Les aspirations sociétales exprimées avant la RTT n’ont pas été entièrement réalisées 136
b. Une société de « temps choisi » s’est développée 138
C. LA FAMILLE A ÉTÉ LA PRINCIPALE BÉNÉFICIAIRE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, ENTRAINANT MÊME UN DÉBUT DE RÉALLOCATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE SOINS ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 140
1. La RTT a facilité la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 141
2. La RTT a opéré un rééquilibrage des tâches parentales 143
3. L’accomplissement des tâches domestiques reste l’apanage des femmes 145
a. La persistance d’une inégale répartition des tâches domestiques 145
b. La faute au temps partiel ? 147
D. MAIS LA SATISFACTION À L’ÉGARD DES AMÉLIORATIONS SOCIÉTALES ENCOURAGÉES PAR LA RTT DÉPEND ÉTROITEMENT DE SES CONDITIONS DE MISE EN œUVRE 148
1. Une appréciation différenciée en fonction des conditions de négociation et de mise en œuvre des 35 heures 149
2. Les jeunes générations se montrent plus sensibles à l’incidence des 35 heures sur leurs conditions de vie 149
3. L’appréciation de la réduction du temps de travail varie en fonction du sexe, de la catégorie socioprofessionnelle et de la présence d’enfants 151
a. Entre hommes et femmes 151
b. En fonction de la catégorie socioprofessionnelle 153
c. En fonction de la structure familiale 154
II. L’OBJECTIF D’AMÉLIORATION GÉNÉRALE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU REGARD DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 156
A. LA DERNIÈRE ENQUÊTE « CONDITIONS DE TRAVAIL », RÉALISÉE EN 2013, MET EN ÉVIDENCE UNE DÉGRADATION CONTINUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEPUIS LES ANNÉES 1980, AVEC UNE PARENTHÈSE ENTRE 1998 ET 2005. 157
1. Les 35 heures ont pu contribuer à l’intensification des conditions de travail observée 157
a. Une exigence accrue de polyvalence 160
b. La « chasse aux heures improductives » 161
c. De multiples facteurs responsables de la dégradation des conditions de travail 162
2. Certains secteurs d’activité ou catégories d’entreprises ont plus fortement subi l’intensification des conditions de travail 163
a. Le difficile passage aux 35 heures dans les TPE et PME 163
b. Les crispations liées à l’intensification des conditions de travail à l’hôpital 164
3. L’importance du contexte dans lequel s’est opérée la RTT 165
a. Une dégradation liée à l’état du marché de l’emploi local et au pouvoir de négociation des salariés 165
b. Le paradoxe des cadres au forfait jours 166
B. IL CONVIENT MAINTENANT DE REPENSER LES MODALITÉS DE NÉGOCIATION ET D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL 168
1. Refonder la politique du temps de travail 168
2. Encourager et approfondir les négociations relatives aux conditions de travail 169
a. L’accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail 170
b. Choisir un niveau de négociation adapté 171
3. Satisfaire des demandes variées 173
a. L’exemple de la journée de douze heures à l’hôpital 174
b. Le forfait jours 175
c. L’organisation du temps de travail à l’heure des nouvelles technologies 176
CONCLUSION 179
I. LES 35 HEURES : UN BILAN RELATIVEMENT CONSENSUEL 179
1. Une politique économiquement efficace 179
2. Un acquis social incontestable 179
II. UNE RÉFLEXION NÉCESSAIRE POUR ATTÉNUER CERTAINS EFFETS NÉFASTES 180
III. LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PEUT ÊTRE POURSUIVIE EN TIRANT LES LEÇONS DU PASSÉ 181
1. Des résultats économiques et sociaux reproductibles ? 181
a. Un soutien politique à la croissance économique 181
b. Réduire le temps de travail pour protéger l’emploi existant 182
c. Demain, vers les 32 heures ? 183
d. Clarifier les rôles respectifs de la loi et de la négociation dans la définition des normes sociales 184
2. Viser l’amélioration des conditions de travail 185
3. Trouver le bon équilibre entre temps de travail et qualité de vie 185
TRAVAUX EN COMMISSION 189
CONTRIBUTIONS 219
COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS ET AUDITIONS ET LISTE DES PERSONNES ENTENDUES LORS DES DÉPLACEMENTS 241
ANNEXES 247
ANNEXE 1 : RÉSOLUTION CRÉANT LA COMMISSION D’ENQUÊTE 247
ANNEXE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 249
AVANT-PROPOS DE M. THIERRY BENOIT,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Proposée par le groupe UDI en mai 2014, la Commission d’enquête sur l’impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail s’est fixé deux objectifs prioritaires :
– établir un diagnostic des réformes successives ayant impacté la durée du temps de travail ;
– formuler des propositions constructives afin de concilier exigences de performance économique, compétitivité, cohésion sociale et épanouissement personnel.
Accueillant des députés et des intervenants de sensibilités diverses, la Commission a aussi souhaité privilégier une réflexion globale sur la question du temps de travail à une approche trop restrictive qui se limiterait à la seule analyse de la durée légale hebdomadaire.
De nombreux experts, représentants de la société civile ou chefs d’entreprises, représentants syndicaux, mais aussi des responsables politiques et membres du Gouvernement, ont été auditionnés afin de partager leur expertise et leurs analyses.
Cette méthode de travail, pluridisciplinaire et transpartisane, était l’une des exigences du groupe UDI et je me félicite, en tant que président de la Commission d’enquête, de la qualité des débats et des discussions qui ont été organisés au sein de l’Assemblée Nationale.
Pour que cette Commission d’enquête soit utile, il était ainsi essentiel que sa réflexion s’inscrive au-delà des débats partisans et des oppositions de principe.
Les témoignages recueillis et le travail effectué par la Commission permettront une lecture nouvelle des enjeux liés à l’organisation du temps de travail.
Je tiens, en conclusion, à saluer le travail sérieux accompli par notre rapporteure Mme Barbara Romagnan, même si je ne partage pas les conclusions de son rapport. Chacun pourra se forger sa propre opinion.
Sur la proposition du président du groupe UDI (Union des démocrates et indépendants), et sur l’initiative plus particulièrement de M. Thierry Benoit, en application du 2ème alinéa de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale (1), l’Assemblée nationale a décidé à l’unanimité, lors de sa séance du 11 juin 2014, de créer une commission d’enquête relative à l’impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail, notamment de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.
Cette commission d’enquête, composée de vingt-huit membres, était chargée d’élaborer un bilan global. Elle a procédé à ses travaux dans un état d’esprit respectant celui qui a présidé à sa création, c’est-à-dire la recherche de la détermination du bilan, aussi précis et complet que possible, de cette réforme importante, qui a marqué la fin du siècle dernier et le début de l’actuel, au plan social, en France.
Dans cette perspective, la commission d’enquête a procédé à 37 auditions (soit près de 80 personnes), ouvertes à la presse, dont les comptes rendus ont été publiés au fur et à mesure et sont accessibles sur le site internet de l’Assemblée nationale (2). La rapporteure, usant des pouvoirs prévus par la loi (3), a également interrogé par écrit diverses administrations et entreprises publiques et privées, de façon à compléter utilement la somme de travaux, rapports, documents, études portant sur ce sujet. Elle s’est également rendue sur un site hospitalier de région parisienne, ainsi que, accompagnée d’une délégation de membres de la commission, en Allemagne où ont pu être rencontrées les parties prenantes.
La question de la réduction du temps de travail se caractérise par sa position aux confluents des domaines économiques, social, sociétal. À ce titre, la réduction du temps de travail constitue à la fois un outil économique, un projet de société, et une approche renouvelée du travail et du temps libre.
*
* *
La réduction du temps de travail (RTT) pose implicitement la question de son partage. Or le travail est déjà partagé, de fait, et inégalement, notamment entre ceux qui ne travaillent pas du tout, – les chômeurs –, et ceux qui travaillent, parfois trop (la durée hebdomadaire de travail à temps plein est bien supérieure à 39 heures selon l'INSEE – Institut national de la statistique et des études économiques – en France). Entre les deux, on trouve ceux qui travaillent à temps partiel - ou plutôt « celles », puisque les femmes françaises constituent 82 % des travailleurs à temps partiel – et ne peuvent en vivre dignement. Un des enseignements de cette enquête est d’ailleurs qu’il est essentiel, notamment dans des comparaisons internationales, de bien préciser de quelle population et de quelle durée il est question : la place de la France varie ainsi du tout au tout selon que l’on considère les seuls travailleurs à temps complet ou également les travailleurs à temps partiel.
La réduction du temps de travail implique par ailleurs de s'interroger sur les évolutions du travail à venir. La durée du temps de travail baisse partout en Europe, à des rythmes divers. À cela s'ajoute la démographie. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à vouloir travailler et à concevoir leur emploi à part entière et non comme un supplément à l'activité professionnelle de leur conjoint. La volonté des femmes de travailler tout en continuant à avoir des enfants met au premier plan la question de l’articulation, pour les hommes et les femmes, de la vie professionnelle et familiale : le temps de travail constitue une variable majeure, non seulement de l’organisation du travail, mais également de la vie familiale. Les modalités de partage du travail constituent de ce fait un véritable choix de société.
Les progrès techniques, technologiques, scientifiques, organisationnels, permettent de libérer nombre d'hommes et de femmes de tâches pénibles et répétitives. Ils permettent également une augmentation de la productivité. Même si certains travaux s’inquiètent de leur ralentissement, ces gains de productivité permettent de produire au moins autant ou davantage avec moins d’heures de travail. Ainsi, engager une réflexion sereine sur les lois Aubry est l’occasion de comprendre dans quelle mesure la RTT peut être un élément de réponse au problème récurrent du chômage.
*
* *
Dans la période de hausse rapide et constante du chômage que notre pays connaît depuis 2008, la question de l’emploi est légitimement au cœur des préoccupations des Français et des débats de politique économique et sociale. Chacun est à la recherche de mesures qui soient à la fois efficaces pour l’emploi et dans le même temps respectueuses des finances publiques, aujourd’hui marquées par l’importante charge de la dette (56,14 milliards d'euros, soit 14,19 % du budget de l'État selon la loi de finances pour 2013).
C’est dans ce contexte que la pertinence et les effets de la réduction du temps de travail sont convoqués. Ils font l’objet d’un débat ancien, qui remonte notamment à l’adoption des lois dites Aubry I de 1998 et Aubry II de 2000. On peut regretter que cette discussion soit plus souvent sous-tendue par des présupposés idéologiques qu’étayée par des éléments précis et chiffrés.
L’initiative du groupe UDI visant à créer une commission d’enquête parlementaire portant sur cette évaluation se donnait comme but de dépasser les postures pour parvenir à une évaluation la plus objective possible des effets directs et indirects de cette politique, et il est remarquable qu’elle ait été soutenue et adoptée à l’unanimité des groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale.
Cette objectivation des impacts de la réduction du temps de travail a été rendue possible par les données chiffrées disponibles qui concernent :
– l’évolution de l’emploi en France, au regard de l'évolution du taux de chômage sur la période au sens du BIT (passé de 10,3 % en 1997 à 7,5 % en 2002) ;
– les dépenses et les recettes publiques induites par les mesures de réduction du temps de travail ;
– la perception par les salariés de l’évolution de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail.
Ont également pu être sollicités les outils permettant de mesurer la réalité du temps de travail effectif dans notre pays, l’évolution des salaires mensuels et horaires, les gains de productivité du travail, ou encore l’intensité du dialogue social dans les branches professionnelles et dans les entreprises.
La prise en compte de ces données ne va pas sans difficultés, car il est toujours délicat d’isoler un facteur pour comprendre le rôle spécifique qu’il joue dans un phénomène complexe. Il est également périlleux de dresser des comparaisons internationales car les mesures ne se font pas toujours de la même façon selon les pays.
Pour autant, il est possible de parvenir à un certain nombre de résultats bien établis, qui permettent de mesurer les effets de la réduction du temps de travail sur plusieurs aspects de la société et de l’économie françaises. Avant même les résultats, nous avons été frappés de constater que presque aucune des personnes auditionnées ne demandait une remise en cause des 35 heures.
● La réduction du temps de travail décidée par la loi de 1998 a contribué à ce que l’économie française crée davantage d’emplois qu’elle ne l’aurait fait sans cette loi sur la même période. Le chiffre de 350 000 est le plus communément admis. Entre 1997 et 2001, l'INSEE estime à 2 millions les créations d'emplois salariés dans le secteur marchand. Il n’est aujourd’hui pas possible de dire combien d’emplois supplémentaires auraient pu être créés si le processus de réduction du temps de travail n’avait pas été interrompu en 2002.
● Cette réduction n’a pas coïncidé avec une dégradation de la compétitivité de notre pays – notamment parce qu’elle s’est accompagnée d’une accélération des gains de productivité. La France reste ainsi attractive et se place régulièrement dans le trio de tête des IDE (investissements directs à l’étranger).
● La réduction du temps de travail, comparée à d’autres politiques publiques mises en œuvre pour stimuler l’emploi, notamment celles qui reposent sur des baisses de cotisations sociales sans conditions, apparaît moins coûteuse pour les finances publiques, au regard du nombre d’emplois qu’elle a permis de créer.
● Elle a permis une réorganisation du travail dans les entreprises de plus de vingt salariés grâce à la relance et au dynamisme du dialogue social pour aboutir à des accords.
● La réduction du temps de travail s’est traduite, pour la majorité des salariés qui en ont bénéficié par une amélioration de l’articulation entre le temps passé au travail et le temps consacré aux activités personnelles, familiales ou associatives. Elle a également permis un rééquilibrage, limité mais réel, des tâches ménagères au sein des familles. Les études disponibles laissent penser que ce processus, s’il avait été mené à son terme, pouvait constituer un puissant élément de recomposition des temps au service de l’égalité hommes-femmes.
À l’aune de ces auditions et des documents à notre disposition, il apparaît que la réduction du temps de travail a constitué un outil pertinent et efficace de lutte contre le chômage, un outil de transformation de la société et d’amélioration de la qualité de vie.
Quinze ans après, il convient de tirer lucidement les leçons des expériences passées de réduction du temps de travail, de leurs conditions, de leurs effets positifs mais aussi de certains effets négatifs qui peuvent expliquer les critiques. L’objectivation de ces derniers est l’un des acquis majeurs de ce rapport, et a pu également faire l’objet d’un large consensus au sein de la commission.
On peut évoquer à ce titre :
– l’intensification du travail, repérée dans plusieurs secteurs, et qui s’est parfois accompagnée de souffrance pour les salariés ;
– les fortes tensions dans la fonction publique hospitalière en raison d’un décalage entre l’application de la loi et le temps des recrutements importants, étalés de 2002 à 2000. Elles ont été incontestables mais les difficultés ne résultaient pas uniquement de la RTT;
– les difficultés qu’aurait pu engendrer l’application de la loi aux entreprises de moins de 20 salariés.
Ces effets, s’ils doivent être pris en compte et corrigés, n’invalident en rien le principe de cette politique. Pour se poursuivre, elle devra s’ajuster à un contexte qui n’est plus celui des lois Aubry. Il nous appartient aujourd’hui, au travers de la négociation sociale, d’accélérer l’amélioration de la qualité de vie au travail, dans le secteur privé et dans le secteur public, de permettre aux jeunes de construire leur parcours professionnel et de ramener de nombreux chômeurs vers l’emploi. Laisser perdurer un chômage de masse serait faire courir à notre pays le risque d’une explosion sociale prochaine.
*
* *
À l’issue de ces travaux, le présent rapport propose, après une analyse historique internationale et française du temps de travail (partie I), de dégager les résultats significatifs de la politique de réduction du temps de travail sur l’emploi, l’économie et les relations sociales au travail en France (partie II), puis d’évaluer les effets de cette politique sur la société française de façon plus générale (partie III).
Des propositions d’orientations générales concluent ce travail qui, plus qu’à celui d’une commission d’enquête s’intéressant à des faits circonscrits, s’apparente à une tentative d’évaluation de politique publique, mais réalisée dans un temps très limité.
PREMIÈRE PARTIE – LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EST UNE TENDANCE DE LONG TERME DES ÉCONOMIES QUI SE DÉVELOPPENT
I. UNE TENDANCE HISTORIQUE DE LONG TERME OBSERVÉE DANS TOUS LES PAYS INDUSTRIALISÉS
A. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A JUSQU’À PRÉSENT ÉTÉ CONCÉDÉE ET NON PAS SPONTANÉE
1. Les Gouvernements libéraux du XIXe siècle ont concédé des réductions légales du temps de travail aux enfants puis aux femmes
L’industrialisation des économies occidentales puis mondiales, à partir du milieu du XVIIIe siècle, a changé les modes de vie des populations. Elle a augmenté leur temps de travail et dégradé les conditions de vie qu’elles espéraient au contraire améliorer en fuyant les campagnes pour les villes industrielles. La littérature européenne du XIXe siècle a abondamment décrit le sort difficile des familles ouvrières dans ces villes.
En l’absence d’études savantes, ces descriptions littéraires permettent de comparer la proportion des actifs occupés dans les ménages ouvriers et leur temps passé à travailler en usine aux travaux agricoles ou à la production artisanale des ménages ruraux. Cette comparaison vaut encore aujourd’hui dans les pays dont l’économie, restée traditionnelle, a échappé à l’industrialisation et la mécanisation de la production.
Au XIXe siècle, les populations rurales ne connaissaient de journées de travail de 12 heures pour toute la famille qu’au moment des récoltes d’été alors que les semaines sans jour de repos étaient devenues le lot quotidien des familles ouvrières des villes industrielles. La description et le spectacle de leurs conditions de vie leur ont valu la commisération des philanthropes et des associations caritatives ou religieuses qui les côtoyaient en ville.
Constatant que l’industrialisation rendait le travail plus astreignant et plus dangereux, les défenseurs des ouvriers ont réclamé leur émancipation dans les termes de leur lutte simultanée contre le servage et l’esclavage. Celle-ci devait passer en premier lieu non pas par l’augmentation des salaires mais par la réduction du temps de travail, sans perte de revenus, des ouvriers les plus jeunes ou les plus exposés à l’exploitation et à la misère en période de chômage.
Ne pouvant obtenir des employeurs l’amélioration de la condition ouvrière en raison de la concurrence que ceux-ci se livraient et en dépit de la sollicitude d’une partie d’entre eux, cette réduction du temps de travail en usine est devenue une revendication politique, portée devant le Parlement de Grande-Bretagne dès la fin du XVIIIe siècle.
Les partisans de la réduction du temps de travail dans les usines ne la demandaient pas pour tous les ouvriers mais seulement pour les enfants, en refusant que ces derniers soient laissés sans instruction comme l’étaient les enfants des campagnes et qu’ils rejoignent, sans espoir d’échapper à ce sort, leurs parents dans les mines ou les ateliers, pour y être réduits à un travail à la chaîne, pensé et divisé par d’autres, indifférent à leurs talents.
Les premières lois sur les usines industrielles qui, en 1801, ont interdit au Royaume-Uni le travail des enfants de moins de 8 ans puis, en 1819, celui des moins de 9 ans, ont limité la durée du travail des plus âgés, alors que la mécanisation de la production généralisait le travail en continu qui était auparavant limité à l’exploitation des mines. Au cours du siècle, une quinzaine de lois ont peu à peu abaissé le temps de travail admissible par jour et par semaine des moins de 18 ans, prohibant également le travail de nuit et la descente dans les mines des moins de 10 ans. Le bénéfice de ces protections légales, d’abord réservé aux plus jeunes, a ainsi été accordé aux enfants de 13 à 18 ans, ainsi qu’aux femmes qui ont obtenu une réduction de leur temps de travail quotidien dans l’industrie textile par la loi dite des 10 heures en 1847. Leur temps de travail maximal dans une semaine a ainsi été limité à 58 heures, la loi leur permettant de chômer chaque dimanche.
Des lois analogues ont ensuite été instaurées en France, avec un décalage dans le temps qui suit celui de l’industrialisation du pays. Une loi de 1833 limite à 48 heures par semaine et 11 heures par jour le travail en usine des plus âgés. À la suite du « Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie » présenté en 1840 par Louis René Villermé devant l’Académie des sciences morales et politiques, une loi de 1841 interdit le travail des enfants de moins de 8 ans dans les usines et limite leur travail la nuit et le dimanche.
Mais beaucoup de ceux qui s’émeuvent, à cette époque, du travail des enfants et de leurs mères dans les ateliers industriels ne se préoccupent guère des conditions de travail des pères. Ce n’est que parce que hommes, femmes et enfants étaient liés par les mêmes chaînes d’atelier que les premiers ont fini par obtenir également, en Angleterre, le bénéfice de la loi des 10 heures par jour et la fermeture des fabriques de textiles la nuit au milieu du XIX siècle.
2. Les salariés adultes ont du se coaliser pour obtenir de travailler moins de 10 heures par jour et de 60 heures par semaine
Les Gouvernements qui ont adouci les conditions de travail des enfants et des femmes ont interdit aux travailleurs de se coaliser pour défendre leurs droits face aux exigences de leurs employeurs. Les syndicats, qualifiés légalement de coalitions de travailleurs, sont interdits dès le début de l’industrialisation, en France par les lois d’Allarde puis Le Chapelier de 1791, et en Angleterre par deux lois, en 1799 et 1800. Le principe d’un repos hebdomadaire avait même été remplacé, en France, par celui d’un jour sur dix selon le calendrier du 5 octobre 1793. Conjugué à la suppression des fêtes religieuses, ce principe réduisait de moitié le nombre officiel de jours chômés.
Les Gouvernements occidentaux des XVIIIe et XIXe siècles qui conduisaient ces politiques industrielles, inspirés par l’individualisme des Lumières, soutenaient que les contrats de travail individuels avaient été avantageusement substitués à des statuts juridiques collectifs et inégalitaires. Ils considéraient aussi que ces contrats n’étaient pas imposés aux faibles par les forts mais librement négociés et conclus entre parties égales.
Ils n’accordaient aux femmes et aux enfants la protection de la loi contre les contrats de travail abusifs, à l’invitation des philanthropes, qu’au motif qu’il s’agissait juridiquement de mineurs (4) à l’époque, inaptes à consentir un engagement contractuel sans risque de dol (5) et à remplir leurs obligations à l’abri des violences. Mais ces principes juridiques qui interdisait aux employeurs d’abuser de l’état de minorité pour assujettir les enfants à des conditions de travail pénibles justifiaient à l’inverse que des criminels soient condamnés aux travaux forcés pour s’amender et que des ouvriers majeurs qui rompaient leur contrat de travail soient sanctionnés pénalement.
Ces principes ne sont bien évidemment plus ceux du droit contemporain mais leur force juridique les imposait au XIXe siècle dans les débats publics sur l’amélioration de la condition ouvrière. Cette force juridique était assurée du concours de la puissance publique qui soutenait les intérêts des employeurs et leur attribuait la pleine propriété des fabriques dont ils ne détenaient pourtant que les immobilisations, alors que les talents et la disponibilité de la main-d’œuvre employée à tirer des profits de ces immobilisations n’était pas pris en compte.
Ce concours public, au bénéfice de l’offre et au détriment de la demande d’emploi et à la valorisation des immobilisations au détriment de celle du capital humain employé, a conduit à une subordination de fait de cette main-d’œuvre à l’employeur, longtemps contestée en droit puisqu’elle était contractuelle et non statutaire et moins astreignante que celles des régimes juridiques du servage et de l’esclavage.
Pour que cette subordination soit reconnue par les autorités publiques et que ces dernières acceptent de tempérer l’inégalité produite par le concours qu’elles apportaient exclusivement aux employeurs lors des conflits avec leurs salariés, ces derniers et les demandeurs d’emploi ont dû attendre la généralisation, dans les pays industrialisés, sous la pression populaire, du suffrage universel masculin qui a donné à leurs revendications une audience politique, portée par des luttes sociales, qui dépassait la seule commisération des milieux philanthropiques et caritatifs.
Pour rétablir un équilibre contractuel dans l’emploi, les travailleurs réclamaient de pouvoir se coaliser afin de négocier collectivement plutôt qu’individuellement leur embauche et leurs conditions de travail. Ils demandaient aussi leur part indivise de la propriété du capital social des entreprises industrielles et, en cas de refus, leur confiscation.
Leur droit de coalition n’a été accepté par les autorités politiques européennes qu’à partir des années 1860, en raison des effets institutionnels du suffrage universel et de l’effervescence révolutionnaire persistante. Légalisés, les unions de travailleurs se sont constituées en syndicats en se donnant des représentants qui n’ont cependant été admis à exprimer publiquement des revendications collectives que dans des conditions restrictives.
Les droits de grève et de manifestation, sur la voie publique ou sur les lieux de travail, leur ont en revanche été longtemps refusés par des Gouvernements qui craignaient qu’ils ne remettent en cause le régime de propriété appliqué aux entreprises industrielles.
Ces syndicats ouvriers, bientôt unifiés en confédérations interprofessionnelles, ont entrepris des échanges et des entraides au plan international qui ont porté leurs revendications de pays en pays, en ne dissociant pas l’amélioration matérielle des conditions de travail des salariés de leur définition juridique, par des conventions collectives qu’ils voulaient imposer aux contrats de travail individuels.
Les premières conventions collectives ont été réservées aux secteurs industriels les plus syndiqués. La première signée en France l’a été le 29 novembre 1891 à Arras, entre syndicats de mineurs et compagnies houillères du Pas-de-Calais, suite à un mouvement de grève. Elle ne portait toutefois que sur les rémunérations.
L’année suivante, la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements industriels interdisait en France l’emploi des moins de 13 ans. Elle limitait à 10 heures par jour celui des moins de 16 ans des deux sexes et à moins de 11 heures par jour et de 60 heures par semaine celui des moins de 18 ans.
Elle plafonnait aussi à 11 heures par jour le travail des filles et des femmes, selon l’expression du texte, mais sans limite hebdomadaire, ce qui permettait de les faire travailler six à sept jours par semaine, ne prévoyant en revanche aucune restriction pour l’emploi des hommes du même âge. Elle créait enfin un corps administratif d’inspecteurs du travail pour veiller à son application.
Les circonstances politiques dans lesquelles ces réductions du temps de travail des salariés de l’industrie ont été accordées indiquent qu’elles ne découlent pas spontanément d’une répartition des gains de productivité plus favorable aux salariés qu’à leurs employeurs ou d’une limitation spontanée de la production, passé un seuil de productivité. Ces réductions n’ont été accordées que sous la pression de l’opinion publique, au profit des enfants et des femmes et après des luttes syndicales pour les hommes.
3. Les syndicats ouvriers sont parvenus à donner une audience mondiale à leurs revendications pour la réduction du temps de travail
C’est en réunissant suffisamment d’adhérents pour influencer le résultat des élections politiques que les syndicats ouvriers ont obtenu que leurs revendications sur le temps de travail des salariés adultes, rejetées tout au long du XIXe siècle par les employeurs qui se coalisaient à leur tour en comités industriels, soient défendues dans les débats électoraux ou parlementaires par les partis politiques d’inspiration socialiste qui les relayaient.
Ces revendications, d’abord locales puis nationales, sont devenues mondiales à mesure que l’industrialisation a reproduit les mêmes effets sociaux dans les pays qu’elle gagnait. La revendication d’une journée de travail limitée à 8 heures et celle de deux jours de repos hebdomadaire, limitant la semaine ouvrée à 40 heures ont été exprimées dès 1810 par l’industriel et philanthrope gallois Robert Owens.
Elles ont été adoptées par le mouvement syndical américain au début des années 1880 et sont devenues le mot d’ordre de la journée internationale des travailleurs du 1er mai après la répression brutale de la grève de Chicago de 1886 qui leur a donné un retentissement mondial.
Ces revendications en faveur d’une réduction du temps de travail ont été étendues des travailleurs de l’industrie à l’ensemble des salariés, en proposant à la société produite par l’industrialisation et le progrès technique un nouveau mode de vie. Elles n’ont été satisfaites que par des lois, qui les ont imposées aux employeurs dans la plupart des principaux pays industrialisés à la suite de la première guerre mondiale.
Pour décider les majorités parlementaires à adopter ces lois, il a fallu que les désastres de cette guerre rallient majoritairement les populations mobilisées sur le front ou dans les usines d’armement aux demandes des syndicats ouvriers et aux grèves générales qui ont éclaté en Europe continentale, renversant les régimes politiques autoritaires qui avaient résisté aux révolutions libérales.
L’alerte sociale fut si chaude pour les Gouvernements européens entre 1917 et 1919 qu’une commission de la législation internationale du travail, présidée par Samuel Gompers, président de la Confédération américaine du travail (American Federation of Labour - AFL) fut réunie entre janvier et avril 1919 en marge de la négociation du traité de paix à Versailles, pour créer l’Organisation internationale du Travail (OIT), souhaitée par les deux réformistes « industrialistes » Roberts Owens et Daniel Legrand.
Le statut de cette organisation constitue la XIIIe partie du Traité. Les Gouvernements signataires, qui ont accepté d’y siéger en tiers entre les représentants des employeurs et des travailleurs, ont admis, dans les attendus du préambule de sa constitution :
« … qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;
« … qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger,
« … qu'il est urgent d'améliorer ces conditions : par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maximum de la journée et de la semaine de travail,
« … que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ».
Ces quatre attendus doivent être considérés avec la plus grande attention parce qu’ils reconnaissent des faits que les Gouvernements et les classes sociales privilégiés niaient auparavant quand ils ne les justifiaient pas par la nécessité ou l’ordre naturel. Ils doivent l’être encore aujourd’hui parce qu’ils n’ont rien perdu de leur actualité.
La commercialisation de biens et de services de consommation courante, standardisés et industrialisés, sur un marché ouvert au libre-échange, entre des économies dissemblables, a produit, comme aux XVIIIe et XIXe siècles, des effets déstabilisateurs sur les sociétés mises en tension concurrentielle. Pour les justifier, les partisans du libre-échange reprennent le principe de « destruction créatrice » utilisé par Joseph Schumpeter pour décrire l’effet de l’innovation technique dans les économies industrielles.
Cette dynamique, qui bouleverse la Grande-Bretagne depuis le milieu du XVIIe siècle, a gagné l’Europe continentale et l’Amérique du Nord dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alimentée plutôt que ralentie par les crises et les guerres, elle n’a été suspendue qu’entre 1945 et 1975, par la décolonisation et la division du monde en plusieurs blocs commercialement isolés.
La remise en concurrence de l’ensemble des pays sur un marché devenu mondial mobilise à nouveau leur société, par des transferts de capital ou de main-d’œuvre qui enrichissent les uns, appauvrissent les autres et éprouvent dans les deux cas les institutions, rouvrant aux États perdants au change la tentation du repli ou du conflit.
Contre cette tentation, le préambule de la constitution de l’OIT faisait de l’amélioration des conditions de travail et en particulier de la réduction universelle du temps de travail, gage d’un partage plus équilibré de la productivité, un enjeu de la paix mondiale. C’est à cet enjeu et pas seulement à celui de la concurrence entre les pays, les populations, les classes sociales et les individus, que les lois françaises sur le temps de travail de la XIIe législature peuvent être rapportées.
B. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EST UNE TENDANCE MONDIALE DIVERSEMENT INSCRITE DANS LE DROIT
1. Le droit international limite les durées maximales de travail à des niveaux qui sont restés relativement élevés
La première convention adoptée par les membres de l’OIT, réunis à Washington en octobre 1919, a limité à 8 heures la durée de la journée de travail et à 48 heures celle de la semaine de travail dans les établissements industriels et les mines. Cette convention est entrée en vigueur en 1921. La convention n° 30, entrée en vigueur en 1933, étend les mêmes maxima aux commerces et aux bureaux.
Ces conventions instaurent un ordre juridique international qui s’impose aux lois nationales voire aux contrats de travail passés entre particuliers. Même dans les États qui séparent l’ordre juridique interne qui régit ces contrats de l’ordre juridique international, ces conventions confortent les revendications des salariés en ôtant à leurs employeurs l’argument de l’avantage concédé à leurs concurrents par des baisses du temps de travail qui ne seraient que locales ou nationales.
Ces conventions admettent cependant que les limites maximales posées au temps de travail ne soient pas absolues mais puissent être respectées en moyenne.
Elles ménagent par ailleurs des exceptions en présence de conventions collectives plus favorables aux salariés, quand les Gouvernements les rendent applicables aux tiers, concurrents des signataires du contrat individuel.
Ces conventions internationales admettent aussi des exceptions sectorielles, qui autorisent à travailler jusqu’à 14 heures par jour et 56 ou 72 heures par semaine dans certains secteurs économiques ou qui permettent un travail continu par équipes. Juridiquement équilibrée, la convention n° 1 de 1919 a connu un large succès puisqu’elle a été ratifiée par 47 États. La convention n° 30 de 1921 ne l’a été que par 27 États.
Après la crise économique de 1929, l’exacerbation de la concurrence commerciale entre les pays industrialisés et les guerres qu’ils se sont livrées ont rapidement entravé les efforts de l’OIT pour obtenir une nouvelle baisse du temps de travail des salariés. En témoigne l’échec de la convention n° 47 du 22 juin 1935, inspirée par une idée de John Maynard Keynes, qui posait le principe d’une durée hebdomadaire du travail de 40 heures par semaine, dans le but de partager le travail pour réduire le chômage de masse qui sévissait à l’époque, sans diminuer le niveau de vie des travailleurs. Cette convention n’a été ratifiée que par 15 pays (6). Elle n’est entrée en vigueur qu’en 1957.
Les tendances observées sur le long terme indiquent que la durée annuelle du travail a connu une forte diminution depuis le siècle dernier. Le tableau ci-dessous indique que la durée annuelle du travail a presque été divisée par deux dans la plupart des grands pays industrialisés, passant par exemple de 2 900 heures environ en 1870 à 1 500 ou 1 600 heures en Europe à la fin des années quatre-vingt.
POPULATION TOTALE, EMPLOI ET DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL EN LONGUE PÉRIODE
Japon |
Allemagne |
France |
États-Unis |
Italie | |
Population totale (en millions) 1870 1989 Emploi (en millions) 1870 1989 Durée annuelle du travail (en heures) 1870 1987 |
34,4 123,1 18,7 61,3 2 945 2 020 |
24,9 70,0 10,3 27,6 2941 1 620 |
38,4 56,2 17,8 22,2 2 941 1 543 |
40,0 248,7 14,7 119,0 2 964 1 607 |
27,9 57,5 15,4 25,1 2 886 1 528 |
Source : Maddison (1991). Frontières de 1989 (Allemagne de l'Ouest notamment).
Après la seconde guerre mondiale, les institutions internationales placées sous l’égide des États-Unis, telles que la Banque Mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement), le Fonds Monétaire International (FMI), l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ont privilégié le libre-échange des biens, des capitaux et de la main-d’œuvre et la croissance de la production plutôt que le droit international du travail pour améliorer les conditions de vie des populations actives.
Sous leur impulsion, l’extension mondiale du régime juridique de la propriété privée du capital industriel a pris le pas sur l’harmonisation des régimes du travail. Cette propriété privée s’est même internationalisée tandis que les rapports sociaux sont demeurés nationaux.
Les salariés des pays industrialisés ont néanmoins profité du plein-emploi des années 1950 et 1960 pour obtenir des hausses de rémunération et des repos supplémentaires. Mais leur situation s’est dégradée lors des crises économiques des décennies suivantes, qui ont redonné l’avantage aux propriétaires du capital industriel et aux employeurs dans les négociations sociales.
ÉVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGÉS PAYÉS ENTRE 1956 ET 2004
DANS QUELQUES PAYS INDUSTRIALISÉS
Heures de travail effectives dans l’industrie textile |
Congés payés annuels | |||
1956 |
2000-2004 |
1956 |
2004 | |
Finlande |
44,8 |
37,1 |
3 semaines |
20 jours ouvrables (4 semaines) |
France |
43 |
35 |
3 semaines |
25 jours ouvrables (5 semaines) |
Allemagne (de l’Ouest) |
48,6 |
38,3 |
12 jours |
24 jours ouvrables (environ 5 semaines) |
Pays-Bas |
45,2-48 |
38,4 |
12 jours (a) |
20 jours ouvrables (4 semaines) |
Royaume-Uni |
48,3 |
41,2 |
6 jours ou 2 semaines (a) |
20 jours ouvrables (4 semaines) |
États-Unis d’Amérique |
39,6 |
40,8 (b) |
1 semaine (a) |
8,9-19,2 jours ouvrables (c) |
Sources : OIT, base de données sur les statistiques de travail et sur l’emploi et les conditions de travail, repris dans Lee Sangheon, Mc Cann Deirdre, Messenger Jon C., Working time around the world, trends in working hours, laws and policies in a global comparative perspective, Editions OIT et Routledge, Genève et Londres, 2007, p. 25.
Notes : a) par accords collectifs ; b) dans le secteur industriel ; c) selon l’ancienneté dans l’entreprise
Entre-temps, de nouveaux entrants sur le marché international des biens industriels ont dû, pour y gagner des parts, tirer profit de l’avantage de prix que leur procurait une main-d’œuvre à bas coût, plus sollicitée que dans les pays déjà développés. Ils ont été réticents à renoncer à cet avantage pour accorder à leur population des conditions de travail comparables à celles des pays qui avaient déjà accumulé suffisamment de capital pour soulager leur main-d’œuvre.
Comme au XIXe siècle, c’est en matière de lutte contre le travail des enfants que l’OIT, placée sous l’autorité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) est néanmoins parvenue, sous la pression des opinions publiques occidentales, à faire adopter par les uns et les autres quelques règles communes.
L’ONU reconnaît désormais que le travail des enfants est une question essentielle des droits de l’homme au travail, aux côtés de la liberté syndicale, du droit à la négociation collective, de l’abolition du travail forcé, ou encore de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Elle estime que 168 millions d’enfants travaillent en 2014 alors qu’ils devraient être scolarisés et qu’au moins 85 millions d’entre eux sont soumis à des formes de travail dangereuses pour leur santé. Ces nombres diminuent chaque année mais à un rythme lent et de manière inégale selon les pays.
Pour les autres catégories de salariés, mises à part les femmes travaillant de nuit, l’OIT a renoncé à obtenir une baisse des maximas universels de travail pour promouvoir des normes prenant la forme juridique de recommandations et non plus de conventions. Le préambule de la recommandation n° 116 du 26 juin 1962 ne fait plus de la semaine de 40 heures qu’une norme à atteindre.
Au cours de son audition, M. Gilles de Robien, ancien député, ancien ministre, délégué du Gouvernement français à l'Organisation internationale du travail (OIT) a expliqué que les lois Aubry avaient exacerbé les disputes sur le temps de travail entre les États membres de l’organisation :
« L’OIT évoque à peine la question de la réduction du temps de travail, en raison du matraquage que cette idée a déchaîné. Au cours des nombreuses réunions internationales consacrées aux moyens de répondre à la crise, l’accent a bien davantage été mis sur les investissements productifs pourvoyeurs d’emplois durables dans des conditions décentes que sur les solutions possibles en termes de temps de travail… »
2. Les normes internationales de temps de travail sont davantage respectées dans les pays industrialisés que dans les pays émergents
En dépit des limites juridiques des stratégies successives de l’OIT, les conventions internationales et les recommandations qu’elle a adoptées ont permis de réduire le temps de travail industriel dans le monde.
Une enquête sur le temps de travail dans le monde (7), menée par trois chercheurs de l’Organisation et publiée en 2007 puis reprise en 2011 par un rapport d’experts du Bureau International du Travail sur le temps de travail au XXIe siècle dresse une comparaison de cette baisse dans plusieurs pays de différents continents.
Les auteurs de l’enquête estiment que la réduction du temps de travail progresse dans les pays en voie d’industrialisation mais que des différences régionales subsistent. Le rapport, quant à lui, conclut que 4 pays sur 10 fixent désormais à 48 heures ou moins la durée hebdomadaire maximale de travail.
Dans près de 2 pays sur dix, aucune durée maximale du travail n’est fixée par la loi ni appliquée. Les pays de la région Asie-Pacifique étudiés ont des maximas de travail par semaine qui peuvent atteindre 60 voire 72 heures. En qualifiant d’excessive une durée du travail qui dépasse 48 heures par semaine, en raison des risques qu’elle fait peser sur la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que sur l’équilibre de leur vie familiale, l’enquête et le rapport évaluent à 600 millions le nombre de travailleurs soumis à ces excès.
Alors que les durées de travail excessives sont en diminution dans les pays développés, elles affectent encore plus de 20 % des salariés en Asie orientale, principalement des hommes. Il ne s’agit cependant que d’estimations puisque ni l’Inde ni la Chine ne fournissent de décomptes des heures travaillées par salarié.
Le rapport d’experts ajoute que « certains pays, tels que l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Thaïlande, affichent une nette tendance à la baisse de la durée excessive du travail, tandis que dans d’autres pays, tels que le Chili, le Maroc et la Turquie, les horaires prolongés paraissent relativement stables.
« En outre, la proportion des travailleurs concernés par la durée excessive du travail est notablement plus élevée dans les pays en développement (Éthiopie, Jordanie, Maroc, Thaïlande et Turquie) que dans la quasi-totalité des pays développés, à l’exception notable de la République de Corée et de Singapour. »
Le rapport relève que la durée excessive du travail, tout comme le travail à temps partiel, sont pratiquement inconnus dans les économies en transition d’Europe orientale comme la Bulgarie et la Fédération de Russie, alors que le travail à temps partiel progresse dans les pays d’Europe de l’Ouest.
S’agissant des pays industrialisés, le rapport se fonde sur une compilation universitaire de statistiques de longue période, établie par Angus Maddison et publiée par l’OCDE (8) pour affirmer que la durée du travail diminue depuis le XIXe siècle dans l’ensemble des pays industrialisés :
« Dans ces pays, la durée du travail, qui était en moyenne de 2 500 à 3 000 heures par travailleur et par an au début du XXe siècle, a diminué progressivement. À la fin du siècle, elle était inférieure à 2 000 heures en moyenne par an dans presque tous les pays développés et, dans un grand nombre d’entre eux… plus proche de 1 500 heures par an. » (9)
Le rapport relève toutefois que les salariés canadiens et américains travaillent 300 heures de plus que leurs homologues d’Europe de l’Ouest parce qu’ils ont deux fois moins de congés payés.
Les comparaisons présentées par le rapport détaillent les durées de travail par branche d’activité. Elles indiquent que ces durées sont plus élevées dans les pays en développement que dans les pays développés et que les écarts sont particulièrement significatifs, même dans les secteurs de main-d’œuvre, entre les employés de bureau et les personnels de service.
Les semaines de travail sont particulièrement longues dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, le transport et les télécommunications, surtout dans les pays en développement qui recourent moins au travail à temps partiel dans ces secteurs d’activité. Les semaines de travail sont plus réduites dans l’administration publique, l’éducation et les services sociaux.
Le rapport insiste enfin sur la situation des travailleurs indépendants qui travaillent en moyenne plus longtemps que les salariés dans tous les pays, même si, dans les pays en développement, une part significative d’entre eux ont un temps de travail réduit par manque de commandes, s’agissant des hommes ou en raison de leurs charges familiales, s’agissant des femmes.
Le rapport estime que dans ces économies, l’économie informelle repose aux trois cinquièmes sur ces travailleurs indépendants, rémunérés à la tâche, à la pièce ou forfaitairement à la journée, le salariat non déclaré aux administrations couvrant les deux derniers cinquième.
3. En deçà des maxima internationaux, trois obligations complémentaires sont utilisées pour baisser légalement le temps de travail des salariés
Pour se conformer aux normes posées en 1919 et 1930, les législations nationales auraient pu imposer aux salariés des horaires fixes, sans entrer dans le détail de l’organisation de leur activité. Des règles uniformes, semblables aux rythmes observés dans les économies agraires, sont encore respectées dans nombre d’administrations publiques – services de sécurité et secours d’urgence mis à part.
Au lieu de cela, les législations nationales ont le plus souvent laissé les partenaires sociaux négocier les horaires ou les cadences appliqués contractuellement dans les branches, les métiers, les entreprises ou les établissements.
Les négociations relatives au temps de travail : le cas de l’Allemagne
Selon les informations transmises par le ministère fédéral du travail et des affaires sociales allemand, dont une délégation de la commission d’enquête a pu rencontrer des représentants au cours d’un déplacement à Berlin, les conventions collectives et les accords d’entreprise occupent une place prépondérante dans la détermination de la durée du travail en Allemagne.
La hiérarchie des normes applicable au temps de travail en Allemagne est relativement classique : les principes généraux sont fixés par la réglementation internationale ou par la loi allemande. Au niveau inférieur, les conventions collectives – il en existe 70 000 – définissent les principes généraux par branche d’activité. Ensuite, les comités d’entreprise sont chargés de définir les conditions applicables au sein de l’entreprise. Le salarié dispose en dernier lieu d’un pouvoir de négociation propre à sa situation individuelle, la règle étant que les conditions négociées avec le salarié ne peuvent être moins bénéfiques que celles négociées au niveau supérieur.
Les principes généraux relatifs au temps de travail ont été fixés en Allemagne par une loi du 6 juin 1994. Selon cette loi :
− Tout salarié doit respecter un temps de travail de huit heures par jour. Des dérogations permettant d’aller jusqu’à dix heures de travail quotidiennes sont possibles, mais elles doivent être prévues par un écrit signé par chacune des parties. En outre, la durée moyenne de travail constatée sur une durée de six mois ne peut en aucun cas être supérieure à huit heures par jour.
− Les dimanches et jours fériés sont des jours non travaillés, sauf en cas de dérogation négociée avec le comité d’entreprise ou par accord de branche, lesquels prévoient les conditions de rémunération liées à ces dérogations.
− En outre, le temps de pause quotidien minimal est de onze heures.
Mais les règles de régulation du temps de travail relèvent essentiellement des conventions collectives négociées par les partenaires sociaux, en application de l’article 9 de la loi fondamentale allemande : 10 % des 70 000 conventions collectives évoquent ainsi la gestion du temps de travail. La loi de 1994 a en outre introduit davantage de flexibilité dans les horaires et accordé plus de souplesse pour les accords d’entreprise et les conventions collectives qui souhaitaient s’écarter des accords de branche. À cette occasion, par exemple, le travail du dimanche a été autorisé pour des raisons économiques, mais également pour ne pas pénaliser les entreprises allemandes en concurrence avec des entreprises étrangères (10).
Les comités d’entreprises jouent également un rôle clé dans la détermination de la durée du travail. À titre d’illustration, au cours d’un entretien au siège de l’entreprise Siemens à Berlin, où travaillent 11 500 salariés de Siemens répartis sur dix sites, la direction des ressources humaines de l’entreprise a indiqué à une délégation de la commission d’enquête que l’accord du comité d’entreprise de Siemens à Berlin prévoit une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, soit trois heures de plus que la durée de 35 heures prévue par la convention collective.
Les législations nationales ont par ailleurs soumis la négociation contractuelle de ces clauses à des obligations destinées à baisser le temps de travail des salariés sous les maximas absolus ou moyens préalablement établis.
Ces obligations se répartissent en trois catégories : les repos compensateurs, les congés payés et les tarifs différenciés d’heures travaillées.
En fixant un maximum de 48 heures de travail par semaine, les conventions internationales ont prévu un jour de repos hebdomadaire obligatoire. Il est cependant loisible aux législations nationales d’en accorder davantage et d’y ajouter des temps de pause quotidiens. La plupart accordent aussi des jours de fête chômés, hebdomadaires ou annuels, aux salariés.
La protection de leur santé encourage l’usage juridique qui leur accorde un temps de repos compensateur proportionnel aux heures accomplies dans une période d’activité. Les repos obligatoires réduisent le temps de travail salarié comme le font les maxima légaux et les temps de pause.
Ils le font d’une manière négociable, plus facilement acceptable par les employeurs et moins dommageable pour la production que des interruptions uniformes à heures fixes. Cet usage est adapté aux secteurs qui connaissent des variations de production qui réclament des horaires de travail variables pour éviter de recourir à une main-d’œuvre intermittente, moins qualifiée que les salariés réguliers, ou de devoir mettre ces derniers au chômage technique.
Cet usage juridique ne peut toutefois tenir compte de l’effort fourni par les salariés pendant la période de surcroît d’activité, pour calculer le repos convenable, qu’au prix de subtils calculs d’intensité qui ne se prêtent pas à des définitions communes à des secteurs d’activité ou à des modes de production disparates.
Pour qu’une égalité juridique de traitement soit maintenue entre les salariés, les législations qui recourent à ce type d’obligations doivent établir des rapports d’équivalence entre les activités, les métiers et les branches. Ces rapports d’équivalence nourrissent le droit du travail de règles particulières et se prêtent à des contentieux.
En révélant les disparités entre les emplois qui en rendent certains plus lourds ou plus ingrats que d’autres, ils accentuent davantage les rapports de force entre employeurs et salariés au lieu de les apaiser.
Dans ces rapports de force, qui déterminent les négociations conventionnelles et contractuelles, les obligations légales d’accorder un repos compensateur proportionnel ne sont en outre favorables à la santé du salarié que lorsqu’elles imposent, comme c’est le cas pour les salariés travaillant en équipe de nuit ou en horaires décalés, que le repos compensateur soit entièrement pris immédiatement après la période travaillée et non pas en partie reporté voire même thésaurisé sur des comptes.
Dans l’Union européenne, par exemple, les directives du 23 novembre 1993 et du 22 juin 2000 prévoient que la limite maximale de travail fixée à 48 heures par semaine soit calculée en moyenne sur au plus quatre mois consécutifs. Pour garantir aux salariés un repos quotidien, plutôt que de fixer un second maximum, la directive a préféré imposer aux États de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures et d'une période minimale de repos tous les sept jours.
Cette période de repos doit être répartie sur la semaine mais peut l’être de manière inégale. Elle impose un repos minimal de 11 heures consécutives par 24 heures et de 24 heures supplémentaires sans interruption tous les sept jours, un calcul de moyenne autorisant à répartir ce repos sur une période de référence de deux semaines. Au final, la limite maximale de 48 heures de travail par semaine, répartie sur quatre mois, autorise des semaines de travail de 78 heures.
Les obligations de temps de repos compensateur établies par la directive donnent encore matière à de nombreux contentieux interprétatifs dans toute l’Union, quand les salariés sont payés forfaitairement à la tâche ou à la mission, quand leur emploi consiste pour partie dans des gardes sur place ou des astreintes à distance, sans activité prévisible ou régulière, ou bien encore quand leurs heures de travail sont entrecoupées de pauses trop courtes pour être assimilées à des temps de repos.
Leur répartition doit enfin tenir compte des périodes diurnes ou nocturnes entre lesquelles les heures de travail et les heures de repos quotidiennes sont réparties. Les directives prévoient qu’un travail de nuit ne doit pas excéder huit heures en moyenne par période de 24 heures, en raison des risques particuliers qu’il fait peser sur la santé physique et mentale du salarié.
En compléments des fêtes chômées, l’usage corporatif de jour de congés proportionnels à la durée d’emploi et à l’ancienneté de l’employé, inclus dans les jours payés par l’employeur, a été repris en droit positif en 1936, à l’initiative du Gouvernement français du Front populaire, en réponse aux grèves générales qui ont accompagné son élection.
Plusieurs conventions de l’Organisation internationale du travail ont, depuis cette période, reconnu le droit des salariés à des congés payés annuels. La dernière en date (n° 132) adoptée en 1970 et entrée en vigueur trois ans plus tard, a été ratifiée par 36 États. Elle accorde trois semaines de congés par année de service aux salariés de tous les secteurs d’activité à l’exception des gens de mer. Elle leur interdit d’y renoncer par contrat en échange d’une indemnité.
Ce congé doit être pris dans les 18 mois après la fin de l’année dans laquelle il a été acquis, deux semaines de congés au moins devant être posées consécutivement. Il ne doit pas inclure les fêtes chômées légales ou coutumières. Cette norme de congés payés proposée par l’OIT a été largement adoptée dans la plupart des pays, qu’ils aient ou non ratifié la convention.
Dans de nombreux pays, les congés payés conventionnels peuvent être supérieurs aux congés légaux mais ils sont alors réservés aux salariés ayant acquis une ancienneté minimale dans l’entreprise. Ils sont accordés en fonction de cette ancienneté, ce qui crée d’importantes inégalités de situations au sein des collectifs de travail.
Selon le rapport d’expert de 2011, presque tous les pays ont inscrit dans leur législation le droit à une période minimale de congés payés annuels et la moitié d’entre eux en accordent 20 jours. Certains y incluent toutefois les fêtes chômées, dont le nombre de jours par an est très variable selon les pays, entre 7 et 20.
Le rapport relève qu’en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, un tiers des pays accordent moins de 10 jours de congés et plus de la moitié moins de 15 jours ouvrables tout en étant prodigues en fêtes chômées.
En Europe, la directive sur l’aménagement du temps de travail impose aux employeurs d’accorder à leurs salariés un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines. Plusieurs législations octroient une cinquième semaine. La France fait figure d’exception puisque ses salariés bénéficient en moyenne de 6,6 semaines de congés, contre 4 semaines légales en Allemagne.
Cette moyenne couvre les cinq semaines légales (dont la cinquième a été accordée en 1981) et les jours de congés conventionnels attribués en compensation d’un travail hebdomadaire supérieur à 35 heures et qualifié de jours de réduction du temps de travail (RTT). Il importe de relever que ceux-ci peuvent représenter jusqu’à quatre semaines supplémentaires pour les cadres au forfait.
c. La tarification différenciée des heures de travail
Le dernier moyen légal utilisé pour réduire le temps de travail moyen des salariés consiste à imposer aux employeurs de les payer à l’heure et non plus à la pièce et de fixer des barèmes progressifs de rémunération des heures qui excèdent des seuils ou bien des heures travaillées pendant des périodes habituellement dévolues au repos.
La législation impose souvent un tarif plus élevé pour les heures de travail accomplies la nuit, lors des jours habituels de repos hebdomadaire ou lors des fêtes chômées. Elle peut également prévoir des limites maximales sous forme de contingents d’heures nocturnes, dominicales ou supplémentaires.
Cette tarification dissuade les employeurs de dépasser les seuils fixés ou convenus autant qu’elle peut inciter les salariés à en bénéficier. Les heures supplémentaires sont cependant très largement utilisées dans les économies industrialisées et près de la moitié des salariés en font chaque année même si toutes ne leur sont pas payées ni compensées par un repos consécutif plus long.
Leur tarification entre en conflit avec les normes qui définissent le temps de travail habituel lorsque ces normes ne s’appliquent qu’en moyenne sur de longues périodes. Il n’est en effet alors plus nécessaire à l’employeur de répartir sa production prévisible dans le temps pour éviter de mobiliser davantage sa main-d’œuvre dans les périodes de pointe ou pour la laisser en chômage technique dans les périodes creuses. Il lui suffit de calculer la durée contractuelle du travail sur l’année pour respecter les normes quotidiennes et hebdomadaires de temps de travail sans plus devoir acquitter de suppléments de rémunération pour les heures nocturnes, dominicales ou supplémentaires ni concéder de congés de récupération.
C’est pourquoi le droit du temps de travail s’attache de plus en plus aux temps de repos compensateur et non plus aux maximas, aux normes de travail ou aux catégories d’heures, individualisant les temps de repos et modifiant les coutumes sociales des jours collectivement chômés, fixés auparavant par le comput officiel, les lois et traditions religieuses.
Incidence de la période de référence choisie pour vérifier le respect des moyennes normales de temps de travail et des obligations qui s’y attachent
À la différence de la fixation des maximas universels de temps de travail, la définition d’une norme peut tenir compte non seulement des catégories d’employés et des secteurs économiques mais aussi de la période de temps choisie pour l’appliquer.
Elle permet d’intégrer dans le calcul des moyennes, en plus des pauses et des repos quotidiens et hebdomadaires minimas, les congés payés et les fêtes chômées. La recommandation de 1962 laisse aux autorités de chaque pays la détermination de l'étendue maximale de la période sur laquelle les heures de travail pourront être calculées.
Le choix d’une période de référence longue et en particulier l’annualisation du calcul du temps de travail favorise les organisations qui peuvent soutenir des stratégies prévisibles sur le long terme au détriment des individus. Elle reporte sur les individus les plus faibles et les moins prévoyants le fardeau des aléas que les assurances sociales avaient socialisé.
Un calcul sur l’année, sur plusieurs années voire sur la durée d’une vie professionnelle, s’avère en outre particulièrement favorable aux employeurs puisqu’il autorise de grandes amplitudes de variations dans les temps de travail intermédiaires.
Ces amplitudes, dissimulées par la moyenne, permettent à l’employeur de différer les repos et les demandes de congés payés de ses salariés ou de suspendre voire de rompre le contrat de travail pendant des temps de repos de longue durée, nécessaires pour équilibrer les périodes de forte activité.
Ces reports de longue durée s’appliquent au détriment de la santé de nombre de salariés qui thésaurisent des jours de repos sur des comptes d’épargne-temps et acceptent implicitement, en contrepartie, une baisse de leur salaire horaire réel, fixé sur les normes de travail contractuelles et non sur les heures réellement faites ou sur des forfaits.
Enfin, les périodes de référence de longue durée, par exemple annuelle, suppriment ou diminuent fortement la portée des tarifications différenciées des heures de travail habituelles et supplémentaires.
4. Les législations nationales du travail s’affaiblissent tandis que l’individualisation des normes restaure l’autonomie du contrat
Les obligations légales imposées aux conventions collectives et aux contrats individuels pour réduire le temps de travail des salariés ont pu répondre à des intentions politiques diverses.
Les unes ont souhaité protéger la santé des travailleurs les plus jeunes des deux sexes, pour assurer la reconstitution de la force de travail nationale ou même parfois pour maintenir une conscription militaire, ce qui n’entrait pas dans les préoccupations des employeurs.
D’autres, dans des États moins autoritaires, ont recherché un maintien de l’ordre public à moindre coût, en évitant, par une réglementation, d’avoir à réprimer les contestations collectives des conditions de travail les plus pénibles, dans des secteurs économiques syndicalisés ou dans ceux qui étaient fréquemment exposés à des coalitions spontanées de travailleurs ou à des grèves.
Dans les États démocratiques, ces obligations imposées ont été adoptées par les législations nationales après des élections qui ont porté au pouvoir des majorités favorables à l’amélioration des conditions de vie des salariés, le plus souvent d’inspiration socialiste ou social-démocrate.
Ces obligations ont permis de réduire le temps de travail des salariés en-deçà des maxima internationaux. Si elles ont atteint leur objectif, ces obligations ont eu des effets qui n’étaient ni anticipés ni souhaités par leurs initiateurs, soit en traversant leur stratégie industrielle ou commerciale d’insertion dans le marché mondial, soit en suscitant des adaptations du corps social imprévues.
Ces obligations ont, au cours des dernières décennies, été assorties de variations croissantes dans la comptabilisation des heures, le calcul des moyennes et le choix des rythmes de travail, jusqu’à conduire à émanciper en pratique les contrats de travail individuels des règles collectives destinées à protéger les salariés des excès et des abus.
Avant 1919, le temps de travail légal reprend les lois anglaises
Le rapport n° 652 déposé le 22 janvier 1998 par M. Jean Le Garrec au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail de décembre 1997, qu’on peut encore lire sur le site Internet de l’Assemblée (11), retraçait les principales étapes de la législation française de la durée du travail depuis le milieu du XIXe siècle. Cette législation a suivi l’exemple donné par les lois britanniques sur les usines.
La loi du 18 novembre 1814 confirme l’obligation du repos dominical, tradition de l’Ancien Régime remise souvent en cause durant la période révolutionnaire et impériale. La loi du 22 mars 1841 interdit le travail avant 8 ans et en fixe la durée maximum à 8 heures par jour de 8 à 12 ans et 12 heures de 12 à 16 ans dans les usines de plus de 20 ouvriers. Elle accorde un repos dominical aux enfants et apprentis, déjà prévu par la loi de 1814 mais sans effet.
Un décret du 2 mars 1848 limite la journée de travail des ouvriers à 10 heures à Paris et 11 heures en province. Ce texte est abrogé le 9 septembre 1848, après la répression des émeutes de juin par un autre décret qui limite la journée de travail ouvrière à 12 heures pour la France entière, sauf exceptions, qui donneront lieu à des précisions réglementaires sous le second empire.
La loi du 19 mai 1874 retarde de 8 à 12 ans l’âge minimum d’emploi à temps plein et à 10 ans celui d’un salarié employé à mi-temps, 6 heures par jour. Elle interdit le travail de nuit des garçons jusqu’à 16 ans et des filles jusqu’à 20 ans. Elle leur accorde un repos les dimanches et fêtes. Elle s’applique à toutes les activités économiques, alors que les précédents textes concernaient exclusivement l’industrie.
La loi 2 novembre 1892 accorde un repos hebdomadaire aux femmes de plus de 20 ans sans faire cas du dimanche et limite leur journée de travail à 11 heures. Elle interdit le travail de nuit aux hommes de moins de 18 ans et aux femmes. Elle relève l’âge minimum d’emploi à 13 ans. Le travail des enfants est réduit à 10 heures par jour pour les 13–16 ans et 11 heures pour les 16–18 ans.
La loi du 30 mars 1900 harmonise la durée maximale du travail dans les ateliers qui réunissent hommes, femmes et enfants à 10 h 30 en 1902 puis 10 heures en 1904. La loi du 15 juillet 1906 accorde un repos hebdomadaire à tous les salariés en abrogeant la loi de juillet 1880.
La loi du 5 avril 1910, qui instaure des retraites obligatoires, par capitalisation, financées par des contributions de l’État, des employeurs et des travailleurs, fixe à 65 ans l’âge de liquidation de ces retraites. Cet âge est abaissé à 60 ans par une loi de 1912.
Au Royaume-Uni, les lois du XXe siècle sur les usines ne limitent le temps de travail que pour les femmes et les enfants. La directive européenne de 1993 précitée, plus favorable que le droit en vigueur, y est d’autant plus décriée que, pour s’y conformer, la loi sur les règles de temps de travail (Working time regulations) a accordé 4 semaines de congés annuels aux salariés à temps plein, soit 20 jours auxquels s’ajoutent 8 jours fériés et chômés.
Auparavant, selon le rapport de M. Le Garrec, « en 1994, parmi les salariés à temps plein, plus d’un quart des hommes et un peu moins de 10 % des femmes travaillaient, en Grande-Bretagne, habituellement plus de 48 heures par semaine... De même, environ 10 % des salariés ne bénéficiaient d’aucuns congés payés et 18 % bénéficiaient de moins de trois semaines de congés payés. »
5. Des limites méthodologiques qui rendent plus difficiles les comparaisons internationales
a. Plusieurs définitions de la durée du travail rendent les comparaisons internationales peu pertinentes
• La notion de « durée du travail » est complexe à définir, à mesurer et à interpréter.
La première définition possible du temps de travail est la durée « légale » du travail. En France, elle correspond depuis 2002 à 35 heures hebdomadaires, ou à 1 607 heures annuelles pour toutes les entreprises. Il s’agit d’une durée de référence pour le travail à temps complet, un seuil au-delà duquel les heures supplémentaires sont calculées. Certaines branches d’activité dérogent néanmoins à cette durée légale : par exemple, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur fixe la durée de travail à quarante heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.
La durée du travail généralement retenue pour mener à bien les enquêtes relatives au temps de travail en France est la durée « effective » du travail. Calculée sur la journée, la semaine, le mois ou l’année, elle est définie à l’article L. 3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Pour les statisticiens, la durée annuelle effective renvoie au temps réellement consacré par les personnes à leur activité professionnelle au cours d’une année. Depuis 2003, les enquêtes de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) utilisant la durée annuelle effective intègrent tous les éléments de variation individuelle du temps de travail sur l’année (heures supplémentaires ponctuelles rémunérées ou non, congés, absences, chômage partiel, grève…). En France, cette durée est mesurée directement auprès des ménages par l’enquête « Emploi » de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
En complément de cette durée effective du travail peut être définie une durée « collective » de travail, qui mesure l’horaire de travail commun à un groupe de salariés, par exemple l’horaire tel qu’il est affiché sur le lieu de travail. Elle est généralement calculée sur une base hebdomadaire.
Enfin, la durée « habituelle » hebdomadaire de travail mesure la durée de travail d’un individu lors d’une semaine « normale », c’est-à-dire sans évènement particulier − jours fériés, jours de réduction du temps de travail, absence pour maladie ou formation…
Face à la coexistence de ces différentes définitions de la durée du travail, et si l’on considère que la mesure de la durée du travail est également susceptible de varier considérablement en fonction du champ considéré – temps complet, temps partiel, secteur public, secteur privé, etc. −, la notion de « durée du travail » se révèle particulièrement sujette à controverses.
La DARES a ainsi attiré l’attention sur les risques engendrés par l’existence de ces différentes définitions dans une publication de juillet 2013 : « selon le champ (salariés, non-salariés, ensemble des actifs occupés), le temps de travail (temps complet, temps partiel, toutes durées du travail) et le concept même de durée, en particulier lorsque la période de référence est hebdomadaire (durée légale, collective, effective ou habituelle), les mesures peuvent donner des résultats très différents et mener à des comparaisons plus ou moins pertinentes » (12).
• Les comparaisons internationales sont peu pertinentes
Plusieurs enquêtes internationales s’attachent à comparer les durées du travail entre les États. Cependant, en raison de l’impossibilité de s’accorder sur une définition de la durée du travail et des limites méthodologiques inhérentes à l’exercice de la mesure du temps de travail, l’établissement de comparaisons internationales sur la durée du travail s’avère très délicat.
Un exemple de la difficulté de comparer les durées du travail entre pays (13)
Selon l’enquête LFS, la durée annuelle effective des salariés à temps complet en Allemagne est l’une des plus élevées de l’Union européenne, à 1 898 heures en 2010 contre 1 672 heures en France. Or la DARES a montré que cet écart de près de 230 heures est nettement supérieur à l’écart constaté entre les durées habituelles hebdomadaires, qui s’élèvent respectivement à 39,4 heures en France contre 40,6 heures en Allemagne, d’où un écart de 62 heures sur la durée annuelle effective.
L’analyse de cet écart révèle des différences significatives entre les absences prises en compte durant la totalité de la semaine de référence. D’après les déclarations des salariés à temps complet dans les LFS en 2010, 14,8 % des salariés à temps complet en France se déclaraient absents durant la totalité de la semaine de référence, contre 9,8 % en Allemagne. Parmi eux, 70,9 % l’étaient pour raison de congés en France, contre 52,9 % en Allemagne, cet écart de taux représentant 5,4 semaines de congés en France, soit deux fois plus que pour l’Allemagne.
Mais l’ampleur de l’écart constaté sur les congés peine à trouver une explication naturelle, puisqu’il excède les différences de congés légaux ou conventionnels entre les deux pays. Parmi les pistes d’explication avancées par la DARES, le mode d’interrogation des ménages dans les enquêtes LFS menées dans chacun des deux pays pourrait être à l’origine de l’écart inexpliqué, ce qu’a confirmé l’audition du directeur général de l’INSEE, M. Jean-Luc Tavernier.
Parmi les enquêtes internationales les plus exhaustives, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publie dans les Perspectives de l’emploi des données sur la durée du travail pour l’ensemble des salariés (à temps plein et à temps partiel), en se fondant sur les données transmises par les comptes nationaux des trente-quatre États membres de l’Organisation. Or le recueil de ces données s’apparente davantage à une « base de données » qu’à un véritable travail statistique, car l’OCDE n’harmonise pas les méthodes de calcul de la durée du travail propres à chaque pays. Ces données ne permettent donc pas de comparer convenablement les durées de travail.
Les enquêtes européennes d’Eurostat sur les forces de travail (Labour Force Survey, LFS) sont quant à elles conduites trimestriellement dans l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne ainsi qu’en Islande, en Norvège et en Suisse. Leurs résultats diffèrent sensiblement des données conformes à la comptabilité nationale publiées par l’OCDE, ainsi que le montre le tableau ci-après.
COMPARAISONS DES DONNÉES ANNUELLES EFFECTIVES DES SALARIÉS
À PARTIR DES DONNÉES DE L’OCDE ET DES DONNÉES LFS POUR L’ANNÉE 2010
(en heures)
Durée annuelle effective de tous les salariés (temps complet et temps partiel) | ||
Données OCDE conformes à la comptabilité nationale |
Méthode directe à partir des données LFS (Eurostat) | |
Allemagne |
1 323 |
1 621 |
Danemark |
1 538 |
1 486 |
Espagne |
1 635 |
1 718 |
Finlande |
1 584 |
1 551 |
France |
1 395 |
1 543 |
Hongrie |
1 818 |
1 975 |
Pays-Bas |
1 335 |
1 366 |
République tchèque |
1 736 |
1 885 |
Source : DARES, à partir de données Eurostat, Labour Force Survey 2010 et OCDE, Perspectives de l’emploi 2010
Les modalités d’élaboration des enquêtes LFS sont fixées par le règlement CE/577/98 du 9 mars 1998 (14), qui détermine un mode d’interrogation commun et des questions s’appuyant sur des définitions internationales de la durée du travail. En dépit de ce système de codification commun, les enquêtes LFS, gérées à l’échelle nationale, présentent inexorablement des fragilités, dues au mode de collecte de données, à l’interprétation du concept d’heures travaillées ou encore au mode de formulation des questions (cf. encadré ci-après).
De surcroît, les durées moyennes hebdomadaires publiées par Eurostat éliminent les personnes ayant déclaré avoir travaillé zéro heure pendant la semaine pour laquelle elles ont été interrogées, ce qui revient à ignorer en grande partie les périodes d’absence pour congés ou maladie ; les données d’Eurostat s’apparentent ainsi davantage à des durées « habituelles » qu’à des durées effectives.
Enfin, la méthode de calcul de la durée du travail a connu des évolutions dans un certain nombre d’États, ce qui ne permet pas de disposer de comparaisons fiables dans le temps comme dans l’espace. En France, par exemple, l’enquête Emploi avait lieu jusqu’en 2002 une seule fois dans l’année – généralement au mois de mars. Or ce mois n’est pas représentatif des autres mois de l’année, notamment en termes de jours de congés, ce qui a justifié le passage au questionnement en continu en 2003. Ces ajustements méthodologiques contribuent donc à fausser également les résultats des comparaisons internationales.
Aussi, en dépit des différentes enquêtes disponibles, force est de constater qu’aucune d’entre elles ne permet de comparer correctement les durées effectives du travail en Europe à ce jour.
b. Il faut surtout tenir compte de la part du temps partiel, très variable d’un pays à l’autre
En application de la directive européenne n°97-81 du 15 décembre 1997 sur le temps partiel, le temps partiel est généralement défini comme une durée inférieure à la durée légale du travail. En France, le travail à temps partiel correspond à une durée inférieure à 35 heures, qui constituent la durée légale de référence. Cette situation concerne un peu plus de 18 % des salariés ayant un emploi en France, mais elle est inégalement répartie entre les hommes et les femmes, puisque 31 % de ces dernières travaillent à temps partiel, contre seulement 7 % des hommes. Le taux de temps partiel en France est inférieur de près de dix points à la moyenne de l’Union européenne (UE) à vingt-sept États, où il s’établit à 26,5 %.
A contrario, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel en France est parmi les plus élevées de l’UE. Depuis 1998, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel est en effet restée stable autour de 23 heures en France, soit les deux tiers de la durée légale des salariés à temps complet, contre 20,2 heures en moyenne dans l’UE. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a fixé la durée minimale du temps partiel, sauf dérogation, à 24 heures hebdomadaires.
Le temps partiel correspond à une toute autre réalité dans d’autres pays de l’Union européenne. À titre d’exemple, en Allemagne, 45 % des femmes travaillaient à temps partiel en 2010, et les deux tiers des mères actives d’enfants de moins de quinze ans ont un emploi à temps partiel. La durée du travail de ces emplois à temps partiel est sensiblement plus courte avec 18,6 heures en moyenne, soit cinq heures de moins qu’en France.
Par conséquent, la méthode consistant à exclure les salariés à temps partiel du calcul de la durée annuelle de travail pour ne conserver que les temps complets revient à faire baisser artificiellement cette durée, et à classer le temps de travail en France parmi les moyennes les plus basses de l’Union européenne, ainsi que le rappelle l’économiste M. Frédéric Lerais. Or, selon une enquête de l’INSEE de 2010, la durée moyenne hebdomadaire de travail en France, en incluant les temps partiels, s’élèverait ainsi à 37,5 heures, soit une moyenne supérieure à la moyenne européenne (37,2 heures), devant l’Allemagne (35,3 heures), l’Italie (36,9 heures), les Pays-Bas (30 heures) ou encore les Britanniques (36,5 heures) (15).
Il convient par conséquent d’avoir conscience que la non prise en compte du temps partiel lorsqu’il s’agit de comparer les données relatives au temps de travail en dehors de la sphère nationale pose un biais méthodologique important.
Commentant l’étude de l’INSEE intitulée « Soixante ans de réduction du temps de travail dans le monde », qui fait apparaître que si la diminution de la durée annuelle moyenne du travail en France et en Allemagne a tendance à fortement converger, cela repose outre-Rhin sur une contribution beaucoup plus forte du temps partiel à cette baisse de la durée du travail, Mme Dominique Méda a souligné qu’« que la durée du travail en Allemagne, qu’elle soit hebdomadaire ou annuelle, n’est pas plus élevée qu’en France si l’on veut bien prendre en considération les salariés à temps partiel, le plus souvent des salariées. Lorsque l’on prend en compte le travail à temps partiel, les dernières statistiques de l’OCDE montrent que les français travaillent en moyenne davantage que les Allemands, les Italiens, les Néerlandais ou les Britanniques. Il s’agit là d’un choix de société : quel type de partage du travail voulons-nous ? ». Compter le temps partiel à part reviendrait à exclure 18 % des salariés français, et en premier lieu les femmes.
En outre, il apparaît clairement que le calcul des heures travaillées par les Français(es) n’a d’intérêt que s’il prend en compte l’ensemble de ces heures, sans considération relative au type de contrat de travail, sans quoi les chiffres obtenus ne représentent pas le temps de travail moyen réel, a fortiori parce que la France se distingue des autres pays européens par des durées de temps partiels élevées.
II. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL S’EST EXERCÉE EN FRANCE PAR DES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES IRRÉGULIÈRES ET SANS DIMINUTION DES SALAIRES
A. APRÈS 1919 ET À L’EXCEPTION DE 1968, LE TEMPS DE TRAVAIL LÉGAL DES SALARIÉS A ÉTÉ RÉDUIT PAR DES MAJORITÉS DE GAUCHE
La loi du 23 avril 1919 se détache du modèle anglais d’un repos hebdomadaire du samedi midi au lundi matin, le fameux week-end – en contrepartie d’une semaine de 54 ou 55 heures – pour satisfaire, sur la proposition d’Albert Thomas, ministre socialiste de l’armement, déposée en janvier sur le bureau de l’Assemblée nationale, la revendication syndicale d’une semaine de 6 jours de 8 heures travaillées, sans distinction d’âge, de sexe ou d’employeur.
Cette revendication, déjà satisfaite en Allemagne après la révolution de novembre 1918, est reprise par les négociateurs du Traité de paix de Versailles. Les organisations patronales obtiennent cependant que ces 48 heures hebdomadaires puissent, sur dérogation réglementaire par branches, être calculées en moyennes sur des périodes de temps plus longues.
Mme Christiane Charbonnier, directrice de la direction « Droit du travail » de l’UIMM a décrit, lors de son audition du 2 octobre 2014, la suite des événements :
« La première réduction importante du temps de travail du XXe siècle est apparue en 1919, couplée avec la fixation, le dimanche, de la journée hebdomadaire de repos. La journée de travail a été limitée à huit heures sur six jours, ce qui faisait 48 heures de travail au plus sur la semaine. Cette première réduction ne sera pas tout de suite réellement effective puisque dès le vote de la loi, des décrets ont été adoptés pour autoriser des heures au-delà de ces huit heures par jour.
« Le volume de ces heures qualifiées d’heures supplémentaires pouvait aller jusqu’à 300 par an. Ce n’est qu’en avril 1935 que l’autorisation de faire des heures supplémentaires fut supprimée. Ce n’est donc qu’à cette date que la réduction du temps de travail à 48 heures deviendra effective.
En 1936, la victoire du Front Populaire aux élections législatives le 3 mai 1936 provoque un mouvement de grève général que le Gouvernement apaise par la signature des "Accords de Matignon". Ces accords limitent la semaine de travail à 40 heures, sans perte de salaire, accordent aux salariés deux semaines de congés payés et prévoient la possibilité d’étendre, par décret, des conventions collectives aux entreprises qui ne sont pas adhérentes des organisations signataires.
Le Gouvernement de M. Guy Mollet fait voter la loi du 27 mars 1956 qui accorde une troisième semaine de congés payés aux salariés.
Puis les syndicats obtiennent, lors des accords de Grenelle de mai 1968, une réduction progressive du temps de travail hebdomadaire maximal de 48 à 40 heures tandis que l’assemblée nationale adopte une proposition de loi instaurant une quatrième semaine de congés payés, promulguée l’année suivante.
Après l’élection de M. François Mitterrand à la Présidence de la République et la victoire de la gauche aux législatives de 1981, le Gouvernement de M. Pierre Mauroy instaure par une ordonnance du 13 janvier 1982 une cinquième semaine et la semaine de travail de 39 heures, première étape d’une réduction à 35 heures qui ne sera pas poursuivie, en raison de l’aggravation de la crise économique.
Mme Charbonnier explique que « …pour tenir compte des enseignements précédents, cette réduction ne devait être que progressive, c’est-à-dire ne rentrer en vigueur que par palier, entre 1982 et le 1er janvier 1986.
« Dans la métallurgie, nous avions négocié à cette époque un accord qui amorçait la réduction effective de la durée du travail de 40 à 35 heures. Il prévoyait une réduction de la durée collective des salariés à 38 heures 30, et même à 38 heures pour les salariés travaillant en équipe de nuit. Par ailleurs, une annexe à cet accord ramena à 33 heures 36 le temps de travail des salariés travaillant en continu dans les entreprises sidérurgiques – équipes se succédant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour des raisons techniques.
« La crise économique de 1983 contraindra les pouvoirs publics à renoncer au projet de ramener la durée légale du travail à 35 heures, Seule la cinquième semaine de congés payés et la semaine de 39 heures seront consacrées par la loi. De la même façon, dans la métallurgie, nous n’avons pas poursuivi les réductions progressives du temps de travail entamées en 1982. Nous nous sommes arrêtés à 38 heures 30, et à 38 heures, et à 33 heures 36 pour les salariés travaillant en continu. »
En 1936, en 1956, en 1982, ce sont des majorités parlementaires de gauche qui parviennent, avec le soutien des organisations syndicales de salariés, à imposer aux employeurs, à chaque fois hostiles, des réductions du temps de travail sous forme de limitation de la norme de durée hebdomadaire et surtout de semaines de congés payés nouvelles ou supplémentaires.
Comme l’a rappelé M. Hervé Garnier, secrétaire national de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), lors de son audition : « Les lois sur les 35 heures de la fin des années 1990 s’inscrivent dans la longue histoire de la réduction du temps de travail qui caractérise depuis le XIXe siècle l’ensemble des économies développées.
« Le temps de travail a, selon les périodes, été réduit soit par l’abaissement de la durée légale hebdomadaire, soit par l’octroi de semaines de congés, soit encore par la diminution des heures supplémentaires. »Les baisses du temps de travail hebdomadaire garantissent aux salariés français des repos compensateurs chaque semaine de travail.
Les congés payés leur rendent, en été, l’habitude des semaines de vacances, que l’on connaissait en hiver dans les campagnes mais qui se sont perdues avec la révolution industrielle et l’exode rural.
Toutefois, chaque réduction du temps de travail, obtenue sans réduction du salaire, a eu des contreparties moins favorables aux salariés, telles que l’intensification des heures travaillées, un contrôle plus sévère des horaires et des absences et des variations de grande amplitude dans la répartition du temps de travail, la loi acceptant que les maxima légaux soient calculés sur une moyenne annualisée dès le début des années 1980.
Selon M. Yves Barou, ancien directeur adjoint du cabinet de Mme Martine Aubry, alors ministre chargée du travail, ces améliorations des conditions de vie des salariés, imposés par des majorités parlementaires progressistes, ont à chaque fois été difficiles :
« En France, nous avons connu plusieurs épisodes de baisse du temps de travail, plus ou moins heureux. L’épisode de 1936 a été plutôt malheureux puisqu’il a conduit rapidement à remettre en cause l’appareil de production. En 1981-1982, les 39 heures – mesure sociale un peu à côté de la plaque – n’ont pas eu beaucoup d’effets. »
L’épisode des accords de Grenelle de 1968, portés par une révolution culturelle qui avait échappé au Gouvernement gaulliste, est le plus significatif de cette difficulté de la société française à accorder la transformation de son économie, imposée par les échanges internationaux, et celles de ses coutumes et de ses modes de vie établis par des rapports sociaux conflictuels, dans lesquels l’arbitrage de l’État en faveur de l’un ou l’autre camp est recherché et attendu.
Au cours du XXe siècle, à la suite de la révolution russe d’octobre 1917 et de son influence sur le syndicalisme européen, le rapport de force a été plutôt favorable aux salariés, parce que la discipline et les grands effectifs de la production en usine favorisaient la coalition syndicale des salariés et parce que l’État prenait davantage leur parti qu’au siècle précédent, à mesure que leurs voix s’imposaient par le suffrage électoral.
La législation favorable aux salariés en la matière, adoptée par les majorités sociales, a été rarement rapportée par les majorités adverses, et la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, créée en 1938 par le Gouvernement de M. Édouard Daladier en même temps qu’il relevait le temps de travail hebdomadaire à 50 heures pour, selon son expression, « remettre la France au travail », est également rarement revenue en arrière.
Les 40 heures ont cependant été rétablies au sortir de la guerre, par une loi de 1946.
Les grèves générales de 1936, interrompues par les accords de Matignon, ont été vécues par le patronat français comme les signes annonciateurs inquiétants d’une confiscation du capital social des entreprises. Ce souvenir a d’autant plus marqué les esprits et la manière française de réduire le temps de travail que les semaines de grève et les deux semaines par an de congés payés accordées l’été suivant ont affecté la production.
Comme dans les épisodes suivants, des dévaluations du Franc (de 58 % entre 1936 et 1939, de 29 % en 1958 et de 11 % en 1969), ont été nécessaires pour rétablir la balance commerciale du pays et compenser l’effet sur les prix des exportations des hausses du salaire horaire, habituant le pays à l’inflation du fait de la hausse des prix des produits importés. Le même scénario s’est reproduit tout au long du siècle, jusqu’aux trois dévaluations décidées entre 1981 et 1983.
Après cette dernière date, le maintien du Franc dans le système monétaire européen mis en place en mars 1979 ne permet plus de compter sur une politique monétaire expansionniste, fût-elle inflationniste, pour réduire le chômage de masse qui pèse désormais sur l’économie française même en période de croissance.
Le Gouvernement de M. Pierre Maurois a dû renoncer à poursuivre son programme électoral de réduction du temps de travail et de hausse des salaires horaires pour maintenir les parités monétaires convenues, attaquées par des fuites massives de capitaux et des spéculations à la baisse sur les marchés internationaux, entretenues par une inflation française supérieure à celle des économies voisines.
Reprendre cette politique, dans de nouvelles conditions économiques, en 1998, a été un acte politique fort, dont le Premier ministre socialiste de l’époque, M. Lionel Jospin, s’est déclaré fier lors de son audition par la commission :
« Je constate que, si les Gouvernements qui ont succédé au mien ont parfois contrarié ou contourné les 35 heures, sans d’ailleurs en obtenir d’effets probants pour la croissance, l’emploi ou la compétitivité de nos entreprises, aucun n’a abrogé les lois qui les instauraient. La réduction du temps de travail a été à mon époque l’un des instruments d’une grande et, je crois, efficace politique pour l’emploi : c’est pourquoi je reste fier d’avoir dirigé le gouvernement qui l’a conduite. »
B. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PRESCRITE PAR LES LOIS AUBRY A ÉTÉ ASSORTIE D’AMÉNAGEMENTS ET DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES
1. Après la récession de 1993, des élus de tous bord tentent de favoriser l’emploi par la baisse du temps de travail
Au cours de son audition, M. Pierre Larrouturou, coprésident du mouvement Nouvelle Donne, fervent partisan de la réduction du temps de travail dès les années 1990, a expliqué comment la baisse du temps de travail des salariés, abandonnée lors du tournant de la rigueur en 1983, est réapparue dix ans plus tard, avant d’être reprise par les candidats à l’élection présidentielle de 1995 :
« Je rappelle que c’est M. Édouard Balladur qui avait mis en place une commission sur ce sujet, présidée par M. Jean Boissonnat, en 1995 ; son rapport recommandait de diminuer le temps de travail de plus de 20 % d’ici à 2015 et de favoriser la formation durant le temps libre. Cette orientation faisait l’objet d’un consensus il y a 20 ans, et M. Michel Barnier expliquait qu’il était nécessaire d’organiser un référendum sur la semaine de quatre jours afin d’édicter une règle claire et stable à la suite d’un débat de société. »
« Le 13 juillet 1995, le Président de la République, M. Jacques Chirac, avait visité l’entreprise des brioches Pasquier, une des quatre entreprises françaises à l’époque à travailler quatre jours par semaine – grâce à un amendement de MM. Jean-Yves Chamard et Gérard Larcher adopté en 1993 –, et avait déclaré qu’il se demandait pourquoi cette organisation n’était pas mise en place ailleurs. »
Lors des débats parlementaires de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, souhaitée par M. Michel Giraud en pleine récession économique, l’idée de la semaine de quatre jours défendue par M. Pierre Larrouturou séduit des parlementaires et des membres du Gouvernement inquiets de la forte remontée du taux de chômage.
L’amendement soutenu à l’Assemblée par notre ancien collègue député M. Jean-Yves Chamard sur la semaine de 32 heures est rejeté à la demande du Gouvernement, mais réintroduit avec des modifications au Sénat, sous la signature de MM. Gérard Larcher et Jean-Pierre Fourcade, dans un esprit plus conforme au projet de loi initial, qui, en matière de temps de travail, permettait d’annualiser le calcul des temps partiels.
Le nouvel amendement devient les articles 38 et 39 de la loi, et autorise les accords d’entreprise. L’article 39 prévoit, à titre expérimental, qu’une baisse d’au moins 15 % de la durée annuelle de travail des salariés et une baisse des salaires qui pourra être moindre, en contrepartie de l’emploi de 10 % de salariés supplémentaires pendant trois ans donnent droit à un allègement des cotisations patronales de 40 % la première année et de 60 % les deux suivantes.
La baisse de salaire exigée a nui au succès de cette disposition mais le principe d’une réduction légale du temps de travail à 32 heures en contrepartie de l’annualisation du décompte, donc d’une baisse du nombre des heures supplémentaires, et d’une aide de l’État à l’embauche et au maintien des salaires s’est invité, en 1995, dans la campagne électorale présidentielle. Ce principe a été adopté peu après par la confédération syndicale CFDT lors de son 43e congrès et a donné lieu, le 31 octobre de la même année, à la signature d’un accord interprofessionnel par les organisations patronales, la CFDT, FO et la CGC.
L’accord signé ensuite par l’UIMM, FO et la CGC dans la métallurgie en 1996 déçoit les initiateurs de la réforme puisqu’il autorise 35 semaines consécutives de 44 à 46 heures de travail en échange d’une semaine de congés payés. La législation est modifiée par la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, dite loi « de Robien » du nom de l’auteur de la proposition de loi dont elle est issue.
Cette loi accorde un allègement des cotisations patronales de 40 % la première année et 30 % les six années suivantes, aux entreprises qui conviennent avec les services de l’État et avec les partenaires sociaux de réduire de 10 % la durée effective du travail et de créer en un an ou sauvegarder sur deux ans la même proportion d’emplois. Si la baisse du temps de travail et l’effet sur les emplois atteint 15 %, les allègements de cotisations dégressifs précités sont relevés respectivement à 50 % et 40 %.
Durant les années 90 l’accent est mis également sur le recours aux contrats à temps partiel dont la croissance est rapide. Les semaines de moins de 30 heures représentent moins de 12 % des salariés en 1984, plus de 15% au début des années 90 puis relative stagnation.
Lors de son audition, M. Gilles de Robien a déclaré : « Je suis incapable de me remettre en situation de manière assez précise pour vous dire si la genèse de la loi de 1996 avait un lien avec la volonté alors exprimée par M. Chirac de réduire la fracture sociale. À l’époque, M. Pierre Larrouturou était venu travailler à mes côtés à la mairie d’Amiens dont je voulais réorganiser certains services.
« Nous avons évoqué l’aménagement du temps de travail et nous avons cheminé un moment de conserve ; je ne me souviens pas si l’appel pertinent à la réduction de la fracture sociale lancé par M. Chirac a encouragé mon tropisme vers la réduction du temps de travail…
« Je ne dispose pas des statistiques précises recensant les créations d’emplois permises par les différents dispositifs mais je crois me souvenir qu’en un an, la loi incitative que nous avons fait voter a conduit à la conclusion de plus de 3 000 accords d’entreprise, dans les plus grandes comme dans les plus petites.
« Selon les statistiques de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), le volet « offensif » du texte avait permis la création de 40 000 à 45 000 emplois et son volet « défensif » d’en sauvegarder entre 50 000 et 55 000. L’application de la loi a donc été un succès. »
Forte de son succès, la CFDT a soutenu le principe de cette loi lors des débats électoraux qui ont suivi la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par le Président de la République Jacques Chirac, en avril 1997.
2. Une baisse générale est préparée par le Gouvernement de M. Lionel Jospin
Lors de son audition, M. Lionel Jospin a rappelé le contexte et les objectifs de la baisse générale du temps de travail débattue lors de la campagne électorale des législatives :
« Dans l’opposition, entre 1995 et 1997, nous avions beaucoup réfléchi et travaillé, en particulier à la question de la réduction du temps de travail. Le passage aux 35 heures était l’un des principaux points du programme que nous avons proposé aux Français pour les élections législatives de 1997 : une fois élus, nous devions tenir nos promesses.
« Le chômage était alors une obsession, puisqu’il y avait à l’époque 3,25 millions de chômeurs, soit 12,6 % de la population active. Il se disait que, contre ce fléau, tout avait été essayé : nous avons décidé de rompre avec ce fatalisme et de mettre l’emploi au cœur de notre action.
« Si l’évolution historique de la productivité faisait de la réduction du temps de travail un instrument précieux, ce n’est pas le seul que nous ayons utilisé. Nous n’étions pas non plus adeptes de la philosophie passive du partage d’une masse de travail constante. Nous considérions que la réduction du temps de travail devait s’inscrire dans une dynamique.
« Avec le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité, puis avec l’ensemble du Gouvernement, nous avons donc cherché un chemin de politique économique qui nous permettrait à la fois d’amorcer le redressement des comptes publics et de retrouver la croissance. Nous devions nous qualifier pour l’euro : pour cela, il nous fallait diminuer notre déficit budgétaire, alors supérieur à 4 % du PIB, et maîtriser notre dette publique, qui venait de franchir le seuil de 60 % du PIB.
« Nous voulions renouer avec la croissance économique, d’abord pour créer des emplois, mais aussi parce que nous pensions que cela nous aiderait à diminuer le déficit budgétaire comme celui de la sécurité sociale.
« Nous ne négligions pas les effets possibles pour la société de la réduction du temps de travail, mais, je le redis, elle ne constituait pour nous ni une fin en soi, ni un remède miracle. Elle s’inscrivait dans une politique d’ensemble, avec la mise en place des emplois-jeunes, la création de postes dans le secteur public et la recherche du retour de la croissance. La détermination du Gouvernement à faire massivement reculer le chômage était absolue.
« Nous voulions aussi faire revenir la confiance dans le pays : la confiance est presque un facteur de production. D’ailleurs, elle est effectivement revenue. C’est seulement quand la croissance a redémarré que nous avons lancé le processus et adopté la première loi sur les 35 heures, promulguée le 13 juin 1998…
« Devions-nous d’entrée de jeu procéder par la loi ? N’aurait-il pas fallu commencer par la négociation ? Si, sur la base des contacts pris par la ministre en charge du dossier, il était apparu que des négociations entre le patronat et les syndicats pouvaient s’ouvrir, dans la perspective de conclure un accord interprofessionnel, alors nous aurions pu en faire la première étape de notre démarche. La loi serait intervenue plus tard.
« Mais à aucun moment le MEDEF – qui venait de succéder au CNPF – n’a laissé entendre qu’il était prêt à envisager un tel accord. Dès lors, le Gouvernement devait soit renoncer à un engagement majeur pris devant les Français, soit commencer le processus par la loi – nous choisîmes cette seconde solution. »
3. Le passage à la norme des 1 600 heures annuelles se fait par deux lois successives
• L’orientation générale des deux lois dites Aubry
M. Yves Barou, ancien directeur adjoint du cabinet de Mme Martine Aubry, alors ministre chargée du travail, a rappelé devant la commission les choix qui ont conduit à promulguer non pas une mais deux lois, la première incitant les partenaires sociaux à négocier une norme dont l’application est annoncée mais dont les modalités ne seront fixées que par une seconde loi.
Ces modalités devaient dépendre du résultat des négociations, l’État, se plaçant en position de juge et non plus seulement de législateur, se réservant de faire pencher la balance en faveur du patronat ou des syndicats selon la conjoncture économique et les intentions que les uns et les autres manifesteraient au cours de la période intermédiaire de négociation.
« Suite à une négociation ratée avec les partenaires sociaux, une première loi – décrite comme violente, volontariste et autoritaire – a été adoptée. L’immense vague de négociations qui a suivi a conduit à l’adoption d’un deuxième texte.
« Ces deux lois ont inauguré un changement de méthode qui, je l’espère, va perdurer d’une alternance à l’autre : une conférence sociale est annoncée ; les pouvoirs publics définissent une feuille de route ; des négociations se déroulent ; une loi est présentée et adoptée. C’est un processus intelligent.
« Dans le cas des 35 heures, la feuille de route a été remplacée par une première loi, au motif qu’il fallait taper du poing sur la table pour dépasser les blocages constatés. (…)
« La première loi ne faisait rien d’autre que d’annoncer la date de l’abaissement de la durée du travail. Ensuite, il s’est passé un événement sans précédent dans ce pays : 100 000 syndicalistes ont participé à des négociations sur le temps de travail, ce qui a constitué une bouffée d’air pour le dialogue social, d’autant que les échanges furent subtils et intelligents…
« Le dialogue social, dynamisé lors de cette période, a permis de tester les idées de certains négociateurs : le forfait en jours, l’annualisation. La seconde loi, très facile à faire, a consisté à débloquer certaines contraintes contenues dans le code du travail. »
• Les mécanismes prévus par ces deux lois
La loi n’a plus pour objet, comme en 1919, de donner à la limite légale du temps de travail hebdomadaire le caractère d’un maximum absolu, afin de protéger la santé des salariés des abus d’exploitation de leur force de travail. Elle définit seulement une norme qui fixe des seuils de sur-tarification des heures de travail sous la limite générale des 48 heures par semaine, posée, avec des exceptions, par la directive européenne et la loi française (48heures pour une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaine.
La loi n° 98–461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail dite Aubry I a fixé la norme française du temps de travail au tarif le plus bas à 1 600 heures par an réparties à raison de 35 heures de travail par semaine. Elle en a différé l’application pour permettre aux entreprises d’en anticiper les conséquences et d’adapter l’organisation de leur production et surtout, leur effectif. La norme légale devait être appliquée au 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 dans les autres, sans baisse de salaires.
La loi a autorisé les partenaires sociaux des branches, des entreprises et même des établissements à fixer par accord négocié la répartition des 1 600 heures annuelles de travail. Si cet accord prévoyait en outre des embauches ou le maintien d’emplois dont un plan social envisageait la suppression, l’État accordait à l’entreprise une aide financière dès lors que la baisse du temps de travail collectif atteignait 10 % et que le nombre d’emplois concernés représentait 6 % de son effectif habituel, maintenus pendant au moins deux ans.
La loi n° 2000–37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail dite Aubry II a confirmé la norme de travail fixée en 1998 mais elle en change le mode de calcul. Comme le relève le rapport n° 1544 du 14 avril 2004 de M. Hervé Novelli au nom de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail (16) : « la mesure de la durée du travail a constitué une difficulté importante » pour l’appréciation de cette législation puisque les lois Robien et Aubry visaient le temps effectif défini par la jurisprudence européenne alors que la loi Aubry II considérait le temps de travail collectif défini par accord d’entreprise.
La loi Aubry I prévoyait que la norme hebdomadaire s’appliquât strictement aux entreprises qui ne seraient pas couvertes par un accord négocié, tandis que ces accords pouvaient choisir à leur convenance la période de référence sur laquelle les 1 600 heures annuelles seraient réparties. La loi Aubry II a rendu la norme hebdomadaire moins stricte en fixant comme référence par défaut le règlement du temps de travail affiché dans l’entreprise et non plus le temps effectif de présence des salariés. Nombre d’entreprises ont pu en conséquence réduire marginalement le temps de travail réel de leurs salariés en supprimant de son calcul des temps de pause ou de transition entre équipes.
Si certaines personnes auditionnées considèrent que la première loi Aubry était trop impérative et louent la prise en considération des résultats de la négociation par la deuxième loi Aubry, d’autres, comme Dominique Méda, inspectrice générale des affaires sociales et professeure de sociologie à l’université de Paris Dauphine, rappellent que la première loi a eu pour double-intérêt de conditionner strictement le versement de l’aide financière de l’État à des créations d’emplois et d’imposer un calcul de la réduction des heures travaillées à mode de décompte constant, de manière à ce que la diminution des heures soit effective.
• La prise en compte des temps de pause a constitué un premier enjeu délicat
L’article L. 3121-2 du code du travail dispose que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif » sous réserve que, conformément à la définition du travail effectif, le salarié demeure à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.
Or la mise en application de cette définition ne va pas de soi. Certains employeurs ont en effet tiré parti de la négociation relative à la réduction du temps de travail pour exclure du temps de travail effectif certains temps de travail jugés « non productifs », tels que les temps de pause ou les temps d’habillage. L’institut Coe-Rexecode estime ainsi que 18 % des entreprises passées aux 35 heures en 2000 ont exclu les temps de pause du mode de décompte de la durée du travail.
Le redécoupage des temps de pause lors du passage aux 35 heures a de ce fait limité la réduction du temps de travail dans un certain nombre d’établissements, ainsi que l’a fait remarquer au cours de son audition l’économiste M. Éric Heyer , économiste, Directeur adjoint au département analyse et prévision de l’OFCE : « on a coutume de dire que le passage de 39 heures à 35 heures a diminué la durée du travail de 10 % ; en réalité, cette baisse s’est limitée à 5 % ».
La prise en compte ou non des temps de pause a pu de surcroît aggraver certaines inégalités à l’égard du temps de travail. Un autre économiste, M. François-Xavier Devetter, a ainsi souligné que « les temps de pause, les temps intermédiaires, les temps de déplacement ou d’habillement, qui concernent plutôt les professions non qualifiées, sont moins souvent inclus dans le temps de travail des employés non qualifiés que dans celui des professions qualifiées, ce qui peut expliquer certaines inégalités ». À l’inverse, il a ajouté que la décision d’intégrer les temps de pause dans le temps de travail dans certains accords a pu rogner une partie non négligeable du temps libéré par la réduction du temps de travail.
La prise en compte des temps de pause reste une question épineuse en milieu hospitalier. Alors que les temps de pause et d’habillement ont été abordés par la grande majorité des accords relatifs à la réduction du temps de travail
– respectivement 86 % et 82 % –, il n’existe à ce jour aucune harmonisation en la matière. Une enquête de la Fédération hospitalière de France (FHF) conduite en 2014 auprès d’un échantillon de 152 établissements adhérents à la FHF a montré que la moitié d’entre eux considèrent que le temps de repas fait partie du temps de travail (51 %), tandis que l’autre moitié (49 %) l’exclut de celui-ci.
• Le surcoût des heures supplémentaires a été tout aussi disputé
Le changement d’orientation le plus net d’une loi à l’autre fut le sort réservé aux seuils de sur-tarification des heures travaillées au-delà de la norme. Il a été décrit dans le rapport n° 1544 précité de la première mission d’information sur les conséquences de ces lois, comme le rappelle l’encadré ci-après :
« Les heures supplémentaires, heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ouvrent traditionnellement droit d’une part, à une rémunération majorée – de 25 % pour les huit premières heures, et 50 % au-delà –, ainsi qu’à un repos compensateur, d’autre part. Ce dernier vise à la fois à pénaliser financièrement le recours aux heures supplémentaires, dans la mesure où il se trouve assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits des salariés et donne donc lieu à ce titre à rémunération, et donc à favoriser l’emploi, par l’embauche de salariés nouveaux moins coûteux.
« La loi Aubry I a commencé à modifier ce régime, en abaissant de la 43ème heure à la 42ème heure le seuil de déclenchement du repos compensateur de 50 % dans les entreprises de plus de 10 salariés, pour les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires réglementaire de 130 heures, à compter du 1er janvier 1999 (article 8). Les entrepreneurs des plus grandes entreprises devaient ainsi être découragés de recourir dans une trop large mesure aux heures supplémentaires.
« Les modifications apportées par la loi Aubry II sont beaucoup plus importantes. En accroissant significativement le surcoût des heures supplémentaires, la loi visait à limiter le temps de travail hebdomadaire, de manière à favoriser, autant qu’il était possible, la création d’emplois. Le régime des heures supplémentaires issu de la loi Aubry II peut être résumé de la façon suivante.
« D’une part, la bonification des heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 39ème heure obéissait à des règles spécifiques, les heures au-delà de la 39ème continuant à bénéficier des dispositions du régime antérieur (majoration de 25 % pour les quatre suivantes, soit jusqu’à la 43ème, et de 50 % ensuite). Ces règles spécifiques étaient les suivantes : en l’absence d’accord collectif prévoyant expressément une majoration de salaire de 25 %, la bonification des quatre premières heures devait obligatoirement être accordée sous forme de repos, par journée ou demi-journée, pris dans un délai de deux mois, à hauteur de 25 % par heure, soit 15 minutes. Ainsi, l’entreprise qui restait à 39 heures était soumise à une RTT d’une heure.
« D’autre part, le contingent légal, au-delà duquel toute heure supplémentaire devait faire l’objet d’un repos compensateur (à hauteur de 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés, de 50 % dans les autres), restait fixé à 130 heures. Mais les heures supplémentaires n’étaient imputées qu’à partir de la 38ème heure en 2000, de la 37ème heure en 2001 et de la 36ème heure en 2002 seulement.
« Pour les entreprises de moins de vingt salariés, les heures supplémentaires n’étaient imputées sur le contingent légal en 2002 qu’à compter de la 38ème heure, en 2003 à compter de la 37ème et ensuite seulement à compter de la 36ème heure. Ce dernier décompte – à partir de la 36ème heure – ne [devait] finalement intervenir qu’au 1er janvier 2006, à la suite de l’adoption d’un amendement, fort bien venu, lors de la discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
« Toutefois, en cas de modulation, ce contingent était abaissé à 90 heures, car le mode de flexibilité que constituent les heures supplémentaires est alors en effet, par définition, moins fréquemment requis. Ce seuil représentait une contrainte assez forte pour les entreprises qui, dans le cas où elles souhaitaient dépasser la durée légale du travail en recourant à un nombre significatif d’heures supplémentaires, devaient en payer le prix. Il visait à éviter que les entreprises ne restent à 39 heures en usant, systématiquement, de 4 heures supplémentaires chaque semaine – ce qui ne leur aurait été possible qu’avec un contingent annuel porté à 188 heures (47 semaines x 4 heures).
« Enfin, élément venant encore ajouter à la complexité, s’agissant des règles spécifiques relatives au repos compensateur de remplacement, selon lequel le paiement bonifié des heures supplémentaires effectuées dès la 36ème heure pouvait être remplacé par un repos équivalent par la signature d’accords spécifiques, seules, désormais, les heures supplémentaires remplacées intégralement par un repos compensateur étaient exclues du décompte du contingent. »
Le but de ces règles de calcul complexes était d’inciter les entreprises à embaucher plutôt qu’à payer des heures supplémentaires en pénalisant le recours à ces dernières et en accordant des aides financières sous forme d’allègements de cotisations patronales au-delà d’un seuil d’embauche.
Si l’accord négocié sur le temps de travail parvenait à répartir les 1 600 heures normales sur les périodes de forte activité prévisible de chaque établissement, quitte à travailler plusieurs semaines à la limite du seuil absolu des 48 heures, l’employeur pouvait toutefois réaliser une économie substantielle en échappant à l’application des seuils de sur-tarification des heures supplémentaires.
Pour ne pas léser les salariés dans cette négociation, la loi Aubry I jouait sur l’autre mécanisme de limitation du recours aux heures supplémentaire – celui du repos compensateur – sur le respect duquel la jurisprudence européenne se montrait en outre particulièrement exigeante.
Ces repos n’étaient pas accordés pour chaque heure supplémentaire au-delà des 1 600 heures annuelles ou des 35 heures hebdomadaires, mais là encore par un seuil, celui des heures supplémentaires annuelles en-deçà de la cent-trentième, qui ouvraient droit à un repos compensateur de 50 % dès qu’une semaine de travail dépassait 43 heures, puis 42 heures dans la loi Aubry I.
Ce premier seuil définissait un contingent annuel d’heures supplémentaires accomplies au-delà de la norme de travail légal mais néanmoins déclaré admissible. Passé ce seuil, avec l’accord de l’inspection du travail, toute heure excédant la norme hebdomadaire de travail donnait droit à un repos compensateur de même durée et non de 50 %.
Ces nouvelles règles n’ont pas dissuadé un grand nombre d’entreprises et en particulier celles de moins de 10 salariés de maintenir l’ancien horaire réel de travail hebdomadaire, en considérant que la différence entre l’ancienne et la nouvelle norme de travail ne faisait qu’augmenter le volume des heures considérées comme supplémentaires et payées comme telles ou compensées par un repos proportionnel.
4. Les entreprises qui augmentaient l’emploi peu qualifié en réduisant le temps de travail payaient moins de cotisations
En abaissant le seuil de déclenchement des sur-tarifications des heures de travail, les lois Aubry ont rendu la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures coûteuse pour les entreprises qui ne souhaitaient pas s’y conformer. L’effet potentiellement récessif sur l’offre et sur l’emploi de la hausse induite de 11,4 % (17) du coût horaire de travail était alors cependant jugé faible puisque l’économie était en forte croissance. Au pire, il ne s’agissait que d’anticiper des hausses de salaires à venir.
Il importait également que cette hausse du coût horaire soit suffisante pour inciter les branches et les entreprises à négocier non seulement la répartition du temps de travail normal mais surtout la création d’emplois au tarif horaire normal à la place du paiement d’heures supplémentaires sur-tarifées.
L’existence d’un salaire minimum pouvait toutefois limiter les créations d’emploi à ce niveau de salaires faible et mettre en difficulté certaines branches qui employaient une main d’œuvre payée en grande partie au SMIC.
Même en comptant sur des gains de productivité résultant d’une diminution du temps de travail individuel et sur la diminution du volume des heures supplémentaires, les économies réalisées par les entreprises pouvaient peut-être suffire, dans les secteurs à forte intensité capitalistique, à absorber la hausse de 11,4 % du salaire horaire normal. Elles ne suffisaient en revanche pas à rentabiliser des embauches dans des postes faiblement productifs.
En outre, le Gouvernement ne souhaitait pas diminuer la rémunération mensuelle des salariés payés au SMIC. Il fallait, pour cela, relever le salaire horaire minimum de 11,4 % sans pour autant menacer la rentabilité économique des postes de travail que la seule modération salariale ne pouvait garantir, ni imposer cette hausse aux entreprises qui n’auraient pas diminué le temps de travail de leurs salariés et devraient payer en heures supplémentaires des heures de travail auparavant normales.
Pour que les entreprises payent leurs salariés au SMIC pour 35 heures comme elles les payaient pour 39 sans relever le SMIC horaire légal, la loi Aubry II a instauré une garantie mensuelle de rémunération, qui s’appliquait de manière différentielle en l’absence de garantie conventionnelle plus favorable. Cette garantie devait évoluer dans le temps suffisamment lentement pour être rattrapée par la hausse du SMIC légal. Elle ne bénéficiait pas toutefois aux salariés recrutés à 35 heures sur de nouveaux postes.
Ce mécanisme de garantie de la rémunération mensuelle des salariés les moins bien payés risquait de nuire considérablement à la création d’emplois. C’est pourquoi l’aide versée par le Gouvernement aux entreprises passées à 35 heures par un accord collectif créateur ou protecteur d’emplois était d’autant plus élevée que les salaires versés étaient proches du SMIC.
L’aide n’était accordée qu’à condition que l’accord négocié prévoie la réduction en un an d’au moins 10 % du temps de travail, la création d’emplois en plus, maintenus pendant deux ans à compter de la première embauche ou, à défaut le maintien d’emplois devant être supprimés par un plan social.
Les volumes d’emplois nécessaires pour bénéficier des aides, fixés à 6 % de l’effectif de l’entreprise par la loi Aubry I pour une réduction de 10 % du temps de travail habituel et à 9 % d’emplois pour 15 % de RTT, ont disparu dans la loi Aubry II, ce qui revenait à accorder des aides en échange de la signature d’un accord entre partenaires sociaux sur une réduction du temps de travail affiché d’au moins 10 %.
Dans son rapport n° 1826 (18) sur le projet de loi Aubry II en première lecture, M. Gaëtan Gorce indiquait que : « le Gouvernement a considéré qu’il n’était pas possible de reconduire dans un dispositif d’exonérations de cotisations à caractère pérenne des objectifs d’embauche ou de maintien de l’emploi contraignants comme cela avait été le cas dans la loi du 13 juin 1998.
« Cette absence de normes d’emplois ne traduit pas un intérêt moindre pour cette question : le présent projet conserve la création d’emplois et la baisse du chômage comme objectif essentiel. Mais le Gouvernement a estimé qu’il n’est pas possible d’assigner aux entreprises un objectif de créations d’emplois sur le long terme, en faisant fi des cycles économiques, des variations de la croissance et en négligeant les mutations inévitables des structures socio-économiques.
« Enfin, comment vérifier le respect d’une éventuelle obligation d’emploi par chacune des entreprises françaises ? Le nouvel allégement est conçu comme la contrepartie de l’effet emploi induit par la réduction du temps de travail au niveau macro-économique. »
Ces aides financières accordées par l’État en contrepartie de la signature d’un accord de réduction du temps de travail d’au moins 10 % consistaient en un abattement forfaitaire de cotisations patronales de 4 000 francs (soit environ 600 euros) sur tous les salaires, qualifié d’aide pérenne aux 35 heures, et un allègement proportionnel, de 26 % en 2000, réduit à 23,5 points en 2002, au niveau du SMIC.
Cet allègement, dégressif jusqu’à 1,8 SMIC, se substituait, pour les salariés concernés, à la « ristourne Juppé » accordée antérieurement sur les salaires inférieurs à 1,3 SMIC. Il était en revanche cumulable avec l’allègement proportionnel analogue de la loi de Robien et avec les abattements forfaitaires de la loi Aubry I, destinés à inciter les entreprises à conclure des accords négociés.
Les entreprises à forte participation publique comme EDF, GDF, La Poste et la SNCF ont été privées des aides, ainsi que l’a rappelé le représentant de la SNCF lors de son audition par la commission, mais ont été incitées à montrer l’exemple d’une réduction du temps de travail négociée. Certaines entreprises sont passées aux 35 heures par un accord négocié sans toutefois accomplir les démarches administratives nécessaires pour bénéficier des aides prévues par les lois Aubry.
5. La réduction du temps de travail s’est appliquée inégalement mais les jours de repos supplémentaires dits de RTT sont « entrés dans les mœurs »
L’incitation à négocier la réduction légale du temps de travail entre partenaires sociaux pour en diminuer le coût pour les entreprises a favorisé les grandes entreprises parce qu’elles sont habituées aux négociations collectives, qu’elles peuvent compenser les variations de leur production et de leur main-d’œuvre et qu’elles disposent des ressources de gestion nécessaires pour élaborer des organisations de travail sophistiquées, utilisant les facilités offertes par la loi pour répartir avantageusement sur douze mois les 1 600 heures de travail annuelles des salariés à temps plein. Le principe du mandatement a aussi, bien qu’inégalement, fait entrer la négociation collective (et les syndicats) dans les PME.
Trois facilités légales de réduction du temps de travail La modulation La modulation du temps de travail consiste à permettre de s’écarter par excès et par défaut d’une norme horaire de telle sorte qu’elle ne soit respectée qu’en moyenne sur une longue période. Un maximum hebdomadaire de 35 heures qui n’est pas imposé de manière absolu mais seulement en moyenne peut être respecté sur un mois, un semestre ou une année en autorisant par exemple la compensation de semaines de travail allant jusqu’à 48 heures par des semaines de congés supplémentaires. Cette modulation était déjà autorisée par l’ordonnance du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés qui a instauré les 39 heures et la 5ème semaine de congés payés et par la loi du 19 juin 1987 relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Elle a été étendue à un calcul des moyennes de travail sur l’année par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle. Les négociations collectives provoquées par les lois Aubry en ont généralisé l’usage dans les entreprises. La loi Aubry II fixe d’ailleurs un équivalent annuel de 1 600 heures à la norme hebdomadaire des 35 heures. Cet équivalent peut être librement réparti sur l’année sous réserve de ne pas dépasser les maxima de 10 heures par jours, de 48 heures par semaine et de 12 semaines consécutives de 44 heures. Cette répartition, dans un programme indicatif obligatoire de répartition du temps de travail, modifiable en principe sous préavis de 7 jours, permet d’éviter les heures supplémentaires. Le compte épargne-temps La modulation du temps de travail nécessite de relever le temps de travail effectif des salariés pour vérifier qu’il respecte en moyenne la norme et décompter les journées et demi-journées de repos accordées individuellement. Le compte épargne-temps avait été instauré en droit du travail par la loi du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise. L’article 16 de la loi Aubry II en a modifié le régime légal. Les jours de repos, s’ajoutant aux congés payés légaux et accordés aux salariés par des accords collectifs en contrepartie de semaines de travail de plus de 35 heures, sont crédités sur ce compte épargne à mesure que les droits en sont acquis. Le forfait pour les cadres La loi Aubry II a créé trois catégories juridiques de cadres salariés pour l’application de la réduction du temps de travail, les cadres dirigeants qui n’y sont pas soumis, les cadres intégrés à une équipe qui sont soumis au régime collectif et les cadres travaillant individuellement sans que leurs horaires soient contrôlés. Leur employeur peut conclure avec ces derniers un contrat de travail fixant leur rémunération au forfait à la journée, à la semaine ou au mois et non plus à l’heure de travail, ce qui les prive du paiement des heures supplémentaires. Un accord collectif doit limiter le nombre annuel de jours d’emplois de ces cadres sans dépasser le maximum légal de 217 jours de travail par an. La jurisprudence tend à remettre en cause les libertés que ces contrats laissent à l’amplitude horaire du travail, supposée fixée par le cadre et non par son employeur, mais néanmoins dépendante de la charge de travail qui incombe au salarié, en s’acheminant vers un décompte obligatoire des heures effectivement passées à la tâche, afin d’assurer au moins la prise de repos compensateur. |
Selon M. Michel Pépin, consultant spécialiste du travail, membre du cabinet ESSOR consultants, lors de son audition : « Les lois Aubry ont fait bien plus que réduire de manière purement quantitative la durée légale du travail. Elles ont ouvert l’éventail de l’aménagement du temps de travail, tant par l’annualisation, qui a élargi la notion de modulation introduite en 1982, que par le forfait annuel en jours, qui s’est beaucoup développé pour les cadres. »
M. Jean-François Poupard, directeur général de Syndex a confirmé que : « Ces dispositifs sont très largement utilisés dans les entreprises pour optimiser le nombre d’heures productives et réduire le nombre de celles jugées improductives. Quant aux mesures sur la durée effective du travail, en particulier le forfait jours des personnels d’encadrement, elles visent à optimiser les ressources employées : il s’agit d’utiliser les souplesses accordées – modulation d’horaires, annualisations, forfaits – pour employer au mieux ces personnels. »
« Depuis que la durée hebdomadaire du temps de travail a été fixée à 35 heures, en 2002, ces mécanismes d’optimisation sont pleinement utilisés et généralisés. En revanche, nous observons assez peu de débats sur la réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail, sauf dans le cas très spécifique de sociétés en graves difficultés financières où les salariés acceptent de partager le temps de travail – ce qui n’est d’ailleurs pas toujours concluant ».
Les économies réalisées par les entreprises, qui ont pu répartir sur le semestre ou l’année le décompte du temps de travail normal de leurs salariés, ne sont pas précisément connues, parce que les trois volumes des heures supplémentaires réalisées, de celles payées et de celles déclarées par l’employeur peuvent varier selon les secteurs d’activités et la conjoncture et parce que le dernier volume, celui des heures supplémentaires déclarées, n’est connue de façon fiable que depuis 2003, grâce à leur défiscalisation.
Selon l’enquête de 2013 sur les conditions de travail de la DARES, les heures supplémentaires ne font l’objet d’une compensation particulière en travail ou en repos que pour 43% des salariés seulement.
Le volume des forfaits de rémunération du temps de travail appliqués aux cadres est en revanche mieux connu. M. Franck Morel, avocat, ancien directeur adjoint du cabinet de M. Xavier Bertrand, ministre du travail a précisé à la commission que :
« Les forfaits jours concernent aujourd’hui 15 % des salariés, soit trois millions de personnes. L’outil répond donc indéniablement à un véritable besoin des entreprises. Du point de vue du droit positif, un équilibre a été trouvé entre souplesse et régulation avec la loi de 2008 qui a fixé un nombre maximal de jours travaillés par an, et elle a prévu un entretien obligatoire. »
Mme Christiane Charbonnier, directrice de la direction « Droit du travail » de l’UIMM, a décrit la manière dont la convention collective sur la réduction du temps de travail négociée dans la métallurgie avait utilisé les souplesses laissées par la loi :
« Nous avons négocié, uniquement au niveau de la branche, les modalités d’application des 35 heures, afin que les entreprises puissent organiser la répartition du volume de l’horaire avec l’ensemble des outils de flexibilité autorisés par la loi mais en perdant le moins possible d’heures productives. Nous y sommes plus ou moins parvenus, compte tenu de ce que permettait la loi.
« Nous avons négocié sur la définition du temps de travail effectif, afin d’écarter au maximum les temps improductifs dans la comptabilisation des 35 heures, et sur le volume du contingent d’heures supplémentaires. En effet, la durée légale du travail n’est pas une durée obligatoire mais seulement le point de départ des heures supplémentaires. Certaines entreprises peuvent se mettre à une durée supérieure, et d’autres à une durée inférieure, sauf si un accord de branche impose à toutes les entreprises de la branche de se mettre à cette durée légale.
« Nous avons négocié pour faire en sorte que cette durée légale soit calculée non plus sur la semaine comme le prévoyait la loi de 1936, mais sur l’année, les heures supplémentaires ne se décomptant qu’à la fin de l’année. Cela permet aux entreprises de faire varier les horaires pour tenir compte de leur charge de travail – dans les limites des durées maximales du travail.
« Nous avons enfin négocié les forfaits en heures ou en jours sur l’année pour les salariés qui ont une autonomie dans la gestion de la répartition du volume horaire de travail qu’ils sont tenus de réaliser en application de leur contrat de travail.
« Cet accord a été vivement critiqué, car il n’imposait pas à toutes les entreprises de ramener leur horaire de travail à 35 heures – ou en dessous. Néanmoins, il fournissait des outils de flexibilité à toutes celles qui souhaitaient le faire pour y procéder dans les meilleures conditions.
« De fait, il a conduit à des mises en œuvre très diversifiées de la réduction du temps de travail. Certaines entreprises, notamment les plus petites, n’ont pas réduit l’horaire à 35 heures. Elles ont utilisé le contingent, soit pour maintenir les horaires auxquels elles étaient, soit pour le réduire légèrement en dessous de l’horaire collectif, qui était généralement, dans la métallurgie, de 38 heures 30.
« Si elles ne l’ont pas fait, c’est qu’il leur était difficile, compte tenu de leur petite taille, de partager les emplois, c’est-à-dire d’en recréer à partir du volume d’heures libérées par la réduction d’horaires. Il était impossible de recruter, sur ces heures libérées, des personnes suffisamment polyvalentes.
« Comment auraient-elles pu remplacer à la fois les salariés qui faisaient de l’administratif, ceux qui faisaient de la recherche, ceux qui faisaient de la production, ceux qui faisaient de la maintenance, ceux qui faisaient du commercial, etc. Il était totalement impossible de partager vraiment les emplois dans les petites entreprises.
« Certaines ont réduit les horaires de travail sur la journée, ou sur la semaine – environ 3 heures 30 dans les entreprises de la branche. D’autres ont préféré regrouper les heures de repos que les salariés auraient dû avoir en plus sur la semaine, et ont formé des journées supplémentaires de repos. Cela les a conduites à augmenter le nombre de jours non travaillés dans l’année de 4 ou 5 semaines – 21 jours si elles étaient à 38 heures 30, 24 jours si elles étaient restées à 39 heures.
« Ces quatre ou cinq semaines supplémentaires de congés payés étaient très difficiles à absorber par les entreprises, d’autant plus que la compensation était intégrale. Les entreprises devaient en effet payer les salariés exactement de la même façon.
« Parmi les entreprises qui ont choisi d’apprécier le temps de travail sur l’année au lieu de la semaine, certaines ont retenu la formule que je vous ai décrite tout à l’heure : une modulation d’horaire permettant de faire varier l’horaire entre 48 heures sur une semaine, voire 0 heure sur d’autres semaines, en fonction de la charge de travail.
« Enfin, les forfaits en heures et en jours sur l’année ont été largement utilisés par les entreprises, pour les salariés ayant une autonomie dans la répartition de leur volume horaire de travail – autonomie dans les limites des contraintes imposées par la fonction, c’est-à-dire par les rendez-vous de la clientèle ou les réunions avec la direction ou les collègues, pour organiser leur travail.
« Finalement, l’avenir a donné raison à cet accord qui avait pourtant été très critiqué. En effet, dès 2003, soit juste un an après l’entrée en application de la durée légale des 35 heures, le chômage a commencé à remonter. La situation des entreprises ne s’améliorant pas malgré les allègements de charges, plusieurs lois sont intervenues pour assouplir les modalités d’application de cette nouvelle durée légale.
« Ces modalités d’application aboutissaient toutes à trouver des solutions pour permettre aux entreprises qui le pouvaient de relever leurs horaires de travail : augmentation du contingent ; élargissement du nombre de jours de repos pouvant être affectés au compte épargne temps ; système des heures choisies et des jours choisis pour les salariés qui souhaitaient travailler au-delà des durées de référence ; rachat des jours de RTT, possibilités ouvertes aux accords d’entreprise de déroger aux accords de branche, même si ces derniers étaient plus favorables. »
Comme l’explique Mme Charbonnier, alors que la conjoncture devenait moins favorable, les Gouvernements qui ont succédé à celui de M. Lionel Jospin ont laissé remonter le niveau du chômage en favorisant l’ajustement du temps de travail à la norme légale par l’accomplissement d’heures supplémentaires, décontingentées, puis défiscalisées à compter de 2007, au moment où la crise économique redémarrait.
Cette politique, coûteuse pour les finances publiques, pouvait certes soutenir la demande, selon un schéma keynésien de relance. Elle ne pouvait guère diminuer le chômage parce que la part de la demande supplémentaire satisfaite par l’offre nationale serait produite principalement par des heures de travail supplémentaires. Elle ne pouvait enfin qu’affaiblir la compétitivité de l’économie française en conduisant à une hausse du salaire horaire moyen, en raison de la sur-tarification de ces heures supplémentaires, même à taux réduit et avec des cotisations sociales patronales diminuées.
6. La mise en œuvre des 35 heures dans la fonction publique a fait l’objet d’accords spécifiques
Les lois Aubry sur le temps de travail ne portaient à l’origine que sur le secteur privé : le passage aux 35 heures dans la fonction publique n’allait donc pas de soi.
Mme Marie-Anne Lévêque, directrice générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), a en effet rappelé au cours de son audition qu’initialement, le Gouvernement n’avait pas pour projet de transposer à la fonction publique des mesures qui devaient être inscrites dans le code du travail, car l’objectif de création d’emplois portait uniquement sur le secteur privé. Mais en 1999, à la suite de la remise d’un rapport de M. Jacques Roché, conseiller maître à la Cour des comptes, constatant d’importants écarts par rapport à la norme des 39 heures dans le secteur public, le Gouvernement a décidé d’aborder également la question du temps de travail dans la fonction publique, en excluant toutefois les enseignants, qui représentent 50 % de la fonction publique de l’État.
La réduction du temps de travail dans la fonction publique s’est donc effectuée selon des modalités relativement différentes de celles du secteur privé, puisqu’il s’agissait de « clarifier le cadre juridique du temps de travail dans la fonction publique et d’y assurer le passage aux 35 heures sans que cela se traduise par des emplois supplémentaires ». L’un des enjeux prioritaires était de rénover le dispositif de paiement des heures supplémentaires, qui avait donné lieu à des dérives significatives, selon Mme Lévêque.
Les principes du passage aux 35 heures dans la fonction publique de l’État ont été déterminés par le décret n°2000-815 du 25 août 2000, qui « fixe le principe de la durée annuelle de 1 600 heures maximum (19), définit les différents cycles et types d’organisation du travail, les horaires variables, les astreintes, les horaires d’équivalence, et pose l’obligation de procéder à un contrôle automatisé par badge du temps de travail accompli ». Ce décret définit également le régime spécifique de forfait applicable aux cadres de la fonction publique ; selon Mme Lévêque, le régime au forfait concerne à ce jour 42 % des agents des ministères.
Ces principes ont ensuite été déclinés soit par la voie d’une concertation avec les organisations syndicales, dans les ministères de l’Écologie et de l’Intérieur par exemple, soit par une négociation, comme ce fut le cas au sein du ministère de la Défense ou dans les services du Premier ministre.
En pratique, les cycles de travail sont restés en majorité supérieurs à 35 heures hebdomadaires. Mme Lévêque estime que « 72 % des agents de la fonction publique de l’État hors Éducation nationale ont des cycles de travail supérieurs à 38 heures hebdomadaires. ». Par conséquent, « la durée quotidienne et hebdomadaire de travail n’a pas été substantiellement modifiée, ce qui explique que la RTT n’ait pas déstabilisé l’organisation du travail » au sein de la fonction publique de l’État.
L’une des principales mesures ayant accompagné la mise en place des 35 heures fut la création du compte épargne temps (CET), qui a été mis en place en 2002 dans la fonction publique d’État. Le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 prévoyait initialement l’utilisation des jours épargnés sous forme de congés uniquement, et sous réserve d’avoir accumulé un minimum de 40 jours sur le compte. Ces dispositions ont été assouplies par la suite, le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 prévoyant par exemple une indemnisation possible de la moitié de jours inscrits sur le compte au 31 décembre 2007, tandis que le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 a permis de monétiser les jours placés sur le CET ou de les prendre en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (au-delà de 20 jours épargnés). Au 31 décembre 2009, 31 % des agents des ministères étaient titulaires d’un CET.
S’agissant de la fonction publique territoriale, c’est la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui a fixé le cadre juridique relatif à la réduction du temps de travail. Mme Lévêque a indiqué que les principales dispositions prévues par cette loi respectent le principe constitutionnel d’autonomie des collectivités, mais que ce dernier est assorti d’une exigence de parité avec la fonction publique de l’État : « les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail sont fixées par délibération de la collectivité dans les limites applicables aux agents de l’État ». Toutes les collectivités territoriales ne sont pas passées aux 35 heures pour autant : certaines collectivités, qui avaient conclu dès 1998 des accords de réduction du temps de travail prévoyant parfois des seuils inférieurs aux 1 600 heures annuelles, ont gardé la possibilité de maintenir ces seuils plus favorables. Selon une enquête menée en 2000, citée par Mme Lévêque au cours de son audition, quelques 1 550 collectivités étaient concernées par cette durée inférieure aux 35 heures hebdomadaires.
La fonction publique hospitalière est, elle aussi, passée aux 35 heures avec la signature d’un protocole national le 27 septembre 2001, suivi dans la majorité des établissements de négociations avec les partenaires sociaux.
Ce protocole national a été l’occasion de redéfinir les règles et les garanties relatives au temps de travail, qui étaient auparavant particulièrement disparates. En effet, en dépit de principes généraux, la DREES a constaté qu’avant la réduction du temps de travail, « au sein d’un même établissement coexistaient plusieurs régimes, pour les personnels dits de jour (aux horaires fixes en journée, ne travaillant ni la nuit, ni les week-ends), pour les personnels dits à repos variables (aux horaires souvent alternants matin et soir, et effectuant le cas échéant des nuits et des week-ends) et pour les personnels de nuit (qui étaient officiellement aux 35 heures depuis déjà 1993) ». En outre, si entre les établissements la règle applicable était identique – 39 heures hebdomadaires –, « dans les faits la situation était hétérogène, du fait de jours de repos supplémentaires accordés au fil du temps à tout ou partie du personnel : fêtes locales, fête des mères, jours d’ancienneté, etc. ».
Le protocole national de 2001 prévoyait en conséquence la mise en place d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à compter du 1er janvier 2002, et de 32,5 heures pour les personnels de nuit à compter du 1er janvier 2004. La durée quotidienne de travail ne peut dépasser, selon cet accord, neuf heures de travail en journée, ou dix heures par nuit. L’accord prévoyait également l’octroi de jours de RTT en fonction de la durée de travail hebdomadaire retenue : 20 jours maximum de RTT pour un maintien à 39 heures, 18 jours pour 38 heures, 12 jours pour 37 heures et enfin 6 jours de RTT pour 36 heures. Le dispositif s’est accompagné d’un plan prévisionnel de recrutement et, dès 2002, de la mise en place de comptes épargne temps (CET).
L’exemple du passage aux 35 heures au sein de l’établissement de santé publique
de Ville-Evrard (93)
L’accord visant à réduire le temps de travail dans l’établissement de santé publique de Ville-Evrard, visité par votre rapporteure, a été engagé en mars 2001, après un avis favorable du comité technique d’établissement (CTE). Une démarche participative a été engagée, et un groupe de projet « Aménagement et réduction du temps de travail » (ARTT), constitué de représentants de la direction, du corps médical et des organisations syndicales a été mis en place. Huit réunions de négociations se sont déroulées entre le 20 décembre 2001 et le 25 février 2002.
Les principes définis dans l’accord sont les suivants :
− Durée hebdomadaire de travail (avant déduction des RTT) : 38 heures, mais les agents en repos fixe bénéficient d’un droit d’option entre 35 heures et 38 heures hebdomadaires ;
− Organisation majoritaire du temps de travail : 4 journées de 8 heures par semaine et une journée réduite de 6 heures ;
− Durée annuelle de travail : 1 575 heures (repos fixe) et 1 547 heures (repos variable) ;
− Nombre de jours de congés annuels : 25 jours ouvrés + 2 jours supplémentaires pour les congés « hors saison » et 1 jour supplémentaire pour fractionnement ;
− Nombre de jours de RTT par an : 18 jours (dont 1 réservé à la journée de solidarité) et 20 pour les personnels en forfait jours.
Le stock de CET atteignait en 2014 un volume de 27 486 jours, pour un effectif de 2 488 agents, soit 11,04 jours par agent (9,52 jours par agent soignant).
De manière très surprenante, il n’existe à l’heure actuelle aucun état des lieux concernant le temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. S’agissant plus particulièrement de la réduction du temps de travail, Mme Marie-Anne Lévêque, directrice générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a indiqué que, « dans la mesure où le dispositif n’était pas censé engendrer de coûts supplémentaires », la mise en place des 35 heures dans la fonction publique n’a fait l’objet d’aucune évaluation, bien que plusieurs voix s’élèvent pour qu’un tel bilan puisse voir le jour.
Le rapport de M. Bernard Pêcheur sur la fonction publique remis au Premier ministre le 29 octobre 2013 (20) suggère en effet que l’on engage une enquête sur ce sujet ; la Cour des comptes a exprimé un souhait analogue dans son rapport public de juin 2014, tout en reconnaissant la difficulté de l’exercice (21).
En conséquence de cette absence de bilan, les données dans le secteur public sont très lacunaires. Concernant la fonction publique d’État, les dernières données relatives au bilan financier portent sur la période de 2002 à 2004, aucun travail significatif de chiffrage de l’impact des 35 heures n’ayant été mené depuis lors selon Mme Marie-Anne Lévêque. En revanche, en l’absence d’éléments, aucun bilan ne peut être dressé de l’incidence de la réduction du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale, qu’il s’agisse du fonctionnement des services ou du bilan financier.
C. LA POLITIQUE D’EMPLOI PAR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A ÉTÉ INTERROMPUE, ENTRE 2002 ET 2012, AU PROFIT D’UNE INCITATION AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La majorité nouvelle élue en 2002 n’a pas abrogé la réduction légale du temps de travail imposée par les lois Aubry. Elle s’est contentée de brider la création d’emploi en favorisant le paiement d’heures supplémentaires plutôt que l’embauche de nouveaux salariés. Cette politique s’est mise en place en plusieurs étapes.
Le Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin a fait voter, dans la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, dite loi Fillon, une suppression du repos compensateur obligatoire des heures accomplies entre la 35ème et la 39ème au profit d’une sur-tarification.
Dans la même logique, la loi a relevé le second seuil de déclenchement des repos compensateurs obligatoires, qui est passé de 130 à 180 heures et a dispensé les entreprises qui dépassaient ce contingent annuel d’en demander l’autorisation à l’inspection du travail.
Apparemment favorable à la rémunération des heures supplémentaires, cette loi permettait toutefois à une convention de branche étendue de réduire les taux de sur-tarification applicables à chaque seuil jusqu’à 10 %, même pour les 4 heures entre la 35ème et la 39ème, payées par la plupart des entreprises de moins 20 salariés qui ne sont pas passées, en pratique, aux 35 heures et qui ne sont pas toujours couvertes par une convention de branche.
Les allègements de cotisations patronales Juppé et Aubry ont été fusionnés en un nouvel allègement de 26 % accordé aux salaires inférieurs à 1,7 SMIC, appliqué progressivement afin d’éliminer les distorsions introduites par les garanties mensuelles de rémunération.
Cette politique a été poursuivie, sous le Gouvernement de M. François Fillon. L’article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi Tepa, qui défiscalisait toute la rémunération des heures supplémentaires et l’exonérait quasiment de cotisations sociales salariales et réduisait les cotisations sociales patronales.
Il ne s’agissait plus de favoriser la création d’emplois pour faire baisser le chômage mais d’inciter les salariés en poste à réaliser des heures supplémentaires et les entreprises à les déclarer en contrepartie d’exonérations fiscales et sociales. Cette mesure visait à distribuer du pouvoir d’achat en luttant, par la même occasion, contre la dissimulation d’heures supplémentaires pré-existantes mais non déclarées.
Elle a beaucoup contribué à faire respecter les normes de travail de 35 heures par semaine et 1 600 heures par mois dans les entreprises qui n’avaient pas signé d’accord sur le temps de travail, en particulier dans celles de moins de 20 salariés, puisque les salariés et les employeurs n’avaient plus d’intérêt commun tacite à ignorer cette norme.
La loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a poursuivi dans la même direction puisqu’elle autorisait l’abandon contre rémunération supplémentaire de jours de congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et même de jours de repos compensateurs.
Le rapport d’information n° 3615 de notre collègue député M. Jean-Pierre Gorges et du député M. Jean Mallot, déposé le 30 juin 2011 au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale (22), qui a dressé le bilan de ces mesures, à la fois sur l’emploi, les finances publiques et l’économie française, a conduit le Gouvernement de M. François Fillon à renoncer à l’une d’elles, bénéficiant aux entreprises, en décembre 2011 et celui de M. Jean-Marc Ayrault à abroger les autres l’année suivante dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
D. CES POLITIQUES SE SONT INSCRITES DANS UN MOUVEMENT PLUS GÉNÉRAL DE TRANSFORMATIONS DU CADRE DE TRAVAIL ET DE VIE
Les politiques de réduction du temps de travail comme d’incitation aux heures supplémentaires ont pris place dans une période au cours de laquelle l’environnement général de travail s’est profondément modifié.
Bien que certains soient tentés de mettre sur le compte des 35 heures toutes les difficultés rencontrées par les entreprises françaises au début du xxie siècle, il convient de prendre en compte l’ensemble des modifications législatives, réglementaires et organisationnelles intervenues depuis une décennie, qui permettent tout autant d’expliquer cette complexité que la réduction du temps de travail elle-même.
M. Sébastien Rouchon, dirigeant de l’entreprise « Rouchon Paris » et membre du CJD de Paris a concédé que « les 35 heures ont vraisemblablement participé à la complexification de l’activité et de la gestion d’une TPE. Mais combien de nouvelles lois sont-elles venues rendre la fiscalité et le droit du travail encore plus complexes depuis lors ? ». Plus loin, il ajoutait : « de même, les 35 heures ont fatalement contribué à renchérir le coût du travail. Mais combien de nouvelles mesures fiscales et d’augmentations de taux sont venues alourdir la facture des entreprises depuis lors ? ».
L’exemple de l’hôpital illustre également ce propos. Le milieu hospitalier a en effet été confronté, depuis le début des années 2000, à un contexte législatif et réglementaire particulièrement évolutif. Les incidences du seul passage aux 35 heures sur l’aménagement du temps de travail et les conditions de travail sont de ce fait particulièrement difficiles à identifier.
Lors de son audition, M. Franck von Lennep, directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) au ministère des affaires sociales et de la santé, a tenu à rappeler les très lourds changements organisationnels conduits à l’hôpital depuis une dizaine d’années. Ces changements, qui touchent notamment « à la constitution des pôles et des réseaux », « à l’amélioration de l’information des patients », « au développement de la chirurgie ambulatoire et de l’informatisation », ou encore « à la tarification à l’activité », « dépassent la simple question du temps de travail ».
Un constat analogue a été dressé par Mme Isa Linares, psychiatre et chef de pôle de l’établissement de santé mentale de Ville-Evrard (93), qui a estimé que différents éléments avaient pu influencer l’organisation du temps de travail depuis 2002 : par exemple, les repos de sécurité après les gardes, devenus obligatoires par un arrêté du 10 septembre 2002, sont désormais comptabilisés dans le temps de travail. Le sentiment d’intensification des conditions de travail, souvent associé à la mise en place des 35 heures, peut de la même manière être tempéré par d’autres facteurs, l’établissement de Ville-Evrard ayant ainsi été confronté à un surcroît d’activité dû à la réforme de l’organisation des soins sans consentement en psychiatrie en 2011.
La réduction du temps de travail s’est par ailleurs accompagnée de réorganisations du travail plus ou moins profondes, dont il est difficile de dire si elles lui sont liées ou non. Outre le phénomène désormais ancien de tertiarisation de l’économie, qui s’est intensifié depuis le début des années 2000, M. Hervé Lanouzière, directeur de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), a insisté sur l’émergence de nouveaux modes de gestion au sein de l’entreprise tels que le lean management, les flux-tendus, le zéro stock, etc. ; autant de facteurs qui ont pu désorganiser l’entreprise autant que la réduction du temps de travail.
L’intensification des conditions de travail, souvent présentée comme l’un des effets néfastes de la réduction du temps de travail, a de même pu prendre sa source dans les profondes mutations du marché du travail, ainsi que le suggère le rapport du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) (23) : « les Français sont de plus en plus concernés par des tensions dans le monde du travail, liées à la persistance d’un taux de chômage élevé, d’une augmentation de la pression temporelle et de l’intensité du travail ». L’essor de la flexibilité externe à l’entreprise peut également justifier une partie de l’intensification des conditions de travail, par le biais par exemple du développement des emplois précaires – emplois à temps partiel, intérim, apprentissage.
Enfin, plusieurs des personnes auditionnées par la commission d’enquête ont rappelé que les nouvelles technologies, nouvelle donne intervenue depuis la réduction du temps de travail, ont également contribué à troubler le rapport au temps de travail.
Certes, l’émergence de nouvelles formes de travail telles que le télétravail répond souvent à un « souhait » de certains salariés, comme l’a rappelé M. Guillaume Noël, directeur du développement social du groupe Éram, les nouveaux outils technologiques permettant par exemple de « rentrer un peu plus tôt pour aller chercher les enfants à l’école, quitte à travailler le soir à domicile ».
Mais en ramenant le travail « à la maison », les nouvelles technologies ont également contribué à atténuer les frontières spatiales et temporelles entre travail et temps libre. Mme Isabelle Saviane, directrice des ressources humaines du groupe Éram, a ainsi expliqué qu’en raison de cette intrusion du travail au domicile familial, qui va selon elle à rebours de la recherche d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, « le contrôle du temps de travail (…) devient hors de portée ».
L’utilisation des nouvelles technologies pour travailler en dehors des horaires et lieux de travail habituels (soir, week-ends, vacances, à domicile, etc.), concerne à ce jour 39 % des actifs. À l’inverse, près d’un actif sur deux utilise les nouvelles technologies pour un usage personnel sur son lieu de travail – 46 % des actifs ont accès à Internet sur leur lieu de travail. Dès lors, la distinction entre ce qui relève du temps de travail effectif et ce qui n’en relève pas n’est pas aisée.
Outre le fait qu’il ait largement contribué à brouiller les frontières spatio-temporelles de la notion de temps de travail, le déploiement des nouvelles technologies a pu engendrer de nombreuses réorganisations dans les services, une évolution des missions ou encore une requalification des compétences. Mme Marie-Anne Lévêque a ainsi estimé, s’agissant de la fonction publique, que le poids des nouvelles technologies avait été globalement plus important en termes de réorganisation des services administratifs que celui de la réduction du temps de travail.
E. DES DIFFICULTÉS D’ORDRE MÉTHODOLOGIQUE COMPLEXIFIENT L’ÉVALUATION DES EFFETS DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il existe peu de données exhaustives et actualisées relatives aux incidences sociétales, sociales, économiques et financières de la réduction du temps de travail après 2002.
1. La mesure de la durée du travail est une science imprécise
En France, les enquêtes qui recensent la durée du travail reposent soit sur une base déclarative, soit sur la collecte de données auprès des établissements. Ainsi, l’enquête « Emploi » de l’INSEE est réalisée en continu tout au long de l’année auprès d’un échantillon de ménages. L’enquête Activités et conditions d’emploi de la main d’œuvre (ACEMO) du ministère du Travail recueille quant à elle les données relatives à la durée affichée du travail auprès des établissements industriels et commerciaux de dix salariés et plus (hors établissements agricoles).
L’enquête « Emploi » de l’INSEE, un exemple de mesure de la durée du travail reposant sur une base déclarative
Depuis 2003, la collecte de l’information sur la situation du marché du travail dans l’enquête « Emploi » s’effectue de manière continue tout au long de l’année. Elle permet de mesurer à la fois la durée habituelle de travail et la durée effective de travail.
Après sélection d’un échantillon représentatif par tirage au sort, les personnes sont interrogées sur leur situation pendant une semaine de référence dans le trimestre, les semaines étant réparties de manière uniforme chaque trimestre.
Le questionnaire débute par des questions relatives à la situation sur le marché du travail. Pour les personnes exerçant un emploi, un bloc de questions permet de caractériser les activités professionnelles, et dans un premier temps la profession, l’employeur et le contrat de travail.
Pour calculer la durée hebdomadaire habituelle, les personnes sondées sont interrogées sur leurs horaires habituels, le temps de travail, le type d’horaires, leur souhait de travailler plus ou moins, leurs absences et motifs d’absence, les heures supplémentaires et heures effectives la semaine de référence, ou encore sur le travail en soirée, la nuit ou encore le week-end. La durée hebdomadaire habituelle découle ainsi de la réponse apportée à la question suivante : « en moyenne, combien d’heures travaillez-vous par semaine dans votre emploi (heures supplémentaires comprises) » ?
Pour calculer la durée hebdomadaire effective, les personnes sondées sont invitées à se remémorer tous les évènements ayant pu affecter leur durée habituelle de travail : heures supplémentaires effectuées (rémunérées ou non), congés pris, absences pour maladie ou accident de travail, éventuelles perturbations d’horaires de travail pour cause de chômage partiel, intempéries, formations, grèves… Dans un second temps seulement, les personnes déclarent le nombre d’heures effectivement travaillées dans la semaine.
Compte tenu de ces différences d’approche méthodologique, l’analyse de la durée de travail moyenne hebdomadaire montre que celle-ci peut varier sensiblement selon l’enquête considérée :
− selon l’enquête ACEMO, elle s’élève à 35,6 heures pour les salariés à temps complet des entreprises de dix salariés et plus dans les secteurs concurrentiels ;
− en revanche, selon l’enquête « Emploi » de l’INSEE, la durée moyenne hebdomadaire du travail incluant les heures supplémentaires régulièrement effectuées est de 40 heures pour les personnes à temps complet – et 39 heures pour les seuls salariés, soit environ quatre heures de plus que pour l’enquête ACEMO.
Un constat analogue peut être dressé s’agissant de la durée annuelle effective du travail, calculée sur des périmètres distincts par les enquêtes de la DARES et de l’INSEE. L’enquête « Emploi » de l’INSEE mesure ainsi des durées annuelles de travail pour les seuls salariés à temps complet, sur le champ des personnes présentes en emploi quatre trimestres consécutifs, par extrapolation de la durée effective hebdomadaire. Ce calcul exclut à la fois les personnes ayant travaillé de façon discontinue sur l’année et le corps enseignant. L’enquête de la DARES couvre pour sa part l’ensemble des salariés en emploi, y compris les enseignants, sans condition sur la continuité de l’emploi.
En conséquence, les durées estimées diffèrent sensiblement selon les deux enquêtes. Pour l’ensemble des salariés à temps complet, la durée annuelle en 2011 était estimée à 1 683 heures selon la DARES, contre 1 705 heures selon le calcul de l’INSEE, soit une différence de vingt-deux heures (24).
2. Certaines données disponibles sont incomplètes ou imprécises
La plupart des données disponibles concernant la réduction du temps de travail se fondent sur des évaluations de la loi dite Aubry I. Les incidences de la loi Aubry II ont moins souvent été mesurées par enquêtes statistiques.
M. Frédéric Lerais, directeur général de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), a ainsi expliqué à la commission qu’un bilan des effets de la loi Aubry II s’avèrerait « difficile, probablement impossible » et ne pourrait en tout état de cause pas être aussi sophistiqué que l’évaluation des premiers dispositifs de réduction du temps de travail, en raison notamment de la disparition de repères témoins du fait de la généralisation des 35 heures à la suite de la loi Aubry II. Les évolutions législatives intervenues après 2003 rendent également délicates les évaluations conduites ultérieurement.
À titre d’illustration, les estimations du nombre de créations d’emploi nées de la mise en place des 35 heures données par M. Frédéric Lerais se concentrent sur la période de 1996 à 2002, pendant laquelle les lois Aubry jouent à plein.
S’agissant des effets sociétaux, l’enquête de référence « RTT et modes de vie » de la DARES a été réalisée en 2001 auprès d’un échantillon de personnes ayant connu seulement les lois de Robien et Aubry I. Mme Dominique Méda, sociologue, a souligné, lors de son audition, qu’aucune enquête de la DARES n’était venue mesurer les effets de la seconde loi Aubry, en raison, selon elle, du caractère « tabou » de la réduction du temps de travail après 2002.
M. Francois-Xavier Devetter a par ailleurs rappelé que l’étude réalisée par la DARES demeure la seule enquête statistique de grande ampleur sur les incidences sociétales de la réduction du temps de travail.
DEUXIÈME PARTIE – DANS L’ÉVALUATION DES LOIS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL,
DES FAITS SAILLANTS SE DÉGAGENT
A. LA PÉRIODE 1997-2002 EST CARACTÉRISÉE PAR DES CRÉATIONS MASSIVES D’EMPLOIS
1. Le nombre de chômeurs a beaucoup diminué entre 1999 et 2001
Entre 1997 et 2001, le chômage a diminué en France, dans des proportions inédites, en particulier entre 1999 et 2000, après l’entrée en vigueur de la loi Aubry I. On compte 350 000 chômeurs de moins en une année. C’était l’objectif principal des lois Aubry.
Cet objectif a été atteint, dans des proportions sans doute moindres que celles imaginées par les promoteurs de ces lois, mais néanmoins significatives tant elles sont manifestes dans les relevés statistiques de l’INSEE comme de l’ANPE.
NOMBRE DE CHÔMEURS AU SENS DU BIT
(en milliers)
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2 525 |
2 690 |
2 549 |
2 710 |
2 745 |
2 652 |
2 594 |
2 239 |
2 046 |
2 107 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2 294 |
2 411 |
2 432 |
2 432 |
2 223 |
2 064 |
2 573 |
2 635 |
2 604 |
2 811 |
Source : Site Internet de l’INSEE
Le taux de chômage calculé par l’INSEE selon les règles du Bureau International du Travail qui permettent des comparaisons internationales, passe de 11,8 % de la population active en mars 1998 à 8,8 % en mars 2001. Les relevés statistiques des demandeurs d’emploi de catégorie A de l’ANPE enregistrent une baisse de 600 000 du nombre d’inscrits entre 1999 et 2001.
Cette baisse ne correspond pas un à transfert des demandeurs d’emplois de catégorie A dans les autres catégories de chômeurs, qui admettent ceux qui accomplissent moins de 78 heures de travail dans le mois ou qui, au-delà, n’ont cependant qu’un emploi à temps très réduit. La baisse est identique quand on regroupe les trois catégories A, B et C.
NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DES CATÉGORIES A, B ET C (25)
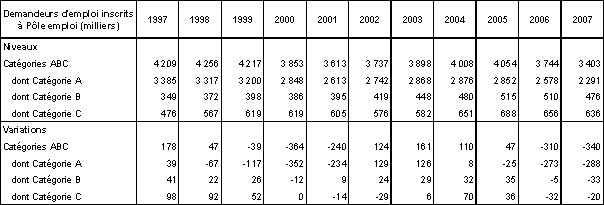
Source : INSEE, STMT, Pôle-Emploi, DARES
Champ : France y compris DOM, hors Mayotte
2. La pertinence d’une politique de RTT face au temps partiel
À partir de 1998, le temps partiel qui avait progressé en continu depuis le début des années 1980 a commencé à décroître. Selon une synthèse de la DARES d’octobre 2001 intitulée « Le temps partiel subi diminue depuis 1998 », en 2001 (26), un salarié sur cinq passait à temps complet l’année suivante, une proportion en augmentation depuis 1999, cette proportion passant à un sur trois parmi les salariés ayant exprimé le souhait de passer à temps plein. Par ailleurs, la diminution du temps de travail permet l’accroissement des temps de travail des salariés à temps partiel, comme en témoigne la diminution d’une année sur l’autre du nombre de salariés souhaitant davantage.
Cette diminution du temps partiel peut s’expliquer par le fait qu’à partir de 1998, les entreprises ayant réduit leur temps de travail embauchent leurs nouveaux salariés plus fréquemment à temps plein que par le passé, comme l’atteste une autre étude de la DARES publiée en septembre 2002 (27).
PART DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL EN 2000 PASSÉS À TEMPS COMPLET EN 2001 SELON QUE L’ENTREPRISE EST PASSÉE À 35 HEURES ENTRE 2000 ET 2001 OU EST RESTÉE À 39 HEURES
(en %)
Taux de passage à temps complet entre 2000 et 2001 | ||
Entreprise passée à 35 heures entre 2000 et 2001 |
Entreprise encore à 39 heures en 2001 | |
Ensemble des salariés à temps partiel en 2000 |
24 |
19 |
Salariés à temps partiel… |
||
… ne souhaitant pas travailler plus |
18 |
16 |
… souhaitant passer à temps complet |
45 |
29 |
… souhaitant travailler plus sans passer à temps complet |
14 |
11 |
Durée habituelle initiale du temps partiel |
||
1 – 19 h |
10 |
11 |
20 h |
33 |
15 |
21 – 29 h |
29 |
16 |
> 29 h |
25 |
27 |
Pas de durée habituelle |
23 |
26 |
Champ : salariés concernés par la loi Aubry du 19 janvier 2000.
Source : enquête Emploi de l’INSEE de mars 2000 et 2001, calculs DARES.
3. La croissance était élevée pendant la période de mise en œuvre de la législation sur le temps de travail.
La croissance en volume du produit intérieur brut a fortement accéléré entre 1998 et 2000, avant de baisser à partir de 2001, comme dans l’ensemble de l’Europe occidentale. Selon l’INSEE, elle a même dépassé 3 % entre 1998 et 2000. Elle n’avait pas atteint un tel niveau depuis les records de 4,7 % et de 4,2 % de 1998 et 1989, respectivement.
ÉVOLUTION ANNUELLE DU PIB EN VOLUMES CHAÎNÉS
(en %)
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2,3 |
3,6 |
3,4 |
3,9 |
2 |
1,1 |
0,8 |
2,8 |
1,6 |
2,4 |
2,4 |
Source : réponse de l’INSEE à une question de la rapporteure
Cette croissance a été tirée par la demande mondiale. L’ensemble de l’Europe occidentale en a bénéficié à l’époque. Selon M. Éric Heyer, directeur adjoint au département analyse et prévision de l’OFCE, la période de 1997 à 2002 « est celle pendant laquelle, au cours des trente dernières années, la croissance économique française a été la plus forte. On invoque souvent un environnement extérieur favorable ; mais ce n’est que partiellement vrai, puisque la croissance de la demande mondiale adressée à la France s’établissait alors à 6,2 %, contre 7,6 % entre 2003 et 2007, période pourtant de moindres performances économiques. »
VARIATION DE LA DEMANDE MONDIALE ADRESSÉE À LA FRANCE
1980-1997 |
1997-2002 |
2003-2007 |
1980-2007 |
1998-2007 | |
En % et en moyenne annuelle |
5,0 |
6,2 |
7,6 |
5,7 |
6,9 |
Source : INSEE, reprise par M. HEYER au cours de son audition.
Ces moindres performances peuvent s’expliquer, après 2002, par des pertes rapides et importantes de parts de marchés à l’exportation, alors que le solde commercial français des échanges de biens, qui était négatif entre 1982 et 1992, était redevenu positif à partir de 1993.
Selon les comptes nationaux de l’INSEE, le solde des échanges de biens, sans tenir compte des services, est excédentaire de plus de 20 milliards d’euros, en base 2005, entre 1997 et 1999. Il n’atteint plus que 6,5 milliards d’euros en 2000, 10,3 milliards en 2001 et remonte à 17 milliards en 2002.
SOLDE COMMERCIAL DES ÉCHANGES DE BIENS
(en milliards d’euros)
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
10,5 |
8,4 |
9,7 |
12,3 |
28,8 |
26,1 |
21,9 |
6,5 |
10,3 |
17 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
7,7 |
-2,2 |
-22,6 |
-31,7 |
-42,7 |
-55,2 |
-47 |
-58,6 |
-75,7 |
-61,6 |
Source : INSEE, comptes nationaux, base 2005 : Les exportations de biens sont évaluées FAB (franco à bord), Les importations de biens sont évaluées CAF (coûts, assurance, fret)
Ce contexte économique a incontestablement contribué à la création d’emplois, à la hausse des marges des entreprises et au rétablissement de l’équilibre des finances publiques.
Il rend délicate l’appréciation de l’incidence des lois de réduction du temps de travail sur ces décomptes, puisque les deux phénomènes sont simultanés, aussi brefs et intenses l’un que l’autre et sans analogue par la suite.
4. Les créations d’emplois entre 1997 et 2001 ont atteint un niveau exceptionnel dans l’histoire économique française
Entre 1997 et 2001, les créations d’emplois en France atteignent un niveau sans précédent depuis les années 1950. En cinq ans, la France a créé 2 millions d’emplois salariés dans le secteur marchand tandis que le PIB progressait sur la période de 16 %, soit une création moyenne de 125 000 emplois par point de PIB supplémentaire.
EFFECTIFS D’EMPLOIS SALARIÉS DU SECTEUR MARCHAND
(en milliers)
Emploi salarié du secteur marchand |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
1997-2007 |
Niveau |
14 623 |
14 996 |
15 460 |
16 048 |
16 305 |
16 346 |
16 284 |
16 319 |
16 416 |
16 622 |
16 895 |
- |
Variation |
270 |
373 |
464 |
588 |
257 |
41 |
- 62 |
35 |
98 |
205 |
273 |
2 272 |
Source : INSEE, estimations annuelles d’emploi - Champ : France y compris Dom, hors Mayotte
Ensemble des secteurs d’activité, hors administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale.
Par comparaison, la croissance économique encore soutenue entre 2004 et 2007, de 9,5 % sur les quatre ans, ne crée que 600 000 emplois marchands, donc moitié moins d’emplois par point de PIB, soit 63 000. Il y a, bien sûr, des effets de seuils dans la création d’emplois selon l’intensité de la croissance économique.
Ces effets de seuils sont particulièrement sensibles en France, du fait du recours aux heures supplémentaires en période de forte activité et des rigidités attribuées au marché français du travail avant 1997 par les instances économiques internationales.
Cette singularité, inlassablement rappelée par l’OCDE, qui appelait à modifier les règles légales et fiscales du droit du travail français, aurait expliqué que le marché du travail français créât moins d’emplois que les marchés analogues, à croissance égale. Grâce aux lois de réduction du temps de travail, ce n’est plus le cas.
Sans elles, la croissance observée entre 1997 et 2002 et même celle de la législature suivante, n’auraient sans doute pas permis de voir autant diminuer le chômage. Le Gouvernement de M. Lionel Jospin a prouvé que le marché du travail français pouvait créer autant d’emplois en période de croissance qu’une économie dérégulée à l’anglo-saxonne, ce qui était contesté depuis l’apparition d’un chômage de masse dans le pays à partir de la fin des années 1970.
Comme l’a rappelé M. Lionel Jospin lors de son audition : « …entre 1997 et 2002, au moment où l’effet des 35 heures jouait à plein, notre croissance économique a été supérieure d’un point à la moyenne européenne ; 2 millions d’emplois nets ont été créés, ce qui est le record absolu pour cinq années dans l’histoire économique de la France, y compris pendant les Trente Glorieuses, durant lesquelles le taux de croissance était pourtant supérieur. Le nombre des heures travaillées en France a atteint un record. »
Avant 1997, la France se voyait reprocher une rigidité excessive de son marché du travail pour les tranches d’âge de la population active les plus jeunes et les plus âgés.
La croissance des années 1997-2002 a eu peu d’effet sur le taux d’emploi des 15-24 ans qui reste stable, autour de 30 %, depuis le début des années 1990, en raison aussi bien du taux de chômage de cette classe d’âge que de l’allongement de la durée des études. En revanche, le taux d’emploi des 50-64 ans est remonté de 7 points entre 1998 et 2003 et même de 8 points pour les femmes de cette classe d’âge contre 5 points pour les hommes.
TAUX D’EMPLOI EN FRANCE PAR TRANCHE D’ÂGE
(au sens du BIT, en moyenne annuelle)
(en %)
Année |
15-24 ans |
25-49 ans |
50-64 ans |
Hommes de 50 à 64 ans |
Femmes de 50 à 64 ans |
1998 |
28,2 |
79,4 |
46,7 |
53,5 |
40,3 |
1999 |
28,4 |
79,8 |
48,4 |
54,6 |
42,5 |
2000 |
30,8 |
80,8 |
49,5 |
55,8 |
43,5 |
2001 |
31,1 |
81,6 |
50,5 |
57,1 |
44,2 |
2002 |
31,2 |
81,7 |
51,8 |
58,2 |
45,6 |
2003 |
31 |
81,1 |
53,3 |
58,7 |
48,1 |
Source : INSEE
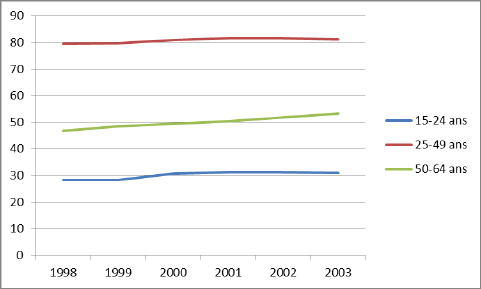
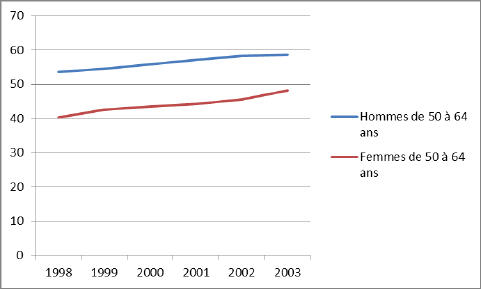
Les créations d’emplois de l’époque ont pu ramener sur le marché du travail des chômeurs de longue durée et maintenir au travail des personnes de 50 à 64 ans qui , auparavant, auraient été mises au chômage avec dispense de recherche d’emploi en attendant de pouvoir toucher leur retraite.
C’est parce qu’ils ont conservé leur emploi entre 1997 et 2002 que le taux d’emploi français a pu rejoindre celui des autres pays.
La réduction du temps de travail a pu y contribuer, sans contraindre pour autant les femmes à des emplois à temps partiels, comme c’est le cas dans la plupart des autres pays européens.
Mme Dominique Méda, inspectrice générale des affaires sociales et professeure de sociologie à l’université de Paris Dauphine, a ainsi rappelé que les types de partage à l’œuvre dans les différents pays européens étaient très différents du point de vue de la répartition des temps travaillés entre hommes et femmes, l’Allemagne présentant une configuration où coexistent des temps complets longs plutôt masculins et des temps partiels très courts occupés par des femmes alors que le « modèle » français présente des temps complets plus courts et des temps partiels plus longs et donc une plus grande concentration autour d’une norme de temps plus courte.
5. La baisse du chômage est d’autant plus notable que la population active a augmenté sur la période
M. Michel Didier, président du Centre d’observation économique et de recherche pour l’expansion de l’économie et le développement des entreprises (COE Rexecode), a suggéré à la commission d’évaluer l’impact des lois Aubry, en comparant l’évolution des marchés du travail de pays bénéficiant d’une demande internationale comparable et d’une croissance économique interne analogue, pour isoler les effets propres à la réforme législative française.
Il l’a invité notamment à regarder l’évolution du taux d’emploi et du taux de chômage en France et dans les autres pays au début des années 2000, qui, eux, n’ont pas engagé de réforme législative du temps de travail.
Cette comparaison néglige le fait que le taux d’emploi ne varie pas seulement selon le nombre d’emplois créés par l’économie ou selon le nombre d’actif occupés et de chômeurs qui entrent ou quittent le marché du travail, mais aussi selon l’évolution démographique de la population en âge de travailler.
Ce taux mesure la déformation de l’économie au bénéfice de l’emploi lorsque l’effectif de cette population reste constant. Autrement, il peut tout aussi bien mesurer des variations purement démographiques, en raison de tranches d’âges plus ou moins nombreuses aux deux extrêmes de la classe.
Or, en France, on ne peut pas imputer la baisse du chômage à celle de la population, comme cela s’est produit en Allemagne dans les années récentes ni au retrait du marché du travail de chômeurs découragés, sous prétexte que le taux d’emploi aurait varié de la même façon.
Entre 1997 et 2002, la population française de 20 à 59 ans a augmenté de 1,5 million d’individus. Dans cette classe d’âge, tous, en particulier les plus jeunes, ne sont pas sur le marché du travail mais la part active de cette population, qui ne compte que ceux qui ont un emploi ou en cherchent un activement, même calculée par l’INSEE sur la classe plus large des 15-64 ans selon la définition du BIT, a augmenté elle aussi de plus de 1,1 million d’individus entre 1997 et 2002, passant de 25,5 à 26,6 millions.
POPULATION ACTIVE, ENTRE 15 ET 64 ANS
(en moyenne annuelle, en milliers)
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
25 002 |
25 105 |
25 246 |
25 523 |
25 497 |
25 650 |
25 865 |
26 145 |
26 317 |
26 618 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
26 861 |
27 077 |
27 267 |
27 442 |
27 641 |
27 813 |
28 074 |
28 157 |
28 147 |
28 328 |
Source : Site Internet de l’INSEE
Quand la population active augmente dans de telles proportions, pour maintenir le taux d’emploi que M. Didier prend comme base de comparaison internationale, il faut déjà créer suffisamment d’emplois pour les nouveaux venus. C’est ce que mesure la population active occupée qui ne compte que les actifs qui ont un emploi.
Si les créations d’emplois nettes d’une année sur l’autre ne suffisent pas pour accueillir ce surcroît démographique d’actifs, le taux d’emploi baisse et le chômage augmente sans pour autant que des postes de travail aient été supprimés. Dans la situation démographique et économique de la France de la fin des années 1990, on pouvait s’attendre à ce qu’une croissance soutenue parvienne à stabiliser le taux de chômage mais soit insuffisante pour le faire baisser puisque, entre 1997 et 2002, la population active occupée a crû encore plus vite que la classe d’âge et que la population active.
POPULATION ACTIVE OCCUPÉE
(AU SENS DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE)
(en milliers)
Emploi total |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
1997-2007 |
Niveau |
24 012 |
24 437 |
25 033 |
25 671 |
26 037 |
26 161 |
26 162 |
26 196 |
26 378 |
26 667 |
27 042 |
- |
Variation |
189 |
425 |
596 |
638 |
367 |
124 |
1 |
34 |
182 |
289 |
375 |
3 220 |
Source : INSEE, comptes nationaux
Champ : France y compris Dom et Mayotte
Si le chômage a baissé quand même, c’est que les créations d’emplois ont été très importantes, surtout entre 1998 et 2001 et bien supérieures à celles qu’une croissance de 3 à 4 % provoquait auparavant dans l’économie française.
B. LES LOIS AUBRY ONT CONTRIBUÉ DE FAÇON IMPORTANTE AUX CRÉATIONS D’EMPLOI
1. Les premières prévisions des effets sur l’emploi des lois Aubry faisaient espérer la création de 700 000 postes
En partant d’une population de 13 millions de salariés dans les entreprises de plus de 20 personnes, une baisse du temps de travail hebdomadaire de 11,4 %, le réduisant de 39 heures à 35 heures, aurait pu se traduire par l’augmentation, dans la même proportion, de l’effectif de ces entreprises, à condition de ne pas autoriser d’heures supplémentaires et de baisser les salaires à due concurrence.
En maintenant les salaires nets mensuels et en y associant des allégements de cotisations, les promoteurs de la politique de réduction du temps de travail anticipaient, sur la base du nombre d’emplois créés dans les entreprises qui avaient eu recours aux incitations offertes par la loi Robien, que la loi Aubry I permettrait d’augmenter de 6 % l’effectif des entreprises qui réduiraient leur temps de travail d’au moins 10 %.
Le partage de ce temps pouvait potentiellement créer 780 000 emplois. En réalité, comme le note M. Éric Heyer, directeur adjoint au département analyse et prévision de l’OFCE, lors de son audition, la réduction en moyenne du temps de travail a été deux fois plus faible et c’est l’une des raisons qui explique l’ampleur presque deux fois plus faible des évaluations postérieures.
Revenant sur les objectifs des lois Aubry lors de son audition devant la commission, le Premier ministre de l’époque, M. Lionel Jospin a reconnu que : « On attendait 700 000 créations d’emplois, et il n’y en eut que 350 000 à 400 000 : les experts que vous accueillerez pourront sans doute répondre mieux que moi, mais il me semble que le fait que seuls 10 millions de salariés – ceux des entreprises de plus de vingt salariés – aient été concernés par les 35 heures n’est pas indifférent. »
M. Yves Barou, ancien directeur adjoint du cabinet de Mme Martine Aubry, ministre chargée du travail, estime pour sa part que : « La réforme a engendré entre 400 000 et 500 000 créations d’emplois. »
Si la réalité de l’ampleur des créations d’emplois de la période qui vit la mise en œuvre des 35 heures est incontestable, comme l’a rappelé le paragraphe précédent, une controverse subsiste sur l’impact respectif de la croissance économique, de la réduction du temps de travail, et de la baisse relative du coût du travail sur ces créations d’emploi.
Deux méthodologies sont susceptibles d’y répondre : l’une s’appuie sur des données d’enquêtes auprès des entreprises (c’est le cas des travaux de la DARES, mais aussi de certains travaux réalisés notamment par des chercheurs de l’INSEE), l’autre sur la reconstitution à l’aide d’un modèle macroéconomique des effets des différents facteurs (c’est le cas de l’OFCE).
2. Une étude macro-économique extrapole la création de 320 000 emplois entre 1998 et 2001
Des modèles économétriques ont permis d’évaluer l’impact des lois Aubry. Au cours de son audition, M. Éric Heyer, directeur adjoint au département analyse et prévision de l’OFCE, a présenté les travaux que lui-même et M. Xavier Timbeau ont publiés sur ce sujet dans la revue de l’OFCE :
« Outre qu’elles impliquent une réduction réduite du temps de travail, les lois Aubry ne sont pas assimilables à un partage pur de ce dernier, compte tenu de la compensation salariale intégrale et instantanée ; il faut plutôt les analyser comme un échange entre temps de travail et flexibilité, générant des gains de productivité sensibles, et comme une baisse de charges conditionnée à la réduction du temps de travail : c’est ainsi que nous les modélisons…
« Selon les modèles de l’OFCE, une réduction de charges de 10,5 milliards et une réduction du temps de travail de deux heures devaient créer 320 000 emplois – soit un chiffre proche de celui de la DARES –, avec, pour les finances publiques, un bénéfice ex post équivalant à 3,4 milliards de cotisations salariales supplémentaires…
« Il est globalement admis, dans le monde scientifique, que ces lois ont créé des emplois : on s’interroge plutôt, désormais, sur le fait de savoir s’il y aurait eu plus de créations d’emplois avec des baisses de charges inconditionnelles. Dans cette dernière hypothèse, les simulations de l’OFCE concluent cependant à la création de seulement 124 000 emplois, soit presque trois fois moins, avec un coût identique pour les finances publiques.
« D’aucuns espéraient, avec les 35 heures, la création de 2 millions d’emplois : ce chiffre a effectivement été atteint pendant la période considérée, mais avec un impact modeste, quoique réel, des 35 heures elles-mêmes. Quant au coût pour les entreprises, il a été compensé en grande partie par une détérioration des finances publiques. Enfin, les études scientifiques attestent que la réduction du temps de travail crée des emplois à court terme, c’est-à-dire dans les cinq années qui suivent sa mise en œuvre ; mais le doute subsiste à moyen et long terme. »
Pour quantifier ces créations d’emploi, les économistes de l’OFCE ont été conduits à établir une typologie des entreprises, selon leur attitude à l’égard de la réduction du temps de travail (28) :
« Nous distinguons 3 cas d’entreprises, celles qui ne réduisent pas la durée (NR), celles qui ont réduit la durée dans le cadre de la loi Aubry I (RS), et celles qui réduisent la durée modérément dans le cadre de la loi Aubry II, en exploitant les aides de l’État pour en absorber le coût ».
Dans le bilan disponible à l’époque (en 2001), 20 % des entreprises concernées avaient signé un accord Aubry I (cas RS avec une réduction de 10 % du temps de travail) et 27 % un accord de type Aubry II (cas R avec 6 % de réduction du temps de travail).
Depuis le 1er janvier 2000 les entreprises n’avaient plus accès aux aides de la Loi Aubry I, de sorte que « le compteur des salariés concernés par cette loi restait bloqué à RS =20 % ». Si l’ensemble des salariés concernés étaient couverts à terme par un accord de type Aubry II, les créations d’emploi pouvaient atteindre 482 000 emplois comme l’illustre le tableau suivant pour (NR= 0 % et R = 80 %).
EFFETS POSSIBLES SUR L’EMPLOI
(En milliers d’emplois)
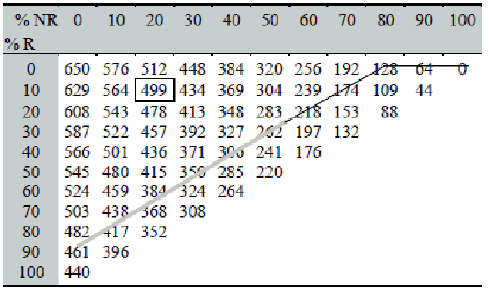
Source : MM. Éric Heyer et Xavier Timbeau in Lettre de l’OFCE n° 206 du vendredi 1 juin 2001, p. 6
En réalité un peu moins de 50 % des entreprises ont signé un accord de type Aubry II, 20 % un accord de type Aubry I et donc 30 % sont restées à 39 heures, de sorte que l’OFCE évalue aujourd’hui l’impact des Lois Aubry autour de 320 000 à 350 000 emplois. Dans le tableau suivant, l’intersection de NR = 30 % et R = 50 % donne en effet 350 000 emplois.
Ce tableau permet également de comprendre l’écart entre les prévisions initiales qui, sur le champ des entreprises concernées attendaient 700 000 emplois, et les 350 00 effectivement créés.
Si toutes les entreprises avaient utilisé la loi Aubry I, on serait proche des 700 000 emplois évoqués avant la mise en œuvre des lois Aubry (les hypothèses RS=100 %, NR=R=0 %, donnent 650 000). Si toutes les entreprises concernées avaient conclu des accords (20 % Aubry I et 70 % Aubry II, soit RS=20 %, R=80 % et NR=0 %) le nombre d’emplois créés aurait été de l’ordre de 480 000. Compte tenu des 30 % d’entreprises restées à 39 heures, on arrive à l’évaluation actuelle de l’OFCE.
Au cours de son audition, M. Éric Heyer, directeur adjoint au département analyse et prévision de l’OFCE, a présenté aux membres de la commission cette mise à jour des créations d’emplois imputables aux lois Aubry conduisant à 350 000 emplois sur la période 1997-2002, avec un pic au cours de l’année 2000 où la réduction du temps de travail aurait contribué à 160 000 des 580 000 créations d’emplois de cette année « record ».
PART DES 35 HEURES DANS LES CRÉATIONS D’EMPLOIS ENTRE 1997 ET 2002
(en milliers)
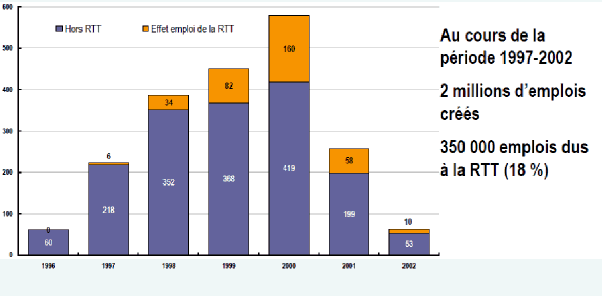
Source : Ministère du Travail, INSEE, repris par M. Eric Heyer au cours de son audition
3. Des études micro-économiques commandées par la DARES confirment la création de 350 000 emplois
Pour savoir quelle proportion de ces emplois créés est imputable aux lois Aubry, la DARES a exploité statistiquement les formulaires administratifs établis pour soumettre les accords négociés à l’approbation des services de l’État et obtenir, en contrepartie, les allègements de cotisations.
Elle a également diligenté des enquêtes auprès des chefs d’entreprise pour connaître leur stratégie à l’égard de la réduction du temps de travail. Elle a enfin comparé les résultats de ses enquêtes avec celle de l’INSEE de 2004.
Mme Françoise Bouygard, directrice de la DARES, a présenté les résultats de ces études comparées à la commission d’enquête :
« En 2000, la DARES a mené une étude sur la base de l’enquête trimestrielle relative à l’activité et aux conditions d’emploi de la main-d’œuvre, dite " ACEMO ", réalisée auprès des entreprises de dix salariés et plus qui avaient eu recours au dispositif Robien ».
« D’après cette enquête, la RTT avait eu, dans les deux années suivant sa mise en œuvre, un effet net sur la création d’emplois de 6 à 7 % ; une autre étude de la DARES, réalisée en 2002 par M. Bunel – qui s’était fondé sur l’enquête " Passages " – avait conclu à un effet net de 6,6 % pour la loi Aubry I, et de 4 % pour les entreprises du dispositif Aubry II qui avaient anticipé la loi.
« Enfin, l’étude de l’INSEE menée par MM. Crépon, Leclair et Roux en 2004 faisait apparaître des effets nets sur l’emploi de près de 5 % pour les entreprises visées par le dispositif Aubry II. Le fait que cette étude n’ait pas pris en compte la dynamique antérieure des effectifs dans les entreprises concernées explique sans doute la différence avec les chiffres de la DARES. Quelle que soit la source retenue, cependant, on constate un effet positif sur le niveau de l’emploi.
« J’en viens à l’effet sur les salaires. Sur ce point, les analyses empiriques mettent en évidence une contribution de la RTT à la modération des évolutions salariales. Si, dans la plupart des accords, le niveau des salaires mensuels de base a été maintenu, les études de la DARES montrent qu’une majorité des entreprises a également engagé des accords de modération ou de gel des salaires.
« Ainsi, les trois quarts des salariés passés aux 35 heures avant 2000 ont été concernés par une modération salariale, tandis que la moitié de ceux qui y sont passés après 2000 travaillaient dans une entreprise où une telle modération était prévue, pour une durée moyenne de 23 mois. »
M. Stéphane Carcillo, professeur affilié au département d’économie à l’Institut d’études politiques de Paris, a critiqué les études économiques de la DARES au motif qu’elles souffraient de faiblesses méthodologiques et qu’elles confondaient l’effet sur l’emploi de la réduction du temps de travail et celui de la baisse des cotisations.
« Pour arriver au chiffre synthétique de 350 000, ces études s’appuyaient sur les entreprises qui étaient passées aux 35 heures, avec les incitations financières dites « Aubry I », entre 1998 et 2000. Elles les comparaient aux entreprises restées à cette époque aux 39 heures. Je dois préciser qu’entre 1998 et 2000, le passage aux 35 heures se faisait de manière volontaire…
« Ces études ont été menées de manière extrêmement sérieuse, mais avec les données dont on disposait alors. On peut également relever plusieurs problèmes méthodologiques, qui sont encore parfois évoqués dans le débat aujourd’hui.
« Premier problème : les entreprises passées à l’époque aux 35 heures ont été probablement plus productives ou en plus forte croissance que celles qui étaient restées à 39 heures, tout simplement parce qu’elles avaient choisi de passer aux 35 heures et qu’elles en avaient probablement les moyens.
« C’est ce que l’on appelle le biais de sélection, ou l’effet de sélection, qui est difficilement corrigeable. En effet, on ne sait pas identifier correctement ces entreprises et les raisons qui ont fait qu’elles avaient pris la décision de passer aux 35 heures, ou les raisons qui ont fait que certaines ne l’avaient pas prise…
« En fait, dans ces études, on compare des entreprises en réalité peu comparables et on attribue aux 35 heures une évolution de l’emploi sur la période qui s’explique probablement par la différence de nature de ces entreprises… »
M. Frédéric Lerais, directeur général de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), a répondu à cette critique en soulignant, lors de son audition, la pertinence de la méthode d’extrapolation retenue par la DARES et confirmé les conclusions que cette dernière tirait de la politique de réduction du temps de travail en matière de création d’emploi :
« La méthode d’analyse utilisée, assez sophistiquée, a parfois été critiquée un peu vite de mon point de vue, alors qu’il faut reconnaître le sérieux des travaux réalisés à l’époque. Ces travaux ont été effectués à partir d’enquêtes de la DARES, qui présentaient le très grand avantage d’être trimestrielles, mais aussi avec des données de l’Unedic notamment.
« Le principe général consistait à analyser l’évolution des effectifs des entreprises passant aux 35 heures par rapport à celles restées à 39 heures. Il s’agissait donc de comparer les trajectoires des entreprises bénéficiaires à d’autres non bénéficiaires mais considérées comme comparables en termes de secteur, de dynamisme, etc., pour éviter les biais de sélection.
Ainsi, en s’attachant à déterminer, dans la mesure du possible, les échantillons témoins et les biais de sélection, l’ensemble de ces travaux économétriques estime les effets emplois à 6 %-7 % pour le dispositif " de Robien "» – taux assez éloigné de l’objectif des 10 % affiché initialement –, à 6 %-7 % pour " Aubry I ", à 3 %-4 % pour " Aubry II anticipatrice ", et à environ 4 % pour « Aubry général ».
RÉSULTATS DES MODÈLES D’ÉTUDE DES EFFETS
DES LOIS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’EMPLOI
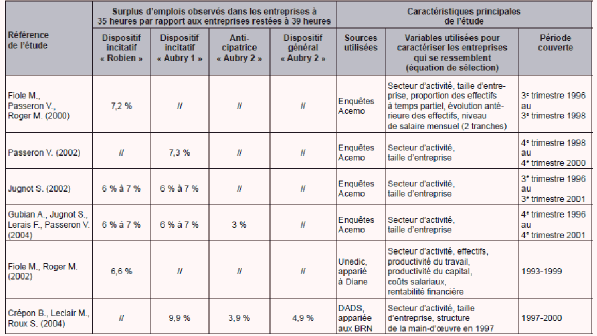
Source : Stéphane Jugnot, L’évaluation sous tension : l’exemple des effets sur l’emploi des « 35 heures », Revue de l’IRES, n° 77, 2013, p. 48
note : // dispositif non étudié
Selon M. Frédéric Lerais : « Ces estimations présentent des limites. D’abord, des limites générales liées à la représentativité de l’échantillon, à l’attrition – disparition spontanée des entreprises de l’échantillon au cours du temps –, etc. Ensuite, des limites spécifiques liées aux 35 heures, du fait d’accords d’entreprise ou d’accords d’établissement, de caractéristiques utilisées relativement pauvres – qui négligent en particulier l’opinion des acteurs sociaux. Par ailleurs, les entreprises restées à 39 heures étaient-elles de bons témoins ? Avaient-elles des caractéristiques particulières ? »
« Selon ces estimations, relativement convergentes, qui ont donné lieu à de nombreuses publications, 350 000 emplois ont été créés sur la période 1996-2002. Les estimations ex ante tablaient sur 700 000 emplois. Deux facteurs expliquent cet écart : le champ, car les petites entreprises ont été moins concernées, et la baisse de la durée du travail, de moins grande ampleur que prévue initialement. On le voit : le passage des évaluations ex ante aux évaluations ex post n’est pas si simple. »
4. Controverses sur les effets de la réduction du temps de travail : création d’emploi ou augmentation du coût du travail et pertes de compétitivité ?
Que les économistes soient ou non favorables à la réduction du temps de travail, il y a au moins un point de consensus entre eux : l’effet sur l’emploi de la réduction du temps de travail dépend de façon cruciale de son impact sur le coût du travail et par conséquent sur la compétitivité et sur les marges des entreprises.
Comme l’exprime M. Stéphane Carcillo, professeur affilié au département d’économie à l’Institut d’études politiques de Paris :
« Si la compensation salariale est totale, le salaire mensuel ne change pas alors que la durée travaillée a baissé. Cela augmente mécaniquement le coût horaire du travail et impacte la compétitivité des entreprises, à moins qu’il y ait, soit des gains de productivité horaire, soit des aides de l’État réduisant le coût du travail, suffisants pour compenser cette hausse. Sans cela, l’emploi n’augmente pas. Dans certains cas, il risque même de diminuer. »
M. Michel Didier, président de l’institut COE-Rexecode, a souligné lors de son audition les pertes de compétitivité et les rigidités induites par les lois Aubry :
« …la baisse de la durée du travail telle qu’elle a été mise en œuvre, si elle a pu avoir, à certains moments, des effets positifs sur l’emploi et dans certains secteurs, a eu également des effets négatifs qui ont pu compenser, voire peut-être l’emporter sur les premiers.
« Ces effets négatifs proviennent, pour l’essentiel, de la perte de compétitivité de notre économie et de la désindustrialisation qui en a résulté…
« En résumé, les conséquences économiques de la baisse de la durée du travail telle qu’elle a été conduite sont peu visibles sur l’emploi. Elles ont plutôt accentué les rigidités du marché du travail et elles sont très visibles et défavorables sur la compétitivité qui constitue aujourd'hui le principal défi économique des différents gouvernements, de droite comme de gauche. »
En sens contraire M. Éric Heyer, directeur adjoint du département analyse et prévision de l’OFCE, a indiqué lors de son audition que trois facteurs ont permis aux entreprises de ne pas augmenter le coût du travail et de maintenir ainsi leurs marges et leur compétitivité :
« Le fait que les entreprises n’aient vu ni leurs marges, ni leur compétitivité se dégrader en dépit des 35 heures payées 39 s’explique par plusieurs facteurs. Le premier est le gel des salaires, de dix-huit mois en moyenne aux termes des accords Aubry – et même un peu davantage en réalité –, ce qui s’est donc traduit par une perte de pouvoir d’achat.
« Le deuxième facteur, le plus important sans doute, est la réorganisation du travail au sein des entreprises, d’abord à travers l’annualisation du temps de travail ; il est sans doute abusif, de ce point de vue, d’appeler les lois Aubry " lois des 35 heures " puisque cette durée ne constitue pas une norme : beaucoup de salariés travaillent 1 600 heures par an, d’autres, au forfait jours, 210 jours par an.
« L’annualisation a représenté, pour les entreprises, un gain considérable en termes de flexibilité et de coût du travail, réduit par la limitation du recours aux heures supplémentaires ; c’est pourquoi, d’ailleurs, elle était une revendication du patronat dès avant les lois Aubry. La réorganisation du travail s’est aussi traduite, comme je l’indiquais, par une augmentation de la productivité horaire.
« Le troisième facteur réside dans les aides de l’État, ciblées jusqu’à 1,7 SMIC et forfaitaires pour les plus hauts salaires : aux 6,5 milliards d’euros d’allégements de charges Juppé se sont ainsi ajoutés les 10,5 milliards consentis par la loi Aubry 2. »
En définitive, les économistes les plus réticents à reconnaitre les effets sur l’emploi de la réduction du temps de travail trouvent une porte de sortie en admettant que si les lois Aubry ont créé des emplois, c’est en raison des allègements de cotisations.
Mais, d’une part, des allègements de cotisations ont été mis en place à différentes périodes : aucun de ces allègements seul n’a produit des effets aussi significatifs sur l’emploi que les lois Aubry ou de Robien. D’autre part, les lois Aubry formaient un tout et cela n’a pas de sens d’en isoler les différentes composantes. C’était un ensemble complexe où réduction du temps de travail, allègement de cotisations et modération salariale permettaient de privilégier l’emploi plutôt que la hausse des rémunérations individuelles, de façon à ne compromettre ni la profitabilité des entreprises ni leur compétitivité.
C’est, d’une certaine façon, ce qu’exprime M. Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, lors de son audition par la commission :
« Deux écoles s’affrontent quand il s’agit de savoir si la réduction du temps de travail a créé des emplois, comme le montre un récent article de l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES)… Que certains nient le fait que la réduction du temps de travail puisse créer des emplois, je l’ai noté.
« Au cours des débats, les chiffres de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) – 300 000 à 400 000 créations d’emplois imputables aux lois Aubry – ont été contestés. À l’autre extrémité, se situait le COE-Rexecode, présidé par Michel Didier.
« Cet organisme – parfois accusé, avec quelque exagération, d’être pro-patronal et qui, en tout cas, se place du point de vue des entreprises – évoquait quant à lui 150 000 à 200 000 créations d’emplois. Dans cet éternel débat, les arguments des uns et des autres sont passionnants mais vers lesquels faut-il pencher ?
« Dans le groupe Alpha, on peut dire que les créations d’emplois sont dues à la baisse des cotisations, à l’augmentation de la productivité qui a placé l’entreprise dans une bonne dynamique, à la réduction du temps de travail. Mais sans l’effet d’aubaine de la réduction du temps de travail, il n’y aurait sans doute pas eu de créations d’emplois et donc de baisse de cotisations et d’amélioration de l’organisation du travail. Sans les réductions du temps de travail, peut-être aurais-je quand même réorganisé le groupe mais pas forcément à ce moment-là et dans ces proportions. L’effet déclencheur des lois Robien et Aubry est réel. »
Quant à savoir si, à l’échelle macroéconomique, la réduction du temps de travail a engendré une hausse du coût du travail et donc une perte de compétitivité et une dégradation de la profitabilité des entreprises qui serait la principale explication de leur inefficacité sur l’emploi, c’est l’observation des données qui peut seule y répondre et c’est précisément l’objet du paragraphe suivant.
5. Après les lois Aubry, les baisses de cotisations patronales sont devenues l’instrument principal de la politique de l’emploi
L’imputation des créations d’emplois par les lois Aubry aux seuls allègements de cotisations patronales aurait pu être analysée en étudiant les niveaux de salaires d’embauche dans les entreprises qui ont créé ces emplois entre 1999 et 2002 sous l’empire d’un accord de réduction du temps de travail, afin de vérifier si la proportion de ceux bénéficiant des plus forts allègements de cotisations était plus élevée que leur part dans l’effectif antérieur de l’entreprise.
Après 2002, les Gouvernements renoncent à la politique de l’emploi par la réduction du temps de travail dont ils ne demandent plus à évaluer les effets. Ils dispensent les entreprises de moins de 20 salariés de réduire le temps de travail et facilitent le recours aux heures supplémentaires, dont les contingents sont relevés, les tarifs abaissés et les montants exonérés de cotisations et d’impôts.
Cette politique n’a pas créé d’emploi, n’a même pas augmenté le nombre d’heures supplémentaires accomplis par les salariés en poste mais a coûté, pour les seules exonérations accordées par l’article premier de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite TEPA, plus de 4,5 milliards d’euros, selon le constat établi par le rapport d’information n° 3615 déposé le 30 juin 2011 par notre collègue le député M. Jean-Pierre Gorges et par le député M. Jean Mallot (29) en conclusion de travaux précités du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale.
Les limites des politiques d’exonérations de cotisations sociales avaient auparavant été constatées par le rapport d’information déposé par le député M. Yves Bur (30), le 25 juin 2008, au nom d’une mission d’information commune de l’Assemblée nationale. Ce rapport estime que les allégements généraux de cotisations patronales ont eu des effets positifs sur l’emploi, même si ces effets ont varié d’une phase à l’autre de l’extension de ces allègements et si leur bénéfice fut inégal selon les secteurs et les régions.
M. Yves Bur évoque d’abord le problème du partage des effets des lois Aubry pour constater que : « la réduction du temps de travail est venue brouiller les conditions de l’évaluation : la plupart des évaluations portent sur les créations d’emplois liées à la réduction du temps de travail dans son ensemble, et non sur le seul volet dédié aux allégements.
« Dans ces conditions, comment évaluer aujourd’hui les effets sur l’emploi des allégements généraux ? Extrapolant l’estimation de 300 000 emplois créés grâce au dispositif en vigueur avant 1998 au regard des sommes désormais consacrées aux allégements, la [Direction générale du trésor] estime que leur suppression entraînerait la perte nette de 800 000 emplois, « sauf à revenir sur les fortes augmentations du SMIC horaire décidées et votées du fait de la réduction du temps de travail ».
C. LES LOIS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SONT-ELLES RESPONSABLES DE LA PERTE DE COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE ?
La question de l’impact des 35 heures sur le coût salarial et par conséquent sur la compétitivité-prix et/ou le taux de marge des entreprises est doublement cruciale. C’est, en effet l’argument principal des opposants aux 35 heures pour en contredire les effets favorables sur l’emploi. Et c’est, de la même façon l’argument évoqué pour expliquer la dégradation du solde extérieur de la France à partir de 2003.
La critique de la dégradation de la compétitivité qui résulterait des 35 heures ne repose pas en général sur une analyse détaillée de la compétitivité-prix, mais sur la concomitance entre la mise en place des Lois Aubry et la baisse de la part des exportations françaises dans le total des exportations de la zone euro depuis le début des années 2000, comme M. Michel Didier, président de l’institut COE-Rexecode le répète depuis de nombreuses années et à nouveau lors de son audition devant la commission :
« Ces effets négatifs (des 35 heures) proviennent, pour l’essentiel, de la perte de compétitivité de notre économie et de la désindustrialisation qui en a résulté ; nous n’avons aucun doute sur ce point. Au cours des quinze dernières années, la part des exportations françaises dans le total des exportations de marchandises ou de biens et services des pays de la zone euro a reculé fortement.
« Pour les exportations de marchandises, le recul est de 4 %, passant de 16,9 % en 1998 à 12,5 % en 2013. 4 %, cela ne paraît pas beaucoup, mais c’est 4 % du total des exportations de marchandises européennes, soit un chiffre tout à fait considérable… À quelques exceptions près, les pertes de parts de marché de la production française ne tiennent pas à un seul secteur ou à une mauvaise implantation de nos entreprises : elles coïncident clairement avec la période des 35 heures, ce qui indique qu’elles sont dues à un environnement global devenu moins favorable pour la compétitivité des entreprises… »
Au cours de l’audition de l’ancien Premier ministre, M. Lionel Jospin, l’ancien Président de l’Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer souligne de son côté que : « Deux missions parlementaires consacrées à la compétitivité de l’économie française et aux coûts de la production en France ont clairement démontré que c’est à partir du début des années 2000 que la compétitivité de notre pays a décroché. Peut-être trouverez-vous une autre explication. Mais ce fait n’est pas contesté. »
Remarque à laquelle M. Lionel Jospin a répondu : « Il me semble étrange de rendre les 35 heures responsables de la baisse de compétitivité des entreprises françaises. Vous semblez considérer que les coûts de production sont les seuls éléments de la compétitivité : mais il n’est que de regarder les publicités de certaines entreprises de certain pays que je ne citerai pas pour se rendre compte qu’elles vantent la qualité du produit et non son faible coût… Peut-être faudrait-il regarder de ce côté-là. En tout cas, je note que c’est au moment où les 35 heures sont détricotées, voire annulées, que la compétitivité s’affaisse. Voilà une contradiction logique que je vous laisserai lever. »
1. Le diagnostic partagé par les organisations patronales et syndicales sur la compétitivité indique qu’il n’y a pas eu de dérive des coûts salariaux unitaires
Le rapport de la mission d’information sur la compétitivité de l’économie française du 9 novembre 2011 (31) n’est pas parvenu à dresser un bilan consensuel ni à déterminer les causes de cette perte de compétitivité parce que, selon M. Accoyer, qui présidait la mission, « les blocages et les postures idéologiques l’ont emporté. »
Les mêmes obstacles n’ont cependant pas empêché trois organisations syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC) et trois organisations d’employeurs (CGPME, MEDEF, UPA) de signer, en mai de la même année, un document rendant compte de leur approche commune de cette question.
Ce document rappelle que le solde de la balance commerciale française s’est apprécié jusqu’à redevenir positif pendant la mise en œuvre des lois Aubry, avant de se dégrader à partir de 2002.
SOLDE DE LA BALANCE COMMERCIALE
(en milliards d’euros)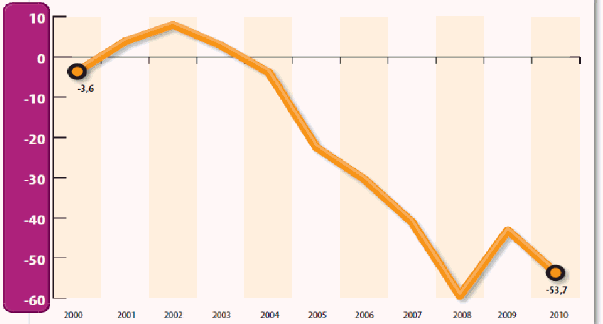
Source : Balance des transactions courantes, Banque de France, repris par le document Approche de la compétitivité française de juin 2011, page 12 - http://www.cgpme.fr/upload/docs/Appdelacompetitivitefr.pdf
Le document décrit la baisse de la part des exportations françaises dans les exportations de la zone Euro, abondamment citée par l’institut COE-Rexecode et commentée par M. Michel Didier lors de son audition…
PART DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DANS LES EXPORTATIONS TOTALES DE MARCHANDISES DE LA ZONE EURO
(moyenne mobile sur trois mois)
(en %)
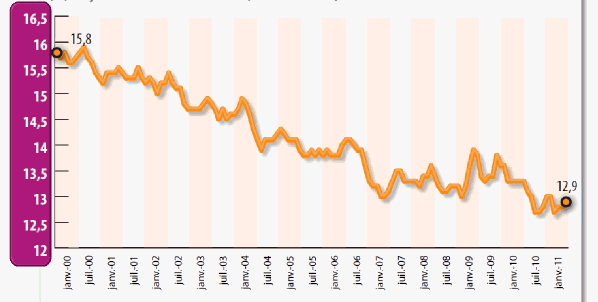
Source : Douanes, Eurostat, repris par le document Approche de la compétitivité française de juin 2011, page 14
..ainsi que la hausse de la part des importations dans la demande intérieure commune à tous les pays européens, mais moins prononcée en Allemagne qu’en France :
PART DES IMPORTATIONS DANS LA DEMANDE INTÉRIEURE
EN